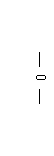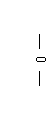![]()
N° 2925
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
au nom du comité d’évaluation et de contrôle
des politiques publiques sur
les autorités administratives indépendantes
par
MM. René DOSIÈRE et Christian VANNESTE,
Députés.
___
TOME II.- AUDITIONS
TOME II.- AUDITIONS
SOMMAIRE
___
Pages
– AUDITIONS 5
– NOTES RELATIVES AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
AUDITIONNÉES 247
Le tome II de ce rapport est composé des comptes rendus des auditions des représentants d’un certain nombre d’autorités administratives indépendantes (AAI), dans leur ordre chronologique, faisant suite à la réponse de celles-ci à un questionnaire commun, dont les éléments de réponse ont été utilisés pour nourrir les notes présentées à la suite de l’ensemble des comptes rendus, dans le même ordre que les auditions elles-mêmes.
Sont également présentés les comptes rendus de l’audition du vice-président du Conseil d’État (par ailleurs lui-même président d’une AAI) et du directeur du Budget.
__
Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des séances tenues par le Groupe de travail.
Pages
M. Pierre Bordry, président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), accompagné de MM. Robert Bertrand, secrétaire général de l’AFLD et Fabrice de Battista, secrétaire général de la CPPAP 9
M. Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public (CNDP), accompagné de M. Jean-François Béraud, secrétaire général. 13
M. Philippe Josse, directeur du Budget au ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, accompagné de M. Romuald Gilet, chef de bureau 17
M. Michel Cardona, secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI), M. Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de la Commission bancaire, et Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du gouverneur de la Banque de France 23
M. Philippe Jurgensen, président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), accompagné de M. Antoine Mantel, secrétaire général 29
M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de MM. Thierry Francq, secrétaire général, et François Ardonceau, directeur de la gestion interne et des ressources humaines 33
M. Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), accompagné de MM. Marc Dubourdieu, directeur général, et Paul-Bernard Delaroche, directeur administratif et financier 48
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle et de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, accompagné de M. Timothée Paris, chargé de mission 59
M. François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagné de M. Régis Lambert, secrétaire général, et de Mme Marie-Thérèse Merny, chef du service des affaires générales, du personnel et des finances 71
M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, accompagné de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale et de M. Fabien Zivy, chef du service du Président 82
M. Bertrand Schneiter, président de la Commission des participations et des transferts (CPT), accompagné par M. Dominique Augustin, secrétaire général 96
M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), accompagné de M. Christian Huchon, attaché principal au ministère de l’économie, membre du contrôle général 100
Mme Dominique Versini, Défenseure des enfants, accompagnée de M. Hugues Feltesse, délégué général, et de Mme Christine Pierre-Neunreuther, directrice de l’administration générale et des ressources humaines 112
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, accompagné de MM. Bernard Dreyfus, directeur général des services, et Christian Le Roux, directeur de cabinet 125
M. Roch-Olivier Maistre, Médiateur du cinéma, accompagné de Mme Isabelle Gérard, chargée de mission 137
M. Denis Merville, Médiateur national de l’énergie, accompagné de MM. Bruno Léchevin, délégué général, et Stéphane Mialot, directeur des services 143
M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), accompagné de Mmes Christine Le Bihan-Graf, directeur général, Anne Monteil, directrice des relations institutionnelles et de la communication, et Nadine Redon, chef du service financier 152
M. André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), accompagné de MM. Marc Sanson, commissaire, Jean-Christophe Niel, directeur général, et Luc Chanial, secrétaire général 165
M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), accompagné de M. Philippe Distler, directeur général, et Mme Claire Bernard, directrice des ressources humaines de l’administration et des finances 177
M. François Lagrange, président de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), accompagné de MM. Georges Vianès, vice-président, Bernard Rozenfarb, administrateur civil, Jérôme Pichonnier, attaché au chef de bureau, et Joris Dumazer, instructeur CNAC 188
M. Jean-Pierre Leclerc, président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), accompagné de M. Alexandre Lallet, rapporteur général 195
M. le professeur Laurent Degos, président de la Haute autorité de santé (HAS), accompagné de MM. François Romaneix, directeur, et Éric Delas, directeur de l’administration générale et des ressources internes 206
M. Michel Boyon, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), accompagné de M. Olivier Japiot, directeur général, et de Mme Danièle Brault, directrice administrative et financière. 217
M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), accompagné de M. Yann Padova, secrétaire général, et de Mme Isabelle Pheulpin, directrice des ressources humaines, financières, informatiques et logistiques 225
M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), accompagné de M. Benoît Narbey, secrétaire général 239
Audition de M. Pierre Bordry, président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), accompagné de MM. Robert Bertrand, secrétaire général de l’AFLD et Fabrice de Battista, secrétaire général de la CPPAP.
Jeudi 17 décembre 2009
M. René Dosière, rapporteur. Merci, monsieur le Président, de venir devant nous. Notre travail d’évaluation va nous conduire à cibler notre réflexion sur un petit nombre d’autorités administratives indépendantes. Nous ne pensions pas spontanément à l’Agence française de lutte contre le dopage ou à la Commission paritaire des publications et agences de presse mais vous présidez les deux et vous avez demandé à être entendu.
Je vous laisse la parole.
M. Pierre Bordry, président de l’Agence française de lutte contre le dopage et de la Commission paritaire des publications et agences de presse. Merci pour votre accueil. J’ai personnellement tenu, depuis sa création, à ce que l’AFLD soit à la disposition du Parlement.
Le dopage est un fléau, qui s’accentue probablement. La lutte contre ce phénomène est ancienne : la première loi remonte à 1965. Toutes les formules ont été essayées, les premières étaient de nature judiciaire. La première commission de lutte contre le dopage a été créée en 1989, mais elle rendait seulement un avis. Le pouvoir de sanction était alors laissé au ministre, le plaçant parfois dans des situations délicates. D’autres lois ont été adoptées, en 1995 et, surtout, en 1999 (loi Buffet) : une autorité administrative indépendante a alors été créée (le CPLD, Conseil de prévention et de lutte contre le dopage) ; le laboratoire qui réalise les analyses est devenu un établissement public. L’Agence mondiale antidopage a été mise en place en 1999. L’AFLD, sous sa forme actuelle, a été créée par la loi en 2006. Le législateur a souhaité que son collège demeure inchangé par rapport à celui du CPLD. L’AFLD a intégré la compétence de réalisation opérationnelle des contrôles antérieurement exercée par le ministère des sports, ainsi que le laboratoire de Châtenay-Malabry. Autorité publique indépendante, elle a été dotée par la loi de la personnalité morale.
L’AFLD a connu des difficultés au départ.
Ainsi, le ministère du budget a essayé d’avoir un droit de veto sur son budget, mais il a été désavoué par le Conseil d’État : finalement le décret ne prévoit qu’une procédure, non contraignante, de seconde délibération.
De plus, le projet de décret prévoyait que le directeur des contrôles rende des comptes au Gouvernement à différents niveaux : de nouveau, le Conseil d’État a critiqué cette orientation, le directeur des sports est demeuré indépendant conformément à la loi.
Des frictions politiques ont également eu lieu à propos de l’opportunité de tel ou tel contrôle.
M. René Dosière, rapporteur. Le pouvoir politique n’a-t-il pas cherché à se défausser de ses responsabilités en matière de lutte contre le dopage ?
En termes budgétaires, la procédure de seconde délibération, les difficultés de financement n’affectent-ils pas votre indépendance ?
M. Pierre Bordry. Notre indépendance résulte de la loi.
M. René Dosière, rapporteur. Certes, mais au-delà des textes ?
M. Pierre Bordry. Il est incontestable qu’il y a des problèmes. Nous avons connu des difficultés avec l’administration qui aurait dû cesser de s’occuper de ces questions et qui ne l’a pas fait. J’ai aussi eu un conflit avec Jean-François Lamour qui m’a poursuivi devant les tribunaux car j’avais dénoncé certaines pressions dont j’avais fait l’objet. Il a été débouté en première instance et en appel. En appel, la Cour a même précisé que le président d’une autorité administrative indépendante avait le devoir de dénoncer les pressions…
M. René Dosière, rapporteur. Sur le plan budgétaire ou de la gestion du personnel, y a-t-il des problèmes ?
M. Pierre Bordry. En ce qui concerne le personnel, les choses se passent bien. Nous passons des conventions avec le ministère des sports, qui nous permettent de recourir à ses directions régionales.
La partie budgétaire est plus compliquée. Pour 2010, le ministère a fait le choix de diminuer de moitié sa subvention et de nous attribuer pour le reste le produit de l’augmentation d’une taxe qui a finalement été supprimée par le Sénat. Il nous manque donc 4 millions d’euros pour équilibrer un budget sur lequel le Gouvernement n’a pourtant pas demandé de seconde délibération. En revanche, le ministre m’a adressé, hier, une lettre par laquelle il demande à l’AFLD de lui soumettre de nouveau son budget au début de l’année 2010… comme si le Conseil d’État ne nous avait pas donné raison lorsque le Gouvernement a essayé de se reconnaître un droit de regard sur notre budget ! Dois-je le contester devant les tribunaux ? Je suis sûr de gagner… mais, de toute manière, je ne peux pas obliger le Gouvernement à augmenter sa subvention.
Une autorité publique indépendante devrait avoir des recettes pérennes : l’Agence doit poursuivre sa mission ; le laboratoire doit fonctionner. Aujourd’hui, au plan budgétaire, je ne sais plus ce que je dois faire.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je découvre que vous jouez ainsi en quelque sorte au ping-pong avec le Gouvernement ! Je voudrais vous poser quelques questions.
Créée pour des raisons conjoncturelles, l’AFLD a-t-elle une raison réelle d’exister alors même que le Gouvernement n’a pas cessé d’intervenir pour autant ?
Pourquoi y a-t-il une tendance à la diminution du nombre des contrôles positifs ?
Quelle est votre efficacité en matière de prévention et de recherche ?
Vous avez deux sites : le siège et le laboratoire. Quelle est la répartition des effectifs entre les deux ? Le siège doit-il réellement être situé en plein cœur de Paris ?
Votre rôle à l’international est-il significatif ?
M. Pierre Bordry. En matière de recherche, il est important que l’AFLD parraine des projets, souvent cofinancés par l’Agence mondiale antidopage. Ces projets, de très haut niveau, sont essentiels.
À l’international, nous travaillons avec l’Agence mondiale et avec nos homologues qui partagent les mêmes objectifs que nous, parfois avec un statut différent. Nous travaillons également avec des services étrangers de police ou de douane. Ce réseau nous apporte d’ailleurs beaucoup d’informations, que nous exploitons. Face à des organisations criminelles organisées, c’est essentiel.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Doit-on supprimer l’AFLD, ou, au contraire, lui donner les moyens de son indépendance ?
M. Pierre Bordry. C’est un débat essentiel qui est de la compétence du législateur. Si l’on veut une vraie politique de lutte contre le dopage, il faut aller vers l’indépendance. Si l’on veut pouvoir négocier, transiger… alors on peut en rester là. C’est un débat de société.
M. René Dosière, rapporteur. Parlez-nous de la CPPAP.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Et quand aurons-nous les réponses à notre questionnaire ?
M. Pierre Bordry. À vrai dire, je ne suis pas complètement convaincu que la CPPAP soit une véritable autorité administrative indépendante. Le Conseil d’État a d’ailleurs dit que ce n’était qu’une quasi-autorité administrative indépendante… C’est son Président qui est indépendant.
La réglementation remonte aux années 1930. Le choix a alors été fait d’associer la profession.
Cette commission paritaire, autorité administrative indépendante ou non, remplit un rôle essentiel. Les choix sont parfois difficiles : associer la profession et l’État est une bonne chose car les décisions peuvent avoir des conséquences de vie ou de mort pour les publications. Le pluralisme est en jeu.
M. René Dosière, rapporteur. Tout repose sur le Président et il n’y a pas de budget individualisé… au point que vous n’arrivez pas à répondre à notre questionnaire !
M. Pierre Bordry. Nous devons aujourd’hui faire face à de nouvelles responsabilités en matière de presse en ligne, comme l’a voulu le législateur. C’est la raison pour laquelle les services sont débordés et n’ont pu traiter votre questionnaire. Mais c’est conjoncturel et des réponses vous seront apportées.
S’agissant du rôle du Président, ce n’est pas une question de personne mais de statut. En cas de vote, sa voix compte double et dans une instance paritaire, c’est important.
M. René Dosière, rapporteur. Je vous remercie.
M. Pierre Bordry. Je vous invite à visiter les locaux de l’AFLD.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Qui ne sont pas très loin d’ici…
M. Pierre Bordry. Il est important que les membres du collège n’aient pas à faire des déplacements trop importants. C’est aussi une question de convivialité et d’efficacité. Je l’ai voulu ainsi ; le loyer n’est d’ailleurs pas excessif.
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le Président, je vous remercie.
Audition de M. Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public (CNDP), accompagné de M. Jean-François Béraud, secrétaire général.
jeudi 17 décembre 2009
M. Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public. La CNDP est indépendante. Elle est composée de 21 membres dont 8 élus, 4 magistrats, des représentants associatifs, des personnalités qualifiées. La structure est légère : une petite dizaine de personnes en tout.
La CNDP veille à la participation du public. Il y a actuellement douze débats en cours, sur des sujets divers : nanotechnologies, autoroutes, gazoducs, installations portuaires…
En moyenne, la CNDP organise sept à huit débats par an, mais actuellement nous sommes sur une tendance haute.
Un débat public dure quatre mois. Il en faut six pour le préparer.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait d’être indépendant est-il un avantage ?
M. Philippe Deslandes. C’est la première exigence du public, celle sur laquelle il nous interroge toujours.
M. René Dosière, rapporteur. Pourtant, c’est le maître d’ouvrage qui prépare le dossier…
M. Philippe Deslandes. Certes, mais sous le contrôle de la commission particulière du débat public, qui en définit le contenu.
M. René Dosière, rapporteur. Sur le Grand Paris, pourquoi le Gouvernement a-t-il cherché à vous exclure ?
M. Philippe Deslandes. Le Gouvernement a voulu confier le débat au Préfet de région pour aller plus vite… mais c’était un mauvais calcul. Le Préfet de région aurait été juge et partie. En outre, nous avons une expérience qui nous permet de gagner du temps ! Finalement, nous avons été entendus et la CNDP sera associée au dispositif.
M. René Dosière, rapporteur.Comme cela se passe-t-il à l’étranger ?
M. Philippe Deslandes. À l’étranger, il y a également des débats publics, mais les procédures, en Europe, ne sont pas aussi marquées que chez nous. Nous sommes un cas à part.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Dans quelle proportion vos avis et recommandations sont-ils suivis d’effet ?
Faut-il élargir votre représentation, au niveau du collège ?
En 2008, il y a eu moins de débats. Pourquoi ?
Le coût de vos locaux a été critiqué… ainsi que les frais de déplacement du Président. Pouvez-vous nous donner des explications ?
M. Lionel Tardy. Quel est le nombre de dossiers pour lesquels la saisine est obligatoire ?
M. Philippe Deslandes. En 2008 nous n’avions pas de Président…
M. René Dosière, rapporteur. Pourquoi sa nomination a-t-elle tant tardé ?
M. Jean-François Béraud, secrétaire général de la Commission nationale du débat public. Le mandat du précédent Président est arrivé à son terme… la nomination du suivant a tardé. Pour quelles raisons ? Elles sont nombreuses ! Mais elles sont propres au Gouvernement.
M. Lionel Tardy. Vos décisions ne s’imposent pas ? Elles n’ont pas de portée impérative ?
M. Philippe Deslandes. Nos décisions se limitent à déterminer s’il y a lieu ou non d’organiser un débat public.
M. Lionel Tardy. Si vous n’étiez pas là, il y aurait quand même un débat. Quelle est votre plus-value ?
M. Philippe Deslandes. Nous organisons un débat comme l’exigent les textes internationaux, notamment la convention d’Arrhus. Puis nous rendons compte du débat, de la façon dont il s’est passé, mais nous sommes neutres sur le fond du dossier.
M. Lionel Tardy. Que fait-on de ce que vous dites ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Comment décidez-vous du choix de faire ou non un débat public ?
M. Philippe Deslandes. Les critères qui déterminent l’organisation d’un débat public sont fixés par la loi : impact économique, impact sur l’environnement, intérêt national…
M. Jean-François Béraud, secrétaire général de la Commission nationale du débat public. La saisine doit d’abord être recevable, au vu notamment des seuils définis par la loi. Ensuite la CNDP décide ou non d’organiser un débat public en appréciant le projet qui lui est soumis conformément à la loi.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Pouvez-vous nous donner un exemple de décision écartant un débat public ?
M. Philippe Deslandes. Un tramway… par exemple n’est pas, par principe, d’intérêt national.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quel est le coût de votre loyer ?
M. Jean-François Béraud : Il y a une convention, passée avec le ministère, pour un coût de 200 000 euros. Mais cette somme ne recouvre pas que le loyer : eau, gaz, électricité, téléphone, gardiennage, entretien… tout est compris. Cela n’a pas été pris en compte par le rapport du Sénat auquel vous faites allusion.
Ce loyer n’est pas appelé… Mais en fin d’année nous reversons au ministère une partie du reliquat de crédit qui correspond souvent au montant de la convention.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Cette pratique n’est-elle pas critiquable ?
M. Jean-François Béraud. Pour nous, cela revient au même.
M. René Dosière, rapporteur. S’agissant des installations de traitement des déchets, il semble qu’il y ait un problème de seuil ?
M. Philippe Deslandes. En effet, puisque ces installations, considérées comme des équipements industriels, se voient appliquer une règle qui rend très improbable la probabilité même de toute saisine : le seuil retenu ne prend en compte que le coût « bâtiments et infrastructures » et non le coût total des projets. Cette exclusion de fait est regrettable et nous réclamons une modification du décret depuis quatre ans ! Il en a été beaucoup question dans le cadre du Grenelle de l’environnement : j’ai bon espoir.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous faites des recommandations et ensuite il est possible de ne pas en tenir compte…
M. Jean-François Béraud : Ce que nous exprimons, ce n’est pas l’avis de la commission, ni ses recommandations, mais les opinions qui se sont dégagées au cours du débat public.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je voudrais savoir dans quelle proportion les maîtres d’ouvrage suivent le sens du débat public.
M. Philippe Deslandes. La traçabilité est assurée... La plupart des projets sont modifiés par le débat. Le maître d’ouvrage y est partie prenante et le risque de contentieux est significatif
M. Christian Vanneste, rapporteur. Dans un cas que je connais bien, la recommandation n’a pas été suivie d’effet et je me suis demandé à quoi vous serviez… Le débat était passionnant, réellement passionnant, mais il n’a pas eu d’impact !
M. René Dosière, rapporteur. Sur les nanotechnologies, je crois savoir que le débat ne se passe pas très bien ?
M. Philippe Deslandes. Il y a eu des incidents à Grenoble et à Lille. Certains considèrent que parler des nanotechnologies c’est déjà les accepter. Nous devrons nous organiser en conséquence. Mais nous avons foi en notre mission : le débat public est essentiel, les difficultés apparues dans le cas des nanotechnologies sont l’exception.
M. René Dosière, rapporteur. Un tiers des membres ne viennent pas à vos réunions. Lesquels ?
M. Philippe Deslandes. Ce sont les élus qui ne viennent pas. C’est dommage. En particulier, la participation de ceux qui représentent les départements pourrait être très utile.
Nous sommes naturellement à votre disposition pour vous accueillir dans nos bureaux, si vous le souhaitez.
M. René Dosière, rapporteur Nous vous remercions. Nous poursuivrons donc ce dialogue sous d’autres formes.
Audition de M. Philippe Josse, directeur du Budget au ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, accompagné de M. Romuald Gilet, chef de bureau.
jeudi 14 janvier 2010
M. René Dosière, rapporteur. Merci d’avoir répondu à notre invitation. Sans plus attendre, je vous laisse la parole.
M. Philippe Josse, directeur du Budget au ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. C’est moi qui vous remercie d’avoir convié la Direction du Budget à s’exprimer devant vous.
Nous vous adresserons, dans les jours qui viennent, des éléments statistiques qui font le point sur les principales données budgétaires relatives aux autorités administratives indépendantes. Ces éléments ne sont pas toujours faciles à collationner, d’autant que certaines de ces autorités disposent de ressources propres.
Il est difficile de faire un tableau précis des autorités administratives indépendantes car elles couvrent un paysage aussi large qu’hétérogène. Le besoin de recourir à cette formule se manifeste généralement dans deux domaines : les droits et libertés ; la régulation technique de certains secteurs d’activité. Mais les services de l’État sont aussi capables de faire face à leurs missions, y compris dans ces domaines. J’en veux pour exemple les tâches techniques et difficiles du contrôle des installations industrielles classées, ou même du calcul et du recouvrement de l’impôt.
M. René Dosière, rapporteur. Parvenez-vous à suivre de façon efficace l’activité et les dépenses des autorités administratives indépendantes ?
M. Philippe Josse. Lorsqu’elles disposent de ressources propres, notre capacité à appréhender les choses est faible. Lorsqu’elles sont financées sur des crédits budgétaires, en revanche, c’est plus aisé. Dans un cas ou dans l’autre, notre suivi n’est pas le même. J’ajoute que nous ne nous occupons pas des autorités administratives indépendantes qui gravitent dans l’orbite de la Banque de France.
Cela dit, notre contrôle n’est jamais tatillon : le montant des crédits budgétaires affectés aux autorités administratives indépendantes s’élève à environ 260 millions d’euros, à rapporter aux 340 milliards d’euros du budget de l’État : ce n’est pas non plus une priorité. Cependant, ces autorités et leurs présidents ont parfois une visibilité médiatique qui conduit à donner à leurs problèmes financiers une importance dépassant celle des sommes réellement en jeu.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il semble qu’en matière de dopage, le contrôle est scrupuleux… Je pense à l’Agence française de lutte contre le dopage, qui a parfois du mal à boucler son budget, notamment cette année.
M. Philippe Josse. En matière de dopage comme en toutes choses il revient aussi aux ministères de gérer leurs priorités, et il ne nous appartient pas de résoudre tous les micro-conflits. Cela dit, de manière générale, on ne peut pas dire que les autorités administratives indépendantes sont mal traitées.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Les choix qui sont faits, en ce qui les concerne, au niveau de la nomenclature budgétaire, sont-ils adaptés ?
M. Philippe Josse. Au départ a prévalu une logique fonctionnelle, qui tenait compte de la nature de leur activité et rattachait les crédits aux missions ministérielles correspondantes. Par la suite, il nous a été demandé de regrouper autour des services du Premier ministre toutes les autorités administratives indépendantes qui interviennent en matière de droits et libertés. Mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose.
La régulation budgétaire s’applique à elles, comme à tous les services de l’État, même si elles disposent d’une grande latitude pour gérer ses conséquences. Nous avons d’ailleurs constaté que, en ce qui concerne la mission budgétaire regroupant les AAI, celles-ci ont opéré la régulation budgétaire de leurs crédits entre elles-mêmes.
M. René Dosière, rapporteur. Qu’en est-il des indicateurs de performance ?
M. Romuald Gilet, chef de bureau. Ils existent, y compris pour les autorités administratives indépendantes, même si on peut les juger insuffisants. Ils présentent la particularité qu’ils sont définis de façon consensuelle avec ces autorités. Cependant, nous essayons progressivement de les rendre plus homogènes, ce qui n’est pas toujours facile car elles s’estiment toutes très spécifiques… Le critère de base, c’est le nombre de dossiers, et l’efficacité avec laquelle ils sont traités, notamment leur délai de traitement.
M. Philippe Josse. Dans un certain nombre de cas, l’approche est la même que lorsqu’il s’agit de mesurer l’efficacité du traitement judiciaire. Elle est simplement transposée. Certes, il faut aussi appréhender la qualité des décisions, au-delà de leur nombre et de leur rapidité. Dans le domaine de la justice, nous utilisons, dans cette perspective, le taux de réformation des décisions faisant l’objet de recours devant des instances externes. Cette logique n’a pas été transposée aux autorités administratives indépendantes, c’est peut-être en effet plus difficile à faire et moins pertinent, notamment pour celles qui ne prennent pas de décisions faisant grief, comme le Médiateur ou la Halde. Il convient également de prendre en compte le fait que certaines autorités revêtent une grande importance symbolique mais ne représentent que des crédits limités, et que les commissions des Finances (cf. le deuxième rapport Lambert-Migaud) ont souhaité, à ce stade, limiter le nombre total d’indicateurs et d’objectifs.
M. Christian Vanneste, rapporteur. S’agissant d’autorités qui ont une activité juridictionnelle, le taux de classement des instructions ouvertes serait-il un indicateur intéressant ?
M. Philippe Josse. Pourquoi pas, si le Parlement nous le demande... Les indicateurs sont destinés à permettre au Parlement d’exercer son contrôle et, dans ce domaine, nous travaillons avec lui, notamment avec la commission des finances.
M. René Dosière, rapporteur. En matière d’indicateurs de performance, les autorités administratives indépendantes sont-elles réceptives ?
M. Romuald Gilet. Elles sont réceptives, et même demandeuses. Le problème vient sans doute du fait que, comme je vous l’ai indiqué, elles s’estiment toutes spécifiques.
M. René Dosière, rapporteur. Il y a des autorités administratives indépendantes avec lesquelles vous avez des liens privilégiés. Pouvez-vous nous parler de la Commission des participations et des transferts ? Il ne semble pas que son activité soit importante.
M. Philippe Josse. En 2009 sans doute pas, compte tenu de la conjoncture très défavorable des marchés financiers… mais il y a des périodes au cours desquelles elle peut avoir beaucoup de travail, notamment en 2005, avec la privatisation de certaines sociétés d’autoroute ! En tout état de cause, budgétairement, elle ne représente pas des sommes très importantes.
M. René Dosière, rapporteur. S’agissant du contrôle budgétaire, les autorités administratives indépendantes disposent-elles de beaucoup de latitude ?
M. Philippe Josse. Oui, mais dans une certaine mesure tout de même. Dans la plupart des cas il n’y a pas de contrôle financier, pas de visa pour l’engagement des dépenses, car la loi l’a exclu. Mais elles sont soumises à un plafond d’emploi ministériel et il leur appartient de le respecter en gestion : si elles ne le faisaient pas, nous le saurions.
Cela dit, il ne serait pas illégitime de demander aux autorités administratives indépendantes de fournir un certain nombre d’indicateurs de bonne gestion. Par exemple en matière de surface immobilière : un ratio de m2 par agent, ce n’est pas une atteinte à l’indépendance ! Et cela permettrait de comparer au ratio de 12 m2 par agent qui a été retenu comme référence pour l’ensemble de l’administration. Dans d’autres domaines, ça peut être plus difficile.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il y a parfois des doublons. Regardez l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)…
M. Philippe Josse. L’IRSN n’est pas une autorité administrative indépendante, ni un service de l’État, mais un opérateur de l’État (EPIC) ; mais c’est une très bonne question.
M. René Dosière, rapporteur. La dernière discussion budgétaire a montré que les autorités administratives indépendantes n’étaient pas soumises à la même norme de progression budgétaire que les services de l’État. Qu’en pensez-vous ?
M. Philippe Josse. Il faudrait le faire dans l’avenir. Des rattrapages étaient nécessaires, des évolutions devaient être prises en compte : je pense à la CNIL et au CSA. Mais, sous cette réserve, il faut une norme.
M. René Dosière, rapporteur. Et vous pourrez la faire respecter ?
M. Philippe Josse. Oui, sauf pour les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de ressources propres, ou si nous perdons des arbitrages interministériels, ce qui arrive.
M. Christian Vanneste, rapporteur. En matière de rémunération des dirigeants, en revanche, les autorités administratives indépendantes décident-elles seules ?
M. Philippe Josse. La rémunération des présidents est fixée par des arrêtés publiés pris en application du décret statutaire, en tout cas pour les grandes autorités dont le président exerce ses fonctions à temps plein. Pour ces derniers, la référence est souvent le niveau « hors échelle G », c’est-à-dire la plus élevée des rémunérations de la fonction publique. La rémunération est parfois complétée par une indemnité de fonction.
M. René Dosière, rapporteur. Il arrive parfois qu’une voiture et un chauffeur soient prêtés par Bercy... je pense encore à la Commission des participations et des transferts. Comment ces décisions sont-elles prises ?
M. Philippe Josse. Je l’ignore. Ce que je peux dire c’est que nous veillons à diminuer la taille du parc automobile du ministère.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Avez-vous le sentiment qu’il y a des doublons ? J’ai évoqué l’IRSN et l’ASN. Je pense aussi à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et au médiateur de l’énergie.
M. Philippe Josse. La CRE et le médiateur ne font pas exactement le même travail, puisque la CRE régule le secteur économique de l’énergie, alors que le médiateur traite des différends avec les consommateurs. Cela étant, il commence à y avoir beaucoup d’autorités administratives indépendantes, au-delà de quarante, et on peut considérer que la cote d’alerte est atteinte.
M. René Dosière, rapporteur. La formule de l’autorité administrative indépendante apporte-t-elle un plus ?
M. Philippe Josse. En matière de régulation économique il est important de bien identifier les intervenants. Le paysage n’est pas homogène. Il faudrait sans doute plus de clarté. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n’est pas une autorité administrative indépendante.
Dans le domaine des libertés, le recours à une autorité administrative indépendante est souvent incontournable.
En tout cas, la multiplication de structures indépendantes de petite taille conduit mécaniquement à des dépenses supplémentaires, puisque chaque structure doit disposer d’un secrétaire général, d’une fonction de communication… autant de dépenses qui peuvent être mutualisées au sein d’autorités plus importantes.
Si l’on prend le cas de la commission des participations et des transferts, le recours à la formule de l’autorité indépendante permet d’éviter un débat public qui peut être sensible sur le niveau de la valorisation des entreprises cédées. Par ailleurs, la nécessité de s’inscrire dans des fenêtres de marché financier parfois courtes pour procéder aux opérations financières dans les meilleures conditions exige une certaine permanence de la structure. Cela constitue en tout cas un élément de confort important pour le ministre concerné.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le fait qu’une autorité administrative indépendante ait la personnalité morale change-t-il les choses ?
M. Philippe Josse. Assurément. Dès lors qu’elle a la personnalité morale, l’autorité administrative indépendante sort de la comptabilité de l’État. Cela dit le vrai changement se produit lorsqu’elle dispose en outre de ressources propres, ce qui n’est pas le cas de toutes les autorités administratives indépendantes qui ont la personnalité morale.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il semble qu’elles ont toutes une grande liberté en matière de gestion, par exemple pour les emplois.
M. Philippe Josse. Les autorités administratives indépendantes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale sont soumises à un plafond d’emplois, de façon très classique. Elles disposent en revanche d’une marge de manœuvre pour fixer le niveau de rémunération de leurs contractuels, si la rémunération des fonctionnaires détachés ou mis à disposition est en principe déterminée par la grille de leur corps d’origine.
Ce n’est pas le cas, il est vrai, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale. Une autorité publique indépendante n’est pas un opérateur de l’État. Et lorsque, de surcroît, elle est dotée de ressources propres, alors c’est encore plus net car nous n’avons plus aucun levier, même indirect.
Il y a sans doute, ici, une lacune dans le dispositif. Pourquoi ne proposeriez-vous pas un plafond d’emploi, au moins global, qui s’appliquerait aux autorités publiques indépendantes, en complément des plafonds existants (plafonds ministériels, plafonds des opérateurs en France, plafond des opérateurs à l’étranger) ?
M. Louis Giscard d’Estaing. Pouvez-vous nous dire un mot sur le projet qui consiste à fusionner la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ?
M. Philippe Josse. Comme je l’ai indiqué, les autorités administratives indépendantes qui dépendent de la Banque de France sont, d’un point de vue budgétaire, en dehors de ma sphère. De manière générale je peux cependant dire que les fusions sont une bonne chose : la multiplication des petites structures est coûteuse.
M. René Dosière, rapporteur. Je pense que nous avons abordé toutes les questions ?
M. Philippe Josse. Votre évaluation, de par son caractère transversal, sera très utile. Une à une les autorités administratives indépendantes représentent peu de choses. Mais globalement elles mobilisent tout de même 430 millions d’euros, sans prendre en compte la Commission bancaire, et représentent plus de 3 000 emplois.
Audition de M. Michel Cardona, secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI), M. Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de la Commission bancaire, et Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du gouverneur de la Banque de France.
jeudi 21 janvier 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Merci d’avoir répondu à notre invitation. Nous sommes dans un contexte particulier puisque le conseil des ministres a adopté, hier, une ordonnance qui fusionne les autorités administratives indépendantes compétentes dans le domaine des banques et des assurances. Votre audition est d’autant plus nécessaire que certaines de vos réponses à notre questionnaire écrit nous ont paru lacunaires.
M. René Dosière, rapporteur. En effet. Nous nous situons dans le cadre d’un travail d’évaluation initié par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques : il s’agit sans doute pour vous d’un nouvel interlocuteur mais qui va progressivement trouver sa place.
Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du gouverneur de la Banque de France. Nous sommes à la disposition du Parlement, aussi bien la Banque de France que la Commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Les deux autorités administratives indépendantes que vous recevez aujourd’hui sont intégrées dans la Banque de France et n’ont pas de budget propre : c’est la raison pour laquelle il était parfois difficile de répondre à vos questions.
M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de la Commission bancaire. Il est vrai que nous avons été gênés pour vous répondre car, budgétairement, les lignes de la Banque de France et de la Commission bancaire sont uniques. Tout cela va changer avec la fusion mais, en attendant, nos dépenses ne sont pas identifiées de façon distincte. La fluidité qui existe entre nous et la Banque de France, notamment sur le plan des effectifs et en particulier pour les contrôles, est un avantage, notamment parce qu’elle permet de bénéficier d’effets d’échelle substantiels en utilisant les fonctions support communes, mais elle ne permet pas d’opérer des distinctions aussi précises que celles que vous souhaitiez.
Demain, les choses seront différentes : un budget annexe sera affecté à la nouvelle institution née de la fusion de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Aujourd’hui, nous savons, à partir d’informations issues de notre comptabilité analytique et reconstituées a posteriori, après la réalisation des dépenses, que la Commission bancaire représente un peu plus de 100 millions d’euros, soit une proportion limitée de l’ensemble du budget de la Banque de France, mais ce n’est qu’une estimation. Nous allons mettre en place, dans le cadre de la fusion une analyse a priori des coûts, ne serait-ce que pour arrêter un budget, tout en conservant l’avantage de la fluidité avec la Banque de France pour l’efficacité des contrôles.
M. Lionel Tardy. Le fait de pouvoir mobiliser rapidement des inspecteurs de la Banque de France pour réaliser des contrôles a un coût qu’il doit être possible d’évaluer.
M. Jean-Pierre Brard. Je ne suis pas choqué que vous recourriez à des personnels qualifiés s’ils sont utiles. L’année 2008 a été marquée par une crise bancaire majeure : qu’a fait la Commission bancaire ?
Autre question : est-il légitime, en l’espèce, de conserver le modèle d’une autorité administrative indépendante, dès lors que l’État s’est retiré du secteur bancaire ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. La Commission bancaire est chargée de veiller au respect des règles prudentielles. Que pouvez-vous dire de la réalisation de cette mission ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Nous avons joué tout notre rôle dans le cadre qui nous est fixé, ce qui ne veut pas dire que ce cadre soit optimal. Les normes que nous appliquons sont internationales, issues en grande partie des travaux du Comité de Bâle, ce sont celles de notre profession, mais nous sommes cités comme une référence pour la mise en œuvre de cette réglementation et un exemple de bonne organisation. J’ajoute que les banques françaises ont enregistré des pertes inférieures à celles des banques étrangères et font l’objet de moins de critiques quant à leur solvabilité. Certes en soi la crise a mis à l’épreuve ce cadre général du contrôle des banques dont les résultats n’ont pas été fabuleux, mais la comparaison est à notre avantage.
M. Jean-Pierre Brard. Que pouvez-vous dire des problèmes des Caisses d’épargne et de Natexis, Dexia…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Avez-vous vu venir les problèmes, notamment liés aux opérations de titrisation ?
M. Édouard Fernandez Bollo. Nous n’avons pas examiné nous-mêmes les opérations de titrisation en cause. Nous n’imaginions pas que les choses iraient jusqu’où elles sont allées à la suite de la faillite de Lehman Brothers... Personne ne l’imaginait. Mais nous connaissions et dénoncions les risques des subprimes. La surprise, ça a été la panique, l’effet systémique et l’assèchement total du marché qui a porté préjudice à toutes les banques, les bonnes comme les mauvaises : face à une telle panique bancaire, la qualité intrinsèque des banques prise individuellement ne suffit plus pour qu’une autre accepte de prendre un risque en lui prêtant Les banques françaises ont certes eu dans leurs comptes des actifs toxiques et ont enregistré de ce fait des dépréciations importantes, mais elles n’en ont pas généré et vendu elles-mêmes.
M. Lionel Tardy. Selon vous, tous les actifs toxiques sont-ils maintenant « purgés » au niveau des banques françaises ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Je ne peux pas dire ça. Je peux dire en revanche que l’effort de provisionnement a été à la hauteur du risque, à un niveau satisfaisant au vu de ce qui s’est fait ailleurs. Mais on sait que les risques se dévoilent parfois de façon progressive. Il peut toujours y avoir des risques latents qui ne se découvrent qu’ultérieurement.
M. René Dosière, rapporteur. A posteriori, pouvez-vous nous dire quels sont les moyens qui vous permettraient de mieux travailler ?
M. Édouard Fernandez-Bollo : Trois choses :
– des normes qui s’adaptent mieux aux évolutions des cycles économiques et accentuent le coût du risque de marché et de la liquidité ;
– une analyse des risques en amont sur des bases qui ne soient pas fondées sur la simple situation de chaque banque, car l’autoréférencement et la juxtaposition des situations individuelles à ses limites ; il faut développer une approche macroprudentielle ;
– de meilleurs outils pour améliorer la gestion de la crise.
Pour prendre l’exemple britannique, les règles d’intervention de la Bank of England lui ont interdit d’intervenir en temps utile pour faire face aux difficultés de la banque Northern Rock. La proximité de la Commission bancaire et de la Banque de France a permis d’éviter ce genre de difficultés en France.
M. Lionel Tardy. Quel est le rôle de la Commission bancaire à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne l’élaboration des règles internationales ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Nous participons très activement aux travaux des instances internationales : dix à quinze personnes sont affectées en permanence à ces missions internationales.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quel est le poids international de la France en la matière ? La résilience du système français à la crise vous a-t-elle renforcé ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Le fait que la première banque de la zone euro soit française nous donne un rôle additionnel particulier. Par ailleurs, la convergence des normes demeure difficile au niveau international, en particulier avec les États-Unis. Nos idées avancent, notamment sur le plan du provisionnement.
M. Jean-Pierre Brard. Quelqu’un a récemment déclaré dans la presse que les banques n’ont rien compris ; elles recommencent comme avant. Que pensez-vous de ce jugement tranché ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Il est vrai que le mimétisme est grand dans le secteur bancaire… et que la recherche du profit est au cœur de cette activité. Mais nous continuons à penser que les banques françaises sont plus prudentes que les autres. La proportion de banques moins prudentes est marginale parmi les grandes banques : dans aucun cas, par exemple, les opérations à fort effet de levier ne permettraient d’effacer les fonds propres d’un établissement de premier ordre.
M. René Dosière, rapporteur. M’adressant également à M. Cardona, en quoi le fait d’être une autorité administrative indépendante est-il un atout ? Êtes-vous d’ailleurs totalement indépendants ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. je voudrais aussi que vous nous parliez de la complémentarité entre la Commission bancaire et le CECEI, de la capacité du CECEI à délivrer des agréments à des banques étrangères dont le siège se trouve hors zone euro, et des différences de schéma entre l’organisation des agréments et des contrôles dans l’univers bancaire, avec le CECEI et la Commission bancaire d’un côté, proches de la Banque de France, et dans l’univers de l’assurance, où l’ACAM est totalement indépendante, mais le CEA a son secrétariat assuré par la direction du Trésor
M. Michel Cardona, secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Il y a une fonction d’agrément et une fonction de contrôle qui sont distinctes. Mais entre les deux fonctions la complémentarité est certaine, d’autant que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement n’intervient pas qu’au stade de l’agrément : il accompagne les banques au fil des changements statutaires, de dirigeants et d’actionnariat qui les affectent tout au long de leur vie. Sur le plan des outils informatiques, la complémentarité entre les deux fonctions et l’adossement à la Banque de France jouent un rôle déterminant car elles nous permettent de constituer et d’utiliser des fichiers communs sur une plateforme gérée par la Banque de France. Il en va de même pour le suivi des dossiers où la coopération entre les équipes du contrôle et celles de l’agrément est étroite.
M. René Dosière, rapporteur. En quoi le fait d’être une autorité administrative indépendante est-il un plus ?
M. Michel Cardona. L’indépendance est une garantie d’objectivité. L’approche collégiale avec une multiplicité d’expériences améliore le choix des décisions et contribue à un examen éclairé des dossiers. C’est important : on évite ainsi toute pression. En ce qui concerne l’agrément des banques étrangères, nous demandons aux autorités de contrôle étrangères des informations précises, notamment sur la composition et la solidité de l’actionnariat, et dans le cas d’actionnaires non européens nous demandons souvent un actionnaire de référence bancaire, si possible européen.
M. Jean-Pierre Brard. Au-delà des textes, y a-t-il indépendance intellectuelle ? idéologique ? Il est permis d’en douter, au vu du cursus des membres du collège !
M. René Dosière, rapporteur. M. Fernandez-Bollo, je voudrais également vous demander de justifier le statut d’autorité administrative indépendante de la Commission bancaire.
M. Édouard Fernandez-Bollo. La Commission bancaire a une double nature puisqu’elle est à la fois une autorité administrative indépendante et aussi une juridiction administrative de plein exercice. Dans le cadre de la nouvelle structure, les deux volets seront d’ailleurs mieux séparés, avec la mise en place d’une commission des sanctions.
Ce qui compte au niveau international, en termes de crédibilité, c’est que le contrôleur puisse remplir sa mission sans subir d’interférences. Cela étant les statuts peuvent être divers, l’élément essentiel étant la notion d’ « indépendance opérationnelle ». Pour mémoire, d’ailleurs, la FSA britannique est une compagnie commerciale, de droit privé, et n’est pas une personne morale de droit public.
M. René Dosière, rapporteur. Êtes-vous soumis aux plafonds d’emplois ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Non. Nos effectifs sont d’ailleurs en forte augmentation, mais il s’agit d’un rattrapage par rapport à nos homologues. Ils devraient d’ailleurs continuer à croître pour mettre à niveau les deux secteurs bancaires et assurantiels. Nos effectifs demeurent très en deçà des ratios des autres pays en termes de contrôleurs/établissement à contrôler.
M. Jean-Pierre Brard. Pourrait-on imaginer que le Parlement sollicite des avis de la Commission bancaire, comme il le peut le faire avec la Cour des comptes ou l’Autorité de la concurrence ?
Je souhaiterais également disposer d’une notice biographique de tous les membres du collège de la Commission bancaire.
M. Édouard Fernandez-Bollo. Avec la fusion, je vous signale cependant que ces notices seront bientôt dépassées. La composition de la commission comme du CECEI est fixée par la loi, avec la différence que la Commission bancaire ne comprend aucun professionnel contrairement au CECEI, et les personnes nommées membres sont connues publiquement. Pour le reste, une fonction de délivrance d’avis est envisageable : c’est le Parlement qui fixe le cadre.
M. Louis Giscard d’Estaing. J’ai proposé, dans les discussions préalables à la rédaction de l’ordonnance qui vient d’être adoptée, et auxquelles j’ai pu participer au sein d’un comité élaborant des normes financières auprès de Bercy, que, dans le collège de la nouvelle autorité, le Parlement soit représenté. La réponse a été négative, notamment en raison de réticences des représentants des hautes juridictions, et de la Banque de France.
M. René Dosière, rapporteur. Je pense que toutes les questions ont été posées ?
Mme Véronique Bensaïd. Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous apporter des éléments complémentaires par écrit.
M. René Dosière, rapporteur. Madame, Messieurs, nous vous remercions.
Audition de M. Philippe Jurgensen, président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), accompagné de M. Antoine Mantel, secrétaire général.
jeudi 21 janvier 2010
M. René Dosière, rapporteur. Merci d’avoir répondu à notre invitation.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Dans votre intervention, je souhaite que vous preniez en compte la situation actuelle de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), mais aussi celle de demain, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui va résulter de la fusion de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
M. Philippe Jurgensen, président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Il est vrai que vous êtes devant un cas rare, celui d’une autorité administrative indépendante qui disparaît…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Disons qui fusionne… ce n’est pas tout à fait pareil.
L’ACAM n’est pas adossée à la Banque de France, elle est autonome, ce qui n’est pas le cas de la Commission bancaire et du CECEI. Dès lors, le regroupement est-il pertinent ?
Autre question : quelle a été votre vision de la crise, qui n’a pas épargné les assurances : avez-vous bien rempli votre rôle ?
M. Philippe Jurgensen. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas véritablement répondre. Le Gouvernement a décidé la fusion, c’est son choix, il ne m’appartient pas de le commenter. Il faut cependant relever qu’il existait déjà des liens étroits entre les organes qui fusionnent. Les réunions communes étaient régulières, à fréquence semestrielle ; je siège à la Commission bancaire et mon homologue de la Commission bancaire siège au sein de l’ACAM ; des contrôles communs ont pu être mis en place.
Entre les secteurs de la banque et de l’assurance, des différences subsistent mais elles sont prises en compte, au moins en partie, par l’ordonnance. En particulier, le secteur assurantiel a moins besoin, par sa nature, d’être appuyé sur le pouvoir monétaire.
Je dois préciser que la fusion concerne quatre organismes. Il y a la Commission bancaire et le CECEI, l’ACAM et le Comité des entreprises d’assurance (CEA), qui est responsable de l’agrément dans ce secteur même s’il n’est pas qualifié d’autorité administrative indépendante. Le CEA s’appuie beaucoup sur l’expertise de l’ACAM, et suit quasiment toujours son avis. Les services du CEA sont ainsi surtout ceux de l’ACAM, même si le secrétariat du comité est confié à la direction du Trésor. En tout état de cause, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) va intégrer ces quatre organismes.
Nous pensons en effet avoir bien joué notre rôle. Nous avons veillé au respect des normes prudentielles. Nous sommes intervenus sur le terrain de la gouvernance, ce qui a d’ailleurs provoqué des réactions. Nous avons regardé les modes de commercialisation des contrats pour contrôler les comportements et défendre les intérêts des clients. Le régulateur est en quelque sorte la « l’ange gardien » : il n’est pas responsable lui-même du développement des activités, mais il protège néanmoins l’intérêt des assurés qui en sont les clients et les rassure.
Les autorités administratives indépendantes – qui ne sont d’ailleurs pas totalement indépendantes puisque l’on peut les supprimer assez facilement, comme vous le constatez aujourd’hui – ont un rôle d’arbitrage, d’harmonisation, de surveillance et de sanction, de diffusion des bonnes pratiques.
On parle toujours des sanctions alors qu’il n’y en a pas tant que ça : trente-six seulement en cinq ans et demi. Notre rôle est donc d’abord préventif.
Ce rôle, nous le tenons également en édictant de la « soft legislation », en l’espèce sept recommandations (sur le contenu des rapports de solvabilité, la valorisation des actifs, la gouvernance, …) qui ne sont pas obligatoires, l’ACAM n’étant pas dotée du pouvoir réglementaire, mais tracent la bonne voie. Le fait de ne pas les respecter n’est sanctionnable en lui-même, mais peut traduire des agissements qui, eux, peuvent donner lieu à des sanctions.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait d’avoir des ressources propres était-il de nature à renforcer votre indépendance ?
M. Philippe Jurgensen. Assurément, même si la redevance dont nous percevons le produit est tout de même encadrée dans une fourchette fixée par la loi et son barème déterminé par le Gouvernement. En l’espèce, le Gouvernement en est resté au plancher prévu par la loi, mais nos éventuelles difficultés n’étaient pas dues à un manque de ressources. Disposer de ressources propres est un gage d’indépendance et je dois dire que le Gouvernement n’y a jamais porté atteinte. Cela ne nous permet pas pour autant d’empêcher la fuite de notre personnel vers le secteur privé…
La future Autorité de contrôle prudentiel (ACP) aura un sous-collège dédié aux assurances. Le principe de la ressource propre est étendu à l’ensemble du nouveau dispositif, avec une taxation des banques.
M. René Dosière, rapporteur. Vous avez fait allusion au taux de renouvellement de votre personnel, qui est en effet très élevé. Puisque vous avez des ressources propres, pourquoi n’arrivez-vous pas à faire en sorte de les retenir ?
M. Antoine Mantel, secrétaire général. Les salaires sont fixés par référence aux barèmes de la fonction publique, et notamment des ministères de l’Économie et du Budget, plutôt assez bien placés de ce point de vue. L’autonomie budgétaire dont nous bénéficions nous a permis de nous en affranchir, mais dans une certaine mesure seulement, pour nos agents contractuels. Mais les entreprises que nous contrôlons offrent des rémunérations élevées, en particulier pour les commissaires-contrôleurs, issus de l’École polytechnique, et il reste un différentiel certain (de l’ordre de 50 % après une expérience de trois ou quatre ans). De surcroît, les personnels cherchent des expériences intéressantes et le passage par l’ACAM en début de carrière est valorisé par les employeurs privés. Notre taux de turn-over demeure trop élevé. Même si nous avons pu globalement accroître nos effectifs, passés de 147 à 217, en augmentant le nombre de nos contractuels, nous ne pouvons pas pourvoir tous les postes de commissaires contrôleurs que nous ouvrons.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous avez actuellement un loyer onéreux, de plus de cinq millions d’euros hors charges, et une surface par agent de 18 m2 soit sensiblement plus que la norme de 12 m2 retenue pour l’ensemble des administrations publiques.
M. Philippe Jurgensen. Nous sommes maintenant correctement logés, c’est vrai, dans le quartier des assurances, près de la Trinité. Cela contribue à améliorer un peu notre attractivité pour les personnels : nos agents sont constamment débauchés ; on pourrait également considérer que la qualité améliorée de nos locaux compense celle, très médiocre, des locaux dont nous disposions jusqu’en 2005.
M. Lionel Tardy. Combien de temps les contrôleurs passent-ils dans leur bureau ?
M. Antoine Mantel. C’est difficile à dire mais ils doivent passer environ 40 % de leur temps à l’extérieur.
M. Louis Giscard d’Estaing. Le loyer a augmenté depuis 2006… Qui est le propriétaire de ces locaux ?
M. Philippe Jurgensen. C’est un fonds d’investissement allemand. Nous tenions beaucoup d’ailleurs à ne pas être locataires d’une compagnie d’assurance pour éviter tout conflit d’intérêt.
M. Louis Giscard d’Estaing. Vous avez de surcroît un fonds de roulement élevé, de trente millions d’euros. Pourquoi ne pas avoir acheté des locaux ?
M. Philippe Jurgensen. Nous souhaitions acquérir nos locaux « historiques », mais il fallait pour cela faire déménager l’Agence nationale d’indemnisation des Français de l’outre-mer (ANIFOM), qui occupait les cinquième et sixième étages de notre immeuble de l’époque (54, rue de Châteaudun), appartenant à l’État. La décision a été prise, dès 2004, mais elle n’a pas pu être appliquée.... Alors nous sommes partis, en prenant d’autres locaux à bail. Et pourtant l’État a ensuite vendu l’immeuble en question et l’ANIFOM doit de toute façon quitter les lieux, finalement. C’est regrettable.
M. René Dosière, rapporteur. Comment rendez-vous compte de votre action au Gouvernement et au Parlement ?
M. Philippe Jurgensen. Rendre compte est une dimension de la bonne gouvernance, mais la remise d’un rapport annuel public n’a pas été prévue par la loi. Cela étant, deux commissaires du Gouvernement siègent auprès de nous, représentant l’un la direction du Trésor, l’autre la direction de la Sécurité sociale, qui rapporte à quatre ministères aujourd’hui.
M. René Dosière, rapporteur. Vous auriez pu faire un rapport sur une base volontaire.
M. Philippe Jurgensen. Encore aurait-il fallu que le Gouvernement l’accepte, ce dont je suis loin d’être certain… Par ailleurs, je ne crois pas qu’aucune autorité administrative indépendante ait pris d’elle-même la décision de publier un tel rapport s’il n’était pas prévu par la loi.
M. Lionel Tardy. Étant indépendants, n’auriez-vous pas pu vous affranchir de son accord ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Parlez-nous de vos performances et des indicateurs.
M. Philippe Jurgensen. Définir des indicateurs est pour nous très difficile. Le meilleur critère, c’est l’absence de sinistre, même si cela ne dépend pas que de nous. Il n’y a eu qu’une faillite, en mars 2006, une petite mutuelle… mais c’était un micro-problème qui a été réglé sans difficulté ni conséquence financière. À l’étranger il y a eu des faillites spectaculaires de grandes assurances, même si ces faillites n’étaient pas dues à l’activité d’assurance elle-même, comme pour le groupe AIG. Quels autres critères retenir ? Le nombre de décisions rendues ? Ce ne serait pas forcément très pertinent puisque la dissuasion importe autant que la répression effective, et que, à la limite, il serait souhaitable que nous n’ayons aucune sanction à prendre. Pour le reste, il s’agirait sans doute d’indicateurs de moyens ?
M. Lionel Tardy. Pouvez-vous nous parler de la fusion prévue par l’ordonnance, en termes opérationnels ?
M. Philippe Jurgensen. Le nouvel organisme va compter plus de mille personnes. Le regroupement se fera chez nous, dans nos locaux, à l’ACAM : la Commission bancaire est actuellement mal installée et il restait des locaux disponibles dans notre immeuble. Du coup, proportionnellement à la surface, et grâce à une capacité de négociation améliorée par l’effet de taille, nous avons pu obtenir une baisse du loyer.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, accompagné de MM. Thierry Francq, secrétaire général, et François Ardonceau, directeur de la gestion interne et des ressources humaines
jeudi 28 janvier 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
La réforme constitutionnelle de 2008 a créé au sein de l’Assemblée nationale un comité d’évaluation et de contrôle (CEC), qui a décidé de mettre en place une mission consacrée à l’évaluation et au contrôle des autorités administratives indépendantes. C’est à ce titre que nous avons sollicité votre contribution. J’ajoute qu’en raison du contexte de crise financière, votre audition était particulièrement attendue.
L’Autorité des marchés financiers (AMF), créée par la loi du 1er août 2003, résulte de la réunion de trois organismes : le Conseil des marchés financiers (CMF), la Commission des opérations de bourse (COB) et le Conseil de discipline de la gestion des portefeuilles (CDGP). Elle aura bientôt son pendant, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Avant de vous céder la parole pour un propos liminaire, je souhaiterais, monsieur le président, vous poser quelques questions.
Comment l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel vont-elles coordonner leur action ?
L’Autorité des marchés financiers est-elle efficace, notamment par comparaison avec ses homologues étrangères ?
Étant appelés à la fois à édicter les règles, à enquêter et à juger, comment faites-vous pour distinguer les activités du Collège principal et celles de la Commission des sanctions – d’aucuns parlant à ce sujet de « schizophrénie » ?
Vos jugements sont-ils toujours justes ? Certaines entreprises ne sont-elles pas « trop grosses » pour pouvoir être sanctionnées ? Si l’on examine les dernières décisions de l’Autorité des marchés financiers, on s’aperçoit qu’un internaute suisse donnant des indications erronées en matière boursière a fait l’objet de poursuites, mais que l’affaire EADS s’est conclue le 17 décembre par un non-lieu. Vous avez évoqué à ce sujet une « procédure de sanction sécurisée » : pouvez-vous expliciter cette notion ? Quelles relations l’Autorité des marchés financiers entretient-elle avec, d’un côté, les juridictions administratives, de l’autre, les juridictions judiciaires ?
De quels moyens disposez-vous, et quelle est leur évolution ? Entre 2005 et 2009, l’Autorité des marchés financiers a vu ses dépenses augmenter de 21 %, alors que ses recettes, évaluées sur les trois trimestres de l’année précédente, ont un niveau très variable ; en 2009, du fait de la conjoncture économique, elles ont même diminué de presque 50 %. Cela ne risque-t-il pas de fragiliser l’Autorité des marchés financiers ?
M. René Dosière, rapporteur. Les sanctions sont-elles prononcées de manière équitable ? Les droits de la défense sont-ils bien respectés ?
M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers : L’Autorité des marchés financiers est une autorité indépendante, dotée du statut de personne morale de droit public. Ce statut est conforme aux préconisations européennes et, en particulier, à la directive relative aux abus de marché, qui exige que les autorités de surveillance et de contrôle soient indépendantes par rapport aux opérateurs économiques et qu’elles évitent les conflits d’intérêts.
Le statut des membres de l’Autorité des marchés financiers, organisme collégial, répond à ce souci d’indépendance ; leur mandat est irrévocable et le mandat du président n’est pas renouvelable.
Il existe toutefois des interférences entre les institutions publiques et l’Autorité des marchés financiers, puisque les membres du Collège et de la Commission des sanctions sont nommés par les pouvoirs publics – le Parlement, les Hautes juridictions et le Gouvernement pour les personnalités qualifiées –, que le commissaire du Gouvernement joue un rôle important dans le cadre du Collège et que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers est homologué par un arrêté ministériel.
L’Autorité des marchés financiers a un statut analogue à celui de la plupart de ses homologues dans les grands pays développés. Nos prérogatives en matière de réglementation, d’enquête ou de sanction sont similaires, ce qui est particulièrement important car les enquêtes ont une dimension internationale de plus en plus marquée.
L’Autorité des marchés financiers bénéficie d’une large autonomie de gestion, en matière de personnel et d’organisation. Son financement est assuré par des prélèvements à caractère fiscal effectués sur les opérations financières que l’Autorité des marchés financiers vise – ce qui explique la diminution de ses recettes en période de crise –, sur les capitaux dont elle surveille la gestion et sur les fonds propres des autres prestataires de services d’investissement. Ce mode de financement, dès lors qu’il est équilibré, ne pèse pas sur son indépendance. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une spécificité française.
Certes, il existe bien un paradoxe : en période de crise, au moment où le régulateur est le plus sollicité – que ce soit dans le cadre du G20, de la coopération internationale ou de ses activités nationales –, nos recettes tendent à diminuer, au point de nous placer aujourd’hui dans une situation de déficit. Je reconnais par ailleurs que nous manquons d’effectifs et de savoir-faire pour remplir de manière satisfaisante certaines de nos fonctions, notamment la surveillance des marchés, en raison de leur fragmentation, de leur plus grande sophistication et des bouleversements causés par les innovations technologiques, qui impliquent des moyens informatiques considérables si l’on veut suivre en temps réel l’évolution des marchés. C’est un domaine sur lequel nous concentrons tout particulièrement nos efforts.
La France n’a pas souhaité créer un régulateur unique, chargé à la fois de la régulation prudentielle, bancaire et assurantielle, et de la régulation des marchés financiers. Ce fut une sage décision, car, depuis la crise financière, les pays qui ont choisi un tel système – comme le Royaume-Uni – éprouvent quelques difficultés. Cela équivaut en effet à posséder deux cœurs : autant, pour le régulateur des marchés, la transparence s’impose, autant les activités du régulateur prudentiel répondent à des exigences de discrétion et de confidentialité. L’Allemagne a suivi le modèle britannique, qui s’avère inadapté à sa structure fédérale et à ses traditions ; le système de régulation unique lui pose aujourd’hui de gros problèmes.
La loi de 2003 a cependant considérablement amélioré le dispositif antérieur en fusionnant les multiples organismes en deux pôles. Ce système associant un régulateur prudentiel et un régulateur de marché me paraît excellent, non seulement à l’échelon national, mais également à l’échelon européen. Malheureusement, ce n’est pas l’option actuellement retenue par l’Union européenne : la réforme du système de supervision européen laisse coexister un Comité européen du risque systémique, un régulateur bancaire, un régulateur assurantiel et un régulateur des marchés. Il serait bon de s’orienter vers un dispositif plus simple.
Revenons-en à la France. Nous souhaitons travailler en bonne entente et en étroite coopération avec la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel. Un pôle commun sera mis en place, qui devra assurer la cohérence de nos politiques de contrôle, notamment en matière de commercialisation des produits financiers. Pour ma part, j’ai indiqué à la ministre qu’il me paraissait important que nous mettions en place des procédures et des programmes de contrôle communs et que nous travaillions en étroite collaboration sur le terrain.
Il ne faut plus laisser de zones non couvertes : l’imbrication croissante des produits financiers proposés aux épargnants – assurance-vie, crédits adossés à des OPCVM – et distribués par les mêmes réseaux – guichets bancaires, certains intermédiaires indépendants, compagnies d’assurances – imposait ce rapprochement. Comment expliquer à un épargnant qu’il bénéficie d’une sécurité variable suivant le réseau ou l’intermédiaire auquel il s’adresse ?
S’agissant des sanctions, il avait été prévu en 2003 de se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme et de distinguer clairement les différentes phases de la procédure – ce qui peut, en conséquence, laisser penser à l’opinion publique qu’il existe, pour reprendre l’expression que vous avez utilisée, une certaine « schizophrénie ».
La procédure comporte trois phases.
La première phase, l’enquête préalable, jusqu’à la notification des griefs, relève des services de l’Autorité des marchés financiers et du Collège. Les enquêtes sont ouvertes par le Secrétaire général et instruites par les services d’enquête, de même que les contrôles sont instruits par les services de contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont transmises au Collège de l’Autorité des marchés financiers, à qui il revient de décider si elles sont fondées ou non, et s’il convient de notifier les griefs à la Commission des sanctions et d’informer le Parquet.
M. Christian Vanneste, rapporteur. On note entre 2007 et 2008 une diminution de 85 % à 63 % de la part des dossiers transmis par le Collège à la Commission des sanctions et qui donnent lieu effectivement à sanction. Comment expliquez-vous cette évolution ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Le mieux serait que M. Francq vous réponde sur ce point tout à l’heure…
La deuxième phase, l’instruction des griefs, est réalisée par un rapporteur désigné par le président de la Commission des sanctions.
Enfin, troisième phase, le jugement est mis en délibéré puis prononcé par la Commission des sanctions.
La Commission des sanctions est donc bien distincte du Collège, y compris dans sa composition. Elle mène ses travaux de manière indépendante par rapport aux services de l’Autorité des marchés financiers, ce qui permet de respecter les prescriptions de la directive européenne sur les abus de marché, qui prévoit que la même autorité doit réglementer, contrôler et sanctionner les manquements boursiers.
Le dispositif antérieur n’opérait pas une distinction aussi claire entre autorité de poursuite et autorité de sanction. Des modifications ont donc été introduites par le législateur en 2003, sans pour autant enlever au régulateur la possibilité d’identifier et de sanctionner le plus rapidement possible les délits commis sur les marchés – au nom d’une spécificité de la régulation financière reconnue par tous les grands pays développés, qui justifie d’ailleurs notre position particulière par rapport à l’autorité judiciaire. Notre objectif est de ne pas dépasser, entre l’ouverture de l’enquête et la sanction prononcée, un délai d’environ 28 mois.
Le maintien de ce dispositif me paraît essentiel à la bonne coopération internationale. Si la procédure dépendait davantage du Parquet et de l’autorité judiciaire, comme le propose le « rapport Coulon », il faudrait remplacer la coopération administrative actuelle, qui fonctionne bien, par une coopération judiciaire moins efficace. Autant l’on peut rencontrer des difficultés dans l’application des règles financières, autant la coopération fonctionne bien en matière de surveillance, de lutte contre les manquements au marché et de poursuite des délits, même avec des pays qui ont une philosophie différente de la nôtre.
Je reconnais que le choix fait en 2003 n’est pas exempt de critiques, eu égard à son manque de lisibilité. Les réactions à la récente décision de la Commission des sanctions dans l’affaire EADS en sont l’illustration. La Commission des sanctions ayant un caractère juridictionnel, elle ne s’exprime pas, ce qui fait que l’on se retourne vers le président de l’Autorité des marchés financiers ou vers le secrétaire général, qui n’ont pas participé au délibéré de la Commission. On en a conclu que l’Autorité des marchés financiers, après avoir notifié des griefs à l’encontre de quarante personnes, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de les sanctionner. Pourtant, que la Commission des sanctions n’ait pas suivi le Collège n’est pas en soi anormal ! En matière pénale, il arrive fréquemment que les juges ne suivent pas les réquisitions ou les demandes du juge d’instruction : cela n’est pas propre à l’autorité administrative.
Avec le Secrétaire général, nous souhaitons que l’on tire très vite les enseignements de cette décision de la Commission des sanctions dans l’affaire EADS – sur laquelle je n’ai pas à me prononcer –, qu’il s’agisse de la conduite des enquêtes ou du renforcement du contradictoire avant la notification des griefs. Nous avons fait part aux pouvoirs publics de la nécessité pour l’Autorité des marchés financiers de pouvoir faire appel des décisions de la Commission des sanctions. Cela peut paraître étrange, mais comme l’Autorité des marchés financiers bénéficie, à l’instar de ses homologues des autres pays occidentaux, de pouvoirs de réglementation, d’enquête et de sanction, il serait logique que le Collège puisse faire appel s’il n’est pas satisfait d’une décision – ce qui n’est pas prévu par les textes. Nous souhaitons en outre l’introduction d’un pouvoir de transaction pour les affaires courantes, afin de concentrer nos moyens sur les affaires les plus complexes.
Monsieur Dosière, si l’on veut renforcer les droits de la défense, il convient non seulement d’introduire davantage de contradictoire au stade de l’enquête, mais aussi de veiller à ce que ceux qui ont ouvert celle-ci puissent se faire entendre devant la Commission des sanctions. En effet, j’ai été frappé, dans l’affaire EADS, par la représentation inégale des parties : d’un côté, une quarantaine d’avocats, parmi les plus brillants de la place de Paris ; de l’autre, une seule personne, le directeur juridique de l’Autorité des marchés financiers – qui, de surcroît, n’avait pas nécessairement instruit lui-même le dossier. Nous avons réuni plusieurs groupes de travail sur ces questions ; à la mi-mars, nous devrions être en mesure de faire aux pouvoirs publics des propositions, qui, si elles sont acceptées, pourront se traduire par des amendements au projet de loi de régulation bancaire et financière.
Nous souhaitons mettre en place un système cohérent, en termes de sanctions, entre l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers. Dès lors que va être présenté au Parlement un ensemble de mesures relevant partiellement de la régulation prudentielle, partiellement de la régulation des marchés, il faut que notre mode de fonctionnement soit à peu près identique. Je saisis cette occasion pour attirer votre attention sur l’importance d’un examen rapide de ce projet de loi de régulation bancaire et financière. Enfin, à titre personnel, je crois que nous devrions également nous interroger sur la composition de la Commission des sanctions et, notamment, nous demander si elle ne devrait pas comporter davantage de magistrats.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Sur douze membres, la Commission des sanctions comprend en effet huit professionnels ou personnes qualifiées, contre neuf sur seize au Collège. Néanmoins, on peut penser que les professionnels sont davantage experts que les magistrats sur ces questions, et qu’ils n’éprouvent pas forcément davantage de clémence pour leurs pairs. Un rééquilibrage est-il vraiment nécessaire ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Qu’il y ait, au sein du Collège, des professionnels de qualité, désignés par les institutions publiques, n’est pas une mauvaise chose parce que sur les questions de régulation et de réglementation, il importe que se noue un dialogue entre professionnels et magistrats.
S’agissant de la Commission des sanctions, en revanche, le système actuel peut fonctionner, mais il nourrira inévitablement un soupçon de « consanguinité » s’il y a trop de professionnels. Pour donner davantage de poids à ses décisions, il faudrait renforcer la proportion des magistrats en son sein – de même qu’à l’ACP, d’ailleurs.
M. Thierry Francq, secrétaire général. En outre, être rapporteur sur un dossier complexe à la Commission des sanctions représente un lourd travail ; pour des professionnels en exercice, c’est difficile à assumer. Augmenter la proportion de magistrats pourrait contribuer à régler ce problème.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Y aurait-il un lien entre ce phénomène et la diminution du nombre de dossiers donnant lieu à sanction ? Par ailleurs, comment expliquez-vous l’augmentation de 25 % des dépenses de personnel entre 2005 et 2009 ?
M. Thierry Francq. S’agissant du transfert des dossiers, on ne peut jamais être certain, lorsque l’on ouvre une enquête, qu’il y aura au bout du compte de quoi notifier des griefs. Nous présentons toutes les enquêtes au Collège, même celles que nous pensons devoir être classées. Cela n’est pas toujours le cas pour les contrôles.
Par ailleurs, les enquêtes ont été délicates à mener en raison de la situation des marchés. Lorsque ceux-ci sont extrêmement volatils ou orientés à la baisse, les manquements sont plus difficiles à détecter. Par exemple, le fait que des investisseurs vendent une ligne entière d’actions la veille de l’annonce des résultats d’une société est-il le signe d’un délit d’initié ou la simple illustration du pessimisme ambiant ? Les conditions de marché influent énormément sur notre capacité à détecter les manquements parmi les centaines de millions de transactions et le milliard d’ordres ayant lieu chaque année à la Bourse de Paris.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quid de la diminution de la proportion de dossiers ouverts donnant lieu à des sanctions ?
M. Thierry Francq. Elle est en partie due au moindre nombre de notifications de griefs, mais la variation est probablement aléatoire.
Peut-être observe-t-on aussi un renforcement des exigences en matière de preuves. Il faut savoir que nos sanctions sont systématiquement soumises à appel, notamment parce que l’AMF, ne peut pas elle-même faire appel ; l’appel ne fait donc courir aucun risque à la personne sanctionnée. Nos sanctions sont rarement entièrement annulées, même s’il arrive qu’elles soient réduites, mais les juridictions d’appel peuvent nous appeler à revoir nos éléments de preuve.
Cela a peut-être joué sur les chiffres. C’est pourquoi nous révisons l’ensemble de nos procédures – ce qui n’est pas aisé. Par exemple, certains dossiers contiennent des données intéressantes pour l’enquête, mais qui relèvent du secret professionnel ou du respect de la vie privée. Nous nous efforçons de renforcer les éléments de preuve et de réduire au maximum le risque d’annulation. En général, nos conclusions se fondent sur un faisceau d’indices : nous avons rarement affaire à des manquements d’initié explicites !
J’en viens aux ressources humaines. Il est vrai que les dépenses ont fortement augmenté en ce domaine, ce qui peut s’expliquer par deux phénomènes.
Le premier est le rattrapage de certains niveaux de salaire qui est intervenu ces dernières années. En cas de fusion entre plusieurs organismes, la tendance est en effet d’aligner les salaires par le haut. Or, au CMF, d’essence privée, les salaires étaient plus élevés qu’à la COB, organisme de nature publique.
Le deuxième phénomène est lié au marché du travail dans le secteur de la finance. Nous recrutons des auditeurs, des financiers, mais aussi des scientifiques de la finance, et cela coûte très cher.
M. Lionel Tardy. En revanche, en comparaison avec la Commission bancaire, vous connaissez un faible taux de rotation des personnels.
M. Thierry Francq. C’est vrai aujourd’hui, mais il n’en était pas de même lorsque la finance était florissante.
M. Jean-Pierre Jouyet. Ce taux était alors beaucoup plus important : de l’ordre de 15 %.
M. Thierry Francq. L’effet du marché a joué depuis. Aujourd’hui, en dehors de quelques expertises très spécifiques qui méritent que l’on consente un certain effort financier, nous sommes dans une phase de stabilisation de la masse salariale : les efforts de rattrapage sont terminés et l’état du marché du travail nous permet de souffler.
Une autre cause de la hausse de nos dépenses est l’augmentation des effectifs. Or, je crois que nous devons poursuivre dans cette voie. L’organigramme-cible comprend environ 460 personnes, contre 400 aujourd’hui, et nous continuons donc à procéder à des recrutements.
Il existe deux raisons à cette augmentation.
Tout d’abord, nous avons pris conscience que nous ne faisions pas suffisamment de contrôle et de surveillance, en amont, de la partie commercialisation de l’épargne – même si des sanctions ont été prises dans ce domaine, y compris à l’encontre de grands établissements, et si d’autres pourraient être bientôt prises. Au passage, je suis un peu frustré, parce que si l’on parle beaucoup des délits d’initiés, la presse fait beaucoup moins état des sanctions prononcées pour manquement à des règles professionnelles. C’est dommage, dans la mesure où les décisions que nous prenons ont avant tout pour but de montrer l’exemple.
L’autre raison est qu’en plus de la surveillance de la bourse de Paris, nous allons devoir assumer celle des autres plateformes qui mènent des transactions sur les valeurs françaises, mais aussi de toutes les opérations sur dérivés, y compris hors marché. C’est une gageure, et si nous travaillons d’arrache-pied avec nos principaux homologues pour nous y préparer, il est également indispensable de prévoir des moyens humains supplémentaires, notamment pour ce qui concerne certaines opérations extrêmement sophistiquées.
Ainsi, nous sommes convaincus que l’utilisation d’ordinateurs permet à certains de pratiquer la manipulation de marchés en passant des ordres qui, s’ils ne restent qu’une milliseconde dans le carnet d’ordres, donnent lieu, en quelques instants, à des dizaines de milliers d’ordres sur des valeurs. Pour détecter puis prouver une telle manipulation de cours, nous sommes contraints de construire un système informatique permettant de reproduire la séance « au ralenti » et d’examiner l’impact de chaque ordre passé. Un tel projet nécessite des développeurs informatiques, bien sûr, mais aussi des experts. Or, il me paraît nécessaire de le mettre en œuvre, pour corriger le biais que j’ai déjà évoqué.
En effet, nous parvenons aujourd’hui à détecter les manquements d’initiés et manipulations de cours les plus classiques, ceux qui portent le plus souvent sur des valeurs moyennes – suffisamment liquides, mais pas trop. Mais il existe des manquements beaucoup plus sophistiqués, par exemple lorsque l’on utilise les Credit Default Swaps sur une société en difficulté pour peser sur le cours. Nous avons donc besoin d’étendre notre surveillance, car je pense – et mes homologues avec moi – qu’il existe certaines pratiques que nous ne détectons pas, et qui cette fois concernent de grandes valeurs. Une des causes du biais est que certaines valeurs intéressent plus que d’autres les délinquants, mais aussi le fait qu’aujourd’hui nous sommes « borgnes » pour observer le marché.
M. Louis Giscard d’Estaing. La Cour des comptes a parlé d’une certaine aisance financière au sujet de l’Autorité des marchés financiers, et vous disposez en effet d’une trésorerie importante. En revanche, vos ressources souffrent d’une certaine volatilité. Pouvez-vous nous dire un mot de votre fonds de roulement, ainsi que de votre politique immobilière ?
Par ailleurs, confirmez-vous le souhait exprimé par l’Autorité des marchés financiers de disposer d’un siège dans le collège de la future Autorité de contrôle prudentiel, issue de la fusion entre les autorités administratives indépendantes compétentes dans le secteur de la banque et de l’assurance ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Je crois en effet de bonne méthode que nous puissions disposer d’un siège dans la nouvelle institution. Dans la mesure où nous devons adopter une approche commune en termes de commercialisation, cela me paraîtrait logique. De même, un représentant du gouverneur de la Banque de France siège au collège de l’Autorité des marchés financiers afin de faire valoir son expertise en matière d’intérêts prudentiels.
M. François Ardonceau, directeur de la gestion interne et des ressources humaines. La trésorerie de l’Autorité des marchés financiers était en effet importante jusqu’à la fin de l’année 2008 : de l’ordre de 85 millions d’euros. Mais le budget pour 2009 a été adopté avec un déficit d’environ 20 millions. Notre trésorerie, qui s’apparente plutôt à un fonds de réserve, devrait donc s’établir à environ 63 millions d’euros à la fin de 2009. Quant au budget 2010, il a également été voté avec un déficit de l’ordre de 22 à 23 millions. La volonté est d’abaisser progressivement le niveau de trésorerie jusqu’à 40 millions d’euros fin 2010. Ce montant, qui correspond à environ six mois de fonctionnement, paraît être le bon niveau de précaution pour assurer la fluidité des opérations courantes de l’Autorité.
Ces déficits successifs nous amènent à revoir la structure des recettes, car celles qui dépendent des émetteurs sont extrêmement fragiles. Les opérations boursières, sur lesquelles les contributions sont assises, sont en effet moins nombreuses : alors qu’elles nous procuraient en temps normal 25 millions d’euros de recettes, ce chiffre est tombé à 11 millions en 2009. La chute est donc brutale.
Plusieurs pistes de réflexion sont explorées afin de remédier à cette fragilité. L’idée serait de ne pas trop toucher à la partie des contributions dont le produit est le plus stable, telles que celles liées à la gestion des OPCVM, et de prélever un faible pourcentage sur les capitalisations boursières. Une autre hypothèse serait la mise en place d’un forfait annuel pour les très grands émetteurs, qui permettrait de stabiliser les recettes. Paradoxalement, en effet, celles-ci tendent à chuter en période de crise, c’est-à-dire au moment précis où la surveillance de l’état financier des émetteurs nous donne le plus de travail, et où nous devons donc engager le plus de dépenses. Autre piste : porter le taux de contribution des infrastructures de marché au maximum autorisé par la loi. Enfin, on pourrait envisager la création d’une contribution sur les opérations de salles de marché.
M. Louis Giscard d’Estaing. Une forme de taxe Tobin ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Non, elle ne porterait pas sur les transactions, mais serait calculée sur la base des volumes traités dans les salles de marché.
M. Thierry Francq. À partir du moment où nous devons étendre notre surveillance à toutes les activités de gré à gré, il me paraîtrait logique qu’elles apportent toutes leur contribution. Songeons que, pour mener à bien cette surveillance étendue, nous avons décidé de maintenir un budget informatique de 12 millions d’euros pendant les trois prochaines années, dont 6 millions pour le développement.
M. Jean-Pierre Jouyet. J’ai eu l’occasion de rencontrer mon homologue américaine, Mme Shapiro, directrice de la SEC – Securities and exchange commission –, et qui dirigeait auparavant un organisme professionnel d’autorégulation, la FINRA – Financial industry regulatory authority. Elle m’a dit que les moyens informatiques qu’elle avait trouvés à la SEC étaient dix fois moins importants que ceux dont elle bénéficiait auparavant. J’ai été choqué par ces propos, et je crois, comme le Secrétaire général, qu’il convient de renforcer notre capacité informatique. L’évolution de la technologie permet en effet, comme l’a rappelé M. Francq, des manquements de marché ou manipulations de cours que nous ne pouvons pas voir. Nous concentrons donc nos efforts sur ce point. Toutefois, vous avez raison de souligner l’augmentation de nos dépenses. La nouvelle équipe a souhaité réduire certains frais de fonctionnement de l’Autorité des marchés financiers : le budget 2010 prévoit ainsi une réduction de 10 %, soit une économie de 1,7 million d’euros. Bien que nos marges en matière de gestion ne soient pas illimitées, nous sommes décidés à faire des efforts.
M. Thierry Francq. D’une certaine façon, le déficit que nous avons connu du fait de la crise a été doublement positif, du moins d’un point de vue conjoncturel. D’une part, cela nous a permis de réduire une trésorerie objectivement trop importante – laquelle provenait, entre autres, de la vente, à un prix de13 millions d’euros, d’un immeuble que l’Autorité des marchés financiers possédait avant de devenir locataire. D’autre part, il en a résulté une tension sur les « faux frais » de l’institution. Cela étant, une telle logique ne peut durer éternellement. Un niveau de trésorerie correspondant à une demi-année de fonctionnement est une bonne chose, mais descendre plus bas nous ferait prendre trop de risques.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quel est le coût de cette location ?
M. François Ardonceau. Le loyer annuel est de 7 millions d’euros. En tenant compte des frais d’entretien, nos dépenses immobilières atteignent 11 millions.
M. Christian Vanneste, rapporteur. En ce qui concerne les bureaux, le coefficient d’occupation est de 10, 50 mètres carrés, ce qui est plutôt bien.
M. François Ardonceau. Ce taux va être optimisé dans la mesure où nous recrutons à bureaux constants.
M. Thierry Francq. Soixante personnes supplémentaires, cela fait une augmentation de 12 %. J’ai cependant décidé de ne pas augmenter la surface de nos bureaux.
M. Jean-Pierre Jouyet. Par ailleurs, nous sommes locataires de ceux qui possèdent le plus de biens immobiliers, c’est-à-dire les assureurs. Nos bailleurs sont Groupama et Generali.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait que la fonction de président de l’Autorité des marchés financiers ne soit pas renouvelable vous paraît-il un gage d’indépendance, ou cela reste-t-il sans effet ?
M. Jean-Pierre Jouyet : Je pense que c’est un gage d’indépendance. Lorsque vous savez que votre mandat ne sera pas renouvelé, vous pouvez conduire un certain nombre de réformes, dire ce que vous avez à dire. Pour ma part, je ne juge pas souhaitable de revenir sur cette disposition.
M. René Dosière, rapporteur. Si je pose la question, c’est parce que cela pourrait constituer une règle générale applicable aux autorités administratives indépendantes.
M. Jean-Pierre Jouyet. Le mandat non renouvelable ne rend pas les choses plus faciles sur le plan professionnel, mais il permet de garantir l’indépendance des autorités, conformément à la préoccupation du Parlement. En revanche, vous pourriez vous interroger sur la durée du mandat. Cinq ans sont-ils suffisants pour mettre en place des réformes ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Bien d’autres se posent la question…
M. Jean-Pierre Jouyet. En ce qui concerne le caractère non renouvelable en tout cas, je ne préconise pas de modification. Il me semblerait d’ailleurs sain que la plupart des autorités indépendantes fonctionnent ainsi.
M. René Dosière, rapporteur. J’ai le sentiment que la rémunération du président de l’Autorité des marchés financiers est fixée de façon partiellement discrétionnaire. Faut-il poursuivre dans cette voie, ou ne serait-il pas logique de prévoir des montants qui s’inscrivent dans des règles ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Je suis heureux que vous me posiez la question, car ma prise de fonction a été marquée par une polémique sur ce sujet. La rémunération du président de l’Autorité des marchés financiers a été fixée en 2003. Je touche donc le même montant que mon prédécesseur mais, n’ayant pas le même âge, il n’est pas besoin dans mon cas de déduire une indemnité de retraite. Je précise que ma future pension sera calculée à partir de mon traitement de fonctionnaire, et non sur ma rémunération de président de l’Autorité des marchés financiers.
Cette rémunération étant fixée de manière discrétionnaire par les pouvoirs publics, il paraît légitime de s’interroger sur son montant. Les parlementaires peuvent en particulier se poser la question de la proportionnalité entre la rémunération et les pouvoirs du président. Là est la vraie question.
De même, autant le montant des rémunérations des cadres – secrétaire général et secrétaires généraux adjoints – me paraît justifié dans la mesure où il convient d’asseoir l’indépendance de l’Autorité par rapport aux marchés, autant il serait légitime que le Parlement soit amené à rendre plus homogène la grille des indemnités dont bénéficient les dirigeants d’autorités administratives indépendantes. Je le dis très franchement et sereinement.
M. René Dosière, rapporteur. Ma question portait moins sur le montant actuel que sur la possibilité, pour un gouvernement, d’influencer l’orientation du président en fonction de la rémunération proposée. C’est le caractère discrétionnaire de la décision qui me pose problème.
M. Louis Giscard d’Estaing. Ce que vous suggérez, c’est l’établissement d’une grille commune à tous les présidents d’autorité indépendante…
M. Jean-Pierre Jouyet. Non, parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Je suggère plutôt d’examiner la réalité des pouvoirs des présidents de ces autorités, leurs responsabilités, afin d’ajuster leur rémunération en conséquence. Cela me semblerait préférable d’un point de vue éthique. Le secteur privé n’est pas, en effet, le seul susceptible de recevoir des leçons en ce domaine. Le secteur public est également concerné. Mais il ne faudrait pas que l’encadrement de la rémunération des présidents d’autorité indépendante – car il est exact, monsieur Dosière, qu’ils la négocient directement avec les pouvoirs publics – conduise à pénaliser les agents et les cadres de ces institutions. Non seulement la rémunération de ces derniers est une garantie d’indépendance, mais elle correspond, pour le coup, à des responsabilités très importantes et à des compétences très recherchées par le marché. C’est vrai, en tout cas, pour ce qui concerne l’Autorité des marchés financiers.
M. René Dosière, rapporteur. De toute façon, la rémunération des cadres et du personnel ne semble pas poser de problème.
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet. Pour les cadres supérieurs, elle me paraît correspondre au marché. Ce n’est donc pas faire preuve de démagogie que de vouloir qu’elles soient maintenues.
Pour les raisons que nous avons déjà indiquées – mieux contrôler la commercialisation des produits d’épargne –, nous créons une direction des relations avec les épargnants, pour laquelle nous recherchons un directeur, dont la rémunération devrait varier entre 120 000 et 140 000 euros. Le collège nous a appelés à recruter un professionnel reconnu, ayant une bonne connaissance du secteur, et désireux de rejoindre le service public de régulation. Or, nous n’y parvenons pas : à ce niveau de rémunération, nous pouvons recruter un cadre moyen d’établissement bancaire ou de société de gestion, sans doute compétent, mais pas le profil initialement recherché. C’est le problème auquel nous sommes confrontés. De même, il nous est très difficile de trouver des experts dans les domaines les plus pointus des mathématiques financières : ces ingénieurs étant ceux qui procurent aux établissements bancaires les marges les plus importantes, ils sont aussi les plus recherchés, et donc les mieux rémunérés.
M. Thierry Francq. Heureusement, nous arrivons à trouver des personnes acceptant d’être moins bien payées. Car nous sommes obligés de tenir compte du marché tout en proposant des rémunérations inférieures à celles qui s’y pratiquent.
M. Jean-Pierre Jouyet. Largement inférieures !
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous avez besoin d’incorruptibles !
M. Thierry Francq. Pour faire simple, nous proposons la même rémunération fixe, mais pas du tout le même bonus. Cela étant, il n’est pas mauvais de proposer des rémunérations inférieures, parce que les personnes qui l’acceptent prouvent ainsi leur motivation.
M. Lionel Tardy. Le même raisonnement pourrait s’appliquer à certains patrons prenant la tête d’une entreprise publique…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous avons l’intention d’auditionner également les usagers des autorités administratives. À votre avis, quelles sont les personnes qui bénéficient en priorité de votre travail et pourraient en proposer une évaluation ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Je pense que vous devriez rencontrer des responsables de sociétés de gestion, des prestataires d’investissement, des responsables bancaires ou des opérateurs de marché, mais aussi des représentants d’associations d’actionnaires minoritaires ou d’associations d’épargnants. Nous essayons en effet de conserver un équilibre entre, d’une part, la compétitivité et l’intérêt de la place, afin que les activités se tiennent à Paris plutôt qu’à Luxembourg ou à Londres, et, d’autre part, la sécurité des épargnants et les droits des actionnaires minoritaires. Enfin, vous pourriez rencontrer des représentants d’associations professionnelles, avec lesquels nous ne sommes pas toujours d’accord.
M. Thierry Francq. Ou les émetteurs, qui sont parfois critiques à l’égard de notre travail.
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet, ils trouvent parfois les procédures trop longues ou trop complexes.
M. Thierry Francq. Ou trop dures.
M. Louis Giscard d’Estaing. Vous regrettiez que les sanctions prises ne fassent pas l’objet d’une plus grande publicité…
M. Thierry Francq. On parle du manquement d’initié, qui porte une charge émotionnelle forte – ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un délit. Mais l’Autorité des marchés financiers a par exemple sanctionné deux réseaux bancaires, et non des moindres, pour la manière dont ils avaient placé les actions EDF. Or, cette sanction est passée inaperçue. Ce n’était pas assez « croustillant ».
M. Louis Giscard d’Estaing. Le placement des actions Natixis par les Caisses d’épargne a-t-il fait l’objet d’une procédure ?
M. Thierry Francq. Non. Ce dont se plaignent les actionnaires de Natixis, et on peut les comprendre…
M. Christian Vanneste, rapporteur. …c’est qu’un placement de père de famille se soit transformé en catastrophe !
M. Thierry Francq. Voilà. Ces actions ont été vendues quelques mois seulement avant la crise, et les souscripteurs ont subi une grosse perte. Mais contrairement à ce qui s’est passé pour EDF, la façon dont elles ont été placées n’a pas donné lieu à des récriminations à l’époque. Je rappelle que de nombreuses personnes ont « acheté » des actions EDF sans vraiment l’avoir voulu.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous n’avez pas la possibilité d’intervenir sur la complexité des produits ?
M. Thierry Francq. Si, parce qu’il existe deux catégories, les produits simples et les produits complexes, qui ne peuvent pas être vendus de la même manière.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Mais il n’y a pas de limite dans leur complexité.
M. Jean-Pierre Jouyet. Nous vérifions l’adéquation de la formation des vendeurs à la complexité des produits. À cet égard, et surtout depuis le scandale de l’année dernière, le collège est soucieux de ne pas accorder un agrément à des maisons dont on n’est pas sûr qu’elles aient la compétence nécessaire pour maîtriser les produits en cause. Par ailleurs, une directive européenne prévoit une distinction entre professionnels, seuls habilités à acquérir des produits dits « complexes », et non-professionnels. Mais une fois le produit vendu à un professionnel, rien ne garantit qu’il ne sera pas vendu à nouveau, dans le cadre d’un marché secondaire, à un organisme de placement collectif auquel vous, moi ou d’autres seraient susceptibles de souscrire. Là réside la difficulté.
M. Thierry Francq. En effet, car les OPCVM sont des investisseurs institutionnels. Ce n’est certes pas illogique, car acheter les services d’un gestionnaire, c’est aussi faire appel à son savoir-faire pour investir dans des actifs que l’on ne maîtriserait pas soi-même. Mais ce raisonnement a des limites. Il en est de même pour l’assurance : pour les unités de comptes, c’est l’assureur, et non l’épargnant, qui est l’investisseur.
Pour agir dans ce domaine, nous avons lancé des contrôles conjoints avec l’ACAM et la Commission bancaire sans attendre la constitution de l’ACP. Il existe certains produits structurés assez complexes qui garantissent le capital sauf si le cours tombe en dessous d’un certain seuil, auquel cas la valeur de l’investissement est considérablement réduite. Or plusieurs d’entre eux sont en perdition. On les retrouve aussi bien sous forme d’obligations structurées vendues directement par les banques qu’à l’intérieur des OPCVM ou dans des unités de compte d’assurance-vie. Nous avons donc adopté une approche commune avec les autres autorités. Je ne peux rien dire sur les contrôles en cours, mais je ne serais pas surpris qu’ils conduisent à des sanctions.
La sanction est importante, car elle est une façon de marquer des limites aux établissements. D’ailleurs, les plus importants d’entre eux sont en train de revoir leur politique afin de revenir à des produits plus simples et de jouer davantage sur l’efficacité de leur gestion – d’où l’engagement de fusions destinées à obtenir des économies d’échelle. Une telle évolution serait doublement positive : l’effet de concurrence conduirait à réduire les frais, et les produits proposés seraient plus simples. En effet, la plupart de nos compatriotes n’ont pas besoin de produits complexes.
Audition de M. Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, accompagné de MM. Marc Dubourdieu, directeur général, et Paul-Bernard Delaroche, directeur administratif et financier
jeudi 11 février 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous sommes heureux de vous accueillir, Monsieur le président Schweitzer, au sein de ce groupe de travail du Comité d’évaluation et de contrôle créé à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008. Il est en l’occurrence chargé d’une mission consacrée à l’étude, à l’évaluation et au contrôle des autorités administratives indépendantes, dont M. René Dosière et votre serviteur ont l’honneur d’être les rapporteurs. J’ajoute que nous avons programmé, la semaine prochaine, une visite des locaux de la HALDE.
Dans un premier temps, monsieur le Président, pourriez-vous rappeler la nature des missions de la HALDE et comparer celle-ci aux structures du même type présentes à l’étranger ?
La HALDE donne-t-elle satisfaction ?
Qu’en est-il de la composition et du fonctionnement de son collège, de son comité consultatif et de leurs modalités de renouvellement ?
Par ailleurs, non seulement la HALDE n’est pas une autorité administrative discrète mais elle suscite parfois des polémiques et même des débats parlementaires, notamment en ce qui concerne son budget : quel est donc le coût de l’ensemble de ses missions ?
Je note que sur 7 788 réclamations dont elle a été saisie en 2008 – sans compter les 30 000 appels téléphoniques annuels reçus –, 5 412 ont été rejetées immédiatement et, au final, 704 dossiers effectivement traités. Une telle proportion est-elle satisfaisante ?
De surcroît, et si vous me permettez ce trait d’humour, la HALDE n’est-elle pas elle-même vecteur de discriminations, celles-ci n’étant pas toutes traitées de la même façon ? Les dossiers liés à l’origine et au handicap sont prépondérants ; or si deux conventions ont été signées respectivement avec des réseaux d’associations de soutien aux personnes handicapées et d’organisations luttant contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, il n’en va pas de même avec des structures antiracistes.
Pourquoi, par ailleurs, la HALDE n’entretient-elle pas de relation avec des associations de rapatriés, notamment de harkis, dont nous savons pourtant combien ils sont victimes d’humiliations de toutes sortes ?
Pourquoi, également, une telle différence entre le nombre de dossiers traités à Paris – 900 – et en province – 200 dans les Bouches-du-Rhône, par exemple ?
Enfin, les moyens dont dispose la HALDE ne sont-ils pas disproportionnés ? Sur 81 agents, 51 traitent effectivement les dossiers – ce qui représente, pour chacun, 14 dossiers définitifs et 152 réclamations. De plus, elle occupe 2 304 m² dans le 9e arrondissement de Paris pour plus de deux millions d’euros par an, et chaque agent dispose de 20,38 m² en moyenne alors que la norme est de 12 m².
M. Louis Schweitzer. Je me réfèrerai au rapport des activités de la HALDE en 2009, actuellement sous presse, qui sera rendu public dans la première semaine du mois de mars et remis au Président de la République ainsi qu’aux présidents des deux assemblées.
La HALDE est née certes d’un projet politique national, mais également d’une directive européenne qui précise que tous les pays de l’Union doivent comporter une institution indépendante visant notamment à soutenir les réclamations des personnes victimes de discriminations. Le champ d’intervention de cette institution varie selon les pays, certains d’entre eux tels que Chypre ou la République tchèque l’ayant intégrée dans une structure équivalente à celle du médiateur de la République ou du futur défenseur des droits des citoyens quand l’immense majorité l’ont constituée en autorité autonome ou en commission dédiée aux seuls problèmes de discrimination.
La HALDE, dont le collège a été nommé le 8 mars 2005, se réfère quant à elle aux autorités préexistant à la directive européenne – et dont l’histoire est donc ancienne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique – mais, également, au Canada – en particulier au Québec – et aux États-Unis. En outre, elle fait partie du réseau des autorités de lutte contre les discriminations de l’Union européenne, EQUINET, et participe régulièrement à des échanges. Sur un plan financier, je note que le budget de l’autorité britannique est sept fois plus important que le nôtre et que si celui de la Belgique lui est comparable, il n’en va pas de même du nombre d’habitants de nos deux pays...
La plupart de ces autorités ont deux missions : d’une part, le traitement des réclamations de personnes qui estiment être victimes de discriminations et, d’autre part, la mise en place d’actions proactives ou préventives afin de promouvoir une meilleure égalité des droits et des chances.
Le collège de la HALDE, instance souveraine, se compose de 11 personnes désignées par le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux assemblées pour une durée de cinq ans non renouvelable, gage de crédibilité et d’indépendance. Le président de l’autorité occupe un emploi à part entière et ses dix collègues perçoivent une indemnité de 130 euros par séance – dont la durée est d’environ trois heures et demie, cinq ou six heures de préparation étant par ailleurs nécessaires.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quelle est leur fréquence ?
M. Louis Schweitzer. Nous nous réunissons une trentaine de fois par an.
Au sein du collège, le président est primus inter pares et sa voix est prépondérante en cas de partage. Je précise, à ce propos, que j’avais demandé avant ma nomination de pouvoir exercer d’autres activités tout en m’engageant à travailler plus de 35 heures hebdomadaires à la HALDE, ce que j’ai fait.
Le collège délibère sur les questions budgétaires ou règlementaires mais également sur les décisions prises – autres que les rejets et les simples rappels à la loi – à la suite de réclamations ainsi que sur la politique générale de l’organisation.
Afin d’assurer une certaine continuité, il a été décidé que le mandat d’une partie de ses membres, tirée au sort, serait renouvelable au bout de deux ans et demi : en l’occurrence, les postes de six d’entre eux – dont celui du président – doivent être renouvelés d’ici le 8 mars prochain.
J’ajoute que je ne suis pas intervenu dans la composition du collège actuel – je suis d’ailleurs le dernier membre à avoir été choisi – mais que les concertations qui ont eu lieu ont permis de parvenir à un équilibre satisfaisant : cinq femmes, six hommes. Siègent au sein de ce collège une ancienne ministre chargée des personnes handicapées, une directrice des ressources humaines, deux musulmans, un ultramarin expert en démographie, un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, une ancienne syndicaliste – Nicole Notat –, un professeur de médecine, ….
A été créé auprès du collège un comité consultatif représentant la société civile et qui est chargé de lui donner des avis sur les sujets qu’il lui soumet. Ce comité s’exprime uniquement devant le collège et se réunit cinq à dix fois par an.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Qui décide de sa composition ?
M. Louis Schweitzer. Outre que cette dernière est relativement équilibrée entre hommes et femmes, les membres sont choisis par le collège en fonction de leur expertise – M. Régis de Gouttes est ainsi premier avocat général à la Cour de cassation, Mme Marie-Thérèse Lanquetin juriste et chercheur, Mme Anne Debet professeur de droit à l’université de Paris XII et ancienne membre de la CNIL – et de leur représentativité – personnalités musulmanes mais également représentants d’une association de personnes handicapées, du MEDEF, des syndicats, de la LICRA, du MRAP, de SOS Racisme et de la Ligue des Droits de l’Homme. Les organisations syndicales étant trop nombreuses et n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, il y a un roulement car elles n’ont droit qu’à deux places.
Il est vrai que ce comité ne comprend pas de représentants des associations de harkis mais, à notre décharge, le choix n’a pas été aisé. Au départ, la situation a été rendue difficile par le fait que les représentants des associations étaient mal à l’aise à l’idée de ne pas pouvoir s’exprimer au nom de la HALDE.
Les membres du comité consultatif sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; il y a donc déjà eu un renouvellement.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je note également l’absence de représentants des associations familiales alors qu’elles sont au cœur, par exemple, des problèmes de discriminations liés au logement. Ne serait-il pas plus efficace de raisonner en termes de secteurs où s’exercent des discriminations plutôt qu’en termes de représentativité globale des personnes potentiellement discriminées ?
M. Louis Schweitzer. Nous organisons des groupes de travail thématiques sur tel ou tel type de discrimination ou tel secteur dans lequel elles sont susceptibles de se produire. C’est ainsi que, même si nous n’avons pas passé de convention avec les associations qui représentent les personnes handicapées, nous organisons une ou deux fois par an des réunions avec elles – une seule étant représentée au comité consultatif, nous avons créé avec ces associations un comité de coordination dépourvu d’existence juridique mais qui nous permet de travailler avec elles. Il en va de même avec les associations qui oeuvrent au respect des différentes orientations sexuelles. Les organisations générales de défense des droits de l’homme, vous l’avez noté, font quant à elles partie du comité consultatif et sont attentives aux discriminations liées à l’origine. J’ajoute que nous organisons également des groupes de travail ad hoc sur les problèmes liés, par exemple, à l’emploi ou au logement.
M. René Dosière, rapporteur. Le rôle de ces groupes de travail consiste-t-il à répondre à des sollicitations individuelles ou à faire part de considérations plus générales ?
M. Louis Schweitzer. Mission principale de la HALDE, le traitement des réclamations ne se fait jamais au sein d’un groupe de travail ou après un avis extérieur, fût-ce celui du comité consultatif : les dossiers sont en effet confidentiels et seuls le collège et les juristes les examinent. Les groupes de travail, quant à eux, contribuent aux activités de la direction de la promotion de l’égalité et peuvent prendre des initiatives d’ordre général.
Par ailleurs, nous organisons tous les six mois des enquêtes de satisfaction et de notoriété : connue par 54 % des personnes interrogées – ce chiffre est d’ailleurs en hausse –, 83 % d’entre elles considèrent également que la HALDE fait œuvre utile. Ce dernier chiffre est lui à peu près stable, il varie entre 78% et 86%. Ce qui important, c’est la notoriété : les gens ne peuvent s’adresser à nous que s’ils connaissent notre existence. Ce n’est pas comme le CSA, l’AMF ou la CNIL, qui sont des points de passage obligé pour un certains nombre de décisions.
En 2009, nous avons reçu 10 545 réclamations, soit une augmentation par rapport à 2008. Le mois de janvier 2010 confirme la tendance à la hausse.
M. René Dosière, rapporteur. Ces réclamations sont-elles écrites ?
M. Louis Schweitzer. Oui, qu’elles soient formulées sur un support papier ou, pour un tiers d’entre elles, sous une forme électronique avec Internet. J’ajoute que, parmi elles, 2 200 ont été déposées auprès de nos correspondants locaux – qui sont autant de bénévoles ayant bénéficié d’une formation spécifique –, lesquels ont par ailleurs reçu 1 500 personnes pour des entretiens informels. Dans la même année, 10 734 dossiers ont été clôturés, ce qui constitue pour nous une satisfaction puisque, toute institution devant trouver ses marques, nous traitions jusqu’à présent un peu moins de dossiers que nous n’en recevions – nous avions en conséquence un nombre de dossiers en cours qui avait tendance à croître ; en 2009, nous avons donc réduit ce nombre d’environ 200 dossiers. J’ajoute que chacun fait l’objet d’un accusé de réception.
Faute de concerner une discrimination au sens juridique du terme ou en raison d’une trop grande généralité, 7 200 dossiers ont été immédiatement rejetés : en effet, si la discrimination est devenue synonyme d’injustice dans le langage courant, elle doit être en droit définie comme une différence de traitement dans certains domaines – emploi, accès aux biens et aux services, dont le logement et l’éducation –, fondée sur un critère cité par le code pénal, le code du travail ou les conventions internationales. Donc pour qu’il y ait discrimination, les deux éléments que sont le critère et le domaine doivent être réunis. En aucun cas, par exemple, ne peuvent y être inclus d’une manière ou d’une autre des troubles de voisinage, des contrôles de police jugés excessifs ou une injure, fût-elle à caractère raciste. À cela s’ajoute que certaines personnes ne s’engagent pas dans le processus d’instruction lorsque nous leur demandons de préciser un peu plus les problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous avons donc précisément instruit 1 752 dossiers, ce qui constitue un lourd travail puisque nous interrogeons, certes, la personne potentiellement victime d’une discrimination, mais également celle qui est mise en cause.
M. Bernard Debré. Sur les 1 752 dossiers, combien sont traités localement ?
M. Louis Schweitzer. En l’occurrence, 347, mais en liaison avec notre direction juridique. Les correspondants locaux sont des gens compétents.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Comment les correspondants locaux sont-ils recrutés ?
M. Louis Schweitzer. M. Marc Dubourdieu, notre directeur général, va vous répondre, mais je précise d’ores et déjà que nous en avons recruté 127 et que 115 ont été installés.
M. Marc Dubourdieu, directeur général. Une publicité est diffusée sur le site Internet de la HALDE afin de savoir si des personnes bénévoles souhaitent s’engager pour tenir une permanence d’une demi-journée à raison de 35 semaines par an. Après avoir fait acte de candidature, elles sont reçues par les délégués régionaux et, in fine, par un comité de sélection qui juge de leurs motivations et vérifie l’absence d’incompatibilité entre les fonctions qu’éventuellement elles exercent et le travail qui leur sera demandé. Une majorité d’entre elles sont retraitées, notamment des cadres de l’administration – magistrats, policiers, inspecteurs du travail, enseignants –, mais certaines viennent du secteur privé ou d’autres origines – un chef d’entreprise, deux anciens sénateurs…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Les délégués régionaux sont-ils des permanents ?
M. Louis Schweitzer. Outre qu’ils font en effet partie des effectifs que vous avez cités – 82 personnes en 2009, 84 en 2010 –, certains d’entre eux sont mis à disposition par d’autres administrations, et nous employons également des stagiaires, notamment des avocats stagiaires, notre force de frappe effective étant ainsi plus proche de 100 que de 80.
M. René Dosière, rapporteur. Faut-il comprendre que l’administration d’origine continue parfois à assurer la rémunération des fonctionnaires que vous employez ?
M. Louis Schweitzer. Tout à fait. En raison de certaines difficultés de gestion des carrières, certains fonctionnaires d’une extrême qualité ne peuvent pas toujours bénéficier des débouchés qu’ils méritent.
M. Jean-Pierre Brard. Vous n’êtes donc pas un refuge pour « bras cassés » ?
M. Louis Schweitzer. Certainement pas. Je reconnais que nous avons parfois rencontré des difficultés : les personnels mis à disposition qui ne donnaient pas toute satisfaction sont retournés auprès de leur administration d’origine ; les autres agents n’ont pas été embauchés au terme de leur stage ou bien nous n’avons pas prolongé ou renouvelé leur premier CDD. Nous nous efforçons d’avoir une gestion du personnel aussi exigeante que celle d’une entreprise.
La moitié des réclamations instruites est rejetée après instruction, les dossiers concernés n’étant pas suffisamment solides. Nous appliquons une procédure contradictoire qui n’est certes pas imposée par la loi, mais qui nous paraît légitime : nous sollicitons d’une manière formalisée les personnes mises en cause pour recueillir des éléments d’information, puis pour leur permettre, le cas échéant, d’exercer un droit de réponse. À cela peut s’ajouter, par la suite, une demande de complément d’informations.
Quatre cents réclamations sont traitées, chaque année, par le collège de la HALDE, 350 le sont par nos correspondants locaux, 800 sont rejetées après instruction et 175 donnent lieu à un règlement amiable, procédure dont nous souhaitons le développement. Dans cette hypothèse, la personne mise en cause règle le problème à la satisfaction du plaignant après l’engagement d’une procédure auprès de la HALDE. Dès lors que les parties se sont entendues, nous estimons que la procédure n’a pas vocation à se poursuivre.
Sur les 400 dossiers examinés par le collège de la HALDE, sept ont donné lieu à un rejet pour des problèmes de fond qu’il a semblé important d’examiner de façon collégiale. Je pense, par exemple, à une plainte déposée par une étudiante portant la burqa : alors même que la loi sur le voile ne pouvait pas s’appliquer dans son cas, son professeur de langues refusait sa présence au motif qu’il ne voyait pas son visage. Considérant qu’il est important de voir la personne à laquelle on enseigne une langue, nous avons estimé que l’enseignant était dans son droit.
Nous intervenons également devant les tribunaux civils et administratifs – nous l’avons fait 212 fois au cours de l’année 2009 –, avec un taux de succès de 78 % depuis que la HALDE existe, et nous avons transmis 12 dossiers au parquet. Nous allons peu au pénal, car ce n’est pas une voie très efficiente en matière de discriminations, notamment à cause des difficultés d’établissement de la preuve. Il n’y a en France que 17 condamnations pénales par an pour ce motif, et c’est d’ailleurs une voie qui n’existe pas dans les pays anglo-saxons.
M. Christian Vanneste, rapporteur. En quoi consiste votre intervention devant les tribunaux ?
M. Louis Schweitzer. La loi de 2006 permet à la HALDE d’être entendue de droit devant tous les tribunaux – il s’agit essentiellement des prud’hommes, mais nous sommes également entendus par les cours d’appel et par la Cour de cassation, et nous intervenons devant les tribunaux administratifs et le Conseil d’État. Le statut exact de la HALDE devant les tribunaux donnant lieu à des débats de juristes, j’indiquerai seulement que nous nous efforçons d’éclairer les tribunaux en présentant l’opinion de la HALDE après que les parties ont été entendues et avant une éventuelle intervention du ministère public.
L’activité judiciaire est très faible en matière de discriminations. Les conseils de prud’hommes connaissent plus de 60 000 cas de discrimination par an en Grande-Bretagne, contre quelques centaines de cas en France. La plupart des magistrats et des avocats sont donc peu familiers de ce type de dossiers. Or, on ne connaît bien que ce que l’on traite souvent. Les textes de droit national sont certes assez simples, mais il faut prendre en compte de nombreuses autres normes, généralement mal connues : des conventions internationales, des textes de droit communautaire, à quoi s’ajoutent la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et celle de la Cour européenne des droits de l’homme. D’où l’intérêt de l’expertise que nous apportons.
La HALDE a également pour mission d’adopter des recommandations et des avis – au nombre de 163 en 2009 –, qui sont soit de portée générale, soit de portée particulière. Il s’agit alors de réparer une situation individuelle. Je précise que notre position est suivie dans près de 65 % des cas.
M. Jean-Pierre Brard. Vous avez évoqué une « loi sur le voile » qui n’existe pas : c’est une invention du journal Le Monde, qui a mené une véritable campagne en la matière, et plus particulièrement de l’un de ses plumitifs, Xavier Ternisien, lié aux cercles islamistes et aujourd’hui mis à l’écart de ses fonctions.
M. Louis Schweitzer. J’ai effectivement quelque peu simplifié le nom de la loi. Je voulais seulement indiquer que ce texte ne s’applique pas à l’université.
M. Jean-Pierre Brard. La HALDE est victime de sa notoriété : elle est saisie de nombreux sujets ne relevant pas de sa compétence.
Avant de vous rencontrer, Monsieur Schweitzer, en ma qualité de rapporteur spécial de la commission des finances, j’avais une opinion assez peu positive de la HALDE en raison d’un avis rendu sur le principe de laïcité. Or, je me suis aperçu que cet avis n’avait pas grand-chose à voir avec l’image qui en a été donnée. Il y a certainement un problème de communication, aggravé par le traitement que les médias font de ce type d’information.
M. René Dosière, rapporteur. À ce propos, continuez-vous votre émission radio du dimanche matin sur Europe 1 ?
M. Louis Schweitzer. Elle a disparu avec le départ de Jean-Pierre Elkabbach, ce que je regrette.
M. Jean-Pierre Brard. Compte tenu des discussions en cours sur l’avenir de la HALDE, cette audition pourrait bien être une oraison funèbre.
Ce n’était pas mon opinion à l’origine, mais j’estime que nous ferions mieux de préserver la HALDE au lieu de la fondre dans un magma institutionnel informe, ainsi que cela est parfois envisagé. Quels arguments opposeriez-vous, de votre côté, à une telle évolution ?
M. René Dosière, rapporteur. Selon certains échos, plusieurs autorités administratives indépendantes, dont la HALDE, pourraient effectivement être regroupées au sein du défenseur des droits.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il me semble que nous pourrions revenir sur cette question plus tard, au terme des travaux que nous allons mener.
M. Jean-Pierre Brard. Chacun sait, cher collègue, que vous avez soutenu un amendement à la loi de finances qui n’était pas très favorable à la HALDE.
M. Louis Giscard d’Estaing. Hors crédits de personnel, le budget de fonctionnement de votre institution est supérieur à 6 millions d’euros et à 4,2 millions hors loyer. À quoi correspondent ces dépenses, sachant que les indemnités prévues pour les membres du collège ne dépassent pas 42 900 euros ?
Je rappelle que nous avons émis, dès l’origine, des réserves sur les conditions de signature de votre bail – d’une durée de 9 ans – et sur le montant du loyer payé. Où en êtes-vous ?
Ne peut-on pas envisager de réaliser des synergies avec d’autres autorités, en particulier les réseaux de correspondants locaux du médiateur de la République et ceux du défenseur des enfants ? L’ancien président du groupe Renault que vous êtes sera sans doute sensible à cette question.
Ma dernière question est plus personnelle : pensez-vous que les fonctions de président d’une autorité administrative sont compatibles avec une participation à des conseils d’administration d’entreprises du secteur privé ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Et à celui d’un grand groupe de presse ?
Vous avez indiqué, dans vos réponses au questionnaire que nous vous avons adressé, que la HALDE n’avait pas de fonds de roulement. Or, on observe que les crédits dépensés sont systématiquement inférieurs aux crédits alloués – ce fut d’ailleurs particulièrement le cas dès la première année.
M. Louis Schweitzer. Nous n’avons pas de fonds de roulement, car la HALDE ne jouit pas de la personnalité morale. Les crédits non consommés sont donc rendus. La question se pose aujourd’hui de façon moins aiguë qu’au cours de la première année de notre existence – il aurait vraiment fallu jeter l’argent par les fenêtres pour dépenser les crédits alloués. Notre taux de consommation varie désormais entre 99 et 99,5 %.
Permettez-moi de revenir sur le nombre des dossiers traités. Nos homologues américains, britanniques et belges n’examinent que les affaires qu’ils considèrent comme intéressantes et symboliques. Nous traitons, pour notre part, tous les dossiers dont nous sommes saisis, ce qui signifie que nous examinons beaucoup plus de cas. J’ajoute que nous ne faisons pas de différence, ni de hiérarchie, entre les différents types de discriminations.
Depuis 2005, on observe une grande stabilité des critères de discrimination invoqués et des domaines concernés : les origines représentent 30 % des dossiers, contre 20 % pour la santé et le handicap ; 50 % des cas concernent un problème relatif à l’emploi.
La première activité de la HALDE est le traitement des réclamations. Nous sommes un centre d’expertise unique, gratuit et très utile pour de nombreux acteurs, y compris les avocats. Nous disposons, à cette fin, d’une direction des affaires juridiques comptant 47 agents.
Notre service administratif emploie, par ailleurs, 8 personnes. Il faut reconnaître que le caractère public de notre gestion est à l’origine de quelques lourdeurs. Un agent s’occupe ainsi des marchés publics à temps plein, alors qu’une structure privée de taille comparable n’emploierait certainement pas quelqu’un à la seule fin de gérer les achats.
À cela s’ajoute une direction de l’action régionale, chargée d’animer le réseau des correspondants locaux, lesquels jouent un rôle essentiel grâce au traitement « humanisé » et de proximité qu’ils peuvent apporter aux dossiers. Il me paraît en effet important de recevoir physiquement les gens et de pouvoir leur parler.
Nous avons, en outre, une direction de la promotion de l’égalité dont le champ d’action s’est progressivement élargi, passant du logement à l’emploi, puis à l’éducation. Je précise qu’il n’est pas prévu d’aller au-delà de ces domaines, qui constituent le cœur de notre mission.
La première action que nous avons menée au titre de la promotion de l’égalité a été l’envoi d’une lettre à 150 chefs de grandes entreprises, auxquels nous avons demandé de décrire les actions qu’ils mènent concrètement. Nous avons obtenu, à cette occasion, un taux de réponse de 70 % qui me semble tout à fait satisfaisant. Nous nous efforçons également d’assurer la circulation de l’information et la diffusion des pratiques intéressantes. J’ajoute que nous sommes en relation avec les intermédiaires publics et privés de l’emploi, avec l’Union sociale de l’habitat et avec les acteurs privés du logement, notamment la FNAIM, auprès desquels nous conduisons une action préventive.
Une des forces de la HALDE est de formuler des recommandations sur la base d’une expérience concrète. Nous différons en cela d’autres organes de réflexion : nous travaillons à partir des réclamations qui nous sont adressées.
Notre direction des affaires juridiques a-t-elle toujours été aussi efficiente qu’elle aurait pu l’être ? Ce n’est pas certain, mais nous avons réalisé un effort considérable pour améliorer le traitement des dossiers, à l’image de ce qu’ont fait les juridictions judiciaires et administratives au cours des dernières années. Nous avons désormais atteint un niveau d’efficience tout à fait satisfaisant.
Nous avons des locaux trop chers, trop grands et trop beaux. Un bail irrévocable de neuf ans a été signé le 25 janvier 2005, c’est-à-dire avant ma nomination, intervenue le 8 mars de la même année. Ce bail est en rediscussion grâce à l’implication de M. Woerth : notre capacité de négociation avec notre bailleur est à peu près nulle. Il est aujourd’hui difficile d’envisager une nouvelle réduction de notre loyer, car la crise a vidé plusieurs étages de l’immeuble.
M. René Dosière, rapporteur. Nous pourrons revenir sur la question des locaux à la faveur du déplacement sur place que nous allons réaliser.
M. Louis Schweitzer. J’en viens à la dernière question de M. Louis Giscard d’Estaing : il est prévu que je n’intervienne pas dans un dossier concernant une entreprise avec laquelle j’ai un lien, la BNP par exemple. Le fait d’avoir d’autres responsabilités me permet d’être plus efficace lorsque je m’adresse aux employeurs : je sais ce qui est possible ou pas.
M. Bernard Debré. Oui, mais c’est une chose d’avoir eu des responsabilités et une autre de continuer à les exercer.
M. Louis Schweitzer. Il y a des incompatibilités prévues par la loi. Nous les appliquons avec rigueur.
En ce qui concerne les synergies, nous pourrions peut-être nous passer de deux personnes au sein de la direction administrative et financière, mais la majeure partie de nos actions est très spécifique. Ayant une assez bonne expérience des synergies et des fusions, je peux vous dire qu’il faut affecter une personne à plein temps à un dossier si l’on veut qu’il soit traité ; sinon, ce dossier risque de passer après d’autres priorités. L’existence d’une institution spécifique pour la lutte contre les discriminations, jugée importante par plus de 90 % des Français consultés, est donc une chance.
Une autre force de la HALDE est son caractère collégial : ses délibérations sont certainement bien plus pertinentes que si elles étaient adoptées par son seul président.
M. René Dosière, rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur Schweitzer. Nous aurons l’occasion d’aborder d’autres sujets la semaine prochaine en rencontrant vos services.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous remercions pour la précision de vos réponses.
Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle et de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, accompagné de M. Timothée Paris, chargé de mission.
jeudi 11 février 2010
M. René Dosière, rapporteur. Nous aimerions savoir quelle appréciation vous portez sur les autorités administratives indépendantes, objet du rapport public du Conseil d’État de 2001 ; il nous a également semblé utile de vous entendre sur le fonctionnement des deux organismes et autorités intervenant dans le domaine de la vie politique que vous présidez.
M. Christian Vanneste, rapporteur. On peut s’interroger sur les différences de « silhouette » des différentes autorités administratives indépendantes. Certaines ne disposent pas de la personnalité morale, alors que d’autres en bénéficient. Cela vous semble-t-il justifié ?
Faut-il, par ailleurs, interdire au président d’une autorité administrative d’exercer certaines responsabilités ? Il existe notamment une autorité présidée par un sénateur. Cela vous semble-t-il logique et équilibré ?
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle et de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Comme vous l’avez rappelé, le rapport public annuel de 2001 comportait des réflexions sur le phénomène des autorités administratives indépendantes, apparu en 1978 avec la création de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. C’est à cette occasion que la catégorie des autorités administratives indépendantes a été consacrée pour la première fois par la loi.
Au cours des débats sur la création de la CNIL, les parlementaires s’étaient posé la question de savoir si la régulation du secteur concerné relevait d’un service public du ministère de la justice – sous la forme d’une administration classique ou d’un établissement public – ou d’une autorité indépendante. Le Parlement a opté pour la formule la plus radicalement nouvelle en créant une catégorie juridique particulière reposant sur un oxymore : l’administration étant à la disposition du Gouvernement, une autorité peut-elle être à la fois « administrative» et « indépendante » ? C’est un choix que le Parlement a fait de manière délibérée en adoptant des amendements introduits au Sénat. L’Assemblée nationale avait en effet retenu, dans un premier temps, des catégories juridiques plus classiques.
Alors que les débats sur la CNIL étaient à l’époque assez circonstanciels, la catégorie des autorités administratives indépendantes s’est ensuite installée dans le paysage institutionnel : le Conseil d’État a dénombré entre 25 et 35 autorités administratives indépendantes en 2001. Je n’ai pas procédé à un décompte précis des autorités qui existent aujourd’hui, mais je dirais que leur nombre est supérieur à 40. S’il y a eu un mouvement de concentration, on a également constaté un phénomène d’expansion, qui s’est poursuivi durant les années 2000 avec la création de telles autorités dans des secteurs nouveaux, y compris ‘une autorité compétente en matière de lutte contre le dopage.
Ces autorités jouissent aujourd’hui d’une légitimité institutionnelle difficilement contestable. Loin de correspondre à une simple mode, la création des autorités administratives indépendantes relève, selon moi, d’une véritable nécessité. Leurs caractéristiques ont été entérinées par le juge, constitutionnel et administratif, et leur création répond à un besoin évident d’efficacité dans certains domaines de l’action publique.
Il me semble également important de rappeler que le Parlement a la haute main sur la création des autorités administratives indépendantes, sur la détermination de leurs missions et sur les conditions de leur fonctionnement. Il joue un rôle essentiel dans la composition de ces autorités, soit directement par la nomination de certains membres, par les présidents des assemblées, soit indirectement grâce aux pouvoirs que pourront exercer les commissions permanentes une fois adoptée la loi organique relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui concerne certaines autorités administratives indépendantes, à côté d’entreprises et d’établissements publics intervenant dans les domaines économiques et sociaux.
L’indépendance des autorités administratives indépendantes résulte de leur mode de nomination, de leur collégialité et de la nature du mandat exercé par leurs membres, lequel est irrévocable et bien souvent non renouvelable. Le Parlement fixe, en outre, les règles relatives à l’autonomie financière de ces autorités.
Je suis d’avis que le Parlement dispose aujourd’hui d’un véritable droit de regard sur leur fonctionnement. On peut notamment observer que les commissions parlementaires ne manquent pas d’auditionner leurs présidents et de procéder à des investigations, comme ce fut le cas en ce qui concerne l’ARCEP, dans le domaine de la régulation des postes et des communications électroniques. Cela peut conduire, le cas échéant, à une réorientation des politiques publiques qui sont menées. Le Parlement exerce donc pleinement son rôle, qui est tout à fait légitime. La question peut se poser de savoir si ses pouvoirs doivent être renforcés, mais c’est à la représentation nationale de se prononcer elle-même sur cette question.
Comme je l’ai déjà indiqué, les caractéristiques essentielles des autorités administratives indépendantes ont été entérinées par le juge.
En dépit du débat doctrinal qui a eu lieu dans le monde anglo-saxon et celui que nous avons connu en France dans les années 90 sur la nature des autorités administratives indépendantes, considérée par certains comme quasi-législative, quasi-juridictionnelle et quasi-exécutive, il n’est pas contestable que ces autorités administratives indépendantes relèvent du pouvoir exécutif. Elles sont certes distinctes du Gouvernement et ne sont pas placées sous son autorité, mais elles appartiennent à la sphère exécutive et présentent un caractère administratif. Lorsqu’elles exercent un pouvoir de sanction, elles sont naturellement tenues de respecter un certain nombre de règles et de principes, notamment l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles n’en restent pas moins des autorités exécutives, soumises en tant que telles à un contrôle juridictionnel. Ajoutons à cela qu’elles ne peuvent pas exercer des missions et des compétences empiétant, si peu que ce soit, sur le domaine de compétences du Parlement.
La principale question qui s’est posée au plan juridique concerne les relations entre les autorités administratives indépendantes et l’exécutif. L’article 20 de la Constitution, aux termes duquel le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation », est-il compatible avec l’existence d’instances administratives ne relevant pas directement de son autorité ? Le Conseil constitutionnel a répondu par l’affirmative en 1989, malgré quelques restrictions.
La deuxième question était de savoir si de telles autorités pouvaient exercer un pouvoir de sanction. La réponse, apportée par le Conseil constitutionnel dès 1989, puis précisée en 1992, a bien évidemment été positive : pourquoi les autorités indépendantes ne pourraient-elles pas disposer d’un pouvoir de sanction auquel l’administration elle-même a massivement recours ? On peut penser, par exemple, aux sanctions fiscales et aux sanctions prévues à l’encontre des conducteurs de véhicules automobiles. Il aurait été étrange de ne pas reconnaître un pouvoir de sanction aux autorités indépendantes. Je précise cependant qu’elles ne présentent pas en principe de caractère juridictionnel, bien que les garanties du procès équitable doivent s’appliquer dans le cadre de leur pouvoir de sanction.
Le juge a donc confirmé que ces autorités relèvent de l’exécutif, mais il a aussi veillé à garantir leur indépendance en confirmant l’irrévocabilité du mandat de ses membres : le Conseil d’État a d’ailleurs considéré que le fait d’atteindre la limite d’âge, pour un fonctionnaire qui préside une autorité indépendante, ne peut pas conduire à remettre en cause son mandat (arrêt Ordonneau du 7 juillet 1989).
Le juge a également précisé que le pouvoir réglementaire des autorités indépendantes est limité et technique, et que leur pouvoir de sanction ne peut être inférieur à celui de l’administration.
Les autorités indépendantes répondent certainement à un besoin d’efficacité dans des domaines spécifiques, lorsqu’il s’agit de garantir l’indépendance et l’impartialité de l’action publique – on le voit quand des libertés sont en cause, avec par exemple le CSA ou la CNIL –, ou lorsque des monopoles historiques s’ouvrent à la concurrence et qu’il se révèle difficile d’assurer la régulation alors que l’État se trouve être propriétaire, ou actionnaire majoritaire, d’entreprises publiques. En matière de communications électroniques, de poste, d’activités ferroviaires, l’État aurait pu exercer directement la régulation après avoir privatisé les entreprises dont il était historiquement le propriétaire ; mais l’ouverture à la concurrence est passée par des autorités sectorielles qui se devaient d’être distinctes de l’autorité de tutelle.
Autre motif justifiant l’existence des autorités indépendantes : la légèreté de leurs structures et leur capacité à agir rapidement. Là encore, le rapport de 2001 reste pleinement pertinent. La rapidité d’intervention des autorités indépendantes leur confère une réelle efficacité. En outre, ces instances permettent de mettre en œuvre le principe de participation, en associant à la régulation de certaines activités des personnes qui ont acquis une légitimité et une compétence dans les secteurs en question.
Pour l’avenir, je formulerai quelques réflexions et recommandations relatives à la consolidation des compétences et de l’indépendance de ces autorités.
Pour ce qui est de la consolidation des compétences, il est souhaitable de poursuivre le mouvement de concentration engagé ces dernières années. De même, il est toujours possible d’améliorer la répartition des compétences entre les autorités indépendantes et le pouvoir exécutif d’une part, entre les autorités indépendantes et le pouvoir judiciaire d’autre part.
Pour ce qui est de l’indépendance, on pourrait imaginer, dans l’évolution du statut des autorités indépendantes, une clarification des garanties statutaires, notamment en matière de durée et de caractère non renouvelable des mandats, et un renforcement de leurs moyens.
S’agissant de la personnalité morale, elle n’est pas du tout indispensable aux autorités indépendantes. Ce n’est pas une garantie fondamentale mais une facilité, proposée par le Gouvernement et acceptée par le Parlement dans certains cas, pour autonomiser le financement desdites autorités et les soustraire au principe d’unité et d’universalité budgétaires – je pense notamment à l’Autorité des marchés financiers, mais aussi à la toute récente Autorité de régulation des activités ferroviaires. La mise en place de ressources fiscales affectées permet d’éviter de les soumettre à une discussion budgétaire annuelle.
Cela dit, après la mise en cause d’une autorité à raison de son activité de régulation – il s’agit, sauf erreur de ma part, de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles –, il est apparu que la personnalité morale présentait aussi quelques inconvénients : l’autorité est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour des montants financiers considérables, qui peuvent excéder ses ressources. Dans ce cas l’adossement à l’État n’est pas sans intérêt.
À mes yeux, donc, la personnalité morale est un élément circonstanciel qui vise à faciliter le financement des autorités indépendantes et à les soustraire à la contrainte d’une négociation budgétaire annuelle, voire triennale.
En tout état de cause, il me paraît de bonne méthode – et je ne peux qu’approuver la solution retenue – de placer le budget d’un certain nombre d’autorités indépendantes dans une mission budgétaire spécifique regroupant plusieurs programmes et rattachée au Premier ministre : c’est le complément budgétaire normal, légitime, du statut d’autorité indépendante ; il serait étrange que le financement de telles autorités relève directement des administrations dont elles ont pour objet de réguler une partie des activités.
Il est par ailleurs envisageable de renforcer les contrôles juridictionnels sur l’activité des autorités indépendantes. La réflexion doit être poursuivie par les juridictions qui en sont chargées.
Quelles sont, pour conclure, les conditions d’une action réussie ?
La création d’une autorité indépendante doit répondre, non à une convenance ou à une mode, mais à une exigence, soit pour protéger des libertés, soit pour assurer la régulation de secteurs d’activité qui, selon les cas, s’ouvrent à la concurrence ou exigent une technicité particulière et la participation d’une communauté d’intérêt – Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel, par exemple.
En deuxième lieu, il faut définir précisément la mission de l’autorité en veillant aux articulations et aux jointures avec l’exécutif d’une part, avec les autorités juridictionnelles d’autre part. La jurisprudence du Conseil constitutionnel à propos de la loi Hadopi conduit à renouveler quelque peu la réflexion sur le sujet. Il convient de bien tracer les frontières car rien n’est pire que la confusion des genres.
En troisième lieu, si l’on estime nécessaire de créer des autorités indépendantes, il faut se donner tous les moyens de garantir et de conforter cette indépendance, au niveau législatif comme au niveau du fonctionnement et des moyens.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Lors des auditions que nous avons menées, le mot de « démembrement » – démembrement de l’autorité politique, voire judiciaire – a souvent été prononcé au sujet des autorités indépendantes. Je parlerais plus volontiers d’un « syndrome de Becket » : les autorités sont créées par la volonté du législateur, à partir de projets de loi présentés par le Gouvernement, mais leur indépendance peut se manifester par une contradiction avec la volonté politique.
Nous avons ainsi découvert qu’une vive confrontation avait opposé l’Agence française de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports à l’époque, et que cela s’était traduit par un procès.
Autre problème, il existe toujours une marge d’interprétation quant aux buts d’une autorité indépendante, même s’ils sont bien délimités. C’est ainsi que si l’on interprète, en matière de discriminations, la notion d’appartenance nationale comme le fait d’avoir une nationalité autre que la nationalité française, cela conduit à dire qu’il y a discrimination lorsque l’accès à certains droits est refusé à des étrangers en situation irrégulière. On passe donc d’une question purement juridique – la situation irrégulière – à une conception reposant sur la discrimination – il y a discrimination à l’égard d’étrangers. J’en veux pour preuve les recommandations de la HALDE en matière de prestations familiales, de travail temporaire et d’ouverture de compte bancaire : l’autorité a pris là une position que, certes, elle justifie par son interprétation des missions qui lui sont confiées, mais qui va manifestement à l’encontre de la volonté du Gouvernement et des lois que le Parlement a votées.
M. Bernard Debré. Vous avez parlé d’une quarantaine d’autorités indépendantes. N’est-ce pas trop ? Ne pourrait-on en fusionner certaines, non seulement pour faire des économies mais aussi parce que leurs attributions se chevauchent parfois, comme celles de la HALDE et celles du médiateur de la République ? Alors que des missions auraient très bien pu être confiées à des autorités existantes, on a multiplié les instances.
Tous les gouvernements, quels qu’ils soient, cherchent des experts afin de leur déléguer l’autorité qu’ils pourraient exercer eux-mêmes. D’une certaine manière, ils se cachent derrière les experts des autorités administratives. Ce faisant, ils abandonnent des prérogatives dont l’exercice suppose un courage qu’ils ne veulent pas assumer. Pourtant, la protection des libertés devrait constituer l’action essentielle de tout gouvernement !
Comme l’a dit Christian Vanneste, l’exemple des personnes en situation irrégulière illustre le retournement contre l’État d’une institution qu’il a créée pour se défausser. Autant certaines autorités sont évidemment indispensables – la CNIL, l’AMF... – autant d’autres peuvent susciter l’interrogation.
M. Louis Giscard d’Estaing. Il est prévu que la création de l’Autorité de contrôle prudentiel se fasse par ordonnance. Dans un tel cas le contrôle parlementaire a priori est très faible. Le Parlement n’a pu s’exprimer que dans le cadre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, dont je suis membre. J’ai demandé que le Parlement soit représenté dans la composition de cette autorité mais le représentant du Conseil d’État au sein du comité consultatif, M. Yves Rossi, a exprimé au nom du Conseil de fortes réserves sur ce point, estimant qu’il n’était pas dans le rôle du Parlement de figurer dans le collège d’une autorité administrative indépendante.
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Ce point de vue n’engage que lui. Il n’a pas de mandat de la part de notre institution. De même, un parlementaire siégeant dans une autorité indépendante parle en son nom, pas au nom de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
M. Louis Giscard d’Estaing. Reste le problème de la création d’une nouvelle autorité indépendante par voie d’ordonnance. Notre contrôle ne pourra s’exercer qu’a posteriori et seulement par le biais de l’examen des dépenses de cette autorité.
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. On peut parler de surgissement de la notion d’autorité indépendante avec la loi du 20 janvier 1978. Cette catégorie n’a été ni conçue ni voulue ni encouragée par le Conseil d’État, qui est resté pendant deux décennies extrêmement critique à l’égard de ces nouvelles instances, à tel point que l’on a pu stigmatiser son « conservatisme » par rapport à ces nouveaux modes de régulation.
Le rapport de 2001 a été l’occasion d’entreprendre une réflexion à ce sujet et de tenir pour la première fois un discours constructif et positif, bien qu’assorti de conditions et réserves. Dans ce document, le Conseil d’État prend acte de l’émergence et du caractère incontournable des autorités administratives indépendantes, ainsi que de la jurisprudence qui s’est développée autour d’elles. Cela étant, depuis 10 ou 15 ans, le Conseil est saisi deux à trois fois par an du cas de la création d’une nouvelle autorité. Ses délibérations sur ces sujets ont souvent été grinçantes, parfois hostiles.
M. Bernard Debré. Toujours en raison de l’article 20 de la Constitution ?
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Oui, en raison de l’idée de l’unité de l’État et du risque de démembrement.
Je rappelle que le Conseil d’État s’est opposé, à la fin des années 90, à la création d’une autorité indépendante dans le domaine de la sûreté nucléaire, estimant que l’État ne pouvait se défausser d’une responsabilité qui n’appartenait qu’à lui. Il a fini par donner un avis favorable à une nouvelle proposition du Gouvernement quelques années après. C’est dire que l’institution au nom de laquelle je parle ne s’est jamais engagée dans cette voie avec euphorie !
En revanche, Monsieur Giscard d’Estaing, je ne pense pas qu’il y ait démembrement de la fonction législative. Le recours aux ordonnances relève d’un autre débat, celui qui concerne le recours à l’article 38 de la Constitution. Fondamentalement, la création de ces autorités constitue un démembrement du pouvoir exécutif.
Vous parlez d’un « syndrome de Becket », Monsieur Vanneste : la créature échapperait à son créateur et partirait vivre sa vie propre, explorant des terres que l’on n’avait pas envisagées initialement… On peut le dire des autorités indépendantes, mais peut-être plus encore – et cela depuis le XIIIe ou XIVe siècle – de la fonction juridictionnelle dans les États de droit.
S’agissant des discriminations – sujet extrêmement sensible pour la société française –, qui dit le droit ? Le Parlement fixe des règles. Il a créé une autorité indépendante. Mais, ultimement, c’est au juge qu’il appartient de dire si l’on est en présence d’une discrimination ; si, par exemple en matière d’accès aux prestations sociales, la différence de traitement est justifiée ou non par des différences objectives de situation ou un motif d’intérêt général. Pour cela, il se fonde sur le principe d’égalité et sur celui de non-discrimination – article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. En dernier recours, ces questions peuvent être portées devant le Conseil constitutionnel ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.
M. Bernard Debré. Donc cela va devant le juge...
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Il ne peut en être autrement. Une autorité indépendante ne peut pas avoir le dernier mot : elle est nécessairement soumise à un contrôle juridictionnel.
Je prendrai l’exemple de l’arrêt Perreux du 30 octobre 2009. Il s’agissait de savoir si la décision prise par le ministre de la justice au sujet de la désignation d’un enseignant de l’école de la magistrature était entachée de discrimination syndicale. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a mené ses propres investigations et a conclu par l’affirmative. Après qu’elle eut fait connaître sa position au ministre de la justice et l’eut rendue publique, elle a été mise en cause dans une procédure juridictionnelle.
Appelé à juger cette affaire, le Conseil d’État s’est prononcé en premier lieu sur la question de savoir si une directive communautaire non transposée produisait des effets de droit en France, non pas en ce qui concerne les actes réglementaires ou les lois, mais en ce qui concerne les décisions individuelles. Il a répondu par l’affirmative, renversant une jurisprudence vieille de 32 ans.
Cette directive s’appliquant, le Conseil d’État a été amené à définir en second lieu le mode d’administration de la preuve lorsqu’une discrimination est alléguée. Il a procédé à une interprétation constructive de la directive – laquelle pose pour principe le renversement de la charge de la preuve – en affirmant que, lorsque le juge a des pouvoirs, il dirige l’enquête ; qu’il appartient au demandeur de faire état d’éléments objectifs permettant de faire présumer une discrimination ; qu’il appartient au défendeur de préciser les raisons pour lesquelles une décision a été prise ; qu’enfin le juge doit forger sa conviction au vu des prétentions et des défenses avancées par les parties.
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État en assemblée du contentieux a estimé qu’il n’y avait pas de discrimination. La HALDE avait pris une autre position mais, à la fin, c’est le Conseil d’État qui a dit le droit.
Il en va de même dans bien d’autres domaines. En matière de relations de droit privé, par exemple, le droit sera dit par la Cour de cassation.
La loi de 2006 a renforcé les pouvoirs de la HALDE en lui permettant, lorsqu’elle constate des infractions, non pas de sanctionner, mais de provoquer des transactions qui doivent être homologuées par l’autorité judiciaire. C’est un point extrêmement important. Dans notre monde de communication, la prise de position d’une autorité peut paraître définitive. Une entreprise mise en cause par la HALDE peut en subir un préjudice. Mais ce qui compte ultimement, c’est l’exercice des compétences des autorités juridictionnelles.
Saisi en 2006 d’un texte qui visait à donner à la HALDE un pouvoir très général de sanction administrative pour des infractions susceptibles d’être poursuivies pénalement, le Conseil d’État a écarté ces dispositions sur deux terrains : premièrement, la généralité des infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives mettait en cause le principe de légalité des délits et des peines, applicable non seulement en matière pénale, mais également à l’ensemble des décisions qui ont le caractère d’une punition ; deuxièmement, l’ampleur du pouvoir de sanction que le Gouvernement envisageait de confier à la HALDE conduisait aussi à un empiétement sur les compétences de l’autorité judiciaire, alors que le droit pénal comprend déjà une multitude de dispositions permettant de réprimer les discriminations.
Le dispositif est clair. Dans le domaine de la lutte contre les discriminations, l’autorité indépendante est chargée de réaliser des investigations, de dénoncer à l’autorité judiciaire, de faire de la médiation, le cas échéant de proposer des transactions, mais elle n’a pas le pouvoir de sanction : le Parlement ne l’a pas voulu et, en amont, le Conseil d’État s’y était opposé dans un avis très net.
Par ailleurs, le mouvement de concentration est engagé. Créée par la loi de sécurité financière de 2003, l’Autorité des marchés financiers procède de la fusion de trois instances. Il en va de même de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui fusionne également quatre instances. Ce mouvement est légitime et bienvenu.
À plus long terme, ce mouvement pourra se poursuivre lorsque coexistent des autorités transversales, comme l’Autorité de la concurrence, et des autorités chargées de la régulation de secteurs qui s’ouvrent à la concurrence – autorités sectorielles. Une fois achevée cette phase nécessairement transitoire, on s’acheminera vers une convergence.
Il appartient aussi au Parlement d’apprécier une éventuelle réduction du nombre des autorités. À l’évidence, la création par le Constituant du défenseur des droits renvoie à une concentration. Il est loisible au Parlement d’en étendre ou d’en restreindre le périmètre tel que le Gouvernement l’a fixé dans le projet de loi organique.
Bref, les autorités indépendantes répondent à un besoin, mais il n’est pas nécessaire d’en avoir plus de 40.
M. René Dosière, rapporteur. Vous présidez la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle et la Commission pour la transparence financière de la vie politique, que l’on peut considérer peu ou prou comme des autorités administratives indépendantes. Sachant qu’il existe par ailleurs une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne pourrait-on envisager, comme c’est le cas au Québec, une seule autorité regroupant tous les missions concernant ce domaine ?
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, créée en vue de la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965, a un fonctionnement très intermittent. À chaque élection, elle travaille trois ou quatre mois avant de remettre son rapport.
M. Bernard Debré. Sur quoi ces travaux pourraient-ils déboucher ? Une fois que le président du Conseil constitutionnel a installé le Président de la République, la Commission détient-elle l’autorité nécessaire pour affirmer, le cas échéant, que l’élection n’est pas valide ?
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. C’est le Conseil constitutionnel qui exerce les pouvoirs de juge de l’élection. La Commission a été créée pour veiller à l’égalité de traitement des candidats, à une époque où il n’existait pas d’instance indépendante en matière d’audiovisuel. En revanche, le Conseil constitutionnel existait déjà. D’où une articulation assez complexe entre les pouvoirs des uns et des autres. Cela étant, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour l’élection présidentielle ne coûte pas cher et joue un rôle utile : entre les pouvoirs propres du Conseil constitutionnel, qui se prononce sur des textes, et les pouvoirs propres du CSA, il existe à l’évidence des vides. Si l’on en venait à la supprimer, il faudrait veiller à ce que ses attributions soient confiées à l’une ou à l’autre de ces instances.
Je note que, pour la première fois, des prises de position de cette commission ont donné lieu à un contentieux administratif : cela concernait les conditions dans lesquelles s’appliquait la législation sur les sondages et l’interdiction de rendre compte du résultat de l’élection avant la fermeture du dernier bureau de vote – c’est ainsi que les départements français des Antilles votent désormais avant la métropole. Par chance, les prises de position de la commission qui faisaient grief n’avaient pas donné lieu à des suspensions ou à des annulations.
C’est aussi cette commission qui a soulevé, en termes assez abrupts, la question des conditions de traitement des candidats par les sociétés de communication audiovisuelle. Elle a considéré que le régime mis en place par le CSA au nom de l’égalité entre les candidats portait atteinte à la liberté d’information et de communication. Nous avons dit de la manière la plus nette que le régime applicable entre le moment où la liste des candidats est rendue publique et celui où débute la campagne officielle pose une question majeure de conciliation entre le principe d’égalité et le principe de liberté de communication.
On peut très bien rebattre les cartes et redistribuer les compétences exercées par la Commission nationale de contrôle, mais il faut que ce type de propos puissent être tenus par une instance ayant la capacité de le faire.
Pour ce qui est de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, une chose est sûre : ses compétences ne sauraient être exercées par un bureau du ministère de l’intérieur. Une instance intraparlementaire est tout à fait imaginable, étant entendu que son champ serait restreint aux seuls parlementaires. On peut également envisager une autorité indépendante transversale traitant de deux sujets assez différents : le contrôle du patrimoine des 3 000 personnes soumises à déclaration – élus nationaux, membres du Gouvernement et grands élus locaux – et le financement des campagnes.
Je tiens toutefois à souligner que si, en tant que président de la Commission nationale de contrôle, je travaille avec le Conseil constitutionnel, le CSA et, parfois, la Commission nationale des comptes de campagne – à laquelle il arrive de réagir à telle ou telle question –, je n’ai en revanche jamais été confronté à un cas me conduisant, en tant que président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, à me demander ce que pouvait penser, dire et faire la Commission nationale des comptes de campagne. Il n’y a pas de lien fonctionnel entre les deux instances.
Le Parlement peut décider de rassembler ces commissions dans une instance unique afin de simplifier le paysage institutionnel, mais, ce faisant, il ne remédiera pas à un éventuel dysfonctionnement. Autrement dit, nous n’avons aucun rapport avec la commission présidée par François Logerot.
M. René Dosière, rapporteur. Voilà des années que la Commission pour la transparence financière de la vie politique souligne les limites de ses compétences en matière de vérification de la sincérité des déclarations de patrimoine. Elle n’est apparemment pas entendue. J’ai déposé des propositions de loi auxquelles il est arrivé ce qui arrive aux propositions de loi… De son côté, le Gouvernement n’a pas voulu saisir l’occasion pour compléter la législation et la rendre plus efficace. Ne faut-il pas souhaiter une autorité qui, sur le plan politique, aurait plus de poids ?
M. Bernard Debré. Comme la Cour des comptes, par exemple.
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Peut-il y avoir une autorité qui ait plus de poids que celle où siègent en personne le vice-président du Conseil d’État, le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour des comptes ? Si le Parlement entreprenait de fusionner en une grande autorité de régulation de la vie publique, et la Commission nationale des comptes de campagne et la Commission pour la transparence financière de la vie politique, il lui faudrait de toute façon aussi se prononcer à cette occasion sur les propositions de réforme rassemblées dans les treizième et quatorzième rapports de la seconde instance, où nous avons rédigé le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire correspondant à nos préconisations, de façon à faciliter le travail du pouvoir exécutif.
Je ne pense pas qu’une fusion permette à elle seule de mener à bien des propositions de réforme qui peuvent parfaitement aboutir dans le format actuel, pour peu que la représentation nationale et le Gouvernement le veuillent. Le rapport de 2009 rappelle que le Gouvernement s’est engagé à adopter plusieurs dispositions absolument nécessaires pour renforcer l’efficacité de notre contrôle, j’ai toute confiance dans sa capacité à mettre en œuvre ses engagements.
M. René Dosière, rapporteur. Je vous remercie vivement, Monsieur le vice-président, pour la précision et la qualité de vos propos.
Audition de M. François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagné de M. Régis Lambert, secrétaire général, et de Mme Marie-Thérèse Merny, chef du service des affaires générales, du personnel et des finances
jeudi 18 février 2010
M. René Dosière, rapporteur. Merci, monsieur le président, d’avoir répondu à notre invitation.
Les autorités administratives indépendantes, ou considérées comme telles, sont nombreuses et diverses. Nous disposons déjà des réponses très précises que vous avez données à nos questionnaires – j’en profite pour vous en remercier – et des rapports d’activité de votre commission. J’aimerais maintenant vous demander de nous présenter votre activité de nous dire, d’une part, si vous rencontrez des difficultés ou points de blocage précis, et, d’autre part, si la transformation de la CNCCFP en autorité administrative indépendante, puisque ce n’en était pas une à l’origine, a été un atout.
M. François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Merci de nous recevoir. Je suis accompagné de M. Régis Lambert, secrétaire général de la Commission, et de Mme Marie-Thérèse Merny, chef du service des affaires générales, du personnel et des finances.
Après une expérience de désormais vingt ans, il peut être utile de se demander d’abord si les raisons qui ont conduit le législateur à créer cette commission en 1990 ont conservé leur pertinence, ensuite si la commission a pu s’acquitter correctement de ses tâches, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, et enfin à quel coût pour les finances publiques.
La question qui s’est posée au législateur, lorsqu’il a voulu organiser la surveillance des finances des partis politiques, a été de savoir à quel type d’organisme confier cette mission nouvelle, qui a d’ailleurs largement évolué : jusqu’en 2003 par exemple, la commission arrêtait les comptes des candidats mais c’est le préfet qui fixait le montant des remboursements, les décisions de la commission n’étant donc pas attaquables devant le juge puisqu’elles ne faisaient pas grief.
Fallait-il choisir une administration classique, un bureau du ministère de l’intérieur par exemple ? C’était difficile, parce qu’il était nécessaire d’afficher l’indépendance des décisions prises dans ce domaine délicat.
Une juridiction administrative de droit commun ? Mais il ne s’agissait pas de régler des litiges.
La Cour des comptes, juridiction administrative spécialisée en matière financière ? La Cour n’a pas pour habitude de dispenser des subventions, ni de donner un feu vert au Gouvernement en la matière. Certes, elle contrôle l’usage que font de l’argent public les organismes qui en reçoivent, mais, justement, les partis, dès lors qu’ils répondent aux critères de représentativité posés par la loi et respectent leurs obligations comptables, doivent être laissés absolument libres de l’utilisation de l’aide publique – selon le principe constitutionnel, ils se constituent et agissent librement – alors que la Cour exerce un contrôle au fond, se référant à l’intention du ministère qui subventionne. Quant aux fonds destinés aux candidats, il ne s’agit pas d’une subvention traditionnelle, mais d’une somme versée a posteriori. Enfin, la Cour des comptes ne se voyait pas sans appréhension assumer ces tâches à l’égard des personnes privées que sont les candidats et les partis, alors qu’elle ne traite habituellement qu’avec des organismes institutionnels.
C’est donc une institution ad hoc qui a été créée, qui n’avait à l’origine pas le statut d’autorité administrative indépendante. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel lui ont reconnu cette qualité très vite, mais cela n’a été formalisé que par une ordonnance de décembre 2003. Il s’agit d’un organisme qui n’est pas assimilable à une administration et dont les décisions qui font grief peuvent être déférées devant un juge – ce qui aurait d’ailleurs représenté une difficulté supplémentaire pour la Cour des comptes, dont les décisions ne peuvent être contestées devant le Conseil d’État qu’en tant que juge de cassation, alors que c’est au fond que les décisions de la commission doivent pouvoir être contestées au contentieux. Cette solution donc, qui n’a jamais été sérieusement remise en cause, assure un assez bon équilibre entre l’indépendance nécessaire à l’accomplissement par la commission de ses missions et le droit des partis et candidats à contester les décisions prises à leur égard.
Comment la commission s’est-elle acquittée de ses missions ?
Pour ce qui est des comptes de campagne, et d’un point de vue quantitatif, elle a contrôlé environ 85 000 comptes depuis sa création – et je parle bien d’un contrôle exhaustif. Même s’il existe un certain nombre de petits comptes, voire de comptes « zéro », dans les élections locales notamment, la masse de travail est considérable, d’autant que la commission doit respecter un délai de six mois pour se prononcer, raccourci à deux mois en cas de contentieux. Or, lors des dernières élections européennes, il y avait contentieux dans chacune des circonscriptions ! Il est arrivé que la commission n’arrive pas à examiner tous les comptes dans le délai prescrit, auquel cas les comptes concernés sont réputés approuvés, ce qui est évidemment fâcheux. En 2001, 3 % des comptes des circonscriptions en contentieux, soit 140 comptes, n’avaient pu être examinés. Cela n’a été le cas que pour un seul des 9 910 comptes des élections municipales et cantonales de 2008, et encore, uniquement parce que l’envoi postal s’était perdu et que le candidat n’avait pas de double !
Les fonds versés aux candidats varient selon les types d’élections. Ils se sont élevés, en 2007, à 43 millions d’euros pour les législatives et à 44 millions pour les présidentielles, à 37 millions pour les municipales et cantonales de 2008 et à 27,5 millions pour les européennes de 2009. Ce sont des sommes considérables, qui exigent la plus grande vigilance.
Sur le plan qualitatif, il est beaucoup plus délicat de porter une appréciation. Si très peu de comptes sont rejetés, est-ce parce que les règles sont bien appliquées ou que la commission est laxiste ?
M. René Dosière, rapporteur. Ce n’est pas la réputation qu’elle a auprès des élus !
M. François Logerot. Si elle est sévère, est-ce parce que trop de candidats ne respectent pas la loi ou parce qu’elle est trop tatillonne ?
Je sais que les élus se plaignent du caractère excessivement détaillé – selon eux – du travail de la commission, mais ce reproche est surtout une réaction aux questionnaires envoyés par nos rapporteurs. Je ne trouve pas anormal que nos rapporteurs examinent les opérations du compte dans le détail, ni que leurs observations n’aient parfois qu’un faible impact financier. Ce qui compte, c’est ce que la commission retient ensuite comme grief pour réformer le compte, ce qui arrive dans environ 15 à 20 % des cas, ou pour le rejeter, ce qui s’est produit pour 3 % des comptes des élections locales récentes et 10 % des dernières européennes – encore que, dans ce cas, quatorze des dix-neuf rejets aient été motivés par l’absence de désignation d’un mandataire financier, formalité substantielle pour laquelle la commission n’a pas d’autre option que le rejet.
Un critère d’appréciation se trouve dans l’attitude des juges devant les décisions de la commission, soit parce qu’elles sont contestées, soit parce que la commission elle-même a saisi le juge de l’élection en cas de rejet ou de non-dépôt du compte. Pour les élections locales de 2008, le juge de l’élection a considéré que la commission avait statué à tort dans 5 % seulement des cas qu’elle lui avait soumis. Quant aux recours directs devant le Conseil d’État, il n’y en a eu que cinq, sur 2 700 réformations, et sur quatre jugés, un seul a été admis. Les juges semblent donc considérer que la commission remplit correctement son office.
Un autre critère d’appréciation est le degré de satisfaction des candidats quant aux remboursements ; or, pour ces mêmes élections locales de 2008, 79 % d’entre eux ont reçu un remboursement égal ou supérieur à 90 % de leur apport personnel. Le taux de réformation est donc extrêmement faible.
Pour ce qui est des comptes des partis, nous sommes tenus à l’examen et à la publication des comptes annuels, qui sont déposés avant le 30 juin. Le délai de publication de ces comptes est le seul indicateur de notre activité au sens de la LOLF. Jusqu’au début des années 2000, ce délai pouvait atteindre dix ou douze mois après le dépôt des comptes. Depuis quatre ans, nous publions les situations avant la fin de l’année suivant l’exercice – la publication des comptes 2008 a eu lieu le 19 décembre 2009. Ce délai de six mois est très difficile à réduire encore du fait de la procédure contradictoire que nous entretenons avec les partis.
Surtout, nous avons essayé d’enrichir progressivement notre contrôle, dans la limite de nos pouvoirs – c’est-à-dire par exemple sans aucun droit de regard sur la nature et la destination des dépenses des partis. C’est sur leurs recettes que la commission exerce la surveillance la plus rigoureuse. Elle contrôle l’origine des fonds – notamment depuis l’interdiction totale des ressources provenant de personnes morales autres qu’un parti –, vérifie les dons des personnes physiques, gère les demandes de « reçus-dons » et suit les nombreuses relations financières entre partis – ce qu’un parti a déclaré comme versement à un autre doit bien se retrouver dans la comptabilité du second, ce qui est beaucoup moins élémentaire que cela n’en a l’air.
Pour finir, il est toujours difficile d’apprécier le coût d’une institution par rapport à son efficacité. Ce qui est sûr c’est que le budget de la commission reste très raisonnable, avec des variations d’une année sur l’autre en fonction de son activité. Il se situe aujourd’hui aux alentours de 4,5 millions d’euros : 50 % vont aux dépenses de personnel permanent, 12 % à celles de personnel non permanent – les vacataires et rapporteurs recrutés en période électorale –28 % aux loyers.
Nos locaux sont dimensionnés en fonction des besoins dans les périodes électorales, notamment par la conjonction depuis 2007 de l’élection présidentielle – pour laquelle nous étions compétents pour la première fois – et des législatives. En 2008, nous avons eu 10 000 comptes à examiner, dont le quart en deux mois.
Enfin, les 10 % restants du budget vont au fonctionnement, avec une part informatique importante, qu’il s’agisse de nos liaisons permanentes avec les préfectures ou du réseau intranet qui nous permet de travailler avec nos rapporteurs dans toute la France. De façon générale, on constate une grande stabilité : notre budget de fonctionnement était déjà de l’ordre de 2 millions d’euros en 1995, contre 1,8 en 2009.
Pour ce qui est du personnel, les comparaisons sont très difficiles, la commission ayant fonctionné jusqu’en 2003 avec des fonctionnaires mis à disposition. Ce n’est que depuis qu’elle est autorité administrative indépendante qu’elle assure elle-même son recrutement. Néanmoins, les effectifs semblent être restés stables. La commission comptait déjà, en-dehors bien sûr de ses neuf membres, qui ne sont pas des agents permanents de la commission, une quarantaine de permanents dans les années 1990, et ils sont trente-trois aujourd’hui. Elle met un point d’honneur à ne pas atteindre, sauf très ponctuellement peut-être, le plafond d’équivalents temps plein qui lui est fixé – nous sommes actuellement à 37,5 ETP, à comparer à un plafond de 41. Nous avons un souci constant d’économie et d’adaptation à notre activité réelle.
Nous avons donc les moyens de fonctionner normalement, même si nos moyens d’investigation sont limités – d’autant que nous ne faisons jamais appel aux brigades financières de la police judiciaire, bien que ce soit théoriquement possible, parce que les délais auxquels nous sommes astreints sont incompatibles avec ceux de leurs enquêtes.
Notre souci porte plutôt sur le « toilettage » du code électoral, qui nous semble nécessaire : nous avons développé ce point dans nos différents rapports d’activité. Sans même soulever un certain nombre de questions de principe qui peuvent faire débat, et que le législateur peut souhaiter ne pas aborder, une simple relecture et une clarification des dispositions du code seraient bénéfiques, non seulement pour la commission, mais pour les candidats et les partis. Ce n’est évidemment jamais le bon moment, parce qu’on vote beaucoup en France : depuis 2005 que je préside la commission, 2006 a été la seule année sans élections générales ! Toutefois, les échéances essentielles sont les présidentielles et les législatives et il est tout à fait possible de mener une réforme entre leurs dates. La commission regretterait beaucoup que l’on ne trouve un petit créneau dans l’emploi du temps, certes très chargé, du Parlement, pour procéder à quelques améliorations relativement faciles.
M. René Dosière, rapporteur. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez évoqué des moyens susceptibles de permettre d’apprécier la qualité du travail de la commission, comme le niveau du remboursement alloué aux candidats ou le sens des décisions rendues par les juridictions. Ne serait-il pas possible de publier régulièrement les résultats ainsi obtenus ? Ces indicateurs sont au moins aussi pertinents que le délai de publication des comptes des partis politiques…
M. François Logerot. Nous communiquons ces données dans chacun de nos rapports d’activité, qui deviennent quasiment annuels. Le prochain rapport comprendra un chapitre dédié aux suites juridictionnelles données à nos décisions sur les élections locales de 2008, sauf quelques unes sur lesquelles il n’a pas encore été statué.
Nous avons bien sûr analysé les cas dans lesquels nous n’étions pas suivis. Ainsi le Conseil d’État a-t-il jugé qu’un candidat qui n’avait pas présenté son compte par l’intermédiaire d’un expert-comptable pouvait le faire après son dépôt, alors que nous estimions qu’il s’agissait d’une formalité substantielle qui ne pouvait être régularisée. Cette décision fait jurisprudence et nous engage évidemment pour l’avenir, même si nous la regrettons : il est des cas où les décisions rendues nous créent quelques soucis, mais nous sommes obligés de nous incliner.
Pour ce qui est des indicateurs de performance, nous en avions envisagé trois à l’origine.
Le premier portait sur le nombre de comptes non examinés, mais la commission des finances de l’Assemblée nous a fait remarquer qu’il ne servait qu’à déterminer tout bonnement si nous avions ou non rempli notre mission, ce qui n’en faisait pas un indicateur de performance très pertinent.
Le deuxième concernait le pourcentage de comptes rejetés pour une raison substantielle mais formelle. Dans notre esprit, si les candidats ne respectaient pas leurs obligations, c’est que notre action pédagogique à leur endroit n’était pas suffisante… mais le ministère de l’intérieur nous a fait observer que certains candidats pourraient de toute façon négliger ces formalités. Ce critère n’a donc pas non plus été jugé pertinent.
Seul l’indicateur concernant le délai de publication des comptes des partis est donc resté, mais je reconnais que ce n’est pas très satisfaisant.
M. René Dosière, rapporteur. Même si le résultat s’est amélioré !
M. François Logerot. Certes, mais il faut bien dire que cet indicateur ne rend compte que d’une partie de l’activité de la commission.
M. René Dosière, rapporteur. Saisissez-vous souvent le procureur de la République ?
M. François Logerot. Pas souvent, mais c’est arrivé. Le GRECO, groupe d’États contre la corruption, constitué au sein du Conseil de l’Europe, a fait le point lorsqu’il s’est intéressé à la France fin 2008 début 2009 : il y a eu, je crois, quatre saisines en quatre ans. Les dernières saisines ont donné lieu autant que je sache à un classement, mais nous ne sommes pas toujours informés des suites qui leur sont données.
M. Régis Lambert, secrétaire général. En revanche, nous sommes parfois sollicités par des juges d’instruction.
M. François Logerot. Les juges d’instruction peuvent en effet disposer d’éléments révélés par dénonciation, que la commission n’a absolument pas la possibilité de déceler dans les comptes faute de moyens d’investigation policière. Il y a eu un cas par exemple d’entente frauduleuse entre un candidat et un imprimeur : un quart seulement de la marchandise avait été livré, et ils s’étaient partagé la somme correspondant au remboursement de l’État sur les trois quarts restants. Mais si une facture, d’apparence convenable, détaillée et correspondant au prix du marché est fournie à la commission, celle-ci ne peut pas se rendre compte de la malversation...
M. Christian Vanneste, rapporteur. Entre 1991 et 2008, nous sommes passés de 28 à 296 partis politiques, ce qui accroît manifestement votre charge de travail et laisse en outre planer quelque doute sur la réalité de ces partis, et donc sur notre cadre législatif. Il ne faut pas beaucoup de mauvais esprit pour penser que certains de ces partis servent essentiellement de source de financement. On sait que des personnes étrangères au monde politique, plus intéressées par des questions boursières par exemple, ont créé des partis politiques.
Par ailleurs, si les dépenses de la commission ne sont clairement pas excessives, leur montant est très variable, en raison de l’irrégularité de son activité. Peut-être des économies peuvent-elles être réalisées, notamment en matière de locaux : ne serait-il possible par exemple de réduire les dépenses permanentes et de louer des bureaux supplémentaires pour les élections les plus importantes ?
Pourrait-on par ailleurs imaginer un regroupement avec des autorités voisines de la vôtre, comme la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle ?
Entre nous soit dit, on se demande ce qu’il adviendrait si vous rejetiez le compte du Président de la République élu…
M. René Dosière, rapporteur. Pas de remboursement, c’est tout !
M. Christian Vanneste, rapporteur. Enfin, ne serait-il pas souhaitable qu’un commissaire du Gouvernement siège au sein de la commission ?
M. François Logerot. Chaque année, la commission enregistre des créations et des disparitions de partis politiques. Dans le chiffre actuel – environ 260 –, et mis à part le cas particulier de l’outre-mer, il faut savoir que cinquante partis ne déposent pas leurs comptes et que nombre d’entre eux n’ont que quelques milliers d’euros sur leur compte de résultats – et parfois une année sur quatre ou cinq seulement : ce sont des comités de soutien d’un candidat, qui sont en sommeil lorsqu’il n’y a pas d’élections. Le plafond des dons de personnes physiques est plus élevé pour les partis – 7 500 euros par an – que pour les candidats – 4 600 euros par campagne. Il est donc intéressant de créer un petit parti.
En l’absence de définition juridique précise de ce qu’est un parti politique, la jurisprudence a dégagé des critères très libéraux : sont reconnus en tant que parti politique bien sûr ceux qui obtiennent l’aide publique, mais aussi simplement les partis qui ont désigné un mandataire, personne physique ou association, pour recueillir des fonds – ce qui leur crée en revanche l’obligation de produire des comptes l’année suivante, sans quoi ils disparaîtront.
Selon une décision récente du Conseil d’État, et contraire à la position de la commission, un parti qui ne remplit pas ses obligations comptables ne perd pas le droit de percevoir des dons de personnes physiques ouvrant droit à l’avantage fiscal. En l’occurrence, nous avions refusé de délivrer les « reçus-dons ». Sur recours du parti concerné, le Conseil d’État a annulé notre décision en estimant que quelle que soit sa logique, la loi ne prévoyait pas cette solution. J’appelle votre attention sur cette lacune. Un parti qui ne remplit pas ses obligations devrait perdre ses aides publiques directes s’il en avait, ce qui n’est souvent pas le cas, et au moins ses aides indirectes sous la forme de l’avantage fiscal.
Enfin, plus de la moitié de ces petits partis sont d’outre-mer. Les règles d’accès au financement public – je rappelle qu’il se monte à 1,67 euro par voix – sont en effet beaucoup plus libérales outre-mer, puisqu’il suffit que le candidat du parti ait obtenu 1 % des voix.
M. René Dosière, rapporteur. À une époque, il suffisait d’une voix !
M. François Logerot. Pour ce qui est de nos locaux, nous sommes sur le point de renégocier nos loyers, avec l’aide de France Domaine : étant situés avenue de Wagram, nous sommes dans la fourchette haute des loyers de bureaux. Nous disposons de 2 000 mètres carrés au total, dont 1 100 de bureaux, qui ne sont pas occupés en permanence. Nous devons loger non seulement les 33 permanents et les 9 membres de la commission, qui sont deux par bureau, mais aussi les rapporteurs qui viennent travailler pour les élections partielles (plusieurs dizaines de scrutins par an) et sur les comptes des partis politiques. Et quand il y a des élections générales nous devons aussi loger entre 30 et 60 personnes (contractuels en renfort temporaire et rapporteurs « parisiens », les provinciaux travaillant chez eux).
On pourrait certes se cantonner dans un plus petit espace et louer pendant les élections générales, pour six mois, des bureaux supplémentaires. Mais il est difficile de trouver des bureaux, sinon dans le même immeuble, du moins à proximité, sans compter que les locations de courte durée sont beaucoup plus chères. Nous n’avons pas fait de véritable bilan, mais l’opération semble pour le moins compliquée.
M. Régis Lambert. L’élection présidentielle de 2007 a fait apparaître un autre souci : la commission détenant les comptes des candidats, le Conseil constitutionnel lui a demandé de prévoir d’importantes mesures de sécurité, concernant notamment les locaux. Avec des bureaux séparés et la navette que cela implique, cette question gagnerait en acuité. C’est une des raisons pour lesquelles la commission a préféré s’étendre un peu plus sur place.
M. François Logerot. Des locaux se sont en effet libérés dans notre immeuble. Mais je suis conscient de ce problème de locaux, et tous les conseils et observations que vous pouvez formuler seront utiles.
Pour ce qui est du regroupement de la commission avec d’autres organismes, il se trouve que j’ai siégé ès-qualité à la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle, qui nous associe systématiquement à ses travaux. Ainsi, lors de la dernière élection, s’est posé en urgence le problème du papier écologique : la campagne était commencée, les candidats avaient commandé leur papier et nous ne savions pas dans quelles conditions nous devions ou non leur rembourser la dépense. Quoi qu’il en soit, cette commission ne siège que pendant les quelques mois de la campagne présidentielle ; elle remplit un rôle de surveillance juridique – au cas où la profession de foi d’un candidat comporterait des appels à l’émeute ou contre l’État républicain… – et a la haute main sur les commissions départementales de contrôle de l’élection présidentielle. Bref, son rôle est assez différent du nôtre.
M. René Dosière, rapporteur. On voit bien les différences, mais on pourrait imaginer une grande autorité de la vie politique avec des divisions administratives et financières par exemple. C’est plus ou moins le cas au Québec.
M. François Logerot. Au Québec cela va même beaucoup plus loin puisque l’organisation même de l’élection est confiée à cet organisme unique.
La Bosnie-Herzégovine, qui est en train de bâtir son système et dont nous venons de recevoir des représentants, a fait le choix d’une commission nationale qui fait le travail de notre ministère de l’intérieur, de notre juge de l’élection, de la commission des comptes de campagne et de la commission pour la transparence financière de la vie politique… C’est une conception nouvelle. Dans notre paysage ancien, il n’était pas question de déposséder le ministre et le juge de leurs attributions ! Et la commission pour la transparence financière dépasse largement le champ politique puisqu’elle examine les déclarations de patrimoine non seulement des élus, mais aussi d’un certain nombre de dirigeants d’entreprises publiques.
Des rapprochements sont certainement possibles. Le tout est de savoir s’ils se traduiraient par de réelles économies d’échelle. Je ne suis pas sûr du small is beautiful anglo-saxon, mais je ne garantis pas non plus que tout regrouper constituerait forcément un avantage.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous des difficultés à trouver des rapporteurs ? Comment les choisissez-vous ?
M. François Logerot. Ce sont pour une grande part des retraités : anciens fonctionnaires des finances, anciens conseillers de tribunaux administratifs ou de chambres régionales des comptes, anciens policiers, anciens magistrats… Ce n’est en effet pas de gens travaillant à temps partiel que nous avons besoin, mais de gens travaillant à plein temps sur une courte période, et souvent d’ailleurs en été. Il n’y a que des retraités pour cela ! Nous avons un vivier dans lequel nous puisons. Ils sont nommés en principe pour trois ans. Certains sont gentiment poussés dehors s’ils n’ont pas tout à fait donné satisfaction, et d’autres épuisent les charmes du métier…
M. René Dosière, rapporteur. Reçoivent-ils une formation particulière ?
M. François Logerot. À chaque campagne électorale générale, nous les réunissons pour faire le point et nous leur remettons des documents de travail qui essayent de tout prévoir – ce qui n’est bien sûr pas possible. Nous les conseillons et leur préparons le travail avec des paragraphes tout rédigés sur les questions à poser aux candidats par exemple, ce qui donne il est vrai aux questionnaires un aspect un peu brutal que je souhaiterais atténuer.
Nous avons aussi huit chargés de mission permanents, de jeunes contractuels bardés de diplômes – qui ne feront pas carrière à la commission mais passeront des concours administratifs ou seront recrutés dans les services juridiques des collectivités locales par exemple – répartis par secteur géographique et par parti ou groupe de partis. Ils assurent l’homogénéité du travail des rapporteurs et éventuellement suppléent aux lacunes de leur instruction. Il arrive qu’ils envoient un questionnaire supplémentaire, par exemple, lorsque le travail du rapporteur est incomplet… et qu’il leur en reste le temps.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de mal à trouver des rapporteurs en nombre et en qualité suffisants.
M. René Dosière, rapporteur. Y a t-il quelques retraités des collectivités territoriales ?
M. François Logerot. Quelques-uns. Leur nombre pourrait être renforcé.
Enfin, pour répondre à la dernière question de M. Vanneste, nous n’avons effectivement pas de commissaire du Gouvernement. Nous ne nous étions même jamais posé la question. Il faut dire que la commission comprend trois conseillers d’État, trois magistrats de la Cour de cassation et trois conseillers-maîtres – ou au-dessus – à la Cour des comptes. Que ferait donc le commissaire au Gouvernement : devrait-il nous rappeler la loi ?
Surtout, la commission n’est pas une juridiction, mais un organe administratif, même si nos décisions ont par la force des choses un aspect juridictionnel. Notre commissaire du Gouvernement, c’est, d’une certaine manière, le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel lorsqu’il nous censure.
M. René Dosière, rapporteur. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président, de nous avoir si bien éclairés. J’avais déjà régulièrement noté, au fil de vos rapports d’activité, les mesures de toilettage du code électoral que vous jugez nécessaires. Peut-être pourrions-nous en glisser certaines dans le texte relatif à l’élection des députés, dans lequel nous voudrions déjà insérer des mesures de transparence financière.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Y a-t-il des incompatibilités pour les membres de la commission ? Un élu pourrait-il être membre du collège ?
M. François Logerot. Un de nos conseillers d’État, qui malheureusement est décédé l’année dernière, était maire d’une petite commune et président d’une communauté d’agglomérations relativement importante. Il n’a évidemment pas participé à l’examen des comptes de la campagne de la commune centre, et s’est déporté pour les comptes de toute la région, alors qu’il n’était qu’élu municipal.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Mais ce ne sont que des règles de bonne pratique qui ne sont écrites nulle part…
M. René Dosière, rapporteur. On voit bien les inconvénients de cette situation, mais elle peut aussi apporter une vision enrichissante.
M. François Logerot. Bien sûr ! Le collègue dont je parlais nous a souvent permis de mieux connaître le sentiment des élus locaux sur le travail de la commission ou les difficultés qu’ils rencontrent, comme pour le recrutement d’un mandataire par exemple. Je ne suis pas du tout hostile à la présence d’élus au sein de la commission, à condition évidemment que cette qualité n’interfère pas avec leur travail.
La question est la même dans toutes les institutions collégiales. Un certain nombre de membres de la Cour des comptes exercent par exemple, durant une partie de leur carrière, des fonctions extérieures. Lorsqu’ils reviennent à la Cour, ils sont précieux par l’expérience qu’ils ont acquise, mais, en même temps, il ne faut pas accepter qu’ils prennent position sur des dossiers auxquels ils ont été mêlés directement ou indirectement.
M. René Dosière, rapporteur. On voit de plus en plus de déports sur les dossiers.
M. François Logerot. Les chefs de la Cour y sont très attentifs. Toute institution collégiale doit s’assurer en permanence de son impartialité. Et surtout il ne suffit pas d’être impartial : il faut être ressenti comme tel. Je ne doute pas un instant que le collègue dont je parlais, s’il avait eu à s’exprimer sur les comptes d’une commune voisine de la sienne, l’aurait fait en totale indépendance, mais cela n’aurait pas été ressenti de cette façon.
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition de M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, accompagné de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale et de M. Fabien Zivy, chef du service du Président.
jeudi 25 février 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Merci d’avoir accepté notre invitation, nous tenions à entendre l’Autorité de la concurrence. Après une présentation générale courte, je souhaiterais, pour ma part, que vous évoquiez trois sujets essentiellement.
Le premier sujet, c’est l’activité de l’Autorité de la concurrence, et notamment son évolution. Vous pourriez nous expliquer, à cette occasion, pourquoi les décisions de sanction sont en diminution, puisqu’elles sont passées de 26 à 13 entre 2004 et 2009, tandis que les avis sont, au contraire, en augmentation. Y a-t-il une évolution du rôle de l’autorité que vous présidez ? Je me demande également pourquoi le taux de recouvrement des amendes a baissé de façon très importante – de 88 % à 18 % –, je pense que c’est lié à la déconcentration du recouvrement mais vous aurez peut-être l’occasion de nous l’expliquer.
Le deuxième sujet a trait au problème des moyens en personnel et des moyens matériels. Je pense notamment à l’immobilier puisque trois immeubles vous sont dévolus, dont l’un fait partie des domaines et vous offre – mais mes calculs sont peut-être faux – une surface moyenne par personne assez élevée, de l’ordre de 27 m2 par agent. Cela me conduira d’ailleurs à vous interroger sur la possibilité de rechercher des « économies d’échelle », je pense à l’idée qui a été avancée par le vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé, d’un regroupement de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et de l’autorité que vous présidez.
Enfin, troisième et dernier sujet en ce qui me concerne, c’est le problème du benchmarking, pour parler anglais, au niveau européen. Vous êtes, à vous lire, l’autorité qui travaille le plus. Vous rendez un nombre de décisions cinq à dix fois plus élevé que la grande majorité de vos homologues européens. Vous fournissez à la Commission européenne des avis qui servent à l’étude des projets de réglementation et des cas individuels de pratiques anticoncurrentielles ou de concentrations au niveau européen et, à ce titre, vous participez au Réseau européen des autorités nationales de concurrence (le « REC »). Mais j’ai été un peu frappé par le caractère parfois contradictoire des données chiffrées. Si la France est le pays qui fournit le plus de dossiers à ce réseau européen (173, l’Allemagne n’en fournit que 112, l’Italie 59), en revanche le nombre de dossiers qui semblent être résolus – qui aboutissent à une décision en tout cas – est plus faible pour la France (59 sur 173). Pour l’Italie, c’est 43 sur 59. La performance ne paraît pas au rendez-vous.
Question subsidiaire, concernant votre décision sur le cartel de l’acier, qui a été réformée par la Cour d’appel : il n’y a pas eu de pourvoi en cassation de la part du Gouvernement. Nous aimerions avoir votre point de vue, savoir comment vous justifiez la hauteur de l’amende initiale, pourquoi vous n’avez pas été suivi par la Cour d’appel et quelles conséquences vous en tirez.
M. René Dosière, rapporteur. Je voudrais rebondir sur le dernier point que M. Vanneste a soulevé. De manière plus générale, puisque vous avez la possibilité de prononcer des sanctions, qui sont, d’une certaine manière, juridictionnelles, pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe concrètement ? Peut-on avoir une vue d’ensemble de la procédure, qui nous permette de comprendre comment, dans l’affaire du cartel de l’acier, le montant des sanctions a été diminué en appel ? Est-ce habituel ? La réformation des décisions peut d’ailleurs être elle-même un indicateur de performance pour une structure telle que la vôtre. Dans cette affaire, pourquoi, devant l’ampleur de la diminution des sanctions imposée par la cour d’appel, le ministère public a-t-il décidé de ne pas se pourvoir en cassation ? Pense-t-il que vous n’avez pas bien fait votre travail ?
M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence. Pour commencer, je voudrais rappeler que l’Autorité de la concurrence a trois activités principales, qui sont assez différentes.
La première est la surveillance et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, c’est-à-dire les ententes et les abus de position dominante.
La deuxième est de statuer sur les concentrations d’entreprises, pour éviter que les projets de fusion ou de rachat d’entreprises ne conduisent à diminuer à l’excès la concurrence sur les marchés, au détriment des consommateurs. C’est une attribution de nature administrative : nous délivrons des autorisations, ce pouvoir ayant été transféré du ministre vers l’Autorité de la concurrence l’année dernière.
La troisième fonction, qui prend effectivement de plus en plus d’importance, c’est le pouvoir d’avis et de recommandation, à la demande du Gouvernement, des assemblées parlementaires, des fédérations professionnelles ou, maintenant, à notre propre initiative : nous pouvons éclairer les pouvoirs publics, les associations de consommateurs, les entreprises, sur des questions permettant d’améliorer la concurrence sur les différents marchés.
Nous avons donc trois attributions différentes, qui ont été complétées et élargies par la réforme de l’année dernière, réforme dont il faut se souvenir que le maître d’œuvre a été le Parlement. A l’initiative des rapporteurs du projet de loi de modernisation de l’économie, M. Charié et Mme Lamure, et du président Larcher qui présidait alors la commission spéciale constituée par le Sénat sur ce texte, le parlement a souhaité se saisir lui même de la création de l’Autorité de la concurrence, de son design et de la façon dont elle contrôlerait les fusions, à la fois pour marquer l’importance qu’il attachait à cette réforme destinée à créer une autorité de concurrence unique, plus forte et plus efficace, et pour bien montrer qu’il voulait y être associé de près.
Vous me posez la question de la procédure : elle est assez différente selon les cas. Pour ce qui vous intéresse au premier chef, les pratiques anticoncurrentielles, nous avons un pouvoir de sanction : nous étudions les cas (en enquêtant sur le terrain et en analysant les preuves obtenues), puis nous les tranchons (en qualifiant juridiquement les comportements et en leur apportant la réponse qu’ils méritent, sous la forme d’un constat de non lieu ou d’infraction (entente ou abus de position dominante). En cas présence d’une infraction, notre décision est généralement assortie d’injonctions et d’une amende. L’exercice de ce pouvoir de sanction est naturellement assorti d’un certain nombre de droits garantis aux entreprises.
Comment cela se passe-t-il ? Premièrement, nous distinguons, de façon fonctionnelle, les fonctions d’instruction et de décision au sein de l’Autorité, depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001. C’est très important et très original en Europe puisque nous sommes un des rares pays d’Europe à offrir cette garantie d’impartialité dans la prise de décision. Mme Beaumeunier, ici présente, qui est rapporteure générale, dirige ces services d’instruction, qui ne rendent de comptes qu’à elle. Lorsque nous recevons une plainte ou que nous nous saisissons nous-mêmes, c’est elle qui nomme les rapporteurs, décide des enquêtes à effectuer, ordonne des visites et saisies et conduit le débat contradictoire écrit et oral avec les entreprises concernées. Lorsque le rapporteur estime, au vu de la phase préliminaire de réflexion et d’enquête, qu’une infraction a été commise, les services d’instruction ouvrent la procédure contradictoire. Ce débat se noue par l’envoi d’une notification des griefs, qui est l’acte formel d’accusation par lequel le rapporteur explique en quoi, selon les services d’instruction, l’entreprise a violé les règles de concurrence, soit en s’entendant avec ses concurrents, soit en abusant de sa position dominante. Les entreprises ont deux mois pour répondre. Il y a ensuite un second échange contradictoire écrit : le rapporteur doit synthétiser les arguments opposés par les entreprises à la notification de griefs et y répondre par un rapport qui est, lui aussi, transmis aux entreprises, qui ont une nouvelle fois l’opportunité de contester la position des services d’instruction. C’est quasiment unique en Europe : la plupart des autres autorités de concurrence ne font qu’un seul échange écrit avec les entreprises mises en cause.
C’est lorsque cette instruction contradictoire est achevée que le dossier est transmis au collège, en vue de la séance. Cela veut dire que le collège non seulement n’intervient à aucun titre pendant l’instruction, mais n’a même pas connaissance du dossier.
Le collège est composé de 17 membres – 5 permanents et 12 non permanents –, mais il statue très rarement en formation plénière. C’est une des sections constituées en son sein, et présidées soit par le président soit par un vice-président, qui se réunit pour statuer sur chaque affaire. Toutes les parties sont convoquées à la séance, pour un troisième échange contradictoire, oral cette fois. C’est là aussi une spécificité française en Europe. Très peu d’autres autorités donnent aux entreprises, de façon systématique, le droit d’être réunies en présence des « décideurs » eux-mêmes, et non seulement des services, pour débattre du cas. Comme cela se passe-t-il en pratique ? Le rapporteur présente son point de vue. Le rapporteur général ou son adjoint, qui assiste à la séance, donne ensuite un éclairage complémentaire. Puis les parties sont entendues, ainsi que le commissaire du Gouvernement.
Une fois que la séance de questions est achevée, les parties prennent la parole en dernier. Tout le monde quitte ensuite la salle et la décision est prise par les membres du collège, qui délibèrent en toute indépendance, en l’absence de ceux qui ont participé à l’instruction. La même procédure orale est suivie en cas de non lieu, ce qui est une troisième spécificité française, car cela veut dire que le plaignant a le même statut que les parties mises en cause et qu’il a le droit de contester la décision finale devant le juge. Au final, ce qu’il faut retenir, c’est qu’aucune autre autorité de concurrence d’Europe ne réunit cet ensemble complet de garanties : séparation des fonctions, double échange contradictoire écrit, contradictoire oral systématique, statut égalitaire du plaignant et des entreprises poursuivies. J’ajoute à cela que la LME a créé un conseiller auditeur, qui joue le rôle de médiateur entre les entreprises et les services d’instruction sur les questions de procédure, avant de remettre un rapport au collège qui, dans sa décision finale, statue collégialement sur la légalité de la procédure suivie et non seulement sur le fond.
Un même constat vaut pour les visites et saisies. Elles sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention, à la différence de ce qui se passe dans un certain nombre d’autres pays, et les entreprises visées peuvent en contester tant l’autorisation que le déroulement devant le juge du fait (la cour d’appel), puis le juge suprême (la Cour de cassation), sans attendre la prise d’une décision finale sur le fond par l’Autorité.
Les décisions sont souvent très longues car nous répondons de manière motivée aux arguments factuels et juridiques des entreprises. Celles-ci ont la possibilité de déposer un recours devant la Cour d’appel de Paris, qui est juge de plein contentieux à la fois sur la procédure, sur le fond et sur la sanction ; elles peuvent ensuite former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, qui, elle, ne va statuer qu’en droit.
Dans le dossier que vous évoquez, je tiens à dire que nous avons eu affaire au cartel le plus achevé, le plus sophistiqué, le plus grave qu’ait découvert le Conseil de la concurrence dans toute son histoire, c’est-à-dire en vingt-deux ans. Il ne s’agissait pas d’un cartel entre les sidérurgistes, c’est-à-dire entre des fabricants d’acier, mais d’un cartel entre les entreprises de négoce de l’acier, c’est-à-dire entre des entreprises, dont certaines étaient d’ailleurs des filiales de grands groupes (Arcelor-Mittal ou Klöckner), qui achètent en gros de l’acier et en font des produits transformés – poutrelles, produits longs, armatures de béton, etc. Ces produits sont ensuite achetés, non pas par les très grosses entreprises de la sidérurgie, mais par des petites et moyennes entreprises. Les victimes de ce cartel étaient donc d’abord les milliers de PME du secteur du BTP, de la chaudronnerie, de la serrurerie, de la métallurgie, etc., qui dépendaient des cartellistes pour leur approvisionnement et donc pour leur activité économique.
Entre les années 1999 et 2004, période sur laquelle nous avons statué, nous avons eu la preuve d’une mise en coupe réglée de ce secteur. Les visites et saisies nombreuses que nous avons faites et que les services du ministre de l’économie, dont il faut souligner qu’il était plaignant dans cette affaire, nous ont apporté des éléments extrêmement nombreux. La France était divisée en onze régions. À la tête de chaque région était placé un président et ce qu’on appelait un « parrain » – c’est le terme qui était employé à l’intérieur du cartel –, chargé de surveiller le fonctionnement du cartel. Dans chaque région, mais aussi au niveau national, était établie une commission par type de produit : les poutrelles, les produits longs, etc. Les onze entreprises membres du cartel, qui couvraient ensemble plus de 90 % du marché, se réunissaient au sein de ces commissions. Il y avait trois leaders : une filiale d’Arcelor, Klöckner Distribution Industrielle (KDI), qui est une filiale d’un conglomérat allemand, et une société lyonnaise qui s’appelle Descours et Cabaud. Les commissions fixaient les prix, sur la base de barèmes concertés. Les clients étaient par ailleurs répartis entre les entreprises, lesquelles ne pouvaient plus dès lors procéder à des démarchages. Les appels d’offre étaient truqués dans la mesure où, dès lors qu’ils émanaient d’un client réservé, les autres entreprises s’interdisaient d’y participer. À la fixation des prix et à la réservation des clients s’ajoutait un partage géographique des marchés.
Ceux qui déviaient du cartel, qui ne respectaient pas les prix du barème ou qui démarchaient un client réservé à un autre membre du cartel étaient exclus des affaires pendant trois mois avec interdiction de participer aux appels d’offre, sauf s’ils dénonçaient un autre déviant, auquel cas ils avaient le droit d’être réintégrés.
Tout cela était non seulement très strict mais connu des intéressés, puisque, à l’intérieur du cartel, des avertissements circulaient : ne jamais prononcer le mot d’entente, prévenir les parrains du cartel si un client a des soupçons... En tant que président du Conseil de la concurrence depuis 2004, je n’avais jamais vu en France un tel cartel, que l’on peut qualifier de « cas d’école » comme le fameux cartel mondial de la lysine, qui a été découvert grâce à des enregistrements du département de la justice américain qui ont, depuis, fait le tour du monde et aidé les gouvernements et les parlements du monde entier à comprendre que la violation du droit antitrust constitue une forme de criminalité économique particulièrement néfaste pour la société et l’économie. En l’occurrence, des milliers de PME en ont été victimes, car elles n’avaient pas la possibilité de s’adresser aux grandes entreprises sidérurgistes et étaient obligées de passer par des négociants. Elles ont dû supporter une hausse très importante du prix de l’acier en 2004, du fait de l’explosion de la demande chinoise, en plus des surprimes imposées par l’existence du cartel. Les études économiques qui ont été faites montrent qu’un cartel aussi organisé, aussi sophistiqué, peut conduire à des hausses de prix de l’ordre de 20 à 25 % au minimum.
M. René Dosière, rapporteur. Y a-t-il beaucoup de traces écrites ?
M. Bruno Lasserre. Je vous ferai parvenir la décision de l’Autorité de la concurrence, qui fait 140 pages. Les preuves qui y sont mentionnées sont tellement accablantes que les grandes entreprises n’ont pas jugé opportun de contester les faits. Une entreprise a même invoqué notre clémence et accepté de coopérer à l’instruction. La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui représente le ministre de l’Économie dans nos procédures, nous a demandé de faire preuve d’une sévérité exemplaire, je cite ses propres termes, face à des actes qui, selon le commissaire du Gouvernement, présentaient « un caractère de gravité exceptionnelle ». Certaines évaluations du ministère aboutissaient à des sanctions supérieures à celles que nous avons retenues en définitive, de l’ordre de 680 millions d’euros. Devant le collège, le commissaire du Gouvernement a d’ailleurs demandé pour les trois seules entreprises leaders, la filiale d’Arcelor, KDI et Descours et Cabaud, un montant de sanctions qui ne soit pas inférieur à 410 millions d’euros. Le Conseil a fixé le montant des sanctions à 575 millions d’amende pour l’ensemble des onze entreprises concernées. Ce montant tenait compte des réductions accordées aux entreprises qui n’avaient pas contesté les griefs, qui avaient reconnu les faits et avaient pris l’engagement de changer leurs pratiques à l’avenir. Nous avons également tenu compte du fait que ces entreprises souffraient de la crise économique récente.
Nous avons agi sur le fondement du droit français mais aussi du droit communautaire, car évidemment cette affaire affectait le commerce entre les États membres de l’UE. Nous avons calculé que, si la Commission européenne avait sanctionné elle-même ce cartel, comme elle en avait le droit, elle aurait imposé, en vertu de ses lignes directrices, un montant d’amende pouvant aller jusqu’à 1,6 milliard d’euros.
L’affaire est venue devant la Cour d’appel de Paris. Nous avons défendu notre décision mais nous avons senti, dès le départ, que le commissaire du Gouvernement ne nous soutenait plus et le parquet non plus, ce qui nous a beaucoup étonnés parce que, d’habitude, le parquet défend nos positions. On nous a dit que nos sanctions étaient trop lourdes. En clair, on nous a accusés, dans des termes assez vifs au cours de la séance, de provoquer des licenciements chez Arcelor. Il faut cependant préciser que ces sanctions n’avaient été payées qu’en petite partie car nous avions invité les entreprises à s’adresser au Trésor public pour qu’il accorde des échéanciers de paiement, ce qu’elles avaient fait.
Dans son jugement, la Cour d’appel a divisé par huit les sanctions qui avaient été prononcées par le Conseil de la concurrence : de 575 à 73 millions d’euros. Plus important, pour les très grosses entreprises, l’amende a été divisée par dix, notamment pour Arcelor. Pour Descours et Cabaud, la réduction fut supérieure, puisqu’on est passé de 89 à 3 millions, atteignant le niveau des amendes qui sont couramment données pour de petits marchés publics. Paradoxalement, les petites entreprises concernées par l’affaire ont eu, elles, des réductions beaucoup plus faibles, certaines de 5 % seulement.
Nous avons été étonnés par ce jugement. Ce qui nous a troublés, c’est tout d’abord que le juge a estimé que cette affaire était « moyennement grave », pour reprendre le terme employé, « en raison de la crise économique ».
M. René Dosière, rapporteur. Sur quelles pièces le tribunal s’appuie-t-il pour statuer ? Procède-t-il à une contre-enquête ?
M. Bruno Lasserre. Non, il n’a comme éléments que la décision de l’Autorité et les recours des entreprises. Or, la Cour d’appel n’a pas remis en cause la substance des faits. Elle a confirmé notre enquête, la qualification des faits et leur durée. Le fond de notre décision n’a pas été réformé. La réformation n’a porté que sur le niveau des sanctions, mais d’une manière très importante. On peut admettre que la crise économique actuelle affecte la capacité de paiement des entreprises, mais il est plus difficile de comprendre en quoi elle atténue la gravité des actes commis, les excuses en quelque sorte. Nous n’avions jamais vu cela dans la jurisprudence française et européenne, qui est plutôt sur la ligne inverse. D’autre part, la Cour d’appel considère que le préjudice économique est moins important que ce qui était estimé par le Conseil de la concurrence, mais elle ne motive pas beaucoup cette décision. Enfin, la Cour énonce une série de circonstances atténuantes qui auraient dû être prises en compte mais qui sont là aussi nouvelles dans la jurisprudence, comme le fait que les cartellistes étaient des sociétés de droit privé, qui constitue, dit-elle, une circonstance dont le Conseil de la concurrence « aurait dû se féliciter » parce que s’ils avaient été des sociétés de droit public, cela aurait été plus grave de son point de vue. C’est étonnant, parce que la propriété du capital n’intervient pas, juridiquement, dans l’appréciation de la gravité du comportement, ce qui se comprend bien : que ce soient des sociétés privées ou des sociétés publiques, il y a eu, de la même manière, entente au détriment des PME.
J’ai demandé au Gouvernement de porter l’affaire en cassation. Je n’avais pas la capacité de décider cela moi-même, la décision initiale ayant été prise par le Conseil de la concurrence dont le président n’avait pas le pouvoir de se pourvoir en cassation, à la différence de l’Autorité de la concurrence aujourd’hui. La ministre de l’Économie a décidé de ne pas donner suite à cette demande et les sanctions sont donc devenues définitives, au niveau auquel les a fixées la Cour d’appel de Paris.
M. Christian Vanneste, rapporteur. La Cour d’appel de Paris est-elle spécialisée dans ce type d’affaires ?
M. Bruno Lasserre. Il y a, au sein de la Cour d’appel, une chambre qui suit les affaires qui nous concernent, ainsi que celles de l’AMF et des régulateurs sectoriels tels que la Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de régulation des communications et des postes. Mais il y a peut-être – les avocats le disent – un manque de moyens et de formation. C’est dommage que la réforme opérée par la LME ait porté sur la modernisation de l’autorité administrative de régulation de la concurrence, sans se poser aussi dans le même temps la question de la modernisation du stade suivant de la « chaîne de contrôle », à savoir la phase contentieuse. Au niveau européen, toute une réflexion a été menée pour doter l’Union européenne d’un juge spécialisé dans le contentieux économique complexe qu’est la concurrence.
M. René Dosière, rapporteur. Si je vous comprends bien, l’Autorité de la concurrence a mené l’enquête sur des faits qui concernaient auparavant le Conseil de la concurrence ?
M. Bruno Lasserre. Pas tout à fait : la décision a été prise en décembre 2008, c’est donc l’une des dernières du Conseil de la concurrence.
M. René Dosière, rapporteur. Vous disiez également que lorsque vous prenez des sanctions financières, le paiement peut être différé ?
M. Bruno Lasserre. Nos décisions sont exécutoires, indépendamment d’un éventuel recours qui n’est pas suspensif. Le président de l’Autorité de la concurrence émet, en tant qu’ordonnateur principal, le titre qui exige le paiement de la sanction. Je le fais dans les jours qui suivent la décision, afin que les amendes puissent être immédiatement encaissées par le budget de l’État. Néanmoins, les entreprises peuvent obtenir un sursis de la part du premier président de la Cour d’appel de Paris, notamment en cas de difficultés graves affectant l’entreprise. Les services comptables de l’État peuvent aussi, de leur côté, accorder des délais de paiement en cas de difficulté.
Depuis une réforme récente, ce recouvrement comptable a été délégué aux trésoriers payeurs généraux. Alors qu’auparavant le recouvrement des titres émis par l’Autorité de la concurrence était centralisé auprès d’une trésorerie basée à Châtellerault, les titres sont désormais répartis entre les trésoreries générales en fonction de la localisation du siège social de l’entreprise concernée et l’exigibilité des créances est soumise au même régime que les créances ordinaires de l’État, sans priorité. Cette déconcentration a conduit à une chute extrêmement sensible du taux de recouvrement, de 90 % en moyenne à 18 %. Cette chute, entamée bien avant la crise, s’est accentuée avec celle-ci. Ainsi, dans l’affaire du cartel de l’acier, des sursis et des délais de paiement ont été accordés par le comptable. C’est légitime de se poser la question et d’accorder des délais à chaque fois que des difficultés réelles sont constatées, mais il faut vérifier au préalable le bien-fondé des demandes, sinon on bascule dans la permissivité, alors que le principe du paiement immédiat des sanctions fait partie de leur caractère dissuasif.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Savez-vous s’il y a des différences régionales en matière de recouvrement ?
M. Bruno Lasserre. Il faudrait interroger le ministère des finances sur ce point.
M. René Dosière, rapporteur. Quand et comment a été prise cette décision de déléguer le recouvrement des titres aux trésoriers payeurs généraux ?
M. Bruno Lasserre. Elle a été prise il y a trois ans. Je précise que nous n’avons pas été consultés au préalable.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le nombre des décisions de sanctions a baissé de 26 à 13 et le nombre d’entreprises sanctionnées de 137 à 56.
M. Bruno Lasserre. Oui, car nous avons fait un gros effort de ciblage, comme nous l’ont d’ailleurs demandé tant le Parlement, lors de mes auditions parlementaires avant d’être nommé à la présidence de l’Autorité, que le gouvernement, dans l’exposé des motifs de l’ordonnance de modernisation de la régulation de la concurrence. En substance, on nous a demandé de faire porter notre action encore davantage sur les affaires importantes et structurantes pour l’économie et les consommateurs. Cela veut dire peut-être moins de décisions, mais des sanctions d’un montant plus élevé. C’est ce que l’on a fait. Avant 2004, le montant total des sanctions était en moyenne de 60 à 65 millions d’euros par an. En 2005, ce montant était de 754 millions d’euros, du fait d’une affaire exceptionnellement importante (le cartel des mobiles), de 128 millions en 2006, 221 millions en 2007, 631 millions en 2008 (avant la réformation de la décision relative au cartel de l’acier) et 206 millions en 2009. Cette augmentation, qui reflète une évolution intervenue partout ailleurs à l’étranger (au niveau européen, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Asie) résulte de la prise de conscience par les pouvoirs publics de la gravité des ententes, qui s’est traduite par des réformes législatives (comme la loi NRE en France) et par un engagement des autorités de concurrence à prendre des décisions véritablement dissuasives. Notre pratique l’illustre, notamment dans les affaires du secteur du bâtiment et des travaux publics, où pendant longtemps les sanctions n’étaient pas suffisamment élevées. Les sanctions antitrust doivent être dissuasives car elles ne sont pas un simple « coût administratif » (comme le paiement d’un service, d’un contrôle, d’un permis de construire, etc.), mais bien la conséquence d’un « crime en col blanc ».
M. Christian Vanneste, rapporteur. Souhaitez-vous avoir le choix de l’opportunité des poursuites ?
M. Bruno Lasserre. La tradition était autrefois que le ministre nous saisisse de toutes les petites affaires qu’il décelait, notamment relatives au bâtiment et aux travaux publics. Aujourd’hui, le ministre est beaucoup plus sélectif, ce qui se ressent sur le nombre de décisions. Nous nous concentrons donc davantage sur des affaires importantes. Celle des trois opérateurs de téléphonie mobile s’est conclue par une amende de 534 millions d’euros. Nous avons aussi traité les affaires des lycées d’Île-de-France, de la répartition des marchés de travaux en Île-de-France ou du Crédit immobilier, qui ont été lourdes, importantes, difficiles, mais que nous avons menées jusqu’au bout.
M. René Dosière, rapporteur. J’ai noté que maintenant vous avez la possibilité de vous pourvoir en cassation, si une affaire comme celle du cartel de l’acier se reproduisait…
M. Bruno Lasserre. Je ne vous cache pas que si nous avions eu ce pouvoir, nous l’aurions exercé.
M. René Dosière, rapporteur. Vous disposez d’un effectif important, qui a beaucoup augmenté. Pensez-vous qu’on pourrait aller vers un rapprochement supplémentaire de vos services et de ceux de la direction de la concurrence ?
M. Bruno Lasserre. J’observe que la loi de modernisation de l’économie a transféré à l’Autorité l’essentiel des compétences de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en matière de concurrence, notamment le pouvoir de statuer sur les concentrations, qui était dans les mains du ministre auparavant, ainsi que les pouvoirs d’enquête au niveau national. La DGCCRF se recentre donc sur sa fonction essentielle de direction centrale, qui aide le ministre de l’économie à préparer ses décisions, à prendre en compte le point de vue de la concurrence dans les arbitrages gouvernementaux, etc. Elle redevient une direction régalienne sur les sujets de protection de la consommation, de qualité des produits, de surveillance du marché intérieur... Il est normal que le ministre dispose d’une direction forte qui l’aide à prendre des décisions dans ces domaines qui relèvent de son pouvoir. Mais en ce qui concerne les cas individuels de concurrence, les compétences ont bien été transférées à l’Autorité de la concurrence et il me semble que, de ce point de vue, nous avons trouvé un équilibre satisfaisant.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Que pensez-vous d’une autre hypothèse de fusion, avec la Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de régulation des communications téléphoniques et des postes ?
M. Bruno Lasserre. Je n’y suis pas du tout favorable car je pense que ces autorités exercent des métiers différents de celui de l’Autorité de la concurrence.
La régulation économique sectorielle portant sur l’électricité, le gaz, les télécoms ou la poste suppose de prendre en compte beaucoup d’intérêts qui ne sont pas uniquement ceux de la concurrence : l’aménagement du territoire, la défense du service universel, l’utilisation efficace du spectre des fréquences, l’attribution de ressources rares, la formation des prix, etc. Ce métier est différent de celui de l’Autorité de la concurrence qui a pour objectif la protection des consommateurs et des entreprises en garantissant le fonctionnement concurrentiel des marchés. Nous ne pouvons pas être les juges du niveau des prix, les gardiens de l’aménagement du territoire. De mon point de vue, ce serait un mélange des genres : nous sommes une autorité indépendante à laquelle les autorités politiques ont confié une mission de pure régulation économique, fondée sur la détention d’une expertise technique, économique et juridique.
Ce qui me paraît essentiel, c’est plutôt d’organiser la dévolution progressive des pouvoirs. Au fur et à mesure que la concurrence se développe dans ces secteurs, ce qui est un fait par exemple dans la téléphonie mobile, l’accès à internet… la régulation ex-ante laisse de plus en plus de place à la régulation ex-post, en se concentrant pour sa part sur les autres aspects que j’ai cités (le service universel par exemple), parce qu’il n’y a plus besoin de construire la concurrence et que le droit commun de la concurrence suffit. On démantèle en quelque sorte les instruments de régulation les plus interventionnistes au fur et à mesure que le marché prend sa place dans ces secteurs.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous des difficultés sur le plan budgétaire ? Le fait que vous ayez des ressources exclusivement budgétaires est-il une source de problème ?
M. Bruno Lasserre. Nous sommes à la hauteur des petites économies européennes, et donc bien moins dotés que nos homologues étrangers comparables, qu’ils soient britannique, allemand ou italien, aussi bien en effectifs qu’en budget. Nous sommes pourtant les plus actifs en Europe. L’indicateur d’activité pertinent est effectivement le nombre d’enquêtes engagées sur le fondement du droit communautaire, c’est-à-dire 173 au 30 novembre 2009. Si le nombre de décisions déjà rendues est moindre, cela s’explique par une double raison. D’abord, il y a une déperdition naturelle car un certain nombre d’enquêtes ouvertes peuvent conduire à la conclusion, au terme d’une phase préliminaire d’analyse, qu’il n’y a pas de problème de concurrence sérieux, ce qui nous amène à clore le dossier avant toute ouverture d’une procédure formelle. La fusion des pouvoirs d’enquête de l’Autorité et de la DGCCRF devrait permettre de réduire ces cas grâce à l’unification de la stratégie d’enquête. Ensuite, l’instruction des affaires prend du temps, non seulement parce qu’elles sont souvent complexes et comportent des dossiers volumineux, mais aussi parce que la loi nous demande de prendre du temps, pour pouvoir tenir le débat contradictoire très fouillé dont je parlais tout à l’heure.
M. René Dosière, rapporteur. Obtenez-vous les moyens budgétaires que vous demandez pour votre activité ou êtes-vous soumis à un arbitrage ?
M. Bruno Lasserre. Notre budget est inscrit au programme 134. Le responsable de ce programme est le secrétaire général du ministère de l’Économie, qui rend donc les arbitrages sur nos demandes. Puis le Parlement vote nos crédits. Nous n’avons pas la personnalité morale et pas de ressources propres (même si les unes peuvent aller sans l’autre, comme le montre l’exemple d’autres autorités comme, je crois, la future Autorité de régulation des activités ferroviaires). Nous dépendons intégralement du budget de l’État. Nous aimerions disposer d’un volant de ressources propres qui permette d’asseoir davantage l’indépendance de l’Autorité et conforte la stabilité de ses crédits. Nous avons réfléchi à l’introduction en France d’un mécanisme qui existe dans quasiment tous les pays européens et étrangers : la possibilité de faire payer l’examen des opérations de concentration, dans une mesure modeste mais utile pour nous, paraît légitime. Dans tous les autres pays, y compris aux États-Unis, les entreprises supportent de tels droits en contrepartie de l’examen des fusions-acquisitions qu’elles soumettent au contrôle, qui sont calculés en fonction de l’importance de l’opération. Pourquoi l’examen de ces opérations est-il gratuit en France ? Cela pourrait rapporter 2 à 2,5 millions d’euros, soit un dixième de notre budget.
M. René Dosière, rapporteur. Pensez-vous que si les mandats du président ou du vice-président n’étaient pas renouvelables, l’indépendance de l’Autorité en serait renforcée ?
M. Bruno Lasserre. Je ne pense pas que la perspective d’être renouvelé puisse peser sur l’indépendance des membres du collège. Un mandat limité à cinq ans et renouvelable et peut-être aussi plus sain qu’un mandat plus long mais non renouvelable, car cela permet davantage de respiration. Le renouvellement peut par ailleurs être utile car nos fonctions sont très techniques. Il faut maîtriser le droit et l’économie, dans une relation où la disproportion des forces est considérable : nous sommes une très petite structure face à des entreprises puissamment dotées, qui peuvent opposer à notre collège et à notre rapporteur dix, quinze, vingt avocats et des budgets considérables. Ces fonctions supposent donc un apprentissage. J’avais déjà été membre du Conseil de la concurrence pendant six ans avant de devenir président. De même, nous avons toujours privilégié pour les nominations aux fonctions de vice-présidents d’anciens membres du collège, afin que ceux-ci soient armés au moment où ils prennent leurs fonctions. Si on interdit le renouvellement, on ne permettra plus du tout cette « politique de filière » qui a montré son intérêt.
M. Lionel Tardy. L’Autorité est implantée en trois lieux différents, un rassemblement des structures est-il envisagé ?
Deuxième question, 69 % de votre budget, lequel est de l’ordre de 20 millions d’euros, correspondent à des dépenses de personnel. Comment travaillez-vous ? Sur les 187 équivalents temps plein, tout le monde reste-t-il au bureau ? A contrario, je suis étonné que vous ayez peu de dépenses de fonctionnement. Pour le budget transport, c’est 174 000 euros soit 1 % du budget, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que vous vous déplaciez beaucoup dans les entreprises pour rechercher des pièces…
M. Bruno Lasserre. La nouvelle Autorité n’a été créée qu’il y a moins d’un an. Les enquêtes sur place, qui conduisent les rapporteurs à aller dans les entreprises, sont récentes. Nous manquons de recul pour mesurer leur impact sur notre budget. Si nos crédits de fonctionnement s’avèrent insuffisants, il faudra effectivement soulever le problème.
En ce qui concerne l’immobilier, il est exact que nous sommes répartis sur trois sites. Historiquement, le siège du Conseil de la concurrence est situé rue de l’Échelle, à Paris, dans un immeuble classique de six étages datant du début du XXe siècle. Le service des domaines nous a attribué, de l’autre côté de l’avenue de l’Opéra, un petit immeuble où sont installés une partie des services d’instruction. Avec la réforme, qui a conduit à nous affecter soixante personnes supplémentaires, nous avons demandé et obtenu la possibilité de louer, place de Valois, de l’autre côté du Palais Royal, un immeuble qui était auparavant loué par un autre service de l’État, dépendant du ministère de la culture. Cela a été conclu en plein accord avec France Domaine, à la fois sur le principe et sur le montant du loyer. Nos dépenses de loyer sont raisonnables : pour le site dans son intégralité, nous avons un loyer qui, toutes charges comprises, est légèrement inférieur à 2 millions d’euros, ce qui est faible.
En ce qui concerne les surfaces, il est vrai qu´en moyenne nous avons une norme peut-être plus élevée que les administrations ordinaires. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, étant dispersés entre trois immeubles, nous perdons de la surface utile par rapport à un site unique. Deuxièmement, nous avons une salle d’audience où nous devons accueillir parfois plus d’une centaine d’avocats ou d’entreprises. Enfin, les rapporteurs traitent des affaires lourdes et confidentielles et donc travaillent dans des bureaux individuels dans lesquels ils auditionnent les entreprises, comme des cabinets d’instruction. Il faut prendre en compte les contraintes de notre métier.
M. René Dosière, rapporteur. Le ministre de l’Économie a décidé de créer une mission sur le niveau des sanctions, suite à l’affaire du cartel de l’acier. Est-ce que cette mission n’empiète pas sur vos compétences ?
M. Bruno Lasserre. Pour revenir sur cette affaire et sans vouloir commenter une décision de justice, j’aurais aimé que la Cour de cassation tranche, en droit. Le Gouvernement a estimé qu’il n’y avait pas de chances de gagner un tel pourvoi. On ne saura jamais qui avait raison, je le regrette d’autant plus qu’il s’agit de sommes importantes pour le budget de l’État : la différence entre les 575 millions d’euros de la décision initiale et les 73 millions d’euros de la décision réformée n’est pas négligeable !
On nous a proposé, un peu en contrepartie, de faire en sorte que les sanctions décidées par la Cour d’appel soient plus prévisibles. À cette fin, la ministre de l’Économie a confié une mission de réflexion à trois personnes : M. Jean-Martin Folz, ancien président de PSA et de l’AFEP, M. Christian Raysseguier, Premier avocat général à la Cour de cassation et M. Alexander Schaub, avocat.
M. René Dosière, rapporteur. En toute hypothèse, et sauf modification des textes, vous ne serez pas lié par les recommandations que cette mission pourra faire ?
M. Bruno Lasserre. Nous ne savons pas vers quelles conclusions cette mission se dirigera. Si elle considère qu’il faut changer la loi, le législateur aura le dernier mot. Elle pourrait aussi recommander, par exemple, que le Gouvernement adopte des directives. Mais nous sommes une autorité indépendante, dont le propre est de devoir statuer en toute liberté, sans pression des autorités politiques ou des entreprises. Le plus naturel serait que l’Autorité établisse ses propres lignes directrices pour la détermination du niveau des sanctions et les publie pour assurer au maximum la transparence et la cohérence, comme l’ont d’ores et déjà fait bon nombre de ses homologues en Europe. Mais cela suppose le soutien de la Cour d’appel, à défaut de quoi cette solution ne sera pas effective.
Pour évoquer non plus le format et la méthode, mais le fond, j’ajoute que tout cela n’a de sens que si l’objectif consiste à faire comprendre aux contrevenants qu’ils risquent gros s’ils se livrent à des pratiques violant la loi. Pendant longtemps, les entreprises ne se sont pas préoccupées du Conseil de la concurrence, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, car le niveau des sanctions n’était pas dissuasif. A tel point que le Parlement s’est saisi de la question en 2001 pour élever le plafond des amendes et nous demander explicitement de prendre en compte la réitération, autrement dit le fait que bon nombre de cartellistes sont des multirécidivistes, comme le montrent les études économiques. Le niveau des sanctions a donc été considérablement augmenté et, désormais, ces entreprises font plus attention à ne pas violer la loi. Par ailleurs, il ne faut oublier que l’Autorité de la concurrence n’est pas isolée, mais membre du réseau européen de la concurrence (le REC) créé par le législateur européen, le Conseil de l’UE. La Cour européenne de justice exige des autorités de concurrence et de la Commission européenne qu’elles mènent une politique de sanction cohérente, effective et dissuasive. Si l’on affaiblit la dissuasion en France, Bruxelles reprendra ces affaires en main et les entreprises françaises ne seront pas forcément gagnantes.
M. Christian Vanneste, rapporteur. La possibilité qui vous a été maintenant donnée de vous pourvoir en cassation apporte d’ores et déjà des éléments de solution. Ce sera à l’avenir à la justice de trancher, à son plus haut niveau.
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, cette audition a été très instructive, à tous points de vue. Je vous en remercie.
Audition de M. Bertrand Schneiter, président de la Commission des participations et des transferts, accompagné de M. Dominique Augustin, secrétaire général
jeudi 25 février 2010
M. René Dosière, rapporteur. Merci, M. Schneiter, d’être venu jusqu’à nous.
La Commission des participations et des transferts est qualifiée par le Conseil d’État et le Secrétariat général du Gouvernement d’autorité administrative indépendante. C’est une appellation qui n’est pas encore protégée... Or, quand on lit les réponses que vous avez apportées au questionnaire, on peut s’interroger : vos moyens sont mis à votre disposition par l’administration, votre autonomie est limitée, qu’est-ce qui justifie que l’on vous qualifie d’autorité administrative indépendante ?
M. Bertrand Schneiter. C’est une très bonne question à laquelle il n’a été répondu, à ma connaissance, que par une étude du Conseil d’État datant de 2001 : la Commission des participations et des transferts, que j’ai l’honneur de présider depuis septembre 2008, a alors découvert qu’elle était une autorité administrative indépendante. Cela n’a pas surpris ses membres qui exerçaient déjà leurs fonctions avec un sentiment d’indépendance très grand mais cela leur a donné un degré de reconnaissance auquel les textes constitutifs de la commission – qui sont un peu économes puisqu’ils se bornent à définir les cas dans lesquels elle doit se prononcer et la portée de ce qu’elle doit faire – ne conduisaient pas nécessairement par eux-mêmes.
Cette commission mobilise effectivement des effectifs et des moyens limités. Les personnalités qui la composent présentent toutes les garanties d’indépendance et de compétence nécessaires. Ses membres sont d’ailleurs soumis à de strictes incompatibilités, de surcroît interprétées de façon extensive. Les moyens sont modestes puisque nous avons des locaux, trois secrétaires, un petit budget de représentation et de déplacements et un cadre de qualité exceptionnelle qui présente un degré d’indépendance accru dans la mesure où il nous vient de la Banque de France. La question revient parfois de savoir si nous devrions avoir davantage de moyens propres pour réaliser des études ou faire procéder à des expertises supplémentaires à son initiative. Mais nous travaillons dans l’urgence et, en outre, la commission a toujours considéré que le travail que nous faisions était fondé sur l’étude des dossiers par tous les membres, qui sont tenus de s’impliquer personnellement.
Les raisons pour lesquelles nous sommes une autorité administrative indépendante tiennent aux critères que le Conseil d’État avait retenus : nos décisions s’imposent et leurs conséquences sont incontournables pour les décisionnaires, qu’il s’agisse, notamment, de la fixation du prix au dessous duquel l’affaire ne peut pas être cédée ou des avis conformes en ce qui concerne le choix du partenaire ou de l’acquéreur dans les dossiers de gré à gré.
Je pense pouvoir dire que la commission a toujours veillé à ne pas créer de délais excessifs dans le déroulement du processus des transferts de propriété, au prix le cas échéant de la tenue de réunions intensives et convoquées à très bref délai.
M. Christian Vanneste, rapporteur. L’autorité que vous présidez a pour ancêtre une commission qui avait été créée, en 1986, par Edouard Balladur, lors de la grande vague des privatisations. Le problème c’est que, soit pour des raisons politiques d’alternance, soit pour des raisons économiques, le rythme des privatisations est loin d’être constant. D’une certaine manière, le rôle de votre autorité est intermittent. Par là même, est-il vraiment nécessaire d’avoir une autorité permanente ? Ne serait-il pas possible d’imaginer une structure qui ne se réunirait qu’en cas de besoin ? Je vous pose la question de façon très directe : qu’avez-vous eu à faire au cours des deux dernières années ?
M. René Dosière, rapporteur. Si vous le permettez, j’ai une autre question : comment procédez-vous, concrètement, lorsqu’il vous est demandé de fixer un prix ?
M. Bertrand Schneiter. Premièrement, les pouvoirs publics sont-ils fondés à avoir une institution permanente, si modeste soit-elle, pour gérer des affaires qui sont comme vous le dites intermittentes ?
Parlons de la durée et de la période récente : sur la durée, le chiffre d’affaires des privatisations est régulier, très élevé, que le Gouvernement soit d’un bord politique ou de l’autre.
Il est vrai que, depuis la fin de l’année 2008 et sur les huit premiers mois de 2009, nous avons été moins sollicités. Au printemps 2009, le Gouvernement a souhaité, hors de nos compétences, que nous donnions un avis sur la question de l’évaluation des fréquences de la quatrième licence de téléphonie mobile : nous avons accepté d’appliquer nos méthodes à un sujet qui n’était pas dans notre champ de compétences. Et nous avons veillé très précisément à la rédaction de notre saisine pour qu’il ne nous soit pas demandé autre chose que ce que nous savions faire.
Aujourd’hui, nous revenons à un plan de charge qui est plus naturel, même si je ne peux pas dire que nous avons devant nous un champ d’activités qui soit à la mesure de ce qu’il a été à certaines périodes dans le passé. Le rythme de la commission, c’est en principe de se réunir les mardi et jeudi. Depuis le début de l’année, nous avons eu quinze réunions. La machine tourne.
Je réponds à la deuxième question : faut-il conserver une structure permanente ou imaginer une formule au cas par cas, en fonction des besoins ? Ce n’est pas à nous de le dire, encore que je vois mal comment en pratique se concilierait l’urgence des dossiers et le délai inévitable pour réunir une commission ad hoc, présentant à chaque fois toutes garanties d’indépendance. Sur le fond la permanence de notre commission et l’expérience ainsi accumulée constituent des atouts indéniables pour la qualité de nos avis, qui portent sur des affaires souvent complexes, et relevant parfois de séquences d’opérations portant sur plusieurs années.
La commission ne se borne d’ailleurs pas à faire de l’évaluation, elle fait aussi du droit dans un cadre très contraint qui s’impose à elle. Dans les opérations de gré à gré, elle est ainsi amenée à donner un avis conforme qui conclut à la fois sur la valeur de l’entreprise et sur le choix du repreneur, qui ne doit pas être entaché d’une erreur d’appréciation. La commission a toujours dit : « nous ne choisissons pas », mais le juge peut rechercher dans ses avis la preuve que les questions ont été pesées, ce qui est d’autant plus utile que les décisions du Gouvernement ne sont pas motivées.
Tout cela me permet de dire que, sans exagérer la technicité ou la spécificité des dossiers, la commission a construit un corpus à travers le temps, dégageant des principes qui sont ainsi connus des acteurs concernés, qu’il s’agisse de l’État, des entreprises ou des experts et conseils.
Ainsi, je crois que la balance aujourd’hui penche très clairement en faveur du système existant, qui est fait d’expérience et de continuité.
M. René Dosière, rapporteur. Quand vous devez arrêter un prix, comment procédez-vous ? Vous vérifiez les travaux de banques spécialisées ou est-ce vous qui fixez la valeur des actifs transférés ?
M. Bertrand Schneiter. C’est clairement de la seule responsabilité de la commission de fixer une telle valeur. Nous disposons de rapports d’évaluation (des conseils de l’État et des entreprises concernées) qui constituent la base de travail à partir de laquelle nous cherchons notamment les insuffisances des analyses et raisonnements présentés, mais nous n’avons qu’exceptionnellement jugé nécessaire d’exiger une expertise supplémentaire. J’ai un très grand respect pour les travaux d’expertise ; les divergences sont rares dans ces domaines. Ce qu’il faut regarder de près, ce sont les méthodes d’évaluation, notamment le respect de l’exigence d’une approche multicritères posée par la Loi. Je dirais que les documents que nous exigeons, les auditions auxquelles nous procédons, permettent d’atteindre un degré de sécurité suffisant.
M. Lionel Tardy. Vous compulsez les données et vous émettez un avis…
M. Bertrand Schneiter. Nous ne pouvons pas faire des audits dans les délais qui nous sont imposés, mais l’examen critique des documents dont nous disposons donne lieu, je vous l’assure, à des débats souvent animés, et à des demandes d’informations complémentaires. .
M. René Dosière, rapporteur. Vous examinez des évaluations et votre rôle consiste à trancher, en quelque sorte, entre ces évaluations, et à prendre une décision.
M. Bertrand Schneiter. Vous soulignez une des difficultés du sujet : en théorie, nous pourrions attendre en toute tranquillité que tout soit bouclé et nous n’aurions plus alors qu’à dire oui ou non aux projets et aux valeurs retenues. Il a pu arriver que la commission rende des avis négatifs. Très honnêtement, la Commission considère que son rôle consiste plutôt à anticiper les difficultés et donc à bénéficier en temps opportun des éléments d’information pour cela, ce qui conduit le cas échéant à des modifications du projet qui lui sera finalement soumis
M. René Dosière, rapporteur. Un délai est-il généralement fixé ?
M. Bertrand Schneiter. Il est arrivé qu’on nous fixe un délai, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’opérations de marché comportant un calendrier déterminé. Des cessions de titres doivent parfois se faire en 48 heures. En général, nous savons à quel stade en est la procédure lorsque nous examinons les dossiers. Les avis de la commission étant valides pour un mois, il arrive qu’ils doivent être formellement renouvelés si une opération n’est pas finalisée dans ce délai.
M. René Dosière, rapporteur. Pouvez-vous nous parler des locaux que vous occupez ?
M. Bertrand Schneiter. Ils sont situés boulevard Diderot, dans un local qui est loué par le ministère de l’économie et dans lequel se trouve aussi l’Autorité des Normes comptables. C’est bien Bercy qui nous fournit nos moyens matériels, mais je ne constate pas à l’usage que ce sujet fasse problème, nos dotations étant acceptées sans difficulté.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous voulions vérifier ce point car dans votre réponse vous nous dites que ces données ne sont pas disponibles.
M. René Dosière, rapporteur. Quelle est la superficie ?
M. Bertrand Schneiter. Chaque membre dispose d’un bureau de dimensions modestes. J’ai un bureau qui doit avoir deux fenêtres, ce qui n’est pas considérable.
M. René Dosière, rapporteur. Cela représente une dizaine de bureaux au total ?
M. Bertrand Schneiter. Cela fait effectivement trois bureaux avec deux fenêtres et sept bureaux avec une fenêtre.
M. René Dosière, rapporteur. Il me semble que nous avons fait le tour des questions que nous voulions évoquer avec vous.
M. Bertrand Schneiter. C’est beaucoup d’honneur pour nous.
M. René Dosière, rapporteur. Nous avons le souci d’entendre les représentants de structures de tailles et de missions très différentes. Nous vous remercions.
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, accompagné de M. Christian Huchon, attaché principal au ministère de l’économie, membre du contrôle général
jeudi 11 mars 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Monsieur le Contrôleur général, vous avez eu l’occasion ces derniers jours, en présentant votre rapport annuel, de détailler assez largement votre action. Dans le cadre du travail que nous menons actuellement sur la quarantaine d’autorités administratives indépendantes que compte notre pays, nous aimerions vous entendre sur votre fonctionnement, vos objectifs, les moyens dont vous disposez. Vous nous direz si vous pensez que votre rôle pourrait être accru ou si, au contraire, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir l’exercer aussi pleinement que vous le souhaiteriez.
M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par définition, nos objectifs sont connus du législateur. Il s’agit de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes dans tous les lieux où elles sont maintenues en vertu d’une décision administrative ou judiciaire. Mais il s’agit aussi, de façon plus ambitieuse et pour respecter cette mission qui nous est dévolue par la loi, de visiter efficacement le plus grand nombre possible d’établissements ; de gagner la confiance des populations captives, en particulier en échangeant avec elles les courriers que prévoit également la loi ; de gagner la confiance des personnels, ce à quoi je tiens énormément ; de catalyser toutes réflexions utiles portant sur les lieux de privation de liberté, ce qui nous amène à réunir autour de nous des représentants d’associations, des chercheurs, des juristes, des syndicalistes ; de proposer aux pouvoirs publics les modifications nécessaires, en réfléchissant à l’ordre dans lequel les choses doivent être présentées ; enfin de veiller, même si cela ne relève pas directement de notre mission, à la façon dont les pouvoirs publics donnent suite ou non à nos recommandations.
Pour remplir ces objectifs, la loi de finances pour 2008 nous avait fixé un plafond de 18 emplois. Ils ont été pourvus au cours de l’année 2008, avec 14 contrôleurs à temps plein, dont mon adjoint et moi-même, et 4 agents administratifs. L’ampleur du courrier que nous avons reçu et la nécessité d’en vérifier la teneur en se rendant parfois sur place m’a amené à demander au Gouvernement, au cours de l’année 2009, la création de deux emplois supplémentaires de « chargé d’enquêtes ». Nous en sommes donc aujourd’hui à 20 emplois à temps plein. Comme le prévoit le décret du 12 mars 2008, nous avons en outre recruté des contrôleurs à temps partiel, désormais au nombre de 12. Contrairement à ce que prévoyait le décret, il s’agit essentiellement de retraités, qui nous accordent donc le temps qu’ils veulent. Ainsi, globalement, le contrôle général fonctionne avec environ 25 équivalents temps plein.
S’agissant des moyens financiers, la création de deux emplois supplémentaires en 2009 nous a amenés à une prévision de crédits de 3,3 millions d’euros pour 2010. Vous en trouverez la ventilation dans le rapport annuel, que j’ai souhaité aussi transparent que possible en matière de dépenses, y compris sur les rémunérations complémentaires que j’alloue aux contrôleurs.
Les rémunérations représentent 80 % du total car nous n’employons pratiquement que des agents de catégorie A, relativement anciens dans la fonction publique, dont le traitement a été aligné sur celui dont ils disposaient avant de rejoindre le contrôle général.
Si nous n’avons pas dépensé en 2009 la totalité de notre dotation au titre des rémunérations, c’est parce que j’ai espéré longtemps, comme je m’en étais ouvert devant votre Commission des lois en mai dernier, que le Gouvernement accède à ma demande de créer quatre emplois supplémentaires de contrôleur ; faute de les avoir obtenus, j’ai recherché des personnes à temps partiel, mais je ne les ai pas trouvées tout de suite. Le décalage devrait être résorbé en 2010 puisque des contrôleurs à temps partiel ont été recrutés au 1er août 2009 puis au 1er janvier 2010.
Les dépenses de fonctionnement comportent principalement deux postes : les déplacements et le loyer. La mobilité est notre vocation même ; ainsi en 2009, nous nous sommes rendus dans la moitié des départements français, y compris outre-mer. Mais nos dépenses sont très maîtrisées et nous avons recours à des moyens de déplacement modestes. S’agissant du loyer, voilà un an que nous sommes installés au bord du bassin de La Villette, dans le XIXe arrondissement, où j’ai estimé que nous trouverions les loyers les moins élevés de Paris intra-muros – où il nous était nécessaire de demeurer, afin d’être à proximité des gares. Le montant annuel de notre loyer est d’environ 250 000 euros.
Vous trouverez dans le rapport le détail de nos réalisations, auxquelles la presse a fait écho ces derniers jours. Nous avons, en dix-huit mois, visité 230 établissements de toute nature : dépôts de tribunaux, centres de rétention, locaux de douanes, commissariats de police, hôpitaux psychiatriques, établissements pénitentiaires... C’est plus que ce qu’avait fait toute autre institution de mission comparable. Ainsi, depuis sa création il y a vingt ans, le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe a effectué cinq visites dans notre pays, où je pense qu’il a vu une quarantaine d’établissements.
Le nombre de nos visites a pour premier effet que chaque responsable d’établissement a désormais conscience qu’il peut être visité. En second lieu, il nous permet de constituer un socle de connaissances sans équivalent, dont j’estime qu’il peut servir de base aux pouvoirs publics pour procéder aux évolutions nécessaires. Troisièmement, pour autant que tout cela puisse être rendu public – mais ce sera le cas tôt ou tard –, nous disposons d’un matériau susceptible d’éclairer l’opinion sur l’état des lieux de privation de liberté. Enfin, bien entendu, nous contribuons à développer un dialogue, jusqu’ici inusité, entre les captifs, les personnels et des personnes extérieures.
Je crois que nous avons frayé notre chemin et que cette activité mérite d’être poursuivie, quelle qu’en soit la forme institutionnelle. Si le législateur a souhaité instaurer le contrôle général des lieux de privation de liberté, c’est en raison de l’utilité collective de ce que nous faisons.
Enfin, même si ma décision définitive n’est pas encore arrêtée, je pense que je demanderai à nouveau au Gouvernement de créer quatre postes supplémentaires de contrôleur. Cela me paraît indispensable pour que notre institution remplisse son rôle, nos visites dans les établissements ne cessant de s’allonger : alors qu’à l’origine, nous passions en moyenne trois jours dans un établissement psychiatrique ou dans une prison, nous y restons désormais quatre à cinq jours en moyenne – et en janvier dernier, à Fleury-Mérogis, nous étions quinze et nous sommes restés deux semaines... Cet allongement tient au fait que nos contrôles sont mieux organisés et plus approfondis et que nous demandons à avoir connaissance d’un plus grand nombre de documents, mais aussi au nombre de plus en plus important de gens que nous rencontrons, à leur demande ou à la nôtre. Je veux que nous continuions à effectuer chaque année au moins 150 visites, afin en particulier que chaque responsable d’établissement se sente tenu à certaines obligations quant au respect des droits fondamentaux.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Certaines autorités administratives indépendantes sont dotées d’un collège ; ce n’est pas le cas de la vôtre, où vous êtes en quelque sorte seul maître à bord. Quelles réflexions cette situation vous inspire-t-elle ?
Par ailleurs, dans l’ensemble des lieux de privation de liberté sur lesquels vous exercez votre contrôle, on trouve des malades mentaux – non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en prison. Quel est votre sentiment à ce propos ? Pensez-vous qu’il serait possible de traiter d’une manière plus respectueuse des droits les personnes présentant des troubles psychiques ?
M. Jean-Marie Delarue. Le législateur a voulu que nous ne soyons pas dotés d’un collège. Pour ma part, par nature, je ne suis guère enclin à concentrer l’attention sur ma personne et je fonctionne de manière plutôt collégiale. Je regrette donc que ce qui est dit sur notre institution ait trop tendance à se focaliser sur un seul individu.
Je constate néanmoins qu’il n’est pas désagréable de disposer d’une certaine souplesse, et qu’une organisation collégiale nous obligerait sans doute à passer des compromis. Peut-être ce système me donne-t-il une plus grande liberté d’esprit et favorise-t-il la cohérence.
Je ressens toutefois, s’agissant de questions aussi délicates, le besoin d’un fonctionnement collectif. Nous avons pris l’habitude de nous réunir une fois par mois pour débattre des sujets qui sont apparus à l’occasion de nos visites. C’est d’ailleurs pourquoi je ne tiens pas à ce que le contrôle général s’agrandisse massivement : la discussion qui est possible à 25 ne le serait pas à 60. Qui plus est, si nous étions plus nombreux, je ne maîtriserais plus ce que font les contrôleurs lors de leurs missions. Or, je souhaite leur tenir les rênes courtes en matière de déontologie et de comportement sur place.
Au total, donc, je ne ressens pas le besoin d’une autorité collégiale : nous ne sommes pas une juridiction, nous ne faisons pas un travail de médiation ; nous jouons un rôle de prévention de la torture et des atteintes aux droits fondamentaux et, en cette matière, une autorité unique ne me paraît pas insensée.
La question des malades mentaux est autrement plus difficile. Si parmi les personnels certains vont jusqu’à affirmer que 80 % des personnes en détention souffrent de maladie mentale, les études épidémiologiques menées au début des années 2000, en particulier une étude sérieuse conduite en 2003, montrent que la proportion serait plutôt de 25 %, soit 15 000 des 60 000 détenus.
Pour faire sortir ces 15 000 personnes de détention, il faudrait d’abord changer le code pénal, dont l’article L. 122-1 a introduit en 1994 un cas intermédiaire entre l’abolition et le maintien du discernement, ce qui a eu pour effet que le nombre de personnes déclarées non coupables pour cause d’irresponsabilité mentale n’a cessé de s’amenuiser.
Il faudrait ensuite savoir où mettre ces personnes. La psychiatrie publique est aujourd’hui très malade ; 900 emplois de psychiatres publics sont vacants, les interrogations sont nombreuses, les services à la limite de la rupture à la suite des fermetures de lits. Ainsi, alors qu’en application de l’organisation des centres médico-psychologiques (CMP), un malade doit en principe être accueilli dans l’unité psychiatrique de son propre secteur géographique, il est fréquent qu’on le mette, faute de place, dans un autre secteur, et qu’on le transfère ultérieurement, ce qui est extrêmement perturbant pour lui. Dans les grandes agglomérations, les CMP débordent ; si l’on devait ajouter 15 000 personnes, le système exploserait.
Si nous avons autant de malades mentaux en détention, c’est donc non seulement parce que le code pénal les y conduit, mais aussi parce que nous sommes incapables de faire autrement. Dans ces conditions, il convient de faire en sorte, dans un premier temps, que le traitement psychiatrique des malades mentaux qui sont en prison soit à peu près assuré – il ne l’est pas aujourd’hui ! – et, d’autre part, de réfléchir d’urgence à la manière dont l’hospitalisation psychiatrique doit être organisée, en particulier dans le secteur public.
Les effets de la situation actuelle sont nombreux. Par exemple, deux expertises psychiatriques étant requises pour que l’auteur d’un crime puisse bénéficier d’un allègement de peine, et deux à trois mois de délai étant nécessaires pour en réaliser une du fait du manque d’experts psychiatres, un détenu qui sait que le juge est prêt à lui accorder la permission de sortir doit encore attendre six mois ! Comment s’étonner que les courriers que nous recevons expriment une totale incompréhension ?
De façon indirecte, ce sujet m’amène à évoquer la possibilité que je me réserve de demander aux pouvoirs publics d’étendre les missions du contrôle général aux établissements d’accueil pour personnes âgées, où l’on observe certaines formes de maltraitance. À l’échelle internationale, le Comité européen de prévention de la torture et le Sous-comité des Nations unies ont vocation à s’intéresser à ces lieux ; il est assez singulier qu’il n’en aille pas de même dans notre pays.
M. René Dosière, rapporteur. Pourriez-vous nous dire comment se passent concrètement les visites que vous effectuez ? Sont-elles annoncées à l’avance ? Rencontrez-vous des difficultés pour accéder à l’ensemble des documents ?
Les moyens dont vous disposez vous paraissent-ils suffisants au regard du nombre de lieux à visiter ? Pourrait-on, en s’abstenant de vous accorder les moyens nécessaires, limiter votre capacité d’action en tant qu’autorité indépendante ?
Enfin, quel est le profil de vos contrôleurs ?
M. Jean-Marie Delarue. Pour les visites, il n’y a pas de religion absolue ; je suis très attentif à l’adaptation de leur forme au cas par cas. En ce qui concerne leur programmation, nous ne prévenons jamais à l’avance lorsque nous nous rendons dans un établissement de petite taille, dont la physionomie pourrait être métamorphosée en peu de temps en cas de préavis, même court : dans un local de garde à vue, il suffit de retirer toutes les personnes gardées à vue et le tour est joué… Les choses sont différentes pour les établissements plus grands, où il ne faut pas mésestimer l’intérêt que peut présenter une visite programmée. Lorsque nous annonçons notre venue à un hôpital psychiatrique, à un établissement pénitentiaire ou, parfois, à un centre de rétention, c’est tout d’abord pour obtenir à l’avance des documents qui nous permettront d’orienter nos investigations et nos questions ; et c’est aussi pour donner au personnel et aux personnes captives la possibilité de réfléchir à ce qu’elles ont envie de nous dire. Dans la pratique, lorsqu’il y a présomption de faits inhabituels dans un établissement, nous nous y rendons de façon inopinée ; mais si tel n’est pas le cas, nous privilégions plutôt les visites programmées.
En ce qui concerne l’attitude des autorités, nous avons eu tout concours des autorités déconcentrées : même si l’enthousiasme n’a pas toujours été débordant, nous n’avons jamais rencontré d’opposition franche à nos visites. On nous a laissé agir comme nous le souhaitions, nous avons eu toute liberté de mouvement et d’accès aux documents.
Nous n’avons pas bénéficié de la même coopération de la part des autorités centralisées. Les administrations centrales n’ont pas fait preuve d’une grande bonne volonté pour nous donner accès aux circulaires et aux documents aptes à nous éclairer sur la politique suivie. Mais ce qui m’inquiète beaucoup plus, et j’y reviendrai sans doute dans les mois qui viennent, c’est ce que je ne qualifierai pas de mesures de représailles – encore que… –, mais qui est en tout cas la suite donnée à nos visites pour les personnes que nous avons entendues. Je sais par exemple que dans une maison d’arrêt où nous nous sommes rendus en janvier, toutes les personnes qui avaient demandé à nous voir ont été ensuite interrogées par les cadres de la maison. Si ces pratiques devaient perdurer, le Contrôle général n’aurait bientôt plus aucun interlocuteur. Il faut donc y mettre un coup d’arrêt, et j’ai dit avant-hier au directeur de l’administration pénitentiaire qu’elles me paraissent d’un autre âge. Cela vaut pour les captifs, mais aussi pour les membres du personnel : on leur demande des comptes, mais il faudra bien que l’on s’habitue à ce qu’ils puissent avoir un entretien confidentiel avec une personne extérieure.
S’agissant des moyens matériels, nous ne rencontrons pas de difficulté majeure. Nous avons fait l’acquisition de petits matériels facilitant les contrôles, par exemple de thermomètres afin de mesurer la température des lieux. Mais nous gérons nos crédits de façon un peu drastique, notamment en matière de frais de déplacement, afin de garder la possibilité d’effectuer deux à trois fois par an des visites outre-mer.
M. Jean-Pierre Brard. Ayant eu, monsieur le Contrôleur général, le privilège de vous rencontrer dans le cadre de mes fonctions de rapporteur spécial, j’avoue avoir été très impressionné par le caractère quasi-monacal de vos locaux. Il ne vous manque que la robe de bure ! Le Contrôle général vit fort modestement et nombre d’administrations devraient s’inspirer de son exemple.
Sur la question de l’organisation collégiale, je partage votre sentiment, dès lors que vous êtes soumis à notre contrôle pour l’ensemble de vos activités. Il nous serait ainsi tout à fait possible de vous accompagner lorsque vous faites des visites inopinées.
Pourriez-vous nous dire un mot des cas où vous estimez, après un premier contrôle, qu’un retour sur place ne serait pas inutile ?
Si je pense comme vous que vous pourriez être chargé de contrôler les maisons de retraite, il me semble que votre mission pourrait également être étendue à des établissements tels que la maison d’accueil pour autistes qui se trouve à Montreuil, sur laquelle j’entends des choses épouvantables. Il y a eu des décès, la maltraitance – par incompétence – est évidente ; par exemple, un enfant s’est perdu dans la neige, il a été retrouvé plusieurs heures après, les pieds brûlés, et il n’y avait même pas eu de signalement à la DDASS… Les familles entretiennent de tels rapports avec ces établissements – maisons de retraite comprises – qu’il leur est extrêmement difficile de donner l’alerte. Un regard extérieur, distancié et objectif paraît donc tout à fait indispensable.
Nous avons, nous aussi, le droit de nous rendre dans les lieux de privation de liberté – ce que je fais. Je me suis ainsi rendu à plusieurs reprises au commissariat de police de Montreuil, pour voir les cellules de garde à vue. La dernière fois, j’ai demandé que l’on me montre les couvertures. La question n’était pas attendue…On a fini par en trouver une, tellement crasseuse qu’il m’a semblé que mieux valait subir le froid. Mais que fait donc le commissaire ? Quelle sanction encourt-il quand il ne veille pas au respect de la personne humaine dans son commissariat ? Aucune…
Si le regroupement de certaines autorités peut être envisagé, pour ma part je milite pour que le Contrôleur général reste une autorité autonome, réellement indépendante.
M. Jean-Marie Delarue : Je précise, même si cela va de soi, que je suis prêt à accueillir à tout moment tel ou tel d’entre vous qui souhaiterait voir comment nous travaillons : pour moi, la transparence est la rançon de l’indépendance.
Oui, nous avons commencé à revenir sur les lieux de nos visites antérieures : nous avons ainsi revu, en 2009, un commissariat de police et une maison d’arrêt. Bien nous en a pris puisque, dans cette dernière, nous nous sommes aperçu de choses que nous n’avions pas vues lors de notre premier déplacement. Ces retours nous ont aussi incités à une certaine humilité, plusieurs recommandations que nous avions faites n’ayant pas été suivies d’effet. La situation s’était même aggravée dans un domaine : les horaires ayant été modifiés, les détenus étaient obligés de choisir entre travailler et déjeuner…
Ces vérifications me paraissent décisives pour notre institution, car c’est là que l’on mesurera le poids de ce que nous disons, et je souhaite qu’elles s’amplifient cette année. J’ajoute que l’administration n’est pas du tout inerte de ce point de vue : le directeur de l’administration pénitentiaire m’a informé qu’il avait demandé à ses inspecteurs de se rendre dans chacun des établissements visités pour voir si nos recommandations y étaient suivies d’effet. Je souligne toutefois que ni les recommandations que nous adressons aux ministres, comme la loi nous y invite, ni nos rapports de visite ne sont transmis aux services déconcentrés : les hôpitaux, les commissariats, les établissements pénitentiaires concernés n’en ont pas communication. Je me suis ouvert de ce problème auprès des cabinets ministériels concernés et, si cet état de fait devait perdurer, je prendrais publiquement position car l’efficacité du dispositif est en jeu.
J’en viens à la question du rapprochement avec le Défenseur des droits. Même si je ne souhaite pas m’aventurer sur un terrain qui n’est pas le mien, j’ai fait dans mon rapport une brève remarque à ce propos.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Pourriez-vous à ce propos nous donner un éclairage sur ce qui se passe à l’étranger ?
M. Jean-Marie Delarue. Précisément. Parmi les États membres du Conseil de l’Europe, dans la très grande majorité des pays d’Europe centrale et orientale et en Espagne, l’équivalent du contrôle général est rattaché à l’ombudsman. Mais ce n’est pas le cas dans les pays de tradition démocratique plus ancienne de l’Europe de l’Ouest : Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni. Il me semble que cela tient au fait que, dans les pays où la démocratie est récente, la lisibilité des droits de l’homme est une question essentielle et qu’il faut une institution capable de l’incarner immédiatement aux yeux de l’opinion. N’oublions pas toutefois que, dans un certain nombre d’États, notamment en Suède, l’appellation « ombudsman » recouvre en fait plusieurs entités. Dans des pays comme le nôtre, les Anglais l’ont parfaitement compris, la question de la lisibilité apparaît moins importante que celle de la compétence spécialisée : pour être efficaces, nous avons besoin d’institutions capables d’affronter à armes égales les administrations avec lesquelles elles sont en dialogue.
Mais nous verrons bien les décisions qui seront prises : dès avant ma nomination, j’avais dit devant la Commission des lois du Sénat que si le contrôleur général était efficace, il travaillerait à sa propre disparition…
M. René Dosière, rapporteur. Même si votre expérience est encore récente, avez-vous le sentiment d’être efficace ? Vos recommandations – dont vous nous dites qu’elles ne sont pas transmises aux intéressés – vous paraissent-elles néanmoins suivies d’effets ?
M. Jean-Marie Delarue. C’est tout l’intérêt de notre institution, et je ne voudrais surtout pas vous laisser sur ce point une impression trop négative.
Les efforts les plus nombreux concernent les mesures matérielles qui n’engagent pas de crédits importants et qui ne remettent pas en cause les traditions pesantes de l’administration. « Vous nous coûtez cher en pots de peinture ! », m’a dit un jour un responsable policier… Même si cela ne va pas aussi loin que je le souhaiterais, un certain nombre de modifications bienvenues sont apportées à l’aspect des commissariats. Autre exemple : dans un établissement pénitentiaire, un miroir avait été placé sous les pieds des personnes fouillées à nu ; nous avons estimé que ce n’était pas conforme à la dignité et le miroir a été retiré.
En revanche, les administrations ne sont pas aujourd’hui en état de satisfaire nos demandes lorsque cela suppose de faire appel à des effectifs supplémentaires.
Enfin, nous sommes confrontés à des différences de conception sur ce que doivent être aujourd’hui un hôpital psychiatrique ou un établissement pénitentiaire. Nous aurons en particulier avec le Gouvernement un débat sur la dimension des établissements pénitentiaires. La Garde des sceaux est d’ailleurs parfaitement consciente de ce problème ; elle a demandé que l’on revoie à la baisse la taille de certains programmes qui lui étaient présentés, mais à mon avis on est encore très loin du compte : je suis convaincu que, pour les détenus comme pour le personnel, une maison d’arrêt ne doit pas accueillir plus de 150 à 200 personnes.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Dans vos interventions devant les médias à l’occasion de la remise de votre rapport, la tonalité de votre propos paraissait assez négative, mais peut-être est-ce parce que les journalistes s’intéressent davantage aux trains qui arrivent en retard qu’à ceux qui sont à l’heure… Vous avez en particulier semblé lier la surpopulation des établissements pénitentiaires à un nombre excessif de peines prononcées. Dans la mesure où le taux d’incarcération de la France se situe dans la moyenne européenne, entre la Belgique et l’Allemagne, ne peut-on pas aussi considérer que ce phénomène tient simplement au manque de places ?
C’est une question que l’on aborde souvent par le biais des suicides. Quel est votre sentiment à ce propos ?
Je vous ai par ailleurs entendu dénoncer l’insuffisance dramatique de l’offre de travail en prison. Que faudrait-il faire selon vous pour améliorer la situation ?
M. Jean-Marie Delarue. La surpopulation en prison diminue depuis quatorze mois, essentiellement en raison du développement du placement sous surveillance électronique. Ce n’est pas le nombre des cellules disponibles qui est en cause, mais la durée des peines : quand elle augmente, le nombre de détenus, mécaniquement, augmente aussi. Cet allongement n’est pas propre à notre pays mais concerne l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. J’observe en outre en France un certain essoufflement des formes alternatives à l’incarcération, à l’exception des bracelets électroniques : voilà des années que nous n’avons pas mené une réflexion approfondie sur la question du contrôle judiciaire.
Dans le rapport, nous nous sommes intéressés non pas seulement au travail mais, plus largement, à l’activité, aussi bien en prison que dans les hôpitaux psychiatriques et dans les centres de rétention. Si l’on voulait appliquer effectivement l’article 27 de la loi pénitentiaire, qui dispose qu’un détenu ne peut refuser une activité qu’on lui propose, il faudrait des moyens humains et matériels dont on est très loin de disposer aujourd’hui.
Le travail en prison a fortement décliné depuis dix-huit mois en raison de la crise économique : j’estime à 30 % la perte d’emplois au cours de cette période ; elle serait de 20 % dans les 12 établissements que gère la SIGES, gestionnaire privé d’activités en détention. Cela paraît logique dans la mesure où ce sont les entreprises les plus vulnérables qui recherchent les bas salaires.
L’insuffisance du travail en prison tient à différents facteurs. Dans les vieilles prisons, elle est liée à la trop faible surface en ateliers, problème qui n’existe plus dans les constructions récentes. Il est également fréquent que l’on manque du personnel nécessaire pour conduire les détenus de leurs cellules vers les ateliers. Pour moi, dans les prisons modernes, le mot-clé est le mouvement : il faut être en capacité de faire effectuer un déplacement à un détenu ; tant que l’on n’aura pas réglé ce problème, la prison ne sera pas ce qu’elle devrait être aujourd’hui. Mais il y a aussi une difficulté majeure du côté de l’offre de travail ; il faut que des entreprises soient intéressées, ce qui signifie d’une part qu’il faut s’adresser à celles qui ont besoin d’un travail peu qualifié, par exemple dans le secteur de l’emballage, et d’autre part qu’il faut s’efforcer de lever les réticences des dirigeants.
Tout cela mérite réflexion et beaucoup s’y emploient dans l’administration pénitentiaire. Pour ma part je m’étonne tout d’abord que l’informatique, qui pourrait être formidablement développée auprès de cette population faiblement qualifiée, en soit encore au stade embryonnaire ; ensuite, que les rémunérations demeurent aussi faibles ; en troisième lieu, que l’on n’inscrive pas le travail en prison dans un cheminement qui puisse conduire le détenu, à travers la formation professionnelle, à l’exercice d’emplois de plus en plus qualifiés ; enfin, que face à la carence actuelle des entreprises privées, certaines activités de la RIEP, la Régie industrielle des établissements pénitentiaires, ne soient pas davantage développées.
M. René Dosière, rapporteur. J’ai cru comprendre, d’après la presse, qu’à vos yeux les nouvelles prisons manquaient un peu d’humanité. Faut-il voir cela comme une véritable critique bien que, comme j’ai pu le constater à Saint-Denis-de-la-Réunion, sur le plan de l’hygiène, les progrès soient assez spectaculaires par rapport aux établissements anciens ?
M. Jean-Marie Delarue. C’est en effet une critique, que j’assume, et un gros motif d’inquiétude. Que les choses soient claires, des progrès substantiels ont été enregistrés pour le confort matériel : les détenus sont les premiers à le reconnaître, on a réglé l’essentiel en ce qui concerne les douches dans les cellules, l’eau chaude, la chaleur, la fraîcheur, la cuisson… Ce que j’ai dit, c’est qu’une prison ne peut fonctionner, c’est-à-dire permettre de libérer des personnes qui soient en état de vivre une vie sociale normale, qu’à la condition que s’y développent des relations humaines susceptibles de permettre à la personne de se reconstruire. Or ces nouveaux établissements tournent résolument le dos aux relations humaines : l’architecture, la circulation, les effectifs sont conçus de telle sorte que les contacts – entre détenus, entre membres du personnel, entre personnel et détenus – sont réduits au strict minimum et même en deçà. Dans un établissement, nous avons fait un décompte très précis du nombre des visites médicales qui ont été annulées en raison des problèmes de circulation – longueur des couloirs, nombre de portes à franchir, nombre de surveillants nécessaires pour les ouvrir : un médecin spécialiste venu un matin pour recevoir dix détenus en consultation n’en a vu arriver aucun ; lorsqu’il est revenu l’après-midi pour en voir dix autres, il a vu arriver huit de ceux qui devaient venir le matin ; à la fin de la journée, douze personnes avaient donc manqué à l’appel. On mesure la frustration qu’engendre une telle désorganisation, aussi bien pour les personnels qui ont commencé à sortir les détenus de cellule pour rien, que pour les malades, qui ont le sentiment de ne pas être traités comme ils devraient l’être. Et je crains fort qu’on ne vérifie à l’avenir que les frustrations engendrent l’agressivité, donc la violence. Le fait que, dans les trois établissements neufs que nous avons visités simultanément, les demandes de mutation de personnels et de changement d’affectation de détenus soient aussi massives est un signe évident que les choses n’ont pas été conçues comme elles auraient dû l’être.
M. René Dosière, rapporteur. La difficulté des contacts faisait-elle partie du « cahier des charges » pour la construction de ces établissements ?
M. Jean-Marie Delarue. Il y a derrière cela une conception erronée de la sécurité, dont on pense qu’elle sera d’autant mieux assurée que l’on séparera les gens. Ma conviction profonde, qui s’oppose à celle de certaines organisations professionnelles, est inverse : pour moi, plus on assure des relations entre les personnes, mieux la sécurité est assurée.
M. René Dosière, rapporteur. Une question plus personnelle pour terminer. Vous avez été précédemment directeur des libertés publiques ; entre ce poste et celui que vous occupez aujourd’hui, lequel vous paraît le plus intéressant ?
M. Jean-Marie Delarue. Je ne me suis jamais posé la question ! Je suis plutôt porté à m’investir dans les fonctions dont je suis chargé… J’ai pris beaucoup de plaisir au ministère de l’intérieur, mais j’ai aussi beaucoup de goût pour ce que je fais maintenant, surtout parce que j’ai autour de moi une équipe formidable. J’ai recruté des gens issus de milieux divers – policiers, membres d’associations, gendarmes, médecins, magistrats… –, parce que je crois beaucoup au mélange des cultures professionnelles.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous avons interrogé tout à l’heure sur les suicides, et par ailleurs sur les critères de recrutement et la formation des contrôleurs. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
M. Jean-Marie Delarue. La question des suicides est extrêmement compliquée ; tout suicide est inexplicable. Dans les suicides en détention, des facteurs multiples interviennent et je trouve absurde de demander systématiquement des comptes à l’administration pénitentiaire. Tel détenu se suicide juste après avoir appris au parloir que sa femme a décidé de le quitter. Un autre se suicide à la veille de sa libération, parce qu’il est effrayé à l’idée de se retrouver dehors. Un autre encore croule sous les dettes contractées auprès de ses codétenus et ne voit pas comment s’en sortir. Sans doute la prison est-elle un facteur de plus, mais on ne peut pas en dire davantage.
Il ne suffit pas d’empêcher les suicides, il faut s’attaquer à leurs causes : on peut distribuer des pyjamas indéchirables, mais l’essentiel est de savoir prendre en considération les difficultés des détenus au moment où elles surviennent et d’y répondre avec les instruments adaptés.
Prenons un autre exemple : dans tous les établissements, certains détenus sont sous surveillance spéciale, ce qui signifie que, toutes les deux heures, on allume la lumière dans leur cellule pour leur demander de donner un signe de vie. Est-ce un bon moyen pour aider une personne qui va mal ? Il faudrait y réfléchir.
S’agissant des critères de sélection des contrôleurs, j’ai expliqué dans le rapport 2008 que je souhaite m’entourer de personnes ayant une bonne expérience dans leur métier et que j’apprécie qu’elles n’aient pas eu une carrière linéaire. Nous avons ainsi dans notre équipe une psychiatre qui a exercé dix ans à Fleury-Mérogis, une avocate qui a été précédemment directrice des services pénitentiaires, des personnes qui ont acquis beaucoup d’expérience dans les inspections générales.
Tous, nous nous sommes formés à la fois par l’expérience – je m’étais empressé de me rendre auprès du Comité européen pour la prévention de la torture à Strasbourg – et par les échanges entre nous. Dès le 1er septembre 2008, j’ai élaboré des règles déontologiques et je veille à ce qu’elles soient très étroitement suivies.
M. René Dosière, rapporteur. Il nous reste à vous remercier pour cet échange et pour toutes les précisions que vous nous avez apportées.
Audition de Mme Dominique Versini, défenseure des enfants, accompagnée de M. Hugues Feltesse, délégué général, et de Mme Christine Pierre-Neunreuther, directrice de l’administration générale et des ressources humaines.
jeudi 11 mars 2010
M. René Dosière, rapporteur. Madame la Défenseure des enfants, merci d’avoir répondu à notre invitation. Dans le cadre de notre réflexion sur les autorités administratives indépendantes, et alors qu’il est question de fondre votre institution au sein d’une structure plus importante, nous souhaiterions mieux connaître le travail que vous avez effectué jusqu’à présent et ce qui, selon vous, pourrait justifier le maintien du Défenseur des enfants.
Mme Dominique Versini, défenseure des enfants. Nommée en juin 2006, j’ai succédé à Mme Claire Brisset. En 2000, l’objectif était de créer une institution spécifique accessible aux enfants, dans la logique de la Convention internationale des droits de l’enfant. Un rapport de MM. Laurent Fabius et Jean-Paul Bret avait montré en 1999 que celle-ci était insuffisamment appliquée dans notre pays. Mais si la loi de mars 2000 a été adoptée à l’unanimité, elle a été précédée d’un débat proche de celui d’aujourd’hui, qui opposait les tenants de la création d’un adjoint au Médiateur de la République, spécialisé dans la défense des enfants, et les partisans de la création d’une institution spécifique pour les enfants et les adolescents, ceux-ci ne sachant pas à qui s’adresser en cas d’atteinte à leurs droits fondamentaux reconnus par la Convention. L’un des arguments les plus forts en faveur du maintien d’une autorité spécifique est le constat que des enfants confrontés à des situations graves nous saisissent, au seul motif que je m’appelle « Défenseur des enfants » – étant entendu qu’il appartient ensuite à nos équipes d’examiner si l’atteinte fondamentale aux droits est avérée, puis, le cas échéant, d’intervenir pour rétablir l’enfant dans ses droits.
Le Défenseur des enfants a été conçu comme un médiateur : il ne faut pas confondre son rôle avec celui de l’avocat, ni avec celui des parents, et pas davantage avec celui de toutes les institutions qui entourent l’enfant, notamment l’Aide sociale à l’enfance et la Justice. Le futur Défenseur des droits ne pourra d’ailleurs pas davantage interférer dans le cours de la justice : il pourra tout au plus formuler des observations écrites ou orales.
En 2000, le débat avait également porté sur l’appellation de la nouvelle institution : M. Bernard Stasi, alors Médiateur de la République, n’avait pas souhaité que l’on retienne celle de « Médiateur des enfants », et l’on a ainsi choisi celle de « Défenseur des enfants ».
La mission la plus visible de l’institution est la défense des enfants à partir du recueil des réclamations individuelles ou collectives. Le législateur a donné au Défenseur des enfants la possibilité d’être directement saisi, contrairement au Médiateur de la République. De ce point de vue, la loi de 2000 était très en avance.
Dix pour cent des réclamations individuelles sont faites par les enfants eux-mêmes. Le Défenseur des enfants, qui n’est ni un service administratif ni une juridiction, a pour mission de porter la parole de l’enfant, d’être pour lui un médiateur afin de défendre son intérêt supérieur, tel qu’il est reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant. Nous intervenons à cette fin tant auprès des personnes privées qu’auprès des institutions publiques ou privées concernées. La moitié des réclamations concernent le champ parental, du fait de la multiplication des séparations – qui conduisent à des conflits sur le lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite, les vacances… Nous amenons les parents à entrer dans une démarche de médiation familiale, dans l’intérêt de leur enfant ; et par ailleurs, bien entendu, nous vérifions que les procédures ne portent pas tort à l’enfant, dans le cadre d’une convention avec le ministère de la Justice qui nous permet de saisir le procureur de la République ou le procureur général, auquel nous adressons des observations écrites afin qu’il puisse lui-même, le cas échéant, se retourner vers le juge.
Lorsque ce sont les institutions auxquelles l’enfant est confié – en particulier l’Éducation nationale et l’Aide sociale à l’enfance, qui est notre principal interlocuteur – qui sont en cause, notre mode d’action est la médiation interinstitutionnelle ; ce n’est jamais la confrontation. Nous disposons pour cela de correspondants territoriaux locaux, qui sont souvent de jeunes retraités, indemnisés comme les délégués du Médiateur de la République, et qui sont tous des spécialistes de l’enfance – anciens pédiatres, pédopsychiatres, magistrats, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse... Confrontés à des problèmes d’un tout autre ordre que les tracasseries administratives des adultes, ils interviennent auprès des institutions non pour les contrôler, mais pour rechercher avec elles des solutions concrètes. Il peut s’agir, par exemple, du placement d’enfants d’une même fratrie dans des familles d’accueil différentes : la séparation étant, en principe, interdite par le code civil, il convient de veiller au moins à ce que ces enfants se voient régulièrement. De même, la loi prescrit la scolarisation des enfants handicapés, mais quand celle-ci se révèle difficile, nous agissons auprès de l’Éducation nationale pour trouver une solution. Nous jouons un rôle de « facilitateur », conformément à la mission que la loi de 2000 nous a confiée : nous sommes là pour simplifier la vie des enfants. Comme dans le champ social – j’ai créé avec le docteur Xavier Emmanuelli le SAMU social, que j’ai dirigé pendant de nombreuses années –, l’idée est de chercher ensemble la meilleure solution.
Le Défenseur des enfants n’est pas une spécificité française : je suis présidente du réseau européen des défenseurs des enfants, qui compte trente-sept membres dans vingt-neuf pays. Vous devez savoir que le Parlement suédois, il y a deux ans, a lui aussi réfléchi à un éventuel regroupement des autorités indépendantes : il a finalement décidé de les regrouper toutes à l’exception du défenseur des enfants, au motif que, les enfants n’étant pas des citoyens jouissant de tous leurs droits, ils ne devaient pas être considérés de la même façon que les adultes. Du reste, si nous étions en Suède, en Irlande ou en Belgique, nous serions venus ici accompagnés d’enfants qui vous auraient apporté leur témoignage. Pour notre part, nous réunissons un comité consultatif de jeunes plusieurs fois par an.
En Espagne, un Défenseur du peuple a été créé à la suite de la période franquiste, mais il existe aussi des défenseurs des enfants dans la plupart des communautés régionales autonomes. Il y en a un à Madrid, qui fait partie de notre réseau. En Finlande, l’Ombudsman général a une reconnaissance constitutionnelle depuis plus de quarante ans, ce qui n’a pas empêché, il y a deux ans, la création d’un défenseur des enfants.
Je reconnais qu’il ne s’agit pas là d’un argument juridique, mais par ailleurs il ne faut pas oublier que la loi de 2000 avait été votée à l’unanimité. L’institution a fait son chemin en se positionnant dans un vrai rôle de médiation : juges, avocats et autres professionnels de l’enfance aiment travailler avec nous pour, dans le cadre de la Convention internationale, déterminer ce qu’est l’intérêt supérieur d’un enfant, au cas par cas.
De plus, afin d’encourager notre saisine par les enfants, j’ai créé depuis 2007, à titre expérimental, dans douze départements, des équipes de jeunes civils volontaires, dans le cadre d’un partenariat avec Unis-Cité. Ces trente-quatre « jeunes ambassadeurs », qui ont pour la plupart entre vingt et vingt-deux ans et qui souhaitent participer à une mission d’intérêt général, sont formés par nos soins pour se rendre dans les établissements scolaires – où, en classe de cinquième, la Convention internationale fait partie du socle commun des connaissances – afin de faire œuvre de pédagogie à leur tour. Chaque année, ils rencontrent près de 25 000 enfants, auxquels, loin de tout esprit utopiste, il s’agit de faire comprendre qu’ils ont des droits mais que ceux-ci impliquent une réciprocité : le droit fondamental à ne pas subir des violences ou des discriminations implique le devoir de ne pas en faire subir aux autres. Il arrive par ailleurs que les questions posées par les enfants au cours de ces séances révèlent des situations très graves, dont nous nous autosaisissons alors afin de les instruire.
M. René Dosière, rapporteur. De quels indicateurs objectifs de réussite disposez-vous pour mesurer votre efficacité, notamment en termes de suivi de vos recommandations ?
Mme Dominique Versini. Lorsque je travaillais au SAMU social, on nous demandait de mesurer notre efficacité grâce au nombre de SDF que nous réinsérions, mais sans préciser ce que l’on entendait par réinsertion. Or, pour le clochard qui est depuis trente ans dans la rue, le seul fait d’accepter de prendre une douche est déjà une étape… Il est toujours très difficile de mesurer le travail portant sur le lien social et humain. En matière de défense des enfants, une évaluation est cependant possible : nous avons préparé à votre attention un dossier qui contient des indicateurs d’efficience et de notoriété, qui ont été progressivement mis en place.
Un premier indicateur concerne le traitement des réclamations. Nous en recevons tous les jours ; et chaque jour, un comité d’évaluation examine leur degré d’urgence : si, par exemple, un enfant se plaint de viol au sein de sa famille, la justice est immédiatement saisie. Un comité d’évaluation pluridisciplinaire, réunissant magistrats, juristes, psychologues et assistantes sociales, examine les autres dossiers. S’il considère qu’il y a atteinte à un droit fondamental, nous instruisons le dossier. S’il considère que la réclamation ne concerne pas le Défenseur des enfants, nous procédons à une mini-instruction en vue de rediriger la réclamation, dans le cadre d’une procédure de réorientation que j’ai mise en place à mon arrivée. Cela me paraît très important : il est regrettable que le projet de loi organique visant à créer un défenseur des droits ne prévoie pas l’obligation pour celui-ci de justifier son refus de traiter une réclamation ; la personne concernée, qui aura déjà rencontré des difficultés pour trouver un interlocuteur, sera de nouveau laissée seule face aux méandres de l’administration.
Lorsque je suis arrivée, le 1er juillet 2006, les dossiers en cours de traitement étaient au nombre de 642 – certains dossiers peuvent demander deux années avant d’être clôturés. Entre cette date et le 1er février 2010, nous avons reçu 4 964 réclamations concernant 6 602 enfants. On arrive ainsi à un total de 5 600 dossiers, concernant 7 500 enfants. Au cours de la même période, nous en avons clôturé 4 864 – ce qui signifie que l’instruction a permis, à un degré variable, d’obtenir un résultat.
Sur ces 4 864 dossiers clôturés, 40 % n’ont pas révélé une atteinte fondamentale à un droit de l’enfant au sens de la Convention internationale, tout en mettant en évidence une problématique sociale et familiale. Nous avons donc fait le nécessaire pour orienter les intéressés vers les bons interlocuteurs.
En ce qui concerne les dossiers qui ont fait l’objet d’une instruction – soit 60% de la totalité, à savoir 2 909 dossiers concernant 3 970 enfants –, dans 68 % des cas, nous avons pu aboutir à un résultat positif dans l’intérêt de l’enfant. Il s’agit notamment d’enfants d’une même fratrie placés dans des familles d’accueil différentes et pour lesquels le conseil général a pu trouver une solution de regroupement à la suite de notre intervention, ou d’enfants handicapés qui ont pu être accueillis – car l’existence de dispositions législatives ne suffit pas : du fait du manque de place dans les centres adaptés, nous sommes souvent obligés d’intervenir pour trouver une solution.
Quant à nos interventions auprès des procureurs généraux, elles permettent de redynamiser des dossiers et d’appeler l’attention sur des situations qui n’ont pas été traitées de manière satisfaisante à nos yeux ou sur des dysfonctionnements procéduraux contraires à l’intérêt de l’enfant.
Quinze pour cent de nos interventions concernent des enfants étrangers. Quand les parents sont en situation régulière, le problème vient souvent des tracasseries administratives auxquelles ils sont confrontés, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, pour prouver l’état-civil de leur enfant resté au pays. Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, nous aidons les familles à constituer les dossiers. Lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont en situation irrégulière, nous sommes très fréquemment conduits à intervenir auprès des préfets pour les amener à revoir une décision qui ne nous paraît pas conforme à l’intérieur supérieur de l’enfant. Nous jouons là pleinement notre rôle de médiateur. En cas de refus du préfet, nous faisons parfois appel au ministre, et le plus souvent nous obtenons gain de cause – mais il s’agit bel et bien de médiation, et non, bien sûr, de contestation de la politique menée en matière d’immigration.
Nous intervenons aussi pour améliorer la prise en charge médicale de certains enfants ; je pense notamment à une petite fille de 12 ans qui nous a écrit de Guyane, où elle avait été placée pour quinze jours à l’hôpital psychiatrique pour adultes parce que l’Aide sociale à l’enfance n’avait pas trouvé de famille d’accueil, et qui y était toujours au bout de deux ans, enfermée dans une chambre grillagée… Je suis intervenue auprès de diverses autorités, en constatant à cette occasion la présence dans le même établissement d’un enfant psychotique de 11 ans ; et j’ai pu obtenir le placement en urgence, de ces deux enfants dans des établissements adaptés.
Dans 14 % des dossiers, nous faisons des recommandations individuelles, afin d’aider la famille à trouver une solution pour l’enfant. Nous dépensons beaucoup d’énergie à convaincre des parents en situation de conflit que l’intérêt de leur enfant commande qu’ils s’entendent pour toutes les questions le concernant. Nous nous efforçons également de leur expliquer ce qu’est l’autorité parentale conjointe. J’avais du reste rédigé un rapport en vue d’assurer, en la matière, une meilleure information des jeunes parents, notamment au moment de la naissance de leur enfant. Nous sommes aussi confrontés aux histoires terrifiantes d’enlèvement d’enfant.
Nous faisons enfin des propositions aux pouvoirs publics, comme celle d’une loi qui imposerait aux parents qui sont en situation de conflit de recourir à la médiation familiale avant toute rencontre avec le juge, ce qui réduirait le nombre des contentieux. C’est le cas de la Suède, où le juge n’intervient que dans 10 % des cas.
M. Christian Vanneste, rapporteur. J’aimerais maintenant vous amener sur le terrain budgétaire. Ces trois dernières années, le nombre des réclamations traitées n’a quasiment pas évolué : 2 110 en 2007, 1 758 en 2008 et 2 157 en 2009…
Mme Dominique Versini. Vos chiffres correspondent au nombre de nouvelles réclamations traitées, auxquelles on doit ajouter les réclamations des années précédentes qui sont en cours d’instruction. Globalement le nombre des nouvelles réclamations enregistrées progresse de 10 % par an.
M. Christian Vanneste, rapporteur. L’augmentation des ressources affectées a été tout à fait considérable puisque qu’elles sont passées de 1,7 million d’euros en 2001 à 1,9 million en 2005 et à 2,7 millions en 2009. Cela représente une augmentation de 43 % entre 2005 et 2009, qui semble en grande partie due à une très forte augmentation des rémunérations, et notamment de celle du délégué général. En effet, alors que celle du secrétaire général s’élevait en 2005 à 86 208 euros, celle du délégué général, qui le remplace, est passée en 2007 à 107 865 euros et en 2010 à 131 000 euros : l’augmentation est donc de 25 % entre 2005 et 2007 et de 21,44 % entre 2007 et 2010. Or celle-ci n’est pas justifiée par une élévation comparable du niveau d’activité.
Il est vrai que vous suivez deux orientations : traiter les réclamations et faire des propositions d’ordre général…
Mme Dominique Versini : La promotion des droits de l’enfant fait aussi partie intégrante de nos missions.
M. Christian Vanneste, rapporteur. On peut observer, à cet égard, l’augmentation, elle aussi tout à fait considérable, du budget de la communication. Les frais de déplacement ont été multipliés par sept entre 2005 et 2009, passant de 7 000 à 51 000 euros et les dépenses relatives aux outils et actions de communication sont passées de 1 536 euros en 2005 à 56 000 euros en 2009. Comment justifiez-vous cette augmentation des dépenses de communication, qui passent de 0,3 % des charges de fonctionnement en 2005 à 7,8 % en 2006 et à 18,9 % en 2009 ?
Pourquoi n’avez-vous pas suivi la préconisation du rapport de la Cour des comptes de mars 2008, justifiée par le souci de transparence des coûts, de prendre en charge sur votre budget les huit personnes mises à votre disposition, après transfert des crédits correspondants ?
Je reconnais en revanche que les dépenses de loyer restent modérées, après une brusque augmentation en 2004. La surface occupée par agent est de 17 mètres carrés ; certes la règle est 12 mètres carrés, mais nous avons vu plus hors norme que vous.
Mme Dominique Versini : Je ne peux vous répondre que pour la période débutant à ma prise de fonctions en juillet 2006.
Tout d’abord, en 2010, nous avons satisfait à la transparence exigée par la Cour des comptes, puisque nous avons réussi à convaincre, non sans difficulté, les ministères concernés de procéder au transfert des postes des agents mis à notre disposition. Des arbitrages au plus haut niveau de l’État ont été nécessaires pour obtenir le simple respect de la LOLF. Le budget 2010, qui s’élève à 3,178 millions, est donc totalement transparent.
Mme Christine Pierre-Neunreuther, directrice de l’administration générale et des ressources humaines. Ce dernier chiffre comprend la somme de 442 000 euros qui correspond au transfert de six emplois de fonctionnaire et d’un magistrat, que nous avons obtenu au cours des négociations budgétaires de 2009. En 2008, mon prédécesseur avait demandé sans succès le détachement de trois fonctionnaires. Le dossier intitulé « Budget simplifié » que nous vous avons remis en début d’audition vous donne toutes les informations nécessaires.
M. René Dosière, rapporteur. Étaient-ce les fonctionnaires eux-mêmes qui ne souhaitaient pas le transfert ?
Mme Dominique Versini. Non, les ministères n’étaient pas prêts à transférer les postes.
Mme Christine Pierre-Neunreuther. C’est grâce à l’intervention du cabinet de M. Darcos que nous avons obtenu ces transferts, à la fin du mois d’août 2009. Tous les fonctionnaires, magistrat compris, sont en position de détachement à compter du 1er janvier 2010.
M. Jean-Pierre Brard. Ils perdent donc leur droit à l’avancement.
Mme Christine Pierre-Neunreuther. Oui et non : leur détachement s’est fait dans des conditions financières avantageuses (la prime de détachement intègre l’ex indemnité de mise à disposition) mais nous devons aussi tenir compte du déroulement ultérieur de leur carrière dans leur administration d’origine et, autant que possible, la transposer dans leur contrat.
Mme Dominique Versini. En 2009, sur un budget de 2,73 millions d’euros, il restait, après paiement des salaires et du loyer, 527 000 euros pour faire vivre une institution qui comprend vingt-huit personnes, cinquante-cinq correspondants territoriaux et trente-quatre jeunes civils volontaires. Si on le compare à celui d’autres institutions de la République, notre train de vie n’apparaît pas comme immodéré.
En ce qui concerne les dépenses de loyer, je rappelle que Mme Claire Brisset avait d’abord dû déménager de Matignon au boulevard Montparnasse, avant de louer des locaux à une adresse qui n’a rien de prestigieux : nous sommes au 104, boulevard Auguste-Blanqui, au métro Glacière.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Mes questions ne portaient pas sur le loyer, dont j’ai reconnu la modestie, mais sur l’augmentation considérable des rémunérations et sur celle, non moins considérable, du budget de la communication, laquelle met en cause l’équilibre entre les deux grandes orientations de votre institution, puisque le nombre des agents traitant les réclamations est devenu inférieur à 50 %.
Mme Dominique Versini. Qu’appelez-vous « communication » ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Par exemple l’organisation de forums. Je me suis contenté de lire vos documents, où il apparaît notamment que le nombre de fois où vous avez été citée a été multiplié par trois ou quatre. Cela traduit bien la volonté de mettre l’accent sur la communication. Ce n’est pas là une critique de ma part, mais un constat.
Mme Dominique Versini. Ce que vous appelez « communication » est la seconde mission que nous a confiée la loi de 2000, selon laquelle le Défenseur des enfants est chargé non seulement de défendre, mais également de promouvoir les droits de l’enfant, dans le cadre de nos engagements internationaux et de notre législation.
Cette mission de promotion des droits de l’enfant, qui implique de faire connaître la Convention internationale, était mal remplie avant mon arrivée. Le réseau de correspondants territoriaux était insuffisant, et c’est pourquoi nous l’avons renforcé – ce qui ne coûte pas très cher. J’ai souhaité développer cette mission, conformément aux recommandations des Nations unies, qui demandent aux défenseurs des enfants de faire connaître la Convention internationale et de faire remonter la parole des enfants jusqu’aux pouvoirs publics, afin d’améliorer les politiques publiques.
M. René Dosière, rapporteur. Quelles sont les modalités de cette action ?
Mme Dominique Versini. Il m’a paru important de rencontrer les enfants, car nous ne sommes pas un service administratif. C’est pourquoi nous avons fait appel à des équipes de « jeunes ambassadeurs ». Cela se fait au moindre coût, puisque nous les recrutons dans le cadre d’Unis-Cité et que leur indemnité est versée par l’Agence nationale de la cohésion sociale. Nous assumons en revanche le coût de la formation et du pilotage des activités de ces jeunes, pour lesquelles nous avons embauché une ancienne ambassadrice, qui est chargée d’assister la directrice de la promotion des droits de l’enfant. Ces jeunes voient 25 000 enfants par an, auxquels ils consacrent 50 000 heures de formation.
J’ai également signé un partenariat avec M. Albert Uderzo, le père d’Astérix, qui a dédié une partie des bénéfices de la vente d’un de ses albums au développement de la promotion des droits de l’enfant. Nous avons par ailleurs obtenu l’ouverture d’un fonds de concours, lequel a permis de créer des kits pédagogiques qui ont reçu l’aval de l’Éducation nationale et sont téléchargeables gratuitement par les enseignants.
C’est parce que j’ai conscience de l’état des finances publiques que j’ai décidé de développer des partenariats. La formule des « jeunes ambassadeurs » a ainsi été développée dans le cadre du service civil volontaire. J’ai également mis en place un partenariat avec les conseils généraux, qui mettent à disposition des locaux, voire un véhicule comme c’est le cas dans la Vienne, ce qui permet aux six « jeunes ambassadeurs » de se rendre au cours de l’année dans tous les établissements scolaires publics et privés du département. Nous avons par ailleurs, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Convention internationale, organisé une grande consultation nationale dont le résultat figure dans notre rapport intitulé Parole aux jeunes ; les dix forums, financés par le fonds de concours, se sont conclus le 20 novembre 2009 par une journée à la Sorbonne, dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation nationale, les conseils généraux, le conseil régional d’Île-de-France, la CNAF et M. Uderzo.
L’augmentation des frais de déplacement résulte de la nécessité de nous rendre dans les départements du Bas-Rhin, de la Vienne, de l’Isère, du Rhône et dans l’ensemble de la région Île-de-France pour former sur place nos jeunes ambassadeurs. Eux-mêmes viennent parfois suivre une formation à Paris, mais le financement est alors assuré par Unis-Cité.
Mme Christine Pierre-Neunreuther. La formation est dispensée à Paris Tech, qui nous prête des salles et qui ne nous demande de payer que les repas, au coût de cinq euros par repas pendant deux jours.
M. René Dosière, rapporteur. En matière de ressources, vous avez fait appel plusieurs fois à la réserve parlementaire.
Mme Dominique Versini. Trois fois.
M. René Dosière, rapporteur. Était-ce une manière de contourner des arbitrages budgétaires défavorables ?
Mme Dominique Versini : Non. Nous avons notamment demandé à l’Assemblée nationale une subvention exceptionnelle, qu’elle nous a accordée, pour organiser l’assemblée générale du réseau européen des défenseurs des enfants en septembre dernier.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous aviez précédemment fait appel à l’Assemblée nationale pour remplacer votre matériel informatique.
Mme Dominique Versini. À mon arrivée, j’ai trouvé une institution exsangue. Le matériel informatique était hors d’usage et les agents n’avaient pas été augmentés depuis six ans.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Depuis, ils l’ont été sérieusement ! Deux fois 25 % !
Mme Dominique Versini. Je ne peux pas vous laisser dire cela : leurs salaires ne sont pas exorbitants du droit commun.
Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait permis à notre pays d’accueillir les trente-sept défenseurs des enfants d’Europe pour leur assemblée générale. M. Jacques Barrot, alors vice-président de la Commission européenne, et M. Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, nous ont honorés de leur présence.
Le Sénat nous a également versé l’an dernier une subvention exceptionnelle pour le vingtième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle nous a permis de faire venir pour la journée de clôture à la Sorbonne, qui nous a prêté des locaux, 800 enfants, dont certains étaient handicapés. Ils sont venus de tous les départements français, y compris d’outre-mer, présenter aux plus hautes autorités de l’État leurs propositions sur les questions les concernant. Je puis vous assurer que, contrairement à la réputation qui leur est faite dans la presse, les enfants savent se montrer raisonnables et faire preuve de pragmatisme !
M. René Dosière, rapporteur. Cette journée a certainement coûté moins cher que le Parlement des enfants.
M. Hugues Feltesse, délégué général. Il doit être clair, en tout cas, que les appels à la réserve parlementaire ont servi à financer des opérations exceptionnelles et non à couvrir des dépenses de fonctionnement.
M. Jean-Pierre Brard. Madame la Défenseure, je ne pense pas que le nombre d’occurrences vous concernant soit un critère d’évaluation pertinent. Au-delà de cette remarque, j’ai deux questions à vous poser.
Dans les collèges, à l’âge de la préadolescence, il arrive que les enfants se livrent entre eux à des pressions ou des chantages. Ces pratiques remontent-elles jusqu’à vous ?
D’autre part, avez-vous une idée du taux d’aboutissement de vos interventions auprès des préfets ?
Mme Dominique Versini. Je laisserai M. Feltesse répondre à votre première question.
Sur le deuxième point, on peut dire que, dans la moitié des cas, les situations sont revues par le préfet dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Que cette proportion ne soit pas supérieure me semble normal, les préfets ayant pour rôle d’appliquer la politique gouvernementale, notamment en matière d’immigration. Lorsqu’il nous paraît nécessaire de remonter jusqu’au ministre, nous obtenons gain de cause dans la quasi-totalité des cas. Par ailleurs, j’ai demandé qu’on ne fasse plus séjourner des enfants dans des centres de rétention administrative, la Convention internationale s’opposant à ce qu’un enfant qui n’a pas commis d’infraction soit placé dans un lieu privatif de liberté ; j’ai recommandé l’assouplissement de la procédure d’assignation à domicile, et le ministre a indiqué qu’il allait examiner la question.
En ce qui concerne les indicateurs de résultats, je conviens que l’indice de notoriété n’est pas le mieux adapté. Aussi avons-nous mis au point en 2006 dans le cadre du budget opérationnel de programme (BOP), deux autres indicateurs d’efficience de la gestion des réclamations et, en 2010, deux indicateurs supplémentaires d’évaluation des résultats de la mission de promotion des droits de l’enfant.
M. Hugues Feltesse. Seulement 8 % des réclamations qui nous sont adressées concernent la vie scolaire ; et pour une bonne part, il s’agit de problèmes de scolarisation.
Lorsqu’un problème de discipline se présente, il faut faire en sorte de rétablir la paix dans l’établissement, mais sans transférer le problème ailleurs : une simple exclusion ne fait qu’aggraver la situation, en laissant le jeune livré à lui-même. Nous jouons donc notre rôle de médiation, en prenant contact avec l’inspection d’académie afin de trouver, avec les parents, la meilleure solution pour tous.
M. René Dosière, rapporteur. Les enfants qui ont bénéficié dans leur collège de la visite de « jeunes ambassadeurs » vous saisissent-ils davantage que les autres ?
Mme Dominique Versini. Oui, l’augmentation du nombre de saisines par les enfants selon les départements est grandement corrélée avec la présence des « jeunes ambassadeurs ». Je me réjouis que le Défenseur des enfants soit ainsi devenu un véritable recours pour les enfants.
Nous avons cependant beaucoup de difficultés à repérer les enfants qui subissent une maltraitance intrafamiliale. Il est rare, même quand l’enfant l’évoque, qu’il le fasse à la première personne. Le partenariat avec les conseils généraux, qui sont chargés de la protection de l’enfance, permet de réaliser un travail de signalement, en cas notamment de paroles inquiétantes. Il convient toutefois de se montrer prudent afin de ne pas accabler à tort une famille.
M. Hugues Feltesse. Depuis un an, nous avons mis en place un nouveau dispositif d’alerte. Il en résulte, chaque mois, une quinzaine de saisines directes par les enfants, chiffre élevé compte tenu du fait qu’il s’agit de situations sérieuses. Dans le cadre d’un partenariat avec les académies, notamment avec les conseillers techniques, un premier travail est effectué au sein de l’institution scolaire, avant que le département n’intervienne à travers la cellule de recueil des informations préoccupantes.
Le dispositif repose d’une part sur les questionnaires que les enfants remplissent à la fin de l’intervention des jeunes ambassadeurs : nous recueillons par ce biais des signaux d’alerte. D’autre part, les jeunes ambassadeurs ont été formés à repérer la signification de certaines paroles prononcées par les enfants. Nous prenons aussitôt contact avec l’équipe éducative avant d’instruire éventuellement le dossier. Le fait d’aller au-devant des enfants leur permet de faire remonter des problèmes dont ils ne réussissaient pas auparavant à nous informer.
Mme Dominique Versini. Nous avons également mis au point des questionnaires d’évaluation de la formation, destinés aux enfants et aux enseignants.
Mme Christine Pierre-Neunreuther. En ce qui concerne les ressources , si la page 14 de notre réponse à votre questionnaire indique bien que les ressources totales de l’institution passent de 1,7 million d’euros en 2001 à 2,7 millions en 2009, il convient de décomposer le million d’euros supplémentaire de la façon suivante : 400 000 euros correspondent, à partir de 2004, au fait que l’institution a dû, à partir de cette date, payer son loyer ; 100 000 euros correspondent, en 2009, à l’intégration d’un personnel détaché du ministère de l’Éducation nationale ; 134 000 euros proviennent du fonds de concours. Il convient d’ajouter à ces sommes 86 000 euros de crédits reportés en 2003, que nous avons perçus en 2007.
L’augmentation réelle s’élève donc à moins de 300 000 euros, en raison notamment d’une augmentation de 26 % des dépenses de personnel depuis 2005, liée au fait que nous sommes passés de 22 à 30 équivalents temps plein (ETP) de 2006 à 2009.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ma question portait sur la hauteur des rémunérations.
Mme Christine Pierre-Neunreuther. La hausse des dépenses de personnel a été limitée à 26 % en raison du recrutement de fonctionnaires certes en plus grand nombre, mais plus jeunes et à la rémunération moins élevée que ceux qu’ils remplaçaient.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je ne visais que la rétribution du délégué général, qui occupe, sous ce titre, la fonction de l’ancien secrétaire général.
M. Hugues Feltesse. Ma rémunération n’a pas bougé et l’on ne saurait comparer deux personnes aux profils totalement différents, dont l’une, qui ne faisait pas l’affaire, est restée très peu de temps.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ma remarque concerne le poste, elle ne vise pas votre personne. Je constate que l’augmentation a été considérable.
Mme Dominique Versini. Il ne s’agit ni de la même personne ni du même statut.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il s’agit néanmoins du même poste budgétaire.
Mme Dominique Versini. J’ajoute que le secrétaire général présent jusqu’en novembre 2006 (et intégré à cette date dans la magistrature) percevait un traitement net mensuel (4 250 euros) très modeste compte tenu de ses responsabilités et de son engagement. La faiblesse des moyens de l’institution n’a pas permis à Mme Claire Brisset de l’augmenter comme elle l’aurait souhaité. L’arrivée du nouveau délégué général en 2007 a été l’occasion d’un réajustement. Je rappelle également que M. Christian Feltesse était précédemment directeur général de l’UNIOPSS, fédération qui regroupe 20 000 structures sanitaires, sociales et médico-sociales en 23 délégations régionales. Le niveau de rémunération antérieur constituait l’un des éléments pris en compte pour l’évaluation de sa rémunération. Enfin, cette rémunération est comparable à celle d’un sous-directeur d’administration centrale et a été établie en concertation avec le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du programme budgétaire de rattachement.
M. Jean-Pierre Brard. Le secrétaire général du Gouvernement vous a-t-il reçue pour vous entretenir de l’avenir de votre institution ?
Mme Dominique Versini. Non. Personne, du reste, ni à l’Élysée, ni à Matignon, ni au ministère de la Justice, ne m’a reçue pour m’annoncer la suppression de l’institution que je préside.
M. Jean-Pierre Brard. Je voulais le vérifier.
Mme Dominique Versini. Je n’ai été reçue qu’en décembre à l’Élysée par Mme Emmanuelle Mignon, la veille de son départ pour le Conseil d’État, ainsi que, toujours au mois de décembre, avec beaucoup de courtoisie, par Mme Alliot-Marie. En dépit des courriers très nombreux que j’ai envoyés, personne ne m’a reçue à Matignon.
M. René Dosière, rapporteur. Nous vous remercions pour cet échange.
Audition de M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, accompagné de MM. Bernard Dreyfus, directeur général des services, et Christian Le Roux, directeur de cabinet
jeudi 25 mars 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous remercions, monsieur le Médiateur de la République, d’avoir accepté notre invitation.
Le médiateur de la République – l’une des plus anciennes autorités indépendantes, puisque nous avons fêté il y a deux ans son trentième anniversaire – joue un rôle grandissant, comme en témoigne l’écho rencontré par son rapport de 2009, qui insistait sur la fragmentation de la société française.
Pouvez-vous, monsieur le Médiateur, nous donner des éléments sur le rôle de la médiature, sur l’adaptation de ses moyens à sa mission et sur son efficacité – qu’en est-il par exemple du rapport entre ses effectifs et le nombre de saisines et de médiations réussies ?
Certains ont jugé que vous n’utilisiez pas tous les pouvoirs dont vous disposez en matière de poursuites, d’injonctions et de propositions. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, la médiature est appelée à se transformer, puisque la dernière réforme constitutionnelle a institué un Défenseur des droits appelé à reprendre ses attributions. Quel serait, selon vous, le juste périmètre à assigner à cette institution ?
M. René Dosière, rapporteur. En bref, plus qu’un bilan complet de votre activité, nous vous demandons de nous dire sur quels points votre action a été, selon vous, satisfaisante et sur quels autres votre jugement serait plus réservé.
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. Je vous remercie de votre invitation. L’évaluation parlementaire me semble en effet essentielle, et je vous ferai d’ailleurs un certain nombre de propositions à cet égard.
Dès que j’ai été nommé Médiateur, j’ai demandé à la Cour des comptes un bilan de clôture et un bilan d’ouverture, non par suspicion vis-à-vis de mon prédécesseur mais parce que celui qui est placé à la tête d’une autorité doit pouvoir assumer pleinement la responsabilité des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions – ces bilans seront en outre utiles au Parlement pour analyser objectifs et résultats. La Cour des comptes m’a répondu qu’elle ne pouvait satisfaire ma demande, ayant effectué un contrôle deux ans auparavant. J’ai donc demandé à l’Inspection des finances d’effectuer un contrôle. D’aucuns se sont récriés, demandant pourquoi je tenais tant à faire entrer le loup dans la bergerie. C’est que, pour moi, il importe de combattre la culture de l’opacité. L’indépendance, c’est la transparence. La crédibilité d’une institution telle que la nôtre, son autorité morale dépendent de cette transparence, de cette capacité à assumer la totalité de son bilan, fût-il négatif sur certains points, afin d’éviter la reproduction des mêmes erreurs.
D’autre part, la responsabilité du Médiateur n’était pas engagée, faute de comptable public. J’ai donc indiqué à la Cour des comptes que, tant que cette lacune perdurerait, c’est moi qui, à titre personnel, serais responsable de l’engagement des agents de la médiature, car aucun euro d’argent public ne doit être dépensé sans que quelqu’un en prenne la responsabilité.
M. René Dosière, rapporteur. Comment cela se passait-il concrètement, auparavant ?
M. Jean-Paul Delevoye. Une ouverture de crédits de Matignon permettait à la médiature d’engager des dépenses sans fournir de justificatif. Le Médiateur était à la fois ordonnateur et comptable. En effet, pour le législateur de 1973, son indépendance impliquait aussi l’indépendance financière. Je ne partage pas du tout cette analyse. L’indépendance doit se limiter à ce qu’exige l’esprit de l’institution que l’on préside, mais chacun doit justifier de l’usage qu’il fait de l’argent public. C’est la raison pour laquelle je suis demandeur de bilans et d’une évaluation parlementaire.
Nous avons été félicités par la Cour des comptes pour notre bonne gestion, mais notre seul mérite est d’avoir suivi les observations et conseils de l’Inspection des finances et de la Cour elle-même, qui avait relevé dans son rapport plusieurs manquements aux règles statutaires comme aux règles comptables. Cela démontre l’intérêt des contrôles et des audits extérieurs, dont je suis un gros consommateur. Il est dans la culture française de craindre le contrôleur fiscal, à croire que nous avons tous un tricheur qui sommeille au fond de nous. Mais cette peur du contrôle est le commencement de la vertu. Personne ne peut garantir que tel ou tel, au sommet ou à la base, ne sera pas tenté un jour de commettre un écart comptable.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quand avez-vous mis en place les nouvelles règles ?
M. Jean-Paul Delevoye. Dès mon arrivée : après avoir annoncé qu’ils allaient travailler deux fois plus mais qu’ils seraient trois fois plus heureux, j’ai fait part aux personnels de la médiature de ma volonté d’une transparence totale, y compris pour mes propres déplacements, qui font l’objet de comptes rendus mensuels, voire hebdomadaires. Nous avons arrêté un objectif de contractualisation : toutes les économies réalisées sont réaffectées à de nouveaux équipements. Nous avons organisé trois séminaires. Le premier avait pour objet d’étudier les pouvoirs que nous confère la loi de 1973. Quelques-uns de mes collaborateurs, en place depuis plusieurs années, ont ainsi découvert que nous disposions d’un pouvoir d’injonction et d’inspection.
Notre deuxième séminaire portait sur l’éthique. J’ai été nommé par le Président de la République, et pour que l’institution soit crédible, il ne doit pas y avoir la moindre suspicion d’esprit partisan. Nous avons discuté de la meilleure façon d’assurer l’indépendance et de la contrôler – et la confrontation de nos idées a été extrêmement intéressante, en raison de la diversité de nos options politiques et philosophiques. Elle nous a amenés à nous fixer des règles de conduite, pour éviter des conflits d’intérêts, et, pour ma part, à me démettre de mon mandat en région Nord-Pas-de-Calais, considérant que je ne pouvais être juge et partie. Cela étant, je pense qu’une surveillance externe – celle du Parlement – est également nécessaire.
Enfin, une troisième réflexion a porté sur la maîtrise comptable et sur les moyens d’une utilisation optimale de l’argent public. Celle-ci ne dépend pas de la qualité des dirigeants, mais de leur capacité à responsabiliser chaque acteur, du plus important au plus humble. Nous avons mis en place un comité de participation en sollicitant des propositions d’économies, dont chacune serait soumise à une analyse quantitative, les sommes réaffectées faisant ensuite l’objet d’une évaluation. Nous avons reçu un nombre important de suggestions : pourquoi, par exemple, assurer la garde de la médiature jour et nuit, ce qui coûtait environ 70 000 euros ? Ne peut-on réduire les frais téléphoniques du siège, qui s’élèvent à plus de 50 000 euros ? Nous avons institué des appels d’offres et la même entreprise nous a fait des propositions deux fois plus intéressantes. Ces décisions nous ont permis de dégager 300 000 euros, que nous avons réaffectés à l’amélioration du parc informatique, à la tenue d’un séminaire réunissant l’ensemble des délégués et des administrateurs, à la mise en place du comité de participation et à la fourniture d’un chèque déjeuner. La salle qui était réservée au médiateur est maintenant ouverte à tous, et notamment aux délégués.
Notre souci a été de faire partager les objectifs, l’éthique et la recherche de la vertu comptable. Chaque acteur doit être totalement responsabilisé, disais-je : nous avons appliqué ce principe à l’accueil, une des fonctions les plus importantes de l’administration car elle est un facteur d’apaisement. Un quart des appels téléphoniques adressés au Médiateur se perdaient. Pour y remédier, nous avons décidé de basculer tous les appels sur les postes de l’ensemble des secrétaires – ce qui a été accepté en dépit des réticences initiales. Le taux de déperdition des appels a été ramené de 25 à 7 %.
Nous avons mis en place un dispositif permettant de recevoir des courriels dont le nombre, depuis la dernière semaine d’août, ne cesse d’augmenter. Nous avons organisé un séminaire avec le personnel afin de mettre au point un système, plus souple, permettant de répondre à l’ensemble des courriels dans de meilleurs délais.
L’un des plus gros problèmes auxquels avait à faire face la médiature était celui de son loyer, qui atteignait 2,4 millions d’euros, avec un bail mettant à la charge du locataire la totalité des réparations – or il s’agit d’un bâtiment en périmètre classé monument historique. Avec un tel bail, nous n’aurions pas tenu jusqu’à son renouvellement ! Nous avons fait analyser la situation par le service des Domaines du ministère des finances – qui était un peu gêné d’avoir accepté ces conditions – ainsi que par des services juridiques, privés et de l’État : impossible d’annuler le bail ! Nous avons alors engagé un bras de fer avec le propriétaire, qui a fini par accepter de réduire le loyer de 450 000 euros et de faire des travaux. Nous avons ainsi économisé 450 000 euros et récupéré une surface de 400 m2. Notre loyer est maintenant l’un des plus bas du secteur et nous avons les moyens de regrouper nos services…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je reviens sur le personnel. La médiature emploie aujourd’hui moins de fonctionnaires détachés et davantage de contractuels. Cela correspond-il à une volonté ?
M. Jean-Paul Delevoye. À effectif constant, nous traitons 25 % de dossiers supplémentaires, et même davantage puisque notre périmètre a été élargi pour intégrer le pôle santé. En matière de statuts, nous avons mis fin aux irrégularités constatées. Mais je laisse au directeur général le soin de répondre plus précisément à votre question.
M. Bernard Dreyfus, directeur général des services du Médiateur de la République. À notre arrivée, les trois quarts du personnel étaient mis gratuitement à notre disposition par une vingtaine de ministères. Nous avons souhaité appliquer la LOLF, rétablir les coûts et obtenir le transfert du personnel. Pour pouvoir accueillir les postes, il a d’abord fallu obtenir un décret portant organisation des services. Puis nous avons demandé le transfert des crédits correspondants et ces personnels sont devenus agents du Médiateur.
Parmi les 102 personnes qui composent la médiature, nous comptons un peu plus d’un quart de contractuels recrutés directement depuis 2004, un quart de personnels détachés par leur ministère – que nous remboursons –, un tiers de personnels mis à disposition, gratuitement ou non, par le secteur public comme par le secteur privé, et, depuis le 1er janvier 2009, les agents transférés par la Haute autorité de santé (HAS), qui, eux, se situent encore dans un no man’s land.
M. Jean-Paul Delevoye. Nous prenons en charge environ 150 à 200 000 euros de déficit de ce transfert de l’ex-MIDISS, et nous sommes en train de négocier avec le ministère de la santé pour clarifier les comptes. Nous avons mis en place une comptabilité analytique, avec un tableau de bord mensuel. Nous avons un indicateur pour notre programme budgétaire dans le cadre de la LOLF et 19 indicateurs pour nous-mêmes, et nous savons exactement où nous en sommes des flux et des stocks. Ces documents nous permettrent de suivre l’évolution des dépenses dans tous les domaines. Nous tenons des réunions de stratégie budgétaire et nous ne lançons une action – séminaire, colloque ou publication – que si notre budget le permet. Il existe donc un triple verrou : une décision politique, qui m’appartient, une décision technique, qui émane de mes collaborateurs, et une décision comptable.
À l’économie de 450 000 euros sur le loyer s’est ajoutée, l’année dernière, la suppression des surloyers. Mais nous avons créé des services nouveaux – à effectif constant, je le répète –, notamment un service de communication : les médias sont l’arme absolue du XXIe siècle et faire bouger les administrations suppose de les mobiliser. Notre service de communication est extrêmement modeste puisqu’il n’emploie que trois agents et que ses dépenses, hors frais de personnel, atteignent à peine 150 000 euros – 56 000 euros pour le rapport annuel, 80 000 euros pour les 20 000 exemplaires de la revue Médiateur Actualités et 10 000 euros pour certaines opérations, auxquels s’ajoutent quelques colloques grâce à la réserve parlementaire. Quant à notre dispositif d’information, très complet, il se compose de deux sites Internet – l’un pour la médiature proprement dite, l’autre pour le pôle santé –, d’une plateforme téléphonique, d’une plateforme médias, qui enregistre à ce jour 8 000 visites, d’un journal, d’une newsletter et d’un site Facebook.
M. Christian Vanneste, rapporteur. On a vu le cas de certaines autorités qui engageaient des batailles médiatiques sans toujours les remporter, par exemple parce qu’elles se heurtaient à l’opposition de l’institution judiciaire. Cela vous est-il arrivé ?
M. Jean-Paul Delevoye. Il nous est arrivé d’engager une bataille médiatique et de nous le voir reprocher. La première nous a opposé au Trésor public, qui utilisait de façon abusive le blocage des comptes pour le paiement des amendes. Il existe, je le rappelle, deux sortes de blocages : l’avis à tiers détenteur et l’opposition administrative. Dans un souci d’efficacité du recouvrement, les trésoriers bloquaient la totalité du compte au lieu de ne le bloquer qu’à hauteur de l’amende. Nous avons tenté, à plusieurs reprises, de persuader la comptabilité publique de revenir à un comportement plus normal, mais sans succès jusqu’à ce que nous alertions les médias. Quarante-huit heures après la parution d’un article dans Le Parisien, le problème était réglé auprès des TPG !
Il y a quatre ans, lorsque nous nous en sommes pris aux banques à propos du « malendettement » et du surendettement, la Fédération française des banques a réagi avec agressivité dès le lendemain. Aujourd’hui, nous disposons d’une loi sur le sujet. Sur la question des assurances-vie en déshérence, la Fédération des assurances a eu la même attitude que celle des banques, mais Axa et Aviva se sont rapidement rendues à nos arguments, reconnaissant qu’elles « gagnaient de l’argent » sur la gestion des risques et que par conséquent, elles devaient payer lorsque le risque se réalisait. Forts du soutien de ces deux grandes compagnies, nous avons pu travailler avec les parlementaires à une révision de la loi.
Or le problème numéro 1 de demain, en matière de santé, sera celui de l’assurance cependant qu’aujourd’hui, avec les opérateurs téléphoniques, les banques sont, à cause de leur comportement à l’égard des consommateurs, les meilleurs avocats des actions de groupe (class actions) !
Il nous est arrivé de corriger notre communication médiatique, des experts nous ayant signalé que certaines de nos affirmations n’étaient pas tout à fait exactes. Mais, précisément, ils avaient réagi parce que nous communiquions et nous n’en considérons pas moins que la peur des médias est le commencement de la sagesse. Soyons attentifs toutefois à ce que la peur du lynchage médiatique ne pousse pas les fonctionnaires à ne plus prendre de décisions. Depuis les dégâts causés par l’affaire d’Outreau, les magistrats redoutent de mettre un innocent en prison au point de prendre plutôt le risque de laisser un coupable en liberté ; le recours à la libération conditionnelle est menacé, tant l’on craint que ceux qui en bénéficient ne commettent un nouveau crime. Pour combattre les injustices manifestes et abolir les privilèges indus, les médias sont donc une arme absolue mais qu’il faut manipuler avec beaucoup de précautions, à cause de cette peur du lynchage médiatique qui paralyse les décideurs.
M. René Dosière, rapporteur. Votre indépendance s’est-elle heurtée à des limites ?
M. Jean-Paul Delevoye. Non, même lorsque nous avons adopté des positions un peu tranchées, comme dans le dernier rapport. Il nous est arrivé de déborder de nos frontières mais, si nous interpellons le politique, c’est pour mieux le restaurer dans ses prérogatives. Nous voulons lui poser les bonnes questions. Et, pour cela, nous nous interrogeons nous-mêmes en permanence : l’application de la loi est-elle juste ? Certains éléments – nos conceptions philosophiques, nos traditions, nos habitudes professionnelles, nos réflexes – ne perturbent-ils pas notre jugement, et sommes-nous aussi indépendants que nous le croyons ? Pour parer aux dérives, nous avons fait le choix de la collégialité. Lorsque j’ai un doute, j’interroge mes collaborateurs et nous confrontons nos jugements. Cela m’a conforté lorsqu’il m’a fallu user de mon pouvoir d’injonction contre des maires qui abusaient de leur mandat et refusaient un permis à un opposant politique. Je constate d’ailleurs une dérive partisane de l’administration locale, du fait des élus, mais aussi de la fragilité de leur administration, accrue par la complexité des textes. J’ai donc été amené parfois à prendre des décisions à l’encontre de mes propres amis…
Ce n’est donc pas à propos de l’indépendance que j’ai pu avoir des inquiétudes, mais bien plutôt au regard du principe d’équité. Sur ce sujet auquel Aristote et Platon ont réfléchi, le législateur de 1973 a bien compris que lorsqu’il vote une loi, il ne peut prendre en considération toutes les situations auxquelles cette loi s’appliquera, et qu’une application rigoureuse des textes peut alors entraîner une iniquité. C’est au Médiateur d’émettre une recommandation en équité, comme si le législateur tenait la plume, pour y remédier.
Je donnerai quelques exemples des problèmes ainsi posés. Le premier a trait à Metaleurop. Lors de la fermeture de l’entreprise, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, avait décidé de verser une prime de 15 000 euros à chaque salarié. Bercy a refusé de payer, au motif qu’aucune ligne budgétaire n’était prévue pour cela, mais a renvoyé le dossier au ministre responsable de l’aménagement du territoire – moi, en l’occurrence. J’ai donné des instructions en vue du paiement, mais le préfet responsable de la DATAR a refusé à son tour en invoquant sa responsabilité. J’ai signé, mais on aurait pu imaginer que l’on demande au Médiateur de la République une recommandation forte en équité.
Autre exemple : l’administration fiscale avait autorisé une entreprise libérale à exercer son activité hors taxes. Après quelques années, la règlementation ayant changé, l’administration demande à cette entreprise de passer au régime de TVA. Mais trois ans plus tard, lors d’un contrôle fiscal, elle lui réclame trois ans de TVA non facturée avant la recommandation ! Nous avons soumis le cas au ministre, qui nous a répondu que la loi ne lui permettrait pas de remettre les amendes relatives aux contributions indirectes, l’entreprise étant considérée dans ce cas comme percepteur, et non comme contribuable.
La recommandation en équité aurait-elle permis d’interpréter la loi pour exonérer du contrôle de la Cour des comptes ou de la hiérarchie ? Ce n’est pas évident. Elle a quelquefois été fragilisée par l’opposition de l’administration. Je travaillais donc avec Philippe Séguin sur cette question très complexe. Quoi qu’il en soit, on ne peut en vouloir à un fonctionnaire de ne pas signer.
Dernier exemple : nous avons été chargés par un ministère d’une médiation en vue d’indemniser des veuves d’agents tués dans l’exercice de leur mission. Ces femmes ayant laissé passer le délai fixé pour le recours en indemnisation, le ministre se trouvait dans l’impossibilité juridique d’accorder cette réparation qu’il jugeait moralement indispensable. Nous avons rédigé ensemble une recommandation en équité afin de transférer au Médiateur la responsabilité que le comptable du ministère aurait pu se voir imputer par la Cour budgétaire.
M. René Dosière, rapporteur. Lorsque je posais la question de votre indépendance, il s’agissait surtout de savoir si elle avait pu être bornée par une insuffisance de moyens.
M. Jean-Paul Delevoye. Cela n’a jamais été le cas. Il y a six ans, j’ai fixé la stratégie budgétaire de la médiature : nous établissons chaque budget en prenant pour hypothèse qu’il ne croîtra pas. Dans un souci de transparence, nous avons rendu à Bercy 2 millions d’euros, estimant qu’il était anormal, en période de crise, de laisser une telle somme sur un compte dormant. L’année dernière, nous avons également rendu 300 000 euros. Grâce à cette sorte de contrat de transparence, à la différence de certains, nous n’avons jamais rencontré la moindre difficulté avec le ministère du budget. L’année dernière, lorsque nous avons demandé 200 000 euros pour intégrer le pôle santé, nous les avons obtenus sans le moindre problème. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours joué cartes sur table. La culture qui consiste à dépenser coûte que coûte les crédits restant en fin d’année n’est pas la nôtre.
Soyons clairs : depuis la LOLF, la médiation, qui pourrait engendrer des économies pour le budget de l’État, est souvent moins intéressante pour le gestionnaire que la condamnation par un tribunal. Elle oblige en effet à demander l’ouverture de crédits. De la même manière, dans les commissions de conciliation pour la réparation des accidents médicaux, les assurances préfèrent la condamnation à la médiation. Pourquoi pensez-vous que les gendarmes ne vous demandent pas de payer vos contraventions par carte bancaire ? Simplement parce que Bercy imputait les frais de carte sur le budget de la gendarmerie ! Certains comportements de l’administration ne peuvent ainsi s’expliquer que par l’application stricte de la LOLF.
Votre décision de réduire le montant des amendes prononcées par un tribunal en cas de paiement immédiat, décision que je trouve très pertinente, a failli être mise en échec parce que les TPG refusaient de transférer les régies à l’intérieur des tribunaux, pour des problèmes de responsabilité ! Dans le domaine de la santé, messieurs les rapporteurs, vous devriez évaluer ce que coûte le traitement des recettes et des dépenses à l’intérieur de l’hôpital. La justice doit déjà plusieurs millions d’euros à la santé et il lui est difficile de trouver des médecins experts pour réaliser certaines autopsies, simplement parce que celles-ci ne rapportent que 200 euros à l’hôpital. Bien souvent, les administrations agissent en fonction des conséquences budgétaires qu’aura leur comportement, bien plus que de l’éthique professionnelle.
Le pouvoir d’injonction est un sujet qui mérite une réflexion approfondie. La médiation relève de l’incitation, non de la contrainte, et lorsqu’on donne un pouvoir à une autorité indépendante, il faut imaginer un contre-pouvoir, ce qui implique une perte d’indépendance... J’ai, par exemple, utilisé mon pouvoir d’injonction sous le gouvernement Raffarin : la France avait été condamnée pour un abus de rétention de terrain dans un département d’outre-mer. La famille lésée a obtenu réparation, la Cour européenne a condamné l’État français à verser 2 millions d’euros. Mais aucune des cinq administrations concernées n’a voulu payer. L’État a donc été condamné l’année suivante à verser 200 000 euros d’intérêts moratoires. J’ai rédigé une lettre d’injonction, et le Premier ministre a demandé à l’équipement de payer l’amende. Reste que j’ai des hésitations quant à cette procédure, que nous utilisons aussi pour faire respecter des décisions de justice.
M. René Dosière, rapporteur. Le regroupement auquel va conduire l’institution du Défenseur des droits conférera-t-il à ce dernier davantage de pouvoirs que n’en avait le Médiateur ? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients du nouveau dispositif ?
M. Jean-Paul Delevoye. Ce regroupement devrait donner au Médiateur de nouveaux moyens, comme la possibilité de consulter le Conseil d’État et celle d’intervenir dans les tribunaux, dans les procès, non à la demande des parties mais sous l’autorité des magistrats. Si Mme Claire Brisset avait défendu les enfants d’Outreau en tant que Défenseure des droits, elle aurait peut-être été davantage entendue.
Il faut distinguer la saisine, les pouvoirs et le périmètre d’action. Que le Défenseur des droits ajoute aux attributions du Médiateur de la République, outre celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), celles du Défenseur des enfants ne me choque pas, dans la mesure où la problématique de l’enfant ne se limite pas à l’enfant – elle concerne la famille, le logement, la société même. Le jour même où était présenté le projet de loi, je travaillais d’ailleurs avec la Défenseure des enfants sur la kafala et sur le droit de l’adoption.
Ne considérons pas la nouvelle institution comme un contre-pouvoir, mais comme le moyen d’un rapport nouveau entre l’autorité et l’individu – l’autorité étant de plus en plus fragile dans l’exercice de sa responsabilité, l’individu de plus en plus fragile face à cette autorité. Le fait de rassembler pour renforcer, plutôt que de diviser pour affaiblir, me paraît être une bonne démarche.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le regroupement pourrait-il, selon vous, s’étendre à la HALDE ou à la CNIL ?
M. Jean-Paul Delevoye. Il faut éviter l’effet masse et considérer les conséquences d’une telle démarche. S’agissant de la HALDE, le regroupement ne serait pas sans intérêt, car il permettrait de ne pas cantonner la défense des droits à la sphère publique. Mais cela pose aussi le problème de savoir si la HALDE doit être source de jurisprudence ou si son rôle doit se borner à une incitation à respecter la loi. Le débat est ouvert, dans les limites qu’impose le respect des conventions internationales et étant bien entendu qu’aucune des autorités ainsi regroupées ne devra avoir moins de moyens et de pouvoirs qu’elle n’en avait auparavant.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ma question portait plutôt sur la capacité qu’aura la nouvelle institution à traiter tous les dossiers jusqu’ici soumis à ces autorités.
M. Jean-Paul Delevoye. Je le crois possible. On peut toujours allier concentration et diversité. Quatre Ombudsmen cohabitent ainsi sous l’autorité de mon collègue suédois, travaillant dans des domaines transverses. Les entreprises, les administrations fonctionnent de cette façon. La RGPP nous y invite. Ce n’est pas la fusion qu’il faut rechercher, mais la complémentarité. Nous avons d’ailleurs déjà des échanges avec la HALDE et la CNIL.
Je m’inquiète par conséquent moins de ce rapprochement que des pouvoirs qu’il conviendrait de donner à la nouvelle institution. Le pouvoir d’inspection, en particulier, me paraît s’imposer, pour garantir l’accès aux documents. Mais se pose aussi le problème du délai de réponse des administrations. Si le ministère des finances se comporte de façon plutôt satisfaisante, les choses deviennent de plus en plus compliquées dans le secteur social. Or, alors que nous devons respecter un objectif de durée moyenne de traitement des dossiers, je suis totalement dépourvu si une administration met quatre ans pour répondre à notre demande. Certains nous ont demandé de ne surtout pas les obliger à le faire dans un délai prescrit, au motif qu’elles n’en ont ni le temps, ni les moyens. Mais comment, dans ces conditions, accéder à la vérité pour faire évoluer une situation ? J’aimerais donc disposer de deux pouvoirs : de celui d’accéder aux documents et de celui de contraindre les administrations à répondre.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Utilisez-vous votre pouvoir d’inspection et rencontrez-vous des difficultés à cet égard ?
M. Jean-Paul Delevoye. Non, essentiellement du fait de la coopération dont fait preuve l’administration. Je me suis rendu à Nantes pour vérifier le service central d’état civil et comprendre pourquoi certaines personnes ont tant de difficultés à obtenir une carte d’identité. Les fonctionnaires, qui voyaient bien que mon propos n’était pas de les condamner mais de cerner les causes de dysfonctionnement, m’ont ouvert le dossier d’un homme qui avait 66 femmes et 111 enfants, et cela de façon parfaitement légale ! En matière d’état civil, en effet, les tribunaux de grande instance n’étaient compétents que sur leur seul territoire et l’on pouvait donc faire enregistrer un mariage dans chacun sans craindre d’être découvert. Le procureur général de Nantes m’a suggéré une parade, consistant à centraliser les inscriptions sous son autorité. De retour à Paris, j’ai rendu visite aux cinq ministères concernés. Je leur ai demandé pourquoi ils laissaient subsister ce problème, dont ils avaient d’ailleurs connaissance. La difficulté n’étant que celle de se réunir, nous nous sommes retrouvés à la médiature et la question a été réglée. Mais, pensant rendre service au procureur général, j’ai eu le malheur de dire que cette idée, qu’on jugeait si bonne, venait de lui. Il a été muté quelques temps après (avec une promotion)…
M. René Dosière, rapporteur. La centralisation est maintenant acquise…
M. Jean-Paul Delevoye. Oui, en principe, les systèmes doivent s’interconnecter. Autre exemple: un habitant du Nord achète une voiture et obtient l’immatriculation de la préfecture ; il se rend en Espagne et, sur le bateau, il est arrêté par les douaniers espagnols, qui lui affirment que son véhicule a été volé en Belgique. Il conteste et présente sa carte grise, mais n’en fait pas moins trois jours de prison. À son retour, il attaque l’État français. Je suis saisi de l’affaire et j’apprends que le fichier Schengen des véhicules volés, accessible aux policiers et aux gendarmes, ne l’est pas aux agents des préfectures chargés de délivrer les cartes grises. Il nous a fallu six mois, avec le ministère de l’intérieur, pour régler cette affaire.
Cela fait trois ans que nous nous battons pour faciliter le renouvellement des cartes d’identité des Français nés à l’étranger – M. Sanguinetti, par exemple, n’a jamais pu obtenir la sienne, non plus que tel ancien ministre connu dont les parents sont nés dans un village polonais détruit par les nazis… Nous avons obtenu une, puis deux circulaires ; Mme la garde des sceaux m’a reçu à ce sujet et le ministre de l’intérieur a adopté une circulaire, cosignée par le ministère des affaires étrangères. Huit jours plus tard, nous avons envoyé l’un de nos délégués dans une préfecture importante d’Île-de-France pour demander le renouvellement de sa carte d’identité. En dépit des circulaires ministérielles, il est reparti sans le document ! On peut comprendre l’exaspération des Français : ils entendent à la télévision des ministres faire des déclarations, et lorsqu’ils se rendent dans une administration, leur interlocuteur, dans l’ignorance du droit, leur tient un discours exactement inverse.
Nous essayons par ailleurs d’imaginer de nouveaux moyens de combattre les abus de services publics à des fins privées. Est-il admissible qu’un malade, dans un hôpital public, se voie réclamer 230 euros par un spécialiste, au motif qu’il s’agissait d’une consultation privée – ce dont on ne l’avait pas averti – ? Est-il admissible que ce même spécialiste effectue la totalité de ses consultations à titre privé alors qu’elles devraient être limitées à 20 % de son activité ? De même, est-il acceptable que les gros revenus de certains départements soient ceux de gens qui vendent des informations tirées des tribunaux du commerce, service gratuit ? En tolérant cela, on tolère un enrichissement privé sur le dos du service public.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous déjà été saisi des problèmes d’état civil qui se posent à Mayotte ?
M. Jean-Paul Delevoye. Oui. À Mayotte, où j’ai rencontré un monsieur Cuillère et une madame Fourchette, mais également en Guyane, au-delà du Maroni, où les hommes enregistrent leurs enfants sous les noms de Cahier, de Stylo… Mais nous connaissons aussi des dysfonctionnements en métropole, même s’ils sont plus limités. Un jour, un couple est venu me voir, totalement paniqué : ils voyaient le moment où leur fils ne pourrait épouser sa fiancée, l’état civil la déclarant déjà mariée. L’employé avait commis une confusion avec sa sœur jumelle et, pour éviter une réprimande de son supérieur, avait marié l’une et l’autre… avec le même homme, qui se retrouvait ainsi bigame sans le savoir. L’erreur a finalement été corrigée par le procureur, mais huit jours seulement avant le mariage, en raison des vacances.
Autre anecdote sur le même sujet : une jeune mère avait accepté que la maternité fasse enregistrer son nouveau-né. Quelques jours plus tard, elle apprend par la caisse d’allocations familiales que cela n’a pas été fait et que, le délai légal étant dépassé, il faut une rectification du procureur. Or celui-ci vient d’être muté, et le greffier en chef est en congé maladie… Il a fallu attendre deux mois et demi et une injonction forte de ma part pour que cet enfant soit inscrit. Que serait-il arrivé s’il était décédé entre-temps ? Il n’aurait eu aucune existence légale et aucune prestation familiale n’aurait été versée, les congés de maternité auraient été contestés…
J’en viens à un tout autre sujet : nous développons un réseau international. À ce titre, nous avons lancé des appels d’offres avec le Quai d’Orsay pour mettre en place des médiateurs. Et, hier, j’ai rencontré la Haute-Commissaire des droits de l’homme aux Nations unies qui nous a incités à demander une accréditation de statut « A » pour le Défenseur des droits.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous constatons que le nombre des saisines par l’intermédiaire d’un parlementaire diminue, tandis que celui des saisines directes augmente. Cela étant, comment les affaires qui vous sont soumises sont-elles traitées et résolues ?
M. Jean-Paul Delevoye. Certaines médiations se font par courrier ou par entretiens téléphoniques mais, souvent, une rencontre physique est nécessaire. Les tableaux que nous vous avons remis font apparaître les médiations « lourdes » et leur taux de réussite.
Par ailleurs, je souhaite indiquer que le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits interdit à celui-ci d’intervenir dans les litiges entre deux administrations. Cela nous pose un problème car Christian Le Roux, ici présent, a réalisé, entre Voies navigables de France (VNF) et une mairie, une médiation physique à l’enjeu financier important – il s’agissait de 5 millions d’euros – et des négociations sont de même engagées pour un transfert de patrimoine entre Réseau ferré de France (RFF) et des mairies.
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le Médiateur, nous vous remercions.
Audition de M. Roch-Olivier Maistre, Médiateur du cinéma, accompagné de Mme Isabelle Gérard, chargée de mission.
jeudi 25 mars 2010
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le Médiateur du cinéma, je vous souhaite la bienvenue. Je vous poserai deux questions principales.
D’abord, votre indépendance est-elle réelle, ou la jugez-vous limitée par votre statut ou par des moyens insuffisants ?
Ensuite, les missions qui vous sont attribuées nécessitaient-elles la création d’une structure particulière ? N’auraient-elles pas pu être assumées, par exemple, par une section du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), dont vous dépendez à certains égards ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le Médiateur du cinéma s’intéresse aux aspects commerciaux, non aux contenus : sa mission essentielle est de régler les conflits entre les exploitants de salles et les distributeurs. Or, vous avez traité l’année dernière cent quarante-quatre dossiers, chiffre record. À quoi cette forte augmentation est-elle due ?
Quelles améliorations pourrait-on apporter au fonctionnement, a priori plutôt satisfaisant, du cinéma en France, s’agissant de la production – qui est du ressort du CNC – et de la distribution ?
Enfin, aurez-vous la capacité de contribuer au maintien d’un nombre important de salles de projection, compte tenu du coût considérable des équipements dont il va falloir les doter au cours des prochaines années – ce qui risque d’ailleurs d’aiguiser les conflits entre petits et gros exploitants ?
M. Roch-Olivier Maistre, Médiateur du cinéma. Messieurs les rapporteurs, je vous remercie de me donner l’occasion de parler d’une institution peu connue du grand public, mais très appréciée par la profession.
Le Médiateur du cinéma a été créé en 1982, à la suite du rapport Bredin, dont les conséquences ont été extrêmement importantes pour l’industrie française du cinéma. L’un des enjeux de ce rapport était de répondre au phénomène de concentration. En France en effet, contrairement aux États-Unis, un exploitant de salle peut également être distributeur de films – c’est par exemple le cas d’UGC ou du groupe EuroPalaces, qui possède les enseignes Gaumont et Pathé –, situation susceptible de provoquer des déséquilibres dans la diffusion des films.
Le Médiateur du cinéma a alors été conçu comme une vigie indépendante, chargée de gérer ces problèmes de concurrence à mesure qu’ils se posent, c’est-à-dire au rythme de la programmation cinématographique, qui est hebdomadaire. La procédure judiciaire apparaissait en effet à la profession trop longue, trop coûteuse et trop complexe ; la mise en place d’une procédure précontentieuse était destinée à limiter les saisines des juridictions commerciales.
Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment de l’histoire du cinéma où un ensemble de problèmes nouveaux sont en train de surgir, et l’activité du Médiateur tend à s’amplifier.
Tout d’abord, nous assistons à une modernisation sans précédent du parc, avec les multiplexes apparus au début des années 1990. Il existe actuellement quelque cent soixante multiplexes, qui recueillent près des deux tiers des entrées et des recettes en France.
Ensuite, toutes ces salles proposent désormais des cartes d’abonnement illimitées. Ce système, inventé par UGC, a été repris par les autres groupes ainsi que par certains exploitants indépendants. En conséquence les multiplexes ne se contentent plus de proposer des productions pour le grand public, mais ils se doivent d’offrir à leurs abonnés l’accès à une gamme de films bien plus large ; ils concentrent une part croissante de l’offre cinématographique, empiétant sur le champ des salles d’art et d’essai, ce qui suscite des tensions nouvelles avec les exploitants indépendants.
Enfin, on entre dans la phase de numérisation des salles de cinéma, avec des enjeux financiers très importants et de nouvelles problématiques de distribution. Désormais, les distributeurs fourniront leurs films sous forme de fichiers numériques, dont le coût est marginal par rapport à celui des copies argentiques ; par ailleurs, la nouvelle chronologie des médias réduit la durée d’exploitation en salles, les films sortant plus rapidement en DVD ou sur d’autres supports. Il existe donc un risque de saturation des écrans par les mêmes films ; une partie de l’offre cinématographique, très abondante en France – plus de 600 films sortent tous les ans –, rencontrera des difficultés d’accès croissantes. C’est ce qui s’est passé avec le film Katyń, qui avait de surcroît fait l’objet d’une diffusion préalable à la télévision.
Après quatre ans de mandat, je crois pouvoir dire que le Médiateur du cinéma remplit une mission utile. Son indépendance est garantie statutairement, puisqu’il est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l’économie et des finances, après avis de l’Autorité de la concurrence ; il est choisi parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation. Il bénéficie du statut d’autorité administrative indépendante et ne rend de comptes qu’à lui-même, si je puis dire, et à la profession ; ses actes sont susceptibles de recours, mais il n’est pas placé sous une tutelle directe. Les professionnels du cinéma sont très attachés à la possibilité qui leur est offerte, à l’occasion d’un litige, de faire appel à un tel interlocuteur, choisi en raison de sa connaissance du secteur, mais qui, exerçant un autre métier et n’étant pas partie prenante dans les débats internes à la profession, peut « objectiver » le litige, rappeler les grands principes du cinéma, du droit commercial, du droit civil, et intervenir comme un juge de paix. Le CNC, au contraire, représente l’appareil administratif, celui qui fixe la réglementation et qui finance.
M. René Dosière, rapporteur. N’auriez-vous pas les mêmes possibilités au sein de l’Autorité de la concurrence ?
M. Roch-Olivier Maistre. Le sujet sera prochainement débattu au Parlement, à l’occasion de la ratification de l’ordonnance du 5 novembre 2009, modifiant le code du cinéma et de l’image animée. Ce texte a élargi et renforcé le statut du Médiateur : revenant sur ses relations avec l’Autorité de la concurrence, il en fait un régulateur sectoriel. Il lui donne la faculté de saisir cette Autorité des infractions au code du commerce dont il aura eu connaissance ; réciproquement, l’Autorité doit consulter le Médiateur sur les litiges concernant le secteur du cinéma.
Les procédures devant l’Autorité de la concurrence sont cependant rares, car elles sont longues et complexes – durant mon mandat, une seule a été engagée, qui a abouti à la condamnation d’un opérateur majeur du secteur, le groupe Ciné Alpes. Cette rareté s’explique : beaucoup de dossiers portent sur de petits litiges commerciaux, liés aux difficultés rencontrées par un exploitant pour obtenir d’un distributeur la copie d’un film, et ces litiges exigent une solution rapide. Par ailleurs, la profession ne souhaite pas exposer ses litiges sur la place publique : les exploitants ont besoin des distributeurs de films, et réciproquement.
Médiateur du cinéma n’est pas une fonction à temps complet ; mon prédécesseur était membre du Conseil d’État, je suis moi-même magistrat à la Cour des comptes – c’est ma collaboratrice, Isabelle Gérard, qui assure la permanence de l’institution pour l’instruction des dossiers. Mais, dans un univers éminemment passionnel, avec des enjeux financiers très lourds, il est important qu’un acteur puisse écouter les points de vue des parties, suivant une procédure contradictoire, et examiner les faits : si, par rapport au plan de sortie d’un film au niveau national, j’observe une anomalie frappante, je suis en droit de demander des explications au distributeur.
M. René Dosière, rapporteur. Lorsque vous lui demandez de corriger cette anomalie, le distributeur vous écoute-t-il ?
M. Roch-Olivier Maistre. Oui. Le simple fait que l’autorité existe évite bien des litiges. Chaque lundi matin, lorsque le bouclage de la programmation des salles donne lieu à des débats serrés, chacune des parties a la possibilité de menacer l’autre de « la mettre chez le médiateur » – suivant l’expression consacrée. Cela suffit bien souvent à régler le désaccord ; sinon, nous arrivons en général à trouver une solution, par la discussion ou par l’injonction.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Votre dernier rapport mentionne un taux de satisfaction des demandes de médiation de 63 %, en incluant les conciliations, les accords avant réunion et les injonctions. Cela signifie que 37 % des dossiers ne trouvent pas de solution. Qu’en advient-il ?
M. Roch-Olivier Maistre. Tout d’abord, certaines procédures sont abusives, et le désaccord en est la conclusion normale. Quelques exploitants bien connus ont des mœurs procédurières ; le fait que, dans ces cas, les dossiers n’aboutissent pas est un gage de la crédibilité de l’institution.
Par ailleurs, le législateur demande au Médiateur, non de juger, mais de mener une mission de conciliation. Le rôle du Médiateur est d’entendre les deux parties et de les aider à trouver une solution.
Si la discussion, les interventions du Médiateur et les rappels aux principes permettent d’aboutir à un accord, le procès-verbal établi par le Médiateur devient la loi des parties et met un terme au litige.
Si le désaccord persiste, le Médiateur constate le fait ; soit l’on en reste là, soit une partie souhaite aller plus loin et demande au Médiateur d’utiliser son pouvoir d’injonction, seule procédure contraignante dont il dispose. Dans ce cas, le Médiateur se substitue aux parties et impose une solution – sa décision étant bien entendu susceptible de recours.
Le cumul de ces procédures permet de trouver une issue au litige dans deux cas sur trois à peu près.
M. René Dosière, rapporteur. L’injonction est-elle obligatoirement suivie d’effet ? Quelles sont les sanctions possibles ?
M. Roch-Olivier Maistre. Je n’ai connu qu’un cas de refus d’obtempérer. On revient alors à un litige commercial traditionnel. En l’occurrence, l’exploitant a saisi en référé le tribunal de commerce, en présentant la médiation et l’injonction du Médiateur ; le tribunal de commerce lui a immédiatement donné raison et l’injonction a été rendue exécutoire sous astreinte.
Depuis plus de vingt-cinq ans que l’institution existe, les décisions du Médiateur sont respectées. C’est le fruit de son indépendance, et cela répond à l’intérêt de la profession comme à l’intérêt général : un exploitant peut difficilement rompre durablement avec un distributeur de film, même s’ils peuvent être ponctuellement en conflit ; il est alors bénéfique qu’une personnalité indépendante aide à régler le litige et à surmonter les conflits d’ego.
Pour résumer, les avantages du Médiateur sont multiples : il s’agit d’une procédure rapide – la médiation intervient quelques heures après la saisine et dure en moyenne une heure –, en prise avec le rythme de la vie cinématographique, simple – on saisit le Médiateur par téléphone, par courriel ou par courrier –, légère, gratuite – il n’y a pas de ministère d’avocat, ni de frais de justice –, confidentielle – le Médiateur et ses collaborateurs sont soumis au secret professionnel –, qui permet de trouver une solution sur mesure à un litige donné. Permettez enfin au magistrat de la Cour des comptes que je suis d’ajouter que le rapport coût/efficacité est particulièrement avantageux, puisque nos charges permanentes sont réduites à deux salaires et à l’indemnité mensuelle versée au Médiateur, le CNC mettant trois bureaux à notre disposition.
Durant les quatre années de mon mandat, par comparaison aux périodes antérieures, l’institution a connu une intense activité, qui est due à la transformation en profondeur de la vie cinématographique. L’année dernière, l’inquiétude a été grande chez les petits et moyens exploitants, face aux pratiques des distributeurs ; elle s’est logiquement exprimée par une sollicitation accrue du Médiateur, devant qui la parole est totalement libre. Cela contribue d’ailleurs à l’utilité de l’institution : le Médiateur est en mesure d’avertir la présidente du CNC des tensions qui se font jour dans la profession.
M. René Dosière, rapporteur. L’indépendance de l’institution ne souffre-t-elle pas d’un manque de personnel ?
M. Roch-Olivier Maistre. Statutairement, nous sommes une autorité différente des autres, au sens de la LOLF. Nous ne disposons pas de budget spécifique : le personnel est rémunéré sur les crédits du CNC, et nos dépenses de fonctionnement, très modestes, apparaissent sur les lignes budgétaires de ce dernier. Toutefois, nous ne sommes pas sous sa tutelle. Chaque fois que nous avons besoin d’une expertise technique, le CNC, la direction de la concurrence ou l’Autorité de la concurrence sont tenus de nous la procurer. Je ne sens donc pas le besoin d’une autonomie budgétaire.
Cela étant, l’ordonnance du 5 novembre 2009 affirme une volonté d’accroître les attributions et les missions du Médiateur, afin d’en faire un régulateur sectoriel plutôt qu’un juge de paix intervenant ponctuellement sur des litiges. Le CNC travaille en outre sur un projet de loi relatif au financement de l’équipement numérique des salles de cinéma en France, qui prévoit une intervention du Médiateur. Si cette tendance se confirme et que le nombre de saisines du Médiateur continue de s’accroître, la question des moyens se posera peut-être.
Pour l’heure, je reconnais que la charge de travail est intense, mais nous arrivons à y faire face avec les moyens qui nous sont alloués, en toute indépendance.
M. René Dosière, rapporteur. L’exercice de vos fonctions à temps partiel vous permet-il de répondre aux saisines en temps voulu ?
M. Roch-Olivier Maistre. Notre activité actuelle ne justifierait pas un emploi à temps complet. Elle est très liée aux caractéristiques du marché : d’une part, certains films sont demandés par tous les exploitants au même moment ; d’autre part, le calendrier des sorties est très irrégulier. Le Médiateur doit donc faire face à des pics d’activité, mais cela ne pose qu’un problème d’organisation professionnelle personnel. Grâce aux moyens de communication modernes, en particulier à Internet, je peux suivre aisément tous les dossiers. Les médiations ont presque toujours lieu dans la semaine de la demande.
M. René Dosière, rapporteur. Les professionnels, distributeurs et exploitants, sont-ils contents de votre existence et de votre fonctionnement ? Disposez-vous d’indicateurs permettant de mesurer leur satisfaction ?
M. Roch-Olivier Maistre. Nous ne disposons pas d’indicateurs. Toutefois, le hasard a voulu que je sois auditionné hier par la Fédération nationale des distributeurs de films et j’ai eu, une fois encore, le sentiment que la profession était sincèrement attachée à « son » Médiateur ; c’est quelqu’un qui les connaît, y compris individuellement, qui sait leurs problèmes, leurs usages, bref, qui « fait partie de la famille » – sans toutefois en être, ce qui lui donne un certain recul. De ce fait, il les aide à régler leurs litiges. Il ne s’agit ni d’une instance solennelle comme l’Autorité de la concurrence, ni d’une structure administrative comme le CNC. C’est la raison essentielle de son succès.
M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le Médiateur, nous vous remercions.
Audition de M. Denis Merville, Médiateur national de l’énergie, accompagné de MM. Bruno Léchevin, délégué général, et Stéphane Mialot, directeur des services.
jeudi 25 mars 2010
M. René Dosière, rapporteur. Nous vous remercions, monsieur le Médiateur national de l’énergie, d’avoir répondu à l’invitation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, pour cette audition par la mission sur les autorités administratives indépendantes.
Nos premières questions seront les mêmes que pour les autres autorités administratives : en quoi la création d’un médiateur national de l’énergie (MNE) était-elle nécessaire ? Ses missions ne pouvaient-elles pas être assumées par une autre structure ou organisme ? En quoi son rôle se distingue-t-il de celui de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et quelles relations entretient-il avec elle ? Par ailleurs, quels sont ses effectifs et quelles sont les prévisions d’évolution à cet égard ?
M. Christian Vanneste, rapporteur. En quoi les tâches du Médiateur national de l’énergie se distinguent-elles, non seulement de celles de la CRE, mais aussi de celles des médiateurs des différents fournisseurs d’énergie ? Dans votre activité, quelle est la part respective de vos deux missions, à savoir le règlement des litiges et l’information des consommateurs, dont les résultats sont peut-être plus difficilement mesurables ?
Enfin, pourquoi la durée moyenne de traitement des réclamations, déjà considérable, tend-elle à s’allonger ? Elle est passée de 4,8 à 7 mois entre 2008 et 2009. Pourtant, rapporté à l’effectif de 35 personnes dont vous disposez et que vous souhaitez porter à 50 personnes, le nombre de 13 000 dossiers recevables qui vous sont parvenus dans les onze premiers mois de 2009 n’est pas considérable, en comparaison des 76 000 qui ont été adressés au Médiateur de la République. J’ajoute que vos services ne traitent en définitive que 954 dossiers, dont 241 seulement débouchent sur des recommandations…
M. Denis Merville, Médiateur national de l’énergie. Je vous remercie de votre invitation, à laquelle je me présente accompagné de M. Bruno Léchevin, mon délégué général et, par ailleurs, conseiller spécial du président de la CRE, et de M. Stéphane Mialot, directeur des services.
Si le Médiateur de la République existe depuis plus de trente ans, la création du MNE ne remonte qu’à la loi du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie. Ce texte lui a confié deux missions : proposer des solutions aux litiges entre consommateurs et fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, et informer les consommateurs, notamment de leurs droits ou des démarches à accomplir dans le contexte nouveau résultant de l’ouverture des marchés.
En se dotant en 2006 d’un médiateur national de l’énergie, la France était en avance sur les directives du « troisième paquet énergie », demandant la création d’une instance indépendante – par exemple un médiateur – chargée de régler les litiges.
Notre première mission est donc de traiter les réclamations. Le nombre de celles-ci n’a cessé d’augmenter depuis ma nomination, en novembre 2007, et la mise en place progressive de mes services, qui n’ont été vraiment opérationnels qu’en avril 2008. Les unes parviennent au centre d’appels Énergie-info, ouvert le 1er juillet 2007 et commun à la CRE et au MNE ; les autres nous sont adressées par courrier ou par courriel. En 2009, nous en avons reçu près de 14 000, soit 116 % de plus qu’en 2008. Sur un nombre total de 5 111 saisines écrites, 1 294 ont été déclarées recevables au regard des critères légaux. Nous avons émis en réponse 279 recommandations.
Pour être recevable, une saisine doit nous parvenir moins de deux mois après la forclusion d’un délai de deux mois au terme duquel une réclamation adressée par un client à son fournisseur n’a pas été satisfaite ou n’a pas reçu de réponse. Dès sa réception, nous informons le fournisseur de la situation, ce qui l’incite parfois à traiter certaines demandes qu’il avait négligées. En 2009, nous avons trouvé une solution pour 73 % des saisines entrant dans notre champ de compétence.
Les litiges peuvent avoir trait à un problème de facturation – il arrive qu’aucune facture ne soit adressée pendant deux ans à un abonné, qui doit acquitter ensuite des arriérés considérables –, à un changement de fournisseur, à une mise en service, à une résiliation, à un dysfonctionnement des compteurs ou à une démarche commerciale particulièrement agressive.
Notre seconde mission, complémentaire de la première, consiste à informer les consommateurs de leurs droits, car ils ont du mal à appréhender la situation nouvelle. Si près de 55 % d’entre eux considèrent que les dépenses d’énergie ont une incidence sur leur pouvoir d’achat, plus d’un tiers ignorent la séparation intervenue entre EDF et GDF, et beaucoup la différence entre fournisseur et distributeur. Rares sont ceux qui, quelle que soit leur catégorie professionnelle, connaissent les démarches à accomplir en cas de déménagement.
Nous menons notre mission d’information en partenariat avec la CRE. Le centre d’appels Énergie-info répond à la volonté européenne de mise en place d’un guichet unique d’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. Il fonctionne du lundi au vendredi, de huit heures trente à dix-huit heures. Il reçoit 1 800 appels par jour. Un site Internet, qui héberge un comparateur d’offres ouvert en novembre 2009, permet aux consommateurs de s’informer à tout moment. Un guide pratique permettant de mieux comprendre le fonctionnement du marché de l’énergie a été rédigé en partenariat avec l’Institut national de la consommation (INC). Enfin, pour nous faire connaître du grand public, il a été décidé dès 2007 de mener une campagne d’information, qui n’a pu être lancée qu’en 2009.
J’en viens aux questions que vous m’avez posées.
Le MNE et la CRE font-ils double emploi ? Le Parlement a choisi de créer le médiateur alors que la Commission de régulation existait déjà. Ces deux instances, qui poursuivent un même but dans le domaine de l’information des consommateurs d’énergie, travaillent ensemble. D’ailleurs, le médiateur s’est mis en place avec le concours de la CRE, qui l’a notamment aidé à recruter son équipe. Le travail en commun est facilité par la double mission de M. Bruno Léchevin, chargé de la coordination entre les deux instances. Les missions du médiateur national de l’énergie et de la CRE sont cependant différentes. Ainsi, au sein de la CRE, le CORDIS, comité de règlement des différends et des sanctions, qui est chargé des conflits liés à l’accès au réseau, est une quasi-juridiction, ce qui n’est pas le cas du médiateur national de l’énergie, dont les recommandations, bien que largement suivies par les fournisseurs et les distributeurs, n’ont pas de caractère contraignant.
M. Bruno Léchevin, délégué général du Médiateur de l’énergie. Sur un sujet aussi complexe que l’énergie, il nous a semblé important d’instaurer, dans l’intérêt du consommateur, une cohérence entre les deux autorités indépendantes voulues par le législateur. La mission d’information leur étant commune, nous avons créé un guichet unique. Alors qu’il dépendait initialement de la CRE, le service Énergie-info est géré par le MNE depuis le début de l’année 2009, mais cofinancé à égalité par les deux autorités. Cette collaboration améliore le service rendu au consommateur, garantit la cohérence entre médiateur et commission de régulation, et obéit à un souci de bonne gestion de l’argent public.
Le service Énergie-info utilise trois médias.
Le site Internet propose, outre de nombreuses informations, un comparateur d’offres, d’autant plus utile que la possibilité de changer de fournisseur est nouvelle pour les Français. Mis en œuvre avec les acteurs du secteur – fournisseurs historiques ou alternatifs, CRE, associations de consommateurs, administration –, le comparateur d’offres a trouvé son rythme de croisière. Lors de la campagne de communication, cet instrument s’est révélé être un outil pédagogique utile pour informer les consommateurs de leurs droits.
Un centre d’appels externalisé, qui gère 35 000 à 40 000 appels par mois, est installé dans la banlieue ouest de Paris. Un back office, ou groupe d’experts, traite les réclamations adressées au MNE, notamment celles des consommateurs victimes de vente sans commande préalable – de vente forcée –, ou par ceux qui découvrent tardivement qu’ils ne sont plus clients de l’opérateur historique.
Le MNE est compétent pour les litiges relatifs à l’exécution du contrat de fourniture mais pas pour les litiges liés à la formation du contrat ce qui est difficile à comprendre et regrettable du point de vue du consommateur. Cela dit, même quand la question d’un consommateur excède notre domaine de compétence, nous considérons que notre mission d’information nous oblige à lui répondre et à le conseiller, par exemple en lui indiquant la procédure à suivre.
M. René Dosière, rapporteur. Pour revenir à ma question initiale, fallait-il que le médiateur soit indépendant de la CRE ?
M. Bruno Léchevin. Plusieurs choix étaient possibles. On pouvait même imaginer que le médiateur, à l’instar du CORDIS, créé en 2006 et hébergé par la CRE, en constitue une troisième entité indépendante aux côtés du collège des commissaires. Toutefois, notre propos n’est pas de remettre en cause l’organisation voulue par le législateur, mais de trouver la meilleure synergie possible entre les deux instances qu’il a mises en place. Tel est le sens de la double fonction que j’exerce aujourd’hui.
M. Denis Merville. Les directives européennes de l’été 2009 ont préconisé la création d’un guichet unique et d’un médiateur afin d’apporter des réponses aux questions des consommateurs. Quand j’ai été nommé, mon premier interlocuteur a été Jean-Claude Lenoir, mon prédécesseur, qui a renoncé à exercer la fonction, l’estimant incompatible avec son mandat de parlementaire. Je me suis également mis en rapport avec les différents services existants, telles que la CRE et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). C’est ainsi que certains services du MNE et de la CRE ont pu être mutualisés. Mais, si nos missions sont complémentaires, le MNE a pour vocation première de s’adresser au grand public, ce qui n’est pas le cas de la CRE.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il existe aussi un médiateur à GDF et à EDF…
M. Denis Merville. Même si les grandes entreprises se sont dotées de médiateurs, l’existence d’un médiateur indépendant me semble indispensable. Celui-ci joue le rôle d’observateur et peut formuler des propositions. Par exemple, quand un fournisseur reconnaît qu’un usager a payé plus que son dû, nous jugeons inadmissible que celui-ci doive attendre neuf mois avant d’être remboursé. Nous estimons, dans un tel cas, que le remboursement doit être complété d’intérêts de retard ; si les opérateurs ne l’acceptent pas, nous pourrons proposer au Parlement une évolution de la législation. Un médiateur payé par une entreprise n’adoptera jamais une position semblable !
En outre, avant l’ouverture des marchés, un consommateur d’énergie pouvait déjà saisir un médiateur indépendant des médiateurs des entreprises publiques, en la personne du Médiateur de la République, qui ne pouvait toutefois être saisi que par l’intermédiaire d’un parlementaire.
M. Christian Vanneste, rapporteur. C’est de moins en moins le cas.
M. Denis Merville. Le médiateur de l’énergie, lui, est saisi directement par les consommateurs, qui lui adressent une copie de la réclamation préalable qu’ils ont envoyée à leur fournisseur.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Mais, dès lors que vous n’avez pas de vrais pouvoirs, votre mission ne se réduit-elle pas à faire du cocooning ?
M. Bruno Léchevin. Nous n’avons pas eu à regretter de ne pas disposer de pouvoirs contraignants. En 2009, environ 80 % de nos recommandations ont été suivis par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux. Par ailleurs, parce que nous sommes financés par de l’argent public, nous essayons de prendre en compte les réclamations qui nous parviennent, non seulement pour régler chaque différend, mais aussi pour en tirer des propositions générales afin de rendre le système plus vertueux. C’est pourquoi nous publions nos recommandations. N’ignorant pas les contraintes techniques et les enjeux économiques du secteur, nous nous inscrivons pleinement dans le dispositif de concertation mis en place par la CRE, en cherchant à améliorer les procédures sans créer pour cela une « usine à gaz ». L’expérience montre que notre posture, non de gendarme, mais d’observateur et de conseiller, est sans doute la bonne.
Un problème de fond, qui explique l’allongement de nos délais de traitement, doit cependant être signalé. Si nous recevons un nombre croissant de réclamations écrites – environ 6 000 par an –, c’est que les opérateurs n’ont pas suffisamment pris en compte la possibilité nouvelle offerte aux consommateurs de saisir le médiateur en l’absence de réponse favorable – ou tout simplement de réponse – de leur part dans un délai de deux mois. A titre d’illustration, 50 % des saisines déclarées recevables n’avaient fait l’objet d’aucun traitement préalable par les fournisseurs, pas même une simple réponse au courrier de réclamation. Le MNE n’entend pas devenir un service de réclamation externalisé pour les fournisseurs, qui se déroberaient à leurs obligations. Pour citer quelques chiffres, l’an dernier, le médiateur de GDF-Suez a traité 65 dossiers et celui d’EDF 550, alors que ces entreprises ont reçu plus de 300 000 réclamations écrites. Ainsi, très peu de dossiers remontent jusqu’aux médiateurs internes, qui jouent en fait le rôle d’une instance ultime d’appel qui ne peut pas intervenir la plupart du temps dans un délai de deux mois après la première réclamation.
M. Denis Merville. Le MNE n’a pas vocation à devenir un super-service de réclamations qui gérerait les 300 000 réclamations écrites qui parviennent au service clientèle des différents fournisseurs. Dans le rapport d’activité 2008 que je vous ai adressé, j’avais déjà souligné ce dysfonctionnement. Même quand les fournisseurs répondent aux réclamations de leurs clients, l’existence de différents niveaux de traitement – par les services locaux, régionaux, nationaux, ou par le médiateur d’entreprise – allonge leur temps de réponse. De ce fait, une saisine est recevable, au bout de deux mois, bien avant que le traitement du dossier ait pu aboutir en interne. Nous avons avisé les entreprises de la nécessité de résoudre ce problème, sachant que le délai de deux mois est peut-être un peu court. Les directives européennes de l’été 2009 mentionnent un délai de trois mois maximum.
Quel que soit le cas, nous accusons réception de la demande, avant de vérifier qu’elle est recevable. Même quand elle ne l’est pas, par exemple quand elle concerne la formation du contrat, nous essayons d’orienter le consommateur, puisque notre politique n’est pas d’exclure d’emblée les sollicitations qui sortent de notre champ de compétence. D’ailleurs, nous parvenons parfois à faire annuler certains contrats qui ont été quasiment imposés aux usagers. Si l’affaire est déclarée recevable, nous adressons des demandes d’observations au fournisseur. Mais celui-ci met souvent, ensuite, beaucoup de temps à nous répondre.
M. Bruno Léchevin. Le temps de réponse d’ERDF est aujourd’hui de 110 jours alors que nous lui demandons de répondre en 3 semaines !
M. Denis Merville. Il faut prendre des mesures afin que les réponses soient adressées plus rapidement. En ce qui nous concerne, nous avons recruté du personnel ; de leur côté, les entreprises doivent aussi faire un effort.
M. René Dosière, rapporteur. Quel est le profil des collaborateurs que vous avez recrutés ?
M. Denis Merville. Les collaborateurs qui traitent les dossiers sont principalement des juristes qui ont travaillé dans des associations de consommateurs, chez des opérateurs du secteur de l’énergie, ou au sein d’administrations comme la CRE ou la direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, du ministère de l’Écologie.
M. René Dosière, rapporteur. Ce sont des contractuels ou des fonctionnaires ?
M. Bruno Léchevin. À l’exception d’un fonctionnaire, tous sont contractuels. Leur contrat est de trois ans, renouvelable une seule fois. Nous cherchons à maintenir une certaine flexibilité, espérant que le système deviendra à la longue plus vertueux.
Nous espérons en effet que notre action permettra de diminuer le nombre de dossiers dont nous serons saisis, et ainsi les besoins de personnels de l’institution. À cette fin, nous avons opté pour la transparence. Nous publions des recommandations, mais nous donnons aussi une deuxième chance aux fournisseurs incriminés en leur adressant systématiquement une copie des dossiers qui nous sont adressés. Ce procédé donne d’assez bons résultats, ce qui réduit le nombre de recommandations nécessaires. Il ne faudrait cependant pas que toutes les réclamations aient à passer par le médiateur national de l’énergie pour être traitées convenablement !
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il serait intéressant que vous nous communiquiez tous les chiffres. Il existe visiblement un circuit court et un circuit long, ce qui explique la différence entre le nombre de réclamations qui vous parviennent et le nombre de recommandations édictées.
M. René Dosière, rapporteur. Comment et par qui est fixé le taux de prélèvement sur la facture d’électricité qui assure votre financement ?
M. Denis Merville : Notre budget ne correspond pas à un pourcentage de la CSPE, la contribution aux charges de service public de l’électricité. Il nous appartient de soumettre une proposition de budget au ministère des finances, avant novembre, proposition qui fait l’objet d’une négociation. Ainsi, pour 2010, notre budget est inférieur à celui de l’an passé, qui intégrait les frais de la campagne de communication prévue en 2007 mais menée en 2009 seulement.
M. René Dosière, rapporteur. Il faut bien que le taux de prélèvement fiscal soit fixé à un certain niveau pour assurer le budget qui vous a été attribué.
M. Christian Vanneste, rapporteur. En réponse à notre questionnaire, vous avez indiqué que le compte financier des revenus faisait apparaître en 2008 une capacité de financement de 1,876 millions d’euros. Il est tentant de penser que, si vous pouvez dégager un tel excédent budgétaire, c’est parce que vous aviez d’abord demandé un budget trop important.
M. Denis Merville. Les premiers arrêtés fixant nos premiers budgets ont été signés, l’un fin décembre 2007, et l’autre, le 31 décembre 2008. Ceci nous a obligés à fonctionner sur l’année courante avec le budget de l’année précédente. Celui de 2009 l’a été le 21 juillet, et celui de 2010, le 12 février 2010.
M. Bruno Léchevin. Pour éviter d’être en cessation de paiement au mois de mars 2010, nous avons différé le règlement de toutes les factures qui nous sont parvenues depuis le début de l’année.
M. Denis Merville. En 2008, la première année de fonctionnement, nous avons bénéficié d’un report important. Le total est venu en déduction de notre demande pour l’année suivante. Nous n’avons rien dépensé sur le budget 2007 (hormis la contribution au service Énergie-info géré à l’époque par la Commission de régulation de l’énergie) car nous n’avons pas recruté tout de suite, ni lancé la campagne de communication qui était déjà prévue dans le budget 2007.
M. Stéphane Mialot. Une fois notre budget approuvé par le ministre du budget, par le ministre des finances et par celui de l’énergie, nous recevons une subvention correspondant à la différence entre le budget prévu et le trop-perçu de l’année précédente. De ce fait, aucune réserve n’est constituée au fil du temps. L’institution ne dispose donc pas d’un fonds de roulement.
Le budget de 2007 ayant été versé au début de 2008, il n’avait pas pu être dépensé. Toute l’année 2008 s’est faite grâce à la subvention 2007. Nous avons ensuite assuré le début de l’année 2009 sur la somme de 1,8 million qui nous restait, puisque le budget ne nous a été versé qu’en juillet 2009. De même, pendant les premiers mois de 2010, en attente du budget, nous avons vécu grâce à l’excédent de 2009, sans pouvoir procéder à aucune autre dépense que le versement des salaires. La procédure est lente. Nous sommes sans doute pénalisés par le fait que nous sommes une petite institution aux yeux de Bercy, et que notre budget doit cependant être approuvé par trois ministres.
M. René Dosière, rapporteur. J’avais cru comprendre que votre budget était alimenté par un prélèvement fiscal opéré sur la facture.
M. Denis Merville. Il ne correspond cependant pas à un pourcentage de la CSPE qui nous serait attribué d’office.
M. Stéphane Mialot. Sur proposition de la Commission de la régulation de l’énergie (CRE), un arrêté ministériel fixe le montant de la taxe destinée notamment à nous financer. Celle-ci est actuellement de 4,5 euros par mégawattheure, ce qui correspond environ à 5 % de la facture d’électricité. Sont ainsi collectés 1,9 milliard d’euros. La subvention de notre institution ne représente qu’une part infime de ce montant.
M. René Dosière, rapporteur. Tout le reste va à la CRE ?
M. Bruno Léchevin. Non, le budget de la CRE est pris sur le budget de l’État.
M. Stéphane Mialot. Les sommes collectées retournent aux fournisseurs d’énergie ou vont à d’autres acteurs, puisque la CSPE finance principalement la péréquation tarifaire dans les systèmes insulaires (60 % environ) et les obligations d’achats (35 % environ), et dans une moindre mesure les tarifs sociaux d’électricité (4 %). La proportion qui nous est reversée correspondait environ à 0,1 % de la taxe en 2008.
M. René Dosière, rapporteur. Mais qui fixe ce taux de 0,1 % ?
M. Denis Merville. Quand le montant de notre budget est établi, on calcule le pourcentage de la CSPE qu’il représente à titre d’information. Il s’avère qu’il est de 0,1 % pour 2008 mais ce taux varie chaque année en fonction de notre budget approuvé et des sommes collectées par la CSPE.
M. René Dosière, rapporteur. Il est donc fixé a posteriori, comme le taux de TIPP des départements.
M. Stéphane Mialot. En réponse à vos questions préliminaires sur les différences de productivité apparentes entre le Médiateur de la République et notre institution, je tenais à souligner qu’il faut comparer le nombre de nos saisines avec les seules réclamations adressées au siège de l’institution du Médiateur de la République [13222 en 2009]. La majorité des 76 000 réclamations que vous évoquiez est adressée aux délégués du Médiateur de la République, près de quatre cents personnes. Il convient également de prendre en compte les différences de traitement des réclamations entre les institutions : nous avons une obligation légale d’adresser au consommateur une recommandation écrite et motivée, que n’a pas le Médiateur de la République.
M. René Dosière, rapporteur. Considérez-vous que certains pays européens constituent un exemple ou un contre-exemple en matière de médiation sur l’énergie ?
M. Stéphane Mialot. Les directives européennes demandant la mise en place de médiateurs indépendants de l’énergie ou un dispositif équivalent dans chaque État Membre datent d’août 2009. Seuls les pays qui avaient anticipé cette réglementation ont à ce jour mis en place une médiation de l’énergie : il s’agit à notre connaissance de la France et de la Belgique. La médiation belge fonctionne depuis le 21 janvier 2010 seulement, bien que son responsable francophone n’a pas encore été nommé.
M. René Dosière, rapporteur. Pourquoi avoir choisi d’installer vos bureaux dans un des quartiers les plus chers de Paris ?
M. Denis Merville. Nous nous sommes d’abord installés à proximité des locaux de la CRE qui nous apportait un soutien technique et logistique. Nous avons retenu la solution d’hébergement en centre d’affaires, sachant que cette situation était provisoire, puisque, n’ayant aucune visibilité sur les effectifs, il était difficile de signer un bail de 3 ans minimum. Disposant de plus de visibilité sur notre activité à partir de mi-2009, nous avons commencé à prospecter pour une location classique (3/6/9). La CRE nous a fait part de son projet de déménagement et il nous est apparu judicieux d’étudier un projet de locaux communs. La CRE nous a alors proposé à l’été 2009 de partager des locaux dans un immeuble rue Pasquier. Cette opération s’est réalisée à des conditions de prix et de taux d’occupation approuvés par France Domaine.
M. René Dosière, rapporteur. Êtes-vous soumis à une norme d’emploi en ce qui concerne vos effectifs ?
M. Bruno Léchevin. Chaque année, le plafond d’emplois figure dans l’arrêté qui fixe notre budget.
M. Denis Merville. Notre souci des fonds publics nous incite cependant à limiter les embauches, même lorsque nous pourrions recruter davantage.
M. Bruno Léchevin. Le recours aux contractuels permet de réguler les flux d’emplois en fonction de notre activité.
Par ailleurs, le fait que le médiateur et que le régulateur occupent le même bâtiment nous a permis de mieux négocier le bail et de mutualiser certains services généraux, comme le service informatique, l’accueil, le gardiennage, le ménage etc. En acquittant un loyer de 450 euros hors taxes par mètre carré, nous respectons notre objectif initial, qui était de ne pas dépenser plus de 500 euros.
M. Denis Merville. Des salles de réunion communes au MNE et à la CRE nous permettent de réunir facilement nos collaborateurs. En outre, nous avons supprimé le temps de transport entre les deux instances.
M. René Dosière, rapporteur. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie, accompagné de Mmes Christine Le Bihan-Graf, directeur général, Anne Monteil, directrice des relations institutionnelles et de la communication, et Nadine Redon, chef du service financier.
jeudi 1er avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous remercions, monsieur le président, d’avoir accepté notre invitation.
Ma première question concerne un éventuel regroupement. Nous avons auditionné la semaine dernière le Médiateur national de l’énergie (MNE). Est-il nécessaire de conserver deux instances distinctes ?
Comment comptez-vous répondre aux critiques formulées par la Cour des comptes au sujet de certaines pratiques commerciales touchant la formulation des contrats ?
Pouvez-vous nous apporter des précisions sur l’augmentation récente du prix du gaz et le processus de décision qui a conduit à cette augmentation ?
S’agissant de votre budget et de son évolution, on pourrait légitimement envisager que vos ressources reposent davantage sur votre autonomie financière. Qu’en pensez-vous ?
Les dépenses de l’autorité que vous présidez ont beaucoup augmenté – de 49 % en quatre ans –, en particulier les dépenses de communication qui correspondent à environ 11 % du budget de fonctionnement.
Enfin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, comme presque toutes les autorités administratives, vous avez une telle attirance pour les beaux quartiers parisiens ?
M. René Dosière, rapporteur. Je vous indique, monsieur le président, que cette audition sera rendue publique dans le cadre du rapport que nous établirons sur les autorités administratives indépendantes, mais nous vous en soumettrons auparavant le compte rendu.
M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est une autorité indépendante qui a été créée il y a une dizaine d’années dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, et ce en application des directives de 1996 et 1998. Les pouvoirs publics français étaient en avance – une fois n’est pas coutume – sur les obligations européennes, qui n’imposaient pas encore la création d’un régulateur. C’est seulement depuis 2003 que les pays européens sont obligés de se doter d’une autorité de régulation. Nous sommes donc aujourd’hui vingt-sept régulateurs. Nous nous réunissons à Bruxelles chaque mois, et chaque trimestre nous rencontrons la Commission européenne. C’est un élément important en matière de régulation.
La libéralisation des systèmes électriques et gaziers a pour objectif de créer un grand marché unique européen de l’énergie. La régulation de l’énergie n’est donc pas strictement interne. Elle est européenne, à tel point que le « troisième paquet énergie », voté l’été dernier, prévoit la création d’une agence européenne de coordination en matière de régulation de l’énergie, laquelle sera mise en place à la fin de cette année. Basée en Slovénie, cette agence regroupera l’ensemble des régulateurs et comprendra un conseil technique et un conseil d’administration composé des représentants des États ; elle réunira une cinquantaine de personnes et jouera un rôle en matière d’interconnexions.
Notre action ne se comprend donc que dans le contexte européen, qui représente une grande part de nos activités. Ainsi, les 131 personnes qui travaillent à la CRE consacrent environ 30 à 35 % de leur temps aux activités européennes, en participant à des réunions à Bruxelles et dans l’ensemble des pays européens.
La CRE veille à l’ouverture du marché du gaz et de l’électricité, et à la régulation des monopoles naturels que sont les réseaux. Elle élabore les tarifs d’accès et approuve chaque année les programmes d’investissement des gestionnaires du réseau de transport. Nous discutons régulièrement avec les maisons mères, EDF et GDF Suez, d’autant que nous limitons les responsabilités qu’elles détiennent en tant qu’actionnaires. Dans le domaine particulier de l’énergie, il existe une opposition entre le droit normal des sociétés et la pratique de la régulation, car le régulateur, d’une certaine manière, a plus de pouvoirs que l’actionnaire pour approuver les investissements.
S’agissant des tarifs de l’électricité, la CRE donne des avis au Gouvernement.
Pour ce qui est de ceux du gaz, un décret de 2009 donne au Gouvernement la responsabilité de recadrer chaque année les prix du gaz. Dans l’intervalle, il laisse la possibilité à l’opérateur GDF Suez de faire varier ses prix, à la hausse comme à la baisse, en fonction des prix d’approvisionnement basés sur les contrats à long terme. L’opérateur soumet ses propositions au régulateur, qui vérifie qu’elles correspondent bien à l’application de la formule de calcul.
L’augmentation du prix du gaz appliquée au 1er avril dernier comporte deux parties distinctes : 3,8 % concernent le gaz lui-même et 5,9 % portent sur les infrastructures – transport, distribution, stockage – et les frais commerciaux. En ce qui concerne la deuxième partie de l’augmentation, elle n’est pas laissée à notre appréciation : c’est, en effet, un arrêté de décembre 2009 qui en a fixé le niveau et la date d’application. D’ailleurs, l’augmentation aurait dû être appliquée le 1er janvier, mais les pouvoirs publics ont estimé qu’il était préférable de la reporter pour éviter qu’elle n’intervienne en période de chauffe.
Dans un souci de pédagogie et d’information, nous avons, le jour même de la délibération de la CRE, fait porter un dossier à l’ensemble des parlementaires, mais certains d’entre eux semblent ne pas l’avoir reçu.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Certains l’ont reçu, d’autres pas encore. Cela peut en effet prendre un certain temps.
M. Philippe de Ladoucette. S’agissant de l’opportunité d’un regroupement entre le médiateur et le régulateur, je vous rappelle que s’il existe deux entités, c’est que le Parlement en a décidé ainsi. Dans le projet initial, le médiateur devait s’appuyer sur les services de la CRE, mais, en décembre 2006, après des débats plutôt agités à propos de l’ouverture du capital de Gaz de France, le Parlement a décidé qu’il s’agirait d’une structure ad hoc. Actuellement, le médiateur dispose de son propre personnel et mène une politique active – trop peut-être... aux yeux de certains.
Faut-il continuer sur cette base ou regrouper les personnels au sein d’une même entité – qui pourrait être la CRE ? Je rappelle que nous partageons désormais nos locaux avec les services du médiateur. Cela dit, si les parlementaires faisaient le choix du regroupement, ils seraient confrontés aux réactions négatives des associations de consommateurs. En effet, le régulateur ne mène pas exactement la même politique que le médiateur : notre approche est plus strictement juridique que la sienne et nous restons plus volontiers dans le cadre qui a été fixé au départ, celui de l’ouverture du marché. Nous serions probablement considérés comme de moins bons défenseurs des consommateurs que le médiateur. À tort ou à raison, la CRE est perçue comme étant favorable à la libéralisation et au marché. Les associations de consommateurs, dont l’une des plus actives, Que Choisir, considèrent que nous sommes là pour encourager les gens à aller sur le marché, à quitter les tarifs réglementés ; ce n’est pas tout à fait exact, loin s’en faut, mais c’est la perception que certains ont de notre mission. À l’inverse, le médiateur apparaît comme un chevalier blanc, toujours prêt à défendre les consommateurs. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Un tel regroupement, qui aurait fort bien pu être prévu dès le départ, serait probablement une bonne solution sur le plan budgétaire, mais il entraînerait des réactions négatives en termes d’images.
M. René Dosière, rapporteur. Les autres pays européens disposent-ils d’une commission de régulation de l’énergie ?
M. Philippe de Ladoucette. La situation est très variable d’un pays à l’autre. En Grande-Bretagne, où il y avait un médiateur très puissant, assisté d’une équipe de 350 personnes, le système a été récemment changé car il coûtait trop cher.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Voulez-vous dire qu’ils ont supprimé la médiation ?
M. Philippe de Ladoucette. Il y a eu une intégration au sein des services du régulateur. Du reste, il existait des oppositions très fortes entre le médiateur et le régulateur.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ne peut-on envisager de séparer complètement la médiation de la régulation et d’intégrer la médiation dans un cadre beaucoup plus large : une médiation de la consommation, par exemple ?
M. Philippe de Ladoucette. Il existe une synergie entre notre équipe et celle du médiateur, de manière à ce que les préconisations de cette dernière ne soient pas totalement contraires à notre analyse de la réalité du marché. Je doute, pour ma part, de l’efficacité d’une médiation qui serait totalement extérieure au monde de l’énergie.
Mme Christine Le Bihan-Graf, directeur général. Il aurait été possible de considérer que l’Autorité des marchés financiers, en tant que régulateur financier, était en mesure de surveiller le marché de l’énergie. Le législateur n’a pas fait ce choix, au regard de l’extrême technicité du secteur de l’énergie et de la spécificité des problèmes qui s’y posent. Un médiateur de la consommation aurait beaucoup de difficultés pour s’approprier des sujets très techniques et fournir une véritable expertise au consommateur. Notre proximité avec le Médiateur de l’énergie nous permet de lui fournir cette expertise sans qu’il soit obligé de recruter des personnes spécialisées, ce qui ferait double emploi avec les experts de la régulation.
M. Philippe de Ladoucette. Au départ, c’est nous qui avons « agit en lieu et place » du Médiateur, avant de lui transférer une partie de l’équipe concernée. On ne peut traiter l’énergie sous le seul aspect de la consommation, du fait de la technicité des problèmes qu’elle pose : ainsi, la problématique des relations avec ERDF, domaine dans lequel intervient le Médiateur, n’est pas à la portée de personnes qui ne maîtriseraient que l’aspect consommation.
M. René Dosière, rapporteur. La synergie que vous évoquez est-elle liée à vos nouveaux locaux ?
M. Philippe de Ladoucette. Nous avons en effet déménagé il y a cinq semaines. Depuis 2001, nous occupions des locaux situés rue du 4 Septembre, près de la Bourse. Le bail arrivant à échéance, nous avons essayé de le renégocier, mais la baisse que l’on nous a proposée n’était pas suffisante par rapport aux offres que l’on pouvait trouver sur le marché immobilier – en raison de la crise financière. Nous avons donc déménagé rue Pasquier, dans un immeuble permettant de réunir les services du Médiateur et les nôtres ; au reste, France Domaine a considéré qu’il s’agissait d’une opération relativement exemplaire en ce qu’elle permettait une mutualisation.
M. René Dosière, rapporteur. Une mutualisation qui, compte tenu de la location de l’immeuble, est tout de même relativement coûteuse. N’aurait-elle pu être réalisée dans un quartier moins prestigieux ?
M. Philippe de Ladoucette. Contrairement à ce que l’on peut penser, le quartier central des affaires à Paris est l’un des moins chers de la région parisienne : notre loyer est de 449 euros le m2, contre 923 auparavant. Le quartier de la Défense était plus cher, et à Bercy nous n’avons pas trouvé de locaux. Si nous n’avons pas souhaité nous éloigner de Paris, c’est que nous comptons parmi notre personnel 50 % de jeunes femmes qui nous auraient probablement quittés si nous nous étions installés en banlieue. De plus, nous subissons la concurrence des entreprises de l’énergie, lesquelles offrent des salaires plus élevés ; nous avons du mal à conserver notre personnel plus de trois ans. J’ajoute que 85 % de notre personnel viennent du privé… et y retournent. Bref, nous avons besoin de garder nos compétences. Je vous indique que lorsque Charbonnages de France a déménagé à Rueil-Malmaison, ses effectifs ont considérablement diminué… Parfois, c’est la finalité recherchée, mais pas dans notre cas.
M. René Dosière, rapporteur. Que pensez-vous du financement de la CRE par les usagers ?
M. Philippe de Ladoucette. Depuis plusieurs années, nous essayons de sensibiliser le ministère des finances sur ce point. La CRE est en Europe l’une des deux seules autorités de régulation de l’énergie financée à 100 % sur le budget de l’État. Le sénateur Marini a essayé de faire évoluer les choses, mais les pouvoirs publics se sont toujours opposés à une modification.
Nos ressources pourraient en effet provenir d’un prélèvement – et non d’une taxe – sur les entreprises que nous régulons, c’est-à-dire les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. En 2008, nous avons estimé qu’un prélèvement de 0,10 % sur le chiffre d’affaires comptable des entreprises concernées – RGP Gaz, GrDF, RTE… – représentait pour nous 20,16 millions d’euros – 22 millions pour un prélèvement de 0,11 %. Ce pourcentage pourrait être soumis chaque année au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances, et permettrait de sortir du budget de l’État les crédits qui nous sont affectés – il s’agit certes d’une somme relativement faible, mais nous avons peu de poids pour négocier une augmentation.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait de dépendre du budget de l’État met-il en cause l’indépendance de la CRE ? Vous donne-t-on toujours les moyens de remplir votre mission ?
M. Philippe de Ladoucette. Au même titre que les autres administrations, nous sommes astreints au gel annuel des crédits.
Par ailleurs, nous avons un problème, que la Cour des comptes a souligné dans ses deux derniers rapports : depuis la mise en place de la LOLF en 2006, nous n’avons jamais réussi à combler notre retard de un million d’euros.
Enfin, nous serons bientôt confrontés à un problème d’emploi, dû à la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite « NOME »), que vous examinerez prochainement, et à la transposition du troisième paquet des directives européennes relatives aux marchés électrique et gazier, qui accroîtra nos responsabilités. Un audit réalisé par Cap Gemini sur l’optimisation de nos emplois devrait nous servir de base de discussion avec le ministère des finances ; en tout cas, pour les trois années qui viennent, nous avons besoin de dix-neuf emplois supplémentaires – chiffre d’ailleurs inférieur à celui déterminé par Cap Gemini. Bien que cette demande soit très modeste, le secrétaire général de Bercy nous a indiqué qu’il lui serait très difficile de la satisfaire dans la mesure où il doit appliquer un programme de suppression de 3 000 à 3 500 postes.
Sortir du cadre des règles de l’administration nous apporterait plus de souplesse, tout en laissant la main au Parlement et au Gouvernement. Il ne s’agit pas d’augmenter notre budget de façon considérable, mais de nous mettre à niveau et de sortir des règles extrêmement contraignantes du ministère des finances en matière d’emploi. Il serait plus intéressant pour nous de disposer d’une masse salariale que nous répartirions en fonction de nos besoins. Ce n’est pas le cas, chaque poste étant précisément défini. Ainsi, nous avons du mal à recruter des personnes entre quarante et cinquante ans, faute de pouvoir leur offrir une rémunération attractive.
M. Christian Vanneste, rapporteur. L’autonomie financière serait manifestement un plus. Doit-elle, selon vous, s’accompagner de la personnalité morale ?
M. Philippe de Ladoucette. Naturellement.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quelle différence faites-vous entre prélèvement et taxe ?
M. Philippe de Ladoucette. Dans mon esprit, le prélèvement sur le chiffre d’affaires des entreprises correspond à la rémunération d’un service, dans la mesure où notre action s’apparente à celui d’un actionnaire dans un système concurrentiel. Toutefois, comme il s’agit de monopoles naturels, il a été décidé de ne pas laisser ce secteur complètement dans les mains d’entreprises intégrées. Cela dit, si nous étions un cabinet d’audit, nous serions rémunérés, il ne me paraît donc pas anormal de prélever sur les entreprises une petite fraction de leur chiffre d’affaires, comme cela se passe dans les autres pays européens.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le million d’euros de retard ?
Mme Christine Le Bihan-Graf. Lorsque la LOLF a été mise en place, en 2006, les administrations et les structures qui dépendent de l’État ont eu de vives discussions avec la direction du budget pour définir leur base budgétaire. Celle de la CRE a été estimée à 8 millions d’euros, alors que 9 millions auraient permis de couvrir nos besoins. Par la suite, la direction du budget n’a jamais accepté de « rebaser » nos crédits de fonctionnement. La Cour des comptes, qui a contrôlé la CRE à deux reprises en deux ans, a parfaitement admis ce déficit structurel de un million d’euros. Notre président a alors fait le choix stratégique de réduire drastiquement toutes nos dépenses relevant du titre III. Aujourd’hui, dans le cadre de la négociation que nous menons avec le ministère des finances, nous sommes fiers d’avoir trouvé ce million d’euros en faisant des économies sur notre politique immobilière.
M. Christian Vanneste, rapporteur. C’était donc une incitation intelligente !
Mme Christine Le Bihan-Graf. Nous avons été incités à être performants, et les choix du président sont allés dans ce sens.
M. Jean Mallot. Je comprends mal la logique d’une commission qui n’a pas de personnalité morale et vit sur des ressources budgétaires. Qu’est-ce qui vous distingue d’un service du ministère de l’économie, mis à part la présence d’un président et d’un conseil d’administration ?
À un moment où l’on prive les collectivités locales de leur autonomie financière, quel est l’intérêt d’une autorité administrative indépendante, dotée de ressources propres et d’une personnalité morale ?
M. Philippe de Ladoucette. Cela correspond à une obligation européenne ! L’Europe a estimé que, en la matière, il ne devait pas y avoir de confusion entre le Gouvernement et l’action d’une autorité administrative indépendante. L’Europe, qui, jusqu’au troisième paquet, admettaient l’existence de deux régulateurs – l’administration et une autorité indépendante –, a changé d’orientation. Le troisième paquet, accepté par l’ensemble des vingt-sept pays, prévoit qu’il ne peut y avoir qu’un seul régulateur de l’énergie, indépendant des pouvoirs publics et ne recevant pas d’instruction du Gouvernement.
M. Jean Mallot. Tout cela est totalement fictif !
M. René Dosière, rapporteur. En tout cas, cela ne s’applique pas à toutes les autorités administratives.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Cette question est complexe, mais dès lors qu’il y a un marché européen, il doit y avoir une instance indépendante.
M. Philippe de Ladoucette. Qu’entendez-vous par fictif, monsieur le député ? Voulez-vous dire que le Gouvernement intervient dans nos décisions ?
M. Jean Mallot. J’ai du mal à croire que votre commission est totalement indépendante.
M. Philippe de Ladoucette. Nous sommes suffisamment indépendants pour exprimer parfois des avis différents des orientations retenues par le Gouvernement. Au cours des deux dernières années, nous avons à plusieurs reprises préconisé de modifier un texte proposé par le Gouvernement ou exprimé un avis négatif sur des sujets sensibles. Par exemple, s’agissant de l’éolien ou du photovoltaïque, nous n’avons jamais reçu la moindre directive de la part du Gouvernement. Notre collège est composé de personnalités venant d’horizons très divers qui sont très attachées à un respect de l’indépendance du régulateur.. J’occupe ma fonction depuis quatre ans et je n’ai jamais reçu la moindre directive de l’exécutif ou de la Présidence de la République, ce qui n’exclut pas le dialogue.
M. Christian Vanneste, rapporteur. La deuxième partie de l’augmentation du prix du gaz est bien décidée par le Gouvernement ?
M. Philippe de Ladoucette. En effet, cette augmentation a fait l’objet d’un arrêté de décembre 2009, pris après avis de la CRE.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Mais la décision appartient au Gouvernement. Ne serait-il pas plus logique qu’elle vous revienne ?
M. Philippe de Ladoucette. Je suis d’accord avec vous, mais je ne suis pas certain que le Gouvernement y soit favorable, pas plus d’ailleurs que les parlementaires. Beaucoup d’entre vous estiment en effet que la fixation des prix de l’énergie doit continuer à relever d’un arbitrage politique.
M. René Dosière, rapporteur. La part d’augmentation fixée par le Gouvernement, qui correspond au transport, à la distribution et au stockage de l’énergie, est de loin la plus importante. La Cour des comptes a fait un certain nombre d’observations sur les limites de votre évaluation. Avez-vous les moyens d’y répondre ?
En matière de fixation des prix, les organisations de consommateurs dénoncent une formule dépassée. Qu’en pensez-vous ?
M. Philippe de Ladoucette. Nous avons donné un avis favorable à l’arrêté de décembre 2009, et certaines de nos remarques ont été prises en compte. La règle est la suivante : avant de prendre une décision, le Gouvernement nous demande un avis ; ensuite il en tient compte ou non.
M. René Dosière, rapporteur. Que répondez-vous à la Cour des comptes, qui regrette les limites de votre contrôle ?
M. Philippe de Ladoucette. Selon la loi, nous pouvons approuver les programmes d’investissements annuels des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz, mais pas ceux des réseaux de distribution électrique – c’est une question qui intéresse beaucoup les élus locaux. Nous fixons certes un tarif global pour l’électricité – transport et distribution –, mais nous n’avons pas la possibilité d’approuver chaque année les plans d’investissements destinés au réseau de distribution : en ce domaine, l’actionnaire peut décider ce qu’il veut.
Pour résoudre ce problème, il pourrait sembler suffisant de donner à la CRE la responsabilité d’approuver tous les investissements d’ERDF. De fait, c’est un peu plus compliqué que cela car, en réalité, toutes les autorités concédantes sont parties prenantes. L’idéal serait de trouver un équilibre entre les besoins exprimés par les autorités concédantes sans que ceux-ci coûtent trop cher au consommateur, tout en respectant les droits de l’actionnaire. Personne n’a la solution. C’est cette complexité à laquelle faisait allusion la Cour des comptes.
S’agissant de l’augmentation du prix du gaz, les associations de consommateurs dénoncent une formule dépassée. Toutefois, cette formule n’existe que depuis quinze mois et prend en compte de façon correcte les coûts d’approvisionnement de GDF Suez jusqu’à la fin 2010. D’ici là, nous allons lancer un nouvel audit de cette formule.
Aujourd’hui, les tarifs réglementés du gaz augmentent tandis que les prix du gaz sur le marché spot sont en baisse. À cela, il y a une raison relativement simple : les tarifs réglementés sont fondés sur des contrats d’approvisionnement à long terme, issue de la volonté, exprimée il y a plus de quarante ans, d’assurer la sécurité d’approvisionnement des consommateurs ; ainsi, GDF Suez est lié par des contrats à long terme à ses fournisseurs historiques que sont Gazprom, l’Algérie, la Norvège et quelques autres.
La question qui se pose est de savoir si on peut continuer à vivre sur un système reposant sur des contrats à long terme liés au prix du baril de pétrole – qui passe de 145 à 35 dollars en quelques mois, avant de remonter à 80. En tout cas, c’est cette dernière augmentation qui est répercutée aujourd’hui, selon la formule « 6/1/3 », prix moyen lissé sur les 6 derniers mois, moins 1, pour une durée de 3 mois.
On pourrait certes introduire dans la formule une part qui refléterait le prix de l’approvisionnement sur le marché spot. Mais comment la fixer a priori ? Il faut que GDF Suez négocie avec ses fournisseurs pour obtenir qu’ils acceptent de prendre en compte un prix du gaz beaucoup moins intéressant pour eux – deux fois moins. Je doute que des fournisseurs comme Gazprom soient prêts à accepter de perdre la moitié de leurs ressources. Tout cela ne peut relever que d’une négociation complexe et difficile.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ce système de contrats à long terme mis en place pour le gaz est-il typiquement français ou existe-t-il dans d’autres pays, avec les mêmes conséquences ?
M. Philippe de Ladoucette. Certains pays sont beaucoup plus libéralisés que d’autres, mais tous les opérateurs européens sont liés à des fournisseurs qui, comme, l’Algérie, la Russie ou la Norvège, ont posé comme condition de départ d’adosser le prix du gaz à celui du pétrole.
C’est la première fois depuis la guerre qu’il y a une absence de corrélation entre le prix du gaz et celui du pétrole, et cela pour deux raisons : la crise financière, qui a fait chuté la demande de gaz au niveau mondial, et le fait que les États-Unis ont réussi à exploiter des gaz non conventionnels, issus du schiste, ce qui réduit leurs besoins en GNL. Aujourd’hui, des quantités importantes de GNL sont disponibles sur le marché, en particulier pour l’Europe et l’Asie. Dans le même temps, le prix du pétrole a augmenté. Bref, ce décalage crée une incompréhension dans le public, mais il repose sur une volonté de sécuriser les approvisionnements.
Je ne pense pas qu’on puisse imaginer de modification à très court terme, car si nous pouvons affirmer que le prix du gaz restera peu élevé sur le marché spot dans les deux ans qui viennent, personne ne sait ce qui se passera au-delà de 2012. L’expérience des vingt-cinq dernières années démontre que la plupart des prévisions en matière de prix de l’énergie se sont révélées fausses. Les grands groupes pétroliers et gaziers ont des opinions très divergentes sur cette question.
Intégrer dans la formule un élément lié au marché spot est probablement une très bonne idée car les consommateurs en bénéficieraient, mais s’en tenir uniquement au marché du spot comporterait un risque : le prix du gaz pourrait connaître de violents soubresauts, que, d’ailleurs, les associations de consommateurs ne manqueraient pas de dénoncer.
Ce que l’on appelle nos dépenses de communication couvrent certes des dépenses de communication, mais elles couvrent surtout des dépenses d’information – il y a une sorte d’abus de langage. Le « saut » budgétaire observé entre 2007 et 2008 est en grande partie dû à l’ouverture des marchés, le 1er juillet 2007, ainsi qu’à la mise en place du site d’Énergie-Info – qui a coûté 110 000 euros – et du centre d’appels destiné à répondre aux demandes du public, tout cela représentant une somme de 530 000 euros. En l’occurrence, il s’agit plus de dépenses d’information que de communication. En fait, le Gouvernement de l’époque n’a pas estimé judicieux, juste avant les élections présidentielle et législatives, c’est-à-dire dans une période particulièrement sensible, de lancer une grande campagne d’information pour présenter l’ouverture du marché au public français. Nous avons donc été amenés à prendre en main cette opération, en accord avec la DGCCRF et la direction générale de l’énergie, et avec votre collègue Jean-Claude Lenoir – à l’époque Médiateur de l’énergie –, mais qui n’avait ni budget ni personnel.
Voilà sur quoi porte la moitié de nos dépenses de communication. Le reste est essentiellement dédié à la publication de nos rapports – le rapport annuel, que la loi nous oblige à présenter au Parlement, et tous les rapports portant sur la surveillance des marchés, les interconnexions, les codes de bonne conduite –, pour un montant d’environ 120 000 euros.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Avez-vous évalué sur cinq ans les conséquences en termes d’effectifs et en termes de dépenses de la transposition du troisième paquet des directives européennes relatives aux marchés électrique et gazier et de l’application de la loi NOME ?
M. Philippe de Ladoucette. Une évaluation sur trois ans nous permet de chiffrer à dix-neuf le nombre de personnes supplémentaires nécessaires pour accomplir nos missions –notre équipe en comporte actuellement 131. En termes de budget de fonctionnement, nous estimons n’avoir pas besoin de crédits supplémentaires, du fait des économies que nous avons réalisées.
M. René Dosière, rapporteur. Les indicateurs budgétaires qui figurent dans les documents que vous nous avez transmis reflètent-ils correctement l’évolution de l’activité de la commission ?
M. Philippe de Ladoucette. Je vous le dis clairement, ces indicateurs n’ont pas grand sens.
M. René Dosière, rapporteur. Qui les a fixés ?
Mme Christine Le Bihan-Graf. Lors des discussions liés à la mise en place de la LOLF, la DRB – la direction de la réforme budgétaire – nous a interrogés sur la nécessité de ces indicateurs, tout en nous faisant savoir qu’il n’en fallait pas trop dans la mesure où le Parlement ne pouvait pas tenir compte de milliers d’indicateurs. Comme nous faisons partie du programme 134 avec l’ARCEP et l’Autorité de la concurrence, la DRB a proposé de mettre en place des indicateurs communs à ces trois autorités administratives indépendantes. Ces indicateurs, qui se devaient d’être assez rustiques, ont le mérite d’exister et nous obligent à une certaine vélocité, mais ils ne rendent pas compte de la spécificité de notre travail. Le rapport annuel que nous présentons à l’Assemblée nationale est une illustration plus pertinente de notre travail et de notre performance.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait d’avoir le mérite d’exister est-il suffisant ? Dans la logique de la LOLF, ces indicateurs ont un intérêt : ils permettent l’évaluation de résultats. S’ils ne servent pas à cela, on peut se demander s’ils sont vraiment nécessaires.
Mme Christine Le Bihan-Graf. C’est une indication d’efficience.
M. Jean-Pierre Brard. Je préfère l’« efficacité » à l’« efficience ».
Vous avez indiqué tout à l’heure avoir agi en concertation avec la DGCCRF, vous avez également souligné qu’à un moment le Gouvernement avait jugé qu’il n’était pas judicieux de lancer une campagne d’information. En tant qu’autorité indépendante, comment ressentez-vous ces avis extérieurs qui ne vous contraignent nullement ? On vous accuse à tort d’avoir décidé l’augmentation du prix du gaz. La réponse du Gouvernement hier dans l’hémicycle montre bien que vous servez d’alibi.
Quelles sont les personnalités qui composent votre institution ? Sont-elles toutes formatées de la même manière ? Quels sont vos critères ultimes ? Les dividendes ayant connu une augmentation très substantielle, comment expliquer ces 9,7 % de hausse ?
Dans le champ médiatique, vous êtes très exposé. Ne seriez-vous pas une cible injustement désignée ?
M. Philippe de Ladoucette. J’ai déjà répondu à beaucoup de ces questions.
La CRE est composée de neuf personnalités. Il y a deux représentants des consommateurs. Celui qui représente les consommateurs domestiques a plutôt une coloration « verte ».
M. Jean-Pierre Brard. Ces gens sont généralement favorables, par principe, à l’augmentation du prix de l’énergie.
M. Philippe de Ladoucette. Celui-là ne l’est pas vraiment : il est membre d’une association de consommateurs. Le représentant des gros consommateurs industriels, quant à lui, est tout à fait opposé à une augmentation des tarifs.
La commission comprend également deux membres du Conseil d’État, lesquels sont neutres par définition, une personnalité nommée par le Gouvernement, M. Jean-Christophe Le Duigou, qui est membre de la CGT, un ancien directeur de Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), un ancien industriel, M. Éric Dyèvre, et un ingénieur général des mines, Mme Anne Duthilleul.
M. René Dosière, rapporteur. Vos délibérations sont-elles généralement prises à l’unanimité ?
M. Philippe de Ladoucette. Pas toujours. Il y a beaucoup de débats et il m’arrive d’être mis en minorité, mais une fois les décisions prises tout le monde s’y tient.
M. Jean-Pierre Brard. Concernant le prix du gaz, avez-vous voté ?
M. Philippe de Ladoucette. Il n’y avait pas lieu de voter. Permettez-moi d’y revenir, cette augmentation se décompose en deux parties, l’une de 5,9 % fixée en décembre dernier par arrêté ministériel – à laquelle nous avons donné un avis favorable assorti de quelques remarques –, l’autre de 3,8 %, que nous avons décidée après avoir discuté en amont avec GDF-Suez pour arriver à un chiffre correspondant exactement à la formule transparente qui encadre la possibilité pour l’entreprise d’augmenter ou de baisser ses prix en « infra-annuel ». Il ne s’agissait pas de se prononcer sur l’opportunité d’un mouvement, mais de déterminer si ce mouvement correspond à la formule qui reflète le coût d’approvisionnement.
À un journaliste qui me demandait si cela me paraissait juste, j’ai répondu que ça l’était d’un point de vue comptable. Pour le reste, nous n’avons pas à porter de jugement moral.
M. René Dosière, rapporteur. Il ressort de vos propos que le Gouvernement, compte tenu de la période, vous aurait incité à renoncer à une campagne d’information...
M. Philippe de Ladoucette. Nous n’y avons pas renoncé : nous aurions souhaité que le gouvernement de l’époque lance une grande campagne de ce type. Comme nous n’avions pas les moyens financiers nécessaires, nous avons décidé de réaliser un site Internet où le public puisse trouver l’information. Nous l’avons fait en accord avec la DGCCRF et la direction générale de l’énergie.
M. René Dosière, rapporteur. Si vous aviez eu des recettes propres, auriez-vous éventuellement lancé une grande campagne ?
M. Philippe de Ladoucette. Oui, nous aurions pu le décider. Aurions-nous eu le courage de le faire en période électorale ? Je ne sais pas.
M. René Dosière, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le Président.
Audition de M. André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire, accompagné de MM. Marc Sanson, commissaire, Jean-Christophe Niel, directeur général, et Luc Chanial, secrétaire général
jeudi 1er avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Vous nous présenterez, dans un exposé liminaire, si vous le voulez bien, votre fonctionnement, votre bilan et vos perspectives pour l’avenir. Le rapport que nous remettrons à la fin de nos travaux comportera des préconisations en matière de regroupement, de définition, ou encore de moyens : aussi toutes les informations que vous pourrez nous donner sur ces sujets seront-elles les bienvenues.
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une des AAI les plus connues, tant elle est associée à une politique essentielle de notre pays et tant la question de la sûreté en ce domaine est importante dans l’esprit du public. L’épisode récent de la sous-évaluation du plutonium restant à Cadarache a soulevé quelques craintes. Il m’amène à vous interroger sur les relations entre l’ASN et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui est un établissement public sous tutelle ministérielle et qui vous apporte un appui essentiel.
Peut-être pourrez-vous aussi dresser une comparaison avec les dispositifs existants dans d’autres pays et évoquer le rôle que les AAI ont pu jouer lors d’incidents ou d’accidents.
Nous souhaiterions également obtenir des précisions au sujet de l’évolution de votre budget et de vos effectifs. Le taux de renouvellement du personnel atteint 15 % sur un an. Cela nous paraît relativement élevé.
M. René Dosière, rapporteur. Avant la création de l’ASN, le contrôle de la sécurité nucléaire était assuré par un service gouvernemental. Le transfert s’est-il effectué complètement ou subsiste-t-il, du côté de l’administration, des activités qui font doublon avec les vôtres ?
Par ailleurs, votre budget est réparti entre quatre programmes différents. Comment l’expliquez-vous ? Ne pourrait-on procéder à un regroupement ?
M. André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire. Une autorité indépendante comme la nôtre a le souci majeur de rendre compte, notamment au Parlement. Nous travaillons surtout avec l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques – OPECST–, qui est largement à l’origine de l’évolution que nous avons connue.
De service du ministère de l’industrie – le service central de sûreté des installations nucléaires, ou SCSIN –, nous sommes devenus une direction rattachée aux ministres chargés respectivement de l’industrie et de l’environnement, puis une direction générale rapportant également au ministère de la santé, et, enfin, en 2006, une AAI. Tout cela s’est effectué grâce à et sous le contrôle de l’OPECST et des parlementaires qui ont marqué son histoire en ce qui concerne les affaires nucléaires – Claude Birraux, Christian Bataille, Henri Revol, Jean-Yves Le Déaut – et qui ont toujours entretenu avec nous des relations suivies et critiques.
La mission de l’ASN est d’assurer, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. L’ASN contribue à l’information des citoyens.
Le contrôle des quelque 150 grosses installations nucléaires est l’activité la plus connue mais il convient d’insister sur la protection du patient et sur le contrôle du nucléaire médical. C’est l’ASN, par exemple, qui a découvert l’affaire d’Épinal.
Notre action s’articule autour de quatre valeurs. Deux qui vont de soi : compétence et rigueur ; deux qui sont parfois plus délicates : indépendance et transparence.
Pour ce qui est des 150 grosses installations, nous avons en face de nous EDF, AREVA, le CEA et l’ANDRA ; pour le reste, nos interlocuteurs sont les dizaines de milliers d’utilisateurs de sources radioactives, notamment pour les radiothérapies. Les deux secteurs sont donc de structures très différentes.
Nous nous efforçons de mettre en œuvre une conception élargie de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, c’est-à-dire une vision globale qui prend en compte non seulement les problèmes techniques mais aussi le facteur humain et les questions organisationnelles. La façon dont les gens se comportent et dont ils sont gérés est au moins aussi importante que l’aspect technique.
Nous exerçons les métiers classiques des autorités de contrôle : nous préparons la réglementation, même si c’est le Gouvernement qui signe la majeure partie de la réglementation générale ; nous délivrons la plupart des autorisations - le Gouvernement se réservant les autorisations jugées majeures et politiques - et nous effectuons 2 000 inspections par an.
Par ailleurs, nous sommes sans doute la seule Autorité administrative indépendante en France à disposer d’implantations régionales – onze divisions au total.
Notre effectif s’élève à 450 personnes, dont 200 réparties dans ces divisions régionales.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Parmi les quatre programmes entre lesquels votre budget est réparti, je note que le fonctionnement de ces divisions est inscrit au programme 217, « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer ».
M. André-Claude Lacoste. Une telle répartition entre quatre programmes rend très difficile la gestion globale de nos ressources : nos comptes sont dispersés et il n’est plus possible d’avoir une vision d’ensemble. Parmi nos effectifs, par exemple, une centaine de personnes sont mises à disposition par l’IRSN, conformément à la loi. Or elles émargent au plafond d’emplois de l’IRSN et ne sont pas décomptées dans le nôtre. Personne ne peut le déceler !
En matière de liberté de gestion, nous sommes au Moyen Âge par rapport à nos homologues étrangers. Par exemple, la loi qui institue l’agence fédérale suisse prévoit explicitement que celle-ci doit être gérée selon les principes de l’économie privée et que, quel que soit le sujet, les considérations de sûreté et de sécurité doivent prévaloir sur toute considération financière. Mon collègue suisse dispose donc d’une totale liberté de gestion.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Y compris en ce qui concerne les ressources financières ?
M. André-Claude Lacoste. Le problème est celui de la liberté de gestion. Ma collègue suédoise m’a récemment confié qu’elle avait pu embaucher un expert pour un salaire beaucoup plus élevé que le sien. Nous devrions nous engager dans cette révolution intellectuelle.
À preuve, le système officiel d’astreinte que nous souhaitons mettre en place pour que notre personnel puisse répondre à l’urgence. L’organisation actuelle est fondée sur le volontariat. Nous souhaitons l’asseoir de façon plus rigoureuse, moyennant un dispositif d’équipes d’alerte se relayant semaine après semaine et une compensation des contraintes qui s’ensuivent pour les agents. Le contrôle financier nous objecte que ce système revient à octroyer des primes supplémentaires à des fonctionnaires, ce qui suppose un décret puis un arrêté après consultation des comités techniques paritaires correspondants – sans doute ceux du ministère de l’économie et du ministère de l’environnement, auxquels nos agents ne sont pas représentés puisque nous avons notre CTP propre. Voilà plus de deux ans que nous sommes en négociation avec le ministère de la fonction publique ; il est heureux que notre système officieux fonctionne !
J’en reviens à nos effectifs. Outre les 450 personnes que nous employons, nous disposons au titre de l’appui technique d’un droit de tirage sur l’IRSN d’environ 400 personnes, si bien que l’effectif global que nous utilisons s’élève plutôt à 850. Sont également placés auprès de nous sept groupes d’experts où nous tenons à avoir autant d’experts étrangers qu’il est possible.
Nous nous impliquons beaucoup à l’international, où nous jouons un rôle important. J’y consacre environ le tiers de mon temps.
Il est pour nous primordial de rendre compte. Le danger qui nous guette est l’isolement. Nous avons donc une politique d’information et de publication très active. Nous présenterons le 7 avril prochain notre rapport annuel à l’OPECST lors d’une séance publique. Les lettres que nous envoyons à chaque entité inspectée sont publiées sur notre site, quel qu’en soit le degré de sévérité.
En conclusion, notre ambition est d’« assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime et crédible, reconnu par les citoyens et qui constitue une référence internationale ». Compte tenu de ce qu’est le parc nucléaire français, il nous apparaît que nous avons à jouer le rôle de deuxième autorité au monde. Nous nous situons face à l’autorité américaine, non contre elle : lorsque celle-ci prend des positions aventureuses, les autres délégations se tournent plutôt vers nous – nous sommes en quelque sorte le premier opposant.
Cela étant, l’harmonisation en matière de sûreté, dans laquelle nous investissons beaucoup, implique la constitution d’un pôle européen. Nous avons encouragé l’adoption de la directive européenne relative à la sûreté nucléaire en juin 2009. J’ai fondé il y a dix ans un club rassemblant les 17 chefs européens d’autorités de sûreté. Il regroupe tous les pays nucléaires d’Europe à l’exception de la Russie, de l’Arménie et de l’Ukraine, qui néanmoins sont associés en tant qu’observateurs – et je pense que l’autorité américaine demandera bientôt d’envoyer elle aussi des observateurs. Nous avons également créé un club européen des chefs d’autorités de radioprotection.
Je ne crois pas une seconde à la perspective d’une autorité européenne mais je crois à une forte harmonisation entre des autorités formant un réseau, partageant la même doctrine et s’échangeant des personnels.
J’insisterai enfin sur la question de la sécurité, c’est-à-dire de la résistance aux attentats, qui est historiquement du ressort des hauts fonctionnaires de défense. Dans 13 des 15 principaux pays nucléaires au monde, c’est l’autorité de sûreté qui s’occupe également de lutte contre le terrorisme. La France et … la Corée du Sud font exception.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Et en matière d’intelligence économique ?
M. André-Claude Lacoste. Il me faut préciser ce que j’entends par « lutte contre le terrorisme ». Il est hors de question que nous empiétions sur les tâches des services secrets, de la gendarmerie et de la police, mais force est de constater qu’aucun service n’est chargé de veiller à la sécurité des sources radioactives. Nous comptons sur un arbitrage de Matignon pour commencer à investir dans ce domaine.
M. René Dosière, rapporteur. Le « bricolage » budgétaire actuel n’est-il pas nuisible à votre fonctionnement ? Toutes ces discussions administratives ne favorisent pas un travail serein. Par rapport à l’exemple suisse que vous avez mis en exergue, on a l’impression que toute action suppose chez vous un ensemble de démarches compliquées.
Vous rendez un service important aux entreprises que vous contrôlez. Pourquoi n’assurent-elles pas en retour votre équilibre financier ?
M. André-Claude Lacoste. Nous nous efforçons de faire en sorte que notre situation budgétaire ne gêne pas les agents. Nous avons à leur assurer la sérénité qui convient pour qu’ils se consacrent à leur tâche. Par contre, la gêne est bien réelle en termes de gestion : nous consacrons un temps déraisonnable à des sujets qui ne le méritent pas. Nous nous retrouvons dans une position extraordinaire puisque nous ne discutons avec personne la plus grande partie de notre budget, même si le directeur de cabinet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) est un interlocuteur important. Nous ne savons pas réellement pas le montant du budget dont nous disposons : nous émargeons à des lignes qui ne sont pas les nôtres et nous ne les exécutons pas.
L’idée serait de regrouper tout ce qui nous concerne dans un programme dont j’aurais la responsabilité. Cela donnerait de la lisibilité pour ceux qui nous contrôlent, et permettrait de faire des arbitrages.
M. René Dosière, rapporteur. J’imagine que cette suggestion a déjà été formulée. Pour quelles raisons n’a-t-elle pas abouti ?
M. André-Claude Lacoste. On ne nous a pas dit pourquoi.
M. René Dosière, rapporteur. Une sorte d’inertie ?
M. André-Claude Lacoste. C’est votre appréciation.
M. René Dosière, rapporteur. Quel est votre interlocuteur ?
M. André-Claude Lacoste. Principalement le MEEDDM.
M. Jean-Christophe Niel, directeur général. Nous ne discutons vraiment que de la part du budget de l’ASN accueilli par le programme 181 et ce avec la direction générale de la prévention des risques, la direction du budget n’intervenant pas dans les éventuels arbitrages au sein de ce programme.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Qu’en est-il du rétablissement d’un prélèvement sur les organismes contrôlés ?
M. André-Claude Lacoste. Par le passé, nous émargions à un fonds de concours alimenté par une taxe que payaient les exploitants nucléaires. Après que le Conseil constitutionnel eut estimé que les fonds de concours étaient trop nombreux et qu’ils contrevenaient aux grands principes budgétaires, la taxe, qui rapporte 500 millions d’euros par an (taxes additionnelles comprises), a été affectée au budget général de l’État.
M. René Dosière, rapporteur. Ne pourrait-on supprimer cette taxe et considérer qu’un prélèvement sur les exploitants correspond au financement d’un service rendu ?
M. André-Claude Lacoste. Ce système existe dans plusieurs pays. Il ne me paraît pas très simple car il donne l’impression que le contrôleur est directement payé par les exploitants. Autant c’est admis aux États-Unis, autant cela poserait des problèmes en France.
Cela dit, si nous arrivions à nous raccorder d’une manière ou d’une autre à la taxe globale acquittée par les exploitants, nous serions dans une meilleure situation budgétaire, surtout si cela aboutissait à un programme unique.
M. René Dosière, rapporteur. L’ASN est une autorité sur laquelle nous souhaitons réaliser un travail approfondi. Dans la façon dont vous fonctionnez, il y a certainement matière à propositions. Tous les éléments qui pourront orienter notre réflexion seront bienvenus.
M. André-Claude Lacoste. L’essentiel de notre budget est consacré à la rémunération des personnels. Après l’extension de nos compétences à la radioprotection, nos effectifs ont doublé depuis 2002. Sans doute sommes-nous un des rares organismes à pouvoir affirmer que nous n’avons pas à nous plaindre en termes de dotation budgétaire : à mesure que l’on nous a confié de nouvelles responsabilités, on nous a donné les moyens de les exercer dans des conditions correctes.
M. Jean-Pierre Brard. Ne le dites pas trop fort !
M. André-Claude Lacoste. Il y a un minimum d’honnêteté...
M. Jean-Pierre Brard. En la matière, le maximum n’est jamais de trop !
M. André-Claude Lacoste. Il n’est pas neutre d’affirmer que l’on a les moyens nécessaires à l’inspection des installations, cela signifie que l’on assume ce que l’on dit.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Et pour ce qui est du taux de renouvellement du personnel ?
M. André-Claude Lacoste. Il tient à une de nos caractéristiques. Certaines autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection emploient leur personnel quasiment à vie. Cela a été le cas de l’autorité britannique, qui a de ce fait vieilli en même temps que le parc nucléaire qu’elle contrôlait, perdant toute distance. Nous sommes dans une situation inverse puisque nous embauchons des gens qui ne font chez nous qu’une partie de leur carrière, d’où cette rotation assez importante. Lorsqu’un jeune ingénieur de bonne qualité a fait quelques années à l’ASN, je l’incite à aller voir ailleurs pour revenir chez nous nanti d’une expérience supplémentaire.
Nous veillons à ce que la rotation ne soit pas trop rapide non plus, mais un taux de renouvellement de cet ordre ne nous fait pas peur. Si, contrairement à beaucoup de nos homologues, nous nous occupons des problèmes d’environnement autour des installations nucléaires, cela est largement dû au fait que nous accueillons des personnes qui, au début de leur carrière, se sont occupées de protection de l’environnement en tant que telle.
La comparaison avec les autorités des autres pays est difficile car les chiffres demandent interprétation. Nos collègues américains sont 4 000, par exemple. Alors que l’on ne construit pas de nouveau réacteur aux États-Unis, il a été créé un office spécialisé dans la surveillance de la construction des réacteurs pour lequel, en trois ans, ont été embauchées 400 personnes.
M. René Dosière, rapporteur. Vous avez donc une productivité bien supérieure !
M. André-Claude Lacoste. Toute modestie mise à part, les Américains nous le disent aussi. Mais leurs procédures entrent dans un luxe de détails qui, dans certains cas, nous paraissent attenter à la responsabilité des exploitants. Les Espagnols, quant à eux, emploient 450 personnes. Bref, nous ne sommes pas très nombreux mais, je le répète, nous ne nous plaignons pas.
En matière de statut, la tendance globale dans le monde est à se diriger vers des structures d’autorité indépendante ou d’agence fédérale à l’américaine. Notre situation, de ce point de vue, est satisfaisante.
J’en viens à votre question concernant le transfert survenu après la création de l’ASN en 2006. Avant la loi de 2006, notre activité était assurée par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, que j’ai dirigée. L’ensemble des personnels a été transféré dans la nouvelle autorité. Restait à mettre en place une courroie de transmission avec le Gouvernement. On a créé à cette fin, au sein de la direction générale de la prévention des risques, une mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui rapporte à trois ministres – industrie, environnement, santé – et qui comprend une petite dizaine de personnes. C’est elle, par exemple, qui vérifie au nom du Gouvernement nos projets de décret autorisant telle ou telle installation. Nous veillons bien entendu à ce que ces activités ne fassent pas doublon.
C’est le législateur qui a voulu que l’IRSN nous apporte un appui technique. Je vous renvoie au rapport remis en juillet 1999 par M. Jean-Yves Le Déaut, alors président de l’OPECST, où il répondait négativement à la question d’une éventuelle fusion avec l’IRSN en cas de création d’une autorité indépendante. Le système que l’on a bâti depuis lors repose sur l’existence de deux organismes ayant vocation à travailler ensemble.
M. René Dosière, rapporteur. À l’expérience, jugez-vous que cette séparation est judicieuse ?
M. André-Claude Lacoste. On pourrait imaginer un système plus simple où les 400 ingénieurs de l’IRSN – ou au moins une partie d’entre eux – travaillant pour l’ASN seraient chez nous. Cela étant, je constate que le système existant fonctionne.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quelle est sa justification ? Ne pourrait-on envisager de rattacher complètement l’IRSN à l’ASN ?
M. André-Claude Lacoste. Un des éléments soulignés par Jean-Yves Le Déaut était la différence de statut des personnels. À l’époque, l’IRSN se trouvait au sein du CEA. Mélanger des personnes qui sont majoritairement des fonctionnaires et des personnes relevant du CEA posait des problèmes majeurs. De plus, les agents de l’IRSN ne manifestaient aucune envie qu’une telle fusion se réalise. On aurait donc rencontré de graves difficultés, en particulier avec les syndicats. Avec Jean-Yves Le Déaut, nous nous sommes dis que la sûreté nucléaire méritait mieux que de devenir l’enjeu d’une lutte à couteaux tirés avec les syndicats.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Les oppositions sont donc plus sociales ou politiques que techniques.
M. André-Claude Lacoste. Beaucoup de gens estiment que la partie expertise de l’IRSN pourrait aller à l’ASN et la partie recherche au CEA.
M. René Dosière, rapporteur. Pensez-vous que vos exigences en matière de sûreté peuvent entraîner des difficultés pour le développement de la filière nucléaire française – je pense en particulier au retard du chantier de Flamanville et à l’échec de la vente de centrales à Abou Dabi ?
M. André-Claude Lacoste. Je n’ai pas participé aux négociations à Abou Dabi : ce n’est pas mon rôle, je ne suis pas payé pour promouvoir l’exportation du nucléaire français. Mon sentiment est que le marché d’Abou Dabi, comme celui d’Olkiluoto 3 en Finlande, est un marché de dumping où le gagnant est celui qui est disposé à perdre un certain nombre de milliards de dollars.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Un commentaire fréquent est que l’EPR est surdimensionné par rapport aux besoins d’Abou Dabi et que nous avons quelque peu perdu la main en ce qui concerne les équipements légers.
M. André-Claude Lacoste. La Corée du Sud présente des similitudes frappantes avec la France des années 70 : le programme de ce pays est lancé et permet un processus de standardisation puisqu’il est prévu de construire un réacteur par an. Dans ces conditions, il est facile de fabriquer à bas prix et d’exporter. Je ne crois pas que l’on puisse invoquer les considérations de sûreté pour ce qui est de l’attribution du marché.
L’EPR est un des premiers réacteurs de troisième génération : il a tiré les conséquences de Three Miles Island – gestion du cœur fondu et récupération du corium – et du 11 Septembre 2001 – résistance à la chute d’un avion. Le club européen des autorités de sûreté, WENRA – Western European Nuclear Regulators Association – a décidé de créer un groupe de travail consacré aux objectifs de sûreté des nouveaux réacteurs et a considéré, dans un projet de texte approuvé par les 17 membres, que l’EPR est représentatif de ce que l’on doit exiger des réacteurs que l’on construit actuellement. Nous espérons qu’une fois cela fait, nous arriverons à faire partager plus globalement dans le monde l’idée que ces objectifs de sûreté sont les bons.
Du reste, j’ignore ce que l’autorité d’Abou Dabi, qui est dirigée par d’anciens responsables des autorités de sûreté américaine et suédoise, exigera in fine du constructeur sud-coréen.
M. Jean-Pierre Brard. Est-il pour vous imaginable qu’un opérateur étranger ou privé puisse un jour construire ou exploiter une centrale en France ?
On connaît les péripéties traversées par la Russie. Je me rappelle une discussion surréaliste avec le directeur de la centrale de Tchernobyl en 1991 : il s’indignait du tintamarre international organisé autour de son usine, qui, selon, lui, ne marchait pas si mal ! Aujourd’hui, les Russes vous consultent-ils ?
Depuis Tchernobyl, l’opinion publique a toujours tendance à se demander si tout ce qui touche à la sûreté nucléaire n’est pas un peu frelaté. Personne ne remet en cause la compétence des personnes, mais la question de savoir si elles sont sincères et vraiment indépendantes par rapport au pouvoir politique est restée dans les esprits.
Votre mandat de président de l’ASN n’est pas renouvelable. Pensez-vous que ce soit une bonne chose, au regard des sujets très lourds que vous avez à traiter ?
M. André-Claude Lacoste. Qu’un exploitant étranger ou privé exerce en France, pourquoi pas, pourvu qu’il réponde aux critères énoncés par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et assume ses responsabilités pour la construction, l’exploitation et le démantèlement de l’installation. J’ai indiqué à plusieurs reprises que l’arrivée de GDF-Suez était tout à fait possible. Des exploitants comme EON et d’autres sont honorablement connus. Je ne vois pas pourquoi on refuserait leur arrivée en France dès lors qu’ils remplissent les critères.
Dans le cas particulier de Penly 3, l’État a décidé que la propriété de l’installation actuellement en construction serait assurée par une société de projet où EDF serait majoritaire mais qui associerait GDF-Suez et éventuellement d’autres acteurs. Nous avons été amenés à prendre position en affirmant que, si cette société de projet était retenue comme exploitant, il faudrait qu’elle se dote de l’ensemble des moyens nécessaires en propre : on ne peut imaginer que ce soit une coquille vide. La nationalité et le caractère public ou privé ne nous importent pas : ce qui importe, c’est que l’exploitant – en anglais licensee : celui à qui on donne l’autorisation – soit capable d’assumer ses responsabilités.
Pour ce qui est de Tchernobyl, nous sommes très conscients des conséquences qui en résultent dans l’opinion publique française. C’est pour cela que nous mettons en exergue notre indépendance : une indépendance que nous manifestions déjà avec notre statut antérieur et qui est maintenant encore mieux affirmée, en droit et en fait. Elle est manifestée notamment par le collège des cinq commissaires. Nous nous efforçons de construire cette indépendance, mais nous sommes conscients du handicap que constitue le souvenir de Tchernobyl dans l’opinion française.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Et celui de Cadarache, où le volume de matière résiduelle avait été largement sous-estimé ?
M. Lionel Tardy. Et les incidents à répétition du Tricastin ? Dans la Drôme, cela soulève beaucoup de questions et l’image est ternie pour un moment.
M. André-Claude Lacoste. Fin 2009, au cours du démantèlement de l’ATPu, l’atelier de technologie du plutonium de Cadarache, le CEA a trouvé davantage de plutonium que prévu dans les boîtes à gants. L’administrateur général adjoint du CEA m’a téléphoné un matin et nous l’avons rencontré le soir même : les résidus étaient trois fois plus importants que prévu. Nous lui avons demandé une déclaration formelle et avons décidé de suspendre les opérations de démantèlement avant d’y voir plus clair, ce qui nous semblait s’imposer. Le CEA a obtempéré, mais en grommelant. Depuis, il s’est avéré qu’il s’agit d’un problème générique : bien d’autres pays dans le monde, dont la Belgique, ont eu des difficultés à estimer le plutonium accumulé dans les boîtes à gants. Nous avons classé l’incident au niveau 2 et autorisé peu à peu la reprise du démantèlement. L’élément le plus étrange dans cette histoire est la mauvaise volonté du CEA, mais nous nous sommes expliqués à ce sujet.
M. Lionel Tardy. Ce que pense le grand public, c’est que si l’on n’avait pas retrouvé le plutonium dans les boîtes à gants, personne n’aurait su qu’il était perdu et qu’il aurait pu se retrouver n’importe où dans la nature.
M. André-Claude Lacoste. Il est sûr que le plutonium qui est dans les boîtes à gants ne peut pas se retrouver dans la nature – il n’empêche qu’il aurait été préférable que l’incident n’eût pas lieu. J’ajoute, s’agissant de plutonium, que notre contrôle de sûreté se double d’un contrôle des matières nucléaires qui n’est pas de notre fait. Il me semble donc que l’incident a été un peu monté en épingle. Le contrôle des matières nucléaires est mené par le HFDS – haut fonctionnaire de défense et de sécurité – du ministère de l’énergie, chargé de prévenir le détournement et la dissémination des matières nucléaire.
M. Jean-Pierre Brard. Comment expliquez-vous les grommellements du CEA ?
M. André-Claude Lacoste. Le CEA est une grande institution. Se trouver ramené à la qualité de simple exploitant soumis à notre contrôle peut parfois lui sembler contraire à sa vision de sa propre dignité. Mais cela ne pose pas problème : pour nous, ce qui importe est que les opérations de démantèlement aient été suspendues sur le champ.
M. Lionel Tardy. M. Proglio semble regretter que nous nous soyons focalisés sur l’EPR et que nous ayons perdu notre savoir-faire pour d’autres types d’installation, comme les centrales hydroélectriques. Dans ce contexte, qu’en est-il de la sécurité et de la durée de vie de nos centrales ? Les deux EPR qui sont en cours ne suffisent pas au renouvellement de notre parc, qui comporte une cinquantaine de centrales dont le vieillissement s’accélère. Comment voyez-vous l’énorme chantier des travaux de maintenance, dans lequel vous tenez un rôle important, et notamment l’intervention d’acteurs à la fois publics et privés ?
M. André-Claude Lacoste. La durée de vie d’une centrale est constituée par l’ensemble construction-exploitation-démantèlement. Vous parlez plus particulièrement de la durée d’exploitation : en France, la durée d’exploitation des centrales n’est pas fixée lors de leur autorisation ; elles sont soumises à un contrôle continu, ponctué par un rendez-vous décennal.
Nous avons actuellement à traiter deux sujets. Le premier est de savoir si les trente-quatre centrales de 900 mégawatts peuvent dépasser les trente ans. Nous n’y voyons pas de problème d’ensemble et allons maintenant prendre parti au cas par cas : les deux premières qui feront l’objet d’une prise de position par nous en 2011, seront Fessenheim 1 et Tricastin 1, et le processus s’étalera sur sept ou huit ans. Mais EDF nous demande aussi si les centrales peuvent aller au-delà de quarante ans – nous ouvrons tout juste ce dossier. EDF fait référence aux centrales américaines dont l’autorisation a été portée de quarante à soixante ans à partir de leur construction. Notre sentiment est que nous serons sans doute plus exigeant que les Américains sur ce point. En tout cas, l’autorisation sera donnée dans d’autres conditions que celles qu’ils ont retenues. Mais le sujet reste ouvert. Nous sommes conscients que les décisions que nous prendrons auront des conséquences directes sur les modes de production d’énergie en France et sur le renouvellement du parc.
M. René Dosière, rapporteur. Intervenez-vous en matière de contrôle des déchets ?
M. André-Claude Lacoste. Oui. Nous avons en particulier contribué à la mise en place du PNGMDR, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, sur une suggestion de l’Office parlementaire. Je copréside ainsi un groupe qui se réunit régulièrement pour élaborer ce plan et faire le point sur l’ensemble des déchets, de haute ou faible activité. Le plan est régulièrement mis à jour et approuvé par décret. Sa dernière version est en cours d’examen par l’Office parlementaire. Ce processus a par ailleurs débouché sur la loi de programmation du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. La France est très en pointe sur ce sujet. Je ne connais pas de pays où la gestion des déchets fasse l’objet d’autant de soin, de concertation et de prise en charge publique : par exemple, la loi prévoit la mise en exploitation d’un stockage souterrain des déchets de haute activité en 2025. Nous avons une véritable politique nationale en ce domaine.
M. René Dosière, rapporteur. Vous avez un rôle important vis-à-vis du grand public, qui pourtant vous connaît peu. Est-ce une difficulté ?
M. André-Claude Lacoste. Nous nous efforçons de beaucoup communiquer, mais surtout à destination d’un public averti : responsables politiques, associatifs, qui nous connaissent mieux et servent de relais. Pour être connu du grand public, il faut passer aux informations télévisées de vingt heures et cela ne nous arrive qu’en cas de difficultés.
M. Jean-Pierre Brard. Et la petite lucarne est toujours un calvaire pour les spécialistes, qui doivent résumer la matière en trente secondes devant un journaliste qui n’y connaît rien et cherche seulement à extraire un mot-clef. Comment faire de l’anticipation ? C’est très difficile, s’agissant de votre domaine de compétences, mais ne pas le faire serait vous exposer à des déboires certains en cas de pépin – car il y en aura forcément un, qui risquerait de faire exploser très vite le consensus français sur le nucléaire.
M. André-Claude Lacoste. Je n’ai pas de bonne réponse. Ce qui est sûr, c’est que nous investissons beaucoup dans la communication, et que nous consacrons un temps non négligeable au media-training. Chacun de nous ici autour de cette table est capable de répondre à un journaliste en moins de trente secondes, quel que soit le sujet – sans quoi nous n’aurions aucune chance d’être entendus. Par ailleurs, les simulations de crise que nous menons – une dizaine chaque année – prennent en compte la pression médiatique : des journalistes nous mettent à la torture, diffusent de fausses informations…
Par ailleurs, je vous indique que nous présenterons notre rapport annuel 2009 à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques le 7 avril 2010 à dix-sept heures.
M. Jean-Pierre Brard. L’Office est un organe d’une grande importance – j’y participe ! –, mais il me semble que vous auriez tout à gagner à ne pas vous limiter à ses membres, qui sont très « profilés ». Vous pourriez peut-être convier parfois les parlementaires pour des échanges informels, comme le fait régulièrement le CEA.
M. René Dosière, rapporteur. Des études comparatives avec les autres autorités européennes nous seraient utiles, si vous en disposez.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ainsi que le rapport de la Cour des comptes qui vous concerne.
M. André-Claude Lacoste. Je vous ferai parvenir tous les documents qui peuvent vous être utiles.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il nous reste à vous remercier d’avoir répondu à notre invitation.
Audition de M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de M. Philippe Distler, directeur général, et de Mme Claire Bernard, directrice des ressources humaines de l’administration et des finances
jeudi 22 avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation.
Nous nous posons plusieurs questions au sujet de l’ARCEP. Celle-ci dispose d’un collège de membres à plein temps. Qu’est-ce qui justifie cette spécificité ? Quelles relations cette autorité entretient-elle avec d’autres autorités administratives indépendantes comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ou la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), ou avec l’Agence nationale des fréquences (ANFR) ? Enfin, quelle est votre position à l’égard de la neutralité sur internet, qu’on appelle, en jargon moderne, la « net-neutralité » ?
M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Messieurs les rapporteurs, Messieurs les députés, je vous remercie de votre invitation.
Avant de présider l’ARCEP, j’ai exercé entre 1995 et 1998 les fonctions de commissaire à la réforme de l’État. Ma nomination à ce poste est intervenue un an après l’affaire du Crédit lyonnais qui a révélé l’importance de distinguer clairement, au sein de l’État, les administrations qui jouent le rôle d’actionnaire ou de tuteur d’entreprises publiques, et celles dont le rôle est de réguler un secteur. En effet, une même administration ne peut être à la fois « juge et partie ». Cette conclusion a conduit les pouvoirs publics – exécutif comme législatif, de gauche comme de droite, en France comme dans beaucoup d’autres pays, – à accélérer la mise en place d’autorités de régulation indépendantes. En outre, dans les secteurs qui s’ouvrent à la concurrence, l’existence de telles autorités est prévue par les directives européennes. Mais, indépendamment même des obligations communautaires, notre principe de droit national, celui de « bonne administration », conduit à instituer des autorités de ce type dans le secteur économique.
C’est dans ces conditions qu’a été créée l’ART, l’Autorité de régulation des télécommunications, devenue l’ARCEP. Les missions confiées à l’ART en 1996 par le Parlement ont été, pour une large part, menées à bien. Grâce notamment au dégroupage du réseau de France Télécom et aux obligations imposées par le régulateur, un véritable marché concurrentiel a été créé, pour les réseaux fixes et pour la téléphonie mobile. La concurrence a produit des effets favorables aux consommateurs. Notre pays connaît, en matière de téléphonie fixe, les prix les plus bas d’Europe. Dans le cadre des offres triple play, les consommateurs français ont accès, via l’ADSL, à l’internet, à la téléphonie et à la télévision, pour moins de trente euros par mois. Ce prix est deux fois inférieur à celui qu’acquittent les consommateurs de plusieurs autres pays d’Europe, et trois fois inférieur à celui que paient les consommateurs des États-Unis. Pour la téléphonie mobile, en revanche, le coût du panier moyen de consommation est légèrement plus élevé pour les Français que pour les autres Européens. C’est pourquoi le Premier ministre a décidé en août 2009 d’attribuer une licence de téléphonie mobile à un quatrième opérateur. L’ARCEP a été chargée de désigner le candidat retenu, en l’occurrence Free Mobile. Cela permettra de faire baisser les prix de ce secteur.
En 2005, les attributions de l’ART, qui est devenue ARCEP, ont été étendues à la régulation postale.
Enfin, l’ARCEP a pour mission de s’assurer que les obligations de service universel sont respectées dans le secteur de la téléphonie et de la poste.
Pour les années 2009-2010, les « grands chantiers » sont au nombre de quatre.
En premier lieu, la loi de modernisation de l’économie de 2008 et la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009 ont chargé l’ARCEP d’élaborer le cadre réglementaire du déploiement de la fibre optique. Celui concernant les zones très denses est entré en vigueur en janvier 2010. Dès février, les principaux opérateurs ont rendu publiques leurs offres d’accès. Prochainement, les grands opérateurs de réseaux fixes – France Télécom, SFR et Free – auront fait connaître les premières listes des communes dans lesquelles ils vont investir. Bouygues Telecom a aussi fait part de son intérêt en la matière. On peut donc considérer que le cycle d’investissement dans la fibre optique est lancé.
Nous préparons actuellement le cadre réglementaire pour le déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses du territoire, en cohérence avec le plan national du très haut débit présenté par le Premier ministre en janvier. Nous souhaitons que le déploiement soit mené parallèlement dans les zones très denses et dans les zones moins denses, dans lesquelles il sera toutefois plus long. Le très haut débit fixe sera complété par le très haut débit mobile. La loi relative à la lutte contre la fracture numérique prévoit à cet effet la création d’un fonds d’aménagement numérique des territoires, qui sera alimenté au départ par le grand emprunt.
Le deuxième chantier sur lequel nous travaillons concerne les fréquences. Après l’attribution d’une licence à un quatrième opérateur de téléphonie mobile, en janvier, nous attribuerons en mai le reliquat des fréquences de téléphonie mobile de troisième génération (3G). Les candidatures nous parviendront jusqu’au 11 mai. Pour la première fois en France, les licences seront attribuées par un mécanisme d’enchères.
Dès l’automne, nous procéderons à l’attribution des licences pour la quatrième génération de téléphonie mobile (4G), notamment les fréquences issues du « dividende numérique ». Cela permettra de déployer un réseau de téléphonie mobile de très haut débit. Conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique, le très haut débit mobile devra être prioritairement déployé dans les zones moins denses (contrairement à ce qui a été fait pour les réseaux 2G et 3G), notamment dans les zones non concernées par le déploiement de la fibre optique. Ainsi, pour le très haut débit, le déploiement du réseau fixe et celui du réseau mobile sont complémentaires.
Notre troisième chantier est la mise en œuvre de la loi postale votée en janvier 2010. Si l’ARCEP n’est pas concernée par la transformation du statut de La Poste, elle doit, en revanche, se doter d’outils pour mettre en place une régulation dans un secteur pratiquement sans concurrence, dont l’ouverture sera totale à partir du 1er janvier 2011. Elle veillera à ce que des opérateurs concurrents de La Poste puissent se développer sur le marché, tout en tenant compte du fait que cette entreprise connaît d’importantes difficultés dues à la baisse du trafic du courrier. Outre la recherche d’un bon niveau d’ouverture du marché, l’Autorité veillera au respect du service universel et évaluera le coût du maintien du réseau de proximité de La Poste.
Le quatrième et dernier chantier de l’ARCEP a trait à la transposition du nouveau paquet télécom voté en décembre par le Parlement et le Conseil européens. Ce paquet comporte deux volets. D’une part, il autorise les régulateurs, outre la régulation asymétrique qui conduit à des obligations spécifiques pour l’opérateur historique, à effectuer une régulation symétrique édictant, pour tous les opérateurs, des règles identiques, comme celles qui ont été mises en place, par exemple, pour le déploiement de la fibre optique. D’autre part, le paquet télécom appelle la transposition dans le droit national des principes de neutralité des réseaux, notamment d’internet. Le travail que nous menons dans ce cadre, depuis l’automne, en étroite relation avec le Gouvernement, nous a conduits à organiser, le 13 avril, un colloque qui a connu un vif succès et auquel plusieurs parlementaires ont assisté. Cette démarche nous amènera à édicter, au début de l’été, des lignes directrices, parallèlement au rapport que le Gouvernement remettra au Parlement au mois de juin.
En prenant mes fonctions, il y a moins d’un an, j’ai indiqué que l’ARCEP était une belle voiture de course qui, comme telle, nécessitait, de temps en temps, de menus réglages. Dès l’automne, en étroite collaboration avec le personnel, nous y avons pourvu, Philippe Distler, Claire Bernard et moi-même. Mises en œuvre au 1er janvier, ces décisions ont visé essentiellement à recentrer les moyens humains de l’Autorité sur son cœur de métier. Cette décision, qu’imposait le souci d’une bonne gestion des moyens humains de l’administration, nous a permis notamment de renforcer nos relations avec nos interlocuteurs extérieurs : opérateurs de télécoms, équipementiers, collectivités territoriales et consommateurs.
Par ailleurs, avec l’Autorité de la concurrence et la Commission de régulation de l’énergie (CRE), nous avons commandé une étude comparative sur les autorités administratives indépendantes de régulation économique des principaux pays européens. Elle nous est parvenue hier soir. Je vous remettrai, dans les jours qui viennent, cette étude. Elle montre clairement que l’ARCEP, l’Autorité de la concurrence et la CRE obtiennent, en termes de résultats et de productivité, de meilleurs résultats que leurs homologues britannique, allemande, italienne ou espagnole. Toutefois, il ne faut pas se contenter de cette bonne situation, laquelle, s’agissant de l’ARCEP a été saluée, en 2009, par la Cour des comptes ; nous devons bien entendu poursuivre nos efforts pour construire un État régulateur, à la fois pilote et stratège, à l’avant-garde de la modernisation de l’administration.
J’en viens aux questions que vous m’avez posées.
Vous avez rappelé en premier lieu que l’ARCEP possède un collège de sept membres à temps plein. Il me semble indispensable que les membres du collège des autorités indépendantes exerçant des fonctions de régulation économique, surtout dans des secteurs qui s’ouvrent à la concurrence, y exercent à temps plein. En revanche, on peut envisager de réduire leur nombre. Des membres exerçant à temps partiel devraient nécessairement avoir une activité complémentaire dans le secteur qu’ils connaissent, c’est-à-dire, assez logiquement, celui qu’ils régulent. Ceci introduirait un risque de conflit d’intérêts. Ce n’est pas par hasard si la loi interdit actuellement toute activité extérieure aux membres de l’ARCEP, afin de garantir leur indépendance.
Vous m’avez ensuite interrogé sur l’articulation de l’ARCEP avec d’autres autorités proches.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public, exerce au nom du Premier ministre une double mission.
Elle représente d’abord la France au plan européen et mondial en matière de fréquences, notamment auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT). En effet, les fréquences n’ont pas de frontières et une harmonisation doit être effectuée au plan européen voire mondial.
Ensuite, l’ANFR propose au Premier ministre une segmentation du tableau national des fréquences, qui constituent un des éléments du domaine public de l’État. Le spectre est ainsi réparti en trois grands blocs. Le premier, affecté aux besoins propres de l’État, par exemple en matière de sécurité et d’urgence, revient notamment aux ministères de la défense et de l’intérieur, ainsi qu’à tous les services d’urgence. Le deuxième échoit aux télécommunications, et le troisième à l’audiovisuel. Parce qu’il relève d’une mission régalienne et politique, le partage des fréquences entre ces trois blocs ne peut incomber qu’à une administration rattachée au Premier ministre. Une fois le spectre ainsi réparti en trois blocs, le bloc affecté aux télécoms est sous-affecté par l’ARCEP aux différents opérateurs, de même que la partie attribuée à l’audiovisuel est sous-affectée par le CSA aux opérateurs audiovisuels. Ainsi, les rôles respectifs de l’ARCEP et de l’ANFR sont clairement déterminés.
Nos relations avec cette instance sont bonnes. Nous sommes représentés à son conseil d’administration et aucune difficulté n’a jamais surgi entre nous.
Dans les pays développés, il existe divers schémas d’organisation en ce qui concerne la ou les autorités chargées des télécoms et de l’audiovisuel. En France, comme dans la plupart des pays européens, deux instances coexistent. En Allemagne, une même autorité régit tous les réseaux : énergie, télécoms, poste et transports ferroviaires ; mais cette structure très importante, qui emploie environ 2 500 personnes, est lourde et cette organisation n’est donc pas forcément optimale. Enfin, dans les pays anglo-saxons, la même autorité régule les télécoms et l’audiovisuel. S’inspirant de ce modèle, certains proposent de rapprocher l’ARCEP et le CSA. Cependant, si, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, l’État, par tradition, ne contrôle pas ou peu les contenus audiovisuels, tel n’est pas le cas en France. À cet égard, la loi de 1986 fixe des obligations importantes aux opérateurs audiovisuels, en matière, par exemple, de contenus culturels, de diversité culturelle ou de pluralisme. Ce contrôle est effectué ex ante et ex post par le CSA. Du fait de cette situation propre à la France et à une partie de l’Europe continentale, le régulateur de l’audiovisuel ne peut être assimilé à un régulateur, qui se bornerait à attribuer des fréquences, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons. L’importation d’un tel modèle en France confierait, en outre, à une autorité unique le soin de s’occuper de tous les contenants et de tous les contenus en matière de communications électroniques et audiovisuelles. Ce n’est pas impossible, mais il faut y réfléchir à deux fois avant de donner à un seul organisme des pouvoirs aussi importants.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Sur le plan non plus spatial mais temporel, qu’il importe de considérer, puisque le secteur connaît une évolution technique très rapide, la convergence n’implique-t-elle pas la concentration numérique ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Les experts estiment que, d’ores et déjà, l’audiovisuel constitue environ 90 % des contenus d’internet : il ne s’agit pas principalement de programmes, mais surtout de création et d’échanges de fichiers audiovisuels, d’accès à des sources ou à des bases de données audiovisuelles. En outre, les programmes de télévision linéaires ou délinéarisés parviendront aux usagers, de plus en plus, et, à terme, essentiellement par les réseaux filaires (ADSL, fibre) beaucoup plus que par les réseaux hertziens. Ainsi, même si l’on ne change en rien la mission de l’ARCEP, son rôle sera appelé à augmenter, car le régulateur des contenants ne s’occupe pas seulement de « tuyaux ». En matière de télécommunications, les opérateurs disposent d’équipements, associés aux « tuyaux », qui introduisent des différences de qualité dans le service. D’où l’utilité de la concurrence. Le rôle de l’ARCEP dans la régulation de l’écosystème d’internet s’accroît donc naturellement.
Toutefois, il restera toujours à effectuer un contrôle des contenus eux-mêmes : la question des temps de parole accordés aux partis politiques ou de l’expression des différents points de vue sociétaux et culturels n’a aucune raison de relever du champ des compétences de l’ARCEP. Le schéma de convergence que vous évoquez, s’il conduisait à avoir un seul régulateur des réseaux de communications électroniques, en l’occurrence l’ARCEP, devrait toujours comporter une autre instance qui régulerait uniquement les contenus, sans attribuer de fréquences, contrairement à ce que fait actuellement le CSA. Cette instance pourrait être autonome ou relever d’une autorité plus large chargée de défendre les droits et les libertés, ou encore faire partie d’une instance unique regroupant toutes celles régulant les contenus transitant sur les réseaux de communications électroniques (filaires ou hertziens) : CSA, HADOPI, ARJEL (jeux en ligne). On le voit, au-delà de critères économiques ou techniques, l’organisation à retenir relèvera d’un choix politique et donc, bien sûr, du Parlement.
En ce qui concerne l’articulation entre l’ARCEP et l’Autorité de la concurrence, je tiens à dénoncer une position erronée, émanant d’experts proches de la Commission européenne qui a, d’ailleurs, fait évoluer sa position d’origine. Selon cette approche, les autorités de régulation devraient se limiter à des secteurs monopolistiques qui s’ouvrent à la concurrence et, celle-ci une fois mise en place, les autorités devraient disparaître. C’est précisément l’inverse qu’on observe, par exemple, aux États-Unis : dès lors que la Federal Communications Commission (FCC), équivalente américaine de l’ARCEP, traite d’une question, la Federal Trade Commission (FTC), autorité de la concurrence, ne s’en occupe plus, se contentant de faire respecter la concurrence dans les secteurs où il n’y a pas d’autorité sectorielle. La spécialisation s’effectue par conséquent dans le sens inverse de celui qu’on nous présente comme irréversible. D’ailleurs, si les autorités de régulation sectorielle ne devaient exister que dans les secteurs non pleinement concurrentiels, il faudrait supprimer immédiatement l’Autorité des marchés financiers (AMF) et ajourner la création de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) des secteurs de la banque et de l’assurance, domaines concurrentiels qui n’ont jamais connu de situation de monopole. Il convient donc de mettre un point final à cette analyse erronée.
En outre, je souligne que les relations de l’ARCEP avec l’Autorité de la concurrence sont très fécondes.
M. René Dosière, rapporteur. Au cours des dernières années, des problèmes particuliers ont-ils affecté vos relations avec l’Autorité de la concurrence, dont les missions ne sont pas toujours très différentes de celles de l’ARCEP ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Nous n’avons rencontré aucun problème, puisque chaque instance prend des décisions dans son secteur. Le législateur a prévu la possibilité d’avis croisés qui permettent d’échanger des informations et d’adopter des positions cohérentes. L’Autorité de la concurrence nous saisit de questions concernant les télécoms, tandis que nous la sollicitons pour des dossiers qui posent des problèmes de pure concurrence. Toutefois, si le législateur français et les directives européennes ont tenu à mettre en place des autorités sectorielles, c’est parce qu’elles poursuivent un double objectif de mise en place d’un marché concurrentiel et de défense d’autres intérêts généraux. Ainsi, aux termes de la loi, l’ARCEP tend à assurer un bon niveau de concurrence, mais elle poursuit également d’autres objectifs fixés par le code des postes et des communications électroniques : aménagement du territoire, satisfaction des consommateurs, emploi et protection de l’environnement. En résumé, les opérateurs sectoriels doivent trouver un équilibre entre des objectifs de politique publique et le respect de la concurrence.
M. René Dosière, rapporteur.En tant qu’élu de la France profonde, j’aimerais savoir quelle part de votre temps et de vos moyens vous consacrez à l’installation du haut débit sur tout le territoire. De quels indicateurs de résultats disposez-vous dans ce domaine ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Je profite de votre question pour vous transmettre un tableau d’indicateurs de performances, qui fait apparaître des données en matière de gestion et de résultats. Nous consacrons une part importante de notre temps et de nos moyens à l’objectif de bonne couverture du territoire. Depuis 2000, grâce à l’ADSL et au dégroupage, la France possède un pourcentage d’abonnés au haut débit particulièrement important, qui est deux fois supérieur à celui des États-Unis. Parce que nous poursuivons notre action dans ce domaine et grâce au déploiement de la fibre optique, nous devrions parvenir à couvrir les zones blanches : environ 1,5 % des foyers ne sont, en effet, toujours pas couverts par le haut débit par ADSL. Enfin, nous menons avec les collectivités territoriales une action visant à favoriser le déploiement des réseaux d’initiative publique, qui sont autorisés par le code général des collectivités territoriales depuis 2004. Nous avons beaucoup milité pour que 2 milliards d’euros soient consacrés, dans le cadre du grand emprunt, à aider les collectivités territoriales et les opérateurs, notamment au travers des réseaux en fibre optique, à élever le débit dans les zones peu denses.
À la demande du Parlement, nous avons publié deux rapports en 2009 sur les réseaux mobiles. Le premier, au mois d’août, concerne la deuxième génération de téléphonie mobile (2G). Le second, en décembre, porte sur la couverture du territoire par les réseaux de haut débit de la troisième génération (3G). Il souligne le retard de deux opérateurs, Orange France et, surtout, SFR, sur les engagements qu’ils ont pris lorsque leur licence leur a été attribuée. L’ARCEP les a mis en demeure de le rattraper selon un calendrier précis ; elle a fixé un objectif intermédiaire dont la réalisation sera vérifiée fin juin. Depuis lors, nous avons constaté une accélération considérable des investissements de ces deux opérateurs dans le réseau de téléphonie mobile 3G et nous nous en félicitons.
En ce domaine, notre intervention relève de l’observation mais aussi de l’action, puisque la loi de modernisation de l’économie a doté l’Autorité de la possibilité non seulement de mettre les opérateurs en demeure, mais aussi de prononcer contre eux des sanctions financières, qui peuvent s’élever à 500 millions d’euros. Par ailleurs, nous effectuons une veille permanente auprès des consommateurs et des collectivités territoriales sur les zones du territoire dont la couverture est insatisfaisante. Même si nous sommes conscients que la téléphonie mobile ne parviendra sans doute jamais dans certaines zones retirées de montagne ou dans des vallées très encaissées, nous veillons, avec Michel Mercier, ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, à résorber progressivement les zones pas ou peu couvertes en matière de haut débit fixe comme de téléphonie mobile. En ce domaine, la couverture complète du territoire devrait être atteinte d’ici à 2013. Pour l’avenir, il s’agira d’être encore plus efficace pour la nouvelle génération du très haut débit fixe et mobile (4G).
M. Christian Vanneste, rapporteur. Dans quelle mesure prenez-vous en compte les questions sanitaires que posent certains groupements de consommateurs sur l’installation des antennes ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Les mêmes personnes demandent aux pouvoirs publics de veiller à assurer rapidement la couverture de l’ensemble du territoire en matière de téléphonie et à ralentir l’implantation d’antennes de radio-émission près des domiciles. Il faut réussir à concilier ces deux préoccupations, de prime abord, contradictoires.
À la demande du Gouvernement, une commission présidée notamment par le député François Brottes devait remettre ses conclusions en mai, mais Denis Rapone, membre de l’Autorité, qui suit particulièrement ces questions, m’a indiqué qu’elle ne le ferait pas avant l’automne. Le sujet est sensible et complexe. L’ARCEP, qui participe à la commission en tant qu’expert, lui a transmis des informations indiquant, par exemple, les conséquences de l’abaissement du seuil d’émission à tel ou tel niveau. Mais, in fine, l’arbitrage entre les deux objectifs, celui de réduction des émissions et celui d’accès à la communication, relève d’un choix politique, donc du Gouvernement et du Parlement.
M. René Dosière, rapporteur. Votre responsabilité en matière de couverture du territoire s’étend-elle à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Non, elle se limite à la métropole et aux départements d’outre-mer. Ces questions relèvent, en revanche, des compétences propres des anciens territoires d’outre-mer. Il incombe à leurs assemblées délibérantes de fixer les règles et les objectifs en la matière.
M. Philippe Distler, directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cependant, nous rencontrons régulièrement leurs représentants.
M. Jean-Ludovic Silicani. En effet, nous leur servons d’experts, mais nous n’avons aucun pouvoir de décision ou d’action en ce qui concerne leurs territoires.
M. René Dosière, rapporteur. Quel type de personnel recrutez-vous ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Avant d’arriver à l’ARCEP, vous le savez, je me suis intéressé à la fonction publique. J’ai d’ailleurs remis un Livre blanc au Gouvernement en 2008 à ce sujet. À la différence de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui emploie environ 80 % de contractuels, ou de l’Autorité des marchés financiers (AMF), où les fonctionnaires ne représentent que 6,5 %, l’ARCEP a fait le choix de l’équilibre, puisqu’elle emploie 45 % de fonctionnaires et 55 % de contractuels. Elle a autant besoin des uns que des autres : les premiers apportent la continuité et la connaissance des fonctions régaliennes, tandis que les seconds, plus jeunes, mettent à sa disposition leurs compétences techniques ou économiques, avant de poursuivre leur carrière dans le secteur privé. Plus de 80 % de nos agents appartiennent à la catégorie A/A+. L’Autorité dispose donc d’une administration d’état-major, qui comporte très peu de personnels d’exécution et regroupe essentiellement des ingénieurs, des économistes et des juristes. Enfin, l’équipe, réduite mais excellente, qu’anime Claire Bernard, assure son administration. Quand des postes sont à pourvoir, nous recevons un grand nombre de candidatures issues de l’administration ou du secteur privé. Dans le cadre de la réforme menée à l’automne en concertation avec les syndicats, nous avons harmonisé les régimes de rémunération des contractuels et des titulaires. Ainsi, depuis le 1er janvier, qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre catégorie, deux agents de l’ARCEP qui exercent la même fonction et obtiennent les mêmes résultats perçoivent une rémunération similaire.
M. Christian Vanneste, rapporteur. L’ARCEP est installée dans le quinzième arrondissement de Paris, dans un bâtiment dont le loyer s’élève à 478 euros au mètre carré, alors que les loyers du quartier s’échelonnent entre 280 et 440 euros. Ne pourrait-on réaliser quelques économies à cet égard ?
M. René Dosière, rapporteur. Et si le choix de tels locaux se justifie par l’obligation d’être situé dans un quartier central ou d’avoir pignon sur rue, pourquoi chaque membre du collège dispose-t-il d’une voiture de fonction ?
M. Jean-Ludovic Silicani. Le chiffre de 280 euros correspond, dans le quartier en question, à des immeubles vétustes impropres à accueillir des bureaux décents pour le personnel ou pour nos partenaires. Cela dit, en ce moment même, nous sommes en train de renégocier notre loyer avec notre propriétaire, la MGEN, qui est un propriétaire exigeant. Cette démarche est engagée sous l’égide de France Domaine, qui escompte parvenir à une baisse de 10 % à 15 % du loyer, qui serait ainsi réduit à environ 420 euros au mètre carré. Bien qu’il s’agisse d’un immeuble de grande hauteur, qui comprend donc beaucoup de locaux techniques et d’espaces de circulation non utilisés pour des raisons de sécurité, nous avons rationalisé son utilisation. Quant au parc automobile, il a déjà été réduit, mais je souhaite qu’il le soit encore. Nous nous employons actuellement à le faire, Claire Bernard et moi-même.
Par ailleurs, nous poursuivons une politique permanente de réduction de nos frais de communication, de représentation et de déplacement. Nos frais de représentation, d’un montant annuel de 190 000 euros, sont inférieurs au plafond fixé par la Cour des comptes, qui est de 200 000 euros, et les frais de missions et de déplacements, qui s’élevaient à 420 000 euros en 2007, ne dépasseront pas 300 000 euros en 2010. Je n’ai personnellement effectué, depuis ma nomination, il y a un an, que deux déplacements à l’étranger : l’un à Bruxelles auprès de la Commission européenne, l’autre à Genève pour une conférence de l’UIT.
Sur les dépenses de fonctionnement, qui se montent globalement à 22 millions, environ 14 millions sont consacrés à la masse salariale. Les 8 millions restants correspondent aux loyers, à des frais divers et aux marchés d’études : il s’agit de travaux d’expertises que nous externalisons pour économiser des emplois.
Nos dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) représentent 35 % de notre budget, alors qu’elles constituent entre 40 % et 50 % du budget des autorités comparables. Elles sont donc raisonnables, ce qui ne signifie pas qu’elles ne puissent pas être réduites. Quant à nos effectifs, j’ai proposé aux ministres de l’économie et du budget d’abaisser notre plafond d’emploi de 174 à 170 personnes, mais je n’ai pas encore reçu leur réponse.
M. René Dosière, rapporteur. Venons-en à vos ressources. Votre financement actuel convient-il aux missions que vous remplissez ? Ne pensez-vous pas que certains opérateurs pourraient vous financer par le biais d’une redevance, ce qui serait assez moral puisque vous travaillez pour eux, et votre autonomie comme vos moyens s’en trouveraient renforcés ?
M. Jean-Ludovic Silicani. L’expérience montre que nous sommes toujours parvenus à un accord avec la direction du budget sans demander l’arbitrage du Gouvernement, dont l’indépendance de l’Autorité pourrait avoir à souffrir. Sans doute nos propositions paraissent-elles raisonnables. Elles sont d’ailleurs assez stables, en dehors de la masse salariale qui évolue du fait de l’augmentation du point d’indice et de l’effet GVT.
M. Philippe Distler. Bien que la complexité des tâches de l’Autorité ait beaucoup augmenté depuis sa création en 1997, nous avons travaillé à effectif constant. En dehors de l’adjonction d’une quinzaine d’emplois sur trois ans pour pourvoir, depuis 2005, à la régulation postale, nous avons compensé l’augmentation de charge et de complexité en recrutant des personnels plus compétents et plus productifs, généralement de niveau bac + 5 minimum.
M. Jean-Ludovic Silicani. Nous n’avons jamais eu de « partie de bras de fer » à jouer avec la direction du budget. Le directeur du budget, comme le responsable du programme LOLF dont nous dépendons, qui est le secrétaire général du ministère des finances, et avec lesquels nous avons des contacts réguliers et fructueux, ont bien voulu tenir compte de nos efforts.
À titre personnel, je suis défavorable au principe d’un financement autre que budgétaire. Tout d’abord, notre système fonctionne bien, de sorte qu’il ne me semble pas nécessaire d’en changer. Si un autre financement était prévu, il prendrait nécessairement la forme d’une taxe, c’est-à-dire que, contrairement à une idée reçue, il n’entraînerait aucune diminution ni des prélèvements obligatoires ni de la dépense publique. En outre, il faudrait asseoir cette taxe sur une assiette stable, ce qui pose une réelle difficulté, si l’on veut assurer à l’Autorité des recettes régulières. Celle-ci ne devrait pas connaître les mêmes problèmes que l’AMF, qui a perdu une grande partie de ses réserves et qui aurait pu se retrouver pratiquement sans recettes si la crise avait duré une année de plus. Il ne me semble pas souhaitable qu’une mission régalienne de puissance publique soit financée, non par des impôts généraux, mais par des taxes prélevées sur les acteurs concernés : mieux vaut éviter, précisément au nom de la morale, de créer un lien entre l’instance qui contrôle et les personnes contrôlées, d’autant que celles-ci ne sont pas demandeuses – au contraire -, car la régulation réjouit rarement les acteurs économiques. Il serait aussi pernicieux d’imposer au citoyen de payer directement le policier qui le contrôle que de faire supporter par les opérateurs les frais de nos décisions de police économique. Enfin, puisque nous intervenons dans un secteur où la régulation est encore largement asymétrique – France Télécom représente la moitié du marché des télécoms, sur le fixe comme sur le mobile –, il faudrait trouver une assiette neutre afin que la source de financement ne puisse pas être impactée par nos mesures de régulation, car il faut absolument éviter que l’ARCEP soit incitée à prendre des décisions favorables à l’accroissement de ses recettes.
Pour toutes ces raisons, l’Autorité n’est pas favorable à ce que son financement provienne de ressources autres que budgétaires.
M. René Dosière, rapporteur. Nous vous serions obligés de nous transmettre l’étude comparative que vous avez mentionnée.
Madame, messieurs, nous vous remercions.
Audition de M. François Lagrange, président de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), accompagné de MM. Georges Vianès, vice-président, Bernard Rozenfarb, administrateur civil, Jérôme Pichonnier, attaché au chef de bureau, et Joris Dumazer, instructeur CNAC.
jeudi 22 avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Monsieur François Lagrange, vous êtes président de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), lieu de rencontre entre intérêt général et intérêts particuliers.
Pouvez-vous faire le point sur la situation actuelle de la CNAC ? Quelle réponse cette autorité apporte-elle à la mission qui lui est confiée et de quels moyens dispose-t-elle ? Comment expliquez-vous la disproportion entre les refus et les autorisations d’exploitation commerciale – car il semble qu’il y ait une inégalité de traitement ?
M. René Dosière, rapporteur. La CNAC n’établissant pas d’indicateur de performance ni de rapport annuel d’activité, comment le législateur peut-il évaluer l’efficience de votre mission ?
Compte tenu des moyens dont vous disposez, quel est votre niveau d’indépendance ?
M. François Lagrange, président de la Commission nationale d’aménagement commercial. Merci de nous accueillir. Nous sommes honorés d’être sous votre contrôle et de l’intérêt que vous portez à notre activité.
Je préside la CNAC depuis le mois de mai 2009. Je suis président de droit, cette fonction devant être exercée, aux termes de la loi, par un membre du Conseil d’État.
Je suis accompagné de M. Vianès, issu de la Cour des comptes, vice-président de la CNAC, de M. Bernard Rozenfarb, secrétaire général et cheville ouvrière de notre commission, et de ses deux adjoints.
La Commission nationale d’aménagement commercial a été créée par la loi du 4 août 2008 – cinquième loi sur le commerce depuis 1969.
Composée de huit personnes, la CNAC est saisie des recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), recours exercés contre les projets ayant pour objet la création ou l’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Une fois l’autorisation accordée par le préfet, un appel est formé devant la commission départementale, le deuxième devant la Commission nationale d’aménagement commercial. Jusqu’au 1er avril dernier, le troisième recours était exercé devant le Conseil d’État mais, depuis cette date, en vertu d’un décret sur lequel je me permettrai d’émettre quelques critiques, le tribunal administratif de chaque département est compétent après la CNAC. Le sont ensuite la cour administrative d’appel puis, enfin seulement, le Conseil d’État. Je reviendrai sur cette pyramide compliquée.
La CNAC est un organisme d’État. Si la loi ne l’a pas qualifiée d’autorité administrative indépendante, elle en est une dans les faits pour plusieurs raisons.
D’abord, si ses membres sont, comme pour toutes les commissions indépendantes, nommés par décret du Premier ministre, d’après la loi, la CNAC doit comprendre un président membre du Conseil d’État (nommé par le vice-président du Conseil d’État), un membre de la Cour des comptes (nommé par le Premier président de la Cour des comptes) et un membre de l’Inspection générale des finances (désigné par le chef de ce service).
En outre, quatre membres sont désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement.
Les nominations sont donc très objectives.
Ensuite, nous sommes nommés pour une durée de six ans non renouvelable. La Commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Enfin, nous ne rendons pas des avis, mais prenons de véritables décisions dans un contexte contradictoire, en entendant toutes les parties : le porteur du projet – celui qui souhaite créer sa surface de plus de 1 000 mètres carrés – ; le maire de la commune d’implantation ; les personnes ayant intérêt à agir, à savoir les concurrents.
Nos séances sont très longues et notre travail intense : nous siégeons environ tous les quinze jours, de huit heures et demie à dix-neuf heures.
Ainsi, nous avons toutes les caractéristiques d’une autorité indépendante et relevons certainement de votre contrôle.
La loi du 4 août 2008, qui a établi de nouveaux critères, est une bonne loi.
D’abord, l’article L. 750-1 du code de commerce indique que les implantations de plus de 1 000 mètres carrés doivent « contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur ».
Ensuite, l’article L. 752-6 du code de commerce définit des critères. Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale, la CNAC doit se prononcer sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Ainsi, les critères d’évaluation sont : l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, l’effet du projet sur les flux de transport, la qualité environnementale du projet, son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
Dans chaque dossier, nous regardons la zone de chalandise, mais – point fondamental par rapport au passé – nous ne regardons plus la concurrence en tant que telle.
Nous regardons de près la qualité de l’environnement et le développement durable, autrement dit l’effort en matière de consommation d’énergie. Sur ce point, les dossiers présentés sont assez bons et font apparaître un réel effort avec l’utilisation des nouvelles technologies, de systèmes informatiques pour réguler l’énergie, etc.
Nous regardons également le traitement des déchets, domaine très important s’agissant des grandes surfaces.
Par ailleurs, nous examinons les transports en commun, mais aussi l’accessibilité en voiture, la présence de parcs de stationnement et le volume de la circulation locale, sachant que la plupart des dossiers concernent aujourd’hui des villes secondaires ou moyennes, dans des zones relativement rurales, le plus souvent sans transports en commun.
Enfin, nous regardons de très près l’insertion paysagère, à laquelle les dossiers répondent malheureusement assez mal. Sur ce point, nous ne sommes donc pas souvent satisfaits.
Nous n’examinons pas la qualité architecturale, car ce n’est pas notre rôle – la loi ne le dit pas – et ne devons pas entrer en concurrence avec le contrôle du permis de construire. Pourtant, tous ces dossiers ne nous semblent pas forcément contribuer à l’embellissement de la France !
Cela étant dit, nous essayons d’appliquer au mieux les critères de la loi, notamment au regard de l’insertion paysagère.
Jusqu’à présent, les pourvois devant le Conseil d’État étaient relativement faciles, et les gens n’ont pas hésité à les utiliser à chaque refus d’implantation. D’après les statistiques, nous avons confirmé deux tiers d’implantations et en avons refusé un tiers. Un peu moins de la moitié de nos décisions ont fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État, mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd’hui quel est le pourcentage de ce qu’il confirme ou infirme car un stock d’affaires est en cours.
Sommes-nous efficaces ou pas ?
D’abord, s’agissant des moyens, nous sommes très économes : la CNAC siège dans un bâtiment du ministère des finances, son budget dépend directement de ce même ministère, et les membres nommés ne sont pas rémunérés par ce dernier, mais perçoivent une faible indemnité par séance.
Il y a uniquement un secrétaire général qui est un administrateur du ministère, avec ses adjoints, également agents du ministère.
Notre secrétaire général évalue à environ à 17 le nombre total de personnes qui travaillent pour la commission : celles-ci reçoivent tous les appels, vérifient que les dossiers sont complets et recevables, établissent notre ordre du jour et préparent les dossiers à remettre aux huit membres.
Nos décisions sont très motivées, aussi motivées qu’un arrêt du Conseil d’État. Nous les rédigeons et les envoyons aux intéressés.
Ensuite, la loi nous demande de statuer dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Nous respectons parfaitement ce délai et sommes même très en deçà.
En conclusion, notre commission fonctionne bien avec très peu, sinon aucun moyen. On ne peut pas être plus économe : aucun équipement, aucune voiture et 17 agents – dont je tiens la liste à votre disposition – appartenant à la direction de la compétitivité, de l’industrie et des services du ministère de l’économie !
M. René Dosière, rapporteur. S’agissant des membres nommés, en particulier par un ministre, le seul problème est celui de leurs intérêts éventuels avec l’une des affaires traitées par votre commission. Cela ne doit pas se produire car chacun d’eux est amené à déclarer ses intérêts, mais y a-t-il eu doute dans certains cas ?
M. François Lagrange. Aux termes de la loi, aucun membre ne doit avoir un intérêt dans les affaires traitées. En outre, chacun d’eux a l’obligation de souscrire une déclaration indiquant ses intérêts éventuels.
M. Christian Vanneste, rapporteur. L’objectif des lois réglementant le régime d’autorisations administratives préalables à l’implantation des projets commerciaux était la protection du petit commerce – aujourd’hui appelé commerce indépendant – face aux grandes surfaces. Or il n’a pas été atteint car vous autorisez plus d’implantations que vous n’en refusez, autrement dit – je me fais l’avocat du diable –, vous soutenez davantage la multiplication des grandes surfaces que la protection du commerce indépendant qui, certes, comme vous l’avez rappelé, n’est plus aujourd’hui votre mission première.
Ainsi, entre 1997 et 2008, le nombre annuel d’autorisations d’ouvertures est passé de 1 million à 3 millions de mètres carrés, et le nombre de refus d’ouverture n’a progressé que de 600 000 à 1 million de mètres carrés. Le taux d’autorisations est passé de 68 % à 86 %, et la surface moyenne des projets de 981 mètres à 1 576 mètres carrés. Manifestement, le décalage s’est accentué !
M. François Lagrange. C’est un sujet important et délicat.
Qu’ils administrent une grande ville ou un village, les maires viennent à toutes nos séances, en général avec leur adjoint, et parlent toujours au nom de leur conseil municipal. Nous leur demandons comment réagit l’ensemble des commerçants de leur ville et de quelle manière ils voient l’équilibre entre grandes surfaces et petit commerce. Et, à chaque fois, ils nous disent approuver la nouvelle surface, n’y voyant pas de conflit direct.
D’abord, le plus souvent, une galerie commerciale est associée à la grande surface et, parfois, des commerces du centre-ville viennent s’installer dans cette galerie marchande. Il y a donc une certaine complémentarité.
Ensuite et surtout, il faut voir la France d’aujourd’hui comme elle est : beaucoup de grandes villes et de villes moyennes ont, sur le plan géographique, un centre relativement limité et une périphérie importante. Or ces nouvelles surfaces s’installent à la périphérie et sont, en quelque sorte, le commerce de proximité des gens qui y vivent.
En découvrant cette commission, j’ai été étonné de voir autant de dossiers, y compris pendant la période qu’il est convenu d’appeler la crise : en 2009 et 2010, nous avons eu à traiter environ 20 dossiers à chaque séance – un tiers concernant des extensions, les deux tiers de vraies créations. Il s’agit de commerces traditionnels, comme Carrefour, Auchan, Leclerc, mais aussi – et de plus en plus – de magasins nouveaux qui correspondent à l’évolution des modes de vie, tournés vers le jardinage, l’outillage, le bricolage, le sport et la culture.
Aujourd’hui, compte tenu de la nouvelle géographie, on ne peut plus dire que les nouvelles surfaces détruisent le petit commerce, surtout dans les villes importantes. Personnellement, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas apporter notre confiance aux maires, qui sont aussi parfois conseillers généraux, députés ou sénateurs et que nous entendons avec beaucoup de soins.
M. Georges Vianès, vice-président de la Commission nationale d’aménagement commercial. En 2007, la CNEC (ancêtre de la CNAC) a pris moins de décisions d’autorisation que de décisions de refus : respectivement 45 % contre 55 %. En outre, elle a autorisé 33 % de surfaces de vente et en a refusées 67 %.
Avec la nouvelle législation, nous sommes passés d’un régime de liberté contrôlée à un régime que j’appellerai de liberté surveillée. Autrefois, nous avions le critère très précis de la densité d’équipement commercial ; la loi actuelle a fait sauter ce verrou, et nous sommes maintenant dans une situation nettement plus libérale sur le plan des principes d’autorisation.
En outre, la nouvelle loi a entraîné une transformation complète des recours formés devant la Commission nationale. Autrefois, les recours – la plupart du temps contre un refus de la part des commissions départementales – étaient accessibles au porteur de projet, ainsi qu’au préfet et à deux membres de la CDEC ; dorénavant, ils le sont à tout tiers intéressé, et la jurisprudence du Conseil d’État est très large. Ainsi, les recours de tiers sont très souvent faiblement argumentés et sont formulés contre des autorisations accordées à la concurrence.
Vous avez donc raison : les taux ont complètement changé. Cependant, ils n’expliquent pas un plus grand laxisme en termes d’autorisations.
Enfin, c’est vrai, nous n’avons plus les critères de l’équilibre entre les différentes formes de commerce et du gaspillage des équipements commerciaux, éléments essentiels de l’ancienne loi. Néanmoins, nous avons celui de l’animation de la vie urbaine et rurale, et un certain nombre de nos décisions sont justement destinées à préserver l’animation des centres-villes.
M. René Dosière, rapporteur. Le nouveau système est-il plus satisfaisant qu’un système dans lequel les autorisations commerciales dépendraient de la législation sur l’urbanisme ?
M. François Lagrange. Votre question est fondée et elle m’a été posée à plusieurs reprises : est-il possible de supprimer le système de commissions départementales et Commission nationale pour le remplacer par celui du permis de construire avec le critère de l’urbanisme ? Personnellement, je ne le pense pas.
Le permis de construire implique d’étudier la technique de construction, le voisinage, la validité technique du projet stricto sensu. Or apprécier les grandes surfaces est une responsabilité importante et nécessite du temps pour vérifier la présence des critères de la loi, et une commission d’urbanisme n’aurait ni le temps ni la possibilité d’avoir cette vision nécessaire, car de gros investissements sont en jeu. En effet, la plupart des dossiers portent sur 5 000, 6 000, voire 10 000 mètres carrés de grande surface, associés à une galerie marchande d’une vingtaine ou d’une trentaine de petits commerces.
Je voudrais insister sur le changement de législation à la suite du décret du 22 février 2010. Jusqu’à maintenant, les trois étages – commission départementale, Commission nationale, Conseil d’État – donnaient entière satisfaction. Aujourd’hui, le périple est kafkaïen : commission départementale, commission nationale, tribunal administratif, cour administrative d’appel et, enfin, Conseil d’État. À cause de ce décret, cinq échelons sont maintenant nécessaires pour avoir une décision stabilisée.
Dans la liste des autorités indépendantes pour lesquelles le Conseil d’État demeure compétent en premier ressort, figure l’Agence française de lutte contre le dopage, par exemple. Or celle-ci est-elle plus importante que la commission nationale d’aménagement commercial qui examine les dossiers de création des grandes surfaces de Dunkerque à Marseille ? Je profite donc de cette audition pour vous demander d’intervenir à propos de ce décret, et je vous laisserai une note à ce sujet.
M. René Dosière, rapporteur. Dans l’ancien système, dans quel délai était prise la décision ?
M. Bernard Rozenfarb, secrétaire général. Deux ans.
M. René Dosière, rapporteur. Et avec la procédure nouvelle ?
M. Bernard Rozenfarb. Huit ans.
M. François Lagrange. En France, le tribunal administratif met plus d’un an pour juger – souvent deux –, la cour administrative d’appel au moins un an ; et le Conseil d’État au moins un an également.
M. René Dosière, rapporteur. Et ce n’est pas suspensif !
M. Georges Vianès. Avec la nouvelle loi, les recours sont beaucoup plus nombreux puisqu’ils sont issus des tiers.
M. René Dosière, rapporteur. Le décret aura-t-il un effet ?
M. François Lagrange. Il n’est pas impossible que les tiers utilisent toutes les voies de recours.
M. Bernard Rozenfarb. Effectivement, ce n’est pas impossible.
M. Georges Vianès. Depuis la nouvelle loi, il y a beaucoup de recours dilatoires, et c’est la raison des recours des tiers de plus en plus nombreux. La superposition des décisions est catastrophique : nous avons calculé que la durée totale de la procédure sera vraisemblablement de huit ans.
En outre, faire annuler un investissement qui peut porter sur des dizaines de millions, voire sur davantage pour de grands projets, est extrêmement dissuasif, car cela risque de bloquer de nouveaux investissements commerciaux, ce que le législateur n’a jamais voulu.
Quant à l’efficacité des commissions départementales et de la Commission nationale, elle est réelle puisque les décisions sont prises très vite : le délai maximal pour rendre une décision est de deux mois pour les premières et de quatre mois pour la seconde. Avec le nouveau système, nous raisonnerons en années !
M. François Lagrange. Un requérant n’a que deux mois pour saisir le Conseil d’État, mais ce dernier met deux ans pour juger.
Le délai actuel de deux ans passera à sept ou huit ans avec le nouveau système et bloquera la création commerciale, pourtant nécessaire à la modernisation de la France, comme le dit la loi. Ne l’oublions pas : les grandes surfaces permettent de créer des emplois, entre cinquante et cent emplois directs ou indirects pour chaque dossier important, ce qui n’est pas négligeable !
Certes, beaucoup de dossiers portent sur des extensions, mais celles-ci permettent une modernisation profonde et donc un embellissement des grandes surfaces, dont les dernières créées sont nettement supérieures à celles d’il y a vingt ans.
M. René Dosière, rapporteur. Messieurs, nous vous remercions.
Audition de M. Jean-Pierre Leclerc, président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), accompagné de M. Alexandre Lallet, rapporteur général.
jeudi 22 avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous sommes très heureux d’accueillir le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, institution à laquelle nous sommes très attachés. Nous avons parfois l’occasion d’intervenir directement auprès d’elle, ou bien de conseiller à certains de nos concitoyens de la saisir.
Pouvez-vous nous présenter l’action de la CADA et dresser le bilan de son efficacité ? Estimez-vous que ses moyens soient adaptés aux objectifs qui lui sont fixés par la loi ?
M. René Dosière, rapporteur. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir. À titre personnel, j’ai toujours tenu à mettre l’accent sur la communication des documents administratifs dans les ouvrages relatifs aux finances locales que j’ai eu l’occasion d’écrire. Bien que je n’aie jamais été amené à saisir la CADA, c’est une question à laquelle je porte un grand intérêt.
Dans quelle mesure la CADA est-elle parvenue à modifier l’atmosphère de secret qui prévalait avant 1978 ? On a l’impression qu’il existe encore une culture de l’opacité, en particulier au plan communal. Il reste en effet difficile d’avoir accès à certains documents. Que pourrait-on faire pour aller plus loin ?
M. Jean-Pierre Leclerc, président de la Commission d’accès aux documents administratifs. La loi du 17 juillet 1978 a imposé un changement très important en substituant au principe du secret celui de la transparence et en établissant une obligation de communication des documents administratifs.
Le législateur a ensuite complété les dispositions en vigueur grâce à différents textes : la loi du 12 avril 2000 a étendu les possibilités de saisine de la CADA ; l’ordonnance du 6 juin 2005 a notamment visé à transposer la directive communautaire de 2003 sur la réutilisation des informations publiques, en posant un principe de libre réutilisation assorti d’un encadrement, notamment par des mécanismes de licences ; la loi du 26 octobre 2005 a transposé une autre directive communautaire en prévoyant que, dans le domaine de l’environnement, la loi de 1978 s’appliquait sous réserve d’un certain nombre de dispositions nouvelles – contrairement au droit commun, par exemple, un certain nombre de secrets protégés par la loi ne sont pas opposables, et le caractère préparatoire des documents n’est pas un motif légal de refus de communication –; dans le domaine du nucléaire, la loi du 13 juin 2006 a prévu que la loi de 1978 et le code de l’environnement s’appliquent, sous réserve de dispositions particulières qu’elle fixe.
L’évolution de la législation a renforcé le principe de communication des documents administratifs, en faveur duquel la CADA a beaucoup œuvré en réglant un certain nombre de questions de principe, dans le respect d’un équilibre entre le droit d’accès, les exigences de la confidentialité et les contraintes de l’administration. La CADA a pleinement joué son rôle de recours administratif préalable obligatoire, c’est-à-dire de filtre précontentieux – chacun l’a reconnu à l’occasion du trentième anniversaire de la loi de 1978.
Contrairement à d’autres instances, la CADA ne tranche pas de litige. Elle n’est qu’une cellule d’expertise technique, chargée de se prononcer sur le caractère communicable des documents. Sa saisine ne constitue qu’un recours administratif préalable. Elle émet un avis qui ne lie pas l’administration, bien que celle-ci le suive dans la majorité des cas. . La CADA se prononce sur la communicabilité des documents, l’administration concernée prenant ensuite ses responsabilités sous le contrôle de la juridiction administrative, qui peut être saisie par les intéressés en cas de confirmation du refus.
M. René Dosière, rapporteur. La juridiction administrative donne-t-elle généralement satisfaction au requérant dans l’hypothèse où la CADA a estimé que le document était communicable ? Si c’est le cas, ce mécanisme pourrait jouer un véritable rôle dissuasif à l’égard de l’administration.
M. Jean-Pierre Leclerc. Malgré les évolutions de la législation, les administrations demeurent très souvent réticentes. On se heurte en particulier à un certain nombre de difficultés au plan local, notamment lorsqu’un ancien maire ou un ancien élu demande à consulter des documents pour contester la gestion de la municipalité en place, ou bien lorsqu’une même personne adresse à l’administration des demandes récurrentes.
La CADA a renforcé la qualité et la motivation de ses avis au cours de ses trente années de fonctionnement, et elle a su faire face aux nouvelles questions qui lui ont été posées. Elle doit en effet se prononcer sur de nouveaux sujets à chaque séance, dans des domaines aussi variés que l’aide sociale à l’enfance, les archives publiques et les marchés publics. Il va de soi que les membres de la Commission ne peuvent pas approuver expressément chacun des avis rendus – plus de 200 tous les quinze jours –, mais les dossiers soulevant une question de principe donnent systématiquement lieu à un débat, et chacun des membres a un « droit d’évocation » sur toute affaire.
On assiste assez fréquemment à une sorte d’épreuve de force entre l’administration et le demandeur : une fois que celui-ci a démontré sa détermination en saisissant la CADA, l’administration finit souvent par céder. Dans 30 % des cas, nos avis sont « sans objet », soit parce que le document n’existe pas, ce que révèle l’instruction, soit parce qu’il a été communiqué avant que nous ne nous prononcions, ce qui peut aussi tenir au rôle dissuasif de la commission.
La CADA se prononce sur le caractère communicable des documents en se plaçant sur le plan des principes. Elle ne prend pas en compte l’identité du demandeur, ni ses motivations, contrairement à l’administration, qui refuse parfois la communication (juridiquement à tort) en se fondant sur l’usage que le demandeur pourrait faire du document. Cela ne veut pas dire que la CADA soit insensible aux conséquences que pourrait entraîner la communication des documents, par exemple dans les affaires familiales (faut-il transmettre à une assistante maternelle une lettre rapportant que son concubin ne se conduit pas très bien avec les enfants qu’elle accueille ?). Mais ces éléments viennent seulement alimenter un débat juridique sur la possibilité d’opposer telle ou telle exception. L’administration, pour sa part, est directement confrontée à un contexte qui peut la conduire à adopter une position différente.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quel contrôle exercez-vous sur les décisions prises par les administrations ? Nous avons appris qu’elles ne faisaient pas savoir quelle suite elles donnaient à 21,5 % des avis favorables que vous rendez.
M. Jean-Pierre Leclerc. Nous demandons à l’administration ou à la collectivité territoriale concernée de faire connaître, généralement dans un délai d’un mois, la suite donnée au dossier, mais nous n’obtenons pas de réponse dans environ 20 % des cas. Nous n’avons pas les moyens matériels d’exercer un contrôle ou d’assurer un suivi. C’est parfois à l’occasion d’un contentieux que nous apprenons la suite donnée à un avis.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quelle est la proportion des avis favorables à la communication des documents ?
M. Jean-Pierre Leclerc. Près de 30 % des demandes sont « sans objet ». Les deux tiers des avis rendus sont favorables, chiffre d’autant plus élevé qu’un certain nombre de secrets protégés par la loi, tels que le secret industriel et commercial ou le secret des affaires, peuvent s’opposer à la communication des documents, notamment en matière de marchés. Pour des raisons tenant au respect de la vie privée, le II de l’article 6 de la loi de 1978 impose en outre de ne communiquer certains documents qu’à l’intéressé, et non à des tiers. Mais globalement, les statistiques sont le reflet fidèle du droit : le droit d’accès est le principe, les restrictions, l’exception.
M. René Dosière, rapporteur. La CADA a souhaité mettre en place des correspondants au sein de chaque administration. Avez-vous rencontré des difficultés dans ce domaine, ou bien estimez-vous que la situation soit satisfaisante ?
M. Jean-Pierre Leclerc. L’ordonnance de 2005 a prévu la désignation de personnes responsables de l’accès aux documents (PRADA) dans la plupart des administrations), sauf les plus petites. Les communes et les communautés de communes de plus de 10 000 habitants sont concernées, ce seuil étant sans doute un peu trop bas. La mise en place de ce dispositif a été très difficile. Bien que le ministère de l’intérieur nous ait apporté une aide précieuse en ce qui concerne les préfectures, nous avons dû envoyer des centaines de courriers. Il y a aujourd’hui environ 1 400 PRADA, soit à peu près la moitié du vivier potentiel.
Le système fonctionne bien au sens où les PRADA sont très motivées et très intéressées par leurs tâches, exercées à temps partiel. Notre rapport d’activité, qui doit paraître dans les prochaines semaines, fait état de leurs réponses à un questionnaire portant sur les difficultés qu’elles rencontrent et sur les types de demandes les plus fréquentes.
Une première difficulté concerne l’animation du dispositif, dont nous souhaiterions faire un véritable réseau. Notre site internet permet de diffuser une lettre d’information mensuelle, qui présente les principaux avis rendus et fait le point chaque mois sur une question particulière, mais nous souhaiterions organiser des rencontres avec les PRADA. La difficulté est que la PRADA de la mairie de Grenoble a peu en commun avec celle du ministère de l’intérieur : elle ne traite pas du tout les mêmes dossiers.
Un autre problème a trait à l’articulation entre la PRADA et la personne en charge des dossiers dans l’administration concernée. La demande devrait normalement être adressée à la PRADA, mais c’est généralement la personne en charge du dossier qui la reçoit. Les Archives de France nous ont récemment demandé s’il était possible d’organiser une saisine simultanée de leur service et de la PRADA en poste au ministère de la culture. La raison est que le délai de réponse a quasiment expiré quand la demande leur parvient.
Un autre type de problème se pose dans les hôpitaux : s’il existe un médecin chargé des relations avec les patients, les dossiers se trouvent dans les services, dont la principale activité n’est pas de répondre aux demandes de communication.
M. René Dosière, rapporteur. Pouvez-vous nous dire s’il existe une PRADA au Palais de l’Élysée et à l’Assemblée nationale ?
M. Jean-Pierre Leclerc. Cela me semble inutile à l’Assemblée nationale…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Chacun sait, en effet, que nous sommes parfaitement transparents…
M. Jean-Pierre Leclerc. Surtout, les documents détenus par le Parlement n’entrent plus dans le périmètre d’intervention de la CADA. Le Conseil d’État avait considéré que les « actes des Assemblées parlementaires » non communicables étaient ceux établis par le Parlement à sa demande, ce qui excluait les documents faisant seulement l’objet d’une transmission, comme un rapport des renseignements généraux. L’ordonnance du 29 avril 2009, prise en application de la loi de 2008 relative aux archives, précise désormais qu’il s’agit des actes « produits ou reçus » par les Assemblées parlementaires.
En ce qui concerne l’Élysée, nous avons eu à connaître de quelques dossiers présentant des difficultés particulières en raison du statut du Président de la République tel qu’il résulte de la Constitution.
Le système mis en place fonctionne bien, mais toutes les PRADA n’ont pas encore été désignées. En outre, nous n’avons pas les moyens de réaliser les actions de formation et d’animation du réseau qui s’imposent.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous un budget propre ? Peut-on même parler de budget en ce qui vous concerne ?
M. Jean-Pierre Leclerc. La CADA est une petite structure rattachée à Matignon, qui se charge d’ordonnancer nos dépenses, au demeurant très peu nombreuses. Un système de délégation avait été envisagé, mais il n’a pas vu le jour. La Commission est hébergée dans des locaux relevant des services du Premier ministre, au 35, rue Saint-Dominique.
Le président et les membres de la Commission perçoivent des indemnités ; les rapporteurs généraux et les rapporteurs, qui sont essentiellement des membres du Conseil d’État, des conseillers des tribunaux administratifs et des membres des inspections générales, bénéficient également d’indemnités, mais elles sont tout à fait insuffisantes, ce qui pose des difficultés de recrutement, en particulier pour les rapporteurs, car nous sommes en concurrence avec d’autres institutions.
Nous disposons d’un personnel permanent, rattaché à Matignon, qui assure sa gestion. Il se compose d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’une dizaine de rédacteurs.
Nous n’avons quasiment pas de dépenses de matériel : nous n’avons pas de véhicules à notre disposition et nous n’effectuons pas de déplacements. Nous avons ainsi été hébergés par le Conseil d’État pour le colloque organisé à l’occasion du trentième anniversaire de la CADA. Nous avons pu réimprimer notre guide l’année dernière, mais pas notre rapport d’activité, parce que cela coûtait trop cher.
Nous pourrions certes essayer d’obtenir plus de moyens, mais les temps ne sont pas très favorables, et l’essentiel est que nous puissions nous acquitter de notre tâche principale, à savoir le traitement des demandes d’avis en ne nous écartant pas trop du délai de trente jours prévu par la loi – nous en sommes à environ trente-cinq jours.
Ce délai a été retenu comme indicateur de performance, mais cela ne me paraît pas très pertinent. En effet, l’objectif n’est pas de traiter les demandes aussi vite que possible. Nous devons souvent demander des précisions aux intéressés et les réponses de l’administration mettent parfois du temps à nous parvenir.
M. René Dosière, rapporteur. Si je comprends bien, votre indépendance financière et budgétaire est quasiment nulle.
M. Jean-Pierre Leclerc. C’est juridiquement exact, mais nous n’avons jamais subi la moindre pression.
M. René Dosière, rapporteur. Tel n’était pas le sens de ma question. S’il y a une autorité administrative indépendante qui devrait communiquer sur son action, afin que nos concitoyens connaissent précisément leurs droits, c’est bien la vôtre. Or, vous fonctionnez comme un service du Premier ministre. Vos moyens dépendent de ce que Matignon veut bien vous accorder.
M. Jean-Pierre Leclerc. Avec d’autres institutions, comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme, nous sommes rattachés au programme « Protection des droits et libertés ». Matignon reconduit à peu près les crédits d’une année sur l’autre. En revanche, j’ai dû me battre pour les indemnités des rapporteurs. Il a fallu traiter directement avec le ministère des finances et faire intervenir le secrétaire général du Gouvernement. Nous avons réussi à obtenir quelques effectifs supplémentaires pour les personnels permanents, mais chaque action nécessite une démarche particulière de notre part, car nous n’avons pas un volume global de crédits à notre disposition.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Si l’on vous suit, la CADA est une institution modeste, mais efficace. Ne peut-on pas, pour autant, imaginer d’autres modes d’action ? On pourrait, tout d’abord, confier un pouvoir d’injonction à la CADA. Cela lui permettrait d’imposer son avis aux autorités récalcitrantes, notamment au plan local. Pour donner plus de poids et d’indépendance à la CADA, on pourrait en outre la rattacher à une autre institution – l’accès aux documents administratifs étant un droit, il pourrait s’agir du Défenseur des droits, qui dispose au demeurant d’un pouvoir d’injonction.
Que pensez-vous de ces différentes pistes ? Je rappelle que nous comptons formuler un certain nombre de préconisations à l’issue de nos travaux.
M. Jean-Pierre Leclerc. Nous avons également appris que le sénateur Patrice Gélard devait prochainement présenter un texte dans ce domaine. Pour ma part, je trouverais paradoxal que l’on rattache la CADA à une autre institution dans le but de préserver son indépendance…
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ce serait une institution qui serait vraiment indépendante !
M. Jean-Pierre Leclerc. Une première difficulté est que la CADA exerce avant tout une mission d’expertise. Si les demandes étaient portées devant le Défenseur des droits, qui disposera d’un pouvoir d’injonction, la procédure ne constituerait plus un recours administratif préalable. Le Conseil d’État a pourtant souligné l’intérêt de ce mécanisme dans un récent rapport. Par ailleurs, le Défenseur des droits ne se prononcerait pas sur le caractère communicable des documents, mais donnerait des injonctions en tenant compte des circonstances locales, ce qui n’a rien à voir avec la mission actuelle de la CADA.
En second lieu, le rapprochement des autorités administratives indépendantes est une tâche très délicate. Pour l’exercice des missions relevant du Défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits sera assisté d’un collège composé de trois membres. La première question est celle de savoir comment le Défenseur des droits parviendra à concilier toutes ses missions. On peut également s’interroger sur la composition du collège compétent en ce qui concerne la communication des documents administratifs.
Le collège de la CADA se compose aujourd’hui, outre le Président, de dix membres – dont un député et un sénateur, un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un représentant de l’Autorité de la concurrence une personne qualifiée en matière d’archives, un professeur des universités, un représentant de la Cour de cassation et un représentant de la Cour des comptes –, ce qui n’a rien d’excessif compte tenu des enjeux. On pourrait imaginer que le collège de la CADA continue à émettre un avis dans sa formation actuelle, mais je vois mal comment le Défenseur des droits pourrait se prononcer sur les avis ainsi rendus. Il faudrait donc fusionner les institutions au lieu de se contenter de les « rattacher » l’une à l’autre, mais ce serait au détriment de ce qui fait la spécificité de leurs missions. Vous comprendrez donc que je sois d’un avis très réservé sur le sujet.
Il a été proposé de regrouper toutes les autorités administratives indépendantes hors de Paris afin de réaliser des économies, notamment en matière de personnel. Or, je ne suis pas certain que les rédacteurs en charge par exemple des dossiers de la CNIL soient aujourd’hui qualifiés pour traiter les demandes de communication des documents administratifs. Cette solution poserait également des problèmes à certains membres de notre collège, qui se réunit actuellement au Conseil d’État. Je pense, par exemple, au professeur d’université qui vient de province.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Venons-en à la réutilisation des documents administratifs. La problématique est différente, car c’est l’administration qui a un grief dans ce cas. Avez-vous l’autonomie nécessaire pour traiter ces dossiers ?
M. Jean-Pierre Leclerc. Il faut distinguer les demandes d’accord en vue d’une réutilisation et la question des sanctions. La loi n’a pas prévu que la demande d’accès et la demande de réutilisation soient formulées simultanément. Dans certains cas, nous avons la certitude qu’une réutilisation des documents aura lieu, mais nous ne recevons pas de demande en ce sens. Nous ne nous sommes saisis que d’une centaine de demandes par an.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ce sont les demandeurs de réutilisation qui vous saisissent dans cette hypothèse. Quid de l’action exercée par l’administration ?
M. Jean-Pierre Leclerc. La loi a prévu un système de licences et de redevances, mais les administrations, réticentes en matière de communication des documents, ont pris très peu d’initiatives dans ce domaine. L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) est certes très active, mais son action se place dans une perspective d’exploitation économique très différente des problèmes que nous rencontrons.
Le premier concerne le code électoral, dont une refonte est en cours d’étude au ministère de l’intérieur. Si l’on peut accéder aux listes électorales, c’est à condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Or aucune sanction n’est prévue.
Une autre difficulté a trait aux archives : en application d’une directive européenne, les organismes culturels – terme qui vise sans doute avant tout les organismes de spectacles, mais qui englobe aussi les archives –, fixent eux-mêmes les conditions de réutilisation de leurs documents, alors que les principes de la loi de 1978 devraient normalement trouver à s’appliquer.
Lorsqu’elle est saisie par l’administration d’une réutilisation non-conforme à la loi ou à la convention établie, la CADA dispose d’un pouvoir de sanction. Mais elle n’a eu à se prononcer que dans une seule affaire, aujourd’hui pendante devant le Conseil d’État. Bien qu’il existe probablement de nombreux cas de réutilisation illégale, les règles n’ont pas été clairement fixées, et les administrations ne suivent pas la question de très près, sans doute parce qu’elles ne sont pas très bien informées.
L’intervention de la CADA présente un caractère quasi-juridictionnel dans ce domaine, et elle doit donc être conformes aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme : il faut notamment que le rapporteur soit différent en cas de demande de réutilisation et en cas de sanction ; la composition de la commission chargée de se prononcer sur les sanctions est également différente de celle qui examine les demandes d’avis. Si la compétence de la CADA devait revenir au Défenseur des droits, il faudrait sans doute transférer le pouvoir de sanction aux juridictions ordinaires, car les différents mécanismes mis en place ne pourraient pas être transposés tels quels au Défenseur des droits.
La faiblesse du nombre de demandes de réutilisation nous surprend, car nous sommes saisis de nombreuses demandes de communication présentées par des acteurs ayant visiblement l’intention de réutiliser les documents – quand on demande à consulter tous les permis de construire délivrés dans un espace donné, on peut penser que c’est pour l’exercice d’activités de promotion immobilière.
M. René Dosière, rapporteur. Merci pour vos réponses. Souhaitez-vous attirer notre attention sur des sujets qui n’auraient pas été évoqués jusqu’à présent ?
M. Alexandre Lallet, rapporteur général de la Commission d’accès aux documents administratifs. La CADA dispose de moyens réduits, mais c’est un organisme qui fonctionne bien. Nous n’éprouvons pas le besoin d’imprimer notre rapport d’activité sur du papier glacé, et nous sommes fiers de rendre un service de qualité à un coût très modeste.
Quelles sont les améliorations envisageables pour améliorer l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs et pour faciliter le fonctionnement de la CADA ?
En cas de divergence d’appréciation entre la CADA et l’administration concernée, il faut aujourd’hui saisir le juge administratif. On peut envisager de confier un pouvoir d’injonction à la CADA, mais cela aurait pour effet de préjuger la position de la juridiction, et surtout de vider totalement le litige de son objet, car l’intéressé aura préalablement eu accès au document souhaité.
L’équilibre instauré par la loi de 1978 me semble satisfaisant : la CADA, forte de son autorité morale, incite l’administration à communiquer les documents demandés, mais c’est au juge administratif de se prononcer en dernier ressort.
Dans un certain nombre de cas relevant quasiment de la médiation, les autorités locales refusent de répondre aux demandes. Dans de telles situations – qui ne représentent pas plus de 5 % des saisines –, on peut envisager que la CADA saisisse le Défenseur des droits afin que celui-ci pèse de tout son poids sur l’administration concernée. De la même façon qu’il existe aujourd’hui un protocole entre la CADA et la CNIL, il est tout à fait possible d’établir une convention avec le Défenseur des droits, sans que cela implique de revoir intégralement le dispositif et de confier directement une compétence à celui-ci.
Une des principales causes du refus de communication des documents est la méconnaissance des obligations posées par la loi. Nous constatons que de nombreux refus reposent sur des motifs manifestement erronés, résultant bien souvent d’une approche « patrimoniale » : les administrations opposent un refus au motif qu’elles ne sont pas l’auteur des documents, alors que c’est leur détention qui constitue le critère déterminant. Un travail de pédagogie est donc nécessaire. Nous avons commencé à nous y atteler en procédant à une refonte du guide de l’accès aux documents, qui n’avait pas été modifié depuis 1997. Il est aujourd’hui accessible en ligne et régulièrement actualisé.
M. Jean-Pierre Leclerc. Ce guide rappelle les règles retenues par la CADA et reprend très largement la jurisprudence. Comme je l’ai indiqué, nous mettons également en ligne, tous les mois, une lettre d’information.
M. Alexandre Lallet. Nous pourrions améliorer nos efforts en matière de pédagogie grâce à des moyens supplémentaires, mais nous avons déjà des outils efficaces à notre disposition.
Ce dont nous aurions surtout besoin, c’est d’une stabilité normative plus grande. La loi de 1978 a été modifiée en 1979, puis elle est restée inchangée jusqu’au 12 avril 2000. Depuis cette date, elle a été modifiée à de nombreuses reprises, notamment par l’ordonnance du 6 juin 2005, par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et ensuite par l’ordonnance du 29 avril 2009. Certaines modifications ont été utiles, tandis que d’autres ont suscité des problèmes d’application, mais toutes ont eu pour effet de perturber le travail de pédagogie entrepris par la CADA. À cause de la multiplication des dispositions législatives, les administrations ne savent plus très bien quelles sont les règles applicables, et la situation se complique du fait de l’application des directives communautaires.
Je rappelle que la CADA effectue un travail juridique très pointu, qui n’a rien à voir avec une médiation ou avec un jugement en équité ex aequo et bono. La saisine de la CADA constitue un recours administratif préalable obligatoire, et celle-ci suit le même type de raisonnement que le juge administratif. Dans certains cas, elle est ainsi conduite à écarter l’application de la loi pour incompatibilité avec le droit communautaire.
Un autre problème, peut-être plus important encore que l’instabilité normative, est lié à l’organisation des administrations. La loi de 1978 fait peser sur elles des contraintes très lourdes. Une solution très simple, déjà autorisée par cette loi, mais que les administrations ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer faute de moyens, est la diffusion publique des documents par leur mise en ligne. Dans cette hypothèse, le droit d’accès au cas par cas (sur demande) n’a plus lieu d’être. Or, les obligations de diffusion publique sont aujourd’hui très limitées : dans la plupart des cas, il s’agit d’une simple faculté. De nombreuses administrations préfèrent donc attendre d’éventuelles demandes.
Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous pourrions renforcer les moyens disponibles – j’ai récemment eu l’occasion d’évoquer ce sujet avec un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.
Il serait essentiel de développer la diffusion publique des documents, domaine dans lequel la France accuse un retard considérable. En Suède, la plupart des administrations ont installé des bornes permettant de télécharger et d’imprimer les documents, ce qui tend à marginaliser l’accès sur demande. La situation est inverse en France, où les administrations subissent des charges très importantes, notamment en matière de photocopies. Elles sont parfois obligées de recourir à des prestataires, alors que les demandeurs pourraient télécharger les documents chez eux. Il serait possible de réserver l’accès au cas par cas à ceux qui n’ont pas accès à internet.
La principale difficulté n’est pas liée aux moyens dont dispose la CADA, mais aux moyens des administrations. La mise en ligne permettrait de décharger la CADA de très nombreuses affaires ne présentant aucun intérêt juridique. Celle-ci pourrait alors se concentrer sur les problèmes nécessitant véritablement l’expertise de ses rapporteurs et de ses membres.
M. Jean-Pierre Leclerc. Les modifications législatives successives ont, par exemple, rendu particulièrement difficile l’application des règles que nous avions dégagées en matière de marchés publics.
S’il y a un domaine dans lequel nous manquons cruellement de moyens, c’est celui de la formation. Nous recevons de nombreuses demandes, en particulier de la part des instituts régionaux d’administration et des archives, mais nous ne pouvons pas y répondre.
Nous restons naturellement à votre disposition pour d’autres questions, et nous ne manquerons pas de vous adresser notre rapport d’activité.
M. René Dosière, rapporteur. Messieurs, nous vous remercions.
Audition de M. le professeur Laurent Degos, président de la Haute autorité de santé (HAS), accompagné de MM. François Romaneix, directeur, et Éric Delas, directeur de l’administration générale et des ressources internes
jeudi 29 avril 2010
M. René Dosière, rapporteur. Merci, Messieurs, d’avoir répondu à notre invitation.
Pour commencer, pouvez-vous nous indiquer comment vous rendez compte de votre activité au Parlement, en dehors de votre rapport public d’activité ? Y a-t-il des moments de contact privilégiés ?
M. le professeur Laurent Degos, président de la Haute autorité de santé. Merci de nous accueillir. C’est avec le Parlement que nous cherchons à avoir le plus de liens, puisque nous sommes indépendants à la fois du financeur et du décideur. Nous faisons en sorte que la remise de notre rapport annuel – fin juin ou début juillet – se fasse en présence de personnalités du Parlement et s’accompagne d’une discussion publique. Nous entretenons aussi des liens privilégiés avec les parlementaires et l’un des membres récemment nommés de notre collège, Jean-Michel Dubernard, est un ancien député – il y a incompatibilité entre les deux fonctions. La Haute autorité poursuit ce dialogue privilégié tout au long des travaux des commissions, des auditions des rapporteurs et de l’ensemble des rendez-vous que nous pouvons avoir avec les parlementaires attachés à la santé.
M. René Dosière, rapporteur. De quel budget relève la Haute autorité de santé ?
M. François Romaneix, directeur de la Haute autorité de santé. Des crédits du ministère de la santé. Nous sommes auditionnés quasiment tous les ans par le rapporteur spécial de la Commission chargée des finances à l’Assemblée nationale, M. Gérard Bapt.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Contrairement aux autres organismes que nous avons auditionnés, vous n’avez pas répondu à toutes les questions que nous vous avons adressées, en particulier concernant les rémunérations des membres du collège. Par ailleurs, vous disposez d’un fonds de roulement qui a été considérable – 48 millions en 2006 – et vos dépenses ont beaucoup augmenté, passant de 47 à 67 millions entre 2005 et 2009. Y a-t-il un suivi de ces évolutions ?
M. René Dosière, rapporteur. Et si les 48 millions de 2006 paraissent élevés pour un fonds de roulement, que penser des 600 000 euros d’aujourd’hui ?
M. Laurent Degos. La Haute autorité de santé a été créée en 2005 par le regroupement de plusieurs organismes : la commission de transparence et la commission d’évaluation des produits et prestations, issues de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), le Fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique (FOPIM) et, enfin, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), sans compter les autres missions qui lui ont été dévolues par la loi. Elle a donc hérité de plusieurs fonds de roulement, en plus du budget qui lui était alloué, qui nous ont permis de ne pratiquement rien demander à l’État ou à la caisse d’assurance maladie pendant les trois premières années. Cet héritage est épuisé depuis un an et demi – notre fonds de roulement représente moins d’un mois, et notre trésorerie est proche de zéro. En revanche, notre budget est resté stable, depuis 2008, et nous nous sommes astreints à ne pas augmenter les dépenses, ni de personnel, ni de fonctionnement, sachant que de nouvelles missions nous ont été dévolues par la loi du 21 juillet 2009 (loi HPST). Nous avons un projet d’établissement, un suivi, un contrôle de gestion et une charte de dialogue avec le ministère. Nous nous montrons extrêmement stricts en matière budgétaire et notre situation financière est très contrainte, pour ne pas dire dangereuse.
M. René Dosière, rapporteur. Je comprends l’évolution du fonds de roulement, mais les dépenses ne sont pas restées stables : elles sont passées de 47 à 67 millions entre 2005 et 2009, soit 40 % d’augmentation. Les dépenses de personnel ont crû de 33 % en quatre ans, alors que le nombre d’agents n’augmentait lui que de 17 %. C’est substantiel et cela dénote aussi une augmentation des rémunérations moyennes.
M. Laurent Degos. Nous étions une administration nouvelle. Nous avons hérité de moyens de l’ANAES, du FOPIM et de l’AFSSAPS, mais nous avons aussi reçu des missions nouvelles, qu’il s’agisse de l’évaluation des actes, du médico-économique, de la sécurité des soins ou de la prise en charge à 100 %. Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain : pendant la montée en charge, nos dépenses sont passées de 47 millions à 55, puis à 65. Cela fait trois ans qu’elles sont stabilisées. Depuis, nous nous sommes fixés une contrainte interne drastique pour ne plus les augmenter, tout en voyant nos missions encore croître. Enfin, l’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que nous avons eu besoin de personnes hautement qualifiées, dont les salaires individuels étaient supérieurs aux précédents.
M. François Romaneix. En 2005, la Haute autorité a récupéré le personnel de l’ANAES et certains agents de l’AFSSAPS. Le personnel recruté depuis correspond aux nouvelles missions reçues dans ses premières années. Je voudrais être sûr que vous disposez des chiffres précis à ce sujet.
M. René Dosière, rapporteur. Je ne dispose d’aucun autre élément que les chiffres, d’ailleurs partiels, que vous nous avez fournis. Nous vous adresserons un autre questionnaire pour les compléter.
M. François Romaneix. Nous sommes bien entendu prêts à répondre à toute question complémentaire, sur la rémunération des membres du collège, par exemple, nous avions le sentiment d’avoir été complets.
M. René Dosière, rapporteur. Vous nous avez renvoyés au décret relatif au calcul de la rémunération. Cela fait penser à ces délibérations des conseils municipaux qui devraient donner le chiffre de la rémunération des élus et expliquent plutôt qu’elle est fondée sur tel pourcentage de tel indice, multiplié par tel élément… bref, qui sont complètement illisibles.
M. François Romaneix. Nous avons sans doute mal compris ce que vous désiriez. Je vous remets donc en main propre le tableau des rémunérations de chacun des membres du collège.
M. Laurent Degos. Cette rémunération correspond à peu près à celle d’un professeur des universités – praticien hospitalier. Elle avoisine 120 000 euros par an, une moitié en base et l’autre en primes.
M. René Dosière, rapporteur. Cela correspond à une rémunération à temps plein, qui doit d’ailleurs être diminuée du montant des pensions de retraite que toucheraient les intéressés. Les membres du collège sont-ils occupés à temps plein ? Certains exercent-ils d’autres activités ?
M. Laurent Degos. C’est une fonction à temps plein. Chacun gère une commission spécialisée, ce qui correspond à un jour ou un jour et demi de travail dans la semaine, et nous avons aussi une journée de délibérations et une journée de réunions. Au total, nous sommes pris quatre jours ou quatre jours et demi sur place et une journée en représentation à l’extérieur – comités, commissions, congrès…
Pour ce qui est d’autres activités, Raoul Briet est président du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et perçoit une rémunération à ce titre. Étienne Caniard, lui, est membre du Conseil économique et social, comme l’était un ancien membre du collège, Claude Maffioli, et ils ont été autorisés à le rester.
M. René Dosière, rapporteur. Les membres la Haute autorité ne doivent être suspects d’aucun conflit d’intérêts, de quelque sorte que ce soit. Avez-vous une procédure particulière – un code de déontologie, des dispositions spécifiques – pour les déceler ?
M. Laurent Degos. Nous y mettons toutes nos forces, et sommes les leaders dans ce domaine. Ainsi, un comité extérieur, présidé par le conseiller d’État, Christian Vigouroux, s’occupe de tout ce qui est du domaine de la déontologie et du conflit d’intérêts. Nous avons une charte de déontologie. Tous les experts et tous les membres de la Haute autorité doivent remplir une déclaration d’intérêts, obligatoire et surtout publique – ce qui n’est pas le cas partout – et à chaque séance nous avons connaissance des intérêts de chacun des intervenants. C’est notre fragilité autant que notre force. Nous ne pouvons travailler que si nous sommes crédibles, ce qui va de pair avec l’indépendance. Nous y veillons sans cesse, sachant par ailleurs que l’absence totale d’intérêts est impossible. Les intérêts financiers sont les plus visibles, mais ce ne sont pas ceux qui m’intéressent le plus. Il existe des intérêts d’école, par exemple : un médecin faisant partie d’une école interdit certaines pratiques d’une autre école, ce qui oblige à faire très attention quand on choisit les experts. Il faut aussi veiller à ce que la personne qui va examiner un produit pharmaceutique ne soit pas un expert pour une firme concurrente… Cette question est une des grandes priorités de la maison.
M. René Dosière, rapporteur. Vous faites appel à trois mille experts pour préparer les avis que vous émettez. Sur le nombre, vous parvenez à éviter les problèmes ?
M. Laurent Degos. Nous avons environ huit cents experts qui certifient les hôpitaux et cliniques : il ne faudrait pas qu’ils appartiennent à un hôpital ou à une instance dans la région, par exemple. Les points à surveiller sont très différents pour ceux qui évaluent les technologies médicales – médicaments, dispositifs, actes. C’est pour ceux qui travaillent aux recommandations de bonnes pratiques que les difficultés sont les plus grandes : en effet, ceux qui élaborent les règles doivent être des gens très compétents. Nous travaillons avec nos voisins, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne, à une vision commune de ce que doit être le président d’un groupe de travail. Nous avons conclu que, pour être sûr qu’il est indépendant, il doit exercer dans une autre branche – la neurologie, par exemple, pour un groupe sur le diabète.
Nous sommes donc en état de veille permanente. Bien sûr, tout ne peut pas être parfait en un jour : c’est en étudiant les problèmes qu’on les élimine. Mais c’est un des points les plus forts de la Haute autorité, sur le plan national ou international. Les conflits sont analysés différemment selon que l’on doit évaluer une technologie, faire une recommandation, visiter des hôpitaux ou certifier des médecins. Vous pourrez voir sur notre site la liste des intérêts de tous nos membres et de tous nos experts
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous rencontré des problèmes durant votre présidence ?
M. Laurent Degos. Deux notamment, sur le diabète et la maladie d’Alzheimer, qui ont été rendus publics et nous ont permis d’améliorer le système au jour le jour. Nous avions choisi par exemple, pour travailler sur la maladie d’Alzheimer, une personne hautement reconnue, sur le plan national et international, praticien hospitalier et chef de service à Lille. C’est le fait qu’elle ait fait des essais thérapeutiques dans son service, dans le dessein d’aider ses patients – et sans toucher le moindre argent – qui a posé problème. Nous ne pensions pas que cela constituait un conflit d’intérêts, mais nous avons eu des réflexions, et nous avons changé nos règles. Nous choisissons maintenant des personnes à l’indépendance incontestable, voire qui pratiquent en dehors du champ de l’étude. Nous allons jusqu’à émettre des appels à candidature, et vérifions les intérêts de tous ceux qui nous répondent. Mais il faut garder à l’esprit que le groupe ne peut pas être composé de naïfs totalement extérieurs au sujet, sans quoi il ne s’agit plus d’une expertise ! Il faut donc trouver un modus vivendi. C’est pourquoi nous recourons à un groupe extérieur pour nous aider devant ce genre de problèmes.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Un article du Monde fait allusion à ces deux problèmes, ainsi qu’au groupe présidé par Christian Vigouroux, baptisé « Déontologie et indépendance de l’expertise ». Il y est mentionné que la Haute autorité n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.
M. François Romaneix. Il est possible que le journaliste nous ait interrogés une heure avant de boucler son article… Mais nous avons répondu par une lettre publique à l’association qui avait soulevé le problème et essayons d’être parfaitement transparents. Nous avons organisé un débat sur les conflits d’intérêts lors de nos rencontres nationales de décembre dernier. C’est une question complexe, qui n’a pas de solution miracle. Il faut arriver à arbitrer entre la compétence et l’indépendance. S’agissant de maladies rares, par exemple, nous ne disposons que d’experts hospitalo-universitaires, qui soignent des malades, font des essais cliniques et ont donc des rapports avec les industries pharmaceutiques. C’est l’organisation de l’ensemble de la procédure d’expertise qui nous permet de trouver un équilibre : d’abord une expertise interne menée par les agents de la Haute autorité, qui ne peuvent pas être spécialisés en tout, puis le recours à des experts, enfin l’examen par une commission pluri-professionnelle qui étudie l’ensemble des données disponibles. L’expert n’est qu’un des éléments de ce processus.
M. Laurent Degos. L’important est de comprendre que les intérêts financiers ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Il faut prendre en compte les intérêts d’écoles, de carrière, de personnes… Pour un médecin, avoir de l’influence par le biais d’une école, avoir un plan de carrière passant par des congrès internationaux est beaucoup plus important que de se faire offrir un voyage. C’est pourquoi nous nous efforçons de faire s’exprimer l’ensemble des courants de pensée. Pour une recommandation, nous allons jusqu’à quatre-vingts relecteurs ! Nous organisons aussi des consultations publiques, afin que tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à dire puissent le faire.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le comité de déontologie est présidé par un conseiller d’État. Beaucoup d’autorités indépendantes sont présidées par des magistrats de haut niveau ou des énarques, par exemple. Le collège de la Haute autorité est composé par moitié de médecins et de non médecins. Est-il bon que son président soit un médecin ?
M. Laurent Degos. Ce sera à vous d’y réfléchir en étudiant les prochaines candidatures, puisque mon mandat arrive à son terme en décembre et que les commissions parlementaires doivent donner un avis.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Il est renouvelable une fois, ce qui pose au demeurant un problème d’indépendance.
M. Laurent Degos. Pour vous répondre à titre personnel, il me semble que le médecin a l’avantage de bien connaître ce monde en tension entre une vision individuelle – efficacité, sécurité des soins, accès aux soins – et collective – que le système soit durable, équitable, solidaire – et qu’il peut apaiser les tensions entre le payeur, le décideur, l’industriel, le patient et le professionnel. Plus généralement, ces tensions ne peuvent être apaisées que par un argumentaire scientifique. Le président doit posséder cette base scientifique. Je rappelle que nous ne sommes pas une autorité qui décide et qui sanctionne : nous aidons à la décision. Nous publions nos recommandations, nous consultons tout le monde. L’expertise scientifique est à la base de notre avis. Je pense donc que le président doit être une autorité scientifique, parce que c’est lui qui dit que tel médicament ne doit pas être remboursé, tel hôpital n’est pas certifié, tel médecin n’a pas fait ce qu’il devait, telle information est fausse – toutes choses qui seront contestées si elles n’émanent pas d’une autorité scientifique. C’est pourquoi tous les pays suivent désormais le même modèle : une autorité indépendante – indépendante du décideur, le ministère de la santé chez nous, ou, dans d’autres pays, des payeurs – et présidée par un médecin. Il faut une autorité crédible aux yeux de la population, alors que des intérêts personnels et collectifs s’affrontent. Une autorité crédible est scientifique, transparente et pratique la concertation.
M. René Dosière, rapporteur. Venons-en à l’utilité de la Haute autorité. Nous ne disposons que d’un indicateur concernant votre activité et même si j’étais capable d’en comprendre les finesses, je ne suis pas sûr qu’il serait significatif. Quels sont donc vos résultats ? Sont-ils mesurés ? Votre intervention a-t-elle permis d’améliorer quelque chose ?
M. Laurent Degos. Il n’y a qu’un indicateur parce que nous sommes inclus dans le programme 171 de la LOLF « Offre de soins et qualité du système de soins ». Lorsque nous visitons un établissement, nous émettons des réserves, qui peuvent être levées par la suite. L’indicateur est lié au nombre de réserves. Il est donc, en effet, parfaitement mineur par rapport à notre activité. Par ailleurs, nous avons un projet d’établissement sur trois ans qui comprend soixante actions, mesurées d’un point de vue aussi bien quantitatif – par des indicateurs – que qualitatif, ainsi qu’une programmation et un contrôle de gestion. Tout est en place et nous suivons de près chacun des aspects de notre activité.
Avons-nous servi à quelque chose ? Je vais vous donner quelques exemples. Le déremboursement, pour commencer, ne se faisait auparavant que pour des médicaments facultatifs. Il est beaucoup plus difficile de dérembourser des médicaments prescrits : à notre création, le ministre nous a demandé de nous en charger parce que c’était beaucoup trop impopulaire pour lui… Quatre cent vingt médicaments ont été déjà déremboursés, et ce n’est pas fini. Nous avons aussi estimé que certaines radios ou certain examens étaient inutiles, ce que le ministre ne peut pas se permettre de faire. Nous avons aussi décidé d’instaurer une évaluation des pratiques professionnelles des médecins, entre pairs bien sûr, ce qui est une véritable révolution. Elle sera effectuée par des conseils nationaux indépendants des industries pharmaceutiques, qui sont naturellement très intéressées par le sujet des pratiques, et il y aura une fédération des conseils. Tout est en place.
En matière de médecine générale, je m’emploie depuis quatre ans à remplacer les 160 petites formations qui agissent dans tous les sens par un seul collège. Ce sera sans doute officialisé à Nice en juin – une autre révolution. Nous nous sommes également occupés de la coopération interprofessionnelle entre médecins, infirmiers et aides-soignants : lorsque M. Berland, qui travaillait pour le ministère sur la démographie médicale, est venu me voir, personne n’acceptait de se mettre autour de la table. La Haute autorité a été chargée de la question, elle a réuni tous les acteurs et, à la fin de la journée, la situation était débloquée parce que chacun avait pu s’exprimer sans être dans une situation de force avec un payeur ou un décideur. Aujourd’hui, cette coopération est passée dans la loi HPST. Il en est de même pour des dispositions en matière d’éducation thérapeutique ou d’innovation : c’est nous qui avons fait tout le travail en amont.
C’est donc un véritable changement de décor que nous avons opéré. Auparavant, la certification des établissements était confidentielle. Aujourd’hui, elle est publique et sert aux agences régionales de santé ou aux agences régionales de l’hospitalisation. Nous avons imposé des indicateurs, des chiffres, des priorités. Faire comprendre à un établissement que ce qu’il fait va être rendu public, que cela servira à l’élaboration de son contrat d’objectifs et de moyens et qu’il va être jugé a été un changement de pensée dramatique. Cela ne pouvait être fait que par une autorité extérieure : décidé par le ministre ou, pire, par le payeur, cela aurait jeté les gens dans la rue. Indépendants d’eux, nous avons une place privilégiée pour changer les choses. J’aurais pu vous citer de nombreux autres exemples : l’important est que cela s’est fait sans bruit. Je ne suis pas allé dans les médias, pour ne pas susciter les réactions, mais le décor a changé autant pour les médecins que pour les industries et les établissements.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous ne faites peut-être pas de bruit, mais vos dépenses de communication ont augmenté dans des proportions considérables, atteignant 5,3 millions en 2009. Ajoutées aux dépenses de déplacement, elles représentent 15 à 20 % de votre budget total. Les maîtrisez-vous ?
M. Laurent Degos. Je parlais de la communication dans les grands médias nationaux. En revanche, il va de soi que nous sommes obligés de faire un important travail de diffusion auprès des professionnels, sur les bonnes pratiques, par exemple. Lorsqu’un nouveau médicament très onéreux risque d’être prescrit à toute la population alors qu’il ne concerne qu’une cible restreinte, nous devons agir avant même qu’il ne soit mis sur le marché. Cette activité de diffusion coûte extrêmement cher. Quant aux dépenses de déplacement, elles sont pour 80 à 90 % liées à nos experts visiteurs – 700 établissements par an, 5 à 8 visiteurs qui restent une semaine, 720 experts en tout qui font en moyenne 4 visites par an… faites le compte ! Cela coûte extrêmement cher, mais la certification des hôpitaux et des cliniques permet d’améliorer nettement notre parc. Et nous finançons également le déplacement des experts qui viennent nous voir dans nos locaux, ainsi que la compensation de leur perte de ressources due à l’interruption de leurs activités de consultation pour les médecins libéraux.
M. René Dosière, rapporteur. Comment se déroule la procédure de déremboursement d’un médicament ?
M. Laurent Degos. L’opération est lancée par le ministre, qui nous saisit – en fait après une première concertation entre nous – d’une liste de médicaments à étudier. Si nous constatons que le service médical rendu est insuffisant par rapport au coût pour la collectivité, ce qui ne veut pas dire que le médicament est inefficace, nous proposons le déremboursement. La dernière fois, cela a été le cas pour 420 médicaments. Le ministre n’en a retenu que 380 mais toutes nos recommandations étant rendues publiques avant même la décision – ce qui est une force par rapport aux autres agences sous tutelle – cela lui a posé des difficultés. Il ne se fondait pas sur un argument médical, mais sur un autre, industriel celui-là, tout aussi prioritaire sur le plan national. Nous l’admettons parfaitement : nous apportons un avis médical ; au ministre de prendre sa décision en fonction de l’ensemble des considérations pertinentes.
M. René Dosière, rapporteur. Votre champ d’investigation est délimité au départ par le ministre, qui prend aussi la décision finale.
M. Laurent Degos. Nous pouvons nous autosaisir. En revanche, nous n’intervenons pas en matière de décision ni de sanction. Je le répète, nous sommes une autorité d’aide à la décision. Nous apportons une évaluation crédible qui légitime la décision vis-à-vis de la population et de toutes les parties prenantes. Vous n’avez pas vu grand monde dans la rue lors des déremboursements, ni lorsque la certification des hôpitaux a été rendue publique. C’est parce que nous avions travaillé en amont. Notre force est plus dans notre degré de crédibilité que dans des pouvoirs de sanction. Nous n’avons pas à prendre la place du décideur, du payeur ni de l’inspecteur. Nous sommes sur ce point très différents d’autres autorités, qui disposent d’un pouvoir de sanction ou d’autorisation, par exemple.
M. François Romaneix. Les déremboursements évoqués font partie d’une opération de révision de l’ensemble de la pharmacopée, entreprise à la fin des années 1990 et qui s’est achevée en 2006. Mais nous pouvons de notre propre initiative proposer le déclassement d’un médicament lors de la réévaluation que nous pratiquons systématiquement cinq ans après son inscription, ou recommander qu’un nouveau médicament ne soit pas remboursé (ce qui est le cas de près de 10 % des médicaments proposés au remboursement). En général, nous sommes suivis par le ministre.
M. René Dosière, rapporteur. Pour ces nouveaux médicaments justement, comment s’organise votre intervention avec celle de l’autorité de mise sur le marché ?
M. Laurent Degos. La mise sur le marché de nouveaux médicaments innovants est dorénavant décidée au niveau européen par l’EMA, l’agence européenne des médicaments, basée à Londres, avec laquelle l’AFSSAPS est en relation. Ensuite, chaque pays décide de son remboursement selon ses propres critères – un critère d’égalité pour nous ou d’utilité pour les Britanniques, par exemple. Chaque pays a donc une agence chargée de l’évaluation des technologies, qui aide à déterminer notamment le prix auquel le médicament sera accepté. Notre force est que nous agissons immédiatement après la mise sur le marché, en établissant une liste positive des médicaments remboursés et en donnant au ministère des arguments pour négocier le prix avec l’industriel. Tous les autres pays n’agissent qu’au bout de deux à trois ans. Entre-temps, le médicament a été admis au prix fixé par l’industriel, et remboursé… et voilà que l’agence décide que ce n’est pas un bon produit, ou que son prix est trop élevé ! Cela soulève des réactions des industriels, des professionnels et de la population. Mes collègues britanniques sont en permanence en procès et l’agence allemande est carrément en péril.
En France, le prix peut donc être négocié : dans les faits, le prix public est forcément le prix européen – s’il était plus bas, tout le monde viendrait acheter chez nous –, mais si nous avons estimé que le produit ne le valait pas, l’industriel fait une ristourne officieuse au gouvernement. Notre système est donc très efficace, mais il suppose d’étudier 800 médicaments par an, un par un, alors que les autres agences n’en voient qu’une quinzaine, et du même type. C’est un travail forcené, mais extrêmement utile pour l’État.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous une idée de la répartition de l’activité des membres du collège ?
M. Laurent Degos. Les activités de flux sont extrêmement importantes, avec 5 000 médicaments, 50 000 dispositifs, 7 200 actes et 3 000 établissements à examiner. Parallèlement, il y a l’activité relative aux bonnes pratiques, qui peut se programmer, sachant que chaque recommandation prend 18 mois. Notre équivalent en Grande-Bretagne, le National Institute for Clinical Excellence (NICE) qui a un budget deux fois plus élevé que nous sans avoir à s’occuper de la certification des hôpitaux, ne formule que douze recommandations par an, contre une vingtaine pour nous. Enfin, il y a des travaux plus ponctuels, comme la révision de la liste des maladies chroniques remboursées à 100 % que nous avons menée durant ces cinq années. Le prochain collège ne refera pas ce travail.
M. René Dosière, rapporteur. Chaque membre du collège préside une commission ?
M. Laurent Degos. Oui, sauf moi.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quelle est la limite des compétences entre la Haute autorité et l’AFSSAPS, qui est un établissement public mais qui jouit également d’une réelle autorité ? Et pouvez-vous dresser la géographie de l’ensemble des organismes du secteur : ANESM, INPES, INCa… ? Avons-nous besoin de tout cela ?
M. Laurent Degos. L’AFSSAPS effectue la mise sur le marché et le contrôle des boîtes de médicaments. C’est la police des médicaments – ainsi que je vous l’ai dit, la douane est assurée au niveau européen. Elle est placée, comme toutes les agences analogues des autres pays, sous l’autorité directe du ministre pour pouvoir agir immédiatement en cas d’alerte. Et dans tous les pays, c’est une autorité totalement indépendante, afin d’être crédible, qui effectue le travail sur le remboursement des médicaments. Ces deux activités sont extrêmement différentes. Il n’y a pas de chevauchement entre nous. Nous avons seulement à nous concerter en matière de bon usage du médicament.
Mais une difficulté se manifeste tout de même dans les contours des institutions, entre la Haute autorité, créée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2004, et le Haut conseil de la santé publique créé par la loi sur la santé publique de la même année. Ce conseil mène des activités très ressemblantes, mais n’est qu’une réunion d’experts, et non pas une institution permanente. Pourquoi est-il chargé du vaccin alors que nous nous occupons du reste des médicaments ? Pourquoi intervient-il en matière de dépistage alors que nous établissons les recommandations de santé publique ? Certains points méritent des ajustements et je compte sur le Parlement pour y voir plus clair.
M. Christian Vanneste, rapporteur. C’est le Haut conseil qui a été consulté sur la vaccination pour la grippe A ?
M. François Romaneix. C’est le comité technique des vaccinations, qui lui est rattaché.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Ne pourrait-on imaginer un regroupement ?
M. Laurent Degos. Au bout de cinq ans, il semblerait que si, mais cela ne nous a pas empêchés de vivre très bien ensemble jusqu’à présent.
Autre exemple de difficulté : pour ce qui est de la prévention, je comprends que l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, soit chargé du tabac, de l’alcool et des addictions, mais il me semble que la prévention secondaire en cas de diabète ou d’hépatite devrait plutôt revenir à l’autorité chargée des bonnes pratiques ! Cela peut encore se faire : notre homologue britannique NICE qui a été chargé de la prévention des complications de maladies six ans après ses débuts.
L’Institut national du cancer, l’INCa, remplit un rôle de préparation alors que nous décernons tous les labels, autorisations et certificats. Nous travaillons fort bien ensemble : ils fournissent tout le travail en amont qui nous est nécessaire. Nous nous entendons aussi très bien avec l’Agence de la biomédecine et l’Établissement français du sang, avec lequel nous avons même passé des contrats. Les ajustements ne sont donc pas tant nécessaires avec l’AFSSAPS qu’avec le Haut conseil de santé et peut-être l’INPES. Pour ce qui est du regroupement entre l’AFSSET et l’AFSSA, les agences françaises de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail d’une part, et des aliments d’autre part, nous avons pour l’instant assez peu travaillé sur la santé au travail.
M. René Dosière, rapporteur. Nous nous reverrons spécifiquement sur la question du contour de ces différents organismes. En ma qualité de géographe, j’aimerais tracer des cercles figurant leurs domaines de compétences respectifs afin de pouvoir mesurer les recoupements : une réorganisation pourrait faire partie de nos recommandations. Nous y reviendrons donc. Nous vous adresserons également un questionnaire complémentaire sur les points qui restent à éclaircir. Je voudrais juste revenir sur la question du coût de location de vos locaux, qui paraissent assez élevés, même si vous êtes loin d’être la seule autorité dans ce cas.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le bon point est que vous êtes installés hors de Paris.
M. Laurent Degos. Dans un premier temps, nous avons repris la location de l’ANAES à Saint-Denis et avons loué des locaux dans les environs pour installer le personnel issu de l’AFSSAPS et celui qui répondait à nos missions supplémentaires. Les deux sites ne sont qu’à 500 mètres de distance mais il est assez peu fonctionnel de travailler dans ces conditions. Nous avons envisagé de rompre le contrat de l’ANAES, mais le coût aurait été exorbitant. En revanche, nous allons bientôt avoir la possibilité de renégocier le contrat.
M. François Romaneix. L’ANAES s’est installée en 2003. Lors de la création de la Haute autorité, nous avons dû louer des locaux supplémentaires pour accueillir le personnel provenant de l’AFSSAPS. Depuis, nous avons subi la hausse de l’indice INSEE concernant les loyers. Aujourd’hui, le coût de nos locaux est légèrement supérieur au prix du marché. Nous avons donc entrepris avec l’aide d’un consultant une renégociation des deux baux, qui arrivent à échéance dans les prochaines années. Le coût d’une dénonciation serait bien trop élevé. Cette renégociation prend du temps, elle s’accompagne de toutes les procédures et de toutes les menaces judiciaires appropriées, mais nous avons bon espoir de la mener à bien.
M. René Dosière, rapporteur. Merci beaucoup. Nous nous reverrons.
Audition de M. Michel Boyon, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), accompagné de M. Olivier Japiot, directeur général, et de Mme Danièle Brault, directrice administrative et financière.
jeudi 29 avril 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Monsieur le Président, le Comité d’évaluation et de contrôle (CEC), créé au sein de notre Assemblée à la suite de la réforme constitutionnelle, et présidé par M. Bernard Accoyer, diligente des missions d’information. L’une des premières est consacrée à l’évaluation des autorités administratives indépendantes, dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) fait partie. Nous avons déjà entendu plusieurs présidents d’organismes similaires. Dans ce tableau, vous faites figure de « chauve-souris » puisque vous vous situez à la fois parmi les autorités qui protègent les droits et parmi celles qui régulent un marché. Vous avez ainsi considérablement accru votre champ d’action depuis quelques années. Avez-vous atteint les objectifs qui vous étaient assignés ? Vos moyens sont-ils suffisants ?
Votre domaine d’interventions est caractérisé par la convergence. N’y aurait-il pas des regroupements possibles avec d’autres autorités qui se situent à votre frontière de compétences, telles que l’ARCEP ? En sens inverse, la multiplicité de vos missions ne rend-elle pas votre tâche trop lourde ? Celle-ci pourrait-elle être segmentée ?
M. Michel Boyon, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. La nature très particulière du CSA résulte de ce qu’il est une institution de régulation, une autorité administrative indépendante parmi les toutes premières qui aient été créées, dont on a peu à peu développé les missions, mais aussi de ce qu’il se situe à un carrefour entre les libertés publiques et la vie économique.
J’avoue n’être que moyennement satisfait de la floraison d’autorités administratives indépendantes. Celles-ci se justifient quand on touche aux libertés publiques. Dans d’autres domaines, leur existence est plus discutable. J’ai ainsi présidé, il y a quelques années, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD). Il avait été mis en place en raison de l’hésitation traditionnelle des ministres des sports à prononcer des sanctions contre des sportifs. L’expérience s’est toutefois révélée positive et le Conseil s’est transformé en Agence de lutte contre le dopage exerçant un rôle beaucoup plus important.
M. René Dosière, rapporteur. La création d’autorités administratives indépendantes résulterait-elle de ce que le pouvoir exécutif n’ose pas faire face à toutes ses responsabilités ?
M. Michel Boyon. Je ne peux pas m’inscrire en faux contre ce que vous venez de dire. Dans certains cas, des autorités ont été créées au nom de la technicité du domaine concerné alors que les administrations traditionnelles auraient parfaitement pu remplir les missions correspondantes. Il existe deux raisons justifiant la mise en place d’une autorité indépendante : la possibilité d’infliger des sanctions dans un domaine touchant à une liberté publique fondamentale et celle d’accompagner, à titre transitoire, la fin d’un monopole et l’ouverture d’un secteur à la concurrence. Ce fut la raison de la création de l’ART devenu ARCEP avec la fin du monopole de France Télécom. Cela a aussi été le cas dans le secteur ferroviaire lorsque la SNCF a perdu l’exclusivité du fret, et peut-être demain celui des voyageurs. Je dis cela à titre purement personnel…
Le CSA a vingt-et-un ans. Il a résisté aux alternances, petites et grandes, auxquelles avaient successivement succombé la Haute Autorité de la communication audiovisuelle créée en 1982 et la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) créée en 1986. Le principe de son existence n’est plus contesté, même si, naturellement, on peut toujours discuter de sa composition ou de l’étendue de ses missions. Il a maintenant acquis compétence et légitimité.
La régulation audiovisuelle a beaucoup changé depuis 1982. Il s’agissait à l’origine de rompre la dépendance de l’audiovisuel public à l’égard du pouvoir politique. C’est à ce titre que, par exemple, la Haute Autorité fut chargée de la répartition des temps de parole à l’antenne entre le gouvernement, la majorité et l’opposition.
La CNCL comportait treize membres, ce qui était excessif. Lorsqu’elle fut créée, la suppression du monopole d’État sur la télévision faisait craindre une invasion de programmes étrangers, surtout américains, sur nos écrans. Il fallait donc prendre des précautions et mener une politique culturelle comportant notamment des quotas de diffusion et des obligations de production. La deuxième grande mission de la régulation audiovisuelle consista ainsi, pour la CNCL, à contribuer à la défense de l’exception culturelle française, terme que je trouve personnellement trop défensif et auquel je préfère celui d’« expression » culturelle.
Après 1988, le CSA, en plus de ces deux missions de régulation, a développé son action dans le domaine sociétal, notamment pour la protection de l’enfance et de l’adolescence, le respect et la promotion de la diversité de la société française, la façon, au-delà de la question de leur durée de diffusion, de présenter les messages publicitaires. Il a également accompli un travail remarquable pour l’application de la loi du 11 février 2005 sur les droits des personnes sourds et malentendants afin de faciliter l’accès de celles-ci aux programmes télévisés. Cela entraîne pour les chaînes des coûts importants de sous-titrage des émissions et de traduction en langue des signes. Plusieurs lois ont ainsi confié au CSA des responsabilités sociales nouvelles qui ont introduit une troisième forme de régulation.
Enfin, l’activité du CSA a acquis une dimension économique et technologique. Nous prenons désormais des décisions structurantes dans un secteur audiovisuel très diversifié. Le nombre des chaînes a beaucoup augmenté. Leur taille est très disparate. On compte environ mille cinq cents producteurs : seuls les États-Unis et l’Inde en ont davantage. Il s’agit pour la plupart d’entreprises modestes, mais qui occupent néanmoins une place sur le marché. Il faut aussi mentionner les entreprises de la filière technique. Au total, le secteur représente environ 400 000 emplois. Le CSA jette donc aujourd’hui un regard plus économique sur l’audiovisuel. Ses rapports avec les opérateurs ont changé : ceux-ci ne viennent plus seulement pour se faire morigéner, mais pour procéder à des échanges, particulièrement sur les questions économiques et techniques.
Le CSA a accompli un travail impressionnant et rarement contesté. Il ne réclame pas pour autant de moyens supplémentaires. Ses décisions sont rarement critiquées même s’il lui arrive de devoir procéder à des arbitrages entre des intérêts économiques divergents. Ainsi, sa récente acceptation, assortie de conditions, de l’achat par TF1 de TMC et de NT1 a suscité les critiques de chaînes telles que M6.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous n’avez pas répondu à mes questions initiales. Aujourd’hui, la télévision passe aussi par Internet. La convergence s’accroît considérablement. Le paysage audiovisuel s’élargit. Après la télévision numérique terrestre (TNT), le CSA traite de la télévision mobile personnelle (TMP). Or, trois autorités administratives interviennent dans ce même secteur : le CSA, l’ARCEP et la HADOPI. Ne serait-il pas opportun de les regrouper en un seul organisme ? De même, le CSA intervient dans la lutte contre les discriminations, comme la HALDE. Faut-il rassembler toutes les compétences dans une même maison ou, au contraire, séparer les deux types de régulation, économique et technique d’un côté, relative aux libertés publiques de l’autre ?
M. Michel Boyon. Il m’est un peu difficile de répondre sans encourir le soupçon de défendre ma paroisse, d’un plaidoyer pro domo.
On aurait pu, en effet, imaginer que les compétences confiées à la HADOPI soient attribuées au CSA. Mais cela aurait changé la nature de l’institution car il s’agit d’une mission essentiellement répressive.
Le domaine d’intervention de la HALDE est très différent de celui du CSA car, dans un cas, le regard sur la diversité concerne les ressources humaines des entreprises, dans l’autre les programmes audiovisuels eux-mêmes.
L’ARCEP exerce une mission d’accompagnement de suppression d’un monopole, ce qui n’est plus la problématique du CSA, dont les fonctions sont très différentes. L’ARCEP attribue des blocs de fréquences à des opérateurs de télécommunication, qui ensuite les répartissent entre services, engendrant d’ailleurs ainsi des jachères, alors que le CSA attribue les fréquences une par une et à un seul opérateur pour un programme déterminé dont il assure le suivi. L’usage des fréquences relevant de l’ARCEP est payant alors que celui des fréquences du CSA est gratuit en contrepartie d’obligations éditoriales. L’ARCEP n’assure aucun contrôle des contenus tandis que le CSA veille au respect des règles applicables au contenu des émissions.
On ne constate aujourd’hui aucun chevauchement de compétences entre l’ARCEP et le CSA, ni de conflits de frontières. Mais nous avons des échanges sur des questions telles que le dividende numérique ou la télévision mobile personnelle. La Commission européenne a d’ailleurs estimé notre coopération exemplaire.
Les pays dans lesquels il n’existe qu’un seul organisme rassemblant les compétences de l’ARCEP et du CSA sont aussi ceux où l’on n’exerce aucun ou peu de contrôle sur les contenus.
La régulation économique et technique et la régulation pour le respect du droit fonctionnent bien car elles sont précisément exercées ensemble au sein du même organisme. Leur séparation soulèverait de grandes difficultés pratiques et menacerait l’effectivité des décisions de l’autorité de régulation.
M. Louis Giscard d’Estaing. Je m’interroge globalement sur les moyens attribués aux autorités administratives indépendantes. Qui assure le suivi de vos crédits dans notre assemblée ? Est-ce le rapporteur spécial de la mission média à la Commission des finances ?
Le budget de fonctionnement du CSA a beaucoup augmenté ces derniers temps, notamment ses dépenses de loyer et ses crédits affectés au lancement de la TNT, lesquels ont été abondés de 2 millions d’euros pour 2010. Quelle différence de traitement fait-on entre les charges de fonctionnement ordinaires et ce type de dépenses exceptionnelles ? On connaît la tendance des autorités administratives à demander des augmentations de moyens pour faire face à des besoins exceptionnels et à les faire ensuite reconduire comme des charges courantes.
M. Michel Boyon. La Cour des Comptes a plusieurs fois contrôlé le CSA et lui a toujours décerné un satisfecit. C’est notamment le cas de son dernier rapport en 2008.
M. Louis Giscard d’Estaing. Ce rapport comportait aussi des préconisations…
M. Michel Boyon. Depuis 1989, les effectifs de personnels du CSA n’ont pas considérablement augmenté. On comptait alors soixante-cinq chaînes de télévision, on en compte quatre cents aujourd’hui.
Le ministère des finances n’a jamais réellement contesté l’accroissement des crédits du CSA.
Les crédits exceptionnels obtenus pour la planification de la TNT et le passage à la diffusion en haute définition n’ont qu’un caractère temporaire et correspondent au sommet des besoins. Les recrutements complémentaires auxquels nous avons procédé portent sur des contrats à durée déterminée dont les missions s’achèveront à partir de 2012.
L’accroissement pérenne des moyens du CSA reste faible sur vingt ans et nous n’en réclamons pas de supplémentaires. Je n’aime pas participer aux lamentations des pleureuses.
Des nombreux organismes publics que j’ai connus, le CSA est l’un de ceux où l’on travaille le plus.
Quant à notre charge immobilière, elle vient de connaître une diminution spectaculaire.
M. Louis Giscard d’Estaing. Pour cette année ?
M. Olivier Japiot, directeur général. Notre bailleur est un fonds allemand. Notre contrat de location ne s’achève qu’à la fin de 2011, ce qui ne nous met pas aujourd’hui en bonne position pour en renégocier les termes. Le CSA a pourtant déjà obtenu une diminution sensible du prix au mètre carré, qui est passé de 575 à 505 euros dès cette année. Nous avons pour cela bénéficié de l’appui de France Domaines et de la libération de locaux par les services du ministère du travail. Nous espérons réduire encore le loyer « économique » (grâce à des franchises de loyers), jusqu’à 430 euros.
M. Christian Vanneste, rapporteur. C’est donc encore mieux que l’objectif de 480 euros dont vous nous aviez informés. Se pose aussi la question de votre ratio de mètres carrés par poste de travail, qui est aujourd’hui de 16,7 alors que la norme s’établit à 12.
M. Olivier Japiot. En réalité, nous sommes plutôt à 14. Car la tour où est installé le CSA, en forme de tripode, nous fait perdre de la surface utile. En outre, nos salles de réunion sont extrêmement utilisées. Mais nous parviendrons à réduire le ratio.
M. Michel Boyon. Nous tenons en effet de plus en plus de réunions avec « nos ressortissants ».
Un élément à prendre en compte est aussi que notre proportion d’agents de catégorie A, eu égard à la nature des missions du CSA, est particulièrement élevée.
M. Olivier Japiot. Nous avons étudié, avec France Domaines, la possibilité de quitter l’actuelle tour. Mais le coût du déménagement et les coûts annexes qui en résulteraient ne permettraient pas de réaliser un gain aussi important que la diminution des loyers que nous sommes en train d’obtenir avant même le terme de notre bail actuel.
M. Louis Giscard d’Estaing. Libérerez-vous des locaux à la fin de 2012 ?
M. Olivier Japiot. Oui car, à ce moment-là, nos prestataires et effectifs supplémentaires partiront, ce qui représente l’occupation d’un demi-étage.
Mais il faut rappeler que les grands chantiers audiovisuels ne sont pas encore terminés : il reste au CSA à traiter de la libération des fréquences de diffusion analogique et de l’attribution consécutive de nouvelles fréquences numériques à de nouvelles chaînes et à des programmes en haute définition. Le passage au « tout numérique » se traduira par l’ouverture de deux nouveaux multiplex à la fin de 2011, pour atteindre, au terme du plan France numérique 2012, le nombre de onze multiplex, plus deux consacrés à la télévision mobile personnelle. L’ensemble nécessitera encore au moins deux ans de travaux. Il faut y ajouter la numérisation de la radio, rendue indispensable par la saturation de la bande en modulation de fréquences, soit encore trois à quatre ans de travail. Enfin, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle a donné compétence au CSA en matière de services de médias audiovisuels à la demande. La décrue de nos missions techniques ne sera donc que progressive.
M. Louis Giscard d’Estaing. Le ministère de la défense a libéré des fréquences qui seront affectées à la téléphonie mobile. Les synergies du CSA et de l’ARCEP seront de plus en plus grandes. À l’horizon des trois à cinq prochaines années, les mêmes opérateurs fourniront les services téléphoniques et ceux de la télévision mobile. Cette évolution va-t-elle modifier vos méthodes de travail ?
M. Olivier Japiot. L’ARCEP ne planifie pas dans le détail les fréquences qu’elle attribue. Elle n’exerce aucune compétence sur les contenus des services. En matière de télévision en haute définition et de radio numérique, il n’existe pas non plus d’interaction entre elle et le CSA.
M. René Dosière, rapporteur. Le contrôleur budgétaire du CSA est, à l’Assemblée nationale, M. Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial de la Commission des finances, mais vos crédits sont inscrits avec ceux des services du Premier ministre, qui dépendent d’un autre rapporteur spécial, M. Jean-Pierre Brard. Comme s’opère la coordination du contrôle ?
M. Olivier Japiot. Sans problème. On nous pose des questions. Nous y répondons.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous parfois des conflits avec certaines administrations de l’État ?
M. Michel Boyon. Depuis trois ans que je préside le CSA, je n’en ai pas connu. Il en exista dans le passé. Mais nos compétences sont maintenant clairement définies, ce qui évite les problèmes d’interprétation de la loi quant aux frontières avec les administrations.
L’augmentation de nos crédits de fonctionnement résultait largement de celle de nos crédits d’études et de planification de fréquences, notamment pour celles confiées à Télédiffusion de France (TDF). Ce poste de dépenses diminuera donc également.
M. René Dosière, rapporteur. Quand vous réalisez ainsi des économies, conservez-vous les crédits libérés pour votre fonctionnement courant ou les rétrocédez-vous ?
M. Michel Boyon. Nous les rétrocédons. Je précise que jamais le ministère des finances n’a véritablement contesté les demandes budgétaires du CSA, aussi bien pour les crédits que pour les effectifs. Il nous a également aidés dans notre dossier immobilier.
M. Christian Vanneste, rapporteur. La Cour des comptes avait cependant pointé des surévaluations de crédits initiaux par rapport à leur consommation, témoignant de mauvaises prévisions initiales.
M. Olivier Japiot. Cela a été amélioré : en 2009, le CSA a consommé 99,9 % de ses crédits inscrits. L’écart antérieur provenait, jusqu’en 2007, du décalage des études réalisées pour la mise en place de la TNT, qui étaient très lourdes et avaient pris du retard.
M. René Dosière, rapporteur. Tous les responsables d’autorités administratives indépendantes tiennent le même discours sur leurs relations avec le ministère des finances, à croire que celui-ci se montre plus généreux avec elles qu’avec les ministères.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Votre charte de gestion s’applique-t-elle dans de bonnes conditions ?
M. Olivier Japiot. Oui, et depuis plusieurs années. Le Secrétariat général du Gouvernement n’a pas autorité pour répartir nos crédits, mais le CSA s’est porté volontaire pour être pionnier pour expérimenter le service facturier.
Nous sommes bien sûr ouverts à la mutualisation de moyens avec d’autres autorités.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous relevé des conflits d’intérêts concernant certains membres du CSA liés à certaines entreprises audiovisuelles ?
M. Michel Boyon. Je n’ai eu connaissance que d’un seul cas, en 2002. Un membre, resté actionnaire d’un opérateur audiovisuel, a dû démissionner du CSA.
La loi est très stricte sur les interdictions d’exercer une activité dans l’audiovisuel pour les membres du CSA.
Les règles sont tout aussi sévères à la fin du mandat. D’une part, s’applique la disposition pénale de droit commun interdisant d’occuper, avant trois ans, des fonctions dans un organisme sur lequel on a exercé un contrôle. D’autre part, des règles spécifiques au CSA interdisent à ses anciens membres de travailler, avant un an, dans plusieurs, secteurs, dont l’audiovisuel, la presse, l’édition, le cinéma. Ce champ, très large, peut d’ailleurs soulever des difficultés pratiques pour la composition du collège si l’on veut que celui-ci comporte des professionnels et non uniquement des non-professionnels en fin de carrière. Aujourd’hui, la composition du CSA présente un équilibre satisfaisant entre les différentes compétences professionnelles et entre les âges, qui vont de trente-neuf à soixante-cinq ans.
M. René Dosière, rapporteur. La loi a transféré au pouvoir exécutif la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, après avis conforme du CSA. N’existe-t-il pas un risque que celui-ci, s’il le donne, soit accusé de se tenir aux ordres du pouvoir politique et, s’il ne le donne pas, de se rebeller contre l’autorité du Président de la République ?
M. Michel Boyon. L’application du nouveau mode de désignation ne pose aucun problème au CSA, qui assume ses responsabilités. Ainsi, pour la nomination de M. Jean-Luc Hees à la présidence de Radio France, nous avons procédé à son audition publique, qui pouvait être retransmise à la télévision. Aucune chaîne n’a choisi de le faire, mais le CSA a diffusé l’audition sur son site Internet. L’avis conforme a été donné, au scrutin secret, par six voix contre deux et une abstention. Pour la présidence de France Télévisions, une chaîne publique retransmettra peut-être l’audition du candidat…
En tout état de cause, le CSA pourrait parfaitement envisager un désaccord avec le Gouvernement si celui-ci lui présentait une candidature discutable, en raison d’une insuffisante indépendance d’esprit ou d’une trop faible compétence de la personne concernée. Nous n’aurions pas d’état d’âme à affirmer notre position.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Selon la loi, le CSA peut saisir la justice, mais ne peut se porter partie civile. Est-ce gênant ?
M. Michel Boyon. Pas jusqu’à présent.
Je voudrais souligner un autre problème qui est celui de la diffusion sur Internet. Le CSA est compétent pour toutes les radios et télévisions, même si leurs programmes ne sont diffusés que par Internet. Il est également compétent pour les services audiovisuels à la demande. En revanche, il n’exerce aucun contrôle sur les autres contenus audiovisuels circulant sur Internet. L’opinion publique comprend mal qu’il existe une signalétique des programmes de télévision, faite par le CSA, et qu’il n’existe rien pour Internet. Le sujet est délicat car on court toujours le risque, en évoquant ce sujet, d’être accusé d’être liberticide. Il a été un peu abordé à l’Assemblée nationale lors des débats sur la réforme de l’audiovisuel public et sur la loi HADOPI. Mais le problème demeure. Le CSA ne réclame pas pour autant des pouvoirs supplémentaires. Je tiens seulement à signaler une anomalie.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous avons entendu et nous vous remercions.
Audition de M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), accompagné de M. Yann Padova, secrétaire général, et de Mme Isabelle Pheulpin, directrice des ressources humaines, financières, informatiques et logistiques
Mercredi 19 mai 2010
M. Christian Vanneste, rapporteur. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
La réforme constitutionnelle de 2008 a créé un comité d’évaluation et de contrôle destiné à permettre au Parlement de mieux évaluer l’impact des lois qu’il vote. C’est dans ce cadre que nous souhaitons vous interroger sur ce qu’est la Commission nationale de l’informatique et des libertés – la CNIL –, sur ses objectifs, sur ses moyens et sur l’évaluation que vous faites de cet instrument très important, qui dispose d’un pouvoir réel en tant notamment que conseiller de l’exécutif et du Parlement et dont la mission s’accroît au fil des évolutions technologiques – je pense notamment aux craintes que vous exprimiez récemment devant les menaces que pourrait représenter pour les libertés individuelles l’évolution des technologies, et en particulier des nanotechnologies.
M. René Dosière, rapporteur. Compte tenu de votre rôle important de protecteur des libertés individuelles, vous devez souvent vous heurter, officiellement ou officieusement, au pouvoir exécutif, qui n’obéit pas toujours à la même logique. M. Vanneste et moi-même sommes tout juste de retour du Québec, où nous avons pu observer que la protection du citoyen y est plus ancrée dans les mœurs qu’elle ne l’est dans notre pays. Les frictions avec le pouvoir exécutif gênent-elles le fonctionnement de votre commission ?
M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Non seulement de telles frictions, prévisibles à chaque contact avec le cabinet du ministre de l’intérieur ou de la justice, ne me gênent pas, mais elles me semblent même très saines. À cet égard, le fait d’être élu par mes pairs, les seize autres membres de la CNIL, me donne une légitimité indispensable, qui facilite grandement les choses. Cette situation est, du reste, unique parmi les autorités indépendantes et nous y tenons beaucoup.
Il est heureux, par ailleurs, que je sois aussi parlementaire, car je ne sais pas comment j’aurais obtenu les mêmes budgets ou remporté les mêmes combats – à propos des fichiers de police, par exemple – si je ne l’avais pas été. Je ne suis donc, je le répète, nullement gêné par ces frictions avec des ministres qui se situent pourtant, politiquement, du même côté que moi.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Est-ce le syndrome de Becket – nommé par le roi et indépendant du roi ? La fonction crée-t-elle cet état d’esprit ?
M. Alex Türk. C’est aussi dans ma nature. Bien que non-inscrit, j’ai des opinions politiques que je ne cache pas. Je sais surtout que je travaille sous le regard de mes seize collègues : étant, à l’origine, parlementaire – ce qui n’avait du reste rien de nécessaire, car le président de la CNIL aurait pu être aussi bien magistrat, universitaire ou avocat –, je sais que mes collègues m’observent et s’assurent que je présente bien l’indépendance nécessaire à cette fonction – ce qui semble être le cas pour l’instant. Si j’étais désigné par l’exécutif ou par le législatif, mon positionnement serait très différent.
M. René Dosière, rapporteur. Le fait d’être désigné pour une durée non révocable ou limitée ne vous donnerait-il pas une indépendance totale ?
M. Alex Türk. Je ne suis pas certain que, si j’avais été magistrat, j’aurais obtenu du pouvoir exécutif l’aide considérable qu’il m’a apportée en matière budgétaire et qui a permis de tripler pratiquement l’effectif de la CNIL en cinq ans.
M. René Dosière, rapporteur. Ce serait peut-être plus facile si vous étiez nommé par le Parlement. Au Québec, le président de la Cour des comptes et le directeur des élections, nommés par le Parlement à la majorité des deux tiers – de fait par consensus –, ne rendent de comptes qu’à celui-ci, ce qui leur confère un poids considérable.
M. Alex Türk. Jennifer Stoddart, commissaire à la vie privée du Canada et ancienne présidente de la Commission d’accès à l’information du Québec, que je connais depuis longtemps, a néanmoins dû lâcher prise plusieurs fois, car elle n’avait pas la possibilité de s’imposer face au Parlement.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Parce qu’elle est fonctionnaire parlementaire ?
M. Alex Türk. Oui.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Votre mode d’élection, qui est l’exception, devrait-il être généralisé ?
M. Alex Türk. Pour les autorités de contrôle, c’est une garantie absolue. La CNIL est, ne l’oublions pas, la première autorité de ce genre créée en France. Le fait que je sois parlementaire, même si cela m’a été très utile, est accessoire, car le président qu’élisent en leur sein les dix-sept membres de la Commission peut être aussi bien un parlementaire que, comme cela a été le cas avant moi, une personnalité extérieure ou un conseiller d’État, et même un Premier président de la Cour de cassation.
La légitimité de mon élection par mes pairs me donne une grande marge de manœuvre. Je peux ainsi résister au Premier ministre ou au ministre concerné sur certains points en m’appuyant sur le mandat reçu de mes collègues.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Cela ne serait-il pas plus facile encore si le mandat du président n’était pas renouvelable ?
M. Alex Türk. Les parlementaires membres de la CNIL sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. Ainsi ne suis-je pas élu pour cinq ans à la présidence de la Commission – à la différence de ce qui serait le cas, par exemple, pour un magistrat. Il serait difficile de modifier la loi pour instaurer un mandat de cinq ans correspondant au mandat parlementaire, car les renouvellements de l’Assemblée nationale et du Sénat ne correspondent bien évidemment pas à ceux de la CNIL.
Je me sens aussi à l’aise aujourd’hui vis-à-vis d’un gouvernement de droite que je le serais vis-à-vis d’un gouvernement de gauche, car les seize membres de la Commission qui m’ont élu me fixent des lignes d’action. Les positions que je défends ne sont pas mes positions personnelles, mais celles qui ont été définies en séance plénière par des membres aussi divers par leur statut que par leur sensibilité politique. Il m’est ainsi arrivé de soutenir une position qui n’était pas la mienne. À propos de la loi Hadopi, par exemple, j’ai défendu la position de la CNIL en ma qualité de président de celle-ci, alors que j’ai voté différemment en tant que sénateur. Personnellement, je vis bien cette contrainte, qui fait partie de mon métier. Pour la presse, en revanche, la situation est moins confortable et on m’a parfois reproché, à tort, un double langage.
M. René Dosière, rapporteur. J’avais quelques réserves sur le fait qu’un parlementaire puisse être président de la CNIL. Or, vous nous expliquez que ce statut est plutôt favorable.
M. Alex Türk. Si je n’avais pas été parlementaire, je n’aurais par obtenu les mêmes résultats.
M. René Dosière, rapporteur. Les succès budgétaires ne sont pas un argument, car on devrait donner à la CNIL les moyens nécessaires, indépendamment de la qualité de son président.
M. Alex Türk. Il ne s’agit pas seulement de budget, mais aussi du travail que je mène auprès des parlementaires, qui m’ouvrent leurs portes beaucoup plus facilement. Alors que mon prédécesseur, en cinq ans de mandat, n’a jamais été auditionné au Parlement, je l’ai été cinquante ou cent fois.
M. René Dosière, rapporteur. S’il n’a pas été auditionné, c’est parce que le Parlement n’a pas fait son travail.
M. Alex Türk. Vous savez bien que, dans la pratique, il est facile pour moi de téléphoner pour être reçu au Sénat et à l’Assemblée quand j’en ai besoin. Je peux ainsi avoir un contact permanent avec les parlementaires et leur apporter de la matière pour réfléchir aux grands sujets de société. C’est à ce titre que la CNIL est la « petite sœur » des deux assemblées. En contrepartie, j’écoute.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous apportez aussi des avis.
M. Alex Türk. Il m’arrive, au retour d’une réunion avec les parlementaires, d’informer mes collaborateurs de leurs critiques ou de leurs suggestions. Ce jeu très intéressant pour notre autorité lui a permis, en cinq ans, de se repositionner fondamentalement sur les enjeux essentiels.
M. René Dosière, rapporteur. Les parlementaires assistent-ils à vos réunions ?
M. Alex Türk. Systématiquement.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Le collège est-il assez nombreux pour le nombre de dossiers à traiter ? D’un autre côté, n’est-il pas, avec dix-sept membres, un peu lourd ?
M. Alex Türk. Le collège fonctionne un peu comme une académie. Toutes les sphères de la société y sont représentées et ses débats sont très vivants et très enrichissants. Bien que ses membres soient aussi bien de gauche que de droite, dans une proportion qui a varié au cours des dix-huit dernières années, 98 % de ses décisions sont prises quasiment à l’unanimité, et pratiquement jamais avec des votes contre – tout au plus, parfois, quelques abstentions.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Certains débats ont-ils un caractère idéologique ?
M. Alex Türk. En cinq ans, je n’en ai jamais vu. Il m’arrive en revanche de demander aux journalistes, à l’issue d’une séance à laquelle ils ont assisté, s’ils sont capables de dire qui est de gauche ou de droite, et les résultats sont parfois surprenants. Tout récemment encore, un journaliste s’est mépris à propos de deux de nos collègues, dont l’un, très à droite – d’une droite « libérale » au sens que le terme pouvait avoir sous la monarchie de Juillet – se montre intraitable en matière de libertés individuelles, tandis que l’autre, plutôt de gauche, est plutôt étatiste. Il me semble donc plutôt bon que les membres de la Commission soient assez nombreux.
M. René Dosière, rapporteur. Un quorum est-il requis ?
M. Alex Türk. La moyenne de participation est de quinze membres sur dix-sept. À dire vrai, cela tient sans doute un peu au fait que la CNIL est l’une des seules autorités dont les membres ne sont pas rémunérés au forfait : un membres qui ne viendrait jamais ne toucherait pas un centime. Dans le cadre de la réflexion sur la nouvelle loi, M. Guy Braibant avait envisagé de ramener à neuf le nombre de membres, mais y avait renoncé pour toutes ces raisons. En outre, nous nous sommes répartis les tâches en seize secteurs et, à l’exception de l’un ou l’autre membre qui se dit débordé, la charge de travail est raisonnable – de l’ordre d’une journée et demie ou deux journées et demie par semaine, sans compter les déplacements, un peu plus pour les vice-présidents.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Les indemnités sont, en outre, savamment calculées en fonction de la difficulté du dossier.
M. Alex Türk. J’ai souhaité mettre en place ce mécanisme car je trouvais gênant qu’une personne qui avait passé sept ou huit heures à préparer une séance, puis était à la peine pendant l’heure et demie que durait celle-ci, ne touche pas plus que celle qui venait simplement assister à cette séance. L’évaluation de la quantité de travail relève du secrétaire général, qui tient compte, le cas échéant, de l’avis de l’intéressé.
S’il est toutefois une réserve à formuler sur la composition de la Commission, c’est peut-être qu’elle est très juridique et qu’il conviendrait sans doute de l’ouvrir en direction des acteurs de l’informatique – ingénieurs et patrons de structures informatiques – et vers les sciences humaines. Sans doute recruterons-nous d’ailleurs prochainement un sociologue ou un philosophe, qui apporterait à nos débats une dimension qui leur manque.
M. René Dosière, rapporteur. Il faudrait donc le nommer au titre des personnalités qualifiées.
M. Alex Türk. Ou parmi les parlementaires. Du reste, les deux sénateurs membres de la Commission appartiennent l’un à la commission des Lois, et l’autre à la commission des Affaires économiques, tandis que leurs collègues députés viennent tous deux de la commission des Lois.
Pour les parlementaires aussi, la situation a évolué. En 1992, mon élection à la CNIL s’est déroulée de la manière suivante : arrivé un peu en retard à la réunion de la Commission des lois du Sénat, j’y ai été accueilli par un tonnerre d’applaudissements. Le président de la séance m’a alors informé que je venais d’être élu pour siéger à la CNIL : le fait que je ne le souhaitasse pas était ma première qualité, la deuxième étant que je n’étais pas là pour me défendre, la troisième, que j’étais le benjamin de la Commission et la quatrième, que j’étais juriste. Devant mon peu d’enthousiasme, on m’a promis de me trouver un remplaçant l’année suivante, mais j’ai finalement pris goût à cette tâche et, du reste, les sénateurs seraient aujourd’hui prêts à se battre pour siéger à la CNIL.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Quel est le rôle du commissaire du Gouvernement ?
M. Alex Türk. C’est un rôle très complexe et un peu ambigu pour nous.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Est-ce vraiment utile ?
M. René Dosière, rapporteur. La CNIL ne doit-elle pas, dans certains cas, transmettre préalablement ses avis à l’exécutif ?
M. Yann Padova, secrétaire général de la CNIL. Si, à peine de nullité.
M. Alex Türk. Cette obligation est très lourde, et cela d’autant plus que l’exécutif, après avoir fixé par décret des délais très courts, est parfois tenté de passer outre.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous avez, me semble-t-il, connu récemment quelques difficultés en la matière.
M. Yann Padova. En effet, les avis de la CNIL sur les deux décrets d’application relatifs à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ont été pris sur le fondement d’un texte dépourvu de base légale, car la loi n’était pas promulguée. Nous avons néanmoins envoyé notre projet de délibération une semaine avant le délai, car cette procédure s’impose sous peine de nullité et, en cas de contentieux, un avocat habile pourrait soulever le moyen du vice de procédure et obtenir l’annulation du texte d’application. Le cas s’est déjà présenté par le passé. Nous sommes donc régulièrement amenés à rappeler au Gouvernement les dispositions réglementaires qu’il a lui-même fixées.
M. Alex Türk. Si le commissaire du Gouvernement peut nous apporter des éléments d’information, par exemple sur les raisons qui ont motivé la rédaction d’un décret, il est parfois – nécessairement – aussi un peu l’« œil de Moscou » ! Il est donc légitime, dans le cadre de la préservation de l’indépendance de notre Commission, que soient parfois organisées des séances - non officielles, bien entendu – de travail réservées aux dix-sept membres de la Commission. Par exemple, chacun peut comprendre qu’il soit préférable, pour nous, de ne pas exposer devant le commissaire du Gouvernement notre stratégie quant aux amendements que nous pouvons proposer aux parlementaires membres de notre Commission. Cette manière de procéder nous évite de mettre ces derniers en porte-à-faux vis-à-vis du Gouvernement.
Enfin, s’agissant de la présence du commissaire du Gouvernement lorsque la CNIL est réunie en formation contentieuse, qui est amenée à prononcer des sanctions, il arrive que les avocats qui viennent plaider devant nous se montrent quelque peu perplexes lorsqu’ils découvrent que le Gouvernement intervient sur des questions concernant le secteur privé (qui représentent aujourd’hui 80 % de notre activité).
M. René Dosière, rapporteur. Que faudrait-il pour limiter l’activité du commissaire du Gouvernement aux questions relevant du secteur public ?
M. Alex Türk. Il faudrait au moins le faire pour sa présence en formation contentieuse.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Cela supposerait de changer la loi.
M. Yann Padova. De fait, le commissaire du Gouvernement ne joue pas le rôle de l’accusation, qui revient au rapporteur de la CNIL. Sa présence est donc très difficile à comprendre pour les avocats des organismes mis en cause.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Vous paraît-il logique qu’une autorité nouvellement créée soit chargée de superviser les questions liées à la vidéoprotection publique, tandis que la vidéoprotection privée relève de la compétence de la CNIL ?
M. Alex Türk. Notre position, que j’ai exposée à plusieurs reprises au ministre de l’intérieur, est que la CNIL doit disposer de pouvoirs de contrôle sur l’ensemble du territoire national. Il doit s’agir d’un contrôle « par évocation » – il est du reste impossible de contrôler tous les systèmes.
Il convient de bien distinguer la fonction d’évaluation de la performance d’un système en termes de sécurité collective, qui pourrait être confiée à la Commission nationale de vidéosurveillance, de la garantie des libertés publiques et des libertés individuelles dans l’exercice de la vidéosurveillance. Dans la pratique, la plupart des systèmes de vidéosurveillance ne respectent pas la loi, en matière notamment de définition des destinataires des images, de durée de conservation, d’accès des citoyens aux images qui les concernent et de définition des zones soumises à vidéosurveillance. La CNIL n’a pas de jugement à porter sur la technologie, mais elle doit analyser l’usage qui en est fait. Elle n’est ni pour, ni contre la vidéo, qui est parfois efficace et parfois inutile, mais elle doit veiller à ce que ces systèmes se développent en préservant les libertés individuelles. C’est concrètement possible et nous sommes prêts à le faire, car nous disposons d’un corps de contrôleurs professionnels, habilités par le Premier ministre. Il suffit que nous en embauchions encore quelques-uns et les chargions de ce contrôle. La CNIL pourrait rendre chaque année au ministère et au Parlement un rapport sur cette question. Cette proposition rencontre un très fort soutien au Sénat, où elle fait pratiquement l’unanimité au sein de la commission des Lois. J’espère donc qu’elle sera reprise.
M. René Dosière, rapporteur. Il semblerait que les moyens dont vous disposez limitent fortement les contrôles auxquels vous procédez.
M. Alex Türk. Le corps des contrôleurs compte aujourd’hui 13 personnes. C’est encore faible, mais le progrès est considérable. En effet, lorsque je suis arrivé à la présidence de la CNIL, nous procédions à deux contrôles par mois, soit 24 par an, contre pratiquement 300 aujourd’hui, soit 12 fois plus. L’Espagne, pays d’environ 45 millions d’habitants, réalise 700 ou 800 contrôles par an. Un chiffre de 700 à 1 000 semblerait donc raisonnable. Il convient pour cela de développer le service des contrôles, et cela d’autant plus si nous devons contrôler également la vidéosurveillance.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Au-delà des moyens matériels dont vous disposez pour procéder aux contrôles prévus par la loi de 2004, quels sont vos moyens juridiques ?
M. Alex Türk. Nous sommes confrontés à une grave difficulté depuis que le Conseil d’État a donné gain de cause à un avocat qui a développé la thèse selon laquelle les contrôleurs de la CNIL devaient, au moment de procéder à un contrôle inopiné, faire savoir aux responsables concernés qu’ils avaient la possibilité de s’opposer au contrôle. Nous avons alors rédigé une proposition d’amendement visant à régler ce problème en permettant la saisine rapide du juge. Cette proposition a été reprise dans la proposition de loi déposée au Sénat par Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, mais l’avenir de ce texte nous inquiète. La question est urgente et la décision du Conseil d’État a eu pour la CNIL de lourdes conséquences financières.
M. Yann Padova. Les décisions du conseil d’État se sont traduites par l’annulation de toutes nos procédures de sanction et de contrôle jugées irrégulières du fait que les personnes concernées n’avaient pas été averties qu’elles pouvaient s’opposer aux contrôles. Une année du travail de 11 personnes a donc ainsi été perdue, ce qui a fait chuter nos taux d’activité et nous coûte 11 équivalents temps plein travaillés sur une année, soit 600 000 à 700 000 euros.
La rédaction proposée au Sénat permettrait de saisir le juge avant même que puisse se manifester un droit d’opposition, afin d’éviter la disparition des preuves.
M. René Dosière, rapporteur. C’est là une proposition que nous pourrions faire, compte tenu cependant du fait que le président de l’Assemblée nationale insiste sur le suivi des mesures proposées.
M. Alex Türk. À ma connaissance, cette proposition est la seule à laquelle le Gouvernement serait prêt à souscrire dans la proposition de loi Escoffier-Détraigne. Il nous faut donc trouver un autre véhicule législatif, plus rapide.
Au-delà de la perte en volume que vient d’évoquer le secrétaire général, nous déplorons surtout la perte de dossiers importants, qui soulevaient de graves problèmes éthiques en matière de protection des données et des libertés.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Faut-il publier systématiquement les avis de la CNIL sur les projets de loi ?
M. Alex Türk. Cette publication est prévue par la loi Warsmann de mai 2009. Elle ne l’est pas, en revanche, pour les avis relatifs aux décrets. Or, dans une grande démocratie, les avis d’une autorité comme la nôtre devraient pouvoir être connus. Libre à chacun, ensuite, d’en faire ce qu’il voudrait – les parlementaires, par exemple, pourraient s’en inspirer. Il est regrettable que, lors de l’examen du projet de loi Hadopi, j’aie dû répondre à mon collègue sénateur Bruno Retailleau, rapporteur de ce texte, que je n’avais pas le droit de lui communiquer l’avis de la CNIL. Il conviendrait donc que la loi prévoie désormais la publication des avis de la CNIL pour les décrets aussi.
M. Yann Padova. Certains décrets sont pris en application de dispositions de la loi qui prévoient leur publicité automatique. En revanche, lorsque le Gouvernement se contente de demander le conseil de la CNIL, les avis ne sont pas publiés systématiquement. Notre travail disparaît alors et, lorsque nous le publions sur notre site, c’est une décision qui peut irriter le Gouvernement.
M. Alex Türk. Dans le même esprit, il conviendrait que le Gouvernement, lorsqu’il saisit la CNIL, ne le fasse pas de manière sélective. Pour la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, par exemple, nous avons été saisis de toutes les dispositions, à l’exception de celles qui concernaient la vidéosurveillance. Outre la maladresse de ce procédé en termes de communication, rien ne nous empêche de nous saisir nous-mêmes. Mieux vaudrait donc que le Gouvernement nous consulte au lieu de suggérer que la CNIL ne serait pas compétente en matière de vidéosurveillance.
M. René Dosière, rapporteur. Quel est le rôle des correspondants informatique et libertés, en particulier dans les sociétés privées ?
M. Alex Türk. Ces correspondants, qui sont environ au nombre de 6 000, sont insérés dans la structure des entreprises et doivent faire l’inventaire de tous les systèmes existants. Ils sont en liaison régulière avec la CNIL pour aborder les dossiers problématiques et les questions nouvelles. Ce dispositif nous permet, au lieu d’agir par vagues, de diffuser une culture de protection des données dans les systèmes. Le résultat est visible : pour éviter les ennuis, les grandes entreprises demandent à leurs correspondants informatique et libertés de mettre de l’ordre dans leurs fichiers. Le chef d’entreprise comprend vite qu’il y trouve un intérêt direct s’il ne veut pas comparaître devant la formation restreinte ou être traîné au pénal.
Il s’agit donc là d’une vision pédagogique de la question. Je rappelle à cet égard que l’Allemagne, si elle ne pratique pas de contrôles, a considérablement développé son réseau de correspondants, et cela depuis 1972 – au point que le président de la CNIL allemande m’a déclaré un jour qu’il ne comprenait pas comment nous avions pu nous passer si longtemps, en France, de ces correspondants. S’ils disparaissaient, la perte serait aujourd’hui colossale.
Ce dispositif suppose de notre part un travail important. Nous avons notamment créé un service chargé de réagir quasiment en temps réel, afin que les correspondants informatique et libertés ne perdent pas leur crédibilité au sein des structures dans lesquelles ils se trouvent. Par ailleurs, nous leur dispensons systématiquement et gratuitement une formation dans nos locaux : dans les semaines qui suivent sa désignation, tout nouveau correspondant est invité à participer à un séminaire de formation d’une journée, au cours duquel nos spécialistes expliquent le métier, puis il peut assister aux séminaires spécialisés que nous organisons régulièrement, par exemple sur le marketing ou les données de santé, au rythme d’au moins deux par mois depuis quatre ans. La formation et l’information de notre réseau de correspondants sont un important travail de communication.
Les correspondants vont ensuite diffuser les informations que nous leur avons communiquées, notamment à la suite des sanctions prononcées. Celles-ci acquièrent alors une valeur pédagogique, comme on l’observe dans le secteur bancaire où, dans les heures qui suivent une sanction, les organisations professionnelles diffusent à toutes les banques des messages d’information. Toutefois, les banques refusent encore de se doter de correspondants informatique et libertés. Dans d’autres secteurs d’activité, les correspondants jouent directement ce rôle.
Il y a dans tout cela une logique. De même que les rencontres régionales que nous organisons tous les deux mois – la prochaine aura lieu dans quelques jours en Auvergne – nous permettent d’expliquer le sens de la loi, les correspondants informatique et libertés font le même travail à l’intérieur de leur structure. Il est alors légitime de procéder à des contrôles – et nous constatons avec satisfaction que la situation est toujours plus saine lorsque la structure dispose d’un correspondant, qui a pu mettre de l’ordre dans les fichiers. Au fond, la vocation première de la CNIL n’est pas tant de contrôler et de sanctionner que de faire œuvre de pédagogie afin que chacun comprenne qu’il est dans l’intérêt de tous nos concitoyens de préserver ensemble nos libertés individuelles.
M. Yann Padova. J’ajouterai que la présence d’un correspondant informatique et libertés au sein d’une structure exonère celle-ci de formalités préalables et de déclaration. Les structures y ont donc tout intérêt. Par ailleurs, nous avons mis en place sur notre site un Extranet dédié présentant des services spécifiques, en vue de fédérer cette nouvelle profession.
M. Christian Vanneste, rapporteur. La sociologue Michèle Tribalat, qui a beaucoup travaillé sur l’immigration, déclarait ce matin que les pays scandinaves, auxquels on ne reproche guère de n’être pas démocratiques, disposent de répertoires nationaux de la population qui leur permettent une parfaite maîtrise statistique, et déplorait que la France soit dépourvue d’un semblable appareil, présentant la CNIL comme un obstacle aux croisements de fichiers nécessaires à la constitution de ces données.
Peut-on atteindre un juste milieu entre la protection des données personnelles, qui est la vocation de votre commission, et la constitution de données statistiques qui permettraient à notre pays de fonder ses politiques sur une connaissance précise ?
M. René Dosière, rapporteur. Le pouvoir politique doit d’abord définir sa politique, après quoi la CNIL pourra, le cas échéant, la mettre en application.
M. Alex Türk. Nous avons réalisé un travail considérable, procédant à plus de 60 auditions qui nous ont permis d’entendre tout ceux qui comptaient dans le pays dans ce domaine, à la suite de quoi nous avons publié un rapport sommaire, puis un rapport détaillé exposant une dizaine d’avancées possibles qui ne remettaient pas pour autant en question l’ordonnancement juridique. Nous avons tenté de faire passer deux de ces propositions sous forme d’amendements, qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il s’agissait de cavaliers insérés dans un texte relatif à l’immigration. Il ne s’agissait pourtant que de donner la possibilité aux chercheurs, notamment de l’INSEE et de l’INED, de procéder à des analyses très encadrées, après autorisation expresse de la CNIL. Après le refus du Conseil constitutionnel, nous avons considéré que la décision en matière de référentiel ethno-racial revenait au Parlement. La CNIL n’est ni favorable, ni opposée à la collecte de ces données : elle n’a cependant pas la légitimité nécessaire pour trancher une question aussi étroitement liée à notre unité nationale.
M. Thierry Mariani, préoccupé par la récente affaire de fraude impliquant une jeune femme verbalisée au volant de son véhicule alors qu’elle portait un voile intégral, a incriminé la CNIL ; je lui ai écrit que la CNIL était toute disposée à régler ce genre de problème, pour peu cependant que le Parlement le décide. La critique était, du reste, mal venue, car le fichier que réclamait M. Mariani est déjà prévu par un texte de 2007, qui n’a jamais été appliqué.
M. Yann Padova. Il s’agit du répertoire national commun de la protection sociale, ou RNCPS, pour lequel le décret d’application n’a jamais paru.
M. Alex Türk. Qu’on ne vienne donc pas nous reprocher de ne pas appliquer des textes qui n’existent pas. Par ailleurs, depuis 1978, la CNIL a accordé 50 autorisations de croisement de fichiers. En imputant à une prétendue opposition de la CNIL l’absence de progrès, les parlementaires dévalorisent leur propre rôle aux yeux des citoyens. Qui est le patron ? La CNIL, ou le Parlement ?
M. René Dosière, rapporteur. Pour en revenir aux moyens, que vous manque-t-il ?
M. Alex Türk. Si le Gouvernement confirme les engagements pris, nous devrions avoir 18 postes l’année prochaine. Une montée en puissance raisonnable, de l’ordre de 8 à 9 postes pendant deux ou trois ans, devrait nous permettre d’atteindre d’ici à 2015 le niveau de la Grande-Bretagne ou de l’Allemagne.
M. René Dosière, rapporteur. Qu’en est-il des crédits de communication ?
M. Alex Türk. Le budget de fonctionnement pose en effet d’autres problèmes. Ainsi, le budget de communication de l’autorité britannique est seize fois supérieur au nôtre. Nous sommes donc contraints de choisir une activité par an.
C’est ainsi que, l’année dernière, nous avons élaboré un guide, que nous avons envoyé à 40 000 collectivités locales – opération qui nous a coûté 130 000 ou 140 000 euros. Cette année, nous avons réalisé une bande dessinée visant à sensibiliser les élèves du primaire. Nous voyons bien cependant, au contact des rectorats lors de nos rencontres régionales, que la cible la plus pertinente serait les chefs d’établissement et les professeurs, à qui nous devrions pouvoir adresser un guide leur permettant d’adapter leur pédagogie à des jeunes qui se trouvent dans des situations terribles. Voici trois mois, j’ai passé une matinée avec deux classes de CM2 à Erquinghem-Lys, dans le Nord : 90 % des élèves, âgés de 10 ou 11 ans, étaient inscrits sur Facebook, alors que ce réseau social prétend interdire son accès aux moins de 13 ans. Le soir, pendant que leurs parents regardent tranquillement la télévision, ces enfants sont dans leur chambre, devant leur ordinateur – ce qui revient à dire qu’ils ne sont pas dans leur chambre, mais dans un monde virtuel qui présente de grands dangers. Il faut aider les enseignants, dépassés par ce phénomène, à trouver une pédagogie adaptée, et, chose plus difficile, s’occuper aussi des parents, sous peine de voir des générations de jeunes perdre leur libre arbitre et leurs défenses mentales et intellectuelles face à ces tentations du réseau. Il y a là un enjeu de société majeur et j’enrage de ne pas disposer des quelques centaines de milliers d’euros qui permettraient une opération forte de communication sur ce thème. C’est là un exemple concret de l’un de nos besoins en termes de fonctionnement.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Pour apaiser vos ardeurs dépensières, monsieur le président, nous nous interrogeons sur l’augmentation des dépenses de loyer de votre institution, passées entre 2005 et 2009 de 814 000 euros à 2,1 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 157 %. Une implantation moins ancrée dans le centre économique et tertiaire de Paris ne serait-elle pas génératrice d’économies ?
M. Alex Türk. L’implantation actuelle de nos locaux procède d’une décision précipitée. En effet, lorsque j’ai avisé le Premier ministre que le coût et la durée probables des travaux à réaliser sur le site qui nous étaient initialement destiné – un hôtel particulier situé au n° 24 de la rue de l’Université, dont nous devions être propriétaires – nous empêcheraient de travailler dans de bonnes conditions, il a été décidé de trouver des locaux nous permettant de nous mettre sans tarder au travail. Les locaux envisagés ont été examinés par les Domaines, après quoi le choix a été validé par la Commission interministérielle de la politique immobilière (CIPI), au jugement de laquelle nous nous sommes remis.
Mme Isabelle Pheulpin, directrice des ressources humaines, financières, informatiques et logistiques de la CNIL. Après analyse du loyer que nous acquittons pour nos locaux de la rue Vivienne, France Domaine – assisté à cet effet par la société ICADE – a conclu que ce montant se situait dans la norme du marché pour ce quartier central d’affaires et qu’il n’y avait pas lieu de renégocier le bail.
M. Alex Türk. De 2005 à aujourd’hui, l’effectif de la CNIL est passé de 65 à 150 personnes, de telle sorte qu’il a fallu disposer d’une superficie beaucoup plus importante. En outre, nous avons besoin d’une très grande salle pour organiser la formation des correspondants informatique et liberté.
M. René Dosière, rapporteur. Avez-vous rencontré des difficultés budgétaires ? Qui sont vos interlocuteurs en la matière ?
M. Alex Türk. Nous avons des échanges formels avec Bercy, mais je m’adresse, pour ma part, directement au Premier ministre. Jusqu’à présent, des efforts considérables ont été faits pour nous permettre d’obtenir chaque année ce que nous souhaitions. J’espère que cela continuera.
Deux problèmes se posent toutefois. Tout d’abord, notre proposition de recourir à un financement « à l’anglaise » a été rejetée. Alors qu’au Royaume-Uni, le budget de l’organisme correspondant est financé par une taxe annuelle forfaitaire prélevée sur les entreprises et les collectivités locales, il nous semblait logique que la CNIL soit financée par l’ensemble des acteurs développant des systèmes informatiques. Un tel prélèvement, qui est de l’ordre d’une cinquantaine de livres par an en Grande-Bretagne et dont nous aurions dispensé les petites collectivités locales et les entreprises de moins de dix personnes, n’aurait sans doute pas posé de problèmes en France, mais le Premier ministre, après avoir reconnu la logique de cette démarche, a renoncé à la mettre en application, de crainte d’être accusé de créer de nouveaux impôts. Sans doute viendrons-nous tout de même un jour à un tel mécanisme, car les ministères passent, mais la CNIL reste.
Nous avons cependant regretté que l’abandon de ce projet de moyens nous empêche de mener à bien un projet d’objectifs : la création, en une douzaine d’années, de quatre ou cinq antennes interrégionales. De fait, de nombreuses tâches – comme le traitement des plaintes, les contrôles ou la gestion des correspondants – pourraient être bien plus judicieusement réalisées à l’échelle régionale qu’à Paris. Ce serait aussi une manière d’éviter les déplacements perpétuels de nos contrôleurs. Il est, en outre, anormal qu’une quarantaine de départements français n’aient jamais reçu la visite de la CNIL. Étant moi-même provincial, j’ai déclaré d’emblée que je ne voulais pas que la CNIL soit vue comme une institution parisianiste et j’ai demandé aux contrôleurs de se rendre sur le terrain.
Nous envisagions de créer quatre ou cinq antennes interrégionales d’une dizaine de personnes, et de ne plus développer le siège parisien. En compensation de son refus d’adopter le financement à l’anglaise, le Premier ministre a accepté de nous attribuer un grand nombre de postes – 16 cette année et probablement 18 l’année prochaine. Faute d’antennes régionales, nous avons donc installé dans une annexe de la rue Vivienne l’ensemble du service des contrôles.
M. René Dosière, rapporteur. Votre personnel est-il constitué de fonctionnaires ou de personnes que vous recrutez vous-mêmes ?
M. Alex Türk. Ce sont des contractuels.
M. Yann Padova. À 90 %.
M. René Dosière, rapporteur. Dans le contexte du rapport de la Cour des comptes qui met en lumière une relative stabilité des effectifs des fonctionnaires de l’État, mais aussi une explosion des autres statuts, ne pensez-vous pas que l’effectif de contractuels pourrait, à l’avenir, être plafonné ?
M. Alex Türk. Nous arrivons à la fin du « plan de rattrapage » mis en œuvre par M. Raffarin, alors Premier ministre, compte tenu du fait que la CNIL employait alors 65 personnes, contre 400 et 230 pour ses homologues allemande et britannique. Après les 18 nouveaux postes prévus l’an prochain, nous passerons à un régime de croisière. En dehors de ce plan de rattrapage, l’embauche de contrôleurs supplémentaires – quatre ou cinq – ne se justifierait que dans le cas où la CNIL serait chargée du contrôle de la vidéosurveillance.
M. Christian Vanneste, rapporteur. C’est précisément pour cette raison que je me suis vu opposer l’article 40.
M. Alex Türk. Chaque fois qu’on nous demandera d’assumer une tâche supplémentaire, il faudra réexaminer la question des effectifs. Ainsi, la proposition de rattacher la Commission d’accès aux documents administratifs – la CADA – à la CNIL, formulée ce matin par le rapporteur Patrice Gélard devant la Commission des lois du Sénat, ne nous poserait pas de problème, car les deux fonctions relèvent de la même autorité dans la plupart des pays européens, mais ce n’est pas à moi de revendiquer une fusion qui se ferait au détriment du président d’une autre autorité. Que le Parlement prenne ses responsabilités ! Cependant, une grande partie de la CADA étant installée au Conseil d’État et composée de personnels détachés, un rapprochement avec cet organisme, si modestes que soient ses effectifs – 15 personnes – aurait nécessairement des conséquences budgétaires.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Comment expliquez-vous le fait que le nombre des contrôles augmente plus vite que celui des sanctions ?
M. Alex Türk. C’est probablement de notre faute. Sur les six membres de la formation restreinte, trois ont du mal à prendre des sanctions, tandis que les trois autres, dont je suis, pensent qu’on ne peut pas obtenir de résultats autrement. Nous progresserons, mais un travail de pédagogie est nécessaire pour faire comprendre que, compte tenu de l’enjeu, qui n’est rien de moins que la protection des libertés individuelles, il ne faut pas se sentir gêné de sanctionner.
Ainsi, les contrôles que nous avons effectués au sein de l’entreprise Acadomia, qui dispense des cours de soutien scolaire, ont révélé des pratiques si scandaleuses – on a notamment relevé des commentaires ignobles sur la santé et la vie sexuelle des professeurs et des élèves – que j’ai décidé d’engager une action au pénal, mais mes efforts n’ont pas permis d’obtenir mieux qu’un avertissement qui sera rendu public. De tels cas permettent de faire évoluer les pratiques, mais ces progrès demandent du temps. Les sanctions ont un caractère relativement nouveau dans la culture de la CNIL, ce qui explique que la métamorphose soit difficile pour certains de ses membres – mais nous y viendrons.
M. Christian Vanneste, rapporteur. Nous vous remercions.
Audition de M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), accompagné de M. Benoît Narbey, secrétaire général.
Mercredi 16 juin 2010
M. Christian Vanneste Messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
La révision constitutionnelle de 2008 a renforcé les pouvoirs de contrôle et d’évaluation de l’Assemblée nationale. Un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a été créé, qui a décidé la constitution d’une mission sur les autorités administratives indépendantes. C’est à ce titre que nous sollicitons votre contribution.
M. René Dosière. Nous avons obtenu du garde des sceaux que le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits ne soit examiné par l’Assemblée nationale qu’en octobre, après la remise de notre rapport. J’espère que nos conclusions contribueront à éclairer les débats.
Le projet de loi prévoit de mettre un terme au fonctionnement des services de votre commission. Qu’en pensez-vous ? La création d’un Défenseur des droits permettra-t-elle de préserver la spécificité de vos missions ?
M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. L’institution de la CNDS a été acceptée avec difficulté. D’une part, l’usage de la force publique étant une prérogative régalienne, le pouvoir exécutif ne voyait pas d’un bon œil l’émergence d’un organe de contrôle indépendant. D’autre part, dans tous les secteurs d’activité, les réflexes corporatistes conduisent à un rejet des contrôles extérieurs.
Pourtant, la création de cette autorité s’imposait, en raison de la multiplication des organes chargés de la sécurité. À côté des forces traditionnelles que sont la police, la gendarmerie et l’administration pénitentiaire, sont apparues les polices municipales, les polices des transports et, plus récemment, des entreprises de sécurité privées, dont les effectifs seront bientôt aussi importants que ceux des forces publiques. Il convenait de veiller au respect non seulement des règles légales, mais aussi des grands principes déontologiques.
La CNDS a peiné à s’implanter dans le paysage institutionnel. La première année, elle n’a fait l’objet que de 19 saisines. Puis, sa notoriété augmentant, et son action étant de mieux en mieux perçue, elle a gagné en efficacité. En 2005, le nombre des dossiers examinés dépassait la centaine ; de 2005 à 2008, la progression s’est ralentie, avant de s’accélérer brutalement l’an dernier, le nombre de saisines passant de 157 en 2008 à 228 en 2009, soit une augmentation de 50 %. Cette évolution peut paraître inquiétante si l’on estime qu’elle correspond à une augmentation des manquements à la déontologie, mais je pense qu’elle est due plutôt à la meilleure visibilité de la CNDS. L’institution a fini par trouver sa place.
La CNDS comprend quatre parlementaires – deux députés et deux sénateurs –, un représentant du Conseil d’État, un représentant de la Cour de cassation, un représentant de la Cour des comptes et un président désigné par le Président de la République, ces huit personnes étant appelées à coopter six autres membres. Ces modalités de désignation sont une garantie non seulement d’indépendance, les nominations, à l’exception des parlementaires et du président, ne dépendant d’aucun pouvoir politique, mais également d’efficacité, les membres cooptés étant choisis en raison de la diversité de leurs compétences et de leurs expériences : on compte parmi eux un magistrat, un avocat, un professeur des université, un professeur de médecine légale, un ancien directeur des services actifs de la police, un ancien directeur de l’administration pénitentiaire. Chacun apporte sa pierre à l’édifice.
M. René Dosière. Le choix des six membres supplémentaires a-t-il fait problème ?
M. Roger Beauvois. Depuis le 1er janvier 2008, date de mon accession à la présidence de la CNDS, les décisions ont toujours été prises à l’unanimité ; je crois savoir que c’était également le cas auparavant.
M. René Dosière. Les quatre parlementaires assistent-ils régulièrement aux réunions ?
M. Roger Beauvois. Certains sont assidus, d’autres ne viennent quasiment jamais.
La question de l’indépendance doit toujours être envisagée sous deux aspects : d’une part, chacun des membres doit se sentir indépendant ; d’autre part, la commission tout entière doit renvoyer aux citoyens l’image d’un organe impartial. Comme le dit le vieil adage anglais, la justice ne doit pas simplement être rendue, elle doit montrer qu’elle est rendue.
La CNDS dispose en outre de pouvoirs d’investigation importants : droit de procéder à des auditions, de demander aux autorités administratives et aux sociétés privées de lui communiquer les pièces dont elle a besoin, droit de pratiquer des visites inopinées. Seule réserve : lorsque l’affaire est en même temps soumise à l’autorité judiciaire, celle-ci peut refuser de transmettre à la CNDS certains documents, non parce qu’ils seraient soumis au secret de l’instruction, qui ne peut nous être opposé, mais parce qu’elle jugerait inopportune une telle communication. À l’issue de son enquête, la CNDS adresse aux responsables des autorités et sociétés concernées soit un avis simple, soit un avis assorti de recommandations.
Le problème, c’est que la mise en œuvre de ces prérogatives n’a pas été toujours efficace. Cela tient en premier lieu à la faiblesse des effectifs de la CNDS. De sa création à 2006, les services n’ont fonctionné qu’avec trois emplois à temps plein : le secrétaire général et deux secrétaires. Depuis, le personnel administratif s’est étoffé, et il comprend aujourd’hui également une secrétaire comptable et trois rapporteurs adjoints, titulaires d’un master ou d’un doctorat. Cela reste malheureusement insuffisant par rapport à nos besoins.
Notre budget de fonctionnement est adapté à nos effectifs, mais nous ne pouvons pas embaucher de nouveaux personnels. Nous devons passer par les services du Premier ministre et, dans la conjoncture présente, les créations d’emploi sont difficiles.
M. René Dosière. En raison de l’insuffisance de votre budget ou parce que Matignon ne vous en donne pas l’autorisation ?
M. Roger Beauvois. Cette année, nous avions les ressources financières pour recruter une personne supplémentaire, mais nous n’avons pas eu l’autorisation de le faire.
M. René Dosière. Cela limite quelque peu votre indépendance…
M. Roger Beauvois. C’est indéniable.
M. Benoît Narbey, secrétaire général de la CNDS. Cette année, l’exercice budgétaire se soldera par un excédent de 60 000 euros, sans que nous ayons l’autorisation de procéder à une embauche. Nous devrons donc restituer la somme.
M. Christian Vanneste. En revanche, vous pouvez compter sur la présence parmi vos membres d’un commissaire du Gouvernement.
M. Roger Beauvois. Il s’agit d’une innovation de 2007, qui a été plutôt mal reçue à la CNDS, car on y a vu « l’œil de l’exécutif ». Toutefois, la personne choisie, un ancien directeur des services actifs de la police nationale, remplit parfaitement son rôle et apporte dans le débat un regard et une expérience précieux. De surcroît, sa présence facilite nos rapports avec la police.
M. Christian Vanneste. Quel est le taux de réussite de vos différentes démarches ?
M. Roger Beauvois. Je n’ai pas de chiffres précis à vous communiquer.
Dans un avis simple, il arrive que nous proposions l’ouverture de poursuites disciplinaires contre un fonctionnaire coupable d’un manquement à la déontologie. Dans ce cas, nous sommes très peu suivis – dans une proportion de 10 à 20 %. On nous répond en général que « ce n’est pas si grave ».
M. René Dosière. Vous tient-on informés du suivi du dossier ?
M. Roger Beauvois. Non, et c’est pourquoi je ne peux pas vous donner de chiffres.
Lorsque nous transmettons un avis au ministre, celui-ci a deux mois pour nous répondre. S’il décide de ne pas donner suite, nous le savons en général immédiatement ; dans le cas contraire, nous ignorons ce qu’il advient du dossier.
M. Christian Vanneste. Si ces avis étaient formulés par une autorité disposant d’un statut constitutionnel, comme le Défenseur des droits, pensez-vous que le comportement des administrations serait différent ?
M. Roger Beauvois. En l’espèce, ce ne sont pas les administrations qui sont en cause, mais les ministres. À cet égard, la recommandation d’une autorité ayant un statut constitutionnel aurait sans doute, politiquement, davantage de poids. Tout dépendra de son président, de sa force de persuasion et de la place qu’il saura prendre dans le paysage institutionnel.
M. René Dosière. Quoi qu’il en soit, cela ne mettra pas fin aux réticences administratives, et rien ne dit que ses recommandations seront suivies d’effet !
M. Roger Beauvois. Je ne fais qu’exprimer un espoir.
M. René Dosière. Au fil du temps, les forces de sécurité ont-elles fini par admettre l’utilité de la CNDS ?
M. Roger Beauvois. Certains syndicats de policiers sont restés très hostiles et quelques-unes de nos décisions ont donné lieu à des tracts injurieux. Toutefois, notre commission est de mieux en mieux admise par les fonctionnaires de police, notamment par les cadres. Les questions posées durant mes conférences à l’École nationale supérieure des officiers de police ou à l’École nationale supérieure de la police ne sont plus agressives. La déontologie fait désormais l’objet de modules obligatoires dans la formation des officiers et des commissaires et elle est de plus en plus intégrée dans celle des gardiens de la paix. C’est un effet particulièrement positif de notre action.
Quant à nos recommandations d’ordre général, elles finissent assez souvent par se traduire par des instructions aux forces de sécurité concernées. Ainsi, les recommandations de la CNDS en matière de fouille et de menottage ont été reprises par une circulaire du ministre de l’intérieur de 2003 et par des instructions du directeur général de la police nationale.
M. Christian Vanneste,. Dans quel cadre matériel exercez-vous vos activités ?
M. Benoît Narbey. Nos locaux se situent au 62, boulevard de La Tour Maubourg, dans le VIIe arrondissement de Paris. Leur superficie est de 200 mètres carrés, pour un loyer annuel d’environ 140 000 euros, charges comprises. C’est très cher.
M. René Dosière. Est-ce la CNDS qui les a choisis ?
M. Roger Beauvois. À l’origine, la Commission étant présidée par M. Truche, ses services furent hébergés au siège de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, au 35, rue Saint-Dominique. Les nouveaux locaux ont tout simplement été installés à proximité.
Nos effectifs ayant augmenté, nous nous trouvons désormais à l’étroit. À mon arrivée, en janvier 2008, j’avais entrepris des démarches pour déménager dans un quartier où les loyers sont plus raisonnables. À la suite de la réforme constitutionnelle, l’existence de la CNDS étant remise en question, j’ai considéré que la dépense inhérente à un déménagement ne se justifiait plus. En définitive, compte tenu des délais d’adoption de la loi organique, nous serons restés dans nos locaux plus longtemps que prévu.
M. Christian Vanneste. Vos avis ont-ils des suites judiciaires ? Êtes-vous mieux écoutés par la justice que par l’exécutif ?
M. Roger Beauvois. À mon arrivée, les délais de réponse de l’autorité judiciaire me désespéraient. Les choses s’améliorent progressivement. Il arrive que les procureurs généraux, qui ont dans leurs attributions le pouvoir disciplinaire sur les officiers de police judiciaire, nous écrivent pour nous dire quelles suites ils ont donné à nos recommandations.
Nous saisissons le procureur de la République lorsque nous estimons que, derrière le manquement à la déontologie, il existe une infraction pénale. Il n’y a eu que quatre cas de ce genre en 2009. Au mieux, le procureur requiert l’ouverture d’une information judiciaire, mais nous sommes rarement informés des suites qui sont données à nos recommandations.
M. Christian Vanneste. Le délai moyen de traitement des dossiers par la CNDS était de douze mois en 2008. Estimez-vous que vous disposez des moyens nécessaires pour remplir correctement vos missions, eu égard à la multiplication des saisines ?
M. Roger Beauvois. Je reconnais que les délais de traitement des dossiers sont trop longs. Ces retards sont essentiellement imputables au manque de personnel : nous n’arrivons pas à instruire dans une année autant d’affaires qu’il nous en arrive. Le stock augmente.
Par ailleurs, lorsque nous réclamons des documents à l’administration concernée ou à l’autorité judiciaire, les délais de transmission sont en général très longs, de l’ordre de six à huit mois.
M. René Dosière. Ils ne sont pas limités ?
M. Roger Beauvois. Si, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
M. Christian Vanneste. Au cours de l’année 2009, vous avez rendu 33 décisions d’irrecevabilité. Pourquoi ?
M. Roger Beauvois. La principale cause d’irrecevabilité est le non-respect des délais de saisine : nous ne pouvons pas être saisis de faits datant de plus d’une année.
M. Christian Vanneste. Est-ce une bonne chose ?
M. Roger Beauvois. Cela tend à garantir le sérieux de l’instruction et la fidélité des témoignages.
En outre, nous refusons d’instruire les dossiers relatifs aux contraventions, qui sont du ressort du tribunal de police ou du juge de proximité, ainsi que les plaintes des fonctionnaires de police contre leur hiérarchie.
Enfin, dans 35 à 40 % des affaires, nous concluons, à l’issue de l’instruction, qu’il n’y a eu aucun manquement à la déontologie : cela prouve que, contrairement à ce que d’aucuns insinuent, nous ne sommes pas « anti-flics » !
M. René Dosière. Dans quels cas recourez-vous à des visites inopinées ?
M. Roger Beauvois. Nous effectuons de nombreux déplacements, notamment dans les établissements pénitentiaires, mais les visites inopinées sont exceptionnelles.
L’an dernier, nous avons vécu une expérience malheureuse : un détenu ayant été blessé lors d’un échange de coups de feu avec des policiers, à la suite d’une tentative d’évasion, un parlementaire nous a saisis parce que, en dépit de l’état de santé de ce détenu, celui-ci était menotté sur son lit d’hôpital. J’ai demandé à un rapporteur de la commission, professeur de médecine légale, d’aller vérifier les faits, mais les policiers de garde lui ont refusé l’accès au blessé. La CNDS a publié, comme la loi le lui permet, un rapport spécial au Journal officiel pour critiquer l’attitude de l’administration dans cette affaire.
M. René Dosière. Vos interventions auprès des détenus n’interfèrent-elles pas avec les missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
M. Roger Beauvois. Au départ, nos attributions se recoupaient pour partie, mais nous avons signé une convention, de manière à nous répartir les tâches : lorsqu’une affaire concerne le fonctionnement général ou l’état des lieux de privation de liberté, elle relève du contrôleur général ; lorsqu’elle prend un caractère individuel, elle est du ressort de la CNDS.
M. Christian Vanneste. Un certain nombre d’autorités administratives indépendantes, comme la CNDS, le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), peuvent être regroupées sous la rubrique de la défense des libertés ; il existe des collaborations, voire des interférences entre elles. Trouvez-vous cette situation satisfaisante ? Ne faudrait-il pas redéfinir les tâches de chacune des autorités ou les regrouper au sein d’une même structure ?
M. René Dosière. Je précise que la question doit être entendue indépendamment du projet gouvernemental actuel.
M. Roger Beauvois. Il est bon que les autorités disposent de compétences spécifiques, car leurs approches sont très différentes. Ainsi, les attributions du Défenseur des enfants et de la HALDE ne concernent que de très loin les problèmes de sécurité. La défense des libertés constitue un aspect important, mais non exclusif, de l’activité de chacun de ces organismes. Il importe que la gestion de problèmes spécifiques soit confiée à des spécialistes.
Que nous collaborions sur certains dossiers n’est pas gênant, bien au contraire. Par exemple, le Défenseur des enfants et le Médiateur de la République nous saisissent des problèmes de sécurité ; de même, nous saisissons la HALDE lorsque nous avons connaissance de comportements discriminatoires.
Même si cet ensemble était réuni sous l’autorité d’un seul haut personnage, il faudrait créer des services différents, car l’on ne peut traiter de la même manière la protection d’un enfant et la plainte d’un détenu contre un surveillant ; au service compétent de se saisir du dossier.
M. René Dosière. Êtes-vous saisis de manquements à la déontologie commis par des forces de sécurité privées ?
M. Roger Beauvois. Très rarement. Cela tient sans doute au fait que le public ignore que nous sommes compétents en la matière. Nous avons instruit quelques affaires concernant des vigiles et, surtout, des dossiers relatifs aux contrôles dans les aéroports – les plaignants étant en général mieux informés.
M. Christian Vanneste. Les dossiers dont vous êtes saisis concernent en général les policiers ?
M. Roger Beauvois. Oui ; les gendarmes sont moins nombreux et interviennent essentiellement en milieu rural.
Bien souvent, des faits bénins sont à l’origine de l’incident : un contrôle routier, un véhicule mal garé, ou, comme ce fut le cas récemment, le contrôle d’un cabas sur un marché ; de fil en aiguille, la situation dégénère. Il est rare que nous soyons saisis d’affaires provoquées par l’arrestation d’un individu dangereux. Dans la plupart des cas, un peu de calme et de discernement de part et d’autre aurait suffi à éviter le conflit.
M. René Dosière. Monsieur le président, nous vous remercions. Nous étudierons avec attention la note de synthèse que vous nous avez remise, ainsi que vos observations sur le projet de création du Défenseur des droits.
M. Roger Beauvois. Cette fusion absorption – pour reprendre un terme de droit commercial – nous préoccupe, car nous doutons que les missions de la CNDS puissent être assurées par nos successeurs avec les mêmes garanties et dans les mêmes conditions.
M. Christian Vanneste. Dans l’hypothèse d’un regroupement, l’idée d’une spécialisation des commissions internes semble toutefois l’emporter.
M. Roger Beauvois. Il est indéniable que le texte adopté par le Sénat comporte des avancées importantes par rapport au projet de loi initial.
M. René Dosière. Nous comptons bien qu’il soit encore amélioré par l’Assemblée nationale !
M. Benoît Narbey. Pour revenir aux visites inopinées, elles sont particulièrement utiles pour l’instruction des dossiers concernant d’éventuels manquements commis dans les centres de rétention administrative. À plusieurs reprises, la CNDS a envoyé dans les vingt-quatre heures un ou plusieurs de ses membres pour entendre le plaignant avant qu’il ne soit libéré ou renvoyé dans son pays. La saisine de la CNDS ne suspendant pas la procédure, il faut réagir très rapidement. Dans ce cas, nous sommes plus rapides que l’autorité judiciaire.
M. Christian Vanneste. Messieurs, nous vous remercions.
SOMMAIRE DES NOTES RELATIVES AUX AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES AUDITIONNÉES
__
Les notes présentées ci-après on été élaborées pour la préparation des auditions des présidents d’autorités administratives indépendantes. Les données chiffrées figurant dans ces notes sont donc datées et peuvent être différentes de celles figurant dans d’autres parties du présent rapport.
Pages
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 249
Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) 255
Commission nationale du débat public (CNDP) 259
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) 269
Commission bancaire 269
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) 269
Autorité des marchés financiers (AMF) 283
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) 291
Commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection présidentielle 299
Commission pour la transparence financière de la vie politique 299
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 306
Autorité de la concurrence 315
Commission des participations et des transferts (CPT) 323
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) 327
Défenseur des enfants 333
Médiateur de la République 343
Médiateur du cinéma 353
Médiateur national de l’énergie 359
Commission de régulation de l’énergie (CRE) 365
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 373
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 381
Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) 391
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) 397
Haute autorité de santé (HAS) 405
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 421
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 429
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) 440
AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (AFLD)
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a été créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 (codifiée dans le code du sport aux articles L. 232-2 et suivants) relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, qui la qualifie d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Elle a alors succédé au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), qui était une simple autorité administrative, au Laboratoire national de détection du dopage de Châtenay-Malabry (établissement public) et au ministère chargé des sports pour ses attributions dans la définition de la stratégie des contrôles antidopage et leur organisation.
Le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (codifié désormais dans le code du sport, articles R. 232-10 et suivants) a précisé l’organisation et les règles de fonctionnement de l’AFLD, qui a effectivement été créée le 1er octobre et existe donc depuis trois ans.
— Composition du collège :
La composition du collège de l’Agence, qui est la même que celle du CPLD antérieurement, fait appel à des compétences et à des légitimités diverses. Il comprend neuf membres, nommés pour six ans, renouvelables une fois, tous désignés par des autorités elles-mêmes indépendantes du Gouvernement :
– trois juristes : un Conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État (M. Pierre Bordry, Président), deux magistrats de la Cour de cassation désignés par son Premier Président et son Procureur général ;
– trois scientifiques, désignés par les présidents des Académies de médecine, de pharmacie et des sciences ;
– trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : deux désignées par le président du Comité national olympique et sportif français (un membre du conseil d’administration du CNOSF et un sportif ou ex-sportif de haut niveau), une par le Comité consultatif national d’éthique.
Par ailleurs, une personnalité compétente en médecine vétérinaire est désignée par le Président de l’Académie vétérinaire de France pour participer aux travaux du collège en matière de dopage animal.
— Missions :
L’AFLD intervient dans sept domaines complémentaires :
– l’organisation des contrôles anti-dopage ;
– l’analyse des prélèvements ;
– le suivi des procédures disciplinaires ;
– les actions de prévention ;
– les actions de recherche ;
– le conseil des fédérations et du Gouvernement dans la lutte contre le dopage ;
– la présence internationale.
Pour exercer ses responsabilités, le collège de l’Agence s’est réuni à 19 reprises au cours de l’année 2008.
● Au titre des contrôles antidopage, l’Agence définit les stratégies mises en œuvre en ce qui concerne les compétitions et les entraînements se déroulant en France en dehors des règles des fédérations internationales.
Elle peut organiser des contrôles lors de compétitions internationales en coordination avec l’agence mondiale antidopage ou avec la fédération internationale compétente.
L’Agence est également compétente pour les contrôles antidopage animaux réalisés lors de compétitions équestres ou canines.
Conformément à la loi, l’Agence peut s’appuyer sur les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Elle dispose d’un réseau de 400 préleveurs (médecins, vétérinaires, infirmiers) agréés par elle.
Au total, l’AFLD a réalisé, en 2008, plus de 10.000 contrôles (en augmentation marquée, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une année atypique).
● Au titre des analyses, l’AFLD dispose de l’unique laboratoire accrédité en France auprès de l’Agence mondiale antidopage. La loi permet toutefois, le cas échéant, à l’Agence de s’appuyer sur des laboratoires tiers, comme c’est d’ailleurs le cas en matière d’analyses sur des prélèvements réalisés sur des chevaux lors de compétitions équestres.
Le département des analyses de l’AFLD a réalisé, en 2008, plus de 9.000 analyses.
● L’Agence exerce un pouvoir disciplinaire, consistant à prononcer des sanctions administratives de suspension, dans quatre cas :
– elle est saisie d’office lorsque les organes disciplinaires de la fédération nationale compétente ne se sont pas prononcés dans les délais prévus par la loi (dix semaines en première instance, quatre mois en appel) ;
– elle peut se saisir pour réformer une décision prise par la fédération française compétente ;
– elle peut étendre une sanction prise par une fédération aux activités du sportif sanctionné relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
– elle est directement compétente lorsque le sportif contrôlé positivement n’est pas licencié en France, sauf lorsque le contrôle a eu lieu durant une compétition internationale pour laquelle seule la fédération internationale correspondante est disciplinairement compétente.
L’Agence régule et assure le suivi de l’ensemble des procédures disciplinaires mises en œuvre par les fédérations nationales. Elle peut se porter partie civile dans des enquêtes pénales (pour trafic de produits dopants par exemple). Elle prend certaines délibérations de portée réglementaire, en complément des règles fixées par la loi ou par décret.
Par ailleurs, en corollaire de son rôle disciplinaire, l’Agence délivre au plan national les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques de produits interdits.
Les décisions de sanction de l’Agence peuvent faire l’objet de recours de plein contentieux devant le Conseil d’État. Les décisions individuelles sont portées devant le tribunal administratif.
● En matière de prévention l’Agence intervient, aux côtés d’autres acteurs (ministères, notamment le ministère chargé des sports auquel la loi confie la coordination des actions de prévention ; mouvement sportif ; collectivités territoriales ; antennes médicales de prévention du dopage ; professions de santé…), au plan de la réflexion générale, par la voie de recommandations aux fédérations, par la réponse aux questions que celles-ci lui posent, ou encore par la réunion de commissions spécialisées composées de représentants d’administrations, du mouvement sportif ou des professions de santé. Elle réalise également des opérations de sensibilisation, ou à caractère pédagogique, qui lui sont propres.
● Sur le terrain de la recherche l’AFLD dispose d’un comité d’orientation scientifique, composé de neuf chercheurs français et étrangers de haut niveau, désignés par le président de l’Agence, ainsi que de trois représentants des administrations concernées et d’un représentant de l’Agence mondiale antidopage.
Le comité examine les actions de recherche assurées par le département des analyses de l’AFLD ainsi que les projets proposés par d’autres laboratoires dans le domaine spécifique du dopage ; il peut éventuellement les promouvoir auprès de grands laboratoires de recherche ou d’organismes nationaux ou internationaux susceptibles de contribuer à leur financement (notamment l’Agence mondiale antidopage ou la Commission européenne).
● En tant qu’instance consultative l’AFLD est chargée de répondre aux questions des fédérations sportives relevant de sa compétence. Elle peut leur adresser des recommandations. Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’État, en particulier lors de l’élaboration de la liste des produits interdits.
L’AFLD est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage, notamment vis-à-vis de l’Agence mondiale antidopage, des fédérations internationales, du CIO et des autres agences nationales.
— Effectifs :
L’effectif de l’Agence était, au 31 décembre 2008, de 58 personnes : 56 rémunérées sur le budget propre de l’Agence (15 au siège et 41 au Département des analyses), deux mises à disposition.
L’Agence rémunère également ses 400 préleveurs à titre de collaborateurs occasionnels de service public et mobilise, sans les rémunérer, les agents des services régionaux de la Jeunesse et des sports.
— Budget :
L’Agence est dotée de l’autonomie financière. C’est à son collège qu’il revient de déterminer le budget (de l’ordre de 8 millions d’euros). L’article R. 232-10 du code des sports permet aux ministres chargés des sports et du budget de demander une nouvelle délibération, mais sans leur permettre d’imposer de modifications.
Ses ressources financières proviennent majoritairement d’une subvention versée à partir du budget du ministère chargé des sports et, plus accessoirement, des prestations d’analyses ou de prélèvements qu’elle réalise pour le compte de fédérations internationales, d’États étrangers ou d’organisations antidopage étrangères.
L’exercice 2008 s’est soldé par un résultat positif de l’ordre de 500.000 euros, qui correspond à la différence entre :
– les recettes de fonctionnement (8.641.774 euros) ;
– les dépenses de fonctionnement (8.106.244 euros).
La part des subventions de l’État a représenté 82,6 % des recettes totales (86 % en 2007 ; 94,7 % en 2006).
Les données relatives au solde de l’exercice 2009 ne sont pas encore connues.
Pour 2010, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) devait bénéficier d’une subvention à hauteur de 3,8 millions d’euros et d’un fonds de concours de 4 millions d’euros provenant du Centre national pour le développement du sport (CNDS), grâce à une majoration de 0,5 % de la « taxe Buffet ». Cette majoration a cependant été supprimée par le Sénat.
Au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », le programme 219 fait apparaître un objectif n° 5 intitulé : « Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs ».
Trois indicateurs sont associés à cet objectif :
– le premier retrace l’évolution du nombre de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical au cours de l’année rapporté au nombre total de sportifs de haut niveau ou espoirs ;
– le second vise à établir le coût moyen des contrôles et des analyses antidopage ;
– le troisième évalue la proportion de contrôles effectués en dehors des compétitions.
Les deux derniers concernent directement l’AFLD.
INDICATEUR 5.2 : COÛT MOYEN GLOBAL DES CONTRÔLES
ET DES ANALYSES ANTI-DOPAGE
(en euros)
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Coût moyen global des contrôles et des analyses anti-dopage |
604 |
568 |
640 |
640 |
668 |
676 |
Coût moyen global des contrôles et des analyses anti-dopage en compétition |
N.D |
382 |
N.D |
408 |
426 |
445 |
Coût moyen global des contrôles et des analyses anti-dopage hors compétition |
N.D |
326 |
N.D |
370 |
386 |
403 |
INDICATEUR 5.3 : NOMBRE DE CONTRÔLES
HORS COMPÉTITION / NOMBRE TOTAL DE CONTRÔLES
(en pourcentage)
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Nombre de contrôles hors compétition / nombre total de contrôles |
12,4 |
15,8 |
18 |
17 |
18 |
20 |
NB. Cet indicateur témoigne de l’importance du recentrage des outils antidopage sur les contrôles à l’entraînement, en principe plus efficaces car inopinés, mais sans doute plus difficiles à réaliser.
Les documents budgétaires comprenaient antérieurement un indicateur correspondant au taux de contrôles positifs, en légère baisse en 2008 (3,1 % contre 3,4 % en 2007).
COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS
ET AGENCES DE PRESSE (CPPAP)
La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est l’héritière de la « Commission paritaire des papiers de presse » créée par l’article 2 du décret du 23 juillet 1931, dont la mission était à l’origine de donner un avis sur l’accès à certains avantages douaniers. Elle a été reconstituée après la seconde guerre mondiale par le décret n° 50-360 du 25 mars 1950 (voir également la loi n° 57-1323 du 26 décembre 1957 complétant l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, le décret n° 58-1245 du 15 décembre 1958 et le décret n° 60-829 du 2 août 1960). Elle est chargée de rendre un avis sur l’octroi, aux journaux et écrits périodiques, du régime économique particulier qui leur est réservé.
Ce régime comprend, essentiellement, deux types de mesures :
– des tarifs postaux préférentiels (270 millions d’euros pour 2010 au titre de l’aide au transport postal, dont 28 millions en compensation du report des accords Presse-Poste du 23 juillet 2008) ;
– des allègements fiscaux, prévus à l’article 298 septies du code général des impôts (TVA au taux de 2,1 % sur les recettes de vente au numéro et par abonnements, pour un coût évalué à 200 millions d’euros dans les documents budgétaires associés au projet de loi de finances pour 2010).
Environ 11.000 publications sont inscrites, à ce titre, sur les registres de la CPPAP.
Par ailleurs, la CPPAP fait des propositions pour l’inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance précitée de 1945. Ces agences exercent leur activité dans un cadre spécifique destiné à assurer leur liberté et leur indépendance juridique, économique et financière ; en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, elles bénéficient de certaines dispositions fiscales prévues pour les entreprises de presse.
Enfin, la CPPAP est désormais chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse(1).
Elle est régie par le décret n° 97-1065 modifié du 20 novembre 1997 et dotée d’un règlement intérieur (délibération du 14 septembre 2006) qui fixe ses conditions de fonctionnement.
Ses avis ne sont susceptibles de recours devant aucune autre autorité administrative, ce qui explique qu’elle ait été rangée dans la catégorie des autorités administratives indépendantes par le Conseil d’État dans son étude de 2001. Ils peuvent, en revanche, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, juge en premier et deuxième ressort (le Conseil d’État rend ainsi entre cinq et dix décisions par an).
La commission, en formation plénière, comprend :
– un membre du Conseil d’État, président ;
– quatre représentants du ministre chargé de la communication ;
– un représentant du ministre chargé du budget ;
– quatre représentants du ministre chargé de l’économie ;
– un représentant du ministre de la justice ;
– un représentant du ministre chargé de la culture, sauf lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la liste des organismes constituant des agences de presse en application de l’article 8 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
– un représentant des entreprises éditrices de services de presse en ligne (sauf dans le cas précité de l’article 8 bis de l’ordonnance) ;
– dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission est appelée à se prononcer en application de l’article 8 bis de l’ordonnance.
Le Président et les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Chaque membre titulaire est remplacé, en cas d’empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.
Les représentants des entreprises et des agences de presse ainsi que ceux des services de presse en ligne sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Par ailleurs, des représentants de La Poste assistent à l’ensemble des séances de la CPPAP en qualité d’experts.
La commission plénière ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
● En formation publications, la CPPAP est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allègements fiscaux et postaux prévus par les textes.
Chaque sous-commission comprend quatre représentants de l’administration et quatre des entreprises de presse, désignés au sein de la commission par le président de cette dernière. La présidence de chaque sous-commission est assurée alternativement par un représentant de l’administration et par un représentant des entreprises de presse, désignés par le président de la commission.
Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents. Elle ne peut émettre un avis favorable qu’à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu’une telle majorité n’est pas réunie, l’avis est réputé défavorable.
● En revanche, la Commission en formation agences ne se réunit qu’en séance plénière, en pratique tous les deux mois.
En 2008 comme en 2007, la CPPAP dans sa formation publications et ses sous-commissions se sont réunies à 32 reprises (9 plénières, 23 sous-commissions). 4 252 dossiers ont été traités (soit une progression de près de 27 % qui mérite cependant d’être relativisée eu égard aux 1.166 décisions de radiations prononcées pour des motifs techniques, contre 456 en 2007).
RÉPARTITION PAR NATURE D'EXAMEN DES DOSSIERS EXAMINÉS PAR LA CPPAP
2007 |
2008 |
2008/2007 | |||
Nouveaux examens |
584 |
17 % |
357 |
8 % |
- 39 % |
Nouvelles demandes |
639 |
19 % |
681 |
16 % |
7 % |
Révisions |
2 081 |
62 % |
3 213 |
76 % |
54 % |
Réexamens |
52 |
2 % |
1 |
0 % |
- 98 % |
Autres |
2 |
0 % |
0 |
0 % |
- 100 % |
Total |
3 358 |
100 % |
4 252 |
100 % |
27 % |
Source : CPPAP
Au total, 1 665 avis négatifs ont été rendus par la Commission en 2008, dont 499 refus nets (refus ou retraits d’agréments), hors radiations techniques, notamment pour cause de défaut de vente effective ou défaut de périodicité.
Le taux d’acceptation des recours gracieux par la Commission est en progression : 35 % en 2008, contre 22 % en 2007 et 16 % en 2006. En revanche, le nombre des recours gracieux est en baisse sensible : 46 en 2008, 69 en 2007, 152 en 2006. La CPPAP considère en conséquence que : « moins nombreux, les recours correspondent plus souvent à des cas sérieux qui légitimement réclament une seconde analyse, et sont en outre mieux argumentés ».
En 2008 le Conseil d’État a statué sur cinq recours formés contre des décisions de la Commission ; la décision contestée a été annulée dans quatre cas. La CPPAP fait valoir que « cette évolution de l’activité contentieuse peut être comparée à celle des recours gracieux : si au total, le nombre des décisions déférées devant le juge administratif est en forte baisse, en revanche le taux d’annulation des dites décisions s’accroît. (…) Les cas portés devant le Conseil d’État renvoient plus systématiquement à des sujets réellement complexes et prêtant davantage à débat, pour lesquels il a été plus difficile de se déterminer ».
Sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la communication, le secrétariat de la CPPAP est assuré par la Direction du Développement des Médias et, plus précisément, par le bureau de l’homologation des publications et des agences de presse rattaché à la sous-direction de la presse écrite et de l’information.
La Commission ne dispose pas d’un budget individualisé : ses moyens de fonctionnement (humains et matériels) sont intégrés au budget global de fonctionnement de la DDM. Les seuls frais spécifiquement attachés au fonctionnement de la CPPAP sont constitués par l’indemnité versée à son président (dont le principe et le montant sont respectivement prévus par le décret n°2005-135 du 15 février 2005 et par son arrêté d’application du même jour).
COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP)
La procédure du débat public a été introduite, en droit français, pour les grandes opérations d’aménagement d’intérêt national, par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. L’article 2 de cette loi a institué la Commission nationale du débat public, laquelle est alors chargée de décider, après avis des ministres concernés, s’il y a lieu d’organiser un tel débat, et de veiller aux modalités de son organisation.
Installée le 4 septembre 1997, la CNDP a été transformée en autorité administrative indépendante par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Celle-ci a également modifié ses conditions de saisine, élargi ses missions et précisé les conditions d’organisation du débat public.
La CNDP exerce désormais son activité dans le cadre de la convention d’Aarhus signée, dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies, le 25 juin 1998, et ratifiée par la France le 8 juillet 2002 (2), et de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (3).
Les règles qui régissent le fonctionnement de la CNDP figurent aux articles L.121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement (R. 121-1 à R. 121-16 pour la partie réglementaire).
La CNDP est une instance collégiale de 21 membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Ses membres sont irrévocables ; leur mandat est renouvelable une fois. Sa composition fait appel, comme la plupart des autorités administratives indépendantes, à des compétences et à des légitimités diverses.
Le collège est actuellement constitué de la façon suivante :
– Un Président (M. Philippe Deslandes, Préfet).
– Deux vice-présidents (MM. Patrick Legrand et Philippe Marzolf)(4).
– Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat (MM. Jean Lasalle et André Dulait).
– Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés.
– Un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État.
– Un membre de la Cour de cassation, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation.
– Un membre de la Cour des comptes, élu par l’assemblée générale de la Cour des comptes.
– Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
– Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’environnement.
– Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.
– Deux personnalités qualifiées, dont l’une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’équipement.
La CNDP, dont les missions sont présentées ci-après, est garante, devant le public, de l’impartialité, de la transparence et de la sincérité du débat public (5). À cet effet, elle n’est soumise à aucun pouvoir hiérarchique. Elle ne dispose ni d’un pouvoir réglementaire ni d’un pouvoir de sanction mais prend des décisions, émet des avis et formule des recommandations.
● La CNDP « est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire » (article L. 121-1 du code de l’environnement, paragraphe I).
Il appartient à la CNDP, au cas par cas, d’apprécier dans quelle mesure les critères fixés par la loi s’appliquent aux projets qui lui sont présentés.
La participation du public peut prendre la forme d’un débat public, lequel porte alors sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet :
– la CNDP peut organiser elle-même ce débat, auquel cas elle en confie l’animation à une commission ad hoc, dite commission particulière du débat public (CPDP), qui le mène sur la base d’un dossier fourni par le maître d’ouvrage (voir infra) ;
– elle peut confier l’organisation du débat au maître d’ouvrage concerné, sur la base de préconisations ;
– elle peut en outre estimer qu’un débat public ne s’impose pas, mais recommander au maître d’ouvrage l’organisation d’une concertation selon des modalités qu’elle propose.
● Le ministre chargé de l’environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la CNDP en vue de l’organisation d’un débat public portant sur des options générales en matière d’environnement ou d’aménagement.
● La CNDP conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d’ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l’élaboration d’un projet.
● La CNDP a également pour mission d’émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
La CNDP ne maîtrise pas son activité car elle ne peut « s’autosaisir ». Le nombre des saisines est fonction de l’activité des maîtres d’ouvrage publics ou privés.
La loi fixe deux types de seuils :
– ceux au-dessus desquels la saisine de la CNDP est obligatoire ;
– à un niveau inférieur, ceux à partir desquels le maître d’ouvrage doit rendre publiques les caractéristiques essentielles du projet, la commission pouvant alors être saisie, dans un délai de deux mois, par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace, territorialement intéressés, ou par une association agréée de protection de l’environnement exerçant son activité sur l’ensemble du territoire national.
Lorsque la saisine est obligatoire, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet doivent adresser à la CNDP un dossier qui expose ses objectifs et ses caractéristiques, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l’identification des impacts sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
Lorsque la saisine est facultative, la CNDP, si elle est saisie, informe le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable qui, dans un délai d’un mois, lui adresse un dossier.
La liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la CNDP est saisie de droit, en application du I de l’article L. 121-8, ou de façon facultative, en application du II du même article, est fixée comme suit, conformément à l’article R. 121-2 du code de l’environnement :
CATÉGORIES ET CONDITIONS DE SAISINE DE LA CNDP
Catégories d’opérations visées à l’article L. 121-8 |
Seuils et critères visés à l’article L. 121-8-I |
Seuils et critères visés à l’article L. 121-8-II |
1. a) Créations d’autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
b) Elargissement d’une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
|
|
c) Création de lignes ferroviaires ; |
|
|
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
|
|
2. Création ou extension d’infrastructures de pistes d’aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€. |
3. Création ou extension d’infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
5. Création de gazoducs. |
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. |
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
6. Création d’oléoducs. |
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. |
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
7. Création d’une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d’un coût supérieur à 300 M€. |
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d’un coût supérieur à 150 M€. |
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
9. Transfert d’eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
10. Équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
11. Équipements industriels. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
● Le président de la CNDP forme, avec les deux vice-présidents, un bureau permanent qui se réunit périodiquement dans l’intervalle qui sépare deux réunions plénières.
Le président et les vice-présidents se répartissent l’instruction des saisines, l’examen des modalités d’organisation des débats et le suivi des décisions.
● Lorsque la CNDP décide d’organiser un débat public, elle en confie la charge à une « commission particulière du débat public » (CPDP) dont elle désigne le président dans un délai de quatre semaines. Le président de la CPDP propose la désignation de membres présentant les qualités susceptibles de garantir l’impartialité et l’équilibre des débats.
Ces commissions particulières sont composées, en moyenne, de 5 à 6 membres y compris le président. Le Président de la CNDP ne peut ni présider ni participer à une CPDP (article R. 121-7-I) ; ses vice-présidents ont en revanche vocation à le faire (ils ont assuré la présidence du quart des débats ainsi organisés). Les membres de la CNDP ont pour leur part participé 28 fois à de telles commissions.
La commission particulière est assistée par une équipe restreinte mais permanente, composée d’un secrétaire général et de un à trois collaborateurs, pris en charge financièrement par le maître d’ouvrage.
● Dans un délai de six mois à compter de la décision d’organiser un débat public, le maître d’ouvrage ou la personne responsable du projet propose au président de la CPDP un dossier, constitué suivant les indications de la CNDP, en vue du débat public. La CNDP, ayant entendu l’avis du président de la commission particulière, peut demander des compléments ou des modifications.
Lorsqu’elle juge le dossier suffisamment complet la CNDP en accuse réception et fixe, dans un délai de deux mois, le calendrier et le programme du débat public, sur proposition du président de la CPDP. Le débat public lui-même ne peut normalement excéder quatre mois (il peut être prolongé de deux mois à titre exceptionnel).
Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du débat le président de la CPDP établit le compte-rendu du débat public et celui de la CNDP en dresse le bilan. Puis, dans un délai de trois mois, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet rend publique sa décision (maintien, modification, suspension ou abandon du projet).
Au total, le respect de la procédure résultant des articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l’environnement induit des délais d’environ 21 mois en moyenne. Des délais plus courts (de l’ordre de 14 mois) ont été constatés dans certains cas.
Le nombre de saisines de la Commission nationale est plutôt stable : environ une douzaine par an (99 depuis 2003).
En moyenne, la Commission a décidé une participation du public dans 77 % des cas, sous forme de débat public (51 %) ou de concertation recommandée (26 %). C’est donc une saisine sur deux qui conduit à l’organisation d’un débat public, mené par la CNDP dans 91 % des cas et par le maître d’ouvrage dans 9 % des cas.
Le niveau d’activité est actuellement plutôt élevé : la nouvelle Commission, renouvelée au premier trimestre de l’année 2008, a décidé d’organiser plus de dix débats publics depuis le début de l’année 2009 et a recommandé six concertations.
Ainsi, à titre d’exemples, il a été décidé d’organiser un débat public :
– sur le projet de construction d’un nouveau réservoir et d’un nouvel appontement en vue de prolonger l’exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin (2 décembre 2009) ;
– sur le projet de construction d’un terminal méthanier à Fos-sur-mer (2 décembre 2009) ;
– sur le projet de parc éolien en mer des deux côtes (7 octobre 2009) ;
– sur le projet Arc Express (2 septembre 2009) ;
– sur le projet de liaison ferroviaire « Roissy Picardie » (2 septembre 2009).
Il convient de noter, en préalable, que le coût de chaque débat public est à la charge du maître d’ouvrage, à l’exception des indemnités et frais des membres des commissions particulières et des expertises complémentaires éventuellement nécessaires.
Pour le reste, les seules ressources de la Commission sont budgétaires. La CNDP dispose, de par la loi, de l’autonomie comptable et financière.
Son président et ses vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et perçoivent à ce titre une rémunération. Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. L’équipe administrative est constituée de sept personnes dirigées par un secrétaire général.
DÉPENSES DE PERSONNEL
(en euros)
Frais de personnel |
Indemnités membres CPDP | |
2006 |
342 741 |
481 557 |
2007 |
370 672 |
220 960 |
2008 |
537 562 |
138 325 |
2009 |
840 000 |
323 791 |
Le siège de la CNDP est situé au 6, rue du Général Camou, dans le 7e arrondissement de Paris, dans des locaux mis à sa disposition, moyennant convention, par le ministère de l’Écologie et du développement durable.
Rattachés à l’origine aux services du Premier ministre, les emplois et les crédits de fonctionnement de la CNDP sont désormais imputés sur une action spécifique 25 du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables de la mission Écologie, développement et aménagement durables.
2010 – CRÉDITS DE PAIEMENT
(en euros)
Numéro et intitulé de l’action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Total | |
25 |
Commission nationale du débat public |
1 151 076 |
796 251 |
1 947 327 |
Cette action a pour seule vocation de permettre d’identifier le budget attribué à la Commission : en vertu d’un principe qui aurait été défini avec le ministère du Budget ce budget serait tenu hors des mouvements de fongibilité pouvant intervenir au sein du programme.
Le Gouvernement indique, dans la présentation du programme et des actions associée au projet de loi de finances pour 2010, que : « Aucun objectif n’est mentionné au sein du programme car, la CNDP ne pouvant s’autosaisir, son activité dépend entièrement de l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des autres autorités qui peuvent la saisir. – Au regard du statut de la commission, le responsable de programme ne peut, en aucune façon, s’engager en lieu et place du président de la CNDP ».
La CNDP considère qu’il est difficile de définir un indicateur d’activité qui puisse permettre de porter un jugement sur sa performance.
g) Vers une réforme des procédures de la CNDP ?
Les procédures mises en œuvre par la CNDP ont été débattues à plusieurs reprises au cours de la période récente devant la représentation nationale, en particulier dans le cadre du suivi du « Grenelle de l’environnement ».
● L’article 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que : « La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l’impact des projets sur l’environnement ».
● L’article 95 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), adopté en 1ère lecture par le Sénat le 8 octobre 2009, modifie les dispositions correspondantes du code de l’environnement afin de prévoir :
– un élargissement de la composition de la CNDP à deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux des entreprises et deux des chambres consulaires ;
– la possibilité de saisir la CNDP sur de grandes options d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement ;
– la possibilité de désigner un garant dans les concertations recommandées par la CNDP ;
– de nouvelles modalités d’organisation de l’après-débat : information de la CNDP par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable, pendant la phase postérieure au débat jusqu’à l’enquête publique, des modalités de l’information et de la participation du public ainsi que de leur contribution à l’amélioration du projet ; possibilité pour la commission d’émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
● On relève, enfin, que, dans le cadre du débat relatif au « Grand Paris », l’implication de la CNDP, écartée au stade du projet de loi, a finalement été réintroduite, selon des modalités particulières, par l’Assemblée nationale.
L’article 14 de la loi précitée du 3 août 2009 prévoyait déjà que : « En Ile-de-France, un programme renforcé de transports collectifs visera à accroître la fluidité des déplacements, en particulier de banlieue à banlieue. À cet effet, un projet de rocade structurante par métro automatique sera lancé après concertation avec l'autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres projets d'infrastructures de transport déjà engagés dans le cadre du contrat de projets État-région. La procédure du débat public aura lieu en 2009 sur le projet de rocade dans sa totalité ».
L’article 3 du projet de loi relatif au Grand Paris, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2009, dispose que : « La participation du public au processus d’élaboration et de décision du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est assurée par un débat public, conformément à l’article 14 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009. (…) Ce débat public est organisé par la Commission nationale du débat public conformément au présent article (…) ».
La CNDP associera au débat public l’établissement public « Société du Grand Paris », lequel en assumera la charge matérielle et financière. À cette fin et pour ce débat public, elle mettra en place une commission spécialisée dont le nombre des membres ne pourra être supérieur à douze. Le dossier destiné au public sera établi par la SGP et transmis à la CNDP qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constatera qu’il est complet ou indiquera les éléments qu’il convient d’y ajouter. Le dossier sera rendu public par la CNDP au plus tard un mois avant le début de la consultation du public. La durée du débat public sera de quatre mois.
COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT (CECEI)
AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES (ACAM)
1. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI)
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) a succédé au Comité des établissements de crédit, qui lui-même avait remplacé le Conseil national du crédit institué en 1945. Il est régi par des dispositions du code monétaire et financier.
La principale mission du CECEI est de concourir au bon fonctionnement du système bancaire et financier français, afin d’en assurer la stabilité. Il exerce cette mission à travers un pouvoir d’autorisation administrative, le plus souvent préalable, appliqué aux principales étapes de la vie sociale des établissements assujettis. Le Comité prend en effet toutes les décisions administratives individuelles relatives aux établissements de crédit (6) et aux entreprises d’investissement (7) (hors sociétés de gestion de portefeuille) ayant leur siège social en France ou dans un pays non-membre de l’Union européenne (8). Il délivre les agréments. Il intervient pour tout changement important dans la vie des personnes agréées (modification des statuts, de l’actionnariat, etc.). Par ailleurs, il joue le rôle de « guichet unique » pour les procédures de « passeports européens » dans son secteur d’intervention.
Cette activité s’inscrit dans un contexte institutionnel qui conduit le CECEI à développer des échanges d’informations avec les autres autorités participant à la stabilité financière, au premier rang desquelles figurent la Commission bancaire et l’Autorité des Marchés Financiers pour ce qui concerne les services d’investissement.
Le CECEI considère que l’indicateur le plus pertinent de son activité est le nombre de décisions qu’il prend, soit, pour l’exercice 2008 : 177 décisions pour les établissements de crédit agréés en France ou pour exercer à Monaco ; 43 décisions concernant les entreprises d’investissement. À ces décisions s’ajoutent l’examen des désignations de dirigeants responsables, les notifications concernant l’implantation de succursales d’établissements européens et les déclarations de libre prestation de services.
Dans son étude réalisée en 2001, le Conseil d’État a estimé que, en raison de ses caractéristiques, le CECEI devait être considéré comme une autorité administrative indépendante. Il s’est notamment fondé sur la présence, au sein de son collège, de catégories de personnes qui ne sont pas dans un lien de subordination à l’égard du Gouvernement, et sur son pouvoir de délivrer des agréments.
Le Président du CECEI est, de par la loi, le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission bancaire. Le Comité comprend, en outre :
– le directeur de la Direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l’économie, ou son représentant ;
– le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
– le président du directoire du fonds de garantie des dépôts, ou un membre du directoire le représentant ;
– huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie pour une durée de trois ans : un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction (dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d’investissement), deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l’agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les fonctions des membres du collège du CECEI sont exercées à titre gratuit.
Le Secrétaire général du CECEI est désigné par accord entre le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le Gouverneur de la Banque de France. Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de la Banque de France, qui met à sa disposition les agents et les moyens (financiers, en locaux et en matériels) dont il a besoin pour l’exercice de ses missions.
Le niveau de ces effectifs n’est pas communiqué par le CECEI, pas plus que celui de ses dépenses.
Créée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire a remplacé la Commission de contrôle des banques qui avait été instituée par une loi du 13 juin 1941. Elle est régie par des dispositions du code monétaire financier.
La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Son existence est plus largement justifiée par la nécessité de veiller à la sécurité des dépôts du public et du système bancaire. À cet effet, elle s’assure du respect des règles prudentielles (9) quantitatives et qualitatives qui s’appliquent aux entreprises du secteur bancaire, veille à la qualité de leur situation financière et examine leurs conditions d’exploitation. Cette mission s’exerce à travers des contrôles sur pièces et sur place menés par son Secrétariat général.
Dans l’exercice de ses missions, la Commission bancaire collabore avec les autres autorités nationales du secteur financier, le CECEI, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d’assurance (10) et l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’avec ses homologues étrangers.
La Commission bancaire dispose de pouvoirs importants. Outre celui d’effectuer des contrôles sur pièces et sur place, elle détermine, par voie d’instruction, la liste, le modèle et les délais de transmission des documents qui doivent lui être remis par les établissements assujettis, auxquels elle peut demander de surcroît tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Elle bénéficie d’un pouvoir de communication concernant les commissaires aux comptes des établissements soumis à son contrôle. Elle peut, lorsque la situation d’un établissement le justifie, prendre différentes mesures de police administrative (mise en garde, injonction, désignation d’un administrateur provisoire…).
Par ailleurs, la Commission bancaire dispose d’un pouvoir de sanction (de l’avertissement à la radiation). Elle peut prononcer, à la place ou en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire (pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros pour une banque depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).
Selon la Commission bancaire son activité peut être mesurée par le nombre d’enquêtes sur place (149 en 2008), de lettres aux établissements demandant des actions correctrices (1831 en 2008), de réunions avec les représentants des établissements assujettis ainsi que des autres autorités (871 en 2008), de participations aux groupes de travail nationaux et internationaux (448 en 2008), de décisions administratives (81 en 2008) et de sanctions (5 en 2008) prises par le collège.
La qualification d’autorité administrative indépendante donnée à la Commission bancaire trouve également son origine dans l’étude réalisée en 2001 par le Conseil d’État. Celui-ci a alors considéré que, si la Commission a la nature d’une juridiction lorsqu’elle exerce son pouvoir de sanction, elle doit être qualifiée d’AAI dans l’exercice de sa mission de contrôle du respect des règles jurisprudentielles par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, de surveillance de la situation financière de ces établissements et de traitement des situations de crise, eu égard à ses pouvoirs et à sa composition.
La composition de la Commission bancaire est fixée par l’article L. 613-3 du code monétaire et financier qui dispose que celle-ci est présidée par le Gouverneur de la Banque de France, ou son représentant. La Commission comprend en outre :
– le directeur de la Direction du Trésor, ou son représentant ;
– le président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
– quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie pour une durée de cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois : un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
Les membres du collège, à l’exception du Président et du directeur de la Direction générale du Trésor et de la politique économique, perçoivent une indemnité de 800 euros par séance à laquelle ils sont présents. La Commission bancaire tient une vingtaine de séances par an.
Comme pour le CECEI la Banque de France met à la disposition du Secrétariat général de la Commission bancaire les agents et les moyens (financiers, en locaux et en matériels) dont il a besoin. Les effectifs globaux (contrôle sur pièces et contrôle sur place) devraient atteindre 586 agents fin 2009, contre 485 fin 2005 (application d’un plan de renforcement des effectifs couvrant la période 2005-2009).
3. L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM)
L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a été créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière : initialement appelée « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance », elle a été renommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. Elle procède de la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP).
La loi la qualifie d’autorité publique indépendante et la dote de la personnalité morale (article L. 310-12 du code des assurances).
Dans le prolongement des missions de la CCA et de la CCMIP, l’ACAM est chargée de veiller au respect, par l’ensemble des organismes du secteur de l’assurance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents, et de la conformité du fonctionnement de leurs organes dirigeants et délibérants aux textes qui les régissent.
Le Collège peut :
– adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation individuelle ;
– prendre les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées lorsque la situation financière d’un organisme contrôlé ou ses conditions de fonctionnement sont telles que leurs intérêts sont compromis ou susceptibles de l’être ;
– prononcer des sanctions (disciplinaires ou pécuniaires) lorsqu’un organisme contrôlé a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’il a contractés.
En revanche, la loi n’autorise pas l’ACAM à adresser des recommandations impératives de portée générale aux organismes placés sous son contrôle. Investie par le législateur du seul pouvoir de décision individuelle, elle ne dispose, en effet, d’aucun pouvoir réglementaire.
L’ACAM considère que sa mission étant d’exercer le contrôle de l’État sur le secteur de l’assurance dans l’intérêt des assurés, l’indicateur pertinent de résultat est, la concernant, le nombre de faillites d’organismes d’assurance (une seule depuis sa création).
En vertu de l’article L. 310-12-1 du code des assurances, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
1° un président nommé par décret du Président de la République ;
2° le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
3° un conseiller d’État, proposé par le vice-président du Conseil d’État ;
4° un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d’assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance.
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l’Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président.
Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l’Autorité de contrôle le remplace lorsqu’il exerce les compétences du président.
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération. Lorsqu’elle décide d’une sanction, l’Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La rémunération du Président actuel (incluant les primes, indemnités et avantages en nature) est de 75.000 euros par an, en sus de son traitement d’inspecteur général des finances (depuis septembre 2009, à titre honoraire). La rémunération des membres de l’Autorité représente 103.000 euros en 2008, variant de 1.000 à 13.000 euros par membre et par an (selon que le membre est titulaire ou suppléant).
Les services de l’Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé, parmi les membres du corps de contrôle des assurances, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. Le personnel de l’Autorité de contrôle est composé d’agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Les effectifs totaux s’élèvent actuellement à 204 personnes.
Les charges de personnel sont égales à 14,3 millions d’euros, soit 52 % des dépenses globales d’exploitation. Les dépenses immobilières totales (loyer + charges locatives) représentent 23 % de ces dépenses.
Le budget de l’ACAM est alimenté par le produit d’une taxe versée par les organismes soumis à son contrôle (article L. 310-12-4 du code des assurances). Les dépenses, qui s’élevaient à environ 13 millions d’euros au cours du premier exercice (2005), sont depuis proches de 30 millions par an. L’ACAM dispose par ailleurs d’un fonds de roulement de plus de 30 millions d’euros, soit une année entière de fonctionnement.
AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES
DONNÉES FINANCIÈRES
(en milliers d’euros)
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 | |
Crédits votés |
28 139 |
29 393 |
28 345 |
23 052 |
19 944 |
Recettes encaissées |
28 540 |
28 868 |
28 345 |
23 052 |
19 944 |
Crédits consommés (fonct. + inv.) |
27 859 |
27 041 |
26 915 |
13 422 |
7 522 |
Charges de personnel |
14 267 |
13 724 |
10 311 |
9 512 |
3 101 |
Autres dépenses (hors loyer) |
7 568 |
7 452 |
6 032 |
2 687 |
4421 |
Loyer immobilier |
5 523 |
5 315 |
3 441 |
1 020 |
400 |
Dépenses d’investissement |
501 |
550 |
7 131 |
203 |
23 |
Résultat de l’exercice |
1 181 |
2 376 |
8 561 |
9 833 |
12 422 |
Source : ACAM.
*
* *
Le cloisonnement et l’hétérogénéité des autorités de contrôle du secteur financier sont aujourd’hui jugés excessifs.
● Ce constat est pour partie à l’origine des dispositions de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, « les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière française ». Il est précisé que l’ordonnance devra « redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d’une part, entre autorités d’un même secteur et, d’autre part, entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » (11).
● La Cour des comptes, pour sa part, a estimé que le modèle français de supervision du secteur financier et l’existence de différents organes indépendants dotés de pouvoirs de contrôle et de sanction ne devait pas être remis en cause, mais a également dénoncé une architecture trop complexe et trop fragmentée et recommandé un renforcement des coopérations entre ces autorités(12).
● Consécutivement, Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, a confié à M. Bruno Deletré, Inspecteur des finances, une mission sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières. Le rapport, remis en janvier 2009, préconise une architecture en deux piliers distincts : un pôle prudentiel, d’une part, un pôle de contrôle des pratiques commerciales et de marché, d’autre part. Il propose, dans cette perspective, diverses réformes parmi lesquelles une fusion de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, du Comité des entreprises d’assurance et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles(13).
De fait, durant l’automne, la ministre de l’Économie, Mme Christine Lagarde, a soumis à consultation un projet d’ordonnance créant une autorité de contrôle et d’agrément commune aux secteurs de la banque et de l’assurance. La nouvelle instance, qui fusionnerait la Commission bancaire, l’ACAM, le comité des entreprises d’assurance et le CECEI, a été provisoirement baptisée Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Le projet la dote du statut d’autorité administrative indépendante et l’adosse à la Banque de France. L’ordonnance pourrait être examinée en Conseil des ministres très prochainement.
Article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l’économie
Les dispositions qui sont à l’origine de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et donc de l’ordonnance qui doit en résulter, ont été ajoutées au projet initial en première lecture par le Sénat.
Dans leur rapport n° 413 (24 juin 2008) les rapporteurs (Laurent Béteille, Elisabeth Lamure et Philippe Marini) écrivaient : « Votre commission spéciale vous propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la fusion des deux autorités de contrôle prudentiel que sont la commission bancaire et l’ACAM. Votre commission spéciale considère en effet que la récente crise des subprimes et le constat d’une « marchéisation » croissante des risques ne font que plaider davantage en faveur d’une rationalisation de l’architecture française de surveillance des acteurs financiers. Il est aujourd’hui nécessaire de prévoir une régulation reposant sur deux piliers correspondant à deux logiques : la surveillance des marchés et émetteurs, assurée par l’AMF, et la surveillance prudentielle intersectorielle ».
Au cours de la séance du 4 juillet 2008 les débats ont été les suivants :
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Marini, au nom de la commission. (…) L’amendement n° 40 est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis. De fusionner la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles afin de disposer d’un régulateur prudentiel unique pour les acteurs financiers réglementés ;
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. (…) L’amendement n° 40 vise également à compléter l’habilitation à réformer le droit financier par ordonnances.
Il s’agit, madame le ministre, de conforter vos initiatives en matière de rationalisation de notre architecture de régulation, en vous permettant de prendre, dans un délai de dix-huit mois, les mesures législatives nécessaires à la fusion des deux autorités de contrôle prudentiel que sont la Commission bancaire et l’ACAM, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Nous avons eu l’occasion de nous exprimer assez longuement sur ces sujets en diverses enceintes, et je ne prolongerai donc pas exagérément mon propos. Qu’il me suffise de dire que cette simplification de notre architecture de régulation serait de nature à tenir compte de la « marchéisation » croissante des risques et du fait que ceux-ci, ces derniers temps, sortent volontiers des bilans bancaires pour circuler dans ceux des compagnies d’assurance et être récupérés dans les fonds d’investissement et tous les outils de marché. Cela renforce, me semble-t-il, la nécessité d’avoir une approche horizontale de la régulation financière.
M. le président. L’amendement n° 1064, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis. De prendre les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) de redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le rapprochement d’une part entre autorités d’un même secteur, et d’autre part entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
b) de moderniser le mandat des autorités de contrôle et d’agrément afin notamment d’y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le conseil Ecofin ;
c) d’ajuster les champs de compétence de ces autorités et d’autres entités susceptibles d’intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
d) d’adapter les procédures d’urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu’elles peuvent prononcer, afin d’en assurer l’efficacité et d’en renforcer les garanties procédurales.
II. - Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :
, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a été déposé en réponse à l’amendement n° 40 que M. Marini vient de présenter.
Monsieur le rapporteur, vous proposez d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour fusionner l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire.
Je vous remercie de cette initiative, car, en la matière, il n’est pas inopportun de travailler par voie d’ordonnance, compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de soumettre ensuite, pour ratification, un travail extrêmement fouillé.
Vous proposez d’élargir le champ de l’habilitation, notamment sur ce point. Le Gouvernement partage pleinement votre objectif. Comme vous venez de le rappeler, nous avons eu l’occasion d’évoquer ensemble ce sujet dans différentes enceintes.
Les mutations du secteur financier, notamment le développement des bancassurances, qui connaissent des flux et des reflux, mais qui, me semble-t-il, sont en développement, l’avènement de standards prudentiels de Solvabilité 2 pour les assureurs inspirés de Bâle 2, et la porosité entre les secteurs de la banque et de l’assurance, que vous évoquiez tout à l’heure, dans un contexte de circulation rapide d’actifs à la valorisation parfois difficile, plaident pour un rapprochement des autorités prudentielles des banques et des assurances.
Je vais d’ailleurs confier, dans les prochains jours, une mission pour identifier, en étroite concertation avec les professionnels, les utilisateurs de notre place financière, les autorités de supervision et leurs personnels, les scénarios cibles les mieux adaptés pour permettre un rapprochement de ces autorités, et je ferai des propositions d’ici à la fin de l’année.
Par l’amendement n° 1064, le Gouvernement souhaite introduire de légères modifications à l’habilitation que vous proposez, monsieur le rapporteur.
Vous souhaitez une fusion de l’ACAM et de la Commission bancaire. Si je partage l’objectif d’un rapprochement, pour autant, je ne suis pas nécessairement convaincue, en tout cas à ce stade, de l’opportunité d’une fusion stricto sensu. Je souhaite en effet laisser les options ouvertes, afin que toutes les voies soient explorées, dans leur dimension nationale, bien sûr, mais aussi au regard de leurs implications européennes, et ce en étroite concertation avec l’ensemble des parties prenantes, qui, nous le savons, sont à la fois bien informées et très sensibles.
Il me semble par ailleurs que d’autres questions doivent être abordées au cours de ce chantier. Je souhaite notamment réfléchir à la fusion des autorités de contrôle et d’agrément, aux moyens de prévoir une meilleure articulation entre les procédures judiciaires et les sanctions administratives dans les matières financières, et à la possibilité de renforcer les moyens d’action de l’AMF en matière de lutte contre les comportements délictueux, notamment en réfléchissant à l’introduction d’une procédure de transaction.
Voilà, en quelques mots, ce à quoi une réforme pourrait ressembler et les thèmes sur lesquels je souhaite pouvoir réfléchir, dans le cadre d’une concertation avec la place financière.
Je veux maintenant préciser ce à quoi la réforme ne doit pas, selon moi, ressembler.
Cet été, l’expérience de Northern Rock, au Royaume-Uni, a montré le danger à couper le lien entre supervision prudentielle, d’une part, et accès à la liquidité de la banque centrale, d’autre part. Je suis donc fermement attachée au maintien du lien entre la Commission bancaire et la Banque de France.
Cette expérience a également souligné la difficulté à poursuivre au sein d’une institution unique les objectifs de transparence à l’égard des marchés et de gestion d’épisodes de tension dans le secteur bancaire. Je suis donc fermement attachée au maintien de deux pôles : un pôle prudentiel, d’une part, et un pôle « marchés financiers » autour de l’Autorité des marchés financiers, d’autre part.
Pour résumer, si je suis favorable à un rapprochement de l’ACAM et de la Commission bancaire, je souhaite que l’AMF en soit séparée, afin de conserver deux pôles distincts. (…)
M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 41 tend à compléter l’amendement n° 40 et à fixer à dix-huit mois le délai d’habilitation pour la fusion de la Commission bancaire et de l’ACAM.
S’agissant des amendements identiques nos 482 et 941, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 40, au sujet duquel j’ai eu un aparté avec le président de la commission spéciale, il nous paraît raisonnable de le retirer au profit de l’amendement n° 1064 du Gouvernement.
J’ajouterai un bref commentaire sur ce point, madame le ministre. Vous évoquez un rapprochement entre la Commission bancaire et l’ACAM. Il est vrai que différentes formes de rapprochement peuvent être envisagées, notamment entre les collèges ou les services. Une approche qui permettrait peut-être de bien avancer dans ce domaine serait de faire en sorte que les spécificités professionnelles soient respectées dans l’organisation des services, mais qu’il y ait une même responsabilité collégiale. Une telle approche serait envisageable dans la mesure où le rapprochement ne se confondrait pas avec la fusion, mais s’en « rapprocherait », si j’ose dire, ce qui irait dans le sens de nos préoccupations. Mais n’en préjugeons pas !
J’observe, par ailleurs, que l’amendement n° 1064, qui vise à ajouter au 1° de l’article 42 une série de mesures que le Gouvernement pourra prendre par voie d’ordonnance, est très riche, d’une rédaction très claire et précise quant aux objectifs poursuivis et aux sujets à traiter par ordonnances. Bien entendu, le moment venu, le Sénat sera attentif à la ratification de ces ordonnances.
M. le président. L’amendement n° 40 est retiré. (…) Je mets aux voix l’amendement n° 1064.
Mme Catherine Procaccia. Je m’abstiens !
(L’amendement est adopté.)
En conséquence, le Sénat a adopté le texte suivant :
1° bis (nouveau) De prendre les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) De redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d’une part, entre autorités d’un même secteur et, d’autre part, entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
Ce texte n’a plus évolué par la suite. Il est devenu l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière(14) et installée le 24 novembre de la même année. Elle est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière. Autorité publique indépendante, elle est dotée de la personnalité morale et dispose de l’autonomie financière.
Le regroupement, en 2003, au sein d’une entité unique, des missions de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements, d’information des investisseurs et de surveillance du bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers (article L. 621-1 du code monétaire et financier) a traduit une volonté de simplifier l’architecture du dispositif français de régulation des marchés financiers.
L’AMF exerce quatre types de responsabilités : réglementer ; autoriser ; surveiller ; sanctionner.
Elle adopte un règlement général, qui est homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce règlement détaille les droits et obligations des acteurs financiers ; il précise le fonctionnement des marchés et des instruments financiers ainsi que le déroulement des introductions en bourse ou des offres publiques d’acquisition.
La commission des sanctions de l’AMF (voir infra) peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou professionnelles à l’égard de toute personne dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements régissant l’offre au public d’instruments financiers et le fonctionnement des marchés.
Les décisions de l’AMF sont susceptibles de recours devant les juridictions judiciaires ou administratives, selon leur nature.
L’AMF agit en coordination avec les autres autorités chargées du contrôle des professions financières et bancaires, c’est-à-dire la Banque de France et les organes indépendants qui interviennent dans le secteur des banques ou des assurances, et dont la fusion (par ordonnance, sur le fondement de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) est en cours : Commission bancaire, Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Comité des entreprises d’assurance. Dans un contexte de mondialisation des marchés financiers, elle contribue à la régulation européenne et internationale en participant aux instances internationales et en coopérant avec ses homologues étrangers.
Les attributions confiées à l’Autorité des marchés financiers sont exercées par un Collège composé de seize membres (six désignés par les pouvoirs publics et six par les professionnels, trois personnalités qualifiées et un représentant des salariés) :
– un président nommé par décret du Président de la République ;
– un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
– un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
– un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
– un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
– le président du Conseil national de la comptabilité (15) ;
– trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
– six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l’objet d’appel public à l’épargne, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
– un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre de l’économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l’économie, siège au sein du collège, sans voix délibérative, et peut demander une seconde délibération.
Le président de l’AMF est pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. M. Jean-Pierre Jouyet, actuel président, a ainsi été désigné par un décret du 12 décembre 2008.
La durée du mandat des autres membres du Collège, à l’exception du représentant de la Banque de France et du président du Conseil national de la comptabilité, est également de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le Collège est renouvelé par moitié tous les trente mois.
Organe décisionnel de l’Autorité, c’est le collège qui :
– arrête le budget de l’AMF sur proposition du secrétaire général et approuve le compte financier ;
– fixe le règlement intérieur, les règles de déontologie interne et les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération des agents ;
– adopte le règlement général de l’AMF ;
– prend les décisions individuelles (avis de recevabilité, agréments, etc.) ;
– peut ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques contraires aux lois ou règlements, lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le marché.
Le collège initie en outre les procédures de sanction :
– il examine les rapports de contrôle et d’enquête et notifie aux personnes concernées les griefs s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction ;
– en cas d’urgence, il suspend l’activité des professionnels soumis à son contrôle ;
– il peut transmettre les rapports de contrôle et d’enquête au Procureur de la République.
Toutefois, l’exercice de ce pouvoir est confié à la Commission des sanctions.
Le Collège peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions spécialisées, constituées en son sein et présidées par le président de l’Autorité des marchés financiers. Le commissaire du Gouvernement siège également au sein des commissions spécialisées. Ces commissions spécialisées sont ordinairement au nombre de trois.
Il peut constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
b) La commission des sanctions
La Commission des sanctions compte douze membres :
– deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
– deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
– six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’offre au public de titres financiers, d’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l’objet d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
– deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
Le commissaire du Gouvernement siège au sein de la commission des sanctions, mais il n’est pas présent au moment des décisions et ne peut demander une seconde délibération.
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les conseillers d’État ou les conseillers à la Cour de cassation visés ci-dessus : M. Daniel Labetoulle, président honoraire de la section du contentieux du Conseil d’État, préside la commission des sanctions depuis le 29 mai 2006 ; il a été réélu à cette fonction le 26 novembre 2008 après le renouvellement de son mandat par le vice-président du Conseil d’État.
C’est également parmi ces conseillers que sont choisis les présidents des deux sections de six membres qui sont ordinairement constituées.
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Leur fonction est incompatible avec celle de membre du collège.
La commission des sanctions peut prononcer des sanctions à l’égard de toute personne dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements régissant l’appel public à l’épargne et le fonctionnement des marchés financiers. Elle statue sur les griefs qui lui sont transmis par le collège de l’AMF. Elle dispose d’une totale autonomie de décision dans l’accomplissement de sa mission.
Le président de la commission des sanctions désigne, pour chaque affaire, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d’instruire le dossier en application de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. Le rapporteur est assisté par le Service de l’instruction et du contentieux des sanctions. Il ne prend pas part à la décision.
Le statut de l’AMF confère, dans ce domaine, un rôle particulier au secrétaire général, dans l’organisation des contrôles et l’instruction des plaintes. Il décide de procéder à des enquêtes et habilite les enquêteurs ; il peut demander aux commissaires aux comptes de procéder à des analyses ou vérifications complémentaires.
Le plafond forfaitaire des sanctions pécuniaires que peut prononcer la commission des sanctions a été porté, par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de 1,5 à 10 millions d’euros. Lorsque le manquement a permis à l’auteur du manquement de réaliser un profit direct, le plafond de la sanction encourue peut être porté à dix fois le profit réalisé (article L. 621-15 du code monétaire et financier).
De plus, des sanctions pénales peuvent être prononcées dans les cas visés par le code monétaire et financier.
Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, l’AMF dispose, selon les termes de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du Secrétaire général.
Elle perçoit directement le produit de taxes dues par les opérateurs, dont le barème est fixé par décret dans la limite de plafonds et de planchers eux-mêmes fixés par la loi (article L. 621-5-3 du code des marchés financiers).
ÉVOLUTION DU BUDGET DE L’AMF
(en milliers d’euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (prév.) | |
Dépenses |
58 598 |
68 827 |
60 927 |
70 420 |
75 096 |
- personnel |
33 772 |
33 441 |
34 932 |
39 422 |
42 468 |
- loyers immobilier |
3 530 |
5 181 |
6 089 |
6 993 |
7 098 |
- autres charges |
17 050 |
27 606 |
18 133 |
19 784 |
20 346 |
- investissements |
4 246 |
2 599 |
1 773 |
4 221 |
5 184 |
Recettes |
52 768 |
72 760 |
60 079 |
68 340 |
51 000 (1) |
- opérations financières |
21 241 |
24 604 |
17 352 |
23 379 |
11 870 |
- gestion + infrastructures de marchés |
29 129 |
32 074 |
36 505 |
38 673 |
36 359 |
- autres |
2 398 |
16 082(1) |
6 222 |
6 288 |
2 771 |
Résultat de l’exercice |
- 1 583 |
+ 6 533 |
+ 925 |
+ 2 142 |
- 18 912 |
(1) Y compris le produit de la vente d’un immeuble (13 millions d’euros)
Source : AMF.
L’évolution annuelle du fonds de roulement de l’AMF est présentée ci-après.
ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT DE L’AMF
(en milliers d’euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (1) |
2010 (1) |
57,96 |
75,13 |
78,07 |
79,39 |
58,46 |
30,36 |
(1) Prévisions : cette forte diminution s’explique par la baisse des recettes de l’AMF liées à la crise financière et plus particulièrement à l’absence d’opérations financières soumises à un contrôle, dès lors qu’il y a une offre au public d’instrument financier.
Source : AMF.
La loi précise que les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l’AMF. Sa gestion financière et comptable est néanmoins soumise au contrôle de la Cour des comptes. Elle fait un rapport annuel au Président de la République et au Parlement.
L’AMF dispose aujourd’hui d’environ 390 collaborateurs.
EFFECTIFS DE L’AMF EN 2009
2009 |
Droit public |
Droit privé |
Fonctionnaires détachés |
Banque de France |
CDD droit public |
total effectif réel avec CDD | ||||||
Nb |
Évolution |
Nb |
Évolution |
Nb |
Évolution |
Nb |
Évolution |
Nb |
Évolution |
Nb |
Évolution | |
Cadre sup. |
23 |
0,0 % |
7 |
40,0 % |
9 |
- 10,0 % |
1 |
0,0 % |
0 |
0,0 % |
40,3 |
2,2 % |
Cadre |
224 |
3,7 % |
26 |
62,5 % |
14 |
- 12,5 % |
7 |
- 22,2 % |
1 |
0,0 % |
271,7 |
5,5 % |
Non cadre |
65 |
6,6 % |
7 |
16,7 % |
2 |
0,0% |
0 |
0,0 % |
5 |
25,0 % |
79 |
8,2 % |
TOTAL |
312 |
4,0% |
40 |
48,2 % |
25 |
-10,7 % |
8 |
- 20,0 % |
6 |
20,0 % |
391 |
5,7 % |
Source : AMF.
Sur le plan de la mesure de la performance il doit être souligné que l’AMF ne constitue pas un opérateur de l’État et n’entre pas, en conséquence, dans le périmètre de la LOLF. Elle ne fait donc pas l’objet des indicateurs et objectifs prévus par celle-ci.
Toutefois, l’AMF s’est dotée d’un certain nombre d’outils qui lui permettent de rendre compte de son efficacité et de ses performances.
Parmi ces indicateurs on relève, par exemple, la proportion des entités régulées ayant fait l’objet d’un contrôle sur place ou sur pièces au cours de l’année, ou le pourcentage de contrôles menés en moins de six mois ; la proportion de dossiers présentés à la Commission des sanctions donnant lieu à sanction (16), ou la proportion des procédures devant la Commission des sanctions clôturées en moins de douze mois.
*
* *
La Cour des comptes a examiné, à partir de juillet 2006, l’activité et la gestion de l’Autorité des marchés financiers.
La Cour a notamment recommandé, dans son rapport annuel paru en janvier 2009 :
– que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport sur « l’État régulateur financier », afin de disposer d’un instrument de mesure de la performance analogue à celui résultant de la LOLF pour les services de l’État et de permettre à la représentation nationale d’appréhender les actions conduites par l’AMF (qui, n’étant pas dotée de crédits budgétaires, n’apparaît pas dans les documents budgétaires remis au Parlement) ;
– qu’une meilleure coordination soit recherchée avec les autres régulateurs nationaux ;
– une adaptation des procédures de sanction (y compris en reconnaissant au président de l’AMF un droit de recours incident sur les décisions de la Commission des sanctions) ;
– une meilleure adéquation entre l’utilisation des moyens et les zones de risques ;
– la rationalisation des ressources financières (la Cour observe que l’AMF connaît une certaine « aisance financière », que sa trésorerie est importante, mais que ses ressources souffrent d’une forte volatilité).
Il doit être noté, par ailleurs, que le Gouvernement a déposé, le 16 décembre 2009, sur le Bureau de l’Assemblée nationale, un projet de loi « de régulation bancaire et financière » dont les dispositions du titre IER et certaines du titre II concernent directement l’Autorité des marchés financiers.
Il est ainsi prévu de créer un Conseil de régulation financière et du risque systémique dont serait membre le président de l’AMF aux côtés du gouverneur de la Banque de France, de donner au président de l’AMF la capacité de prendre un certain nombre de mesures d’urgence en ce qui concerne les conditions de négociation des instruments financiers ou de désigner l’AMF comme autorité responsable, en France, du contrôle des agences de notation.
L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance (JO du 22 janvier 2010), prise sur le fondement de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, n’a en revanche pas modifié l’indépendance de l’AMF par rapport aux autres autorités indépendantes financières.
HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ (HALDE)
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été créée par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004(17). Elle a alors remplacé le groupement d’études et de lutte contre les discriminations (GELD), créé en 1999 sous la forme d’un groupement d’intérêt public : le GELD, qui était d’abord chargé d’une mission d’observation des discriminations raciales, associait, sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, d’autres ministères, des organisations professionnelles, des associations et des universitaires.
La création de la HALDE s’est inscrite dans le prolongement des directives communautaires n° 2000-43 et 2000-78 des 29 juin et 27 novembre 2000 (18). Elle était motivée par une volonté de lutter plus efficacement contre les pratiques discriminatoires, notamment celles liées au sexe, à l’origine ethnique, aux convictions politiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, au handicap, à l’état de santé, à l’âge ou à l’orientation sexuelle. Les contours de la future autorité avaient été exposés par le rapport remis au Premier ministre, le 16 février 2004, par M. Bernard Stasi, Médiateur de la République, intitulé : « Vers la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ».
Le législateur a ultérieurement confié à la HALDE des pouvoirs et des moyens nouveaux. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances lui permet ainsi de prendre l’initiative de présenter des observations devant les tribunaux et la dote d’un pouvoir transactionnel.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2004 la haute autorité est composée d’un collège de onze membres :
– deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;
– deux membres désignés par le président du Sénat ;
– deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
– deux membres désignés par le Premier ministre ;
– un membre désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
– un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
– un membre désigné par le président du Conseil économique et social.
La loi précise que : « Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ».
Le projet de loi organique pris pour l’application de l’article 13 de la Constitution, actuellement en discussion, prévoit que la désignation du président de la HALDE fait partie de celles qui devront faire l’objet d’un avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Le Président de la HALDE exerce son mandat à temps partiel. Sa rémunération brute annuelle (incluant les primes, indemnités et avantages en nature) était, en 2009, de 70 422 euros.
Le mandat des membres de la HALDE a une durée de cinq ans. Ils ne sont ni révocables, ni renouvelables. Le renouvellement a lieu par moitié tous les trente mois. Ils exercent leur mandat à temps partiel et perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion plénière du Collège, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour chaque séance de travail à laquelle ils participent et pour chaque rapport dont ils sont chargés(19).
La HALDE a pour première mission de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de fournir toute l’information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité.
Les critères de discrimination prohibés par la loi sont au nombre de 18 : âge, sexe, origine, situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales.
La HALDE est également chargée de promouvoir l’égalité. À cet effet elle mène des actions de communication, d’information et de formation, conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche, suscite et soutient les initiatives publiques ou privées visant à la promotion de l’égalité. Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité et peut l’être sur toute question relative à ces domaines ; elle peut d’ailleurs recommander des modifications législatives ou réglementaires. Elle contribue, enfin, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales qui concernent la lutte contre les discriminations.
La HALDE remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport dans lequel elle rend compte de l’exécution de ses missions.
La HALDE peut être saisie par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un parlementaire. Elle peut également être saisie, avec l’accord de la victime, par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations. Elle peut, enfin, se saisir d’office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance sous réserve que la victime, lorsqu’elle est identifiée, ait été avertie et qu’elle ne s’y soit pas opposée.
Pour instruire les réclamations qui lui sont adressées la HALDE peut demander des explications à toute personne physique ou morale, y compris aux personnes publiques, et se faire communiquer des informations ou des documents. Elle peut procéder à des vérifications sur place et entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. Lorsque ses demandes ne sont pas suivies d’effet, la HALDE peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe. Lorsque cette mise en demeure n’est pas elle-même suivie d’effet, son président peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner toute mesure d’instruction que ce dernier juge utile.
La HALDE aide également les victimes de discriminations à constituer leur dossier et les informe sur les procédures adaptées à leur cas.
L’instruction des réclamations donne lieu à des projets de délibérations soumis au Collège qui décide de la suite à leur donner. Il peut, notamment, faire procéder à la résolution amiable des différends par voie de médiation.
La HALDE informe le procureur de la République des faits paraissant constitutifs d’un délit portés à sa connaissance.
À la demande des parties ou d’office, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent inviter la HALDE à présenter des observations sur les faits de discriminations dont elles sont saisies. La HALDE peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions. Cette audition est de droit.
La HALDE peut enfin proposer une transaction comportant une amende et la réparation du préjudice subi par la victime, ainsi que des mesures de publicité. Cette transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République. En cas de refus de la transaction ou de l’inexécution de celle-ci, elle peut procéder par citation directe devant la juridiction pénale.
Le nombre des réclamations a évolué comme suit :
– 1 410 en 2005 ;
– 4 058 en 2006 ;
– 6 222 en 2007 ;
– 7 788 en 2008 ;
– 9 704 en 2009.
Depuis 2005, l’emploi a toujours été le principal domaine de réclamation (la moitié des réclamations en 2009, dans le secteur privé à hauteur des 2/3), et l’origine le premier critère mis en avant par les réclamants.
Parmi les 9 523 dossiers clos au cours de l’année 2009 :
– 2 ont été transmis en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
– 3 ont été transmis à la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
– 23 ont fait l’objet d’un rappel à la loi par le Président de la HALDE ;
– 69 ont connu une issue positive en cours d’instruction, suite à un accord amiable ;
– 295 ont été traités par les correspondants locaux par des actions d’information ou de bons offices ;
– 299 ont été présentés au Collège qui a pris une délibération ;
– 700 ont été abandonnés sur désistement du réclamant ou en l’absence de réponse aux sollicitations de la HALDE ;
– 725 ont été clos avant la présentation au Collège, la discrimination n’étant pas établie ;
– 925 ont été réorientés vers d’autres institutions compétentes ;
– 1 218 ont fait l’objet d’une instruction approfondie ;
– 6 372 ont été rejetés pour irrecevabilité.
La HALDE fait valoir que les suites données à ses délibérations sont le plus souvent favorables. Pour celles dont les suites sont connues, la proportion de suites positives s’établirait comme suit :
– 8 % pour les transmissions au parquet (une condamnation) ;
– 57 % pour les médiations ;
– 64 % pour les recommandations générales ;
– 73 % pour les recommandations individuelles ;
– 79 % pour les observations présentées devant les tribunaux ;
– 98 % de transactions pénales proposées au parquet ont été homologuées.
S’agissant des indicateurs de performance, l’objectif fixé à la HALDE au sein du programme 308 Protection des droits et libertés (services du Premier ministre), auquel elle est rattachée depuis le 1er janvier 2009, est de défendre et protéger efficacement les droits et les libertés. L’indicateur associé à cet objectif est le nombre de réclamations traitées par an et par ETP.
NOMBRE DE RÉCLAMATIONS REÇUES PAR LA HALDE
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 prév. |
2010 prév. | |
Nb. de réclamations traitées par an et par un ETP d’agent traitant |
64,9 |
176,4 |
136,5 |
155,1 |
200 |
205,9 |
Nb. de réclamations traitées par an |
2 143 |
6 526 |
6 414 |
7 600 |
9 800 |
10 500 |
ETPT d’agents traitants (Direction des affaires juridiques) |
33 |
37 |
47 |
49 |
49 |
51 |
Source : direction générale de la HALDE.
La HALDE a en outre arrêté une série d’indicateurs internes mesurant la performance de son activité.
Ces indicateurs, renseignés mensuellement, sont d’abord de nature juridique :
– nombre de dossiers de réclamations ouverts ;
– nombre de dossiers clos ;
– suivi des dossiers par les correspondants locaux ;
– nombre de dossiers à l’instruction depuis plus de douze mois ;
– nombre de délibérations adoptées par le Collège.
S’agissant de la promotion de l’égalité, la HALDE mesure les données suivantes :
– nombre de délibérations ou de présentations au Collège ;
– nombre de consultations d’outils sur le site internet ;
– nombre de téléchargements d’outils sur le site internet.
S’agissant de l’action régionale, la HALDE se fonde sur le nombre de correspondants locaux installés. Sur le plan de la communication, elle recense le nombre de connexions sur son site internet et le nombre d’abonnés à sa lettre d’information. Au plan administratif, elle dispose des deux indicateurs suivants : pourcentage de consommation du budget ; nombre d’appels du numéro dédié 08 1000 5000.
Enfin, annuellement, la HALDE recense les suites réservées aux délibérations de son Collège (cf. supra).
En prenant en compte les reports de crédits, le budget de la HALDE avoisine les 12 millions d’euros.
HALDE – CRÉDITS DISPONIBLES ET CONSOMMÉS
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |||||
Crédits ouverts |
Budget réalisé |
Crédits ouverts |
Budget réalisé |
Crédits ouverts |
Budget réalisé |
Crédits ouverts |
Budget réalisé |
Crédits ouverts | |
Fonctionnement hors personnel |
4 656 393 |
2 306 968 |
4 661 516 |
6 838 866 |
8 001 800 |
7 832 446 |
6 191 565 |
6 182 210 |
6 107 805 |
dont loyers |
1 806 619 |
1 415 218 |
1 872 401 |
1 744 641 |
1 960 750 |
1 876 799 |
1 935 000 |
1 884 137 |
1 935 000 |
Fonctionnement personnel |
2 843 607 |
962 551 |
5 787 049 |
3 454 732 |
4 534 928 |
4 489 952 |
5 084 000 |
5 065 029 |
5 520 531 |
Total |
7 500 000 |
3 269 519 |
10 448 565 |
10 293 598 |
12 536 728 |
12 322 398 |
11 275 565 |
11 247 239 |
11 628 336 |
dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 528 |
Source : HALDE.
Le tableau ci-après retrace l’évolution annuelle des effectifs de la HALDE depuis 2005 au travers d’une répartition des agents permanents par statut, par catégorie et par emplois.
HALDE – EFFECTIFS
Effectifs au 31 décembre |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
plafond d’emploi (hors agents mis à disposition) |
50 |
66 |
73 |
80 |
82 | |
effectifs permanents (hors agents mis à disposition) |
38 |
66 |
73 |
76 |
80 | |
effectifs permanents (avec agents mis à disposition) |
38 |
67 |
76 |
81 |
87 | |
répartition des agents permanents par statut |
contractuels |
32 |
56 |
63 |
67 |
69 |
dont CDD 3 ans |
20 |
43 |
50 |
38 |
21 | |
dont CDI |
13 |
13 |
13 |
29 |
48 | |
titulaires détachés * |
6 |
10 |
10 |
9 |
11 | |
Mis à disposition |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
Mis à disposition + remboursement |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 | |
Total |
38 |
67 |
76 |
81 |
87 | |
Agents non permanents (CDD inférieur ou égal à 10 mois) |
3 |
11 |
6 |
13 |
11 | |
répartition des agents permanents par catégorie |
A+ |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
A |
28 |
53 |
55 |
62 |
66 | |
B |
3 |
6 |
9 |
8 |
9 | |
C |
3 |
3 |
6 |
5 |
6 | |
Total |
38 |
67 |
76 |
81 |
87 | |
* tous les agents détachés à la HALDE sont sur un contrat à durée déterminée
Source : HALDE.
Le montant et l’évolution annuelle des dépenses de personnel sont retracés ci-après.
HALDE – DÉPENSES DE PERSONNEL
(en euros)
2008 |
2009 | |
Rémunérations brutes |
3 485 135 |
3 546 089 |
Indemnités |
135 985 |
137 135 |
Charges sociales |
589 605 |
596 463 |
Charges patronales |
1 199 444 |
1 153 894 |
TOTAL |
5 410 169 |
5 433 582 |
Source : HALDE.
Les dépenses de communication représentent une part importante des dépenses de fonctionnement.
HALDE – DÉPENSES DE COMMUNICATION
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
dépenses de communication |
151 347 |
2 986 214 |
1 853 062 |
1 273 036 |
dépenses de fonctionnement |
3 269 519 |
10 293 598 |
12 322 398 |
11 247 239 |
% |
5 % |
29 % |
15 % |
11 % |
Source : HALDE.
La HALDE considère que les actions de communication qu’elle mène correspondent à la mise en œuvre de l’objectif qui lui est fixé par l’article 15 de la loi du 30 décembre 2004, pour assurer la promotion de l’égalité.
La HALDE est implantée au 11 rue Saint-Georges, dans le IXe arrondissement de Paris. Elle occupe une surface globale de 2 224 m². Le bail, conclu le 13 janvier 2005 au nom du ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, puis transféré à la HALDE, a été signé pour une durée ferme de neuf années entières et consécutives.
HALDE – DÉPENSES IMMOBILIÈRES
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
(prévision) | |||||
Total annuel |
1 415 218 |
1 691 428 |
1 781 757 |
1 855 676 |
2 047 069 |
La HALDE fait valoir qu’elle accueille dans ses locaux :
– 11 membres du collège (le Président et les 2 vice-présidents ayant un bureau permanent) ;
– 18 membres du comité consultatif ;
– 80 agents (plus deux postes en cours de recrutement) ;
– 7 personnes mises à disposition ;
– 12 stagiaires ;
– 10 prestataires (courrier, logistique, accueil, 08 1000 5000) ;
Soit un total de 138 personnes utilisatrices, dont 113 à titre permanent.
Avec une surface utile nette (SUN) déclarée de 1 362 m2 (20), le ratio d’occupation s’établit à 11,6 m2 par poste de travail, et le loyer du m² occupé (TTC charges comprises) à 690 euros.
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DE LA CAMPAGNE
POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
DE LA VIE POLITIQUE
1. Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle
La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle a été instituée par l’article 10 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, pris pour l’application de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Son fondement est aujourd’hui l’article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001. Elle est chargée du contrôle du déroulement de la campagne présidentielle, et notamment du respect des dispositions prévues par le IV de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, aux termes duquel : « Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle ».
Dans son étude réalisée en 2001, le Conseil d’État a estimé que, en raison de ses caractéristiques et notamment de sa composition, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle devait être considérée comme une autorité administrative indépendante.
La Commission assure le respect des dispositions en vigueur en matière d’affichage et d’envoi des « professions de foi » – notamment l’uniformité de leur présentation sur l’ensemble du territoire de la République – ainsi que, pour la première fois en 2007, d’enregistrement sonore (articles 17 à 20 du décret du 8 mars 2001).
Elle veille à ce que les candidats bénéficient, pour la campagne électorale, des mêmes facilités de la part de l’État, ce qui lui confère un pouvoir général d’intervention pour assurer entre eux le respect du principe d’égalité. À ce titre, elle est attentive aux conditions dans lesquelles se déroulent les réunions publiques, la campagne par voie de presse et la campagne audiovisuelle ; elle s’assure de l’absence de toute diffusion de résultats partiels ou d’estimations de résultats avant la clôture du scrutin.
La Commission ne dispose pas de pouvoirs de sanction mais elle exerce une magistrature morale. Son autorité n’est au demeurant pas mise en cause.
Toutefois, la Commission a relevé que, en 2007, l’une de ses décisions a été contestée tant devant le Conseil d’État que devant le Conseil constitutionnel. Deux de ses communiqués en date des 26 mars et 18 avril 2007 ont également fait l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État. Elle en a tiré la conclusion suivante : « La commission estime qu’il serait opportun que, pour des raisons évidentes de lisibilité de la norme de droit, les textes consacrent explicitement le pouvoir d’homologation de l’affiche, de la profession de foi et de l’enregistrement sonore qu’ils lui reconnaissent dans l’exercice de ses prérogatives particulières. Les textes devraient également déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir en mentionnant les motifs pour lesquels l’homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ils devraient enfin organiser la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l’homologation » (21).
Dans le cadre de la dernière campagne électorale la commission s’est réunie à treize reprises entre le 23 février et le 6 mai 2007. Elle a été en relation avec les autres institutions appelées à intervenir dans la campagne : le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la commission des sondages et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle a rendu compte de son action dans un rapport qui a été publié au Journal officiel le 10 octobre 2007 : elle y formule des propositions qui touchent à tous les aspects de la réglementation, format des affiches, apposition sur les panneaux, déclarations, campagne électorale, diffusion des résultats, etc.
La Commission est présidée par le vice-président du Conseil d’État. En sont également membres le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes. Deux autres membres sont désignés par les trois membres de droit.
Cette composition est destinée a garantir son impartialité et, en conséquence, sa crédibilité à l’égard des candidats eux-mêmes et de tous ceux qui interviennent dans le débat public.
La Commission est assistée de quatre hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des finances et de la culture et de la communication. Interviennent auprès d’elle sept rapporteurs délégués pour l’outre-mer et neuf rapporteurs près la commission, choisis parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
La Commission ne possède pas de budget propre et l’évaluation des dépenses – ainsi que la notion d’indicateur de performance – est, il est vrai, en ce qui la concerne, en grande partie sans objet. Elle fonctionne avec les moyens qui lui sont fournis par le Conseil d’État et par le ministère de l’Intérieur, qui prend en charge ses dépenses. Il s’agit, au demeurant, d’un organisme intermittent, institué à l’occasion de chaque élection présidentielle.
2. Commission pour la transparence financière de la vie politique
La Commission pour la transparence financière de la vie politique a été instituée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (22). Elle remplit une mission d’information sur le non-respect, par les membres du Gouvernement ou certains élus, de leurs obligations de déclaration de situation de leur patrimoine.
Dans son étude réalisée en 2001, le Conseil d’État a estimé, « après hésitation », que la Commission pour la transparence financière de la vie politique devait être qualifiée d’autorité administrative indépendante : « Bien qu’elle ne détienne pas de pouvoir de décision, elle doit être qualifiée d’autorité administrative indépendante en raison de son pouvoir de révéler des manquements à des obligations visant à renforcer un contrôle démocratique sur le comportement de la classe politique et qui est à l’origine de la procédure pouvant déboucher sur une déclaration d’inéligibilité des auteurs de ces manquements ».
C’est en vue d’assurer une plus grande transparence financière de la vie politique et de la vie publique que le législateur a institué, à travers la loi du 11 mars 1988, un mécanisme permettant d’apprécier l’évolution de la situation patrimoniale de certains élus et dirigeants d’organismes publics. La commission apprécie les variations éventuelles afin d’identifier, le cas échéant, des situations d’enrichissement anormal au regard des fonctions exercées.
Ainsi, chaque assujetti doit déposer une déclaration de situation patrimoniale au début et à la fin de son mandat ou de ses fonctions. Le non respect de l’obligation déclarative est sanctionné par l’inéligibilité d’un an pour les élus et par la nullité de la nomination pour les dirigeants.
La commission informe les autorités chargées de l’application des sanctions prévues par la loi en cas de non respect des obligations déclaratives. Dans le cas où elle a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet.
La commission effectue le contrôle de variations des patrimoines de 1500 assujettis par an. Le nombre total des assujettis est supérieur à 6.000 (23). Elle publie, lorsqu’elle le souhaite et au moins tous les trois ans, un rapport au Journal Officiel : son dernier rapport – le quatorzième – a été publié au J.O. le 1er décembre 2009.
La commission est présidée par le vice-président du Conseil d’État. Le Premier Président de la Cour de cassation et le Premier Président de la Cour des comptes en sont également membres de droit. Six autres membres titulaires et six suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois.
Le budget est fixé par le président de la Commission. Il est constitué, pour l’essentiel, des vacations des membres et rapporteurs, les agents et les locaux étant mis à disposition par le Conseil d’État.
BUDGET DE LA COMMISSION
POUR LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Dépenses courantes |
7 622 |
7 772 |
5 000 |
11 400 |
4 000 |
Vacations (1) |
64 942 |
6 4942 |
64 942 |
87 252 |
107 252 |
Frais de transport |
2 150 |
1 921 |
1 000 |
2 265 |
1 860 |
Personnel |
Sans objet (2) |
Sans objet (2) |
345 600 |
352 800 |
306 000 |
Informatique |
4 410 |
4 500 |
4 590 |
4 680 |
4 764 |
Loyer des locaux (3) |
72 000 |
74 400 |
78 000 |
80 400 |
84 000 |
(1) Le nombre de vacations des membres et rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est proportionnel au nombre de séance à laquelle ils assistent effectivement.
(2) Agents mis à disposition par le ministère des Finances et par le ministère de l’Intérieur au Conseil d’État jusqu’au 31 décembre 2006, puis pris en charge par le Conseil d’État à compter de cette date.
(3) Loyer théorique : les locaux sont mis à disposition par le Conseil d’État.
Source : Commission pour la transparence financière de la vie politique
Sur le plan des effectifs la Commission est assistée par neuf rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ; par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ; par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales de comptes.
La Commission bénéficie en outre, pour l’accomplissement de ses tâches, de cinq fonctionnaires détachés à temps plein : deux agents de catégorie A, un de catégorie B et deux de catégorie C.
DÉPENSES DE PERSONNEL
(HORS VACATIONS)
(en euros)
2009 |
Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie C |
Rémunération brute |
70 800 |
22 800 |
38 400 |
Indemnités |
36 000 |
14 400 |
24 000 |
Charges sociales |
13 200 |
4 800 |
9 600 |
Charges patronales |
36 000 |
12 000 |
24 000 |
TOTAL |
156 000 |
54 000 |
96 000 |
Source : Commission pour la transparence financière de la vie politique
Les douze membres, le Secrétaire général, les neuf rapporteurs et les cinq fonctionnaires perçoivent des vacations dont le montant est fixé par des textes réglementaires(24).
VACATIONS 2009
(en euros)
Membres |
Rapporteurs |
Fonctionnaires |
TOTAL |
20 000 |
58 968 |
28 284 |
107 252 |
Source : Commission pour la transparence financière de la vie politique
Les dépenses de personnel s’élèvent au total à 413 252 euros.
Les dépenses de fonctionnement – 98 396 euros – sont prises en charge par le Conseil d’État. Celui-ci héberge le secrétariat de la commission au 151 bis rue Saint-Honoré dans des locaux d’une superficie de 120 m2 (les réunions de la commission se tenant dans une salle annexe du Conseil d’État), soit 20 m2 par agent. Le prix du m² occupé s’élève à 700 euros, charges incluses.
La Commission appelle de ses vœux, depuis plusieurs années, une réforme des textes qui régissent le dépôt et le contrôle des déclarations. Ses propositions ont été réitérées, et même renforcées, dans son 14e rapport publié au Journal Officiel le 1er décembre 2009. Le vice-président du Conseil d’État s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du journal Le Monde du 29 décembre 2009.
– Élargir le champ des informations mises à la disposition de la Commission au revenu des assujettis
La Commission a proposé, dès son quatrième rapport publié au Journal officiel le 21 janvier 1993, d’instaurer l’obligation de lui transmettre les déclarations faites au titre de l’impôt sur le revenu. La même proposition a été faite en ce qui concerne la déclaration remplie au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès le huitième rapport, publié au Journal officiel du 25 mars 1999.
En l’état actuel, elle ne contrôle en effet les évolutions du patrimoine des déclarants que sur la seule base des déclarations qui lui sont transmises. Elle peut certes demander aux assujettis de compléter ou de préciser leur déclaration, lorsque celle-ci suscite des interrogations.
Le refus par les intéressés de communiquer ces déclarations à la Commission serait pénalement sanctionné. La Commission disposerait auprès de l’administration fiscale d’un droit de communication des mêmes déclarations.
La Commission estime également que, dans les situations douteuses, elle devrait pouvoir étendre ses investigations au patrimoine des proches de l’assujetti. Elle souhaite ainsi pouvoir demander communication de la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l’administration légale des biens.
– Sanctionner les déclarations mensongères
La Commission fait valoir qu’une sanction spécifique devrait pouvoir être prononcée à l’encontre des personnes ayant adressé des déclarations mensongères pour retracer l’état de leur patrimoine.
En effet, selon elle, les sanctions prévues par la loi du 11 mars 1988 en cas d’absence de déclaration – l’inéligibilité pour une durée d’un an ou la nullité de la nomination – ou en cas d’évolution inexpliquée du patrimoine – transmission du dossier au parquet – ne permettent pas d’apporter des réponses adaptées à de tels agissements.
Ces sanctions seraient d’autant plus insuffisantes que l’altération de la vérité, quelle qu’en soit l’importance, commise à l’occasion d’une déclaration de patrimoine déposée auprès de la Commission, n’est pas susceptible de constituer le support matériel d’un faux, tel qu’il est défini à l’article 441-1 du code pénal.
En conséquence, pour la quatrième fois depuis le onzième rapport qu’elle a publié au Journal officiel le 18 juillet 2002, la Commission a proposé, en 2009, que le dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale mensongère, ainsi que le fait de lui communiquer sciemment des informations erronées ou relatant des faits matériellement inexacts, soient punis de deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code.
– Restreindre le champ des dirigeants d’organismes publics assujettis à la déclaration de patrimoine
Depuis son huitième rapport publié au Journal officiel du 25 mars 1999 la Commission propose de restreindre le champ des personnes soumises à l’obligation de déclaration en ce qui concerne les dirigeants d’organismes et d’entreprises publics, afin de concentrer son contrôle sur un nombre raisonnable de dirigeants d’entreprises.
Elle fait en effet valoir qu’il est difficile, en raison de leur nombre et surtout de l’existence de multiples filiales, d’identifier l’ensemble des organismes dont les dirigeants sont assujettis à l’obligation de déclaration, puis d’obtenir que ces dirigeants y satisfassent.
En outre, le contrôle des déclarations de patrimoine d’organismes relevant du secteur concurrentiel n’apparaît pas nécessairement pertinent.
L’instauration d’un seuil, exprimé en montant de chiffre d’affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial ne seraient plus soumis à l’obligation de déclarer leur patrimoine permettrait, selon la Commission, de réduire significativement le nombre des organismes et de leurs dirigeants entrant dans son champ de compétence. Un seuil de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires entraînerait ainsi une baisse de 65 % du nombre de dirigeants soumis à l’obligation de déclaration.
*
* *
L’essentiel des réformes ainsi demandées au nom de la Commission pour la transparence financière de la vie politique a été repris dans une proposition de loi, n° 2188, déposée, le 21 décembre 2009, par MM. René Dosière, Jean-Jacques Urvoas, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés (25).
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été créée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des financements des activités politiques. Elle a été installée le 19 juin de la même année.
La CNCCFP a été qualifiée d’emblée d’« autorité administrative » par le Conseil constitutionnel (décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990). Son statut d’autorité administrative indépendante, reconnu par le Conseil d’État dans son rapport public pour 2001, a été consacré par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale. Elle n’est pas dotée de la personnalité morale.
À la fin des années 1980, à la suite de nombreuses «affaires» ayant suscité le trouble dans l’opinion publique, le Gouvernement et le législateur ont souhaité mettre en place un dispositif permettant de limiter et de rendre plus transparent le financement de la vie politique en France tout en introduisant, en contrepartie, un financement public destiné à la fois aux principaux partis politiques et aux candidats aux différentes élections.
À partir de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les candidats aux élections législatives ont donc été tenus de déposer en préfecture un compte de campagne, ceux des élus étant transmis au bureau de l’Assemblé nationale.
En 1990 il a été décidé que les contraintes nouvelles imposées aux partis et aux candidats devaient faire l’objet d’un contrôle par une structure indépendante du pouvoir politique et ne risquant pas la confusion avec celui des institutions publiques : la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission compte neuf membres nommés pour cinq ans par décret du Premier ministre, sur propositions du Vice-président du Conseil d’État, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres actuels ont pour la plupart été nommés par décret du 19 avril 2005 :
– membres du Conseil d’État : MM. François Bernard, Jacques Négrier et Herbert Maisl (26) ;
– membres de la Cour de cassation : M. Bernard Chemin, Mme Martine Betch (27) et M. Roger Gaunet ;
– Membres de la Cour des comptes : MM. François Logerot, Roland Morin et Jean-Pierre Guillard.
Le président est élu par ses pairs lors du renouvellement général de la commission. L’actuel président (M. François Logerot, Premier président honoraire de la Cour des comptes) a été élu le 9 mai 2005. Il exerce, en pratique, un quasi temps plein durant la période de contrôle des comptes, et une tâche à 2/3 de temps en dehors. Sa rémunération brute est fixée, par un arrêté du 30 janvier 2007, à 3 430 euros par mois.
Conformément au décret du 18 mars 1997, M. Logerot a nommé M. Roland Morin vice-président. Celui-ci perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 716 euros.
Les autres membres de la commission perçoivent une rémunération fondée sur le nombre des séances auxquelles ils assistent, à raison de 100 euros par présence effective (entre une demi-journée par semaine et trois demi-journées lors des périodes de pointe) (28). Par ailleurs, les membres, à l’exception du président, exercent des fonctions de rapporteur général des comptes (vérification de l’instruction et proposition des décisions) et perçoivent, à ce titre, une indemnité forfaitaire. Les membres ont ainsi perçu, pour l’ensemble de leurs travaux (y compris les indemnités de séance), 13 027 euros en 2009, en moyenne. Le vice-président a perçu en sa qualité de rapporteur général 9 405 euros.
L’autorité ne dispose pas d’un commissaire du Gouvernement. Aucune incompatibilité ne s’applique aux membres du collège.
La commission assure deux missions principales :
– d’une part, contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections au suffrage universel direct ;
– d’autre part, vérifier que les partis politiques respectent la réglementation applicable à leur financement et assurer la publication de leurs comptes.
Au titre de la première mission la commission contrôle les comptes de campagne pour l’élection présidentielle (29), les élections au Parlement européen et les élections législatives, régionales, cantonales et municipales dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants, provinciales et territoriales (Outre-mer), qu’il s’agisse de scrutins généraux ou partiels.
À l’issue de l’instruction des comptes, la commission délibère et prend des décisions collégiales. Elle peut :
– approuver le compte de campagne ;
– l’approuver après réformation, notamment lorsque des dépenses engagées par le candidat ne présentent pas de caractère électoral ;
– le rejeter en cas de manquement à une formalité substantielle édictée par la loi (absence de mandataire ou d’expert-comptable, don de personne morale, compte en déficit, dépassement de plafond...) ou de paiements directs significatifs.
La commission peut également constater le dépôt hors délai du compte voire l’absence de dépôt.
Pour toutes les élections, la commission assure la publication au Journal officiel des comptes de campagne dans une forme simplifiée, mentionnant le montant des réformations éventuelles dont ils ont fait l’objet, et le sens de la décision.
Le rejet, l’absence de dépôt ou le dépôt hors délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne (dans le cas où il aurait pu y prétendre). Ils entraînent, en outre, hormis le cas de l’élection présidentielle, la saisine automatique du juge de l’élection (Conseil constitutionnel, Conseil d’État ou tribunal administratif), lequel peut éventuellement prononcer l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an, ainsi que sa démission d’office s’il a été élu.
Les décisions de réformation peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en formulant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État (après que le juge de l’élection ait statué s’il a été saisi par la commission, lors d’un contentieux initial).
S’agissant de l’élection présidentielle, les décisions de la commission peuvent faire l’objet, par le candidat concerné, d’un recours de plein contentieux devant le Conseil constitutionnel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, mais la sanction de l’inéligibilité en cas de rejet du compte ne s’applique pas.
Au titre de sa seconde mission, la commission est placée au centre du dispositif encadrant le financement de ceux qui sont habilités à apporter leurs concours à une campagne électorale ou un autre parti. À ce titre, la commission :
– vérifie le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières et communique chaque année au Gouvernement la liste de ceux qui ne s’y sont pas conformés, ces derniers ne pouvant alors ni percevoir l’aide publique pour l’année suivante lorsqu’ils y étaient éligibles, ni participer au financement d’une campagne électorale ;
– assure la publication sommaire des comptes des partis au Journal officiel ;
– donne ou retire l’agrément aux associations de financement des partis ;
– gère les formules de reçus-dons (plusieurs centaines de milliers chaque année) et vérifie, lors de l’examen des souches, l’absence d’irrégularité au regard de la loi de 1988 ;
– assure le contrôle du respect de leurs obligations spécifiques par les mandataires financiers (personne physique ou association de financement) et, éventuellement, les sanctionne, en refusant de leur délivrer des formules de reçus-dons ;
– saisit le procureur de la République si un fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté.
À l’action correspondant au fonctionnement de la commission, au sein du programme (232) « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « administration générale et territoriale de l’État », sont associés un objectif et un indicateur. Cet indicateur est le délai séparant la date limite de remise des comptes des partis et groupements politiques (30 juin de chaque année) et la date de transmission des documents à la direction des Journaux officiels pour publication.
Ce délai, qui durant longtemps a oscillé entre dix et douze mois, est inférieur à six mois depuis trois ans.
Plus généralement, parmi les indicateurs d’activité pertinents, la CNCCFP retient le nombre de partis politiques qui sont susceptibles d’entrer dans le champ de la loi de 1988. Ce nombre s’est constamment accru entre 1991 et 2008 (de 28 à 296) tandis que les contrôles, notamment sur les obligations des mandataires, se sont développés et affinés. Cependant, l’activité du service est aussi corrélée au nombre des différents actes de la vie de ces partis (créations, changements de responsables, dissolutions, changements d’intitulés, etc.).
La CNCCFP se fonde également sur le nombre de scrutins nationaux par an et le nombre de candidats tenus de déposer un compte de campagne. À titre d’illustration elle précise ainsi le nombre et le volume des comptes qu’elle contrôle :
– en 2007, 7 634 candidats aux élections législatives étaient tenus de déposer un compte de campagne ; lors des élections municipales et cantonales de mars 2008, 9 910 candidats au total avaient l’obligation de déposer un compte et sur ce total, 1 632 candidats (16,5 %) concouraient à une élection faisant l’objet d’une protestation électorale initiale (ce qui a pour effet de réduire de six à deux mois le délai dont la commission dispose pour statuer) ;
– en termes de volume les comptes vont de quelques pièces justificatives (pour la plupart des comptes des candidats à une élection cantonale) à plusieurs dizaines de cartons (pour les candidats du deuxième tour à l’élection présidentielle de 2007).
Il doit être précisé que, pour ce qui concerne l’ensemble de son champ de compétence, chaque année, ou au moins dans les douze mois qui suivent un scrutin national, la commission édite un rapport d’activité, disponible sur son site internet, dans lequel elle expose le bilan de son action et les observations qu’elle juge utile de formuler.
Le budget de la CNCCFP, qui oscille entre 4,5 et 5 millions d’euros, est inscrit, dans la mission « administration générale et territoriale de l’État », sur le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » qui relève du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Ce programme 232 comprend cinq actions dont l’action 3 « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Celle-ci n’a pas mis en œuvre de contrôle au cours des cinq dernières années.
BUDGET DE LA CNCCFP 2005-2009
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Crédits votés |
2 902 579 |
AE: 3 195 798 CP:3 021 990 |
AE : 4 992 774 CP : 4 992 774 |
AE: 4 338 319 CP: 4 338 319 |
AE : 4 719 567 CP : 4 784 642 |
Crédits disponibles |
3 024 557 |
AE : 3 033 856 CP : 2 871 663 |
AE : 4 542 774 CP : 4 542 774 |
AE: 4 949 319 CP: 4 949 319 |
AE : 4 619 567 CP : 4 684 642 |
Crédits consommés |
2 700 950 |
AE : 2 854 271 CP : 2 758 805 |
AE : 4 070 264 CP : 4 036 640 |
AE: 4 855 920 CP : 4 940 423 |
AE : 4 493 800 CP : 4 473 903 |
Crédits non consommés |
323 607 |
AE : 179 585 CP : 112 858 |
AE : 472 510 CP : 506 134 |
AE : 93 399 CP : 8 896 |
AE : 125 275 CP : 210 247 |
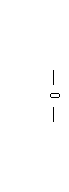
Source : CNCCFP.
DÉCOMPOSITION DU BUDGET DE LA CNCCFP 2005-2009
(en euros)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP | ||
Budget total |
3 024 557 |
3 033 856 |
2 871 663 |
4 542 774 |
4 542 774 |
4 949 319 |
4 949 319 |
4 619 567 |
4 684 642 |
Dépenses de personnel |
1 571 814 |
1 680 329 |
1 680 329 |
2 113 772 |
2 113 772 |
3 144 000 |
3 144 000 |
2 761 273 |
2 760 781 |
Autres dépenses de fonct. dont loyers dont charges locatives |
1 129 136 647 649 110 641 |
1 173 942 675 960 112 034 |
1 078 477 675 960 112 034 |
1 956 492 1 006 539 167 578 |
1 922 867 1 006 539 167 578 |
1 711 920 1 085 436 164 238 |
1 796 423 1 085 436 164 238 |
1 733 019 1 143 532 175 914 |
1 713 122 1 143 532 175 914 |
Source : CNCCFP.
La CNCCFP dispose de 33 collaborateurs à titre permanent, dont 13 titulaires en position de détachement, 13 CDD et 7 CDI de droit public. Au cours de la période récente cet effectif a connu une légère progression puis s’est stabilisé : 31 en 2005, 32 en 2006, 33 depuis 2007.
Le plafond d’emploi fixé à la CNCCFP est déterminé de façon à lui permettre, en plus de ses effectifs permanents, de recruter des vacataires (généralement sur des CDD de un à dix mois) lorsqu’elle connaît des pics d’activité liés aux échéances électorales. Après deux années 2005 et 2006 sans scrutin national cette procédure a été utilisée à hauteur de 7,7 équivalents temps plein en 2007 (élections présidentielles et législatives), 8 en 2008 (élections cantonales et municipales), 4,6 en 2009 (élections européennes). Cette particularité explique l’évolution des dépenses de personnel.
DÉPENSES DE PERSONNEL
(en euros)
Années |
Rémunérations d’activité |
Cotisations et Contributions sociales |
Prestations sociales et allocations diverses |
Total |
2005 |
1 332 482,0 |
229 594,0 |
9 738,0 |
1 571 814,0 |
2006 |
1 328 866,6 |
313 979,4 |
10 028,6 |
1 652 874,6 |
2007 |
1 525 120,4 |
391 647,4 |
12 908,1 |
1 929 675,9 |
2008 |
1 567 731,9 |
615 083,5 |
43 334,5 |
2 226 149,9 |
2009 |
1 533 190,8 |
637 454,7 |
51 605,7 |
2 222 185,3 |
Source : CNCCFP.
La commission est installée dans des locaux pris à bail depuis le 1er avril 1992 (bail ministère de la Justice conclu avec BNP Paribas REAL), au 33 avenue de Wagram dans le XVIIe arrondissement de Paris. L’extension de la compétence de la commission au contrôle des comptes des candidats à l’élection présidentielle a conduit à louer un local supplémentaire à l’étage immédiatement inférieur de l’implantation principale.
Le loyer s’élève à un peu plus de 1,3 million d’euros (TTC charges comprises).
La surface totale utile pondérée est de 1 402,25 m2 au 3e étage (bail renouvelé le 16 septembre 2004) et de 626,50 m2 au 2e étage (bail conclu le 1er mars 2007). Les surfaces de bureaux occupées sont de 731 m2 au 3e étage et de 422 m2 au 2e étage, le reste des surfaces correspondant aux espaces de circulation, aux sanitaires, réserves et locaux techniques.
S’agissant des surfaces de bureaux occupées par les membres et les agents, la CNCCFP considère qu’il convient de distinguer les périodes hors contrôle des comptes de scrutins généraux et les périodes de contrôle proprement dit.
Hors période de contrôle, les bureaux sont occupés par les neuf membres de la commission, les 33 collaborateurs permanents du secrétariat général et quatre rapporteurs en moyenne qui travaillent sur les comptes des élections partielles et, au troisième trimestre, sur ceux des partis politiques. La surface moyenne par agent est alors de 731 m2 : 46 = 15,89 m2.
En période de contrôle, l’occupation doit répondre à des pics d’utilisation des locaux. Ainsi, les locaux ont accueilli jusqu’à 105 personnes en même temps en 2007 (soit un ratio de 1 153 m2 : 105 = 10,98 m2 par personne), 99 en 2008 (11,64 m2 par personne), 76 en 2009 (15,17 m2 par occupant).
Une pondération grossière de l’utilisation des surfaces de bureau aboutirait à un ratio de 14,24 m2 par occupant.
LOCAUX DE LA CNCCFP (DONNÉES 2009)
(en euros)
Étage |
Surface utile pondérée (m2) |
Loyer annuel net |
Prix du m2 net |
Charges annuelles |
Prix du m2/ |
3e étage |
1 402,3 |
780 973,5 |
556,9 |
121 176,8 |
86,4 |
2e étage |
626,5 |
362 558,4 |
578,7 |
54 737,1 |
87,4 |
Total |
2 028,8 |
1 143 531,9 |
563,7 |
175 913,9 |
86,7 |
Source : CNCCFP.
Les principales manifestations de communication concernent une à deux conférences de presse par an (notamment à l’occasion de la publication du rapport d’activité), des travaux de mise en forme (éventuellement de traduction) et impression de documents (notices candidats, rapports d’activités, plaquettes de présentation, etc.) et quelques dépenses de relations publiques (réceptions de délégations étrangères, etc.).
Le parc automobile est composé d’un seul véhicule depuis 2002. Le véhicule actuel, dont l’utilisation est polyvalente (voiture de service/voiture de fonction pour le président), est une Citroën C5 acquise en avril 2005.
L’Autorité de la concurrence a été créée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (articles 95 à 97), complétée par l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence et par les décrets pris pour leur application respective.
L’Autorité de la concurrence a succédé, avec des compétences élargies, des règles de fonctionnement modernisées et des moyens étoffés, au Conseil de la concurrence créé par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Le Conseil de la concurrence avait lui-même succédé à la Commission de la concurrence créée par la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et abus de position dominante. La Commission de la concurrence créée en 1977 jouait un rôle essentiellement consultatif, le pouvoir de poursuivre et de sanctionner les auteurs de pratiques anticoncurrentielles étant du ressort du ministre chargé de l’économie.
La réforme de 1986, effectuée à l’initiative du ministre de l’Économie de l’époque, M. Édouard Balladur, sur proposition d’un comité des sages présidé par M. Jean Donnedieu de Vabres, avait pour objectif principal de mettre fin au système d’économie administrée instauré à l’époque de la libération et de la reconstruction, en revenant au principe de libre fixation des prix par les acteurs économiques eux-mêmes. Toutefois, un consensus s’est fait pour considérer que ce retour à la liberté économique devait être équilibré par la mise en place d’une régulation publique, destinée à prévenir et à sanctionner les abus de marché. Un accord s’est dégagé pour considérer, pour des raisons différentes, que les pouvoirs d’examen et de décision exercés par le ministre chargé de l’économie devaient être transférés à une autorité administrative indépendante.
Pour sa part, la réforme de 2008 a été motivée par la volonté de moderniser en profondeur le système français de régulation de la concurrence, notamment pour rendre l’autorité de régulation plus forte et plus efficace, en s’inspirant des meilleures pratiques mises en place ailleurs en Europe. La solution retenue a été double. Elle a consisté, en premier lieu, à parachever l’évolution entamée en 1986, en transférant à l’autorité indépendante les dernières attributions conservées par le ministre chargé de l’économie en matière de régulation concurrentielle des marchés : pouvoir d’examiner les projets de fusion au cas par cas, pouvoir d’enquêter sur le terrain, etc. En second lieu, un ensemble d’attributions et d’outils nouveaux ont été créés pour permettre à l’Autorité de la concurrence d’intervenir autrement qu’au cas par cas (études de marché, avis d’initiative) et de jouer le rôle de force de proposition auprès du Parlement et du Gouvernement (avis et recommandations sur des questions générales de concurrence ou sur des projets de textes).
— Principales caractéristiques :
L’Autorité n’est pas dotée de la personnalité morale.
Les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence sont essentiellement de trois ordres.
L’Autorité constitue le guichet unique en charge du contrôle des concentrations économiques, dès lors que ces opérations remplissent certains seuils de chiffres d’affaires, et à l’exception des cas dans lesquels le droit communautaire des concentrations est applicable, auquel cas la Commission européenne est compétente pour les traiter.
Au titre du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité est compétente pour appliquer non seulement le droit français de la concurrence, mais aussi le droit communautaire en la matière. Elle a le pouvoir de réaliser toute enquête sur le terrain et de se saisir d’office de toute affaire de pratique anticoncurrentielle. Elle peut aussi recevoir des plaintes émanant d’entreprises, d’associations professionnelles ou de consommateurs, de collectivités territoriales ou des services du ministère de l’Économie. Au terme de l’instruction de ces affaires, elle peut prononcer un non-lieu, accepter des engagements mettant fin à ses préoccupations de concurrence ou encore constater l’existence d’une infraction, imposer des injonctions (remèdes dits « comportementaux » ou « structurels ») et infliger des amendes.
Enfin, dans l’exercice de sa compétence consultative, l’Autorité peut, d’elle-même ou à la demande d’une commission parlementaire, du Gouvernement ou de certaines personnes privées, émettre des avis et faire des recommandations sur certains projets de textes ou sur des questions générales de concurrence.
L’Autorité est également habilitée à établir chaque année un rapport annuel, qu’elle transmet au Parlement et dont son président peut être appelé à discuter avec les commissions parlementaires compétentes en matière de concurrence.
Le président de l’Autorité est nommé par décret du Président de la République pris après avis des commissions parlementaires compétentes en matière de concurrence. Il est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ses fonctions sont soumises au droit commun des incompatibilités prévues pour les emplois publics. Le mandat du président est un mandat à temps plein. Rémunération : indice nouveau majoré de 1501 ; indemnité de fonctions, montant annuel brut : 100 500 euros.
Le collège de l’Autorité comprend 16 membres en sus du président. Quatre de ces membres ont rang de vice-présidents. Ils sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé. Ils exercent leurs fonctions à titre permanent. Ils sont soumis au même régime d’incompatibilités que le président. Les douze autres membres sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé. Ils exercent leurs fonctions à titre non permanent et ne sont donc pas soumis au même régime d’incompatibilités que les membres permanents.
Environ la moitié des effectifs de catégories A/A+ est constituée de fonctionnaires et l’autre moitié de contractuels. La plus grande partie des effectifs de catégories B et C est constituée de fonctionnaires.
L’Autorité dispose d’un commissaire du Gouvernement. En pratique, cette fonction est exercée par un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’Économie. Le commissaire du Gouvernement a pour mission d’exposer la position du Gouvernement dans chaque affaire de pratique anticoncurrentielle ou de concentration donnant lieu à une instruction approfondie sur le fond.
Si le nombre des plaintes est resté relativement stable sur la période 2004-2009 (70 par an), celui des demandes d’avis est passé de 30 à 66. L’Autorité est obligée de traiter tous les dossiers qu’elle reçoit, ce qui se traduit en moyenne par un nombre de décisions 5 à 10 fois plus élevé que tous ses homologues européens. Elle demande donc la possibilité de pouvoir se concentrer sur les dossiers les plus importants pour l’intérêt du public et des consommateurs ; et cela d’autant que, conformément à l’esprit de la LME, l’Autorité est appelée à faire monter en puissance sa politique d’auto-saisine, en ouvrant d’office des cas contentieux, en réalisant des études de marché ou en prenant l’initiative de rendre des avis sur des questions générales de concurrence. Une bonne partie de ces avis portent sur la mise en oeuvre de la LME (délais de paiement) ainsi que sur des questions économiques structurantes posées à l’Autorité par les pouvoirs publics (crise de la filière laitière, difficultés économiques des départements d’outre-mer, accords d’exclusivité dans le secteur des médias, etc.). Le nombre de demandes de mesures conservatoires reste stable sur la période 2004-2009 (environ 18).
Sur le fond, l’Autorité estime qu’elle continue à faire un usage équilibré de la palette d’outils disponibles pour garantir ou rétablir la concurrence : politique de sanction et d’injonction et procédures négociées (« engagements »). Elle rappelle qu’elle a pris devant le Parlement l’engagement de maintenir une politique vigoureuse de sanction.
Sur la période 204-2009 le nombre de décisions de sanction a baissé de 26 à 13 et le nombre de décision a augmenté de 0 à 9. Le nombre d’entreprises sanctionnées est passé sur la période de 137 à 56. Le montant des sanctions est très variable d’une année sur l’autre, en fonction des procédures (de 50 à 754 millions d’euros). L’Autorité de la concurrence note que la décision de déconcentration des procédures de mise en recouvrement des sanctions, prise en 2007, a fait chuter dramatiquement le taux de recouvrement (de 88 % en 2006 à 18 % en 2009).
Enfin, le contrôle des concentrations, activité transférée à l’Autorité en mars 2009, témoigne d’un démarrage « sur les chapeaux de roue » malgré la crise, qui a pesé sur les projets des entreprises et donc sur le nombre de notifications :
- 104 projets de concentration notifiés, dont 78 ayant d’ores et déjà donné lieu à une décision finale et 26 en cours d’examen ;
- 6 décisions de non-contrôlabilité, 69 décisions d’autorisation sans conditions, 3 décisions d’autorisation sous réserve d’engagements, aucune décision d’interdiction.
L’Autorité siège au comité consultatif chargé de donner un avis sur l’ensemble des projets de décision préparés par la Commission européenne en matière de contrôle communautaire des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles. Elle participe activement au Réseau européen de la concurrence (« REC »), mis en place par les règlements communautaires, qui réunit l’ensemble des 27 autorités nationales de concurrence (« ANC ») autour de la Commission européenne et qui peut être consulté sur des projets de textes ou sur des questions relative à la mise en oeuvre du droit communautaire de la concurrence. À ce titre, elle peut, en premier lieu, notifier des cas individuels de pratiques anticoncurrentielles à la Commission européenne et aux ANC, dès lors que ces cas sont susceptibles d’entrainer la mise en oeuvre du droit communautaire et de permettre l’application des mécanismes de coopération (échanges d’informations, enquêtes conjointes, etc.) prévus par les règlements. En outre l’Autorité rend régulièrement des avis sur les projets de réformes des textes communautaires relatifs à la concurrence.
— Affaires récentes traitées par l’Autorité (30) :
- Rachat de TMC et NT1 par TF1
- Sanction du « Cartel de l’acier »
- Sanction de 11 banques pour commissions interbancaires non justifiées
- Tarifs des banques
- Exclusivités dans la télévision à péage
- Obligation imposée par Apple de subventionner l’I-Phone plus que les autres smartphones
- Relations entre les producteurs et les industriels du lait
- Gestion des gares par la SNCF
- Conflit entre la Deutsche Bahn et la SNCF sur les prix « prédateurs »
- Monopole de la SNCF sur les trains régionaux
- Contrats d’assurance liés à un prêt immobilier
- Concurrence de la grande distribution dans les collectivités d’outre-mer
- Conflit entre Canal+ et Orange
- Prix unique du livre numérique
- Entente des opérateurs de téléphonie mobile
- Entente des entreprises de travail temporaire
- Position dominante de Google sur le marché de la publicité en ligne
— Indicateurs et performance :
En 2009, l’Autorité de la concurrence constitue un BOP unique et une seule action (Mise en oeuvre du droit de la concurrence) du programme Développement des entreprises et de l’emploi. Les indicateurs associés aux trois AAI membres de ce programme (ARCEP, CRE et Autorité de la concurrence) mesurent la qualité et la rapidité des travaux conduisant à leurs avis et décisions (délai moyen de réponse aux demandes d’avis et délai de traitement des différends et plaintes).
Un autre indicateur est constitué par le ratio affaires en stock/affaires traitées dans l'année ; il mesure l'encombrement de l'institution, qui donne un délai théorique d'écoulement du stock ou délai théorique d'attente pour les nouveaux dossiers. Cet indicateur oscille entre 15 et 22 sur la période 2004-2008 ; pour 2009, les prévisions sont de 18 mois et la cible 2011 est de 15 mois. Aucun indicateur ne mesure la nouvelle mission de contrôle des concentrations, mais comme cette activité est soumise à des délais légaux à la fois très courts et impératifs (25 jours ouvrés en phase 1 et 65 jours ouvrés en phase 2), l’Autorité estime qu’il n’est pas nécessaire d’en construire un.
L’Autorité n’a pas conclu de contrat de performance.
Les ressources de l’Autorité de la concurrence sont exclusivement budgétaires. Elles sont passées de 11,4 millions d’euros en 2006 à 20,4 millions d’euros prévus en 2010. En 2009, les dépenses de personnel (12,6 millions d’euros) représentent 69 % des dépenses globales (18,2 millions).
Le plafond des effectifs autorisés pour l’Autorité est passé de 119 ETPT en 2006 à 187 ETPT en 2010. Les effectifs consommés sont passés de 112 ETPT en 2006 à 159 ETPT en 2009.
Une forte augmentation de la subvention budgétaire et des effectifs est intervenue en 2009, année où la loi a transformé le conseil de la concurrence en autorité, avec un accroissement de ses compétences.
S’agissant de l’immobilier, jusqu’en 2008, le Conseil était installé sur deux sites :
– le siège historique du Conseil et désormais de l’Autorité est l’immeuble situé au 11, rue de l’Echelle. Il s’agit d’un immeuble d’une superficie de 2 541 m2 loué à un propriétaire privé. En 2009, son loyer annuel s’est élevé à 967 772 euros TTC (pas de TVA, aucune charge) (380 euros TTC/m2). La seule variation de l’indice ICC a entraîné une augmentation de 5,5 % du loyer au 1er janvier 2008 et une augmentation de 8,8 % au 1er janvier 2009 ;
– depuis l’été 2006, le Conseil et désormais l’Autorité occupe aussi un immeuble domanial de 1 460 m2 situé au 6, avenue de l’Opéra, soit en face de l’immeuble du 11, rue de l’Echelle. Le loyer budgétaire a été fixé à 600 000 euros.
Depuis janvier 2009, l’Autorité occupe en outre un troisième immeuble de 1 220 m2 situé un peu plus loin du siège, au 3, place de Valois, pour un loyer annuel de 530 372 euros TTC (soumis à TVA) (435 euros TTC/m2). Ce troisième site loge les 60 agents supplémentaires transférés à l’Autorité parallèlement au transfert de compétences.
En 2009, les dépenses immobilières s’élèvent donc à 2 millions d’euros (hors taxes hors charges). Ces dépenses représentent donc 11 % du budget global.
IMMOBILIER DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
(en euros)
Postes de travail (fin 2009) |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN / poste |
Loyer hors taxes hors charges |
Notes | |
Autorité |
188 * |
5 231 |
5 099 |
27,1 |
2 011 230 ** |
3 sites cumulés |
* 175 agents de l’Autorité + 10 stagiaires + 3 prestataires de service extérieurs présents sur site
** Ce montant comprend le loyer budgétaire pour le 3e site (Opéra)
En 2009, les dépenses de communication (300 000 euros) représentent 1,6 % des dépenses globales et 5,4 % des dépenses de fonctionnement. Les principaux postes de dépenses sont les suivants : rapport annuel ; site Internet ; colloques « RDV de l’Autorité » ; édition de la revue « Entrée libre » ; édition d’un manuel à usage interne reprenant l’ensemble des textes de références de l’Autorité ; organisations d’évènements divers (voeux internes, externes, etc.).
En 2009, les dépenses de transport et de déplacement s’élèvent à 174 000 euros, soit moins de 1 % du budget global, et se décomposent comme suit : achats de billets de trains et d’avions : 100 000 euros ; indemnités frais de missions : 45 000 euros ; taxis : 14 000 euros ; entretien des véhicules : 15 000 euros. L’Autorité dispose de 4 véhicules : Peugeot 607 (voiture du président) ; Ford Mondéo ; Peugeot 406 ; Renault Clio. Ces trois derniers véhicules sont utilisés pour les enquêtes sur le terrain et, accessoirement, pour les transports des dossiers à la cour d’appel de Paris.
COMMISSION DES PARTICIPATIONS ET DES TRANSFERTS (CPT)
La Commission des participations et des transferts (CPT) a été créée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, sous le nom de « Commission de la privatisation ». Son rôle a été étendu par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation et, accessoirement, par l’article 31 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. Son nom actuel lui a été donné par le décret n° 98-315 du 27 avril 1998.
La Commission a pour mission de déterminer la valeur des entreprises ou participations qui font l’objet d’un transfert au secteur privé (31).
Dans son étude réalisée en 2001, le Conseil d’État a considéré que, eu égard aux « règles très strictes d’incompatibilités imposées par la loi aux membres du collège », la Commission des participations et des transferts devait être qualifiée d’autorité administrative indépendante.
La CPT n’est pas dotée de la personnalité morale.
La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, nommés par décret pour cinq ans « en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique » (32).
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Par ailleurs, les membres de la Commission ne peuvent, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.
Les membres de la CPT sont astreints au secret professionnel.
Le président perçoit une indemnité mensuelle de 6 150 euros nets (en plus de son traitement de la fonction publique). Les membres du collège perçoivent une indemnité mensuelle de 4 600 euros nets. Leur emploi est à temps partiel.
L’autorité ne dispose pas d’un commissaire du Gouvernement.
La Commission émet des avis et rend des décisions qui revêtent un caractère contraignant à l’égard du ministre en charge des privatisations.
S’agissant des participations détenues majoritairement et directement par l’État :
– la Commission « évalue la valeur » des entreprises à transférer (minoritairement ou majoritairement) au secteur privé, ce transfert ne pouvant se faire à un prix inférieur à la valeur qu’elle fixe ;
– l’avis conforme de la Commission est requis pour toute cession effectuée hors marché financier, cet avis portant sur l’ensemble de l’opération, y compris la sélection des acquéreurs.
S’agissant des participations indirectes (cessions de filiales par des entreprises publiques), l’avis conforme de la Commission est requis pour l’intervention du décret d’approbation lorsque la filiale cédée a un chiffre d’affaires consolidé de plus de 375 millions d’euros ou un effectif de plus de 2 500 salariés.
Enfin, la Commission examine, avec le pouvoir de s’y opposer, toute offre d’actions réservée aux salariés ou toute distribution d’options (« stock-options ») initiées par une entreprise publique.
Les avis de la Commission sont, dans les cas prévus par la loi, publiés au Journal officiel en même temps que l’acte (décret ou arrêté) sur lequel ils portent.
D’un point de vue pratique, quand elle est saisie par le ministre chargé de l’économie d’un projet de transfert, la Commission procède à des auditions et examine les rapports d’évaluation établis par les banques conseil de l’État et de l’entreprise. Sur ces bases, elle évalue la valeur de l’entreprise.
En termes d’activité – celle-ci dépendant des décisions de transfert prises par l’État ou les entreprises publiques – la Commission fournit, pour les dix dernières années, les éléments suivants : 600 séances, 140 avis, 20 décisions. Les opérations examinées ont représenté un montant d’environ 125 milliards d’euros (dont 60 milliards de recettes directes pour l’État).
Interrogée sur l’évolution des ressources publiques mobilisées pour son fonctionnement, la Commission a fait la réponse suivante :
« La Commission ne dispose pas de ressources ni de moyens propres.
Les dépenses administratives courantes (documentation, informatique, frais de missions et de représentation, documentation) font l’objet d’une dotation de fonctionnement annuelle inscrite au programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » du ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi. Elles sont ordonnancées sur décision du président de la Commission par la Direction des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel (DPAEP). Le montant de cette dotation a été a cours des cinq dernières années :
- en 2005 de 35 623 euros,
- en 2006 de 35 077 euros,
- en 2007 de 29 503 euros,
- en 2008 de 34 463 euros,
- en 2009 de 33 081 euros.
Cette dotation ne comprend :
- ni les indemnités versées au président et aux membres de la Commission,
- ni les frais de personnel directement pris en charge par les institutions publiques mettant à disposition,
- ni les loyers ni les frais des travaux des conseils directement pris en charge par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi ».
Les effectifs, inchangés au cours des cinq dernières années, sont les suivants :
– le secrétaire général (catégorie A), mis à disposition par la Banque de France ;
– trois secrétaires administratives (catégorie C), mises à disposition par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi.
Pour le reste, interrogée sur le montant et l’évolution annuelle de ses dépenses de personnel, la Commission indique que ces données ne sont pas disponibles car lesdites dépenses sont prises en charge directement par les institutions mettant à disposition les agents concernés.
Ne seraient pas davantage disponibles, car prises en charges directement par le ministère, le montant des dépenses de fonctionnement, de communication et les dépenses immobilières.
S’agissant des dépenses de transport, il est indiqué que le président de la Commission dispose d’une voiture et d’un chauffeur dépendant des services communs des ministères de Bercy.
*
* *
En guise d’observation finale, la Commission fait le commentaire suivant :
« Comme la lecture des réponses qui précèdent le fait comprendre, la Commission travaille avec des moyens permanents minimaux, l’essentiel de son activité reposant sur l’étude des dossiers et la participation à ses réunions, qui incombent directement et personnellement à ses membres. Ceux-ci ont pris lors de leur nomination l’engagement de participer à ses travaux, souvent avec un très court préavis, compte tenu de la spécificité des opérations visées, le plus souvent entourées de la plus grande confidentialité. La Commission s’appuie sur les prestations de conseils extérieurs, grandes banques d’affaires françaises et étrangères et cabinets d’avocats, dont le coût est pris en charge par ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, ainsi que sur celles des experts indépendants nommés le cas échéant per les entreprises publiques concernées ».
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ (CGLPL)
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, à la suite de la signature par la France du Protocole facultatif des Nations unies se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants(33). Ce Protocole – dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2008-739 du 28 juillet 2008 et le décret n° 2008-1322 du 15 décembre 2008 – impose en effet aux pays signataires de se doter d’un « mécanisme national de prévention », dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté à l’instigation d’une autorité publique, pour protéger ces personnes, garantir l’accès à leurs droits fondamentaux et éviter que ne se manifestent à leur encontre des comportements et des situations attentatoires à leur dignité.
Le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 a défini les modalités de recrutement des contrôleurs placés sous l’autorité du Contrôleur général, les dispositions administratives, financières et comptables applicables et les dispositions relatives à l’exercice du contrôle des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur est expressément qualifié d’« autorité indépendante » par l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007.
Le Contrôleur général est nommé, « en raison de ses compétences et connaissances professionnelles », par décret du Président de la République après avis de la commission des Lois de chacune des deux assemblées. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Ses fonctions sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
M. Jean-Marie Delarue, Conseiller d’État, a été nommé par décret du Président de la République du 13 juin 2008 (JO du 14 juin 2008) pour un mandat de six ans. Il exerce ce mandat à temps plein. Dans sa réponse au questionnaire il précise que « sa rémunération est fixée par lettre ministérielle, le décret du 12 mars 2008 devant être modifié afin que soit déterminé le niveau d’emploi ».
Le Contrôleur général est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission. Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés. Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général.
Le Contrôleur général – et, sur délégation, les contrôleurs placés sous son autorité – peut visiter, à tout moment et sur l’ensemble du territoire, les établissements dans lesquels se trouvent des personnes privées de liberté : établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue, locaux de rétention administrative(34), centres éducatifs fermés ou établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement(35), etc. Il peut solliciter tout document utile à l’exercice de sa mission et s’entretenir de façon confidentielle avec les personnes qu’il juge utile d’entendre.
Après avoir recueilli les observations des ministères de tutelle à l’égard du rapport de visite d’un établissement donné, le Contrôleur leur adresse des recommandations, de portée générale, qu’il peut choisir de rendre publiques. Il peut, lorsqu’il le juge utile, effectuer une nouvelle visite dans un même établissement pour constater si les engagements pris ont été suivis d’effet.
En 2008, après son installation effective en septembre, le Contrôleur a visité 52 lieux de privation de liberté. En 2009, le Contrôleur a effectué 160 visites, l’objectif fixé dans le cadre de la loi de finances initiale étant de 150 (voir infra).
Le second volet de l’activité du Contrôleur général concerne le traitement des saisines.
Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peut porter à la connaissance du Contrôleur général des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
Du 1er janvier au 14 décembre 2009, le Contrôleur a eu à connaître de la situation de 691 personnes ou groupes de personnes privées de liberté. En année pleine cette activité correspond à 1 220 dossiers de saisine environ. Ces saisines ont donné lieu à 272 enquêtes.
Le Contrôleur peut, enfin, émettre des avis sur une thématique donnée (36) et formuler toute proposition de modification législative ou réglementaire au Gouvernement.
L’indicateur retenu dans le cadre de la LOLF pour mesurer son activité est le nombre annuel de visites effectuées (objectif du projet annuel de performance du programme 308 en 2009 : 150 visites). En outre, l’activité du Contrôleur est suivie à l’aide des trois indicateurs suivants : la durée des visites, qui tend à s’allonger ; l’évolution du nombre de saisines ; le délai de réponse aux courriers.
Le budget du Contrôleur est inscrit au programme 308 « droits et libertés », qui dépend des services du Premier ministre. Il s’élève à un peu plus de trois millions d’euros. En 2009, première année pleine d’activité, seulement 2,2 millions d’euros avaient été consommés au 1er décembre(37).
ÉVOLUTION DES CRÉDITS VOTÉS, DISPONIBLES ET CONSOMMÉS
(en euros)
2008 |
2009 |
2010 | ||||||||
Crédits LFI |
Régu-lation budgé- |
Crédits dispo- |
Consom- |
Crédits LFI |
Régu-lation budgé- |
Crédits dispo- |
Consom-mation |
Crédits LFI |
Crédits | |
crédits de |
2 050 000 |
2 050 000 |
582 188 |
2 550 000 |
- 1 903 |
2 548 097 |
1 776 929 |
2 716 929 |
2 716 929 | |
% p/r total |
82,2 % |
80,2 % |
81,1 % | |||||||
autres titres |
||||||||||
AE autre que titre II |
450 000 |
- 4 772 |
445 228 |
306 146 |
632 294 |
- 4 341 |
627 953 |
493 771 |
633 962 |
633 962 |
CP |
450 000 |
- 4 772 |
445 228 |
40 406 |
632 294 |
- 4 341 |
627 953 |
391 847 |
633 962 |
633 962 |
TOTAL AE CP |
2 495 228 |
888 334 622 594 |
3 176 050 |
2 270 700 2 168 777 |
3 350 891 |
Les dépenses de personnel représentent près de 80 % de ce budget.
Dix-huit agents ont en effet été recrutés, dont douze contrôleurs à temps plein et quatre personnes composant les services de l’organisme (ressources humaines, finances, documentation et presse, secrétariat). Des intervenants à temps partiel ont également été recrutés en qualité de contrôleurs (soit, au total, une vingtaine de contrôleurs en équivalent temps plein).
La répartition des effectifs, selon leur statut, depuis la création de l’autorité, est présentée dans le tableau présenté ci-après.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
2008 |
2009 |
2010 (prév.) | |
Plafond d’emploi LFI Effectifs physiques |
18 17 |
18 18 |
20 |
Titulaires Détachés entrants Détachés sortants Mise à disposition CDD de droit public Autres |
1 13 3 |
1 14 3 |
Non précisés |
Répartition par catégorie en fonction des emplois exercés A B C |
15 2 |
16 2 |
18 2 |
Les dépenses de communication représentent environ 1 % du budget (plaquettes, rapports annuels, supports à en tête, site internet), les frais de déplacement 5 % (ils ont permis d’effectuer 158 visites dont deux outre mer ; il existe un seul véhicule (en location de longue durée), les dépenses de locaux un peu plus de 9 %(38).
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
(en euros)
2008 |
2009 |
||||
crédits LFI |
consommation |
crédits LFI |
consommation au 10.12.09 |
% | |
crédits de personnel |
2 050 000 |
582 188 |
2 550 000 |
1 776 930 |
78,3 % |
autres titres |
|||||
AE autre que titre II |
450 000 |
306 146 |
632 294 |
493 771 |
21,7 % |
loyer |
0 |
211 675 |
9,3 % | ||
frais de déplacement |
40 504 |
110 155 |
4,9 % | ||
communication |
0 |
24 871 |
1,1 % | ||
investissement |
220 508 |
11 849 |
0,5 % | ||
*
* *
En guise d’observation finale, le Contrôleur général fait le commentaire suivant :
« Le Contrôleur général considère que le Parlement est son interlocuteur privilégié pour rendre compte de son action. Dans cet esprit, il a été régulièrement auditionné par la commission des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale tant à l’occasion de la remise de son rapport annuel que lors de l’examen de projets de loi concernant la détention, la rétention, la garde à vue ou l’hospitalisation sans consentement ».
Le Défenseur des enfants est une autorité de l'État, indépendante, créée par la loi du 6 mars 2000. Elle est chargée de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, tel que la convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990.
L'instauration d'un Défenseur des enfants en France est intervenue à la suite d'un rapport d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale (Rapport Fabius-Bret, « Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir ») dont les conclusions, adoptées à l'unanimité par l'Assemblée, faisaient apparaître que malgré l'existence de nombreuses lois destinées à protéger les enfants et d'un Médiateur de la République, la convention sur les droits de l'enfant n'était pas suffisamment appliquée en France.
Ce texte a été complété et enrichi par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance qui a notamment élargi le nombre de personnes et instances habilitées à saisir le Défenseur des enfants. Jusqu'alors, celui-ci pouvait être saisi directement par tout mineur, par ses parents ou ses représentants légaux et par des associations défendant les droits de l'enfant reconnues d'utilité publique. Désormais, il peut également être saisi par tout membre de la famille du mineur ainsi que par les services médicaux ou sociaux. De même, les parlementaires peuvent aussi le saisir. Enfin, le Défenseur des enfants peut s'autosaisir de situations qui lui paraissent mettre en cause l'intérêt d'un enfant.
— Principales caractéristiques :
Pour atteindre ces objectifs, la loi a fixé au Défenseur des enfants plusieurs missions :
– recevoir des saisines directement et traiter les réclamations individuelles ou s’autosaisir ;
– identifier les dysfonctionnements collectifs ou ceux qui font obstacle à l'application des droits de l'enfant et proposer des modifications de textes législatifs, réglementaires ou de pratiques professionnelles et suggérer toute modification de texte législatif ou réglementaire visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant par intégration des engagements internationaux dans le droit interne ;
– assurer la promotion des droits de l'enfant et organiser des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif. Remettre chaque année un rapport annuel au Président de la République et au Parlement dans lequel est produit notamment le bilan des activités du Défenseur des enfants. Ce rapport est publié. Le Défenseur des enfants dispose d’une équipe de 55 correspondants territoriaux « bénévoles indemnisés ». Il a développé une stratégie d’actions fondées sur des partenariats novateurs (Éducation nationale, service civil volontaire, fondation d’entreprise, le dessinateur Albert Uderzo…).
Le Défenseur des enfants n'est pas doté de la personnalité morale.
La Défenseure des enfants est nommée par décret du Président de la République. La Défenseure actuelle, Mme Dominique Versini a été nommée par décret du Président Jacques Chirac du 29 juin 2006. La durée de son mandat est de 6 ans non renouvelable. Elle exerce son mandat à temps plein.
La Défenseure, pendant la durée de son mandat, ne peut être candidate à un mandat de conseiller municipal, général ou régional si elle n’exerçait pas ce même mandat avant sa nomination. Mme Versini a démissionné de son mandat de conseillère régionale d’ile de France en septembre 2006.
Le niveau de rémunération de la Défenseure a été fixé par décret au groupe hors échelle F (indice 1369). L’indemnité de fonction de la Défenseure a fait l’objet d’un arrêté interministériel ; le montant annuel brut de cette indemnité de fonction est fixé à 43 950 euros (soit 3 662 euros/mois). En 2009, Mme Versini a perçu un traitement net mensuel de 6 307,33 euros (8 576,61 euros brut). Le coût employeur mensuel est de 15 103,91 euros (181 010 euros annuel).
La Défenseure des enfants dispose d’un véhicule de fonction acheté par l’institution en remplacement du premier alloué gracieusement. Il est en réalité utilisé par l’institution comme un véhicule de service. Il sert essentiellement au conducteur/vaguemestre/logisticien qui, hors certains déplacements de la Défenseure, livre les courriers, assure certaines livraisons, transporte les documents et matériels à l’occasion des participations à différentes manifestations…
La loi n’a pas placé de commissaire du Gouvernement auprès de cette autorité administrative indépendante.
Le Défenseur des enfants instruit toutes les réclamations qui lui sont transmises. Dans la pratique, le Défenseur des enfants intervient selon trois modes à la suite d’une réclamation :
– la médiation interinstitutionnelle,
– le signalement à différentes autorités de situations inquiétantes ou de dysfonctionnements institutionnels graves (conseils généraux, Éducation nationale, Justice, CNDS, Médiateur de la République, Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, CNIL, HALDE, …),
– la réorientation.
RÉCLAMATIONS
Année |
Saisines |
Instruction |
Réorientation (en %) | |
nouvelles |
en cours | |||
2008 |
1 400 |
358 |
58 |
38 |
2007 |
1 350 |
760 |
56 |
44 |
2006 |
1 200 |
800 |
57 |
43 |
Source : rapports d’activité annuels du Défenseur des enfants.
Le Défenseur des enfants exerce une mission de médiation assortie de trois catégories de pouvoirs :
- Un pouvoir de recommandation :
Le Défenseur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur auteur de la réclamation ou concerné par elle. Pour instruire les réclamations dont il est saisi, le Défenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé, non investies d'une mission de service public, communication de toute pièce ou dossier qui lui paraît utile et nécessaire à la compréhension du problème soulevé, sans que le caractère secret des pièces réclamées puisse lui être opposé.
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il peut rendre publiques ses recommandations. Lorsqu'une réclamation présentant un caractère sérieux met en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public, le Défenseur des enfants la transmet au Médiateur de la République. Dans la pratique cette transmission a eu lieu 44 fois en 9 ans et 37 fois à destination d’autres AAI (HALDE, CNDS, CNIL, CGLPL …). Le caractère sérieux de la réclamation peut être invoqué sur la base de la Convention internationale des droits de l’enfant dont tous les articles ne sont pas d’application directe en France.
- Un pouvoir de proposition de réformes :
Ce pouvoir de proposition de réforme intervient lorsqu’il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables ou lorsqu'il identifie et met en évidence des dysfonctionnements collectifs qui se produisent au détriment des enfants ou qui font obstacle à l'application des droits de l'enfant.
- Un pouvoir d'injonction :
En cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, le Défenseur des enfants peut enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal Officiel.
En ce qui concerne les relations avec l’autorité judiciaire, le Défenseur des enfants doit porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. De même, le Défenseur des enfants doit informer le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
Le Défenseur des enfants ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause. Il n'est pas habilité à demander aux autorités judiciaires, ni même aux services agissant sur mandat de justice (ASE, PJJ, secteur associatif habilité...), communication de pièces ou dossiers lorsqu'il est saisi d'une réclamation intéressant une procédure judiciaire en cours.
Dans la pratique le Défenseur des enfants estime que même si il ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte ou de sanction, ses recommandations n'en sont pas moins suivies d'effets dans de nombreuses situations de blocage avec les administrations ou institutions ou avec les parents eux-mêmes, à l’exception des saisines faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou de décisions de justice.
— Indicateurs et performance :
L'Institution du Défenseur des enfants est rattachée depuis 2004 au programme Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales qui relève de la Mission Solidarité et Intégration. Aucun indicateur destiné à mesurer l'activité du Défenseur des enfants n'a été expressément prévu dans les documents budgétaires transmis au Parlement. La Défenseure des enfants a néanmoins mis en place des indicateurs interne dans la gestion de son Budget opérationnel de programme (BOP).
- nombre de réclamations reçues et traitées (indicateur d’activité) : ainsi, partant de 700 réclamations individuelles reçues en 2001, année de démarrage, les statistiques ont enregistré 1 532 nouvelles réclamations en 2009 (soit une progression d'un peu plus de 10 % par an en moyenne) et 2 157 dossiers traités ;
- taux des effectifs occupés au traitement des réclamations (indicateur d’efficience). Ce taux a baissé de 56 % en 2004 à 45 % en 2008 : il a permis de déployer les effectifs vers les activités de promotion des droits de l’enfant ;
- coût de gestion moyen d’un dossier (indicateur d’efficience) : il a été ramené de 342 euros en 2004 à 276 euros en 2009 ;
- notoriété : elle est mesurée par un indicateur qui recense le nombre de citations de la Défenseure des enfants dans la presse écrite et radiotélévisée. Ainsi, de 830 relevés constatés en 2005, on a atteint 1 800 relevés (interviews, articles et citations) en 2009.
Le Défenseur des enfants n’a pas conclu de contrat de performance.
Les crédits en LFI sont passés de 1,4 million d’euros en 2001 à 1,9 million en 2005 et 2,6 millions d’euros en 2009. En incluant les autres ressources (reports, dotation d’action parlementaire, fonds de concours et abondements en gestion), les ressources ont atteint 2,7 millions d’euros en 2009 (augmentation de 43 % entre 2005 et 2009). Deux fortes augmentations sont intervenues en 2004 (conclusion du bail immobilier) et en 2007 (arrivée de l’actuelle Défenseure des enfants, augmentation des salaires des agents et investissement informatique). Le recrutement de nouveaux collaborateurs, souvent de qualification supérieure aux précédents, et la revalorisation des salaires constituent la principale raison de la progression de plus de 26 % des charges de personnel au cours de la période 2005-2009.
Les gels et annulations de crédits s’élèvent entre 1 et 3 % des crédits selon les années. Le Défenseur des enfants n’a pas de fonds de roulement. Les dispositions relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Défenseur des enfants.
En 2001, la Défenseure a obtenu une subvention exceptionnelle de 45 700 euros allouée par l’Assemblée nationale au titre de la « réserve parlementaire » afin de financer l’acquisition d’un système de gestion et d’archivage électronique des dossiers de réclamations (GARGANTUA). La dotation d’action parlementaire qui figure à l’exercice 2006 concernait l’exercice 2005 à hauteur de 45 000 euros pour financer des achats de matériels (photocopieurs et informatique) qui n’a pu être perçue qu’en 2006 car les crédits avaient été virés sur un programme qui n’était pas celui de la Défenseure.
En 2009, la dotation initiale a été augmentée de même par des dotations d’action parlementaire du Sénat et de l’Assemblée nationale à hauteur de 70 000 euros. Le Président du Sénat a, en effet, attribué à la Défenseure des enfants, 40 000 euros afin d’organiser l’assemblée générale du réseau européen des défenseurs des enfants ENOC (European network of Ombudspersons for children).
L’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la commission des Finances, a également majoré la dotation de l’institution de 30 000 euros sur sa réserve, de manière à permettre le financement du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le Défenseur des enfants dispose d’un effectif de 30 personnes en 2009 (15 en 2000 et 24 en 2005) : 8 fonctionnaires – dont 7 mis à disposition à titre gracieux – et 22 contractuels. Depuis la création de l’institution, on note une moyenne de 2 départs par an (sur un total de 30) pour l’ensemble des personnels quel que soit leur statut.
La Défenseur des enfants a fait le choix, en février 2004, de louer trois étages dans un immeuble de bureaux appartenant aux Assurances Générales de France - AGF (maintenant Allianz Real Estate). Ces locaux, situés 104 boulevard Blanqui, Paris 13e, précédemment occupés par la CNAF, constitués de 723 m2 ont été livrés après rénovation à la charge des AGF et les travaux d’agencement ont été également pris en charge par le propriétaire. Il est à noter que le bail initial qui expirait fin janvier 2010 vient d’être renouvelé pour 3 ans.
Le loyer a connu une forte augmentation entre 2004 et 2009. Aussi, la Défenseur des enfants a-t-elle renégocié les conditions locatives à la faveur du renouvellement du bail. Elle a obtenu une diminution du loyer de 10,4 % en 2009 et le plafonnement des hausses annuelles à venir à 4 % avec répercussion en 2009 et 2010 de la baisse probable de l’indice du coût de la construction. La renégociation du loyer en 2009 permet d’atténuer la progression des charges locatives (+ 21 % au lieu de + 25 % initialement). Ces dernières représentent cependant 48 % des charges de fonctionnement en moyenne durant ces 5 années et 1/7e des dépenses totales.
Les charges locatives sont fixées à un tarif intéressant de 27 euros/m2, alors que France Domaine souligne que ce coût est couramment de 40 à 50 euros le m2 dans des immeubles comparables. Par ailleurs, le propriétaire s’est engagé dans le contrat à procéder à l’audit des installations de chauffage/climatisation et de plomberie et à prendre à sa charge les travaux consécutifs à l’audit.
La Défenseur des enfants indique un ratio d’occupation de 17 m2 (« surface de bureau ») par agent. Ce taux n’est pas normalisé selon les préconisations du service France domaine, qui repose sur une surface utile nette (SUN) incluant les salles de réunion et qui a défini un objectif de 12 m2/agent, salles de réunion incluses, pour l’ensemble des administrations de l’État
Les frais de déplacement sont passés de 7 223 euros en 2005 à 51 043 euros en 2009. Ceux de formations de participation à la restauration collective représentent 4 627 euros en 2009. Les stages rémunérés et les charges d’intérim (remplacement pendant les congés) représentent 16 524 euros en 2009.
Le Défenseur des enfants conçoit plusieurs outils de communication (dépliants, affiches, site Internet, publication du rapport, manifestations…) dont le coût s’élève à 177 080 euros en 2009 (41 357 euros en 2005) représentant 19 % des charges de fonctionnement, ce qui apparaît élevé.
— La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ses suites :
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué le Défenseur des droits, afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose l'intervention d'une loi organique.
Constitution :
« Titre XI bis - Le Défenseur des droits
« Art. 71-1. - [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Projets de loi organique (n° 610) et de loi ordinaire (n° 611) relatifs au Défenseur des droits déposé le 9 septembre 2009 au Sénat :
Le projet de loi organique précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits.
Ses attributions incluront celles aujourd'hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour que son action puisse bénéficier de toutes les compétences utiles, il sera assisté de deux collèges composés chacun de trois personnalités qualifiées, pour l'examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l'enfance. Leurs membres sont désignés par les Présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les membres de chaque collège sont nommés pour la durée du mandat du Défenseur des droits. Leur mandat n’est pas renouvelable. L'articulation avec les autres autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés est également renforcée : le Défenseur des droits sera, en particulier, associé aux travaux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le Défenseur des droits pourra être saisi directement par toute personne s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration. En matière de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité, il pourra également connaître des agissements de personnes privées. La saisine du Défenseur sera gratuite. Le Défenseur des droits disposera de pouvoirs importants, qui lui permettront notamment de prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, de proposer une transaction, d'être entendu par toute juridiction ou encore de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis pour couper court aux difficultés qui proviendraient d'interprétations divergentes des textes. Il bénéficiera de larges pouvoirs d'investigation. Le Défenseur des droits peut faire toute proposition au Gouvernement de modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines relevant de sa compétence.
Le projet de loi ordinaire complète le texte organique en prévoyant notamment les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits.
TABLEAU COMPARATIF
DES POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS
ET DES AUTORITÉS DE DÉFENSE DES DROITS ET LIBERTÉS QU'IL REMPLACE
Pouvoirs et attributions |
Défenseur des droits |
Médiateur de la République |
CNDS |
Défenseur des enfants | |
Recommandation |
En droit |
oui |
oui |
oui |
oui |
En équité |
oui |
oui |
oui | ||
Publication d'un rapport spécial après injonction non suivie d'effet |
oui, pour l'ensemble de ses recom-mandations |
uniquement en cas d'inexécution d'une décision de justice |
uniquement en cas d'inexé-cution d'une décision de justice | ||
Transaction |
oui |
||||
Audition par toute juridiction |
oui |
||||
Saisine de l'autorité disciplinaire |
oui |
en cas de carence, engagement des poursuites disciplinaires |
information de l'autorité disciplinaire |
||
Demande d'avis au Conseil d'État |
oui |
||||
Proposition de modifications législatives ou réglementaires |
oui |
oui |
oui |
oui | |
Rapport annuel d'activité |
oui |
oui |
oui |
oui | |
Source : étude d’impact des projets de loi organique et ordinaire créant le Défenseur des droits.
Le Médiateur de la République a été institué par la loi du 3 janvier 1973, qui a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par :
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (auto-saisine en matière de réformes, consécration législative du rôle des délégués du Médiateur de la République, présentation du rapport annuel devant le Parlement) ;
- la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (reconnaissance de l’existence de « services » placés auprès du Médiateur de la République. Jusque là, il ne disposait que de « collaborateurs » et, de fait, outre quelques contractuels, des agents mis à disposition gratuitement).
Inspiré du modèle de l’Ombudsman suédois, développé en Europe au milieu du XXe siècle, le Médiateur de la République n’a remplacé aucune institution semblable en France, et les particularités de sa mission le font échapper à la séparation tripartite des pouvoirs.
Considérée comme un mode alternatif de règlement des conflits, la médiation institutionnelle a été développée afin de désengorger les juridictions administratives. Le Médiateur a donc été crée pour améliorer les relations entre l’administration, ou plus généralement, le service public et ses usagers. Il traite les réclamations individuelles dont il est saisi afin de trouver un règlement amiable aux différends opposant un service public à un usager. Il a pour fonction non de censurer les actes de l’administration mais de résoudre des difficultés qui échappent à un contrôle juridictionnel, ou qui blessent l’équité ou le bon sens. Il peut proposer des réformes de textes législatifs ou réglementaires lorsque des dysfonctionnements récurrents sont constatés.
Le Médiateur dispose d’un réseau de délégués qui couvre l’ensemble du territoire français. Ces délégués assurent aujourd’hui des permanences dans les établissements pénitentiaires. Dans chaque département, un délégué a été désigné pour être le correspondant d’une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). L’implantation territoriale du Médiateur a été renforcée avec un nombre stable de délégués depuis 2008, puisque 276 délégués bénévoles accueillent le public quotidiennement dans 398 points d’accueil différents. Les délégués sont présents dans toutes les zones urbaines sensibles (ZUS) et assurent également des permanences dans les maisons de justice et du droit (MJD), les mairies, les préfectures et sous-préfectures et, depuis 2005, dans les prisons. Le Médiateur dispose en outre de onze délégués thématiques qui apportent leur expertise dans des domaines particuliers et sur des questions souvent complexes.
Enfin, le Médiateur s’est peu à peu engagé dans la promotion internationale des droits de l’homme. Il est d’ailleurs, depuis 1993, membre de droit de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), avec laquelle il participe à un projet expérimental visant à veiller à l’exécution effective des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’action du Médiateur de la République, reconnu comme « structure nationale des droits de l’Homme » (SNDH) par le Conseil de l’Europe, est complémentaire de celle de la CNCDH.
Le Médiateur de la République s’attache également à renforcer ses relations avec le monde associatif et notamment les ONG œuvrant pour la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques. Il est, en outre, le secrétaire général de l’Association des ombudsmans et des médiateurs de la Francophonie (AOMF) et de l’Association des ombudsmans de la Méditerranée (AOM).
— Principales caractéristiques :
Le Médiateur ne dispose pas de la personnalité morale.
Le Médiateur intervient en cas de dysfonctionnement administratif ou d’iniquité et formule, pour y remédier, des recommandations aux organismes mis en cause. Au-delà des cas individuels, le Médiateur formule, auprès du Gouvernement et des parlementaires, des propositions de réformes. Le Médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions.
Lorsqu’il estime que la responsabilité d’un agent devrait être mise en cause, le Médiateur peut substituer partiellement son action à celle de l’autorité disciplinaire compétente en cas d’inaction de celle-ci et engager une procédure disciplinaire ou saisir d’une plainte la juridiction répressive. Ce pouvoir se limite toutefois à l’engagement des poursuites et le Médiateur ne peut en aucun cas intervenir sur l’issue de cette procédure. Notons toutefois que ce pouvoir n’a, jusque là, jamais été mis en œuvre.
Le Médiateur dispose d’un pouvoir d’injonction en cas d’inexécution d’une décision de justice devenue définitive et concernant les administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. En cas d’injonction non suivie d’effet, le Médiateur de la République peut établir un rapport spécial, présenté au Président de la République et au Parlement, et publié au Journal officiel.
Le Médiateur de la République dispose d’un pouvoir d’inspection et peut ainsi convoquer tout agent public et solliciter les corps de contrôle pour procéder à des vérifications ou à des enquêtes. Il peut également demander au Conseil d’État et à la Cour des comptes de faire procéder à des études. D’une façon générale, pour l’accomplissement de sa mission, le Médiateur de la République peut demander communication de tout document utile pour l’instruction d’une réclamation.
Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement son rapport annuel d’activité. Ce rapport est rendu public et fait l’objet d’une communication devant chacune des deux assemblées. Plutôt que de contraindre, le Médiateur estime qu’il doit user de son autorité morale en empruntant la voie du dialogue et de la persuasion et n’hésite pas à interpeller l’opinion publique par l’intermédiaire de la presse ou de ses rapports publics. En ce sens, le Médiateur de la République exerce une magistrature d’influence.
Nouvelles propositions de réforme que le Médiateur suivra en 2010 - Amélioration des droits des victimes de dommages corporels ; - Amélioration de la protection des enfants (prise en compte des procédures dites « Kafala » (39), octroi des allocations familiales aux parents d’enfants étrangers, la réforme de la procédure d’agrément en vue d’adopter, réforme de la fiscalité des successions et donations concernant les adoptés simples) ; - Amélioration de la protection des incapables majeurs. |
LES PROPOSITIONS DE RÉFORME SATISFAITES EN 2009
Objet |
Date de clôture |
Condition d’inactivité pour percevoir l’AAH (allocation aux adultes handicapés) |
07/01/2009 |
Remboursement anticipé des créances de carry back |
23/01/2009 |
Instauration d’un recours juridictionnel pour les prises de position formelles de l’administration fiscale |
23/01/2009 |
Reconnaissance en France des unions civiles étrangères |
04/06/2009 Satisfaction partielle |
Assurance maladie coordination RSI et régime général Sécurité sociale |
16/06/2009 |
Insaisissabilité de la majoration de pension au titre de l’assistance tierce personne |
25/06/2009 |
Automaticité de l’application du solde bancaire insaisissable (SBI) |
25/06/2009 |
Possibilité de conclure un PACS en Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna |
27/07/2009 |
Procédures disciplinaires applicables aux médecins du service public |
19/08/2009 |
Exonération de la redevance audiovisuelle des téléviseurs loués par les détenus |
19/08/2009 |
Reclassement en catégorie A de fonctionnaires de l’État de catégorie B |
18/09/2009 Satisfaction partielle |
Extension du bénéfice du capital décès au partenaire lié à un fonctionnaire par un pacte civil de solidarité |
07/12/2009 |
LES PROPOSITIONS DE RÉFORME AYANT ABOUTI AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2010
Objet |
Date de clôture |
Création d’un dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français |
05/01/2010 |
Reconnaissance en France des unions civiles étrangères |
13/01/2010 Entrée en application définitive |
LES PROPOSITIONS DE RÉFORME NON SATISFAITES EN 2009
Objet |
Date de clôture |
Accès aux derniers indices pour les professeurs de collège |
04/06/2009 |
Validation des périodes d’invalidité au titre de la retraite proportionnelle des non salariés agricoles |
25/06/2009 |
Pension des commandants de sapeurs-pompiers professionnels |
28/07/2009 |
Application automatique de la technique du quotient pour les revenus différés |
07/12/2009 |
Départ anticipé à la retraite de certains fonctionnaires handicapés |
07/12/2009 |
Intégration d’anciens élèves du cycle international de l’ENA |
07/12/2009 |
Le Médiateur est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas d’empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Son mandat n’est pas renouvelable.
Incompatibilités : pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général ou municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les indemnités de fonction allouées au Médiateur sont réglementées par l’arrêté du 23 décembre 2004 qui en fixe le montant (139 842 euros brut par an).
Le Médiateur de la République ne dispose pas d’un commissaire du Gouvernement.
Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur. Toute réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur ; ceux-ci la transmettent au Médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.
Enfin, sans pouvoir intervenir dans une procédure juridictionnelle ni remettre en cause une décision de justice, le Médiateur peut faire des recommandations à l’organisme public mis en cause.
Le dernier rapport annuel du Médiateur, portant sur l’année 2009, indique que l’institution a reçu 76 286 affaires, décomposées en 43 481 réclamations et 32 805 demandes d’information et d’orientation. Le taux de réussite des médiations s’élève à 93 % au niveau des services centraux du Médiateur et à 82 % pour ses délégués.
— Indicateurs et performance :
En 2006, dans le cadre du projet annuel de performance de la mission Direction de l’action du Gouvernement, dont le responsable est le secrétaire général du Gouvernement (SGG), le Médiateur a fixé comme objectif général de Favoriser l’accessibilité de tous au droit. Il a choisi un indicateur de périodicité mensuelle dont l’unité de mesure est le nombre de jours d’instruction d’un dossier. Cet indicateur, relatif au Délai moyen d’instruction des dossiers mesuré en 2006 à plus de 160 jours, avait une cible prévue à l’horizon 2010 à 150 jours. D’ores et déjà, cette cible est dépassée (140 jours en 2009) et a été réévaluée à 130 jours en 2010 et 2011. Par ailleurs, cet indicateur de performance se double en interne, depuis début 2009, d’une veille sur les dossiers dont le délai de présence est supérieur à 200 jours.
En ce qui concerne la performance interne, le Médiateur s’est fixé trois objectifs qui font l’objet de mesures et figurent dans des tableaux de bord mensuels :
- l’accueil des usagers du Médiateur (indicateurs sur le nombre d’affaires, le nombre de points d’accès, les délais de demande de prise de rendez-vous ou d’accusé de réception d’une réclamation…) ;
- le traitement des affaires (indicateurs sur le pourcentage de médiations tentées et réussies, le nombre de dossiers issus de ZUS, le nombre de dossiers clos, le volume d’affaires en stock, les délais de traitement, la répartition des réclamations par secteur, région ou thématique…) ;
- le traitement des propositions de réformes (nombre de propositions et de demandes de réforme, délai de traitement des demandes de réforme…).
Le Médiateur de la République n’a pas conclu de contrat de performance ou de gestion avec l’État, mais il est associé à la charte du secrétariat général du Gouvernement (SGG).
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au programme Protection des droits et libertés de la mission Direction de l'action du Gouvernement. Toutefois, le Médiateur discute directement son budget avec la direction du budget. Il est ordonnateur principal de l’État et n’est pas soumis au contrôle budgétaire a priori. Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
BUDGET DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
(en euros)
2005 |
2006* |
2007 |
2008 |
2009** | |
Crédits inscrits en loi |
7 822 583 |
11 722 781 |
10 698 435 |
11 096 653 |
11 099 009 |
Crédits ouverts |
7 822 583 |
10 954 930 |
10 698 400 |
10 802 751 |
11 697 233 |
Crédits consommés |
7 886 046 |
10 875 290 |
10 806 661 |
*** 10 790 805 |
11 251 219 |
* En 2006, les crédits correspondants à la masse salariale des MAD ont été transférés en cours d'exercice.
** Le montant des crédits inscrits dans la LFI a été abondé en cours d'exercice de 849 840 euros (transfert de la Mission pour le développement de la médiation, de l’information et du dialogue pour la sécurité des soins - MIDISS)
*** Dont crédits issus du compte de dépôt de fonds du Médiateur au Trésor.
Le Médiateur ne dispose plus de fonds de roulement depuis la mise en place d’un comptable au sein de l’Institution.
À la suite des observations définitives effectuées en 2004 par la Cour des comptes sur la gestion des services du Médiateur (exercices 1995 à 2002), ce dernier a entrepris des modifications qui sont globalement jugées satisfaisantes par la Cour :
- rattachement des opérations financières du Médiateur à un comptable public ;
- présentation budgétaire complète s’appuyant sur une comptabilité analytique et un contrôle de gestion ;
- pratiques en matière de recrutement et de rémunération conformes à l’esprit et à la lettre du statut général de la fonction publique ;
- évolutions favorables en matière de gestion immobilière (voir ci-dessous).
La part des dépenses de personnel représente 48 % du budget total en 2009. Les effectifs du Médiateur sont relativement stables depuis cinq ans pour un nombre de dossiers en hausse de près de 20 %. Désormais seuls 7 agents restent en position de mise à disposition à titre gratuit.
EFFECTIFS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Mis à disposition |
Détachés |
Contractuels |
Total | |
2005 |
66 |
9 |
19 |
94 |
2006 |
57 |
15 |
23 |
95 |
2007 |
51 |
16 |
27 |
94 |
2008 |
51 |
11 |
36 |
* 98 |
2009 |
56 |
9 |
35 |
100 |
* En 2007/2008, 17 fonctionnaires titulaires sont partis et ont été remplacés par des contractuels. 2008 voit l’arrivée des agents de la Médiation du service universel postal.
Les services du Médiateur n’en ont pas moins connu une véritable « rotation » des personnels puisque seules 30 personnes (en majorité les secrétaires et quelques chargés de mission) sont des personnels déjà présents en mai 2004. Dès son arrivée, le Médiateur a indiqué à l’ensemble des personnels son souhait d’avoir une institution ouverte sur l’ensemble des services publics et des trois fonctions publiques, ce qui n’était pas le cas jusque là hormis cinq personnes issues des caisses de sécurité sociale. Par ailleurs, la mise en œuvre de la LOLF a conduit de nombreux agents, jusque là mis à disposition gratuitement de l’institution, à préférer leur ministère d’origine plutôt que de se voir désormais détachés. Il est à noter que, désormais, des personnels des trois fonctions publiques et de la magistrature sont en poste chez le Médiateur.
Les dépenses de loyer ont baissé de 2,3 à 1,8 millions d’euros entre 2008 et 2009. Cette économie de 0,5 million d’euros a permis de prendre en charge les dépenses relatives au transfert de la Mission pour le développement de la médiation, de l’information et du dialogue pour la sécurité des soins (MIDISS) et de rendre plus de 0,3 million d’euros au budget de l’État en fin d’exercice.
IMMOBILIER DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
(en euros et en m2)
Nbre de postes de travail |
Surface globale brute |
Suface globale/ poste de travail |
Surface utile nette |
SUN / poste de travail |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT HC /m2 (surface globale) | |
Médiateur de la République |
117 |
3 768 |
32,2 |
3 526 |
30,1 |
1 620 000 |
430 |
Dès 2004, le Médiateur avait cherché à diminuer le coût du loyer des locaux où ont été regroupés ses services centraux (7, rue Saint Florentin, Paris 8e). Le fait qu’il ait régulièrement fait savoir que le bail conclu en 2003 ressortait comme onéreux au mètre carré a amené le bailleur non seulement à prendre à sa charge plusieurs gros travaux initialement inscrits dans le bail comme étant à la charge du locataire, mais surtout à financer, outre les travaux d’installation d’un ascenseur desservant, enfin, tous les étages, la réalisation concomitante de travaux permettant de disposer de surfaces complémentaires, notamment une salle de formation. Enfin, des surfaces supplémentaires ont été mises à disposition des services du Médiateur (à l’origine pour la durée des travaux, elles le resteront jusqu’au terme du bail) pour un montant de loyer revu à la baisse. Dans sa lettre définitive du 1er septembre 2009, la Cour des comptes souligne que des « évolutions favorables » sont intervenues concernant la situation immobilière du siège de l’institution. « Elle souhaite toutefois que de nouveaux locaux, mieux adaptés et moins coûteux, soient recherchés dans des délais compatibles avec l’échéance du bail en cours ».
La part des dépenses de communication représente 2,5 % du budget hors titre 2 en 2009. La part des dépenses de transport représente 1,7 % du budget hors titre 2 en 2009. Taille du parc automobile disponible (voitures de fonction incluses) : 4 véhicules.
— La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ses suites :
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué le Défenseur des droits, afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose l'intervention d'une loi organique.
- Constitution :
« Titre XI bis - Le Défenseur des droits
« Art. 71-1. - [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
- Projets de loi organique (n° 610) et de loi ordinaire (n° 611) relatifs au Défenseur des droits déposé le 9 septembre 2009 au Sénat :
Le projet de loi organique précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits.
Ses attributions incluront celles aujourd'hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour que son action puisse bénéficier de toutes les compétences utiles, il sera assisté de deux collèges composés chacun de trois personnalités qualifiées, pour l'examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l'enfance. Leurs membres sont désignés par les Présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les membres de chaque collège sont nommés pour la durée du mandat du Défenseur des droits. Leur mandat n’est pas renouvelable. L'articulation avec les autres autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés est également renforcée : le Défenseur des droits sera, en particulier, associé aux travaux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le Défenseur des droits pourra être saisi directement par toute personne s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration. En matière de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité, il pourra également connaître des agissements de personnes privées. La saisine du Défenseur sera gratuite. Le Défenseur des droits disposera de pouvoirs importants, qui lui permettront notamment de prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, de proposer une transaction, d'être entendu par toute juridiction ou encore de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis pour couper court aux difficultés qui proviendraient d'interprétations divergentes des textes. Il bénéficiera de larges pouvoirs d'investigation. Le Défenseur des droits peut faire toute proposition au Gouvernement de modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines relevant de sa compétence.
Le projet de loi ordinaire complète le texte organique en prévoyant notamment les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits (cf. le tableau comparatif dans la note sur le Défenseur des enfants).
Dans le prolongement du rapport de la mission de réflexion et de propositions sur le cinéma remis au ministre de la Culture le 23 juillet 1981 par M. Jean-Denis Bredin, le médiateur du cinéma a été institué par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Il est chargé de régler de façon préalable et par voie de conciliation les litiges relatifs à la diffusion des films en salle, afin de veiller au respect des principes du droit de la concurrence et d’assurer la diversité de l’offre et de l’exploitation cinématographique.
Ce cadre juridique a été modifié à plusieurs reprises. Le fonctionnement concret de l’institution est fixé par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982. En termes de compétences, le médiateur du cinéma est chargé, depuis 2001, d’examiner les autorisations de création et d’extension des multiplexes décidées par les commissions départementales d’équipement commercial (devenues « commissions départementales d’aménagement commercial »). L’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée a prévu un rapprochement plus étroit entre l’Autorité de la concurrence et le médiateur du cinéma, une participation directe de ce dernier – au-delà de la médiation – à la régulation du secteur et son intervention dans le processus de déclaration des engagements de programmation souscrits par certains exploitants.
Le médiateur du cinéma est désormais régi par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du cinéma et de l’image animée. Il a été qualifié d’autorité administrative indépendante par le Conseil d’État en 2001 en raison de son statut ainsi que de son pouvoir d’émettre des injonctions et de décider de la publication des procès-verbaux des médiations.
Conformément à l’article 1er du décret du 9 février 1983, le médiateur du cinéma est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de Cassation ou de la Cour des comptes, après avis de l’Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du cinéma (40). Il s’agit d’un emploi à temps partiel, en adjonction des activités exercées à titre principal, qui ne fait pas l’objet d’incompatibilités et qui donne lieu au versement d’une indemnité mensuelle d’environ 1 300 euros.
Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du directeur général du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
En application de l’article L. 213-1 du code du cinéma, le médiateur est chargé d’une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :
– à l’accès des exploitants d’établissements aux œuvres cinématographiques et à l’accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d’exploitation en salle de ces œuvres, qui ont pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conformes à l’intérêt général ;
– à la fixation d’un délai d’exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionnée à l’article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l’article L. 232-1 ;
– à la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu’ils ont trait aux conditions de l’exploitation en salle d’une œuvre cinématographique.
La saisine est ouverte à toute personne physique ou morale concernée, à toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée et au président du CNC. Le médiateur du cinéma peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Le décret du 9 février 1983 précise que le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour concilier les parties en cause. Pour l'examen de chaque affaire, il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le médiateur, ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent, sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.
En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Le médiateur peut rendre public ce procès-verbal (L. 213-3).
À défaut de conciliation, le médiateur peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. Cette injonction peut être rendue publique (L. 213-4).
L’article L. 213-6 prévoit que le médiateur du cinéma saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le médiateur peut aussi saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence.
De son côté l'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale rappelées par l’article L. 213-8 du code du cinéma.
L’article 11 du décret du 9 février 1983 prévoit que le médiateur adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du cinéma. Une copie de ce rapport est adressée au Président de l’Autorité de la concurrence.
Les données relatives à l’activité du médiateur du cinéma en 2009, qui figurent dans le rapport rendu public au mois de février 2010, sont résumées ci-après.
S’agissant des médiations, 144 dossiers ont été ouverts, soit plus du double qu’en 2008 et 51 % de plus qu’en 2000, année « record » jusqu’à présent : 125 ont émané d’exploitants (classés « Art et Essai » principalement), 12 de distributeurs et 1 d’une organisation syndicale. 6 affaires ont pour origine une autosaisine du médiateur du cinéma.
131 des 144 dossiers traités ont porté sur une situation limitée à une ou plusieurs villes précises (41). L’année 2009 témoigne d’une forte mobilisation d’exploitants situés dans des petites communes puisque 32 demandes intéressaient des villes de moins de 100 000 habitants.
131 demandes ont eu pour objet l’organisation d’une réunion de conciliation entre un (ou des) exploitant(s) et un (ou des) distributeurs en vue du règlement d’un litige à propos soit du placement de films précis, soit de tranches de films (42). 6 dossiers ont porté sur des situations de concurrence entre exploitants. 7 portaient sur des relations commerciales conflictuelles (5 d’entre elles ont donné lieu à des réunions de conciliation).
Parmi les 144 demandes de médiation, 86 ont donné lieu à des réunions ; les 58 autres ont été closes sans réunion, soit parce que les parties sont parvenues à un accord, soit parce que le demandeur a retiré sa demande ou que la réunion n’a matériellement pas pu se monter en raison du caractère tardif de la saisine.
Les demandes de médiation ont été satisfaites dans 63 % des cas en 2009, contre 69 % l’année précédente. 31 constats de désaccord ont été dressés (36 % des affaires ayant donné lieu à une réunion). 15 demandes d’injonction ont été enregistrées : 9 ont été satisfaites (43), 6 rejetées (44). À l’issue de quatre réunions de conciliation, le médiateur a émis des recommandations.
Le médiateur du cinéma mentionne également les simples demandes d’intervention qui lui sont adressées et qui constituent une part significative de son activité. Ainsi, en 2009, 110 demandes ne sont pas allées au-delà d’une intervention informelle de ses services, faute d’une demande de médiation proprement dite, contre 84 en 2008. Parmi elles, 94 étaient relatives à un ou plusieurs films précis (60 films, dont 24 films « Art et Essai ») et 16 portaient sur des situations plus générales. Le différend a été résolu dans un peu plus de 50 % des cas, la plupart des autres affaires ayant été abandonnées.
Enfin, comme la loi le permet désormais, le médiateur a formé, en 2009, deux recours contre des décisions d’autorisation de projets de multiplexes de plus de 300 fauteuils délivrées par une commission départementale d’aménagement commercial. Tous deux ont été suivis par la Commission nationale d’aménagement commercial.
Le médiateur du cinéma ne dispose pas d’indicateurs propres au sens de la LOLF. Néanmoins, il indique s’être doté lui-même de 5 indicateurs de performance fondés sur : le nombre de médiations réussies, le nombre de saisines, le nombre d’injonctions prononcées, le pourcentage des demandes ayant été satisfaites parmi les saisines (accords avant réunion, conciliations, injonctions), le nombre d’accords trouvés par des interventions hors médiation.
L’institution n’a pas de budget spécifique. Ses crédits sont gérés et mis à disposition par le CNC. De ce fait, le médiateur du cinéma a considéré comme sans objet les questions relatives à l’évolution annuelle de ses crédits et de ses dépenses.
Ses effectifs n’ont pas évolué depuis plus de 5 ans. Le médiateur est assisté, en effet, de deux agents du CNC : un chargé de mission (catégorie A), détaché du ministère de l’Éducation nationale, en poste depuis sept ans, et un adjoint administratif, titulaire (catégorie C), en poste depuis quinze ans. Les dépenses de personnel représentent environ 140 000 euros charges comprises, en augmentation de 13 % par an sur les trois dernières années (rémunérations brutes).
DÉPENSES DE PERSONNEL DU MÉDIATEUR DU CINÉMA
(en euros)
Poste |
Statut |
Remarques |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | ||||
Brut |
Charges |
Brut |
Charges |
Brut |
Charges |
Brut |
Charges | |||
Médiateur |
Agent mis à disposition Cumul de rémunération |
En poste depuis le 06/04/2006 |
11 787 |
703 |
16 703 |
1 238 |
16 792 |
1 238 |
23 390 |
3 184 |
Chargé de mission |
Agent titulaire détaché sur contrat / cat. A (Cat 1) |
32 385 |
8 844 |
42 191 |
12 475 |
38 551 |
24 581 |
46 458 |
32 077 | |
Assistante |
Agent titulaire affecté cat. C (Adjoint administratif) |
17 572 |
9 194 |
18 184 |
10 593 |
19 059 |
12 550 |
21 620 |
15 710 | |
Total |
61 744 |
18 741 |
77 078 |
24 306 |
74 402 |
38 369 |
91 468 |
50 971 | ||
La part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement est de 71 %, celle des dépenses de communication de 0,3 %, celle des dépenses de déplacement de l’ordre de 1,5 % (0,3 % en 2009).
Les dépenses relatives aux locaux du médiateur du cinéma (84 m2 en surface globale brute et 59 m2 en surface utile nette pour trois postes de travail, situés rue Boissière dans le XVIe arrondissement de Paris) s’élèvent à 42 764 euros (un peu moins de 510 euros par m2) et représentent 21 % des dépenses de fonctionnement.
MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
— Principales caractéristiques :
Le choix de créer un médiateur sectoriel indépendant, sans précédent en France, reposait sur une volonté de mieux protéger les consommateurs de gaz et d’électricité dans le cadre de l’ouverture totale des marchés de l’électricité et du gaz naturel du 1er juillet 2007. La loi 7 décembre 2006 créant le médiateur national de l’énergie (MNE) a anticipé les directives européennes d’août 2009 qui disposent que : « les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges. ».
Le MNE a deux missions principales : participer à l’information des consommateurs d’électricité et de gaz naturel sur leurs droits et proposer des solutions aux litiges entre consommateurs et fournisseurs.
Le MNE émet des recommandations écrites et motivées de solutions aux litiges entre fournisseurs et consommateurs, mais qui ne sont pas contraignantes. Il sollicite les observations des parties et peut les entendre, dans un délai qu’il fixe.
En 2009 le MNE a mis en œuvre sa première médiation de groupe, qui concernait près de 4 000 consommateurs et a entraîné un dédommagement de 550 000 euros accordés par les professionnels concernés par le litige.
Le MNE établit un rapport annuel dont le premier, portant sur l’activité en 2008, a été rendu public le 30 mars 2009.
Le MNE ne dispose pas de commissaire du Gouvernement. Il n’est pas soumis au contrôle financier a priori.
Le MNE est nommé pour 6 ans par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la consommation. Son mandat n’est ni renouvelable, ni révocable.
Aucune incompatibilité n’a été précisée dans la loi. Toutefois, le premier MNE nommé, M. Jean-Claude Lenoir, a démissionné quelques mois après sa nomination estimant le mandant de médiateur incompatible avec celui de parlementaire.
Le régime indemnitaire du MNE a été arrêté le 18 mars 2009 à 50 000 euros annuels avec pour effet le 1er janvier 2009. Auparavant, la fonction a été exercée à titre bénévole. Le MNE ne bénéficie d’aucune prime ou avantage en nature.
ACTIVITÉ DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Mission |
Indicateur |
2008 |
2009 (au 30/11) |
Information des consommateurs sur leurs droits |
Nombre de visites des sites internet energie-mediateur.fr et energie-info.fr |
362 000 |
657 000 |
Nombre d’appels au n° Azur 0810 112 212 pour des demandes d’information |
409 000 |
350 000 | |
Nombre de courriers, courriels et fax reçus de demandes d’information |
820 |
750 | |
Traitement |
Nombre de réclamations reçues (téléphone, courriers, courriels) |
6 400 |
13 000 |
Nombre de réclamations reçues |
1 448 |
4 000 | |
Nombre de réclamations recevables reçues |
401 |
954 | |
Délais de traitement des réclamations recevables (mois) |
4,8 |
7 | |
Nombre de recommandations émises |
48 |
241 | |
Suites favorables données aux recommandations par les fournisseurs et distributeurs |
74 % suivies en totalité, 17 % en partie |
63 % suivies en totalité, 24 % en partie | |
Montant moyen obtenu par consommateur (remboursement + dédommagement) en euros |
629 |
498 |
La mission d’information est assurée principalement au travers des sites internet (www.energie-mediateur.fr et www.energie-info.fr) et d’un centre d’appel (0810 112 212). Une campagne d’information auprès du grand public a été lancée le 5 novembre 2009. Le MNE réalise sa mission d’information des consommateurs en s’appuyant sur un partenariat avec la Commission de Régulation de l’énergie (CRE), qui cofinance le dispositif Énergie-Info à hauteur de 50 %. Il bénéficie également pour ce faire du soutien de la direction générale de la consommation (DGCCRF), de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), de l’Institut National de la Consommation (INC) et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
S’agissant de la mission de résolution des litiges, et par rapport à leur nombre de clients respectif, EDF fait l’objet d’un nombre de saisines inférieur à la moyenne, GDF-Suez au dessus de la moyenne, et les fournisseurs alternatifs comme Direct Énergie et POWEO une proportion à la fois importante et croissante des litiges.
— Indicateurs et performance :
Le MNE considère qu’il n’est pas concerné par la démarche de performance de la LOLF (objectifs et indicateurs) dans la mesure où il n’est pas financé par le budget de l’État, mais par une taxe.
A fortiori, le MNE n’a conclu aucun contrat de performance ou de gestion avec l’État.
Le décret précisant les missions du MNE dispose qu’il doit accuser réception « sans délai » des courriers de saisine et que la recommandation est envoyés aux parties concernées « deux mois au maximum » après l’envoi de l’accusé de réception. En pratique le délai moyen de traitement des réclamations recevables est de 7 mois en 2009 (4,8 mois en 2008). Le dernier rapport d’activité du MNE (portant sur l’année 2008) précise que le délai moyen d’envoi d’un accusé de réception est de 29 jours.
Le pourcentage de suites favorables données par les fournisseurs et distributeurs aux recommandations du MNE s’établit en 2009 à 63 % (suivi en totalité) et 24 % (suivi en partie).
Le MNE est financé par une contribution de 0,4 % sur la taxe prélevée sur les factures d’électricité (la contribution au service public de l’électricité - CSPE). Cette contribution représentait un montant total de 1,9 million d’euros en 2009, soit 5 % de la facture moyenne d’un petit consommateur.
BUDGET DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
(en euros)
Budget arrêté (euros) |
Date de parution au JO de l’arrêt budgétaire |
Crédits consommés (euros) |
Commentaire | |
2007 |
4 100 000 |
26/10/2007 |
681 589 |
Contribution au service énergie-info |
2008 |
2 015 000 |
24/12/2008 |
1 677 237 |
|
2009 |
7 781 000 |
21/07/2009 |
(prev) 7 400 000 |
Le compte financier 2008 faisait apparaître une capacité d’autofinancement de près de 1,9 millions d’euros.
DÉCOMPOSITION DU BUDGET DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
(en euros)
2007 |
2008 |
2009 | |
Budget total |
4 100 000 |
2 015 000 |
7 781 000 |
Dépenses de personnel |
0 |
292 500 |
(est) 1 690 000 |
Autres dépenses fonctionnement dont loyers |
681 589 0 |
1 279 263 371 777 |
(est) 5 600 000 (est) 480 000 |
Dépenses investissement |
0 |
105 474 |
(est) 90 000 |
Résultat de l’exercice (solde) |
3 418 411 |
337 763 |
(est) 401 000 |
Le MNE employait 26 ETPT en 2009. Il estime que son dimensionnement cible devrait lui permettre d’atteindre à la fin de cette année un effectif proche de 50 ETPT, soit un doublement en un an. Les dépenses de personnel représentaient 23,2 % des dépenses de fonctionnement en 2009.
EFFECTIFS DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
(en ETPT)
2007 |
2008 |
2009 | |
Nb total de postes autorisés |
15 |
15 |
40 |
Contractuels |
0 |
9 |
32 |
Fonctionnaire détaché (cat A) |
0 |
1 |
1 |
Total ETPT consommés |
1,1 |
6,2 |
26,1 |
Les dépenses de communication courante ne représentent que 200 000 euros en 2009. Une campagne de communication auprès du grand public a été lancée en 2009 pour un budget de 3,5 millions d’euros. La dépense correspondante n’est pas récurrente. Au total, les dépenses de consommation ont représenté 52,7 % des dépenses de fonctionnement en 2009.
Les dépenses de transport représentent 16 000 euros en 2009 (0,2 % des dépenses de fonctionnement). Le MNE ne dispose pas de parc automobile.
En l’absence de visibilité sur son dimensionnement cible, mais compte tenu de l’évolution prévisible de ses services, le MNE a retenu pour ses deux premières années de fonctionnement la solution d’hébergement dans un centre d’affaire. La Cour des comptes a calculé que, dans cette phase constitutive, le MNE a supporté un coût s’élevant à 1 190 euros au m2.
Depuis le 1er mars 2010, le MNE est hébergé dans de nouveaux locaux qui ont fait l’objet d’une opération immobilière conjointe avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE), validée par France Domaine avec un bail de 12 ans. Le MNE indique qu’à compter du 1er mars 2010, son loyer est de 456 000 euros (436 euros HT/m2/an), avec un ratio d’occupation inférieur à la cible de 12 m2/agent.
IMMOBILIER DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
(en euros et m2)
Nbre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface globale/ poste de travail |
Surface utile nette (m2) |
SUN / poste de travail |
Loyer HT hors charges (euros) |
Loyer HT HC /m2 (surface globale) | |
MNE 2009 |
35 |
663 |
18,9 |
378 |
10,8 |
334 200 |
504 |
MNE 2010 |
46 |
1 045 |
22,7 |
484 |
10,5 |
456 000 |
436 |
COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE)
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l’électricité a crée la Commission de régulation de l’électricité. La loi du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie a étendu au gaz les compétences de la commission et transformé sa dénomination en Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La loi du 7 décembre 2006 a également institué, au sein de la CRE, un comité de règlement des différends et des sanctions chargé de régler les différends entre, d’une part, les utilisateurs et, d’autre part, les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité et de gaz naturel et les exploitants des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de sanctionner les opérateurs en cas de manquement à la règlementation ou à une décision de règlement de différend. Ce comité est composé de quatre membres : deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation. Le président du comité est nommé par décret parmi ses membres.
Les directives communautaires d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie et leur transposition en droit interne sont à l’origine de la création d’une autorité administrative indépendante chargée de réguler le secteur de l’énergie. En effet, la directive du 19 décembre 1996 imposait la mise en place d’une instance indépendante des parties qui permette notamment de mettre en œuvre l’accès des tiers aux réseaux, indépendamment de l’influence, supposée ou réelle, des parties prédominantes dans le secteur au moment de la transposition de la directive.
La CRE a été chargée de la préparation et du suivi de l’ouverture des marchés à tous les professionnels en 2004, puis à tous les consommateurs domestiques en juillet 2007. Sa compétence a été étendue en 2006 à la surveillance des marchés et de la question des énergies renouvelables.
— Principales caractéristiques :
La CRE ne dispose pas de la personnalité morale.
La CRE dispose de plusieurs pouvoirs :
- pouvoir de proposition (tarifs d’accès aux réseau publics d’électricité et de gaz, montant de la contribution aux charges de service public de l’électricité, mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics, mesures propres à garantir l’indépendance des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution…) ;
- pouvoir d’approbation (programme annuel d’investissement des gestionnaires de réseau de transport, principes de la dissociation comptable des activités des opérateurs intégrés, barèmes de raccordement, modèles de contrat d’accès au réseau de transport, procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport…) ;
- pouvoir de décision règlementaire (missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution en matière d’exploitation et de développement des réseaux, en matière de conditions de raccordement, sur les conditions d’accès aux réseaux, sur les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, détermination des modalités d’échange d’informations entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les concessionnaires…) ;
- pouvoir d’avis (sur tous les projets de règlement relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics, les sur projets de tarifs règlementés de vente, sur toute question relative aux secteurs électrique et gazier sur saisine de l’Autorité de la concurrence…) ;
- pouvoir de surveillance des marchés de gros français de l’électricité et du gaz (large droit d’accès à l’information et possibilités de sanctions en cas de refus, possibilité de mener des enquêtes, possibilité de saisir l’Autorité de la concurrence en cas de constatation d’une pratique anticoncurrentielle…) ;
- pouvoir d’enquête (droit d’accès aux informations détenues par les acteurs des marchés et les administrations, missions sur pièces et sur place, dans certains cas après autorisation du juge judiciaire) ;
- pouvoir de règlement des différends et de sanction (le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi par les parties intéressées de tout différend relatif à l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, ou de stockage de gaz naturel. Le comité peut également être amené à prendre des sanctions en cas de violation de la réglementation ou de non respect de ses décisions de règlement de différend.) ;
- pouvoirs complémentaires à ceux du ministre (en matière de production d'électricité, la CRE assure l’instruction des appels d'offres destinés à la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle des investissements de production. Toutefois, la décision de procéder à ces appels d'offres appartient au ministre chargé de l'énergie. L’élaboration et la mise en œuvre du cahier des charges est de la responsabilité de la CRE. Elle en dépouille les résultats et émet un avis motivé sur les offres à retenir. Le ministre désigne ensuite le ou les candidats retenus.)
Au terme de la transposition du « troisième paquet énergie », les pouvoirs de la CRE seront élargis en matière d’élaboration des tarifs d’accès aux réseaux, de règlement des différends et de sanction compte tenu des décisions contraignantes qui pourraient être adoptées par la future agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), ou encore au regard des pouvoirs de fixation ou d’approbation des conditions de raccordement. De nouveaux pouvoirs devraient également lui être confiés : fixer ou approuver les capacités d’allocation pour les importations journalières aux frontières en électricité et gaz ; approuver ou fixer des règles de gestion des congestions en électricité et en gaz ; mettre en œuvre une procédure de certification des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) ; veiller à l’indépendance des personnels et des dirigeants des GRT ; participer au conseil des régulateurs de l’ACER.
Le président du collège est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Cette fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Le président du collège exerce ses fonctions à plein temps.
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle G soit 85 475,52 euros. Une indemnité de sujétion spéciale d’un montant annuel brut de 109 226,70 euros lui est allouée.
Les deux vice-présidents sont désignés dans des conditions et régis par les droits et sujétions similaires.
Les autres membres du collège sont nommés pour six ans, leur mandat n’est pas renouvelable et ils sont également soumis à des règles d’incompatibilité. Ils sont rémunérés à la vacation.
Les 5 plus hautes rémunérations de directeurs sont comprises entre 130 434 et 172 199 euros.
Un commissaire du Gouvernement est placé auprès de la CRE.
La CRE a pour mission de garantir un accès équitable de aux réseaux publics de transport et de distribution de gaz et d’électricité, aux installations de gaz naturel liquéfie (GNL) et aux stockages de gaz. Pour assurer cette mission, la CRE propose au Gouvernement les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution. La CRE veille également au bon développement des réseaux et à leur bon fonctionnement. Elle approuve également les principes de séparation juridique et comptable entre les activités de transport, de fourniture et de distribution (respect de l’indépendance des gestionnaires de réseaux). La CRE surveille les marchés de l’électricité et du gaz, notamment des transactions sur les marchés de gros.
La CRE concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Dans le cadre de l’ouverture totale des marchés du 1er juillet 2007, et en accord avec la DGCCRF, avec la Direction générale de l’énergie et du climat et avec le Médiateur national de l’énergie, elle a mis en place un dispositif commun d’information des consommateurs domestiques appelé « Énergie-Info », constitué d’un site internet (www.energie-info.fr) et d’un centre d’appels chargé d’informer les consommateurs, de répondre à leurs questions ou de les orienter vers les interlocuteurs compétents pour ce faire.
La CRE procède chaque année à l’évaluation des charges du service public de l’électricité (CSPE) qui sont dues au titre du soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées et aux dispositions sociales en vigueur depuis 2005.
Le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE a, pour sa part, compétence pour régler les différends entre, d’une part, les utilisateurs et, d’autre part, les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution et les exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et sanctionner les opérateurs en cas de manquement à la règlementation ou à une décision de règlement de différend.
Le nombre de saisines du comité de règlement des différends est passé de 11 en 2004, 21 en 2005 à 4 en 2007 et le même nombre en 2008. La CRE explique cette baisse par le pouvoir dissuasif du comité, qui incite les acteurs à régler leurs différends à l’amiable.
L’ensemble des activités de la CRE s’effectue en coordination avec les régulateurs européens, en particulier au sein du Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CEER) et du Groupe des régulateurs européens institué par la Commission européenne (ERGEG) et demain au sein de l’agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), mais aussi dans le cadre de relations directes avec les institutions communautaires et dans le cadre de contacts bilatéraux et multilatéraux, notamment dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
— Indicateurs et performance :
Le programme Développement des entreprises et de l’emploi de la mission Économie comporte un objectif commun Rendre des décisions de qualité dans les délais aux trois AAI figurant dans (la CRE, l’ARCEP et l’Autorité de la concurrence). À cet objectif sont associés deux indicateurs de performance. La CRE met en moyenne 15 jours pour rendre des avis (10 jours pour l’ARCEP et 3 mois pour l’Autorité de la concurrence). Elle met en moyenne 1 mois ½ pour mener à son terme une procédure de traitement des différends et plaintes (4 mois pour l’ARCEP et 18 mois pour l’Autorité de la concurrence). Pour ces deux indicateurs, les délais prévus par le législateur sont respectés (1 mois pour les demandes d’avis et 2 mois pour les différends).
La CRE n’a pas conclu de contrat de performance avec le responsable de son programme de rattachement. Elle est liée à lui par une charte de gestion.
La CRE indique qu’elle dispose d’autres indicateurs internes de performance. En matière RH, il s’agit du ratio gérants/gérés tel que défini par le « rapport Lacambre ». Ce ratio est de 1,5 % en 2007 et de 1,6 % en 2008. Le rapport Lacambre indique que les valeurs de ce ratio s’établissent d’ordinaire entre 2 et 8 %. Par ailleurs les délais de règlement des factures s’établissent à 38 jours et à 32 jours en y intégrant les frais de mission.
La CRE est financée quasi exclusivement sur ressources budgétaires. La préparation budgétaire se déroule s’effectue en relation avec le responsable du programme Développement des entreprises et de l’emploi dans lequel sont inscrits les crédits de la CRE.
Une fois adopté en loi de finances, le budget de la CRE est soumis, sous le contrôle et l’arbitrage du responsable de programme, aux diverses mesures de régulation budgétaire : mise en réserve initiale et, éventuellement, autres mesure de régulation décidées par le Gouvernement en cours d’exercice. La CRE peut également être amenée, en gestion, à procéder à des mesures de fongibilité asymétrique en tant que de besoin.
La CRE estime pâtir en matière de crédits de fonctionnement d’un déficit depuis la mise en œuvre de la LOLF en 2006 (insuffisance de la dotation, non rebasage des reports de crédits). Elle estime que les économies récentes intervenues sur le poste immobilier ne suffiront pas à combler ce déficit structurel de crédits de fonctionnement dans un contexte caractérisé par l’accroissement à venir de ses missions qui découlera de la mise en œuvre des dispositions du projet de loi relative à la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) en cours d’examen et de la transcription du 3eme paquet des directives européennes relatives aux marchés électriques et gaziers.
Les dépenses de la CRE sont passées de 14,1 millions d’euros en 2005 à 21 millions d’euros en 2009 (+ 49 % en 4 ans).
La CRE indique que la France disposait, début 2008, du régulateur proportionnellement le moins doté en ressources humaines parmi les quinze autorités de régulation nationales (ARN) de l’Union européenne à 15.
Les dépenses de personnel représentent en 2009 11,6 millions sur un total de 21 millions d’euros (55,2 %).
Les effectifs de la CRE (hors collège) sont passés de 101 en 2005 à 129 en 2009 (+ 28 % en 4 ans). En 2009 la CRE employait 111 contractuels, 16 fonctionnaires détachés et 2 personnes mises à disposition.
Le taux de renouvellement des personnels est de 22 % en 2009. La Cour des comptes calcule que l’ancienneté moyenne a été de 2,7 ans en 2008 (absence de perspectives dévolution de carrière, rémunérations insuffisamment attractives…).
La part des dépenses de communication représente, en 2009, 10,8 % du budget de fonctionnement (donc environ 1 million sur 9,5 millions d’euros de dépenses de fonctionnement) : publications, sites internet et extranet, diverses enquêtes d’opinion, revue de presse quotidienne sous-traitée, traduction, cofinancement avec le Médiateur national de l’énergie du dispositif d’information des consommateurs « Énergie-emploi », organisation de conférences et colloques….
Les dépenses de transport et, plus généralement, de déplacement représentent 5,5 % du budget de fonctionnement en 2009. Le parc automobile de la CRE est composé de 6 véhicules en location longue durée ; il sera ramené à 4 véhicules au premier semestre 2010, lors du renouvellement du marché.
Jusqu’au 1er trimestre 2010 la CRE occupait un immeuble en location situé au 2, rue du Quatre Septembre à Paris, 2e arrondissement. Cet immeuble représentait pour la CRE un loyer HT HC de 923 euros / m2 de surface globale (à comparer au loyer de 543 euros / m2 représentant la moyenne pour les immeubles de bureau situés dans le « quartier central des affaires » selon les dernières données de l’indicateur trimestriel Immostat). La Cour des comptes a calculé que le poids des dépenses immobilières ont constitué jusqu’à 60 % du montant de la dotation de fonctionnement…
La CRE a décidé de changer de site pour emménager au 11-15, rue Pasquier, Paris 8e arrondissement, dans un immeuble partagé avec le Médiateur national de l’énergie. Un bail de 12 ans a été signé. Depuis la signature de ce bail, le loyer HT HC est de 449 euros / m2. Malgré une division par deux, ce loyer reste encore très élevé, en raison de la localisation de l’immeuble dans la zone la plus chère de Paris (« quartier central des affaires »). Le ratio d’occupation est maintenant de 12,2 m2 de surface SUN par agent (valeur cible fixée par le service France Domaine).
IMMOBILIER DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
(en euros et m2)
Adresse |
Nbre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN / poste de travail |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT HC /m2 (surface globale) |
Loyer TTC charges comprises | |
CRE 2009 |
2, rue du Quatre Septembre 75002 Paris |
138 |
3 649 |
2 329 |
16,9 |
3 368 027 |
923 |
4 137 966 |
CRE 2010 |
11-15, rue Pasquier 75008 Paris |
145 |
3 807 |
1 764 |
12,2 |
1 709 343 |
449 |
2 192 832 |
AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN)
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite loi « TSN »).
Depuis 1973, le contrôle de la sûreté nucléaire en France relevait du Service central de sûreté des installations nucléaires (SCSIN), rattaché au seul ministre chargé de l’industrie. Ce service est devenu, en 1991, la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), rattachée aux ministres chargés respectivement de l’industrie et de l’environnement, avec au niveau régional neuf divisions des installations nucléaires (DIN) placées au sein des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE). Le 22 février 2002, la DSIN voit son champ d'actions étendu à la radioprotection, c’est à dire à la protection contre les rayonnements ionisants utilisés dans les domaines médical, de la recherche ou de l’industrie.
La réforme de 2006 a regroupé l’ensemble de ces moyens et agents au sein de la nouvelle AAI, créée sous la dénomination d’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Elle relève, sans en dépendre naturellement, des ministres chargés respectivement de l’industrie et de l’environnement pour les aspects liés à la sûreté nucléaire et de la santé pour les aspects liés à la radioprotection. Elle est donc indépendante des personnes en charge de la promotion, du développement ou de la mise en œuvre des activités nucléaires.
La nouvelle organisation ainsi retenue en France, fondée sur le « modèle » de l'AAI, est similaire à celle qu’on peut déjà rencontrer dans d’autres grands pays dits « nucléaires », comme les États-Unis, le Canada ou l’Espagne. D’autres pays ont ces dernières années engagé une évolution identique (Suède et en Suisse en 2008, Royaume-Uni en 2010) pour accroître l’indépendance de l’organisme chargé du contrôle. De plus, l’article 8 de la Convention sur la sûreté nucléaire, adoptée en 1994, relatif à l’indépendance des Autorités de sûreté dispose que « chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire. »
Le dispositif de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des activités et installations nucléaires en France repose ainsi sur l’ASN et son appui technique, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui demeure en revanche un établissement public à caractère industriel et commercial, sous tutelle ministérielle, créé par le décret du 22 février 2002, au sein duquel environ 450 personnes réalisent des expertises et formulent des avis pour le compte de l’ASN.
Les objectifs de 2006 en matière d’indépendance n’ont pas évolué. En donnant en 2006 à l’ASN le statut d’AAI, le législateur a d’une certaine manière anticipé la recommandation d’indépendance préconisée au plan européen par la directive du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires de base. En effet, l’article 5 de cette directive dispose que « Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation […] et s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris la production d’électricité, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire. »
— Principales caractéristiques :
L’ASN n’a pas la personnalité morale.
Ses pouvoirs sont les suivants :
- l’ASN rend des avis au Gouvernement sur les projets de décret et d’arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire qui comprend, en application de l’article 1er de la loi TSN, la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident ;
- l’ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail ;
- l’ASN donne son avis au Gouvernement sur l’autorisation de création ou de démantèlement des grandes installations nucléaires ; elle prend des décisions individuelles et accorde les autorisations de moindre importance relatives à l’activité de ces installations et fixe les prescriptions encadrant leur fonctionnement ; elle accorde les autorisations pour les autres activités nucléaires ;
- dans le cadre de ses missions de contrôle des installations nucléaires et du transport de substances radioactives, l’ASN dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives (consignation, exécution d’office, suspension ou arrêt du déroulement d’une opération ou du fonctionnement d’une installation nucléaire). Dans ce cadre, les agents de l’ASN, inspecteurs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, disposent d’un droit de visite, sur autorisation du président du tribunal de grande instance en cas d’entrave, et d’un droit à communication des documents. Ils ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux INB et au transport de substances radioactives. Ils disposent du droit d’effectuer des prélèvements dans les installations nucléaires, aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Les agents de l’ASN chargés du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les INB disposent, dans le cadre de leur mission de contrôle, d’un pouvoir d’enquête.
L’ASN comprend un collège de cinq membres, nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. La durée des mandats est de six ans et n’est pas renouvelable.
La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Les membres du collège exercent leurs fonctions à temps plein.
L’ASN ne dispose pas de commissaire du Gouvernement.
L’ASN participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France.
Les missions de l’ASN s’articulent ainsi autour des domaines principaux de l’article 4 de la loi TSN : contribuer à l’élaboration de la réglementation ; délivrer des autorisations individuelles pour des activités nucléaires ; participer au contrôle de la sûreté nucléaires et de la radioprotection ; participer à l’information du public et des médias dans ces domaines ; participer à la gestion des situations d’urgence radiologique.
Dans ce cadre, elle peut être amenée, notamment à l’issue des inspections qu’elle réalise, à prendre des mesures de police administrative (mise en demeure et, en cas de non exécution de la mise en demeure consignation, exécution d’office ou suspension d’une activité selon la gravité des faits constatés) et à rechercher et constater des infractions pénales.
L'ASN participe à l'information du public, y compris en cas de situation d'urgence.
L'ASN assiste le Gouvernement en situation d’urgence pour toutes les questions relevant de sa compétence, en particulier en adressant aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. En cas de risques graves et imminents, l’ASN peut suspendre si nécessaire le fonctionnement d’une installation nucléaire en en informant sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’ASN formule par ailleurs des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
Enfin, l’ASN adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
— Indicateurs et performance :
L’ASN n’a pas conclu de contrat de performance avec l'État.
Actuellement, le budget de l’ASN est éclaté entre quatre programmes distincts :
– programme 181 Préventions des risques, qui couvre les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’intervention de l’ASN ;
– programme 190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables au titre de l’appui technique de l’IRSN à l’ASN ;
– programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer au titre du fonctionnement des onze divisions territoriales de l’ASN ;
– programme 218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière au titre du fonctionnement des services centraux de l’ASN.
Dans le cadre de la mission Écologie, développement et aménagement durable, le programme 181 Prévention des risques prévoit deux indicateurs pour mesurer l’objectif n° 4 Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public :
- l’indicateur 4.1 Maîtrise des délais de publication des décisions de l’ASN fait apparaître, d’une part, que le pourcentage de décisions de l’ASN prises dans les délais prévus s’établit en 2008 à 93 %, soit une progression de trois points par rapport à l’année 2007 et, d’autre part, que celui des décisions prises la même année avec un retard inférieur à 30 % s’est également amélioré de 3 points atteignant désormais 96 % ;
- l’indicateur 4.2 Niveau de connaissance auprès du grand public et niveau de satisfaction sur sa mission d’information auprès du public : Le niveau de connaissance auprès du grand public a atteint 29 % en 2008, ce qui traduit une progression de huit points par rapport à l’année 2007. De même, le pourcentage de personnes connaissant l’ASN se déclarant satisfaites de l’information qu’elle leur fournit a atteint 25 %, ce qui représente une progression de deux points rapport à l’année 2007. Il conviendrait cependant, pour en tirer des conclusions, de connaître la précision de la mesure qui, pour des sondages, est généralement de l'ordre d'au moins un à deux points.
Par ailleurs, de manière complémentaire aux indicateurs budgétaires, et dans le cadre d’une démarche interne volontaire et participative, l’ASN a défini un certain nombre d’indicateurs de performance internes, concernant l’ensemble de ses entités. À titre d’illustration, l’un des indicateurs les plus significatifs vis-à-vis de l’activité de l’ASN est celui qui concerne le nombre d’inspections réalisées. Il s’établit pour 2009 à 2 100 : 900 dans le domaine des installations nucléaires de base et du transport des matières radioactives et 1 200 dans le domaine du nucléaire de proximité (médical, industrie et recherche).
Le Comité interministériel d’audit des programmes préconisait dans sa mission de septembre 2009 de conserver l’indicateur 4.1 (Maitrise des délais de publication des décisions de l’ASN), mais de remplacer l’indicateur 4.2 (Taux de notoriété) par un indicateur plus représentatif de l’activité de base de l’Autorité, fondé par exemple sur le Nombre pondéré de contrôles rapporté aux effectifs d’inspecteurs.
En l'absence de personnalité morale distincte, les crédits de l’ASN sont inscrits au budget général de l’État. L’ASN ne dispose par conséquent pas d’un fonds de roulement.
Entre sa création et l’année 2000, le système français de contrôle du nucléaire en France a été financé par des prélèvements directs ou indirects sur les exploitants nucléaires contrôlés.
Le tableau ci-après retrace l’évolution entre 2007 et 2009 des crédits (CP) de l’ASN inscrits en LFI et exécutés en gestion (tous titres confondus).
BUDGET DE L’ASN
(en euros)
(Programmes 181, 217 et 218 - CP) |
2007 |
2008 |
2009 |
Evolution (2009/2008) |
LFI |
57 925 533 |
58 927 692 |
64 137 255 |
8,8 % |
Exécution |
54 241 314 |
57 963 337 |
64 350 478 |
8,8 % |
Le CIAP recommandait en septembre 2009 de consolider l’autonomie fonctionnelle de l’ASN en regroupant ses crédits en les inscrivant dans l’action 9 du programme 181 les moyens mis en œuvre par les programmes 217 (gestion des onze divisions territoriales de l’ASN) et 218 (fonctionnement des sites centraux de Paris et Fontenay) au bénéfice de cette AAI (ce transfert devant s’accompagner d’une délégation de gestion aux programmes d’origine).
Les effectifs de l’ASN sont passés de 377 en 2005 à 443 en 2009 (+ 17,5 %). Les 443 postes employés en 2009 se décomposent en 308 fonctionnaires, 42 contractuels et 93 personnes mises à disposition par des administrations, des opérateurs publics ou des entreprises.
Le CIAP recommandait en 2009 d’envisager de remplacer le système de mise à disposition de personnels d’établissements publics auprès de l’ASN par un dispositif d’accueil en détachement ou, à défaut, de financement des mises à disposition dans le cadre de conventions de délégation de gestion.
La rémunération des quatre membres du collège autres que le Président varie entre 10 627 et 10 644 euros par mois, ce qui suppose qu'ils aient chacun une fonction spécifique et permanente au sein de l'autorité.
La rémunération des cinq personnes de la direction les mieux rémunérées est comprise entre 7 641 et 10 923 euros par mois.
Le taux de renouvellement du personnel, élevé, a été de 15 % entre 2008 et 2009.
Le tableau ci-après présente le montant des dépenses liées à la mission d’information et à la communication de l’ASN entre 2007 et 2009 et la part 2009 de ces dépenses par rapport aux dépenses totales. Ces dépenses ont augmenté de 38 % en trois ans.
DÉPENSES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
(en euros)
(Exécution programmes 181, 217 et 218 - CP) |
2007 |
2008 |
2009 |
Part 2009 |
Information et communication |
1 701 375 |
1 931 347 |
2 340 305 |
3,6 % |
Dépenses totales |
54 241 314 |
57 963 337 |
64 350 478 |
- |
Les dépenses de déplacement se sont élevées à 829 500 euros en 2009, soit 1,3 % des dépenses totales (580 600 euros en 2007). Ce montant ne comprend pas les dépenses de déplacement des agents des divisions territoriales, prises en charge par les DREAL, et sur lesquelles l’ASN ne dispose pas de visibilité. L’ASN dispose d’un arc de 11 voitures de service en 2009. Les agents des divisions territoriales peuvent disposer des véhicules de fonction des DREAL.
Les services centraux de l’ASN sont hébergés sur deux sites parisiens. L’ASN est tout d’abord affectataire d’un immeuble domanial à Fontenay-aux-Roses, pour lequel un loyer budgétaire de 0,64 millions d’euros a été payé en 2008 et 2009. Par ailleurs, elle est également locataire d’un immeuble à Paris (place du colonel Bourgoin) dont le loyer a respectivement été de 2 et 2,2 millions d’euros en 2008 et 2009.
Les dépenses de loyers des onze divisions territoriales de l’ASN implantées au sein des DREAL sont inscrites sur le programme 217. L’ASN n'est pas en mesure d’en chiffrer le coût.
IMMOBILIER DE L’ASN
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT /m2 | |
ASN |
6, place du Colonel Bourgoin 75012 Paris |
244 |
8 849 |
5 371 |
22,0 |
2 299 277 |
260 |
AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ET DES POSTES (ARCEP)
Dans le secteur des communications électroniques, à la suite de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990, qui a fixé les conditions générales d’accès des fournisseurs de services au réseau des opérateurs publics, et de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (45), qui a fixé au 1er janvier 1998 la date d’ouverture totale à la concurrence des marchés de télécommunications, la loi du 26 juillet 1996, codifiée dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), a posé le principe du libre exercice des activités de télécommunications, affirmé l’existence d’un service universel des télécommunications et garanti, par anticipation du cadre communautaire, l’indépendance de la fonction de régulation par rapport à la fonction d’exploitation. La mission de régulation est, ainsi, confiée au ministre chargé des télécommunications et à une institution indépendante, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), mise en place le 5 janvier 1997. Par la suite les deux « paquets télécom » de 2002 et 2009 ont précisé le cadre communautaire.
Dans le secteur postal, la directive n° 97/67/CE, du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil, a posé le principe d’un service universel postal et la directive n° 2002/39/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil, a précisé les étapes de la libéralisation du secteur postal. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ouvre partiellement le secteur à la concurrence et confie la régulation du marché à l’ART, qui devient l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ce faisant, la loi du 20 mai 2005 met fin au contentieux engagé par la Commission européenne contre la France, en raison de l’absence de régulation indépendante du secteur postal.
Il est généralement admis que l’économie de marché nécessite le respect d’un corpus de règles destinées à assurer, d’une part, la pérennité de l’offre, d’autre part, des garanties aux consommateurs. Ce besoin de règles est accru dans les secteurs qui, originellement monopolistiques, s’ouvrent à la concurrence (et en particulier ceux qui présentent de fortes barrières à l’entrée), ce qui est le cas des télécommunications et, plus récemment, des activités postales. Pour cela, il est notamment nécessaire d’éviter que l’opérateur historique, par son poids, économique et « moral », ne fasse obstacle à l’émergence d’opérateurs concurrents (dits alternatifs). À l’inverse, il convient d’éviter qu’un nombre excessif de concurrents n’apparaissent trop rapidement, ce qui fragiliserait l’ensemble des opérateurs (historique ou nouveaux).
En matière de communications électroniques, la régulation porte, bien sûr, sur l’ensemble des activités et des réseaux, fixes et mobiles, d’autant que la convergence entre ces deux catégories de services est croissante. L’ARCEP est ainsi chargée par la loi, et conformément aux directives communautaires, de réguler les marchés de communications électroniques et d’attribuer les fréquences, ressources rares, dans des conditions de totale impartialité et neutralité.
À la fin de l’année dernière, l’ARCEP a fixé le cadre juridique (symétrique pour les différents opérateurs) du déploiement de la fibre optique dans les zones denses, en application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Les principaux objectifs fixés à l’Autorité par le législateur sont les suivants :
- favoriser l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ;
- veiller à l’effectivité du service universel tant dans le secteur postal que dans celui des communications électroniques ;
Le service universel S’agissant des communications électroniques, le service universel comprend : - la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable ; - la fourniture d’un service de renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique ; - l’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ; - l’accès aux utilisateurs finaux handicapés au service téléphonique, aux services de renseignements et aux cabines publiques dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs. S’agissant des activités postales, le service universel garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux (offres de services nationaux et transfrontières d’envois postaux de moins de 2kg, de colis jusqu’à 20kg, d’envois recommandés et d’envois à valeur déclarée) répondant à des normes de qualité déterminées et à des prix abordables. |
- veiller au développement de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité ;
- prendre en compte l’intérêt des territoires et des utilisateurs dans l’accès aux services et aux équipements, afin, par exemple, de favoriser la couverture mobile et d’étendre le haut débit dans les zones peu denses. La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales charge l’ARCEP d’une évaluation annuelle du coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste.
- Principales caractéristiques :
L’ARCEP n’est pas dotée de la personnalité morale.
Elle dispose de plusieurs types de pouvoirs.
Compétence réglementaire : l’ARCEP dispose d’un pouvoir réglementaire délégué, soumis à l’homologation du ministre chargé des communications électroniques, et des compétences réglementaires propres, dispensées de cette homologation.
Pouvoir de règlement des différends : l’ARCEP est chargée du règlement des différends entre opérateurs en matière de refus d’interconnexion, fourniture des listes d’abonnés, utilisation partagée des installations de communications électroniques existantes, utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil, établissement et exploitation des réseaux câblés, conclusion ou exécution des contrats dérogeant aux conditions du service universel postal, conventions d’accès aux moyens indispensables à l’exercice des activités postales détenues par La Poste.
Pouvoir de sanction : l’ARCEP dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations législatives et réglementaires. Elle peut prendre des mesures de suspension temporaire ou définitive d’une autorisation ou infliger une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires de l’opérateur en cas de récidive. Elle peut aussi leur retirer des ressources en fréquences et en numérotation et, en cas d’urgence, elle peut prendre des mesures conservatoires.
En matière postale, le pouvoir de sanction de l’Autorité ne peut être mis en œuvre que pour sanctionner des manquements à des obligations relatives à l’exercice de l’activité dans le champ du service universel. De ce fait, seul le prestataire de service universel et les opérateurs autorisés en vertu de l’article L. 3 du CPCE peuvent être soumis à sanction de la part de l’Autorité.
Le pouvoir de sanction de l’Autorité ne s’exerce qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
Pouvoir de contrôle tarifaire : en matière de communications électroniques, l’ARCEP peut limiter la capacité d’un opérateur à fixer librement ses prix : en matière de service universel ; pour certaines prestations ; pour les tarifs d'itinérance sur les réseaux mobiles ; et à l’encontre des opérateurs qui exercent une influence significative. Pour assurer le respect des ces restrictions à la liberté tarifaire, l’ARCEP dispose de plusieurs modes d’intervention : obligation de communiquer toute évolution d'un tarif assorti du pouvoir de l'ARCEP de s'opposer à cette évolution par une décision publique motivée (service universel) ; capacité d'exiger une modification de tarif par un opérateur exerçant une influence significative sur un marché de l'accès ou de l'interconnexion ; sanction administrative sur saisine d'un tiers ou sur auto saisine avec possibilité de mise en demeure ; procédure de règlement de différend entre opérateurs.
En matière postale, l’ARCEP dispose de plusieurs outils de contrôle des tarifs : elle décide des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant distinguer les envois en nombre des envois égrenés ; elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé ; avec l’ouverture complète à la concurrence du secteur postal et l’entrée en vigueur prochaine de la loi relative à la régulation postale, ce pouvoir disparaît toutefois ; à l’avenir, subsistera le pouvoir d’encadrement pluriannuel pour celles des prestations qui, actuellement en monopole, relèveront du service universel ; elle est informée des tarifs des prestations du service universel non réservé et peut, dans un délai d’un mois, rendre son avis public, si elle le décide ; elle émet un avis sur les tarifs du service public du transport et de la distribution de la presse, qui sont homologués par les ministres chargés des postes et de l’économie. Comme dans le secteur des communications électroniques, l’ARCEP peut également intervenir sur les tarifs postaux à l’occasion d’une procédure de sanction ou à l’occasion du règlement d’un différend.
Pouvoir de médiation : cette fonction a été créée pour trouver une issue à l'impuissance des collectivités territoriales confrontées à la déshérence des réseaux câblés, en cas de difficultés rencontrées pour la mise en conformité des conventions, conclues entre ces collectivités et ces distributeurs de services, avec le nouveau cadre législatif issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'Autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires.
Pouvoir d’enquête : l'ARCEP recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions.
Pouvoir de saisine et avis : le président de l'ARCEP saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. De son côté, l'Autorité de la concurrence communique à l'ARCEP toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des communications électroniques et des postes. En outre, lorsqu’elle effectue une analyse concurrentielle des marchés de communications électroniques, l’ARCEP se doit d’effectuer des consultations publiques sur ces projets de décision et de recueillir l’avis de l’Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, du CSA. Par ailleurs, le président de l'Autorité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Enfin, l’ARCEP est consultée sur les projets de loi ou de règlements relatifs au secteur des communications électroniques et des postes, participe à leur mise en œuvre et est associée à la préparation de la position française dans les négociations et les groupes de travaux européens et internationaux.
Publication de lignes directrices : lorsqu’un point de la régulation du secteur apparaît particulièrement complexe, l’ARCEP peut être amenée à fournir à l’ensemble des acteurs, opérateurs, distributeurs et consommateurs, une visibilité sur les règles applicables en la matière. Elle informe le secteur par un texte non contraignant juridiquement en adoptant et publiant des lignes directrices.
L’activité de l’ARCEP se répartit en plusieurs grandes fonctions : l’attribution de fréquences et numéros (1/3), l’analyse des marchés et la mise en œuvre des obligations correspondantes (1/3) ainsi que l’application des dispositions relatives au service universel (10 %). Au-delà de ces activités, le solde correspond à la mise en œuvre de dispositions générales telles que le dispositif de déclaration et les taxes correspondantes, la mise en œuvre d’une observation statistique du marché, le développement de l’information auprès des consommateurs, et enfin la gestion de l’Autorité (avec un coût de la fonction support limité à 12 % - méthode des coûts complets mise au point sur la recommandation de la Cour des Comptes).
L’ARCEP partage la gestion du spectre des fréquences avec le CSA et l’Agence nationale des fréquences (ANFr). Si ces trois organismes exercent par ailleurs des missions très différentes, ne rendant pas souhaitable un rapprochement, la Cour des comptes propose cependant une évolution de la répartition des compétences pour regrouper la gestion des fréquences.
L’ARCEP entretient également des relations étroites avec l’Autorité de la concurrence (échanges d’avis dans les cas de litiges entre opérateurs) et le Médiateur des communications électroniques (qui relève d’une initiative autonome des opérateurs de droit privé et n’est en aucun cas un médiateur de service public).
L'ARCEP est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques et qui disposent d'un pouvoir de veto. Nommé pour une durée de six ans, son mandat est irrévocable et non renouvelable.
Deux autres membres de l’Autorité sont nommés par décret du Président de la République, tandis que deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux autres par le président du Sénat. Leur mandat est irrévocable et non renouvelable.
Une charte de déontologie des membres de l’ARCEP a été adoptés en 2007 pour fixer les principes déontologiques s’appliquant à tout agent public (secret professionnel, obligation de discrétion, devoir de réserve, interdiction de prise illégale d’intérêts, etc.). La fonction de membre de l'ARCEP est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. À l’issue de leur mandat, ils doivent recueillir l’avis de la commission de déontologie s’ils souhaitent exercer une activité dans le secteur privé, dans le délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions à l’Autorité.
Le président et les membres de l’Autorité exercent leur mandat à temps plein.
Le Président a perçu en 2009 une rémunération annuelle globale (traitement indiciaire et régime indemnitaire) de 186 781 euros et les membres du collège 128 237 euros. Le président et les membres du collège disposent chacun d’un véhicule de fonction (C5), qui fait l’objet d’une déclaration fiscale en tant qu’avantage en nature.
L’ARCEP établit un rapport annuel d’activités.
- Indicateurs et performance :
L’ARCEP constitue l’action 13 du programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi de la mission Économie du budget de l’État. Ce programme héberge les trois autorités administratives indépendantes de régulation économique que sont l’ARCEP, la CRE et l’Autorité de la concurrence. Le dispositif performance, inchangé depuis la mise en œuvre de la LOLF en 2006, assigne aux trois entités un objectif commun : « rendre des décisions de qualité dans les délais ».
Un premier indicateur est relatif au délai moyen de réponse aux demandes d’avis, subdivisé en deux sous-indicateurs, selon le type d’avis rendu par l’ARCEP : avis tarifaires, avec une cible de 15 jours ; avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires, avec la même cible. Un second indicateur est relatif au délai de traitement des différends et plaintes, avec une cible de 4 mois.
Les cibles, dont certaines s’inscrivent dans des délais légaux, ont toujours été atteintes depuis 2006.
INDICATEUR 5.1 : DÉLAI MOYEN DE RÉPONSE AUX DEMANDES D’AVIS
(DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
Unité |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2011 | |
ARCEP - avis tarifaires |
Jours |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
ARCEP - projets de textes |
Jours |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
CRE |
Jours |
13 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Autorité de la concurrence |
Mois |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Précisions méthodologiques :
Certains avis sont soumis à délais tandis que les autres ne sont pas encadrés. ARCEP : délai légal de trois semaines pour les avis tarifaires et pas de délai légal pour les avis relatifs aux projets de textes législatifs et réglementaires, qui entrent dans la mission consultative de l’Autorité.
INDICATEUR 5.2 : DÉLAI DE TRAITEMENT DES DIFFÉRENDS ET PLAINTES
(DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
Unité |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2011 | |
ARCEP |
Mois |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
CRE |
Jours |
56 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Autorité de la concurrence |
Mois |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
15 |
Précisions méthodologiques :
Le traitement de certains différends et plaintes est soumis à délais tandis que les autres ne sont pas encadrés. ARCEP : délai légal de quatre mois pour les règlements de différends et pas de délai légal pour les plaintes.
Source : projets et rapports annuels de performances.
La Cour des comptes note qu’en réalité c’est bien plus les multiples données figurant dans le rapport annuel d’activité que les indicateurs LOLF qui permettent d’évaluer la qualité, l’efficacité du travail de l’ARCEP, et son impact positif sur les secteurs régulés et en faveur des citoyens-consommateurs.
Pour le secteur des télécommunications :
- Indicateurs d’efficacité administrative du régulateur : mesure qualitative (rendre des décisions dans les délais - c’est l’existant ; rendre des décisions fiables - mesure des contentieux) ; mesure quantitative (volume de décisions prises - 1 457 avis et décisions ont été adoptés en 2008 par le collège de l’ARCEP)
- Indicateurs d’évolution du marché régulé : indicateurs d’équipement du pays (nombre d’abonnés haut et très haut débit, mobiles, internet), données techniques (type équipements, nombre de prises, taux d’équipement très haut débit), indicateurs de couverture géographique (mobile, haut débit, fibre)
- Indicateurs de qualité de service : délai de construction et de réparation, qualité de réception
- Indicateurs de prix : indicateurs sur l’évolution des prix d’une série de produits, constitution d’un « indice global télécommunications ».
Pour le secteur postal :
- Qualité de service (délai d’acheminement…)
- Nombre d’opérateurs (concurrence).
Les négociations budgétaires sont préparées en liaison avec les services du responsable de programme qui finance l’ARCEP, la CRE et l’autorité de la concurrence. Les demandes concernant le titre 2 (personnel) sont traitées par le secrétaire général des ministères de l’Économie et du Budget. Les demandes concernant le titre 3 (fonctionnement) sont négociées directement avec la direction du Budget, en liaison avec le responsable du programme. L’ARCEP estime que jusqu’à présent elle a toujours réussi à trouver un « compromis budgétaire » acceptable avec la direction du Budget sans avoir besoin de recourir à un arbitrage interministériel.
Entre 2005 et 2009, les crédits de fonctionnement et de personnel consommés (CP) sont passés de 18,7 à 22,3 millions d’euros. En 2010 la dotation de l’ARCEP devrait légèrement diminuer (- 100 000 euros) pour la première fois depuis sa création. La très forte augmentation des dépenses de personnel entre 2005 et 2006 s’explique essentiellement par l’inscription au budget de l’ARCEP des cotisations patronales de pension civile des fonctionnaires pour un montant de 1,4 million d’euros. Chaque année sont constatées des différences entre crédits votés et crédits disponibles, en raison des reports et mises en réserve (qui sont systématiquement gelés depuis 2008). En outres des ajustements sont décidés en gestion au sein du programme de rattachement, en tant que contributeur ou bénéficiaire.
La contrainte budgétaire croissante a eu des répercussions sur la dotation de fonctionnement (hors personnel) accordée à l’ARCEP. L’Autorité met en œuvre depuis trois ans un plan de réduction de certaines dépenses : communication et frais de représentation en 2007 ; missions et déplacements en 2008 ; réduction du parc automobile en 2009 ; projets liés au développement durable en 2010.
L’ARCEP n’a pas de fonds de roulement puisqu’elle n’a pas la personnalité morale.
L’ARCEP n’a pas conclu de contrat de performance avec l’État, ni de contrat de gestion avec le ministère de l’Économie.
L’ARCEP emploie en 2009 170 agents dont 59 fonctionnaires titulaires, 15 fonctionnaires détachés et 96 contractuels. Elle employait 152 agents en 2004 et l’augmentation résulte principalement de la prise en charge de la régulation postale. Les fonctionnaires représentaient 70 % de l’effectif de l’ARCEP en 2000, ils n’en représentent plus que 45 % maintenant. Les facteurs d’explication principaux sont la forte composante technique du profil des personnes recherchées (qui se trouvent rarement dans les administrations classiques) et la difficulté persistante rencontrée lors de leur réintégration ultérieure dans leur ministère d’origine.
Les rémunérations annuelles globales des cinq agents les mieux rémunérés (hors collège) s’étalent entre 111 000 et 162 000 euros.
Le taux annuel de renouvellement du personnel est chaque année d’environ 10 %.
L’ARCEP s’est engagée, à la suite d’une recommandation de la Cour des Comptes, dans une démarche de maîtrise de ses dépenses de communication. Ce poste, qui mobilisait en 2002 près de 500 000 euros a été ramené à 315 000 euros en 2005, 345 000 euros en 2006, 357 000 euros en 2007 et 359 000 euros en 2008. Il devrait rester stable entre 350 000 euros et 370 000 euros en rythme de croisière annuel.
Le poste de dépenses de déplacements et transports est important pour l’ARCEP en raison de sa présence à l’étranger. Il a néanmoins baissé de 475 044 à 309 965 euros entre 2005 et 2009 (- 35 %).
Un effort de gestion maîtrisée des frais liés aux missions et déplacements a été engagée en 2008 : réduction des délégations, choix systématique de la classe économique (sauf pour les vols longs courriers de plus de sept heures), application des nouvelles modalités réglementaires en matière d’application des per diem (17,5 % pour chacun des repas, 65 % pour l’hébergement), préférence pour des choix d’hébergements avantageux et adaptés aux per diem, obligation de justificatifs de paiement de l’hébergement, négociation ex ante d’une enveloppe avec chaque direction opérationnelle, assortie d’un engagement ferme de non dépassement des crédits ainsi « déconcentrés » sur le plan de la gestion. Au cours du quatrième trimestre 2009, un nouveau voyagiste a été retenu après mise en concurrence, qui propose systématiquement toute la gamme de tarifs de transports possibles.
En juin 2009, le parc automobile de l’ARCEP a été ramené, sur décision du président, de 22 véhicules à 17 (13 véhicules loués en location longue durée ; 4 véhicules domaniaux), afin de se conformer aux recommandations de la Cour des Comptes, ce qui représente une réduction du parc automobile de 20 %.
L’ARCEP occupe depuis 1998 un immeuble locatif situé dans le 15e arrondissement (Montparnasse). Le bail a été renouvelé à compter du 1er août 2006, moyennant un loyer annuel (hors charges et hors taxes) de 1,9 million d’euros et un étalement sur trois ans de la hausse du loyer. Le nouveau loyer est toujours revalorisé en référence à l’indice du coût de la construction (ICC). Cet indice a augmenté de 14 % entre le 4e trimestre 2005, correspondant à l’indice de départ arrêté dans le bail, et le 4e trimestre 2008. Le loyer (hors charges) payé en 2009 s’établit à 2,1 millions d’euros HT pour une surface utile totale de 4 340 m2. Le prix du m2 est de 478 euros HT. Ce prix se situe au dessus de la fourchette des loyers constatés pour la zone géographique des 14 et 15e arrondissements de Paris (280 – 440 euros), selon le baromètre Immostat. Le seul loyer supporté par cet immeuble représente 37 % des dépenses de l’ARCEP. Les dépenses de loyer ont très fortement augmenté (plus de 40 % en 4 ans), en raison notamment de l’incidence de l’évolution de l’ICC, sur lequel est indexé le montant du loyer. Il convient enfin de noter que des démarches de renégociation ont été engagées au cours du premier semestre 2010. Le président de l’AECEP a informé les rapporteurs qu’au cours de l’été ces démarches ont abouti à un avenant entraînant une baisse de loyer de plus de 10 %.
L’ARCEP dispose actuellement d’une surface utile nette de 18 m2 par agent. L’ARCEP explique ce ratio, qui est très éloigné de l’objectif de 12 m2 par agent, par l’utilisation de quatre salles de réunion qui servent à l’accueil de ses interlocuteurs et à l’existence d’un centre de documentation ouvert au public.
IMMOBILIER DE L’ARCEP
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT /m2 | |
ARCEP |
7, square Max Hymans 75730 Paris Cedex 15 |
175 |
4 342 |
3 144 |
18,0 |
2 075 625 |
478 |
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC)
Plusieurs réglementations instituant un régime d’autorisations administratives préalables à l’implantation des projets commerciaux se sont succédées depuis la fin des années 1960.
La loi du 31 décembre 1969 portant certaines dispositions d’ordre économique et financier institue une procédure d’examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3 000 m². Elle crée, à cet effet, les comités départementaux d’urbanisme commercial (CDUC) et la commission nationale d’urbanisme commercial (CNUC).
La loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat (« loi Royer ») institue un régime juridique de l’urbanisme commercial, en mettant en place une procédure d’autorisation d’ordre économique, distincte du permis de construire. Cette loi vise notamment à garantir un développement équilibré entre les différentes formes de commerces. Elle renforce le rôle des CDUC, jusque là cantonnées dans des attributions consultatives, en leur donnant un pouvoir de décision et abaisse le seuil de l’autorisation (à 1000 m² de surface de vente dans les communes de moins de 40 000 habitants et à 1 500 m² dans les communes de plus de 40 000 habitants).
La loi du 29 janvier 1993 (« loi Sapin ») relative à la prévention de la corruption et à la transformation de la vie économique et des procédures publiques, complétée par le décret du 9 mars 1993, transforme de manière significative le régime institué en 1973. Le ministre en charge du commerce n’est plus l’autorité compétente en matière d’appel formé à l’encontre des décisions rendues par les CDUC : la CNUC n’est plus saisie pour avis mais devient une autorité administrative indépendante compétente en matière d’appel des décisions rendues par les commissions départementales.
La loi du 5 juillet 1996 (« loi Raffarin ») renforce le dispositif en étendant l’exigence d’une autorisation préalable d’exploitation commerciale à un nombre accru de projets par l’abaissement des seuils de surfaces de vente pour les opérations déjà soumises à autorisation (abaissement du seuil à 300 m² de surface de vente). Par ailleurs, les commissions départementales d’équipement commercial (CDEC) et la commission nationale d’équipement commercial (CNEC) se substituent aux CDUC et à la CNUC.
La loi du 4 août 2008, dite « loi de modernisation de l’économie (LME) » crée la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le décret du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial, pris en application de la LME, précise les nouvelles règles de composition et de fonctionnement des commissions d’aménagement commercial.
Plus de trente années dans le secteur de la grande distribution ont démontré que les réglementations successives n’avaient pas toujours conduit à un développement suffisant de la concurrence, et qu’elles n’avaient pas complètement réussi à préserver la diversité existante entre les différentes formes de commerce. L’accroissement des surfaces de vente a conduit à la multiplication parfois désordonnée de petites et moyennes surfaces et à la constitution de zones commerciales laissant peu de place aux considérations architecturales et d’aménagement urbain.
Par ailleurs, la conformité de la législation française de l’équipement commercial aux règles communautaires avait fait l’objet d’une contestation de la part de la Commission européenne, dans le cadre d’une procédure précontentieuse engagée contre la France. De plus, la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait de réformer la législation, afin d’y supprimer ses composantes assimilables à des tests économiques.
L’adoption de la LME opère ainsi une rénovation des critères de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales. Les commissions compétentes statuent désormais sur la base de critères relatifs au développement durable et à l’aménagement du territoire et non plus sur la base de critères économiques. Alors que la législation en la matière, développée depuis le début des années 70, avait pour ambition d’assurer la protection du petit commerce, la nouvelle réglementation privilégie d’autres objectifs : l’aménagement du territoire et le développement durable. Par ailleurs, il s’agit de renforcer la concurrence sur le marché en vue de permettre une diminution des prix et la réalisation de gains de pouvoir d’achat pour les consommateurs.
La LME permet désormais que toute personne justifiant d’un intérêt à agir puisse saisir la CNAC (antérieurement seuls le préfet, le porteur de projet et deux membres de la CDEC). Cette évolution des objectifs poursuivis par la réglementation s’exprime également dans l’évolution de la composition de la commission nationale : le ministre en charge de l’emploi a perdu son pouvoir de nomination d’un des membres de la commission au profit du ministre du ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement.
- Principales caractéristiques :
La CNAC est saisie des recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Il s’agit donc, à titre principal, pour la commission de statuer, dans un délai de 4 mois, sur les recours exercés contre les projets ayant pour objet la création ou l’extension de commerce de détail ou d’ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1000 m².
Depuis la mise en œuvre de la LME, la saisine de la CNAC est un préalable obligatoire à un recours contentieux, directement devant le Conseil d’État (article L. 752-17 du Code de commerce). Les tiers (notamment les concurrents) sont désormais tenus de saisir la CNAC s’ils souhaitent contester les décisions rendues par les commissions départementales.
Si la CNAC a vocation à rendre des décisions, elle ne dispose ni de la faculté de délivrer des sanctions, ni d’effectuer des contrôles.
La CNAC n’est pas dotée de la personnalité juridique et ne constitue donc pas une personne morale. La commission nationale, comme les commissions départementales, est un organe de l’État.
Elle est une autorité administrative ayant pouvoir de décision et non un organisme consultatif. Bien qu’elle ne soit pas qualifiée comme telle par la loi, le rapport du Conseil d’État de 2001 la considère comme une autorité administrative indépendante « en raison de sa composition et de ses pouvoirs ». En revanche, elle n’est ni une juridiction, ni un tribunal, au sens de l’Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Composition :
La CNAC comprend huit membres nommés, pour une durée de 6 ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les 3 ans (Articles L. 751-5 et s. du Code de commerce).
La CNAC est présidée par un conseiller d’État, désigné par le Vice-président de la Haute juridiction. Comme tout autre membre du collège de la commission, le président ne peut prendre part au délibéré dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées (Article L. 751-7 du code de commerce, cf. infra).
La CNAC est composée de 7 autres membres :
– un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes,
– un membre de l’Inspection générale des finances désigné par le chef de ce service,
– un membre du corps des inspecteurs généraux de l’Équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées,
– quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi à raison d’une par le président de l’Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement.
Le régime d’incompatibilité des membres de la CNAC, ainsi que de son président, est prévu par l’article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. »
Par ailleurs, chaque membre de la CNAC remet au Président de la Commission une lettre d’intérêts afin que celui-ci veille à ce qu’aucune prise illégale d’intérêt ne survienne au cours de l’examen d’un dossier en commission.
Aucune disposition du code de commerce ne prévoit une procédure de révocation du Président de la CNAC. Il résulte des prescriptions de l’article R. 751-9 du code de commerce que les membres de la CNAC peuvent être révoqués par le Président de la Commission : « Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7 ». Ainsi, tout membre de la CNAC qui n’aurait pas fait part de ses intérêts lors de l’examen d’un recours est révocable par le président de la CNAC.
Le président de la CNAC est rémunéré par un forfait annuel de 9 146,94 euros. En ce qui concerne les autres membres de la commission, le montant de leurs indemnités varie suivant qu’ils sont en activité ou non, dans le secteur public ou privé. Ainsi, les membres retraités ou exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé perçoivent une indemnité de 114,34 euros par séance, alors que ceux en activité dans la fonction publique perçoivent une indemnité de 60,98 euros.
De plus, conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, le Président de la CNAC, ainsi que ses membres ont droit au remboursement des éventuels frais de déplacements qu’ils auraient à engager dans le cadre de leurs fonctions au sein de la commission.
RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DES COLLÈGES
(en euros)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Coût cumulé des rémunérations versées aux membres des collèges de la CNAC/CNEC |
17 692 |
25 093 |
28 638 |
25 955 |
32 548 |
27 937 |
La CNAC dispose d’un commissaire du Gouvernement (le directeur chargé du commerce ou son représentant). Sa fonction est comparable à celle du rapporteur public devant les juridictions administratives : il propose un avis aux membres de la CNAC en tenant compte de l’historique des décisions rendues et des avis émis par le préfet, les services locaux en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement et du ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Ainsi, il a pour fonction d’assurer la cohérence de « la doctrine » de la CNAC.
Pour mémoire, les commissions départementales de l’aménagement commercial (CDAC) sont présidées par le préfet (qui ne prend pas part au vote) et composées de 5 élus locaux et de 3 personnalités qualifiées (consommation, aménagement du territoire, développement durable).
En 2008 les CDEC ont traité 2 405 dossiers avec 2 071 autorisations et 334 refus. Le taux d’autorisation est de 86 % ; il a constamment augmenté depuis 1997, où il s’établissait à 68 %. La surface moyenne des projets autorisés a constamment augmenté depuis 1997 (981 m2), pour s’établir à 1 576 m2 en 2008.
Sur 2 405 décisions prises par les CDEC en 2008, 132 (contre 16 autorisations et contre 116 refus) d’entre elles ont fait l'objet d'un recours auprès de la CNAC, soit un taux de recours de 5,5 %. Le taux de recours contre autorisation est de 0,8 % et le taux de recours contre annulation est de 35 %. Par rapport aux 2 071 autorisations délivrées par les CDEC, la CNAC a accordé 64 autorisations supplémentaires et annulé 11 autorisations départementales.
Entre 1993 et 2008, la CNEC (ancêtre de la CNAC) a annulé 1 885 refus départementaux, alors qu’elle a annulé seulement 388 autorisations départementales (sur un total de 4 335 saisines). Le même déséquilibre intervient en 2008 avec 123 refus départementaux annulés et seulement 18 autorisations départementales annulées (sur un total de 240 saisines).
Entre le 9 décembre 2008 (46) et le 12 novembre 2009, la CNAC a rendu 155 décisions. Elle a délivré 107 autorisations d’exploitation commerciale et a refusé 48 demandes. Sur cette période, la CNAC a autorisé la création de 456 042 m² de surface de vente.
Depuis l’entrée en vigueur de la LME, les recours effectués par les tiers (concurrents) étant recevables devant la CNAC, et non plus devant les tribunaux administratifs, le bureau de l’aménagement commercial, chargé du secrétariat de la CNAC, enregistre un réel accroissement du nombre des recours à traiter. Ainsi, à titre d’illustration, il a été permis d’enregistrer 45 recours différents dirigés à l’encontre d’une seule et même décision rendue par une CDAC.
La CNAC indique qu’au vu des premières statistiques sur l’année 2009, environ 45 % de ses décisions 2009 font l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Elle explique ce pourcentage par l’élargissement de sa saisine à toute personne ayant un intérêt à agir. Elle constate une pratique systématique des concurrents pour retarder la date d’ouverture du nouveau commerce.
La CNAC n’établit pas de rapport annuel d’activité, au contraire de la CNEC, qui l’a précédé.
- Indicateurs et performance :
La CNAC indique qu’elle n’établit pas d’indicateur de performance. Il n’est donc pas possible de vérifier dans quelles conditions elle respecte son obligation de statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine (article L. 752-17 du code de commerce) et de notifier ses décisions dans un délai de 2 mois (article R. 752-52). Il n’est pas non plus possible d’évaluer son efficience avec par exemple un indicateur mesurant le nombre de recours traités par agent.
La CNAC ne dispose pas d’un budget autonome et est financièrement rattachée au programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi de la mission Économie, qui est placée sous l’autorité conjointe de la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi et de son secrétaire d'État chargé du commerce.
Le secrétariat de la CNAC est assuré par les agents du bureau de l’aménagement commercial de la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services du ministère de l’Économie - DGCIS (article R. 751-10.–I du code de commerce). Il est composé de 17 agents, dont 3 assurent à plein temps la fonction de greffe de la commission.
Le bureau de l’aménagement commercial élabore la réglementation en matière d’aménagement commercial et en suit la mise en œuvre, avec les services déconcentrés du ministère et avec les ministères chargés de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il assure également le secrétariat de la CNAC, dont il instruit et rapporte les dossiers. En outre, il représente l’État devant les juridictions administratives pour les dossiers contentieux relatifs à l’aménagement commercial.
Le secrétariat de la CNAC est hébergé dans les locaux de la DGCIS du ministère de l’Économie, au 61 bd Vincent Auriol, Paris 13e.
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (CADA)
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été créée par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui a institué le principe de libre accès aux documents administratifs et a chargé la CADA de veiller à son application. La CADA a remplacé la Commission chargée de favoriser l’accès aux documents administratifs qu’avait institué le décret du 11 février 1977.
La création de la commission d’accès aux documents voulait être une réponse à la nouvelle conception des relations entre les administrations et les citoyens. Cette loi pose une règle de transparence et met fin à celle du secret qui avait prévalu jusque-là. Il n’allait pas de soi que, dans un pays comme la France, pays de forte administration, où les relations entre les pouvoirs publics et les citoyens sont marquées par l’inégalité et les prérogatives de la puissance publique, un droit à la communication des documents administratifs soit d’abord consacré, puis ensuite respecté.
Selon les travaux préparatoires de cette loi, le législateur, afin de rendre effectif ce droit, a choisi de mettre en place une autorité administrative indépendante pour :
– améliorer les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent faire valoir leurs droits en facilitant leur accès aux informations détenues par l’administration ;
– favoriser la transparence administrative ;
– prévenir les contentieux devant la juridiction administrative, la saisine de la CADA apparaissant comme un véritable recours administratif préalable obligatoire ;
– éviter l’engorgement des tribunaux administratifs ;
– offrir un recours moins complexe et accessibles aux non-initiés ;
– jouer le rôle de médiation entre le citoyen et l’administration et d’aiguillon pour cette dernière.
- Principales caractéristiques :
La CADA veille au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques, ainsi qu’à l’application du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques.
Elle dispose pour ce faire de plusieurs formes de pouvoirs :
Un pouvoir consultatif : à titre principal, la CADA dispose d’un pouvoir consultatif. Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication d’un document administratif ou pour consulter par dérogation des documents d’archives publiques. Elle répond aux demandes de consultation provenant des autorités administratives sur toute question relative à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Un pouvoir de proposition : elle peut proposer, à la demande de l’autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de textes et toute mesure de nature à faciliter le droit d’accès et à renforcer la transparence administrative.
Un pouvoir de sanction : depuis l’ordonnance du 6 juin 2005, elle peut infliger des sanctions aux personnes qui réutilisent des informations publiques en méconnaissance des prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 qui consacre le droit de réutilisation.
Une mission d’information : par son site Internet, la CADA informe les particuliers sur leur droit en matière d’accès et de réutilisation des données publiques. Grâce au réseau des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation (1 400 personnes), la CADA diffuse au sein des administrations ses avis et conseils, ce qui contribue à l’amélioration du traitement des demandes. Elle établit un rapport annuel qui est rendu public et qui retrace notamment les difficultés rencontrées par les demandeurs au regard des différentes catégories de documents.
La CADA n’est pas dotée de la personnalité morale.
La CADA n’a pas compétence pour toute question relative à la communication de documents administratifs ou à la réutilisation d’informations publiques. Les différentes modifications législatives intervenues à partir de la loi du 12 avril 2000 ont eu pour effet d’élargir constamment le périmètre d’intervention de la CADA. L’ordonnance du 6 juin 2005 a ajouté à sa compétence la question de la réutilisation des informations publiques, volet complémentaire à celui de l’accès, mais qui introduit une nouvelle problématique, aux enjeux économiques fort, qui n’existent pas autant dans le droit d’accès.
L’instruction des demandes d’avis dont la saisissent les personnes à qui l’autorité administrative sollicitée refuse la communication de documents administratifs est largement prédominante dans l’activité de la CADA (95,6 % des dossiers soumis à l’examen de la commission). Les demandes d’avis n’ont cessé d’augmenter depuis la création de la CADA jusqu’en 2002 pour atteindre un seuil de près de 4 500 demandes constaté depuis (seuil dépassé toutefois pour les années 2004 et 2006, avec plus 4 900 pour chacune de ces deux années). De plus, la part provenant de refus d’accès à des documents l’emporte très largement sur celle relative à la réutilisation des informations publiques qui concerne moins de 10 % du total.
Le reste des dossiers examinés par la CADA sont des demandes de conseil en provenance des autorités administratives qui ont été au nombre de 200 en 2008, soit le chiffre le plus faible constaté depuis 10 ans. Cette très nette baisse qui confirme une tendance observée depuis trois ans doit être relativisée. Elle ne s’explique pas tant par le nombre des sollicitations dont font l’objet les administrations, – qui reste très élevé –, que par leur objet, et, par conséquent, par les modalités de la réponse qui leur est apportée. En effet, seules les demandes qui portent sur une question inédite, un point d’actualité important, ou une interprétation délicate des textes sont soumises à la commission. Mais dans les faits, de très nombreuses demandes portent sur des questions pour lesquelles la CADA s’est prononcée à de nombreuses reprises et par conséquent appellent une réponse qui ne fait aucun doute. Il suffit, dans ce cas, que le secrétariat général explique la position de la CADA et transmette des avis précédemment rendus sur lesquels il s’est appuyé pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Le secrétariat général invite également ses interlocuteurs à consulter le site de la CADA qui s’est enrichi de nombreuses rubriques pour permettre aux administrations d’avoir un large accès aux travaux de la commission. Comme pour les avis, les demandes de conseil portent principalement sur des questions d’accès, la réutilisation ne concernant que 10 % des interrogations.
Depuis 2005, et la création du pouvoir de sanction, la CADA n’a eu à instruire qu’une demande qui a abouti au prononcé d’une sanction le 16 décembre 2008. Il s’agissait d’un cas de réutilisation non-conforme d’informations publiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), à l’encontre d’une société de restauration qui s’était prévalu de ses recommandations dans le cadre d’une campagne publicitaire.
La CADA établit un rapport d’activité annuel.
Le président de la CADA est membre du Conseil d’État désigné par le Vice-président du Conseil d’État et nommé par décret du Premier Ministre. Le président actuel, Jean-Pierre Leclerc, président de section honoraire du Conseil d’État, a été nommé pour un second mandat à compter du 19 décembre 2008. Le mandat est court, puisque d’une durée de trois ans.
Les textes en vigueur ne prévoient pas d’incompatibilité particulière. Toutefois, pour les membres de la formation restreinte de la commission qui statue en matière de sanction et dont le président est également président de droit, il est prévu qu’il ne peut siéger :
- s’il détient un intérêt direct ou indirect à l’affaire qui fait l’objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l’autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
- s’il a, au cours des trois années précédent la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans l’affaire qui fait l’objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l’autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
Le président exerce son mandat à temps partiel.
Le président perçoit une indemnité mensuelle, à l’exclusion de toute rémunération ou avantage, de 3 200 euros bruts.
Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le président titulaire. Son mandat est également d’une durée de trois ans, avec le même régime d’incompatibilité que le président. Le président suppléant assiste aux séances de la commission. Il perçoit une indemnité mensuelle de 400 euros bruts, à l’exclusion de toute autre rémunération ou avantage.
Hormis le président et son suppléant, la commission est composée de dix membres titulaires et de dix membres suppléants. Ils sont nommés, par décret du Premier Ministre, pour trois ans, à l’exception des élus qui sont nommés pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
L’exercice de leur activité est représenté par leur participation aux séances de la commission (la CADA se réunit tous les 15 jours, sauf pendant les vacances). Ils perçoivent une indemnité de 40 euros par séance dans la limite d’un plafond annuel de 803 euros.
Ce sont : un magistrat de la Cour de cassation ; un magistrat de la Cour des comptes ; un député titulaire et un suppléant ; un sénateur titulaire et un suppléant ; un élu d'une collectivité territoriale, titulaire et un suppléant ; un professeur de l'enseignement supérieur, titulaire, et un suppléant ; une personnalité qualifiée en matière d'archives, titulaire, et un suppléant ; une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, titulaire, et un suppléant proposés par le président de la CNIL ; une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, titulaire et un suppléant proposés par le président de l'Autorité de la concurrence ; une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations, titulaire et un suppléant.
- Indicateurs et performance :
La mesure de son activité retenue pour la LOLF est l’indicateur qui mesure le délai moyen d’instruction d’un dossier en jours et qui est inscrit dans la Mission Direction de l’action du Gouvernement, programme 308 Protection des droits et libertés. Cet indicateur est significatif dans la mesure où le décret du 30 décembre 2005 précise que la CADA doit notifier son avis au demandeur dans un délai d’un mois, mais également parce que l’intérêt d’obtenir la communication d’un document administratif est souvent lié à la rapidité avec laquelle on l’obtient. Ce délai d’un mois n’est pas respecté en moyenne annuelle. La CADA indique qu’elle n’entend pas sacrifier la qualité des avis et conseils, que ses moyens en personnel n’ont pas été accrus à due proportion de l’accroissement de son activité et que son application informatique reste obsolète.
INDICATEUR 1.2 : DÉLAI MOYEN D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
(DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
Unité |
2007 Réalisation |
2008 Réalisation |
2009 Prévision PAP 2009 |
2009 Prévision actualisée |
2010 Prévision |
2011 Cible | |
Délai moyen d’instruction des dossiers par le Médiateur de la République |
jours |
158 |
150 |
140 |
130 |
130 | |
Délai moyen d’instruction des dossiers par la CNDS |
mois |
11,5 |
12 |
11 |
10,30 |
10 |
9 |
Délai moyen d’instruction des demandes d’interception adressées en urgence absolue à la CNCIS |
minutes |
30 |
25 |
< 60 |
< 60 |
< 60 |
< 60 |
Délai moyen d’instruction des dossiers par la CADA |
jours |
35,4 |
35 |
34,5 |
34,5 |
33,5 |
Précisions méthodologiques :
Sous-indicateur 4 : « délai moyen d’instruction des dossiers par la CADA »
Modalités de calcul : Le délai affiché correspond à la moyenne du nombre de jours entre la date d’arrivée et la date de notification pour l’ensemble des demandes inscrites aux séances de l’année.
Source : les données sont fournies par le secrétaire général de la CADA. Elles s’appuient sur l’utilisation d’un système automatisé de gestion et d’information TEXTO dans lequel est saisi chaque évènement de la procédure de traitement de chaque demande, dont la date d’arrivée tamponnée sur chaque demande lors de son arrivée dans le service par acheminement postal, la date du courrier électronique ou du fax (ou du jour ouvré si la date d’arrivée correspond à un jour de fin de semaine ou un jour férié), et la date de départ du service de la lettre de notification.
La CADA participe aussi à l’information de l’administration et du public pour le respect du droit de l’usager à travers son site Internet, des réponses que le secrétariat général donne aux demandes faites par courrier électronique et par téléphone. Le nombre de réponses ainsi fournies est un indicateur d’activité en ce qui concerne la diffusion du droit. En 2008, la CADA a envoyé 2 749 lettres de réponse à des courriers.
Le taux d’avis favorables qui aboutit à la communication des documents par les services sollicités et le faible nombre de recours devant le tribunal administratif sont également des indicateurs de la pertinence de son activité. Le sens de ces avis se retrouve en général dans celui des décisions des juridictions administratives lorsque celles-ci sont saisies par les personnes qui n’ont pas obtenu satisfaction malgré l’intervention de la CADA.
La CADA a enregistré 4 756 dossiers en 2008. La légère diminution du nombre des saisines constatée en 2007 s’est poursuivie en 2008. Elle est due notamment à la décroissance du nombre des demandes de conseil formulées par les administrations, liée sans doute en partie à l’effort fait par le secrétariat général de la CADA pour développer l’information des administrations. La CADA rend un avis favorable dans 43,3 % des cas et défavorable dans 8,4 % des cas ; 38,4 % des demandes sont considérées sans objet (document déjà communiqué ou désistement, document inexistant, document détruit ou perdu). La CADA indique qu’en 2008 65,5 % des avis qu’elle a rendus avaient été suivis, 13 % non suivis et 21,5 % sans réponse.
Un autre indicateur envisagé est le « taux de couverture des personnes responsables ». Il s’agit en effet de mesurer la présence de ces personnes dans les administrations, les collectivités et les établissements publics qui sont tenus de procéder à leur désignation. Le réseau s’est stabilisé depuis 2009 à environ 1 400 personnes responsables, alors que l’évaluation faite début 2008 indiquait qu’il devrait être de près de 3 000 personnes si toutes les autorités visées par la loi en désignaient une. La CADA indique que cet objectif n’est pas forcément le plus pertinent car certaines collectivités (telles les communautés de communes dépassant tout juste 1 000 habitants) sont peu sollicités pas des demandes d’accès et dès lors la désignation d’un personne responsable n’apparaît pas prioritaire.
Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier Ministre. Elle ne dispose d’aucune autre ressource que budgétaire. Les services du Premier Ministre mettent à la disposition de la commission les moyens nécessaires à son fonctionnement : agents permanents, crédits de vacation pour le paiement des indemnités allouées à ses rapporteurs, locaux, mobilier, équipement informatique, fournitures.
À partir du 1er janvier 2009, elle a rejoint un groupe d’autres autorités administratives indépendantes dans le programme 308 Protection des droits et libertés. Ses dépenses sont inscrites dans l'action 6 Autres autorités indépendantes du programme 308. Elle y partage un BOP avec la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Cependant les crédits qui y sont inscrits, pour la part qui la concerne, ne représentent pas la totalité du coût budgétaire de la CADA, mais seulement la couverture de postes de dépenses qui ont été identifiés et lui sont rattachés dans le cadre de l’exécution budgétaire. Ce sont, en 2009, les dépenses suivantes : frais de représentation ; frais de déplacement ; abonnements et documentation ; dépenses de logistique ; dépenses informatiques et télécommunications. En revanche n’apparaissent pas : les dépenses liées à l’occupation et l’entretien des locaux mis à sa disposition ; les dépenses d’équipement en mobilier, matériels informatiques.
Les éléments budgétaires transmis par la Direction des services administratifs et financiers (DSAF) des Services de Premier ministre à la CADA sont les suivants :
BUDGET DE LA CADA
(en euros)
CADA |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (PLF) |
CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT CONSOMMÉS (T3) |
32 855 |
27 546 |
28 420 |
46 810 |
65 481 |
62 731 |
CRÉDITS DE PERSONNELS (T2) |
NC |
542 166 |
591 618 |
752 136 |
761 349 |
NC |
La CADA ne dispose pas de fond de roulement puisqu’elle n’a pas la personnalité morale.
Pour assurer ses missions, la CADA a recours à deux types de collaboration :
- un service administratif permanent qui assure le secrétariat général de la commission. Ses agents sont des agents des services du Premier Ministre affectés à la CADA. Celle-ci ne dispose pas d’agents mis à disposition au sens statutaire du terme ;
- une collaboration assurée par des hauts fonctionnaires qui interviennent, à titre accessoire, en plus de leur activité principale. Ils occupent les fonctions de rapporteur général, de rapporteur général adjoint et de rapporteurs (10) et de chargé de mission (1). Ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d’indemnités mensuelles.
EFFECTIFS DE LA CADA
Secrétariat général |
Collaborateurs | |
2005 |
12 agents |
13 collaborateurs (indemnités) |
2006 |
12 agents |
13 collaborateurs (indemnités) |
2007 |
11 agents |
13 collaborateurs (indemnités) |
2008 |
12 agents |
13 collaborateurs (indemnités) |
2009 |
12 agents |
13 collaborateurs (indemnités) |
Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint sont, comme indiqué ci-dessus, des collaborateurs qui interviennent à titre accessoire de leur fonction principale, qui n’ont donc pas de rémunération principale au titre de cette fonction à la CADA, mais seulement des indemnités mensuelles respectivement de 1 400 euros et 1 200 euros bruts.
Le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe sont des fonctionnaires de catégorie A qui sont rémunérés sur la base de la grille indiciaire de leur grade et bénéficient du seul régime indemnitaire de droit commun de leur corps.
Les dépenses en matériel sont évaluées, selon le périmètre retenu, entre 40 et 80 000 euros.
La CADA ne dispose ni de service, ni de budget de communication. Sa communication externe se fait uniquement par le biais de son site Internet (dont une lettre mensuelle d’information mise en ligne uniquement et qui ne donne lieu à aucun tirage papier) qui est pris en charge par le personnel permanent, en complément des activités principales liées directement à l’exécution de ses missions.
La CADA ne dispose pas de budget de transport (elle ne dispose d’aucun parc automobile). Les seules dépenses de déplacement sont les remboursements des frais de déplacement d’un membre de la commission pour venir assister aux séances.
Hébergée par les services du Premier ministre dans un immeuble domanial, la CADA ne supporte aucune charge immobilière. L’entretien des locaux et les travaux d’entretien ne figurent pas sur son budget. La CADA dispose de bureaux et d’une salle de réunion et de stockage des dossiers pour une surface totale de 223 m². À raison de 15 agents disposant d’un poste de travail dans ces locaux (à la différence des rapporteurs généraux les rapporteurs ne travaillent pas sur place), la surface moyenne est de 14,9 m2 par agent.
IMMOBILIER DE LA CADA
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT /m2 | |
CADA |
35, rue Saint Dominique, Paris 7e |
15 |
280 |
223 |
14,9 |
73 145 |
261 |
NB. Certaines informations présentées ci-après résultent de précisions apportées par la HAS après l’audition de ses représentants, en réponse à des demandes des rapporteurs.
Créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS) a été mise en place le 1er janvier 2005. Dotée du statut juridique d’autorité publique indépendante à caractère scientifique, elle a repris les missions de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et une partie de celles de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) en matière d’évaluation des médicaments : commission de la transparence, commission d'évaluation des produits et prestations, fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (FOPIM). Par ailleurs, de nouvelles missions lui ont été confiées par le législateur.
Le principal motif justifiant la création de la HAS, selon sa propre réponse, est qu’elle consacre une approche renouvelée de la démarche qualité en France dans le domaine qui est le sien. De plus, l’étendue et la diversité de ses missions favorisent une démarche intégrée au service de l’amélioration de la qualité des soins. La HAS a ainsi été créée pour assurer la régulation de la qualité en santé.
- Principales caractéristiques :
La HAS, qui est dotée de la personnalité morale, rend des avis, élabore des guides de bon usage des soins et recommandations de bonnes pratiques, établit et met en œuvre les procédures de certification des établissements de santé, fixe des orientations.
Elle ne fixe pas de normes réglementaires.
La Haute autorité évalue scientifiquement l’intérêt médical et médico-économique des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes professionnels et propose ou non leur remboursement par l’assurance maladie.
Elle a la charge de :
– promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et des usagers de santé
– la certification des établissements de santé,
– l’évaluation des pratiques professionnelles,
– l’amélioration de la qualité de l’information médicale et de sa diffusion,
– la procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale,
– la procédure d’évaluation et de certification de la qualité de la visite médicale,
– la promotion d’avis et de recommandations sur la définition et la prise en charge des affections de longue durée (ALD) et sur le périmètre de soins remboursables.
Le président de la HAS est désigné par le Président de la République parmi les membres du Collège. Son mandat est de 6 ans renouvelable une fois. Il exerce son mandat à temps plein.
Régime d’incompatibilités : les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la HAS, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des médicaments ou fabricant des produits de santé. Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou exercent de telles fonctions disposent, à compter de la date de leur nomination, d'un délai de trois mois pour s'en défaire ou les quitter. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité des membres le composant, après la présentation par l'intéressé, qui ne participe pas au vote, de ses observations.
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'État classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement, correspondant à un emploi à temps plein, égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'État classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la HAS : deux membres désignés par le Président de la République ; deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ; deux membres désignés par le Président du Sénat ; deux membres désignés par le Président du Conseil économique et social. Les membres du collège sont formellement nommés par décret du Président de la République.
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois, comme pour le président. La plupart des membres sont chargés de la présidence d’une commission spécialisée de l’autorité. Certains d’entre eux exercent des fonctions à l’extérieur (président du Conseil de surveillance du Fonds de réserve des retraites ; consultant ou attaché hospitalier ; vice-président d’une commission du Conseil économique, social et environnemental ; président de la Conférence de santé des Pays-de-Loire.
La question de la gestion des éventuels conflits d’intérêt a fait l’objet à la HAS d’une attention particulière. Afin de répondre aux exigences légales et réglementaires en matière de prévention des conflits d’intérêts, la HAS a mis en place, dès 2005, des formulaires de déclaration d’intérêts pour les membres du Collège, les agents et l’ensemble des collaborateurs occasionnels de la HAS.
Les dispositions légales prévoient que la HAS assure la publication des déclarations d’intérêts des membres de ses commissions spécialisées et des experts (article R.161-85 du code de la sécurité sociale). Sont publiées sur le site internet de la HAS les déclarations des membres du Collège et les déclarations des membres des commissions et des experts participant aux groupes de travail de la HAS. La HAS publie, en outre, les déclarations d’intérêts du Directeur et des membres du comité de direction, des responsables des services, missions et unités transversales et des chefs de projet qui participent directement aux missions de la HAS.
En 2006, la HAS a rédigé un Guide des déclarations d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts qui a été actualisé début 2010. Ce guide précise notamment : la nature et les caractéristiques de l’ensemble des intérêts à déclarer pour chaque catégorie de collaborateur ; les modalités de déclaration, traitement, publication et actualisation de ces déclarations; les critères permettant de classer les intérêts déclarés ; la procédure de gestion des conflits.
Parallèlement à la publication de ce guide, la HAS a souhaité s’adjoindre le conseil d’un groupe indépendant dénommé « Déontologie et indépendance de l’expertise ». Composé d’un conseiller d’État, de personnalités issues du monde médical et scientifique, d’un juriste ainsi que d’un membre du Collège de la Haute Autorité, ce groupe a pour fonction d’évaluer en toute indépendance les procédures mises en œuvre, de formuler toute proposition de nature à améliorer les règles déontologiques et de se prononcer- à la demande du Président ou du Directeur- sur des situations individuelles. L’ensemble des actions du groupe « Déontologie et indépendance de l’expertise » fait l’objet d’un compte rendu dans le cadre du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité de Santé.
Depuis sa création, le groupe a élaboré une charte de déontologie, a rédigé plusieurs avis sur des questions particulières posées par le Président du Collège et le Directeur, et a formulé des propositions d’amélioration de la procédure de gestion des conflits d’intérêts, lesquelles ont été reprises dans la version actualisée du Guide des déclarations d’intérêts.
En 2008, le Collège de la HAS a adopté la Charte de déontologie proposée par le Groupe« Déontologie et indépendance de l’expertise », qui détaille les obligations déontologies générales qui s’appliquent à tous, puis celles qui sont spécifiques aux membres du Collège, aux agents et aux experts.
- Indicateurs et performance :
La HAS est incluse dans le programme 171 Offre de soin et qualité du système de santé de la mission Santé. L’indicateur retenu pour mesurer l’objectif d’Amélioration de l’impact de l’évaluation du système de santé est le Taux de levée des conditions mises à la certification par la HAS.
OBJECTIF N° 2 : AMÉLIORER L’IMPACT DE L’ÉVALUATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
L’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système de soins passe en particulier par l’élaboration et la mise en œuvre de recommandations destinées à rendre plus efficaces et plus sûres les pratiques des professionnels de santé. Le législateur a confié cette tâche à la Haute autorité de santé (HAS) en lui attribuant les moyens et les compétences antérieurement dévolues à l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) et en lui conférant la qualité d’autorité publique indépendante.
L’indicateur proposé permet ainsi de mesurer, dans sa globalité, le taux de mise en œuvre des prescriptions obligatoires de la HAS et de donner ainsi la mesure de la réactivité du système de soins à ce qui constitue un ensemble d’évolutions positives pour l’usager.
INDICATEUR 2.1 : TAUX DE LEVÉE DES CONDITIONS MISES À LA CERTIFICATION
PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
(DU POINT DE VUE DU CITOYEN)
(en %)
2007 Réalisation |
2008 Réalisation |
2009 Prévision |
2009 Prévision actualisée |
2010 Prévision |
2011 Cible | |
Taux de levée des conditions mises à la certification par la Haute Autorité de Santé (HAS) |
89 |
83 |
92 |
83 |
85 |
86 |
Source : HAS
Précisions méthodologiques
L’indicateur est disponible sous la forme du ratio suivant : nombre de réserves et réserves majeures ainsi que de mesures de suivi ou conditionnelles levées / nombre total de mesures de suivi des réserves et réserves majeures ainsi que de mesures de suivi ou conditionnelles examinées au cours d’une année civile.
Les rémunérateurs et dénominateur de cet indicateur présentent des chiffres variables d’une année à l’autre. Pour mémoire les chiffres constatés en 2007 et 2008 sont les suivants :
– mesures de suivi examinées : 399 en 2007 et 327 en 2008 ;
– nombre de niveau de certifications levées : 271 en 2007 et 355 en 2008.
Les prévisions faites se traduisent par une augmentation graduelle qui aboutit en année cible aux chiffres moyens des résultats des deux années précédentes.
Le rapport annuel d’activité de la HAS comporte deux indicateurs de performance supplémentaires, annuels :
– délai moyen d’instruction des dossiers de demande d’inscription (73 jours),
– renforcement de l’image et de la notoriété (6 370 visites en moyenne par jour sur le site Internet, + 31 % par rapport à l’année précédente).
Tous les autres indicateurs contenus dans le rapport annuel sont des indicateurs d’activité (nombre de recommandations, de médecins habilités, d’établissements certifiés, etc.).
Le collège arrête chaque année en septembre les orientations budgétaires dans une lettre de cadrage qui constitue la ligne directrice des conférences budgétaires qui ont lieu avec chaque direction au cours du mois d’octobre. Il délibère dans le courant du mois de décembre sur le budget annuel et ses modifications en cours d’année.
La HAS est financée principalement par une dotation de l’assurance maladie, une contribution des établissements de santé et une quote-part de la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments. Elle reçoit également une dotation budgétaire de l’État (6,2 millions d’euros prévus dans la loi de finances pour 2010), d’un montant très variable, en fonction notamment du fonds de roulement de l’organisme.
BUDGET DE LA HAS
(en euros)
Nature des recettes |
Exécution au 31-12-2005 |
Exécution au 31-12-06 |
Exécution au 31-12-2007 |
Exécution au 31-12-2008 |
BP 2009 |
Subvention État |
8 849 790 |
6 111 534 |
958 402 |
2 533 386 |
8 850 160 |
Dotation Assurance maladie |
19 620 913 |
19 299 580 |
2 000 000 |
5 063 818 |
18 826 320 |
Contribution financière des établissements de santé |
9 222 600 |
9 477 591 |
9 537 600 |
8 900 000 |
9 982 600 |
ACOSS : quote-part de la taxe sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques |
21 000 000 |
20 700 000 |
28 801 103 |
17 600 000 |
15 000 000 |
Taxe « transparence » (demande d’inscription, de renouvellement de certains médicaments) et taxe « Commission d’évaluation des produits et prestations » (demandes d’inscription de certains dispositifs médicaux à usage individuel) |
4 243 500 |
4 466 025 |
3 598 350 |
3 005 745 |
3 000 000 |
Produits divers |
352 238 |
1 163 930 |
2 042 034 |
2 201 434 |
1 693 082 |
Total des produits |
63 289 041 |
61 218 660 |
46 937 489 |
39 304 383 |
57 352 162 |
On observe que les ressources de la HAS sont fluctuantes, passant de 63 à 39 millions d’euors, entre 2005 et 2009.
Les dépenses augmentent de 47,3 à 67,2 millions d’euros entre 2005 et 2009 (+ 42,1 % en quatre ans, soit près de 10 % de croissance moyenne par an) :
– + 8,5 millions d’euros pour les dépenses de personnel, soit + 33 % en 4 ans, ou près de 8 % par an ;
– et + 11,5 millions d’euros pour les dépenses de fonctionnement (soit une croissance de 60 % en 4 ans, soit près de 15 % par an.
En 2009, le résultat de l’exercice a fait apparaître un déficit de 7,4 millions d’euros.
Le fonds de roulement est passé d’un maximum de 48,2 millions d’euros en 2006 à 8,8 millions d’euros en 2008, et 4,3 millions d’euros en 2009.
La HAS n’a pas conclu de contrat de performance ou de gestion. Elle s’est dotée d’un projet stratégique triennal (« projet HAS 2009 »).
La HAS employait en 2009 un effectif physique de 432 personnes (410 ETPT). Il se décomposait en 402 contractuels et 30 fonctionnaires. Les effectifs physiques ont cru de 369 à 432 entre 2005 et 2009 (+ 17,1 %). La HAS rémunère également 3 000 experts.
La HAS a indiqué que la rémunération brute annuelle moyenne des personnels de direction se situe autour de 106 000 euros.
Le taux annuel moyen de renouvellement du personnel atteint 6 % (ce taux s’élevant à 11 % et 6,5 % pour deux des quatre catégories de personnels).
Les dépenses de loyer représentent 6,1 des 28,5 millions d’euros de dépenses de fonctionnement (21 %).
Le dépenses de communication ont atteint un maximum en 2008, à hauteur de 5,3 millions euros (soit 8 % du total du budget de la HAS), avec les objets suivants (fixés par l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale) : élaboration et diffusion de guides de bon usage des soins et de recommandations de bonne pratique ; contribution à l’information des professionnels de santé et du grand public dans ces domaines. Les dépenses de communication ont diminué en 2009, pour s’établir à 3,9 millions d’euros.
Les dépenses de frais de déplacement se sont établies à environ 3,5 millions d’euros par an depuis 2006, et les frais de représentation à environ 450 000 euros par an. Ces dépenses concernent tant les déplacements réalisés par les agents de la HAS (14 % du total) que ceux des experts participants aux travaux de la HAS, notamment ses 7 commissions (22 %) et aux 700 à 800 visites de certification des établissements de santé (64 %).
La HAS dispose de 2 véhicules de fonction et de 4 véhicules de service.
La HAS loue des locaux sur deux implantations au 2, avenue du Stade de France à Saint-Denis La Plaine. Le loyer HT hors charges s’élève à 4,3 millions d’euros, soit un ratio de 372 euros le m2, un niveau correspondant à ce qui est pratiqué dans plusieurs arrondissements de Paris intra muros. Les charges s’élèvent à 1 million d’euros, ce qui représente plus de 20 % du loyer et est donc élevé. L’occupation présente un ratio de 14,2 m2 de surface utile nette (SUN) par poste de travail, soit un peu plus que la cible fixée à 12 m2 par le service France Domaine.
IMMOBILIER DE LA HAS
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges (€) |
Loyer HT /m2 | |
HAS |
2, avenue du Stade de France 93218 Saint-Denis La Plaine |
479 |
11 488 |
6 815 |
14,2 |
4 276 173 |
372 |
La HAS indique qu’elle a engagé des démarches en matière de renégociation des loyers. À la date du 29 juillet 2010, et pour la première implantation au 2, avenue du Stade de France, l’état d’avancement de la démarche en cours montre que le propriétaire accepterait de ramener le loyer en 2011 à hauteur de 1 861 000 euros HT et HC, soit 18,6 % en dessous du dernier loyer payé de 2 287 068 euros. Concernant le loyer de la seconde implantation, dite du « Stadium », la variation de l’indice du coût de la construction (INSEE) entraînera une quasi-stabilité en 2011.
Le Comité d’évaluation et de contrôle, lors de la séance où il a décidé de retenir le sujet des AAI, s’est interrogé, à la demande de certains de ses membres issus de la commission des Affaires sociales, sur l’opportunité d’ajouter au champ de l’étude l’AFSSAPS et l’AFSSA, dont la mission n’est pas sans rapport avec celle de l’HAS, mais qui n’ont pas le statut d’autorité indépendante mais de simples établissements publics.
Cette proposition n’a pas été retenue compte tenu du périmètre de l’ensemble des AAI, mais il importe de comparer les missions, le fonctionnement, l’efficacité et le budget de la HAS et de ces différentes agences du domaine sanitaire.
● L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a été créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 instituant un dispositif de veille et de sécurité sanitaire. Elle a été mise en place le 9 mars 1999.
L’AFSSAPS est une composante importante du système de santé publique. Elle a pour mission de garantir la sécurité d’emploi, la qualité et le bon usage des produits de santé. Elle mobilise une équipe de près d’un millier de professionnels. Plus de 2000 experts sont réunis dans des commissions et groupes de travail. Elle possède des laboratoires à Saint-Denis, Lyon et Montpellier. Son budget de fonctionnement est de 109,6 millions d’euros pour 2009.
Toutefois, il s’agit non pas d’une autorité administrative indépendante mais d’un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé (article L. 5311-1 du code de la santé publique). Son président est nommé par décret. Son conseil d'administration est composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'État. Le directeur général est nommé par décret (L. 5322-1).
La HAS a été créée en partie en lui transférant une partie des attributions de l’Affsaps. La logique de répartition des compétences entre la HAS (API) et l’AFSSAPS (établissement public) est la suivante :
– l’AFSSAPS gère l’autorisation de mise sur le marché des produits de santé (mission régalienne de pouvoir de police de l’État), ainsi que la pharmacovigilance ;
– la HAS évalue le service médical des produits de santé à la fois de façon absolue (SMR), mais également de façon relative, au regard de son efficacité en vie réelle, et de façon comparative par rapport aux autres produits ou stratégies thérapeutiques (mission scientifique). Cette évaluation est réalisée en vue du remboursement.
● L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été créée en avril 1999 à la suite de différentes crises sanitaires.
L’AFSSA est chargée d’une mission de veille, d'alerte, d'expertise, de recherche et d'impulsion de la recherche, qui contribue à la protection et à l'amélioration de la santé publique, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et de l'environnement. Elle possède onze laboratoires, sur dix implantations géographiques. Ses effectifs représentent 1 190 personnes ; près de 500 experts sont mobilisés au sein des comités. Son budget est proche de 100 millions d'euros.
Il s’agit également d’un établissement public de l’État, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de la santé (L. 1323-1). Le président de son conseil d’administration est nommé par décret. Outre son président le conseil d’administration est composé pour moitié de représentants de l’État. Le directeur général est nommé par décret (L. 1323-5).
L’ordonnance du 7 janvier 2010 prise en application d’une habilitation législative porte création d'une Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), qui fusionne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).
● L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) était lui aussi un établissement public administratif de l’État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du travail.
Dans le but d’assurer la protection de la santé humaine, l’agence avait pour missions :
- de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement et du travail, en évaluant les risques qu'ils peuvent comporter ;
- de réaliser ou faire procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaire, en prenant appui sur les services et établissements publics ou tout autre organismes compétent ;
- de fournir aux autorités toutes les informations sur les risques sanitaires, et les conseils nécessaires à l'élaboration de dispositions législatives et réglementaires ;
- d'exercer une veille scientifique et de mettre en oeuvre des programmes de recherche dans les domaines de sa compétence ;
- de susciter le débat, à travers l'édition de publications, l'organisation de colloques et la participation à des manifestations didactiques et scientifiques.
Pour l’exercice de ces missions, l’agence exerçait une veille sur l’évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
L’AFSSET était notamment chargée de la coordination de l’expertise pour l’évaluation des risques liés aux produits chimiques. Elle organisait un réseau entre les organismes disposant des capacités d’expertise scientifique dans ses domaines de compétence et travaillait avec près d'une trentaine de partenaires permanents. Elle s'appuyait sur plus de deux cents experts issus d'une centaine d'organismes.
L’Agence a été placée au cœur du dispositif d’information et d’expertise scientifique sur la santé et l’environnement, ainsi que la santé au travail. Elle établissait aussi des relations étroites avec la communauté scientifique française mais également internationale, notamment en Europe. Les avis et les recommandations de l’AFSSET, ainsi que d'autres travaux scientifiques étaient publics et consultables sur le site Internet de l’agence.
À la demande des rapporteurs, la HAS a fourni les éléments suivants décrivant la cartographie des organismes intervenant dans le domaine de la santé publique, qui attestent de la complexité et de l’enchevêtrement des compétences exercées par ces organismes.
CARTOGRAPHIE COMMENTÉE DES COMPÉTENCES DES DIFFÉRENTS ORGANISMES PUBLICS INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ PAR RAPPORT AUX MISSIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
|
MISSION HAS |
THÈME |
ACTION |
FONDEMENT JURIDIQUE |
Zone frontière avec agences sanitaires | |
|
Loi |
Règlement | ||||
1 |
ÉVALUATION DES PRODUITS, ACTES ET PRESTATIONS DE SANTE |
Actes et prestations |
Avis sur le remboursement |
CSS L161-37, 1° |
CSS R161-71, 1° a) |
|
Médicaments |
CSS R161-71, 1° c) |
HCSP : le Comité Technique de la Vaccination (commission du HCSP) statue en amont de la Commission de la Transparence (CT) pour les vaccins à inscrire au remboursement (art L3111-1 CSP) | ||||
Dispositifs médicaux |
CSS R161-71, 1° b) | |||||
Technologies de santé |
Etudes |
CSS L161-37, 1° |
| |||
Ensembles de soins ou catégories de produits ou prestations |
Recommandations sur le bien-fondé du remboursement |
CSS L161-39, al. 1 |
CSS R161-71, 3°,a |
INCA : peut solliciter de la HAS une recommandation de ce type (CSS R161-71, 3°,a) | ||
Modes particuliers de soins curatifs ou préventifs |
Avis sur les projets de lois ou de décrets les instituant |
CSS L161-37, 6° |
|
| ||
|
MISSION HAS |
THEME |
ACTION |
FONDEMENT JURIDIQUE |
Zone frontière avec agences sanitaires | |
|
Loi |
Règlement | ||||
2 |
RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE, |
Général |
Elaboration et diffusion de Recommandations de Bonne Pratique |
CSS L161-37, 2° |
CSS R161-72, 1° |
INCA : informe les professionnels et le public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer (CSP L1415-2, 3°) La HAS élabore ses documents à destination du public et des PS en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés par l'INCA (CSS R161-72, 1°) Agence de la Biomédecine : formule des RBP pour les activités relevant de sa compétence (CSP L1418-1, 1°)
ANESM : valide ou élabore des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles (CASF, L312-8, 1°) |
Produits de santé |
Détermination des domaines nécessitant des recommandations de l'AFSSAPS, et diffusion de ces recommandations |
CSS L161-39, al. 2 |
CSS R161-72, 2° |
AFSSAPS : décisions de bonnes pratiques opposables à la préparation, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments (CSP L5121-5) | ||
Délivrance de l'information aux patients |
Proposition de RBP au ministre santé |
CSS L161-37, 2° |
CSS R161-72, 3° |
| ||
Ostéopathes et chiropracteurs |
RBP |
L. n° 2002-303 art. 75 |
CSS R161-72, 5° |
| ||
Avis sur les projets de décrets |
CSS L161-37, 2° | |||||
Références Médicales Opposables |
Proposition de RM |
CSS L162-12-15, al. 1 |
CSS R161-72, 6° |
AFFSAPS : établit les références médicales susceptibles d'être rendues opposables pour le domaine du médicament (CSS L162-12-15) | ||
RBP accompagnant les RMO |
CSS L162-12-15, al. 3 | |||||
Accords de bon usage des soins |
Avis |
CSS L161-37, 2° |
CSS R161-72, 7° |
| ||
Bon usage des médicaments |
Référentiels de bon usage hors GHS |
CSS L162-22-7 |
CSS D162-9 |
AFSSAPS + INCA : référentiels nationaux de bon usage dans leur domaine respectif (D. n° 2008-1121, annexe, art. 7, al.11) | ||
|
MISSION HAS |
THEME |
ACTION |
FONDEMENT JURIDIQUE |
Zone frontière avec agences sanitaires | |
|
Loi |
Règlement | ||||
3 |
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE |
Liste des ALD |
Avis sur les projets de décrets |
CSS L161-37, 1° |
CSS R161-71, 1°,e |
|
Traitement des ALD |
Recommandations sur les actes et prestations nécessaires |
CSS R161-71, 3°,b |
INCA : définit des référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie (CSP L1415-2, 2°) | |||
Définition des ALD |
Recommandations sur les critères médicaux |
CSS R161-71, 3°,c |
| |||
4 |
ACCREDITATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE |
Qualité des soins et des pratiques professionnelles |
Elaboration et diffusion de Référentiels |
CSS L161-37, 3° |
|
INCA : définit des critères d'agrément des professionnels de santé pratiquant la cancérologie (CSP L1415-2, 2°) |
Procédure d'accréditation |
Définition de la procédure |
CSS R161-73, 1°, a |
| |||
Organismes d'accréditation |
Agrément |
|
CSP D4135-5 |
| ||
Accréditation |
Délivrance des accréditations |
CSS L161-37, 3° |
CSP D4135-1 à -9 |
Les PS accrédités transmettent à la HAS les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables (CSP L4135-1) | ||
5 |
CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE |
Procédure et référentiel de certification |
Décision |
CSS L161-37, 4° |
CSS R161-74 |
ANESM : habilite les organismes d'évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (CASF L312-8) |
Certification des établissements de santé |
Décision de certification |
CSP L6113-3 à -6 |
Décis. HAS 17 déc. 2008 | |||
Certification des hôpitaux des armées |
Décision de certification |
|
CSP R6113-16 | |||
|
MISSION HAS |
THEME |
ACTION |
FONDEMENT JURIDIQUE |
Zone frontière avec agences sanitaires | |
|
Loi |
Règlement | ||||
6 |
EVALUATION QUALITE PRISE EN CHARGE DE LA POPULATION |
Qualité du Développement Professionnel Continu |
Participation à l'évaluation |
CSS L161-40, 1° |
(attente du décret d'application HPST sur le DPC) |
|
Prévention / Education |
Avis sur les projets d'arrêtés fixant des consult. de prév. Et des examens de dépistage |
CSS L161-37, 5° |
|
INPES : en matière de prévention : met en œuvre des programmes + fonction d'expertise + développement de l'éducation + gestion de crise + programmes de formation (CSP L1417-1) InVS : surveille en permanence l'état de santé de la population + veille sur les risques sanitaires + alerte sanitaire en cas de menace + contribution à la gestion de crise sanitaire (CSP L1413-2)
| ||
Evaluation de la qualité des programmes de prévention |
CSS L161-40, 3° |
| ||||
Actes présentant un risque sérieux |
Information du ministre santé |
CSP L1151-1, al. 5 |
CSS R161-70, al. 3 |
| ||
Avis sur les projets d'arrêtés |
| |||||
Infections nosocomiales et événements indésirables graves |
Analyse + propositions de mesures aux autorités sanitaires |
CSS L161-40, 2° |
|
AFFSAPS : met en œuvre les vigilances (CSS L5311-1, al. 23) InVS : participe au recueil et au traitement de données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques (CSP L1413-2, 1°) | ||
7 |
CERTIFICATION DES SITES ET LOGICIELS |
Règles de bonnes pratiques |
RBP (référentiel de certification) |
CSS L161-38 |
CSS R161-75 |
ASIP : est compétente pour l'homologation des logiciels de santé pour assurer leur interopérabilité |
8 |
LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE |
Références des normes harmonisées en vigueur |
Avis aux ministres santé, et industrie |
CSP L1414-5 |
|
|
9 |
PUBLICITE POUR LES PRODUITS DE SANTE |
Publicité diffusée auprès des professionnels de santé |
Saisine de l'AFSSAPS |
CSS L161-39, al. 4 |
|
AFSSAPS |
10 |
EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE |
Recommandations et avis médico-économique |
Saisine Ministérielle, des caisses |
CSS L 161-37 |
|
|
Source : HAS
ESSAI DE CATÉGORISATION DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL SANITAIRE
Sécurité |
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) |
Institut National de Veille Sanitaire (INVS) |
Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) |
Institut de radioprotection et de sécurité Nucléaire (IRSN) |
Agence Nationale de sécurité sanitaire - alimentation, environnement (ANSES issue de la fusion AFSSET et AFSSA) |
Production/stockage approvisionnement/ régulation |
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) |
Établissement Français du Sang (EFS) |
Qualité/Santé publique |
Haute Autorité de santé (HAS) |
Institut national du Cancer (INCA) |
Institut National Pour la Prévention et l'Éducation à la Santé - (INPES) |
Agence Nationale d'Appui pour la Performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (ANAP) |
Agence nationale d'évaluation des établissements médico-sociaux (ANESM) |
Agence de Biomédecine (ABM) |
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) |
Système d'Information |
Agence Technique de l'Information Hospitalière (ATIH) |
Agence des systèmes d'information Partagés de Santé (ASIP) |
Recherche |
Institut national supérieur d'enseignement et de recherche médicale (INSERM) |
Centre national de la recherche Scientifique (CNRS) |
Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) |
Agence Nationale de Recherche (ANR) |
Territoires |
Agences régionales de santé (ARS) |
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA)
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été créé par la loi du 17 janvier 1989. Il a pour mission de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Créée par une loi du 29 juillet 1982, la Haute autorité de la communication audiovisuelle a été la première institution française de régulation de l’audiovisuel. Elle a été remplacée par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) créée par la loi du 30 septembre 1986. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a remplacé cet organisme en 1989.
La création d’une institution de régulation de l’audiovisuel s’est inscrite dans une ligne générale de création d’autorités administratives indépendantes dans des domaines qui concernaient l’exercice de libertés publiques fondamentales ou qui étaient encore régies par un monopole d’État. La loi du 29 juillet 1982 a eu ainsi pour objet d’exprimer la volonté de rompre le lien entre le pouvoir politique et le secteur audiovisuel qui commençait de s’ouvrir à des entreprises privées.
Le rôle du CSA s’est renforcé et enrichi au fil des ans. Le respect de cette diversité implique notamment que les concentrations soient limitées par la loi et soumises au contrôle du CSA et des autorités en charge de la concurrence.
Outre le respect des règles relatives au pluralisme politique sur les antennes et à l’organisation des campagnes électorales radiotélévisées, le CSA exerce une régulation de caractère culturel (dispositifs destinés à assurer la force de l’expression culturelle française : quotas de diffusion imposés aux chaînes, obligations d’investissement des chaînes dans la production audiovisuelle et cinématographique), sociétal (protection de l’enfance, accessibilité des programmes aux personnes handicapées, représentation de la diversité de la société française, contribution à la protection de la santé publique et au développement durable), technologique et économique (préparation et accompagnement des évolutions liées à la généralisation des technologies numériques dans l’audiovisuel).
- Principales caractéristiques :
Le CSA n’est pas doté de la personnalité morale et constitue donc juridiquement un service de l’État.
Du point de vue de sa capacité à agir en justice, le CSA n’est pour autant pas dépourvu de moyens : en particulier, il dispose du pouvoir de saisir le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 1989, a cependant dénié au CSA la qualité de partie poursuivante. Seul le procureur de la République met en mouvement l’action publique et le CSA ne peut intervenir à l’instance sauf à être appelé en qualité d’expert. Pareillement, il ne peut faire appel ou former un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Toutefois, le CSA peut intervenir de manière incidente en demandant au parquet de faire appel si la décision des juges du fond lui semble erronée. Il lui arrive d’intervenir au cours d’une instance par l'intermédiaire de notes au parquet.
Les principaux pouvoirs du CSA sont notamment :
– l’attribution et la gestion des fréquences hertziennes terrestres dont l’usage est ouvert aux services privés de radio et de télévision ;
– la délivrance des autorisations aux services de radio et de télévision privés diffusés par voie hertzienne terrestre ;
– le conventionnement des services de radio et de télévision non hertziens diffusés autrement que par la voie hertzienne terrestre ;
– le contrôle du respect de l’ensemble des obligations incombant aux éditeurs de radio et de télévision (déontologie, publicité, quotas de diffusion, etc.) ;
– la sanction (astreintes) des opérateurs pour d’éventuels manquements à ces obligations ;
– l’organisation des campagnes officielles radiotélévisées prévues pour certaines consultations électorales (élection présidentielle, élections législatives, certaines élections locales, référendum) ;
– le règlement des différends relatifs à la distribution de services de télévision et de radio ;
– l’adoption d’avis au Gouvernement sur les projets de loi et de décret concernant l’audiovisuel ;
– l’avis conforme sur la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, société en charge de l’Audiovisuel extérieur de la France) ;
– la nomination de personnalités indépendantes dans les conseils d’administration de ces sociétés et de l’Institut national de l’audiovisuel.
En outre, le CSA veille au respect du pluralisme politique et syndical sur les antennes, à la protection du jeune public, à l’accessibilité des programmes aux personnes handicapées ainsi qu’à la représentation de la diversité française dans les programmes télévisés. Il est compétent pour l’examen des difficultés éventuelles de réception des téléspectateurs et auditeurs.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ont entraîné d’importantes modifications dans les compétences du CSA. Celui-ci dispose désormais du pouvoir de régler les différends relatifs à la distribution de services de télévision et de radio. Son champ de compétence a été étendu aux radios et télévisions accessibles par Internet ou par ADSL, qui doivent être conventionnées ou déclarées selon le cas.
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision étend la compétence du CSA à la régulation du nouveau secteur des services de médias audiovisuels à la demande (SMAd). Elle lui confie également de nouveaux pouvoirs : le CSA peut consulter l’Autorité de la concurrence, assigner des fréquences aux collectivités territoriales et faire prononcer des astreintes lors d’un règlement de différend. Le CSA doit désormais être consulté sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle.
Le CSA doit rendre compte chaque année au Parlement des actions des chaînes de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et proposer les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes. Il doit veiller, pour les services de médias audiovisuels à la demande, à la mise en œuvre des moyens adaptés pour assurer la protection des mineurs à l’égard des programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement. Dans le cadre de la reforme du secteur public audiovisuel, la loi prévoit que les contrats d’objectifs et de moyens doivent être transmis au CSA préalablement à leur signature.
La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique renforce les pouvoirs du Conseil pour favoriser un développement de la TNT respectant l’équité territoriale.
Le CSA publie un rapport annuel d’activité.
Le président du CSA est désigné par le Président de la République et nommé par décret pour un mandat de six ans non renouvelable.
Des règles régissent les incompatibilités qui s’appliquent au président et aux autres membres du CSA. Les fonctions de membre du CSA sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Les membres du CSA ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du CSA détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Il convient à cet égard de noter que le précédent contrôle de la Cour des comptes avait mis en évidence un important problème de conflit d’intérêts concernent deux membres du conseil.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du CSA sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Le président occupe ses fonctions à temps plein. Sa rémunération annuelle (incluant les primes, indemnités et avantages en nature) s’élève en 2009 à 184 964 euros.
Les membres du collège sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable par décret du Président la République. Trois, dont le président, sont désignés par le Président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale. Les conseillers exercent leurs fonctions à temps plein. En 2009 la rémunération globale (incluant les primes, indemnités et avantages en nature) des conseillers hors président est de 1 million d’euros (rémunération de sept conseillers à hauteur de 127 631 euros brut annuel et rémunération d’un conseiller à hauteur de 129 495 euros brut annuel).
- Indicateurs et performance :
L’activité du CSA est évaluée dans les documents budgétaires accompagnant le PLF à l’aide d’un indicateur unique : Déploiement de la télévision numérique terrestre sur le territoire métropolitain répondant à l’objectif n° 3 Accélérer le déploiement de la TNT du programme 308 Protection des droits et libertés de la mission Direction de l’action du Gouvernement.
INDICATEUR 3.1 : DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN (DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
INDICATEUR DE LA MISSION
Unité |
2007 Réalisation |
2008 Réalisation |
2009 Prévision PAP 2009 |
2009 Prévision actualisée |
2010 Prévision |
2011 Cible | |
Pourcentage de la population ayant accès à la TNT |
% |
85 |
87 |
92 |
89 |
92 |
95 |
Nombre de sites allumés |
Nb |
50 |
170 |
- |
365 |
216 |
714 |
Précisions méthodologiques :
Sous-indicateur 1 : « pourcentage de la population ayant accès à la TNT »
Source de données :
Les données sont fournies par la direction des technologies et la direction administrative et financière du CSA.
Le nombre d’habitants présents susceptibles de recevoir la TNT en mode hertzien est déterminé, par le biais de prédictions de couverture radioélectrique, à l’aide de l’outil de planification Chirplus de la société LS Telcom. Le nombre d’habitant en France métropolitaine est donné par les statistiques de l’INSEE 1999.
Modalités de calcul :
Numérateur : nombre d’habitants susceptibles de recevoir la TNT en mode hertzien.
Dénominateur : nombre d’habitants recensés par l’INSEE (recensement 1999).
Sous-indicateur 2 : « nombre de sites allumés »
Source de données :
Les données fournies par la direction des technologies et la direction administrative et financière du CSA.
Modalités de calcul :
Le nombre de sites allumés permet d’expliquer la plus faible progression apparente, depuis 2008, du pourcentage de population ayant accès à la TNT, celle-ci étant simultanément compensée par une forte croissance du nombre de sites allumés.
De fait, si depuis fin 2007 le réseau principal est quasiment déployé, 112 sites suffisant à couvrir 85 % de la population métropolitaine, plus de 1 500 émetteurs sont nécessaires pour gagner, d’ici à 2011, les 10 % restants pour respecter l’objectif fixé par la loi. Ces émetteurs seront désormais numérisés au rythme du passage au tout numérique des différentes régions. Ainsi, en 2009, la diffusion analogique sera arrêtée dans le Nord Cotentin. En effet, conformément au schéma national d’arrêt de l’analogique et au basculement vers le tout numérique, approuvé par le Premier ministre le 22 décembre 2008, le CSA doit procéder à l’arrêt de la télévision analogique sur le territoire métropolitain. L’échéance, conformément à la loi du 5 mars 2007, est fixée au 30 novembre 2011. C’est donc sur la base du découpage des 24 régions, une région devant être comprise au sens des éditions locales de France 3, que le CSA procèdera à l’extinction de la diffusion analogique des chaînes historiques en clair et cryptées. Il convient toutefois de préciser que la réalisation de ce projet ne dépend pas uniquement des leviers d’actions du Conseil en termes de diffusion et de calendrier, mais également des moyens budgétaires alloués au GIP France Télé Numérique.
Cet indicateur unique ne peut prétendre représenter l’ensemble de l’action du CSA. Le CSA indique à cet égard que le ministre chargé du budget et le responsable du programme 308 ont souhaité limiter le nombre d’indicateurs mesurant la performance du CSA de manière à alléger les tableaux de bord de la LOLF, qui accompagnent le PLF.
Le rapport annuel du CSA contient cependant d’autres indicateurs, comme le nombre d’avis et de décision rendus par le Conseil ou le nombre de services régulés. Mis à part le taux de couverture de la TNT et la notoriété de l’institution (mesurée par le nombre d’appels, de courriers ou d’accès au site Internet), il s’agit de simples indicateurs d’activité et non d’indicateurs de performance.
Le CSA est exclusivement financé sur dotation budgétaire. Il dispose d’un budget opérationnel de programme (BOP) spécifique lui permettant une autonomie de gestion. En l’absence de personnalité morale, il ne dispose pas de fonds de roulement. Le CSA a signé une charte de gestion avec le responsable du programme 308.
Les crédits consommés du CSA sont passés de 33,8 millions d’euros en 2005 à 36 millions d’euros en 2009 (+2,2 millions d’euros, soit 7 % sur 4 ans).
L’augmentation des crédits du CSA provient exclusivement du besoin de financement des missions qui lui ont été nouvellement confiées, tant par la loi du 5 mars 2009 que pour le lancement de la TNT outre-mer dans le cadre d’une accélération du calendrier de déploiement.
Pour 2010, les crédits du CSA augmentent cependant de près de 10 % en une seule année, à raison de :
– de 940 000 euros en titre II (personnels) pour assurer le financement de 10 emplois (ETPT) supplémentaires : 3 pour la régulation des services de médias audiovisuels à la demande et 7 pour l’extension de la télévision numérique terrestre en métropole et outre-mer ;
– de 2,2 millions d’euros en titre III (crédits d’intervention), car ils intègrent en rebasage la dotation complémentaire de 1,2 million d’euros, au titre de la TNT, allouée au CSA en gestion 2009 sur reports de l’année précédente et 1 million d’euros supplémentaire au titre de la TNT outre-mer. Ces crédits ont été intégralement consacrés à la passation de marchés de planification hertzienne, de réalisation de mesures de champ et d’achat de matériels informatiques pour le déploiement de la TNT.
Par ailleurs, les nouvelles compétences du CSA résultant de la loi du 5 mars 2009 ont entraîné des besoins supplémentaires. Notamment, un marché de prestations d’études sur la diversité a été conclu en juin 2009, dont la première tranche n’a pu être engagée qu’à partir de redéploiements, au détriment d’autres projets. Le montant de ce marché s’élève à 280.000 euros.
Le CSA estime que l’évolution de ses missions n’a pas été accompagnée, loin s’en faut, d’une croissance proportionnelle des crédits et des effectifs. Alors qu’il exerçait initialement sa régulation sur un nombre réduit d’opérateurs (notamment moins d’une dizaine de chaînes de télévision), il doit aujourd’hui assurer le suivi de 440 chaînes de télévision et de 900 stations de radio.
Le périmètre de compétence du Conseil s’élargit aussi à plusieurs centaines de nouveaux services : services de vidéo à la demande déjà proposés par les distributeurs de services déclarés (Orange, Neuf Cegetel, Free…) ; services de vidéo à la demande accessibles uniquement sur Internet (Glowria…) ; services audiovisuels proposés sur Internet et qualifiés de services de médias audiovisuels à la demande.
Le plafond d’emplois du CSA est passé de 278 ETPT en 2007 à 293 ETPT en 2010. Le CSA emploie également 16 fonctionnaires titulaires mis à disposition (hors plafond). Comptabilisés en effectifs physiques (chaque personne physique présente au CSA à un moment donné comptant pour un), le CSA emploie 305 contractuels et 16 fonctionnaires.
Le CSA bénéficie du concours d’autres personnels mis à disposition. Il s’agit principalement d’agents employés dans le cadre d’une convention passée avec le ministère de l’Intérieur, pour assurer le secrétariat des seize comités techniques radiophoniques. Sont également mis à disposition un administrateur de l’Assemblée nationale et un administrateur du Sénat ; en application des conventions signées avec les assemblées parlementaires, ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement des rémunérations par le CSA. Le coût global des mises à disposition s’élève pour 2009 à 545 000 euros.
Outre ces collaborateurs permanents, les comités techniques radiophoniques comprennent 112 membres titulaires et suppléants.
La rémunération globale des cinq personnels de direction les mieux rémunérés est de 600 428 euros brut annuel, soit environ 120.000 euros bruts/an en moyenne.
Le taux annuel de renouvellement du personnel est élevé pour les 45 ETPT de la catégorie A+ (13,3 %) et plus de deux fois moindre (5,2 %) pour la catégorie A (sur 152 ETPT).
Les dépenses de communication ont représenté 0,7 % des dépenses de fonctionnement en 2008 et, à titre exceptionnel, 2,6 % en 2009, notamment en raison des dépenses liées aux 20 ans du CSA. Ce taux reviendra en 2010 au niveau de 2008.
Les dépenses relatives aux missions et aux déplacements représentent 3,6 % des dépenses de fonctionnement en 2008 et 2,8 % en 2009.
Le parc automobile est composé de 6 véhicules de fonction, 14 véhicules de service à disposition des attachés techniques régionaux pour les missions d’inspection, 6 véhicules du pool des conducteurs et 4 véhicules de service pour les besoins du département des moyens généraux.
En 2008, les dépenses liées à l’immobilier ont représenté 42,5 % des dépenses de fonctionnement.
Le Conseil loue des locaux dans la Tour Mirabeau 39-43, quai André-Citroën, à Paris. Un bail avait été conclu avec la société DEGI (Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds MBH) le 1er janvier 2006 pour un montant de 3,6 millions euros hors taxes et hors charges, pour une durée classique de trois, six ou neuf années. Un bail complémentaire a été passé à compter du 1er mars 2008 pour un montant de 283 632 euros hors taxes et hors charges. Au 1er janvier 2009, à la suite de la révision de prix et selon l’indice appliqué de l’ICC, le montant du loyer du Conseil s’élève à 4,7 millions d’euros hors taxes et hors charges.
Le loyer s’élève donc à 576 euros HT hors charge par mètre carré. Ce montant est supérieur au loyer moyen (543 euros HT hors charges le m2) constaté dans le « quartier central des affaires » à Paris. Le CSA indique qu’il a entrepris une renégociation de son bail. Les démarches devraient aboutir dans le courant de l’année 2010 à une réduction du montant du loyer qui passerait à 505 euros HT hors charges le m2. Cette mesure serait assortie d’une franchise de loyer correspondant à un mois de loyer par an sur la durée du bail, ainsi que de la réalisation de travaux à la charge du propriétaire. Au total, le montant économique du loyer se situerait alors aux environs de 460 euros HT hors charges le m².
Avec une surface utile nette (SUN) de 7 577 m2 et 321 postes de travail, le ratio d’occupation s’élève à 16,7 m2 par poste de travail, soit nettement au dessus du ratio cible fixé à 12 m2 par le service France Domaine.
IMMOBILIER DU CSA
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT /m2 | |
CSA |
Tour Mirabeau 39-43 quai André Citroën 75739 Paris Cedex 15 |
321 |
7 577 |
5 362 |
16,7 |
4 360 906 |
576 |
- Contrôle de la Cour des comptes
La Cour des comptes a contrôlé le CSA sur les exercices 2000 à 2005 ; son rapport final n’a cependant été délibéré qu’en mars 2008. Les points relevés étaient notamment les suivants :
– une proportion très élevée des crédits ouverts non consommés, dénotant une mauvaise prévision budgétaire : de 11 % à 19 % chaque année ;
– la question de la place du budget du CSA dans l’organisation des missions et des programmes issus de la LOLF, et les incidences sur l’indépendance du CSA de certaines décisions du Gouvernement réduisant ses moyens ;
– la nécessité de développer une comptabilité analytique pour mieux connaître ses coûts ;
– des économies réalisées grâce aux accords passés avec l’INA pour l’enregistrement des émissions surveillées par le CSA et avec l’ANFr pour le traitement des réclamations des téléspectateurs en terme d’accès au signal (auparavant gérées par TDF pour un coût élevé) ;
– l’intégration des personnels de Tdf mis à disposition du CSA en application de la loi, au sein du CSA ;
– l’importance du loyer et son évolution rapide, empêchant toute économie substantielle sur les dépenses de fonctionnement ;
– l’amélioration de la gestion des incompatibilités et des règles déontologiques et d’indépendance s’imposant aux membres du conseil, avec l’adoption en 2003 d’un code de déontologie reprenant en partie les recommandations issues du précédent contrôle de la Cour, mais ne traitant pas certaines questions (incompatibilités après la fin du mandat par exemple, non respectées) ;
– la remise en cause du modèle français d’un régulateur spécifique à l’audiovisuel, en raison de la déspécialisation des réseaux et des gammes de fréquence liée au passage du hertzien au numérique.
COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)
Le texte fondateur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004. L’existence d’une autorité indépendante en charge de la protection des données et de la vie privée est une obligation communautaire en application de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La CNIL a vu ses compétences profondément modifiées par la loi du 6 août 2004 portant transposition de cette directive. Si elle conserve ses anciennes missions d’avis et de conseil, la CNIL dispose désormais, depuis 2004, de nouvelles prérogatives : contrôles sur place, pouvoir de sanction, création et animation du réseau des correspondants informatique et libertés, autorisation des fichiers les plus sensibles mis en œuvre tant par le secteur public que privé. Ces fichiers dits « sensibles » sont énumérés à l’article 25 de la loi et doivent être préalablement autorisés par la CNIL avant leur mise en œuvre en raison des risques qu’ils comportent pour les libertés individuelles et la vie privée. Il s’agit, notamment, des fichiers biométriques, de « profilage » des personnes mis en œuvre par les banques ou les assurances, d’infractions, d’appréciation des difficultés sociales des personnes, des interconnexions.
Ces nouvelles compétences ont accru l’activité de la CNIL dans une proportion considérable bien que parfois méconnue. Ainsi, en 2008, elle a adopté 588 délibérations, contre 68 en 2003, et réalisé 218 contrôles sur place, contre 20 « visites » en 2003. Au 15 décembre 2009, elle avait adopté 700 délibérations, dont 90 % concernaient le secteur privé, et conduit 280 contrôles sur place.
En un domaine aussi technique et évolutif que l’informatique, une autorité nationale spécialisée disposant des compétences nécessaires et d’une capacité d’expertise permanente est en principe en mesure de dégager des règles cohérentes et harmonisées d'application des principes de protection des données personnelles et de les adapter au développement rapide des technologies de l’information. Le fait de disposer d’une autorité de contrôle nationale, assurant, de façon impartiale, le rôle de médiateur et de vigie, permet d'apaiser les craintes éventuelles des citoyens, des consommateurs et des groupes sociaux, et contribue ainsi, dans la transparence, à une diffusion maîtrisée des technologies de l'information dans la société et dans l’administration. Enfin, comme l’a souligné le Conseil Constitutionnel, la désignation d’une autorité administrative indépendante du Gouvernement « constitue une garantie fondamentale pour l’exercice d’une liberté publique ».
Dans l'ensemble des pays qui ont adopté une législation protectrice des données personnelles, outre les pays membres de l’Union européenne pour lesquels c’est une obligation en application de la directive du 24 octobre 1995 (soit plus d’une cinquantaine d’États à ce jour dans le monde), les parlements ont souhaité confier le contrôle de leur application – au premier niveau – à une autorité spécialisée plutôt qu'au juge.
Sur le plan des instruments juridiques internationaux, les lignes directrices des Nations Unies adoptées en ce domaine par l'Assemblée générale en 1990 (résolution n° 45/95 du 14 décembre1990), qui établissent les garanties minimales de protection des droits de l'homme appelées à figurer dans les législations nationales, recommandent la mise en place d'une autorité de contrôle chargée de veiller au respect des principes de protection des données. Il est d’ailleurs précisé qu’elle doit offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance. Sur le plan européen, la directive du 24 octobre 1995 prévoit également l'institution d'une autorité de contrôle qui doit agir « en toute indépendance ». À cette fin, l’autorité doit disposer de pouvoirs de contrôle, d'investigation, d'information et de sanction soumis à un contrôle juridictionnel.
La nécessité d’agir rapidement en cas de dysfonctionnement ou d’usage abusif des fichiers, de divulgation d’informations ou de non respect des droits des personnes, justifie également l’instauration d’une autorité spécialisée indépendante, réactive, habilitée à recevoir les plaintes et dotée de pouvoirs effectifs de contrôle et de sanction.
Les modes de mise en œuvre de l’objectif de régulation et de service à l’usager ont largement évolué, passant d’une logique quasi-exclusive de contrôle a priori des fichiers à une démarche plus globale et diversifiée, combinant à la fois communication et conseil, réglementation et autorisation, contrôle sur place et sanction.
Confier à la CNIL un pouvoir de labellisation a consacré une approche nouvelle de la régulation reposant sur une intervention de la CNIL plus en amont, lors de la phase de conception même des applications, permettant ainsi d’intégrer les principes de protection des données dès ce stade.
Enfin, la promotion d’une approche internationale de la protection des données et de la coopération internationale en ce domaine, rendue indispensable par la révolution technologique mondiale à laquelle nous assistons aujourd’hui, constitue un objectif nouveau et stratégique pour l’institution. Face aux géants américains de l’Internet qui se sentent souvent peu concernés par les lois européennes, il est en effet impératif, pour la CNIL, de contribuer à l’élaboration, au niveau mondial, d’un corpus de principes communs. Il est tout aussi essentiel que la CNIL participe activement aux travaux de normalisation internationale conduits dans le cadre de l’Organisation Internationale de Standardisation (ISO), afin que les normes techniques élaborées dans le domaine des nouvelles technologies intègrent pleinement la protection des données personnelles.
La CNIL n’est pas dotée de la personnalité morale
Elle dispose d’un commissaire du Gouvernement. Désigné par le Premier ministre, il assiste à toutes les délibérations de la Commission ainsi qu’à celles de son bureau délibératif. Il est rendu destinataire de tous les avis et décisions de la Commission. Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale. Il émet des « observations ». Il y a lieu de relever que la CNIL ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l’ordre du jour d’une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance. Ce délai, dont l’inobservation entraînerait la nullité de droit de la délibération, constitue une contrainte qui peut s’avérer d’une particulière rigidité en cas d’urgence, y compris pour le Gouvernement.
Une proposition de loi n° 93 (2009-2010) visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique a été déposée au Sénat le 6 novembre 2009 par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier. Elle a été adoptée, après modifications (contre l’avis du Gouvernement, notamment en ce qui concerne l’élargissement de la compétence de la CNIL à tout numéro identifiant le titulaire d’un accès à internet, la publication des avis de la CNIL sur les projets de fichiers, l’obligation de mentionner les modalités de traçabilité des consultations, …) le 23 mars dernier puis transmise à l’Assemblée nationale le lendemain sous le numéro 2387.
- Principales caractéristiques :
La CNIL a vu ses pouvoirs, d’une part, élargis et, d’autre part, orientés vers le contrôle a posteriori :
● L’autorisation préalable des fichiers à risques
À la différence de la loi de 1978, celle d’août 2004 dote la CNIL d’une compétence étendue à l’égard du secteur privé dont certains fichiers, les plus sensibles tels que définis par la loi (la biométrie, le « profiling commercial », les « listes noires ») doivent être autorisés préalablement à leur mise en œuvre (article 25 de la loi). Ainsi, en 2003, dernière année d’application de la loi initiale de 1978, la CNIL a adopté 68 délibérations qui, pour 90 % d’entre elles, concernaient le secteur public. En 2008, la CNIL a adopté 588 délibérations et 700 au 15 décembre 2009 (soit dix fois plus) ; 90 % d’entre elles s’adressent au secteur privé.
À défaut d’une décision expresse de la CNIL dans les deux mois, le fichier n’est pas autorisé et le non-respect de ce refus est passible de lourdes sanctions pénales (5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende). La célérité de la réaction de la CNIL est donc un élément de la sécurité juridique des entreprises et, partant, de leur compétitivité. Or, la CNIL reçoit, en moyenne, près de 2 000 demandes d’autorisation par an. Selon la CNIL, elle n’est pas en mesure de les traiter dans les délais prévus par la loi.
Quant aux fichiers « non sensibles », les entreprises et les administrations qui les mettent en œuvre doivent simplement les déclarer à la CNIL ; ils sont au nombre de 75 000 chaque année. En contrepartie de ces obligations incombant aux entreprises ou aux administrations, la CNIL tient à la disposition de toute personne qui le demande la liste des fichiers déclarés ou autorisés.
● Les contrôles a priori et a posteriori
La loi initiale de 1978 avait doté la CNIL d’un pouvoir de contrôle a priori des projets de fichiers se traduisant par l’adoption d’« avis » publié au Journal Officiel. Toutefois, la loi d’août 2004 procède à une inversion des modalités de ce contrôle qui s’exerce désormais majoritairement a posteriori, sur place et sur pièces, et peut donner lieu au prononcé de sanctions qui n’existaient pas auparavant.
S’agissant des contrôles, ils peuvent intervenir dans tout local professionnel aux horaires des perquisitions judiciaires (6 heures à 21 heures) ; le fait de s’y opposer constitue un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Leur nombre est passé de 30 en 2004 à 218 en 2008 et 280 en 2009 (plus de neuf fois plus). La CNIL a reçu 4 500 plaintes en 2008. Cet effort doit donc être poursuivi et amplifié car ces contrôles se concentrent encore trop sur la région parisienne, faute de moyens.
● Le pouvoir de sanction
Les sanctions que la CNIL peut prononcer, généralement à la suite des constats opérés lors des contrôles, consistent en la suppression de données, l’injonction de cesser le traitement, l’avertissement ou le prononcé d’une amende pouvant atteindre 300 000 euros. L’ensemble de ces mesures sont susceptibles de faire l’objet d’une publicité et d’un recours devant le Conseil d’État.
Ce faisant, la loi a conféré à la CNIL une fonction juridictionnelle, reconnue officiellement par le Conseil d’État dans son ordonnance du 19 février 2008, qui la considère comme un « tribunal » au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La CNIL met en œuvre une procédure contradictoire publique dans le cadre de laquelle interviennent souvent des avocats, pour respecter des délais de signification aux parties, motiver ses décisions comme des jugements et savoir défendre lesdites décisions lorsqu’elles font l’objet d’un recours.
Activité contentieuse de la CNIL : en 2004 elle n’a examiné aucune procédure puis 31 en 2005 pour atteindre 140 en 2008 et 180 procédures en 2009 soit quasiment une multiplication par six entre 2005 et 2009. On observera cependant à cet égard que le rythme de progression du nombre de procédures de sanctions est près de deux fois inférieur à celui des contrôles, ce qui peut résulter de diverses causes : effet dissuasif des contrôles, « ciblage » des contrôles non homogène dans le temps ou moins efficace, …
● Une mission pédagogique d’information
La CNIL a développé un réseau de correspondants informatique et libertés (CIL) dans le cadre de sa mission générale d’information.
L’expérience montre que la présence du CIL dans une structure contribue à l’amélioration des relations tant avec le personnel de l’entreprise qu’avec le réseau de la clientèle. Le fait de désigner un CIL a pour contrepartie et avantage de dispenser l’organisme de toute déclaration de ses fichiers auprès de la CNIL, qui mène une politique de développement dynamique des CIL dans l’ensemble des secteurs d’activité (collectivités publiques, entreprises, banques…) : plus de 4000 organismes ont désigné un CIL en 2008, 5 000 en 2009, contre 50 en 2005.
La CNIL organise régulièrement, à son siège parisien, des formations (gratuites) ayant trait aux principes fondamentaux de la protection des données, ou à des sujets spécifiques pour des publics spécialisés (santé ; biométrie ; ressources humaines ; etc.).
La CNIL développe une politique active d’information et de conseil, en amont, auprès des entreprises, des administrations publiques, des usagers afin que les contrevenants ne puissent exciper de leur méconnaissance de la loi et que les victimes d’abus sachent mieux se défendre.
Or la CNIL estime que, limitée par un budget de 217 200 euros en 2009, sa politique de communication est insuffisante. À titre de comparaison, celui du Royaume-uni est de 3 millions d’euros. Selon un sondage, réalisé chaque année depuis 2004, si 50 % des personnes interrogées déclarent connaître la CNIL, contre 39 % en 2006, seules 26 % d’entre elles ont le sentiment d’être suffisamment informées sur leurs droits.
● La labellisation de produits innovants développés par les entreprises
La loi du 12 mai 2009 de simplification du droit donne à la CNIL les instruments juridiques lui permettant de mettre en œuvre le pouvoir de labellisation, introduit par la loi de 2004, mais qui était resté lettre morte faute de texte d’application. La CNIL peut délivrer un « label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard des traitements de données », ce qui permet de garantir le respect de la vie privée et des données personnelles.
● Le conseil et le contrôle des fichiers de police
Au-delà de ces nouvelles missions introduites en 2004, la CNIL a conservé toutes celles prévues par la loi initiale de 1978. Deux principales doivent être rappelées : celle de conseil des pouvoirs publics qui la conduit à émettre des avis sur les projets de loi ou les actes réglementaires créant des fichiers (Hadopi, LOPPSI, EDVIGE etc.), celle de contrôle des fichiers de souveraineté.
La loi prévoit que les personnes désireuses de connaître les informations les concernant détenues par les services de police ou de gendarmerie doivent s’adresser à la CNIL qui désigne l’un de ses membres, nécessairement magistrat, pour procéder aux investigations nécessaires. Ce droit d’accès aux données est qualifié d’indirect (DAI), puisqu’il passe obligatoirement par l’intermédiaire de la CNIL, à la différence du droit d’accès « direct », applicable aux autres fichiers, par exemple commerciaux.
Or, afin de renforcer la sécurité intérieure, notamment celle des aéroports et des zones « sensibles », les lois du 16 novembre 2001 et 18 mars 2003 ont prévu que, pour le recrutement ou le maintien en poste dans certaines fonctions (policiers, magistrats, agents des douanes, gardiens privés, bagagiste etc.), les préfets peuvent, préalablement à l’agrément du candidat, consulter des fichiers de police et de gendarmerie (fichiers STIC et JUDEX). Au total, près d’un million d’emplois sont désormais concernés par cette procédure. Ces vérifications sont devenues d’autant plus importantes que le caractère erroné des données contenues dans ces fichiers peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes licenciées, ou non recrutées, sur leur fondement. Compte tenu de ces enjeux, la rapidité d’instruction des demandes par les services compétents, tant de la CNIL que des ministères, est primordiale. La CNIL regrette à cet égard le sous dimensionnement de ses moyens.
Auparavant destinataire d’environ 400 demandes par an (avant 2001), la CNIL a été saisie de 1 600 demandes de DAI en 2006 et de 2 516 en 2008. Compte tenu de ses moyens, les services de la CNIL sont en mesure de clôturer environ 1 500 dossiers par an. Dès lors, le stock des demandes non traitées ne fait que croître, ce qui la place, tout comme les services du ministère de l’Intérieur et les Parquets, dans une situation délicate vis-à-vis des requérants.
● La veille et l’alerte
Le développement des « RFID » (identification par radiofréquence), demain des nanotechnologies, peuvent faciliter techniquement le « traçage » géographique des personnes. La CNIL s’est dotée, depuis 2006, d’un service d’expertise composé d’ingénieurs de haut niveau capables d’identifier les nouveaux développements technologiques, leurs avancées mais aussi leurs risques en matière informatique et libertés. Elle mène à ce titre des actions au niveau international puisque l’internationalisation de l’action de la CNIL est à l’image de celle de l’économie et des réseaux numériques. Nombre des problématiques abordées aujourd’hui par la CNIL impliquent des négociations avec des partenaires américains, européens et bientôt asiatiques. Qu’il s’agisse, notamment, des questions relatives aux moteurs de recherche et à la conservation des données à laquelle ils procèdent (le « droit à l’oubli »), aux réseaux sociaux et au « profilage des personnes » qu’ils mettent en œuvre, à la protection des données des passagers aériens (PNR), toutes exigent une présence internationale, des négociations nombreuses, tantôt directement, tantôt sous l’égide de l’Union européenne. Ainsi le président de la CNIL préside-t-il actuellement le « G29 », groupement des homologues européens de la CNIL.
La CNIL publie un rapport annuel d’activités. Ainsi dans son dernier rapport annuel (2008), la CNIL indique avoir reçu 4 244 plaintes pour non respect de la loi informatique et libertés (25 % commerce, 25 % banque-crédit, 15 % travail, 15 % opérateurs télécoms, 10 % éducation et 10 % divers). La même année, la CNIL a reçu 2 516 demandes de droit d’accès indirect (DAI) aux fichiers de police ; sur cette base, elle a effectué 87 missions d’investigation (67 au ministère de l’Intérieur et 20 au ministère de la Défense). Elle a enregistré 5 303 signalements (dispositif Internet permettant à toute personne de témoigner d’un problème rencontré et d’alerter la CNIL).
La CNIL a reçu 24 225 courriers en 2008, soit 13 % d’augmentation par rapport à l’année antérieure. Elle indique répondre dans le délai moyen de 15 jours pour les « demandes simples ou récurrentes ». La CNIL a reçu environ 115 000 appels téléphoniques. Elle a reçu 71 990 déclarations de fichiers.
La CNIL a effectué 218 missions de contrôle en 2008 (+ 33 % par rapport à 2007). Sa formation contentieuse a engagé 126 procédures de sanctions (101 en 2007). La CNIL indique, sans citer de chiffres, que la grande majorité des organismes destinataires de mises en demeure se conforment à ses demandes dans un délai très bref. Deux décisions prises par la formation contentieuse de la CNIL ont été déférées devant le Conseil d’État, qui les a rejetées (société Profil-France spécialisée dans le traitement de recherche de débiteurs et société Directannonces de « piges » immobilières).
ACTIVITÉ DE LA CNIL
2003 ou 2004* |
2008 |
2009 (au 15 décembre) | |
Nombre de délibérations adoptées par la CNIL |
68 |
588 |
700 |
Nombre de contrôles |
30 |
218 |
280 |
Nombre de procédures de sanctions engagées |
** 31 |
140 |
180 |
Nombre d’organismes ayant désigné un CIL |
*** 50 |
4 000 |
5 000 |
Nombre de demandes de vérification des fichiers de police (DAI) |
1 163 |
2 516 |
n.c. |
Nombre d’agents |
80 |
120 |
132 |
* Pour les nouvelles compétences introduites par la loi du 6 août 2004.
** En décembre 2005, car le décret d’application précisant les modalités de la procédure de sanction est intervenu le 20 octobre.
*** En décembre 2005, car le décret d’application précisant les modalités de désignation des CIL est intervenu le 20 octobre 2005.
Le collège de la CNIL comporte 17 commissaires : 4 parlementaires (2 députés, 2 sénateurs) ; 2 membres du Conseil économique et social ; 6 représentants des hautes juridictions (2 conseillers d’État, 2 conseillers à la Cour de cassation, 2 conseillers à la Cour des comptes) ; 5 personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale (1 personnalité), le Président du Sénat (1 personnalité), le conseil des ministres (3 personnalités). Le mandat des commissaires est de 5 ans ou, pour les parlementaires, d’une durée égale à leur mandat électif. Il est renouvelable une fois.
Le Président de la CNIL est élu par ses pairs, et non pas nommé. M. Alex Türk, sénateur, a été élu Président en février 2004. Il siège pour la « durée de son mandat à l’origine de sa désignation », en l’espèce jusqu’au mois de septembre 2011.
La loi détermine les incompatibilités de tous les membres de la CNIL sans distinguer celles applicables au président : « aucun membre de la commission ne peut : - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat, - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. »
Le Président bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 3 246,85 euros, qui s’ajoute à sa rémunération en tant que parlementaire. Il ne bénéficie d’aucun avantage en nature. Les vice-présidents et autres membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire de séance. Son montant est demeuré inchangé depuis 1999 à 180 euros. En outre, les réunions de travail, dans une limité maximale annuelle de 20, sont indemnisées à hauteur de 65 euros. Ce montant est également inchangé depuis 1999.
Les vice-présidents et autres membres du collège perçoivent « des vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le Président en fonction du temps nécessaire à sa préparation ». Le taux unitaire de la vacation est demeuré inchangé depuis 1999 à 22,11 euros. Compte tenu de l’augmentation considérable du nombre de délibérations, donc du nombre de rapport (+ 929 % en 5 ans), l’application mécanique des barèmes des vacations aurait dû conduire à une augmentation symétrique du montant total des vacations. Le Président a décidé de modifier les modalités de calcul des vacations ; les nouvelles modalités ont conduit à rationaliser et simplifier les barèmes en identifiant trois catégories de rapport : les complexes, les simples et ceux adoptés sans débat. Pour ces trois catégories, les montants perçus ont été réduits respectivement de 17 %, 36 % et 60 %. Le budget global des indemnités versées aux commissaires a connu en quatre ans une hausse, certes significative (+ 37 %), mais sans commune mesure avec celle de l’activité de la CNIL.
- Indicateurs et performance :
La CNIL a choisi comme seul indicateur de son activité dans les documents budgétaires de la loi de finances le pourcentage de citoyens qui s’estiment suffisamment informés de leurs droits en matière de protection des informations personnelles les concernant.
Cet indicateur figurant dans le programme 308 Protection des droits et libertés fait l’objet d’une évaluation annuelle, en décembre, dans le cadre de la réalisation, par IFOP, d’un sondage auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française.
OBJECTIF N° 4 : ECLAIRER LE CITOYEN SUR LA DÉFENSE DES DROITS ET LIBERTÉS
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, a pour mission de veiller au respect des principes généraux énoncés par cette loi : l’informatique doit être au service du citoyen et ne porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. L’indicateur retenu pour caractériser sa performance a été jugé comme le plus synthétique et le plus juste au regard des missions de la CNIL, car il permet de mesurer la perception de leurs droits par les citoyens.
INDICATEUR 4.1 : POURCENTAGE DE CITOYENS QUI S’ESTIMENT SUFFISAMMENT INFORMÉS DE LEURS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION
DES INFORMATIONS PERSONNELLES LES CONCERNANT
(DU POINT DE VUE DU CITOYEN)
(en %)
2007 Réalisation |
2008 Réalisation |
2009 Prévision PAP 2009 |
2009 Prévision actualisée |
2010 Prévision |
2011 Cible | |
Pourcentage de citoyens qui s’estiment suffisamment informés de leurs droits en matière de protection des informations personnelles les concernant |
26 |
33 |
28 |
28 |
29 |
30 |
Précisions méthodologiques :
Source de données :
Les données sont fournies par la direction des ressources humaines, financières et informatiques de la CNIL, à partir d’une enquête réalisée chaque année par TNS SOFRES et portant sur la perception et l’image de la CNIL.
Modalités de calcul :
Cet indicateur donne le pourcentage de citoyens, sur un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population française, ayant répondu « oui tout à fait » ou « oui plutôt » à la question : « vous-même, avez-vous le sentiment d’être suffisamment informé à propos de vos droits en matière de protection des informations personnelles vous concernant ? »
En 2007, 26 % de la population s’estimait suffisamment informée ; pourcentage qui a monté à 33 % en 2008, et 37 % en 2009. La prévision pour 2010 était fixée à 29 %, pour une cible de 30 % en 2011. Ce sondage pose également la question de la notoriété de la CNIL, ainsi qu’une question ouverte différant chaque année. La précision de la mesure fournie par un tel sondage n’est cependant pas précisée.
La CNIL a mis en place de façon interne des indicateurs complémentaires tels que le taux de satisfaction des usagers mesuré par enquête (la première ayant été réalisée en 2009), le nombre de dossiers traités par an et par agent et les délais observés, ou encore le nombre de contrôles effectués dans l’année (indicateur d’activité). Ces indicateurs ne figurent malheureusement pas dans le rapport d’activité annuel de la CNIL.
Les ressources de la CNIL proviennent exclusivement du programme 308 Protection des droits et des libertés conduit par les services du Premier Ministre. Afin de définir et d’organiser son fonctionnement, une charte de gestion précisant les règles de pilotage du programme a été établie dans le respect des spécificités des autorités administratives indépendantes rattachées. La CNIL ne dispose pas de fonds de roulement propre. Elle n’a pas à ce jour conclu de contrat de performance ou de gestion avec l’État.
Les crédits consommés ont augmenté de 7,3 à 12,5 millions d’euros entre 2005 et 2009 (+ 71 % en quatre ans).
La CNIL a effectué un effort de maîtrise du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Ainsi le taux de GVT positif est passé de 6 % en 2006 à 2,6 % au titre des prévisions 2010. Ces résultats ont été obtenus alors même qu’a été mise en place une prime de performance dont le montant global est passé de 33 875 euros charges comprises en 2007 (première année de distribution) à 105 344 euros en 2009.
La CNIL note que sa politique d’achats a été profondément modernisée et sécurisée juridiquement. Fin 2006, la direction de la CNIL a décidé de se mettre définitivement en conformité avec la législation sur les marchés publics en vigueur en vue, notamment, d’assurer la sécurité juridique de son président, afin de remédier à l’absence de mise en concurrence qui prévalait (le volume financier de ses achats hors marché était de l’ordre de 400 000 euros chaque année). Cette formalisation s’est révélée génératrice d’économies substantielles : environ 150 000 euros par an sur l’ensemble des dépenses relatives au nettoyage des locaux, à la location maintenance de photocopieurs, aux déplacements des agents ou aux acquisitions de matériels informatiques.
Les effectifs physiques ont augmenté de 92 à 144 entre 2005 et 2009 (+ 56,5 % en quatre ans). Les ETPT ont augmenté de 85 à 126 sur la même période (+ 48,2).
En 2008 les contractuels étaient au nombre (effectifs physiques) de 132 (91,7 %) et les fonctionnaires de 12 (8,3 %), 4 mis à disposition et 8 détachés.
En 2009 le taux de renouvellement du personnel s’établissait à 8,3 %.
La CNIL fait remarquer qu’elle emploie moins d’effectifs que ses homologues britannique (260) et allemand (400), mais aussi espagnol (160).
Les dépenses réalisées par la CNIL en 2009 au titre du loyer acquitté pour les locaux occupés se portent à 1 975 000 euros TTC plus 165 350 euros pour les charges afférentes, soit un montant total de 2 140 350 euros, ce qui représente 44 % du budget de fonctionnement. Les dépenses de loyer ont ainsi augmenté de 814 000 à 2,1 millions d’euros entre 2005 et 2009 (+ 157 % en quatre ans).
IMMOBILIER DE LA CNIL
(en euros et m2)
Adresse |
Nombre de postes de travail |
Surface globale brute (m2) |
Surface utile nette (m2) |
SUN/ poste |
Loyer HT hors charges |
Loyer HT /m2 | |
CNIL |
8, rue Vivienne 75001 Paris |
153 |
2 789 |
1 752 |
11,5 |
1 650 084 |
592 |
Le loyer HT hors charges rapporté à la surface globale s’établit à 592 euros par m2. Il est supérieur au prix moyen constaté dans le « quartier central des affaires » autour du 8e arrondissement (543 euros le m2).
La surface utile nette (SUN) occupée par poste de travail se situe légèrement en dessous de la cible de 12 m2 par agent fixée par le service France Domaine.
Les dépenses de communication ont été en 2009 de 217 200 euros, soit l’équivalent de 4,48 % du budget de fonctionnement. La CNIL relève que son homologue britannique dispose d’un budget de communication 30 fois supérieur.
Les dépenses de déplacement (avions et trains), d’hébergement et de location de véhicules ont représenté 235 000 euros en 2009. La part des déplacements représente donc 4,85 % du budget dédié au fonctionnement. Ce montant ne tient pas compte des dépenses liées à l’utilisation du parc automobile de la CNIL composé actuellement de quatre véhicules dont le coût n’est pas chiffré.
COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ (CNDS)
- Origine :
La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été créée par la loi du 6 juin 2000. Sa création est la résultante de deux évolutions.
- D’une part, sur le plan national, la sécurité est une exigence de plus en plus revendiquée par les citoyens. Aux problèmes habituels de maintien de l’ordre et de garantie de la sécurité sur la voie publique se sont jointes des préoccupations croissantes quant à la sécurité dans les transports publics, quant à la maîtrise de certaines situations spécifiques telles que les contrôles des immigrants aux frontières ou celui de la population carcérale et, bien sûr, quant à la lutte contre la menace terroriste. En outre, cette demande accrue de sécurité conduit à ce que les diverses fonctions de sécurité – surveillance, contrôle, prévention, répression – traditionnellement exercées par les forces publiques, soient davantage déléguées à des personnes ou institutions privées. La variété des situations auxquelles s’applique la demande de sécurité ainsi que la variété des professionnels chargés d’y répondre exigeait qu’un socle commun de règles déontologiques à toutes ces professions soit défini et respecté. La CNDS entend répondre à cette attente.
Une des évolutions du droit public contemporain conduit à la création d’autorités administratives indépendantes dans les activités où une instance arbitrale indépendante peut concourir à la qualité des relations entre l’État et les citoyens. Le législateur a voulu inscrire le domaine de la sécurité dans cette évolution du droit moderne. Il s’agit, par l’indépendance de cette Commission et la transparence de ses procédures de contrôle, de renforcer la confiance des citoyens envers les acteurs professionnels de la sécurité. Partant du principe que « le respect s’obtient par des comportements respectables », l’objectif de la Commission est également de renforcer l’autorité des forces de sécurité en veillant à ce qu’elles ne se départissent, en aucune circonstance, d’un comportement fidèle aux règles déontologiques.
- D’autre part, sur le plan international, la France s’inscrit dans une dynamique qui a vu se développer plusieurs organismes indépendants de contrôle tels que le Comité européen pour la prévention de la torture, le Commissaire européen aux droits de l’Homme ou le Comité contre la torture des Nations Unies, dont le rôle est unanimement salué et qui disposent de pouvoirs de contrôle et de visite dans les lieux où des personnes sont privées de liberté. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de Strasbourg, par sa jurisprudence, apporte également une contribution remarquée au respect des libertés fondamentales par les services chargés de la sécurité. La création de la CNDS répondait aux mêmes préoccupations.
- Principales caractéristiques :
Aucun texte ne confère expressément la personnalité morale à la CNDS.
La CNDS, sur chaque dossier dont elle est saisie, rend, après l’étude des faits allégués, un avis, éventuellement assorti de recommandations, visant à remédier aux manquements à la déontologie qui ont pu être constatés ou à en prévenir le renouvellement. Cet avis est adressé aux ministres de tutelle ou dirigeants des entreprises de sécurité privée concernés. Ceux-ci sont tenus, lorsque la Commission le demande, de lui rendre compte des suites qui y auront été données. En l’absence de réponse ou si, au vu du compte-rendu qui lui a été communiqué, la CNDS estime que ses recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle établit un rapport spécial publié au JO.
Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Commission saisit les autorités ou personnes investies du pouvoir disciplinaire, afin qu’elles envisagent des poursuites. Elle ne dispose pas d’un pouvoir propre de sanction. De même, elle porte à la connaissance du procureur de la République les faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale.
La Commission peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Elle remet au Président de la République et au Parlement un rapport annuel sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui est rendu public.
- Activité :
La CNDS est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Chaque saisine fait l’objet d’investigations par un binôme membre/rapporteur adjoint qui procède :
– à des demandes de pièces aux différentes autorités concernées, notamment les parquets et les autorités administratives ;
– aux auditions des plaignants, des témoins, des mis en cause et éventuellement d’experts ;
– à des vérifications dans les locaux où les faits ses sont déroulés.
A l’issue de ces investigations, le binôme rédige un projet d’avis qui est soumis à l’ensemble des membres de la Commission qui se réunissent une fois par mois.
La CNDS fait état d’une augmentation importante du nombre des saisines : 19 en 2001, 152 en 2008, 228 en 2009 (augmentation de 50 % en un an). Ses membres ont procédé à 473 auditions (451 en 2008) et effectué 22 déplacements, dont un outremer, à l’occasion desquels ils ont visité une quinzaine de centres de rétention.
Dans son rapport annuel pour 2009, la CNDS « avance plusieurs hypothèses pour expliquer cette augmentation : la notoriété grandissante de la Commission, la médiatisation de certaines affaires rendant d’autant plus visibles les activités de sécurité, la confiance des parlementaires et des autorités administratives auteurs de saisines, combinée à une contestation croissante des citoyens confrontés à des personnes exerçant une mission de sécurité, enfin la possibilité ouverte à certaines autorités administratives indépendantes de saisir la CNDS : le Défenseur des enfants depuis 2003, le Médiateur de la République et le Président de la HALDE depuis 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté depuis 2008.
L’analyse consistant à faire un parallèle entre l’augmentation du nombre de saisines de la Commission et l’augmentation hypothétique des manquements à la déontologie par les personnes exerçant une mission de sécurité n’est pas vérifiable, au regard du nombre de saisines qui reste faible par rapport au nombre d’interventions pouvant appeler un contrôle de la CNDS. »
La CNDS a rendu au cours de l’année 2009 plus d’avis qu’en 2008 (153 avis contre 147). Ces 153 dossiers ont donné lieu à :
- 120 avis avec ou sans recommandations, dont 78 avis (65 %) dans lesquels la Commission a constaté un ou plusieurs manquements à la déontologie et 42 (35 %) pour lesquels aucun manquement n’a été constaté ;
- 33 décisions d’irrecevabilité (classement sans suite, hors délai, hors compétence).
La Commission a transmis, afin qu’ils envisagent des poursuites disciplinaires, 26 de ses avis aux ministres de tutelle et 18 avis pour que les agents mis en cause reçoivent des lettres d’observations. De même, elle a transmis 18 de ses dossiers aux procureurs généraux, compétents en matière disciplinaire pour les actes de police judiciaire exercés par les officiers de police judiciaire. La CNDS a saisi les procureurs de la République dans 4 de ses affaires, afin que ceux-ci envisagent l’opportunité de poursuites pénales. Elle a saisi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 de 15 dossiers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés de 2 affaires et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sur 1 dossier.
- Composition :
La Commission nationale de déontologie de la sécurité est composée de quatorze membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable :
– le président, nommé par décret du Président de la République ;
– deux sénateurs, désignés par le président de Sénat ;
– deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
– un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
– un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général de ladite cour ;
– un conseiller maître, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
– six personnalités qualifiées désignées par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Par dérogation au premier alinéa, le mandat de ce dernier est renouvelable lorsqu'il a commencé moins de deux ans avant son échéance normale.
Un commissaire du Gouvernement siège à la CNDS. Il a pris ses fonctions en septembre 2007. Il est présent à chaque réunion mensuelle de la CNDS et présente systématiquement l’analyse de l’administration concernée par chaque projet d’avis. Il n’a pas voix délibérative.
Un même régime d’incompatibilité régit le Président et les autres membres de la CNDS. Les modalités d’exercice du mandat du Président ne sont pas précisées par son statut. En l’état, il s’agit d’un emploi à temps plein. Sa rémunération nette est de 2 702,37 euros par mois.
Les parlementaires membres de la CNDS ne sont pas rémunérés. La rémunération des autres membres de la CNDS est 300 euros par mois, plus une prime de dossier de 100 euros par dossier, dès lors que plus de deux auditions ont été réalisées.
- Indicateurs et performance :
Le budget de la CNDS fait partie du programme budgétaire 308 Protection des droits et libertés. L’indicateur retenu dans les documents annexés au projet de loi de finances est le délai moyen de traitement des saisines.
D’après le rapport annuel de performance sur la gestion 2009 de la mission Direction de l’action du Gouvernement, publié en mai 2010, le délai moyen de traitement des dossiers par la CNDS était de 11 mois et demi en 2007 et de 12 mois en 2008. Seules sont indiquées une prévision de 11 mois en 2009, une prévision de 10 mois en 2010 et une cible de 9 mois en 2011. Dans ce rapport, la CNDS ne fournit malheureusement pas de statistique sur le délai moyen d’instruction de ses dossiers en 2009.
Rapport annuel de performances pour 2009 (actualisation en mai 2010) du programme (n° 308) Protection des droits et libertés :
Objectif Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
S’agissant de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), chaque dossier qui lui est soumis comprend une enquête au cours de laquelle, suivant les nécessités, la CNDS peut demander des pièces de procédure au parquet, une enquête aux inspections internes ou tout autre document. L’instruction d’un dossier entraîne des auditions du plaignant ainsi que de toute personne, agent exerçant des activités de sécurité ou autre, dont le témoignage paraît nécessaire. Cette procédure peut engendrer des délais que la CNDS ne peut totalement maîtriser. Toutefois, l’indicateur destiné à mesurer sa performance est bien envisagé sous l’angle des délais d’instruction des dossiers et se montre donc tout naturellement tourné vers l’usager, c'est-à-dire la victime ou le témoin de ce qui semble constituer un manquement à la déontologie des forces de sécurité.
INDICATEUR 1.2 : DÉLAI MOYEN D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
(DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
Unité |
2006 Réalisation |
2007 Réalisation |
2008 Prévision PAP 2008 |
2008 Prévision actualisée |
2009 Prévision |
2010 Cible | |
Délai moyen d’instruction des dossiers par la CNDS |
mois |
- |
11,5 |
- |
13 |
11 |
9 |
Délai moyen d’instruction des demandes d’interception adressées en urgence absolue à la CNCIS |
minutes |
- |
30 |
- |
25 |
< 60 |
< 60 |
Précisions méthodologiques :
Sous-indicateur 1 : « délai moyen d’instruction des dossiers par la CNDS »
Source de données :
Les données sont fournies par la secrétaire générale de la CNDS.
En raison d’un engorgement des dossiers réceptionnés en 2005 et en 2006 alors que la commission ne disposait pas de moyens humains suffisants, il convient de noter que la durée moyenne de traitement n’a pas encore atteint le délai souhaitable. Le nombre de dossiers traités en 2007 et en 2008 est en augmentation. L’objectif d’une plus grande célérité sera bientôt atteint.
Modalités de calcul :
Le nombre de mois est calculé par différence entre la date de réception du dossier et la date de l’adoption de l’avis en commission plénière.
Il comprend les délais correspondant aux demandes de pièces au parquet ou à un juge d’instruction, aux demandes d’enquêtes des inspections internes, aux auditions des présumées victimes, des fonctionnaires concernés ou de toutes personnes dont le témoignage peut éclairer la commission, ainsi qu’à la rédaction d’un avis motivé devant être adopté en réunion plénière. Tous les dossiers concernant des détenus entraînent en outre un ou plusieurs déplacements en milieu pénitentiaire.
INDICATEUR 1.2 : DÉLAI MOYEN D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
(DU POINT DE VUE DE L’USAGER)
Unité |
2007 Réalisation |
2008 Réalisation |
2009 Prévision PAP 2009 |
2009 Prévision actualisée |
2010 Prévision |
2011 Cible | |
Délai moyen d’instruction des dossiers par le Médiateur de la République |
jours |
158 |
150 |
140 |
130 |
130 | |
Délai moyen d’instruction des dossiers par la CNDS |
mois |
11,5 |
12 |
11 |
10,30 |
10 |
9 |
Délai moyen d’instruction des demandes d’interception adressées en urgence absolue à la CNCIS |
minutes |
30 |
25 |
< 60 |
< 60 |
< 60 |
< 60 |
Délai moyen d’instruction des dossiers par la CADA |
jours |
35,4 |
35 |
34,5 |
34,5 |
33,5 |
La CNDS juge cet indicateur peu révélateur de l’activité de la Commission au regard de l’augmentation continue du nombre de saisines. La CNDS estime qu’elle est tributaire des délais de réponse parfois très longs des autorités sollicitées pour transmettre des pièces, ainsi que des disponibilités des personnes convoquées pour des auditions. La Cour des comptes avait regretté dans ses observations définitives portant sur les exercices 2001 à 2006 que la CNDS ne disposait pas d’outils ou d’analyse de ses activités.
La CNDS publie dans son rapport annuel un certain nombre d’indicateurs d’activité : nombre de saisines reçues et traitées, origine des saisines, nombre d’auditions, nombre de déplacements réalisés pour le traitement des saisines. Cependant aucun indicateur de performance n’y figure.
La Cour des comptes avait estimé dans ses observations définitives portant sur les exercices 2001 à 2006 que les rapports d’activité de la CNDS avaient un contenu inégal selon les années. Elle regrettait l’absence d’étude ou d’analyse de l’activité de la CNDS : recevabilité des saisines ; temps consacré par type de dossier ; nombre de saisines par origine (parlementaire ou autre), par secteur d’activité (police, gendarmerie…) ; les irrecevabilités (prescription, incompétence…) ; le nombre d’actes d’instruction… La Cour suggérait « que la CNDS procède à une évaluation de son efficience, d’autant qu’elle intervient dans un domaine où la réactivité est un gage d’efficience. (…) A cet égard la Cour prend acte de la réponse de la Commission qui indique qu’elle « va multiplier ses indicateurs d’activité afin d’améliorer son efficience. Ceci sera réalisable grâce à un effectif plus conforme avec l’ampleur de son activité et une amélioration de son système informatique » ».
- Budget :
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre (programme 308 Protection des droits et libertés de la mission Direction de l’action du Gouvernement).
Évolution du budget sur les cinq dernières années d’activité :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Budget initial |
541 602 |
613 629 (+100 000) |
760 400 |
728 615 |
764 472 |
Titre 2 |
355 234 |
399 400 |
389 045 |
427 718 | |
Titre 3 |
358 395 |
361 000 |
339 570 |
336 754 | |
Crédits consommés |
446 037 |
481 255 |
548 967 |
655 963 |
728 635 |
La CNDS estime qu’elle souffre d’un manque de moyens humains et financiers qui affecte son travail et son influence. Pour elle « une augmentation des moyens humains a été indispensable. Actuellement, quatre rapporteurs adjoints dont deux à temps plein sont au service de la CNDS. La faiblesse du budget demeure handicapante en ce qu’elle met en question la capacité d’action et l’indépendance de la CNDS. Alors que son audience s’accroît constamment, et avec elle le nombre de saisines, elle souffre d’une insuffisance du volume d’emplois mis à sa disposition. Ainsi, chacun des rapporteurs adjoints est en permanence en charge d’une cinquantaine de dossiers en cours d’instruction. Le manque de moyens a également pour conséquence un allongement de la durée de traitement des dossiers, qui s’élève aujourd’hui en moyenne à environ un an. La CNDS perd en efficacité et en réactivité, qualités essentielles à son affirmation comme autorité au service des citoyens. »
- Effectifs :
Tableau de l’évolution des ETPT :
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
ETPT |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
titulaires |
2 (C) |
2 (C) |
2 (C) |
2 (C) |
2 (C) |
Contractuels droit public |
1 (A) |
2 (A) |
3 (A) |
4 (A) |
5 (4 A, 1 B) |
- Autres dépenses :
Au cours de l’année 2009, les dépenses de communication (publication des rapports) se sont élevées à 18 496 euros.
Au cours de l’année 2009, les frais de déplacements (rapporteurs, membres et personnes auditionnées par la Commission) se sont élevés à 42 969 euros.
La Commission n’est pas propriétaire de véhicule, ni de biens immobiliers.
La CNDS loue des locaux au 62, bd de la Tour Maubourg, Paris 7ème. Ils représentent une superficie d’environ 200 m2, pour un loyer annuel de 131 560 euros TTC, 110 000 euros HT, ce qui fait une moyenne de 550 euros HT annuel le m2. Ce ratio est légèrement supérieur au ratio moyen de 543 euros le m2 tel qu’il est constaté dans le « quartier central des affaires » (autour du 8ème arrondissement), le plus cher de France.
- Projet de création du Défenseur des droits :
La CNDS a pris position, dans son rapport annuel pour 2009, sur le projet de création du Défenseur des droits qui inclurait les compétences de la CNDS :
« La Commission a appris le 9 septembre 2009, par un communiqué de presse publié par le gouvernement, qu’un projet de loi déposé au Sénat le même jour proposait sa disparition par l’abrogation de la loi du 6 juin 2000. Le projet prévoit de confier la mission de contrôle de la déontologie de la sécurité à une nouvelle autorité indépendante, constitutionnelle : le Défenseur des droits.
La Commission regrette de n’avoir été consultée à aucun moment lors de la phase d’élaboration de ce texte. Elle a émis de sérieuses réserves sur les disparitions envisagées en publiant tout d’abord un communiqué de presse le 22 septembre 2009, puis un bilan le 24 novembre 2009, dans lequel elle présente notamment ses réflexions sur ses réalisations et son avenir.
En l’état actuel du texte, la Commission a relevé que le projet de loi prévoit le transfert de ses attributions à une seule personne, le Défenseur des droits, nommé en Conseil des ministres, à charge pour lui, lorsqu’il intervient en matière de déontologie, de consulter un collège de trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, en raison de leur compétence dans le domaine de la sécurité.
Par comparaison avec son propre statut, la CNDS constate que cette nouvelle organisation :
1- n’offre aucune des garanties d’impartialité objective tenant au mode de désignation de ses membres, qui, pour treize d’entre eux sur quatorze, sont nommés par des autorités indépendantes du pouvoir exécutif et, à l’exception du président et des parlementaires, de toute autorité politique ;
2- fait disparaître le caractère multidisciplinaire de sa composition, qui lui a permis de regrouper des juristes, avocats ou magistrats, un professeur de médecine légale, des universitaires et chercheurs, d’anciens responsables de la police et de l’administration pénitentiaire, ayant tous eu à connaître dans l’exercice de leur profession des problèmes de déontologie des forces de sécurité, chacun apportant dans une approche différente ses connaissances et expériences propres ;
3- ne comporte aucune précision sur la qualité des délégués du Défenseur des droits pouvant intervenir pour instruire et participer au règlement des affaires en matière de déontologie ;
4- permet aux autorités mises en cause de s’opposer à la venue du Défenseur des droits dans les locaux dont ils sont responsables pour des motifs tenant « aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité publique ou dans le cas de circonstances exceptionnelles », cette disposition ayant pour conséquence de donner désormais à ces autorités la faculté de se soustraire à tout contrôle qui pourrait les gêner ;
5- interdit toute investigation sur des réclamations émanées de personnes ou associations témoins de manquements déontologiques ou de graves irrégularités en matière de reconduite à la frontière en raison de l’impossibilité d’avertir les victimes de ces faits et d’obtenir leur accord lorsque, entre-temps, elles auront été expulsées ;
6- donne au Défenseur des droits le pouvoir arbitraire de rejeter toute requête sans avoir à motiver sa décision ni respecter le principe de la contradiction ;
7- va diluer au sein d’une institution omni compétente des attributions spécifiques nécessitant des connaissances et une approche particulières dans le domaine sensible des rapports entre les citoyens avec les forces de sécurité, les manquements commis dans l’usage de la force légale n’appelant ni « transaction » ni « règlement en équité » ;
8- dote le Défenseur des droits d’un pouvoir d’injonction factice, puisque dans l’article 21 qui lui octroie ce pouvoir, il est prévu : « s’il n’est pas donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut rendre publiques ses recommandations, ses injonctions et la réponse de la personne publique ou de l’organisme mis en cause, sous la forme d’un rapport spécial », pouvoir dont dispose déjà la Commission et qu’elle a utilisé à une reprise en 2009 dans la saisine 2009-23 concernant les mesures de sécurité prises pour assurer la surveillance d’une personne blessée au cours de son interpellation, à la suite de son évasion de prison ;
9- permet d’opposer au Défenseur des droits le secret de l’enquête ou de l’instruction, alors que, selon la loi du 6 juin 2000, seule l’autorité judiciaire peut refuser son accord pour la communication à la CNDS des pièces qu’elle détient, cette communication relevant donc d’un régime particulier et non du régime général du secret de l’instruction.
La CNDS considère que sur chacun des points qui précèdent, la réforme projetée marque un recul des garanties démocratiques qu’elle offrait aux citoyens, pour le respect de leurs droits fondamentaux. Elle rappelle enfin que son existence et la qualité de son action ont été saluées par les institutions internationales – notamment le Commissaire européen aux droits de l’Homme –, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et les organisations non gouvernementales attachées à la défense des droits de l’Homme, dont plusieurs ont exprimé le souhait de voir ses compétences et ses moyens élargis. »
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué le Défenseur des droits, afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose l'intervention d'une loi organique.
- Constitution :
« Titre XI bis - Le Défenseur des droits
« Art. 71-1. - [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
- Projets de loi organique (n° 610) et de loi ordinaire (n° 611) relatifs au Défenseur des droits déposé le 9 septembre 2009 au Sénat :
Le projet de loi organique précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits.
Ses attributions incluront celles aujourd'hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour que son action puisse bénéficier de toutes les compétences utiles, il sera assisté de deux collèges composés chacun de trois personnalités qualifiées, pour l'examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l'enfance. Leurs membres sont désignés par les Présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les membres de chaque collège sont nommés pour la durée du mandat du Défenseur des droits. Leur mandat n’est pas renouvelable. L'articulation avec les autres autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés est également renforcée : le Défenseur des droits sera, en particulier, associé aux travaux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le Défenseur des droits pourra être saisi directement par toute personne s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration. En matière de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité, il pourra également connaître des agissements de personnes privées. La saisine du Défenseur sera gratuite. Le Défenseur des droits disposera de pouvoirs importants, qui lui permettront notamment de prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, de proposer une transaction, d'être entendu par toute juridiction ou encore de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis pour couper court aux difficultés qui proviendraient d'interprétations divergentes des textes. Il bénéficiera de larges pouvoirs d'investigation. Le Défenseur des droits peut faire toute proposition au Gouvernement de modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines relevant de sa compétence.
Le projet de loi ordinaire complète le texte organique en prévoyant notamment les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits.
La première lecture au Sénat (3 juin 2010) a entraîné la création :
- d’un collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité ;
- de deux postes d’adjoint au Défenseur des droits chargés respectivement de la déontologie dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité ;
- d’un Défenseur des enfants ayant rang d’adjoint au Défenseur des droits.
1 () Voir l’article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (qui a modifié à cet effet l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse), et le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (Journal officiel du 30 octobre 2009) qui précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse. Cette réforme devrait conduire à un élargissement de la composition de la CPPAP.
2 () Convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
3 () Directive prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil.
4 () Décret du 18 février 2008 portant nomination du président et des vice-présidents de la Commission nationale du débat public.
5 () Aux termes de la convention d’Aarhus, « la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
6 () Établissements recevant des dépôts et/ou accordant des crédits.
7 () Anciennes sociétés de bourse.
8 () S’agissant des établissements et entreprises ayant leur siège social dans un État tiers, le « passeport européen » leur permet, lorsqu’elles disposent de l’agrément de l’autorité de leur pays d’origine, d’exercer leurs activités dans toute l’Union européenne.
9 () Par exemple, s’assurer que les ratios de solvabilité et de liquidités demeurent dans des limites fixées réglementairement.
10 () Le CEA est une autorité collégiale chargée de délivrer des agréments aux entreprises d’assurance. Sa composition est analogue à celle du CECEI mais son secrétariat est assuré par un service de l’État (direction du Trésor).
11 () Les travaux préparatoires de cette loi sont présentés en annexe à la présente note.
12 () Référés 2008 et 2009 puis Rapport public annuel 2009.
13 () Bruno Deletré, Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, janvier 2009. Voir, à ce propos, le rapport d’information (n° 2208) présenté, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, par M. Sébastien Huyghe (22 décembre 2009).
14 () Articles L. 621-1 et suivants du code monétaire et financier. Voir également le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l’Autorité des marchés financiers et le décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l’Autorité des marchés financiers (articles R. 621 et suivants du code monétaire et financier).
15 () La fusion du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable au sein d’un organe unique, l’Autorité des normes comptables, est mise en œuvre par le décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 (JO du 17 janvier 2010).
16 () La proportion de dossiers présentés à la Commission des sanctions donnant lieu à sanction était de 63 % en 2008, contre 85 % en 2007.
17 () Voir le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la HALDE, modifié par le décret n° 2007-55 du 11 janvier 2007.
18 () Directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, notamment son article 13. Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
19 () Le montant de ces indemnités ainsi que le nombre maximal annuel de séances de travail et de rapports pouvant être confiés à un membre du collège sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les montants actuels des indemnités pour une réunion plénière et une séance de travail sont respectivement de 135,20 euros et de 67,06 euros. Elles suivent l’évolution du point d’indice de la Fonction publique. En moyenne, le Collège s’est réuni 31 fois en 2008.
20 () A la suite d’une visite des rapporteurs sur le site de la HALDE, il est apparu que cette surface utile nette (SUN) déclarée de 1 362 m2 ne comprenait ni toutes les surfaces utiles des deux étages, ni la quote-part du hall d’entrée.
21 () Sur la décision no 2007-110 du 29 mars 2007 refusant d’homologuer l’affiche et la profession de foi de M. Gérard Schivardi : ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 2 avril 2007, M. Gérard Schivardi (no 304255) et Conseil constitutionnel, 5 avril 2007, M. Gérard Schivardi. Sur le second point : ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 21 avril 2007, Société anonyme Antilles télévision (no 304961) et ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 2 mai 2007, Mme B. (no 305200).
22 () Modifiée par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995, la loi n° 95-126 du 8 février 1995 et la loi n° 96-5 du 4 janvier 1996.
23 () Les membres du Gouvernement, les parlementaires, les présidents de conseil régional, les présidents de conseil général, les présidents élus d’une assemblée territoriale et d’un exécutif d’outre-mer, les maires de communes de plus de 30 000 habitants, les présidents élus d’un groupement de communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers régionaux, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature de leurs exécutifs.
24 () Arrêté du 27 mars 2008, décret n°2009-769 du 23 juin 2009 et arrêté du 23 juin 2009 fixant les taux et les modalités d’attribution des indemnités susceptibles d’être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
25 () Voir également la proposition de loi organique n° 2137 déposée le 2 décembre 2009 et relative à la déclaration de patrimoine du Président de la République et des membres du Parlement.
26 () Nommé par décret en date du 19 novembre 2008.
27 () Nommée par décret en date du 6 janvier 2010.
28 () La commission a tenu 79 séances en 2008, 41 en 2009.
29 () La loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République a étendu la compétence de la commission au contrôle des comptes des candidats à l’élection présidentielle, jusque là assuré par le Conseil constitutionnel.
30 () Depuis l’audition du président de l’Autorité de la concurrence par le groupe de travail du CEC, cette autorité a sanctionné le 20 septembre 2010 11 banques à hauteur de 384,9 millions d’euros pour avoir mis en place des commissions interbancaires non justifiées lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques.
31 () Dans sa décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, examinant les conditions du transfert, par ordonnances, du secteur public au secteur privé, de la propriété de participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l’État dans certaines entreprises, le Conseil constitutionnel a précisé que toute privatisation impose : que le prix de vente soit au moins égal à la valeur des entreprises concernées ; que le choix des acquéreurs ne procède « d’aucun privilège » ; que l’indépendance nationale soit préservée.
32 () C’est ainsi qu’a été publié, au Journal officiel du 21 septembre 2008, un décret, daté du 18, nommant membres de la Commission : M. Bertrand Schneiter, président, Mme Perrette Rey et MM. Pierre Achard, Philippe Martin, Daniel Deguen, Jean Serisé et Philippe Rouvillois.
33 () La Convention a été adoptée en 1984 et est entrée en vigueur en 1987.
34 () Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a remplacé, s’agissant des locaux de rétention administrative, la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente, mise en place par le décret n° 2005-616 du 30 mai 2005.
35 () 62 252 personnes étaient écrouées au 1er janvier 2009 ; 71 831 hospitalisations sous contrainte au cours de l’année 2005 ; 577 816 mesures de garde à vue selon le ministère de l’Intérieur en 2008 ; 35 246 personnes admises en centre de rétention administrative en 2008.
36 () Par exemple : avis du 21 octobre 2009 relatif à l’exercice de leur droit de correspondance par les personnes détenues.
37 () Ce montant est proche de celui qui aura été constaté au 31 décembre, car il est difficile d’engager les crédits après le 1er décembre.
38 () Les locaux se trouvent au 16/18 quai de la Loire, dans le XIXe arrondissement de Paris. Le loyer HT est de 168 870 euros, le loyer TTC de 201 969 euros. La surface de bureau occupée (y compris les espaces communs et les salles de réunions) est de 467 m2 (soit une surface moyenne par agent de 22,23 m2).
39 () Qui remplace, sans s’y substituer complètement, l’adoption dans les pays de droit coranique.
40 () Le mandat du médiateur actuellement en fonctions a débuté le 6 avril 2006. M. Roch-Olivier Maistre est magistrat de la Cour des comptes, Premier avocat général au parquet.
41 () Angers, Anglet, Asnières, Aubagne, Avignon, Bagnères-de-Luchon, Bastia, Beauvais, Bourgueil, Brest, Brive, Bron, Cahors, Cannes, Carry-le-Rouet, Chambéry, Chantilly, Clermont-Ferrand, Courchevel, Créteil, Forbach, Ganges, Grenoble, Le Havre, Lannemezan, Louviers, Lyon, Marseille, Montgeron, Montpellier, Montreuil, Nancy, Nantes, Nanterre, Nîmes, Nogent-le-Rotrou, Noisy-le-Grand, Orléans, Paris (une cinquantaine de demandes), Plaisance-du-Touch, Réville, la Roche-sur-Yon, Rouen, les Sables-d’Olonne, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Etienne, Saint-Hilaire-Du-Harcouët, Saint-Louis de la Réunion, Sarlat, Sevran, Strasbourg, Tours, Valence.
42 () Les films les plus concernés ayant été, dans l’ordre : « Etreintes brisées », « Ponyo sur la falaise », « Le ruban blanc », « Dans la brume électrique », « Welcome », « Volt, star malgré lui », « Walkyrie », « Gran Torino », « Mademoiselle Chambon », « Le temps qu’il reste », « Looking for Eric », « Whatever works », « Harry Potter et le prince de sang mêlé », « Là-haut », « Rapt », « Le petit Nicolas » et « Bright Star ».
43 () Dans un cas, le cinéma était reconnu pour sa programmation et son travail d’accompagnement et participait ainsi à la plus large diffusion de l’oeuvre. Des difficultés d’accès aux films de sa ligne éditoriale étaient constatées ainsi qu’une offre restreinte de films « Art et Essai » à cette période de l’année. Le cinéma avait démontré sa performance sur des films obtenus seul et le placement de deux copies n’était pas justifié dans le quartier. Aussi, le médiateur a enjoint au distributeur de fournir le cinéma par déplacement de l’une des deux autres copies prévues.
Dans un autre cas, le cinéma, reconnu pour son travail et sa compétitivité, rencontrait des difficultés d’accès aux films français en raison de sa situation concurrentielle (les 8 derniers films français sortis dans le quartier l’étaient chez les concurrents). La demande étant toutefois tardive, le Médiateur a enjoint au distributeur de servir l’exploitant avec un prochain film français de son choix.
44 () Dans un cas, le distributeur avait initialement prévu de placer la copie du film chez le demandeur mais avait finalement choisi le concurrent à la suite d’une révision du plan de sortie. La saisine du médiateur était tardive, un débat autour du film était déjà organisé chez le concurrent, le demandeur était régulièrement servi et le distributeur lui avait proposé en compensation un prochain film porteur ainsi qu’un autre film de son catalogue au choix de l’exploitant.
Dans un autre cas, une majorité de films du distributeur étaient exploités chez le demandeur dans le cadre de circulations de copies ; les lignes éditoriales des deux parties les amenaient à travailler ensemble de façon régulière ; le film demandé était le plus porteur du catalogue du distributeur en 2009 et il était légitime que celui-ci choisisse l’établissement le plus performant de la commune. Enfin, le distributeur proposait le film en continuation à l’arrêt de son exploitation chez le concurrent.
45 () modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
46 () Date à laquelle la CNAC a commencé à statuer en application de la nouvelle réglementation introduite par la LME.
© Assemblée nationale