

TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2011
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur le financement des politiques culturelles de l’État
par des ressources affectées
et prÉsentÉ
par MM. Richard DELL’AGNOLA, Nicolas PERRUCHOT,
et Marcel ROGEMONT
Députés
___
MM. Olivier CARRÉ et David HABIB
Présidents
____
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Olivier Carré, David Habib, Présidents, Jérôme Cahuzac, Président de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, M. Gilles Carrez, Rapporteur général, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Pierre Brard, Bernard Cazeneuve, Alain Claeys, Charles de Courson, Richard Dell’Agnola, Yves Deniaud, Jean-Louis Dumont, Jean-Michel Fourgous, Louis Giscard d’Estaing, Laurent Hénart, Jean Launay, François de Rugy, Philippe Vigier.
LES PROPOSITIONS DE LA MEC 7
INTRODUCTION 11
I.– LA DÉBUDGÉTISATION : UNE PRATIQUE DÉROGATOIRE À LA LOLF ET AUX PRINCIPES BUDGÉTAIRES QU’IL CONVIENT DE LIMITER AU STRICT NÉCESSAIRE 13
A.– LES RESSOURCES AFFECTÉES : GRILLE DE LECTURE 13
1.– La ressource affectée comme contrepartie d’un service rendu 14
2.– La ressource affectée comme application du principe « pollueur-payeur » 14
3.– La ressource affectée comme mécanisme de péréquation 15
B.– RESSOURCES AFFECTÉES ET CONTRÔLE : DES RELATIONS COMPLIQUÉES 15
1.– Un contrôle moins effectif du Parlement quant à l’autorisation de dépenser 16
2.– Un lien plus lâche entre la tutelle et l’opérateur pouvant rigidifier le pilotage des politiques publiques 18
3.– Des risques potentiels sur le niveau de la dépense publique 19
C.– LES PRÉCONISATIONS DE LA MEC POUR UN RECOURS EXCEPTIONNEL AU FINANCEMENT PAR RESSOURCES AFFECTÉES 21
1.– Remédier à la myopie budgétaire des pouvoirs publics 22
2.– Éviter tout dérapage des coûts et soumettre les opérateurs à l’effort de modération de la dépense publique 22
D.– LES OPÉRATEURS CULTURELS FINANCÉS PAR DES RESSOURCES AFFECTÉES : PLUS DE 860 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES EN 2010 22
1.– Champ de l’étude de la MEC 22
2.– Masses financières en jeu 24
II.– LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE : LIMITER LES ACTIONS AUX BESOINS OBJECTIFS 25
A.– ADAPTER LE FINANCEMENT AUX BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES DU SECTEUR TOUT EN PRÉVENANT L’INFLATION DES DÉPENSES 26
1.– Le CNC bénéficie de trois taxes affectées 26
2.– Pour une meilleure définition de la taxe sur les services de télévision couplée à une modération de la pression fiscale pesant sur les distributeurs 28
B.– RÉORIENTER LE DISPOSITIF DE SOUTIEN VERS PLUS DE SÉLECTIVITÉ ET PLUS DE TRANSPARENCE 32
1.– Renforcer la part des aides sélectives 32
2.– Clarifier les procédures de traitement des dossiers 33
III.– POUR UN FINANCEMENT PÉRENNE DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 35
A.– REPENSER À NOUVEAU LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE… OU OPTER POUR UN FINANCEMENT EXCLUSIVEMENT BUDGÉTAIRE ? 37
1.– Une situation financière dégradée 38
2.– L’insuffisance structurelle du produit de la redevance d’archéologie préventive nécessite régulièrement l’octroi de subventions complémentaires 39
3.– Le circuit de financement de l’archéologie préventive pourrait être utilement simplifié et clarifié 41
4.– Les trois pistes de réforme de la redevance d’archéologie préventive 44
a) Aménager le dispositif actuel : une réforme a minima 44
b) Substituer à la redevance une taxe sur les mutations de terrains à bâtir : des inconvénients dirimants 45
c) Articuler la réforme de la redevance avec celle de la taxe d’aménagement : le scénario le plus prometteur 45
B.– MODERNISER LES OUTILS DE PILOTAGE DE L’INRAP 46
1.– Adapter les instruments de suivi de l’activité de l’INRAP à la nouvelle logique concurrentielle 46
2.– Veiller à la bonne adéquation entre ressources humaines et niveau d’activité 48
C.– EXPRIMER PLUS CLAIREMENT LA « DEMANDE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE » AFIN D’APAISER LES OPÉRATEURS ET DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 50
D.– RÉAFFIRMER LE RÔLE DE LA CO-TUTELLE AU PROFIT D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES RENFORCÉS ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 52
IV.– POUR LE RETOUR À UNE BUDGÉTISATION INTÉGRALE DES FINANCEMENTS DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 53
A.– SUPPRIMER LA RESSOURCE AFFECTÉE ET REVENIR À UN FINANCEMENT BUDGÉTAIRE CLASSIQUE 54
1.– Le CMN a déjà bénéficié d’une ressource affectée par le passé 54
2.– La création d’une nouvelle ressource affectée ne répond à aucun impératif 55
B.– RAMENER LE FONDS DE ROULEMENT À UN NIVEAU NORMAL 56
1.– Un fonds de roulement surabondant 56
2.– Mobiliser au maximum le fonds de roulement au profit de la restauration des monuments nationaux 57
C.– MODERNISER ET FLUIDIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 58
1.– La gestion des ressources humaines au sein des opérateurs culturels : une problématique récurrente 58
2.– Permettre le détachement des agents d’administration centrale au sein du CMN 59
V.– LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET DU JAZZ : CLARIFIER LES CONTOURS DU SOUTIEN AUX SPECTACLES DE VARIÉTÉS 61
A.– DES RESSOURCES ESSENTIELLEMENT CONSTITUÉES DE LA TAXE AFFECTÉE 61
B.– DES REDISTRIBUTIONS EN HAUSSE 63
C.– UN CONTEXTE INCERTAIN 65
VI.– LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE : UN ÉTABLISSEMENT QUI DOIT SÉCURISER SON FINANCEMENT 67
A.– UN MODE DE FINANCEMENT NÉCESSITANT UNE RÉÉVALUATION PÉRIODIQUE 68
1.– La part prépondérante des taxes affectées dans le financement du CNL 68
a) La taxe sur l’édition des ouvrages de librairie 68
b) La taxe sur l’emploi de la reprographie et l’impression 69
2.– L’évolution inquiétante du produit de la taxe sur la reprographie et l’impression 69
3.– Les solutions envisagées 70
B.– UN DISPOSITIF DE SOUTIEN QUI DOIT ÊTRE RESSERRÉ 71
EXAMEN EN COMMISSION 73
ANNEXES 85
● Propositions générales Proposition n° 1 – Limiter strictement le recours à la débudgétisation permise par l’affectation, à des opérateurs, de ressources qui devraient être versées au budget général de l’État. Proposition n° 2 – Indiquer, dans le cadre de chaque projet de loi de finances et pour chaque opérateur affectataire de recettes fiscales, le montant des charges estimées pour l’année suivante, ce plafond de dépenses permettant de déterminer le plafond des recettes nécessaires pour les couvrir. Poser le principe selon lequel la part des ressources affectées dépassant le plafond ainsi arrêté est automatiquement reversée au budget général de l’État. ● Le Centre national du cinéma et de l’image animée Proposition n° 3 – Adapter le volet « distributeurs » de la taxe sur les services de télévision : – en élargissant son assiette. Veiller à la circonscrire aux seuls montants acquittés par les usagers en rémunération de services de télévision ou d’offres dont la souscription est nécessaire à la réception de tels services ; – et en abaissant ses taux. Proposition n° 4 – Renforcer la part des aides sélectives dans le soutien total accordé par le CNC. Proposition n° 5 – Formaliser, pour chaque commission attributrice de soutiens, une charte établissant précisément les principes et critères de sélection présidant aux choix des projets aidés. Rendre ces chartes publiques via leur mise en ligne sur le site Internet du CNC. ● L’Institut national de recherches archéologiques préventives Proposition n° 6 – Simplifier et clarifier les modalités d’affectation de la redevance d’archéologie préventive. Étudier la faisabilité d’une affectation totale de la redevance d’archéologie préventive au FNAP qui en confierait la gestion à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle reverserait à l’INRAP et aux opérateurs concernés les sommes nécessaires au financement des activités de diagnostic au prorata des diagnostics réalisés. Proposition n° 7 – Procéder à l’apurement de la dette de l’Institut national de recherches archéologiques préventives auprès de l’Agence France Trésor. Proposition n° 8 – Créer, dans les plus brefs délais, des outils de pilotage de l’activité de l’INRAP ainsi que des instruments de comparaison permettant d’analyser la compétitivité de l’Institut par rapport à ses concurrents, notamment en termes de coûts et de délais d’intervention. Proposition n° 9 – Rédiger plus précisément les cahiers des charges établis par les services régionaux d’archéologie (SRA) afin d’éviter tout « angle mort » susceptible de favoriser des prestations de moindre qualité scientifique. Proposition n° 10 – Renforcer les liens entre l’INRAP et les différents acteurs de la recherche. Encourager les collaborations scientifiques entre les acteurs institutionnels de l’archéologie préventive et entre les archéologues, quels que soient leur statut et leur structure d’appartenance. ● Le Centre des monuments nationaux Proposition n° 11 – Supprimer l’affectation au Centre des monuments nationaux de la part du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne codifiée à l’article 302 bis ZI du code général des impôts. Procéder à la rebudgétisation intégrale des financements publics alloués au CMN en les majorant à due concurrence de la perte de recettes subie au titre de la suppression de l’affectation de recettes fiscales. Proposition n° 12 – Mobiliser au maximum le fonds de roulement afin de financer les dépenses de restauration des monuments nationaux prévues dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2011-2013. Proposition n° 13 – Étudier les possibilités de détachement, au sein des opérateurs culturels, des agents de catégorie C rattachés au ministère de la Culture et de la communication. Accompagner ce détachement du transfert de la masse salariale correspondante. ● Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz Proposition n° 14 – Substituer au dispositif de remboursement pour les sommes recouvrées inférieures à 80 euros un seuil de même montant, en dessous duquel la taxe n’est pas recouvrée. Proposition n° 15 – Le CNV et son ministère de tutelle, en collaboration avec les professionnels du secteur, doivent redéfinir les critères d’attribution des aides afin de rendre le dispositif de sélection plus opérant. Proposition n° 16 – Clarifier les compétences respectives du CNV et de l’Association pour le soutien du théâtre privé en définissant plus précisément le champ des spectacles respectivement pris en charge par ces deux organismes. Proposition n° 17 – Améliorer l’information relative au CNV dans les lieux publics de spectacles. Proposition n° 18 – Préparer la transposition de la directive « Services » en définissant au plus vite les règles de déclaration des spectacles et de perception de la taxe applicables aux entreprises européennes de spectacle non établies en France. ● Le Centre national du livre Proposition n° 19 – Étudier, eu égard au produit relativement modeste des taxes affectées et aux risques pesant sur leur rendement, la rebudgétisation du financement du CNL. Proposition n° 20 – Resserrer le dispositif de soutien du livre autour de quelques grandes catégories d’aides. |
Lorsque le bureau de la commission des Finances a décidé, le 8 février 2011, de mettre au programme de la MEC la question du financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées, il s’inscrivait dans une démarche générale portant sur les moyens de maîtriser la dépense dans les différents secteurs de l’action de l’État.
La Mission d’évaluation et de contrôle ne pouvait en effet rester à l’écart des réflexions nées du contexte de tension sur les finances publiques, qui exige que le meilleur usage soit fait des prélèvements obligatoires.
Parmi les grands domaines d’intervention de l’État, le soutien de la création culturelle avait l’avantage de s’appuyer sur un nombre limité d’opérateurs affectataires de ressources, ces opérateurs présentant un éventail de situations variées. Les cinq établissements concernés présentent des caractéristiques très diverses, de par leur taille, leur rôle économique et le volume des recettes qui leur sont affectées.
Afin d’acquérir une vision d’ensemble de la problématique générale et d’approfondir la situation propre aux cinq opérateurs concernés, la mission a conduit sept auditions et organisé cinq tables-rondes. Elle a entendu successivement les directions de ces établissements, leurs tutelles, les redevables des différentes taxes, les bénéficiaires des politiques publiques et des actions de soutien menées par ces opérateurs, ainsi que leurs éventuels concurrents.
Le présent rapport a été préparé par les deux rapporteurs spéciaux de la commission des Finances sur la culture et par le vice-président de la commission des Affaires culturelles – qui avaient ensemble rapporté pour la MEC sur la politique des musées en 2009. Quoique les rapporteurs soient issus de trois groupes politiques différents, il exprime un diagnostic pleinement partagé. L’analyse a été également partagée par le co-président de la MEC Olivier Carré, qui s’est particulièrement impliqué dans l’animation des auditions, puis par la MEC et la commission des Finances.
Le résultat de ces travaux s’incarne dans vingt propositions de consensus plaidant fermement pour une utilisation raisonnée des instruments des politiques publiques.
I.– LA DÉBUDGÉTISATION : UNE PRATIQUE DÉROGATOIRE À LA LOLF ET AUX PRINCIPES BUDGÉTAIRES QU’IL CONVIENT DE LIMITER AU STRICT NÉCESSAIRE
L’affection directe de ressources fiscales à des opérateurs suscite nombre d’interrogations quant à la bonne gestion des deniers publics.
Cette question renvoie à une problématique globale : celle de la « débudgétisation ». Le choix de recourir à des ressources fiscales directement affectées aux opérateurs intéressés plutôt qu’à des crédits budgétaires versés sous forme de subventions n’est pas neutre du point de vue de la gestion publique.
De nombreux opérateurs, relevant du champ culturel mais pas uniquement, sont destinataires de recettes fiscales qui, si elles ne leur étaient pas directement reversées, viendraient abonder le budget général de l’État. Ce phénomène de « débudgétisation », de plus en plus fréquent, entraîne un certain nombre de difficultés inhérentes, notamment, à la portée du contrôle du Parlement et à l’exercice de la tutelle sur ces opérateurs.
En effet, si le recours à ce mode alternatif de financement peut légitimement se justifier, il n’est pas sans risque quant au pilotage de la dépense publique. Aussi l’affectation directe de ressources aux opérateurs ne doit-elle s’effectuer que dans des cas précis et strictement limités. Cette procédure dérogatoire au droit budgétaire commun doit rester exceptionnelle et en aucun cas devenir une facilité de gestion qui, pour efficace qu’elle puisse être à certains égards, constitue une sorte d’angle mort du contrôle exercé par le Parlement comme par la tutelle.
Il faut le rappeler une fois de plus, les principes consacrés par n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) sont justifiés par des préoccupations de légitimité démocratique et de qualité des politiques publiques.
A.– LES RESSOURCES AFFECTÉES : GRILLE DE LECTURE
Il est possible d’opérer une classification, certes sommaire mais relativement éclairante, des différentes « familles » de ressources affectées. En effet, ces impositions peuvent servir des objectifs divers, qui varient selon la nature et l’organisation du secteur socio-économique auquel elles se rapportent et selon la logique qui a inspiré leur création et leur affectation.
Une telle grille de lecture, utilisée au demeurant par le ministère du Budget, permet de mieux appréhender le concept de « ressource affectée », et d’en saisir les fondements ; c’est notamment au regard de ceux-ci qu’il convient d’apprécier la pertinence d’un éventuel recours à la technique de débudgétisation. Assurément, les frontières entre les différents types de ressources affectées ne sont pas totalement étanches, les critères pouvant s’entrecroiser et se cumuler au sein d’une même imposition.
1.– La ressource affectée comme contrepartie d’un service rendu
Dans certains cas, une taxe spécifique ou une redevance est acquittée par les opérateurs économiques concernés en contrepartie directe du bénéfice que ces mêmes opérateurs tirent de l’accomplissement d’une mission de service public conduite à leur profit.
C’est, par exemple, cette philosophie qui a prévalu lors de la création de la redevance d’archéologie préventive dont le produit est directement affecté aux acteurs publics à dimension nationale de ce secteur (2) : l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP).
La logique est celle du paiement du service rendu. En l’espèce, les aménageurs rétribuent les opérateurs de l’archéologie préventive en contrepartie de la prise en charge, par ces mêmes institutions, des opérations de diagnostic préalables à tout projet d’aménagement affectant un sous-sol qui peut s’avérer riche en trésors archéologiques.
2.– La ressource affectée comme application du principe « pollueur-payeur »
Parfois, la taxe vise à restaurer les équilibres d’un secteur donné. Elle tend alors à corriger, du moins à aplanir, ce que la théorie économique définit comme des « externalités négatives ». Ce terme désigne l’ensemble des conséquences néfastes supportées par un agent économique du fait de l’activité de consommation ou de production d’un autre agent. Taxer ces externalités revient à leur attribuer un coût qui sera pris en compte dans le calcul économique global : les externalités sont alors internalisées.
Tel est le fondement du principe « pollueur-payeur », lequel trouve notamment à s’appliquer aux activités économiques qui engendrent des dommages environnementaux. Ainsi des marchés de production et de consommation d’hydrocarbures, dont les externalités générées ont, par exemple, conduit à instaurer des dispositifs tels que le « bonus-malus » automobile reçu ou acquitté lors de l’achat d’un véhicule selon que celui-ci est plus ou moins polluant.
Ce principe a trouvé une consécration institutionnelle majeure avec la Charte de l’environnement, qui l’a reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle. Sur le plan économique, il a donné lieu à la création du marché européen des « droits à polluer ». Un système d’échange des quotas d’émission a été définitivement mis en place au sein de l’Union européenne en 2005, la France s’étant dotée, cette même année, d’un registre national de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3).
Dans le champ culturel, analysé par la mission d’évaluation et de contrôle, cette philosophie a notamment trouvé à s’appliquer pour le financement du Centre national du livre (CNL) via la création d’une taxe sur la vente des appareils de reproduction et d’impression affectée à cet opérateur. Cette création se justifie en effet par la menace que fait peser l’utilisation de ce type d’appareils pour le secteur du livre, dont le CNL assure le soutien.
Le mode de financement de l’INRAP fait également écho à ce principe, la redevance d’archéologie préventive renvoyant à une logique « aménageur-payeur » au motif que les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont susceptibles de produire des externalités négatives (destruction ou dégradation de sites archéologiques notamment).
3.– La ressource affectée comme mécanisme de péréquation
Enfin, l’institution d’une ressource affectée au bénéfice d’un opérateur dont l’action est dédiée à un secteur spécifique peut répondre à un besoin de péréquation interne entre les acteurs dudit secteur. Elle permet alors d’assurer une solidarité financière entre les opérateurs concernés en faisant financer la politique publique afférente par ces mêmes opérateurs et non par l’ensemble des contribuables.
Rappelons toutefois que la logique redistributrice et péréquatrice fait partie des fonctions traditionnelles de l’impôt « classique », et que de tels objectifs peuvent donc également être atteints sans recourir à des mécanismes de financement dérogatoires au droit commun.
Dans le domaine culturel, les taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) ou au CNL obéissent à cette philosophie.
B.– RESSOURCES AFFECTÉES ET CONTRÔLE : DES RELATIONS COMPLIQUÉES
L’affectation de recettes constitue une entorse au principe classique d’universalité budgétaire, lequel dispose que l’ensemble des ressources publiques ont vocation à financer indistinctement l’ensemble des politiques publiques, sans que les premières soient directement « fléchées » vers des dépenses spécifiquement identifiées.
L’article 6 de la LOLF le rappelle clairement en disposant que « le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. ». Il s’en déduit deux corollaires :
– la non-affectation : une recette particulière n’est pas affectée à une dépense particulière (4).
– la non-contraction, ou règle du produit brut : le budget présente non pas le solde des opérations mais l’ensemble des recettes d’une part, et l’ensemble des dépenses d’autre part.
Par ailleurs, l’article 34 de la LOLF dispose que la loi de finances « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État » (5), l’article 36 du texte organique rappelant que « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ». En application de ces dispositions, l’affectation de recettes relève donc du domaine exclusif – mais facultatif – de la loi de finances.
Au total, les dispositions organiques certes autorisent, mais surtout encadrent strictement le recours à un mécanisme qui, en dérogeant frontalement au principe d’universalité budgétaire doit impérativement se limiter à des cas spécifiques. De fait, au-delà du respect légitimement dû aux grandes règles du droit budgétaire, un tel encadrement paraît nécessaire au regard des effets que cette procédure est susceptible de produire sur la gestion des deniers publics.
1.– Un contrôle moins effectif du Parlement quant à l’autorisation de dépenser
L’affectation directe de ressources à des opérateurs de l’État plutôt que le versement de subventions attribuées en application des règles budgétaires de droit commun entraîne incontestablement un affaiblissement du contrôle du Parlement et réduit ses marges de manœuvre quant à l’importance des moyens financiers qu’il entend consacrer à telle ou telle politique publique.
Car c’est bien le Parlement qui accorde au Gouvernement l’autorisation – et non l’obligation – de dépenser les crédits votés à l’occasion de chaque loi de finances. Encore faut-il qu’il soit pleinement éclairé sur la totalité des masses financières.
Or les montants correspondant aux ressources affectées ne sont pas retracés au sein des différents programmes et missions du budget général. Aussi, alors que les parlementaires peuvent déposer et défendre des amendements de crédits susceptibles de moduler à la hausse ou à la baisse la dotation budgétaire de tel ou tel programme pourvu que le plafond de la mission qui englobe ledit programme ne soit pas dépassé (6), il est beaucoup moins aisé d’adapter les financements des opérateurs affectataires de ressources fiscales.
Si le Parlement estimait qu’il convient de modifier le régime de telle taxe affectée à tel opérateur, ou que le niveau des ressources de celui-ci est objectivement trop élevé au regard des missions dont il a la charge, il lui serait impossible de minorer directement les recettes du bénéficiaire. En effet, en application de l’article 40 de la Constitution, les amendements parlementaires induisant, pour un organisme relevant du champ de l’article 40, une perte de recettes non compensée – non « gagée » –, sont déclarés irrecevables au dépôt. Ils ne peuvent donc même pas faire l’objet d’un débat en commission ou en séance publique.
Or les opérateurs financés par ressources affectées rentrent dans le champ de l’article 40. Aussi, un amendement parlementaire proposant la diminution des ressources d’un tel organisme – via une réduction du taux, de l’assiette, du nombre de redevables de la taxe ou via l’institution d’un plafond de ressources – devra, pour se conformer aux exigences constitutionnelles, comporter un gage neutralisant la minoration de recettes pour le même organisme, à concurrence de la perte financière subie… Il s’agirait bien entendu d’un gage purement « cosmétique », contraire à l’intention des auteurs de l’amendement, et il appartiendrait au Gouvernement de lever le gage afin de donner leur plein effet aux dispositions voulues par les parlementaires. Si le Gouvernement ne levait pas le gage, l’opération serait financièrement neutre pour l’opérateur et l’intention des auteurs ne serait pas satisfaite.
Ainsi, sauf appui ou initiative de l’exécutif (7), l’affectation de ressources fiscales à des organismes tiers peut constituer une sorte de cliquet anti-retour quant au niveau de financement de la politique publique concernée, et partant, quant au niveau de la dépense publique.
De fait, le financement par ressources affectées peut également être utilisé par l’État – et appelé de leurs vœux par les opérateurs, pour peu que la recette soit suffisamment dynamique – comme un substitut à la baisse des subventions, dont le niveau est autorisé et, le cas échéant, modifié, annuellement par le Parlement. C’est ce qu’illustre l’attribution au Centre des monuments nationaux (CMN) de 10 millions d’euros de ressources affectées en contrepartie d’une diminution, décidée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2011, de 9,5 millions d’euros sur les crédits budgétaires qui lui étaient alloués. Une telle technique permet ainsi de sanctuariser le financement des opérateurs, la modulation des moyens qui leur sont affectés étant rendu beaucoup plus complexe que dans le cadre de subventions financées par crédits budgétaires.
Si elle ne soustrait pas totalement les opérateurs qui en bénéficient au contrôle du Parlement, elle réduit sa portée en le soumettant directement, au surplus, au bon vouloir du Gouvernement lorsqu’est en jeu une minoration de leurs recettes.
2.– Un lien plus lâche entre la tutelle et l’opérateur pouvant rigidifier le pilotage des politiques publiques
Le Gouvernement lui-même, au travers des diverses tutelles qui s’imposent auxdits opérateurs, peut également se voir dépossédé d’une partie de ses prérogatives.
Échappant plus facilement à l’autorisation de dépenser délivrée par le Parlement, parfois chargés d’assurer directement le recouvrement des taxes qui leur sont affectées (8), pouvant jouir de marges financières confortables, responsables de la régulation d’un secteur qui en fait les interlocuteurs privilégiés voire uniques des professionnels concernés, parfois dotés de réelles prérogatives de puissance publique via un pouvoir de règlementation (9), les opérateurs peuvent être tentés de pousser au maximum le processus d’autonomisation par rapport à leur tutelle, quand bien même, juridiquement et hiérarchiquement, celle-ci est supposée contrôler leur action.
Les déclarations de Mme Marie-Astrid Ravon, sous-directrice chargée de la 8ème sous-direction de la direction du Budget tendent à corroborer ce constat lorsqu’elle confirme que « la gouvernance des opérateurs est parfois plus délicate, les professionnels du secteur étant mieux représentés – et souvent majoritaires – dans les conseils d’administration, ce qui n’est pas le cas pour les opérateurs financés par le budget de l’État » (10).
De fait, par le degré de liberté supplémentaire qu’elle confère
– l’autonomie financière étant la première étape, et sans doute l’étape essentielle, vers une autonomie de fonctionnement –, l’affectation directe de ressources fiscales tend à un affadissement du rôle joué par la tutelle et partant, à un pilotage plus erratique des politiques dont elle a la charge via ses opérateurs.
En outre, comme rappelé précédemment, les mécanismes d’ajustement sont beaucoup plus lents et moins efficaces en matière de ressources affectées. Pour modifier une affectation de recettes, une disposition législative est nécessaire, procédure beaucoup plus contraignante qu’un ajustement de dotation budgétaire en cours d’année.
3.– Des risques potentiels sur le niveau de la dépense publique
Les risques que fait peser le recours à l’affectation de recettes sur le niveau de la dépense publique sont réels. S’ils ne se manifestent pas systématiquement
– et c’est heureux – ils n’en sont pas moins inhérents à cette technique et, à ce titre, doivent être sérieusement pris en considération avant de décider de l’utilisation de celle-ci.
● Le premier risque est celui d’un pilotage de la politique publique par la recette. Ce qui importe alors est moins la définition et l’appréciation objectives des besoins attachés à cette politique publique que le niveau maximal de dépenses que la ressource – pour peu qu’elle soit dynamique – permet d’assurer. Dans ce cas, le système s’auto-entretient et se déconnecte progressivement de son cœur de métier, tandis que s’opère un décrochage entre la pression fiscale pesant sur tel secteur et les besoins objectifs de celui-ci. Au total, si la ressource affectée doit permettre une légitime corrélation entre les ressources et les besoins identifiés, elle ne doit en aucun cas favoriser une mise en adéquation artificielle des besoins aux ressources.
● Le caractère procyclique des taxes affectées peut venir aggraver ce premier risque. Lorsque la conjoncture est favorable, le produit des taxes augmente mécaniquement : davantage d’actions sont entreprises, davantage d’aides sont accordées au secteur concerné et de nouveaux besoins peuvent opportunément se manifester qui induiront une extension des compétences de l’opérateur et, partant, une augmentation de ses dépenses.
En outre, l’affectation de recettes peut être une source d’aisance financière pour les organismes bénéficiaires, protégés des régulations budgétaires qui affectent souvent les subventions. L’affectation peut donc encourager un certain laxisme dans la gestion.
Toutefois, cette logique procyclique devient défavorable aux opérateurs en cas de retournement de conjoncture. Dans cette hypothèse, le produit des taxes affectées peut s’avérer insuffisant au regard des charges à couvrir. Une telle situation peut alors conduire la tutelle à envisager l’attribution de subventions d’équilibre accroissant encore le niveau de la dépense publique.
Le financement par ressources affectées peut donc compromettre la visibilité financière des bénéficiaires de celles-ci en cas de décalage entre le rendement de la taxe et les besoins des opérateurs. Des taxes dont le taux ou l’assiette serait mal calibré, trop peu dynamiques, trop sujettes à la conjoncture et dont le produit serait par conséquent incertain, peuvent menacer l’équilibre financier des opérateurs et, in fine, nécessiter le versement de subventions. Tel est structurellement le cas pour l’INRAP. Au cours des exercices les plus récents, l’insuffisance du produit de la redevance d’archéologie préventive affectée à l’Institut s’est régulièrement traduite, en loi de finances initiale comme en gestion, par l’octroi de subventions financées par crédits budgétaires.
● Par ailleurs, il convient d’éviter tout contournement de la norme de dépense par le recours à l’affectation de recettes. Le ministère du Budget est conscient d’un tel risque et ses représentants ont indiqué à la mission que « pour [le] juguler, nous avons défini une charte de budgétisation (11) et considéré qu’en dehors des cas de la typologie [cf. supra], l’évolution de ces affectations de recettes serait intégrée dans le calcul de la norme de dépenses dite élargie » (12). Reste à savoir si le Gouvernement fait une appréciation stricte ou souple de cette typologie et des critères qui lui sont associés.
● Une autre problématique, liée aux risques précédemment identifiés et au rétrécissement des pouvoirs du Parlement et de la tutelle, tient à l’absence, ou du moins l’insuffisante participation des opérateurs affectataires à l’effort de modération de la dépense publique. Des ressources potentiellement dynamiques, largement à l’abri des régulations budgétaires ministérielles ou parlementaires permettent en effet à leurs bénéficiaires de ne pas ressentir trop durement les contraintes qui pèsent sur le niveau de la dépense publique.
M. Jacques Renard, directeur du CNV, ne dit pas autre chose lorsqu’il déclare à la mission que « notre mode de financement a [l’avantage] de nous faire échapper aux conséquences des difficultés rencontrées par les finances publiques, nationales ou locales : par les temps qui courent, les subventions augmentent rarement ! Il nous rend autonomes, nous épargnant la probable stagnation de nos moyens d’intervention que nous aurions éprouvée si nous vivions des subventions de l’État. » (13).
De la même manière, interrogée sur la pertinence du recours à la taxe affectée, Mme Isabelle Lemesle, présidente du CMN, assurait : « il ne nous appartient certes pas de décider de notre mode de financement, mais nous constatons que la ressource budgétaire diminue tandis que la taxe affectée qui lui a été partiellement substituée reste plafonnée à 10 millions d’euros » (14).
À cet égard, l'attachement des opérateurs au principe de la ressource affectée est parfaitement compréhensible – qui ne souhaiterait échapper à la contrainte budgétaire ? Toutefois, l'effort de réduction de la dépense publique se doit d'être global et équitablement réparti entre toutes les composantes de la sphère publique, quel que soit leur mode de financement.
● Enfin, dernier risque qu’il convient de souligner, celui qui tend à la distension du lien entre la taxe et les dépenses qu’elle finance. Or, comme le rappelait à juste titre Mme Marie-Astrid Ravon, « l’intérêt des affectations de recettes est qu’elles reposent sur un lien direct entre les agents économiques assujettis aux taxes et la redistribution du produit de celles-ci au sein du secteur, lien de nature à accroître le consentement à l’impôt et à réduire les externalités économiques négatives » (15).
Certains redevables des taxes affectées au CNC, et notamment les fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui acquittent la part « distributeurs » de la taxe sur les services de télévision, ne semblent pas totalement convaincus du lien entre l’imposition qu’ils supportent et les dépenses que celle-ci permet de financer. Si l’on peut légitimement considérer que les FAI profitent directement de l’audience et de la richesse produite par les contenus audiovisuels générés par le secteur soutenu par le CNC et mis à disposition des internautes, on éprouve davantage de difficultés à identifier spontanément le lien logique entre les ressources directement affectées au CMN et les dépenses dont il assure le financement.
Rappelons en effet que le CMN, dont la mission est de conserver, restaurer, gérer, animer et ouvrir à la visite une centaine de monuments, s’est vu affecter, dans le cadre de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (16), 15 % du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne, dans la limite de 10 millions d’euros par an (cf. infra : partie dédiée au CMN pour un développement plus précis).
C.– LES PRÉCONISATIONS DE LA MEC POUR UN RECOURS EXCEPTIONNEL AU FINANCEMENT PAR RESSOURCES AFFECTÉES
Au regard des effets indésirables que produit le recours à l’affectation de ressources sur le contrôle du Parlement et du Gouvernement, et à la lumière des risques pour la gestion publique, la MEC est conduite à formuler deux premières propositions . Elles ont une vocation globale, et ne visent pas spécifiquement les seuls opérateurs culturels bénéficiaires de taxes affectées.
1.– Remédier à la myopie budgétaire des pouvoirs publics
La première vise à réintégrer dans le cadre budgétaire de droit commun un maximum de financements publics afin d’éviter la myopie du Parlement comme du Gouvernement dans la gestion des finances publiques.
Proposition n° 1 – Limiter strictement le recours à la débudgétisation permise par l’affectation, à des opérateurs, de ressources qui devraient être versées au budget général de l’État. |
2.– Éviter tout dérapage des coûts et soumettre les opérateurs à l’effort de modération de la dépense publique
La deuxième entend, d’abord, améliorer l’information du Parlement ; ensuite, éviter tout risque de pilotage par la recette des politiques publiques concernées ; enfin, soumettre les opérateurs financés par ressources affectées à l’effort de modération de la dépense publique en proposant que le surplus de recettes constaté par rapport à la couverture de leurs charges soit automatiquement reversé au budget général de l’État et contribue, le cas échéant, à la réduction du déficit public.
Bien entendu, ce plafond de dépenses – et donc de recettes – pourrait être révisé en gestion si des circonstances objectives l’exigeaient, dans l’hypothèse où l’opérateur aurait à assumer des charges supplémentaires, dès lors que la couverture de celles-ci serait pleinement justifiée. Des subventions d’équilibre, financées par crédits budgétaires, pourraient alors être attribuées.
Proposition n° 2 – Indiquer, dans le cadre de chaque projet de loi de finances et pour chaque opérateur affectataire de recettes fiscales, le montant des charges estimées pour l’année suivante, ce plafond de dépenses permettant de déterminer le plafond des recettes nécessaires pour les couvrir. Poser le principe selon lequel la part des ressources affectées dépassant le plafond ainsi arrêté est automatiquement reversée au budget général de l’État. |
D.– LES OPÉRATEURS CULTURELS FINANCÉS PAR DES RESSOURCES AFFECTÉES : PLUS DE 860 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES EN 2010
1.– Champ de l’étude de la MEC
Ainsi qu’on a pu le deviner à la lecture des développements précédents, cinq opérateurs culturels bénéficient de ressources affectées et ont, à ce titre, fait l’objet des travaux de la MEC, qui consacre à chacun d’entre eux une partie dédiée. Ils se caractérisent par leur grande hétérogénéité quant à la nature et l’étendue de leurs missions, leur poids en termes de financement public, et l’importance des ressources affectées qui leur sont allouées.
Ces cinq opérateurs sont :
– le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;
– le Centre des monuments nationaux (CMN) ;
– le Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV) ;
– le Centre national du livre (CNL).
LES OPÉRATEURS CULTURELS BÉNÉFICIAIRES DE RESSOURCES AFFECTÉES AU SEIN DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Opérateur |
Mission de rattachement |
Programme de rattachement |
CNC |
Culture |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
INRAP |
Culture |
Patrimoines |
CMN |
Culture |
Patrimoines |
CNV |
Culture |
Création |
CNL (a) |
Médias, livre et industries culturelles |
Livre et industries culturelles |
(a) Jusqu’au projet de loi de finances pour 2011, le CNL était un opérateur de la mission Culture, rattaché au programme Création.
La MEC se sera également intéressée à l’Association pour le soutien au théâtre privé (ASTP), bien qu’elle ne soit pas à proprement parler un opérateur. Cette structure privée, sous statut d’association loi de 1901, est en effet bénéficiaire d’une recette fiscale qui lui est directement affectée et, à ce titre, soumise au contrôle économique et financier de l’État (cf. infra : partie relative au CNV).
Comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-dessous, outre le cas spécifique du CMN, les ressources affectées ont un poids prédominant dans le financement des opérateurs culturels qui en bénéficient.
MODALITÉS DE FINANCEMENT DES OPÉRATEURS CULTURELS BÉNÉFICIANT DE RESSOURCES AFFECTÉES (EXÉCUTION 2010)
(en millions d’euros)
Opérateur |
Ressources publiques |
Dont ressources affectées |
Part des ressources affectées dans les ressources publiques |
Ressources propres et autres |
Ressources totales |
Part des ressources affectées dans les ressources totales |
CNC |
754,4 |
754,2 (a) |
100 % |
– |
754,4 |
100 % |
INRAP |
59,9 |
43,5 |
72,6 % |
93,9 |
153,8 |
28,3 % |
CMN |
48,6 |
5,2 |
10,7 % |
64 |
112,7 |
4,6 % |
CNV |
25,8 |
25,7 |
99,6 % |
2,7 |
28,5 |
90,1 % |
CNL |
36,2 |
33,2 |
91,7 % |
0,4 |
36,6 |
90,7 % |
TOTAL |
924,9 |
862 |
93,2 % |
161 |
1 085,9 |
79,4 % |
(a) Sur la légère différence entre les ressources publiques totales et les ressources affectées, voir infra la partie dédiée au CNC.
Les données pour l’année 2011 se fondent sur les budgets prévisionnels des opérateurs et, le cas échéant, sur les décisions modificatives intervenues.
MODALITÉS DE FINANCEMENT DES OPÉRATEURS CULTURELS BÉNÉFICIANT DE RESSOURCES AFFECTÉES (DONNÉES PROVISOIRES 2011)
(en millions d’euros)
Opérateur |
Ressources publiques |
Dont ressources affectées |
Part des ressources affectées dans les ressources publiques |
Ressources propres et autres |
Ressources totales |
Part des ressources affectées dans les ressources totales |
CNC |
749,8 |
749,8 |
100 % |
– |
749,8 |
100 % |
INRAP |
66,7 |
46,7 |
70 % |
101,9 |
168,6 |
27,7 % |
CMN |
41,8 |
9 |
21,5 % |
62,6 |
104,4 |
8,6 % |
CNV |
23,9 |
23,8 |
99,6 % |
2,2 |
26,1 |
91 % |
CNL |
38 |
35,3 |
93 % |
0,6 |
38,7 |
91 % |
TOTAL |
920,2 |
864,6 |
94 % |
167,3 |
1 087,5 |
79,5 % |
II.– LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE : LIMITER LES ACTIONS AUX BESOINS OBJECTIFS
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est une institution originale au sein du paysage culturel français. Il dispose d’un statut hybride spécifique qui fait de lui à la fois un établissement public administratif (EPA) et une direction d’administration centrale en charge de la réglementation et du contrôle d’un secteur et dépositaire, à ce titre, de prérogatives qu’il exerce sous l’autorité du ministre de la Culture et de la communication.
Le CNC a conduit des réformes d’importance, entreprises dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), et qui ont concerné tant son organisation que ses missions et les moyens de les exercer. Le résultat de ces réformes s’est incarné dans l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 qui procède à la substitution d’un code du cinéma et de l’image animée (CCIA) en lieu et place de l’ancien code de l’industrie cinématographique datant de 1956.
Aux termes de l’article L. 111-2 du CCIA, six missions incombent au Centre :
– une mission générale de veille de l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés ;
– une mission de soutien au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée (jeu vidéo notamment via la gestion d’un crédit d’impôt dédié (17)) pour en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies ;
– une mission de contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisée par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
– l’administration des registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, la centralisation et la communication aux titulaires de droits de tout renseignement relatif aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
– la collection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique (à ce titre, le Centre exerce notamment les missions relatives au dépôt légal) ;
– la participation à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.
Le CNC est quasi exclusivement financé par des ressources issues de la fiscalité affectée. Rappelons que le choix d’un tel mode de financement remonte à la création du Centre : la loi du 23 septembre 1948 avait ainsi créé une taxe « de sortie de film », ancêtre de la taxe sur les entrées en salle de cinéma (ou taxe spéciale additionnelle, TSA ; cf. infra), conçue pour alimenter le fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique.
A.– ADAPTER LE FINANCEMENT AUX BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES DU SECTEUR TOUT EN PRÉVENANT L’INFLATION DES DÉPENSES
1.– Le CNC bénéficie de trois taxes affectées
Les ressources du CNC sont aujourd’hui constituées du produit de trois taxes dont le montant total est estimé à 750 millions d’euros pour 2011 et qui alimentent le compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) :
– la taxe sur les entrées en salle de cinéma (18) (TSA) : son taux est fixé à 10,72 % du prix d’un billet de cinéma ; son produit est évalué à 127,9 millions d’euros pour 2011 ;
– la taxe sur les services de télévision (19) (TST) : son produit est évalué à 583,3 millions d’euros pour 2011 ; elle est subdivisée en deux volets :
● le volet « éditeurs », acquitté par les éditeurs de services de télévision (les chaînes) : le taux de ce volet est fixé à 5,5 % de l’assiette imposable (20) au-delà d’une franchise de 11 millions d’euros, et après abattement de 4 % pour les sommes constituées (produit estimé à 316,2 millions d’euros pour 2011) ;
● le volet « distributeurs », acquitté par les distributeurs de services de télévision (21) : son taux est progressif, de 0,5 % à 4,5 % selon 9 tranches d’imposition applicables à l’assiette imposable (22) au-delà d’une franchise de 10 millions d’euros (produit estimé à 267,1 millions d’euros pour 2011).
– la taxe vidéo (23) : assise sur le chiffre d’affaires des secteurs de l’édition de vidéo physique et de vidéo à la demande, son taux est fixé à 2 % ; son produit est estimé à 38,5 millions d’euros pour 2011.
Un compte spécial du Trésor retraçant les opérations de soutien avait été créé par la loi de finances pour 1960. Transformé par la suite en compte d’affectation spéciale (24), il fut supprimé en 2009, le CNC devenant, à compter du 1er janvier de cette même année, affectataire direct des ressources du fonds.
Le CNC est chargé du recouvrement et du contrôle de la TSA depuis le 1er janvier 2007 et de la TST depuis le 1er janvier 2010. Il apparaît que la gestion directe de ces taxes par le Centre a permis de réaliser des économies substantielles en termes de gestion. En effet, d’après les informations recueillies par la MEC, le coût de la gestion et du contrôle par les services du CNC est inférieur à 1 million d’euros pour les deux taxes. Sous le régime antérieur, la direction générale des Finances publiques (DGFIP) prélevait des frais de gestion à hauteur de 4 % sur le produit de TSA (soit 4,7 millions d’euros en 2006), et de 1,5 % sur le produit de la TST (soit plus de 6 millions d’euros en 2009). Au total, la gestion directe aura donc permis d’économiser quelque 10 millions d’euros.
LES RECETTES DU CNC DE 2004 À 2011
(en euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 (BP) | |
TSA |
120 325 917 |
104 596 978 |
119 720 927 |
116 699 329 |
122 197 099 |
127 771 156 |
146 343 408 |
127 870 000 |
TST |
325 016 896 |
323 984 729 |
340 278 010 |
362 238 424 |
377 392 609 |
451 020 421 |
574 754 782 |
583 346 000 |
Taxe vidéo |
38 258 297 |
37 459 669 |
35 323 139 |
33 296 335 |
32 756 387 |
32 909 594 |
33 065 975 |
38 517 000 |
Autres recettes (a) |
1 325 477 |
734 816 |
340 169 |
414 644 |
1 147 687 |
161 062 |
228 034 |
50 000 |
TOTAL |
484 926 588 |
466 776 192 |
495 662 245 |
512 648 732 |
533 493 782 |
611 862 233 |
754 392 199 |
749 783 000 |
Source : CNC.
(a) Les autres recettes sont constituées :
– majoritairement, jusqu’au 31 décembre 2008, des remboursements d’avances sur recettes attribuées avant 1996. Depuis le 1er janvier 2009 et l’affectation directe des taxes au CNC, ces remboursements sont enregistrés directement dans le budget du Centre (au même titre que les remboursements d’avances postérieures à 1996) et ne sont plus suivis au titre des recettes du fonds de soutien ;
– de deux taxes d’objet dissuasif et de rapport faible : les prélèvements spéciaux sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à la violence ;
– et plus marginalement, des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par le CSA à l’encontre des éditeurs de services de télévision qui n’ont pas respecté leurs obligations.
Le CNC a encore récemment adapté sa politique et ses mécanismes de soutien en ouvrant le bénéfice du compte de soutien aux productions sur Internet (25).
En outre il fait face à des charges croissantes qui tiennent à deux phénomènes :
– dans le domaine du cinéma, la numérisation des œuvres et des salles, laquelle va se traduire par un investissement de 121 millions d’euros d’ici 2012 ; au total, selon son président M. Éric Garandeau, le soutien à la numérisation – via des aides à la production tous supports notamment – suppose un investissement global de quelque 500 millions d’euros au cours des trois à cinq années à venir ;
– la nécessité de disposer d’un volume croissant de productions audiovisuelles – en donc d’en soutenir davantage –, du fait de la multiplication des « écrans », des supports et des usages de diffusion et de consommation ; en ce sens, le CNC répond clairement à une demande nouvelle et massive.
LES TAXES AFFECTÉES AU CNC : LES PRINCIPALES MESURES D’ASSIETTE DE 2004 À 2010
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Taxe vidéo Extension de l’assiette à la vidéo à la demande (VàD) |
TST Élargissement assiette : – au produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de SMS liés aux programmes des redevables concernés ; – aux recettes de parrainage. |
– |
TSA Transfert du recouvrement au CNC Taxe vidéo Taux majoré à 10 % pour les œuvres pornographiques et violentes |
TST 1) Élargissement de l’assiette aux distributeurs de services de télévision 2) Majoration du taux éditeur pour la diffusion haute définition et la télévision mobile personnelle |
Toutes taxes Affectation directe des taxes au CNC (clôture du CAS Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale) |
TST Transfert du recouvrement au CNC |
Source : CNC.
2.– Pour une meilleure définition de la taxe sur les services de télévision couplée à une modération de la pression fiscale pesant sur les distributeurs
● La TSA, la taxe vidéo et la TST dans son volet « éditeurs » ne semblent pas poser de difficultés majeures et sont globalement bien acceptées dans leurs principes comme dans leurs modalités d’acquittement par les redevables – même si certains éditeurs, tout en rappelant le caractère légitime du soutien à la création, soulignent la contrainte forte que la TST peut faire peser sur leur politique d’investissement. Elles ne paraissent donc pas devoir faire l’objet d’adaptations spécifiques. En revanche, le volet « distributeurs » de la TST cristallise certaines tensions, liées à la réforme du régime fiscal afférent à la TVA pesant sur les FAI.
La loi de finances pour 2011 a en effet procédé à la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques. Concrètement, il s’agissait de réviser le régime fiscal applicable aux offres triple play proposées par les FAI et incluant les services d’Internet, de téléphonie et de télévision afin, aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi de finances, « de mettre un terme à l’incidence sur les recettes publiques de l’application du taux réduit aux services de télévision […] et de l’utilisation extensive de la solution forfaitaire retenue depuis 2007 pour la répartition de la base d’imposition entre taux applicables selon la nature des services rendus ».
Sans entrer dans les détails techniques d’une telle réforme (26), rappelons que, en vertu de la réglementation antérieure à 2011, les FAI pouvaient légalement appliquer un taux réduit de TVA sur la partie « services de télévision » de leurs offres, les autres services étant taxés selon le droit commun. Conformément à une instruction fiscale datée de 2008 (27), les FAI commercialisant des offres composites ont donc procédé à une « répartition fiscale » selon l’activité concernée.
Afin de simplifier et d’uniformiser les pratiques, la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur avait consacré le principe d’une valorisation de la part des services de télévision dans de telles offres – et, corrélativement, de la part soumise aux taux réduits de TVA – à hauteur de 50 % du prix desdites offres (28). Toutefois, en application de l’instruction fiscale précitée, postérieure à la loi, une ventilation différente permettant une valorisation des services de télévisions supérieure à 50 % restait possible, pour peu que les opérateurs fussent en mesure de prouver que cette répartition reflétât davantage la réalité économique de l’offre qu’ils proposaient (29).
En contrepartie de cette fiscalité allégée, les FAI devaient contribuer au soutien de la production cinématographique et audiovisuelle via l’acquittement du volet « distributeurs » de la TST, dont l’assiette correspondait à la part de l’offre consacrée aux services de télévision, après déduction de 10 %. Dans le cas d’une part de services de télévision valorisée à hauteur de 50 % du prix de l’offre, l’assiette de la TST « distributeurs » s’établissait donc à 45 % du prix de l’offre composite.
Or, en raison d’exigences relatives à la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire, la loi de finances pour 2011 a fait basculer les services de télévisions inclus dans des offres composites dans le droit commun de la fiscalité, avec application d’un taux normal de TVA (30), ces services étant considérés comme un simple accessoire de l’accès à un réseau de communications électroniques dont ils doivent, par conséquent, suivre le régime fiscal.
En dépit de cette réforme, les FAI restent redevables du volet « distributeurs » de la TST. De fait, si cette imposition ne peut désormais plus s’analyser comme la contrepartie d’un allègement fiscal sur la TVA, force est de constater que les opérateurs concernés sont les bénéficiaires directs des contenus cinématographiques et audiovisuels. Ceux-ci attirent et produisent de l’audience et du trafic en termes de volume d’internautes, participent à la valorisation et à l’attractivité des réseaux mis à disposition par les FAI en répondant à une demande forte et exponentielle des utilisateurs en ce sens et, partant, génèrent de la richesse dont les FAI tirent profit in fine. Par conséquent, il n’est pas illégitime que les acteurs d’Internet participent au financement de contenus produits par d’autres secteurs et grâce auxquels ils sont en mesure d’attirer clients et annonceurs.
● C’est pourquoi il convient de s’assurer du respect de la législation fiscale par l’ensemble des opérateurs et de mettre fin aux stratégies de contournement de l’esprit de la loi – sinon de sa lettre – qui ont pu se faire jour suite à la suppression du taux réduit de TVA, risque qu’avait souligné le Rapporteur général lorsque la réforme a été proposée, de même qu’il avait mis en garde contre « les conséquences collatérales [qui] pourraient être brutales sur le produit de la taxe COSIP » (31).
Analysant le cas d’un opérateur qui valorisait, avant 2011, les services de télévision proposés à hauteur de 50 % du prix de l’offre et qui, après la réforme, estimerait qu’ils représentent une part – et donc une valeur – plus que marginale dans cette offre globale, on est fondé à s’interroger s’il n’y avait pas soit survalorisation de ces services ex ante soit, inversement, sous-valorisation ex post.
Il apparaît donc nécessaire de procéder à une révision de la définition de la TST dans son volet « distributeurs » afin que l’ensemble des opérateurs censément redevables le soient effectivement. Son assiette doit être adaptée afin d’appréhender la totalité des services concernés et de sécuriser le dispositif au regard des bouleversements technologiques et économiques que connaît le secteur des nouveaux médias. Il s’agit de retenir la définition la plus globale possible du champ des services couverts par la taxe pour y soumettre l’ensemble des redevables potentiels afin que le dispositif soit pleinement opérant en dépit des sauts technologiques qui ne manqueront pas de se produire – et des stratégies commerciales qui ne manqueront pas d’être élaborées. Faute d’une telle réforme et dans l’hypothèse d’une contagion à l’ensemble des opérateurs des stratégies d’optimisation fiscale, le CNC estime que la perte de recettes atteindrait, en année pleine, quelque 140 millions d’euros, une moins-value d’importance compte tenu des investissements à réaliser dans les années à venir (notamment le plan de numérisation).
Parallèlement à cet élargissement d’assiette – qui, en réalité, n’est qu’une correction nécessaire afin de rendre la norme et les pratiques conformes à la volonté exprimée par le législateur et de garantir l’équité fiscale entre opérateurs – il conviendra de procéder à une minoration des taux applicables afin de maintenir la pression fiscale pesant sur les redevables à un niveau constant, voire de la réduire sensiblement. En effet, si ces opérateurs doivent participer à la rémunération de contenus dont ils profitent, il s’agit de ne pas grever inconsidérément des secteurs en pleine expansion économique faisant figure de locomotives de l’innovation et de l’investissement, et s’inscrivant dans un champ particulièrement concurrentiel.
Proposition n° 3 – Adapter le volet « distributeurs » de la taxe sur les services de télévision : – en élargissant son assiette. Veiller à la circonscrire aux seuls montants acquittés par les usagers en rémunération de services de télévision ou d’offres dont la souscription est nécessaire à la réception de tels services ; – et en abaissant ses taux. |
Enfin, de manière plus globale, l’importance des recettes du CNC – et par conséquent, de ses dépenses – induit un besoin impératif : celui de s’assurer que le Centre mène une politique de demande, répondant à des charges et des nécessités objectives, et non une politique d’offre, adaptée a posteriori en fonction du niveau de ses ressources.
B.– RÉORIENTER LE DISPOSITIF DE SOUTIEN VERS PLUS DE SÉLECTIVITÉ ET PLUS DE TRANSPARENCE
Eu égard aux masses financières en jeu et à l’importance des soutiens accordés par le CNC pour les différents secteurs concernés, la MEC juge essentiel de procéder à une adaptation des mécanismes actuels afin d’en assurer la pleine efficacité conformément à l’impératif d’utilité et de bon emploi de la dépense publique.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE SOUTIEN DU CNC DE 2007 À 2010
(en millions d’euros)
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
528,4 |
600,7 |
631,3 |
665,3 |
Source : CNC.
1.– Renforcer la part des aides sélectives
Les dépenses d’intervention du CNC peuvent être classées en deux catégories : le soutien automatique et les soutiens sélectifs, les seconds étant attribués après avis de commissions composées de professionnels du secteur en fonction de la qualité artistique des projets.
Ainsi que l’a rappelé M. Éric Garandeau, président du CNC, les soutiens accordés par le Centre peuvent atteindre près de 9 % du financement d’un film : 6 % au titre du soutien automatique, et jusqu’à 2,7 % d’aide sélective. En ajoutant les 2 % d’aides régionales dont peuvent potentiellement bénéficier les productions, le financement du cinéma peut se voir pris en charge à hauteur de plus de 10 % par l’effort public global.
Les dernières données disponibles montrent que plus de la moitié – 53 % – des dépenses d’intervention du CNC relèvent des aides automatiques. Les masses financières considérables collectées et gérées par le CNC pour être reversées aux opérateurs économiques invitent incontestablement, dans un contexte de rigueur budgétaire rendue nécessaire par la situation dégradée des finances publiques, à reconsidérer le poids relatif de chaque type de soutien dans les dépenses du Centre.
Parallèlement, si le CNC doit effectivement apporter une assistance inconditionnelle à certains opérateurs afin de maintenir, de consolider et d’éviter l’émiettement d’un tissu économique et industriel spécifique, et si soutien automatique et soutien sélectif sont liés, il n’en demeure pas moins que la mission première du Centre consiste à favoriser les productions artistiques de qualité afin d’en permettre l’émergence et d’en accompagner le succès. En outre, le renforcement des aides sélectives pourrait permettre le renouvellement du vivier des producteurs en évitant le développement, préjudiciable et inefficace, de situations de rente.
Pour imparfaites que soient de telles mesures, le nombre d’entrées en salles des films soutenus, l’audience recueillie par les productions audiovisuelles aidées, et le succès à l’export de l’ensemble de ces créations constituent des indicateurs de l’efficacité du soutien public à ce secteur. Or si le cinéma français enregistre de belles performances (32), force est de constater, ainsi que le reconnaissent les professionnels eux-mêmes (33), qu’en dépit des aides et comparativement à nos voisins européens notamment, les volumes de fictions audiovisuelles françaises exportées restent modestes, de même que leurs résultats d’audience (34).
Aussi, il conviendrait certainement de renforcer le poids des aides sélectives dans les dépenses totales de soutien, une part inférieure à la moitié de l’effort financier accordé paraissant insuffisante. Il n’appartient pas à la MEC de décider de la part des dépenses qu’il faudrait consacrer au soutien sélectif. Il ne s’agit évidemment pas davantage de soumettre le secteur à un quelconque oukase, la reventilation des aides devant s’opérer en concertation avec les professionnels concernés. Il n’en demeure pas moins qu’une réorientation substantielle apparaît nécessaire.
Proposition n° 4 – Renforcer la part des aides sélectives dans le soutien total accordé par le CNC. |
2.– Clarifier les procédures de traitement des dossiers
Certains professionnels auditionnés par la MEC ont pu relever, pour la déplorer, une certaine opacité dans le processus de traitement des demandes de soutiens. Aux dires de ceux-ci, il pouvait apparaître difficile à tel professionnel soumettant un dossier aux commissions compétentes de prévoir, objectivement, le sort probable qui serait réservé à sa demande.
La MEC ne saurait évidemment confirmer ou infirmer de telles déclarations. Quoi qu’il en soit, eu égard à l’importance de la dépense publique afférente, elle estime par principe tout à fait légitime de demander aux commissions du CNC d’expliciter précisément les critères de sélection auxquels elles font référence pour accorder – ou dénier – le soutien du Centre.
La critique se nourrissant du manque de transparence – réel ou supposé –, une telle formalisation officielle de la doctrine adoptée par chaque commission permettra, le cas échéant, d’y répondre et de la neutraliser, d’évacuer tout soupçon de favoritisme et, en tout état de cause, d’améliorer les procédures en les clarifiant.
Proposition n° 5 – Formaliser, pour chaque commission attributrice de soutiens, une charte établissant précisément les principes et critères de sélection présidant aux choix des projets aidés. Rendre ces chartes publiques via leur mise en ligne sur le site Internet du CNC. |
III.– POUR UN FINANCEMENT PÉRENNE DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Établissement public administratif de recherche placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a été créé en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Son statut a été précisé par le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié.
L’Institut a pour mission d’assurer la détection et l’étude du patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par les travaux d’aménagement du territoire. Il exploite et diffuse l’information auprès de la communauté scientifique, et concourt à l’enseignement et à la valorisation de l’archéologie auprès du public. Ces missions, qui figurent à l’article L. 523-1 du code du patrimoine, couvrent ainsi la totalité du spectre des activités de l’archéologie – en dehors des prérogatives de l’État prescripteur. L’INRAP est destinataire de l’ensemble des rapports finaux d’opérations, à des fins d’exploitation scientifique et de mise à disposition de la communauté archéologique.
Rappelons qu’antérieurement au régime mis en place par la loi de 2001, les services de l’État s’appuyaient sur la loi du 27 septembre 1941 pour s’opposer à la destruction des sites archéologiques par les travaux concourant à l’aménagement du territoire : ils négociaient ainsi avec les aménageurs la réalisation de « fouilles de sauvetage » qui étaient confiées à l’Association pour les fouilles nationales (AFAN), structure créée en 1973.
La loi de 2001, en modernisant et en consolidant le cadre juridique de l’archéologie préventive, est venue consacrer les engagements pris par la France dans le cadre de la convention de Malte, signée en 1992 (cf. infra). Elle précise que l’archéologie préventive repose sur les trois principes suivants :
– l’État prescrit, contrôle et évalue la réalisation des opérations ;
– un établissement public administratif créé par la loi – l’INRAP – est chargé de les réaliser et de conduire les études et recherches afférentes. Pour ce faire, il est doté de missions élargies (cf. supra) et doit associer à l’exécution de ses missions l’ensemble des institutions de recherche publiques ;
– le financement de l’archéologie préventive repose sur les aménageurs qui doivent acquitter une redevance, imposition de toute nature, calculée par l’établissement selon les paramètres définis dans la prescription et en application d’un calcul précisé par la loi, fonction de l’importance des dommages subis par le site menacé.
Malgré le progrès qu’elle représentait dans l’organisation et la conduite du service public de l’archéologie préventive, la loi de 2001 ne devait pas subsister très longtemps sous sa forme originelle. En effet, 18 mois après son entrée en vigueur, elle était profondément modifiée par la loi du 1er août 2003 (35).
À cette occasion, le principe du monopole de l’INRAP est doublement abandonné :
– sur l’activité de diagnostics : si elle demeure publique, sa prise en charge est désormais partagée avec les collectivités territoriales dotées de services archéologiques agréés par l’État. On peut certes considérer qu’un monopole subsiste au profit du secteur public, toutefois au sein de ce « marché », l’INRAP n’est désormais plus l’opérateur unique : le monopole intégral a donc bien été supprimé ;
– sur l’activité de fouilles : la réalisation des opérations est totalement ouverte à la concurrence et peut relever de tout opérateur, public comme privé, dès lors que celui-ci a obtenu l’agrément de l’État.
Dans ce nouveau dispositif, le financement des opérations de diagnostic repose sur une redevance d’archéologie préventive (RAP) due par toute personne projetant d’exécuter des travaux d’aménagement affectant le sous-sol et soumis à déclarations ou autorisations en application notamment du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, à compter d'un certain seuil lié à la nature du projet. Une partie du produit de la RAP est affectée à un Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP, cf. infra).
Des exonérations sont prévues pour les travaux relatifs aux logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l'État, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements liés à des travaux agricoles et forestiers.
Les opérations de fouilles quant à elles, s’inscrivent dans le champ concurrentiel et commercial et sont rémunérées par un prix négocié entre l’aménageur et l’opérateur qu’il a choisi pour réaliser la fouille.
Au total, les ressources de l’INRAP sont constituées :
– de ressources propres qui correspondent à l’encaissement du produit de l’activité de fouilles et représentent jusqu’à 60 % de ses recettes totales (36) ;
– du produit d’une taxe affectée, la RAP, laquelle, subdivisée entre une « redevance DDE » et une « redevance DRAC », est censée assurer 33 % des recettes de l’Insitut.
De fait la RAP n’aura jamais tenu ses promesses en termes de rendement, fragilisant l’équilibre économique de la recherche archéologique préventive. Faut-il alors donner sa chance à une énième réforme du dispositif, ou convient-il plutôt de prendre acte d’une inadaptation de celui-ci au regard des charges qu’il est supposé couvrir, et tirer les conséquences qui s’imposent à la lumière d’un financement qui repose en réalité de plus en plus sur le versement de subventions budgétaires complémentaires ?
A.– REPENSER À NOUVEAU LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE… OU OPTER POUR UN FINANCEMENT EXCLUSIVEMENT BUDGÉTAIRE ?
La redevance d’archéologie préventive s’inscrit parfaitement, et doublement, dans la grille de lecture précédemment esquissée (cf. supra I) :
– elle répond à la logique de paiement pour service rendu, les aménageurs payant le prix de l’activité de diagnostic prise en charge par les opérateurs publics de l’archéologie préventive ;
– elle renvoie au principe « pollueur-payeur » et au souci d’internalisation des externalités négatives que sont susceptibles de produire les opérations d’aménagement affectant le sous-sol.
En ce sens, elle honore l’engagement international pris par la France, aux termes duquel il convient de conserver un lien entre celui qui porte atteinte au patrimoine archéologique et celui qui participe au financement des mesures de protection prises en conséquence.
Ainsi l’article 6 de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, ratifiée par la France en 1995, prévoit les modalités de financement de la recherche et conservation archéologique (37) :
« Chaque Partie s'engage :
I) À prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives ;
II) À accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive :
a) En prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux ;
b) En faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes. »
1.– Une situation financière dégradée
L’INRAP fait face à une situation financière extrêmement déséquilibrée, caractérisée par :
– des capitaux propres négatifs (- 21 millions d’euros), fruits de la succession de résultats d’exercice négatifs : pour 2010, le résultat de l’exercice a été déficitaire à hauteur de 6,15 millions d’euros, soit - 7,46 millions d’euros pour le secteur non lucratif et + 1,31 million d’euros pour le secteur lucratif, notamment en raison de reprises de provisions importantes ; le déficit 2010 du secteur non lucratif résulte d’importantes moins-values de RAP, le rendement ayant été inférieur de 20,5 % à la prévision (38) ;
– un endettement auprès de l’Agence France Trésor (AFT) de 18,9 millions d’euros (cf. infra) ;
– un fonds de roulement négatif de 5,2 millions d’euros au 31 décembre 2010 ;
– une trésorerie négative de 12 millions d’euros au 31 décembre 2010.
Il convient de préciser que cette situation est moins la conséquence d’une gestion hasardeuse qu’un produit de l’histoire de l’Institut.
En effet, l’INRAP a été créé sans fonds de roulement, les avances du Trésor effectuées en 2002 (20 millions d’euros), 2005 (3 millions d’euros), et 2007 (7,5 millions d’euros) auront atteint au total 30,5 millions d’euros sur cinq ans. Elles avaient vocation à être remboursées sous deux ans, grâce au produit de la redevance telle qu’instituée par la loi de 2001. Il n’en aura rien été puisque la RAP n’a pas produit le rendement escompté. Aussi, la dette contractée auprès du Trésor grève depuis lors les comptes de l’Institut. La RAP telle qu’issue de la réforme de 2003 ne génèrera pas davantage une ressource suffisamment dynamique en adéquation avec le niveau de prescription de l’État, alimentant à son tour les déficits de l’INRAP.
L’Institut s’est partiellement acquitté de cette dette en 2006 et 2007, à hauteur de 7,5 millions d’euros chaque année. L’État l’y a aidé via une subvention productrice d’intérêts. Sur les 30,5 millions d’euros avancés par l’AFT, 15 millions d’euros ont donc été remboursés. Reste à honorer une dette de 15,5 millions d’euros au titre du principal, auxquels s’ajoutent les 3,4 millions d’euros d’intérêts, soit 18,9 millions d’euros au total.
Aujourd’hui, l’enjeu est donc double : recapitaliser l’INRAP afin d’assainir sa situation financière ; et mettre en place un financement public stable et pérenne du secteur non lucratif, en adéquation avec les besoins.
2.– L’insuffisance structurelle du produit de la redevance d’archéologie préventive nécessite régulièrement l’octroi de subventions complémentaires
En dix ans d’existence, la redevance d’archéologie préventive n’aura jamais atteint le rendement initialement espéré, soit 80 millions d’euros environ. L’insuffisant dynamisme de la recette a ainsi compromis la visibilité financière de l’INRAP et n’a pas permis d’établir un modèle de financement stable et pérenne. Le régime de la RAP est codifié aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.
|
LE CALCUL DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (ART. L. 524-7 DU CODE DU PATRIMOINE) Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I.– Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2 (1), l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors œuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas. La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface. Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. II.– Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 (2), son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. La surface prise en compte est selon le cas : – la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; – la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; – la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ; – la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés. (1) Travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme. (2) Travaux affectant le sous-sol et donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, soumis à déclaration administrative préalable. |
Le tableau ci-dessous retrace le rendement de la RAP dans son dispositif consolidé tel qu’issu de la loi de 2003 récemment modifiée par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, dont l’article 8 a procédé à un relèvement des taux de la redevance.
RENDEMENT DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE « LOI DE 2003 » DEPUIS L’ORIGINE
(en millions d’euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 (a) | |
Part INRAP |
20,00 |
44,07 |
42,36 |
43,68 |
45,68 |
43,54 |
46,70 |
20,00 |
Dont sommes reversées aux collectivités territoriales |
– |
– |
– |
0,14 |
0,48 |
0,17 |
0,38 |
nd |
Part FNAP |
3,84 |
8,80 |
19,57 |
19,70 |
20,23 |
21,47 |
21,20 |
21,20 |
Frais de gestion DGFIP |
0,19 |
0,44 |
0,98 |
0,99 |
1,01 |
1,07 |
1,06 |
1,11 |
TOTAL |
12,80 |
29,33 |
65,23 |
65,67 |
67,43 |
71,57 |
70,67 |
74,01 |
(a) : Prévisions.
Source : INRAP.
Pour 2010, les encaissements de RAP se sont révélés inférieurs de 20,5 % aux prévisions, l’effritement du produit nécessitant l’octroi par le ministère de la Culture, en gestion, d’une subvention compensatrice complémentaire de 6,43 millions d’euros en sus des crédits alloués en loi de finances initiale (10 millions d’euros). Le solde (4,73 millions d’euros) est venu dégrader les ratios de l’activité de diagnostics.
De fait, face au rendement structurellement insuffisant de la RAP, des subventions budgétaires, dont le montant varie entre 10 et 30 millions d’euros selon les années, sont régulièrement versées à l’INRAP, en loi de finances initiale comme en gestion. En 2011 une fois encore, le ministère de la Culture a consenti un versement supplémentaire de 8 millions d’euros intervenu dans le cadre du collectif budgétaire relatif à la réforme de la fiscalité du patrimoine.
Au total, l’INRAP estime que l’ensemble des subventions budgétaires s’élève, en cumulé, à 134 millions d’euros depuis 2002 (39).
Incidemment, il semble nécessaire de rappeler que près de 10 % des recettes potentielles de RAP s’évaporent faute d’être recouvrées. En effet, si, selon les informations recueillies, le taux de recouvrement a fortement progressé, il s’établit autour de 90 %. Si toutefois elle est possible, une plus grande mobilisation des services de la DGFIP devrait permettre d’améliorer le produit de la RAP effectivement disponible.
3.– Le circuit de financement de l’archéologie préventive pourrait être utilement simplifié et clarifié
La loi du 1er août 2003 a créé le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), fonds de péréquation hébergé dans les comptes de l'INRAP sous forme d’un budget annexe.
Le FNAP a principalement pour objet de financer :
– la prise en charge du coût des fouilles prescrites à l’occasion de la construction de logements locatifs aidés ou de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes ;
– ainsi que les subventions pouvant être accordées par l'État aux aménageurs « traditionnels » impécunieux pour leur permettre d'assumer le coût des fouilles, à condition que leurs projets d’aménagements répondent aux critères définis par la commission du FNAP.
Dès notification des décisions d'attribution de subvention ou de prise en charge, l'INRAP procède au paiement par prélèvement sur le FNAP.
Le Fonds est alimenté par une partie du produit de la RAP. Cette quote-part est fixée annuellement par arrêté interministériel (40) sans pouvoir être inférieure à 30 % de ce produit.
Il apparaît, au regard des informations recueillies par la MEC, que l’INRAP ne peut, en 2011, poursuivre son activité que grâce au principe de trésorerie unifiée INRAP-FNAP, le Fonds disposant, jusqu’ici, d’une trésorerie excédentaire, son fonds de roulement atteignant 21,95 millions d’euros au 31 décembre 2010.
Toutefois, une telle situation est doublement insatisfaisante. D’une part, le rappeler est une lapalissade, mais si le législateur a pris soin d’isoler le FNAP au sein d’un budget annexe, c’est précisément pour que les financements alloués respectivement au FNAP et à l’INRAP ne soient pas fongibles. Si les contraintes qui pèsent sur l’INRAP sont compréhensibles, elles ne sauraient justifier le siphonage de ressources qui sont attribuées au FNAP pour un emploi bien particulier.
D’autre part, et c’est là une critique qu’ont pu émettre certains opérateurs concurrents de l’INRAP, cette trésorerie unifiée jette le doute quant à la réalité de la concurrence sur l’activité de fouilles, d’aucuns laissant entendre que si l’INRAP remporte certains marchés, c’est parce qu’il peut indûment mobiliser les moyens financiers du FNAP afin de couvrir le coût des opérations concernées, charges qu’il n’aurait pu honorer grâce à ses seules ressources. Or le financement, par l’impôt, d’une activité concurrentielle paraît pour le moins problématique.
Aussi, afin de remédier, d’une part, à une situation douteuse au regard des principes budgétaires et de la volonté du législateur, et, d’autre part, de répondre aux critiques affirmant que la concurrence se trouve parfois faussée au profit de l’INRAP, il conviendrait sans doute de clarifier et de simplifier les modalités de versement de la RAP.
Celle-ci pourrait être attribuée en totalité au FNAP, sa gestion étant assurée in concreto par un organisme tiers peu suspect de favoritisme, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par exemple. Les sommes nécessaires seraient ensuite reversées respectivement à l’INRAP et aux opérateurs publics réalisant des diagnostics, au prorata des diagnostics réalisés sur le territoire.
REPRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU MÉCANISME DE VERSEMENT DE LA RAP
Situation actuelle
Redevance d’archéologie préventive |


INRAP |
|
FNAP |
![]()
Opérateurs |
Situation envisageable
Redevance d’archéologie préventive |
![]()
FNAP |
[CDC]
![]()
![]()
INRAP |
Opérateurs |
Proposition n° 6 – Simplifier et clarifier les modalités d’affectation de la redevance d’archéologie préventive. Étudier la faisabilité d’une affectation totale de la redevance d’archéologie préventive au FNAP qui en confierait la gestion à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle reverserait à l’INRAP et aux opérateurs concernés les sommes nécessaires au financement des activités de diagnostic au prorata des diagnostics réalisés. |
4.– Les trois pistes de réforme de la redevance d’archéologie préventive
Face à l’insuffisance structurelle du produit de la RAP, le Premier ministre a missionné l’Inspection générale des Finances (41) afin de faire le bilan de la RAP et d’élaborer des propositions alternatives permettant de définir un système stable et pérenne de financement de l’archéologie préventive.
D’après les informations qu’elle a pu recueillir, la MEC est en mesure de présenter succinctement les trois scénarios de réforme envisagés et d’indiquer sa préférence a priori, sous réserve des arbitrages qui seront définitivement arrêtés, la réforme devant être proposée dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances.
a) Aménager le dispositif actuel : une réforme a minima
Le premier scénario, qui envisage une réforme a minima, consisterait à :
– réduire les exonérations de RAP, en y soumettant les lotissements et les zones d’aménagement concerté (ZAC) ;
– élargir son assiette, en abaissant le seuil d’imposition pour la RAP « urbanisme » (concrètement, il s’agirait d’abaisser de 1 000 m² à 300 m² de surface hors œuvre nette – SHON – le seuil au-delà duquel l’imposition est due) ;
– augmenter le taux de chacune des deux composantes de la RAP (filière « urbanisme » et filière « DRAC »).
Cette réforme ne remettrait donc pas en question le fonctionnement actuel de la RAP et ne permettrait pas, a priori, de répondre aux défauts structurels de la celle-ci.
b) Substituer à la redevance une taxe sur les mutations de terrains à bâtir : des inconvénients dirimants
Le second scénario envisage le remplacement de la RAP par une nouvelle taxe sur les mutations de terrains à bâtir.
Il présente trois défauts majeurs :
– il risquerait de renchérir le foncier ;
– il conduirait à introduire une nouvelle part « État » dans un impôt local, complexifiant et opacifiant encore davantage les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales ;
– son rendement serait volatil car soumis aux variations du marché immobilier.
c) Articuler la réforme de la redevance avec celle de la taxe d’aménagement : le scénario le plus prometteur
Le troisième et dernier scénario apparaît comme le plus satisfaisant a priori. Il viserait à mieux articuler la RAP avec la réforme de la taxe d’aménagement. Il s’agirait de supprimer la RAP « urbanisme » pour lui substituer une augmentation de la taxe d’aménagement, offrant une assiette plus large et permettant de simplifier les modalités de recouvrement. La RAP « DRAC » serait maintenue et simplifiée.
Rappelons que, instituée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 (42), la taxe d’aménagement (TA) – couplée à un versement pour sous-densité (VSD) – s’est substituée à quelque six anciennes taxes d’urbanisme (43).
Si la réforme était effectivement proposée et votée avant la fin de l’année 2011, il faudrait toutefois attendre 2014 pour apprécier le rendement, en année pleine, du nouveau dispositif (en raison du décalage dans la perception de la TA).
Position de la MEC La MEC indique sa préférence a priori pour l’adossement à la taxe d’aménagement de la filière « urbanisme » de la redevance d’archéologie préventive, sous réserve des arbitrages qui seront définitivement arrêtés. |
En tout état de cause, quel que soit le scénario retenu, il semble nécessaire, au-delà de la stricte problématique du financement « quotidien » de l’archéologie préventive, d’assainir la situation financière de l’INRAP en procédant à un apurement de la dette contractée auprès de l’Agence France Trésor, afin de solder celle-ci et de ne plus grever les comptes de l’Institut.
Proposition n° 7 – Procéder à l’apurement de la dette de l’Institut national de recherches archéologiques préventives auprès de l’Agence France Trésor. |
Précisons enfin qu’une première préconisation de l’IGF, relative aux activités du FNAP, pourrait être mise en œuvre, par voie réglementaire : l’introduction d’un ticket modérateur à la charge des aménageurs hors particuliers qui construisent pour eux-mêmes. Le FNAP ne prendrait en charge que 75 % des coûts, contre 100 % aujourd’hui, ce qui lui permettrait de dégager des marges de manœuvre budgétaires tout en incitant les aménageurs à s’impliquer sur des zones vierges de vestiges archéologiques. À la connaissance de la MEC, cette mesure n’avait pas été mise en œuvre au moment de la publication du présent rapport.
POUR UN FINANCEMENT EXCLUSIVEMENT BUDGÉTAIRE DU VOLET « DIAGNOSTICS » DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ? Constatant que la RAP n’a jamais tenu les promesses de rendement qui auraient permis un financement stable et pérenne de l’archéologie préventive, la MEC s’interroge sur l’opportunité de procéder à une budgétisation totale de la ressource publique allouée à celle-ci. Cette activité de service public n’étant, en réalité, maintenue à flot qu’au prix de contorsions budgétaires constantes via l’attribution de subventions complémentaires, peut-être conviendrait-il d’en tirer pleinement les conséquences. En plus de remédier aux défauts de toute ressource affectée quant à la portée du contrôle des pouvoirs publics identifiés supra (cf. partie I), une telle réforme aurait au moins une vertu : celle d’obliger État à faire coïncider ressources et niveau de prescription des diagnostics. |
B.– MODERNISER LES OUTILS DE PILOTAGE DE L’INRAP
1.– Adapter les instruments de suivi de l’activité de l’INRAP à la nouvelle logique concurrentielle
Assez étrangement, malgré l’ouverture à la concurrence d’une partie substantielle de ses activités, il semble que l’INRAP n’ait pas encore développé d’outils de pilotage et de comparaison permettant de mettre en regard ses réalisations et l’efficacité de son action – en termes de coûts et de délais notamment – avec celles des autres opérateurs de l’archéologie préventive.
Interrogé sur ce thème, son directeur général M. Roffignon avait ainsi répondu à la mission : « Je ne suis pas certain d’être en mesure de vous apporter des éléments plus précis. À l’heure actuelle, ni l’INRAP ni – à ma connaissance – l’État, ne disposent d’outil permettant d’apprécier, en moyenne nationale, les délais d’intervention réels de l’archéologie préventive. En revanche, il existe une certitude : les délais associés à la phase terrain sont quasiment toujours tenus, sur la partie diagnostic comme sur la partie fouille. En effet, le contrat conclu avec l’aménageur formalise trois éléments : la date de mise à disposition du terrain, qui est de la responsabilité de l’aménageur ; la date de début et de fin des opérations pour la phase terrain ; la date de remise du rapport d’opérations. » (44).
Rassurant, M. Roffignon avait toutefois ajouté que, bien que ne disposant pas de statistiques « puisque l’Institut ne possède pas encore d’outil de gestion de l’activité qui lui permettrait de calculer les moyennes nationales relatives à ses délais d’intervention », un tel instrument était « en cours de développement et devrait être mis en production à la fin de l’année 2011. Dès 2012, nous serons donc en mesure de suivre de telles statistiques, qui sont effectivement essentielles. » (45).
La MEC lui en donne volontiers acte, mais plaide pour une mise en œuvre effective et rapide de tels instruments de mesure de la compétitivité de l’Institut. Elle rejoint d’ailleurs sur ce point l’analyse de la direction du Budget, qui soulignait que « une augmentation des prélèvements obligatoires [via une réforme de la redevance d’archéologie préventive] doit en effet s’accompagner d’une réflexion sur les marges de productivité existant au sein de l’établissement, sur la maîtrise des coûts et des délais des services rendus » (46).
Proposition n° 8 – Créer, dans les plus brefs délais, des outils de pilotage de l’activité de l’INRAP ainsi que des instruments de comparaison permettant d’analyser la compétitivité de l’Institut par rapport à ses concurrents, notamment en termes de coûts et de délais d’intervention. |
Dans la même logique, la MEC insiste pour que soit conclu dans les meilleurs délais le contrat de performance entre l’INRAP et ses tutelles. Entamées en 2007, les négociations ont achoppé l’année 2008 dans un contexte de divergences stratégiques et de fortes tensions sociales et financières au sein de l’Institut. Si elles ont repris depuis, elles n’ont pas encore abouti. On peut toutefois se montrer raisonnablement optimiste puisque le projet de contrat de performance a été approuvé par le conseil d’administration de l’établissement le 12 juillet dernier.
2.– Veiller à la bonne adéquation entre ressources humaines et niveau d’activité
L’activité de l’INRAP, du moins dans son volet « diagnostics », est dépendante des décisions de l’État dans ce domaine.
Le directeur général de l’Institut le reconnaissait lui-même : depuis 2003, le taux de prescription arrêté par l’État se stabilise, tandis que, parallèlement, l’activité de l’INRAP a largement été ouverte à la concurrence, sur le volet « diagnostics » avec les collectivités territoriales disposant d’un service d’archéologie préventive, et sur l’activité « fouilles » avec les mêmes collectivités et des opérateurs privés.
On aurait pu en déduire que les besoins de l’INRAP en termes de ressources humaines s’étaient eux-mêmes stabilisés, voire réduits. Il n’en est rien puisque depuis 2003, le nombre d’équivalents temps plein travaillé (ETPT) a augmenté de 44 %, passant de 1 464 ETP cette année-là, contre 2 113 en 2010.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’INRAP 2003-2010
(en ETPT)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
CDI |
1 285 |
1 321 |
1 379 |
1 372 |
1 717 |
1 702 |
1 709 |
1 752 |
CDD |
179 |
299 |
362 |
432 |
178 |
252 |
309 |
197 |
CDA (a) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
164 |
TOTAL |
1 464 |
1 620 |
1 741 |
1 804 |
1 895 |
1 953 |
2 018 |
2 113 |
(a) : Contrat d’activité.
Source : INRAP.
En guise de justification, le directeur général devait répondre à la MEC que « le niveau d’activité prescrit par l’État est effectivement constant en pourcentage, mais pas quant au volume des aménagements réalisés. Par ailleurs, la réponse de l’INRAP à la prescription s’est améliorée au fil du temps, le stock d’opérations non réalisées décroissant progressivement », ajoutant que « l’établissement a pour mission de répondre aux prescriptions de l’État. Celles-ci n’ayant jamais été pleinement satisfaites, il n’a pas été demandé à l’INRAP de réduire ses moyens humains » (47).
De fait, ainsi que le montrent les deux graphiques ci-dessous, l’activité de l’INRAP suit effectivement la même trajectoire ascendante que celle des ressources humaines.
Il n’en demeure pas moins qu’il convient de rester vigilant quant à la croissance des effectifs et de la masse salariale.
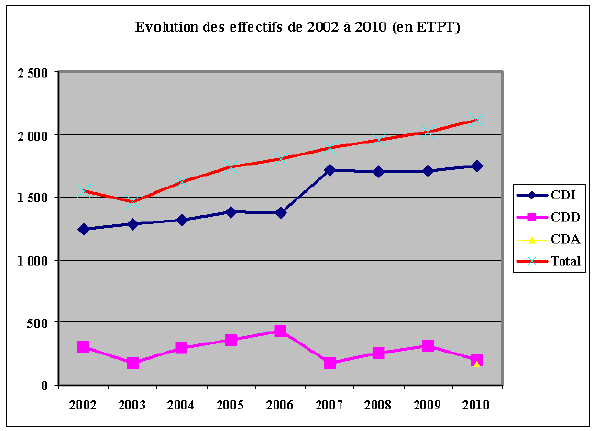 Source : INRAP.
Source : INRAP.
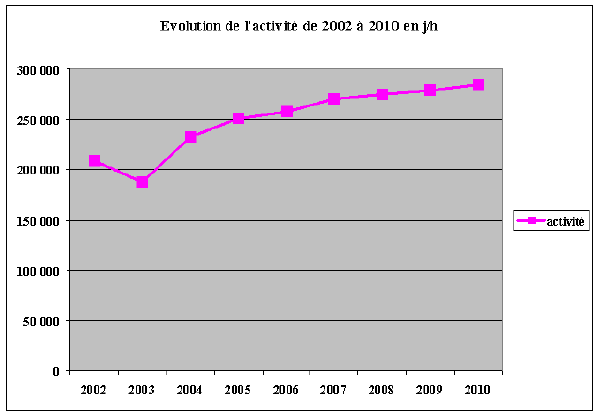
Source : INRAP.
LE CONTRAT D’ACTIVITÉ : UN BILAN MITIGÉ Le contrat d’activité (CDA) est un dispositif créé à titre expérimental par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés, et par le décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 pour doter l’INRAP, à l’instar de ses concurrents privés, de la capacité d’adaptation nécessaire de ses moyens humains à des surcroîts exceptionnels d’activité en matière de fouilles. Ces contrats auront ainsi permis de recruter 164 ETPT en 2010. La mise en place de ces contrats a suscité d’emblée une forte opposition des organisations syndicales, qui voyaient dans leur utilisation un outil de précarisation des personnels. Le 31 mars 2011, la signature du protocole portant « sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique : accès à l’emploi titulaire et amélioration des conditions d’emploi » a suspendu l’expérimentation du contrat d’activité à compter du 1er avril 2011. Les contrats d’activité conclus antérieurement à cette date continueront néanmoins de produire leurs effets jusqu’à leur terme : le nombre d’ETPT CDA s’établira en 2011 à 31,19 pour couvrir les besoins satisfaits jusqu’au 31 mars 2011 et ceux courant jusqu’au 31 décembre prochain, et à quelques unités en 2012. Dans le cadre du protocole d’accord, il a été prévu que le plafond d’emploi de l’INRAP voté en loi de finances initiale par le Parlement serait relevé à hauteur de 150 ETPT CDD, l’Institut perdant la capacité de recruter des CDA, dont la caractéristique était d’être hors plafond LFI. L’INRAP a d’ores et déjà engagé une réflexion avec les services de l’État afin de définir des règles d’utilisation du CDD plus adaptées aux enjeux de l’activité de fouilles. |
C.– EXPRIMER PLUS CLAIREMENT LA « DEMANDE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE » AFIN D’APAISER LES OPÉRATEURS ET DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
Lors de son audition, la direction de l’INRAP a laissé entendre à la MEC que si l’Institut se conformait scrupuleusement – et même au-delà – aux exigences formalisées au sein des cahiers de charges établis par les services régionaux d’archéologie (SRA) et se montrait particulièrement attentif aux conditions de travail de ses agents, tel n’était pas forcément le cas de tous ses concurrents.
Ainsi, d’après le directeur général de l’INRAP, « on constate parfois que certains concurrents sacrifient la qualité scientifique ou qu’à l’inverse nous avons fait de la "sur-qualité" par rapport aux prescriptions de l’État. Il nous appartient d’adapter notre offre à ces prescriptions. Il y a également d’autres aspects qui ne sont pas scientifiques, comme la prévention ou l’hygiène et la sécurité. Il existe des comportements très différents en fonction des opérateurs. Par exemple, lors d’interventions sur des sites pollués, l’importance accordée à la santé des agents varie en fonction des opérateurs. » (48).
Certains représentants des services d’archéologie préventive des collectivités territoriales ont souscrit à ce diagnostic, M. Matthieu Fuchs, directeur général du Pôle d'archéologie interdépartemental rhénan (PAIR) soulignant « qu’il existe des différences liées à l’élaboration des cahiers des charges, qui revient à l’État. Si les cahiers des charges ne sont pas précis, il est délicat d’établir des comparaisons honnêtes entre l’INRAP, les collectivités et les opérateurs privés. Ces derniers ont, en effet, tendance à "coller" autant que possible aux cahiers des charges. C’est normal, mais il peut en résulter des travaux d’archéologie "au rabais". L’INRAP et les collectivités s’efforcent, pour leur part, de développer une archéologie de qualité répondant à des objectifs scientifiques qui ne sont pas toujours décrits dans les cahiers des charges. Cela peut conduire à des différences de coût avec le secteur privé, même si ce dernier ne fait pas à proprement parler de dumping. » (49).
De leur côté, les opérateurs concurrents ont réfuté ces accusations, rappelant, à juste titre au demeurant, que leurs projets scientifiques étaient contrôlés en amont par les SRA, puis lors de la phase terrain à l’occasion de contrôles sur place et enfin, lors de la remise du rapport de fouilles, par les SRA et les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA). Rappelons également que ces opérateurs sont tenus de faire renouveler leur agrément tous les cinq ans.
Comme le relevait malicieusement M. Pierre Hauser, directeur général d’Archéodunum, « Si nous sacrifiions la qualité, nous risquerions de perdre notre agrément, lequel est délivré en fonction de deux critères : la qualité des personnels engagés par les entreprises et les avis des CIRA sur les rapports. Paradoxalement, l’opérateur par excellence qu’est l’INRAP ne fait pas l’objet d’un agrément : des avis négatifs des CIRA n’ont guère d’incidence sur son activité, alors que nous pouvons être contraints de fermer notre entreprise si l’agrément est refusé ! Nous ne pouvons donc nous permettre de "casser" les prix. » (50).
Au total, il est indéniable que la qualité des prestations offertes par les opérateurs – quels qu’ils soient – est nécessairement corrélée au degré de précision des cahiers de charges établis par les SRA. Aussi, afin que les opérations d’archéologie préventive répondent bien aux standards minima requis en termes scientifiques, techniques et sociaux, et pour apaiser les tensions entre les différents acteurs concernés, il semble nécessaire que ces cahiers des charges soient plus précis quant au niveau de qualité attendu des opérateurs.
D.– RÉAFFIRMER LE RÔLE DE LA CO-TUTELLE AU PROFIT D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES RENFORCÉS ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
L’INRAP est placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche. Si le premier est effectivement présent, le second semble plus effacé. Or, une plus grande implication de celui-ci permettrait sans doute de renforcer les liens entre l’INRAP et les acteurs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche – CNRS et Université notamment –, et de valoriser davantage les objets mis au jour à l’occasion des fouilles.
Il apparaît en effet que des cloisons quasi étanches subsistent entre des opérateurs dont les agents ont suivi la même formation, exercent le même métier et poursuivent les mêmes objectifs. Aux dires de certains acteurs, il semblerait même que l’INRAP soit relativement réticent à l’idée de collaborer scientifiquement avec ses concurrents, au détriment de la liberté et de l’efficacité de la recherche scientifique.
Ainsi, si M. Julien Denis, directeur scientifique de l’opérateur privé Éveha assurait que « en raison de son acceptation progressive de la concurrence, l’administration de l’INRAP était jusqu’à présent assez réticente devant des collaborations avec des opérateurs privés, mais cela changera, et plus rapidement que prévu » (51), M. Pierre Hauser indiquait être « plus réservé sur les collaborations avec l’INRAP. Nous avons l’impression que la situation, après s’être améliorée il y a deux ans, tend à se dégrader. Certains collègues archéologues de l’Institut rechignent parfois à communiquer des informations. Nous avons créé une maison d’édition ainsi qu’une revue, mais nous avons dû renoncer à traiter certains thèmes parce que des membres de l’INRAP ont refusé d’être publiés dans celle-ci au motif qu’elle appartenait à un opérateur privé ! » (52).
M. François Lacrampe-Cuyaubère, gérant d’Archéosphère, précisait quant à lui : « Nous avons l’habitude de travailler régulièrement depuis de longues années avec du personnel du CNRS et d’une université membre d’une UMR [unité mixte de recherche] : nous voulions, pour conforter cette relation, développer un partenariat avec cette unité, mais cela n’a pas été possible parce que certains personnels de l’INRAP conventionnés avec l’UMR ont fait pression sur sa direction sous la forme de menaces d’annulation de leur propre convention. » (53).
De son côté, l’INRAP a assuré à la MEC qu’à l’occasion de la modification prochaine de son décret statutaire il sera précisé que la coopération avec d’autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique pourra s’engager avec toute institution, de droit public ou privé, nationale ou étrangère.
La MEC n’est évidemment pas en mesure de juger de la réalité des faits rapportés. Elle estime toutefois nécessaire que la double tutelle de l’Institut, et notamment le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, « absent du débat » selon certaines personnes auditionnées, s’assure du bon développement des relations entre les opérateurs – publics comme privés – dans le domaine scientifique.
Proposition n° 10 : Renforcer les liens entre l’INRAP et les différents acteurs de la recherche. Encourager les collaborations scientifiques entre les acteurs institutionnels de l’archéologie préventive et entre les archéologues, quel que soit leur statut et leur structure d’appartenance. |
IV.– POUR LE RETOUR À UNE BUDGÉTISATION INTÉGRALE DES FINANCEMENTS DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Le Centre des monuments nationaux (CMN) est l’opérateur central de la politique monumentale menée par le ministère de la Culture et de la communication. Établissement public à caractère administratif, il a pour missions d’entretenir, de conserver et de restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, d’en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d’en développer la fréquentation, lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation ou leur utilisation (54). Ainsi, le CMN gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments (55), où il a accueilli 8,8 millions de visiteurs en 2009.
Parmi eux, on compte des éléments majeurs du patrimoine français tels que l’Arc de triomphe, le Panthéon, l’hôtel de Sully, la Sainte-Chapelle et la Conciergerie à Paris, l’abbaye et les remparts du Mont-Saint-Michel, les grottes ornées de Font-de-Gaume, des Combarelles et du Cap-Blanc, le site mégalithique de Carnac, ou encore les fortifications de Carcassonne et d’Aigues-Mortes. Plusieurs sont inscrits par l’Unesco au patrimoine mondial (56).
Rappelons que l’article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a élargi les missions du CMN à la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration et d’entretien des monuments nationaux dont il a la garde. Il avait par ailleurs donné à l’État la possibilité de confier au CMN la maîtrise d’ouvrage de travaux de restauration sur d’autres monuments appartenant à l’État et affectés au ministère de la Culture et de la communication. En 2008 et 2009, le CMN a exercé ses compétences de maître d’ouvrage uniquement sur les « monuments nationaux » (57) dont il assure également la gestion.
Outre la mission de conservation, de restauration, d’entretien et de mise en valeur des monuments placés sous sa responsabilité, le CMN favorise, avec près de 200 manifestations par an, la participation des monuments nationaux à la vie culturelle et au développement du tourisme, en concertation avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les collectivités territoriales et les réseaux d’institutions culturelles.
Enfin, il assure une mission d’éditeur public sous la marque Éditions du patrimoine et contribue ainsi à la connaissance et à la promotion du patrimoine par l’édition d’un éventail très large de publications, allant des ouvrages à vocation touristique aux publications scientifiques de haut niveau et de portée internationale.
A.– SUPPRIMER LA RESSOURCE AFFECTÉE ET REVENIR À UN FINANCEMENT BUDGÉTAIRE CLASSIQUE
1.– Le CMN a déjà bénéficié d’une ressource affectée par le passé
En application de l’article 47 de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le CMN se voit affecter 15 % du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne (poker, black jack etc.), dans la limite, indexée sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros par an. Ce dispositif a été codifié à l’article 302 bis ZI du code général des impôts.
Le produit ainsi reversé au CMN devrait s’élever à quelque 9 millions d’euros en 2011 – voire atteindre le plafond de 10 millions d’euros si l’on en croit le directeur administratif, juridique et financier du CMN (58) –, pour sa première application en année pleine. En 2010, le CMN avait enregistré 5,2 millions d’euros de recettes à ce titre.
Ce n’est pas la première fois que le Centre voit ses ressources « traditionnelles » partiellement remplacées par le produit d’une taxe affectée. En effet, en 2006, face à la crise de financement des travaux sur monuments historiques, le Gouvernement avait créé une taxe affectée via un prélèvement de 25 % des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par l’État et plafonné à 70 millions d’euros par an. Dès 2007, il était revenu sur sa décision en procédant à une rebudgétisation de ces ressources, substituant à la taxe affectée des crédits budgétaires. Précisons par ailleurs qu’une grande partie des sommes censément affectées au CMN avait in fine été reversée au budget général par voie de fonds de concours, nuisant à la visibilité et à l’efficacité du dispositif.
Ce précédent, aux résultats mitigés, n’a pas empêché le retour à ce mode de financement trois ans plus tard. Si la taxe a changé, l’intérêt de l’opération reste plus que jamais sujet à caution.
2.– La création d’une nouvelle ressource affectée ne répond à aucun impératif
Si l’on reprend la grille d’analyse présentée précédemment, force est de constater que l’affectation au CMN d’une partie du produit de l’imposition des jeux de cercle en ligne ne répond à aucun des critères permettant de justifier le recours à un tel mécanisme.
Elle ne relève d’aucune des trois grandes « familles » – contrepartie d’un service rendu, internalisation des externalités, mécanisme de péréquation – et, par ailleurs, elle ne s’appuie sur aucun lien logique entre la nature de l’assiette fiscale et les dépenses qu’elle est censée couvrir. Si le financement de la culture par le produit des impositions pesant sur les jeux constitue une pratique traditionnelle dans les pays anglo-saxons, telle n’est pas la philosophie du système français.
Mme Marie-Astrid Ravon l’a du reste, clairement affirmé devant la MEC – « quant à l’affectation d’une quote-part du prélèvement sur les jeux en ligne, elle ne s’inscrit pas dans la grille d’analyse que je vous ai présentée » (59) –, ajoutant qu’ « il n’est guère dans la tradition française de financer les « bonnes causes » par des prélèvements sur les jeux » et concluant sans ambiguïté : « nous n’encouragerons donc pas la multiplication de ce type d’affectations ».
M. Philippe Bélaval, directeur général des Patrimoines au ministère de la Culture et de la communication, devait adopter, quelques heures auparavant, une position similaire, en déclarant à la mission : « Ce prélèvement me semble le dernier avatar, au sens brahmanique du terme, de la fascination française pour le modèle britannique. On peut l’analyser comme un simple jeu d’écriture dans le budget de 2011, puisqu’il se substitue à la dotation initiale. Je dirai, sans vouloir manquer à la solidarité gouvernementale, que le ministère de la Culture n’était pas demandeur de ce prélèvement. » (60).
Rappelons en effet que l’affectation s’est substituée à la dotation budgétaire du CMN, les crédits versés à ce titre ayant été réduits d’un montant quasiment identique – 9,5 millions d’euros – dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2011.
Au total, cette affectation, via la débudgétisation, a certes pu constituer une facilité comptable – dont l’intérêt réel, au-delà du « jeu d’écriture », échappe néanmoins à la MEC –, toutefois il ne semble pas opportun de la maintenir à l’avenir.
De fait la MEC se montrera moins magnanime que le directeur général des Patrimoines, lequel précisait : « il est trop tôt pour porter un jugement sur ce dispositif. Je ne sais pas s’il s’agit d’une facilité imposée par la nécessité de boucler le budget ou d’un système appelé à durer. » (61).
En effet, eu égard à la modicité des sommes en jeu – 10 millions d’euros maximum – au caractère artificiel du rattachement d’une telle ressource aux dépenses du CMN, et au fait que l’affectation ne répond à aucune nécessité économique, la MEC estime que la création d’un tel système de financement dérivé dérogatoire au droit budgétaire commun ne se justifiait pas.
Si l’Histoire ne se répète pas, il lui arrive de bégayer. La MEC ne souffre d’aucun défaut d’élocution mais préconise toutefois la suppression du dispositif au profit d’une rebudgétisation intégrale des financements publics alloués au CMN, en procédant, naturellement, à un rebasage de sa dotation afin de couvrir à due concurrence la perte de recettes induite.
Proposition n° 11 – Supprimer l’affectation au Centre des monuments nationaux de la part du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne codifiée à l’article 302 bis ZI du code général des impôts. Procéder à la rebudgétisation intégrale des financements publics alloués au CMN en les majorant à due concurrence de la perte de recettes subie au titre de la suppression de l’affectation de recettes fiscales. |
B.– RAMENER LE FONDS DE ROULEMENT À UN NIVEAU NORMAL
1.– Un fonds de roulement surabondant
En 2009, le fonds de roulement du CMN excédait 60 millions d’euros (63,1 millions d’euros), après avoir dépassé les 50 millions d’euros l’année précédente (52,9 millions d’euros). Fin 2010, il avait atteint près de 93 millions d’euros en crédits de paiement, et 46 millions d’euros après retraitement suite au fléchage des sommes correspondantes vers des opérations programmées.
La Cour des comptes, à l’occasion d’un rapport d’enquête (62) remis en octobre 2010 à la commission des Finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la LOLF, évoquait une situation de « suréquilibre financier », « amenée à perdurer ».
Se pose donc la question de l’emploi d’une telle manne financière, et, le cas échéant, de l’opportunité de recalibrer ponctuellement les subventions versées au CMN si le fonds de roulement du Centre devait structurellement se maintenir à de tels niveaux.
FONDS DE ROULEMENT NET DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 2003-2010
(en millions d’euros)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (a) |
26,4 |
25,9 |
25,9 |
26 |
34,8 |
52,9 |
63,1 |
46 |
(a) Fonds de roulement disponible après retraitements.
Le décrochage, perceptible dès 2007, est particulièrement net à partir de 2008. En effet, les niveaux exceptionnels atteints depuis s’expliquent certes par une fréquentation soutenue depuis quatre ans – laquelle a permis au Centre d’enregistrer davantage de recettes de billetterie –, mais surtout par le retard considérable pris dans la mise en place de la compétence de maîtrise d’ouvrage, reconnue au CMN par décret du 6 avril 2007 (63).
En effet, alors que la réorganisation induite par une réforme ne s’est achevée que début janvier 2011, le CMN enregistrait, depuis 2007, les crédits supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence. Ne trouvant pas être mobilisés dans l’immédiat, ils sont donc venus gonfler les réserves du Centre.
C’est ce qu’a rappelé Mme Isabelle Lemesle, présidente du CMN, à la MEC : « le décret [conférant la compétence de maîtrise d’ouvrage au CMN] date de 2007 ; j’ai été nommée en mai 2008 ; nous avons réorganisé la structure en février 2009. Il était prévu que les emplois liés à la maîtrise d’ouvrage soient pourvus par des crédits de personnel du titre 2 et des transferts depuis les DRAC, mais cela n’a pu se faire. Ce n’est donc qu’en janvier 2011 que la direction de la maîtrise d’ouvrage a enfin disposé de l’ensemble des emplois nécessaires à l’exercice de sa mission. Or, durant tout ce temps, les crédits nécessaires à celui-ci avaient été inscrits à notre budget. » (64).
2.– Mobiliser au maximum le fonds de roulement au profit de la restauration des monuments nationaux
Au total, il convient donc de ramener le fonds de roulement à un niveau plus conforme aux modalités de gestion généralement applicables aux opérateurs en la matière. Nul doute que les réserves du CMN trouvent à s’employer utilement. Les fonds disponibles sont en effet à mettre au regard des dépenses induites par la restauration des éléments patrimoniaux dont le Centre à la charge. Rappelons à cet égard que le coût de la seule campagne de travaux de restauration du Panthéon est estimé à une centaine de millions d’euros. Structurellement, selon la direction du CMN, et bien que les situations soient extrêmement variées d’un monument à l’autre, les diagnostics font apparaître un besoin de 50 millions d’euros par an pour entretenir, conserver et restaurer le patrimoine remis en gestion.
Le CMN a, dans cette optique, engagé une programmation pluriannuelle 2011-2013 guidée par le principe d’une concentration de l’investissement sur un nombre réduit de projets d’envergure. Il s’agit ainsi d’éviter le saupoudrage, inefficace, de crédits publics. Les travaux envisagés concernent treize projets à titre principal et représentent un coût total de 156 millions d’euros.
Sur ce budget total, 97 millions d’euros seraient consacrés aux treize projets principaux (65), dont 30,6 millions d’euros pour le seul Panthéon. Le solde, soit 59 millions d’euros, permettra le financement d’investissements divers (66).
Proposition n° 12 – Mobiliser au maximum le fonds de roulement afin de financer les dépenses de restauration des monuments nationaux prévues dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2011-2013. |
C.– MODERNISER ET FLUIDIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
1.– La gestion des ressources humaines au sein des opérateurs culturels : une problématique récurrente
Par le passé, la MEC a déjà été amenée à analyser la problématique de la gestion des ressources humaines au sein des opérateurs culturels. C’est ainsi que la MEC relative au musée du Louvre et aux musées nationaux (67), d’ailleurs conduite par les trois mêmes co-rapporteurs que la présente mission, avait identifié plusieurs pistes d’amélioration dans ce domaine.
Les informations recueillies à l’occasion des travaux menés en ce printemps 2011 tendent à confirmer la nécessité de procéder à quelques évolutions en la matière, les opérateurs ne disposant que d’un contrôle encore trop partiel du volet « ressources humaines » dans leur activité quotidienne.
La multiplicité des statuts et des employeurs – en l’espèce le CMN et le ministère de la Culture – peut ainsi être source de tensions, de viscosités, de lenteurs et d’inefficacité dans la gestion des personnels et, partant, dans la mise en œuvre de la politique patrimoniale dont le Centre a la charge.
À cet égard, il est intéressant de rappeler les propos qu’avait tenus Mme Anne Baldassari, directrice du musée Picasso, à la MEC relative au musée du Louvre et aux musées nationaux : « Nous nous voyons attribuer des personnels de la DMF [direction des Musées de France] et de la RMN [Réunion de musées nationaux] qui ne nous reconnaissent pas comme étant au sens strict leur employeur et dont les carrières sont administrées parallèlement selon des appartenances et dans des hiérarchies parfois incompatibles les unes avec les autres. Le système de corps ou de filières souvent limités à des plans de carrière déjà obsolètes et formant parfois des « castes », est rarement ancré dans la culture professionnelle des sites de détachement ou d’affectation des agents. Pourtant c’est bien à partir de ceux-ci, précisément, qu’une mobilisation effective des énergies est possible – laquelle, d’ailleurs, conditionne aussi notre travail sur le plan international. ».
2.– Permettre le détachement des agents d’administration centrale au sein du CMN
Environ 1 270 agents travaillent au CMN, au siège ou au sein des monuments dont il a la charge. Nombre d’entre eux sont affectés au Centre par l’État.
RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU CMN PAR STATUT 2003-2010
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
État |
552 |
558 |
500 |
470 |
444 |
426 |
456 |
478 |
CMN |
802 |
799 |
789 |
757 |
725 |
722 |
791 |
791 |
TOTAL |
1 354 |
1 357 |
1 289 |
1 227 |
1 169 |
1 148 |
1 247 |
1 269 |
part État |
40,8 % |
41,1 % |
38,8 % |
38,3 % |
38 % |
37,1 % |
36,6 % |
37,7 % |
Interrogée sur le défaut d’attractivité de la filière accueil-surveillance-magasinage (ASM) et sur les difficultés de gestion afférentes, la présidente du CMN avait répondu sans détours en des termes similaires à ceux employées par Mme Baldassari deux ans plus tôt : « Notre principal problème tient au statut des agents censés être sous l’autorité du président de l’établissement. Je ne connais aucun patron qui ne recrute lui-même ses collaborateurs, et qui ne puisse ni les promouvoir, ni les sanctionner. Or la plupart des 478 agents dont vous parlez [les agents de la filière ASM] ne sont pas des agents du CMN – ils ne se perçoivent d’ailleurs pas comme tels. Ce sont des agents du ministère de la Culture affectés à notre établissement, qui ignorent l’autorité hiérarchique de proximité – l’administrateur du monument. » (68).
Afin de remédier à de tels blocages, le CMN serait favorable au détachement (69) des personnels de catégorie C au sein des établissements qu’il gère. La MEC ne peut que souscrire à ce souhait. Toutefois, contrainte juridique ou réticence – difficilement compréhensible – de la tutelle oblige, il semble que la voie du détachement ne soit pas envisageable et, en tout état de cause, pas envisagée, à l’heure actuelle. Il n’en demeure pas moins qu’elle constituerait un progrès indéniable dans la gestion des ressources humaines – non seulement du CMN mais de l’ensemble des opérateurs culturels –, mais aussi, et surtout, une amélioration du service public rendu aux visiteurs des institutions patrimoniales. Rappelons que le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office, la commission administrative paritaire devant obligatoirement être consultée dans ce dernier cas.
L’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État – dont le détachement – dispose que « le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'État ».
Or, les agents de catégorie C employés par le ministère de la Culture et de la communication sont bien régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui constituent le titre Ier du statut général de la fonction publique, et dont l’article 13 dispose que « le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions » (70), ce qui n’exclut pas, a priori, les personnels de catégorie C.
Aussi, sauf disposition expresse contraire dont les rapporteurs n’auraient pas connaissance, il semble possible de procéder au détachement des agents de catégorie C au sein des opérateurs culturels, et notamment du CMN.
Le cas échéant, il conviendrait d’accompagner un tel détachement du transfert, aux opérateurs concernés, de la masse salariale correspondante.
Proposition n° 13 – Étudier les possibilités de détachement, au sein des opérateurs culturels, des agents de catégorie C rattachés au ministère de la Culture et de la communication. Accompagner ce détachement du transfert de la masse salariale correspondante. |
V.– LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET DU JAZZ : CLARIFIER LES CONTOURS DU SOUTIEN AUX SPECTACLES DE VARIÉTÉS
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) a été créé par l’article 30 de la loi 2002–5 du 4 janvier 2002 en vertu duquel cet établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture a pour mission « de soutenir la création, la promotion et la diffusion du spectacle de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz. ». Son organisation a été définie par le décret n° 2002–569 du 23 avril 2002 modifié le 13 février 2008.
Le CNV est un opérateur de l’État, avec lequel un contrat de performance a été signé pour la période 2007-2009. Les orientations stratégiques d’un nouveau contrat de performance pour la période 2011-2013 doivent encore être négociées avec l’établissement.
Le Centre remplit sa mission en gérant un fonds destiné à améliorer les conditions d’exercice des activités de ce secteur et à favoriser le développement d’actions d’intérêt commun. Il fédère les acteurs, rassemble la profession au travers un mécanisme de mutualisation qui permet, selon son directeur : « de faire reposer sur les succès rencontrés par les grands spectacles l’aide au développement d’artistes, aux nouveaux talents, aux salles de spectacles, aux résidences de musiques actuelles et aux festivals, lesquels sont souvent déficitaires ».
Par ailleurs, le CNV tient lieu de centre de ressources sur l’économie de la production de spectacles de variétés. Il mène également une activité commerciale d'exploitation de réseaux d'affichage et de promotion, et une activité de conseil aux maîtres d’ouvrage d’équipements de spectacles. Enfin, il est chargé de la coordination du programme des salles « Zénith » en régions.
Les dernières données relatives à l’économie du secteur indiquent que, en 2009, les recettes de billetterie se sont élevées à 600 millions d'euros pour 40 000 représentations et 20 millions de spectateurs Avec un budget d’environ 30 millions d'euros, le CNV représente environ 5 % de cet écosystème.
A.– DES RESSOURCES ESSENTIELLEMENT CONSTITUÉES DE LA TAXE AFFECTÉE
L’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 (71) a institué une taxe de 3,5 % perçue sur la billetterie des spectacles vivants de variétés (tours de chant, concerts de spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et comédies musicales notamment). Depuis le 1er janvier 2005, le CNV est chargé de son recouvrement.
La taxe sur les spectacles de variétés est une des impositions de toutes natures prévues par la LOLF, soumise chaque année au vote du Parlement dans le cadre de la loi de finances. Il s’agit d’une taxe obligatoire à caractère déclaratif. Elle est acquittée par l’organisateur du spectacle, responsable de la billetterie.
Pour les spectacles à entrée gratuite, la taxe, perçue au même taux de 3,5 %, porte sur le montant hors taxes des sommes encaissées en contrepartie de la cession du droit d’exploitation, c'est-à-dire sur son prix de vente. Elle est alors acquittée par producteur ayant vendu le spectacle à l’organisateur. Les spectacles à entrée gratuite n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de cession entre un producteur et un organisateur n’y sont donc pas assujettis.
Les séances éducatives et les spectacles de musiques traditionnelles sont exonérés de paiement de la taxe. Par ailleurs, lorsque le montant cumulé sur une année de la taxe due par un redevable n’excède pas 80 euros au 31 décembre, le CNV rembourse à celui-ci les sommes encaissées. Ce dispositif ne semble toutefois pas le plus efficace compte tenu des frais de gestion engendrés pour le CNV et des contraintes qu’il implique pour la gestion de trésorerie des redevables.
Proposition n° 14 : Substituer au dispositif de remboursement pour les sommes recouvrées inférieures à 80 euros un seuil de même montant, en dessous duquel la taxe n’est pas recouvrée. |
Le produit de la taxe affectée, en constante augmentation, représente 90 % des ressources de l’établissement. Alors qu’il était de l’ordre de 13 millions d'euros en 2004, de 17,6 millions d'euros en 2008, il a dépassé 19,7 millions d'euros en 2009 pour atteindre 24 millions d'euros en 2010, soit une hausse de 22 % en un an.
Cette progression repose avant tout sur le succès rencontré par les grands spectacles, les grosses productions ou les grands festivals. Elle est également due à l’intégration, depuis mai 2009, des cabarets dans le champ de perception de la taxe. Hors cabarets, le montant perçu au titre de la taxe serait passé de 19,4 millions d'euros en 2009 à 20,9 millions d'euros en 2010. Par ailleurs, l’efficacité des opérations de perception auprès des redevables s’est améliorée, notamment au travers d’une meilleure connaissance des redevables et des spectacles par l’agence comptable et le service de la taxe fiscale. L’établissement dispose depuis quelques années d’un agent comptable à temps plein, ce qui lui permet de montrer une plus grande rigueur dans la perception de la ressource.
Ces résultats ne doivent cependant pas cacher la situation très contrastée du secteur des variétés. En effet, si la tenue de grands spectacles (grands événements, artistes de renommée mondiale, tournées internationales etc.) permet de générer un rendement important pour la taxe, il n’en demeure pas moins qu’une part très importante du secteur, notamment les petites et moyennes entreprises de spectacle, et spécialement celles qui se consacrent au développement des jeunes artistes, s’est trouvée fragilisée par la crise économique survenue fin 2008.
Le CNV reçoit par ailleurs des subventions d’exploitation qui se sont élevées à 1,3 million d'euros en 2010, en hausse de 14 % par rapport à 2009. Elles comprennent la subvention de fonctionnement attribuée par l’État qui s’est stabilisée à 0,1 million d'euros depuis 2007, la dotation spéciale pour soutenir un programme d’aide aux résidences (géré par délégation du ministère) pour 0,4 million d'euros et un soutien de la Ville de Paris pour favoriser l’activité de promotion du réseau d’affichage. Concernant ce dernier point, il convient de noter que le CNV exerce deux activités de type commercial qui lui ont rapporté 1,2 million d'euros en 2010, en hausse de 13 % par rapport à 2009 : l’aide à la promotion de spectacle (ce service permet l’accès à des supports de promotion négociés à des tarifs préférentiels à Paris et en régions), et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements culturels.
Les produits totaux de l’établissement se sont élevés à 28,5 millions d'euros en 2010, contre 23,3 millions d'euros en 2009.
B.– DES REDISTRIBUTIONS EN HAUSSE
Le CNV ne soutient pas directement les artistes et les musiciens mais exerce une activité de redistribution au profit des entrepreneurs de spectacles qui les emploient. Pour bénéficier de ce soutien financier, ces derniers doivent être affiliés au CNV (sauf pour les commissions 3 et 6 cf. infra) et être à jour du paiement de la taxe. Pour s’affilier, l’entreprise doit être régulièrement dirigée par une personne titulaire d’une ou plusieurs licences d’entrepreneur de spectacles (72) et exercer tout ou partie de son activité dans le domaine des variétés, au sens de la réglementation relative à la taxe sur les spectacles de variétés (73).
Le budget du CNV respecte la clé de la répartition suivante dans l’utilisation du produit de la taxe :
– 65 % alimentent les comptes-entrepreneurs, et sont reversés via le droit de tirage ;
– 35 % sont affectés aux programmes et activités de l’établissement.
Deux dispositifs d’aides coexistent donc : le droit de tirage permet à un affilié de récupérer tout ou partie des sommes inscrites sur son compte entrepreneur pour poursuivre son activité de production et de diffusion, tandis que les aides sélectives visent à soutenir les entreprises et projets de production, diffusion de spectacles en phase de développement, des actions d’intérêt général ou encore l’équipement des salles de spectacles.
Par ailleurs le CNV a consacré une dotation de 1,5 million d'euros sur la période 2009-2010 pour la partie de la profession qui s’est trouvée menacée par la crise de 2008.
Les dossiers et les demandes d’aides sont étudiés par neuf commissions (74), composées de professionnels, représentant les employeurs, les salariés, les auteurs et le ministère de la Culture et de la communication.
Au travers des deux grands mécanismes d’aides décrits ci-dessus et parallèlement à l’augmentation des ressources, les activités de redistribution ont connu une hausse sensible, passant de 16,8 millions d'euros en 2008, à 19,2 millions d'euros en 2009 pour atteindre 23,3 millions d'euros en 2010.
Le taux de satisfaction global des demandes d’aides est élevé : près de 83 % des dossiers instruits en commission sont acceptés. Il est de 99 % pour le droit de tirage. Selon le directeur du CNV, cette proportion élevée de réponses favorables s’explique par la professionnalisation croissante du secteur, de plus en plus au fait des critères à satisfaire. Le taux de recevabilité des dossiers était un des indicateurs qui figurerait dans le précédent contrat de performances.
Toutefois, ce taux de recevabilité semble élevé aux rapporteurs de la mission et semble s’expliquer par l’existence de critères de sélection peu sélectifs.
Proposition n° 15 : Le CNV et son ministère de tutelle, en collaboration avec les professionnels du secteur, doivent redéfinir les critères d’attribution des aides afin de rendre le dispositif de sélection plus opérant. |
Le CNV présente depuis 2009 un compte de résultat déficitaire (0,9 million d'euros en 2009 et 0,2 million d'euros en 2010) en raison de l’existence d’un fonds de réserve financier très élevé, constitué pour l’essentiel des ressources accumulées avant 2002 au cours de la période qui a précédé la transformation de l’ancienne association de Fonds de soutien aux variétés en établissement public.
Fin 2008, ce fonds de réserve s’élevait à 10,3 millions d'euros (soit 164 jours de fonctionnement). En contrepartie de la quasi-suppression de la subvention de fonctionnement que lui attribuait l’État jusqu’en 2007, le CNV a été autorisé à construire ses budgets en intégrant la possibilité d’un prélèvement sur ce fonds de réserve. Celui-ci est par conséquent amené à diminuer progressivement pour atteindre un niveau équivalent à celui des autres établissements publics.
● En dépit des incertitudes qui pèsent sur l’activité d’un secteur encore confronté aux effets de la crise économique, le CNV envisage pour 2011 une nouvelle augmentation du produit de la taxe.
L’établissement, par son mode de financement par ressources affectées, ne connaît pas de stagnation de ses moyens d’intervention et échappe ainsi aux conséquences des restrictions budgétaires.
Toutefois, on constate que si les grosses productions rencontrent un public nombreux, permettant une hausse des tarifs et générant ainsi des recettes importantes pour le CNV, les spectacles vivants musicaux qui se tiennent dans des salles petites et moyennes ou ceux présentant des artistes en développement connaissent une fréquentation et des recettes en diminution. La profession connaît en réalité de graves difficultés.
Les perspectives quant à la fréquentation des grands spectacles musicaux ne sont pas mauvaises pour la période 2011-2012, laissant donc présager un niveau de ressources satisfaisant pour le CNV. Toutefois un retournement de situation reste toujours possible, car les prévisions en la matière sont aléatoires.
Par ailleurs, il existe encore une marge de progression des ressources en ce qui concerne les cabarets. En effet, seuls les cabarets parisiens s’acquittent actuellement de la taxe.
● Un autre sujet de préoccupation concerne la délimitation du périmètre de deux catégories de spectacles, ceux soumis à la taxe sur les spectacles de variété au profit du CNV, et ceux soumis à la taxe sur les spectacles, instituée par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003, au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). Le contentieux entre les deux institutions porte plus particulièrement sur le cas des comédies musicales non traditionnelles et des spectacles d’humour. Une commission de médiation est chargée d’arbitrer les cas de désaccord.
L’ampleur de la hausse du produit de la taxe dépendra donc également des clarifications qui seront réalisées quant au périmètre de la perception de la taxe au regard du champ réservé au théâtre privé, défini notamment par le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003, définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l’ASTP, les types d’aides et leurs critères d’attribution.
Un travail de concertation avec l’État a été mis en œuvre depuis plusieurs mois mais n’a pu encore aboutir. En tout état de cause, les règles qui seront retenues seront porteuses d’enjeux financiers non négligeables, susceptibles de modifier le niveau de perception des deux taxes.
Proposition n° 16 : Clarifier les compétences respectives du CNV et de l’Association pour le soutien du théâtre privé en définissant plus précisément le champ des spectacles respectivement pris en charge par ces deux organismes. |
● L’ensemble des professionnels est très attaché au dispositif et y participe volontiers, mais il existe encore une marge de progression dans la perception de la taxe, en raison du caractère déclaratif du dispositif : tous les redevables qui devraient acquitter la taxe ne la versent pas, notamment les petits entrepreneurs, soit par méconnaissance, soit par oubli. Le directeur du CNV se déplace personnellement à la rencontre des petites associations, notamment les comités des fêtes, pour expliquer le dispositif, et une nouvelle plaquette de présentation du CNV doit être tirée à 20 000 exemplaires. En tout état de cause, il conviendrait d’améliorer l’information relative au CNV dans les lieux publics de spectacles (maisons des jeunes et de la culture, scènes de musiques actuelles etc.)
Proposition n° 17 : Améliorer l’information relative au CNV dans les lieux publics de spectacles. |
● Il convient également d’aborder les conséquences de la transposition de la directive européenne « Services ». En effet, celle-ci va entraîner une réforme des licences d’entrepreneurs de spectacles qui sont au cœur du fonctionnement du CNV. Jusqu’à présent, l’entrepreneur étranger devait s’adosser à un entrepreneur français, détenteur de la licence. Désormais, l’entrepreneur européen non-établi en France pourra y organiser un spectacle en procédant à une simple déclaration préalable. Les entrepreneurs non-européens continueront à devoir s’adosser à un entrepreneur français.
Le dispositif de perception de la taxe devra être adapté afin que les opérateurs européens non installés sur le territoire national s’en acquittent. Parallèlement, ils pourront bénéficier du même système d’aides dans les mêmes conditions que leurs homologues français.
Cette possibilité offerte aux entreprises européennes de présenter de façon autonome des productions sans obligation de détenir une licence d’entrepreneur de spectacle aurait pour conséquence, en l’absence de régulation adaptée à ce nouveau contexte, d’engendrer une perception fiscale bien moindre, voire de déstabiliser les équilibres de fonctionnement actuel de l’établissement. Un nouveau dispositif de déclaration de ces spectacles et de perception de la taxe doit donc impérativement être élaboré.
Proposition n° 18 : Préparer la transposition de la directive « Services » en définissant au plus vite les règles de déclaration des spectacles et de perception de la taxe applicables aux entreprises européennes de spectacle non établies en France. |
Enfin, le CNV va devoir affronter les nouveaux défis engendrés par la concentration verticale ou horizontale de certains groupes qui menacent la diversité musicale et artistique. Il doit également s’interroger sur les bouleversements apportés par la révolution numérique. Ces nouvelles données conduiront certainement à une extension du champ de la taxe sur les spectacles de variétés.
VI.– LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE : UN ÉTABLISSEMENT QUI DOIT SÉCURISER SON FINANCEMENT
Établissement public sous tutelle du ministère de la Culture et de la communication, le Centre national du livre (CNL), créé à la Libération sous le nom de Caisse nationale des Lettres, a pour mission de favoriser la création, l’édition, la promotion et la diffusion d’œuvres littéraires ou scientifiques de qualité, grâce à des actions de soutien aux divers acteurs de la chaîne du livre.
Les compétences et l’organisation du CNL sont définies par la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une Caisse nationale des lettres et par le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre. Ce dernier a été modifié par le décret n° 2010-430 du 27 avril 2010 afin d’harmoniser le statut du Centre avec celui des autres établissements publics. Sous la tutelle du service du livre et de la lecture (SLL) de la direction générale des Médias et des industries culturelles (DGMIC), la gouvernance du CNL est désormais assurée par un président exécutif, nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de tutelle, et chargé de mener le conseil d’administration et d’assurer la direction de l’établissement.
Les actions de soutien du CNL répondent à un objectif à la fois culturel et économique. Décidées par le président de l’établissement, elles s’adressent à l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, qu’ils soient auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires ou organisateurs de manifestations littéraires.
Le budget du CNL, qui représente moins de 1 % du chiffre d’affaires de l’édition, permet une intervention essentielle pour certains segments à faible rentabilité et à certains moments du cycle de production. Grâce à lui, un tissu éditorial diversifié peut se maintenir sur l’ensemble du territoire.
A.– UN MODE DE FINANCEMENT NÉCESSITANT UNE RÉÉVALUATION PÉRIODIQUE
1.– La part prépondérante des taxes affectées dans le financement du CNL
Aux termes de l’article 1609 undecies du code général des impôts, le CNL bénéficie de deux taxes fiscales qui lui sont affectées et qui constituent l’essentiel de ses ressources :
– une redevance sur la vente de matériel de reproduction et d’impression ;
– une redevance sur le chiffre d’affaires de l’édition.
À l’origine, dans l’esprit du Gouvernement et du législateur, ces deux taxes ont été créées d’une part pour prendre en compte le préjudice que la photocopie, alors en plein essor, faisait subir au secteur du livre et, d’autre part, pour soutenir les secteurs les plus fragiles de l’édition en mettant en place un système d’épargne automatique des éditeurs.
Ces deux taxes sont recouvrées par la direction générale des Douanes et des droits indirects pour les importations d’appareils en provenance de pays et territoires tiers à la Communauté européenne, et par la direction générale des Impôts dans tous les autres cas.
En 2010, les recettes de l’établissement (hors reprise sur provisions) se sont élevées à 43 millions d'euros. Le produit des deux taxes a représenté 78 % de ces recettes, et les autres ressources 28 %.
Il convient de noter que depuis 2004, le CNL ne bénéficie d’aucune subvention du ministère de la Culture et de la communication. Toutefois, en 2011, le ministère a mis 20 emplois à la disposition du Centre, celui-ci étant prêt à les prendre en charge afin de mener une politique du personnel plus homogène. Par ailleurs, 52 contractuels sont directement rémunérés par l’établissement.
À terme, les ressources affectées devraient constituer la presque totalité des ressources du CNL.
a) La taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
En vertu de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie est perçue au taux de 0,20 %. Elle est due par les éditeurs dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’a pas excédé 76 300 euros. Elle permet une redistribution au sein de la filière des métiers du livre. Son produit constitue 13,9 % des ressources du CNL en 2009, soit 5,07 millions d'euros.
b) La taxe sur l’emploi de la reprographie et l’impression
L’article 1609 terdecies précise que la taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression est perçue au taux de 3,25 %. Elle concerne la première vente sur le territoire d’appareils de reprographie ou d’impression, qu’il s’agisse des ventes ou de livraisons à soi-même (sauf les livraisons dans un autre État membre de la Communauté européenne) d’appareils fabriqués en France, ou des importations et acquisitions intracommunautaires de ces mêmes appareils. Sa justification obéit à une logique « pollueur-payeur ».
Sont actuellement assujettis à cette taxe les machines à imprimer offset de moins de 500 kg, les duplicateurs, les appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie, les appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner, les imprimantes, machines à copier et machines à télécopier. En revanche, les pièces détachées et les produits consommés pour le fonctionnement des appareils imposables sont exclus du champ de la taxe.
2.– L’évolution inquiétante du produit de la taxe sur la reprographie et l’impression
Les modifications récentes du taux et de l’assiette de la taxe sur la reprographie et l’impression sont significatives de l’instabilité de ce système à moyen terme et de sa nécessaire réévaluation périodique.
En effet, dès 1993, les innovations technologiques et le développement des appareils multifonctions ont contraint à une réflexion sur l’élargissement de l’assiette de la taxe. Par ailleurs, au début des années 2000, des baisses successives du produit de la taxe ont été constatées : 20,2 millions d'euros en 2002, 18 millions d'euros en 2003 et 16,2 millions d'euros en 2004.
L’article 105 de la loi de finances rectificative pour 2006 a donc intégré dans l’assiette de la taxe « les imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ». Cet élargissement de l’assiette de la taxe s’est accompagné d’une baisse du taux de 3 à 2,25 % s’appliquant toujours au prix hors taxe.
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2009 a augmenté le taux de 2,25 % à 3,25 %, car les dispositions prises en 2007 n’ont pas permis d’atteindre l’objectif de rendement de 30,2 millions d'euros.
ÉVOLUTION DU PRODUITS DES TAXES AFFECTÉES
(en millions d’euros)
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011(a) | |
Taxe sur le matériel impression / reprographie |
28,05 |
27,35 |
21,19 |
28,1 |
30,2 |
Taxe sur l’édition |
5,25 |
5,27 |
5,07 |
5,05 |
5,1 |
TOTAL |
33,30 |
32,62 |
26,26 |
33,1 |
35,3 |
(a) prévisions.
Si le produit de la taxe sur l’édition connaît une stabilité certaine entre 5 et 6 millions d'euros depuis plusieurs années, la taxe reprographie / impression n’a jamais atteint le niveau de 35 millions d'euros escompté depuis 2007, ni même les 30 millions d'euros portés, de façon prudente, au budget primitif.
On constate un tassement de l’assiette de la taxe dû, selon une étude de juin 2009 (75), d’une part à la baisse du nombre d’appareils vendus entre 2006 et 2008, et, d’autre part, à la baisse encore plus marquée du prix de ces appareils. Rien ne peut être affirmé quant au caractère tendanciel de cet effritement du produit de la taxe, notamment au vu des chiffres des années 2009 et 2010. Il n’en demeure pas moins que l’établissement éprouve des difficultés à anticiper correctement ses recettes d’une année sur l’autre.
À court terme, les dernières réformes du dispositif ont permis de répondre aux nouveaux enjeux du numérique, mais il apparaît indispensable de sécuriser durablement les ressources du CNL.
Une augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires de l’édition ne semble pas opportune afin de ne pas faire peser un coût supplémentaire sur une économie déjà fragilisée par les mutations liées à la révolution numérique.
Quant à la taxe reprographie/impression, les récentes augmentations ont rendu les fabricants d’appareils plus attentifs à toute nouvelle évolution. Les risques économiques et juridiques liés à toute nouvelle augmentation devraient être attentivement étudiés ex ante. Toutefois, la taxation des consommables, dont les ventes représentent une part croissante, pourrait constituer une mesure intermédiaire.
Des pistes de réforme du mode de financement sont actuellement à l’étude :
– créer une taxe globale sur le chiffre d’affaires des industries et services d’impression et de gestion de documents, sous forme de taxe compensatoire ;
– intégrer le domaine du livre dans tous les éventuels mécanismes à venir impliquant les fournisseurs d’accès Internet (FAI) ;
– intégrer les excédents du Centre français de la copie (CFC) et de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), et taxer les différents supports et appareils numériques contenant des écrits (ordinateurs portables, smartphones et liseuses).
Pour sa part, conformément aux principes qu’elle a dégagés et eu égard au produit relativement modeste des taxes affectées au CNL, la MEC recommande d’envisager la rebudgétisation de son financement.
Proposition n° 19 – Étudier, eu égard au produit relativement modeste des taxes affectées et aux risques pesant sur leur rendement, la rebudgétisation du financement du CNL. |
B.– UN DISPOSITIF DE SOUTIEN QUI DOIT ÊTRE RESSERRÉ
Le CNL met en oeuvre plus d’une trentaine de dispositifs sous forme de subventions, crédits de préparation, prêts à taux zéro et bourses. Il les attribue sur décision de son président, après avis des commissions consultatives organisées par domaines d’activité ou par type d’intervention.
ÉVOLUTION DU MONTANT DES AIDES ACCORDÉES DEPUIS 2007
En euros
Domaines d’interventions |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Création |
2 892 676 |
3 041 407 |
2 974 262 |
2 808 892 |
Édition |
5 336 100 |
5 719 920 |
5 567 686 |
5 758 641 |
Promotion |
3 923 733 |
3 841 150 |
3 723 500 |
4 182 425 |
Diffusion marchande (a) |
2 680 926 |
5 106 335 |
4 152 501 |
5 862 840 |
Diffusion non marchande (b) |
14 182 225 |
11 329 480 |
6 488 398 |
5 278 132 |
TOTAL |
29 015 660 |
29 038 292 |
22 906 347 |
23 890 930 |
(a) dont extraduction, librairies, sites Internet collectifs, politique numérique (éditeurs et e-distributeurs).
(b) dont politique numérique (BNF).
Source : Centre national du livre.
Le taux de satisfaction des demandes d’aides a été de 68 % en 2010.
La nature de ces aides varie en fonction des domaines d’intervention. Ce sont pour la création, soit des dispositifs d’assistance, allocations d’urgence ou renouvelables, soit des bourses, des crédits de préparation d’ouvrage ou des subsides de résidence en vue d’un projet d’écriture. S’agissant de l’édition ou de la diffusion, les aides consistent en des subventions et des prêts sans intérêts. Enfin, les aides à la promotion consistent en des subventions aux manifestations d’envergure.
Le CNL compte 31 dispositifs d’aides examinés au sein de 21 commissions ou comités d’experts. Cette variété d’interventions correspond à la multiplicité des besoins des acteurs et des publics dans un secteur, certes unitaire et identifié, mais aussi multiforme et segmenté. Cette panoplie d’aides permet également de soutenir des projets individuels ou collectifs, mais aussi des organismes professionnels. Le CNL est ainsi le principal bailleur de fonds du Bureau international de l’édition française (BIEF).
Le nombre de dispositifs a évolué au cours des dernières années. Afin d’adapter son intervention aux besoins du secteur, le conseil d’administration du CNL délibère chaque année pour modifier, créer ou supprimer des aides.
Il n’apparaît certes pas souhaitable de transformer les aides aux projets en une aide plus globale au fonctionnement des entreprises et des structures. En effet, axés sur la santé économique de l’entreprise, les soutiens seraient alors déconnectés de la qualité des projets.
Toutefois, à la suite de l’enquête globale menée auprès des usagers du CNL au cours des cinq dernières années, une réforme structurelle réorganisant ces dispositifs en grands ensembles devrait permettre une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité de ceux-ci.
Proposition n° 20 – Resserrer le dispositif de soutien du livre autour de quelques grandes catégories d’aides. |
*
* *
La Commission examine le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle relatif au financement des politiques culturelles par des ressources affectées, présenté par MM. Richard Dell’Agnola, Nicolas Perruchot, et Marcel Rogemont, Rapporteurs.
M. Jérôme Cahuzac, Président. Même si ce n’est pas manifeste, le thème de votre rapport a un lien précis avec le précédent. Si le bureau de la commission des Finances les a retenus tous les deux, c’est en considération de leur portée pour la politique budgétaire et la maîtrise des dépenses de l’État.
L’évolution de la masse salariale permet d’aborder la question sous l’angle de la rigidité des moyens de fonctionnement. Les modes de financement des politiques culturelles mettent en question, à partir de l’exemple d’une politique publique particulière, les marges de manœuvre en matière d’intervention de l’État. Le thème sur lequel vous avez travaillé permet en outre de s’interroger sur le rôle des opérateurs sur les débudgétisations et naturellement, sur la technique de l’affectation des recettes.
Messieurs les rapporteurs, nous vous écoutons.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. La mission d’évaluation et de contrôle de la commission des Finances de l’Assemblée nationale a souhaité inscrire la problématique du financement des politiques culturelles par ressources affectées à son programme de travail de l’année 2011.
L’affectation directe de recettes constitue un mode de financement dérogatoire au droit commun budgétaire qui voit l’attribution directe de recettes fiscales se substituer au financement traditionnel par versement d’une subvention abondée par des crédits budgétaires. Concrètement, les sommes afférentes « sortent » du budget général pour être directement versées aux bénéficiaires de l’affectation.
Au-delà de préoccupations générales, qui ne concernent pas uniquement les opérateurs culturels, la mission aura consacré aux cinq institutions concernées une attention particulière en étendant, lorsqu’elle l’a jugé nécessaire, le champ de son analyse à des problématiques dépassant le strict cas du financement par ressources affectées : relations avec la tutelle, gestion des ressources humaines, pilotage de l’activité, etc.
Au total, la MEC a retenu une série de 20 propositions. Deux d’entre elles sont des recommandations à caractère général. Les 18 autres concernent chacun des cinq opérateurs étudiés, lesquels se caractérisent par leur grande hétérogénéité quant à la nature et l’étendue de leurs missions, leur poids en termes de financement public, et l’importance des ressources affectées qui leur sont allouées.
Ces opérateurs sont : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ; le Centre des monuments nationaux (CMN) ; le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) ; et le Centre national du livre (CNL).
Les recettes fiscales directement affectées à ces cinq opérateurs ont représenté une masse financière supérieure à 860 millions en 2010, les données provisoires pour 2011 tendant à démontrer une stabilisation à cette même hauteur. La part des ressources affectées dans les ressources totales de ces opérateurs laisse apparaître des situations très hétérogènes, avec des écarts allant de 1 à 20 entre le CMN, où elle représentent moins de 5 % de ses financements pour 2010, et le CNC qui est intégralement financé par ce biais.
Au total, les ressources affectées aux cinq opérateurs ayant fait l’objet de notre étude représentent près de 80 % de leur financement global, le solde étant constitué de subventions complémentaires et de ressources propres.
Les institutions culturelles analysées par la MEC ne sont pas les seuls opérateurs à bénéficier de ressources affectées. Or le recours à un tel mécanisme de financement n’est pas neutre du point de vue de la gestion publique et suscite bon nombre d’interrogations.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le recours à cette technique de financement dérogatoire peut se justifier. La ressource affectée peut s’avérer un outil efficace est pertinent dès lors qu’elle a vocation :
– à constituer la contrepartie directe d’un service rendu : tel est le cas de la redevance d’archéologie préventive ;
– à restaurer les équilibres d’un secteur par neutralisation des externalités, en application de la logique « pollueur-payeur » : c’est, par exemple, l’objectif visé par taxes affectées au CNL ou par la redevance d’archéologie préventive ;
– à assurer une péréquation au sein d’un secteur donné : tel est le fondement de l’action du CNC, du CNV ou du CNL.
Il n’en demeure pas moins que la « débudgétisation » soulève plusieurs questions de principe qui sont loin d’être anodines au regard du contrôle et de suivi de la dépense, ce phénomène entraînant un certain nombre de difficultés inhérentes, notamment, à la portée du contrôle du Parlement et à l’exercice de la tutelle sur ces opérateurs.
Ces questions acquièrent une résonance particulière dans le contexte actuel de tensions sur les finances publiques qui rend nécessaire la participation de l’ensemble de la sphère publique à l’effort de redressement des comptes nationaux.
Dès lors, les propositions de portée générale formulées par la MEC tendant à limiter au strict nécessaire le recours à la « débudgétisation », légitimes au regard de la nécessaire maîtrise de la dépense publique, de l’efficacité du pilotage des opérateurs, et du respect des grands principes du droit budgétaire, sont susceptibles de trouver un écho d’autant plus grand dans la perspective de l’indispensable assainissement des comptes publics.
La « débudgétisation » est porteuse de plusieurs difficultés. Tout d’abord, elle entraîne un affaiblissement du contrôle du Parlement et réduit ses marges de manœuvre quant à l’importance des moyens financiers qu’il entend consacrer à telle ou telle politique publique. Il est en effet beaucoup moins aisé d’adapter les financements des opérateurs affectataires de ressources fiscales, alors qu’un simple amendement de crédits permet de calibrer les dotations des opérateurs financés par les traditionnels crédits budgétaires.
Par ailleurs, en conférant une autonomie financière plus grande aux opérateurs, elle peut tendre à un affadissement du rôle joué par la tutelle et partant, à un pilotage plus erratique des politiques dont elle a la charge.
Enfin, elle fait peser des risques sur le niveau de la dépense publique qui, s’ils ne se manifestent pas systématiquement – et c’est heureux – n’en sont pas moins inhérents à cette technique et, à ce titre, doivent être sérieusement pris en considération avant de décider du recours à celle-ci.
Les principaux risques sont :
– un pilotage de la politique publique par la recette, favorisant une mise en adéquation artificielle et inflationniste des besoins aux ressources ;
– un certain laxisme dans la gestion tenant au caractère procyclique des taxes, qui s’avéreront dynamique si la conjoncture est favorable ;
– l’absence, ou du moins l’insuffisante participation des opérateurs affectataires à l’effort de modération de la dépense publique, puisque des ressources potentiellement dynamiques, largement à l’abri des régulations budgétaires ministérielles ou parlementaires permettent à leurs bénéficiaires de ne pas ressentir trop durement les contraintes qui pèsent sur le niveau de la dépense publique.
Au regard de ces constats, la MEC estime que l’affectation de ressources à des opérateurs ne doit s’effectuer que dans des cas précis et strictement limités. Cette procédure doit rester exceptionnelle et en aucun cas devenir une facilité de gestion qui, pour efficace qu’elle puisse être à certains égards, constitue une sorte d’angle mort du contrôle exercé par le Parlement comme par la tutelle.
C’est pourquoi la MEC a été conduite à formuler deux propositions à caractère général. La première vise à réintégrer dans le cadre budgétaire de droit commun un maximum de financements publics afin d’éviter la myopie du Parlement comme du Gouvernement dans la gestion des finances publiques.
La deuxième entend :
– améliorer l’information du Parlement ;
– éviter tout risque de pilotage par la recette des politiques publiques concernées ;
– soumettre les opérateurs financés par ressources affectées à l’effort de modération de la dépense publique.
C’est pourquoi la MEC propose que le surplus de recettes constaté par rapport à la couverture objective de leurs charges soit automatiquement reversé au budget général de l’État et contribue, le cas échéant, à la réduction du déficit public. En effet, l'effort de réduction de la dépense publique se doit d'être global et équitablement réparti entre toutes les composantes de la sphère publique, quel que soit leur mode de financement.
Bien entendu, ce plafond de dépenses – et donc de recettes – pourrait être révisé en gestion si des circonstances objectives l’exigeaient, dans l’hypothèse où l’opérateur aurait à assumer des charges supplémentaires, et dès lors que la couverture de celles-ci serait pleinement justifiée.
Nous allons maintenant présenter les propositions relatives à chacun des opérateurs.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Concernant le CNC, la principale problématique a tenu à la sécurisation de ses ressources, remise en question par le comportement de certains redevables. Cette préoccupation s’inscrit dans le respect des principes généraux précédemment énoncés et tendant à la modération d’une dépense publique qui doit couvrir des charges objectives, et non des besoins nouveaux opportunément découverts à la faveur de rentrées fiscales dynamiques.
Notre première proposition a donc trait à l’adaptation de la taxe sur les services de télévisions (TST) dans son volet « distributeurs ». Il convient d’en recalibrer l’assiette afin de parer à tout risque d’optimisation fiscale de la part de certains redevables, tout en assurant un maintien, voire une réduction, de la pression fiscale pesant sur ceux-ci. Une telle redéfinition n’est, en réalité, qu’une correction nécessaire et légitime afin de rendre la norme et les pratiques conformes à la volonté exprimée par le législateur à l’occasion de la loi de finances pour 2011, et de garantir l’équité fiscale.
Parallèlement, il s’agira de procéder à une minoration des taux applicables. En effet, si les opérateurs concernés – les fournisseurs d’accès Internet notamment – doivent participer à la rémunération de contenus, produits par d’autres secteurs, dont ils profitent et grâce auxquels ils sont en mesure d’attirer clients et annonceurs, il s’agit de ne pas grever inconsidérément des acteurs économiques en pleine expansion économique, faisant figure de locomotives de l’innovation et de l’investissement, et s’inscrivant dans un champ particulièrement concurrentiel.
Nous insistons sur ce point : il ne s’agit pas d’augmenter les recettes du CNC. Nous raisonnons à pression fiscale constante voire réduite. Il s’agit simplement de redresser une situation fiscale insatisfaisante tant du point de vue de l’équité entre redevables que du point de vue du respect de la volonté du législateur.
Notre proposition n’entre donc pas en contradiction avec les recommandations de caractère général présentées précédemment et tendant à une modération de la dépense publique, tout en s’assurant que chaque opérateur ait les moyens de s’acquitter efficacement des missions dont il a la charge. Or le CNC doit notamment faire face à une demande nouvelle et exponentielle de contenus du fait de la multiplication des supports de diffusion et de consommation audiovisuelle, et assumer un coûteux plan de numérisation des œuvres et des salles de cinéma.
Notre deuxième proposition tient à la répartition entre soutien automatique et aides sélectives. En effet, les masses financières considérables collectées et gérées par le CNC invitent incontestablement, dans le contexte de rigueur budgétaire, à reconsidérer le poids relatif de chaque type de soutien dans les dépenses du Centre. Aussi, il apparaît nécessaire de renforcer le poids des aides sélectives dans les dépenses totales de soutien, une part inférieure à la moitié de l’effort financier accordé – 47 % actuellement – paraissant insuffisante.
Enfin face à certaines critiques, réelles ou supposées, soulignant l’opacité de la procédure de traitement des demandes de soutien, la MEC juge légitime de demander aux commissions du CNC de formaliser clairement et de rendre publics les critères de sélection auxquels elles font référence pour accorder – ou dénier – le soutien du Centre. Une telle formalisation de la doctrine adoptée par chaque commission permettrait de neutraliser ces critiques et, en tout état de cause, d’améliorer les procédures en les clarifiant.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Pour l’INRAP, nous avons formulé cinq propositions.
Tout d’abord, eu égard à la complexité du versement de la redevance d’archéologie préventive (RAP), la MEC recommande une simplification du système : la RAP pourrait être intégralement affectée au Fonds national d’archéologie préventive (FNAP) et sa gestion assurée par un organisme tiers telle la Caisse des dépôts et consignations, laquelle en redistribuerait le produit à l’INRAP et aux autres opérateurs publics chargés d’une activité de diagnostic, au prorata des diagnostics effectivement réalisés. Seraient ainsi évités les soupçons quant aux relations de trésorerie parfois opaques entre FNAP et INRAP.
Il conviendrait en outre que le Gouvernement procède à l’apurement de la dette de l’INRAP vis-à-vis de l’Agence France Trésor, celle-ci grevant depuis trop longtemps les comptes de l’Institut. En effet, si l’INRAP n’a pas été en mesure d’honorer cette dette, ce n’est pas en raison d’une gestion hasardeuse, mais parce que le produit de la RAP, censé couvrir cette charge, n’aura jamais atteint les niveaux espérés.
Notre troisième proposition concerne le pilotage des activités de l’INRAP. Je rappelle que celles-ci ont été ouvertes à la concurrence :
– partiellement sur le volet « diagnostics » puisque les services compétents des collectivités territoriales peuvent dorénavant les réaliser ;
– totalement sur la partie « fouilles », opérateurs publics comme privés pouvant se porter candidats pour mener ces opérations.
Or l’INRAP n’est toujours pas doté d’instruments de pilotage et de comparaison de son activité par rapport à ses concurrents. La MEC plaide donc pour une mise en œuvre rapide de ceux-ci.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, les personnes auditionnées par la MEC ont souligné les risques tendant à la dégradation des prestations d’archéologie préventive. Aussi la MEC estime nécessaire que les cahiers des charges établis par les services régionaux d’archéologie soient plus précis quant au niveau de qualité attendu des opérateurs, afin que les opérations répondent bien aux standards minima requis en termes scientifiques, techniques et sociaux.
Enfin, constatant la timidité du ministère de la Recherche dans sa fonction de tutelle de l’INRAP comme la persistance de « cloisons » entre les différents acteurs de l’archéologie préventive, la MEC recommande de renforcer les liens entre l’INRAP et les différents acteurs de la recherche et d’encourager les collaborations scientifiques entre les acteurs institutionnels de l’archéologie préventive et entre les archéologues, quel que soit leur statut et leur structure d’appartenance.
Au-delà de ces propositions, et si elle ne souhaite pas insulter l’avenir puisqu’une nouvelle évolution du régime de la RAP est envisagée à moyen terme, la MEC s’interroge sur l’opportunité de revenir à une budgétisation intégrale du financement de l’archéologie préventive, la RAP n’ayant jamais atteint les rendements espérés malgré de nombreuses réformes.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Trois propositions ont été formulées concernant le CMN, la troisième ayant toutefois vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérateurs culturels.
Conformément à la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le CMN se voit affecter une partie du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne (poker, black jack, etc.). Or on constate qu’une telle affectation ne répond à aucun des critères précédemment évoqués permettant d’en justifier le recours. Aussi la MEC estime-t-elle que la création d’un tel système de financement dérivé dérogatoire au droit budgétaire commun ne se justifiait pas et qu’il convient de revenir à une rebudgétisation de l’ensemble des financements accordés au CMN, celle-ci passant naturellement par un recalibrage de sa dotation budgétaire pour couvrir la perte de recettes subie.
En outre, l’importance du fonds de roulement du Centre plaide pour une mobilisation plus forte des sommes concernées afin de financer les dépenses de restauration des monuments dont le CMN a la charge. Je rappelle que pour le seul Panthéon, le coût de tels travaux est estimé à 100 millions d’euros.
La dernière recommandation est valable pour le CMN comme pour d’autres opérateurs. Afin de moderniser la gestion des ressources humaines au sein des opérateurs culturels et d’améliorer le service rendu aux usagers, et parce que la multiplicité des statuts et des employeurs peut être source de tensions, de viscosités, de lenteurs et d’inefficacité dans la gestion des personnels, il semble nécessaire de permettre le détachement auprès de ces opérateurs des agents qui demeurent statutairement rattachés à l’administration centrale.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Le CNV fait l’objet de cinq propositions.
La première est une mesure de simplification purement technique visant à substituer à l’actuel mécanisme de remboursement de la taxe pour les sommes recouvrées inférieures à 80 euros un seuil de même montant, en deçà duquel la taxe n’est pas recouvrée. Une telle mesure serait susceptible d’épargner des frais de gestion au CNV et d’améliorer
– modestement – la gestion de trésorerie des redevables.
Par ailleurs, le taux de satisfaction global des demandes d’aides est très élevé puisque près de 83 % des dossiers instruits en commission sont acceptés, ce qui semble indiquer que les critères de sélection ne sont pas particulièrement opérants. Aussi il conviendrait que le CNV et sa tutelle, en collaboration avec les professionnels du secteur, redéfinissent les critères d’attribution des aides afin de rendre le dispositif de sélection plus efficace.
Le CNV n’est pas la seule institution à intervenir dans le domaine du spectacle vivant. Il partage, bon gré mal gré, une partie de ses compétences avec une association loi de 1901, l’Association pour la sauvegarde du théâtre privé (ASTP), laquelle est également bénéficiaire de ressources affectées. Les deux structures s’opposent régulièrement quant à la délimitation du périmètre de deux catégories de spectacles : ceux soumis à la taxe sur les spectacles de variété, établie au profit du CNV, et ceux soumis à la taxe sur les spectacles, instituée par la loi de finances rectificative pour 2003 au bénéfice de l’ASTP.
Certes, une commission de médiation est chargée d’arbitrer les cas de désaccord, mais il semble que ceux-ci persistent. Il conviendrait donc de clarifier les compétences et, partant, les financements respectifs des deux structures.
Par ailleurs, si les professionnels du secteur sont très attachés au dispositif du CNV, il existe encore une marge de progression dans la perception de la taxe, en raison de son caractère déclaratif : tous ceux qui devraient acquitter la taxe ne le font pas, notamment les petits entrepreneurs, soit par méconnaissance, soit par oubli. Aussi la MEC préconise-t-elle d’améliorer l’information relative au CNV dans les lieux publics de spectacles : maisons des jeunes et de la culture, scènes de musiques actuelles par exemple.
Enfin, et il s’agit sans doute du principal dossier qu’auront à gérer le CNV et sa tutelle, il est nécessaire de préparer la transposition de la « Directive Services » en définissant au plus vite les règles de déclaration des spectacles et de perception de la taxe applicables aux entreprises européennes de spectacle non établies en France.
Je rappelle que cette réglementation communautaire va entraîner une réforme des licences d’entrepreneurs de spectacles. Jusqu’à présent, l’entrepreneur étranger devait s’adosser à un entrepreneur français, détenteur de la licence. Désormais, l’entrepreneur européen non-établi en France pourra y organiser un spectacle en procédant à une simple déclaration préalable. Les entrepreneurs non-européens continueront à devoir s’adosser à un entrepreneur français. Le dispositif de perception de la taxe devra donc être adapté afin que les opérateurs européens non installés sur le territoire national s’en acquittent.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Notre dernière série de propositions concerne le Centre national du livre, lequel, confronté aux bouleversements technologiques qui animent le secteur dont il assure le soutien, doit sécuriser son financement.
Le CNL est financé par deux taxes affectées : la taxe sur l’édition, au produit relativement modeste, et qui n’appelle pas de remarques particulières ; la taxe sur le matériel de reprographie et d’impression, laquelle, censée couvrir la majeure partie des charges du CNL, n’a jamais atteint les rendements escomptés.
Aussi la MEC propose-t-elle d’étudier la rebudgétisation du financement du CNL, eu égard au produit relativement modeste des taxes affectées et aux risques pesant sur leur rendement.
Parallèlement, craignant que le grand nombre d’aides gérées par le CNL – plus de 30 – ne favorise une dispersion peu efficace du soutien alloué, la MEC recommande un resserrement du dispositif autour de quelques grandes catégories d’aides, une telle réforme devant naturellement s’opérer en concertation avec les professionnels du secteur.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Au total, la MEC s’est efforcée de concilier des exigences et des intérêts parfois difficilement compatibles mais souvent d’égale importance. Elle a donc formulé des préconisations qui ont vocation :
– à améliorer la gestion publique, le suivi et le contrôle de la dépense par le Parlement comme par les tutelles ;
– à dégager, le cas échéant, des marges de manœuvres budgétaires, en plaidant pour un pilotage efficace des politiques publiques qui ne soit pas déterminé par le dynamisme des ressources affectées aux opérateurs, mais par des besoins clairs et objectivement identifiés ;
– tout en veillant à ne pas grever la capacité de ces opérateurs à mener à bien les missions essentielles dont ils ont la charge et dont ils s’acquittent tous avec passion et détermination.
M. Jérôme Cahuzac, Président. Je vous remercie.
En vous entendant, on ne peut qu’être frappé par votre attitude très réservée sur la technique de l’affectation, qu’elle se traduise par des comptes spéciaux, au sein du budget de l’État, ou par des établissements publics, en dehors de lui. Dans ces conditions, seriez-vous éventuellement partisans de la suppression de certains comptes d’affectation spéciale existants ?
M. Marc Francina. Les sommes rebudgétisées seraient-elles réaffectées au budget de la Culture, au sein du budget général ?
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Pour plusieurs opérateurs, nous serions en effet partisans de réaffecter ces taxes au budget général. Ceci aurait alors naturellement pour contrepartie un abondement des crédits des différentes missions de rattachement de ces opérateurs, et notamment de la mission Culture.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Il existe deux types de ressources et deux types d’organismes. La différence est grande entre le Centre des monuments nationaux et le Centre national du cinéma et de l’image animée. Les ressources versées au CNC relèvent de l’auto-organisation d’un secteur économique qui est une industrie puissante. Un tel système doit être distingué d’une taxe dont l’assiette n’a aucun lien direct avec le secteur qu’elle finance. La nécessité d’une rebudgétisation est évidemment différente suivant les types de système et de taxe.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Sur la question plus spécifique des éventuels surplus de taxes, les réaffecter au budget général me paraît aussi tout à fait légitime. Il ne peut y avoir enrichissement sans cause. Mais les situations sont extrêmement diverses. Il existe des organismes très modestes dotés d’une taxe modique comme le Centre national du livre dont le bien-fondé budgétaire et institutionnel n’est pas évident, alors que le CNC a sa propre logique qui permet au cinéma français d’exister en tant qu’industrie au niveau international, notamment face aux États-unis.
Mme Marie-Christine Dalloz. Concernant l’INRAP, les deux missions de cet Institut ont été clairement définis lors de sa création : le diagnostic d’une part et les fouilles d’autre part. Or, beaucoup de départements se sont dotés d’un service d’archéologie préventive créant des doublons. Et l’ouverture à la concurrence s’est fait dans un cadre de distorsion de la concurrence, car les cahiers des charges n’ont pas été assez strictement définis et de manière générale, les services régionaux d’archéologie préventive n’ont pas fait preuve d’assez de pugnacité dans l’accompagnement des collectivités dans ce domaine. Je regrette que les Rapporteurs ne donnent pas davantage de pistes pour réformer en profondeur la redevance d’archéologie préventive de manière à ce que l’archéologie préventive ait un réel financement. Je ne suis pas convaincue par le fait d’assurer la gestion de la RAP par la Caisse des dépôts et consignations.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Dès lors que l’on est sorti de la situation monopolistique qui prévalait avant la création de l’INRAP, on ne peut empêcher la création de services départementaux d’archéologie. En matière de fouilles, la concurrence est ardemment souhaitée par les élus locaux qui dénoncent les lenteurs de l’INRAP. Les investissements des collectivités sont ralentis. Mais personne ne s’interroge sur les raisons de l’état actuel de l’INRAP. Nous proposons, pour l’améliorer, l’apurement de la dette de l’Institut. Il est impossible pour un organisme de fonctionner avec une trésorerie négative. Comment recruter du personnel pour faire face aux besoins dans une telle situation ? Je pense que l’on a souvent fait un mauvais procès à l’INRAP.
La concurrence n’est pas la panacée dans ce domaine et on pourrait craindre qu’à terme la concurrence mène à ce que les fouilles soient gérées par les seuls grands groupes de travaux publics. C’est pour cette raison que les services régionaux d’archéologie doivent être très vigilants sur la qualité scientifique des projets et le suivi de leur réalisation. Tel est l’objet de notre proposition tendant à ce que les services régionaux de l’archéologie établissent des cahiers des charges plus précis et plus rigoureux.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Sur le financement pérenne de l’INRAP, ainsi que nous l’avons indiqué et sans vouloir enterrer la réforme de la RAP avant qu’elle ait été présentée, nous formulons une préconisation en forme d’interrogation : ne faudrait-il pas procéder à une rebudgétisation intégrale des moyens de l’Institut ? En outre, celle-ci permettrait un contrôle et un suivi plus efficaces de la dépense.
M. Olivier Carré, Président de la Mission d’évaluation et de contrôle. La tentation pour ces organismes peut être de vouloir élargir leurs missions quand les ressources augmentent. C’est au législateur de fixer ces missions. Un organisme prospère ne doit s’attribuer des missions qui sont à la marge de sa mission principale. La question s’est posée pour le CNC. Et le législateur pourrait dans ce cas ajuster le niveau des taxes en jouant sur les taux. La rebudgétisation est aussi nécessaire que la définition d’un cadre rigoureux des missions.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Faire revenir d’éventuels excédents du CNC au budget général pourrait s’apparenter à un détournement. Si les sommes reversées servaient, par exemple, à financer la création d’un centre national de la musique, comme certains pourraient en avoir la tentation.
La Commission, en application de l’article 145 du Règlement, autorise la publication du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle sur le financement des politiques culturelles par des ressources affectées.
I. – LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
– le 5 mai 2011, M. Éric Garandeau, président du Centre national de la cinématographie, accompagné de Mme Audrey Azoulay, directrice générale déléguée
– le 5 mai 2011, M. Arnaud Roffignon, directeur général, Institut national de Recherches archéologiques préventives (INRAP) et M. Jacques Ballu, directeur de l’administration et des finances de l’INRAP
– le 19 mai 2011, Audition commune de représentants du ministère de la Culture et de la communication : Mme Laurence Franceschini, directrice générale des Médias et des industries culturelles, M. Georges-François Hirsch, directeur général de la Direction artistique, M. Philippe Bélaval, directeur général des Patrimoines
– le 19 mai 2011, M. Jean-François Colosimo, président du Centre national du livre (CNL) accompagné de Mme Véronique Trinh, directrice générale
– le 19 mai 2011, Audition conjointe de Mme Marie-Astrid Ravon, sous-directrice, 8ème sous-direction de la direction du Budget accompagnée de Mme Anne-Hélène Bouillon, chef du bureau de la culture, de la jeunesse et du sport à la 8ème sous-direction du Budget. et de M. John Palacin, chef du bureau D2 à la direction de la Législation fiscale, en charge de la politique sectorielle et des taxes sur les transactions
– le 26 mai 2011, Mme Isabelle Lemesle, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN)
– le 26 mai 2011, M. Jacques Renard, directeur du Centre national des variétés et du jazz (CNV)
– le 26 mai 2011, Table ronde sur le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : Mme Hortense de Labriffe, délégué général de l’Association des producteurs indépendants (API), MM. Guy Verrecchia, président d’UGC et Marc Lacan, directeur général de Pathé ; M. Jean Labé, président de la fédération nationale des cinémas français (FNCF) accompagné de M. Marc Olivier Sebag, délégué général ; M. Victor Hadida, président de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) ; M. Stéphane Le Bars, délégué général de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) ; et M. Guillaume Prieur, Directeur des Affaires Institutionnelles et Européennes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
– le 9 juin 2011, table ronde d’éditeurs de services de télévision : M. Philippe Bony, directeur adjoint des programmes en charge de la production de M6 métropole télévision ; M. Yann Le Prado, responsable des acquisitions sur Direct 8 et directeur général adjoint de Direct Star ; M. Gérald Brice Viret, directeur général du pôle télévision de NRJ 12 et Mme Françoise Marchetti, secrétaire générale de Pôle Télévision ; M. Christian Vion, directeur général adjoint en charge de la Production et des Moyens des Antennes de France Télévisions et Mme Anne Grand d'Esnon, directrice des relations institutionnelles ; M. Fabrice Blancho, directeur de la production de ARTE-France
– le 9 juin 2011, table ronde de distributeurs de services de télévision : M. Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad ; M. Éric Haentjens, directeur financier de Bouygues Télécom ; MM. Philippe Logak, Secrétaire général de SFR, Vincent Talvas, Directeur des affaires publiques et Laurent Vannimenus, Adjoint du Directeur, Direction de la Réglementation et de la Concurrence
– le 9 juin 2011, table ronde d’opérateurs privés d’archéologie préventive : M. Pierre Hauser, directeur général d’Archéodunum ; M. Julien Denis, directeur technique d’Eveha ; M. Régis Picavet, co-gérant de Paléotime ; M. François Lacrampe-Cuyaubère, gérant d’Archéosphère
– le 9 juin 2011, table ronde d’organismes publics d’archéologie préventive : M. Thomas Vigreux, président de l’Association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT) ; M. Matthieu Fuchs, directeur général du Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR) ; M. Hervé Sellès, chef du service départemental d’archéologie d’Eure-et-Loire ; M. Bruno Dufaÿ, chef du service archéologique départemental d’Indre-et-Loire (SADIL) et M. Olivier Brun, responsable de la cellule départementale d’archéologie des Ardennes
II.– COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Pages
Audition du 5 mai 2011
À 8 heures 30 : M. Éric Garandeau, président du Centre national de la cinématographie, accompagné de Mme Audrey Azoulay, directrice générale déléguée 89
À 10 heures : M. Arnaud Roffignon, directeur général, Institut national de Recherches archéologiques préventives (INRAP) et M. Jacques Ballu, directeur de l’administration et des finances de l’INRAP 102
Auditions du 19 mai 2011
À 9 heures : Audition commune de représentants du ministère de la Culture et de la communication : Mme Laurence Franceschini, directrice générale des Médias et des industries culturelles, M. Georges-François Hirsch, directeur général de la Direction artistique, M. Philippe Belaval, directeur général des Patrimoines 113
À 10 heures : M. Jean-François Colosimo, président du Centre national du livre (CNL) accompagné de Mme Véronique Trinh, directrice générale 122
À 11 heures : Audition conjointe de Mme Marie-Astrid Ravon, sous-directrice, 8ème sous-direction de la direction du Budget accompagnée de Mme Anne-Hélène Bouillon, chef du bureau de la culture, de la jeunesse et du sport à la 8ème sous-direction du Budget. et de M. John Palacin, chef du bureau D2 à la direction de la Législation fiscale, en charge de la politique sectorielle et des taxes sur les transactions 131
Auditions du 26 mai 2011
À 9 heures : Mme Isabelle Lemesle, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN) 140
À 10 heures : M. Jacques Renard, directeur du Centre national des variétés et du jazz (CNV) 151
À 11 heures : Table ronde sur le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : Mme Hortense de Labriffe, délégué général de l’Association des producteurs indépendants (API), MM. Guy Verrecchia, président d’UGC et Marc Lacan, directeur général de Pathé ; M. Jean Labé, président de la fédération nationale des cinémas français (FNCF) accompagné de M. Marc Olivier SEBAG, délégué général ; M. Victor Hadida, président de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) ; M. Stéphane Le Bars, délégué général de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) ; et M. Guillaume Prieur, Directeur des Affaires Institutionnelles et Européennes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 161
Auditions du 9 juin 2011
À 9 heures 30 : Table ronde d’éditeurs de services de télévision : M. Philippe Bony, directeur adjoint des programmes en charge de la production de M6 métropole télévision ; M. Yann Le Prado, responsable des acquisitions sur Direct 8 et directeur général adjoint de Direct Star ; M. Gérald Brice Viret, directeur général du pôle télévision de NRJ 12 et Mme Françoise Marchetti, secrétaire générale de Pôle Télévision ; M. Christian Vion, directeur général adjoint en charge de la Production et des Moyens des Antennes de France Télévisions et Mme Anne Grand d'Esnon, directrice des relations institutionnelles ; M. Fabrice Blancho, directeur de la production de ARTE-France 168
À 10 heures 30 : Table ronde de distributeurs de services de télévision : M. Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad ; M. Éric Haentjens, directeur financier de Bouygues Télécom ; MM. Philippe Logak, Secrétaire général de SFR, Vincent Talvas, Directeur des affaires publiques et Laurent Vannimenus, Adjoint du Directeur, Direction de la Réglementation et de la Concurrence 178
À 11 heures 30 : Table ronde d’opérateurs privés d’archéologie préventive : M. Pierre Hauser, directeur général d’Archéodunum ; M. Julien Denis, directeur technique d’Eveha ; M. Régis Picavet, co-gérant de Paléotime ; M. François Lacrampe-Cuyaubère, gérant d’Archéosphère 184
À 12 heures 30 : Table ronde d’organismes publics d’archéologie préventive : M. Thomas Vigreux, président de l’Association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT) ; M. Matthieu Fuchs, directeur général du Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR) ; M. Hervé Sellès, chef du service départemental d’archéologie d’Eure-et-Loire ; M. Bruno Dufaÿ, chef du service archéologique départemental d’Indre-et-Loire (SADIL) et M. Olivier Brun, responsable de la cellule départementale d’archéologie des Ardennes. 190
Audition du 5 mai 2011
À 8 heures 30 : Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Garandeau, président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), accompagné de Mme Audrey Azoulay, directrice générale déléguée, et de M. Olivier Guillemot, directeur des affaires financières et juridiques
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. La Mission d’évaluation et de contrôle commence un nouveau cycle de travaux concernant le financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées, et c’est à ce titre que nous accueillons les représentants du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Le rapport de nos travaux sera établi par trois rapporteurs : M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur spécial sur les programmes Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ; M. Nicolas Perruchot, Rapporteur spécial pour les Patrimoines, qui, empêché, vous prie d’excuser son absence ; M. Marcel Rogemont, vice-président de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Nous sommes accompagnés ce matin par deux magistrats de la Cour des comptes : M. Emmanuel Marcovitch, conseiller référendaire, et M. Antoine Mory, auditeur.
L’état actuel de nos finances publiques nous impose d’appréhender parfaitement l’ensemble des dépenses de l’État. Or, des interrogations subsistent sur l’exacte adéquation entre les ressources affectées aux organismes, nombreux dans le domaine culturel, et leurs différentes utilisations. Nous vous entendrons donc avec intérêt.
M. Éric Garandeau, président du Centre national de la cinématographie. Je préside le CNC depuis quatre mois, mais j’y ai occupé différentes fonctions pendant de nombreuses années. Le Centre assure six missions qu’il entend mener dans la plus grande transparence.
Le détail de ces missions est désormais fixé à l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée :
– une mission générale de veille de l’évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d’accès aux métiers concernés ;
– le soutien, dans l’intérêt général, du financement et du développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée pour en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies ;
– l’administration des registres du cinéma et de l’audiovisuel et, dans ce cadre, la centralisation et la communication aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
– la collection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique. À ce titre, le Centre exerce notamment les missions relatives au dépôt légal ;
– la participation à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia ;
– enfin, une mission de contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public pour en informer les ayants droit.
Le CNC est d’ailleurs devenu une institution de référence en matière de publication de données économiques et financières ; cette mission, qui s’est renforcée au fil du temps, est désormais assurée par notre direction des études, des statistiques et de la prospective. Par ailleurs, l’article L. 114-2 du code du cinéma et de l’image animée oblige le CNC à adresser au Parlement, en même temps que le projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel rendant compte du rendement et de l’emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit. Enfin, le CNC est doté depuis peu d’un conseil d’administration qui s’est réuni une première fois à la fin de l’année 2010, puis le 7 avril dernier ; sous peu, ce conseil d’administration comprendra, vous le savez, deux membres du Parlement.
Le CNC a été fondé en 1946, mais un rapport de l’Inspection générale des finances avait préconisé sa création dès 1936. Partant du constat que le cinéma, invention française - celle des frères Lumière, de Méliès, d’Émile Reynaud et d’Émile Cohl - et qui avait inondé le monde, en particulier les États-Unis, avant la première guerre mondiale, avait disparu des écrans, la volonté s’exprimait de ressusciter ce qui était un art mais aussi une industrie nationale. D’emblée, le CNC s’est vu affecter une taxe assise sur le prix des billets d'entrée dans les salles de cinéma, la taxe spéciale additionnelle, dite TSA. Au fil du temps, la règle selon laquelle tout diffuseur d’images animées doit contribuer à la création des images a été confirmée.
La France est l’un des cinq premiers pays du monde pour la production cinématographique et le nombre de salles de cinéma. En termes d’influence, il se situe dans le trio de tête, ce qui est remarquable pour un pays d’un peu plus de 60 millions d’habitants, surtout si on le compare aux États-Unis, dont la puissance économique et industrielle est très supérieure, ou encore à l’Inde ou à la Chine, dont le marché intérieur est beaucoup plus important et qui mènent des politiques de plus en plus ambitieuses. Si nous voulons tenir notre rang, le mécanisme de prélèvement de recettes sur la distribution d’images - étendu aux chaînes de télévision dans les années 1980, puis au marché de la vidéo, de la vidéo à la demande (VOD) et enfin à celui de l’Internet - doit absolument perdurer. Les bilans qualitatifs relatifs au cinéma français, à notre politique audiovisuelle et au marché des jeux vidéo montrent que la France reste une puissance artistique et technique de premier plan dans toutes les industries de l’image.
Voilà, rapidement brossé, comment se caractérisent notre activité et notre organisation. J’ajoute que, bien qu’autonome, le CNC conserve un lien très fort avec les pouvoirs exécutif et législatif : établissement public à caractère administratif mais aussi direction d’administration centrale, le CNC a en effet une double mission de soutien financier et de réglementation.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. À quelles dates les taxes successives ont-elles été affectées au CNC ?
M. Éric Garandeau. La taxe spéciale additionnelle a été instaurée en 1948, la taxe sur les services de télévision en 1984, puis étendue en 2007 aux distributeurs Internet et celle sur les vidéogrammes en 1993 avant d’être étendue à la VàD – ou VOD – en 2004.
M. Olivier Carré, Président. Quelles sont les parts de TVA et de taxe affectée dans le prix d’un billet de cinéma ?
M. Éric Garandeau. La TSA représente 10,72 % du prix d’un billet, dont le produit est soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Les secteurs de la vidéo et la VàD sont soumis à une taxe de 2 % hors TVA.
Mme Audrey Azoulay, directrice générale déléguée du CNC. La taxe a été fixée à 2 % parce que le secteur de la vidéo est soumis à la TVA au taux plein.
M. le président Olivier Carré. Quelle est la part de la TSA dans les recettes du CNC ?
M. Éric Garandeau. Elle devrait approcher 128 millions d’euros en 2011.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. L’année dernière, la taxe affectée au CNC lui a tant rapporté que le Sénat s’en est ému. Qu’en est-il ?
M. Éric Garandeau. Nous percevons 750 millions d’euros au titre de l’ensemble des taxes affectées. Ce sont nos uniques ressources, puisque le CNC ne reçoit plus de dotation budgétaire.
M. Olivier Carré, Président. Quelle part et quel montant représente chacune des trois taxes dans ce volume global et comment cette distribution est-elle susceptible d’évoluer ?
Mme Audrey Azoulay. L’amplitude de la TSA varie, faiblement, en fonction de nos anticipations du volume et du prix du billet ; elle représentait 121 millions d’euros dans le budget prévisionnel pour 2010 et 127 millions dans celui de 2011.
La taxe sur les services de télévision (TST) a deux composantes. La première est prélevée sur les chaînes de télévision qui ne sont pas financées par abonnement. Cette composante « éditeurs » n’a pas pour assiette l’intégralité du chiffre d’affaires des chaînes mais, pour l’essentiel, la publicité et la contribution à l’audiovisuel public – ex-redevance –ainsi que, de manière annexe, d’autres éléments tels que les recettes que ces chaînes tirent des SMS surtaxés. La contribution à l’audiovisuel public est prévisible ; le volume de la taxe sur la publicité dépend évidemment de l’évolution du marché. Je parle là des chaînes gratuites, au nombre desquelles les chaînes de la TNT ; toutes sont soumises à une taxe de 5,5 %, qui s’applique au-delà d’une franchise.
La deuxième composante de la taxe sur les services de télévision est prélevée sur les distributeurs de chaînes de télévision : CanalSat, Canal+, le câble, Orange, et maintenant tous les fournisseurs d’accès à Internet qui vendent l’accès aux chaînes de télévision par abonnement, généralement dans le cadre d’une offre triple play. C’est la loi de 2007, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, qui a étendu la taxe aux offres triple play.
M. Olivier Carré, Président. Lors du débat relatif à l’augmentation de la TVA sur les abonnements triple play, le Parlement et le Gouvernement ont eu le plus grand mal à obtenir des fournisseurs d’accès qu’ils différencient les trois segments de leurs offres et qu’ils indiquent précisément la part de leur chiffre d’affaires liée à la télévision. Dans ce contexte, comment réussit-on à asseoir la taxe sur les services de télévision affectée au CNC ?
M. Éric Garandeau. Avant la loi de 2007, un rescrit permettait déjà aux fournisseurs d’accès de négocier avec l’administration fiscale la part qu’ils estimaient être celle de l’offre de télévision dans l’offre global du triple play. Puis, étant donné la difficulté éprouvée pour mesurer la part précise de télévision dans l’offre, la loi l’a fixée à 50 % ; ensuite a eu lieu l’ajustement récent du régime de TVA que l’on sait. Ce dont on est sûr, c’est que la part d’images animées dans les flux transportés par Internet ne cesse de croître ; déjà estimée à 40 %, la proportion passerait à 70 % au moins d’ici cinq ans.
M. Olivier Carré, Président. Pour vous, rien ne distingue YouTube de TF1 ?
M. Éric Garandeau. La distinction existe sur le plan juridique puisque TF1 propose un service de télévision et YouTube un simple canal de diffusion permettant à qui le souhaite de diffuser des séquences d’images animées. Mais, de plus en plus, YouTube comme Dailymotion et les autres sites de ce type, offrent des services d’éditorialisation du contenu, ce qui les apparente à des chaînes de télévision. Mais le principe de neutralité fiscale quels que soient les acteurs et le fait que le réinvestissement des ressources collectées dans des programmes d’images animées a montré son efficacité plaident fortement en faveur de l’extension engagée des interventions du CNC. Le récent décret dit « web COSIP » qui nous permet de contribuer au financement de programmes destinés à être diffusés exclusivement ou partiellement sur les réseaux de communication Internet fixes et mobiles va en ce sens.
M. Olivier Carré, Président. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément ce que les différentes taxes affectées rapportent au CNC ?
Mme Audrey Azoulay. Le budget prévisionnel pour 2011 prévoit que la taxe sur les services de télévision, ou TST, dans sa composante principale, dite « éditeurs », rapporte 316 millions d’euros, après 296 millions en exécution 2010. Cette taxe correspond à 5,5 % du chiffre d’affaires au-delà d’une franchise de 11 millions d’euros après abattement de 4 %. Je précise que la loi prévoit des déclarations par chaîne. D’autre part, le produit de la part de taxe acquittée par les distributeurs a connu une forte augmentation l’année dernière, avec 277 millions d’euros en exécution ; la prévision est de 267 millions d’euros dans le budget prévisionnel 2011. Cette taxe est assise sur le produit des abonnements à des services de télévision, selon un barème progressif de 0,5 à 4,5 % du chiffre d’affaires au-delà d’une franchise de 11 millions d’euros.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Quel est le poids du CNC dans l’économie du secteur ? Quelle est la proportion d’œuvres aidées rapportée aux aides demandées ? En somme, quel est le taux de satisfaction des demandes d’aide ?
M. Éric Garandeau. Nos interventions prennent la forme d’un soutien automatique et de soutiens sélectifs. Le premier est destiné à accompagner le développement économique et à récompenser le succès de certains films, les seconds sont décidés après avis d’une commission composée de professionnels du cinéma en fonction de la qualité artistique des projets. Dans notre budget 2011, les aides automatiques représentent environ 53 % de celui-ci et les aides sélectives 47 %, soit 32 % pour les soutiens sélectifs « classiques » et 15 % pour les soutiens liés au plan numérique.
Le soutien automatique permet de financer 6 % d’un film ; peuvent s’y ajouter 2,7 % d’aide sélective. La contribution du CNC au financement d’un film peut donc aller jusqu’à près de 9 %. Peuvent s’y agréger 2 % supplémentaires d’aides régionales.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Au regard des moyens que la France consacre à l’aide à son cinéma, comment expliquez-vous que la part des films français dans les salles soit passée de 41 % à 35 % en une dizaine d’années ?
M. Éric Garandeau. La part de marché des films français en France varie. Elle était de 35 % en 2010 en raison du considérable succès du film américain Avatar, mais elle atteint 45 % pour les quatre premiers mois de l’année 2011. Les films à grand spectacle, américains ou français, font bondir les chiffres de la fréquentation des salles : un film peut enregistrer à lui seul 20 millions de spectateurs, comme ce fut le cas pour Bienvenue chez les Ch’tis, qui a fait exploser la part de marché des films français.
La part de marché du film français est importante, surtout si on la compare à la part de marché des productions locales dans les autres pays, en particulier chez nos voisins d’Europe occidentale. La France est l’un des rares pays du monde où les films « nationaux » bénéficient d’une part de marché aussi forte, si l’on excepte l’Inde et la Turquie, qui sont des marchés spécifiques. Ainsi, en 2009, la part de marché du film national était de 23 % en Italie, 27 % en Allemagne et 16,5 % au Royaume-Uni.
La solide part de marché des films français en France assoit la politique menée et les moyens investis. Par ailleurs il est intéressant de noter que les spectateurs de films français sont aussi nombreux à l’étranger qu’en France - environ 75 millions dans les deux cas. Cette situation atypique montre que les films français, qui s’exportent assez bien - et avec eux la culture française - réunissent une assez forte fréquentation. Nous en tenons compte dans nos mécanismes de soutien.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Le CNC a-t-il des homologues dans des pays comparables à la France ? Comment s’organise, hors de nos frontières, le soutien au cinéma ?
M. Éric Garandeau. La France est le pays qui dispose de l’outil de soutien au secteur artistique et industriel le plus développé, et notre mécanisme a été largement exporté. Chaque année, pendant le Festival de Cannes, des délégations étrangères souhaitent nous rencontrer pour s’en inspirer. Au Royaume-Uni, le British Film Institute, organisme public, vient de remplacer le UK Film Council. L’Espagne s’est dotée d’un Institut de la cinématographie, l’ICAA ; en Allemagne, pays très décentralisé, le FFA, structure fédérale, ajoute ses aides à celle qu’apportent les länder. Il existe également l’équivalent du CNC en Autriche, en Pologne et en Finlande, au Canada avec l’Office national du film ainsi qu’au Québec, et en Australie avec Screen Australia. Aucun de ces organismes n’a la même palette d’interventions que celle du CNC mais l’on retrouve un grand nombre d’interventions semblables aux nôtres : soutiens automatiques ou sélectifs, taxes sur la billetterie des salles de cinéma…
M. Olivier Carré, Président. Il me semble qu’aux États-Unis, le soutien n’est pas national mais coopératif : la profession elle-même a mis en place un fonds de redistribution.
Mme Audrey Azoulay. Les conditions de marché aux États-Unis sont très différentes de ce qu’elles sont pour le cinéma en France, et beaucoup est fait par la Motion Picture Association, organisation professionnelle. À la différence de ce que l’on constate dans les autres pays, le soutien au cinéma opéré en France par le CNC concerne l’ensemble de la filière, avec un très fort soutien aux salles. Il en résulte que notre réseau de salles est le plus dense et parmi les plus modernes d’Europe, et que la répartition des salles sur le territoire est la plus équilibrée.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Envisage-t-on l’unification des systèmes d’aide et des coproductions européennes ou en restera-t-on au niveau national ?
M. Éric Garandeau. Le projet européen est construit sur le principe de l’harmonisation des règles dans tous les domaines afin de faciliter la circulation des biens et des services. Mais ce principe ne vaut pas pour le marché culturel, la diversité des expressions culturelles et artistiques suscitant les échanges. Il serait catastrophique d’entraver, au nom de l’harmonisation, le soutien de leurs productions nationales et régionales par les pays européens ; on ferait le lit des productions formatées déjà amorties sur leur marché national, à savoir les productions américaines et, demain, chinoises et indiennes.
La France est depuis longtemps convaincue de la nécessité pour chaque État de préserver la diversité culturelle, une conviction que traduit une convention de l’UNESCO. Cela suppose que chaque État se dote d’un établissement tel que le CNC, organisé et financé comme il l’entend. L’important est que chaque pays puisse soutenir sa production nationale, afin qu’émerge un marché européen de la culture : on pourra alors voir davantage de films allemands, espagnols et italiens dans les salles françaises et de films français à l’étranger.
Nous avons le sentiment que la France résiste fortement car elle a réussi à adapter son modèle au XXIème siècle pour répondre à l’enjeu de la révolution numérique. Nos ressources nous permettent d’investir fortement dans le numérique, les salles de cinéma, les contenus, les réseaux, les services pour conforter la position de leader de la France en Europe. Mais certains de nos partenaires européens se trouvent dans une situation plus difficile, et cela n’est pas dans notre intérêt. En matière culturelle, la Commission européenne a changé sa manière de voir en constatant que nous tenions tous le même langage, à savoir que l’union fait la force et que les Anglais, les Allemands, les Espagnols et les Français ne considèrent pas leurs voisins comme des concurrents mais comme des partenaires susceptibles d’apporter ensemble à l’Europe une plus-value économique et culturelle. Il est très important que les organismes publics du cinéma européen, les EFAD, se coalisent pour faire valoir à la Commission européenne qu’il s’agit de renforcer la vitalité du secteur en Europe. Leurs représentants se réuniront à Cannes la semaine prochaine.
M. Olivier Carré, Président. Soit, mais que l’industrie cinématographique des États-Unis ne reçoive pour ainsi dire pas d’aides publiques ne l’empêche pas d’avoir une position dominante dans le monde. En France, l’aide publique au cinéma est financée par des prélèvements non négligeables qui pèsent sur les consommateurs. Quelle est l’efficacité de l’action du CNC au regard des taxes collectées ? Je perçois toute l’importance du volet culturel, mais mon interrogation porte sur la justification économique du mécanisme actuel.
M. Éric Garandeau. Le CNC finance, selon les cas, de 6 à 9 % d’une production cinématographique ; c’est une part significative, mais on est loin d’une économie administrée… S’agissant de la distribution de films, les aides du CNC, en 2010, ont représenté 7,3 % des encaissements des distributeurs, sur la base de 470 millions d’euros. La même année, la part de financement du CNC pour les programmes audiovisuels s’élevait à 14,9 %, soit 203,8 millions d’euros, sur un total d’environ 1,365 milliard ; en 2009, sa part de financement pour l’édition vidéo et la VOD représentait 1,3 %, soit 11,3 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 855 millions. Les aides du CNC peuvent paraître élevées, mais c’est que l’économie du cinéma et de l’audiovisuel est elle-même très importante. Et si nos aides contribuent pour 24 % à l’effort de numérisation des salles, on ne peut davantage dire qu’il s’agit d’une économie collectiviste…
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Avez-vous un moyen de mesurer l’impact des soutiens que vous accordez sur la fréquentation des salles ?
M. Éric Garandeau. Bien sûr. La donnée la plus spectaculaire concerne la part de marché du cinéma national dans les salles de France, supérieure à ce que l’on peut observer dans tous les autres pays, exception faite des États-Unis et de l’Inde. Tout aussi remarquable est la fréquentation des salles de cinéma : après une baisse continue, nous sommes revenus au record enregistré en 1967, avec 206,7 millions de spectateurs en 2010.
M. Olivier Carré, Président. Je ne conteste pas que les différents acteurs aient tout fait pour relancer l’activité, et je ne contesterai pas non plus la relative vitalité des salles d’Art et d’essai, à laquelle le CNC n’est certainement pas étranger, mais cette situation favorable s’explique aussi par les qualités propres de l’opérateur dominant, le groupe Gaumont-Pathé.
M. Éric Garandeau. La filière cinématographique française est une sorte d’écosystème ; en son centre est le CNC, qui l’irrigue. Dans cet écosystème, des acteurs importants ont toute leur place, mais ils sont aidés eux aussi : 53 % du budget du CNC est consacré au soutien automatique, qui leur bénéficie également - mais pas à eux seulement, car nous avons aussi pour mission de soutenir les productions indépendantes. Aujourd’hui, le CNC consacre une grande partie de ses ressources à l’aide à la numérisation des salles et des œuvres, domaine dans lequel la France est en avance sur les autres pays européens. Nous pouvons conforter cette avance avec les moyens dont nous disposons mais, sans eux, il est manifeste que notre pays perdra cette bataille cruciale.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Le CNC n’est pas l’unique organisateur du marché du cinéma – Canal + et France Télévisions, en particulier, étant tenues à des obligations de financement de productions pour des montants plus élevés que ceux apportés par le CNC. On ne peut donc attribuer au seul CNC la vigueur du cinéma français, mais l’on peut dire qu’il concourt, avec les chaînes, à la bonne santé des acteurs de la filière cinématographique française – c’est grâce à la structure existante que des groupes comme Pathé se portent bien.
Dans un autre domaine, le ministre de la Culture avait annoncé que 125 millions d’euros seraient consacrés à la numérisation des salles – mais d’où provient cette somme ? À combien s’établit la participation du CNC ? Quel est l’état d’avancement des négociations à ce sujet avec les régions, les départements et les communes à ce sujet ?
M. Olivier Carré, Président. Personne ne conteste que la France compte de bons opérateurs et de bons créateurs. Mais, considérant que le montant du soutien alloué à la création par le CNC est le même que celui d’une des taxes prélevées - non négligeable pour le consommateur -, on peut se demander si le dispositif de redistribution en vigueur est plus efficace que le serait une allocation directe.
Par ailleurs, les frais de gestion du CNC représentent 5,6 % du montant des fonds distribués ; ce taux est-il constant au fil des ans ? À combien s’élèvent les dépenses de personnel ?
Mme Audrey Azoulay. Nos frais de gestion ont augmenté de 0,3 % après que le recouvrement de la TSA et de la taxe sur les services de télévision – jusqu’alors collectée par la direction générale des Finances publiques –, nous a été confié. Toutefois, cette évolution a permis à l’État de réaliser une économie substantielle, de l’ordre de 10 millions d’euros. Le taux de frais de gestion est désormais de 5,6 %, soit 0,6 point d’augmentation après prise en charge des nouvelles missions de recouvrement fiscal de la TSA, depuis 2007, et de la TST, depuis 2010. Par ailleurs, en 2010, année au cours de laquelle les recettes ont été plus fortes qu’escompté dans le budget prévisionnel, le CNC n’a pas prélevé de frais de gestion sur le surplus, s’en tenant à ce qui était prévu au budget.
Notre budget de fonctionnement évolue assez peu, puisque nous sommes soumis depuis deux ans au non remplacement d’un agent sur deux partant à la retraite, ce qui a conduit à la baisse du nombre d’équivalents temps plein.
M. Éric Garandeau. Le CNC compte parmi ses missions la gestion du patrimoine cinématographique. En notre sein, le service des Archives françaises du film gère un million de bobines de films entreposées à Bois d’Arcy et à Saint-Cyr - dont certaines datent des frères Lumière - et celles de la Cinémathèque française.
Cette mission de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique mobilise plus de 80 personnes au sein du CNC, dont l’effectif est passé de 467 agents en 2007 à 458 en 2011 ; six emplois devraient nous être reversés du ministère de l’Économie, des finances pour la prise en charge du recouvrement de la taxe sur les services de télévision. Ainsi, alors que nos missions ne cessent d’augmenter, notre effectif est stable. Quant aux dépenses de personnel, elles sont passées de 25,4 millions d’euros en 2007 à 28,1 millions en 2010.
Mme Audrey Azoulay. Cette évolution s’explique par le fait que nos frais de personnel comportent quelques éléments variables, dont l’activité des commissions chargées d’attribuer les aides sélectives, car nous rémunérons, faiblement, une partie des 700 commissaires.
M. Olivier Guillemot, directeur des Affaires financières et juridiques. Ces personnes interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et perçoivent une petite somme forfaitaire par dossier examiné.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Tout en ayant, à titre personnel, une opinion à ce sujet, je pose à nouveau la question posée par le président et restée sans véritable réponse : le CNC a-t-il une utilité réelle pour la filière ?
M. Olivier Carré, Président. En d’autres termes, quelle est l’efficacité du dispositif de prélèvement-redistribution ?
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Le président pourrait aussi vous demander pourquoi, en France, si peu de producteurs font faillite…
M. Éric Garandeau. Tout n’est pas facile pour les producteurs, et il en est qui font faillite…
Je suis bien entendu convaincu de l’utilité du CNC, dont les acteurs du marché, si vous les interrogez, vous parleront mieux que moi. Outre que tout ce qui nous remonte des contributeurs et des bénéficiaires nous est favorable, nous ne cessons de recevoir des délégations étrangères - plusieurs cette semaine encore - venues s’enquérir de notre organisation et de nos missions. Nous sommes étudiés, observés, parfois imités et transposés dans le monde entier, et même si nos homologues ne reprennent pas forcément la palette complète de nos activités, ils pourraient éclairer la MEC sur ce qui suscite dans le monde un intérêt aussi soutenu.
Que le CNC contribue au financement de la numérisation des salles de cinéma n’est pas étranger au fait que la France, avec ses 5 500 salles, est au troisième rang mondial - nous occupions le deuxième rang il y a quelques mois encore ; c’est à présent celui de la Chine, où trois salles s’ouvrent chaque jour. Ce n’est pas non plus un hasard si le taux d’équipement numérique des salles en France est le plus élevé d’Europe. Et, si tout se passe comme nous le souhaitons, nous serons bientôt les premiers au monde pour la numérisation des films, ce qui aura été rendu possible par les ressources allouées à cette fin dans le cadre du grand emprunt et assorties d’un complément du CNC pour les œuvres dont la rentabilité est insuffisante pour que leur numérisation intéresse un opérateur.
En 2011 et 2012, le CNC consacrera à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques 121 millions d’euros – dont 9 millions prendront la forme d’une dotation complémentaire à l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, l’IFCIC, qui contre-garantit les emprunts concédés par les banques aux exploitants. Ce financement sera concentré sur les plus petites exploitations, soit un millier de salles environ. Notre objectif, ambitieux, est que l’ensemble du parc soit numérisé fin 2012 et, après la catastrophe qui a frappé le Japon, l’interrogation principale est de savoir si les équipementiers seront capables de fournir les matériels dans les délais prévus. Il est préférable que la période de transition soit la plus courte possible car elle est coûteuse : plus longtemps l’ancien et le nouveau systèmes coexisteront, plus longtemps les distributeurs devront continuer de fournir des copies argentiques et les exploitants d’entretenir les projecteurs en 35 mm.
M. Olivier Carré, Président. Numérisation des salles, fort bien, mais si elle a pour finalité la retransmission dans les salles de cinéma françaises d’opéras captés au Metropolitan Opera de New-York, peut-on encore parler de création d’images animées ?
M. Éric Garandeau. Ce débat a beaucoup agité la profession. Nous serons très attentifs à la programmation des salles et nous l’avons fait savoir, car notre objectif n’est évidemment pas de transformer les salles de cinéma françaises en nouvelles salles d’opéra. Toutefois, les captations d’opéra ne sont pas des exercices passifs, ce sont des films à part entière, avec une mise en scène créative. D’autre part, il peut être très intéressant pour les petites salles de cinéma situées en zones rurales d’attirer et de fidéliser les spectateurs par une programmation semblable à celle que proposaient les maisons de la culture. Une synergie est donc possible mais il faut bien sûr laisser suffisamment de place aux 200 à 260 films qui sortent chaque année.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Il faudra effectivement veiller à ce que le dispositif ne soit pas détourné de son objet. Par ailleurs, ne peut-on craindre que la multiplication continue du nombre des chaînes de télévision, qui aura pour effet une répartition plus étalée des recettes publicitaires, n’affaiblisse la principale ressource du CNC ? Comment, selon vous, concilier des règles conçues pour être appliquées dans un cadre national avec la généralisation de la télévision connectée et l’internationalisation croissante des supports ?
M. Éric Garandeau. Le financement futur des contenus préoccupe tous les acteurs de l’audiovisuel, comme l’a montré le colloque consacré à la télévision connectée à Internet que vient d’organiser le CSA.
Au président Olivier Carré qui, observant que les sommes collectées et les sommes redistribuées sont à peu près les mêmes, s’interroge sur la validité du mécanisme en vigueur, je ferai valoir que ce dispositif nous a permis de développer des segments très forts, tels l’animation et le documentaire, qui ont une économie très puissante et un palmarès international impressionnant. Notre point faible est la fiction ; mais, sans le CNC et France Télévisions, la fiction française n’existerait plus, les diffuseurs ayant tout avantage à acheter des produits « sur étagère » qui ont déjà été amortis à l’international.
M. Olivier Carré, Président. Le problème est dans l’organisation des flux.
M. Éric Garandeau. Nous considérons que pour assurer la qualité, il faut des producteurs et des diffuseurs puissants et une logique industrielle.
M. Olivier Carré, Président. Vous êtes des fonctionnaires, à ce titre tenus à la neutralité. Cette particularité a-t-elle des conséquences ?
M. Éric Garandeau. Assurément. Le CNC, établissement public, est neutre. En son sein, des commissions composées de professionnels rendent des avis sur les projets qui leur sont soumis mais, in fine, les décisions sont prises par des agents publics. Ce système de poids et de contrepoids, conforme à L’Esprit des lois, empêche les interférences politiques potentielles - au demeurant inexistantes.
M. Olivier Carré. À ce sujet, quelles sont la puissance relative des grands groupes de création et l’influence respective des différentes « écoles » ?
M. Eric Garandeau. Pour que les meilleurs projets soient choisis, nous veillons à ce que la composition de chaque commission soit équilibrée et toutes les sensibilités représentées.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Étant donné les mutations en cours, comment envisagez-vous l’évolution du dispositif de financement des missions du CNC ?
M. Éric Garandeau. L’évolution vers la télévision connectée, stade ultime de l’intégration de l’univers audiovisuel, secteur très réglementé, et de l’univers d’Internet, secteur non réglementé, renforce la nécessité de favoriser les investissements dans la création, car ce sont la qualité, la diversité et la puissance des créations françaises et européennes qui nous permettront de résister. Il n’y a pas de raison d’être plus inquiet de cette évolution qu’il n’y en avait de l’être lors de l’apparition de la connexion à la télévision par câble et satellite. Les obligations d’investissements et les financements encadrés visent à encourager cet effort nécessaire. Si nous voulons résister - et nous le pouvons – nous devons investir dans la création de qualité, qu’il s’agisse de fictions, de documentaires ou d’œuvres nouvelles.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. On comprend que la persistance de productions audiovisuelles et cinématographiques françaises tient à une singularité esthétique et à une vision particulière. Mais le dispositif d’aides en vigueur a été conçu pour fonctionner dans un cadre circonscrit, celui du territoire national. Il ne pourra plus en être ainsi à l’avenir ; comment ce système devra-t-il évoluer ?
M. Éric Garandeau. Il convient en effet de transposer le dispositif à l’univers d’Internet. Deux évolutions importantes en ce sens ont déjà eu lieu : d’une part, l’extension des obligations d’investissement aux services de médias audiovisuels à la demande, les SMAD, d’autre part, l’extension de la taxe sur les services de télévision aux nouveaux opérateurs instituée par la loi de 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
La deuxième mesure a récemment connu un accroc, un certain opérateur ayant entrepris d’individualiser la part « audiovisuelle » de son offre et surtout de l’apprécier à la portion congrue. Cela a été source d’inquiétude pour nous. En effet, quels que soient les modes de diffusion et de réception, les nouveaux services délinéarisés internationaux vont transiter par Internet ; il est donc vital pour nous de préserver l’assiette élargie de cette taxe. La question est donc de savoir s’il faut maintenir un lien entre la taxe et les services de télévision au sens traditionnel ou s’il n’est pas préférable de fixer pour assiette l’ensemble des services d’Internet. Évoluer vers une taxe à l’assiette large et au taux faible permettrait de couper court à des discussions infinies sur la part exacte de la télévision dans l’ensemble de l’offre considérée.
Mme Audrey Azoulay. Depuis que le CNC a été créé, en 1948, le législateur a très souvent modifié le dispositif de financement en fonction des modes successifs de création de valeur. La nouvelle adaptation en cours renforcera notre alliance objective avec les fournisseurs d’accès à Internet, de même que, par le passé, des alliances objectives se sont forgées avec nos autres contributeurs.
M. Olivier Carré, Président. Le sujet n’est pas épuisé, car s’il est facile de financer la création dans un système national fermé, cet objectif est beaucoup plus difficile à atteindre dans un système ouvert où prévaut le principe de la « gratuité » des contenus.
M. Éric Garandeau. L’ouverture rend plus nécessaires que jamais les financements publics et encadrés destinés à alimenter la création, mais elle a aussi pour aspect positif que des couloirs nouveaux s’ouvrent qui permettront de diffuser nos œuvres. Notre mission est donc d’encourager la qualité afin que nos diffuseurs continuent d’exister et notre pays d’avoir une culture cinématographique et audiovisuelle singulière, afin que nous soyons beaucoup plus performants à l’exportation. Nous finançons doublages et sous-titrages, précisément pour favoriser l’exportation, et nous souhaitons aussi réformer notre système d’aides pour continuer d’attirer des talents en France et nous permettre ensuite de mieux exporter.
M. Olivier Carré, Président. Quelles limites fixez-vous à l’action du CNC ?
M. Éric Garandeau. Nous devrons investir 500 millions d’euros dans la numérisation des salles et des œuvres au cours des trois à cinq ans qui viennent ; pour financer cette évolution historique, aussi capitale que le fut la création de l’imprimerie, nos ressources doivent donc connaître une progression dynamique. Le choix qui s’offre à nous est soit de mourir - c’est-à-dire abandonner l’idée d’une culture audiovisuelle propre -, soit à l’inverse de prendre le leadership en ce domaine en Europe et aider à affirmer le leadership européen à l’international. Autant dire que l’enjeu déborde largement les seules questions artistique et économique. Tout en ayant le souci de bien gérer les deniers publics, nous considérons devoir accomplir un effort majeur au cours des cinq prochaines années. Notre mode de financement permet l’adéquation entre nos ressources et nos besoins ; nous sommes en discussion avec la tutelle pour sécuriser notre taxe, indispensable. Je le redis, la pertinence de notre modèle est avérée, en France mais aussi aux yeux de l’étranger - sait-on que la Tunisie nouvelle, soucieuse de se reconstruire sur le plan culturel, veut créer son propre CNC ?
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. L’étranger vous observe mais, mise à part la Corée du Sud qui a adopté un système assez comparable au nôtre, vous imite peu, me semble-t-il. D’autres pays ont-ils réellement copié le dispositif du CNC ?
M. Éric Garandeau. Tous s’en sont inspirés. Mais, je vous l’ai indiqué, tous n’ont pas repris l’entière palette de nos activités. Outre les pays précédemment cités, je puis évoquer Israël, le Brésil qui a créé l’équivalent des SOFICA, la Chine qui envisage d’étoffer son réseau de salles d’art et d’essai, l’Inde… Dans ce contexte, le fait que le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne aient quelque peu « levé le pied » est une source d’inquiétude pour l’Europe. Nous espérons un sursaut.
M. M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. La question se pose du juste retour aux différents diffuseurs de la taxe affectée. Le CNC a-t-il vocation à opérer un choix dans la redistribution entre les différents vecteurs de diffusion – le cinéma, la télévision et l’Internet - ou y a-t-il un déséquilibre constant ?
M. Éric Garandeau. Le CNC doit répondre à tous les besoins artistiques dans toutes les disciplines de sa compétence. Il n’y a pas de retour direct au diffuseur - mais il n’y en a jamais eu. En revanche, le principe qui sous-tend le dispositif est que tous les créateurs profitent de la création. Nous sommes à la fois moteur et pilote, et nous jouons pleinement ce rôle. Ce que nous finançons a vocation à être diffusé par ces trois voies, et c’est le cas. Il n’y a plus aucun verrou, puisque, depuis la publication du nouveau décret, nous aidons aussi des œuvres qui seront diffusées uniquement par le biais d’Internet.
Mme Audrey Azoulay. Quand, dans le temps, la question s’est posée de savoir dans quelles proportions respectives aider la production audiovisuelle et la production cinématographique, la chose a été réglée de manière presque administrative : il y avait un compte d’affectation spéciale avec deux sections étanches et une clef de répartition. La question s’est ensuite posée pour la vidéo. Mais la pertinence de cette manière de procéder se perd : les aides du CNC finançant de plus en plus souvent des projets qui profitent à tous les secteurs, la logique de retour sur des périmètres définis de façon trop fermée a de moins en moins de sens.
M. Olivier Carré, Président. Je tiens donc la réponse à ma question : il n’y a aucune limite à votre volonté d’accompagner l’évolution de la diffusion de l’image ! Vous avez suivi l’évolution du cinéma à mesure qu’il se diffusait sur de nouveaux medias ; mais à présent, avec Internet, on est dans un changement complet de rapport à la création, devenue beaucoup plus diffuse. Vous souhaitez accompagner ce mouvement ; cela se conçoit, mais un moment vient où il faut se poser des limites, sans quoi vous expliquerez en permanence que vos ressources doivent être préservées pour vous permettre de suivre ces évolutions.
M. Éric Garandeau. Il y a une limite financière : celle que pose le législateur ; mais les cinq prochaines années seront une période charnière. L’autre limite, c’est que nous ne soutenons que les productions de qualité professionnelle, avec une sélectivité sévère ; ainsi, pour l’avance sur recettes, seuls 5 % des projets qui nous sont soumis bénéficient de notre soutien.
Enfin, on ne peut mésestimer une forme de retour indirecte de nos aides. Nous entreposons un patrimoine de 10 000 longs métrages dont les premiers remontent au XIXe siècle, et dont 5 à 10 % seulement sont connus. Les numériser, c’est servir l’Histoire, et c’est aussi permettre d’enrichir les catalogues de vidéo à la demande. La numérisation de ces œuvres donnera donc de l’utilité aux réseaux de fibre optique et, en nourrissant de nouvelles chaînes de télévision, apportera du chiffre d’affaires aux opérateurs du haut débit. Vous conviendrez qu’il ne sert à rien de développer des réseaux de fibre optique si l’on n’a pas d’images à diffuser. Le montant de 750 millions d’euros voté par le législateur représente un montant ridicule par rapport à ce qui va être investi dans les nouveaux réseaux, et pourtant il justifie cet investissement. Nous sommes donc encore très loin d’avoir atteint les limites de notre action.
M. Olivier Carré, Président. Nous conclurons sur cette note enthousiaste. Madame, Messieurs, je vous remercie.
Audition du 5 mai 2011
À 10 heures : Audition, ouverte à la presse, de MM. Arnaud Roffignon, directeur général de l’Institut national de Recherches archéologiques préventives (INRAP), et Jacques Ballu, directeur administratif et financier
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. La commission des Finances est de plus en plus sensible aux sujets relatifs aux financements extra-budgétaires. Elle a ouvert cette année deux missions d’évaluation et de contrôle en ce domaine, l’une sur la recherche et l’enseignement supérieur, l’autre sur la culture. Le financement par ressources affectées constitue en effet au même titre que la dépense budgétaire un prélèvement sur la valeur ajoutée produite dans le pays. Mais ces dépenses satellites échappent à la trajectoire globale des finances publiques.
Pourriez-vous nous présenter l’activité de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ? Au cours du débat sur le plan de relance, on se souvient qu’un amendement avait été adopté, qui tendait à l’augmentation de la redevance d’archéologie préventive, présentée comme insuffisante, en contrepartie d’une accélération des procédures afférentes.
M. Arnaud Roffignon. L’INRAP a été créé sous la forme d’un établissement public administratif par la loi du 17 janvier 2001. Cette loi a également institué un régime juridique propre à l’archéologie préventive. Avant elle, l’action de l’État se fondait, dans ce domaine, sur une loi de 1941 qui lui conférait un droit d’opposition et l’amenait à négocier directement avec les aménageurs afin de sauvegarder le patrimoine archéologique. Depuis 1973, une association pour les fouilles archéologiques nationales, l’AFAN, dont l’État avait suscité la création, était devenue le « bras armé » des différents responsables publics intéressés au suivi de la question. De nombreuses fouilles ont lieu dans le cadre de cette « archéologie de sauvetage », pour reprendre la terminologie de l’époque. L’action des pouvoirs publics manquait cependant d’une véritable assise juridique.
En 1992, la France a signé la convention de Malte qui encourage les États parties à sauvegarder leur patrimoine archéologique et à instituer pour ce faire un régime juridique particulier. À la suite de l’adhésion de la France à la convention, le Parlement, la Cour des comptes et les corps d’inspection se sont penchés sur cette question, qui a fait l’objet de nombreux rapports.
La loi du 17 janvier 2001 est née de ce long processus. Elle a créé l’INRAP comme bras armé de l’État, mais en séparant nettement sa fonction d’opérateur, jouissant du monopole de réalisation des fouilles, et les services centraux de l’État, qui conservent le rôle du prescripteur. La loi a également institué la redevance d’archéologie préventive censée financer les dépenses relatives aux diagnostics et aux fouilles ainsi que l’exploitation scientifique et la valorisation auprès du grand public de leurs résultats ; elle n’a pas produit le rendement attendu. Dans le même temps, un plafond d’emplois très strict a considérablement limité les moyens humains de l’établissement public.
Contesté de toutes parts, le dispositif de 2001 fut réformé dès 2003, par une loi qui conserva le principe d’un service public de l’archéologie préventive, élargissant même le monopole public en matière de diagnostic aux services agréés des collectivités territoriales, mais ouvrit à la concurrence la réalisation des fouilles. Depuis son entrée en vigueur, des opérateurs publics locaux ou des opérateurs privés peuvent répondre, pourvu qu’ils soient agréés par l’État, aux appels d’offre lancés par les aménageurs. Le diagnostic continue d’être payé par les deux filières dites « DRAC » et « DDE » de la redevance d’archéologie préventive, tandis que les opérateurs facturent les fouilles aux aménageurs. La loi de 2003 n’a donc pas remis en cause le principe, consacré par la convention de Malte de 1992, de l’aménageur-payeur.
M. Marcel Rogement, Rapporteur. Quel bilan dressez-vous de la loi de 2003 ? Toutes les parties en présence paraissent mécontentes. N’a-t-elle pas induit des coûts trop élevés ? C’est l’impression générale qui se dégage.
M. Arnaud Roffignon. Une récente tournée dans les huit directions régionales de l’INRAP nous a récemment fourni l’occasion de présenter un bilan. Malgré le mécontentement, les aménageurs comprennent et acceptent de mieux en mieux notre activité. Il semble que le consentement à l’archéologie préventive progresse. Les aménageurs sont en effet de moins en moins nombreux à n’y avoir jamais été confrontés. Sur la durée, le travail de pédagogie réalisé tant par l’État que par l’INRAP a produit ses fruits. Par ailleurs, la question de l’archéologie préventive est prise en compte de plus en plus tôt dans leur programmation : ce poste de dépenses étant prévu dès l’origine, les mauvaises surprises sont moins courantes. Enfin, les aménageurs s’intéressent de beaucoup plus près à la valorisation des découvertes, qu’ils utilisent de plus en plus dans leur communication.
Ces progrès restent cependant fragiles. Certains cas difficiles continuent d’exiger une forte mobilisation. En 2010, l’INRAP a confié une enquête à un sociologue afin d’analyser la perception et les attentes des aménageurs vis-à-vis de l’archéologie préventive en général, et de l’Institut en particulier. Parmi la trentaine d’aménageurs interrogés, près des deux tiers ont exprimé une insatisfaction dans leur relation avec l’établissement. Beaucoup ont exprimé leur frustration devant un maquis de procédures, confondant parfois le rôle des services de l’État prescripteur et celui des opérateurs. Aux bonnes relations sur le terrain sont opposés des rapports plus difficiles avec les services administratifs -notamment dans leur articulation avec l’opérationnel- qui sont l’objet de fortes attentes. Les aménageurs considèrent en outre que la dimension économique de leur projet n’est pas suffisamment prise en compte quel que soit l’opérateur concerné, public ou privé. Cette enquête qualitative, diligentée par l’INRAP, a fourni sur ce point de précieux témoignages personnels.
À la suite de cette enquête, nous avons lancé un « Plan reconquête aménageurs » qui vise à mettre ceux-ci au cœur des préoccupations de l’INRAP et décline toute une série de mesures afin d’améliorer la « relation client » – puisque les aménageurs, à tort ou à raison, se considèrent comme tels – d’analyser la question des délais et des prix, et de mieux adapter nos procédures internes aux attentes des aménageurs.
M. Arnaud Roffignon. Lorsque les aménageurs sont des collectivités territoriales, la relation que nous pouvons entretenir est différente car les élus locaux sont plus sensibles, au départ, que les aménageurs privés à la question de la valorisation du patrimoine. Cette préoccupation est internalisée dès l’origine du projet, tandis que les aménageurs privés ont tendance à la prendre en considération de manière plus progressive, à mesure que l’achèvement du chantier se rapproche.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Disposez-vous d’éléments précis et chiffrés quant à la conséquence de la fin du monopole sur les activités de l’INRAP ? Notamment, quels sont les coûts comparés de l’Institut et de ses concurrents, qu’il s’agisse de personnes publiques ou d’opérateurs privés, quant à la conduite des chantiers ? Que nous apprennent ces comparaisons en termes de délais ?
M. Arnaud Roffignon. La loi de 2003 a effectivement mis fin au monopole et a donc permis la multiplication des acteurs. Aujourd’hui, on compte quelque 80 opérateurs agréés, 60 organismes publics et 20 organismes privés. Pour autant, cette multiplication des acteurs ne s’est pas accompagnée d’une adaptation de la ressource publique qui permet le financement d’opérations d’archéologie préventive. En effet, alors que la loi de 2003 prévoyait un certain rendement de la redevance d’archéologie préventive, celui-ci n’a pas été atteint. Au total, une ressource constante est dorénavant distribuée entre davantage d’opérateurs.
La question reste donc : comment disposer d’une ressource qui soit en adéquation avec des besoins dont je rappelle qu’ils ne sont pas décidés par les opérateurs de l’archéologie préventive, mais par les services prescripteurs de l’État. En 2002, le taux de prescription des diagnostics était supérieur à 12 %. En 2003, suite à la crise qu’a connue l’INRAP, ce taux avait été divisé par deux et atteignait 6 %. Depuis 2003, le taux de prescription de diagnostic oscille entre 6,4 % et 7,6 %, et celui des fouilles varie entre 1 et 1,2 %. On constate donc une stabilité de la politique de prescription de l’État, une croissance du nombre d’opérateurs susceptibles d’intervenir et une stagnation de la ressource depuis 2006 avec un produit compris entre 65 et 70 millions d’euros. Ainsi, en 2010, le produit de la redevance d’archéologie préventive a atteint 70 millions d’euros.
M. Olivier Carré, Président. Dans ce contexte de stabilité des prescriptions et d’accroissement de la concurrence, comment justifiez-vous la croissance de vos équivalents temps plein (ETP) de 44 % depuis 2003 ? On comptait 1 464 ETP cette année-là, contre 2 113 aujourd’hui.
M. Arnaud Roffignon. Le niveau d’activité prescrit par l’État est effectivement constant en pourcentage, mais pas quant au volume des aménagements réalisés. Par ailleurs, la réponse de l’INRAP à la prescription s’est améliorée au fil du temps, le stock d’opérations non réalisées décroissant progressivement.
M. Olivier Carré, Président. L’étape « archéologie préventive » n’est plus neutre quant à la conduite d’un projet. Elle en conditionne la réalisation. Elle est même devenue l’un des éléments décisionnaires de l’opération. Or, je ne suis pas certain que telle était l’intention du législateur lorsque celui-ci a décidé de renforcer la valorisation du patrimoine et de le protéger. On a parfois le sentiment, en la matière, que le mieux est l’ennemi du bien, de nombreux projets ne pouvant aboutir du fait de surcoûts trop importants liés à l’archéologie préventive. En outre, non seulement ces opérations avortées ne produisent pas les effets escomptés en termes économiques, mais elles se révèlent également nulles quant à la valorisation du patrimoine puisque celui-ci demeure sous terre.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. J’ai porté sur les fonts baptismaux le texte de la loi de 2003, je pense donc pouvoir apporter quelques éclaircissements quant aux intentions du législateur. Il ne s’agissait pas de favoriser les recherches. Dans l’esprit du législateur, il était préférable que les objets restassent enterrés. Il est dans l’intérêt de la collectivité que peu de fouilles soient entreprises dans le cadre de l’archéologie préventive, contrairement aux fouilles programmées. S’il n’existait aucune sanction financière, aucun coût pour l’aménageur, ce serait un désastre ! Le cas échéant, les projets d’aménagements peuvent parfaitement être réalisés sur d’autres emprises, dont le sous-sol serait vierge de tout patrimoine archéologique et qui ne nécessiteraient alors pas de coûteuses opérations de fouilles.
M. Olivier Carré, Président. Deux visions s’opposent ici. Si dans les petits villages il est assez facilement envisageable de « déplacer » un projet d’aménagement, dans les milieux denses, qui sont des lieux de vie multiséculaires et qui, en conséquence renferment un patrimoine riche, il est en revanche malaisé de repousser une opération, faute de terrains et de sous-sols vierges. Faut-il empêcher le développement des villes ? Je ne souscris pas à l’idée selon laquelle les opérations d’aménagement devraient se raréfier du fait de la cherté attachée aux opérations d’archéologie préventive. Il convient au contraire de maintenir une fourchette de coûts raisonnable. Un équilibre doit être trouvé entre la préservation du patrimoine et les exigences d’aménagement.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. En tant que législateur, nous devons faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, auxquels, en tant qu’élu local, je suis par ailleurs sensible. Ainsi, à Rennes, la construction d’un parking s’est traduite par un coût d’archéologie préventive important, de l’ordre de 10 millions d’euros sur les 70 millions d’euros du projet. En la matière, le cumul des mandats nous rend quelque peu schizophrènes ! En tout état de cause, c’est bien l’intérêt général qui doit primer au sein de l’Assemblée nationale.
M. Arnaud Roffignon. Je pense qu’un parallèle peut être fait entre l’archéologie préventive et le développement durable. On a ainsi créé des marchés de droits à polluer et les entreprises doivent intégrer le coût de la pollution dans leur prix. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il est possible de raisonner en coûts complets. Opposer d’un côté les considérations économiques liées à un projet d’aménagement et l’archéologie préventive ne résout rien. Celle-ci était auparavant une sorte de coût caché qui n’était pas pris en compte. Il doit dorénavant être internalisé dans le coût total de chaque projet.
M. Olivier Carré, Président. J’estime pour ma part que le fait de pouvoir loger nos concitoyens relève de l’intérêt général au moins autant que la préservation du patrimoine.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Je souhaiterais revenir à ma question précédente : est-ce que le fait de solliciter l’INRAP plutôt qu’un opérateur concurrent revient plus ou moins cher ? Est-ce que les délais sont différents ? Procédez-vous à des comparaisons avec vos concurrents ? Qu’a apporté la fin du monopole en la matière ?
M. Arnaud Roffignon. Je ne suis pas certain d’être en mesure de vous apporter des éléments plus précis. À l’heure actuelle, ni l’INRAP ni – à ma connaissance – l’État, ne disposent d’outil permettant d’apprécier, en moyenne nationale, les délais d’intervention réels de l’archéologie préventive. En revanche, il existe une certitude : les délais associés à la phase terrain sont quasiment toujours tenus, sur la partie diagnostic comme sur la partie fouille. En effet, le contrat conclu avec l’aménageur formalise trois éléments : la date de mise à disposition du terrain, qui est de la responsabilité de l’aménageur ; la date de début et de fin des opérations pour la phase terrain ; la date de remise du rapport d’opérations.
Je ne dispose pas de statistiques puisque l’Institut ne possède pas encore d’outil de gestion de l’activité qui lui permettrait de calculer les moyennes nationales relatives à ses délais d’intervention. Un tel outil est en cours de développement et devrait être mis en production à la fin de l’année 2011. Dès 2012, nous serons donc en mesure de suivre de telles statistiques, qui sont effectivement essentielles. En tout état de cause, je peux vous assurer qu’une fois les interventions contractualisées avec l’aménageur, les délais sont tenus. Les difficultés liées aux délais tiennent davantage à la date de mise à disposition du terrain, décidée par l’aménageur, et à la date de démarrage des opérations. Par ailleurs, concernant les diagnostics, les moyens humains attribués à l’INRAP dans ce domaine dépendant du montant de la redevance d’archéologie préventive, nous ne pouvons pas répondre de manière optimale aux besoins. C’est ainsi que, ces dernières années, les moyens humains se sont essentiellement développés sur l’activité de fouille.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Quels sont, selon vous, les moyens de pallier l’insuffisance de la redevance d’archéologie préventive – la RAP –, insuffisance qui nécessite, en gestion, le versement de subventions budgétaires ? Quelles sont les conclusions de la mission de l’Inspection générale des Finances (IGF) diligentée à ce sujet ?
M. Arnaud Roffignon. En 2004, première année de perception de la RAP, son produit s’élevait à 12,8 millions d'euros. En 2006, il était de 65 millions d'euros. Depuis lors, il oscille entre 65 et 70 millions d'euros : 65,67 millions en 2007 ; 68,43 en 2008 ; 71,57 en 2009 et 70,67 en 2010, ce qui témoigne d’un léger décrochage.
La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, adoptée dans le cadre du Plan de relance de l’économie, a augmenté les taux des deux filières de la redevance, mais cela n’a pas suffi à en accroître le produit. Il semblerait donc que le régime fiscal institué par la loi de 2003 ait atteint ses limites. C’est ce constat qui a conduit le Premier ministre à demander en juin 2010 à l’Inspection générale des Finances un rapport sur la RAP.
Il faut savoir que, ces dernières années, le Premier ministre a systématiquement dû rendre des arbitrages sur le budget de l’INRAP. En 2007, l’INRAP s’est vu octroyer une subvention pour charges de service public. Cette subvention a été supprimée par la loi de finances pour 2010, du fait de l’augmentation des taux de la RAP prévue par le Plan de relance. Mais en 2010, le ministère de la Culture et de la communication a versé à l’INRAP une subvention de 16,43 millions d'euros, en raison de la diminution du rendement de la RAP. De même, le bouclage du budget 2011 a nécessité le versement d’une subvention de 20 millions d'euros. Il semble donc nécessaire de repenser le régime de la redevance.
M. Olivier Carré, Président. L’insuffisance du produit de la RAP est liée à son assiette, liée au nombre d’aménagements réalisés. Il conviendrait donc que l’INRAP dispose d’une marge de manœuvre sur ses charges, afin de pouvoir s’adapter aux évolutions conjoncturelles. À cet égard, l’augmentation des effectifs de l’Institut, que j’évoquais précédemment, me paraît problématique, d’autant que, si l’on en croit l’intention du législateur, l’évolution des effectifs devrait aller en sens inverse.
M. Arnaud Roffignon. Je tiens à signaler que le volume de contrats à durée déterminée dont nous disposons permet de tels ajustements.
M. Olivier Carré, Président. Mais ce volume diminue, puisque vous avez transformé 350 CDD en contrats à durée indéterminée.
M. Arnaud Roffignon. L’établissement a pour mission de répondre aux prescriptions de l’État. Celles-ci n’ayant jamais été pleinement satisfaites, il n’a pas été demandé à l’INRAP de réduire ses moyens humains.
S’agissant de la mission de l’IGF, la question était la suivante : peut-on adapter l’actuelle RAP, ou faut-il en repenser totalement l’architecture ?
L’IGF a dressé un triple constat. Premièrement, il est difficile de lire le rendement de la redevance, dont le produit est soit affecté directement aux services agréés des collectivités locales, soit à l’INRAP, lequel peut également procéder à des reversements le cas échéant. Deuxièmement, le fait que l’INRAP gère pour le compte de l’État le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP), au moyen d’un budget annexe, est facteur de complexité. Troisièmement, il existe un écart entre le niveau, et donc le coût des prescriptions, et le produit de la RAP.
Sur cette base, l’IGF a envisagé trois scenarii :
– le perfectionnement de la RAP, par un élargissement de son assiette, une augmentation de ses taux et une réduction des seuils d’imposition. L’IGF estime toutefois que cette solution ne serait pas à la hauteur des besoins ;
– l’adossement de la RAP sur la taxe d’aménagement, issue de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme. Cette solution ferait sens, dès lors que la RAP est adossée sur la taxe locale de l’équipement, concernée par ladite réforme ;
– la création d’une taxation alternative, assise sur les mutations de terrains à bâtir. Cette solution présente des avantages : internalisation à la source du coût de l’archéologie préventive, prévisibilité de la ressource, assiette large. Mais elle n’est pas sans inconvénients : les droits de mutation relevant de la fiscalité locale, la création de cette nouvelle taxe reviendrait à réintroduire de la fiscalité d’État dans la fiscalité locale ; en outre, la recherche archéologique ne se fait pas seulement sur les terrains à bâtir.
L’IGF a remis son rapport en octobre 2010. Les ministères de tutelle de l’INRAP en ont conclu que la RAP ne permet pas la prise en charge des missions de l’INRAP et du FNAP, et qu’une réforme est donc nécessaire. Une modification du régime de la redevance devrait ainsi être proposée dans le projet de loi de finances pour 2012. Une première préconisation de l’IGF devrait cependant être mise en œuvre dès juillet 2011, par voie réglementaire : l’introduction d’un ticket modérateur à la charge des aménageurs hors particuliers qui construisent pour eux-mêmes, s’agissant des activités du FNAP ; celui-ci ne prendrait en charge que 75 % des coûts, contre 100 % aujourd’hui. Cela permettrait au FNAP de dégager des marges de manœuvre budgétaire tout en incitant les aménageurs à s’impliquer sur des zones vierges de vestiges archéologiques. Par ailleurs, le passage d’une gestion en autorisations d’engagement à une gestion en crédits de paiement, afin de tenir compte du rythme des décaissements, concourra à engager le stock de dossiers en retard.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. L’activité de l’INRAP dépend des prescriptions de sa tutelle. Mais quelles sont les exigences d’efficience de l’Institut, notamment en matière de masse salariale, sachant que l’INRAP n’a toujours pas signé de contrat de performance avec l’État ?
M. Arnaud Roffignon. L’INRAP n’a en effet pas signé de contrat de performance. Mais nous suivons depuis 2002 un ratio d’efficience, mesurant le nombre de jours/homme à l’hectare diagnostiqué. Le ratio constaté en moyenne nationale varie de 6 à 8. Il s’est progressivement amélioré entre 2002 et 2007, mais avait tendance à augmenter depuis 2008 ; il était de 8 en 2010. Pour 2011, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, partagé avec l’État : ramener le ratio à 6,5. Au préalable, des analyses ont été faites afin de mieux comprendre les évolutions du ratio, qui dépendent notamment de la zone de recherche – urbaine ou rurale –, mais aussi de la surface moyenne des prescriptions, en hectares. Ainsi, l’augmentation du ratio en 2010 s’explique par la baisse de la surface moyenne prescrite par l’État.
L’INRAP avait un projet de contrat de performance en 2008, qui n’a pas abouti du fait de la dégradation de la situation financière de l’Institut et de divergences en termes de stratégie. Mais, la réforme prochaine de la RAP étant conditionnée à la signature d’un contrat, le conseil d’administration de l’INRAP a, le 28 avril dernier, validé le plan détaillé d’un projet de contrat qui devrait être approuvé lors de la séance du 12 juillet prochain.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Comment améliorer le taux de recouvrement de la RAP, qui est seulement de 90 % ? Quelles sont les exonérations sur lesquelles il serait possible de revenir, sachant qu’il n’est ni envisageable ni souhaitable de renoncer à celle applicable aux opérations de logement social ? S’agissant des pistes de réforme évoquées par l’IGF, lesquelles vous semblent les plus fructueuses ?
M. Arnaud Roffignon. Je tiens tout d’abord à rappeler que, contrairement à d’autres opérateurs, l’INRAP ne procède pas directement à la liquidation et au recouvrement de la taxe qui lui est affectée.
S’agissant des voies d’amélioration du taux de recouvrement de la RAP, la question pourrait être utilement posée à la direction générale des Finances publiques.
S’agissant de la liquidation, les deux filières de la RAP se trouvent dans des situations différentes. La filière des directions départementales des territoires (DDT), ex-DDE, ne pose pas de problème, les DDT étant bien placées dans le processus d’instruction des demandes pour liquider la redevance. En revanche, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ne sont pas un passage obligé dans le circuit ; si la liquidation est simple en cas de demande volontaire de diagnostic, elle est plus délicate dans les autres cas. L’inspection générale des Affaires culturelles et l’inspection générale de l’Administration conduisent une mission dont les conclusions, attendues fin juin, devraient permettre d’améliorer les procédures et de procéder au rattrapage des assujettis qui ne se sont pas acquittés de la redevance.
S’agissant des pistes évoquées par l’IGF, notre préférence va à l’adossement de la RAP sur la taxe d’aménagement. L’application d’un taux de 0,5 à 0,7 % devrait permettre de générer 84 à 100 millions d’euros de recettes, auxquels il faut ajouter 35 à 40 millions au titre de la filière DRAC, soit un total de 120 à 140 millions d'euros pour un besoin estimé à 135 millions hors frais de gestion. Je rappelle qu’à l’heure actuelle, les financements publics dédiés à l’archéologie préventive (RAP et subventions) s’élèvent à 102 millions d'euros (FNAP, INRAP, services agréés de collectivités locales).
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Pourriez-vous revenir sur le désaccord stratégique que vous évoquiez précédemment, et qui a empêché la signature du contrat de performance en 2008 ?
M. Arnaud Roffignon. Il s’agissait d’un différend sur l’implantation des directions interrégionales de l’INRAP, qui souhaitait alors proposer un découpage différent de celui des commissions interrégionales de la recherche archéologique. L’INRAP a aujourd’hui abandonné ce projet, non prioritaire. Il n’existe plus de différend stratégique entre l’INRAP et ses tutelles.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Quelle est selon vous l’allocation optimale des ressources humaines, d’un point de vue géographique ? En effet, il est parfois dit que le volume des recherches est fonction des effectifs locaux de l’INRAP. Comment répondez-vous à cette critique ?
M. Arnaud Roffignon. Il faudrait regarder avec précision le cas particulier que vous avez en tête. Les services de l’État connaissent en général la situation des ressources de l’INRAP en cas de prescription. Les réactions sont alors différentes, et il a pu arriver que des services régionaux de l’archéologie aient étudié les moyens de l’INRAP avant de former leur prescription. Je n’ai pas d’autre commentaire sur ce sujet.
M. Olivier Carré, Président. Comment vous assurez-vous de l’étanchéité du budget de diagnostic et du budget de fouilles et comment vous assurez-vous d’être dans l’épure des règles relatives aux appels d’offres ? On constate depuis cinq ans une évolution sensible des réponses en termes de prix en raison de l’arrivée de nouveaux acteurs. Comme dans tout marché, il faut respecter une règle de séparation stricte entre prescripteurs et prestataires afin d’éviter que l’un des opérateurs ne bénéficie d’avantages indus au détriment des autres.
M. Arnaud Roffignon. L’INRAP a radicalement changé de métier depuis 2003, même si nous sommes encore dans une situation intermédiaire, puisque sa mue n’est pas encore achevée. Nous sommes passés d’une situation de monopole à une situation dans laquelle l’Institut doit répondre à des appels d’offres. Pour cela, l’établissement s’est professionnalisé. Dans le cadre de notre plan « reconquête aménageurs », nous avons entrepris des actions afin d’améliorer la qualité de la réponse pour augmenter nos chances d’être retenus. Face à la complexité des situations, nous avons amélioré nos explications pour que le client puisse juger de la qualité scientifique de nos propositions. Les aménageurs et nous-mêmes avons fait des efforts pour nous professionnaliser. Toutefois, on constate encore que les aménageurs ne laissent pas un délai suffisant aux opérateurs pour répondre ou ne pondèrent pas correctement les critères de prix et de qualité.
Un groupe d’experts marché va être créé prochainement sous l’égide de la direction des Affaires juridiques (DAJ) afin de formuler des recommandations et d’homogénéiser ainsi les comportements pour parvenir à une normalisation des pratiques des aménageurs.
M. Olivier Carré, Président. Dans un champ concurrentiel, on peut ainsi espérer un ajustement des prix afin de parvenir à la formation d’un juste prix pour une juste prestation. Ce prix est ainsi plus juste que celui issu d’une nomenclature.
M. Arnaud Roffignon. La rencontre entre l’offre et la demande n’a effectivement pas fait baisser les prix car la prestation est issue majoritairement de moyens humains, dont le coût, qui fait l’objet d’évolutions et d’indexations, s’est élevé entre 2004 et 2011. On essaie tout de même de jouer sur d’autres paramètres et d’adapter au mieux notre offre à la prescription. Pour cela, nous nous sommes dotés d’une capacité d’analyse des marchés qui ont été perdus. On en étudie précisément les raisons. On constate parfois que certains concurrents sacrifient la qualité scientifique ou qu’à l’inverse nous avons fait de la « sur-qualité » par rapport aux prescriptions de l’État. Il nous appartient d’adapter notre offre à ces prescriptions. Il y a également d’autres aspects qui ne sont pas scientifiques, comme la prévention ou l’hygiène et la sécurité. Il existe des comportements très différents en fonction des opérateurs. Par exemple, lors d’interventions sur des sites pollués, l’importance accordée à la santé des agents varie en fonction des opérateurs.
La stratégie de l’établissement se résume en deux points. Il s’agit, premièrement, d’optimiser les coûts. Nous avons mis en place une politique d’achats : 20 % de nos dépenses étaient couvertes par des marchés nationaux en 2009 ; elles l’étaient à 50 % en 2010. Deuxièmement, nous essayons d’expliquer aux aménageurs en quoi consiste une intervention archéologique, c'est-à-dire que nous expliquons ce qu’on leur vend, ce que comprend le prix, notamment l’intervention scientifique, les moyens de terrassement, la valorisation, la communication, la sécurité, l’environnement, etc.
Confronté à la concurrence, l’établissement doit repenser ses interventions et ne plus additionner des jours/homme. Il s’est doté d’un cadre de négociation à l’instar de ce qui se pratique chez les opérateurs privés, puisque l’aménageur se considère comme un client et souhaite discuter du prix. Il y a bien sûr un prix national du jour/homme, mais une ristourne est possible en fonction de la nature de l’intervention. Les directeurs interrégionaux ont maintenant la capacité de négocier et d’accorder d’éventuelles ristournes, fondées sur des éléments tangibles. Le ministère du Budget, l’un de nos ministères de tutelle, suit cela de près. Il s’agit de trouver une voie médiane entre une négociation responsable – la ristourne ne doit pas aboutir à une perte – et la nécessaire souplesse à avoir vis-à-vis de l’aménageur.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Sur quels aspects porte la concurrence ? Pour que le dispositif fonctionne, il convient de s’assurer que le rapport de fouilles et que le travail intellectuel font l’objet d’une surveillance attentive, au risque que l’esprit public ne disparaisse. On ne doit pas être obnubilé par le prix. Les fouilles étant réalisées par des personnes, la concurrence sur les prix est en fait une concurrence sur les salaires. Payez-vous trop vos personnels ? La concurrence provoque certes une réflexion utile sur votre fonctionnement, mais y a-t-il suffisamment d’éléments de sécurisation dans le dispositif actuel pour éviter tout dérapage ?
Ma deuxième question concerne vos ressources propres. Comment comptez-vous les développer sur ce marché concurrentiel ?
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Comment ces ressources propres ont-elles évolué sur les trois ou quatre dernières années ? Quelles sont les marges de manœuvre dont vous disposez en la matière ?
M. Arnaud Roffignon. S’agissant de la qualité d’intervention scientifique des opérateurs et des moyens dont l’État se dote pour la vérifier, ce dernier serait plus à même de répondre à la question. En tant que simple opérateur, je rappellerai les dispositifs existants. Tout d’abord, l’agrément. Il fonde la qualité de l’opérateur. Il est donné pour une période de cinq ans, renouvelable. La fréquence du renouvellement est-elle adaptée pour suivre l’activité de l’opérateur ? Cet agrément est donné sur des critères scientifiques. D’autres critères pourraient être considérés, comme l’hygiène et la sécurité ou les volumes d’équipes permanentes constituées pour répondre. Des réflexions pourraient donc être menées autour de cette question.
Ensuite, il y a le contrôle. Celui-ci est quotidien au travers du contrôle scientifique et technique de l’État, c'est-à-dire des DRAC et des services régionaux de l’archéologie en leur sein. Ils délivrent d’abord l’autorisation de fouilles. Le projet scientifique et technique d’intervention doit être à la hauteur de la prescription. La commission interrégionale de recherche archéologique intervient également pour juger de la qualité scientifique. Sur le terrain, le contrôle se poursuit, les opérateurs peuvent recevoir la visite inopinée ou programmée des services régionaux de l’archéologie. Le dernier contrôle concerne l’évaluation de la qualité du rapport.
Mis à part l’agrément, j’estime que le dispositif existant pour le contrôle scientifique et technique est relativement satisfaisant. Il faudrait toutefois examiner les modalités de mise en œuvre du contrôle et donc savoir si des services régionaux de l’archéologie disposent des effectifs nécessaires pour sa réalisation. Je n’ai pas la réponse, mais je pose le problème.
Sur la question de la qualité scientifique, en tant qu’opérateur et observateur, nous avons constaté, comme je l’ai dit précédemment, que nous perdions des marchés en raison de la sur ou de la sous qualité proposée. Comment obtenir une régulation du système qui prenne en compte cette situation ? Je n’ai pas de réponse à la question. Mais le risque est que la concurrence ne se fasse plus que sur les prix. Dans ce cas, le fondement même de l’intervention archéologique perdrait tout son sens.
Notre taux de ressources propres est compris entre 54 % et 60 %. Ce taux a eu tendance à s’élever ces dernières années, en raison de la stagnation des diagnostics et du renforcement de notre capacité à répondre aux appels d’offre pour les fouilles. Nous étions à 53,6 % en 2009, 54 % en 2010 et nous serons probablement à 59,5 % en 2011. Ces ressources proviennent pour la quasi-totalité de la facturation des fouilles aux aménageurs. On ne prend évidemment pas en compte la redevance d’archéologie préventive parmi les ressources propres.
Lorsque je suis arrivé en janvier 2010, il m’est apparu qu’il existait certainement des marges de manœuvre pour développer les ressources propres, notamment en matière de valorisation culturelle. Par exemple, il n’y avait pas de stratégie de mécénat. L’établissement s’en est depuis doté, elle a été présentée à son conseil d’administration le 7 décembre dernier.
Il convient de développer cette démarche, même si ces ressources resteront limitées. Auparavant, l’établissement se concentrait sur l’effet de levier vis-à-vis des partenaires extérieurs. En mettant 10, l’établissement suscite parfois 100, mais l’argent ne transite pas par nos comptes. Cette stratégie reste bonne, nous la poursuivons et la consolidons.
Un volume financier qui correspond à 2,9 % du total du budget de l’établissement (168 millions d’euros) est consacré à la politique de valorisation (1,8 million d’euros de crédits et 3 650 jours-hommes valorisés) : c’est peu. Nous cherchons à développer les ressources propres pour développer des projets, notamment des ressources pédagogiques pour les enseignants et les jeunes dans leur ensemble. Nous avons, par exemple, un site Internet, apprécié par ceux qui le consultent et qui connaît une croissance forte des connexions, lesquelles devraient atteindre le million en 2011 contre 850 000 en 2010. Il n’y a cependant pas d’espace pédagogique sur le site, ni d’espace dédié aux aménageurs. Ce sont des dépenses que nous souhaitons réaliser, mais elles restent subordonnées à l’obtention de mécénats.
Cette stratégie de mécénat commence à porter ses fruits. La deuxième édition des journées de l’archéologie aura lieu les 21 et 22 mai prochains. Avec le même budget qu’en 2010, nous avons conquis deux mécènes, qui ont une volonté de collaboration à long terme, et qui seront nos partenaires pour ces journées. Il s’agit de la Fondation Diversiterre d’EDF et de Bouygues Constructions. Cette stratégie de mécénat se heurte toutefois à une difficulté : contrairement aux établissements publics culturels qui développent des stratégies ambitieuses en la matière, l’INRAP ne dispose pas de lieux identifiés à titre de contrepartie en termes de mise à disposition. Pour surmonter ce handicap, nous souhaitons collaborer avec d’autres institutions culturelles qui disposent de tels lieux et les mettent à notre disposition à travers des coopérations croisées, ce qui permettrait de donner des contreparties à nos mécènes.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Je souhaiterais avoir une petite précision sur la gestion des ressources humaines. Dans votre dernier bilan d’activité, il est indiqué que plus de 2 100 jours/homme sont consacrés à des colloques sur le territoire national, sur les 17 000 jours/hommes consacrés à la recherche. Pouvez-vous commenter ces chiffres ?
M. Arnaud Roffignon. 17 000 jours/homme, soit seulement 6 % de la capacité opérationnelle totale de l’établissement, sont les moyens consacrés à l’exploitation des résultats. Ce n’est pas satisfaisant, compte tenu de l’effort de la collectivité nationale pour l’archéologie préventive. Par ailleurs, le CNRS et l’Université ne sont pas en capacité d’absorber tout ce que l’archéologie préventive produit. L’INRAP a été créé pour cela et doit pouvoir compléter ce travail.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. À quoi servent donc ces fouilles si les ressources mises au jour ne peuvent être valorisées ?
M. Arnaud Roffignon. Il faut réduire l’écart entre la masse d’information produite et son exploitation. C’est l’un des enjeux de la politique nationale d’archéologie que mène l’État.
S’agissant des colloques, en faisant le tour de la France avec le Président, nous ne rencontrons que des gens qui nous disent que nous n’en faisons pas assez.
Une précision : ces 17 000 jours sont affectés uniquement sur projet. Nous avons entre 28 000 et 35 000 jours/homme sollicités pour des projets. Le taux de sélection est fort, voire trop fort selon nous.
Pour répondre à votre question, nous privilégions les colloques où nous communiquons et non ceux auxquels nous nous contenterions d’assister. Il s’agit de pure production scientifique.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Il y a une grande différence entre les volumes de recherches qui sont menées et la valorisation que vous pouvez en faire. On est loin des objectifs. Il faut soit revoir les objectifs, soit diminuer les fouilles.
M. Arnaud Roffignon. Nous regrettons cette situation et nous souhaiterions que les moyens soient mobilisés pour mieux exploiter les résultats scientifiques obtenus.
M. Olivier Carré, Président. Nous constatons que vous avez de l’ambition dans votre démarche, mais également que vous avez un nœud avec l’arrivée de la concurrence sur des activités qui représentent un peu moins des deux tiers de vos ressources, c'est-à-dire les fouilles et autres prestations. Vous avez par ailleurs des éléments de charges, comme le personnel, qui continuent à augmenter alors que votre activité devrait ralentir avec l’arrivée de la concurrence. Vous êtes également confrontés à des coûts induits importants compte tenu de l’aménagement du temps et des externalités. Une réflexion devra être menée avant d’envisager de changer votre mode de recettes, pour qu’elles soient plus dynamiques.
La notion de critère de performance est essentielle. Il faut la rétropoler et non pas uniquement l’extrapoler. Malgré des changements importants des taux de la redevance, les recettes afférentes ne sont pas arrivées, ce qui a ralenti votre développement. Tout cela devra interpeller le législateur lorsqu’il reverra votre mode de financement.
Je vous remercie.
Audition du 19 mai 2011
À 9 heures : Audition commune, ouverte à la presse, de représentants du ministère de la Culture et de la communication : Mme Laurence Franceschini, directrice générale des Médias et des industries culturelles, M. Georges-François Hirsch, directeur général de la Création artistique, M. Philippe Bélaval, directeur général des Patrimoines, M. David Zivie, sous-directeur des affaires financières au secrétariat général du ministère, M. Marc Drouet, sous-directeur de l’archéologie à la direction générale des Patrimoines, et Mme Isabelle Maréchal, chef du service du patrimoine à la direction générale des Patrimoines
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Mesdames, messieurs, la MEC souhaiterait savoir comment les ressources affectées sont utilisées par les établissements publics qui en bénéficient et dont vous représentez ici la tutelle, de quel contrôle budgétaire elles font l’objet, et selon quelles modalités elles permettent de financer les politiques culturelles définies par le Gouvernement.
Selon l’usage de la mission, nous serons aidés dans notre tâche par la Cour des comptes, représentée par M. Emmanuel Marcovitch, conseiller référendaire.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Quels sont, du point de vue de la tutelle, les avantages et les inconvénients du financement par ressources affectées ? Le recours à ce type de financement est-il toujours motivé par un intérêt public réel ? Comment contrôle-t-on l’usage de ressources fiscales directement affectées aux opérateurs ?
M. Olivier Carré, Président. Quel est l’intérêt de débudgétiser les ressources de ces « bras séculiers » de l’État que sont le Centre national du livre (CNL), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), ou encore le Centre des monuments nationaux (CMN) ? Quels sont vos rapports avec ces institutions ?
M. Philippe Bélaval, directeur général des Patrimoines au ministère de la Culture et de la communication. Le mode de financement de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, se justifie par la nature même du patrimoine archéologique. Ce patrimoine est un capital dissimulé, et l’objectif d’une politique archéologique bien pensée est de préserver ce capital de vestiges que leur enfouissement même protège de la destruction. Or les travaux d’exploration menés dans une perspective de construction ou d’aménagement urbain sont susceptibles de porter atteinte à ce capital. Il n’est donc pas absurde de taxer celui qui porte atteinte à ce patrimoine, pour financer sa préservation sur le modèle du principe « pollueur-payeur ». Ce principe est d’ailleurs posé par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte. La redevance d’archéologie préventive (RAP), versée par les aménageurs, est la traduction du lien entre la commission d’un dommage et sa réparation.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Cette taxe a en effet une vocation dissuasive, ce qui surprend beaucoup de nos collègues.
M. Olivier Carré, Président. En outre, l’INRAP assume une double mission, de diagnostic et de fouilles. Cependant, cette dernière activité est appelée à décroître puisque l’INRAP intervient dans un secteur désormais concurrentiel ; cette évolution devrait se refléter dans la structure de ses coûts. N’y a-t-il pas une tentation pour ce type d’opérateurs externalisés d’excéder leur mission initiale afin de préserver leurs ressources, déclenchant ainsi une mécanique inflationniste ?
M. Philippe Bélaval. Cette dualité de l’activité de l’INRAP a, au contraire, le mérite de permettre une « riposte graduée » : une fois que la nécessité de fouiller est avérée, le diagnostic permet de déterminer l’ampleur des moyens à mettre en œuvre. C’est pourquoi le législateur a distingué ces deux étapes : celle du diagnostic, qui est une mission de service public, et celle de la fouille, ouverte à la concurrence. Cette ouverture peut être un avantage en termes de raccourcissement des délais et de réduction des coûts. L’ensemble du système est régulé par l’État, à travers la direction générale des Patrimoines et les services régionaux de l’archéologie, qui exercent un contrôle permanent de la prescription, notamment sur le plan scientifique, afin d’éviter toute dérive des coûts.
M. Olivier Carré, Président. Je veux simplement dire que la tutelle doit veiller à ce que l’opérateur sache se réorganiser pour s’adapter à l’évolution du contexte global tout en restant dans les limites de sa mission.
M. Philippe Bélaval. Le fait que l’INRAP, depuis la réforme de 2003, intervienne à la fois dans un secteur réglementé et dans un secteur concurrentiel peut en effet entraîner des tensions internes, notamment en termes de financement. Il n’en reste pas moins qu’avoir permis à l’INRAP d’intervenir dans le secteur de la fouille était une sage décision, car c’est précisément ce qui fonde la qualité et l’autorité de son expertise : cantonné au diagnostic, l’Institut se serait considérablement appauvri sur le plan scientifique, la fouille constituant le cœur du métier archéologique.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Des trois scénarios de réforme du financement de l’archéologie préventive proposés par l’inspection générale des finances, lequel vous apparaît le plus intéressant ? Confirmez-vous qu’une première réforme pourrait être mise en œuvre par voie réglementaire dès juillet 2011 ?
M. Philippe Bélaval. Ces scénarios sont actuellement l’objet d’arbitrages interministériels, dans la perspective d’une inclusion de ces dispositions dans le projet de loi de finances pour 2012. Sans vouloir préjuger du choix du Gouvernement, je peux simplement dire que le ministère est favorable à l’adossement du financement de l’Institut à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, pour des raisons de dynamisme de la ressource et de simplification de la gestion. Par ailleurs, et sous réserve que le Premier ministre le confirme, une réforme réglementaire devrait intervenir dans les prochaines semaines, permettant l’introduction d’un ticket modérateur à la charge des aménageurs.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Comment expliquez-vous que les effectifs de l’INRAP connaissent une augmentation significative depuis 2003 – près de 45 % –, en dépit de la stabilisation des prescriptions décidées par l’État ? Comment l’État évalue-t-il la qualité de la prestation scientifique fournie par les concurrents de l’INRAP ?
M. Philippe Bélaval. L’ouverture à la concurrence a été une bonne chose dans la mesure où elle a permis de remédier au problème des délais, dont la longueur était à l’origine des critiques les plus virulentes contre notre système d’archéologie préventive. Ces délais traduisent l’intensité des besoins dans le domaine du diagnostic en raison du dynamisme de l’aménagement urbain, dont on ne peut que se féliciter pour notre pays. Reste que l’INRAP a dû aussi renforcer ses effectifs pour éviter que ces grands projets ne s’enlisent dans des délais insupportables pour les élus et pour les aménageurs.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Voulez-vous dire que ce n’est pas tant la concurrence qui a permis de réduire les délais, mais que celle-ci a servi de prétexte pour ne pas donner de moyens supplémentaires à l’Institut ?
M. Philippe Bélaval. Les pouvoirs publics ont au contraire manifesté leur volonté de donner à l’Institut les moyens de fonctionner en le dotant d’un nombre d’équivalents-temps plein accru et d’un un outil juridique ad hoc avec le contrat d’activité. L’État a, en outre, pris régulièrement des mesures pour mettre fin à la crise de trésorerie que l’Institut traverse depuis plusieurs années. Cette augmentation des moyens de l’INRAP et l’intervention d’opérateurs privés ont permis de réduire les délais.
M. Olivier Carré, Président. En effet, une augmentation substantielle de la RAP a été votée dans le cadre du plan de relance de l’économie. De plus, si chaque projet d’aménagement intensifie les besoins de diagnostic, il est aussi la source de moyens nouveaux pour cette partie de l’activité de l’INRAP, et celle-ci ne devrait pas souffrir d’un problème de coût. En tout état de cause, nous devons veiller à maintenir le cloisonnement entre les deux missions de l’INRAP, et à ne pas subventionner la partie de son activité ouverte à la concurrence, sous peine d’encourir les foudres de l’Europe.
M. Philippe Bélaval. Cette distinction entre les deux missions de l’INRAP est garantie par deux comptabilités distinctes. Nous proposons en outre que le surplus de recettes qui pourrait être dégagé soit géré par un organisme tiers, pour éviter que des soupçons puissent naître quant à la manière dont l’INRAP gère ses ressources.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Comment expliquez-vous que la signature du contrat de performance de l’INRAP ait pris tant de temps ? La tutelle n’aurait-elle pas dû trancher les problèmes et dépasser les blocages plus rapidement ? Pensez-vous qu’on valorise suffisamment les découvertes de l’archéologie préventive ? Les autres acteurs de la recherche, tels que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et les universités, sont-ils suffisamment associés à l’INRAP ?
M. Philippe Bélaval. J’attribue le retard que vous signalez aux difficultés successives rencontrées par le système d’archéologie préventive, notamment sur le plan financier et social, et que nous évoquons depuis le début de cette audition. Ces crises n’ont pas permis à l’INRAP de connaître une période de stabilité assez longue pour normaliser son fonctionnement. La conclusion du contrat de performance devrait, dans les semaines qui viennent, permettre à l’Institut de rompre avec cette période d’incertitude.
En matière de valorisation des découvertes, on peut toujours progresser. L’Institut a déjà noué de très nombreux partenariats dans le monde de la recherche. Il faudrait mieux promouvoir auprès du grand public des découvertes telles que celle, l’année dernière, d’un temple de Mithra à Angers. Quoi qu’il en soit, monsieur le député, votre question confirme l’intérêt pour l’institut de continuer ses activités de fouille, la valorisation ne pouvant pas intervenir avant cette étape.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Je souhaiterais maintenant aborder les questions relatives au CNC. Le CNC n’a-t-il pas trop d’argent ? Les taxes affectées au Centre sont-elles adaptées à la nouvelle donne économique et technologique à l’œuvre dans le secteur de l’audiovisuel – délinéarisation des contenus, piratage, etc. – ? La mission conjointe de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) a-t-elle déjà rendu des conclusions provisoires ? Ne faudrait-il pas augmenter la proportion des aides sélectives au détriment des aides automatiques, qui représentent plus de la moitié des soutiens versés par le CNC ?
M. Olivier Carré, Président. Sans parler d’une masse salariale qui n’est pas négligeable.
Mme Laurence Franceschini, directrice générale des Médias et des industries culturelles au ministère de la Culture et de la communication. Sur la question des emplois, je laisserai la parole au représentant du secrétariat général du ministère.
La gestion par le CNC de ressources affectées, provenant essentiellement à l’origine de la taxation de la vente de billets de cinéma, est un mécanisme déjà ancien et qui a prouvé son efficacité, et l’attachement des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel au CNC est dû en grande partie au fait que le Centre finance ainsi les subventions à ce secteur. Il faut noter aussi que l’ordonnance du 24 juillet 2009 a doté le CNC d’une nouvelle gouvernance, qui fait de cet établissement un cas à part parmi les établissements qui gèrent des ressources affectées. Le CNC se distingue notamment par la diversité de ses missions, puisque, outre l’allocation de la ressource, il possède un pouvoir réglementaire et un pouvoir de sanction. Cela lui donne une très grande force.
L’augmentation de ses ressources, observée depuis 2005, est due à l’élargissement en 2004 de l’assiette de la taxe aux services de télévision, assiette encore étendue en 2007 à la distribution de services, notamment à la fourniture d’accès à Internet. Cette réactivité de la taxe et son adaptation à l’évolution du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique ont dynamisé ses ressources à un point tel que le CNC dispose désormais d’une masse financière extrêmement importante au regard de ses missions. Le risque de voir dans un tel cas l’opérateur excéder les limites de ses missions a motivé le débat parlementaire et la mission conjointe IGF-IGAC, qui devrait rendre ses conclusions à la fin du mois. Celles-ci, notamment en ce qui concerne le degré d’adéquation de la ressource aux missions du CNC, devraient permettre d’établir avec lui, en concertation avec les professionnels du secteur, un contrat de performance ou un contrat d’objectifs et de moyens.
Il est un peu délicat de dire que le CNC a trop d’argent, alors que chacun reconnaît l’efficacité de cet outil et sa pertinence pour assurer de nouvelles missions. Je pense notamment à la nécessaire adaptation des soutiens à la production audiovisuelle à la croissance des services et des programmes en ligne – c’est l’objectif d’un chantier tel que le « web cosip ». C’est une nécessité d’autant plus urgente que notre pays est beaucoup moins performant dans le domaine de la production audiovisuelle que dans le cinéma, en dépit de l’efficacité de nos dispositifs de soutien. Il y a probablement une réflexion à mener à ce propos en concertation avec le CNC.
Par ailleurs, la simple multiplication des chaînes de télévision suscite un besoin accru en matière de production audiovisuelle. Enfin, le plan de numérisation du patrimoine culturel mobilisera également les ressources du CNC.
Dans ce contexte, on mesure mieux l’importance de la mission conjointe des deux inspections. Elle devra ainsi apprécier si la manne dont profite actuellement le CNC a un caractère durable ou si elle est appelée à décroître dans les années à venir.
La question de la répartition du soutien entre aides automatiques et aides sélectives doit faire l’objet d’un dialogue constant entre le CNC et sa tutelle, de tels choix déterminant structurellement la politique que l’on souhaite mener dans le domaine de la production audiovisuelle et cinématographique. Je reconnais que les aides sélectives sont plus séduisantes a priori : elles permettent de choisir les projets qu’on souhaite soutenir, de favoriser la qualité et de donner leur chance à de nouveaux producteurs. En revanche, le soutien automatique, par son aspect mécanique, est, aux yeux de certains, intrinsèquement inflationniste. Il faut cependant prendre garde au fait que les soutiens doivent également favoriser une logique industrielle. Or l’automaticité des aides, par la continuité et la stabilité qu’elle leur offre, permet aux sociétés de production, voire à certains auteurs et créateurs, de s’inscrire dans la durée. La répartition de ces deux catégories de subventions doit pouvoir être révisée annuellement en fonction des résultats de l’année précédente et de la politique poursuivie.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Mes questions porteront sur le CNV. Aujourd’hui, le produit de la taxe sur les spectacles est partagé entre le CNV et l’Association pour le soutien au théâtre privé (ASTP). Une centralisation des missions et des financements publics ne serait-elle pas préférable afin d’éviter tout risque de dispersion et de renforcer le rendement de ces aides ?
Par ailleurs, si les grands spectacles se maintiennent, il semble que les manifestations de moindre ampleur ressentent plus durement les effets de la conjoncture, la crise économique et financière ayant fragilisé les petites et moyennes entreprises de spectacle. Redoutez-vous cette situation ? Dans l’affirmative, comment comptez-vous y faire face ?
M. Georges-François Hirsch, directeur général de la Création artistique au ministère de la Culture et de la communication. Le financement du spectacle vivant par le ministère obéit au modèle des deux sphères évoqué par M. Bélaval : un secteur d’économie de transfert rassemblant toutes les politiques publiques de l’État et des collectivités territoriales, et un secteur concurrentiel, relevant du soutien du CNV. En effet, la tâche du Centre, que celui-ci remplit parfaitement, est de soutenir les producteurs de musiques actuelles.
Le fonctionnement actuel du CNV n’appelle pas de remarque particulière : il donne toute satisfaction, comme le prouvent l’augmentation constante des recettes qu’il perçoit, ainsi que l’affiliation toute récente de la chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques.
Je m’inquiète davantage de l’évolution du modèle économique de ce secteur, marquée par une concentration croissante des moyens de production et de diffusion des manifestations relevant du CNV. La crise et l’explosion de l’économie numérique avaient déjà entraîné une mutation considérable des schémas économiques au détriment des majors, le spectacle vivant s’est aujourd’hui révélé plus porteur que le disque.
La réorganisation de l’économie du secteur profite à quelques grands groupes
– deux, trois, quatre au maximum – qui sont en train de racheter des sociétés de production indépendantes. Ces groupes acquièrent également des lieux de diffusion, comme des salles de spectacles de type Zénith et, plus récemment, financent des projets Arena, dont la capacité d’accueil est double de celle des Zénith sans en avoir les équipements techniques adaptés au spectacle vivant.
Une telle concentration risque d’être fortement dommageable pour le monde du spectacle vivant. Or les producteurs français, enfermés dans une vision franco-française du secteur, ne semblent pas avoir encore pris toute la mesure de cette évolution. Ils souhaitent le statu quo, sans se rendre compte que ce modèle économique est frappé d’obsolescence dans un monde globalisé où les moyens se concentrent dans un très petit nombre de mains. Nous risquons d’aller vers un système dérégulé, où les producteurs indépendants ne survivront pas. On ne peut plus se contenter aujourd’hui d’être un simple producteur de spectacle vivant, sans décliner toutes les autres formes de production.
La perception de ressources affectées par le CNV est un bon levier pour orienter la politique culturelle. Si l’on devait envisager le rapprochement du CNV et de l’ASTP, il est clair qu’il faudrait à terme réorganiser la perception de la taxe, voire l’économie du secteur, sans que les répartitions CNV / ASTP s’en trouvent modifiées. Aujourd’hui, la direction générale de la création artistique a souhaité une réflexion sur les moyens de trouver des recettes extrabudgétaires pérennes pour le spectacle vivant. À cette fin, une mission sera chargée d’étudier toutes les solutions en la matière. Ces ressources devront venir en complément, et non se substituer aux moyens budgétaires existants.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quel sera l’impact de la transposition d’une directive communautaire relative à l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacle sur l’activité du Centre ?
M. Georges-François Hirsch. Il est à craindre que cette transposition n’induise un système à deux vitesses. Actuellement, tout producteur doit disposer d’une licence d’entrepreneur de spectacles ; demain, cette obligation n’existera plus pour les ressortissants de l’Union européenne, qui ne seront tenus qu’à une déclaration préalable. De plus, la licence étant la base de la détermination du périmètre d’intervention du CNV, sa suppression pourrait bouleverser l’économie du Centre. À cela s’ajoutent des risques accrus d’évasion fiscale. Il est donc plus que temps de réfléchir à une évolution du CNV et des modalités de perception de la taxe.
M. Olivier Carré, Président. Un tel système existe-t-il dans d’autres pays européens ?
M. Georges-François Hirsch. Si le système de la ressource affectée existe ailleurs, la perception de la taxe à travers les titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles est propre à la France.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Ne risque-t-on pas de voir des sociétés de production s’installer dans des pays où n’existe pas de taxe sur le spectacle vivant ?
M. Georges-François Hirsch. Bien sûr, ce risque existe, mais la menace la plus grave réside, je le répète, dans la formidable mutation du modèle économique du secteur, qui risque d’être laminé s’il ne parvient pas à anticiper et à créer d’autres modèles. Depuis plusieurs mois que nous avons engagé des discussions avec les professionnels du spectacle vivant. Nous n’avons pas encore trouvé de réponse convaincante à ce problème.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Les modalités de perception des ressources affectées diffèrent selon les établissements, certains disposant de leur propre service de perception quand d’autres recourent à l’administration fiscale. Cette différence dans les modalités de perception est-elle justifiée ? Pensez-vous qu’un système soit plus pertinent que l’autre ?
Deuxièmement, avez-vous défini des modalités d’intervention commune à ces différents organismes, ou chacun définit-il ses modes d’action ?
Troisièmement, monsieur Hirsch, les aides publiques au spectacle vivant peuvent également être directement distribuées par le ministère et les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Avez-vous pu comparer l’efficience de ces deux modalités de subvention ?
M. Olivier Carré, Président. Le rapatriement de l’ensemble des subventions au sein de l’administration d’État est-il au nombre des hypothèses d’évolution que vous envisagez ?
M. Georges-François Hirsch. Le système de perception du CNV est un bon système. Le nombre des missions assumées par le CNV étant appelé à s’accroître, on pourrait même envisager un élargissement du périmètre de la taxe, par exemple aux spectacles de variétés dans les parcs d’attraction. Pour cette raison, on doit envisager une évolution à la hausse des effectifs du CNV – le Centre emploie aujourd’hui 26 équivalents-temps plein, ce qui ne sera plus suffisant à terme.
Il est difficile d’envisager d’unifier les modalités d’action d’établissements qui interviennent dans des secteurs aussi différents, organisés selon des schémas et une démarche qui leur sont propres.
L’économie du spectacle vivant relève de deux sphères très différentes.
L’une, entièrement financée par les deniers publics, État ou collectivités territoriales, est une sorte d’économie de transfert aux institutions. Je souhaite dans ce domaine un dialogue fructueux entre l’État, les collectivités et les professionnels afin que nous nous mettions d’accord sur des politiques publiques communes dans le cadre de conventions sur trois ans. C’est dans cette perspective que nous dialoguons avec chacune des régions.
Il est difficile de comparer l’efficience des aides directes à celle des aides distribuées par le CNV, dans la mesure où elles interviennent dans deux domaines très différents : l’un principalement financé sur deniers publics, et l’autre relevant du secteur concurrentiel. Il faut que l’État et les collectivités territoriales parviennent à harmoniser leurs actions dans la sphère où ils interviennent. Il nous faut dialoguer en amont avec les collectivités pour définir, voire contractualiser, une politique commune sur trois ans. Nous avons déjà engagé ce dialogue, qui s’est révélé jusqu’à présent plutôt fructueux. Les choses sont fort différentes dans le secteur concurrentiel, où il n’est pas question de changer les règles du jeu.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Envisagez-vous de transformer le CNV en un centre national du spectacle vivant, au champ de compétence plus large ?
M. Georges-François Hirsch. Je vois, monsieur le député, que vous avez d’excellentes lectures ! Je suis heureux que vous me donniez l’occasion d’exprimer ma pensée, sans anticiper les conclusions de la mission. Il est hors de question de charger une agence totalement indépendante du ministère de la Culture de financer toutes les activités du spectacle vivant : ce serait à mes yeux le début du démantèlement du ministère. Un tel organisme aurait pour fonction, à travers diverses missions, d’être le cadre permanent d’un dialogue régulier, fructueux et constructif entre l’État, les collectivités territoriales et les professionnels.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Abordons si vous le permettez le cas du Centre des monuments nationaux (CMN). En application de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, celui-ci se voit affecter 15 % du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne, dans la limite de 10 millions d’euros par an. La création d’un tel système de financement « dérivé » se justifiait-elle alors que le CMN a vu sa dotation budgétaire diminuée de 9,5 millions d’euros dans le cadre de la loi de finances pour 2011 ?
M. Philippe Bélaval. Ce prélèvement me semble le dernier avatar, au sens brahmanique du terme, de la fascination française pour le modèle britannique. On peut l’analyser comme un simple jeu d’écriture dans le budget de 2011, puisqu’il se substitue à la dotation initiale. Je dirai, sans vouloir manquer à la solidarité gouvernementale, que le ministère de la Culture n’était pas demandeur de ce prélèvement. Mais il est trop tôt pour porter un jugement sur ce dispositif. Je ne sais pas s’il s’agit d’une facilité imposée par la nécessité de boucler le budget ou d’un système appelé à durer.
Grâce à une gestion particulièrement rigoureuse, le CMN s’est constitué un « trésor de guerre », qui n’a rien d’excessif quand on voit l’ampleur des opérations de restauration auxquelles il devra faire face. Les 80 millions d’euros qui constituent son fonds de roulement sont à comparer au coût estimé de la campagne de travaux de restauration du Panthéon, à savoir une centaine de millions d’euros. Sachant que le CMN gère quatre-vingt-seize monuments, on voit qu’il est loin d’être surdoté.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Un fonds de roulement de 60 millions d’euros pour 2009 et de 80 millions d’euros à l’heure actuelle, cela fait quand même beaucoup ! Votre argumentation n’est-elle pas justifiée par une affectation a posteriori de fonds excédentaires ?
Par ailleurs, que pensez-vous de la dévolution aux collectivités territoriales de monuments historiques appartenant à l’État ? Présente-t-elle un risque ou une opportunité pour le CMN ?
M. Philippe Bélaval. Vous savez que le Sénat a voté une proposition de loi instituant un nouveau mécanisme de transfert des monuments historiques aux collectivités territoriales – et aux collectivités territoriales seulement –, que l’Assemblée nationale devrait examiner avant la fin de l’année. Le Sénat a pris soin d’encadrer ce processus, notamment en posant le principe de péréquation de la gestion du CMN, qui garantit l’équilibre de ses comptes. Cela signifie qu’on ne pourra pas retirer au CMN la gestion des six monuments qui lui permettent d’assumer le coût des quatre-vingts autres. En ce qui concerne le seul Panthéon, le Centre a programmé pour 2012 une première tranche de travaux de 23 millions d’euros. Pour débloquer une telle somme d’un coup, il faut bien disposer de réserves.
Mme Isabelle Maréchal, chef du service du patrimoine à la direction générale des Patrimoines. Le CMN n’est devenu que très récemment maître d’ouvrage des travaux d’investissement et de restauration pour ses propres monuments et a peiné à constituer son équipe de maîtrise d’ouvrage. Or une conjonction de circonstances lui a permis de constituer ce petit « trésor de guerre », lui donnant l’opportunité d’engager les travaux de restauration du Panthéon.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Nous achèverons cette audition avec le Centre national du livre (CNL). Le CNL gère une trentaine de dispositifs de soutien. Un tel éclatement n’est-il pas préjudiciable à la lisibilité et à l’efficacité de ses interventions ?
Mme Laurence Franceschini. Votre remarque est très juste. Le statut du CNL vient d’être réformé, et le président récemment nommé à sa tête est tout à fait conscient des inconvénients d’un tel éparpillement. Le contrat de performance que l’État doit signer avec le Centre prévoit une simplification et une clarification de ces dispositifs, qui tiennent compte de la spécificité du secteur, où cet établissement est extrêmement apprécié. Le dispositif de soutien à la numérisation a déjà été clarifié.
Il est également prévu d’expertiser l’efficacité des aides à l’issue de la première année d’application du contrat de performance. Nous envisageons aussi de vérifier la compatibilité entre aides du DRAC et action du CNL.
M. Olivier Carré, Président. Mesdames, messieurs, nous vous remercions.
Audition du 19 mai 2011
À 10 heures : Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-François Colosimo, président du Centre national du livre (CNL), accompagné de Mme Véronique Trinh-Muller, directrice générale
Présidence de M. Olivier Carré, Président, puis de M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur
M. Olivier Carré, Président. Monsieur le président, Madame, dans le contexte économique actuel, il nous semble intéressant d’analyser l’efficacité des opérateurs dont une partie des recettes provient de taxes affectées, et d’évaluer les incidences de ce mode de financement sur leur gestion.
M. Jean-François Colosimo, président du Centre national du livre (CNL). Je suis heureux d’être parmi vous et très honoré de l’intérêt que porte l’Assemblée nationale au monde du livre, et ce d’autant plus qu’il est confronté à de grandes mutations. Dans notre pays, les relations entre le monde politique, les élus et le livre sont anciennes et très fécondes – d’ailleurs, beaucoup d’entre vous ont déjà publié un livre et c’est également le cas de tous les présidents de la Ve République, depuis le général de Gaulle jusqu’à Nicolas Sarkozy. J’ajoute que tous ont considéré que le livre ne saurait être un produit comme les autres.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir, monsieur le président, en raison de votre parcours, de votre expérience et de la pertinence de vos réflexions. Le livre se trouve en effet face à des perspectives vertigineuses car il évolue vers un produit relevant moins de l’écrit « physique ». Notre pays a toujours entretenu avec le livre une relation intime, considérant l’acte de lire comme un signe d’intelligence et de réflexion. Les nouvelles techniques vont considérablement bouleverser notre façon d’appréhender le soutien que notre pays apporte au secteur du livre depuis 1946.
Quels sont selon vous les défis auxquels sera confronté demain le Centre national du livre ? À cette aune, comment pensez-vous qu’évolueront ses ressources affectées ?
M. Jean-François Colosimo. Nous sommes véritablement confrontés à une révolution anthropologique. Pendant trois millénaires, l’écrit a dominé le mode de l’intellection et déterminé l’évolution de l’humanité sur l’ensemble de la planète. Même les sociétés qui ne pratiquaient pas l’écriture ont vu leur histoire écrite par d’autres sociétés qui, elles, la pratiquaient.
Depuis plus de quatre siècles, nous menons en France une politique du livre, depuis le dépôt légal et l’invention de Gutenberg jusqu’à la gratuité des livres scolaires de Jules Ferry, en passant par l’institution du droit à la propriété intellectuelle par la Révolution. Tout cela témoigne de la continuité de la politique de l’État et de l’implication de la Nation tout entière en faveur du livre. Le Centre national du livre – qui fut d’abord dénommé Caisse nationale des lettres, puis Centre national des lettres – accompagne de façon unique au monde depuis soixante-dix ans l’évolution de cette médiasphère dont les enjeux sont cruciaux en termes anthropologiques, culturels et de civilisation, mais aussi, plus immédiatement, en termes industriels, économiques et financiers.
L’industrie du livre demeure la première industrie culturelle en France puisque son chiffre d’affaires est trois fois supérieur à celui de l’industrie du cinéma. Elle réalise 22 % de ce chiffre d’affaires à l’étranger. Elle est la première industrie de notre pays par son lien à la langue et à l’histoire et par le rapport qu’elle a su établir entre un ensemble d’éléments comme l’autonomie de ses moyens – ce n’est pas le cas des autres industries culturelles –, son importance économique – elle génère des emplois sur l’ensemble du territoire –, la pluralité de son offre, sa capacité d’adaptation – elle a traversé de très nombreuses mutations industrielles avec succès – et la qualité de sa relation avec les pouvoirs publics. À ce titre, la loi de 1981 sur le prix unique du livre, dont nous fêterons cette année le trentenaire, et la récente adaptation de la loi sur le prix unique du livre numérique, sont emblématiques.
Le monde du livre a su conserver sa structure d’oligopole à large frange, se doter d’organes représentatifs, mutualiser ses objectifs et travailler en concertation avec le législateur. En ce sens, il symbolise l’exception culturelle française.
À travers ses différentes appellations, le Centre national du livre comme organe de soutien a toujours contribué à la création, à l’édition, à la diffusion et à la promotion du livre et mené à bien sa mission, qui consiste à encourager l’excellence, à garantir la diversité et à démocratiser la qualité du livre. Le Centre s’intéresse à tous les métiers du livre : auteurs, traducteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires et organisateurs de manifestations littéraires d’envergure nationale, les autres étant réalisées par délégation de ses missions aux services déconcentrés du ministère et aux collectivités locales.
La galaxie Gutenberg laisse aujourd’hui la place à l’ère numérique, qui va profondément transformer les mentalités et les pratiques et dont nous ne pouvons encore mesurer pleinement les effets – quiconque se prêterait à cet exercice risquerait d’être rapidement contredit.
Cette mutation ouvre pour le monde du livre un horizon plein de risques et de dangers. La dématérialisation des modes de production, d’information et de consommation en est l’aspect le plus saillant, mais le monde du livre est confronté à de nombreux autres problèmes : recul de la lecture normative, standardisation de la création, mise en cause de la propriété intellectuelle, dépréciation des métiers, paupérisation des professions, fragilisation des réseaux de diffusion, tassement de la décentralisation, de la déconcentration et des moyens qui les accompagnent, érosion de la francophonie, et plus généralement accélération de la concurrence, de la concentration et de l’internationalisation. Il faut savoir que, sur les cinq plus grands éditeurs français, deux réalisent une part très significative de leur chiffre d’affaires en Amérique du Nord, deux sont passés sous l’égide de groupes étrangers – l’un espagnol, l’autre italien –, et un seul reste d’essence parfaitement patrimoniale.
La tendance à l’unification marchande du monde entraîne une désagrégation des identités et une marginalisation toujours plus grande des originalités. Nous devons réagir contre cette tendance, qui n’est pas une fatalité dès lors qu’existe une volonté politique pour la contrer.
Le cycle industriel de massification et de mécanisation des biens culturels initié en 1880 est clos. La manière remarquable dont le monde du livre s’est adapté à cette mutation, qui passe par l’invention du livre de gare, du livre de poche et de diverses formules qui ont permis de démocratiser la lecture est également périmée. Mais le livre obéit à des cycles très lents – le codex a mis presque trois siècles pour remplacer le rouleau et il existait encore des copistes au XVIIIe siècle –, ce qui en fait un secteur moins fragile que la musique ou l’audiovisuel, par exemple.
En 2010, l’État, se montrant avisé, a accordé au CNL son autonomie dans le cadre de l’harmonisation générale des statuts des établissements publics. Le Centre est désormais doté d’un président exécutif, nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de la Culture et de la communication, ministère qui exerce la tutelle de l’établissement à travers l’une de ses trois directions générales, à savoir la direction générale des Médias et des industries culturelles (DGMIC), au sein de laquelle a été intégré le service du Livre et de la lecture, qui a remplacé la direction du Livre.
Quelles sont les missions du CNL ? La loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 lui a confié le rôle de soutenir et d’encourager l’activité littéraire par tous moyens, de favoriser par des subventions l’édition d’œuvres littéraires, d’allouer des pensions aux écrivains et d’assurer le respect des œuvres littéraires.
Par la suite, le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié a renforcé le rôle du Centre en lui confiant les missions suivantes : offrir aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires, imprimeurs, bibliothécaires et à tous les professionnels et amateurs du livre un centre permanent de rencontres et de dialogues ; encourager tous les modes d’expression littéraire et concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des œuvres littéraires ; contribuer au développement économique du livre ainsi qu’au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion, participer à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; favoriser la traduction d’œuvres étrangères en français et d’œuvres françaises en langue étrangère. Le CNL est en effet la plus grande entreprise du monde d’import-export de littérature : tandis que les autres pays dotés d’un organisme analogue favorisent l’exportation de leur littérature nationale, le CNL, dans un principe d’égalité culturelle et au bénéfice des industries du livre, soutient tout autant l’importation de littératures étrangères que l’exportation de la littérature française. Cette ouverture est significative de l’esprit dans lequel nous menons notre action.
Le décret fixe en outre au Centre les missions d’intensifier les échanges littéraires, de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français, et de favoriser les commandes par les bibliothèques, en France et à l’étranger. Ses missions statutaires donnent au CNL un rôle d’interlocuteur et de partenaire des professions du livre, avec lesquelles il entretient des liens constants.
Le CNL doit aujourd’hui relever un double défi : assumer son statut d’autonomie dans le cadre d’un ministère lui-même réformé et affronter les défis qui se présentent au monde qu’il est censé servir.
Le CNL est un établissement public à caractère administratif, dont les modes de paiement sont soumis aux règles en vigueur. Son conseil d’administration compte des représentants de divers ministères ainsi que des personnalités qualifiées.
Pour mener à bien sa mission d’aide et de soutien au livre, le CNL perçoit deux taxes fiscales affectées qui constituent l’essentiel de ses ressources : l’une sur la vente du matériel de reproduction et d’impression, qui constituait 58,1 % de ses ressources en 2009, soit 21,19 millions d’euros, l’autre sur les chiffres d’affaires des éditeurs, qui représente 13,9 % de ses ressources, soit 5 millions d’euros, et dont sont exonérés certains éditeurs.
Nous exerçons notre mission de soutien en redistribuant ces ressources aux acteurs du livre à travers une trentaine de dispositifs – subventions, crédits de préparation, prêts à taux zéro, bourses. Généralement, ces aides sont attribuées après avis de commissions consultatives, organisées par domaines d’activité ou par type d’intervention, et sur décision du président du CNL. Ces commissions, au nombre de vingt, comptent environ 250 membres, tous issus des professions du livre, qui effectuent un mandat d’une durée de trois ans.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Qu’est-ce qui, selon vous, a justifié à l’origine l’attribution de ressources affectées ? Quelle pourrait être leur évolution ? Une ressource budgétaire n’apporterait-elle pas une meilleure garantie au CNL ?
M. Jean-François Colosimo. Dès sa fondation en 1946, la Caisse nationale des lettres s’est vu affecter comme principale ressource une taxe de 0,2 % du chiffre d’affaires de l’édition – c’est-à-dire sur les ventes de livres réalisées par les maisons d’édition. Mais le grand nombre des exonérations, ainsi que le rôle social qu’a joué la Caisse après la guerre auprès des écrivains ont vite fait apparaître que la ressource était insuffisante. L’instauration en 1957 du « domaine public payant », qui prolonge la durée du droit d’auteur au bénéfice de la Caisse – et non plus au bénéfice de l’auteur – a permis d’y remédier partiellement. La transformation en 1973 de la Caisse nationale des lettres en Centre national des lettres, puis la création, en 1975, de la direction du Livre et de la lecture ont réaménagé le financement en ajoutant à la taxe de 0,2 % sur l’édition une taxe de 3 % du chiffre d’affaires des ventes de matériel de reprographie. Ces deux taxes alimentaient un fonds national du livre qui, par souci de simplification administrative et de bonne gestion, a été transféré en 2000 au Centre national du livre.
Depuis 2004, le CNL ne bénéficie plus des 400 000 euros de subventions de fonctionnement que lui attribuait auparavant le ministère de la Culture et de la communication. Quant aux emplois mis à disposition par le ministère sans remboursement, au nombre de 20 en 2011, j’ai demandé, dans le cadre de la réforme de l’établissement, qu’ils soient absorbés par le CNL dès 2011, au pire en 2012, afin d’homogénéiser notre politique du personnel.
Mes prédécesseurs ont progressivement substitué à l’octroi de prêts celui de subventions. Actuellement, le remboursement des prêts occupe une part essentielle des ressources propres non affectées de l’établissement, mais cette part est naturellement en diminution constante – elle est passée de 28 % en 2009 à 11 %, à titre prévisionnel, en 2011. Sachant que le mécénat s’adresse plus volontiers aux arts plastiques et à l’audiovisuel qu’au livre, nous pouvons dire qu’à terme les ressources affectées constitueront la presque totalité des ressources du CNL, à l’exception de quelques produits financiers. Le financement par des ressources affectées est le fruit d’une triple motivation, politique, industrielle et culturelle.
C’est en 1970 que la Commission des affaires culturelles du VIe Plan entreprend de mettre un terme à la dispersion des actions en faveur du livre et de la lecture, alors assurées par divers ministères et administrations. En 1973, la crise interrompt brutalement la croissance de l’édition et de son chiffre d’affaires, jusqu’alors exponentiel, incitant les pouvoirs publics à s’intéresser à la filière. De 1973 à 1975, le marché de la reprographie vit une totale transformation. L’apparition de machines qui emploient du papier ordinaire entraîne une large démocratisation des appareils, ce qui alarme les métiers du livre et donne lieu à la fameuse plainte concernant le « photocopillage ». Enfin, en 1974, apparaît la vente discount dans la commercialisation du livre. Toutes ces mutations ont justifié la création, en 1975 et 1976, de la direction du Livre et de la lecture, ainsi que la réforme du Centre national des lettres, en lui affectant notamment un financement.
La situation actuelle ressemble fortement à celle de 1976 : volonté de l’État de réformer le Centre national de la lecture, situation de crise économique, mutations technologiques propres à alarmer la profession, problèmes de commercialisation posés par l’ « e-commerce », politiques de discount propres à fragiliser le dispositif législatif. Tout cela engendrant de nouvelles missions pour le CNL.
La taxe due par les éditeurs, dont sont exonérés ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 76 300 euros, a un caractère redistributif, donc une vertu de solidarité, tandis que la taxe sur les appareils de reprographie et d’impression, qui obéit à la logique « pollueur-payeur », a une vertu réparatrice. Cette taxe a beaucoup évolué à partir de 1993, lorsque nous avons pris conscience de la mutation des appareils de reprographie. Afin de corriger l’effondrement des recettes du CNL, la loi de finances rectificative pour 2006 a intégré la multifonctionnalité de ces appareils. Mais cette taxe instaurée en 2007 n’ayant pas atteint son objectif de rapporter 30 millions d’euros, la loi de finances rectificative pour 2009 en a augmenté une nouvelle fois le taux, le portant de 2,25 à 3,25 %.
La difficulté actuelle tient au fait que le secteur du livre évolue sur un terrain qui s’effrite et les perspectives ne sont pas du tout encourageantes.
En effet, si la taxe sur l’édition reste à périmètre constant, la taxe sur les appareils de reprographie connaît une courbe descendante. Ainsi, en 2007, les consommables dégageaient encore un moindre chiffre d’affaires par rapport à la vente d’appareils de reprographie. L’effet retard qui s’est produit et, qui a pu paraître inhérent à la mise en place de la nouvelle assiette, s’est confirmé en 2008 et nous force à une révision budgétaire à peu près constante. Les premiers chiffres pour 2009 indiquent l’accélération de ce tassement. Le Centre s’attend à ce qu’en 2011 le produit de la taxe soit inférieur de 2 millions d’euros au montant espéré, soit une baisse de 7 à 8 %. En dépit des réformes engagées et des dispositifs mis en place, le CNL devra faire face à une nouvelle baisse tendancielle de sa principale recette fiscale.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Pour retrouver l’équilibre, ne peut-on élargir aux consommables la taxe assise sur les appareils ?
M. Jean-François Colosimo. Plusieurs pistes existent, qui ont fait l’objet d’un rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles en 2005 et d’un audit conjoint des ministères de la Culture et des Finances. Cette préoccupation n’est pas neuve. Je vais vous présenter quelques-unes de ces pistes, auxquelles je joindrai mes commentaires personnels eu égard à la pratique qui est la mienne du Centre et du monde de l’édition.
Il existe des solutions à court terme, comme augmenter le taux de la taxe actuelle et en étendre l’assiette aux pièces détachées, mais dans une industrie en mutation et compte tenu de la dématérialisation accrue de la reprographie, cette mesure ne pourrait être que temporaire – d’ailleurs, elle n’a jamais donné de résultats satisfaisants. En outre, cette extension de taxes pèserait lourdement sur l’activité des fabricants d’appareils de reprographie qui, même convaincus de la nécessité de contribuer à l’activité culturelle, ne manqueraient pas de réagir. Pour élargir l’assiette aux consommables, il faudrait envisager une taxation unique des matériels et des consommables car il serait extrêmement complexe de mettre en place une taxation différencielle.
Une autre mesure immédiate consisterait à augmenter la taxe sur le chiffre d’affaires de l’édition, ce qu’il faut éviter dans le contexte actuel d’un secteur déjà fragilisé. En outre, elle contredirait formellement la mission du CNL, qui est de soutenir le secteur du livre et serait donc contreproductive. Nous nous y opposons donc.
Il existe d’autres pistes à moyen et à long terme, et ces pistes sont beaucoup plus intéressantes, surtout quand on sait par ailleurs que le mode de collecte du Centre national du cinéma lui permet d’obtenir des résultats vingt fois supérieurs à ceux du CNL, puisqu’on estime l’effet levier du CNC à 10 %, contre 0,5 % pour le CNL.
La première de ces pistes serait la création d’une taxe globale sur le chiffre d’affaires des industries et services d’impression et de gestion de documents, sous forme de taxe compensatoire, et de l’étendre à la totalité de la filière, services compris ; la deuxième consisterait à intégrer le domaine du livre dans tous les mécanismes à venir impliquant les fournisseurs d’accès à Internet, lesquels emploient massivement des contenus écrits et de livres ; la troisième piste serait de taxer les nouveaux appareils et supports numériques qui utilisent des contenus écrits, comme les ordinateurs portables, les smartphones et les liseuses – dont le parc devrait connaître un essor important en France.
Certains organismes comme le Centre français d’exploitation du droit de copie ou la SOFIA – Société française des intérêts des auteurs de l’écrit – enregistrent des excédents importants dus à leur manière de collecter les droits sur la reproduction individuelle. J’attire votre attention sur le fait que ces excédents les incitent à promouvoir une sorte de mécénat de l’écrit qui me paraît redondant avec les missions du CNL.
Au CNL, nous optons plutôt pour la diversification des ressources et la mise en place d’un modèle labile qui nous permettrait d’équilibrer nos budgets tout en nous adaptant aux mutations industrielles.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Ces différentes hypothèses ont-elles fait l’objet d’estimations de la part du CNL ? Par ailleurs, en termes de recettes fiscales, envisagez-vous de restructurer les nombreux dispositifs de soutien du CNL pour en améliorer la lisibilité ? Est-il urgent, selon vous, de réformer le financement du Centre ?
M. Jean-François Colosimo. Nous n’avons pas procédé à une évaluation actualisée des différentes pistes que nous proposons à votre réflexion, mais il me paraît évident que nous lirons bientôt des ouvrages écrits sur nos smartphones – comme le font les Japonais avec les mangas. S’agissant d’un marché exponentiel et très fluide, qui passe directement du producteur au consommateur, je pense qu’une taxe même faible sur les smartphones pourrait rapporter une ressource notable qui ne gênerait pas l’expansion du marché. Il va de soi que nous sommes prêts à détailler ces propositions, en collaboration avec des organismes compétents, afin de vous fournir des modèles sur lesquels vous pourriez réfléchir.
La multiplicité des dispositifs de soutien correspond au nombre de métiers, d’activités et de pratiques qui composent le monde multiforme et, d’une certaine façon, artisanal du livre.
Avec l’assentiment du personnel et des organes de tutelle, j’ai réformé le CNL en transformant les treize bureaux existants en quatre départements d’activités chargés respectivement des ressources internes, de la diffusion – bibliothèques, librairies, numérisation –, de la création – auteurs, traducteurs, éditeurs –, et des relations extérieures – événements littéraires et communication. De la même manière, j’ai eu le souci de clarifier ce catalogue à la Prévert que nous présentons sur notre site, lequel s’apparente, j’en conviens, à une épreuve initiatique, une sorte de présélection. Avec l’aide d’un organisme d’études, nous mettons au point un sondage auprès de 5 000 usagers du CNL – grands éditeurs, petits éditeurs, auteurs, membres de commissions – sur la façon dont ils perçoivent le Centre et la pertinence de ses commissions et de ses pratiques. Cette étude est indispensable pour légitimer une réforme profonde de cette multiplicité qui tient en partie à la nature de la filière et en partie à l’histoire du Centre. Il faut rendre hommage à Jean Gattégno qui, à partir des années 1980, s’est montré ouvert à de nouvelles formes d’aides.
Nous avons un effort à faire pour rationaliser nos pratiques. Cet effort sera fait, je m’y engage !
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Le CNL est-il engagé dans un contrat de performance ?
M. Jean-François Colosimo. La LOLF nous y a obligés et nous nous en félicitons. Ce contrat, que nous avons élaboré avec beaucoup de sérieux, attend la signature du ministre de la Culture.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Comment a évolué la masse salariale du CNL ? Quel est le nombre de personnes qui y travaillent et combien sont détachées du ministère ? Le cumul de personnels venus d’horizons différents influe-t-il sur la gestion du Centre ?
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. À quelle date et dans quelles conditions doit être effectué le transfert sous votre gestion directe de la vingtaine de personnes qui dépendent encore du ministère de la Culture ? Ces personnes conserveront-elles leur statut ? Seront-elles sous l’entière responsabilité du CNL ?
M. Jean-François Colosimo. En 2010, sur les 72 personnes employées par le CNL, 48 étaient rémunérées par le Centre et 24 par le ministère. Mais c’était une année de transition car nous avons été contraints d’harmoniser avec le ministère les documents antérieurs et les documents plus récents quant au nombre d’emplois concédés ou affectés. Nous avons souhaité mettre un terme à cette situation et, cette année, ce sont 52 agents qui sont rémunérés par l’établissement, contre 20 par le ministère.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Les personnes rémunérées par le ministère sont-elles simplement mises à la disposition du CNL ?
M. Jean-François Colosimo. En effet. Elles proviennent de filières et de catégories très différentes. Nous souhaitons vivement les intégrer au sein du CNL.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Jusqu’à prendre totalement en charge leurs salaires ? Quel en est le montant total ?
M. Jean-François Colosimo. Chaque agent rémunéré par le ministère exprimera son souhait de devenir contractuel du CNL ou de retourner à son corps ou à son affectation d’origine. Il n’y aura pas de contrainte.
Mme Véronique Trinh-Muller, directrice générale du Centre national du livre (CNL). Ces 20 emplois représentent une masse salariale de 1,3 million d’euros.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Quelle est la part de contractuels dans le nombre total d’employés ?
M. Jean-François Colosimo. Le CNL emploie 72 personnes, dont 52 contractuels et 20 agents du ministère.
Mme Véronique Trinh-Muller. Sur ces 52 personnes, 4 ont passé des concours et sont donc titulaires et payées par l’établissement. Quant aux 20 agents du ministère, ils ont des statuts différents : ils peuvent être contractuels du ministère de la Culture, titulaires, agents des bibliothèques ou personnels administratifs. Une même mission peut être remplie par des personnes ayant 4 à 5 statuts différents. Dans un souci de cohérence, nous avons demandé le transfert des emplois.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. L’unification des statuts n’est pas seulement une nécessité pour l’établissement, elle est importante pour chaque personne concernée. Espérez-vous y parvenir un jour ?
M. Jean-François Colosimo. Les défis que doit relever le CNL, tant vis-à-vis de ses nouveaux statuts que du monde de l’édition, exigent une professionnalisation, une efficience et une innovation qui ne peuvent être satisfaites qu’avec un personnel homogène, dans le respect de chacun et de ses compétences. C’est un objectif crucial, car tant que le CNL était l’extension opérationnelle de la direction du Livre et de la lecture, celle-ci conservait la fonction stratégique, le CNL se contentant d’un rôle d’exécution qu’il remplissait en instruisant les demandes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Devant le double défi que représentent l’autonomie et la mutation du monde du livre, si nous voulons remplir la mission qui nous est confiée par l’État, nous devons homogénéiser notre personnel, sans aucune contrainte mais dans un élan dynamique. Le personnel, avec l’accord des syndicats, a adopté les réformes structurelles que j’ai engagées, confirmant ainsi son engagement au service du livre.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Les dépenses de personnels du CNL sont importantes eu égard aux ressources dont il dispose. Comment comptez-vous absorber des personnels supplémentaires tout en continuant à distribuer des aides au secteur du livre ?
Mme Véronique Trinh-Muller. Certes, le transfert de 20 emplois suppose une augmentation des charges directes de l’établissement, mais nous ne savons pas encore si nous devrons absorber immédiatement le coût du transfert. Nous avons fait la demande d’une prise en charge dans le cadre du contrat de performance et nous sommes soutenus par notre organisme de tutelle, la direction générale des Médias et des industries culturelles, mais à ce jour celle-ci ne nous a pas informés de sa décision, pas plus que le ministère des Finances. Cela dit, les inconvénients d’une gestion par le ministère sont tels qu’il serait préférable pour nous de récupérer la gestion des 20 agents.
M. Jean-François Colosimo. D’autant que nombre d’entre eux approchent de l’âge de la retraite, ce qui provoquera une réduction mécanique du nombre des agents puisque nous sommes tenus de ne remplacer qu’une personne partant à la retraite sur deux. En outre, en investissant significativement dans un système de gestion moderne de l’information – nous en sommes encore à l’archivage de dossiers papier ! – et en simplifiant nos dispositifs, nous pourront, d’ici deux à trois ans, inverser les courbes de la masse salariale et diminuer le nombre d’agents dont nous avons besoin pour remplir nos missions.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Madame, monsieur, nous vous remercions pour la qualité de vos réflexions.
M. Jean-François Colosimo. Je vous remercie à mon tour. J’ai trouvé en arrivant au CNL un instrument très efficace de la politique culturelle de l’État et un personnel remarquable. Il faut donner au CNL les moyens – il le mérite et c’est ce que le monde de l’édition attend des pouvoirs publics – de mener une action concrète et efficace au service de cette liberté d’expression qui est l’un des piliers de notre République et qui caractérise notre manière de nous adresser au reste du monde.
Audition du 19 mai 2011
À 11 heures 30 : Audition conjointe, ouverte à la presse, de Mme Marie-Astrid Ravon, sous-directrice à la 8e sous-direction de la direction du Budget, accompagnée de Mmes Anne-Hélène Bouillon, chef du bureau de la culture, de la jeunesse et du sport, et Mélanie Joder, chef du bureau de la justice et des médias à la 8e sous-direction de la direction du Budget, ainsi que de M. John Palacin, chef du bureau D2 à la direction de la Législation fiscale, en charge de la politique sectorielle et des taxes sur les transactions
Présidence de M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Mesdames, monsieur, le rôle de la MEC consiste à formuler des propositions qui recueillent un consensus sur des politiques publiques ou des thèmes se rapportant à la gestion de l’État. Le rapport sur le financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées sera rédigé par trois rapporteurs – Nicolas Perruchot, Marcel Rogemont et moi-même – représentant les commissions des Finances et des Affaires culturelles et issus de trois groupes politiques différents. Nous sommes assistés dans nos travaux par la Cour des comptes, représentée aujourd’hui par M. Emmanuel Marcovitch, conseiller référendaire.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. La multiplicité des taxes affectées suscite bien des questions, qui touchent notamment au contrôle et au risque de démembrement des comptes publics – car, finalement, on vous enlève une côte, si je puis dire, chaque fois que l’on crée une taxe affectée. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de ces taxes aux yeux de l’administration centrale ?
Mme Marie-Astrid Ravon, sous-directrice à la 8e sous-direction de la direction du Budget. Nous avons essayé de nous forger une doctrine en dressant une typologie des cas dans lesquels il semble pertinent de pouvoir affecter directement des taxes au financement de politiques publiques déterminées. Nous avons identifié trois grandes familles.
Il y a d’abord les cas où la recette affectée est une redevance ou obéit à une logique de service rendu. Les bénéficiaires de la mission de service public contribuent alors directement à son financement. C’est cette logique qui a prévalu lors de la création des deux redevances finançant l’archéologie préventive et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Il y a ensuite les cas où la recette affectée constitue une sorte de contrepartie, en application du principe « pollueur-payeur ». Je pense, par exemple, à la taxe sur la vente des appareils de reproduction et d’impression, affectée au Centre national du livre (CNL), qui trouve son origine dans le postulat que l’utilisation de ces appareils menace directement le secteur du livre.
La troisième famille regroupe les cas où la recette affectée résulte de la mise en œuvre d’une péréquation interne au sein d’un secteur économique, permettant ainsi d’éviter un financement d’une dépense publique par l’ensemble des contribuables. C’est la logique à laquelle obéissent les taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) ou au CNL.
L’intérêt des affectations de recettes est qu’elles reposent sur un lien direct entre les agents économiques assujettis aux taxes et la redistribution du produit de celles-ci au sein du secteur, lien de nature à accroître le consentement à l’impôt et à réduire les externalités économiques négatives.
Au-delà de cette grille d’analyse, d’autres conditions doivent cependant être remplies. Si l’affectation de taxes permet de mutualiser la ressource et d’assurer une solidarité financière entre les professionnels d’un secteur économique, il faut également que le rendement de la taxe soit corrélé dans le temps avec les besoins de l’opérateur : le « décrochage » entre les prélèvements obligatoires qui pèsent sur le secteur et la nécessité de redistribution qui sous-tendait l’affectation de taxes doit être évité. Il est également intéressant que la taxe permette de responsabiliser le secteur et de créer des effets vertueux – par exemple lorsque son rendement s’accroît quand le secteur est performant et dynamique.
Néanmoins, les affectations de recettes présentent aussi des inconvénients. J’en vois au moins cinq. Bien que prévues et autorisées par la LOLF, elles constituent – vous le suggérez vous-même dans votre question – une entorse au principe d’universalité budgétaire.
Ensuite, elles peuvent présenter un risque de contournement de la norme de dépenses de l’État. Pour juguler ce risque, nous avons défini une charte de budgétisation et considéré qu’en dehors des cas de la typologie, l’évolution de ces affectations de recettes serait intégrée dans le calcul de la norme de dépenses dite élargie. On évitera ainsi tout arbitrage entre le respect de la norme de dépenses de l’État et une affectation de recettes permettant de contourner cette norme.
En outre, on court le risque d’un pilotage de la politique concernée par la recette. On s’inquiète alors moins de la définition du besoin que du suivi de la ressource affectée au financement de cette politique.
Au surplus, les taxes suivent nécessairement une logique procyclique : lorsque la conjoncture est favorable, leur produit augmente et on redistribue davantage d’aides au secteur considéré. En cas de retournement de la conjoncture, on est confronté à un risque d’effet de ciseaux, qui peut certes être maîtrisé par la mise en place de mécanismes de lissage pluriannuels ou la constitution de réserves, mais qui doit néanmoins être pris en considération.
Enfin, les affectations de recettes rendent plus difficile le pilotage par l’État de la politique publique considérée. Les mécanismes d’ajustement sont en effet beaucoup plus lents : pour modifier une affectation de recettes, il faut passer par la loi, ce qui est beaucoup moins souple qu’un ajustement de dotation budgétaire en cours d’année. En outre, la gouvernance des opérateurs est parfois plus délicate, les professionnels du secteur étant mieux représentés – et souvent majoritaires – dans les conseils d’administration, ce qui n’est pas le cas pour les opérateurs financés par le budget de l’État.
Il existe aussi un risque de distension du lien direct entre la taxe affectée à l’opérateur et les dépenses qu’elle finance au fil du temps et des modifications législatives.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Tout cela est intéressant, mais reste assez théorique. Pouvez-vous évoquer concrètement les taxes affectées existantes ? Quelles sont celles qui ne répondent pas aux critères que vous avez définis ? Quelles sont celles qu’il faudrait supprimer ? Quelles sont celles qui ont souffert de l’effet procyclique ? Quelles sont celles qui entraînent des difficultés de pilotage pour l’État ?
L’analyse nous intéresse moins que les aspects pratiques.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Les contrats de performance ne peuvent-ils apporter une solution partielle aux problèmes que vous soulevez ?
Mme Marie-Astrid Ravon. J’avais compris que nous passerions les différents organismes en revue dans un second temps, d’où mon introduction générale.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Commençons donc par le CNC. Compte tenu de l’évolution du monde dans lequel vivent le cinéma et la production audiovisuelle, nous ne pouvons manquer de nous interroger sur l’avenir. Comment voyez-vous les choses ? Que pensez-vous par ailleurs de la répartition entre aides « sélectives » et aides « automatiques » ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Les affectations de taxes au CNC reposent sur une logique simple : prélever des impôts sur les diffuseurs pour financer la création et la production françaises. Par rapport à la grille d’analyse que je vous ai présentée, nous sommes dans le cas d’une péréquation au sein d’un secteur économique. Ces affectations nous paraissent donc pertinentes.
En ce qui concerne la gouvernance, la réforme qui a fait du CNC un établissement public doté d’un conseil d’administration va dans le bon sens, et donne des leviers à l’État pour piloter l’opérateur.
Compte tenu de l’évolution des taxes qui lui sont affectées, le CNC n’a pas été confronté à des retournements de conjoncture. Il a su constituer des réserves à mesure que le niveau de ses recettes augmentait.
Historiquement, le CNC est financé par trois taxes : la taxe sur les entrées en salles, la taxe sur les services de télévision (TST) et la taxe sur la vidéo et la vidéo à la demande. L’affectation de ces taxes au CNC a d’abord reposé sur l’idée de financer la création cinématographique française en prélevant des impôts sur les entrées dans les salles. Affectées dans un premier temps au compte d’affectation spéciale de soutien au cinéma et à l’audiovisuel puis au CNC, ces taxes ont suivi la logique et les évolutions de l’environnement économique et technologique du secteur. Elles ont été élargies aux modes de diffusion, avec la création de la TST en 1986, puis de la taxe sur la vidéo en 1993. L’assiette de la TST a ensuite été étendue aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en 2008.
Cette affectation de taxes repose sur une double logique de solidarité et de mutualisation des moyens au sein du secteur, d’une part entre les grosses productions cinématographiques, essentiellement étrangères, et celles qui rencontrent un public plus restreint, et d’autre part entre la diffusion en salles et la diffusion à la télévision et sur Internet. Les taxes ont donc cherché à s’adapter aux mutations économiques et technologiques du secteur. Depuis 2003, leurs assiettes ont été modifiées presque chaque année pour prendre en compte les nouveaux usages et les nouveaux modes de financement du secteur de l’audiovisuel.
Bref, elles ne soulèvent pas de difficulté majeure. La question se pose néanmoins de la répartition du poids de ces prélèvements au regard de la chaîne de valeur de l’œuvre en fonction des différents supports de diffusion. Le débat s’est cristallisé à la fin de l’année dernière. Le rendement de la nouvelle taxe sur les FAI – justifiée par le fait qu’Internet devient un nouveau mode de diffusion des œuvres – est en effet passé de 95,4 millions d’euros en 2008 à 277,8 millions d’euros en 2010. Elle représente désormais 37 % des taxes affectées au CNC. Ce dynamisme est notamment lié au développement des offres triple play, mais aussi au fait qu’au sein de ces offres les services de télévision étaient soumis à un taux réduit de TVA, ce qui conduisait les entreprises à optimiser l’assiette soumise à taux réduit – qui est aussi celle de la TST. Le passage d’un taux de TVA réduit à un taux normal les a donc poussées à se repositionner sur le marché : Free propose désormais une offre double play – c’est-à-dire sans services de télévision – assortie d’un faible complément donnant accès aux services de télévision. Devant le risque d’érosion des recettes du CNC, les ministères des Finances et de la Culture ont diligenté une mission d’inspection chargée de réfléchir à la consolidation des recettes du CNC et à leur niveau, en analysant également les besoins du secteur. Compte tenu de la croissance de ces recettes au cours des trois dernières années, il est en effet légitime de s’interroger sur le « bon » niveau de péréquation au sein du secteur.
Se pose également la question de l’harmonisation du régime fiscal de la publicité sur les services de télévision en ligne avec celui des chaînes hertziennes. La vidéo à la demande (VàD) payante contribue aujourd’hui au fonds de soutien du CNC, mais ce n’est pas le cas de la VàD gratuite, qui est en plein développement. Ce point doit donc être intégré à la réflexion sur les taxes affectées au CNC. Nous attendons les conclusions de la mission d’inspection, qui fonderont la réflexion du Gouvernement. À ce stade, nous n’en avons pas encore connaissance.
M. Marcel Rogemont, Rapporteur. Vous vous interrogez sur le bon niveau des recettes affectées au CNC. On peut aussi poser la question de leur bon emploi – car les œuvres de l’esprit qui circulent sur Internet ne sont pas nécessairement des images animées. Nous avons reçu tout à l’heure le président du CNL, qui regrette la faiblesse de ses recettes. Je ne plaide évidemment pas contre le cinéma et la production audiovisuelle, mais on pourrait très bien envisager une autre répartition du produit de la taxe.
M. John Palacin, chef du bureau D2 à la direction de la Législation fiscale, en charge de la politique sectorielle et des taxes sur les transactions. La TST constitue un cas très spécifique parmi l’ensemble des taxes que nous évoquons aujourd’hui. L’octroi d’un taux réduit de TVA sur les services de télévision, pour un montant forfaitaire, allait en effet de pair avec l’utilisation de ce volume de chiffre d’affaires comme assiette pour la TST. C’est dans le secteur de la télévision – et pas seulement dans celui de l’Internet et des télécommunications – qu’on a observé une rupture technologique très importante. Certaines entreprises ont réussi à fournir des services de téléphone, puis de télévision, en utilisant des adresses IP et le circuit Internet. De nombreuses entreprises qui n’appartenaient pas au secteur de la télévision sont dès lors devenues éligibles au bénéfice du forfait de 50 % de TVA à taux réduit. Dans le même temps, elles ont fortement contribué aux recettes du CNC. On peut donc s’interroger sur le point de savoir si la dynamique de ces recettes est corrélée à un besoin du CNC ou à une évolution économique.
Lorsqu’une taxe vise à financer une institution dans un secteur déterminé et pèse sur l’activité de ce dernier, sa gestion et sa cohérence économique apparaissent claires. Mais, dès qu’on élargit son assiette, d’autres logiques se mettent en place. Dans le cas de la TST, on a ainsi prélevé une recette sur d’autres activités économiques. Le financement du monde de la culture et le prélèvement de la taxe sur l’économie numérique sont pour nous un vrai sujet de réflexion, à l’heure où se posent avec une particulière acuité les questions de territorialité et où les opérateurs culturels traditionnels se trouvent en concurrence avec des acteurs situés en amont ou en aval sur la chaîne de valeur ajoutée – portails, moteurs de recherche – qui captent une part de la valeur ajoutée de la publicité. La piste de la fiscalisation de la publicité en ligne apparaît donc comme assez prometteuse.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Venons-en à l’INRAP. Quel est votre sentiment sur le rendement de la redevance d’archéologie préventive (RAP), jugé insuffisant ? Que pensez-vous du versement de 8 millions d’euros prévu par le collectif relatif à la réforme de la fiscalité du patrimoine, et des différents scénarios de réforme du financement de l’archéologie préventive ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Le rendement de la RAP a progressé depuis sa création, puisqu’il est passé de 12,8 millions d’euros en 2004 à 70,7 millions en 2010. À l’origine, l’INRAP ne bénéficiait pas de dotations budgétaires, la redevance – dont le rendement avait été estimé à 80 millions d’euros – étant censée financer l’intégralité de la politique d’archéologie préventive. Le décalage entre son niveau effectif et celui des dépenses a mis l’établissement en difficulté financière : ses fonds propres négatifs atteignaient 21 millions d’euros fin 2010. Le traitement de ces difficultés n’a pas permis de déboucher sur un mode de financement stable et pérenne de l’archéologie préventive. Des subventions budgétaires – dont le montant a varié entre 10 et 30 millions d’euros selon les années – ont donc été versées. L’Agence France Trésor a par ailleurs consenti à l’INRAP en 2002 une avance de trésorerie de 23 millions d’euros, qui pèse encore sur les comptes de l’établissement aujourd’hui. Il faut également rappeler que la trésorerie de l’INRAP est commune avec celle du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP), ce qui a assuré son fonctionnement pendant plusieurs années. Enfin, les réformes successives de la RAP – principalement des augmentations de taux – ont permis d’améliorer son rendement. Des efforts ont également été entrepris pour améliorer le taux de recouvrement de la taxe, qui est passé de 50 % en 2005 à près de 90 % aujourd’hui.
Les difficultés structurelles de financement de l’établissement appellent cependant une réflexion de fond. C’est donc dans une perspective de réforme qu’une mission d’inspection a été diligentée en 2010. Les conclusions qu’elle a rendues en octobre dernier suggèrent plusieurs scénarios de réforme.
Le premier – qui est une version a minima – consisterait à réduire les exonérations de RAP et à élargir son assiette, sans remettre son fonctionnement en question. Ce scénario aurait l’intérêt de renforcer la cohérence de la taxe et de maintenir le principe « aménageur-payeur », qui sous-tendait la logique d’affectation de la taxe à l’INRAP. Il présente cependant l’inconvénient de complexifier encore davantage la gestion de la taxe, déjà critiquée, et de n’offrir qu’un potentiel d’augmentation modeste, même si le rendement se situe entre 25 et 30 millions d’euros. À ce stade, ce scénario n’est pas totalement écarté.
Il faudra faire un choix entre l’adoption d’une taxe très spécifique, qui ménage le principe « aménageur-payeur » mais reste relativement concentrée, et un élargissement de l’assiette, qui rendrait l’affectation un peu moins pertinente mais qui assurerait à la taxe une efficacité et un rendement supérieurs. Le mieux serait de trouver un équilibre entre ces deux logiques.
Une autre solution proposée par la mission consisterait à remplacer la RAP par une nouvelle taxe sur les mutations de terrains à bâtir. Nous y sommes défavorables, d’abord en raison du risque d’enchérissement du foncier, et ensuite parce que cela conduirait à introduire une nouvelle part « État » dans un impôt local. Si l’on veut éviter des taxations en cascade, la détermination de son assiette serait en outre complexe. Enfin, son rendement serait volatil, puisqu’il dépendrait des variations sur le marché immobilier.
Un troisième scénario – à nos yeux la seule alternative au premier – vise quant à lui à mieux articuler la RAP avec la réforme de la taxe d’aménagement. Il s’agirait de supprimer la RAP « urbanisme » pour lui substituer une augmentation de la taxe d’aménagement, offrant une assiette plus large et permettant de simplifier les modalités de recouvrement. Il faudrait cependant attendre 2014 pour bénéficier d’un rendement en année pleine, ce qui obligerait à prévoir un régime transitoire.
Il est important de s’interroger sur les besoins de l’INRAP. Une augmentation des prélèvements obligatoires doit en effet s’accompagner d’une réflexion sur les marges de productivité existant au sein de l’établissement, sur la maîtrise des coûts et des délais des services rendus. Cette réflexion doit déboucher sur la signature d’un contrat de performance, contrepartie à la réforme du financement. Cela suppose d’élaborer un plan de redressement et d’assainissement de la situation financière de l’établissement.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Comment expliquer que la signature de ce contrat de performance exige un délai aussi long ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Les discussions sur le contrat de performance de l’INRAP ont été engagées en 2007 avec la précédente équipe de direction – mais les tutelles n’ont pas réussi à se mettre d’accord avec l’établissement sur un diagnostic. Relancées l’année suivante, elles ont à nouveau été interrompues en raison des difficultés sociales qu’a connues l’établissement fin 2008. L’ouvrage a été remis sur le métier en 2010, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général. Il nous faut aboutir courant 2011, la démarche allant de pair, comme je l’ai dit, avec une réflexion sur la réforme du financement de l’établissement.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Permettez-moi de poser une question d’ordre général. Le ministère de la Culture et le CNC affirment que le recouvrement des taxes a progressé depuis qu’il est assuré par le CNC, alors même que celui-ci mobilise moins de personnel pour cette tâche. Avez-vous une doctrine sur les modalités de recouvrement par les établissements, certains recouvrant eux-mêmes leurs taxes, comme le CNC, tandis que d’autres passent par la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Nous n’avons pas de doctrine précise sur ce sujet, que nous traitons au cas par cas. Nous choisissons avec la DGFiP, au moment de la mise en place de la taxe, le circuit qui semble le plus pertinent. Je ne dispose pas d’éléments factuels me permettant de vous en dire plus.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Nous aimerions maintenant vous interroger sur le CNV, qui est lui aussi confronté à plusieurs défis. Il y a d’abord des évolutions de marché : l’intégration d’opérateurs privés par les grands groupes a un impact sur l’offre, mais aussi sur l’évolution des produits pouvant être taxés. Par ailleurs, la transposition d’une directive communautaire relative à l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles va considérablement modifier le dispositif existant, et sans doute le produit des taxes affectées au CNV.
Au-delà de ces évolutions, comment envisagez-vous l’avenir du secteur ? Doit-on redouter que les grands groupes ne déportent les taxes dès l’entrée en vigueur de cette directive, occasionnant une perte de ressources importante pour le CNV ? Comment anticiper cette évolution, qui paraît inéluctable ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Le produit de la taxe affectée au CNV est passé de 15,1 millions d’euros en 2006 à 24 millions aujourd’hui, soit une progression de près de 60 % en quatre ans. Les mutations de fond du marché de la musique – notamment le déclin du chiffre d’affaires de la musique enregistrée – n’ont pas frappé de plein fouet le secteur du spectacle. À court terme, il n’y a donc pas de risque d’effondrement du marché.
Rappelons par ailleurs que le fonds de roulement du CNV s’élève à 8,9 millions d’euros, montant bien supérieur au niveau prudentiel communément admis. Il peut donc constituer une réserve pour aléas en cas de retournement conjoncturel.
Si l’on devait réfléchir à une nouvelle répartition des aides au sein du secteur, celle-ci serait au demeurant facile à mettre en œuvre, puisqu’elle ne dépend que du règlement intérieur du CNV.
Je laisse M. Palacin vous répondre sur la directive.
M. John Palacin. Il s’agit là d’une question de technique fiscale. Par le passé, les producteurs étrangers souhaitant donner un spectacle en France devaient désigner un producteur français qui était redevable de la taxe – autrement dit un représentant fiscal. Des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne l’interdisent désormais aux États lorsqu’il existe un accord d’assistance mutuelle. La question que vous posez nous renvoie donc à notre capacité à faire jouer ces mécanismes – et cela ne concerne pas que le CNV. Sachez que le ministère y est particulièrement attentif.
J’observe par ailleurs que le déclin de l’achat de disques au profit du téléchargement et le déport de la valeur ajoutée entre plusieurs acteurs pourrait entraîner un retour vers le spectacle, la musique gratuite conduisant à une hausse de la fréquentation des concerts.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Nous avons reçu tout à l’heure le président et la directrice générale du CNL. Nous avons évoqué avec eux le basculement dans un nouveau monde avec la révolution numérique, dont les conséquences pour le livre ne sont pas encore entièrement appréhendées. Les taxes affectées au CNL sont-elles adaptées à cette nouvelle donne économique et technologique ? Je pense principalement à la taxe sur la vente des appareils de reprographie et d’impression, dont l’assiette pourrait être élargie à la vente de consommables.
Mme Marie-Astrid Ravon. Les menaces qui pesaient sur le secteur de l’édition et du livre en 1976 – date à laquelle a été instaurée la taxe sur la vente des appareils de reprographie et d’impression – n’étaient pas de même nature que celles que nous connaissons aujourd’hui. Cette taxe obéissait à l’origine à une logique « pollueur-payeur », qui s’est estompée au fil des évolutions économiques et technologiques. Elle a en outre fait l’objet de réformes en raison de l’érosion de son rendement. À la suite d’un rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles, son assiette a d’abord été élargie aux copieurs multifonctions au 1er janvier 2007. En 2009, la question s’est posée pour les consommables. Bercy n’était pas favorable à l’élargissement de la taxe aux consommables. Nous sommes déjà l’un des seuls pays d’Europe à taxer la vente d’appareils de reprographie et d’impression. La délocalisation des flux à laquelle conduirait cet élargissement – il est aujourd’hui très facile d’acheter des cartouches en ligne – aurait un impact économique significatif, qui nous paraît démesuré au regard du rendement supplémentaire espéré. Cette piste n’a donc pas été retenue : il a été décidé d’augmenter les taux sans modifier l’assiette – ce qui ne permet pas tout à fait d’atteindre le rendement attendu.
Bref, le débat sur l’avenir des taxes affectées au CNL n’est pas épuisé. À ce stade, nous n’avons pas de réforme « clés en main » à proposer. Le CNL dispose d’ailleurs de ressources qui lui permettent de fonctionner correctement.
M. John Palacin. Nous étions en effet opposés à un élargissement de l’assiette de la taxe aux consommables en raison du risque de déport vers les achats en ligne – on revient ici à la difficulté de territorialiser la recette fiscale à une époque où les échanges peuvent être dématérialisés et où la vente à distance occupe une place croissante.
Nous n’avons pas d’opinion particulière sur le type de taxe qui pourrait être affectée au CNL. On peut opposer le cas du CNC, qui bénéficie du dynamisme de la recette qui lui est affectée, et celui du CNL, qui souhaite bénéficier de nouvelles ressources propres. Mais, dès lors qu’on a fait le choix de l’autonomie pour ces opérateurs, il n’est pas possible d’avoir des « vases communicants ». Il faut donc passer par la loi. La réflexion pourrait s’orienter sur la piste de la publicité en ligne, qui bénéficie de la nouvelle économie et peut supporter une taxation qui permettrait de financer les activités culturelles.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le fonds de roulement du Centre des monuments nationaux (CMN) s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros. Certes, le CMN doit consentir de nombreux investissements très coûteux, notamment en faveur du Panthéon et de la Sainte-Chapelle, et les travaux de conservation de la centaine de monuments qu’il gère ont pris du retard. De nombreux établissements sont en outre déficitaires. Le fonds de roulement ne demeurera donc pas nécessairement à ce niveau. Néanmoins, nous aimerions connaître votre avis sur cette tendance financière – sans doute provisoire.
D’autre part, le CMN s’est vu affecter une partie du prélèvement sur les jeux en ligne dans la limite de 10 millions d’euros par an. Cela vous paraît-il justifié alors que, parallèlement, sa dotation budgétaire a été diminuée d’un montant quasiment identique – 9,5 millions d’euros – dans le cadre de la loi de finances pour 2011 ?
Mme Marie-Astrid Ravon. Je partage le constat de la Cour des comptes sur le niveau élevé du fonds de roulement du CMN, qui atteignait 93 millions d’euros fin 2010 – 46 millions après retraitement, c’est-à-dire après fléchage des opérations programmées. Ce niveau s’explique par le fait que l’équipe de maîtrise d’ouvrage du CMN, laquelle s’est vu transférer la maîtrise d’ouvrage des monuments, a été constituée trop tard pour pouvoir engager réellement les opérations. L’année 2011 sera en effet la première année de fonctionnement de cette équipe, et il est difficile de préjuger de sa capacité à mettre en œuvre tous les projets d’investissement programmés.
Nous entendons être vigilants en cette période de contrainte budgétaire : dans le cadre de l’élaboration du budget de 2012, le CMN devra nous démontrer ses capacités et s’interroger sur sa priorité – la réfection du Panthéon ou d’autres projets.
Quant à l’affectation d’une quote-part du prélèvement sur les jeux en ligne, elle ne s’inscrit pas dans la grille d’analyse que je vous ai présentée. Selon nous, les prélèvements sur les jeux doivent revenir au budget de l’État, et ce type d’affectation rester une exception. Il n’en existe d’ailleurs qu’une autre, au Centre national pour le développement du sport (CNDS), pour financer les grands stades et l’Euro 2016. Il n’est guère dans la tradition française de financer les « bonnes causes » par des prélèvements sur les jeux : cela relève plutôt de la philosophie anglo-saxonne, très éloignée de la nôtre puisque, dans les pays où elle a cours, le financement des politiques culturelles fait plus appel au secteur privé qu’au financement public. Nous n’encouragerons donc pas la multiplication de ce type d’affectations.
Pour éviter que le fonds de roulement ne continue d’augmenter, nous avons réduit le montant de la subvention de l’État à due concurrence de la taxe affectée au CMN. Ces crédits participent cependant de l’objectif du Président de la République de mobiliser des moyens importants en faveur de la restauration et de l’entretien des monuments historiques. C’est dans ce cadre général que doit s’inscrire notre réflexion.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Mesdames, monsieur, je vous remercie pour cette très riche audition.
Audition du 26 mai 2011
À 9 heures : Audition, ouverte à la presse, de Mme Isabelle Lemesle, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN), accompagnée de Mme Patricia Ferré, chef du département des relations avec les élus, de Mme Isabelle Tilly-Backer, directrice des ressources humaines, de M. Brice Cantin, directeur administratif, juridique et financier, et de M. Matthieu Juin-Levite, conseiller de la présidente, chef du département des relations avec le monde de l’entreprise
Présidence de M. Nicolas Perruchot, Rapporteur, puis de
M. Olivier Carré, Président
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons nos travaux relatifs au financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées.
J’accueille en premier lieu aujourd’hui Mme Isabelle Lemesle, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN). Mme la Présidente, je vous souhaite la bienvenue.
Au cours des précédentes réunions, nous avons entendu notamment les directeurs concernés du ministère de la Culture et de la communication ainsi que des représentants des ministères de l’Économie et du Budget. Nous avons également pu échanger avec les porte-parole d’organismes qui, comme le Centre des monuments nationaux, bénéficient de recettes affectées, pour évaluer la façon dont la présence de ces recettes influence leur gestion.
Mme la Présidente, vous connaissez sans doute le principe de la MEC, qui est de formuler des propositions recueillant un consensus sur des politiques publiques ou des thèmes se rapportant à la gestion de l’État. Nous sommes trois rapporteurs, issus de trois groupes parlementaires différents et appartenant aux commissions des Finances et des Affaires culturelles. Mais MM. Richard Dell’agnola et Marcel Rogemont, retenus par ailleurs, vous prient d’excuser leur absence ce matin.
Selon l’usage de la MEC, nous serons accompagnés par des magistrats de la Cour des comptes. Je remercie de sa présence M. Emmanuel Marcovitch, conseiller référendaire, responsable du secteur Culture à la troisième chambre.
Madame, je vous propose de commencer cette audition par un bref propos introductif de quelques minutes avant de passer à notre échange de questions et réponses.
Mme Isabelle Lemesle, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN). Héritier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, créée en 1914, le CMN s’est vu confier progressivement des missions plus étendues. Alors que la Caisse se bornait à encaisser les droits d’entrée dans les monuments historiques de l’État, le CMN est un opérateur intégré : maître d’ouvrage, il développe également une politique culturelle et scientifique, ainsi qu’une approche économique. Il est en outre éditeur.
Ces missions multiples s’inscrivent dans une double temporalité. Nous avons d’abord à conserver pour les générations futures une centaine de monuments, que l’État nous remettait jusqu’à présent en dotation, régime qui a été supprimé en décembre 2008 au profit d’une procédure déconcentrée, mais nous avons aussi à faire connaître ce patrimoine au plus grand nombre de visiteurs. Le CMN est ainsi le premier opérateur public touristique culturel français, avec 8,6 millions de visiteurs accueillis – soit, à titre de comparaison, un peu plus que le Louvre.
Présent dans dix-huit régions, le CMN assure l’ouverture à la visite et la conservation de monuments qui sont les grands témoins de l’histoire de France, mais aussi de l’histoire de l’art et de l’architecture. Cela couvre un vaste champ historique, qui va des grottes ornées de Dordogne – qui datent de 30 000 ans avant Jésus-Christ – aux villas contemporaines de Le Corbusier et de Mallet-Stevens. Le CMN est aussi le premier gestionnaire de sites UNESCO en France.
Depuis 2007, il est également maître d’ouvrage des travaux de conservation et de restauration sur les monuments qui lui sont remis en dotation. Il assure par ailleurs l’ouverture au public d’un certain nombre de monuments qui ne sont pas des monuments nationaux, en particulier des tours et des trésors de certaines cathédrales – qui restent sous la maîtrise d’ouvrage des directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Les monuments confiés au CMN bénéficient d’une politique dynamique de promotion et de communication. Ils font l’objet d’un système de péréquation, les six monuments présentant un résultat bénéficiaire nous permettant d’en ouvrir une centaine sur l’ensemble du territoire. C’est ce que j’appelle un « système de solidarité nationale patrimoniale ».
J’en viens à notre mode de financement. Le budget total du Centre s’élève à 120 millions d’euros, investissement et fonctionnement confondus. L’investissement est pris en charge à hauteur de « seulement » 25 millions par l’État, dont 15 millions sur le budget du ministère de la Culture, le reste provenant d’une ressource affectée. En fonctionnement, nous nous autofinançons à près de 80 % – ce qui est rare pour un établissement public culturel - grâce à des ressources propres constituées à 68 % des recettes de billetterie – environ 41 millions d’euros par an –, à 9 % des recettes tirées de l’occupation domaniale, c’est-à-dire des tournages de films, baux ou concessions de restaurants, et à 17 % des ventes par les boutiques des monuments, auxquelles s’ajoute notre activité éditoriale – nous figurons au 98e rang des éditeurs français.
Le CMN compte 1 269 agents permanents, auxquels s’ajoutent 879 agents occasionnels ou saisonniers, dont 191 équivalents temps plein (ETP) ; 478 des permanents sont des agents de l’État affectés, 711 des agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI). Trois cents personnes travaillent au siège à Paris, et environ mille dans les monuments ; 40 % des agents se consacrent à l’accueil et à la surveillance, 17 % à la billetterie et à la vente, et 33 % occupent des fonctions d’administration et de gestion.
Nous avons remanié notre structure en février 2009 pour intégrer la nouvelle compétence de maîtrise d’ouvrage et nous doter d’une organisation plus efficace nous permettant de développer nos savoir-faire et de mieux nous faire connaître. Nous avons donc mis en place, dans une économie de moyens, un siège expert au service des monuments. Nous avons créé 23 ETP pour exercer la nouvelle compétence de maîtrise d’ouvrage ; hormis ces postes, nous n’avons procédé à aucune création d’emplois. Quatre directions ont été créées : la direction de la maîtrise d’ouvrage, mais également une direction scientifique, une direction des relations extérieures et de la communication – nous n’avions jusqu’ici qu’une direction de la communication qui ne s’occupait ni des relations avec les élus ni des relations internationales, et n’avait pas vraiment les moyens de développer le mécénat – et, enfin, une direction du développement économique : puisque nous vivons essentiellement de nos ressources propres, nous devons nous attacher à les faire croître.
Les monuments sont placés sous la responsabilité d’une trentaine d’administrateurs, chacun en ayant donc plusieurs sous son autorité. Nous avons revu leur profil pour privilégier les bons généralistes, capables d’appréhender sur le terrain l’ensemble des missions du CMN. Nous avons en outre abandonné progressivement le système qui consistait à confier certains monuments à des architectes des bâtiments de France (ABF). Enfin, nous avons établi des organigrammes normés qui clarifient les responsabilités dans les monuments – à ce propos, il faut garder à l’esprit que nos structures administratives sont parfois très légères : trois agents dans les plus petits monuments, contre 80 dans les plus grands.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Je vous remercie pour cette présentation très complète.
Le CMN s’est vu affecter 15 % du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne, dans la limite de 10 millions d’euros par an. Au regard de la modicité, relative, des sommes en jeu, la création de ce système de financement « dérivé » vous paraissait-elle justifiée, sachant que dans le même temps, le CMN a vu ses dotations budgétaires diminuer d’un montant quasiment identique – 9,5 millions d’euros ? Vu de l’extérieur, cela s’apparente à un jeu d’écritures comptables…
Par ailleurs, avez-vous des éléments de prévision quant au produit attendu pour 2011 ? Peut-on améliorer ce dispositif ou faut-il, au contraire, revenir à une budgétisation intégrale des soutiens de l’État ?
Mme Isabelle Lemesle. Cette ressource est importante pour nous, ne serait-ce que parce que l’engagement budgétaire de l’État a, en effet, diminué à due concurrence de la recette. Même si nous n’avons appris qu’elle nous serait affectée qu’au moment de la discussion budgétaire, il ne s’agit pas moins d’un élément structurant dans notre mode de financement. Je comprends que cette somme de 10 millions d’euros puisse paraître modeste au regard du budget de l’État, mais elle représente les deux cinquièmes du financement de notre investissement par l’État et un cinquième du total de notre budget d’investissement, qui s’élève à 50 millions d’euros par an et dont une grande part est donc couverte par l’autofinancement.
Pour des raisons conjoncturelles, nous finançons en effet, cette année, 25 millions d’investissements par un prélèvement sur le fonds de roulement. Comment ferons-nous lorsque ce fonds de roulement aura été ramené – car telle est notre intention – à un niveau courant, d’ici à 2014 ou 2015 ? Outre les charges de conservation des monuments, nous devons faire face à des travaux d’envergure, comme ceux qui figurent dans notre plan pour le Panthéon, dont le coût est estimé à 100 millions d’euros. Nous pouvons engager 30 millions sur les réserves de l’établissement dans les trois années qui viennent, mais quid des 70 millions restants ?
Il ne nous appartient certes pas de décider de notre mode de financement, mais nous constatons que la ressource budgétaire diminue tandis que la taxe affectée qui lui a été partiellement substituée reste plafonnée à 10 millions d’euros. Nous avons donc quelque inquiétude sur notre capacité à financer l’ensemble de notre programme d’investissements.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Avez-vous des éléments sur le rendement de la taxe en 2011 ?
Mme Isabelle Lemesle. Je dois dire que nous avons assez peu de contacts avec nos tutelles sur le sujet…
M. Brice Cantin, directeur administratif, juridique et financier du Centre des monuments nationaux. La taxe présente l’avantage d’être versée par mensualités, ce qui est préférable pour notre trésorerie. Compte tenu des versements effectués depuis le début de l’année, nous estimons que les 10 millions seront atteints d’ici à juillet. C’est donc un bon rendement, qui pourrait être bien supérieur si le versement n’était pas plafonné…
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Vous touchez donc entre un million et un million et demi d’euros par mois ?
M. Brice Cantin. En effet.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Comme la Cour des comptes, qui évoque une situation de « suréquilibre financier », nous sommes quelque peu perplexes quand nous constatons le niveau atteint par le fonds de roulement du CMN. Selon la Cour, cette situation est « amenée à perdurer » et pose donc la question du modèle de financement de l’établissement. Compte tenu de votre plan d’investissements, vous estimez que ce fonds de roulement sera ramené à un niveau proche de zéro en 2014 ou 2015. Je rappelle qu’en 2009, il était supérieur à 60 millions d’euros. Comment en était-on arrivé à cette situation, unique à ma connaissance ? Pensez-vous qu’elle pourrait se reproduire ?
Mme Isabelle Lemesle. La Cour des comptes, qui s’est intéressée au CMN à la demande de la commission des Finances du Sénat, a en effet relevé l’importance de notre fonds de roulement. Celui-ci atteignait 63,1 millions d’euros fin 2009 et 92,9 millions en crédits de paiement fin 2010, sur lesquels nous avons prélevé 26 millions au titre du budget 2011. Cette situation – qui ne doit pas perdurer à mon avis – résulte de deux facteurs. Tout d’abord, les années 2007 à 2010 ont été marquées par une fréquentation soutenue qui, avec 500 000 visiteurs supplémentaires, a procuré 7 à 8 millions d’euros par an. Surtout, un retard considérable a été pris s’agissant de la mise en place de notre nouvelle compétence de maîtrise d’ouvrage. Le décret date de 2007 ; j’ai été nommée en mai 2008 ; nous avons réorganisé la structure en février 2009. Il était prévu que les emplois liés à la maîtrise d’ouvrage soient pourvus par des crédits de personnel du titre 2 et des transferts depuis les DRAC, mais cela n’a pu se faire. Ce n’est donc qu’en janvier 2011 que la direction de la maîtrise d’ouvrage a enfin disposé de l’ensemble des emplois nécessaires à l’exercice de sa mission. Or, durant tout ce temps, les crédits nécessaires à celui-ci avaient été inscrits à notre budget.
Nous nous attachons aujourd’hui à résorber cette sous-consommation de crédits : à la mi-mai, nous avions déjà engagé 17 millions d’euros. L’utilité de nos réserves ne fait cependant pas de doute. Notre programmation 2011-2013 s’articule autour de trois axes : la connaissance de l’état sanitaire du patrimoine qui nous est remis en dotation, par le moyen de diagnostics et d’études pour un coût de 4 millions d’euros ; la conservation des monuments, pour 21 millions d’euros…
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Globalement, l’état sanitaire des monuments est-il correct ?
Mme Isabelle Lemesle. Les grands monuments ont évidemment fait l’objet d’un entretien plus ou moins régulier. Celui-ci reste néanmoins insuffisant puisque les diagnostics font apparaître un besoin de 50 millions d’euros par an pour entretenir, conserver et restaurer le patrimoine qui nous est confié. La situation varie aussi d’un monument à l’autre. Pour améliorer le rendement de la dépense, il importe d’assurer un entretien régulier. Lorsque les DRAC étaient maîtres d’ouvrage, le saupoudrage des investissements était inévitable. Nous concentrons désormais notre investissement sur douze projets majeurs, ce qui permet d’avoir une évaluation globale des monuments concernés et des résultats visibles rapidement, ce sans préjudice pour l’entretien de fond de tous les autres.
Les grands programmes de travaux – qui concernent ces douze projets – représentent 97 millions d’euros, dont 30 millions pour le Panthéon, et les réparations courantes 11 millions. Si l’on y ajoute les aménagements des parcours de visite et d’autres investissements d’un montant de 10 millions, le besoin de financement total s’élève à 156 millions d’euros pour 2011-2013.
Parmi les monuments qui font l’objet de grands programmes de travaux, je citerai, outre le Panthéon, l’Hôtel de Sully où se trouve notre siège et où nous allons prochainement ouvrir de nouveaux espaces au public ; le château de Champs-sur-Marne que nous allons rouvrir après une longue fermeture et d’importants travaux ; le domaine national de Saint-Cloud où nous procédons à des reprises de voirie sur les axes principaux ; la villa Cavrois, chef-d’œuvre de Mallet-Stevens, qui, rachetée par l’État à un promoteur immobilier qui l’avait laissé saccager, sera rouverte au public l’année prochaine ; l’abbaye du Mont-Saint-Michel, les châteaux de Pierrefonds et de Rambouillet…
Notre prévision de recettes s’appuie sur la reconduction de la subvention de l’État – 15 millions d’euros – et de la ressource affectée – 10 millions d’euros. La contribution de l’État s’élève donc à 73 millions d’euros sur trois ans, pour un besoin de financement évalué, comme je l’ai dit, à 156 millions. Le solde de 83 millions sera en partie couvert par autofinancement, notre capacité à cet égard se montant à 12 millions d’euros, et par des recettes de mécénat à hauteur de 3 millions, puisque nous développons une politique active dans ce domaine. Seul l’apport du fonds de roulement nous permettra donc de mettre en œuvre notre programme d’investissement.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Nous aimerions savoir combien a rapporté le placement de la trésorerie du CMN.
M. Brice Cantin. Les rendements sont faibles, car les placements des établissements publics sont très encadrés par la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Je vous ferai parvenir des chiffres précis.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Du moins y a-t-il un rendement…
Au vu de tous ces éléments, la signature d’un contrat de performance nous semble nécessaire. Où en est-on ?
Mme Isabelle Lemesle. Nous sommes nous aussi convaincus de la nécessité de signer ce contrat. Mais pour le mettre en œuvre, encore fallait-il réorganiser l’établissement, qui a connu une révolution culturelle il y a trois ans. Et l’organisation ne faisant que traduire la mise en œuvre d’une politique nouvelle, il convenait d’abord d’établir celle-ci. Ce fut chose faite en février 2009, avec la lettre de mission du ministre. Une fois l’établissement réorganisé, nous avons enfin pu discuter du diagnostic, des objectifs et des indicateurs avec la tutelle. Cela a pris du temps, comme la mise en place de la direction de la maîtrise d’ouvrage, mais la partie diagnostic du contrat est aujourd’hui rédigée. Elle est en cours de discussion avec la tutelle et ne soulève pas de difficulté particulière. Nous arrivons aujourd’hui à l’étape du plan détaillé sur les objectifs, et pouvons donc nous engager à signer le contrat de performance dans l’année.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Vous êtes optimiste !
Mme Isabelle Lemesle. Raisonnablement… Je suis en tout cas déterminée !
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quelle est votre position sur la décentralisation culturelle ? La dévolution aux collectivités territoriales de monuments historiques appartenant à l’État représente-t-elle un risque ou plutôt une chance pour vous ? En d’autres termes, vous prive-t-elle de recettes ou est-elle source d’économies ?
Mme Isabelle Lemesle. C’est évidemment un sujet qui nous préoccupe. Il s’agit à mes yeux d’une question politique et non d’une question administrative ou institutionnelle. Je me réjouis donc que le Parlement s’en saisisse, après la Cour des comptes qui a beaucoup apporté à la réflexion.
Le sujet doit être appréhendé de manière globale. Quel doit être aujourd’hui le rôle de l’État en matière de sauvegarde du patrimoine national ? De diffusion de la connaissance ? Où sont les compétences et les moyens pour exercer ces missions ? Quel est le meilleur dispositif qui nous permette, dans le temps long qui est celui du patrimoine, de préserver l’intérêt général dans des conditions économiques raisonnables ?
Je souscris pour ma part à l’analyse conduite en 2003 par René Rémond dans son rapport sur la répartition entre l’État et les collectivités territoriales des monuments nationaux affectés au ministère de la Culture : doivent demeurer propriétés de l’État tous les lieux de mémoire nationale, les résidences royales et biens de la couronne représentatifs de la constitution de l’État national, les archétypes architecturaux, les sites archéologiques et grottes ornées constituant des réserves ou dont la fragilité et la complexité exigent la compétence de l’État.
Nous ne sommes plus dans les années 1980. Il ne s’agit plus tant, pour les collectivités territoriales que pour l’État, de se déchirer pour s’approprier un monument que de se demander ce que l’on peut faire de mieux, ensemble, pour ce monument dans l’intérêt général. C’est aujourd’hui la position du CMN. Nous essayons, en lien avec les collectivités concernées, de tirer le meilleur des 96 monuments dont nous avons la charge pour les conserver, mais aussi y attirer le plus de touristes possible. À cet égard, nous sommes un acteur économique à part entière. Pour prendre un exemple, il n’y aurait plus d’activité économique à Azay-le-Rideau sans le château !
J’observe par ailleurs que la péréquation que nous assurons permet aux « petits » monuments de bénéficier d’une force de frappe inespérée : nous sommes présents sur trente salons dans le monde ; nous organisons 76 « éductours » par an ; dans nos brochures, le petit château à 2 000 visiteurs par an est traité comme l’Arc de triomphe.
Il convient enfin de mesurer les conséquences de chaque transfert de monument à une collectivité territoriale. Celui du château du Haut-Koenigsbourg, monument bénéficiaire, au département du Bas-Rhin il y a quelques années s’est soldé par la perte de plusieurs centaines de milliers d’euros de bénéfice pour le CMN, autrement dit par un transfert de charges du visiteur au contribuable, puisque le ministère de la Culture verse à l’établissement une subvention compensant cette perte de bénéfice pour lui permettre de continuer à assurer une péréquation. Est-ce bien ce que nous souhaitons ? C’est une question politique à laquelle il ne m’appartient pas de répondre. On vous dira qu’il se passe beaucoup plus de choses au château depuis ce transfert : bien sûr, puisqu’il ne contribue plus à la redistribution. Mais transférer un monument bénéficiaire, c’est aussi prendre le risque d’en fermer dix qui sont déficitaires ! Gardons donc à l’esprit que le CMN a un rôle d’aménagement du territoire.
Quant aux monuments déficitaires, il faut s’assurer, avant de les transférer, qu’ils bénéficieront des mêmes compétences. Nous avons tout de même un siège expert de 300 personnes qui est au service de chaque monument. Il est peu probable que les petites collectivités puissent assurer la même qualité d’expertise. C’est aussi l’étendue de ses compétences qui fait la force du CMN, que beaucoup d’États – je pense par exemple à l’Italie – nous envient.
M. Olivier Carré, Président. Faites-vous appel au mécénat ? Percevez-vous une évolution dans ce domaine ?
Mme Isabelle Lemesle. Le mécénat apparaît comme une voie prometteuse pour le développement de nos ressources propres. Nous avons élaboré pour chaque monument un schéma directeur de développement, à cinq ou dix ans selon les sujets. C’est important pour le mécène, qui souhaite désormais avoir une vision globale du monument. Nous concentrer sur une douzaine de projets par an nous aide par ailleurs à assurer cette visibilité. C’est ainsi que les mécènes vont participer à la réouverture du logis royal du château d’Angers, qui avait brûlé. Nous espérons retirer du mécénat environ trois millions d’euros par an. Parmi nos grands mécènes, je citerai la fondation Velux, qui finance à hauteur de cinq millions d’euros – soit la moitié – les travaux de restauration des verrières de la Sainte-Chapelle, et le groupe Dassault, qui a financé intégralement les 800 000 euros de la restauration des quatre grands reliefs de l’Arc de triomphe.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Comment ces mécènes viennent-ils à vous ?
Mme Isabelle Lemesle. Nous les démarchons. Si le CMN n’était pas un établissement public culturel, je dirais même que nous avons une « démarche commerciale agressive ». Lorsque nous avons un projet global pour un monument, nous évaluons d’abord notre capacité à le financer. Nous élaborons ensuite un dossier qui détaille ce projet, le montant des travaux et ceux pour lesquels nous cherchons des mécènes. Le mécène d’aujourd’hui ne se contente plus de « compléter l’addition » : il veut être associé en amont. Le mécénat de compétence tend à se développer, tout comme le petit mécénat, ce qui est intéressant pour un établissement public en réseau comme le nôtre. Les grandes entreprises françaises étant régionalisées, c’est en effet en région que se prennent les décisions de mécénat, avec un effet d’entraînement sur les PME et sur les chambres de commerce et d’industrie. Pour la restauration du logis royal du château d’Angers, nous avons ainsi pu créer un club de mécènes. Bref, il faut travailler en direction des PME.
M. Olivier Carré, Président. Créez-vous des fondations spécifiques ?
Mme Isabelle Lemesle. Plutôt des clubs de mécènes. Lorsque nous voulons toucher les particuliers, comme ce fut le cas aussi pour le logis royal du château d’Angers, nous passons par la Fondation du patrimoine.
Les mécènes privilégient désormais les projets pérennes – le temps de l’événementiel est révolu – et de préférence solidaires. Ils sont particulièrement intéressés par les projets à dimension sociale, tels ceux qui font intervenir les compagnons ou les chantiers d’insertion. Le mécénat est donc une voie de développement que nous entendons continuer à explorer.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Certains monuments qui ne sont pas dans le giron du CMN vous semblent-ils en danger ? A-t-on cherché à vous en confier ?
Mme Isabelle Lemesle. Le périmètre du CMN ne cesse de fluctuer. Certains monuments, comme le château du Haut-Koenigsbourg ou l’abbaye de Fontevraud, l’ont quitté récemment cependant que d’autres – le château de Rambouillet, la villa Cavrois – y entraient. Il n’est pas rare que le ministre de la Culture nous demande de prendre en charge l’un ou l’autre, appartenant à l’État. En tant que présidente, je ne peux pas ne pas commencer par m’interroger sur les travaux qui doivent être faits sur ce monument comme sur la possibilité de l’ouvrir au public – car le métier du CMN reste l’ouverture au public. Pour prendre un exemple, la situation du château de Gaillon, dans l’Eure, a été évoquée à plusieurs reprises. Sachant qu’il est complètement en ruine et que son attractivité économique et touristique est faible, je ne vois pas l’intérêt de le transférer au CMN. L’alternative est donc simple : soit le ministère de la Culture continue à assurer lui-même sa conservation parce qu’il y a là un témoignage historique essentiel, soit il faut envisager un projet privé. Dans une économie comme la nôtre, l’activité se déploie partout où elle est opportune. Son absence pose donc une vraie question. À ce jour, le château de Gaillon reçoit un entretien minimal de la part de la DRAC, qui est maître d’ouvrage.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Votre portefeuille va-t-il grossir en 2012 ?
Mme Isabelle Lemesle. Pas que je sache. Je rappelle cependant que, depuis le décret de décembre 2008, qui a mis un terme au système d’affectation précédent, le ministre de la Culture n’a plus son mot à dire. C’est avec les préfets que nous passons désormais des conventions, sur une durée déterminée, comme cela s’est produit pour le château de Rambouillet. Cela pose à mon sens une question politique de fond, mais il ne m’appartient pas d’y répondre.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le développement de l’offre de restauration et d’hébergement peut-il constituer une ressource à considérer ? Dans quels monuments l’envisagez-vous ?
Mme Isabelle Lemesle. Cette politique n’est pas nouvelle, mais il est vrai que nous cherchons à améliorer le confort du visiteur : dans l’environnement concurrentiel qui est le nôtre, et au risque de choquer certains, le château d’Azay-le-Rideau doit offrir les mêmes commodités qu’Eurodisney. La présence d’un espace de restauration est un élément de cette « montée en gamme ». C’est pourquoi nous avons conduit une première étude sur le développement de cette offre. Qu’il s’agisse de restauration ou d’hébergement, il apparaît que deux conditions doivent être réunies : il faut que le monument s’y prête et que le projet soit économiquement pertinent. L’étude a porté aussi, plus précisément, sur la possibilité de développer une activité de restauration dans quatorze monuments. Un salon de thé a par la suite été ouvert à Azay-le-Rideau – comme souvent en pareil cas, ce ne fut pas chose simple : les commerçants du village ont menacé de s’enchaîner aux grilles du château en criant à la concurrence déloyale ! Nous avons également décidé de créer des espaces de restauration au Palais du Tau à Reims, dans les communs du château de Champs-sur-Marne et à la villa Cavrois.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Confiez-vous leur gestion à des prestataires extérieurs ?
Mme Isabelle Lemesle. Oui, après une mise en concurrence destinée à trouver le meilleur exploitant possible. Dans les lieux où de tels projets n’auraient aucune pertinence économique, nous nous contentons d’installer des distributeurs de boissons.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Les sociétés intéressées sont-elles plutôt des chaînes de restauration ou des particuliers ?
Mme Isabelle Lemesle. Le marché est trop hétérogène et trop disséminé sur le territoire pour intéresser des chaînes. En règle générale, il s’agit de restaurateurs locaux ayant un goût pour le patrimoine.
Une convention a été signée fin 2009 entre le ministère de la Culture et le secrétariat d’État au Tourisme pour favoriser le développement des lieux d’hébergement. Comme le premier métier du CMN n’est pas d’ouvrir des hôtels, mais d’ouvrir des monuments au public, cela suppose de trouver un lieu qui puisse accueillir cette activité sans que les visites en soient perturbées, l’idée étant qu’elle est avant tout là pour contribuer au financement de notre mission culturelle. La rentabilité économique du projet doit cependant être assurée, aussi bien pour l’exploitant que pour le CMN. L’étude que nous avons lancée concernait cette fois vingt monuments. Nous nous concentrons aujourd’hui sur quatre d’entre eux. L’offre envisagée va du gîte rural au quatre-étoiles selon les lieux. Nous remettrons en juin une étude précise au ministre de la Culture, qui tranchera. Il nous faudra alors rechercher des partenaires privés. On touche ici à un sujet délicat, que j’ai à connaître par ailleurs en qualité de membre de la commission chargée de réfléchir à l’avenir de l’Hôtel de la Marine. Il s’agit en effet de travaux qui sont sans commune mesure avec l’installation d’un salon de thé. Or la loi actuelle ne permet pas de conférer systématiquement des droits réels. L’État doit certes rester propriétaire, mais il faudra trouver une solution à ce problème juridique.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Ne peut-on envisager un bail emphytéotique administratif ?
Mme Isabelle Lemesle. Hormis le cas de l’Hôtel de la Marine, qui a fait l’objet d’une loi spécifique en juillet 2010, le bail emphytéotique administratif n’a pas encore été étendu à l’ensemble des établissements publics administratifs de l’État. Peut-être trouverons-nous des instruments juridiques qui heurtent moins les sensibilités, mais on ne contraindra pas les acteurs privés. Nous l’avons nous-mêmes éprouvé lorsque nous avons cherché un exploitant – ce sera finalement Angelina – pour le futur restaurant de l’orangerie de l’Hôtel de Sully. L’exploitant ne peut constituer de fonds de commerce, alors même qu’il prend en charge les travaux. Beaucoup de restaurateurs, dont des gens renommés, sont venus visiter les lieux mais ont refusé de prendre le risque, estimant que le régime du contrat administratif ne leur offrait pas une sécurité suffisante.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Du point de vue de la gestion interne, y a-t-il une différence entre les ressources budgétaires et les ressources affectées ? Ayant connu des allers et retours entre les deux, avez-vous une préférence pour l’un ou l’autre de ces modes de financement ?
Mme Isabelle Lemesle. Comme l’a relevé la Cour des comptes, ces allers et retours ont été imposés au CMN de l’extérieur. Confronté à une crise de financement des travaux patrimoniaux, le Gouvernement a estimé opportun à une époque d’affecter à l’établissement une recette de 70 millions d’euros pour financer des travaux, y compris sur un patrimoine dont il n’était pas chargé… Je n’ai pas de jugement à porter sur le procédé, mais il est clair que le sujet n’avait pas été bien étudié. La ressource affectée a donc été rebudgétisée. En réalité, le problème n’avait pas été pris dans le bon sens. Une première question concernait la maîtrise d’ouvrage sur les cathédrales : il est vite apparu qu’elle n’avait rien à faire dans le périmètre du CMN. Il fallait par ailleurs – ce que nous avons fait par la suite – réorganiser l’établissement, recruter les personnels compétents et mettre en œuvre la compétence de maîtrise d’ouvrage, car on ne donne pas de l’argent à un établissement qui n’est pas en situation de le dépenser efficacement.
Les choses sont toutes différentes avec la taxe affectée d’aujourd’hui. C’est une ressource certaine – plus qu’une ressource budgétaire qui peut être modifiée en cours d’année. Pour un établissement comme le nôtre, qui programme ses travaux à dix ans, c’est un réel avantage. En devenant maître d’ouvrage, nous avons constaté que les travaux nécessaires avaient été ajournés dans de nombreux monuments faute de certitude sur le financement de la deuxième tranche. Bénéficier d’une recette affectée d’un montant garanti pour plusieurs années est donc fondamental pour le CMN, et nous ne souhaitons pas revenir au système antérieur. Au Parlement de dire ce qu’il entend faire du patrimoine national, emblématique de la mémoire de la Nation, et de prendre une décision sur le mode de financement. Pour notre part, nous sommes favorables à ce système de taxe affectée, et même à son déplafonnement.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le CMN a-t-il le droit d’emprunter ?
M. Brice Cantin. Oui, mais ce droit est soumis à autorisation. En pratique, nous n’en usons pas.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la Cour des comptes a constaté un défaut d’attractivité de la filière accueil-surveillance-magasinage, qui comptait 478 ETP en 2009. Faut-il envisager une externalisation de ces fonctions ? Quelles en seraient les conséquences budgétaires ?
Mme Isabelle Lemesle. Notre principal problème tient au statut des agents censés être sous l’autorité du président de l’établissement. Je ne connais aucun patron qui ne recrute lui-même ses collaborateurs, et qui ne puisse ni les promouvoir, ni les sanctionner. Or la plupart des 478 agents dont vous parlez ne sont pas des agents du CMN – ils ne se perçoivent d’ailleurs pas comme tels. Ce sont des agents du ministère de la Culture affectés à notre établissement, qui ignorent l’autorité hiérarchique de proximité – l’administrateur du monument.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Diriez-vous que c’est un État dans l’État ?
M. Olivier Carré, Président. … ou dans l’établissement !
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le CMN n’est, hélas, pas le seul établissement culturel dans ce cas.
Mme Isabelle Lemesle. Nous voulons que cela change. Le plus facile serait de détacher les agents mais cela ne semble pas possible pour les agents de catégorie C. En outre, comme la Cour des comptes l’a relevé, l’insuffisance des effectifs contraint l’établissement à recruter des contractuels sur des postes d’agent. Comment gérer dans un même monument deux catégories qui vivent différemment l’exercice de leurs fonctions ?
Vous m’interrogez sur l’opportunité d’une externalisation. Encore faudrait-il que le secteur privé soit à même de répondre à la demande. Personnellement, je n’en suis pas certaine : nos monuments sont disséminés sur l’ensemble du territoire ; dans les petits monuments, l’agent d’accueil fait tout, de l’accueil proprement dit à la caisse en passant par le nettoyage des toilettes. Cette polyvalence est une qualité rare.
Il faut ensuite s’interroger sur le coût de la mesure. À cet égard, les quelques expériences d’externalisation que nous avons tentées sont économiquement édifiantes. La surveillance nocturne de la villa Savoye, chef-d’œuvre de Le Corbusier, située en zone sensible à Poissy, a longtemps été assurée par un agent logé – fort mal – sur place. Lorsque nous l’avons relogé ailleurs, nous avons fait appel à une société de gardiennage. Le surcoût par rapport au système précédent est de 30 %.
M. Olivier Carré, Président. Pourquoi ne pas avoir réhabilité l’appartement ?
Mme Isabelle Lemesle. Il s’agissait d’une pièce de vingt mètres carrés, dans laquelle il n’était décemment plus possible de loger quelqu’un. Par ailleurs, le pavillon fait partie de l’ensemble corbuséen : il convenait donc de mettre fin à son occupation.
Pour conclure, la solution la plus facile me semble être le détachement, moyennant bien sûr un transfert de masse salariale.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le ministère de la Culture y est-il opposé ?
Mme Isabelle Lemesle. Il ne nous donne aucune indication précise. Rappelons qu’il s’agit d’un ministère extrêmement sensible sur le plan social.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le détachement me semble tout de même envisageable.
Mme Isabelle Lemesle. Si vous savez comment faire détacher des agents de catégorie C, donnez-moi la marche à suivre !
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Je pense que nous y arriverions pour peu que la tutelle y soit favorable.
Mme Isabelle Lemesle. Les termes du problème sont simples. Pour ouvrir un monument, nous avons besoin – pour des raisons de sécurité et sauf à réduire les heures d’ouverture – d’un nombre minimum d’agents. À partir de là, il y a un choix politique à faire : recourt-on à des fonctionnaires ou à des contractuels ? Ou à l’externalisation, qui a aussi un coût ? Je demande simplement que l’État nous donne les moyens d’exercer la mission qu’il nous a confiée. À lui de trancher !
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Je vous remercie pour cette intéressante audition.
Audition du 26 mai 2011
À 10 heures : Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Renard, directeur du Centre national des variétés et du jazz (CNV)
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. J’accueille maintenant M. Jacques Renard, directeur du Centre national des variétés et du jazz (CNV).
Vous connaissez le principe de la MEC, qui est de formuler des propositions recueillant un consensus sur des politiques publiques ou des thèmes se rapportant à la gestion de l’État. Deux des trois rapporteurs, MM. Richard Dell’Agnola et Marcel Rogemont, retenus par ailleurs, vous prient d’excuser leur absence ce matin. C’est donc M. Nicolas Perruchot qui vous posera les questions qu’ils ont préparées en commun.
Selon l’usage de la MEC, nous serons accompagnés par la Cour des comptes, en la personne de M. Emmanuel Marcovitch.
Monsieur le Directeur, vous pourriez dans un premier temps nous présenter le Centre national des variétés et du jazz, en rappelant brièvement ses principales missions, son organisation et les défis auxquels il est actuellement confronté.
Puis les questions porteront plus particulièrement sur vos recettes.
M. Jacques Renard, directeur du Centre national des variétés et du jazz (CNV). Créé au début des années 2000, le CNV est un établissement public industriel et commercial qui a succédé à l’Association du fonds de soutien aux variétés, elle-même issue en 1986 du Fonds de soutien au théâtre privé.
Il a pour fonction de percevoir une taxe de 3,5 % sur tous les spectacles relevant du champ des musiques actuelles et des variétés et d’en redistribuer le produit aux professionnels et aux entrepreneurs de spectacles – et non aux artistes – via dix commissions. La répartition passe par un double mécanisme de droit de tirage et d’aide sélective.
Nous jouons donc le rôle d’un petit Centre national du cinéma dans le secteur de la musique actuelle et des variétés : perception d’une taxe obligatoire et redistribution aux bénéficiaires. Le droit de tirage, qui n’est pas totalement automatique, représente 65 % de la redistribution et les aides sélectives absorbent les 35 % restants, la différence avec le CNC étant à cet égard très faible.
Nous aidons au développement économique des entreprises de spectacles et, à travers ce soutien, contribuons à la promotion de la diversité culturelle et artistique. Notre mission première est en effet de rassembler la profession, d’en fédérer les acteurs, qui sont très divers, et, grâce au mécanisme de mutualisation que je viens de décrire, de faire reposer sur le succès rencontré par les grands spectacles l’aide au développement d’artistes, aux nouveaux talents, aux salles de spectacles, aux résidences de musiques actuelles et aux festivals, lesquels sont souvent déficitaires.
Nous sommes également chargés, par délégation du ministère de la Culture, du programme Zénith – dix-sept salles en France. De nouveaux projets apparaissent, notamment de construction de salles de spectacles. Nous disposons par ailleurs d’un centre de ressources qui joue un rôle d’observation, d’information, d’expertise et de conseil auprès des professionnels et qui publie les documents que nous vous avons adressés, notamment les rapports d’activité. Nous organisons des débats, des conférences et des réunions. Nous disposons enfin de réseaux de promotion commerciale, afin de faciliter l’accès des entreprises de spectacles à la publicité par voie d’affichage, notamment dans les gares ou les stations de métro, ce qui leur permet de trouver de nouveaux spectateurs.
L’évolution de la taxe est positive depuis trois ans : son produit est passé de 17 millions en 2007 à 23,5 millions en 2010, l’augmentation dépassant même 16 % l’année dernière. Cette progression repose sur le succès rencontré, surtout en 2009, un peu moins en 2010, par les grands spectacles, les grosses productions ou les gros festivals. De plus, les cabarets font à présent partie de notre champ de compétence : ils ont généré, surtout les cabarets parisiens, des recettes non négligeables en 2010.
Cette augmentation des recettes ne doit pas masquer la situation très difficile du spectacle vivant musical : si les grosses productions marchent très bien, les petites et les moyennes salles et les spectacles centrés sur les artistes « en développement » et les nouveaux projets connaissent en revanche une diminution de leurs recettes, en raison d’une baisse des réservations et de la fréquentation dont les responsables de salles nous disent qu’elle s’accentue cette année. Seuls échappent à ce phénomène certains festivals rassemblant un large public.
Il faut donc se méfier de l’effet trompe-l’œil que pourraient produire l’augmentation des recettes de la taxe et le succès rencontré par les grands spectacles. La réalité, c’est que la profession est confrontée à de graves difficultés.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Monsieur le directeur, l’établissement a-t-il toujours bénéficié de ressources affectées ? Qu’est-ce qui a motivé le recours à ce type de financement ? Quels en sont les avantages et les inconvénients par rapport à un financement sur crédits budgétaires ? Seriez-vous enclin à préférer un financement par subventions de l’État ?
M. Jacques Renard. Le fonctionnement de l’établissement a toujours reposé sur cette taxe affectée. Lors de sa création, il a bénéficié d’une aide en fonctionnement du ministère de la Culture d’un montant d’un million d’euros, qui a été, il y a deux ans, réduite à 100 000 euros. Nous recevons de plus, pour le programme de résidences de musiques actuelles que nous gérons par délégation du ministère, une subvention couvrant les dépenses et les aides correspondantes.
La taxe affectée est liée à la mission même de l’établissement, qui est une mission de mutualisation des ressources au service de l’intérêt général de la profession. Les grands spectacles de Johnny Hallyday ou de Mylène Farmer financent les artistes en développement par le biais des aides sélectives qui ne vont pas en priorité, vous vous en doutez, aux spectacles les plus courus.
Comme je l’ai dit, le produit de la taxe a augmenté entre 2007 et 2010. Outre cet avantage conjoncturel, notre mode de financement a celui de nous faire échapper aux conséquences des difficultés rencontrées par les finances publiques, nationales ou locales : par les temps qui courent, les subventions augmentent rarement ! Il nous rend autonomes, nous épargnant la probable stagnation de nos moyens d’intervention que nous aurions éprouvée si nous vivions des subventions de l’État.
Les inconvénients sont le revers des avantages : en cas de baisse des recettes et des tarifs des gros événements musicaux, nos propres recettes diminueraient également, ce qui entraînerait la diminution des aides que nous apportons. Tel n’est pas le cas aujourd'hui et, en dépit des difficultés actuelles, les perspectives sont bonnes pour les grosses productions en 2012. De plus, les cabarets, récemment entrés dans notre « giron », nous offrent encore une marge de progression : en effet, nous n’avons touché pour l’instant que les cabarets parisiens. Nous étendons donc notre fonction d’explication de la taxe aux cabarets de province.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Cela se passe-t-il bien ?
M. Jacques Renard. Oui, parce que nous travaillons avec la chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques. Nous avons réuni l’ensemble des cabarets de province pour effectuer auprès d’eux un travail de pédagogie. Nous essayons de ne pas apparaître d’abord comme une administration fiscale mais comme un établissement qui a une mission à remplir. En tant qu’administration fiscale, nous ne recourons au bâton qu’en cas de besoin.
Nous avons également une marge de progression liée au caractère déclaratif du dispositif : tous ceux qui devraient payer la taxe ne la versent pas, soit par méconnaissance
– c’est le cas des petits spectacles ou des spectacles d’amateurs, occasionnels ou de comité des fêtes –, soit par oubli – dans ce cas, nous rappelons notre existence. Cela étant, les progrès que nous pouvons espérer de ce côté se traduiront plus par une augmentation du nombre de redevables que par une augmentation de la masse fiscale, car il s’agit pour l’essentiel de petits entrepreneurs.
Nous améliorons également notre capacité de recouvrement et de contentieux : il y a deux ou trois ans, l’établissement ne disposait pas encore d’un agent comptable à temps plein, ce qui est le cas désormais. Cette plus grande rigueur dans la perception de la taxe nous permettra d’accroître nos ressources dans les deux ou trois prochaines années.
M. Olivier Carré, Président. Qu’en est-il des spectacles dits « gratuits » ?
D’autre part, votre tarification prévoit-elle un montant en dessous duquel vous ne percevez pas la taxe ?
M. Jacques Renard. En cas de spectacle gratuit, la taxe a pour assiette le montant du contrat de cession du producteur à l’organisateur du spectacle. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de cession, nous ne percevons aucune taxe.
Par ailleurs, lorsque la taxe perçue, au terme de l’année civile, est inférieure à 80 euros, nous la remboursons en début d’année suivante, conformément à la loi de finances
– c’est un système informatique qui nous signale les bénéficiaires de ce remboursement. Cela permet d’épargner les petits spectacles, auxquels nous sommes très attentifs. Si tous les spectacles sont redevables de la taxe, nous ne voulons pas décourager les spectacles occasionnels ou d’amateurs. La loi s’applique donc à eux avec une certaine souplesse puisqu’ils doivent générer plus de 80 euros de taxe pour que le CNV la conserve.
M. Olivier Carré, Président. Il existe, pour les administrations, des dispositions réglementaires fixant des montants minimaux – autour de 150 euros, je crois – en dessous desquels une taxe n’est pas recouvrée, compte tenu des coûts de gestion afférents aux prélèvements. Vous préférez donc, vous, percevoir, puis rembourser…
Quel est le montant des recettes provenant des spectacles dits « gratuits » ?
M. Jacques Renard. Ils doivent procurer quelque 5 % des recettes.
M. Olivier Carré, Président. Que représentent-ils en nombre de dossiers ?
M. Jacques Renard. De mémoire, le pourcentage doit être du même ordre : 5 %.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Les entrepreneurs de spectacles, cabarets compris, qui ont versé la taxe ont la garantie d’un retour des deux tiers, le troisième tiers étant versé à un pot commun et attribué sous forme d’aides aux projets. Ne préféreriez-vous pas percevoir 1,5 % sans retour plutôt que 3,5 % avec un retour des deux tiers ?
M. Jacques Renard. Le droit de tirage n’est pas totalement automatique : l’entrepreneur de spectacles doit faire état de projets de production dans les vingt-quatre mois qui suivent le paiement de la taxe pour demander à en bénéficier ; son dossier passe alors devant une commission, dont la réponse est positive dans 99 % des cas.
Le taux de la taxe était à l’origine de 1,75 %. Lorsqu’il a été porté à 3,5 %, le consensus entre l’administration et les professionnels s’est fait pour le partage actuel de la redistribution : 65 % en droit de tirage et 35 % en aides sélectives – je précise que l’assiette de la taxe est hors TVA. Ce retour de 65 % garantit aux entreprises de spectacles une aide très appréciée pour monter leurs nouveaux projets. Elles sont donc soucieuses de préserver le système, qu’il s’agisse du droit de tirage ou des aides sélectives, même si elles peuvent avoir de temps à autre des mouvements d’humeur.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Votre taux de satisfaction des demandes d’aides est élevé : près de 83 % des dossiers instruits en commission sont acceptés, ce qui peut conduire à s’interroger sur la force et la pertinence des critères de sélection. Ne conviendrait-il pas de les revoir ? Le taux évolue-t-il ou est-il stable ?
M. Jacques Renard. Il existe à la fois des critères de recevabilité administrative et des critères d’appréciation, lesquels constituent, pour les commissions, comme un fil conducteur.
Le taux d’acceptation est variable selon les commissions – s’il est de 99 % pour le droit de tirage, il est plus bas pour les dossiers d’aides sélectives.
Cette proportion élevée s’explique par la professionnalisation croissante du secteur, professionnalisation qui était très peu développée dans les années quatre-vingt, voire au début des années quatre-vingt-dix encore. Les professionnels étant de plus en plus au fait des mécanismes et connaissant les écueils à éviter, les dossiers qu’ils présentent répondent de mieux en mieux aux critères d’appréciation de la commission. Du reste, le taux de recevabilité des dossiers était un des indicateurs chiffrés figurant dans le précédent contrat de performance passé avec le ministère de la Culture.
Cela étant, avant mon arrivée, l’établissement avait, à la suite de la crise, mis en place un plan de soutien de deux ans en faveur des entreprises dont l’existence était menacée et la commission d’attribution de ces aides était très sélective. Ce plan a fait place cette année à un autre type d’aide aux entreprises en difficulté et, pour avoir participé à la commission, je puis vous dire que nombre de dossiers ont également été rejetés.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quel est le poids du CNV dans l’ensemble de l’économie du secteur ?
M. Jacques Renard. Les chiffres 2009 de la diffusion font apparaître des recettes de billetterie de 600 millions d’euros pour 40 000 représentations et 20 millions de spectateurs. Le chiffre de 600 millions d’euros est certes sous-estimé puisque nous ne couvrons pas la totalité des spectacles : toutefois, les véritables professionnels ne font aucune difficulté pour verser la taxe, ce qui nous permet de la percevoir sur la majorité des grosses recettes. Notre budget étant de 25 à 30 millions d’euros avec l’ajout des recettes commerciales et des subventions, nous pesons quelque 5 %.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quelle est l’évolution du chiffre d’affaires ?
M. Jacques Renard. En 2009, elle a été très positive en raison du nombre élevé de grosses productions et de l’augmentation de leurs tarifs, le tout générant des recettes importantes. Le public a suivi – il n’est qu’à mentionner les tournées de Johnny Hallyday ou de Mylène Farmer ou certains grands festivals.
Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs de 2010, la taxe pouvant être payée jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante. Nous observons déjà un ralentissement en raison des difficultés que j’ai déjà évoquées, ralentissement qui est compensé en termes de recettes par les revenus issus des cabarets et de quelques grosses productions. Celles-ci ont toutefois été moins nombreuses qu’en 2009 mais on note un ressaisissement cette année et, en 2012, de très grosses productions permettront au secteur de redémarrer.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le cycle n’est donc pas annuel…
M. Jacques Renard. L’évolution est très difficile à prévoir car nous ne connaissons pas toutes les grosses productions à l’avance. Certains spectacles étrangers sont annoncés très en amont alors que la visibilité, pour d’autres, n’est qu’à deux, trois ou quatre mois. Ainsi plusieurs grands spectacles, qui généreront une billetterie importante, sont prévus pour le mois de juin 2011 au Stade de France mais nous l’ignorions il y a trois mois à peine.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Les producteurs attendraient-ils pour se lancer ?
M. Jacques Renard. Certains projets ont besoin de temps pour être montés, comme la Nuit africaine qui se déroulera au Stade de France le 11 juin prochain : 55 000 spectateurs ont déjà réservé des places dont le prix moyen tourne autour de 40 à 50 euros. Je puis donc déjà avoir une idée des recettes que percevra le CNV. Or les organisateurs du projet n’étaient pas certains il y a encore deux mois de pouvoir le monter, pour des raisons de visas notamment.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Le produit de la taxe est partagé entre le CNV et l’Association pour le soutien au théâtre privé (ASTP). Afin d’éviter tout risque de dispersion des actions et des moyens, ne faudrait-il pas préférer à l’actuel partage des tâches et de la taxe une centralisation des missions et des financements publics ?
M. Jacques Renard. Il n’y a pas à proprement parler partage puisqu’il existe deux taxes : une sur les spectacles de variétés, l’autre sur les spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques. Le débat que nous avons avec nos amis de l’ASTP porte sur la délimitation des deux catégories de spectacles, et plus particulièrement sur l’appartenance des comédies musicales à l’une ou à l’autre.
En effet, les comédies musicales traditionnelles – une opérette d’Offenbach, par exemple – relèvent de l’ASTP, les autres du CNV, mais la frontière est très floue… et nos deux organismes ont une conception extensive, qui du traditionnel, qui du non traditionnel !
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Qui tranche en cas de désaccord ?
M. Jacques Renard. En cas de désaccord persistant, le décret prévoit une commission d’arbitrage, placée sous l’autorité du ministre de la Culture.
La tendance actuelle est à la multiplication des spectacles conflictuels. Les décrets de 1976 donnent des définitions contestables des musiques actuelles, des variétés et de la chanson ou des spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques. Que sont le théâtre musical, une comédie musicale, un spectacle d’humour ? Tout cela est un peu ubuesque car la vie artistique se nourrit de transdisciplinarité, du croisement des genres, tandis que nos deux institutions essaient chacune de tirer à elle le maximum de taxes.
Le ministère, l’ASTP et le CNV réfléchissent depuis plusieurs années à une solution. Pour modifier les décrets, il faudrait arriver à une rédaction consensuelle, ce qui est très difficile. Un projet de circulaire, l’année dernière, n’a pas fait consensus. L’idéal serait peut-être d’avoir un organisme unique, mais la réalité des professions fait que chacun est attaché à son territoire.
Mais le problème est encore plus vaste. Le ministère a lancé une mission sur le financement de la diversité musicale à l’ère numérique et va bientôt en annoncer une autre sur le financement du spectacle vivant. Or nous sommes concernés par les deux. La première approche, qu’on pourrait dire verticale car intéressant la filière qui réunit l’édition, la production discographique et le spectacle vivant, pourrait conduire à la création d’un Centre national de la musique, en partant, peut-être, du CNV. Le spectacle vivant musical s’allierait alors à la production discographique. Dans la seconde approche, le point de vue est horizontal – théâtre, danse et musique classiques, danse et musique actuelles –, l’idée étant de créer une Agence nationale du spectacle vivant : nous y serions au titre du spectacle, le problème de frontière entre l’ASTP et le CNV étant alors résolu à des conditions satisfaisantes.
Il existe donc deux approches possibles pour notre établissement : celle de la filière musicale et celle du spectacle vivant, puisque nous appartenons aux deux.
Néanmoins, notre débat avec l’ASTP ne nous empêche pas de vivre : les conflits ne portent que sur les spectacles dont la définition peut faire problème, ce qui est loin d’être la majorité.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Lequel des deux organismes craint le plus une éventuelle fusion ?
M. Jacques Renard. Personne ne l’envisage ! Le CNV est un système en expansion, contrairement à l’ASTP, constituée pour l’essentiel par le regroupement de la quarantaine de théâtres privés parisiens. C’est pourquoi elle est plus sur la défensive que nous, ce qui explique sa tentative de mainmise sur les comédies musicales non traditionnelles : ce genre étant en plein développement, elle y voit un moyen de sortir de sa relative stagnation.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Elle a, semble-t-il, peur de l’absorption. Mais, pour un observateur extérieur, une fusion semblerait logique.
M. Olivier Carré, Président. Tout dépend de la finalité ultime des deux établissements. Est-elle identique ? L’ASTP, me semble-t-il, se préoccupe avant tout de soutien alors que le CNV tend davantage à favoriser l’affirmation de nouveaux talents.
M. Jacques Renard. L’ASTP s’occupe du théâtre privé – je le répète : essentiellement de la quarantaine de théâtres privés parisiens.
M. Olivier Carré, Président. Il aurait peut-être été plus judicieux de lui attribuer les cabarets…
M. Jacques Renard. Non, car les cabarets présentent des spectacles de variétés, de divertissement et de music-hall, qui relèvent de notre champ de compétence.
Les théâtres privés ne souhaitent pas du tout la fusion avec le CNV : ils ont leurs traditions, leurs règles ; un consensus interne préside à leurs relations. La finalité de l’ASTP est de les préserver des menaces qui pèsent sur eux, en particulier sur leurs salles.
Notre logique est différente. Les variétés se trouvaient jadis logées dans une sorte d’annexe du Fonds de soutien au théâtre privé mais l’enfant s’est développé depuis et est devenu plus grand que le parent ; nos artistes ne souhaitent pas une fusion qui serait un retour en arrière.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quelle est l’attitude des redevables de la taxe ? La jugent-ils légitime et adaptée à la réalité économique ? Proposent-ils des dispositifs alternatifs ?
M. Jacques Renard. Les professionnels qui organisent de grosses tournées ou qui s’occupent du « développement » d’artistes sont très attachés au système parce qu’ils ont compris l’intérêt du mécanisme de redistribution et les avantages procurés par l’établissement public : information, possibilité de dialoguer avec le reste du secteur…
À l’intention des petites associations, nous organisons un grand nombre de réunions sur le terrain pour faire connaître et expliquer la taxe. Depuis mon entrée en fonction, je me suis personnellement déplacé une vingtaine de fois pour discuter avec elles, avec les professionnels et avec les élus locaux, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, voire intercommunal. Je cherche à toucher tous ceux qui sont potentiellement concernés par la taxe. Nous ne rencontrons ni hostilité ni rejet – à moins que nous n’ayons à réclamer à des organisateurs le paiement rétroactif de la taxe.
Je me suis entretenu récemment avec les responsables d’une fédération qui regroupe 2 500 comités des fêtes : la rencontre a été très fructueuse. Ils souhaitent coopérer avec le CNV et j’irai début juin à leur congrès national pour présenter à plusieurs centaines de présidents de comités les activités du CNV et le mécanisme de la taxe. Développer ainsi l’information permet d’arrondir les angles au besoin. Nous allons bientôt tirer à 20 000 exemplaires une nouvelle plaquette de présentation du CNV et la diffuser sur l’ensemble du territoire.
M. Olivier Carré, Président. Pensez-vous vraiment que les responsables de comités des fêtes s’inscrivent dans la même logique que les grands organisateurs de spectacles ? En tant qu’élu local, je doute qu’ils voient la taxe avec les mêmes yeux : pour eux, c’est une simple dîme, surtout en l’absence de recettes.
M. Jacques Renard. La logique partagée est artistique et musicale.
M. Olivier Carré, Président. La loi a assurément institué le CNV en vue de soutenir la création, mais il n’est pas certain que l’artiste qui se produit dans une simple salle des fêtes entre dans cette logique. Constatez-vous l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes dans les spectacles de salles des fêtes ou le phénomène n’est-il qu’anecdotique ?
M. Jacques Renard. Tous les artistes qui ont acquis une notoriété ont débuté dans de petites salles.
M. Olivier Carré, Président. Je n’en disconviens pas, mais certains types de spectacles resteront très circonscrits à un certain public, indépendamment de la qualité de l’artiste.
M. Jacques Renard. Les recettes de la taxe permettent de financer le renouvellement artistique.
Aussi bien la SACEM que le CNV peuvent être mal perçus par les organisateurs des spectacles occasionnels ou par les responsables de comités des fêtes, mais je n’ai pas le sentiment que nous nous heurtions à un rejet violent de la taxe.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Les professionnels du spectacle anticipent-ils la transposition de la directive européenne « services » et ses conséquences sur l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles ? Comment vous y préparez-vous vous-mêmes ?
M. Jacques Renard. Jusqu’à maintenant, l’entrepreneur européen ou non européen devait s’adosser à un entrepreneur français. Désormais, l’entrepreneur européen non établi en France pourra y organiser un spectacle en procédant à une simple déclaration préalable, les entrepreneurs non européens – et donc les Américains, dont la part n’est pas négligeable – continuant de devoir s’adosser à un entrepreneur français.
Nous ne sommes pas capables d’évaluer le nombre de ces opérateurs européens qui produiront des spectacles en France sans s’y établir, mais nous travaillons avec le ministère de la Culture et avec les professionnels à une adaptation du dispositif de perception de la taxe puisqu’ils devront, de toute façon, la payer. Ils pourront même bénéficier du système d’aide dans les mêmes conditions que leurs homologues français, mais à condition qu’ils s’affilient au CNV.
Il convient toutefois de noter que les entrepreneurs européens soumis au régime de la déclaration préalable ne seront pas obligés de prendre une licence, alors que les entrepreneurs français y sont contraints pour être affiliés à l’établissement : il y aurait donc inégalité entre eux et il faudra prévoir un dispositif d’analyse des dossiers de ces entrepreneurs européens permettant d’y remédier.
Cela étant, il s’agira le plus souvent de spectacles occasionnels ou temporaires, sinon ces entrepreneurs s’installeraient en France, comme certains l’ont déjà fait – ainsi Live Nation, qui est affilié au CNV et à une organisation syndicale. Or, si le nombre de représentations est égal ou inférieur à six, il n’est pas, aujourd'hui, nécessaire de prendre une licence d’entrepreneur de spectacles. Peut-être conviendrait-il de s’inspirer de cette règle pour les entrepreneurs européens non établis en France : ils ne pourraient pas bénéficier du système d’aide s’ils ne donnent pas plus de six représentations. Ce serait une autre façon de rétablir l’égalité.
Le dispositif n’est pas encore arrêté. Nous y travaillons depuis plusieurs mois avec les professionnels et avec le ministère de la Culture. L’objectif est d’être prêts à la rentrée. Nous nous sommes également interrogés sur la traçabilité de la perception de la taxe. Nous avons proposé au ministre de la Culture et obtenu, avec l’accord, semble-t-il, du ministère des Finances, une modification du code général des impôts permettant l’institution d’un système de représentation fiscale : l’entrepreneur européen non établi en France sera contraint de recourir à un représentant fiscal qui, à sa place, s’acquittera des formalités et versera la taxe sur les spectacles de variétés. Ce dispositif permettra d’assurer le versement effectif de la taxe.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Comment vivez-vous les rachats ou les regroupements d’entreprises de production ? Je pense à Gilbert Coullier Production, à Jean-Claude Camus Production ou encore à Marc Ladreit de Lacharrière, qui n’appartenait pas au secteur de la production. Je ne les accuse pas de faire de l’optimisation fiscale en vue d’échapper à la taxe, mais la concentration peut favoriser l’évasion fiscale si les sociétés sont basées ailleurs qu’en France.
M. Jacques Renard. Ce point agite beaucoup la profession. Depuis quelques années, on peut distinguer quatre types de nouveaux entrants : les multinationales, comme Live Nation ; les producteurs de disques qui font du « 360° » et deviennent producteurs de spectacles ou, comme Warner, prennent des participations dans des sociétés d’entreprises de spectacles ; les grandes entreprises de communication comme Lagardère, qui a pris des participations dans des sociétés d’exploitation de salles ou de production de spectacles ; enfin, des sociétés extérieures au secteur culturel, comme la FIMALAC de M. Ladreit de Lacharrière – encore que celui-ci ne soit pas étranger à ce domaine.
La profession craint non sans raison une concentration, verticale ou horizontale : Live Nation est aujourd'hui producteur de spectacles, organisateur de festivals, gestionnaire de salles et il vient de racheter Ticketnet qui est le deuxième réseau de distribution de billets en France. Il s’agit là d’une concentration verticale caractérisée. Le CNV a constitué un groupe de travail sur les moyens de préserver la diversité culturelle et artistique face aux conséquences de ces concentrations. Ne conviendrait-il pas d’imiter le cinéma, secteur extrêmement réglementé – notamment du point de vue financier – grâce au CNC et à un dispositif anti-concentration, et pourvu de surcroît d’un médiateur ? Rien de tel n’existe pour le secteur des musiques et du spectacle vivant, exception faite de la réglementation sur les droits d’auteur et de celle sur les entreprises de spectacles. Nous réfléchissons donc à cette possibilité mais ne nous est-elle pas fermée ? Nous sommes un secteur ouvert et rien ne dit que les institutions européennes seraient d’accord…
Il convient en tout cas de préserver l’écosystème du spectacle vivant musical : les producteurs doivent conserver la possibilité de monter des projets assurant le renouvellement artistique. Telle est la question d’intérêt général qui se pose à la profession.
M. Olivier Carré, Président. La profession doit également relever le défi d’Internet : toucher les réseaux artistiques en se faisant connaître sur la Toile ne coûte quasiment rien.
M. Jacques Renard. C’est vrai, la révolution numérique n’affecte pas seulement la musique enregistrée, mais également, du moins potentiellement, le spectacle vivant. Il peut y avoir des représentations de spectacles vivants sur la Toile, soit en direct, soit en différé. Le phénomène est assez peu développé pour l’instant, mais des projets de cette nature existent. La filière musicale et le ministère de la Culture s’interrogent : comment préserver les capacités de création et de production dans l’environnement numérique ?
J’ai suggéré trois pistes pour étendre le champ de la taxe sur les spectacles de variétés. La première concerne précisément les représentations sur Internet : dès lors qu’il s’agit de nouveaux spectacles, pourquoi ne pas les imposer ? Le ministère de la Culture réfléchit lui-même à une taxation des fournisseurs d’accès pour financer la création musicale. Pourquoi, par exemple, ne pas s’appuyer sur la taxe sur les spectacles de variétés ?
Ma deuxième suggestion concerne les spectacles qui font l’objet de retransmissions dans des salles, notamment de cinéma, en direct ou en différé. Le phénomène est en pleine expansion. N’y aurait-il pas lieu d’appliquer la taxe sur les spectacles de variétés à ces représentations ?
Enfin, les parcs de loisirs du type Disneyland ou Parc Astérix donnent des spectacles parfois liés à des attractions permanentes mais qui peuvent aussi en être totalement indépendants. Or ces parcs ne versent pas la taxe sur les spectacles de variétés. J’ai commencé de prendre des contacts en vue de corriger cela et je ne désespère pas d’arriver à mes fins avec l’aide des pouvoirs publics.
M. Olivier Carré, Président. On constate que 57 % des redevables versent moins de 1 000 euros de taxe, procurant 3 % seulement de vos recettes. Compte tenu du coût de recouvrement, est-il rentable de maintenir ces recettes ?
M. Jacques Renard. Il faut maintenir la solidarité de l’ensemble de la chaîne : les professionnels du spectacle y sont très attachés. D’autre part, le recouvrement des taxes sur les petits spectacles ne représente qu’une part négligeable de nos frais de fonctionnement et de personnel – ces 57 % de redevables n’occupent pas 57 % de notre temps de travail ! Pour l’essentiel, nos frais sont liés au mécanisme général de perception de la taxe auprès des professionnels et à la répartition des aides sélectives.
M. Olivier Carré, Président. Je vous remercie, monsieur le directeur.
Audition du 26 mai 2011
À 11 heures : Table ronde sur le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), avec la participation de : MM. Guy Verrecchia et Marc Lacan, coprésidents de l’Association des producteurs indépendants (API), accompagnés de Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale ; M. Jean Labbé, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) ; M. Victor Hadida, président de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) ; M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ; M. Stéphane Le Bars, délégué général de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Dans le cadre de son programme consacré aux organismes alimentés par des taxes affectées, la Mission d’évaluation et de contrôle s’est entretenue avec les responsables du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et, après cette audition, il lui a paru nécessaire d’entendre aussi ceux qui sont à la fois les contributeurs et les bénéficiaires du compte de soutien : une partie notable des aides revenant de manière automatique à ceux qui les financent, on peut en effet s’interroger sur l’intérêt de maintenir ce qui peut apparaître comme une « boîte aux lettres ».
D’autre part, l’irruption du numérique a induit bien des bouleversements. Dans la mesure où les flux financiers se déportent vers ces nouveaux supports, il peut être tentant de courir après l’innovation, mais l’économie de ce secteur n’est pas du tout la même que celle des modes de diffusion traditionnels. Qu’attendez-vous d’une institution qui se pose de plus en plus comme un régulateur, fût-il bienveillant ?
Le rôle du législateur étant d’évaluer la pertinence des outils existants, nous souhaitons un dialogue ouvert et sans tabous.
M. Guy Verrecchia, coprésident de l’Association des producteurs indépendants (API). Un autre l’a dit avant moi : si le cinéma est un art, il est aussi une industrie. Le talent ne se décrétant pas, la politique française a toujours été d’offrir les meilleures conditions économiques pour encourager la création. Le principal pilier de cette intervention, poursuivie sous tous les gouvernements, est le fonds de soutien, et nous avons aujourd’hui le recul suffisant pour affirmer qu’il a fait la preuve de son efficacité : le cinéma français connaît un succès exceptionnel, en termes d’entrées comme de parts de marché ; de surcroît, beaucoup de films étrangers sont coproduits par des producteurs français.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, nous sommes contributeurs du compte de soutien, et ce à hauteur de 11 % de nos recettes. Nous percevons le dispositif à la fois comme une épargne forcée et comme une incitation aux investissements, dans les salles comme dans les films, puisque, sans investissements de notre part, nous serions privés d’une part de financement.
Selon nous, non seulement le système garde toute sa pertinence, mais il doit être renforcé : la numérisation, qui bouleverse la donne de la concurrence par la multiplication des contenus, rendra nécessaires de nouveaux investissements dans les cinq prochaines années.
J’ajoute que, si nous représentons des organisations distinctes, nous avons l’habitude de débattre entre nous au sein du Bureau de liaison de l’industrie cinématographique, avec le souci de dépasser l’intérêt particulier de chaque branche pour servir l’intérêt général du secteur.
M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le système de financement, qui reposait il y a cinquante ans sur les seules recettes des salles de cinéma, a vu depuis son assiette s’étendre : aux chaînes de télévision, à la vidéo, à la vidéo à la demande – ou VàD – et, plus récemment, aux fournisseurs d’accès à Internet – FAI. Il est certes légitime de se demander si, dans ces conditions, il a conservé toute sa pertinence mais il faut bien voir aussi que l’année 2010, au cours de laquelle les recettes du CNC ont augmenté de 30 %, restera probablement une exception. Tous les voyants étaient alors au vert : forte fréquentation des salles ; reprise économique pour les chaînes de télévision ; développement de la vidéo à la demande et du Blu-ray ; enfin et surtout, hausse des recettes issues de la taxe sur les FAI. Mais ces derniers ont depuis perdu le bénéfice du taux réduit de TVA, ce qui a d’ores et déjà eu deux effets qui nous laissent craindre une forte diminution des encaissements du CNC.
Il s’agit, en premier lieu, du comportement d’optimisation fiscale à laquelle se livre Free : lorsque les FAI bénéficiaient d’une TVA à 5,5 %, cette entreprise avait en effet obtenu un rescrit fiscal aux termes duquel l’offre de télévision était supposée représenter 56 % de la valeur de l’abonnement, ce qui portait à un niveau élevé sa contribution au compte de soutien ; mais, depuis l’an dernier, Free considère son offre de télévision comme une option de l’abonnement, proposée à 1,99 euro par mois : l’assiette de sa contribution – qui est aussi celle de la rémunération des auteurs – s’en trouve considérablement réduite.
En deuxième lieu, alors qu’un certain nombre de FAI avaient une lecture pour le moins extensive de la réglementation relative aux offres « triple play », dans lesquelles ils intégraient toutes les offres de télévision, y compris celles destinées aux téléphones mobiles, celles-ci sont désormais exclues de l’assiette de contribution au compte de soutien. Si rien ne vient contrer ces deux évolutions, on peut prévoir un retour aux niveaux antérieurs du compte de soutien, voire une diminution de celui-ci. Il nous paraît donc indispensable de réfléchir aux moyens de sécuriser juridiquement l’assiette de contribution.
Les bouleversements dus à l’arrivée du numérique doivent effectivement nous amener à nous interroger sur la politique du CNC. Le numérique entraîne d’abord la multiplication des canaux de diffusion ; d’où la nécessité de maintenir les aides existantes, qu’elles soient automatiques – pour soutenir l’industrie cinématographique et audiovisuelle dans son ensemble – ou sélectives – pour garantir la diversité de la création artistique dans ce secteur. Mais, au-delà de ce rôle traditionnel, il est essentiel que le CNC mène une politique ambitieuse en faveur de la création et de la diffusion numériques, comme il a commencé de le faire avec les aides aux nouveaux médias, qu’on les appelle transmedia ou cross-media – et le décret « web COSIP » pris au début de cette année a ouvert le bénéfice du compte de soutien aux productions sur Internet – et avec le plan de numérisation des salles et des œuvres. Pour ces dernières, l’action du CNC porte plutôt sur les films a priori peu rentables – les crédits du Grand emprunt étant plutôt destinés aux longs métrages.
D’une façon plus générale, toute contribution doit donner lieu à retour et l’aide à la numérisation en est un. Nous avons tout intérêt à l’amplifier, l’enjeu étant culturel aussi bien qu’industriel : c’est la condition d’une présence massive de la création française sur l’ensemble des réseaux et de la préservation de notre industrie cinématographique et audiovisuelle. Mais il en va aussi du développement d’offres légales, attractives et variées, sans lesquelles la démarche pédagogique de la loi HADOPI ne suffira jamais à combattre efficacement la piraterie.
M. Jean Labé, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Le compte de soutien est vital pour le maintien de notre parc de salles de cinéma. Cette épargne forcée, selon l’expression de Guy Verrecchia, a obligé les exploitants à investir pour améliorer la qualité de ces salles – au reste, aucune entreprise digne de ce nom ne peut laisser dormir un compte sans dommages.
Le plan numérique entraîne des besoins de financement d’autant plus considérables que la transition doit être aussi brève que possible : la coexistence du 35 millimètres et du numérique se traduit en effet par des surcoûts pour les producteurs, pour les distributeurs et pour les exploitants et on estime que, d’ici à la mi-2013, ces derniers devront investir environ 400 millions d’euros. Or le plan triennal du CNC en faveur des salles économiquement fragiles ne représente que 80 millions…
Ces besoins ne se tariront pas une fois le basculement achevé : d’une part, même si on ignore quelle sera la durée de vie des matériels, il est sûr qu’elle sera inférieure à vingt ans ; d’autre part, les salles de cinéma, où les films prennent vie et acquièrent leur notoriété, doivent se moderniser en permanence. Or, selon le Livre blanc que nous avons publié, les coûts d’investissements ont progressé beaucoup plus vite que le prix des places.
Le système actuel est globalement satisfaisant. Pour la taxe spéciale additionnelle (TSA), le taux de retour est légèrement inférieur à 50 %. Compte tenu des besoins de financement que je mentionnais à l’instant, nous aimerions atteindre ce seuil et l’avons dit au CNC qui nous a donné des assurances en ce sens. Cela étant, les aides automatiques reversées aux exploitants le sont selon une logique partiellement sélective, redistributive, puisqu’elles diminuent à mesure qu’augmente le nombre d’entrées : elles équivalent à 30 % de la TSA versée quand ce nombre dépasse un million, et à 80 % au minimum du barème. Quant aux aides sélectives, elles vont aux salles d’art et d’essai et, au titre d’un soutien à l’investissement, aux salles ayant peu de moyens financiers – beaucoup d’exploitants ne pourraient moderniser leurs équipements sans cet apport.
Il faut par exemple vingt ans pour récupérer, via le compte de soutien, un investissement de 6 ou 7 millions d’euros – soit le prix d’un petit multiplex – ; mais, en vingt ans, on doit renouveler les équipements plusieurs fois. Non seulement les aides du compte de soutien sont utiles, mais il faudrait donc les augmenter dans les prochaines années, ce qui permettrait d’ailleurs d’alléger celles que donnent les collectivités territoriales, dont les budgets sont de plus en plus serrés.
M. Stéphane Le Bars, délégué général de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA). Guy Verrecchia invitait à ne pas baisser la garde ; je rappellerai, pour ma part, que la puissance d’un pays se mesurera de plus en plus à sa capacité de production et de diffusion des images sur les réseaux : la présence dans ce secteur sera tout aussi essentielle que dans l’aéronautique ou le nucléaire. Le compte de soutien aura donc à venir en appui à une production audiovisuelle nécessairement croissante.
Une étude canadienne a récemment montré qu’aux États-Unis, la consommation de contenus de divertissements représentait aujourd’hui 50 % du trafic sur Internet et devrait approcher les 60 % à la fin de l’année. En Europe, la proportion est déjà de 33 %.
En France, depuis une dizaine d’années, le volume de production audiovisuelle est relativement stable – entre 4 000 et 4 500 heures en moyenne – ; mais il devrait atteindre les 5 000 heures dès cette année, et de 6 000 à 7 000 heures dans un avenir proche. La première cause, mécanique, est la multiplication du nombre de chaînes sur la TNT. Certaines d’entre elles arrivent aujourd’hui à maturité et peuvent investir dans la fiction ; ainsi, NRJ12 est en train de conclure son appel d’offres pour une série comportant cent épisodes de 26 minutes. Cet investissement dans la fiction, notamment dans les séries, s’explique aussi par le besoin d’affirmer une identité dans un contexte fortement concurrentiel. Mais la production française est également amenée à augmenter parce que nos chaînes de télévision devront réduire leur dépendance à l’égard des séries américaines, dépendance devenue malheureusement très forte depuis quatre ou cinq ans : en effet, ces séries font l’objet d’une diffusion de plus en plus « délinéarisée », de sorte que les consommateurs peuvent y avoir accès par d’autres médias.
M. Victor Hadida, président de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF). Pour les raisons exposées par les précédents intervenants, les recettes auront plutôt tendance à diminuer et nous devons donc nous préoccuper des moyens de maintenir une institution qui est à peu près unique en Europe, non pour ce qui est de sa fonction de régulation, mais pour son rôle de soutien à la politique culturelle. Grâce à son action en faveur de la production et de la distribution nationales comme en faveur de la diversité des œuvres distribuées, le CNC a permis à la France d’enregistrer 200 millions des 900 millions d’entrées en salle comptabilisées en 2010 en Europe !
Les interventions du CNC ont aussi un rôle correcteur puisque le système des aides automatiques, Jean Labé l’a rappelé, est lui-même très redistributeur. Vous avez parlé à son sujet de « boîte aux lettres », monsieur le président, mais, dans le domaine de la distribution, la redistribution peut aller jusqu’à 140 % pour les films réalisant peu d’entrées, contre 15 % pour ceux qui en réalisent entre 500 000 et un million.
Par ailleurs, l’aide automatique est structurante pour l’industrie car elle suppose un réinvestissement. L’aide sélective, elle, va à des œuvres peu diffusées et corrige les effets de la concurrence. Si elle ne représente que 7 millions d’euros, contre 20 millions pour l’aide automatique, elle contribue à la diversité culturelle.
Les œuvres du patrimoine et les nouveautés seront numérisées, mais toutes les autres, que l’on peut appeler les œuvres de catalogue, ne pourront plus être projetées au sein du nouveau parc numérique. Il convient de leur étendre l’effort consenti.
On sait par ailleurs que le cinéma est le dernier maillon du secteur audiovisuel à être atteint par la numérisation : il doit rattraper son retard sur la télévision et la vidéo à domicile ; d’où d’importants besoins de financement, notamment au cours de la période transitoire pendant laquelle les distributeurs devront financer à la fois la diffusion de films en 35 millimètres et celle des films numérisés.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quelles pistes suggérez-vous pour améliorer le système des taxes affectées au CNC ?
M. Guy Verrecchia. Comme vous l’avez compris, nous espérons plutôt, au moins dans les prochaines années, une intensification globale des aides sans bouleversement de la répartition actuelle, vu l’importance des investissements à effectuer. L’équilibre actuel du compte de soutien, constitué au fil des ans, nous semble pertinent.
M. Jean Labé. Au cours des dernières années, les aides sélectives ont augmenté beaucoup plus que les aides automatiques ; on peut s’en féliciter, mais il ne faut pas que cette évolution se poursuive à l’infini : le soutien à la diversité serait vain si nous laissions péricliter le socle industriel.
M. Stéphane Le Bars. L’année 2010 a été particulière puisque, comme l’a rappelé Guillaume Prieur, tous les voyants étaient au vert alors qu’en 2008 et 2009, la chute des recettes publicitaires de TF1 et de M6 avait réduit d’autant les ressources du compte de soutien. Par ailleurs, même si le marché de la vidéo représente une faible part des recettes du CNC, il connaît une décroissance qui ne s’arrêtera peut-être que lorsque le Blu-Ray et la vidéo à la demande auront pris le relais. Une multiplicité de taxes nous semble donc nécessaire pour compenser le déphasage des marchés : 2010 reste de ce point de vue une année à part.
M. Olivier Carré, Président. Multiplicité d’assiettes, plutôt que multiplicité de taxes !
M. Marc Lacan, coprésident de l’Association des producteurs indépendants (API). Même si ce n’est pas forcément très visible, le système a beaucoup évolué au cours des dernières années. L’aide automatique porte d’ailleurs mal son nom, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’investissements ; elle n’est pas une pompe aspirante-refoulante qui prend et rend aux mêmes ; elle prend à tout le monde et rend à ceux qui investissent. C’est grâce à ce système que la production française détient 37 % de parts de marché et que, tous les ans, cent nouveaux écrans voient le jour et deux cents films sont produits.
Au demeurant, ce système automatique peut également être dit objectif, puisque c’est le public qui est juge, moyennant le correctif de la redistribution, et ce dans les domaines de l’exploitation, de la distribution comme de la production. À la fin de 2010, le CNC a ainsi fortement corrigé le barème du compte de soutien producteur, puisque le taux de retour a été réduit de 40 % à seulement 10 % pour les films réalisant plus de cinq millions d’entrées.
L’aide automatique, qui absorbait 75 % des dépenses du compte de soutien il y a trente ans, n’en consommera plus que 52 % en 2011. La question, dès lors, est de préserver l’aide sélective des critiques formulées pour distorsion de concurrence, et aussi, dans la logique qui est la vôtre, de l’évaluer en fonction d’objectifs dont on peut se demander s’ils prennent suffisamment en compte, aujourd’hui, l’évolution du secteur. L’année 2010, par exemple, a été celle de la 3D : faut-il abandonner ce secteur à l’industrie américaine, ou faire en sorte que le cinéma français y soit également performant ?
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Y a-t-il, dans des pays comparables à la France, des opérateurs analogues au CNC ?
M. Guy Verrecchia. Il y en a dans d’autres pays européens, mais qui ont plutôt un caractère administratif, pour ne pas dire bureaucratique : ils ont une fonction de contrôle, souvent sous la tutelle du pouvoir politique, sans avoir les moyens d’intervention dont le CNC dispose grâce au compte de soutien.
L’absence d’organisme comparable suggère d’ailleurs, en creux, la pertinence du modèle français : le cinéma italien, qui était naguère aussi florissant que le nôtre, a connu un net déclin, ce que nous ne pouvons que déplorer. En effet, à cette époque, les coproductions avec la France étaient nombreuses et les goûts des deux publics s’étaient rapprochés.
M. Olivier Carré, Président. La gestion de l’« épargne forcée », selon votre expression, n’aurait-elle pu assumée par les professionnels organisés en filière ? En France, il est rare que les branches s’organisent ainsi, mais c’est, à mon avis, ce qui explique les difficultés de certains secteurs. Est-il indispensable que l’État joue un rôle dans ce dispositif ? Le voyez-vous en garant de votre bonne entente à tous ?
M. Guy Verrecchia. Depuis ses débuts, le CNC ressemble à Janus : il représente les professionnels auprès de l’administration, et incarne celle-ci pour ces mêmes professionnels. Cela étant, si les professionnels doivent contribuer à définir la politique du CNC, notamment au sein du futur conseil d’administration, je ne crois pas souhaitable qu’ils gèrent seuls l’épargne forcée dont je parlais. Que l’administration soit chargée de cette tâche est au demeurant rassurant, même si l’on peut poser le problème du coût, et le secteur, à mon avis, pourrait difficilement envisager une autre organisation.
Sans remettre en cause l’aide sélective, nous estimerions utile que chaque commission définisse une doctrine et des objectifs clairs, et établisse des bilans réguliers de ses décisions : celles-ci y gagneraient sans doute en cohérence et cela éviterait les soupçons de « copinage ».
M. Marc Lacan. Vous avez posé la question du rôle de l’État dans ce dispositif, monsieur le président…
M. Olivier Carré, Président. Le système américain, qui ne dépend pas de l’État fédéral, a lui aussi fait ses preuves.
M. Marc Lacan. La tradition française est sans doute plus étatiste. Quoi qu’il en soit, le cinéma américain n’a pas besoin du relais de la puissance publique.
Le fonds de soutien contribue au rayonnement du cinéma français dans le monde ; les accords multilatéraux permettent à des cinéastes iraniens ou africains, par exemple, de s’exprimer.
M. Stéphane Le Bars. Le coût de gestion du CNC est tout à fait raisonnable, puisqu’il ne représente que 5 à 6 % de son budget.
M. Olivier Carré, Président. Soit environ 30 millions d’euros.
M. Stéphane Le Bars. Je veux revenir sur l’effet redistributif des aides qui, dans l’audiovisuel, joue beaucoup entre les genres : si la fiction de prime-time et l’animation sont respectivement financées par les chaînes de télévision à hauteur de 70 % et de 30 % au plus, le compte de soutien assure un certain rééquilibrage puisque sa contribution est dans le premier cas de 10 % et dans le second de 20 %. C’est ce qui a permis à l’industrie française de l’animation d’être la troisième dans le monde et de loin la première en Europe.
M. Jean Labé. Le CNC est le lieu de la concertation entre les professionnels et, tels que ceux-ci les ont arrêtés, les taux différenciés des soutiens à la distribution ont un caractère objectif : aucun exploitant ne songerait à diminuer le nombre de ses entrées pour percevoir davantage d’aides ! À ma connaissance, il n’existe pas, aux États-Unis, de système comparable pour les salles.
M. Guillaume Prieur. Il est essentiel que ce soient les pouvoirs publics qui gèrent le compte de soutien. Le CNC, d’ailleurs, s’apparente un peu à une direction d’administration centrale que l’on aurait extraite du ministère de tutelle, et la gestion des aides relève aussi de logiques politiques.
Les critiques portant sur l’attribution des aides sont beaucoup plus nombreuses dans le domaine du spectacle vivant que dans celui du cinéma. Néanmoins, il peut être utile en effet que les commissions établissent chacune sa doctrine en la matière et publient des bilans.
M. Olivier Carré, Président. Je vous remercie pour ces contributions.
Audition du 9 juin 2011
À 9 heures 30 : Table ronde, ouverte à la presse, d'éditeurs de services de télévision : M. Philippe Bony, directeur adjoint des programmes en charge de la production de M6 métropole télévision et Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des études règlementaires ; M. Yann Le Prado, responsable des acquisitions sur Direct 8 et directeur général adjoint de Direct Star ; M. Gérald Brice Viret, directeur général du pôle télévision de NRJ 12 et Mme Françoise Marchetti, secrétaire générale de Pôle Télévision ; M. Christian Vion, directeur général adjoint en charge de la production et des moyens des antennes de France Télévisions et Mme Anne Grand d’Esnon, directrice des relations institutionnelles ; M. Fabrice Blancho, directeur de la production d’Arte-France
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Je vous souhaite la bienvenue devant notre mission d’évaluation et de contrôle, qui a choisi de s'intéresser plus particulièrement cette année au financement des politiques culturelles de l'État par des ressources affectées. Dans ce cadre, il nous a paru nécessaire de rencontrer des représentants de ceux qui contribuent au financement des organismes du domaine culturel, en s'acquittant des taxes parafiscales, et qui bénéficient aussi de leurs actions. Ainsi, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) reçoit beaucoup d'argent des éditeurs de services de télévision que vous représentez, mais il leur en redistribue également beaucoup, indirectement, par le soutien qu’il apporte au secteur de la création audiovisuelle. Procède-t-il de la sorte à une régulation utile à la profession ? C'est une des questions que nous vous poserons ce matin. Je vous indique que les représentants de TF1 et Canal + ne pouvant être présents, leurs contributions écrites nous seront adressées ultérieurement.
Issus de groupes parlementaires différents et appartenant aux commissions des Finances et des Affaires culturelles, nos rapporteurs sont Richard Dell’Agnola, Nicolas Perruchot et Marcel Rogemont, ce dernier étant retenu ce matin en séance publique. Ils sont assistés par la Cour des comptes, représentée aujourd’hui par M. Antoine Mory et Mme Blandine Sorbe, auditeurs à la troisième chambre.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Nous aimerions tout d'abord savoir si les taxes affectées au CNC et dont vous être redevables vous paraissent légitimes. Sont-elles adaptées au regard des évolutions du secteur de l'audiovisuel ?
M. Yann Le Prado, responsable des acquisitions sur Direct 8 et directeur général adjoint de Direct Star. Les chaînes de Bolloré Médias, en particulier Direct 8 et Direct Star, contribuent fortement, via la « taxe COSIP » (compte de soutien à l'industrie de programmes), aux ressources du CNC. Depuis qu'elles existent, 6,2 millions d'euros ont été prélevés de la sorte, pour moitié au cours de la seule année 2011. Si l’on y ajoute les contributions aux sociétés d'auteurs comme la SACEM et à d'autres sociétés de gestion collective comme la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), pas moins de 16 millions d'euros ont été alloués par nos chaînes à la création dans son ensemble, somme qui ne comprend bien évidemment pas tous les achats que nous effectuons, lesquels contribuent également à la création, en finançant les distributeurs et les producteurs.
Outre qu'elle nous retarde dans notre recherche d'un équilibre financier, cette taxe nous paraît injuste pour une société en développement comme la nôtre car elle est assise sur un pourcentage du chiffre d'affaires, et il est plus pénalisant d'être privé de 55 000 euros sur un chiffre d'affaires total d’un million d'euros que de 5,5 millions sur 100…
L'objectif de cette taxe est toutefois légitime puisqu’il s’agit d'aider la création. Ce sont surtout les œuvres audiovisuelles originales à vocation patrimoniale qui bénéficient du compte : fictions, animations, documentaires, captations de spectacles vivants, magazines présentant un intérêt culturel, vidéo-musiques.
Par un choix de positionnement éditorial, nous ne faisons pas d'animation. Qui plus est, nous ne sommes pas encore à même de financer nous-mêmes des fictions, genre dont la fabrication est très onéreuse – je ne parle pas de la fiction low cost, qui ne donne guère que des audiences au rabais. Le système nous bénéficie donc moins qu’aux chaînes historiques.
En revanche, nous pouvons escompter des aides pour la captation de spectacles vivants, notre convention nous faisant obligation de capter chaque année une vingtaine de spectacles inédits. Pourtant, nous nous sommes aperçus que les producteurs avec lesquels nous travaillons avaient la plus grande peine à se faire aider par le CNC. En effet, les critères d'attribution de l’aide sélective sont assez opaques et subjectifs, comme si le projet, le producteur et la chaîne étaient appréciés a priori. Pour parler clairement, Direct 8 n'est pas Arte, la première faisant souvent l'objet d'un a priori négatif et la seconde d'un a priori positif, au nom d'une vocation culturelle supposément plus affirmée… Nous avons ainsi les plus grandes difficultés à trouver des producteurs aidés pour réaliser des captations de qualité.
La situation est identique pour le documentaire de création. Direct 8 s'est engagé dans une politique de production de documentaires tout à fait respectables, sur des sujets difficiles, comme celui sur la situation des transsexuels au Bangladesh – diffusé d'ailleurs également sur Arte. En l'occurrence, le producteur a obtenu l'aide du CNC. Mais nous avons aussi développé sous une « marque ombrelle », Quartier général, une série de documentaires de prime time, forme de cinéma du réel avec une qualité d'écriture, une vraie vision de l'auteur, un montage original et soigné, un commentaire très personnel, et pour lesquels nous prenons énormément de risques. Or, parce que certains perçoivent, de façon subjective, ces émissions comme relevant davantage du magazine que du documentaire, nous avons de grandes difficultés à obtenir des aides. C'est dommage ! Direct Star commande aussi des documentaires musicaux de très grande qualité à des producteurs extérieurs, qui parviennent souvent à se faire aider par le CNC, ce qui n'est pas le cas de nos productions internes, qui portent pourtant sur les mêmes sujets et sont de même qualité.
Le dispositif actuel devrait en outre être remis à plat car il me paraît inadapté à l'arrivée des télés connectées : certains acteurs, parfois même basés à l'étranger, vont pouvoir dégager des profits avec des contenus aidés par le CNC sans avoir contribué eux-mêmes au financement de cet écosystème.
M. Gérald Brice Viret, directeur général du pôle télévision de NRJ 12. NRJ 12 est une jeune chaîne issue de la génération TNT de 2005, mais surtout une chaîne « isolée » puisque nous sommes ici les seuls à ne disposer que d’une seule chaîne sur la TNT.
La production française est au cœur de notre écosystème car cela nous permet de défendre une ligne éditoriale distincte et de maîtriser nos coûts de grille : nous travaillons avec 50 producteurs, avec un coût de grille plafonné pour les prochaines années.
Je m'étonne que le dernier rapport du CNC laisse entendre que les chaînes de la TNT ne participent quasiment pas au financement de la production française. Prétendre que leur part dans ce financement ne dépasse pas 1 % est absurde : en réalité, en proportion de leurs chiffres d’affaires, la plupart des chaînes de la TNT surinvestissent dans leurs programmes, notamment dans la production française. Ainsi, depuis sa création, NRJ 12 a investi 47 millions d'euros et le dernier bilan du CNC montre que nous sommes en 2010 au premier rang des chaînes de la TNT pour le volume d’heures commandées et au deuxième pour l’investissement financier.
Nous sommes favorables à la taxe CNC sur les diffuseurs parce qu'elle est légitime et parce que le principe redistributif est valide en théorie. Pour autant, nous jugeons la pratique actuelle insatisfaisante.
Depuis 2005, nous avons versé un montant cumulé de plus de 10 millions d’euros de taxe au CNC, tandis que ce dernier n’a aidé les productions que nous avons initiées qu’à hauteur de 3 millions. Nous avons donc « reçu » presque un quart de ce que nous avons « donné ». Certes, il serait mathématiquement impossible que tous les contributeurs soient gagnants dans un système redistributif, mais d’habitude les petits reçoivent plus qu’ils ne donnent, puisque le système vise à les soutenir.
Depuis un peu plus de deux ans, nous diffusons chaque jeudi en première partie de soirée Tellement Vrai, magazine-documentaire pour lequel nous faisons travailler 29 producteurs différents, y compris des petites sociétés indépendantes. Nous avons commandé au total 395 heures de documentaires pour ce seul magazine, en y investissant en propre plus de 10 millions d'euros. Mais le CNC n’a soutenu que 115 heures, c’est-à-dire moins d’un tiers du volume. Pourquoi nos partenaires producteurs n’ont-ils pas été aidés pour les deux autres tiers ? En fait, quand un producteur bénéficie de l’aide automatique, il est aidé dans 90 % des cas. S’il ne l’est pas – en général parce que c’est un nouvel entrant – il doit passer par l’aide sélective et il est alors aidé dans 1 % des cas…
En théorie, tout devrait être fait pour privilégier l’aide sélective, puisque, à projet de production comparable, elle est censée donner des chances égales à tous les producteurs, quels que soient leur ancienneté, leur taille et le volume de leur production passée. Le problème est qu’elle est parfois beaucoup trop sélective car excessivement liée à l’appréciation personnelle et subjective de professionnels, dont la vision de la télévision pourrait être qualifiée d’élitiste – j’en ai été témoin en tant que membre de la commission dans le collège représentant minoritaire des diffuseurs. Même si cette commission a fait un travail très important, il faudra optimiser son fonctionnement pour aider d’avantage les nouvelles écritures qui sortent des schémas classiques.
Permettez-moi enfin de proposer quelques pistes en vue d’améliorer le système.
Elles sont multiples pour ce qui concerne le versant réglementaire, relatif au mécanisme de redistribution du produit de la taxe. On pense d’abord à la fiction, dont la production est en baisse dans notre pays notamment parce que le réservoir de fiction lourde de prime time s’est asséché, après avoir été surexploité pendant deux décennies. Ce type de fiction a de plus en plus de mal à rencontrer un public nombreux. En revanche, la demande du public reste forte pour un nouveau type de fiction, de day time, qu’il faut absolument encourager, en les survalorisant grâce aux aides du CNC.
Autre piste, sortir enfin de la vision étroite de la fiction strictement patrimoniale, de la production « noble », qui est la seule que les quotas audiovisuels prennent en compte et qui est inadaptée au nouveau paysage audiovisuel à l’heure des téléviseurs connectés.
Enfin, il conviendrait que le mécanisme de soutien prenne en compte certains critères objectifs du statut de diffuseur commanditaire des productions. Il faudrait, notamment que les productions lancées par des chaînes indépendantes, qui ne profitent de facto ni des synergies de groupe ni de la mutualisation des obligations de production, bénéficient, en compensation, d’un soutien accru du CNC.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quelle est la différence entre des fictions de day time et de prime time ?
M. Gérald Brice Viret. La France est pratiquement le seul pays en Europe ou la fiction nationale vient après la fiction américaine. Il y a une dizaine d'années, nous avions énormément de fictions de day time ou de fin d'après-midi, comme Marc et Sophie ou Hélène et les garçons. Ce terreau, qui a fait émerger des centaines de talents – auteurs, acteurs, réalisateurs – a aujourd'hui disparu, en dehors de Plus belle la vie sur France 3, et Scènes de ménages sur M6, mais qui sont dans un autre créneau horaire. C'est pourquoi je propose au législateur que les fictions diffusées l'après-midi, quand il est plus simple pour une chaîne de la TNT d'aller chercher l'audience, soient décomptées des heures de grande écoute. Il faut un vrai élan national pour aider et valoriser la fiction de day time, un peu low cost. Nous avons déjà fait une tentative il y a deux ans, avec L'été où tout a basculé ; d'autres chaînes de la TNT, comme TMC, l'ont fait, avec un succès prometteur. À l’heure des télévisions connectées, je suis persuadé qu'il faut se battre pour développer cette fiction, comme on le fait en Angleterre, en Allemagne et en Espagne.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Il ressort de ces deux premières interventions que vous souhaiteriez que les commissions du CNC élaborent une charte afin de clarifier les critères de sélection des projets.
M. Gérald Brice Viret. En effet. Pour avoir été membre de la commission pendant deux ans, je sais bien que tous les projets d'Arte sont aidés alors que ce n'est presque jamais le cas de ceux de Direct 8, de W9 ou de NRJ 12. Il faut donc revoir les critères au regard de la nouvelle écriture de la TNT.
M. Christian Vion, directeur général adjoint en charge de la production et des moyens des antennes de France Télévisions. Vous souhaitez connaître notre point de vue sur la légitimité et sur l'efficacité du système.
À côté des obligations des chaînes, le dispositif du CNC est le fondement de la politique culturelle en matière de production audiovisuelle. On ne peut donc que le soutenir, d'autant qu'il devient encore plus important avec les nouveaux usages et les nouveaux modes de consommation, qui renforcent la nécessité de disposer d'un volume croissant de productions françaises, dont une partie doit être pérenne afin d'être utilisée sur les nouveaux supports. Or, c'est ce type de productions que finance le CNC.
France Télévisions est l'acteur le plus important de la production audiovisuelle de création, à laquelle nous consacrons 20 % de notre chiffre d'affaires, soit, l'année prochaine, plus de 400 millions d'euros. Le CNC est un partenaire fondamental dans le financement de ces productions puisque plus de la moitié de ses aides vont à des commandes de France Télévisions. Nous avons donc un rôle prépondérant, que nous-mêmes jugeons trop important : la production audiovisuelle nous paraît trop dépendante de la télévision publique et le rôle des autres diffuseurs devrait être renforcé.
Il n'est pas tout à fait exact que le système revienne à reverser aux mêmes acteurs une partie de leur contribution car ce ne sont pas les chaînes mais les producteurs qui bénéficient des subventions. En 2010, au travers des plans de financement, ces derniers ont perçu 90 millions d'euros, alors que nos versements au CNC ont été de 140 millions. Cela signifie qu’en raison de notre chiffre d'affaires important nous contribuons fortement au financement de l'ensemble de la production audiovisuelle, y compris celle qui n'est pas faite chez nous. Nous acceptons cette règle du jeu parce que nous soutenons cette politique culturelle.
Nous n'en estimons pas moins légitime que l'ensemble des acteurs qui bénéficient de la production audiovisuelle la financent, à travers le CNC. Certes, les textes doivent être adaptés à la situation des nouvelles chaînes de la TNT, mais il faut surtout s'intéresser aux acteurs de l'Internet qui, pour l’heure, ne participent pas au financement du CNC ou ne le font qu'à la marge. La question est assez complexe pour les fournisseurs d'accès Internet (FAI) en cas de triple ou de quadruple play. En effet, ils échappent de la sorte à une contribution sur une partie de leur chiffre d'affaires alors que c'est bien d'audiovisuel qu'il s'agit. Autre sujet complexe, celui des hébergeurs Daily Motion et YouTube, qui utilisent les programmes pour faire du chiffre d'affaires mais qui échappent à l'obligation de financer le CNC. Dès lors que l'on parle de légitimité, il est impératif de se pencher sur ces problèmes.
Si l'on veut aussi apprécier l'efficacité de ce système, il convient de comparer notre situation à celle des pays étrangers qui n'en bénéficient pas. À l'évidence, le système du CNC a permis l'émergence d'une industrie française de l'animation très créative et attractive puisque des projets internationaux sont produits chez nous. Mais les résultats ne sont pas les mêmes en matière de fiction, qui est pourtant le fer de lance pour les producteurs comme pour les industries techniques. En dépit des aides, nos volumes de fictions produites et exportées sont faibles, de même, ces dernières années, que les résultats d'audience, inférieurs à ceux de nos voisins. La responsabilité de cette situation n'incombe pas au CNC, mais elle est partagée entre les chaînes et les producteurs. Ces derniers doivent donc construire en partenariat une nouvelle politique de fiction, en particulier de séries, et travailler à des coproductions internationales ambitieuses. Le CNC devra bien évidemment accompagner ce mouvement.
Il convient en outre que les dispositifs du CNC puissent évoluer car il va falloir imaginer de nouveaux contenus, de nouvelles formes de productions et de nouveaux modèles économiques adaptés aux nouvelles chaînes de la TNT et aux nouveaux modes de consommation numérique : pas plus que celle des chaînes de la TNT ne peut être la même que celle des chaînes historiques, l'économie de la production du web ne saurait être identique à celle de la télévision. La création du « web-COSIP », qui aide les contenus spécifiquement à destination d'Internet, marque ainsi une évolution intéressante.
Sur la question très complexe de l'aide sélective ou automatique, je ne partage pas totalement l'opinion de M. Viret. Bien évidemment, nous préférons, par sécurité, que le producteur bénéficie de l'aide automatique. Par ailleurs, si je suis favorable à l'aide sélective pour aider certains projets et pour permettre l'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde de la production, je constate que cette aide a jusqu'ici favorisé un certain émiettement de la production alors que l'on a aujourd'hui besoin, en particulier dans le domaine de la fiction, d’un secteur plus industriel, plus concentré, plus solide et plus professionnel. Il faut donc trouver un équilibre entre aides sélectives et automatiques.
Dans la mesure où beaucoup d'argent public est engagé dans le système du CNC, en particulier au travers de notre contribution, nous souhaitons que son utilisation soit transparente et contrôlée. Le CNC a, je crois savoir, mis en place un contrôle des demandes dans le cadre du crédit d'impôt audiovisuel. Il nous paraîtrait utile que soient également vérifiés les comptes des producteurs qui bénéficient des aides.
M. Fabrice Blancho, directeur de la production d’Arte-France. Je rappelle qu’Arte-France fait partie d’Arte GIE, qui est une chaîne binationale franco-allemande. Notre financement est entièrement public.
Il est vrai qu'avec le mécanisme de la « taxe COSIP », au titre de laquelle nous acquittons 12,9 millions d'euros, on donne d'une main ce que l'on reçoit de l'autre.
Cependant, le CNC nous paraît tout à fait légitime dans son rôle de régulation, d'aide et de soutien, son intervention reposant sur des critères objectifs d'éligibilité financière et artistique.
Son aide représente en moyenne 20 % des plans de financement de nos coproductions.
Avec le développement des nouveaux usages et des nouveaux supports, on est bien évidemment amené à se demander si l’utilisation d'une œuvre par la télévision est essentielle ou accessoire, ce qui est bien difficile à déterminer dans des logiques d'utilisation hybrides. Sans doute sera-t-il nécessaire d'adapter les règles du COSIP pour tenir compte à la fois de la télévision et des nouveaux médias : il est en effet désormais fréquent que les programmes soient récupérés par d'autres utilisateurs, qui n'ont pas participé à leur financement.
Il convient également de tenir compte des genres et des caractéristiques des programmes : on ne peut pas aider un documentaire d'auteur comme on aide une fiction lourde ou sérielle.
Il nous paraît également nécessaire de renforcer le contrôle des coûts, en concertation avec les professionnels.
Selon les chiffres du CNC, 500 producteurs de documentaires ont été aidés en 2009, mais 50 d'entre eux consomment à eux seuls la moitié des fonds du COSIP. Je pense, moi aussi, qu'il faut apprécier la question de l'aide sélective ou automatique au regard de la nécessité de disposer d'acteurs suffisamment forts pour peser dans la production internationale. Mais il est vrai que l'aide sélective favorise un certain renouvellement du vivier de producteurs. Pour sa part, Arte France travaille chaque année avec une centaine de producteurs.
M. Philippe Bony, directeur adjoint des programmes en charge de la production de M6 métropole télévision. Je rejoins assez largement ce qu’a dit Christian Vion sur l'aide automatique et sélective.
On a par ailleurs l'impression que, alors que chacun contribue au financement du système, personne ne reçoit, en soutien à la production, l'équivalent de ce qu’il a versé au titre de la « taxe COSIP ».
M. Olivier Carré, Président. Selon le « Bilan 2010 » du CNC, le rapport est de moitié environ : 422 millions collectés au titre de la taxe sur les services de télévision (TST) et 230 millions « reçus », c'est-à-dire réinvestis dans des programmes audiovisuels.
M. Philippe Bony. En effet, cette perte en ligne est préoccupante car l’objectif est d’investir dans les programmes afin qu'ils soient de qualité et performants à la fois lors de la diffusion en France et pour être vendus à l'international. Si, a contrario, le dispositif de la taxe spéciale additionnelle (TSA) sur les tickets de cinéma apparaît extrêmement vertueux, c'est sans doute parce que les salles de cinéma n'investissent pas directement dans les contenus qu'elles diffusent. On peut légitimement se demander s'il ne serait pas plus efficace que les chaînes de télévision, qui, elles, financent les programmes, investissent directement cet argent dans des programmes, en plus de leurs obligations de production.
Qui plus est, ce système repose sur une séparation totale des activités de production et de diffusion. Ce choix politique a été fait en France à un moment où tous les autres pays industrialisés faisaient de même, en raison de la rareté des fréquences et de la crainte de voir apparaître des positions dominantes trop fortes. Mais, partout ailleurs, au fur et à mesure de l'avancement des technologies vers une ère de profusion des moyens de communication vis-à-vis du public, on a renoncé à cette séparation. La plupart des pays ont même adopté des politiques destinées à inciter à la création de groupes audiovisuels intégrés, extrêmement performants aux niveaux national comme international. C'est notamment ainsi que se sont constituées les majors américaines, qui combinent activités de production et de diffusion. La situation est analogue en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni ; seule la France étant demeurée attachée à l'ancien principe de séparation, ce qui empêche la constitution de grands groupes audiovisuels forts et intégrés de façon verticale.
C'est bien ce principe qui conduit à soumettre les diffuseurs à une taxe dont le produit est géré par un organisme qui l’attribue à des producteurs afin de leur constituer un actif. S'interroger sur la pérennité de cette séparation production/diffusion sera à n'en pas douter un des grands enjeux des années à venir car les diffuseurs ne se contentent plus d'être les détenteurs d'une fréquence analogique mais exercent des métiers de plus en plus complexes et doivent impérativement être présents dans l'ensemble des médias. Ainsi, le groupe M6 est présent sur Internet, sur le satellite, sur le câble, sur les mobiles. Pour lutter contre les opérateurs internationaux – à un moment où les frontières ont tendance à disparaître dans l'exploitation des œuvres – et contre les géants d’Internet – qui se renforcent encore avec l'arrivée de la télévision connectée – nous avons besoin de maîtriser les programmes et les contenus, d'en être véritablement à l'initiative et de gérer leur exploitation de façon cohérente dans l'ensemble des modèles. À défaut, les groupes de production qui se constituent dans notre pays continueront à être repris par des fonds d'investissement ou par des grands groupes étrangers, ce qui fera peser une lourde menace sur les diffuseurs.
C'est pour toutes ces raisons que nous préconisons que l'on revoie les règles afin de permettre aux diffuseurs de prendre part au mouvement de concentration que l'on observe chez les producteurs et qui nous semble un gage d'efficacité et de performance.
M. Olivier Carré, Président. Merci pour cette intervention très éclairante.
En fait, vous financez également le cinéma, dont vous achetez les droits par la suite. Cela vous paraît-il légitime ?
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Les spécialistes du cinéma que nous avons reçus ne tarissent pas d'éloges sur l'action du CNC. Considérez-vous pour votre part qu'il faut faire évoluer ce dispositif, afin de soutenir davantage la production audiovisuelle ?
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. On a souvent dit que le cinéma français était de qualité et qu'il avait été sauvé par l'aide publique, à la différence de ce qui s’est passé en Italie. Si les majors françaises que vous appelez de vos vœux se constituent, cela ne se fera-t-il pas au détriment du cinéma et comment financera-t-on alors ce dernier ?
M. Philippe Bony. Les chaînes de télévision contribuent beaucoup au financement du cinéma en dehors même du CNC. L'investissement de Canal + et de l'ensemble des chaînes hertziennes est ainsi très important et finance une grande partie de la production. Est-il indispensable que l’investissement de ceux dont le métier est précisément d'investir dans les programmes passe aussi par le CNC, avec la perte en ligne que l'on a mentionnée ?
Je l'ai dit, le système de la TSA est vertueux, parce qu’il permet une contribution des salles qui ne financent pas le cinéma, nous nous réjouissons donc que des discussions soient en cours en vue d'une contribution des opérateurs Internet et de tous ceux qui bénéficient des œuvres sans investir directement dans la production.
M. Christian Vion. Il est normal de se poser la question de la répartition entre la télévision et le cinéma des sommes que nous versons au CNC. Philippe Bony vient de souligner l'importance du total des contributions de la télévision au cinéma : versement au CNC, obligations de coproduction à travers les filiales – 3,5 % du chiffre d'affaires de France Télévisions –, et bien sur, achats pour disposer de droits. S'il est normal que nous contribuions au financement du cinéma, force est de constater que ces montants considérables vont au-delà de la place qu’il a aujourd'hui dans nos grilles.
Cela étant, si l'on modifiait le système, il conviendrait de compenser cette perte pour continuer à avoir dans notre pays un volume important de production cinématographique de qualité. Cela pourrait se faire à travers la participation d’un certain nombre d'acteurs qui pour l'instant ne contribuent au financement ni de la production audiovisuelle ni de la production cinématographique.
Mme Françoise Marchetti, secrétaire générale de Pôle Télévision, NRJ Group. Nous ne jouons pas tous avec les mêmes armes : alors qu'on peut trouver les films sur tous les sites de vidéo à la demande, pour notre part, nous sommes confrontés à des limites en nombre, en heures et en jours de diffusion. Bien que nous financions les productions par plusieurs biais, nous ne pouvons les exposer comme nous en aurions besoin avec l'explosion de la consommation de la télévision et de l'Internet.
M. Olivier Carré, Président. Une partie du prix payé pour l’achat d’une vidéo à la demande – VàD ou VOD – alimente-t-elle le CNC ?
M. Philippe Bony. Les achats de VOD sont soumis à la « taxe COSIP ». La question se pose plutôt pour les opérateurs qui bénéficient de façon indirecte des œuvres, par exemple lorsqu’une personne souscrit un abonnement à Internet pour bénéficier de la VOD : dans ce cas, l'abonnement n’est pas soumis à la taxe, quand bien même le FAI a utilisé la VOD comme argument promotionnel. Il faut donc bien se demander si la mise à disposition doit impliquer une contribution.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Y a-t-il selon vous une limite à l'action du CNC ? Ne peut-on pas considérer que le système s'auto entretient ? L’évolution des recettes est-elle mécanique ou correspond-elle à celle des besoins ?
M. Olivier Carré, Président. Ces questions se posent parce que les recettes du CNC ont beaucoup augmenté et parce que celui-ci a mené de nouvelles actions. Il réfléchit en outre à la taxation des usages de l'image sur le web. En tant que législateurs, nous nous demandons s’il peut continuer à se développer sur un marché en croissance, en justifiant lui-même sa légitimité – la question se pose d'autant plus qu’il a fait en faveur du cinéma une œuvre extrêmement utile –, ou s’il doit être encadré afin de répondre strictement aux besoins qui avaient été initialement définis.
M. Philippe Bony. On a le sentiment que la taxation évolue en fonction des développements économiques, que cela procure des ressources au CNC, qui s'interroge ensuite sur la façon de dépenser cette manne… On pourrait en effet imaginer un fonctionnement inverse qui consisterait à se demander d'abord ce qu'il est nécessaire de financer, puis à calculer le budget dont on a besoin pour cela, et enfin de définir une taxation adaptée.
Nous sommes tout à fait déterminés à financer les œuvres cinématographiques et la place du cinéma est pour nous importante tant à l'antenne que dans notre diversification – nous sommes aussi éditeurs et distributeurs en salle et vidéos. Mais à l'évidence la diffusion des films à la télévision est en recul : ils ont réalisé l’an dernier 3 des 100 meilleures audiences, contre 45 il y a sept ans… Cela est lié à la forte augmentation des exploitations du cinéma sur d'autres supports : salles, VOD, chaînes dédiées avec diffusions de rattrapage, etc. De la sorte, compte tenu de la chronologie des médias, lorsqu'un film arrive sur une chaîne nationale trois ans après sa sortie en salles, ce n'est vraiment plus un événement !
La performance du cinéma pour nos chaînes a donc baissé tandis que notre contribution restait au même niveau : il bénéficie à la fois de 40 % de la taxe COSIP que nous acquittons et de 3,2 % de notre chiffre d'affaires au titre de nos obligations. Au total, le cinéma français représente 5,5 % du chiffre annuel du groupe M6, pour moins de 2 % du temps d'antenne…
Si nous ne nous sommes jamais opposés à l'arrivée de nouvelles formes d'exploitation, force est de constater qu'elle entraîne un phénomène de substitution et une dégradation de la valeur de l'œuvre qui arrive sur une grande chaîne après avoir été déjà largement consommée. La situation est donc sensiblement différente de l'époque nous étions les seuls à diffuser. Or, on n'en a pas tenu compte et le niveau de notre contribution demeure inchangé.
M. Christian Vion. L’augmentation des ressources du CNC ne me choque pas puisque le besoin de productions s'accroît en raison de la multiplication des chaînes et de l'apparition des nouveaux modes de consommation. La question est plutôt celle de l'équité de traitement des différents acteurs dans le financement des contenus audiovisuels. Si on continue à faire peser cette augmentation uniquement sur la télévision, en premier lieu sur les chaînes historiques, cela pose un problème au regard de tous ceux qui vont bénéficier de ces contenus.
Au-delà, il convient de vérifier que l'utilisation des fonds correspond bien aux besoins des différents acteurs. Or, les besoins des chaînes historiques, des chaînes de la TNT et des supports Internet ne sont pas les mêmes. Il faut donc vérifier que tous ces acteurs trouvent dans le CNC un partenaire qui s'adapte à leur économie spécifique.
Mme Françoise Marchetti. Certes, la majeure partie du financement repose sur les chaînes historiques, mais c'est parce qu'il est calculé en pourcentage du chiffre d'affaires : proportionnellement, nous en supportons la même part.
Le rapport du CNC montre que les chaînes produisent de plus en plus, qu’elles financent de mieux en mieux, mais qu'elles sont de moins en moins aidées. La collecte de la taxe progresse, mais l'enveloppe de 196 millions d'euros est stable depuis des années en ce qui concerne le soutien aux œuvres audiovisuelles en général.
Enfin, il est vrai que nous avons besoin de groupes de productions forts et qu'il y a peut-être trop de nouveaux producteurs. Mais n'oublions pas que la TNT a précisément permis l'émergence de nouveaux acteurs de l'audiovisuel, avec une nouvelle écriture, une nouvelle façon de produire, à des coûts souvent restreints. Cela a redonné un souffle à la production, a favorisé la création d'emplois. Peut-être faut-il aujourd'hui passer par une phase de stabilisation ; mais fermer le marché présenterait le risque de créer une situation analogue à celle de la fiction de prime time, dont la production, trop lourde et trop onéreuse, est progressivement abandonnée.
M. Fabrice Blancho. Je pense que les coûts de production vont augmenter car le système demeure centré sur la diffusion du programme télé, qui est aujourd'hui décliné sous des formes diverses et qui doit suivre l'évolution technique, en particulier vers la HD et la 3D. On a donc bien besoin d'un soutien plus important du CNC, qui prenne en compte, comme fait générateur de son aide, non plus la diffusion télé mais l'intégralité d'un programme sous toutes ses formes.
Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des études règlementaires de M6 métropole télévision. L’intervention du législateur pourrait viser à ramener le CNC dans une logique de demande par rapport aux acteurs du secteur, et non plus dans une logique d'offre liée à l'abondance de ses ressources. En effet, on a parfois l'impression que le CNC se félicite de l'augmentation du nombre des œuvres sans se préoccuper du public qu'elles rencontrent et sans même se demander quelle est la part des œuvres d'initiative française dans l'ensemble de la consommation.
Vous nous avez par ailleurs demandé si le CNC devait jouer un rôle de régulation. Le CSA est bien un régulateur vis-à-vis des chaînes dont il contrôle le respect des conventions et des cahiers des charges. Lorsque le CSA s'interroge sur une problématique, il entend tous les diffuseurs, comme tous les acteurs du secteur ; la DGMIC (direction générale des Médias et des industries culturelles) fait de même. Pour sa part, le CNC peut proposer des décrets ou des arrêtés qui ne sont ni soumis au CSA pour avis, ni écrits en coordination avec la DGMIC alors qu’il convient de prendre en considération la situation des chaînes. En tant que chaînes de télévision, nous ne sommes pas consultés par le CNC. Au mieux un diffuseur est entendu alors que nos modèles de financement – abonnement, publicité ou ressource publique – et nos poids diffèrent du fait de nos dates de création. Le CNC devrait nous considérer dans notre globalité, mais aussi selon nos niveaux et moyens de financement. Peut-être le législateur pourrait-il aussi s’interroger sur le type d’encadrement qui doit venir du CNC, si tant est qu’il doive venir de lui.
M. Olivier Carré, Président. Il me reste à vous remercier pour vos remarques enrichissantes, qui complètent des réflexions qu’avaient suscitées des auditions antérieures.
Audition du 9 juin 2011
À 10 heures 30 : Table ronde, ouverte à la presse, de distributeurs de services de télévision : M. Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad ; M. Éric Haentjens, directeur financier de Bouygues Telecom ; Mme Florence Chinaud, directrice des relations institutionnelles, et M. Pierre Petillault, responsable de réglementation audiovisuelle de France Télécom ; M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques et M. Laurent Vannimenus, directeur adjoint de la réglementation et de la concurrence de SFR
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Notre Mission d’évaluation et de contrôle consacre cette année une partie de ses travaux à l’évaluation du financement des politiques publiques par des ressources affectées. Nous avons souhaité entendre dans ce cadre ces nouveaux diffuseurs de contenus que sont les opérateurs de télécommunications, qui contribuent au financement du CNC. Nous aimerions, madame et messieurs, connaître votre point de vue sur la pertinence de ce système typiquement français, où des montants importants sont prélevés par des institutions publiques qui les redistribuent à leur tour aux acteurs de la création culturelle.
Selon l’usage de la MEC, nous sommes assistés dans nos travaux par la Cour des comptes.
M. Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad. Free est le troisième opérateur français de télécommunications, uniquement dans la téléphonie fixe pour l’instant, et bientôt aussi dans la téléphonie mobile, avec un peu moins de cinq millions d’abonnés. Depuis 2006, tous nos abonnés des zones dégroupés disposent d’un boîtier leur permettant de recevoir la télévision, dans le cadre de nos offres triple play.
Quant au système de financement objet de vos travaux, nous déplorons d’abord son opacité. Tout le monde sait qu’il est de tradition dans le milieu du cinéma de gonfler ses budgets pour obtenir le maximum de subventions, et que c’est ainsi que les producteurs gagnent leur vie. Ce qui nous ennuie davantage, nous distributeurs, c’est que, tout en exerçant une pression très insistante sur les pouvoirs publics pour obtenir le plus d’argent possible, le CNC se dispense dans le même temps de donner la moindre information sur sa gestion. Les conseillers de Bercy eux-mêmes nous disent ne pas parvenir à obtenir des chiffres précis pour 2010. Il n’est facile de connaître ni le montant exact de la contribution de chacun, ni celui affecté à chacune des actions du centre, ni le résultat dégagé par le Centre.
M. Olivier Carré, Président. Il existe pourtant un rapport détaillé.
M. Maxime Lombardini. Je confirme que ce rapport fournit des données détaillées sur la partie relative aux dépenses du CNC, mais, concernant les recettes, les chiffres sont rares et incomplets : on ne sait pas quelle est la part des différents acteurs et en particulier des opérateurs de télécommunications, dans le total des recettes de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services. Il n’y a pas non plus de visibilité sur l’évolution, caractérisée par une croissance très forte, depuis la création de cette taxe étendue aux opérateurs par la loi de 2007.
Ce qui nous préoccupe dans l’avenir le plus immédiat, ce sont les projets d’amendement à la loi de finances rectificative visant à modifier le taux et l’assiette de la contribution des opérateurs de télécommunication au COSIP, sur la base des conclusions de la mission confiée par Bercy à l’inspecteur des finances Bruno Parent. Bien que nous ayons été auditionnés dans le cadre de cette mission, nous ne disposons que de très vagues indiscrétions.
De plus, les opérateurs pâtissent d’un défaut de stabilité et de cohérence de la règle fiscale. Depuis 2007, la règle du jeu change tous les six mois. On nous a d’abord octroyé un taux réduit de TVA à 5,5 % sur une partie de notre activité, ce qu’on nous avait alors présenté comme la contrepartie de notre soutien à la création. Quelques mois après était institué un prélèvement de 0,9 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs, destiné à compenser en partie le manque à gagner de France Télévision du fait de la suppression de la publicité. Il y a quelques mois, on décidait de nous priver du taux de TVA à 5,5 %, ne nous laissant que trois mois pour adapter nos offres. Pour le secteur, cette dernière décision a provoqué un véritable séisme, toute modification tarifaire ouvrant droit à résiliation. Et voilà qu’on parle de modifier à nouveau les modalités de notre contribution. Il n’est pas simple de devoir ainsi modifier son offre tous les six mois quand on a cinq millions de contrats à gérer !
À ce propos, on a parfois le sentiment que le Gouvernement ne se préoccupe des mises en demeure de la Commission européenne que lorsque cela l’arrange : alors qu’il s’est hâté de prendre prétexte des observations de la Commission pour supprimer la TVA à 5,5 %, allant au-delà de ses demandes, il ne tient aucun compte de la mise en demeure de mettre fin à la taxe France Télévision, considérée comme illicite par la Commission. Qu’importe, puisque les amendes ne devraient pas tomber avant 2014, et qu’il reviendra à un autre gouvernement de les acquitter…
M. Olivier Carré, Président. Le seul amendement que je connaisse, d’autant que j’en suis cosignataire, est celui visant à annuler la « taxe Google », auquel, je pense, vous n’êtes pas opposé.
Diverses options sont envisagées en ce qui concerne l’avenir du financement du CNC, dans un sens comme dans l’autre, mais le débat n’est pas tranché. C’est précisément une des raisons pour laquelle nous avons tenu à vous entendre.
M. Maxime Lombardini. Nous déplorons par ailleurs l’approche conservatrice du CNC, qui préfère s’accrocher à un système obsolète plutôt que de s’adapter aux nouveaux usages. Ainsi nous demandons depuis la création de la taxe COSIP que l’accès des producteurs audiovisuels à cette ressource soit subordonné à la mise à disposition des œuvres ainsi financées dans le cadre des offres légales. Il s’agirait simplement que les producteurs s’engagent à ce que ces films puissent être diffusés, quatre mois après leur sortie en salles, dans le cadre d’offres de vidéo à la demande, VoD ou SVoD – vidéo à la demande avec abonnement. Certes, le CNC a signé un accord sur un tel réaménagement de la chronologie des médias, mais celui-ci est peu appliqué et le Centre semble peu pressé de le faire respecter. Bien au contraire, le décret sur les services de médias audiovisuels à la demande, ou décret SMAD, dont le CNC a été un des artisans, est totalement défavorable aux offres innovantes du type SVoD. On nous impose des quotas de diffusion d’œuvres françaises, que personne ne veut nous vendre : c’est quand même un problème !
Le CNC pourrait également promouvoir les nouveaux usages tels que la télévision de rattrapage ou la distribution dématérialisée, dont la mise en place est coûteuse pour les distributeurs. Il est dommage que nous ayons dû nous associer avec la société Disney pour lancer un service de téléchargement définitif qui est une première en Europe.
M. Éric Haentjens, directeur financier de Bouygues Telecom. Bouygues Telecom est un opérateur qui a une histoire plus longue en téléphonie mobile qu’en téléphonie fixe, avec dix millions de clients sur le réseau mobile et un million dans le fixe. Mais dans les deux cas, nous assurons surtout un rôle de diffuseur, avec une faible implication dans les contenus.
La taxe COSIP appelle deux observations de ma part. En 2007, comme l’a rappelé M. Lombardini, la TVA à 5,5 % avait été présentée explicitement comme la contrepartie de l’extension de la taxe COSIP aux opérateurs de télécommunications. Nous avions alors fait savoir aux députés que nous craignions qu’un tel choix ne génère un opportunisme tarifaire, au détriment des recettes fiscales de l’État, ainsi qu’une instabilité des offres des fournisseurs d’accès. Nos craintes se sont malheureusement vérifiées, ce qui a conduit le Gouvernement à supprimer le taux réduit. Nous sommes cependant surpris de voir que cette suppression n’a pas remis en cause la contribution des opérateurs au COSIP.
Deuxièmement, considérant que nous sommes avant tout des fournisseurs d’accès, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes taxés sur les contenus qui transitent par nos tuyaux sans dégager pour nous de revenus. Nous le comprenons d’autant moins qu’on nous demande dans le même temps de veiller à la neutralité du net…
Nous demandons donc une fiscalité qui pèse sur les contenus et non sur la fourniture d’accès ; une fiscalité stable, l’instabilité fiscale étant source de confusion pour les consommateurs, comme on l’a vu au cours du premier trimestre ; enfin une fiscalité qui n’ait pas pour effet pervers d’inciter au marketing fiscal, comme l’illustre l’offre par Free d’une fourniture de services de télévision facturée 1,99 euro. Un tel marketing fiscal n’est bon, ni pour les consommateurs, qui ne s’y retrouvent plus, ni pour les recettes de l’État, ni pour les opérateurs, contraints de modifier leurs offres dans l’urgence pour s’adapter à cette concurrence.
M. Olivier Carré, Président. En un mot, vous demandez à être moins taxés, ce que je peux comprendre. Ce que je voudrais savoir, c’est ce que vous pensez de votre contribution au financement de la création.
M. Éric Haentjens, directeur financier de Bouygues Telecom. Je ne crois pas que ce soit le rôle d’un fournisseur d’accès. Les contenus qui transitent via notre accès étant déjà assujettis à une taxe, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes mis à contribution. C’est une décision de l’État, soit. Mais qu’au moins la règle de droit soit pérenne afin de ne pas favoriser la création d’offres tout à fait artificielles dont la seule raison d’être est le changement de régime fiscal.
M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques de SFR. SFR est le deuxième opérateur de télécommunications en France, avec vingt-cinq millions d’abonnés, dont vingt millions à la téléphonie mobile et cinq à la téléphonie fixe.
Nous partageons les points de vue qui viennent d’être exprimés. Nous aussi, nous jugeons que l’assujettissement des opérateurs de télécommunications à la taxe COSIP ne se justifie plus depuis la fin de la TVA à taux réduit sur les offres triple play. La conformité de cette contribution à la législation européenne pourrait d’ailleurs être mise en doute. En effet, lorsque ce nouveau régime fiscal avait été notifié à la Commission européenne en 2007, les recettes attendues étaient évaluées entre onze et seize millions d’euros. Or, à en croire la presse – le CNC ne donnant pas aux opérateurs d’informations précises en la matière –, cette contribution s’est élevée à 180 millions d’euros en 2010, et cette explosion des recettes aurait dû faire l’objet d’une nouvelle notification auprès de la Commission.
Nous ne refusons pas le principe d’une contribution des opérateurs de télécommunications au financement de la création et de l’exception culturelle française ; nous souhaitons simplement qu’elle reste à des niveaux raisonnables au regard de notre capacité contributive. Comme Bouygues Telecom et Free, nous souhaitons par ailleurs que l’assiette de cette contribution soit stable, afin que les opérateurs puissent jouir d’une lisibilité à long terme, au lieu d’être incités à adopter des stratégies d’optimisation fiscale telles que celles qu’on a pu observer au début de cette année. Cette taxe pourrait, par exemple, être assise sur le chiffre d’affaires généré par la fourniture de services internet au grand public.
M. Pierre Petillault, responsable de la réglementation audiovisuelle de France Télécom. Le groupe France-Télécom-Orange contribue au COSIP principalement au titre de son activité de distributeur de services de télévision sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile, même s’il est également éditeur. Comme le représentant de SFR, si nous ne remettons pas en cause l’existence d’un outil de soutien au cinéma, nous nous interrogeons sur l’évolution de la taxe sur les services de télévision, la TST. L’équilibre entre le bénéfice du taux à 5,5 % et l’assujettissement à la taxe était vertueux pour l’ensemble des acteurs : il incitait les opérateurs à intégrer de la télévision dans leurs offres, accroissant ainsi la diffusion des programmes, dont la création était financée par le COSIP. La suppression de la TVA à taux réduit a rompu cet équilibre, les opérateurs étant désormais incités au contraire à exclure les services de télévision, soumis à la TST, de leur offre, dans un objectif de marketing fiscal qui n’est sain pour personne.
Je tiens également à souligner, comme l’on fait les parlementaires lors de l’examen de la loi de finances, l’explosion des recettes de la TST acquittée par les distributeurs, même si on en est réduit à des estimations. En effet, en dépit de leur épaisseur, les bilans du CNC sur l’affectation de ses ressources ne distinguent pas la TST distributeurs de la TST éditeurs et n’isolent pas, au sein de la TST distributeurs, les montants acquittés par les opérateurs de télécommunication. Nous estimons cependant que la contribution de l’ensemble de notre secteur dépasse assez largement celle du groupe Canal +, principal distributeur de télévision payante.
Par ailleurs, le lien entre la consommation réelle de télévision et la création cinématographique est de plus en plus ténu, notamment en matière de téléphonie mobile. Ainsi, la croissance des abonnements à des forfaits de téléphonie mobile multimédias est à l’origine de l’augmentation exponentielle de la contribution de France-Télécom, sans que la consommation d’œuvres audiovisuelles sur les téléphones mobiles connaisse le même accroissement. Cette déconnexion entre consommation effective des œuvres et taxation ne me semble pas très saine, même pour le CNC. Il faudrait trouver un système assis sur la consommation réelle des services de télévision.
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Quels rapports entretenez-vous avec le CNC ?
M. Éric Haentjens. Aucun, en dehors du paiement de la taxe – vingt millions d’euros en 2010.
M. Maxime Lombardini. Nos relations avec la direction générale du CNC sont bonnes, mais si nous sommes écoutés, nous ne sommes jamais entendus. Ainsi nos propositions pour favoriser le développement de l’offre légale, telle l’institution d’un observatoire trimestriel des films disponibles dans la chronologie des médias, se sont toutes heurtées à un refus. Je l’ai dit, le CNC ne veut pas non plus entendre parler de notre proposition de subordonner le financement des œuvres à l’existence d’une offre légale dans la chronologie des médias. Nous entretenons en revanche des contacts réguliers avec le trésorier du CNC.
Il est vrai que le CNC est otage de son secteur, autant que l’est le ministère de la culture. Face au prestige dont jouit le monde de la création en France, les opérateurs de télécommunications, incapables d’assurer leur propre promotion auprès des institutions, ne font pas le poids, en dépit de leur puissance financière. Ce petit monde terriblement passéiste est prisonnier d’une vision à très court terme et du souci de maintenir des positions acquises, qui en réalité ne protègent personne.
M. Pierre Petillault. Les relations que nous entretenons avec le CNC, d’ailleurs excellentes, sont liées surtout à notre activité de production cinématographique et d’éditeur de chaînes de cinéma. C’est à ce titre que nous avons signé l’accord sur la chronologie des médias. Je pense cependant, comme M. Lombardini, que le CNC est soumis à un lobbying intense du secteur du cinéma.
M. Vincent Talvas. Si notre actionnaire Vivendi a par nécessité des relations fortes avec le CNC, pour notre part nous ne les voyons quasiment jamais, hormis lorsque nous demandons à les rencontrer, comme nous l’avons fait à la fin de l’année dernière. Il s’agissait de discuter avec eux de la remise en cause de la TVA à 5,5 %, inscrite au projet de loi de finances, et de tenter de trouver une solution convenant aux opérateurs sans entraver l’action du CNC. Nous n’avons pas été entendus, probablement en effet à cause d’un manque d’indépendance vis-à-vis de leur secteur. Le Centre devrait cependant entretenir un minimum de relations avec ses principaux contributeurs.
M. Olivier Carré, Président. Normalement, le CNC dépend des pouvoirs publics et non de tel ou tel secteur particulier…
M. Nicolas Perruchot, Rapporteur. Une telle absence de contact est pour le moins paradoxale, eu égard aux montants des recettes affectées.
M. Olivier Carré, Président. Vous concourez en effet à hauteur d’un tiers au financement du CNC, le produit de la taxe distributeurs étant estimé à 267 millions d’euros.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Quelles pistes préconisez-vous pour améliorer cette taxe ?
M. Laurent Vannimenus, directeur adjoint de la réglementation et de la concurrence de SFR. Afin d’éviter ce qui a été qualifié de marketing fiscal, nous préconisons une assiette stable et qui évolue avec notre capacité contributive réelle, par exemple le chiffre d’affaires des services internet sur téléphonie fixe pour les particuliers. Cette assiette assez large, qui aurait en outre l’avantage de ne pas être déconnectée de notre activité réelle, devrait être frappée d’un taux assez faible.
M. Maxime Lombardini. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous ne sommes pas, quant à nous, favorables à une assiette limitée aux services internet aux particuliers, d’autant que, selon nous, le droit européen interdit une taxe générale sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications. Ceci dit, je n’ai pas d’autre proposition, sinon de faire financer le CNC par le budget général. S’il doit y avoir une taxe assise sur le chiffre d’affaires des services de télécommunications aux particuliers, son taux devrait être le plus bas possible, et les opérateurs de télécommunications devraient pouvoir compter en contrepartie sur des services innovants.
Je voudrais, par parenthèses, répondre au reproche de marketing fiscal que l’on fait à Free. Premièrement, notre offre de télévision optionnelle à 1,99 euro est tout à fait licite. Deuxièmement, nous pourrions devenir un simple distributeur de double play, en laissant à nos abonnés la faculté de souscrire à des offres de télévision.
M. Olivier Carré, Président. Quelle est l’approche des autres opérateurs quant à cette solution, qui aurait l’avantage d’éviter la survente et d’établir une grille tarifaire claire pour les consommateurs ? Ce business model est d’ailleurs celui des câblo-opérateurs.
M. Pierre Petillault. Avant l’arrivée de Free sur ce marché, les opérateurs faisaient du double play, et si tous se sont mis au triple play, c’est que cela répondait à une exigence du marché, donc des consommateurs. Il serait dommage de revenir en arrière sous l’effet d’une aggravation de la fiscalité des offres d’accès.
M. Maxime Lombardini. C’est Éric Besson lui-même qui, une fois votée la suppression de la TVA à 5,5 %, a demandé aux opérateurs d’instituer une offre double play, afin de ne pas contraindre les clients qui ne le souhaitaient pas à s’abonner à des services de télévision. Ce n’était donc pas pure turpitude de notre part !
M. Éric Haentjens. Ces problèmes de taxation me semblent dus à une regrettable confusion entre distribution de services de télévision et fourniture d’accès, les opérateurs de télécommunications fournissant à la fois un contenu et un accès technique. En matière de téléphonie fixe, la fourniture d’accès deviendra de plus en plus prépondérante par rapport au contenu, et celui-ci pourrait être acheté à la demande, dans le cadre de bouquets spécifiques ou de la VoD. Quant à la fourniture de services de télévision en streaming par le réseau mobile, sa mise en œuvre est complexe et suppose des investissements importants. De ce point de vue, je ne suis pas opposé à une séparation nette entre fourniture de contenus et fourniture d’accès, pourvu que l’accès soit dans ce cas indemne de toute taxation destinée à financer la production audiovisuelle, d’autant qu’il supporte déjà beaucoup d’autres taxes.
M. Olivier Carré, Président. Je vous remercie.
Audition du 9 juin 2011
À 11 heures 30 : Audition sous forme de table ronde, ouverte à la presse, d’opérateurs privés d’archéologie préventive : M. Pierre Hauser, directeur général d’Archéodunum ; M. Julien Denis, directeur scientifique d’Éveha ; M. Régis Picavet, co-gérant de Paléotime ; M. François Lacrampe-Cuyaubère, gérant d’Archéosphère
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Messieurs, vous connaissez sans doute le principe de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC), qui est de formuler des propositions recueillant un consensus sur des politiques publiques ou des thèmes se rapportant à la gestion de l’État. Les rapporteurs de la MEC sur le financement des politiques culturelles de l’État par des ressources affectées sont Richard Dell’Agnola, Nicolas Perruchot et Marcel Rogemont. Ces ressources sont constituées de taxes fiscales qui échappent à la régulation budgétaire de l’État tout en finançant des politiques publiques.
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est à cet égard un acteur majeur, qui a développé des activités archéologiques diverses, lesquelles constituent l’essentiel de son activité actuelle. Au-delà de sa mission d’opérateur public, il s’inscrit, pour une grande partie de son activité, dans un cadre concurrentiel, qui est en pleine expansion.
Comment se fait la collaboration en matière d’archéologie préventive entre l’INRAP et les opérateurs privés, notamment en ce qui concerne le cahier des charges fixé par les services régionaux de l’archéologie (SRA) sur les prescriptions et le contenu scientifique des fouilles ? Trouvez-vous normal qu’un opérateur dont une grande partie des fonds est d’origine publique intervienne sur votre marché ? Quelles dispositions législatives préconisez-vous dans ce domaine ?
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Le problème principal est l’articulation entre les différents organismes faisant de la recherche archéologique préventive. Comment faire en sorte que les moyens soient pérennes en la matière, sachant qu’on est confronté à un problème de rendement ? Quelles sont les réformes qui vous paraissent souhaitables – je rappelle que l’inspection générale des Finances a été missionnée sur le sujet ? Quel regard portez-vous sur l’exercice de votre métier et la concurrence qui s’y exerce ?
M. Pierre Hauser, directeur général d’Archéodunum. Notre société était au départ installée en Suisse, puis nous avons eu un agrément pour travailler en France.
Nous estimons que le système français est le meilleur d’Europe en matière d’archéologie préventive. Le contrôle de l’État par les services régionaux de l’archéologie (SRA) est primordial à cet égard.
En matière de financement, il faut distinguer les fouilles – qui sont financées par les aménageurs et dont le régime est un des meilleurs qui soient – et le volet lié à la redevance, au diagnostic, au Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) et aux jours consacrés aux projets d’activité scientifique (jours « PAS ») –, qui est plus opaque.
Cela dit, il est très important pour la recherche que les diagnostics se poursuivent. Nous ne connaissons pas exactement les difficultés que rencontre l’INRAP ou les collectivités territoriales agréées pour les diagnostics. Mais le FNAP est confronté à un manque criant de moyens, ce qui nous pose un problème avec les aménageurs. Quant aux jours « PAS », ils soulèvent un problème de concurrence et de valorisation de nos actions, car nous finançons celles-ci sur nos fonds propres – qu’elles soient scientifiques ou destinées au grand public –, alors que l’INRAP bénéficie d’une affectation de moyens à cet effet.
Si le système des jours « PAS » doit être conservé, leur nombre doit être augmenté et mieux réparti entre les différents acteurs de la recherche.
M. Julien Denis, directeur scientifique d’Éveha. L’INRAP joue un rôle très important et les informations qu’il publie sont utiles aux autres opérateurs.
La redevance finançant la réalisation de diagnostics par l’INRAP et les collectivités territoriales est stratégique pour l’archéologie préventive dans la mesure où ces analyses permettent d’évaluer, de quantifier et de qualifier les éventuels vestiges. Or, pour la réalisation de fouilles archéologiques, contrairement à un projet de construction, on est confronté à une incertitude sur l’ampleur des travaux à réaliser, Plus le diagnostic sera précis, plus on réduira l’incertitude, on aura une vision claire des fouilles, on limitera le coût de celles-ci et les écarts entre les projets des opérateurs publics et privés seront faibles. La redevance donne donc lieu à une forme d’investissement mutualisé.
M. Régis Picavet, co-gérant de Paléotime. Vous indiquez dans votre questionnaire préparatoire que d’aucuns ont laissé entendre à la MEC que, pour remporter des marchés, certains opérateurs sacrifiaient la qualité scientifique de leurs prestations sur l’autel du prix et qu’à l’inverse l’INRAP faisait de la « sur-qualité ». Je tiens à dire que nous ne pouvons faire autre chose qu’un travail de qualité, surtout lorsqu’on est un opérateur privé : nous devons réaliser des prestations de très haut de gamme. En tout état de cause, nos travaux sont contrôlés par les SRA, qui effectuent des vérifications sur place. Nous sommes également contrôlés en aval pour les recherches menées dans le cadre de la réalisation des rapports de synthèse, qui peuvent faire l’objet de sanctions par les SRA sur la forme ou par les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) sur le contenu scientifique. Nous sommes donc tous à armes égales à cet égard.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Sur quels aspects porte la concurrence entre l’INRAP et vous ?
M. Régis Picavet. Elle porte sur la réactivité, qui chez nous est extrêmement grande, ainsi que sur les prix, sachant que nous ne pouvons travailler à prix « cassés », comme peut le faire parfois l’INRAP lorsqu’il veut obtenir un marché.
M. Olivier Carré, Président. Les représentants de l’INRAP disent au contraire qu’ils ne peuvent baisser les prix, contrairement à vous…
M. Régis Picavet. Il nous est impossible de « casser » les prix !
M. François Lacrampe-Cuyaubère, gérant d’Archéosphère. Je le confirme. Nous perdons parfois des marchés contre l’INRAP, qui propose des prix de 30 à 40 % moins élevés, sur lesquels nous ne pouvons nous aligner, même si nous répondons aux minima contenus par le cahier des charges proposé par le SRA. Nos propositions sont accompagnées d’un projet scientifique, qui est validé par le SRA avant la signature du contrat avec l’aménageur. Ce service valide également la constitution des équipes. Ce contrôle de la qualité est poursuivi pendant le déroulement du chantier, qui fait l’objet de visites régulières des agents prescripteurs. Notre rapport scientifique donne également lieu à une validation du SRA. Nous ne pouvons donc proposer à prix « cassés » des projets qui ne tiennent pas la route.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Comment est évaluée la qualité de la prestation scientifique ? Qui en est chargé concrètement ?
M. Régis Picavet. Cette mission relève des CIRA, qui sont composées d’archéologues reconnus et expérimentés, à même de juger de la qualité des projets. L’analyse est la même pour les travaux de l’INRAP que pour ceux des opérateurs privés.
Pratiquer des prix « cassés » nous obligerait donc à travailler à perte, ce que nous ne pouvons nous permettre.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Disposez-vous d’instruments de suivi de la qualité des prestations ? Sont-ils rendus publics ?
M. Régis Picavet. Toutes les personnes travaillant à l’INRAP ou pour les autres opérateurs ont la même formation, les mêmes diplômes et sont issues des mêmes universités : elles n’ont pas d’autre choix que de faire un travail de qualité !
M. Pierre Hauser. Si nous sacrifiions la qualité, nous risquerions de perdre notre agrément, lequel est délivré en fonction de deux critères : la qualité des personnels engagés par les entreprises et les avis des CIRA sur les rapports. Paradoxalement, l’opérateur par excellence qu’est l’INRAP ne fait pas l’objet d’un agrément : des avis négatifs des CIRA n’ont guère d’incidence sur son activité, alors que nous pouvons être contraints de fermer notre entreprise si l’agrément est refusé ! Nous ne pouvons donc nous permettre de « casser » les prix.
M. Olivier Carré, Président. On nous a également fait part de critiques sur vos conditions de travail, notamment s’agissant du nombre et de la sécurité des personnels, pour les interventions réalisées en site pollué par exemple.
M. Julien Denis. Nous appliquons la réglementation du travail et sommes très attentifs à la sécurité ; nos fouilleurs disposent d’équipements individuels de protection. Les critiques dont vous faites état participent d’une difficile acceptation de la concurrence par l’INRAP. Celui-ci a créé une mythologie de l’opérateur privé. Nous avons par exemple une fouille en cours dans le 3e arrondissement de Paris, qui donne toute satisfaction au coordonnateur « sécurité », alors qu’il s’agit d’un chantier difficile et compliqué.
M. Régis Picavet. Chez nous, les techniciens, les spécialistes et les responsables d’opérations disposent, non seulement de véhicules, mais des garanties d’un confort physique : nous ne les logeons jamais dans des hôtels de moins de deux étoiles et évitons qu’ils utilisent leurs frais de déplacement comme complément de salaire aux dépens de leurs conditions de travail. Je suis donc très étonné des critiques que vous évoquez ! Nous cherchons au contraire à améliorer les conditions de travail de nos salariés, car nous savons que nous y gagnons, même du point de vue de la rentabilité !
M. Julien Denis. Lorsque j’étais salarié de l’INRAP, j’ai expérimenté le fonctionnement des chantiers et les hébergements : j’ai vu des fouilleurs essayant d’accroître leurs revenus grâce aux forfaits repas ou d’hébergement en s’alimentant d’un sandwich ou en dormant dans des conditions précaires. Pour notre part, nous prenons en charge directement tous les hébergements, que nous voulons de qualité – les fouilleurs n’ont pas à avancer les frais –, ainsi que les repas au restaurant, pour éviter qu’ils ne mangent des sandwiches. De fait, l’entreprise s’y retrouve in fine en termes de productivité et d’ambiance de travail.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Quels avantages l’aménageur-client tire-t-il de s’adresser aux opérateurs privés ?
M. Pierre Hauser. Il peut y trouver trois avantages principaux. D’abord, une plus grande réactivité, les opérateurs étant plus nombreux et les délais d’attente par conséquent réduits : lorsque nous avons commencé notre activité, certains dossiers attendaient entre six mois et deux ans, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ensuite, l’aménageur peut y gagner en termes de prix en mettant en concurrence les entreprises, sachant que les SRA doivent jouer leur rôle et s’assurer que l’offre la mieux-disante répond aux prescriptions demandées. Enfin, l’aménageur peut choisir l’opérateur avec lequel il souhaite travailler.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. À quel rythme sont renouvelés les agréments ?
M. Pierre Hauser. Tous les cinq ans.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Comment valoriser davantage les objets mis à jour par l’archéologie préventive ? Comment procédez-vous dans ce domaine ?
M. Régis Picavet. Je rappelle que recueillir des objets n’est pas un but en soi pour la fouille. Les objets archéologiques sont généralement mobiliers et leur intérêt principal repose sur leur apport ethnographique : ils sont placés dans les dépôts de fouille officiels des services compétents, lesquels sont plus ou moins bien organisés ; les objets de nature organique sont soumis à des contraintes particulières.
M. Olivier Carré, Président. La question portait plutôt sur la valorisation vis-à-vis du grand public, qu’il s’agisse d’un objet mobilier ou de la description d’un site. Comment participez-vous à cette œuvre à la fois scientifique et pédagogique ?
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Qu’en est-il en particulier vis-à-vis de l’enseignement supérieur et de la recherche ?
M. Julien Denis. Valoriser consiste à rendre utilisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche.
Pour l’archéologie, l’action de valorisation s’organise selon deux axes, et en premier lieu en direction du grand public et des médias culturels, au travers de la réalisation d’expositions, de dépliants, d’ouvrages, d’ateliers pédagogiques pour les publics scolaires ou de la visite de sites en cours de fouille. Lors des dernières journées de l’archéologie organisées par le ministère de la Culture et l’INRAP, nous avons ouvert deux sites à la visite, accueilli plus de 300 visiteurs, soit le nombre maximal autorisé, et la visite de l’un des sites a fait la une de la presse quotidienne régionale. Tous les opérateurs privés et l’INRAP contribuent à cette action, sachant que, dans le cadre de la fouille préventive, il est nécessaire d’aller vite – le chantier ayant parfois une durée relativement brève – et des problèmes de sécurité peuvent se poser.
Le deuxième axe de la valorisation est à destination de la communauté scientifique, au travers de publications, qui peuvent demander beaucoup de temps, de colloques ou de la participation à des projets de recherche communs à des archéologues issus de différentes institutions – Centre national de la recherche scientifique (CNRS), universités, collectivités territoriales et INRAP. En raison de son acceptation progressive de la concurrence, l’administration de l’INRAP était jusqu’à présent assez réticente devant des collaborations avec des opérateurs privés, mais cela changera, et plus rapidement que prévu. En revanche, les chercheurs d’autres institutions interviennent de façon plus régulière, soit parce qu’ils disposent de compétences particulières auxquelles on fait appel, soit parce que les données que nous prélevons alimentent leurs projets de recherche.
M. Pierre Hauser. Je suis plus réservé sur les collaborations avec l’INRAP. Nous avons l’impression que la situation, après s’être améliorée il y a deux ans, tend à se dégrader. Certains collègues archéologues de l’Institut rechignent parfois à communiquer des informations. Nous avons créé une maison d’édition ainsi qu’une revue, mais nous avons dû renoncer à traiter certains thèmes parce que des membres de l’INRAP ont refusé d’être publiés dans celle-ci au motif qu’elle appartenait à un opérateur privé ! Cela dit, de son côté, l’INRAP fait bien son travail de valorisation.
Par ailleurs, je rappelle que nous finançons toutes les actions de valorisation sur nos fonds propres, alors que l’INRAP bénéficierait de quelque 16 500 jours « PAS », permettant de faire soit de la recherche scientifique, soit de la valorisation. Cela constitue une distorsion de concurrence. Les autres acteurs devraient pouvoir également être aidés de cette façon.
Quant aux relations avec les universités ou les unités mixtes de recherche (UMR), on observe encore des blocages. Nombre de nos archéologues sont membres à titre personnel de ces UMR, mais aucune de nos entreprises n’arrive à entrer en tant que telle dans l’une d’entre elles, comme c’est le cas dans les sciences dites « dures », où des entreprises privées participent à la recherche avec les universités. Ces blocages devraient être levés.
M. François Lacrampe-Cuyaubère. Nous avons l’habitude de travailler régulièrement depuis de longues années avec du personnel du CNRS et d’une université membre d’une UMR : nous voulions, pour conforter cette relation, développer un partenariat avec cette unité, mais cela n’a pas été possible parce que certains personnels de l’INRAP conventionnés avec l’UMR ont fait pression sur sa direction sous la forme de menaces d’annulation de leur propre convention.
Alors que, pour l’archéologie programmée, on arrive à organiser des collaborations scientifiques à titre personnel avec certains agents de l’INRAP, cela reste impossible pour l’archéologie préventive.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Des cloisons étanches persistent donc entre l’INRAP et vous-même, alors que vous faites le même métier et avez la même formation. Quelles réformes préconisez-vous ? Comment l’État pourrait-il mieux organiser la recherche archéologique préventive ?
M. Régis Picavet. La gestion du FNAP pourrait être revue. Nous avons récemment présenté notre candidature pour le chantier du site néolithique de Cournon, près de Clermont-Ferrand. Nous étions les mieux-disants, mais comme nous ne pouvions assumer une avance de trésorerie de 950 000 euros, l’INRAP a obtenu le marché grâce à l’aide du FNAP. Cela me paraît anormal : ce fonds devrait être géré par un organisme tiers et ne plus être lié à l’INRAP.
M. Olivier Carré, Président. C’est clair.
M. Pierre Hauser. Le ministère de tutelle de l’INRAP devrait peut-être encourager les collaborations scientifiques entre archéologues. Au cours de sept dernières années, les opérateurs privés ont obtenu de nombreux chantiers et nous nous trouvons aujourd’hui dans une réelle situation de concurrence. Mais si, comme le rappelle l’INRAP, il est le meilleur dans la valorisation, cela est dû aux moyens dont il dispose : certains opérateurs privés se sont dotés de médiateurs culturels et font des efforts en ce domaine mais ils ne bénéficient pas de la même manne !
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Combien d’archéologues travaillent respectivement pour les opérateurs privés et l’INRAP ?
M. Pierre Hauser. Je ne dispose pas de données complètes. Le Syndicat national des professionnels d’archéologie, auquel j’appartiens, regroupe neuf structures privées, qui, en 2010, totalisaient 253 contrats à durée indéterminée (CDI) à temps plein et 154 contrats à durée déterminée (CDD). En tout, cela représente environ 400 personnes, mais il faut y ajouter les personnels des opérateurs non membres du Syndicat et ceux des collectivités territoriales.
L’on peut estimer les effectifs de l’INRAP à 2 000, et à environ 1 000 le nombre de personnes travaillant dans les autres structures, soit de l’ordre d’un tiers des effectifs globaux.
M. Julien Denis. Notre société, qui n’est pas membre du Syndicat, compte 75 CDI.
M. Olivier Carré, Président. Je vous remercie de votre témoignage, qui incite à réaffirmer les missions essentielles incombant à l’opérateur public afin d’éviter tout dévoiement.
Audition du 9 juin 2011
À 12 heures 30 : Audition, sous forme de table ronde, ouverte à la presse, de représentants d'organismes publics d'archéologie préventive : M. Thomas Vigreux, président de l'Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale (ANACT), M. Matthieu Fuchs, directeur général du Pôle d'archéologie interdépartemental rhénan (PAIR), M. Hervé Sellès, chef du service départemental d'archéologie d'Eure-et-Loir, M. Bruno Dufaÿ, chef du service archéologique départemental d'Indre-et-Loire (SADIL), M. Olivier Brun, responsable de la cellule départementale d’archéologie des Ardennes
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. Olivier Carré, Président. Messieurs, la MEC, émanation de la commission des Finances, s’intéresse au financement des politiques culturelles par des ressources affectées dans divers domaines, tels que les monuments historiques, la création audiovisuelle ou encore les fouilles archéologiques. Je rappelle que ce travail bénéficie de l’assistance de la Cour des comptes.
Après avoir auditionné des opérateurs privés d’archéologie, nous allons maintenant entendre des représentants de plusieurs organismes relevant des collectivités territoriales. Nous aimerions notamment savoir ce qui a motivé la création de services dédiés à l’archéologie préventive au sein des collectivités, et quel est leur positionnement par rapport à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), qui est entré dans un champ concurrentiel dans le cadre de la passation d’appels d’offres.
M. Thomas Vigreux, président de l'Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale (ANACT). Le financement de l’archéologie publique, et plus particulièrement de l’archéologie préventive, est un important sujet de préoccupation sur lequel nous travaillons depuis septembre 2010. Deux activités doivent être distinguées : les diagnostics et les fouilles.
L’activité de diagnostic est une mission de service public réalisée par des opérateurs publics : les collectivités territoriales et l’INRAP. Il existe aujourd’hui un consensus sur la nécessité d’augmenter l’assiette de la redevance d’archéologie préventive (RAP) pour financer de manière pérenne l’archéologie préventive. On peut s’interroger, à ce titre, sur les exonérations concernant les lotissements et les zones d’activités.
En ce qui concerne la répartition de la redevance, l’ANACT regrette l’existence d’une certaine inégalité entre les opérateurs publics. En Île-de-France, par exemple, les services de certaines collectivités réalisent 90 % des diagnostics sur leur territoire alors qu’ils ne bénéficient que de 10 % de la redevance. Nous demandons une redistribution plus juste : il nous paraîtrait normal qu’une collectivité réalisant 50 % des opérations touche 50 % de la redevance perçue sur son territoire.
Si les collectivités ne réalisent pas l’intégralité des opérations, ce qui leur permettrait de percevoir l’intégralité de la redevance au titre du diagnostic, c’est que les 10 % restants sont les plus difficiles : ils nécessitent une logistique importante et les prescriptions de l’État varient dans le temps. Les élus hésitent à s’engager dans une situation de monopole faute d’une visibilité à moyen terme.
J’en viens aux activités de fouille, secteur de nature concurrentielle dans lequel plusieurs acteurs interviennent : l’INRAP, les collectivités territoriales, mais aussi les opérateurs privés que vous venez d’auditionner.
Les collectivités sont transparentes sur les coûts jours/homme, car ils font l’objet de délibérations publiques dont chacun peut prendre connaissance. Afin d’éviter les accusations de concurrence déloyale, les collectivités intègrent l’archéologie préventive dans leur budget global sous la forme d’une ligne spécifique, ou bien elles constituent un budget annexe. Nous avons d’ailleurs transmis, en octobre 2010, un certain nombre de ces budgets à l’inspection générale des Finances dans le cadre de ses travaux sur le financement de l’archéologie préventive.
Ce sont les personnels et les moyens techniques affectés aux opérations qui varient. Les coûts ne sont certes pas homogènes, mais les collectivités ont une bonne connaissance de leur territoire, ce qui leur permet de bien s’adapter. C’est précisément l’intérêt des services archéologiques des collectivités : on peut faire du sur-mesure.
Différents contrôles sont réalisés d’un bout à l’autre de la chaîne : les appels d’offres sont, tout d’abord, assortis d’un cahier des charges qui est élaboré par l’État et au regard duquel les projets sont contrôlés sur le plan scientifique ; l’État exerce ensuite des contrôles sur la conformité des fouilles au cahier des charges – si l’opérateur ne joue pas le jeu, il peut lui adresser une mise en demeure, voire suspendre son autorisation de fouille –; une fois les fouilles réalisées, un rapport final d’opération est soumis aux commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA), qui peuvent rappeler à l’ordre les collectivités en rendant un avis défavorable en cas de problème ; lorsqu’une collectivité fait l’objet de plusieurs avis défavorables, le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) peut remettre en cause son agrément, nécessaire pour réaliser des opérations d’archéologie préventive, ce qui incite les collectivités à ne pas s’engager dans des opérations « au rabais ». Je rappelle que leur mandat doit être renouvelé tous les cinq ans par le CNRA, contrairement à l’INRAP qui n’est soumis à aucun agrément. Les collectivités sont donc appelées périodiquement à rendre des comptes.
L’intérêt pour un aménageur de recourir aux services des collectivités territoriales réside dans le fait que les collectivités sont à la fois opérateurs et aménageurs : il existe donc une culture commune favorable au dialogue. Les services des collectivités dépendent, en outre, d’élus qui fixent le cap en ayant conscience des enjeux que présente l’aménagement de leur propre territoire. Il y aura donc un meilleur équilibre entre aménagement du territoire et sauvegarde du patrimoine.
S’agissant de la valorisation des objets mis au jour, les collectivités n’ont pas à rougir de leur bilan depuis les premières lois de décentralisation, que ce soit grâce aux expositions qu’elles organisent ou grâce aux médiateurs du patrimoine qu’elles emploient.
Devenues des acteurs incontournables de l’archéologie nationale, les collectivités territoriales sont donc des organes privilégiés pour concilier développement durable, exigences économiques et conservation du patrimoine.
M. Matthieu Fuchs, directeur général du Pôle d'archéologie interdépartemental rhénan (PAIR). Les collectivités territoriales peuvent se reconnaître, me semble-t-il, dans le tableau qui vient d’être dressé. J’aborderai, pour ma part, le sujet selon un prisme spécifique, celui du Pôle d'archéologie interdépartemental rhénan, qui constitue un cas unique en France : il s’agit, en effet, d’un établissement public créé conjointement par les conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Nous avons donc une dimension régionale, ce qui peut rendre difficiles les comparaisons avec d’autres services.
Je ne suis pas absolument certain que le rendement de la RAP soit « notoirement insuffisant » comme le laissent entendre les documents que vous nous avez adressés au préalable. En effet, nous n’avons pas de vision complète des dépenses réalisées dans chaque territoire en matière de diagnostics et de recettes liées à la redevance. Mon service, qui a fait le choix de réaliser des opérations au cas par cas, connaît un déficit structurel, mais je pense qu’il existe un équilibre au niveau régional. Il n’en reste pas moins que les exonérations actuelles limitent singulièrement le rendement de la redevance – c’est une piste importante de réflexion, mais je resterai prudent tant qu’il n’y aura pas de transparence complète, notamment sur les coûts de l’INRAP.
S’agissant des écarts éventuels entre les prestations, nous n’avons bien sûr pas accès à toutes les informations, mais nous réalisons un benchmarking qui fait apparaître des différences structurelles. Le PAIR étant autonome au sens où il ne s’appuie pas directement sur des moyens relevant des collectivités, nous avons pu développer une comptabilité analytique complète : nous sommes entre 25 et 30 % moins cher que l’INRAP sur des opérations comparables. Il est donc permis de s’interroger.
J’ajoute qu’il existe des différences liées à l’élaboration des cahiers des charges, qui revient à l’État. Si les cahiers des charges ne sont pas précis, il est délicat d’établir des comparaisons honnêtes entre l’INRAP, les collectivités et les opérateurs privés. Ces derniers ont, en effet, tendance à « coller » autant que possible aux cahiers des charges. C’est normal, mais il peut en résulter des travaux d’archéologie « au rabais ». L’INRAP et les collectivités s’efforcent, pour leur part, de développer une archéologie de qualité répondant à des objectifs scientifiques qui ne sont pas toujours décrits dans les cahiers des charges. Cela peut conduire à des différences de coût avec le secteur privé, même si ce dernier ne fait pas à proprement parler de dumping.
En Alsace, où un opérateur privé est très présent sur le terrain, l’écart de prix entre les collectivités et l’INRAP est de 25 ou 30 %, et d’environ 5 % avec les opérateurs privés, dans un sens ou dans l’autre : nous sommes donc assez proches des coûts du « marché ». Cela étant, je le répète, si l’on veut que les offres soient réellement comparables, il reste des progrès à réaliser dans la rédaction des cahiers des charges.
J’ajoute que la création d’un service relevant des collectivités a permis de réduire considérablement les délais. L’augmentation des capacités d’intervention a, en effet, produit des effets quasiment mécaniques. Si j’en crois les « retours » qui nous viennent des aménageurs publics et privés, la situation est aujourd’hui satisfaisante en Alsace.
La notion de « productivité » est un sujet glissant : on peut difficilement établir des barèmes tant la richesse des territoires et des sites est aléatoire. La référence à des moyennes est peu pertinente pour apprécier la façon dont les opérations sont réalisées. Ce n’est pas, à mon avis, un indicateur à retenir pour ce type d’analyse : nos instruments de suivi démontrent le caractère très hétérogène des opérations de diagnostic.
Les délais sont plus aléatoires en matière de fouilles, car tout dépend des plans de charge respectifs. L’existence de grands projets, tels que les lignes à grande vitesse en Alsace, limite notre capacité à répondre à la demande, mais ce n’est pas un facteur structurel.
Pour ce qui est de la qualité scientifique des opérations, il serait bon de réaffirmer le contrôle de l’État au niveau des services régionaux de l’archéologie et des commissions interrégionales. On peut comprendre sur le plan économique que des projets « moins disants » soient retenus par certains aménageurs, mais il n’y a pas d’équité de traitement entre les opérateurs si l’État n’exerce pas un véritable contrôle.
Les avantages tirés par les aménageurs, qui étaient auparavant des clients captifs de l’INRAP, sont considérables : l’introduction de la concurrence a conduit à une réduction indéniable des coûts et des délais. Il existe toutefois un risque réel de dérapage vers une archéologie de moindre qualité en l’absence de verrous garantis par les services de l’État. On constate, à cet égard, une certaine défaillance en Alsace.
Quant aux rapports entre la conservation du patrimoine et l’équilibre économique, je plaide en ce qui me concerne pour une archéologie raisonnée : les différents acteurs ont bien souvent des prismes trop particuliers, voire des œillères, et ils ne parviennent pas à mettre en œuvre une véritable politique scientifique à l’échelle des territoires. Il existe bien des directives nationales – cela renvoie au rôle du CNRA –, mais on manque de cohérence et de lisibilité sur le plan territorial. Or l’existence de disparités, voire de particularismes, est loin d’être bénéfique.
L’aménagement du territoire peut être concilié avec la conservation du patrimoine, mais à condition d’améliorer les rapports entre les acteurs concernés – le prescripteur, l’aménageur et l’opérateur. Des améliorations très nettes ont eu lieu depuis 2003, au moins dans les discours, mais il reste encore un long chemin à parcourir.
La valorisation des objets est probablement le grand oublié de la loi de 2003, qui n’a raisonné qu’en termes d’aménagement du territoire. Les collectivités jouent un rôle actif, mais leurs capacités sont limitées. L’enjeu est pourtant fondamental : il s’agit de valoriser les données collectées pour leur donner une traduction concrète aux yeux de nos concitoyens, et de partager les connaissances. Tout repose aujourd’hui sur le volontarisme des collectivités, car il n’y a pas de clé de financement permettant d’apporter une réponse homogène sur l’ensemble du territoire.
M. Hervé Sellès, chef du service départemental d'archéologie d'Eure-et-Loir. La décision de créer mon service a été prise en 2004 pour saisir l’opportunité offerte par la loi de 2003. Les deux premiers postes ont ensuite été pourvus en 2005.
Nos missions sont en priorité de réaliser des diagnostics et, dans un second temps, des fouilles préventives. Nous avons obtenu un agrément dès 2006, ce qui nous a permis de réaliser très rapidement des opérations d’archéologie préventive. Notre équipe a été notablement renforcée depuis sa création, puisque ses effectifs ont été portés à 18 postes, dont 16 sont occupés par des personnels permanents, les 2 autres correspondant à des surcharges temporaires d’activité.
Nous bénéficions d’un budget autonome qui permet d’identifier clairement les dépenses relevant de notre service. Nos moyens doivent nous permettre de réaliser des diagnostics couvrant approximativement 100 hectares et de réaliser un ou deux chantiers de fouilles par an. Depuis 2006, nous avons ainsi été engagés pour réaliser 34 diagnostics selon des critères précis : les projets d’aménagement de la collectivité font l’objet d’une priorité absolue ; viennent ensuite des projets à caractère économique réalisés dans le département. Nous ne sommes donc pas appelés à intervenir sur les lotissements, les carrières ou les travaux sur les routes nationales. Depuis 2006, 80 prescriptions de diagnostic ont été réalisées dans l’ensemble du département, exception faite de la ville de Chartres, qui dispose d’un service archéologique agréé réalisant la totalité des prescriptions de diagnostic sur son territoire. Nous avons réalisé en moyenne 48,5 % des prescriptions, représentant 40 % des 919 hectares concernés.
Au cours de la même période, le département a perçu un total de 741 000 euros au titre de la RAP, les montants variant dans le temps en fonction de l’importance des projets en cours. Cela représente environ 150 000 euros par an sur un total départemental qui devrait être de 715 000 euros selon nos estimations – il est très difficile de connaître les recettes réellement collectées. Nous bénéficions donc de 21 % des recettes, alors que nous traitons 40 % des surfaces concernées.
Nous avons conduit, par ailleurs, 12 fouilles, essentiellement en régie de travaux, pour le compte de la collectivité. Nous avons aussi réalisé 4 fouilles pour des tiers, pour un budget total de 780 000 euros, et deux fouilles ponctuelles, correspondant à des urgences absolues et représentant environ 40 000 euros.
Notre budget d’investissement et de fonctionnement varie entre 310 000 et 350 000 euros par an. Les recettes sont d’un montant équivalent, mais les charges de personnel sont exclues. Notre budget présente donc un aspect déficitaire qui résulte en particulier du rendement de la redevance et de l’existence d’opérations non couvertes par elle.
Comme l’indique le document qui nous a été remis au préalable, le rendement de la RAP est évidemment insuffisant. Il est d’ailleurs inexistant pour les aménagements dont la surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 3 000 mètres carrés et pour les aménagements exonérés, tels que les lotissements et les opérations aidées par l’État. Cela étant, nous intervenons peu dans le cadre de telles opérations, sauf pour des projets propres au département – nous sommes alors amenés à réaliser des investissements relativement lourds pour des recettes nulles.
La part de la redevance qui nous revient pour les aménagements importants en termes de surface couvre globalement les opérations réalisées, le seuil d’équilibre étant proche d’une dizaine d’hectares. Ce sont les opérations de rebouchage et de remise en état des terrains qui grèvent le plus les budgets – si ces opérations n’étaient pas prises charge, la redevance couvrirait globalement les besoins.
Dans la mesure où nous réalisons peu de fouilles pour des tiers, nous faisons peu l’objet de mise en concurrence : nous effectuons des fouilles en régie afin de réduire les coûts et les délais d’intervention. De façon générale, je doute que les opérateurs sacrifient la qualité scientifique des prestations fournies : ils doivent, en effet, bénéficier d’un agrément et les projets d’opération doivent être conformes aux cahiers des charges.
Le critère le plus souvent retenu est de nature financière – nous avons pu le constater en assistant des aménageurs dans la lecture des propositions qui leur étaient faites dans le cadre de projets auxquels nous n’étions pas candidats. Le second critère est la capacité de l’opérateur à mobiliser une équipe aussi rapidement que possible : la question du délai de démarrage des chantiers est, en effet, extrêmement importante pour les aménageurs. Nous en sommes bien conscients, car le département a dû conclure, en tant qu’aménageur, des marchés publics pour réaliser des fouilles que notre service archéologique ne pouvait pas réaliser, soit parce qu’il n’était pas agréé pour la période concernée, soit parce que son volume d’activité était déjà très important.
La comparaison entre l’INRAP et ses concurrents ne porte, évidemment, que sur les fouilles préventives, et non sur les diagnostics. Pour notre part, nous n’avons jamais été en concurrence avec l’INRAP sur les projets auxquels nous avons répondu. Je n’ai donc pas d’éléments à vous fournir sur cette question.
Selon les estimations dont nous disposons, les coûts techniques de l’INRAP sont comparables aux nôtres : les moyens dont nous disposons étant similaires, les seules variations peuvent concerner les jours/homme à l’hectare. La comparaison porte donc sur les moyens que l’on met réellement en œuvre pour chaque opération.
En ce qui concerne les instruments de suivi, nous sommes en train de développer, avec la direction des finances du département, un outil de comptabilité analytique extrêmement détaillé afin de prendre en compte l’ensemble des coûts directs et indirects des opérations prises en charge par la collectivité, mais nous disposons déjà de tableaux de bord pour suivre les moyens engagés et les coûts.
Je rappelle, en outre, que la qualité scientifique des prestations n’est pas évaluée par l’État, mais par les CIRA et le CNRA – pour ce qui est de l’agrément. La qualité scientifique est donc essentiellement appréciée en aval des opérations.
Le principal avantage de la suppression du monopole est la réduction des coûts et des délais. La collectivité départementale a souhaité éviter, pour sa part, d’être dépendante vis-à-vis de l’INRAP en matière de diagnostics, et elle tenait à maîtriser plus facilement ses opérations propres. Il en résulte aussi que les coûts sont bien inférieurs : contrairement aux autres opérateurs, nous n’avons pas d’objectif de rendement ou de couverture des fluctuations d’activité.
Selon moi, c’est à l’État qu’il appartient de définir un équilibre entre l’aménagement du territoire et la conservation du patrimoine archéologique. Dans ce domaine, les décisions sont prises par le préfet de région, mais il existe des échanges étroits et permanents avec les collectivités territoriales disposant de services archéologiques agréés. Presque toutes les collectivités ont constitué un inventaire du patrimoine archéologique local, et elles ont une bonne connaissance de leur territoire.
La conservation des collections et de la documentation qui leur est associée est un des aspects les plus délicats : cette mission est clairement dévolue à l’État, mais les collectivités s’engagent activement dans ce domaine. Il reste à améliorer l’articulation entre les uns et les autres pour l’attribution, la propriété et la gestion des collections.
En ce qui concerne l’association des acteurs de la recherche, l’Université ou le CNRS n’ont développé que peu de projets nous concernant. Nous invitons toutefois nos agents à s’engager dans les unités mixtes de recherche (UMR) du CNRS autant que possible, en fonction de leur domaine de recherche et de leurs compétences.
M. Olivier Carré, Président. Il n’y a donc pas de fermeture dans ce domaine ?
M. Hervé Sellès. Il n’y en a pas, bien que le système repose sur un principe de cooptation au sein des UMR.
M. Olivier Carré, Président. N’y a-t-il pas de veto à la participation des uns et des autres en fonction de leurs liens éventuels avec l’INRAP ? Tout se passe donc bien…
M. Hervé Sellès. L’équipe étant relativement jeune, ses membres n’ont pas encore le potentiel nécessaire pour intégrer des UMR, mais le travail est en cours.
M. Olivier Carré, Président. On peut donc dire qu’il y a des échanges entre archéologues, peu importe leur provenance et leur rattachement.
M. Hervé Sellès. Nous n’avons pas identifié de problème particulier dans ce domaine. Nous n’avons pas intégré d’UMR pour le moment, mais nous participons à des projets collectifs de recherche (PCR) soutenus financièrement par l’État.
M. Bruno Dufaÿ, chef du service archéologique départemental d'Indre-et-Loire (SADIL). Je ne reviendrai pas sur les sujets déjà abordés, car je suis globalement d’accord avec ce qui a été dit.
En matière de financement, il me semble que nous devrions travailler sur la maîtrise de la dépense. Une vraie réflexion doit être menée sur ce point par le ministère de la Culture, mais aussi par celui de la Recherche, un peu absent dans le débat alors qu’il a, lui aussi, la charge d’exercer la tutelle de l’INRAP. J’ajoute que la réflexion ne doit pas être uniquement parisienne.
Je souscris pleinement à l’idée que la redevance devrait être plus équitablement répartie. Cela risque toutefois d’être assez complexe, notamment en zone urbaine – il n’y a que des services départementaux représentés ce matin, mais je crois pouvoir dire que le contexte municipal est très différent – : les diagnostics sont complexes à réaliser pour des raisons de profondeur et de sécurité des immeubles voisins, alors que la redevance perçue est souvent faible. À l’heure actuelle, le financement de l’archéologie urbaine n’est donc pas du tout assuré. Un certain nombre de villes essaient de sortir de ce mauvais pas en se plaçant dans le cadre de l’agglomération : l’existence de territoires encore ruraux permet de travailler sur des espaces plus vastes, tels que les zones d’aménagement. Cela étant, il reste à trouver des clés de répartition permettant de régler ce problème en veillant à ne pas constituer d’« usines à gaz ».
M. Olivier Carré, Président. Nous venons d’apprendre que Chartres avait son propre service. Est-ce également le cas de Tours ?
M. Bruno Dufaÿ. Ce n’est pas le cas de Tours. Nous travaillons, par exemple, avec l’INRAP dans le cadre de la construction du tramway de Tours.
M. Olivier Carré, Président. Qu’en est-il de l’Alsace ?
M. Matthieu Fuchs. Il n’y a pas d’autre service relevant d’une collectivité territoriale.
M. Hervé Sellès. Le service archéologique de Chartres est particulièrement important : ses effectifs sont au moins deux fois plus nombreux que ceux du service archéologique départemental. Il assure une grande partie des fouilles dans son périmètre.
M. Bruno Dufaÿ. Sa taille le rend assez peu représentatif des services municipaux…
J’ajoute qu’une réflexion méthodologique doit être engagée – il faut notamment travailler sur les cahiers des charges, mais je ne reviendrai pas sur ce point, qui a déjà été abordé.
Pour améliorer l’efficacité du système, il conviendrait aussi de réorganiser les rapports entre les opérateurs. Thomas Vigreux a expliqué tout à l’heure pourquoi une majorité de collectivités ne se chargeaient pas de poser tous les diagnostics. Pour ma part, je pense qu’il faudrait mieux cadrer les collaborations entre l’INRAP et les collectivités territoriales.
Le fait qu’une collectivité prenne en charge tous les diagnostics sur son territoire exclut, de fait, l’INRAP. Président de l’ANACT lorsque la loi de 2001 a été mise en place, j’avais protesté, avec les élus, contre le monopole de l’INRAP. Ne renversons pas aujourd’hui la situation en laissant un des acteurs majeurs du système, voire son acteur principal, entièrement à l’écart dans certains territoires !
Il conviendrait d’inciter les opérateurs à dépasser le stade des discours, qui consacrent le principe d’ouverture, en passant de véritables conventions. Nous sommes une des rares collectivités à avoir signé, en juillet 2010, une convention de partenariat scientifique avec l’INRAP, qui s’est en particulier concrétisée par une réponse conjointe à l’appel d’offres pour le tramway de Tours.
Je le répète : il faut éviter l’exclusion de certains acteurs et inciter à un plus grand travail en commun. L’État a sans doute un rôle à jouer, lui aussi, dans ce domaine.
Notre coût moyen est d’environ 2 300 euros par hectare en matière de diagnostic, rebouchage non compris, alors que cette charge peut être élevée. Le rendement de la redevance sur les territoires ruraux est de 3 350 euros par hectare. On pourrait avoir l’impression que nous gagnons beaucoup d’argent, ce qui est parfois vrai : les élus incitent à choisir les diagnostics rentables, ce qui me pose un problème déontologique. Un meilleur système de répartition de la redevance nous permettrait d’échapper à cette logique mercantile qui pousse les élus à ne choisir que les diagnostics qui rapportent.
L’intégration des parcs de la DDE au plan départemental est un autre moyen de réduire les coûts : nous travaillons totalement en régie dans certains cas, et les coûts techniques – liés aux pelleteuses, par exemple –, sont alors bien inférieurs à ceux de l’INRAP.
Contrairement à Matthieu Fuchs, je ne suis pas certain que les notions de ratio et de rendement manquent entièrement de pertinence. Je dirai plutôt qu’il faut les manier avec précaution. Les moyennes sont robustes dans mon service, dans la mesure où une opération supplémentaire ne les fait guère varier, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de simples moyennes. Elles sont comprises entre 5 et 7 jours/homme par hectare en matière de diagnostic, quand la réalité va de 2 à 22. Certaines opérations sont, en effet, très atypiques, et on ne peut effectuer des lissages que sur des volumes importants. Il est impossible, pour autant, d’affirmer qu’on ne peut rien prévoir, chaque cas étant particulier : on ne saurait se dispenser totalement d’utiliser des instruments de prévision.
S’agissant de l’évaluation scientifique, j’insisterai seulement sur les conséquences désastreuses de la RGPP pour les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les services régionaux de l’archéologie (SRA). Les mécanismes de contrôle actuels sont à peu près satisfaisants à condition que les agents soient en nombre suffisant et qu’ils aient une compétence reconnue. Or les agents sont de moins en moins nombreux et ils sont de plus en plus submergés. Le cri unanime des DRAC en souffrance a dû parvenir à vos oreilles ! Il ne faudrait pas casser des services de l’État qui sont absolument nécessaires dans notre métier.
Quant aux collaborations avec l’Université et le CNRS, le ministère de la Recherche est un peu absent du débat, ainsi que je l’ai déjà dit.
En ce qui concerne l’équilibre entre l’aménagement du territoire et la conservation du patrimoine, il me semble que nous ne sommes pas allés assez loin dans la mesure où l’aménagement du territoire ne sait pas assez profiter de l’archéologie. Il faut renverser les mentalités : l’archéologie n’est pas un obstacle ; dans un certain nombre de cas, les aménageurs auraient intérêt à profiter davantage de l’expertise du sous-sol dont disposent les archéologues, notamment en matière de travaux routiers – je pense, en particulier, aux stratigraphies des épaisseurs superficielles. Ce sont les archéologues qui peuvent indiquer la présence de tel ou tel substrat à un endroit donné, ce qui peut conduire à modifier les plans.
Revenant d’un stage à l’Institut national du patrimoine, je peux vous dire que les archéologues ont développé une expertise considérable en matière de berges, de modifications des rivières, de crues et d’inondations. Sur ces questions, les archéologues doivent être davantage écoutés – même si c’est aussi à eux de se faire entendre. Nous avons beaucoup à apporter à l’aménagement. Il ne faut donc pas seulement raisonner en termes de conciliation, mais aussi d’enrichissement mutuel.
M. Olivier Brun, responsable de la cellule départementale d’archéologie des Ardennes. Le service archéologique du conseil général des Ardennes, territoire rural connaissant des difficultés économiques, est une création récente puisqu’elle date de juillet 2009. Nous sommes l’un des deux départements à avoir fait le choix de prendre en charge l’ensemble des diagnostics prescrits sur son territoire.
Si les collectivités font le choix d’exercer cette compétence volontaire, ce qui n’est pas forcément simple dans le contexte actuel, c’est qu’elles considèrent l’archéologie comme une partie intégrante de l’aménagement du territoire. Cette option permet de réduire les délais, voire les coûts, et d’obtenir d’autres résultats déjà signalés. Les collectivités font ce choix au titre de leur mission d’aménagement et de développement économique, mais ce n’est une possibilité pour elles que grâce à la recette attendue : elles n’ont ni la vocation ni les moyens de prendre à leur charge le « trou » de l’INRAP, et elles ne bénéficient pas de subvention compensatrice versée par l’État en matière d’archéologie.
En matière de financement, je rappelle qu’il existe non seulement un certain nombre d’exemptions, mais aussi des dossiers pour lesquels il n’y a pas de fait générateur, notamment les lotissements. Certains cas posent, en outre, des problèmes particuliers : les parcs photovoltaïques sont censés être soumis au versement de la redevance, mais les arrêtés d’autorisation ne sont jamais transmis aux DRAC. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, les demandes volontaires de diagnostic (DVD), qui représentent 95 % du financement que nous recevons au titre de la redevance, et 30 millions d’euros sur le plan national sur un total de 70 millions. Si les DVD devaient être supprimés, une structure telle que la mienne ne pourrait pas subsister, alors qu’elle est en équilibre sur un exercice et demi, et l’ensemble du système courrait à la faillite.
J’ajoute qu’un lien me semble nécessaire dans chaque territoire entre les montants de redevance perçus au titre des diagnostics – je rappelle que 30 % de la redevance sont reversés au Fonds national d’archéologie préventive (FNAP) –, et les montants dépensés. Cela permettrait de responsabiliser les aménageurs – ils doivent savoir à quoi sert ce qu’ils déboursent –, mais aussi les archéologues.
S’agissant du FNAP, il va de soi que plus les montants de redevance seront importants, mieux le fonds sera doté. Je rappelle qu’il a deux missions : la prise en charge du coût de certaines fouilles et le versement de subventions. Comme il ne récupère qu’une fraction des sommes correspondant aux opérations qu’il prend en charge de droit, la marge de manœuvre pour le versement des subventions est naturellement des plus réduite. Il me paraît nécessaire de réduire drastiquement, voire de supprimer les prises en charge automatiques pour dégager des fonds dans une logique de subventionnement de projets, de manière à éviter l’existence d’un droit à prise en charge au-delà des recettes et à responsabiliser les aménageurs autour de logiques de projet. Il faut notamment se demander si les aménageurs ont cherché à anticiper les questions archéologiques ou à les éviter, et quels sont les projets les plus utiles pour les territoires si tous ne peuvent pas être pris en charge. Les élus locaux doivent naturellement être associés à cette démarche.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit concernant le lien entre la qualité et les prix en matière de fouilles, sauf pour rappeler que le coût journalier facturé par l’INRAP a beaucoup augmenté au cours des six dernières années, alors que le nombre de jours/homme affecté par hectare a diminué dans les mêmes proportions.
Pour notre part, nous réalisons globalement peu de fouilles : notre activité est similaire à celle du service dirigé par Hervé Sellès : 100 hectares en matière de diagnostic et une à deux fouilles par an. J’ajoute que la DVD nous procure 400 000 euros de redevance.
En ce qui concerne la concurrence, la question des prix et des délais a déjà été évoquée. J’insisterai, pour ma part, sur le moment où la concurrence intervient : elle ne concerne que les fouilles, lesquelles ne sont attribuées dans le cadre d’appels d’offres que dans 30 % des cas, compte tenu des opérations d’aménagements privées. Il s’agit de savoir quel opérateur l’aménageur choisit en amont du démarrage de l’opération. Ensuite lors de la réalisation de la fouille, puis pour la recherche sur les données découvertes, la concurrence actuelle n’est nécessaire ni scientifiquement, ni économiquement, ni politiquement. En y mettant un terme, les archéologues pourraient améliorer la qualité tout en réduisant les coûts généraux de l’archéologie, ainsi que les coûts de chaque structure. Chacune d’entre elles ne peut pas nécessairement se permettre d’avoir à sa disposition un spécialiste, par exemple de la céramique, pour toutes les périodes. La mutualisation permettrait de réduire les coûts et d’améliorer les connaissances des spécialistes : plus ils voient de matériel, plus leurs connaissances s’accroissent.
On collabore aujourd’hui sur des projets, au cas par cas, avec tous les opérateurs d’archéologie préventive et de recherche, y compris les bénévoles. Un seul refuse de participer : l’INRAP. Le 9 mars 2010, le sénateur président du conseil général des Ardennes a adressé un courrier au président de l’INRAP de demande de convention, mais il n’a pas eu de réponse pour le moment. En région, l’INRAP interdit à ses agents de parler aux autres acteurs, y compris lorsque les chantiers sont côte à côte, et de communiquer ses plans. Comme ils sont publics, on peut aller les photocopier, mais cela prend beaucoup de temps. Je pourrais vous citer le cas d’une autoroute où nous intervenons à côté de l’INRAP : chaque fois que l’emprise change, il faut se rendre à la DRAC pour scanner les plans. Cela fait perdre du temps et de l’argent à l’INRAP, aux aménageurs et à nous-mêmes.
Je voudrais insister, par ailleurs, sur l’obligation d’équilibre des collectivités pour leur budget de fonctionnement, et donc sur la nécessité du lien entre les dépenses et les recettes sur un territoire donné.
Le délai moyen d’intervention a peu d’importance, en revanche : c’est la capacité de répondre aux urgences des aménageurs qui importe.
Je ne partage pas tout à fait l’avis de mes collègues sur les services régionaux de l’archéologie. Même si certains d’entre eux connaissent des difficultés, et même s’il existe aussi des différences importantes d’une région à l’autre, ce qui pose un problème, les politiques de prescription sont un soutien très important, et un travail de grande qualité est réalisé. Je m’étonne, en revanche, que les SRA ne soient pas dotés en personnels selon l’activité archéologique réalisée : cela permettrait d’aller plus vite.
J’en viens aux agréments. Bien qu’il soit absolument nécessaire, le système actuel nous expose à quelques difficultés, qui appellent des adaptations : étant délivrés pour des périodes chronologiques très strictes, les agréments ne tiennent pas compte des réalités archéologiques. La plupart des sites couvrent plusieurs périodes, et il est dommage de ne pas pouvoir réaliser une opération à cause d’un tesson datant d’une période minoritairement représentée. En second lieu, les petites structures ne peuvent pas se former à l’ensemble des périodes, d’où l’importance des collaborations entre structures que j’ai évoquées. Enfin, si une grosse structure dispose d’un spécialiste de chaque période sur le plan national, ce n’est pas nécessairement le cas chantier par chantier, région par région, alors qu’une collectivité se doit d’avoir le spécialiste de la période concernée sur son territoire pour intervenir.
M. Richard Dell’Agnola, Rapporteur. Il ressort des auditions de ce matin que les situations sont très hétérogènes, alors que les formations délivrées aux archéologues sont identiques, de même que leurs cursus et leurs missions. Les regards divergent aujourd’hui selon qu’on travaille pour l’INRAP, pour des organismes privés ou pour des opérateurs relevant des collectivités, et on observe une concurrence parfois dommageable.
M. Fuchs a indiqué que la qualité scientifique des prestations n’était pas toujours de même niveau : elle serait parfois un peu « bradée ». Lors de la table ronde précédente, les opérateurs privés ont pourtant rappelé qu’ils devaient, eux aussi, faire renouveler périodiquement leur agrément et qu’ils faisaient l’objet d’un contrôle portant sur la qualité scientifique de leurs travaux. Pourriez-vous donc revenir sur cette question ?
M. Matthieu Fuchs. Les éléments que j’ai indiqués résultent d’observations faites sur le terrain. Il y a parfois une certaine indigence dans la rédaction des cahiers des charges : en laissant trop de liberté, on ouvre la porte à une archéologie « au rabais ». Or c’est la mission des collectivités que de promouvoir une archéologie de qualité. Le contraire serait un non-sens : autant livrer directement le terrain aux aménageurs.
M. Olivier Carré, Président. Messieurs, je vous remercie.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Une partie étant ensuite reversée aux collectivités territoriales disposant d’un service d’archéologie préventive agréé compétent en matière de diagnostics.
3 () Le marché des « droits à polluer » englobe ainsi toutes les transactions opérées entre les entreprises concernées, celles qui émettent moins de CO2 que ce que leur quota, fixé au niveau de chaque État, leur permet pouvant vendre leur surplus à une autre entreprise qui aurait des émissions de CO2 plus importantes que le quota qui lui a été initialement alloué.
4 () Ainsi, juridiquement, le RMI n’a pas été financé par l’ISF, même si politiquement, l’un était conçu comme la contrepartie de l’autre.
5 () 3° du I de l’article 34 de la LOLF.
6 () En application de l’article 47 de la LOLF, « au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ».
7 () Le Gouvernement n’est pas soumis à l’article 40 et peut donc déposer et défendre des amendements induisant des pertes de recettes pour telle personne publique relevant du champ de l’article 40, sans être soumis à l’obligation de compenser celles-ci.
8 () Par exemple, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).
9 () Le CNC notamment.
10 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
11 () La charte de budgétisation a pour objet de s’assurer que tout mouvement de dépense (ou de recette) ayant pour objet d’accroître (ou de diminuer) le niveau de la dépense publique, que ce soit directement ou indirectement, est bien pris en compte dans la norme de dépense, à la différence de mouvements pouvant être considérés comme une simple ré-imputation au sein du budget de l’État ou un simple transfert entre l’État et une autre entité. L’annexe VII « Charte de budgétisation de l'État » de la circulaire 1BLF-08-803 du 10 avril 2008 relative au budget pluriannuel 2009-2011 / conférences de budgétisation explicite les règles associées à la charte de budgétisation.
12 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
13 () Audition du 26 mai 2011, 10 heures.
14 () Audition du 26 mai 2011, 9 heures.
15 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
16 () Article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
17 () Dispositif codifié à l’article 220 terdecies du code général des impôts.
18 () Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
19 () La taxe sur les services de télévision a été créée par l’article 36 de la loi de finances du 29 décembre 1983.
20 () L’assiette du volet « éditeurs » de la TST est constituée :
– du chiffre d’affaires tiré du produit des recettes publicitaires et du parrainage, ces sommes faisant l’objet d’un abattement de 4 % ;
– du produit de la contribution à l’audiovisuel public (ex redevance audiovisuelle) et des autres ressources publiques (dotations budgétaires notamment) ;
– des recettes que les chaînes tirent des éléments suivants : appels téléphoniques à revenus partagés, connexions à des services télématiques, SMS surtaxés.
21 () CanalSat, Canal+, le câble, Orange, et tous les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qui vendent l’accès aux chaînes de télévision par abonnement.
22 () L’assiette du volet « distributeurs » de la TST est constituée du produit des abonnements à des services de télévision.
23 () La taxe vidéo a été instituée par l'article 49 de la loi de finances pour 1993.
24 () CAS Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.
25 () Par le décret n° 2011-365 1er avril 2011 relatif aux aides financières aux nouvelles technologies en production, dit décret « web COSIP ».
26 () Pour ce faire, on se reportera utilement au rapport n° 2857 du Rapporteur général Gilles Carrez, tome 2 portant examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011, commentaire de l’article 11.
27 () Instruction fiscale 3 C-2-08 du 7 avril 2008 : « lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais son facturées sous un prix forfaitaire et global, chacune d’elle doit être imposée à raison de son prix au taux qui lui est propre, le redevable étant tenu de répartir dans sa comptabilité les recettes qu’il réalise par taux d’imposition ».
28 () Article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 : « lorsque ces services [de télévision] sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d’autres services fournis par voie électronique, le taux réduit [de TVA] s’applique à hauteur de 50 % de ce prix ».
29 () L’instruction précisait en effet que la disposition de la loi du 5 mars 2007 « ne fait naturellement pas obstacle à ce que ces opérateurs [les FAI], sous leur responsabilité, retiennent une ventilation différente entre taux réduit et taux normal lorsqu’ils sont en mesure de montrer, selon une méthodologie simple, que la proposition retenue traduit mieux la réalité économique de la prestation offerte ».
30 () Le principe d’une application du taux réduit de TVA étant maintenu pour les services de télévision fournis par abonnement.
31 () Cf. rapport n° 2857 du Rapporteur général Gilles Carrez, tome 2 portant examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011.
32 () La part de marché des films français atteint ainsi 45 % pour les quatre premiers mois de l’année 2011. Elle était de 35 % « seulement » en 2010 en raison du considérable succès du film américain Avatar. Par ailleurs, quelque 206,7 millions de spectateurs se sont pressés dans les salles obscures en 2010, atteignant le record enregistré en 1967.
33 () Cf. audition du 9 juin 2011, 9 heures 30.
34 () Si les ventes internationales de programmes audiovisuels français ont progressé de 5,1 % en 2010 (pour un moment total de 105,6 millions d’euros), ce résultat s’explique par les bonnes performances de l’animation et du documentaire (+ 9,1 % et + 13,7 %). Les ventes de fictions elles, sont en recul de - 11,6 % (L’exportation des programmes audiovisuels français en 2010 – Les études du CNC, septembre 2011).
35 () Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
36 () Elles oscillent, depuis 2007 dans une fourchette comprise entre 54 % et 60 %.
37 () Cf. décret n° 95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992.
38 () 43,4 millions d’euros réalisés contre 54,7 millions d’euros prévus, compensées à hauteur de près de 60 % par des subventions exceptionnelles du ministère de la Culture et de la communication.
39 () Hors subventions versées au titre de la résorption de la dette auprès de l’AFT.
40 () Par les ministères chargés du budget, de la culture et de l’équipement.
41 () Par lettre en date du 4 juin 2010.
42 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.
43 () La taxe locale d’équipement (TLE) ; la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France (TC/TLE) ; la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (TD/CAUE) ; la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) ; la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie (TSE Savoie, non reconduite) ; le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD).
44 () Audition du 5 mai 2011, 10 heures.
45 () Audition du 5 mai 2011, 10 heures.
46 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
47 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
48 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
49 () Audition du 9 juin 2011, 12 heures 30.
50 () Audition du 9 juin 2011, 11 heures 30.
51 () Audition du 9 juin 2011, 11 heures 30.
52 () Idem.
53 () Idem.
54 () Article L. 141-1 du code du patrimoine.
55 () 80 monuments nationaux et 18 en vertu de conventions de gestion. Le périmètre du CMN mériterait d’être clarifié (sur ce point, cf. rapport d’enquête de la Cour des comptes remis à la commission des Finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la LOLF, octobre 2010).
56 () Le plus récent en date, la place forte de Mont-Dauphin, a été inscrit le 7 juillet 2008 en même temps que d’autres forteresses de Vauban.
57 () Monuments qui lui ont été remis en dotation, ou qui lui sont, depuis le début de l’année 2009, confiés par France Domaine.
58 () Audition du 26 mai 2011, 9 heures.
59 () Audition du 19 mai 2011, 11 heures 30.
60 () Audition du 19 mai 2011, 9 heures.
61 () Idem.
62 () « Le Centre des monuments nationaux depuis 2003 ».
63 () Décret n° 2007-532 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.
64 () Audition du 26 mai 2011, 9 heures.
65 () Le Panthéon (30,6 millions d’euros), l’Hôtel de Sully (9,8 millions d’euros), le château de Champs-sur-Marne (9,8 millions d’euros), l’abbaye du Mont-Saint-Michel (8,3 millions d’euros), la Saint Chapelle (7,2 millions d’euros), la villa Cavrois (7,2 millions d’euros), le château de Pierrefonds (6,2 millions d’euros), le domaine national de Saint-Cloud (6 millions d’euros), le château de Rambouillet (6 millions d’euros), le château de Ferney Voltaire (2,5 millions d’euros), le château d’Angers (1,5 million d’euros), la Conciergerie (1,1 million d’euros) et le château de Jossigny (0,8 million d’euros).
66 () Programmes de conservation des monuments (21 millions d’euros), aménagements des parcours de visite (13 millions d’euros), réparations courantes (11 millions d’euros), autres investissements – informatique et achat d’œuvres notamment (10 millions d’euros), réalisation d’études diagnostiques relatives à l’état sanitaire du patrimoine (4 millions d’euros).
67 () Rapport n° 1719 du 3 juin 2009.
68 () Audition du 26 mai 2011, 9 heures.
69 () Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ».
70 () Première phrase de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
71 () Loi n° 2003-1312
72 () Ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945.
73 () Décret n° 2004-117 du 4 février 2004.
74 () Comptes entrepreneurs (droit de tirage) et économie des entreprises (1)
Festivals (2)
Structuration et développement professionnels (3)
Production (4 et 5)
Aménagement, équipement des salles de spectacles (6)
Activités des salles de spectacles (7)
Résidences musiques actuelles (8)
Développement à l’international (10).
75 () Rapports de Serge Kancel, juin 2009.
© Assemblée nationale
