

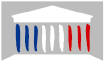
N° 3864
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 octobre 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
RELATIVE À L'ANALYSE DES CAUSES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
ET À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE (1)
TOME II : Auditions
Président
M. Armand JUNG,
Rapporteur
M. Philippe HOUILLON,
Députés.
——
La mission d’information est composée de :
M. Armand Jung, président ; M. Guy Geoffroy, Mme Françoise Hostalier, M. Alfred Trassy-Paillogues, M. Jean-Jacques Urvoas, vice-présidents ; Mme Pascale Gruny, M. François Rochebloine, M. François de Rugy, M. Gérard Voisin, secrétaires ; M. Philippe Houillon, rapporteur ; M. Jean-Jacques Candelier, M. René Dosière, M. Olivier Dosne, M. Jean-Paul Garraud, M. Jérôme Lambert, M. Gilbert Le Bris, M. Marc Le Fur, M. Jean-Louis Léonard, Mme Annick Lepetit, M. Philippe Meunier, M. Jacques Myard, M. Henri Nayrou, M. Dominique Raimbourg, M. Michel Raison, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean-Marc Roubaud, M. Rudy Salles, M. Alain Suguenot, M. Jean-Louis Touraine, M. Christian Vanneste, M. Alain Vidalies, M. Michel Voisin.
Audition de Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière 9
Audition de Mme Anne Guillaume, directrice du laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain (constructeurs automobiles) 23
Audition de M. Claude Azam, chef du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre et de M. Jean-Louis Humbert, chef de la division transports routiers (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) 28
Audition de M. Marc Giroud, président de SAMU-Urgences de France, et de M. François Braun, médecin référent 38
Audition de M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière et de M. Christian Roy, chargé d’études en accidentologie 45
Audition de Mme Anne Lebrun, sous-directrice de la circulation et de la sécurité routières à la direction de la modernisation et de l’action territoriale, au secrétariat général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, accompagnée de M. Guillaume Audebaud, chef du service du fichier national des permis de conduire, et de M. Fabrice Dingreville, chef du bureau de la sécurité et de la réglementation routières 50
Audition de M. Robert Namias, ancien président du Conseil national de la sécurité routière 59
Audition de M. Jean Pechinot, sous-directeur à la direction des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d’assurances, accompagné par Mme Ludivine Daniel, chargée de mission, et Mme Ludivine Azria, attachée parlementaire 68
Audition de M. Jean Chapelon, ancien secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière 74
Audition de M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche) 81
Audition de M. Régis Guyot, préfet 87
Audition de M. Jean-Pierre Pillard, chef de la division police, M. Patrick Letailleur, chef de la division gendarmerie et Mme Dominique Choffé, chef de la division transports au Centre national d’information routière (CNIR) 96
Audition de M. Marc Bertrand, chargé de mission sécurité routière, MM. Frédéric Roy et Nathanaël Gagnaire, membres du bureau national à la Fédération française des motards en colère (FFMC) 102
Audition de MM. Loïc Ratier, président, Fabien Pierlot, vice-président, Jean-Georges Schwartz, trésorier, David Roizen,et Yves-Paul Robert, chargés de mission et M. Laurent Bernard, porte-parole de l’Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d’aides à la conduite (AFFTAC) 112
Audition de M. Yves Gascoin, président de l’association lyonnaise « Les droits du piéton » 121
Audition de M. Jean-Pierre Beltoise, créateur de l’école « conduire juste » 128
Audition de MM. Louis Derboulle, président, Laurent Hecquet, délégué général, Gérard Minoc, responsable de l’Institut d’études des accidents de la route, et Jean-Pierre Fourcat, président de la commission « sociologie des usagers » de l’association « 40 millions d’automobilistes » 135
Audition de Mme Geneviève Laferrère, présidente et de Mme Monique Giroud, suppléante, de la Fédération française des usagers de la bicyclette 143
Audition de Mme Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière 147
Table ronde sur l’acceptabilité sociale de la politique de sécurité routière : M. Fabrice Hamelin et Mme Isabelle Ragot-Court, chargés de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration) ; M. Benoît de Laurens, vice-président et Mme Sophie Dauphin, directrice conseil de l’agence « Lowe Strateus » (ancienne agence de communication de la DSCR) 156
Table ronde sur la sécurité des véhicules : M. Daniel Kopaczewski, sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement) ; M. Jean-Yves Le Coz, expert leader « Sécurité routière » pour le Groupe Renault, M. Jean-François Huère, responsable « Sécurité routière » pour le Groupe PSA Peugeot Citroën, membres du Comité des constructeurs français d’automobiles et M. Nicolas Bertholon du Laboratoire d’Accidentologie, de Biomécanique et d’étude du comportement humain ; M. Christian Sibrik, président de la branche « contrôle technique » du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et Mme Pauline Johanet coordinatrice média et lobbying ; M. Philippe Toussaint, délégué général du Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR) ; M. Dominique Cesari, directeur de recherche émérite à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; M. Jacques Ehrlich, directeur du Laboratoire sur les Interactions Véhicules-Infrastructure-Conducteurs (Livic) à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 171
Table ronde sur les addictions et la conduite : Docteur Charles Mercier-Guyon, secrétaire de la commission médicale de la Prévention routière ; M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; Mme Claudine Pérez-Diaz, chercheuse au CNRS ; Mme Hélène Martineau, directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies ; M. Félix Comeau, président-directeur général et M. Stéphane Vialettes, directeur général de la Société Alcolock (fabricant d’éthylotests anti-démarrage) ; M. Daniel Orgeval, président de l’association I-Tests ; M. Bertrand Jermann, président de la société Ethylo (fabricant d’éthylotests) ; M. Patrick Maroteaux, membre du bureau de l’association « Vin et société » (acteur de la filière viti-vinicole) et Mme Delphine Blanc, directrice des relations institutionnelles ; M. Alexis Capitant, directeur général et M. Jean-Yves Moreau, chargé des actions prévention et des relations avec les partenaires, de l’association « Entreprise et prévention » (association des producteurs de boissons alcoolisées pour la prévention du risque alcool) ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle (DSCR) et M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national de la sécurité routière ; M. Hubert Berry, responsable du département Éthylométrie et addictions au laboratoire national de métrologie et d’essais 194
Table ronde sur le coût économique et social des accidents, leur traitement judiciaire et l’aide aux victimes : M. Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et Mme Martine Hours, médecin épidémiologiste, unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance - Transport Travail Environnement à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; M. François Werner, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ; Mme Barbara Berrebi, chargée d’étude au Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), Mme Nathalie Irisson, secrétaire générale de GEMA Prévention, et M. Philippe Hingray, fondé de pouvoir de la MAAF ; M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) ; M. le Professeur Djamel Bensmail, chef de service en médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches ; Mme Dina et M. Jean-Pierre Freani, parents d’une victime ; Mme Monique Fritz, présidente de l’association « Aide aux victimes des accidents de la route » (AIVAR), M. Nicolas Fritz, membre fondateur, et Me Laurent Hincker, avocat ; M. Vincent Julé Parade, vice-président de l’association « Victimes et citoyens contre l’insécurité routière » ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle, Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) 211
Table ronde sur la fatigue et le défaut d’attention comme facteurs d’accidents :M. Jean-Louis Martin et Mme Catherine Gabaude, chargés de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Mme Anne Guillaume, directrice du Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain ; M. Arnaud Grison, directeur général de Cofiroute (Fondation d’entreprise Vinci autoroutes pour une conduite responsable) ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la DSCR ; M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national de la sécurité routière 234
Table ronde sur l’aptitude à la conduite : MM. Alain Dômont, professeur de médecine, auteur d’un rapport sur les contre-indications médicales à la conduite, Bernard Delorme de l’unité de l’information des patients et du public de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et Joël Valmain, conseiller technique Europe-International auprès de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR ; Docteur Xavier Zanlonghi, membre du service de l’exploration fonctionnelle de la vision à la clinique Sourdille et membre de la Société française d’ophtalmologie (SFO) ; Mme Sylvie Bonin-Guillaume, professeur de gériatrie (Marseille) et membre de la Société française de gériatrie et de gérontologie ; MM. Claude Marin-Lamellet et Bernard Laumon, directeurs de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 250
Table ronde sur la formation à la conduite : M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche au laboratoire de psychologie de la conduite à l’IFSTTAR ; Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité ; M. Loïc Turpeau, président de l’Association nationale pour la promotion de l’éducation routière (formation des moniteurs) ANPER ; M. Marc Meunier, sous directeur de l’éducation routière - Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (DSCR) ; M. Michel Schipman, vice-président de la branche des écoles de conduite et M. Philippe Malpièce, secrétaire de la branche des écoles de conduite du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) 269
Table ronde sur les problèmes spécifiques des deux roues motorisés : M. David Dumain, rédacteur en chef de Moto Journal, et M. Pierre Orluc, rédacteur en chef adjoint ; M. Phan Vuthy, responsable du département accidentologie au CEESAR ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la DSCR ; M. Hervé Gicquel, directeur général du Club 14, M. Michel Guendon et M. Philippe Monneret, vice-présidents ; M. Patrick Jacquot, président-directeur général de l’Assurance mutuelle des motards, M. Patrick Bayse, responsable du département Indemnisation, et M. Bertrand Nelva-Pasqual, responsable du service Études et développement technique ; M. Guillaume Chatillon, responsable marketing France de Piaggio, et M. Timothé de Romance, conseil pour les affaires publiques auprès de Piaggio (cabinet Anténor public affairs) ; M. Jean-Claude Hogrel, président de la branche des professionnels du deux-roues du CNPA, Mme Margaret Erbin, secrétaire générale de la branche des professionnels du deux-roues, et Mme Ève Lambert ; M. Pierre Van Elslande, directeur de recherche à l’IFSTTAR, et M. Jean-Louis Martin, chercheur 282
Table ronde sur le problème spécifique des jeunes : M. Jean Yves Salaün, délégué général de l’Association Prévention routière ; M. Ahmed Lel Khadiri, délégué général de Animafac ; M. Philippe Loup, président de la Fédération générale des associations étudiantes (Fage) ; M. Marc Meunier, sous directeur de l’éducation routière - Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (DSCR) ; M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche à l’IFSTTAR et M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche 301
Table ronde, ouverte à la presse, sur les infrastructures : M. Yves Krattinger, sénateur, président du conseil général de la Haute-Saône, président de la commission « transports et infrastructures » de l’Assemblée des départements de France ; Mme Marie-Line Gallenne, chargée d’animation en sécurité et efficacité des infrastructures à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et M. Dominique Fleury, directeur de recherche ; M. Jean-Louis Hélary, directeur du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ; M. Philippe Redoulez, directeur du Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) ; M. Christophe Saintillan, chef du service infrastructures de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ; M. Lionel Walker, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentant de l’Association des maires de France (AMF) sur les questions de sécurité routière ; Mme Annie Canel, directrice des opérations et de la sécurité de l’Association des sociétés françaises d’autoroute (ASFA) ; M. Thierry Latger, secrétaire général du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics d’État, accompagné de M. Yves Legrenzi, secrétaire national ; M. Olivier Deleu, secrétaire général de l’association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE) 320
Table ronde sur le contrôle sanction automatisé : M. Aurélien Wattez, chef du département du contrôle automatisé à la délégation à la sécurité et à la circulation routière du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; M. Thierry Pocquet du Haut-Jussé, procureur de la République de Rennes, responsable du volet judiciaire du contrôle sanction automatisé, et M. Emmanuel Grandsire, 1er substitut, adjoint au chef du bureau de la politique d’action publique générale de la direction des affaires criminelles et des grâces ; M. Jean-Jacques Debacq, préfet, directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et Mme Isabelle Gally, adjointe au préfet ; M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), et M. Laurent Carnis, économiste, chargé de recherche à l’IFSTTAR ; M. Éric de Caumont, secrétaire général de l’Association des avocats de l’automobile ; M. Sébastien Roux et M. Philippe Zamora, chercheurs au Centre de recherches en économie et statistiques (CREST). 340
Table ronde sur le risque routier professionnel : M. Thierry Fassenot, ingénieur conseil du CNAMTS et Mme Aude Genot, chargée d’études en prévention ; M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilités de la FFSA, M. Jean-Claude Robert, président de l’association Prévention et suivi de la sécurité routière en entreprise, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires de la FFSA ; M. Francis Davoust, vice-président du CNPA, et Mme Pauline Johanet, coordinatrice média et lobbying ; M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, et Mme Patricia Maladry, médecin-chef de l’inspection du travail ; M. Robert Piccoli, conseiller technique travail auprès du délégué interministériel (DSCR) ; M. Jacques Deletang, président national de la Fédération nationale des agents commerciaux, et M. Luc-Alain Leplat, président de la délégation Alsace ; M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’IFSTTAR, et M. Reinhard Gressel, chargé de recherche 360
Audition de M. Jean-Luc Nevache, délégué interministériel à la sécurité routière 372
Auditon de M. Bernard Pottier, président, et de M. Jean-Yves Salaün, délégué général de l’Association Prévention routière 382
Auditon du Général Éric Darras, sous-directeur à la sécurité publique et à la sécurité routière, et du colonel Gérard Escolano, chef du bureau de la sécurité routière et des formations et moyens spécialisés (Gendarmerie nationale) 389
Audition de M. Didier Bollecker, président, et de Roger Braun, directeur général de l’Association française des automobilistes (Automobile Club) 397
Audition de Mme Monique Fritz, présidente, et de M. Nicolas Fritz, membre fondateur de l’Association d’aide aux victimes de la route (AIVAR) 406
Audition de Mme Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale, de M. Jean-Paul Mizzi, directeur général adjoint, de M. Sylvain Lassare et M. Bernard Laumon, directeurs de recherche, et de M. Jean-Louis Martin, chargé de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) 411
Audition de M. Claude Liebermann, président et de M. Dominique Lebrun, inspecteur général de l’équipement de l’Institut national de sécurité routière et de recherches 419
Audition de M. Claude Got, professeur honoraire de médecine 428
Audition de M. Jean Bardet, député, co-président du groupe d’études sur la route et la sécurité routière 441
Audition de MM. Didier Joubert, direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, Jean-Cyrille Reymond, commissaire divisionnaire, Didier Perroudon, contrôleur général « DCSP » 448
Audition de MM. Bernard Darniche, fondateur de l’association Citoyens de la route et Rémy Julienne, consultant spécialiste en sécurité 458
Audition de M. Claude Guéant, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration 464
Déplacement à Strasbourg le 28 juillet 2011 : compte rendu 475
Déplacement à Montlhéry le jeudi 15 septembre 2011 : compte rendu 487
Déplacement à Bruxelles le 28 septembre 2011 : compte rendu 489
Audition de Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière
Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Le développement de la circulation des véhicules motorisés au xxe siècle s’est accompagné d’une forte augmentation de la mortalité jusqu’en 1972, année où 18 034 personnes ont perdu la vie sur les routes. On ne pouvait plus longtemps accepter de payer un tel prix humain et c’est de ce moment que datent les premières mesures contraignantes et des opérations de communication – parmi lesquelles le film « Mazamet, ville morte » – ainsi que la création de la délégation interministérielle à la sécurité routière (DISR), rattachée au Premier ministre.
Malgré ces actions, depuis 1972, de nombreux drames de la route ont continué d’endeuiller les familles de France : 380 000 vies perdues, 8 900 000 blessés, 300 000 handicapés à vie, des dizaines de milliers d’orphelins… Néanmoins, alors que, depuis cette date, le volume du trafic routier a été multiplié par 25, des progrès considérables ont été enregistrés : dans les trente premières années, le nombre de morts sur les routes a été divisé par deux, et de nouveau par deux au cours des dix dernières années. En 2010, pour la première fois, moins de 4 000 personnes – 3 992 très exactement – ont laissé leur vie sur la route. Ce nombre n’avait pas été aussi bas depuis 1948 !
Ces progrès sont d’abord dus à l’amélioration considérable du réseau routier : création de voies séparatives, construction d’autoroutes, amélioration de la qualité des revêtements, rectifications de virages, suppression d’obstacles latéraux et de passages à niveau, création de ronds-points et pose de rambardes. Désormais, les études portent sur la route « intelligente » et « communicante », en relation avec le véhicule de l’usager.
La sécurité du véhicule s’est aussi considérablement améliorée, aussi bien au profit du conducteur et des passagers que des autres usagers. L’impact des chocs entre les véhicules a été réduit. Des dispositifs de freinage ABS et de contrôle de trajectoire, des airbags, des limiteurs de vitesse et des détecteurs d’endormissement, etc. ont été installés. Ces améliorations ont aussi concerné les poids lourds – la dernière en date à cet égard est un rétroviseur couvrant mieux les angles morts – et les transports de personnes. En 2015, le parc de camions et d’autocars français sera sans doute le plus sûr d’Europe : les autocars français seront équipés d’un éthylotest antidémarrage et de ceintures de sécurité pour tous les passagers, et seront accessibles aux handicapés.
Avec l’apparition de nouveaux modes de propulsion et de locomotion, notamment de la propulsion électrique, il convient maintenant de se préoccuper de la coexistence entre véhicules de natures différentes. Certains seront très légers, d’autres très lourds. L’organisation de la sécurité routière en sera rendue encore plus complexe.
L’amélioration de cette sécurité est aussi largement due à celle de la chaîne des secours. L’alerte, l’intervention des forces de l’ordre, des pompiers, du SAMU et de l’hôpital, ainsi que les soins, ont connu des progrès considérables depuis 1972. Une meilleure articulation entre les intervenants et des techniques plus efficaces ont permis non seulement de diminuer la gravité des accidents mais aussi d’assurer à beaucoup de blessés – qui, auparavant, auraient pu décéder – le retour à une vie meilleure.
Les progrès ont aussi pour origine une meilleure adaptation des comportements des usagers de la route aux règles qui organisent l’usage collectif de la liberté constitutionnelle d’aller et venir. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à occuper l’espace public de mobilité, celui-ci ne croît que fort peu. Les règles instaurées visent à limiter les risques et à codifier droits et devoirs de façon que chacun puisse utiliser la rue et la route sans mettre en péril sa vie ni celle des autres.
Ces comportements se modifient sous l’effet d’une action publique multiforme : prévention sur le terrain, en liaison avec les associations ; campagnes de communication, dont certaines ont beaucoup marqué nos imaginaires et nos mémoires ; formation – aujourd’hui, avec 1,3 million d’épreuves annuelles, l’examen du permis de conduire est devenu le premier de France – ; la dissuasion, autrement dit la peur du gendarme, et enfin la sanction, lorsque celle-ci est nécessaire au respect de la règle. Tous ces leviers sont utilisés simultanément avec un unique objectif : moins de morts, de blessés et d’accidents.
L’histoire de la sécurité routière a été marquée par des décisions fortes : limitation des vitesses sur les routes – à 90, 110 ou 130 kilomètres/heure selon les cas – en 1973 et 1974, limitation de la vitesse en ville à 50 km/h en 1990, obligation de porter la ceinture de sécurité à l’avant, hors agglomération en 1973 et en agglomération en 1979, puis à l’arrière en 1990. Et je n’aurai garde d’oublier les mesures de prévention de l’alcoolisme prises depuis 1970, en 1990 et 1995 notamment, puis tout récemment dans la LOPPSI, facteur d’avancées considérables : souvenons-nous qu’il y a seulement quinze ou vingt ans, en cas d’accident, l’alcoolisme était encore considéré comme un facteur atténuateur de la responsabilité.
À ces mesures s’ajoutent le permis à points, créé en 1989 et entré en vigueur en 1992, l’automatisation des contrôles et des sanctions en 2002 et 2003, la fin des indulgences et enfin la loi contre la violence routière, adoptée en 2003.
Toutes ces décisions ont été vécues comme des restrictions de la liberté individuelle, suscitant souvent des débats houleux. Elles n’ont parfois été que difficilement acceptées, même si une grande partie des conducteurs, soucieux de leur sécurité et du respect des règles, s’y sont pliés. Les progrès n’ont pas non plus été linéaires. Il y a eu des retours en arrière. Cependant, les gains en termes de vies sauvées ont été au rendez-vous.
En 2002 a commencé une nouvelle étape. La sécurité routière a été proclamée « grande cause nationale » par le Président de la République. Aussitôt, les ministres chargés de l’intérieur et des transports ont mis en œuvre la fin des indulgences, lancé le programme de déploiement des radars et fait voter la loi contre la violence routière.
En 2007, non seulement la sécurité routière a été confirmée comme grande cause nationale, mais le Président de la République a fixé pour objectif de ramener en 2012 à moins de 3 000 le nombre annuel des morts de la route, notamment en combattant l’alcool au volant et en réduisant la surmortalité des jeunes ainsi que la « sur-accidentalité » des usagers des deux-roues motorisés.
En vue d’atteindre ces objectifs, quatre réunions du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ont suivi le conseil restreint présidé par le Président de la République fin 2007. Les trois premières, tenues en février 2008, janvier 2009 et février 2010, ont abouti à 103 mesures, dont 101 sont déjà en application. La dernière s’est tenue le 11 mai dernier et ses décisions seront mises en œuvre avant le mois de septembre pour l’essentiel, et avant la fin de l’année pour le reste.
Grâce à l’action menée, la baisse de la mortalité routière a été continue de 2002 à 2010, même si elle a marqué des paliers en 2007, puis en 2009, année où une diminution de 103 décès pour les usagers de véhicules autres que les deux-roues a été contrariée par une augmentation de 101 décès d’usagers de deux-roues motorisés.
En 2010, nous avons renoué avec les progrès, le nombre des tués baissant de 6,6 %, celui des accidents de 7 %, celui des blessés de 7,1 % et celui des personnes hospitalisées de 8,8 %.
Cependant, à partir de janvier 2011, et pendant quatre mois consécutifs, la courbe s’est inversée. Une augmentation de 13 % des décès – 144 de plus que pendant les quatre mêmes mois de 2010 – a laissé présager, en cas de confirmation de la tendance, une mortalité de 4 500 personnes à la fin de l’année.
Les causes de cette dégradation ne pourront être comprises qu’avec le recul. Il est cependant possible d’effectuer une observation et de proposer quelques hypothèses.
D’abord, pour la première fois depuis 2007, les chiffres du premier trimestre ont été mauvais dans l’ensemble de l’Europe. Selon la Commission européenne, ils seraient en augmentation de 4 %. Les quelques améliorations auraient en effet été compensées par des aggravations de 10 % en France, mais de 16 % en Allemagne, de 19 % en Finlande et de 29 % en Suède.
Si nous ne disposons pas encore d’explications de nos collègues de ces pays, nous pouvons supposer que la météorologie extrêmement défavorable à la circulation au début de 2010 avait entraîné une forte diminution du trafic, des vitesses et de la circulation des deux-roues motorisées. Au contraire, du fait de la reprise économique, le début de l’année 2011 a connu une augmentation du trafic, notamment des camions. À cela se sont ajoutées de meilleures conditions météorologiques, qui ont favorisé les départs en week-end et entraîné une reprise de l’utilisation des deux-roues motorisés un mois et demi plus tôt que l’année précédente. Enfin, ont joué une diminution de l’effet dissuasif des radars et le développement d’attitudes de contournement de certains usagers, ainsi que l’annonce de mesures liées à la LOPPSI : chaque fois que les automobilistes ont pu penser que la sévérité pourrait s’atténuer, on a assisté à une détérioration momentanée de la sécurité routière.
Cette détérioration a paru suffisamment alarmante au Gouvernement pour justifier une rapide réaction de sa part, d’autant que le 11 mai, jour où devait se réunir le CISR, était aussi celui du lancement à l’ONU de la décennie mondiale de la sécurité routière – l’insécurité routière tue chaque année dans le monde 1,3 million de personnes et en blesse 50 millions. Pour autant, le comité a pu s’appuyer sur nombre d’éléments : sur l’analyse des données de sécurité routière, qui vous sera présentée par l’Observatoire national interministériel de sécurité routière, sur les résultats des travaux et études réalisés dans les années passées par le réseau scientifique et technique, sur les concertations engagées sous l’égide de la Sécurité routière ou en liaison avec elle – notamment sur un « code de la rue », sur les deux-roues motorisés et sur l’aptitude à la conduite –, sur les observations remontant du terrain via les préfets, et sur les discussions avec les partenaires de la route : sociétés d’autoroute, assureurs, constructeurs et associations de victimes. À ce dernier propos, j’ai communiqué à la Mission, en avant-première, un guide d’aide aux familles des victimes de la route, qui vient d’être élaboré en collaboration avec les ministères de l’intérieur, de la justice et de la santé et qui est préfacé par le ministre de l’intérieur. Mais, pour accompagner toutes nos actions, nous menons une plus large politique de communication. Ainsi, depuis ce matin, une nouvelle campagne a été lancée à la télévision à l’attention de ceux qui, souvent raisonnables dans la vie courante, changent profondément d’attitude une fois au volant et transgressent les règles. Nous venons aussi d’achever deux campagnes, l’une sur l’usage du téléphone et l’autre pour expliquer les risques routiers ; dans ce contexte, avec les émissions C’est pas sorcier et Auto-moto, nous avons monté un film décortiquant, chaque fois en une minute, 91 risques pour mieux faire comprendre et respecter les règles qui permettent d’y parer.
(Le président Armand Jung remplace Mme Françoise Hostalier à la présidence de la séance)
Les commentaires pourtant abondants qui ont été faits des décisions prises par le dernier CISR n’ayant peut-être pas donné une idée exacte de leur portée, je m’attacherai pour finir à les retracer plus précisément.
Ces décisions concernent d’abord la vitesse, l’alcool et la drogue. Ces trois facteurs étant causes, ensemble, de la moitié des morts de la route, il s’imposait de ne pas relâcher l’effort.
L’excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été transformé en délit dès la première infraction.
Nous avons aussi décidé de poursuivre le développement de notre gamme de radars. Depuis 2003, elle s’est considérablement enrichie : nous disposons désormais de radars capables de mesurer la vitesse, mais aussi de radars discriminants, permettant de distinguer les camions des voitures, de radars mesurant le respect des feux rouges, de radars installés aux passages à niveau, de radars de chantier, que nous pourrons déplacer, de radars permettant de mesurer la vitesse moyenne sur un parcours et, à partir de cet été, nous expérimenterons des radars « mobiles-mobiles », embarqués dans des véhicules de police qui pourront continuer à circuler.
Nous allons déployer 1 000 radars supplémentaires en 2011 et 2012.
Il a aussi été décidé de supprimer l’annonce des radars mais on présenterait plus exactement la chose en disant qu’il s’agit de poursuivre la démarche pédagogique qui a présidé à l’implantation de ces appareils. Pour accoutumer les Français à respecter les limitations de vitesse, il avait d’abord été décidé d’annoncer les radars fixes 400 mètres à l’avance. Puis nous avons demandé de mettre progressivement fin à l’annonce des radars mobiles. En 2010, une nouvelle étape a été franchie dans cette pédagogie avec l’éloignement de l’annonce, faite désormais à un ou deux kilomètres du ou des radars – sans précision de leur nombre. Le temps est maintenant venu d’une troisième étape, où nous éloignons encore plus l’information du lieu des contrôles, en annonçant par des « radars pédagogiques », très en amont, l’entrée dans une zone où un ou plusieurs radars peuvent être présents.
De plus, de nombreux radars – ceux qui sont installés aux feux rouges et ceux qui seront demain déployés dans les véhicules de police en mouvement – ne feront l’objet d’aucune annonce.
Notre politique en la matière est donc claire. Dans un premier temps, nous allons déployer 200 premiers radars pédagogiques, aux emplacements des panneaux d’avertissement que nous aurons supprimés. Ensuite, dans le cadre d’un nouveau marché, nous allons installer deux fois 2 000 radars pédagogiques supplémentaires très en amont des radars destinés à sanctionner ainsi que dans des zones accidentogènes – du fait de dangers particuliers ou de travaux par exemple – qui seront déterminées département par département. Ces radars sont interactifs : loin de se contenter de préciser la vitesse maximale, ils indiquent sa vitesse au conducteur, et ajoutent donc un élément supplémentaire à cette pédagogie du respect de la vitesse que nous nous attachons à développer.
La décision d’interdire les avertisseurs de radars complète cette politique de transformation de l’annonce des radars en annonce des zones dangereuses. Le ministère de l’intérieur travaille actuellement à déterminer jusqu’à 5 000 ou 10 000 zones où l’attention des usagers sera particulièrement appelée sur les dangers spécifiques encourus. La volonté du Gouvernement est de développer l’ensemble des technologies nouvelles au bénéfice de la sécurité routière. Tout cela se fera donc sans préjudice pour les autres fonctionnalités des GPS ou des avertisseurs, qui doivent pouvoir continuer à fournir aux conducteurs le maximum d’informations utiles – emplacement des postes d’essence, des aires de repos, etc. –, dans les meilleures conditions et au bénéfice de la sécurité routière.
Le label « voiture sûre » va quant à lui favoriser l’installation, en première monte et en série, de limiteurs de vitesse, de dispositifs d’éthylotests antidémarrage et, en général, de tous les systèmes permettant de rendre le véhicule encore plus sûr, sur la base du volontariat. Par exemple, coupler le GPS et le limiteur de vitesse donne le LAVIA (limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée) dont tous les travaux prouvent qu’il est efficace à 85 %.
La LOPPSI a apporté beaucoup de solutions en matière d’alcoolémie. À partir de 0,8 gramme d’alcool dans le sang, l’aggravation du risque est très nette. Pour empêcher les buveurs d’habitude de prendre le volant, nous souhaitons développer l’éthylotest antidémarrage. Nous avons aussi multiplié les campagnes de communication et des actions à l’attention des jeunes, notamment la campagne « Sam – celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas » et l’organisation du raccompagnement à l’issue des soirées.
Les deux-roues motorisés, qui représentent moins de 2 % du trafic, ont été cause en 2009 de 28 % de la mortalité, au lieu de 9 % dix ans plus tôt. Or, 50 % de ces tués sont des jeunes de moins de trente ans. Si nous avons renoncé aux plaques d’immatriculation à l’avant, nous souhaitons accroître la dimension des plaques arrière jusqu’à leur faire atteindre celle des plaques allemandes, pour les rendre lisibles. En concertation avec les associations de conducteurs de deux-roues motorisés, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la formation. Nous avons ainsi rendu obligatoire une formation de sept heures pour ceux des conducteurs qui ne sont pas titulaires d’un permis moto.
Nous avons aussi cherché à améliorer la visibilité et la protection du motard. Si nous n’avons pas imposé le port du gilet jaune, nous savons qu’un motard qui tombe cesse d’être visible. Pour cette raison, nous voulons que les motards portent un brassard, peu coûteux, qui leur permette d’être vus par les autres usagers.
En relation avec le monde médical, mais aussi avec les sociétés d’autoroutes, nous nous sommes préoccupés de tout ce qui peut distraire les conducteurs ou contribuer à leur endormissement.
Enfin, nous avons donné une importance majeure à la prévention, ainsi qu’à la place du citoyen dans la sécurité routière. À cette fin, il a été décidé de relancer le Conseil national de la sécurité routière (CNSR). Celui-ci doit être réorganisé pour tenir compte des nouvelles responsabilités des collectivités territoriales. Il nous faut aussi développer l’éducation à la sécurité routière dispensée dans les lycées depuis l’an dernier. Enfin, nous devons intervenir dans les entreprises, car la première cause de mortalité au travail, c’est la route.
Telles sont les dispositions arrêtées par le CISR. Par leur cohérence, elles doivent permettre de faire diminuer l’insécurité routière. L’objectif de 3 000 morts sur les routes est tout à fait à notre portée.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Madame la déléguée interministérielle, pourriez-vous nous donner des indications sur le mode de fonctionnement de la Délégation interministérielle à la sécurité routière, sur ses effectifs – une centaine d’agents, je crois –, sur son budget et sur la part de ses crédits qui est consacrée à la communication ? Vous avez conclu, je suppose, un marché public avec une agence de communication.
Depuis votre prise de fonctions, en juillet 2008, quelles ont été les campagnes de communication menées ?
Pourriez-vous être plus précise sur les mesures arrêtées par les précédents CISR et sur leur application ?
Quelles sont vos relations avec l’Observatoire de la sécurité routière ? Combien de réunions celui-ci tient-il ?
Quelle est la périodicité des réunions du Conseil national de la sécurité routière ? Quels enseignements en tirez-vous ?
Si vous ne pouvez pas nous répondre précisément aujourd’hui, peut-être pourriez-vous nous adresser une note sur chacun de ces points. La Mission devra sans doute aussi vous revoir d’ici au mois d’octobre.
Comme certaines associations, vous évoquez l’incidence de la météorologie sur le nombre d’accidents. Disposez-vous d’un instrument de mesure, région par région, voire département par département, susceptible d’étayer cette corrélation ?
J’ai compris de votre propos liminaire que la progression du nombre d’accidents, réelle en France, était supérieure dans d’autres pays d’Europe, mais que vous n’aviez pas encore l’explication de cette recrudescence.
Comment expliquez-vous l’ampleur de la levée de boucliers – allant jusqu’à des manifestations – suscitée par l’annonce des décisions du 11 mai dernier ? N’y avait-il pas lieu de mener au préalable une action de pédagogie ou de communication ? Où se trouve selon vous le seuil de tolérance aux mesures que vous proposez ?
Alors que les préfets ont fait démonter la plupart des panneaux avertisseurs de la présence de radars, nous ne disposons que de peu d’éléments sur le respect des engagements pris de lancer une autre communication. Que pouvez-vous nous en dire ?
Les usagers disent accepter d’être contrôlés, mais non d’être piégés. Considérez-vous comme convenable et efficace que des contrôles soient effectués par des agents qui se dissimulent ?
Enfin, avez-vous réfléchi à un éventuel bridage des véhicules, de façon qu’ils ne puissent dépasser la vitesse légale ? On sait que la publicité dont certains font l’objet s’appuie bel et bien sur la vitesse...
Mme Michèle Merli. Le budget de la DISR est de 54,6 millions d’euros et se décompose en trois grands programmes – nous vous communiquerons toutes les données à ce sujet. Nous consacrons entre 16 et 17 millions d’euros à la communication. Le poste le plus coûteux est l’achat d’espaces, pour lequel nous dépensons deux à trois millions d’euros par campagne. C’est d’ailleurs ce point qui nous a conduits à lancer à l’attention des jeunes une campagne sur Internet, média beaucoup plus économique : nous y avons diffusé le film « Insoutenable », qui a rencontré un très grand succès, avec 10 millions de connexions.
Je vous ferai parvenir un tableau de toutes les campagnes conduites depuis 2007.
Comme je l’ai dit, les trois CISR tenus depuis 2007, avant celui du 11 mai dernier, ont pris 103 décisions, dont 101 sont mises en œuvre ; nous vous en communiquerons le détail. La rédaction du décret d’application des décisions prises le 11 mai sera bientôt achevée.
M. le rapporteur. J’avais cru comprendre, sur ce point précis, que le Premier ministre attendrait les résultats des travaux de la présente Mission d’information avant de prendre des mesures nouvelles, y compris réglementaires.
Mme Michèle Merli. Seule la mise au point du texte est en cours. Il faut bien partir de propositions, d’éléments écrits de débat, qui pourront ensuite être modifiés.
M. le rapporteur. Vous nous confirmez donc qu’il s’agit simplement de la préparation d’un fond de dossier écrit, et que, hormis l’enlèvement des panneaux, déjà annoncé, aucune mesure ne sera prise avant la remise de notre rapport ?
Mme Michèle Merli. Certaines mesures ne soulèvent absolument aucune difficulté.
M. le rapporteur. Vous nous confirmez donc qu’aucune mesure nouvelle ne sera prise sans que la Mission en ait été avertie.
Mme Michèle Merli. L’Observatoire interministériel de la sécurité routière est une structure indépendante, dirigée par un ingénieur et composée d’une toute petite équipe. Il travaille avec le réseau scientifique et technique du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il élabore les statistiques, puis les consolide à partir des bulletins d’accidents remplis par les forces de l’ordre puis vérifiés par le réseau des observatoires départementaux et régionaux. Même s’il réalise de façon autonome ses propres travaux, l’Observatoire est associé à toutes les réunions de la Délégation à la sécurité et à la circulation routières, nous fournissant les éléments statistiques dont nous avons besoin pour travailler avec nos partenaires. Ainsi, depuis que nous avons engagé une concertation sur les deux-roues motorisés, il a mené une série d’études qui nous assure une connaissance beaucoup plus fine de cette catégorie d’accidents.
Le CNSR a réalisé ses derniers travaux à la fin de 2007 et au début de 2008. Alors qu’il avait été question de le supprimer, nous avons réussi à obtenir son maintien, mais dans une configuration nouvelle. Nous devons en effet tenir compte aujourd’hui de nombreuses modifications dans toute une série de thématiques. Par exemple, les thématiques relatives à la conduite, notamment à celle des personnes âgées, imposent une plus forte représentation du corps médical. La décentralisation de la responsabilité du réseau routier justifie aussi un accroissement de la présence des collectivités territoriales.
M. le rapporteur. Serait-ce à dire que le Conseil national ne s’est pas réuni depuis 2008 ?
Mme Michèle Merli. En effet. Ses réunions ont été remplacées par des concertations sur les thématiques pour lesquelles nous avions besoin d’un partenariat plus large, en particulier avec le corps médical : deux-roues motorisés, code de la rue, aptitude à la conduite. La relance du CNSR venant d’être décidée dans le cadre du comité interministériel, nous travaillons à un nouveau décret modifiant sa composition.
M. Jacques Myard. Selon le Gouvernement, des associations considèrent que c’est parce que les députés ont allégé les retraits de points de permis que le nombre des accidents de la route a augmenté en France. Le fait que ce nombre ait crû dans d’autres pays d’Europe, comme vous l’avez souligné, amène à rechercher ailleurs l’explication. Pour moi, celle-ci réside notamment dans la vitesse et dans la consommation d’alcool ou de drogue. Un conducteur ivre peut tuer à 30 km/h !
Le réseau routier, avez-vous aussi noté, a été considérablement amélioré. Dans la ville dont je suis le maire, le nombre de blessés est tombé de 96 à moins de 10 sans qu’un seul radar soit posé, uniquement grâce à l’amélioration de la signalisation. Autrement dit, il y a bien d’autres mesures efficaces que l’installation de radars.
Pouvez-vous nous indiquer aussi les raisons expliquant que, selon certaines statistiques, 10 % de nos concitoyens conduiraient sans permis ? Cette situation ne rend-elle pas vaine la politique de développement du nombre de radars, la sanction par le retrait de points ou de permis ne fonctionnant plus ? En revanche, cette politique semble bien interdire la recherche des causes sociologiques de ce nouveau comportement d’un certain nombre de conducteurs…
M. Christian Vanneste. À mon sens, la réaction négative de la population aux propositions faites repose sur la distinction insuffisante entre excès de vitesse à petite et à grande allure. Alors que chacun est favorable à la répression des grands excès de vitesse, une proportion importante de nos concitoyens considère que la répression des petits excès de vitesse, à petite allure, a pour objectif non pas de réduire le nombre de morts mais de faire entrer de l’argent dans les caisses de l’État.
Des associations telles que la Ligue contre la violence routière exposent souvent que toute diminution de la vitesse, aussi faible soit-elle, entraîne une diminution du nombre de morts. Dispose-t-on de statistiques sur le sujet ? Si les vitesses élevées sont la cause d’un grand nombre d’accidents et de morts, je ne pense pas que tel soit le cas des petits excès de vitesse. Or ceux-ci finissent par être la cause de retraits de permis à des professionnels de la route qui perdent du même coup leur emploi – et ce pour la seule raison qu’ils parcourent un grand nombre de kilomètres, alors qu’à aucun moment ils n’ont mis de vies en danger.
Les motos étant dépourvues de carrosserie, leurs utilisateurs sont plus vulnérables. Or la première cause de la diminution de morts en voiture, c’est l’amélioration considérable de la sécurité des automobiles, et non pas la lutte contre les excès de vitesse. A-t-on envisagé d’imposer aux motards le port de vêtements protecteurs, dotés d’un airbag par exemple ? Ils sont coûteux, certes, mais ce serait sans doute l’un des premiers moyens de réduire le nombre des morts parmi cette catégorie d’usagers de la route.
Si l’alcoolémie coûte plus cher que la vitesse – la combinaison des deux étant terrible –, la consommation de drogue, également désastreuse, est peu évoquée. La raison de ce silence n’est-elle pas que les moyens de la détecter coûtent plus cher et sont plus rares que ceux qui permettent de déceler la présence d’alcool, alors que les effets sont rigoureusement les mêmes ?
Enfin, pendant les années 2002 et 2003, plusieurs comités avaient évoqué la possibilité d’un contrôle médical des conducteurs. Alors que tous devraient être concernés, on visait surtout les personnes âgées, de sorte que la survenue de la canicule a fait renoncer à cette idée… Quel est l’état actuel de la réflexion sur ce contrôle de l’aptitude physique à la conduite, quel que soit l’âge, tel que le pratiquent nombre de pays étrangers ?
M. Jean-Louis Léonard. Je suis surpris qu’aujourd’hui, pour diminuer le nombre de décès, la coercition soit privilégiée. Pourquoi n’a-t-on pas développé des réglementations incitatives auprès des constructeurs pour généraliser la technologie du LAVIA, développée sur des crédits d’État en association avec l’ensemble de la recherche française ? Le gain qui en résulterait serait supérieur à celui d’une réglementation renforcée pour des raisons conjoncturelles.
Pourquoi mépriser aussi la technologie ? Pourquoi supprimer les avertisseurs de radar ? L’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) a parfaitement démontré que leur utilisation incite les conducteurs à la prudence. Que n’a-t-on écouté les chercheurs ? Le freinage devant les panneaux avertisseurs de radars et l’accélération une fois le radar passé sont aussi des phénomènes tout à fait marginaux. Une fois le véhicule ralenti, il lui faut beaucoup de temps pour retrouver éventuellement une vitesse excessive. N’étant fondée ni sur des faits réels ni sur les résultats de la recherche, la suppression des panneaux avertisseurs me paraît être une mauvaise décision.
Je suis moi aussi surpris que l’action ne porte que sur la vitesse, en oubliant la consommation d’alcool. La décision de développer les éthylotests anti-démarrage aurait rassuré les parents et nous aurions eu là un moyen de minorer fortement les risques mortels. Le ministre de l’intérieur ayant mentionné cette piste, je suis désolé qu’on ne s’y soit pas engagé.
M. Philippe Meunier. Comment et par qui les mesures récemment prises ont-elles été préparées ? Les associations de motards, qui nous disent travailler depuis deux ans sur les mesures de sécurité à prendre pour les deux-roues, n’ont apparemment pas été associées à ces décisions. Pouvez-vous le confirmer et, si oui, jugez-vous cela normal ?
Je regrette également que les mesures annoncées soient exclusivement des mesures de répression. Le rejet du corps social me semble dès lors fondé, la sécurité routière devant reposer aussi sur la prévention. Mais sans doute est-il plus facile de sanctionner la vitesse !
M. Alfred Trassy-Paillogues. Madame la déléguée interministérielle, pouvez-vous nous communiquer la liste de tous les organismes qui travaillent pour la sécurité routière, ainsi que le montant des subventions publiques que chacun reçoit ?
Pourquoi n’avez-vous pas évoqué la somnolence au volant ?
Disposez-vous de statistiques sur les motifs des procès-verbaux qui sanctionnent les conducteurs ? Connaît-on les causes, ou les successions de causes, qui conduisent aux retraits de permis ?
Il ne vous a sans doute pas échappé que certains éléments de signalisation sont inappropriés, fantaisistes, voire dangereux. Il est bon de responsabiliser les conducteurs, mais avez-vous prévu de faire de même des services de l’État et des forces de l’ordre qui ont connaissance de ces indications incorrectes et ne les signalent pas ? Envisagez-vous des sanctions dans ces cas ?
Mme Annick Lepetit. Puisqu’un nouveau marché de 2 000 radars pédagogiques, en plus de ceux qui sont déjà en cours d’installation, va être passé, pouvez-vous nous préciser les expérimentations qui ont été conduites sur le sujet ? Selon vous, justifient-elles l’extension de leur nombre ? Les détracteurs de ces radars considèrent aussi qu’ils peuvent parfois produire des effets contraires à ceux qui sont escomptés. Certains conducteurs, m’a-t-on dit, s’amuseraient à les déclencher en dépassant la vitesse autorisée.
Comment expliquez-vous que, alors que le permis de conduire est devenu le premier examen de France, de plus en plus de personnes prennent le volant sans permis ? Est-ce parce que ce permis leur a été retiré, ou parce qu’elles n’ont jamais passé l’examen ?
Avez-vous étudié l’éventualité d’une réforme du permis de conduire ? De plus en plus coûteux, il demande de véritables sacrifices financiers. Un volet de prévention et d’information, plus large que le simple apprentissage technique de la conduite, serait-il envisageable ? Travailler sur les comportements me paraît nécessaire.
Enfin, les trois-roues sont de plus en plus nombreux. Leur cylindrée dépasse souvent largement 125 centimètres cubes. Or, alors que pour conduire des deux-roues de ces cylindrées, un permis moto spécifique est demandé, il n’en est rien pour ces engins. Envisagez-vous de leur étendre cette obligation ?
M. Henri Nayrou. La fonction des radars fixes est-elle d’abord de faire ralentir les véhicules à l’approche de passages dangereux, ou de sanctionner leurs conducteurs par des amendes et des pertes de points pouvant conduire à celle du permis de conduire ?
L’installation de radars pédagogiques ou de dispositifs d’information sur les zones dangereuses me semble la moindre des choses. Ne se moque-t-on pas quand on met ces mesures en avant ?
Est-il exact que la somnolence n’est pas techniquement prise en compte dans les statistiques d’accidents ? Est-il vrai aussi que 2 % seulement des automobilistes sanctionnés le sont pour avoir roulé à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ?
Enfin, seriez-vous d’accord ave moi pour considérer que si le permis de conduire donne le droit de conduire, il n’est en aucun cas un certificat de la capacité à bien conduire ?
M. le président Armand Jung. Le nombre et l’intérêt des questions posées confirment la nécessité d’organiser une seconde audition.
Mme Michèle Merli. S’agissant de l’incidence de la météorologie, monsieur le rapporteur, le modèle sur lequel on s’appuyait, très ancien, a cessé d’être pertinent du fait de l’évolution des modes de circulation, et est en cours de refonte. M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, pourra vous en dire plus à ce sujet. Cette refonte fait en effet partie des missions confiées à l’Observatoire, à côté d’études nouvelles dont nous devrons absolument tirer la substantifique moelle, comme nous l’avons fait s’agissant de l’usage du téléphone au volant, pour lequel nous mettons en œuvre les décisions proposées par l’INSERM et l’INRETS.
Nous communiquerons à la Mission les comparaisons établies par la Commission européenne sur l’évolution comparée de l’accidentologie dans les pays européens.
Je ne sais que répondre à propos de la levée de boucliers contre les mesures récemment prises. J’ai rappelé que la plupart des principales décisions du passé ont de même fait l’objet de violentes attaques. L’obligation du port de la ceinture de sécurité a même été considérée par certains comme source d’accidents supplémentaires ! Or, aujourd’hui, plus personne n’aurait l’idée de la contester. L’une des causes des protestations actuelles est sans doute aussi que, alors même que, depuis quatre mois, nous devions bien constater une détérioration très nette de la sécurité routière, ces décisions n’étaient pas attendues.
Les travaux effectués de 2004 à 2006 ont montré que le LAVIA informatif était efficace à 85 %. En revanche, alors que le GPS peut dès aujourd’hui indiquer la vitesse maximale sur une portion de route, nous ne disposons toujours pas, malgré nos travaux, d’une cartographie qui puisse être mise à jour instantanément. La décision de modifier les limitations relève en effet des collectivités territoriales, qui peuvent la prendre à tout moment. Cela étant, nous souhaitons, comme vous monsieur Léonard, coupler le GPS au limiteur de vitesse afin que la technologie moderne de la communication embarquée vienne assister le conducteur pour l’aider à éviter d’être sanctionné. Le jour où les radars ne rapporteront plus rien à l’État, nous aurons gagné la bataille de la régulation de la vitesse et de la sécurité routière ! Les radars ne sont pas là pour piéger les conducteurs. Les premiers à être installés l’ont été dans les endroits les plus accidentogènes.
M. Henri Nayrou. Mais quelle est votre priorité à vous ?
Mme Michèle Merli. C’est, sans ambiguïté, de faire baisser le nombre d’accidents, et la vocation des radars est de finir par ne plus servir !
Le ministre de l’intérieur a la volonté de faire travailler ses services, département par département, à la lisibilité de la route. Ce travail n’a pas été suffisamment effectué. Lors de mes déplacements, je demande que des comités d’usagers soient réunis par les préfets, pour que chacun puisse alerter sur des signalisations déficientes, ou encore sur des changements de limitation de vitesse trop fréquents pour permettre une conduite cohérente. Le préfet de la région Rhône-Alpes a réuni l’ensemble des gestionnaires de voirie pour leur demander de se mettre d’accord sur la gestion cohérente de chaque itinéraire ; la multiplication des changements de limitation de vitesse rendant cette gestion impossible, il a proposé une vitesse moyenne cohérente, assortie d’une signalisation spécifique des passages éventuellement dangereux.
Aujourd’hui, l’essentiel du travail des départements est la rectification des signalisations et des limitations de vitesse. Il existe probablement des endroits où la vitesse maximale est inférieure à celle que réclame une circulation sûre. Il faut donc organiser des réunions entre tous les partenaires de la route pour essayer, département par département, de constituer des itinéraires cohérents, intelligents et compréhensibles par tous. La réglementation sera alors mieux respectée.
Le lancement de cette concertation est la traduction de notre volonté d’améliorer pour tous nos concitoyens la lisibilité de la route. Personne n’a pour objectif de piéger les automobilistes. Ce travail aboutira à une diminution considérable des mécontentements liés aux difficultés de la route.
Eu égard au nombre des questions posées, la DISR se permettra, si vous le voulez bien, d’y répondre précisément par écrit. Je reviendrai aussi volontiers devant vous.
Ce que nous voulons, c’est rendre facile la vie des usagers de la route. Il reste que la vitesse est bien l’une des causes des accidents de la route. Son incidence sur l’accidentalité relève d’une loi des grands nombres.
M. Alfred Trassy-Paillogues. Votre action vise à faire diminuer la vitesse moyenne.
Mme Michèle Merli. Sa diminution explique largement celle du nombre d’accidents.
M. Jacques Myard. Comment se fait-il alors que ceux-ci aient recommencé à augmenter ?
Mme Michèle Merli. Même si elle entre en ligne de compte, la vitesse n’est pas la seule cause des accidents. Si j’ai présenté l’ensemble des motifs qui peuvent expliquer l’augmentation des accidents depuis quatre mois, nous ne disposons pas aujourd’hui d’une explication définitive. Nous travaillons avec nos homologues étrangers à comprendre ce qui a pu se passer en Europe pendant les trois premiers mois de l’année 2011.
Nous évaluons le nombre de personnes qui conduisent sans permis à 400 000 ou 410 000, dont les deux tiers n’ont jamais passé le permis.
M. Jacques Myard. Les services de police concluent des sondages qu’ils effectuent à une proportion de 10 %. J’ai entendu ce chiffre de la bouche de hauts responsables du ministère de l’intérieur. Dans les Yvelines, les contrôles menés par la police et la gendarmerie font également ressortir cette proportion sur 3 500 contrôles. Vos chiffres, qui émanent des associations actives en matière de sécurité routière, ne semblent donc pas correspondre à la réalité.
Mme Michèle Merli. Les chiffres que je vous ai donnés émanent non pas d’associations, mais de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.
La proportion de conducteurs sans permis est très supérieure dans les grandes agglomérations à celle qu’on peut observer en milieu rural, où les conducteurs sont beaucoup plus rares à conduire sans permis. C’est ce qui peut expliquer le pourcentage dont vous faites état.
Le permis de conduire est un véritable examen. Il est très difficile à réussir ; il faut apprendre beaucoup et certains jeunes, en échec scolaire ou réfractaires aux examens, sont incapables de fournir l’effort qu’il exige. Cette situation est très grave.
Le coût du permis – entre 1 200 et 1 500 euros, un peu plus en région parisienne –est d’un niveau comparable à celui qu’on peut constater dans les autres pays européens. Pour y faire face, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Le permis à 1 euro par jour permet au jeune d’emprunter à taux zéro, avec une caution familiale, ou, pour ceux qui ne peuvent en bénéficier, une caution donnée par les pouvoirs publics ; 20 000 jeunes par an peuvent la fournir, sachant qu’ils n’auront que 30 euros par mois à rembourser sur une durée pouvant aller jusqu’à 46 mois. Ce dispositif rend le tarif du permis acceptable, même s’il demeure élevé – mais chacun ne passe cet examen qu’une fois dans sa vie.
M. Alfred Trassy-Paillogues. Ce dispositif a échoué.
Mme Michèle Merli. Par ailleurs, beaucoup de collectivités locales créent à l’intention des jeunes des « bourses au permis de conduire ». Il s’agit d’une prise en charge partielle du coût du permis, allant de 400 à 800 euros, en échange d’une participation à des tâches effectuées par des associations communales. Ce dispositif et le permis à 1 euro par mois étant cumulables, nous disposons donc bien désormais de formules fonctionnelles permettant de diminuer le coût du permis.
Un petit nombre de jeunes peut aussi bénéficier d’écoles sociales, qui permettent de resocialiser des jeunes en situation d’échec et ne pouvant que difficilement passer leur permis.
Depuis deux ans, nous travaillons sur l’ensemble des questions relatives aux motards dans le cadre de la concertation sur les deux-roues motorisés. La possibilité de conduire un trois-roues sans permis moto prendra bientôt fin : la transcription de la troisième directive européenne sur le permis de conduire aboutira en effet à une harmonisation des permis dans toute l’Europe et rendra impossible, à partir de 2013, de conduire sans permis adéquat aussi bien un cyclomoteur qu’un trois-roues.
Les motards n’étant pas protégés par une carrosserie, nous nous sommes préoccupés de leur protection. Il avait été envisagé en CISR de leur imposer une tenue spécifique. Il est cependant impossible d’imposer le même équipement à un conducteur de cyclomoteur et à celui d’une moto de 600 centimètres cubes. Nous sommes donc en train d’élaborer, avec la participation des médecins de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches et celle d’un champion du monde d’enduro, un guide de l’équipement des motards précisant celui qui est nécessaire en fonction de la vitesse que le deux-roues peut atteindre. Il sera diffusé cet été.
Nous participons aussi à la mise au point du gilet à airbag. J’ai assisté à des démonstrations. Aujourd’hui, il existe des équipements s’encastrant sous le casque qui permettent de rigidifier la colonne vertébrale, afin d’éviter fractures du rachis, hémiplégies et tétraplégies.
La publication du guide sera accompagnée d’une campagne destinée à inciter tous les jeunes à s’équiper correctement dès cet été. Les médecins nous disent que tomber de moto sur la voie publique, c’est tomber sur une râpe à fromage et être ensuite, à l’hôpital, nettoyé à la brosse à chiendent !
Nous travaillons aussi à un guide d’aménagement de la voirie pour résoudre les difficultés spécifiques que celle-ci pose aux motards. Je vous en ai communiqué un exemplaire.
Enfin, dans le cadre de la concertation avec les associations représentatives des usagers de deux-roues motorisés, nous travaillons sur la formation, pour préparer la transcription de la troisième directive et pour faire prendre conscience que l’accès à la puissance doit être fonction de l’âge et de l’expérience.
Si l’accidentalité des deux-roues motorisés a connu un fort recul en 2010, c’est que, pour la première fois, nous avons intégralement consacré à ces engins la « semaine de la sécurité routière ». Pour la première fois aussi, nous avons réalisé pour la télévision des films montrant la vision qu’a un motard de la route derrière sa visière, afin que les autres usagers, voyant les choses du même point de vue, apprennent à les respecter au même titre que les motards doivent respecter l’ensemble des règles communes.
M. Philippe Meunier. Vous travaillez avec les associations de motards, nous dites-vous. Mais, à leur demande, ceux-ci ont été des milliers ce week-end à manifester contre les mesures prises, sans concertation, nous disent-ils. Comment expliquez-vous le fait ?
Mme Michèle Merli. Nous travaillons sur de nombreuses mesures. Vous allez auditionner, je crois, M. Régis Guyot, qui a exploré les « gisements » de sécurité routière en ce qui concerne les deux-roues motorisés et élaboré 78 propositions. Nous avons lancé une concertation sur celles-ci. Nous en avons écarté certaines, comme la plaque minéralogique à l’avant. En revanche, nous voulons que la plaque arrière soit lisible. Les motards doivent comprendre que l’ensemble des règles de sécurité routière leur est applicable. Or nous savons qu’ils respectent moins les limitations de vitesse que les autres usagers. On ne saurait non plus admettre que les plaques arrière soient trafiquées ou rendues illisibles.
M. le rapporteur. Le bridage des véhicules fait-il partie de vos hypothèses de travail ? Se heurte-t-il à des difficultés industrielles ? La promotion des véhicules est aussi fondée sur la vitesse ! Pourquoi cette question n’est-elle pas abordée ?
Mme Michèle Merli. Elle l’est par l’intermédiaire du limiteur volontaire de vitesse, embrayable et débrayable par l’usager. Son efficacité étant de 85 %, nous voulons en favoriser le développement et le coupler avec une transmission embarquée de l’information sur les limites de vitesse applicables.
M. le rapporteur. Comment concilier l’idée selon laquelle la vitesse doit être limitée parce qu’elle est une cause d’accident et la commercialisation de véhicules de plus en plus rapides ?
Mme Michèle Merli. Nous ne pouvons pas agir à l’échelle française. Nous souhaitons convaincre l’Union européenne de rendre obligatoire l’équipement, en première monte, de tous les véhicules, de quelque gamme qu’ils relèvent, d’un limiteur volontaire de vitesse. Le ministre de l’intérieur y tient beaucoup. C’est ainsi que nous allons pouvoir progresser.
Par ailleurs, la vitesse d’une forte proportion des engins à propulsion électrique que nous allons voir se multiplier sur nos routes sera limitée à 130 km/h. Dès lors que sera ainsi mis en évidence l’intérêt d’une telle limitation, il sera possible d’aller beaucoup plus loin dans le bridage des voitures.
Enfin, le bridage à 130 km/h d’un véhicule n’empêchera pas son conducteur de commettre des excès de vitesse en ville, où la vitesse est limitée à 30 ou 50 km/h. L’outil le plus intéressant pour la sécurité routière est donc bien le limiteur de vitesse volontaire, qui permet au conducteur de réguler celle-ci, et, couplé au GPS, d’éviter tout risque de verbalisation.
M. le président Armand Jung. Merci, madame la déléguée interministérielle, pour vos propos et vos réponses. J’ai bien noté que vous allez répondre en détail par écrit à toutes les questions posées. La Mission devra aussi vous réentendre. Je demande à nos collègues qui n’ont pas pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient de les communiquer à la présidence de la Mission, qui les transmettra à la DISR.
*
* *
Audition de Mme Anne Guillaume, directrice
du laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain (constructeurs automobiles)
M. le président Armand Jung. Nous accueillons maintenant Mme Anne Guillaume, directrice du laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain. Pourriez-vous, madame, en nous présentant ce laboratoire, nous dire en quoi il se distingue de la multitude d’autres organismes s’occupant de sécurité routière ?
Mme Anne Guillaume. Le laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain, ou LAB, a été créé en 1969 par Renault et PSA – devenu depuis PSA Peugeot-Citroën –, à un moment où le nombre de tués sur les routes ne cessait de s’élever. Sa vocation est d’analyser les causes et les conséquences des accidents. En effet, ceux-ci étant le plus souvent d’origine multifactorielle, la sécurité routière doit être l’affaire de tous les acteurs, pouvoirs publics, conducteurs ou constructeurs.
En tant que laboratoire de recherche amont, le LAB produit des connaissances scientifiques pour les deux constructeurs en sorte qu’ils puissent développer des systèmes de sécurité adaptés. Nous analysons les causes des accidents à partir de bases de données et d’enquêtes que nous conduisons sur le terrain et, sur ce fondement, nous établissons des hypothèses sur lesquelles travaille le service de biomécanique. Nous sommes alors à même de fournir aux constructeurs des éléments pour la mise au point des systèmes de sécurité. Ensuite, nous vérifions l’efficacité de ceux-ci, en biomécanique, par nos enquêtes sur le terrain et via nos bases de données accidentologiques, en cherchant à identifier les dispositifs les plus prometteurs.
L’accidentologie recouvre un champ très vaste. Nous travaillons à la fois en faveur de la sécurité primaire – prévenir l’accident – et en faveur de la sécurité secondaire – réduire autant que possible les conséquences de l’accident. Nous étudions aussi les comportements des conducteurs afin de déterminer leurs besoins et de leur fournir les aides à la conduite les plus appropriées.
Nous nous appuyons sur des bases de données nationales et internationales – européennes en particulier mais nous recourons aussi à la GIDAS (German In-Depth Accident Study) allemande et à la CCIS (Co-operative Crash Injury Study) britannique. Cependant, le LAB a aussi constitué ses propres bases. Ainsi, en accidentologie secondaire, nos spécialistes examinent les véhicules accidentés pour déterminer le type de choc, sa force, pour être à même d’établir ensuite comparaisons et statistiques ; ils relèvent également les dispositifs de sécurité dont étaient dotés les véhicules impliqués ainsi que les lésions subies par les occupants, afin d’établir le lien entre choc et lésion.
Pour donner un exemple de nos conclusions, l’enquête effectuée par le LAB sur l’évolution des lésions, graves à mortelles, subies par un conducteur ceinturé lors d’un choc frontal démontre que les dispositifs dont les véhicules ont été dotés au fil des années – en premier lieu le renforcement de l’habitacle, mais avec tous les compléments indispensables que sont l’airbag, la ceinture de sécurité, les limiteurs d’efforts, etc., car la rigidité accrue des structures augmente l’énergie transmise aux passagers – ont permis de diminuer très sensiblement l’importance des lésions pour un même choc.
Dans le domaine de l’accidentologie primaire, les équipes du LAB, en coopération avec le Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR), recueillent sur le terrain les informations labiles sur les conditions de survenue des accidents. Cela permet de déterminer les situations accidentelles et leur fréquence, d’analyser de façon très détaillée ce qu’on appelle les « pertes de contrôle », mais aussi, à partir de scénarios réels, de tester ensuite par simulation les systèmes de sécurité primaire. Nous avons ainsi, dans le cadre du projet européen TRACE, démontré que l’aide au freinage d’urgence et le système de contrôle électronique de stabilité ESC permettaient de réduire de 70 % le nombre des blessures graves ou mortelles.
La biomécanique consiste à tester de façon rigoureuse toutes les hypothèses de lésion en laboratoire, en reproduisant expérimentalement les conditions des accidents. Il s’agit d’évaluer, à l’aide de mannequins – nous en avons un pour chaque type de choc – le risque de lésions, de comprendre les mécanismes à l’œuvre. Nous essayons également d’améliorer les mannequins utilisés par les constructeurs pour évaluer leurs systèmes de sécurité – nous espérons parvenir à dépasser le stade des modèles numériques pour arriver à un « modèle être humain ».
On a avec la ceinture de sécurité un exemple de ce que peut produire la collaboration entre le LAB et les constructeurs. Il s’agit en effet, sous une apparente simplicité, d’un dispositif extrêmement complexe comportant un bloqueur de sangle, des prétensionneurs et un limiteur d’effort thoracique, dont la mise au point a été permise par une analyse biomécanique de l’effort supporté au niveau du thorax lors d’un choc – et nos données accidentologiques ont confirmé l’efficacité d’un tel dispositif pour réduire les risques de lésions graves.
Depuis de nombreuses années, le LAB est très impliqué dans des projets européens axés sur la protection des enfants. Il a ainsi reconstitué un accident pour rechercher l’origine des lésions abdominales observées sur une fillette en dépit du dispositif de retenue, et a conclu à une mauvaise position du harnais. Plus généralement, une étude sociologique menée dans le cadre du projet européen CASPER (Child Advanced Safety Project for European Roads), a mis en évidence un taux de 70 % d’utilisation incorrecte des dispositifs de retenue destinés aux enfants, les DRE. C’est à partir de ces observations que les constructeurs ont mis au point le système ISOFIX d’ancrage de sièges qui équipe tous les nouveaux véhicules depuis 2009.
Dans l’avenir, le LAB a l’ambition d’améliorer la sécurité des nouveaux véhicules électriques, de travailler sur les véhicules « communicants » et de participer à des projets internationaux.
M. le président Armand Jung. Les travaux du LAB bénéficient-ils à d’autres constructeurs que Renault ou Peugeot-Citroën ?
Mme Anne Guillaume. Nous participons à un grand nombre de projets collaboratifs et nous publions la plupart de nos résultats.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Quelles mesures techniques préconiseriez-vous au législateur pour améliorer la sécurité ? Que pensez-vous du bridage des véhicules ? Cette solution vous semble-t-elle réaliste dans une économie mondialisée ? Le low cost est-il compatible avec la sécurité ?
Mme Anne Guillaume. Renforcer les contraintes de sécurité secondaire n’est pas forcément la solution d’avenir, car on ne peut indéfiniment alourdir les véhicules, d’autant que les normes environnementales poussent plutôt dans le sens d’un allégement. Les perspectives offertes par les véhicules communicants semblent sans doute plus intéressantes. Surtout, il serait temps de raisonner en termes de sécurité intégrée, c’est-à-dire incluant la sécurité primaire. Il faut désormais avoir une conception globale de la sécurité dans sa dimension multifactorielle, intégrant tous les acteurs.
M. le rapporteur. Ce n’est pas le cas ?
Mme Anne Guillaume. En matière de sécurité routière, on pointe toujours la responsabilité des constructeurs alors que ceux-ci font déjà beaucoup dans ce domaine. Il faudrait aussi considérer le comportement de l’ensemble des usagers, y compris donc les piétons et les utilisateurs de deux-roues, et ne pas demander à la technologie seule d’améliorer la sécurité routière. La prise de conscience doit être générale.
L’accidentologie nous montre qu’en France les autoroutes, qui sont pourtant les voies les plus rapides, sont aussi les plus sûres, ce qui conduit à penser que le bridage n’est pas la solution. En tout état de cause, la France ne peut pas prendre seule une mesure de ce genre, le marché étant international.
Certes, les voitures de luxe sont équipées de tous les dispositifs de sécurité les plus perfectionnés. Cependant, la plupart des gens considérant aujourd’hui la mobilité comme un droit, les constructeurs font le maximum pour développer des systèmes de sécurité financièrement abordables pour une grande majorité des consommateurs.
M. Jacques Myard. Les constructeurs comptent-ils équiper à très court terme tous les véhicules de série d’avertisseurs du type Coyote, signalant les limitations de vitesse et les bouchons dus aux accidents ?
Mme Françoise Hostalier. On ne peut pas nier que certains systèmes de protection des enfants sont d’une utilisation trop complexe. Ne devrait-on pas adopter le système, en usage aux États-Unis, de la ceinture de sécurité à déclenchement automatique, fixée à la portière ? Y a-t-il une homogénéisation des normes de sécurité au niveau européen ? Certaines de vos analyses portent-elles sur les deux-roues ? L’équipement des véhicules par des dispositifs de sécurité de plus en plus sophistiqués ne va-t-il pas donner aux conducteurs un sentiment d’assurance dangereux ?
M. Jean-Louis Léonard. Vos recherches ont-elles une incidence sur l’évolution de la réglementation ? Y a-t-il une coopération entre les constructeurs européens ? Vos recherches sont-elles le fruit de commandes des constructeurs ? Dans quelle mesure pouvez-vous influer sur leurs décisions ? Enfin, quelle place occupent les sciences humaines dans vos analyses ? Autrement dit, recherchez-vous les causes culturelles des accidents ?
M. Christian Vanneste. Les accidents trouvent aussi leur origine dans le comportement et l’état du conducteur. Peut-on envisager un véhicule capable de contrôler ces éléments – de détecter par exemple l’état de somnolence, responsable de 30 % des accidents ?
Mme Pascale Gruny. Les sièges d’enfants les moins chers sont-ils vraiment sûrs ? Par ailleurs, je ne comprends pas qu’on autorise la circulation des véhicules électriques, dangereux pour les piétons parce que trop silencieux.
M. Michel Raison. La démocratisation de la technologie embarquée n’est-elle pas le nouveau défi à relever pour assurer la sécurité primaire ?
M. Philippe Meunier. Les progrès accomplis en deux décennies en matière de sécurité, sous la pression de la réglementation et de la concurrence, sont considérables. Quelles nouvelles améliorations prévoyez-vous à échéance de dix ou vingt ans ? Une voiture puissante, équipée d’un système de freinage adapté à la grande vitesse, n’est-elle pas de ce fait plus sûre qu’une voiture bon marché ?
Mme Anne Guillaume. Je pense que les constructeurs seront dans quelques années à même d’équiper leurs véhicules d’un système limitant la vitesse en fonction des indications fournies par le GPS.
M. Jacques Myard. Sera-ce possible à partir des panneaux de signalisation routière ?
Mme Anne Guillaume. Je pense qu’un dispositif de communication directe avec la voiture est réalisable, mais à un coût extrêmement élevé car cela supposerait d’équiper tous ces panneaux d’émetteurs. Le GPS, malgré l’imprécision de la cartographie, permet un repérage assez fiable et pourra donner au conducteur toutes les indications de vitesse utiles.
En ce qui concerne la protection des enfants, les constructeurs se sont efforcés de simplifier les dispositifs de retenue, contribuant ainsi à améliorer la sécurité. Il semble en revanche que la communication sur ces dispositifs soit insuffisante, nos enquêtes montrant que peu de parents connaissent le système ISOFIX. En tout état de cause, les DRE sont homologués au niveau européen et les constructeurs n’ont pas leur mot à dire en la matière. Mais peut-être faudrait-il envisager d’imposer des normes plus sévères… Quant au système de ceinture de sécurité à déclenchement automatique, il est onéreux, pour un intérêt modeste, le taux de port de ceinture étant excellent en France. Il s’agit en réalité d’un dispositif de confort plutôt que de sécurité.
Associant accidentologie et biomécanique sous l’égide des constructeurs, le LAB fait figure d’exception parmi les laboratoires européens. Cela ne nous empêche pas de participer à quatre projets européens, dont DaCoTA (Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis), qui vise à harmoniser le recueil des données d’accidents à travers l’Europe. Nous travaillons également en collaboration avec les organismes actifs dans nos domaines de compétence.
Même si nous avons participé à une étude « 2RM » du PREDIT (programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres) sur les deux-roues motorisés, et à différentes études consacrées aux piétons, le LAB se consacre avant tout à la sécurité du véhicule quatre-roues.
Le développement des technologies de sécurité ne déresponsabilise pas le conducteur, qui reste maître à bord : c’est toujours lui qui prend la décision, même s’il est aidé. En outre, les constructeurs veillent à ce qu’il ne soit pas abreuvé par un flux d’informations qu’il serait incapable de maîtriser ou qui ne lui seraient pas directement utiles.
Le LAB contribue à l’évolution de la réglementation via sa participation à une quinzaine de groupes préréglementaires et normatifs, comme les groupes de travail sur les normes ISO.
Conformément au souhait des constructeurs, le LAB compte développer dans l’avenir ses analyses du comportement humain. Nous envisageons notamment d’utiliser ces nouveaux outils que sont les field operational tests et l’observation naturaliste, qui visent à suivre le comportement d’un conducteur lambda grâce à des capteurs équipant son véhicule. S’agissant d’outils extrêmement onéreux, ces enquêtes sont en général menées dans le cadre de projets européens. Les études de ce genre qui ont déjà été conduites aux États-Unis ont permis de recueillir nombre d’informations très instructives sur le comportement du conducteur avant l’accident ou le « presque accident ». Elles ont ainsi montré que la somnolence était une cause d’accident beaucoup moins fréquente que l’on ne croyait. Richard Hanowski en particulier a montré que des accidents qui pouvaient lui être imputés étaient dus en fait à la distraction du conducteur, occupé à chercher un objet par exemple.
M. Jacques Myard. Avez-vous auditionné des conducteurs qui avaient fait des tentatives de suicide au volant ?
Mme Anne Guillaume. Il y a très peu de cas de suicides dans nos bases de données. De toute façon, nous n’auditionnons pas les conducteurs.
En ce qui concerne la sécurité des piétons, les deux constructeurs sont engagés dans un projet européen relatif aux moyens de sonoriser les véhicules électriques roulant à faible vitesse, leur bruit étant suffisant dès que leur vitesse augmente.
Mme Pascale Gruny. Ne faudrait-il pas alors conseiller à leurs conducteurs d’accélérer ?
Mme Anne Guillaume. Je n’irai pas jusque-là ! Par ailleurs, certains de ces véhicules seront également équipés d’un détecteur de piétons.
M. Christian Vanneste. Ne pourrait-on équiper les pneus des véhicules électriques de bandes de roulement sonore ?
Mme Anne Guillaume. À grande vitesse, cela produirait un bruit intolérable !
M. le président Armand Jung. Pourrez-vous nous faire connaître les grandes tendances qui se dégagent des bases de données sur lesquelles vous travaillez et les préconisations les plus urgentes en matière d’accidentologie ?
Mme Anne Guillaume. Ces données ne signifient pas grand-chose en elles-mêmes.
M. le rapporteur. Les causes des accidents n’y figurent-elles pas ?
Mme Anne Guillaume. Elles ne les décrivent pas de façon suffisamment détaillée tant que nous ne les avons pas retravaillées selon des critères bien précis. Elles nous permettent, en amont de fournir des orientations aux constructeurs, et en aval d’évaluer la performance des systèmes de sécurité.
M. le président Armand Jung. Qu’est-ce qui vous semble prioritaire ?
Mme Anne Guillaume. Même s’il faut évidemment continuer à progresser dans le domaine de la sécurité secondaire, la sécurité primaire et la sécurité tertiaire constituent désormais la priorité des constructeurs.
*
* *
Audition de M. Claude Azam, chef du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre et de M. Jean-Louis Humbert, chef de la division transports routiers (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement)
M. le président Armand Jung. Le processus d’auditions qui vient de commencer doit nous permettre d’entendre toutes les personnalités, administrations et associations et tous les organismes qui comptent dans le domaine de la sécurité et de la prévention routière.
Nous accueillons aujourd’hui M. Claude Azam, chef du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), et M. Jean-Louis Humbert, chef de la division transports routiers au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, que je remercie de leur présence.
Si le bureau d’enquêtes est souvent évoqué par les médias, il reste peu connu du grand public. Notre Mission d’information va s’intéresser principalement aux causes des accidents de la circulation, qu’il est souvent difficile d’appréhender de manière objective comme de hiérarchiser. Au-delà des drames qui endeuillent chaque année des milliers de familles et des passions, elle se donne pour objectif de présenter au Gouvernement, dès le mois d’octobre, des propositions aussi précises que possible.
M. Claude Azam, chef du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT). C’est un grand honneur pour nous d’intervenir aujourd’hui devant votre Mission d’information. Notre exposé s’articule en trois parties, qui seront respectivement consacrées aux missions du BEA-TT, à l’analyse d’un certain nombre d’accidents significatifs de la circulation routière, et aux enseignements et orientations que nous en tirons pour la prévention routière.
Rattaché au ministre chargé des transports, le BEA-TT est un service récent : il a été créé en 2004, bien après ses aînés, le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, né en 1946, et le bureau enquêtes accidents de mer, né en 1997.
C’est à la suite de l’accident du tunnel du Mont-Blanc, dans lequel 39 personnes ont trouvé la mort, que vous avez décidé – par la loi – de créer le BEA-TT. Son champ d’intervention couvre tous les transports terrestres : transports ferroviaires, transports guidés, transports routiers et voies navigables. Il n’existe aucun organisme de ce type dans les autres pays européens, qui ne disposent en général – en vertu d’ailleurs d’une directive européenne – que d’un bureau d’enquêtes accidents ferroviaires.
Notre mission consiste à analyser les circonstances et les causes des accidents ou incidents graves ou complexes, à émettre des recommandations destinées à prévenir de futurs accidents ou incidents similaires, et enfin à assurer le suivi de leur prise en compte – ce qui ne veut pas dire leur mise en œuvre. La loi se borne en effet à prévoir que les destinataires de ces recommandations ont trois mois pour nous répondre qu’ils les prennent – ou non – en compte.
Les décisions d’ouverture des enquêtes techniques sont prises par le directeur du BEA-TT à la demande ou avec l’accord du ministre chargé des transports, tout au moins en ce qui concerne la circulation routière puisque, s’agissant de la circulation ferroviaire, la directive européenne nous laisse la plus grande latitude.
La loi nous confère une totale indépendance dans l’organisation des enquêtes, la conduite des investigations et l’établissement de nos conclusions. Notre capacité d’investigation est très large, avec un droit d’accès à tous les éléments et documents utiles à la conduite de l’enquête, ainsi qu’au dossier d’information ou d’instruction judiciaire. Les textes définissent précisément les relations que nous sommes autorisés à entretenir avec le procureur de la République et le juge d’instruction. Cette capacité d’investigation est assortie d’un régime de sanctions – que nous n’avons jusqu’ici jamais eu à mettre en œuvre – en cas d’entrave à l’action des enquêteurs.
Nous n’en avons pas moins des obligations : nous en tenir à une analyse technique des circonstances et des causes des accidents, ne jamais émettre d’opinion sur les responsabilités des acteurs concernés, rendre publics les rapports qui concluent les enquêtes, consultables sur internet, et respecter le secret de l’instruction et le secret médical. Le rapport étant le plus souvent rendu public avant la clôture de l’instruction, nous vérifions avec le juge d’instruction que son contenu ne risque pas de gêner l’instruction en cours.
Pour faire face à ses missions, le BEA-TT dispose de 7 enquêteurs permanents, affectés à l’une ou l’autre de ses deux divisions – transports ferroviaires ou guidés et transports routiers. Nous pouvons également recourir à des enquêteurs occasionnels, commissionnés pour les besoins d’une enquête.
Depuis sa création, le BEA-TT a conduit 108 enquêtes techniques, soit une vingtaine par an ; 28 concernent le seul transport ferroviaire et 54 impliquent des véhicules routiers, dont 16 concernent des accidents survenus au droit de passages à niveau.
Vous l’aurez compris, nous choisissons les accidents sur lesquels nous conduisons une enquête, et ce en fonction de trois critères. Il y a d’abord la gravité de l’accident, ensuite ses circonstances –pour prendre un exemple, nous ne faisons jamais d’enquête sur les accidents dont peuvent être victimes les jeunes qui sortent de boîte de nuit après avoir trop bu ou pris des stupéfiants. Leurs causes ressortissent en effet à l’accidentologie générale. Or nous n’avons pas vocation à faire de l’accidentologie générale, mais à venir en complément de celle-ci pour analyser les comportements ou les situations accidentogènes. Troisième critère : les personnes impliquées dans l’accident ; dans la mesure où nous avons le souci de formuler des recommandations opérationnelles, bon nombre de nos enquêtes concernent des accidents impliquant des professionnels de la route.
Jean-Louis Humbert va maintenant vous présenter une sélection de 11 accidents significatifs, que nous avons classés selon leur type.
M. Jean-Louis Humbert, chef de la division transports routiers au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les accidents de transports en commun de personnes – autocar ou autobus – sont un premier type d’accidents. Il a fait l’objet de 15 enquêtes. Je vous en présenterai 4 exemples.
Il s’agit d’abord de l’encastrement d’un autocar dans un passage souterrain à gabarit réduit, survenu à Rouen le 5 février 2010. Un autocar transportant des enfants s’est engagé sous un passage souterrain à gabarit réduit de 2,70 mètres de hauteur. La hauteur de l’autocar étant de 4 mètres, celui-ci a été littéralement « décapité ». La première cause de cet accident spectaculaire tient au manque d’attention de la conductrice, qui était préoccupée par des problèmes personnels et portait des écouteurs pour écouter de la musique sur son lecteur MP3 – elle s’est donc retrouvée « coupée » de l’environnement de conduite. Les autres causes sont l’insuffisance de réaction de l’entreprise de transport, qui avait détecté de mauvaises pratiques de conduite chez cette conductrice lors d’évaluations périodiques non obligatoires, l’absence de ceintures de sécurité dans l’autocar, et enfin l’absence de portique de sécurité signalant le gabarit en amont du passage souterrain – il avait en effet été accidenté et n’était pas encore remplacé.
Le deuxième exemple, qui fut très médiatisé, est l’accident survenu à un autocar polonais dans la descente de Laffrey, sur la commune de Notre-Dame-de-Mésage, dans l’Isère, le 22 juillet 2007. Ayant perdu sa capacité de freinage en bas de la descente, l’autocar a fait une sortie de route et s’est écrasé après une chute de 15 mètres, avant de s’embraser. Les facteurs qui peuvent expliquer l’accident sont ici le non-respect – délibéré – de l’interdiction de la descente de Laffrey aux poids lourds et autocars, une conduite inappropriée dans la descente – le conducteur savait mal conduire en montagne et n’a pas utilisé le frein moteur – ainsi que le mauvais état du système de freinage, qui n’était pas signalé par les témoins d’alerte.
Le troisième accident s’est produit le 20 janvier 2006 sur la ligne régulière Arles-Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l’heure de la sortie des classes. L’intérêt de ce cas est de soulever la question des problèmes médicaux. C’est en effet à la suite du décès du conducteur – dû à un arrêt cardiaque – que l’autocar est sorti de la route. Or, bien souvent, comme ici, le médecin du travail hésite à déclarer l’inaptitude en cas de problèmes cardiaques. L’employeur n’étant pas au courant, l’accident finit par se produire. L’absence de port de la ceinture par la plupart des passagers a été un facteur aggravant.
Le dernier exemple est constitué par la collision d’un autocar de transport scolaire et d’un poids lourd, le 12 mars 2007, à Angliers, dans la Vienne. Malgré le panneau « Cédez le passage », l’autocar a refusé la priorité à un camion-benne et s’est encastré sur le côté de ce dernier. Outre le refus de priorité, nous avons incriminé une mauvaise visibilité sur la droite depuis l’intérieur de l’autocar, et des problèmes de discipline. Un élève a été tué dans l’accident : il était assis sur le tableau de bord, dos au pare-brise ! Là encore, l’absence de ceintures de sécurité – l’autocar, ancien, n’en était pas équipé – a été un facteur aggravant.
Les accidents de poids lourds constituent une deuxième catégorie d’accidents, qui a fait l’objet de 9 enquêtes. J’en citerai deux exemples.
Il y a d’abord la collision entre un autocar et un poids lourd survenue le 5 mars 2009 sur l’autoroute A9, à Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales. Après avoir heurté l’autocar stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, à seulement 80 centimètres de la voie de droite, le poids lourd a terminé contre les glissières du terre-plein central. Cet accident est assez représentatif de ceux qui se produisent sur les autoroutes : les arrêts sur la bande d’arrêt d’urgence sont particulièrement dangereux. Le premier facteur qui peut expliquer l’accident est donc l’arrêt inopportun de l’autocar sur la bande d’arrêt d’urgence – à la suite de la fermeture défectueuse d’une porte de soute à bagage, qui n’avait pas été détectée par le système de verrouillage centralisé – alors même qu’une aire de service était annoncée à 300 mètres. Par ailleurs, la trajectoire du poids lourd, qui roulait à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence, était anormale, probablement en raison de la conduite en convoi de deux poids lourds. Il est à noter que le conducteur du poids lourd avait été sanctionné quelques mois auparavant sur une autre autoroute pour non-respect de la distance de sécurité.
L’enquête sur le deuxième accident est toujours en cours. Elle concerne la collision entre deux poids lourds survenue le 16 décembre 2010 sur l’autoroute A8, à La Trinité. À la suite d’une panne, un camion-citerne de transport de GPL s’est arrêté sur la voie de droite de l’autoroute, dans le contournement de Nice. Un camion-plateau transportant un mobil-home a heurté ce camion-citerne, qui s’est immédiatement enflammé. L’accident aurait pu être beaucoup plus grave s’il avait eu lieu à un autre endroit. Les facteurs ayant joué un rôle sont ici l’hypovigilance ou l’inattention du conducteur du camion-plateau, décédé dans l’incendie, mais surtout le manque de résistance à l’arrachement de la vanne de fond de cuve du camion-citerne. Celui-ci n’aurait jamais dû prendre feu. La réglementation européenne en vigueur impose en effet que la vanne de fond de cuve se referme en cas d’arrachement afin d’empêcher toute fuite. Néanmoins, les dispositions constructives ne sont guère précises, si bien que les constructeurs ont une marge d’interprétation. Il serait donc bon de procéder à une harmonisation de ces normes de sécurité.
Les accidents liés aux conditions de trafic constituent un troisième type d’accidents, qui a fait l’objet de 4 enquêtes. J’évoquerai deux exemples.
Il s’agit d’abord du carambolage impliquant 24 véhicules survenu le 19 octobre 2008 sur l’autoroute A4, à Courcelles-Chaussy, en Moselle. Le brouillard a certes joué un rôle dans l’accident, mais il n’est pas inhabituel dans cette région, notamment en cette période de l’année. C’est donc la présence de fumées – provenant de la combustion de bottes de paille répandues à proximité de l’autoroute à la suite de l’incendie d’un hangar agricole – qui a été déterminante. La combinaison du brouillard et de la fumée produit en effet un nuage très opaque – le fameux smog anglais. D’autre part, il s’est révélé difficile d’informer les usagers sur les difficultés qu’ils allaient rencontrer.
Le deuxième exemple, classique de la « queue de bouchon », est celui de la collision entre une file de véhicules et un poids lourd, survenue le 24 juillet 2006 sur la RN10, à Reignac, en Charente. Le poids lourd, qui roulait à 85 kilomètres-heure, a écrasé un camping-car qui se trouvait arrêté à la queue d’un bouchon provoqué par un premier accident. Le camping-car a été littéralement écrasé entre deux poids lourds : sa longueur a été réduite à environ 1,50 mètre. L’assoupissement du conducteur du poids lourd a pu être établi, les appareils de mesure ayant mis en évidence des oscillations de vitesse caractéristiques d’une alternance de phases de sommeil et de réveil. En outre, il avait eu une semaine de travail chargée et traînait une dette de sommeil due à des dépassements d’horaires ; il participait en plus à la moisson le samedi ! Enfin, une forte canicule sévissait à cette date. On note également l’absence d’alerte des usagers, la fourgonnette devant annoncer la « queue de bouchon » n’étant pas encore positionnée au moment de l’accident.
Les incendies spontanés de véhicules constituent un quatrième type d’accidents, qui a fait l’objet de trois enquêtes. À la suite des accidents des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, nous avons cherché à comprendre pourquoi les poids lourds et les autocars prenaient feu. Nous nous sommes ici intéressés à l’incendie d’un autocar à étages survenu le 23 février 2008 sur l’autoroute A43, au péage de Chignin, sur la commune des Marches, en Savoie. Le constat est simple : un autocar brûle très bien et très vite. Il concentre en effet dans un volume réduit le moteur, qui comporte des pièces très chaudes, les échappements, et un certain nombre de matériaux inflammables. Dans le cas présent, le feu venait de la chaudière. Il a couvé vingt minutes dans le compartiment moteur, à l’arrière du véhicule, avant que d’autres usagers de la route n’avertissent le conducteur à la vue des flammes. Il ne restait alors que dix minutes avant la combustion totale de l’autocar, qui a heureusement pu s’arrêter et évacuer ses passagers à temps. Les facteurs qui concourent à expliquer l’accident sont ici la désolidarisation du tuyau d’échappement de la chaudière, le manque de propreté de l’environnement de celle-ci, qui était couvert de résidus graisseux et de carburants inflammables, l’absence de détecteur d’incendie, la vulnérabilité des autocars à l’incendie, dont j’ai déjà parlé, et enfin la présence d’un seul escalier d’accès à l’étage, problématique pour l’évacuation. Dans le cas présent, les passagers étaient des jeunes revenant des sports d’hiver ; mais qu’en aurait-il été avec des personnes moins mobiles ?
Cinquième type d’accidents : les accidents impliquant un autre mode de transport, qui ont fait l’objet de 16 enquêtes. Je rappellerai d’abord le dramatique accident survenu à Allinges le 2 juin 2008, où 7 collégiens avaient alors trouvé la mort à la suite de la collision entre un TER et un autocar. L’autocar a été heurté par le TER sur un passage à niveau ; sa partie arrière a été arrachée. Parmi les facteurs ayant joué un rôle dans l’accident vient d’abord l’immobilisation de l’autocar, peut-être due à des facteurs mécaniques, mais plus encore au mouvement de panique du chauffeur qui, ayant bloqué le véhicule contre une bordure, a calé et n’a pu redémarrer assez vite. Cela a cependant été favorisé par la géométrie difficile du passage à niveau, qui rendait sa traversée longue et délicate pour des véhicules lourds et encombrants. La marge de sécurité par rapport au délai d’annonce des trains était donc réduite : pour un délai d’annonce des trains de 24 secondes, il fallait environ 13 secondes à un autocar pour traverser. Dans le cas présent, il s’est lancé au moment où le feu rouge s’allumait : le moindre incident pouvait donc être fatal.
Mme Françoise Hostalier. Y avait-il des barrières ?
M. Jean-Louis Humbert. Oui, mais elles ont commencé à s’abaisser 7 secondes après que les feux rouges du passage à niveau se furent allumés et que la sonnerie eut retenti. Au terme de la manœuvre, il restait 8 secondes avant le passage du train – c’est le dispositif classique. L’autocar a démarré son franchissement au moment où les feux rouges s’allumaient. Lorsque les barrières se sont abaissées, il n’était pas tout à fait sorti du passage à niveau. Comme il roulait légèrement sur la gauche, il a braqué à droite à la vue de la demi-barrière de gauche qui commençait à s’abaisser, ce qui l’a acculé à une bordure et a provoqué l’enchaînement que l’on sait.
Permettez-moi de citer un dernier exemple, celui de la collision entre un tramway et une voiture dans un carrefour giratoire, survenue le 27 avril 2010 à Orvault, dans l’agglomération de Nantes. C’est un type d’accident assez classique, car les tramways traversent souvent des carrefours giratoires. Le premier facteur qui explique l’accident est ici le non-respect de la signalisation lumineuse – feu tricolore et feu rouge clignotant d’annonce du tramway – par la conductrice de la voiture. Il est cependant un fait que ce carrefour est complexe, et que la visibilité de la signalisation lumineuse dans le contexte urbain était particulièrement médiocre.
J’en arrive à la dernière partie de notre exposé, à savoir la synthèse des enseignements et des orientations que nous tirons de ces exemples pour la prévention routière.
Ces orientations de prévention peuvent viser les causes des accidents, les facteurs ayant aggravé le bilan, et enfin certains types de transport ou circonstances particulières.
Parmi les causes des accidents, on retrouve très souvent l’inattention ou l’hypovigilance des conducteurs. La première me semble encore plus fréquente. Il faut donc éliminer les sources potentielles de distraction qui peuvent se trouver dans l’environnement du conducteur, en rappelant l’interdiction du téléphone au volant – même en mains libres, il peut poser problème – et en proscrivant l’usage d’écouteurs, notamment pour les conducteurs professionnels. Il est plus délicat d’agir sur le front de l’hypovigilance, en dehors bien sûr des formations et autres campagnes de sensibilisation. Nous avons pu constater l’influence de la prise de certains médicaments comme les antihistaminiques. Les avis des médecins sont partagés, certains estimant que ces effets ont disparu avec les médicaments de nouvelle génération. Il reste qu’une bonne partie de la population prend ce type de médicaments. Le triangle jaune apposé sur les boîtes ne suffisant pas toujours, c’est au médecin d’attirer l’attention de ses patients sur les risques de somnolence qu’entraîne la prise de tel ou tel médicament.
Une partie de nos recommandations portent sur le suivi médical. Nous avons ainsi proposé d’instaurer une limite d’âge pour la validité des permis « lourds », d’augmenter la fréquence des visites médicales et d’améliorer la communication entre médecins du travail et employeurs.
Les fautes de conduite des poids lourds sur autoroute sont une cause récurrente d’accidents. Il faut donc lutter contre les plus fréquentes : le non-respect des distances de sécurité et la circulation à cheval sur les bandes d’arrêt d’urgence. Au-delà des sanctions, quelques pistes nous paraissent intéressantes. On peut ainsi poursuivre les expérimentations d’alerte sonore par « bandes rugueuses » en limite de bande d’arrêt d’urgence. Il importe également de promouvoir les systèmes d’aide à la conduite embarqués – assistance au freinage d’urgence par radar, par exemple – qui font leur apparition chez certains constructeurs de camions, comme Mercedes. Ils sont très efficaces, mais le surcoût s’établit tout de même à 30 000, voire à 40 000 euros. Les compagnies d’assurance peuvent donc accorder des aides. Je pense que c’est une voie prometteuse.
Il convient d’autre part de continuer de lutter contre le défaut de port de la ceinture de sécurité, qui reste fréquent dans les autocars, où les passagers se sentent faussement en sécurité. Le rajeunissement des autocars assurant les transports scolaires devrait permettre un progrès puisque, depuis 1999, ils doivent obligatoirement être équipés de ceintures. Les autorités organisatrices de transports, les départements, imposent déjà des spécifications rigoureuses dans leurs cahiers des charges. Dans certains cas, ils prévoient même l’accompagnement des élèves. Ces exemples doivent être valorisés.
J’en viens aux conditions particulières de trafic comme le brouillard ou les bouchons. Si conduire dans le brouillard est particulièrement difficile, la règle du code de la route qui impose de limiter sa vitesse à 50 kilomètres-heure lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres est peu respectée. Or, si certains ralentissent et d’autres non, le carambolage est inévitable. Il faut donc poursuivre la réflexion avec les professionnels de la conduite pour définir les recommandations adéquates. Que ce soit pour les bouchons ou le brouillard, il faut aussi améliorer l’information en temps réel des usagers sur les conditions de visibilité qu’ils s’apprêtent à rencontrer. Les panneaux à message variable n’existent pas partout et les messages ne sont pas toujours significatifs. De même, il n’est pas toujours aisé de localiser les difficultés à partir des messages radio diffusés sur le 107.7. Les systèmes de navigation, qui sont en pleine expansion, me paraissent en revanche porteurs d’avenir. Ils permettent justement de délivrer des messages en temps réel.
Mme Françoise Hostalier. Je croyais que c’était interdit !
M. Jean-Louis Humbert. Tout dépend du type de message.
En ce qui concerne la prévention des incendies spontanés de véhicules, la mise en place de détecteurs va être intégrée dans la réglementation européenne, qui est en cours de modification.
S’agissant des passages à niveau, des audits sont en cours. Nous avons recommandé de vérifier la compatibilité entre les délais d’annonce des trains et le temps de franchissement des véhicules routiers autorisés.
Pour ce qui concerne les tramways, le débat porte sur l’efficacité du feu rouge clignotant par rapport au feu tricolore, que les usagers connaissent mieux.
M. le président Armand Jung. Si vous deviez vous cantonner à une ou deux suggestions à mettre en œuvre d’urgence, lesquelles choisiriez-vous ?
M. Claude Azam. Il importe d’abord de combattre toutes les sources d’inattention des conducteurs de véhicules, en particulier des professionnels.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Comment ?
M. Claude Azam. Nous n’avons pas réfléchi aux dispositifs techniques. Il peut y avoir des dispositions réglementaires, comme il en existe déjà sur le téléphone portable – je pense au port des écouteurs, en particulier par les conducteurs professionnels. On peut également imaginer de limiter l’accès à internet à partir des véhicules.
M. le président Armand Jung. Ne me dites pas que les conducteurs regardent la télévision pendant qu’ils conduisent…
M. le rapporteur. Cela arrive, et c’est pourquoi le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai dernier a décidé d’aggraver les sanctions en pareil cas.
M. Claude Azam. Ma deuxième suggestion est de développer les systèmes qui aident véritablement à la conduite. Certains ne font que compliquer celle-ci, il ne s’agit donc pas de les multiplier. Il faut en revanche développer tous ceux qui aident à repérer l’hypovigilance ou les conduites anormales comme le non-respect des distances de sécurité.
M. Jean-Louis Humbert. Nous avons noté que, par souci d’économie, les entreprises de voyages limitent leur personnel dans le véhicule : elles ont supprimé l’équivalent de l’hôtesse, si bien que le chauffeur doit assumer plus de tâches qu’auparavant – commentaires, liaisons avec le siège, notamment. Cela nuit à sa concentration sur la conduite proprement dite.
M. Claude Azam. Permettez-moi une dernière suggestion : développer les actions de formation et de sensibilisation à destination des nombreux conducteurs professionnels qui sont présents sur la route. L’exemple du brouillard est intéressant. Personne ne sait conduire par temps de brouillard ; des actions et des recommandations spécifiques pourraient donc être mises en œuvre à destination des professionnels. Nos recommandations sont fondées sur deux axes, l’axe technique et l’axe d’acteur. S’agissant du second, il faut privilégier les professionnels si l’on veut éviter les comportements accidentogènes.
M. le rapporteur. Connaît-on la proportion d’accidents où un professionnel est impliqué, et celle des accidents concernant les seuls professionnels ?
M. Claude Azam. Nous allons faire en sorte de vous fournir ces éléments le plus rapidement possible.
M. le rapporteur. Vous avez déjà émis plus d’une centaine de recommandations, dont vous suivez la prise en compte – autrement dit, vous recevez un accusé de réception – mais non la mise en œuvre. Êtes-vous cependant en mesure de nous dire lesquelles ont été mises en œuvre ? Le mieux serait que vous nous communiquiez la liste exhaustive des recommandations que vous avez formulées, en nous précisant celles qui ont été suivies d’effets.
M. Claude Azam. Nous pourrons vous adresser très rapidement la liste des recommandations que nous avons formulées, en les classant par types et en faisant ressortir celles qui ont été prises en compte. En revanche, nous ne sommes pas chargés de suivre leur mise en œuvre. Nous avons cependant cette préoccupation à l’esprit. La situation est différente dans le domaine ferroviaire, où les textes imposent clairement à l’établissement public de sécurité ferroviaire de suivre la mise en œuvre de toutes les recommandations émises par le BEA. Nous avons ainsi les moyens de savoir quelles sont les recommandations mises en œuvre et celles qui ne le sont pas. Mais, dans le domaine de la route, nous n’avons aucun outil. Nous pouvons toujours écrire aux destinataires de nos recommandations pour savoir ce qu’il en est, mais ils ne sont pas tenus de nous répondre. C’est un type d’enquête que nous commençons à mettre en œuvre. Je ferai le point début septembre et vous adresserai les éléments que nous aurons pu recueillir.
M. le rapporteur. Compte tenu de l’accroissement du trafic automobile, ne pensez-vous pas qu’il soit difficile de descendre – quelles que soient les mesures prises – au-dessous d’un certain nombre d’accidents ?
M. Claude Azam. Il m’est difficile de répondre à cette question, car nous ne faisons pas d’accidentologie générale – autrement dit, nous ne disposons pas d’éléments scientifiques. Nous n’en dressons pas moins plusieurs constats.
Tout d’abord, beaucoup d’accidents trouvent leur origine dans une cause humaine. Il ne s’agit pas toujours de la consommation d’alcool ou de la vitesse : l’inattention ou la panique devant une situation inconnue peuvent également jouer. Ensuite, deux types d’infrastructures posent particulièrement problème quant à leur conception : les autoroutes sont de plus en plus monotones et, aujourd’hui, les professionnels de la route circulent dans des véhicules qui se conduisent tout seuls ou presque. C’est indéniablement un facteur accidentogène. En milieu urbain, les aménagements de partage de la voirie sont de plus en plus complexes et de moins en moins lisibles.
M. le rapporteur. Que faut-il faire selon vous concernant les autoroutes ?
M. Claude Azam. Éliminer les sources d’inattention dans les véhicules, assurer le respect des distances de sécurité et empêcher les véhicules de rouler à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence sont déjà quelques pistes, en tout cas pour les véhicules lourds. Songez à ces camions qui roulent en convoi avec un deuxième chauffeur qui se contente de suivre la trace du premier : on comprend qu’il glisse insensiblement vers une sorte d’état d’hypnose.
M. le rapporteur. Il existe une « liste noire » des compagnies aériennes. Savez-vous s’il y a l’équivalent pour les infrastructures de transport terrestre ou les constructeurs ?
M. Claude Azam. Dans les accidents sur lesquels nous avons enquêté, le véhicule est très rarement mis en cause. Des améliorations ont pu être apportées – je pense par exemple au signal de fermeture de la porte des soutes à bagages pour les autocars, ou encore au détecteur d’incendie. Mais aucun type de véhicule n’a été plus particulièrement mis en cause.
S’agissant des infrastructures, les points noirs ont été supprimés, et nous n’avons pas observé de plus grande occurrence sur telle ou telle infrastructure, à l’exception des passages à niveau. Il peut en revanche y avoir répétition d’une situation – par exemple le carrefour giratoire traversé par des tramways, à l’origine de 5 ou 6 enquêtes.
Pour revenir aux infrastructures, il est difficile de tirer une règle générale des exemples que nous connaissons. Je vous en citerai un, sur lequel l’enquête n’est pas terminée – le rapport sera publié d’ici à la fin de l’année.
Dans cet accident, survenu à Puymorens, sur une route de montagne, une des roues d’un autocar a « pris » le bas-côté de la route. Le véhicule a alors dévié de sa trajectoire, pour venir en heurter un autre. Nous avons constaté lors de l’enquête que cette voie avait été « rechargée » en bitume sans que les bas-côtés soient remis au même niveau. Une marche s’était donc formée. Lorsque la roue de l’autocar est partie sur le bas-côté, le conducteur n’est pas parvenu à remonter la marche et a perdu la maîtrise de son véhicule. Nous ferons des recommandations à l’issue de l’enquête. On ne peut pour autant considérer ce cas comme répétitif.
M. Jacques Myard. Avez-vous des éléments sur la confusion qu’entraînent les partages de zone ? Un décret a récemment autorisé les cyclistes à emprunter les sens interdits en milieu urbain. Si j’en crois les taxis parisiens, c’est source d’accidents.
M. Jean-Jacques Candelier. Vous avez longuement parlé du comportement des conducteurs. La meilleure solution ne serait-elle pas de revenir cinquante ans en arrière et d’interdire téléphone, radio, télévision et musique à bord des véhicules ?
M. le président Armand Jung. Vous n’avez jamais évoqué l’heure des accidents. Or nombre d’entre eux concernent des transports scolaires. L’éducation nationale a en effet pris la fâcheuse habitude de faire voyager les élèves de nuit pour économiser une, voire deux nuits d’hôtel. On sait pourtant que c’est entre quatre et cinq heures du matin qu’un accident a le plus de risques de survenir – comme ce fut le cas à Beaune, accident dont vous n’avez pas parlé. Plusieurs associations de chauffeurs professionnels demandent d’ailleurs l’interdiction des transports de nuit des scolaires entre deux et six heures du matin. C’est un point que je soumets à votre réflexion.
M. le rapporteur. Pensez-vous qu’il serait utile de rendre vos recommandations obligatoires ?
M. Olivier Dosne. J’observe que vous parlez très peu de la vitesse, que vous n’avez mise en cause que dans un ou deux exemples. Or elle constitue un sujet majeur.
L’inattention est en effet un facteur aggravant des accidents. En tant que pharmacien, je tiens à préciser que, si les antihistaminiques d’ancienne génération – type polaramine – entraînent bien un fort risque de somnolence, et ceci très rapidement, les nouveaux antihistaminiques sont dépourvus de tels effets secondaires. Dans la mesure où une grande partie de la population prend ce type de médicaments ou des anti-dépresseurs, il est cependant nécessaire d’aller plus loin.
Par ailleurs, je suis particulièrement attaché au contrôle technique et à la qualité de celui-ci. Je viens d’ailleurs de demander officiellement à notre président l’audition de représentants de centres de contrôle technique : si certains grands centres se donnent les moyens d’assumer correctement leur mission, d’autres n’ont pas les mêmes scrupules. Il faut également renforcer les contrôles effectués sur les deux roues – il semble que l’on contrôle les vitesses, mais pas toujours les systèmes de freinage.
Je voulais enfin ouvrir une réflexion d’avenir en vous parlant du véhicule électrique. J’ai essayé le prototype de M. Bolloré. Si j’encourage le développement de ces véhicules, je m’inquiète de leur silence, qui sera inévitablement source d’accidents.
M. le président Armand Jung. Cette question a été abordée hier. Le silence absolu des véhicules électriques pose en effet un vrai problème.
M. Claude Azam. Nous n’avons pas fait d’enquêtes sur le partage de voirie, et je n’ai donc guère d’éléments à vous apporter sur ce point. Nous avons en revanche enquêté sur plusieurs accidents impliquant des tramways. Ceux-ci ont un inconvénient, qui vient précisément d’être évoqué à propos des véhicules électriques : on ne les entend pas. Récemment, un enfant a ainsi été happé par un tramway à Bordeaux.
C’est évidemment à un problème du même ordre que nous confrontent les piétons ou les cyclistes qui circulent avec des écouteurs sur les oreilles.
Quant au problème de la vitesse, il y a deux façons de l’aborder. On peut bien sûr dresser des statistiques à partir des causes premières des accidents relevées par la gendarmerie ou la police. Ce n’est pas l’esprit de notre travail, qui consiste à « décortiquer » les causes d’accidents complexes. Nous constatons que, si la vitesse est un facteur aggravant des accidents, il est très rare qu’elle soit au premier plan des causes incriminées. Dans les exemples d’accidents d’autocars ou de poids lourds que nous avons cités, il n’y avait ainsi pas eu dépassement de la vitesse autorisée. De toute façon, ces véhicules sont bridés.
M. Jean-Louis Humbert. Un mot sur le contrôle technique. Nous avons en effet constaté dans certaines enquêtes que des défauts mécaniques n’avaient pas été corrigés lors du contrôle technique. Nous avons donc préconisé d’élargir celui-ci à certains points. Je pense par exemple au contrôle des amortisseurs des poids lourds : le contrôle technique ne mesure que le déséquilibre qui peut exister entre la roue droite et la roue gauche ; on peut donc y satisfaire avec deux amortisseurs en mauvais état, pourvu qu’ils soient au même niveau ! Nous avons fait une recommandation sur ce point.
M. le président Armand Jung. J’ai bien noté que vous nous feriez parvenir un récapitulatif des recommandations que vous avez émises et de celles qui ont été mises en œuvre.
M. Claude Azam. Le récapitulatif des recommandations que nous avons faites vous sera adressé d’ici à une quinzaine de jours. Pour celles qui ont été mises en œuvre, cela prendra un peu plus de temps.
M. le rapporteur nous a demandé si ces recommandations devraient être obligatoires. Je rappelle qu’elles sont de natures diverses : certaines sont normatives, d’autres concernent des aménagements de voirie ou s’adressent uniquement à tels ou tels professionnels. Nous ne préconisons donc pas de les rendre obligatoires. Mieux vaut instaurer une obligation de rendre compte – par exemple au bout d’un an – de leur mise en œuvre.
M. le président Armand Jung. Messieurs, nous vous remercions pour cette passionnante audition.
*
* *
Audition de M. Marc Giroud, président de SAMU-Urgences de France, et de M. François Braun, médecin référent
M. le président Armand Jung. Nous avons le plaisir d’accueillir à présent le docteur Marc Giroud, président de SAMU-Urgences de France, et le docteur François Braun.
Messieurs, notre mission porte principalement sur les causes des accidents de la route. Nous attendons beaucoup de votre expérience pour connaître la réalité du terrain, nous forger une opinion et faire des propositions précises au Gouvernement.
M. Marc Giroud, président de SAMU-Urgences de France. Les SAMU sont issus d’un programme de sécurité routière finalisé à la fin des années 1960. À l’époque, il s’agissait de lutter contre ce fléau épouvantable que constituent les accidents de la route. Dans ce domaine, des progrès considérables ont été réalisés. L’implication des SAMU a été constante malgré la diminution régulière de la proportion d’accidentés de la route dans leur activité du fait, d’une part, de l’élargissement de cette dernière aux infarctus, aux crises d’asthme et à diverses pathologies des personnes âgées et, d’autre part, à la baisse des accidents de la route eux-mêmes, qui n’en restent pas moins un problème majeur.
Un temps fort de l’implication des SAMU a été le programme RÉAGIR, lancé en 1983 et à la réflexion initiale de laquelle nous avions participé, qui présentait le grand intérêt de réunir sur le terrain, après un accident mortel, la direction départementale de l’équipement (DDE), des élus de terrain, des journalistes, des médecins, des pompiers, afin de réfléchir à toutes les causes du drame. Ce programme nous a permis d’avancer dans notre compréhension des choses.
Je laisse la parole à François Braun, médecin référent au sein de SAMU-Urgences de France sur les questions de sécurité routière, qui est également membre du Collège français de médecine du trafic, présidé par le docteur Michèle Muhlmann-Weill.
M. François Braun, médecin référent au sein de SAMU-Urgences de France. Je souhaite insister sur quatre sujets.
Le premier est la sécurité de nos propres équipes d’intervention SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) lors des interventions sur la voie publique.
Depuis 2003, année à partir de laquelle nous avons commencé à alerter la commission interministérielle de sécurité routière, nous militons pour le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules d’intervention prioritaire – véhicules SMUR, ambulances et autres véhicules –, et ce pour deux raisons. D’abord, ces véhicules, qui roulent souvent rapidement et dans l’urgence, peuvent avoir des accidents – nous avons en mémoire des exemples dramatiques, en particulier le décès, il y a deux ans, d’un conducteur ambulancier SMUR partant en intervention. Ensuite, nous considérons que le non-port de la ceinture de sécurité par les propres acteurs de la sécurité routière donne au public une image particulièrement négative. Cela est vrai pour nos véhicules d’intervention. Cela doit l’être aussi pour les ambulances lorsqu’elles reviennent avec un blessé car, actuellement, il n’existe pas de normes imposant des sièges et des ceintures de sécurité dans leurs cellules sanitaires pour protéger les passagers.
Dans le cadre de la sécurité des équipes SMUR en intervention, SAMU-Urgences de France a demandé l’année dernière un rapport sur la sécurité routière, le rapport « Templier », dont je relèverai trois points.
Premier point : la notion de véhicule d’intérêt général prioritaire pour les véhicules partant en intervention permet d’améliorer leur sécurité.
Cette notion est pour l’instant limitée à ce que nous appelons les unités mobiles hospitalières, c’est-à-dire aux véhicules transportant des blessés. Or il serait souhaitable qu’elle englobe aussi les véhicules de renfort et les véhicules légers médicalisés dont disposent également les SAMU et les SMUR. En outre, le développement des réseaux de soins dans le cadre de la loi HPST amène les véhicules SMUR à faire des trajets qui les éloignent de 80 à 100 kilomètres de leur base, en particulier en province, pour conduire un blessé à l’hôpital ou au plateau technique le plus apte à la prise en charge. Or il me semble nécessaire que les véhicules SMUR, en retour d’intervention, puissent relever de cette catégorie juridique de véhicules d’intérêt général.
Le deuxième point a trait à la ceinture de sécurité, mais aussi aux systèmes de retenue du patient sur le brancard et aux systèmes de fixation des brancards. Nous avons en effet constaté, à la suite d’accidents, des lésions chez les personnels non attachés, mais aussi sur la victime transportée non attachée ou attachée sur un brancard dont les systèmes de sécurité n’étaient pas suffisants pour répondre au choc.
Le troisième point concerne la signalisation et le balisage de nos véhicules qui, actuellement, ne sont pas normalisés. Comme vous avez pu le constater, les couleurs, la signalétique et les moyens de balisage des véhicules du SAMU sont différents en fonction de leur origine. S’il est important de faciliter leur cheminement, il convient également d’éviter des « sur-accidents » en localisant mieux les lieux de leur intervention sur la voie publique.
Le deuxième sujet sur lequel nous souhaitons insister est l’implication de la médecine d’urgence dans une meilleure connaissance de l’accidentologie.
Aujourd’hui, l’ensemble des structures d’urgence ne dispose pas d’un registre national lui permettant d’analyser les conséquences et les causes des accidents. Un outil de ce type existe dans certains départements, comme le Rhône. Nous serions très favorables à la mise en place d’un tel registre, qui serait alors probablement piloté par l’Institut de veille sanitaire (INVS), et dans lequel les urgentistes pourraient apporter toute leur expertise sur différents points : l’âge, mais aussi les déficits sensoriels des conducteurs et des victimes – déficits liés à la prise de toxiques ou de médicaments, mais aussi à des accidents neurologiques bénins pouvant se révéler particulièrement dangereux. Nous souhaitons un tel registre car nous avons l’habitude d’apporter des informations et de traiter des données sur la base d’études comportant un haut niveau de preuve. Or nous n’avons pas beaucoup d’études de ce type sur l’incidence de certaines pathologies sur les accidents.
Le troisième sujet concerne les systèmes d’alerte automatique.
Nous sommes favorables à la généralisation des systèmes d’alerte et de géolocalisation des véhicules. Pour autant, nous ne souhaitons pas que les appels arrivent directement au niveau de nos structures de SAMU centre 15, qui seraient alors submergées par des demandes ne devant pas être traitées par elles. Nous pensons qu’une interconnexion entre un central de réception des appels et le centre 15 est très importante pour favoriser l’intervention très rapide de nos équipes SMUR sur les accidents avec blessés potentiellement graves.
Le quatrième sujet a trait aux raisons pour lesquelles nous voulons une prise en charge rapide des blessés par des équipes SMUR formées à cet effet.
L’étude OPALS (major trauma study), réalisée par les Canadiens de l’Ontario sur plus de 3 000 patients, a démontré qu’il n’y avait aucune amélioration de la morbidité et de la mortalité des traumatisés graves pris en charge par l’Advanced Life Support, qui est une prise en charge par les paramedics nord américains (l’équivalent des infirmiers) versus le Basic Life Support des Anglo-saxons, qui est une prise en charge par des secouristes. Quant à la récente étude française First, publiée en début d’année dans la prestigieuse revue américaine Critical Care, elle montre une très nette amélioration de la mortalité et de la morbidité des patients traumatisés graves de la route pris en charge par les médecins des équipes de SMUR versus une prise en charge par des secouristes.
En conclusion, nous avons maintenant la preuve scientifique, grâce à ces deux études, que ce qui permet de sauver les patients est la prise en charge la plus précoce possible par un médecin SMUR qui les dirigera vers l’établissement le plus adapté.
M. Jacques Myard. Les causes des accidents sont multiples. Parmi elles, figurent les tentatives de suicide au volant, comme l’ont analysé les médecins SMUR et SAMU dont les méthodes de réanimation sont très efficaces. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
M. Marc Giroud. C’est une vraie question. Sans doute y a-t-il plus d’accidents-suicides qu’on ne le pense, mais cela est difficile à prouver.
Dans ce registre, le mélange des causes est courant. Il n’est pas exclu que les personnes répertoriées « suicide » y aient été poussées. Le sujet est très délicat. Si la personne avait avec elle des médicaments, la cause – le suicide – peut sembler évidente au premier abord. Mais il y a peut-être eu – avant ce temps-là – d’autres temps qui ont conduit au suicide. De la même manière, il y a peut-être quelque chose qui a précédé le temps de l’accident.
Selon moi, il n’y a pas assez d’autopsies des victimes en France. Il n’y a pas non plus assez d’études sur ce qui s’est passé avant le drame, comme pour les accidents dans l’aéronautique où des enquêtes sont menées sur l’état psychologique du pilote. Si notre pays faisait plus en faveur de l’analyse des causes des accidents de la route, on apprendrait probablement beaucoup.
En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes peu enclins à formuler des réponses intuitives aux questions posées. François Braun vous l’a dit : nous faisons des études, qui doivent être longuement travaillées de façon multicentrique, sur des bases rationnelles, avec des méthodologies très strictes. SAMU-Urgences de France et la Société française de médecine d’urgence, avec laquelle nous travaillons sur les études scientifiques, sont très ouverts aux impulsions que vous pourriez donner pour nous permettre de participer à des études multicentriques sur des thématiques comme celle que vous évoquez, car le domaine de l’accidentologie routière mériterait qu’on en fasse davantage.
M. René Dosière. Les professionnels du SAMU sont amenés, après l’accident, à apporter des précisions sur les causes de l’accident, à dire ce qu’ils ont pu déceler. Sont-ils interrogés quelque temps plus tard dans le cadre d’études plus générales ?
M. François Braun. Comme je l’ai dit, nous manquons d’études. Actuellement, il n’est pas demandé d’explications aux médecins du SAMU, pour deux raisons.
La première est que leur principale préoccupation est de prendre en charge les victimes. L’analyse de la cinétique au moment de l’accident – choc frontal ou latéral, déformations de l’habitacle – est très importante et les renseignera sur les lésions potentielles des victimes. C’est un élément qu’ils recherchent systématiquement sur place. Mais la cause elle-même de l’accident ne leur est que très rarement demandée. Et le SAMU ne dispose pas de registre en la matière.
La deuxième raison est que le facteur temps au moment de la prise en charge limite considérablement la possibilité de chercher des informations complémentaires sur les causes exactes de l’accident.
M. Olivier Dosne. Si l’alcool est la cause de l’accident, j’imagine que vous transmettez systématiquement l’information, comme le font les forces de police ou de gendarmerie.
Disposez-vous de statistiques sur les accidents dus aux drogues ? C’est un vrai sujet à l’heure où l’on parle de légalisation du cannabis. Des études complémentaires s’imposent pour nous permettre d’avoir des chiffres.
Mme Françoise Hostalier. Des personnes auditionnées nous ont parlé des progrès en matière de protection des passagers dans les véhicules – airbags, carrosserie, etc.
Quels sont les équipements qui vous paraissent les plus utiles pour la survie des personnes ou pour atténuer les risques physiques ? Que faudrait-il améliorer ?
M. Marc Giroud. Tout système de nature à éviter le choc – dispositifs électroniques d’espacement des véhicules, freinage intelligent, par exemple – est bon à prendre.
Premièrement, nous avons pu constater l’effet fantastique et l’absence totale de complication que permet la ceinture de sécurité. Évidemment, de temps en temps, elle provoque un bleu sur l’épaule, mais c’est sans commune mesure avec les traumatismes subis si elle n’est pas portée. Elle a donc été un facteur de progrès considérable et, personnellement, nous insistons auprès de nos amis pour qu’ils la portent en toutes circonstances ! Grâce à elle, les traumatismes épouvantables que j’avais pu voir à l’hôpital de Pontoise il y a plusieurs années – visages explosés, crânes fracassés sur le pare-brise de la voiture, traumatismes graves du thorax après éjection de la personne du véhicule – ont en grande partie disparu.
Tout ce qu’on nous dit sur la ceinture de sécurité – par exemple que, sans elle, la victime aurait pu être éjectée avant que son véhicule ne tombe dans un précipice ou un volcan en flammes – doit exister, mais nous ne le constatons pas. Ce que nous constatons, ce sont tous les traumatismes dus à l’absence du port de la ceinture.
Après l’accident de la princesse Diana, j’ai été interrogé, y compris par des experts de Scotland Yard qui voulaient savoir si les SAMU n’étaient pas impliqués dans le complot qui visait à la faire périr ! La princesse n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, considérant sans doute que son statut l’affranchissait de toutes contraintes. Comme je l’ai expliqué dans d’autres commissions, si elle l’avait portée, elle ne serait pas morte – la seule personne à ne pas avoir perdu la vie dans l’accident est celle qui l’avait mise, sachant que la vitesse du véhicule était, certes, rapide pour une circulation de ville, mais relativement modérée par rapport à ce que nous constatons en matière d’accidents de la route.
Deuxièmement, s’il existe un paramètre sur lequel on pourrait aller plus loin, c’est la vitesse puisqu’il existe une relation de proportionnalité entre cette dernière et le drame. Certes, cette proportionnalité est atténuée par les airbags et tous les systèmes qui réduisent l’impact. Néanmoins, la vitesse reste un élément essentiel.
Troisièmement, le port du casque et tous les habillements du motard sont très importants. À cet égard, je pense que des mesures devraient être prises pour faciliter l’accès à toutes ces protections, qui sont coûteuses. Nous constatons également leur utilité pour les conducteurs de scooters, dont les risques sont comparables à ceux des motards, mais qui ne prennent pas les mêmes précautions parce qu’ils conduisent en ville.
En conclusion, si la technologie de pointe peut être une piste, elle ne doit pas être considérée comme une alternative à toutes les protections physiques que je viens d’évoquer.
M. François Braun. Dire que tel type d’accident est lié à la prise de cannabis plutôt qu’à la vitesse est très difficile. Actuellement, nous n’avons pas ces informations. Néanmoins, nous savons, essentiellement sur la base des études neurophysiologiques, que tout ce qui perturbe la concentration du conducteur – la conduite étant un geste compliqué, qui implique de faire plusieurs choses en même temps – est potentiellement accidentogène.
M. Marc Giroud. Comme le démontre un journal international de médecine, un médecin qui sort d’une garde au petit matin a entre cinq et six fois plus de risques d’avoir un accident, et a deux à trois fois plus de risques d’en mourir. C’est la preuve que la fatigue est un facteur accidentogène – et aussi qu’elle empêche de soigner correctement les malades, mais c’est une autre histoire.
M. Philippe Houillon, rapporteur. On entend parler d’une concurrence entre les différents services d’urgence. Est-ce une réalité ? Si oui, comment aboutir à une complémentarité ?
Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai suggère que les infirmiers pratiquent des prises de sang pour dépister l’alcoolémie et la présence de stupéfiants. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, quelle est votre position sur le contrôle périodique de l’aptitude à la conduite, notamment des personnes âgées ?
M. Marc Giroud. La caractéristique de notre organisation est la complémentarité des uns et des autres.
Il n’y a pas d’exemple, monsieur le député, de services qui travaillent de manière plus étroitement imbriquée que les pompiers et le SAMU. Cette complémentarité est essentielle pour nous. Certes, elle pourrait être encore améliorée. À cet égard, le groupe de travail constitué par le Président de la République permet de faire avancer les choses en matière de procédures et de qualité des relations entre les deux services.
Néanmoins, il est deux domaines dans lesquels on pourrait aller plus loin.
Le premier concerne les médecins correspondants du SAMU, notamment en dehors des villes. Ce dispositif performant, constitué de médecins généralistes ruraux sur le terrain, formés et équipés par le SAMU, prêts à intervenir en première ligne, existe notamment dans la région de François Braun. Il devrait être étendu, car il est un maillon qui manque aujourd’hui à la chaîne dans la mesure où le temps d’accès est plus important en milieu rural.
Le deuxième domaine d’amélioration est l’hélicoptère, qui est sous-utilisé. Il n’existe pas de politique d’utilisation de l’hélicoptère sanitaire en France. Par conséquent, sans doute y a-t-il dans ce domaine une certaine concurrence entre la sécurité civile et les services de santé.
M. François Braun. Nous sommes très favorables à la prise de sang par les infirmiers. Cet acte ne nécessite pas de diagnostic et est réalisé sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie, dans le cadre des actes infirmiers.
Le rôle du médecin est de faire un diagnostic et de soigner, et tout ce qui peut économiser son temps dans ses activités débordantes au niveau des structures d’urgence est une très bonne chose.
M. Marc Giroud. La personne qui se tue est celle qui est la plus apte, qui vous bat au tennis, au golf ou au football, autrement dit l’homme jeune. Celui-là est le plus dangereux, non seulement pour lui-même, mais encore pour tout le monde.
Certes, des conflits de circulation impliquant des véhicules un peu lents conduits par des personnes âgées se produisent de temps en temps, mais nous voyons surtout des morts jeunes – les vieux, eux, sont fauchés sur le trottoir, et généralement par des véhicules conduits par des personnes jeunes !
Par conséquent, une piste importante en matière d’aptitude physique est de faire comprendre aux jeunes qu’être fort – capable de réussir toutes sortes de tests, d’être « au top » dans le domaine sportif – met en confiance, pousse à rouler vite et à s’affranchir des règles, sachant que certains estiment, surtout dans notre pays, que les règles sont pour les autres. Il est très frappant de constater l’incompréhension de la population à l’égard de ce phénomène.
En effet, quand nous annonçons le décès d’une personne à sa famille, il est très étonnant d’entendre : « On ne comprend pas… ». Et pourtant, en parlant plus avant, nous apprenons que la victime avait antérieurement frôlé à plusieurs reprises l’accident grave. Curieusement, quand nous annonçons la mort d’une personne de cinquante ans victime d’un infarctus du myocarde, les proches et la famille trouvent toutes les explications du monde : « Elle travaillait trop ! », nous dit-on.
Ainsi, l’accident de la route est incompréhensible pour les gens : ils ne sont pas prêts à comprendre qu’il n’est pas la fatalité et que le comportement du conducteur en est la cause principale.
Certes, le dépistage des troubles de la vision latérale et des déficits auditifs fait partie des pistes, mais il ne faut pas s’y tromper : ce sont les comportements à risque qui sont extrêmement dangereux. Cela rejoint votre question sur les suicides, monsieur Myard : certains comportements frisent l’inconscience et l’on ne sait pas où est la limite entre l’inconscience et la prise de risque à la « roulette russe » !
La loi HPST est un facteur de progrès à deux titres.
D’abord, elle introduit le principe de proximité, avec un maillage territorial le plus serré possible des antennes du SAMU. Il est en effet indispensable que le territoire national soit couvert puisque les accidents surviennent souvent sur des routes reculées.
Ensuite, elle prévoit le réseau de prise en charge. De ce fait, elle favorise la prise en charge des personnes gravement accidentées, non pas à l’hôpital le plus proche – méthode nord-américaine dont les résultats sont assez mauvais –, mais directement à l’endroit le plus approprié. Nous encourageons les élus que vous êtes à aller encore plus loin en ce sens. La réponse de proximité n’a d’intérêt que pour les pathologies relativement modérées. Un accidenté de la route doit être orienté, selon les lésions qu’il porte, après une première analyse médicale, vers le service ou l’équipe qui sera à même de le prendre en charge.
Mme Françoise Hostalier. Pensez-vous que les nombreuses formations en secourisme – qui existent aussi dans les écoles et les lycées – soient une bonne chose ou estimez-vous au contraire qu’elles pourraient être contre-productives dans la mesure où des gens pourraient faire des gestes inconsidérés ?
M. François Braun. La formation au secourisme – ou apparentée, comme celle aux gestes de premier secours dans les hôpitaux – est essentielle, et pas seulement pour la sécurité routière. Elle permet aux gens d’apprendre les gestes indispensables, comme appuyer sur une plaie pour stopper l’hémorragie. Surtout, elle leur apprend à « établir un diagnostic » et à donner une alerte correcte aux médecins régulateurs du SAMU.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, messieurs, pour votre contribution à nos travaux.
*
* *
Audition de M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière et de M. Christian Roy, chargé d’études en accidentologie
M. le président Armand Jung. Nous sommes heureux d’accueillir M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Nous avons auditionné hier Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière, que nous avons interrogée sur les statistiques de la sécurité routière, dont nous avons besoin pour que les propositions du rapport que nous devons remettre au Gouvernement en octobre se fondent sur les données chiffrées les plus précises et les plus objectives possible. Selon les sources, des chiffres différents circulent en effet, parmi lesquels on a du mal à voir clair. La tâche est d’autant plus difficile que la cause d’un accident de la circulation est rarement unique. Chaque accident semble plutôt la résultante d’un faisceau d’éléments, entre lesquels il est difficile de distinguer le principal de l’accessoire. Nous aimerions pouvoir nous appuyer sur les données dont dispose l’ONISR. Nous vous remercions par avance, monsieur le secrétaire général, de nous faire bénéficier de votre expertise.
M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). L’ONISR, créé par un décret du 8 novembre 1993 modifiant le décret du 15 mai 1975 ayant institué le comité interministériel à la sécurité routière (CISR), fait partie de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR), elle-même placée sous l’autorité conjointe du ministère chargé des transports et du ministère de l’intérieur. Il fonctionne comme un service ordinaire de la DSCR, à laquelle il est rattaché, qu’il s’agisse de la logistique ou des ressources humaines.
Aux termes du décret, l’ONISR est chargé de « rationaliser et d’unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d’assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ; d’effectuer ou d’assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l’insécurité routière ; d’évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées. »
Pour remplir ces missions, l’Observatoire s’appuie largement sur le réseau scientifique et technique du ministère chargé des transports : le service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), issu de la fusion de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) et du Laboratoire central des Ponts et chaussées (LCPC).
Nous travaillons en priorité à l’intention des gestionnaires de voirie chargés de prendre les mesures de sécurité routière nécessaires. Nous collaborons donc avec l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), pour les autoroutes concédées, la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), pour le réseau routier national, mais aussi avec les départements, notamment au travers de l’Association des départements de France – le réseau départemental est, de loin, le plus accidentogène –, les communes et les structures intercommunales, pour les autres réseaux.
Ne comptant que sept agents, l’ONISR s’appuie sur un petit réseau d’observatoires locaux de la sécurité routière, placés au niveau régional auprès des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et au niveau départemental auprès des directions départementales des territoires (DDT) mais aussi parfois directement auprès des préfectures. Ce réseau représente environ 200 ETPT (équivalent temps plein travaillé) répartis dans l’ensemble des régions et des départements. Certains postes ne sont pas pourvus et dans un département standard, cela représente un poste, parfois moins. Ce réseau nous est indispensable pour la correction et la vérification des données, ainsi que l’analyse locale des enjeux pour le compte des préfectures et des collectivités.
L’ONISR est aussi chargé de conduire des études et des recherches dans le domaine de la sécurité routière. Il s’appuie là encore très largement sur le réseau scientifique et technique du ministère chargé des transports, notamment sur l’IFSTTAR, mais aussi les universités et des organismes comme l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ou l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED).
Indépendant, l’ONISR publie d’une part un baromètre mensuel de la sécurité routière, en général le 6 ou le 7 d’un mois pour le mois précédent, d’autre part un bilan annuel, désormais mis en ligne, à l’automne pour l’année précédente. Le bilan de la sécurité routière pour 2009 a ainsi été publié en octobre 2010. Nous venons d’arrêter la base des données statistiques d’accidentalité à partir du fichier national des accidents corporels de la circulation routière de 2010, après vérification et contrôle. Le bilan définitif devrait paraître fin octobre-début novembre.
L’ONISR mène également diverses études thématiques. Il établit ainsi tous les deux ans des statistiques pluriannuelles par grandes catégories d’usagers : poids lourds, deux roues motorisées, piétons, etc.
Avant de vous présenter en détail les chiffres, quelques remarques générales. Les statistiques d’accidentalité n’ont pas grande valeur en soi. Il faut les compléter à la fois par des statistiques d’exposition afin de pouvoir calculer les sur-risques et par des statistiques de contexte, entendues au sens large. L’évolution de l’accidentalité doit ainsi être rapportée à celle de la mobilité. Quand le trafic diminue, quelle qu’en soit la raison, le nombre d’accidents diminue lui aussi, immédiatement et de façon mécanique, sans que cela ne traduise une quelconque amélioration de la sécurité routière. Les données relatives au trafic sur certains réseaux font, hélas, cruellement défaut. Pour des raisons qui tiennent à la décentralisation, il n’existe quasiment plus de bases de données, coordonnées et harmonisées, concernant le trafic sur le réseau départemental. Et il n’y a jamais eu de statistiques cohérentes relatives au trafic en milieu urbain.
Nos baromètres mensuels sont très suivis – trop peut-être. Cette périodicité est extrêmement rapprochée pour des statistiques, qui n’ont de sens véritable que sur un temps plus long. Les chiffres d’accidentalité, même agrégés au niveau national, sont extrêmement volatils et difficiles à interpréter. L’ONISR est le seul organisme à publier aussi vite des chiffres en matière de sécurité routière, ce qui pose d’ailleurs un problème, car ceux-ci ne peuvent être correctement interprétés que couplés à des données de contexte. Or, lors de la publication du baromètre, on ne dispose pas encore des données concernant le trafic, qui ne seront disponibles que quatre mois plus tard, non plus que des bulletins complets de Météo France, qui le seront, eux, plus tard dans le mois. Enfin, il n’existe plus maintenant que des données annuelles, et non plus mensuelles, relatives aux différentes consommations de carburant.
Un mot de l’élaboration de nos statistiques. Le baromètre mensuel est établi à partir des remontées rapides du terrain. Les unités de police ou de gendarmerie appelées sur le lieu d’un accident cochent des cases sur des fiches-types, qui sont concentrées au niveau des préfectures puis remontent au ministère de l’intérieur, qui nous les transmet. Les données ainsi recueillies se limitent au nombre d’accidents corporels, de personnes tuées – sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l’accident –, blessées et blessées hospitalisées (données dites ATBH). Ce sont des chiffres bruts fin de mois, éclatés par département, donnant la répartition des tués par catégorie d’usagers, par tranche d’âge – on en distingue quatre – et par motif présumé d’accident – vitesse, alcool, refus de priorité et autres. Nous retravaillons ces données brutes, qui peuvent comporter des omissions ou des doublons, avant d’en extrapoler des estimations au niveau national, qui constituent le baromètre mensuel. Nous les corrigeons notamment en y appliquant les écarts constatés entre ces remontées brutes et les chiffres finals du fichier national des accidents corporels, sur les douze derniers mois pour lesquels nous disposons des deux séries. Cela donne de très bonnes estimations en base annuelle pour le nombre de tués, moins bonnes pour le nombre d’accidentés et de blessés. Pour ce qui est des blessés hospitalisés, la comparaison n’est pas encore possible puisqu’on ne disposait pas de cette donnée en remontée rapide il y a encore quelque temps. Le baromètre offre diverses comparaisons : d’un mois au même mois de l’année précédente, des n premiers mois de l’année aux mêmes n mois de l’année précédente. Un suivi de tendance est également établi sur la base de douze mois glissants.
La véritable base de données, que gère l’ONISR, est le fichier national des accidents corporels. Chaque unité des forces de l’ordre intervenue lors d’un accident de la circulation établit sur le terrain, par voie électronique, un bulletin d’analyse d’accident corporel de la circulation, dit bulletin BAAC. Tous les services de police le saisissent désormais grâce au logiciel Procea. Ce bulletin comporte une soixantaine d’items, relevant de diverses spécialités – médicales, techniques relatives aux infrastructures routières, aux véhicules… Il est impossible que ceux appelés à le remplir soient des experts chevronnés en tous ces domaines. Pour quantité d’items, se retrouve donc la mention « indéterminé ».Avec 70 000 à 80 000 bulletins chaque année, on mesure le travail que représente leur traitement ultérieur !
Les bulletins sont concentrées à Juvisy pour la police et l’étaient jusqu’à présent à Rosny-sous-Bois pour la gendarmerie. Les données sont vérifiées une première fois, sous leur propre responsabilité, par la police ou la gendarmerie, puis versées sur le portail web « Accidents » de l’ONISR. Les forces de l’ordre ayant beaucoup à faire et l’établissement de statistiques ne figurant pas parmi leurs premières priorités, la qualité de la saisie de ces bulletins demeure médiocre. Il faut donc vérifier, corriger, compléter les données qu’ils livrent. C’est un travail lourd qui s’opère d’abord à l’ONISR puis dans les observatoires départementaux de sécurité routière (ODSR), qui travaillent souvent en liaison avec les collectivités – ce travail peut aller jusqu’à la consultation du procès-verbal d’accident pour confronter les indications. La variable qui manque le plus souvent est l’endroit précis où est survenu l’accident. Certaines incohérences sont facilement repérées et corrigées. D’autres ne peuvent l’être que par un dialogue avec les forces de l’ordre qui ont saisi les données sur le terrain. Pour une année n, le gel de la base intervient entre mi-mai et mi-juin de l’année n+1 : les chiffres définitifs pour 2010 seront ainsi annoncés dans quelques jours par le ministère de l’intérieur.
La base de données établie à partir des BAAC est réputée complète. Elle l’est pour les accidents mortels, pas pour les accidents corporels sans tués. Elle comporte d’autres défauts, avec lesquels nous composons pour l’instant. Des indications importantes comme de savoir si un conducteur tué téléphonait au moment de l’accident n’y apparaissent pas – cette précision n’est d’ailleurs donnée nulle part. N’y figure pas non plus la vitesse, sauf si les forces de l’ordre ont eu l’impression qu’elle a pu être un facteur déterminant et en ont expressément fait mention. L’une de mes préoccupations actuelles est de défendre cette base et d’enrayer la dégradation de la qualité de ses informations.
Des mesures du comportement des usagers sont également effectuées quadrimestriellement. Elles concernent les vitesses pratiquées par les différentes catégories d’usagers, et d’autres comportements des conducteurs.
Un travail beaucoup plus fin est effectué sur un très petit nombre d’accidents, d’une part par une unité de l’IFSTTAR, basée à Salon de Provence, qui réalise des études détaillées sur une cinquantaine d’accidents par an, avec utilisation de logiciels pour en reconstituer la dynamique et en procédant à une étude approfondie de l’état des véhicules pour en déduire la vitesse à partir de l’énergie estimée du choc ; d’autre part par le centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR) sur une centaine d’accidents en région parisienne, essentiellement dans les Yvelines. Ce travail permet de beaucoup mieux comprendre les facteurs des accidents que le fichier BAAC, mais l’échantillon est extrêmement réduit.
Enfin, depuis 1995, est en service dans le Rhône un registre des victimes d’accidents de la route, qui vise à recenser de la manière la plus complète possible les victimes d’accidents de la route dans ce département, la nature et l’évolution de leurs blessures, puis de leurs éventuelles séquelles. Des extrapolations sont ensuite effectuées à partir de ces données. Il serait très utile que d’autres départements, de profil différent, soient dotés d’un tel registre.
M. Fernique donne ensuite lecture des principaux documents statistiques remis à la mission d’information.
M. le président Armand Jung. Nous vous remercions de toutes ces informations, très riches et intéressantes, dont certaines remettent en cause des idées reçues. Il nous reste à en extraire la « substantifique moelle ».
M. Louis Fernique. Nous ne disposons des données que depuis trois semaines. Nous avons réalisé un travail considérable pour produire ce recueil statistique de façon à vous communiquer le plus vite possible le maximum d’informations.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Le rapport définitif de l’ONISR pour 2010 ne sera disponible que fin octobre ou début novembre 2011. Or, notre mission d’information doit déposer son propre rapport en octobre. Pourrions-nous donc disposer d’une première ébauche, même non encore officielle, du vôtre, au plus tard à la mi-septembre ?
M. Louis Fernique. En général, aux alentours du 15 septembre, nous disposons d’une ébauche qui doit encore être relue, mais est exploitable. Nous pourrons vous la transmettre.
M. Jacques Myard. À vous entendre, monsieur, comme hier Mme Merli, il est évident qu’il ne faut pas s’affoler devant les données brutes mensuelles. Les récentes décisions prises dans la précipitation par le comité interministériel de la sécurité routière vous semblent-elles fondées sur une analyse objective ? Au-delà, est-il opportun de publier mensuellement des chiffres bruts, au risque de provoquer une réaction excessive, décalée par rapport à la réalité, du Gouvernement ?
M. Louis Fernique. Il ne m’appartient bien sûr pas de me prononcer sur le bien-fondé des décisions du CISR. Nous sommes pris entre deux feux. Les réactions face à l’explosion des accidents mortels chez les motards en 2009 ont peut-être été disproportionnées, d’autant que, ne disposant pas des bons chiffres, les cyclomoteurs et les motos n’ayant pas été initialement distingués, nous avions fait des erreurs d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que les mesures prises ont été salutaires et ont permis en quelques mois d’abaisser de nouveau fortement la mortalité de cette catégorie d’usagers. Et les progrès enregistrés ont duré toute l’année 2010. Il est donc utile de pouvoir réagir vite. Pour autant, il est vrai que l’analyse exige du temps.
M. le rapporteur. Il semble que le conseil national de la sécurité routière ne se soit plus réuni depuis 2008. Nous le confirmez-vous ?
M. Louis Fernique. Le mandat des membres du CNSR n’a pas été renouvelé à son expiration il y a deux ans. Depuis lors, cette instance n’est donc plus opérante. Cela ne signifie pas que rien n’ait été fait mais il est indéniable que cela pose des problèmes à l’ONISR. En effet, le CNSR évaluait chaque année notre programme d’activité et le comité d’experts l’assistant nous conseillait sur les méthodes statistiques, en même temps qu’il orientait notre programme d’études et de recherches. Il y a deux mois, en accord avec la déléguée interministérielle, nous avons reconstitué auprès de l’Observatoire, un collège de quatorze experts qui tient, par défaut, le rôle que jouait le comité des experts du CNSR. Cela étant, le CISR a décidé de remettre en route le CNSR.
M. le rapporteur. Nous avons l’impression qu’une multitude d’organismes, de statut divers et à des niveaux divers, traitent de sécurité routière ou du moins s’expriment sur le sujet. Cette impression est-elle juste ? Si oui, que pensez-vous de la situation et que faudrait-il faire selon vous ?
M. Louis Fernique. Visez-vous seulement les services de l’État ou l’ensemble des partenaires avec lesquels nous pouvons être amenés à travailler ?
M. le président Armand Jung. Nous visons tous les organismes qui comptent dans le domaine de la sécurité et la prévention routières. Nous en découvrons tous les jours !
M. Louis Fernique. S’agissant des services de l’État, une réorganisation est en cours, avec le rapprochement depuis novembre dernier de la DSCR du ministère de l’intérieur. S’agissant de la constellation de partenaires extérieurs avec lesquels nous travaillons, notamment dans le cadre des grandes concertations nationales où il peut arriver que, sur 80 participants, on dénombre 60 à 70 représentants d’intérêts différents – constructeurs, assurances,… –, chacun a sa spécialité et tous ont leur importance. Les bonnes volontés sont nombreuses en matière de sécurité routière, les lobbies aussi… Le paysage de la sécurité routière est ainsi fait mais peut-il en aller différemment dès lors que c’est toute la société qui est concernée par le sujet ?
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de toutes les informations que vous nous avez apportées. Nous attendons avec impatience de disposer à la mi-septembre de vos premières conclusions pour 2010.
*
* *
Audition de Mme Anne Lebrun, sous-directrice de la circulation et de la sécurité routières à la direction de la modernisation et de l’action territoriale, au secrétariat général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, accompagnée
de M. Guillaume Audebaud, chef du service du fichier national des permis de conduire, et de M. Fabrice Dingreville, chef du bureau de la sécurité et de la réglementation routières
M. le président Armand Jung. Nous éprouvons quelques difficultés à tirer des leçons de l’avalanche des chiffres et des statistiques que l’on nous remet. Notre mission doit proposer, en octobre prochain, un certain nombre d’orientations précises au Gouvernement. Nous comptons donc beaucoup sur votre éclairage.
Mme Anne Lebrun, sous-directrice de la circulation et de la sécurité routières à la direction de la modernisation et de l’action territoriale, au secrétariat général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. J’anime une petite structure, qui existait avant le rattachement de la direction de la sécurité routière (DSR) au ministère de l’intérieur. Son activité consiste : en premier lieu, à réaliser des remontées statistiques rapides afin de disposer d’indications de tendances sur la sécurité routière ; en deuxième lieu, à tenir les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules et du permis de conduire à points ; en troisième lieu, depuis cette année, à aider les préfectures à mettre en place et à développer des politiques locales de sécurité routière.
Nos statistiques se présentent différemment de celles de l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) : elles proviennent de données fournies très rapidement par les préfectures à partir des informations relatives aux accidents que leur communiquent les forces de l’ordre. Ces remontées brutes sont à la fois hebdomadaires – chaque lundi – et mensuelles ; elles font également l’objet d’un bilan consolidé, établi pour une période d’un mois plus 45 jours. Les données correspondantes ne sont ni corrigées ni manipulées d’aucune façon. Elles ne prétendent pas à une valeur scientifique, elles ambitionnent seulement d’indiquer, rapidement et régulièrement, les tendances observées sur le terrain, conformément à ce qu’a souhaité le cabinet du ministre. Nous disposons ainsi, en attendant leur confirmation par les travaux ultérieurs des statisticiens, de données pour 2010 et pour les cinq premiers mois de 2011.
Ces données mentionnent la répartition des tués selon les catégories de véhicules, selon les âges et selon les causes. Plus de 57 % des accidents mortels concernent des véhicules légers, dont 17 % impliquent des motocyclettes et 6 % des cyclomoteurs. Plus de 52 % portent sur la classe d’âge de 25 à 65 ans. La vitesse représente 26,25 % des causes et l’alcool 20 %.
M. le président Armand Jung. Mais il s’agit souvent de faisceaux de causes.
Mme Anne Lebrun. En établissant le procès-verbal d’accident, les forces de l’ordre peuvent mentionner chacune des causes qui se sont conjuguées.
Nous disposons aussi, pour 2010, de la liste des départements où l’on déplore le plus grand nombre de tués sur les routes. Certains d’entre eux, comme les Bouches-du-Rhône, l’Héraut, le Var, le Nord, la Seine-et-Marne, comptent de 80 à 100 morts et davantage.
Nos chiffres sont beaucoup plus récents que ceux figurant dans les bilans et les brochures publiés après vérifications et corrections. Mais, pour l’essentiel, les tendances brutes que nous observons sont ensuite confirmées ; on peut donc se fonder sur elles.
Pour les cinq premiers mois de 2011, le nombre de tués a augmenté de 8,57 % par rapport à la même période de 2010 ; plus de 43 % étaient des motocyclistes.
Au début de cette année, nous avons, toujours selon la même méthode de remontées rapides d’informations par les forces de l’ordre et par les préfectures, lancé une nouvelle étude portant sur les auteurs présumés d’accidents mortels afin de mieux cerner les causes de ces derniers. Nous disposons ainsi d’éléments qui les caractérisent : 80% résidaient dans le département où a eu lieu l’accident – constat identique pour toute la France ; 49 % avaient déjà commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de points ; 40 % avaient déjà subi une condamnation judiciaire pour une ou plusieurs infractions ; 10 % avaient déjà été condamnés pour une alcoolémie délictuelle ; enfin, la vitesse était la cause de 24 % des accidents mortels.
M. Philippe Houillon, rapporteur. La vitesse est-elle un facteur déclenchant ou un facteur aggravant ? Apparemment, on ne le sait pas vraiment : les appréciations portées sur les causes d’accidents le sont souvent de façon rapide.
Mme Anne Lebrun. L’appréciation résulte, dans ce cas, de l’absence d’autre cause, telles que l’alcoolémie ou le non respect de la signalisation.
M. le rapporteur. On nous dit que beaucoup d’accidents s’expliquent par des comportements humains, comme des accès de fatigue, des perturbations provoquées par l’usage du téléphone portable, des défauts d’attention. Il s’agirait là de l’effet déclencheur de l’accident, la vitesse n’intervenant que pour en aggraver les conséquences. Mais, sans doute, est-ce particulièrement difficile à préciser.
Mme Anne Lebrun. Les forces de l’ordre parvenant sur le lieu de l’accident ne peuvent évidemment savoir quelle est la part revenant, en amont, au comportement du conducteur. Mais elles peuvent se rendre compte du caractère excessif, ou inapproprié, de la vitesse, notamment lorsque le tachymètre du véhicule est bloqué ou lorsque, par exemple, un motocycliste aborde un virage à trop vive allure. Comment savoir s’il y a eu, en plus, inattention ou trouble du conducteur ?
Nous disposons aussi d’éléments sur les véhicules : 69 % des auteurs présumés d’accidents mortels conduisaient un véhicule léger – ce qui confirme les chiffres de 2010 – et 74 % étaient propriétaires de leur véhicule. Nous disposons également de données relatives à la voierie : 70 % des accidents mortels se sont produits en dehors des agglomérations, 80 % d’entre eux sur le réseau secondaire et 64 % sur les routes départementales. De telles indications peuvent servir la politique de prévention, par exemple pour l’implantation de panneaux de signalisation ou de radars.
Notre étude ne porte encore que sur un nombre d’accidents relativement faible mais elle nous fournira bientôt des indications quant à l’évolution de la tendance.
Depuis la rentrée de 2010, nous aidons les préfectures à déterminer des politiques locales de sécurité routière. Nous avons ainsi lancé les « entretiens de gestion sécurité routière », dont 25 ont déjà été réalisés. Ils consistent, dans chaque département, à réunir le directeur de cabinet du préfet, en sa qualité de chef de projet pour la sécurité routière, ses collaborateurs et les représentants des forces de l’ordre. Des questionnaires ont été préalablement envoyés et remplis. Tous les chiffres sont examinés, les causes d’accidents étudiées. Nous montrons l’importance d’une politique locale de sécurité routière, comportant une stratégie définie avec l’aide de comités de pilotage auxquels participent le parquet, les collectivités locales, les associations. Nous insistons sur la nécessité de bien analyser les causes locales des accidents afin de réaliser des opérations de contrôle et de prévention adaptées à chaque département, même si elles se situent naturellement dans le cadre d’une politique nationale. On peut ainsi définir des actions prioritaires pour les forces de l’ordre, par exemple en fonction de l’influence de l’alcoolémie, de la circulation en fin de semaine, des trajets entre domicile et travail, ce qui permet d’établir des plans de contrôle routier.
M. le rapporteur. Dispose-t-on d’éléments d’information de ce genre en fonction des départements, des régions, voire des saisons, et permettant, comme vous le dites, d’adapter au plus près du terrain des politiques de sécurité routière éventuellement différenciées ?
Mme Anne Lebrun. Chaque préfecture dispose de ses propres statistiques relatives à la sécurité routière grâce à l’observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR), qui établit des cartes.
M. le rapporteur. On nous a expliqué que ces travaux étaient très « variables », n’employant parfois qu’un agent à mi-temps, voire personne.
Mme Anne Lebrun. Du fait de la réorganisation en cours, certains observatoires ont été transférés à la préfecture tandis que d’autres demeurent auprès des directions départementales des territoires (DDT), ce qui complique un peu le dispositif. Mais on dispose aussi de toutes les statistiques tenues par la police et la gendarmerie et que ces instances font remonter à leurs directions nationales respectives.
Dans chaque département, sous l’égide du directeur du cabinet du préfet, il importe de mettre en commun toutes les informations, nombreuses mais dispersées, provenant des administrations comme des collectivités locales, telles que, par exemple, celles des bornes du système informatisé de recueil de données (SIREDO) dont disposent les conseils généraux pour la voierie ; celles-ci fournissent, en effet, des indications de vitesse moyenne à certains endroits.
Mieux ordonnée, cette masse d’informations peut améliorer non seulement les contrôles mais aussi la prévention.
Nous allons maintenant élaborer un guide des bonnes pratiques, fondé sur les expériences positives conduites dans certains départements.
M. le rapporteur. Nous allons également en faire un.
Mme Anne Lebrun. Et nous le présenterons à l’ensemble des préfectures.
La deuxième grande tâche de notre sous-direction concerne la gestion du fichier du permis à points.
J’en rappelle la réglementation. Le permis de conduire à points fut créé par la loi du 10 juillet 1989 et il est entré en vigueur en juillet 1992. Le capital maximal de points est de 12. Mais le permis initial a un caractère probatoire : doté de six points, il dure trois ans, ou deux ans en cas de conduite accompagnée. Depuis 2007, si aucune infraction n’est commise dans l’année écoulée, on acquiert deux points de plus et l’on parvient à un permis complet de 12 points à la fin de la période probatoire.
Les retraits de points interviennent de plein droit lorsque la réalité de l’infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, ou par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ou encore par l’exécution d’une condamnation pénale ou civile. Ils ont donc un caractère automatique en fonction d’une grille progressive, de un à six points, selon la gravité des infractions. Entraînent, principalement, le retrait d’un point les petits excès de vitesse, de moins de 20 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, en agglomération et hors agglomération ; de deux points, les excès de vitesse entre 20 km/h et 30 km/h et le fait de tenir en main un téléphone portable; de trois points, les excès de vitesse entre 30 et 40 km/h et le défaut de port de la ceinture ; de quatre points les excès de vitesse entre 40 et 50 km/h, les refus de priorité, le non respect du signal stop et des feux rouges ; enfin, de six points, les grands excès de vitesse, supérieurs à 50 km/h, toutes les infractions relatives à l’alcoolémie et à l’usage de stupéfiants, ainsi que les refus de se soumettre aux contrôles correspondants.
Les contrevenants sont ensuite informés du retrait de leurs points, par quatre types de lettres envoyées automatiquement depuis le fichier des permis de conduire. Lorsqu’un retrait aboutit à un solde de points égal ou inférieur à six, une lettre d’avertissement, recommandée simple, incite à l’accomplissement d’un stage de récupération de points. En cas de retrait de points au cours de la période probatoire, une lettre recommandée avec accusé de réception signifie à l’intéressé l’obligation de suivre un stage. Il en va de même de l’information relative à la perte totale des points, à l’invalidation consécutive du permis et à l’obligation de le rendre à l’autorité administrative – ce qui fait courir le délai au terme duquel il devient possible d’en présenter de nouveau la demande.
D’autres types de lettres automatiques, au nombre de cinq – autant que de possibilités de récupération de points – sont envoyés en vue d’informer du rétablissement des points : un courrier simple pour une reconstitution totale du nombre de points après trois ans sans infraction ; la lettre de rétablissement d’un point dans le délai d’un an ; une nouvelle lettre consécutive à la réduction de ce délai à six mois en vertu de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) ; celle indiquant une réattribution de points au terme de dix ans sans infraction ; enfin, la future lettre relative au rétablissement des points au bout de deux ans pour les infractions des trois premières classes, laquelle n’entrera en vigueur que dans deux ans.
Toujours en application de la LOPPSI, il sera possible de récupérer, tous les ans et non plus tous les deux ans, quatre points en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
M. le rapporteur. Savez-vous, sur le volume total de points retirés chaque année, quelles sont les proportions respectives de retraits pour chaque nombre de points ? Constate-t-on plutôt des « petites » pertes, de un ou de deux points, ou bien, à l’inverse, des pertes élevées en une seule fois ?
Mme Anne Lebrun. En 2010, par exemple, les retraits d’un point pour petits excès de vitesse ont représenté plus de 42 % du total des points retirés tandis que les autres excès de vitesse en ont représenté 15 %.
M. le rapporteur. Nous serions intéressés par une ventilation plus fine.
M. Anne Lebrun. Nous établissons chaque année un bilan du permis à points qui répond à votre préoccupation. Celui de 2009 est déjà public sur le site du ministère, celui de 2010 est en cours de finalisation et sera disponible la semaine prochaine.
Mme Pascale Gruny. Connaissez-vous le nombre d’infractions ne pouvant donner lieu à retrait de points, en raison de l’ignorance de l’identité des auteurs ? Quelle part cela représente-t-il ?
M. le rapporteur. En d’autres termes, existe-t-il des failles dans le système ? On entend dire que certains avocats font commerce des cas d’impossibilité de retirer des points.
Mme Pascale Gruny. Nous connaissons ce problème avec les véhicules d’entreprises, lesquelles payent les amendes mais n’indiquent pas qui était responsable de l’infraction.
Mme Anne Lebrun. Je rappelle que 74 % des auteurs d’infractions sont propriétaires de leur véhicule. La plaque d’immatriculation permet de connaître le propriétaire d’un véhicule, et c’est à lui que le procès-verbal est automatiquement adressé : il n’y a pas de perte à ce stade. S’il s’agit d’un véhicule inscrit au nom d’un chef d’entreprise, celui-ci est le responsable de l’infraction, sauf s’il désigne un autre conducteur.
Mme Pascale Gruny. Mais si le véhicule appartient à une société ?
M. le rapporteur. Ou à une administration ? Il n’y a pas, alors, de retrait de points.
Mme Anne Lebrun. Dans le cas de sociétés, en effet, c’est le cas. Toutefois, pour les administrations, des directives sont intervenues afin que l’on désigne les personnes qui conduisent un véhicule de service, ou de fonction, à un moment donné. Quant à la pratique …
On connaît le nombre de véhicules dont le propriétaire est une personne morale : il est très faible. Je vous communiquerai les chiffres précis.
M. le rapporteur. On observe que l’alcool et la vitesse sont responsables, à part quasiment égale – à hauteur d’environ 30 % chacun – des accidents mortels. Toutefois, l’alcoolémie provoque bien moins de retraits de points que la vitesse. Les petits excès de vitesse, bien que responsables de peu d’accidents, entraînent un nombre très élevé de retraits de points. N’y a-t-il pas là une inadéquation du système ?
Les retraits de permis consécutifs à des retraits de points résultent-ils plutôt de l’accumulation de pertes de un ou de deux points ou bien de pertes de points plus importantes en une seule fois ?
Dispose-t-on de précisions supplémentaires sur la nature des infractions commises par les récidivistes ? Car il est tout de même très différent de multiplier les infractions au stationnement et les excès de vitesse.
Mme Anne Lebrun. Dans le nombre de points retirés, il faut tenir compte de l’incidence des radars automatiques, qui ne peuvent évidemment jouer le même rôle en matière d’alcoolémie, puisque, comme pour les stupéfiants, il faut une interception du contrevenant.
M. le rapporteur. Certes, mais cela nous incitera peut-être à adapter notre politique de sécurité routière. Car si 30 % des accidents mortels sont dus à l’alcool alors que seulement 9 % des retraits de points lui sont imputables, même pour des raisons pratiques qui se comprennent, nous devons nous poser des questions.
Mme Anne Lebrun. Le nombre d’infractions relevées par radars est nécessairement plus élevé que celui des interceptions. Quant à l’alcool au volant, il ne peut évidemment être réprimé sans infraction ou sans contrôle préventif.
M. Jean-Louis Léonard. De quelles informations disposez-vous concernant les conducteurs sans permis, dont on nous dit qu’ils seraient de plus en plus nombreux, alors que les statistiques qu’on nous présente à ce sujet ne sont jamais les mêmes ? Existe-t-il une corrélation entre les accidents mortels ou graves et ces conducteurs-là ? Connaît-on leur pourcentage d’implication ?
Selon vous, 24 % des accidents mortels seraient dus à la vitesse. Comment peut-on établir une statistique aussi précise quand on sait que le constat de la vitesse est malaisé à établir, même en cas de compteur bloqué, et que le policier qui rédige immédiatement le constat ne dispose évidemment pas, sur le moment, de tous les éléments d’appréciation ?
Les petits excès de vitesse, inférieurs à 20 km/h, aussi faibles soient-ils, sont « susceptibles » de donner lieu, selon le procès-verbal que l’on reçoit, à retrait de points. Or, on constate souvent que les points ne sont pas retirés. Comment s’opère donc l’arbitrage entre retrait et non retrait en fonction de l’excès de vitesse puisque la sanction n’est pas systématique ?
M. le rapporteur. Le défaut de notification est un argument utilisé par les avocats.
Mme Anne Lebrun. S’agissant des conduites sans permis, nous ne pouvons disposer que du nombre des infractions relevées à ce titre : 100 314 en 2010 contre 106 227 en 2009, soit une diminution de 6 %.
M. Jean-Louis Léonard. Peut-on rapprocher cette statistique du nombre de contrôles effectués par la police et par la gendarmerie ?
Mme Anne Lebrun. Notre système de remontées rapides ne le permet pas.
M. Jean-Louis Léonard. Mais combien de contrôles sont effectués par an ?
Mme Anne Lebrun. Je ne peux pas vous le dire ici mais je vous ferai parvenir l’information.
Comme je l’ai indiqué, le retrait d’un point fait l’objet d’une lettre automatique.
Des avocats ayant obtenu gain de cause en contestant les retraits de points, nous avons essayé, en liaison avec le Conseil d’État, de perfectionner le système afin d’en fiabiliser la procédure. Nous sommes donc en train de modifier les formulaires des procès-verbaux pour supprimer le doute que soulevait auparavant le fait de cocher, ou non, la case relative au retrait de points. Il existera désormais quatre modèles de formulaires, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2012 : le stationnement ne sera pas concerné ; quant à l’excès de vitesse, il entraînera automatiquement un retrait de points.
M. le rapporteur. Attendez peut-être que nous ayons formulé nos propres propositions.
Mme Anne Lebrun. Il s’agit d’un travail déjà commencé. Les documents relatifs aux infractions donnant lieu à retrait de points comporteront des cases déjà imprimées et seront d’une couleur particulière. Les autres ne comporteront pas de cases et seront d’une autre couleur. Les forces de l’ordre recevront des instructions précises pour l’utilisation des nouveaux formulaires. Ce système devrait diminuer sensiblement le nombre de recours fondés sur l’ancien problème de remplissage, ou non, d’une case.
Nous vous communiquerons très vite le nombre de contrôles effectués au titre de la sécurité routière.
M. Jean-Louis Léonard. Ai-je bien compris que les petits excès de vitesse n’entraînaient pas de retrait de points ?
Mme Anne Lebrun. Il y a retrait de points lorsque l’infraction a bien été caractérisée. Je ne comprends donc pas les cas auxquels vous faites allusion.
M. Jean-Louis Léonard. Mon cas personnel, sur trois ans, dément votre modèle. Il n’est pas isolé. Je persiste donc à me demander s’il n’existe pas une part d’aléatoire.
Mme Anne Lebrun. Après deux années de diminution, le nombre de points retirés a augmenté de 9 %, en 2010. En revanche, le nombre des permis de conduire invalidés a diminué : de 6 % en 2009 et de 7 % en 2010. Ce qui traduit un certain équilibre.
J’ajoute qu’un permis de conduire sur cinq invalidés pour solde nul de points est un permis probatoire.
M. le rapporteur. Ce qui confirmerait que la population la plus jeune est davantage impliquée dans les accidents et commet plus d’infractions.
Mme Anne Lebrun. Le nombre de permis au capital initial de 12 points rétablis dans un délai de trois ans sans infraction concerne plus de 2,3 millions de conducteurs en 2010, sur environ 40 millions de titulaires de permis de conduire, pour toutes sortes de véhicules.
Le nombre de récupérations d’un point au bout d’un an sans infraction progresse régulièrement : on en comptait trois millions en 2010.
Sur les 85 700 personnes dont le permis fut invalidé, 86 seulement n’avaient commis que des excès de vitesse à un point. Ce qui démontre que la perte de permis par disparition de la totalité des points résulte surtout d’infractions graves et que, si d’une façon générale, on perd beaucoup de points, on en récupère aussi beaucoup. Le mécanisme de restitution à un an et, maintenant, à six mois, fonctionne bien.
M. le rapporteur. Sous réserve toutefois de l’incidence des nouvelles dispositions et de l’augmentation des infractions constatées par radars.
M. Guillaume Audebaud, chef du service du fichier national des permis de conduire. Le nombre de permis rétablis à 12 points est 27 fois plus élevé que le nombre de permis invalidés.
M. le rapporteur. Les 86 personnes que vous signalez ne représentent en effet qu’une statistique négligeable. Cela dit, il serait intéressant de comprendre plus précisément comment on perd son permis. On ne saurait en effet assimiler les pertes successives d’un point et celles de deux fois six points. Nous avons donc besoin, en la matière, d’une photographie très fine, faute de quoi nos conclusions pourraient être faussées. Peut-on disposer d’un tableau exhaustif de tous les cas de figures avec la mention de la part prise par chacun ?
M. Fabrice Dingreville, chef du bureau de la sécurité et de la réglementation routières. Nous disposons du panel de toutes les infractions ayant conduit à l’invalidation de permis de conduire et de leur répartition par catégories d’infractions.
Mme Anne Lebrun. Les infractions relatives aux franchissements de feux rouges coûtent quatre points et sont en forte hausse du fait de l’installation récente de radars. Un conducteur peut donc se trouver rapidement privé d’une partie importante de ses points alors qu’il ne lui semble pas avoir commis d’infraction très grave.
M. Guillaume Audebaud. Il faut aussi rappeler que 75 % des conducteurs possèdent la totalité de leurs 12 points.
M. le rapporteur. Comment alors, avec un tel système progressif et équilibré, expliquer la très vive réaction des populations à l’annonce des mesures prises par le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai dernier et aux déclarations gouvernementales qui les ont suivies ?
Mme Anne Lebrun. Ces réactions nous paraissent plus épidermiques et psychologiques que vraiment rationnelles, les statistiques montrant que 75 % des personnes ne sont pas concernées.
M. Jean-Louis Léonard. Disposez-vous de statistiques sur les récidives et sur les infractions relevées par les radars ?
Mme Anne Lebrun. Nous n’avons pas de statistiques portant sur les récidives : elles ne sont pas répertoriées administrativement mais seulement sur le plan judiciaire.
M. Jean-Louis Léonard. Ce devrait pourtant être possible puisque tout est enregistré.
Les radars et leur signalétique semblent avoir un effet bénéfique sur la conduite, notamment en appelant le conducteur à plus de vigilance.
Que pensez-vous des systèmes avertisseurs du type Coyote, qui contribuent au même résultat ? Plusieurs recherches ont montré leur aspect positif. Pourquoi n’a-t-on pas, dans les décisions intervenues récemment au CISR, davantage tenu compte de leur apport au lieu de se focaliser sur la question, marginale, du freinage et de l’accélération à hauteur des panneaux de signalisation des radars ?
Mme Anne Lebrun. Ce sujet ne relève pas de ma sous-direction mais d’autres services du ministère.
M. Jean-Louis Léonard. Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière, ne pouvait pas non plus nous répondre. À qui faut-il donc s’adresser ? Qui pèse, techniquement, sur les décisions du CISR ?
M. le rapporteur. C’est aussi pourquoi je demande, de façon réitérée, les raisons pour lesquelles le Conseil national de la sécurité routière ne s’est pas réuni depuis 2008, alors que tous nos interlocuteurs ont attesté de son utilité et de la qualité des experts qu’il réunissait. Aujourd’hui, les décisions sont prises directement par le CISR sans consultation de ce qui tenait lieu de « parlement » de la sécurité routière.
Je renouvelle aussi ma demande de disposer d’éléments d’analyse plus fine pour compléter les informations que vous nous avez fournies.
Mme Anne Lebrun. La brochure « bilan » du permis à points sera disponible la semaine prochaine.
M. le rapporteur. Je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Robert Namias, ancien président du Conseil national de la sécurité routière
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons les auditions de la mission d’information en accueillant M. Robert Namias, journaliste que nous connaissons bien mais dont j’ignorais qu’il avait publié en 1994 un rapport consacré à la vitesse et à la sécurité routière. Ce sujet intéresse particulièrement notre mission, dont l’objectif est de mieux connaître les causes des accidents de la route afin de faire des propositions précises au Gouvernement.
M. Robert Namias, ancien président du Conseil national de la sécurité routière. Je vous remercie de m’avoir invité. J’en suis à la fois très honoré et très heureux. Alors que je dirigeais la rédaction de TF1, je m’intéressais à de nombreuses questions de société mais pas particulièrement à la sécurité routière. En 1994, le ministre des transports, Bernard Bosson, m’a demandé de présider une commission extraparlementaire, laquelle comprenait des parlementaires, issus de l’Assemblée nationale et du Sénat, et des représentants du ministère de la défense, dont dépendait à l’époque la gendarmerie, du ministère de l’intérieur et de l’ensemble des acteurs de la sécurité routière – associations de victimes, constructeurs automobiles ou encore assureurs. J’ai accepté et durant trois mois, à raison de deux séances par semaine, nous avons étudié l’accidentologie au regard de la vitesse et les rapports entre sécurité routière et vitesse. Ces travaux ont donné lieu à un rapport, édité par la Documentation française, consacré à la vitesse et à la sécurité routière.
Ce rapport proposait un certain nombre de mesures susceptibles d’améliorer la situation. Il convient de rappeler les chiffres : en 1994, la route faisait plus de 12 000 morts par an – mais ce chiffre était de 17 500 en 1973, lorsqu’ont été prises les premières mesures telles que le port de la ceinture de sécurité et les limitations de vitesse. En vingt ans, le nombre de victimes n’avait baissé que de 5 000.
La situation était suffisamment alarmante pour nous amener à nous interroger sur l’efficacité des limitations de vitesse en vigueur à l’époque – elles ont d’ailleurs été maintenues – et sur les mesures qu’il convenait de prendre. Pendant dix-sept ans, toutes les mesures préconisées dans ce rapport ont accompagné la politique de sécurité routière. Toutes sauf une, à laquelle je continue de croire, qui n’a pas été mise en œuvre à l’époque compte tenu de la difficulté administrative qu’aurait entraîné le travail conjoint de deux ministères - le ministère de l’intérieur et celui de la défense : il s’agit de la création d’une police de la route, dédiée à la sécurité sur la route.
Le rapport préconisait la mise en place de radars automatiques. Les experts de la police et de la gendarmerie que nous avions consultés estimaient qu’il était nécessaire d’installer 5 000 radars automatiques fixes pour assurer le contrôle effectif de la vitesse sur l’ensemble du territoire. Nous en sommes encore loin aujourd’hui ; et lorsqu’on voit les réactions que cela provoque, on peut se demander si nous pourrons un jour parvenir à ce résultat.
Je vous remercie d’autant plus de m’avoir invité que, depuis trois ans, je ne suis plus président du Conseil national de la sécurité routière (CNSR), après l’avoir été pendant cinq ans. Ce qui m’inquiète, c’est que je n’ai pas de successeur et qu’il n’y a plus, de facto, de Conseil national de la sécurité routière.
Ce conseil, créé par le Gouvernement Jospin en 2001, a été présidé par l’un d’entre vous pendant les deux premières années. En 2003, le Gouvernement Raffarin, découvrant que la politique de sécurité routière était pour l’essentiel basée sur le rapport que j’avais produit en 1994, m’a demandé si je voulais en assurer la présidence, neuf mois après que le Président de la République eut décidé de faire de la sécurité routière une grande cause nationale. J’ai donc terminé le premier mandat avant d’assumer le second mandat de trois ans, de 2005 à 2008.
Le Conseil de la sécurité routière, à vocation consultative, était alors considéré par certains, dont le Gouvernement, comme l’un de ces nombreux comités Théodule qui n’ont qu’un intérêt relatif. Sa composition était presque identique à celle de la commission que j’avais présidée en 1994. J’avais souhaité qu’il en soit ainsi mais j’avais demandé aussi aux services du Premier ministre d’élargir la composition du Conseil aux représentants de différents secteurs. La totalité des acteurs de la sécurité routière y était représentée puisqu’il était composé de parlementaires, de représentants des ministères intéressés, dont le ministère des transports directement en charge de la sécurité routière – Gilles de Robien, qui fut un ministre très efficace, nous a beaucoup soutenus –, le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense. Étaient également représentés au Conseil tous les acteurs de la société civile dont les associations, y compris celles avec lesquels j’ai eu des rapports très conflictuels – je suis allé jusqu’à suspendre pendant un temps la participation de l’association des Motards en colère –, mais également les associations d’aide aux victimes, les associations des usagers de la bicyclette et des deux-roues, les représentant des piétons, enfin les constructeurs automobiles et les compagnies d’assurances.
Le Gouvernement avait confié au Conseil la mission de réfléchir, d’évaluer les effets – positifs et négatifs – des mesures en vigueur et de faire des propositions, inspirées notamment par les exemples étrangers. Le Conseil comprenait un comité d’experts qui nous a apporté ses lumières. Durant les trois premières années de vie du Conseil, jusqu’en 2007, tout a très bien fonctionné grâce aux acteurs impliqués en matière de sécurité routière, qu’il s’agisse du Gouvernement, en particulier des ministères des transports et de l’intérieur, du Président de la République, mais aussi de la Délégation interministérielle, en la personne de Rémy Heitz, qui a accompli un travail remarquable. Je me dois de dire que la politique de sécurité routière a été durant toutes ces années conduite de concert par le Gouvernement, le Président de la République, le délégué interministériel, qui appliquait avec beaucoup de conviction les mesures prises dans le cadre du comité interministériel, allant parfois jusqu’à en proposer d’autres, et le Conseil lui-même. Cela a permis d’éviter les cafouillages comme ceux auxquels nous assistons depuis quelques semaines.
Si le Conseil a permis d’éviter de tels cafouillages, particulièrement déplorables, c’est qu’il entendait les avis des uns et des autres et qu’il était capable d’évaluer la façon dont seraient accueillies les mesures qui pouvaient être envisagées.
Nous avons fait un certain nombre de propositions spectaculaires, dont certaines, qui n’ont pas été retenues, me paraissent plus que jamais d’actualité.
Si j’ai tant insisté sur le fonctionnement du Conseil, c’est qu’il traduisait une volonté politique extrêmement forte et courageuse permettant d’éviter les pièges, de mesurer les seuils d’intolérance de l’opinion publique et de prévoir la façon dont serait acceptée telle ou telle mesure – ce qui est primordial en matière de sécurité routière car le seuil d’acceptabilité évolue en permanence, en fonction de l’environnement dans lequel la mesure a été prise et de la façon dont elle est portée, expliquée et communiquée dans la durée.
Je considère que cette volonté politique n’existe plus au plus haut niveau de l’État. Certes, tout le monde affirme, la main sur le cœur, qu’il faut tout faire pour que le nombre de morts diminue, mais, derrière ces mots, je ne vois aucun acte, sinon des décisions contradictoires, très souvent prises à l’emporte-pièce et contraires à une politique efficace, utile et acceptée par tous.
M. Philippe Houillon, rapporteur. On dit que le Conseil national serait le Parlement de la sécurité routière ; pourtant il ne s’est pas réuni depuis 2008 et vous n’avez pas de successeur. Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai dernier préconise de lui redonner vie. Comment expliquez-vous que son activité ait été interrompue ? Aurait-il permis, selon vous, d’éviter les récents cafouillages ? Enfin, que pensez-vous des mesures prises dans le cadre du CISR concernant les radars ?
M. Robert Namias. Je vous remercie de me poser cette question, à laquelle j’entends répondre très librement. À l’époque, le Conseil national, qui travaillait étroitement avec les services de la Délégation interministérielle, était porté par cette délégation. J’ai, pour ma part, travaillé avec deux délégués, Rémy Heitz et Cécile Petit. Un an après la prise de fonctions de Mme Petit, j’ai quitté les miennes. C’est à sa demande que j’ai rencontré, à deux reprises, Mme Merli, qui m’a indiqué qu’elle entendait proposer à Matignon de remettre en activité le Conseil national et de nommer un nouveau président, me demandant si j’accepterais de prolonger ma mission – question à laquelle je n’ai pas répondu. Depuis, je n’ai jamais plus entendu parler de la déléguée interministérielle à la sécurité routière… Le Conseil national a disparu, faute de volonté de le réactiver et de lui redonner la place qu’il avait eue auparavant. Il n’intéressait plus personne, pas plus le ministère des transports que Jean-Louis Borloo ou le Premier ministre.
En ce qui concerne les radars, il est clair que la première décision annoncée, qui consistait à supprimer la totalité des panneaux prévenant de l’existence d’un radar automatique, décision qui, pendant 48 heures, a été confirmée, puis démentie, puis à nouveau confirmée, aurait fait l’objet d’une recommandation du CNSR. Je reste en contact avec un certain nombre d’acteurs : tous savaient que l’annonce urbi et orbi de la suppression de ces panneaux ne serait pas acceptée. Les associations qui se sont exprimées à la télévision ou à la radio – sachant que chacune s’exprime désormais en son nom et non plus dans une enceinte officielle, ou tout au moins semi-officielle – ont toutes indiqué qu’elles n’avaient pas demandé cette suppression.
Si le Conseil avait fonctionné correctement, le schéma aurait été le suivant : le délégué interministériel, après délibération du Conseil national, aurait rapporté ses conclusions au ministère intéressé, et cette décision n’aurait pas été prise.
M. le rapporteur. Ce que vous nous dites est très important. Le Conseil national compte une cinquantaine de membres : ce chiffre ne vous paraît-il pas excessif ?
Certains critiquent le fait que les associations de victimes y sont plus représentées que les associations d’usagers de la route. Sa composition vous semble-t-elle équilibrée ?
M. Robert Namias. À l’époque, les associations de victimes n’étaient pas surreprésentées. La seule vraie difficulté, c’est qu’elles entendaient être représentées à chaque réunion du Conseil par une personne différente.
La liste des membres mérite sans doute d’être actualisée. Le Conseil s’apparente peur-être à un parlement, mais l’ensemble des acteurs de la politique de sécurité routière - compagnies d’assurances, constructeurs automobiles, ministères, associations – ne peuvent représenter moins de 50 personnes.
M. le président Armand Jung. Les délégués interministériels relèvent aujourd’hui du ministère de l’intérieur. Ceux que vous avez cités, Rémy Heitz et Cécile Petit, relevaient du ministère des transports. D’aucuns se demandent si le délégué interministériel ne devrait pas relever du Premier ministre.
M. Robert Namias. J’en suis absolument convaincu. C’est une très mauvaise mesure que d’avoir transféré la Délégation interministérielle du ministère des transports à celui de l’intérieur, et ce pour une raison simple : la sécurité routière est un dossier symbolique ; or le fait qu’elle dépende du ministère de l’intérieur souligne le caractère répressif de la politique de sécurité routière. Je suis tout à fait favorable à la répression dans ce domaine, mais faire de la police, des contrôles et des amendes l’essentiel de notre politique de sécurité routière constitue une erreur. D’autant que les délégués interministériels viennent d’horizons très différents – nous avons souvent oscillé entre un préfet et un magistrat, et la personne actuellement en poste vient de la police. Cette origine est tout à fait respectable, mais elle a une connotation répressive et reflète une certaine culture de la sécurité routière qui pèse sur l’image de la politique que nous menons.
M. le président Armand Jung. Dans son titre, le rapport de 1994 évoquait déjà la vitesse. Dix-sept ans après, nous sommes toujours confrontés à la même problématique, que nous ne parvenons pas à résoudre.
M. Jean-Marc Roubaud. Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention, monsieur Namias. Je suis d’accord avec vous sur un certain nombre de points, mais je ne peux vous laisser dire qu’il n’existe pas de volonté politique. Les décisions du CISR répondent à l’inquiétude des responsables politiques face à la hausse du nombre des morts sur les routes et tiennent compte de l’objectif que s’est fixé le Gouvernement de passer sous le seuil des 4 000 morts par an dans des accidents de la route.
Les mesures qui sont prises doivent en effet être utiles et acceptées par l’opinion publique, faute de quoi celle-ci entre en rébellion, ce qui mène à l’échec des mesures. Dans ces conditions, que pensez-vous des mesures proposées par le CISR en mai dernier ?
Mme Françoise Hostalier. De par sa dimension interministérielle, le délégué doit être placé auprès du Premier ministre et non auprès de l’un des ministres.
La mise en sommeil du Conseil national il y a trois ans accompagnait la suppression de nombreuses instances, dont le nombre était pléthorique. Il était nécessaire de procéder à un balayage.
Lorsque j’étais inspecteur général de l’éducation nationale, j’ai eu l’occasion de travailler avec votre prédécesseur sur le brevet de sécurité routière dans les collèges et la politique de prévention dans les établissements scolaires. J’avais trouvé au sein du Conseil tous les interlocuteurs que je souhaitais rencontrer.
Les préfectures mettent en place des comités locaux pour lutter contre les exactions routières. Ne serait-il pas opportun de mettre en place un conseil ad hoc qui assurerait le suivi de toutes les mesures prises ? Les personnes que nous avons auditionnées nous ont indiqué que lorsqu’elles adressent des préconisations aux institutions, elles n’ont aucun regard sur le suivi de ces préconisations. Une structure relativement souple, composée de spécialistes, pourrait traiter les problèmes au fond.
M. Michel Raison. En France, nous sommes en situation d’échec s’agissant de la compréhension par les automobilistes des règles qu’ils doivent respecter. Pour que les mesures soient acceptables, il faut qu’elles soient présentées avec pédagogie. Nous devons expliquer à nos concitoyens les raisons d’être de telle ou telle réduction de vitesse et faire en sorte qu’elles soient moins systématiques, à l’instar de ce qui se passe en Allemagne. Ainsi dans ma ville, l’État a installé un radar sur une nationale, à un endroit où la route est parfaitement droite, mais il n’a pas expliqué pourquoi, alors même qu’on sait pertinemment que les accidents sont parfois plus nombreux dans les lignes droites.
M. Jacques Myard. L’augmentation du nombre de tués sur les routes françaises en 2011 m’a beaucoup frappé.
Par ailleurs, certains chiffres me laissent pantois : selon certaines estimations, 10 % de nos concitoyens conduiraient sans permis. J’y vois plutôt un problème sociologique. En multipliant les peurs – peur des radars, peur du gendarme – n’avons-nous pas atteint les limites de la politique répressive ? Certes, toute infraction à la règle doit avoir une sanction, mais est-ce que cela ne finit pas par provoquer une certaine lassitude ?
M. Jean-Jacques Candelier. Je vous ai écouté avec beaucoup d’intérêt. La décision visant à remplacer les panneaux de signalisation des radars par des radars pédagogiques vous satisfait-elle ? S’ils répondent aux attentes de nombreux automobilistes et des motards, les radars pédagogiques n’auront pas plus d’effets que les panneaux, mais ils coûteront beaucoup plus cher.
M. Rudy Salles. La mise en place de radars a permis de faire évoluer les comportements des Français au volant. Cela étant, s’ils s’appliquent de façon systématique aux conducteurs français, les radars ne s’appliquent pas aux automobilistes étrangers qui circulent sur nos routes. Or la France est un grand pays de transit, et l’on voit circuler sur nos routes des automobilistes qui roulent à une vitesse folle sans recevoir de procès-verbal et sans se voir retirer le moindre point. Le Conseil avait-il fait des préconisations pour lutter contre ce phénomène ?
M. Michel Voisin. Je suis favorable à la répression, à condition qu’elle ne soit pas excessive – je peux en parler d’autant plus volontiers qu’il ne me reste que deux points sur mon permis…
Je m’intéresse à l’automobile depuis mon plus jeune âge et plus récemment, j’ai participé aux travaux de la Commission des affaires européennes en matière d’infrastructures et de technique automobile. Si nous voulons que les décès, les handicaps et les dégâts matériels décroissent, nous devons nous intéresser aux infrastructures routières.
Par ailleurs, il ne serait pas inutile que notre mission auditionne les représentants des ministères de l’intérieur et des transports.
J’ajoute que les nouvelles technologies, qu’elles soient embarquées sur les véhicules ou disposées le long des routes, offriront sans doute demain une meilleure sécurité ; les véhicules de moyenne gamme sont déjà équipés d’un système permettant d’éviter l’endormissement. Toutes ces technologies de pointe doivent être favorisées si l’on veut durablement diminuer le nombre des accidents.
M. le président Armand Jung. Nous avons abordé ces aspects techniques dès que nous avons commencé nos travaux, ce qui nous amènera sans doute à rendre visite à quelques constructeurs. Les nouvelles technologies permettront sans nul doute de limiter la vitesse des véhicules.
Mme Marie-Line Reynaud. Vous avez indiqué, monsieur Namias, que certaines de vos préconisations étaient restées lettre morte. Quelles sont-elles ?
M. le président Armand Jung. Permettez-moi de vous raconter une anecdote : depuis la mise en place de la Mission, j’ai été contacté par quelques journalistes, en accord avec le Président de l’Assemblée nationale. L’un d’entre eux, dont je tairai le nom par charité, souhaitait me parler des victimes de la route. Après une demi-heure de discussion, je me suis rendu compte que pour lui, les victimes de la route sont les personnes qui perdent des points de permis et non celles qui agonisent sur le bas-côté. Cette attitude dénote une inversion des valeurs que je n’arrive pas à comprendre...
M. Robert Namias. S’agissant de la volonté politique, j’assume mes propos : c’est l’ancien président du CNSR et le journaliste qui a assisté depuis vingt ans à tous les épisodes de l’histoire de la sécurité routière qui les tient. La volonté politique s’est exprimée en 2002 à travers les actes et surtout les déclarations fortes du Président Jacques Chirac, mais depuis 2007 je n’ai jamais entendu le président Sarkozy rappeler que la sécurité routière était une priorité et qu’il entendait faire baisser le nombre des victimes de la route.
Cette volonté politique ne peut venir que de l’Élysée. Si le Président de la République ne met pas une pression permanente sur les différents ministères concernés, à commencer par ceux qui sont responsables de la Délégation interministérielle, ni sur la Délégation elle-même pour qu’elle œuvre, quotidiennement et publiquement, en matière de sécurité routière, c’est que la volonté politique a disparu. Or, depuis deux ou trois ans, je ne vois pas beaucoup à la télévision, je n’entends pas souvent à la radio et je ne lis pas souvent dans la presse des déclarations de la déléguée interministérielle.
Vous connaissez les noms de certains délégués, comme Rémy Heitz et quelques autres avant lui ; mais demandez aux gens dans la rue le nom de la déléguée interministérielle à la sécurité routière : personne ne saura vous répondre. Rémy Heitz intervenait tous les trois jours à la télévision. La sécurité routière avait une image. Le Président de la République de l’époque l’avait voulu ainsi, et le Premier ministre avait pris le relais. Encore une fois, personne ne peut être défavorable à une politique qui tend à faire diminuer le nombre de victimes, simplement il faut que les actes suivent.
En ce qui concerne les radars, si nous avions conservé les panneaux indicateurs, nous aurions pu, sans le dire, multiplier le nombre de radars et passer de 2 500 à 3 000, voire à 3 500 radars et personne ne s’en serait aperçu – nous ne sommes pas obligés de faire une conférence de presse chaque fois que nous installons un radar. Je ne comprends pas pourquoi cette décision a été prise. J’ai naturellement entendu les explications : en l’absence de panneaux, les conducteurs supposent en permanence que la vitesse est limitée – je pense en ce qui me concerne que c’est exactement le contraire. Toujours est-il que personne ne demandait une telle mesure. Nous aurions pu accentuer la politique de contrôle sans le dire.
Non seulement les décisions prises depuis deux mois n’améliorent pas la sécurité routière, mais, de plus, elles vont à l’encontre de la politique de sécurité routière et augmentent le seuil d’intolérance – ou diminuent le seuil d’acceptabilité – de l’opinion publique. Ce sont des décisions totalement contre-productives. Désormais qui osera prendre une mesure réellement efficace sans mettre 15 000 motards dans la rue et sans susciter un tollé général – avec toutes les conséquences électorales que cela pourrait avoir ? Je pense qu’il faudra laisser passer un certain temps avant de prendre la moindre décision.
Nous avions pourtant réussi à faire passer des mesures beaucoup plus difficiles que la suppression des panneaux indicateurs de radars – je pense à la diminution du taux d’alcoolémie toléré ou au durcissement du système de retrait de points sur les permis. Cela a été possible grâce à une communication permanente, qui elle aussi relève d’une volonté politique dans la mesure où elle a un impact budgétaire.
Je pense pour ma part qu’une politique de sécurité routière n’est efficace que si la communication est permanente. Ce ne sont pas quelques spots télévisés avant les départs en vacances qui peuvent changer les choses. On peut certes s’interroger sur l’efficacité des spots, des plus soft aux plus gore, mais une communication pédagogique est essentielle. Si les Français sont allés très loin dans l’acceptabilité s’agissant de l’alcool au volant, c’est que chacun peut vérifier que les effets de l’alcool au volant modifient son comportement, donc sa conduite. S’agissant de l’utilisation du téléphone portable, nous pouvons aussi aller très loin. Nous en sommes tous conscients, téléphoner au volant, même avec le kit mains libres, demande un effort de concentration. Celui qui engage une conversation professionnelle, sur un budget ou une affaire en cours, n’est pas capable de voir si le feu est rouge. Cette incompatibilité entre le téléphone et la conduite est relativement facile à comprendre et à accepter.
En revanche, personne n’accepte l’idée que la vitesse est fondamentalement dangereuse et meurtrière – cela n’a jamais fait l’objet d’une communication permanente. Pourtant le danger est assez facile à comprendre. J’avais proposé il y a quelques années de diffuser des spots afin d’alerter sur ce danger. On cite souvent l’exemple de l’Allemagne, mais en Allemagne la vitesse n’est vraiment libre que sur quelques autoroutes et elle est beaucoup plus réglementée qu’elle ne l’est en France. Lorsque vous conduisez à 50 km/h en ville, ce qui est autorisé dans la plupart des cas, si un enfant traverse la rue en courant, il a malheureusement beaucoup de risques d’être tué parce que vous n’avez pas le temps de freiner. Il est facile de comprendre cela, même si c’est difficile à accepter. Si vous roulez à 30 km/h, vous le renverserez mais il aura des chances de s’en sortir. Tous les travaux réalisés sur les dangers de la vitesse devraient faire l’objet d’une communication.
En ce qui concerne le téléphone, j’ai lu que parmi toutes les bonnes mesures qui ont été envisagées par le comité, aucune n’a été prise. La bonne mesure serait l’interdiction pure et simple de l’usage du téléphone au volant. Compte tenu du contexte, ce sera désormais très difficile. Il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie. Un délégué interministériel pourrait expliquer le bien-fondé de cette mesure, et si nous diffusions des spots informant du danger de l’usage du téléphone en conduisant, il ne faudrait que quelques mois à nos concitoyens pour accepter une interdiction.
Au Conseil national, après avoir consulté les experts et effectué un certain nombre de voyages à l’étranger, nous procédions à l’évaluation du nombre de vies qu’une mesure aurait permis d’épargner. Ainsi, on avait évalué à 400 le nombre de vies pouvant être sauvées grâce à l’interdiction de l’usage du téléphone au volant.
En 2007, le Conseil national avait voté, à une majorité très relative, le principe de la tolérance zéro en matière d’alcool au volant. Toutefois, le secrétaire d’État aux transports de l’époque, M. Dominique Bussereau, avait « retoqué » cette proposition. Il serait très pédagogique de reprendre les vieux slogans de la sécurité routière : « Boire ou conduire, il faut choisir », ou encore « Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts ». Mais il faudrait aussi faire preuve de pédagogie pour déterminer, lorsque l’on a bu un verre, s’il faut attendre une heure ou deux avant de conduire, voire attendre le lendemain. Appliquer la tolérance zéro en matière d’alcool au volant aurait une valeur symbolique – même si chacun sait que l’on ne peut avoir moins de 0,2 g d’alcool dans le sang car certains résidus médicamenteux provoquent une synthèse de l’alcool.
Telle aurait pu être notre politique de sécurité routière. Nous aurions pu ne pas toucher aux radars et installer des radars supplémentaires sans rien dire, et, s’agissant de l’usage du téléphone, prendre des mesures fortes, après une large communication et grâce à la présence sur le terrain des délégués régionaux. Je suis persuadé nous en viendrons à la tolérance zéro dans quelques années, sauf si nous abandonnons l’idée de mener une véritable politique de prévention.
M. le président Armand Jung. Les techniques, qui ont beaucoup évolué depuis 1994, nous y aideront.
M. le rapporteur. Nous avons bien compris l’utilité du Conseil national.
Vous avez beaucoup parlé de volonté politique. Si j’ai bien compris, Rémy Heitz et Cécile Petit ont bien fait leur job, mais depuis les choses laissent à désirer… Dont acte.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de la gouvernance en matière de sécurité routière ? Disposez-vous d’éléments de comparaison avec les pays étrangers ?
Je suis d’accord avec vous, le seuil de tolérance n’évolue que grâce à une démarche pédagogique. La communication est-elle adaptée ?
Que pensez-vous des publicités qui mettent en valeur les performances des véhicules, alors même que la vitesse est réduite à 130 km/h sur l’ensemble du territoire ?
M. le président Armand Jung. Qui est le plus irresponsable en matière d’insécurité routière : le constructeur qui propose des voitures qui roulent à 220 km/h et des motos superpuissantes, ou le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée ou roule sous l’emprise du cannabis ? Les constructeurs ne se sentent pas responsables, pas plus que les conducteurs qui prennent la route après une soirée arrosée. Où placez-vous le curseur des responsabilités ?
M. Robert Namias. C’est une question très délicate, d’abord parce que je ne suis pas là pour porter des jugements sur la responsabilité de tel ou tel. Je crois sincèrement, sans vouloir me dérober, que la responsabilité est collective.
Il est absurde de construire des véhicules qui roulent à 220 ou 250 km/h, mais cette situation évolue car, aujourd’hui, les constructeurs automobiles, indépendamment de leurs obligations en matière de publicité, accentuent leur communication sur l’aspect confortable et convivial des véhicules, et sur leur capacité à protéger la vie. Par ailleurs, ils ont désormais l’obligation de proposer, y compris sur les modèles peu coûteux, des limitateurs de vitesse. Construire des véhicules qui roulent à 250 km/h n’a plus aucun sens, étant entendu qu’une voiture doit pouvoir aller jusqu’à 180 km pour pouvoir accélérer au cas où la situation l’exigerait.
J’en viens à la gouvernance. Un signal fort serait de dédier à la sécurité routière une administration, pourquoi pas un secrétariat d’État ? Dans le contexte très difficile que nous connaissons, alors qu’un certain nombre de choses ont été fragilisées, voire détruites, il faudra du temps pour rétablir la confiance entre les Français et les gouvernants. Cette confiance devra être incarnée soit par un délégué interministériel dépendant directement de Matignon, soit par un secrétaire d’État, en tout cas par une structure forte, administrativement cohérente et disposant d’un budget de communication. Car la sécurité routière, si elle est liée aux infrastructures, qu’elles soient régionales ou nationales, est surtout une affaire de communication. La communication peut représenter des sommes très élevées, mais s’il y a un domaine dans lequel elle peut faire avancer les choses, c’est bien celui de la sécurité. La création d’une telle structure serait le symbole d’une réelle volonté politique.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie sincèrement, monsieur, pour votre contribution aux travaux de notre mission d’information.
*
* *
Audition de M. Jean Pechinot, sous-directeur à la direction des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d’assurances, accompagné par Mme Ludivine Daniel, chargée de mission, et Mme Ludivine Azria, attachée parlementaire
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons nos travaux par l’audition d’un représentant de la Fédération française des sociétés d’assurances, M. Jean Pechinot, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation.
M. Jean Pechinot, sous-directeur à la direction des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d’assurances. La Fédération française des sociétés d’assurances – FFSA – est un syndicat professionnel créé en 1937. Elle regroupe 248 entreprises d’assurances qui représentent environ 90 % du marché français et la quasi-totalité de l’activité internationale du secteur. Elle réunit des sociétés anonymes mais aussi de nombreuses sociétés d’assurance mutuelle. S’agissant du risque automobile des particuliers, le marché se répartit à égalité entre les adhérents de la FFSA et ceux du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance – GEMA.
La promotion des actions de prévention est une des missions principales de la FFSA, en matière de sécurité routière, bien entendu, mais aussi dans de nombreux autres domaines, via notamment le Centre national de prévention et de protection – CNPP – et la Mission risques naturels.
Avec environ 120 sociétés d’assurances, le marché français du risque automobile est sans doute le plus concurrentiel d’Europe. En 2010, son encaissement s’est élevé à 18,3 milliards d’euros, les prestations à 15,5 milliards et le résultat à 50 millions, alors que les pertes avaient été de 500 millions d’euros en 2009.
L’assurance automobile indemnise environ 10 millions d’événements par an en France, parmi lesquels 270 000 accidents corporels concernant un total de 300 000 victimes – le ratio étant de 1,2 victime par accident.
Si le secteur des assurances participe à la prévention du risque routier, c’est tout d’abord parce qu’il est un acteur très important de l’économie française et qu’il a, à ce titre, un rôle sociétal à jouer. La FFSA est du reste à l’origine de la création, en 1949, de l’Association de prévention routière.
Mais l’objectif de la prévention est également de permettre l’« assurabilité » des risques. À titre d’exemple, le gros problème que constituait le vol des véhicules il y a une quinzaine d’années a conduit les sociétés d’assurances à mener un travail avec les constructeurs automobiles pour diminuer cette sinistralité, en équipant notamment les véhicules de systèmes de sécurité en première monte. Cette démarche a porté ses fruits puisque, au cours des cinq dernières années, la fréquence des vols – c’est-à-dire le nombre de vols rapporté au nombre de contrats d’assurance – a encore baissé de 30 %.
Pour en revenir à la sécurité routière, nous avons conclu au milieu des années 1990 un accord de partenariat avec la Direction à la sécurité et à la circulation routières – DSCR – aux termes duquel les assureurs s’engagent à consacrer 0,5 % des primes de responsabilité civile à des actions de prévention. Les primes s’élevant à 6 milliards d’euros, la somme consacrée à ces actions est de l’ordre de 30 millions.
L’accord prévoit trois axes prioritaires.
Le premier est l’éducation routière, expression à laquelle nous préférons celle de « continuum éducatif ». La prévention commence en effet dès l’école maternelle et primaire, où nous sommes présents notamment par le biais de la Prévention routière. Le concours « Les clés de l’éducation routière » récompense chaque année les établissements qui ont réalisé des actions dans ce domaine.
Ces actions se poursuivent au collège et au lycée, ainsi qu’à l’université où nous luttons principalement, en coordination avec les bureaux des étudiants, contre la conduite sous l’emprise de l’alcool.
J’ajoute que nous sommes les acteurs incontournables de la conduite accompagnée, pour laquelle nous avons pris l’engagement de ne pratiquer aucune majoration de cotisation. Nous organisons également des stages post-permis pour les conducteurs novices.
Le deuxième axe est celui des entreprises, où nous intervenons à deux niveaux.
En premier lieu, dans les grandes entreprises. Celles-ci se plaignaient, il y a une quinzaine d’années, de payer des primes trop élevées. Ces primes reposant sur une analyse de la sinistralité propre à chaque entreprise, nous avons proposé que les sociétés financent avec nous la mise en place de programmes de prévention. Les résultats ont été si satisfaisants qu’il n’est plus imaginable aujourd’hui, pour une grande entreprise, de souscrire un contrat d’assurance sans l’assortir d’un programme de prévention, et que les prix de l’assurance automobile dans ce secteur ont diminué de 50 % en sept ou huit ans.
En second lieu, nous intervenons dans les petites et moyennes entreprises, pour lesquelles nous avons sollicité la création de l’association PSRE – promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise. L’objectif principal de ce travail mené sur le terrain avec d’autres acteurs – en particulier les organismes de sécurité sociale – est de sensibiliser les patrons de PME à l’intérêt de mener des actions de sécurité routière.
Le troisième axe, qui est aussi la dernière étape du continuum¸ concerne les seniors, auxquels des stages de remise à niveau sont proposés.
Pour ce qui est de la lutte contre la conduite sous l’emprise de produits psychoactifs, la FFSA, en liaison avec l’Association de prévention routière, mène des actions telles que « Capitaine de soirée » ou « Rentrez en vie ».
La question des deux-roues motorisés constitue, pour nous comme pour la déléguée interministérielle à la sécurité routière, un grand sujet de préoccupation. Si aucun assureur ne fait de publicité pour assurer ces véhicules, c’est parce qu’il s’agit aujourd’hui d’un risque « inassurable », et donc, sur le plan technique, mutualisé avec le risque automobile.
Comment rendre ce risque assurable ? Après avoir réalisé plusieurs enquêtes, certaines pistes nous semblent prometteuses.
Premièrement, nous attendons avec impatience la réforme du permis de conduire. Le brevet de sécurité routière n’a pour nous aucune valeur et nous demandons avec insistance aux pouvoirs publics de faire du permis des 50 cm3 un vrai permis de conduire à points.
Deuxièmement, nous souhaitons la généralisation du gilet airbag à capteurs, lancé il y a quelques mois pour les motos – malheureusement pas pour les cyclomoteurs – et qui succède au gilet filaire. La plupart de nos adhérents se sont d’ores et déjà engagés à prendre en charge le remplacement ou la réparation de cet équipement en cas d’accident seul en cause. Nous avons néanmoins besoin d’un levier pour lancer ce système : c’est pourquoi nous sommes en train de bâtir un partenariat avec le fabriquant et deux syndicats de moniteurs de moto-écoles. Si l’on incite le candidat dès sa formation à porter un casque intégral et un gilet airbag, il y a tout lieu de penser qu’il se procurera ces équipements lors de l’achat de son véhicule. Pour les constructeurs, l’idée que l’on puisse livrer la moto avec ces gilets n’est pas inenvisageable. Par ailleurs, l’évocation d’une participation financière à l’équipement des moto-écoles a soulevé un certain enthousiasme.
Le gilet airbag doit permettre de réduire, sinon la fréquence, tout au moins la gravité des accidents corporels. Il y a les morts, mais aussi les blessés : combien de témoignages recevons-nous de jeunes gens gravement atteints et complètement désocialisés ! L’objectif est de protéger des lésions les plus handicapantes, celles du rachis cervical, de la colonne vertébrale et de l’abdomen.
À cet égard, nous avons engagé des actions communes avec des associations de victimes, ce qui constitue presque une révolution intellectuelle pour les assureurs. Nous travaillons par exemple avec l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens – UNAFTC – pour améliorer la connaissance des risques qui sont à l’origine des traumatismes crâniens. Nous participons au financement de l’Institut de recherche sur la moelle épinière – IRME – et collaborons également avec la Fédération nationale des accidentés de la vie – FNAV. Ces institutions sont autant de relais en matière de prévention.
Enfin, je rappelle que nous travaillons à partir de statistiques et que ni les données de la sécurité routière ni les nôtres ne sont suffisantes. Nous travaillons donc avec l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux – l’IFSTTAR – et avec le registre des victimes de la route du Rhône, en espérant étendre l’expérience au département de l’Ain, en coordination avec nos collègues de la MACIF.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Notre mission d’information serait très intéressée par les chiffres détaillés du coût des accidents corporels, notamment leur répartition entre les voitures et les motos. Par ailleurs, disposez-vous de données relatives à la responsabilité des collectivités ou de l’État pour cause d’un déficit d’infrastructures ?
M. Jean Pechinot. Non.
M. le rapporteur. Pourtant, ce sont des risques que vous assurez.
M. Jean Pechinot. En effet, mais il est très difficile de collecter des données cohérentes d’une société à une autre. Nous n’avons que des données globales. Par exemple, le coût moyen d’un sinistre corporel est de 50 000 euros. De façon plus détaillée, si nous n’avions, il y a sept ans, aucun dossier d’un montant de plus de 8 millions d’euros, il en existe aujourd’hui dix-sept. Les sinistres de plus de 3 millions d’euros ont doublé en cinq ans.
M. le rapporteur. En tout état de cause, la mission d’information vous serait reconnaissante de lui transmettre les données chiffrées dont vous disposez.
Nous souhaiterions également recueillir des éléments concernant la conduite sans assurance, la conduite sans permis et les indemnisations prévues dans de tels cas.
En matière d’incitation, ne pourrait-on réfléchir à une accentuation du système de bonus-malus ?
Enfin, comment gérez-vous le cas des personnes qui ont eu des accidents alors qu’elles étaient en infraction ? Qu’en est-il de leur capacité à souscrire à nouveau une assurance ?
M. Jean Pechinot. La conduite sans permis et la conduite sans assurance n’entraînent pas les mêmes conséquences.
Lorsqu’il n’y a pas d’assurance – soit que la personne n’en ait jamais souscrit, soit que le contrat ait fait l’objet d’une annulation pour fausse déclaration, soit que la cotisation n’ait pas été payée dans les délais –, c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, anciennement Fonds de garantie automobile, qui indemnise les victimes et engage systématiquement un recours
Quant à la conduite sans permis, le code des assurances considère qu’elle constitue une exception inopposable aux victimes. Il appartient donc à l’assureur de les indemniser et, en fonction de ses propres critères, d’engager un recours.
S’agissant du bonus-malus, le système a fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice des communautés européennes pour atteinte à la concurrence. Le dispositif était inscrit dans la loi de trois pays – France, Belgique et Luxembourg –, mais, dès le début de la procédure, la Belgique s’est empressée d’y mettre fin. La France a persisté et la Cour lui a finalement donné raison.
Aujourd’hui, moins de 10 % des assurés n’ont pas de bonus et 35 à 40 % sont au seuil de 50 %. Certains assureurs pratiquent des bonus complémentaires, mais il s’agit de dispositions commerciales contractuelles qui ne sont pas transférables lorsque le client passe d’une société à une autre. Il me semble que la concurrence, très importante en France comme je l’ai dit, est à elle seule un élément d’incitation considérable.
Pour ce qui est, enfin, des personnes connaissant beaucoup de sinistres, la France a mis en place un Bureau central de tarification. Cet organisme, présidé par un professeur de droit, et réunissant des représentants des assureurs et des représentants des consommateurs, statue sur le montant de la cotisation d’assurance obligatoire et tout assureur est alors tenu d’accepter cette tarification. Il est intéressant de noter que le nombre de dossiers soumis à cette instance a considérablement baissé, passant de 2 000 ou 2 500, il y a trois ou quatre ans, à environ 700 aujourd’hui. De plus, l’alcool est devenu la première cause de refus de prendre en charge un client de la part des assurances.
M. le président Armand Jung. Je m’associe à la demande du rapporteur concernant les chiffres.
M. le rapporteur. Je précise que les seuls chiffres objectifs sont ceux des condamnations de l’État ou des collectivités à des indemnisations pour dommages de travaux publics, et de l’intervention des assurances à ce titre. Mais je comprends qu’il soit difficile de les établir.
M. Gérard Voisin. Comme l’a souligné le rapporteur, il existe des risques associés aux infrastructures. Certaines routes sont particulièrement accidentogènes : 100 morts par an, par exemple, pour la route Centre-Europe Atlantique.
En tout état de cause, les infrastructures jouent un rôle déterminant en matière de sécurité routière. Le ministère chargé des transports et les collectivités territoriales – y compris les municipalités – ont le devoir de les maintenir en état et de veiller à leur signalisation. Il est en effet établi qu’un bon entretien des routes a des conséquences importantes sur la diminution de la mortalité et des accidents corporels.
Je ne peux qu’approuver l’idée de livrer les motos avec un gilet airbag. Sans doute l’effet sera-t-il le même que celui de la ceinture de sécurité pour les voitures. Je considère que ces aspects techniques ont une importance primordiale.
Pour déterminer le montant de la prime annuelle, les assureurs évaluent le risque pour le véhicule, pour le conducteur, pour les personnes qu’il transporte et pour les personnes extérieures susceptibles d’être victimes. C’est là une mine de renseignements qui intéresse notre mission.
En ce qui concerne les systèmes intelligents de transport, tout ne relève pas de la plus haute technologie. Un carrefour à feux, où le conducteur a tendance à accélérer lorsque le feu passe du vert à l’orange, est plus accidentogène qu’un rond-point. L’airbag a constitué une avancée déterminante. Les perspectives ouvertes par l’eCall et le système d’anti-endormissement sont considérables. Les assureurs peuvent et doivent travailler avec les constructeurs pour développer ces systèmes qui, loin d’être des gadgets, sont essentiels à la sécurité de tous.
Mme Françoise Hostalier. Une question de la part de M. Jacques Myard, qui a dû s’absenter : dans quelle mesure les assureurs peuvent-ils refuser d’assurer les véhicules surpuissants, qui sont potentiellement les plus dangereux ?
Avant l’annonce du ministère de l’intérieur, je travaillais à une proposition de loi tendant à obliger les conducteurs à passer de façon régulière – tous les dix ans, par exemple – un stage de remise à niveau. Une telle obligation étant difficile à instituer, les assureurs seraient-ils prêts à participer financièrement à un dispositif de cette sorte ? À l’évidence, si nous devions passer à nouveau notre permis de conduire, nous serions en difficulté !
La conduite en circuit permet aussi de mieux comprendre le comportement du véhicule. Comment la rendre plus accessible ?
Des questions se posent quant à l’habilitation des organismes effectuant le contrôle technique des véhicules. Les assureurs ont-ils un droit de regard à ce sujet ?
Qu’en est-il, enfin, de l’assurance des personnes qui conduisent un véhicule différent de celui sur lequel elles ont reçu leur formation initiale ? Une voiture automatique, par exemple, suppose une conduite particulière. Les assureurs seraient-ils prêts à aider les conducteurs à s’approprier de tels véhicules ?
M. le président Armand Jung. Notre mission auditionnera également les associations de motards. Il nous serait très utile, à cet égard, d’assister à une démonstration du nouveau gilet airbag.
M. Jean Pechinot. Les assureurs, madame Hostalier, n’ont aucun droit de regard sur les centres de contrôle technique. L’habilitation est du ressort des pouvoirs publics. En revanche, la plupart des sociétés d’assurance ont un partenariat avec ces centres, qui accordent des réductions aux assurés.
Le contrôle technique des cyclomoteurs sera mis en place au 1er janvier 2012. Nous y sommes tout à fait favorables : dans une enquête récente effectuée sur 3 000 cyclomoteurs accidentés, nous avons établi que 60 % des véhicules ne répondaient pas aux règles élémentaires de sécurité.
Pour ce qui est des stages de remise à niveau, la directive européenne laisse aux États membres la possibilité de poser des règles concernant l’actualisation du permis de conduire. En tout état de cause, beaucoup d’assureurs s’occupent déjà de remise à niveau, notamment en milieu rural.
Votre question concernant l’assurance des véhicules surpuissants me conduit à soulever un élément d’ordre juridique : lorsqu’un assureur garantit un risque, il peut faire le lien entre le véhicule et son conducteur habituel mais le code des assurances lui impose de garantir la responsabilité de tout conducteur dudit véhicule. Dans l’absolu, donc, nous ne pouvons savoir qui conduit un véhicule surpuissant : le pilote confirmé, par exemple, à qui nous avons bien entendu accordé la garantie, ou son fils ou tout autre jeune conducteur, à qui nous ne pouvons l’interdire.
Dans les faits, les vrais assureurs motos apportent des conseils à leurs clients et peuvent orienter un jeune motard, par exemple, vers un engin semblable à celui qui a été utilisé pour le passage du permis.
Nous sommes très favorables aux avancées technologiques, monsieur Voisin. Mais la Commission européenne a demandé aux assureurs de participer au système eCall en tenant le même raisonnement que le consommateur, à savoir que les primes baisseraient dès les premiers résultats, voire permettraient de financer une partie du système. Pour ma part, je crois que l’on doit se référer à notre expérience en matière de vol de véhicule : il faut que la plus grande partie du parc soit équipée pour que le système soit efficace. Sachant que l’âge moyen du parc est de plus de sept ans, on a une perspective à dix ans. Dans l’intervalle, on continuera à payer les sinistres comme aujourd’hui. On ne peut attendre des conséquences à court terme sur la sinistralité et le coût des sinistres.
S’agissant enfin des infrastructures, nous pourrons nous renseigner auprès des quelques assureurs spécialisés dans la garantie des collectivités locales. La responsabilité de l’État et des collectivités est établie par le tribunal administratif et, en dernier ressort, par le Conseil d’État. Ce n’est pas une procédure des plus rapides. Aussi beaucoup d’assureurs préfèrent-ils payer les sinistres et clore les dossiers, en estimant que la gestion de ces derniers leur coûterait beaucoup plus cher. Il sera donc difficile d’avoir une vue précise de la situation.
Cela dit, j’ai lu dans le Journal officiel de ce matin que le passage à deux fois deux voies de la route Centre-Europe Atlantique ferait l’objet d’une procédure accélérée.
M. Gérard Voisin. Et vous y croyez ?
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, monsieur Pechinot, pour votre contribution.
*
* *
Audition de M. Jean Chapelon, ancien secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière
M. Jean Chapelon, ancien secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Au cours des dix ans passés en tant secrétaire général de l’Observatoire national, j’ai introduit plusieurs innovations destinées à mieux faire comprendre et à mieux faire connaître la sécurité routière.
Les données mensuelles sont publiées à J+7, ce qui a l’énorme avantage d’intéresser les médias à la sécurité routière. Désormais, les gros titres des journaux scandent les résultats, chaque début de mois. Les chiffres provisoires sont extrapolés de façon à dégager une tendance exacte. Surtout, une analyse des effets météorologiques est effectuée pour obtenir un résultat intrinsèque. Le but est d’interpréter le résultat à comportements inchangés, en effaçant les effets calendaires, de façon à savoir si le mois a été vraiment bon ou mauvais. Sinon, comparer un mois au même mois de l’année précédente n’a pas grand sens, car on ignore si le dénominateur a été un bon ou un mauvais mois. C’est comme si, en rentrant de l’école, votre enfant vous annonçait, au lieu de sa dernière note, l’écart de points avec la note précédente.
L’Observatoire a procédé à une modernisation du fichier accidents.
Je me suis beaucoup intéressé au concept d’effet « attribuable » qui nous vient de la médecine. Il s’agit de mesurer l’impact de tel ou tel facteur de risque – l’alcool, la ceinture, la vitesse, le téléphone portable… – sur le résultat obtenu. J’ai également établi un palmarès des départements. À l’aune du ratio entre le nombre de tués rapporté et le nombre d’habitants, les Hauts-de-Seine sont le meilleur département de France et la Lozère, l’un des pires. C’est sans compter les distances parcourues – plus courtes en milieu urbain –, la densité du réseau de transports en commun, et les autoroutes souvent congestionnées. La comparaison sera donc plus équitable si l’on tient compte du trafic. Après trois ans de mise en sommeil, le comité des experts, qui assiste le Conseil national de sécurité routière, va bientôt reprendre son activité.
J’ai publié, seul, le rapport « Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière (2003-2005) » et, avec d’autres, les rapports « L’alcool sur la route : état des lieux et propositions » et « Le téléphone portable au volant ». Sans oublier une analyse du permis à points, dont il ressort que la base du ministère de l’intérieur ne se prête pas à des études sophistiquées. C’est à partir des sauvegardes annuelles des données « anonymisées » du ministère de l’intérieur que le ministère de l’environnement et du développement durable, auquel l’Observatoire est rattaché, a pu procéder à des études approfondies.
J’ai étudié deux populations sur lesquelles on ne s’attarde pas, mais qui sont intéressantes : les sans permis et les conducteurs sous l’emprise de l’alcool. Enfin, un ouvrage rassemble le fruit de dix ans d’expérience en distinguant les différents facteurs, ceux qui ont été étudiés et ceux qui mériteraient une analyse.
Sur le long terme, on observe une baisse tendancielle du nombre de tués sur les routes de 2,1 % par an, entre 1974 et 2001, avec, en toile de fond, une augmentation du trafic qui tourne autour de 2 % par an. Autrement dit, la sécurité routière améliore régulièrement son « efficacité » d’environ 4 à 4,5 % par an, depuis trente ans. À deux moments, le nombre de tués a chuté de façon plus accentuée : au démarrage de la sécurité routière, dans les années 1970, quand ont été prises les grandes mesures concernant la vitesse, l’alcool et la ceinture ; et en 2002, lors du lancement du chantier de la sécurité routière, notamment avec l’installation des radars.
M. le président Armand Jung. À quoi imputez-vous principalement la baisse du nombre de tués ?
M. Jean Chapelon. Principalement, à l’infrastructure et aux véhicules. Une étude a mis en évidence que le risque d’accident doublait selon que les véhicules avaient moins de quatre ans d’âge ou plus de huit ans, à distances parcourues égales, et en neutralisant l’âge du conducteur. Pour les comportements, on ne peut pas remonter trente ans en arrière. Au cours des dix à quinze dernières années, les facteurs positifs tels que l’amélioration du port de la ceinture ou le recul de la vitesse ont été contrebalancés par les effets négatifs du téléphone portable. Pour ce qui est de l’alcool, cela ne bouge pas.
Le net ralentissement des infractions observé aujourd’hui était prévisible. En 2002, M. Chirac avait simplement ouvert le chantier alors qu’en 2007, M. Sarkozy a voulu se fixer un objectif très ambitieux, avec 3 000 victimes par an. Pour y parvenir, j’avais mis en avant plusieurs conditions, notamment en matière de communication.
Les infractions pour excès de vitesse, qui ont fortement chuté à partir de 2002, se décomposent en infractions décelées à l’occasion de contrôles aléatoires et infractions détectées par des radars fixes, installés à partir de décembre 2003.
L’analyse des courbes montre que la baisse des vitesses est bien antérieure à la mise en place des radars fixes. En matière de sécurité routière, l’effet d’annonce est courant. Ainsi, en 1978, les infractions ont baissé avant l’autorisation donnée aux forces de l’ordre de pratiquer des contrôles d’alcoolémie sans passer par le procureur ; puis elles ont remonté quand les gens se sont rendu compte que les contrôles n’étaient pas si nombreux. De même, la vitesse a diminué avant que les radars ne soient en service.
Les infractions constatées par contrôles aléatoires – pourtant plus rares que les autres car ils mobilisent du personnel – sont paradoxalement beaucoup plus nombreuses que celles enregistrées par les radars fixes fonctionnant 24 heures sur 24, et qui révèlent un taux d’infraction extrêmement bas : 0,3 %.
D’après l’étude de 2006 sur les effets du contrôle sanction automatisé, l’impact des radars fixes n’excède pas trois kilomètres, et ils ne font pas baisser la vitesse de plus de 5 % à 6 %. En fait, même si l’attention s’est focalisée sur les radars fixes, c’est à la complémentarité entre les deux types de radars et à l’apprentissage des radars fixes que l’on doit la baisse des vitesses. Certains contestent la conclusion au motif que les accidents peuvent baisser sans radars, mais, s’il y a une baisse globale de la vitesse en France, c’est à cause des contrôles de vitesse. La répartition autour de la vitesse moyenne fait apparaître un effet de peloton : tout le monde roule moins vite, ceux qui commettent des infractions, ceux qui n’en commettent pas ; il en va de même pour les étrangers.
Conclusion : le gros succès des radars fixes a été lié au fait qu’ils ont permis d’arrêter de raisonner en « grand excès de vitesse » ou en « récidive de grand excès de vitesse ». Ces dispositions n’ont pas marché car le contrôle en était excessivement difficile et elles n’étaient pas bien ciblées sur le gros du trafic. Or c’est quand le peloton réduit sa vitesse que le nombre d’accidents diminue. Quant au lien entre vitesse et accident, il est démontré par des centaines d’études. Les mesures concernant les radars expliquent les trois quarts de la baisse des vitesses observée de 2002 à 2006.
Je vous mets en garde contre le fait d’être plus accommodant avec les petits excès de vitesse, surtout s’agissant des retraits de points – l’amende n’est pas dissuasive. Ne plus punir les petits excès de vitesse reviendrait à relever la vitesse autorisée de 10 ou 20 kilomètres à l’heure. Autrement dit, on referait en sens inverse le chemin parcouru de 2002 à 2006 puisque les vitesses ont diminué de 8 % ; le nombre des tués augmenterait de 30 à 40 %.
Nos concitoyens, dit-on, supporteraient de moins en moins les radars. Mais il existe d’autres moyens pour faire baisser la vitesse : les infrastructures telles que les chicanes ou les ralentisseurs à l’entrée des villages ; ou le LAVIA, le limiteur de vitesse s’adaptant à la vitesse autorisée, lié au GPS, pourvu qu’il soit aussi facile à un conducteur de s’en servir qu’à un chauffeur de taxi de changer de zone de tarif sur son compteur. Il faudrait que le conducteur qui veut respecter la réglementation puisse le faire sans difficulté.
Le nombre d’infractions, qui était passé de 1 million à près de 6 millions entre 2002 et 2007, plafonne depuis cette date, après la décision de diminuer la durée nécessaire pour récupérer des points perdus à l’unité. Cette stabilisation globale dissimule une très forte augmentation, qui se ralentit toutefois, des infractions à un point et, corrélativement, une diminution des infractions à deux points et plus. La dureté du système a donc été considérablement atténuée avec cette réforme. Plus des trois quarts des conducteurs ont douze points sur leur permis, et ceux qui ont moins de six points représentent moins de 2,5 % – ces derniers sont donc très peu nombreux.
La comparaison des causes de la perte des points entre l’ensemble des conducteurs et ceux qui ont vu leur permis invalidé en 2006 ou 2007 pour solde nul est instructive : si les excès de vitesse sont à l’origine de près de 30 % des points perdus par l’ensemble des conducteurs, c’est l’alcool ou les stupéfiants qui sont, dans les mêmes proportions, la cause de la perte des points chez ceux qui ont perdu leur permis, ce qui n’est pas très surprenant puisque la sanction est de 6 points. Dans cette seconde catégorie, la vitesse n’explique pas plus de 8 % des points perdus.
Pour améliorer la sécurité routière, il est plus facile de réduire la vitesse que d’agir contre l’alcool, qui est pourtant à l’origine de plus de 25 % des accidents. Un chiffre parle de lui-même : la part des personnes tuées depuis 2002 dans des accidents où l’alcool est en cause est étonnamment stable – autour de 30 % – alors que les règles se sont durcies en même temps que les sanctions.
L’analyse de la répartition du nombre des conducteurs impliqués dans des accidents mortels en fonction de leur taux d’alcoolémie met à mal l’idée reçue selon laquelle les accidents seraient dus à de petits excès d’alcool. Le taux d’alcool moyen de cette population est de l’ordre de 1,8 gramme par litre. Tout le monde n’est pas capable d’en absorber autant.
On a tort de penser que l’alcool ne concerne que les jeunes. En se focalisant sur eux, comme dans la campagne vantant les capitaines de soirée, on déresponsabilise les autres conducteurs. Ensuite, il ne faut pas se cacher que la solution des problèmes d’alcool passe par la médecine – au stade curatif pour supprimer la dépendance et au stade préventif par une détection précoce. Il faudrait aussi être plus rigoureux dans le suivi des retraits de permis. Une autre piste intéressante est l’éthylotest anti-démarrage, autorisé depuis la LOPPSI, dont les tribunaux pourraient imposer l’installation, et qui est facile à vérifier et à contrôler. La suppression du permis ne sert à rien, les gens continuent de rouler. Les États-Unis installent tous les ans environ 20 000 éthylotests anti-démarrage. Il s’agit de modèles sophistiqués puisqu’ils identifient la personne qui souffle, indiquent le jour, l’heure et le taux d’alcoolémie.
En conclusion, ce qui nous différencie des autres pays est surtout le management de la sécurité. Beaucoup de pays ont opté pour des plans pluriannuels, arrêtés par une instance ad hoc, et non pour des mesures au coup par coup.
M. le président Armand Jung. Notre mission bute sur la fiabilité des chiffres. D’où viennent vos statistiques ? Aucune de celles que nous avons ne corrobore les autres. Nous avons reçu des témoignages selon lesquels l’alcool était rarement le facteur unique des accidents. Si les personnes alcoolisées n’avaient pas des bolides entre les mains, elles n’auraient pas d’accident. Or personne ne s’offusque de la puissance des véhicules.
M. Jean Chapelon. Le domaine de la sécurité routière est bien, et même très bien documenté, à partir des PV qui sont renseignés…
M. le président Armand Jung. …sommairement, d’après ce que nous ont dit des personnes qui les reçoivent des préfectures. Les gendarmes, pour aller vite, se contentent de cocher la case « alcool », sans se préoccuper de savoir si le responsable roulait trop vite, téléphonait, etc. Du coup, on mesure mal les causes multiples.
M. Jean Chapelon. Il ne faut pas confondre les remontées rapides du ministère de l’intérieur et le fichier accidents, où le délai de remontée des fiches est d’un mois, et que nous utilisons pour notre travail. En tout cas, les données alcool sont recueillies avec soin, et leur pertinence est avérée. Les données vitesse, produites par un bureau d’études indépendant suivant un plan de sondage, constituent une originalité française très intéressante. Nous disposons aussi de renseignements sur l’usage du téléphone tenu en main. Nous cernons les différents facteurs.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Nous avons l’impression, d’où nos questions réitérées, que la collecte des données est un peu floue. Incontestablement, la vitesse est un facteur aggravant des accidents. Vous venez par ailleurs de confirmer que les fiches de police étaient remplies vite, en s’en tenant à la cause la plus évidente. Peut-on aller plus loin dans l’analyse ?
M. Rudy Salles. Les comportements ont changé sous l’effet des mesures prises pour limiter la vitesse. Vous nous avez dit que celle des étrangers, qui échappent aux sanctions, avait baissé, elle aussi. D’où tenez-vous vos chiffres, qui infirment l’impression que j’ai, au vu des étrangers roulant à vive allure sur l’autoroute ?
M. Jacques Myard. Avez-vous des chiffres sur les automobilistes qui roulent sans permis ? La vitesse n’est pas la cause première des accidents, même si elle constitue une cause certaine. Comment mieux connaître les autres ?
M. Jean Chapelon. Le fichier accidents ne recense pas les causes ; il fait état de circonstances objectives. Un conducteur alcoolisé impliqué dans un accident n’est pas forcément responsable. On ne peut pas prouver la causalité, tout au plus la concomitance. En tout cas, et c’est l’essentiel, la baisse de la vitesse fait diminuer le nombre des accidents.
M. Jacques Myard. Respecter la vitesse ne suffit pas à ne pas provoquer d’accident.
M. Jean Chapelon. On ne pourra jamais faire des analyses aussi sophistiquées que vous le souhaitez. Mais le fichier accidents est une base de données extraordinairement riche, même si elle a des faiblesses, qui sont inversement proportionnelles à la gravité des accidents. C’est la raison pour laquelle on se focalise sur les accidents mortels. Vous avez raison, un accident est multicausal, mais le lien entre vitesse et accident est corroboré par des centaines d’études. Le meilleur accidentologue du monde, M. Elvik, a confirmé la liaison vitesse-accident-tués ; il a même trouvé un facteur 5, au lieu de 4, entre la variation de la vitesse moyenne et le nombre d’accidents. Toutes choses égales par ailleurs, les accidents augmentent avec la vitesse.
En ce qui concerne les étrangers, ils ont un taux d’accident similaire à celui des Français. Ils vont vraisemblablement plus vite que nos compatriotes, mais ils boivent moins. Ce qui distingue la France par rapport aux autres pays européens, c’est d’abord la moindre densité des autoroutes – qui est un facteur aggravant – et la consommation d’alcool au volant, qui est supérieure à celle des Anglais ou des Allemands.
Les sans-permis sont estimés selon la même méthode que la moyenne des conducteurs sous l’emprise de l’alcool, qui est de 1 %. On considère que les conducteurs impliqués dans un accident, mais sans en être responsables, sont en quelque sorte choisis au hasard. Ainsi évalués, les sans-permis représentent 1 % de cette population. On en déduit qu’ils sont environ 400 000, puisque le nombre de détenteurs d’une autorisation de conduire est de 40 millions.
M. le rapporteur. Comment expliquer la réaction très négative d’un grand nombre de nos concitoyens aux décisions du dernier conseil interministériel de sécurité routière ? Et quelles mesures prendre pour faire baisser le nombre de tués et de blessés sur la route ?
M. Jean Chapelon. Beaucoup de nos concitoyens voient surtout, dans les radars fixes, un moyen pour l’État de gagner de l’argent – alors qu’il en perd, la baisse de la vitesse provoquant un manque à gagner sur la TIPP. Mais ils les ont peu à peu acceptés puisqu’ils sont allés au-delà de ce qui était demandé : la baisse de la vitesse a été constatée sur tout le territoire, et pas seulement autour des radars fixes. Le choix de les signaler par des panneaux a été une sorte de compromis politique, pour les faire accepter. Étant fonctionnaire, je n’ai pas à me prononcer sur l’intérêt ou non de les démonter.
Pour le futur, il faudrait retrouver un consensus. Bien que je n’aie pas à dire comment, je constate que certains pays ont créé une grande commission qui définit des plans, qui sont approuvés. Ensuite, des objectifs sont fixés. La facilité de mise en œuvre des décisions dépend du cadre dans lequel elles sont préparées. Annoncer les mesures au dernier moment, à la sortie des CISR, a des inconvénients en termes de dialogue et de négociation, même si toutes les radios et les télévisions sont là pour relayer l’information.
Sur la vitesse, il faut tenir bon. En outre, vitesse, radars, permis à point sont indissociables. Si vous supprimiez le permis à point, les radars ne serviraient plus à rien. Cela dit, leur déploiement peut être discuté. En revanche, je vous mets en garde contre les radars aux feux rouges : la perte de points risque d’être énorme pour une efficacité assez limitée.
L’autre grande priorité serait de s’attaquer à l’alcool, mais ce n’est vraiment pas facile. Il faudrait travailler en transversal avec d’autres administrations : par exemple, avec celles de la santé et de la justice pour les éthylotests anti-démarrage.
Enfin, la question du téléphone portable mériterait d’être remise sur la table. On a interdit l’appareil tenu en main parce que les forces de l’ordre ne pouvaient pas vérifier le kit mains libres. Mais il faut savoir que, pour nos concitoyens, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé…
Les feux de jour ont été tentés en 2004, sans grand succès. Mais, depuis 2011, la réglementation européenne impose les feux de jour sur tous les nouveaux modèles. Les modèles de luxe s’y mettent très rapidement, et, petit à petit, la mode aidant, les autres suivront.
M. Rudy Salles. Le non-respect des feux rouges et les refus de priorité ne sont-ils pas une cause très importante des accidents en ville ? Pourquoi les considérer comme secondaires ?
M. le président Armand Jung. Nous n’avons pas le droit à l’erreur, d’où notre prudence. Les chiffres d’excès de vitesse et de feux rouges non respectés – certains sont maintenant équipés de caméras – que l’on nous a communiqués sont proprement astronomiques. D’après eux, personne ou presque ne respecte plus rien. Cela ne provoque peut-être pas d’accident, mais je m’interroge. Les données que vous présentez isolent les facteurs d’accident mais ne disent rien des causes multiples – l’alcool n’est pas toujours seul en cause, la vitesse non plus. Nous avons besoin d’aller plus loin dans l’analyse pour pouvoir formuler des propositions.
M. Jean Chapelon. Je parle en tant qu’accidentologue. Les feux rouges représentent un enjeu faible. Les études sont peut-être discutables, mais il en ressort que la baisse des accidents latéraux est compensée par la hausse des chocs à l’arrière. Après, c’est un choix politique. Mais, aux yeux d’un accidentologue, l’enjeu des feux rouges est faible car il y a très peu de tués aux feux rouges.
On ne peut pas dire que personne ne respecte la vitesse. Le taux de dépassement de 10 kilomètres heure au-dessus de la vitesse autorisée, au-delà de la tolérance admise, est tombé à 10 %, alors qu’il était de 33 % en 2002.
M. le rapporteur. Sur les 35 millions de personnes qui conduisent régulièrement.
M. Jean Chapelon. Sachez que l’on prend les mesures à des endroits où les automobilistes ont le choix de leur vitesse. Par ailleurs, ces 10 % vont provoquer 18 % des accidents. C’est beaucoup, mais, a contrario, cela signifie que 90 % des gens respectent les limitations de vitesse.
M. le rapporteur. Conclusion hâtive, me semble-t-il.
Revenons aux sanctions sur les petits excès de vitesse. Elles n’ont pas été assouplies, c’est seulement le temps de récupération qui a été réduit.
M. Jean Chapelon. L’indulgence à l’égard des petits excès de vitesse, en deçà de 10 kilomètres à l’heure au-dessus de la limite, peut se comprendre, mais cela revient à relever d’autant la limitation de vitesse. Une telle mesure peut avoir des effets énormes : faire augmenter de 40 % le nombre de tués.
Un changement des règles entraîne aussitôt une modification des comportements. L’assouplissement des règles du permis à point décidé en novembre ou décembre va avoir un impact, comme en avait eu un l’annonce des radars en 2002.
M. Jacques Myard. Pensez-vous vraiment que le débat en France a eu un effet en Allemagne ou en Finlande ?
M. Jean Chapelon. En règle générale, on constate une érosion de la baisse des vitesses car les dispositifs perdent en efficacité marginale à mesure que le temps passe. Pour se prononcer sur le raccourcissement du délai de récupération des points, il faudra attendre les résultats du premier quadrimestre 2011.
Quant à la simultanéité des conjonctures entre les différents pays, je n’y ai jamais cru.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de votre contribution, monsieur Chapelon.
*
* *
Audition de M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche)
M. le président Armand Jung. Messieurs, notre mission d’information cherche à cerner au plus près les causes de l’accidentologie, afin de formuler des propositions aussi adéquates que possible, en particulier dans le contexte des évolutions technologiques actuelles. Nous espérons que vos travaux nous éclaireront dans cette voie.
M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFFSTAR). Statisticien de formation, j’ai débuté ma carrière de chercheur dans le domaine de la sécurité routière en contribuant à guider la politique en la matière dans les années 1970. J’ai beaucoup travaillé sur l’évaluation et la gestion du risque routier et j’ai participé, en tant qu’expert, à plusieurs groupes internationaux. J’ai rencontré M. Robert Delorme à l’occasion du master « sécurité des transports » que nous avons codirigé pendant une dizaine d’années à l’université de Versailles-Saint-Quentin. C’est à cette occasion que nous avons entrepris ensemble des recherches dans le domaine de la sécurité routière. Notre exposé portera sur la notion de « caractérisation » ou de « régime » du risque routier.
M. Robert Delorme, professeur émérite à l’université de Versailles, ancien président du conseil scientifique de l’Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR). Notre domaine d’expertise est celui des facteurs permanents du risque d’insécurité routière : au-delà des causes immédiates, il existe aussi de causes peu visibles, très difficilement saisissables et très rarement évoquées, qui font partie du risque routier. Ces causes ne se laissent pas appréhender de manière statistique et sont principalement qualitatives, voire organisationnelles.
Les travaux que nous avons consacrés à la France et les comparaisons internationales auxquelles nous avons procédé – principalement avec la Grande-Bretagne, où la situation est quasiment un miroir de celle de la France – nous ont permis de dégager plusieurs notions clé.
La première est celle de risque routier : au-delà des causes immédiates d’accidents, telles que la vitesse ou l’alcool, d’autres facteurs, je le répète, sont moins visibles et peu affectés par l’action touchant les facteurs immédiats.
Ces facteurs relèvent – et c’est la deuxième notion – de l’organisation de l’activité des acteurs de la sécurité routière. Aussi surprenant que cela soit en effet, l’organisation a une incidence sur l’ampleur, plus ou moins contrôlée ou régulée, des risques – ce qui pose la question des indicateurs.
La troisième notion est celle de l’information des acteurs de la sécurité routière sur le risque et sur le rôle de l’organisation comme facteur pertinent de sécurité routière. Dans ce domaine, une prise de conscience s’impose.
La quatrième notion est la comparaison internationale. Celle-ci est nécessaire, mais il convient aussi de s’en méfier, car il ne suffit pas d’importer « clés en main » les observations réalisées dans un autre pays, considéré comme plus performant en matière de sécurité routière. La comparaison internationale est révélatrice du rôle de l’organisation. Ce qui pourrait être adapté en France de l’expérience de la Grande-Bretagne est la combinaison de trois volets interdépendants : professionnalisation, intégration des actions et évaluation. Ces trois volets présentent une cohérence propre à chaque pays, que nous appelons « facteur P.I.E. », acronyme de ces trois volets.
En matière d’organisation, la présence de plans à moyen et long terme et de stratégies de sécurité routière est déterminante. Les pays scandinaves et la Grande-Bretagne parlent à ce propos de « vision » et les études faites par la Chambre des communes britannique sur la sécurité routière insistent sur la nécessité d’une vision à dix ans, qui permet de définir des orientations d’une grande stabilité, indépendantes des préoccupations conjoncturelles.
L’évaluation permet aux acteurs de rendre compte de leur activité et d’être responsabilisés. Ce facteur prioritaire est un stimulant des deux autres. L’évaluation pousse en effet à plus de professionnalisation et de coordination.
M. Sylvain Lassarre. Je présenterai maintenant quelques points saillants de l’insécurité routière en France.
Tout d’abord, la courbe générale de la mortalité en France, toutes causes confondues, fait apparaître, vers l’âge de 20 ans, un sur-risque lié aux accidents de la circulation, qui frappe principalement les jeunes hommes, comme dans tous les pays occidentaux. L’apprentissage du risque par les jeunes conducteurs, hommes ou femmes, est particulièrement long : ce n’est que vers l’âge de 23 ans que le saillant de la courbe s’atténue, indiquant que le risque diminue – il est alors pratiquement divisé par 10.
On observe par ailleurs, en France comme en Grande-Bretagne, une très grande stabilité à long terme des évolutions du risque. De 1950 à 2010 en effet, les courbes du nombre de tués par milliards de véhicules-kilomètres dans les deux pays sont pratiquement parallèles, la Grande-Bretagne conservant toujours son avance sur la France. En 2003, la France a commencé à rattraper son retard, mais les chiffres britanniques accusent une nouvelle baisse en 2007-2008.
En France, la sécurité routière évolue à un rythme presque constant, avec une baisse régulière du risque routier de l’ordre de 6 % par an, et les seules modifications tiennent à l’application de mesures nationales. Les chutes brutales constatées en 1973 avec l’instauration des limitations de vitesse et du port de la ceinture de sécurité, puis en 2003 avec l’introduction des radars et la sensibilisation des usagers aux dangers de la vitesse, ont été suivies d’une reprise du rythme antérieur de la diminution. En Grande-Bretagne, en revanche, la tendance connaît des inflexions liées à des efforts de mobilisation réalisés au niveau des politiques.
En troisième lieu, la courbe du nombre de tués, qui a connu une croissance jusqu’à 1973, puis une décroissance, est le produit d’une compétition entre la mobilité et la sécurité. Au début des années 1970, la mobilité croissait à un rythme de 8 % à 10 % par an – taux que l’on observe aujourd’hui par exemple en Chine ou en Inde – et l’emportait sur la sécurité, qui saturait avec une progression de l’ordre de 6 % par an, d’où une augmentation du nombre de tués. La crise de 1973 a marqué une rupture dans la mobilité, dont le taux de croissance est passé à 3 % ou 4 %, voire à 0 % aujourd’hui. La sécurité l’emporte, ce qui se traduit par une baisse du nombre de tués – qui enregistre des records : moins 14 % en 1973 et moins 17 % en 2003.
Sur le court terme, les pays européens ont connu, entre 2009 et 2010, une décroissance moyenne de 11 % – avec des chiffres variant entre 0 % et 25 % selon les pays. En France, la décroissance est restée de l’ordre de 6 %, tandis qu’elle atteignait plus de 12 % en Grande-Bretagne.
Les pays obtenant les meilleurs résultats en termes de sécurité routière dans le monde sont européens : il s’agit de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Suède, qui se sont regroupés en réseau et ont produit différents rapports en vue d’entraîner à leur suite les autres pays européens, la Commission européenne et les membres du Parlement européen. La Grande-Bretagne est actuellement le pays où les routes sont les plus sûres au monde et a l’intention de rester en tête de ce classement. À nous de relever ce défi. En adoptant l’organisation adéquate et les mesures nécessaires, la France peut en effet atteindre le niveau de la Grande-Bretagne.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur Delorme, vous avez évoqué d’autres causes d’accident, qui ne sont pas visibles. Quelles sont-elles ?
Monsieur Lassarre, quelle est la fiabilité des données à partir desquelles sont établies les statistiques de sécurité routière ?
M. Robert Delorme. Au-delà des causes immédiates d’accident, bien réelles, comme l’alcool ou la vitesse, il existe un facteur qui encadre les phénomènes conduisant à ces causes immédiates en créant un environnement de conduite et de comportements sur les espaces de transport routier : c’est ce que j’appelle « organisation » ou « facteur organisationnel ».
M. le rapporteur. Pouvez-vous préciser de quelle organisation il s’agit ?
M. Robert Delorme. J’ai déjà évoqué la professionnalisation, l’intégration et l’évaluation.
En Grande-Bretagne, la professionnalisation de l’activité de sécurité routière se traduit par le fait que l’on compte aujourd’hui sur l’ensemble du territoire britannique entre 650 et 700 road safety officers , c’est-à-dire des chargés de mission sécurité routière, dont les fonctions remontent aux années 1950 et qui sont très professionnalisés. Ces agents dépendent des autorités locales et ont une responsabilité directe dans l’établissement des plans locaux de transport et de sécurité des transports. Les subventions allouées par les organismes régionaux disposant de fonds du ministère des transports dépendent des résultats obtenus. En France, on compte tout au plus, pour l’ensemble du territoire, une dizaine de chargés de mission dans les conseils généraux. Le niveau de professionnalisation de l’activité est donc très différent.
Pour ce qui est de l’intégration, il existe en Grande-Bretagne une seule force de police, ce qui réduit les risques de comparaison ou de rivalité et la nécessité d’une harmonisation entre des intervenants dépendant d’autorités différentes.
L’évaluation, enfin, est en Grande-Bretagne une partie intrinsèque de l’activité de sécurité routière, du fait de l’affichage des plans de transport. À la différence de la France, les plans de transport sont définis en Grande-Bretagne à l’échelle des autorités locales – lesquelles sont au nombre de 450 et 500, comptant en moyenne 80 000 habitants, contre plusieurs dizaines de milliers en France.
Les efforts de professionnalisation, de coordination et d’évaluation des politiques publiques existent bien évidemment en France, mais leur niveau de coordination est très différent. C’est là que l’organisation fait une différence.
M. le rapporteur. Ce seraient là les causes indirectes que vous évoquiez ?
M. Robert Delorme. C’est le facteur « P.I.E. » – professionnalisation, intégration et évaluation – qui représente un gisement de gains en termes de sécurité routière. Il s’agit d’un facteur profond, structurel, qui n’est pas modifiable à court ou moyen terme. Il explique en grande partie la différence observée en comparant la France et la Grande-Bretagne.
M. Sylvain Lassarre. Comme pour les accidents touchant d’autres modes de transport, il faut aller au-delà des causes immédiates pour identifier les facteurs organisationnels.
Pour ce qui est de la fiabilité des données, nos collègues anglais rencontrent les mêmes problèmes que nous.
M. le rapporteur. Les données dont nous disposons sont-elles fiables ou non ? S’il y a des carences, quelles sont-elles ?
M. Sylvain Lassarre. Les données ne sont pas fiables absolument, mais nous connaissons leurs limites. Il conviendrait que le recueil par la gendarmerie et la police soit plus exhaustif. Certains accidents échappent en effet encore au recueil, comme les accidents à véhicule seul ou ceux qui impliquent des enfants dans les milieux défavorisés, mais on sait les retrouver, par exemple par les registres des hôpitaux. Le rôle du chercheur analysant les risques consiste précisément à utiliser au mieux tout le potentiel des données dont il dispose. On peut corriger le tir en s’appuyant sur d’autres données et sur les recherches menées dans d’autres pays disposant de systèmes plus avancés. Ainsi, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas s’efforcent de connecter les données de la police et celles des hôpitaux – mais la France ne le fait pas. Ce sont pourtant là des occasions d’améliorer notre système d’information sur les accidents.
M. le rapporteur. Existe-t-il, selon vous, un nombre de tués et de blessés sur la route qui représenterait un seuil au-dessous duquel on ne pourrait pas descendre ?
M. Sylvain Lassarre. Il est certain qu’on n’atteindra jamais le risque zéro. La Suède, qui vise l’objectif de zéro tué, a adopté un système de mobilité particulier, réduisant notamment fortement les vitesses autorisées. La société doit faire des choix et accepter des risques.
Il est néanmoins possible de bâtir un système sûr en adoptant par exemple des mesures telles que celles qu’appliquent les Britanniques en centre-ville – mais M. Jung n’est pas parvenu à faire adopter la limitation de vitesse à 30 kilomètres/heure à Strasbourg. La technologie permet également d’équiper les véhicules de limiteurs de vitesse qui limiteraient considérablement le risque.
M. le rapporteur. Faut-il brider les véhicules ?
M. Sylvain Lassarre. C’est précisément la fonction des limiteurs de vitesse.
M. le rapporteur. J’attendais des réponses précises à des questions précises, mais nous n’avons pas eu ces réponses.
M. Jacques Myard. Bien qu’il existe certainement à l’étranger des modèles dont nous pourrions nous inspirer, il faut souligner que la Grande-Bretagne et la Suède ne sont pas des terres de transit routier.
En outre les statistiques qui nous ont été fournies présentent quelques incertitudes en ce qui concerne l’évaluation du nombre des tués. Ainsi, à la différence de la France, la Suède ne prend pas en compte les suicides dans ses calculs.
M. Gérard Voisin. Je félicite M. Lassarre et M. Delorme pour leur travail fouillé et très méthodique. J’en retiens notamment que les différences entre la Grande-Bretagne et la France s’expliquent, en particulier, par l’aménagement du territoire lié à l’action des collectivités territoriales. Dans ma ville, le remplacement des carrefours à feux par des ronds-points et l’instauration de zones à 30 kilomètres/heure ont eu des résultats très satisfaisants. Avec ses 36 000 communes, la France possède différents niveaux d’organisation territoriale ; il n’en reste pas moins qu’elle devra bien se mettre au diapason au regard des mesures qui donnent de bons résultats en Grande-Bretagne. Par ailleurs, les motos, qui provoquent des hécatombes, sont moins nombreuses en Grande-Bretagne.
Au-delà du contrôle et de la répression, il faut aussi recourir à la technologie. Nous avons les moyens d’obliger les constructeurs à installer, malgré le coût dont ils excipent pour ne pas le faire, des systèmes intelligents sur les véhicules. Il en existe aujourd’hui une douzaine dont le coût a baissé et qui devraient être systématiquement embarqués. Il existe également des systèmes de protection extérieurs, employés notamment au Japon.
Mme Marie-Line Reynaud. La conduite à droite a-t-elle une incidence sur l’insécurité routière ? Avez-vous également comparé les systèmes d’apprentissage de la conduite des deux pays ? Peut-on en tirer des conclusions ?
M. Robert Delorme. La question de la conduite à droite ou à gauche a donné lieu à de nombreuses hypothèses, mais aucune conclusion indiscutable ne se dégage encore. Nous nous sommes efforcés de neutraliser les effets géographiques ou ceux qui tiennent au trafic de transit. Il n’est en effet pas évident que ce dernier soit plus accidentogène.
Quant à l’apprentissage de la conduite en Grande-Bretagne, il est en effet différent, mais je n’ai pas de compétence particulière sur ce point.
M. Sylvain Lassarre. Les différences entre les deux systèmes sont importantes. Le temps d’apprentissage est plus long en Grande-Bretagne et le nombre de kilomètres parcourus un peu plus élevé. Chaque pays d’Europe a son propre système et il y a sans doute beaucoup à apprendre des autres.
M. Robert Delorme. Les road safety officers ont un rôle d’enseignants de sécurité routière dès l’école primaire et ils entraînent également à la circulation cycliste. En Grande-Bretagne, cette profession, créée voilà cinq décennies, est très structurée. Elle possède sa propre documentation et ses propres diplômes, délivrés par une université. Cette situation témoigne d’une prise en considération différente de la sécurité routière par l’ensemble de la société.
Les road safety officers sont chargés de la rédaction des projets présentés par les collectivités locales pour obtenir le financement de leurs aménagements. Ces projets sont soumis à des évaluations conditionnant la reconduction des subventions. Ce système d’évaluation-sanction fait l’objet d’un large consensus dans la société et on remet chaque année une médaille au meilleur de ces road safety officers. C’est impensable chez nous !
M. Jacques Myard. Vous n’avez pas évoqué les tués qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques suédoises.
M. Sylvain Lassarre. Les statistiques appellent évidemment une certaine vigilance, mais les suicides ne représentent que 1 % ou 2 % des tués, ce qui ne modifie que peu les données.
Il faut enfin préciser que les Britanniques s’intéressent aussi à nos routes ; en témoignent les publications diffusées en Grande-Bretagne avec l’intitulé : « How safe are you on french roads ? »
M. Robert Delorme. La courbe indiquant le nombre de tués par année et par milliards de véhicules-kilomètres fait apparaître un écart constant entre les chiffres français et les chiffres anglais, avec une rupture lors de l’introduction des radars en France ; mais l’écart se creuse de nouveau à partir de 2008-2009, au profit de la Grande-Bretagne.
Durant les 50 à 60 années de régularité de ces courbes, le rapport de tués est resté constant, avec deux fois plus de tués en France par milliard de kilomètres-véhicules. Ce rapport est passé à 1,4 à partir de 2003, ce qui représentait un progrès par rapport à la Grande-Bretagne, mais il est remonté à 1,7 entre 2009 et 2008. C’est là un sujet d’interrogation pour lequel nous n’avons pas de réponses. Un travail de recherche s’impose car, quelle que soit l’observation statistique, les deux pays sont chacun comme le miroir de l’autre, en tendances lourdes.
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de notre Mission.
*
* *
Audition de M. Régis Guyot, préfet
M. le président Armand Jung. Nous accueillons maintenant M. le préfet Régis Guyot, qui a effectué des études sur la sécurité routière, en particulier sur la sécurité des motards, et a présidé un groupe de travail « Gisements de sécurité routière : les deux-roues motorisés ».
M. Régis Guyot, préfet. Je me présente d’abord devant vous comme un praticien. Voilà un peu plus de trente ans que je sais ce que sont les bords de route, les contrôles routiers et la pédagogie qu’ils requièrent. Je sais aussi, comme ceux d’entre vous qui sont maires, ce que sont les horreurs de l’accident, les drames qu’il engendre, et ce que cela signifie que d’avoir à annoncer un décès à une famille.
J’ai cependant eu l’occasion de prendre par deux fois du recul pour réfléchir, avec les acteurs de la sécurité routière et avec des chercheurs, aux causes de fond de l’insécurité routière et aux remèdes pratiques à appliquer. En 2000, la Direction de la recherche du ministère de l’équipement m’a demandé de constituer un groupe de travail pour revisiter ces causes en désagrégeant les principales – vitesse, alcool, oubli de la ceinture – et en opérant des coupes transversales. C’est ainsi que nous sommes arrivés à l’idée de « gisements de sécurité routière », croisements d’enjeux, définis par des circonstances et des caractéristiques communes d’accidents, avec des actions spécifiques à mener. Nous nous sommes efforcés de quantifier ces gisements, puis de les exploiter pour proposer des mesures susceptibles d’épargner, le plus vite possible, le plus grand nombre de vies. Remis au Gouvernement entre les deux tours des élections législatives de 2002, ce rapport a servi à élaborer une nouvelle politique de sécurité routière – qui a aujourd’hui fait ses preuves.
En 2006, constatant l’échec de cette politique en ce qui concernait les deux-roues motorisés, en particulier les motos, on m’a demandé de constituer un nouveau groupe de travail. C’était en quelque sorte une ironie de l’histoire, puisque nous avions déjà inscrit ces catégories de véhicules et d’usagers au nombre des « gisements de sécurité routière » importants, sans toutefois parvenir à une quantification adéquate faute de données suffisantes. Cette fois-ci, nous avons pu aller plus loin en leur accordant une attention spécifique. Mais la matière est difficile car une multitude de facteurs joue dans presque tout accident et nous avons du mal à pondérer leur rôle respectif.
Nous nous focalisons depuis une vingtaine d’années sur les comportements qui constituent en effet un problème massif pour la sécurité routière. Nous avons oublié que, même si nous avons beaucoup progressé dans les autres domaines, en particulier sur la sécurité des véhicules, il restait beaucoup à faire pour certaines catégories d’usagers. D’autre part, nous avons vu apparaître de nouveaux gisements de sécurité routière, au premier rang desquels les problèmes liés à la vigilance ou à l’utilisation du téléphone portable.
J’aborderai brièvement les causes de l’insécurité routière et les remèdes qui me semblent prioritaires à travers cinq thèmes : les infrastructures, les véhicules, certains publics particuliers, puis quelques problèmes transversaux à plusieurs gisements de sécurité routière – qui constituent sans doute des verrous dont le déblocage permettrait de mieux exploiter ces gisements et d’épargner des vies supplémentaires. Je finirai par les comportements.
La réelle amélioration des infrastructures et la croissance continue du réseau autoroutier, sur lequel l’accidentalité est beaucoup plus faible, ne doivent pas faire oublier que nous avons encore des marges de progression importantes qu’il convient d’exploiter, même si nous ne pouvons attendre de résultats qu’à moyen ou à long terme.
Les « points noirs » ayant été résorbés, ces marges se trouvent d’abord dans les zones de forte accidentalité – que nous avons baptisées zones prometteuses – qui requièrent une méthodologie nationale et locale de diagnostic et de traitement. Dans le contexte financier contraint que nous connaissons, c’est d’abord là qu’il faut faire porter l’effort.
Notre priorité doit également aller au réseau interurbain, aux traversées de petites agglomérations – où l’usager de la route tend à se croire encore en rase campagne – et aux parcours internes aux quartiers, à savoir les « zones 30 ». En ce qui concerne les deux derniers points, les efforts entrepris commencent à porter leurs fruits. En 2009, alors qu’on a enregistré 225 décès sur les autoroutes et un peu plus de 1 000 sur les routes nationales, 3 640 sont survenus sur les routes départementales et communales : là est donc l’enjeu de sécurité majeur. N’oublions pas que deux tiers des tués le sont en rase campagne et 30 % en territoire urbain, même si la proportion est quasiment inverse pour les blessés. La priorité doit donc aller aux zones rurales de forte accidentalité.
Le traitement des obstacles fixes constitue un autre gisement important. Je n’évoquerai ici que ceux qu’on trouve en rase campagne, la densité de ces obstacles dans les zones urbaines étant telle que leur traitement est impossible. En 2009, un peu plus de 1 200 personnes se sont tuées en rase campagne contre des obstacles fixes – dont environ un tiers contre des arbres. La recherche a mis en évidence des données qui sont rarement portées à la connaissance du public. Dans ce type d’accident, 43 % des décès surviennent entre zéro et deux mètres de la chaussée, 25 % entre deux et quatre mètres, et un petit tiers au-delà de quatre mètres. Les études techniques ont par ailleurs prouvé que l’élimination ou le recul de ces obstacles fixes permettrait d’éviter 80 % des décès à moins de deux mètres de la chaussée, 50 % entre deux et quatre mètres et 30 % au-delà. Autrement dit, on pourrait espérer un gain de 700 vies. Bien évidemment, c’est une action qui ne peut être conduite que sur le long terme. Il faudrait reculer les obstacles à l’occasion des travaux qui peuvent être effectués, mais aussi remplacer les poteaux de signalisation par des « poteaux fusibles », qui se plient par articulation au sol ou par déformation. Il est tout de même paradoxal qu’on puisse se tuer sur des panneaux de signalisation ! On fabrique de ces poteaux fusibles en France et des expérimentations sont en cours. J’espère que leur emploi pourra être généralisé : nous en attendons le même effet que celui que nous avons pu obtenir pour les voitures se heurtant de face – à savoir une capacité d’absorption de l’énergie, de manière à ce que celle-ci ne soit pas restituée à la victime. Il faut savoir qu’aujourd’hui, les chances de survie d’un motard qui rate un virage et termine sa course 50 centimètres plus loin dans un platane sont nulles.
Il faut également travailler sur les dispositifs de retenue. Les améliorations apportées par les communes et les communautés de communes dans la traversée des petites agglomérations sont à cet égard particulièrement intéressantes. La mise en chicane étroite, par exemple, contraint dans la plupart des cas l’automobiliste à modifier sa vitesse. De même, la limitation de la vitesse à 30 kilomètres-heure sur les voies internes aux quartiers est une bonne chose, à condition qu’elle ne concerne que les voies terminales d’accès aux logements. Il faut en effet résister à la tentation d’en mettre sur les voies traversées par des axes plus importants car, comme on le constate souvent en matière de sécurité routière, si l’on ne « dose » pas les mesures, on leur fait perdre leur crédibilité.
Je note enfin que les routes ne sont pas faites pour les motards. Les panneaux de signalisation et les îlots directionnels n’ont pas été pensés pour eux. Il importe donc, lorsqu’on construit, restructure ou entretient une voirie, de porter une attention particulière à ces usagers qui sont – et de loin – ceux qui courent le risque le plus élevé. Nous avions ainsi recommandé d’apporter aux gestionnaires des routes et aux techniciens une formation orientée sur les questions spécifiques liées aux deux-roues motorisés, et de faire des contrôles de la signalisation. Il n’est pas rare en effet qu’un panneau de signalisation masque un deux-roues motorisé, provoquant un accident.
J’en viens aux véhicules. La majorité des progrès enregistrés en matière de sécurité routière entre 1980 et 2000 est venue de la conception des véhicules. Nous avons fait des gains considérables : après cinq ou six tonneaux, les voitures d’aujourd’hui peuvent certes être cabossées, mais leurs passagers sont vivants – sauf s’ils n’ont pas mis leur ceinture, auquel cas la mort est certaine.
Il reste cependant beaucoup à faire, ne serait-ce que parce que les gains que nous avons faits concernent les chocs de face, non les chocs perpendiculaires ou latéraux. Les constructeurs travaillent évidemment tous les jours sur ce point, mais les résultats en matière de baisse de la mortalité sont moindres, car l’espace disponible pour absorber l’énergie est beaucoup plus étroit. En revanche, l’amélioration du taux de port de la ceinture et l’airbag ont été facteurs de progrès.
Nous arrivons désormais à l’ère de l’aide à la conduite. Mais n’oublions pas qu’in fine, c’est bien le conducteur qui reste responsable de sa conduite. Ne prenons pas le risque de le déresponsabiliser en lui laissant croire que c’est de tel instrument ou de tel outil que dépend sa survie – certains comportements nous montrent qu’il s’agit hélas d’un danger réel. Nous avons néanmoins beaucoup à gagner au développement de ces instruments, notamment en matière de vigilance et de contrôle de la vitesse.
Sont cependant exclus de ces progrès les deux-roues motorisés, plus particulièrement les motards. Pour mémoire, on estime que 90 % des cyclomoteurs ne sont pas conformes à la réglementation sur la vitesse et cela pour une raison simple : il suffit de quelques secondes pour les débrider. N’oublions pas non plus que 68 % des cyclomotoristes tués ont entre 15 et 24 ans. Nous en arrivons donc à ce qui est désormais la seule solution : la réglementation européenne obligeant les constructeurs à fabriquer des blocs qui empêchent le débridage. On évitera ainsi qu’un certain nombre de jeunes se fracassent le crâne contre un poteau de leur quartier quelques semaines seulement après avoir étrenné leur cyclomoteur, comme je l’ai vu à plusieurs reprises…
J’en viens aux motos. Les constructeurs ont beaucoup moins travaillé sur ce véhicule que sur les autres, alors qu’il est infiniment plus vulnérable. Les deux-roues motorisés, et plus particulièrement les motards – du fait de leur vitesse et de leur capacité d’accélération – posent en effet un important problème de détection. C’était d’ailleurs l’un des gisements les plus importants identifiés par le groupe de travail sur les deux-roues motorisés. Pour le dire vite, la détectabilité résulte de mécanismes qui sont à la fois d’ordre physique, d’ordre cognitif et d’ordre comportemental, le comportement des conducteurs de ces véhicules ajoutant parfois à la difficulté de leur détection. Une première mesure a donc consisté à imposer l’allumage des feux de jour. Ce n’est cependant pas suffisant, car subsiste un handicap majeur : un trop faible gabarit visuel, qui fait que sur les routes de campagne, a fortiori de nuit, on ne peut ni voir arriver un motard, ni apprécier sa vitesse. Une équipe japonaise a ainsi démontré que l’augmentation du gabarit des motos rapprocherait leur détectabilité de celle d’un véhicule léger. Il suffirait pour ce faire d’élargir le guidon, d’ajouter deux lumières – orientées vers le véhicule qui arrive en face – aux extrémités de celui-ci, et deux de chaque côté de la fourche avant. On obtient alors une sorte de parallélépipède, avec un gabarit visuel plus proche de celui des véhicules légers. C’est une mesure que la France a proposée à l’Europe.
Il faut bien sûr aussi une meilleure connaissance par les autres usagers de ces véhicules et de leur conduite. Cet impératif a été pris en compte dans la préparation du permis de conduire. De même, comme le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) vient de le décider et même si la mesure a été mal comprise, il convenait de renforcer la visibilité des conducteurs de motos, notamment lorsqu’ils circulent à pied à côté de leur véhicule, en leur imposant – progressivement – le port de bandes réfléchissantes. Cela se pratique dans un grand nombre de pays et produit des résultats appréciables, en particulier de nuit.
Il faut également atténuer les gênes liées au véhicule, c’est-à-dire les effets des angles morts. On assiste justement aujourd’hui à l’arrivée de systèmes qui permettent de les éliminer. On peut enfin agir – j’en ai déjà parlé – sur l’implantation des panneaux de signalisation.
Je voudrais maintenant évoquer trois publics spécifiques, pour lesquels les enjeux et les gains de vies potentiels sont importants.
Il y a d’abord les entreprises. Dotées de processus organisationnels très rigoureux, elles ont la capacité de calculer des coûts et sont déjà des lieux de formation : elles constituent donc un cadre adéquat pour la mise en œuvre de plans de prévention des risques routiers. Ce gisement est aisé à exploiter, car le risque pris est faible. Dans le meilleur des cas, l’entreprise réalisera même des économies importantes – il ne faut pas oublier que 50 % des décès par accident du travail ont lieu sur la route. Lors du dernier CISR, le Gouvernement a d’ailleurs renoué avec une initiative lancée à la fin des années 1990 en incitant les entreprises de plus de 500 salariés à relancer les plans de prévention des risques routiers. Nous avons beaucoup à y gagner.
Je pense en deuxième lieu aux personnes âgées. Le problème ne peut que s’amplifier et le négliger aujourd’hui obligerait demain à prendre des mesures mal ressenties. La catégorie des plus de 75 ans est celle qui a le plus augmenté au sein de notre population entre 2001 et 2008. C’est aussi celle où le nombre de tués sur la route a le moins diminué depuis 2002. C’est enfin celle où la responsabilité du conducteur impliqué dans un accident corporel est le plus souvent engagée – dans 59 % des cas, et même 70 % si l’on ne considère que les accidents mortels.
Deux solutions sont ici envisageables. La première consiste à interdire la conduite à partir d’un certain âge en l’absence de visite médicale « satisfaisante ». Je rappelle que tout médecin peut aujourd’hui prendre la décision d’empêcher une personne âgée de conduire ou de limiter l’usage de son permis de conduire, par exemple au jour. La deuxième méthode a été appliquée en Belgique avec l’aide des mutuelles : le diagnostic posé lors d’une visite médicale est transmis à un spécialiste de la sécurité routière qui, en fonction des capacités réflexes, visuelles et auditives de l’intéressé, lui explique comment adapter sa conduite à son état physique. En résumé, il s’agit d’une sorte de prescription-consultation. L’avenir me semble davantage résider dans cette voie. Les initiatives qui ont été prises – rappel des règles de conduite ou de prudence – ne suffiront pas en effet à traiter le problème.
Le troisième public spécifique est constitué par les motards – à distinguer des conducteurs de cyclomoteurs, dont les capacités d’accélération et de vitesse sont bien inférieures. Les motards sont à la fois les conducteurs les plus vulnérables et ceux qui roulent le plus vite. Ils ne sont guère convaincus du caractère dissuasif des radars… Ce sont enfin ceux qui ont les conduites les plus répréhensibles. Il n’est donc pas étonnant que la part des motards dans les tués ne cesse d’augmenter : sur les quatre premiers mois de 2011, les conducteurs de cyclomoteurs et les motards représentent 30 % des morts de la route – pour 2 % du trafic. C’est de loin la catégorie pour laquelle les progrès ont été les plus faibles : en dix ans, de 1999 à 2009, on est passé de 947 à 888 morts à trente jours. Les chiffres concernant la vitesse sont également sans appel : les excès de vitesse de plus de 30 kilomètres-heure sont treize fois plus fréquents chez les motards que chez l’ensemble des usagers ; ceux de plus de 40 kilomètres-heure sont vingt-quatre fois plus fréquents, et ceux de plus de 50 kilomètres-heure quarante fois plus fréquents. Leur vitesse moyenne a certes diminué depuis 2002, à peu près au même rythme que celle des véhicules légers, mais elle reste supérieure d’environ 10 %. Si elle s’alignait sur celle des autres usagers, un peu plus de 350 morts et de 600 blessés graves pourraient être évités chaque année. Chez les motards, les blessés graves sont en effet plus nombreux que les morts – on compte 1,75 blessé grave pour un mort, le rapport s’établissant à un pour un, environ, pour les véhicules légers.
Quant aux problèmes transversaux, j’en mentionnerai brièvement trois. Il y a d’abord l’éducation et la formation ; ensuite, il y a le fait que la sécurité routière est un problème de santé publique qu’on ne traite pas comme tel ; enfin, il y a l’obligation de prendre conscience qu’il ne peut y avoir de politique de sécurité routière réussie sans un constant aller et retour entre le national et le local et sans stratégies locales élaborées, celles-ci étant plus efficaces que les stratégies nationales.
J’en arrive aux comportements. Des progrès doivent certes être accomplis dans beaucoup d’autres domaines, mais ils relèvent d’efforts de longue durée, alors que faire évoluer les comportements permettrait des gains immédiats et d’une tout autre ampleur. Si tous les conducteurs avaient respecté les limites de vitesse en 2009, ils auraient réduit leur vitesse, en moyenne, d’un peu moins de 4 kilomètres-heure, et plus de 750 vies auraient été épargnées. Si tous les passagers avaient porté leur ceinture, à l’avant comme à l’arrière, ce sont environ 300 vies qui auraient été sauvées. Nous avons déjà beaucoup gagné sur ce terrain, mais il reste à faire : songez que le port de la ceinture double les chances de survie en cas d’accident ! En ce qui concerne l’alcool, les résultats des actions entreprises au niveau local restent très décevants. Or on considère que si personne n’avait conduit sous l’emprise de l’alcool, on aurait pu épargner de l’ordre de 1 200 vies.
Les trois facteurs sont certes souvent conjugués, de sorte que ces chiffres ne sont pas à additionner, mais nous avons là tous les éléments permettant de ramener le nombre de morts à moins de 3 000 par an.
Je vous livre pour conclure quelques réflexions de praticien. Le lien entre vitesse et mortalité est non seulement direct, mais instantané. Je prendrai ici l’exemple de ce que j’ai vécu dans l’Ain. En 2008, nous avions enregistré 49 morts sur la route. Nous avons commencé l’année 2009 avec une baisse simultanée du pourcentage d’usagers dépassant les limites de vitesse – mesuré par trois stations SIREDO implantées sur le réseau départemental – et du nombre de morts. Début août, nous étions à 11 morts de moins que l’année précédente. Nous avons pourtant terminé l’année avec 51 morts – autrement dit, nous avons tout reperdu en quatre mois – et je dois dire que nous avons constaté une simultanéité, au mois près, de la remontée du pourcentage d’usagers roulant trop vite et du nombre de morts. Je ne pensais pas que la corrélation serait établie de manière aussi nette.
Je note aussi, à nouveau, l’efficacité salvatrice de la sécurité passive des véhicules légers. Le défi à relever maintenant est celui de la sécurité sur le réseau interurbain, départemental et communal.
L’analyse semaine après semaine des accidents mortels permet d’incriminer non seulement la vitesse excessive, mais aussi la vitesse inadaptée – deux maux avec lesquels il faut rompre. La vitesse inadaptée par rapport à la configuration de la route, à l’environnement et aux circonstances, comme la surestimation de soi, conduisent à se priver de toute marge de manœuvre par rapport aux aléas. On le constate notamment avec les sorties de virage à vitesse inadaptée, les dépassements mal calibrés ou le non-respect des distances de sécurité. Les gens qui tuent les autres sur la route ne l’ont en général pas voulu ; mais bien souvent, ils savaient – et leur entourage aussi – que leur comportement était dangereux.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Vous avez répondu par avance à un certain nombre de mes questions. Il m’en reste néanmoins quelques-unes ! Vous aviez écrit dans votre rapport de 2002 qu’en matière de sécurité routière, l’interministérialité n’était pas complètement mise en œuvre. Que pensez-vous de la gouvernance actuelle ?
M. Régis Guyot. Elle est particulièrement éprouvante pour le délégué interministériel à la sécurité routière. Dans tous les systèmes organisés de sécurité, la coordination est un élément primordial. Or notre système de circulation routière n’est pas un système professionnel à proprement parler ; cela entraîne des incohérences structurelles qui sont sources de risques.
La réforme des responsabilités en matière d’environnement, l’amélioration de la sécurité des véhicules et la décentralisation de l’organisation de la voirie ont conduit à mettre l’accent sur les comportements et à revoir la répartition des tâches : l’animation du système repose désormais sur le délégué interministériel, sous la tutelle de deux ministres essentiellement. Or on peut regretter que le ministère de la santé ne soit pas plus actif sur ces questions. Nous aurions beaucoup à y gagner, en particulier pour le travail d’éducation et de prévention que pourraient effectuer les médecins.
M. le rapporteur. Les méthodes de recueil des données vous paraissent-elles fiables ?
M. Régis Guyot. Les recueils sont inégalement fiables, pour des raisons qui tiennent à la fois au nombre des données traitées et à la difficulté du travail. Le nombre de données recueillies pour les deux-roues motorisés est insuffisant : nous avons besoin de séries plus longues pour assurer une fiabilité scientifique. Mais certains éléments sont difficiles à mesurer : je pense à au port de la ceinture à l’arrière ou à l’utilisation du téléphone portable au volant.
Les données humaines et économiques de l’insécurité routière sont d’une ampleur telle qu’il me semble nécessaire d’investir pour disposer de plus d’informations sur un certain nombre de points. Ainsi en ce qui concerne ces « emmurés vivants » que sont les blessés graves : j’appelle de mes vœux la création de deux indices médicaux, l’un mesurant la gravité immédiate des blessures et l’autre la gravité des séquelles potentielles. Je suis convaincu que porter ces données à la connaissance de nos concitoyens nous permettrait d’obtenir des résultats concrets. On crée chaque année des dizaines de milliers de handicapés à vie ; mais on compte pour rien leurs souffrances et celles de leur entourage. Je rappelle que, jusqu’en 2004, nos statistiques enregistraient les morts à six jours quand le monde entier en était déjà aux morts à trente jours. Nous avons mis fin à cette anomalie mais, s’agissant des hospitalisés, nous en restons à des données bureaucratiques. Il existe des échelles médicales de mesure de la gravité des blessures et des séquelles, qui sont reconnues dans le monde entier, et nous ne nous en servons pas ! Or je le répète, la prise de conscience et la connaissance publique de ces données seraient capitales pour le combat que nous menons.
M. le rapporteur. Tout le monde s’accorde bien sûr à dire que si les véhicules roulaient très lentement, il y aurait moins d’accidents. Mais ne pensez-vous pas qu’en la matière, il existe un seuil d’acceptabilité ? Le principal motif de retrait de points sur le permis de conduire – dans 57 % des cas – reste en effet la vitesse, sachant que dans la majorité des cas, il s’agit de petits excès de vitesse, de moins de 20 kilomètres-heure. La vitesse ne pèse cependant guère plus de 18 ou 20 % dans les causes d’accident. La répression vous paraît-elle bien ciblée ?
S’agissant des motos, les contrôles de vitesse par radar vous semblent-ils efficaces ? Que pensez-vous des mesures – agrandissement des plaques et port de gilet – décidées par le CISR le 11 mai ?
M. Régis Guyot. Il y a, d’un côté, les faits que l’on peut établir grâce à la recherche et, de l’autre, le décideur public et la population. Le moment où un certain nombre de mesures dont le bien-fondé est reconnu sont prises correspond à celui où le besoin et l’acceptabilité se rejoignent. C’est toute la difficulté pour le décideur public. Je note à ce propos que le dialogue entre le chercheur et le décideur public reste en partie à inventer – les chercheurs ne savent pas toujours parler aux décideurs publics, qui eux-mêmes ne savent pas toujours exprimer parfaitement les objectifs qu’ils poursuivent. Quoi qu’il en soit, la ligne de crête est bien l’acceptabilité sociale.
Aucun gouvernement n’a jamais pensé qu’on pouvait séparer l’éducation, l’information et la prévention de la dissuasion et de la répression. Il faut agir sur les deux fronts. Nous le constatons aujourd’hui avec la vitesse : dès que la vitesse moyenne effective remonte de quelques kilomètres-heure, on en paye le prix ; lorsqu’elle diminue, les progrès s’amplifient rapidement. Prenons un autre exemple qui s’inscrit dans le débat des dernières semaines. Nous n’allons pas demander aux usagers la permission de leur appliquer la loi. Cependant, tout montre que, sauf consultation fréquente du compteur, le conducteur a une notion floue de sa vitesse. Je l’expérimente régulièrement : le tableau lumineux implanté à l’entrée de la commune bretonne où je passe mes vacances, qui m’indique ma vitesse en approche, est toujours riche d’enseignements pour moi ! La multiplication de ces signaux aux abords des agglomérations et des zones accidentogènes, ou encore aux fins de rappel sur les trajets longs, me semble donc utile. Mais si les usagers ne savent pas qu’ils s’exposent à une sanction, nous n’aboutirons à aucun résultat. En 2000, nous avions observé que plus de 50 % des usagers roulaient au-dessus des limites de vitesse, et cela sur toutes les catégories de routes ! La répression doit donc demeurer, mais il importe tout autant de créer un terreau favorable aux prises de conscience et aux changements de comportement. On en revient ici à la nécessité de rendre publiques les données sur les blessés graves.
Agissons cependant à bon escient : je me suis toujours opposé – y compris auprès des agents agissant sous mon autorité – à l’installation de contrôles radars mobiles dans des lieux où il était prouvé que l’accidentalité était faible. Il m’est arrivé de refuser de prendre les résultats de ces contrôles en compte lorsqu’on n’avait pas obéi à mes instructions. En matière de contrôles, comme de limites de vitesse, on décrédibilise en effet l’appareil réglementaire si l’on ne se fonde pas sur l’accidentalité réelle.
M. Jacques Myard. Très bien !
M. Régis Guyot. Je suis convaincu qu’en allant trop loin, on va à l’encontre des objectifs visés.
M. Jacques Myard. Vous avez dit que les trois sources d’insécurité sur lesquelles agir pour épargner encore des vies – vitesse, oubli de la ceinture et consommation d’alcool – étaient parfois combinées.
M. Régis Guyot. Souvent. C’est notamment le cas pour la consommation d’alcool et l’absence de port de la ceinture.
M. Jacques Myard. Cela prouve que la vitesse n’est pas toujours en cause. Du reste, vous avez aussi parlé de vitesse inadaptée : même en respectant les limites en vigueur, on peut avoir un accident en raison d’un comportement imbécile.
M. Régis Guyot. C’est en effet ce que tendait à démontrer, dans les départements où j’ai été préfet, l’analyse des causes d’accidents mortels. Dans un certain nombre de cas, le conducteur ne conduisait pas vite, mais il n’avait pas adapté sa conduite à la topographie de la chaussée – par exemple sa trajectoire au profil d’un virage, dont il sortait alors un peu trop à gauche. En l’absence de visibilité, on risque le choc frontal – je l’ai encore vu récemment dans l’Ain.
M. Jacques Myard. Comment expliquez-vous l’incompréhension totale qui règne entre les motards, la sécurité routière et les autorités publiques, et l’échec des actions de sensibilisation ?
M. Régis Guyot. Je fais le même constat que vous. J’avais d’ailleurs écrit dans le rapport de 2002 que le lobby des motards effrayait les élus… J’ai participé à la première réunion de la concertation nationale sur les deux-roues motorisés. Les choses se sont fort bien passées ; le dialogue entre les pouvoirs publics, la Fédération française des motards en colère (FFMC) et les différentes autres organisations de motards paraissait bien engagé. Mais j’ai cru comprendre que, sitôt la réunion passée, des communiqués vengeurs avaient été publiés. J’avoue que j’ai éprouvé le même sentiment d’échec sur le terrain. Je pense que la base de ces organisations n’est pas encore familière du dialogue institutionnel, dans lequel on avance par compromis successifs. Mais, face à des usagers qui vous disent qu’ils ne vous suivront que s’ils obtiennent tout ce qu’ils demandent, le dialogue ne peut que tourner court… Il nous faudra donc de la patience et de nombreuses rencontres pour nous apprivoiser mutuellement – car ce n’est pas à un refus catégorique que nous sommes confrontés, mais à une incapacité à avancer ensemble.
M. Michel Voisin. Aux dires de ceux qui viennent nous trouver dans nos permanences, c’est la verbalisation au kilomètre-heure d’écart près qui exaspère le plus les usagers de la route. J’ai moi-même perdu trois points pour de tels dépassements. A-t-on appréhendé tous les effets de cette politique ? Je suis convaincu que conduire en ayant l’œil rivé en permanence sur le compteur provoque un certain nombre d’accidents – d’où l’intérêt de l’avertisseur de dépassement.
M. Régis Guyot. L’expérience enseigne malheureusement que la marge de tolérance est considérée comme un droit, auquel chacun va ajouter son plus… Lorsqu’un de vos administrés vous explique qu’il a été pris en faute à 52 kilomètres-heure, vous pouvez être assuré qu’il roulait en réalité à 57 kilomètres-heure. S’il circulait en ville, il était déjà à plus de la moitié de la marge qui sépare la sauvegarde de la vie d’un piéton qui traverserait de sa mort !
Le limiteur sonore amène à poser la question autrement. N’est-ce pas notre compteur lui-même qui devrait être bruyant, à l’instar de ce qui existe pour la ceinture ? La technique a ici permis de triompher d’un certain nombre de récalcitrants : l’avertisseur sonore est tellement insupportable qu’on finit par boucler sa ceinture ! Peut-être est-ce dans cette direction qu’il faut aller, à moins que le respect des limitations de vitesse par les usagers ne nous permette de tolérer à nouveau les micro-dépassements. Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que tout dépassement est une marge de manœuvre dont on se prive. La limitation à 50 kilomètres-heure n’a pas été fixée au hasard mais elle a été calculée à partir de données scientifiques sur les chances de survie d’un piéton, renversé par un véhicule, en fonction de la vitesse de celui-ci.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de votre contribution.
*
* *
Audition de M. Jean-Pierre Pillard, chef de la division police, M. Patrick Letailleur, chef de la division gendarmerie et Mme Dominique Choffé, chef de la division transports au Centre national d’information routière (CNIR)
M. Jean-Pierre Pillard, chef de la division police au Centre national d’information routière (CNIR). Comme vous pouvez le constater, la direction du Centre national d’information routière (CNIR) est strictement collégiale, à ce détail près que nous assurons chacun à tour de rôle la permanence pendant une semaine.
L’information routière est une composante à part entière de la sécurité routière. Jusqu’au début des années 1960, elle était de nature statique : élaboration de cartes routières et de guides touristiques, établissement de signalisations verticales, de localisation et de direction, et horizontales, de sécurité et de guidage. Le radioguidage, lancé en 1958 par la RTF, aboutira dix ans plus tard à la création du CNIR, puis, dans les années 1970, à celle de sept centres régionaux d’information et de coordination routières (CRIR ou CRICR), adossés chacun à une zone de défense.
Les missions, l’organisation, les prestations et le fonctionnement des centres d’information routière sont régis par un protocole interministériel en date du 4 novembre 1998, actuellement en cours de réécriture.
Depuis 1976, la production du CNIR est associée à la marque « Bison futé » : cette figure emblématique – que tous connaissent – sert de support aux campagnes de communication du CNIR, notamment lors des grands départs en vacances. La création de « Bison futé » a d’ailleurs été la réponse des pouvoirs publics à un événement qui avait connu un fort retentissement médiatique : le 2 août 1975, le traditionnel chassé-croisé de l’été avait entraîné la formation de 600 kilomètres de bouchons, par une chaleur torride.
Progressivement, les interventions de « Bison futé » se sont étendues à l’ensemble des trajets, y compris quotidiens. Ce personnage sert désormais de vecteur au CNIR pour diffuser des messages à caractère réglementaire, ainsi qu’une information à la fois prévisionnelle et en temps réel.
Notre tâche est ainsi de satisfaire à une obligation légale de l’État de veiller à la sécurité des usagers et à leur bonne information sur l’état du trafic. L’information routière est assurée sur le réseau des routes à grande circulation et sur le réseau routier national. Comme l’a rappelé le comité interministériel de la sécurité routière, lors de sa réunion du 24 janvier 2005, l’information des usagers en temps réel est « un axe d’amélioration pour la sécurité routière ». Dans le même esprit, une directive européenne sur les systèmes de transport intelligents prévoit, parmi les actions prioritaires à réaliser, la mise à disposition – si possible gratuite – d’« informations universelles sur la circulation », à partir d’une « liste type de situations liées à la sécurité routière ».
Le fait de fournir une information routière en temps aussi près que possible du temps réel, via par exemple les radios, les panneaux à messages variables et les navigateurs embarqués dans les véhicules, permet de prévenir accidents et sur-accidents. Lors des grandes migrations estivales ou lors d’événements particuliers comme des manifestations de masse ou des intempéries, elle offre aux usagers la possibilité de choisir leur mode de transport ou d’opter pour les itinéraires et créneaux horaires les moins chargés... Nous travaillons avec le souci d’un meilleur partage de la route, du respect des règles de la sécurité routière et d’une amélioration des performances environnementales.
L’ensemble de la réglementation applicable en France – interdictions de circuler et levée de ces interdictions, dérogations, arrêtés préfectoraux – mais aussi, autant que possible, dans les pays limitrophes, est également diffusée par « Bison futé » sur son site Internet à destination des professionnels de la route, français et étrangers, comme de l’ensemble du public.
Enfin, lorsqu’ils en reçoivent la demande de la part des autorités, le CNIR et les CRIR diffusent des messages d’alerte destinés à l’ensemble de la population : ainsi en a-t-il été lors des épisodes caniculaires de 2003 et de 2006 et c’est encore le cas chaque fois qu’est déclenchée la procédure « alerte enlèvement ».
Mme Dominique Choffé, chef de la division transports au Centre national d’information routière (CNIR). Le CNIR est une entité interministérielle, composée de trois grands services dénommés divisions : la division gendarmerie, la division police et la division transports.
Il a pour mission d’informer les usagers de la route, afin d’améliorer leurs conditions de déplacement et leur sécurité, et de renseigner et de conseiller les autorités – autorités ministérielles pour le centre national et autorités préfectorales pour les centres régionaux.
Comme on l’a dit, la direction du CNIR est collégiale. Chaque semaine, l’un des trois chefs de division est de permanence : il n’y a donc pas « un » patron du centre, mais trois divisions dont chacune est à tour de rôle responsable de l’ensemble de la diffusion à l’échelle nationale. Le fonctionnement du CNIR, comme celui des CRIR, est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Le CNIR anime et coordonne les sept CRIR. Il garantit notamment une diffusion homogène de l’information : le site « Bison futé » est mis à jour à la fois par le centre national et par les centres régionaux, mais selon une norme commune.
Les informations nous sont fournies principalement par les gestionnaires de voirie : les directions interdépartementales des routes (DIR) pour le réseau routier national non concédé, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) et, éventuellement, les collectivités locales. Les renseignements reçus portent sur les conditions de trafic, sur l’état des routes, sur la gestion des chantiers et sur les interventions liées à des incidents.
Les informations nous viennent également des forces de l’ordre, des pompiers et des services de secours – elles concernent alors généralement les accidents et les perturbations. D’autre part, nous avons conclu de longue date des marchés avec Météo France pour la fourniture de bulletins quotidiens, adaptés à la route, et nous répercutons ses alertes. Les autorités administratives nous communiquent les mesures de gestion de trafic qu’elles sont amenées à prendre en cas de crise notamment – interdiction de la circulation des poids lourds pour cause de neige, fermeture d’une autoroute… Enfin, il arrive que nous recevions des alertes de médias ou d’usagers de la route.
En bref, nos informations concernent tous les événements susceptibles d’affecter la fluidité de la circulation.
Leur diffusion est évidemment gratuite : nous sommes un service de l’État. Elle s’effectue d’abord en direction de ce que nous appelons des abonnés. Le premier canal est celui de notre messagerie – beaucoup de médias sont abonnés à nos bulletins –, mais nous disposons également d’un serveur vocal, dont le numéro d’appel, le 0 800 100 200, est gratuit et accessible de l’étranger. Enfin, notre site Internet « Bison futé », très riche en informations en temps réel, en prévisions et en informations sur la réglementation, est le site national le plus consulté après le site « Sytadin » consacré à l’information routière en Île-de-France ; en 2010, nous avons enregistré 12,4 millions de connexions. S’il est régulièrement fréquenté par des habitués, il connaît des pointes de consultation, notamment lors des grands départs d’été ou lors de crises climatiques – le 17 décembre 2010, par exemple, nous avons enregistré 232 000 connexions.
Pour traiter les informations que nous recevons, nous disposons d’une base de données. Depuis la fin de novembre 2010, le logiciel « Tipi » – n’oublions pas que nous sommes « Bison futé » ! – permet de recueillir l’information et de la diffuser auprès de nos abonnés, et ce automatiquement pour certains messages. L’an prochain, les DIR et les exploitants gestionnaires des routes nationales pourront mettre eux-mêmes à jour cette base de données. Dès qu’une information y sera introduite, elle sera diffusée. Les véhicules vont aussi être de plus en plus nombreux à être équipés de systèmes embarqués permettant aux usagers de disposer immédiatement des renseignements qui leur sont utiles.
Nos « abonnés », au nombre de 4 000 environ, sont composés pour moitié de médias et de professionnels de la route ; en font partie également les autorités publiques nationales, régionales ou départementales. Mais nous comptons aussi parmi ces abonnés des étrangers, surtout frontaliers.
En 2010, Bison futé a élaboré quelque 250 000 à 300 000 messages sur des événements qui lui ont été annoncés par la police, par les DIR ou par les SCA, et a adressé 11 millions de courriers électroniques. Le site, je l’ai dit, a enregistré 12,4 millions de connexions. Si le serveur vocal connaît un peu moins de succès, il reste un outil très intéressant : pour peu qu’ils soient munis d’un téléphone, les usagers, confrontés à une situation de crise, peuvent le consulter depuis leur véhicule.
M. Jean-Pierre Pillard. Ce serveur vocal leur permet aussi, s’ils le souhaitent, d’être mis en relation avec un agent d’un CRIR. En outre, en situation de crise, il est possible de relier le serveur vocal de chaque centre au PC établi à cet effet au sein de la préfecture concernée. Le numéro vert, gratuit et dont nous venons de revoir l’ergonomie, conserve donc toute sa pertinence.
M. Philippe Houillon, rapporteur. De quels ministères le CNIR dépend-il ?
M. Patrick Letailleur, chef de la division gendarmerie au Centre national d’information routière (CNIR). De deux : les divisions police et gendarmerie du ministère de l’intérieur et la division transports du ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement.
Mme Dominique Choffé. Je relève plus précisément de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et, au sein de celle-ci, de la direction des infrastructures de transport.
M. Jean-Pierre Pillard. Quant à moi, je relève de la direction centrale de la sécurité publique. C’est elle qui, au nom de la direction générale de la police nationale, assure la représentation de la police au sein des centres d’information routière.
M. le rapporteur. Seriez-vous en mesure de nous fournir un document, une carte par exemple, détaillant les zones les plus accidentogènes du territoire ?
Mme Dominique Choffé. L’information que nous recevons ne concerne que les perturbations affectant le trafic routier ; de ce fait, nous ne disposons pas d’une vue d’ensemble des accidents survenant sur le réseau français – tous ne provoquent pas de perturbations.
M. le président Armand Jung. La masse des informations qui remontent jusqu’à vous vous met peut-être en mesure d’effectuer des recoupements. Si, dans une zone donnée, les remontées sont plus nombreuses que dans d’autres, peut-être en avez-vous tiré des conclusions, qui pourraient être intéressantes pour notre Mission, sur les lieux, les périodes ou les horaires les plus dangereux.
M. Jean-Pierre Pillard. Nous ne disposons d’aucune base de données où nous conserverions ces événements en mémoire. Notre mission est la production d’informations en temps réel pour aider l’usager de la route au cours de son trajet.
M. le rapporteur. À défaut de base de données, la répétition de certains événements peut vous suggérer certaines conclusions, par exemple sur un éventuel lien, à un endroit ou à un moment donné, entre la congestion du trafic et l’accidentalité. D’autre part, les informations que vous fournit Météo France ne vous permettent-elles pas, ne serait-ce que de pressentir l’existence d’une relation entre les conditions météorologiques et le nombre des accidents, à certaines époques ou dans certaines régions ?
Bref, à défaut d’éléments scientifiques, votre expérience vous permet-elle d’esquisser une analyse des causes d’accident ?
M. Patrick Letailleur. La France compte près d’un million de kilomètres de routes. Le CNIR exerce une veille sur 65 000 kilomètres, soit les 20 000 kilomètres d’autoroutes et les 45 000 kilomètres d’anciennes routes nationales qui constituent aujourd’hui ce qu’on appelle le réseau grande circulation (RGC). Dans cet ensemble, nous n’avons détecté aucun « point noir ».
En revanche, certains jours sont propices aux accidents. Les retours de boîte de nuit, le dimanche matin, s’accompagnent d’accidents graves, fréquemment mortels. Ainsi seize personnes sont décédées sur les routes de France dimanche dernier, dont deux très tôt le matin, sans doute après une nuit en discothèque.
M. le rapporteur. Vous n’établissez pas de rapport entre la congestion de la circulation et l’accidentalité ?
M. Patrick Letailleur. Plus un bouchon sera important, moins il y aura d’accidents ! Et s’il s’en produit un, il y aura toute chance pour que les dégâts ne soient que matériels.
En revanche, on peut penser qu’un usager qui sort d’un bouchon se trouve énervé et qu’il y a là une cause possible d’accident. Mais nous ne disposons pas de l’ensemble des éléments permettant de l’établir.
D’autre part, les 500 ou 600 kilomètres de bouchons que provoquent, de façon assez récurrente, les grands flux migratoires de l’été concernent des personnes qui, partant en vacances, ne sont évidemment pas soumises à la même pression que celles qui se déplacent pour des raisons professionnelles. Une étude d’accidentologie doit évidemment en tenir compte.
M. le rapporteur. Les bouchons ne se produisent pas seulement à l’occasion des grands départs en vacances. Quelles en sont alors les causes ? Sont-ils une singularité française ? Nos voisins connaissent-ils des situations comparables ou ont-ils développé des politiques plus efficaces que les nôtres ? Faut-il mettre en cause les infrastructures ?
M. Jean-Pierre Pillard. La congestion des réseaux routiers ou autoroutiers est liée à des perturbations. Celles-ci peuvent se cumuler : des intempéries vont provoquer une série d’accrochages, les autres automobilistes vont ralentir pour satisfaire leur curiosité. D’autres fois, ce sera une opération « escargot » ou telle autre manifestation sociale, et l’embouteillage va très vite prendre de l’ampleur même si l’on n’a à déplorer que des dégâts matériels…
Partenaires de la sécurité routière, nous travaillons en liaison étroite avec la Délégation interministérielle et pouvons être amenés à lui rendre compte à toute heure de tout accident particulièrement significatif ou à fort retentissement médiatique, même si le bilan n’en est pas aussi grave qu’on aurait pu le craindre. Il faut en effet souligner l’effet amplificateur de la couverture médiatique. J’ai ainsi le souvenir d’un épisode de verglas, en Île-de-France, qui avait, certes, provoqué des carambolages, mais très peu d’accidents corporels : on en a pourtant parlé à la radio toute la matinée ! Les périodes qui mobilisent le plus l’attention des médias ne sont pas forcément celles où l’on enregistre les accidents les plus graves.
Quoi qu’il en soit, nous ne souhaitons pas nous immiscer dans le domaine de compétence de l’Observatoire national de la sécurité routière, d’autant que rien ne nous permet de contester ses conclusions.
Mme Dominique Choffé. En fonction des conditions météorologiques, les CRIR ou le CNIR vont compléter leurs messages par des conseils de conduite adaptés à la situation. Les CRIR connaissent bien, dans les régions dont ils ont la responsabilité, les zones les plus exposées aux risques de verglas ou de brouillard.
M. le rapporteur. Seraient-ils à même de dire où les accidents sont les plus fréquents ?
Mme Dominique Choffé. Les CRIR ne s’occupent pas d’accidentologie. En revanche, les plans de gestion du trafic, comme les plans « intempéries », recensent toutes les zones exposées à un risque de verglas – ponts, sous-bois, etc. – ou de brouillard. Ils répertorient également les pentes un peu raides, par exemple celles où les poids lourds risquent de se mettre en travers en cas de neige.
M. Jean-Pierre Pillard. Les CRIR sont astreints à une veille opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En situation de crise ou lors des grands départs estivaux, le personnel qui assure cette veille est renforcé. Nous essayons alors d’accompagner les messages d’information de conseils de sécurité routière que nous qualifions d’opportunistes, adaptés au contexte, à la saison, mais aussi aux dangers qui ont pu être identifiés : nous réagissons en effet aussi promptement que possible aux situations accidentogènes sur lesquelles nous sommes alertés.
Nous sommes en permanence reliés à l’ensemble des médias : radios généralistes ou spécialisées, ou encore presse audiovisuelle. Tous les jours, nos chefs de salle sont contactés par des journalistes. Dans notre rôle primordial d’information, nous sommes donc pleinement intégrés au dispositif de sécurité routière.
Tous les internautes peuvent aussi trouver sur notre site Internet la réglementation applicable en France et dans les pays limitrophes, des conseils de sécurité routière et des panoramas par saison. Nous y mettons également en ligne des informations à la demande de la direction de la sécurité et de la circulation routières.
M. le rapporteur. Se fondant sur la politique allemande, certains proposent de relever la vitesse maximale sur les autoroutes, ou au moins sur certaines portions de celles-ci. Qu’en pensez-vous ? Nous ne vous demandons pas de vous substituer à l’Observatoire national de la sécurité routière, mais votre expérience doit bien vous donner quelques idées de mesures qui répondraient aux vœux de nos concitoyens sans nuire à la sécurité routière…
M. Patrick Letailleur. Nos études font apparaître que si la vitesse n’est pas systématiquement la première cause d’accidents, elle peut transformer un accident en accident mortel.
M. le rapporteur. Je réitère ma question. Selon certains, la vitesse maximale sur autoroute devrait être relevée à 140 ou 150 kilomètres-heure au lieu de 130. Quelle est votre position ?
M. Patrick Letailleur. Les conducteurs français respectent globalement la vitesse maximale sur autoroute. Si un effort doit être fait dans ce domaine, il doit porter sur l’harmonisation des comportements des usagers étrangers avec ceux des Français. Aujourd’hui, les conducteurs étrangers roulent tous au-delà de la vitesse autorisée ! Le système de contrôle et de sanction automatisé n’a aucun effet sur eux.
M. le rapporteur. Vous avez raison d’évoquer ce point, mais vous ne répondez toujours pas à ma question. En tant qu’observateurs privilégiés de la sécurité routière et des routes françaises, ne pourriez-vous éclairer notre Mission d’information ?
M. Patrick Letailleur. À titre personnel, je ne pense pas que relever de 130 à 140 km/h la vitesse maximale sur autoroute aurait un intérêt du point de vue de la sécurité routière. Aujourd’hui, il existe déjà un seuil de tolérance de 5 % qui fait qu’on peut déjà rouler à 137 km/h sans être sanctionné.
M. le président Armand Jung. Merci, madame et messieurs, pour cet échange.
*
* *
Audition de M. Marc Bertrand, chargé de mission sécurité routière, MM. Frédéric Roy et Nathanaël Gagnaire, membres du bureau national à la Fédération française des motards en colère (FFMC)
M. le président Armand Jung. Je suis particulièrement heureux de recevoir une délégation de la Fédération française des motards en colère. Les conducteurs d’engins à deux roues, motorisés ou non, paient un lourd tribut à la route.
Messieurs, je compte sur votre témoignage pour nous éclairer sur ce qui se passe sur le terrain et pour dissiper certaines idées reçues.
M. Frédéric Roy. Merci de votre invitation. Nathanaël Gagnaire et moi-même sommes membres du bureau national de la Fédération française des motards en colère ; Marc Bertrand est, quant à lui, salarié, membre du secrétariat national, en charge de la sécurité routière.
Notre bureau national est composé de huit personnes, élues par les quatre-vingt antennes départementales, pour un mandat de trois ans. La Fédération emploie cinq salariés : un délégué général, un chargé de mission sécurité routière, une coordonnatrice juridique et deux secrétaires.
La FFMC est surtout connue du grand public pour ses positions contestataires et ses manifestations. Mais son action va bien au-delà. Depuis trente ans, son objectif est de défendre les usagers des deux ou trois roues motorisés, du cyclomoteur au gros cube.
Les motards ont créé les structures dont ils avaient besoin pour les représenter : outre la FFMC, une maison d’édition qui publie Moto Magazine, numéro 1 de la presse moto en France, pour faire connaître les actions de la FFMC et transmettre des messages, notamment de sécurité routière ; l’Assurance Mutuelle des Motards, créée dans les années quatre-vingt, aujourd’hui numéro 2 de l’assurance moto en France et le premier assureur spécialisé en ce domaine ; l’Association pour la formation des motards, qui regroupe des moto-écoles et organise, entre autres, des stages de perfectionnement à la conduite.
En matière de sécurité routière, notre Fédération prône la formation et le continuum éducatif. Nous organisons des interventions auprès des plus jeunes, mais aussi auprès des motards ayant déjà le permis, pour les sensibiliser à la sécurité routière et les amener à corriger certaines mauvaises pratiques.
La FFMC Loisirs est une structure destinée aux jeunes, regroupant des centres de vacances ou des associations autour de la pratique du cyclomoteur. Elle organise des opérations de sensibilisation à la sécurité en deux roues, à l’entretien du cyclomoteur, au port des vêtements de sécurité, etc.
La FFMC accueille deux commissions assez importantes : la commission juridique, qui apporte un soutien juridique à nos adhérents en cas d’accidents ou de verbalisations abusives ; la commission à l’éducation routière de la jeunesse, de création plus récente, qui a mis en place, à destination de nos militants, des formations d’intervenants dans les établissements scolaires. En effet, c’est en pratiquant au quotidien que l’on peut se rendre compte des problèmes qui surgissent sur la route ; en partageant notre expérience, nous espérons contribuer à faire baisser la sinistralité en cyclomoteur. Il y a deux ans, ce type de formations, organisé tout au long de l’année, a reçu l’agrément de l’Éducation nationale. Aujourd’hui, 160 intervenants sillonnent la France.
M. le président Armand Jung. Monsieur Roy, les bruits les plus divers circulent à propos des motards : ils rouleraient trop vite et ne respecteraient rien. En tant que parlementaires, nous aimerions découvrir où est le problème, car les drames sont nombreux. Nous avons besoin de connaître votre expérience. N’hésitez pas à nous parler franchement. De nos discussions pourraient naître des propositions, susceptibles d’être reprises par le Gouvernement ou par le Parlement.
M. Frédéric Roy. Je vais passer la parole à Marc Bertrand, qui a participé pendant deux ans à la concertation sur les engins deux-roues motorisés, engagée par Michèle Merli quand elle était encore Déléguée interministérielle à la sécurité routière.
M. le président Armand Jung. Le communiqué que vous avez publié au moment de son départ était très élogieux, alors même que vos relations n’avaient pas toujours été au beau fixe. Je vous en félicite.
M. Marc Bertrand. Cette concertation nationale sur les deux-roues motorisés a été animée en effet, à partir de juin 2009, par la Délégation interministérielle à la sécurité routière. Initiée par Mme Michèle Merli, elle faisait suite au rapport du préfet Guyot, à l’époque préfet des Deux-Sèvres…
M. le président Armand Jung. Nous venons de l’auditionner.
M. Marc Bertrand. Le rapport Guyot, qui comptait 280 pages, fut le premier rapport gouvernemental français sur la sécurité des deux-roues motorisés. On peut d’ailleurs s’étonner qu’il ait fallu attendre 2008 pour un tel rapport, alors que ce mode de transport est pratiqué en France depuis des dizaines d’années.
Je reconnais néanmoins que l’usage des motos s’est profondément modifié ces dix dernières années. Le parc s’est accru de 60 %. 50 % des personnes circulant en deux-roues motorisés entendent ainsi faciliter leurs déplacements quotidiens dans les grandes agglomérations. Mais les nouveaux pratiquants ne sont pas tous formés comme il le faudrait et des conflits surgissent avec les autres usagers, essentiellement les automobilistes. C’est ce que les chercheurs en sécurité routière appellent des « incidences entre les différents usages ».
Les automobilistes, de leur côté, ne sont pas formés à la coexistence avec les conducteurs de deux-roues qui, à Paris, représentent déjà 15 % du trafic. Chacun d’entre nous se souvient d’avoir été doublé par un motard qui roulait très vite, que l’on n’avait pas vu arriver, qui remontait les files, etc. Bien des fantasmes persistent, notamment chez ceux qui n’ont aucune expérience des deux-roues et ne savent pas comment ils se déplacent.
Au sein de la concertation à laquelle nous avons participé pendant deux ans, nous avons travaillé avec des assureurs, avec les chercheurs de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), aujourd’hui rebaptisé Institut français des sciences et des technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) – né de la fusion entre l’INRETS et le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) – ainsi qu’avec les fonctionnaires du Centre d’études sur les réseaux et techniques de l’urbanisme (CERTU). Avec ces derniers, nous avons étudié, notamment, comment rendre les infrastructures routières moins dangereuses pour les usagers de deux-roues. Nous avons également travaillé avec des représentants d’associations, en particulier les associations dites de sécurité routière : Prévention routière, Ligue contre la violence routière, « Victimes et Citoyens », etc.
M. le président Armand Jung. Je vais devoir vous interrompre et vous demander d’aller droit au but. Devant le nombre des accidents, la mission d’information souhaiterait que vous nous disiez quels problèmes vous rencontrez, et que vous nous fassiez des propositions.
M. Marc Bertrand. Les deux-roues motorisés sont insuffisamment pris en compte dans la circulation, tant au niveau des infrastructures que de la formation des automobilistes. En outre, les représentants des pouvoirs publics voient davantage les deux-roues motorisés comme un inconvénient que comme un avantage, alors qu’ils facilitent la mobilité dans les grandes villes ; moi-même, je mets trois fois moins de temps pour me rendre à mon travail, de banlieue à banlieue, que si j’empruntais les transports en commun.
M. le président Armand Jung. De fait, le rapport du préfet Guyot a établi que l’infrastructure routière n’était pas conçue pour les deux-roues, motorisés ou non. Mais nous n’en savons pas davantage. Pourriez-vous être plus précis ?
M. Nathanaël Gagnaire. Il est fréquent d’entendre dire que les deux-roues motorisés sont un moyen de locomotion dangereux. De notre côté, nous disons que c’est un moyen de locomotion qui rend les conducteurs vulnérables. Concrètement, si deux voitures s’accrochent à un feu rouge, l’accident se limite le plus souvent à de la tôle froissée. Si vous remplacez une des voitures par un deux-roues motorisé, l’accident devient beaucoup plus grave et le motard risque de se retrouver à l’hôpital. Or cette vulnérabilité n’est pas prise en considération par les pouvoirs publics. Par exemple, voici très longtemps que nous demandons, en vain, une défiscalisation pour les équipements adaptés à la conduite des deux-roues motorisés.
M. le président Armand Jung. Les cyclistes demandent également un taux de TVA adapté pour les équipements de sécurité. Mais dites-nous donc de quoi les motards doivent s’équiper.
M. Nathanaël Gagnaire. D’abord du casque, qui est indispensable et obligatoire. Seulement, les casques coûtent très cher et, pour l’instant, ils sont toujours taxés à 19,6 %. Ensuite, du blouson, du pantalon, des bottes et des gants. Mais les pouvoirs publics n’ont pas de politique incitant au port de ces équipements et ne prévoient pas de mesure d’incitation fiscale pour leur achat.
Quant au gilet ou à tout autre équipement permettant au motard d’être mieux repéré, ils n’apporteront absolument rien en matière de sécurité, dans la mesure où un deux-roues motorisé est déjà éclairé par l’allumage obligatoire de ses feux, et repéré grâce à certains dispositifs réfléchissants comme les autocollants apposés sur son casque.
M. le président Armand Jung. Et le gilet airbag ?
M. Marc Bertrand. Ce gilet permet de réduire les blessures en cas de chute, mais n’empêche pas l’accident. Il ne se déclenche, d’ailleurs, qu’en cas de chute, après l’accident. En outre, à la suite d’un choc frontal ou latéral contre une voiture, le corps touche le véhicule en 90 millisecondes, alors que le gilet le plus rapide ne se gonfle qu’au bout de 120 millisecondes.
Il coûte en moyenne 500 euros. Ceux qui l’adoptent sont déjà majoritairement équipés et possèdent une culture de sécurité routière. Ainsi, le gilet airbag ne concernera que les motards les moins exposés aux accidents, et pas ceux qui ne possèdent pas cette culture : les jeunes, les nouveaux utilisateurs, les urbains qui passent de l’auto ou du scooter à la moto de 125 cm3.
Il faut absolument convaincre tous les automobilistes que les motards ne sont pas des sauvages qui roulent trop vite et sont responsables de leurs propres accidents, mais des conducteurs vulnérables à l’égard desquels il convient de redoubler d’attention. La formation ne suffira pas : les pouvoirs publics, les assureurs et les associations devront mener des campagnes en ce sens. Le problème est que, dans cette chaîne, les pouvoirs publics constituent le maillon faible. J’en veux pour preuve les annonces du Conseil interministériel de la sécurité routière du 11 mai dernier, qui ont fait beaucoup de bruit, mais n’apportent que de mauvaises réponses à de bonnes questions.
Un exemple avait été mis en avant par le rapport Guyot : pour les pouvoirs publics, le port d’un gilet haute visibilité ou l’apposition de dispositifs réfléchissants résoudrait le problème de visibilité des motards. Or les chercheurs de l’INRETS ont démontré que les motards n’étaient pas invisibles, mais que les automobilistes ne les voyaient pas, parce qu’ils ne les cherchaient pas dans la circulation. Concrètement, un gilet fluorescent ne protégera pas un motard si un automobiliste décide de faire demi tour pour prendre une place sur le trottoir d’en face.
Un automobiliste peut circuler avec un kit mains libres. On sait pourtant qu’une oreillette mobilise les mêmes zones du cerveau…
M. le président Armand Jung. Seriez-vous opposés au kit mains libres pour les motards ?
M. Marc Bertrand. Notre position est la suivante : on ne téléphone pas quand on conduit. Maintenant, la FFMC, par tradition, n’est pas pour les clivages « pour ou contre ». Si elle devait se prononcer, ce serait en faveur de la formation et de la sensibilisation.
Il est possible de réduire la mortalité en moto. Je rappelle que la baisse de mortalité a été plus importante, ces quarante dernières années, pour les usagers des deux-roues motorisés que pour tous les autres usagers. Sur les six premiers mois de 2010 analysés par l’Observatoire interministériel de la sécurité routière, elle a été de 29 % pour les motards, 16 % pour les cyclomotoristes et de seulement 6 % pour les automobilistes. Il faut que chacun s’approprie la culture de la sécurité routière. Bien sûr, cela suppose un travail de très longue haleine, sans doute peu compatible avec les impératifs électoraux.
Mais revenons à la visibilité. On veut nous faire porter un gilet fluorescent en nous disant que cela va nous protéger, alors qu’il n’y a plus de lumière sur certaines voies extrêmement dangereuses ! C’est le cas, depuis un an, sur les voies rapides urbaines d’Ile-de-France. Le motard ne voit rien sur une bretelle de sortie non éclairée, avec un seul phare. Et on ne peut pas le voir s’il doit s’arrêter au bord de la chaussée, par exemple à la suite d’une crevaison : en effet, le gilet de haute visibilité avec des bandes rétro-réfléchissantes n’a d’utilité que dans l’éclairage direct des phares, mais pas sur le côté.
Connaissez-vous la récente campagne lancée par les sociétés d’autoroutes où leurs agents posent sur des affiches avec un cône sur la tête, un gilet fluorescent et un tutu ? Le slogan est le suivant : « Que faudra-t-il faire pour qu’on nous voie ? » Ils ne sont pas invisibles, pourtant. Mais il faut apprendre aux conducteurs à partager la route.
M. Frédéric Roy. Pour que les motards se sentent impliqués et prêtent une oreille attentive quand on leur parle de sécurité routière, il faut arrêter de les pointer du doigt à toute occasion. Comme l’a dit Marc Bertrand, sur les six premiers mois de l’année dernière, la baisse de la mortalité en moto a été de 29 %. Cette année-ci, nous avons eu du mal à faire mieux. Les chiffres de 2011 étant mauvais, on a incriminé les motards.
La sécurité routière doit se faire avec l’usager de la route et non pas contre lui. En outre, dès qu’il s’agit des deux-roues, en cas d’accident, on a tendance à confondre victimes et coupables. C’est comme si, lorsque des enfants meurent noyés dans une piscine, on disait que ces enfants font n’importe quoi. Le problème n’est pas du côté des victimes, mais du côté des responsables des accidents.
M. le président Armand Jung. Monsieur Roy, ni M. Houillon, le rapporteur, ni moi-même n’entendons stigmatiser les motards. Nous voulons aller au fond des choses, comprendre où le bât blesse, pour tenter d’améliorer la situation.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur Bertrand, j’ai deux questions à vous poser. Premièrement, pourquoi avez-vous quitté la concertation ouverte entre 2009 et 2011 ? Deuxièmement, êtes-vous favorables à la réactivation du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) qui n’a pas été réuni depuis 2008 ?
M. Marc Bertrand. Nous n’avons pas quitté la concertation. Nous avons claqué la porte d’une réunion, alors que se préparaient les annonces du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) et que M. Claude Guéant, après avoir reçu les associations de prévention routière, avait fait des déclarations allant à l’encontre de ce qui s’était dit dans le cadre de la concertation. Par exemple, le 11 février, au cours d’une conférence de presse, il avait prétendu n’être pas compétent sur la question de la légalisation de la circulation interfiles dans les embouteillages, alors que l’on y travaillait depuis deux ans. Notre départ était une façon de dire à Mme Merli que nous étions d’accord pour discuter mais que, dans ces conditions, il fallait nous écouter.
Cela dit, la FFMC a toujours été favorable à la concertation avec les pouvoirs publics. Depuis trente ans, notre fédération occupe les champs que les pouvoirs publics ont laissés vacants en matière de connaissance des deux-roues motorisés. Lorsque nous discutons avec les fonctionnaires, ils reconnaissent notre expertise et nous croisons souvent nos analyses pour arriver aux mêmes conclusions. Mais nous voudrions être entendus des politiques et nous souhaiterions que les annonces qui sont faites en matière de sécurité routière soient au moins représentatives des échanges qui ont eu lieu préalablement.
M. Frédéric Roy. Il y a quelques années, la FFMC a fait partie du CNSR. Malheureusement, ce conseil a été détourné de son objectif premier, qui était de faire des propositions en matière de sécurité routière. Au fur et à mesure, nous avons eu l’impression qu’il ne servait plus qu’à valider les décisions politiques prises en ce domaine.
C’est un peu ce qui se passe en matière de concertation, où l’on ne tient pas compte de notre avis, ni des explications avancées par les chercheurs sur les causes des accidents. À quoi peut servir cette concertation quand les décisions politiques n’ont aucun rapport avec ce qui s’est dit ? Car c’est bien ce qui s’est passé lors des deux derniers CISR, qui se sont prononcés pour le contrôle technique des cyclomoteurs, puis pour le port de gilets fluorescents, pour des plaques d’immatriculation plus grandes et, enfin, pour une formation en cas d’interruption de la conduite d’un deux-roues.
Maintenant, pourquoi ne pas réactiver le CNSR ? Reste à savoir dans quel objectif.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Il ne s’agit pas de stigmatiser les pilotes de motos, mais de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Nous attendons que vous nous apportiez des explications, pour que nous puissions, de notre côté, proposer des solutions.
D’abord, je remarque que le parc des deux-roues représente près de 2 % des véhicules, et un peu moins de 30 % des accidents. Statistiquement, les dépassements de vitesse sont plus souvent le fait des motards que des automobilistes. Depuis des années, la réduction du nombre de tués est beaucoup plus importante dans toutes les autres catégories d’usagers de la route : sur la période 2002-2009, 43,3 % pour les piétons ; 28,2 % pour les cyclistes ; 56,1 % pour les véhicules légers et 13,7 % pour les motards. Nous avons entendu dire que des mesures concernant les motos permettraient de sauver 300 vies et d’éviter 500 handicaps par an, ce qui n’est pas rien.
Tous les députés, qui font beaucoup de voiture, ont constaté que de nombreux motards effectuaient des dépassements à des vitesses excessives. Or il semble difficile de contrôler la vitesse des motos, notamment avec les radars : d’où l’impression d’une certaine impunité. Le CISR a donc proposé que l’on augmente la surface des plaques pour mieux identifier les motos et contrôler leur vitesse. Tout semble prouver que la circulation en deux-roues motorisés pose des problèmes spécifiques – ce qui ne signifie pas qu’il faille incriminer les motards.
Ensuite, j’ai été frappé par une campagne publicitaire qui a été lancée sur le thème : « partager la route ». Les affiches placardées à cette occasion représentent un motard entre deux files de véhicules, comme je le vois tous les jours sur l’A15. Le problème est que ces affiches légalisent, d’une certaine manière, un type de déplacement qui ne me semble pas autorisé actuellement par le code de la route. Ce type de déplacement ayant tendance à s’amplifier, notamment dans les régions urbaines, que préconisez-vous ?
Enfin, j’ai appris qu’il y aurait aujourd’hui 1 960 radars fixes dans notre pays. Pour tenir compte des lieux les plus accidentogènes, il en faudrait, paraît-il, entre 4 500 et 5 000. Qu’en pensez-vous ?
M. Nathanaël Gagnaire. Je veux bien admettre, monsieur le rapporteur, qu’il n’y ait pas, de votre part, d’intention de stigmatiser les motards. Pourtant, j’ai remarqué que vous aviez parlé des « pilotes » de motos. Or les usagers de deux roues motorisés sont des conducteurs comme les autres, au même titre que les automobilistes.
J’ai observé également que votre intervention était principalement basée sur le contrôle de la vitesse, ou sur le fait que les accidents étaient principalement dus à la vitesse, alors qu’un accident est un phénomène multifactoriel. La politique du Gouvernement, en matière de lutte contre l’accidentalité, se focalise, de la même façon, sur les excès de vitesse, alors que nous préférerions que l’on mette l’accent sur la formation, s’agissant notamment des remontées de files.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Que proposez-vous ?
M. Nathanaël Gagnaire. Par exemple, quand des voitures sont ralenties sur un périphérique, nous préconisons que les deux-roues motorisés puissent remonter la file, avec un différentiel n’excédant pas 20 km/h.
M. Marc Bertrand. Je précise que si nous souhaitons la légalisation de la circulation interfiles, c’est afin de pouvoir l’enseigner. Vous vous êtes demandé si ce mode de déplacement était ou non légal. En fait, nous sommes face à un vide juridique : le code de la route ne le prévoit pas – pas plus qu’il ne prévoit les embouteillages récurrents, deux fois par jour, sur certains axes.
Il s’agit d’une circulation en décalé entre les voitures et les nombreux fourgons, qui masquent la visibilité. En effet, sur une moto, encore plus qu’en voiture, il est particulièrement important de voir très loin. N’oubliez pas qu’on conduit une moto en équilibre. Cet équilibre est autostabilisé dès les plus basses vitesses, mais les anticipations aux freinages, aux accélérations et aux changements de chaussée dépendent essentiellement de la visibilité.
Quoi qu’il en soit, nous avons déterminé, avec les services de la Direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR), quatre cas de figure : la circulation complètement arrêtée ; la circulation fortement ralentie ; la circulation dense mais roulante ; la situation normale. La remontée de files n’est envisageable que dans le cas du trafic totalement arrêté ou très fortement ralenti, avec des phénomènes d’accordéon.
Reconnaître cette possibilité de circulation interfiles permettrait de l’enseigner. Nous nous sommes aperçus que bien des motards la pratiquaient de façon dangereuse. Je suis moi-même très souvent obligé de me pousser, parce qu’un deux-roues roule trop près derrière moi et risque de me percuter, si je dois éviter un automobiliste qui change lui-même de file. Une formation permettrait d’apaiser cette pratique de la circulation interfiles, et amènerait les motards à prendre conscience des risques.
Plus généralement, rouler en deux-roues motorisé entraîne des risques qu’on ne fera jamais disparaître. Mais on peut enseigner ces risques, comme on le fait pour la plongée sous-marine ou la course en montagne.
Cela suppose d’abandonner le discours qui consiste à dire : vous faites de la moto, c’est dangereux et si vous avez des accidents, vous en êtes responsables. De fait, on s’est aperçu que la faute du motard était inférieure à la faute, même non intentionnelle, de l’automobiliste. Il s’agit le plus souvent d’une faute d’inattention. En outre, le rapport MAIDS montre que la majorité des accidents en moto intervient à moins de 50 km/h, ce qui confirme que les risques en moto ne sont pas ceux qui sont mis en avant dans les communications publiques.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je reste un peu sur ma faim, car je n’ai pas obtenu de réponses précises à des questions précises. Par définition, l’accident qui survient à une vitesse plus ou moins importante aura, pour un motard, des conséquences immédiatement graves.
Ne considérez-vous pas comme normal que l’ensemble des usagers, les motards et les autres usagers, soit soumis aux mêmes contrôles, et que les contrôles soient adaptés en fonction des modalités de déplacement ? Ne doit-on pas faire en sorte de résoudre les problèmes techniques qui s’opposent au contrôle de vitesse des motos ? Les motards n’ont-ils pas le sentiment que leur vitesse est moins décelable et qu’ils seront donc moins contrôlés ? Aujourd’hui, nous voyons très rarement des voitures rouler à des vitesses très importantes. Or c’est encore le cas des motos – sans que cela soit général. Pourquoi ?
M. Henri Nayrou. Quelles solutions préconisez-vous pour compenser le manque de visibilité des motards sur la route ? Des flash ou des points fluorescents sur les motos ?
Considérez-vous le deux-roues comme un véhicule comme les autres ou pas ? Dans le premier cas, les motards doivent rouler au milieu de la voie de droite, comme n’importe quel engin à quatre roues. Dans l’autre, on admet les remontées de files de voitures arrêtées, ce qui est assez risqué.
M. Jean-Marc Roubaud. Pour permettre les contrôles radars, les plaques minéralogiques des motos doivent être visibles. Je suppose que vous n’y êtes pas opposés ?
M. Marc Bertrand. Les plaques homologuées permettent déjà le contrôle/sanction automatisé. Le problème vient de quelques motards, minoritaires, qui utilisent des plaques très petites, ou horizontales. Il vient aussi du système de verbalisation robotisé qui a été mis en place ; un contrôle avec des policiers et des gendarmes au bord des routes suffirait sans doute à cadrer les comportements les plus transgressifs.
M. Jean-Marc Roubaud. Améliorer la visibilité des vêtements ou des accessoires, comme les casques, ne peut être que positif, même si, je le reconnais, le port du gilet jaune ne constitue pas la bonne solution.
Il faut bien admettre, par ailleurs, que les deux-roues doublent fréquemment en ville, ce qui est interdit, changent de file ou remontent les files. Il serait temps de régler le problème.
Je remarque, en dernier lieu, qu’un même argument, lié au prix, a été avancé au moment de l’installation des premiers airbags sur les Audi ou les Mercedes. Mais, aujourd’hui, la moindre Twingo en est équipée : leur prix a diminué fortement, du fait de leur généralisation. Seriez-vous opposés à une mesure imposant des airbags sur toutes les nouvelles motos qui sortent, ou à partir d’une certaine cylindrée ?
M. Philippe Meunier. Je suis motard depuis 1984. Tous les accidents que j’ai eus étaient dus à des véhicules qui n’avaient pas respecté la réglementation : un camion qui avait déversé son gas-oil sur la chaussée ou une voiture qui m’avait coupé la route… Malgré tout, je me rends compte que celui qui vient d’obtenir son permis moto n’a pas la même approche de la route qu’un motard exercé. Je me demande aussi si l’on ne confie pas trop tôt des machines trop puissantes aux détenteurs du permis. Ne conviendrait-il pas de réduire les puissances autorisées ou d’exiger une certaine expérience avant de pouvoir conduire un véhicule d’une cylindrée supérieure ?
Connaissez-vous le nombre des accidents par rapport au nombre de kilomètres parcourus, s’agissant des conducteurs de deux-roues ?
Je remarque enfin que la France manque cruellement de circuits, qui permettent aux motards de perfectionner leur conduite et d’utiliser le potentiel de leurs deux-roues. Quand les motards sortent de ces circuits, ils roulent plus tranquillement. Considérez-vous comme une priorité d’aménager des circuits dans les grandes agglomérations ?
M. Dominique Raimbourg. Vous vous êtes déclarés favorables à une formation continue. Êtes-vous donc partisans de stages organisés régulièrement ? Si oui, qui devra les financer ?
M. Jacques Myard. Comment analysez-vous la mauvaise entente qui règne entre les motards et les autorités publiques ? Il faut bien constater que le nombre des décès dus à des accidents de motos est très élevé. En tant qu’automobilistes, nous sommes souvent témoins d’imprudences caractérisées de la part des motards.
M. Marc Bertrand. Plusieurs personnes nous ont interrogés sur la visibilité des motards. Le manque de visibilité est en effet un élément majeur des accidents de moto, relevé par le rapport Guyot : dans 84 % des cas, l’automobiliste n’a pas perçu le motard dans son environnement. D’où la nécessité d’une formation et du port d’équipements adaptés. Pour autant, on ne voit pas ce que l’on ne s’attend pas à voir.
Les chercheurs de l’INRETS nous ont parlé du phénomène de « l’homéostasie du risque » : une sorte de recherche d’équilibre inconscient de la part du conducteur qui fait que, plus il se sent protégé, plus il relâche sa vigilance. Aujourd’hui, les voitures sont très sures ; on conduit vitres fermées grâce à la climatisation ; on écoute la radio ; on peut éventuellement avoir une conversation téléphonique ; on se laisse piloter par son GPS… et on ne voit pas le motard.
L’automobiliste perd toute sensation de vulnérabilité et de danger – à la différence du motard – et devient inattentif. D’ailleurs, le premier facteur d’accident sur les autoroutes, aujourd’hui, est l’hypovigilance. Le problème lié au manque de visibilité mériterait donc d’être travaillé en relation avec l’accroissement de la sécurité dans les véhicules.
Maintenant, je tiens à préciser que les airbags dont nous parlons ne sont pas installés sur les deux-roues, mais portés par leurs conducteurs.
M. le président Armand Jung. Confirmez-vous que ces blousons airbag coûtent 500 euros ?
M. Marc Bertrand. Ils coûtent entre 400 et 600 euros, selon les systèmes.
M. le président Armand Jung. Le blouson airbag est-il un équipement d’avenir ?
M. Marc Bertrand. Oui, dans la mesure où il est adopté librement par le conducteur de deux-roues. Mais pourquoi en faire une obligation, alors même que l’équipement de base n’est pas porté par tout le monde ?
Cet équipement de base est le suivant : des chaussures montantes ou des bottes ; des vêtements solides, même quand il faut très chaud ; un blouson renforcé avec une dorsale intégrée ; des gants et un casque – intégral ou jet, du moment qu’il est bien attaché et que les yeux sont protégés.
M. le président Armand Jung. Pratiquement personne ne porte tout cela. Pourriez-vous nous faire la liste de ce que vous considérez comme constituant l’équipement de sécurité de base ? Nous demanderons d’ailleurs la même chose aux cyclistes ou à d’autres usagers. Si le Gouvernement ou le Parlement devait prendre des décisions en la matière, il faudrait que nous sachions sur quoi nous appuyer.
M. Nathanaël Gagnaire. Plusieurs d’entre vous ont mis en cause le comportement des usagers de deux-roues motorisés. De notre côté, nous dénonçons, depuis très longtemps, le manque de formation, notamment dans les grandes villes – auto-écoles surchargées, cours très difficilement assurés, un moniteur pour 5, 6, 7 motos, voire davantage. Ces problèmes de formation, qui ne sont pas pris en compte par les pouvoirs publics, se traduisent logiquement, sur le terrain, par les problèmes de comportement auxquels vous faites référence.
Rendre obligatoire le port des blousons airbag entraînerait une certaine déresponsabilisation des usagers qui, une fois équipés, se diraient qu’ils ne risquent rien à tomber. Il faut au contraire les responsabiliser. À l’obligation, nous préférons l’incitation.
Nous sommes évidemment favorables aux circuits, qui constituent des lieux où un motard peut développer la pleine puissance de sa machine en toute sécurité – éventuellement avec des formateurs. Je précise que la Fédération française de motocyclisme (FFM) organise des journées portes ouvertes de circuits, qui remportent un très grand succès.
Monsieur Myard, la mauvaise entente entre les motards et les autorités s’explique par une réelle incompréhension. Par exemple, depuis le début de cette audition, on a surtout parlé des deux-roues motorisés dans les grandes villes, notamment en Ile-de-France. Mais les motards ne se contentent pas de rouler sur le périphérique. Le week-end, ils vont à la campagne, où ils sont confrontés à différents problèmes : gravillons sur les routes, infrastructures inadaptées.
Revenons à la question des plaques d’immatriculation. Pourquoi devraient-elles être plus grandes ? Pour que les motards puissent se faire flasher par les radars ! Encore une fois, cela sous-entend un problème de vitesse. Or, comme l’a précisé le rapport MAIDS, la majorité des accidents en deux-roues motorisés se produit entre zéro et 50 km/h. On se focalise donc sur un non problème.
De la même façon, le Gouvernement a voulu instaurer un contrôle technique. Mais il ressort clairement du même rapport que l’état du véhicule n’intervient que pour 0,7 % des cas dans les accidents. Le contrôle technique n’aurait donc aucun effet en matière de sécurité routière. S’intéresser à l’état du véhicule paraît logique mais, encore une fois, c’est un faux problème, auquel on propose une mauvaise solution.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Estimez-vous normal que toutes les catégories de conducteurs subissent les mêmes contrôles, y compris de vitesse ?
M. Marc Bertrand. Oui. Mais il se trouve que les motards sont soumis à davantage de contrôles que les automobilistes et font l’objet de contrôles ciblés. Par exemple, depuis le printemps, de véritables souricières ont été mises au point : des CRS dirigent les motards sur une aire de contrôle ou de stationnement des bus et saisissent toutes les occasions possibles de les verbaliser : un échappement bruyant ou non conforme ; conforme mais pas homologué pour la moto, etc. Les forces de l’ordre verbalisent parfois « au doigt mouillé », quand elles considèrent qu’une vitesse est inadaptée en raison des circonstances ou qu’un pot est trop bruyant, sans utiliser de radar ou de sonomètre. Ces pratiques donnent lieu à des procès-verbaux abusifs, que nous contestons ensuite devant les tribunaux.
M. le président Armand Jung. Je suis un fidèle lecteur de Moto Magazine. Vous nous reprochez parfois de stigmatiser les motards. Mais vous êtes vous-mêmes franchement « paranos », si j’en crois l’article sur le dernier sondage motard, publié dans le numéro de juillet-août. Cela dit, nous ne demandons pas mieux que de nous exprimer dans votre revue, ce qui permettrait d’équilibrer les points de vue.
Messieurs, je vous remercie pour votre contribution.
*
* *
Audition de MM. Loïc Ratier, président, Fabien Pierlot, vice-président, Jean-Georges Schwartz, trésorier, David Roizen,et Yves-Paul Robert, chargés de mission et M. Laurent Bernard, porte-parole de l’Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d’aides à la conduite (AFFTAC)
Mercredi 29 juin 2011
M. le président Armand Jung. Nous accueillons à présent les représentants de l’Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d’aide à la conduite (AFFTAC), sur lesquelles nous avons beaucoup d’interrogations, en particulier sur l’efficience des matériels existants.
M. Loïc Ratier, président de l’Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d’aide à la conduite. L’AFFTAC a été créée à la suite du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011, par Fabien Pierlot, Georges Schwartz et moi-même qui représentons les sociétés Coyote System, Inforad et Wikango. Ces dernières, tout comme leurs utilisateurs, ont en effet été très étonnées d’être montrées du doigt au travers des décisions du CISR, et leur première réaction a été de penser que, finalement, leur technologie était méconnue.
Nos appareils ne sont en effet pas que des avertisseurs de radars – leur dénomination première, il est vrai. Comme nous essayons de le faire comprendre depuis un mois et demi, les technologies ont évolué.
Nos produits ont émergé sur le marché à l’époque où les radars fixes ont été installés dans des zones dangereuses signalées par les systèmes GPS. Finalement, ils ont signalé ces zones de la même façon que le faisaient les panneaux installés avant les radars.
Ensuite, nos produits ont évolué. Outre ces zones de radars, ils ont pu intégrer, via Internet, des zones accidentogènes, recensées par les utilisateurs. Puis ils ont signalé les limitations de vitesse : dans un premier temps, sur les zones de radar ; dans un deuxième temps, sur les zones de danger ; puis, comme c’est le cas aujourd’hui, sur l’ensemble du réseau routier.
En reposant, d’abord, sur la technologie GPS (global positioning system), puis à présent également sur le GSM (global system for mobile communications), nos produits permettent à nos utilisateurs de former une communauté et d’échanger – en temps réel – des informations. Chaque utilisateur peut informer les gens qui roulent en même temps que lui et connectés sur le même serveur des perturbations (un embouteillage, par exemple), des incidents ou des dangers (comme la présence d’un patrouilleur) qui peuvent survenir sur la route. En signalant des informations beaucoup plus rapidement que tout autre service, ce type de technologie contribuera, demain, à la sécurité routière.
Aujourd’hui, la voiture communicante émerge au travers de modèles très haut de gamme et très chers, en l’occurrence allemands. Nos technologies proposent les mêmes services, puisqu’elles peuvent être embarquées sur des véhicules, mais à des prix abordables, et pourront être embarquées sur l’ensemble des véhicules à l’avenir.
M. Guéant nous a parlé de la sécurité. Nous avons mis en avant certaines fonctionnalités intéressantes de nos produits. Par exemple, nos utilisateurs, qui sont munis d’un boîtier connecté et suivis par nos serveurs, peuvent être identifiés s’ils roulent sans interruption depuis deux heures.
M. le président Armand Jung. Le même boîtier offre-t-il plusieurs fonctionnalités ? Et quelles sont celles en faveur de la sécurité routière ?
M. Fabien Pierlot, vice-président de l’AFFTAC. Notre système est une plateforme de contenus permettant de relayer des informations en temps réel à l’ensemble des utilisateurs.
Aujourd’hui, nous affichons en permanence les limitations de vitesse.
Nous avons passé un accord avec les sociétés d’autoroute pour que les accidents, les bouchons et la présence des patrouilleurs soient relayés en temps réel entre eux et nous. Ainsi, lorsqu’un utilisateur constate un accident qui vient de se produire, il appuie sur le bouton du boîtier ; puis la société d’autoroute récupère instantanément cette information, la relaie auprès de ses services qui la dirigent vers les panneaux d’affichage.
M. le président Armand Jung. C’est un geste volontaire, alors que la détection des radars est automatique avec vos boîtiers.
M. Fabien Pierlot. Tout à fait, mais les sociétés d’autoroute nous informent également de l’existence d’un bouchon qui vient de se produire.
En outre, nos produits diffusent des messages sonores de sécurité routière du type « mettez votre ceinture de sécurité », « attention à l’alcoolémie », « vous roulez depuis plus de deux heures, la pause s’impose, ralentissez ».
Ils indiquent également l’aire de repos d’une autoroute la plus proche.
Ils préviennent les utilisateurs de leur entrée dans une zone école, avec un message indiquant « vous entrez dans une zone école limitée à 30 km/h, ralentissez ».
J’ajoute que nos produits pourront très prochainement diffuser des messages liés à l’hypovigilance – une des premières causes de mortalité en France. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement. Dans la mesure où nos systèmes communiquent en temps réel avec nos utilisateurs, ils sont en mesure de détecter, en fonction de la vitesse moyenne du véhicule, de sa situation, du temps de conduite et de l’heure, les conducteurs à risque. Si l’un d’eux roule à 130 km/h sur autoroute à deux heures du matin depuis trois heures, par exemple, nous pourrons lui envoyer des messages d’information du type « attention, vous êtes un sujet à risque », et l’obliger à appuyer sur le bouton à intervalles réguliers, par exemple tous les quarts d’heure, pour qu’il conserve sa vigilance au volant.
Ces messages sont à la fois vocaux et affichés sur écran.
M. le président Armand Jung. Dans votre équipement, le seul message automatique est donc le détecteur de radar.
M. Fabien Pierlot. Non, depuis trois ans, nous affichons en permanence par GPS les limitations de vitesse, les bouchons, les accidents, les travaux et la présence des patrouilleurs.
Dans six mois ou un an, tous nos produits seront équipés d’accéléromètres. Ceux-ci nous permettront de détecter, à la seconde près, un freinage ou une accélération brutale, ou encore un changement de voie, puis de remonter cette information à nos serveurs qui la relaieront aux sociétés d’autoroute et aux utilisateurs eux-mêmes. Nous ne ferons ni plus ni moins que ce que font aujourd’hui les constructeurs automobiles qui commencent à intégrer ces technologies : la communication en temps réel entre automobilistes et les accéléromètres qui permettent de détecter tous les mouvements du véhicule.
M. Jean-Georges Schwartz, trésorier de l’AFFTAC. Nos appareils n’ont pas fait autre chose que ce qu’avait décidé le gouvernement : nous avons prévenu nos utilisateurs de la présence d’un radar. Il ne faut pas se voiler la face : l’argument marketing « avertisseur de radar » était non négligeable.
Nos appareils ont beaucoup évolué technologiquement et leur confort d’utilisation est aujourd’hui sans commune mesure avec celui des appareils qui ont été posés, il y a peu encore, dans les automobiles. En effet, ils rappellent en permanence aux utilisateurs, par exemple, s’ils roulent au-dessus de 130 km/h, permettant ainsi d’éviter le risque d’endormissement.
La moyenne d’âge de nos utilisateurs se situe au-dessus de quarante ans. En clair, ce sont des gens qui n’ont pas envie de perdre des points à cause d’une minute d’inattention. C’est cela qui a permis à nos appareils de se vendre aussi bien.
M. David Roizen, chargé de mission à l’AFFTAC. Aujourd’hui, nos appareils permettent de détecter : des sections de voie accidentogènes identifiées par les services de l’État ; des sections de voie à fort trafic, en lien avec le calendrier de Bison Futé ; les obstacles au trafic (passages à niveau, chaussées rétrécies, traversées de voies de tramways) ; les passages dangereux (ponts, tunnels, fortes pentes, virages signalés dangereux) ; les lieux où se concentrent les publics fragiles (écoles, colonies de vacances, hôpitaux, maisons de retraite) ; les sources de danger temporaires : zones de travaux routiers, obstacles imprévisibles liés à une perte de chargement ou à la présence d’un animal, chaussées glissantes ou rétrécies, interventions d’exploitation en cours, dévoiements temporaires de chaussée, accidents ou embouteillages ponctuels.
M. le président Armand Jung. Qui vous donnent ces renseignements ?
En outre, les constructeurs s’intéressent-ils à vos appareils ?
M. Fabien Pierlot. Ces renseignements nous proviennent des deux cartographes qui localisent la voirie mondiale : Tele Atlas et Navteq. Ils nous vendent leurs informations sur les limitations de vitesse, les voies dangereuses, les descentes, les pentes, les virages dangereux.
Nous récupérons aussi ce type d’informations auprès des ministères chargés de la sécurité routière.
En fait, nous sommes passés d’un produit communicant – un avertisseur de radar – à une plateforme de contenus, dans laquelle peuvent être insérées un grand nombre d’informations en temps réel et automatiquement.
Quant aux constructeurs automobiles, nationaux ou européens, ils réfléchissent depuis dix ou quinze ans à ce type de service. Nous avons été un peu plus réactifs qu’eux ces six ou sept dernières années et travaillons aujourd’hui avec les marques Renault et PSA afin de leur apporter notre contenu. Ainsi, la technologie des constructeurs automobiles est identique à la nôtre et tend vers des contenus de type sécurité routière, mais aussi d’éco-conduite – nos outils permettant en effet de détecter des conducteurs qui freinent ou accélèrent trop.
J’y insiste : les deux points forts de nos produits dans les prochaines années seront l’éco-conduite et la sécurité routière.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Pouvez-vous nous parler de vos discussions actuelles avec M. Guéant ? Vers quoi votre accord se dirige-t-il ?
M. Yves Paul Robert, chargé de mission à l’AFFTAC. L’industrie des avertisseurs de radars est en train de se transformer en industrie des outils d’aide à la conduite. Ses représentants ont compris qu’elle devait désormais consacrer ses produits à la sécurité routière.
M. Guéant nous a informés, de manière assez transparente, de la décision du CISR de supprimer les panneaux indiquant la présence des radars fixes et mobiles, de la mise en place de radars pédagogiques, de l’évolution de la carte des radars puisque ceux-ci seront mis en place dans les zones dangereuses. Notre industrie est prête à se mettre en cohérence avec les décisions du Gouvernement, car les choses évoluent dans le bon sens. C’est une vraie mutation pour notre industrie : nous n’allons plus signaler les radars, mais les zones dangereuses.
M. le rapporteur. Les zones comportant des radars seront-elles incluses dans les zones dangereuses ?
M. Yves Paul Robert. D’après ce que nous avons compris, la cartographie des zones à risque ou des zones dangereuses en France est actuellement élaborée par les préfectures qui nous transmettront un certain nombre d’informations. Notre mission sera de signaler ces zones.
Il se trouve que la politique de cohérence du Gouvernement consiste à placer les radars dans les zones dangereuses. Y aura-t-il un radar dans chacune d’elle ? Ce n’est pas à nous de le déterminer.
Le succès de nos produits réside dans l’aspect communautaire, qui permet aux conducteurs d’être plus intelligents derrière leur volant grâce aux informations qui leur indiquent ce qui se passe 300 mètres devant eux. Ce principe d’intelligence collective ne doit pas être remis en cause.
Ainsi, nos produits continueront d’indiquer les zones dangereuses dans lesquelles pourront – ou pas – se trouver des radars.
M. le rapporteur. D’après mes informations, l’accord que vous êtes en train de conclure avec le ministère de l’intérieur prévoit que vous allez passer d’une signalisation radars à une signalisation de « zones à risque », lesquelles comprendront éventuellement des radars. Vos produits n’indiqueront donc plus directement l’emplacement des radars, mais l’entrée dans une zone à risque – le risque pouvant être le contrôle de la vitesse.
Vos utilisateurs pourront-ils alors signaler à la communauté, d’une part, l’emplacement, ou pas, d’un radar fixe ; d’autre part, la présence, ou pas, de radars mobiles ?
M. Jean-Georges Schwartz. En prenant l’engagement de signaler les zones à risque, nous nous sommes engagés à ne pas donner à la communauté le point précis d’un contrôle qui serait signalé par un utilisateur. Les zones ayant des longueurs définies – 4 kilomètres sur autoroute, 2 km hors agglomération et 300 mètres en ville –, les conducteurs auront largement le temps de réduire leur vitesse pour appréhender le danger dans la zone, par exemple un accident.
M. Yves Paul Robert. Nous ne signalerons plus des points précis, mais des zones à risque. Dans une zone de 4 kilomètres, 2 km ou 300 mètres – distances sur lesquelles nous sommes tombés d’accord avec le Gouvernement –, le danger peut se trouver n’importe où.
En outre, et cela est très important, nous ne qualifierons pas la nature du danger dans la zone.
M. le rapporteur. Si je comprends bien, une zone non répertoriée « à risque » le deviendra dès qu’un utilisateur vous signalera un radar mobile.
M. Yves Paul Robert. D’après les informations que nous fournit le ministère de l’intérieur, les contrôles mobiles ne s’effectueront plus uniquement dans les zones considérées comme dangereuses.
M. le rapporteur. Qu’en sera-t-il des systèmes intégrés dans les véhicules, c’est-à-dire fournis par les constructeurs ?
M. Fabien Pierlot. Le principe est le même.
Renault, avec laquelle nous travaillons depuis un an, a intégré une technologie identique à la nôtre. Nous sommes en relation commerciale avec cette entreprise et lui communiquons les informations que nous récoltons de notre communauté qui, de ce fait, s’agrandit.
Finalement, les constructeurs automobiles, les constructeurs d’assistants de navigation personnels (PND, personal navigation device) et les constructeurs de boîtiers comme les nôtres ont vocation à disposer d’un contenu de plus en plus fiable et pertinent pour communiquer ces informations à l’ensemble des usagers. C’est un challenge.
M. le rapporteur. Actuellement, les constructeurs vendent des voitures qui signalent les radars fixes. Qu’adviendra-t-il de ces équipements ?
M. Fabien Pierlot. Comme les nôtres, tous les systèmes existants des constructeurs seront mis en conformité afin de signaler les zones à risque en fonction des distances que j’ai citées.
Vous le voyez : la grande force de nos systèmes est de pouvoir évoluer en temps réel.
M. Yves Paul Robert. En fait, les constructeurs pourront mettre à jour leurs produits sans demander l’avis des utilisateurs. Ces derniers n’auront donc pas le choix : les produits communicants seront mis en conformité à distance et n’indiqueront plus les radars. C’est nous qui avons la main sur la mise à jour des produits, et cet argument important de la négociation a permis d’aboutir à un accord.
Pour les appareils non communicants, comme certains GPS, qui représentent une minorité du parc, deux options sont possibles. Soit ils seront mis à jour via Internet par les utilisateurs, à qui nous suggérerons de le faire pour que leur produit soit conforme. Soit ils disparaîtront mécaniquement du marché dans une période d’un an à deux ans, sachant que des avertisseurs de radar non mis à jour ne pourront plus être pertinents à la suite de l’évolution de la carte des radars et que nous prenons l’engagement de fabriquer des produits conformes à la réglementation dans un délai raisonnable de trois à quatre mois.
M. le rapporteur. Combien de véhicules sont équipés de ce genre de système ?
M. Fabien Pierlot. L’AFFTAC comptabilise 6,5 millions d’utilisateurs. Renault, pionnière dans cette activité, recense 1 million de véhicules.
Dans un avenir proche, tous les constructeurs intégreront cette technologie communicante. Elle va donc se démocratiser très vite.
M. le rapporteur. Où en est votre accord avec le Gouvernement ? Est-il sur le point d’être conclu ?
M. Yves Paul Robert. Nous ne voulons pas un accord a minima, mais un accord qui acte la reconnaissance de notre industrie – pour laquelle la France est leader mondial – comme un véritable partenaire de la sécurité routière. En luttant contre l’hypovigilance, qui est un des premiers facteurs d’accidents, nos produits peuvent en effet avoir un impact réel sur le nombre de morts sur la route. La voiture du futur est construite aujourd’hui avec nos produits. Dans dix ans, la voiture communicante devra être construite avec des industriels comme nous.
Au final, nous souhaitons que cet accord pérennise une position industrielle innovante. Nous espérons le signer avec le Gouvernement dans les prochaines semaines.
M. Fabien Pierlot. Notre technologie est en effet brevetée en France. Dans deux à trois ans, elle sera un standard au niveau européen en matière de sécurité routière et d’éco-conduite. Nous avons réellement les moyens de développer de vrais services.
M. le rapporteur. En dehors des zones à risque, vos outils ne libèrent-ils pas la vitesse ?
M. Laurent Bernard, porte-parole de l’AFFTAC. La particularité d’un utilisateur de boîtier communicant et communautaire est sa vigilance constante.
En ayant la possibilité d’informer les autres utilisateurs des aléas qu’il croise sur sa route, il sort d’un exercice très individualiste de la conduite. Il fait confiance aux autres, lesquels lui font confiance. Étant attentif, il vérifiera également si une information qu’il a reçue est toujours valable, pour la confirmer ou l’infirmer.
Vous le comprenez : dans les zones à risque, des accidents peuvent survenir, mais sur l’ensemble du trajet, beaucoup d’autres événements amènent l’utilisateur à conserver sa vigilance.
M. Fabien Pierlot. Nos utilisateurs ne sont pas des aventuriers de la route. Ce sont généralement de gros rouleurs qui ont besoin de leur permis de conduire pour travailler et qui trouvent dans nos boîtiers, nous disent-ils, la possibilité d’avoir une conduite beaucoup plus sereine et attentive à leur environnement, en arrêtant de regarder leur compteur de vitesse ou les sorties d’autoroute en permanence.
Certes, ils peuvent penser qu’il n’y a pas de radar si leur outil ne sonne pas. Néanmoins, comme le montrent nos études, la grande majorité d’entre eux ne veut tout simplement pas « se faire avoir » bêtement à 132 km/h au lieu de 130.
D’ailleurs, comme le montrent les études de l’Observatoire national de la sécurité routière, la vitesse moyenne des véhicules en France a considérablement baissé, passant de 92 à 81 km/h de 2002 à 2010. Les excès de vitesse et les amendes ont également considérablement diminué ces cinq dernières années – les grands excès de vitesse représentant aujourd’hui 0,01 % du total.
Ainsi, ce n’est plus la vitesse qui détermine le choix de nos boîtiers, mais leur capacité à offrir aux utilisateurs des services leur permettant d’être vigilants tout au long de leur trajet et pas seulement dans les zones à risque. Le débat a donc changé.
M. Yves Paul Robert. Selon une étude CSA pour l’AFFTAC, que nous tenons à votre disposition, les utilisateurs de nos produits sont plutôt de gros rouleurs et ont moins d’accidents.
Entre 10 % et 15 % du parc automobile français est équipé de nos boîtiers. Nous pensons que ces véhicules ont une influence positive sur les autres : si 15 % d’entre eux freinent, les 85 % restants freinent également.
M. Fabien Pierlot. Les sociétés d’autoroute nous ont demandé si nous étions capables d’informer nos utilisateurs de la présence des patrouilleurs – sachant que deux d’entre eux décèdent chaque année dans l’exercice de leur fonction. Effectivement, lorsqu’un patrouilleur est en intervention, nous communiquons sa présence deux kilomètres avant le point kilométrique où il se trouve en diffusant un message écran et verbal indiquant « attention patrouilleur, mettez vos warnings, roulez à 110 km/h ». Selon les sociétés d’autoroute elles-mêmes, ce type de message permet à une quinzaine de véhicules qui se trouvent derrière le véhicule ayant actionné ses feux de détresse de ralentir et, ainsi, de faire ralentir une succession de véhicules.
Vous le voyez : l’atout de nos produits est de constituer un vrai moyen d’anticiper tous les risques qui surgissent sur la route. Les constructeurs automobiles ne s’y sont pas trompés. Nous avons donc vocation à développer de formidables outils qui pourront être exploités pour des études statistiques, mais aussi pour l’information sur le trafic. Nous sommes en effet capables de connaître le trafic en temps réel – une vitesse de 10 km/h des véhicules de nos utilisateurs sur le périphérique parisien, par exemple, signifiant la présence d’un bouchon –, ce qui sous-entend que nous avons la possibilité de faire évoluer le trafic.
M. Jean-Georges Schwartz. En Allemagne, des expériences ont prouvé que la vitesse adaptée au trafic est beaucoup plus bénéfique que la « stupide » limitation à une vitesse constante.
M. le président Armand Jung. Je ne comprends pas votre choix stratégique et commercial consistant à rester en marge de la recherche et de l’action des constructeurs automobiles qui, je le pense, vous dépasseront d’ici à trois ans dans votre domaine.
Quant à la vitesse, ne nous racontez pas de blague ! Vous nous dites qu’elle n’est plus un problème, alors que tout votre matériel vise à en éviter les pièges ! Notre mission, qui réfléchit aux principales causes des accidents, est au moins d’accord sur le fait que plus la vitesse est élevée, plus l’accident est grave !
M. Jacques Myard. Je me réjouis que vous ayez trouvé un accord avec le Gouvernement. Sachez que nous sommes un certain nombre de parlementaires à avoir « appuyé sur le champignon » pour que vous deveniez des partenaires et non des proscrits !
Hormis le GPS, qui peut se tromper, la technologie moderne peut-elle permettre à chaque automobiliste d’être averti en temps réel de la vitesse à respecter, grâce à des avertisseurs posés sur nos routes ?
En outre, est-il possible d’imaginer à bord des véhicules une sorte de boîte noire qui informe pratiquement en temps réel des causes de l’accident ? Comme vous, je pense que la vitesse adaptée est la clé du problème. Une voiture qui roule à 30 km/h dans une zone à 50 peut très bien faire une embardée et tuer quelqu’un. Aujourd’hui, l’ennemi numéro un n’est pas la vitesse, mais la somnolence, l’alcool, le cannabis – voire le mélange des trois. Le débat sur la vitesse et les radars est donc un faux débat.
M. Christian Vanneste. Jacques Myard et moi sommes d’accord : mettre l’accent sur la vitesse a sans doute été une erreur. Elle n’explique pas les accidents du samedi soir liés à l’alcool et au cannabis, qui sont dus à l’incapacité de conduire.
Vous intervenez sur la vitesse des quatre roues, mais mettez-vous des appareils à disposition des motos pour lesquelles, d’ailleurs, il existe une extraordinaire disproportion entre le nombre d’usagers et le nombre d’accidents ?
M. Fabien Pierlot. D’ores et déjà, nos outils affichent en permanence les limitations de vitesse. Lorsque vous roulez à 130 km/h sur autoroute et que vous prenez un axe limité à 110 km/h, notre système affiche automatiquement cette dernière limitation, et cela grâce à la technologie GPS et à la cartographie de Navteq. Nous estimons à 85 % la fiabilité de l’information.
M. le président Armand Jung. Est-elle mise à jour de manière instantanée ?
M. Fabien Pierlot. Non, la cartographie est mise à jour tous les six mois.
En revanche, nous avons travaillé sur la limitation de la vitesse dynamique. En prenant en compte la moyenne des vitesses de nos véhicules pendant plusieurs mois, nous arrivons à déterminer la vitesse réglementaire. Par exemple, si nous constatons pendant deux mois que nos utilisateurs roulent à 90 km/h pour cause de travaux sur un tronçon de l’A4 limité à 130 km/h par le cartographe, nous informons ce dernier de cette limitation ponctuelle. Ce faisant, nous améliorons en permanence la qualité de l’information sur l’ensemble des tronçons en France, en collaboration étroite avec les cartographes.
M. Loïc Ratier. Le système dynamique permet d’étudier la vitesse moyenne des véhicules.
Par ailleurs, notre communauté de 6 millions de personnes remonte les informations. Jusqu’à présent, elle l’a fait via Internet pour mettre à jour ses appareils en ce qui concerne les zones à risque. Ce faisant, elle a pu également remonter des informations sur la vitesse. Contrairement aux cartographes, nos utilisateurs sont en permanence sur la route ; ils peuvent relever les changements de vitesse et nous en informer très vite, ce que ne font pas les services de la DDE ou ceux des autoroutes. Notre communauté peut donc aller très loin.
M. Jacques Myard. Des émetteurs placés sur les autoroutes, qui produiraient un signal instantanément, auraient-ils un coût rédhibitoire ?
M. Jean-Georges Schwartz. Techniquement, cela est possible et n’aurait pas un coût rédhibitoire. Il faudrait pour cela que nous disposions en temps réel des informations émanant des services de l’État. Dans ce cas-là, nous serions en mesure d’apporter des informations dynamiques à nos utilisateurs leur permettant d’adapter leur vitesse à l’état de la route, au trafic, etc.
M. Fabien Pierlot. Techniquement, il faudrait concevoir un lecteur de panneau de limitation de vitesse.
M. Loïc Ratier. Ce système existe sur certains véhicules. Il n’est pas très efficace, mais la technologie évoluera.
M. Jacques Myard. Je pensais à une puce sur les panneaux, qui émettrait un signal.
M. Fabien Pierlot. Je reviens sur l’idée intéressante de la « boîte noire ».
Nos produits n’ont pas vocation à être des « boîtes noires » car nous n’avons pas cette technologie, les constructeurs automobiles étant beaucoup plus compétents que nous en ce domaine. Néanmoins, nos boîtiers peuvent apporter certaines informations après un accident dans la mesure où ils permettent de savoir depuis combien de temps le conducteur roulait, sa vitesse moyenne, et sa façon de conduire grâce aux accéléromètres.
Pour répondre à M. Vanneste, nos systèmes sont compatibles avec les deux roues. Nous travaillons avec des associations sur la sécurité de ces véhicules et développons différents services. Par exemple, en cas d’embouteillage sur le périphérique, si nos utilisateurs de Coyote en voiture circulent à 10 km/h et qu’une moto roule à 20 km/h, autrement dit remonte la file, nous pouvons envoyer à cette dernière un message de prudence. Ce n’est pas notre métier principal, mais il est clair que nos applications moto permettent d’établir une corrélation entre la vitesse d’une voiture et celle d’une moto.
M. le rapporteur. Excepté le cas de force majeure, un problème contractuel avec vos clients respectifs ne risque-t-il pas de se poser en cas de changement de service rendu, par exemple à la suite d’une décision du gouvernement ?
M. Yves Paul Robert. En cas de changement de service, la question est : avons-nous vraiment le choix ? Si ce n’est pas le cas, nous pourrons invoquer le cas de force majeure.
En outre, d’après les échanges que nous avons avec nos clients, ils n’y seront pas perdants puisque nous pensons faire plus à l’avenir. Nous n’avons donc pas de raison de nous inquiéter.
M. le président Armand Jung. Merci, messieurs, pour votre contribution.
*
* *
Audition de M. Yves Gascoin, président de l’association lyonnaise « Les droits du piéton »
M. le président Armand Jung. Nous accueillons maintenant M. Yves Gascoin, président de la branche lyonnaise de l’association nationale « Les droits du piéton ».
M. Yves Gascoin, président de l’association lyonnaise « Les droits du piéton ». Notre association milite pour le développement de la marche à pied – premier mode de déplacement en ville – et des transports collectifs, son complément naturel. Elle recherche l’évolution de la cité dans un sens pratique et humain. Nous voulons préserver la liberté d’aller et venir à pied, partout dans la ville, dans des conditions sûres, confortables et, si possible, agréables, avec une attention particulière pour les personnes les moins valides.
Notre présence dans une douzaine de grandes villes françaises, nos contacts soutenus avec diverses associations amies, notamment cyclistes, et notre participation active au « code de la rue » nous permettent d’avoir une bonne connaissance du piéton et de son interférence avec l’ensemble des autres usagers de la rue.
Je présenterai rapidement les paramètres de l’accidentologie routière.
Un accident de la route résulte généralement de la concomitance de plusieurs événements, introduisant un enchaînement non maîtrisable. Par exemple, si, dans une intersection de rues, deux véhicules se présentent simultanément – première circonstance – et que le conducteur non prioritaire n’a pas respecté la consigne – deuxième circonstance –, il en résultera une collision. Il y a eu là conjonction de deux éléments.
On distingue habituellement trois constituants de la sécurité routière.
D’abord, l’infrastructure. Elle est d’une façon globale plutôt correcte, même si elle peut présenter des défauts voire des pièges, mais ils sont généralement signalés. Il n’y a donc pas là un grand réservoir de mesures.
Le deuxième constituant – les défaillances des véhicules – représente un réservoir encore plus faible. Si le contrôle technique a été introduit en France, ce n’était pas en effet pour trouver de nouveaux gains en matière de sécurité, mais pour que notre pays ne devienne pas le dépotoir des voitures n’ayant pas réussi ce contrôle dans les pays voisins l’ayant adopté.
Le comportement des usagers, enfin, est identifié depuis longtemps comme le facteur prépondérant. Je parlerai à cet égard de bilan de guerre. En effet, pour prendre l’exemple de la guerre d’Algérie, que j’ai faite, on comptait alors en moyenne 5 000 morts par an, côté français. En 1970, les accidents de la route ont tué jusqu’à 17 000 personnes par an, soit 3,4 fois plus. Le terme « bilan de guerre » n’est donc pas excessif.
Les choses, très progressivement, ont heureusement changé puisque l’on est passé à 4 000 morts. Mais les résultats stagnent depuis quelques années. Or, des gains substantiels sont encore possibles si l’on se réfère aux meilleurs États européens, tels que la Grande-Bretagne.
J’en viens à la cause d’aggravation de tous les accidents : la vitesse.
Les détracteurs des contrôles de vitesse indiquent souvent que ce ne sont pas quelques km/h de plus qui vont provoquer des accidents. Certes, la vitesse excessive n’est pas à l’origine de tous les accidents. Mais la vitesse est directement corrélée à la gravité de l’accident et donc toute variation de vitesse a des effets extrêmement sensibles. Entre 2002 et 2009, les mesures du Plan Chirac ont fait baisser de 10 km/h la vitesse moyenne sur le réseau avec pour effet de diviser par 2 – de 8 000 à 4 000 – le nombre des tués. 10 km/h en moins égale 50 % d’accidents en moins : une variation de 2 ou 3 km/h de la vitesse moyenne a donc un impact important – et non pas négligeable comme on voudrait nous le faire croire parfois – en termes de sécurité
Pourquoi les résultats n’ont-ils pas été aussi bons en agglomération ? Parce que, selon nous, la vitesse réglementaire de 50 km/h reste trop élevée. Les résultats ne pourront être améliorés de façon décisive qu’en l’abaissant, à l’exemple de Chambéry, sur lequel je reviendrai. Nous sommes donc fermement partisans du maintien du cap sur le contrôle des vitesses. Il convient d’expliquer aux conducteurs que, s’agissant de la tolérance de 5 km/h des radars, être pénalisé pour 52 km/h, signifie que l’on roulait en fait à 57 km/h, soit un excès de vitesse bien lisible sur le compteur. On n’est donc pas condamné pour 2 km/h, mais pour 2 km/h plus 5 km/h, soit 7 km/h.
En ville plus particulièrement, nous proposons – en reprenant également là l’exemple de Chambéry – d’étendre les 30 km/h aux grandes zones centrales, seules les radiales ou rocades restant à 50 km/h, et d’accélérer la création de zones de rencontre à 20 km/h introduites au code de la route en 2008.
Autre idée reçue, les radars automatiques seraient des « pompes à fric ». Les détracteurs du contrôle de la vitesse ont en effet réussi à introduire dans l’opinion publique l’idée que les radars sont destinés à renflouer les caisses de l’État en étant installés de façon à piéger les conducteurs. En réalité, avec la division par deux du nombre des morts, les primes d’assurance, en francs constants, ont baissé de plus de 15 % depuis 2002. C’est ainsi que non seulement le montant des amendes infligées par les radars automatiques est faible si on le compare à celui des primes d’assurance obligatoires – 500 millions contre 15 milliards –, mais l’ensemble des conducteurs – y compris ceux qui ont payé les amendes – a bénéficié, en contrepartie, de réductions de primes.
Il convient donc d’expliquer au public, d’une part, qu’il est possible d’échapper à ces prétendus pièges – il suffit d’observer les limitations de vitesse, comme le font les 80 % de conducteurs qui ont la totalité de leurs points –, d’autre part que les radars automatiques ont contribué à la baisse spectaculaire de l’abominable cortège de souffrances de la mortalité, enfin, et surtout, que ce système, dénoncé par certains conducteurs qui le trouvent trop contraignant, est au contraire parfaitement moral puisqu’il a permis des réductions de primes d’assurance, bien supérieures au montant des amendes.
J’en viens à l’exemple de Chambéry, qui, depuis trente ans, s’est attaquée au problème de la sécurité en ville au bénéfice des modes doux, c’est-à-dire les déplacements des piétons et des cyclistes, lesquels représentaient une bonne partie des tués. C’est ainsi que les élus ont supprimé l’hégémonie de la voiture en baissant la vitesse – tout le centre est en zone 30 –, en inversant les priorités et en réduisant le stationnement sur voirie. Les intersections ont par ailleurs reçu un statut d’espace mixte dans lequel les règles de priorités sont inversées : le piéton est prioritaire sur le vélo et le vélo prioritaire sur l’auto. Ce concept a préfiguré, avec quinze ans d’avance, celui de zone de rencontre introduit depuis en Suisse.
Le résultat est là : en 2006, le taux de piétons tués ou blessés pour 1 000 habitants dans l’agglomération de Chambéry était 3,5 fois moindre que la moyenne nationale. Nous proposons que l’on s’inspire de cet exemple pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la rue.
Le premier problème de la voiture en ville est le stationnement, bien avant la circulation. En effet, une voiture ne circule que 8 % du temps. Le reste, elle doit stationner. C’est ainsi que nos villes sont devenues obèses du stationnement depuis au moins vingt ans et que le stationnement gênant devient dangereux pour les piétons. Le stationnement illicite sur trottoirs, passages piétons et en double file à proximité des passages piétons ne peut en effet, en contraignant parfois les piétons à descendre du trottoir et à circuler sur la chaussée et en les masquant lors des traversées, qu’entraîner des accidents.
Pourtant depuis vingt ans, le stationnement interdit est présenté comme une infraction bénigne, appuyé en cela par les amnisties lors des élections présidentielles, sachant en outre que le montant des PV est resté bloqué à un niveau ridicule depuis tout ce temps – il suffit de le comparer à celui qu’il faut payer à Amsterdam, Francfort ou Milan.
Aussi proposons-nous de porter le PV pour stationnement gênant de 35 à 100 euros par référence aux pays voisins, et de développer les méthodes de contrôle et de recouvrement modernes, automatisées, permettant, sur la base de photos, de multiplier par un facteur 3 au moins le nombre de PV, cela à effectifs de police constants ; d’interdire le stationnement à moins de cinq mètres d’un passage piétons ; de classer comme dangereux et non pas simplement gênant tout stationnement masquant les traversées de piétons.
La question de l’alcoolisme et autre drogues est très difficile. L’addiction à l’alcool peut être extrêmement tenace et grave et conduire jusqu’à la folie et à la mort. Dès lors, ce n’est pas avec des peines d’amende voire de prison que l’on ira vers le sevrage et la guérison. Nous proposons de stabiliser les seuils admissibles aux valeurs actuelles.
Nous ne sommes pas d’accord pour les abaisser encore plus pour les nouveaux conducteurs, car ceux-ci sont déjà sévèrement encadrés par des limites de vitesse plus basses et un plus petit capital de points. Une nouvelle baisse des seuils ne ferait qu’accroître la distorsion entre le nombre des personnes en infraction et celui des personnes sanctionnées, ce qui décrédibiliserait les contrôles.
Pour les infractions les plus graves – récidives à un taux d’alcoolémie significatif – nous proposons d’aller, comme pour les grands excès de vitesse, jusqu’à la saisie et la vente du véhicule – considéré alors comme une arme –, quel que soit son propriétaire : cela fera réfléchir à deux fois ceux qui prêtent leur véhicule à quelqu’un qu’ils savent alcoolique – car cela se sait, notamment dans les entreprises.
La conduite d’une moto peut elle-même relever d’une addiction très dangereuse, sachant que l’accidentologie particulière à ce mode est déjà extrêmement grave : il est 15 fois plus dangereux de faire 1 kilomètre en moto qu’en voiture. Alors que le Plan Chirac a très bien réussi pour les voitures, ce n’est pas le cas pour les motos. Or, une proportion des motards ne se déplace pas pour des besoins fonctionnels, mais pour éprouver des sensations, comme sur une piste de compétition. Dès lors, ils sont insensibles à tous les conseils. Il ne reste que la sanction comme moyen de modifier ces comportements.
Nous proposons l’obligation de plaques d’immatriculation plus grandes – ce que les Allemands font depuis longtemps – ainsi que la limitation de la cylindrée en plus de la puissance. Le Japon, qui a une part prépondérante dans la fabrication des motos, y compris des plus grosses, a ainsi limité la cylindrée, mais sur le territoire national : les grosses motos, il les exporte, en particulier en Europe !
Nous militons en outre pour des plaques d’immatriculation lisibles Chacun peut faire l’expérience : au moins une voiture sur dix, si ce n’est une sur sept, a une plaque endommagée. Si ce n’est pas toujours intentionnel, ce sont donc, sur les 30 millions à peu près de véhicules circulant en France, 3 millions de véhicules qui circulent ainsi.
Il n’y aurait pourtant rien de plus simple que d’engager une vaste campagne de contrôle des plaques, par exemple sur les véhicules en stationnement, et, en se raccordant au fichier des cartes grises, de contacter les propriétaires en leur donnant un délai pour se présenter au commissariat le plus proche avec des plaques conformes. Il suffit en effet d’une petite tache pour que la lecture automatique des plaques par les radars soit bloquée.
S’agissant enfin du code de la rue, cette démarche, initiée par M. Perben alors ministre des transports, a eu pour objet de moderniser le code de la route fait pour la voiture dans les années trente. Nous avons participé aux réunions tant du comité de pilotage à Paris que du comité technique à Lyon – au Centre d’études réseaux, transports et urbanisme (CERTU) – mis en œuvre en la matière. Nous avons obtenu des avancées qui ont un impact sur la sécurité : doubles sens cyclables, réelle priorité donnée aux piétons dans les traversées de chaussée, zones de rencontre limitées à 20 km/h dans les centres villes... Ainsi le code de la route s’est-il adapté à la ville et modernisé, ce qui aura des retombées en termes de sécurité. Cependant, nous attendons encore une définition du trottoir, notamment « repérable et détectable », définition qui est bloquée au ministère de l’intérieur pour diverses raisons. Nous entendons en tout cas obtenir notamment l’interdiction de stationner aux abords des passages piétons et le relèvement du montant des amendes pour infractions au stationnement.
M. le président Armand Jung. La zone 30 pose un problème d’acceptabilité. À Strasbourg, où je l’ai défendue avec le maire, 55 % des votants au référendum organisé sur ce point s’y sont déclarés opposés. La pédagogie, dont ce résultat souligne la nécessité, est un sujet que traite d’ailleurs notre mission.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Le président vient de soulever le problème d’acceptabilité de la zone 30. Or vous proposez de la réduire à 20 km/h dans certaines situations, alors que les automobilistes disent déjà avoir du mal à respecter cette limitation à 30 km/h.
M. Yves Gascoin. Nous demandons en effet que soient créées, à l’intérieur des centres villes, que nous proposons de limiter entièrement à 30 km/h, des zones dites de rencontre limitées à 20 km/h. Il s’agit en effet de dépasser la notion de limitation par rue en portant cette limitation à tout un quartier, périmètre qui pourra ensuite être agrandi, comme cela s’est fait à l’étranger.
Les conducteurs ne sont pas mûrs, mais il faut avancer. Nous ne demandons pas, s’agissant des zones 30, qu’elles soient élargies rapidement, mais que l’on en crée petit à petit afin de gagner tranquillement du terrain. À Lyon, la zone 30, qui est très étendue, a demandé cinq ans pour être totalement mise en place. Les résultats des référendums et sondages successifs se sont effrités, le dernier quarteron étant composé des commerçants – qui sont, comme chacun sait, très attachés à la voiture. À Strasbourg, par exemple, les opposants sont majoritaires, mais de 5 % seulement : dans cinq ans, le résultat sera inversé.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Plus de 40 % des piétons tués ont plus de 75 ans. Existe-t-il une fragilité particulière à partir d’une certaine classe d’âge ? Dans l’affirmative, que préconisez-vous pour protéger ces publics ?
M. Yves Gascoin. L’accidentologie concerne les jeunes enfants puis croît avec l’âge.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Elle n’augmente en tout cas pas pour les jeunes enfants, grâce à la sécurisation du périmètre des écoles et autres lieux fréquentés par eux.
M. Yves Gascoin. Avec la baisse des facultés – l’attention, la vue, l’ouïe,...–, qui vient avec l’âge, tous les dangers se concentrent dans les traversées. Pour les personnes âgées en effet, le trottoir est le seul endroit de relative tranquillité dans la rue, et c’est d’ailleurs pourquoi nous le défendons contre les intrusions de toutes sortes, y compris la circulation de vélos.
Il n’y a d’ailleurs pas de catégorie plus vertueuse qu’une autre. Mais quand deux piétons ont une distraction à un angle de rue, cela se termine par une bosse, alors que si c’est un conducteur roulant à 50 km/h qui a une distraction, cela finit par un mort. Tout est dans la vitesse. Si l’on veut baisser la mortalité en ville, on ne peut jouer que sur la vitesse, sauf à imaginer des traversées à la japonaise en trois temps, ce que personne n’imagine en France : une diminution de 30 % de la capacité de circulation avec des embouteillages généralisés, aucun maire n’y songe ! Ce serait pourtant très efficace.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Dans des agglomérations importantes, comme Paris, des couloirs de circulation ont été isolés pour certains usagers – bus, taxis, vélos – qui font rouler ceux-ci à contresens. Est-ce un facteur accidentogène supplémentaire ?
Que pensez-vous par ailleurs de la tolérance dont il est fait preuve envers les vélos, voire les cyclomoteurs, roulant sur les trottoirs ?
M. Yves Gascoin. Il y a eu à Lyon comme à Paris quelques accidents lors de la mise en circulation des couloirs à contresens, les habitants des quartiers concernés étant habitués, avant de traverser, à ne regarder que d’un côté. Il y a été pallié avec des panneaux prévenant de la circulation de bus à contresens. Là encore, les résultats sont directement liés à la vitesse : un bus, selon qu’il roule à 50 ou à 30 km/h, s’arrêtera sur trente ou quinze mètres, ce qui change tout.
Pour ce qui est des vélos, la possibilité, pour eux seulement, de rouler à contresens dans certaines rues fait l’objet d’une signalisation à l’entrée de la zone, au sol et aux intersections. Elle a pu paraître dangereuse. En fait, non seulement le cycliste voit très bien le véhicule arrivant en face, mais l’automobiliste voit également très bien le vélo, et les deux ralentissent en conséquence et se croisent à faible vitesse. C’est un progrès du même ordre que celui qui avait été obtenu à la campagne en faisant marcher les piétons à gauche face à la circulation. À la limite même, plus la rue est étroite, plus le trafic automobile est freiné et plus les accidents baissent. À Lyon, où l’introduction des vélos en libre-service a pourtant multiplié par deux, en cinq ans, la quantité de deux roues en circulation, le nombre des accidents est resté stable. L’impact des vélos sur la réduction, dans une certaine mesure, de la vitesse automobile a amélioré la sécurité de tout le monde : les automobilistes, qui ont ainsi baissé leur vitesse, se présentent moins vite au carrefour suivant, ce qui permet de ne déplorer, en cas d’accident, qu’un blessé léger au lieu d’un blessé plus grave.
Quant aux vélos sur les trottoirs, il est le résultat du vent de liberté qui souffle dans notre société : chacun interprète le code à sa façon, le tout dans une atmosphère de laisser-faire. Pour autant, cette circulation n’est pas franchement dangereuse pour les piétons. Il suffit de se référer aux circonstances dans lesquelles des piétons ont été blessés ou tués. Néanmoins, un Vélo’v de 30 kg qui renverse une personne âgée peut entraîner une fracture du col du fémur chez cette dernière, avec pour conséquence de la terroriser ensuite à la simple idée de sortir de chez elle.
Le trottoir, dans nos villes archi-motorisées, bruyantes et dangereuses, est le dernier havre de tranquillité et de sécurité, certes relatives. Laisser les véhicules, fussent-ils non motorisés, se l’approprier, c’est faire perdre cette tranquillité aux piétons qui en ont d’ailleurs assez d’être frôlés, talonnés, croisés par un cycliste lancé à toute allure à qui l’on permet tout.
M. Jacques Myard. Pour bien connaître Chambéry, permettez-moi d’être quelque peu en désaccord avec vous : s’il y a une limitation à 30 km/h, elle concerne le cœur historique où l’on serait de toute façon obligé de rouler doucement. De là à vouloir généraliser cet exemple, il y a un pas.
Par ailleurs, des accidents mortels ont eu lieu avec des automobilistes roulant à 30 km/h, tout simplement parce qu’ils étaient sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. Je suis donc un peu étonné par vos affirmations quelque peu abruptes sur les questions de vitesse. Nous le constatons depuis que nous étudions le sujet : ce n’est pas la vitesse la première cause des accidents mortels, mais l’alcool, la somnolence, la drogue.
Je vous accorde en revanche que les zones partagées sont un concept intéressant. Je les développe d’ailleurs, en supprimant du stationnement pour faire de la place aux piétons, non sans mal d’ailleurs – je n’ai pas été épargné à cet égard par les critiques des commerçants.
Vous parlez des droits du piéton, mais quid de leurs devoirs ? En matière de sécurité routière, tout est une question de comportement voire de respect : par exemple, on ne traverse pas avec des écouteurs sur la tête sans regarder à droite ou à gauche. Votre démonstration gagnerait donc à mettre également l’accent sur le respect des règles.
Les accidents entre cyclistes et piétons font, croyez-moi, des dégâts. En Allemagne il y a ainsi énormément d’accidents de ce type. De même, rouler ivre à 30 km/h peut tuer. N’évacuez-vous pas un peu trop facilement ces problèmes, au risque d’être moins crédible ?
Comment expliquez-vous par ailleurs que 10 % sans doute des automobilistes conduisent sans permis ?
M. Yves Gascoin. Je n’ai pas prétendu que la vitesse était la seule cause des accidents, mais que la gravité de ceux-ci était en relation avec la vitesse. Selon que l’accident se produit à grande, moyenne ou petite vitesse, sa gravité sera également grande, moyenne ou petite.
M. Jacques Myard. C’est là une affirmation contestable.
M. Yves Gascoin. Quant à l’alcool, je suis d’accord pour reconnaître qu’il s’agit d’un phénomène très grave. Je l’ai dit dans mon propos introductif, l’addiction à l’alcool ne se guérit pas par 1 ou 3 mois de prison. C’est même pour lutter contre l’alcoolisme que j’ai proposé la mesure la plus sévère : la confiscation et la vente du véhicule.
Quant aux infractions commises par les piétons, je l’ai dit également : il n’y a pas de catégorie vertueuse. Les piétons n’attendent pas toujours que la figurine passe au vert, et ils traversent parfois à moins de 50 mètres d’un passage piétons. Savez-vous d’ailleurs ce qu’il en est pour un piéton qui traverse à plus de 50 mètres d’un tel passage ?
M. Jacques Myard. Il est dans son droit.
M. Yves Gascoin. Combien de conducteurs le savent ?
En tout cas, s’agissant de responsabilité, nous avons dit à nos adhérents, dans l’attente du décret facilitant la traversée des piétons en leur donnant une véritable priorité, de ne pas abuser de ce droit de traversée inscrit dans le code de la route, mais, en ville, de rejoindre le passage piétons le plus proche ou, sinon, de faire signe à l’automobiliste qui arrive et de ne traverser qu’après l’arrêt du véhicule. De même, nous avons proposé d’accompagner la ville de Lyon dans sa campagne contre les vélos sur les trottoirs, en rappelant aux piétons qu’ils ne doivent pas traverser lorsqu’ils sont à moins de 50 mètres d’un passage, lorsque la figurine est rouge, etc. Notre charte comporte d’ailleurs une colonne Droits et une colonne Devoirs.
M. le président Armand Jung. Parler de droits et de devoirs pour tous, c’est très bien. Mais entre le fort et le faible, c’est-à-dire entre l’automobiliste, d’une part, et le cycliste et le piéton, d’autre part, le rapport de force n’est pas le même.
Concernant les cyclistes sur les trottoirs, il y a beaucoup plus d’accidents qu’on ne le pense. Certes, il n’y a pas de morts, mais les témoignages sur des cyclistes renversant des personnes au sortir de chez elles sont nombreux – Dieu sait pourtant que je suis favorable aux cyclistes : je suis même à l’origine d’un rapport en ce sens.
M. Yves Gascoin. À Lyon, c’est la police municipale – qui est l’une des plus importantes de France – qui est chargée de la lutte contre ces infractions, après un partage des tâches avec la police nationale : les statistiques font apparaître que, sur les milliers d’infractions commises chaque jour, les PV distribués à des cyclistes pour circulation sur les trottoirs sont en moyenne de 0,7 par jour contre 50 pour stationnement de véhicule sur bande cyclable. Ce n’est pas du tout à l’échelle. Cela prouve qu’il y a une volonté de laisser faire, l’idée étant probablement que la priorité doit être donnée pour le moment au développement du vélo et que l’on verra bien après comment on les fera descendre des trottoirs – ce qui demandera certainement du temps, maintenant que l’habitude est prise.
M. Jacques Myard. Je préfère pour ma part voir un enfant rouler doucement sur un trottoir que sur une route départementale où il est en danger.
Au-delà du fait qu’en l’absence de plaque minéralogique, le cycliste roulant vite sur un trottoir sait qu’il sera difficilement rattrapé et verbalisé, n’y a-t-il pas plus généralement un problème de culture auquel il faudrait s’attaquer dès l’école maternelle ? Il y a, c’est évident, des progrès à faire en la matière.
M. Yves Gascoin. Pour reprendre l’exemple des vélos en libre-service à Lyon, ceux-ci n’étaient pas numérotés au départ. Lorsqu’il a été question d’apposer des chiffres, de 4 centimètres de haut, sur la jupe, le tollé a été général, car c’était là, entre autres arguments, porter atteinte à la liberté individuelle. Depuis que les vélos ont été numérotés, le nombre d’accidents a baissé de 30 % !
M. le président Armand Jung. Merci pour la clarté de vos propos.
*
* *
Audition de M. Jean-Pierre Beltoise, créateur de l’école « conduire juste »
Mardi 12 juillet 2011
M. le président Armand Jung. Mes chers collègues, nous recevons aujourd’hui une personnalité tout à fait remarquable du monde automobile, M. Jean-Pierre Beltoise.
Monsieur Beltoise, votre action en faveur de la « conduite juste », de la conduite citoyenne, nous intéresse tout particulièrement. L’objet de notre mission est la connaissance des causes réelles de la mortalité sur les routes, afin de pouvoir faire des propositions au Gouvernement dès le mois d’octobre.
M. Jean-Pierre Beltoise, créateur de l’école « Conduire juste ». Monsieur le président, merci de votre invitation. Après avoir été pilote de Formule 1, j’ai travaillé à la sécurité des circuits automobiles, puis à celle de la route. Je crois être compétent en matière d’insécurité routière.
J’ai perdu un frère, puis ma première épouse, dans des accidents de la route. Ayant vécu dans le risque, j’ai fini par comprendre les raisons de ces deux accidents, a priori difficilement explicables. La voiture de mon épouse a percuté, avec un prototype matra, un poteau téléphonique sur l’autoroute A6, avant que ceux-ci ne soient protégés par des rails de sécurité. Mon frère a été percuté de face dans un virage par une voiture qui doublait ; après avoir considéré que le conducteur de celle-ci était responsable, je pense aujourd’hui que c’est mon frère qui roulait trop vite et qu’il a été victime d’un mauvais contrôle de sa vitesse. Il en va de même pour l’accident que j’ai eu en solex.
Lorsque j’ai créé l’école « Conduire juste », en 1986, on m’a expliqué qu’apprendre à conduire aux gens était utopique. On m’a pris pour un fou ! Cependant, depuis les années 1970, je travaillais sur l’insécurité sur les circuits automobiles, et donc sur l’insécurité routière. J’étais convaincu que les accidents de la route n’étaient pas une fatalité, mais la conséquence de comportements défaillants. Cette analyse a été confirmée par les études détaillées d’accidents menées par l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) et le Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’étude du comportement humain (LAB). Elles ont montré que plus de 80 % des accidents de la route sont dus à une erreur de conduite ; 50 % de ces accidents peuvent être imputés à une mauvaise perception du danger – l’apprentissage de la conduite rend les conducteurs respectueux d’un système mais ne leur apprend pas à être méfiants – ; enfin 40 % de ces accidents sont dus à de mauvaises interprétations et prévisions du danger.
Au volant, la véritable performance est de savoir éviter de mettre en péril sa propre vie et celle des autres, et d’être capable de supprimer tout risque d’accident, même simplement matériel. C’est sur ces bases que j’ai créé l’école « Conduire juste ».
La philosophie de cette école est de faire en sorte que le conducteur ne soit jamais en situation d’urgence. Pour cela, nous déclinons quatre grands thèmes : préparer la conduite ; voir ; prévoir ; anticiper. Loin de prôner les qualités d’habileté d’un conducteur au volant, le référentiel « Conduire Juste » rappelle comment celui-ci doit se comporter en fonction des situations. La conduite n’est pas une affaire d’habileté, mais d’anticipation.
Le référentiel incite le conducteur à modifier son comportement dans le sens d’une meilleure conscience des risques et d’une meilleure attention à ceux-ci, donc d’une plus grande méfiance, d’une plus forte exigence envers lui-même et aussi d’une meilleure tolérance envers les autres. La sécurité routière passe par un comportement de non agressivité, de tolérance et de respect des autres.
Nos formations ont d’abord pour objet de faire prendre conscience aux conducteurs de la nature et de l’importance des risques routiers. En développant des stratégies de perception des situations et d’anticipation des événements dangereux, nous enrichissons l’expérience des conducteurs face aux situations à risque et aux réponses qu’ils peuvent y apporter. Ce travail, autrefois effectué sur piste, l’est maintenant sur simulateur.
Nous travaillons aussi à convaincre les conducteurs du caractère aléatoire de l’efficacité des techniques d’urgence : un bon conducteur ne doit jamais avoir besoin de donner un coup de frein ou de volant au dernier moment ; lorsqu’il en arrive là, il est déjà dans l’erreur.
Nous développons également une attitude de respect de la règle et des autres usagers, ainsi que de tolérance et de courtoisie à l’égard de ceux-ci.
Enfin, nous valorisons une démarche de conduite éco-citoyenne.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré un référentiel de conduite facilement mémorisable, applicable à toutes les situations, permettant à chacun de s’auto-évaluer et de progresser facilement. Nos exercices privilégient l’observation, l’imagination – voire la curiosité – et l’anticipation plutôt que la maîtrise de techniques d’urgence : un bon conducteur ne se met pas en situation d’urgence.
Nous proposons un catalogue de stages théoriques et pratiques sur piste sécurisée, route et simulateur.
Les exercices s’effectuent à vitesse réelle – à 90 km/h – sur piste, en conditions réelles de circulation.
Nous disposons d’outils d’évaluation et d’enregistrement de la conduite – G-Cam, freinographes ou encore Nod-box. Ces systèmes d’acquisition de données réelles permettent de faire revivre au conducteur les moments où il aurait pu mieux éviter un éventuel accident, par exemple en étant plus attentionné.
Lors des exercices pratiques, chaque véhicule embarque un formateur et trois stagiaires : ainsi, chacun peut non seulement bénéficier de la parole du formateur, mais aussi évoquer avec les autres stagiaires les points forts ou faibles de sa conduite. Il s’agit d’enrichir l’expérience de chacun et sa capacité à comprendre le point de vue des autres passagers.
Afin de favoriser la participation, l’échange et l’attention, mais aussi d’éviter toute déperdition liée à un trop grand nombre de stagiaires, les groupes comprennent entre 12 et 24 personnes.
Notre équipe comprend 40 formateurs titulaires du BEPECASER – Brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Nous disposons d’un circuit automobile à Trappes, à 25 kilomètres de Paris – base de notre système depuis plus de vingt ans –, et sommes en relation avec une dizaine de circuits partenaires en France.
Quels sont nos résultats ? En moyenne, nous observons une diminution de 50 % des accidents de nos clients – une lettre d’EDF fait état d’une diminution de 53 % des accidents. Loin d’être liée à des modes de répression exagérés – toujours injustes –, cette réduction a pour origine notre système pédagogique, fondé sur l’enseignement de la compréhension des situations.
Cette diminution s’accompagne de deux autres : celle, bien sûr, des coûts liés aux accidents, mais aussi celle de la consommation moyenne de carburant : consommer moins non seulement réduit les émissions de CO2, mais coûte aussi moins cher ! J’ai été l’un des précurseurs de cette démarche. Après leur formation, nos stagiaires consomment en moyenne 12 % de carburant de moins, avec la même voiture.
Avec des moyens modestes, nous sommes devenus le premier organisme de formation automobile postérieure à l’obtention du permis. Nos clients – nous comptons parmi eux de très grandes entreprises telles EDF ou Total – nous font part d’un taux élevé de satisfaction, et nous constatons une confiance renouvelée de leur part.
Lorsque j’ai envisagé la création de ce centre, en 1980, cinq ans après avoir abandonné la course automobile à très haut niveau, j’avais pour motivations la perte de mon frère et de mon épouse, mais aussi la connaissance que j’avais acquise, par la course automobile, que bien des éléments peuvent permettre de diminuer le risque : lorsque je courais en Formule 1, dans les années 1970, chaque saison voyait la mort de deux ou trois pilotes connus. Aujourd’hui, les morts sont infiniment moins nombreux alors que, compte tenu de l’accroissement considérable de la vitesse des voitures de course, la force de gravité transversale, qui s’exerce dans les virages sur un pilote de Formule 1, peut atteindre 4 ou 5 G, contre 2 ou 2,5 G à l’époque. Cette diminution du nombre des morts sur les circuits est certes due à l’évolution de la structure des voitures mais aussi à celle des structures des circuits.
L’amélioration de la structure des routes et de leurs abords peut être la source, en France comme ailleurs, de progrès considérables. Si je considère que le tracé des autoroutes est globalement fonctionnel, je suis parfois ébahi par les aberrations de celui de certaines routes, avec des passages très rétrécis ou des trottoirs à angle vif, facteurs potentiels d’accidents mortels – lesquels seront peut-être ensuite attribués à une surconsommation d’alcool ou à un excès de vitesse du conducteur, alors que ce n’en est pas la cause réelle.
D’autres actions sont encore à conduire pour diminuer le nombre et la gravité des accidents. Je pense par exemple à la fluidification du trafic par la coordination informatique des feux rouges en fonction de la vitesse, comme aux États-Unis ou sur le boulevard périphérique de Paris.
M. le président Armand Jung. Merci, monsieur Beltoise, pour la sincérité de vos propos. Ils constituent une réelle contribution à nos travaux.
La comparaison avec les États-Unis ne serait-elle pas faussée par le fait que les Américains roulent globalement beaucoup moins vite que les Français ?
Quelle est, selon vous, la cause principale des accidents de la route ? Quelle principale mesure proposeriez-vous aux pouvoirs publics pour y remédier ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur Beltoise, la formation dispensée dans les auto-écoles vous paraît-elle adaptée ? Des améliorations seraient-elles souhaitables, et si oui lesquelles ?
Par ailleurs, selon vous, les stages de récupération de points ont-ils une utilité pour l’amélioration de la conduite de ceux qui les suivent ?
M. Jean-Pierre Beltoise. Mon âge fausse sans doute mon opinion sur la formation au permis de conduire. Un de mes amis, âgé de 83 ans et cascadeur automobile prestigieux – il s’agit de Rémy Julienne –, a perdu son permis, sans doute points par points. Or il n’arrive pas à réussir de nouveau l’examen ! Les méthodes ont changé. De ce fait, alors que les jeunes se présentent avec succès, les personnes d’un certain âge, même responsables et habituées aux risques de la route, auront bien du mal à répondre aux questions posées.
Aucune formation de quarante heures ne permet de passer d’un statut de néophyte à celle de connaisseur maîtrisant un savoir-faire. Si, à l’issue de la formation en auto-école, un conducteur a appris les règles du code de la route et est capable de répondre aux questions posées par les examinateurs, il ne sait pas conduire. Les aviateurs expliquent qu’à 500 heures de vol, on croit savoir piloter, et qu’à 1 000 ou 5 000 heures on s’aperçoit qu’on ne sait rien.
Pour moi, il ne devrait pas être possible de se libérer du sigle « A », qui figure à l’arrière du véhicule de tout nouveau conducteur, simplement après deux ans de conduite sans incident majeur. Un examen supplémentaire devrait être nécessaire. Faute de le réussir, le conducteur devrait conserver le « A » qui, indiquant aux autres conducteurs qu’il reste un apprenti, susciterait ainsi leur attention.
Ce deuxième examen – qui créerait certes un léger coût supplémentaire – ouvrirait droit à une sorte de « permis de maturité ». Comme nous le pratiquons à « Conduire juste », il y serait vérifié la qualité du comportement du conducteur, sa maîtrise de la route et sa capacité de méfiance envers les autres ainsi qu’envers les aléas éventuels de la circulation ; bref sa capacité à rouler sans accident. Aujourd’hui, après l’obtention de son permis, le jeune conducteur est jeté ad vitam aeternam dans la circulation, où il prend ses habitudes, en général plutôt mauvaises. Un bon conducteur qui n’a pas d’accident parce qu’il a appris à se méfier ne le doit qu’à lui-même.
L’un de nos moniteurs a dit un jour qu’une journée de stage à « Conduire juste » valait dix ans d’expérience. Nos stagiaires n’imaginent pas que ce que nous allons leur enseigner, c’est la conduite en sécurité. Ils sont surpris d’apprendre qu’elle est faite d’un regard porté plus loin, plus large, d’une méfiance généralisée envers l’ensemble de l’environnement et d’une vigilance de chaque instant. En auto-école, on apprend des règles par cœur et à manœuvrer une voiture. Mais on en sort non pas méfiant mais confiant en sa capacité de maîtrise, au motif qu’on respecte les règles.
Comme tous les Français qui roulent beaucoup, j’ai été amené à plusieurs reprises à effectuer des stages de récupération de points. Il est en effet très difficile de ne pas commettre de petits excès de vitesse ; or ceux-ci sont très pénalisants. Ces stages sont étonnants par leur caractère suranné : alors que la presse évoque sans cesse les émissions de CO2, elles ne sont jamais évoquées lors de ces stages. De même, devant la violence des reproches d’un psychologue d’un stage envers un stagiaire, j’ai cru que celui-ci avait causé des accidents graves : en réalité, il avait simplement commis de petits excès de vitesse de moins de 10 km/h ! C’est insupportable.
Au bout du compte, ces stages permettent de faire connaissance avec d’autres personnes, de déjeuner avec elles à midi... Pendant le stage, certains écoutent – écouter quelqu’un parler de sécurité routière est toujours utile –, d’autres plaisantent…
Nous avons envisagé, à « Conduire juste », d’organiser des stages de récupération de points, assortis d’une heure de conduite sur notre circuit, pendant laquelle nous montrerions les dangers de la route. Mais ce concept nous amenait à être plus chers de 30 % ou 40 % que la concurrence. Nous n’étions pas compétitifs ! La philosophie du client d’un stage de récupération de points, c’est d’aller au plus tôt, au moins cher et au plus près possible de chez lui pour récupérer ses points.
M. le rapporteur. Les Français ne sont-ils pas moins disciplinés que les ressortissants d’autres pays ? Ne serait-ce pas leur comportement qui expliquerait, en matière de sécurité routière, les résultats moins bons de la France par rapport à ceux du Royaume-Uni ?
L’un de nos précédents interlocuteurs nous a expliqué que le conducteur le plus accidentogène, c’est celui qui, fort de la confiance qu’il pense avoir en son aptitude à la conduite, va prendre des risques. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Pierre Beltoise. Dans notre école, nous menons un travail d’éducation, de formation et d’information. Devant vous, je n’ai pas employé le mot de confiance, mais celui de méfiance : nous apprenons aux conducteurs à devenir méfiants. Manifestement, ce n’était pas une qualité que possédaient deux conducteurs que j’ai croisés avant-hier sur une petite route de la vallée de Chevreuse : alors que je me trouvais derrière un camion en panne, à proximité d’un croisement, ces deux conducteurs qui arrivaient en face n’ont pas ralenti, estimant certainement qu’ils avaient le droit de rouler à 90 km/h… Pour notre part, nous enseignons à ralentir quand c’est nécessaire ! Les conducteurs ne respectent plus l’article du code de la route qui impose d’être maître de sa vitesse, autrement dit d’être capable de s’arrêter quoi qu’il arrive. C’est parce que nous enseignons le respect de cette règle que nous constatons une réduction de plus de 50 % des accidents de nos stagiaires, et que nous conservons nos entreprises clientes, voire que nous en augmentons le nombre, malgré des tarifs plus élevés que ceux la concurrence. Par ailleurs, cette démarche entraîne aussi la réduction de la consommation de carburant : lorsqu’on regarde plus loin, on n’a pas besoin de freiner ou d’accélérer brusquement.
La culture anglo-saxonne est en effet fondamentalement différente de la culture française. Pour illustrer mon propos, je citerai un exemple personnel : alors que je signais des autographes à Silverstone, au Royaume-Uni, les deux seuls demandeurs indisciplinés auxquels j’ai eu affaire étaient des Français !
Cela étant, la France a fini par rattraper son retard sur la Grande-Bretagne en matière de sécurité routière. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne ne subit pas un trafic de transit du Nord au Sud, notamment du fait d’étrangers de passage. L’agglomération de Londres n’est pas moins accidentogène que celle de Paris. La Grande-Bretagne comporte aussi moins de zones rurales, notamment de montagne, que la France.
Les causes de l’accidentologie routière sont connues. Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui ont le plus d’accidents. Parmi eux, 80 % des victimes sont des garçons. Et la proportion de ceux qui en sont responsables est supérieure encore : 90 %. Les jeunes femmes de moins de 25 ans qui trouvent la mort sur la route sont le plus souvent des passagères.
Les routes les plus accidentogènes sont aussi les petites routes, moins surveillées que les autres.
La limitation de vitesse sur autoroute, telle qu’elle est appliquée, est un peu injuste. Un conducteur qui n’a pas conduit depuis un certain temps a besoin d’un temps d’adaptation avant de bien conduire à la vitesse maximale autorisée. Mais une fois réhabitué, et ayant retrouvé le niveau d’attention nécessaire, il pourrait rouler au-delà de la vitesse autorisée sur autoroute, jusqu’à 150 ou 160 km/h. Si, sur autoroute, je roule bien sûr à 130 km/h, à cette vitesse, je suis beaucoup moins attentif qu’avant. Je fais partie de ceux –nombreux – qui sont devenus de mauvais conducteurs sur autoroute : je ne suis plus assez attentif au volant !
Lors d’un voyage au Royaume-Uni, des responsables du ministère des transports m’ont expliqué franchement – au contraire de la France où je n’ai jamais pu obtenir toute la vérité à ce sujet – que l’accidentologie des autoroutes était si faible par rapport à celle des petites routes qu’elle ne constituait pas une question prioritaire. Je suis donc un peu étonné du renforcement des contrôles radar sur autoroute et du durcissement de la répression des excès de vitesse qui y sont commis. Pour la limitation de la vitesse à 130 km/h, si le taux d’émission de CO2 peut être un argument, la sécurité n’en est pas un.
Mme Françoise Hostalier. Monsieur Beltoise, si les personnes qui suivent des stages de récupération de points ont envie de bien faire et d’apprendre, je pense comme vous, par expérience, que l’organisation de ceux-ci est plus que perfectible.
La sécurité routière relève aussi du « vivre ensemble ». Quant à la prudence sur la route par rapport à des comportements inopinés, elle découle de la capacité d’anticipation.
Que pensez-vous de l’amélioration de la sécurité et de celle des conditions de conduite des véhicules ? Dans une 2 CV ou une Renault 4, on percevait la vitesse, on entendait le bruit du moteur ; aujourd’hui, le conducteur, enfermé dans une sorte de cocon, n’a plus aucune perception, en particulier de sa vitesse.
Enfin, quel serait votre sentiment sur l’organisation, tous les dix ans par exemple, de stages réguliers de remise en condition pour les conducteurs, comme il en existe dans d’autres pays ? Au bout d’un certain temps de conduite, le conducteur prend de mauvaises habitudes, alors même que les normes, ou même les panneaux, peuvent changer.
M. Michel Raison. Monsieur Beltoise, n’avons-nous pas un travail à faire sur l’acceptabilité et la compréhension des règles, dans la mesure où elles ne sont plus comprises. De même, étant donné que trop de dispositifs de sécurité nuisent à l’attention nécessaire à la conduite, ne conviendrait-il pas d’en diminuer le nombre ? Une expérimentation a été réalisée dans cet esprit, dans un pays du nord de l’Europe, laquelle a consisté à supprimer les feux tricolores en agglomération.
Mme Pascale Gruny. Quel est votre avis sur la conduite accompagnée, pratiquée depuis quelques années pour l’apprentissage de la conduite ? J’y suis moi-même assez favorable.
M. Patrick Lebreton. À la Réunion, département dont je suis député, la mortalité routière est légèrement supérieure à la moyenne nationale. De nombreux jeunes y pratiquent « la pousse », autrement dit la course sur route ouverte, en dehors de toute réglementation. La démarche de méfiance que vous préconisez est donc tout à fait d’actualité : ce ne sont pas toujours les « pousseurs » qui subissent les effets de leur action.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée que les municipalités sécurisent la pratique de « la pousse » en installant des circuits réservés à cet effet ? En tant que maire, j’ai tenté d’organiser un projet en ce sens, pour faire prendre conscience aux jeunes des dangers de « la pousse », mais j’ai vite compris que l’autorité préfectorale n’y était absolument pas favorable.
M. Henri Nayrou. Monsieur Beltoise, vous avez raison : si les équipements actuels améliorent la sécurité des véhicules, ils favorisent le relâchement du conducteur, lequel nuit à sa propre sécurité. Quelles solutions préconisez-vous ?
Pour ma part, je n’ai réellement appris à conduire que onze ans après avoir obtenu mon permis, sur un circuit à Albi, avec un instructeur ancien pilote ; depuis, je n’ai jamais eu d’accident.
Comment allier la nécessité d’obtenir le permis de conduire et celle de se perfectionner à la conduite ? Avoir son permis de conduire ne signifie pas que l’on sait conduire.
M. Jean-Pierre Beltoise. Monsieur Nayrou, la formation « Conduire juste » que nous proposons répond à votre préoccupation.
Si je ne suis pas partisan d’une obligation d’apprentissage du permis de conduire sur la base de formations du type « Conduire juste », je considère, en revanche, qu’il serait tout à fait possible de créer une formation obligatoire pour libérer les conducteurs du sigle « A » – ce qui leur permettrait de mieux conduire, et de façon plus responsable. De la sorte, quand les conducteurs verraient un sigle « A » à l’arrière d’un véhicule, cela signifierait que la personne qui le conduit a peu d’expérience, et donc qu’ils doivent faire plus attention.
Madame Hostalier, les nouveaux équipements des voitures ont en effet aseptisé celles-ci. Ainsi, une femme qui avait l’habitude de rouler à 120 km/h sur autoroute a été stupéfaite de découvrir qu’au volant de la voiture de son mari, elle roulait, presque sans s’en rendre compte, à 190 km/h ! La formation et l’information peuvent contribuer à l’accompagnement des processus d’amélioration des véhicules.
M. Henri Nayrou. Sept conducteurs sur dix sont victimes de somnolence !
M. Jean-Pierre Beltoise. Monsieur Lebreton, j’ai organisé un cycle de formation à la Réunion. Du fait du caractère autarcique des conditions de circulation dans cette île, une école appliquant nos principes aurait pu faire apparaître, en cas de réduction du nombre des accidents, l’efficacité de notre démarche. Malheureusement, le coût induit a empêché la réalisation de ce projet.
Mon ami Henri Pescarolo invite des stagiaires à rouler aussi vite que possible sur un circuit sécurisé ; l’objectif est qu’ils prennent conscience des risques de sortie de route !
Il est vrai que la sécurité des voitures actuelles provoque une sorte de déresponsabilisation ; or il faut avoir conscience de sa responsabilité personnelle.
Une expérimentation est en cours en Finlande pour remplacer les feux tricolores par des dispositifs de ralentissement – en l’absence de trafic, outre qu’elle fait perdre du temps, la succession des arrêts et des démarrages a un coût, que ce soit en consommation de carburant ou en émission de CO2. Il s’agit d’obliger les conducteurs à redevenir responsables de leur conduite et à respecter les autres. De plus, le dispositif est conçu de façon à ce que, en cas de choc, celui-ci ne soit pas violent.
M. le président Armand Jung. Très sincèrement, monsieur Beltoise, merci pour votre contribution aux travaux de notre mission.
*
* *
Audition de MM. Louis Derboulle, président, Laurent Hecquet, délégué général, Gérard Minoc, responsable de l’Institut d’études des accidents de la route, et Jean-Pierre Fourcat, président de la commission « sociologie des usagers » de l’association « 40 millions d’automobilistes »
Mardi 12 juillet 2011
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons nos travaux en accueillant les représentants de l’Association 40 millions d’automobilistes. Nous avions hâte, messieurs, de vous rencontrer car vous avez pris sur le sujet qui nous intéresse des positions fermes et fortes et car nous espérons que vous nous aiderez à atteindre notre objectif qui est d’aller au plus près des causes et des faits en matière d’accidentologie. Nous serions également heureux d’entendre vos propositions précises
M. Louis Derboulle, président de l’association 40 millions d’automobilistes. Partant du constat d’une carence de la représentation des automobilistes auprès des différentes institutions gouvernementales, l’Automobile club de l’ouest (ACO) a décidé en 2005, à l’initiative notamment de MM. Fourcat et Minoc, de créer 40 millions d’automobilistes, afin de porter le concept d’« automobilité » et de représenter les automobilistes raisonnables. De fait, nous représentons aujourd’hui l’ensemble des Automobile clubs français membres de l’UNAC (Union nationale des automobile clubs) ainsi que de l’Automobile club de France (ACF) qui a lui-même créé la Fédération internationale de l’automobile (FIA) en 1904. Ainsi, « FIA action for all safety » est l’équivalent au niveau mondial de ce que nous essayons de développer en France. L’ACF et l’ACO entretiennent des liens tout à fait privilégiés : ils sont membres de droit l’un de l’autre et le président du premier est administrateur du second.
40 millions d’automobilistes s’intéresse à tous les aspects directs et indirects de l’automobile, de la route ainsi que du partage de cette dernière entre tous les usagers. Nous intervenons auprès des pouvoirs publics et des médias sur de nombreux dossiers : sécurité, infrastructures, technologie, développement durable. Nous prenons tout particulièrement en compte le besoin d’aide, de soutien et de conseils des personnes accidentées – on ne parle plus de victimes –, en faveur desquelles travaille une avocate remarquable, Mme Sylvie Vernassiere. Nous travaillons en commissions présidées par des experts professionnels et confirmés.
Notre objet est de comprendre pour transmettre : on comprend les raisons de l’accident, on les transmet par l’intermédiaire des médias et de différentes commissions, avec pour objectif absolu de diminuer le nombre des accidentés de la route, de la rendre plus sûre et plus compréhensible par les usagers.
La création de votre mission et vos débats sur la sécurité routière nous confortent dans le besoin de mieux comprendre le ressenti et les comportements de nos concitoyens vis-à-vis de l’usage et de la place de l’automobile dans notre société.
M. Gérard Minoc, responsable de l’Institut d’études des accidents de la route de l’association 40 millions d’automobilistes. Nous avons créé l’Institut d’études des accidents de la route parce que nous ne trouvions pas, dans les statistiques officielles, la réponse à nos interrogations. Il nous était par exemple impossible de savoir combien de piétons étaient tués la nuit sur la route. Nous nous sommes en particulier demandé ce qui se passe au moment d’un accident et comment il se produit. C’est le résultat de ce travail que nous vous présentons.
Nous avons segmenté les accidents à partir d’une étude qualitative portant sur les 1167 tués du premier quadrimestre de l’année, les résultats que nous vous présentons aujourd’hui portant sur les 907 tués du premier trimestre. À partir de là, nous avons souhaité appeler votre attention sur le problème majeur des pertes de contrôle en ligne droite qui représentent 30 % des tués, hors piétons et vélos.
M. le président Armand Jung. À quoi attribuez-vous ce phénomène ?
M. Gérard Minoc. Nous n’avons pas de certitude, mais il est bien évident que la ligne droite est le seul lieu où peut jouer la somnolence. Quoi qu’il en soit, l’ampleur de ce phénomène, le plus souvent inexpliqué, est impressionnante et il y a bien là un véritable problème.
M. le président Armand Jung. Les automobilistes roulent toujours lentement...
M. Gérard Minoc. Pas forcément, mais dans de très nombreux cas on ne comprend vraiment pas pourquoi l’accident a eu lieu.
Nous avons également souhaité appeler votre attention sur le problème des piétons, en particulier des seniors : aucune loi ne les rendra plus visibles !
Alors que nous pensions que l’étude montrerait que les chauffards traversent les carrefours sans faire attention, ce n’est absolument pas le cas. En fait, un grand nombre de conducteurs, relativement âgés, éprouvent de grandes difficultés à s’insérer dans le trafic : le conducteur d’une voiturette qui veut traverser une route à grande circulation ne peut tout simplement pas y parvenir, sauf à prendre le risque d’y laisser la vie…
Les accidents liés au dépassement ne concernent pas plus particulièrement les seniors, qui sont prudents, mais plutôt des gens pressés, qui vont trop vite.
Autre point noir, la combinaison alcool/drogue, que l’on trouve plus particulièrement les nuits de week-end, en ville, en particulier dans des pertes de contrôle sans raison apparente.
Parce que nos statistiques portent sur le début de l’année, nous n’avons pas traité le cas des deux-roues, qui sortent aux beaux jours...
Notre étude montre ensuite qu’il n’y a pas de dégradation de la sécurité routière. Les pouvoirs publics ont insisté sur le fait que l’on est descendu l’an dernier à un peu plus de huit tués par jour, mais c’était un résultat tout à fait exceptionnel. Aujourd’hui, on demeure en dessous de 10 tués par jour en hiver, soit sensiblement le résultat obtenu en 2006, et l’on passera probablement à 14 ou 15 en juillet et en août, la différence tenant principalement au fait que les deux-roues sont alors de sortie.
Voilà plusieurs années que l’on ne parle que des radars auxquels on attribue tous les succès. Mais on oublie que, de 2003 à 2007, on a aussi porté le nombre des contrôles d’alcoolémie de 9 à 13 millions, ce qui a eu des effets sur le nombre des tués jeunes et alcoolisés.
Nous sommes par ailleurs choqués non pas par le principe mais par le fonctionnement du permis à points. Nous ne comprenons pas qu’alors qu’au sein du ministère les mêmes personnes rédigent le rapport sur les infractions relevées et celui sur les infractions portées au fichier du permis à points, seulement une infraction sur deux se traduise par un retrait de points. L’argument des photos illisibles ne tient pas puisque le ratio est le même pour l’alcoolémie ou pour le défaut de port de la ceinture de sécurité…
Qui plus est, l’État ne dispose d’aucun outil de prévision. Ainsi, l’assouplissement du permis à points appliqué à partir de 2007 aurait dû permettre à des conducteurs de récupérer un point en 2008, mais on n’en trouve trace, dans les rapports publics sur la sécurité routière, ni cette année-là, ni la suivante. C’est seulement dans le dernier alinéa du rapport concernant l’année 2010 que l’on voit mentionné que 73 % des points perdus en 2008 et en 2009 ont été récupérés un an après. Il y a donc là un problème de fond : à quoi bon mettre au point une véritable usine à gaz pour confisquer 4 millions de points une année et en rendre 3 millions l’année suivante ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je vous remercie pour la contribution écrite que vous nous avez remise, à laquelle nous nous intéresserons de près.
Entre 2002 et aujourd’hui, la vitesse moyenne a été réduite de 10 km/h tandis que le nombre des tués sur la route diminuait de moitié. Selon vous, y a-t-il un lien, ou pas, ou pas seulement ?
M. Gérard Minoc. La réponse figure dans le document que nous vous avons remis. Les radars – c’est un de leurs grands succès – ont fait chuter le nombre des grands excès de vitesse, ceux de plus de 20 km/h au-dessus de la limite autorisée. C’est de la sorte que le nombre des tués a diminué mais, ces grands excès de vitesse ne représentant plus aujourd’hui que 1,7 % du total, on voit mal comment on pourrait réduire encore le nombre de ces fous de la route, qui tuent 4 000 personnes...
Notre analyse en fonction des réseaux montre bien que la formule selon laquelle 1 % de vitesse moyenne en plus est à l’origine de 4 % de tués ne fonctionne pas. En appliquant cette formule aux autoroutes – domaine privilégié de la vitesse – entre 2003 et 2007, le nombre des tués aurait dû être réduit de 14 %. Or, il a diminué de 64 % ! En fait, parce qu’elle est en facteur 4 et linéaire, cette formule sous-estime le poids des grands excès de vitesse et elle ne peut être vérifiée mathématiquement. On a ainsi vu en 2000 qu’elle ne fonctionnait pas puisque l’on a observé à la fois une augmentation de la vitesse et une diminution du nombre des tués… Contrairement à ce que l’on prétend, il ne s’agit donc pas de la formule de Nilsson, qui est en puissance 4 et exponentielle : plus on va vite, plus c’est dangereux et c’est bien pourquoi la sanction en nombre de points retirés s’accroît proportionnellement à la vitesse.
M. Jean-Pierre Fourcat, président de la commission « sociologie des usagers » de l’association 40 millions d’automobilistes. La corrélation est un sujet extrêmement important. Nous parlons ici d’une corrélation macro, qui ne signifie pas forcément une relation de causalité directe : on peut faire cette corrélation sur les grandes masses mais elle ne vaut pas obligatoirement pour un accident donné. Or nous avons besoin de comprendre chaque accident.
On observe en outre une forte diminution de la relation entre la vitesse et l’importance des conséquences d’un accident. Cela tient aux progrès très importants enregistrés ces dernières années dans la sécurité des voitures, notamment dans la protection interne avec les ceintures et les airbags : un accident provoque aujourd’hui moins de dégâts mortels qu’auparavant.
Il faut faire d’autant plus attention à l’interprétation des données que nous manquons d’éléments approfondis pour comprendre ce qui se passe au moment même de l’accident, en particulier au regard de la somnolence et de la baisse de vigilance en ligne droite. Nous sommes ainsi fort peu capables d’apprécier les effets de panique face à un obstacle, un nid-de-poule ou un phénomène particulier comme le brouillard. Alors qu’elle est particulièrement développée dans le domaine aéronautique et ferroviaire, la recherche en la matière est insuffisante pour l’automobile.
M. le rapporteur. Nos travaux nous montrent déjà que la sécurité routière n’est pas une science exacte, puisque nous entendons ici tout et son contraire, ainsi que beaucoup de généralités…
Comme dans beaucoup d’autres pays, il n’est pas possible sur notre territoire de rouler à plus de 130 km/h. Faudrait-il dès lors préconiser que l’on bride les véhicules, par exemple à 150 km/h ? Ainsi, les constructeurs ne pourraient plus vendre des véhicules qui roulent à 250 et en faire la promotion sur cette base…
M. Gérard Minoc. Statistiquement, on n’économiserait aucune vie.
M. le président Armand Jung et M. le rapporteur. Pourquoi ?
M. Gérard Minoc. Tout simplement parce que cela ne concernerait que les autoroutes, donc 6 % seulement des tués, qui le sont en outre peu souvent à cause de la vitesse.
M. le rapporteur. Alors que les autorités affirment qu’il faut réduire la mortalité et l’accidentalité sur les routes, que la question de la vitesse est sans cesse mise en avant, on continue à vendre des voitures qui vont à 250 km/h bien que l’on ne puisse pas rouler à plus de 130, voire de 150 en tenant compte des petits excès de vitesse !
M. Laurent Hecquet, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes. L’objectif de la sécurité routière est de mettre en œuvre des mesures véritablement efficaces. Or, 72 % des personnes sont aujourd’hui tuées sur le réseau secondaire où la vitesse est limitée à 90 km/h…
M. le président Armand Jung. D’où tirez-vous ces chiffres ? Nous avons du mal à nous y retrouver car, depuis le début de nos auditions, ceux qui nous sont donnés vont du simple au triple !
M. Gérard Minoc. Vous trouverez les nôtres en page 9 de notre document. Ils sont identiques à ceux de la gendarmerie et nous les tirons des fiches rédigées sur chaque accident, qui montrent où les gens se tuent et dans quelles conditions
M. le rapporteur. Ma question est infiniment plus simple : dans la mesure où il est peu probable que l’on autorise demain à rouler à 200 km/h sur les autoroutes, où est la logique quand on continue à vendre des voitures de plus en plus puissantes ?
M. Laurent Hecquet. Je n’ai pas de position.
M. le président Armand Jung. Cela paraît étonnant de la part d’une association qui est habituellement prompte à prendre des positions tranchées, qui font beaucoup parler d’elle. Nous aurions précisément aimé bénéficier de vos certitudes…
M. Laurent Hecquet. Cette idée, qui revient régulièrement dans les débats, me paraît un peu dogmatique. Même si nous ne sommes pas pleinement compétents pour nous prononcer, on peut s’interroger sur son utilité…
M. le rapporteur. Êtes-vous pour ou contre ?
M. Laurent Hecquet. Contre car je pense que cela n’apportera pas de solution au regard d’une accidentalité qui se concentre sur le réseau secondaire.
M. le rapporteur. Je persiste à ne pas comprendre à quoi sert de vendre des voitures que l’on ne peut pas utiliser au maximum de leurs possibilités…
M. Laurent Hecquet. La puissance d’un véhicule est parfois gage de sécurité, par exemple pour éviter un obstacle subit, mais je conviens que je ne vais pas au maximum de la puissance de ma propre voiture.
Cela étant, il est faux que les voitures puissantes sont à l’origine de l’accidentalité. Brider les véhicules peut donc être une mesure intéressante, mais qui ne résoudra pas le problème. C’est une fausse bonne idée, qui pourrait entraîner les constructeurs sur de mauvaises pistes.
M. le rapporteur. Vous ne répondez toujours pas à la question « à quoi ça sert ? » !
M. Jean-Pierre Fourcat. Vaste question : faut-il autoriser les objets inutiles ?
M. le rapporteur. Et inutilement dangereux !
M. Jean-Pierre Fourcat. Dans notre société de consommation, nous sommes entourés d’objets que nous jugeons inutiles. Certaines chaînes hi-fi développent 1000 W, mais nous ne les mettons jamais à fond…
M. le rapporteur. En l’occurrence, la législation interdit l’usage des véhicules trop puissants !
M. Jean-Pierre Fourcat. Elle en interdit l’usage dans certaines conditions mais elle n’interdit pas de rouler à 130 avec une voiture qui peut rouler à 250… Toutes les études montrent qu’une très grande partie de ceux qui possèdent des voitures puissantes ne les utilisent pas de façon absurde. On peut en revanche se poser la question de la maîtrise de tels véhicules par des conducteurs débutants : peut-être faudrait-il un permis particulier. Mais de là à interdire les belles mécaniques…
J’ajoute que les constructeurs français sont assez peu présents sur ce marché qui se développe pourtant beaucoup, en particulier en Chine, où il est vrai que les accidents sont nombreux.
Plus généralement, votre question renvoie à la place de l’automobile dans la cité. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, elle est devenue un bien indispensable à la vie d’une grande partie de nos concitoyens. C’est ce qui explique les réactions très fortes et parfois épidermiques lorsque les Français ont l’impression que l’on s’attaque à l’automobile.
M. le rapporteur. Pourriez-vous précisément en venir à la décision du CISR (Comité interministériel de la sécurité routière) de supprimer les panneaux annonçant les radars ?
M. Jean-Pierre Fourcat. Le nombre des voitures a beaucoup augmenté ; les ménages sont de plus en plus multi motorisés, le lien entre les femmes et l’automobile s’est considérablement renforcé depuis une quarantaine d’années.
On souligne rarement à quel point le sentiment de proximité de l’accident potentiel s’est développé : nous connaissons désormais presque tous quelqu’un qui a été touché d’une façon ou d’une autre. Je crois que cela explique pourquoi les gens ont été réceptifs à bien des modifications du code de la route, même s’il a fallu du temps pour que l’idée du permis à points pénètre les esprits et remplace un certain sentiment d’impunité.
M. le rapporteur. Le permis à points ne fonctionne pas si mal que cela puisque 75 % des conducteurs disposent de la totalité des points…
M. Jean-Pierre Fourcat. Cela signifie aussi que 25 % d’entre eux n’ont pas tous leurs points, c’est beaucoup…
Lorsqu’ils perdent des points, beaucoup d’automobilistes ont le sentiment d’avoir été piégés, notamment par les radars.
Outre que les Français réagissent mal lorsqu’ils ont le sentiment que l’on s’en prend à l’automobile, l’annonce brutale et sans concertation de la suppression des panneaux a bousculé leurs habitudes. Or, la concertation et l’explication me paraissent aujourd’hui essentielles pour la sécurité routière. Nombreux sont ceux qui considèrent que l’on retire les panneaux pour les piéger.
Nous recevons d’ailleurs beaucoup de courrier d’automobilistes qui ont le sentiment d’avoir été piégés pour un excès d’1 km/h…
M. le président Armand Jung. C’est impossible !
M. Jean-Pierre Fourcat. C’est bien évidemment faux, mais cela s’explique par le fait que le compte rendu que reçoit l’automobiliste mentionne, par exemple, que la vitesse observée était de 56 km/h et que la vitesse retenue a été de 55. C’est donc un défaut de communication, dans une société en perpétuelle recherche de sens, qui est à l’origine de cette incompréhension et qui freine l’acceptation sociale de la décision. Nous ne saurions trop recommander de rechercher systématiquement la concertation, mais aussi de dégager une vision à long terme – c’est-à-dire qui aille au-delà d’un objectif chiffré – des buts poursuivis par la sécurité routière.
Cela pourrait passer aussi par le rattachement du CISR à une autorité supérieure, par exemple le Premier ministre. Je suis scandalisé qu’il existe aujourd’hui, au sein du même ministère, deux sources statistiques et que la moitié seulement des infractions déclarées par la police et la gendarmerie fasse l’objet d’un retrait de points. Et les explications avancées ne valent pas, puisque cet écart est le même pour les infractions en matière d’alcoolémie !
M. le président Armand Jung. Depuis le début de notre mission, nous avons appris à nous méfier des statistiques et des chiffres. Nous procéderons donc à des vérifications.
M. Gérard Minoc. En dépit de nos demandes d’explications, nous n’avons jamais eu de réponse…
M. le rapporteur. Il existe 2000 radars fixes automatiques et l’on dit que, pour couvrir le territoire, il en faudrait 3000 de plus, dont 1 000 immédiatement. Quel est votre sentiment à ce propos ?
M. Gérard Minoc. Le nombre des radars a fortement augmenté de 2007 à 2010, sans effet sur le nombre de tués.
M. le président Armand Jung. Les chiffres sont peut-être sujets à caution et l’on peut être opposé au système des radars, mais il est faux de dire qu’ils n’ont pas eu d’impact sur le nombre de tués sur les routes !
M. Gérard Minoc. Le nombre des radars a triplé depuis 2007 mais on a arrêté d’augmenter le nombre des contrôles d’alcoolémie, qui reste de 11 millions depuis 2007. Or, depuis lors, le nombre de tués est resté quasiment identique
M. le rapporteur. Il y a quand même eu 620 morts de moins !
M. Dominique Raimbourg. Dans la mesure où les causes des accidents sont multiples, il est bien difficile de trouver « la » mesure qui répondrait à toutes les questions.
Parmi les diverses solutions, vous paraîtrait-il acceptable de réfléchir à des dispositifs anti-endormissement ou d’aide à la vigilance et à des systèmes anti-démarrage couplés à un éthylomètre ?
S’agissant des personnes âgées, si perdre son permis c’est aussi perdre une partie de sa vie sociale, notamment à la campagne, serait-il néanmoins possible d’organiser une visite médicale à partir d’un certain âge – assez tôt pour que cela ne paraisse pas discriminatoire ?
Ma dernière question, un peu annexe, porte sur les automobiles qui ne roulent pas : le fort développement de la motorisation des ménages amène un grand nombre de véhicules sur l’espace public, qui n’est pas extensible. Réfléchissez-vous à des utilisations de la voiture moins consommatrices d’espace, notamment lorsqu’elle ne roule pas ?
M. Laurent Hecquet. Vous avez évoqué les technologies embarquées, notamment pour lutter contre la somnolence. Il existe déjà des solutions, mais nous sommes preneurs de toutes celles qui permettraient une avancée significative sur cette question majeure – pas seulement sur le réseau autoroutier. Je pense en particulier à tous les dispositifs, beaucoup plus simples, de marquage au sol, qui provoquent une vibration délivrant un message fort à l’automobiliste. Hélas, ce marquage n’est obligatoire que sur le réseau principal, alors que le réseau secondaire représente une grande partie de notre réseau total d’un million de kilomètres. Le développement de ce concept de la « route intelligente » fait partie de nos préconisations. L’administration a elle-même proposé des solutions, tel le système SARI (Surveillance automatisée des routes pour l’information des conducteurs et des gestionnaires de réseaux) élaboré par le laboratoire central des Ponts et Chaussées, qui aide à réfléchir à la signalisation en courbe et aux accidents en ligne droite. L’État a donc mis de l’argent et de l’énergie dans des études destinées à apporter des solutions techniques intéressantes. Je confirme que nous sommes preneurs de toutes ces évolutions.
On ne peut qu’être également favorable aux outils permettant de combattre l’alcoolémie, tels les éthylotests anti-démarrage – dont l’usage a été heureusement systématisé dans les transports en commun et professionnels. J’observe toutefois que ces dispositifs ne sont installés qu’après qu’on a constaté l’infraction. Aussi, il ne faut pas se tromper de cible, donc être d’abord efficace dans la lutte contre l’alcoolo-dépendance. Or, les familles concernées sont souvent identifiées depuis longtemps par les services sociaux : il s’agit d’un problème de société qui dépasse largement le cadre de la route. Il faut donc agir en amont, notamment par l’éducation, en montrant aux jeunes que l’on peut s’amuser autrement qu’en consommant de l’alcool, et par la sensibilisation des familles.
Les visites médicales sont un sujet d’autant plus complexe que la population vieillit et qu’il faut éviter toute stigmatisation liée à l’âge. Qui plus est, certaines personnes de 75 ans sont pleinement aptes à conduire. Est-il vraiment nécessaire de créer un nouveau « machin » ? Notre système de santé est performant, ne suffirait-il pas de sensibiliser les médecins-traitants – mais aussi les familles ?
La question relative à la multi motorisation des ménages renvoie aux modes de vie : 36 % des ménages sont multi motorisés, nombre de familles vivent à la campagne et ont besoin de plusieurs véhicules. Si l’on veut inverser cette tendance, il faut proposer des alternatives intelligentes aptes à favoriser des reports modaux, mais cela suppose une réflexion de fond à laquelle notre société ne semble pas encore prête. Il y faudrait en outre du temps : il est bien difficile de traiter ces questions à très long terme pendant la durée d’un mandat électoral… Or, c’est quand on prend des décisions précipitées que l’on provoque des réactions. Ainsi, on peut faire comprendre que réduire la place de l’automobile en ville est une nécessité, mais il faut pour cela proposer des alternatives car on ne peut empêcher les gens de vivre.
M. le président Armand Jung. Merci beaucoup, messieurs.
*
* *
Audition de Mme Geneviève Laferrère, présidente et de Mme Monique Giroud, suppléante, de la Fédération française des usagers de la bicyclette
Mardi 12 juillet 2011
M. le président Armand Jung. Présentés tantôt comme les victimes, tantôt comme les responsables de nombreux accidents, les deux-roues ont été au cœur d’une grande partie de nos auditions. D’après vous, quelles sont les principales causes d’accidents impliquant les deux-roues non motorisés ? Quelles mesures préconisez-vous pour y remédier ?
Mme Monique Giroud, présidente suppléante de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Au risque de sembler provocatrice, je dirai d’abord que la réflexion sur la sécurité ne concerne pas tellement les vélos : il n’y a que 150 cyclistes tués par an sur un total de 4 000 victimes de la circulation.
Mme Geneviève Laferrère, présidente de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Certes. Mais tant pour le nombre que pour la gravité des accidents, la distinction entre deux-roues avec ou sans moteur est essentielle. En faveur des premiers, il faut vraiment faire un effort national. Mais le nombre de tués à vélo a baissé de 10 % l’an dernier pendant que le nombre total de tués sur route ne diminuait que de 2 %. Or, dans le même temps, la pratique du cyclisme a explosé en centre-ville. Le fait est qu’en provoquant une baisse de la vitesse, l’augmentation du nombre de cyclistes réduit le nombre de blessés et de tués, comme l’a montré le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU).
Mme Monique Giroud. À Paris et à Lyon, où Vélib’ et Vélo’V ont fait augmenter de 80 % la pratique du vélo, la fréquence des accidents de cyclistes par rapport au nombre de déplacements a baissé de 20 %.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Le fait que certaines villes autorisent les vélos à rouler à contresens ou sur les trottoirs, en dépit du code de la route, est-il accidentogène ?
Mme Geneviève Laferrère. L’article R-110 du code de la route dispose que, dans les zones où la vitesse de circulation est limitée à 30 kilomètres-heure, les vélos peuvent rouler à contresens dans les rues à sens unique, à moins que le maire ne l’interdise. Mais il est vrai que cette règle n’est pas connue de tous, d’où certains malentendus. À Grenoble, où elle est appliquée de manière systématique, tout se passe très bien.
En revanche, il ne semble pas souhaitable de multiplier les aménagements cyclables sur trottoir. Selon le code de la route, les cyclistes de plus de huit ans ne doivent pas rouler sur les trottoirs s’il n’existe pas d’aménagements spécifiques. Le problème est que ces derniers empiètent sur le domaine très restreint des piétons, ce qui génère des conflits avec les cyclistes, lesquels croient souvent plus sûr de ne pas rouler sur la chaussée, alors que c’est l’inverse. La place des vélos, comme celle des autres véhicules, est sur la chaussée.
Mme Monique Giroud. Une étude de l’Observatoire de la sécurité des déplacements, qui a recensé tous les accidents survenus depuis dix ans dans l’agglomération grenobloise, montre qu’ils se produisent à 80 % en intersection, particulièrement le long des axes urbains à quatre voies, parce que les automobilistes ne voient pas arriver les cyclistes qui roulent sur le trottoir.
M. le rapporteur. En dehors de l’aspect réglementaire, la circulation à contresens, de plus en plus fréquente même hors des zones limitées à 30 kilomètres-heure, est-elle dangereuse ?
Mme Monique Giroud. À Strasbourg, Grenoble et Bordeaux, où les rues à double sens cyclable sont nombreuses, la fréquence des accidents n’a pas augmenté, bien au contraire.
M. le président Armand Jung. Je le confirme pour Strasbourg.
Mme Geneviève Laferrère. Quand les cyclistes arrivent de face, les conducteurs de véhicules les voient mieux. Ils apprécient plus précisément les distances latérales que lorsqu’ils effectuent un dépassement. Enfin, ils ne risquent pas d’ouvrir une portière. En ville, on se respecte quand on se voit. C’est pourquoi il y a très peu d’accidents à contresens.
M. le président Armand Jung. La première fois qu’un automobiliste voit surgir face à lui un cycliste dans une rue à sens unique, il est forcément surpris, mais tout est question d’habitude. Généralisation, réglementation et pédagogie sont essentielles.
M. le rapporteur. En effet. Autre chose : croyez-vous souhaitable que les infractions concernant les cyclistes soient répercutées sur le permis à points ?
Mme Monique Giroud. Selon un arrêt du Conseil d’État qui remonte à 1995, cela serait illégal.
Mme Geneviève Laferrère. Au nom du principe d’égalité : cela conduirait en effet à sanctionner plus lourdement les usagers de la bicyclette qui ont passé leur permis.
M. le president Armand Jung. Il y a en effet une jurisprudence dans ce domaine. En revanche, l’automobiliste et le cycliste qui grillent un feu rouge acquittent la même amende.
M. Dominique Raimbourg. Constatez-vous des difficultés particulières liées à la montée en puissance des vélos électriques ? L’éclairage des bicyclettes est-il satisfaisant à l’achat et sur la durée ?
Mme Monique Giroud. Les vélos à assistance électrique homologués ne posent aucun problème particulier tant qu’on n’augmente pas leurs seuils de puissance et de vitesse.
Le fait que beaucoup de vélos circulent sans éclairage satisfaisant tient à l’insuffisance des équipements de première main. Le problème n’est pas réglementaire. Il concerne les normes de qualité industrielles.
M. Gérard Voisin. Que penser de la forte pression qui s’exerce sur les élus locaux pour qu’ils mettent en place à grands frais des voies cyclables dont l’utilisation sera restreinte ? Au Japon, où je me rends souvent, l’utilisation des trottoirs par les vélos, qui ne requiert aucun investissement particulier en dehors de quelques panneaux, ne pose aucun problème. Pourquoi en va-t-il différemment en France ?
Mme Geneviève Laferrère. Sans être nécessaires partout, des aménagements sont utiles à certains points stratégiques, notamment aux carrefours entre les axes principaux. Grâce aux nouveaux outils prévus par le code de la route ou celui de la rue, la cohabitation entre les différents usagers a été aménagée dans les centres-villes. Ailleurs, notamment dans le périurbain, la place de chacun doit être réservée, par exemple au moyen d’un marquage au sol.
Le vélo n’est pas dangereux, mais son développement doit être organisé. Dans les villes, il faut de toute façon limiter la place de la voiture, même électrique, car les rues sont saturées. La difficulté est de redonner un espace aux vélos sans empiéter sur les trottoirs. Nous militons depuis longtemps pour qu’on laisse le cycliste sur la voirie, où on le voit mieux, et pour qu’on rende le trottoir aux piétons. Nous y travaillons au niveau local avec des associations de parents d’élèves ou de défense des droits des piétons. L’une d’elles, « Rue de l’avenir », veut donner leur juste place aux transports en commun, aux piétons et aux cyclistes.
Mme Monique Giroud. Le seul cas dans lequel le double sens cyclable génère un risque d’accident, c’est quand, à une intersection, l’automobiliste oublie de regarder des deux côtés. Le danger disparaîtra bientôt si l’on généralise le dispositif et qu’on l’explique.
Je ne connais pas le Japon, mais, à mon sens, on ne peut pas transposer en France des mesures en vigueur dans les pays où les automobilistes respectent parfaitement piétons et cyclistes. En Grande-Bretagne, il suffit d’avancer un pied ou une roue sur un passage réservé pour que les voitures s’arrêtent.
Mme Geneviève Laferrère. En outre, au Japon comme dans les pays nordiques, les trottoirs sont larges. En France, il faut éviter la congestion urbaine, un phénomène qui pénalise tout le monde. Au lieu de réfléchir uniquement en termes de sécurité, on doit organiser la cohabitation. À Strasbourg ou Bordeaux, le développement massif du vélo s’est accompagné de la mise en place de tramways et de systèmes de transport lourd.
Mon point de vue vous paraît sans doute plus technique que celui d’un simple militant associatif. C’est que j’ai une formation d’ingénieur transport ; j’ai travaillé sept ans au CERTU, et trois ans à la cellule dédiée aux déplacements et à la sécurité dans le Rhône.
En matière de sécurité, nous réfléchissons essentiellement sur la problématique des angles morts des camionnettes, des poids lourds et des autobus.
M. le président Armand Jung. Il semble d’autre part que neuf cyclistes sur dix ne respectent pas les feux rouges.
Mme Monique Giroud. Peut-être. Néanmoins, selon un rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la proportion de conducteurs responsables en cas d’accident est légèrement inférieure parmi les cyclistes.
M. le président Armand Jung. Que préconisez-vous quant au port du casque ? Faut-il le rendre obligatoire ?
Mme Monique Giroud. Ce serait une fausse bonne idée. Selon une étude de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), il n’est protecteur que dans 2 % des accidents. En outre, le pourcentage de lésions à la tête étant le même pour les cyclistes et les piétons, il faudrait alors, en bonne logique, l’imposer aussi à ces derniers.
M. le président Armand Jung. Faut-il se fier à ces chiffres ? Il semble exister de grandes différences selon les sources.
Mme Geneviève Laferrère. Celui que je cite ne provient pas de la sécurité routière, mais du suivi effectué par les services d’urgence du département du Rhône, qui ont reçu plus de 8 000 cyclistes accidentés en dix ans. Ils ont relevé leur âge, le type de blessures et leur gravité, la durée d’hospitalisation, le lieu et les conditions de l’accident, en précisant chaque fois s’ils portaient ou non un casque. Sur 144 cyclistes gravement blessés à la tête, il n’y a guère que les cyclistes sportifs accidentés en rase campagne.
Mme Monique Giroud. Il faut ajouter à cela le risque d’un effet pervers. Dans les quelques pays où le port du casque a été rendu obligatoire, 30 % des cyclistes se sont reportés sur les deux-roues motorisés, qui sont infiniment plus dangereux que les vélos.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, mesdames, de ces réponses claires et précises.
*
* *
Audition de Mme Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière
Mardi 12 juillet 2011
M. le président Armand Jung. Je souhaite la bienvenue à Mme Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, dont l’avis nous sera précieux s’agissant de la ou des causes principales de l’accidentologie.
Mme Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. Je vous remercie de m’accueillir et de pouvoir ainsi restaurer quelque peu l’image de la Ligue, car nous sommes souvent victimes de caricatures – nous serions autophobes, motophobes...
Nous sommes des bénévoles qui partageons les mêmes valeurs de partage, de tolérance, de respect de l’autre et des règles, ce dont il faudrait presque parfois s’excuser. Tout a commencé en 1983 avec quatre femmes qui avaient perdu leurs enfants dans des accidents de voiture et qui avaient décidé que cela n’arriverait pas à d’autres. À l’époque, elles pouvaient dire, en se rendant dans les écoles, qu’un enfant sur dix mourrait avant ses dix-huit ans ou serait gravement blessé. Tout était à faire, car dans la tête des gens l’accident n’était pas évitable : c’était une fatalité.
Notre objectif, comme cela figure dans notre logo, est zéro accident. Cela fait rire, et il est vrai que cela relève un peu de l’utopie. Mais n’est-ce pas ce qui fait souvent progresser l’humanité ? En tout cas, si nous avons choisi cet objectif, auquel nous tenons beaucoup, c’est aussi pour appliquer ce qui se fait dans le monde de l’entreprise, à savoir l’analyse de toutes les causes, en l’occurrence de l’accident, pour mieux les combattre.
Nous n’avons pas de conflits d’intérêt – nous n’organisons pas, par exemple, de stages de récupération de points –, nous sommes apolitiques – nous aiguillonnons aussi bien la droite que la gauche –, et tous ceux que nous accueillons viennent nous voir pour faire avancer une cause, c’est-à-dire un grand problème de santé publique.
Nous ne privilégions aucune cause s’agissant des facteurs de l’accidentalité. Pour nous, les quatre premiers facteurs d’accidents sur nos routes sont d’abord l’alcool, puis la vitesse, l’utilisation du kit mains libres et le non-port de la ceinture.
Nous avons un bilan dont nous n’avons pas à rougir. Nous nous sommes battus pour que le taux d’alcoolémie délictuel baisse, pour que la vitesse en ville passe à 50 kilomètres/heure maximum, pour que le port des ceintures à l’arrière soit obligatoire – cela nous a pris sept ans pendant lesquels nous avons été, là encore, traités de grands utopistes qui privaient les gens de leur liberté –, ou pour que les enfants aient des systèmes spécifiques pour s’attacher à l’arrière des voitures. Qui oserait remettre cela en cause aujourd’hui ?
Nous nous portons partie civile lorsque notre cause est battue en brèche, et pour faire avancer celle-ci dans les tribunaux par des procès exemplaires. Nous avons mené un très grand combat pour le permis à points et, en 1992, lorsque les routes étaient bloquées, c’est en discutant avec les routiers, qui étaient alors taillables et corvéables à merci, que nous avons réussi à obtenir que, si l’on changeait leurs conditions de travail, ils lèveraient les barrages.
Nous collaborons avec de nombreux pays – l’Espagne, la Colombie et bien d’autres encore – et nous avons été des ambassadeurs du modèle français, en montrant tout ce que notre pays avait été capable de réaliser à partir de 2002, et en étant très fiers d’exporter ce modèle. Aujourd’hui, je me suis permis d’arborer une décoration qui m’a été remise par le ministre de l’intérieur espagnol, M. Alfred Perez Rubalcaba – qui a parlé, à cette occasion, d’une nouvelle technologie espagnole : le « copier-coller des Français » –, car nous avons aidé son pays à mettre en place le permis à points, notamment en facilitant la rencontre entre M. Rémy Heitz, délégué interministériel français à la sécurité routière, et M. Pere Navarro, directeur général espagnol du trafic.
Du fait d’ailleurs de ces nombreuses relations avec les autres pays, nous lançons la Ligue internationale contre la violence routière, car nous sommes saturés de ces grandes institutions, pleines de bonne volonté – OMS, ONU, etc. –, qui organisent de grandes Journées du souvenir, mais qui ne prennent pas les décisions que nous attendons, telle que la limitation de la vitesse des voitures à la construction, que nous réclamons depuis la rédaction du Livre blanc demandé par M. Michel Rocard en 1988. Et de même que nous mettons en place des passerelles avec les autres associations pour échanger les bonnes pratiques, nous souhaitons que les pays le fassent à leur niveau.
Pour atteindre l’objectif zéro accident et donc pour faire avancer la situation s’agissant des quatre facteurs d’accidents que je décrivais, nous demandons la mise en place de boîtes noires – l’ADN des accidents – afin d’avoir une meilleure connaissance de l’accidentologie. Personne ne remet en cause les boîtes noires sur les avions, et l’on en a besoin pour les accidents de train. Pourtant, on nous dit souvent que c’est un « flic » embarqué. Non. C’est un avocat embarqué. C’est une aide dans la procédure, et les familles ont besoin de comprendre ce qui s’est passé. Et cette boîte enregistre les paramètres des dernières secondes avant l’accident, notamment la vitesse exacte.
Prenons l’exemple de l’accident de Joué-les-Tours, qui a défrayé la chronique fin mai, où une camionnette a fauché des enfants tuant une fillette de cours élémentaire et faisant des blessés graves et des blessés légers. Avec la boîte noire, les gendarmes, au lieu de se lancer dans une enquête technique approfondie, auraient disposé tout de suite des paramètres de l’accident. Nous souhaiterions donc le lancement d’une expérimentation en la matière, notamment dans les flottes publiques. Il est prévu depuis plus d’un an que 200 boîtes noires soient expérimentées par la gendarmerie nationale. La mise en œuvre de cette expérimentation serait un signe très fort. Quand, à Berlin, la police a installé des boîtes noires sur ses véhicules, six mois après on comptait un tiers d’accidents en moins. De même, quand la société Cofiroute a placé des boîtes noires dans les véhicules d’une vingtaine de volontaires, là encore un changement des comportements a pu être constaté. Aux États-Unis, 65 % des véhicules ont une boite noire à l’insu du conducteur, simplement pour répondre à l’acheteur en cas de procès, et les autorités fédérales réfléchissent à une généralisation. La boite noire permettra de faire progresser l’accidentalité et l’accidentologie.
J’en viens au Lavia, l’avertisseur radar permanent, système qui informe immédiatement les conducteurs – qui sont des millions à souhaiter ne plus avoir à scruter en permanence leur compteur – de la vitesse de leur voiture. Ce serait la fin des radars au bord de nos routes. Qui peut s’opposer à cela ? Pourtant, une sorte d’omerta entoure ce procédé alors qu’une expérimentation faite dans les Yvelines a montré que ce système embarqué était fiable et opérationnel. Nous attendons la deuxième expérimentation, mais encore faut-il que la cartographie embarquée soit certifiée, ce qui implique que l’État s’engage. Sinon, les constructeurs ne mettront jamais en place ce système. Nous déplorons donc l’arrêt de l’expérimentation, sachant que le blocage, concernant par ailleurs la limitation de la vitesse des voitures à la construction, vient notamment de la part des constructeurs allemands.
S’agissant du téléphone, l’expertise collective lancée sous l’égide de Mme Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière, a montré que le téléphone, qu’il soit tenu en main ou qu’il s’agisse d’un kit main libre, multiplie le risque d’accident par trois. Chaque année, 400 personnes meurent dans notre pays parce que quelqu’un téléphonait. Or, dix-neuf mois d’études plus tard, aucune décision n’a été prise ! Il faut tout de même rappeler, quand l’on entend parler d’atteinte à la liberté individuelle, que, dans 60 % des cas, celui qui va mourir n’a rien fait. C’est une famille heureuse, de retour de vacances, qui est victime d’un choc frontal avec un véhicule dont le conducteur téléphonait.
On nous parle du cannabis – encore que le risque est moindre puisque l’on compte 120 morts chaque année du fait de son usage. Est-ce qu’il serait moins grave de mourir parce que quelqu’un a téléphoné au volant ? Quelle différence cela fait-il pour la famille ? Aussi, nous demandons de la cohérence : qu’il y ait, bien évidemment, des actions contre la conduite sous l’emprise du cannabis, mais que l’on sanctionne également ceux qui téléphonent au volant.
Quant à la mise en place des radars de troisième génération – mesure qui avait été présentée en mars 2006 comme urgente à prendre –, l’appel d’offres a bien été lancé par les services de M. Claude Guéant, quelques semaines après son entrée en fonction, mais que de temps perdu ! Pourtant, cela signifierait – même si je préfère le Lavia – que partout et à tout moment nous serions susceptibles d’être contrôlés,
Nous souhaitons aussi une communication efficace. Or, il n’y en a eu aucune depuis trois ans. Comment voulez-vous que les Français acceptent des mesures qui « réduisent » leur liberté si on ne leur explique pas pourquoi ? L’acceptabilité dépend de l’information. Quand M. Rémy Heitz était délégué interministériel à la sécurité routière, un tiers de son temps était consacré aux médias, lesquels sont affamés d’information. Ils sont là pour relayer et pour expliquer ce que les politiques ont décidé. Les campagnes d’information doivent donc accompagner les mesures. Sinon, elles ne font que jouer sur l’émotion, sans rien changer aux comportements.
Nous demandons la remise en place du Conseil national de la sécurité routière (CNSR), disparu – dans quel monde vivons-nous ? – depuis trois ans. Comment en effet aider les décideurs politiques s’il n’y a pas en amont des discussions organisées avec les acteurs de la sécurité routière et, surtout, les experts ? De même, il conviendrait que l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dispose des moyens humains nécessaires à la production de statistiques. Nous serons d’autant plus exigeants qu’ils seront nombreux – et non quatre ou cinq comme à l’heure actuelle – pour répondre à nos demandes.
Nous insistons pour qu’un travail soit entrepris dans le monde de l’entreprise où un accident sur deux est dû à la route – l’accident de trajet. Rien n’y est fait, sinon signer des chartes – nous avions une déléguée interministérielle qui en était une spécialiste –, le tout sans aucun suivi. Or, on assiste depuis quelques années à une remontée de l’accidentalité concernant les véhicules utilitaires légers car il n’y a pas de carnet de bord. On ne sait pas qui conduit et l’amende est payée sans qu’il y ait de retrait de points, ce qui peut entraîner par là même des conditions de travail insupportables pour l’employé.
Nous réclamons un – ou une – délégué interministériel qui dépende de Matignon et non d’un seul ministère. Avec l’intervention du ministère de l’intérieur, la connotation est extrêmement négative, le terme de répression étant préféré à celui de sanction. À l’université, si les étudiants ne satisfont pas au contrôle de fin d’année, une sanction tombe : ils n’ont pas leur examen. Est-ce pour autant qu’ils accusent l’université d’être répressive ? Quand on ne respecte pas une règle, on est sanctionné.
Après deux ans de stagnation, le constat que l’on peut faire aujourd’hui est mauvais. L’objectif du Président de la République de baisse du nombre annuel des accidents pouvait pourtant être atteint, puisque l’on avait constaté une diminution de 10 % environ chaque année. Or, il ne l’a pas été ces deux dernières années et demi – je ne pointerai pas à nouveau l’action de la déléguée interministérielle – alors que ce sont 1 800 vies qui auraient pu être sauvées si la courbe descendante que nous connaissions depuis 2002 s’était poursuivie. Il faut en effet expliquer aux Français que 25 000 vies ont été sauvées depuis cette date, d’autant qu’on ne leur parle déjà pas assez de ces familles meurtries qui vivent avec des personnes handicapées, cela sans qu’on les aide suffisamment.
On parle du racket des radars. Il faut être sérieux ! Qu’est-ce que 500 millions d’euros perçus en amendes au regard des 24 milliards d’euros du coût de l’insécurité routière en 2009 ? Et qu’en est-il des assurances qui n’ont pas augmenté pendant des années – encore qu’elles vont certainement croître de 10 à 20 % du fait de l’accidentalité qui remonte ?
Que doit-on faire ? Se croiser les bras ou prendre des mesures qui fâchent ? N’aurait-on pas le courage dans ce pays d’expliquer pourquoi on prend de telles mesures ? C’est pourtant de la vie des gens dont on parle !
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je suis quelque peu désappointé car vous avez répondu par avance à l’essentiel des questions que j’allais poser.
Concernant cependant la vitesse, comment expliquez-vous, alors que l’on ne peut rouler en France, comme dans nombre de pays européens à plus de 130 km/h, que l’on vende des voitures qui roulent à 250 km/h ? À quoi cela sert-il et pourquoi n’y a-t-il pas, comme dans certains pays, de bridage des véhicules à la construction ?
Mme Chantal Perrichon. On peut en effet vraiment se demander à quoi cela sert, surtout que, sur l’ensemble du réseau, donc même en ville, ce sont les voitures les plus puissantes qui ont le plus d’accidents – les bases de données des assureurs sont éloquentes. On nous répète que les autoroutes allemandes ne sont pas limitées. C’est se moquer du monde : un tiers d’entre elles seulement n’est pas limité. Nous n’arrivons d’ailleurs pas à obtenir du gouvernement allemand l’accidentalité entre les autoroutes limitées et les autres – je vous laisse deviner pourquoi. Un représentant de la police allemande m’a avoué pour sa part que si l’on relevait 200 morts sur les deux tiers d’autoroutes limitées, on en comptait plus du double sur les autres. Cherchez l’erreur ! On sait bien que la vitesse tue. Il faut être dans le déni de la réalité pour affirmer le contraire.
Ce qui a tout changé en 2002, c’est la mise en place des radars, et non pas l’appel à la responsabilité des conducteurs ou encore la transformation des véhicules ou des changements dans l’infrastructure. Tout le monde, brusquement, a alors changé son comportement au volant.
Certains, certes, ne comprennent pas pourquoi on s’attaque aux petits excès de vitesse. Mais la gauche s’était attaquée aux grands excès de vitesse en annonçant en 1997 sa volonté de diviser par deux le nombre de morts en cinq ans. Or, non seulement en 1998 le nombre des morts avait augmenté, mais au bout de cinq ans l’accidentalité n’avait baissée que de 2,2 %, ce qui montre bien que l’objectif visé n’était pas le bon. Si le comportement a changé ensuite, et que la vitesse moyenne a baissé, c’est parce qu’il n’y avait plus de tolérance pour les petits excès, sachant que la gendarmerie acceptait un dépassement jusqu’à 30 km/h de la vitesse autorisée au prétexte que sinon elle devrait arrêter tout le monde.
Nous savons, depuis les travaux de Nilsson en 1982, que 1 % de vitesse en moins se traduit toujours par 4 % de morts en moins. Nous l’avons nous-même vérifié entre 2002 et 2009 où la baisse des vitesses moyennes pratiquées de 10 km/h a abouti à 40 % de tués en moins.
Concernant l’alcool, en 2002 comme aujourd’hui, 30 % des morts sont dus à cette cause. Or, rien n’a été fait en matière de lutte contre l’alcool – on compte toujours 10 millions de contrôles d’alcoolémie par an. Le lobby de l’alcool est extrêmement puissant. Nous n’avons pas obtenu l’interdiction de la vente d’alcool dans les stations service, et ceux qui ont un problème avec l’alcool ne sont ni suivis ni orientés vers les centres d’addictologie – dans l’accident de Chelles, le conducteur était ivre, sans permis et récidiviste.
Ce qui a changé cependant, c’est que l’on roule moins vite. Les causes de l’accident étant multifactorielles, quand vous supprimez un facteur dans l’arbre des causes, le risque d’accident diminue : à alcoolémie égale, si vous roulez moins vite, l’accident n’arrive pas.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Êtes-vous d’accord avec la mesure adoptée dans la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) assouplissant le système actuel de récupération des points – dans un délai de 6 mois, au lieu d’un an pour les petits excès de vitesse ?
Mme Chantal Perrichon. Certes non ! Comment voulez-vous obtenir plus de vigilance et de concentration de la part d’un conducteur s’il sait qu’il récupérera le point perdu au bout de six mois et non plus un an, et qu’il pourra suivre un stage de récupération de points tous les ans – quelle que soit la gravité de la faute et en dépit de l’iniquité entre ceux qui pourront s’offrir un stage chaque année et les autres ?
Sans être trop désagréable, permettez-moi de dire que ceux qui ont présenté les amendements en question ne parlent pas avec des experts. Il faut aller voir ceux qui savent. La Ligue, pour sa part, n’en est pas un. Si elle a accumulé une petite culture en matière de sécurité routière, elle travaille en permanence avec des experts : ce n’est pas parce que vous faites de l’automédication que vous devenez cardiologue. Chacun croit savoir, mais n’a en fait qu’un petit vernis de sécurité routière. Nous avons même parfois l’impression que les amendements en la matière, c’est un peu le concours Lépine ! Or, très concrètement, ce qui est en cause c’est la vie de 66 millions de Français.
Nous sommes donc contre de tels amendements. Nous avons d’ailleurs souhaité que le Gouvernement se mobilise, et nous avons été très déçus. Nous espérions qu’il n’autorise que la récupération de deux points chaque année car on sait bien que cette petite pression qui joue sur le conducteur oblige à plus de concentration. Avec douze points, on peut en perdre un – à la Ligue, des gens ont perdu un voire deux points et ce n’est pas un drame. Simplement, celui qui perd un point fait attention pendant un an. Or, ce qui est grave, c’est que, alors que l’on était dans un cercle vertueux avec 36 % de plus de conducteurs ayant récupéré l’intégralité de leurs points au bout de trois ans, on freine brusquement la démarche engagée.
Nous avions alors annoncé que l’on courait le risque d’une augmentation des morts et des blessés. Les résultats des mois qui viennent de s’écouler vont dans ce sens. Les gens sont plus sereins, font moins attention. C’est la raison pour laquelle le Lavia nous semble si important. Les radars, c’est hier. Le Lavia, c’est aujourd’hui et demain.
M. Jacques Myard. J’ai toujours pensé qu’il fallait aller vers celui qui cherche la vérité et fuir celui qui la trouvait. À cet égard, je vous trouve dogmatique. Nous avons eu 10 % de tués en plus sur nos routes – taux en effet inacceptable, car nous sommes d’accord sur l’objectif – contre 16 % en Allemagne, 19 % en Finlande et 27 % en Suède ; or, pour expliquer ce phénomène, vos explications sont un peu courtes. De plus, rejeter la faute sur des députés dits irresponsables est inadmissible.
Les experts auxquels vous vous référez l’ont démontré : un mouvement incontrôlé à 40 km/h peut tuer comme à 70 ou à 80 km/h. La camionnette qui a provoqué l’accident que vous avez analysé allait à très basse vitesse. Vous focaliser sur la vitesse, alors qu’il faut rechercher les causes en amont, relève de l’autisme.
Je suis convaincu que l’alcool est un problème tout comme le cannabis, le mélange des deux ou encore la somnolence. À cet égard, je suis d’accord avec vous concernant le Lavia, c’est-à-dire l’information en temps réel sur la vitesse qui doit être respectée. Mais mettre l’accent uniquement sur la vitesse n’est plus, je le crains, d’actualité. Il faut rechercher les causes réelles des accidents en allant au-delà de la simple répression de la vitesse, politique qui a eu ses effets, mais qui a aujourd’hui atteint ses limites.
Mme Françoise Hostalier. Que pensez-vous des campagnes de communication avec des images violentes comme celles qui ont porté sur le tabac ? Est-ce positif ou contre-productif ?
Ne faudrait-il pas par ailleurs mener davantage d’actions de prévention dans les écoles pour prévenir la violence des futurs conducteurs ou des jeunes usagers de deux roues ?
M. Alfred Trassy-Paillogues. Vous avez souhaité en introduction de votre propos ne pas être caricaturée. Pour ne pas l’être, encore faut-il soi-même ne pas caricaturer les autres. Or, vous avez caricaturé quelque peu Mme Merli et, plus massivement encore, les élus que nous sommes. Que cela plaise ou non, nous représentons notre population.
Vos raisonnements ne sont d’ailleurs pas exempts d’à peu près : vous expliquez parmi les paramètres de l’accidentologie que l’alcoolisme, ce n’est pas trop grave à petite vitesse. Mais quand on a deux grammes d’alcool dans le sang, attache-t-on de l’importance à la présence ou non de radars et donc à la vitesse ?
Là où je vous rejoins en revanche, c’est que l’arrivée des nouvelles technologies – assistance à la conduite et autres – permettra des améliorations grâce à des véhicules et à une route que l’on pourra qualifier d’intelligents. Ces nouvelles technologies répondront d’ailleurs, de façon quasi automatique, à la question du bridage des véhicules puisque les véhicules électriques, par exemple, rouleront à des vitesses moindres pour préserver une certaine autonomie. Renault sortira d’ailleurs deux modèles à grande diffusion en 2011 et deux autres en 2012.
Vous n’avez pas par ailleurs évoqué le problème de la signalétique fantaisiste sur les routes françaises, ni l’état de ces dernières et les éventuels points noirs.
Vous évoquez également la nécessité d’une concentration extrême du conducteur. Mais une réglementation toujours plus répressive n’est-elle pas plutôt anxiogène, notamment pour les conducteurs qui ont besoin de leur permis de conduire pour travailler ?
Enfin, que penseriez-vous d’une expérimentation de contrôles massifs d’alcoolémie et d’usage de drogues sur un an, délai qui permettrait de comprendre vraiment ce que ces fléaux provoquent comme accidentologie et ce que leur traitement pourrait avoir comme résultat ?
M. Dominique Raimbourg. Pourriez-vous nous expliquer plus précisément en quoi consiste le Lavia ?
Par ailleurs, comment le bridage des véhicules à 130 ou 150 km/h peut-il permettre de respecter les vitesses limitées à 50 ou 90 km/h ?
M. le président Armand Jung. Le Lavia est un limiteur intelligent de vitesse lié au GPS ou, dans deux ou trois ans, à Galiléo.
M. Jacques Myard. Permet-il toujours d’accélérer ?
M. le président Armand Jung. Tout à fait. Le problème est que le GPS n’est intelligent que par rapport aux données qu’on lui donne. Or, les changements de données ne sont pas forcément instantanés, et celles-ci peuvent donc être erronées.
Mme Françoise Hostalier. Il peut y avoir problème aussi lorsque le signal GPS se perd.
Mme Chantal Perrichon. Les mots, monsieur Myard, qui m’ont été adressés sont forts.
M. Jacques Myard. Je les maintiens, mais ils ont été prononcés en toute amitié.
Mme Chantal Perrichon. Préservez-moi alors de votre amitié !
Vous avez plus fait part d’un sentiment que de questions, et je n’y répondrai donc pas. Je suis dogmatique, autiste : notre association reste toujours pour vous quelque chose de caricatural.
M. Jacques Myard. Pas sur tout.
Mme Chantal Perrichon. Il y a un progrès !
S’agissant, madame Hostalier, de la pédagogie, notre association est une fédération nationale composée d’associations départementales dont les adhérents qui le souhaitent se rendent dans les écoles pour expliquer la dangerosité de la route. Nous veillons cependant à ne pas tout faire peser sur les épaules de l’enfant en lui demandant à lui seul de faire attention. La rue en effet n’est plus faite pour les piétons, mais pour les voitures, et c’est pourquoi nous demandons une meilleure répartition des responsabilités. L’école est toutefois importante, car c’est un socle à partir duquel on va pouvoir faire passer des messages afin qu’en grandissant, les enfants comprennent mieux pourquoi certaines mesures sont prises.
Pour ce qui est des campagnes de communication, celles que les pays anglo-saxons ont produites pendant longtemps étaient extrêmement violentes. À notre tour, dix ou quinze ans après, nous nous sommes lancés dans de telles campagnes qui choquent. Pour autant, nous ne changerons pas un comportement uniquement par l’émotion. Cela laisse une trace, mais quand il conduira, l’automobiliste ne pensera pas à la campagne de communication. C’est pour cela que celles qui sont lancées doivent être pédagogiques en expliquant pourquoi certaines mesures sont prises.
Concernant les deux roues auxquels vous avez fait allusion, nous demandons que des contrôles soient réalisés de temps en temps dans les établissements scolaires, car, dès qu’ils achètent un cyclomoteur, la première chose que font les jeunes c’est de commander des kits de débridage – hier en Belgique, aujourd’hui sur Internet. Non seulement ils apprennent ainsi à contourner la loi, mais ils se mettent en danger, avec une mortalité effrayante. Nous souhaitons même qu’une charte soit signée par les parents par laquelle ils s’engagent, avec l’enfant, à ce que le cyclomoteur ne soit pas débridé. Il devrait d’ailleurs en aller de même pour le permis de conduire qui devrait s’appeler « engagement à conduire » – les mots sont très importants.
Pour ce qui est de la signalétique, monsieur Trassy-Paillogues, nous estimons que, plutôt que de dépenser 8 millions d’euros pour l’installation des nouveaux radars pédagogiques, il aurait suffi de déplacer ceux existants de façon aléatoire. L’argent ainsi économisé aurait alors permis d’installer des radars dans les villes ou à leurs abords.
Il conviendrait d’ailleurs que les commissions départementales de la sécurité routière, qui se réunissent fréquemment, soient l’occasion de vérifier la légitimité des limitations de vitesse, car si elles ne sont pas compréhensibles, les gens ne pourront pas les accepter.
Quant au côté anxiogène qu’il y aurait à conduire avec la peur de perdre son permis, qu’il me soit permis de rappeler que 75 % des conducteurs ont douze points et que 90 % en ont entre dix et douze. Que je sache, nous ne fréquentons pas que des gens anxieux ! À cet égard, on nous parle souvent du permis blanc. Mais la France est le seul pays à utiliser cette formule. Lorsque quelqu’un a perdu ses points, l’entreprise peut très bien l’affecter à une autre tâche pendant le délai de six mois au terme duquel il pourra obtenir un nouveau permis.
Pour prendre l’exemple de la SAAQ, une compagnie d’assurance du Québec, les primes sont fonction du nombre de points retirés, car ses dirigeants sont arrivés à la conclusion que le degré de dangerosité d’un conducteur était corrélé au nombre de points perdus – la prime est multipliée par 4 après que les conducteurs ont perdu une première fois leur permis. On parle toujours ici de répression. Au Québec, cette mesure dissuasive a été prise, qui donne d’excellents résultats, pour faire en sorte que les comportements se modifient. S’il y a anxiété, cela concerne quel pourcentage de la population et pour combien de vies sauvées ?
Nous ne sommes pas une association de familles de victimes. Lorsque ces femmes ont créé la Ligue, la charte d’accueil des familles de victimes de la violence routière l’a souligné dès les premières lignes : nous accueillons les familles et les orientons vers des professionnels. Nous sommes dans la prévention. L’anxiété à cet égard de ceux qui ont perdu quelqu’un ne devrait pas être oubliée. Nous ne sommes pas ici en effet que pour parler de chiffres. Ce soir, des familles vont traverser un drame, et c’est pour cela que nous sommes aussi réunis, et non pas seulement pour fantasmer sur des données selon lesquelles la vitesse, par exemple, pourrait ne pas tuer. Nous sommes dans du concret et nous voulons des mesures concrètes qui nous permettront de gagner la bataille de la vie sur la route, parce que nous y croyons.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Pensez-vous qu’arrivé à un certain âge, il faudrait un examen pour vérifier les capacités à conduire ?
Mme Chantal Perrichon. Il s’agit d’une question récurrente importante. Très souvent lorsqu’un senior est auteur d’un accident mortel, la presse met en exergue l’âge du conducteur. Or les bases de données des assureurs montrent que ce ne sont pas les seniors qui sont les plus accidentogènes. Ils sont même, le plus souvent, victimes, car leur corps est plus fragile. Surtout, les seniors adaptent leur comportement à leurs performances : ils feront des trajets moins longs, ils rouleront moins de nuit et plus lentement. Leur comportement est à cet égard moins dangereux. Si 92 % des permis suspendus appartiennent à des hommes, faut-il d’ailleurs en conclure que, dans ce pays, seules les femmes pourraient conduire ?
Plus sérieusement, l’Espagne a mis en place des examens médicaux. M. Pere Navarro, directeur général du trafic espagnol, m’a conseillé de ne surtout pas le demander en France car ces visites, effectuées de façon automatique, ne servent à rien : elles n’ont pas fait baisser l’accidentalité.
Partons du principe que les seniors ne sont pas plus dangereux que les autres, sachant que s’il fallait vraiment se fonder sur la dangerosité, ce serait peut-être une autre catégorie de la population qui devrait ne pas conduire...
M. le président Armand Jung. Merci, madame, pour la clarté de vos propos et pour la passion que vous y avez mise.
*
* *
Table ronde sur l’acceptabilité sociale de la politique de sécurité routière : M. Fabrice Hamelin et Mme Isabelle Ragot-Court, chargés de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration) ; M. Benoît de Laurens, vice-président et Mme Sophie Dauphin, directrice conseil de l’agence « Lowe Strateus » (ancienne agence de communication de la DSCR)
Jeudi 1er septembre 2011
M. le président Armand Jung. Après avoir poursuivi ses travaux de manière décentralisée cet été, notre mission reprend son cycle d’auditions par une série de tables rondes qui se tiendront dans un délai resserré, notre objectif restant de rendre nos conclusions très rapidement, au plus tard à la mi-octobre. Je rappelle que M. le ministre de l’intérieur souhaite prendre connaissance de nos analyses avant de finaliser ses décisions.
Mesdames et messieurs les intervenants, je vous remercie de votre présence en cette période de prérentrée et je vous cède immédiatement la parole. Le sujet qui nous occupe aujourd’hui est essentiel. Au cours de nos auditions précédentes, notre attention a en effet souvent été appelée sur le seuil d’acceptabilité sociale de la politique de sécurité routière, au-delà duquel les mesures mises en œuvre ne sont plus efficaces car intolérables pour la population. Merci de nous éclairer à ce sujet.
M. Fabrice Hamelin, chargé de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Chargé de recherche à Sciences Po et à l’IFSTTAR, j’ai notamment travaillé sur l’acceptabilité sociale du contrôle sanction automatisé (CSA) et je partage l’idée, Monsieur le Président, qu’il est essentiel de s’assurer de la légitimité de toute politique publique en étudiant sa réception par le corps social. Nos sociétés politiques modernes sont dominées par l’impératif délibératif, lequel exige que toute décision soit concertée et que ses modalités d’adoption prennent en compte les aspirations des uns et des autres. Ainsi l’assentiment de la population à la politique de sécurité routière est-il étudié depuis longtemps, au moins depuis les années 1970, en particulier dans les pays de culture anglo-saxonne.
Il est acquis que toute tentative d’imposer une mesure peu acceptable est vouée à l’échec, du fait des phénomènes de rejet et de contournement ainsi que des controverses qui en découlent. En revanche, si une décision découle de la prise en compte d’un risque identifié et documenté – par exemple la tolérance zéro de l’alcoolisation pour les conducteurs de bus scolaires -, la question de l’acceptabilité se pose avec une moindre acuité.
L’acceptabilité sociale peut être mesurée au regard d’indicateurs quantitatifs fondés notamment sur les notions d’efficacité et d’équité perçues. Ces outils de mesure ont cependant leurs limites. D’abord, en tant que conducteur, je peux juger utile et efficace un outil de sécurité routière mais, du fait de problématiques qui me sont propres, ne pas l’utiliser car je considère qu’il est réservé aux autres, en particulier les « mauvais conducteurs ». Ensuite, ces instruments sont impuissants à faire ressortir finement les controverses – lesquelles constituent pourtant des obstacles significatifs à l’efficacité d’une mesure – et à retracer les évolutions de la popularité de la politique menée.
L’acceptabilité sociale, c’est aussi le résultat d’un travail de légitimation ou de dé-légitimation d’une politique publique. La réception d’une mesure par la population ne détermine pas à elle seule son efficacité et sa pérennité. Il faut aussi mobiliser les professionnels en charge de l’appliquer, en se demandant par exemple ce que pensent les gendarmes des radars mobiles.
L’acceptabilité politique d’une mesure s’évalue par la réception des élus et autres corps intermédiaires, ainsi que de la société civile et des communautés directement impactées. Il faut tenir compte des enjeux individuels où interviennent les problématiques personnelles : ma perception de la politique de CSA dépend aussi du radar devant lequel je passe tous les matins. Joue aussi le jugement porté sur les destinataires de la mesure : l’infractionniste verbalisé est-il un dangereux délinquant ou une victime ?
Mme Isabelle Ragot-Court, chargée de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Comme l’a exposé mon collègue, l’acceptabilité sociale d’une politique publique telle que celle de la sécurité routière se situe à la confluence d’enjeux sociaux et personnels. Au plan collectif, la politique de sécurité routière suscite une adhésion massive, chacun étant favorable à la diminution du nombre de morts. À l’échelle de l’individu, force est d’admettre que nos enjeux personnels mettent à l’épreuve notre acceptation des mesures prises.
Trois variables me semblent essentielles pour rendre acceptable une telle politique : la bonne information de ses destinataires, la perception de l’équité des mesures prises, la perception de leur efficacité.
L’information constitue la première condition d’acceptabilité : je dois connaître et comprendre la politique menée, dans ses objectifs comme dans ses modalités. A cet égard, un travail important a été accompli pour faire prendre conscience du risque lié à la vitesse préalablement à l’installation du système de CSA. Parallèlement, la politique menée gagne en crédibilité si les modalités de sa mise en œuvre sont aisément compréhensibles.
L’équité et la justice perçues sont déterminantes. Dans la mesure où l’usager est directement confronté au système, il est essentiel qu’il en comprenne les objectifs et qu’il ne considère pas que son application se fait à son détriment.
L’efficacité perçue est éminemment variable, comme en témoignent les appréciations très divergentes portées sur les évolutions des vitesses limites autorisées. Les représentations de la vitesse participent très étroitement de l’acceptation sociale des politiques menées : celui qui associe la vitesse au danger sera plus enclin à accepter le CSA et le LAVIA que celui qui l’associe au plaisir et à la liberté.
Cependant, les représentations ne sont pas figées et elles évoluent dans le temps, du fait notamment des politiques menées : aujourd’hui, celui qui se plaint d’avoir été verbalisé pour avoir circulé à 60 km/h en ville ne rencontre plus aucun écho favorable dans son entourage. Son indignation risque même d’être fort mal perçue par son environnement social.
Toutefois, si les pouvoirs publics laissent augurer un changement de tendance, les représentations n’évoluent plus ; in fine, l’acceptation sociale est entamée et l’on aura le plus grand mal à la restaurer.
La communication publique trouve la limite de son efficacité dans le fait que ce sont les pratiques qui comptent plutôt que les discours idéologiques. Le bon équilibre entre la prévention et la sanction se vérifie dans les actes plutôt que dans les déclarations d’intention.
Enfin, pour être acceptable, la politique de sécurité routière ne doit pas ignorer les facteurs d’accidentalité qui ne sont pas directement liés aux comportements humains.
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Le département communication de la DSCR, que je dirige depuis trois ans et demi, présente un fonctionnement atypique puisqu’il s’agit d’une équipe réduite d’une douzaine de personnes, en charge de l’un des plus gros budgets publics de communication – 17 à 18 millions d’euros. L’externalisation est très forte et nous travaillons avec les entreprises de tous les métiers de la communication.
La spécificité de la période présente, c’est que le plus gros a été fait et que, par conséquent, le plus dur reste à faire.
Depuis le début du millénaire, des progrès considérables ont été accomplis car ceux qui étaient les plus accessibles aux politiques menées ont changé de comportement. Pour descendre sous la barre des 3000 morts annuels, il convient, d’une part, de continuer à convaincre ceux qui sont devenus plus vertueux de le rester – en les aidant à intérioriser les enjeux de la sécurité routière plutôt que par peur du gendarme – et, d’autre part, de toucher désormais les plus récalcitrants.
M. le rapporteur Philippe Houillon. Est-ce à dire que nous serions arrivés à un seuil incompressible en deçà duquel il ne sera plus possible de réduire le nombre d’accidents mortels ?
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Absolument pas. Neuf accidents sur dix surviennent du fait d’une infraction au code de la route. Il n’y a donc aucune fatalité. À la différence d’autres accidents de la vie, les drames de la route sont parfaitement évitables. Au reste, huit à neuf Français sur dix considèrent que l’on peut encore progresser.
M. le rapporteur Philippe Houillon. Si je vous ai bien comprise, on peut tout de même considérer que ces progrès seront plus difficiles à accomplir désormais qu’un palier a été atteint.
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Oui. Il faut s’y prendre autrement et mobiliser de nouvelles ressources. Il faut tout mettre en œuvre pour sauver de nouvelles poches de vie, cible par cible, dans un contexte d’opinion publique toujours très majoritairement favorable à la sécurité routière. Le sujet passionne. Il touche notre quotidien et chacun a son avis : il faut tirer parti de cette sensibilité de l’opinion et répondre à une véritable demande de sécurité routière.
La communication joue un grand rôle dans la politique de sécurité routière puisqu’il s’agit tout à la fois de porter des politiques publiques et d’exercer la pédagogie de la sanction. On peut considérer qu’elle a fortement contribué aux progrès spectaculaires enregistrés au cours des dernières années. Aux termes d’enquêtes menées depuis 2005, 70 % des Français indiquent que les campagnes de communication les ont incités à changer de comportement. Un tel taux de réponse positive est très important par rapport aux standards d’efficacité de campagnes analogues.
La communication sur la sécurité routière poursuit trois buts principaux : réduire le nombre d’accidents graves et mortels, rendre acceptable la politique menée, aider les usagers à intérioriser les bons comportements.
Pour les atteindre, il convient d’élaborer une stratégie de communication aussi complète que possible. Notre travail se nourrit de toutes les formes d’études d’opinion, qu’il s’agisse de baromètres, de pré et post tests de campagnes, de groupes qualitatifs ciblés, etc. Il se fonde également sur l’analyse permanente des chiffres de l’accidentalité : qui se tue ? À quel âge ? En appartenant à quel sexe – ce dernier critère étant, on le sait, très clivant - ?
Comme nous l’avons vu, il convient désormais de s’adresser aux personnes qui mettent en danger les autres et elles-mêmes. La communication de la sécurité routière fait l’objet d’un marché quadriennal – qui vient d’être renouvelé – avec une agence de communication, laquelle décline la stratégie quadriennale en plans annuels en fonction des évolutions de l’accidentalité et des modes de communication - cf. la prise en compte de l’apparition des Smartphones et des réseaux sociaux.
Dans le champ de la communication, l’action très soutenue du Délégué interministériel à la sécurité routière mérite d’être rappelée puisque le Délégué donne environ 200 interviews par an, cependant que son service de presse répond à 600 sollicitations annuelles. Il s’agit de mener une communication pro active car il a été établi que plus on parle de la sécurité routière, quelle que soit la tonalité du message, mieux c’est pour l’accidentalité.
Chaque campagne d’envergure fait l’objet de pré et post tests. Dans le processus d’élaboration d’une campagne, il y a l’identification de pistes créatives, puis leur validation par des groupes qualitatifs pour prévenir d’éventuelles erreurs d’interprétation. Une fois que la campagne s’est déroulée, nous procédons à un test quantitatif sur un échantillon de 1 000 personnes, à partir de questions quasi barométrisées sur les thèmes « la campagne a-t-elle été vue ? » et « a-t-elle été efficace ? ».
De nouveaux axes et leviers de communication doivent être recherchés en permanence. Je pense notamment à la campagne de spots télévisés de 30 secondes intitulée « Les coups de fil », où l’on comprend que la personne qui décroche son téléphone apprend la perte d’un proche dans un accident de la route. Nous avons constaté que, dans les publics les plus récalcitrants – en gros, les jeunes hommes –, cette campagne avait eu un retentissement considérable car si eux-mêmes étaient assez imperméables aux messages de prévention, l’idée que leur mère puisse être confrontée à une telle annonce les perturbait fortement.
De même, le court-métrage de six minutes exclusivement diffusé sur Internet et intitulé « Insoutenable » a rencontré un succès phénoménal puisqu’il s’agit de la vidéo la plus vue sur les plateformes Internet en 2010. Son impact a été encore augmenté par l’énorme buzz qu’il a suscité.
Parallèlement, les leviers classiques de communication doivent être actionnés : pédagogie du risque et de la règle, rappel de l’idée qu’il n’y a pas de fatalité, absence de relâchement de l’action publique face à la demande de sécurité routière.
À l’heure où l’on voit – et c’est heureux ! – de moins en moins d’accidents sur le bord des routes, il importe de montrer la réalité des faits sans céder pour autant à la tentation du trash pour le trash. En outre, l’exposition des tragédies de la route doit toujours s’accompagner d’un message délivrant une solution, en veillant à s’adresser à l’interlocuteur sans injonction ni infantilisation. Il est de notre responsabilité de faire appel à l’intelligence de nos concitoyens.
En fonction de la cible et du support, une grande variété de registres s’offre à nous. Il y a le registre de l’émotion, dont témoigne la campagne « Les coups de fil » que j’évoquais à l’instant. Celui de l’indignation, avec le film « Insoutenable ». L’exemplarité, par le rappel des centaines de milliers de vies sauvées depuis un demi-siècle. La prévention, bien sûr, avec le personnage du conducteur sobre appelé SAM, très bien identifié par les 18-25 ans, l’idée étant de créer une véritable « génération sécurité routière », en profitant du fait qu’elle a déjà intégré un grand nombre de bonnes pratiques comme le bouclage de la ceinture de sécurité. Enfin, il y a le registre de l’humour et de la connivence, avec la campagne sur le gilet jaune réalisée avec la complicité de Karl Lagerfeld, qui a presque fait de la chasuble réfléchissante un objet fashion !
L’efficacité de nos actions repose sur l’alternance des moyens et des registres et sur la qualité des partenariats noués avec tout le réseau des acteurs de la sécurité routière – associations, entreprises, acteurs économiques et institutionnels…
M. Benoît de Laurens, vice-président de l’agence de communication Lowe Strateus. Lowe Strateus est une agence de conseil en communication d’environ 120 personnes. Elle a été sous contrat avec la DSCR entre 2001 et 2011 grâce à deux renouvellements successifs, en 2004 et en 2007. Depuis dix ans, toutes les campagnes de communication de la sécurité routière ont été créées par notre agence, ce qui a nécessité une forte implication de notre part dans cette thématique et un suivi régulier des enquêtes d’opinion. Sur un sujet tel que celui de la sécurité routière, il faut insister sur l’importance du long terme. Je peux aujourd’hui parler de cette collaboration de façon tout à fait libre dans la mesure où cette dernière s’est inscrite sur le long terme et où elle est désormais achevée. J’en retire quelques convictions personnelles.
En premier lieu, les succès rencontrés ont été le fruit d’une forte volonté politique, d’actions de contrôle et de sanction intelligentes et d’effort de communication. Cette dernière ne s’est pas bornée à accroître l’acceptabilité sociale de la politique de sécurité routière, elle a engendré une réelle demande sociale chez les Français, notamment depuis 2002. Les Français étaient demandeurs de davantage de sécurité routière. Ceci explique que la mise en place des radars ait été acceptée : elle était comprise. Un cercle vertueux s’est donc instauré jusqu’en 2011 entre la demande sociale, les sanctions et la communication. Cependant, nous avons atteint un palier en 2010. Pour le dire simplement, nous avions fait le plein des gens raisonnables et nous arrivions au noyau dur.
Ce cercle vertueux a pris fin sous l’action combinée de deux facteurs. Le rattachement de la DSCR au ministère de l’intérieur a produit un basculement dans l’opinion publique, qui a eu l’impression d’une verbalisation à la chaîne. L’aménagement du permis à points a également eu des conséquences désastreuses. Dans les études d’opinion, 31 % des Français ont dit avoir modifié leur comportement à la suite de cet aménagement. Des mesures fortes ont donc été annoncées, mais qui n’ont pas été comprises car la majorité de nos concitoyens respectent les règles. Ils ont eu le sentiment d’être infantilisés et punis à cause des mauvais chiffres de la sécurité routière, ce qui a provoqué un risque de rejet d’une politique qui était bien acceptée jusqu’à présent.
En fait, ce n’est pas le nombre d’accidents qui a augmenté, mais leur gravité. Il n’est pas rare que des accidents mortels soient le fait de personnes circulant avec 2,5 grammes d’alcool par litre de sang. L’opinion juge donc que les comportements provoquant des accidents mortels résultent de phénomènes marginaux et excessifs et ne comprend pas pourquoi des dépassements de limitations de vitesse de quelques kilomètres heure sont punis. Il est problématique que la peur d’être sanctionné devienne plus forte que la peur de l’accident. En conséquence, les gens s’organisent pour éviter les radars – alors qu’ils sont, de surcroît, rarement contrôlés par les forces de l’ordre qui n’en ont pas les moyens.
La spirale vertueuse a donc connu des ratés, notamment ces derniers mois. Mais si l’on a atteint un palier, il ne s’agit aucunement d’une limite.
M. le rapporteur Philippe Houillon. Ce que vous avez dit me semble particulièrement intéressant : même s’il n’existe pas de seuil incompressible, « on a fait le plein des gens raisonnables » et il reste désormais le noyau dur, d’où l’impression que les progrès seront plus difficiles. Je souhaiterais vous interroger sur les conséquences que vous en tirez, notamment dans le domaine de l’action publique. Qu’est-ce qui explique les réactions virulentes au CISR du 11 mai ? Vous avez avancé un élément d’explication, à savoir que les mesures annoncées concernaient chacun et non pas les « irréductibles », y en a-t-il d’autres ? Vous avez dit que tout le monde était d’accord sur les objectifs de la sécurité routière. Mais comment expliquer que la politique menée ne soit pas source de satisfaction mais de polémiques ?
Je souhaiterais également poser une question à M. Hamelin et à Mme Ragot-Court qui ont contribué à un ouvrage sur le contrôle sanction automatisé en France et à l’étranger. Où ce système est-il le mieux accepté et existe-t-il partout des polémiques analogues à celles que l’on connaît en France ?
En ce qui concerne la communication, certains intervenants, tels que M. Namias, nous ont dit que son impact avait diminué après le passage de M. Heitz et de Mme Petit à la DSCR. Ceci peut-il expliquer les réactions aux annonces du CISR du 11 mai ? La mission souhaiterait pouvoir disposer des actions de communication qui ont été menées ces dernières années ainsi que le rôle respectif de la DSCR et de l’agence Lowe Strateus dans la définition de ces campagnes.
M. Lionel Tardy. Dans nos circonscriptions, la peur d’être « attrapé » revient fréquemment. Les gens ont l’impression que l’on se focalise sur la vitesse et sur l’alcool alors que les accidents peuvent être liés à beaucoup d’autres circonstances (la présence de drogue, l’obscurité…) ou à la présence d’usagers vulnérables (personnes âgées, conducteurs de deux roues…). Or, ces facteurs semblent être peu pris en compte dans la politique menée.
En matière de communication, certains pays vont assez loin dans la diffusion d’images choc. Est-ce une bonne méthode ? Faut-il cibler les campagnes en direction des récalcitrants ou continuer à mener des campagnes grand public ?
M. Jean-Jacques Candelier. À mon sens, il faut associer prévention, sanctions et communication pour mener la meilleure politique possible en matière de sécurité routière, sans viser pour autant le zéro accident, qui est une utopie.
M. Jacques Myard. Il est essentiel de remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier, dans la mesure où les jeunes doivent être continuellement sensibilisés.
Je m’interroge sur les actions de communication menées sur le thème des motards, qui représentent plus de 20 % des tués sur la route. Je suis d’ailleurs surpris par l’absence de dialogue entre ces derniers et les pouvoirs publics.
Je tiens également à préciser que l’augmentation du nombre d’accidents au début de l’année 2011 a été observée non seulement en France mais dans de nombreux autres pays européens. Il est donc erroné d’en faire porter la responsabilité aux députés et à l’aménagement du permis à points. D’ailleurs, je rappelle que la LOPPSI 2 a également durci un certain nombre de sanctions.
Les accidents graves sont causés non seulement par l’alcool mais aussi par la drogue et par ce que l’on pourrait appeler des « imprudences incompréhensibles ». Il en résulte un sentiment de disproportion entre l’ampleur de la répression et la gravité de la faute. Nos concitoyens nous décrivent fréquemment cette impression d’injustice dans nos circonscriptions.
Enfin, selon certains, la conduite sans permis concernerait jusqu’à 10 % des conducteurs. Y a-t-il des actions de communication prévues en la matière ?
M. Christian Vanneste. Il est nécessaire de ménager un temps à la pédagogie, c’est ce qui a manqué en mai 2011. Mais peut-on quantifier le temps nécessaire pour préparer l’opinion à certaines annonces ?
Je m’interroge sur le ciblage des politiques de sécurité routière. La vitesse est en tête des priorités mais elle n’est plus la première cause d’accidents. Ne faudrait-il pas augmenter les contrôles à la sortie des boîtes de nuit, l’alcool étant la première cause d’accidents ?
M. de Laurens a indiqué qu’il ne fallait pas infantiliser les conducteurs. Dans cette perspective, ne faudrait-il pas présenter les mesures prises de manière positive, en donnant le sentiment à celui qui ne se sent pas concerné qu’il trahit la cause de la sécurité routière ?
Enfin, quand on cible une mesure de communication, par exemple sur les jeunes, observe-t-on une diminution de l’accidentalité dans la catégorie visée ?
M. Dominique Raimbourg. Considérez-vous que le fait d’avoir modifié le permis à points ait été une erreur ?
Avez-vous envisagé des campagnes en direction des conducteurs de deux roues motorisés ? Ces derniers ont tendance à se positionner en victimes, tous les accidents étant provoqués par des fautes des automobilistes.
Enfin, communiquez-vous sur le coût des accidents ? On entend en effet fréquemment que la politique de sécurité routière vise à remplir les caisses de l’État.
M. Christian Vanneste. En écho à M. Raimbourg, je voudrais souligner la vulnérabilité des conducteurs de deux roues motorisés. Ne faudrait-il pas envisager des campagnes de communication sur des équipements tels que le gilet airbag, afin d’inviter les conducteurs à s’en doter ?
M. le président Armand Jung. Il s’agit là d’un enjeu qui est actuellement discuté avec les motards.
M. Lionel Tardy. La fédération française des motards en colère (FFMC) donne les chiffres suivants : 28 % des décès sont des conducteurs de deux roues motorisés mais si l’on tient compte de l’augmentation du nombre de conducteurs, qui est de 61 % sur les dix dernières années, la sinistralité a diminué de 50 %.
Pour ce qui est de l’alcool, il s’agit effectivement du premier facteur d’accidents. Il est nécessaire de sensibiliser l’entourage des personnes qui s’apprêtent à prendre le volant en état d’ébriété. Les films sur la conduite sous l’emprise de drogues (de la série SAM) pourraient servir de modèle.
Mme Françoise Imbert. Je voudrais apporter un témoignage au débat. J’ai récemment rencontré dans ma circonscription un conseil municipal des jeunes, qui a pris l’initiative de distribuer des brassards réfléchissants aux enfants de la commune, sur le thème « être vu, c’est la vie ». Il me semble que cela contribue à sensibiliser nos concitoyens dès le plus jeune âge.
M. le président Armand Jung. Je souhaiterais faire deux remarques.
En premier lieu, l’un des acquis majeurs de la mission d’information est qu’il faut apprendre à se méfier des statistiques, qui peuvent varier entre le simple et le décuple et peuvent faire l’objet de multiples interprétations. Par exemple, on dit que 30 % des morts sur la route sont dues à l’alcool. Mais l’on sait que les accidents sont la conséquence d’un cumul de facteurs, tels que la vitesse, la drogue, le téléphone… Il faut donc faire attention à l’utilisation que l’on fait des chiffres, surtout lorsqu’ils sont mobilisés à l’appui d’une thèse.
En second lieu, je souhaiterais savoir s’il y a actuellement des projets de communication ? Attendrez-vous la fin des travaux de la mission d’information pour en lancer de nouveaux ou certains sont-ils d’ores et déjà prévus ?
M. Fabrice Hamelin, chargé de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Sur la question des vives réactions et des controverses qui ont suivi les décisions du dernier CISR, je répondrais volontiers, en observant les différents pays qui pratiquent une politique volontariste dans le domaine de la sécurité routière et, notamment, qui appliquent le contrôle sanction automatisé – merci d’ailleurs, à ce propos, d’avoir fait référence à mon livre : Les radars et nous –, que ces pays connaissent tous la controverse à un degré ou à un autre.
La question que l’on peut se poser c’est de savoir pourquoi la controverse apparaît aujourd’hui de manière aussi vive, alors qu’en fait, en 2004 par exemple, il y avait déjà eu beaucoup de débats sur l’implantation des radars, notamment avec la FFMC, mais que les controverses avaient fini par s’apaiser. Un élément de réponse pourrait être le fait qu’aujourd’hui les radars sont devenus un outil symbole de la politique conduite – une politique plutôt taxée de répressive – et qu’ils apparaissent même, en fait, comme le principal outil, voire même le seul outil, utilisé par le gouvernement.
Pourtant, notre politique de prévention routière est un mixte de différentes mesures, pour la plupart assez diversifiées. Pour rendre la politique de prévention routière mieux comprise, et donc plus acceptable, il faudrait davantage communiquer sur ce caractère mixte et diversifié. Plus généralement, en termes de communication, il est d’ailleurs toujours très important de savoir si l’on se focalise sur telle ou telle action ou si l’on présente, de manière exhaustive, tout ce que l’on fait.
Je compléterai ces remarques par trois observations. Tout d’abord, actuellement, dans le domaine de la sécurité routière, on peut remarquer qu’il y a un très grand nombre de voix qui s’expriment, que leur origine soit une source publique ou privée. Cette polyphonie n’aboutit par à un discours toujours très cohérent pour le grand public.
D’autre part, aujourd’hui, il semble que l’efficacité des radars soit moins avérée. À partir de là, beaucoup de barrières sautent qui empêchaient jusque-là de critiquer l’outil. C’est ce que j’ai appelé dans mon livre « la spirale du silence ». Quand on a une opinion que l’on pense être minoritaire, fréquemment, on se censure, on ne l’exprime pas. En revanche, quand les freins disparaissent, la spirale s’inverse.
Enfin, on doit noter qu’aujourd’hui, les motards n’ont pas repris le leadership de la contestation. Ceux qui se mobilisent actuellement contre la politique suivie, ou contre les radars, sont d’autres acteurs, plus proches du grand public.
Mme Isabelle Ragot-Court, chargée de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). J’apporterai également quelques réponses de manière cursive. Tout d’abord une remarque : on a l’impression que, derrière les questions, le fonds commun de pensée, c’est que la sécurité incombe entièrement aux conducteurs. Les questions, et plus généralement la politique suivie, reflètent le souci, en quelque sorte, de mettre à jour et d’influencer l’intentionnalité des comportements. De telles actions sur les comportements ne sont pas négligeables ; mais, néanmoins, une attention trop exclusive portée aux seules habitudes des conducteurs ne doit par conduire, non plus, à négliger d’autres éléments, des éléments sur lesquels on pourrait également agir.
À propos des deux roues motorisés, un stéréotype en vogue actuellement sur les motards correspond un peu à l’image suivante : « un conducteur qui, en général, roule très vite et est relativement imprévisible ». La communication publique, au service des mesures adoptées par les différentes autorités responsables, tend à oublier tous ceux qui ne sont pas dans le stéréotype. D’où l’incompréhension – voire la victimisation – de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette image. C’est un point important sur lequel il faut réfléchir lorsque l’on veut faire de la communication diversifiée, en fonction des clivages retenus, catégories par catégories ; si les catégories deviennent des stéréotypes, non seulement il n’y a aucune adhésion de la part des personnes que l’on veut sensibiliser, mais, au contraire, on suscite des postures de victimes.
On doit relever, d’autre part, que les automobilistes qui font eux-mêmes de la moto sont moins impliqués dans les accidents avec les deux roues motorisés. Beaucoup de problèmes semblent provenir, au fond, d’un manque de familiarité avec les deux-roues. En matière d’acceptabilité des mesures concernant tant les deux-roues motorisés que les conducteurs d’autos, en tant que ces derniers peuvent avoir des liens étroits avec les motos (lors des remontées de files par exemple), il faudrait donc faire des signes clairs et précis pour indiquer que tous font partie intégrante d’une même communauté et que – s’agissant spécifiquement des motards – on reconnaît que les autres participent à leur accidentalité.
La communication doit être ciblée sur la pratique. Plus encore que les automobilistes, les différentes catégories de conducteurs de deux-roues motorisés ne sont pas homogènes. Il y a les passionnés, les conducteurs de petites cylindrées, de scooters, etc. L’exposition au risque n’est pas la même. Il faut tenir compte des différents comportements et sous-comportements.
La communication doit tenir compte aussi des différences d’âge et d’expérience. Une expérimentation récente a été mise en place : on a présenté à différentes catégories de conducteurs de petites scènes routières reliées à leur accidentologie spécifique. On demandait à ces conducteurs d’évaluer la dangerosité des scènes. Au terme de l’expérience, on s’est aperçu que, plus les conducteurs avaient de l’expérience, et plus leurs réactions ou leurs attentes étaient pertinentes en matière d’accidentologie. À l’inverse, les jeunes avaient tendance à surestimer les capacités des véhicules ainsi que leurs compétences propres.
Une bonne acceptabilité sociale suppose donc, pour telle ou telle mesure, que l’on cible sur la pratique et, au-delà, que l’on cible également sur les sous-parties spécifiques de la population qui vont être visées expressément par la mesure.
La communication n’est également efficace que si elle est couplée avec la répression. Sinon, sans la peur de la sanction, l’effet de l’information ne fonctionne qu’à très court terme.
Il faut aussi se méfier – on l’a constaté en Suède – de la surabondance des signalisations qui tendent à aboutir, en fait, à une baisse de l’attention. C’est ce qui pourrait se passer si l’on couplait la pratique de telle ou telle cylindrée, chez les motards, avec le port d’un brassard fluorescent par exemple. Il pourrait y avoir des effets pervers.
M. Jacques Myard. L’endormissement de la vigilance.
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Je tiens à préciser qu’il n’existe aucune étude d’opinion concernant le rattachement de la DSCR au ministère de l’intérieur. De même, il n’existe pas d’étude concernant les blogs et quantifiant un éventuel mécontentement lié au fait que la délégation a été rattachée à ce département ministériel.
S’agissant de l’alcool, onze millions de contrôles d’alcoolémie sont réalisés chaque année et 22 % des Français reconnaissent avoir été contrôlés au moins une fois.
M. Alfred Trassy-Paillogues. Quels sont les chiffres pour la drogue ?
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). On procède à 100.000 dépistages par an.
M. Alfred Trassy-Paillogues. Ce chiffre est insuffisant.
M. Jacques Myard. C’est aussi un problème de technique. Je crois qu’actuellement on met au point des « languettes » qui sont plus simples d’utilisation et d’un résultat plus efficace.
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). S’agissant de l’efficacité de la communication, nous avons été confrontés au problème de ceux qui, souvent grands contrevenants, ne sont pas sensibles aux campagnes et n’écoutent même pas en direct les slogans. Nous avons alors choisi de ne plus dire « ne faites pas » mais de passer par le contrôle social. Tel est le cas pour les gros consommateurs d’alcool. Nous avons communiqué sur le thème : « Ne laissez pas une personne conduire… ». Car, aujourd’hui, il faut noter qu’au moins 50 % des accidents les plus graves et qui mettent en cause l’alcool sont causés par des personnes qui ont un très fort taux d’alcoolémie (supérieur à 1,2 gramme). Ces personnes, quand elles s’apprêtent à conduire, n’ont plus le discernement. Il faut donc renvoyer à des tiers pour que ces derniers les dissuadent de prendre leur voiture.
Nous avons remis à la mission parlementaire un dossier qui recense toutes les campagnes de communication qui ont été réalisées ces dernières années. Je ne pense pas qu’on puisse dire que la garde a été baissée depuis 2008. Si M. Namias a eu cette impression, c’est que, ayant cessé son mandat à cette date, il a peut-être été moins sensible à nos efforts depuis lors.
Actuellement, la délégation réalise moins de courts-métrages pour la télévision mais ses spots sont toujours présents dans certaines émissions (« C’est pas sorcier », « Auto-moto »). La présence de la délégation apparaît peut-être moins, de la sorte, sur le petit écran, mais le travail de fond de sensibilisation à la sécurité routière reste effectif.
En ce qui concerne les deux-roues motorisés, une concertation nationale a eu lieu sous l’égide du Délégué interministériel à la sécurité routière. Les questions liées à l’équipement des motards ont occupé une grande place dans la concertation. Un guide destiné aux deux-roues est sorti récemment, faisant le point sur tous les problèmes évoqués au cours des tables rondes, et il a été très largement diffusé.
La surmortalité des deux-roues – c’est tout à fait vrai – reste un grave problème auquel est confrontée la prévention routière. Tout se passe comme si les deux-roues motorisés restaient, malgré tout, moins concernés par les progrès de la sécurité routière.
En termes de communication, nous avons consacré beaucoup d’énergie à la sensibilisation des motards aux questions de prévention routière. En 2010, notamment, on a créé un site internet dédié, on a délivré des informations sur le délit de débridage, on a lancé une campagne de distribution de post-it sur les pare-brise des voitures pour les inciter à faire attention aux motards, etc. Et l’on peut constater qu’en 2010, même si les progrès restent encore insuffisants, la mortalité des motards a baissé (entre 10 et 20 % selon les types d’usagers). Cela n’est sans doute pas sans lien avec l’action de la DSCR.
À propos des slogans et des campagnes télévisées de la prévention routière, la question a été posée de savoir si les thématiques abordées n’étaient pas trop trash. Pour ma part, je pense que non. Les courts-métrages de la DSCR ne font jamais du trash par goût ou par esthétisme. Il s’agit de montrer la réalité concrète de l’accident et de faire de la pédagogie en prenant appui sur des images tirées de la réalité.
Sur les phénomènes d’hypovigilance – et la possibilité de généraliser les bandes bruyantes sur autoroute pour lutter contre l’endormissement –, la DSCR reconnaît qu’il s’agit là d’une préoccupation tout à fait fondée, cause d’environ 30 % des accidents. La DSCR a fait des campagnes, cet été, avec les sociétés d’autoroutes pour anticiper et prévenir les phénomènes de perte d’attention au volant. Mais ces campagnes ne sont pas encore suffisantes et la somnolence demeure une source d’accidents majeure qu’il va falloir considérer avec attention.
Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur les motocyclistes et sur le point de savoir s’ils étaient toujours fautifs en cas d’accidents. La communication doit effectivement les associer à la collectivité des conducteurs et leur montrer que l’on reconnaît qu’ils peuvent être aussi victimes des autres usagers de la route.
Enfin, sur la question des « radars pompes à fric », la récrimination du public est bien connue et elle est très difficile à remettre en cause. Les usagers, en général, ne critiquent pas l’efficacité des radars et leur intérêt pour la sécurité routière ; mais ils ont beaucoup de difficultés à admettre – ce qui est pourtant le cas – que les recettes perçues ne vont pas principalement alimenter les caisses de l’Etat. En ce domaine, il faut faire de la pédagogie soutenue.
M. le président Armand Jung. Si l’on rattachait le Délégué interministériel, en tant que Haut-Commissaire ou Secrétaire d’Etat, au Premier Ministre, ne pensez-vous pas que la DSCR aurait plus de facilité à exercer ses missions et à assurer la nécessaire coordination de toutes les actions conduites dans le domaine de la sécurité routière ?
M. Lionel Tardy. Je pense que le ralentissement de l’économie que l’on a constaté sur la période 2009/2010 a eu aussi un impact sur la moindre attention portée par nos concitoyens aux problèmes de la sécurité routière. C’est un peu ce que rappelait, d’ailleurs, notre collègue Jacques Myard au moment des débats sur la loi LOPPSI 2. En période de crise, ces sujets deviennent secondaires pour les administrés. Dans ce cas, le gouvernement ne fait pas du tout ce qu’il veut ; en même temps, il convient de ne pas multiplier les contraintes sur nos compatriotes. Tel est le sens de la fameuse phrase : « Cessez d’emmerder les Français ».
M. Jacques Myard. C’est une phrase de Georges Pompidou.
M. le président Armand Jung. Il ne faut pas non plus baisser les bras ou tomber dans le laxisme.
Je rappellerai moi-même une phrase que j’ai prononcée, également dans le cadre des débats sur la loi LOPPSI 2. « Si vous touchez au permis à points, vous ne manquerez pas d’avoir des morts supplémentaires sur les routes ».
M. Benoît de Laurens, vice-président de l’agence de communication Lowe Strateus. Je peux indiquer que, selon des enquêtes d’opinion, 31 % des sondés, soit environ 12 millions de personnes, ont déclaré avoir changé leurs comportements après la loi LOPPSI 2. Le changement s’est manifesté dans le sens d’un moindre respect des règles, dans la mesure où les conducteurs avaient moins peur de perdre des points.
D’autre part, en avril 2011, un autre sondage a montré que, pour la première fois, le pourcentage de ceux qui déclaraient respecter les règles en toutes circonstances était tombé en dessous de la barre des 50 %, à 48 % très exactement. Cela veut dire qu’il y a 52 % des conducteurs qui reconnaissent implicitement que, face à une réglementation, ils font ce qu’ils veulent. Ce chiffre est d’autant plus significatif que le pourcentage de ceux qui reconnaissent observer strictement les règles n’a fait que croître depuis 2002. Aujourd’hui, par conséquent, on peut parler du libre arbitre comme forme et expression de la résistance face à la réglementation.
En même temps, la demande de sévérité face aux contrevenants dans le domaine de la circulation routière est majoritaire. Cela veut dire que les décideurs et les élus sont placés dans une situation difficile car, au fond, les demandes et les comportements sont tout à fait contradictoires.
En ce qui concerne la lutte contre la vitesse excessive, on doit noter que le souci de ne pas baisser la garde en ce domaine provient tout autant des préoccupations des médias et de l’opinion publique que de l’effet des campagnes officielles. En effet, la dernière campagne de la DSCR sur la vitesse remonte à 2006, ce qui n’est pas si récent.
En même temps, quand on compare ce que dépensent annuellement les agences de communication de Renault et de PSA – les chiffres avoisinant les 300 millions d’euros – et ce que dépense la DSCR pour ses actions de prévention (de l’ordre de 17 millions d’euros), la balance est très défavorable à la délégation interministérielle. On comprendra que celle-ci ne peut pas tout faire, ni agir simultanément sur tous les publics.
De ce point de vue, il est bien entendu plus opérant qu’elle essaie de toucher toute la population, sur des actions de communication d’intérêt général, plutôt qu’elle ne procède « cible par cible ».
M. Jacques Myard. La communication n’est pas le seul vecteur, si l’on veut agir sur la sécurité routière. Je prendrai l’exemple de ma commune : Maisons-Laffitte. Quand j’ai débuté mon mandat de maire, on enregistrait 96 accidents corporels. En travaillant uniquement sur les infrastructures, nous sommes arrivés à faire tomber les chiffres à 6 accidents. Auriez-vous des compléments à m’apporter sur ce sujet ?
M. Alfred Trassy-Paillogues. Plusieurs intervenants ont dit que l’on arrivait actuellement à un palier dans la diminution des victimes des accidents automobiles, un noyau de personnes – plus ou moins important – ne manifestant aucune écoute à l’égard des messages de prévention routière.
Dans ce noyau de récalcitrants, quelle est la part de ceux que l’on peut proprement appeler les « chauffards » ? Leur nombre me paraît important. Par exemple, sur le trajet Rouen-Paris que j’emprunte fréquemment, il n’est pas rare que je sois doublé, en automobile, par environ une dizaine de véhicules – voitures ou motos – qui roulent à près de 200 km/h. Avez-vous prévu des mesures, ou des campagnes de sensibilisation spécifiques, pour que ces usagers, d’un type particulier, se trouvent circonscrits ou exclus, du fait même de leur entourage ?
Par ailleurs, l’insonorisation plus grande des moteurs des deux-roues ne serait-elle pas de nature à modifier les modes de conduite de leurs possesseurs ? On a en effet l’impression, parfois, que l’accélération, et donc la vitesse, sont recherchées non pas tant en elles-mêmes, mais pour la satisfaction de produire des décibels.
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Pour les chauffards, il existe peu de statistiques. Toutefois, les grandes infractions à la vitesse limite autorisée sont inférieures en nombre aux grandes infractions liées à l’alcool. En fait, l’alcool reste la première cause de mortalité sur route…
M. le président Armand Jung. Les statistiques en matière d’accidentologie ne sont pas si sûres que cela. Notamment, on sait très mal évaluer la part de chaque cause lorsqu’on a affaire à un accident à causes multiples. Il est donc difficile d’avoir une répartition très fiable entre les différentes causes de l’accidentologie et, a fortiori, d’avoir des avis tranchés sur telle ou telle cause, qu’elle vienne, soit disant, en première ou en seconde position. Et cela est d’ailleurs très ennuyeux, y compris pour les campagnes de communication. Car si l’on se trompe sur la nature des causes, on se trompe sur la communication.
M. le rapporteur Philippe Houillon. Il y aura un débat sur les statistiques. À partir du moment où l’on voit que les chiffres sont un peu arbitraires, il y a deux possibilités : soit on les rejette ; soit on les prend au moins comme curseurs, fournis par les professionnels pour permettre d’apprécier l’accidentologie. Mais il est certain que la consommation d’alcool décroît. Ainsi, il y a beaucoup moins de consommation d’alcool, le midi, dans les cafés et les restaurants. Il y a aussi la question des choses que l’on sait difficilement quantifier, telle que l’hypovigilance. Là, on a affaire à un vrai problème.
Maintenant, en ce qui concerne les populations à cibler, comme le dit M. de Laurens : « on a fait le plein s’agissant des gens raisonnables ». Et il est vrai que 75 % des automobilistes sont en possession de tous leurs points. C’est sur les 25 % restants qu’il faut travailler, et notamment, parmi eux, sur la petite population qui n’a plus de points. D’où mes questions : Quelles sont les pratiques à l’étranger ? Quelles sont les campagnes de communication qui sont actuellement en cours ?
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Nous n’avons pas de campagnes de communication en cours. Nous venons de notifier, la semaine dernière, un nouveau marché de communication à un nouveau titulaire de marché. Pour une prochaine campagne, nous réfléchissons à la « ringardisation » des comportements des chauffards.
M. le président Armand Jung. Une campagne avait déjà eu lieu, en 2006, sur le thème « La vitesse, c’est dépassé… ».
Mme Laurence Derrien-Lallement, chef du département communication et information de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR). Effectivement, mais nous estimons que, compte tenu de la relative ancienneté de cette campagne, les automobilistes peuvent avoir baissé la garde.
M. Fabrice Hamelin, chargé de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Je ferai à mon tour trois remarques. Tout d’abord, il convient d’observer que tous les pays étrangers qui mènent une politique active et volontariste en matière de sécurité routière affichent souvent l’objectif de « zéro mort ». D’autre part, on peut rappeler qu’installer des radars, à partir de l’année 2002, c’était lutter contre les indulgences ainsi que contre les petits excès de vitesse. C’est là que se situe, aujourd’hui, l’incompréhension des usagers et la difficulté pour les pouvoirs publics : l’outil sert bien à lutter surtout contre les petits excès de vitesse et non pas contre les gros. On lui reproche donc, aujourd’hui, ce pour quoi il a été mis en place. Les motifs initiaux de déploiement des radars ont été oubliés et le travail pédagogique est sans doute à refaire. D’où ma troisième remarque : il faut des actions désormais très diversifiées et un mixage de différentes mesures.
M. le président Armand Jung. On pourrait peut-être proposer des week-ends de communication à zéro mort. Ce serait une campagne combinée avec des opérations de terrain.
M. Benoît de Laurens, vice-président de l’agence de communication Lowe Strateus. Nous avions fait cette proposition dans notre offre, en répondant au marché de la DSCR.
M. le président Armand Jung. Nous allons maintenant devoir conclure…
Mme Isabelle Ragot-Court, chargée de recherches à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). En guise de conclusion, je souhaiterais rappeler, pour ma part, qu’il me paraît important, dans ce débat sur l’acceptabilité sociale des mesures de prévention routière, d’éviter la confusion entre la chasse à l’infractionniste et la recherche des causes des accidents.
*
* *
Table ronde sur la sécurité des véhicules : M. Daniel Kopaczewski, sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement) ; M. Jean-Yves Le Coz, expert leader « Sécurité routière » pour le Groupe Renault, M. Jean-François Huère, responsable « Sécurité routière » pour le Groupe PSA Peugeot Citroën, membres du Comité des constructeurs français d’automobiles et M. Nicolas Bertholon du Laboratoire d’Accidentologie, de Biomécanique et d’étude du comportement humain ; M. Christian Sibrik, président de la branche « contrôle technique » du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et Mme Pauline Johanet coordinatrice média et lobbying ; M. Philippe Toussaint, délégué général du Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR) ; M. Dominique Cesari, directeur de recherche émérite à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; M. Jacques Ehrlich, directeur du Laboratoire sur les Interactions Véhicules-Infrastructure-Conducteurs (Livic) à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
Jeudi 1er septembre 2011
M. le président Armand Jung. Madame et messieurs, merci de votre présence. Nous attendons beaucoup de votre expertise en matière de sécurité des véhicules. Je vous propose de vous présenter chacun brièvement avant de faire état des points sur lesquels il vous semble utile d’insister.
M. Dominique Cesari, directeur de recherche émérite à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Ingénieur mécanicien, titulaire d’un doctorat de biomécanique, je préside le Comité européen pour l’amélioration de la sécurité des véhicules, qui pose les bases scientifiques des réglementations. Je suis également expert auprès de la Communauté européenne pour les projets de recherche du septième programme-cadre de recherche et de développement (PCRD) et directeur de recherche émérite rattaché à la direction scientifique de l’IFFSTAR.
J’ai abordé cette question de la sécurité des véhicules en travaillant à la protection des usagers depuis le début des années soixante-dix. J’ai participé au développement des ceintures de sécurité et des airbags ; j’ai également étudié le comportement des véhicules soumis à des chocs et, plus récemment, la protection des piétons en cas d’accident.
Je souhaiterais faire passer plusieurs messages.
Premièrement, il est habituel de distinguer entre sécurité active – comment éviter l’accident – et sécurité passive – comment protéger les usagers en cas d’accident –, mais il faut bien voir que chacune interagit avec l’autre. Voilà pourquoi nous adoptons de plus en plus souvent une approche intégrée.
Deuxièmement, les questions liées à la sécurité des véhicules sont d’abord internationales : la France a signé des accords dans le cadre des Nations unies ; les règlements de sécurité sont établis à Genève, repris sous forme de directives à Bruxelles et appliqués dans les pays de l’Union européenne. Notre pays n’est pas dépourvu pour autant de moyens d’agir, puisque, présent dans ces différentes instances, il peut par exemple pousser en faveur de telle ou telle réglementation.
Troisièmement, la sécurité passive a énormément progressé au cours des quarante dernières années même si certaines niches restent à exploiter – ainsi l’amélioration de la compatibilité entre véhicules ou de l’adaptation des systèmes aux caractéristiques des occupants ou des accidents. C’est donc de la sécurité active que nous pouvons attendre l’essentiel des améliorations à venir. Comme de nouvelles technologies apparaissent tous les jours, il nous faut faire des choix, ce qui suppose de développer des méthodes d’évaluation et de validation. Or cette évaluation est particulièrement difficile s’agissant des systèmes de sécurité active dans la mesure où ils interfèrent directement avec les actions du conducteur.
Enfin, ces progrès, qui s’apprécient au niveau international, ne peuvent être le fruit que de recherches collaboratives, entre les pouvoirs publics et ceux qui étudient les accidents – ceux qui sont à même d’évaluer les progrès et de les mettre en œuvre.
M. Jacques Ehrlich, directeur du Laboratoire sur les interactions véhicules-infrastructure-conducteurs (LIVIC) à l’IFSTTAR . Le laboratoire que je dirige, placé sous la double tutelle du Laboratoire central des Ponts et Chaussées et de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, a pour mission le développement de systèmes d’aides à la conduite – relevant donc plutôt de la sécurité active – et je souhaite vous entretenir particulièrement du limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée, le LAVIA.
Entre 2001 et 2006, en partenariat avec les deux constructeurs français PSA Peugeot Citroën et Renault, avec le Laboratoire d’accidentologie et de biomécanique, avec la direction régionale des transports d’Île-de-France et avec le Centre d’études techniques de l’équipement (CETE), j’ai dirigé un projet qui visait à évaluer l’acceptabilité et l’usage fait par les conducteurs d’un système limitant automatiquement la vitesse du véhicule à la vitesse réglementaire à l’endroit où il se trouve, et d’en mesurer le bénéfice pour la sécurité routière.
Ce projet a donné lieu, pendant une année, à une vaste expérimentation : 93 conducteurs volontaires du département des Yvelines ont testé le système dans différents modes d’utilisation, du mode simplement informatif au mode réellement limitatif. Il est alors apparu que le LAVIA contribuait de façon certaine à réduire le nombre de tués sur la route et même que, dans un cas particulier d’accident, si 100 % du parc en était équipé, le nombre de tués et de blessés graves baisserait respectivement de 270 et de 300 par an.
En 2006, la question s’est posée de savoir s’il fallait développer un tel système.
M. le président Armand Jung. Est-il techniquement maîtrisé ? Combien coûte-t-il par véhicule ?
M. Jacques Ehrlich. Ce système repose sur une interaction entre des éléments embarqués dans le véhicule, dont un GPS, et d’autres qui proviennent de l’extérieur, comme la cartographie des limitations de vitesse.
La partie purement technologique, embarquée, limite la vitesse du véhicule une fois la consigne de limitation connue. Le dispositif est parfaitement au point. Aujourd’hui déjà, les constructeurs commercialisent des limiteurs de vitesse mais, dans ce cas, c’est le conducteur lui-même qui fixe la vitesse tandis qu’avec le LAVIA, c’est l’infrastructure qui est à l’origine de la consigne de limitation. Le problème est là : pour commercialiser un tel système, il faut qu’il soit fiable et donc que les limitations de vitesse du réseau routier français soient régulièrement réactualisées dans la base de données.
M. le président Armand Jung. Le LAVIA pourrait-il constituer une alternative aux radars ?
M. Jacques Ehrlich. Absolument, mais cela dépend des modalités d’utilisation qui seront choisies. Si son fonctionnement est imposé au conducteur, il peut en effet se substituer aux radars. En revanche, si sa mise en marche est laissée à l’appréciation du chauffeur, il ne fera que compléter les nouveaux radars pédagogiques.
M. Daniel Kopaczewski, sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. La réglementation en matière automobile, qui est extrêmement sophistiquée, s’élabore au niveau international, essentiellement à la demande des constructeurs automobiles et des équipementiers. Ceux-ci ont en effet besoin d’une réglementation harmonisée qui leur permette de vendre l’ensemble de leurs produits à l’échelle de la planète.
Toutefois, comme on l’a dit, la France peut encore faire entendre sa voix dans le processus d’élaboration de cette réglementation. Elle le fait d’abord au sein du Parlement et du Conseil européens, mais aussi auprès de la Commission. À propos de cette dernière, je voudrais d’ailleurs nuancer ce qu’a dit M. Cesari : dans le domaine de l’automobile comme dans d’autres, la Commission a de plus en plus tendance à procéder par voie non plus de directives mais de règlements, directement applicables par les États membres et ne nécessitant donc pas, eux, de transposition. À Genève, sous l’égide des Nations unies, les Français participent au groupe de travail connu sous le nom de Working Party 29, qui réunit constructeurs, équipementiers, associations et même, dans une mesure que nous souhaiterions d’ailleurs plus importante, pétroliers.
Il me semble important de signaler que l’essentiel de la réglementation pertinente est déjà écrit, y compris la réglementation qui s’appliquera demain, jusqu’en 2020. Au niveau communautaire, un règlement général de sécurité des véhicules décrit l’ensemble des équipements que vous verrez sur les nouvelles voitures particulières, dites de catégorie M1, mais aussi sur les nouveaux camions, camionnettes et véhicules de transport en commun. Un calendrier a été déjà établi et l’on peut savoir à quel moment chaque gamme de véhicules devra être dotée des nouvelles technologies de sécurité, en distinguant à chaque fois entre les nouveaux modèles mis sur le marché – ceux que l’on vient d’homologuer –, et les nouveaux véhicules – c’est-à-dire les véhicules neufs qui peuvent avoir été homologués antérieurement –, étant entendu qu’il existe un décalage entre ce que l’on impose aux uns et ce que l’on impose aux autres. Il en est de même des différentes catégories de véhicules : ainsi l’ESC – système de contrôle électronique de la stabilité – qui devra équiper les voitures de catégorie M1 dès cette année, n’équipera que progressivement les autres véhicules : poids lourds, véhicules de transport en commun de personnes.
Je vous transmettrai un document décrivant les normes qui s’imposeront aux constructeurs automobiles et aux équipementiers d’ici à 2020, et ce qui se passera après 2020, voire au-delà. En effet, la mise au point de certains équipements comme le LAVIA peut se heurter à des difficultés – manque de fiabilité de la technologie, coût excessif… – qui nous obligent à continuer d’y travailler avant de pouvoir décréter leur généralisation.
M. Philippe Toussaint, délégué général du Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR). J’ai pris mes fonctions de délégué général il y a quatre ans. Je suis également membre du collège des experts géré actuellement par Louis Fernique au sein de l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR). J’interviens enfin au sein du pôle de compétitivité Mov’eo et du Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT).
Le CEESAR est un organisme de recherche qui réunit l’école Centrale de Paris, le laboratoire d’anthropologie appliquée et un professeur d’anatomie de l’Université Paris V, la fondation MAIF et les constructeurs Renault et PSA. L’assemblée générale du Centre comprend également des enseignants, des chercheurs et un équipementier automobile, dans un souci de pluridisciplinarité.
Nous fonctionnons avec deux entités de régulation : un conseil scientifique et un médecin délégué. Les membres du conseil scientifique, qui est consulté sur des problèmes éthiques et scientifiques, viennent du monde médical et de la recherche. C’est ainsi que le professeur Got, qui a été vice-président du CEESAR, l’a présidé de 1997 à 2003.
Le CEESAR intervient dans trois domaines : l’accidentologie, la biomécanique et les facteurs humains. Nous sommes mandatés par les membres du conseil d’administration pour différentes missions. Dans le domaine de l’accidentologie, la principale est le recueil de données de terrain, pour mieux comprendre les risques routiers et les mécanismes d’accident et pour mettre en relation le bilan lésionnel d’un accidenté avec les circonstances de l’accident.
Nous réalisons également pour différents organismes des études visant à déterminer les priorités de recherche en vue d’améliorer la sécurité. Nous intervenons a posteriori pour constater les progrès apportés sur les véhicules : par exemple, pour évaluer le bénéfice tiré de la généralisation de l’ABS.
M. le président Armand Jung. Je suppose que le résultat s’est révélé positif ?
M. Philippe Toussaint. Oui, l’ABS a réellement contribué à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves.
Nous participons enfin à des projets de recherche nationaux et internationaux.
Dans le domaine de la sécurité routière, le monde de la recherche – pas seulement en France – a besoin de s’appuyer sur des bases de données détaillées, pertinentes, fiables et homogènes.
M. le président Armand Jung. Le sont-elles ?
M. Philippe Toussaint. Oui et non. Aujourd’hui, Louis Fernique dirige des groupes de travail qui s’emploient à améliorer la pertinence du fichier BAAC d’analyse des accidents corporels de la circulation (BAAC). En effet, les informations qui y sont entrées manquent d’homogénéité ou de précision, s’agissant des circonstances de l’accident, de l’environnement ou des types de véhicules concernés. Il conviendrait donc d’obtenir des données plus précises et plus cohérentes. Il serait également important de généraliser les registres comme celui du Rhône, qui recense les victimes d’accidents de la route dans ce département et qui permet de mesurer des incidences et d’avoir une vue globale de la situation sur un territoire. Enfin, il serait indispensable de disposer de données récentes et actualisées sur l’exposition aux risques et sur le trafic.
Le deuxième domaine dans lequel nous souhaitons améliorer nos connaissances est celui de la biomécanique – biomécanique des chocs et mécanismes lésionnels du corps humain. Nous travaillons sur un certain nombre d’essais réalisés à partir de programmes numériques et avec l’aide de mannequins. En ce domaine aussi, les recherches sont menées aux niveaux français, européen et mondial.
Pour ce qui est de la recherche relative aux facteurs humains, notre objectif est d’étudier l’homme dans son environnement automobile et d’essayer de mieux comprendre les facteurs entrant en jeu dans l’utilisation, la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des systèmes, en particulier des systèmes d’aide à la conduite aujourd’hui proposés aux conducteurs de véhicules récents. Pour cela, nous procédons à des expérimentations en vraie grandeur. Nous faisons ensuite aux constructeurs, aux équipementiers et aux organismes de recherche des propositions destinées à faciliter l’usage de ces systèmes par les conducteurs.
M. le président Armand Jung. Vos avis sont-ils suivis par les constructeurs ?
M. Philippe Toussaint. Oui.
M. Jean-Yves Le Coz, expert leader « sécurité routière » pour le groupe Renault, membre du Comité des constructeurs français d’automobiles. Je suis docteur en médecine, spécialiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. Pendant une quinzaine d’années, j’ai vécu dans le monde du handicap, prenant en charge des patients souffrant de séquelles d’accidents de la voie publique. C’est par ce biais que j’ai été amené, il y a vingt ans, à travailler pour les constructeurs automobiles. Je suis par ailleurs professeur d’université en bio-ingénierie et enseigne à l’école des Arts et Métiers ParisTech.
Tout comme M. Huère, je suis membre du Comité des constructeurs français d’automobiles. Voilà plus de quarante ans que ces constructeurs travaillent ensemble sur un sujet dont l’importance vous sera démontrée par l’exposé que fera Nicolas Bertholon, mais cette coopération est également active au niveau international et nous participons aux différentes instances déjà citées, dans le cadre de l’Union européenne ou des Nations unies.
Chaque élément du système routier doit offrir le même niveau de sécurité. L’automobile en est évidemment un et la prise en compte de la sécurité routière fait donc partie de notre responsabilité sociale d’entreprise. Aujourd’hui, l’automobile est probablement le bien de consommation le plus réglementé au monde et cette réglementation est largement internationale. Mais les deux constructeurs français ont une spécificité : ce sont des constructeurs généralistes, qui produisent aussi bien de petites que de grosses voitures, et les progrès réalisés dans la sécurité des unes comme des autres sont très notables. L’European New Car Assessment Program (EuroNCAP), créé par des associations de consommateurs et des gouvernements, dont le gouvernement français, a élaboré un label mesurant la sûreté des véhicules et permettant donc des comparaisons : la première voiture à obtenir la meilleure note était française et aujourd’hui, les deux constructeurs français sont au meilleur niveau.
Deuxièmement, il ne faut oublier que les constructeurs automobiles vivent dans un contexte concurrentiel, sur le plan national et international.
Après ces deux remarques, j’en viendrai à la question de la vitesse, qui fait aujourd’hui débat, pour d’abord inviter à ne pas confondre vitesse de circulation et vitesse de choc.
Aujourd’hui, les vitesses de choc prises en compte dans nos laboratoires d’essai couvrent 97 % des vitesses de choc des accidents. Nos données en la matière proviennent des travaux que nous menons en commun avec le CEESAR et le LAB ainsi que de toutes les bases de données existantes, nationales et internationales. Nous ne sortons jamais un chiffre au niveau national qui n’ait pas été comparé aux bases de données de Grande-Bretagne (CCIS) ou d’Allemagne (GIDAS). Et nous travaillons tous ensemble, constructeurs automobiles et autorités, dans des groupes internationaux d’accidentologie.
S’agissant de la vitesse de circulation, nous nous interrogeons tous sur les moyens de faire respecter les panneaux de limitation mais souffrez que je verse quelques éléments à ce dossier.
Premièrement, quand on mène des études détaillées d’accidents, on s’aperçoit dans 97 % des cas que la vitesse de circulation était inférieure à 130 km/h. Cela figurait déjà dans le rapport fait par Robert Namias à la fin des années quatre-vingt-dix.
Deuxièmement, brider un véhicule à 150 km/h n’empêchera jamais son conducteur de rouler à 110 km/h quand il devrait rouler à 90 km/h, ou à 90 km/h quand il devrait rouler à 50 km/h.
Troisièmement, les limitations de vitesse relèvent d’une réglementation technique qu’il faudrait discuter au niveau international.
Tous ces arguments pragmatiques nous conduisent à penser que le bridage des automobiles n’est pas forcément la mesure la plus efficace.
Face à ce problème, quelle a été l’attitude des constructeurs ? Nous n’avions pas à attendre que la société, au sens large, ait traité de la question un peu philosophique de « l’utilité des choses inutiles ». Ni que toutes les discussions aient abouti au niveau international. Il était en revanche de notre responsabilité d’installer sur nos voitures des systèmes facilitant la conduite automobile et le respect de la loi par les automobilistes. Voilà pourquoi les voitures françaises ont aujourd’hui le plus fort taux d’équipement en limiteurs volontaires de vitesse.
Il ne faut pas confondre limiteur volontaire et régulateur de vitesse. Avec le premier, vous vous imposez vous-même de ne pas dépasser la vitesse indiquée sur le bord de la route. C’est le cas avec le LAVIA informatif, dont certaines automobiles françaises sont d’ailleurs déjà équipées.
M. le président Armand Jung. Je sais que les voitures françaises sont parmi les plus sûres. Mais il se trouve que, pendant les vacances, je suis allé voir un concessionnaire Renault et un concessionnaire Peugeot pour vérifier si les voitures disposaient d’un compteur à aiguille ou d’un affichage digital de vitesse. Nombre des personnes que nous avons auditionnées avaient en effet déploré d’avoir à regarder l’aiguille de leur tableau de bord pour s’assurer qu’elles ne dépassaient pas la vitesse autorisée. Or il semble bien que, malgré toutes les avancées technologiques de ces quarante dernières années, les constructeurs français ne se soient pas donné la peine d’installer un affichage digital de vitesse, qui ne leur coûterait pourtant rien du tout.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur le président, sur ma Renault Laguna, qui est un modèle de série, la vitesse de circulation est indiquée par une aiguille mais la vitesse autorisée s’affiche et, lorsqu’elle est dépassée, j’en suis averti par un petit clignotant.
M. Jean-Yves Le Coz. Comment délivrer des informations aux conducteurs ? C’est tout le problème de l’IHM – interface homme-machine.
L’important est le temps que va mettre le conducteur à intégrer une information. Or, monsieur le président, il est parfois plus long de lire un chiffre que de repérer la position d’une aiguille sur un cadran.
M. le président Armand Jung. Tout le monde nous dit l’inverse.
M. Jean-Yves Le Coz. C’est faux, les études le montrent. En outre, si vous mettez en marche votre limiteur volontaire de vitesse, vous savez que vous n’allez pas dépasser la vitesse autorisée et, de ce fait, vous n’avez plus besoin de regarder votre tableau de bord. Ainsi, vous pouvez consacrer à regarder à l’extérieur de votre véhicule le temps que vous passiez à observer l’indicateur de vitesse.
M. le président Armand Jung. Cela ne vaut que sur autoroute, où vous pouvez utiliser votre régulateur de vitesse…
M. Jean-Yves le Coz. Monsieur le président, nous pourrons vous faire essayer des voitures équipées de ces systèmes de sécurité. Mais je vous rappelle aussi qu’il y a une différence entre le limiteur volontaire et le régulateur de vitesse. Avec le premier, vous fixez la vitesse que vous ne voulez pas dépasser – par exemple 50 km/h en ville – et vous continuez pour le reste à conduire normalement ; avec un régulateur, vous stabilisez votre vitesse comme vous l’entendez – par exemple à 130 km/h sur autoroute – mais vous n’avez plus à utiliser vos pieds pour conduire : vous ne faites que corriger la trajectoire de votre véhicule.
M. Jean-François Huère, responsable « sécurité routière » pour le groupe PSA Peugeot Citroën, membre du Comité des constructeurs français d’automobiles. Je précise, pour ma part, que tout limiteur de vitesse s’accompagne d’un affichage digital et je vous invite moi aussi à venir tester ces interfaces homme-machine.
Je suis chargé, à la direction des affaires publiques de PSA, de la sécurité routière et des systèmes de transport intelligents, après avoir passé plus de quinze ans à réaliser des crash tests dans notre laboratoire de Paris. J’ai eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années avec Jean-Yves le Coz, comme expert en accidentologie au sein du LAB. Je crois donc avoir une longue expérience des accidents et de leurs conséquences.
Jean-Yves Le Coz a parlé de la vitesse. Je traiterai quant à moi de l’alcool, qui est la première cause d’accidents mortels en France.
La première question qui se pose à ce propos est celle de l’équipement de l’alcoologue. PSA et Renault y travaillent, de concert, depuis très longtemps. Ils ont participé activement à l’élaboration de la loi d’orientation sur la sécurité intérieure, la LOPPSI 2. Cette loi comprend des mesures d’équipement pour les mini-vans et les transports scolaires et une mesure complémentaire que les juges peuvent imposer aux récidivistes de conduite alcoolisée : grâce à un post-équipement, le conducteur ne peut démarrer la voiture que s’il ne dépasse pas un certain taux d’alcoolémie. Ce dispositif, qui est à la charge du conducteur, doit être installé par un garage agréé et son coût s’élève au moins à 1 000 euros. Son démontage est également à la charge du conducteur.
M. le président Armand Jung. Est-il fiable ?
M. Jean-François Huère. En tant que constructeurs automobiles, nous avons aidé le ministère à définir un cahier des charges garantissant la sécurité et la sûreté de fonctionnement des voitures. Nous avons travaillé, notamment avec l’Union technique de l’automobile et du cycle (UTAC), à l’intégration en post-équipement de ce type de dispositif. Il s’agissait d’éviter que son intrusion sur le véhicule n’entraîne un risque – par exemple, celui de tomber en panne au milieu d’un passage à niveau.
Nous n’avons jamais caché nos réserves vis-à-vis de la généralisation de ce système : il est coûteux ; ne seraient concernés que 3 % des conducteurs, même si ceux-ci génèrent de très nombreux accidents graves ; le manque de maturité de la technologie empêche, selon nous, de l’intégrer en premier équipement. Il faut encore souffler dans un tuyau et, malgré les progrès réels faits par les équipementiers, il est encore possible de biaiser ce système.
Enfin, en tant que constructeurs, il nous semble que pouvoir démarrer sa voiture dans un cas d’urgence est indispensable. Or la lourdeur actuelle de l’interface homme-machine pourrait entraîner des situations dangereuses, rappelant ce qui s’est passé aux États-Unis dans les années quatre-vingt, lorsque certains constructeurs s’étaient risqués à subordonner le démarrage de la voiture au bouclage de la ceinture de sécurité. Des conducteurs paniqués qui avaient oublié de boucler leur ceinture n’ont pas pu démarrer instantanément et ont eu des accidents très graves.
Le démarrage est une fonction de sécurité qui doit être mise à disposition de la façon la plus fiable possible. Le processus conditionnant le démarrage de la voiture à un éthylotest ne nous paraît pas mature. Cela étant, nous surveillons bien évidemment l’évolution des technologies. Le moment venu, lorsqu’il n’y aura plus besoin de souffler pendant un certain temps dans cet éthylotest et que le système sera fiabilisé, nous y regarderons de très près.
Le dernier point que je souhaite aborder n’est pas forcément aussi connu que les précédents mais je souhaite vous montrer qu’en matière de réglementation, les constructeurs sont capables de prendre les devants.
Les voitures sont aujourd’hui extrêmement protectrices en cas d’accident : renforcement des structures, habitacles indéformables et systèmes de retenue sophistiqués. Mais de ce fait, lorsqu’elles sont obligées de désincarcérer des victimes d’accidents, les forces de secours ont du mal à découper les véhicules. En 2004, à la suite de leurs observations, Renault et PSA ont pris l’initiative d’élaborer avec la direction de la défense et de la sécurité civile des fiches fournissant toutes les informations nécessaires dans ces cas. Elles leur indiquent, pour chaque type de véhicule, là où il faut couper et là où il ne faut pas – en raison de la présence de systèmes pyrotechniques, de carburant, de gaz ou de carburants alternatifs et d’électricité.
Aujourd’hui, chaque fois que nous commercialisons de nouvelles voitures, nous nous rendons au Centre de formation des forces de secours des pompiers, à Fleury-Mérogis, et nous leur donnons des voitures crashées dans nos laboratoires, pour qu’ils y exercent leurs nouveaux outils. En outre, nous améliorons nos fiches en sorte que les secours disposent de tous les éléments techniques utiles sur ces nouveaux modèles.
M. le président Armand Jung. Se pose également le problème du matériau qui sert à fabriquer les véhicules et des angles d’accident les plus courants. Je crois que vos concurrents, Fiat et Volvo, ont arrondi certains angles et modifié, à certains endroits, le matériau utilisé…
M. Jean-François Huère. Nous faisons exactement la même chose et nous n’avons pas à rougir de notre technologie, qu’il s’agisse des carrosseries, des matériaux ou des systèmes de retenue.
M. Jean-Yves Le Coz. Toutes les évolutions en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement vont dans le même sens mais certaines se heurtent à un défaut d’éducation technologique chez les consommateurs. Par exemple, pour protéger l’environnement, nous nous efforçons d’utiliser des matériaux plus légers mais ce n’est pas bien vécu par nos clients, qui n’associent pas allégement et sécurité.
M. Jean-François Huère. Les progrès réalisés à cet égard sont énormes, mais ne se voient pas sur les voitures. C’est pour cela qu’il est important de les souligner.
En dernier lieu, je traiterai des systèmes avancés de sécurité. Nous avons réalisé des progrès considérables de ce point de vue également. S’agissant de la protection des occupants en cas d’accident, 80 % du travail a été fait et pour ce qui est des émissions de CO2 et des contraintes économiques, nous ne pourrons guère aller au-delà de ce qui est déjà acquis. En revanche, en ce qui concerne l’assistance apportée aux conducteurs pour éviter l’accident, nous avons encore beaucoup à faire et nous nous y attelons.
M. le rapporteur. Pourriez-vous développer ?
M. Jean-François Huère. Sont déjà sur le marché des voitures équipées de radars et de caméras qui permettent de détecter les obstacles, éventuellement de freiner au moment où le conducteur ne pourrait le faire par lui-même, pour éviter l’accident. En outre, certains systèmes – freinage automatique d’urgence, contrôle de trajectoire – sont dans les tuyaux « prérèglementaires ».
L’essentiel de ce qui fait une voiture performante est déjà présent sur les produits d’aujourd’hui. C’est donc en éliminant les vieilles voitures du parc et en les remplaçant par des voitures modernes, protectrices du passager et évitant les accidents, qu’on arrivera le plus rapidement, par un effet de masse, à sauver des vies humaines.
M. Jean-Yves Le Coz. Vous utilisez probablement des véhicules classés « cinq étoiles » par EuroNCAP, très évolués pour ce qui est des structures, des éléments de protection, de l’aide au freinage d’urgence, etc. Par rapport aux véhicules antérieurs, c’est vraiment le jour et la nuit ! Le risque d’être blessé ou tué a été divisé par quatre. Mais il faut savoir que ces automobiles ne représentent que 20 % du parc actuel.
M. Nicolas Bertholon, directeur adjoint du Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain (LAB). Le LAB est une structure de recherche commune aux deux constructeurs PSA Peugeot Citroën et Renault. Anne Guillaume vous ayant déjà présenté ses activités, je traiterai aujourd’hui de la part de l’automobile dans les progrès constatés, sur le terrain, en matière de sécurité.
En 2010, les décès des occupants d’automobiles représentaient la moitié des décès survenus sur la route en France, contre les deux tiers il y a dix ou vingt ans. La mortalité de l’ensemble des usagers de la route ayant baissé de 50 % depuis 2000, celle des seuls occupants d’automobiles a donc baissé de 60 %.
Ces bons résultats résultent d’abord de l’amélioration de la sécurité passive ou secondaire, c’est-à-dire de la protection offerte aux occupants d’automobiles en cas d’accident. La structure des voitures a été complètement modifiée, des déformations étant programmées dans les zones inoccupées cependant que l’habitacle était renforcé pour créer une cellule de survie. À cela est venue s’ajouter l’optimisation de l’ensemble des moyens de retenue – ceintures de sécurité, sièges et coussins gonflables de sécurité – qui équipent maintenant l’intérieur des véhicules. D’après nos études fondées sur des cas réels d’accident, les coussins gonflables de sécurité frontaux permettent de réduire de 90 % les lésions graves à la tête lors d’un choc frontal.
Dans un second temps, associée à la sécurité secondaire, la sécurité primaire – qui permet d’éviter les accidents ou d’en limiter la violence – a elle aussi bénéficié d’améliorations majeures, concernant tant le freinage que le comportement routier des voitures.
Dans le cadre du projet européen de recherche TRACE, nous avons montré que l’assistance au freinage d’urgence, qui est présente sur toutes les nouvelles voitures depuis fin 2009, permet de réduire de 15 % le nombre des blessés graves ou des tués, et que le contrôle dynamique de stabilité, qui sera installé sur toutes les nouvelles voitures à la fin de cette année, permet de réduire leur nombre de 20 %.
Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons évalué l’efficacité d’un ensemble de systèmes de sécurité primaire et secondaire qui équipent maintenant pratiquement toutes les voitures neuves.
Pour apprécier la sécurité secondaire, nous avons utilisé la notation de l’EuroNCAP. Nous avons comparé une voiture « cinq étoiles » en sécurité secondaire, équipée de l’assistance au freinage d’urgence et du contrôle dynamique de stabilité, à une voiture « quatre étoiles » sans les équipements de sécurité primaire. Et nous avons observé, sur la route, une réduction de 70 % des blessés graves ou des tués.
Les progrès sont donc considérables : une voiture d’aujourd’hui est quatre fois plus sûre qu’une voiture d’il y a vingt ans. En revanche, une grande partie de ces progrès reste à capitaliser puisque les taux d’équipement de l’ensemble du parc roulant sont encore relativement faibles : nous n’en sommes qu’à 20 % pour l’ESC, par exemple. Or, si le parc roulant était équipé à 100 % de l’ensemble des systèmes de sécurité, le nombre des blessés graves et des tués sur la route, parmi les occupants d’automobiles, baisserait de moitié – à accidents équivalents.
Parmi les nouveaux systèmes de sécurité, soit en cours de développement, soit sur le marché, trois nous paraissent particulièrement prometteurs.
Le premier est le limiteur de vitesse intelligent, qui permet au conducteur de fixer sa vitesse maximale en fonction de la limite réglementaire applicable à l’endroit où il se trouve.
Le deuxième est l’appel d’urgence automatique, qui permet de mettre en relation les occupants de la voiture avec les secours, et aux secours de localiser celle-ci.
Le troisième est l’aide au suivi de voie, qui alerte le conducteur, voire corrige sa trajectoire, si jamais il franchit involontairement la ligne.
M. le président Armand Jung. Ne pourrait-on pas généraliser la boîte noire ? Cela éviterait de débattre sur les causes d’accidents.
M. Nicolas Bertholon. Cela nous aiderait énormément mais, aujourd’hui, une boîte noire ne peut pas tout enregistrer. Par exemple, elle ne rend pas compte de l’environnement, et donc du cadre de l’accident. D’autre part, la légalité d’un tel dispositif est incertaine…
M. Jean-Yves Le Coz. Il faut savoir ce que l’on entend par « boîte noire ». Aux États-Unis, on utilise des crash recorders où sont retenus en mémoire des éléments dynamiques très ponctuels, au millième de seconde près, sur ce qui s’est passé au moment de l’accident. Mais ils n’apprennent rien sur l’environnement.
M. le président Armand Jung. Nous disposerions au moins d’éléments techniques et d’informations sur le comportement du conducteur.
M. Christian Sibrik, président de la branche « contrôle technique » du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Vingt métiers sont représentés au CNPA, du concessionnaire au démolisseur en passant par les auto-écoles – soit 90 000 entreprises et 410 000 salariés.
Le contrôle technique va bientôt fêter ses vingt ans puisqu’il a été rendu obligatoire en 1992 – depuis 1986, il l’était seulement en cas de mutation. Nous traquons, sur les véhicules ayant plus de quatre ans, 398 altérations élémentaires dont 165 entraînent l’obligation d’une contre-visite. Nous avons ainsi effectué en 2010 un peu plus de vingt millions de contrôles dans nos 5 434 stations.
Depuis 1992, l’état du parc s’est considérablement amélioré. Par exemple, on ne voit pour ainsi dire plus de planchers troués ni de ceintures de sécurité rafistolées avec des épingles à nourrice. En revanche, ce parc vieillit : l’âge moyen des véhicules est passé de 7,3 à 8 ans. Et sur ces véhicules de huit ans, le taux de contre-visites est de 25 %, contre 6 % pour les véhicules de quatre ans. Nous pensons donc qu’il faudrait revoir plus fréquemment les véhicules plus anciens.
Un contrôle prenant environ trois quarts d’heure, nous devrions également profiter de ce temps pour diffuser aux conducteurs des messages ou des vidéos de sensibilisation à la sécurité routière.
M. le rapporteur. Rien ne vous en empêche.
M. Christian Sibrik. Certains centres le font. Mais le problème est que les établissements, qui sont de plus en plus nombreux, se préoccupent de ce fait davantage de leur productivité que de communication avec les clients.
Mme Pauline Johanet, coordinatrice « media et lobbying » au Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Tous les dispositifs dont il a été question dans cette table ronde sont indéniablement efficaces, mais ne concernent que les 2,5 millions de véhicules neufs vendus chaque année. Or on en compte 37 millions en circulation. S’il y a donc un message que notre branche « contrôle technique » souhaite faire passer, c’est la nécessité d’un bon entretien de l’ensemble de ce parc pour limiter le nombre des accidents.
M. Geoffrey Michalak, directeur technique « qualité, sécurité, environnement » du groupe Dekra Automotive, membre de la branche « contrôle technique » du CNPA. Le contrôle technique n’a pas pour mission d’inventer de nouveaux dispositifs, mais de vérifier le bon fonctionnement de ceux qui équipent les véhicules tout au long de la vie de ceux-ci. Or nous nous heurtons là à plusieurs difficultés. D’abord, comme la plupart de ces dispositifs sont optionnels, nous avons du mal à savoir si un véhicule ancien en est équipé. Ensuite, il n’existe pas de bases de données, qui devraient être au moins européennes, permettant de connaître les dispositifs de sécurité de manière à effectuer sur eux les contrôles pertinents. Notre secteur s’applique certes à évoluer et à tenir compte des nouvelles réglementations, mais nous nous trouvons parfois démunis devant les avancées technologiques les plus « pointues ».
M. le président Armand Jung. J’observe qu’il est fait mention du contrôle technique sur la carte grise : la police ou la gendarmerie peuvent donc vérifier qu’il a bien été effectué.
M. Jean-Yves Le Coz. Les résultats des enquêtes RÉAGIR sont assez clairs : parmi les facteurs techniques à l’origine des accidents, les éléments tenant à la conception des véhicules jouent un rôle bien moindre que ceux qui tiennent à la maintenance, notamment des pneumatiques, impliqués dans 3 à 3,5 % des cas.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de la précision de ces premiers propos, et je vous livre maintenant au feu des questions du rapporteur !
M. le rapporteur. La première, qui s’adresse à M. Le Coz, sera un peu provocatrice. Certes, brider les véhicules à 130 kilomètres-heure n’empêchera pas les excès de vitesse en agglomération mais quelle logique y a-t-il à construire des véhicules qui peuvent atteindre 250 kilomètres-heure et, comme la limitation à 130 kilomètres-heure s’impose en France et dans de nombreux autres pays, à s’ingénier ensuite à mettre au point des systèmes permettant de réduire la vitesse ? J’aimerais vous voir aller jusqu’au bout du raisonnement : pourquoi estimez-vous que le bridage n’est pas une solution ?
M. Jean-Yves Le Coz. Parce que les études – dont les données détaillées sont à votre disposition – nous montrent que, dans 97 % des cas, la vitesse de circulation des véhicules juste avant l’accident est inférieure à 130 kilomètres-heure.
Ne nous demandez pas de régler aujourd’hui la question sociologique, voire philosophique, de l’utilité des choses inutiles…
M. le rapporteur. Je dirai plutôt de la dangerosité des choses inutiles, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
M. Jean-Yves Le Coz. …Nous ne pouvons cependant nous permettre d’attendre sans rien faire et c’est pourquoi nous proposons d’autres solutions pour que le conducteur puisse exercer sa responsabilité. Il reste que la décision de brider les véhicules ne peut être prise par un ou deux constructeurs automobiles. J’ai tenu à le rappeler en préambule, je viens du monde du handicap et, pour moi, les impératifs de sécurité routière l’emportent évidemment sur les considérations économiques. Mais les constructeurs automobiles n’en vivent pas moins dans un environnement concurrentiel. Autrement dit, c’est à la société de répondre à la question que vous posez – car ce n’est pas une question industrielle, mais bien une question de société.
M. le rapporteur. Cela mériterait de plus amples développements, car je ne partage pas entièrement votre avis. Au surplus, les aspects juridiques du sujet n’ont pas été évoqués.
M. Jean-François Huère. Je vous retournerai la question, monsieur le rapporteur : comment expliquez-vous le succès des voitures qui dépassent les vitesses limites ?
M. le rapporteur. C’est sans doute que le budget de communication des constructeurs automobiles est supérieur à celui de la délégation interministérielle à la sécurité routière !
M. Jean-François Huère. Il y a une autre explication : l’envie d’aller vite. Les constructeurs automobiles sont légalistes et prêts à fabriquer les voitures qu’on leur demandera. Mais nous vivons dans un marché ouvert, et vous n’ignorez pas que dans certains pays d’Europe, on peut rouler très vite.
M. le rapporteur. La principale explication est donc d’ordre commercial et, pour ne pas porter préjudice à tel ou tel constructeur, il faudrait une réglementation uniforme. En attendant, on construit des voitures pouvant rouler à 250 kilomètres-heure ; la publicité aidant, elles plaisent car on suscite une envie ; mais, en même temps, on fait tout pour interdire aux gens de rouler vite et on conçoit des systèmes extrêmement ingénieux pour limiter la vitesse… Tout cela est grandement hypocrite et mériterait un vrai débat. Reste que, selon certains juristes, il n’est pas impossible qu’un constructeur finisse par être attaqué en justice pour complicité – via la fourniture d’engins dangereux – en cas d’accident mortel ayant pour cause essentielle et avérée la vitesse.
J’en viens à ma deuxième question. De l’avis général, les constructeurs automobiles français sont plutôt bons pour ce qui est de la sécurité des véhicules et de l’adaptation d’un certain nombre de systèmes. Or, curieusement, nous n’obtenons pas les meilleurs résultats européens en matière de sécurité routière. Comment expliquez-vous ce décalage ?
À quelle échéance estimez-vous, d’autre part, que l’ensemble du parc automobile pourra être équipé d’un certain nombre des dispositifs qui ont été mentionnés, sachant que l’âge moyen des véhicules est d’environ huit ans et que l’on achète sa première voiture neuve à 51 ans ?
M. Jean-François Huère. Nous n’avons pas d’explication au décalage que vous évoquez. Nous l’avons dit tout à l’heure, la voiture ne fait pas tout. Les nôtres sont au meilleur niveau européen ; du point de vue de la technologie automobile, il n’y a donc aucune raison que nos résultats en matière de sécurité routière ne soient pas comparables à ceux de nos voisins. Je note d’ailleurs qu’ils se sont bien améliorés depuis quelques années, ce qui constitue une performance qui mérite d’être saluée. Cependant, le réseau routier, la structure du parc automobile et le comportement des conducteurs ne sont pas les mêmes partout : autant de sujets qui demanderaient à être approfondis pour pouvoir répondre à votre question. Ce qui est certain, c’est que la voiture, qu’il s’agisse d’une Peugeot ou d’une Renault, est la même dans toute l’Europe. Ce n’est donc pas elle qui peut expliquer les différences de résultats.
M. Jacques Ehrlich. Je suis assez optimiste sur la question du bridage et de la puissance des véhicules. Nous sommes en effet en pleine évolution : les valeurs attachées à la voiture sont en train de changer, et je pense que le contrôle-sanction automatisé y est pour quelque chose. La valeur « puissance vitesse » devient obsolète.
M. Jacques Myard. Cela vaut-il pour les motos ?
M. Jacques Ehrlich. Peut-être pas – mais c’est un domaine que je connais moins bien. S’agissant des voitures, d’autres valeurs se substituent – contrôle automatisé aidant – à la valeur « puissance vitesse » : le confort, la faible consommation, la sécurité passive et active. La période est donc très favorable à l’acceptation de la technologie. C’est pourquoi je suis convaincu que le LAVIA est l’une des options qui s’offrent à nous pour améliorer nos performances par rapport aux autres pays. Sachant le rôle que joue la vitesse dans l’accidentalité, tout progrès sur le respect des vitesses autorisées permet de réduire le nombre de tués et de blessés.
M. le rapporteur. Le LAVIA est évidemment une solution. Mais ne risque t-on pas de susciter un débat – qui est un débat de société – sur l’accès à la sécurité ? Il n’est pas censé dépendre des moyens de chacun.
M. Jacques Ehrlich. Bien entendu, mais il faut un certain temps pour que les technologies se déploient. Le processus est toujours le même : une innovation est d’abord coûteuse et limitée aux véhicules haut de gamme, puis son coût diminue progressivement. Elle peut alors se diffuser pour s’étendre à toute la gamme des véhicules. On l’a observé pour le limiteur-régulateur de vitesse contrôlé par le conducteur, dont tous les véhicules de constructeurs français sont aujourd’hui équipés. L’évolution sera la même pour le LAVIA, qui est un limiteur de vitesse dont la consigne vient de l’extérieur, puisqu’il est couplé à un système GPS et à une base de données des limitations de vitesse.
Notre discussion est pour l’instant restée centrée sur le véhicule. Le LAVIA, lui, suppose une interaction entre véhicule et infrastructure. Nous devons donc essayer d’étendre le débat au rôle des gestionnaires d’infrastructures dans la mise en place de ces systèmes. Si le LAVIA ne peut aujourd’hui se déployer comme nous le souhaiterions, c’est parce que, pour disposer d’une base de données des limitations de vitesse qui soit à jour, il faut un système d’information qui parte des collectivités locales – qui fixent ces limitations – et couvre ensuite toute une chaîne pour finalement arriver aux véhicules. Au-delà des technologies embarquées, c’est aussi de cela – l’évolution des infrastructures et le modèle économique qu’elle implique – que nous devons discuter.
M. le rapporteur. L’obligation de porter la ceinture de sécurité a suscité un vaste débat et maintes contestations lorsqu’elle a été instaurée dans les années 1970. Elle a cependant abouti à une baisse très substantielle du nombre des victimes. Avez-vous aujourd’hui en vue un dispositif susceptible de produire des effets équivalents ?
M. le président Armand Jung. Je m’associe à cette question. Bien qu’elle n’ait jamais été présentée comme une avancée technologique exceptionnelle, la ceinture de sécurité a permis de sauver des milliers de vies. Notre ambition serait de pouvoir proposer au Gouvernement, à l’issue des travaux de cette mission d’information, l’idée « de génie » qui permettrait d’obtenir un résultat du même ordre. C’est pourquoi nous faisons appel à vos lumières…
M. Jean-Yves Le Coz. Il s’agit pour moi d’un dispositif dont nous parlons depuis le début de l’après-midi, mais que fort peu de conducteurs – comme c’était le cas pour la ceinture de sécurité au début des années 1960 – utilisent aujourd’hui : le limiteur volontaire de vitesse, dont la généralisation pourrait avoir un effet aussi important que le port obligatoire de la ceinture.
M. le président Armand Jung. Mais il faut une carte électronique. En ville, les limitations de vitesse sont éminemment variables : ici à 30 kilomètres-heure, là à 50 ou 70 kilomètres-heure.
M. le rapporteur. S’il s’agit du limiteur volontaire, sa non-utilisation n’est pas une infraction – contrairement à l’absence de port de la ceinture.
M. Jean-Yves Le Coz. Si les gens avaient connaissance de l’existence de ces équipements et de l’intérêt de les utiliser et qu’ils en maîtrisaient le fonctionnement, leur efficacité en serait considérablement augmentée… Cela nous ramène à la question de M. Houillon sur le délai d’équipement de la totalité du parc. Je pourrais vous dire comme tant d’autres, monsieur le rapporteur, que demain, la technologie permettra de régler tous les problèmes. Pour ma part, j’estime qu’il ne faut pas tout attendre d’elle, et que le grand pas a déjà été fait. Il reste à permettre à la population d’utiliser les dispositifs qui existent et dont nous avons mesuré l’efficacité. Or moins de 20 % des conducteurs peuvent aujourd’hui le faire. Autrement dit, il reste à trouver le moyen de favoriser l’utilisation générale de ces systèmes – ce qui permettra des gains substantiels.
M. Ehrlich a relevé que nos préoccupations étaient centrées sur le véhicule. C’est vrai mais, même si cela ne peut déplaire aux constructeurs automobiles que nous sommes, il nous faut aussi insister sur l’importance fondamentale de l’éducation et de la formation à l’utilisation de ces nouveaux systèmes. Nous devons consacrer du temps aux acquéreurs de véhicules neufs pour leur apprendre comment fonctionne un limiteur volontaire ou un régulateur de vitesse. Par exemple, il est inutile de s’effrayer parce que la pédale vibre lorsqu’on appuie un peu fermement dessus : cela signifie simplement que l’ABS fonctionne correctement. Il ne faut donc surtout pas relâcher la pédale ! Encore faut-il l’avoir expérimenté et ressenti.
Mme Françoise Hostalier. Contrairement au rapporteur, je pense que la sécurité devient de plus en plus un argument de vente. C’est en tout cas ce que je constate dans mon entourage. Comment vous, constructeurs, vivez-vous cette évolution, compte tenu des limites que vous impose le secret technologique, puisque la sécurité fait l’objet de lourds investissements en matière de recherche ? Y a-t-il des « secrets maison » que l’on ne partage pas, ou existe-t-il des structures favorisant, dans l’intérêt des consommateurs, les échanges de technologie entre constructeurs ?
Ma deuxième question porte sur le contrôle technique. Vous nous dites que l’âge moyen des voitures a augmenté. N’est-ce pas dû à l’amélioration des véhicules ? Je constate pour ma part que la carrosserie de ma voiture est impeccable au bout de dix ans. De même les pneumatiques. Bref, il semble que les véhicules d’aujourd’hui soient devenus inusables !
Profiter du contrôle technique pour mener une action de sensibilisation à la sécurité routière auprès des conducteurs – par exemple par des vidéos – me semble une excellente idée. N’y aurait-il pas moyen d’y associer les assureurs, pour qui l’enjeu est également important ?
Un autre point m’inquiète. Vous construisez des véhicules de plus en plus sophistiqués. Mais assurez-vous la formation correspondante aux mécaniciens et autres réparateurs ? Si je me permets de poser cette question, c’est que je suis tombée un jour en panne en Auvergne avec un de ces véhicules, et qu’il m’a fallu attendre trente-six heures pour être dépannée !
Enfin, puisqu’il a été question de la formation des automobilistes aussi, agissez-vous auprès des auto-écoles et des lycées pour apporter vos connaissances aux futurs conducteurs et les inciter à utiliser les nouvelles technologies de sécurité ?
M. Jacques Myard. Je suis frappé, à vous entendre tous, par la « balkanisation » qui semble toucher la filière automobile. Vous avez notamment expliqué que les progrès qui avaient été faits sur l’habitacle – qui protège les passagers – étaient tels que vous aviez dû donner leur « mode d’emploi » aux pompiers pour pouvoir l’ouvrir ! N’existe-t-il vraiment aucun lieu – je me tourne ici vers les représentants du ministère – où puissent se faire les « connexions » sur tout ce qui est nécessaire à la sécurité ? Je crains que vous ne vous parliez guère et que les informations ne circulent pas suffisamment…
M. le rapporteur. C’est une bonne question.
M. Alfred Trassy-Paillogues. En tant que président du groupe d’études sur l’automobile, j’ai moi aussi quelques questions à vous poser.
En ce qui concerne le débat sur la puissance et la vitesse, l’avènement progressif du véhicule électrique et du véhicule hybride rechargeable va conduire à l’arrivée sur le marché de véhicules à vitesse maximale limitée. Pour préserver l’autonomie, celle-ci ne dépassera en effet pas les 150 à 160 kilomètres-heure. Or la puissance est utile pour certains dépassements ou certaines situations critiques.
J’observe par ailleurs que les options constituent pour les constructeurs des sources de fortes marges. Peut-on envisager qu’ils fassent un effort particulier sur les équipements de sécurité ? Je ne pense évidemment pas qu’aux constructeurs français… De même, ne pourrait-on standardiser l’utilisation de ces équipements, afin de faciliter celle-ci, notamment par les seniors ? Pour prendre un exemple, le régulateur pourrait se mettre en marche de la même façon sur tous les véhicules, quel que soit le constructeur, Renault, Peugeot, Volkswagen ou Toyota…
En vue de mettre au point le limiteur de vitesse « intelligent », le LAB a-t-il déjà conduit des études sur l’interactivité avec une signalétique verticale intelligente ?
Enfin, sans en arriver à la boîte noire, complexe à mettre au point, ne pourrait-on imaginer une boîte noire pédagogique, à l’image de cette clé que M. Le Coz connaît bien, qui stocke pour le constructeur toute une série de données sur la vie du véhicule ? Il suffirait en effet d’y intégrer des données concernant l’utilisation des régimes et la fluidité de la conduite, par exemple, qui seraient mises à la disposition de l’automobiliste pour lui permettre de s’améliorer.
M. Patrick Lebreton. Pour résumer, les véhicules neufs sont mieux équipés, mais les véhicules anciens restent à équiper. Cela suppose une meilleure formation des jeunes conducteurs et un vrai « recyclage » des conducteurs plus anciens – dont je fais partie. A-t-on évalué le coût d’une telle révolution ?
Ma deuxième question concerne plus particulièrement mon département de l’île de la Réunion, où l’on voue un véritable culte à la voiture, et qui compte aujourd’hui 430 000 véhicules pour 833 000 habitants. En 2007, dernière statistique dont je dispose, le taux de véhicules neufs y était limité à 10 %. Auriez-vous des chiffres plus récents à me fournir ? Cet élément a son importance puisque, vous l’avez dit tout à l’heure, on peut établir un lien entre l’âge des véhicules et l’accidentalité.
M. Lionel Tardy. Je reviens tout d’abord sur les éthylotests anti-démarrage. Nous sommes tous conscients, monsieur Huère, que cela peut poser des problèmes sur les véhicules de série, notamment en cas de démarrage d’urgence. Je rappelle cependant que la loi s’est bornée à instaurer ce dispositif pour les récidivistes de l’alcoolémie au volant, et avec un accompagnement. Pour le généraliser, il faudrait en diminuer le coût – nous en reparlerons.
Ma deuxième question s’adresse au CNPA. Vous nous dites que 2 millions de véhicules seulement, sur les 37 millions aujourd’hui en circulation, seraient équipés des systèmes de sécurité les plus récents. Quel a été l’impact de la prime à la casse à cet égard ? Si nous n’avons jamais eu de chiffres sur ce point, la mesure a tout de même dû contribuer à abaisser un peu la moyenne d’âge des véhicules. Quels véhicules les constructeurs ont-ils pu vendre à cette occasion ? S’est-il agi de véhicules bas de gamme, ou aussi de véhicules équipés des dispositifs les plus récents de sécurité active ou passive ? Il serait intéressant de le savoir : en l’absence de normes imposées, le choix d’équipements de sécurité par les acquéreurs dépendra de leur prix. L’ESC sera intégré sur les véhicules de série d’ici à la fin de l’année. Plus les systèmes seront intégrés d’office dans les véhicules, et mieux ce sera !
Je m’adresse maintenant au représentant du CEESAR. Si l’on parle bien de sécurité des véhicules au niveau européen, la pratique et la réglementation ne suivent guère. Je pense aux pneus neige, qui ne sont obligatoires que dans certains pays, mais aussi au suivi des amendes, à la protection des véhicules ou encore aux pièces détachées…
Monsieur Le Coz, quelle différence faites-vous entre le limiteur volontaire de vitesse et le régulateur de vitesse pour ce qui est de l’impact réel sur la sécurité routière ?
Je suis persuadé, monsieur Ehrlich, que le LAVIA constitue à terme une bonne solution. Le problème réside dans la mise à jour de la base embarquée, puisque les limitations de vitesse varient suivant les communes et les départements. À mon avis, un LAVIA en mode actif – avec un mode kick down permettant par exemple de « piler » en cas de besoin – associé à une base de données vraiment fiable peut être efficace. La Haute-Savoie est prête à être département pilote pour la mise en place de ce système, mais il faut d’abord régler la question de la base de données – gestion, mise à jour et aspects juridiques.
M. Jean-Jacques Candelier. Monsieur Sibrik, nous avons appris ce matin que des milliers – voire des dizaines ou des centaines de milliers – de conducteurs roulaient sans permis. Connaissez-vous pour votre part le nombre de véhicules qui roulent sans avoir passé le contrôle technique ou dont les conducteurs s’abstiennent de respecter les consignes données lors de ce dernier ?
Quant au bridage, si nous sommes tous conscients qu’il pourrait être une solution, on conçoit mal que des constructeurs comme Ferrari puissent produire des voitures ne pouvant dépasser 140 kilomètres-heure. La mesure mérite donc une vraie réflexion, d’autant que la vitesse est avant tout un phénomène de société.
M. Dominique Raimbourg. Monsieur Toussaint, n’y a-t-il pas parfois confusion entre cause et corrélation ? Lorsqu’on affirme par exemple que l’alcool est responsable de 30 % des accidents, est-ce à dire qu’il en est vraiment la cause, ou simplement que la présence d’alcool a été constatée chez un des conducteurs à l’occasion d’un accident ?
Je m’interroge d’autre part sur le rôle du trafic dans les accidents. Le nombre de véhicules multiplié par le kilométrage moyen induit-il un certain nombre d’accidents ? Autrement dit, peut-on espérer faire baisser le nombre de ceux-ci par le report d’un certain nombre de déplacements sur le train ou sur la marche à pied ?
Mes autres questions s’adressent plutôt à M. Ehrlich. Combien coûte le LAVIA ? Le consommateur peut-il espérer récupérer une partie de sa dépense via une baisse de la police d’assurance ?
M. Christian Vanneste. La plupart d’entre nous ont connu l’époque où la voiture était un objet de désir – rappelons-nous la « mythologie » de la DS selon Roland Barthes ! – mais il semble qu’elle soit désormais vouée à devenir un outil sécurisé, avec tout le désenchantement que cela implique. Pour autant, sera-ce un objet égalitaire ? Si l’on s’en tient aux véhicules les plus récents, les voitures les plus puissantes – et les mieux équipées – sont-elles plus sûres que celles à bas coût ? Les constructeurs se préoccupent-ils du coût de l’intégration des systèmes de sécurité dans la voiture ? Avez-vous essayé d’évaluer le coût minimum d’un véhicule équipé de tous ces systèmes, accessible à tous ?
Plusieurs des personnes que nous avons auditionnées ont d’autre part insisté sur le fait que conduire une voiture toujours à la même vitesse sur un itinéraire présentant peu de difficultés induisait un risque. L’endormissement est ainsi devenu l’une des premières causes d’accident. Avez-vous déjà réfléchi aux moyens – et notamment aux moyens embarqués – qui permettraient de combattre ce danger ?
M. Jérôme Lambert. Que préconisez-vous pour lutter contre un phénomène proche de l’endormissement mais néanmoins différent, l’inattention ? Je suis personnellement frappé par les « records » qu’enregistrent les radars automatiques, pourtant signalés par des panneaux. Sans aller jusqu’à ce qui se pratique pour certains trains, où le conducteur doit appuyer sur un bouton toutes les n secondes sous peine d’arrêt automatique de l’engin, existe-t-il des moyens techniques permettant de s’assurer de la vigilance du conducteur ? Beaucoup d’infractions relèvent en effet moins d’une volonté délibérée que de ce phénomène d’inattention.
M. Dominique Cesari. Il convient de rester prudent : la technologie ne peut suffire à garantir la sécurité routière. Elle doit être adaptée à ce que les conducteurs, dans leur diversité, sont capables de faire : tout le monde ne peut pas utiliser de la même façon tous les dispositifs.
Les performances de ces technologies sont du reste très diverses. Les ESB ou les ESC répondent en effet à des spécifications propres à chaque constructeur. À ce jour, il n’y a pas de méthode commune pour les évaluer ou les valider. Il reste donc tout un champ de recherches à mener dans ce domaine.
La ceinture de sécurité a certes constitué un réel progrès, mais elle n’a plus rien à voir avec celle des années 1970. C’est parce que son port a été rendu obligatoire que ses performances se sont améliorées. Il faut donc accepter l’introduction de dispositifs qui ne sont pas optimisés. C’est seulement à mesure qu’on développera des méthodes permettant de les évaluer – en pratique mais aussi en laboratoire – qu’ils gagneront en efficacité. On peut donc rester optimiste dans ce domaine.
S’agissant de la puissance et de la vitesse, je rejoins mon collègue. Nous sommes en pleine évolution, ne serait-ce qu’avec les véhicules électriques, dépourvus de boîtes de vitesses, qui ne seront plus des véhicules à conduite agressive. Tout cela va dans le sens de la sécurité. Nous pouvons donc – là aussi – être optimistes.
M. Jacques Ehrlich. Pour ce qui est de la gestion de la base de données, monsieur Tardy, il faut bien voir que nous avons à la fois une chaîne d’acteurs et une chaîne de valeurs. La collecte des données sur les limitations de vitesse ne peut se faire qu’au niveau des communes. L’information doit ensuite être intégrée dans des bases de données et reliée à une carte – autrement dit située sur la route. Une fois cela fait, il faut l’amener dans les véhicules, ce qui peut passer par plusieurs moyens, dont les télécommunications. Certains éléments de cette chaîne de valeurs relèvent à mon sens de la responsabilité de l’État. Reste à voir où placer le curseur entre État et opérateurs privés, ceux-ci assurant le formatage et la diffusion des données. La constitution de la base de données est à la frontière entre les deux. Elle pourrait être de la responsabilité de l’État ou des collectivités locales. Le projet BALI, que nous avons développé dans les Yvelines, avait justement pour objectif de montrer la faisabilité de cette base de données et de définir l’organisation à mettre en place pour faire remonter les informations jusqu’à cette base. Ce schéma est-il viable à long terme du point de vue économique ? Je l’ignore, mais l’État ne peut en tout cas se désengager de cette chaîne de valeurs. Lorsque l’information sera disponible, les opérateurs privés sauront bien s’en emparer...
En ce qui concerne le LAVIA, je parlerai de surcoût plutôt que de coût. Ce dispositif associe en effet le limiteur de vitesse, un GPS et une carte intégrant les limitations de vitesse. Dans les années à venir, le parc automobile va progressivement s’équiper à 100 % du limiteur de vitesse et du GPS. Ne restera donc que le surcoût que représente l’actualisation des bases de données, qui peut être estimé, en gros, à 100 ou 200 euros par an, à la charge du conducteur, ou partagé avec les assureurs, ou encore intégré dans des bouquets de services plus vastes.
M. Daniel Kopaczewski. S’agissant du bridage des véhicules, un autre élément est désormais pris en considération : l’impact environnemental. On sait que les émissions de CO2 sont liées à la consommation de carburant. La pression aujourd’hui exercée par les pouvoirs publics en faveur d’une baisse de ces émissions conduit tout naturellement les constructeurs automobiles à réfléchir aux meilleurs moyens d’assurer le respect des normes environnementales. La limitation de la puissance des véhicules en est un – et il est de plus en plus souvent évoqué.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, madame Hostalier, la sécurité n’est pas vraiment un argument de vente pour nos concitoyens, qui privilégient d’abord, dans leur choix d’options, la peinture métallisée, la qualité de l’autoradio ou les jantes en alliage, les équipements de sécurité n’arrivant qu’en sixième ou septième position. Nous n’avons donc d’autre choix que de les rendre obligatoires…
Il existe heureusement des lieux d’échange pour réfléchir à la sécurité des véhicules, monsieur Myard. Comme l’a dit M. Huère, les constructeurs tendent désormais à intensifier les échanges avec les pompiers dès la conception des véhicules – de plus en plus sophistiqués – sur lesquels ils sont appelés à intervenir. Nous plaidons pour être associés à ces échanges, comme devraient l’être à notre sens les autres acteurs de la sécurité.
Quant à l’impact de la prime à la casse sur le renouvellement du parc, il a été assez faible, la mesure ayant surtout servi à soutenir le marché à un moment où il s’effondrait. Sans les deux mesures de soutien que sont le programme bonus-malus écologique et la prime à la casse, on aurait observé une baisse de l’ordre de 10 à 20 % des immatriculations. Cela ne signifie évidemment pas qu’il ne faille pas encourager ce renouvellement : les véhicules modernes sont bien plus sûrs que les véhicules anciens.
À l’endormissement et à l’inattention, j’ajouterai la distraction du conducteur. Si une partie des accidents sont imputables à l’endormissement et une autre à l’inattention, la part de la distraction – manipulation de téléphone portable, visionnage de vidéos et j’en passe – est en train de croître.
M. Christian Vanneste. Il y a en effet des chauffeurs routiers qui regardent la télévision.
M. Daniel Kopaczewski. Dans certains bus, des panneaux invitent les passagers à ne pas parler au chauffeur pour ne pas le distraire de sa conduite. Nous devons nous attaquer à ce même problème de la distraction s’agissant cette fois des conducteurs de voitures particulières. Pour un certain nombre de dispositifs – qui vont d’abord être installés dans les poids lourds, car la réglementation les impose –, il faudra ainsi trouver un juste milieu de manière qu’une confiance excessive dans la technologie embarquée n’empêche pas l’automobiliste de rester maître et responsable de sa conduite. Il ne faut pas qu’il s’en remette aux seuls équipements…
M. le rapporteur. N’y a-t-il pas là un risque ?
M. Jacques Myard. Bien sûr !
M. Philippe Toussaint. Pour ce qui est de l’implication de l’alcool dans les accidents, monsieur Raimbourg, nous nous fondons sur les données du fichier BAACC, alimenté par les forces de l’ordre – gendarmerie, police et CRS. Je rappelle en effet qu’une prise de sang est systématiquement effectuée après tout accident corporel. Mais pour établir de manière certaine l’existence d’un lien direct, il faudrait davantage d’éléments.
En ce qui concerne le report modal, il est particulièrement important pour nous de disposer de données de trafic fiables. Auparavant, ces données – concernant notamment les vitesses moyennes et les flux – nous étaient fournies par les DDE. C’est en combinant les informations sur le nombre des accidents et sur ces données de trafic que nous pourrons éventuellement déterminer si des reports modaux peuvent avoir une influence sur le nombre d’accidents.
M. Jean-Yves Le Coz. Je m’abstiendrai de vous répondre sur l’inattention, la distraction ou l’hypovigilance, puisqu’une autre table ronde sera consacrée à ce sujet.
Soyons clairs, les véhicules électriques seront au même niveau de sécurité routière que les véhicules thermiques. L’électrification ne se fera donc pas au détriment de la sécurité. Je précise d’ailleurs, à l’intention de M. Myard, que nous avons travaillé avec les forces de secours dès le début de la conception de ces véhicules. Lorsqu’on sait que la tension est de 400 volts en courant continu, on comprend que les pompiers redoutent de mettre les mains dans la prise ! Il fallait donc établir des procédures d’intervention spécifiques, et nous les avons mises au point avec eux. Nous avons également mis des véhicules électriques à leur disposition pour qu’ils puissent s’entraîner.
Pour moi, monsieur Tardy, le régulateur de vitesse est un dispositif de confort qui a peu d’effet sur la sécurité routière, alors que le limiteur volontaire est, lui, un dispositif de sécurité routière.
Les achats qui ont été faits grâce à la prime à la casse se sont orientés, non vers les voitures bas de gamme, mais vers les petites voitures, qui peuvent être de très haut de gamme.
Lorsque nous avons évoqué la sécurité passive, nous avons omis un point important : la compatibilité. Il existe en effet, dans les structures mêmes des voitures, des sources d’incompatibilité, qu’il s’agisse d’incompatibilités de masse, comme entre les petits et les gros véhicules, d’incompatibilités de géométrie – véhicules plus ou moins bas ou hauts – ou encore d’incompatibilités de raideur de structure – une petite voiture de structure molle résistera fort mal au choc avec une grosse voiture de structure très rigide… Introduire la compatibilité entre les véhicules dans la réglementation me semble donc s’imposer. Nos véhicules sont d’ailleurs compatibles entre eux – nous les testons les uns contre les autres dans nos laboratoires d’essais.
Si l’arrivée sur le marché de véhicules low cost répond à une attente, elle ne se fait pas au détriment de la sécurité routière. Ils intègrent en effet dans leur conception un niveau de sécurité bien supérieur à celui des véhicules d’occasion sur lesquels leurs acquéreurs auraient porté leur choix s’ils n’avaient pu s’offrir une voiture neuve. On peut donc dire que ces véhicules concourent à la sécurité routière.
M. Jean-François Huère. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, madame Hostalier, la sécurité n’est pas un argument de vente – ce qui fait peser une vraie responsabilité sur les constructeurs. Faites le test autour de vous : vous verrez que les acheteurs sont avant tout sensibles au style ou à la couleur du véhicule. Pour eux, un constructeur sérieux offre par définition une voiture sûre.
Les taux de panne ont incontestablement baissé. Nous n’en sommes plus à la quatre-chevaux qui tombait régulièrement en panne sur la route des vacances : ne nous en plaignons pas !
Mme Françoise Hostalier. Certes, mais la quatre-chevaux, la deux-chevaux ou la 4L, on la réparait soi-même au bord de la route ! Ce n’est plus possible avec les véhicules sophistiqués d’aujourd’hui. Ancienne enseignante en lycée professionnel et technologique, je connais le profil des élèves qui choisissent la filière automobile. Je m’interroge donc sur l’adéquation entre leur niveau de formation et la nécessité pour les ateliers de réparation de disposer de personnel de plus en plus qualifié.
M. Jean-François Huère. Il est évident que le niveau de formation requis pour réparer une voiture est bien plus élevé qu’auparavant – c’est presque un phénomène de société et cela va dans le sens de l’histoire. Mais nous prenons en charge la formation de tout le réseau : à chaque fois que nous sortons une voiture, nous lui fournissons toute une gamme d’instrumentation, de documentation technique et de moyens de communication. Nous prenons également en charge la diffusion des équipements nécessaires à la maintenance des voitures.
M. Nicolas Bertholon. Vous avez parlé d’un LAVIA intelligent, monsieur Trassy-Paillogues, avec une signalétique interactive. Nous avons des projets de recherche en cours sur les communications de véhicule à véhicule ou entre véhicule et infrastructure et sur leurs apports éventuels à la sécurité. À terme, on pourrait associer ces dispositifs au LAVIA, en prenant en compte des limitations de vitesse qui ne seraient plus seulement réglementaires, mais aussi contextuelles – liées par exemple à la météorologie ou au trafic.
Pour ce qui est de l’alcool, je voudrais rappeler qu’un accident est le résultat de facteurs multiples. Lorsqu’on dit que l’alcool intervient dans 30 % des cas, cela signifie que dans 30 % des accidents, au moins un des conducteurs avait bu mais cela n’exclut nullement d’autres facteurs. Nous essayons de les identifier tous pour déterminer les meilleurs moyens de réduire les risques. Mais, corrélativement, la somme des taux d’efficacité des divers systèmes de sécurité active et passive dont nous parlons est largement supérieure à 100 % – car il y a plusieurs façons d’éviter un accident.
Je reviens pour finir sur les différences entre segments et entre générations de segments. Si je ne vous ai parlé que des différences entre générations de segments, c’est parce que ce sont les plus importantes : les améliorations constatées entre les décennies de conception permettent de gommer les différences entre segments. Celles-ci subsistent, mais elles sont beaucoup plus faibles que les différences entre générations. Autrement dit, une petite voiture d’aujourd’hui est bien plus sûre qu’une grosse voiture d’hier. Par ailleurs, les différences se sont réduites au fil du temps : on a commencé à homogénéiser le parc.
M. Christian Sibrik. Les véhicules sont en effet de plus en plus fiables, madame Hostalier. Cela tient en partie à la détection précoce des altérations, qui réduit la gravité des conséquences que celles-ci peuvent avoir sur l’ensemble du véhicule – car une rotule de train qui joue, par exemple, entraîne une usure irrégulière des pneus. Nous avons mené une étude sur la prospective du commerce jusqu’en 2020 qui montre clairement que les véhicules sont de plus en plus sûrs et réclament de moins en moins d’entretien. Perçu comme une taxe il y a encore dix ans, le contrôle technique fait aujourd’hui figure d’aide. J’ai ainsi contrôlé hier une voiture de sport dont les quatre pneus étaient quasiment usés jusqu’à la toile : le propriétaire ne s’en était pas aperçu ! C’est dire combien nous avons besoin de pédagogie. La fourniture de vidéos officielles par les pouvoirs publics nous aiderait à faire passer un certain nombre de messages.
Mme Pauline Johanet. Je ne puis que confirmer les propos de M. Kopaczewski sur l’impact de la prime à la casse. Les recycleurs d’automobiles, qui sont également représentés au CNPA, ont eu à démanteler de nombreux véhicules récents et encore en excellent état, ce qui leur a fait peine, mais l’objectif premier de la mesure était d’ordre économique – et je crois qu’il a été atteint.
Mme Hostalier a soulevé un point important. Les professionnels des réseaux de constructeurs sont régulièrement informés des évolutions techniques des véhicules et formés en conséquence, mais les mécaniciens et réparateurs indépendants, dits mécaniciens et réparateurs automobiles (MRA), présents dans toutes les campagnes françaises, peinent à recruter des jeunes suffisamment qualifiés. Il semble que les élèves qui s’orientent vers notre filière – qui a son propre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et ses propres CFA – ont tendance à arrêter leurs études un peu trop tôt pour acquérir toutes les compétences requises.
Afin de limiter la consommation d’alcool par les automobilistes, objectif auquel nous ne pouvons que souscrire, la loi « hôpital, patients, santé et territoires » encadre désormais strictement la possibilité pour les stations-service d’en vendre. Le CNPA observe néanmoins que cette mesure n’a pas modifié le poids de ce facteur dans l’accidentalité, et déplore que les grandes et moyennes surfaces proches des autoroutes et des routes ne soient pas elles aussi concernées.
M. le président Armand Jung. Je vous rappelle que cette mesure n’est applicable qu’à partir de 18 heures.
M. Geoffrey Michalak. Les véhicules qui ne se présentent pas au contrôle technique sont assez peu nombreux, monsieur Candelier : ils représentent moins de 5 % du parc. En effet, non seulement leurs propriétaires s’exposent à une contravention, mais ils sont régulièrement relancés – la plupart des réseaux de contrôle technique achètent des fichiers des véhicules immatriculés quatre ans auparavant. On peut en revanche nourrir certaines craintes à propos d’une catégorie de véhicules qui sera prochainement soumise au contrôle technique : les cyclomoteurs. D’une part, ils ne sont pas encore tous immatriculés et, d’autre part, on ignore la proportion des conducteurs qui soumettront effectivement leur véhicule au contrôle.
M. Alfred Trassy-Paillogues. Trois de mes questions sont restées sans réponse. Elles portaient respectivement sur la possibilité d’avoir une carte mémoire à vocation pédagogique permettant d’avoir une trace de la nature de la conduite, sur le prix de vente des équipements de sécurité et sur l’effort que pourraient consentir les constructeurs en la matière, et enfin sur la standardisation du mode de fonctionnement de ces dispositifs entre constructeurs.
M. Jean-Yves Le Coz. Les éléments de comportement sont déjà pris en compte, même si c’est insuffisamment du point de vue de la sécurité routière. Nous sommes capables de créer des bases de données individualisées sur les effets environnementaux des modes de conduite et nous travaillons aujourd’hui sur ces éléments, principalement avec des gestionnaires de flotte afin qu’ils puissent intervenir. Ce sont aussi des éléments qui tendent à prendre un poids accru dans la formation des conducteurs. Nous y œuvrons d’ailleurs avec les auto-écoles : une fédération du secteur développe un produit d’éducation à la formation en sécurité routière qui repose sur ce type de données. Il pourra ultérieurement être proposé aux particuliers.
M. Daniel Kopaczewski. En ce qui concerne la boîte noire, nous avons l’expérience de l’élaboration des cahiers des charges des deux éthylotests anti-démarrage – l’un destiné aux véhicules de transport en commun de personnes, l’autre aux véhicules des récidivistes de conduite en état d’alcoolémie. Nous avons eu de longs débats avec les ministères de l’intérieur et de la justice sur la nature des informations qui pouvaient être stockées dans ces dispositifs : si l’on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine, nous avons dû renoncer à y intégrer une bonne partie des éléments prévus, pour des raisons tenant à la protection des données personnelles.
J’en viens à la standardisation des équipements. Un constructeur que je ne nommerai pas – et qui n’est pas présent ici – vend un certain nombre d’équipements de sécurité dont nous avons parlé, en option, près de dix fois leur prix de revient. Le TPMS, instrument de mesure de pression des pneumatiques en passe de devenir obligatoire, élément de sécurité important qui permet également de réduire les consommations de carburant, coûte aujourd’hui 30 euros, ce qui n’est pas négligeable sur une petite voiture. On comprend qu’un certain nombre de grands constructeurs soient peu pressés de voir généraliser tous ces équipements, qu’ils vendent aujourd’hui très cher en option.
M. Jean-Yves Le Coz. Que peuvent faire les constructeurs automobiles pour aider à la diffusion de ces systèmes ? Prenons l’exemple du contrôle de trajectoire : convaincus de son efficacité et en mesure de le proposer sur la totalité des véhicules, nous avons volontairement décidé, lorsqu’il était en option, de le vendre au prix le plus bas.
M. Dominique Cesari. La standardisation entre équipements et constructeurs passe aussi par la réglementation : dès lors qu’un équipement devient obligatoire, il est nécessairement standardisé.
M. Daniel Kopaczewski. La réglementation est en effet tellement précise qu’on aboutit de fait à cette standardisation.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie pour ce débat passionnant.
*
* *
Table ronde sur les addictions et la conduite : Docteur Charles Mercier-Guyon, secrétaire de la commission médicale de la Prévention routière ; M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’IFSTTAR (Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; Mme Claudine Pérez-Diaz, chercheuse au CNRS ; Mme Hélène Martineau, directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies ; M. Félix Comeau, président-directeur général et M. Stéphane Vialettes, directeur général de la Société Alcolock (fabricant d’éthylotests anti-démarrage) ; M. Daniel Orgeval, président de l’association I-Tests ; M. Bertrand Jermann, président de la société Ethylo (fabricant d’éthylotests) ; M. Patrick Maroteaux, membre du bureau de l’association « Vin et société » (acteur de la filière viti-vinicole) et Mme Delphine Blanc, directrice des relations institutionnelles ; M. Alexis Capitant, directeur général et M. Jean-Yves Moreau, chargé des actions prévention et des relations avec les partenaires, de l’association « Entreprise et prévention » (association des producteurs de boissons alcoolisées pour la prévention du risque alcool) ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle (DSCR) et M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national de la sécurité routière ; M. Hubert Berry, responsable du département Éthylométrie et addictions au laboratoire national de métrologie et d’essais
Jeudi 1er septembre 2011
M. le président Armand Jung. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre participation aux travaux de notre mission d’information, dont les conclusions seront remises au ministre de l’intérieur au plus tard à la mi-octobre.
Je remarque que le thème des addictions, sujet de cette table ronde, a été présent tout au long de nos travaux.
Je vous propose tout d’abord de vous présenter brièvement.
M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux à l’ IFSTTAR, (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche). J’ai eu la chance de coordonner une des plus belles études jamais réalisées sur les stupéfiants et l’alcool en matière de sécurité routière. Ce travail a été rendu possible par le Parlement, auquel j’adresse mes remerciements.
M. Charles Mercier-Guyon, secrétaire de la commission médicale de la Prévention routière. Je suis médecin, secrétaire de la commission médicale de la Prévention routière, membre du groupe d’experts Alcool-drogues-médicaments à la Commission européenne et représentant français au CENELEC – Comité européen de normalisation électronique –, en particulier pour la question des éthylotests antidémarrage.
Je travaille sur ces dossiers depuis une trentaine d’années. Nous avons mis en place, par exemple, les procédures de dépistage utilisées par les forces de l’ordre en matière de drogues, les pictogrammes apposés sur les boîtes de médicaments – dont l’initiative revient à la Prévention routière –, ou encore les programmes d’éthylotests antidémarrage, introduits en France depuis 6 ans.
Mme Claudine Pérez-Diaz, chercheuse au CNRS. Je travaille au sein de l’équipe CERMES3 (Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société) du CNRS. Ma contribution concernera les interventions des institutions en matière d’alcool au volant.
Mme Hélène Martineau, directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies. Je représente l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, organisme public qui a participé à l’enquête SAM – Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière – évoquée par M. Laumon. Je pourrai fournir à votre mission des données concernant la consommation d’alcool et de drogues en France.
M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle (DSCR). Je représente la Délégation à la sécurité et à la circulation routières – DSCR – du ministère de l’intérieur. Cette structure est chargée de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de lutte contre l’alcool et les drogues au volant. Je vous présenterai nos réalisations les plus récentes et nos pistes de travail.
M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Après avoir participé à une audition de votre mission consacrée à l’accidentalité en général, je reviendrai aujourd’hui sur les traces ou les preuves d’addiction en matière d’accidents, et sur ce qu’il est possible – ou impossible – d’en déduire quant à leur prévalence dans la circulation routière en général. S’agissant des stupéfiants, notamment, les résultats sont décevants car les données de l’accidentalité sont peu significatives.
M. Daniel Orgeval, président de l’association I-Tests. La jeune association I-Tests que je préside regroupe les industriels et les spécialistes de la production des appareils de mesurage et de dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants. Elle a pour vocation de consigner les questions qui nous reviennent de façon récurrente et de faire des propositions. Ainsi, nous réclamons l’application, par un décret en Conseil d’État, de la disposition de l’article L. 234-14 du code de la route prévoyant que tout automobiliste justifie de la possession d’un éthylotest. Dans une enquête menée par RTL, 70 % des votants se sont prononcés pour cette mesure.
En matière de prévention du risque alcool, notre principe est que, si l’on trouve de l’alcool à toute heure et en tout lieu, on doit trouver des éthylotests à toute heure et en tout lieu. Les industriels ont déjà conçu des bornes qui feront l’objet d’une réglementation dans le cadre de la LOPPSI. La plupart de nos autres propositions ne coûteront rien à l’État, sont de mise en œuvre rapide et peuvent avoir un effet non négligeable sur les comportements.
M. Hubert Berry, responsable du département Éthylométrie et addictions au laboratoire national de métrologie et d’essais. Responsable du département Éthylométrie et addictions au laboratoire national de métrologie et d’essais, je suis membre des comités européens et AFNOR pour la révision des normes européennes en matière d’éthylotests, ainsi que de la commission internationale de métrologie légale pour la révision de la recommandation internationale sur les éthylomètres.
Mon laboratoire travaille, entre autres, pour le ministère de l’industrie. Il s’occupe principalement de l’étalonnage de tous les éthylomètres des forces de l’ordre en France ainsi que des cinémomètres laser pour les forces de l’ordre. Pour l’AFNOR, il gère la marque NF 227, qui regroupe tous les éthylotests : classe 1 pour les forces de l’ordre, classe 2 pour le grand public, ainsi que les éthylotests chimiques.
M. Stéphane Vialettes, directeur général de la société Alcolock (fabricant d’éthylotests antidémarrage). La société Alcolock France est une filiale du groupe canadien ACS – Alcohol Countermeasure Systems Corp –, leader mondial de la gestion des programmes judiciaires d’éthylotests antidémarrage avec près de 50 000 personnes contrôlées chaque jour. Nous sommes heureux de participer à votre réflexion pour réduire l’accidentalité due à l’alcool
M. Félix Comeau, président-directeur général d’ACS et président d’Alcolock. Je suis président d’Alcolock France et président-directeur général du groupe ACS, fabriquant d’éthylotests antidémarrage.
M. Bertrand Jermann, président de la société Ethylo (fabricant d’éthylotests). La société que je préside est une PME française qui fabrique des dispositifs d’éthylotests électroniques, parmi lesquels une borne éthylotest destinée à être installée dans tous les lieux publics où il pourrait s’avérer nécessaire de déterminer son degré d’imprégnation alcoolique.
Je suis également vice-président de l’association I-Tests.
M. Jean-Yves Moreau, chargé des actions de prévention et des relations avec les partenaires, de l’association « Entreprise et prévention » (association des producteurs de boissons alcoolisées pour la prévention du risque alcool). Je suis responsable des actions de prévention de terrain de l’association « Entreprise et prévention ».
M. Alexis Capitant, directeur général de l’association « Entreprise et prévention ». Notre association loi de 1901, créée il y a une vingtaine d’années, réunit 19 des principales entreprises du secteur des boissons alcoolisées en France – spiritueux, bières, champagnes, vins. Elle s’investit dans toutes les opérations de lutte contre la consommation excessive ou inappropriée d’alcool, en s’appuyant sur deux principes : travailler en partenariat avec les acteurs nationaux ou locaux de la prévention et privilégier l’évaluation, qui est souvent le parent pauvre des politiques de prévention en France.
Nous sommes présents sur tous les champs du risque alcool. Nous menons des actions sur les thèmes alcool et grossesse, alcool et travail, alcool et jeunes, en partenariat notamment avec des syndicats étudiants et le ministère de l’éducation nationale.
En ce qui concerne la thématique alcool et route, nous sommes partenaires de la Prévention routière depuis 1999. Nous sommes très impliqués dans la promotion de la pratique du conducteur désigné. Nous sommes également à l’origine de la création de la première borne éthylotest électronique, certifiée il y a quelques années et qui utilise la même technologie que celle des forces de l’ordre. Nous insistons particulièrement sur la sensibilisation des patrons de discothèques à la nécessité de contrôler l’alcoolémie de leur clientèle.
M. Patrick Maroteaux, membre du bureau de l’association « Vin et société » (acteur de la filière vitivinicole). Mme Marie-Christine Tarby, présidente de l’association « Vin et société », n’a pu se joindre à nous et vous prie de bien vouloir l’excuser. Je suis pour ma part membre du bureau de cette association et membre du Conseil de modération et de prévention. Nous remercions la mission de nous donner l’occasion d’exprimer notre point de vue.
Mme Delphine Blanc, directrice des relations institutionnelles de l’association « Vin et société ». Notre association réunit l’ensemble des syndicats et des interprofessions de la filière vitivinicole en France. Elle s’intéresse à toutes les questions qui concernent la place du vin dans la société. À ce titre, elle mène des actions de prévention des risques liés à une consommation excessive d’alcool, notamment en matière de sécurité routière et en direction des jeunes. Elle conduit également une campagne pour promouvoir une consommation responsable de vin.
M. le président Armand Jung. Je vous invite maintenant à aborder le fond du sujet qui nous réunit.
M. Charles Mercier-Guyon. Tout le monde a un avis sur la sécurité routière parce que c’est un sujet de la vie de tous les jours. Une des difficultés est que l’on confond souvent le travail des spécialistes – et les propositions construites qui en résultent – avec des questions qui relèvent plus de la communication ou du vécu de chacun.
Il convient donc de clarifier les définitions. Les politiques menées confondent fréquemment alcoolisation et alcoolisme. Ainsi, la notion de « conduite en état alcoolique » employée par les forces de l’ordre et par la justice est un non-sens. Alors que l’alcoolisation renvoie à un problème de comportement et de respect des règles, l’alcoolisme renvoie à un problème de dépendance. Sur le plan administratif, cela se traduit par la distinction entre capacité à conduire et aptitude générale à la conduite. Les réformes apportées à la réglementation relative à l’aptitude à la conduite ont intégré ces définitions, mais la question reste malheureusement source de grande confusion dans les débats : on le voit avec les dispositions destinées à être incluse dans la LOPPSI, qui confondent le système de sanction et les systèmes d’accompagnement, de probation et de contrôle. La sanction des conducteurs est encore fondée sur le modèle des excès de vitesse, dans lequel la sanction pondérée de l’effet éducatif du permis à points est supposée modifier le comportement des conducteurs. Or les problèmes d’alcool et de drogues ne répondent pas au même schéma. La raison en est si simple qu’on ne la rappelle jamais : une personne dépendante à l’alcool a du mal à contrôler son comportement, alors que l’on est rarement dépendant à la vitesse ou au téléphone mobile. Dans le deuxième cas, quelques points perdus et un coup de semonce feront changer de comportement ; dans le premier, la dépendance rend le système de sanctions inopérant pour un gros noyau dur de personnes.
De plus, une personne qui a bu perd en partie le contrôle de ce qu’elle fait. Dans 90 % des cas, les personnes n’avaient pas prévu de conduire dans un état alcoolisé : elles partaient pour s’amuser, ont bu de l’alcool, mais ensuite il fallait ramener la voiture...
Le débat fondamental et préalable oppose donc sanction d’une part, probation, éducation et accompagnement d’autre part. L’addiction ne se traite pas par la sanction. Des dispositifs de contrôle et d’accompagnement sont nécessaires. Les programmes d’éthylotests antidémarrage fournissent le meilleur exemple : la plupart des pays qui ont procédé à des installations « sèches » de ces équipements ont rapidement abandonné cette voie au profit de systèmes de contrôle, d’accompagnement et d’éducation des conducteurs. En France, la mise en place d’éthylotests antidémarrage dans les cars scolaires relève de l’effet de communication.
Mme Claudine Pérez-Diaz. Quel est l’effet des lois sur les comportements ? Les évaluations, constamment vérifiées depuis plus de 40 ans, montrent que la sévérité des peines est peu efficace. En revanche, des peines légères, fréquentes et certaines sont efficaces pour peu que la politique soit maintenue dans le temps – sinon, les vieilles habitudes reprennent le dessus. Il s’agit de modifier les mœurs, donc de mener une action de long terme.
Par ailleurs, si les lois peuvent amener les personnes à dissocier le fait de boire et celui de conduire, elles n’ont pas d’effet sur leur comportement vis-à-vis de l’alcool. C’est au niveau de ce comportement qu’il faudrait intervenir – comme c’était l’ambition du code de la route de 1958 – et repérer des individus afin de les soigner. L’analyse des données des années 2006 et 2007 fait apparaître que moins d’un quart des conducteurs ayant commis un délit font l’objet d’une procédure les sensibilisant au problème de l’alcool et susceptible de les mettre en contact avec un centre de soins. Seule une petite partie de cette population sera véritablement prise en charge. Sachant que les problèmes d’alcool se cumulent avec des problèmes de santé et des problèmes socio-économiques, une telle prise en charge est très lourde et coûteuse.
Une piste d’amélioration serait d’intervenir sur des buveurs d’habitude encore débutants. En effet, pour la plupart des conducteurs ayant une alcoolémie délictuelle, l’alcoolémie mesurée dépasse largement le seuil légal et exprime une relation problématique à l’alcool. Pour prévenir le risque de récidive, il conviendrait de repérer la nature de la relation du conducteur avec l’alcool dès la réalisation de l’infraction. Les gros buveurs débutants pourraient bénéficier d’un mode de soin léger qui les empêcherait de s’engager dans l’usage habituel et dans la maladie. Les interventions brèves, par exemple, ont déjà été évaluées dans plusieurs pays dont la France : elles donnent de bons résultats, notamment en séance de groupe, pour un coût peu élevé.
Mais les obligations de soins prévues actuellement demeurent indispensables pour les individus très engagés dans l’alcool. Les services pénitentiaires d’insertion et de probation prennent en charge l’intégralité des problèmes de ces personnes et obtiennent des améliorations notables.
Le contrôle routier pourrait être utilisé pour inciter des buveurs habituels débutants à modifier leur comportement. C’était, j’y insiste, l’ambition du code de la route en 1958.
Mme Hélène Martineau. D’après les données de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, l’alcool – 5 millions de consommateurs quotidiens – est de loin le produit le plus consommé en France. La première drogue illicite est le cannabis, avec 550 000 consommateurs quotidiens. La problématique de santé publique n’est donc pas la même. Néanmoins, les proportions sont différentes pour les populations jeunes : l’alcool est toujours présent, mais le cannabis constitue un problème plus important, de même que des produits tels que la cocaïne, qui apparaît de plus en plus régulièrement.
M. Michel Vilbois. Nous n’opposons pas les politiques de prévention, de contrôle et de sanction, qui sont les maillons d’une même chaîne. Nous insistons, bien entendu, sur la prévention et l’éducation au risque alcool, et ce dès le plus jeune âge. Le risque spécifique que constitue l’alcool au volant est présent dans notre communication à l’école primaire, au collège et au lycée où, depuis la dernière rentrée, le Gouvernement a mis en place un module de sensibilisation à la sécurité routière intégrant cette thématique pour un public très exposé.
Notre politique vise également à permettre aux conducteurs de se tester chaque fois que cela est nécessaire. C’est le sens de la mesure que les parlementaires ont voulu intégrer dans la LOPPSI et qui vise à rendre obligatoire la mise à disposition d’un mode de dépistage dans les établissements ouverts la nuit. C’est également le sens d’une charte que nous avons signée avec six syndicats professionnels de cafetiers, restaurateurs et hôteliers pour la mise à disposition gratuite d’éthylotests dans les établissements ouverts le jour.
Pour la réduction du risque in situ, qui passe par exemple par nos campagnes en faveur du conducteur désigné, nous sommes partenaires de différentes associations et mutuelles qui vont au contact des publics dans les soirées étudiantes, festives, sportives, etc., avant la prise d’alcool pour en expliquer les risques, et après, en indiquant les solutions que l’organisateur a mises en place pour éviter que la personne alcoolisée ne reprenne le volant.
Viennent ensuite les éthylotests antidémarrage, dont l’usage commence en France. Il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que la pose de ce dispositif dans les transports collectifs d’enfants n’est pas assortie d’un suivi : l’employeur a bien évidemment le devoir de vérifier que son salarié est en situation de conduire, et donc de traiter la question de l’addiction à l’alcool à travers les dispositifs connus de médecine de prévention et de médecine du travail.
En ce qui concerne le contrôle de l’alcoolémie sur les routes, les chiffres sont stables depuis une demi-douzaine d’années : 11,5 millions de contrôles, en ciblant les lieux et les moments où la consommation d’alcool est la plus forte. À la sortie d’une foire aux vins ou d’une discothèque, la probabilité d’être contrôlé est plus forte que pour tout un chacun sur son trajet domicile-travail.
Un dernier élément de cette politique est la réduction de l’accès à l’offre d’alcool dans les lieux où cela peut poser un problème. Le Parlement a ainsi décidé, dans la loi HPST, d’interdire la vente d’alcool dans les stations-services de 18 heures à 8 heures – ce qui constitue une extension de la période d’interdiction – et d’y interdire également la vente de boissons alcoolisées réfrigérées.
M. Daniel Orgeval. Comme je l’ai dit, on trouve de l’alcool à toute heure et en tout lieu. Or, même lorsque l’on sort d’un repas de famille arrosé – et sans qu’il y ait forcément abus –, on n’a pas la possibilité de connaître son taux d’alcoolémie et son aptitude à la conduite. La probabilité d’être contrôlé est très faible : on le sait, le nombre des dépistages réalisés par les forces de l’ordre plafonne, et ce sont des opérations ciblées. Pour autant, on se tue à toute heure du jour et de la nuit à cause de l’alcool. À titre d’exemple, 48 % des accidents mortels du travail sont des accidents de la route et, dans 20 % de ces cas, l’alcool est en cause.
On doit pouvoir se procurer des éthylotests non seulement sur les lieux de consommation mais aussi dans les lieux de vente, sur les rayons mêmes où l’on trouve de l’alcool. Aujourd’hui, les éthylotests électroniques normés sont commercialisés à partir de 50 euros. L’aspect normatif est essentiel puisque la fiabilité de la mesure en dépend. Or on trouve sur l’Internet des appareils ne répondant à aucun label métrologique. La DGCCRF a mené des campagnes qui restent insuffisantes. Il faut les développer si l’on veut encourager le dépistage au moyen d’appareils disponibles dans le commerce.
L’éducation des jeunes doit également être privilégiée. On trouve aujourd’hui des jeunes qui boivent à la sortie des collèges. Le milieu parental ou amical peut être un facteur, mais on peut se demander si, au sujet de l’alcool, l’éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge est suffisante. Les enfants d’âge scolaire doivent pouvoir comprendre, cependant, l’intérêt, pour les personnes en âge de consommer, de le faire de façon raisonnable et raisonnée.
La communication peut créer de la confusion. Ainsi, on ne cesse de parler de la limite de 0,5 gramme alors que la quasi-totalité des mesures d’alcoolémie se font dans l’air alvéolaire expiré et que le seuil légal est de 0,25 milligramme par litre d’air. Les gens ne comprennent pas que, lorsqu’on les mesure à 0,48 milligramme, ils sont non seulement dans l’infraction, mais dans le délit. Il faut donc parvenir à lisser la communication et à utiliser comme seule unité de mesure le milligramme par litre d’air, car c’est ce qui correspond à 95 % des cas.
Par ailleurs, nous avons des remontées des forces de l’ordre, dont nous sommes les formateurs et les fournisseurs. Il apparaît que les procédures françaises de contrôle d’alcoolémie sont parmi les plus lourdes au monde. Une procédure délictuelle peut exiger 3 heures de présence des forces de l’ordre. Une simplification est nécessaire pour améliorer l’efficacité des contrôles.
Pour ce qui est de l’application de l’article L. 234-14 du code de la route, nous avons saisi M. Guéant en lui adressant un dossier complet. Il nous paraît en effet élémentaire de disposer d’un éthylotest à bord de son véhicule. La probabilité d’avoir à s’en servir est 100 fois plus grande que celle d’avoir à utiliser le gilet jaune ! En outre, l’offre est très étendue – elle va du prix d’un café à un montant de près de 300 euros pour les appareils les plus sophistiqués. Si la réglementation établit l’obligation en question, les éthylotests électroniques trouveront leur place dans les grands magasins au milieu des GPS et des avertisseurs communautaires de radars. Dès lors que l’on aura cet équipement à disposition, il deviendra aussi naturel et banal de s’en servir que de boucler sa ceinture de sécurité. Non seulement la mesure ne coûtera rien à l’État, mais elle permettra de réduire la charge que représentent les accidents.
M. Hubert Berry. S’agissant des éthylotests, l’AFNOR a établi des normes françaises. Bientôt, des normes européennes seront applicables pour les produits offerts au grand public. La marque NF permet de sécuriser les dispositifs chimiques ou électroniques, tant pour les produits utilisés par les forces de l’ordre que pour les produits grand public.
L’attribution se fait en trois étapes : d’abord, nous réalisons une étude de prototype suivant un cahier des charges, où nous testons la réponse de l’instrument en matière d’alcool, ainsi que son fonctionnement dans différentes conditions climatiques ; ensuite, nous procédons à des audits dans les usines ; enfin, nous opérons des prélèvements pour vérifier la qualité de la fabrication dans le temps.
Cinq sociétés sont admises à la marque NF en France, qui concerne quatre éthylotests grand public, deux bornes éthylotest et deux éthylotests chimiques. Sur l’Internet, pourtant, une trentaine de marques sont disponibles. La différence s’explique par la difficulté de maîtriser cette technologie. La mesure, qui s’effectue en 5 secondes, doit être fiable. Dès lors que l’on souhaite mettre en œuvre une politique de large diffusion, la procédure de vérification devient primordiale et il faut réglementer en s’appuyant sur la marque NF et sur les contrôles au niveau des entreprises. Le nombre de produits mis sur le marché pourrait se trouver multiplié par 20 ou 50, et de mauvais instruments pourraient mettre en danger des automobilistes qui, en toute bonne foi, se seraient dépistés au préalable.
M. Stéphane Vialettes. Je souscris aux propos de M. Orgeval et de M. Berry sur l’importance de la fiabilité des mesures.
Pour en revenir aux éthylotests antidémarrage, il faut bien distinguer les deux applications de cette technique.
D’une part, la prévention. De nombreuses sociétés souhaitent utiliser des éthylotests antidémarrage dans le but de réduire le nombre d’accidents du travail. Nous préconisons en outre d’étendre l’obligation en vigueur pour les cars scolaires aux transports de matières dangereuses ou aux convois exceptionnels. Il y a à peine un mois, à cause d’un conducteur de poids lourd alcoolisé, un convoi d’acide s’est renversé sur le ring de Bruxelles, bloquant la circulation pendant près de 4 heures et provoquant l’évacuation de 25 000 personnes. Par rapport au reste de l’Europe, la politique française est en pointe. La mesure concernant les bus scolaires est peu à peu reprise par les autres pays. Les pays nordiques, quant à eux, sont en avance pour ce qui concerne notamment les taxis.
D’autre part, les programmes judiciaires. Outre les dispositions prévues à l’article 27 de la LOPPSI et les questions de normes – les dispositifs de prévention et ceux utilisés dans les programmes judiciaires répondent à deux normes CENELEC –, les autorités doivent prendre conscience de l’enjeu européen. Il s’agit d’un outil important de lutte contre la récidive : pour les personnes ayant bénéficié de ces programmes, la chute du taux de récidive se situe entre 50 et 60 %. L’objectif gouvernemental est de descendre au-dessous des 3 000 tués en 2012. Or il faut savoir que le nombre de morts sur les routes imputables à l’alcool est de 1 200 ou de 1 300, et que ces accidents impliquent beaucoup de conducteurs déjà condamnés pour des délits d’alcoolémie.
Je souscris également aux propos de Mme Pérez-Diaz au sujet des mesures légères. L’éthylotest antidémarrage, peu onéreux, en fait partie. Les constructeurs automobiles objectent qu’il n’est pas fiable et qu’il n’est pas prêt pour être intégré aux véhicules. Pourtant, le groupe de travail sur les transports de la Commission européenne a préconisé l’intégration d’éthylotests antidémarrage en première monte dès 2020, suivant en cela une demande de la France et de l’Allemagne. Nous installons depuis 2008 des éthylotests antidémarrage pour la marque Volvo, connue pour être toujours très en avance en matière de sécurité routière. Si le dispositif n’était pas fiable, notre client nous l’aurait dit depuis longtemps !
M. Bertrand Jermann. L’axe de la prévention et l’axe de la répression doivent être clairement associés, ne serait-ce qu’en raison des limites quantitatives de l’axe répressif : il y a entre 35 et 40 millions de détenteurs du permis de conduire en France, pour 11,5 millions de contrôles d’alcoolémie par an. La probabilité de souffler dans un éthylotest dans le cadre d’un contrôle est donc très faible. De plus, nous n’avons pas encore, dans notre rapport à la consommation d’alcool, le réflexe de nous tester nous-mêmes. C’est pourquoi il faut promouvoir l’idée d’autotest, que ce soit dans les véhicules ou dans les lieux de consommation d’alcool – débits de boisson mais aussi espaces pouvant être loués, comme les salles communales ou les salles polyvalentes.
M. Alexis Capitant. Il faut en effet trouver le bon équilibre entre la prévention et la sanction. La sanction sera d’autant plus légitime que chacun aura pu trouver le moyen de se tester dans les lieux de consommation ou chez soi. Il est important de développer le réflexe éthylotest. Nous devrons vérifier la bonne application de la mesure obligeant les exploitants d’établissements de nuit à proposer un moyen de dépistage à leur client, et mesurer avec attention ses résultats.
Je me méfie des chartes d’autodiscipline, comme celle passée avec les cafetiers. Je doute que cela puisse être suivi d’effet. Il ne faut pas hésiter à enfoncer le clou et à faire de la pédagogie.
En matière de risque alcool et de sécurité routière, beaucoup reste à faire pour améliorer l’information et les connaissances des jeunes. Par exemple, l’équivalence entre les différentes boissons alcoolisées, qui est une notion de base, est peu connue, et les enquêtes montrent même une régression. Les générations de jeunes arrivant à l’âge de conduire se succèdent et nous ne devons pas relâcher l’effort.
Nous disposons d’un arsenal de règles important. Il faut s’attacher désormais à les faire appliquer avant de penser à en édicter de nouvelles.
M. Patrick Maroteaux. L’association « Vin et société », créée en 2004, s’est étoffée ces dernières années car le monde viticole est de plus en plus convaincu qu’il se doit d’être un partenaire loyal et responsable défendant des positions sérieuses face à ces problèmes. Notre action contre l’insécurité routière porte essentiellement sur les surconsommations. Nous diffusons ainsi des outils pédagogiques qui sont en phase avec les recommandations de modération de l’Organisation mondiale de la santé. Depuis 2007, nous menons un partenariat avec la sécurité routière et nous mettons en avant le slogan : « Soufflez, vous saurez » pour promouvoir l’usage des éthylotests. Il s’agit d’une action régulière mais nous l’intensifions pendant les périodes de fêtes et de vacances. Nous travaillons également en partenariat avec les autorités préfectorales pour toutes les manifestations à caractère plus spécifiquement viticole ou agricole : « Vin et société » a déjà distribué 300 000 éthylotests dans ce cadre.
Par ailleurs, les travaux de l’Observatoire interministériel de la sécurité routière font apparaître que 91 % des conducteurs impliqués dans des accidents mortels avec implication de l’alcool présentent des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,80 gramme. Le taux moyen constaté est d’environ 1,80 gramme par litre. Selon certaines études, le respect du taux de 0,50 permettrait de diminuer d’un quart le nombre des accidents de la route. « Vin et société » soutiendra sans ambiguïté toutes les initiatives qui permettront d’empêcher de prendre le volant avec un taux supérieur à 0,50, qu’il s’agisse de prévention ou de répression.
Pour ce qui est des populations dites « critiques », le travail est complexe. Au-delà de la prévention, il faut réfléchir à des opérations ciblées qui supposent des stages de formation spécifiques.
Bref, notre association, qui est membre du Conseil de modération et de prévention, favorise un comportement globalement responsable dans la consommation du vin et utilise pour cela différents vecteurs, comme par exemple la promotion de la vente du vin au verre ou l’incitation à rapporter chez soi les bouteilles entamées au restaurant au lieu de les boire en entier. Notre « guide de la consommation responsable » est largement diffusé, ainsi que différentes plaquettes précisant les niveaux de risque en fonction de la consommation et du poids de la personne. Ce n’est sans doute pas suffisant mais, je le répète, nous souhaitons être des partenaires responsables.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Alors que 30 % des accidents mortels sont dus, semble-t-il, à une absorption excessive d’alcool, pensez-vous qu’il faille aller, comme certains le préconisent, jusqu’à la tolérance zéro ? Si oui, à quelle échéance ? Faut-il que tous les conducteurs soient concernés ? Ou doit-on au contraire s’en tenir à une consommation raisonnable, c’est-à-dire au taux actuel, à condition de justifier que cela ne présente pas de risque ? À cet égard, les spécialistes sont-ils en mesure de déterminer à quel moment la consommation est suivie de conséquences évidentes ?
Nos interlocuteurs de la précédente table ronde ont affirmé que la fiabilité des éthylotests faisait débat et qu’il existait par ailleurs des moyens de contournement des dispositifs antidémarrage. Qu’en est-il ?
Enfin, comment expliquer que, malgré les campagnes de communication anciennes et réitérées sur les dangers de l’alcoolisation au volant, on n’arrive pas à réduire de manière substantielle le phénomène ?
M. Bernard Laumon. Expérimentalement, on note une dégradation des performances dès que le conducteur est alcoolisé, quelle que soit la dose absorbée. En revanche, aucun accident ne serait imputable à des alcoolémies inférieures à 0,5 gramme par litre de sang – un projet européen, Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine (DRUID), est en train d’analyser les études publiées sur le sujet.
Ce paradoxe s’expliquerait par le fait qu’un conducteur alcoolisé à faible dose aurait conscience d’une dégradation de ses capacités et qu’il la compenserait par une plus grande prudence au volant, suivant un mécanisme similaire à celui observé chez les personnes âgées ; au-delà d’un certain seuil, en revanche, le conducteur n’a plus conscience des effets de l’alcool sur sa conduite, ce qui lui fait courir un risque d’autant plus grand que la probabilité de provoquer un accident augmente très rapidement avec la dose absorbée : au-delà de 2 grammes par litre de sang, le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 40 ou 80, selon les études. L’effet-dose est une des caractéristiques de l’alcool.
Néanmoins, peut-être serait-il pertinent d’abaisser le taux d’alcoolémie autorisé à un niveau inférieur à 0,5 gramme, dans la mesure où cela permettrait de tirer toutes les alcoolémies vers le bas et de réduire les taux supérieurs à 0,8 gramme, qui sont aujourd’hui responsables du plus grand nombre de morts sur la route.
Notons toutefois qu’il est absurde, sur le plan scientifique, de parler d’alcoolémie zéro, puisque l’organisme est susceptible de fabriquer de l’alcool à très faible dose : on peut avoir une alcoolémie positive, tout en n’ayant jamais consommé d’alcool de sa vie.
J’ai conscience que ma réponse est quelque peu ambiguë, mais c’est tout ce que l’on peut dire du point de vue scientifique et accidentologique !
M. Charles Mercier-Guyon. La Prévention routière s’est prononcée récemment sur un éventuel abaissement du taux d’alcoolémie légal chez les jeunes conducteurs ; nous avons répondu par la négative, et ce pour trois raisons.
Premièrement, comme vient de le souligner Bernard Laumon, on ne peut fonder une politique pénale sur une absence de risque épidémiologique.
Deuxièmement, si les études expérimentales démontrent effectivement qu’avec 0,5 gramme d’alcool dans le sang, le risque théorique d’accident est multiplié par deux ou trois, cela équivaut aux effets d’un traitement tranquillisant à petites doses, d’un état grippal ou d’une nuit blanche, en particulier chez les travailleurs aux trois-huit.
Cela fait quatorze ans que je travaille sur le dossier des médicaments ; nous avons proposé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) un système de pictogrammes avec trois couleurs, en fonction du risque, le premier niveau – jaune – correspondant à un risque potentiel réel, mais non significatif en termes épidémiologiques. Un conducteur avec une alcoolémie légèrement inférieure à 0,5 gramme sera soumis à un « surrisque » théorique s’il est fatigué ou distrait, mais il pourra le compenser à l’aide de conseils ou de pauses. Dans les restaurants d’autoroute, on se plaint que les gens ne boivent plus du tout de vin sur les longs trajets ; mais, en ce qui me concerne, quand je fais un trajet de 500 kilomètres, je m’abstiens de boire de l’alcool, car je cherche à compenser la fatigue accumulée !
M. le rapporteur. D’autant plus qu’on ne peut pas savoir avec précision quand on a dépassé la dose limite.
M. Charles Mercier-Guyon. De nombreux pays ont mis en place des législations « zéro alcool » pour les jeunes conducteurs : l’objectif est, non de réduire le risque lié à ces niveaux d’alcoolémie, mais de modifier le comportement des jeunes qui partent en soirée. On a prétendu, lors du débat sur l’interdiction de la vente d’alcool dans les stations services, qu’ils pourraient acheter de l’alcool ailleurs ou avant. C’est faux ! Les jeunes commencent d’abord par boire un verre, puis ils décident d’en prendre d’autres. La tolérance zéro permettrait d’éviter une telle décompensation du comportement.
J’en viens à la troisième raison. Il existe une fâcheuse tendance en France au durcissement progressif des systèmes de sanction. On avait initialement prévu une suspension de trois points pour l’alcoolémie contraventionnelle, et de six pour l’alcoolémie délictuelle. À la suite d’un accident grave, les parlementaires ont décidé de marquer le coup, d’enlever la progressivité et de faire passer à six points la sanction pour alcoolémie contraventionnelle ; et dans les dernières mesures, on a fixé à 0,8 gramme le seuil des alcoolémies délictuelles.
Or, un abaissement du seuil légal d’alcoolémie au-dessous de 0,5 gramme par litre de sang pour les jeunes conducteurs ne peut se concevoir sans un dispositif d’accompagnement et une campagne d’explication précise. Par ailleurs, d’autres catégories pourraient être concernées par un abaissement relatif, comme les conducteurs de transports en commun, pour lesquels le seuil légal pourrait être fixé à 0,2, et les conducteurs soumis à un programme judiciaire d’installation d’un éthylotest anti-démarrage – ces appareils étant en général réglés au-dessous du taux légal.
M. le président Armand Jung. Les éthylotests anti-démarrage sont-ils réellement efficaces ?
M. Hubert Berry. Il existe différents modèles d’éthylotests ; certains sont chimiques, d’autres électroniques – les éthylotests anti-démarrage (EAD) faisant partie de cette dernière catégorie. Les instruments dédiés aux forces de l’ordre et aux milieux professionnels répondent à des exigences beaucoup plus élevées que ceux destinés au grand public. Il reste que le dossier technique exigé pour la certification « NF » est le plus exigeant au monde. On teste la capacité de l’appareil à discriminer des alcoolémies avoisinant 0,5 gramme par litre de sang, c’est-à-dire qu’il doit être capable de mesurer avec précision, de manière répétée, une variation de concentration de 0,4 à 0,6 gramme par litre, ce qui équivaut à un fond de verre. Certains EAD utilisent même la technologie des instruments des forces de l’ordre, qui peuvent mesurer avec précision les variations de 0,45 à 0,55 gramme par litre. Il s’agit par conséquent d’instruments très fiables.
La présence dans la bouche de substances liées à l’activité humaine, comme l’acétone, ou l’utilisation de produits du type eucalyptol ou phénol, soit fera augmenter le niveau d’alcoolémie mesuré, soit n’aura aucune influence sur le résultat. Il semble actuellement impossible de tromper cet instrument.
M. le rapporteur. Mais on peut demander à une autre personne de démarrer le véhicule.
M. Hubert Berry. En effet : d’où l’intérêt de procéder à des tests aléatoires afin d’éviter ce type de contournement – mais M. Vialettes vous en parlera mieux que moi.
Par ailleurs, cet instrument ne sert pas seulement à réprimer, mais aussi à éduquer. Si l’on a conscience d’avoir un problème avec l’alcool, on n’a aucun intérêt à tricher. Face à l’appareil, dans le véhicule, on ne peut pas se mentir.
M. Stéphane Vialettes. Les EAD sont soumis à des examens métrologiques approfondis. Aujourd’hui, tous les appareils européens sont certifiés par des laboratoires qui garantissent que les appareils mis sur le marché respectent les normes techniques. L’Union technique de l’automobile du motocycle et du cycle (UTAC), chargé de l’homologation des produits sur les bus, est garante de ces essais, ainsi que de la vérification des gaz de calibration : il faut en effet prévoir une procédure de calibration et d’étalonnage périodique des appareils, si l’on veut garantir la fiabilité, la précision et la répétitivité de la mesure. C’est pourquoi nous sommes favorables à la certification des appareils.
Nous travaillons en partenariat avec les constructeurs automobiles sur les véhicules particuliers comme sur les véhicules utilitaires. Les appareils que nous installons dans ce cadre sont testés avant leur installation, selon des normes internes très strictes, notamment s’agissant de la compatibilité électromagnétique, de la compatibilité électrique et de la consommation d’énergie – les EAD actuels consomment moins de 5 milliampères.
Il faut par ailleurs tenir compte du rôle du progrès technologique et des approches marketing. Au début, les constructeurs automobiles ne voulaient pas de l’ABS parce qu’ils pensaient qu’il serait trop compliqué à installer ; aujourd’hui, toutes les voitures en sont équipées. Pour un constructeur automobile, il est actuellement plus facile de vendre un équipement GPS qu’un EAD, mais demain, avec l’évolution des mentalités, ce sera peut-être différent.
Il est certain que n’importe qui peut souffler dans un éthylotest anti-démarrage. C’est pourquoi le programme judiciaire prévoit la possibilité d’intégrer dans les appareils un test aléatoire, intervenant entre 5 et 30 minutes après le démarrage, ce qui obligerait le conducteur à souffler de nouveau dans l’appareil. Cela permettrait de lutter contre certaines stratégies de contournement, comme laisser tourner le moteur du véhicule quand on va boire un coup au bistrot. Aux États-Unis, on travaille aussi sur la reconnaissance faciale – mais c’est une autre culture.
Mme Françoise Hostalier. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes confrontés à de gros problèmes d’alcoolisme au volant chez les jeunes. Quand j’étais enseignante, j’avais participé à la mise en œuvre de mesures comme la désignation de « capitaines de soirée » ; je trouvais cela plutôt efficace. Qu’en pensez-vous ? Quelles mesures de prévention existe-t-il ? Intervient-on, par exemple, lors de la journée défense et citoyenneté (JDC), qui est un moment privilégié pour toucher tous les jeunes, quel que soit leur sexe, à l’âge où ils commencent à conduire ?
Même si j’ai bien compris que l’alcoolémie zéro n’existe pas, la « tolérance zéro » ne résoudrait-elle pas tous les problèmes, en posant le principe qu’entre boire ou conduire, il faut choisir ? Seriez-vous favorable à une mesure à destination des seuls jeunes conducteurs, de manière à leur donner de bonnes habitudes ?
Ne pourrait-on pas organiser des stages de récupération de points dédiés aux questions d’alcoolisme et d’addictions ?
Quid des autres addictions, notamment au cannabis ? Il semble que le mélange d’alcool et d’autres produits, même en faible quantité, empêche d’avoir des réactions normales. Peut-on concevoir des tests permettant de vérifier que l’on est capable de conduire ?
Enfin, les éthylotests – du moins, ceux qui sont valables – me semblent coûter plus cher qu’un café ! Pourquoi ne pas mettre en place une campagne publicitaire visant à fournir un éthylotest pour l’achat de toute bouteille d’alcool fort, ce qui permettrait d’habituer les gens à cet instrument ?
M. Jacques Myard. Les addictions, ce ne sont pas seulement l’alcool et le cannabis, mais aussi le chocolat, le tabac, le sexe et les drogues en tous genres. N’existe-t-il pas aussi une addiction à la vitesse ? L’hybris du mâle chauvin au volant ne relève-t-il pas d’une forme de dépendance ?
M. le rapporteur. Particulièrement à moto !
M. Lionel Tardy. Nous avons eu ce matin un débat avec la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) sur les publics à toucher en matière de prévention routière, et nous avons évoqué le cas des « récalcitrants », c’est-à-dire des automobilistes qui ne s’estiment pas concernés. Certes, avec des radars, on arrive à calmer une personne qui conduit trop vite. Toutefois, pour les personnes qui souffrent d’addiction, il semble que les sanctions ne servent à rien ; d’ailleurs, le taux de récidive est très élevé au sein de cette population, même après un retrait de permis ou la confiscation du véhicule. Or, moins d’un quart des personnes ayant eu un problème d’alcoolémie au volant ont bénéficié d’un programme ou d’un suivi. Qu’en pensez-vous ?
M. Daniel Orgeval. Madame Hostalier, en tant qu’intervenant départemental de sécurité routière (IDSR), je mène des actions bénévoles auprès des jeunes. Parmi les messages que nous essayons de leur faire passer, nous leur disons qu’ils vont être embauchés dans une entreprise grâce à leur diplôme à bac +3 ou bac +5, mais aussi parce qu’ils possèdent le permis de conduire ; s’ils le perdent, leur employeur n’aura plus besoin d’eux. Le permis de conduire est le premier diplôme pour obtenir un emploi, avant tous les autres : il faut insister sur ce point.
Je confirme que l’on peut trouver des éthylotests au prix d’un café et que la dépense est insignifiante comparée à l’achat d’une bouteille de vodka – mais les jeunes ont pris l’habitude qu’on leur donne systématiquement le préservatif et l’éthylotest, sinon, ils ne s’en servent pas ! Le problème, ce n’est pas le prix, c’est d’être sûr de pouvoir en trouver un en cas de besoin. Il faut faire en sorte que ces matériels soient disponibles en tout lieu, à toute heure et, pour cela, explorer toutes les voies et tous les partenariats possibles.
La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) impose aux établissements de nuit de s’équiper de bornes éthylotests murales. Il ne faut pas perdre de vue qu’un éthylotest certifié est valide de 12 à 14 mois pour un appareil de classe 1, et 12 mois pour un appareil de classe 2 ; au-delà, la certification est suspendue dans l’attente du passage d’un technicien. Si cette opération de maintenance n’est pas imposée, les appareils risquent au bout d’un certain temps de ne plus être valides et d’être abandonnés. C’est pourquoi, chez I-Tests, nous estimons qu’il faut rendre obligatoire le contrôle périodique des bornes et que toute intervention technique devrait être conservée au registre de sécurité de l’établissement et présentée à la commission de sécurité, comme c’est déjà le cas pour les extincteurs et les issues de secours.
Il est vrai, monsieur Myard, que les conducteurs de deux ou trois roues motorisés sont particulièrement exposés aux accidents de la route.
M. Jacques Myard. Ma question consistait à savoir s’il n’existait pas une forme d’addiction à la vitesse : conduire une moto de 1 200 cm3 est une source de plaisir quasi orgasmique !
M. Daniel Orgeval. Cela est vrai également pour les voitures ! D’ailleurs, je vous signale que les jeunes conducteurs n’ont pas accès aux grosses cylindrées à moto, alors qu’ils peuvent s’acheter une Ferrari à peine leur permis obtenu ! En outre, la plupart des motards savent que la conduite des deux-roues motorisés n’est guère compatible avec l’absorption d’alcool ; les motards alcoolisés sont rares, car ils connaissent les risques qu’ils courent.
Ayant dirigé une société de radars et ayant été à l’initiative des appareils de contrôle des feux rouge, je suis bien placé pour savoir que l’automatisation des contrôles permet de calmer les ardeurs des automobilistes, sur une base égalitaire. En revanche, on ne pourra jamais automatiser le dépistage de l’alcoolémie, car cela suppose des hommes sur le terrain ; or, policiers et gendarmes sont de moins en moins nombreux. C’est pourquoi il faut veiller à ce que des éthylotests soient disponibles pour tous, à toute heure et en tout lieu, dans un souci d’éducation et de prévention. Les outils sont disponibles ; il suffit de les mettre en place.
M. Bernard Laumon. S’agissant des jeunes, il convient de distinguer les jeunes hommes et les jeunes femmes, car les risques sont bien supérieurs chez les premiers : lors des dépistages, les hommes sont bien plus nombreux à être contrôlées avec une alcoolémie supérieure à 0,5 ; les jeunes femmes boivent aussi souvent, mais à des doses inférieures.
Une autre caractéristique de l’homme jeune, c’est de mélanger l’alcool et le cannabis, ce qui est très dangereux : alors que le risque d’accident est multiplié par 1,8 en cas de consommation de cannabis et par 8 en cas de consommation d’alcool à dose moyenne, il est multiplié par quinze si l’on associe les deux ! De ce point de vue, instaurer une « tolérance zéro » en matière d’alcool chez les jeunes permettrait de limiter le risque en empêchant ce type de mélange.
Il est entendu que l’alcool est responsable du tiers des tués, mais on disait la même chose il y a dix ans, quand a été lancée l’étude « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » (SAM). Or un tiers de 4000, c’est moins qu’un tiers de 7 000 ! On a donc réduit considérablement le nombre de tués imputable à l’alcool. Pourtant, les conducteurs ne sont pas moins alcoolisés. La cause en est la réduction de la vitesse, qui a permis de diminuer, dans les mêmes proportions, le nombre de tués imputable à l’alcool et celui imputable à d’autres causes.
M. Jacques Myard. C’est un sophisme !
M. Bernard Laumon. Non, c’est une réalité !
M. Jacques Myard. Certes, mais on a agi sur tous les facteurs de risque. La vitesse n’est pas la seule en cause : on peut tuer en roulant à 30 kilomètres heure !
M. Bernard Laumon. Cela n’est pas contradictoire avec le fait qu’en réduisant la vitesse, on a diminué le nombre de tués imputable à l’alcool, comme celui imputable à d’autres causes. Je vous invite à y réfléchir sans considérer qu’il s’agit d’un sophisme.
M. Charles Mercier-Guyon. Étant membre du Conseil international « Alcool, drogues et sécurité routière » et expert auprès de la Commission européenne, j’ai beaucoup voyagé et j’ai participé à des discussions de ce type dans une quinzaine de pays. J’aimerais faire en sorte que l’on profite des expériences des autres et que l’on ne réinvente pas la roue en permanence. Aussi rappelerai-je quelques grands principes.
On oppose souvent en France l’éducation et la répression, alors que les autres pays ont souvent fait la synthèse. Or, une bonne politique de prévention et d’éducation repose d’abord sur des contrôles en bord de route : tous les épidémiologistes s’accordent sur l’existence d’une corrélation entre l’efficacité des politiques de sécurité routière et la probabilité d’être contrôlé sur la route. Depuis quelques années, en France, le nombre des contrôles d’alcoolémie et de vitesse s’est fortement accru, ce qui est un plus par rapport à d’autres pays, comme l’Angleterre, les États-Unis ou le Canada, où, au nom de la protection des droits individuels, les forces de l’ordre n’ont pas le droit de contrôler les conducteurs s’il n’y a pas de signes évidents d’ivresse : autrement dit, on rate la partie immergée de l’iceberg ! Il faut donc que vous souteniez les efforts du ministère de l’intérieur pour développer ces contrôles, en veillant à donner aux forces de l’ordre les moyens matériels et humains nécessaires, et, si la police nationale et la gendarmerie ne suffisent pas pour faire face à cette mission, en accroissant les prérogatives des polices municipales, au moins durant l’été.
Ensuite, il faut assurer un continuum d’éducation de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. C’est ce que fait la Prévention routière. On peut discuter de l’instauration d’une « tolérance zéro » pour les jeunes, à condition qu’elle ne soit pas conçue comme une sanction qui aboutirait à annuler leur permis dès la première alcoolémie, à compromettre le début de leur carrière professionnelle et à les inciter à conduire sans permis mais comme une protection.
S’agissant du cannabis, il faut prendre en considération deux aspects. Du point de vue épidémiologique, je suis d’accord avec Bernard Laumon ; j’ai été à l’origine de la création des procédures de dépistage de drogue au volant et nous avons eu, à l’époque, un très violent débat pour savoir s’il fallait empêcher les jeunes de fumer. Aujourd’hui, le problème du cannabis dépasse la sécurité routière : il touche les rapports familiaux, les violences dans les familles, les violences dans la rue, les échecs scolaires ; il s’agit, tout comme l’alcool, d’un facteur de désinsertion sociale. Il faut mettre en œuvre une politique raisonnable, et prévoir, comme aux Pays-Bas, une intervention systématique dès qu’un problème est identifié ; surtout, un traitement adapté est nécessaire. En Haute-Savoie, les procureurs nous ont demandé de mettre en place un suivi sur six mois des jeunes ayant eu un problème avec le cannabis, avec un dépistage mensuel : après six mois d’abstinence contrôlée, les jeunes récidivent moins souvent. De même, pour l’alcool, on divise par quatre le risque de récidive chez les personnes qui suivent de vrais programmes d’éthylotest anti-démarrage. Partout dans le monde où l’on privilégie le système des sanctions, les noyaux durs ne diminuent pas, en raison de la dépendance à l’alcool.
Il faut donc engager une politique cohérente. Les outils sont disponibles ; à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, de définir une stratégie globale, au lieu de prendre des mesures isolées et parfois aberrantes – à ce sujet, je précise qu’en Suède, tous les radars sont signalés par un panneau, mais que ceux-ci ne coûtent que 70 euros pièce, contre 10 000 euros pour nos panneaux pédagogiques… Pour ce faire, il faut voyager et savoir oublier la prétendue spécificité française.
Mme Annick Lepetit. Je partage votre opinion sur la nécessité d’une stratégie globale. En revanche, je crois savoir qu’il existe une polémique sur le dépistage scientifique du cannabis ; on dit par exemple qu’une prise de sang peut révéler une consommation de cannabis remontant à quinze jours ou trois semaines, donc sans effet sur le comportement au volant. Qu’en est-il réellement ?
M. Charles Mercier-Guyon. Il s’agit d’une campagne de désinformation. Le cannabis peut subsister, dans les urines, jusqu’à trois semaines à un mois, dans la salive, de 24 à 36 heures, et, dans le sang, seulement quelques heures – moins longtemps que l’alcool. Si l’on retrouve du cannabis dans le sang, il s’agit d’une consommation récente.
La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (CNSP) estime que le dispositif actuel de dépistage, à l’élaboration duquel nous avions contribué en 2001, doit être réévalué. On a observé en effet une très forte pression en faveur des tests salivaires, plus faciles d’usage et qui, contrairement aux analyses d’urine, ne requièrent pas la présence d’un médecin – la France étant le seul pays d’Europe à ne pas autoriser l’examen des urines par les forces de l’ordre pour le dépistage de la drogue. Or, les tests salivaires sont moins fiables. Quand j’ai été désigné par la CNSP pour être l’interlocuteur du ministère de l’intérieur en la matière, j’ai dû batailler pour maintenir l’interdiction d’utiliser les tests salivaires en cas d’accident mortel, et pour obtenir qu’on ne les utilise que pour la prévention.
La CNSP se tient donc à votre disposition pour travailler à la réévaluation du dispositif, notamment afin d’y intégrer une part d’évaluation comportementale . Aux termes de la loi, on ne peut en effet dépister chimiquement que quatre drogues, alors qu’il existe une vingtaine de produits susceptibles de perturber un conducteur, notamment des médicaments détournés de leur usage. Il convient de ne pas tout faire reposer sur la preuve biologique.
M. Jacques Myard. Combien de temps le cannabis reste-t-il dans le sang ?
M. Charles Mercier-Guyon. De trois à huit heures, les doses diminuant très vite.
M. Jacques Myard. Dans ce cas, comment peut-il rester plusieurs jours dans les urines ?
M. Charles Mercier-Guyon. Tout simplement parce que 90 % du cannabis sont stockés dans les tissus graisseux et que leur élimination est progressive. La durée de vie dans l’organisme est de sept jours ; au bout de cette durée, il en restera la moitié ; après quatorze jours, il en restera un quart ; etc. Chez les gros consommateurs, on peut retrouver du cannabis dans les urines un mois après. En revanche, si l’on n’a fumé qu’un pétard isolé, on ne retrouvera plus rien au bout de dix jours.
M. Bernard Laumon. Plus précisément, le cannabis contient un certain nombre de métabolites, comme le tétrahydrocannabinol (THC), qui agit sur le cerveau, ou le THC-acide, qui est en revanche inactif. Il est impossible d’avoir du cannabis dans le sang ; ce que l’on peut retrouver dans les urines, c’est du THC-acide, en raison d’un phénomène de concentration au niveau du rein : si tel est le cas, cela signifie simplement que vous avez consommé du cannabis dans les jours précédents. Si l’on veut prouver que vous êtes sous son emprise, il faut trouver du THC dans le sang ; or les concentrations en THC diminuent très vite.
Certes, il existe des théories affirmant que le THC serait stocké dans les graisses et évacué sous l’effet du stress, et que l’on pourrait en retrouver longtemps après avoir fumé un joint. Je pense toutefois qu’en matière de sécurité routière, il vaut mieux se fonder sur des données simples et des effets de masse.
Mme Claudine Pérez-Diaz. Si la prévention n’est pas appuyée sur l’éducation, elle restera à peu près sans effets : on ne convainc que ceux qui sont déjà à moitié convaincus. Le problème, c’est que l’addiction à l’alcool repose parfois sur une dépendance physique, mais surtout sur une dépendance psychique. Presque toutes les alcoolémies délictuelles sont révélatrices d’un rapport problématique à l’alcool, avec le risque que la personne sombre rapidement dans la dépendance. C’est pourquoi je propose des interventions brèves à destination de ces individus, car les sanctions, même sous la forme d’éthylotests anti-démarrage, ne suffiront pas pour régler le problème. Il convient d’agir sur l’alcoolisation chronique en intervenant dès le dépistage afin de bloquer la dérive vers la maladie – d’autant qu’il faut de surcroît lutter contre le déni, car ceux qui ont un problème avec l’alcool refusent souvent de le reconnaître. Il est nécessaire, par conséquent, d’aider ces derniers à franchir cette première étape, de créer une motivation et de les amener à accepter, soit de réduire leur consommation, soit de se soigner.
Par ailleurs, je note que certains pays, comme les pays scandinaves, qui ont décidé d’interdire complètement l’alcool au volant, ont été confrontés à un accroissement du nombre de piétons alcoolisés tués. En d’autres termes, le mieux peut être l’ennemi du bien…
M. le président Armand Jung. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre témoignage et votre expertise.
*
* *
Table ronde sur le coût économique et social des accidents, leur traitement judiciaire et l’aide aux victimes : M. Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et Mme Martine Hours, médecin épidémiologiste, unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance - Transport Travail Environnement à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) ; M. François Werner, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ; Mme Barbara Berrebi, chargée d’étude au Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), Mme Nathalie Irisson, secrétaire générale de GEMA Prévention, et M. Philippe Hingray, fondé de pouvoir de la MAAF ; M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) ; M. le Professeur Djamel Bensmail, chef de service en médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches ; Mme Dina et M. Jean-Pierre Freani, parents d’une victime ; Mme Monique Fritz, présidente de l’association « Aide aux victimes des accidents de la route » (AIVAR), M. Nicolas Fritz, membre fondateur, et Me Laurent Hincker, avocat ; M. Vincent Julé Parade, vice-président de l’association « Victimes et citoyens contre l’insécurité routière » ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle, Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Vendredi 2 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Il sera question, ce matin, du « coût économique et social » des accidents de la route : l’expression peut paraître horrible, mais cette Mission d’information se devait de traiter du sujet. Cependant, elle a tenu à aborder également l’aspect humain de ce dossier, en entendant notamment les associations qui défendent le point de vue des victimes, ainsi que les familles de celles-ci. À tous, je demanderai de s’exprimer en toute franchise, en mettant en avant ce qui leur tient le plus à cœur.
M. Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Avant d’appartenir à l’IFSTTAR, organisme de recherche récemment créé, j’étais chercheur au Laboratoire de l’économie des transports et c’est avant tout en me fondant sur les travaux que j’ai alors menés, sur l’économie de la sécurité routière, que je m’exprimerai.
Je traiterai donc du coût économique des accidents, laissant à Mme Hours le soin de traiter de l’aspect social et humain. En France comme à l’étranger, la collectivité s’est depuis longtemps préoccupée de déterminer la valeur de la vie humaine, exprimée sous forme d’un montant monétaire. Ainsi, chaque fois qu’on envisage la création de grandes infrastructures – autoroutes, TGV… –, on s’attache à en évaluer les avantages comme les inconvénients et, dans les premiers, on comptabilise les vies qui seront sauvées, les blessures qui seront évitées. Traduire cela en valeur monétaire n’est certes pas aisé et a donné lieu à de nombreux travaux – vous trouverez des indications sur cette problématique dans un rapport que je vous remettrai, rédigé de concert avec l’INSERM, sur l’usage du téléphone au volant. Je dirai seulement que cette valorisation est susceptible d’approches différentes, selon qu’on est assureur ou puissance publique, selon qu’on prend en compte les seuls dommages mesurables ou également, par exemple, le nombre d’années d’activité perdues… Mais il a fallu faire un choix et une valeur qu’on nomme « tutélaire », en ce sens qu’elle est définie par la collectivité, reflète l’importance que cette dernière attribue à tel ou tel critère à un moment donné. Dès lors, elle ne peut qu’évoluer dans le temps : en France par exemple, elle a doublé entre 1995 et aujourd’hui – les préoccupations de sécurité routière y ont certainement contribué. Les variations sont également fortes d’un pays à l’autre : ainsi, dans les années quatre-vingt, l’écart était important entre les pays du sud et ceux du nord de l’Europe, ces derniers attribuant une plus grande valeur à la vie humaine.
Cette valorisation a un impact sur la décision publique : sont privilégiés les projets les plus susceptibles de favoriser la sécurité routière dès lors qu’on évalue la vie humaine ou l’intégrité physique à un niveau élevé. Actuellement, cette valeur est fixée à un million d’euros pour une vie sauvée. Nous pourrions aller au-delà : cela contribuerait à donner encore plus de poids aux considérations de sécurité routière dans les politiques publiques des transports.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Dans quel cadre prend-on en compte cette valeur d’un million d’euros ? C’est un montant que sont loin d’atteindre les dommages accordés par la jurisprudence.
M. Dominique Mignot. C’est la valeur utilisée par le ministère des transports pour estimer, par exemple, la rentabilité d’un projet d’autoroute : si l’on juge que sa réalisation économisera dix vies, on ajoutera dix millions aux recettes de péage escomptées.
Mme Martine Hours, médecin épidémiologiste, unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance – Transport Travail Environnement à l’IFSTTAR. Je suis depuis cinq ans une cohorte de 1 400 blessés de la route, avec le souci d’étudier les conséquences des accidents sur les victimes ainsi que sur leur entourage. J’ai constaté – mais, pour le vivre, les familles le diront sans doute mieux que moi – que le coût socio-économique individuel de l’accident, qui peut être très élevé, est aussi éminemment variable. Ne joue pas seulement le degré de gravité des lésions initiales : si 35 % des victimes d’accidents graves sont empêchées définitivement de reprendre leur travail, 4 % des blessés légers se retrouvent dans la même situation. Le profil des lésions est en outre différent selon l’âge ou selon qu’on est piéton, automobiliste ou cyclomotoriste : les blessures à la tête graves sont plus fréquentes chez les piétons âgés tandis qu’un jeune adulte sera davantage exposé à des problèmes orthopédiques. Et ce qui peut être bénin à une certaine époque de la vie peut à une autre entraîner une perte d’autonomie.
Ces conséquences ne se limitent pas à la personne du blessé. Si celui-ci peut avoir des difficultés à reprendre son travail, voire le perdre et être contraint à une réorientation professionnelle, sa famille aussi est affectée : un parent peut être obligé d’interrompre son activité, ce qui entraîne un manque à gagner ; il faut parfois réaménager le logement – c’est la situation dans laquelle se retrouvent 7 % des blessés, 4 % devant renoncer faute de moyens – ou déménager. L’accident entraîne aussi trop souvent un état de fragilité économique, soit que le véhicule n’ait pas été assuré, soit qu’il ait été incomplètement payé et qu’il faille continuer d’acquitter les traites. Ces difficultés-là s’estompent certes avec le temps, mais ce n’est pas le cas de celles qu’éprouvent les blessés les plus graves, condamnés à une absence de revenus faute de pouvoir reprendre leur travail.
Je souhaite également insister sur la complexité de la prise en charge médicale ainsi que sur celle des démarches administratives. Tout se passe à peu près bien tant que vous vous trouvez à l’hôpital mais ensuite, du jour au lendemain, vous n’êtes plus confronté qu’à des spécialistes, selon la nature des blessures reçues, sans que jamais personne vous prenne en charge globalement. Mal informés par les médecins hospitaliers, les généralistes ignorent qu’ils vont avoir à s’occuper d’un polytraumatisé ; souvent, ils ne savent pas non plus comment traiter le syndrome post-traumatique qui, faute de prise en charge rapide, risque alors de prendre une tournure chronique. Quant aux démarches administratives, leur complexité est telle que certains chercheurs en viennent à parler de « dose toxique » ! Certains accidentés, découragés, renoncent, quitte à ne pas être indemnisés.
En définitive, l’accident est un facteur aggravant des inégalités sociales : s’en sortent le mieux ceux qui savent ou qui peuvent s’offrir un avocat, les plus fragiles étant, eux, condamnés à le devenir encore plus.
M. François Werner, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le FGAO a notamment pour mission d’indemniser les victimes de la route lorsque l’auteur de l’accident a pris la fuite ou était dépourvu d’assurance. En ce qui me concerne plus particulièrement, j’ai remis récemment à Mme Lagarde un rapport sur ce phénomène de la « non-assurance automobile ».
Je commencerai par décrire la situation telle qu’on peut la voir par le petit bout de la lorgnette : avec des chiffres. Chaque année, notre fonds verse de 75 à 80 millions aux victimes des conducteurs non assurés et un peu plus de 20 millions à celles des auteurs de délit de fuite. Ces montants ne diminuent pas, contrairement à ce qu’on pourrait penser au vu des progrès de la sécurité routière. Cela tient sans doute à l’amélioration des conditions d’indemnisation mais, le nombre de dossiers étant globalement stable, cela pourrait aussi indiquer une augmentation du nombre de conducteurs sans assurance…
M. le rapporteur. Pouvez-vous faire le départ entre ceux qui sont simplement dépourvus d’assurance et ceux qui n’en ont pas parce qu’ils n’ont pas non plus de permis de conduire ?
M. François Werner. J’y viendrai en conclusion.
Ces coûts pour le FGAO ne sont que l’effet d’épreuves dont les associations et les familles rendront mieux compte que moi : celles que subissent les victimes. Mais il ne faut pas oublier, même si évoquer le sujet peut paraître à certains indécent, les difficultés rencontrées par les auteurs d’accident non assurés. Nous sommes en effet financés, non seulement par une taxe de 1,2 % sur les contrats d’assurance responsabilité civile – soit à peu près 2 euros par contrat d’assurance concernant les véhicules –, mais aussi par ce que nous pouvons recouvrer auprès de ces personnes, qui vont souvent traîner une dette importante tout au long de leur vie.
Qui sont-elles ? La mission que m’avait confiée Mme Christine Lagarde m’amenait à essayer de les identifier. Au vu d’un échantillon assez significatif de dossiers, on peut les diviser en deux catégories. Il y a, en premier lieu, des gens qui ont le droit de conduire mais qui, à un moment, vont se retrouver sans assurance, soit pour des raisons culturelles, soit parce qu’ils n’ont pu régler leur prime, soit encore pour des raisons de « facilité » – je pense par exemple aux cas où un adulte se déclare conducteur principal alors que celui-ci est en vérité un jeune, qui serait redevable d’une prime plus élevée.
L’autre catégorie, sans doute peu nombreuse mais à l’origine du plus grand nombre de dossiers parce que dangereuse, est celle des conducteurs sans permis, auteurs multirécidivistes d’accidents et souffrant d’addictions, qu’il conviendrait tout simplement d’immobiliser. Nous ne traitons pas tous les dossiers qui les concernent mais ceux qui nous arrivent nous permettent de cerner plus ou moins précisément leur profil. La proportion de ceux qui ont perdu le permis parce qu’on leur a retiré la totalité de leurs points est relativement faible. Bien plus nombreux sont ceux qui, soit n’ont jamais passé le permis, soit l’ont perdu depuis longtemps, du fait d’une ou même, parfois, plusieurs annulations judiciaires. Dans le monde des automobilistes, ce sont des marginaux.
Auprès de la première catégorie, le travail à mener est, nous semble-t-il, un travail de prévention et d’information – de pédagogie, sur l’utilité de l’assurance et sur les risques encourus en l’absence de police. Effort qui aurait d’ailleurs son utilité pour une plus large population : qui connaît exactement l’étendue des garanties couvertes par son assurance ? C’est une formation qui aurait toute sa place dans les écoles et auto-écoles…
La deuxième catégorie est donc constituée de ceux qui n’ont aucun droit de conduire mais qui, dans notre pays, n’en peuvent pas moins acquérir un véhicule et le faire immatriculer ! Toutes les démarches normales leur sont accessibles, sauf une : souscrire une assurance, car cela exige de pouvoir présenter un permis valable. La parade apparaît dès lors aisée : il suffirait, comme le font tous les pays voisins, de croiser avec le registre des cartes grises un répertoire des contrats d’assurance. Nous serions alors à même de détecter ces conducteurs avant qu’ils n’aient le temps de mettre en danger les autres usagers de la route.
Mme Barbara Berrebi, chargée d’études au Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA). Au sein du GEMA, syndicat professionnel des assureurs mutualistes, je suis chargée d’études sur l’assurance-dommages, notamment dans le secteur automobile.
En 2009, on a comptabilisé environ dix millions de sinistres automobiles, entraînant le versement par les assureurs de 16,3 milliards d’euros, dont 26 % environ au titre de quelque 271 000 sinistres mettant en jeu la responsabilité civile corporelle. La proportion des victimes décédées était de 1 %, celle des blessés devant conserver une atteinte physique et psychique de 24 % – mais ils ont perçu 78 % des indemnités versées.
Ces victimes étaient pour 32 % conducteurs ou passagers d’un véhicule deux-roues motorisé et pour 43,7 % conducteurs ou passagers d’un véhicule quatre-roues – voiture particulière ou camionnette. Cependant, ce que cette statistique ne montre pas, c’est que les premiers sont quatre fois plus exposés que les autres usagers au risque d’accident de la route.
En 2008, l’Association française de l’assurance a publié un livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, témoignant ainsi de la volonté qui anime la profession de faire évoluer le système d’indemnisation et d’harmoniser les pratiques en la matière afin de mieux répondre aux demandes des victimes. La première partie de ce document, intitulée « Pour un traitement équitable des victimes de dommages corporels », propose notamment des outils d’évaluation de ces dommages ; la deuxième est consacrée à l’accompagnement des plus lourdement handicapés, en particulier dans l’élaboration d’un projet de vie permettant une réinsertion socioprofessionnelle.
Depuis cette publication, les assureurs ont créé un comité de liaison réunissant les responsables des départements « indemnisation des dommages corporels » des principales sociétés du secteur. Par ce biais, nous avons pu réfléchir à une meilleure prise en charge des victimes de concert avec des associations telles que l’Association des paralysés de France (APF), la Fédération nationale des accidents du travail et des handicapés (FNATH), l’Association d’aide aux victimes d’accidents médicaux (AVIAM) ou encore le Réseau national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM). Ces échanges, qui ont contribué à rapprocher les points de vue sur certains points, ont permis un aggiornamento des missions d’expertise médicale grâce à l’élaboration d’un guide pratique destiné aux médecins experts – on y expose notamment les moyens d’améliorer la prise de contact avec la victime, phase particulièrement délicate de la procédure.
Les assureurs participent également aux groupes de travail du Conseil national de l’aide aux victimes, présidé par le Garde des sceaux : la réflexion porte là, notamment, sur l’évaluation des dommages corporels, sur la prise en charge des victimes d’accidents collectifs et, depuis cette année, sur celle des victimes d’infractions routières – une des premières réunions de ce groupe a été consacrée à la présentation du guide de l’accompagnement des victimes d’accidents de la route, élaboré par la Délégation à la sécurité et à la circulation routières.
La profession s’est également dotée d’une Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) qui a publié une brochure analysant la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice ainsi que son application. Enfin, dans le même domaine, elle se mobilise en faveur de la formation des juristes et des médecins experts et contribue à de nombreux colloques, en France et en Europe.
M. Philippe Hingray, fondé de pouvoir de la MAAF. Je suis responsable du pôle Performance Corporel au sein de Covéa AIS qui regroupe les mutuelles GMF, MAAF et MMA. Mes missions concernent essentiellement la limitation des risques.
Pour compléter l’exposé de Mme Berrebi, je préciserai que, sur les quelque 16 milliards d’indemnisation, plus de la moitié va à seulement 3 % des blessés et plus de 30 % à seulement 1 % d’entre eux. Cela tient à la jeunesse des intéressés, dont l’intégrité physique et/ou psychique (IPP) est réduite de plus de 50 % : il faut dès lors une indemnisation qui couvre pratiquement la durée d’une vie – tout d’abord d’une vie professionnelle, dans la mesure où ils ne pourront plus jamais travailler, mais cette dépense recouvre aussi, dans la proportion d’une moitié, le coût de l’aide humaine nécessaire.
Le livre blanc en témoigne : notre principal souci est d’accompagner ces grands blessés dans la définition d’un projet de vie qui conduise à leur réinsertion professionnelle. Il nous paraîtrait à cet égard souhaitable de se garder d’une indemnisation trop rapide, effectuée avant qu’ils aient pris la pleine mesure des conséquences de leur handicap : l’échec serait à peu près assuré au bout de cinq ou dix ans. Je dois ajouter que l’imprévisibilité des coûts est la hantise des assureurs : nous voulons être à même de mesurer nos charges dans le temps. Cependant, sur ce point, nous nous heurtons à une disposition de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui oblige à indemniser « dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de [la] consolidation » – cette dernière notion renvoyant en général à la stabilisation des séquelles fonctionnelles, laquelle intervient au bout d’à peu près un an et demi ou deux ans chez les tétraplégiques. Or, ces séquelles, même si elles sont connues, ont des effets sur les chances de réinsertion qui ne peuvent être évalués qu’au terme d’un plus long délai. Nous avons donc engagé avec les associations une réflexion sur le sujet.
M. Dominique Raimbourg. Si j’ai bien entendu, l’enveloppe de 16,3 milliards est consacrée pour 26 % à l’indemnisation des préjudices corporels, mais ce montant se rapporte-t-il à l’ensemble des accidents, ou uniquement à ceux qui sont pris en charge par le GEMA ?
Mme Barbara Berrebi. Ces chiffres sont ceux de l’ensemble de la profession.
M. Philippe Hingray. Et les 30 % de l’enveloppe versés aux 1 % des blessés les plus lourdement atteints correspondent donc à une somme de quelque 4 milliards.
M. le président Armand Jung. Que savez-vous sur cette population particulière ? Avez-vous une idée des causes en jeu dans leur accident ?
M. Philippe Hingray. Non, nous savons uniquement de quel type de handicap ils souffrent.
Mme Martine Hours. La réponse à votre question, monsieur le président, peut être trouvée dans le registre des victimes d’accidents de la route du département du Rhône : on y trouve des données permettant de faire le lien entre le type d’accident et les lésions graves qui en ont résulté. Ainsi on sait que les lésions médullaires ont souvent pour origine les accidents de vélo.
M. le rapporteur. Mais il ne livre aucun élément financier…
Mme Martine Hours. Pour cela, il faut s’adresser aux assureurs. En raccordant ces deux sources, on peut remonter des coûts d’indemnisation aux circonstances de l’accident.
M. le rapporteur. Il est communément admis que le coût de l’insécurité routière se monte à quelque 24 milliards d’euros par an. Les compagnies d’assurance en prendraient donc 16 à leur charge, réparation des dommages matériels et corporels confondus. À qui incombe la charge des huit milliards restants, hormis au Fonds de garantie automobile (FGA) ? Est-ce la solidarité nationale qui couvre cette différence, et à quels postes sont affectées les sommes ainsi dépensées ?
M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La réponse n’est pas aisée car, dans ces affaires, un même concept peut recouvrir des réalités variables.
Établie chaque année par l’ONISR sur la base des valeurs tutélaires dont a traité M. Mignot – tant pour un décès, tant pour les blessures, etc. –, la valorisation de l’insécurité routière ne correspond pas forcément à des débours : elle se rapporte en fait aux différentes conséquences qu’a cette insécurité pour la société. Même si cette estimation peut intégrer des montants d’indemnisation, on est là sur un autre plan,. L’objectif est avant tout d’avoir un outil pour arbitrer entre priorités publiques et, secondairement car l’argument est pour moi d’une efficacité pédagogique incertaine, pour convaincre nos concitoyens de la nécessité d’agir en faveur de la sécurité routière.
Nous venons de recalculer ce coût économique et social pour 2010 : vous disposerez dans une dizaine de jours de ce tableau, qui confirme le chiffre de 24 milliards que vous avez donné tout à l’heure, monsieur le rapporteur – pour être précis, le coût global de l’insécurité routière a été évalué à 23,37 milliards, contre 23,7 en 2009, cette petite baisse s’expliquant par une moindre mortalité. Le premier « poste », avec 9,49 milliards, est constitué par les dommages relatifs aux victimes : les décès y sont comptés pour 5,04 milliards, les hospitalisations pour 4,15 milliards et les blessés légers pour 300 millions. Les dommages matériels accompagnant les accidents corporels ont été évalués, à partir des éléments fournis par les assureurs, à 430 millions cependant que les accidents n’ayant provoqué que des dégâts matériels ont coûté 13,45 milliards.
Dans l’évaluation, notamment en ce qui concerne les décès et les blessures, nous intégrons ce qu’on appelle les coûts marchands directs – coûts des transports sanitaires, des secours, des premiers soins, des médicaments, des appareillages, de la rééducation, de l’aide à domicile, coûts funéraires, etc., auxquels s’ajoutent les coûts matériels : dommages causés aux véhicules, aux propriétés, aux personnes impliquées dans l’accident, à l’environnement, frais de remorquage, de police, d’incendie, jusqu’à la consommation de carburant induite par la congestion du trafic provoquée par l’accident ! Sont également pris en compte les frais marchands indirects – perte de production temporaire des personnes blessées, perte de production future des personnes décédées et de leur descendance potentielle – ainsi qu’un certain nombre de coûts non marchands : préjudice moral, pretium doloris, etc.
M. le président Armand Jung. Pour étayer nos conclusions et nos propositions, il nous serait surtout utile de connaître la part respective des assurances et de la solidarité nationale dans cette dépense de 24 milliards.
M. Louis Fernique. Les procédures de valorisation ne sont pas identiques. Je vous énumérais en gros ce qui a été pris en considération pour une évaluation qui est effectuée chaque année, après fixation – arbitraire, par décision politique et compte tenu de certains indices – des valeurs tutélaires : 1 250 000 euros par exemple pour un décès. Il n’y a là rien qui me permette de déterminer le coût des indemnisations par les assurances, connu d’elles seules.
M. Dominique Raimbourg. Me tromperais-je beaucoup si je disais que, sur les 8 milliards restant après la soustraction des 16 milliards d’indemnisation aux 24 milliards que coûte l’insécurité routière, à peu près la moitié correspond à la « valorisation » des décès, les 4 milliards restants étant supportés par la collectivité, notamment sous forme de dépenses de secours ?
M. Louis Fernique. L’estimation est, me semble-t-il, assez juste en première analyse. Tout au plus faudrait-il prendre également en considération, par exemple, les dommages matériels non déclarés qui échappent aux assurances, les parties impliquées réglant l’affaire par des versements de la main à la main.
Mme Barbara Berrebi. Je précise que les 26 % de 16 milliards ne correspondent qu’à l’indemnisation des sinistres mettant en jeu la responsabilité civile, en présence d’un tiers responsable, et non à l’indemnisation de la totalité des accidents corporels, qui peuvent aussi se produire en l’absence de tiers. Dans ce cas, ils sont cependant pris en compte dans les 16 milliards à condition que les intéressés soient couverts par un contrat individuel.
M. le professeur Djamel Bensmail, chef de service en médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Les traumatismes crâniens et les atteintes médullaires dont souffre la grande majorité des victimes d’accidents de la route soignés dans mon service entraînent un parcours de soin extrêmement long. Rien que la phase initiale – réanimation et rééducation – exige six mois à deux ans, voire davantage. Le coût de ces traitements est donc élevé : la journée d’hospitalisation avec réanimation revient à 1 500 euros et, avec rééducation, de 400 à 500 euros. À cela s’ajoute la dépense résultant des complications induites par le handicap : complications urinaires, fréquentes en cas d’atteintes médullaires, complications cutanées – le traitement de certaines escarres coûte entre 150 000 et 300 000 euros ! –, etc.
Se pose ensuite le problème d’une réinsertion professionnelle, qui n’est accessible qu’à un tiers des patients souffrant de traumatisme crânien grave, à deux tiers si le traumatisme est modéré. Mais, parmi ceux dont le traumatisme n’est que léger, 15 à 17 % encore seront dans l’incapacité de reprendre une activité. On imagine le coût pour la société, sachant qu’on compte de 120 000 à 150 000 cas de traumatisme crânien, dont 40 à 50 % provoqués par des accidents sur la voie publique ! Quant aux blessés médullaires, une enquête menée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 a montré que, sur 75 % qui exerçaient une activité professionnelle avant leur accident, seuls 33 % la reprenaient : moins de la moitié !
La question des aidants familiaux est également préoccupante. Beaucoup de conjoints arrêtent de travailler, se privant ainsi de revenu, et finissent par s’épuiser à force d’assister le malade, souvent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. D’autre part, les procédures d’indemnisation sont souvent très longues et il arrive que des patients restent dans les services de rééducation jusque trois ou quatre ans durant, faute des moyens de se payer une aide à domicile.
Être tétraplégique ou paraplégique est une épreuve mais, quand on est de plus socialement défavorisé, la situation est littéralement catastrophique. Certains doivent prolonger des années leur séjour en rééducation faute de pouvoir faire adapter leur logement. Et ceux pour qui le retour à domicile est exclu se heurtent au manque de maisons d’accueil, d’unités de logement spécialisées ou de foyers de vie médicalisés.
Enfin, dans les années à venir, va se poser avec de plus en plus d’acuité le problème du vieillissement de cette population d’handicapés. Avec les progrès de leur prise en charge, leur espérance de vie s’est accrue mais leur vieillissement suit un cours tout à fait spécifique. Ainsi, pour un paraplégique, la dépendance totale intervient souvent dès l’âge de 55 ou 60 ans.
Mme Dina Freani, mère d’une victime. Mon fils unique a trouvé la mort sur la route, à 21 ans. Il était au volant d’un tracteur : deux mois auparavant, après avoir achevé ses études avec succès, il avait trouvé un emploi chez un viticulteur.
C’était en pleine saison des vendanges, en Alsace, le 5 octobre à seize heures trente, sur une route nationale à quatre voies, parfaitement droite. Un poids lourd est arrivé, le chauffeur n’a pas vu le tracteur ; il a percuté mon enfant qui a été tué.
Le décès est intervenu à dix-neuf heures trente. Nous avons été prévenus par un coup de téléphone à vingt-deux heures.
Nous croyions la vie belle. Nous étions une famille recomposée, à qui s’offrait une deuxième chance dans la vie. Tout allait bien. Nous avions une activité professionnelle, un foyer équilibré. Nous avions un enfant unique, qui avait reçu une bonne éducation et ne posait de problèmes d’aucune sorte. Il avait trouvé un travail dès la fin de ses études. Et puis, un jour, arrive un coup de téléphone. Vous vous retrouvez devant le corps inanimé de votre fils. Tout explose, tout bascule.
Le traumatisme psychologique a été tel, pour moi, que j’ai dû abandonner mon activité professionnelle – la sécurité sociale m’a placée en invalidité, au taux de 80 % – et je n’ai plus aucune activité associative, sociale ni sportive, non plus. Plus rien : tout est parti en éclats ce 5 octobre, à vingt-deux heures.
M. le président Armand Jung. Merci, madame, pour ce témoignage. J’ai tenu à ce que vous puissiez vous exprimer, au nom de tous ceux qui ont connu le même drame.
M. Jean-Pierre Freani, beau-père de la même victime. Pour réduire le coût économique des accidents de la route, il faut pouvoir en réduire le coût social et humain : cela suppose que tous ceux qui en ont été victimes aient les moyens de se reconstruire, afin de ne pas avoir à dépendre de la solidarité nationale.
Je ne m’appesantirai pas sur les problèmes financiers qui peuvent se poser : pour notre part, même s’il y a fallu de longs mois de négociation et si la procédure est encore en cours au bout de cinq ou six ans, l’assurance a accepté de nous indemniser, la justice ayant par deux fois reconnu la responsabilité pleine et entière du chauffeur routier dans l’accident. Mais tout de même…
Un soir, à vingt-deux heures, on nous a donc appris par un coup de téléphone le décès de notre enfant. De Strasbourg où nous résidons, nous nous sommes rendus à l’hôpital de Colmar, où se trouvait son corps. Nous l’avons vu. On nous a demandé de rentrer chez nous pour revenir le lendemain pour les démarches. C’est ce que nous avons fait, et on nous a ensuite envoyé en face, aux Pompes funèbres, alors que nous étions dans un état psychologique que vous pouvez imaginer et que nous n’avions pas dormi de la nuit. Là, condoléances puis, comme nous expliquons que nous n’avons pas de caveau à Strasbourg et que nous voulons enterrer l’enfant à La Ciotat dont nous sommes originaires : « Bien, monsieur. Ce sera 2 500 euros. Vous payez comment ? ». À la mairie de La Ciotat, nous nous enquérons d’une tombe : « Un trou dans la terre, quatre places. C’est 4 200 euros. Vous payez comment ? » Entre-temps, le service des pompes funèbres de Colmar avait acheminé le corps à La Ciotat. Au cimetière, un autre opérateur prend le relais : « C’est 1 500 euros. Vous payez comment ? ».
Je suis cadre supérieur, nous avons des moyens confortables mais je ne sais pas comment d’autres personnes peuvent faire face.
Dans de telles circonstances, assommé par ce qui vous arrive, vous êtes totalement seul. L’attitude des assureurs est parfois assez surprenante, je vais y revenir, mais je voudrais surtout, sans faire pour autant le procès de la Justice, souligner l’existence dans la procédure judiciaire d’une faille qui peut avoir des conséquences morales assez rudes.
Le 28 septembre 2007 – l’accident date d’octobre 2006 –, a eu lieu le procès en première instance, d’une remarquable équité. Nous étions présents, toutes les parties ont pu s’exprimer et hormis, de la part du représentant des assurances, un propos où le cynisme le disputait à l’ignoble, rien n’a prêté à critique. Le chauffeur du poids lourd, reconnu entièrement responsable comme je l’ai dit, a été condamné à vingt mois de prison, dont quatre fermes. Il a fait appel. Ce deuxième procès s’est tenu le 6 février 2008 mais nous n’en avons été informés que par hasard, quatre mois après, au cours d’une conversation avec une amie magistrate à la cour d’appel de Colmar ! Il y a là, dans la procédure, une absence de suivi déplorable. Interpellée, la cour d’appel nous a répondu que la présence des parties civiles était possible mais non obligatoire et que, si nous n’avions pas été informés, c’est que le greffier était débordé de travail.
Nous avons ensuite découvert les attendus du jugement : « Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de la personnalité du prévenu, il apparaît que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est excessive en ce qui concerne la partie ferme ». Celle-ci a donc été annulée, mais ce n’est pas ce qui nous trouble : aucune sanction ne nous rendra le gamin. En revanche, nous avons été privés de la possibilité qui nous avait été offerte en première instance d’apporter au tribunal des éléments qui démontraient la responsabilité du chauffeur. Celui-ci avait dit avoir été aveuglé par le soleil : nous avons pu prouver que son véhicule était doté d’un dispositif anti-éblouissement, ce que le tribunal aurait ignoré sinon. Notre conseil a également signalé qu’il avait dépassé son temps de travail limite et n’avait plus de points sur son permis – j’ajoute que, tandis que notre enfant agonisait, il était encore resté neuf minutes dans sa cabine pour téléphoner à son employeur et à une entreprise de dépannage et que, deux heures après l’accident, il était reparti pour achever ses livraisons. Enfin, comme il prétendait que la route était sinueuse à cet endroit, nous avons dû fournir des documents et des photographies au Parquet pour prouver que c’était faux. Il est donc indispensable que la partie civile soit présente au procès – ou qu’à tout le moins, le parquet dispose de suffisamment d’éléments pour que bonne justice soit rendue.
M. le président Armand Jung. Ce problème juridique qui est venu se greffer sur une affaire déjà dramatique a fait l’objet de débats à l’Assemblée : avec M. Raimbourg et d’autres, j’ai défendu, lors de la discussion d’une proposition de loi de simplification du droit, un amendement visant à renforcer les droits des parties civiles. Par la voix de M. Karoutchi, le Gouvernement s’est déclaré disposé à rendre obligatoire leur information, s’agissant du procès pénal en appel.
M. le rapporteur. Les choses sont un peu plus compliquées… Le problème s’est posé aussi pour les cours d’assises d’appel et la réponse a été que les parties civiles ne pouvaient y intervenir que pour discuter des intérêts civils. Or il est des cas où l’indemnisation sur le plan civil dépend de la seule responsabilité pénale…
M. Dominique Raimbourg. Simple précision de procédure, M. Freani : vous n’aviez pas formé d’appel incident sur l’appel du prévenu ?
M. Jean-Pierre Freani. Non.
Me Laurent Hincker, avocat. Il y avait uniquement un appel au pénal, il n’y avait pas d’appel quant aux intérêts civils de la part du prévenu.
M. le président Armand Jung. Ce qui est choquant, c’est que, même si elle n’avait pas formé elle-même d’appel, la partie civile n’ait pas été prévenue de la tenue du procès en appel.
M. le rapporteur. C’était peut-être une erreur.
M. le président Armand Jung. Le problème est que ce n’est pas obligatoire : certains magistrats le font, d’autres non, faute de temps parfois. Ainsi apprend-on incidemment que la peine ferme à laquelle le présumé coupable avait été condamné en première instance a été commuée en sursis. C’est insensé !
J’ai déposé une proposition de loi sur cette question, qui fait consensus sur tous les bancs de l’hémicycle.
Mme Monique Fritz, présidente de l’association « Aide aux victimes des accidents de la route » (AIVAR). Il nous est difficile, à nous qui avons vécu la même chose, de prendre la parole après le témoignage de Mme et M. Freani.
Je vous remercie de penser aux victimes. N’est-ce pas logique dès lors qu’il ne s’agit au fond que d’en réduire le nombre ? Pourtant, on les place sous une chape de plomb. Sans doute leur parole est-elle trop gênante. Toutefois, notre expérience nous donne une forme d’expertise.
Ainsi avons-nous, mon mari et moi-même, créé l’Association Laurence Fritz, qui a beaucoup fait en matière de prévention, par exemple en intervenant à la télévision, en tenant des stands éducatifs, en s’adressant aux élus et aux décideurs. Tout cela pouvant désormais être considéré comme acquis dans notre région, c’est l’AIVAR, l’association d’aide aux victimes de la route, qui a pris le relais.
Il nous est difficile d’assister à des réunions comme celle-ci, où l’on parle de coûts et de statistiques. Car pour nous, la valeur de la vie humaine, au-delà de toute estimation monétaire, appelle le respect, notamment en matière de communication. Ainsi l’idée des « morts économisées » nous paraît-elle quelque peu étrange. De même, la mention usuelle et officielle d’une « barre » de quatre mille tués, chiffre politiquement correct, nous met très mal à l’aise : s’agit-il du tribut auquel le Minotaure de la route aurait droit ? Mais, en réalité, nous déplorons chaque année 125 000 victimes, y compris les victimes par ricochet : aux personnes décédées ou blessées il faut en effet ajouter les membres de leur famille, qui porteront ce traumatisme en eux leur vie durant. À nos yeux, il est donc essentiel que la notion de personne ne soit pas oubliée et que l’on ne s’en tienne pas aux statistiques.
Précisons par ailleurs que l’indemnisation est plus délicate en cas d’accident individuel qu’après un accident collectif, lequel fait l’objet d’un traitement différent, en premier lieu de la part des médias.
J’ai préparé à l’intention de la mission d’information un dossier dont je résumerai brièvement le contenu.
Il présente d’abord l’AIVAR, association indépendante qui accueille les victimes de la route – victimes directes ou par ricochet –, et organise à leur intention des groupes de parole et des activités collectives, par exemple des week-ends d’art-thérapie, afin de leur permettre de se reconstruire peu à peu, ce qui est beaucoup plus facile à plusieurs.
Le dossier inclut également des témoignages recueillis auprès des personnes qui ont pris contact avec l’association. Permettez-moi de citer quelques phrases tirées de l’un d’entre eux.
« Ce dimanche matin, dimanche comme tant d’autres, deux coups de sonnette nous sortent du lit. Je me lève, encore engourdie de sommeil et de rêves, je demande : “Qui est-ce ? — C’est la police. Nous venons voir M. X.” Je réponds que nous descendons. Dans le couloir froid, deux policiers en habit de travail nous saluent. L’un d’eux nous tend un morceau de papier découpé dans un brouillon de papier administratif utilisé, où on peut lire un numéro de téléphone. Le policier nous dit de téléphoner à ce numéro – celui de la gendarmerie d’un village alsacien. Je dis alors : “Ce sont les enfants ? Il est arrivé quelque chose ? Ils étaient sortis hier soir. Mais pourquoi devons-nous téléphoner à cette gendarmerie ? – Nous ne savons pas”, répondent-ils. Nous remontons, la tête vacillante, la gorge serrée. On se précipite sur le téléphone. Suit un long temps d’attente avant un contre-appel ; cela dure une éternité. Et, en effet, l’éternité nous attend au bout du fil, mais nous ne le savons pas. Puis le téléphone sonne enfin. Nous sommes assis sur le canapé, à l’endroit même où notre fille était assise la veille vers dix-huit heures trente, attendant un coup de fil de son fiancé pour partir. Notre interlocuteur nous dit : “Ils ont eu un accident. Votre fille est décédée. Son fiancé est blessé. Vous devez aller à neuf heures à la gendarmerie du village. Sincères condoléances.” Le malheur vient d’entrer dans notre vie, une vie paisible, riche d’un bonheur construit chaque jour. Je reste incrédule : comment y croire ? Je vois écrit “vingt-cinq ans” ; je vois que c’est court. Puis je ne sais plus. »
Le dossier souligne également d’autres aspects, dont le fait que, comme je l’ai dit, la prévention passe aussi par une communication respectueuse. « Vous roulez juste un peu vite ; vous l’avez juste un peu tué » ou « Vous avez juste oublié un clignotant ; il est juste un peu mort » : qui pourrait être fier de ces slogans ? Il s’agit d’une campagne officielle de la sécurité routière !
Un autre document énumère ce qui a déjà été fait. Il mentionne notamment le numéro national de l’INAVEM. D’autre part, nous avons réfléchi aux modalités de l’annonce du décès : comment peut-on apprendre par un simple coup de fil que son enfant est mort dans un accident de la route ? Nous nous sommes donc tournés vers les services de police et de gendarmerie, qui ont bien voulu nous entendre : ils travaillent désormais en partenariat avec notre psychologue et à la lumière de notre expérience du terrain. Il s’agit d’une belle réussite ; nous leur en savons gré, car nous savons que leur rôle n’est pas facile.
Nous avons enfin publié un guide, « L’accident de la route : quels droits, quelles aides ? », qui en est à sa deuxième édition. Nous en avons envoyé un exemplaire aux rédacteurs du guide d’accompagnement juridique des victimes de la route. Je regrette qu’ils ne nous aient pas ajoutés à la liste des associations qu’ils y ont dressée.
S’agissant enfin de ce qu’il reste à faire, le 26 octobre 2005, l’ONU a invité ses États membres à célébrer la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Parce que le problème est mondial, nous devrions, comme chaque État membre, mener cette importante action de communication au niveau national.
En outre, nous avons demandé que soit prolongé le congé officiel de trois jours accordé aux parents d’une personne tuée sur la route. Voici la réponse que j’ai reçue d’un chef de bureau : « Un décès est une affaire strictement personnelle et familiale, que l’administration prend néanmoins en compte en autorisant l’agent à s’absenter pour assister aux obsèques et accomplir toutes les démarches nécessaires. L’affliction et la peine s’estompent et se guérissent avec le temps […]. » Cette réponse est citée dans le dossier.
Notre association a reçu plus de deux cents personnes. Nous avons développé une expertise de terrain qui concerne la police, la gendarmerie, les hôpitaux, les tribunaux. Le document que nous vous avons transmis en fait état et énonce nos propositions de manière claire et précise.
Pourtant, il nous est particulièrement difficile de nous faire entendre. Des trente et un responsables nationaux à qui nous avons adressé ce document, neuf en ont accusé réception ! Mais tous ont fait suivre, qui à un collègue ministre, qui au service ou à l’organisme censé être compétent – hormis la cour d’appel de Colmar, qui ne nous a pas compris et a répondu qu’elle ne pouvait pas nous accorder de subvention. En somme, tout le monde se débarrasse de la patate chaude ! Nous n’avons pas de véritable interlocuteur.
M. le président Armand Jung. Voilà pourquoi, plutôt que de vous répondre moi aussi par un accusé de réception, j’ai préféré, Madame, vous donner officiellement la parole dans le cadre de cette Mission d’information. J’ajoute que le dossier que vous venez d’évoquer a déjà été versé à nos travaux. En effet, c’est la seconde fois que vous êtes auditionnée par la Mission, après une première rencontre à Strasbourg.
Mme Monique Fritz. Il s’agissait plutôt alors de prévention.
M. le président Armand Jung. Quoi qu’il en soit, le rapporteur et moi-même avons tenu à ce que vous vous exprimiez par deux fois devant la représentation nationale.
Mme Monique Fritz. Je vous en remercie.
M. Vincent Julé Parade, vice-président de l’association « Victimes et citoyens contre l’insécurité routière ». Notre association œuvre à la fois pour l’aide aux victimes et pour la prévention des accidents de la route.
Le coût économique des accidents a été fort bien analysé par des intervenants beaucoup plus compétents que moi. J’ajoute toutefois que lorsqu’un jeune de vingt ou vingt-cinq ans meurt sur la route ou s’y trouve grièvement blessé, cela réduit brutalement à néant les espoirs que la société tout entière plaçait en lui et l’investissement concret que ces espoirs avaient favorisé et que la société avait consenti. Un haut gradé de l’armée a ainsi souligné devant nous le coût de l’accident qui frappe un futur pilote de chasse, dont la formation est extrêmement onéreuse. Cet aspect du coût des accidents est rarement évoqué.
Quant au coût social, j’ai beaucoup apprécié la conclusion de Mme Hours : les accidents de la route sont un facteur aggravant de l’inégalité. De fait, il ressort de notre travail quotidien avec les victimes une inégalité flagrante face aux accidents, qu’il s’agisse de l’accueil immédiat, de l’accompagnement auquel les victimes ont droit ou de leur avenir. Ainsi, la répercussion sociale d’un accident diffère selon que l’on appartient ou non à une famille favorisée. Face à une tétraplégie, à un handicap particulièrement lourd, des parents défavorisés ne pourront réagir de manière appropriée, ne serait-ce que du point de vue relationnel.
Revenons à l’assistance immédiate, évoquée par Mme Fritz et par M. Freani. Nous le constatons, nous qui accueillons vingt-quatre heures sur vingt-quatre des victimes d’accidents de la route : si, quant à la lettre, la France a su se doter d’une charte d’accueil des victimes en milieu hospitalier, sur le terrain, ce texte n’est pas appliqué – faute de moyens, bien souvent, plutôt que par mauvaise volonté. Combien de parents, parmi ceux que nous accueillons, sont reçus aux urgences, entre deux distributeurs de boissons, par un interne débordé ? Les personnels soignants ne sont pas en cause, mais bien plutôt, je le répète, le manque de moyens.
De même, le décès est le plus souvent annoncé à la famille à domicile par les représentants de l’ordre public, lesquels repartent rapidement parce qu’ils considèrent que leur mission est accomplie et parce qu’ils ne savent comment réagir aux effets de leur démarche. Il faut donc mieux former les services de police et de gendarmerie, ainsi que les personnels soignants urgentistes.
En outre, l’accident jette bien souvent les familles dans les dédales d’un système judiciaire qu’elles ignoraient jusqu’alors totalement. C’est l’un des intérêts du guide que nous proposons. Parce que votre enfant a été victime d’un accident grave, vous découvrez soudain la différence entre l’action pénale et l’action civile, sans bien comprendre d’ailleurs pourquoi vous êtes parfois devant le juge civil, parfois devant le juge pénal. Autre question : est-on tenu de faire appel à l’accompagnement juridique proposé par son assureur ? Voilà un point sur lequel les familles sont souvent mal informées. Or, elles ont le droit de savoir qu’elles sont autorisées à recourir à une expertise indépendante.
M. le président Armand Jung. Pourriez-vous transmettre à la mission un exemplaire de ce guide ?
M. Vincent Julé-Parade. Volontiers.
S’agissant du rapport du groupe de travail réuni par la Chancellerie afin de mieux accompagner les victimes de la route, plusieurs points méritent d’être soulignés. D’abord, l’information immédiate doit être pertinente et synthétique. Les associations réalisent des plaquettes d’information, mais tous les commissariats, toutes les gendarmeries n’en disposent pas ; ne faudrait-il pas réfléchir à un outil plus simple et plus systématique ?
Quant à l’accompagnement au cours de la procédure, il a été proposé de créer des cellules spécialisées dans le contentieux routier. On touche là à un autre aspect de l’inégalité entre victimes de la route : selon la juridiction qui instruit le dossier, les magistrats connaîtront plus ou moins bien ce domaine juridique, particulièrement pointu et technique. Pour mesurer l’importance de la spécialisation des magistrats, il n’est que de comparer, dans un autre domaine, les décisions rendues en matière de procédure par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui n’est pas spécialisée, et celles de la deuxième, qui l’est.
J’en viens à la place de la victime en instance pénale. Dès la première instance, une mesure simple permet souvent d’apaiser la souffrance et la frustration qu’a exprimées M. Freani : le président peut donner la parole à la partie civile, et non simplement à son conseil. Il s’agit d’un usage, non d’une obligation ; mais cela donne aux victimes le sentiment d’être entendues.
En ce qui concerne l’indemnisation, la fameuse nomenclature Dintilhac – du nom du président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui l’a établie – est de plus en plus utilisée par les juridictions du fond. Ne peut-on aller plus loin ? Le groupe de travail appelle ainsi de ses vœux un décret tendant à généraliser son usage. Cela permettrait d’identifier plus clairement les postes de préjudices réparables.
J’évoquerai enfin un cas problématique, qui résulte du régime d’indemnisation défini par la loi Badinter du 5 juillet 1985. Il s’agit du statut du conducteur victime. Actuellement, la garantie du conducteur n’est qu’une option du contrat d’assurance. Ainsi, nous sommes quotidiennement témoins de la situation dramatique dans laquelle se trouvent de jeunes conducteurs qui se sont « plantés » tout seuls et qui ne bénéficient donc d’aucune indemnisation, ce qui compromet leur réinsertion sociale. Ce problème s’était déjà posé aux rédacteurs de la loi de 1985, notamment au professeur Tunc. Il faudrait donc s’efforcer de ne plus faire de différence entre la victime conducteur et la victime non-conducteur, tout en conservant la clause d’exonération en cas de faute inexcusable et cause exclusive de l’accident.
Je transmettrai une note écrite à la Mission d’information.
Me Laurent Hincker, avocat. On l’a dit, la loi Badinter indemnise, mais répare rarement. Voilà qui étonne le spectateur – faussement naïf – de l’appareil judiciaire que je suis. Comment remédier aux limites de ce texte ? Comment réparer au-delà de l’indemnisation ? Tel est aujourd’hui l’enjeu. Ainsi, les victimes d’un accident causé par un tramway circulant sur une voie qui lui est propre ne sont pas automatiquement indemnisées, ce qui peut paraître incongru, par exemple lorsque l’accident survient dans une cour urbaine, où il peut être difficile de distinguer la voie propre du trottoir.
D’autres problèmes sont posés par les délais d’indemnisation, évoqués par M. Freani : il faut parfois attendre plusieurs mois la première provision, ce qui oblige à avancer de l’argent. Les choses s’aggravent lorsque les victimes osent aller jusqu’au procès. Car l’indemnisation est censée éviter le procès : telle est la position des assurances. En outre, les experts d’assurances ne sont pas indépendants, puisqu’ils sont payés par l’assureur. Cette absence d’un expert indépendant au côté des victimes relance un débat fondamental : celui qui oppose la procédure accusatoire, selon laquelle chacun serait assisté d’un expert indépendant, au recours à des experts supposés compétents au motif que leur nom figure sur une liste.
Ces violences institutionnelles s’ajoutent à la violence initialement subie par les victimes. Je songe à cette personne qui, après le décès de son enfant, a trouvé une proposition d’indemnisation griffonnée sur un papier glissé dans sa boîte aux lettres. Il en résulte une immense frustration.
En outre, les victimes ont rarement accès au dossier pénal par le biais des assurances, ce qui les conduit à faire appel à un avocat. Sans compter la manière dont l’appareil judiciaire, débordé, règle le litige. Je songe à cette famille qui est venue me trouver la semaine dernière : lors de la médiation pénale qui lui avait été proposée, le chauffard qui avait renversé son enfant – ne fracassant heureusement que son casque – avait été incapable de formuler ne serait-ce qu’une parole d’excuse. Voilà pourquoi cette famille voulait un procès. Dans un cas comme celui-là, ce n’est pas la victime directe qui est en jeu, mais bien les victimes par ricochet, littéralement fracassées sur le plan psychique.
Nous voilà reconduits au fameux syndrome post-traumatique, qui n’est reconnu en France ni par les experts ni par les médecins. Heureusement, le préjudice d’anxiété défini par la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’amiante nous fournit une échelle utilisable.
Le procès peut donc être justifié par sa vertu cathartique, à condition, naturellement, d’être bien mené. M. Freani a évoqué un procès exemplaire en première instance – n’était l’intervention de l’avocat de la compagnie d’assurance, qui a accusé la grand-mère de profiter du décès de son petit-fils pour réclamer une indemnité !
Pour éviter de telles situations, nous considérons, à la lumière de notre pratique professionnelle, qu’il faut distinguer le procès pénal de la considération des intérêts civils, y compris en cas de décès, au lieu de les confondre dans une même procédure, comme on le fait généralement aujourd’hui – sauf en cas de préjudice corporel, où les deux aspects sont dissociés et où l’affaire revient souvent devant le tribunal après expertise.
M. le rapporteur. Ce n’est pas lors d’un décès que l’affaire revient après expertise, mais en cas d’incapacité permanente partielle de travail, par exemple.
Me Laurent Hincker. Je veux simplement dire qu’en faisant cette distinction, on épargnerait aux victimes ces violences institutionnelles que leur infligent des avocats d’assurances d’abord soucieux de défendre les intérêts de leurs mandants.
Dans le cas dont nous parlons, en présence de grands-parents qui venaient de perdre leur petit-fils, un tel débat, jurisprudentiel et technique, était indécent. L’audience devant le tribunal correctionnel de Colmar avait pourtant été, je le répète, extraordinaire. Toutefois, peu de temps auparavant, à Saverne, le juge demandait à des parents désireux d’être entendus si, pour formuler une telle requête, ils avaient été témoins de l’accident qui avait coûté la vie à leur enfant ! La fonction cathartique de la justice ne suppose-t-elle pas que la parole puisse réparer ? Le tribunal n’est pas seulement un lieu où l’on fait du droit ; c’est un lieu où l’on devrait rendre la justice. Mais cela nous renvoie de nouveau à l’alternative entre système accusatoire et système français.
J’ai créé en 1982 la toute première association française d’aide aux victimes, qui a été l’une des associations fondatrices de l’INAVEM. Celui-ci est aujourd’hui une institution. Mais, pour faire leur travail, les associations membres de ce réseau doivent être de véritables fourmis d’administration qui ne cessent de courir après les subventions. Elles ont 30 millions d’euros pour assister les 300 000 victimes qu’elles accueillent chaque année. Que l’on fasse le compte : cela ne représente que 300 euros par victime assistée.
On assiste parallèlement à l’émergence d’associations de défense des victimes – ce qui n’est pas la même chose que l’aide aux victimes. Ces associations ne sont pas institutionnalisées et manquent de moyens. Pour les financer, il faudrait que, en sus des amendes, les auteurs d’infractions acquittent une contribution financière, comme cela se pratique au Québec, afin que l’aide aux victimes ne soit pas seulement à la charge de la collectivité mais dépende de ce que les Québécois appellent la justice restaurative, qui associe l’auteur, la victime et le corps social. Le produit de cette contribution serait directement affecté aux associations d’aide aux victimes ou de défense des victimes.
La prise en considération du préjudice suppose en outre la formation de magistrats spécialisés. Je rappelle, sans vouloir pratiquer l’amalgame, que la remarquable loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales, qui prévoyait une formation de tous les acteurs concernés, n’est pas appliquée sur ce point car le rapport sur lequel devait se fonder cette formation n’a pas été déposé en juin 2011 comme il aurait dû l’être.
Enfin, pour remédier au morcellement que tous dénoncent, il faudrait envisager un lieu de coordination, une sorte de guichet unique qui permettrait aux victimes de mener leurs démarches plus sereinement.
M. le président Armand Jung. Je vous suggère de nous communiquer par écrit, en termes très précis, les modifications législatives ou réglementaires que votre expérience et votre compétence professionnelles vous conduisent à nous proposer.
M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle, Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). Dans le domaine qui nous occupe ce matin, l’action de la DSCR porte plus particulièrement sur l’amélioration de l’accueil et de l’information des victimes ; avec nos partenaires, notamment associatifs, nous avons élaboré un guide de l’accompagnement juridique des victimes de la route, dont il a déjà été question et que je vous remettrai.
La prise en considération des victimes est à la fois un problème de sécurité routière et un enjeu de société. De quoi parlons-nous ce matin ? De la qualité de l’accueil dans les services publics ; de la place des victimes et de leur famille dans la procédure judiciaire ; de la manière de prendre en charge les blessés et leurs familles pour leur permettre de retrouver une vie normale. Autant de questions irréductibles au seul domaine de la sécurité routière.
En ce qui concerne l’annonce d’un décès ou de blessures graves, l’application de la charte de 2002 dépend naturellement de la formation des personnels. Nous y travaillons notamment avec les services de police et de gendarmerie. On l’a dit, leur fonction n’est pas facile. Y a-t-il une bonne manière d’annoncer une très mauvaise nouvelle ? Ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas mieux former les jeunes policiers et les jeunes gendarmes.
Au-delà de cette charte, plusieurs intervenants l’ont dit, nous travaillons avec plusieurs associations afin de coordonner, avec l’INAVEM, les initiatives en matière d’information des familles. Notre guide d’accompagnement juridique est le fruit d’un travail mené avec dix-sept associations de victimes. Assurément, elles pourraient être plus nombreuses encore ; du reste, le panel, déjà relativement large, a vocation à évoluer, et la contribution de l’Association Laurence Fritz sera naturellement prise en considération.
Cet outil reconnu doit être largement diffusé. 30 000 exemplaires sont disponibles et, surtout, le guide est accessible en ligne afin que tous les services concernés puissent s’y référer.
Enfin, madame Fritz, nous ne pouvons nous satisfaire du chiffre de 4 000 morts. Notre objectif est de réduire le nombre de personnes tuées sur les routes, comme les pouvoirs publics l’ont fait depuis 1972, année la plus meurtrière. On ne peut parler d’un droit à un nombre donné de morts, seulement d’une obligation de réduire ce nombre.
Ma collègue Laurence Derrien-Lallement l’a dit hier matin, la communication sur ce sujet est complexe et sensible. Nous avons aussi réalisé une campagne sur les 12 000 vies sauvées grâce à l’évolution favorable du comportement des Français. Quant à la campagne « Juste un peu », je regrette qu’elle ait pu être mal comprise ; il s’agissait au contraire de montrer qu’il n’y a pas de petit excès de vitesse en ville : en roulant à soixante kilomètres-heure en agglomération, on peut tuer un piéton, un enfant, une personne âgée. Voilà qui confirme qu’il faut toujours remettre l’ouvrage sur le métier.
M. le rapporteur. J’aimerais poser une question aux assureurs et au représentant du FGAO. Nous partageons évidemment le point de vue que vient d’exprimer M. Vilbois : on ne peut parler d’un droit à 4 000 tués et à plusieurs dizaines de milliers de blessés. Cela étant, quel est votre avis sur le propos qu’on nous a tenu hier, à savoir qu’il n’y a plus de marge de progrès du côté des conducteurs raisonnables et qu’il faudrait donc s’attaquer au « noyau dur », c’est-à-dire aux chauffards – ce qui est bien sûr plus compliqué ?
M. Lionel Tardy. Monsieur Werner, les parlementaires ont longuement débattu du permis à points et de son allègement. Certains d’entre eux ont fait valoir que le nombre de personnes conduisant sans permis risquait d’augmenter si le système actuel était maintenu.
Vous avez dit tout à l’heure que la conduite sans permis ne résultait guère de l’invalidation du permis à points : elle concerne plutôt des personnes qui n’ont jamais passé le permis ou qui ne l’ont plus depuis longtemps. Or, selon les chiffres que la gendarmerie nationale nous a fournis, parmi les personnes contrôlées, 17 252 conduisaient sans permis en 2006, 20 356 en 2010. Ces mêmes chiffres diffèrent des vôtres en ce qui concerne les personnes conduisant après une invalidation de leur permis, c’est-à-dire alors que leur solde de points est nul : elles auraient été 2 827 en 2006, 6 356 en 2010. Comment expliquer cette évolution alors que le nombre des rétentions a baissé ?
D’autre part, l’idée de vérifier la souscription d’une assurance au moment de l’achat du véhicule constitue une piste très intéressante. Car en la matière comme dans les situations d’addiction, dont nous avons parlé hier, il faut prévenir plutôt que guérir.
M. le rapporteur. Mais cela ne résout pas le problème du stock !
M. Dominique Raimbourg. Je m’adresserai d’abord, à la fois, aux représentants des compagnies d’assurance et à M. Bensmail.
Beaucoup déplorent l’absence d’un corps d’experts indépendants, non missionnés par les compagnies d’assurance. Seul l’expert auprès du tribunal fait exception. N’aurait-on pas intérêt à créer un tel corps ? Certes, cela aurait un coût, mais peut-être apaiserait-on ainsi le climat ambiant et les victimes elles-mêmes, qui regrettent de n’être assistées que par un expert proche de l’assureur. D’autre part, une personne qui a contribué à administrer les soins ne pourrait-elle apporter son concours à l’expertise ? Cela permettrait de résoudre le problème mentionné par Mme Hours : l’absence d’un généraliste qui coordonne les interventions des différents spécialistes.
Ma deuxième question s’adresse aux seuls assureurs. La Sécurité sociale intervient nécessairement dès lors que l’accident de la route est aussi un accident du travail, et elle applique à la même blessure un barème différent du vôtre. Cela pose-t-il un problème ?
Ma troisième question est prospective. Comment protéger les conducteurs de deux-roues motorisés ? En bridant les moteurs ? En réduisant la vitesse autorisée ? Il ne s’agit que de pistes, car on sait que de telles mesures sont très impopulaires dans cette catégorie de population.
Mme Françoise Hostalier. Je souhaite revenir sur le témoignage des parents de victimes. Ce que vous avez dit, mesdames, monsieur, m’a profondément bouleversée ; j’étais loin d’imaginer une telle inhumanité. Il est de la responsabilité de la représentation nationale de mettre fin à ces violences institutionnelles, dénoncées par Me Hincker.
Je travaille depuis longtemps sur la maltraitance des enfants et sur les violences faites aux femmes, également évoquées par Me Hincker. Nous sommes parvenus à créer un numéro vert et à accélérer la prise en charge des victimes grâce à une formation spécifique des forces de police et de gendarmerie et à un relais associatif devenu quasi immédiat, par exemple lorsqu’il s’agit de soustraire une femme battue à son milieu. Je suis donc très surprise que la prise en charge des victimes des accidents de la route, accidents auxquels nous sommes tous exposés, demeure aussi lacunaire.
D’autre part, qu’en est-il de la prise en charge des auteurs d’accidents ? On a parlé de la violence volontaire infligée par les mauvais conducteurs, mais le risque de causer un accident de la route n’épargne lui non plus personne : un assoupissement au volant, un instant d’inattention peuvent suffire à faire de tout un chacun un criminel. Et cela aussi peut gâcher une vie.
Je suis également très surprise des lacunes en matière d’assurance que révèle le témoignage de M. Freani. À quoi sert de souscrire des contrats d’assurance si, lorsqu’un accident survient, on est totalement démuni, réduit à avancer les sommes nécessaires au rapatriement du corps de son enfant ? S’il existe, comme on l’a dit, un seuil de toxicité des démarches, n’est-ce pas aux assureurs d’éviter à leurs clients de l’atteindre ?
En outre, ne faudrait-il pas vérifier lors des contrôles non seulement l’assurance du véhicule, mais aussi celle du conducteur lui-même ?
Enfin, l’estimation du coût d’un accident est-elle la même pour un accident de la route et pour les autres types d’accidents – accident du travail ou de la vie, par exemple ?
M. François Werner. La question de M. le rapporteur est délicate, car nous ne pouvons nous fonder que sur notre sentiment et sur l’observation de la population des non-assurés, qui constitue une catégorie particulière. Mais je répondrai plutôt par l’affirmative : il existe en effet une population résiduelle très dangereuse que les campagnes de prévention peinent à atteindre.
En ce qui concerne le permis à points, le nombre de personnes qui perdent leur permis est d’environ 75 000 par an. La durée d’invalidation du permis étant de six mois lorsque le solde de points a été ramené à zéro, cela revient à un stock moyen de 37 000 personnes, ce qui n’est pas très élevé. Les chiffres issus des constats de police établis lors des contrôles routiers sont assez fluctuants, comme le montrent les statistiques de la sécurité routière, car ils dépendent également de la politique de répression en vigueur. Mais les constats consécutifs à un accident corporel, plus systématiques, ne témoignent pas d’une augmentation considérable du nombre de conducteurs sans permis.
N’oublions pas que tous les conducteurs qui ont perdu leurs points n’en informent pas leur assureur, si bien que celui-ci couvre généralement son client, surtout lorsque le sinistre est mineur. Ces conducteurs ne sont donc pas comptabilisés.
Nous proposons pour notre part que l’on vérifie grâce au fichier des cartes grises que chaque carte grise correspond à un contrat d’assurance.
Je précise à l’intention de Mme Hostalier qu’en principe, un conducteur qui monte dans un véhicule assuré est lui-même couvert, sauf cas particulier lié à une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat.
Mme Françoise Hostalier. Mais que se passe-t-il si le propriétaire d’un véhicule, qui l’a assuré, le prête à un étranger et que celui-ci a un accident ?
M. François Werner. Si cette personne a un permis de conduire valide, elle sera couverte.
Mme Barbara Berrebi. J’ajoute que, dans le cas contraire, la déchéance de garantie n’est pas opposable aux victimes. La victime sera donc indemnisée. Libre à l’assureur de former ensuite un recours contre le conducteur. Mais, le véhicule étant assuré, c’est à l’assureur du véhicule qui cause l’accident de prendre l’indemnisation en charge.
M. Dominique Raimbourg. Je crois que Mme Hostalier fait référence au cas d’un conducteur qui se blesserait seul et qui n’aurait pas souscrit de garantie individuelle accident : ce conducteur n’est pas assuré.
Mme Barbara Berrebi. En effet.
Mme Martine Hours. C’est un problème grave. L’absence de garantie du conducteur est responsable de véritables drames humains.
M. Dominique Mignot. Monsieur Raimbourg, de nombreux travaux attestent des comportements à risque chez les jeunes conducteurs de deux-roues motorisés. On a réfléchi aux moyens de les protéger, par exemple par des airbags ventraux. Ces questions seront sans doute évoquées au cours de la table ronde qui sera consacrée à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, pour en revenir à la dimension économique, peut-être faut-il changer de point de vue dès lors que ces conducteurs et, plus généralement, les jeunes sont en jeu. Plutôt que de se focaliser sur le nombre de morts et de blessés, il s’agirait d’insister sur le nombre d’années de vie en bonne santé préservées. Cette logique existe en économie de la santé et bien des pays l’appliquent déjà au domaine des transports. En faisant de même, nous nous intéresserons naturellement aux jeunes, puisque c’est dans leur cas que l’enjeu est le plus élevé, et nous nous concentrerons sur les accidents les plus graves.
M. Louis Fernique. À propos de la conduite sans permis, beaucoup de chiffres divergents circulent. Certains, liés à différents points de vue, présentent un intérêt propre ; d’autres sont totalement fantaisistes.
À l’ONISR, nous nous efforçons, à partir des statistiques de l’accidentalité, qui fournissent des indications assez fiables sur le permis de conduire et l’assurance de chacun des conducteurs impliqués dans un accident corporel, de reconstituer le taux de prévalence de la conduite sans permis et de la conduite sans assurance dans la population totale. Nous cherchons également à en connaître les raisons : si l’on conduit sans permis, est-ce parce qu’on l’a perdu, parce qu’on ne l’a jamais passé ? Notre travail statistique se fonde sur l’observation des seconds conducteurs, c’est-à-dire des conducteurs non responsables, impliqués par hasard dans l’accident : ils nous servent de pseudo-échantillon.
Il ressort des résultats que nous publions chaque année – les chiffres pour 2010 seront disponibles sous peu – que la population générale compte quelque 450 000 conducteurs sans permis. Parmi eux, 20 % environ, soit 90 000 personnes, ont perdu leur permis, que celui-ci ait été suspendu ou leur ait été retiré ; 9 % ne sont pas titulaires du permis correspondant à la catégorie de véhicule qu’ils conduisent ; enfin, 70 % ne détiennent aucun permis, soit qu’ils ne l’aient jamais obtenu, soit qu’ils ne l’aient même jamais passé. Au-delà de cette tripartition, cette population recouvre des catégories très diverses, des personnes qui circulent très peu, parce qu’elles redoutent un contrôle, à celles qui conduisent au contraire beaucoup. Nous venons d’entamer une étude, dont les résultats seront disponibles dans un an, sur les raisons pour lesquelles certains circulent sans aucun permis.
Le nombre de conducteurs sans assurance est sensiblement identique, puisqu’il représente 2,2 % des conducteurs, soit environ 450 000 personnes encore. Naturellement, les deux catégories se recoupent en partie : 1,6 % des conducteurs assurés et environ 32 % des conducteurs non assurés conduisent sans permis.
Ces chiffres, issus d’une estimation à partir d’un échantillon relativement réduit, apparaissent toutefois comme les plus plausibles. Les chiffres en millions qui circulent sont totalement infondés.
M. le président Armand Jung. Merci d’avoir été aussi précis, monsieur Fernique. Les chiffres que nous avons entendus jusqu’à présent allaient du simple au double ou au triple, voire davantage. Or nous devons nous fonder sur les données les plus réalistes, sans quoi nos travaux risquent de rester lettre morte.
Me Laurent Hincker. M. le rapporteur se demandait comment résorber le noyau dur des délinquants qui ne sont sensibles ni à la pacification, ni aux slogans de prévention. Il s’agit, comme dans d’autres domaines, de passage à l’acte violent : on parle de violences routières comme on parle de violences conjugales, et les délinquants sont souvent les mêmes.
Il est possible de travailler avec ces personnes, à condition de les repérer très tôt et de pratiquer la tolérance zéro lorsque leur pathologie se manifeste pour la première fois – c’est souvent quand ils brûlent un feu rouge, ce qui n’est pas un délit mineur. Cette prise en charge suppose toutefois que l’on dispose d’experts indépendants, compétents en la matière. Ils sont malheureusement rares en France, mais ils existent : je songe à des universitaires avec lesquels je travaille et qui connaissent bien ces cas de passage à l’acte délictueux, qui, au-delà de l’homicide involontaire, constituent des actes de violence contre autrui ou contre soi-même. Ainsi l’association Regain, à Strasbourg, spécialisée dans les violences conjugales, prend-elle en charge à la fois les victimes et les auteurs.
M. le président Armand Jung. Madame Freani, madame Fritz, souhaitez-vous répondre à Mme Hostalier ?
Mme Françoise Hostalier. Je me bornais à une constatation, monsieur le président : j’ai été très touchée et très surprise par le témoignage de M. et Mme Freani. Il ne faut plus que les choses se passent ainsi et les propositions que nous formulerons dans notre rapport doivent y concourir.
Je fais partie de la commission de la défense nationale. Lorsque nous déplorons des blessés graves ou des morts, notamment en Afghanistan, leurs familles sont immédiatement prévenues et prises en charge. Le contexte est très différent ; mais l’inhumanité avec laquelle vous avez été traités, madame, monsieur, est inconcevable.
M. Jean-Pierre Freani. Je vais vous raconter de manière très factuelle ce qui est arrivé.
L’accident est survenu à 16 heures 45. À 22 heures, nous avons été prévenus, non par la gendarmerie, mais par l’employeur de notre fils. Je ne fais pas le procès de la gendarmerie française, mais les gendarmes ne nous ont jamais informés d’un accident qui avait eu lieu à quatre-vingt-quinze kilomètres de chez nous, alors que nous sommes dans l’annuaire et que nous sommes bien connus à Strasbourg.
Nous avons alors appelé l’hôpital de Colmar, distant de soixante-dix kilomètres. Nous n’avons pu être renseignés immédiatement. Puis l’on nous a dit que l’on ne pouvait nous répondre par téléphone : nous devions nous rendre aux urgences de l’hôpital. Nous y sommes arrivés vers 23 heures. C’était une nuit froide d’octobre. Nous nous présentons à l’accueil ; tout le monde s’en va, tout le monde nous fuit.
Arrive un interne qui venait de prendre son service ; il nous conduit dans une salle nue – une table, deux chaises – et nous dit : « J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre enfant est décédé. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’a pas souffert. Je viens de prendre mon service : je ne peux pas vous donner d’autres renseignements. » Une infirmière arrive, lui demande quelque chose ; il sort pour lui répondre ; nous devons aller le chercher.
Nous étions déjà assommés. Mon épouse a eu une crise ; il lui a proposé des médicaments, qu’elle a refusés. Il allait partir ; nous avons demandé à voir le corps. « Attendez, il faut le préparer. » Nous avons attendu là, dans cette salle nue, environ un quart d’heure. Quelqu’un – un infirmier – est venu nous chercher. Nous sommes montés au premier étage. On nous a fait entrer dans une salle rectangulaire : une chaise, une table, et un corps. Et vous, vous êtes là.
Au bout d’un quart d’heure, on vient voir si vous êtes toujours là. Puis, de nouveau, au bout d’une demi-heure. Alors vous partez. Nous sommes sortis par une petite porte ; nous sommes rentrés chez nous.
Avant que nous ne partions, on nous avait dit qu’il faudrait déclarer le décès le lendemain.
Voilà les faits.
Vous l’avez dit, madame : on se croit assuré, mais rien n’est prévu. Notre mutuelle nous a indemnisés quelques semaines plus tard. Notre situation était particulière, car, comme je vous l’ai dit, nous avons enterré le gamin à La Ciotat. Mais le montant de nos débours, demandé par notre assureur, était de 18 000 euros. Comme il a commencé à chicaner sur les détails, nous n’avons pu nous mettre d’accord avec lui. Nous avons été indemnisés pour partie trois ans plus tard. Il se trouve que nous avions les moyens d’avancer ces sommes ; je me mets à la place de ceux qui ne les ont pas.
Je ne fais pas non plus le procès des assurances, mais je constate que l’assureur est informé assez rapidement des circonstances de l’accident par le système Trans-PV. Il peut donc savoir rapidement qui est responsable et évaluer la responsabilité de son client.
Mme Barbara Berrebi. Non.
M. Jean-Pierre Freani. Notre assureur nous a contactés au bout de dix jours pour nous proposer un rendez-vous. Il nous a certifié que la compagnie prendrait en charge tous les frais liés à l’accident et aux obsèques, mais a précisé que nous devions collationner toutes les factures. C’était compréhensible. C’est ce que nous avons fait, toujours, je le rappelle, dans un état somnambulique.
Lorsque nous avons présenté les factures, on nous a fait remarquer que nous avions fait passer deux avis de décès dans la presse, l’un à Strasbourg, où nous habitons, l’autre à Rouffach, où notre gamin travaillait. « Vous comprenez, 450 euros… » Nous avons commencé à nous demander ce qui se passait.
Me Hincker a évoqué le procès. Je me souviens parfaitement de ce qui s’est dit alors. J’ai dit tout à l’heure que le représentant de la compagnie d’assurance avait eu un comportement ignoble : voici pourquoi. Nous avons été obligés – parce qu’on nous a tué un gamin ! – d’acheter un caveau de quatre places à La Ciotat. Nous avions le choix entre l’incinération, la fosse commune et ce trou bétonné dans la terre, de deux mètres sur un mètre, dans lequel on peut mettre quatre cercueils. Nous n’y sommes pour rien ! Cela coûtait 4 200 euros. En plein procès, l’assureur nous dit : « Je vous paie une place, 1 000 euros ; pour le reste, vous essayez d’escroquer l’assurance : vous vous êtes mis d’accord avec vos beaux-parents pour leur payer leur future sépulture ! »
C’était inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes allés au conflit. Et nous avons été indemnisés, mais en partie seulement : l’assureur nous a payé une place, les trois autres sont à notre charge. J’ai les moyens ; je le répète, d’autres ne les ont pas.
Nous sommes des victimes indirectes, des victimes par ricochet. Aujourd’hui, la somme maximale versée par les assureurs aux victimes indirectes, pour préjudice moral et solde de tout compte, est de 25 000 euros. Mesdames et messieurs les députés, dans notre pays, mieux vaut avoir un problème avec le Crédit lyonnais que perdre un enfant !
M. le président Armand Jung. Merci, monsieur Freani, d’avoir apporté ce complément à votre témoignage.
Nous devons conclure cette table ronde. J’ai conscience de ce que cela peut avoir de frustrant, mais toutes les personnes auditionnées peuvent également nous faire parvenir des documents, les plus précis possibles.
Mme Françoise Hostalier. L’une de mes questions est restée sans réponse. L’estimation du coût d’un accident est-elle la même pour un accident de la circulation que pour un autre accident ?
Mme Barbara Berrebi. D’un tribunal à l’autre, le montant de l’indemnisation varie. Voilà pourquoi nous appelons de nos vœux des outils communs d’évaluation de la réparation pour dommage corporel. Cette disposition faisait du reste partie de la proposition de loi Lefrand, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Pourquoi ne pas envisager en outre un référentiel de l’indemnisation, qui permettrait aux victimes d’être indemnisées de la même façon pour un même poste de préjudice, au lieu de cette disparité surprenante d’un tribunal à l’autre ?
M. le président Armand Jung. Merci à tous.
*
* *
Table ronde sur la fatigue et le défaut d’attention comme facteurs d’accidents :M. Jean-Louis Martin et Mme Catherine Gabaude, chargés de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Mme Anne Guillaume, directrice du Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain ; M. Arnaud Grison, directeur général de Cofiroute (Fondation d’entreprise Vinci autoroutes pour une conduite responsable) ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la DSCR ; M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national de la sécurité routière
Vendredi 2 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Notre table ronde a pour thème la fatigue et le défaut d’attention comme facteurs d’accidents. Nous souhaitons, à travers votre expertise et vos témoignages, analyser ces phénomènes de façon plus précise, dans l’optique de formuler des propositions.
M. Jean-Louis Martin, chargé de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Chargé de recherche à l’IFSTTAR, j’ai participé à l’expertise collective consacrée aux dangers du téléphone au volant. Je vous présenterai les travaux relatifs à ce sujet.
Mme Catherine Gabaude, chargée de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Chargée de recherche à l’IFSTTAR au sein du laboratoire Ergonomie et sciences cognitives pour les transports, j’ai participé au comité de pilotage du réseau RESAT (Éveil, Sommeil, Attention et Transports), créé à l’initiative du PREDIT (Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres), de l’IFSTTAR et du CNRS.
Mme Anne Guillaume, directrice du Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain (LAB). Médecin, professeur de physiologie et d’ergonomie, je dirige le laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement humain de PSA Peugeot Citroën et Renault. Ayant été chercheur associé au CNRS, j’ai étudié pendant dix ans la perception et l’attention auditives. J’anime également le domaine d’activité stratégique « Sécurité des usagers de la route » du pôle de compétitivité Mov’eo.
M. Arnaud Grison, directeur général de Cofiroute (Fondation d’entreprise Vinci autoroutes pour une conduite responsable). Directeur général de Cofiroute, je suis aux avant-postes sur les questions de sécurité routière, s’agissant notamment de la vitesse sur les autoroutes. Il y a plus d’un an, lors des rencontres parlementaires que vous aviez organisées avec M. Mariton, je vous avais remis quelques propositions après les drames qui avaient touché notre entreprise. Je suis par ailleurs vice-président de la Fondation Vinci autoroutes pour une conduite responsable, que nous avons également créée à la suite de ces drames.
M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la Délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR). Je vous présenterai quant à moi les réflexions et les actions engagées pour lutter contre le défaut de vigilance sur la route.
M. Louis Fernique, secrétaire général de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR). J’évoquerai pour ce qui me concerne l’hypovigilance et la distraction d’attention, ainsi que leur rôle dans l’accidentalité, en distinguant selon les réseaux routiers.
M. le président Armand Jung. L’un de nos principaux sujets d’interrogation est le téléphone au volant : nous aimerions avoir votre éclairage sur ce point.
S’agissant de la somnolence, je m’interroge sur les transports scolaires de nuit, lorsque les enfants doivent partir le soir et arriver à l’école dès huit heures du matin. Chacun se souvient, par exemple, de l’accident de Beaune. Ces transports, qui ont aussi lieu, de manière récurrente, très tôt le matin, ne posent-ils pas, pour les conducteurs, des problèmes d’hypovigilance ?
Mme Catherine Gabaude. La conduite automobile est une activité banale en apparence car elle est pratiquée par un très grand nombre d’individus – plus de 200 millions en Europe. Mais, lorsque l’on cherche à comprendre pourquoi elle peut conduire à des accidents, on s’aperçoit vite qu’elle recèle un système de régulation très complexe : pour éviter l’accident, un conducteur doit à tout instant adapter son comportement aux situations qu’il rencontre ; les autres conducteurs doivent faire de même.
Si la part des accidents liés à la fatigue ou au défaut d’attention fait débat, il ressort des études que le défaut d’attention est à l’origine d’environ un quart d’entre eux.
La fatigue est une sensation d’affaiblissement physique ou psychique, qui survient lorsque l’on est éveillé, à la suite d’efforts. Elle peut avoir plusieurs causes, physiologique ou pathologique – accumulation d’efforts, maladie infectieuse ou dépression. Cette notion renvoie donc à l’état physiologique et psychologique de l’individu.
Sur le plan physiologique, l’état de vigilance est décrit par l’activité cérébrale. On observe un continuum entre la veille active et le sommeil profond. Il existe différents niveaux d’activité cérébrale, lesquels vont de pair avec certains états potentiellement problématiques pour les régulations nécessaires en conduite automobile – hyperexcitation, distractibilité, préoccupation, fatigue, perte de motivation, ennui ou somnolence. Ainsi, la conduite prolongée dans un environnement monotone, avec peu de trafic et une infrastructure dépouillée – sur une autoroute, par exemple –, peut entraîner de l’ennui, de la fatigue et, pour finir, la somnolence.
La somnolence est un état d’inertie qui peut être dû à la fatigue, à la chaleur ou à un repas trop copieux. Elle atteste une envie irrépressible de dormir, envie dont la réversibilité est difficile et peu durable : lorsque l’on est vraiment fatigué, la somnolence demeure tant que l’on n’a pas dormi. C’est la principale difficulté pour les technologies visant à lutter contre la somnolence : si l’on sait la détecter, il est difficile de maintenir éveillé un conducteur somnolent de façon durable.
Les défauts d’attention surviennent en état d’éveil, alors que le conducteur a un bon niveau de vigilance. Ils sont aussi plus facilement réversibles que la somnolence. Les défauts d’attention se produisent lorsque le conducteur effectue une autre activité : il est alors en situation de « double tâche ». On distingue ordinairement la distraction de l’inattention, distinction peut être critiquable mais qui a le mérite d’être pédagogique : la distraction est due à des facteurs externes, alors que l’inattention est due à des facteurs internes.
Les causes de la distraction sont extrêmement variées. Elles peuvent être externes ou internes au véhicule : il peut s’agir, dans le premier cas, de l’apparition soudaine d’un enfant à vélo et, dans le second, d’une sonnerie de téléphone. Elles sont aussi de différentes natures : visuelle, cognitive ou tactile, ce qui engendre différents types de réaction. Par exemple, une distraction visio-manuelle aura des conséquences sur la trajectoire du véhicule, alors qu’une distraction cognitive affectera les temps de réponse du conducteur. Enfin, la distraction peut être volontaire ou involontaire, en lien ou non avec la conduite.
L’inattention est caractérisée par l’absence de déclencheurs externes au moment où elle survient ; elle est le plus souvent non intentionnelle et liée à la difficulté de canaliser ou de maîtriser ses pensées. Elle survient généralement lorsque la tâche à exécuter est routinière, et ne semble pas exiger une attention particulière de la part du conducteur, ce qui lui laisse l’opportunité de penser à autre chose. L’inattention peut avoir pour cause des difficultés personnelles, telles qu’un divorce, la perte d’un proche ou la perspective d’un achat important.
La caractéristique fondamentale de l’activité de conduite est qu’elle a lieu dans une situation dynamique en constante évolution et sous pression temporelle. Elle requiert à tout instant un contrôle cognitif de la part du conducteur – le contrôle cognitif étant ce qui guide nos choix d’action en fonction de nos buts et des événements externes auxquels nous sommes confrontés. En quelques secondes seulement, le conducteur doit percevoir l’information, l’intégrer, prendre une décision et la mettre en œuvre. Le contrôle cognitif est en ce sens destiné à maintenir un niveau de difficulté acceptable pour la conduite. Le conducteur effectue certaines actions de manière automatique, comme les changements de vitesse, et d’autres de manière très contrôlées, par exemple en situation de dépassement d’un véhicule.
Des régulations avec les autres conducteurs sont aussi nécessaires, puisque l’on ne conduit pas seul mais en coopération avec eux. Le conducteur acquiert en ce domaine une expertise et se dégage des marges de manœuvre pour réguler au mieux son activité : il apprend de ses erreurs.
Le contrôle cognitif joue enfin un rôle dans la performance du conducteur en lui permettant de ne pas mobiliser trop d’attention, quand cela n’est pas nécessaire, dans la réalisation d’une tâche : les facteurs physiologiques et cognitifs sont importants à cet égard. Le conducteur cherche un compromis cognitif ; par exemple, s’il écoute une émission de radio qui suscite son intérêt, il ralentira pour se concentrer au mieux sur les deux activités en cours. Pour atteindre un tel compromis, il peut être soit dans l’anticipation, soit dans la supervision.
Le sentiment de maîtrise de la situation influencera aussi ses décisions : s’il est prudent et qu’il ne se sent pas pressé, il se sentira capable de téléphoner en conduisant.
Malheureusement, ces marges de régulation ont des limites qui, si on les dépasse, mettent en échec le contrôle cognitif et conduisent à l’erreur. Cette notion aide à comprendre les accidents et à mettre en évidence la complexité des relations de cause à effet.
N’oublions pas, enfin, que l’accident peut survenir sans que le conducteur puisse faire quoi que ce soit : il peut être, en d’autres termes, le fruit du hasard.
M. le président Armand Jung. Êtes-vous pour ou contre le téléphone au volant, et notamment le kit mains libres ?
Mme Catherine Gabaude. Je n’ai pas participé à l’expertise collective sur le téléphone au volant.
M. le président Armand Jung. Nous aurons à faire des propositions sur ce point : nous aimerions donc que chacun s’implique un peu.
Mme Catherine Gabaude. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je préfère laisser M. Martin s’exprimer à ce sujet.
Mme Anne Guillaume. Le facteur humain, on vient de le voir, est essentiel dans les accidents. Toutefois, si la fatigue apparaît généralement dans une situation monotone, qui comporte peu de stimuli, le défaut d’attention survient dans une situation complexe et, en ce sens, presque contraire.
J’ai remis un rapport détaillant la façon dont les constructeurs appréhendent le problème, et notamment les défauts d’attention, qui peuvent être nombreux. Les études naturalistiques menées aux États-Unis depuis dix ans permettent ainsi d’observer le comportement habituel de conducteurs via des équipements – caméras et capteurs – installés pendant plusieurs mois dans leur voiture. Elles montrent que le risque lié à l’utilisation du téléphone portable est équivalent à celui que l’on trouve dans les études épidémiologiques– à savoir un taux de 3 ou 4 % –, et ont décomposé cette utilisation en sous-tâches : prendre l’appareil, composer un numéro, parler, raccrocher, ranger l’appareil. Ainsi, le risque d’accident est multiplié par 23 pour l’envoi de SMS, et par 6 pour la numérotation, mais il est nul pour la conversation.
Ces études, menées sur des conducteurs de camions et des conducteurs de véhicules légers, ont révélé que, pour les premiers, qui effectuent de longs trajets, la conversation téléphonique avait même un effet bénéfique, dans la mesure où elle maintient éveillé dans une situation monotone.
M. le président Armand Jung. Parlez-vous de cas où le téléphone est tenu à la main ou de cas où est utilisé un kit mains libres ?
Mme Anne Guillaume. Il n’y a pas de différence pendant la conversation ; en revanche, toute manipulation – numérotation, par exemple – augmente les risques. Mais certains kits à commande vocale permettent de ne jamais manipuler l’appareil.
Ces données, notamment celles qui montrent l’absence de risque pendant la conversation, sont très intéressantes pour les constructeurs, qui travaillent sur l’ergonomie, les commandes vocales et les moyens d’améliorer la présentation des informations dans l’habitacle.
Quant à la vigilance, les constructeurs suivent attentivement les recherches, mais il n’existe actuellement aucune technologie permettant de contrôler, sans capteur, le niveau de concentration du conducteur.
Les constructeurs sont très actifs dans la recherche relative à la sécurité, et développent pour ce faire des études en collaboration avec les universitaires. Ainsi, au sein du laboratoire que je dirige, une équipe étudiera plus spécifiquement les phénomènes de l’attention et de la distraction. Les études naturalistiques que j’évoquais ont été réalisées aux États-Unis : il convient de les mener en France et en Europe.
M. Arnaud Grison. Je souhaite vous faire part de mon expérience à la tête d’une société autoroutière et de ma grande inquiétude pour la sécurité de nos équipes d’intervention.
En quatre ans, trois de nos salariés ont été tués et douze autres blessés, à la suite d’accidents causés par des conducteurs endormis ou distraits, deux causes qui, selon nos chiffres, représentent un accident corporel sur deux et un accident mortel sur trois. Pour les gendarmes, les dépanneurs, les pompiers et nos clients, ces événements sont devenus tragiquement banals. Pas plus tard que mardi dernier, deux de nos agents ont été percutés par un conducteur qui, à quatorze heures, s’était endormi ; par miracle, ils s’en sont sortis avec des blessures légères. Reste que l’on ne peut pas toujours s’en remettre au miracle : il est urgent d’agir.
Sur l’autoroute, nos agents ont, selon leurs propres termes, l’impression d’être sur un champ de tir. Depuis trois ans, nous militons donc pour intégrer les facteurs comportementaux dans les politiques de sécurité routière, au même titre que la lutte contre la vitesse excessive ou la protection des deux roues et des jeunes. La difficulté est que chacun est concerné, partout et à tout moment. Nous avons réitéré nos propositions auprès de la DSCR à l’occasion d’un colloque. Les phénomènes les plus fréquents sont le non-respect de la distance de sécurité, notamment pour les trains de poids lourds, et les franchissements de la bande d’arrêt d’urgence, où nos équipes travaillent toute la journée pour dépanner nos clients.
Loin d’être sanctuarisée, la bande d’arrêt d’urgence est trop souvent considérée comme une « zone de droit à l’erreur » ; ainsi, nos véhicules y sont souvent percutés, avec, comme conséquence, des constats matériels multiples.
La somnolence concerne davantage la conduite sur autoroute, plus monotone, mais elle peut aussi survenir lors des trajets urbains, pour les mêmes raisons que l’on s’endort dans son canapé devant la télévision. Ces cas de figure sont insuffisamment pris en compte dans les politiques de sécurité routière. Certes, depuis douze mois, les médias parlent aussi du problème de la somnolence, et l’opinion ne semble pas l’ignorer : chaque année, il est à l’origine d’un accident ou d’un écart de conduite pour 1,5 million de nos concitoyens. Il s’agit donc d’un enjeu de santé publique, d’autant que, selon les enquêtes, les Français dorment moins et les occasions de déplacement sont de plus en plus nombreuses. Or, comme l’observait Mme Gabaude, on ne peut pas lutter contre le sommeil : lorsque l’on est fatigué, la seule chose à faire est de s’arrêter et de dormir.
Il nous semble donc urgent d’agir. Nous essayons de le faire à notre niveau, à travers la Fondation, des campagnes de presse ou des études, comme celle réalisée cet été avec l’hôpital de Garches pour analyser le phénomène de la somnolence auprès de 3 000 automobilistes. Nous nous efforçons également de sensibiliser la représentation nationale et la DSCR à la nécessité d’intégrer les facteurs comportementaux dans les politiques de sécurité routière.
Nous avons ainsi accueilli avec satisfaction l’annonce du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) au mois de mai dernier concernant le renforcement des sanctions contre les conducteurs – le plus souvent de poids lourds – qui franchissent la bande d’arrêt d’urgence et ne respectent pas les balisages. Trente-deux fourgons de Cofiroute ont été heurtés depuis le début de l’année – le dernier pas plus tard que ce matin, à Ancenis, par une cliente qui prétend n’avoir pas vu le balisage matérialisé par une grande flèche rouge. Le non-respect d’un balisage doit être sanctionné au même titre que le non-respect d’un feu rouge ou d’un stop. Une politique complète en ce domaine doit associer sensibilisation, prévention mais aussi sanction. Nous espérons donc que l’annonce du CISR sera rapidement suivie d’effets.
M. Michel Vilbois. Je rappelle qu’il est interdit de composer un numéro sur un clavier de téléphone, d’envoyer un SMS ou de tenir l’appareil à la main lorsque l’on est au volant. En revanche, aucun État de l’Union européenne n’interdit aujourd’hui l’utilisation du kit mains libres. Il faut faire la part des choses entre la nécessaire vigilance sur la route et les nouveaux usages sociaux de communication : la France ne saurait être le seul État européen à interdire l’utilisation du kit mains libres.
Quant à l’hypovigilance, on ne peut évidemment pas interdire à un conducteur d’être fatigué ; pourtant, la fatigue est un danger. En coopération avec les sociétés autoroutières, nous communiquons pour battre en brèche certaines idées fausses : ouvrir la fenêtre, augmenter le volume de la musique ou boire un café ne peuvent diminuer la fatigue ; le seul remède est de se reposer. Les accidents liés à l’hypovigilance ne surviennent pas seulement la nuit et sur l’autoroute.
Les infrastructures doivent comporter des systèmes d’alerte des automobilistes, comme les bandes de rives sonores certifiées : nous sommes en discussion avec les sociétés autoroutières et l’État gestionnaire pour les installer sur les autoroutes nouvelles. Cette technique n’est certes pas la panacée, mais elle a l’avantage d’être simple.
Dans le cadre du Comité des usagers du réseau routier national, nous réfléchissons aussi, avec les sociétés autoroutières, à l’amélioration de la qualité des aires de repos, afin de donner à l’automobiliste l’envie de s’y arrêter en toute sécurité, notamment la nuit.
Arnaud Grison l’a rappelé, le CISR, lors de sa réunion de mai dernier, a décidé, à juste titre, de sanctionner le franchissement des rives séparatives de la bande d’arrêt d’urgence et le non-respect de l’interdiction de circuler sur les voies réservées : il y va de la sécurité des automobilistes comme des agents des sociétés autoroutières.
Enfin, les véhicules contiennent de plus en plus de technologies embarquées et de systèmes d’aide à la conduite. Les fabricants d’avertisseur de radars ont récemment signé, avec le ministre de l’intérieur, un protocole relatif à la lutte contre l’hypovigilance. Nous n’en sommes qu’au stade des propositions, mais il me semble opportun de réfléchir à l’utilité des GPS en ce domaine. Alors que l’on ne pourra jamais empêcher un conducteur fatigué de prendre le volant, l’infrastructure, l’information embarquée, la sensibilisation et, si nécessaire, la sanction doivent le protéger.
M. Louis Fernique. Je vais m’efforcer de rétablir certaines vérités.
L’hypovigilance est difficile à mettre en évidence lors des accidents car elle requiert un faisceau d’indices. Dans les statistiques d’accidentalité, elle fait l’objet d’un item associant malaise et fatigue mais, les malaises étant relativement rares, cet item prend surtout en compte la fatigue : les gendarmes ou policiers qui le cochent sur la fiche BAACC (bulletin d’analyse d’accident corporel de la circulation) l’estiment déterminant, mais, pour en être sûr, il faudrait conduire une enquête approfondie, de sorte que beaucoup de cas échappent à la compréhension.
Cependant, les chiffres dont nous disposons donnent des résultats sensiblement différents selon les périodes et les réseaux routiers. L’hypovigilance est surtout étudiée sur le réseau autoroutier, où les autres causes d’accident sont rares car il est en lui-même très sûr. Il est donc logique que les accidents liés à l’hypovigilance y soient proportionnellement plus nombreux, d’autant que, je le rappelle, les autoroutes accueillent 25 % du trafic.
Selon le fichier BAACC, le facteur « malaise + fatigue » est mis en cause dans 18 % des accidents sur autoroute – soit beaucoup moins que les 30 % suggérés par des études plus fines. Sur les routes nationales, ce taux n’est plus que de 15 %, et il tombe à 7 % sur les routes départementales et à 3 % sur la voirie communale. Nous venons de lancer une étude avec le docteur Philip, professeur au CHU de Bordeaux, pour mieux appréhender ces différences entre les réseaux.
De 2000 à 2010, ces chiffres ont augmenté sensiblement sur les autoroutes – passant de 16 à 18 % – et les routes nationales, mais ils ont diminué sur les autres réseaux. Il y a donc des distinctions à faire.
M. le président Armand Jung. On roule plus vite sur l’autoroute que sur les voies communales : s’endormir à 130 kilomètres à l’heure n’a pas les mêmes conséquences que s’endormir à 30 kilomètres à l’heure.
M. Louis Fernique. Bien sûr, et l’hypovigilance est aussi liée à la monotonie et aux longs trajets. Mais elle n’est responsable que de 9 ou 10 % des accidents sur l’ensemble des réseaux, et non de 30 % comme on a pu le lire en début d’année. Même si ce taux est proportionnellement plus élevé sur les autoroutes, c’est bien sûr les routes départementales que les accidents mortels liés à l’hypovigilance, comme aux autres causes, sont les plus nombreux.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’on croit parfois, l’hypovigilance est surtout un phénomène diurne : sur l’ensemble du réseau, elle est mise en cause deux fois plus souvent le jour que la nuit.
L’IFSTTAR a réalisé une étude cognitive sur l’utilisation du téléphone au volant : ses représentants nous en exposeront les résultats. Quoi qu’il en soit je ne partage pas du tout la position d’Anne Guillaume quant aux études réalisées en Virginie : si elles comportent quelques analyses générales, d’autres ont une portée beaucoup plus limitée, puisqu’elles concernent des truckers dont les conditions de travail sont très différentes de celles des chauffeurs de poids lourds en Europe. Or ce secteur est le seul où ces études ont montré que l’utilisation du téléphone et le recours à d’autres distractions pouvaient être bénéfiques : de l’ensemble des études que nous jugeons pertinentes par rapport au contexte européen, il ressort tout au contraire que la conversation téléphonique au volant représente un danger – en ce sens, l’utilisation du kit mains libres ne change rien.
Cela dit, pour le futur, il faut surtout insister sur l’extrême danger du SMS ou de toute utilisation sophistiquée du téléphone et de ses équivalents, d’autant que les jeunes, qui passent aujourd’hui leur examen du permis de conduire, préfèrent désormais ces modes de communication à la conversation orale. Comme on l’a dit, la manipulation des appareils, qui mobilise durablement la vue, multiplie les risques par 20.
L’étude globale qui a été menée montre que l’utilisation du téléphone au volant multiplie les risques par 3. Mais avec un taux de prévalence de 6 % – dont 4 % pour le kit mains libres –, la part attribuable à cette pratique dans l’accidentalité corporelle atteint 10 %. D’une façon générale, c’est moins le niveau de risque que l’ampleur de la prévalence qui explique la part attribuable à la plupart des pratiques dangereuses dans l’accidentalité.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Les préconisations du CISR de mai dernier prévoient d’étudier avec les opérateurs les moyens techniques de limiter, pendant la conduite, la conversation téléphonique. Cependant, à moins de demander aux fabricants de construire des appareils à seule commande vocale, le problème de la composition du numéro reste entier, même avec un kit mains libres.
Mme Anne Guillaume. La commande vocale, si le numéro est enregistré dans votre téléphone portable, vous dispense de composer ce numéro vous-même.
M. le rapporteur. Oui, mais il s’agit alors d’une démarche volontaire. La question est de savoir si, en plus de la limitation de la conversation dans la durée, il faut rendre techniquement impossible la manipulation du clavier. Vous dites, madame Guillaume, que la conversation ne comporte pas de risques, ce que plusieurs interlocuteurs contestent. Mais vous conviendrez que la composition manuelle des numéros présente un danger.
M. Jean-Louis Martin. M. Fernique a bien résumé les conclusions de l’expertise collective encadrée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Outre l’établissement d’une bibliographie complète, cette étude a permis de réunir dix spécialistes de plusieurs disciplines. Les travaux expérimentaux ont révélé les différentes perturbations de l’attention liées à l’utilisation du téléphone au volant, et quantifié ces données selon des populations spécifiques. Nous avons également analysé les études épidémiologiques qui nous semblaient les plus sérieuses. La première, réalisée au Canada, date de 1997 ; elle montre que l’utilisation du téléphone présente un risque accru d’accident de 4 à 5. Il est vrai qu’elle ne distingue pas entre les différentes phases d’utilisation –conversation et composition du numéro –, ce qui peut être utile dans la recherche de solutions préventives. Quoi qu’il en soit, la composition du numéro présente un « sur-risque ».
M. le rapporteur. Cette étude dit-elle combien d’accidents seraient évités si l’on interdisait l’utilisation du téléphone ?
M. Jean-Louis Martin. Non. Nous sommes amenés à décomposer les résultats des études, car il n’en existe aucune du même genre en France, en raison de la difficulté à les réaliser. Les estimations de risque ont été rapportées à la prévalence du phénomène dans notre pays, mesurée par l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR). Le chiffre de 6 %, qui a peu évolué, nous paraît fiable. On peut ainsi évaluer, non le nombre de morts, mais le nombre d’accidents évités.
L’étude australienne de 2005, qui portait sur les accidents corporels, a suivi la même méthodologie et a donné les mêmes résultats que la canadienne qui, elle, portait sur les accidents matériels.
Aucune de ces deux études n’a révélé de différence entre l’utilisation du téléphone classique et le kit mains libres, ce qui ne veut assurément pas dire qu’il n’y en ait pas.
M. le rapporteur. Le débat est de toute façon derrière nous, puisque la manipulation du téléphone au volant est une infraction. Estime-t-on qu’il n’y a pas de différence, ou n’a-t-on pas étudié les différences ?
M. Jean-Louis Martin. Selon les études expérimentales, il y a une différence ; les études épidémiologiques d’observation ont envisagé cette hypothèse, sans trouver de différence significative du point de vue statistique.
Mme Catherine Gabaude. Lorsque le conducteur manipule le téléphone, il régule son comportement en fonction du risque.
M. Jean-Louis Martin. Quant aux études naturalistiques dont a parlé Anne Guillaume, je rejoins Louis Fernique : l’effet positif n’a été observé que sur un groupe de camionneurs américains. Dans ces conditions, il me semble difficile de généraliser.
De plus, ces études portent, non pas sur les accidents eux-mêmes, mais sur les événements qui les précèdent et peuvent éventuellement les causer. Leur intérêt est de nous renseigner sur la hiérarchie des risques, s’agissant de l’utilisation du téléphone et de bien d’autres pratiques. Une étude qui permettra d’observer 3 000 véhicules pendant deux ans vient ainsi d’être lancée au États-Unis, ainsi qu’une autre en Europe, portant sur l’observation de 700 véhicules pendant un an ou deux. Nous disposerons ainsi de résultats précis pour identifier les dangers de chacune des tâches et les lier directement au risque d’accident.
M. le président Armand Jung. Des représentants de la police et de la gendarmerie nous ont dit qu’ils ne connaissaient pas précisément le taux d’accidents liés à l’utilisation du téléphone : à moins de trouver le conducteur mort le téléphone dans la main, les causes sont potentiellement multiples et ne peuvent être qu’évaluées. Nous éprouvons donc toutes les difficultés à appréhender les réalités du terrain.
Par ailleurs, à moins de conduire avec une main, il me semble impossible de téléphoner au volant, a fortiori de composer un numéro ou d’envoyer un SMS. Pour ce qui me concerne, seuls les numéros de mes proches sont enregistrés dans mon téléphone mobile.
M. Arnaud Grison. Je tiens à préciser que la question des SMS se pose déjà depuis un certain temps. Une nouvelle étape a été franchie avec la nouvelle génération de téléphones, qui permettent de lire des mails tout en conduisant. Il faut éduquer nos concitoyens aux dangers qui en résultent.
Les technologies embarquées dans les véhicules, quant à elles, sont certes un facteur de progrès, mais elles tendent aussi à accroître la passivité des conducteurs. Or, le temps de réaction joue un rôle essentiel en cas d’imprévu. Quand on téléphone, quand on consulte son GPS, ou quand on regarde la télévision, comme le font les conducteurs de poids lourds, le temps de réaction s’allonge.
Par ailleurs, comme l’observait très justement un gendarme de La Ferté-Bernard, les voitures sont de plus en plus confortables : on regarde le paysage défiler, comme si l’on était assis dans son canapé à regarder la télévision. Là aussi, il y a un danger dont il faut être conscient.
En ce qui concerne les bandes d’arrêt d’urgence, les dispositifs sonores présentent une efficacité pour les véhicules légers, mais ils s’accompagnent d’effets pervers pour les conducteurs de poids lourds : ces derniers les utilisent comme des guides sonores pour savoir s’ils s’écartent ou non de leur trajectoire. Or, on ne voit pas les obstacles quand on conduit à l’oreille. J’ajoute que nous militons pour un marquage continu des bandes d’arrêt d’urgence, suivant l’exemple offert par les autres pays européens, afin d’indiquer clairement qu’il s’agit d’un espace interdit.
Je le répète : nous devons favoriser la prise de conscience des risques, y compris au moment de la formation pour le permis de conduire. Nos concitoyens ne doivent pas seulement connaître les risques de sanction, mais aussi le danger objectif de certains comportements.
M. Louis Fernique. Les études sur le terrain sont difficiles à réaliser. On peut ainsi demander aux opérateurs téléphoniques de vérifier s’il y a eu une communication à l’heure supposée de l’accident, mais celle-ci est difficile à déterminer précisément, surtout en l’absence de survivants. Il faut, en particulier, éviter de confondre un appel au secours après l’accident avec la communication qui a pu être sa cause.
Je demande, pour ma part, une étude systématique de tous les accidents mortels survenant dans notre pays, comme le préconise l’IFSTTAR. Pour cela, nous aurions besoin d’une simplification de la procédure de demande d’information auprès des opérateurs de télécommunications.
Les études de naturalistic driving – « sur le vif » en langue française – sont riches d’enseignements : ce que j’ai retenu, en particulier, des travaux réalisés en Amérique du Nord, c’est que l’acte vraiment dangereux consiste à quitter de vue la « scène de conduite » pendant plus d’une seconde ; en deçà, on arrive à réagir à un événement imprévu sans risque excessif d’accident ; au-delà, à cause d’un SMS par exemple, on entre dans une zone de très grave danger.
M. le rapporteur. Précisons que ces études concernent, plus souvent qu’en France, des véhicules à boîte automatique, ce qui n’est pas neutre.
M. Michel Vilbois. S’il est légitime que la sanction réprime un comportement considéré comme dangereux, encore faut-il qu’il puisse être repéré par les forces de l’ordre. Depuis 2008, il est interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un écran n’apportant pas une aide à la conduite ou à la navigation, et la consultation des SMS est également interdite en situation de conduite, cette infraction étant sanctionnée d’un retrait de quatre points. Or, selon les derniers bilans disponibles, moins de vingt infractions de cette nature ont été constatées sur le plan national. Quand on crée une sanction, il faut être sûr qu’elle pourra être infligée par les forces de l’ordre.
Nous avons engagé, depuis le mois de mai dernier, des discussions avec la Fédération française des télécommunications et des communications électroniques sur les dispositifs susceptibles d’inviter l’usager à s’abstenir de passer des communications quand il est au volant. Un citoyen conscient des risques peut déjà mettre son téléphone en veille, de façon volontaire. On peut aller plus loin grâce à la détection des téléphones dans l’habitacle du véhicule : ils seraient automatiquement mis en veille, l’usager et conducteur disposant alors d’un droit permettant de réaliser un opt out. Les opérateurs de téléphonie ont fait des propositions techniques dont nous allons maintenant discuter avec les constructeurs de véhicules. On peut envisager, grâce à une avancée dans ce domaine et grâce à des actions de communication sur les risques, une réduction importante des communications non souhaitées dans les véhicules.
M. le rapporteur. Il reste à déterminer si l’usage du téléphone au volant, sous la forme du kit mains libres, présente un danger ou non. Même si ce danger est modeste, voire faible, il conduit mécaniquement à un certain nombre d’accidents. Il faut en tirer les conséquences.
Mais on peut se demander s’il ne risque pas d’être difficile pour les constructeurs de faire machine arrière en proposant des véhicules ne permettant plus de connecter les téléphones. Comme je le rappelais hier, on a commencé par fabriquer des véhicules capables de rouler à 250 kilomètres à l’heure, avant de réaliser des études sur des dispositifs permettant de limiter la vitesse.
J’ai bien noté qu’il y avait des travaux en cours, conformément aux décisions du comité interministériel du 11 mai dernier, mais j’ai peur, en vous écoutant, que l’on n’aboutisse à une usine à gaz. Tout cela me paraît bien complexe !
M. le président Armand Jung. Selon les associations que nous avons auditionnées, l’usage du kit mains libres serait responsable de plusieurs centaines de morts par an. Nous n’avons pas les moyens de le vérifier, mais ce que vous nous dites aujourd’hui va dans ce sens. Or, je crains que nous ne soyons rapidement mis devant le fait accompli : toutes les voitures seront bientôt dotées de ce dispositif.
M. le rapporteur. S’il est dangereux, il faut l’interdire, mais la situation n’est pas forcément simple. En région parisienne, par exemple, presque tout le monde téléphone dans les embouteillages – et souvent sans utiliser un kit mains libres. Il faut aussi s’interroger sur l’acceptabilité des mesures.
M. le président Armand Jung. On doit effectivement se poser une double question : une interdiction serait-elle non seulement souhaitable, mais aussi compréhensible ?
Mme Anne Guillaume. Comme je l’ai déjà indiqué, les études dites « naturalistiques », qui ont été réalisées en Amérique du Nord, ont établi que les discussions téléphoniques exercent un effet bénéfique pour les conducteurs de camions, et qu’elles ne s’accompagnent pas d’un risque supplémentaire pour les conducteurs de véhicules légers, du moins en ce qui concerne directement les conversations téléphoniques ; le risque augmente, en revanche, dès qu’on manipule le téléphone et que le regard ne porte plus sur la route – au-delà de deux secondes, le risque devient très important.
On observe aussi que les usagers utilisent encore manuellement leur téléphone en situation de conduite, en dépit de l’interdiction en vigueur.
Je rappelle, en outre, que les constructeurs réalisent des efforts considérables pour intégrer complètement les téléphones portables avec des dispositifs de commande vocale. Il est beaucoup plus facile, en effet, de répartir son attention quand on est engagé dans des activités faisant appel à deux modalités différentes, l’une visuelle et l’autre auditive, que dans l’hypothèse d’une compétition directe entre des activités requérant le même type d’attention, de nature visuelle.
Il me semble, par ailleurs, que les usagers risqueraient d’utiliser manuellement leur téléphone s’il celui-ci était totalement interdit dans les véhicules, ce qui augmenterait naturellement le danger.
Au risque de me répéter, je rappelle aussi qu’il faut développer des études « naturalistiques » en Europe pour mieux apprécier le risque réel du téléphone au volant. Il convient, en particulier, de procéder à des distinctions selon les sous-tâches effectuées : les études épidémiologiques considèrent l’utilisation du téléphone portable de façon globale, alors que les études « naturalistiques » montrent que le risque varie beaucoup en fonction des sous-tâches concernées. Il est considérable quand on rédige un SMS, très important aussi quand on compose un numéro de téléphone, mais il est moindre pendant une discussion téléphonique.
Cela ne signifie pas qu’il faille systématiquement autoriser les conversations téléphoniques au volant : la situation est très différente, en effet, quand on se trouve place de l’Étoile ou bien sur une autoroute – dans ce dernier cas, toute l’attention n’est pas mobilisée par la conduite, et l’on peut très bien en consacrer une partie à une discussion par téléphone. Quand on est à l’arrêt dans un embouteillage ou quand on avance à 5 kilomètres à l’heure, le danger est également faible.
J’ajoute que le risque est très réduit si l’appareil téléphonique est entièrement intégré, c’est-à-dire s’il n’est plus utilisé qu’en mode auditif ou vocal. On peut aussi prévoir un filtrage des appels et des messages d’avertissement – diverses solutions technologiques sont envisageables.
M. le président Armand Jung. Nous nous heurtons déjà à des problèmes nombreux, qui sont liés à la vitesse, à l’alcool, à la drogue, au cannabis ou encore à la somnolence. N’y ajoutons pas le problème du téléphone, dont l’usage au volant va se généraliser lorsque toutes les voitures seront équipées du kit mains libres.
Mme Anne Guillaume. J’aimerais rappeler que les constructeurs travaillent sur l’intégration de ces technologies en toute sécurité, et que des études ont montré l’absence de risque statistique, alors même que nous voudrions vérifier que c’est aussi le cas en Europe.
M. Arnaud Grison. Je considère, pour ma part, qu’on ne peut pas se permettre d’être moins attentif sur autoroute au motif que les tâches sont plus monotones ou que l’infrastructure est plus sûre. Certains vont jusqu’à affirmer qu’on est plus éveillé quand on roule à 200 kilomètres à l’heure…
Or l’imprévu peut toujours se produire, et l’on paie très cher ses erreurs quand on roule très vite. J’ajoute que le champ visuel se restreint quand on téléphone longtemps : on est moins attentif et l’on voit moins les obstacles. On ne peut donc pas dire qu’il n’y ait pas de danger.
Un sondage réalisé en février dernier a montré par ailleurs que, si les conducteurs ont peur du comportement agressif des autres, ils ne s’estiment pas potentiellement agressifs eux-mêmes.
En dernier lieu, j’aimerais rappeler que, si l’on ne peut pas empêcher la fatigue, ni empêcher les gens fatigués de prendre le volant, on peut faire de l’éducation.
M. le rapporteur. S’agissant des autoroutes, la limitation de la vitesse à 130 kilomètres à l’heure vous paraît-elle adaptée ? Certains affirment qu’on pourrait aller plus vite sur ces infrastructures parce qu’elles sont infiniment plus sûres.
M. Jean-Louis Martin. J’ai observé, en participant à des groupes de travail européens, que les Allemands ne souhaitaient pas communiquer les véritables statistiques d’accidents sur les portions d’autoroutes où la vitesse est libre – elles sont restreintes et la vitesse n’y est pas libre en permanence. Nos voisins ont beaucoup de mal avec ce sujet, dont la nature est très politique.
M. Arnaud Grison. Je n’ai pas de raison de remettre en cause cette limitation de vitesse. Selon les gendarmes et les agents de la sécurité routière, elle a permis de réduire le nombre des blessés et des morts sur la route, pour une raison très simple : en cas d’accident, moins on va vite, moins les conséquences sont graves.
M. Louis Fernique. Les limitations de vitesse ont été fixées, à l’origine, pour des raisons techniques. Elles sont ensuite devenues des conventions sociales – il y a, d’un côté, la volonté d’aller vite et, de l’autre, les accidents routiers qui en découlent : dès que la vitesse augmente, l’accidentalité et la mortalité augmentent aussi.
En effet, plus on va vite, plus le temps de réaction diminue, ce qui augmente le risque d’accident ; l’importance des dommages corporels et le risque de mort augmentent aussi, car l’énergie du choc est liée au carré de la vitesse.
Selon le modèle de Nilsson, une variation de la vitesse de 1 % sur l’ensemble d’un réseau routier conduit ainsi à une variation du nombre d’accidents de 2 % et à une variation du nombre de morts de 4 %. Si nous avons évité tant d’accidents et de morts depuis quelque dix ans, c’est parce que la vitesse moyenne a diminué de 10 kilomètres à l’heure. Cela semble peu, mais les gains ont été considérables.
Si l’on augmentait maintenant les vitesses moyennes, d’une manière ou d’une autre, comme l’ont fait certains États d’Amérique du Nord, le nombre d’accidents et de morts serait aussi en hausse. L’introduction d’une tolérance supplémentaire de 10 kilomètres à l’heure, hypothèse assez modérée par rapport à certaines demandes, pousserait les vitesses moyennes à augmenter à terme, ce qui réduirait à néant tous les progrès réalisés depuis une dizaine d’années – cela représenterait des milliers de morts supplémentaires par an.
M. Dominique Raimbourg. Ma première question concernera la position des Allemands. J’aimerais savoir si elle se justifie par leur souhait de vendre des berlines de haut de gamme, capables de rouler très vite, et si cette position a une incidence sur celle des autres États européens.
Peut-on imaginer des véhicules où tout serait contrôlé ? On ne pourrait plus y consulter ses SMS ou ses courriels, les téléphones ne fonctionneraient plus que grâce à des commandes vocales, des alarmes régulières se déclencheraient pour vérifier que le conducteur reste éveillé, comme c’est déjà le cas pour les conducteurs de trains, et un dispositif de limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée (LAVIA) réduirait automatiquement la vitesse à l’approche des chantiers sur les autoroutes. De telles solutions, qui iraient bien au-delà des mécanismes d’éducation et de sanction, dont on perçoit aujourd’hui les limites, vous semblent-elles techniquement et économiquement envisageables ? Est-ce un idéal vers lequel on doit tendre pour améliorer la sécurité routière ?
Mme Catherine Gabaude. J’aimerais revenir sur la notion de multi-activité : on réalise désormais de nombreuses tâches en parallèle, aussi bien au travail que dans la vie quotidienne – quand on regarde la télévision, par exemple, on voit souvent un texte qui défile en même temps sur un bandeau, en bas de l’écran. Il en résulte des phénomènes d’interférences et de compétition entre les tâches.
On peut envisager diverses formes d’adaptation à cette évolution sociale, qui est très forte, mais il y a certainement des limites : la complexité des tâches augmente et les systèmes cognitifs risquent d’être saturés – il y a un danger de surcharge d’information.
Dans ce contexte, il convient de mener des actions de sensibilisation et de prévention auprès des conducteurs pour les informer des dangers de la multi-activité au volant. On peut, en outre, agir sur leur environnement proche : comme Anne Guillaume l’a rappelé, les constructeurs s’efforcent d’intégrer autant que possible les téléphones au sein des véhicules.
J’ajoute que de nombreux travaux de recherche sont en cours sur les ressources attentionnelles des conducteurs afin de déterminer s’ils sont en mesure de conduire tout en effectuant d’autres activités. Il existe, par ailleurs, des projets novateurs d’assistance coopérative à la conduite depuis une dizaine d’années – il s’agit de faire en sorte que la technologie aide véritablement le conducteur dans ses différentes tâches.
J’ai appris, en dernier lieu, que la Délégation à la sécurité et à la circulation routières avait demandé que l’on identifie des priorités à court terme et à moyen terme pour améliorer l’usage du téléphone au volant. Il s’agit, en particulier, d’éviter toute manipulation directe et de faire en sorte qu’on ne téléphone que si les capacités d’attention le permettent. Reste à savoir comment on peut évaluer ces capacités – c’est l’objet de recherches en amont.
M. le président Armand Jung. Une des raisons pour lesquelles cette mission d’information a été constituée est l’incompréhension, à mon avis justifiée, de nos concitoyens à l’égard du système actuel de sanction en cas de dépassement de la vitesse autorisée.
Je suis sensible aux propos de M. Fernique, confirmés par de nombreuses associations, concernant la réduction moyenne de la vitesse au cours des dix dernières années. Cela étant, il convient de faire en sorte que les sanctions soient à la fois compréhensibles et efficaces.
Une première piste serait d’introduire une progressivité des sanctions, grâce à des paliers réguliers, au lieu d’un simple délit de très grande vitesse. Une autre idée consisterait à instaurer une infraction intermédiaire, susceptible d’être mise en œuvre avant le « coup de massue » sur le permis de conduire. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Louis Martin. Pour répondre à la question portant sur les constructeurs automobiles allemands, on peut effectivement penser qu’ils ont un certain poids. Mais, disant cela, je n’exprime pas un point de vue scientifique.
Quant à l’idée d’introduire une graduation plus progressive de la sanction, le danger est une remontée des vitesses du fait d’un changement de comportement des usagers. Les sanctions pourraient certes être mieux comprises, mais il n’est pas certain que cela conduise à un meilleur respect des règles. L’idéal serait de procéder à une expérimentation, mais celle-ci me paraît difficile à réaliser.
M. le président Armand Jung. Je précise qu’il s’agirait de sanctionner de manière différenciée les dépassements de vitesse selon qu’on roule à 52, à 70 ou à 90 kilomètres à l’heure, en évitant bien sûr tout retour en arrière en matière d’accidents.
M. Michel Vilbois. La limitation des communications téléphoniques, volontaire ou contrainte, est techniquement possible, mais cela ne signifie pas que cette solution serait acceptable socialement.
L’idée consistant à fournir aux conducteurs des indications en temps réel sur la limitation de vitesse applicable, sur les dangers éventuels, sur l’évolution du trafic et sur les chantiers en cours semble de plus en plus réaliste – nous y travaillons avec les opérateurs concernés, notamment dans le domaine de la géo-navigation. Il y a là un intérêt commun : des études ont montré que les conducteurs respectent généralement la limite de vitesse applicable quand ils la connaissent. Sans échafauder des scénarios de science-fiction dans lesquels le conducteur n’aurait plus rien à faire, diverses évolutions techniques sont aujourd’hui envisageables.
J’ajoute qu’il existe déjà des seuils en matière de sanctions : celles-ci varient selon qu’on dépasse la vitesse autorisée de moins de vingt kilomètres à l’heure, de vingt à trente kilomètres à l’heure, de trente à quarante kilomètres à l’heure, etc. Il y a déjà une progressivité, avec une différence, en outre, selon qu’on se trouve en agglomération ou non.
Par ailleurs, s’il faut s’interroger sur la connaissance du système par l’usager, il faut aussi prendre en considération le risque de hausse des vitesses moyennes, et par conséquent le risque d’augmentation des accidents.
Le danger d’une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure étant avéré en agglomération, on peut se demander quel message on adressera en rendant plus complexe le système actuel.
Enfin, je rappelle qu’il existe un consensus sur le plan européen quant à l’efficacité du lien entre l’amende financière et la perte de points. Déconnecter ces deux sanctions serait un facteur d’inégalité sociale et d’inefficacité en matière de sécurité routière.
M. le président Armand Jung. Quelle est, selon vous, la sanction la plus efficace. Est-ce l’amende financière ou le retrait de points ?
M. Michel Vilbois. C’est la perte de points. Il existe d’autres enjeux, notamment en matière d’équité sociale, mais ils dépassent largement la question de la sécurité routière.
M. Arnaud Grison. Une réflexion, tout d’abord, sur les véhicules du futur : il faut veiller à ce que les politiques publiques soient adaptées à l’état du parc automobile, qui est à la fois vaste et varié. S’il y a demain en circulation des voitures technologiquement très avancées, la grande majorité du parc demeurera longtemps constituée de véhicules des générations antérieures. Le rythme de renouvellement du parc automobile est, en effet, de quinze ans.
S’agissant de l’assistance apportée par la technologie, il ne faut pas oublier que le conducteur continuera de jouer un rôle malgré tout. Lors d’un récent colloque, un expert en sécurité aérienne appelait ainsi notre attention sur la nécessité d’une bonne formation : nous devons être sûrs que chacun sache bien utiliser les dispositifs sophistiqués à sa disposition – je ne suis pas certain, par exemple, que tout le monde connaisse la différence entre limiteur et régulateur de vitesse. Il faut, en outre, rester conscient de la capacité des êtres humains à détourner les machines de l’usage pour lequel elles ont été élaborées.
M. Jean-Louis Martin. Le système LAVIA, évoqué par M. Raimbourg, vise à fournir au conducteur des informations sur son environnement, notamment la vitesse autorisée là où il se trouve. Une expérimentation est en cours sur la faisabilité du système, mais je pense pouvoir affirmer, sans être un spécialiste de cette question, que les éventuels problèmes techniques seront réglés à terme.
En outre, le système peut être coercitif ou non : on peut envisager que la vitesse maximale soit imposée au véhicule de manière électronique, ou bien qu’elle soit seulement conseillée, avec un avertissement en cas de dépassement.
M. le rapporteur. Force est de constater que l’hypovigilance reste une cause importante d’accident. On peut penser que le phénomène a toujours existé et qu’on ne fait qu’en prendre davantage conscience aujourd’hui, parce qu’on étudie davantage ces questions. Un autre facteur d’explication peut être la monotonie – le paysage défilant lorsqu’on conduit sur autoroute a ainsi été très éloquemment comparé à un programme de télévision. Cela étant, ne pensez-vous pas que les nouveaux équipements des véhicules jouent aussi un rôle ? Dans la mesure où ils constituent un facteur de sécurisation, ne conduisent-ils pas, de manière paradoxale, à une perte de vigilance ? Comment expliquer, plus généralement, la persistance de l’hypovigilance comme cause d’accident, en dépit des progrès technologiques et techniques qui ont été réalisés ?
Mme Catherine Gabaude. Nous avons essayé d’expliquer qu’il y avait non seulement des problèmes de somnolence, mais aussi d’autres défauts d’attention tout aussi délétères. Ne rapportons pas tout à la somnolence pour la seule raison qu’il existe des chiffres relatifs à ce problème sur les autoroutes !
M. le rapporteur. Vous avez raison, ne serait-ce que parce que la plupart des accidents, en particulier les plus graves, ont lieu sur des parcours de routine. Existe-t-il, au demeurant, un rapport entre les deux phénomènes ?
Mme Catherine Gabaude. Le contrôle attentionnel se relâche en effet sur les parcours de routine : comme on croit très bien connaître l’itinéraire, on n’exerce pas une surveillance suffisante.
M. Louis Fernique. Une grande partie des accidents se produisent sur des parcours de routine – ils ont lieu dans le département du conducteur dans 75 % des cas. Mais il ne faut pas oublier qu’on réalise l’essentiel des trajets à proximité de son domicile, c’est-à-dire sur des parcours de routine !.
M. Dominique Raimbourg. Nous venons d’apprendre que les défauts de vigilance sont plus nombreux le jour que la nuit. J’aimerais savoir si c’est seulement parce qu’il y a plus de trafic dans la journée.
M. Louis Fernique. Il y a un décalage considérable : 10 % du trafic circulent la nuit, contre 90 % le jour ; en revanche, 43 % des accidents surviennent la nuit, contre 57 % le jour.
Indépendamment du trafic, le taux de mise en cause de l’hypovigilance dans les accidents est deux fois plus élevé le jour, quel que soit le type de réseau emprunté.
M. Arnaud Grison. N’oublions jamais que les conducteurs sont des êtres humains : ils peuvent commettre des erreurs, même s’ils connaissent les règles, et ces erreurs peuvent avoir de graves conséquences. Chacun a tendance à croire qu’il ne s’endormira pas au volant, qu’il sait maîtriser une vitesse de 150 kilomètres à l’heure et qu’il peut conduire en envoyant un SMS. Nous devons faire prendre conscience à chacun de ses limites, ce qui n’est pas toujours une tâche aisée.
M. le président Armand Jung. Mesdames, messieurs, nous vous remercions. Votre expertise et vos avis nous seront infiniment précieux.
*
* *
Table ronde sur l’aptitude à la conduite : MM. Alain Dômont, professeur de médecine, auteur d’un rapport sur les contre-indications médicales à la conduite, Bernard Delorme de l’unité de l’information des patients et du public de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et Joël Valmain, conseiller technique Europe-International auprès de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR ; Docteur Xavier Zanlonghi, membre du service de l’exploration fonctionnelle de la vision à la clinique Sourdille et membre de la Société française d’ophtalmologie (SFO) ; Mme Sylvie Bonin-Guillaume, professeur de gériatrie (Marseille) et membre de la Société française de gériatrie et de gérontologie ; MM. Claude Marin-Lamellet et Bernard Laumon, directeurs de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Vendredi 2 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Nous procédons depuis plusieurs mois non seulement à des auditions de personnalités politiques et scientifiques sur l’accidentologie routière, mais également à des tables rondes, qui sont une formule dynamique pour faire avancer notre réflexion.
À plusieurs reprises, lors des auditions, l’âge, la vue et, plus généralement, la question de l’aptitude à la conduite ont été évoqués.
Je vous demande de bien vouloir vous présenter puis, lors d’une brève intervention, de nous donner votre point de vue sur le sujet.
M. Claude Marin-Lamellet, directeur de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche). Directeur de recherche à l’IFSTTAR, mes travaux en psycho-ergonomie et sciences cognitives portent sur les phénomènes de vieillissement et de handicap, notamment dans la conduite automobile.
M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’IFSTTAR (ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche). Également directeur de recherche à l’IFSTTAR, j’y suis l’animateur scientifique de la thématique « transports et santé ».
M. Alain Dômont, professeur de médecine, auteur d’un rapport sur les contre-indications médicales à la conduite. Professeur de santé publique et de santé au travail, j’ai été, en 2003, l’auteur d’un rapport sur les contre-indications médicales en matière d’obtention du permis de conduire.
Docteur Xavier Zanlonghi, membre du service de l’exploration fonctionnelle de la vision à la clinique Sourdille et membre de la Société française d’ophtalmologie (SFO). Je suis ophtalmologiste, spécialiste des déficients visuels. Je me suis également spécialisé dans les examens complémentaires et l’exploration fonctionnelle de la vision. J’ai participé au rapport du professeur Dômont.
Mme Sylvie Bonin-Guillaume, professeur de gériatrie (Marseille) et membre de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Professeur de gériatrie à la faculté de Marseille et responsable d’unité de gériatrie, je suis parallèlement enseignante chercheur en neurosciences, spécialisée notamment dans la conduite automobile des personnes âgées et très âgées.
Bernard Delorme de l’unité de l’information des patients et du public de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Je suis pharmacien à l’AFSSAPS, devenue depuis peu l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, où je suis responsable de la cellule « Information des patients et du public ». Je suis également chargé, depuis 2003, d’une mission d’évaluation des effets des médicaments sur l’aptitude à la conduite.
Joël Valmain, conseiller technique Europe-International auprès de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). Je suis le conseiller technique du délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routières pour les questions européennes et internationales. Je souhaite vous apporter l’éclairage européen sur le dossier de l’aptitude, nos voisins se posant les mêmes questions que nous mais y répondant parfois de manière différente.
M. le président Armand Jung. Pouvez-vous maintenant exposer votre point de vue sur le sujet qui nous réunit.
M. Claude Marin-Lamellet. En matière d’aptitude à la conduite, nous évitons, dans le cadre de nos recherches, de nous focaliser sur l’aptitude au sens médical du terme pour considérer, plutôt, la capacité de la personne à réaliser l’activité de conduite. L’aptitude n’est pas le seul élément : il faut également prendre en considération les savoir-faire du conducteur, acquis lors de son parcours, et ses comportements. Ce sont ces trois éléments – aptitude, savoir-faire et comportement – qui définissent la « compétence de conduite », l’important étant leur régulation. Une réduction de l’aptitude fonctionnelle peut être compensée par des stratégies d’adaptation, ce qui permet au conducteur de conserver une compétence suffisante pour conduire en toute sécurité. Ainsi, une personne qui a été victime d’un traumatisme crânien pourra s’adapter en adoptant un comportement approprié, par exemple en réduisant sa vitesse.
Toutefois, cette adaptation suppose que la personne concernée ait non seulement connaissance, mais également conscience de la réduction de ses capacités. Nous nous efforçons donc d’objectiver les stratégies de régulation et d’adaptation et d’analyser la façon dont elles s’expriment en situation de conduite automobile. Nous menons ainsi des expérimentations avec des patients débutant une maladie d’Alzheimer, avec des parkinsoniens ou encore avec des traumatisés crânien, qu’ils soient à peine sortis du centre de réadaptation ou qu’ils aient repris, après deux ans, une activité quotidienne et qu’ils se soient remis à conduire régulièrement : nous voulons comprendre comment ces personnes, si elles y sont arrivées, ont compensé leur nouvel état fonctionnel.
Toutefois, la variabilité individuelle entraîne une grande diversité de situations : l’approche au cas par cas reste la plus efficace même si nous essayons d’établir des groupes cohérents de personnes qui surcompensent, qui ne compensent pas ou qui compensent de manière correcte.
M. Bernard Laumon. Je donnerai quelques chiffres pour situer l’enjeu : l’alcool est responsable d’un tiers des tués sur la route, le téléphone au volant de 10 %, le cannabis de 4 % et les médicaments de quelque 3 %.
La question des médicaments concerne la table ronde de cet après-midi sur les pathologies et l’aptitude à conduire, puisqu’ils sont rarement indépendants de la pathologie. En matière d’insécurité routière, un équilibre est à trouver entre les effets du traitement et ceux de la maladie. L’arrêté de 2005, révisé en 2010, qui établit la liste des affections médicales incompatibles avec la conduite, est une véritable liste à la Prévert, alors que les pathologies sont responsables d’une faible part des accidents, en raison des stratégies de compensation et d’adaptation qui viennent d’être évoquées, et qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt volontaire de la conduite.
Cet arrêté intégrant également l’addiction, notamment au cannabis et à l’alcool, je tiens à rappeler que, en ce qui concerne l’alcool, il faut distinguer son caractère festif, qui ne peut pas être considéré comme une pathologie, de l’alcoolisme chronique qui relève de notre table ronde.
M. Alain Dômont. Il faut dénoncer la médicalisation abusive de problèmes de santé environnementale, dont relève avant tout la sécurité routière, et davantage prêter attention à l’individu lui-même, à son état, à l’environnement dans lequel il vit et aux processus de compensation qu’il mettra éventuellement en œuvre. C’est uniquement dans des situations évidentes d’inaptitude qu’on peut confier au seul médecin la responsabilité d’autoriser ou d’interdire la conduite.
Dans tous les autres cas, il convient de réfléchir en termes de promotion des capacités du conducteur : en effet, si certaines capacités relèvent du médical et du psychologique, d’autres relèvent de ses habitudes ou de son expérience.
Dans la notion d’aptitude à la conduite il faut donc distinguer deux aspects : l’aspect médico-psychologique et celui qui relève du comportement social. On peut avoir des problèmes de santé et être apte à la conduite comme on peut n’avoir aucun problème de santé et être inapte à la conduite. Tous ceux qui se tuent sur la route n’ont pas des problèmes de santé. Il faut rompre avec les clichés pour avancer sur la question des relations entre pathologie et aptitude à la conduite.
La réglementation prévoit, à l’heure actuelle, des contrôles médicaux qu’on croit prédictifs de l’avenir médical de la personne. C’est à tort. Ils ne sont pas pour autant inutiles. En effet, en niant l’impact médical, on laisse évoluer des pathologies vers l’inaptitude alors que l’évaluation devrait viser à prévenir les différentes incapacités en agissant sur elles le plus en amont possible pour permettre aux personnes concernées de conserver leur capacité à conduire. À cette fin, il faut, à un moment ou à un autre, évaluer les compensations médico-psychologiques et fonctionnelles évoquées par M. Marin-Lamellet.
Or, ce n’est pas dans un cabinet médical qu’on peut déterminer l’aptitude à la conduite : c’est au volant. Nous nous trouvons aujourd’hui en France dans une logique d’inversion des dispositifs : tout passe par la médicalisation, en dehors de toute réflexion sur la problématique de fond. N’oublions pas que la société vieillit, ce qui entraînera, à plus ou moins long terme, le développement de pathologies liées à l’âge : il faut donc se préparer à accompagner les personnes âgées à conduire le plus longtemps possible. Des actions préventives de suivi médical sont nécessaires.
En ce qui concerne l’addiction, notamment à l’alcool, les médecins des commissions médicales accompagnent depuis plusieurs années, en vue de les mettre sur la voie de la maîtrise de leur consommation d’alcool, voire de l’abstinence, des conducteurs contrôlés positifs par les forces de l’ordre.
J’ai transmis à votre secrétariat une synthèse praticienne sur cet aspect de la question.
Il convient, enfin, de réfléchir à la notion de responsabilité du conducteur. Tout conducteur est responsable de son état de santé quand il prend le volant, ce qui implique de se poser les questions suivantes : mon médecin m’a-t-il informé de mon état de santé et des effets des médicaments que je prends ? Ainsi, un anesthésiste réanimateur en chirurgie ambulatoire conseille à chacun de ses patients en consultation préopératoire de ne pas prendre son véhicule pour venir ou pour repartir. L’approche situationnelle pose un problème majeur car elle renvoie à la responsabilité des individus. Le corps médical peut aider les conducteurs à prendre conscience de leurs éventuels problèmes afin qu’ils modifient leurs comportements, voire réduisent leur conduite.
Il est nécessaire que le médecin et le psychologue fassent, à la demande des personnes qui s’interrogent sur leur aptitude à conduire, un bilan de leurs capacités. Or, trop souvent, les médecins refusent de peur d’engager leur responsabilité, ce qui laisse ces personnes dans l’angoisse de devoir entrer dans le dispositif mis en place en 1998 et qui prévoit, pour tout conducteur ayant un problème de santé, l’obligation de passer devant une commission médicale de permis de conduire, laquelle peut retirer le permis.
J’ai déjà été sollicité en 1993 sur la question : nous avions proposé des éléments d’évaluation médicale mais nos propositions n’ont pas été reprises. Il en a été de même en 2003, où nous avions amorcé une réflexion approfondie sur l’aptitude à la conduite. Il existe évidemment des contre-indications médicales que les praticiens et les patients doivent connaître.
Docteur Xavier Zanlonghi. Nous ne disposons, en France, d’aucune donnée chiffrée concernant les relations entre les accidents automobiles et les différentes affections. Notamment, nous n’avons pas de statistiques en ce qui concerne les accidents liés à des problèmes de vision. Rien ne corrobore les chiffres qui sont habituellement donnés. Nous ignorons également le nombre de personnes qui conduisent, en France, en infraction à l’arrêté de 2005 révisé en 2010. Une étude américaine ainsi qu’une grande étude française Handicap – Incapacités – Dépendances donnent à penser que quelque 300 000 personnes conduisent en France en infraction à la réglementation – ce chiffre comprend les personnes conduisant avec des lunettes inadaptées. Des études épidémiologiques approfondies restent donc à mener pour connaître le lien entre vision et accidentologie.
Quelques articles, traitant d’une pathologie précise, étudient un surrisque éventuel ou un taux élevé d’accidents. En ce qui concerne la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qui est un problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés, une seule étude au monde concerne dix patients alors que, probablement, 500 000 personnes en France sont atteintes de DMLA avec baisse de vision.
Notre approche est pragmatique : depuis quinze ans nous effectuons, dans un laboratoire, des bilans de conduite. Nous menons également des activités de recherche, notamment avec l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS). Lorsqu’il fut envisagé de réaliser tous les dix ans un bilan médical de tous les conducteurs, nous avons cherché à savoir si les médecins généralistes pouvaient, avec des instruments de mesure très simples, vérifier, dans leur cabinet, que la vision de leurs patients correspondait aux normes exigées pour la conduite. La conclusion fut positive.
Deux catégories de patients ayant une pathologie visuelle viennent nous voir. Outre ceux qui ont déjà le permis, tous ceux qui ne l’ont pas encore et qui veulent savoir s’ils peuvent le passer compte tenu de leurs problèmes de vue. Pour les jeunes qui sont à la limite de la réglementation, nous montons des dossiers avec les auto-écoles, dossiers que nous présentons à la commission médicale départementale. Nous sommes très satisfaits de la directive européenne de 2009 et de sa transposition française puisqu’elle permet désormais à des cas exceptionnels d’obtenir des dérogations, ce qui améliore la place de la personne handicapée dans la société. Nous ne sommes toutefois que deux laboratoires capables de répondre à la question suivante : un déficient visuel qui, en raison d’un nystagmus, n’a que trois-dixièmes, peut-il compenser totalement ou partiellement sa déficience en vision de loin ? La France est sous-équipée en la matière.
La Belgique, avec le CARA (Centre d’aptitude à la conduite et d’adaptation des véhicules), a quinze ans d’avance sur nous. En effet, tous ces cas limites peuvent y obtenir un permis à la carte comportant des interdictions ciblées, inscrites sur le permis : conduite sur autoroute, de nuit ou à plus de cinquante kilomètres de chez soi. Ce permis à la carte permet de remettre sur la route des déficients visuels qui, en France, sont totalement interdits de conduite.
La Société française d’ophtalmologie élabore une recommandation pour aider les professionnels de santé à transcrire dans leur pratique quotidienne l’arrêté de 2010, lequel ne donne aucune précision technique. Nous testons actuellement pour le ministère de la santé les appareils disponibles en France pour savoir s’ils permettent de réaliser les mesures nécessaires.
Mme Sylvie Bonin-Guillaume. J’adhère à la majeure partie de ce qui a été dit concernant les personnes âgées.
Je donnerai également quelques chiffres : si les personnes âgées représentent une part croissante des conducteurs, sur 8 millions de conducteurs ayant plus de soixante-cinq ans, 700 sont mortes en 2010 sur la route.
La conduite est un vecteur de maintien de l’autonomie. C’est un moyen d’éviter la dépendance. Des enquêtes effectuées en France ont montré que conduire permet de réaliser les activités de la vie quotidienne, comme faire ses courses, ou de préserver le lien social – rendre visite à la famille ou à ses amis. Il faut en prendre conscience avant d’envisager des mesures relatives à la conduite des personnes âgées.
M. Marin-Lamellet a eu raison de noter que l’aptitude physique et physiologique ne suffit pas à évaluer la capacité à conduire : c’est particulièrement vrai pour les personnes âgées. Il faut prendre en considération les habitudes antérieures et le comportement routier. Des enquêtes ont du reste montré que les personnes âgées avaient un comportement routier différent de celui des conducteurs plus jeunes : elles commettent moins d’infractions mais plus d’erreurs dues à un défaut de jugement ou d’attention ou à des oublis, certaines de ces erreurs, liées au vieillissement normal de leurs facultés, pouvant représenter un facteur de risque surajouté d’accidents. Toutefois, on ne saurait attribuer à un type d’erreur un surrisque défini. On manque en la matière d’outils d’évaluation.
Il ne faut pas confondre l’âge avec l’aptitude à la conduite. D’ailleurs, certaines des maladies qui sont les plus fréquentes chez les sujets âgés peuvent également toucher des sujets plus jeunes. Il est vrai toutefois qu’on recense plus fréquemment des troubles visuels chez les personnes âgées, du fait, notamment, que, trop souvent, elles ne changent de lunettes que lorsqu’elles les ont cassées : elles portent donc souvent des lunettes inadaptées à l’évolution de leur vue. Les troubles de la mémoire doivent également être pris en considération.
De plus, les médecins généralistes, voire les gériatres, connaissent très peu le cadre législatif et les pathologies à risques en matière de conduite, en dehors des pathologies les plus sévères. Aussi se trouvent-ils souvent démunis pour répondre aux questions qui leur sont posées. Il convient donc de les informer mais également d’informer les personnes âgées elles-mêmes qui, le plus souvent, ignorent qu’elles sont responsables de leur conduite. Nous subissons parfois des pressions de la famille, ce qui rend encore plus complexes les relations, d’autant que nous devons respecter le secret médical. Le rôle du médecin doit être redéfini en termes d’information, de prévention et de stabilisation des pathologies, afin d’améliorer les aptitudes physiques et psychologiques à la conduite.
En ce qui concerne les comportements, nous avons mené, avec l’INRETS, durant cinq ans, une recherche longitudinale sur les conducteurs âgés de soixante-quinze ans et plus, en bonne santé ou dont les maladies étaient stabilisées. Cette étude a permis de dégager trois facteurs prédictifs d’accidents : avoir déjà eu un accident ; avoir commis antérieurement des infractions ; la prise de médicaments. Le conducteur âgé est en revanche moins concerné par les risques dus à l’alcool ou à l’utilisation du téléphone portable au volant.
Bernard Delorme. À l’heure actuelle, en France, 16 000 médicaments sont autorisés dont 9 000 sont commercialisés : un tiers d’entre eux, soit 3 000, ont été identifiés comme ayant des effets potentiels sur la conduite.
Depuis le début des années 2000, nous avons cherché à quantifier cet impact : certains médicaments ont de simples effets transitoires de somnolence – c’est le cas des antihistaminiques ou des antiallergiques – quand d’autres ont des effets très incapacitants – hypnotiques, sédatifs puissants. Nous avons donc mis en place une stratégie de gradation du risque comportant trois niveaux, illustrés, chacun, par un pictogramme, l’objectif étant de cibler les médicaments les plus dangereux – 2 % d’entre eux ont obtenu un pictogramme de niveau 3. Ce travail a tout d’abord été mené à partir des données pharmacologiques issues des essais cliniques, que nous avons ensuite confrontées aux données de la pharmacovigilance : nous nous sommes ainsi aperçus que les traitements antiparkinsoniens, notamment les agonistes dopaminergiques, qui agissent sur le système nerveux central et sont susceptibles d’entraîner des somnolences, peuvent également induire des somnolences brutales. Nous avons alors décidé de prendre également en considération l’impact épidémiologique de ces médicaments en confrontant les bases de données de la sécurité sociale relatives à la consommation de ces médicaments avec les données accidentologiques contenues dans les procès-verbaux de la police. L’étude, très importante puisqu’elle a porté sur 20 % des accidents survenus en trois ans, vient d’être prolongée pour trois nouvelles années. Elle a permis non seulement de connaître le nombre de personnes accidentées prenant tel ou tel médicament mais également d’évaluer la responsabilité des conducteurs accidentés. C’est une première mondiale, puisqu’elle a permis de récolter 75 000 dossiers documentés de conducteurs, qui se partagent pour moitié entre responsables et non responsables.
Nous disposons donc désormais de données objectives permettant de valider notre classification initiale. Aucun médicament nouveau n’a été impliqué et seuls un petit nombre de médicaments, appartenant aux classes 2 et 3, notamment les benzodiazépines – sédatifs puissants –, peuvent être considérés comme dangereux pour la conduite.
L’étude a donc permis de confirmer que les médicaments sont bien responsables de 3 % des accidents mortels, qui sont à comparer aux 4 % des accidents dus à l’usage du cannabis. Le chiffre n’est pas énorme, sans être négligeable. Nous avons également constaté que le facteur accidentogène de ces médicaments était indépendant de la consommation d’alcool : les deux facteurs sont donc susceptibles de s’additionner.
Cette étude n’avait pas pour objectif de stigmatiser le médicament ou le patient qui le consomme en respectant la posologie et dans des conditions normales. En revanche, l’étude épidémiologique a montré qu’une consommation trop élevée ou anormale de médicaments induit des situations à risque, ce qui pose alors la question de la responsabilité de son utilisateur. C’est pourquoi il faudrait peut-être envisager, dans certains cas, le dépistage des drogues licites.
C’est parce que nous souhaitions envoyer des messages didactiques aux professionnels de santé et aux patients, que nous avons eu recours aux pictogrammes. Des efforts sont encore à fournir pour que le médecin qui prescrit un traitement sédatif informe systématiquement son patient des effets de celui-ci sur la conduite. L’observatoire que nous avons mis en place doit être pérennisé pour surveiller l’évolution de la situation et élargi à d’autres données de la sécurité sociale, comme les affections de longue durée. Par ailleurs, si nous avions pu directement récupérer, dans les PV de la police, le numéro de sécurité sociale de la personne accidentée, nous aurions triplé la puissance de notre étude.
Joël Valmain. L’aptitude médicale à la conduite, qui a évidemment une dimension européenne et internationale, est traitée dans le cadre de la directive européenne sur l’harmonisation de la délivrance du permis de conduire au sein de l’Union européenne. Voilà trente ans qu’on en parle. En 2013, il n’y aura plus qu’un seul modèle de permis de conduire. Les examens de code et de pratique sont également en voie d’harmonisation.
Il y a eu trois directives en matière de permis de conduire : en 1980, en 1991 et en 2006 – cette dernière s’appliquera au début de 2013.
La directive prévoit une visite médicale obligatoire et préalable pour la conduite des véhicules lourds, visite qui doit être reconduite de manière périodique. À l’heure actuelle, cette périodicité est à la discrétion des États membres. C’est ainsi qu’en France, le conducteur de véhicules lourds passe une visite tous les cinq ans, tandis qu’en Allemagne, il la passe juste avant le permis, puis à cinquante ans.
Au sein de l’Union européenne, la visite médicale est facultative pour les conducteurs de véhicules légers. Les seuils minimaux d’aptitude à la conduite sont définis par la directive, les États membres pouvant toujours les rendre plus sévères – c’est un principe de base du fonctionnement de l’Union.
Sur le plan médical, les normes de la directive de 1991 sont devenues évidemment obsolètes compte tenu de l’évolution de la médecine et des traitements. C’est pourquoi la Commission européenne, sous l’impulsion de certains États membres, dont la France, a décidé d’actualiser ces normes au plan européen, le permis d’un État membre étant valable dans le reste de l’Union. Cette actualisation a concerné, notamment, les normes en matière d’épilepsie, de diabète et de troubles de la vision ; par ailleurs, des travaux sont en cours pour les maladies cardio-vasculaires, comme du reste en matière d’usage abusif d’alcool ou de drogue ou de dépendance à ces substances. Des groupes de spécialistes et de médecins travaillent sur tous ces sujets au niveau européen.
En France, l’arrêté de 2010, qui a modifié celui de 2005, a pris en compte cette actualisation qui, depuis le début des années 2000, ne vise plus tant à déterminer les catégories de personnes susceptibles de tomber sous le couperet d’une interdiction que de chercher à accompagner les personnes concernées dans leurs capacités de conduite. Cette évolution est partagée par l’ensemble de nos partenaires européens. Il s’agit de trouver un équilibre entre le souci d’assurer une nécessaire mobilité pour tous – y compris les handicapés moteurs et les personnes âgées – et les impératifs liés à la sécurité routière.
L’Europe, en revanche, ne s’occupe pas de l’organisation du contrôle médical qui revient à chaque État membre.
(M. Philippe Houillon, rapporteur, remplace M. Armand Jung au fauteuil de la présidence.)
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. À quel l’âge ce contrôle est-il effectué ?
Joël Valmain. Les situations sont très différentes selon les pays. Certains limitent le permis de conduire à l’âge de soixante-dix ans.Treize États membres sur vingt-sept font passer un examen médical préalable, puis périodique. Parmi les quatorze autres, huit n’en font passer aucun et six se contentent d’un examen médical si la personne déclare sur l’honneur être atteinte d’une affection susceptible d’avoir une influence sur la conduite – c’est le cas de la France. Cette déclaration entraîne souvent un test de la vue, qui peut mener la personne à passer un examen médical plus approfondi.
En ce qui concerne les pays qui font passer un examen préalable puis périodique, les situations diffèrent. L’Espagne fait passer un examen tous les dix ans puis, à partir de quarante-cinq ans, tous les cinq ans. Il en est de même de l’Italie. Certains pays, je l’ai dit, limitent le permis de conduire à soixante-dix ans. Quant à la Norvège, qui ne fait pas partie de l’Union européenne mais qui applique la directive, elle limite le permis à l’âge de cent ans – c’est une exception. Toutefois, à partir de soixante-dix ans, elle exige que le conducteur soit muni d’un certificat médical rédigé par le médecin de famille assurant qu’il ne fait l’objet d’aucune contre-indication.
Selon les pays, le certificat est rédigé soit par un médecin agréé, soit par un médecin administratif, soit par un médecin du contrôle médical. Il peut s’agir également d’une simple recommandation rédigée par le médecin de famille.
Dans les mois à venir, les États membres vont approfondir leurs discussions en vue de tirer les meilleurs enseignements des meilleures pratiques au sein de l’Union.
La France a mis en place, il y a deux ans, une concertation sur l’aptitude médicale à la conduite, qui a très vite modifié son intitulé pour se pencher sur la promotion des capacités de conduite. L’objectif, en effet, n’est pas de fixer une date couperet au droit de conduire mais de déterminer à partir de quel moment il convient d’accompagner un conducteur atteint de certaines pathologies ou de certains handicaps. Quant à la question de l’âge, il faut rappeler que la vieillesse n’est pas une maladie.
Quatre groupes se réunissent : un premier, dédié aux addictions (alcool et drogue), est sur le point de prendre connaissance des résultats d’une étude européenne, qui sera close en octobre 2011, sur tous les aspects de la question – des contrôles routiers à la réhabilitation du conducteur dépendant ; un autre groupe, qui étudie toutes les autres affections, se penche notamment sur la question du permis à la carte ; le troisième traite du contrôle médical en vue d’améliorer son efficacité ; le dernier examine en profondeur la question des distractions auxquelles le conducteur peut être sujet.
Je me réjouis que l’ensemble des personnes qui ont pris la parole avant moi fasse partie de l’un de ces quatre groupes. Nous ferons des propositions concrètes dans les tout prochains mois.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. L’objet de cette mission d’information est, notamment, de savoir si, s’agissant des conducteurs âgés de soixante-quinze ans et plus, nous devons, oui ou non, modifier la législation. Cette question a des implications politiques au sens large du terme que nous ne saurions négliger : d’autres tables rondes ont en effet mis en lumière la notion d’acceptabilité sociale, d’autant que le nombre de personnes âgées ne cessera de croître et que, comme vous l’avez noté, madame le professeur, il est nécessaire qu’elles conservent le plus longtemps possible leur autonomie, la conduite étant un élément primordial en la matière.
Le phénomène des conducteurs vieillissants a-t-il pris une importance telle qu’il justifie l’adoption d’une disposition législative ? Si oui, ne conviendrait-il pas de prévoir une phase pédagogique et de s’orienter non vers une disposition couperet à un certain âge mais plutôt vers un permis à la carte, en fonction des résultats de l’examen médical ?
Certaines personnes auditionnées nous ont dit que, finalement, le conducteur le plus dangereux était le plus apte : c’est le jeune conducteur d’une voiture performante, en pleine possession de ses moyens et qui, se sentant sûr de lui, ne ressent pas le besoin de compenser de quelconques faiblesses.
Cela dit, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans représentent une part très importante des piétons victimes d’accidents.
Mme Sylvie Bonin-Guillaume. Déterminer un âge pour passer une visite médicale risque de stigmatiser une catégorie de la population. Quel âge choisir du reste ? Celui du départ à la retraite, à savoir le vieillissement social ? Soixante-dix ans ? Soixante-quinze ans, l’âge auquel on entre le plus souvent dans des institutions médicalisées ? Quatre-vingts ? Déterminer un tel âge, vous le voyez, serait très difficile.
De plus, comme je l’ai déjà précisé, ce n’est pas l’âge qui détermine les capacités à la conduite mais plutôt les aptitudes médicales et psychologiques, les habitudes antérieures et le comportement routier. Or, le plus souvent, l’âge n’intervient pas dans ces facteurs.
De plus, d’autres chiffres montrent que des conducteurs vieillissants arrêtent volontairement de conduire lorsqu’ils se sentent en difficulté physique, attentionnelle ou d’organisation, si bien que seuls 20 % des personnes âgées de plus de quatre-vingts ans continuent de conduire. Toutes les autres se sont arrêtées toutes seules, les femmes s’arrêtant avant les hommes, et les urbains avant les ruraux, du fait qu’en ville les transports en commun prennent le relais de la voiture particulière.
Il faut absolument prendre en considération la notion de situation de conduite. Encore une fois, en tant que gériatre, fixer un âge me paraît dangereux. Il serait préférable de repérer les profils les plus à risques, mais cela reste difficile parce que nous manquons de données scientifiques précises. Nous disposons toutefois de pistes.
Comme vous l’avez rappelé, ce sont les conducteurs les plus aptes, et donc les plus difficilement repérables, qui sont les plus dangereux.
Par ailleurs, comme vous l’avez également noté, à quatre-vingt-cinq ans, on meurt moins d’un accident de la circulation comme conducteur que comme piéton.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Que faudrait-il faire pour endiguer ce phénomène ?
Mme Sylvie Bonin-Guillaume. Nous avons créé à Marseille un atelier piéton qui a permis notamment de se rendre compte que la durée du feu rouge pour traverser la grande avenue du Prado était insuffisante, une personne âgée se déplaçant à environ un mètre à la seconde. Cet atelier vise également à apprendre aux personnes âgées à adopter un comportement adapté, notamment lorsqu’elles traversent une rue. Les élus locaux peuvent réfléchir aux différents moyens à mettre en œuvre dans les villes pour, au moins, diminuer les risques d’accidents touchant les piétons âgés.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Il est vrai que la détermination d’un âge fixe représente un déchirement. Je le vois en tant que maire : la première fois que des personnes reçoivent une invitation pour le banquet des seniors, elles ressentent un vrai traumatisme !
Toutefois, comment repérer celles qui ont besoin d’un accompagnement ? D’autant que les médecins refusent de s’en occuper alors, pourtant, que le médecin de famille paraît le mieux placé pour détecter un risque éventuel.
M. Alain Dômont. L’intervention du médecin est nécessaire, mais insuffisante parce qu’il examine son patient dans son cabinet. Or l’examen clinique ne permet pas d’analyser les démarches de compensation du conducteur au volant.
La société actuelle fait jouer au médecin un rôle problématique puisqu’on lui demande d’assumer le fait d’interdire à une personne de continuer à conduire pour une raison médicale alors même que la société récuse cette notion d’interdiction.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Il pourrait être simplement à l’origine d’une visite plus approfondie.
M. Alain Dômont. Cette éventualité a été étudiée en 2003 avec l’académie de médecine : elle pose un problème – jusqu’à ce jour insurmontable – de secret médical. Il est aujourd’hui impossible à un médecin de soins de contacter directement la commission médicale des permis de conduire.
Sur le plan pratique, un médecin évalue une maladie ou des incapacités en se référant à des normes qu’on a qualifiées précédemment de normes « à la Prévert » et dont on doute de la cohérence, compte tenu des évolutions de la médecine.
La réglementation française, depuis 2005, a pris en compte les évolutions médicales. C’est ainsi qu’un conducteur de poids lourds ayant eu un infarctus du myocarde n’est plus déclaré définitivement inapte à la conduite d’un poids lourd.
Le médical, je le répète, évalue une dimension clinique – risque de perte de connaissance ou d’accident aigu, vision ou audition insuffisante – sans pouvoir prendre en considération les démarches de compensation que seule la situation de conduite permet d’évaluer. La Belgique qui, comme cela a déjà été dit, est particulièrement en avance sur le sujet, a mis en place un réseau national d’évaluation des conducteurs en situation. Sauf évidence clinique, on ne devrait jamais déclarer une personne inapte à la conduite avant de l’avoir évaluée au volant. Nous avions prévu cette disposition dans notre rapport de 2003 : elle reste d’actualité.
Ce rapport avait également mis en exergue la notion de nécessité essentielle de la vie courante. Dans le cas où une personne inapte à la conduite est en situation de perdre son autonomie, la société peut souhaiter mettre en place, au nom de cette nécessité, un dispositif pour lui permettre de conduire.
Cependant, quand on s’interroge sur le maintien de l’autonomie, cela veut dire que la prise en compte de l’inaptitude a été trop tardive. Car la question de l’âge à partir duquel doivent commencer les contrôles médicaux pose aussi celle de l’impact du diagnostic médical sur le devenir du conducteur. Si l’on attend l’âge de 80 ans, il n’y aura plus aucun espoir de pouvoir accompagner la personne afin de lui permettre de conduire plus longtemps. Il faut donc commencer suffisamment tôt.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Vous seriez donc favorable à l’idée de fixer un âge à partir duquel chaque personne devrait se soumettre automatiquement à une vérification médicale ?
M. Alain Dômont. Parler de « se soumettre automatiquement » à une telle vérification, c’est déjà adopter une approche fondée sur le contrôle et la sanction.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Il ne s’agirait que de vérifier l’aptitude à la conduite.
M. Alain Dômont. La vraie question est la suivante : comment accompagner nos concitoyens afin de leur permettre de conduire le plus longtemps possible ? La réponse ne réside donc pas dans une stratégie d’interdiction ou de contre-indication médicale, mais dans une stratégie d’évitement des contre-indications. Si l’on attend trop longtemps, les gens vont devenir inaptes à la conduite, car plus on vieillit, plus on a de risques de développer un certain nombre de pathologies. L’âge étant responsable d’un certain nombre de dégradations, la notion d’espérance de vie sans incapacité ou sans pathologie est un élément à verser au débat.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Je suis plutôt d’accord avec vous. Mais comment repérer les personnes concernées ? On peut prévoir que tout le monde se soumette à un contrôle – quitte à lui donner un autre nom – à partir d’un certain âge, à l’image de ce qui se passe dans certains pays. Le résultat de l’examen médical indiquerait alors si on est apte à la conduite, inapte, ou apte seulement dans certaines conditions – c’est la « conduite à la carte » qui se pratique en Belgique. Mais si l’on y renonce, par exemple pour éviter de provoquer le traumatisme que vous avez évoqué, il faudra trouver un autre moyen d’effectuer un repérage, et le faire suffisamment tôt pour permettre, à un moment où c’est encore efficace, l’accompagnement des personnes concernées.
Vous formulez des propositions séduisantes, mais il reste à les traduire par des mesures concrètes – en supposant que la réglementation européenne nous permette de faire preuve de souplesse, ce dont nous ne sommes pas encore certains.
M. Xavier Zanlonghi. Plutôt que d’instituer un contrôle médical, pourquoi ne pas prévoir, à partir de 65 ou de 70 ans, une évaluation de la conduite en auto-école, effectuée par un professionnel de la route, à partir d’une mise en situation réelle ? La difficulté, toutefois, serait de disposer de connaissances sur la pathologie du patient. Par exemple, faute d’une formation adaptée, un moniteur d’auto-école ne pourrait même pas se rendre compte qu’il manque à certaines personnes la moitié de la vision sur le côté.
En tout état de cause, le plus important est de mettre le patient en situation de conduire – sur un rond-point par exemple.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Sans la présence d’un médecin ?
M. Xavier Zanlonghi. Les bilans de conduite que je pratique comportent trois séries de conclusions, issues de l’examen médical, des examens complémentaires et de l’évaluation en auto-école. En général, ce sont ces dernières qui priment – du moins en ce qui concerne la vision.
M. Joël Valmain. À un moment donné, il faut certainement prévoir un dépistage ou un repérage.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. On peut aussi choisir de ne rien faire.
M. Joël Valmain. La concertation en cours a d’ailleurs été l’occasion de formuler des propositions concrètes sur ce sujet.
Il faudrait sans doute donner un vrai rôle au médecin de famille, qui connaît bien ses patients, mais cela ne signifie pas nécessairement lui demander de prendre une décision définitive. Certaines personnes, à 65 ans, peuvent être considérées comme déjà trop âgées pour la conduite automobile, tandis que pour d’autres, à 80 ans, cela ne présente aucune difficulté. Pour autant, on peut faire jouer au médecin un autre rôle que celui de censeur.
On a parlé de la mise en situation de conduire. Certaines associations de prévention routière et des grandes mutuelles d’assurance organisent de plus en plus fréquemment des journées destinées à rafraîchir les connaissances des personnes âgées en matière de conduite automobile. C’est l’occasion de rappeler les dernières évolutions du code de la route, de procéder à une évaluation de la conduite, de prodiguer des conseils… Plutôt que de parler de repérage, d’interdiction, de réglementation, il serait peut-être préférable d’insister sur ce travail d’accompagnement, même s’il est plus compliqué.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Et plus coûteux !
M. Joël Valmain. Pas nécessairement, si les médecins acceptent de relayer l’information auprès des patients.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Les stages organisés par les associations sont payants.
M. Joël Valmain. C’est vrai, mais ils ne sont pas d’un coût très élevé au regard de l’avantage qu’ils procurent de pouvoir continuer à conduire en toute sécurité.
Une préoccupation soulevée maintes fois lors de la concertation en cours est de faire en sorte que la liste des pathologies pouvant poser problème par rapport à la conduite automobile, cet « inventaire à la Prévert » dont on a déjà parlé plusieurs fois, soit rendue plus compréhensible – par exemple grâce à l’édition d’un fascicule à destination du grand public. On demande à certaines personnes de déclarer s’ils souffrent d’une maladie incompatible avec la conduite, mais encore faudrait-il qu’ils sachent quelles pathologies sont concernées !
Le même travail devrait être effectué à l’intention de tous les médecins de France, même si on renonce à leur demander de porter un jugement sur l’aptitude à la conduite.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Une solution très libérale serait que toute personne ayant atteint un âge déterminé soit obligée de consulter son médecin et de se rendre dans une auto-école. Chacun étant responsable de son aptitude à la conduite, les deux avis recueillis permettraient aux conducteurs de prendre une décision en connaissance de cause.
M. Joël Valmain. Peut-être ne serait-il même pas nécessaire de prévoir une obligation. Un médecin de famille peut jouer ce rôle.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Il suffirait de justifier d’avoir été consulter.
M. Joël Valmain. Nous ne devons pas stigmatiser cette population – d’autant que, on l’a dit, elle est loin de regrouper les conducteurs les plus dangereux – mais au contraire l’aider à continuer à pratiquer la conduite, de façon intelligente, si nécessaire en imposant certaines contraintes.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. La question n’est pas de stigmatiser, mais de savoir si, oui ou non, il faut prendre des mesures spécifiques.
M. Bernard Laumon. Quand on dresse le bilan des accidents qui impliquent des personnes âgées, on s’aperçoit qu’elles sont surtout dangereuses pour elles-mêmes. La victime est souvent le conducteur ou son épouse – sachant que plus de la moitié des victimes d’accidents sont les conducteurs eux-mêmes. Par ailleurs, il vaut mieux être percuté par un conducteur âgé – qui, statistiquement, circule à une vitesse moins élevée – que par un conducteur jeune, le nombre d’années de vie perdues étant inférieur dans le premier cas…
Je regrette de voir ce débat, qui devrait concerner l’ensemble des pathologies en lien avec la conduite, se focaliser sur celles liées au vieillissement, et sur la question de savoir à partir de quel âge l’aptitude à la conduite devrait faire l’objet d’attentions particulières. On propose une amniocentèse aux femmes enceintes de plus de 38 ans, mais la trisomie 21 peut survenir avant cet âge. Inversement, lorsque l’on a commencé à proposer un dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans, on a renoncé à le faire au-delà de 70 ans – c’est-à-dire à un âge où, pourtant, le risque de le développer est le plus élevé. Cela s’expliquait par un calcul coûts/bénéfices : il semblait inutile, au moins au début, de convoquer des femmes plus âgées, parce qu’elles ne se rendraient pas au dépistage.
Ces exemples montrent que, pour chaque pathologie, le pic d’incidence ne survient pas au même moment et que les conséquences ne sont pas les mêmes selon l’âge. Dès lors, comment pourrait-on fixer un seuil unique pour le dépistage des maladies susceptibles d’affecter l’aptitude à la conduite ? Les apnées du sommeil font partie de la liste dressée par l’arrêté du 31 août 2010, mais la moitié de ces apnées n’est pas diagnostiquée – alors que, quand elles le sont, on peut les traiter –, et, de plus, elles ne constituent pas des maladies propres aux personnes âgées. Cela n’aurait pas de sens de vouloir les dépister à partir de 70 ans ; c’est à 20 ans qu’il faut le faire. Certes, d’une façon générale, le risque augmente avec l’âge, mais il n’existe pas de valeur seuil à partir de laquelle un examen médical présenterait à coup sûr un intérêt. Pour certaines maladies, un tel examen devrait être effectué relativement jeune ; pour d’autres, il pourrait attendre 70 ou 75 ans. Il faudrait réaliser des études coûts/bénéfices pour chaque type de pathologie, ce qui aurait l’avantage d’éviter de stigmatiser les personnes âgées.
D’autres problèmes peuvent également se poser. Ainsi, dans le cadre d’un travail sur les troubles cognitifs chez les personnes âgées, effectué sur trois groupes différents – personnes démentes, prédémentes ou en bonne santé –, nous avons mis au point, en collaboration avec le laboratoire de Claude Marin-Lamellet, un test simple et peu coûteux, pouvant être pratiqué en médecine générale, et susceptible de dépister un trouble de l’attention en lien avec un état de prédémence. Imaginons cependant que l’on généralise ces tests afin de mesurer l’aptitude à la conduite : une personne venue consulter pourrait non seulement se voir retirer son permis, mais aussi, par la même occasion, apprendre qu’elle risque de souffrir de démence sénile ! Un tel diagnostic, dont les conséquences dépassent largement la question de l’aptitude à conduire, ne me semble pas pouvoir être établi lors d’une visite médicale destinée à vérifier cette aptitude.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Vaudrait-il mieux que la personne ignore son état ?
M. Bernard Laumon. Non, mais il serait préférable qu’elle l’apprenne dans un autre contexte.
Par ailleurs, je le répète, fixer un âge unique pour le dépistage des maladies figurant dans l’arrêté de 2010 serait une erreur. Prévoir des âges différents permettrait non seulement de ne pas stigmatiser les personnes âgées, mais aussi d’alléger le dispositif…
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Nous avons besoin de mesures simples, car notre société s’est déjà trop habituée à la complexité. Si nous devons prendre de nouvelles dispositions, elles doivent être compréhensibles pour les 40 millions d’automobilistes.
M. Bernard Laumon. L’examen médical d’aptitude à la conduite pourrait être orienté par le médecin généraliste en fonction des pathologies dont souffre le patient.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. À titre personnel, je ne suis pas favorable à la fixation d’un âge à partir duquel un tel examen serait nécessaire. Il reste que la question a été posée et que nous serons amenés à l’aborder en tant qu’élus.
M. Bernard Laumon. À mes yeux, la détermination de l’état de santé d’un individu relève plus d’un problème de santé publique que de la sécurité routière.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Pourtant, les institutions européennes réfléchissent à cette disposition, que des pays de l’Union appliquent déjà.
Mme Sylvie Bonin-Guillaume. Je suis plutôt d’accord avec les propos qui viennent d’être tenus. La première question que nous devons nous poser est celle du coût d’un dépistage. Dans le cas du cancer du sein, il a fallu arrêter après 70 ans parce que les coûts devenaient énormes. Il en serait de même pour le dépistage d’une incapacité à conduire. Qui va payer ? Dans la mesure où la problématique qui nous occupe relève de la vie quotidienne, et pas seulement de la maladie, cet élément doit être pris en compte.
Cela étant, il ne fait pas de doute qu’une action régulière procure un grand bénéfice, notamment en matière d’information. J’ai avec moi une plaquette appelée « conduire quand l’âge avance » et destinée à être consultée dans les salles d’attente des médecins. La question d’un âge limite pour la conduite y est notamment abordée. Par ailleurs, dans le cadre des journées de prévention routière à destination des conducteurs seniors, des compagnies d’assurance, des automobiles clubs, des mairies se mobilisent pour informer le public. Les règles du code de la route y sont rappelées, des conseils pratiques sont prodigués – par exemple au sujet des sièges pour bébés, qui intéressent les personnes s’occupant de leurs petits-enfants –, des essais sur simulateur, des tests de vision ou d’audition sont proposés à ceux qui le souhaitent. On est donc plus dans le registre de la responsabilisation du conducteur que dans celui de l’obligation ou de la répression, et c’est pourquoi ces journées ont un grand succès au niveau local. La question se pose donc de savoir s’il faut les développer, et avec quels financements.
D’un point de vue médical, une tentative a été faite d’organiser une visite obligatoire assortie d’une évaluation gériatrique complète pour toutes les personnes partant en retraite et jusqu’à l’âge de 70 ans, mais cela n’a eu aucun succès. En effet, la consultation aurait duré en moyenne une heure, ce qui est très long. En outre, les médecins étaient réticents à faire passer des tests spécifiques à des patients qu’ils connaissaient par ailleurs très bien. Ils n’ont pas adhéré à l’expérience, alors même qu’ils étaient rémunérés pour cela.
Il paraît difficile de prévoir une visite de cet ordre pour vérifier la capacité à conduire. En revanche, il serait possible d’inciter les médecins à avoir, avec leurs patients appartenant à une tranche d’âge déterminée, une discussion relative à la conduite automobile, et à renouveler cet entretien, par exemple une fois par an. Aujourd’hui, une telle démarche est encore rare, même si certains spécialistes commencent à aborder cette question lorsqu’ils procèdent à une évaluation gériatrique.
Par ailleurs, il existe des tests permettant d’évaluer les difficultés cognitives d’une personne. Malheureusement, aucun test n’est capable à lui seul de déterminer de façon certaine le risque d’accident. Il faut adopter une stratégie plus complexe, et non seulement réaliser des tests cognitifs pour évaluer l’autonomie du patient, mais aussi interroger son entourage sur sa façon de conduire. Cela étant, si, au sein d’un couple, une seule personne conduit, son conjoint sera réticent à donner l’alerte, car une incapacité à conduire les mettrait en difficulté tous les deux. Il faut parfois en tenir compte.
Les tests ne constituent pas une preuve, mais ils peuvent être complétés par une vérification devant un simulateur – même si cela n’est pas toujours facile pour les personnes âgées –, voire avec un moniteur d’auto-école. Des moniteurs, des orthoptistes ou des psychologues convenablement formés seraient en mesure de réaliser une véritable expertise. Pour autant, est-il possible de la proposer à tous les conducteurs de plus de 60 ans ?
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Des campagnes nationales de communication ont été organisées dans le passé avec un certain succès. Je pense par exemple à la campagne : « Au volant, la vue c’est la vie. » Peut-être serait-il nécessaire de les réactiver.
M. Xavier Zanlonghi. Cela existe toujours.
M. Joël Valmain. Les thèmes abordés changent au cours des années. Ainsi, une campagne consacrée à la somnolence au volant a été menée pendant l’été par la DSCR en collaboration avec les sociétés d’autoroute. L’objectif était de tordre le cou à certaines idées reçues et de montrer que boire du café, ouvrir la fenêtre ou augmenter le volume de la radio ne suffit pas à éviter l’endormissement. Dès que l’on ressent les premiers signes de fatigue, il faut s’arrêter et dormir pendant un quart d’heure.
Des campagnes ont donc lieu régulièrement et les sujets sont renouvelés : il s’agit d’alerter sur l’exposition aux risques, de rappeler les règles et d’expliquer qu’un petit manquement peut avoir des conséquences importantes. Au-delà de la réglementation, l’important est de faire comprendre qu’en conduisant, on met en jeu sa propre vie et la vie des autres. Dès lors, quel que soit son âge, une personne souffrant d’une pathologie doit se poser la question de sa capacité à conduire.
Je ne pense pas que l’édiction de nouvelles règles permettrait de régler tous les problèmes. Le meilleur moyen d’avancer de façon concrète serait d’aider les médecins à accompagner leurs patients pour permettre à ces derniers de surmonter les conséquences de leurs pathologies.
M. Claude Marin-Lamellet. En ce qui concerne l’institution d’une évaluation obligatoire à partir d’un certain âge, d’un point de vue scientifique, l’efficacité de ce type de mesure n’a jamais pu être démontrée. Certains pays organisés en fédération, comme l’Australie ou les États-Unis, laissent aux États une autonomie de décision et de gestion en matière de sécurité routière, ce qui a permis d’effectuer des comparaisons entre les États organisant un screening régulier à partir d’un âge déterminé et les autres. Or, les données d’accidentologie montrent que c’est plutôt dans les États qui n’ont pas prévu de contrôle que l’on observe le moins d’accidents au sein de la population concernée. Faute de justification scientifique, il est donc difficile d’apporter une réponse claire en ce domaine.
À propos du réseau belge du CARA, j’ai noté les différentes étapes des évaluations auxquelles il procède. Lorsqu’une personne se rend dans un de ces centres, elle remplit d’abord un questionnaire d’ordre général, puis elle a un entretien avec un psychologue. Elle se soumet ensuite à des tests neuropsychologiques, à des tests visuo-attentionnels et à des tests de vision, avant d’effectuer un test de conduite sur route, dont la première partie se déroule dans une zone fermée à la circulation. Dans certains cas – notamment lorsque l’on soupçonne que la personne ne serait pas en mesure de faire face à une situation extrême –, on procède à une évaluation devant un simulateur de conduite.
Toutes ces opérations prennent du temps, généralement une journée. L’évaluation est gratuite pour les personnes concernées, car elle est prise en charge par l’État belge. Mais cela représente un dispositif assez lourd.
La décision finale est prise de façon collégiale par le médecin, le psychologue, le neuropsychologue et le driving assessor. Ce dernier n’est pas un moniteur d’auto-école, mais quelqu’un dont le métier est de ne faire que ce type d’évaluation. Souvent, il s’agit d’anciens ergothérapeutes ou d’anciens moniteurs qui ont complété leur formation grâce à des modules universitaires. Notons que de telles passerelles n’existent pas en France.
M. Alain Dômont. La question est de savoir si tout le monde doit se soumettre à une évaluation ou s’il faut prévoir un seuil de déclenchement. Dans certains pays, ce sont les assureurs qui fixent les critères : l’assurance est renouvelée à la condition de pouvoir produire un certificat médical. Le problème est alors celui de la qualité d’un tel certificat, dans la mesure où l’évaluation de l’aptitude à la conduite nécessite des compétences que tous les médecins n’ont pas. Ils n’ont pas été formés en ce sens, alors même qu’ils ont la responsabilité, en vertu de la loi Kouchner, d’informer leurs patients des conséquences de leur maladie et de leur traitement.
On ne peut guère envisager de soumettre tout le monde à un screening. Dès lors, comment identifier les personnes concernées ? Le code de la route offre un début de réponse à cette question, puisque le permis (E)B, nécessaire pour tracter une remorque, doit, à l’instar de l’autorisation délivrée aux conducteurs professionnels, être renouvelé tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis tous les deux ans jusqu’à l’âge de 76 ans, et chaque année ensuite.
Votre question renvoie donc à celle de la validité administrative du permis de conduire, qu’il ne faut pas confondre avec la validité médicale. Lorsque l’on interroge le ministère de l’intérieur sur le nombre de permis en circulation, on obtient une réponse très imprécise – entre 40 et 45 millions –, parce que l’administration n’a pas nécessairement connaissance du décès des titulaires. Il faut donc bien distinguer la délivrance de l’autorisation de conduire, qui est une décision administrative, et le résultat d’une évaluation médicale de l’aptitude à la conduite. Or, aucun médecin, fut-il membre d’une commission médicale, ne peut promettre à son patient qu’il n’aura aucun problème de santé par la suite, ce qui peut poser un problème lorsque l’on cherche à associer une validité administrative à un avis médical. Ainsi, une disposition introduite subrepticement dans le code de la route en 1998 renvoie au conducteur la responsabilité de faire évaluer son aptitude à la conduite. Mais, si ce dernier n’a pas été informé par son médecin traitant, il n’a aucune raison de se présenter devant la commission médicale. C’est donc le médecin qui, in fine, endosse cette responsabilité.
À l’heure actuelle, le permis de conduire n’a pas une durée limitée de validité administrative. Mais la réglementation européenne pourrait imposer de le renouveler tous les dix ans jusqu’à un certain âge, et plus fréquemment ensuite. Le renouvellement serait assorti d’une visite médicale. Or, consulter un médecin n’implique pas que l’on va s’abstenir d’avoir un problème de santé dans les cinq ans ou les dix ans qui suivent.
Un problème de santé n’entraîne pas automatiquement un accident, et avoir un accident ne signifie pas que l’on a un problème de santé. Il existe un phénomène d’autorégulation comportementale : on sait parfaitement qu’un certain nombre de personnes s’arrêtent spontanément de conduire à partir d’un certain âge. Mais certaines le font à tort. Elles pourraient continuer ; toutefois, faute d’évaluation spécifique, elles ont peur de le faire. À l’inverse, certains ignorent complètement leurs problèmes de santé et continuent à conduire alors qu’ils ne le devraient pas. On les retrouve, par exemple, circulant en sens inverse sur l’autoroute.
Il existe donc déjà une réponse à votre question dans la réglementation actuelle : c’est le permis (E)B, assujetti aux contre-indications médicales du groupe léger, et qui doit être renouvelé périodiquement – à un rythme d’ailleurs sans doute un peu trop élevé pour ce qui concerne les conducteurs les plus jeunes. Mais je ne pense pas qu’imposer une visite médicale à tous les conducteurs soit une solution opérationnelle. Il serait préférable d’évaluer les personnes devant leur volant, pour dépister celles qui rencontrent des difficultés à conduire. Une telle solution aurait l’avantage de démédicaliser le problème.
M. Joël Valmain. Le permis (E)B est requis pour conduire de très grosses remorques ; il ne concerne pas en général les simples vacanciers. Cela justifie la mise en place d’un régime similaire à celui du permis poids lourds.
S’agissant de la validité administrative du permis de conduire, elle n’est, pour l’instant, pas limitée en France. Mais, à partir du début de l’année 2013, une directive européenne imposera effectivement une durée de validité limitée pour tous les titres de conduite, comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans la plupart des pays d’Europe, sauf en Allemagne, en Autriche et en Belgique. Les États membres auront le choix de fixer une durée de validité comprise entre dix et quinze ans. Cependant, la directive ne prévoit pas une visite médicale obligatoire. Elle précise simplement que, dans les pays de l’Union – treize, à l’heure actuelle – où un tel examen est effectué de façon périodique, il conviendra de le faire coïncider avec le moment du renouvellement administratif, afin de limiter les contraintes pesant sur le citoyen.
Quant aux conducteurs que l’on retrouve circulant à contresens sur l’autoroute, il ne s’agit pas nécessairement de personnes âgées : les exemples dramatiques que nous avons connus cet été impliquaient, dans les deux cas, des personnes très alcoolisées. En tout état de cause, nous mettons en place des signalisations expérimentales destinées à éviter de tels accidents.
M. Xavier Zanlonghi. Je précise qu’en matière de vision, les mesures qui doivent être faites pour vérifier l’aptitude à la conduite ne sont pas celles que réalisent habituellement les ophtalmologistes. En effet, ces derniers raisonnent œil par œil, alors qu’en matière de conduite on s’intéresse toujours à la vision binoculaire. De plus, il faudrait également mesurer la vision périphérique, ce qui nécessite des appareillages que les trois quarts des ophtalmologistes ne possèdent pas. La vérification de l’aptitude visuelle à la conduite impliquerait donc une consultation ophtalmologique particulière.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Les ophtalmologistes ne seraient tout de même pas les plus mal placés pour la réaliser !
M. Xavier Zanlonghi. Non, bien sûr, dès lors qu’ils disposent de l’équipement adéquat.
Par ailleurs, si l’on souhaite fixer un âge à partir duquel une consultation serait obligatoire, on pourrait choisir celui de la presbytie, dont souffrent 98 % des gens à partir de 50 ans. Lorsque ces personnes consultent un médecin ophtalmologiste, elles sont informées des conséquences de cette affection sur la conduite – comme la difficulté à lire un tableau de bord, ou les problèmes particuliers posés par les verres progressifs –, mais on ne va pas jusqu’à leur tenir un discours sur la sécurité. Quoi qu’il en soit, l’âge de 50 ans est important en termes de santé visuelle.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Monsieur Delorme, j’ai cru comprendre que les patients n’étaient pas nécessairement avisés – ou sinon verbalement – des éventuelles conséquences sur l’aptitude à la conduite des médicaments prescrits par leur médecin. Ne faudrait-il pas le préciser sur l’ordonnance ?
M. Alain Dômont. C’est ce qu’on conseille de faire à la faculté.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Mais les médecins ne semblent pas toujours le faire. Or, ce serait sans doute préférable, ne serait-ce que pour se dégager de sa responsabilité professionnelle.
M. Bernard Delorme. Inciter le médecin à préciser systématiquement le niveau de risque que le médicament fait peser sur la conduite serait en effet une mesure simple à mettre en œuvre. Mais il ne dispose pas nécessairement de cette information au moment de la prescription. Un pictogramme figure sur les boîtes ; mais dans le dictionnaire Vidal, par exemple, l’appartenance d’un médicament à telle ou telle catégorie n’est pas mentionnée – même si une liste des produits pouvant avoir un effet sur la conduite se trouve placée au début de l’ouvrage. Seuls certains logiciels de prescription comportent cette précision.
En revanche, le pharmacien peut jouer un rôle pédagogique important, ce que facilite la présence du pictogramme sur la boîte. Nombre de mes confrères, en officine, assument parfaitement cette démarche. Cela étant, la transmission de l’information pourrait probablement être améliorée au moment de la prescription.
M. Claude Marin-Lamellet. En ce qui concerne plus particulièrement les benzodiazépines, des études récentes ont bien montré l’importance des effets résiduels de ces molécules. Ainsi, même après une nuit de sommeil, on peut encore, si on conduit très tôt le matin, ressentir les effets atténués de ces médicaments. Cela peut se traduire par des perturbations de l’attention, par exemple. Il serait sans doute nécessaire de sensibiliser le public à ce phénomène, d’autant que ces molécules sont souvent l’objet d’automédication et que leur posologie n’est pas toujours respectée.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Il faudrait donc définir la durée d’effet des médicaments.
M. Bernard Delorme. Cette durée est très difficile à déterminer.
J’ai déjà souligné l’intérêt du système de classification des médicaments pour attirer l’attention des consommateurs sur un petit nombre de molécules parmi les plus dangereuses. Deux hypnotiques, en particulier, rencontrent un grand succès, parce que leur courte demi-vie – c’est-à-dire leur élimination rapide – a été mise en avant lors de leur lancement sur le marché. Or, il apparaît que cette élimination n’est pas si rapide que cela, puisque des effets résiduels persistent.
Par ailleurs, on observe parfois des comportements totalement inadaptés, comme le fait de prendre un somnifère au milieu de la nuit avant de reprendre la route le lendemain, d’en user de façon quasiment récréative, ou de multiplier par quatre ou cinq la dose prescrite. Les études épidémiologiques montrent ainsi que deux molécules sont cause d’une part non négligeable de l’accidentologie. C’est pourquoi certains médicaments – moins de 2 % des spécialités pharmaceutiques – sont accompagnés de la mention « Attention, danger : ne pas conduire ». Il est important que ce message soit transmis.
Mme Sylvie Bonin-Guillaume. La conduite automobile est un élément très important du nouveau plan « Bien vieillir » qui est sur le point d’être finalisé. Et les conclusions du rapport en cours d’élaboration devraient être très utiles pour la mise en place d’actions allant dans le sens du bien vieillir et du maintien de la mobilité.
M. Philippe Houillon, président et rapporteur. Je vous remercie de votre participation.
*
* *
Table ronde sur la formation à la conduite : M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche au laboratoire de psychologie de la conduite à l’IFSTTAR ; Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité ; M. Loïc Turpeau, président de l’Association nationale pour la promotion de l’éducation routière (formation des moniteurs) ANPER ; M. Marc Meunier, sous directeur de l’éducation routière - Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (DSCR) ; M. Michel Schipman, vice-président de la branche des écoles de conduite et M. Philippe Malpièce, secrétaire de la branche des écoles de conduite du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)
Mardi 6 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Le problème de la formation à la conduite a été évoqué de manière récurrente lors des précédentes auditions. Je souhaite que chaque intervenant se présente rapidement. Il reprendra ensuite la parole pour formuler plus précisément ses propositions, remarques ou critiques.
M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche au laboratoire de psychologie de la conduite à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Psychologue de l’enfant et de l’adolescent, je travaille depuis vingt-cinq ans sur les accidents de la route, plus particulièrement des quinze-vingt-cinq ans. J’ai été chargé d’une mission sur la formation à la conduite dans les différents pays de la Communauté européenne, ce qui m’a amené à formuler des propositions pour améliorer cette formation ainsi que celle des formateurs.
Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité à la direction générale de l’enseignement scolaire. Je représente Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire, et je dirige le bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, qui est chargé de l’éducation à la sécurité routière.
M. Marc Meunier, sous-directeur de l’éducation routière à la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). La sous-direction de l’éducation routière à la DSCR traite de la formation des conducteurs et de la formation à la sécurité routière. Elle définit notamment les catégories et les épreuves du permis de conduire. Elle gère également les 1300 inspecteurs de l’examen.
M. Loïc Turpeau, président de l’Association nationale pour la promotion de l’éducation routière (ANPER). Créée il y a vingt-cinq ans à l’initiative de la Chambre syndicale de l’automobile, l’ANPER a formulé des propositions en vue d’agir en amont comme en aval du permis de conduire. L’expérience que nous avons menée il y a une dizaine d’années sur 50 000 jeunes en post-permis a contribué à réduire la sinistralité des jeunes conducteurs.
M. Michel Schipman, vice-président de la branche des écoles de conduite du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Je représente le CNPA pour la branche des écoles de conduite. Si l’auto-école existe depuis environ un siècle, le métier d’enseignant de la conduite ne dispose que depuis vingt-cinq ans d’un véritable programme de formation. Cette professionnalisation doit nous conduire à élargir nos capacités et nos activités.
M. Philippe Malpièce, secrétaire général de la branche des écoles de conduite du CNPA. Le CNPA dont je suis secrétaire général pour la branche formation des conducteurs, c’est-à-dire pour les auto-écoles, est la principale organisation des écoles de conduite en France. Trois sièges lui sont réservés au Conseil supérieur de l’éducation routière.
M. le président Armand Jung. Quand on soulève le problème de la formation des conducteurs, jeunes ou plus âgés, des critiques s’élèvent, souvent très vives, à propos des formateurs. Disposez-vous d’éléments objectifs à ce sujet ? Quelle proposition peut-on transmettre au Gouvernement ?
M. Jean-Pascal Assailly. Le point de vue du chercheur consiste à définir un idéal, tout en sachant qu’on rencontre toujours sur le terrain des problèmes d’ordre économique, financier ou syndical. En l’espèce, on poursuit un objectif d’insertion – il faut que les dix-huit-vingt-cinq ans obtiennent le permis – et un objectif de sécurité – on doit éviter que les jeunes titulaires du permis ne se tuent sur la route. La conduite accompagnée, qui est une bonne mesure au regard du premier critère, ne l’est pas pour le second, puisque les jeunes qui en ont bénéficié n’ont pas moins d’accidents que les autres.
M. le président Armand Jung. La conduite accompagnée est une bonne mesure ? Comment peut-on l’améliorer ?
M. Jean-Pascal Assailly. La plupart des conducteurs qui se tuent au volant sont titulaires du permis, ce qui prouve que la formation et l’examen ne sont pas suffisamment protecteurs. On peut être capable de maîtriser un véhicule sans pour autant s’abstenir de comportements dangereux ou transgressifs qui incitent à prendre des risques. Il est donc nécessaire d’agir au niveau de l’éducation nationale, avant la formation de vingt heures, ou après celle-ci, en post-permis.
Une étude menée sur le plan européen, puisque l’approche scientifique ne se cantonne pas au niveau national, a permis de développer un outil : la matrice GDE (Goals of Driver Education, objectifs de l’éducation du conducteur). Celle-ci détermine la manière dont s’organisent, dans la conduite, la performance et la motivation des conducteurs qui sortent de l’auto-école. Aucun d’eux n’ignore qu’il faut s’abstenir de boire, de fumer du cannabis, de rouler vite ou de téléphoner au volant, mais tous ne sont pas motivés pour respecter ces consignes, et leur motivation pèse lourdement sur leur performance.
À l’auto-école, on apprend au conducteur à effectuer les manœuvres, mais on doit aussi insister sur la compréhension des scénarios d’accident, des trajectoires, des intentions des autres usagers et sur le champ de la motivation. Ce domaine, évoqué tant à l’auto-école que dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière dispensée par l’éducation nationale, met en jeu le rapport à la voiture, au développement durable, à la consommation d’alcool et de cannabis, tout comme la peur, l’émotion, le respect des règles, la relation à autrui, les influences générationnelles, puisque tout jeune conducteur est influencé par la manière dont conduisent ses parents et par les pressions sociétales comme la publicité ou les lobbys. Pour des raisons économiques ou liées à la formation des formateurs, l’auto-école ne prend pas suffisamment en compte ces motivations qui sont au cœur du comportement dangereux.
Pour améliorer la formation initiale, l’auto-école doit travailler davantage sur les aspects affectifs qui déterminent attitudes, valeurs et représentations. Il faut aussi agir en amont, dans le cadre de l’enseignement, pour les quinze-dix-huit ans. Il est regrettable que le continuum éducatif s’interrompe entre quinze et vingt-cinq ans, c’est-à-dire précisément à l’âge où l’on se tue le plus sur la route. Enfin, pour améliorer ce qui n’a pas été acquis à l’auto-école, on pourrait imposer une formation post-permis, sans toutefois que le conducteur risque de se voir retirer le permis. Les problèmes économiques que poserait cette mesure pourraient sans doute être surmontés.
M. le président Armand Jung. Merci d’avoir cadré le problème. Que peut-on faire concrètement ? Que penser de la conduite accompagnée ? Faut-il autoriser de passer le permis à seize ans ? Comment modifier la formation dispensée en auto-école et quelle formation complémentaire peut-on proposer ensuite ?
Mme Nadine Neulat. Nous nous inscrivons dans un continuum éducatif. Dans le primaire, l’écolier se voit délivrer une attestation de première éducation à la route, qui le sensibilise aux dangers que court le piéton. Au collège, il peut obtenir les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR). Sa formation doit se poursuivre au lycée, en intégrant les acquis de la recherche.
Dans le second degré, nous avons rénové toutes les épreuves de l’ASSR grâce à un nouvel outil en ligne élaboré par le centre régional de documentation pédagogique de Versailles, qui a travaillé de manière spécifique sur l’éducation à la sécurité routière. Ce système sera opérationnel l’an prochain. L’enseignant accompagnant disposera d’un tirage de questions aléatoire. Il pourra corriger les erreurs des élèves en cours de travail, ce qui leur permettra de progresser. En outre, de nouvelles questions ont été introduites afin de souligner les dangers liés à la consommation d’alcool et de cannabis.
La mesure 13 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de 2010 a lancé une expérimentation portant sur quatre-vingts établissements. Son bilan, très encourageant, a mis en valeur l’implication des équipes éducatives, même s’il a montré que des outils spécifiques doivent encore être mis en place. Au titre de la mesure 17 du CISR de 2011, le dispositif a été étendu à plus de 300 lycées. À terme, il sera généralisé.
Les établissements ont également été dotés d’outils éducatifs précis et concrets. Le département met désormais à la disposition des lycées des simulateurs de conduite de deux-roues motorisés, permettant de mener des actions de prévention. Un portail internet très complet d’éducation à la sécurité routière propose aux éducateurs un panel d’outils. Enfin, nous avons développé des partenariats, notamment avec l’Association de prévention routière et l’Association prévention MAIF, dont l’appui est précieux.
M. Marc Meunier. Nous avons deux objectifs : d’une part, améliorer la sécurité routière grâce à la formation ; d’autre part, favoriser l’obtention du permis de conduire, auquel 3 millions de personnes se présentent chaque année.
Nous nous sommes fixé trois axes de priorité.
Le premier consiste à développer le continuum éducatif. Même si le point fort de la formation reste la préparation au permis de conduire, c’est en amont, dans le milieu scolaire, qu’on apprend aux futurs conducteurs à se comporter de manière responsable. Par ailleurs, bien que le permis de conduire soit délivré de manière définitive, il importe de prévoir en aval des séances de recyclage, de sensibilisation et de remise à niveau tout au long de la vie, notamment pour aborder des aspects qui ne peuvent être examinés lors de la préparation au permis.
Le deuxième axe concerne le comportement du conducteur. Longtemps, la formation au permis s’est concentrée sur le maniement du véhicule et la maîtrise des situations de conduite. Pour franchir un palier supplémentaire, il faut travailler sur les habitudes des candidats. Les conditions dans lesquelles ils prennent la voiture, leur mode de vie, leurs valeurs, ainsi que leurs rapports à la règle et au groupe ont un impact sur la sécurité routière.
Le troisième principe qui guide notre action est la progressivité. On doit prendre en compte la puissance des véhicules et faire en sorte que le jeune conducteur ait déjà une certaine expérience quand il obtient le permis.
Avant même la transcription de la troisième directive européenne sur le permis de conduire, le Gouvernement avait entrepris une réforme du permis en janvier 2009. Celle-ci comportait trente-sept mesures. Il fallait d’abord combler un vide en proposant, dans le cadre du lycée, une sensibilisation à la sécurité routière. Il convenait aussi d’améliorer la préparation au permis de conduire, ce qui passe par un travail sur la formation des formateurs. Les enseignants à la conduite disposeront d’outils pour travailler sur les aspects comportementaux du futur conducteur. Les voies d’accès à la profession ainsi que le contenu de la formation des formateurs sont également rénovées.
Si l’on veut aider les jeunes à se former correctement à la conduite, notamment à prendre un grand nombre de leçons, celles-ci ne doivent pas leur coûter trop cher. Bien que le coût du permis ne soit pas particulièrement élevé en France, où il est inférieur à la moyenne européenne, le Gouvernement a mis en place des aides pour que certains jeunes en difficulté accèdent au permis de conduire.
Améliorer l’examen étant une manière d’améliorer la formation, nous avons rénové l’épreuve de code – toilettage de la banque de questions, introduction de nouveaux thèmes comme la prise de conscience des risques ou le partage de la route – ainsi que l’épreuve de conduite au permis B. Celle-ci ne se présente plus comme un relevé d’erreurs mais comme un bilan de compétence, car il est plus valorisant pour les candidats d’accumuler les points que d’être sanctionnés à chaque faute. Afin d’évaluer la dimension comportementale, on juge désormais leur autonomie, leur prise de conscience des risques et leur capacité d’analyse.
La troisième directive européenne permettra d’introduire le principe de progressivité, notamment pour la conduite des deux-roues. Une catégorie de permis intermédiaire est prévue pour les cylindrées de moyenne puissance. Le jeune conducteur devra passer par des paliers progressifs, ce qui lui permettra d’acquérir de l’expérience, avant de conduire des motos puissantes.
M. Jérôme Lambert. La progressivité existe déjà puisque les jeunes de moins de vingt et un ans ne peuvent pas conduire des motos d’une puissance supérieure à trente-quatre chevaux.
M. Marc Meunier. Il existe deux types de permis pour les motos : le permis A1 correspondant aux engins de moins de 125 centimètres cubes et, pour les moteurs plus puissants, le permis A, qui comporte une condition d’âge. La directive introduira une catégorie intermédiaire. Le permis A2 permettra de conduire les engins compris entre 125 et 600 centimètres cubes.
Un jeune pourra toujours passer à seize ans le permis A1, pour conduire une moto de moins de 125 centimètres cubes. Il pourra passer à dix-huit ans le permis A2 pour conduire une moto de moins de 600 centimètres cubes. Pour conduire une moto plus puissante, il devra attendre 24 ans pour passer le permis A, sauf s’il possède le permis A2 et deux ans d’expérience, auquel cas il lui suffira de suivre une formation.
Enfin, la directive européenne prévoit de remplacer, à l’intérieur de l’Union, le permis de conduire national par un document unique qui ressemblera à une carte bancaire à puce. Il sera renouvelé tous les quinze ans de manière uniquement administrative, sans que le titulaire passe une nouvelle épreuve ou soit soumis à un contrôle médical.
M. le président Armand Jung. Certains ont fait courir le bruit que la directive imposerait de repasser le permis tous les quinze ans, ce qui a introduit une suspicion inutile à l’égard des autorités européennes. Il faut donc être précis.
M. Marc Meunier. Le temps venu, le Gouvernement ne manquera pas de diffuser clairement l’information et de faire de la pédagogie sur ces mesures importantes. Pour l’heure, nous préparons encore la transcription de la directive.
L’impact de la conduite accompagnée sur la sécurité routière est difficile à évaluer. Néanmoins, ceux qui bénéficient de ce dispositif augmentent de 20 % leurs chances de réussir le permis. En outre, au cours des premiers mois qui suivent l’obtention du permis, ils semblent avoir moins d’accidents que les autres. Nous souhaitons donc développer cet apprentissage anticipé de la conduite. Par ailleurs, les jeunes conducteurs de plus de dix-huit ans pourront s’initier à la conduite supervisée. Ce dispositif pour lequel, dès lors qu’ils ont effectué les vingt heures de conduite réglementaires, ils pourront opter à tout moment est plus souple que la conduite accompagnée, puisqu’il s’effectue pendant trois mois au lieu d’un an et sur 1 000 kilomètres au lieu de 3 000. Les conducteurs pourront y recourir après un premier échec à l’examen, s’ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas été suffisamment formés mais qu’ils n’ont pas les moyens de reprendre un grand nombre de cours.
Dernier chantier, que nous avons à peine ouvert, le post-permis concernera tant les conducteurs novices, qui ne possèdent le permis que depuis quelques mois, que le milieu professionnel ou les seniors.
M. Loïc Turpeau. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d’être dit sur le continuum éducatif. D’ailleurs, les écoles de conduite interviennent déjà pour former les élèves au brevet de sécurité routière, lequel bénéficie d’un volume de formation en augmentation. Toutefois, il faut être conscient que toute amélioration du permis de conduire se traduira nécessairement par une augmentation de son coût.
Nous avons proposé que les jeunes conducteurs disposent de six points au lieu de douze, ce qui a eu pour effet de rendre moins pérenne le permis probatoire. Cette mesure, au même titre que la formation en vue de récupérer des points ou les radars, a diminué le nombre de morts sur les routes. Premier réseau de formation continue des enseignements de la conduite en France, notre association aide les écoles de conduite à se former, comme le prévoit la réforme du permis de conduire. Mais, quel que soit l’investissement dont font preuve les auto-écoles, former en vingt heures des conducteurs pour toute la vie constitue une épreuve de force. La formation continue, qui existe dans tous les domaines, doit concerner aussi la conduite. Le volet post-permis nous semble indispensable.
Si un stage destiné à récupérer des points permet de modifier le comportement d’un conducteur, on peut aussi influer sur celui des jeunes qui viennent d’obtenir le permis, pour lesquels rien n’est prévu. Une étude que nous avons effectuée avec une mutuelle d’assurance sur 50 000 formations post-permis révèle que les jeunes qui ont bénéficié de la conduite accompagnée ont, sinon moins d’accidents, tout au moins des accidents moins graves que ceux qui ont suivi la formation traditionnelle au permis, ce qui montre qu’il faut favoriser cette solution.
On a constaté au début de l’année les effets négatifs induits par l’allégement du permis à points. À mon sens, s’il ne faut pas toucher à la prévention, notamment aux radars, on doit tenter de l’améliorer. Emmener les jeunes sur des pistes d’évolution n’est pas utile, dès lors que leur maîtrise du véhicule n’est pas en cause. Il faut en revanche modifier leur comportement sur la route, ce qui ne peut se faire que par le biais des opérations post-permis, puisque cette sensibilisation ne trouve pas sa place dans la formation initiale. Aujourd’hui, 60 % des morts dans le cadre des accidents du travail se tuent au volant de leur voiture. Pour améliorer la sécurité routière, il faut réfléchir au moyen de former les gens tout au long de leur vie. Reste à savoir qui financera cette mesure.
M. Michel Schipman. Notre profession reste plus axée sur la réussite à l’examen que sur la sécurité routière. Si l’on veut que les écoles de conduite s’orientent davantage vers l’amélioration des comportements, peut-être faut-il poser des bases réglementaires. Depuis 2009, les cours théoriques qu’elles sont tenues de dispenser ne sont guère suivis, puisqu’ils sont facultatifs, de sorte que les professionnels ont tendance à les mettre de côté. Pour que les conducteurs adoptent un comportement plus sûr en dehors des situations d’observation que sont les cours de conduite ou l’examen, on doit rendre ces cours obligatoires. Ceux-ci doivent en outre être repensés. Pour l’heure, l’enseignement théorique s’effectue par le biais de tests, ce qui constitue une anomalie pédagogique, puisqu’un test sert non à apprendre, mais à valider des acquis.
M. Philippe Malpièce. On constate un manque de communication entre le grand public et la corporation des auto-écoles. Les jeunes souhaitent toujours obtenir leur permis dans les délais les plus brefs et au prix le plus bas possible. Or le rôle des enseignants est de leur inculquer non seulement la réglementation – c’est-à-dire la signification des panneaux –, mais le civisme, la responsabilité et l’écoconduite, ainsi que l’utilisation des nouveaux outils de navigation qu’on trouve sur les véhicules. Il faut donc instaurer avec eux un dialogue afin de définir un meilleur rapport qualité/prix.
Un autre déficit de communication, dont la faute incombe tant aux écoles de conduite qu’à l’État, concerne les aides au financement du permis de conduire. Alors que le prix du permis est le cœur du problème, il n’y a aucune communication sur le permis à un euro par jour ou les bourses au permis qui existent sur le territoire. Les jeunes ne disposent d’aucune information sur ces excellentes mesures, et ne savent pas où la chercher.
Le dernier problème concerne le délai d’obtention du permis. L’éducation routière accomplit un travail considérable pour améliorer les épreuves, mais, chaque département étant responsable de son pôle, le nombre d’examens organisés varie d’un territoire à l’autre. L’essentiel ayant été fait au niveau central, il faut à présent agir sur le plan local. Nous avons formulé des propositions à ce sujet. Quand un élève demande à quel moment il pourra passer les épreuves, il est dommage que son seul interlocuteur soit la secrétaire de l’école de conduite, qui n’est en rien responsable du nombre de candidats admis à se présenter.
M. Christian Vanneste. Ma première inquiétude concerne le nombre de personnes circulant sans permis. On croit un peu hâtivement qu’il s’agit de conducteurs ayant perdu tous leurs points. Or, les deux tiers d’entre eux n’ont jamais passé le permis. Le coût est une première explication, mais il y a également le problème des délais. Il en résulte des situations dramatiques dans certains cas, mais aussi des inégalités profondes, notamment entre les jeunes pour l’accès à l’emploi. Quelles propositions concrètes pourriez-vous faire ? Je pense en particulier à des synergies entre les écoles de conduite et l’éducation nationale en matière d’information.
J’en viens aux deux-roues non motorisés, dont la circulation fait l’objet d’un flou croissant. On leur a réservé des voies en sens interdit, ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée, car on voit plus facilement un vélo s’il vient en face que s’il circule du même côté que soi. Le problème est que des comportements un peu anarchiques se développent : on roule sur les trottoirs, croyant à tort que c’est toujours autorisé, ou l’on ne s’arrête pas aux feux rouges. Ne peut-on pas éviter, grâce à une formation à la conduite des deux-roues, que de très mauvaises habitudes ne s’installent d’emblée ?
S’agissant des automobilistes, la proposition de loi que j’ai déposée en vue de rendre obligatoire un examen de santé périodique a déclenché de vives réactions, alors que je ne visais pas les personnes âgées en particulier : on peut être victime, à tout âge, d’un déficit ou d’un handicap ayant des conséquences sur la capacité à conduire. Dans certains pays, tels que les Pays-Bas ou l’Espagne, il existe une vérification périodique de l’aptitude des conducteurs, avec un accompagnement visant à remettre les compétences à niveau. Que pourrait-on faire pour avancer sur ce point dans notre pays ?
M. Jacques Myard. J’aimerais savoir si l’apprentissage d’une plus grande responsabilité quand on se déplace à vélo fait partie des programmes théoriques actuels. En effet, on peut être automobiliste et circuler parfois à vélo ; dans ce dernier cas, il n’y a pas lieu de s’affranchir des règles de conduite.
Que pensez-vous, par ailleurs, des zones partagées qui mêlent automobilistes, cyclistes et piétons ? Elles sont très à la mode, mais elles ne sont pas sans risque.
M. Henri Nayrou. Il a beaucoup été question de principes, mais il ne faudrait pas oublier d’autres facteurs : beaucoup d’accidents se produisent dans la nuit du samedi au dimanche, par exemple, ou au retour de week-end.
Les jeunes doivent pouvoir apprendre, au meilleur coût, les rudiments essentiels pour avoir le droit de conduire une voiture, mais cela ne suffit pas. En suivant une formation sur piste fermée, j’ai ainsi compris que je ne savais pas très bien conduire alors que j’avais le permis. La pré-action, c’est-à-dire l’anticipation, est essentielle : j’ai appris, grâce à cette formation, deux leçons qui m’ont tout le temps servi par la suite, l’une concernant le rayon de courbure, l’autre la position des mains sur le volant.
Même si tout le monde ne peut pas bénéficier, pour des raisons de coût, d’une formation en circuit fermé, comment pourrait-on organiser un « après-permis de conduire » ? Je rappelle que le but de cette mission d’information n’est pas seulement d’établir un état des lieux, mais aussi de formuler des préconisations.
M. Philippe Malpièce. La conduite sans permis, voire sans formation, est un véritable fléau auquel la réponse ne saurait être unique : on se heurte non seulement au problème des délais, mais aussi à la question des moyens financiers disponibles, ainsi qu’à des difficultés liées à la notion d’apprentissage.
Les délais de présentation font l’objet d’un chantier considérable sur lequel nous travaillons d’arrache-pied avec la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). C’est une question complexe, car les inspecteurs du permis de conduire sont des agents de l’État, jouissant en tant que tels d’un statut. Ils consacrent une partie de leur temps à l’examen du permis de conduire, mais ils ont aussi d’autres missions. Selon l’organisation de leur temps de travail, les délais d’attente peuvent varier de plusieurs semaines à plusieurs mois, au niveau départemental, à l’issue d’un premier échec à l’examen.
Nous souffrons, par ailleurs, d’un problème de communication : on imagine, à tort, qu’il suffit de vingt heures de leçons de conduite pour obtenir le permis. Or, la moyenne nationale est de 32 heures par élève. Les auto-écoles ont, en outre, une obligation de résultat à l’examen : il n’est donc pas question de présenter tous les élèves dès lors qu’ils ont suivi un certain nombre d’heures de cours. C’est à l’enseignant de dire au candidat s’il peut se présenter à l’examen en fonction de son degré de préparation.
Sur ce point, il conviendrait de modifier un texte de 1991 aux termes duquel il faut avoir suivi au minimum vingt heures de conduite. Je rappelle qu’il n’y avait pas de rollers, ni de skateboards en circulation à cette époque : les usagers de la route et des trottoirs ont bien changé depuis vingt ans.
M. le président Armand Jung. Si je comprends bien, vingt heures de cours ne suffisent plus.
M. Philippe Malpièce. L’examen du permis de conduire a été revu aussi bien dans sa partie théorique que dans sa partie pratique. Il y a de nouvelles notions à apprendre.
M. le président Armand Jung. De combien d’heures a-t-on besoin ?
M. Philippe Malpièce. Comme je l’ai indiqué, la moyenne nationale est de 32 heures.
M. Jean-Pascal Assailly. Sans instaurer un permis spécifique pour le vélo, on pourrait s’inspirer de l’expérience de pays très portés sur les deux-roues : le Royaume-Uni, le Danemark, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces pays ont instauré des formations obligatoires qui sont très bien conçues et qui produisent de très bons résultats.
En étudiant les accidents impliquant des véhicules à deux-roues et à quatre roues, on s’aperçoit, par ailleurs, qu’il y a généralement eu un problème de communication et de compréhension : l’automobiliste n’a pas vu le vélo, alors qu’il faisait attention, parce que les usagers ont des logiques, des vitesses et des trajectoires différentes. Il faut travailler sur cette question, aussi bien chez les conducteurs que chez les cyclistes, au titre de la protection des usagers vulnérables.
La question de l’examen de l’état de santé de l’automobiliste se pose effectivement, mais j’y apporterai une réponse différente : tous les pays qui ont tenté de mettre en œuvre un dépistage médical ont fini par abandonner cette solution dont le coût pour la société est supérieur au bénéfice réalisé en évitant quelques accidents. Les Espagnols, par exemple, sont en train de revenir en arrière alors qu’ils étaient allés très loin dans ce domaine. Compte tenu de l’importance des faux positifs et des faux négatifs, la prédiction des accidents ne repose pas sur des bases suffisamment solides, au plan scientifique, pour qu’on puisse écarter de la route certaines personnes. Ce type de mesure s’accompagne, en outre, d’une augmentation du nombre d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes, ainsi que de phénomènes de désocialisation et de dépendance.
Pour améliorer la situation, les chercheurs s’accordent pour recommander une amélioration du travail des médecins traitants : ils ne sont pas assez formés dans ce domaine et ils ne se préoccupent pas suffisamment des problèmes que peuvent rencontrer, en matière de conduite automobile, les patients âgés et les personnes souffrant de certaines pathologies. C’est par un dialogue entre la famille, le médecin traitant et le sujet lui-même qu’on peut résoudre le problème, et non par des mécanismes de dépistage obligatoire.
M. Michel Schipman. Pour compléter les propos de Philippe Malpièce, je tiens à rappeler que la formation au permis de conduire est individualisée. On peut souhaiter que le permis soit obtenu plus rapidement, mais il ne faut pas oublier ces deux éléments essentiels que sont la personnalité des candidats et les compétences individuelles.
Dans ces conditions, la question des délais ne peut être envisagée qu’une fois la formation terminée : il s’agit de savoir dans quel délai on peut se présenter à l’examen et, en cas d’échec, quand on peut se représenter. Certains candidats, en particulier ceux qui sont très disponibles, obtiennent le permis un mois seulement après leur inscription dans une auto-école, mais ce n’est pas envisageable pour ceux qui éprouvent des difficultés d’apprentissage ou qui ne disposent pas de beaucoup de temps libre pour leur formation.
J’en viens aux zones de rencontre, qui ont été créées en août 2008. Comme vous l’avez indiqué, ce sont des « zones de partage » où le piéton et le cycliste invitent la voiture. Alors que l’autoroute est un espace consacré aux véhicules roulant vite, à l’exclusion des moins rapides, la ville appartient plutôt aux piétons et aux cyclistes. On pourrait songer à en exclure l’automobiliste, mais ce n’est pas socialement envisageable à grande échelle. D’où la nécessité des zones de rencontre. La notion de partage de l’espace entre piétons, cyclistes, automobilistes et motocyclistes doit être introduite lors des cours théoriques, à la faveur d’une discussion entre élèves : il faut mettre en commun les expériences, faire appel à des témoignages et étudier des cas précis d’accident.
S’agissant des problèmes de comportement à vélo, je rappelle qu’il n’y a pas une partie de la population qui roulerait uniquement à vélo, une autre en voiture et une troisième à moto : bien souvent, les cyclistes sont aussi des automobilistes. C’est donc à l’occasion du permis le plus facilement admis au plan social, à savoir le permis de conduire automobile, qu’il conviendrait d’améliorer la formation – et autrement que sous la forme de questions du type : « dois-je laisser passer le vélo ? ».
Je le répète : il faut améliorer la formation des jeunes conducteurs par des prestations théoriques dépassant largement le cadre de la seule conduite automobile : c’est la question du partage global de l’espace qui est en jeu.
M. Marc Meunier. La question des délais est complexe, car elle fait intervenir trois types d’acteurs dont les modes de fonctionnement sont distincts : les candidats, dont la formation est plus ou moins longue et qui sont plus ou moins motivés ; l’école de conduite, qui choisit de présenter tel candidat à tel moment ; et enfin les personnels de l’État – en l’occurrence, les inspecteurs du permis de conduire – dont le nombre est limité.
Dans ces conditions, il faudrait parvenir à distinguer le temps de formation et le délai de présentation d’un candidat prêt, mais sans place d’examen. Or, nous n’en sommes pas capables pour le moment : il faudrait examiner tous les dossiers, école de conduite par école de conduite. Nous nous attachons donc, pour notre part, à suivre le délai entre deux présentations à l’examen du permis de conduire, et non le délai entre l’inscription dans une école de conduite et une première présentation à l’examen.
J’ajoute que les candidats ayant opté pour l’apprentissage anticipé de la conduite doivent consacrer une année à leur formation pratique avant de pouvoir passer l’examen. Les délais peuvent donc être relativement longs avant une première présentation, mais pour une bonne raison. Ce qui préoccupe nos concitoyens, c’est le délai dans lequel ils peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen en cas d’échec.
Ce délai, que nous suivons de manière très précise depuis un an, est d’environ 75 jours, avec des variations parfois importantes – il s’élève à 50 jours dans certains départements, mais il peut dépasser 100 jours dans d’autres départements, notamment en région parisienne. Dans chaque département, tout dépend, par ailleurs, des écoles de conduite : le système actuel d’attribution des places d’examen permet aux écoles qui ont de bons résultats d’obtenir plus facilement des places, ce qui réduit leurs délais par rapport aux autres écoles.
J’en viens aux formations post-permis, pour lesquelles nous avons déjà des idées assez précises : il s’agirait, en particulier, d’insister sur des points qui ne sont pas abordés, faute de temps, lors de la préparation au permis de conduire – comme on ne peut pas tout faire, la priorité est naturellement d’apprendre à manier le véhicule et de comprendre les situations de conduite.
Des formations ultérieures pourraient ainsi porter sur les habitudes de conduite et sur les modes de vie. Il conviendrait, par ailleurs, de mieux faire prendre conscience des risques : il faut les détecter et les analyser afin de mettre en place des stratégies pour y faire face. Un travail de développement des capacités d’auto-évaluation serait également utile : chaque conducteur doit être conscient de ses points forts et de ses points faibles, ainsi que des erreurs et des infractions qu’il a déjà commises. Tout cela permettrait d’aider les jeunes conducteurs à améliorer leur comportement.
Suivant l’exemple offert par certains pays étrangers, les formations post-permis pourraient comporter trois moments : un travail sur piste, tout d’abord, dont le but ne serait pas d’apprendre à conduire sur une piste mouillée ou sur une simulation de verglas, car cela pourrait conduire à un sentiment de confiance excessif et finalement néfaste, mais plutôt d’apprendre à éviter ce type de danger et de prendre conscience des risques de certaines situations ; à cela pourraient s’ajouter un test sur route, pour réaliser un diagnostic de conduite, ainsi qu’une discussion en salle sur les habitudes d’utilisation du véhicule.
Dans ces différentes phases, il me semble que le travail devrait avoir lieu en groupe pour favoriser les échanges et pour permettre à chacun de déchiffrer le comportement des autres. J’ajoute que de telles formations pourraient durer entre six et huit heures, du moins dans un premier temps.
Reste à savoir s’il convient d’instaurer une obligation et comment financer le dispositif. Des assureurs ont déjà essayé d’instaurer de telles formations, mais ils ont éprouvé beaucoup de difficultés pour mobiliser les jeunes, malgré la « carotte » qui était offerte sous la forme d’une réduction de leur prime d’assurance.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Pouvez-vous revenir sur les exemples étrangers de formation continue ? Que fait-on concrètement ?
M. Marc Meunier. L’expérience n’a pas été très probante en Norvège, où l’accent avait été mis sur le travail sur piste. En faisant des jeunes concernés des experts en situation dangereuse, on a suscité un climat de sur-confiance plutôt négatif en fin de compte. Il conviendrait plutôt d’apprendre à éviter les dangers et à les anticiper. L’enseignement des réflexes nécessaires exigerait, au demeurant, des formations très lourdes.
Un travail est aussi en cours en Autriche, mais je n’ai guère d’informations à ce stade. Jean-Pascal Assailly pourrait sans doute vous répondre plus précisément, car il a beaucoup travaillé sur cette question.
M. Jean-Pascal Assailly. Le dossier est prêt au plan scientifique. Après avoir examiné ce que font des pays tels que la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, nous connaissons les contenus et les méthodes qu’il conviendrait de développer ; nous savons aussi comment améliorer la formation des formateurs.
Je serais donc tenté de dire que le dossier n’est plus entre nos mains. Lorsque nous l’avons présenté aux services du Premier ministre, ces derniers nous ont répondu qu’il s’agissait d’une très bonne idée, mais que les caisses de l’État étaient vides et que le contexte était plutôt de rendre le permis moins cher. On a nous alors suggéré de nous tourner vers les assurances.
M. le rapporteur. Pouvez-vous nous dire qui assure le financement du dispositif à l’étranger ?
M. Jean-Pascal Assailly. Il existe plusieurs systèmes, mais une partie est toujours prise en charge par le jeune lui-même, dans le cadre de formations obligatoires.
M. le rapporteur. Quel est le public concerné ? S’agit-il des jeunes conducteurs à la fin de leur période probatoire ?
M. Jean-Pascal Assailly. Il s’agit des conducteurs novices. En général, il s’agit effectivement des jeunes, mais l’âge n’est pas le critère retenu.
M. le président Armand Jung. Avez-vous une idée précise du surcoût occasionné par ces formations après le permis ?
M. Jean-Pascal Assailly. C’est difficile à dire, car tout dépend du nombre d’heures de la formation. Elle dure 48 heures en Suisse, ce qui peut paraître beaucoup. Michel Meunier évoquait une formation d’une seule journée.
M. Loïc Turpeau. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, 50 000 jeunes ont déjà été formés pour un coût de 200 euros, à la charge de la compagnie d’assurance.
Une première journée était consacrée à des opérations de sensibilisation. Un jeune ayant son premier sinistre entre le 3e et le 6e mois suivant l’obtention de son permis de conduire, c’est à ce moment-là qu’il faut intervenir.
Six ou sept mois plus tard, on voyait les jeunes une seconde fois s’ils avaient eu un accident. En effet, tout le monde ne doit pas être mis dans le même panier : entre 80 et 90 % des jeunes n’ont pas d’accident. D’où la nécessité d’une action à la carte.
M. le rapporteur. Comment avait-on connaissance des sinistres éventuels ?
M. Loïc Turpeau. Par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance avec laquelle les jeunes signaient un véritable contrat : ils devaient s’abstenir de consommer de l’alcool avant de conduire, ils ne devaient pas prêter leur véhicule, et ils n’étaient pas assurés s’ils ne s’engageaient pas dans un cursus de formation – une demi-journée de sensibilisation avec la sécurité routière, puis un audit de conduite en situation, six ou sept mois plus tard, en cas de sinistre.
J’ajoute que les compagnies d’assurances ont tout intérêt à réduire la sinistralité des jeunes : ils représentent entre 14 et 16 % des assurés, contre 50 ou 70 % des frais remboursés – les autres assurés paient donc pour eux. Compte tenu de la situation financière actuelle et du coût du permis de conduire, c’est vers les compagnies d’assurances qu’il convient effectivement de se tourner. Ce qui a été fait dans ce domaine à une certaine époque produisait d’excellents résultats.
M. Jean-Pascal Assailly. Je crois pouvoir dire que la MAIF et AXA seraient intéressées. Nous travaillons déjà sur la conception des formations post-permis.
M. Lionel Tardy. Il a beaucoup été question des jeunes, mais je tiens à rappeler que la courbe des accidents forme un U : il reste beaucoup à faire pour tenir compte du vieillissement de la population. Les personnes âgées perdent, en effet, certains réflexes, elles ne savent pas toujours comment se comporter dans des configurations nouvelles pour elles, telles que les ronds-points, et les panneaux de la sécurité routière leur posent beaucoup de difficultés
Sans revenir directement sur la question de la capacité de conduire, même si je suis intéressé, le cas échéant, par des précisions sur ce point – certains pays ont instauré un contrôle médical tous les deux ou trois ans –, je voudrais aborder le problème posé par l’octroi à vie du permis de conduire. Les plus de soixante ans ont, eux aussi, besoin de leur véhicule, mais ils sont parfois complètement dépassés par l’évolution du contexte de la conduite depuis l’obtention de leur permis, il y a quarante ans. Que pourrions-nous faire pour eux ?
M. Jean-Pascal Assailly. Je suis tout à fait d’accord avec vous. La vraie question est de savoir comment organiser des formations pour les seniors, plus que d’instaurer un dépistage médical.
Il convient, tout d’abord, de bien comprendre les types d’accidents concernés et d’éviter certaines idées fausses : il arrive qu’une personne de 80 ans tue quatre pompiers en roulant à 180 kilomètres à l’heure sur une autoroute, mais c’est absolument atypique. Les problèmes des personnes âgées sont plutôt de tourner à gauche aux intersections ou d’estimer correctement les vitesses.
Peut-être ne faudrait-il pas accorder à vie le permis, comme vous le suggérez, mais je répète que la solution n’est pas d’exclure les personnes âgées de la circulation, car cela finit par coûter plus cher à la société que cela ne rapporte. Mieux vaut maintenir ces conducteurs sur la route en les entraînant, un peu comme des sportifs. Il existe aujourd’hui une documentation très fournie sur ce qu’on fait à l’étranger en ce domaine.
M. Gérard Voisin. Je suis personnellement sous le choc de trois accidents qui ont coûté la vie, ce week-end, à trois jeunes gens d’une vingtaine d’années.
Au risque de vous surprendre, je suis tenté d’établir une comparaison entre l’apprentissage de la conduite automobile et celui du pilotage dans l’aviation civile. Si le nombre d’heures de formation n’est guère plus élevé dans le dernier cas, c’est que les comportements sont différents : il y a une véritable rigueur dans l’aviation civile. Elle est inculquée par les formateurs et l’on est dans une autre dimension : on ne peut pas se permettre de fantaisie, contrairement à ce que l’on peut observer ailleurs.
Deux des décès que j’évoquais tout à l’heure ont eu lieu en courbe au petit matin. Je le répète : il faut agir sur les comportements en essayant d’imposer plus de rigueur au moment de la formation, puis lors des différents contrôles qui peuvent avoir lieu par la suite.
M. le rapporteur. Je crois qu’il n’y a pas eu de réponse précise à la question portant sur l’opportunité de porter à seize ans l’âge auquel on peut passer le permis de conduire.
M. Jacques Myard. Et pourquoi pas à treize ans ?
M. Jean-Pascal Assailly. Seize ans est l’âge auquel la prise de risque et la recherche de sensations sont maximales. Compte tenu de la psychologie de l’adolescent, il y a de nombreuses raisons de ne pas réduire l’âge minimal pour passer le permis de conduire, mais nous aurons l’occasion d’aborder plus en détail cette question à l’occasion de la table ronde consacrée au problème spécifique des jeunes.
M. le président Armand Jung. Merci à tous pour votre contribution aux travaux de notre mission d’information. Votre expertise et votre franchise nous sont précieuses.
*
* *
Table ronde sur les problèmes spécifiques des deux roues motorisés : M. David Dumain, rédacteur en chef de Moto Journal, et M. Pierre Orluc, rédacteur en chef adjoint ; M. Phan Vuthy, responsable du département accidentologie au CEESAR ; M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la DSCR ; M. Hervé Gicquel, directeur général du Club 14, M. Michel Guendon et M. Philippe Monneret, vice-présidents ; M. Patrick Jacquot, président-directeur général de l’Assurance mutuelle des motards, M. Patrick Bayse, responsable du département Indemnisation, et M. Bertrand Nelva-Pasqual, responsable du service Études et développement technique ; M. Guillaume Chatillon, responsable marketing France de Piaggio, et M. Timothé de Romance, conseil pour les affaires publiques auprès de Piaggio (cabinet Anténor public affairs) ; M. Jean-Claude Hogrel, président de la branche des professionnels du deux-roues du CNPA, Mme Margaret Erbin, secrétaire générale de la branche des professionnels du deux-roues, et Mme Ève Lambert ; M. Pierre Van Elslande, directeur de recherche à l’IFSTTAR, et M. Jean-Louis Martin, chercheur
Mardi 6 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Mesdames, messieurs, je suis heureux de vous recevoir aujourd’hui. Le thème des deux-roues motorisés a été abordé à toutes nos auditions.
Avant tout, je tiens à dire que ni le rapporteur ni moi-même n’avons la volonté de stigmatiser qui que soit – cyclistes, motards, vieux, jeunes. J’ajoute que la réduction du nombre d’accidents et de morts sur la route dépendra en très grande partie de votre collaboration et de notre bonne entente. À cet égard, notre objectif est à la fois modeste et ambitieux.
M. Pierre Van Elslande, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Je travaille sur le thème des deux-roues motorisés depuis une dizaine d’années.
À l’IFSTTAR, je suis coresponsable d’une plateforme rassemblant tous les chercheurs qui travaillent sur le sujet en France. En 2009, nous avons organisé un colloque international qui a fait le bilan des travaux de cette plate-forme, bilan que je tiens à votre disposition.
En outre, j’ai dirigé plusieurs projets de recherche sur les deux-roues motorisés. Nous avons réalisé des fiches de synthèse de nos travaux, que je vous remettrai également.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, car nous sommes demandeurs de fiches techniques, et non de documents de plusieurs centaines de pages. À ce stade de notre réflexion, nous attendons en effet de ces auditions des prises de position fortes, même contestées, que nous pourrons mettre en avant dans notre rapport.
M. Jean-Louis Martin, chercheur à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Je suis épidémiologiste et vous ferai un bilan de la mortalité et de la morbidité des usagers de deux-roues motorisés.
M. Michel Vilbois, sous-directeur de l’action interministérielle à la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). Je suis accompagné de Pascal Dunikowski, chargé de mission pour les deux-roues motorisés à la Délégation à la sécurité et à la circulation routières.
M. Hervé Gicquel, directeur général du Club 14. L’association Club 14, qui a fêté ses trente ans avant-hier, comprend 430 000 adhérents à ce jour. Ses deux vice-présidents, Michel Guendon et Philippe Monneret, qui m’accompagnent aujourd’hui, aborderont, pour l’un, la prévention et la formation et, pour l’autre, les principes fondateurs de l’association.
M. Pierre Orluc, rédacteur en chef adjoint de Moto Journal. Je travaille sur la sécurité routière depuis une vingtaine d’années. J’ai participé à des groupes de travail sur ce thème, à l’époque où la presse y était intégrée, notamment au milieu des années 1990.
M. Jean-Claude Hogrel, président de la branche des professionnels du deux-roues du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Je représente les professionnels de la vente et de la réparation de cycles et de motocycles en France.
Mme Margaret Erbin, secrétaire générale de la branche des professionnels du deux-roues du Conseil national des professions de l’automobile CNPA. Nous représentons les deux/trois roues motorisées, et les quads (quatre roues).
M. Timothé de Romance, conseil pour les affaires publiques auprès de Piaggio (cabinet Anténor public affairs). J’accompagne le groupe Piaggio dans ses relations avec les pouvoirs publics français.
M. Guillaume Chatillon, responsable marketing France de Piaggio. Piaggio France est un constructeur de deux-roues motorisés, d’origine italienne, dont les marques – Piaggo, Vespa, Gilera, Derbi – sont présentes en France depuis de nombreuses années, aussi bien en scooters qu’en motos.
M. Bertrand Nelva-Pasqual, responsable du service Études et développement technique de l’Assurance mutuelle des motards. Je suis quant à moi responsable de l’actuariat de la Mutuelle des motards. Je suis membre de l’Institut des actuaires.
M. Patrick Jacquot, président-directeur général de l’Assurance mutuelle des motards. Je suis membre du bureau du Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), syndicat des mutuelles d’assurance qui assure aujourd’hui en France un véhicule sur deux et les deux tiers des motos et des scooters. Je suis également président de GEMA Prévention, association créée par le Groupement. J’ai été représentant pour le GEMA du Conseil national de la sécurité routière (CNSR).
Nous vous expliquerons que les motards et les scootéristes sont les usagers motorisés les plus responsables sur la route, car les plus conscients de leur fragilité.
M. le président Armand Jung. Mesdames, messieurs, au-delà de l’analyse de la situation, notre Mission attend de vous des propositions concrètes et précises.
M. Jean-Louis Martin. En 2009, 888 motocyclistes et 299 cyclomotoristes ont été tués, chiffres à comparer aux 2 160 occupants de véhicules légers (VL).
Selon les estimations de la commission des comptes des transports de la Nation sur les parcs et les véhicules/kilomètres, le risque par milliard de kilomètres parcourus pour les cyclomotoristes est de 125 tués, de 134 tués pour les motocyclistes, et de 5,5 tués pour les occupants de VL, soit un rapport de 24,5 entre les deux-roues motorisés et les occupants de VL.
Entre 2000 et 2009, le nombre de tués chez les motocyclistes est resté très stable. Il a diminué de 30 % pour les cyclomotoristes, en corrélation avec la baisse d’utilisation des cyclomoteurs, et de 54 % pour les occupants de VL.
Selon les estimations du Registre du Rhône, 20 000 personnes en deux-roues motorisés ont été gravement blessées en 2003, soit le même nombre que les occupants de véhicules légers. C’est à partir de cette date que le nombre de blessés graves en deux-roues motorisés est devenu égal ou supérieur à celui des occupants de VL.
Selon notre estimation moyenne sur dix ans, pour un tué occupant d’un véhicule léger, il y a 0,7 blessé avec séquelles graves. Et pour un tué utilisateur d’un deux-roues motorisé, il y a 1,7 blessé avec séquelles graves, chiffre d’autant plus inquiétant que les utilisateurs concernés sont en moyenne plus jeunes.
La principale localisation des lésions chez les usagers de deux-roues motorisés est aux membres inférieurs, toutes gravités confondues. En effet, 62 % des victimes blessées souffrent d’une atteinte aux membres inférieurs, 45 % aux membres supérieurs, 12 % à la tête, 9 % au thorax, et 8 % à la colonne vertébrale.
Quant aux blessures graves potentiellement mortelles, elles concernent la tête pour 43 % des accidentés, le thorax pour 33 %, l’abdomen pour 20 %, et la colonne vertébrale pour 9 %. Comme vous le constatez, la tête reste la plus souvent touchée, ce qui n’est pas le cas pour les autres usagers, d’où l’importance du casque. L’atteinte au thorax nécessite de réfléchir à des protections, en particulier aux gilets dont certains sont à l’étude ou commencent à être disponibles sur le marché.
M. Pierre Van Elslande. Je fais partie des chercheurs qui participent au rapport que l’IFSTTAR vous proposera.
Je vais vous présenter les grandes tendances des mécanismes accidentologiques qui impliquent la population du deux-roues motorisé, tels que nous les étudions depuis une dizaine d’années. Comme vous, monsieur le président, je ne chercherai pas à opposer un groupe d’usager à un autre. Je m’efforcerai, au contraire, de vous expliquer les difficultés de l’usager du deux-roues motorisé face aux autres usagers.
En fait, le deux-roues motorisé n’existe pas. En effet, le monde du deux-roues motorisé s’est énormément diversifié ces dernières décennies et est aujourd’hui très éloigné du stéréotype du blouson noir casse-cou et irréductible. Cette diversité doit être prise en compte afin d’identifier les problèmes spécifiques des conducteurs et de définir des mesures ciblées et efficaces. La population des cyclomotoristes de quinze à dix-sept ans, par exemple, qui se caractérise par des comportements à forte prise de risque, n’est absolument pas représentative des motards.
Je distinguerai deux grandes catégories d’accidents : les pertes de contrôle de véhicules seuls, d’une part ; les accidents en interaction avec autrui, d’autre part.
Les pertes de contrôle de véhicules seuls relèvent d’un problème d’interaction avec l’infrastructure, le conducteur étant confronté à une difficulté qu’il ne réussit pas à surmonter. L’analyse au cas par cas de ces accidents fait ressortir, le plus souvent, un problème d’évaluation pour les motards accidentés d’une difficulté routière à laquelle ils se sont trouvés confrontés, comme une baisse d’adhérence ou la rencontre d’un virage délicat à négocier.
Cette sous-évaluation s’accompagne le plus souvent d’un problème de sur-confiance, c’est-à-dire d’une confiance du motard vis-à-vis de ses capacités d’anticipation et de pilotage. Fort de cette compétence supposée, il ne régule pas sa vitesse, alors qu’il est le plus souvent à la limite des capacités de tolérance du système dans son ensemble (pilote, machine, infrastructure, interactions entre ces différents composants). Du fait de cette absence de régulation, le contrôle du véhicule devient défaillant au moment de la difficulté.
Or, par sa nature même, le deux-roues motorisé se caractérise par une sensibilité beaucoup plus grande aux perturbations environnementales. Autrement dit, les difficultés liées à l’infrastructure qu’un automobiliste peut contrôler aisément peuvent devenir majeures pour un motard. Elles concernent tous les problèmes d’adhérence, notamment en lien avec la très faible surface de contact entre les pneumatiques et l’enrobé de surface. Par conséquent, la rencontre de gravillons, un défaut d’enrobé, parfois même une signalisation horizontale, peuvent favoriser des glissades par temps humide.
Je précise que ces accidents dus à une perte de contrôle sont généralement sous-estimés dans les statistiques nationales par rapport aux accidents impliquant un deux-roues motorisé avec un autre usager, dans la mesure où ils ne font pas systématiquement l’objet d’un procès-verbal.
Je suggère donc trois grands types de mesures pour faire face à ces accidents dits « de véhicules seuls ».
Premièrement, les aménagements devraient davantage prendre en compte les particularités des deux-roues motorisés, de manière à ne pas mettre leurs usagers dans une situation de difficulté là où les automobilistes, eux, n’en rencontrent pas.
Deuxièmement, la formation – qui est essentielle – devrait amener les motards à ne pas être trop confiants dans leur capacité de maîtrise. Elle doit les orienter vers une méfiance envers tout ce qui peut les surprendre et, surtout, leur enseigner à conserver en permanence une marge de régulation pour anticiper la rencontre d’un éventuel imprévu sur la route. Autrement dit, elle doit s’attacher à leur apprendre à ne jamais se mettre en condition limite dans laquelle la moindre surprise ne sera pas rattrapable.
Troisièmement, des améliorations techniques importantes devraient être apportées à la dynamique de ces véhicules pour en garantir une meilleure tenue de route, notamment en situation d’urgence et de freinage. Je pense évidemment à l’anti-blocage de sécurité (ABS).
La deuxième grande catégorie d’accidents de deux-roues motorisés, ceux en interaction avec les autres usagers de la route, fait apparaître des mécanismes totalement différents et éminemment plus complexes dans la mesure où ces accidents sont caractérisés par une complémentarité de dysfonctionnements entre les différents usagers. En effet, bien souvent, les deux protagonistes – le conducteur du deux-roues motorisé et l’automobiliste – contribuent, sans le savoir, à l’accident.
Comme vous le savez, les automobilistes ont de grandes difficultés à détecter les deux-roues motorisés. Dans 60 % des cas impliquant une moto et une automobile, le conducteur de cette dernière n’a pas vu le motard, ou l’a vu trop tard. Quatre raisons expliquent ces difficultés de détection.
Souvent, les automobilistes ne s’attendent pas à rencontrer une moto dans la situation routière où ils se trouvent. Par conséquent, ils prêtent moins attention à cette éventualité. Or il est prouvé scientifiquement que l’on détecte mieux ce qu’on recherche. Il faut savoir que les motards représentent environ 2 % du trafic et que certains conducteurs en rencontrent très peu, en particulier en rase campagne.
Ensuite, le système visuel humain a du mal à détecter ce qui est étroit et rapide. Le projet PERCEPT (Perceptibilité des deux-roues motorisés), que je dirige et qui est financé par la Fondation Sécurité routière, travaille sur la question.
En outre, les motards, par leur comportement, mettent en défaut les stratégies de prise d’information des automobilistes. Concrètement, ils mettent en œuvre des manœuvres inattendues pour les automobilistes – remontées de file, dépassements par la droite, positionnements derrière les angles morts des véhicules, voire niveaux d’accélération surprenants –, de sorte que les automobilistes se trouvent confrontés à des interactions qui se révéleraient impossibles s’il ne s’agissait pas d’une moto.
Enfin, ce qui ne masque pas une voiture peut masquer un deux-roues motorisé, de plus faible gabarit – je pense aux éléments d’aménagement, tels que des panneaux de signalisation ou d’information.
Voilà pour les difficultés accidentogènes qui concernent les automobilistes.
Quant aux difficultés des motards lorsqu’ils détectent un conflit, elles font apparaître qu’ils ont une grande tendance à se laisser guider par un fort sentiment prioritaire, au point de refuser d’entamer la moindre régulation. Dans la mesure où ils s’attendent à ce que ce soit l’autre qui régule la situation, ils ne font rien pour tenter de résoudre le conflit. Cela me ramène au problème de surconfiance qui s’accompagne souvent d’un phénomène bien connu chez les piétons, appelé l’illusion de visibilité : lorsque l’on voit quelqu’un, on a le sentiment, la certitude d’être vu, d’où certains comportements.
Face à ces difficultés, plusieurs mesures peuvent être envisagées. Elles visent à améliorer l’harmonisation des comportements des usagers.
En matière d’infrastructures routières, il est nécessaire d’intégrer la spécificité des deux-roues, le but étant d’améliorer la visibilité et, dans le même temps, de diminuer les vitesses d’interaction. En effet, plus une vitesse d’interaction est diminuée, plus la prise d’information des autres usagers est facilitée.
Les actions sur les infrastructures peuvent également viser à limiter les manœuvres potentiellement génératrices de conflits entre les deux types d’usagers. Par exemple, empêcher les stationnements à gauche pour éviter des manœuvres inopinées des automobilistes qui omettraient un certain nombre de précautions ; ou encore dissuader les remontées de files aux intersections, endroit où peuvent se produire les interactions dangereuses.
Une autre piste consiste à définir les moyens permettant de favoriser la détectabilité du motard. Je pense à l’équipement des conducteurs de motos, dont nous reparlerons.
Enfin, la formation des conducteurs est primordiale.
Les motards doivent être davantage formés à la méfiance qu’à la performance. Ils pourront ainsi tenir compte des difficultés rencontrées par les autres usagers à les percevoir et à anticiper des manœuvres parfois atypiques, plutôt que chercher à imposer leur droit de passage coûte que coûte.
Quant aux automobilistes, leur formation doit s’attacher à intégrer davantage la dimension deux-roues motorisés, pour leur enseigner des stratégies de recherche d’information plus efficaces dans les situations où ils sont susceptibles de rencontrer ce type de véhicule.
M. PhanVuthy, responsable du département accidentologie au Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques (CEESAR). Je centrerai mon propos sur les outils d’analyse des mécanismes accidentels et lésionnels, au travers des projets que nous menons au CEESAR depuis une dizaine d’années.
De 2001 à 2005, dans le cadre des projets MAIDS (Motorcycle accident in depth study) et RIDER (Recherche sur les accidents impliquant un deux-roues motorisé), nous avons analysé environ 350 accidents impliquant un deux-roues motorisé dans le département de l’Essonne. La particularité de ce travail a été que nous nous trouvions en temps réel, avec les forces de l’ordre, sur les lieux de l’accident pour en décrire les paramètres : causes, infrastructures, véhicules, protagonistes impliqués. Il a permis la création d’une base de données importante comportant environ 1 800 paramètres, laquelle apporte aujourd’hui des connaissances sur les causes et les mécanismes lésionnels.
Grâce à cette base de données, nous avons pu initier d’autres projets.
Avec des équipementiers de casques et des universitaires à Strasbourg, nous avons travaillé sur les impacts sur les casques des deux-roues motorisés, ce qui a permis à un équipementier de pouvoir développer, voire d’améliorer les siens.
Nous avons travaillé en collaboration avec un autre équipementier sur la modélisation des détections de chocs et de pertes de contrôle. Il s’agit de savoir, en cas de choc, comment déclencher un gilet ; et en cas de perte de contrôle, comment déclencher un élément de sécurité passif.
Récemment, nous avons participé à une étude de conduite naturelle, avec des motos équipées de différents capteurs et de vidéos. Les données de l’accidentologie recueillies entre 2001 et 2005 ont permis, entre autres, de limiter les paramètres à étudier et à prendre en compte au titre de cette expérience.
Nous avons également participé à la rédaction du rapport du préfet Guyot, intitulé « Gisements de sécurité routière : les deux-roues motorisés ».
Mon message est que, si les données que nous avons analysées entre 2001 et 2005 ont été utilisées par la suite dans le cadre d’autres recherches, il est nécessaire de pérenniser cette activité de recherche et d’analyse des accidents en temps réel afin d’en permettre une bonne compréhension, sachant que le monde des deux-roues motorisés a fortement évolué.
M. Michel Vilbois. Je vais vous présenter les travaux et les pistes que propose la Délégation à la sécurité routière.
En juin 2009, à la suite du rapport du préfet Guyot, nous avons ouvert une concertation nationale sur la sécurité des deux-roues motorisés, concertation à l’issue de laquelle nous avons pu dégager trois pistes d’action.
La première consiste à améliorer la connaissance de l’accidentalité. Les études qui viennent d’être présentées démontrent que connaître permet d’agir. Elles contribuent ainsi à contredire un certain nombre d’idées fausses sur le deux-roues motorisé.
En effet, comme le montre une étude du GEMA, la proportion de motards qui se disent transgressifs, de l’ordre de 18 %, est à peu près la même que pour les automobilistes. Il faut en tenir compte dans l’ensemble de la chaîne, de l’éducation-prévention au contrôle-sanction.
La proportion de motards considérés par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) comme responsables dans les accidents mortels est, à quelques points près, la même que pour les conducteurs de véhicules légers, de l’ordre de 41 à 47 %.
La proportion de motards victimes d’un accident responsable avec un taux d’alcool supérieur au taux légal est similaire à celle des automobilistes.
La deuxième piste d’action vise l’amélioration de la perception mutuelle de l’ensemble des usagers. Dans le cadre de la concertation, nous avons fait diffuser à plus d’un million d’exemplaires une brochure intitulée « Deux-roues motorisés, automobilistes : apprenons à mieux nous connaître », dont l’objectif est d’informer le conducteur d’un VL qu’il doit s’attendre à voir arriver un motard. Cet élément très important pour nous s’inscrit dans les évolutions en cours en matière de formation des conducteurs de quatre roues.
La troisième piste d’action est la formation. Dans ce domaine, les comités interministériels de 2010 et 2011 ont pris des décisions qui relèvent d’un principe simple qui a fait consensus, à savoir qu’il ne peut y avoir de conduite de deux-roues motorisé sans formation adéquate.
C’est ainsi que les titulaires du permis B doivent dorénavant suivre une formation spécifique pour conduire un 125 cm3, un scooter ou un tricycle.
En outre, nous mettons actuellement en place une formation complémentaire pour les titulaires du permis A (permis moto) qui reprennent la conduite d’une moto après plusieurs années de non-pratique.
Cela me permet de faire le lien avec trois pistes de travail.
La première consiste à travailler sur le post-permis, afin de sensibiliser le jeune conducteur, qui a quelques mois de pratique, au problème de surconfiance qui, comme l’a souligné M. Van Elslande, est un vrai sujet. Nous savons tous en effet que la sur-accidentalité, qui n’est pas propre aux deux-roues motorisés, existe également après les premiers mois d’obtention du permis.
La deuxième piste de travail est la protection des motocyclistes. On a l’habitude de dire que le motard est sa propre carrosserie, mais aussi sa seule carrosserie. Un travail est engagé aux niveaux communautaire et international sur l’amélioration de la visibilité et de l’équipement de protection de l’engin lui-même. Nous voudrions continuer de travailler sur les équipements de protection du motard, dont certains sont normalisés, d’autres pas. Les Belges viennent de prendre des mesures pour rendre obligatoire un équipement protecteur minimum. En matière d’amélioration de la situation du motard après accident, c’est pour nous une vraie piste : une dorsale n’empêchera pas un accident, mais évitera des séquelles très importantes.
La troisième piste de travail est celle de l’amélioration des infrastructures. Certes, elles n’éviteront jamais la prise de risque inconsidérée, mais elles peuvent éviter l’accident. Dans le cadre de la concertation, un guide intitulé « Recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés » a été réalisé par un service technique du ministère de l’écologie, le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). Des inspections de sécurité commencent à se mettre en place sur l’ensemble des réseaux, y compris celui des collectivités locales, selon une méthodologie dont nous discutons actuellement avec les associations de motards. Cette piste nous semble prometteuse.
M. Hervé Gicquel. Pour nous, la connaissance est extrêmement importante et devrait être partagée. Au cours des dix dernières années, certaines sciences, comme la biomécanique, ont évolué, et l’Observatoire national de la sécurité routière a fait des progrès considérables. Néanmoins, encore aujourd’hui, la connaissance n’est pas partagée par tous, puisqu’on ne connaît pas précisément le parc des deux-roues motorisés en France. Or cette connaissance nous semble indispensable en termes de formation, d’équipements, voire de répression.
Le portrait type d’un adhérent au Club 14 est très éloigné de l’image du marginal sans ressource qui prévalait à une certaine époque. Les gens qui pratiquent la moto aujourd’hui ont environ quarante ans et un certain mode de vie : ils ont une automobile dans 90 à 94 % des cas, des charges de famille, un emploi et des responsabilités dans la société civile.
Aujourd’hui, 50 % des ventes neuves de motocyclettes concernent des scooters. La population qui conduit ces véhicules utilitaires, essentiellement pour se rendre au travail, a un permis B et n’a pas reçu de formation. Je le confirme : la pratique du deux-roues motorisé est très diversifiée.
On est également dans du multimodal. Certaines personnes font de la moto, mais aussi du scooter, de la voiture, et prennent les transports en commun. Il n’est pas facile de communiquer avec cette population, ce qui est pourtant nécessaire.
L’association Club 14 regroupe 430 000 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire. Ils font du loisir et de l’utilitaire en proportion égale, et leur degré de connaissance est différent.
Les personnes qui roulent en grosse moto, de plus de 125 cm3, ont la connaissance, à travers des études que nous avons nous-mêmes réalisées avec AXA Prévention, de leur fragilité : ils savent qu’il peut leur arriver quelque chose, et donc qu’ils doivent s’équiper.
Les gens qui roulent en scooter, de plus en plus nombreux, en revanche, même s’ils sont matures et responsables, ne s’équipent pas correctement. À cet égard, nous ferons des recommandations. Le guide du CERTU sur la prise en compte des deux-roues motorisés dans les infrastructures est très bien fait. Cette connaissance qui sommeille dans les bureaux devrait être utilisée, même si se pose le problème des ressources : on ne peut pas exiger des équipements pour les motos et pas pour les autres.
Chaque année, 800 personnes se tuent en moto, dont un tiers toutes seules. Ces dernières sont-elles mortes parce qu’elles roulaient très mal, parce qu’elles n’ont pas bénéficié d’une formation ou parce qu’elles étaient mal équipées ? Le sujet doit être étudié.
Aujourd’hui, l’équipement protecteur obligatoire du pilote et du passager en moto est le casque. Nous sommes évidemment favorables à des recommandations en matière d’équipements. Des normes commencent à se mettre en place, mais elles doivent être partagées aux niveaux français et européen.
M. le président Armand Jung. Que préconisez-vous en la matière ?
M. Hervé Gicquel. Le port du casque, de gants, de chaussures, du pantalon, du gilet airbag, de la protection dorsale, du blouson.
M. le président Armand Jung. Tout cela en même temps ?
M. Hervé Gicquel. Bien sûr.
M. le président Armand Jung. Au-delà des constats et des analyses, notre problème est de faire en sorte qu’il y ait le moins de morts possible. On me dit que la tête et le thorax sont les points les plus vulnérables à cet égard. Le blouson airbag vous paraît-il indispensable ?
M. Hervé Gicquel. L’accidentologie ne s’apprécie pas seulement en fonction du nombre de tués. Il ne faut pas oublier les 20 000 blessés corporels, qui engendrent un coût croissant. La traumatologie accidentelle montre que, en dehors de la tête, le tronc et le bassin sont les parties les plus vulnérables. À cet égard, l’airbag constitue une solution et nous encourageons nos adhérents à s’en équiper. Les matériels existants sont en voie d’amélioration et de normalisation.
Cela étant, la traumatologie porte aussi sur les membres inférieurs. Les recommandations d’équipement doivent faire l’objet d’un processus progressif.
Par ailleurs, l’accès à la puissance et la formation sont deux éléments importants.
M. Michel Guendon, vice-président du Club 14. L’accès à la puissance et à la performance en moto constitue un réel problème, tant il est facile. En automobile, un jeune qui vient d’avoir son permis a très peu accès à ce double phénomène dans la mesure où il est limité par le prix des véhicules : pour avoir des accélérations de 0 à 100 kilomètres/heure en 3,5 secondes, il faut avoir une Ferrari ou une Porsche, alors qu’en moto, pour un investissement de 2 000 euros, cela est possible ! Depuis trente ans, nous essayons d’apprendre de façon progressive aux personnes avec lesquelles nous travaillons cet accès à la puissance et à la performance. Un jeune conducteur – qu’il s’agisse de son âge ou de la date d’obtention de son permis – n’a pas forcément la maîtrise de la moto, encore moins celle de sa puissance.
M. le président Armand Jung. Que proposez-vous ? De construire des motos moins puissantes ? Est-il d’ailleurs indispensable d’avoir des motos très puissantes alors que la vitesse est limitée à 130 kilomètres/heure dans notre pays ?
M. Michel Guendon. Cette question touche à un autre domaine : le marché des constructeurs. Nous n’avons pas vocation à nous y opposer, dans la mesure où il génère, notamment, des emplois…
M. Philippe Houillon, rapporteur. On fabrique des machines qui roulent à 250 kilomètres/heure, voire plus, et, en même temps, des centaines de personnes ou organismes réfléchissent aux moyens de réduire la vitesse et produisent des matériels à cet effet. Voilà le problème ! D’ailleurs, les vastes discussions sur le LAVIA en témoignent.
M. Christian Vanneste. Les interventions ont montré que la différence entre les deux-roues motorisés et les véhicules légers, s’agissant du nombre des accidents ou de celui des morts et des blessés graves, est essentiellement liée au manque de protection des motocyclistes.
On a commencé à améliorer sensiblement la sécurité des véhicules, mais beaucoup moins celle des motos.
S’agissant de l’équipement des pilotes, notamment des tenues airbag, on a souligné l’évolution de la mentalité des motards. Il subsiste néanmoins une identité forte du pilote de deux-roues. La résistance à l’égard du port des gilets fluorescents en témoigne.
Si je ne suis pas partisan de cette mesure, la question des tenues airbag me paraît essentielle. Mais la multiplication des tenues de sécurité, forcément peu vendues compte tenu du nombre relativement faible de motards, ne rendra-t-elle pas plus difficile l’accès aux deux-roues motorisés ?
Il faut par ailleurs souligner le transfert de l’accidentologie de la route vers la ville, beaucoup de motards, aujourd’hui, étant des urbains utilisant la moto comme moyen de transport plus facile pour aller travailler. Celle-ci est ainsi devenue un outil plus qu’un objet de désir.
Enfin, vous avez parlé de l’alcoolisme : quelles sont les données s’agissant des autres addictions, à la drogue notamment ?
M. Philippe Monneret, vice-président du Club 14. La formation est un aspect important, dont la sensibilisation aux équipements fait partie.
On pourrait à cet égard rendre obligatoire le port de gants ou interdire de rouler en short, ce qui est pratique courante notamment dans le Sud de la France ; trop de conducteurs de moto ou de scooter sont mal équipés. Avant d’encourager l’airbag, qui coûte cher, certaines mesures simples de ce type pourraient être mises en place.
M. le président Armand Jung. Quel est le prix d’un airbag ?
M. Philippe Monneret. De 400 à 500 euros.
La dorsale devrait également être encouragée.
Les auteurs des statistiques ont dit que les motards se croyaient un peu tout permis, mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité. Les conducteurs de moto savent qu’ils sont plus fragiles et adaptent leur comportement en conséquence – à l’exception de quelques irresponsables, comme il en existe partout. Ce sont donc en général des gens raisonnables, de même que des spécialistes de la sécurité routière, qui viennent sciemment se former. Même après le permis moto, qui est beaucoup plus compliqué à obtenir que le permis auto, dans la mesure où il comporte de la conduite sur piste, des rétrogradages ou des freinages, ils continuent à venir se former.
L’ABS permettrait d’améliorer la sécurité. Des techniques modernes devraient notamment être développées sur les scooters.
M. le président Armand Jung. Faites-nous la liste de vos préconisations sous la forme d’un cahier des charges. Nous souhaitons avoir des propositions émanant des techniciens et des hommes de terrain.
M. Philippe Monneret. Enfin, la vitesse est parfois un facteur de sécurité pour une moto : quand on roule sur des voies rapides avec une petite 125 cm3, on est souvent doublé ! Une limitation de vitesse à 45 kilomètres/heure pour un scooter conduit par un jeune de quatorze ans ne rime à rien et peut être dangereuse ! On peut avoir une moto roulant à 250 kilomètres/heure sur circuit et respecter le code de la route. La moto doit rester un plaisir ! Il vaut mieux apprendre à respecter les règles et à avoir un bon comportement sur la route que d’essayer de tirer les gens vers le bas en fabriquant des motos qui ne dépassent pas 130 kilomètres/heure.
M. le président Armand Jung. Où rouleraient les motos dépassant cette vitesse ?
M. Philippe Monneret. Sur les circuits.
M. le président Armand Jung. Mais la plupart des motards ne vont pas sur les circuits !
On enregistre tous les week-ends des morts dans les cols vosgiens, tel le col du Bonhomme, que les motards utilisent comme des pistes au lieu d’aller sur les circuits !
M. Philippe Monneret. Il faut donc les faire venir le plus possible sur des circuits réglementés…
M. le président Armand Jung. Il faut faire un travail en commun avec les motards, qui relaient les messages, et la gendarmerie. On a ainsi réussi à réduire le nombre de morts dans ces cols depuis un an. Je vous invite d’ailleurs à participer à ce travail.
M. Jérôme Lambert. La vitesse excessive, au-delà des limites autorisées, est-elle la cause de beaucoup d’accidents de deux-roues ? Un grand nombre d’entre eux a lieu en ville : je ne suis pas sûr qu’on puisse les imputer à ce facteur. Quelle est plus largement la part de la vitesse et de la puissance des motos dans l’accidentologie ?
Pour avoir un accident dans le col du Bonhomme, il n’est pas nécessaire de rouler à 140 kilomètres/heure ! Ce n’est donc pas parce qu’une moto roule à 250 kilomètres/heure qu’elle a plus de risque d’avoir un accident qu’une autre roulant à 60 kilomètres/heure en virant mal dans un tournant.
M. Philippe Monneret. On peut en effet aller trop vite à certains endroits à 50 kilomètres/heure…
M. Jean-Louis Martin. Les données accidentologiques démontrent clairement que la vitesse est un facteur d’accident ainsi qu’un facteur aggravant. Personne ne peut dire le contraire ! Bien sûr, il faut adapter la vitesse, mais à 250 kilomètres/heure, le motard est en très grand danger, à moins d’être un expert et sur un circuit !
M. Jérôme Lambert. Y a-t-il beaucoup d’accidents à 250 kilomètres/heure ?
M. Jean-Louis Martin. Il est très difficile de savoir à quelle vitesse roulait une moto à partir des données d’accidents dans la mesure où l’on a techniquement du mal à déterminer la vitesse de choc avec un deux-roues. Mais les observations sur l’ensemble du parc motorisé montrent que les véhicules légers ont diminué considérablement leur vitesse moyenne alors que cette baisse est beaucoup moins marquée pour les deux-roues.
M. Pierre Van Elslande. Certaines données très approfondies permettent d’avoir une meilleure appréciation de la vitesse des deux-roues dans les accidents, mais elles pèchent par leur faible représentativité. Cependant, sur 1 000 accidents étudiés récemment, environ 5 % sont imputables à des vitesses très élevées.
Cela étant, 20 % des problèmes de vitesse viennent, non du fait qu’elle est trop élevée dans l’absolu, mais qu’elle n’est pas adaptée aux situations. L’enjeu ne réside pas dans la limitation des vitesses extrêmes – qui constituent un problème marginal, qu’il faut bien sûr combattre – mais dans l’adoption de vitesses plus appropriées.
M. David Dumain, rédacteur en chef de Moto Journal. Une moto bridée va aussi à 250 kilomètres/heure : le bridage n’est pas une solution à la vitesse !
M. le rapporteur. Pourquoi ?
M. David Dumain. Le bridage de la puissance n’est pas forcément lié à la vitesse.
M. le rapporteur. Le Japon, par exemple, est un producteur de motos important et les motos y sont bridées.
M. Pierre Orluc. Certains pays connaissent en effet des bridages. Parfois ils sont liés à des incitations de la part des assurances, comme en Allemagne au-dessus de 100 chevaux. Au Japon, il existe des limitations à 400 cm3 pour d’autres raisons. Il s’agit d’une question très complexe. On sait, depuis une étude de 1997 menée par un organisme officiel néerlandais, laquelle fait encore autorité, qu’il n’existe pas de rapport entre l’accidentalité et la puissance des motos. Celles de plus de 100 CV – qui font l’objet d’une limitation depuis 1986 – ne sont pas en soi plus accidentogènes que d’autres. De plus, la vitesse s’évalue à partir de multiples critères, notamment l’environnement.
La limitation d’un cyclomoteur à 45 kilomètres/heure dans un environnement limité à 50 est une aberration – ce que la sécurité routière ne veut pas reconnaître. On ne peut être en sécurité à 45 kilomètres/heure quand on est doublé par des véhicules allant à 50 !
La vitesse est donc une notion tout à fait relative. Celle de 250 kilomètres/heure est une donnée emblématique, facile à vendre auprès d’un grand public, mais ne correspond pas à la réalité d’une pratique : elle recouvre des cas exceptionnels. La pratique majoritaire est au contraire une vitesse adaptée en fonction d’un environnement donné. Or on peut être en danger à une vitesse très faible !
M. le rapporteur. Il faut distinguer vitesse en valeur absolue et vitesse adaptée.
M. le président Armand Jung. La presse emploie parfois des termes pudiques, évoquant par exemple, au sujet de la mort d’un motard sur une route départementale, une vitesse qui ne semblait pas adaptée, alors qu’il s’est écrasé contre un arbre parce qu’il roulait comme un fou !
Il ne faut donc pas abuser de cette formule de vitesse adaptée.
M. Jérôme Lambert. Il y a un mois, je roulais sur une route limitée à 50 kilomètres/heure dans la mesure où elle est dangereuse en raison de la présence d’ornières : heureusement que je roulais à 30 ou 40 kilomètres/heure car je suis passé sur un nid-de-poule de 25 centimètres, ce qui, à 50 kilomètres/heure, aurait pu être mortel.
M. David Dumain. Cela renvoie à la maîtrise du véhicule, à l’anticipation et à la formation à la conduite.
En janvier 2010, à Moto Journal, nous avons fait le constat d’un état d’urgence lié au fossé existant entre nos droits et devoirs de motard et la perception qu’en avaient le grand public et les autorités. Peu de gens ont vraiment l’expérience de la moto et savent qu’une moto bridée va aussi vite que celle qui ne l’est pas.
M. le rapporteur. Pourquoi ?
M. David Dumain. Quand on lance une moto de 600 ou 1 000 cm3, même avec 100 CV, elle atteint 250 kilomètres/heure. Dire qu’on va brider les motos est très vendeur, mais les motos bridées vont quand même très vite !
Notre magazine est lu chaque semaine par des dizaines de milliers de motards : nous nous sentons responsables vis-à-vis d’eux ; ils font partie d’un public très large. Par ailleurs, il y a autant de sortes de motos aujourd’hui que de variétés de fromages en France.
Si les statistiques sont utiles, il ne faut pas en conclure à une « surconfiance » des motards à partir de constats très arbitraires !
M. Pierre Van Elslande. J’évoquais à ce sujet des résultats d’analyses accidentologiques approfondies qui s’appuient sur des études que nous réalisons sur les lieux d’accidents, sur le travail d’une équipe technique de deux personnes pendant une semaine sur place et sur des interviews détaillées avec des psychologues auprès des usagers. On ne peut donc guère parler d’arbitraire ! Par ailleurs, nos conclusions portent, non sur les motards en général, mais sur les accidentés.
M. David Dumain. Nous avons aussi des idées sur ce qui pourrait améliorer la protection et la sécurité des motards, mais nous avons pris la peine de consulter préalablement ceux-ci au travers de deux questionnaires très complets, sur lesquels je vous remettrai un dossier. Les résultats montrent que les mesures prises ou envisagées par les autorités sont perçues comme injustes et logiquement incomprises, mais que les motards sont des gens responsables puisqu’ils n’attendent pas d’y être obligés pour porter des plaques dorsales, des gants ou des chaussures montantes. De plus, 86 % de nos lecteurs reconnaissent devoir améliorer la maîtrise de leur véhicule. Cela les pousse à plébisciter la lutte contre l’alcoolémie ou contre le téléphone au volant, ou à réclamer davantage d’aides sur les équipements de protection ou le perfectionnement de la conduite.
Le bridage des motos est une mesure avant tout symbolique pour lutter contre la vitesse. Pour limiter les accidents, il faut surtout mettre l’accent sur la maîtrise du véhicule, dont vous ne voulez pas toujours entendre parler dans la mesure où vous y voyez une sorte de « pousse au crime ».
M. le président Armand Jung. Pas du tout. Il est possible, comme je l’ai dit, de débattre de façon franche sans pour autant stigmatiser qui que ce soit.
M. le rapporteur. Je parcours personnellement de 30 000 à 40 000 kilomètres par an et je vois tous les jours sur des portions autoroutières des motards doublant à des vitesses très importantes, de l’ordre de 180 à 200 kilomètres/heure. Cela n’est pas un phénomène marginal !
M. David Dumain. La conclusion des réponses à nos questionnaires est que la maîtrise du véhicule doit être associée au comportement. Les stages de perfectionnement à la conduite servent aussi à cela. Denis Couvent, qui a récemment écrit un manuel de conduite motocycliste, attache beaucoup d’importance à cet aspect.
Un point clé de la prévention consiste à nous autoriser à circuler dans les couloirs de bus ou entre les files de voiture : cela constitue un préalable. Il nous appartient ensuite d’être préparés et équipés comme il le faut pour que le nombre d’accidents – qui n’a jamais été aussi faible depuis trente-cinq ans malgré un parc roulant quatre fois plus important – diminue.
La Belgique vient à cet égard d’adopter trois mesures de bon sens : la circulation des deux-roues motorisées entre les files, l’autorisation du stationnement sur les trottoirs et la réflexion sur le port de vêtements couvrants pour protéger des chutes. Pense-t-on encore que l’on protégera longtemps les motards en prévoyant des plaques d’immatriculation plus grandes ?
M. le président Armand Jung. Le débat ne doit pas tourner à l’autojustification ni à l’accusation de tel ou tel. Il revient à notre Mission de poser la question des équipements.
M. Jean-Claude Hogrel. En tant que vendeurs de motos, nous observons le comportement des acheteurs. Nous constatons que notre clientèle vieillit : beaucoup recourent aujourd’hui à la moto avant tout comme un moyen de transport en réseau urbain. Nous avons mené une vaste campagne contre le débridage des cyclomoteurs – sur laquelle nous vous remettrons un dossier –, mais nous estimons, comme tous les professionnels, qu’une limitation de vitesse des cyclomoteurs à 60 kilomètres/heure, au lieu de 45, éviterait le débridage.
Une grande partie de nos clients ont entre quarante et cinquante ans et veulent un scooter automatique pour se déplacer. La formation aux 125 cm3 pourrait être améliorée, mais elle a le mérite d’exister. Cela étant, le permis moto est contradictoire : j’ai des clients qui viennent acheter un véhicule automatique et qui doivent passer un examen de permis où ils vont être chronométrés et faire des freinages d’urgence. Ils ne se préparent pourtant pas à un grand prix : ils souhaitent seulement se déplacer !
Commençons par former des conducteurs qui sont de bons pères de famille tranquilles achetant un scooter ou une moto pour aller travailler. Beaucoup ne veulent pas avoir de motos sportives et ne sont pas concernés par les véhicules bridés à 250 kilomètres/heure !
La troisième directive sur les permis de conduire va peut-être conduire à modifier la réglementation, mais on se demande pourquoi il n’y a pas de permis automatique pour les deux-roues, comme cela existe pour les voitures.
Nous sommes très attentifs à ces questions de sécurité car il y va de la survie de nos entreprises. D’ailleurs, lorsque nous livrons un véhicule neuf, nous insistons sur des éléments tels que les pneus neufs, les freins neufs ou le rodage.
La formation est un élément essentiel : elle conduit notamment à porter des équipements tels que des casques ou des gilets airbag.
Mme Margaret Erbin. Il faut distinguer les équipements réceptionnés au titre d’une directive communautaire qu’on appelle « EPI » – équipements de protection individuelle –, lesquels doivent être favorisés, et d’autres équipements qui semblent protecteurs mais qui ne le sont pas en réalité.
Nous avons par ailleurs déposé il y a quelques années auprès de certains de vos collègues députés une demande en vue de réduire la TVA sur les équipements réceptionnés. Pourquoi ne pas relayer cette demande auprès des autorités communautaires ?
Enfin, nous sommes tout à fait favorables à ce que soit mis en place au plus vite un continuum éducatif : le respect des autres est à cet égard un aspect essentiel.
M. Timothé de Romance. La présence d’un constructeur à cette table ronde est très importante. Les constructeurs ont en effet été peu associés aux différentes concertations dans le passé. Pourtant, pour améliorer la sécurité routière, le véhicule constitue un levier substantiel.
Beaucoup d’améliorations ont déjà été réalisées. Des marges de progrès existent encore dans ce domaine, même si elles ne sont pas aussi importantes que pour l’automobile. Le constructeur a donc un rôle à jouer : c’est toujours dans cet esprit que Piaggio a travaillé, que ce soit pour la conception de ses véhicules ou la sensibilisation de ses conducteurs.
M. Guillaume Chatillon. L’éventail des deux-roues motorisés est très large : les motos sportives qui vont très vite représentent une part infime du marché. La majorité des ventes portent sur des scooters de 50 cm3, accessibles à des adolescents ; elles s’inscrivent dans une logique d’aménagement du territoire et sont destinées à des personnes qui ont besoin de se déplacer dans des zones qui ne sont pas forcément desservies par les transports en commun.
Beaucoup de scooters sont utilisés en ville. Or, les statistiques ne rendent pas compte d’une segmentation fine des typologies de véhicules – selon qu’il s’agit de scooters, de motos, ou en fonction des tranches de puissance – pour dégager des facteurs à risque ou des circonstances d’accident particulières.
Piaggio fabrique des motos et des scooters depuis 1946. Nous avons réfléchi à la connaissance que nous avions de nos clients et de notre industrie et imaginé plusieurs pistes d’amélioration. Elles portent sur le comportement - qui concerne également la formation - le programme éducatif et la sensibilisation des personnes passant le permis de conduire à une conduite apaisée. La lutte contre l’alcool et les alertes de sécurité liées à l’usage des téléphones au volant nous paraissent à cet égard primordiales. Nous vous transmettrons nos propositions sur ce point.
S’agissant des infrastructures, le document réalisé par le CERTU constitue une vraie piste de progrès, sous réserve que les préconisations qu’il contient soient effectivement appliquées.
L’industrie automobile conçoit des véhicules en fonction de leur sécurité active – leur capacité à tenir la route – et élabore depuis plus d’une dizaine d’années des systèmes de sécurité passive – qui se sont développés avec les prétensionneurs de ceinture de sécurité ou les airbags. Cela a permis d’améliorer sensiblement la qualité et la résistance des voitures. Mais, pour les deux-roues motorisés, vu leur taille et leur conception, les zones d’absorption de choc n’existent pas et la notion d’airbag solidaire du véhicule paraît peu pertinente dans la mesure où les conducteurs accidentés sont très souvent éjectés.
Les constructeurs ont par ailleurs œuvré pour améliorer la fiabilité des véhicules ; cela correspond à une demande croissante du marché. Il faut aussi réfléchir à la visibilité des deux-roues. On peut faire le parallèle avec les véhicules particuliers européens, commercialisés depuis 2010, qui sont équipés de feux de jour.
M. le président Armand Jung. Sont-ils mis en série ?
M. Guillaume Chatillon. Oui. Or, de tels feux n’existent pas sur les deux-roues motorisés. Ces derniers avaient l’obligation de rouler avec les codes allumés, depuis les années 1980, pour être distingués dans le flux de la circulation ; mais aujourd’hui, vu la généralisation de ces feux de jour sur les véhicules particuliers, la distinction peut être délicate pour les usagers. On pourrait réfléchir à la création d’une couleur spécifique de feux pour les deux-roues motorisés.
Les systèmes de freinage ABS constituent une autre piste. Ils ont été généralisés, depuis 2002, sur toutes les voitures vendues dans l’Union européenne ; mais il n’existe pas de norme européenne en la matière pour les deux-roues motorisés ; ceux-ci ont, par conception, une instabilité plus grande qu’une voiture, et la phase de freinage, surtout dans un virage, est plus difficile à maîtriser.
Nous avons également réfléchi au contrôle technique, qui permet d’assurer un entretien de qualité. Mais il convient que son coût soit limité pour qu’il soit accepté.
Les équipements de protection individuelle constituent une autre piste d’amélioration. On peut toujours instaurer des règles très précises, mais il faut garder à l’esprit l’impact financier qui en résulte. Obliger à porter un pantalon pour conduire un deux-roues motorisé serait déjà une avancée ; mais assujettir cette obligation à des normes peut conduire à mettre sur le marché des produits coûteux et, ce faisant, à freiner leur acquisition.
En outre, pour la formation au permis de conduire, les véhicules avec ABS ne sont pas autorisés. Y recourir permettrait pourtant de sensibiliser les conducteurs à ce système de sécurité. L’évolution de la réglementation belge, au cours de cet été, mériterait d’être examinée.
Enfin, 50 000 personnes utilisent aujourd’hui des tricycles. Elles sont urbaines, ont une moyenne d’âge de quarante-huit ans, appartiennent aux catégories socio-professionnelles supérieures et ont déjà roulé en deux-roues motorisés ; elles utilisent essentiellement leur véhicule entre leur domicile et leur travail, ou pour leur profession dans les grandes villes.
Le succès de ces véhicules tient au fait qu’ils rassurent les utilisateurs, qui ont conscience des lacunes des deux-roues à moteur sur de mauvaises routes ou sur des chaussées glissantes. Ils permettent d’améliorer notamment les distances de freinage et le comportement routier.
M. Patrick Jacquot. Nous assurons depuis vingt-huit ans les conducteurs de deux-roues à moteur. Notre assurance a été créée par ses utilisateurs et comporte 40 000 membres fondateurs ; nous sommes une entreprise mutualiste, sans but lucratif. Notre seul intérêt est la protection des adhérents et, par extension, de tous ceux qui utilisent ce type de véhicules.
Depuis sa création, notre assurance a été amenée à gérer plus de 220 000 accidents.
Selon nos informations, les accidents en l’absence de tiers représentent moins de 20 % de l’ensemble des accidents. Lorsque l’accident a lieu avec un tiers, généralement un véhicule léger, dans deux cas sur trois le conducteur du deux-roues n’est pas responsable.
Dans les statistiques sur les accidents entre un automobiliste et un deux-roues à moteur, la fréquence baisse de moitié lorsque ce premier a obtenu le permis moto. Les travaux actuels sur la détectabilité des deux-roues à moteur montrent aussi que le nombre d’accidents varie du simple au double si l’automobiliste a été sensibilisé aux spécificités du risque de ces véhicules et a appris à les détecter. Je vous renvoie aux travaux de l’IFSTTAR, qui attestent combien le manque d’attention des automobilistes vis-à-vis de ceux-ci est un élément important.
Nous ne pensons pas, contrairement à M. Vanneste, que le risque principal soit dû à un manque de protection : il est avant tout lié au comportement et à la responsabilisation des conducteurs.
Nous faisons plusieurs propositions.
La première consiste à créer un véritable continuum éducatif dès le plus jeune âge, notamment à l’école, en collaboration avec les organisations œuvrant en faveur de la sécurité routière.
M. le rapporteur. Qui le financerait, notamment après l’obtention du permis ?
M. Patrick Jacquot. Ce continuum doit commencer dès la maternelle.
M. le rapporteur. Quel pourcentage de motards assurez-vous ?
M. Patrick Jacquot. 60 % des deux-roues.
M. le rapporteur. Votre mutuelle est-elle prête à participer, dans le cadre de ce continuum, au financement des séances de formation après le permis ?
M. Patrick Jacquot. Nous le faisons déjà depuis notre création, avec beaucoup moins de moyens que la MAIF par exemple, qui regroupe plusieurs millions de sociétaires, contre un peu plus de 200 000 pour ce qui nous concerne. Nous faisons appel également à nos délégués bénévoles, qui sont des sociétaires participant régulièrement dans la France entière à la sensibilisation des plus jeunes, notamment aux particularités et aux risques de la conduite des deux-roues à moteur. Nous estimons que cela relève de notre responsabilité ; nous avons d’ailleurs été les premiers à nous intéresser à la connaissance de ce type de véhicules, à y investir, puis à faire part de notre expérience et de notre savoir-faire.
Notre deuxième proposition tend à mieux former les conducteurs de deux-roues à moteur, notamment à l’analyse du comportement des autres usagers et à la détection des situations à risque. Ces conducteurs sont très attachés au respect des priorités dans la circulation.
M. Pierre Van Elslande. Cela fait partie du phénomène de « surconfiance » que j’ai évoqué.
M. Patrick Jacquot. Oui, mais nous préférons parler du respect des priorités, dans la mesure où beaucoup de conducteurs de deux-roues ont été tués ou blessés alors qu’ils avaient la priorité.
Troisième proposition : former les automobilistes à la détection des deux-roues en intégrant à la formation de base du permis de conduire une initiation à ces véhicules.
Quatrième proposition : créer un vrai décompte officiel du parc des deux-roues à moteur. En effet, beaucoup disent qu’ils représentent 2 % du trafic. Or, le nombre de motards de grosses cylindrées est passé de 200 000 en 1970 à 800 000 en 1980 et à 1,5 million aujourd’hui ; si l’on rajoute les conducteurs de 125 cm3 et de cyclomoteurs, l’ensemble représente 3 millions de personnes, contre 31 millions d’automobilistes. La part des conducteurs de deux-roues motorisés serait, en ce cas, aujourd’hui, bien plus proche des 10 % du trafic.
Cinquième proposition : assurer un réel suivi pédagogique des auto-écoles et des moto-écoles. Celles-ci s’apparentent aujourd’hui à des « boîtes à permis » : on y apprend moins à conduire qu’à passer le permis. Rappelons que le taux de réussite est de 80 % pour le permis moto contre 50 % pour le permis auto. À Paris, selon la préfecture, 30 % des motards tués en 2003 avaient leur permis depuis moins d’un mois et 60 % depuis moins d’un an.
Sixième proposition : créer l’équité entre les usagers. Une des mesures annoncées lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai portait sur l’obligation pour un conducteur de deux-roues à moteur de suivre une formation s’il n’avait pas conduit depuis cinq ans. Pourquoi ne pas prévoir la même obligation pour les automobilistes ?
Dernière proposition : prendre en compte la fragilité des deux-roues à moteur dans l’infrastructure, qui constitue un facteur aggravant dans la majorité des accidents. On peut citer notamment les barrières de sécurité guillotine, les ralentisseurs ou les signalisations non adaptées.
En intégrant la sécurité des deux-roues à moteur dans le cahier des charges de tout nouvel équipement ou mobilier urbain, on améliorerait largement la situation. Selon les expériences menées dans certaines collectivités locales, comme le département de l’Hérault – où se trouve le siège de notre mutuelle, qui a d’ailleurs œuvré en faveur de ces expériences –, lorsque la présence des deux-roues motorisés est prise en compte, le surcoût total de l’infrastructure est estimé à 1 %.
Enfin, je voudrais rappeler que, pour un automobiliste, jusqu’à 30 kilomètres/heure, la probabilité d’être tué dans un choc frontal est quasi nulle – 0 % de risque pour ceux qui portent la ceinture et 0,1 % pour ceux qui ne la portent pas – ; mais pour un motard, elle est très élevée : tous les crash tests des casques de moto sont effectués à 27 kilomètres/heure. Au-delà, le casque et le crâne du motard ne résistent pas.
M. le président Armand Jung. Les chiffres sont encore inférieurs pour les cyclistes…
M. Patrick Jacquot. Oui, mais on ne les accuse pas de vitesse excessive…
M. le président Armand Jung. Je vous invite à nous faire parvenir vos propositions.
Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre contribution et de la franchise de vos propos.
*
* *
Table ronde sur le problème spécifique des jeunes : M. Jean Yves Salaün, délégué général de l’Association Prévention routière ; M. Ahmed Lel Khadiri, délégué général de Animafac ; M. Philippe Loup, président de la Fédération générale des associations étudiantes (Fage) ; M. Marc Meunier, sous directeur de l’éducation routière - Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (DSCR) ; M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche à l’IFSTTAR et M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche
Mardi 6 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de votre présence et vous propose que chacun se présente rapidement, après quoi nous passerons à la discussion de fond. Le rapporteur et moi-même serons très attentifs à vos analyses et à vos suggestions car nous serons ensuite amenés à déposer des conclusions et à adresser des propositions au gouvernement, probablement dans le courant du mois d’octobre.
Le problème des jeunes est apparu de façon récurrente au cours de nos travaux, les uns criant haro à leur encontre, les accusant notamment de rouler trop vite, d’autres formulant des opinions plus nuancées. Votre expertise, à partir de votre connaissance du terrain, et vos observations nous serons donc précieuses.
M. Jean-Pascal Assailly, chargé de recherche à l’IFSTTAR. Je travaille depuis vingt-cinq ans sur les accidents de la route des quinze – vingt-cinq ans. J’essaierai donc de vous transmettre des informations pouvant déboucher sur des pistes d’action en matière de prévention.
M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’IFSTTAR. Statisticien de formation, je travaille tout particulièrement sur la modélisation du risque pour les jeunes conducteurs. Nous avons à cet égard mené une grande enquête, de 2002 à 2005, dont je vous présenterai les grandes lignes. Sur cette base, j’évoquerai les moyens d’une politique efficace pour lutter contre les accidents de la route.
M. Marc Meunier, sous-directeur de l’éducation routière au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Au sein de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR), ma sous-direction prend en charge les questions relatives à la formation des conducteurs, en amont comme en aval du permis de conduire, ainsi que la gestion des inspecteurs qui le délivrent.
M. Ahmed Lel Khadiri, délégué général de Animafac. Notre réseau d’associations étudiantes mène, depuis plus de dix ans, des actions à la fois de sensibilisation et de formation sur les différents thèmes de la sécurité routière et, plus largement, sur la prévention des conduites à risque.
M. Philippe Loup, président de la fédération générale des associations étudiantes (FAGE). Nos associations travaillent aussi sur les questions de sécurité routière depuis bientôt une vingtaine années, en mettant l’accent sur leur interaction avec les activités festives. Nous explorons de nouvelles pistes sur les notions de conduite responsable et de développement durable.
M. Jean-Yves Salaün, délégué général de l’association prévention routière. Notre association agit sur l’ensemble du territoire national par l’intermédiaire de ses 101 comités départementaux. L’éducation routière constitue l’essentiel de notre mission. Nous militons en faveur de son renforcement dans le milieu scolaire, souhaitant notamment qu’une heure d’éducation routière par mois soit programmée tout au long du cursus scolaire.
Par ailleurs cela fait maintenant douze ans que nous avons essayé de créer en France le réflexe dit du capitaine de soirée, ou SAM.
M. le président Armand Jung. Venons-en à la discussion de fond.
M. Jean-Pascal Assailly. J’ai préparé à votre intention un document dans lequel figure l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le problème des jeunes et des accidents de la route.
Les jeunes sont plus nombreux que par le passé en raison de l’accroissement du taux de natalité, ce qui augmente automatiquement le nombre des accidents les affectant. Ils représentent aujourd’hui 15 % de la population mais 25 % des tués sur la route et 31 % des blessés graves. Ce sur-risque coûte très cher à la société : il est évalué à 1,7 million d’euros par personne en intégrant tout ce que le jeune aurait pu apporter à la collectivité s’il avait accompli son espérance de vie. On constate aussi une tendance des accidents mortels à frapper à un âge de plus en plus bas, pour des raisons à la fois biologiques et psychologiques.
Le sur-risque jeune existait déjà dans l’Egypte ancienne et existera probablement encore dans 2000 ans. On constate en effet, dans l’histoire de l’humanité, une tendance constante et quasiment naturelle à la mise en danger de soi entre quinze et vingt-cinq ans.
M. le président Armand Jung. Dans l’antiquité, et pendant très longtemps, la surmortalité des jeunes résultait davantage des guerres que des accidents de chars.
M. Jean-Pascal Assailly. Certes, mais les tablettes égyptiennes déploraient déjà le caractère incivil des adolescents à la sortie des tavernes, où ils consommaient beaucoup de bière et se comportaient plus mal que les adultes.
Il faut donc prendre garde à ne pas porter un regard trop négatif sur l’attitude des jeunes : « il faut bien que jeunesse se passe ».
Notre tableau montre qu’au pic de l’insécurité routière, en 1972, sur 16 000 tués, 4 000 étaient des jeunes ; en 2000, sur 8 000 tués, 2 000 étaient des jeunes ; aujourd’hui, grâce aux progrès récemment réalisés, sur 4 000 tués, 1 000 sont des jeunes. On observe donc un taux constant de 25 %. Par conséquent, les jeunes se comportent de la même façon que la population de référence : mieux que les générations précédentes et dans la même proportion. Il n’existe donc aucune raison de se monter particulièrement pessimiste, stigmatisant ou répressif à leur égard. Les mesures générales de sécurité routière produisent les mêmes effets quelles que soient les classes d’âges. En fait, le sur-risque jeune « coulisse » depuis les débuts de l’humanité, et tout progrès systémique entraîne des conséquences analogues, aussi bien sur les jeunes que sur les autres tranches de la population.
M. Jérôme Lambert. Cela signifie-t-il que toutes les politiques visant à cibler les jeunes sont inutiles ?
M. Jean-Pascal Assailly. C’est, en effet, mon premier message : arrêtons de cibler les actions en fonction de l’âge et prenons des mesures générales efficaces pour l’ensemble de la population. Leurs effets sur les jeunes seront les mêmes. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre des mesures spécifiques concernant, par exemple, le port du casque à cyclomoteur ou la consommation de cannabis.
Mon observation générale est également valable pour les personnes âgées.
En revanche, on constate de grandes différences entre hommes et femmes. Parmi les jeunes, huit tués sur dix sont des garçons et, sur les deux filles, l’une se trouvait être la passagère d’un conducteur masculin. La responsabilité des accidents mortels s’établit donc à neuf contre un selon le sexe ; le retour de discothèque chez les jeunes jouant à peu près le même rôle que le retour de mariage chez les plus vieux.
Le principal déterminant des accidents de la route s’impute à la tenue du volant par un homme ou par une femme. Le reste est presque négligeable.
M. le président Armand Jung. Un de nos axes de réflexion porte précisément sur la possibilité de cibler des actions ou de communiquer sur cette question des hommes et des femmes.
M. Jean-Pascal Assailly. Si l’on ne peut, évidemment, toucher aux différences biologiques entre hommes et femmes, on peut, en revanche, prendre en compte des facteurs psychologiques tels que la masculinité exagérée au volant, l’adhésion aux stéréotypes propres au sexe et la façon dont l’éducation parentale la construit ou l’encourage. Car les hommes et les femmes n’ont pas du tout les mêmes problèmes au volant ; ils ne commettent pas les mêmes fautes de conduite. On retrouve d’ailleurs des différences de même nature en matière de maladies infantiles, d’accidents domestiques, de comportements dans le sport, de délinquance, de coups et blessures … On en viendrait à préconiser des routes pour garçons, comme il existe des écoles pour garçons. Sans tomber dans cette caricature, on pourrait envisager une formation et une prévention « à la carte » afin de prendre en compte le facteur le plus important – et de loin – de l’insécurité routière. De fait, on se limite aujourd’hui à le relever sans mener aucune action en rapport. La formation, à l’école comme à l’auto-école, l’examen pour le permis de conduire, ainsi que les stages de récupération de points de permis sont les mêmes pour les garçons et pour les filles, alors qu’ils n’ont pas les mêmes problèmes à surmonter. L’infraction prédomine chez les hommes, l’erreur chez les femmes.
On sait aussi que le milieu social exerce une influence importante dans l’enfance comme dans l’âge adulte, sur des questions aussi diverses que la santé, la sécurité, la réussite scolaire et sociale. Or, entre quinze et vingt-cinq ans, les jeunes issus de milieux favorisés présentent autant de risques routiers que les autres. Ils s’estiment magiquement protégés. L’ensemble des statistiques relatives aux accidents de la route et de sport, à la consommation d’alcool et de cannabis, aux suicides, aux dépressions et à l’anxiété, montre que les jeunes bourgeois présentent autant, sinon davantage, de risques que ceux des milieux défavorisés. Nous avons donc un message préventif important à adresser à ces jeunes, comme à leurs parents, pour leur expliquer que leur milieu social ne les protège pas.
M. Sylvain Lassarre. La grande enquête que j’ai évoquée fut financée par trois partenaires : la fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), la direction de la sécurité routière (DRS) et l’institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), dans le cadre du contrat passé entre l’État et le secteur des assurances. Elle a permis d’améliorer notre connaissance de la conduite automobile chez les jeunes.
Ainsi, nous savons que 40 % d’entre eux passent le permis de conduire dès dix-huit ans et que 73 % l’ont obtenu à vingt ans. Les garçons le présentent plus tôt que les filles, en moyenne de quatre mois. L’apprentissage accompagné de la conduite accélère l’accès au permis et favorise le taux de réussite à l’examen. En moyenne, les titulaires du permis de conduire l’ont passé 1,7 fois.
L’accès au permis de conduire coûte cher : environ 5 à 600 euros lors de l’enquête, mais on parle aujourd’hui de 1 500 euros.
Quant à l’accès à l’automobile, il n’est pas immédiat. Environ un tiers des dix-huit – vingt-cinq ans sont des emprunteurs de véhicules, à des parents ou à des amis ; les possesseurs de véhicules représentent un autre tiers ; le dernier tiers concerne les conducteurs mixtes : à la fois possesseurs et emprunteurs.
Les jeunes disposent le plus souvent de véhicules très anciens, d’une moyenne d’âge d’environ dix ans, avec des incidences sur la gravité des blessures car ils assurent une moindre protection en cas de choc, et peu puissants, entre 4 et 5 chevaux fiscaux. C’est pourquoi je conteste le mythe des jeunes roulant très vite. Ils sont néanmoins attirés par le désir de transgression des limitations de vitesse. Toutefois, nous manquons de données précises sur ce point, notamment sur les vitesses pratiquées.
L’apprentissage de l’automobile se déroule selon une progression assez lente mais régulière du kilométrage parcouru au cours des premières années, allant de 5 000 ou 6 000 km la première année et se stabilisant, quelques années plus tard, entre 15 et 20 000 km. Les hommes circulent davantage que les femmes : 15 000 km en moyenne contre 10 000.
Selon les statistiques de la DRS, le taux d’accident matériel par kilomètres parcourus est identique pour les hommes et pour les femmes. En revanche, une forte différence apparaît pour ce qui est des accidents corporels : les hommes sont deux fois plus impliqués que les femmes. Toutefois, cet écart s’estompe avec l’expérience de la conduite.
M. le président Armand Jung. Cette différence s’expliquerait-t-elle par la vitesse, l’alcool, la drogue ?
M. Sylvain Lassarre. Nous manquons de données suffisamment précises pour l’affirmer.
M. Christian Vanneste. Ces statistiques portent-elles sur tous les véhicules, à deux comme à quatre roues ? Car les garçons utilisent peut-être davantage les premiers, et ceux-ci sont plus fréquemment accidentés.
M. Sylvain Lassarre. Je ne parle que des automobiles. Les facteurs d’accident que vous avez signalés sont, bien sûr, avérés. En effet, les statistiques relatives aux accidents mortels montrent que le sur-risque masculin s’élève jusqu’à trois contre un. On connaît évidemment les relations entre vitesse et gravité des accidents : ceux impliquant des jeunes hommes se produisent à des vitesses plus élevées.
Plus la conduite devient expérimentée, plus le risque d’accident diminue. Mais il faut quatre ou cinq ans de pratique avant d’atteindre le niveau de risque moyen observé chez les adultes. C’est donc, je le répète, un apprentissage très long. Peut-on l’accélérer ?
M. le président Armand Jung. Le « comment » nous intéresse davantage.
M. Sylvain Lassarre. Peut-on éviter certaines situations à risque ? Cela fera sans doute l’objet de notre discussion.
Les hommes commettent plus d’infractions que les femmes, à près de 85 %.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Cette proportion vaut-elle aussi pour toutes les tranches d’âge ? Se retrouve-t-elle dans l’ensemble de la population pour ce qui est, par exemple, des retraits de points ? Ou bien le facteur est-il spécifique aux jeunes ?
M. Sylvain Lassarre. On retrouve en effet le même phénomène dans toutes les classes d’âge.
Parmi les causes d’accidents, la vitesse figure toujours en premier, puis l’absence de port de la ceinture, ainsi que les infractions aux règles de la circulation, l’alcoolémie …
Nous retirons aussi l’impression que le jeune accédant à la conduite connaît d’abord des accidents matériels, en général dans les cinq premiers mois. Au-delà, 30 % des jeunes ont un accident au cours de leur première année au volant.
M. le président Armand Jung. Quelle conclusion en tirez-vous ? Une action de prévention est-elle possible dans l’année qui suit l’obtention du permis de conduire ?
M. Sylvain Lassarre. Nous suggérons à cet effet une phase de formation, six mois après l’obtention du permis.
M. le président Armand Jung. Je suis prêt à prôner la mise en place d’une telle formation mais de quelle façon ? Organisée et financée par qui ?
M. Sylvain Lassarre. Nous vous transmettrons par écrit les propositions déjà formulées à ce sujet.
Les infractions sont plutôt commises dans la deuxième année de conduite. Car, lorsqu’on prend le volant dans les premiers temps, on n’est pas encore très sûr de soi. L’assurance arrive un peu plus tard, et c’est alors que l’on commence à prendre quelques risques et que les infractions se commettent.
Nous avons également observé un fort taux de récidive, de 30 % pour les accidents matériels et de 42 % pour les infractions.
M. le président Armand Jung. Dans quel délai ?
M. Sylvain Lassarre. Au cours de l’année suivant l’obtention du permis.
Le taux de récidive est important quel que soit l’âge auquel on a passé son permis.
On peut donc identifier les jeunes conducteurs à risque, ou « accidentogènes », ce qui permet de repérer les groupes de population sur lesquels on peut agir, notamment au moyen du permis à points – conçu pour cela et que l’on pourrait renforcer – ainsi que du bonus-malus.
Les facteurs d’accident résident certes dans la vitesse mais nous manquons de données précises sur les vitesses pratiquées.
En revanche, en ce qui concerne l’alcool et les drogues, nous disposons de données plus précises. Ainsi, près de 10 % des jeunes interrogés dans le cadre de notre enquête déclaraient consommer des drogues et cependant conduire, 19 % consommer de l’alcool et conduire la nuit, contre 9 % le jour. Les chiffres obtenus recoupent d’ailleurs ceux de l’enquête SAM réalisée sur la route. De surcroît, 10 % des jeunes interrogés associent drogue, alcool et conduite, soit la combinaison la plus dangereuse imaginable.
Nous disposons ainsi d’éléments permettant d’expliquer le sur-risque d’accidents mortels par la consommation d’alcool et de drogue chez les jeunes.
M. Jean-Pascal Assailly. Bien que les jeunes suivent la tendance générale, ils ont leurs spécificités. La combinaison entre alcool, cannabis, fatigue, pression des passagers et non attachement à l’arrière illustre de façon typique la méthode que pratiquent les jeunes pour se tuer le samedi soir, ou plutôt le dimanche matin. Il faut donc agir sur chacun de ces facteurs de risque, car il s’agit moins d’un problème de conduite automobile que de style de vie.
M. le président Armand Jung. Le rapporteur et moi-même avons appris à relativiser les chiffres. Vous avez parlé de 10 % de consommation de drogue associée à la conduite ; or j’aurais pensé que le taux était plus élevé. Au reste, ce pourcentage reflète-t-il la consommation d’alcool et de cannabis par les jeunes en général ?
M. Jean-Pascal Assailly. Ce sont nos collègues chargés de la recherche médicale qui pourraient le mieux vous répondre. Il est vrai que tous les consommateurs de substances psychotropes ne prennent pas forcément le volant par la suite. La consommation globale est donc nettement supérieure à celle mise en rapport avec la conduite automobile : elle se monte à 20 % s’agissant du cannabis.
M. Marc Meunier. Les préoccupations de la DSCR sont les mêmes que celles qui viennent d’être exposées. En premier lieu, elles concernent l’insécurité routière des jeunes, notamment le fait que 9 % des jeunes entre dix-huit et vingt-quatre ans représentent 24 % des tués sur la route, cela à cause d’un excès de confiance en soi couplé à un manque d’expérience. En second lieu, nous avons le souci de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire, car celui-ci représente, pour un bon nombre d’entre eux, non seulement un passeport professionnel mais aussi un instrument d’insertion sociale, puisque c’est souvent le seul examen qu’ils passent dans leur vie.
Les principes guidant notre action portent d’abord sur la continuité éducative : plus l’apprentissage des règles de sécurité routière intervient tôt, plus celles-ci ont de chance d’être intériorisées et d’être mises naturellement en application ; le jeune joue également un rôle de prescripteur vis-à-vis des adultes, notamment de ses parents, auxquels il peut opportunément rappeler les règles qu’il a apprises. Il nous faut ensuite travailler davantage que par le passé sur les comportements : il ne s’agit plus d’apprendre à manier un véhicule et à connaître les situations circulatoires mais aussi de prendre en compte les modes de vie, les valeurs morales, le respect des règles ; on parviendra ainsi à changer les habitudes au volant. Enfin, il convient d’assurer une progressivité dans l’apprentissage de la conduite avant de lâcher un jeune sur la route à peine muni de son permis de conduire.
Se pose la question de l’accès au permis et de son coût. La situation a évolué au cours des dernières années, notamment du fait de la réforme du permis de conduire et de la mise en place de mesures d’accompagnement. Nous n’avons guère modifié ce qui se fait en milieu scolaire jusqu’au lycée car il existe déjà une attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) à deux niveaux, en classe de cinquième puis de troisième. On constatait cependant un vide au stade du lycée. C’est pourquoi, depuis la rentrée de 2010, nous expérimentons dans un nombre croissant d’établissements, généraux et professionnels, des actions de sécurité routière.
Outre l’apprentissage anticipé de la conduite à seize ans, module en vigueur depuis quelque temps, nous avons mis en place, dans le cadre de la réforme, trois autres modules de conduite accompagnée.
La conduite supervisée s’adresse aux jeunes de plus de dix-huit ans, en cours de formation après un échec au permis de conduire. Elle est assortie de conditions plus souples que celles de la conduite anticipée : trois mois au lieu d’un an et 1 000 km au lieu de 3 000.
La conduite accompagnée en entreprise tend à ce que les jeunes apprentis apprennent à conduire, sur leur lieu et durant leur temps de travail, en se rendant sur leurs chantiers avec un formateur de l’entreprise. Un certain nombre de conventions ont été passées dans ce but avec la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la fédération nationale des travaux publics (FNTP), l’union professionnelle artisanale (UPA) et directement avec certaines entreprises des secteurs correspondants.
Notre troisième cible concerne les jeunes en milieu professionnel passant le diplôme de conducteur routier. Ceux-ci ont le plus souvent passé le permis B (voiture) dès l’âge de seize ans ou seize ans et demi, mais, bien sûr, ne se voient délivrer le certificat qu’à dix-huit ans. Il existait donc une période, allant jusqu’à deux ans, pendant laquelle ces jeunes ne conduisaient plus alors qu’ils avaient déjà réussi l’examen : on leur permet désormais de conduire accompagnés afin d’entretenir et d’accroître leur expérience de la route.
Nous travaillons aussi dorénavant sur les comportements au volant, sachant que les actions principales à mener se situent postérieurement à l’obtention du permis. Car on ne peut tout intégrer à la fois. On perçoit la nécessité, au bout de six mois ou d’un an après l’obtention du permis, de subir une sorte de piqûre de rappel et d’approfondir certains aspects comportementaux.
Depuis 2005, le dispositif d’aide au permis de conduire, par le biais d’un prêt remboursable à raison d’un euro par jour – l’État prenant les intérêts à sa charge – fonctionne bien : sans avoir bénéficié de publicité massive, il profite à plus de 80 000 jeunes par an. Dans le cadre de la réforme du permis de conduire, nous avons également mis en place un mécanisme de caution, financé par l’État, car les jeunes ayant le plus besoin de ce prêt ne sont pas souvent en mesure d’obtenir une facilité de la part des banques.
Nous avons développé un partenariat avec l’association des maires de France en vue de favoriser l’octroi d’une bourse pour passer le permis. Il s’agit d’un dispositif d’aide directe, mis en place par certaines communes et permettant aux jeunes de bénéficier du financement de tout ou partie de leur permis de conduire, en échange d’une activité d’intérêt général de quelques dizaines d’heures au sein de la commune ou d’une association à vocation sociale.
Nous avons enfin participé à une opération organisée par le ministère chargé de la jeunesse, appelée « 10 000 permis pour réussir ». Il s’agit, là encore, d’une aide directe à la préparation du permis destinée aux jeunes en insertion professionnelle ou en formation et inscrits dans les missions locales pour l’emploi.
Nous multiplions donc les dispositifs d’aide aux jeunes et travaillons beaucoup sur la progressivité. L’Europe nous y pousse, à travers notamment la dernière directive en cours de transposition en droit interne, laquelle demande une formation complète des jeunes, quels que soient les engins conduits. C’est ainsi que nous devrons instituer un permis de conduire les cyclomoteurs pour les jeunes nés après 1999, la mesure devant entrer en vigueur en 2013. Le brevet de sécurité routière (BSR) l’anticipe déjà, mais nous devrons le transformer en un véritable permis. Nous devrons aussi créer un permis intermédiaire pour les motocyclettes de moyenne cylindrée, dénommé A2, étape nécessaire entre les petites et les grosses cylindrées qui nécessitent un permis A.
Dans les prochains mois, nous nous efforcerons de mettre en place une formation post-permis, dont on perçoit l’intérêt, mais dont on imagine aussi les difficultés pratiques de réalisation pour ce qui concerne tant son financement que la décision d’en faire un dispositif obligatoire ou simplement volontaire.
M. Ahmed Lel Khadiri. Notre réseau s’est préoccupé de plusieurs questions. La première est celle de la conduite accompagnée, laquelle nous paraît très utile, mais qui mériterait sans doute d’être assortie d’une incitation financière car le problème du coût du permis se pose régulièrement.
L’apprentissage du code et de la conduite débouche certes sur un examen, mais, celui-ci réussi, on observe un certain relâchement de la part de la personne qui l’a passé avec succès. Intervenant à une époque où les jeunes passent d’autres examens, le permis de conduire se prépare selon la méthode du bachotage, qui vise à connaître les règles au moment où la question est posée mais non à les assimiler vraiment. Se pose aussi la question de la dématérialisation de l’enseignement du code, par DVD ou en ligne : on apprend ainsi toutes les réponses par cœur mais sans en comprendre fondamentalement l’intérêt. Il en résulte une perception faussée des enjeux de l’apprentissage, l’unique objectif du candidat étant d’obtenir son permis, non de savoir véritablement conduire.
Nous avons donc eu l’idée d’introduire, en amont de l’apprentissage du code de la route, un temps pour mettre en perspective les vrais enjeux de la conduite automobile.
L’ensemble des statistiques dont il a été fait état incitent chacun à s’interroger de nouveau sur son comportement routier et à essayer de savoir à quelle catégorie de conducteurs il appartient, ne serait-ce que pour s’évaluer et pour progresser. En effet, trop de conducteurs s’autorisent à transgresser les règles, en vertu de la confiance en soi ou de la représentation sociale du « pilote ». Il conviendrait de mieux montrer, statistiques à l’appui, quelles sont les conséquences de ce genre d’attitude.
Le thème récurrent de l’alcool et des jeunes a été beaucoup étudié dans le cadre de la réflexion mise en place par M. Marc-Philippe Daubresse quand il était ministre de la jeunesse et des solidarités actives. Cette réflexion faisait suite au problème soulevé par la pratique des apéros géants. Le lien entre alcool et fête ne concerne évidemment pas exclusivement les jeunes mais il a des implications sur la sécurité routière et, plus largement, sur les comportements à risque. Il faut donc s’efforcer de supprimer l’automatisme de la relation entre fête et consommation d’alcool, notamment par des campagnes de sensibilisation et par des modules d’interventions spécifiques.
M. le président Armand Jung. Le rapporteur me faisait remarquer que nous partageons entièrement vos préoccupations mais comment les traduire en termes législatifs ? Il s’agit plutôt d’un travail de communication et de réseaux, impliquant, par exemple, les programmes d’enseignement. Autant nous pouvons nous inspirer des pistes que vous décrivez, autant il est difficile d’inscrire dans une loi les intentions dont vous faites état.
M. Jean-Pascal Assailly. Certains éléments du problème, comme la relation entre la consommation d’alcool et la conduite, pourraient s’insérer dans le champ législatif. Je pense, par exemple, à la formation des barmen et de tous les personnels servant de l’alcool.
M. Jérôme Lambert. Il n’existe ni diplôme ni formation pour ces personnels.
M. Ahmed Lel Khadiri. Notre réseau expérimente la sensibilisation par les pairs, laquelle consiste à faciliter l’action de jeunes auprès d’autres jeunes, afin qu’ils abordent ensemble la problématique de l’alcool et de la conduite.
Il faut, pour cela, distinguer deux niveaux. Le premier concerne la réduction des risques, c’est-à-dire l’intervention en milieu festif, ce dont s’occupent certaines associations. À cet égard, on devrait également pouvoir s’appuyer sur le service civique, créé pour répondre à des besoins d’intérêt général. Les discussions organisées traduisent une grande sincérité de la part des individus dans leur rapport à la conduite. Il conviendrait de les développer en milieu scolaire.
M. le président Armand Jung. Pourriez-vous nous adresser vos propositions par écrit ? Je crois, en effet, que l’on devrait chercher comment utiliser le service civique.
M. Ahmed Lel Khadiri. Le deuxième niveau porte sur les modes de transport doux, principalement le vélo, dont il faudrait anticiper le développement. Des politiques publiques ont déjà été mises en place à ce sujet. Il faut les renforcer, notamment dans le milieu étudiant, où il existe déjà des prêts à l’année, et réfléchir aux moyens de former les cyclistes à la circulation routière. Des informations sont fournies au stade de l’école primaire et du collège mais ne font pas l’objet de rappels au niveau du lycée, alors qu’on est alors plus enclin à une utilisation régulière de ce mode de transport.
M. Philippe Loup. Nos associations constituent pour les étudiants non seulement des interlocuteurs privilégiés mais aussi souvent des référents presque moraux. C’est pourquoi la FAGE exerce de multiples actions depuis une quinzaine d’années en matière de sécurité et de prévention routières, travaillant avec la DSR depuis 1999.
Notre premier axe d’action consiste à sensibiliser les personnes à l’accidentologie, c’est-à-dire aux causes des accidents, notamment à la poly-consommation de drogue et d’alcool, ce fameux cocktail détonnant qui, en outre, progresse. Nous considérons donc qu’il est de notre devoir d’informer les étudiants sur les dangers qu’ils encourent à ce titre.
Les associations étudiantes sont également organisatrices de soirées et d’événements festifs, ce qui leur confère une certaine responsabilité vis-à-vis des participants. Elles tiennent donc à introduire des éléments de prévention lors de ces manifestations. Ainsi, par exemple en collaboration avec la MACIF, nous mettons en place des stands d’information et des simulateurs permettant de tester la capacité à conduire en sortant d’une soirée. Ces derniers instruments sont beaucoup plus démonstratifs que le simple ballon dans lequel on souffle.
Au fil des années, nous constatons que les étudiants sont de plus en plus sensibles au problème de l’alcool au volant, comme l’a déjà montré le groupe « alcool et jeunes » qu’avait mis en place M. Marc-Philippe Daubresse. Il est donc essentiel que les acteurs de la prévention continuent de bénéficier du soutien des pouvoirs publics afin de continuer à casser le mythe de l’invulnérabilité au volant malgré un peu d’alcool dans le sang.
M. le rapporteur. L’installation de simulateurs est sans doute une bonne formule mais n’est-elle pas un peu lourde et donc difficile à généraliser ?
M. Philippe Loup. Les associations mettant en place de telles actions sont évidemment celles qui disposent de moyens importants. Bien qu’effectivement lourds, ces dispositifs revêtent néanmoins une certaine urgence, compte tenu du nombre de jeunes accidentés sur les routes et de la progression de leur prise de conscience du problème.
Notre deuxième axe d’action tient à notre responsabilité en tant qu’organisateurs de soirées vis-à-vis des risques créés par l’alcool. Nous cherchons ici à agir directement sur les événements festifs. C’est pourquoi nous offrons des formations à nos membres pour apprendre à aborder un jeune en état d’ébriété ou à le gérer, par exemple dans un bar.
Enfin, nous agissons en aval du permis de conduire. Comme on l’a dit, l’accès à la conduite automobile constitue un facteur d’intégration professionnelle et sociale. Il faut donc le faciliter. Dans ce but, nous informons nos membres de l’existence de dispositifs tels que le permis de conduire à un euro par jour ; nous diffusons des guides sur l’éco-conduite concernant la responsabilité écologique et environnementale du jeune conducteur ; nous éditons également un pack de conseil « permis en poche » indiquant comment s’assurer et à qui s’adresser pour différents services. Nous cherchons ainsi à responsabiliser le jeune qui vient d’obtenir son permis.
M. Jean-Yves Salaün. Les chiffres relatifs à la part de la jeunesse dans la population et dans les accidents de la route ont été rappelés. Il faut aussi préciser que le taux de tués est l’un des plus élevés d’Europe. Au-delà des éléments relevant de la natalité ou de la densité de population, cette situation nécessite d’agir.
Il ne faut pas se limiter, s’agissant des jeunes, à la problématique automobile : un quart des jeunes tués le sont sur des deux roues motorisés. Le cyclomoteur, pratiqué par 10 % des adolescents, représente la moitié des accidents corporels dont sont victimes les quatorze – dix- sept ans.
Nous voyons donc bien les leviers par lesquels nous pouvons agir. Nous le voyons d’autant mieux que nous sommes en train de préparer la transposition de la directive européenne prévoyant, notamment, la création d’un permis de conduire pour les cyclomoteurs, distinct du permis moto.
Notre association croit beaucoup à l’éducation routière : quels que soient les progrès réalisés au cours des années sur le permis de conduire, l’obtention de celui-ci continue d’obéir à une logique de bachotage. Les épreuves du code, telles qu’elles se déroulent, ne permettent guère de traiter les problèmes de comportement routier ou les problématiques liées aux normes sociales. Il faut donc aborder la question ailleurs : dans la famille bien sûr, mais cela n’est pas assuré. Reste l’école : l’éducation routière y est obligatoire depuis 1957, et des associations comme la nôtre ont fait beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Depuis 1993, existent certes les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) mais leur mode de délivrance ressemble un peu à celui de l’examen du code de la route, faisant encore appel au bachotage et intégrant peu les comportements au volant.
Le permis de conduire les cyclomoteurs devrait comprendre une formation théorique, dont on ne sait encore si elle sera dispensée à l’école ou en dehors d’elle. En fonction de la solution choisie, il faudra repenser le rôle des enseignants afin de l’orienter davantage vers les questions liées au comportement ou aux normes sociales. Il conviendra aussi de rééquilibrer les actions selon les degrés de l’enseignement : aujourd’hui, nos associations sont très présentes dans l’enseignement primaire, un peu moins dans les collèges et presque pas dans les lycées. L’expérimentation à laquelle nous avons participé montre que se posent là des problèmes de temps et d’implication des enseignants. Or il faut absolument agir dans la tranche d’âge où le risque routier explose.
La réforme de 2008 du permis de conduire a apporté des éléments positifs mais l’objectif politique consistait davantage à réduire le coût du permis et la durée d’attente, avant de pouvoir le passer, qu’à améliorer son contenu.
À la différence de celle du permis à un euro, ne fut pas retenue l’idée de créer un livret d’épargne pour financer le permis de conduire. Le ministère chargé des finances s’y était opposé. Or un tel mécanisme aurait pu être abondé par les parents, les parrains et marraines, les grands-parents, voire par certaines collectivités territoriales. On aurait pu ouvrir le livret, par exemple, à l’âge de douze ans, ce qui aurait aussi permis d’envoyer régulièrement des informations de sensibilisation aux adolescents. L’idée mériterait peut-être qu’on la reprenne aujourd’hui.
La pratique de l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) n’apporte pas d’amélioration sensible en matière de risques routiers. Elle ne fait que décaler dans le temps la survenance des premiers accidents, qui se produisent au moment ou la prise de confiance s’installe chez le conducteur.
Les cyclomoteurs soulèvent deux problèmes : celui de la formation, pour laquelle des textes sont en cours de préparation comme on l’a vu, et celui des engins eux-mêmes, puisque la moitié d’entre eux sont débridés. Aussi demandons-nous depuis des années l’institution d’un contrôle technique. Les études réalisées auprès de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) montrent que les cyclomoteurs, normalement bridés pour ne pas dépasser les 45 km/h, peuvent, lorsqu’ils sont débridés, atteindre des vitesses de 80 à 90 km/h.
Certains pays, notamment anglo-saxons, ont traité le problème des jeunes et du risque routier en travaillant sur l’accès au véhicule. Selon une étude comparative relative aux cyclomoteurs, la France reste l’un des seuls pays où l’on accède à leur conduite dès l’âge de quatorze ans. Nous avons demandé aux pouvoirs publics d’examiner la possibilité de remonter ce plancher. Et encore, il ne s’agit pas seulement d’une question d’âge : l’entourage et le sexe, par exemple, jouent également un rôle et rendent la question plus complexe. Il n’en demeure pas moins qu’il faut agir.
Des pays ont réduit l’usage de la voiture dans les premiers mois de la conduite, mais l’idée en fut abandonnée en France. En contrepartie, il conviendrait d’améliorer la formation des futurs conducteurs, au lycée et avant qu’ils ne passent le permis de conduire.
M. le président Armand Jung. Les statistiques qu’on nous a fournies indiquent que plus de 90 % des scooters sont débridés. Une solution consisterait donc à disposer de blocs moteurs impossibles à débrider. Il s’agirait là d’un important progrès technique.
M. Jean-Yves Salaün. Le taux de 50 % de débridage que j’évoquais est, en effet, discutable. L’obligation de contrôle technique proposée ne répondrait qu’à une partie du problème, car il suffit de procéder à une manipulation très simple pour débrider et rebrider un moteur.
Nous travaillons aussi à la transposition de la directive européenne concernant les motos. Le projet d’accès progressif aux grosses cylindrées ne prévoit actuellement rien au-delà de vingt-quatre ans. Or, grâce aux statistiques de la sécurité routière sur les accidents des deux-roues motorisés, nous savons que le risque est maximal au cours des dix-huit premiers mois de pilotage des grosses motos. L’âge de vingt-quatre ans me semble donc un peu bas pour permettre un accès direct aux grosses cylindrées.
Nous publierons d’ici à la fin de ce mois une étude menée auprès d’environ 300 bureaux des élèves (BDE) qui montre une situation plutôt critique, avec une forte consommation d’alcool et une prise en compte du risque très variable. Les BDE les plus importants, qui organisent le plus d’événements festifs, ont certes mis en place des structures de prévention mais celles-ci font encore défaut dans un grand nombre de soirées. Deux difficultés principales sont à signaler : la première est que les animateurs de BDE considèrent généralement que la responsabilité est d’abord individuelle, chacun devant, par lui-même, savoir s’il doit boire ou non avant de reprendre le volant ; la seconde est qu’il n’existe pas aujourd’hui d’obligations pour la mise en place d’actions de prévention. Nous pourrions donc envisager que, lorsque les soirées se tiennent sur les campus, les dirigeants d’établissements demandent la présence de dispositifs de prévention. Et que, lorsqu’elles se tiennent dans des discothèques ou dans des bars, munis d’une licence IV au titre de laquelle une formation est requise, les propriétaires des lieux soient sensibilisés à la nécessité d’actions de prévention.
En 2008, nous avons mené, dans huit pays européens, une action auprès des jeunes sur la consommation d’alcool, et l’on s’est aperçu que, dans l’Europe du nord, les jeunes boivent beaucoup plus mais ne conduisent pas, tandis que la France est le pays où l’on prend le plus de risques en se jouant de la réglementation. Toutefois, ces dernières années, de nombreux jeunes ont adopté le réflexe du capitaine de soirée. Lorsque ce genre d’habitude est pris dès que l’on a obtenu son permis de conduire, on le conserve par la suite. Il est beaucoup plus difficile de faire changer les habitudes de personnes de cinquante ans sur les questions de consommation d’alcool, de vitesse ou de bouclage de la ceinture de sécurité.
La fixation d’un taux réduit d’alcoolémie pour les jeunes conducteurs, dispositif déjà institué dans de nombreux pays dont l’Allemagne, les Pays-Bas et, plus récemment, l’Italie, est un sujet sensible. Selon l’Observatoire de la sécurité routière, la mise en place d’un taux réduit aurait peu de sens car les accidents mortels liés à la prise d’alcool sont dus à de très forts taux d’alcoolémie. Cela dit, j’attire votre attention sur un problème de communication : les campagnes en cours indiquent que celui qui conduit ne doit pas boire ; or, le taux légal d’alcoolémie étant de 0,5 g, cela signifie que celui qui conduit peut boire deux, voire trois verres. Il y a là une ambiguïté.
Il faut aussi noter l’utilisation de plus en plus fréquente chez les jeunes des téléphones portables et des smartphones en conduisant.
Au même titre que les adultes, un certain nombre de jeunes se comportent très bien au volant. Il faut donc identifier les jeunes à risques. L’aspect prédictif existe, ce qui signifie qu’une première infraction, même purement matérielle, peut conduire à une autre infraction, voire à un accident corporel ou mortel. Voilà une autre piste de réflexion.
Pour lutter contre l’alcoolémie délictuelle, la LOPPSI a prévu la mise en place d’éthylotests antidémarrage pour les conducteurs récidivistes. Pourquoi ne pas équiper les véhicules des jeunes de ces éthylotests – naturellement sur la base du volontariat ?
M. le rapporteur. Tous nos interlocuteurs reconnaissent que d’énormes progrès ont été réalisés en matière de sécurité routière puisque nous sommes passés en quelques années de 17 000 à 4 000 morts par an. Toutefois, nous devons encore progresser ; or cela s’avère plus difficile car il faut s’attaquer à des attitudes radicales qui exigent une action spécifique. Ce seuil n’est pas incompressible, mais le constat est clair : en matière d’accidentalité, la proportion des hommes est infiniment plus élevée que celle des femmes. Que suggérez-vous pour remédier à cette situation ? Les textes réglementaires et légaux doivent naturellement être identiques pour tous, mais la communication nous permettrait peut-être de progresser en ce domaine.
M. Jean-Yves Salaün. Le regard de la société sur cette question est très important. Sur les conseils de Jean-Pascal Assailly, nous avons décidé il y quelques années de mener une campagne sur ce thème en direction des jeunes. Nous avons pour cela réuni des groupes de jeunes, garçons et filles. Cette étude a démontré que, dans une société où les femmes partagent le pouvoir avec les hommes, il reste encore quelques domaines dans lesquels les hommes s’estiment supérieurs : c’est le cas du sport et de la conduite automobile. Il faut faire évoluer les mentalités.
M. le rapporteur. Quelle mesure concrète, pas nécessairement réglementaire ou légale, pouvez-vous nous proposer ?
M. Philippe Loup. Les comportements des hommes et des femmes sont effectivement différents. Les pays scandinaves ont réalisé des études sur ce point et ils tentent de parvenir à une parfaite parité, notamment en cessant d’inculquer aux petits garçons qu’ils doivent nécessairement jouer avec des petites voitures et aux petites filles qu’elles doivent jouer avec des poupées. Cette différence comportementale est très profonde et doit être prise en compte dès la plus tendre enfance ; il faut enseigner la parité dans un environnement mixte. L’école est le lieu privilégié pour cela : certes, on dispense en CM1 un cours de sensibilisation à la sécurité routière, mais il convient d’aller plus loin. L’éducation nationale ne pourrait-elle prendre sa part de responsabilité en prenant en charge l’obtention du permis de conduire, nécessaire pour la mobilité des jeunes et leur insertion professionnelle ? De plus, son coût dépasse les 1 000 euros, ce qui induit une sélection sociale. Qui pourrait le mieux gommer cette inégalité sociale ? C’est naturellement l’école, en particulier le lycée.
M. Ahmed Lel Khadiri. S’agissant de la consommation d’alcool, les femmes sont en train de rattraper leur retard. Nous avons bien compris l’attitude des jeunes hommes vis-à-vis de la transgression, mais il serait effectivement très difficile, sur un plan légal, d’imposer aux hommes un permis différent de celui des femmes.
M. le rapporteur. Il est en effet impossible d’instaurer une telle discrimination. En revanche, nous pourrions imaginer des mesures qui s’appliqueraient à l’ensemble des conducteurs et seraient efficaces pour les populations masculines.
M. Jean-Pascal Assailly. Les 4 000 tués chaque année mettent essentiellement en cause des conducteurs masculins. Toutefois, le facteur de risques tient à la masculinité, non au fait d’être un homme. Il faut remettre en question la masculinité et ses effets. Pour cela, quatre stratégies existent : l’éducation à partir de l’école maternelle, la prévention, la formation des conducteurs et la réhabilitation.
Le rapport à la règle fondamentale est différent pour les garçons et pour les filles, et cela dès l’âge de trois ans. Ce n’est pas que les petits garçons ne perçoivent pas le danger lorsqu’ils transgressent un interdit, mais ils le transgressent, tandis que pour les filles la règle est un mur infranchissable. La thématique de la masculinité et de ses effets doit devenir un thème transversal, à l’école comme dans les cours de formation dispensés à l’auto-école ou dans le cadre des stages de sensibilisation, et être au cœur de la sécurité routière.
M. le rapporteur. Que pensez-vous du permis probatoire ? Comment, selon vous, améliorer son efficacité ?
M. Jean-Pascal Assailly. Je ne vous le cache pas, j’étais défavorable au permis probatoire lorsqu’il a été mis en place car il s’agit pour moi d’une mesure exclusivement répressive et dépourvue de portée éducative. Les jeunes progressant de la même manière que les adultes depuis trente ans, pourquoi mener une politique répressive à leur égard, en leur imposant un taux de zéro gramme d’alcool ou en leur attribuant moins de points ? L’Observatoire national de la sécurité routière lui-même a fini par reconnaître que le permis probatoire n’avait pas eu d’impact ou d’effet bénéfique sur l’accidentalité des moins de vingt-cinq ans.
M. le rapporteur. Mais le supprimer pourrait être compris comme une incitation à la transgression.
M. Jean-Pascal Assailly. Il est fondamental de lui adjoindre un volet éducatif, au travers de mesures post-permis de type « éducation-réhabilitation ».
M. le rapporteur. Qui paiera ces mesures ?
M. Marc Meunier. C’est une vraie question. Tant que le citoyen paie son permis – et je vois mal comment cela pourrait être autrement – et si nous voulons que le permis probatoire soit le plus « indolore » possible, il serait intéressant que le candidat paie un forfait pour une formation globale incluant des heures de formation post-permis.
M. le rapporteur. Cela augmentera le coût du permis !
M. Marc Meunier. Certes, mais un candidat acceptera de payer plus facilement si on lui explique que l’augmentation est liée à l’institution d’une journée de formation complémentaire, à laquelle il participera quelques mois après l’obtention de son permis de conduire.
M. le rapporteur. Le permis probatoire est-il efficace ?
M. Marc Meunier. Si nous nous en tenons aux chiffres, il n’a pas eu d’effets lisibles. En revanche, sur le plan des principes, il me paraît logique. Un conducteur novice commence avec six points et en acquiert d’autres progressivement, et plus rapidement s’il a pratiqué la conduite accompagnée. Ce système ne me paraît pas mauvais et je ne souhaite ni le supprimer ni le durcir. Je ne suis pas certain que démarrer avec quatre points changerait grand-chose.
La masculinité doit naturellement être évoquée en amont et en aval, et pas uniquement au cours de la formation au permis de conduire car c’est un problème de société. Nous ne changerons pas les mentalités uniquement dans le cadre de la formation au permis de conduire.
M. Jean-Pascal Assailly. Il faut expliquer aux gens que l’excès de confiance associé à la masculinité provient des images que la publicité nous adresse, réfléchir à la façon dont nous sommes manipulés et conditionnés et se demander comment fonctionne la masculinité, quels sont ses mécanismes, logiques et psychologiques, et ce qu’elle produit.
M. le président Armand Jung. Cela dépasse largement le cadre de notre mission.
M. Sylvain Lassarre. S’agissant du permis probatoire, n’oublions pas que les jeunes commettent peu d’infractions au cours de leur première année de conduite, car ils roulent peu et se montrent généralement prudents. Cette mesure est donc peu dissuasive.
Certains pays, comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie, et certains États américains ont réussi à faire baisser fortement le taux d’accident chez les jeunes par le biais de mesures contraignantes touchant notamment la mobilité, et allant parfois jusqu’à l’instauration d’un couvre-feu.
M. Jean-Pascal Assailly. Mais sans aucune acceptabilité sociale.
M. Sylvain Lassarre. L’État d’Israël a mis en place un dispositif intéressant pour améliorer le comportement des jeunes au volant. Ainsi, l’autoévaluation est une bonne chose, mais elle doit reposer sur des éléments objectifs. Il serait intéressant de disposer d’un instrument qui recueille certains éléments comme la vitesse, car il nous permettrait de débattre avec le jeune conducteur de son style de conduite.
M. le rapporteur. Vous paraît-il opportun de limiter l’accès aux véhicules puissants en fonction de l’âge du conducteur ou de ses années de possession de permis ?
M. Jean-Yves Salaün. Il convient à cet égard de distinguer les voitures et les deux roues. Je suis favorable à un accès progressif aux grosses cylindrées, voire à repousser le seuil d’accès au-delà de vingt-quatre ans. S’agissant des voitures, un groupe de travail avait soumis il y a plusieurs années une idée au Conseil national de la sécurité routière, laquelle mettait en avant deux éléments : le rapport poids/puissance et la communication. Or, si certains modèles renvoient à une pratique sportive – c’était alors le cas des 205 GTI –, d’autres, comme c’est le cas aujourd’hui, sont souvent utilisés par plusieurs membres de la famille : une limite d’âge poserait donc des problèmes difficiles à résoudre.
M. Christian Vanneste. S’agissant de la disparité entre les deux sexes en matière d’accidentologie, observe-t-on des différences notoires entre les pays latins et les pays nordiques ?
Pour lutter contre l’accidentalité, un certain nombre de solutions apparaissent, dont en premier lieu des solutions matérielles. Vous avez indiqué que les jeunes sont souvent équipés de matériels moins coûteux, donc moins performants et plus dangereux. Devons-nous renforcer le contrôle des véhicules légers afin d’éliminer ceux qui présenteraient des normes de sécurité très inférieures à la moyenne ?
Au permis probatoire, je préférerais un permis progressif. Le terme de bachotage me choque – je suis d’ailleurs défavorable au baccalauréat, lui préférant le contrôle continu. Ne pourrait-on instaurer un contrôle continu en lieu et place de l’examen du permis de conduire, en attribuant au départ un nombre de points très faible, après une formation plus courte et moins coûteuse ? Il me semble que la perspective d’un nouveau contrôle amènerait les jeunes conducteurs à se comporter toujours de façon irréprochable.
Pour les jeunes, les pairs ayant sans doute plus d’importance que le père, il faut que la communication soit davantage ciblée. Pourquoi ne pas utiliser des vecteurs spécifiques – je pense naturellement à Internet – et des techniques de communication qui permettraient de montrer des images choquantes qui ne peuvent être montrées à la télévision ?
M. Jean-Marc Roubaud. Nous avons entendu beaucoup de choses intéressantes. Je souhaite à mon tour vous faire quelques propositions.
Le délai nécessaire pour passer le permis de conduire en France atteint plusieurs mois dans de nombreux départements, contre une semaine en Belgique ou en Allemagne. Ce problème n’a jamais été résolu, ce qui témoigne d’une absence de volonté politique et d’une position dogmatique de l’administration. J’aimerais que nous parvenions à le résoudre une fois pour toutes.
On a évoqué une carence au niveau du lycée, à une période où les jeunes sont amenés à prendre le volant. Pourquoi ne pas mettre en place un module obligatoire en seconde, première ou terminale, qui pourrait être assuré par un professeur ?
Pour prévenir les dangers liés aux sorties de soirées, un certain nombre de pays, dont la Suède et l’Australie, ont réussi à avancer de manière significative. Cela dit, il n’appartient pas au barman, dont le métier est de servir des boissons, de faire de la pédagogie et de la prévention. Pourquoi ne pas institutionnaliser, pour toutes les soirées, privées ou publiques, un responsable sécurité, déclaré en préfecture, qui s’assurerait du retour des personnes à leur sortie de discothèque ?
En ce qui concerne d’éventuelles aides, la situation économique actuelle ne permet pas de recourir à des financements publics. Le permis à un euro répond en partie au problème. Je suis favorable – et ce contre l’avis du ministère des finances – à l’institutionnalisation d’un livret d’épargne associé au permis de conduire, car il permettrait de sensibiliser les familles.
Un certain nombre de pays ont adopté un système de bonus pour les permis de conduire. Cette formule, qui permet aux conducteurs qui n’ont pas eu d’accident de gagner un point chaque année, donne des résultats extrêmement probants.
M. Marc Le Fur. Je ne doute pas qu’il existe un déterminisme en matière d’accidentologie chez les jeunes hommes, mais je vous rappelle que les motards représentent près du quart du nombre de morts sur les routes ; or ce sont essentiellement des jeunes. Si l’on ne prend pas en compte les motards dans le nombre des accidentés de la route, je ne suis pas sûr que la proportion des jeunes hommes victimes d’un accident soit aussi élevée qu’on le dit.
L’idée de calibrer la cylindrée en fonction de l’expérience du jeune conducteur ne me semble pas déplacée.
Je partage l’avis de mon collègue Roubaud s’agissant des délais.
L’examen du permis de conduire représente pour de nombreux jeunes un premier contact avec l’administration ; or il n’est pas très positif. Le permis de conduire ne pourrait-il pas être délivré par des structures agréées – qui seraient bien entendu contrôlées ? Pourquoi un acte d’expert relève-t-il de la puissance publique ? Confier la délivrance du permis au secteur privé permettrait de gagner du temps et de ne plus dépendre d’agents de l’équipement qui ne sont pas suffisamment nombreux, surtout à l’approche de l’été.
M. Olivier Dosne. Le système du capitaine de soirée fonctionne très bien. Pour autant, la bonne solution ne réside-t-elle pas dans le « zéro alcool », d’autant que les jeunes consomment souvent, en plus de l’alcool, du cannabis et différents psychotropes ?
Je suis attaché pour ma part aux contrôles techniques. Il semble que certains deux-roues ne passent pas par les centres de contrôles techniques, dont certains d’ailleurs ne répondent pas aux normes en vigueur. Pour limiter la tricherie, ne faudrait-il pas améliorer la qualité de ces centres et imposer des contrôles. Il conviendrait également d’obliger les assureurs à ne pas assurer les véhicules débridés.
Le président d’une école de commerce m’a indiqué que le président du BDE était juridiquement responsable. Qu’en est-il réellement ?
Mme Pascale Gruny. Le problème de la sécurité routière, en particulier pour les jeunes, me préoccupe tout particulièrement. À la fin de l’année dernière, j’ai organisé à Saint-Quentin une matinée de rencontre pour les lycéens au cours de laquelle nous avons projeté trois courts films, très trash, montrant deux jeunes victimes d’accidents de la route : l’un, handicapé physique, circulant dans une chaise roulante, l’autre cérébrolésé. L’initiative a eu un réel impact. Il faut confronter les jeunes à la réalité, car à vingt ans on se croit invincible. C’est pourquoi je propose que les jeunes suivent un stage pendant la formation au permis de conduire, chez les pompiers ou dans un centre de grands handicapés.
Je suis très favorable à la formule du capitaine de soirée. En Suède, où les jeunes s’alcoolisent très fortement, il n’est pas question pour celui qui boit de prendre le volant. C’est bien une question d’éducation.
Enfin, je pensais que la législation avait condamné les open bar.
M. Philippe Loup. La loi HPST a en effet interdit les open bar. Le récent rapport établi par Mme Martine Daoust, à la demande de Mme Valérie Pécresse, réaffirme cette interdiction et propose de multiplier les contrôles lors des soirées étudiantes et de renforcer la responsabilité juridique des organisateurs. Les contrôles et la déclaration de la soirée en préfecture sont déjà effectifs dans plusieurs départements, le rapport de Mme Daoust préconise de généraliser cette déclaration.
En tant que responsable d’un réseau d’association, la Fédération forme les responsables associatifs à la gestion des risques, qu’elle soit préventive ou curative, les informant par exemple de la conduite à tenir face à un étudiant en état d’ébriété avancée.
L’un des outils dont nous disposons est la Charte nationale des soirées étudiantes responsables. Cette charte incite les associations qui la signent à mettre en place des actions de prévention et une distribution d’alcool raisonnée. Mais la mission de la Fédération ne se limite pas à l’élaboration de textes normatifs. Nous menons également des actions de sensibilisation sur le terrain, qui relèvent quasiment du domaine du médico-social – en effet, selon l’OMS, l’absorption de plus de trois verres au cours d’une soirée pose un problème de santé publique. Certes, il y a encore ici ou là des excès, mais la conscientisation des organiseurs, comme celle des étudiants, est une réalité.
M. Jean-Yves Salaün. Les BDE font preuve de beaucoup de bonne volonté mais les open bar, bien qu’interdits, existent toujours. Il ne faut pas en rejeter la responsabilité sur les gestionnaires des BDE, dont la mission consiste à organiser des soirées. Mais, pour les jeunes, une soirée réussie doit réunir trois éléments : de la bonne musique, un environnement agréable et une importante consommation d’alcool.
J’ai émis l’idée de responsabiliser le président de l’université ou de l’école. Mais il ne faudrait pas pointer du doigt les soirées étudiantes car les BDE choisissent généralement des lieux faciles d’accès, qui ne posent pas de problèmes de sécurité, sachant que nombre de jeunes se tuent en rentrant de discothèques excentrées. Il y aurait également beaucoup à dire sur le report de 5 à 7 heures des horaires de fermeture des discothèques…
S’agissant de l’alcool, il faut être cohérent. Depuis le comité interministériel de la sécurité routière de 2008, tous les établissements qui servent de l’alcool se doivent de mettre des éthylotests à la disposition des participants – les décrets sont en cours de parution. Or, il semble que cette disposition sera limitée aux discothèques et ne s’appliquera pas aux bars. On voit bien que, sur la question de l’alcool, la société a tendance à caler ; si nous voulons progresser comme nous l’avons fait sur la vitesse, il faut prendre des mesures courageuses et cohérentes.
M. Philippe Loup. La conscientisation étant naturellement plus forte au sein des associations, celles-ci accepteront plus facilement de mettre en place des mesures de prévention que les prestataires privés. La loi HPST a interdit les open bar, mais cela a pour conséquence que, désormais, les jeunes arrivent dans les discothèques en état d’ébriété. Le problème de l’alcoolisation a été déplacé vers la sphère privée, où malheureusement toute mesure de prévention est impossible. La loi HPST est intéressante sur le plan de la santé publique en ce qu’elle a diminué la consommation d’alcool en soirée, mais nous en voyons difficilement les effets en termes de sécurité routière.
M. Ahmed Lel Khadiri. Il faut organiser une complémentarité entre la puissance publique et les acteurs de la prévention, demander aux organisations de se montrer responsables et s’assurer qu’il existe des mesures de prévention. Vouloir faire peser la responsabilité sur les présidents et les directeurs des établissements risque de les amener à interdire tout événement, et ceux sur lesquels il serait possible d’intervenir se passeront ailleurs. Il faut une mesure contraignante, qui passe par une déclaration, et on doit pouvoir interdire l’événement si aucune mesure de prévention n’est prévue.
M. Jean-Marc Roubaud. Sachant que les jeunes arrivent de plus en plus tard et déjà alcoolisés dans les discothèques, seriez-vous opposés au fait d’en limiter les horaires d’ouverture ?
M. Philippe Loup. Si vous restreignez les horaires d’ouverture, les jeunes s’alcooliseront beaucoup plus rapidement. C’est ce qui s’est produit en Angleterre, où l’on a vu les étudiants absorber des volumes d’alcool plus importants et plus vite. Cela ne règlerait pas le problème.
Autre élément : comment un étudiant parisien, qui quitte une discothèque à trois heures du matin, rentre-t-il chez lui s’il n’y a pas de transports en commun ? La fermeture des boîtes de nuit à six heures du matin lui permet de prendre le premier métro. La limitation des horaires d’ouverture inciterait les jeunes à utiliser la voiture.
M. Jean-Pascal Assailly. Je vous propose, mesdames et messieurs les députés, de m’adresser vos questions par écrit.
M. le président Armand Jung. De même, messieurs, n’hésitez pas à nous adresser des notes techniques opérationnelles qui nous seront utiles pour rédiger notre rapport.
M. Jean-Yves Salaün. Il serait intéressant que les risques d’accidents chez les jeunes soient évoqués au cours de la Journée défense et citoyenneté car elle s’adresse à tous les jeunes, y compris ceux qui sont sortis du système scolaire.
M. Ahmed Lel Khadiri. Dans la même logique, ne peut-on envisager une formation dans le cadre du Service civique ? Pour notre part, nous sommes résolus à prendre contact avec l’Agence du service civique pour évoquer la possibilité d’inscrire un module de prévention routière dans le cadre des formations civiques obligatoires.
M. Marc Meunier. Un module de huit minutes sur la sécurité routière sera présenté au cours des prochaines Journées défense et citoyenneté. À cette fin, nous avons réalisé un certain nombre de films.
En ce qui concerne le permis probatoire, faut-il partir d’un petit nombre de points et les augmenter progressivement ? C’est un débat récurrent, qui a reçu une réponse il y a quelques années. Nous avions alors décidé de ne pas transiger avec la sécurité routière – ce n’est pas parce qu’un conducteur n’a commis aucune infraction qu’il doit se voir attribuer des points supplémentaires lui ouvrant une sorte de droit à en commettre – et nous avions choisi de laisser aux compagnies d’assurances le soin d’abaisser la prime d’assurance des personnes ne commettant pas d’infraction.
M. Jean-Marc Roubaud. La formule du point bonus fonctionne bien dans un certain nombre de pays. Ne renonçons pas, sous prétexte d’une position dogmatique de l’administration, au droit d’explorer certaines pistes. Rien n’est gravé dans le marbre ! Si tout avait bien fonctionné, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Essayons d’améliorer les choses. Le fait qu’un certain nombre de conducteurs ayant perdu tous leurs points conduisent sans permis pose un vrai problème pour la sécurité routière en France.
M. Marc Meunier. Je ne faisais que citer des éléments de nature à éclairer la représentation nationale.
Je reviens sur les délais de présentation au permis de conduire. En France, cet examen est totalement gratuit et organisé par des fonctionnaires d’État, qui sont naturellement en nombre limité. De plus, la répartition des places à l’examen entre les écoles de conduite dépend indirectement du taux de réussite de chaque école : plus les candidats d’une école réussissent, plus cette dernière peut en présenter chaque mois. C’est un système vertueux, mais qui pénalise les écoles de conduite dont le taux de réussite est moins bon. L’examen du permis de conduire dépend donc de deux acteurs : l’État et l’école de conduite – celle-ci, en fonction de sa propre stratégie commerciale, décide de présenter tel ou tel candidat, et l’administration n’en a pas connaissance auparavant. Les candidats ont également leur propre stratégie : les uns décident de se former rapidement, les autres choisissent la conduite accompagnée. Cette complexité, due à la présence de ces différents acteurs, fait qu’il est difficile d’appréhender la question et de trouver un système qui convienne à tout le monde.
Ce qui préoccupe le plus nos concitoyens, c’est le temps qu’il leur faudra attendre pour repasser l’épreuve en cas d’échec, et non pour se présenter la première fois. C’est très variable d’un département à l’autre et d’une école de conduite à l’autre. On peut imaginer de mettre davantage d’inspecteurs sur le terrain… ou de privatiser le système.
Cela étant, nous disposons de deux outils : soit la mise place d’examens supplémentaires le samedi – mais pour cela, il faut trouver des inspecteurs volontaires – ; soit l’organisation d’opérations « coups de main » entre départements. Toutefois, ce n’est pas totalement satisfaisant et il existe toujours des tensions, surtout dans les départements qui comptent peu d’inspecteurs.
Je reviens aussi sur la progressivité du permis moto. La directive européenne nous impose déjà un seuil de vingt-quatre ans pour les grosses cylindrées. Faut-il porter ce seuil à un âge supérieur, étant entendu que la plupart des personnes qui passeront le permis moto seront déjà titulaires du permis voiture et auront une expérience de la conduite sur route ? Je pose la question.
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous remercie.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur les infrastructures .: M. Yves Krattinger, sénateur, président du conseil général de la Haute-Saône, président de la commission « transports et infrastructures » de l’Assemblée des départements de France ; Mme Marie-Line Gallenne, chargée d’animation en sécurité et efficacité des infrastructures à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et M. Dominique Fleury, directeur de recherche ; M. Jean-Louis Hélary, directeur du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ; M. Philippe Redoulez, directeur du Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) ; M. Christophe Saintillan, chef du service infrastructures de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ; M. Lionel Walker, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentant de l’Association des maires de France (AMF) sur les questions de sécurité routière ; Mme Annie Canel, directrice des opérations et de la sécurité de l’Association des sociétés françaises d’autoroute (ASFA) ; M. Thierry Latger, secrétaire général du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics d’État, accompagné de M. Yves Legrenzi, secrétaire national ; M. Olivier Deleu, secrétaire général de l’association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE)
Mercredi 7 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Mesdames et messieurs, merci de votre présence devant notre Mission d’information. Alors que les infrastructures, sujet de la table ronde d’aujourd’hui, n’étaient pas au centre de nos préoccupations, elles ont été mises en cause à plusieurs reprises au cours de nos auditions précédentes. Nous attendons donc de vous des analyses et des propositions concrètes.
M. Yves Krattinger, sénateur, président du conseil général de la Haute-Saône, président de la commission « Aménagement du territoire et technologies de l’information et de la communication » de l’Assemblée des départements de France (ADF). Bien entendu, j’interviendrai ici uniquement au titre de mes responsabilités de président de conseil général et, surtout, de président de la commission qui, au sein de l’ADF, a en charge les transports.
Les départements gèrent environ 385 000 kilomètres de routes. Composé aussi bien de voies rapides de deux fois deux voies que de chemins intercommunaux, ce réseau est donc très varié, étendu et d’un fonctionnement complexe. Il constitue aussi, avec les 11 500 kilomètres de routes gérés par l’État, le réseau de base des déplacements de nos concitoyens. D’autre part, les départements transportent chaque année plus de deux millions d’élèves. La sécurité est donc pour nous un enjeu essentiel.
Acteurs de proximité, les départements disposent tous d’un programme pluriannuel glissant de sécurité, impliquant la réalisation d’aménagements routiers. Ils apportent aussi soutien financier et conseils aux communes : les routes départementales traversent celles-ci ; or, dans sa commune, le maire dispose du pouvoir de police. La liaison avec les communes est donc constante.
Le lien est également très fort avec l’État, dont le réseau scientifique et technique demeure au service de l’intérêt général, aux termes de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les recommandations de ce réseau, issues de l’expérience partagée des services de l’État, des départements et des communes, sont des références constantes pour notre action ; nos relations avec lui sont excellentes.
Les départements sont donc au centre d’un champ d’interactions de politiques publiques, de décisions économiques – la charge financière est lourde – et de relations sociales, sanitaires, culturelles et éducatives : bref, ils sont à l’interface entre l’organisation générale de l’action publique et nos concitoyens.
L’action des départements en matière de sécurité routière, toujours volontariste, est adaptée à la spécificité de chacun de nos territoires ; elle ne peut pas s’exprimer identiquement dans des départements au relief plat et au climat doux et dans des départements de montagne aux hivers rigoureux. Le relief et le climat justifient des approches spécifiques.
Pour autant, certaines familles d’actions sont communes. Il en est ainsi de la stratégie globale de mobilisation de l’ensemble des services en faveur de la sécurité routière : la nouvelle d’un accident corporel suscite toujours chez nous une interrogation sur notre part éventuelle de responsabilité dans sa survenue, du fait d’une signalisation ou d’un tracé de route inadaptés par exemple.
Je formule donc d’ores et déjà une recommandation : il faut des processus itératifs en matière de sécurité et d’accidentologie routières. Nous devons mettre en œuvre une culture de la qualité, pour non seulement éviter les fautes mais, quand une lacune est détectée, y remédier à la fois dans le cas précis où elle a été mise en évidence et dans toutes les situations identiques qui pourraient se présenter sur l’ensemble du territoire.
M. le président Armand Jung. En matière d’infrastructures, quel vous semble être l’élément le plus délicat pour la sécurité routière ? Quelles difficultés souhaiteriez-vous nous signaler dans les relations entre les services de l’État et ceux des départements, par exemple les SDIS ? Quelles seraient vos propositions ?
M. Yves Krattinger. La qualité des infrastructures est plutôt bonne en France. Cela dit, ma longue expérience d’élu local m’amène à penser que le point de vue du gestionnaire de voirie n’est pas forcément celui de l’usager local. Lors de mes permanences, il est arrivé que des personnes me signalent comme dangereux des points que je ne percevais pas comme tels, une courbe insuffisamment relevée, un virage à double rayon par exemple. Nous devons être réactifs face à ces causes potentielles d’accidents graves, et donc être à l’écoute de l’usager. Malgré sa compétence et sa vigilance, le service gestionnaire ne détecte pas toujours toutes les causes potentielles de danger.
Il m’est aussi arrivé de devoir hausser le ton face aux services de l’État pour obtenir la correction de points sur les routes nationales, la répétition d’accidents sans gravité nous ayant amenés à en détecter les causes.
En matière de sécurité routière, il n’y a pas de mesure miracle : c’est une analyse objective de toutes les causes – signalisation difficile à lire ou inadaptée, par exemple – qui permettra de progresser, y compris pour protéger l’usager un peu distrait ou qui roule un peu trop vite.
Je suis en revanche hostile à une normalisation, à une standardisation totale de la route : la norme ne peut pas être exactement la même en pays plat et en montagne, dans les régions à hivers froids et dans celles où les hivers sont doux.
Je ne perçois guère de difficultés dans les relations entre l’État et les collectivités locales. Les inquiétudes suscitées par la loi du 13 août 2004 ne se sont pas concrétisées : loin de se rompre, le partenariat s’est reconstruit sur des bases nouvelles. Les représentants des collectivités et ceux de l’État se rencontrent ; je copréside ainsi avec le directeur général des infrastructures de transport et de la mer, M. Bursaux, le comité des maîtres d’ouvrages routiers. Nous partageons tous nombre d’objectifs et nous nous attachons à les atteindre ensemble. D’abord inquiet lui aussi, le réseau scientifique et technique de l’État a bien intégré le fait que les collectivités sont ses interlocuteurs naturels pour diffuser les produits qu’il élabore. Les relations sont sans cesse en progrès.
Je regrette – j’ai déjà tenu ailleurs de tels propos – la prééminence de la « trique » sur la pédagogie et les processus qualitatifs. Bien sûr, certaines causes d’accidents, dues à des comportements individuels – l’utilisation du téléphone au volant par exemple – doivent être traitées par la répression. Mais il faut aussi saluer les progrès réalisés en matière de sécurité des véhicules. Nous devons continuer dans cette voie. Il doit en être de même en matière de sécurité des infrastructures. Il nous faut aussi développer encore la pédagogie envers les jeunes. Je plaide pour un état d’esprit général d’éducation et de formation de l’usager, et, au lieu d’un rapport de force avec celui-ci, la recherche d’une certaine irréprochabilité en matière de sécurité. Cette préoccupation nous mobilise tous aujourd’hui.
Mme Marie-Line Gallenne, chargée d’animation en sécurité et efficacité des infrastructures à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). J’ai consacré vingt années de ma carrière à la construction routière, puis dix à la sécurité routière. À l’IFSTTAR, organisme issu de la fusion du Laboratoire national des Ponts et Chaussées et de l’INRETS, l’Institut national de recherches sur les transports et leur sécurité, j’anime un programme de recherche, consacré à la sécurité des infrastructures et au risque routier, qui a fait apparaître la nécessité d’accorder une attention toute particulière à des éléments comme les virages et les carrefours. Nous nous sommes aussi aperçus que certaines caractéristiques routières étaient essentielles pour permettre aux conducteurs de comprendre la route qu’ils empruntent et d’y percevoir à leur juste place les autres usagers. La tenue de route en virage et en freinage est fondamentale ; les obstacles constituent des facteurs aggravants d’insécurité.
Quelles solutions apporter ? D’abord, nombre d’actions destinées à prévenir les risques potentiels sont fondées sur des diagnostics établis à partir d’analyses d’accidents. Or, ce n’est pas là le seul moyen d’évaluer les causes d’accident liées à l’infrastructure. Pour mesurer les risques potentiels, il nous faut aussi développer des indicateurs de risques fondés sur les caractéristiques de celle-ci. C’est ce que nous avons fait dans notre programme de recherche. Nous avons analysé, s’agissant des virages, le rôle des rayons de courbure, des dévers, de l’adhérence et, s’agissant des carrefours, celui – notamment – de leur configuration.
Par ailleurs, les diagnostics sont fondés sur les seuls accidents corporels. La prise en compte des accidents matériels fournirait un supplément de données considérable, permettant de déterminer beaucoup mieux les points à risque de l’infrastructure.
Il nous faut aussi développer la « route auto-explicative », autrement dit la route lisible et répétable. Même si la diversité est réelle en France entre, par exemple, routes de montagne et routes de plaine, un conducteur qui traverse notre pays doit être capable de comprendre un virage ou un carrefour de la même manière, où qu’il se trouve. Des initiatives locales peuvent aboutir à le désorienter ; or, un conducteur désorienté, c’est un facteur de risque supplémentaire.
Nous devons aussi travailler à la « route qui pardonne ». Celle-ci est une route débarrassée d’obstacles là où le risque de perte de contrôle est le plus fort – il ne s’agit pas de supprimer tous les arbres qui bordent nos routes. Ce serait aussi une route où la signalisation serait répétée : les travaux publiés le montrent, il n’est pas rare que les conducteurs ne la perçoivent pas. Le développement de la signalisation embarquée dans les véhicules offrirait un élément d’information supplémentaire au conducteur.
Nous devons également travailler à une signalisation moderne et adaptée, dynamique et personnalisée, comprise par les usagers : ceux-ci ne l’interprètent pas toujours comme les ingénieurs l’ont conçue. Il nous faut continuer à mener des expérimentations. En liaison avec les départements, nous avons travaillé sur les routes départementales, dans le cadre d’un projet SARI (suivi automatisé de l’état des routes pour l’information des gestionnaires et des conducteurs) : là est en effet l’enjeu le plus fort compte tenu de la diversité et de la variété de ces voies, mais aussi des coûts. Nous devons être capables de proposer des alternatives aux travaux, comme par exemple de la signalisation dynamique, concentrée sur les points les plus dangereux – que nous devons donc être capables d’évaluer – et adaptée à des conducteurs dont le comportement, en matière de vitesse par exemple, n’est pas toujours celui qui est attendu.
Par ailleurs, si la vitesse est un élément essentiel de la sécurité routière, sa prescription n’est pas toujours homogène ni même proportionnelle au risque. Dans certaines zones, la limitation de vitesse est supérieure à la vitesse maximale praticable ; dans d’autres, elle est inférieure à la vitesse praticable en sécurité. La définition de la vitesse réglementaire maximale doit donc intégrer la notion de risque. Nos travaux nous mettent à même de proposer des algorithmes de calcul de vitesses réglementaires plus en rapport avec le risque encouru, notamment du fait des circonstances matérielles telles que la météorologie.
Enfin, la France doit se donner les moyens d’une véritable évaluation. Pour cela, il nous faut multiplier les sources de données. La base de données des accidents corporels mériterait d’être plus sûre. Il faut aussi, je le répète, répertorier les accidents matériels. L’accès aux procès-verbaux d’accidents devrait être plus facile. Les données relatives au trafic font également défaut aujourd’hui.
M. Dominique Fleury, directeur de recherche à l’IFSTTAR. Mes recherches sur la sécurité routière – dont les premières remontent à 1973 ! – portent surtout sur la clinique de l’accidentologie, au travers d’études détaillées d’accidents, complémentaires des approches épidémiologiques qui vous ont déjà été présentées lors de précédentes auditions. Je travaille principalement sur la sécurité des infrastructures, en particulier des infrastructures urbaines. Le problème requiert une approche ergonomique : autrement dit, il s’agit notamment de concevoir des infrastructures qui évitent qu’une situation d’infraction, par exemple l’alcoolémie d’un usager, ne dégénère en accident corporel.
L’analyse clinique montre le rôle important des erreurs de conduite dans les accidents. Ces erreurs sont bien souvent involontaires, et de nature cognitive, c’est-à-dire résultant d’une mauvaise compréhension de la situation. De ce fait, dans la conception des infrastructures, la notion de lisibilité de la route, développée depuis plusieurs années, est essentielle.
Les premières actions menées dans cette perspective ont consisté à éliminer les conflits, et, pour cela, à séparer les usagers selon leur mode de déplacement. L’autoroute a révélé l’efficacité de cette approche.
Ensuite, on a de plus en plus travaillé sur l’intégration des modes et des usages. Elle vise à montrer à l’usager quel est l’autre et comment se comporter quand on le rencontre.
Aujourd’hui, nous disposons de quelques outils dont l’efficacité est indiscutable : la limitation de la vitesse à un endroit donné, l’installation d’un sens giratoire à une intersection entraînent à coup sûr la réduction du nombre d’accidents. En revanche, d’autres outils ont une efficacité plus incertaine, leurs résultats différant d’ailleurs selon les études. D’autre part, l’emploi d’un même outil peut produire des effets variables en fonction des situations concrètes.
Nous sommes ainsi renvoyés à l’adaptation des usagers à l’aménagement. L’acte d’aménagement est une sorte de jeu à deux. Quelle que soit l’excellence des intentions de l’aménageur ou du modèle qu’il appliquera, l’adaptation des usagers pourra entraîner des effets non attendus, perturbant ceux qui sont attendus, et provoquant même parfois, non pas une amélioration, mais une détérioration de la sécurité.
Enfin, l’évaluation des projets, essentielle, n’est pas suffisamment pratiquée en France. Pour la mener correctement, il faut des données, sur les accidents, sur les trafics de piétons, de cyclistes, de cyclomotoristes, ainsi que des outils d’analyse performants et des personnels aptes.
Cette évaluation peut être quantitative ; elle mesurera alors l’évolution du risque avant et après la réalisation de l’aménagement. Elle peut aussi être qualitative ; elle fera alors apparaître les scénarios d’accident avant et après l’aménagement. La connaissance ainsi acquise permettra l’amélioration des outils. À l’échelle locale, l’évaluation permet d’obtenir un retour sur les politiques menées et de former les personnels des réseaux techniques à l’analyse de l’accidentologie. Enfin, elle améliore l’état des connaissances et fait évoluer la doctrine technique.
L’examen des projets fait aussi apparaître qu’en matière de sécurité routière, c’est d’abord au bon sens qu’on fait appel. Or telle n’est pas forcément la meilleure démarche. Ainsi, alors que le bon sens pousse à aménager des bandes cyclables pour protéger les cyclistes, le résultat n’est pas toujours celui qu’on attendait, en raison de la complexité des situations de fait.
En Grande-Bretagne ou en Allemagne, l’intégration très en amont des spécialistes de sécurité routière dans l’élaboration des projets permet de donner de meilleures chances à une bonne adaptation des infrastructures à la sécurité routière.
Enfin, comme l’industrie, la route est un domaine sociotechnique. L’industrie s’est beaucoup intéressée à la sécurité de conception – la recherche de la sécurité dès la conception même des projets. Dans cet esprit, la sécurité routière ne pourrait-elle pas être mieux prise en compte dans les schémas de cohérence territoriale, dans les plans locaux d’urbanisme, dans les politiques de développement économique local ou dans les actions de renouvellement urbain ? Les travaux que nous avons conduits très récemment sur la sécurité et sur les niveaux de risque dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ont conduit à des résultats très intéressants.
M. Jean-Louis Hélary, directeur du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). Basé à Lyon, le CERTU, qui appartient au réseau scientifique et technique du ministère de l’écologie, travaille sur les techniques urbaines – voirie, transports collectifs, aménagement et urbanisme. Je rappelle que le tiers environ des tués lors d’accidents de la route en France l’est en milieu urbain.
Même si les directions centrales du ministère restent les grandes pourvoyeuses en moyens pour le Centre, son comité d’orientation, actuellement présidé par le maire de Nancy, M. André Rossinot, permet un partage de la responsabilité de son programme d’activité avec d’autres acteurs. Le caractère prescriptif des documents produits par le Centre a tendance à s’atténuer. En matière de sécurité routière et de techniques urbaines, les schémas sont de moins en moins descendants : l’expérience et les expérimentations proviennent dans une proportion croissante des collectivités locales elles-mêmes. Cela pose le problème de la connaissance, puis de la diffusion de ce qui se fait sur le terrain.
De plus en plus, le cadre est donc celui d’un partage des savoirs et des savoir-faire entre les collectivités, le réseau scientifique et technique du ministère et les services déconcentrés de l’État. Depuis dix ans, nous conduisons avec l’Association des maires de France (AMF) une action sur la sécurité routière en milieu urbain à l’attention des élus.
En liaison avec nos collègues de l’IFSTTAR, nous nous attachons également à améliorer notre connaissance des usagers de deux-roues motorisés en milieu urbain. Le profil de ceux-ci – coursiers, moto-taxis, personnes privées ayant fait le choix de ce mode de locomotion pour se rendre à leur travail – correspond de moins en moins à celui que représentent les associations traditionnelles de motards. Or, ces usagers posent des difficultés spécifiques, notamment sur les voies rapides urbaines comme le boulevard périphérique à Paris.
Nous conduisons aussi, aujourd’hui, un programme de recherche et développement pour mieux connaître l’accidentalité, ainsi que la part de celle-ci qui revient à l’infrastructure et aux comportements des usagers. À cette fin, nous équipons des véhicules de dispositifs s’apparentant aux « boîtes noires » des avions.
Il faut enfin prendre en compte dans les projets d’aménagement les problèmes de conflits d’usages dont le milieu urbain est le cadre ; les élus locaux s’y efforcent de plus en plus souvent.
M. Philippe Redoulez, directeur du Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA). Le SETRA est comme le CERTU un service technique central à compétence nationale du ministère en charge du développement durable. Son effectif, composé pour moitié d’ingénieurs, est de 300 personnes environ. Le SETRA a notamment participé à la conception des ponts de Millau et de Normandie.
L’une de ses quatre orientations stratégiques est dédiée à la sécurité routière. Le SETRA a élaboré des expertises et des documents de méthodologie pour le compte de ses donneurs d’ordres, la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ou encore la Délégation interministérielle à la sécurité et à la circulation routières, et également, tout particulièrement depuis la loi du 13 août 2004, pour celui des collectivités locales. En liaison avec l’ensemble du réseau scientifique et technique, le SETRA a notamment développé pour l’administration centrale du ministère une méthodologie pour le contrôle de sécurité des projets routiers, ainsi que deux approches sur l’examen des itinéraires existants, l’une dénommée « inspection de sécurité routière des itinéraires » et l’autre « démarche SURE – sécurité des usagers sur les routes existantes ». À la différence des études du CERTU, ces analyses ont vocation à s’appliquer plutôt dans le domaine interurbain.
Depuis la loi du 13 août 2004, des structures ont été créées pour permettre aux collectivités locales de participer au pilotage des organismes du réseau scientifique du ministère. Le Comité des maîtres d’ouvrages routiers, coprésidé par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le sénateur Krattinger, représentant de l’ADF, donne des instructions au réseau scientifique et technique dans le domaine des transports en général. L’ADF a aussi délégué auprès de moi dix responsables chargés d’explorer des thèmes très variés – les ouvrages d’art, l’exploitation, la sécurité routière. Les agents du SETRA collaborent en permanence avec eux. Les tâches de ces représentants peuvent être de participer aux groupes de travail chargés d’élaborer des guides ou des recommandations, ou encore d’effectuer la relecture de documents sur lesquels le SETRA a travaillé. Le travail développé par le SETRA à la demande du ministère sur la thématique des passages à niveau l’a été avec les collectivités locales. Nous élaborons actuellement, à la suite de l’accident d’un autocar polonais dans les Alpes, un guide sur les fortes pentes. Nous diffusons aussi des fiches sur les aménagements de sécurité en rase campagne ; le conseil général de la Seine-Maritime s’implique fortement dans cette thématique. Les conseils généraux nous ont aussi demandé de travailler avec eux sur le traitement des obstacles le long des routes, notamment celles à double sens de circulation.
M. Christophe Saintillan, chef du service « infrastructures » de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). Si, pour l’État, offrir des infrastructures présentant le meilleur niveau de sécurité possible est depuis plusieurs années une préoccupation centrale, cette préoccupation doit tenir compte de ce que la sécurité routière implique trois facteurs : un conducteur, un véhicule et des équipements routiers.
La France est pionnière en Europe en matière de sécurité des infrastructures routières. C’est la démarche française qui a servi de fondement à la directive européenne 2008/96/CE définissant les méthodes à appliquer en la matière.
Ces méthodes comportent deux volets, consacrés l’un au parc existant et l’autre aux « projets neufs ».
La démarche en matière de patrimoine existant est inspirée par une volonté d’efficacité aussi rapide que possible. Il s’agit d’analyser les accidents sur les itinéraires marqués par une accidentalité supérieure à la moyenne, de déterminer les causes de celle-ci et de définir des leviers concrets d’action. Pour tenter de comprendre en quoi l’infrastructure a pu jouer, notamment dans les endroits où des concentrations ou des causes communes d’accidents peuvent être constatées, nous conduisons à intervalles réguliers des diagnostics des accidents et de leurs causes. Nous pouvons alors traiter rapidement le défaut constaté, par exemple en relevant un virage, en rectifiant un parcours ou en modifiant la signalisation.
Il reste que, avec plus d’un million de kilomètres, le réseau routier français est sans doute le plus dense d’Europe. Nous devons trouver des méthodes pragmatiques tenant compte de cette densité ainsi que de l’ancienneté de ce patrimoine, parfois construit depuis plusieurs siècles. Nous nous attachons donc à traiter en priorité les cas où des actions simples permettent les résultats les plus probants, et ce dans le cadre d’une logique récurrente : en trouvant des solutions adaptées pour les routes qui présentent le plus d’accidents, nous améliorons ainsi régulièrement et continûment notre réseau. C’est cette démarche qui a été codifiée par la directive européenne, laquelle a été bien sûr transcrite en droit français.
Plus ancienne que celle qui concerne le réseau existant, l’approche en matière de projets neufs consiste plutôt à essayer d’anticiper, notamment dans la formulation des règles de conception, la survenance des accidents.
Il nous faut d’abord trouver des règles adaptées de conception, de façon à nous assurer par anticipation du caractère aussi lisible que possible de la route. Nous nous inscrivons aussi dans une démarche de qualité : à chaque stade de conception et de réalisation du projet, ainsi qu’après sa mise en service, nous veillons à la bonne application des règles, à la traduction concrète des anticipations que nous avons pu faire, c’est-à-dire à leur compréhension et à leur respect par les conducteurs. Si nous savons que la construction d’un giratoire est le meilleur moyen de sécuriser un carrefour, nous savons aussi que celui-ci doit être perçu : autrement dit, sa conception doit le mettre en évidence et non pas le dissimuler dans le paysage, au risque qu’il ne soit pas vu pendant la nuit.
Nous nous sommes aussi intéressés à la « route qui pardonne ». La conception de la route doit permettre de limiter les conséquences d’erreurs de conduite provoquées par des événements inopinés – un animal qui traverse, par exemple. C’est la raison d’être de ce que nous appelons des « zones de récupération ». Cependant, la mise en place de telles zones a abouti à construire des routes très larges, lesquelles ont donné un sentiment d’espace poussant à aller plus vite ! Nous devons donc déterminer la position optimale du curseur en nous appuyant sur l’expérience. À cette fin, nous nous sommes installés dans une démarche de qualité : nous assurons la traçabilité des décisions prises et faisons vérifier l’application correcte des règles par des experts extérieurs à chaque projet.
La conception d’une route ne sera pas non plus la même selon qu’elle sera en rase campagne ou en montagne. Les règles de conception doivent tenir compte de la diversité du territoire français. Nous sommes parfois obligés à faire des exceptions ; nous faisons alors appel à des experts capables de les valider. Ainsi, nous savons que, s’il faut tenter de gommer au maximum le relief des routes de montagne, il faut aussi éviter les routes trop droites en plaine, génératrices d’inattention et donc d’accidents.
Si cette démarche, riche d’enseignements, a fait progresser la conception des routes, le défi principal que nous avons à affronter reste celui de l’amélioration de l’infrastructure existante, parfois très ancienne comme on l’a dit précédemment. Les interventions souvent plus modestes que nous y réalisons sont donc essentielles.
M. Lionel Walker, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentant de l’Association des maires de France (AMF) sur les questions de sécurité routière. Les 36 000 maires de France gèrent 630 000 kilomètres de routes : près de deux fois la longueur des routes départementales. Notre responsabilité est aussi engagée non seulement sur les réseaux communaux mais aussi sur les voies privées ouvertes au public et sur les tronçons de routes dépendant d’autres gestionnaires dans leur traversée du territoire communal.
Les maires disposent de presque tous les outils nécessaires pour travailler à la sécurité routière : pouvoirs d’aménagement des structures, de réglementation, de sanction – avec les polices municipales –, ainsi que de mobilisation, de sensibilisation et de prévention, en liaison avec les réseaux constitués par leurs administrés.
Depuis 2005, l’AMF a pris en main ce chantier. Une première charte, conclue avec la Délégation interministérielle à la sécurité routière – qui peut être qualifiée de charte d’intentions partagées – arrive aujourd’hui à sa fin. Pour la remplacer, nous avons mis sur pied, en septembre 2010, un groupe de travail d’une trentaine d’élus que j’ai l’honneur d’animer. Nous proposons que la nouvelle charte puisse comporter des conventions d’objectifs annuels évaluables, partagés et concrets, sur lesquels l’ensemble des maires pourrait se mobiliser.
Les réflexions de ce groupe de travail interne à l’AMF m’amènent à formuler quatre propositions.
Nous sommes d’abord soucieux de coordination et de cohésion. Ainsi, selon la Fédération nationale des transports routiers, aujourd’hui les camions ne savent plus très bien par quel itinéraire passer, chaque maire réglementant la circulation dans sa commune sans le moindre souci d’un itinéraire global. Nous pouvons aussi tous citer des réglementations de voirie absolument incohérentes ; certaines villes imposent encore des limitations de vitesse à 45 km/h ! Aujourd’hui, l’usager ne comprend plus toujours la logique globale de la réglementation de la voirie ; nous devons réunir les gestionnaires de voirie pour rétablir la lisibilité de la route.
Notre deuxième souci est relatif aux deux-roues motorisés. Ils sont aujourd’hui les grands oubliés de nos infrastructures. Depuis quarante ans, ce parc a été multiplié par 6,4 : c’est celui qui a le plus augmenté. C’est aussi celui qui connaît le plus fort taux d’accidents. Cette suraccidentalité rejoint du reste la surmortalité des jeunes, public assez friand de ce mode de transport. Nous avons du mal à faire avancer ce chantier. Des expérimentations volontaires et ambitieuses en milieu urbain, notamment en région parisienne, seraient sans doute nécessaires. N’oublions pas que l’usage des deux-roues motorisés est l’un des remèdes aux embouteillages et aux difficultés de stationnement urbain.
Nous souhaitons, en troisième lieu, que le travail souhaité par nombre de professionnels sur le « code de la rue » puisse avancer ; ce véritable outil doit être mieux conforté par le législateur et mieux reconnu : il s’agit dans nos villes d’établir solidement la place du faible au regard du fort. Cette revendication revient lors de chacune de nos discussions entre maires.
Les élus, les maires, doivent aussi se voir donner leur vraie place en matière de sécurité routière. L’État a souhaité que chaque commune se dote d’un correspondant chargé de la sécurité routière. Les conseils municipaux ont tous joué le jeu. Cependant, ce réseau qui, lorsqu’il est actif, constitue un support efficace, ne l’est qu’en fonction de la volonté de chaque préfet. Nous devons malheureusement constater que, dans la majorité des départements, celle-ci manque.
La reconnaissance du rôle des maires doit se faire dans le cadre des structures existantes, comme le Conseil supérieur de l’éducation routière. Aujourd’hui, ils n’y trouvent pas forcément toute la place qui pourrait être la leur. Bien souvent, lorsque ce conseil est réuni, c’est pour les informer de mesures annoncées depuis des mois, déjà préparées et débattues de longue date dans les médias !
Pour nous, avancer en matière de sécurité routière nécessite un travail partagé entre les acteurs. Le citoyen doit y prendre toute sa place. Or, ses meilleurs représentants, ce sont ses élus de proximité.
M. Jacques Myard. Bravo !
M. Lionel Walker. Enfin, la capacité à entretenir demain ce réseau routier de 630 000 km constitue un vrai sujet de préoccupation pour les maires. Les communes n’y arrivaient qu’aidées par les départements et les régions. Les transferts aux premiers de charges de solidarité non compensées, la perte d’autonomie financière des secondes ont d’ores et déjà conduit à des retraits ou à des réductions de ces aides. Les maires ne voudraient pas avoir à choisir demain entre combler le trou financier et combler les trous de la voirie !
Mme Annie Canel, directrice des opérations et de la sécurité à l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA). J’ai commencé à travailler à la sécurité routière il y a maintenant plus de dix ans, d’abord au SETRA puis, de 2000 à 2006, à la DSCR et, ensuite, auprès de la Commission européenne. Il y a un an, j’ai rejoint l’ASFA qui regroupe 19 sociétés gérant un réseau de 8 800 kilomètres d’autoroutes. Bien qu’elles soient privatisées, ces sociétés agissent dans le cadre d’une délégation de service public : elles sont soumises aux règles et obligations édictées par l’État et les respectent scrupuleusement. La sécurité du réseau a toujours été pour elles une préoccupation très forte. Les démarches engagées, notamment depuis dix ans, ont produit leurs effets. Le nombre de tués a été divisé par deux : la moyenne annuelle est passée de 300 environ en 2000 à 150 actuellement.
De fait, les caractéristiques du réseau – chaussées séparées, absence de carrefours, etc. – font que les autoroutes sont sûres. Mais ce n’est pas la seule raison : les sociétés d’autoroutes se sont aussi organisées pour maintenir ce niveau de sécurité en insistant sur quatre points.
Premièrement, l’analyse des accidents, qui est un de nos points forts. Les sociétés disposent de données très détaillées tant sur les accidents mortels et corporels que sur le trafic. Au sein de l’ASFA, des groupes d’analyse se réunissent régulièrement pour croiser toutes les informations possibles, afin d’interpréter l’accident et d’en identifier les causes. Depuis peu, nous avons introduit un nouveau niveau d’analyse qui porte sur les circonstances. Il ne s’agit plus seulement d’envisager les causes directes, mais aussi les scénarios des accidents, que nous classons, afin d’en tirer des mesures pour l’exploitation et l’aménagement de l’infrastructure et de la signalisation.
Deuxième axe : l’amélioration de l’infrastructure. Le niveau de service étant déjà satisfaisant, il faut le maintenir. Après avoir exprimé au départ quelques réticences, dues précisément au fait qu’elles considéraient que le niveau de leur réseau était suffisamment élevé, les sociétés appliquent de façon rigoureuse la directive européenne sur la sécurité des infrastructures – à la rédaction de laquelle, par parenthèse, j’ai participé lorsque je travaillais à la Commission. Il en résulte, au demeurant, des améliorations.
Ce qui fait la force des démarches engagées par les sociétés d’autoroutes, c’est qu’elles lient tous les aspects. La sécurité routière n’étant pas une science exacte, on ne peut régler les problèmes en n’agissant que sur un seul élément. À titre d’exemple, pour lutter contre la somnolence au volant, qui est à l’origine d’un tiers des tués sur autoroute et constitue une de nos priorités, nous proposons des mesures touchant à tous les domaines de la sécurité routière : le domaine réglementaire, la formation – nous agissons en forte coordination avec les auto-écoles –, la communication, le véhicule – nous travaillons avec les constructeurs automobiles à des dispositifs d’alerte du conducteur –, le domaine médical.
Troisième champ d’action : les accidents dont les personnels sont victimes. Nous menons beaucoup de travaux pour améliorer la sécurité dans le domaine de l’exploitation et des chantiers. L’année dernière, il y a eu encore un mort, une quinzaine de blessés et une centaine de fourgons endommagés, à chaque fois dans des accidents mettant en cause des usagers.
Quatrième axe : la communication, en direction des conducteurs, mais aussi d’institutions ou de partenaires : nous contribuons ainsi aux programmes de formation des auto-écoles en leur fournissant tous les outils nécessaires.
Nous collaborons avec de nombreux acteurs – la Prévention routière et l’Institut national du sommeil et de la vigilance, par exemple – ainsi qu’avec notre interlocuteur privilégié, l’État, sur les aspects réglementaires et sur les problèmes de coordination entre les services.
Je le répète, on n’obtiendra pas de résultats si l’on ne considère qu’une des variables de la sécurité.
M. Jacques Myard. Quelle serait cette variable ? La vitesse ?
Mme Annie Canel. Il faut les traiter toutes.
M. Thierry Latger, secrétaire général du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’État et des collectivités territoriales. Notre syndicat recueille 80 % des suffrages aux élections professionnelles, dans un corps qui fournit la majorité des cadres techniques du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, anciennement chargé de la sécurité routière. Nous sommes également présents dans l’ensemble des collectivités territoriales et au sein des sociétés d’autoroutes.
J’aborderai des sujets d’ordre général, puis mon collègue,Yves Legrenzi, vous parlera de la manière dont la situation est vécue sur le terrain, dans une direction départementale des territoires.
La première question qui se pose est celle des moyens. Au-delà des drames individuels que représentent les accidents, l’insécurité routière coûte 24 à 25 milliards d’euros par an. Par rapport à ce coût, l’État mobilise très peu de moyens. La révision générale des politiques publiques s’accompagne d’une baisse inquiétante des crédits : ceux qui sont consacrés aux routes nationales sous responsabilité de l’État sont passés de 740 millions d’euros en 2009 à 640 millions en 2011. Il en résulte une réduction de l’entretien. On a fait allusion aux nids de poules mais on pourrait parler aussi des difficultés de déneigement rencontrées cet hiver, ou encore de l’impossibilité de changer les panneaux de signalisation ou d’éclairer les giratoires de campagne mal indiqués pour éviter les sorties de route.
À cela s’ajoute l’important désengagement de l’État en matière d’ingénierie publique, alors même que l’on a besoin de compétences techniques pour venir en appui aux projets de sécurité routière des communes. Des missions de conseil en ingénierie comme l’ATESAT – assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire – sont en train d’être abandonnées faute de personnel. Au 1er janvier 2008, les ingénieurs des travaux publics de l’État étaient 1 800 dans les directions départementales des territoires. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 950. Or ils ont pour mission, entre autres, de conseiller les collectivités, notamment pour leurs travaux de sécurité routière.
M. Jacques Myard. À côté de cela, les départements ont procédé à des recrutements assez importants.
M. Thierry Latger. Il est clair que l’État se désengage de cette mission.
M. Jacques Myard. Il n’y a pas que l’État !
M. Thierry Latger. De plus, le réseau scientifique et technique – RST –, qui dépend principalement du ministère de l’écologie, travaille de moins en moins sur les problèmes routiers, à l’exception des CETE, les centres d’études techniques de l’équipement, mais ceux-ci voient leurs moyens réduits, si bien que les services techniques des départements s’inquiètent de ne plus pouvoir disposer de ces compétences.
M. le rapporteur. Sur quels éléments précis fondez-vous cette affirmation ?
M. Thierry Latger. Nous pourrons vous fournir un dossier précis mais je puis d’ores et déjà vous dire que le nombre d’agents des CETE travaillant à des projets routiers a diminué de 25 % en trois ans.
M. Jean-Marc Roubaud. Et l’absentéisme ?
M. Thierry Latger. Le SETRA, dont le directeur a affirmé qu’il regroupe 300 agents, n’en a en réalité que 200 : il en a perdu un tiers.
M. le président Armand Jung. Nous avons bien noté vos propos sur le manque de moyens. Sur le fond, maintenant, quel problème votre syndicat relève-t-il en priorité ?
M. Thierry Latger. Celui de l’organisation des services. Depuis les lois de décentralisation, le ministère est en réorganisation permanente. La réforme de l’administration territoriale de l’État – la RéATE – a également perturbé le fonctionnement de services qui peinent désormais, en termes de technicité, à répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage, à savoir les présidents de conseil général, les maires et l’État.
M. le rapporteur. Qu’entendez-vous par « en termes de technicité » ?
M. Thierry Latger. En termes de compétences techniques.
M. le rapporteur. Alors ce n’est plus seulement un problème d’organisation...
M. Thierry Latger. Les problèmes de compétences sont liés aux baisses d’effectifs et au fait que le ministère privilégie d’autres secteurs. À l’évidence, la route n’est plus le sujet principal pour le ministère de l’écologie et l’on voit fondre les effectifs qui y sont consacrés. De plus, la réorganisation a coupé des liens qui permettaient de fournir un appui technique homogène aux maîtres d’ouvrage.
D’autre part, on constate un recours croissant à la concession ou à la privatisation des routes. Les sections à péage se multiplient et l’on aboutit à un réseau à deux vitesses : il y a d’un côté ceux qui ont les moyens de prendre des autoroutes payantes, où se produisent très peu d’accidents, et de l’autre ceux qui n’en ont pas les moyens et doivent emprunter les réseaux routiers normaux...
M. Jean-Marc Roubaud. Nous ne sommes pas venus pour écouter un discours syndical !
M. le rapporteur. Je crois en effet que ce n’est pas le lieu de défendre des positions politiques. Nous avons bien compris quelles sont vos opinions, nous préférerions que vous vous en teniez à un plan technique.
M. Thierry Latger. La sécurité routière suppose qu’un service technique puisse contribuer aux décisions de façon homogène sur le territoire.
M. Yves Legrenzi, secrétaire national du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’État et des collectivités territoriales. Je compléterai ce propos par un éclairage de terrain, conformément au souhait de votre Mission d’information.
Je suis ingénieur en poste dans une de ces directions départementales des territoires (DDT) qui sont issues de la fusion des DDE et des DDAF, les directions départementales de l’agriculture et de la forêt. Dans la plupart des départements, il s’agit du service technique qui travaille pour le compte du préfet à la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière.
En matière de prévention, la DDT construit et gère la base de données des accidents de la circulation, laquelle vient ensuite alimenter la base nationale. L’analyse locale lui permet de déterminer les singularités du département afin de cibler les actions de prévention. C’est donc un élément important de territorialisation de la politique nationale.
Je travaille depuis trois ans dans le domaine de la sécurité routière après avoir occupé pendant une durée équivalente un poste d’ingénierie dans la construction d’infrastructures. Or, depuis trois ans, la réorganisation de l’administration territoriale de l’État fait que les directions techniques départementales communiquent beaucoup moins qu’auparavant avec l’échelon ministériel, voire plus du tout. En tant que responsable de la politique de prévention au niveau local, je n’ai que très peu d’échanges avec la DSCR, la Délégation à la sécurité et à la circulation routières. Le niveau ministériel ou interministériel n’a plus vocation à échanger directement avec le niveau départemental. Cela se traduit par une perte d’efficacité d’un point de vue organisationnel et par un appauvrissement réciproque. La DSCR lance des campagnes de prévention, signe des chartes nationales, mais sans se coordonner avec les départements...
M. le président Armand Jung. Au-delà des questions organisationnelles, pourriez-vous faire état des problèmes précis que vous auriez rencontrés sur le terrain et que nous pourrions mettre en avant dans nos propositions ?
M. Yves Legrenzi. Les expériences sont insuffisamment partagées faute de dialogue. La solution serait de rétablir un vrai réseau d’échanges et un vrai pilotage.
M. le président Armand Jung. Comme naguère par le Conseil national de la sécurité routière ?
M. Yves Legrenzi. Moins que d’une instance nationale, nous aurions besoin de réseaux techniques locaux. Dans mon département par exemple, on a choisi de travailler en étroite concertation avec le président local de l’Association des maires de France. Nous avons demandé à chaque commune de désigner un élu référent en matière de sécurité routière et de nous donner son adresse électronique. Par ce moyen, tous les mois, j’envoie des messages et je fournis des outils de sécurité routière aux communes. Chaque année, j’organise un forum réunissant les élus de chacun des arrondissements. Sur 363 communes, 346 ont désigné un élu référent.
C’est parce que nous nous sommes dotés de cet outil que nous disposons d’un réseau partenarial sur le terrain. Il est dommage que le niveau central soit incapable de s’assurer de l’utilisation de ses propres outils – et avec une certaine cohérence – dans tous les départements. Depuis 2008-2009, ceux-ci en sont souvent réduits à réinventer l’eau chaude chacun dans son coin, sans contact avec les experts qui sont à Paris.
S’agissant par exemple des passages à niveau, l’élu ou le citoyen ordinaire aura du mal à remplir la grille que le SETRA a élaborée pour déterminer le degré de danger présenté par une installation et que l’État a envoyée à toutes les communes : une formation technique minimale est nécessaire. Les conseils généraux, qui disposent de services techniques robustes, ont pu exploiter ce document, pas les petites communes, sur les territoires desquelles beaucoup de passages à niveau sont pourtant situés. Comme l’État n’a plus les moyens de les aider, elles n’ont pu réaliser ce diagnostic que partiellement. L’initiative aura été peu efficace et, finalement, restera lettre morte.
M. le rapporteur. Ce sujet, en effet préoccupant, n’est-il pas principalement du ressort de RFF et de la SNCF ?
M. Yves Legrenzi. RFF et la SNCF sont compétents sur leur domaine mais, dans ce cas, se posent aussi des problèmes de signalisation, d’approche, etc. qui se situent sur le domaine routier et il existe donc un besoin d’interface avec le gestionnaire de voirie.
M. le rapporteur. Cela étant, l’espace même du passage à niveau, y compris le dispositif de fermeture, est de la compétence de RFF. Envoyer aux communes un questionnaire par ailleurs compliqué ne résout pas la question.
M. Yves Legrenzi. Chacun est compétent dans son domaine. La sécurité d’un passage à niveau se joue entre RFF, la SNCF et le gestionnaire de voirie.
Cet exemple montre que le transfert de responsabilités ne fonctionne pas sans accompagnement technique. Ma première proposition est donc de restaurer un vrai dialogue entre la DSCR et le niveau départemental.
D’autre part, avec le transfert de la compétence en matière de sécurité routière du ministère en charge de l’équipement et des transports vers le ministère de l’intérieur, on consacre de moins en moins de temps à analyser les causes et les facteurs d’accidents, et les analyses techniques ne sont plus prises en compte dans les décisions. On le voit avec la polémique relative aux panneaux signalant les radars : si l’on avait demandé leur avis aux techniciens, le déroulement et l’issue de la crise auraient été tout différents. C’est l’illustration d’une dérive...
M. le rapporteur. Qu’auriez-vous préconisé ?
M. Yves Legrenzi. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le radar est un outil de prévention. On le place sur des tronçons où l’on a constaté des accidents dus à la vitesse. Le principe consiste à disposer un panneau de manière à avertir de manière équitable tous les usagers, puis à mettre en œuvre des sanctions si la signalisation n’est pas respectée. Le système étant automatique, chacun est sanctionné de la même manière. Cet outil a indéniablement fonctionné puisque le nombre d’accidents liés à la vitesse a baissé.
La suppression du panneau avertisseur revient à rompre le « pacte social » entre l’État et l’usager.
M. le rapporteur. Plutôt que de commenter la décision, veuillez préciser, comme vous l’avez annoncé, ce que vous auriez recommandé si l’on vous avait consulté une fois la décision prise. Quel est l’avis du technicien ? C’est à nous, et non à vous, de porter des jugements de valeur.
M. Yves Legrenzi. Le technicien aurait proposé aux décideurs de ne pas supprimer les panneaux annonçant les radars.
M. le rapporteur. Une telle appréciation porte sur le bien-fondé de la décision.
M. Yves Legrenzi. C’est bien le sens de mon propos : un technicien n’aurait pas proposé cette mesure.
M. le président Armand Jung. Des jugements de valeur de toutes sortes ont déjà été exprimés au sein de l’Assemblée nationale à ce sujet.
Mme Françoise Hostalier. Il ressort de cette intervention que l’administration envoie aux élus locaux des documents qu’ils ne sont pas capables de lire ou d’exploiter par eux-mêmes.
M. Yves Legrenzi. Oui, lorsque ces élus ne disposent pas de services techniques suffisamment étoffés.
Mme Françoise Hostalier. C’est grave !
M. Olivier Deleu, secrétaire général de l’association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE). Tous les intervenants l’ont souligné, la sécurité routière dépend d’une pluralité de facteurs et donc pour partie seulement des infrastructures. Mais, outre que la matière est complexe, elle n’est pas modélisable. Les choses seraient plus simples, y compris pour l’association TDIE qui regroupe l’ensemble des acteurs de la mobilité durable, si l’on pouvait établir une corrélation entre le montant des investissements et l’amélioration de la sécurité. Les travaux de plusieurs économistes – ceux de Marc Gaudry et de Karine Vernier, notamment, menés en liaison avec le SETRA – montrent au contraire que, lorsque la bande de roulement se dégrade de façon visible, les automobilistes deviennent plus vigilants, qu’ils réduisent leur vitesse et que la sécurité routière s’en trouve paradoxalement améliorée. Ce serait certes un sophisme dangereux que de se refuser à entretenir les routes en invoquant la sécurité routière, mais on voit bien qu’il faut se garder de simplifier à l’excès. De même, il serait simpliste de soutenir que la suppression de l’éclairage suffirait à régler certains problèmes de circulation, comme on le lit parfois dans la presse.
Nous sommes à la croisée des chemins. Le président Krattinger, qui représente l’Assemblée des départements de France au sein de TDIE, affirmait récemment que le réseau routier français, qui est un des meilleurs et des plus complets d’Europe, « commence à subir les conséquences de politiques d’entretien guidées davantage par la nécessité économique que par les réalités techniques ». Or ces réalités techniques sont implacables : le défaut d’entretien est un pis-aller qui se paie au prix fort lorsque s’amorce une détérioration structurelle de la chaussée. Le président de l’Union des syndicats de l’industrie routière française (USIRF), autre adhérent de TDIE, parlait quant à lui des « risques importants d’une dégradation rapide du niveau de service de l’ensemble des réseaux routiers existants et du probable accroissement de l’accidentologie liée à leur utilisation ».
Bref, nous risquons d’être confrontés à un effet de ciseaux.
D’une part, l’exigence de qualité de service sur la route augmente. Nous sommes dans une société de l’image et de l’instant, où l’information arrive en temps réel et en abondance, à tel point que certains automobilistes éprouvent des difficultés à appréhender la signalisation existante de façon globale et suffisamment en amont. Il faudra mener une réflexion sur la circulation de l’information routière, en vue de mieux répondre à la demande sociale de technologies intelligentes.
D’autre part, notre travail sur le réseau routier de l’État fait apparaître qu’un entretien insuffisant se traduit en premier lieu, et de façon mesurable, par un accroissement de la distance de freinage. Le risque est alors d’assister à une dégradation des conditions de circulation, indétectable par les automobilistes, donc ne pouvant provoquer de réaction d’anticipation de leur part.
Bref, il faut continuer à investir dans les réseaux routiers. Je vous renvoie à ce propos à la fiche ROU2 de l’avant-projet consolidé du schéma national d’infrastructures de transport, qui illustre un effort de franchise et de cohérence de l’État : « Les coûts moyens d’entretien et d’exploitation des routes en France, évalués par kilomètre exploité ou par kilomètre parcouru pondéré, se situent dans le bas de la fourchette des coûts constatés en Europe pour des routes de structure comparable. Ce résultat peut être le signe d’une bonne efficacité économique mais aussi celui d’une possible insuffisance des moyens affectés à ces fonctions. »
Je tiens également à votre disposition l’étude que nous avons réalisée sur les budgets consacrés à l’entretien, à la modernisation et à la sécurisation du réseau routier national. Ce réseau ne représente que 2 % du réseau total mais accueille 25 % de la circulation routière et 50 % de la circulation des poids lourds. Toutes les données – y compris celles du réseau scientifique et technique national, qui est, j’y insiste, le meilleur du monde et qui mérite qu’on lui donne les moyens d’exister – montrent que ce réseau a besoin de plus de transparence – probablement sous forme d’un audit indépendant –, mais aussi d’une programmation pluriannuelle comme c’est le cas pour les contrats de projets entre l’État et RFF.
Il existe des prémices : le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, est pluriannuel. Pourquoi ne pas généraliser la démarche pour prévoir que, sur dix ans, on allouera tel montant chaque année à tel type de politique sur le réseau routier national ? Ce serait le moyen d’en améliorer la sécurité en ne laissant pas devenir lettre morte les préconisations des techniciens.
M. le président Armand Jung. Je vous saurais gré de nous faire parvenir les données chiffrées que vous avez évoquées.
M. le rapporteur. Vous avez beaucoup parlé d’évaluation, de diagnostic, parfois de défaut de connaissances et de dialogue. Que penseriez-vous de la création, sur l’ensemble du territoire, de comités locaux associant tous les acteurs de la sécurité routière pour apporter des réponses locales adaptées ? Bien que l’on ait une très bonne connaissance des points noirs, il y a toujours des accidents.
Dans le département du président Jung, où nous nous sommes rendus, le dialogue est très satisfaisant mais ce n’est pas le cas partout. Outre le dialogue entre le département et la DSCR, qu’il faut encourager, ne conviendrait-il pas de développer le dialogue à l’intérieur même du département ? Les maires peuvent donner une photographie des points dangereux et des lieux où se produisent les accidents. Il faut assurément une politique nationale applicable à tous, mais également des déclinaisons locales car les conditions sont différentes d’une région à l’autre. Selon vous, serait-il utile de constituer des cellules sous l’autorité du préfet et, le cas échéant, du président du conseil général, auxquelles il serait obligatoire de participer ?
M. Yves Krattinger. Je me méfie de la création d’une commission de plus. Ce sera une mesure d’affichage sans aucun effet.
La volonté d’agir est partagée par les maires, les présidents de conseil général, l’État. Personne ne se désintéresse de la question. Si la situation est devenue compliquée, c’est que l’État, il y a encore dix ans, faisait tout pour tout le monde, grâce à une puissante citadelle, le ministère de l’équipement, dont il convient de saluer les grandes réalisations. Mais, après la loi de 2004, on est passé dans un autre monde où l’État ne travaille plus pour les communes. Cela ne me choque pas, mais on n’a plus de maître d’œuvre et il faut y remédier.
Nous devons notamment veiller à préserver l’homogénéité du réseau entre les 102 départements. Si, lorsqu’on passe d’un endroit à un autre, la signalétique et les conditions changent, on crée de l’insécurité routière.
Tout l’enjeu consiste à bien faire fonctionner le nouveau système entre État, départements et communes, en permettant au travail exemplaire du RST de rayonner sur l’ensemble du réseau mais en permettant également la remontée qui existait naguère entre les agents départementaux et communaux et les instances centrales.
La sécurité routière n’est pas un gadget. Il ne s’agit pas de se réunir à la préfecture pour se demander ce que l’on va faire, mais de consacrer du temps aux maires pour les rassurer, pour leur expliquer que les recommandations du RST sont fondées et que leur application aura un effet sur leur territoire. On ne progressera que tous ensemble, par une bonne communication de bas en haut et de haut en bas, et non en créant une commission de plus !
Les interventions de ce matin me conduisent à formuler quelques suggestions.
En premier lieu, il faut améliorer l’expertise des projets d’aménagement sous l’angle de la sécurité routière.
En deuxième lieu, il serait intéressant d’élaborer un guide Mon village sans accidents s’adressant aux 36 000 maires de France.
M. le rapporteur. Les maires ont surtout besoin d’argent pour régler les problèmes.
M. Yves Krattinger. Il n’y a pas de solution instantanée. Les problèmes de ce type se règlent sur dix ans. Pouvoir se dire, au bout d’une telle période, que l’on a fait œuvre utile et que l’on a probablement sauvé des vies et évité des handicaps, voilà ce qui peut mobiliser un maire ou un conseiller municipal ! Les élus sont des gens sérieux et ils savent avancer, pour peu qu’on leur apporte un concours efficace. Je ne crois pas aux solutions miracles qui viendraient d’une commission départementale, une de plus, alors que nous sommes déjà assaillis de convocations pour des réunions où nous avons l’impression de perdre notre temps. Je préfère agir concrètement avec les techniciens.
M. Gérard Voisin. J’appartiens à la majorité et je soutiens le Gouvernement, mais ce qu’ont dit les deux représentants du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics d’État me semble exact. En travaillant à divers rapports sur les transports terrestres pour le compte de la commission des affaires européennes, j’ai dû me rendre à l’évidence. Les nouvelles DDT n’offrent plus aux communes et aux départements le soutien, la présence et la compétence de leurs ingénieurs, si bien que les élus doivent souvent se tourner vers des cabinets qui coûtent fort cher aux collectivités.
Cette table ronde nous aura permis d’appréhender beaucoup de vérités et nous aura ouvert de nombreuses perspectives.
Mon département, la Saône-et-Loire, a 5 000 km de routes départementales pour seulement 100 km de routes nationales, avec la sinistre RCEA, la route Centre-Europe Atlantique. Il y a donc eu un déplacement des besoins de financement et d’ingénierie et il faut trouver les recettes nécessaires, alors que l’organisation des départements ministériels a changé. Cas unique en France, la RCEA devrait passer en concession autoroutière, ce qui est très mal perçu par les populations qui ont l’impression de devoir payer deux fois, en tant que contribuables et en tant qu’usagers.
Je le répète, je n’ai pas eu l’impression d’entendre un discours syndical : je me suis rendu compte ces dernières années que telle était la réalité. Il est impératif de revoir le lien entre les deux ministères concernés et les départements et communes. Je l’ai dit à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et à M. Mariani, mais je me sens un peu seul pour soutenir cette position.
Les moyens à mettre en place exigent des recettes nouvelles. Or l’AFITF est financièrement à sec. Il faut donc poser la question de l’utilisation de l’écotaxe. Les écologistes voulaient que cet argent, prélevé sur le transport routier, soit affecté au transport maritime, fluvial ou ferroviaire. En Allemagne, le produit de l’écotaxe est de 4 milliards d’euros, pour 1 milliard prévu en France à partir de 2013 seulement.
Je retiens enfin, dans les propos très riches de nos interlocuteurs, la nécessité de nous doter de systèmes intelligents de transports.
M. Jean-Marc Roubaud. Dénoncer le désengagement de l’État pour s’exonérer de ses propres responsabilités me semble un peu facile ! L’argent public est rare. Dans tous les pays, de quelque bord que soit le gouvernement, la priorité est de diminuer la dépense publique. La question principale est donc de faire mieux en gaspillant moins. Je suis maire depuis de nombreuses années et le fonctionnement de certains services de l’État me laisse parfois pantois – par exemple des réunions très longues et parfaitement inutiles mobilisant un nombre considérable de fonctionnaires de l’ex-DDE.
Il faut également en finir avec l’habitude détestable de refaire des chaussées alors qu’il n’y a pas forcément urgence, uniquement parce qu’il faut consommer les crédits avant la fin de l’année. Et je ne parle pas des audits ou de la mobilisation de centres de recherche et de diverses instances dont on distingue mal le rôle.
Sur les autoroutes, le nombre des accidents causés par des automobilistes prenant les voies à contresens semble avoir augmenté. Or l’usager que je suis constate que les aires ont été complexifiées à l’envi, avec des giratoires, des bretelles de dégagement, etc., si bien que l’on perd ses repères et que l’on risque de commettre des erreurs. Dans la pratique, c’est une catastrophe.
En particulier, on aménage des giratoires démesurés, dont le coût s’est accru de façon exponentielle en quinze ans. Je pense que l’on pourrait faire beaucoup plus simple et corriger de ce fait beaucoup plus de points noirs, plutôt que de se faire plaisir avec des giratoires gigantesques ou des déviations démentielles comprenant des ouvrages d’art tous les cent mètres. Nous ne pouvons plus nous permettre un tel gaspillage d’argent public.
M. Jacques Myard. Dans la ville de Maisons-Laffitte, dont je suis le maire, les aménagements de voirie ont permis de passer de 96 accidents corporels en 1990 à moins de dix en l’espace de dix ou quinze ans.
Selon certains experts, si la densité autoroutière de la France était équivalente à celle de l’Allemagne, notre pays compterait 15 % de tués sur les routes en moins. Qu’en pensez-vous ?
D’autre part, j’ai constaté que la sécurité routière dispose parfois sur la voirie des « haricots » qui constituent autant d’obstacles pour les motos et peuvent provoquer des accidents. Cela me semble peu compréhensible.
Quel est votre sentiment sur les espaces partagés dans les infrastructures, notamment sur la possibilité ouverte aux usagers des pistes cyclables de remonter les sens interdits ? Culturellement, cela vous semble-t-il efficace et responsable ?
Enfin, s’il est vrai que l’État s’est désengagé de certains secteurs – et je considère, en bon jacobin, qu’il doit conserver un savoir-faire en matière routière –, il ne faut pas oublier que les directions départementales des territoires se sont considérablement étoffées dans le même temps, ce qui, à mon avis, a largement compensé les réductions qu’il y a pu y avoir par ailleurs dans l’effectif des agents affectés à la voirie et à la sécurité routière.
M. Christophe Saintillan. Tout comme certaines collectivités, l’État est gestionnaire d’infrastructures. À ce titre, il doit assumer des responsabilités, y compris pénales. C’est pourquoi je ne peux être d’accord avec certains discours alarmistes. Je comprends que l’industrie routière française ait intérêt à soutenir qu’il existe des secteurs où l’adhérence est insuffisante pour freiner, mais je ne peux souscrire à une telle thèse. Bien évidemment, des mesures de l’adhérence sont réalisées régulièrement sur les réseaux pour s’assurer de la qualité des infrastructures et de leur conformité aux règles.
On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, par exemple en prenant pour référence l’année 2009 sans faire la part de ce qui relève du plan de relance.
Je le répète, nous sommes des gestionnaires responsables. Nous nous employons à optimiser les investissements et la sécurité routière figure au premier plan de nos préoccupations, qu’il s’agisse de règles ou d’expertise. Dans certains cas, monsieur Myard, les îlots séparateurs sont nécessaires et préférables à une ligne horizontale, mais il n’existe pas de réponse absolue : il faut que l’équipement soit bien conçu et bien perçu.
Pour ce qui est des giratoires, nous sommes bien d’accord : les services de l’État doivent respecter l’impératif de réduction des dépenses publiques et de bonne utilisation des deniers publics. Cela dit, ces aménagements ne sont pas tous critiquables. À une entrée de ville ou dans d’autres secteurs, ils peuvent répondre à un besoin. Quant à les éclairer, cela n’apporte pas une garantie absolue de sécurité.
L’écotaxe est en cours de finalisation. Conformément à la loi, son produit sera affecté à l’AFITF, qui finance des investissements en matière de routes, de voies navigables et de voies ferrées. La comparaison avec l’Allemagne est malaisée : la France passe des concessions de travaux depuis cent cinquante ans et c’est ce qui a permis de construire notre réseau ferré et notre réseau autoroutier. Les 8 800 km d’autoroutes concédées génèrent plus de recettes que l’écotaxe n’en rapporte en Allemagne. Ces questions de recettes doivent donc être examinées de façon globale.
Pour conclure, je rejoins les analyses déjà formulées : les aménagements d’infrastructures permettent d’améliorer la sécurité mais ils font partie d’un tout. Il faut qu’ils soient correctement conçus mais seule l’expérience peut confirmer le bien-fondé de notre intervention. On peut anticiper les comportements dans une certaine mesure, mais les êtres humains évoluent, de même que les véhicules. Nous devons donc mener un travail permanent d’évaluation pour vérifier l’efficacité des mesures prises.
M. Thierry Latger. Tous les intervenants ont souligné l’importance de notre réseau scientifique et technique, qui est un des premiers au monde. Cet outil doit être mis à la disposition de l’ensemble des maîtres d’ouvrage : État, départements, communes. Dans l’intérêt de la sécurité routière, il faut le conforter car il est aujourd’hui en danger.
M. Olivier Deleu. L’association TDIE regroupe, je l’ai dit, l’ensemble des acteurs de la mobilité. Elle n’est le porte-parole de personne, monsieur Saintillan, et, en particulier, pas celui de certaines grandes entreprises.
D’autre part, je n’ai jamais soutenu que l’on avait du mal à freiner sur le réseau routier national : j’ai seulement souligné que c’était le premier symptôme possible d’un défaut d’entretien.
Enfin, je maintiens que nous sommes plus dans une logique de diminution que d’augmentation des crédits affectés au réseau national. Les comptes de l’AFITF et les bleus budgétaires le confirment. Ce n’est pas un jugement de valeur, c’est une certitude chiffrée.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie tous.
*
* *
Table ronde sur le contrôle sanction automatisé : M. Aurélien Wattez, chef du département du contrôle automatisé à la délégation à la sécurité et à la circulation routière du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; M. Thierry Pocquet du Haut-Jussé, procureur de la République de Rennes, responsable du volet judiciaire du contrôle sanction automatisé, et M. Emmanuel Grandsire, 1er substitut, adjoint au chef du bureau de la politique d’action publique générale de la direction des affaires criminelles et des grâces ; M. Jean-Jacques Debacq, préfet, directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et Mme Isabelle Gally, adjointe au préfet ; M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), et M. Laurent Carnis, économiste, chargé de recherche à l’IFSTTAR ; M. Éric de Caumont, secrétaire général de l’Association des avocats de l’automobile ; M. Sébastien Roux et M. Philippe Zamora, chercheurs au Centre de recherches en économie et statistiques (CREST).
Mercredi 7 septembre 2011
M. le president Armand Jung. Cette table ronde sur le contrôle sanction automatisé – c’est-à-dire, en clair, sur les radars automatiques – est particulièrement importante à nos yeux, dans la mesure où la création de cette mission d’information par la Conférence des présidents a justement fait suite aux remous accompagnant la décision du Comité interministériel de sécurité routière de supprimer les panneaux prévenant de l’existence des radars. Votre audition sera donc déterminante pour l’élaboration des propositions que nous allons transmettre au ministre de l’intérieur vers le milieu du mois d’octobre.
De nombreux députés sont retenus par les votes très importants qui ont lieu cet après-midi, mais dès qu’ils le pourront, d’autres membres de la Mission vont nous rejoindre, dont son rapporteur, M. Philippe Houillon. Par ailleurs cette réunion, ouverte à la presse, est enregistrée et diffusée en direct sur le site de l’Assemblée nationale.
M. Aurélien Wattez, chef du département du contrôle automatisé au sein de la Délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR). Le département du contrôle automatisé, dont je suis le responsable, est rattaché à la Délégation à la sécurité et à la circulation routière – DSCR –, elle-même placée sous la double autorité du ministère de l’intérieur et du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Ce département, créé l’année dernière après la séparation en deux entités de l’ancienne Direction du projet interministériel de contrôle automatisé – DPICA –, a pour mission le déploiement et la maintenance des radars automatiques en France.
En ce qui concerne le déploiement, l’objectif fixé par le ministre de l’intérieur est d’installer, en 2011 et en 2012, 1 000 nouveaux radars-sanctions. Parallèlement, le contrôle sanction automatisé aborde une nouvelle phase de son existence, marquée par une grande diversification des systèmes de contrôles, qui seront désormais de sept types différents.
Aujourd’hui, environ 3 500 radars sont déployés sur le territoire, dont 2 000 radars « vitesse » fixes – ces cabines blindées disposées sur l’accotement. La plus grande part est installée sur les routes départementales, le plus grand réseau, mais il en existe aussi sur les routes nationales et sur les autoroutes. Par ailleurs, les unités de police et de gendarmerie sont dotées de 933 radars mobiles. Depuis 2009, des équipements sont également placés sur les feux tricolores afin de contrôler le respect des feux rouges. Ils sont aujourd’hui plus de 600.
M. le président Armand Jung. Disposez-vous d’un premier bilan des équipements « feux rouges » ?
M. Aurélien Wattez. La DSCR a demandé l’année dernière au réseau scientifique et technique du ministère des transports une évaluation de la politique de contrôle automatisé des feux rouges. Le rapport définitif n’est pas encore disponible, mais les premières constatations font état d’une chute du nombre d’infractions relevé par le dispositif plus importante qu’avec les radars « vitesse » fixes : alors que dans le second cas, cette chute est de 10 à 15 % par an, le rythme est sans doute deux fois plus élevé pour ce qui concerne les feux tricolores. Cela montre un apprentissage des usagers et une évolution de leur comportement lorsqu’ils abordent les carrefours équipés. Ces dispositifs sont d’ailleurs bien acceptés par la population dans la mesure où ils ont vocation à pacifier le milieu urbain et à réguler de façon plus intelligente les échanges en zones denses entre automobilistes, cyclistes et piétons. Nous tendons à les installer plus particulièrement devant les écoles ou les centres hospitaliers, c’est-à-dire dans des lieux fréquentés par des usagers vulnérables où, plus qu’ailleurs, nous devons porter attention au respect de la signalisation.
M. le président Armand Jung. Si je vous ai posé la question, c’est qu’au cours des auditions, beaucoup ont déclaré trouver logique d’installer des radars sur les routes départementales, où l’accidentologie ou la mortalité sont les plus importants, mais moins aux carrefours dotés de feux tricolores, où le nombre d’accidents mortels est bien moindre. En filigrane, certains reprochaient à l’État d’installer ces équipements pour « faire du chiffre ». Il est vrai que c’est en dehors des villes que le problème crucial se pose : il serait donc préférable que vous mettiez l’accent sur les radars « vitesse ».
M. Aurélien Wattez. Jusqu’en 2009, le déploiement concernait surtout les radars « vitesse », mais depuis, comme je l’ai dit, nous avons entrepris une politique de diversification des équipements, d’une part pour lutter contre d’autres sources d’insécurité routière, et de l’autre pour éduquer les usagers et leur montrer qu’il faut respecter l’ensemble des règles, partout et tout le temps. Après le respect de la vitesse autorisée, celui des feux tricolores est un nouveau pas vers une diminution du nombre de morts sur les routes.
Parmi les nouveaux dispositifs, on peut citer les radars discriminants. Cette nouvelle génération de radar « vitesse » va permettre de distinguer les véhicules légers des poids lourds, et donc de sanctionner le chauffeur en tenant compte des limitations propres à la catégorie à laquelle appartient son véhicule, mais aussi d’identifier avec certitude la voie sur laquelle circule le conducteur en infraction. La présence de plusieurs véhicules sur un même cliché est en effet, à l’heure actuelle, une des causes de rejet des messages d’infractions relevés par les radars traditionnels. Une quinzaine de ces équipements est d’ores et déjà installée, et leur nombre atteindra plus d’une centaine l’année prochaine.
La diversification ne s’arrête pas là : d’ici à la fin de l’année, nous allons déployer des radars « vitesse moyenne », dits aussi radars « tronçons », qui permettront de mesurer la vitesse moyenne d’un véhicule entre deux points de façon à inciter les usagers à maîtriser leur vitesse sur une distance plus longue, et aussi des radars destinés à contrôler le franchissement des passages à niveaux. Certes, le contrôle des passages à niveaux ne constitue pas le plus gros gisement de sécurité routière mais, une fois de plus, il est important de faire respecter toutes les signalisations et toutes les règles du code de la route.
Par ailleurs, sont en cours d’expérimentation des radars « mobiles mobiles », c’est-à-dire des radars embarqués, à même de contrôler les automobilistes dans le flux de la circulation. Les résultats étant plutôt prometteurs, il n’est pas exclu de voir ces systèmes fleurir sur nos routes l’année prochaine.
Enfin, une expérimentation doit être lancée concernant les routes en travaux. Dans ces zones particulièrement dangereuses, où la vitesse maximale autorisée est abaissée pour assurer la sécurité des personnes évoluant sur le chantier, la limitation n’est en effet presque jamais respectée.
En résumé, la politique de déploiement des radars vise à étendre les lieux d’implantation des dispositifs et le type d’infraction susceptible d’être contrôlé, de façon à inciter les usagers à respecter l’ensemble des règles, partout et tout le temps.
M. le président Armand Jung. La mission d’information s’interroge sur le coût de tous ces dispositifs et sur ce qu’ils rapportent, car certains les accusent de constituer une « pompe à fric ».
M. Thierry Pocquet du Haut-Jussé, procureur de la République de Rennes. Le décret du 29 mars 2011 portant création de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions – ANTAI – a levé certaines ambiguïtés relatives à la répartition des responsabilités en matière de contrôle sanction automatisé. En tant que procureur de la République de Rennes, j’assure ès qualités la tutelle judiciaire sur le Centre national de traitement des infractions routières – CNT – et sur les deux unités qui le composent.
La première est le CACIR – Centre automatisé de constatation des infractions routières – composé d’agents ou d’officiers de police judiciaires appartenant à la police nationale ou à la gendarmerie. Grâce aux moyens que leur donne la technologie automatisée élaborée par l’ANTAI, ils peuvent constater les infractions à partir des images apparaissant sur leurs écrans. Ils jouent donc un rôle similaire à celui des gendarmes et policiers présents sur le terrain, mais de façon centralisée.
La deuxième est l’Officier du ministère public, chargé de traiter les réclamations. Ce service est dirigé par un commissaire agissant sur délégation de l’officier du ministère public de Rennes, c’est-à-dire du directeur départemental de la sécurité publique, sous l’autorité et le contrôle du procureur.
Nos missions sont donc de l’ordre de la garantie et du recours. Je participe également au comité de pilotage qui se tient tous les mois à Rennes, afin de contribuer à la détermination des règles d’action en matière de contrôle automatisé, qu’il s’agisse de la constatation de l’infraction ou de sa contestation, et de faire en sorte que ces règles soient conformes aux textes et préservent les libertés et l’individualisation du système.
M. Emmanuel Grandsire, premier substitut, adjoint au chef du bureau de la politique d’action publique générale de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). La DACG a été associée à la conception du contrôle sanction automatisé dès la mise en place de ce dernier en 2003. Elle poursuit aujourd’hui cette mission en participant au comité de pilotage et à des réunions interministérielles destinées à résoudre certaines difficultés tant juridiques que techniques, liées notamment au développement des nouveaux dispositifs qui ont été évoqués. Nous donnons un éclairage sur les conséquences juridiques de certains choix techniques – par exemple en matière de constatation des infractions ou de recevabilité des preuves – afin de garantir au mieux les droits des différentes parties.
Le cœur de métier de la DACG est la définition de la politique pénale, en concertation avec le garde des sceaux. À ce titre, nous avons diffusé un certain nombre de circulaires sur le contrôle sanction automatisé. L’une d’elle, publiée en 2006, a permis de présenter aux parquets l’architecture juridique du système, caractérisée par la centralisation à Rennes des dispositifs de contrôle et d’examen de la recevabilité des recours, l’examen au fond des dossiers étant réparti entre les différents ressorts des juridictions françaises.
La DACG a été amenée à se pencher, fin 2010, sur une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’article 529-10 du code de procédure pénale – car le dispositif tout entier repose sur l’amende forfaitaire. L’argument présenté était la prétendue impossibilité de contester la décision par laquelle l’Officier du ministère public écarte la recevabilité du recours.
Enfin, du fait de sa tutelle sur le casier judiciaire national, la DACG est destinataire des condamnations prononcées par les juridictions. Elle dispose donc de certaines statistiques. Elle est aussi informée, à la suite de requêtes de particuliers ou de parlementaires, d’éventuels dysfonctionnements affectant le CSA, et peut être amenée à réclamer des explications au procureur de la République de Rennes. Ce qui guide son action, c’est bien entendu le respect des règles fixées par le code de procédure pénale, la garantie des droits de la défense et, d’une façon générale, la recherche d’un équilibre entre la nécessaire répression des infractions routières et le respect des droits des différentes parties.
M. Jean-Jacques Debacq, préfet, directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Avant de diriger l’ANTAI, née en mars de cette année, j’étais, depuis octobre 2006, directeur du projet interministériel de contrôle automatisé. Je connais donc bien l’histoire du système.
Au même titre que le Département du contrôle automatisé, l’Agence est un enfant de la DPICA. Sa principale mission est l’organisation du traitement automatisé des infractions. Elle fait en sorte que le CNT puisse disposer des moyens informatiques nécessaires en vue de lire les messages d’infractions qui lui parviennent, d’interroger le fichier d’immatriculation des véhicules, celui des véhicules volés et celui des loueurs de véhicules, de façon à identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. Une fois validées par le CACIR, ces données sont imprimées, affranchies et adressées aux contrevenants.
La vocation de l’Agence est également de tirer les leçons du contrôle automatisé, et notamment de la dématérialisation de la chaîne pénale. C’est à ce titre que nous avons été chargés de développer le PVE, c’est-à-dire la verbalisation électronique des infractions aux règles de stationnement.
Bien que très moderne, le système de contrôle sanction n’est pas intégralement automatisé, et la part humaine reste importante : nous laissons en effet aux agents et officiers de police judiciaire du CACIR le soin de constater individuellement chacune des infractions. Il en est de même pour les retours de courrier : l’Officier du ministère public a connaissance de chaque lettre visant à contester l’infraction ou à désigner un autre conducteur. Dans ce dernier cas – par exemple si le titulaire de la carte grise avait prêté son véhicule à quelqu’un d’autre –, un deuxième avis de contravention est envoyé à la personne concernée.
La modernisation s’étend également au paiement, puisqu’un tiers des contraventions sont réglées par télépaiement – téléphone ou Internet.
J’en viens à votre question sur les coûts et bénéfices du système. À la question de savoir combien ça rapporte, je réponds très sérieusement : 3 500 vies par an. C’est le plus important. Cela évite que 2 000 enfants deviennent orphelins, et aussi 12 000 blessés plus ou moins graves chaque année.
D’un point de vue économique, des études ont montré que l’insécurité routière coûtait à la nation plusieurs milliards d’euros par an. Dans ces conditions, il est indispensable de lutter contre ce fléau, ce qui requiert un effort important.
M. le président Armand Jung. Le problème est de l’expliquer à nos concitoyens. Avec le rapporteur, nous essayons de trouver les meilleurs arguments, mais ce n’est pas toujours facile.
M. Jean-Jacques Debacq. Absolument : nous savons combien il est difficile de faire passer certains messages. Ainsi, nous ne parvenons pas à faire comprendre que le système ne sert pas à renflouer les caisses de l’État, parce que pour les gens peu informés, l’État est une grande maison dans laquelle on peut inclure toutes les institutions publiques, y compris les collectivités locales. Or le produit des amendes – et pas seulement celui du contrôle automatisé – va principalement à ces dernières, notamment pour le financement des aménagements de sécurité routière, le reste étant consacré aux transports publics.
Le coût du déploiement et de la maintenance des radars, anciens et nouveaux, représente entre 80 et 100 millions d’euros par an. Celui du traitement est du même ordre, y compris l’affranchissement des avis de contravention et les frais liés aux retours de courrier.
Quant au produit des amendes, leur montant atteint 550 millions d’euros par an : 450 millions pour les avis de contraventions et 100 millions pour les amendes forfaitaires majorées. Le taux de paiement est d’ailleurs de 80 %, ce qui en fait un des plus élevés après l’impôt sur le revenu.
Ainsi, sur 450 millions d’euros, environ 200 millions servent à l’entretien du système et au traitement des contraventions ; à peu près 100 millions sont affectés à l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ; le reste est attribué aux collectivités locales. Toutefois, depuis le 1er janvier 2011, l’ensemble du produit des amendes, qu’elles soient classiques ou automatisées, est regroupé dans un compte d’affectation spéciale. Les fonds recueillis, qui s’élèvent à environ 1,3 milliard d’euros, sont désormais ainsi répartis : à peu près 200 millions servent à l’entretien du système, 640 millions d’euros sont attribués aux collectivités locales et 440 millions au désendettement de l’État. Enfin, une petite partie de cet argent sert également à financer l’information des usagers sur le nombre de points que compte leur permis.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres-clés concernant le Centre national de traitement. Nous recevons chaque année 19 millions de messages d’infraction – en incluant le procès-verbal électronique – et nous expédions 10 millions d’avis de contravention. Si l’on s’en tient au seul contrôle automatisé, les chiffres sont respectivement de 18 et 9 millions. Le décalage s’explique pour moitié par la présence de conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger sur nos routes, l’autre moitié étant constituée des « rebuts techniques » liés aux difficultés de lecture des plaques minéralogiques, notamment celles des motos. Au total, nous expédions 15 millions de courriers par an et nous en recevons 3 millions. Nous traitons 50 000 messages d’infraction par jour, un chiffre à mettre en balance avec certains incidents relevés par la presse, comme ce matin, à propos d’une femme ne parvenant pas à régler un problème d’immatriculation usurpée.
M. Sylvain Lassarre, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). J’ai cherché à évaluer l’impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière, et je peux d’ores et déjà vous donner quelques résultats.
Tout d’abord, la mise en place du CSA a eu, dès 2003, un effet massif sur le nombre de tués. Un tel phénomène est très rare : la dernière fois que nous sommes parvenus à changer le système de sécurité routière, c’était en 1973, lorsqu’ont été décidés la généralisation des limitations de vitesse et le port de la ceinture obligatoire. Avec des modèles simples, on a pu estimer que le nombre de tués avait baissé de 19 % entre 2003 et 2010. L’estimation du nombre de vies épargnées fait l’objet d’une petite querelle ; il est, selon moi, d’environ 2 000 sur la période considérée. Quoi qu’il en soit, il ne fait pas de doute que ce résultat est à mettre dans la balance des coûts et des bénéfices.
Cet effet massif est d’autant plus remarquable que, dans les premiers temps, le nombre de radars automatiques était peu élevé : entre 200 et 250 jusqu’en 2005. On a pourtant observé une chute importante des vitesses moyennes, ainsi que des dépassements de vitesse maximale autorisée. Auparavant, on pouvait parler de délinquance de masse, puisqu’environ 50 % des conducteurs ne respectaient pas les limitations, quel que soit le réseau. Les gendarmes et les policiers faisaient le maximum avec les moyens dont ils disposaient, mais la tolérance restait importante, certains chercheurs ayant mis en évidence un phénomène d’indulgence.
La mise en place d’un réseau automatique a, au contraire, été l’occasion d’établir une égalité devant la sanction. En outre, avec ces radars, même en faible nombre, on a commencé à prendre dans les filets non seulement le « super-délinquant » qui dépasse systématiquement les vitesses autorisées, mais aussi le Français moyen. Les conducteurs ont été très surpris, et l’information selon laquelle la vitesse était désormais étroitement contrôlée s’est rapidement diffusée dans la société. Il faut dire que la probabilité d’être contrôlé était multipliée par cent ! Tout cela explique l’ampleur de l’effet obtenu.
J’en viens à l’acceptabilité du système. Dans un premier temps, elle a été forte – les réponses à nos questionnaires le montrent –, parce que la population a compris qu’il ne servait pas à alimenter les caisses de l’État, mais à lutter contre l’insécurité routière. Grâce aux résultats qui ont rapidement été obtenus, les gens ont adhéré à ce qui apparaissait comme une bonne mesure. Ils ont par ailleurs commencé à modifier leur attitude vis-à-vis de la vitesse.
Nos études font apparaître l’existence de quatre catégories de conducteurs : les conducteurs prudents, pour lesquels la vitesse représente un danger – environ 50 % du total – ; les pragmatiques – 23 % –, qui estiment maîtriser la vitesse, et pour qui celle-ci constitue un gain de temps ; les hédonistes, pour qui la vitesse est un plaisir ; et les « défieurs » – 12 % du total –, qui aiment jouer avec la vitesse et avec le risque. On peut donc dire qu’environ 70 % des conducteurs acceptent, voire soutiennent, les efforts consentis en faveur du contrôle sanction automatisé, ou de la mise au point du LAVIA, c’est-à-dire d’un limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée. Mais il subsiste toujours 25 à 30 % de réfractaires. Or, plus on augmente le nombre de radars, et plus ces réfractaires vont se manifester. C’est ainsi qu’apparaissent sur le marché des systèmes de type Coyote destinés à éviter de se faire prendre.
Il existe probablement un optimum à trouver en matière de déploiement des radars, car, pour l’essentiel, nous avons atteint l’effet recherché.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Un de nos interlocuteurs nous a dit qu’il faudrait implanter un total de 5 000 radars sur le territoire national. Cela vous paraît-il une bonne chose ?
M. Sylvain Lassarre. L’efficacité marginale de ces nouveaux radars risque d’être réduite, et nous risquons de connaître des difficultés en termes d’acceptabilité. En tout état de cause, nous n’obtiendrons plus les baisses que nous avons connues au début. On pourra améliorer à la marge la situation dans certains points dangereux, mais il sera plus difficile de faire baisser la vitesse générale.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Selon vous, le parc actuel est suffisant, et toute augmentation n’aurait qu’une efficacité marginale. Celle-ci peut-elle être quantifiée ? Qu’en est-il des radars pédagogiques ?
M. Sylvain Lassarre. Je ne vois pas, en effet, la nécessité d’augmenter le nombre de radars automatiques. Il est vrai que l’on peut toujours en transformer certains en radars pédagogiques. Cela étant, j’attends aussi l’avis de mes collègues ayant travaillé sur cette question.
Bien entendu, d’autres types de radars peuvent s’avérer efficaces. Les radars « tronçon », par exemple, pourraient permettre de sauvegarder de nouvelles vies.
M. le président Armand Jung. Pensez-vous également, monsieur Carnis, que l’on a atteint un palier en matière d’acceptabilité des radars ?
M. Laurent Carnis, chargé de recherche à l’IFSTTAR. Si l’on observe les courbes de l’évolution de la vitesse moyenne, on peut en effet considérer que l’on a atteint un palier avec la stratégie actuelle – pour ne pas dire un plafond. C’est assez normal : la forte réduction des vitesses montre que le système a relativement bien fonctionné, mais qu’il finit par s’épuiser, ce qui est dans la logique de son fonctionnement.
Par ailleurs, il n’est pas impossible de franchir ce plafond. On peut explorer d’autres stratégies, comme la diversification évoquée par M. Wattez, ou l’évolution de la signalisation. En outre, parler d’effet marginal ne signifie pas nécessairement que cet effet est réduit. Simplement, il se produit à la marge. Quand M. Lassarre parle d’un équilibre, il fait référence au rapport entre les gains et les coûts additionnels du dispositif.
Je suis économiste, et je travaille à l’IFSTTAR au sein du département consacré à l’économie et à la sociologie des transports. Je m’intéresse au développement de l’économie de la sécurité routière, et plus précisément, depuis plus de dix ans, aux questions de dissuasion des infractions et de vitesses excessives.
Je conçois le CSA comme un outil de politique publique, bien sûr, mais plus particulièrement comme un instrument de production de dissuasion, lui-même inséré dans un système de gouvernance spécifique.
En tant qu’instrument de production de dissuasion, un dispositif de contrôle automatisé est, selon les savoirs criminologiques, susceptible de produire deux effets distincts. Le premier est la dissuasion générale, qui consiste à prévenir la réalisation de l’infraction, et donc à jouer sur le registre de la prévention. Le deuxième est la dissuasion spécifique, consistant à prévenir la réalisation, mais surtout la récidive, en faisant intervenir une dimension répressive. Les deux phénomènes sont liés.
Ces effets de dissuasion peuvent être d’ordre local, lorsqu’il s’agit de gérer un problème d’accidentalité circonscrit, ou d’ordre global lorsqu’ils portent sur une portion plus large du réseau. Dans la pratique, le système français est mixte, puisqu’il présente un équilibre entre ces dimensions préventive et répressive. Il associe en effet des appareils mobiles et fixes, signalés et non signalés, ainsi que, désormais, des radars pédagogiques. En outre, il permet de prendre en compte les enjeux locaux d’accidentalité tout en recherchant l’obtention d’effets de réseau, avec le déploiement massif d’appareils selon une logique d’itinéraire. Il en a résulté un maillage relativement fin du territoire.
Si nous mettons en regard les efforts consentis en matière de déploiement et les effets en termes de réduction des vitesses moyennes, les résultats sont remarquables. Ils le sont d’autant plus s’agissant des vitesses excessives les plus importantes, en quasi-disparition. Ce relatif succès est également renforcé par l’évolution de l’accidentalité. Même si on pouvait en partie les anticiper, de tels résultats n’étaient absolument pas garantis. Ils sont le fruit d’un véritable pari politique.
L’évolution du dispositif se traduit par une diversification et une multiplication des modes d’intervention qui auront certainement des conséquences sur le niveau de l’accidentalité, sur son rythme et sur la perception qu’en ont les usagers.
Quant à l’évolution des vitesses excessives, elle met en évidence une décélération des gains en termes de réduction de vitesse : les gains futurs seront donc de plus en plus difficiles à obtenir. Autrement dit, une réduction donnée de la vitesse moyenne de circulation nécessitera des efforts de contrôle de plus en plus importants.
M. le président Armand Jung. Si vous estimez que nous sommes parvenus à un palier, non seulement en termes de réduction de la vitesse, mais aussi de résultats – si l’on peut parler ainsi pour désigner des vies humaines –, où se situe le seuil, et comment faire pour le dépasser ?
M. Laurent Carnis. Franchir ce palier nécessite une redéfinition de la stratégie adoptée.
M. le président Armand Jung. C’est un point qui nous intéresse particulièrement.
M. Laurent Carnis. Au regard des expériences étrangères, une piste intéressante réside dans la multiplication des interventions des appareils de contrôle mobiles, alors que le niveau d’équipement des forces de police et de gendarmerie qui avait été fixé est désormais atteint. Une telle stratégie aurait sans doute un aspect plus répressif.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Pensez-vous que les radars mobiles seraient mieux acceptés, dans la mesure où l’on aurait atteint un seuil de saturation s’agissant des radars fixes ?
M. Laurent Carnis. Je ne dis pas cela, car tout est une question de dosage. Le système a été développé pour atteindre une forme d’équilibre entre une dimension préventive – assurée plutôt par les radars fixes – et une dimension répressive – associée aux radars mobiles. Mais les gens apprennent. À force de circuler sur le réseau, ils finissent par savoir où se situent les radars, d’autant qu’ils disposent de dispositifs technologiques spécifiques. Or, l’avantage d’un dispositif mobile, c’est qu’il est beaucoup moins prévisible : on crée de l’aléatoire, de l’incertitude.
Je ne m’aventurerai pas sur le terrain de l’acceptabilité, car je ne suis pas spécialiste de ces questions. Mais j’observe que les radars mobiles demandent des policiers ou des gendarmes pour fonctionner. Comme toute politique publique, la sécurité routière implique donc de faire des choix, économiques et politiques. Il existe, certes, des forces spécialisées, comme les escadrons départementaux de sécurité routière, mais il leur faut à la fois faire tourner les radars mobiles et assumer d’autres missions de contrôle plus traditionnelles : interception des conducteurs en excès de vitesse et lutte contre l’alcoolémie ou la conduite sous l’emprise de la drogue. La question est donc de savoir quelles priorités sont assignées à ces forces présentes sur le terrain, en matière de dissuasion, mais aussi de prévention – car elles interviennent aussi dans les écoles. Les moyens mobilisés doivent donc être mis en rapport avec les bénéfices attendus pour la société.
C’est tout l’enjeu de la mise en œuvre opérationnelle, qui exige, selon moi, une attention particulière, qu’il s’agisse du choix des sites de contrôle, des modalités de déploiement ou des contraintes organisationnelles. Je le répète, les effets d’une politique publique ne sont jamais automatiques : il ne suffit pas de déployer des moyens pour obtenir des résultats.
J’en viens au mode de gouvernance qui, dans le cas du système de contrôle sanction automatisé, a un caractère spécifique, impliquant des acteurs publics – autorités, collectivités locales – ou privés – usagers, fabricants, avocats, chercheurs. Tous ces acteurs entretiennent des relations plus ou moins intenses, collaboratives ou d’opposition. Ces interactions forment un système en évolution où des dynamiques d’action publique sont à l’œuvre.
Le système français me semble pouvoir être qualifié de « technocentré ». Il repose en effet sur des choix technologiques particuliers, comme l’automatisation presque totale de la chaîne pénale, et sur une centralisation de la décision au sein des deux organismes ayant succédé à la DPICA. Ces choix ont évidemment déterminé la stratégie mise en œuvre, consistant à déployer 3 500 appareils dans des délais relativement courts et à organiser un traitement de masse des infractions, en réponse au contentieux de masse généré par un système antérieur défaillant.
Il faut souligner que le déploiement et l’entretien du dispositif sont autofinancés – même si une telle notion, d’ordre économique, est impropre en matière de finances publiques –, ce qui a permis son extension progressive. Cette caractéristique n’avait rien d’évident, comme le montre l’exemple britannique.
Il reste que la diversification des appareils et des modalités d’intervention implique de prêter désormais une attention plus grande aux intérêts des autres parties prenantes, voire d’intégrer leurs contraintes et leurs objectifs. Les maires, par exemple, n’ont pas nécessairement les mêmes objectifs que l’administration centrale, ni les forces de l’ordre, en raison des différentes missions qu’elles doivent assumer. Des arbitrages doivent donc être rendus. Enfin, la prise en compte de l’avis des associations d’usagers permettrait de s’assurer que les sites de contrôle sont choisis de façon adéquate.
Le déploiement massif des appareils sur le réseau pose également la question de leur évaluation. Dans un rapport d’information déposé au nom de votre commission des finances, M. Hervé Mariton s’était ainsi interrogé sur la soutenabilité financière de cette politique. Il convient de prendre en compte la rentabilité socio-économique du dispositif de contrôle sanction automatisé, dont le coût est à mettre en relation avec les gains en termes de vies sauvegardées ou de blessés évités – en tenant compte du fait que les effets des blessures durent de longues années et entraînent des problèmes sociaux et familiaux. La décision a été prise de déployer 4 500 appareils. Est-ce un horizon ultime ? Faut-il rester en deçà de ce seuil ? Une réponse précise à cette question requiert une étude scientifique rigoureuse sur les gains et les coûts du dispositif.
M. Philippe Houillon, rapporteur. À ma connaissance, une telle étude n’a pas été effectuée.
M. Laurent Carnis. Le Commissariat général au développement durable s’est penché sur les bénéfices de la politique de contrôle sanction automatisé, mais pas sur la taille optimale du dispositif. Dans ce domaine, quiconque avancerait un chiffre devrait en justifier les raisons.
Je terminerai sur l’évolution institutionnelle. Les expériences étrangères montrent qu’il existe différentes manières de faire, associant différents acteurs et différents niveaux de gouvernement. Or le choix du schéma institutionnel a des effets sur la mise en œuvre d’une politique sur le terrain. Ainsi, il existe des dispositifs centralisés, comme en France, des organisations associant échelon local et coordination nationale, comme en Grande-Bretagne, des politiques élaborées au niveau municipal comme à Edmonton, ou cantonal, comme en Suisse. La centralisation n’est donc pas le seul schéma institutionnel possible – ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas adapté à la situation française. La diversification des modes d’automatisation du suivi des infractions doit conduire à s’interroger sur le niveau institutionnel de traitement, et donc sur la forme institutionnelle la plus appropriée du dispositif de contrôle sanction automatisé.
M. le président Armand Jung. L’intervention de M. de Caumont éclairera sans doute sous un autre angle le thème qui nous occupe.
M. Éric de Caumont. Sur ce point, je pense pouvoir satisfaire vos désirs, monsieur le président.
En tant que secrétaire général de l’Association des avocats de l’automobile, je serais enclin à ne parler que de droit puisque notre intervention se fait en aval, lors du traitement de l’infraction. Mais cela ne m’empêche pas d’avoir un avis personnel sur le sujet.
En premier lieu, je ne partage pas l’enthousiasme général concernant la mise en place et la persistance d’un système de contrôle sanction automatisé, notamment – et c’est moins l’avocat que le citoyen qui s’exprime – parce que je cherche encore quels en sont les bénéfices. Je ne parle pas de bénéfices en termes budgétaires, car ceux-là ne font pas de doute – même si vous avez eu du mal, monsieur le président, à obtenir des chiffres précis en la matière –, mais en termes de sécurité routière. On ne peut pas aller contre ce qu’affirmait M. le préfet : par définition, les vies sauvées n’ont pas de prix. Mais je m’interroge justement sur l’utilité du CSA dans ce domaine.
En effet, il convient d’analyser les chiffres en élargissant le point de vue, c’est-à-dire en incluant la période précédant la mise en place des radars et en tenant compte de la situation chez nos voisins européens. Certes, on ne peut que se réjouir d’observer, depuis 2003, une diminution sensible du nombre des morts sur nos routes et nos autoroutes. Et si cette diminution est supérieure à celle observée dans les pays où l’on n’a pas adopté le contrôle sanction automatisé ni, a fortiori, donné à un tel système la puissance qu’on lui connaît en France, cela prouve son efficacité. Mais il n’en est pas de même si cette diminution est comparable, voire inférieure à celle qu’ont connue les autres pays. Or, les chiffres de l’INSEE montrent qu’entre 2003 et 2008, le nombre de tués par million d’habitants a baissé de 23 % dans l’Union européenne. Bien sûr, il existe des bons et des mauvais élèves, et nous figurons parmi les premiers, ce qui est une bonne nouvelle. En France, en effet, cette baisse atteint 33 %, contre 4 % dans d’autres pays. Mais d’autres font bien mieux : au Portugal, un État qui ne s’est pourtant pas doté d’une multitude de radars automatiques, la baisse est de 44 %. Par ailleurs, en Allemagne, pays dans lequel on peut rouler, sur une portion majoritaire du réseau autoroutier, à la vitesse de son choix, l’évolution du nombre de décès était la même qu’en France en 2009 et 2010.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Savez-vous quel est le nombre d’accidents constatés sur les portions à vitesse libre des autoroutes allemandes ? Personne n’est en mesure de me l’indiquer.
M. Éric de Caumont. Je ne connais pas ce chiffre, et je le regrette. Mais dès lors que la comparaison entre deux réseaux routiers, l’un entièrement limité et l’autre qui ne l’est que partiellement – avec une majorité de tronçons à vitesse libre –, laisse apparaître des meilleurs résultats dans le second réseau, et sauf à démontrer que les Allemands se tuent beaucoup plus sur les portions à vitesse libre et beaucoup moins que nous sur les portions à vitesse limitée, on peut en déduire que la limitation de vitesse sur autoroute n’est pas vraiment utile. Bien sûr, je ne dirais pas la même chose à propos de la circulation en agglomération.
Tout à l’heure, j’ai entendu parler de vitesse excessive : cette notion nécessite un effort d’explication, de même d’ailleurs que la différence entre radars mobiles et fixes. Tout le monde croit qu’un radar mobile est un dispositif transportable – radar laser, jumelles-radar, etc. –, par opposition aux radars fixes boulonnés sur le bord de la route. Mais c’est faux : ne sont dits « mobiles » – avec les conséquences juridiques que nous connaissons – que les radars embarqués dans des véhicules se déplaçant au moment du contrôle, d’où la déduction plus importante – 10 % contre 5 % dans le cas des radars fixes –, qui est appliquée pour tenir compte de la marge d’erreur.
M. Aurélien Wattez. Les définitions que vous donnez sont fausses.
M. Éric de Caumont. Je persiste, et je signe : ne sont mobiles que les radars utilisés dans des véhicules en déplacement au moment du contrôle.
De même, il ne faut pas perdre de vue la différence juridique entre vitesse excessive et excès de vitesse, deux notions trop souvent confondues alors qu’elles renvoient à deux articles différents du code de la route. L’excès de vitesse est le dépassement d’une limitation fixe appliquée à un endroit donné ; il est quantifié en kilomètres/heure, in concreto, que le dépassement soit dangereux ou non. La vitesse excessive consiste à circuler trop vite eu égard aux conditions de circulation : c’est, selon moi, la vraie cause de l’insécurité routière et celle qu’il faudrait sanctionner en premier. Or, elle ne l’est pratiquement pas, parce qu’il faut pour cela des effectifs suffisants et parce que la notion doit être définie in abstracto.
Il se trouve ainsi qu’aucun point ne sera retiré au permis de conduire de celui qui roule à 49 km/h devant une école au moment de la sortie des classes, mais qu’il en ira tout autrement pour le conducteur qui roule à 132 km/h sur une autoroute déserte. Tel est le choix répressif qui a été fait.
D’autre part, apprécier l’évolution de la situation en prenant comme point de départ l’année 2003 conduit à des conclusions relativement inexactes. Comment tenir compte du déploiement des radars automatiques fixes dans les chiffres de la sécurité routière pour cette année-là, alors que le premier radar a été inauguré en octobre et qu’en décembre on en dénombrait entre 15 et 20 pour la France entière ? Poser que 2003 est la première année de fonctionnement du contrôle sanction automatisé me paraît exagéré. Or, même si depuis 2004, première année pleine pendant laquelle le dispositif a été opérationnel, la courbe de la mortalité routière a affiché un mouvement descendant significatif, la baisse était bien meilleure en 2002 et en 2003, non pas parce que des radars automatiques avaient été installés, mais parce que le Président de la République de l’époque avait su faire adhérer les automobilistes à une nouvelle conception des rapports sur la route.
Dans un premier temps, ces appareils ont été considérés comme aidant la sécurité routière à traquer les chauffards qui ignoraient sciemment la réglementation sur la limitation de vitesse. Mais, il y a un peu plus d’un an, pour la première fois, les sondages ont montré que l’adhésion populaire était perdue, le système étant à présent perçu comme servant à remplir les caisses publiques. Comment s’en étonner, quand des conducteurs se font verbaliser pour avoir roulé à 51ou à 131 km/h ?
M. Aurélien Wattez. C’est faux.
M. le président Armand Jung. Personne, monsieur, n’est verbalisé en ce cas.
M. Éric de Caumont. Je reçois pourtant tous les jours des procès-verbaux qui l’attestent.
M. Aurélien Wattez. Ils font état de la vitesse retenue et non de la vitesse relevée.
M. Éric de Caumont. J’y viens. Si l’on sanctionne la vitesse retenue et non la vitesse relevée, c’est que les pouvoirs publics admettent que les mesures prises par les radars peuvent être affectées d’un coefficient d’erreur – il est de 3 % pour les nouveaux appareils présentés à l’homologation mais il était précédemment de 5 %. Pour ne pas risquer une verbalisation injuste, on déduit la marge d’erreur possible. Il en résulte que le conducteur sanctionné pour avoir roulé à une vitesse relevée de 56 km/h roulait peut-être à 61 km/h, mais peut-être aussi à 51 km/h. À cela s’ajoutent les erreurs d’installation et de fonctionnement des cinémomètres signalées par une étude de la police nationale ; elles sont très choquantes car elles conduisent à verbaliser des automobilistes qui n’ont pas commis d’infraction.
En admettant même que l’on ne tienne pas compte de ces observations parce que l’on considère le contrôle sanction automatisé comme une panacée aux effets largement positifs, je ne puis manquer de vous dire qu’en ma qualité d’avocat, défenseur des libertés individuelles, qui ne méprise pas pour autant l’intérêt collectif…
M. Philippe Houillon, rapporteur. … et qui est aussi auxiliaire de justice…
M. Éric de Caumont. Bien sûr, même si je préfère le terme de « partenaire ». Parce que je suis de ceux pour lesquels « mieux vaut dix coupables en liberté qu’un innocent en prison », je considère qu’une mesure, quelle que soit son utilité, ne doit jamais être appliquée en risquant de faire punir une personne qui n’a pas enfreint la loi. Or, parce que le contrôle sanction automatisé a été mis au point pour traiter un nombre considérable d’infractions le plus facilement possible, il n’est pas prévu que l’on puisse se défendre dans ce cadre aussi facilement qu’on le peut en cas de contrôle non automatique. En matière contraventionnelle, tout procès-verbal rédigé par un agent assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire. Je comprends que cette disposition exorbitante du droit commun soit nécessaire pour traiter un contentieux de masse, mais un problème se pose quand on coupe les ailes de ceux à qui l’on a dit qu’ils n’ont pour se défendre que les écrits ou les témoins – et encore, les témoins à la barre. On a instauré un mécanisme dans lequel les rejets de contestations sont également automatisés, et certaines dispositions de ce système sont scandaleuses.
Ainsi, si l’on conteste une sanction découlant du contrôle sanction automatisé, on doit joindre, selon les cas, 90 ou 135 euros au courrier de contestation puisque, depuis 2003, pour avoir le droit de montrer que l’on est innocent, on est contraint de prêter de l’argent à l’État, qui le rendra à condition que l’on n’oublie pas de le demander. Et c’est ainsi que la malheureuse dont le cas a été évoqué précédemment, non sans une certaine condescendance, s’est retrouvée sans permis parce qu’elle avait omis de consigner une somme dans ses courriers de contestation successifs.
M. Jean-Jacques Debacq. C’est faux. Dans le cas cité, la consignation n’est pas requise.
M. Éric de Caumont. Ce que chacun a pu entendre aujourd’hui au sujet de cette dame dans une émission de télévision était pourtant clair…
M. le président Armand Jung. Pourriez-vous aller à l’essentiel sans vous attarder sur un cas particulier ?
M. Éric de Caumont. J’ajouterai simplement que quiconque aura procédé à la consignation requise, mais contesté l’infraction par courrier simple, recevra une réponse automatique l’avisant que, faute d’avoir été faite par courrier recommandé, la contestation n’est pas recevable et que la somme est donc conservée par l’État en reconnaissance de l’infraction et en paiement de l’amende. Étant donné cette manière de faire, je m’étonne que les réactions ne soient pas plus virulentes et je me demande ce que l’on gagne en sécurité routière à ne pas prendre une contestation en considération pour ce seul motif.
La deuxième dérive de ce système, c’est que, les photos étant désormais prises de dos dans un très grand nombre de cas, y compris aux feux tricolores, on a délibérément renoncé à identifier la personne à punir – dont vous m’accorderez que ce doit être l’auteur de l’infraction et non le propriétaire du véhicule. On a retourné les cinémomètres parce qu’il fallait pouvoir enregistrer aussi les infractions commises par les conducteurs de motos, lesquelles n’ont de plaques d’immatriculation qu’à l’arrière. Il en résulte qu’en l’état de notre droit, toute personne verbalisée, après avoir été photographiée de dos au volant, n’a plus qu’à nier qu’il se soit agi d’elle pour échapper au retrait de point ; la seule conséquence sera l’amende fiscale imposée au propriétaire du véhicule, et cela ne me paraît pas avoir une grande incidence en matière de sécurité routière.
On peut taxer de populisme ceux qui constatent que le contrôle sanction automatisé rapporte chaque année 500 millions aux collectivités territoriales et à l’État, mais l’on ne peut nier qu’étant donné les procédures et la manière dont sont maintenant utilisés les radars, ce n’est plus l’objectif initial – identifier et réprimer les conducteurs auteurs d’infractions, et de préférence d’infractions graves – qui est visé. Le système, tel qu’il a évolué, privilégie désormais la répression financière des propriétaires de véhicules, tout en permettant de manière scandaleuse à tous ceux qui veulent se libérer du respect des lois de le faire.
Les automobilistes ont compris que 80 % des sanctions entraînées par le système dans sa version actuelle concernent les petits excès de vitesse, mais pas les auteurs de graves infractions, ce qui explique la perte de l’adhésion populaire au dispositif. Plus grave encore est le dévoiement politique du système, désormais ainsi organisé que, les clichés étant pour l’essentiel pris de l’arrière, toute personne qui s’affranchit des règles de limitation de vitesse, mais qui entend ne pas se dénoncer, demeure impunie.
M. Philippe Zamora, chercheur au Centre de recherches en économie et statistiques (CREST). Pour dire quelle réduction du nombre d’accidents on peut attendre de l’installation de mille radars fixes en un an, je soulignerai en premier lieu que ces appareils ont trois effets : un effet direct, un effet dit « de halo » et un effet politique. L’effet direct, c’est un impact immédiat dans la zone couverte par le radar, qui se traduit par la réduction de la vitesse et une conduite plus vigilante entre le panneau d’annonce de l’appareil et l’appareil lui-même ; c’est pourquoi les radars ont été installés dans les zones qui présentent le plus de risques. Cet impact est reflété dans les statistiques.
L’effet de halo, c’est qu’après avoir croisé un radar, l’automobiliste garde un comportement respectueux des règles de vitesse, et que, quand il connaît la présence d’un radar en un certain lieu, il anticipe ce comportement vertueux. Il en résulte une réduction des accidents sur quelques kilomètres autour des radars.
L’effet politique, enfin, est celui qu’évoquait M. Lassarre et qui a été observé dès 2002 : la diffusion de l’observation que la politique de sécurité routière allait être très sévère a fait que l’on est passé de quelque 105 000 accidents de la route par an jusqu’en 2002 à 85 000 en 2004. Cette baisse très brutale a eu lieu alors même que très peu de radars avaient été installés.
Selon l’étude que nous avons menée, le nombre d’accidents de la route chute de 50 % pendant les six mois qui suivent l’installation d’un radar dans une commune donnée, comparée à une commune où aucun radar n’a été installé ; c’est une diminution remarquable du taux d’accidentalité. Toutefois, au-delà de six mois, la différence entre les communes considérées n’est plus que de 15 à 20 % : l’accoutumance fait que la vigilance des conducteurs ne s’exerce plus que là où se trouve le radar : l’effet direct persiste mais non l’effet de halo.
On conclura de cette étude que l’installation de mille radars fixes entraînera la diminution de moitié du nombre d’accidents dans les zones couvertes et que l’efficacité du dispositif, tout en demeurant, s’amoindrira avec le temps. L’installation de 1 000 nouveaux radars ne suffira donc pas à répéter le très fort impact constaté entre 2002 et 2004, sauf changement radical de technologie ou de politique. On peut penser, par exemple, que, si l’on cesse de signaler la présence des radars, les conducteurs exerceront une vigilance accrue, et que le taux d’accidentalité en sera fortement diminué sur l’ensemble du territoire.
M. le président Armand Jung. Monsieur Wattez, pourriez-vous nous donner des informations complémentaires sur les radars de nouvelle génération ?
M. Aurélien Wattez. Certainement, mais je souhaite auparavant rectifier plusieurs erreurs. Contrairement à ce qui a été dit, les radars dits « mobiles » sont, certes, embarqués dans les véhicules des forces de l’ordre, mais les contrôles sont faits ces véhicules étant arrêtés ; seules quatre expérimentations de contrôles en circulation ont lieu actuellement. Pour ce qui est de la précision de la mesure de la vitesse, les taux d’erreur maximale tolérés lors de l’homologation sont de 5 % pour les radars en service et de 3 % pour les cinémomètres neufs, mais elle est en général limitée à 1 ou 2 %. Ce qui a été affirmé à ce propos est donc faux.
Par ailleurs, il est indéniable que la vitesse moyenne de déplacement sur les routes de France a diminué depuis 2003, dans la proportion considérable de 10 %, pour s’établir à quelque 80 km/h – mais elle serait à 76 km/h si chacun respectait les limitations de vitesse. Des progrès sont encore nécessaires, ce à quoi de nouveaux équipements devraient contribuer. On est ainsi fondé à penser que l’implantation de radars vitesse moyenne, dits aussi « radars tronçons », dont la zone d’influence est de 10 à 20 kilomètres - celle des radars fixes est d’environ 2 kilomètres - et qui permettent des contrôles sur une distance plus longue, devrait inciter les conducteurs à changer de comportement sur tout leur trajet. Nous savons aussi que l’efficacité des radars mobiles est de quelque 45 minutes ; au-delà, les automobilistes se sont alertés par appels de phare. C’est pourquoi, je vous l’ai dit, nous expérimentons des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement ou « radars mobiles mobiles » ; c’est pour ceux-là, et non pour les radars « mobiles », que l’erreur de mesure maximale tolérée sera de 10 %. Avec ces dispositifs, on ne peut savoir où se fera le contrôle ; cela devrait inciter les conducteurs au respect permanent des règles de limitation de vitesse.
Avec ces deux nouvelles techniques de contrôle automatisé, nous voulons que les conducteurs sachent qu’à terme ils peuvent être contrôlés en tous temps et en tous lieux et qu’il est de leur intérêt de respecter les règles s’ils veulent conserver leur permis et ne pas être sanctionné par des amendes. Nous adaptons nos méthodes pour que l’effet dissuasif demeure.
M. Jean-Jacques Debacq. Même si nous reconnaissons tous que le contrôle sanction automatisé n’est pas une panacée, il faut être aveugle pour ne pas voir le bénéfice qu’il a apporté à la sécurité routière. En cette matière, trois facteurs se conjuguent : la route, le véhicule et le comportement des conducteurs. Pour ce qui est de la route, tous les points noirs ont été traités et les points gris sont en passe de l’être ; demeurent les risques associés aux passages à niveaux. Les véhicules sont de plus en plus « intelligents » et l’ABS, comme la généralisation du port de la ceinture, ont eu de grands effets.
M. Philippe Houillon, rapporteur. On pourrait aussi les brider, au lieu de continuer de fabriquer des véhicules pouvant rouler à 250 km/h, alors que l’on cherche par ailleurs à contrecarrer par tous les moyens les effets de la vitesse excessive de déplacement…
M. Jean-Jacques Debacq. Enfin, l’histoire de la sécurité routière montre qu’au début des années 2000 on s’est focalisé sur le comportement des conducteurs et que l’installation des radars a eu un impact considérable.
Je rappelle ensuite que c’est le législateur qui nous a permis de poursuivre d’abord le titulaire de la carte grise, le conducteur venant en second rang. Il est exact que des clichés sont pris de dos pour éviter que les motards ne défient les contrôles. J’ai été l’artisan de cette mesure : quand les deux-roues motorisés représentent 1 % du trafic et les motards 16 % des morts sur la route, faut-il ne rien faire ? Pour autant, dire que tous les radars prennent les photos de dos est faux. Les 933 radars mobiles prennent les photos de face, et ils enregistrent plus de messages d’infraction que les radars fixes, dont un tiers prend aussi les photos de face. Il me revenait de rétablir les faits, qui sont que la majorité des clichés, dans la somme totale des photos, est prise de face.
Nous tenons pour essentiels l’accès au droit et la possibilité de contester et de se défendre. Sans cela, toute la chaîne pénale s’écroule ! Je ne puis donc laisser dire que nous considérerions quelque contestation que ce soit « avec condescendance » – c’est entièrement faux. Certes, tout dispositif est perfectible et nous pouvons toujours améliorer la qualité de nos réponses aux contestations, mais permettez-moi de souligner que nous recevons vingt mille courriers par jour.
La centralisation de notre système reflète le fonctionnement des institutions publiques d’un État unitaire. Il se trouve que ce dispositif est le plus performant du monde, parce que nos radars fonctionnent 92 % du temps, parce que le mécanisme est bien accepté et qu’il améliore en permanence la sécurité routière.
Nul ne peut dire que la France, qui était la lanterne rouge de l’Europe il y a une dizaine d’années en matière de sécurité routière et qui est maintenant au 5ème ou au 6ème rang de l’ensemble européen, n’a pas fait des progrès considérables en ce domaine.
Je rappelle enfin que chaque kilomètre-heure supplémentaire de vitesse moyenne en France se traduit par 4 % de morts en plus sur nos routes.
M. Philippe Houillon, rapporteur. A-t-on constaté l’augmentation des infractions là où les panneaux annonçant la proximité d’un radar ont été enlevés ?
M. Jean-Jacques Debacq. Oui. Elle a été de 50 % pendant les deux mois qui ont suivi l’enlèvement des panneaux puis elle a fortement chuté pour se stabiliser entre 5 et 10 %.
À ce jour, environ 3 500 appareils sont installés. Nous prévoyons d’en installer mille autres : 500 radars « vitesse » supplémentaires, de 350 à 400 dispositifs aux feux tricolores et une centaine de dispositifs de contrôle aux passages à niveaux. Nous avons pour objectif un parc de 4 500 appareils d’ici fin 2012 ou début 2013.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Retirer quatre points du permis pour un franchissement de feux au rouge ne vous paraît-il pas beaucoup ?
M. Jean-Jacques Debacq. Il s’agit d’éviter des morts, mais il s’agit aussi de civilité. Franchir un feu tricolore lorsqu’il est au rouge devrait être tabou, comme devraient l’être le non-respect d’un panneau « Stop » et la circulation dans un couloir réservé aux autobus. Veuillez considérer qu’installer mille de ces dispositifs en France signifie qu’il y en aura dix par départements. Il le faut, pour obtenir un effet dissuasif général.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Qui décide de l’implantation des radars et des dispositifs de contrôle des franchissements de feux tricolores ?
M. Jean-Jacques Debacq. Les préfets, après concertation et consultation locales.
M. le président Armand Jung. Si je vous ai bien entendu, il n’aurait pas fallu enlever les panneaux annonçant la présence d’un radar, car cela a été contre-productif.
M. Jean-Jacques Debacq. Je rappelle qu’aux débuts du contrôle sanction automatisé, un panneau signalait même les radars mobiles. Cette pratique, qui n’a jamais eu de base juridique, a été abandonnée car l’installation des panneaux mettait en danger la vie des agents affectés à cette tâche et aussi parce qu’il fallait ménager un effet de surprise. Il y a un an environ, il a été décidé d’adapter le dispositif en installant un panneau de signalisation de radar avant une zone de contrôle automatisé et non plus avant chaque radar fixe. Nous sommes maintenant dans une période où la recrudescence du nombre de morts sur les routes suscite l’inquiétude générale – c’est ce qui a motivé la constitution de votre mission d’information. L’État doit fixer des orientations, et la suppression des panneaux de signalisation des radars est un acte de gouvernement. L’implantation de radars pédagogiques est une mesure positive.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Avez-vous constaté la diminution du nombre des infractions là où des radars pédagogiques ont été installés ?
M. Jean-Jacques Debacq. Oui, et elle est notable.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Pourquoi la moitié des infractions signalées restent-elles sans suite ? Est-ce parce que les photos sont prises de dos ? Il est difficilement admissible que 50 % des auteurs d’infractions soient sanctionnés et que les autres ne le soient pas.
M. Jean-Jacques Debacq. Cinquante pour cent des messages d’infraction ne peuvent être traités dont, pour moitié, les infractions commises par des conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger. Toutefois, depuis quelque mois, nous pouvons interroger directement le fichier helvétique des immatriculations, ce qui nous permet de poursuivre les automobilistes suisses. D’autre part, un accord a été passé avec le Luxembourg et, depuis le 1er septembre, avec la Belgique, si bien que nous pourrons utiliser les renseignements relatifs aux contrevenants belges en France, de même que seront utilisées les indications concernant les contrevenants français en Belgique. De plus, le Parlement européen ayant adopté la directive relative à l’échange d’informations sur les infractions routières transfrontalières, des progrès substantiels auront lieu et nous devrions pouvoir poursuivre, à terme, tous les véhicules immatriculés à l’étranger.
Soustraction faite des signalements d’infractions commises par les titulaires de plaques étrangères, 67 % des messages donnent lieu à des avis de contravention. Les motos, parce qu’elles sont dépourvues de plaques d’immatriculation à l’avant, comptent pour beaucoup dans cette déperdition. Leurs conducteurs, qui commettent de sept à huit fois plus d’infractions que les conducteurs de voitures, savent parfaitement où sont installés les radars et s’arrangent souvent pour dissimuler leur immatriculation. Aussi avons-nous engagé une réflexion sur la manière d’améliorer la lisibilité des plaques.
Les autres facteurs de déperdition tiennent à des choix de politique pénale - ainsi, une photo sur laquelle apparaissent deux véhicules est presque systématiquement écartée, ce qui explique l’intérêt des nouveaux radars discriminants, qui permettent d’identifier la voie sur laquelle l’infraction a été commise -, mais aussi à la médiocre visibilité des plaques d’immatriculation, la nuit en particulier, ou à l’insuffisante définition des photos. Nous nous efforçons de manière permanente d’améliorer la qualité des radars.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Des arguments juridiques couramment employés permettent-ils de faire annuler l’invalidation d’un permis de conduire ?
M. Thierry Pocquet du Haut-Jussé. Il me paraît devoir être mis au crédit de ce système automatisé tant critiqué que le choix a été fait de maintenir une chaîne pénale, avec toutes les garanties que cela apporte. Cela n’est pas si fréquent, et beaucoup d’autres pays ont opté pour un traitement administratif. Même si le contrôle est pour partie automatique, chaque identification, en France, est réalisée par un officier du CACIR. De plus, la sanction appliquée aux infractions relatives aux limitations de vitesse, comparée à ce qu’elle est ailleurs, est relativement modérée.
M. de Caumont a estimé insuffisantes les possibilités de recours. Je tiens à préciser que, dans le cas cité, la consignation n’était pas requise ; la dame n’a consigné aucune somme mais cela ne lui a pas été reproché et n’a pas entraîné de conséquences.
Il est exact que la contestation doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception - et cela montre que contester est possible. Pour autant, avoir droit à recours ne signifie pas que l’on puisse exercer ce droit n’importe comment ; il est normal que la loi fixe des règles. Je puis ainsi citer le cas d’une dame qui nous pose de grands problèmes car elle ne cesse de contester des infractions tout en refusant de saisir le juge de proximité comme nous l’y invitons par des courriers individualisés répétés ; elle nous demande d’annuler les contraventions dont elle a fait l’objet, ce que nous ne pouvons évidemment pas faire.
Nous avons bien pour objectif de sanctionner les conducteurs qui échappent aujourd’hui à la verbalisation. Il s’agit en premier lieu des conducteurs de voitures immatriculées à l’étranger, auteurs de 25 % des infractions signalées, une proportion largement supérieure à leur participation au trafic routier français. Des progrès ont lieu mais ils sont lents et l’on pourrait espérer une coopération accrue de la part de certains pays, dits vertueux en d’autres domaines, mais assez peu actifs en celui-ci.
Je ne peux, par ailleurs, passer sous silence l’attitude de certaines entreprises qui, en refusant de désigner les conducteurs fautifs, leur permettent de se soustraire à leurs responsabilités. Reste la sanction pécuniaire, dont l’assez modeste montant est peu dissuasif. Il y a là une défaillance choquante. Pourquoi ne pas imposer, comme une circulaire impérative y contraint les services judiciaires, que, dans chaque véhicule appartenant à une société ou à un organisme, soit affiché un tableau indiquant quel en est le conducteur à tout moment, de manière à pouvoir désigner l’auteur d’une infraction, lorsqu’on le recherche pour le sanctionner ?
Pour ce qui est, enfin, des 25 % de conducteurs photographiés qui restent non identifiés, il ne faut pas se voiler la face : les progrès dépendront des moyens donnés au CACIR pour enquêter et rectifier les erreurs de saisie. En l’état, ses agents n’ont pas le temps de se livrer à des recherches individualisées. C’est choquant car des contrevenants échappent ainsi à toute sanction, mais la solution se trouvera dans les moyens donnés au service, pas dans les textes.
M. Éric de Caumont. Le manque de coopération de certaines entreprises déploré par M. le procureur de la République s’explique par leur souci de sauvegarder leurs forces vives et notamment de protéger leurs commerciaux. Une fois encore, que ne prend-on les photos de face ! L’identification du conducteur fautif prendrait alors très peu de temps aux enquêteurs. Par ailleurs, je suis incapable de vous dire qui conduisait ma voiture le 27 juin à 12 heures 53 : ce peut aussi bien être ma femme que l’un de mes fils, et même si, pétri de bonne volonté, je souhaitais donner le nom de celui ou de celle qui a commis une infraction à ce moment précis, j’en serais empêché, faute de pouvoir l’identifier. Même ceux qui souhaiteraient collaborer à l’établissement de la vérité ne le peuvent si le cliché a été pris de dos.
Oui, il existe des moyens efficaces de faire échec à l’annulation d’un permis, essentiellement en s’appuyant sur le défaut d’information préalable, prévue dans la loi de 1989, sur les conséquences du retrait de points. Il est choquant que les membres des forces de l’ordre, en proposant aux contrevenants, comme c’est leur rôle, de payer l’amende forfaitaire minorée, oublient parfois de leur dire qu’ils disposent de trois jours pour la régler. De ce fait, certains automobilistes payent immédiatement, en oubliant que ce paiement aura pour conséquence de leur faire perdre des points. Il se produit même qu’on leur dise - sans doute de bonne foi - que s’ils règlent immédiatement, aucun point ne leur sera retiré. Et c’est ainsi que des conducteurs se retrouvent sans permis de conduire, et par là sans emploi, alors qu’ils étaient convaincus de ne pas s’être mis dans cette situation. D’une manière générale, l’information sur le permis à points est très insuffisante. C’est un des principaux éléments qui permettent de faire aboutir les recours.
M. Jean-Jacques Debacq. Je ne contredis pas M. de Caumont sur cette faiblesse particulière, mais je précise que nous produisons beaucoup plus vite qu’auparavant les éléments relatifs aux retraits de points successifs. Nous avons aussi amélioré l’information des contrevenants, notamment sur le fait qu’accepter de régler l’amende vaut acceptation du retrait de points. D’ailleurs, depuis un an environ, en cas de recours devant le juge administratif, les avocats perdent plus souvent que l’État.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Chaque année, dix millions de points sont retirés, autant sont restitués, et soixante-dix pour cent des infractions concernent de petits excès de vitesse, ce qui fait débat. Ne pourrait-on trouver un moyen de rationaliser le dispositif ?
M. Jean-Jacques Debacq. Si votre question porte sur l’aspect mécanique du dispositif, je peux vous dire que le nombre de points retirés commence à diminuer. Si vous me demandez s’il faut retirer un point pour les petits excès de vitesse, ma réponse est un « oui » ferme, car c’est là la vraie sanction, qui vaut pour tous. S’en tenir à l’amende, ce serait pratiquer une forme de ségrégation financière puisque, pour certains conducteurs, 135 euros ne sont rien.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Le système actuel prévoyant et le retrait de points et la sanction pécuniaire, l’inégalité existe déjà : un bénéficiaire du RSA est sans conteste plus pénalisé par l’amende que ne l’est le patron d’un grand groupe.
M. Jean-Jacques Debacq. Aussi bien, si l’on supprimait le retrait de point pour les petits excès de vitesse, ne subsisterait qu’une amende identique pour tous les contrevenants, et l’inégalité serait plus criante encore.
M. Emmanuel Grandsire. Et si l’on s’en tenait au retrait de points, les conducteurs de voitures immatriculées à l’étranger ne pourraient plus être sanctionnés.
M. Éric de Caumont. Comme M. Debacq l’a souligné, l’effet du retrait de points est le même pour tous mais le paiement d’une amende d’un montant fixe n’emporte pas les mêmes conséquences pour tous les contrevenants. C’est une autre tare du système de contrôle sanction automatisé ; le juge, lui, a le devoir d’adapter l’amende aux revenus du justiciable.
M. Gérard Voisin. J’ai moi-même reçu la notification m’informant qu’il me reste trois points, et j’en ai récupéré un ; cela montre que les députés sont soumis à la règle commune, ce qui n’était pas le cas précédemment.
En février 2009, j’ai fait rapport, au nom de la commission chargée des affaires européennes, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière. Je sais qu’un quart environ des 17 millions d’infractions enregistrées par les radars fixes est commis par des véhicules immatriculés à l’étranger - la proportion de conducteurs allemands dans l’effectif des auteurs d’excès de vitesse graves étant particulièrement élevée. Or, cette anomalie, qui traduit l’impunité condamnable dont bénéficient les non-résidents et qui prive de quelque 180 millions d’euros les caisses de l’État, perdure car les progrès de la coopération transnationale sont lents. Si les échanges d’informations sont désormais lancés avec la Belgique, une modification de la Constitution allemande serait nécessaire pour que l’accord bilatéral d’échange de renseignements sur les contrevenants signé avec l’Allemagne aboutisse ; pour l’instant, dans ce pays, ne peut en effet être sanctionné que le contrevenant, et non le propriétaire du véhicule. Un long délai sera donc nécessaire avant que la coopération transfrontalière progresse significativement en matière de sécurité routière.
M’étant rendu à Berlin lors de l’élaboration du rapport, j’ai pu y voir les clichés réalisés lors des relevés d’infraction. Il s’agit de photos frontales de qualité parfaite, et les passagers sont dissimulés. En France, outre que les photos prises sont de bien moindre qualité, elles sont, pour les deux tiers, prises de dos, pour que les motards n’échappent pas à la sanction, mais aussi, ai-je cru comprendre, par souci de protection de la vie privée. L’identification des fautifs en est singulièrement compliquée. Pourquoi ne pas en revenir à l’apposition d’une plaque d’immatriculation aussi à l’avant des motos, comme c’était la règle il y a quelques décennies ?
Enfin, je ne suis pas certain que le système français de contrôle sanction automatisé soit le meilleur ; il me semble que le dispositif néerlandais pourrait prétendre à cette qualification.
M. Jacques Myard. La difficulté que pose la sanction des petits dépassements de vitesse sans dommages et sans état d’ébriété, c’est que les contrevenants ont le sentiment d’être victimes d’une injustice ; de ce fait, le dispositif dans son entier provoque des réactions de rejet. D’ailleurs, le principe constitutionnel de la proportionnalité de la peine est-il bien respecté ? Enfin, la fréquente incohérence de la signalisation routière rend plus difficile le respect des limitations de vitesse.
M. Jean-Jacques Debacq. Je maintiens que notre système de contrôle sanction automatisé est de tous le plus performant en terme de disponibilité – elle est supérieure à 90 % en France et n’est que de 40 % en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Suisse. On vient nous visiter pour voir comment faire aussi bien. S’agissant de la proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel est saisi, mais je signale que le nombre de conducteurs à qui ont été retirés 12 points d’un coup ne représente que 0,74 % de tous les conducteurs.
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous remercie pour vos contributions à nos travaux.
*
* *
Table ronde sur le risque routier professionnel : M. Thierry Fassenot, ingénieur conseil du CNAMTS et Mme Aude Genot, chargée d’études en prévention ; M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilités de la FFSA, M. Jean-Claude Robert, président de l’association Prévention et suivi de la sécurité routière en entreprise, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires de la FFSA ; M. Francis Davoust, vice-président du CNPA, et Mme Pauline Johanet, coordinatrice média et lobbying ; M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, et Mme Patricia Maladry, médecin-chef de l’inspection du travail ; M. Robert Piccoli, conseiller technique travail auprès du délégué interministériel (DSCR) ; M. Jacques Deletang, président national de la Fédération nationale des agents commerciaux, et M. Luc-Alain Leplat, président de la délégation Alsace ; M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’IFSTTAR, et M. Reinhard Gressel, chargé de recherche
Mercredi 7 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus
Je vous remercie par avance de bien vouloir nous remettre des fiches techniques précises de manière que nous puissions les utiliser de la manière la plus opportune.
M. Reinhard Gressel, chargé de recherche à l’Institut des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Stricto sensu, il n’y a quasiment pas de « conducteurs professionnels » sur la route au sens que prennent ces mots dans l’aviation civile ou les chemins de fer. En effet, les conducteurs routiers ne se limitent pas à la conduite : les conducteurs de poids lourds, par exemple, doivent tenir compte des problèmes liés aux chargements et aux déchargements, à l’attente devant les quais ou les entrepôts, toutes opérations qui prennent beaucoup de temps sans être réellement encadrées par la réglementation, laquelle concerne donc principalement la durée de conduite et non la durée de travail. Or, c’est cette dernière, considérable pour cette catégorie de professionnels, qui explique principalement les accidents. Plus précisément si, sur le plan européen, la durée de conduite est limitée à 45 heures – ce qui est déjà beaucoup –, toutes les enquêtes montrent qu’il faut y ajouter 30 % d’heures de travail effectives. C’est pourquoi le sociologue Patrick Hamelin, hélas récemment décédé, a proposé de réglementer la conduite de manière à éviter les durées de travail excessives qui, au-delà de onze heures cumulées, multiplient considérablement les risques, surtout lorsque les variations horaires ont été importantes dans la semaine ou les jours précédents.
M. Bernard Laumon, directeur de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). Le rapport qui a été demandé à l’IFSTTAR et que vous ne tarderez pas à recevoir, monsieur le président, comportera précisément un certain nombre de considérations techniques.
Le risque routier se situe à l’intersection de deux mondes qui ne se parlent pas toujours beaucoup – ceux de la route et du travail – alors même que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité au travail. À cela s’ajoute que ce risque est extrêmement divers et ne concerne pas les seuls routiers conducteurs de poids lourds : les types de véhicules concernés sont nombreux, de même que leurs usages. Il convient donc de considérer à la fois le risque routier professionnel et celui qui est lié au travail, le monde du travail et celui de la sécurité routière ayant intérêt à échanger davantage – par exemple dans le cadre du groupe d’échanges et de recherches Patrick-Hamelin créé par l’IFSTTAR.
M. Robert Piccoli, conseiller technique travail auprès du délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). Il convient en effet de tenir compte des statistiques concernant le monde du travail en la matière : 10 % de l’accidentalité routière, 5 millions de journées de travail perdues, 398 décès. Il s’agit donc d’une priorité comme l’atteste le « plan santé au travail 2010-2014 », qui sera décliné dans des plans régionaux.
De plus, les questions liées au risque routier sont transversales, qu’il s’agisse par exemple de l’aptitude à la conduite ou des addictions, et chacun ici peut sans doute apporter des réponses sous l’angle spécifique du monde du travail, celles relevant de la réglementation du travail et, en particulier, des horaires concernant la direction générale des transports dont vous avez d’ailleurs entendu des représentants.
Nous nous efforçons quant à nous de tenir compte de deux sujets différents : l’évaluation du risque professionnel par les entreprises ; la responsabilité du conducteur au titre du code de la route. Nous avons également créé en 2001 un comité de pilotage sur les risques routiers professionnels, lequel a pris un certain nombre d’initiatives importantes en matière de recherche ou de véhicules. Enfin, nous veillons à rendre visibles ces actions en signant avec les professionnels des grandes entreprises et les fédérations patronales un certain nombre de chartes déclinant des points concrets pour démystifier un peu le problème de l’évaluation des risques.
M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail (DGT). Le risque routier constitue en effet l’un des principaux risques professionnels comme en témoignent le nombre de décès et celui des journées de travail perdues. Ainsi que l’atteste notamment le plan « santé au travail » auquel il vient d’être fait allusion, il s’agit là d’une préoccupation prioritaire pour le ministère du travail et la direction générale du travail.
Le principal enjeu consiste à ce que les entreprises considèrent le risque routier à l’instar des risques cancérigènes ou des troubles musculo-squelettiques de manière à ce qu’il soit intégré dans le document unique d’évaluation des risques pesant sur les salariés qu’elles sont obligées de produire, lequel comprend un diagnostic et des actions de prévention. Avec les partenaires sociaux, l’entreprise doit donc évaluer la nécessité et l’organisation des déplacements, veiller au contrôle technique et à l’entretien des véhicules, mais également se soucier de l’utilisation du téléphone pendant les déplacements.
Enfin, le ministère du travail a réalisé des études sur l’utilisation des véhicules utilitaires légers, qui soulèvent un certain nombre de problèmes pour la sécurité des salariés ainsi que pour l’ensemble des usagers de la route, tandis que, du 1er avril au 30 juin 2011, l’inspection du travail a, quant à elle, mené 2 700 contrôles témoignant de ce que le chemin à parcourir est encore long, puisque seule une entreprise sur deux a intégré le risque routier au sein du document unique d’évaluation, et qu’une minorité d’entreprises seulement a engagé des démarches de prévention. Il importe donc de renouveler une telle opération, tant pour les entreprises que pour les partenaires sociaux.
M. Thierry Fassenot, ingénieur conseil du CNAMTS. Le législateur nous a confié la mission de réduire la sinistralité selon les principes d’une responsabilité sans faute et d’une réparation forfaitaire.
Comme cela a été dit, le risque routier constitue la première cause de mortalité parmi les cotisants au régime général de la sécurité sociale. Celui-ci comprend les déplacements en mission, qui sont définis par le chef d’entreprise dans le cadre du travail– 25 % du taux de mortalité – et les trajets domicile-travail effectués par les salariés – 75 % de ce même taux.
Cela fait environ une dizaine d’années que les partenaires sociaux s’impliquent dans le domaine de la prévention, dans le cadre de la politique générale de prévention définie par le Gouvernement. À ce propos, il importe de faire comprendre combien le déplacement constitue un acte de travail dont l’entreprise détermine les conditions– certes, de façon explicite lorsqu’il s’agit d’un déplacement en mission, mais également lors des trajets entre le domicile et le travail puisque c’est d’elle que dépendent les horaires d’activité, de même que les services proposés ou non pour le déjeuner. Cela est, de surcroît, d’autant plus délicat à intégrer que le risque routier se situe dans le domaine public.
Il convient aussi de prendre en considération que, outre les professionnels de la route décrits par M. Gressel, nombre de salariés se déplacent quotidiennement pour procéder à des dépannages ou commercer. Ils sont alors confrontés à une double injonction puisqu’ils doivent obtenir des résultats liés à leurs activités tout en tenant compte des paramètres routiers. Or, ils sont contraints, à un moment ou à un autre, d’opérer un choix entre les règles de l’entreprise et le code de la route, le déplacement professionnel étant en l’occurrence le plus souvent considéré comme une variable d’ajustement. Le professionnel devra au surplus téléphoner à son client, son fournisseur ou son entreprise, ce qui ne manquera pas d’influer sur les risques.
En 2003 et 2004, les partenaires sociaux ont conclu deux accords sur la définition de bonnes pratiques, qui ont été adoptés à l’unanimité par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAM. Les deux textes se réfèrent à la logique du principe de prévention, défini dans le code du travail, tout en engageant l’entreprise à prévenir les risques routiers à travers quatre axes : meilleure définition du déplacement en mission, choix du véhicule, maîtrise de la gestion des communications pendant le déplacement et, enfin, présence au sein de l’entreprise de toutes les compétences, depuis le conducteur et le chef de parc jusqu’au manager définissant la mission. Nous veillons, avec l’ensemble des caisses régionales, à ce que de telles actions soient engagées afin que la prévention du risque routier soit efficace.
Depuis 2002, outre que nous avons bénéficié d’une décision présidentielle concernant la sécurité routière qui a beaucoup impliqué les services de l’État et l’ensemble du monde social, les entreprises ont intégré de nombreux aspects du problème au point que la sinistralité, dans le domaine qui vous préoccupe, évolue d’une façon plus favorable que la sécurité routière dans son ensemble. S’il reste encore beaucoup de travail à accomplir, les entreprises qui ont fait des efforts s’y retrouvent et comprennent que ces enjeux humains, sociaux et juridiques sont aussi économiques.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Connaît-on le nombre de personnes qui se déplacent quotidiennement pour des raisons professionnelles en incluant, ou non, les trajets domicile-travail ?
M. Thierry Fassenot. Nous ne disposons pas de chiffre global mais, dans le cadre de la préparation du document général d’orientation, la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle avait naguère analysé l’ensemble des accidents corporels sur plusieurs années et avait mis en évidence qu’entre 40 % et 44 % d’entre eux impliquaient une personne en déplacement pour une mission ou en trajet domicile-travail. L’enjeu est donc d’importance, tant pour les entreprises que pour l’ensemble de la société.
M. Reinhard Gressel. Selon l’enquête transports, un quart de la population active est amené à se déplacer hebdomadairement pour des raisons professionnelles.
M. Francis Davoust, vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Pendant plus de huit ans, le CNPA a contrôlé gratuitement un million de véhicules et, pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées, il vient de mettre en place une opération spécifique de sensibilisation des chefs d’entreprise à la mise à disposition et à l’utilisation de véhicules en bon état de fonctionnement. Celle-ci permet de les responsabiliser et de les inciter à incorporer le risque routier dans le document unique. Nous avons ainsi mis à leur disposition plus de 5 000 professionnels de l’automobile sur l’ensemble du territoire, lesquels peuvent accueillir les véhicules des entreprises, mais aussi ceux des salariés afin de procéder à un contrôle gratuit des éléments qui nous semblent les plus importants : les pneumatiques – dont 70 % sont mal gonflés et 30 % en mauvais état –, l’éclairage – défaillants sur 30 % des véhicules –, sans parler des nombreux défauts présents en particulier sur les véhicules utilitaires légers. À ce jour, plus de 750 entreprises se sont inscrites afin de bénéficier de ces conseils, depuis la TPE artisanale jusqu’à la SNCF, dont le parc est constitué de 20 000 véhicules. De plus, nous avons créé un site internet spécifique afin que les professionnels de l’automobile, désireux de participer à cette opération, puissent s’y inscrire, les entreprises les trouvant, par ce biais, au plus près de chez elles.
Nous avons également une obligation de résultats et de conseils. Lors du contrôle, nous demandons au conducteur quels sont les usages de son véhicule, s’il effectue de nombreuses manœuvres ou s’il transporte des charges, de façon à proposer une modernisation des équipements améliorant la sécurité : limiteur ou régulateur de vitesse, caméra de recul, kit mains libres, aménagements intérieurs, éthylotest antidémarrage… L’ensemble des contrôles est consigné sur une fiche et nous remettons au conducteur un carnet de suivi du véhicule.
Qui mieux que les professionnels de l’automobile peuvent apporter leur concours à la détermination des causes et à la prévention des risques routiers ?
M. le président Armand Jung. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir m’excuser mais, requis par d’autres obligations, je suis contraint de vous quitter. Je cède la présidence de la table ronde à M. le rapporteur, non sans vous avoir remerciés de votre présence.
(M. Philippe Houillon, rapporteur, remplace M. Armand Jung à la présidence de la table ronde.)
Mme Pauline Johanet coordinatrice média et lobbying au Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). J’ajoute que l’opération dont vient de parler M. Davoust a été développée à partir d’une charte que nous avons signée avec l’Association pour le développement de la sécurité routière (ADSR) et la CNAM.
M. le rapporteur, président. Tel est l’objet du dossier que vous m’avez remis.
Mme Pauline Johanet. En effet. Celui-ci concerne précisément l’opération « Prévenir le risque routier en entreprise » lancée voilà un an.
M. le rapporteur, président. Les contrôles sont-ils gratuits ?
Mme Pauline Johanet. Oui, pour l’ensemble des entreprises françaises, quel que soit leur secteur.
M. le rapporteur, président. Le succès est-il au rendez-vous ?
Mme Pauline Johanet. Ce sont 5 000 professionnels de l’automobile qui se sont investis…
M. Francis Davoust. …750 entreprises étant donc inscrites dans ce dispositif, les clients habituels des garages pouvant quant à eux profiter de ce contrôle gratuit. En l’état, nous ne pouvons pas savoir précisément combien de véhicules auront été contrôlés mais nous ferons bientôt le point, de même d’ailleurs que sur les résultats des contrôles effectués.
Mme Pauline Johanet. En outre, nous devons pouvoir prévenir les entreprises de cette opportunité mais c’est précisément là que le bât blesse. Aux pouvoirs publics, maintenant, de nous aider à développer cette initiative en la faisant connaître !
M. le rapporteur, président. Je ne suis pas certain que cela soit aussi simple, le CNPA étant un syndicat professionnel dont les adhérents ne seront peut-être pas tous volontaires pour y participer.
Mme Pauline Johanet. Nous pouvons nous contenter du maillage territorial des chefs d’entreprise qui ont décidé de s’investir.
M. le rapporteur, président. Certes.
M. Francis Davoust. Je précise que cette opération a été lancée en partenariat avec la CNAMTS, qui s’efforce de favoriser le renouvellement des véhicules utilitaires légers et qui assure le suivi des aides ponctuelles correspondantes – aides qui sont mises à la disposition de l’ensemble des entreprises –, de même qu’avec les caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qui peuvent financer tout ou partie des équipements de modernisation, ces équipements que j’ai évoqués tout à l’heure.
M. Jacques Deletang, président national de la Fédération nationale des agents commerciaux. Notre association représente 35 000 agents commerciaux, travailleurs indépendants qui parcourent plus de 50 000 kilomètres par an, dont plus de 50 % sur des autoroutes.
Limiter le risque routier, c’est tout d’abord bénéficier de bonnes infrastructures : plus les autoroutes sont nombreuses et moins l’on compte de virages dangereux, mieux c’est. La qualité des voitures constitue également un élément important, de même que les différentes mesures qui sont prises en termes de limitations de vitesse ou de taux autorisé d’alcoolémie.
On sait que de 70 % à 80 % des agents commerciaux circulent à titre professionnel sans être des professionnels de la route, leurs véhicules étant des outils de travail. Compte tenu de leur expérience, ils ont d’ailleurs proportionnellement moins d’accidents que le voyageur du dimanche ou le conducteur qui effectue des trajets quotidiens de son domicile à son travail.
S’agissant des infrastructures routières, il convient de distinguer plusieurs niveaux : les autoroutes – où l’on dénombre moins d’accidents que sur les routes départementales alors que la vitesse autorisée y est évidemment supérieure –, les routes départementales – y compris les portions se trouvant à la sortie des autoroutes où il faut veiller à décélérer – et, enfin, la circulation urbaine. Selon moi, la pénalité doit être proportionnée au risque, étant entendu que la dangerosité est plus grande sur les routes départementales et en ville. Les sanctions, de plus, devraient être appliquées en faisant preuve d’une tolérance « professionnelle » à l’endroit des conducteurs accoutumés et, principalement, lorsqu’ils circulent sur les autoroutes. En ce qui me concerne, depuis dix ans, j’ai commis plusieurs infractions sanctionnées par la perte d’un point et une seule m’a coûté deux points.
M. le rapporteur, président. Seriez-vous favorable à un relèvement de la vitesse autorisée sur les autoroutes ?
M. Jacques Deletang. Je considère qu’il faudrait faire preuve de plus de tolérance dans la sanction et ne pas systématiquement enlever un point lorsque l’on roule à 140 km/h sur autoroute.
M. le rapporteur, président. Vous visez donc les petits excès de vitesse sur ces voies-là.
M. Jacques Deletang. En effet, l’autorité publique devant en revanche se montrer beaucoup plus sévère en ville en n’acceptant aucun dépassement de la vitesse autorisée ou en le limitant à 5 km/h.
Les bonnes pratiques dont il a été question me semblent justes mais sans doute serait-il utile d’accroître la sensibilisation des conducteurs par ce que j’appellerais une « signalisation préventive » plus pédagogique, dont je laisserai M. Leplat donner quelques exemples.
M. le rapporteur, président. Ce sont en effet les propositions concrètes qui nous intéressent le plus, comme vous l’avez fait s’agissant de la tolérance aux infractions.
M. Luc-Alain Leplat, président de la délégation Alsace de la Fédération nationale des agents commerciaux. À l’instar d’autres professions utilisant la route comme outil de travail, nous sommes souvent pénalisés par les petits délits, dont l’accumulation empêche certains collègues d’utiliser leur véhicule.
M. le rapporteur, président. Je relativise votre propos en précisant que, parmi les personnes qui n’ont plus de permis, seules 0,70 % le doivent à des retraits successifs d’un point.
M. Jacques Myard. Ce qui représente tout de même 300 000 personnes !
M. le rapporteur, président. Vous proposez, monsieur Leplat, une amende pour un excès de 10 km/h et au-delà une amende et un retrait de points ?
M. Luc-Alain Leplat. Sur autoroute, une amende pourrait s’appliquer pour un excès de 20 km/h, à laquelle on ajouterait un retrait de points pour une infraction qui irait au-delà. En ville, la tolérance ne devrait pas dépasser 5 km/h.
M. le rapporteur, président. En tout cas, il faut que la réglementation soit simple et lisible.
M. Luc-Alain Leplat. Parce que nous soutenons toutes les mesures pédagogiques qui sont ou pourraient être prises, nous considérons que le retrait de la signalisation des radars fixes est un peu dommageable, ces derniers étant aussi pédagogiques que les radars annonçant la vitesse à laquelle un automobiliste circule : dans les deux cas, les radars rappellent en effet combien il importe de surveiller cette dernière, en particulier pour les usagers occasionnels de tel ou tel axe.
De surcroît, nous souhaitons que le nombre de radars augmente, non pas tant sur les autoroutes, où le risque d’accidents est plus faible, mais sur le réseau secondaire ou en ville, à condition toutefois que le réseau de fibre optique nécessaire à leur usage soit bien évidemment installé. À cet égard, les pouvoirs publics doivent faire un effort.
M. le rapporteur, président. Vos collègues empruntent surtout les autoroutes, si je ne m’abuse.
M. Luc-Alain Leplat. En effet, mais s’il m’est arrivé de faire 100 000 kilomètres par an principalement sur autoroutes, j’ai été aussi nécessairement un usager des réseaux secondaires et urbains, ma vigilance ayant été en l’occurrence identique.
Si nous sommes favorables aux installations de radars sur les feux tricolores, nous souhaiterions que ces derniers deviennent également pédagogiques afin qu’à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays un compteur indique le temps restant avant le passage au feu orange ou bien, comme en Allemagne ou en Autriche, que le feu vert commence à clignoter avant un tel passage. Cela serait d’autant plus nécessaire que le franchissement d’un feu à l’orange est susceptible d’être sanctionné.
Plus globalement, nous souhaiterions que la signalisation routière soit encore meilleure, par exemple par la mise en place de panneaux lumineux rappelant, en particulier de nuit ou au crépuscule, la limitation précise de la vitesse.
Afin d’éviter des ralentissements brutaux et, donc, des accidents, nous souhaiterions également que les camions ne soient pas autorisés à doubler sur certaines zones du réseau à quatre voies, comme c’est le cas en Alsace, quitte à ce que des zones de dépassements soient aménagées par ailleurs.
M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA). La FFSA est évidemment concernée par la sécurité routière au plus haut niveau.
Les assureurs se sont engagés auprès de l’État à consacrer chaque année 0,5 % des cotisations obligatoires pour les retraites complémentaires en actions de sensibilisation et de diminution du risque routier. Nous travaillons à cette fin avec notre propre association Assureurs Prévention ainsi qu’avec des associations partenaires, notamment l’association Prévention routière et l’association Prévention et suivi de la sécurité routière en entreprise (PSRE), dont le président, M. Jean-Claude Robert, est ici présent.
Nous pensons, comme nos amis de la Prévention routière, que, si la France a fait des progrès exceptionnels en matière de sécurité, c’est avant tout parce que les pouvoirs publics font reposer leur politique sur une logique de sanctions. Du reste, l’abandon, parfois justifié sur le plan technique, de telle ou telle mesure ou de telle ou telle sanction jugée excessive, est le plus souvent interprété par les conducteurs comme un relâchement des pouvoirs publics en matière de sécurité routière, ce qui se traduit immédiatement par une augmentation de la vitesse. Il faut en prendre conscience : les comportements de fond n’ont pas changé et c’est toujours la sanction qui donne des résultats.
Les actions menées par les assureurs visent quatre cibles prioritaires : les jeunes, dont l’accidentologie, matérielle et corporelle, reste six fois supérieure à celle des conducteurs plus expérimentés ; les deux-roues, dont le taux d’accidentologie n’a pas connu ces dernières années une baisse équivalente à celle des quatre roues ; l’alcool, qui est devenu aujourd’hui la première cause d’accidents ; le risque professionnel.
S’agissant de cette dernière cible, nous avons créé, il y a douze ans, l’association PSRE. Il est en effet primordial que les chefs d’entreprise prennent conscience des responsabilités qui sont les leurs, notamment ceux des TPE et PME, le risque routier étant relativement bien intégré par les très grandes entreprises. Il est très difficile d’aller toucher chaque petite entreprise. Je laisse, sur le sujet, la parole à M. Jean-Claude Robert.
M. Jean-Claude Robert, président de l’association Prévention et suivi de la sécurité routière en entreprise (PSRE). Ces dix dernières années, assurément, le risque « mission » a mieux évolué que le risque civil qui concerne l’ensemble des Français. Mais nous ne saurions affirmer que cette amélioration se poursuivra durablement car les statistiques sont biaisées. Comme le révèle en effet le rapport que nous adressons aux professionnels de la route, si nous confrontons cette amélioration à l’état des parcs automobiles, à la consommation de carburant et aux heures passées à la conduite, nous sommes actuellement en sous-activité. Une reprise de l’activité ne confirmerait donc peut-être pas l’amélioration, surtout si elle impliquait la réembauche de nombreux intérimaires, qui sont les plus vulnérables au risque routier – n’est-ce pas, messieurs les représentants du ministère du travail ?
M. le rapporteur, président. Confirmez-vous, monsieur Combrexelle, la donnée relative aux intérimaires, que nous ignorions jusqu’à présent ?
M. Jean-Denis Combrexelle. Oui et non.
Il faut prendre en considération non seulement les mesures de sécurité routière, mais également l’organisation du travail. Que le conducteur soit intérimaire ou pas, si son employeur exige de lui qu’il se rende en une heure à un rendez-vous situé à 100 kilomètres sans pouvoir emprunter d’autoroute, il prendra nécessairement des risques. Quelle que soit la qualité du réseau routier ou celle du véhicule, si l’organisation du travail n’est pas pensée en fonction de la prévention, le salarié finira immanquablement par violer les règles de sécurité.
M. Jean-Claude Robert. Sans me focaliser sur les intérimaires, je tenais à insister sur un facteur qui aujourd’hui biaise la lecture des résultats.
Le deuxième facteur concerne les victimes. Se focaliser sur le nombre de tués est assurément médiatique mais peu pédagogique pour l’ensemble de la population, qui ignore que, chaque année, il y a entre 8 500 et 9 000 nouvelles invalidités permanentes, dont 8 000 à la charge du régime général, accompagnées de 6 millions de journées d’arrêt de travail – dont 5 millions à la charge du régime général. On évoque souvent le poids des cotisations sociales sur les entreprises en oubliant que les cotisations d’assurance professionnelle représentent également pour elles une charge. Les barèmes des assureurs professionnels et ceux des assureurs complémentaires ont du reste été révisés en tenant compte du fait qu’aujourd’hui un accidenté de la route qui ne meurt pas coûte plus cher qu’un tué.
Quant au risque trajet, il continue d’augmenter chaque année, le nombre de tués entre le domicile et le travail étant devenu trois fois supérieur au nombre de morts en mission, ce qui annule, malheureusement, les effets de l’amélioration du risque « mission ».
Par ailleurs, non seulement le risque routier est considéré aujourd’hui par les services financiers des entreprises comme une variable d’ajustement, mais nous assistons également à une dérive qui aboutit à faire du salarié, lorsqu’il roule, un « homme à tout faire » : il appartient donc aux pouvoirs publics de prendre clairement position sur le sujet. Je fais allusion à l’utilisation du téléphone portable au volant, notamment à l’envoi de SMS. Un sondage révèle que 31 % des moins de vingt-cinq ans et jusqu’à 41 % de cette catégorie – alors qu’ils sont « apprentis conducteurs » – envoient des SMS depuis leurs voitures. Le phénomène est du reste international puisque les États-Unis et le Royaume-Uni réfléchissent à des mesures législatives en la matière. Il faut agir sur ce que la DSCR appelle les « distractions technologiques ».
Les conditions de travail poussent de plus en plus le salarié à tout faire ou presque à partir de son véhicule : le préposé à la réparation des ascenseurs ou le mainteneur informatique commenceront, tout en conduisant, à réaliser leur diagnostic au téléphone pour vérifier s’ils ont à l’arrière de leur véhicule les pièces nécessaires à leur intervention. Le salarié sur la route devient factotum, ce qui présente un risque considérable.
S’agissant de l’effectif, je serai moins optimiste que M. Reinhard Gressel. Si l’on ajoute les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, dont on sait qu’ils sont utilisés par une personne et demie ou deux personnes (ce qui fait quelque 7 millions d’utilisateurs), aux véhicules légers gérés par les grands noms du leasing, nous atteignons plus de 10 millions, voire 12 millions de conducteurs, à temps complet ou partiel – parcourant entre 5 000 et 10 000 kilomètres. Les organismes publics doivent aider les associations, qui n’en ont pas toujours les moyens, à dresser des bilans.
Toutefois, pour mieux connaître le risque routier, il faudrait commencer par l’accepter. Trop longtemps il a été l’objet d’un déni. Il existe encore des chefs d’entreprise pour distinguer le risque professionnel du risque routier alors que le risque routier est un risque professionnel. Aujourd’hui, 35 % des entreprises décrivent le risque routier en rapportant le nombre de conducteurs au nombre de kilomètres parcourus. Cette démarche est insuffisante : il faut prendre également en considération et les conditions dans lesquelles ces kilomètres sont parcourus et les heures auxquelles ils le sont, afin de mettre en place les principes de prévention qu’a évoqués M. Thierry Fassenot.
Il s’agit aussi de rapporter le risque routier à tout un ensemble de facteurs insuffisamment pris en considération, comme le risque lié à l’alcool ou aux stupéfiants. Le ministère du travail a consacré deux excellents forums à la question, au CHU d’Angers et à la Maison de la promotion sociale d’Artigues-près-Bordeaux, qui ont mis notamment en valeur le contexte professionnel dans lequel se développe aujourd’hui la consommation de stupéfiants. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard car les consommateurs occasionnels sont aujourd’hui 5 millions.
Quant à la question des horaires atypiques, elle doit d’autant plus être prise en compte qu’elle concerne 37 % des salariés.
Il faut, en matière de risque routier, de l’accompagnement et de l’investissement, sur le modèle des efforts que les entreprises, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ont réalisés, en matière de prévention des accidents du travail, sur les chantiers, au moyen des échafaudages, des harnais ou des casques. Les entreprises doivent recouvrer les moyens d’avoir des spécialistes en préventologie, lesquels, au début de la crise, ont été chargés d’autres missions alors jugées plus urgentes. Les entreprises qui réalisent des progrès en matière de sécurité routière sont celles qui organisent des quarts d’heure « sécurité » hebdomadaires ou qui renouvellent leurs plans de prévention.
M. le rapporteur, président. Il s’agit d’une politique globale de sécurité sur le plan de l’entreprise, notamment en matière d’exigences raisonnables, comme l’a rappelé M. Combrexelle.
M. Jean-Claude Robert. Les exigences abusives sont le fait d’entreprises dont la direction ne s’est pas engagée en matière de sécurité routière, dans lesquelles les cadres ne se sentent pas concernés par la question et les salariés n’osent pas dire non de peur d’être mal vus. Actuellement, à Tours, nous menons une campagne de formation, pour toute la région Centre, d’une journée par an auprès de 700 personnes de l’industrie gazière. Malheureusement, comme cette formation entre dans le plan de formation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle n’est pas fiscalement déductible.
Il faut également accélérer la mise en place des législations européennes, s’agissant notamment de la création dans les pays de l’Union n’en disposant pas encore du permis C1 pour conduire des poids lourds légers, ce qui permettrait de soulager le recours aux véhicules utilitaires légers. Des professionnels, notamment les paysagistes, nous le demandent parce qu’ils ne peuvent travailler qu’en recourant à un véhicule dont la charge est supérieure à 3,5 tonnes.
La conjoncture est favorable car, après la CNAM et la Mutualité sociale agricole, les collectivités territoriales mettent en place leur dispositif dans le cadre du Fonds national de prévention. Le public est réceptif, l’État agit. Nous aidons à titre expérimental un département de la région Rhône-Alpes à monter son premier plan de prévention au risque routier avec la direction départementale du territoire. Les chartes professionnelles permettent de toucher les cibles que M. Stéphane Pénet a évoquées. Toutefois, ces mesures ont à la fois besoin d’être mieux connues et mieux accompagnées pour développer leurs effets vertueux.
C’est ainsi que, s’agissant des accidents liés à l’alcool, les statistiques en milieu professionnel sont de 2,5 à 4 fois inférieures à la moyenne nationale. Il est important de réaliser un effort sur le risque routier professionnel car il aura des effets bénéfiques sur la sphère publique, notamment au travers du risque-trajet (20 millions de salariés empruntent leur véhicule pour se rendre à leur travail). Un tel effort sera plus efficace qu’une campagne publicitaire à la télévision, coûtant entre 30 et 40 millions d’euros, pour convaincre globalement, et de façon non ciblée, en gros 40 millions de personnes (tous ceux qui utilisent une automobile). Grâce à l’effet d’entraînement, il serait plus efficace de prendre appui sur les milieux professionnels, qui ont déjà réalisé des progrès et qui pourraient en réaliser davantage encore si on leur en donnait les moyens.
M. le rapporteur, président. Certaines catégories professionnelles ont des horaires supérieurs au temps de conduite. Conviendrait-il, s’agissant notamment des chauffeurs de poids lourds, d’envisager une modification de la réglementation ?
Si la réponse était positive, il conviendrait évidemment de prendre en considération le risque que de telles mesures feraient courir aux entreprises de transports, qui connaissent déjà des problèmes de concurrence internationale.
M. Jean-Denis Combrexelle. Le temps de travail des chauffeurs routiers est soumis à deux catégories de réglementation. Pour le droit commun, les chauffeurs sont soumis à la loi du 20 août 2008, qui laisse une très large part à la négociation collective. En revanche, la réglementation propre aux transports pose le problème de l’intégration de la livraison dans le temps de travail. Cette question est très sensible sur le plan communautaire et il sera très difficile, à l’heure actuelle, d’aboutir à un consensus sur le sujet.
Du reste, il n’est pas nécessaire de modifier les textes communautaires régissant, sur le plan technique, le temps de travail des chauffeurs routiers, d’autant qu’une telle modification demanderait beaucoup de temps, comme je viens de le dire. Rien n’interdit dès à présent à une entreprise de faire une démarche de prévention épargnant à ses conducteurs des journées de quinze ou seize heures. Mais cela pose évidemment de gros problèmes de concurrence avec les transporteurs des autres pays, et certains, dans cette situation de concurrence, ont parfois des comportements complètement erratiques, ainsi que l’inspection du travail peut en témoigner. Ces transporteurs posent un grave problème de sécurité à la fois à l’encontre de leurs propres chauffeurs et des autres usagers de la route.
M. Robert Piccoli. Je ne serai pas aussi négatif que M. Robert : que 50 % des entreprises aient mis en place un document unique de prévention et d’évaluation des risques professionnels représente déjà un progrès.
Nous partageons tous le constat que ce sont les TPE et PME qui posent le plus de problèmes en termes de sécurité, qu’il s’agisse du transport scolaire ou du transport routier. La raison tient, non pas à la qualité des chefs d’entreprise, mais à la taille même des sociétés qui rend nécessaire la mutualisation des efforts. Des opérations visibles doivent être menées au niveau de leur direction, comme les chartes professionnelles que M. Davoust a évoquées. Ces chartes, loin d’ignorer les textes en vigueur ou les recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent de faire remonter les pratiques et d’identifier les risques. Il faut progresser en termes de respect de la réglementation – d’où l’importance de la première campagne de l’inspection du travail sur le risque routier professionnel –, tout en ciblant les PME, comme le font nos partenaires du plan « santé au travail », grâce à une problématique spécifique qui identifie tous les risques, notamment les risques liés aux véhicules utilitaires légers, et qui mette en place des plans d’action cohérents.
M. le rapporteur, président. Il importera, dans l’idéal, que ces plans intègrent la question du trajet, ce qui ne sera pas aisé pour les TPE.
M. Robert Piccoli. Nous pouvons mener des actions très concrètes. Les plans déplacements entreprise (PDE) ne visent pas que les grandes entreprises. Rien n’interdit de raisonner en termes de PDIE (plans déplacements inter-entreprises) au sein d’une zone d’activités, en vue de mutualiser les efforts. De telles actions, les CARSAT ou la PSRE les mènent tous les jours. Les petites entreprises, avec l’aide des élus locaux, peuvent recourir au co-voiturage ou utiliser les transports en commun. De telles actions, je le répète, peuvent être menées par zones d’emplois.
M. le rapporteur, président. Elles supposent toutefois un gros travail de pédagogie et de prise en charge économique.
M. Robert Piccoli. Nous sommes face à un problème d’évaluation et de prise en compte global des risques, c’est indéniable. Le risque routier professionnel ne peut pas être traité à travers un seul aspect, comme l’amélioration du réseau routier, ou en donnant à chaque catégorie professionnelle un droit spécifique de conduire à telle ou telle vitesse.
M. le rapporteur, président. D’aucuns préconisent un permis particulier, plus « tolérant » – le mot a été utilisé – pour les professionnels, partant du raisonnement simple selon lequel plus on conduit, plus on est statistiquement exposé aux sanctions.
M. Robert Piccoli. Le permis est aujourd’hui, pour toutes les catégories de conducteurs, un permis personnel.
M. le rapporteur, président. Le nombre de points pourrait également être différencié en fonction de la catégorie, professionnelle ou non, du conducteur.
M. Robert Piccoli. Je n’y crois pas : si l’on accordait des points supplémentaires aux professionnels, on se retrouverait bientôt devant la même situation. En effet, une plus grande latitude donnée par les pouvoirs publics aux professionnels de la route augmenterait la pression des entreprises sur leurs salariés. Ce serait une fausse bonne solution, si même elle était possible sur le plan juridique.
M. le rapporteur, président. Le permis blanc ne soulevait pas de problème d’ordre juridique. C’est une question d’opportunité.
M. Robert Piccoli. En cas de permis différencié, comment résoudre les problèmes liés à l’alcool au volant ? Supprimera-t-on le permis personnel d’un conducteur contrôlé en état d’ébriété tout en lui laissant son permis professionnel ? Les professionnels doivent donner l’exemple !
M. le rapporteur, président. L’éthylotest antidémarrage pour les professionnels apporte une réponse.
M. Francis Davoust. Notre organisation professionnelle a la chance d’avoir une branche auto-école et une association de formation des conducteurs. Les enquêtes qu’elles réalisent révèlent qu’il est dangereux de pouvoir conduire sans permis spécial des utilitaires légers de 6 tonnes pouvant rouler à 150 km/h. Il y en a plus de 5 millions et ils sont du reste impliqués dans un grand nombre d’accidents. C’est pourquoi il conviendrait d’en modifier l’équipement et de former, notamment, leurs jeunes conducteurs sans expérience.
M. Jean-Claude Robert. Ne conviendrait-il pas d’étendre à la conduite en situation professionnelle le taux d’alcoolémie à 0,2 % existant pour les chauffeurs de transport en commun ? Cette mesure a fait l’objet d’un long débat au sein du Comité national des transports, mais beaucoup d’entreprises ont généralisé la mesure à leurs personnels qui ne transportent pas de voyageurs mais font du démarchage. Plus le risque est important, plus les exigences de maîtrise de la conduite professionnelle doivent être élevées. Une telle généralisation permettrait de clarifier la responsabilité des employeurs qui doivent gérer des situations cauchemardesques liées à des dépassements de taux d’alcoolémie au volant par des salariés qui ont absorbé de l’alcool à la cantine ou lors de repas d’affaires.
S’agissant plus spécifiquement des transporteurs de marchandises, le premier facteur de risque professionnel est l’usure au travail. Sur les quarante chauffeurs routiers morts en 2009, vingt sont décédés à l’arrêt de crises cardiaques – ils partagent à cet égard le triste fardeau des agriculteurs professionnels. Le deuxième facteur est le stress, qui pousse des quadragénaires à consommer des stupéfiants et des EPO. Quant au troisième, ce sont les intrusions technologiques dans la cabine, sources de distraction.
M. Jacques Deletang. S’agissant des agents commerciaux, qui sont à 80 % des indépendants, en matière de petites infractions, de tolérance professionnelle et de prévention…
M. le rapporteur, président. Nous avons bien compris quels étaient vos souhaits à leur égard.
M. Jacques Deletang. Il ne s’agit pas de souhaits mais de la nécessité de conserver, dans le circuit économique, une population importante.
M. le rapporteur, président. Mesdames, messieurs, nous vous remercions.
*
* *
Audition de M. Jean-Luc Nevache, délégué interministériel à la sécurité routière
Mardi 13 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Monsieur le délégué interministériel, nous attendons beaucoup de votre audition pour les propositions que nous aurons à formuler. Avez-vous d’ores et déjà esquissé une stratégie ? Quelle sera votre action en matière de communication ? En particulier, souhaitez-vous travailler à l’émergence d’une « génération sécurité routière » ?
M. Jean-Luc Nevache, délégué interministériel à la sécurité routière. Même s’ils se sont améliorés depuis, les mauvais résultats du début de l’année ont confirmé que la baisse de l’accidentalité et de la mortalité sur les routes n’était pas une évolution acquise, comme pouvaient le laisser croire les progrès enregistrés depuis le début des années 2000. Ces progrès nécessitent un travail permanent.
Plusieurs éléments jouent contre nous, et d’abord le développement de formes de mobilité qui exposent aux risques les plus graves. En 2010, les collisions entre motos et automobiles ont provoqué la mort de 288 motards et de cinq automobilistes seulement ; les collisions entre vélos et automobiles celle de 66 cyclistes mais aucune d’automobiliste. On le voit : l’amélioration de la sécurité routière requiert des efforts pour un meilleur partage de la route avec les usagers les plus vulnérables, dont le nombre va continuer de croître.
Ensuite, bien que la consommation d’alcool soit en constante diminution dans notre pays, la part qu’elle tient dans les causes d’accidents ne se réduit pas. La moitié des accidents mortels s’explique par des taux d’alcoolémie dépassant 1,5 gramme par litre de sang ! Nous avons affaire là, d’une part, à des récidivistes, pour lesquels l’éthylotest anti-démarrage (EAD) est probablement une solution très prometteuse – un premier décret vient d’être publié sur le sujet – et, d’autre part, à des personnes qui ne sont coupables que d’un écart ponctuel et qui relèveraient plutôt de procédures d’autocontrôle.
La plupart de nos concitoyens sous-estiment le nombre des contrôles d’alcoolémie effectués par les forces de l’ordre, parce que ces opérations sont concentrées sur des périodes à risque pendant lesquelles eux ne circulent pas : les vendredis et samedis dans la nuit. Il n’empêche, ce nombre est élevé : quelque 11 millions par an. Pour autant, je crois qu’il y a place pour l’autocontrôle, et l’obligation faite aux discothèques de proposer des éthylomètres à leurs clients est probablement le type d’action qui mérite d’être généralisé.
Autre sujet de préoccupation : les deux-roues motorisés, qui comptent pour 2 % dans la circulation mais sont impliqués dans 26 % des accidents mortels. Cette situation est inacceptable, d’autant que la moitié des conducteurs de ces deux-roues n’étaient pas responsables de l’accident dans lequel ils ont perdu la vie. La baisse relativement forte de ces accidents, enregistrée en 2010 par rapport à 2009, le prouve : il est possible de parer à la vulnérabilité de ces usagers en conjuguant incitation, prévention et répression – mais, pour cela, il faut en finir avec les procès d’intention.
Nous nous inquiétons également de ce que j’appellerai les « distracteurs » : téléphoner au volant multiplie le risque par trois, envoyer un SMS le multiplie par vingt – et je ne parle pas du visionnage de films ! Or, les mesures que l’on pourrait prendre en la matière se heurtent à un problème d’acceptabilité sociale. D’autre part, s’il est acquis que 10 % des accidents corporels sont liés à l’usage du téléphone au volant, on ne sait quelle est la proportion d’accidents mortels dans ce cas – même s’il est probable qu’elle est plus faible en ville qu’en rase campagne, en raison d’une moindre vitesse. Des études s’imposent donc sur le sujet.
Dernier sujet de préoccupation : les seniors piétons. Contrairement à une idée reçue, les conducteurs âgés et même très âgés adaptent leur comportement à leurs capacités et on ne constate donc pas de sur-accidentalité dans cette population. En revanche, surtout au-delà de soixante-quinze ans, ces personnes deviennent très vulnérables quand elles marchent dans la rue. En effet, elles ne respectent probablement pas plus que les autres l’obligation de traverser dans les passages cloutés ou d’attendre que le feu soit au rouge pour les automobilistes, mais elles sont un peu moins rapides que vous et moi. Or les automobilistes ne les identifient pas nécessairement comme des personnes dont la mobilité est amoindrie, de sorte qu’ils n’estiment pas correctement le temps qu’il leur faudra pour traverser la chaussée… Cette population âgée étant appelée à croître, voilà une cause qui doit nous mobiliser.
Pour notre communication, nous avons fait le choix d’une nouvelle agence à la suite d’un appel d’offres. Une première campagne, au mois de novembre, sera axée sur l’alcool ; une autre, au début de l’année prochaine, visera à une remobilisation générale. Nous avons également arrêté un plan en vue d’être présents dans l’ensemble des médias. Avec la nouvelle agence, nous allons faire porter notre effort sur les réseaux sociaux pour avoir davantage accès aux jeunes et aux conducteurs de deux-roues, que les campagnes médiatiques ordinaires touchent moins que le reste de la population. Nous allons ainsi ouvrir un compte Twitter et un compte Facebook. Cette stratégie a d’ailleurs déjà inspiré la réalisation, par la délégation interministérielle, du film « Insoutenable », diffusé sur Internet. Beaucoup d’internautes l’ont vu et nous envisageons de répéter l’opération à la télévision, probablement au prix d’une adaptation, afin de rendre ces images moins choquantes pour le grand public tout en leur conservant leur force de persuasion.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Comment expliquez-vous les réactions suscitées par les décisions annoncées à l’issue du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai ?
M. Jean-Luc Nevache. Je proposerai deux explications, au demeurant partielles.
En premier lieu, en dépit de tous nos efforts de pédagogie, nous ne sommes pas parvenus à convaincre que la vitesse était un déterminant fondamental de la sécurité routière.
En effet, on confond cause et déterminant. La vitesse excessive est de moins en moins une cause directe d’accidents – les très grands excès ne comptent plus que pour 0,07 %. En revanche, dès lors qu’un conducteur dépasse de dix kilomètres-heure la vitesse qu’il devrait respecter, la gravité de tout accident se trouve accrue. Les très bons résultats des dix dernières années sont liés à la diminution de la vitesse moyenne. Il faut donc à la fois éliminer les excès de vitesse, notamment les grands excès, et continuer de réduire cette vitesse moyenne, pour diminuer la gravité moyenne des accidents.
Or nous avons du mal à faire admettre cette corrélation. On entend en permanence soutenir qu’une vitesse comprise entre 51 et 53 km/h, en ville, ne serait pas dangereuse. Or, outre que 51 km/h sur un procès-verbal correspondent, comme vous le savez, à une vitesse réelle de 56 ou 57 km/h, il faut savoir qu’un piéton heurté à 50 km/h survivra, mais qu’il mourra s’il l’est à 60 km/h. Cela fait une grande différence ! Il nous faut donc intensifier l’effort de pédagogie sur ce sujet des « petites » vitesses.
En second lieu, les Français ont peut-être eu le sentiment d’une distorsion entre l’attention portée à la vitesse et celle qui a été consacrée à la répression de l’alcoolémie.
En trois ans, le nombre de contrôles d’alcoolémie est passé de 9,5 à 11 millions et celui des dépistages positifs a franchi la barre des 100 000, puis des 110 000 et, enfin, des 120 000. La pression est donc réelle, mais, je le répète, elle n’est pas perçue car ces contrôles sont effectués à des moments où la plupart de nos concitoyens ne circulent pas. Combien en ai-je rencontré qui m’ont dit n’avoir pas eu à souffler dans un ballon depuis dix ans ! Mais un journaliste qui était dans ce cas m’a déclaré récemment : « Maintenant que ma fille sort le samedi soir et que je vais la chercher à la porte de la discothèque, j’ai été contrôlé trois fois en deux mois. » Reste que s’est installée chez beaucoup l’idée d’une différence de traitement entre ceux qui n’ont pas le sentiment d’être dangereux quand ils dépassent de quelques kilomètres-heure la vitesse autorisée, c’est-à-dire bien souvent eux-mêmes, et les autres personnes, qu’ils jugent au contraire très dangereuses car alcoolisées et, au fond, insuffisamment contrôlées.
M. le rapporteur. Les constructeurs sont autorisés à vendre des voitures qui peuvent atteindre 250 km/h, à la suite de quoi on s’ingénie à limiter la vitesse par tous moyens. Il y a là une grande hypocrisie, qui n’est d’ailleurs pas le fait de notre seul pays. Militerez-vous pour le bridage des voitures ?
Vos prédécesseurs ont eu des attitudes diverses, notamment en matière de communication. Comment allez-vous « incarner », vous, cette fonction de délégué interministériel ?
On a souvent bien du mal à se retrouver dans le foisonnement des organismes dédiés à la sécurité routière, ainsi que dans une surabondance de chiffres. Peut-on espérer une rationalisation ?
Envisagez-vous de réactiver le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) ?
Enfin, avez-vous des propositions précises pour les deux-roues motorisés, en particulier s’agissant des plaques et des gilets réfléchissants ?
M. Jean-Luc Nevache. Le problème de la puissance des voitures se pose effectivement au niveau mondial et nous avons des voisins qui ne limitent pas les vitesses sur certaines de leurs autoroutes. Cela étant, nous assistons à des évolutions importantes, avec la volonté de combattre l’effet de serre ou de promouvoir la voiture électrique, dont les caractéristiques changeront la donne…
M. le rapporteur. Ce n’est pas exactement le discours que nous ont tenu les constructeurs.
M. Jean-Luc Nevache. L’autonomie de ces véhicules est très liée à la vitesse à laquelle ils roulent. Si cette flotte se développe selon nos vœux, se posera immanquablement la question de l’harmonisation des vitesses pour toutes les catégories de voitures.
M. le président Armand Jung. Le CISR du 11 mai a évoqué le projet de « voiture sûre ». Ne peut-on envisager que l’État ou votre délégation impose aux constructeurs un cahier des charges obligeant à installer un minimum d’équipements de sécurité sur les véhicules ?
Quant à la voiture électrique, j’y vois un immense espoir si l’objectif est bien de construire des voitures qui roulent moins vite et consomment moins, mais je constate que celui des constructeurs est d’en fabriquer qui roulent aussi vite que les véhicules thermiques ! C’est pure folie !
M. Jean-Luc Nevache. À l’heure actuelle, pour ces véhicules, il y a antinomie entre vitesse et autonomie : plus ils roulent vite, moins ils roulent longtemps.
La sécurité routière exige incontestablement une communication nourrie et je souhaite donc incarner fortement cette action dans les médias, comme le Gouvernement me l’a d’ailleurs demandé. Pour ce faire, j’insisterai sur le respect de la règle, mais aussi sur le fait que nous ne sommes l’ennemi d’aucun usager, en particulier pas des motards : le délégué interministériel que je suis veut qu’ils respectent les règles de vitesse mais aussi que les automobilistes se montrent plus attentifs à leur égard. Contrairement au discours ambiant de ces derniers mois, il ne s’agit pas d’opposer les premiers aux seconds, non plus que les cyclistes aux chauffeurs routiers. L’objectif auquel je me tiendrai est d’aboutir à un bon partage de la route.
En effet, monsieur le rapporteur, même si de nouveaux problèmes se font constamment jour, comme celui du téléphone, ces questions de sécurité routière font l’objet d’une documentation scientifique abondante. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), en particulier, effectue un travail remarquable. Cette expertise est indispensable car elle permet de prendre des décisions opérationnelles. Toutefois, on peut sans doute améliorer la coordination des études et leur exploitation, car on entend parfois des choses surprenantes, si ce n’est contraires aux connaissances scientifiques. Ainsi prétend-on que les Allemands feraient mieux que nous alors même que la vitesse ne serait pas limitée sur leurs autoroutes. Or, outre que ce n’est le cas que la nuit, leurs résultats sont meilleurs que les nôtres sur tous les segments de voirie à une exception près : précisément sur les autoroutes dépourvues de limitations de vitesse, où le taux des accidents est le triple du nôtre – ce sont leurs statistiques qui l’attestent. Il faudrait faire en sorte que la vérité scientifique l’emporte dans le grand public sur les idées reçues.
Le comité interministériel a décidé de reconstituer le CNSR et il faut s’en féliciter car les concertations, si positives qu’elles aient été, n’ont jamais remplacé cette indispensable instance de dialogue.
S’agissant des deux-roues motorisés, il faut, je le répète, sortir des procès d’intention. Le CISR avait dans un premier temps décidé d’imposer le port de vêtements pourvus de bandes réfléchissantes. On lui a alors objecté le coût pour les motards, obligés de changer leur équipement. Le comité a alors proposé – mais non imposé – le gilet réfléchissant, qui ne coûte que quelques euros. Il y a donc eu malentendu. Cela étant, le problème de la visibilité des motards est incontestable.
Deux formes de plaques sont aujourd’hui autorisées pour les motos, dans notre pays. La plus petite mesure 220 centimètres carrés quand les plaques belges en font 290, les plaques italiennes 310, les espagnoles et les autrichiennes 350, les nouvelles plaques allemandes 360 - soit un tiers de plus que les nôtres – et les britanniques 720. La Fédération des motards en colère nous ayant reproché d’aller à contre-courant de l’Allemagne qui diminue la taille des siennes, je lui ai répondu : « Chiche, alignons-nous ! » – ce à quoi elle a consenti. Les dimensions de nos plaques pourraient donc passer de 17 centimètres sur 13 à 20 cm sur 18. Au demeurant, tout le monde le sait : l’enjeu est de faire en sorte que les radars soient à même de lire les plaques des motards. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas beaucoup d’états d’âme sur ce sujet car il en va de l’égalité des citoyens devant la loi.
M. le rapporteur. Il se trouve que les deux tiers des photographies prises à l’occasion des contrôles automatiques le sont par l’arrière. Pas de problème pour les motos, toujours pourvues d’une plaque arrière, mais un certain nombre d’automobilistes contrevenants échappent à la sanction, par exemple lorsque la carte grise du véhicule est au nom d’une société, faute de pouvoir être identifiés. Ne pourrait-on étudier la question des contrôles par l’avant ?
M. Jean-Luc Nevache. Pour les motos en tout cas, cela ne nous a pas paru s’imposer, les plaques à l’avant étant assez peu usitées dans la communauté internationale. .
Il nous faut travailler sur l’équipement individuel des motards. Aujourd’hui, il n’y a pas d’obligation en la matière, mais les intéressés semblent relativement ouverts à des évolutions. De leur côté, les équipementiers consentent des efforts assez notables. On trouve aujourd’hui dans le commerce des blousons avec airbag, certes chers, mais qui offrent une bonne protection. Dans un premier temps, il faut que nos motards portent, outre un casque, des gants, des bottes et un blouson. Les Belges ont rendu obligatoire un équipement minimum depuis le 1er septembre et nous devrions pouvoir nous attaquer, nous aussi, à la question avec l’ensemble des motards, y compris les usagers de deux-roues urbains.
M. Gilbert Le Bris. Depuis les débuts de la Ve République, l’on est passé d’une conduite ludique, caractérisée par une forte liberté, une faible réglementation… et un nombre élevé de morts, à une conduite plus réglementée dont l’effet a été d’atténuer les conséquences des accidents. Mais ne va-t-on pas en arriver à une conduite empêchée, du fait d’un trop grand nombre de contraintes ? Pour faire face à tous les dangers, il faut s’en tenir selon moi à l’indispensable, à ce qui est vital, sans s’attarder à des mesures qui n’auraient d’effets que « périphériques ». Ainsi, je ne vois pas l’utilité vitale des gants pour les motards – dont je suis.
Dans ce dilemme constant entre liberté et responsabilité, quels sont pour vous les domaines vitaux d’intervention et les catégories d’usagers pour lesquels nos efforts ne sont pas encore suffisants ?
M. Jean-Luc Nevache. Un tiers des accidents mortels sont dus à l’alcool ; les « distracteurs » sont impliqués dans 10 % des accidents corporels et 26 % des morts de la route sont des conducteurs de deux-roues motorisés qui ne contribuent pourtant que pour 2 % à la circulation générale. Ces chiffres vous indiquent les grandes priorités.
Si l’on veut faire passer le nombre annuel de morts de 4 000 à 3 000, et peut-être en deçà encore, il faut s’attaquer aux gisements identifiés : d’une part, les mauvais comportements – l’usage de l’alcool et des stupéfiants – ; d’autre part, la vulnérabilité des conducteurs de deux-roues motorisés et des seniors piétons.
En outre, il faut aussi un travail auprès de l’ensemble des automobilistes en vue d’un apaisement et d’un partage de la route. Dans ce cadre, l’abaissement des vitesses moyennes est un élément déterminant pour le succès des politiques de sécurité routière - indépendamment de la responsabilité des conducteurs.
Enfin, je suis convaincu que l’équipement des motards est très important. On oublie parfois qu’il y a autant de handicapés définitifs que de morts tous les ans, soit 4 000 – et près de 70 000 blessés. Par conséquent, on ne peut se focaliser uniquement sur la diminution du nombre des morts, il faut aussi se préoccuper de faire baisser celui des accidents corporels.
Mme Annick Lepetit. Dans notre pays, quels que soient les gouvernements, les campagnes de communication sur la sécurité routière ont souvent été sujettes à polémique : n’allait-on pas heurter le grand public ? Dans les pays voisins, on craint moins de choquer, l’objectif premier étant d’alerter. Cela étant, compte tenu de leur coût et de l’enjeu, ces campagnes doivent être préparées et menées avec beaucoup de soin.
En ville comme à la campagne, nos concitoyens utilisent de plus en plus les moyens de transport en fonction de leurs besoins et peuvent donc être successivement piétons, automobilistes, conducteurs de deux-roues motorisés et cyclistes. Ne conviendrait-il pas de développer, en partenariat entre l’État et les collectivités, les actions menées à l’école, afin de faire comprendre aux enfants que le code de la route – ou le « code de la rue » – est synonyme de comportement civique ? Même si la peur du gendarme y a contribué, les jeunes commencent à se convaincre de la nécessité de ne pas conduire en état d’ivresse le samedi soir. La prévention et l’accompagnement mis en place par les établissements de nuit sont également une très bonne chose, mais il ne faut surtout pas relâcher l’effort
Tout ce qui contribue à distraire de la conduite nous inquiète également. Il est choquant de voir des cyclistes téléphoner tout en pédalant. Une action pédagogique s’impose, ainsi que – pourquoi pas ? – une interdiction ferme, et cela pour toutes les catégories d’usagers : peut-être en sera-t-il alors comme du port de la ceinture de sécurité, obligation fortement contestée à l’origine et depuis très largement admise…
Selon des statistiques fournies par la Préfecture de police de Paris, les accidents les plus graves de deux-roues ou de piétons seraient souvent liés à l’existence d’angles morts pour les conducteurs de poids lourds. La réglementation relative aux rétroviseurs de ces véhicules a été renforcée dans les années 2000, mais elle n’est guère respectée, faute de contrôles suffisants à mon avis. Il faut certes mener des actions incitatives auprès des constructeurs, mais il conviendrait aussi de développer les contrôles sur les routes et, plus largement, d’appliquer les mesures que nous avons votées dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Enfin, les piétons âgés sont fragiles entre tous dans la mesure où ils se déplacent lentement et peuvent souffrir de problèmes d’audition et d’équilibre. Mais se pose également la question des personnes âgées au volant. Connaissant l’évolution de la démographie, il serait dangereux de ne s’adresser qu’aux jeunes. Certes, il n’est pas aisé de dire à une personne âgée qu’elle devrait éviter de conduire mais, précisément, ne faudrait-il pas diversifier les messages ainsi que l’accompagnement en fonction de ceux à qui on s’adresse ? À cet égard, avez-vous toutes les marges de manœuvre souhaitables ?
M. Jean-Luc Nevache. Madame la députée, je n’ai pas le sentiment que mes marges de manœuvre soient contraintes en quoi que ce soit.
S’agissant des campagnes télévisées, je suis très frappé du caractère très professionnel du travail réalisé par la Délégation à la sécurité routière. L’agence de communication lui propose des scénarios ; la Délégation en présélectionne deux ou trois ; puis, elle fait réaliser de petits films tests qui sont expérimentés auprès de publics cibles pour vérifier leur pertinence et la bonne réception des messages ; enfin,elle fait réaliser un film complet destiné à la diffusion.
Si vous souhaitez des messages plus punchy ou trash, regardez « Insoutenable » ! Je précise néanmoins que ce type de film ne peut pas être réutilisé trop souvent car le message est d’ordre émotif, non pédagogique. Après qu’ils l’ont vu une ou deux fois, les gens ont très vite le sentiment de la répétition et, d’après les spécialistes, chercher l’émotion plutôt que s’adresser à la raison ne permet pas nécessairement de modifier les comportements – même si cela nourrit les conversations sur le coup.
Nous avons un bon partenariat avec l’Éducation nationale. Le brevet de sécurité routière (BSR) et les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) des niveaux 1 et 2 sont plutôt des sujets de satisfaction.
Vous avez raison à propos du téléphone portable. La difficulté tient à ce que tout le monde l’utilise aujourd’hui et que le risque est pour ainsi dire le même avec le Bluetooth qui est, lui, autorisé. Les usagers ont conscience du danger, mais une interdiction serait très mal acceptée : compte tenu de la longueur des trajets domicile-travail, le temps passé au téléphone équivaut à du temps social, consacré à ses amis, à ses enfants ou à ses parents. Un travail de sensibilisation est donc nécessaire, mais nous devons aussi nous procurer des données objectives sur le sujet : quand nous pourrons enfin dire combien de morts sont dues à l’utilisation du téléphone portable au volant, nos concitoyens accepteront plus facilement une interdiction.
Les poids lourds provoquent effectivement des accidents extrêmement graves, mais dans une proportion bien plus faible que leur part dans la circulation générale.
Enfin, je pense que notre société n’a pas à empêcher les seniors de conduire, qu’elle doit préserver leur mobilité. En tant qu’automobilistes, ils ne constituent d’ailleurs pas une population dangereuse, toutes les études montrant, comme je l’ai dit, qu’ils adaptent leur comportement à leurs capacités. En revanche, ils présentent une vulnérabilité particulière, qui nous fait un devoir de chercher à les protéger.
(M. Philippe Houillon, rapporteur, remplace M. Armand Jung à la présidence de la séance.)
M. Jacques Myard. Monsieur le préfet, je suis intimement convaincu qu’il n’y a de bonne politique que dans la durée. Autrement dit, il faut fixer une ligne et s’y tenir.
Il faut aussi, vous avez raison, sensibiliser l’opinion publique par un effort de pédagogie. À ce titre, vous devriez davantage insister sur le nombre de blessés – 70 000 tous les ans –, car ce sont autant de drames engendrant des souffrances immenses.
Notre pays souffre d’un problème culturel. Je suis par exemple frappé de la mauvaise entente entre pouvoirs publics et motards. Les associations représentant ces derniers souffrent-elles d’un manque de cohésion interne, ont-elles des difficultés à faire passer des messages à leurs adhérents ? Sont-elles confrontées à un manque de représentativité ?
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faut systématiquement s’aligner sur les positions allemandes mais si l’on doit à tout prix se livrer à des comparaisons internationales, je relèverai que les grosses cylindrées sont interdites au Japon. Le temps n’est-il pas venu chez nous aussi de prendre des mesures draconiennes ?
D’autre part, les cyclistes sont dorénavant autorisés à prendre des sens interdits. Cela ne revient-il pas à ruiner toute une culture qui faisait que ceux-ci étaient respectés ? Certes, la route doit être partagée mais plusieurs accidents se sont produits à Paris en raison de fautes grossières de cyclistes.
Enfin, disposez-vous de statistiques sur les accidents mortels ou corporels graves impliquant des conducteurs dépourvus de permis de conduire ?
M. Jean-Luc Nevache. Les plus grosses motos, au-delà de 100 chevaux, sont interdites en France.
Les premières années de conduite d’une moto sont caractérisées par une sur-accidentalité : le nombre de tués est beaucoup plus élevé les deux premières années, surtout parmi les très jeunes gens n’ayant pas l’expérience de très gros engins. Une solution serait d’adopter un dispositif « en marches d’escalier », consistant à n’autoriser les deux premières années que la conduite d’une moto de moins de 400 cm3, puis d’élever progressivement la limite.
S’agissant des vélos et des sens interdits, je crois que l’on se focalise trop sur la mortalité. À ma connaissance, cette année, nous n’avons eu à déplorer aucune mort de cycliste à Paris. En revanche, on constate chez ces usagers un très fort accroissement des accidents corporels. Nous étudions le phénomène avec la Préfecture de police afin de savoir s’il est lié aux nouvelles règles.
M. Jacques Myard. Modifier les cultures de conduite en si peu de temps peut se révéler extrêmement dangereux, car les automobilistes n’ont pas le temps d’intégrer ces changements pour se comporter en conséquence.
M. le rapporteur président. Je suis assez de cet avis.
Mme Annick Lepetit. Lorsqu’a paru le décret, qui concerne toutes les communes, certains ont prédit un grand nombre d’accidents. Il se trouve qu’aucun cycliste n’a perdu la vie cette année à Paris. Cela étant, le Club des villes cyclables avait demandé une campagne nationale, ne serait-ce que pour informer des nouvelles règles. En effet, introduire un élément totalement nouveau peut avoir des conséquences auxquelles il faut veiller : je pense en particulier aux piétons, notamment aux piétons âgés, qui souvent ne regardent que du côté d’où viennent habituellement les voitures avant de traverser.
Je n’ai pas réussi à me procurer des chiffres précis sur les accidents de vélo, mais il serait intéressant de savoir si ceux-ci sont dus par exemple au fait que les cyclistes ont brûlé un feu rouge, ou s’ils ne s’expliquent pas parfois par l’obligation où ils se sont trouvés de quitter la piste cyclable à cause de voitures garées en double, voire en triple file.
M. Jean-Luc Nevache. La proportion des défauts de permis de conduire constatée à l’occasion d’accidents mortels, après avoir culminé à 4,5 % en 2009, a commencé à décroître à partir de l’an dernier pour s’établir aujourd’hui à 3,8 ou 3,9 %. Parmi les conducteurs concernés, 20 % avaient perdu leur permis, 74 % ne l’avaient jamais eu et 6 % ne détenaient pas le permis de la bonne catégorie.
M. Jacques Myard. À combien peut-on estimer leur nombre ?
M. Jean-Luc Nevache. En croisant les données de l’accidentologie et les relevés d’infractions, on estime qu’il est compris entre 400 000 et 450 000, ce qui est considérable. La très grande majorité – entre les deux tiers et 80 % – n’a jamais passé l’examen.
M. le rapporteur président. Tout en insistant sur les progrès accomplis, qui ont permis de faire tomber le nombre des tués de 17 000 à 4 000 par an, beaucoup des personnes que nous avons auditionnées ont considéré qu’il serait difficile d’améliorer ce résultat. Êtes-vous de leur avis ?
Un sentiment d’injustice commence à s’exprimer à propos des contrôles automatiques installés au passage des feux tricolores. Certains ont sans doute des comportements inadmissibles, car brûler un feu rouge peut entraîner des accidents mortels, mais il arrive aussi que des conducteurs soient « flashés » et se voient retirer quatre points alors qu’ils n’ont pas eu un comportement dangereux, ni le sentiment de griller le feu rouge.
S’agissant des infrastructures, ne va-t-on pas assister à un désengagement de l’État ? Les collectivités pourront-elles se substituer à lui ?
La politique de sécurité routière doit reposer sur deux jambes : la pédagogie et la communication, d’une part ; les contrôles et la sanction, d’autre part. On estime que la vitesse est à l’origine de 20 % des accidents, l’alcool de 30 %. Or 9 % des infractions relevées concernent l’abus d’alcool et près de 70 % les petits et moyens excès de vitesse : n’y a-t-il pas disproportion ? D’autre part, pour constater les infractions, il faut des agents : la baisse annoncée des effectifs ne va-t-elle pas entraîner un déficit de contrôles et, par conséquent, un affaiblissement de la politique de sécurité routière ?
Enfin, notre collègue Myard a raison : on ne communique pas suffisamment sur le nombre de blessés. Toutefois, selon des services de police présents sur les routes, on se heurte à un problème de décompte. En effet, toute personne impliquée dans un accident et qui voit un médecin est comptabilisée dans les victimes d’accidents corporels même si elle n’est pas blessée. Il y a donc abondance de chiffres, mais sont-ils tous fiables ?
M. Jean-Luc Nevache. Il sera sans doute difficile de passer de 4 000 à 3 000 tués. Cependant, il reste des gisements relativement importants à exploiter : je pense en particulier à la lutte contre l’alcoolémie. En outre, indépendamment de la répression des comportements dangereux, l’essentiel du gain est à attendre d’un meilleur respect des petites limites de vitesse, grâce à une conduite plus apaisée de l’ensemble des usagers. La chose est certes difficile à faire comprendre, mais si tout le monde roule un peu moins vite, le nombre des accidents diminuera.
La moitié de l’augmentation des points retirés entre 2009 et 2010 est liée à l’installation de radars aux feux tricolores. On assiste certes à des contestations car les gens ont le sentiment d’être passés à l’orange. Mais, techniquement, il est assuré qu’ils sont passés au rouge. En effet, il y a deux flashs successifs : le premier, au moment du franchissement de la ligne de feux, ne se déclenche qu’au rouge ; le deuxième, une demi-seconde plus tard, permet de vérifier que le conducteur n’a pas « pilé » et a bien eu un comportement dangereux en traversant le croisement.
M. Jacques Myard. Diriez-vous cela la tête sur le billot ? Car en général, on est « flashé » quand on reste au milieu du carrefour.
Dans certains pays, un décompte en secondes s’affiche à proximité du feu pour indiquer le temps restant avant le passage au rouge. Je ne suis pas contre les flashs, mais je crois que nous devrions améliorer notre système afin d’avertir les conducteurs.
M. Jean-Luc Nevache. Je confirme mes propos sur les deux flashs successifs. Le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), installé à Rennes, exploite les photographies et vérifie si le conducteur a immédiatement pilé après avoir franchi la ligne au rouge. Ainsi, la sanction n’intervient que si le véhicule a effectivement traversé le croisement, mais non en cas de repentir.
Certaines contestations sont compréhensibles. En effet, des conducteurs, en voyant le feu à l’orange, accélèrent au lieu de freiner. Or en accélérant, ils regardent autour d’eux et perdent de vue le feu qui passe au rouge. Ils ont donc le sentiment de passer à l’orange, alors qu’il n’en est rien.
M. le rapporteur président. S’ajoute le problème de la densité de la circulation : le phénomène que vous décrivez se produit souvent quand un grand nombre de voitures roulent très lentement.
M. Jacques Myard. Combien de secondes dure le feu orange ?
M. Jean-Luc Nevache. Je ne suis pas capable de vous répondre immédiatement, mais je vous communiquerai cette information par écrit.
M. le rapporteur président. Que préconisez-vous sur ce point ?
M. Jean-Luc Nevache. Il faut rappeler les automobilistes à la règle. Le code de la route est en effet parfaitement clair : on doit « marquer l’arrêt » à l’orange. Or un certain nombre d’automobilistes ne le font pas et passent alors que le feu orange vient juste de s’allumer, voire après. Et ce comportement devient de plus en plus fréquent.
En ce qui concerne les infrastructures, la décentralisation a entraîné le transfert d’un grand nombre de routes aux départements. Tout le monde le sait : c’est sur les belles routes qu’on se tue. Pour avoir été préfet de Haute-Corse, je peux vous confirmer que l’on meurt davantage sur des routes où l’on peut rouler vite, comme celles qui relient Bastia à Calvi et à Porto-Vecchio, que sur celles où la circulation est plus lente, comme les routes de la Castagniccia ou de la haute Balagne. Et il est notoire que les Anglais ont à la fois de bons résultats en matière de sécurité routière et des infrastructures de qualité contestable...
Quant au nombre des contrôles d’alcoolémie, loin d’avoir baissé, il a continué d’augmenter au cours du premier semestre de cette année, ce qui prouve la priorité accordée par le ministre de l’intérieur à ce sujet. Les consignes sont claires et la pression est forte. Mais il est vrai, et j’ai expliqué pourquoi, que la perception n’est pas celle-là.
M. le rapporteur président. La baisse des effectifs va mécaniquement entraîner une baisse des contrôles dans les mois ou les années à venir.
M. Jean-Luc Nevache. Je constate une augmentation des contrôles sur les trois dernières années. D’autre part, les politiques de prévention ne peuvent plus être ce qu’elles étaient il y a dix ou vingt ans : nos concitoyens prennent mieux en compte le risque, notamment les femmes. C’est pourquoi, je l’ai dit, je crois beaucoup au développement de l’auto-contrôle. Il y a là un vrai gisement.
À cet égard, l’obligation faite aux boîtes de nuit de proposer des alcootests est très importante. D’ailleurs, la plupart des établissements, avec lesquels nous avons eu des discussions très ouvertes, perçoivent bien l’intérêt, y compris pour eux, de cette politique. Ce dispositif peut, selon moi, être élargi car, en se fiant au sens de la responsabilité des conducteurs, on facilite son acceptation.
M. Jacques Myard. Chaque génération est un peuple nouveau…
M. le rapporteur président. Monsieur le préfet, nous vous remercions infiniment pour votre apport.
*
* *
Auditon de M. Bernard Pottier, président, et de M. Jean-Yves Salaün, délégué général de l’Association Prévention routière
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je souhaite la bienvenue à MM. Pottier et Salaün. Notre mission, qui doit déposer ses conclusions mi-octobre, doit dorénavant resserrer ses travaux pour arriver au cœur de la problématique. Leur point de vue et leur expertise seront très importants pour notre compréhension de l’accidentologie.
M. Bernard Pottier, président de l’Association Prévention routière. La sécurité routière, depuis qu’elle a été érigée en chantier national le 14 juillet 2002 par le président Jacques Chirac, fait sans doute partie des actions publiques les plus réussies, tous domaines confondus. On est passé de 8 253 tués à trente jours en 2001, dernier exercice complet avant le programme gouvernemental, à 3 992 en 2010. La vitesse moyenne mesurée hors radars suit d’ailleurs une courbe tout à fait semblable. Elle est passée de plus de 90 kilomètres heure à moins de 80. Le Président de la République a proposé un objectif de 3000 tués en 2012, ce qui correspond à 47 tués par million d’habitants, contre 137 en 2001 et 62 en 2010. La Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont respectivement à 28, 31 et 32. Sauf à penser que la société suédoise attache plus de prix à la vie que la nôtre, cet objectif, tout ambitieux qu’il soit, n’est donc pas irréaliste.
Ainsi que l’a fait remarquer la sénatrice du Haut-Rhin Mme Troendle, avant 2001, on ne poursuivait que les grands chauffards. C’est en posant comme principe que chacun devait réduire sa vitesse qu’on a changé radicalement les choses. Certes, c’est un discours un peu plus difficile à tenir – le chauffard, c’est toujours l’autre ! – et certains parlementaires nous invitent d’ailleurs souvent à venir voir ce qu’en pensent les gens sur les marchés. Mais si l’on n’avait rien changé depuis 2001, beaucoup de ces gens, plutôt qu’au marché, seraient au cimetière ! Songez au nombre de maires qui ont eu un jour à annoncer à des amis qu’ils avaient perdu leur fils… Bref, le choix s’analyse de la manière suivante : veut-on dire aux gens sur les marchés qu’ils risquent de perdre un point, mais que cela sauve des vies, ou bien veut-on dire à des parents qui ont perdu leur enfant que cela évite de perdre trop de points ? Toute la noblesse du discours politique est là.
Et c’est bien la volonté politique qui me paraît la plus grave cause de la situation actuelle – le premier semestre 2011 marque la première dégradation depuis 2002. On fait des reproches à la sécurité routière ou à la délégation interministérielle, mais certains parlementaires ont tenu des discours profondément irresponsables, disant aux Français, en gros, qu’on allait arrêter de les ennuyer. On a déjà connu de tels messages, et leurs résultats se font tout de suite sentir dans les comportements, par exemple lorsque les gens espèrent une amnistie présidentielle, bien qu’il n’y en ait plus depuis Jacques Chirac. Quand Dominique Perben, nouveau ministre des transports, a dit en 2005 qu’il souhaitait faire une pause dans l’implantation des radars, il y a eu cent morts dans les deux mois qui ont suivi ! Mais lorsque ces nouveaux radars avaient été annoncés, en 2003, il y avait eu une baisse considérable des chiffres avant même leur installation… Ce qui compte, c’est donc moins les mesures que le message, parce que c’est de comportements qu’il s’agit – et ce sont moins les mesures qui affaiblissent le permis à points que nous condamnons, que le discours qui les accompagne.
M. le président Armand Jung. Je pense, moi aussi, que la pression politico-médiatique est déterminante. Nous avons eu le sentiment, à un moment donné, que le fil avec la population s’était rompu, que le message était troublé. Or, dans un domaine aussi sensible, cela se traduit immédiatement – par des chiffres, certes, mais également par des morts ! C’est pourquoi le sens des responsabilités doit prendre le dessus.
Sur quelles causes faut-il jouer, et de quelle manière ? Sont-elles multiples ? Comment voyez-vous l’organisation de la délégation interministérielle à la sécurité routière, où Mme Merli a été remplacée par M. Nevache ? Comment rétablir le dialogue entre le Gouvernement et les diverses associations ? On a parfois l’impression que les positions se figent de part et d’autre d’un mur d’incompréhension. Notre objectif est de rétablir ce dialogue dont dépendent beaucoup de choses.
M. Bernard Pottier. Les principales causes, on les connaît : la vitesse et l’alcool. Grâce aux radars et au permis à points, la première est devenue seconde et il est clair que l’on n’aurait pas fait les mêmes progrès sans ces deux mesures conjuguées.
M. le président Armand Jung. Faut-il plus de radars, à des endroits plus ciblés ?
M. Bernard Pottier. Le programme de cinq cents radars supplémentaires par an doit être mené à son terme. Il y a quelque temps, lorsqu’on circulait à 110 km/h sur une quatre voies, on était doublé par 10 % des véhicules. Aujourd’hui, par la moitié. Il y a donc un relâchement certain, facilité par les TomTom et autres Coyote. C’est pourquoi il faut poursuivre les efforts en matière de limitations de vitesse, mais en sachant que les résultats ne seront plus aussi importants qu’avant : les trois quarts du chemin ont déjà été parcourus.
Pour consolider cette action, nous souhaitons que tous les véhicules neufs soient équipés d’un limiteur volontaire de vitesse – à distinguer d’un régulateur, qui coupe le lien entre l’homme et la machine.
M. Philippe Houillon, rapporteur de la mission d’information. N’y a-t-il pas une immense hypocrisie à laisser construire des machines qui roulent à 250 km/h et à obliger les gens à acheter des outils pour les limiter ?
M. Bernard Pottier. L’une et l’autre réponse ne peuvent être apportées qu’au niveau européen, au minimum. Et bonne chance pour aller parler de bridage des véhicules à Bruxelles… Mais à tout le moins, on ne voit pas comment refuser à qui le veut, à la vitesse qu’il aura lui-même fixée, de se protéger contre sa distraction et d’éviter de mettre en danger sa vie et celle d’autrui. Voilà le rôle du limiteur volontaire de vitesse. Il y a un système plus efficace : le Lavia, pour « limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée », qui est la version française de l’intelligent speed adaptation existant déjà dans un certain nombre de pays. Sous sa forme active, branché sur le limiteur volontaire de vitesse, il permet d’éviter l’accident non seulement à 150 km/h sur l’autoroute, mais aussi à 90 en ville. C’est d’ailleurs la technologie que préconisent, aujourd’hui, les tenants, hier, du bridage. Mais, au minimum, les pouvoirs publics doivent peser pour que tous les véhicules neufs, peut-être après un certain délai d’adaptation industrielle, soient équipés d’un limiteur volontaire de vitesse.
Cette question soulève toute la problématique des TomTom et autres équipements semblables. Un TomTom qui signale qu’on est en train de dépasser la limitation de vitesse, c’est bien. Un qui avertit qu’on va rencontrer un radar ou des gendarmes, non. Ces appareils sont sans doute pour beaucoup dans les excès que l’on constate actuellement. Nous pensons donc qu’il faut continuer à nous équiper de radars, surtout sur le réseau secondaire. Pour ce qui est des autoroutes, les pouvoirs publics semblent s’orienter vers des mesures de péage à péage. C’est une bonne idée. Certes, cela ne détecte pas les gens qui roulent à 250 et s’arrêtent le temps d’un repas, mais, encore une fois, il s’agit d’influer sur les comportements : on sait qu’on ne traite que 90 % des cas, mais cela permet quand même de progresser.
Une autre de nos propositions a été mise en place dans certaines préfectures, mais pas toutes : les commissions consultatives des usagers pour la signalisation routière. Les parlementaires sont encore plus convaincus que nous de leur utilité. Ce degré de latitude est nécessaire. Il ne s’agit certainement pas de rétablir les indulgences, mais d’avoir un lieu pour discuter des radars dont l’emplacement est contesté.
Tout cela touche aussi au problème de la signalisation des radars. Il y a eu un affreux cafouillage en la matière.
M. le rapporteur. Êtes-vous pour la fin de la signalisation des radars ?
M. Bernard Pottier. Au début, nous étions favorables à la signalisation, parce que le but était de faire changer les comportements. Les gens doivent s’habituer. De la même façon, je préférerais un Lavia informatif, voire intrusif – qui bippe lorsqu’on dépasse la vitesse limite – plutôt qu’automatique. Parce qu’il faudra un jour dépasser l’étape où l’on avertit les gens qu’il y a un gendarme tout près ! Placer le panneau n’importe où sur une distance de deux kilomètres plutôt que systématiquement à quatre cents mètres avant le radar serait une bonne façon de gérer l’évolution vers plus de rigueur. Les radars pédagogiques n’ont été qu’une façon de se sortir d’un mauvais pas. Nous ne sommes pas contre, mais à terme, il faudra un retrait des panneaux. Nous ne le demandions pas aujourd’hui, et n’avons pas été consultés. Comme nous avons toujours soutenu, de façon globale, la politique mise en œuvre depuis 2002, nous n’avons pas voulu nous insurger comme l’ont fait certains, mais l’affaire a été mal menée. Dans ce domaine, le brouillage du message a été incontestable.
L’autre grande cause d’accidents est évidemment l’alcool. Et là, il est clair que les alcooliers ne jouent pas le jeu. Il y a des étudiants qui partent en week-end avec des coffrets d’apéritifs pour chaque soir, des distributions gratuites, alors qu’elles sont en fait interdites… Ce n’est pas seulement la sécurité routière, mais aussi la santé publique qui est en cause. Le problème relève moins de la loi que de son application. Nous nous sommes, par exemple, beaucoup battus pour qu’il y ait des éthylomètres dans toutes les discothèques. Mais lorsque M. Novelli, secrétaire d’État au commerce extérieur, a, par mesure d’harmonisation, reculé les heures de fermeture de ces établissements, les gens de la sécurité routière l’ont découvert dans le Journal officiel ! Si la sécurité routière était véritablement une priorité, les auteurs du décret les auraient consultés… Il y a dans ce domaine des intérêts économiques qui s’opposent fortement aux objectifs de la sécurité routière, et probablement aussi de la santé publique.
Nous nous sommes aussi beaucoup mobilisés sur les éthylotests antidémarrage, et permettez-moi de dire que nous avons fait un bon travail. Le décret d’application est paru la semaine dernière. Nous avons mené une expérimentation en Haute-Savoie depuis 2005 et constaté, comme à l’étranger, une réduction du taux de récidive de 60 à 90 % de la conduite en état d’alcoolémie, à condition de coupler la mesure avec un accompagnement et un suivi médical en cas d’addiction. Nous avons donc fait du lobbying lors de l’élaboration de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et nous nous occupons maintenant de la mise en œuvre des mesures d’application. L’avantage est de réduire le risque tout en permettant aux personnes concernées de continuer à conduire, ce qui est déterminant sur le plan économique et social.
M. Jean-Yves Salaün, délégué général de l’Association Prévention routière. Les éthylotests devaient aussi être rendus obligatoires dans tous les lieux vendant de l’alcool, mais la mesure d’application a pris beaucoup de retard. Le décret paru il y a quelques jours ne concerne que les établissements fermant après deux heures du matin. Il faut l’étendre à tous ceux qui vendent de l’alcool, sans oublier les associations, même pour une soirée. Dès lors qu’on vend de l’alcool, les consommateurs doivent avoir la possibilité de se tester.
M. le rapporteur. Dans les restaurants aussi ?
M. Jean-Yves Salaün. Oui.
M. Bernard Pottier. Dans ce domaine, il y a un changement très net : on n’hésite plus à manger au restaurant sans commander de vin. Mais il y a aussi d’autres évolutions, comme le binge drinking, la « défonce », qui vient des pays du nord et consiste à s’enivrer jusqu’à la limite ultime. Les jeunes Français le pratiquent moins que dans d’autres pays, mais ils prennent davantage le volant ensuite, d’où toutes nos actions « capitaine de soirée ».
Un autre problème nous préoccupe beaucoup : le téléphone – c’est-à-dire aussi les SMS, le GPS, la messagerie… Les gens ont pris l’habitude de tous ces usages et leur voiture est devenue un bureau, au détriment de la conduite. Pour nous, le kit mains-libres est pratiquement aussi dangereux que le téléphone tenu en main. Un certain nombre de pays, comme la Grande-Bretagne, interrogent les opérateurs à chaque accident pour savoir si une communication était en cours. Or, à chaque fois que nous en avons parlé avec les pouvoirs publics français, on nous a répondu que c’était très difficile à réaliser… C’est pourtant indispensable, face à une tendance qui se développe à grande vitesse. Le discours en la matière doit être plus net. L’action peut d’ailleurs aussi passer par les entreprises : certaines, par exemple, interdisent à leurs directeurs commerciaux d’appeler leurs représentants alors qu’ils sont en train de conduire.
M. le président Armand Jung. Vous êtes donc contre le kit mains-libres.
M. Bernard Pottier. Absolument contre. Les études montrent bien sûr une perte d’attention particulière lorsqu’on pianote son numéro, mais surtout une perte de concentration ensuite. Cela n’a rien à voir avec le cas où le conducteur discute avec son passager, parce que celui-ci voit la route en même temps que lui. Le directeur commercial qui dit à son VRP que son plus gros client est en train de le lâcher, lui, ne voit pas ce qui se passe. Les chercheurs ont mis en évidence en particulier un rétrécissement du champ visuel du conducteur.
Tout cela débouche sur une répression accrue, et je sais que c’est une véritable problématique. Notre vocation, c’est la prévention. Dire qu’éduquer les enfants en maternelle aurait permis de sauver autant de vies que les radars et le permis à points serait une vaste hypocrisie, mais si l’on veut dépasser un jour la peur du gendarme et obtenir un véritable changement des comportements, ce sera en enracinant dès le plus jeune âge des réflexes de route partagée. Tous les grands-parents ont entendu un jour un petit leur dire qu’ils n’avaient pas mis leur ceinture… Les réflexes doivent changer. Mais cela ne remplacera pas tout ce qu’il faut avoir le courage de faire en matière de contrôles, voire de sanctions.
Pour ce qui est de l’éducation routière, nous touchons en gros un quart des générations en primaire, 10 à 15 % en collège et moins de 10 % dans les lycées. On nous a demandé de mettre l’accent sur ces derniers – c’est l’âge de tous les dangers : un de nos outils pédagogiques s’appelle d’ailleurs « alcool, cannabis et conduite » ! – et nous sommes en train de mener une expérience, suivie par la sécurité routière et par l’éducation nationale, qui mériterait d’être développée. Plus généralement, de la maternelle à la terminale, il faudrait consacrer une heure par mois à l’éducation routière. C’est pour nous une des formes modernes de l’éducation civique – dire que la vie en société, cela consiste à partager les choses, y compris sur la route. Nous avons aussi obtenu la mise en place de référents dans les collèges et lycées, ils sont en train de s’installer.
M. Jean-Yves Salaün. Il ressort de l’expérimentation que nous conduisons actuellement qu’il est très difficile de faire une place à l’éducation routière dans les lycées, tant les programmes sont chargés. C’est pourtant vraiment le moment de tous les risques. Nous avions réussi à la faire entrer davantage dans les collèges en rendant obligatoire l’attestation scolaire de sécurité routière, et en primaire en créant l’attestation de première éducation à la route. On pourrait donc, comme il en a été question lors du dernier comité interministériel de la sécurité routière, imaginer un module de sécurité routière obligatoire dans les lycées. Face aux réticences de l’éducation nationale, nous avions opté pour l’expérimentation mais il faut maintenant reposer la question. C’est au lycée qu’il faut parler des risques de l’alcool et des drogues et sans une telle obligation, ce sera difficile à implanter.
M. Bernard Pottier. Nous proposons depuis un certain temps de transformer le brevet de sécurité routière, nécessaire pour conduire un cyclomoteur, en véritable permis, qui implique une formation et des points. En passant au permis voiture, le jeune conserverait son crédit ou débit de points. Nous sommes conscients de ce que cela implique au niveau du fichier national du permis de conduire, mais il semble que la nouvelle option technique qui a été prise le permettrait. Certains préféreraient faire passer l’âge minimum pour conduire un cyclomoteur de 14 à 16 ans, comme c’est le cas dans beaucoup de pays européens. Mais il ressort d’une de nos études, certes pas très scientifique, qu’à 14 ans les jeunes, notamment les garçons, sont peut-être un peu moins frimeurs qu’à 16 ans et qu’il n’est pas forcément idiot de commencer à cet âge.
M. Jean-Yves Salaün. Pour ce qui est des relations entre les différents acteurs, le Gouvernement envisage de réactiver le Conseil national de la sécurité routière, qui a été un lieu de dialogue intéressant. L’époque était certes très différente : il s’agissait des quelques années d’un consensus qui était presque imposé par les résultats récurrents des actions de contrôle-sanction, alors que, depuis quelques mois, le doute s’est insinué dans certains esprits. Il est donc nécessaire de rétablir ce dialogue, et votre mission d’information y contribue d’ailleurs. Par exemple, la concertation lancée par Mme Merli sur la question des deux-roues motorisés aurait pu avoir lieu dans le cadre du Conseil national. Nous sommes plutôt favorables à sa remise en place.
M. Bernard Pottier. Quelle que soit l’organisation retenue, notre association est toujours entendue, même si elle n’est pas forcément suivie. Mais une instance institutionnalisée qui regroupe l’ensemble des acteurs a son importance.
M. le rapporteur. Ces acteurs, justement, nous en avons rencontré beaucoup : administrations, chercheurs, associations… avec, pour corollaire, un foisonnement de données. Est-ce une richesse ou faut-il rationaliser, synthétiser, clarifier ?
M. Jean-Yves Salaün. À une certaine époque, des chercheurs très pointus comme ceux de l’INRETS, l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, étaient davantage entendus que maintenant. Puis a émergé le discours politique sur la sécurité routière, concentré sur les objectifs. Peut-être faudrait-il mettre à nouveau l’accent sur les données techniques dont nous disposons. Aujourd’hui, en effet, tout le monde produit ses propres études, parfois contradictoires. Pourtant, certaines sont plus sérieuses que d’autres, telles celles qui montrent le parallèle entre la baisse des vitesses moyennes et celle du nombre de tués… La vitesse a en effet un statut très particulier : elle n’est pas toujours à l’origine d’un accident mais elle est toujours, on ne l’a pas suffisamment rappelé dernièrement, un facteur aggravant. Un accident causé par l’alcool aura des conséquences bien différentes suivant la vitesse du véhicule. Par ailleurs, le fait que la sécurité routière dépende maintenant du ministère de l’intérieur, alors que les chercheurs dépendent du ministère chargé des transports, rend sans doute un peu plus difficile la coordination entre les acteurs publics.
M. Bernard Pottier. Une association comme 40 millions d’automobilistes, qui a émergé ces dernières années, explique, par exemple, qu’il n’y a pas de lien entre la baisse de la mortalité et celle de la vitesse parce que c’est en 2003 que le nombre de tués a le plus diminué, alors qu’il n’y avait pas encore de radars. Mais, ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, les radars avaient été annoncés partout et les gens se méfiaient ! La baisse n’aurait pas duré bien longtemps si l’on avait continué sans vrais radars… Il faut donc prendre un peu de hauteur. Pour le reste, les données que produit l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière sont d’excellente qualité.
M. le rapporteur. Certains de nos interlocuteurs considèrent qu’on est arrivé avec 4 000 morts à un seuil qui n’est peut-être pas incompressible, mais très difficile à franchir par rapport à une population de 40 millions d’automobilistes, considérant, en outre, que 75 % d’entre eux ont leurs douze points et que les comportements, au restaurant comme sur la route, ont beaucoup évolué. Bref, on aurait fait tous les gains de bon sens possibles depuis 2002 et les progrès seraient maintenant beaucoup plus difficiles à obtenir. Est-ce votre sentiment ?
M. Bernard Pottier. Pas du tout. L’objectif de 3 000 morts fixé par le Président de la République correspond à 47 tués par million d’habitants alors que la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont respectivement à 28, 31 et 32. Nous avons donc un potentiel considérable. D’ailleurs, depuis que nous avons montré qu’il était possible d’être latin et de faire des progrès, les Espagnols et les Portugais ont fait encore mieux que nous – l’Espagne a moins de morts que la France par rapport à la population. Cet objectif ne sera pas atteint avec des discours comme en ont proféré certains parlementaires, très démobilisateurs. Il ne le sera pas non plus avec la seule conjonction du permis à points et des radars : les implantations doivent continuer, mais il faudra dorénavant mener une action plus diversifiée. En tout état de cause, cet objectif est réaliste.
M. le président Armand Jung. Je suis particulièrement sensible à cet optimisme, nous voulons continuer à faire baisser les chiffres.
M. le rapporteur. Les mesures en cours, que certains proposent de durcir, sont-elles adaptées à la bonne cible ? Par exemple, il semble que l’alcool soit la cause de 30 % des accidents mortels mais ne fasse l’objet que de 9 % des poursuites, la majorité de celles-ci concernant la vitesse, et particulièrement les petits excès de vitesse. S’il faut, bien sûr, maintenir l’effort sur la vitesse, faut-il vraiment le durcir, sans être sûr d’y trouver des marges de progrès très importantes, plutôt que de chercher des réponses plus adéquates en matière d’alcool, où l’on est loin du compte ?
M. Bernard Pottier. C’est vrai : la somnolence est la première cause d’accidents mortels sur autoroute, et il n’y a pas de radar contre la fatigue. Mais ce que nous savons depuis 2002, c’est que face à une irresponsabilité de masse, il faut une réponse de masse. On l’a trouvée pour la vitesse, pas pour un certain nombre d’autres causes d’accidents. Dès qu’on parle de cible, on oublie l’ensemble des usagers pour se concentrer sur les grands chauffards. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Ce qui a permis de faire des progrès, c’est de dire que tout le monde est responsable. Encore une fois, lorsqu’on roule aujourd’hui à la limite de vitesse sur une autoroute, on est doublé par beaucoup plus de gens qu’il y a quelque temps, peu après 2002.
M. le rapporteur. Pour quelles raisons ?
M. Bernard Pottier. Notamment, pas exclusivement, l’utilisation des TomTom, Coyote et autres. Ils ont leur utilité pour avertir qu’on dépasse la vitesse autorisée, ou qu’elle passe de 110 km/h à 90, mais ils ne doivent pas informer de la présence d’un radar mobile. Il faut se montrer indulgent à l’endroit de la distraction, pas des gens qui enfreignent volontairement, systématiquement, les limitations de vitesse – et il y en a.
M. le président Armand Jung. Merci pour la franchise et la clarté de vos propos.
M. Bernard Pottier. La volonté politique est prépondérante dans ce domaine. Nous attendons ardemment que vous rétablissiez le message qui a été brouillé par certains.
M. le président Armand Jung. C’est notre volonté.
*
* *
Auditon du Général Éric Darras, sous-directeur à la sécurité publique et à la sécurité routière, et du colonel Gérard Escolano, chef du bureau de la sécurité routière et des formations et moyens spécialisés (Gendarmerie nationale)
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, mon général, mon colonel, d’avoir bien voulu participer à nos travaux.
En matière d’accidentologie, vous êtes en première ligne. Nous souhaiterions mener avec vous une analyse au plus près des faits, qui permettra à notre mission d’information de faire des propositions au Gouvernement et au ministre de l’intérieur.
M. le général Éric Darras, sous-directeur à la sécurité publique et à la sécurité routière (Gendarmerie nationale). Quelques mots tout d’abord concernant le bilan de l’action de la gendarmerie en matière de sécurité routière.
Les quatre premiers mois de 2011 ont été difficiles, notamment en raison de conditions météorologiques très différentes de celles de 2010 à la même période. Il y a assurément un lien de causalité entre ces conditions défavorables – enneigement, blocage des routes – et le nombre de tués. Les résultats ont été ensuite plus favorables, si bien que le bilan des tués sur les huit premiers mois se situe à peu près au niveau de celui des huit premiers mois de 2010, avec une augmentation légère de 1,5 % que nous allons nous employer à résorber avant la fin de l’année.
En matière de contrôle et de répression, la gendarmerie a accru son effort. Les actions entreprises reposent sur les unités à vocation généraliste et celles – pelotons d’autoroute, brigades motorisées – dont la mission première est la sécurité routière. Toujours sur les huit premiers mois de l’année, le nombre d’infractions constatées a augmenté de près de 23 % par rapport à la période correspondante de 2010.
Environ 43 000 gendarmes participent à cette mission, partagée en parts égales entre unités territoriales et unités spécialisées. La gendarmerie souhaite rationaliser l’implantation et l’organisation des unités de sécurité routière, notamment en ramenant le nombre de pelotons d’autoroute à une trentaine pour privilégier une action sur le réseau secondaire. Les brigades rapides d’intervention bénéficieront de la livraison échelonnée de nouveaux véhicules rapides.
Au sein des missions de la gendarmerie, la sécurité routière représente 15 % de l’activité. La révision générale des politiques publiques a eu un impact, avec une diminution d’effectif à hauteur de 350 équivalents temps plein, soit l’équivalent de 10 % de la capacité des unités spécialisées. En dépit de cet effort consenti par la gendarmerie, les résultats sont comparables à ceux de l’année dernière.
S’agissant maintenant des causes des accidents, notre système d’analyse statistique montre que les principales infractions à l’origine d’accidents sont la vitesse pour 24 %, l’alcool pour 10 % et les refus de priorité pour 15 %. À côté de ces causes que nous appelons « directes et définies », on peut relever aussi toutes sortes de défauts de vigilance – par exemple le changement d’un CD, l’endormissement du conducteur, etc. – pour lesquelles il semble difficile de mener une action ciblée.
Notre action répressive et préventive porte donc principalement sur la vitesse et l’alcool.
La mise en œuvre des systèmes automatisés de contrôle et de sanction a contribué à abaisser la vitesse moyenne de circulation de 91 km/h en 2002 à 81 km/h en 2010, ce qui a eu pour conséquence directe la diminution du nombre de tués. Il est également à noter que 90 % des titulaires de permis de conduire disposent d’un capital supérieur ou égal à 10 points. En matière de vitesse, la stratégie de la gendarmerie est double. Premièrement, des contrôles de vitesse avec interception, en utilisant des radars embarqués, automatiques ou portatifs. Deuxièmement, la traque des délinquants routiers à bord de véhicules banalisés – motocyclettes, véhicules légers – afin de cibler les infractions liées aux comportements, comme le téléphone au volant.
S’agissant de l’alcoolémie et des stupéfiants, je rappelle que l’alcool est devenu en 2010 la première cause d’accidents mortels. Ce constat a amené la gendarmerie à accroître le nombre de contrôles avec tous les moyens qui sont à sa disposition – éthylomètres, éthylotests – et à renforcer les actions à caractère plus préventif, notamment à la sortie des discothèques. Le dépistage des stupéfiants, en place depuis deux ans, commence à donner de bons résultats. Alors que ces contrôles nécessitent actuellement la présence d’un médecin, ce qui alourdit considérablement la procédure, la mesure décidée par le dernier CICR – comité interministériel de la sécurité routière – prévoit la réquisition d’un infirmier.
Compte tenu de la priorité que constitue la sécurité routière, le directeur général de la gendarmerie nationale a souhaité recentrer l’action des gendarmes sur leur « cœur de métier ». Ainsi, nous avons de plus en plus recours à des réservistes, nous nous désengageons progressivement de missions périphériques – notamment la gestion du réseau d’appel d’urgence des autoroutes, ce qui a permis de réaffecter des gendarmes sur le terrain –, nous avons supprimé les « plantons » des pelotons d’autoroutes, etc.
Notre effort est également très important dans le champ de la prévention, qui se divise en deux approches.
La prévention en aval tout d’abord. C’est celle que nous menons a posteriori sur les circonstances d’un accident ou lorsqu’une infraction a été commise, pour en tirer les enseignements, si possible avec les personnes impliquées.
La prévention en amont ensuite.
En premier lieu, elle consiste en une présence visible sur le terrain – celle qui provoque la fameuse « peur du gendarme » –, au bord des routes, dans les postes de surveillance ou de régulation, dans les patrouilles. Cette présence doit être autant que possible ciblée dans le cadre espace-temps.
Au-delà de cette prévention opérationnelle, nous participons à la prévention éducative en partenariat avec tous les acteurs de la lutte contre l’insécurité routière. Les militaires de la gendarmerie donnent des conférences et dispensent des formations dans les collèges, les lycées, les entreprises, les associations, ils organisent les pistes d’éducation routière, délivrent les attestations de première éducation à la route, le brevet de sécurité routière, etc. Nous considérons que c’est dès l’enfance que les bonnes habitudes doivent être prises.
En aval, notre action se situe dans le cadre des enquêtes « Comprendre pour agir », diligentées notamment dans le cas d’accidents mortels ou très graves afin d’éclairer les responsables départementaux et d’alimenter le programme « Agir pour la sécurité routière », destiné à appuyer la mobilisation et les initiatives de l’ensemble des acteurs locaux.
La prévention est, dans notre esprit, le complément indispensable de l’action répressive, d’autant plus indispensable que l’objectif qui nous est fixé devient plus difficile à atteindre compte tenu des bons résultats déjà obtenus. Il existe encore des gisements qui permettront de réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes, mais il faudra pour cela utiliser tous les instruments à notre disposition. De ce point de vue, nous croyons que la prévention, notamment auprès des plus jeunes de nos concitoyens, offre des perspectives prometteuses.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Comme beaucoup de nos interlocuteurs, vous constatez qu’avec 4 000 tués par an – pour 40 millions d’automobilistes –, on est arrivé, non pas à un seuil, mais du moins à un point dur qui nécessitera des actions plus spécifiques si l’on veut obtenir une nouvelle réduction.
D’autre part, alors que l’alcool est désormais la première cause d’accidents mortels – 30 % –, l’alcoolémie correspond à environ 9 % des infractions poursuivies, contre 70 % pour les excès de vitesse. Cette inadéquation a provoqué le débat qui a abouti à la création de notre mission d’information. Les forces de l’ordre effectuent 10 à 11 millions de contrôles d’alcoolémie par an. S’agissant de la gendarmerie, vous paraît-il possible d’aller au-delà ?
Enfin, considérez-vous qu’il serait opportun de créer une police de la route, comme certains professionnels le réclament ?
M. le général Éric Darras. Si l’on va plus loin en matière de contrôles d’alcoolémie, ce sera dans la limite des effectifs dont nous disposons et des « heures-gendarme » affectées à la mission. Il pourrait donc y avoir un effet sur d’autres champs infractionnels, comme la vitesse.
Pour être efficaces, les contrôles d’alcoolémie doivent être ciblés dans l’espace mais surtout dans le temps. À 10 heures du matin, un contrôle d’alcoolémie n’a guère de sens alors qu’un contrôle de vitesse est pertinent à toute heure. Pour ce qui est de l’approche spatiale, sans doute est-il préférable de mettre l’accent sur le réseau secondaire plutôt que sur l’autoroute, dans la mesure où les personnes qui savent qu’elles feront un long trajet sont peut-être plus vigilantes en matière d’alcool.
Bref, la conception des contrôles d’alcoolémie doit faire l’objet d’une approche très fine. Il est vrai que ces contrôles se font souvent le vendredi et le samedi soir, aux abords des discothèques, et qu’ils sont de ce fait un peu moins visibles que les contrôles de vitesse pour la plupart de nos concitoyens. Un effort supplémentaire peut être fait s’agissant de l’alcoolémie, à la condition expresse que les contrôles se fassent dans des conditions spatio-temporelles intelligemment déterminées.
M. le rapporteur. La gendarmerie dispose-t-elle de moyens suffisants en effectifs pour mener plus de contrôles, de manière à ce que la « peur du gendarme » puisse véritablement jouer ? Si, à l’heure actuelle, les personnes sortant de boîte de nuit savent qu’elles ont un risque sérieux d’être contrôlées, la plupart de nos concitoyens se disent en revanche qu’après un repas arrosé, ils ont peu de chances d’être contrôlés sur le trajet du retour. Bien entendu, il appartient aux professionnels de décider de la manière d’opérer, mais leurs effectifs leur permettent-ils de faire plus ?
M. le colonel Gérard Escolano, chef du bureau de la sécurité routière et des formations et moyens spécialisés (Gendarmerie nationale). L’effort peut encore être accru puisque, sur les 8 premiers mois de 2011, le nombre de dépistages a augmenté de 3 %. De plus, il existe désormais sur le marché un matériel permettant d’effectuer un pré-ciblage rapide des personnes susceptibles d’avoir consommé de l’alcool, sans avoir à utiliser l’éthylotest – qui suppose que l’on souffle dans certaines conditions. Au moyen de cet appareil, qui détermine seulement si l’haleine du conducteur contient ou non de l’alcool, on peut réaliser un premier aiguillage en distinguant les personnes qui n’ont pas du tout consommé de celles qui ont consommé, à charge d’établir ensuite si l’alcoolémie est verbalisable. Cela nous permettra d’augmenter le nombre de personnes évaluées.
Pour ce qui est des effectifs, nous savons bien que le contexte est difficile. Faire plus dans un domaine suppose peut-être de faire un peu moins dans un autre, mais suppose surtout que nous examinions, dans notre environnement de travail, ce qui mérite d’être changé pour nous permettre de nous consacrer, dans de meilleures conditions, à ce qui est vraiment prioritaire.
M. le général Éric Darras. La police de la route est déjà assurée par la gendarmerie et par la police. Je ne vois pas la plus-value qu’apporterait la création d’un service unique chargé de l’action répressive et préventive. Les deux forces actuelles exercent cette mission dans leurs zones de compétence respectives et je sais d’expérience que les dispositifs de coordination fonctionnent plutôt bien. Les nouveaux protocoles de coordination opérationnelle renforcée entre les agglomérations et les territoires – CORAT –, en cours de signature, portent non seulement sur la délinquance mais aussi sur la sécurité routière.
Bref, pour ce qui est de la gendarmerie, aucune réflexion n’est à l’ordre du jour concernant la création d’un corps spécifique de police de la route.
M. le rapporteur. Ceux qui y songent invoquent la valorisation des professionnels. Par exemple, les CRS affectés à la route semblent être moins considérés que ceux qui sont affectés au maintien de l’ordre.
M. le général Éric Darras. Nous n’avons pas connaissance de tels éléments. Les unités de gendarmerie affectées spécifiquement à la route ont une mission, non pas de police de la route, mais de police sur la route qui englobe tous les types de délinquance. Le dispositif est cohérent et s’intègre parfaitement dans notre organisation territoriale, en visant tous les cas de délinquance sur le secteur autoroutier. Une police qui ne s’occuperait que de sécurité routière aurait un champ d’action restreint, alors qu’il faut pouvoir intervenir sur des phénomènes qui concernent également les unités territoriales. La délinquance peut en effet arriver sur le secteur routier, et donc intéresser les professionnels qui y œuvrent en permanence. Il est important que ceux-ci appartiennent à la même communauté que les unités territoriales.
M. le colonel Gérard Escolano. L’action de sécurité routière est assurée par des unités de gendarmerie dont c’est la vocation, mais aussi, pour une large part, par des unités à vocation « généraliste ». Le périmètre de compétence d’une brigade territoriale inclut tout à la fois des missions de police judiciaire et de surveillance générale, une action de proximité et la sécurité routière. Si l’on créait une police de la route spécifique, faudrait-il envisager de retirer la mission de sécurité routière à ces brigades, qui couvrent pourtant 95 % du territoire ? Je doute que l’on y gagne.
M. Christian Vanneste. L’usage du cannabis présente des problèmes nouveaux de sécurité routière. Il semblerait que les moyens de contrôle soient moins nombreux et plus coûteux qu’en matière d’alcoolémie. Alors que les dangers du cannabis et de l’alcool pour la conduite sont similaires, il n’y aurait pas égalité de traitement. Pourriez-vous préciser les moyens dont vous disposez et l’emploi que vous en faites ?
Pour ce qui est des contrôles, l’idée est de cibler les actions sur les situations les plus accidentogènes. On le sait, ce sont les 18-25 ans qui paient le plus lourd tribut, très souvent lors des sorties du samedi soir. Vous arrive-t-il de mener des opérations « coup de poing », avec des contrôles massifs ayant un effet véritablement dissuasif ?
Enfin, certains véhicules échappent plus que d’autres au contrôle et à la sanction. Il y a le cas des deux roues, mais aussi et surtout le problème de l’impunité des conducteurs étrangers. La mise en œuvre d’accords avec certains pays constitue un progrès, certes, mais ces accords sont ponctuels. Il arrive que les conducteurs venant de grands pays où la vitesse n’est pas limitée sur autoroute continuent sur leur lancée en traversant notre territoire. Ils ne sont guère contrôlés – encore faudrait-il que la gendarmerie dispose de véhicules rapides en nombre suffisant – et, lorsqu’ils le sont, ils ne sont pas punis.
M. le général Éric Darras. Pour ce qui est de l’action en direction du public jeune, notamment à la sortie des discothèques, je peux vous faire part de mon expérience de colonel en charge du groupement de la Corrèze pendant trois ans et, auparavant, de commandant de compagnie en Normandie. En association étroite avec les gérants des établissements, nous conduisons, le vendredi et le samedi soir, des opérations ciblées sur l’information des jeunes, en les accompagnant parfois de contrôles sur les routes habituellement empruntées à la sortie de la discothèque ou aux alentours, notamment sur les routes qui la contournent.
M. le colonel Gérard Escolano. La question des stupéfiants appelle les mêmes remarques que celle de l’alcoolémie. En 2011, nous avons presque multiplié par deux le nombre des contrôles dans le domaine des stupéfiants. La gendarmerie continue de se donner les moyens de ces interventions, et ce d’autant plus que les accidents corporels feront désormais l’objet d’un dépistage systématique des stupéfiants au même titre que l’alcool.
Même si nous progressons plus rapidement, nous sommes sans doute dans la même situation que celle qui prévalait, il y a plusieurs décennies, en matière de contrôle d’alcoolémie. Lorsque nous avons dû mettre en place des moyens matériels, il n’existait sur le marché que très peu de kits de contrôle. Nous avons choisi à l’époque le meilleur produit. Aujourd’hui, alors que nous mettons à l’étude un nouveau marché, nous sommes confiants quant aux propositions que les entreprises nous feront car les matériels ont bien évolué.
Il existe également des dispositifs analogues à l’éthylomètre, c’est-à-dire faisant l’objet d’une homologation et fournissant des mesures qui permettraient de valider une verbalisation. Sans doute serait-il intéressant d’étudier les conditions et le cadre législatif dans lesquels on pourrait mettre en œuvre de tels appareils.
Enfin, les mesures décidées récemment permettront de procéder plus rapidement à une prise de sang après que l’on aura constaté qu’un conducteur est sous l’emprise de stupéfiants. Cette accélération de la procédure permettra aux personnels ayant conduit l’intervention de retourner plus vite sur le terrain.
J’en viens à la question des véhicules étrangers qui échappent aux sanctions. C’est une réalité indéniable. Un quart des infractions concernant les limitations de vitesse sont le fait de véhicules immatriculés à l’étranger. Pour la période estivale, le chiffre s’élève à 2 millions de véhicules. Pour répondre à cet enjeu considérable, des décisions ont été prises au niveau européen et la perspective d’une transmission d’informations relatives à ces infractions commence à se dessiner. Demain, le centre de traitement automatisé de Rennes pourra transmettre l’immatriculation des véhicules aux pays européens qui se seront associés à l’opération, en vue du traitement de l’infraction.
Un autre dispositif, le lecteur automatique de plaques d’immatriculation, pourrait aider à la lutte contre ce phénomène. Pour l’heure, il n’est pas ouvert à la sécurité routière. S’il l’était, il nous permettrait de constituer, avec toutes les garanties prévues par la loi, une base de données sur les véhicules impliqués dans des délits et nous pourrions les intercepter lors de leur passage sur le territoire.
Nous entendons également multiplier les interceptions afin de verbaliser sur-le-champ le conducteur en infraction.
On peut enfin recourir à une enquête judiciaire pour essayer d’identifier les conducteurs qui commettent régulièrement des infractions, mais la procédure est beaucoup plus longue.
M. le rapporteur. Bref, ce n’est pas encore au point...
M. le colonel Gérard Escolano. Il y a encore du travail à faire.
M. le rapporteur. En matière de politique de sécurité routière, on parle beaucoup d’acceptabilité sociale : une mesure ne serait appliquée, et donc efficace, que lorsqu’elle est comprise et acceptée ; au contraire, le rejet poserait des problèmes en termes d’efficacité. Les petits excès de vitesse, notamment, ont été au centre du débat après les mesures prises par le CISR au mois de mai. Que pensez-vous de cette notion d’acceptabilité sociale ?
Par ailleurs, nos concitoyens disent souvent qu’ils veulent bien être contrôlés, mais pas piégés comme ils en ont souvent le sentiment en matière de contrôle de vitesse. Selon eux, il arrive que les forces de police ou de gendarmerie se cachent – une circulaire ancienne, aujourd’hui abrogée, demandaient d’ailleurs aux forces de l’ordre de ne pas se mettre volontairement en situation de piège – ou pratiquent des contrôles à des endroits où la route n’est pas lisible : par exemple sur une route à quatre voies où la limitation de vitesse passe de 110 à 90 km/h sur quelques centaines de mètres, sans que l’on sache toujours très bien pourquoi.
Avez-vous des instructions particulières à ce sujet ? Quelle est votre opinion concernant ce sentiment de certain de nos concitoyens ? Existe-t-il, de fait, des méthodes de piégeage ? Il semblerait qu’il existe des instructions, y compris en provenance du Gouvernement, pour « faire du chiffre ». Il n’y a rien d’anormal à exiger des résultats de la part d’une administration. Mais on peut être alors tenté de se placer là où la pêche sera la plus prometteuse...
M. le général Éric Darras. J’opposerai à l’exemple de l’acceptabilité sociale des petits excès de vitesse celui de l’acceptabilité de l’insécurité routière et des tués sur les routes. La répression des excès de vitesse, petits ou moyens, peut en effet donner l’impression d’un acharnement des forces de l’ordre, d’une volonté de piéger l’automobiliste ou de « faire du chiffre ». Mais cette logique est totalement étrangère à la conception du service qui prévaut dans la gendarmerie en matière de sécurité routière. Nous ne sommes pas là pour piéger les gens mais pour les protéger, qu’il s’agisse de sécurité routière ou qu’il s’agisse d’autres formes de délinquance. Peut-être un sentiment est-il en train de se développer à se sujet dans la population, mais j’affirme que nous ne recherchons en aucun cas le piégeage.
Par ailleurs, la question de l’harmonisation des limitations de vitesse, pour laquelle une volonté s’est exprimée, est du ressort des élus et non de la gendarmerie ou de la police.
Je le répète, la présence de la gendarmerie au bord des routes est organisée dans un esprit de ciblage. Que de petits excès de vitesse soient sanctionnés, cela arrive, bien sûr. Mais si les conducteurs échappent à toute verbalisation en roulant à 10 km/h au-delà de la limite – ce qui est déjà beaucoup –, ils risquent de s’autoriser, quelques kilomètres plus loin, un dépassement beaucoup plus important.
En tout état de cause, je m’inscris en faux contre l’idée d’acharnement ou de piégeage.
M. le rapporteur. Ce sentiment peut venir du fait que 70 % des infractions relevées sont liées à la vitesse, notamment aux petits excès de vitesse. Il n’y a rien que de très logique à cela : il suffit de machines pour les constater alors que les contrôles d’alcoolémie mobilisent des effectifs pour appliquer la procédure. Il en résulte une inadéquation entre le taux de poursuite en matière de vitesse et en matière d’alcoolémie et le caractère accidentogène de chacune de ces deux infractions.
Si je vous entends bien, donc, il n’existe pas de dissimulation manifeste du contrôle ou de volonté de situer les contrôles à des endroits particulièrement propices à la constatation d’infractions...
M. le général Éric Darras. Notre priorité, je l’ai dit, est le ciblage dans l’espace et dans le temps. Nous n’avons plus les moyens de faire des contrôles n’importe où, d’autant que le nombre de tués et d’accidents reste très important. Nous ne nous installons pas à un endroit pour « faire du chiffre ».
M. le rapporteur. Pourtant, ce sont des situations que tous les automobilistes peuvent voir. Ce n’est pas une pure invention !
M. le général Éric Darras. Peut-être cela a-t-il pu être constaté, mais, je le répète, ce n’est pas ce qui inspire l’action répressive de la gendarmerie sur le terrain.
M. le colonel Gérard Escolano. Pour ma part, en huit ans de responsabilités dans des groupements, il ne m’est jamais arrivé de donner des directives visant à placer des contrôles pour faire « rentrer » un nombre important d’infractions. Sans doute peut-il arriver que l’interprétation soit différente localement, mais le mot d’ordre ne varie pas : les forces de l’ordre doivent se placer là où leur présence permettra d’abaisser le nombre de tués, c’est-à-dire de sauver des vies. Si leur présence visible pendant un laps de temps donné, sans enregistrer aucune infraction, permet d’éviter un accident mortel, elles auront été efficaces.
Assurément, le volume des infractions traitées augmente car nos moyens nous permettent de travailler un peu plus vite. Nous souhaitons que ces moyens s’accroissent afin de cibler encore mieux notre présence sur le terrain.
M. le rapporteur. De quels moyens parlez-vous ?
M. le colonel Gérard Escolano. Le procès-verbal électronique, par exemple, nous évitera d’avoir à gérer le procès-verbal une fois l’infraction relevée. Ce type de gain technologique nous permet de recentrer notre action. Pour le reste, notre objectif est de trouver le meilleur positionnement pour identifier et intercepter les conducteurs véritablement en marge, dont certains sont coutumiers de ces comportements et profitent des failles du système. Si notre action semble un peu moins lisible, c’est justement parce que nous ne ciblons pas monsieur Tout-le-monde, mais les automobilistes qui se refusent systématiquement à respecter les règles et qui sont de vrais dangers. Leur interception dans de bonnes conditions de sécurité et l’établissement de l’infraction avec certitude suppose le déploiement de toute une stratégie sur le terrain.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de nous avoir apporté ces informations sur votre action et de nous avoir fait part de votre point de vue.
*
* *
Audition de M. Didier Bollecker, président, et de Roger Braun, directeur général de l’Automobile Club - Association française des automobilistes
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons nos auditions relatives aux causes des accidents et à la prévention routière en accueillant les représentants de l’Automobile Club.
Nous avons déjà eu l’occasion de nous rencontrer lors d’une réunion décentralisée. Je vous propose, messieurs, d’aller encore plus loin, de nous faire partager votre expertise et votre connaissance de l’automobile et des automobilistes, et de nous présenter des propositions qui nous aideront à rédiger le rapport que nous allons remettre au Gouvernement.
M. Didier Bollecker, président de l’Automobile Club - Association française des automobilistes. L’Association Automobile Club est issue du regroupement de l’Automobile Club d’Alsace et d’une vingtaine d’autres Automobile-Clubs avec la Fédération française des Automobile-Clubs, à l’époque présidée par Christian Gérondeau, toujours membre de notre comité de direction.
Avec un peu plus de 700 000 membres cotisants, l’Automobile Club est probablement la première organisation représentative des automobilistes. À ce titre, elle est membre de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), au sein de laquelle j’exerce des fonctions de juge auprès du tribunal international et de membre de l’Euroboard. Je suis également membre du conseil d’administration du fonds de garantie automobile, ce qui me permet d’aborder les questions de sécurité routière dans les circonstances particulières que constitue le défaut d’assurance.
L’Automobile Club se préoccupe de sécurité routière depuis maintenant 110 ans. Nous avons donc une certaine expérience et nous avons eu l’occasion d’observer de près le comportement de cet « homo mobilis » spécial qu’est le conducteur.
Un accident fait toujours intervenir trois facteurs : le conducteur, la voiture et les infrastructures. Les réflexions dont je souhaite vous faire part relèvent de ces trois domaines.
Je commencerai par la route, lieu où survient le drame. Les infrastructures ne sont pas toutes égales. En effet, sur le nombre total des accidents mortels, 6 % surviennent sur l’autoroute, 9 % sur les routes nationales, 66 % sur les routes départementales et 19 % sur les voieries communales et urbaines. Si nous pondérons ces chiffres par le kilométrage et le trafic, cela signifie qu’il est huit fois plus dangereux – avec le même véhicule et le même conducteur – de rouler sur une route départementale que sur une autoroute. L’infrastructure a donc une importance considérable.
C’est pour cette raison que la Fédération internationale de l’automobile a développé le programme EuroRAP, qui procède à une analyse des routes au moyen d’un système perfectionné d’enregistrement portant sur la qualité des revêtements et la signalisation, analyse mise en corrélation avec des données d’accidentologie. Ce programme n’a pas d’effets directs sur la sécurité, mais il constitue un outil clair et indiscutable pour déterminer les zones à risques. Malheureusement, la France est l’un des rares pays européens à ne pas y participer. Nous demandons instamment que notre pays rejoigne le programme EuroRAP. J’ai d’ailleurs quelque honte à vous avouer que les seuls axes qui ont pu être examinés en France l’ont été par nos homologues étrangers, à leurs frais, sur la route des vacances de leurs ressortissants. Cette situation est inadmissible. Le Président Chirac avait indiqué que la France rejoindrait le programme, mais, depuis, on invoque des problèmes techniques ou le fait que les routes dépendent désormais des départements. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. Les moyens techniques et les données existent. Il faut que la France s’engage dans ce programme, d’autant qu’elle n’a pas à rougir de son réseau routier. Encore faut-il pouvoir détecter les points noirs.
J’en viens à un autre aspect des infrastructures, à savoir la notion de « route qui pardonne ». Des études suédoises ont montré que chaque conducteur commet, en conduisant, à peu près un geste erroné tous les 500 gestes – tourner le volant, changer de vitesse, actionner les phares, les essuie-glaces, etc… Cette donnée est statistique et, semble-t-il, irréductible. Un accident est donc la conjonction, dans un certain espace temps, de plusieurs gestes erronés, de la part du conducteur lui-même ou de celui qui vient en face. Il faut donc que la route pardonne : nous avons pour cela les rails de sécurité ou encore les pylônes protégés. Dans les pays scandinaves, il existe des glissières de sécurité sur des routes à deux voies. Dans la mesure où le conducteur est imparfait et le demeurera, la notion de route qui pardonne doit être prise en considération.
Le deuxième facteur d’accidents, ce sont les véhicules. Ceux-ci ont fait l’objet de progrès considérables – je pense à la ceinture de sécurité, introduite par Christian Gérondeau, aux cellules déformables en cas de choc, mises en évidence par le programme des crash tests, au fameux programme Euro NCAP, lui aussi initié par la FIA, à l’ESP, rendu obligatoire après une importante campagne de la FIA, et à bien d’autres aides électroniques. Les voitures d’aujourd’hui sont donc infiniment plus sûres que celles d’autrefois, même si cela peut avoir quelques effets pervers dans la mesure où plus confortables, plus silencieuses, elles peuvent entraîner la perte de la notion de risque pour le conducteur.
Ce tableau idyllique est quelque peu assombri par l’âge du parc automobile français. La France est, en effet, l’une des lanternes rouges de l’Europe dans ce domaine, puisque, depuis l’an dernier, l’âge moyen des véhicules a dépassé huit ans. Or, en huit ans, ont été accomplis d’importants progrès en matière de sécurité routière. C’est d’autant plus préoccupant que ce sont souvent les jeunes qui roulent dans de vieilles voitures et qui paient le plus lourd tribut à la sécurité routière. Il n’est pas admissible qu’un conducteur âgé soit simplement un jeune qui ait survécu.
Le facteur voiture me paraît donc globalement très en avance par rapport au dernier facteur, le conducteur. Le fossé se creuse entre le progrès technique et la formation du conducteur. Le viatique rose que l’on obtient lorsque l’on atteint sa dix-huitième année est en principe un permis à vie, alors que tout le monde s’accorde à dire qu’au lendemain de son permis de conduire, un conducteur ne sait pas conduire. Certes, il sait faire un créneau et respecter un certain nombre de règles, après avoir réussi à remplir son QCM sans faire plus de cinq ou six erreurs, mais il est clair qu’il ne sait pas conduire. Or, il va se retrouver dans le flux de la circulation. Que les jeunes paient un plus lourd tribut en matière de sécurité routière est malheureusement tout à fait normal parce qu’ils n’ont pas d’expérience, parce qu’ils roulent probablement dans un véhicule plus ancien et, enfin, parce que lorsqu’on est jeune, on n’a pas la même perception du risque que plus tard, lorsqu’on s’est un peu assagi.
Compte tenu de tous ces facteurs, il existe aujourd’hui un divorce complet entre la formation du conducteur et les nécessités réelles de la conduite. Le meilleur exemple à suivre en la matière est celui de l’Autriche, qui, en 2003, a mis en place un cursus obligatoire de formation des jeunes conducteurs dans les douze mois qui suivent l’obtention du permis de conduire. Il n’est pas question de modifier la formation initiale du permis de conduire mais de reprendre les acquis, après un an de circulation effective, lorsqu’on commence à croire qu’on sait conduire. Cette formation, obligatoire pour la validation définitive du permis, consiste à passer un certain nombre d’heures sur des pistes de sécurité routière, destinées à montrer au conducteur ses limites et à quel point il est facile de sortir de la route.
L’Automobile Club exploite sur l’ensemble du territoire français sept pistes de sécurité routière qui permettent de former annuellement environ 20 000 stagiaires.
En Autriche, l’expérience conduite a entraîné une diminution permanente de l’accidentologie des jeunes conducteurs de 30 %. C’est un résultat tangible, scientifiquement constaté, non équivoque, qui constitue une piste extrêmement sérieuse pour diminuer l’accidentologie en France, particulièrement celle des jeunes conducteurs. Nous préconisons donc d’instaurer en France, le plus rapidement possible, un stage obligatoire post-permis, qui pourrait être effectué avant même l’attribution des douze points.
Comme vous le savez, une directive européenne dispose que le permis de conduire n’est plus décerné à vie mais doit faire l’objet d’une validation tous les quinze ans. Mais la transposition nationale de cette directive permet aux États de procéder à un renouvellement purement administratif. Le moment est peut-être venu de réfléchir aux modalités de renouvellement du permis de conduire. Nous pourrions peut-être envisager un stage de remise à niveau, qui pourrait avoir lieu sur des pistes de sécurité routière, ou encore un examen de la vue – 44 % des accidents interviennent de nuit, ce qui laisse penser que de nombreux conducteurs ont des problèmes de vision. Voilà des pistes que nous pourrions suivre.
M. le président Armand Jung. Nous vous remercions pour la clarté de votre exposé, mais j’attire votre attention sur le fait qu’en Autriche, le nombre de tués sur les routes par million d’habitants est encore largement plus élevé qu’en France.
M. Didier Bollecker. Cela n’exclut pas l’efficacité des solutions mises en œuvre !
M. le président Armand Jung. Il est évident pour notre mission qu’il faut faire quelque chose pour améliorer la formation au permis de conduire.
Êtes-vous favorable au bridage des moteurs et au limiteur de vitesse LAVIA ? Selon vous, quel équipement convient-il de rendre obligatoire ?
M. Didier Bollecker. S’agissant du bridage des véhicules, je vous répondrai de façon quelque peu provocatrice : les seuls véhicules bridés commercialisés en Europe sont les véhicules allemands haut de gamme des marques BMW, Mercedes et Audi, mais ils sont bridés à 250 km/heure. En revanche, aucun véhicule français n’est bridé. Cette boutade mise à part, le fait de brider les véhicules à 150 km/heure ne serait pas une solution, même si techniquement elle est simplissime, car la majorité des accidents se produisent sur les routes nationales et les routes secondaires, là où la vitesse est limitée à 90 ou à 110 km/heure. Le bridage ne pourrait être efficace que pour les véhicules circulant sur l’autoroute.
Par ailleurs, on ne peut créer deux catégories de véhicules. Or le bridage des moteurs n’est envisageable que sur les véhicules nouveaux – sur les véhicules anciens, il faudrait brider la course de l’accélérateur, donc la puissance et la faculté de dépassement, qui est un gage de sécurité. Compte tenu de l’état du parc français, dont l’âge moyen est de huit ans – ce qui signifie que certains véhicules ont un an mais que d’autres en ont seize –, le délai nécessaire pour équiper l’ensemble des véhicules serait de seize ans, ce qui est considérable.
La troisième raison pour laquelle je suis défavorable au bridage des moteurs, c’est qu’il m’arrive de rouler en Allemagne à plus de 130 km/heure. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, mais j’en ai le droit. Il n’est pas envisageable de dire aux conducteurs que leur véhicule ne leur servira à rien à l’étranger. En outre, quelle devra être notre attitude vis-à-vis des véhicules étrangers qui, eux, ne seront pas bridés ? Or je viens d’entendre vos précédents intervenants indiquer que 24 % des infractions d’excès de vitesse concernent des véhicules étrangers. Pour toutes ces raisons, le bridage me paraît une fausse bonne idée.
Là encore, on veut suppléer à un défaut de formation – j’entends par formation la responsabilisation, voire le civisme des conducteurs. Allons-nous continuer à réprimer et à limiter ou allons-nous enfin nous engager dans la responsabilisation et la formation, comme le souhaite l’Automobile Club ?
Les aides électroniques qu’il conviendrait d’élargir à tous les véhicules sont nombreuses. On peut citer l’indicateur de franchissement de ligne continue, l’éthylomètre, le régulateur de distance. Quant au régulateur de vitesse, c’est un outil intéressant, mais le conducteur qui, sur l’autoroute, active son régulateur de vitesse en le fixant à 130 km/heure – en général, en dépassant légèrement cette vitesse – se laisse conduire par le véhicule. En ce qui me concerne, je n’utilise jamais le régulateur de vitesse sur autoroute car je le considère comme un facteur considérable d’endormissement, particulièrement la nuit lorsque la circulation est faible. La voiture roule toute seule. C’est très dangereux !
Le régulateur de distance, quant à lui, est un radar à effet doppler qui permet, en particulier sur l’autoroute, de maintenir une certaine distance – par exemple 75 mètres – entre votre véhicule et celui qui vous précède. Si ce véhicule accélère au-delà de 130, le vôtre restera à cette vitesse, mais s’il ralentit, votre véhicule ralentira pour conserver cette distance de 75 mètres. Il se trouve que mon véhicule est équipé de ce dispositif. Je l’ai testé cet été en Suisse, où les contrôles sont très fréquents. Il se trouve qu’un ralentissement brutal s’est produit, et la voiture a réagi avant moi. Le régulateur de distance est un dispositif très intéressant qui devrait être obligatoirement associé au régulateur de vitesse.
M. le président Armand Jung. Mais il n’est utile que sur l’autoroute.
M. Didier Bollecker. En effet. Il ne s’agit pas de demander aux constructeurs de l’installer car c’est un dispositif coûteux. Quant à l’ESP – l’électro-stabilisateur programmé –, il a été généralisé, et je m’en félicite car c’est un outil extraordinaire.
La première étape pourrait être l’avertisseur de franchissement de ligne continue, dont sont équipés quelques véhicules, notamment chez Citroën. Dès que le véhicule franchit une ligne continue – ou une ligne discontinue sans avoir activé le clignotant –, une vibration se produit dans le volant et dans le siège du conducteur. Ce n’est pas la panacée, mais c’est un progrès considérable, car beaucoup de gens déboîtent sans activer au préalable leur clignotant, tandis qu’un certain nombre de conducteurs franchissent les lignes continues.
M. le président Armand Jung. Quel serait, selon vous, le tableau de bord idéal ? Je m’étonne que des véhicules dont le coût dépasse les 30 000 euros soient encore équipés d’indicateurs analogiques.
M. Didier Bollecker. En matière d’ergonomie du tableau de bord, quelques tentatives ont été entreprises dans les années 1960-1970 – souvenez-vous du cadran rond composé d’une loupe installé sur la Citroën GS : les études ont montré que le conducteur avait une meilleure perception du cadran. Nous nous acheminons vers une nouvelle technologie qui va permettre de réduire le tableau de bord à un écran plasma, comme dans les avions. Le conducteur pourra organiser son écran comme il le souhaite – il lui sera par exemple possible de zoomer sur le compteur de vitesse, un peu comme sur un iPad. Mais je ne sais pas si cet outil aura un impact en matière de sécurité routière.
L’accessoire qui me paraît promis à un bel avenir est la projection des données sur le pare-brise, qui permet de visualiser des données sans perdre la route de vue. Ce dispositif représente à mes yeux un progrès considérable. Il sera d’autant plus utile si les véhicules sont équipés de systèmes de type LAVIA, qui communiqueront en permanence avec la voiture et donneront des indications au conducteur.
Je vous l’ai déjà indiqué, je suis opposé de façon rédhibitoire aux radars dits pédagogiques, car je trouve absurde de dépenser de l’argent pour indiquer aux conducteurs à quelle vitesse ils roulent, alors qu’il leur suffit de regarder leur compteur ! Vous pouvez m’objecter qu’ils ne regardent pas leur compteur, mais cela relève d’un problème de formation. En revanche, le système LAVIA me paraît être une excellente initiative, mais sa mise en place sur les routes et à l’intérieur des véhicules nécessitera des infrastructures très coûteuses, alors qu’un grand nombre d’accidents, j’en suis persuadé, pourraient être évités en améliorant la formation. Je crains qu’en agissant comme nous le faisons, nous continuions à déresponsabiliser les conducteurs.
M. le président Armand Jung. Notre rapporteur s’est souvent demandé pourquoi nous fabriquons des véhicules qui roulent à 250 km/heure pour ensuite mettre en place une batterie de dispositifs techniques afin de réduire la vitesse de ces véhicules.
Concernant l’ergonomie du tableau de bord, nous n’avons cessé d’entendre au cours de nos auditions l’argument selon lequel il faut avoir les yeux « rivés » sur le tableau de bord pour veiller à ne pas dépasser la vitesse autorisée. Il serait pourtant facile, pour les constructeurs, d’améliorer le tableau de bord, mais cela leur coûte cher et ils jugent plus valorisant de proposer des techniques plus sophistiquées.
Le système LAVIA est un bridage intelligent qui, selon nos informations, ne coûte pas très cher. Le problème est que nous ne disposons pas en France des cartes électroniques contenant l’ensemble des limitations de vitesse. Je crois pourtant, pour ma part, que notre pays est tout à fait capable de mettre en place cette cartographie électronique, indispensable à la réussite de ce type de limiteur de vitesse.
M. Didier Bollecker. Selon les chiffres de l’Observateur interministériel de la sécurité routière, les excès de vitesse supérieurs à 50 km/heure représentent 0,07 %, les excès supérieurs à 40 km/heure 0,2 %, et ceux supérieurs à 30 km/heure 0,6 %. Leur cumul n’atteint même pas 1 % ! Dans ces conditions, est-il opportun de mettre en œuvre des dispositifs comme le LAVIA ? Quant au bridage, cela reviendrait, à mon avis, à écraser une mouche avec un marteau-pilon !
M. le président Armand Jung. Si nous poussons votre raisonnement jusqu’au bout, on peut s’interroger sur la nécessité d’imposer des limitations de vitesse ? Mais pour cela, il faudrait que tous les conducteurs aient un comportement idéal ; or ce n’est pas le cas. Voilà pourquoi nous cherchons ce qui peut être amélioré.
M. Didier Bollecker. Il est vrai que le comportement des conducteurs n’est pas idéal et doit être amélioré. Pour autant, nous pourrions alléger notre réglementation. Certains pays expérimentent la suppression des feux tricolores en agglomération, et cela donne d’assez bons résultats : au lieu de passer au vert sans vérifier qu’aucun véhicule n’a grillé le feu rouge, tout le monde ralentit.
Si le Gouvernement annonçait sa décision d’imposer le bridage des véhicules, cela porterait un coup rude aux constructeurs français et aurait une incidence en matière de sécurité routière. Les États-Unis sont le premier pays à avoir introduit des limitations drastiques sur autoroute. Or cette mesure a totalement arrêté les progrès technologiques des voitures américaines, qui n’ont absolument pas les mêmes capacités techniques que les voitures européennes. Cela montre que certaines mesures risquent de freiner les progrès en matière de sécurité routière.
Nous sommes parvenus à un phénomène de seuil. Une voiture puissante, bien insonorisée et confortable, provoque l’endormissement du conducteur et la perte de la notion du risque. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut en revenir à la 4 CV, bruyante, mal amortie et qui freinait mal. Nous devons assumer le progrès et adapter la formation des conducteurs. Telle est notre position.
M. Roger Braun, directeur général de l’Automobile Club - Association française des automobilistes. Je souhaite revenir sur la vitesse et la formation. Nous savons que 66 % des accidents mortels de la circulation se produisent sur les routes départementales. Ces accidents sont plus souvent dus à une vitesse excessive par rapport aux circonstances qu’à un dépassement de la vitesse autorisée. La difficulté est de faire en sorte que le conducteur ne perde pas de vue la notion de risque. Or, les jeunes conducteurs, par manque d’expérience, n’ont jamais été placés dans des situations de danger : pourtant, ce sont eux qui dépassent les 60 km/heure sur une route enneigée ou en présence de brouillard. L’expérience autrichienne nous montre l’intérêt de placer le jeune conducteur, durant la première année après son permis de conduire, face à des situations qu’il risquera de rencontrer. C’est pourquoi sa formation doit comporter une phase pratique le plaçant dans des situations qu’il croit maîtriser, mais qu’en réalité, il ne maîtrise pas du tout.
Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Lorsque l’Automobile Club s’est intéressé, il y a un certain nombre d’années, à la formation à la conduite, nous avons été amenés à reprendre sept pistes dispensant ce type de formation. J’ai personnellement suivi une formation, faisant équipe avec l’un de mes collaborateurs. Celui-ci, qui avait déjà suivi une formation visant à maîtriser son véhicule, m’a assuré qu’il viendrait à bout de l’épreuve… mais il n’y est parvenu qu’à son deuxième tour de piste. Or, sur la route, il n’y a pas deux essais, et c’est pourquoi il est indispensable que les conducteurs reçoivent une formation complète. Ils doivent comprendre que sur la route, on ne joue pas. Que la vitesse soit limitée ou non, un conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances – à condition, bien sûr, de conduire un véhicule en bon état, de n’être ni fatigué ni sous l’emprise de telle ou telle substance.
La sécurité routière pose des problèmes complexes, pourtant, au fond, il s’agit de quelque chose de relativement simple : il suffit que chacun prenne conscience que la conduite n’est pas un acte anodin mais un acte reposant sur l’apprentissage, ce qui justifie une formation continue.
M. le président Armand Jung. Certains des intervenants que nous avons entendus ici même nous ont dit exactement l’inverse.
Quel délai faut-il prévoir entre l’obtention du permis et le stage post-permis ?
M. Didier Bollecker. Un délai situé entre douze et dix-huit mois serait convenable. Les conducteurs ne devraient pas pouvoir enlever le A avant d’avoir effectué le stage.
L’organisation de ces stages pose des problèmes d’infrastructures et de coût. Mais les Autrichiens considèrent qu’en réduisant accidents, décès et invalidités, les stages ont économisé près de 100 millions d’euros par an. Avec une telle somme, on peut former un certain nombre de stagiaires ! Sur le plan de l’équilibre macro-économique, cette formation ne semble pas poser de problèmes majeurs.
Bien que notre association soit une organisation sans but lucratif, nous avons tout de même des impératifs à respecter. L’exploitation des pistes de sécurité routière est un exercice difficile sur le plan financier. Si nous voulons que les gens investissent dans les pistes de sécurité routière, il faut qu’elles intéressent un nombre suffisant de stagiaires. Je pense qu’une incitation de l’État serait la bienvenue, non seulement en direction des jeunes conducteurs, pour qui ce stage serait obligatoire, mais aussi pour tout conducteur qui y participerait, la conduite sur une piste de sécurité routière constituant une expérience intéressante et très ludique. Cette incitation, qui ne serait pas forcément financière et ne coûterait rien à l’État, pourrait prendre la forme d’un bonus d’un point ou de deux points sur le permis du conducteur suivant un stage. Une telle incitation, de nature à multiplier le nombre des stagiaires, permettrait de développer les pistes et les infrastructures nécessaires pour accueillir massivement les jeunes conducteurs. En l’absence d’incitation, je crains que ces stages ne s’adressent qu’à un public marginal.
M. le président Armand Jung. Quel est le prix moyen d’une telle formation ?
M. Roger Braun. Le coût des formations les plus complètes, destinées aux personnels des entreprises, est de l’ordre de 260 euros, mais celui des formations destinées aux jeunes conducteurs est inférieur à 200 euros. Cela dit, le tarif des formations est naturellement lié à leur volume et une organisation plus industrielle permettrait de rendre l’opération encore plus accessible. Je rappelle, en outre, qu’elle intéresse également les assureurs, souvent enclins à contribuer à des opérations qui permettent de faire baisser la sinistralité. Du reste, une part non négligeable des stages que nous dispensons est réalisée en partenariat avec les assurances, qui prennent en charge tout ou partie de leur coût.
Nombre de Français sont persuadés de la nécessité de ces stages. Pour ma part, je ne connais pas de comité interministériel de la sécurité routière qui ne prévoit pas d’expérimenter la mise en place de stages de formation pour les jeunes conducteurs. Toutefois, une telle mesure n’est pas mise en œuvre, en dépit des préconisations de nombreux rapports, tant au plan européen qu’au plan national. Je citerai à cet égard le rapport Lebrun/ Mathieu de 2008 qui concluait au retard important de la France en la matière et à la nécessité de mettre en œuvre des stages post-permis pour les jeunes conducteurs. S’il ne fallait retenir qu’une seule mesure, ce serait celle-ci tant il est évident qu’elle aurait des résultats positifs.
M. Didier Bollecker. Je rappelle que, depuis l’ordonnance de 1970, la détention d’un alcootest dans tous les véhicules est obligatoire dans des conditions fixées par arrêté. Or cet arrêté n’a jamais été publié.
M. le président Armand Jung. C’est justement l’une des propositions de la Mission !
M. Didier Bollecker. À l’inverse, le décret d’application de la loi que vous avez récemment votée concernant l’éthylotest embarqué – cet EAD constituant une peine alternative pour les conducteurs condamnés – est paru, lui, le 5 septembre dernier.
La part de l’alcool dans les accidents est très élevée – de l’ordre de 31 %. Et même si l’alcool est rarement un facteur unique, il est souvent déterminant. Une action pour lutter contre l’alcool au volant serait certainement plus utile que le bridage des véhicules.
M. le président Armand Jung. Nous avons appris, dans le cadre de notre mission, à nous méfier des chiffres. Les causes d’un accident sont très souvent multiples –vitesse, alcool, non respect d’une priorité… – et très difficiles à analyser. Sur laquelle de ces causes faut-il agir prioritairement ?
M. Roger Braun. Nous nous méfions, nous aussi, des chiffres ; c’est la raison pour laquelle tous ceux que nous avons cités sont ceux de l’Observatoire national de la sécurité routière.
Pour illustrer mon propos concernant notre méfiance à l’égard des chiffres, il me suffit de prendre l’exemple du programme RÉAGIR – Réagir par des enquêtes sur les accidents graves et par des initiatives pour y remédier – portant sur les causes multiples des accidents de la circulation. Alors que, à l’époque, nous nous battions pour que le contrôle technique des véhicules soit enfin généralisé, certains rapports affirmaient que seulement 2 à 3 % des accidents étaient liés à l’état du véhicule ; or, les enquêtes RÉAGIR, réalisées par une commission composée de fonctionnaires et de responsables associatifs, ont démontré que ce taux atteignait en réalité 21 % – ce qui a été déterminant pour la mise en place du contrôle technique.
Pour définir la cause d’accident à laquelle il convient de s’attacher prioritairement, il faudrait être capable de répondre à la question de la multicausalité des accidents. Il est incontestable que la solution à mettre en œuvre pour qu’il n’y ait aucun accident réside dans l’association d’un conducteur 5 étoiles, conduisant une voiture 5 étoiles, sur une route 5 étoiles…
M. le président Armand Jung. Je partage votre avis, mais se pose un problème d’égalité car tout le monde ne peut pas posséder une voiture 5 étoiles. Au reste, si le conducteur d’un 4x4 bénéficie d’une plus grande sûreté, ce n’est pas le cas de celui qui se trouve en face en cas d’accident.
M. Roger Braun. Et qui peut être un cycliste ou un piéton !
Désormais, à la demande de ceux qui ont créé les tests européens en la matière – dont Euro NCAP et les Automobile-Clubs –, pour avoir droit aux 5 étoiles, un véhicule ne doit plus protéger seulement ses occupants mais également les personnes qui se trouvent à l’extérieur. Ainsi, la hauteur des pare-chocs a été revue afin de pouvoir, en cas d’accident, absorber une partie du choc.
Toutefois, si l’accident se produit, il faut pouvoir compter sur l’intervention rapide des secours – l’Automobile Club a formulé des propositions en ce sens. Il existe désormais un processus européen, iCall, qui permet aux occupants d’un véhicule de signaler leur problème à une centrale d’appel. Celle-ci rappelle le conducteur et s’il ne répond pas, des secours sont envoyés sur place. Or, alors que ce système est mis en place depuis peu dans un certain nombre de pays européens, la France n’a pas encore adhéré au protocole. Voilà une autre piste intéressante.
L’Automobile Club a également fait une proposition pour aider les services de secours en cas d’intervention. En effet, les véhicules actuels, parce qu’ils protègent mieux, posent un certain nombre de difficultés techniques aux sauveteurs : tôles renforcées, airbags dont l’emplacement n’est pas toujours connu… C’est pourquoi l’Automobile Club a lancé l’idée de la présence de fiches de secours à bord, destinées à renseigner ceux qui interviennent en cas d’accident. Nous avons évoqué ce sujet avec la Direction de la sécurité civile et la Direction interministérielle de la sécurité routière. Les pouvoirs publics devraient développer l’usage de ces fiches. Certes, tout le monde n’a pas la même voiture, mais tous les usagers doivent bénéficier du même niveau de sécurité.
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous remercie pour votre contribution.
*
* *
Audition de Mme Monique Fritz, présidente, et de M. Nicolas Fritz, membre fondateur de l’Association d’aide aux victimes de la route (AIVAR)
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, madame, monsieur, de votre présence. Nous avons déjà eu l’occasion de nous rencontrer pour évoquer ensemble ces drames que sont les accidents de la route, mais nous devons aujourd’hui formuler des propositions. C’est donc à ce titre que je souhaite vous interroger, compte tenu de ce que vous avez vécu et de votre présence sur le terrain, dans le cadre de l’Associations d’aide aux victimes de la route (AIVAR). Quelles propositions déterminantes devrait-on faire, selon vous, au Gouvernement et au ministère de l’intérieur en matière de sécurité routière ?
Mme Monique Fritz, présidente de l’Association d’aide aux victimes de la route. Je vous remercie de cette invitation qui nous permet de partager avec vous l’expérience de l’Association Laurence-Fritz « Savoir vivre la route » au sein de laquelle, pendant une dizaine d’années, nous avons œuvré dans le domaine de la prévention. C’est ainsi que nous avons acquis une culture de la sécurité routière, bien évidemment très utile lorsque nous intervenons sur les plans local, départemental, national voire européen – en effet, on ne s’improvise pas intervenants dans ce domaine sans disposer d’une culture et d’une expérience spécifiques.
Trois points principaux nous paraissent devoir être soulignés.
Premier point : les facteurs des accidents de la route. Trois d’entre eux sont en l’occurrence décisifs : le conducteur, le véhicule et l’infrastructure. Si le deuxième et la troisième compensent la défaillance du premier, la situation est optimale ; en revanche, si l’infrastructure est défaillante en raison, par exemple, de la présence d’obstacles latéraux, l’accident sera plus grave ; si les pneus de la voiture sont lisses, la situation sera encore différente. Toute action en matière de sécurité routière doit donc systématiquement tenir compte de ces trois paramètres, un accident résultant toujours de la conjonction de plusieurs éléments.
Plus précisément, la responsabilisation du conducteur implique de dispenser une éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge. C’est auprès des collégiens et des lycéens, au-delà des attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 et 2 (ASSR 1 et 2), qu’il convient de mettre en place une véritable pédagogie s’insérant dans les programmes obligatoires. La mesure 17 définie lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 dispose que l’éducation à la sécurité routière se généralise au lycée. Il s’agit là d’une bonne idée puisque, dans le cadre de cette sensibilisation, une expérimentation sera lancée dans 80 établissements de 7 académies. Une telle initiative, néanmoins, me semble insuffisante : intégrer des questions sur ce thème dans les programmes de SVT, physique, français et éducation civique permettrait sans doute, à terme, de mettre en place une épreuve au baccalauréat.
L’article L. 312-13 section 6 du code de l’Education – section dédiée aux enseignements de la sécurité – dispose quant à lui que l’enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignements des premier et second degrés. En outre, l’article L. 312-13-1 dispose qu’il est également nécessaire, au cours de la scolarité obligatoire, de sensibiliser les élèves à la prévention des risques, aux missions des services de secours et à l’apprentissage des gestes de premiers secours. Enfin, l’article D. 312-43 du code de l’Education dispose que cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur aux premier et second degrés.
L’application de ces dispositions, après leur intégration au sein des programmes scolaires édités par le Bulletin officiel de l’Education nationale, constituerait une véritable avancée. Par exemple, expliquer aux jeunes la nature de l’énergie cinétique permettrait de leur faire comprendre l’origine des lésions corporelles. En effet, s’il est toujours possible d’améliorer les véhicules et les infrastructures, on se heurte vite aux limites physiques et physiologiques du corps humain : ni un air bag ni une ceinture de sécurité ne peuvent empêcher qu’à 60 km/h le poids de nos organes, inéluctablement projetés contre les parois osseuses lors d’un choc violent, soit multiplié par 16,5, et par 28 à 100 km/h. Au-delà de 65 km/h en choc frontal contre un obstacle fixe et à 35 km/h en choc latéral, le risque de mort est prépondérant. Il faut que les plus jeunes d’entre nous apprennent cela afin de comprendre que la vitesse constitue un élément essentiel de l’accidentologie et qu’il est normal de s’acharner à vouloir la réduire.
Par ailleurs, il importe de continuer à soutenir, grâce aux contrats aidés, les municipalités qui agissent auprès des scolaires dans le cadre des circuits de première éducation – la Ville de Strasbourg a ainsi édité un livret ASSR délivré aux collégiens de la communauté urbaine de cette ville (CUS). Nous avons, quant à nous, fait paraître un ouvrage à destination des plus jeunes, Reste prudent, afin de leur expliquer les risques encourus par les piétons ou les cyclistes. La Documentation française, enfin, a publié un très bon livre pour engager les maires à agir en ce domaine.
En ce qui concerne l’environnement, nous avons beaucoup réfléchi à la question des obstacles latéraux et, en particulier, à l’origine des plantations d’arbres situés en bordure des routes – dont nous savons qu’en cas de heurt, ils ne pardonnent pas – qui émerveillent tant les écologistes. Ils ont été plantés au XVIème siècle afin de fournir du bois pour les affûts de l’artillerie royale, les crosses de fusils, les charpentes des bateaux et les allumettes. Au XVIIIème siècle, les arbres ont été plantés un peu plus loin des chemins, les platanes et les arbres fruitiers n’ayant été, quant à eux, introduits qu’au XIXème siècle. Or, en Alsace, 40 % des victimes sont tuées lors de collisions contre des obstacles latéraux : ainsi, dans sa seule édition du 12 août, notre journal local relevait que dix personnes avaient été blessées dans des accidents de la route et cinq autres tuées ; le 8 septembre, une voiture a percuté un arbre et les jambes de son conducteur ont été broyées. Nous ne sommes pas dans la fiction mais dans la réalité, hélas, la plus banale.
Deuxième point : les spécificités du monde agricole. Nous nous interrogeons sur la circulation de tracteurs – dont la vitesse maximale est de 40 km/h – parfois conduits par de très jeunes gens. Si ceux d’entre eux qui sont issus d’un milieu agricole ne rencontrent pas de difficultés particulières compte tenu de leur expérience, il n’en va pas de même des autres : à tel point que la mise en place d’un permis pourrait être selon nous envisagée. Si, s’agissant de la signalisation, le gyrophare est bien entendu utile, il n’est hélas guère visible. Il conviendrait donc d’améliorer la visibilité de ces véhicules très lents dont la présence brutale peut surprendre les conducteurs.
Troisième point, enfin, la communication, laquelle s’avère très délicate dans le domaine de la sécurité routière, chacun réagissant selon son histoire personnelle. À cet égard, le site du ministère des transports dédié à la sécurité routière pourrait être plus offensif et sans doute une mise à jour s’imposerait-elle, certains documents en ligne datant de 2004 ou de 2007.
M. le président Armand Jung. Bien des personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette mission. Comment envisagez-vous la mise en place d’une synergie, notamment au sein du milieu associatif mais également avec les scientifiques, les enseignants, les techniciens, les experts, les constructeurs, les conducteurs, sur le plan tant départemental que national ou européen ?
Mme Monique Fritz. À Strasbourg, où il ne se passait naguère pas grand-chose en ce domaine, les différents acteurs ont appris à se connaître au fil des réunions et ils parviennent aujourd’hui à travailler ensemble, même si des associations demeurent plus spécifiquement dédiées aux piétons, aux cyclistes ou aux automobilistes. Nous parvenons ainsi à mener des actions communes, y compris sur le plan européen – nous avons rencontré Ari Vatanen –, même si des crispations se font jour, chacun essayant d’abord de tirer la couverture à soi. Il n’en reste pas moins qu’un véritable travail de fond est mené grâce à des expertises partagées : c’est en nous écoutant les uns les autres que nous parvenons à acquérir un savoir. Ne sommes-nous pas tous réunis, au fond, pour faire en sorte que les personnes que nous aimons demeurent près de nous ?
M. Jacques Myard. Si les causes des accidents, vous l’avez dit, sont multiples, que pensez-vous des zones partagées et de la modification du code de la route permettant aux cyclistes de rouler à contresens ?
Mme Monique Fritz. À Strasbourg, les cyclistes sont nombreux et se sont octroyés progressivement tous les espaces, y compris les trottoirs et les zones piétonnières, à tel point que nous sommes confrontés à un problème de respect, les touristes se montrant parfois étonnés de la vitesse à laquelle roulent les vélos ainsi que de la nervosité de leurs pilotes. Il ne faut surtout pas lâcher la main des jeunes enfants promenés dans les zones piétonnes si l’on veut éviter des bousculades ! Les zones de rencontres constituent donc un bel idéal si leurs usagers se respectent : nous avons tous le droit de nous déplacer que l’on soit à pieds, à vélo, sur une chaise roulante, avec une poussette, aveugle ou mal-voyant.
M. Jacques Myard. Précisément, n’est-ce pas faire preuve d’idéalisme ou d’angélisme que de promouvoir de tels espaces ? L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ? Un adolescent qui circule à vélo un peu vite peut heurter un bambin qui zigzague !
Mme Monique Fritz. En effet.
M. le président Armand Jung. Je note que vous utilisez des formules différentes pour désigner une même réalité, les zones de rencontres et les zones partagées.
M. Jacques Myard. Ce sont des zones piétonnes où sur des trottoirs assez larges peuvent circuler des cyclistes.
Mme Monique Fritz. Dans ces zones, les problèmes de cohabitation sont effectivement toujours les mêmes.
À Strasbourg, les cyclistes qui circulent à contresens ne posent pas trop de problèmes dès lors que les automobilistes connaissent la ville. On ne peut pas en dire autant lorsque tel n’est pas le cas – je sais d’ailleurs que des accidents ont eu lieu – mais, selon les experts, il n’en reste pas moins que cette pratique diminuerait les risques encourus. En tout cas, il convient de faire en sorte que les cyclomotoristes qui se sont engouffrés dans cette brèche, eux, cessent de le faire. J’ajoute que les cyclistes empruntent parfois des rues dans des sens qui leur sont interdits et qu’ils ne s’arrêtent pas toujours aux feux rouges. Les usages étant mal définis, seule l’exemplarité permettra d’être durablement efficace.
Enfin, afin d’accroître la cohésion entre les différents intervenants et afin de formuler plus aisément nos préconisations en matière d’infrastructures, nous souhaitons la création d’un secrétariat d’État à la sécurité routière : un interlocuteur unique, en effet, nous éviterait d’avoir à nous adresser aux ministères de l’intérieur, de l’écologie et des transports, au comité interministériel, au Premier ministre, aux préfet, aux maires…
M. le président Armand Jung. Faut-il favoriser une nouvelle synergie nationale des associations autour du Conseil national de la sécurité routière, lequel pourrait à la fois les conseiller et formuler des propositions au Gouvernement ou à l’Assemblée nationale, étant entendu que l’actuel système a peut-être atteint ses limites ?
Par ailleurs, si nous nous sommes rendus compte que tous les acteurs de la sécurité routière se connaissent, il n’en demeure pas moins que leurs points de vue sont très souvent aux antipodes de ceux que vous venez d’exprimer : les approches, qui résultent d’un long travail, sont toujours très affirmées et sensiblement divergentes ! Afin d’éviter de réunir autour d’une table des personnes qui n’ont plus envie de travailler ensemble, la mise en place d’une organisation plus locale, départementale ou régionale, ne serait-elle pas de bonne politique ?
Mme Monique Fritz. La création de maisons départementales de la sécurité routière a été envisagée sans jamais être généralisée. Les problèmes qui se posent, pourtant, diffèrent selon les endroits : nous avons eu l’occasion d’observer le mode de conduite parisien – notamment celui des cyclomotoristes – alors qu’en Alsace, par exemple, ce sont plutôt les cyclistes qui se distinguent ; les infrastructures, de surcroît, ne sont pas les mêmes, non plus que les typologies des accidents. Les mesures doivent donc être prises sur un plan national, certes, mais avec des aménagements régionaux ou départementaux.
Je souhaite maintenant vous présenter le livre de Dongo Rémi Kouabenan, professeur de psychologie du travail et des organisations à l’université Pierre Mendès-France, intitulé Explication naïve de l’accident et prévention. Cet essai est particulièrement intéressant en ce qu’il formule les déterminants de « l’explication naïve de l’accident », lesquels sont perçus différemment selon l’âge. Il explicite ainsi le processus en œuvre dans ce type d’explication : biais de supériorité – l’observateur se juge plus habile que la victime de l’accident et considère que, dans pareille situation, il aurait adopté une conduite plus efficace ; sur le même registre, un grand nombre de conducteurs pensent qu’ils commettent moins d’infractions routières que les autres et sont ainsi persuadé qu’ils seront capables de faire face à un obstacle brusque, même à vive allure ; le biais d’optimisme irréaliste – tendance générale à croire que nous avons plus de chances de vivre des événements positifs que négatifs ; le biais d’illusion de contrôle ; le biais d’invulnérabilité – tendance de certaines personnes à se percevoir comme moins exposées qu’autrui à la victimisation ou aux conséquences néfastes d’événements négatifs. Ainsi, si la conception classique et le diagnostic de sécurité sont l’affaire de spécialistes, il est indispensable de tenir compte des explications ordinaires et subjectives – ce qui constitue d’ailleurs un atout majeur de votre mission car les personnes auditionnées peuvent vous donner une idée très large des problèmes qui se posent. En effet, la prise en compte du fonctionnement cognitif de l’individu ordinaire semble fondamentale pour le succès des actions de prévention, parce qu’elle conditionne leur compréhension et constitue une source appréciable de motivation pour les acteurs de la prévention. En outre, pour qu’une information sur le risque paraisse pertinente et soit assimilée par un individu, il importe qu’elle soit en accord avec ses croyances initiales. Lorsque le CISR applique une mesure « surprise », les réactions sont assez vives faute de préparation, d’où l’aspect contre-productif des dispositifs proposés. Il faut apprendre à évaluer notre propre vulnérabilité et notre pouvoir de contrôle et à développer des techniques pour permettre de nous rendre compte que nous ne sommes pas à l’abri d’un accident, les mesures de prévention nous étant personnellement adressées. Enfin, il convient de faire participer l’individu ordinaire à l’analyse causale des accidents et des risques que présente son environnement. Si tel n’est pas le cas, tout notre travail est vain.
M. Nicolas Fritz, membre fondateur de l’Association d’aide aux victimes des accidents de la route. Je souhaite quant à moi formuler quelques remarques de bon sens.
Les camionnettes de livraison étant le plus souvent conduites en dépit du bon sens, ne serait-il pas judicieux d’inclure dans les contrats de travail des chauffeurs qu’aucune sanction ne sera prise si la livraison n’est pas terminée en fin de journée ?
De plus, ne pourrait-on pas s’inspirer de l’exemple anglais s’agissant des radars fixes ? Ils sont en grand nombre sans être pour autant tous équipés pour flasher les automobilistes, ceux qui le sont variant d’emplacement au gré des autorités ?
Ne serait-il pas possible d’autoriser parfois la circulation des motos dans la Forêt Noire afin d’éviter que des hordes de motards, notamment allemands, ne viennent dans le massif des Vosges chaque fin de semaine ?
Ne contribuerait-on pas à accroître la responsabilisation des cyclistes en imposant la souscription d’une assurance obligatoire ainsi que l’immatriculation des vélos, comme tel est d’ailleurs le cas en Hollande ?
Enfin, comme en Allemagne, une meilleure coordination des feux me semble nécessaire aux carrefours, de manière à ce que les voitures tournent sans avoir à s’arrêter immédiatement pour laisser passer les piétons, et qu’inversement ces derniers puissent traverser en toute sécurité, les voitures étant de tous côtés à l’arrêt.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie pour ces propositions.
*
* *
Audition de Mme Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale, de M. Jean-Paul Mizzi, directeur général adjoint, de M. Sylvain Lassare et M. Bernard Laumon, directeurs de recherche, et de M. Jean-Louis Martin, chargé de recherche à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons les auditions de la mission d’information en accueillant les représentants de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, qui est l’un de nos plus importants partenaires.
Je vous remercie, madame et messieurs, d’avoir accepté de participer à nos travaux. Nous allons ensemble tenter de cerner au mieux les problématiques de l’accidentologie en vue de l’élaboration du rapport que nous remettrons dans quelques semaines au Gouvernement.
Mme Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale de l’IFSTTAR. Je vous remercie à mon tour de nous donner l’occasion de montrer à quoi sert un établissement public de recherche finalisée qui a pour devoir de conseiller l’État et les pouvoirs publics. Nous sommes heureux de pouvoir valoriser nos travaux et nous réjouissons de la confiance que vous nous témoignez.
M. Jean-Paul Mizzi, directeur général adjoint. Le rapport que nous venons de vous remettre a pour origine une synthèse scientifique effectuée sur une durée très courte, donc volontairement condensée et limitée à l’essentiel, des connaissances en matière de sécurité routière. Il ne s’agit pas d’une expertise collective, incompatible avec l’ampleur de la question posée et avec la brièveté des délais impartis.
Sur la base de ces connaissances, un certain nombre d’éléments concernant les causes des accidents peuvent être avancés et des mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre l’insécurité routière peuvent être évaluées.
Même si l’accidentalité a beaucoup baissé en France, elle reste élevée par rapport à celle d’autres pays européens, et il est nécessaire de poursuivre une politique volontariste en matière de sécurité routière. La France fait partie des pays européens intermédiaires entre les pays les plus performants en la matière – moins de 60 tués par million d’habitants – et les nouveaux États membres – plus de 100 tués par million d’habitants.
L’efficacité des politiques de sécurité routière exige des analyses précises, ciblées sur les circonstances des accidents – types de réseaux, périodes de conduite –, et les populations à risques – nouveaux conducteurs, en particulier jeunes conducteurs de deux-roues motorisés –, et également des coopérations entre toutes les parties prenantes.
Le document est structuré en deux parties principales : la première rappelle les causes d’insécurité en lien avec les usagers, les infrastructures et le parc automobile ; la seconde recense, par grands domaines, les mesures, générales ou plus spécifiques, qui ont pu être prises et les enseignements qui ont pu en être tirés.
La connaissance en matière de sécurité routière repose essentiellement sur l’observation d’échantillons d’accidents ou de sujets expérimentaux, souvent de taille limitée. Or, cette observation peut parfois être trompeuse, ou pour le moins comporter une part d’incertitude quant à la pertinence de sa généralisation. La décision publique doit s’appuyer sur une quantification la plus exacte possible des enjeux inhérents à telle ou telle cause d’insécurité routière, mais aussi sur une appropriation plus fine, donc nécessairement plus qualitative, des phénomènes sous-jacents. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que le vraisemblable prime sur le vrai.
Cela étant, il convient de préciser la nature de l’accidentalité. Ainsi, à côté du nombre de morts sur la route et en conservant l’objectif de le diminuer au maximum, le regard doit être porté sur les blessés, qui représentent aujourd’hui un enjeu particulièrement important, notamment pour les jeunes et pour les usagers de deux-roues motorisés : à chaque tué correspond un handicap lourd.
Pour accroître la pertinence de notre regard sur les blessés, il faudrait également prendre en compte la réduction de l’espérance de vie des blessés les plus graves.
En ce qui concerne les causes d’accident, il est indiscutable que celles-ci sont multifactorielles. Il n’y a pas une cause unique d’accidentalité, et c’est sur cette multicausalité qu’il faut agir, par le biais d’une coordination des différentes politiques et mesures, afin que les limites naturelles de l’adaptation humaine ne puissent mettre les usagers de la route dans des situations qui les blessent ou les tuent.
Plus les situations routières seront compliquées, surprenantes, plus elles imposeront de contraintes temporelles, plus elles pousseront à bout les capacités humaines d’adaptation. La prise de risque peut être volontaire, délibérée, active, mais elle peut aussi être liée à la non-perception d’un danger.
S’agissant du risque d’accident, la vitesse reste un facteur causal clé. Le taux d’accidents par véhicule/km sur un réseau augmente en fonction de la vitesse moyenne pratiquée sur le réseau selon un facteur 4.
Parmi les autres causes, nous pouvons souligner le rôle particulier de l’alcool, dont le poids dans l’accidentalité est constant depuis une décennie. S’agissant des autres psychotropes, peu de résultats ont pu être mis en évidence, à l’exception de ceux du cannabis, notamment lorsqu’il est associé à l’alcool.
Parmi les causes, l’inadaptation de la vitesse à l’infrastructure et aux conditions de circulation peut également être notée. Par défaut d’information adéquate ou pour des raisons de détection, la mauvaise adéquation de la vitesse à l’infrastructure, notamment dans les virages et aux intersections, et aux conditions de circulation est source d’accidents.
J’en viens aux causes de l’insécurité en lien avec les véhicules. Les véhicules légers constituent le principal enjeu en termes de mortalité du fait de l’augmentation de la masse des véhicules constatée. Pour ce qui est des deux-roues motorisés, l’enjeu s’apprécie en termes de blessés graves – les origines en sont le non-port du casque et la difficulté de perception par les automobilistes.
Au-delà des causes elles-mêmes, il faut souligner que deux groupes de personnes sont plus vulnérables en cas d’accident : d’une part, les piétons – en particulier les enfants et les personnes âgées – et les cyclistes ; d’autre part, les usagers de deux-roues motorisés. Mais parmi cette population, il existe une sous-population : l’homme jeune, qui reste le plus exposé.
En ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre en matière de sécurité routière, il faut souligner que trop peu de mesures et de politiques de sécurité routière font l’objet d’évaluations.
En tout cas, le bilan des politiques de sécurité routière dans le monde montre que, compte tenu du caractère multifactoriel des accidents, la sécurité routière doit être une action publique multisectorielle qui nécessite un véritable leadership gouvernemental.
Cette action, par définition interministérielle, doit aussi privilégier une approche « intégrale » qui prenne en compte la politique environnementale, la politique de l’aménagement du territoire et la politique de santé publique. Elle doit par ailleurs être élaborée de manière conjointe par l’ensemble des parties prenantes – chercheurs, industriels, associations, institutions.
Dans le débat public, la sécurité routière ne peut être réduite essentiellement à un problème de comportement des usagers. Au niveau mondial, trois modèles inspirent les politiques de sécurité routière car ils affichent clairement une vision hautement ambitieuse et à long terme de la sécurité routière : il s’agit des modèles suédois, hollandais et anglais. Les programmes de ces pays reposent également sur l’adoption d’objectifs intermédiaires pluriannuels et sur des objectifs finaux à long terme.
La sécurité routière doit devenir une priorité des politiques d’aménagement à tous les échelons territoriaux. Des progrès sont possibles, même si ce n’est pas simple, comme le montrent les expériences étrangères, grâce à des politiques coordonnées et structurées portant par exemple sur une intégration de la sécurité routière dès la conception des systèmes, comme cela a été fait pour la sécurité industrielle. La sécurité routière n’étant jamais linéaire, une efficacité continue suppose d’être présent en permanence sur la scène médiatique, en s’appuyant sur des campagnes d’information et leur évaluation.
La politique de sécurité routière doit agir à différents niveaux : instaurer une véritable formation post-permis, du permis probatoire à l’accès gradué à la conduite ; contrôler la vitesse, encore et toujours ; établir des diagnostics préalables à l’aménagement des routes existantes ; moderniser la signalisation des dangers et l’adapter aux conditions de conduite – vitesse, trafic, météo ; améliorer les systèmes d’aide à l’intérieur du véhicule, plutôt en termes de sécurité primaire, mais aussi pour les deux-roues, notamment en ce qui concerne leur détectabilité – casque, dispositifs réfléchissants ; enfin, engager une action à destination des entreprises, plus particulièrement dans le domaine des transports, et mettre en place des plans de prévention routière.
Tous ces éléments en témoignent, la recherche scientifique peut contribuer à améliorer l’efficacité des politiques menées. Comme cela a été le cas en Grande-Bretagne, les travaux scientifiques interviennent d’abord dans la définition et l’analyse des problèmes à résoudre. Des recherches sont donc nécessaires pour produire et affiner les connaissances concernant les causes des accidents et les mesures à mettre en œuvre pour réduire l’accidentalité.
Je souligne la nécessité de faire progresser la connaissance sur l’évaluation des politiques, notamment d’aménagement, et sur l’accidentalité, notamment par catégories d’usagers et par classes d’âge. Il y a également un grand intérêt à cibler des populations particulières comme les personnes vulnérables, les imprudents, les réfractaires. Pour que ces études puissent être réalisées, l’observation, continue ou ponctuelle, est fondamentale.
Parmi les pistes de recherche, on peut également souligner l’intérêt d’une approche en termes d’années de vie perdues, de handicaps, et d’années de vie en bonne santé gagnées, ce qui permettra notamment de se focaliser sur les jeunes, particulièrement vulnérables, qu’ils soient piétons, cyclistes ou usagers de deux-roues motorisés. Il serait, en outre, intéressant d’identifier les situations potentiellement conflictuelles et susceptibles de mener à l’accident, afin de construire un environnement et un tracé de la route complètement lisibles et susceptibles d’induire des comportements sûrs.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie pour cet exposé dont nous allons nous inspirer dans nos conclusions. Quelle gouvernance – nationale, régionale ou départementale – est-elle selon vous la plus en mesure de créer une synergie autour de la problématique de la sécurité routière ? Faut-il créer un poste de Haut commissaire, de secrétaire d’État ou de délégué interministériel rattaché au Premier ministre ? Pour assurer la continuité nécessaire, faut-il créer un Parlement de la sécurité routière, ou au contraire privilégier le niveau local et laisser au préfet le soin de définir les zones à risques ?
M. Jean-Paul Mizzi. Il ressort des expériences étrangères que, compte tenu des causes et du faible nombre des accidents, l’analyse doit être faite à partir d’un échantillon suffisamment vaste. Il est donc important d’associer politiques locales et action gouvernementale.
M. Sylvain Lassare, directeur de recherche. Nous devons en effet étudier les exemples étrangers et les adapter à notre situation. Ainsi les Anglais ont récemment créé un groupe parlementaire, le Parliamentary Advisory Council for transport safety (PACTS), qui a pour mission de promouvoir la sécurité dans les transports et la sécurité routière. Aux Pays-Bas, c’est le SWOW – l’Institut de recherche en sécurité routière des Pays-bas – qui pilote cette politique et conseille le ministère concerné ; toutefois, pour s’adapter au prochain passage à une politique décentralisée, de nouveaux outils de management sont mis en œuvre.
M. Bernard Laumon, directeur de recherche. En tant que provincial et membre de l’Observatoire de la sécurité routière du Rhône, je considère que la connaissance globale et nationale est absolument indispensable, car chaque département doit pouvoir se situer par rapport aux autres. L’analyse au niveau départemental du nombre de tués pose un problème lié au fait que cela correspond à des chiffres trop petits. Admettons que, dans le département du Rhône, le nombre de cyclistes tués passe en un an de un à trois : quelle est la signification de ce chiffre ?
Nous avons mis en place à Lyon un système de location de vélos : quel est l’impact de cette politique en termes de sécurité routière ? Nous contenter d’une évaluation purement locale ne nous apprend rien : ou bien il est déjà trop tard, ou bien il n’y a rien à apprendre.
En tant que chercheur, j’estime que la connaissance doit être d’abord nationale pour ensuite se décliner à un niveau local, et que le niveau local a besoin d’une vision nationale pour prendre des décisions.
Mme Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale. Nous devons nous situer à des niveaux différents selon les fonctions qu’il nous faut prendre en compte pour la sécurité globale. Lorsqu’on parle de sécurité, on pense surtout à la vérification de la règle – c’est le rôle du ministère de l’intérieur. Mais il faut écrire cette règle, et c’est un travail différent, et ensuite il faut l’évaluer, et c’est également un travail différent.
On peut définir localement les mesures à instaurer en fonction des risques locaux, mais nous avons également besoin de définitions nationales, et nous avons surtout besoin de préserver le cercle formé par la définition de la règle, l’application de celle-ci, sa vérification et son évaluation. Si ce cercle est rompu et que seule subsiste l’application de la règle, plus personne ne la comprend.
M. Jean-Paul Mizzi. Je reviens sur les échantillons et l’intérêt de bénéficier d’un nombre suffisant de données. Aujourd’hui, nous n’avons plus 12 000 morts sur nos routes : nous pouvons donc considérer qu’il existe, au niveau de nos infrastructures, non plus des points noirs mais seulement des points gris. Pour autant, il faut que nous ayons suffisamment de points gris pour dégager les éléments qui nous permettront de prendre les bonnes mesures. C’est pourquoi l’IFSTTAR a engagé des recherches sur les « quasi-accidents » afin d’augmenter la base de la pyramide.
M. le président Armand Jung. Au-delà des chiffres, souvent variables, nous avons besoin d’analyses plus approfondies de ce qui se passe sur la route. Selon vous, quelle est la réforme majeure que nous pourrions proposer au Gouvernement ?
M. Jean-Paul Mizzi. Il faut avant tout adopter une approche systémique, voir le problème dans son ensemble et non de façon éclatée. Par exemple, toutes les actions menées en faveur de la politique environnementale, comme celles visant à favoriser le transfert de la voiture vers les modes doux ou les transports en commun, ont des impacts en termes de sécurité routière. Il faut savoir anticiper ces impacts et sortir du système « action/ réaction ». Ce que nous pouvons retirer des expériences hollandaise et suédoise, c’est bien l’intérêt de cette approche intégrée et systémique.
M. Jacques Myard. On perçoit clairement cette approche systémique dans le document que vous nous avez transmis, qui analyse un certain nombre d’éléments sans les hiérarchiser. Je suis pour ma part convaincu que, face à un phénomène complexe, il faut agir sur l’ensemble des éléments. Nous savons que la vitesse multiplie par quatre le risque d’avoir un accident grave. Mais lorsqu’un conducteur qui a bu a un accident en roulant trop vite, la vitesse est-elle la cause réelle de l’accident ou la conséquence de l’état alcoolique – tropisme qui serait alors le premier facteur d’accident ?
M. Jean-Paul Mizzi. Selon nous, l’alcool et les autres substances psychotropes sont des facteurs aggravants, mais le premier d’entre eux est la vitesse.
M. Jacques Myard. On ne peut pas être aussi affirmatif ! Un conducteur appuie sur l’accélérateur parce qu’il est ivre, ou est-ce l’inverse ? Où est la poule et où est l’œuf ?
M. Bernard Laumon. Les méthodes que nous utilisons nous permettent de prendre en compte la part de chacune des causes d’accident. Ce n’est pas parce qu’un individu qui provoque un accident est alcoolisé, voire fortement alcoolisé, que l’alcool sera la cause de l’accident. Puisque les causes d’accident sont multifactorielles, chaque facteur peut être concomitant à un autre facteur et ne contribuer que pour une part à l’accident.
Pour répondre à votre question sur la vitesse, sachez qu’il existe une majorité d’accidents sans alcool, mais qu’il n’existe aucun accident sans vitesse. La vitesse n’est pas une cause comme les autres car elle est toujours présente. La vitesse multiplie par quatre le risque de provoquer un accident et elle est déterminante pour transformer un accident matériel en accident corporel, voire en accident mortel – je précise que nous avons limité notre expertise aux seuls accidents corporels.
Chaque individu, à un moment ou à un autre, présente plusieurs facteurs d’accident : il roule trop vite, il est alcoolisé, il a fumé du cannabis, il est inexpérimenté… Nous avons les moyens de faire la part de chacun de ces facteurs. Nous pouvons affirmer que l’alcool est responsable d’un accident sur trois. Quand vous vous demandez, monsieur le député, quelle est la cause principale de l’accident survenu à un conducteur ivre roulant trop vite, il est indiscutable, en tout cas, qu’un conducteur alcoolisé – étant entendu qu’on parle là d’un taux d’alcool encore relativement bas – roulera plus vite que s’il n’était pas alcoolisé – mais ce n’est pas vrai pour le cannabis.
Permettez-moi de prendre un exemple encore meilleur, celui de l’hypovigilance, car l’hypovigilance a des causes multiples. Considérer le fait que les conducteurs s’endorment au volant comme une cause d’accident est totalement restrictif. Il faut rechercher la cause de cette hypovigilance : ce peut être l’alcool, le cannabis, la fatigue, le stress, les conditions de travail ou des pathologies comme l’apnée du sommeil. C’est seulement lorsqu’elle est physiologique que l’hypovigilance est une vraie cause d’accident.
Mme Hélène Jacquot-Guimbal. Si nous avions la bonne solution et si tout le monde appliquait la loi, le problème serait réglé. Nous avons vécu plusieurs étapes déterminantes dans l’histoire de la sécurité routière, mais si nous nous référons au principe des 80/20, nous avons utilisé les 80… Pour les 20 restants, soit nous réduisons globalement la vitesse à moins de 20 km/heure – mais ce serait une entrave à cette autre liberté fondamentale qu’est la mobilité, et je vois mal les Français respecter une telle disposition –, soit nous devons mettre en place des actions beaucoup plus complexes que par le passé. Pour continuer à faire des progrès, nous devons recourir à l’analyse systémique. Nous sommes navrés de devoir vous le dire, le grand soir n’est pas à l’ordre du jour.
M. Jacques Myard. Je suis frappé par le nombre de personnes qui conduisent sans permis. Est-ce parce que la répression n’est plus la bonne réponse aux causes des accidents ?
M. Jean-Paul Mizzi. La répression seule est insuffisante. Il faut naturellement une sanction, qui soit graduée par rapport à l’acte délictueux, et surtout il faut avoir la certitude qu’elle sera appliquée. Le contrôle sanction automatisé (CSA) répond à cette exigence.
M. le président Armand Jung. Nous non plus ne croyons pas au grand soir, madame la directrice générale, et nous sommes conscients que nos propositions ne régleront pas tous les problèmes. Mais notre pays compte encore 4 000 morts par an sur les routes et nous ne parvenons pas à infléchir ce chiffre de façon significative. Comment pourrions-nous faire baisser ce chiffre ?
M. Sylvain Lassare. Tous les pays qui s’attaquent au problème l’envisagent sous tous ses aspects : voilà la solution. Mais cela suppose de mobiliser beaucoup de monde. Pour mettre en place leur plan d’action, les Autrichiens ont passé en revue 200 mesures, ce qui représente un travail considérable. La France doit s’engager dans cette voie.
Contrairement à ce que vous croyez, monsieur le président, le nombre des morts continue de baisser dans notre pays. Quoi qu’il en soit, nous devons passer à un autre régime en mobilisant les professionnels, les chercheurs, les politiques.
M. le président Armand Jung. L’année 2011 n’annonce pas d’amélioration puisque nous en sommes déjà, à la fin du mois d’août, à 2 642 morts.
M. Bernard Laumon. Je précise que l’essentiel des causes de l’accidentalité sont toutes liées à un interdit. Si la réglementation relative à la consommation d’alcool était respectée, nous verrions immédiatement baisser d’un tiers le nombre des tués sur les routes ! Quant aux pathologies, qu’elles soient ou non liées au vieillissement, elles sont toutes réglementées par l’arrêté de 2005 qui invite les personnes atteintes de certaines pathologies à s’en ouvrir à leur médecin en vue de vérifier si elles sont aptes ou non à la conduite. Toutes les causes que nous avons invoquées devraient donc disparaître. On dit que l’alcool est responsable d’un tiers du nombre des morts, mais il s’agit de personnes qui n’ont pas respecté la réglementation ! Ce n’est pas l’alcoolémie inférieure à 0,5 g qui tue. D’aucuns proposent d’abaisser le seuil d’alcoolémie tolérée : nous leur répondons simplement qu’il n’y a pas d’effet notable de l’alcool au volant en dessous de 0,5 g.
M. Jacques Myard. Dites plutôt qu’aucun accident survenu avec un taux inférieur à 0,5 g n’a été acté comme ayant été provoqué par l’alcool.
M. Bernard Laumon. Je ne suis pas favorable, à titre personnel, à un abaissement du seuil à 0,2 g, mais cela aurait peut-être pour effet de réduire l’ensemble des alcoolémies et donc d’abaisser significativement le bilan des morts sur la route.
M. Sylvain Lassare. Il a été envisagé d’abaisser le seuil d’alcoolémie à 0,2 g pour les jeunes conducteurs, ce qui équivaut, en fait, à un taux zéro. Pourquoi ne pas aller jusque-là ?
M. le président Armand Jung. Cela pose un problème d’égalité entre les citoyens, voire un problème constitutionnel.
Tous les spécialistes de la lutte contre l’alcoolisme que nous avons auditionnés ont reconnu qu’aucun accident n’avait été identifié comme ayant été causé par un individu présentant moins de 0,5 g d’alcool dans le sang. Cela dit, la réduction de ce taux serait une bonne chose en matière de santé publique…
M. Bernard Laumon. En matière de lutte contre l’alcoolisme sur la route, les progrès existent, mais ils s’inscrivent dans des tendances lourdes et ne sont pas spectaculaires, d’autant que nous assistons à une réduction générale de l’alcoolisme en France.
M. Jean-Paul Mizzi. Je reviens sur les différentes approches, systémique et intégrale. Certains chiffres relèvent du principe des vases communicants. Ainsi, les politiques engagées en faveur de certains modes de transports incitent les gens à se reporter sur les deux-roues motorisés, ce qui augmente le nombre des accidents. Toutes les politiques de transports et d’aménagement du territoire doivent intégrer la sécurité routière.
M. Jacques Myard. Que pensez-vous de la possibilité offerte aux cyclistes d’emprunter les sens interdits ? Ce changement de culture ne va-t-il pas à l’encontre de l’action systémique que vous prônez ?
M. le président Armand Jung. Les cyclistes sont autorisés à rouler à contre-sens et non à emprunter les sens interdits!
M. Sylvain Lassare. Nous recommandons d’évaluer cet aménagement, de vérifier qu’il ne provoque pas un surcroît d’accidents et d’étudier la façon dont se comportent les conducteurs.
M. Jean-Louis Martin, chargé de recherche. Cet aménagement sera bientôt évalué, mais il est clair que la circulation des cyclistes doit l’être de façon globale. L’autorisation pour les cyclistes de rouler à contre-sens a été mise en place pour compenser le manque de continuité de certaines voies cyclables, mais je reconnais qu’elle est troublante pour les autres conducteurs car elle va à l’encontre d’un grand principe.
M. Jacques Myard. C’est une forme d’acculturation.
M. Sylvain Lassare. Le problème vient de ce que les automobilistes ne s’attendent pas à faire face à des cyclistes.
M. Bernard Laumon. La mise en place des couloirs de bus à contre-sens a provoqué dans un premier temps de nombreux accidents de piétons, puis ils se sont habitués à un nouveau mode de fonctionnement. Le même phénomène se produira pour les cyclistes.
Mme Hélène Jacquot-Guimbal. Cette discussion montre que chacun a en tête ses propres évidences. Il est sans doute dangereux pour un cycliste de circuler à contre-sens dans une voie à sens unique, mais il voit la voiture arriver et peut toujours se ranger en cas de danger. C’est en tout cas moins dangereux que le fait pour un piéton de traverser un couloir de bus. Le report modal auquel nous assistons a accru le nombre de cyclistes. L’augmentation du nombre de morts est-elle due au fait que les cyclistes ne portent pas de casque ou au fait qu’ils utilisent les rues en sens interdit ? Nous sommes incapables de prédire la dangerosité d’un tel aménagement. Tous les automobilistes savent bien que les cyclistes ne respectent pas les feux rouges et ils sont habitués à faire attention pour ne pas les renverser.
M. Philippe Houillon, rapporteur de la Mission d’information. Certaines mesures heurtent le bon sens le plus élémentaire. Dans une voie à sens unique, on ne s’attend pas à trouver quelqu’un circulant en face. Prendre une telle mesure en disant que c’est une bonne idée ne peut que susciter des interrogations.
Mme Hélène Jacquot-Guimbal. Le bon sens, que nous partageons tous, est quelquefois contrarié par le résultat d’une expérience. Au reste, comment le sens commun peut-il fonctionner quand les contraintes sont si nombreuses qu’il n’est plus possible de les percevoir et donc de les anticiper ? Peut-être que cette mesure est une très mauvaise idée ? Peut-être que l’idée n’est pas si mauvaise que cela ? Actuellement, nous ne le savons pas. Quoi qu’il en soit, les chiffres globaux des accidents sont désormais insuffisants – même si 4 000 morts par an est un chiffre monstrueux – pour pouvoir en tirer des statistiques.
M. le président Armand Jung. Madame, messieurs, vous remercie pour la qualité de vos travaux et votre disponibilité.
*
* *
Audition de M. Claude Liebermann, président et de M. Dominique Lebrun, inspecteur général de l’équipement de l’Institut national de sécurité routière et de recherches
Mercredi 14 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie de votre présence et vous propose de commencer par un exposé liminaire de votre point de vue et, plus encore, de vos suggestions. Je vous remercie de faire en sorte qu’elles soient les plus concrètes possibles, car notre mission entre maintenant dans la phase au cours de laquelle elle devra formuler ses propositions au gouvernement.
M. Claude Liebermann. L’INSERR, créé en 1993 par Pierre Bérégovoy, alors premier ministre, est implanté à Nevers. Il forme les inspecteurs du permis de conduire, assure un certain nombre de formations connexes, comme celle des experts automobiles et des animateurs des stages liés au permis à points, et remplit des missions de recherche en matière de sécurité routière. Il exerce donc une assez large compétence en ce domaine.
Nous-mêmes jouons autant le rôle d’experts auprès du gouvernement, au titre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, que de responsables de l’INSERR. Nous avons déjà remis un certain nombre de rapports sur la sécurité routière, notamment sur la formation des enseignants du permis de conduire et sur la réforme de ce dernier. Nous travaillons actuellement sur le problème du vivier des candidats au permis.
Nous disposons aussi d’une bonne connaissance des politiques locales de sécurité routière, ainsi que des politiques comparées des différents États européens en vue de réduire l’accidentologie.
M. Dominique Lebrun, alors conseiller technique au cabinet de M. Gilles de Robien, lorsque celui-ci était ministre chargé des transports, fut l’un de ceux qui initia la mise en place des radars automatiques à partir de 2002.
Les diverses causes des accidents de la route ont déjà dues être largement exposées devant votre mission mais on ne peut se dispenser de rappeler les deux principales : la vitesse et l’alcool. La première représente un facteur à la fois déclenchant et aggravant, comme l’ont montré de nombreuses études, spécialement celle du suédois Nilsson sur les comportements des conducteurs. Nous l’avons encore vérifié en 2002 avec l’installation des radars automatiques qui, ayant diminué la vitesse moyenne principalement sur route, ont réduit le nombre d’accidents.
D’autres causes commencent à apparaître, telle que le défaut de vigilance, difficile à repérer dans les statistiques de l’accidentologie. On l’impute généralement à l’endormissement, qui affaiblit les capacités d’attention et de réaction des conducteurs, parfois accentué par la consommation d’alcool et de drogues, ainsi qu’à l’usage du téléphone portable.
Deux catégories de population posent des problèmes particuliers : les jeunes de 18 à 24 ans et les utilisateurs de deux-roues motorisés.
Les limitations de vitesse doivent être à la fois claires et cohérentes. Ce n’est pas toujours le cas en France. Tous les rapports insistent sur la nécessité de les homogénéiser tout au long d’un même itinéraire et de signaler les points singuliers, en tant que tels, sans créer de leurres, car, dans cette hypothèse, le point suivant n’est pas respecté. Or plusieurs autorités publiques concourent en même temps à la détermination des limitations de vitesse, en fonction de la nature de la collectivité et non en fonction de celle de l’itinéraire, ce qui pénalise les routes françaises.
Quand les limites sont fixées, elles doivent être respectées. Nous avons peiné à sortir du système antérieur dans lequel on retenait des limites plus basses afin de prendre en compte leur non respect par les conducteurs. Lors de la mise en place des nouveaux radars, en 2002, nous n’avons conservé qu’une marge de 5 km/h. Mais certains maires cherchent à se rassurer par des limitations de vitesse plus sévères que ne le nécessiteraient les besoins de la sécurité routière et les possibilités de circuler. C’est une erreur : la prescription est seulement moins bien observée par les usagers, qui ressentent mal l’existence de ces pièges, considérés comme de simples « pompes à fric ». Il faut parvenir, au niveau local, à supprimer de telles distorsions, probablement sous l’autorité des préfets.
Nous avons envisagé plusieurs séries de mesures.
La première consiste à achever la réforme du permis de conduire, par un nouveau programme de formation accordant une place plus importante à la maîtrise du comportement humain. La conduite n’est pas seulement affaire de règles techniques : les conducteurs doivent apprendre à juger par eux-mêmes leur capacité à tenir convenablement le volant. L’alcool n’est pas seul en cause : il faut aussi savoir s’arrêter quand on est fatigué et, d’une façon générale, intégrer la conduite dans le déroulement de la vie. Nous nous souvenons tous du film de Claude Sautet, Les choses de la vie. Aujourd’hui, les écoles de conduite enseignent parfaitement le maniement des vitesses mais insuffisamment la bonne façon de se conduire au volant. Ce qui explique d’ailleurs ce qu’on appelle à Nevers, siège de l’INSERR, « le paradoxe des filles » : un plus faible taux de réussite au permis que les garçons et, cependant, un moindre nombre d’accidents lors des premières années de conduite. Car les filles se placent tout de suite, par une sorte de réflexe naturel, au deuxième niveau de l’usage de l’automobile, celui de la réflexion. Elles se montrent spontanément plus attentives. Il convient donc que les programmes de formation des jeunes intègrent des mécanismes propres à susciter davantage la prise de conscience.
Pratiquée dans de bonnes conditions, la conduite accompagnée constitue une excellente formule. Encore faut-il que les parents se comportent eux-mêmes correctement afin de transmettre les bons usages à leurs enfants.
Notre deuxième proposition vise à renforcer tous les éléments de probation. Le permis de conduire ne doit pas ouvrir un droit à faire n’importe quoi sur la route. Aussi bien, une période probatoire succédant immédiatement à l’obtention du permis pourrait être envisagée : au cours de celle-ci, le jeune conducteur, se sentant sous la menace d’une mesure de sanction, serait ainsi incité à se montrer plus attentif. Elle pourrait avoir un impact sur l’accidentologie des 18/24 ans. Quelques idées révolutionnaires ont surgi … Mais elles sont difficiles à présenter car elles peuvent paraître vouloir s’attaquer aux jeunes.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Lesquelles ?
M. Claude Liebermann. Nous avons constaté que, après une période de conduite accompagnée, l’inspecteur du permis de conduire n’apporte pas grand-chose de plus à l’apprenti conducteur que son moniteur. On pourrait multiplier les exemples de jeunes sachant déjà conduire lorsqu’ils passent le permis et auxquels l’inspecteur n’offre aucune valeur ajoutée. Peut-on, dès lors, imaginer de délivrer le permis sans intervention de l’inspecteur, après un apprentissage par conduite accompagnée ?
M. le rapporteur. Il faut bien exercer un contrôle à un moment donné.
M. Claude Liebermann. Certes, mais voilà peut-être aussi un moyen de renforcer la responsabilité des différentes parties prenantes : depuis les assureurs, qui, aujourd’hui, ne participent pas à la régulation du système, considérant que c’est à l’État de le faire, jusqu’aux réseaux des écoles de conduite, qui, par ailleurs, fonctionnent plutôt bien.
Selon l’idée esquissée, on délivrerait d’abord un permis probatoire puis un permis définitif, octroyé sur dossier au terme d’un certain temps de pratique de la conduite, par exemple à l’âge de vingt ans. Et pourquoi ne pas attribuer le permis probatoire dès dix-sept ans, les jeunes sachant alors déjà conduire, comme tend à le montrer l’augmentation de leur conduite sans permis ? La question mériterait d’être au moins mise à l’étude, l’essentiel étant, je le répète, de renforcer la période probatoire.
Notre troisième série de propositions porte sur la formation des conducteurs de deux-roues motorisés et sur l’apprentissage du partage de l’espace de conduite entre les différentes catégories d’utilisateurs en fonction des zones urbanisées. Celui-ci pose de plus en plus de problèmes. Le danger augmente. Il suffit de se déplacer dans Paris pour constater les conflits entre cyclistes, cyclomotoristes, motocyclistes, automobilistes et piétons. La situation devient parfois invivable, notamment sur les trottoirs, faisant apparaître de nouveaux facteurs accidentogènes. On distingue de plus en plus difficilement les différents compartiments de la voirie. Un code de bonne conduite serait nécessaire afin que les diverses catégories d’utilisateurs des espaces de circulation se respectent entre eux. Pour la première fois l’année dernière, nous avons relevé à Paris un plus grand nombre de morts chez les piétons et chez les conducteurs de deux roues que chez les automobilistes.
L’INSERR se préoccupe aussi du développement de ce que nous appelons « l’écomobilité », c’est-à-dire l’apprentissage d’une conduite apaisée, où l’on apprend que rouler moins vite présente plusieurs avantages. Jusqu’ici, la France était un pays qui magnifiait la vitesse : on cherchait à parcourir les distances le plus rapidement possible, à l’inverse des Etats-Unis où l’on apprend à conduire régulièrement, afin de se rendre d’un endroit à un autre dans un temps donné. En cultivant le mythe de la performance, le conducteur français ignore le temps réellement gagné, prend plus de risques sur la route et consomme davantage d’essence.
C’est pourquoi, nous avons organisé des formations destinées aux entreprises de transport routier, ainsi que des journées ouvertes au grand public sur le circuit de Magny- Cours près de Nevers. Nous obtenons déjà des résultats encourageants quant aux changements de comportement des personnes qui, par exemple, constatent la diminution de leurs factures d’essence, de l’ordre de 20 à 25 %, ainsi qu’un nombre moindre d’accidents.
L’arrêt progressif de la vie de conducteur soulève de délicats problèmes. Vient un moment où il faut cesser de conduire. Le bon moment dépend de chacun, ainsi que les modalités correspondantes. Le médecin de famille doit, sur cette question, jouer un rôle fondamental, mais il n’est pas formé pour cela. C’est pourquoi nous essayons aussi de prendre des initiatives en ce domaine, telle que, avec l’aide du professeur Bernard Laumon, président du conseil scientifique de l’INSERR, la création d’un site internet afin que les médecins libéraux s’investissent dans la sécurité routière. Des contrôles existent déjà au titre des commissions médicales préfectorales mais ils sont insuffisants. Seul le médecin de famille, proche de ses patients, peut convaincre les personnes en voie de vieillissement, soit de renoncer à la conduite – ce qui peut s’avérer difficile voire négatif dans certaines zones, notamment rurales – soit plutôt de ne conduire que dans des rayons limités : pour des besoins identifiés, en supprimant les longs voyages fatigants et en évitant certaines heures ou la conduite de nuit. Toute une pédagogie est à mettre en place car elle éviterait certains accidents ; elle s’impose du fait des perspectives à 30 ans du vieillissement de la population française. Reste bien sûr à déterminer comment le médecin de famille serait rémunéré pour cette nouvelle mission et comment il trouverait le temps de l’exercer : nous n’avons pas abordé ce type de questions, mais nous souhaitons sensibiliser le corps médical au problème qui se pose. En plus du site internet, nous entendons, en collaboration avec le Délégué à la sécurité routière, organiser une ou plusieurs réunions par an, sur des thèmes particuliers de sécurité routière, avec les médecins, dans leurs régions. Il s’agit de permettre aux personnes âgées d’achever en douceur leur carrière de conducteur.
Nous cherchons aussi à impliquer le milieu associatif, notamment sportif. Les clubs départementaux participent – ou non – positivement – ou non – aux actions visant à améliorer les comportements au volant, s’agissant plus particulièrement de la consommation d’alcool et de la conduite sans permis. Comme ils représentent des exemples pour les jeunes, nous aimerions les compter à nos côtés, ce qui n’est pas toujours le cas.
Nous déplorons le dessaisissement du Conseil national de la sécurité routière. Bien qu’ayant joué un rôle important pour la popularisation de la politique menée à partir de 2002, il a été mis aux oubliettes depuis quatre ans. Le relancer serait une bonne chose car il avait réalisé des études intéressantes et constitue un instrument médiatique pouvant s’avérer précieux. Dans ce domaine, tout ce qu’on peut dire dans le sens du renforcement de la prévention, comme des sanctions, bénéficie d’une incidence positive : les populations comprennent que des mesures sont prises ou vont l’être ; elles sont ainsi incitées à prendre davantage garde à la conduite sur route.
Enfin, nous souhaitons une mobilisation interministérielle en faveur de la sécurité routière. Le ministère auquel on la rattache importe peu. Il est essentiel que le Premier Ministre prenne lui-même la tête de la politique menée dans ce domaine.
M. le rapporteur. Je partage nombre de vos analyses et de vos conclusions. La question des deux-roues motorisés me paraît tout particulièrement sensible. Que pensez-vous de l’idée d’une certaine légalisation des remontées de files, dans les hypothèses d’embouteillage ou de vitesse inférieure à 20 km/h, ainsi que cela vient d’être fait en Belgique ? Au-delà, quelles mesures significatives permettraient de réduire le volume des accidents frappant les deux roues ?
M. Claude Liebermann. Une certaine tolérance à l’égard des remontées de files par les deux roues pourrait apparaître comme une décision permissive et envoyer ainsi un signal négatif.
La notion de deux roues recouvre des catégories très différentes d’usagers, comme l’ont montré notamment les jeudis de l’INSERR, au cours desquels, une fois par mois, un thème de sécurité routière donne lieu à une table ronde avec des spécialistes et des inspecteurs du permis de conduire en formation. La catégorie des motards se regarde comme la mal aimée, ce qui n’est pas totalement faux quand on considère certains aménagements routiers, exclusivement conçus pour les automobiles et dangereux pour les deux roues. On y remédie progressivement. Les motards considèrent aussi que la réglementation n’est pas faite pour eux, spécialement les limitations de vitesse, l’interdiction de remonter les files et celle de dépasser entre les voitures … Il faudrait parvenir à une sorte d’accord avec eux, afin qu’ils ne se sentent plus exclus de la politique de sécurité routière et qu’ils admettent, en contrepartie, leur devoir d’en respecter les exigences. Mais l’expérience montre que toute mesure allant dans leur sens est immédiatement ressentie comme un encouragement supplémentaire à se dispenser un peu plus de l’observation des règles : en d’autres termes, quand vous leur donnez le bras, ils prennent l’épaule. C’est pourquoi tout signal qui leur est adressé, même s’il peut s’expliquer techniquement, comme l’autorisation de remonter les files dans certaines circonstances, présente un risque.
M. le rapporteur. Vous parlez d’un accord avec les motards. Mais, dans la réalité, la remontée de file, bien qu’interdite, se pratique couramment et n’encourt de fait ni contrôle ni sanction. Ce serait d’ailleurs impossible en zone urbaine. Ne peut-on donc la légaliser tout en renforçant les obligations relatives à la vitesse ?
M. Claude Liebermann. N’oublions pas que la remontée de file à vive allure est dangereuse : il suffit de l’ouverture d’une portière pour provoquer un accident mortel. Il faudrait donc mener des expériences en milieu urbain, là où les véhicules vont moins vite, où se produisent des embouteillages, afin d’étudier le comportement des personnes. Mais il faut par-dessus tout éviter de donner l’impression d’une victoire du lobby des motards.
M. le président Armand Jung. L’idée d’un accord avec les motards n’est pas forcément à exclure. Il est vrai qu’ils ont tendance à se considérer comme placés au-dessus des règles : les limitations de vitesse ne seraient pas faites pour eux. Nous avons indiqué à leurs représentants que l’application de celles-ci n’était pas négociable. Si l’on pouvait seulement obtenir une diminution de 10 % de la vitesse moyenne des motos, l’incidence sur les accidents ne serait pas négligeable.
M. Claude Liebermann. On peut discuter avec les motards de nombreuses questions concernant leurs relations avec les autres usagers, notamment celle du partage de l’occupation des domaines routier et piétonnier. Mais le respect des limitations de vitesse n’est pas négociable car le facteur d’accident est trop important.
M. Jacques Myard. Comment se fait-il que la population des motards se croie au-dessus de toute réglementation ? Il s’agit d’un problème interne à cette catégorie d’usagers de la route. Pourquoi ne parvient-on pas à mieux leur faire passer des messages de bon sens ?
M. Claude Liebermann. Le problème est spécifiquement français : les motards allemands n’ont pas le même comportement et leurs associations ne raisonnent pas comme leurs homologues françaises. Leur vision de la réglementation est beaucoup plus saine.
M. Dominique Lebrun. Il faut distinguer trois catégories de conducteurs de deux roues : les motards que la vitesse passionne et qui, chevauchant des engins pouvant atteindre ou dépasser les 250 km/h, succombent à la tentation de s’en servir ; ceux, de plus en plus nombreux en ville, notamment à Paris, qui cherchent à éviter les embouteillages et qui, dans la plupart des cas, ne bénéficient d’aucune formation particulière pour ce type de conduite, souvent accessible avec un permis B ; enfin, les jeunes, conduisant un cyclomoteur de moins de 50 cm3, mais qu’ils font débrider, souvent avec l’appui des parents à qui l’on a expliqué qu’une puissance insuffisante était aussi cause d’accident. Nous en avons vu un exemple à Agen avec la côte du Caoulet, qu’il serait impossible – soit disant - de franchir avec un moteur bridé. Aucune de ces trois catégories de conducteurs de deux roues ne respecte convenablement le code de la route.
Je ne crois donc pas qu’on puisse faire progresser la sécurité en adoptant des mesures plus souples pour les deux roues. Dans la réalité, la remontée des files « en bon père de famille » ne soulève guère de problèmes et la police de la route n’inquiète pas les intéressés. Il en va tout différemment de ceux qui, d’ailleurs très agiles, cherchent l’exploit à travers les rodéos et autres figures de style.
A été récemment instituée l’obligation de suivre sept heures de formation pour conduire un deux roues n’exigeant pas de permis. Mais, dispensée par les auto-écoles, elle ne donne lieu à aucune sanction et n’a d’autre conséquence que le droit de souscrire une assurance.
M. Jacques Myard. On ne supprime pas les feux rouges au motif que certains conducteurs ne les respectent pas. Gardons-nous de la politique du sapeur Camembert.
M. Claude Liebermann. Dans le cadre d’un accord global avec les deux roues, avec pour indicateurs la diminution du nombre des accidents ainsi que celui des infractions commises dans des domaines essentiels, pourquoi ne pas admettre la pratique de la remontée de file ? Mais on ne peut légaliser des pratiques au seul motif qu’on doit céder quelque chose, alors qu’une mesure de tolérance sera ressentie comme un signe de faiblesse et justifiera de nouvelles demandes.
M. le rapporteur. Que pensez-vous des stages de récupération de points de permis ? Certains propagent l’idée qu’il suffit de payer pour retrouver l’intégralité de son permis.
M. Dominique Lebrun. Je n’approuve pas la disposition, votée par l’Assemblée nationale, permettant de récupérer des points chaque année. Elle tombe sous le reproche que vous venez de mentionner.
Il faut, certes, conserver le mécanisme de la récupération de points mais veiller à ce que les stages soient efficaces. Ceux qui les suivent pour la première fois en tirent quelques enseignements. Mais les stages se trouvent un peu pollués par les « récidivistes », qui se présentent pour la deuxième fois, la troisième, ou bien davantage, et qui cherchent uniquement à racheter leurs points. Il y a là une réflexion à mener pour améliorer le système et lui ôter son aspect d’opération commerciale.
M. le président Armand Jung. Je précise que tous les parlementaires n’ont pas voté la disposition incriminée.
M. Claude Liebermann. Il faut prêter la plus grande attention à la façon dont ces stages sont organisés et vécus. L’INSERR en forme les animateurs. L’équipe d’animation doit comporter à la fois un psychologue et un titulaire du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur (BAFM). Mais on éprouve parfois des difficultés à réunir les deux.
Certains stages se déroulent dans le cadre d’une formation continue des conducteurs : les réseaux des écoles de conduite le font assez bien. D’autres stages se sont spécialisés dans le rachat des points et ressemblent en effet à des « pompes à fric ». Il conviendrait donc de les soumettre à un certain contrôle, auquel l’INSERR pourrait participer.
M. le rapporteur. Aujourd’hui, des gestionnaires de stage peuvent contribuer à la récupération de quatre points sans aucun contrôle extérieur de la qualité des prestations qu’ils offrent.
M. Claude Liebermann. Toutes les pertes de points ne sont pas de même nature : certaines proviennent de sanctions infligées à la suite d’infractions importantes, dues à l’alcool et à la vitesse, et d’autres à des fautes beaucoup plus légères. Les conducteurs appartenant à la première catégorie sont souvent irrécupérables. D’autres conducteurs ont besoin de leurs points pour leur travail et sont plus concernés par les excès de vitesse que par l’alcool. Enfin, le tout-venant rassemble des personnes ayant perdu leurs points par des concours de circonstances et par la multiplication de petites infractions : eux sont tout à fait récupérables. Le stage leur fournit l’occasion de renforcer leur connaissance des exigences de la sécurité routière. Je serais donc favorable à une sorte de formation continue des conducteurs, liée à la récupération des points. Reste à savoir comment financer ce système. Les assurances et les mutuelles pourraient s’y impliquer. Car, si le nombre des accidents s’en trouvait diminué, tout le monde y gagnerait. En revanche, les stages de récupération de points au cours desquels les conducteurs n’apprennent rien ne constituent qu’un gaspillage de fonds privés. Il y a là un travail de reconfiguration à effectuer pour l’ensemble du dispositif.
M. Dominique Lebrun. Le système actuel souffre, en effet, d’une carence dans le contrôle des centres de récupération de points, comme d’ailleurs dans celui des écoles de conduite - dont l’agrément est renouvelé tous les cinq ans sans vérification particulière -, alors même que les uns et les autres participent à une mission de service public. Comme il n’est guère imaginable, par les temps qui courent, de créer un nouveau corps de contrôle, les inspecteurs du permis de conduire pourraient pallier cette carence à condition qu’on dégage pour eux le temps nécessaire. Un de nos rapports, remis en 2008, estimait cela possible à hauteur de 25 à 30 % de la durée de travail des inspecteurs, sans accroître pour autant le stock de candidats au permis de conduire.
À titre d’exemple, on peut se demander si le permis poids lourd doit encore être délivré par les inspecteurs, alors qu’il relève pleinement de la formation professionnelle des chauffeurs routiers et que ceux-ci, après l’obtention de leur permis, suivent une formation dite initiale minimale obligatoire (FIMO) durant huit semaines. On peut aussi s’interroger sur l’épreuve du code : un inspecteur ne perd-t-il pas son temps lorsqu’il déroule les visuels des questions posées aux candidats ? Faut-il enfin conserver autant de centres d’examen, quand on voit que certains d’entre eux sont installés dans des cafés, autour desquels, dans les zones reculées, on peine à trouver un feu rouge ? Tout cela a un coût, notamment celui du déplacement de l’inspecteur.
M. le rapporteur. Que pensez-vous de la question des radars sur les feux rouges ? Faites-vous des préconisations à ce sujet ?
M. Dominique Lebrun. Des radars de ce type sont déjà installés, dans des endroits judicieusement choisis comme, à Saint-Cloud, devant une sortie de lycée où plusieurs accidents se sont déjà produits. Ils ont, au début, provoqué quelques émois. Les conducteurs locaux y sont maintenant habitués et veillent à mieux respecter les signaux lumineux.
Les médias en parlent peu et nous sommes rarement sollicités à ce propos, bien que l’infraction correspondante entraîne un retrait de quatre points.
Curieusement, le sujet suscite aujourd’hui moins de réactions que les radars de contrôle de vitesse en 2003. À l’époque, les automobilistes ne comprenaient pas pourquoi un dépassement de la vitesse autorisée en rase campagne coûtait 45 euros, contre 90 euros en ville – sachant que l’on considérait alors que le premier dépassement était moins dangereux que le second.
M. le rapporteur. Les radars sur feux rouges ont entraîné 17 962 sanctions automatiques en 2009 et 287 421 en 2010. N’est-ce pas éloquent ?
M. Dominique Lebrun. Il faut rapprocher ces chiffres du nombre de radars installés en 2009 et en 2010.
M. Jacques Myard. Le principal problème n’est-il pas celui du champ balayé par le radar et de l’instant où le flash se déclenche ? Compte tenu de la longueur moyenne d’une voiture, le radar peut repérer celle-ci franchissant un feu rouge alors que le conducteur s’est engagé au feu orange.
M. Dominique Lebrun. Il faut vérifier, sur le plan technique, que le système fonctionne de façon juste. Il y a peut-être quelques aménagements à effectuer.
On sait très bien, notamment la nuit, que les feux rouges sont très mal respectés. Ce qui justifie pleinement l’installation des radars.
M. le rapporteur. Se pose tout de même le problème du passage de l’orange au rouge et du flash consécutif. Les règles sont-elles suffisamment claires ?
M. le président Armand Jung. Il semblerait que les radars soient bien réglés et que le flash ne se déclenche que pour les véhicules passant vraiment au feu rouge.
M. Jacques Myard. Le problème réside dans le temps qui s’écoule entre l’avancée de la voiture à l’orange et le déclenchement du radar au feu rouge. On devrait pouvoir décompter les secondes correspondantes.
M. Claude Liebermann. On pourrait procéder comme pour les radars de vitesse et admettre une tolérance équivalente à celle des 5 km/h. Le choix est affaire de techniciens. Les premières études ont montré qu’il s’agissait d’un problème très délicat. Nous l’avions déjà éprouvé pour le couplage des radars avec les feux de signalisation des passages à niveau. Les expériences ne sont pas encore achevées.
M. le président Armand Jung. Il est, je crois, prévu de généraliser la mesure.
M. Claude Liebermann. Les appréciations techniques sont toujours complexes pour les radars. On le mesure aussi s’agissant des radars dits pédagogiques. Ceux-ci étaient initialement conçus pour l’usage des communes. La technologie soulève des difficultés lorsqu’existent plusieurs files de circulation et que certains automobilistes roulent beaucoup plus vite que les autres. Au début, quelques ratés sont inévitables.
Dans le domaine de la sécurité routière, trop souvent, les décisions interviennent en même temps que se déroulent les expérimentations. Or, il faudrait stabiliser les systèmes, les adosser à des règles claires, elles-mêmes peu susceptibles de changements. Les initiatives nouvelles se fondent sur de bonnes intentions, mais elles perturbent immanquablement les dispositifs déjà en place, ce qui suscite des mesures compensatoires qui, elles-mêmes, ont des conséquences sur d’autres mécanismes, et ainsi de suite. Les populations éprouvent parfois des difficultés à en comprendre l’enchaînement.
La politique inaugurée en 2002 a été bien perçue car l’annonce de l’installation de nouveaux radars fut enregistrée comme répondant à la nécessité de rouler moins vite. Du coup, les automobilistes ont ralenti, presque un an avant la pose du premier radar. Puis, les mesures ont été appliquées telles qu’annoncées. Une politique de communication unique donne des résultats tangibles, il ne faut donc pas la brouiller.
Mais on s’attaque désormais à des niches, qui donnent moins facilement lieu à la mise en place de systèmes simples et stables. Nous nous trouvons dès lors confrontés à une contradiction entre l’exigence de la simplicité et celle de l’efficacité opérationnelle. Il nous faut la gérer.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Claude Got, professeur honoraire de médecine
Mardi 20 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Nous poursuivons nos auditions relatives aux causes des accidents de la circulation et à la prévention routière en accueillant M. le professeur Claude Got.
Monsieur le professeur, vous faites autorité en matière de prévention routière. Selon vous, les accidents de la circulation ont-ils des causes multifactorielles ? Êtes-vous favorable au bridage des moteurs ? Quelle est votre position sur les panneaux avertisseurs de radars ? Comment pourrait-on faire baisser le nombre des accidents des deux roues motorisés ? Que pensez-vous des campagnes de communication de la sécurité routière ? Que nous suggérez-vous dans le domaine de la gouvernance ? Comment jugez-vous la politique de lutte contre l’alcool au volant ? La semaine dernière, nous avons rencontré les constructeurs d’automobiles français. Quelles suggestions conviendrait-il de leur faire ? Tels sont certains des thèmes que nous aimerions vous voir aborder.
M. Claude Got. Messieurs les députés, votre mission est impossible et je vais tenter de vous expliquer pourquoi.
Depuis une quarantaine d’années, dans le cadre de mes fonctions, j’ai tenté d’articuler des expertises très différentes :
Premièrement, l’expertise des personnes. Chacun est à même d’exprimer des idées personnelles sur les accidents. Tout le monde conduit, tout le monde est conduit. Les Français se considèrent comme des spécialistes de l’accident. Certains même se rassemblent dans des associations. Et cela nous amène à entendre des discours souvent très différents : les uns très rationnels, les autres passionnels et bien éloignés de la réalité.
Deuxièmement, l’expertise scientifique, qui, selon moi, ne pose pas de problème particulier. Sans doute peut-on la perfectionner dans certains domaines mais, dans l’ensemble, elle fournit aux politiques tous les éléments dont ils ont besoin pour définir et appliquer des politiques de sécurité routière. Les succès obtenus en 1973-1974 et 2002-2003 en témoignent.
Troisièmement, l’expertise décisionnelle, qui me passionne, et que j’ai pratiquée à plusieurs reprises. Dans un tel cadre, les experts répondent aux décideurs en fonction de l’objectif qu’ils ont fixé.
Pour ma part, je m’intéresse à la sécurité routière depuis que les chercheurs de chez Renault sont venus me voir à Garches en octobre 1970. J’ai participé au Comité d’études sur l’alcoolisme et pratiqué un autre type d’expertise transversale sur des problèmes de sécurité sanitaire liés au sida, à l’alcool, à l’amiante ou au tabac. Je me suis alors rendu compte comme il pouvait être difficile d’accorder le désir profond des politiques de rendre service à la population en améliorant sa sécurité et certains intérêts économiques et sociaux. Vous en avez entendu un grand nombre s’exprimer.
Quatrièmement, l’expertise opérationnelle, où nous sommes les plus défaillants : une fois les évaluations effectuées par les universitaires et les décisions prises par les politiques, il faut mettre en œuvre ces décisions. C’est là où le bât blesse : les politiques ne se donnent pas les moyens de réussir, alors qu’on connaît parfaitement les conditions de cette réussite.
Quelles sont ces conditions ? On peut se demander sur quels leviers il faut agir et ce qui, en matière de sécurité routière, a fait preuve de son efficacité. Tout dépend des niveaux d’intervention.
Au niveau des véhicules, notre intervention est limitée. En effet, toutes les normes obligatoires relatives aux véhicules sont actuellement fixées au niveau européen, et l’initiative nationale est faible.
La Commission européenne avait conclu à la nécessité d’installer un dispositif limitant la vitesse lors de la construction des véhicules. En effet, pourquoi laisser construire des véhicules qui roulent à 200 km/h si l’on doit ensuite prendre des textes limitant leur vitesse à 130 km/h sur autoroute ? Mais l’Allemagne s’oppose à toute décision de cette nature – pourtant recommandée dans le Livre blanc de sécurité routière, un des rapports auquel j’ai participé – tout comme elle s’oppose à la documentation du risque sur ses autoroutes.
Autre exemple : le WP 29 est une commission de l’ONU qui définit les normes en matière de sécurité routière. La France avait proposé une boîte noire, avec un limiteur de vitesse manuel : il s’agit d’un dispositif extrêmement simple qui enregistre en permanence la vitesse et qu’un policier ou un gendarme peut contrôler à tout moment en branchant un lecteur sur le véhicule concerné. Trois mois après avoir déposé le texte devant le WP 29, la France l’a retiré sous la pression de l’Allemagne ; nous n’avions pas voulu en faire un sujet de conflit avec notre voisin.
Au niveau des infrastructures, il est possible d’agir. Depuis longtemps, nous demandons une expertise indépendante de la sécurité des infrastructures mais, jusqu’à présent, nous n’avons pas pu l’obtenir.
C’est au niveau du dispositif de contrôle et de sanction que nous avons remporté des succès. À partir du moment où des décisions ont été adoptées concernant les vitesses, celui-ci s’est avéré rapidement efficace – à la différence de ce qui se passe avec les infrastructures, dont l’amélioration met plusieurs années à se traduire concrètement sur le terrain.
En 1972 et 1973, nos succès furent extraordinaires.
En mars, avril, mai, juin 1972, fut atteint le pic de 18 000 tués par an sur les routes. En juillet fut créé le Comité interministériel de sécurité routière initié par Michel Ternier. Ce dernier, depuis 1969, travaillait avec des ingénieurs et des techniciens pour tenter d’enrayer cette progression du nombre des tués, qui semblait inéluctable. Il leur fallut deux ou trois ans pour discuter et rationaliser des choix budgétaires portant sur les infrastructures, et s’apercevoir qu’il fallait prendre des décisions concernant les vitesses. À la suite de plusieurs essais peu concluants portant sur une partie du réseau, il fut décidé, en juillet 1972, de limiter la vitesse sur l’ensemble du réseau, à l’exclusion des autoroutes.
En octobre 1973, la guerre du Kippour, qui fit craindre une pénurie en pétrole, accéléra le processus Le délégué interministériel de l’époque, Christian Gérondeau, parvint à convaincre M. Messmer de limiter à 90 km/h la vitesse sur le réseau à voies non séparées, et à 120 km/h sur autoroute. Ce fut un vrai miracle : la mortalité fut divisée par plus de 2 !
Les constructeurs étant intervenus en mars 1974 auprès du Président de la République au motif qu’ils ne vendaient plus de voitures puissantes, la vitesse sur autoroute fut portée à 140 km/h sur autoroute, ce qui fit remonter la mortalité. En novembre, M. Gérondeau obtint que l’on redescende à 130 km/h la vitesse sur autoroute et, surtout, que l’on maintienne à 90 km/h la vitesse sur route. À partir de cette date, la mortalité routière baissa à nouveau rapidement, jusqu’à 15 000 tués. Il s’agit là d’un succès politique exceptionnel.
S’ensuivit une longue période de descente régulière du nombre des tués – jusqu’à 8 000. Cette descente fut favorisée par des dizaines, voire des centaines de petites décisions très ponctuelles. On doit malgré tout déplorer le peu d’impact des contrôles préventifs d’alcoolémie – dont le taux limite était alors de 0,80 gramme par litre – instaurés par la loi de 1978, et l’échec essuyé par le gouvernement de M. Jospin en matière de sécurité routière : M. Gayssot avait annoncé imprudemment que son objectif était de faire baisser la mortalité de 50 % en cinq ans ; or cette baisse ne fut que de 2,2 % !
M. Ternier reprit en main la commission d’évaluation du système de contrôle et de sanction. Cette commission, à laquelle j’ai participé, travailla pendant deux ans sur 5 000 procédures et arriva à la conclusion que la moitié des contraventions n’aboutissaient pas. Dans cette maison, mais aussi dans des commissariats ou des brigades, faire « sauter » les contraventions était devenu un moyen de rendre des services, de renvoyer l’ascenseur, de plaire. Il était difficile aux policiers ou aux gendarmes d’échapper aux demandes qui leur étaient faites, ainsi qu’à un système qui s’était instauré progressivement. Néanmoins, ce système s’arrêta en 2002 quand M. Jacques Chirac décida de faire de la sécurité routière une priorité – je rappellerai pour mémoire le discours du 14 juillet, la tenue des États généraux de la sécurité routière de septembre et l’élaboration d’un plan gouvernemental. Le jour même de la tenue du Comité interministériel, en décembre 2002, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, signa une circulaire interdisant les indulgences. En un mois, la mortalité s’effondra de 30 % !
Toute une série de lois et de textes réglementaires furent alors pris : début février, loi sur la pénalisation de l’usage des stupéfiants ; fin mars, textes augmentant la perte de points pour l’usage du téléphone au volant ou pour le non respect du port de la ceinture de sécurité ; en juin, loi Perben.
L’amélioration de la situation s’explique non seulement par le fait que le Comité interministériel avait accepté les conclusions de la commission Ternier, mais aussi par l’installation de radars automatiques – véritable révolution inspirée par le succès des expériences, menées notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, pour automatiser les contrôles de vitesse : l’installation de caméras numériques, la transmission d’images à distance et l’analyse de celles-ci permettant la mise au point d’un système centralisé extraordinairement efficace. Cela signait l’abandon par les gendarmes et les policiers des saisies manuelles des données, saisies qui induisaient, pour que les forces de l’ordre ne croulent pas sous la paperasserie, une tolérance d’une vitesse de 20 à 30 km/h supérieure à la vitesse autorisée
Le Conseil interministériel avait décidé de ne plus tolérer les faibles excès de vitesse. Chacun avait compris que pour être efficace, il ne fallait pas seulement désigner les chauffards commettant de grands excès de vitesse, mais faire en sorte que toute la population respecte les règles. C’était rejoindre les exigences de l’épidémiologie, laquelle implique de s’occuper non seulement des malades très exposés à une maladie, mais aussi des dizaines de milliers d’individus qui le sont moins – je pense notamment à tous ceux qui ont été exposés à l’amiante.
Le succès de 2002 s’explique donc par un retour à l’égalité devant la loi, dans la mesure où il n’était plus possible de faire sauter les contraventions – en particulier celles des notables ; par une faible tolérance sur les excès de vitesse ; par l’automatisation du système de contrôle, qui devient ainsi plus efficace. La chute de la mortalité s’est alors poursuivie jusqu’en 2006.
La stagnation actuelle est due, selon moi, à un manque de volonté politique de maintenir le système en l’état, et donc de le développer pour en conserver l’efficacité. Ce qui s’est passé avec les radars est significatif à cet égard : le rapport d’évaluation des radars automatiques de mars 2006 recommandait que l’on installe des radars dans le flux de circulation pour porter la dissuasion partout. Nous sommes en 2011, et ces radars ne sont toujours pas au point ! Dans le même temps, les avertisseurs de radars se sont développés, et la neutralisation du radar fixe est devenue opérationnelle, sans que le Gouvernement n’y fasse rien. Aujourd’hui, la situation est bloquée.
Le dernier épisode est celui de la LOPPSI 2. Le projet initial comportait des mesures favorables à la sécurité routière, mais un amendement a divisé par deux la valeur d’un point de permis. Maintenant, on peut en effet récupérer 4 points par an au lieu de 2 points. On ne peut que déplorer cette dévalorisation de la dissuasion par le permis à points, qui avait été un des éléments fondamentaux du succès de 2002.
Telle est l’expérience que je retire de ces quarante dernières années. Je tiens à préciser qu’en 2002, aucun chercheur en sécurité routière n’imaginait que la décision de M. Jacques Chirac aboutirait à un tel succès.
Il me faut maintenant aborder un problème important, lié à un déficit de communication.
Il y a des sujets dont on ne s’occupe pas. Par exemple, je n’ai jamais vu présenter de façon valorisante pour l’action gouvernementale les sommes qui ont été épargnées par les usagers à la suite des décisions de 2002 – notamment grâce à la diminution des tarifs d’assurance, lesquels vont repartir fortement à la hausse au début de l’année prochaine. De même, les services de l’État répugnent à dénoncer les manipulations ou les mensonges proférés en matière de sécurité routière. Quand je le fais, je me sens extrêmement seul.
M. le président Armand Jung. Monsieur le professeur, soyez plus précis !
M. Claude Got. C’est très facile.
Vous avez dit un jour, et votre rapporteur vous avait alors approuvé, que l’accidentologie n’était pas une science exacte. Expliquez-moi ce qu’est une science inexacte ! La science suppose la volonté de se rapprocher d’une réalité, avec des méthodes scientifiques. On met les chiffres sur la table et on en discute avec sincérité ; or ce n’est pas toujours le cas.
À cet égard, j’ai écrit un ouvrage intitulé La violence routière : des mensonges qui tuent. Un journaliste a cru bon de porter plainte et je me suis retrouvé devant la 17e chambre correctionnelle. Cela m’a amené à présenter un CD-ROM contenant une centaine de documents prouvant qu’Airy Routier, journaliste connu, avait bien menti dans son ouvrage intitulé La France sans permis, dans lequel il avançait que notre pays comptait deux millions de conducteurs sans permis. J’ai obtenu gain de cause, comme cela ressort des attendus du jugement : « Le prévenu pouvait affirmer, comme il l’a fait, que les erreurs factuelles et de raisonnement qu’il dénonçait relevaient d’une volonté délibérée de l’auteur de travestir la vérité et de tromper le lecteur. » Ayant perdu son permis de conduire et ayant été placé deux fois en garde à vue, ce journaliste n’avait pas supporté cette « violence » faite, selon lui, à un individu estimable – il ne l’était pas à mes yeux. Reste qu’il est difficile d’être confronté à ce type de mensonges.
Voilà pourquoi je m’inquiète de votre mission et de ce que vous pourrez écrire. Soyez notamment attentifs à ce que vous ont dit les intervenants de l’association « 40 millions d’automobilistes ». Ainsi, un monsieur à l’air très respectable a abordé devant vous la règle de Nilsson – équation mondialement connue, selon laquelle une diminution de 1 % de la vitesse moyenne s’accompagne d’une diminution de 4 % de la mortalité. Mais ce que vous a dit ce monsieur à propos de cette équation s’apparente, selon moi, à un mensonge caractérisé dans la mesure où il pratique un amalgame entre du linéaire et de l’exponentiel. Et je me demande si vous ferez remarquer, dans votre rapport, que ses affirmations étaient totalement fausses.
M. le président Armand Jung. L’idée que les intervenants voulaient faire passer était que si la vitesse moyenne diminue, le nombre d’accidents et de tués diminue également, dans une proportion plus grande, et ce par effet mathématique. Le contestez-vous ?
M. Claude Got. J’ai dit que ce qu’ils avaient affirmé était faux.
Je peux vous donner un autre exemple, qui concerne les contrôles d’alcoolémie. Il a été dit que les 13 millions de contrôles d’alcoolémie qui avaient été effectués à une certaine époque avaient permis de diminuer de façon importante la mortalité liée à l’alcool, mais que cet effort n’avait pas été poursuivi, ce qui s’était traduit par une aggravation de la situation. Or c’est totalement faux. Il n’y a pas eu d’effondrement des contrôles d’alcoolémie en 2005-2006, comme en témoignent les chiffres des policiers et des gendarmes, qui ont été repris par le ministère de l’intérieur.
En revanche, à un moment donné, du fait de la méconnaissance technique des problèmes, l’association « 40 millions d’automobilistes » a commis une erreur majeure en écrivant : « Des chiffres encourageants, des interprétations non concordantes : en ce qui concerne la lutte contre l’alcoolémie, les chiffres officiels sont les suivants : 2005 : 28,8 % des tués sont dus à l’alcool (rapport ENISR, page 153), soit 1 532 victimes ; 2006 : la sécurité routière annonce 21,1 % des tués dus à l’alcool, soit 992 victimes. L’écart de 540 des victimes de la route dues à l’alcool entre 2005 et 2006 représente 88 % du gain total des 615 vies sauvées en 2006 ». Il était donc fait état, dans ce communiqué, de l’énorme succès remporté en 2006 dans la lutte contre l’alcoolémie au volant. Devant de tels chiffres, qui étaient ceux du rapport provisoire de 2006, je me suis adressé au responsable de l’Observatoire interministériel de l’époque, qui confirma ce que je pensais : les chiffres étaient faux. Le malentendu était dû à une erreur de gestion informatique des résultats collectés à partir des bulletins d’analyse d’accidents corporels. Ces résultats provisoires ont été immédiatement corrigés, publiés dans des communiqués, confortés dans le résultat définitif. Pourtant, cinq ans plus tard, on vous « ressort » les mêmes chiffres erronés.
J’ai oublié précédemment de vous préciser que l’équation de Nilsson n’était pas applicable sur autoroute. Selon vos interlocuteurs, la diminution du nombre de morts y aurait été beaucoup plus importante que ce qu’aurait pu laisser prévoir la diminution de la vitesse moyenne. Mais c’est simplement parce qu’ils avaient pris comme référence non pas les autoroutes de liaison où la vitesse peut s’exprimer, mais les autoroutes de dégagement, qui sont encombrées et où, bien entendu, la notion de circulation à vitesse libre n’existe pas. C’est la densité de circulation qui fixe la vitesse et on ne peut pas appliquer l’équation de Nilsson dans ce contexte-là.
De la même façon, M. de Caumont a repris devant vous l’argument des autoroutes allemandes. Mais il répète sans cesse les mêmes mensonges, avec une mauvaise foi absolue, car il sait parfaitement que ce qu’il dit est inexact. Il a oublié de vous préciser que les Allemands refusent de communiquer séparément les chiffres des kilomètres parcourus sur le réseau non limité et sur le réseau limité. Une étude comparative, que s’apprêtaient à faire les ingénieurs allemands et français, a même été bloquée au dernier moment par un ukase fédéral ! Il ne vous dit pas non plus qu’un an après que la vitesse a été limitée sur l’autoroute Berlin-Hambourg, la mortalité y a baissé de moitié.
La vitesse est un facteur commun à tous les accidents. Et remarquez que je parle ici de vitesse, et non d’excès de vitesse. Certes, les véhicules qui ne se déplacent pas n’ont pas d’accidents… Quoi qu’il en soit, avant même que je m’intéresse à l’accidentologie, certains chercheurs, comme Bolin en Suède ou Solomon aux États-Unis, ont montré que lorsque la vitesse augmente, l’accidentalité augmente plus que la proportion linéaire.
Que peut-on faire actuellement, devant la stagnation de la mortalité ?
Les troubles de l’attention sont des facteurs d’accidents. Seulement, nous n’avons pas de moyens commodes pour agir sur eux. On ne peut pas les pénaliser ! Les constructeurs ont fait des essais assez élaborés, pour étudier, par exemple, le mouvement des yeux afin de repérer si les conducteurs s’endormaient. Mais ces essais n’ont abouti qu’à quelques applications pratiques, qui n’ont jamais été généralisées. Les sociétés d’autoroutes ont consacré cette année une campagne sur le sujet. Malheureusement, si les accidents liés à un trouble de la vigilance sont nombreux, leur proportion ne bouge pas : il y a dix ans, 32 à 38 % des accidents mortels sur autoroute s’expliquaient déjà de cette façon. Et pourtant, la vitesse a diminué sur les autoroutes et, en nombre absolu, le nombre de morts a été divisé à peu près par deux.
Avec l’alcool, le phénomène est exactement le même. Avant les réformes de 2002, quand on dénombrait 8 000 tués par an sur les routes, 30 % des accidents mortels étaient liés à l’alcool. Maintenant, il n’y a plus que 4 000 tués par an sur les routes, mais le pourcentage des accidents mortels liés à l’alcool n’a pas baissé pour autant. Et si l’on se réfère aux contrôles préventifs d’alcoolémie effectués par les policiers et les gendarmes, le nombre de gens qui conduisent sous l’influence de l’alcool n’a pas chuté. Seulement, comme les autres conducteurs et eux-mêmes ont ralenti, ils se tuent moins. Ainsi, la division par deux du nombre d’accidents mortels liés à l’alcool n’est pas due à la modification de la conduite sous l’influence de l’alcool, mais à la modification de la vitesse.
Voilà pourquoi il me semble pouvoir affirmer que seule la réduction de la vitesse a fait la preuve de son efficacité. Je reconnais que la ceinture, dont le port a été rendu obligatoire à l’été 1973, réduit par 2 ou 3 le risque de trouver la mort en voiture. Plus généralement, tous les progrès qui ont été faits sur les véhicules – airbags, coque résistante qui ne s’écrase pas, avant déformable, etc. – ont contribué à réduire les risques. L’efficacité de ces équipements est d’autant plus grande que la vitesse diminue. On peut parler d’un système où tous les éléments se combinent, mais où la vitesse reste le facteur commun.
Maintenant, qu’est-ce qu’un conseiller technique qui s’intéresse au fonctionnement politique pourrait proposer à un décideur qui voudrait relancer la politique de sécurité routière ?
Selon moi, il faut se pencher de nouveau sur la question de la réduction des vitesses de circulation. On a de nombreuses raisons de le faire : l’équilibre de la balance des paiements, la réduction de la consommation, la sécurité routière.
S’agissant de la sécurité routière, je vous suggérerais trois méthodes.
La première s’apparenterait à celle adoptée en 1972 : diminuer les vitesses de circulation – par exemple 80 km/h sur route, 110 ou 120 km/h sur autoroute. Et la courbe de la mortalité redescendrait.
La deuxième méthode serait la plus conflictuelle, comme on peut l’imaginer après le débat sur la LOPPSI 2. Elle consisterait à augmenter le poids et l’efficacité du système de contrôle-sanction, en prenant trois mesures.
Premièrement, développer – c’est en cours – les fameux radars « mobiles mobiles », pour que les conducteurs se disent qu’ils peuvent être contrôlés n’importe où.
Deuxièmement, interdire les avertisseurs de radars. Les conducteurs ne doivent pas pouvoir compter sur le système Coyote ou sur tout autre système pour les prévenir qu’un radar déplaçable opère à tel ou tel endroit. Pour cela, une loi est nécessaire. Je ne crois pas un seul instant au protocole qui a été signé avec l’Association française des fournisseurs et utilisateurs des technologies d’aide à la conduite (AFFTAC). L’efficacité de ce protocole sera nulle, parce que tous ceux qui le souhaitent pourront continuer à signaler aux autres conducteurs les radars et les contrôles de police. Il faut être d’une naïveté incroyable pour passer un accord avec ceux qui travaillent et gagnent de l’argent à empêcher les policiers et les gendarmes de faire leur travail, et d’exercer la dissuasion par les contrôles…
M. le président Armand Jung. Votre troisième mesure ?
M. Claude Got. Vous la connaissez : revaloriser les points du permis en instituant des stages de rattrapage dès que l’on en perd deux. Une telle mesure permettrait de neutraliser la décision prise par la LOPPSI 2, qui a réduit la capacité de dissuasion du permis à points. Elle redonnerait du sens et de la force au système de contrôle-sanction.
Troisième méthode : développer le système Lavia (Limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée). Nous avions exprimé, dans le Livre blanc de 1988-1989, l’idée qu’il ne fallait pas mettre entre les mains des usagers des véhicules qui sont faits pour transgresser les règles. Mais nous savons que l’Allemagne s’opposera…
M. le président Armand Jung. Monsieur le professeur, nous avons largement débattu du système Lavia…
M. Claude Got. Mais vous n’avez pas envisagé les deux conditions de son utilisation.
Il pourrait constituer une peine complémentaire, pour des personnes ayant été sanctionnées pour excès de vitesse. Celles-ci seraient autorisées à conduire avec un Lavia – à l’instar des personnes sanctionnées pour alcoolémie, qui sont obligées d’utiliser un véhicule muni d’un éthylotest antidémarrage.
Il pourrait aussi être installé volontairement. Les personnes qui décideraient de s’en équiper auraient la faculté de négocier une ristourne avec leurs assureurs. Il me semble évident qu’avec ce système, leur accidentalité évoluerait favorablement.
Cela nous dispenserait de devoir nous adresser aux instances européennes, et d’attendre une directive… qui ne serait pas prise.
M. le président Armand Jung. Merci, monsieur le professeur, pour votre témoignage, votre expertise et vos propositions.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur le professeur, vous avez déjà répondu par avance à un certain nombre de mes questions. Je me bornerai donc à quelques-unes. Je désire rebondir sur ce que vous venez de dire, car la vitesse est en permanence au cœur de nos débats.
Vous nous dites que si nous voulons faire des progrès, il faut abaisser la vitesse de circulation, donc revenir à la baisse sur les vitesses maximales actuellement applicables sur les différents types de routes. Mais ne pensez-vous pas qu’un tel raisonnement peut avoir des limites ? Il est bien évident qu’un véhicule qui ne se déplace pas ne risque pas d’avoir d’accident, comme vous l’avez fait remarquer. Or, il est également évident qu’un véhicule est fait pour se déplacer. Il faut donc fixer une vitesse acceptable, raisonnable : l’utilité de la voiture doit être conforme aux attentes des conducteurs. On ne saurait réduire la vitesse à 50 km/h sur autoroute.
La limitation de vitesse est-elle la seule solution possible pour faire baisser le nombre des blessés et des morts sur nos routes ? Les vitesses règlementaires ont déjà été réduites de façon importante. Je pense que nous avons besoin de faire preuve d’inventivité. Auriez-vous quelque chose de plus original à nous proposer ?
Par ailleurs, comment expliquez-vous les réactions de nos concitoyens suite au CISR du 11 mai dernier ? En d’autres termes, la solution première que vous nous proposez ne risque-t-elle pas d’être rejetée par nos concitoyens ? Une politique qui n’est pas acceptée et qui entraîne ce type de réaction est-elle pertinente ?
M. Claude Got. Je vous ai fait trois propositions qui ne sont pas à prendre en bloc. Elles peuvent se combiner ou être exploitées séparément.
Selon moi, le risque d’inacceptabilité sociale est plus grand s’agissant de la poursuite d’un renforcement du système de contrôle et de sanction que des deux autres méthodes que je vous ai proposées.
Aux États-Unis, quand Reagan a transféré du niveau fédéral à celui des États le choix des limites de vitesse sur autoroutes, certains d’entre eux ont opté pour des vitesses basses. Or, 60 ou 65 miles est une vitesse très inférieure aux vitesses autorisées en France, qui est un pays beaucoup plus petit.
Quand on s’habitue à conduire doucement, ce qui paraît anormal, c’est de rouler vite. Ma première 2 CV ne dépassait pas 75 km/h, ce qui n’empêchait pas de parcourir l’Europe. Il ne s’agit pas de ne plus utiliser la voiture, mais de l’utiliser avec une vitesse plus faible, plus calmement. J’ai fait moi-même l’essai d’aller à Toulouse puis à Montpellier et de revenir à Paris en roulant à 100 km/h sur les autoroutes, soit à une vitesse un peu plus élevée que celle des poids lourds – ce qui m’a permis, en outre, de consommer 1,5 litre de carburant en moins aux 100 km –, et j’ai vite retrouvé les habitudes qui étaient les miennes quand je conduisais aux Etats-Unis, où les vitesses limites sont inférieures à celles retenues en France et n’empêchent en aucune façon de se déplacer. On peut donc imaginer des limites de vitesse de 10 km/h plus basses. À mon avis, l’acceptabilité sociale d’une telle mesure est peut-être plus grande que celle qui consisterait à multiplier les radars fixes.
Selon moi, le radar fixe, qui a été l’instrument pédagogique des années 2002-2005, a atteint son efficacité maximale. La raison en est simple : les emplacements sont connus et signalés. Au mois de mai dernier, le ministre de l’intérieur a eu la velléité de faire passer deux mesures : ne plus les signaler par des panneaux et interdire les avertisseurs de radars. La première de ces mesures constituait une provocation inutile, dans la mesure où de nombreux systèmes permettent de repérer les radars. Bien sûr, on pourrait décider de multiplier ces radars et d’en faire passer le nombre à 3 000, 4 000 ou 6 000…
M. le président Armand Jung. Alors, que préconisez-vous ?
M. Claude Got. D’abord, l’utilisation de radars déplaçables combinés avec une interdiction stricte des avertisseurs de radars – comme l’avait décidé ce CISR. Il est possible de procéder à des contrôles – car tout passe par un serveur central qui permet d’identifier les utilisateurs – et de faire respecter le protocole signé avec l’AFFTAC. Mais il faut prévoir une pénalisation. Sinon, cette interdiction ne sera pas efficace. Je préconise également l’utilisation des radars « mobiles mobiles », comme on l’avait recommandé en mars 2006.
Parmi ces trois méthodes, les moins brutales et les plus acceptables socialement sont, selon moi, la diminution des vitesses sur le réseau et l’installation du système Lavia.
Qui peut être opposé au système Lavia ? Une fois réglé, vous ne vous apercevrez même pas de son existence. Grâce au positionnement GPS couplé à une cartographie certifiée par l’Etat, vous n’aurez plus à guetter les panneaux ou les radars, car vous saurez que vous ne pouvez pas dépasser la vitesse autorisée localement.
M. le président Armand Jung. Nous avons fait l’essai du système Lavia la semaine dernière.
M. le rapporteur. Je voudrais vous poser une question plus originale. Il a été constaté que les femmes au volant avaient beaucoup moins d’accidents que les hommes. Quel parti pourrions-nous tirer de cet état de fait ?
M. Claude Got. Si les femmes en France vivent plus longtemps que les hommes, ce n’est pas uniquement en raison de leur façon de conduire. C’est parce qu’elles ont un comportement plus sécuritaire que les hommes. Les discussions qui ont lieu à ce propos entre médecins de santé publique sont absolument passionnantes.
Il est beaucoup question de l’alcoolisme féminin. Or, en France, l’alcoolisation des femmes demeure moindre que celle des hommes. C’est ainsi que le décès par cirrhose du foie continue à toucher à peu près trois ou quatre hommes pour une femme.
Les accidents liés à l’alcool sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Une partie de la différence dans l’accidentalité est donc liée à cette différence de comportement vis-à-vis de l’alcool.
On observe le même phénomène dans des pays de culture différente de la nôtre. Une étude menée aux États-Unis a par exemple montré que, dans la classe des 16-18 ans, pour des niveaux d’alcoolémie identique, les jeunes gens présentaient un risque d’accident plus élevé que les filles. Ce qui prouve bien qu’il n’y a pas que le niveau d’alcoolémie qui joue, mais aussi la façon dont on se comporte avec un même niveau d’alcoolémie.
Cette différence caractérise tous les comportements féminins, comme le révèlent les indicateurs de sécurité sanitaire. Comment l’expliquer ? Par des raisons physiques, hormonales ? Ce qui est sûr, c’est que si vous consultez les statistiques sur les rixes et les bagarres, que l’alcool soit ou non présent, vous y verrez un nombre incroyablement faible de femmes et beaucoup d’hommes. Mais je ne vous apprends rien…
M. le président Armand Jung. Est-ce que nous pouvons le prendre en compte dans notre politique de sécurité routière ?
M. Claude Got. Oui, en expliquant aux femmes de se méfier des hommes qui les raccompagnent chez elles alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool. J’ai autopsié beaucoup de victimes d’accidents dans lesquels l’homme et la femme qui s’étaient tués présentaient un taux d’alcoolisation élevée.
Au cours des six mois qui suivirent la loi de juillet 1978 autorisant les contrôles préventifs d’alcoolémie, on constata que les accidents liés à l’alcool avaient diminué chez les hommes et légèrement augmenté chez les femmes : par crainte des contrôles, certains hommes qui s’étaient alcoolisés préféraient confier le volant à leur compagne. Quand les conducteurs réalisèrent que le risque de contrôles n’était pas élevé, tout redevint comme avant. Cet épisode révèle le caractère déterminant de la crédibilité d’une sanction.
Le risque d’accident n’est pas perçu par les conducteurs comme un risque permanent, à l’inverse du risque de sanction. Cela signifie que le succès des politiques de sécurité routière ne réside pas dans le fait de modifier la perception du risque d’accident, mais de modifier la perception du risque de perdre, un, deux ou trois points de permis.
Le Délégué interministériel à la sécurité routière a fait remarquer que les périodes de contrôle pour alcoolémie sont de plus en plus pertinentes. Ce sont surtout les personnes qui sortent le soir qui se font dépister, ce qui explique que celles qui ne sortent pas le soir peuvent conduire dix ou quinze ans sans souffler dans un éthylotest. Malgré tout, on ne compte que 10 ou 11 millions de contrôle pour alcoolémie pour 40 ou 45 millions de conducteurs, ce qui ne fait qu’un contrôle tous les trois ou quatre ans. C’est très peu.
Il en va différemment avec les radars. Il arrive souvent de passer devant des radars plusieurs fois par jour. J’ai moi-même eu le privilège d’être flashé en excès de vitesse, pour la première fois de ma vie, il y a huit mois : je roulais à 61 km/h – retenus, donc probablement à 66 km/h réels – dans une zone à 50 km/kh.
J’observe que le système du permis à points est un système de sursis : le conducteur perd un point, puis un deuxième, puis trois, etc. À la fin, s’il n’a pas toujours pas compris, il finit par devoir repasser son permis. À ce stade, on ne peut pas prétendre que le conducteur a été piégé : il a fait n’importe quoi. Une telle sanction est normale.
M. le président Armand Jung. Nous ferons remonter le message…
M. Christian Vanneste. Monsieur le professeur, pour parodier Molière, on pourrait vous faire dire : « La vitesse, la vitesse, vous dis-je… ». Pour ma part, je m’attendais à ce que vous traitiez plus longuement de certains problèmes qui nous préoccupent tout particulièrement, comme la mortalité des conducteurs de deux-roues motorisés ou celle des jeunes conducteurs de 18 à 24 ans. Ces problèmes nous obligent à multiplier les solutions, et nous ne pouvons pas nous focaliser sur la vitesse.
Par ailleurs, ne faudrait-il pas rendre plus lisibles les limites de vitesse ? L’annonce de la suppression des panneaux indiquant la présence de radars a été ressentie par les automobilistes comme un facteur supplémentaire de stress. Ces derniers ont toujours plus ou moins l’impression d’être en faute. Les panneaux de limitation de vitesse se multiplient sur certaines portions de route, au point qu’on ne sait plus où l’on en est. Il conviendrait au moins de simplifier les règles pour que l’on sache qu’en ville, la vitesse est limitée à 50 km/h, sur route à 90 km/h et sur autoroute à 110 ou 130 km/h.
Enfin, que penseriez-vous de l’institution d’un contrôle médical périodique de l’aptitude à la conduite, comme il en existe dans certains pays, par exemple l’Espagne ou les Pays-Bas ? J’ai déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelque temps.
M. Jacques Myard. Je ne peux pas admettre que nous ne fassions pas un travail scientifique, ni que tout soit scientifique. On ne peut pas négliger certains aspects qui relèvent de l’irrationnel, et la science humaine n’est pas toujours une science exacte. Sur ce point précis, je vous trouve un peu dur et un peu excessif.
Cela étant, tout le monde nous a dit que les accidents étaient le résultat de multiples facteurs. Vous insistez sur les problèmes de vitesse. Pourtant, les accidents graves dont nous avons entendu parler dernièrement mettaient en cause des personnes qui ne roulaient pas vite, mais qui étaient très alcoolisées et avaient pris l’autoroute à contresens.
Dans ma ville de Maisons-Laffitte, nous avons fait baisser par dix les accidents corporels simplement en travaillant sur les infrastructures. On voit bien que la vitesse n’est pas le seul facteur à prendre en considération. Vos discours sont fort bien documentés, mais je me demande si, en insistant trop sur la vitesse, vous ne passez pas à côté d’autres causes.
Enfin, vous nous avez reproché de nous être conduits comme des irresponsables lorsque nous avons permis aux conducteurs de récupérer un point de permis au bout de six mois, au lieu d’un an. Vous nous avez dit que nous avions donné un mauvais signal. Certes, à ce moment-là, la mortalité a augmenté en France de 10 %. Mais, à la même période, elle a augmenté de 13 % en Allemagne, de 17 % en Finlande et de 26 % en Suède. Je ne pense pas que le débat parlementaire français ait eu des effets extraterritoriaux !
M. Claude Got. Je parle en effet de la vitesse, de la vitesse et encore de la vitesse. Mais, à court terme, la limitation de la vitesse est la seule solution efficace que je connaisse. Et, en disant cela, je m’appuie sur un constat.
Le taux d’accidentalité des jeunes conducteurs – ceux qui détiennent leur permis depuis moins de cinq ans – est en effet plus élevé que celui des conducteurs expérimentés, et ce dans tous les pays du monde. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce rapport entre les jeunes conducteurs et les conducteurs expérimentés est à peu près le même partout. Cela signifie que si un pays a une accidentalité par habitant très élevée, elle est extrêmement élevée pour les jeunes conducteurs, mais élevée aussi pour les autres conducteurs. L’école de la conduite, c’est la banquette arrière, et donc le comportement des parents. Certes, les conducteurs inexpérimentés ont davantage d’accidents que les autres, mais, les concernant, il n’y a pas de solution miracle.
En France, le problème posé par les motocyclistes est évident. Au kilomètre parcouru, ils ont plus d’accidents que les motocyclistes allemands et leur vitesse de circulation est plus élevée. Et si l’on voulait installer un système Lavia sur les motos, les « Motards en colère » s’y opposeraient. Il y a peu, revenant d’un centre de réadaptation, alors que je roulais à 90 km/h, j’ai été doublé par cinq motards qui roulaient, eux, à 180 ou 200 km/h ! Certes, il s’agit là de comportements extrêmes. Mais, sur une autoroute urbaine complètement pacifiée comme le périphérique parisien, on a dénombré trois tués en 2009 : parmi eux, il n’y avait pas un automobiliste. Nous sommes donc confrontés à un problème grave.
La puissance maximale d’une moto est de 100 CV. Quand j’ai obtenu mon permis moto, ma moto ne faisait 12,5 CV, et, à mon avis, elle était suffisamment rapide pour la façon dont je conduisais à l’époque.
Il ne faut pas laisser conduire et laisser mettre en circulation des véhicules trop puissants : c’est une question de responsabilité politique. Et cela nous renvoie à la question du bridage. Cela étant, le système Lavia constitue, à mon avis, une solution efficace.
Plusieurs pays ont mis en place des systèmes d’expertise pour déterminer s’il était possible de réduire les risques encourus par les seniors. Toutefois, ce n’est pas concluant. On peut retirer de la circulation un certain nombre de personnes sans que cela ait une action probante sur la diminution de l’accidentalité des seniors. On risque même de tomber dans l’excès en empêchant tous les seniors de conduire. Pourquoi leur faire perdre leur autonomie et leur liberté de se déplacer, et ce pour un bénéfice dont les assureurs nous disent bien qu’il est inexistant, puisque la suraccidentalité des seniors n’existe pas ?
Les seniors ont des accidents particuliers – notamment aux intersections. Mais ils ont moins d’accidents dus à la consommation d’alcool ou à la conduite de nuit – ils circulent moins aux heures dangereuses. Leur formation pourrait néanmoins être améliorée pour éviter, justement, les accidents dont ils sont coutumiers : on avait déjà montré, il y a trente ans, que c’était surtout aux intersections que les personnes âgées avaient des accidents, mais rien n’a été fait en ce domaine.
Monsieur Myard, sur une période longue, les courbes d’évolution de la mortalité dans le monde ressemblent à des montagnes russes. Dans certains pays comme ceux que vous avez cités, la mortalité augmente, mais dans d’autres, elle continue de baisser.
M. le président Armand Jung. On a dit que l’augmentation de la mortalité au début de l’année – notamment en janvier, février et mars – était due à la réforme du permis à points du mois de décembre. M. Myard considère que c’est faux puisque, à la même période, la mortalité a également progressé dans tous les pays européens, et parfois davantage qu’en France. Cela mérite une réponse.
M. Claude Got. Il est légitime de s’interroger.
En janvier dernier, la mortalité a augmenté brutalement de plus de 20 %. Depuis que je m’occupais d’accidents de la route, j’avais assisté à cinq augmentations aussi brutales, et, à chaque fois, il avait été possible d’expliquer le phénomène.
Le mois de janvier 2011 est apparu d’autant plus mauvais que le mois de janvier 2010 avait été anormalement bon par rapport à la contribution à la mortalité annuelle d’un mois de janvier, qui est de 7 %.
À l’inverse, le mois de juillet 2011 a semblé bon, comparé à celui de 2010, qui avait été calamiteux. En outre, cet été, le temps a été mauvais et la mortalité motocycliste s’est effondrée. Mais, par rapport à la contribution à la mortalité annuelle d’un mois de juillet, qui est de 10 %, ce fut un mois quasiment ordinaire.
Le mois de janvier présentait une double caractéristique : on pouvait expliquer une partie de l’augmentation de la mortalité par la comparaison avec le même mois de l’année précédente ; mais on pouvait aussi prendre en compte la contribution moyenne d’un mois de janvier, et, suivant les types de calcul, on obtenait une progression de la mortalité de 12 à 14 %.
S’agissant de la mesure permettant de récupérer des points plus rapidement, nombre de parlementaires ont indiqué que, si elle était présentée comme un affaiblissement du permis à points, la mortalité repartirait à la hausse. Cela dit, pour moi, l’élément le plus destructeur n’est pas la possibilité de récupérer un point en un an, mais celle de pouvoir en récupérer quatre tous les ans, contre quatre tous les deux ans, comme c’était le cas auparavant.
On savait déjà que les conducteurs pouvaient modifier leur comportement d’un mois sur l’autre, comme en témoignent les anticipations des mesures d’amnistie. J’avais été le premier à dire que l’amnistie de 1988 avait fait 500 morts. Les analystes et les statisticiens de Dauphine, ainsi que des experts, ont confirmé que les mois de janvier, février, mars et avril 1988 avaient été calamiteux.
Au reste, en raison des conditions météorologiques, janvier 2011 peut être comparé à janvier 1988, la hausse de la mortalité se poursuivant dans les deux cas en février, mars et avril.
Curieusement, alors que l’amnistie a été abandonnée, on a encore observé un petit effet « amnistie » au moment des deux dernières élections présidentielles. Sera-ce encore le cas l’année prochaine ? J’observe qu’en 2007, Ségolène Royal avait commis une maladresse en déclarant au mois de novembre, dans une émission de radio, que son opinion n’était pas faite sur l’amnistie des fautes de conduite. Et elle l’a répété en janvier à un journaliste de Poitiers. Cela s’est traduit par une petite augmentation du nombre des tués à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie pour votre contribution et votre expertise, qui nous seront très utiles.
M. Claude Got. Je vous disais que votre tâche était difficile.
M. le président Armand Jung. Vous avez même dit « impossible ». Mais telle n’est pas notre position.
M. Claude Got. Vous allez devoir valider tout ce que vous avez entendu. C’est en ce sens que j’ai dit que votre mission était impossible. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques de vous donner son avis, en aval de votre rapport ? Ses travaux sont remarquables. Je m’étonne d’ailleurs que l’Office ne se soit jamais penché sur les accidents de la circulation, qui constituent la première cause de mortalité chez les jeunes.
M. le président Armand Jung. Nous disposons du rapport de l’Institut français des sciences et techniques des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFFSTAR), qui a été rédigé à l’attention de cette mission, et qui est précis et documenté.
Monsieur le professeur, nous aurions pu parler encore de la gouvernance de la sécurité routière. Mais nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir. Quoi qu’il en soit, je vous renouvelle mes remerciements.
*
* *
Audition de M. Jean Bardet, député, co-président du groupe d’études sur la route et la sécurité routière
Mardi 20 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je souhaite la bienvenue à M. Jean Bardet, député du Val d’Oise, avec lequel j’ai l’honneur de co-présider le groupe d’études sur la route et la sécurité routière.
Avec M. le rapporteur Houillon, nous avons tenu à vous auditionner, monsieur Bardet, non seulement parce que nous savons combien ces questions vous préoccupent, mais également en raison de l’entretien que vous avez accordé au journal L’Hémicycle dans lequel vous avez tenu des propos assez durs, évoquant, par exemple, la « démagogie électorale » dont il est parfois question dans les sujets qui nous intéressent, tout en insistant sur la nécessité de lier prévention et sanction.
M. Jean Bardet, député, co-président du groupe d’études sur la route et la sécurité routière. Si j’ai refusé de faire partie de la mission que vous présidez, monsieur Jung, c’est, certes, pour des raisons personnelles, mais, surtout, parce que je vous fais entièrement confiance, ainsi qu’à M. le rapporteur, d’une part, pour formuler des propositions raisonnables s’inscrivant dans le cadre de la politique menée par l’ensemble des gouvernements qui, depuis plus de 25 ans, se sont attaqués à ce fléau qu’est l’insécurité routière, et, d’autre part, pour répondre aux questions légitimes que se posent les usagers sur un certain nombre de dispositions, dont ils ne comprennent pas toujours l’utilité.
En effet, entre les différentes thèses en présence, il semble qu’une incompréhension réciproque empêche toute discussion, tant à l’Assemblée nationale – où une part de démagogie, comme je l’ai dit, n’est pas exclue –, que dans certains endroits où se tiennent ce que je pourrais appeler des propos de « café du commerce », qui consistent souvent à contester pour contester – depuis Jules César, nous savons combien les Gaulois sont frondeurs. En fait, au même titre que nous croyons que notre équipe de foot est la meilleure du monde, nous pensons que nous sommes d’excellents conducteurs. De la même façon que nous estimons que, lorsque notre équipe préférée perd un match, c’est la faute de l’arbitre, nous considérons que, quand nous avons un accident, c’est la faute des autres ; c’est d’ailleurs le cas aussi pour ceux qui ont bu un « petit coup » – ils connaissent leurs limites, disent-ils.
Je suis plutôt favorable à la politique menée par les différents gouvernements depuis 25 ans en matière de sécurité routière car, grâce à elle, le nombre de tués sur les routes est passé de 17 000 en 1971 à moins de 5 000 en 2005 et à moins de 4 000 en 2010. Je note, de plus, que, même si la vie humaine est sans prix, le coût des accidents de la route a été évalué en 2009 à 24,7 milliards d’euros, ce qui représente plus de deux fois le déficit de la sécurité sociale pour la même année.
L’augmentation de la mortalité routière constatée en ce début d’année – qui constitue d’ailleurs l’une des raisons de la création de cette mission – a coïncidé avec l’assouplissement des règles de récupération des points de permis tandis que l’amélioration qui a suivi a coïncidé, quant à elle, avec l’affirmation du Gouvernement qu’il n’avait pas l’intention de baisser la garde.
Les raisons de cette évolution ne sont pas univoques, et la nécessaire répression que certains considèrent actuellement comme une atteinte à leur liberté n’est qu’un élément de la politique de sécurité routière. Rappelons, cependant, que le port de la ceinture de sécurité, qui a été rendu obligatoire en 1973 et qui, à l’époque, avait soulevé des tollés – cette mesure était considérée comme liberticide –, a entraîné une inflexion significative de la courbe de mortalité, laquelle est passée en un an de 17 000 à 15 000 tués.
La sécurité routière dépend de trois facteurs : la qualité du réseau routier, la sécurité passive des véhicules et le comportement des conducteurs. Les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer sur ces trois plans. C’est en effet à eux qu’il appartient de créer et d’entretenir les routes, même si, en ce qui concerne les autoroutes, ce rôle peut être concédé à des sociétés privées. C’est à eux qu’il appartient d’imposer aux industriels des normes de sécurité en fonction des progrès techniques – j’ai déjà parlé de la ceinture de sécurité mais je pourrais ajouter, par exemple, les limiteurs de vitesse, lesquels pourraient être obligatoires, les éthylotests au démarrage, ou encore le bridage de la vitesse par satellite selon le type de route utilisé.
S’agissant du comportement des conducteurs, les pouvoirs publics ont deux obligations : la prévention et la répression. En ce qui concerne le second point, un réel effort de pédagogie doit être accompli pour que nos concitoyens comprennent que les mesures prises ne sont pas faites pour les embêter – en général, ils emploient un autre terme – mais pour sauver des vies. Ce n’est qu’ainsi qu’un véritable dialogue pourra s’engager entre les uns et les autres, pour que l’objectif du Président de la République de faire passer le nombre de morts à moins de 3 000 soit atteint en 2012.
Pour nos concitoyens, les limitations de vitesse sont souvent incohérentes, inadaptées et mal signalées, à tel point qu’ils se révoltent parfois lorsqu’ils les jugent aberrantes, tandis que les radars fixes ou mobiles semblent être déployés uniquement pour les piéger et « faire du fric », comme ils disent. Il m’arrive d’être sur une route et de me poser en toute bonne foi la question de savoir quelle est la vitesse autorisée, surtout quand celle-ci change sans raison apparente. Je prendrai comme exemple la route nationale 13 entre Saint-Germain-en-Laye et La Défense qui est à quatre voies et qui comporte un terre-plein central : la vitesse passe successivement de 90 à 70 puis à 50 km/h selon les communes traversées, des radars ayant été déployés pour avertir ou punir les contrevenants. Or, la réglementation doit être simple : 130 km/h sur les autoroutes, 110 km/h sur les autoroutes peri-urbaines, 90 km/h sur les routes nationales à quatre voies – je suis favorable à un abaissement à 70 km/h sur celles qui n’en ont que deux –, 50 km/h en ville, voire, pourquoi pas, 30 km/h : ces vitesses ne doivent pas changer constamment ! Je conçois que, si le profil de la route change – virage serré par exemple –, l’automobiliste soit invité à réduire sa vitesse mais je ne comprends pas pourquoi, en revanche, il y aurait un radar. Je me suis fait moi-même « piéger » il y a quelques années, dans le Morvan, sur l’autoroute du sud. Je croyais que la vitesse était limitée à 130 km/h ; or, sur un tronçon, la vitesse autorisée n’était que de 110 km/h en raison de la présence d’un virage serré. Je n’avais pas vu le panneau indiquant cette limitation, encore moins le radar, mais j’avais spontanément réduit ma vitesse par prudence. Pour autant, cela ne m’a pas empêché d’être flashé à 117 km/h, lesquels ont été ramenés à 112. Je comprends la colère de l’usager vigilant qui se fait « piéger » et qui se dit : « Ils veulent se faire du fric », alors que la police peut toujours verbaliser pour conduite dangereuse un automobiliste qui, malgré les indications de prudence, ne lèverait pas le pied.
Les associations d’usagers devraient être davantage impliquées dans les décisions d’implantation des radars fixes, lesquelles devraient être accompagnées d’une large publicité. De surcroît, l’utilisation de l’argent des radars devrait faire l’objet d’une large diffusion – je reviendrai sur certaines utilisations possibles. En début d’année, la suppression de la signalisation des radars fixes a fait l’objet de polémiques. Toutefois, la mise en place de « radars pédagogiques » me semble une décision mi-figue mi-raisin, qui vise surtout à ne pas donner l’impression de faire machine arrière. Outre que je perçois mal la différence avec le dispositif précédent, l’implantation de ces « radars pédagogiques » coûtera cher ; or cet argent pourrait être mieux utilisé.
Lorsque les premiers radars fixes ont été mis en place au mois de novembre 2003, l’idée de les signaler m’avait semblé un peu saugrenue même s’il s’agissait déjà de faire preuve de pédagogie. Connaissant nos concitoyens, je me doutais de ce qui allait se produire : les automobilistes freineraient avant le radar et re-accéléreraient après. Compte tenu de la mentalité de nombreux conducteurs, il me semble difficile de revenir en arrière. En l’occurrence, je crois beaucoup plus à l’efficacité de radars dits « de tronçon » qui calculeraient la vitesse moyenne entre deux points et qui auraient le double intérêt d’éviter l’attitude que nous connaissons et de répondre à l’objection souvent faite par les automobilistes évoquant « le moment d’inattention » : sur 50 kilomètres, l’argument ne tiendrait plus.
Je suggère également que les véhicules d’automobilistes volontaires – peut-être les professionnels de la route – soient équipés d’une boîte noire enregistrant leur vitesse chaque fois qu’ils passent devant un radar. S’ils passent cinq fois sur six sans commettre un excès de vitesse, la sixième fois – à condition que l’infraction soit « mineure » – pourrait être considérée comme un moment d’inattention n’entraînant qu’une contravention sans retrait de points. Les professionnels de la route roulent beaucoup, puisque tel est leur métier, mais c’est une raison supplémentaire pour qu’ils soient plus vigilants. Les règles de sécurité routière étant faites pour sauver des vies, est-ce moins grave d’être écrasé à 70 km/h par un professionnel de la route que par un autre conducteur quand la vitesse est limitée à 50 km/h ?
Les radars de feu rouge récemment installés font aussi l’objet de polémiques, certains automobilistes arguant – de bonne ou de mauvaise foi – qu’ils ont vu le feu orange et qu’ils croyaient avoir le temps de passer – comme le code de la route le leur permet – mais qu’en raison d’un ralentissement, le feu est passé au rouge alors qu’ils étaient engagés. Je propose que ces radars comportent un système de compte à rebours indiquant combien de secondes il reste avant que le feu ne passe au rouge et qu’un tel système soit généralisé comme cela existe déjà dans d’autres pays.
M. Jacques Myard. D’accord !
M. Jean Bardet. Les limiteurs de vitesse – et non les régulateurs – devraient être quant à eux obligatoires sur tous les véhicules sortant d’usine, une aide de l’État pouvant être accordée aux conducteurs qui veulent faire équiper un véhicule ancien. L’argent nécessaire pourrait être prélevé sur le produit des contraventions liées aux radars. Une telle mesure, je le crois, serait comprise des usagers.
La polémique a également fait rage s’agissant des indicateurs de radars – et non des détecteurs, qui, eux, sont et resteront interdits. Or, les assureurs ont constaté que ceux qui en font usage avaient plutôt moins d’accidents que les autres. Il me semble, en effet, que ces appareils servent de « piqûre de rappel » pour faire respecter la vitesse et que, en outre, ils donnent tellement de fausses alertes que l’automobiliste qui ne lèverait le pied qu’en cas d’avertissement se montrerait tout de même plus prudent qu’un autre.
Par ailleurs, les contrôles systématiques d’alcoolémie ou de drogue ne sont pas assez nombreux. Depuis qu’ils existent, je crois avoir été contrôlé quatre fois pour la consommation d’alcool et je ne l’ai pas été une seule fois s’agissant de celle de drogue : cela n’est donc en rien dissuasif, même s’il faut bien avouer que je ne fréquente pas les boîtes de nuit le samedi soir !
Sur le plan de la prévention, je défends depuis très longtemps l’idée de faire passer le permis de conduire au lycée. Outre que son obtention est aussi importante pour entrer dans la vie professionnelle que le fait de parler anglais ou de pianoter sur un ordinateur, plus tôt on apprend les règles de bonne conduite, plus on est enclin à les respecter. Là encore l’argent issu des contraventions des radars pourrait être consacré à ce projet. Je crois que cette mesure serait particulièrement appréciée des jeunes et des parents.
De plus, le permis de conduire – comme d’ailleurs le préconise la récente reforme – doit être davantage orienté vers une pédagogie de la bonne conduite que sur la pratique de certaines manœuvres comme la réalisation d’un créneau ou d’un démarrage en côte.
Faut-il augmenter ou diminuer les vitesses autorisées ? Je ne suis pas un ayatollah, et l’argument qui consiste à dire que les voitures actuelles ont des dispositifs de sécurité passive qui n’existaient pas en 1973 – lorsque la vitesse a été limitée à 130 km/h sur les autoroutes – ne m’est pas indifférent. Mais jusqu’où pourrait-on l’augmenter ? Et, surtout, quel devrait être le degré de tolérance ? Si la vitesse sur autoroute passait à 140 ou à 150 km/h – hypothèse d’école – que diraient les automobilistes flashés à 145 ou à 155 km/h, sachant que ceux qui sont verbalisés pour un dépassement de 5 km/h protestent déjà. Quoi qu’il en soit, s’il y a une règle, il faut la respecter.
Au reste, cette notion de vitesse est toute relative. J’ai une voiture qui a 33 000 kilomètres au compteur, dont environ un tiers a été effectué sur autoroute en respectant les vitesses autorisées. Eh bien, ma vitesse moyenne globale s’élève à 39 km/h ! Alors, que la vitesse soit limitée à 120, à 130 ou à 140 km/h, cela ne changera pas grand-chose quant aux déplacements.
La vitesse en ville, elle aussi, est relative. Une étude récente, réalisée dans une ville de moyenne importance, à une heure d’affluence normale, a montré que si la vitesse est limitée à 50 km/h, la vitesse moyenne pour traverser la ville est de 19 km/h. Si elle était limitée à 30 km/h, la vitesse moyenne serait de 17 km/h, ce qui représente une perte de temps négligeable. En revanche, d’autres études ont montré que l’abaissement de la vitesse en ville réduirait significativement la mortalité des plus vulnérables : les piétons et les deux roues.
Il y a quelques années, des lampadaires d’éclairage ont été installés à grands frais sur les autoroutes péri-urbaines. À la suite de vol de câbles en cuivre, ils ne fonctionnent plus.
Or, parmi les raisons évoquées pour justifier qu’ils ne soient pas réparés, on trouve, à côté de celle tenant au coût prohibitif du remplacement, en raison de l’augmentation du prix des métaux non-ferreux, ou encore de celle liée à la nécessité d’économiser de l’énergie et de respecter des critères écologiques, la raison selon laquelle une autoroute non éclairée est moins « accidentogène » ! L’argument n’est pas partagé par tout le monde car la diminution globale du nombre de tués n’est pas prise en compte dans les statistiques. Pour le moins, des études expérimentales auraient pu être réalisées avant d’engager les collectivités territoriales dans des dépenses faramineuses ! Mais, si une route non éclairée est moins accidentogène, poussons le raisonnement à l’extrême : pourquoi les tunnels sont-ils éclairés alors que l’absence de lumière obligerait les automobilistes à ralentir ? L’absence d’éclairage sur les autoroutes peut provoquer des accidents pour des raisons physiologiques : lorsque l’on passe dans un tunnel éclairé, la pupille se rétrécit ; lorsque l’on en sort et que l’on est plongé dans le noir, elle se dilate pour laisser entrer le maximum de lumière. Ce mécanisme d’adaptation met quelques secondes pendant lesquelles la vision est mauvaise et, donc, la conduite dangereuse.
À cet égard, je souhaite formuler trois propositions : premièrement, éclairer les autoroutes en allumant un lampadaire sur deux ou sur trois, ce qui permettrait d’avoir une vision du tracé de la route tout en réalisant des économies ; deuxièmement, autoalimenter les lampadaires par des piles photovoltaïques qui restitueraient l’énergie emmagasinée le jour ; troisièmement, diminuer la vitesse autorisée la nuit sur tous les axes, qu’ils soient éclairés ou non.
Je terminerai par une boutade – ou presque. En temps que médecin, je suis un adepte de la théorie dite de « la preuve par l’expérimentation ». Dès lors que les thèses des uns et des autres semblent parfois si éloignées et si inconciliables, je propose de faire l’expérience suivante : pendant six mois ou un an, supprimons tous les radars fixes ou mobiles, les radars de feux rouges, les contrôles d’alcoolémie et de toxiques, autorisons à téléphoner au volant et voyons ce que cela donne ! Si la mortalité sur la route ne change pas, c’est que toutes ces mesures ne servent à rien ; si elle change – ce que je crois –, cela fera peut-être réfléchir certains.
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, cher collègue, pour cette intervention ainsi que pour la précision de vos propositions.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je vous remercie moi aussi pour cet exposé passionné et précis.
Les causes des accidents, nous a-t-on souvent expliqué au cours de ces auditions, sont multifactorielles. Le pensez-vous également ? Si oui, ne convient-il pas tout de même de s’attaquer à ces facteurs principaux que sont la vitesse ou l’alcool ? Dans le cas contraire, conviendrait-il de promouvoir une approche différente ?
M. Jean Bardet. Les facteurs d’accidents sont bien évidemment multiples, même si l’alcool est aujourd’hui le premier d’entre eux – avant même la vitesse. En l’occurrence, l’alcool inhibe les réflexes et la conscience du danger. Sous son emprise, un conducteur considérera qu’il peut fort bien passer sous la barrière d’un passage à niveau alors qu’elle est en train de se baisser, de la même manière qu’il accélérera pour passer à l’orange. Cela dit, un conducteur qui roule vite, qui a bu et qui téléphone multiplie bien évidemment les risques encourus !
M. le rapporteur. Les personnes âgées qui continuent de conduire doivent-elles être soumises à un examen médical d’aptitude ? La presque totalité des différents acteurs que nous avons auditionnés à ce propos ont considéré que cela était inutile.
M. Jean Bardet. Par principe, je n’y suis pas, quant à moi, opposé : les chauffeurs de poids lourds subissent de tels examens, de même que les conducteurs qui tractent des caravanes, lesquels passent un examen tous les cinq ans et, à partir d’un certain âge, tous les deux ans. Et puis, cela peut faire plaisir à certaines personnes qui sont scandalisées quand elles apprennent aux informations qu’un octogénaire a fait une embardée, même si tout le monde sait que les seniors ne sont pas les plus grands fauteurs d’accidents !
M. le rapporteur. Quid du bridage des véhicules et du système Lavia ?
M. Jean Bardet. J’y suis favorable, tant à la construction que par satellite en fonction de la route et de la vitesse autorisée. De surcroît, il conviendrait d’interdire dans les publicités la promotion de la vitesse pouvant être atteinte par tel ou tel véhicule.
M. le rapporteur. Parce que tel est déjà le cas, les constructeurs précisent que la vitesse en question est calculée sur circuit.
M. Jean Bardet. Ce qui revient quasiment au même.
M. le rapporteur. En effet.
M. Jérôme Lambert. Il semble que la politique de sécurité routière soit élaborée au coup par coup en fonction des statistiques. Or, toute augmentation, si importante qu’elle paraisse en valeur absolue, doit être interprétée dans le cadre de la baisse considérable des chiffres que nous avons connue, puisqu’en quelques décennies nous sommes passés de 18 000 tués sur la route à presque 3 000 tués. À cela s’ajoute le fait qu’une telle augmentation peut être compensée par une baisse identique le mois suivant. Une politique de sécurité routière digne de ce nom ne doit-elle donc pas se garder de toute sur-réaction afin de maintenir un cap précis ?
M. Gilbert Le Bris. En la matière, une approche spécifique concernant les motards vous paraît-elle souhaitable ?
Vous êtes favorable à une limitation de vitesse par itinéraire afin d’éviter des variations erratiques, mais, dans ce cas-là, comment régler le problème juridique de leur établissement par les mairies, les départements, les régions ou l’État ? Est-ce à ce dernier d’en prendre la seule responsabilité ?
M. Christian Vanneste. Considérez-vous que la politique de sécurité routière tienne suffisamment compte de l’interaction de ces trois éléments que sont le conducteur, le véhicule et l’infrastructure, de manière à ce que le premier puisse circuler dans des conditions optimales ? Je note que vous avez évoqué, à ce propos, les problèmes liés, en particulier, à la vision nocturne ou à la multiplication des signalisations.
M. Jean Bardet. Il est vrai, monsieur Lambert, que les pouvoirs publics réagissent parfois au coup par coup, mais cela me semble globalement symptomatique d’une époque où l’émotion prend le pas sur la raison. Ce n’est pas, en effet – si terrible cela soit-il –, parce que 30 personnes de plus ont perdu la vie, tel ou tel mois, qu’il faut bouleverser l’ensemble des règles en vigueur.
M. Jérôme Lambert. Cela favorise en effet la confusion alors que la politique de sécurité routière doit s’inscrire dans la durée sans varier au gré des statistiques.
M. Jean Bardet. Si les deux roues, monsieur Le Bris, ne représentent que 3 à 4 % des véhicules en circulation, 17 % des accidents mortels touchent leurs conducteurs. Il faut donc faire preuve de pédagogie tout en sachant que ce public, en raison de sa jeunesse, n’y est guère réceptif – de la même manière qu’avertir un jeune qui commence à fumer en lui disant qu’il mourra dans trente ans ne le dissuade en rien. Il importe aussi de savoir écouter ce public particulier, par exemple lorsque les motards se battent pour la suppression des glissières de sécurité et leur remplacement par des murs. Outre le port obligatoire du casque, il serait peut-être bienvenu d’envisager le port d’une combinaison protectrice ou de gilets fluorescents, comme cela est déjà le cas dans d’autres pays.
Les maires, quant à eux, ont en effet le droit d’abaisser la vitesse de circulation autorisée sur le territoire de leur commune, mais il serait bon que cela prenne fin, de manière à éviter ou à limiter des variations dont tout le monde se plaint et qui impliquent de surcroît de regarder en permanence le compteur de vitesse, ce qui n’est pas le meilleur moyen de se montrer vigilant. Une décision s’impose donc au plus haut niveau afin d’uniformiser les vitesses en vigueur.
La signalisation, monsieur Vanneste, est en effet insuffisante et mal faite, à tel point que cela peut conduire certaines personnes à prendre les autoroutes à contresens.
L’amélioration de notre réseau routier – qui est d’ailleurs l’un des plus performants du monde – est également nécessaire, et nous savons, de ce point de vue, que les ronds-points jouent un rôle essentiel, de même que la limitation du nombre des virages – même si les accidents surviennent souvent sur des lignes droites, par temps sec et lorsque la circulation est faible.
D’énormes progrès ont également été réalisés pour améliorer la sécurité passive des véhicules, mais les pouvoirs publics doivent encore encourager les constructeurs à aller plus loin. Ainsi, je ne serais pas vraiment choqué à l’idée d’une augmentation de la vitesse autorisée sur les autoroutes, car les conditions de circulation ont considérablement évolué depuis 40 ans.
M. Christian Vanneste. Existe-t-il un organisme spécifiquement chargé de réfléchir à ces questions ?
M. Jean Bardet. Avant de répondre à votre question, je précise que, si je n’ai pas voulu faire partie de votre mission, c’est en fait parce que, comme j’ai eu l’occasion de le dire au Président Accoyer, le groupe d’études sur la route et la sécurité routière, que je co-préside avec M. Jung, n’a été ni consulté ni averti, lorsque le Gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions en matière de sécurité routière, en réponse aux mauvaises statistiques du début de l’année.
Ce dont vous parlez, monsieur Vanneste, doit relever du Délégué interministériel à la sécurité routière. Sinon à quoi servirait-il ?
M. Christian Vanneste. Le professeur Got a évoqué la possibilité que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques puisse mener une mission scientifique sur l’adaptation du conducteur à la route.
M. Jacques Myard. On est dans l’irrationnel !
M. le président Armand Jung. La « gouvernance de la sécurité routière », dans ses versants technique, d’orientation et de conseil, sur un plan local ou national, constitue en tout cas un de nos axes de réflexion.
Nous vous remercions, monsieur Bardet, pour votre contribution et votre expertise.
*
* *
Audition de MM. Didier Joubert, direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, Jean-Cyrille Reymond, commissaire divisionnaire, Didier Perroudon, contrôleur général « DCSP »
Mardi 20 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons déjà entendu vos collègues de la gendarmerie. Et, avec le rapporteur, nous avons rencontré, à l’occasion d’une réunion décentralisée, la police nationale et la gendarmerie à Strasbourg. Votre expertise et vos propositions nous seront très précieuses, d’autant que nous sommes à la veille de présenter nos conclusions au Gouvernement et que des incertitudes demeurent.
J’évoquerai, de manière cursive, quelques questions restant en suspens. Quelle crédibilité donner aux statistiques ? Faut-il créer une police de la route ? À combien s’élève le nombre de contrôles d’alcoolémie ? Peut-on contrôler sans piéger ? Qu’en est-il de la détection de consommation de stupéfiants ? Comment annoncer aux familles la mort d’un proche ? Que penser de l’autorisation accordée aux vélos de rouler à contresens ? Nous souhaitons que vos réponses reflètent le plus possible votre expérience du terrain.
M. Didier Perroudon, contrôleur général « DCSP ». La Direction centrale de la sécurité publique est une branche de la DGPN – Direction générale de la police nationale. La Police nationale comprend des services spécialisés, dont les CRS font partie, et un service généraliste, la sécurité publique, comprenant 66 000 fonctionnaires. Ces hommes et ces femmes assurent la sécurité dans 1 594 villes, ce qui représente à peu près la moitié de la population française. La sécurité publique, c’est encore 62 % du traitement de la délinquance en France. En 2010, cela s’est traduit par 6 800 interventions par jour, soit une intervention toutes les treize secondes.
En termes de sécurité routière, les caractéristiques des zones urbaines sont déterminantes. La ville, c’est la rencontre d’usagers divers : voitures, véhicules utilitaires, camions, deux roues, engins de trottoirs – trottinettes, patins à roulettes, etc. – piétons, les personnes âgées et les très jeunes enfants étant plus particulièrement fragiles. En ville, en outre, l’espace est moins bien défini que sur l’autoroute. Il est surtout moins bien respecté, chacun des usagers ayant tendance à empiéter sur l’espace des autres. Cela va engendrer certains types d’accidents, moins graves cependant que ceux qui surviennent sur la route.
De par son organisation, la ville a un impact très fort sur nos stratégies et tactiques d’intervention. Il faut prendre en compte les grands axes pénétrant dans la ville – rocades, autoroutes urbaines – et qui ont quasiment la même configuration que la route hors la ville. Nous pouvons mettre en place des contrôles puis prévoir des interceptions sur ces flux dont les automobilistes sont un peu prisonniers.
En zone urbaine, en revanche, de par le réseau des voies, nous ne sommes jamais sûrs de la permanence des flux, même s’ils sont à peu près fixes à certaines heures. La ville permet donc aux automobilistes les plus récalcitrants de mieux nous repérer et de nous éviter. La stratégie consistant à mettre en place des points de contrôle lourds et durables en zones très urbanisées est donc vouée à l’échec. Il faut mettre en place des mini voire des micro-contrôles, extrêmement légers, souples et faciles à déplacer. Surtout, il faut faire de la sécurité routière une mission transversale : chacun des 66 000 policiers de la sécurité publique doit se sentir investi de cette mission et doit être à même, en permanence, de contrôler et de relever une infraction. Cela explique notre volonté d’équiper un maximum de patrouilles d’éthylotests.
S’agissant de la circulation des cyclistes à contresens, on peut se demander si cette mesure n’est pas de nature à compliquer encore la lecture de l’espace urbain pour les uns et pour les autres. Je pense notamment aux piétons, surtout lorsqu’ils sont âgés.
Les effectifs consacrés par la sécurité publique à la sécurité routière sont relativement limités concernant les services spécialisés. Nous disposons au niveau national de 250 unités pour les brigades des accidents et des délits routiers, chargées de travailler sur le plan judiciaire. Rappelons que, depuis le début de l’année, nous avons enregistré 105 697 délits routiers, ce qui n’est pas insignifiant.
M. le president Armand Jung. Est-ce plus ou moins par rapport à 2010 ?
M. Didier Perroudon. Je ne dispose pas des éléments de comparaison qui me permettraient de répondre à cette question.
Je préciserai encore que 1 085 agents sont chargés des procédures, que 118 unités représentant 1 058 motocyclistes sont affectées aux zones urbaines. Les motocyclistes sont les spécialistes de certaines verbalisations concernant notamment les infractions à la coordination des transports, procédures relativement lourdes et très techniques. Enfin, nous avons quelques unités de sécurité routière dans les grandes villes – 360 agents dans 46 villes –, quelques brigades de contrôle technique et quelques unités de prévention. Notez que tous ces chiffres ne tiennent pas compte du reste de l’activité effectuée par l’ensemble de la sécurité publique. En gros, 3,2 millions d’heures ont été consacrées à la sécurité routière, 250 000 heures pour le seul mois d’août dernier.
Si l’on prend en compte l’activité globale de ces unités et celle de l’ensemble des autres services de la sécurité publique, on constate, s’agissant des infractions classiques – non-respect des stops, des feux rouges, de la vitesse autorisée, du port du casque, de celui de la ceinture de sécurité, usage du téléphone au volant –, une hausse sur les huit premiers mois de l’année 2011, plus 2,20 %. Nous en sommes à un peu plus de 350 000 infractions constatées. Notons toutefois qu’un léger fléchissement apparaît en matière de non-respect des feux rouges : baisse de 11,13 %. On peut l’attribuer soit à une prise de conscience des automobilistes, soit à l’impact de l’implantation en cours des contrôles automatisés. C’est un phénomène nouveau et nous n’avons pas assez de recul pour l’analyser avec précision.
Cela étant, les contrôles routiers sont également en hausse – plus 51 % –, avec notamment une très forte augmentation des opérations de dépistage des taux d’alcoolémie – progression de 17, 04 %, soit 3 % de plus qu’en 2010. C’est ainsi que 800 000 personnes ont soufflé dans le ballon en ville et que nous avons relevé 49 000 dépistages positifs. La conduite sous l’emprise de l’alcool reste donc un phénomène relativement important.
Les conséquences de la réforme de la garde à vue ont également entraîné une diminution assez significative des gardes à vue en matière de délit routier. Sur certains mois, elle peut être de moitié par rapport à l’année précédente.
En matière de prévention, nous agissons notamment auprès des très jeunes : 270 fonctionnaires sont affectés à cette tâche au niveau national, 240 000 élèves suivent les cours de code de la route, 18 000 enfants souhaitent passer leur Permis piéton.
En matière de dissuasion, nous développons avec les autres services chargés de la sécurité routière – gendarmerie et police municipale – des opérations combinées relativement importantes avec l’idée de contrôler tout un axe routier, par exemple de Reims jusqu’au Havre, à une heure de forte accidentologie. Il s’agit de maintenir une pression constante sur l’automobiliste en mettant en place des contrôles tous les cinquante kilomètres environ.
Enfin, nous lançons des actions en direction des piétons, en coopération avec les polices municipales. Ainsi, en Seine-Maritime, en 2010, 1 700 piétons s’étant rendus coupables d’une infraction ont été sensibilisés au danger que constituait leur comportement.
S’agissant de l’accidentalité dans les zones de sécurité publique, les statistiques relatives aux tués et aux blessés sont plutôt bonnes. Rapportée à l’année 2009, 2010 fait ainsi apparaître une baisse de 5,81 % du nombre des accidents, soit 2 088 accidents de moins, une baisse de 5,57 % du nombre des tués, soit 52 vies épargnées, et une baisse de 6,33 % du nombre des blessés, soit 2 840 blessés en moins.
Sur les huit premiers mois de 2011, la diminution du nombre des accidents est de l’ordre de 5,11 % pour la zone de police alors que la moyenne nationale est de 3,5 %. On constate donc une accentuation de la baisse dans les zones urbaines. Concernant le nombre des tués, la baisse est de 7,37 % alors qu’on note pour la moyenne nationale une hausse de 0,7 %. Pour le nombre des blessés, la diminution est de 5,10 % contre 3,8 % pour la moyenne nationale.
Depuis un an et demi, nous assistons donc à une baisse des accidents et des conséquences corporelles en zones urbaines. Précisons cependant que la sécurité publique ne couvre pas Paris et les trois départements de la petite couronne qui relèvent de la Préfecture de police, totalement indépendante.
S’agissant des causes des accidents, nous retrouvons, bien sûr, les « grands classiques » : la vitesse et l’alcool, qui nous amènent à augmenter considérablement nos opérations de contrôle. D’autres causes apparaissent néanmoins, notamment en ville. Je citerai en premier lieu l’absence de port de la ceinture de sécurité. Si l’on en croit l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 98 % des usagers utilisent, certes, leur ceinture de sécurité mais uniquement à l’avant. Or, selon les mêmes sources, 682 tués par an n’étaient pas ceinturés. Si l’on considère que le port de la ceinture sauve la vie une fois sur deux, nous pouvons gagner 300 vies. Aujourd’hui, si l’on s’attache à l’avant, on le fait un peu moins à l’arrière. Il faut en conséquence valoriser le port de la ceinture à l’arrière. L’arsenal législatif existe : il suffit de faire appliquer la loi fermement.
Le téléphone au volant est une deuxième cause importante d’accidents en ville. Toujours selon les sources de l’Observatoire, le téléphone portable est impliqué dans 6 % des accidents. Nous devons donc agir en termes de répression pour essayer de réduire le nombre de morts et de blessés.
M. Didier Joubert, Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Les services intervenant en matière de sécurité routière au titre de la Direction centrale des CRS sont constitués d’unités très spécialisées. Tout d’abord, neuf compagnies autoroutières ont en propre les autoroutes de dégagement, c’est-à-dire le réseau autour des grandes agglomérations, en deçà des péages. À ce titre, nous avons quatre compagnies autour de la région parisienne, une au niveau du contournement de Lyon, une sur l’ensemble du réseau autoroutier non concédé entre Marseille et Toulon, une gérant le réseau à la frontière belge sur l’ensemble de l’agglomération lilloise, une sur le périphérique autour de Bordeaux, et, enfin, une compagnie Alsace-Lorraine couvre l’agglomération Metz-Nancy et un linéaire lié à l’agglomération de Strasbourg.
Nous avons ensuite six unités motocyclistes zonales présentes sur l’ensemble du territoire national, avec vingt-deux détachements.
S’agissant des compagnies autoroutières, le kilométrage est relativement modeste – 4 500 kilomètres –, mais les contraintes sont très particulières. Ces linéaires ont en effet les flux de circulation les plus importants et requièrent un fonctionnement sur vingt-quatre heures. On n’intervient pas de la même façon sur le contournement de Lyon, l’A86, l’A3, l’A1 entre la Porte de la Chapelle et le péage de Chamant-Senlis, que sur les autres réseaux. Les dispositifs sont particuliers. Les contraintes sont liées par exemple à la multiplication des tunnels routiers. Les sujétions sont très précises. Des questions de sécurité se posent également sur les différentes aires d’autoroute. Au titre de cette spécificité autoroutière, nous formons les futurs officiers de sapeurs-pompiers, à Aix-les-Milles.
Les six unités motocyclistes interviennent sur le ressort de la zone et apportent la plus-value de leur culture de mobilité lors de grands événements. On les rassemblera ainsi à l’occasion du G20 en projetant 200 motocyclistes CRS afin de renforcer la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et le SPHP – service de protection des hautes personnalités.
En termes d’effectifs, on compte 6 657 policiers dans les compagnies autoroutières. La force de projection des unités motocyclistes représente, quant à elle, 400 motards.
Les CRS assurent également la représentation de la police au sein de l’unité de coordination récemment créée. Ils sont également présents auprès de la sécurité publique dans les centres régionaux de coordination et d’information routières.
Au titre des actions de prévention et d’éducation routière, plusieurs dispositifs nationaux sont en cours. Avec les assureurs de Groupama, nous formons quelque 7 160 jeunes de 112 établissements scolaires. Avec Gema (groupement des entreprises mutuelles d’assurances), qui rassemble dix-huit mutuelles, nous menons une action spécifique en direction des deux-roues motorisés, responsables d’un grand nombre de morts. En 2010, 9 200 jeunes sont entrés dans le cadre de ces dispositifs. Enfin, nous participons, à Lyon, à un dispositif associatif intitulé Percigones (piste d’éducation routière et civique des gones) tendant à mobiliser les scolaires. À chaque fois que la ressource disponible le permet, nous animons des pistes d’éducation routière et délivrons les attestations scolaires de sécurité routière. Au titre de l’année 2010, plus de 200 000 jeunes sont passés par ces structures.
Nos orientations opérationnelles visent à renforcer les actions sur les créneaux soirée, nuit et fin de semaine, à cibler les lieux de contrôle, à renforcer également les actions en direction des deux roues et des conducteurs de deux-roues motorisés – je rappelle que ces derniers représentent 1 % du parc et 18 % des tués – et à réprimer ce qu’on appelle les infractions de contournement ou les comportements à risque.
La direction centrale des CRS s’est également inscrite dans le cadre d’une politique clé en main et d’opérations à la carte. Depuis le mois de juillet dernier, nous avons relancé la notion d’opération ciblée de sécurité routière. Nous avons ainsi écrit à l’ensemble des préfets de département pour leur proposer d’utiliser la capacité de projection des motocyclistes CRS, afin de mener des opérations de contrôle, sur un temps et un lieu donnés, avec un objectif déterminé. Dans le Jura, par exemple, où trois personnes sont mortes en trois jours à la suite d’accidents, nous pouvons, si le préfet le souhaite, projeter une équipe de motocycliste pour marquer les esprits.
Depuis le 1er juillet, nous avons monté 354 opérations à la suite de demandes précises et nous voulons poursuivre dans cette voie. Nous sommes en effet en mesure d’aller en tout lieu du territoire et de conduire nos actions pour la durée décidée par l’autorité d’emploi là où elle le souhaite. Dans de petits départements, l’Ardèche par exemple, nous pouvons envoyer des hommes pour des week-ends spécifiques, tel celui de la Toussaint.
Avant de conclure, je voudrais exprimer quelques convictions. Il faut, selon moi, préserver des unités spécialisées dédiées à la sécurité routière au sein de la police nationale. L’expérience a montré en effet – et cela répondra peut-être, messieurs, à votre question relative à la création d’une police de la route – que la superposition d’objectifs ou de contraintes dans les services généralistes conduit à une érosion des effectifs. Il faut également prendre en compte la spécificité des réseaux urbains et autoroutiers, qui ont des exigences propres. Nous avons tous à l’esprit ces photos d’abribus fauchés ou de comportements de délinquants de la route – queue de poisson, circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence… Or, nous constatons précisément qu’en notre qualité d’unité très spécialisée, nous relevons davantage de circulation sur la BAU (bande d’arrêt d’urgence) ou d’infractions aux règles spécifiques de circulation sur l’autoroute que d’autres institutions déployées sur l’ensemble du territoire. Il y a des inconduites particulières sur le réseau de l’agglomération parisienne.
Je veux encore souligner l’impact de l’activité sur les besoins. Sur l’ensemble des données collectées en matière d’activité de verbalisation sur des délits ou des contraventions, 79 % des procès-verbaux ont été effectués par la police nationale en 2010. De même, près de 75 % des accidents corporels nécessitent de la procédure et surviennent sur le territoire urbain ou autoroutier autour des grandes agglomérations. Il faut être attentif à l’endroit où l’on doit faire porter son action.
J’appelle également votre attention sur une forme de rejet du fétichisme technologique. S’il faut du matériel, il faut aussi des hommes et une action de l’homme. Si la sanction automatisée a eu, semble-t-il, un impact sur l’évolution de la mortalité, ce n’est pas tant l’outil que la certitude de la sanction qui a eu un effet.
Enfin, je veux souligner l’impact sans équivalent de l’image de fermeté du motard. Il est un vecteur de sagesse pour les automobilistes. C’est un formidable outil au profit de la sécurité routière.
M. Philippe Houillon, rapporteur. N’y a-t-il pas un problème d’effectifs, notamment la nuit et chez les CRS ?
M. Didier Joubert. Non. C’est plus un problème d’emploi et de répartition de ces effectifs.
M. le rapporteur. Je parle des effectifs de CRS consacrés à la police autouroutière. Certains CRS disent parfois préférer exercer le métier noble de maintien de l’ordre.
M. Didier Joubert. Ce n’est ni la position ni le ressenti de la direction centrale des CRS. Au regard des contraintes subies par différentes directions de la Police nationale, les gens ont peur de disparaître et insistent sur leur spécificité. C’est un comportement de repli.
En tout cas, les effectifs déployés le dimanche ont été doublés en trois ans. Les cycles de travail ont été modifiés afin précisément d’avoir une présence forte sur les routes le week-end. Les instructions données ont ainsi été mises en œuvre.
Je reviendrai d’un mot sur l’importance de l’éducation routière et, plus concrètement, sur le rôle des enfants à l’égard des adultes en matière de diffusion d’une culture de sécurité routière. Il faut participer à cette diffusion car, dès leur plus jeune âge, les enfants ont une influence sur leurs parents.
M. le rapporteur. Vous dites, monsieur Joubert, qu’il faut augmenter le nombre de motards sur les routes.
M. Didier Joubert. Il faut préserver l’outil motocycliste.
M. le rapporteur. Vous avez dit que le motard des forces de l’ordre était un vecteur de sagesse. Il faut donc veiller à ce que leur nombre ne baisse pas.
M. Didier Joubert. Tout dépend aussi de la façon dont sont utilisés les effectifs. Il nous appartient de les utiliser au mieux. Ce n’est pas qu’un problème de volume.
M. le rapporteur. Le volume baisse néanmoins dans quelques compagnies.
M. Didier Joubert. Dans le cadre de la RGPP, un effort a été demandé à la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité au titre de la sécurité routière.
M. le rapporteur. Que les choses soient claires : effort signifie économie, n’est-ce pas ?
M. Didier Joubert. Oui. Cet effort a été gagé sur deux vecteurs d’économie : l’externalisation du guidage des transports exceptionnels et la généralisation du procès-verbal électronique. Force est cependant de constater que l’application des directives et la baisse des effectifs ont été plus rapides que la mise en place de l’externalisation du guidage des transports exceptionnels et la généralisation des PVE. Je rappelle que le guidage des transports représente l’équivalent de cinquante emplois.
M. le rapporteur. Êtes-vous favorable à la création d’une police de la route ?
M. Didier Joubert. Je suis favorable à la persistance de l’existence d’unités spécialisées dédiées aux métiers de la sécurité routière.
M. le rapporteur. Vous souhaitez qu’au sein de la gendarmerie, des CRS et de la police nationale, soient préservées des unités spécialisées. Souhaitez-vous pour autant une seule et unique police routière ?
M. Didier Joubert. Cela ne me paraît pas possible aujourd’hui, en raison de la partition délicate qui interviendrait sur les zones de police et de gendarmerie, du fait notamment de l’activité judiciaire postérieure à l’activité contraventionnelle ou aux accidents. J’ai rappelé tout à l’heure que la police nationale assure le suivi de 75 % des accidents à l’origine de procédure.
M. Didier Perroudon. Si l’on devait avoir une police de la route spécialisée, toutes les forces de police de sécurité publique seraient désengagées de cette mission au profit d’un groupe spécialisé. On peut imaginer une police de la route qui intervienne sur l’autoroute, par exemple : c’est quasiment ce qui se fait à Lyon où des autoroutes traversent l’agglomération ; elles ont été cédées par la sécurité publique aux CRS s’agissant de l’aspect autoroutier. Cependant, pour le tissu urbain, nous avons besoin d’une grande mobilité, d’une permanence des contrôles pour insécuriser le chauffard. L’individu qui va boire excessivement dans une boîte de nuit doit avoir le sentiment qu’il peut, à chaque coin de rue, faire l’objet d’un contrôle d’alcoolémie et qu’il vaut mieux qu’il rentre chez lui en taxi. Or ce sentiment, il ne peut l’avoir que si les services de police générale sont présents dans la ville. Par exemple, si l’officier de nuit note un creux dans l’activité, il pourra récupérer deux, trois véhicules de patrouille et organiser quelques contrôles. La richesse de la sécurité civile en zone urbaine, ce sont ses 66 000 fonctionnaires mobilisés. Il ne faudrait pas que leur action soit compromise par la spécialisation d’une unité de sécurité routière et qu’ils se trouvent en quelque sorte « désimpliqués » de cette mission.
M. le rapporteur. Comme on l’a souvent entendu dire, les automobilistes veulent bien être contrôlés mais pas piégés. Des instructions sont-elles données en la matière ? Si oui, lesquelles ? Verriez-vous un inconvénient à ce qu’une circulaire, si tant est que celle-ci puisse être appliquée, précise les conditions dans lesquelles doivent être effectués les contrôles ?
Concrètement, et tout le monde le dit, il y a un problème de lisibilité de la route. Ainsi, des vitesses différentes peuvent se succéder sur une route à quatre voies et les contrôles ont lieu souvent sur la portion de route où la vitesse autorisée est la plus faible : n’y a-t-il pas là une forme de piège ? Je n’imagine pas que des instructions soient données en ce sens. Mais n’y a-t-il pas une demande de résultats ?
M. Didier Perroudon. C’est un fantasme de penser que les policiers sont astreints à un nombre de PV précis. On leur demande d’avoir des résultats, notamment en termes d’accidentologie. L’indicateur de l’efficacité, c’est la baisse de la délinquance routière et de l’accidentologie. Les DDSP (directions départementales de la sécurité publique) doivent essayer de cibler leurs contrôles en se fondant sur les zones accidentogènes.
Je suis personnellement très attaché à la lisibilité de la route. La voie publique doit être lisible ; or, et cela fait le bonheur des bêtisiers, il faut parfois être à l’arrêt pour prendre connaissance de tous les panneaux de signalisation. Il importe donc d’homogénéiser les changements de vitesse, qui peuvent être très déstabilisants. N’oublions pas cependant que ceux-ci sont souvent intervenus du fait d’un fort risque d’accident sur la portion de route en question. Dès lors, il faut faire respecter cette limitation de vitesse en prévoyant des contrôles.
M. Didier Joubert. Voilà un peu plus de deux ans, à l’occasion d’une réunion de l’ensemble des commandants d’unité et des acteurs de la sécurité routière CRS, en présence de Mme Merli, Déléguée interministérielle à la sécurité routière, nous avions donné des consignes très précises. Elles visaient à faire remonter auprès des préfets les informations relatives aux failles de lisibilité et de dangerosité de la structure routière, Mme Merli s’étant engagée à agir si rien ne bougeait.
M. le rapporteur. Qu’en est-il aujourd’hui ?
M. Didier Joubert. Une dizaine de cas particuliers sont remontés du terrain avec des effets quasi immédiats. Récemment, nous avons signalé que le revêtement de la N 118 dans sa remontée vers Vélizy était devenu dangereux. Je ne sais si c’est dû cette intervention, mais ce revêtement a été refait.
En tout cas, il n’y a aucune volonté de piégeage, monsieur le rapporteur.
M. le rapporteur. Il n’en reste pas moins que l’exemple que j’ai donné n’est pas inventé. Le contrôle, lorsqu’on passe d’une limitation de vitesse à 110 à une limitation à 90, même s’il n’est pas systématique, n’est pas une vue de l’esprit.
M. Didier Joubert. La culture de sécurité routière ne vise pas à piéger l’automobiliste. Nos instructions sont très claires.
M. le rapporteur. Vous ne verriez donc aucun inconvénient à ce qu’une circulaire le précise en reprenant vos termes.
En ce qui concerne les deux roues, quelle est votre position s’agissant de la remontée de files, revendication importante des motards ? Dans les faits, en zone urbaine, ceux-ci remontent déjà par centaines les files de voitures dans les embouteillages.
M. Didier Perroudon. Cette situation, très parisienne, apparaît dorénavant dans toutes les grandes villes. Les deux roues prennent un risque considérable. Pour les législateurs que vous êtes, ne vaut-il pas mieux réglementer que de laisser l’anarchie actuelle ? Faut-il prévoir une voie pour les deux roues qui remontent les files ? S’ils sont tous, comme sur l’autoroute A4, entre la voie de gauche et celle du milieu, ça va. Mais lorsque, comme sur l’avenue de la Grande-Armée, ils se faufilent de tous les côtés, c’est extrêmement dangereux. Faut-il laisser les choses en l’état ? De toute façon, nous ne pourrons pas réglementer, sauf à déployer une énergie considérable et à demander aux motards de rester derrière les voitures. La solution n’est-elle pas de prévoir une voie spécifique ?
M. Gilbert Le Bris. Je note que chez vous aussi les sacrifices sont payés au comptant alors que les contreparties sont souvent virtuelles ou tardives.
S’agissant de l’interface police/gendarmerie, vous avez dit, monsieur Joubert, que des contrôles se faisaient conjointement, sur un temps et un itinéraire donnés. Au-delà de ce type d’opérations, comment fonctionne la coopération entre la police et la gendarmerie nationale ? Nous, élus, sommes amenés à constater que, dans les zones rurales, périphériques des agglomérations urbaines, la police va fort peu, car c’est trop loin du centre, tandis que la gendarmerie n’intervient pas, puisque l’on est en zone police. Résultat : on ne voit pas beaucoup d’uniformes dans ces sortes de zones grises.
J’ai bien compris que vous étiez contre la spécialisation d’une unité routière, mais qu’en est-il du fonctionnement au quotidien ? Les volontés de coopération et de coordination entre vous sont-elles claires ?
Vous avez évoqué, monsieur Perroudon, des micro-contrôles. Ceux-ci peuvent effectivement être efficaces, je pense notamment à ceux effectués par les voitures banalisées. Souvent, cependant, ces contrôles sont mis en place là où il est le plus facile de les installer, où ils sont le plus rentable, et non dans les zones accidentogènes. Cette constatation participe de la difficulté à obtenir une bonne lisibilité de la route. Reconnaissons-le, l’incohérence des itinéraires est aussi provoquée par les élus locaux qui réclament, par exemple, une limitation de vitesse à 50 km/h dans la partie communale, pour donner satisfaction à des riverains. Ne faudrait-il donc pas qu’une décision, prise par le préfet – ou une autre autorité –, se substitue au patchwork actuel ?
M. Jérôme Lambert. Existe-t-il une corrélation entre le nombre des infractions relevées et celui des accidents ?
Que pensez-vous de l’utilisation des motards en civil ? On se prive de la peur de l’uniforme mais ils peuvent prendre des chauffards en flagrant délit.
Je le dis en tant qu’utilisateur d’un deux-roues motorisé, tout l’intérêt de rouler à moto en agglomération repose sur le fait que l’on peut gagner du temps. Si, demain, on demande aux utilisateurs de deux-roues motorisés de se comporter comme des automobilistes, ne va-t-on pas les inciter à revenir à la voiture ? Que se passerait-il si le quart ou la moitié des utilisateurs de deux roues optaient à nouveau pour un véhicule à quatre roues en milieu urbain ?
M. Christian Vanneste. Vous avez parlé de taux d’alcoolémie mais vous n’avez pas abordé les contrôles de drogue. Je crois savoir qu’en la matière, les moyens sont moins nombreux et plus coûteux. Or, l’usage du cannabis présente les mêmes dangers que ceux de l’alcool, lorsqu’on est automobiliste ou motard.
S’agissant des deux roues, on le sait, on trouve davantage de victimes parmi les motards : 2 % d’utilisateurs et 18 % des morts. Observe-t-on également un plus grand nombre de verbalisations les concernant ? Ou est-ce plutôt le contraire ? Les utilisateurs de deux-roues motorisés ne font-ils pas l’objet de sympathie, et donc d’une moins grande sévérité ? En outre, dans les villes, ils échappent plus facilement aux contrôles.
Enfin, la vidéoprotection peut-elle être utilisée – en collaboration, bien sûr, avec la police municipale – pour améliorer la sécurité routière ? Je pense au non-respect des feux rouges, au défaut de port de la ceinture ou encore à l’usage du téléphone portable au volant ?
M. Didier Perroudon. Sur les zones grises, le dispositif CORAT, coordination renforcée entre les services de police et de gendarmerie, est en train de se développer sous l’autorité du préfet. Il vise à permettre de mieux adapter les efforts des deux forces dans les territoires et répondra donc à vos observations.
S’agissant de la corrélation entre les infractions et les accidents, nous ne disposons pas d’éléments très probants. En outre, le nombre des contraventions est limité par notre capacité de travail.
M. Jérôme Lambert. Si tous les automobilistes deviennent subitement moins respectueux des règles, cela doit se traduire dans les chiffres ? Avez-vous constaté le relâchement dont il a été beaucoup question ?
M. Didier Perroudon. Pas de manière scientifique. C’est une impression.
M. Didier Joubert. S’agissant du linéaire très particulier que j’ai évoqué tout à l’heure, je peux vous dire que, l’an dernier, nous avons constaté deux évolutions simultanées : une hausse de notre activité et une hausse de l’accidentalité et du nombre des tués. Sur ce linéaire de 4 500 kilomètres, nous avons au moins une indication de tendance.
M. Didier Perroudon. Les motards en civil constituent un outil extrêmement efficace notamment pour certains types d’infractions – défaut de port de la ceinture, utilisation du téléphone portable au volant… Cela étant, l’interpellation doit toujours être effectuée par des motards en uniforme pour ne pas prêter à confusion.
S’agissant de la moto comme moyen de gagner du temps, nous, chargés de l’exécution de la loi, n’avons pas à nous prononcer sur cet aspect des choses. Certains motards sont raisonnables et d’autres ne le sont pas. Cela étant, il y a de plus en plus de motards qui se mettent de plus en plus en danger. Voilà un vrai chantier, qui concerne aussi les vélos. En effet, le développement des Vélib, et autres dispositifs du même type, constitue un souci dans les villes car leurs utilisateurs s’exposent de manière inconsidérée. Utilisant un moyen de transport propre, ils ont le sentiment qu’ils peuvent s’affranchir d’un certain nombre de règles, se mettant ainsi en danger.
S’agissant des stupéfiants, les textes relatifs aux contrôles sont sortis il y a peu. La montée en puissance est donc relativement lente mais elle commence à se faire. Nous, police nationale, avons rencontré un problème avec les kits de contrôle, non pas de nature budgétaire, mais de marché. Une difficulté s’est présentée au niveau de la procédure de marché public, laquelle a provoqué un retard en 2010. La situation est en train de se régulariser.
Pour ce qui est de la verbalisation des deux roues, on peut toujours imaginer que quelques motards feraient l’objet d’une certaine sympathie. Mais les gendarmes et les policiers ont le sens du service public et l’indulgence dont ils pourraient faire preuve à l’égard d’un motard ne serait pas différente de celle qu’ils pourraient manifester vis-à-vis d’un conducteur de quatre roues. La vraie difficulté, c’est de pouvoir interpeller un deux-roues sans le mettre en danger.
M. Didier Joubert. Cela répond à votre question, monsieur le rapporteur, sur la capacité à mettre en œuvre le contrôle, pour ne pas décrédibiliser une réglementation supplémentaire.
Monsieur Vanneste, il est en effet compliqué d’intercepter des motards sans mettre en danger les autres usagers de la route.
M. Christian Vanneste. Pourrait-on avoir des chiffres ?
M. le president Armand Jung. Je vous suggère, messieurs, de nous les faire parvenir par écrit.
Je vous remercie de nous avoir fait part de votre expertise.
*
* *
Audition de MM. Bernard Darniche, fondateur de l’association Citoyens de la route et Rémy Julienne, consultant spécialiste en sécurité
Mardi 20 septembre 2011
M. le président Armand Jung. Je vous remercie, messieurs, d’avoir répondu à notre invitation. Au cours de nos auditions, nous avons entendu beaucoup de théories. La présente audition devrait nous permettre d’aborder d’autres aspects.
M. Bernard Darniche. Je suis très étonné que le sujet qui préoccupe votre mission parlementaire fasse encore l’objet de discussions aujourd’hui, dix ans après l’instauration de la tolérance zéro.
Il y a dix ans, au moment où j’avais créé l’association Citoyens de la route, j’avais alerté Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, que la tolérance zéro était nécessaire sous réserve que la réglementation soit accessible et compréhensible par les usagers ; que ce n’était qu’à cette condition que les punitions pouvaient être légitimes.
Depuis, les chiffres m’ont donné raison. En dix ans, dix millions de points ont été retirés. Or des enquêtes ont montré que ces retraits de points sont dûs à des infractions commises à des endroits du réseau routier où il n’y a pas de danger et où la réglementation est illisible. La multiplicité des intervenants – maires, présidents des conseils régionaux, présidents des conseils généraux et représentants de l’État – est en cause : l’effet est désastreux pour les citoyens.
La politique de la tolérance zéro est nécessaire ; des pays comme l’Allemagne et le Japon l’appliquent d’ailleurs avec une très grande sévérité. Mais une réglementation ne doit pas surprendre ; il faut qu’elle soit adaptée aux besoins de la conduite.
Les dialogues avec mes auditeurs, au cours d’une émission que j’anime chaque matin sur Radio bleu 107.1, me permettent de constater que les citoyens ne demandent qu’à respecter les règles mais qu’ils ne les comprennent pas. Et elles sont en effet incompréhensibles : il suffit de se déplacer sur une route qu’on ne connaît pas pour constater des incohérences dans les signalisations ; si un contrôle est effectué, on est alors mécaniquement pénalisé.
Si je suis favorable à des contrôles sévères, je suis absolument opposé à des punitions généralisées. Or tel est bien le cas aujourd’hui ; car qu’est-ce que le retrait de 10 millions de points en dix ans si ce n’est une punition généralisée ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Dix millions de points ont été retirés en dix ans mais le même nombre a été restitué.
M. Bernard Darniche. Oui, mais le sentiment d’injustice est légitime car trois peines se cumulent : le retrait de points, le paiement de l’amende et la nécessité de récupérer les points perdus. Tout cela pour des fautes commises, dans de nombreux cas, en raison d’une réglementation incompréhensible.
On sait que les parents échouent s’ils tentent de faire respecter à des enfants des règles qu’ils ne comprennent pas. Il en va de même avec les conducteurs : il faut garder un cadre logique et de bon sens.
Le résultat est que les conduites alcoolisées et les mauvais comportements passent à travers les mailles du filet, la police se consacrant à lutter contre les excès de vitesse.
La sécurité routière constitue pourtant un champ d’action où un Président de la République peut facilement réussir. Car il ne s’agit pas de fournir des réponses à des préoccupations politiques mais de résoudre des problèmes techniques portant, par exemple, sur la protection individuelle – utilisation de la ceinture de sécurité, installation d’un air bag – ou les infrastructures… Au lieu de cela, l’Etat s’est préoccupé de montrer son autorité en installant des radars automatiques.
Une fois le seuil des 4 000 morts annuels atteint, il aurait fallu créer une agence consacrée non pas à la sécurité routière mais à la mobilité ; gérée par des techniciens, son rôle aurait été de proposer des règles pérennes. Mais la promesse a été faite de réduire le nombre de tués à 3000, ce qui n’est techniquement pas possible.
La multiplication des entraves envers des véhicules qui sont pourtant de plus en plus sécurisés – des milliards ont été dépensés pour protéger l’automobiliste à l’intérieur de son véhicule – ainsi que les carences que connaît le développement des transports en commun ont, en outre, eu pour effet d’encourager « le système démerde ». De nombreux usagers préfèrent se déplacer sur des deux-roues motorisés. Mais que se passera-t-il quand la part des deux roues dans la circulation passera de 2 % à 4 % ? Une catastrophe de santé publique, car la moto ne protège pas son conducteur en cas d’accident. On subira alors toutes les conséquences d’un système incohérent consistant à culpabiliser les conducteurs et à ne pas construire de parkings.
M. le rapporteur. Quand on sait que deux heures sont parfois nécessaires en zone urbaine pour parcourir 30 kilomètres, n’est-il pas normal que certains cherchent d’autres solutions de transport ?
M. Bernard Darniche. Le dossier de la mobilité n’a jamais été un dossier politique alors que les gens sont obligés d’habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail.
Les citoyens ont besoin d’une vision positive des règles qu’on leur demande de respecter. C’est pourquoi, j’ai suggéré la création d’une plate-forme de gouvernance adaptée aux moyens modernes de mobilité ; celle-ci intégrerait les questions de mobilité dans un système acceptable au lieu de multiplier les entraves.
La sécurité routière manque en effet de lisibilité ; que quatre autorités différentes puissent intervenir garantit l’incohérence du système. Certains maires n’ont pas même l’idée de synchroniser les feux de signalisation installés sur les voies routières de leur commune !
La perte de temps causée par les centaines de kilomètres de bouchons quotidiens est dénoncée par tous. Il serait d’ailleurs intéressant d’en évaluer les conséquences sur le PIB.
M. le président Armand Jung. Quand il y a beaucoup de bouchons, on peut au moins se dire qu’il y aura moins de morts. Mon propos est peut être paradoxal mais il prend sens au vu de l’augmentation du nombre de morts constatée au début de cette année.
Ne pensez-vous pas que le choix de circuler en deux roues soit aussi motivé par la considération des avantages qu’on peut retirer de ce moyen de transport ?
M. Bernard Darniche. J’ai reçu des lettres de mères de famille qui s’inquiétaient que leur mari n’ait trouvé que cette seule solution. Mais que peut faire un jeune cadre qui habite à 40 kilomètres de son bureau et qui est réprimandé par son employeur à cause de ses retards ? En prenant un scooter, il fait vivre sa famille, et notre économie…
M. le président Armand Jung. L’étalement des villes pose en effet des problèmes ingérables. Il faut développer le transport multimodulaire.
M. le rapporteur. Pensez-vous que les transports en commun ne soient pas assez développés ? Car les solutions sont limitées : il y a la voiture, les moyens accessoires comme les motos, les cyclomoteurs et les vélos, et enfin les transports en commun, routiers ou ferroviaires. Ou auriez-vous autre chose à proposer ?
M. Bernard Darniche. Je pense à des solutions mixtes. Par exemple à Paris, le maire aurait mieux fait de créer des parkings et d’interdire le stationnement sur les voies de circulation, comme c’est le cas au Japon et dans la ville de New-York. Cela aurait permis de dégager des voies libres pour des cyclistes utilisant des vélos à assistance électrique et aurait amélioré de beaucoup la vitesse de circulation dans la capitale. Cette solution aurait été plus efficace et moins onéreuse que la création de lignes de tramway.
M. le rapporteur. Quel est le prix d’un vélo électrique ? Il me semble que cela coûte cher.
M. Bernard Darniche Un vélo électrique coûte moins cher qu’une voiture qui ne permet pas d’arriver à l’heure à son travail et dont l’usage entraîne des frais annexes comme le paiement des parkings.
C’est tout un environnement qu’il faut créer. Personnellement, je fais 14 000 kilomètres de vélo par an, mais jamais je ne prends le risque d’emprunter les voies de bus !
Dans le domaine de la conduite, une juste vision des dangers est indispensable. Malheureusement les jeunes ne sont sensibilisés qu’aux risques de répression et non pas aux vrais risques. Ils devraient être mieux informés sur les contraintes liées au partage de la route. En ce sens, le code de la route, qui a déjà 50 ans d’âge, est complètement obsolète.
Mes propos peuvent apparaître violents…
M. le président Armand Jung. Aucunement : c’est précisément la franchise que nous recherchons.
Je donne maintenant la parole à M. Rémy Julienne.
M. Rémy Julienne. Cela fait quarante-cinq ans que je parcours toutes les routes du monde et, en tant que citoyen responsable, je mets volontiers mon expérience au service de vos travaux.
Le premier constat dont je peux faire part est que les comportements sur la route sont très différents, différences particulièrement marquées entre les pays du nord et les pays latins. Une formation est donc nécessaire pour réguler ces attitudes car les routes ne s’élargissent pas avec l’augmentation du nombre des usagers !
La pédagogie est évidemment plus efficace envers les jeunes qu’envers les anciens qui ont acquis des mauvaises habitudes ; et elle le sera d’autant plus qu’elle sera simple dans son contenu et dispensée par des personnes crédibles. Ce qui se fait en Allemagne et au Japon en ce domaine peut servir de modèle.
En tant que spécialiste des accidents, j’ai ainsi été contacté par deux ministres – MM. Gayssot et Sarre – pour lancer des projets qui auraient pu connaître un grand succès mais qui n’ont pas abouti, malheureusement, car on était alors en fin de mandat.
M. le rapporteur. Nous serions intéressés de les connaître !
M. Rémy Julienne. Il s’agissait de faire des démonstrations en dynamique destinées à montrer quelles pouvaient être les causes d’un accident – et pas seulement ses conséquences. Pour le filmage, la production avait trouvé des financements de la part d’équipementiers et d’assureurs ; le film n’aurait donc entraîné aucun frais. Il devait même être inscrit dans la grille des programmes télévisés de l’époque, Alain Jérôme, le directeur des programmes des chaînes publiques, ayant donné son accord – même si au départ il avait été réticent car les messages consacrés à la sécurité routière, m’avait-il dit, « font baisser l’audience ».
Mon but n’était pas de remettre en cause la réglementation mais de l’illustrer sous la forme d’une présentation ludique et accessible à tous. Dans l’essai qui a été réalisé, je m’adressais à un public de Latins, a priori plus difficile à convaincre, et j’expliquais pourquoi, moi qui suis un cascadeur, je mettais ma ceinture de sécurité dans tous mes déplacements en voiture, même à faible allure. La confiance que j’inspire en raison de mes activités de cascadeur confortait la crédibilité du message.
J’ai été également sollicité par M. Michel Ledru, chargé alors de la sécurité routière, lorsqu’il a été décidé d’abaisser la vitesse en ville de 60 à 50 km/h. J’ai alors organisé une démonstration qui consistait à faire glisser sur 40 mètres une voiture lancée à 50 km/h sur la place des Invalides! Je voulais montrer qu’un conducteur très respectable pouvait, par l’addition de petites erreurs, commettre une faute de conduite aux conséquences spectaculaires. Mon film a intéressé les autorités du canton de Genève et a été multidiffusé, avec succès, à la télévision Suisse Romande.
M. Bernard Darniche En ce domaine, la sémantique est importante. Parler de sécurité routière n’intéresse personne ; car cela fait penser aux gendarmes, à des règles imposées et suscite des mouvements légitimes d’hostilité de la part de l’opinion. La notion de « sérénité routière » est de loin préférable.
Les outils existent : l’administration a conçu un plan national de formation qui constitue un cahier des charges définissant les paliers d’enseignement destinés à former des bons conducteurs. J’avais pris l’initiative, il y a déjà un certain temps, de faire rédiger à partir de ce document un livret pédagogique qui devait être distribué par les magasins Carrefour. Cette grande enseigne était en effet sensibilisée au problème car la création de magasins dotés de parkings à l’extérieur des villes liait l’acte d’achat à l’utilisation d’un véhicule. Ce livret d’apprentissage passait en revue toutes les phases de la conduite. Mon projet était de proposer une formation au permis de conduire via un contrat de confiance impliquant les familles et dont le prix serait réduit en raison de la mécanisation des actes pédagogiques. Par exemple, le problème de la perte d’adhérence de la voiture était traité sous la forme d’un canevas de questions destinées à identifier les incompétences de l’élève en mettant en évidence des situations dans lesquelles il serait incapable de maîtriser son véhicule.
Cependant un tel programme de formation aurait exigé une réforme du permis de conduire ; car, de fait, le plan national de formation se traduit par au minimum 60 heures d’apprentissage : les 20 heures d’enseignement actuelles restent très insuffisantes. Des initiatives prises en collaboration avec le privé sont seules susceptibles d’apporter des progrès dans la pédagogie de la formation à la conduite.
M. le rapporteur. Que pensez-vous alors de la formation des conducteurs au permis de conduire ? Seriez-vous favorables à l’instauration d’une formation post-permis ? Quel est votre avis sur les stages de récupération de points ?
M. Bernard Darniche. Il faudrait s’inspirer de ce qui se fait en Allemagne, au Japon et en Norvège. En France aussi on peut être novateur, mais il faut y mettre les moyens. Les sources de financement ne peuvent plus provenir de l’administration. Il faut donc impliquer des sociétés privées soucieuses de mettre en avant une image positive de leur activité. Malheureusement aucun projet de cette nature n’a été réalisé.
Il y a près de trente ans, j’avais tenté avec l’aide de Noël de Saint Pulgent, à l’époque où il s’occupait des financements public-privé au ministère des finances, de créer des centres d’enseignement à la conduite, dénommés « Auto Campus ». Quand je me suis rendu au Japon, il y a cinq ans, j’ai appris que 1400 écoles correspondant exactement à la formule de l’Auto campus y avaient été ouvertes. Financés par les constructeurs et les assureurs, ces centres permettent de juger les candidats en fonction de leurs résultats à la formation continue ; seules des personnes aux compétences vérifiées se présentent à l’examen d’obtention du permis de conduire. Qui plus est, il n’y a plus à attendre des mois avant l’examen.
Ce type de préparation répond aussi au problème de l’aptitude à la conduite. On sait que, pour différentes raisons, 5 % de la population ne doit pas être autorisée à prendre un véhicule. C’est un fait qu’il faut assumer. Tout le monde ne peut donc pas obtenir son permis de conduire, au risque sinon de le dévaloriser, comme il en est déjà du baccalauréat dont on réduit les exigences pour que tous les candidats puissent le réussir.
M. Christian Vanneste. À la différence d’autres intervenants, vous ne faites pas de la vitesse le coupable ni de la répression la solution.
Dans la mesure où l’on ne saurait tenir tout conducteur pour un coupable a priori, et entretenir ainsi chez les usagers un état de stress préjudiciable, que convient-il d’améliorer ? Est-ce un problème d’infrastructures ?
Un permis de conduire se gagne ; mais il se perd aussi, ce qui est source, là aussi, d’angoisse. J’ai rédigé ainsi une proposition de loi demandant l’instauration, sur le modèle de ce qui se fait aux Pays-Bas et en Espagne, d’un contrôle périodique des conducteurs qui porterait sur leur capacité physique et sur leur connaissance des règles en vigueur du code de la route. Seriez-vous partisan d’une telle procédure ?
M. Gérard Voisin. Je suis très convaincu par les propos qu’on vient d’entendre et par une approche de la problématique de la vitesse qui aborde le conducteur en tant que pilote responsable ; cette thèse se distingue de beaucoup de celle de M. Claude Got.
Pourriez-vous préciser, M. Bernard Darniche, ce que vous entendez par « plate-forme de gouvernance de la mobilité ? » En matière de mobilité, je tiens à dire qu’en tant que maire j’ai remplacé dans ma commune les carrefours à feux par des ronds-points qui apportent une plus grande fluidité de circulation et sont plus sûrs.
M. Bernard Darniche. Vous aurez remarqué que je n’ai pas parlé de seuils de vitesse. Si l’on veut être crédible, il faut en effet considérer la vitesse comme un élément évolutif qui doit être adapté à la situation, par exemple à la fluidité du trafic et aux conditions météorologiques. Quel sens y a-t-il de limiter à 50 km/h le déplacement d’un véhicule qui roule seul sur une route ? En Allemagne, dans les cas où il n’y a pas de raison de limiter la vitesse, on parle de vitesse « conseillée » en fonction de la situation. Au Japon, il existe différents types de permis de conduire qui donnent plus ou moins de liberté au conducteur. Dans ce système, il est évidemment nécessaire que la sanction soit très sévère en cas de faute.
Concernant les retraits de points, de nombreux témoignages montrent que leur comptabilité est mal tenue par l’administration. Or il est inadmissible qu’on puisse retirer à une personne son droit à la mobilité – c’est-à-dire son droit à la vie – sans une décision judiciaire.
Quant à la plate-forme de gouvernance que je propose, il s’agirait d’un système laissant toute sa place aux ingénieurs et aux techniciens ; les politiques y seraient évidemment présents à titre de gardiens du temple. Elle aurait pour fonction de mettre en place une réglementation crédible, uniforme et adaptée ; elle favoriserait une mobilité répondant aux besoins, n’hésitant pas à faire appel au marché privé, et serait notamment à même de s’opposer aux initiatives malheureuses de certains maires.
Le nombre de tués sur la route parait maintenant difficile à faire baisser ; comme toute activité humaine, conduire présentera toujours des risques. Il semblerait donc souhaitable de passer à un système de gouvernance déporté par rapport à l’administration. Un pareil mode de gestion existe en Allemagne où l’automobile club allemand (ADAC) se voit confier des fonctions de gestion de la sécurité routière.
M. le président Armand Jung. Messieurs, je vous remercie de vos interventions qui contribueront à enrichir notre réflexion.
*
* *
Audition de M. Claude Guéant, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
Mercredi 12 octobre 2011
M. le président Armand Jung. Monsieur le ministre, cette mission a été créée au mois de juin à la suite des problèmes posés par la réforme du permis à points, votée dans le cadre de la LOPPSI 2 (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), et par les nouvelles mesures concernant les radars.
Tout au long de nos travaux, qui comptent plus de soixante heures d’auditions, notre souci premier a été d’affirmer qu’il n’y a pas de seuil incompressible de morts sur les routes.
Nous espérons que vous tiendrez compte de nos propositions, qui vous seront remises dès la semaine prochaine.
Monsieur le ministre, la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) est désormais rattachée au ministère de l’intérieur. Quelle gouvernance proposez-vous pour la politique de sécurité routière ?
Les causes principales des accidents sont incontestablement la vitesse et l’alcool. Quelle est votre appréciation en la matière ?
Pouvez-vous nous parler de l’acceptabilité sociale, thème dont nous discutons depuis plusieurs mois ?
Que proposez-vous face à l’augmentation des accidents et des morts chez les deux-roues, motorisés ou non ?
Enfin, que suggérez-vous s’agissant du téléphone mobile ?
M. Claude Guéant, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Permettez-moi d’abord de vous remercier de votre invitation. La sécurité routière est un sujet très important. Vos travaux témoignent d’une réflexion intense, et l’accent mis sur les priorités permet de rétablir un certain nombre de vérités.
Beaucoup de chemin a été parcouru. En effet, en 2002, nous déplorions environ 8 000 tués – à comparer aux 18 000 morts en 1972 – et, en 2010, nous avons franchi, pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, le seuil des 4 000 tués sur les routes. Au total, depuis 2002, 23 000 vies ont été épargnées et 300 000 hospitalisations évitées.
Cependant, la tendance des premiers mois de l’année a montré que le nombre de tués augmenterait d’environ 500 à 600 en fin d’année. Cette perspective inacceptable a conduit à la réunion, sous la présidence du Premier ministre, du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) au mois de mai. Les débats qui ont eu lieu à cette occasion ont permis de sensibiliser de nouveau nos compatriotes, et l’on assiste depuis l’été à un véritable ressaisissement. Aujourd’hui, les chiffres sont pratiquement au même niveau que ceux de l’an dernier – avec douze tués de plus fin septembre. Nous pouvons donc raisonnablement espérer être à nouveau sous la barre des 4 000 morts cette année.
Ces résultats sont dus aux bonnes décisions qui ont été prises par les gouvernements, mais aussi au changement de comportement de nos concitoyens dont la vitesse moyenne sur les routes s’est réduite de 10 kilomètres par heure. Comme vous le soulignez, monsieur le président, il est encore possible d’obtenir de meilleurs résultats.
S’agissant de la gouvernance, j’ai tendance à penser que l’organisation actuelle n’est pas mauvaise. Le Premier ministre, auquel vous proposez de confier la sécurité routière, ne peut tout faire. La sécurité routière a été confiée au ministre de l’intérieur en vue d’avoir, en un même lieu, une gestion de la conception et une gestion des forces de l’ordre.
Le premier point de mon intervention portera sur le respect des règles.
Comme votre mission l’a montré, la première cause de mortalité sur les routes est l’alcool, avec 1 200 personnes tuées chaque année. Il nous faut donc travailler sur plusieurs axes afin de renforcer la lutte contre ce fléau.
Le premier axe est celui de la réglementation et du contrôle.
Nous avons beaucoup insisté, avec les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, pour que les contrôles soient renforcés, particulièrement aux moments les plus sensibles que sont les nuits des fins de semaine.
J’ai également demandé aux préfets que les véhicules des personnes ayant commis, en état de récidive, un accident sous l’empire de l’alcool soient immédiatement immobilisés, conformément aux dispositions de la LOPPSI.
Je rappelle que ce texte prévoit la confiscation obligatoire par le juge du véhicule des auteurs de ce délit, le magistrat ne pouvant y déroger que par une décision spécialement motivée.
Enfin, le CISR du 11 mai dernier est venu renforcer ce dispositif : tout conducteur qui dépassera le taux de 0,8 gramme d’alcool par litre de sang se verra retirer huit points, au lieu de six actuellement.
Le second axe retenu par le Gouvernement est celui de la prévention en matière d’alcoolémie.
Je citerai en premier lieu l’obligation d’équipement et d’utilisation des éthylotests anti-démarrage dans les cars de transport d’enfants depuis le 1er janvier 2010, et l’équipement complet du parc des autocars d’ici à 2015.
Le Gouvernement est favorable à la généralisation de ces éthylotests anti-démarrage à l’ensemble des véhicules. Mais cette mesure doit être prise au niveau communautaire, et encore faut-il que ces tests soient utilisables facilement et que les constructeurs, actuellement très réservés sur le sujet, puissent maîtriser les coûts.
Je citerai ensuite l’interdiction de la vente d’alcool dans les stations-service de dix-huit heures à huit heures, ainsi que l’obligation, à compter du 1er décembre prochain, pour les établissements de nuit de mettre à disposition de leur clientèle des éthylotests chimiques ou électroniques.
Le deuxième point de mon intervention concerne l’accidentologie des conducteurs de deux-roues motorisés, qui demeure préoccupante. Ces derniers représentent en effet 2 % du trafic, mais 24 % des victimes tuées, parmi lesquelles un très grand nombre de jeunes gens. Nous envisageons plusieurs mesures.
La première vise à identifier les conducteurs de deux-roues qui commettent une infraction grâce à une meilleure lisibilité des plaques d’immatriculation. Le modèle de plaques dit « allemand », que les motocyclistes eux-mêmes nous ont demandé, nous convient parfaitement et est même un peu plus lisible que ce que nous avions nous-même envisagé.
La deuxième concerne la visibilité des motocyclistes. Il faut, bien sûr, renforcer la formation des automobilistes, mais aussi améliorer les équipements des motards grâce à des bandes ou des points réfléchissants sur les blousons. Je précise qu’il n’a jamais été question d’affubler les motards d’un gilet jaune, comme ceux que l’on trouve dans le coffre de nos voitures…
La circulation en inter-file, revendiquée par le monde des motards, avec lequel nous avons désormais une relation apaisée, mérite d’être étudiée, car force est de constater que beaucoup d’entre eux circulent de cette façon et bénéficient le plus souvent d’une assez grande tolérance de la part des forces de l’ordre. Il faut admettre que circuler en inter-file est une particularité de la conduite à moto, en particulier en région parisienne. En Belgique, par exemple, ce type de conduite ne semble pas entraîner une hausse de la mortalité et de l’accidentalité. Pour ce qui nous concerne nous pourrions aller en ce sens.
Le troisième point de mon intervention portera sur le respect des limitations de vitesse.
Comme vous le savez, la vitesse a causé la mort de 760 personnes l’an dernier, soit 20 % de l’ensemble des tués sur les routes. À la différence de l’alcoolémie, elle est facilement mesurable compte tenu des moyens automatiques dont nous disposons, ce qui a d’ailleurs parfois donné le sentiment qu’elle était davantage réprimée que la consommation d’alcool.
En la matière, nous continuons la mise en place des radars pédagogiques : 304 sont actuellement en service, notre objectif étant d’arriver à 4 000 à la fin de l’année 2012. À compter du mois prochain, 250 radars seront installés tous les mois. En outre, j’ai donné aux préfets des directives pour l’organisation, préalablement au retrait des panneaux des radars fixes, de réunions de concertation avec l’ensemble des acteurs locaux de la sécurité routière, afin que les radars soient installés aux meilleurs endroits.
Par ailleurs, nous avons signé avec l’association qui représente les fournisseurs des technologies d’aide à la conduire un protocole d’accord aux termes duquel les avertisseurs de radars n’annonceront plus la présence des radars fixes, mais tous les secteurs dangereux – dans lesquels se trouvent d’ailleurs systématiquement les radars fixes. J’ajoute que les fournisseurs de ces avertisseurs communautaires vont proposer des fonctionnalités nouvelles, comme celle destinée à lutter contre l’hypovigilance. La situation est donc désormais très apaisée avec la profession.
L’équité européenne est une question importante car, comme le savent les élus des départements frontaliers, nos voisins allemands, luxembourgeois, suisses ou encore néerlandais se livrent à des excès condamnables. À cet égard, une directive a été adoptée par le Conseil de l’Union, à la fin du mois de septembre, avec une limite de transposition fixée à deux ans. Ainsi, en 2013, tous les pays de l’Union devront coopérer pour que les infractions commises par un de leurs ressortissants dans un État voisin soient sanctionnées. Entre-temps, nous pouvons poursuivre la coopération bilatérale engagée avec certains États, ou l’organiser avec des pays qui ne sont pas actuellement coopérants, comme l’Espagne. Je précise néanmoins que la retenue du véhicule d’un étranger en infraction est d’ores et déjà possible.
Sur le sujet des petits excès de vitesse sur autoroute, je ne peux conclure aujourd’hui pour plusieurs raisons. La première tient à l’acceptabilité de la mesure : l’autoroute est en effet un axe sur lequel les dépassements sont assez faciles dès lors que le limiteur de vitesse n’est pas utilisé. La deuxième raison, en revanche, est que les décrets d’application de la LOPPSI, qui seront bientôt arrêtés, permettront des restitutions de points plus rapides qu’auparavant. Il ne faut donc pas trop charger la barque, la sécurité routière étant aussi une affaire de perception psychologique par nos concitoyens. Cela étant dit, la mesure proposée par votre Mission est de bon sens, mais, plutôt qu’une amende, peuvent être envisagés un système de sursis de retraits de points, ainsi que la mise en place sur les autoroutes de radars tronçons qui enregistrent la vitesse sur une plus grande distance. Ce sujet mérite discussion.
Le dernier point de mon intervention concerne l’éducation et la formation, la sécurité routière ne pouvant se limiter au seul contrôle et à la sanction des infractions.
En matière d’éducation à l’école, des progrès importants ont été réalisés. En effet, à l’école primaire, les élèves passent désormais le permis piéton : à ce jour, 2,5 millions de permis piétons ont été passés dans toute la France. Au collège, est menée une sensibilisation aux risques sur la voie publique, notamment pour les cyclistes. Au lycée, des actions de sensibilisation sont également conduites, en particulier pour l’utilisation du deux-roues motorisé, actions que le Gouvernement a décidé d’étendre à 50 % des lycées d’ici à la prochaine rentrée.
En outre, la réforme du permis de conduire se poursuivra dans le cadre de la troisième directive européenne sur le permis de conduire. La transposition de ce texte permettra d’établir une meilleure progressivité dans l’accès à la puissance des conducteurs de motos. Ainsi, l’accès aux plus grosses cylindrées sera repoussé à vingt-quatre ans.
Pour finir, je réponds à votre question sur le téléphone mobile, monsieur le président. L’utilisation manuelle du téléphone pendant la conduite est condamnable et doit être proscrite. En revanche, l’utilisation du Bluetooth, ou encore d’un système de commande vocale installé par les constructeurs et permettant de parler sans manipuler un appareil, ne me semble pas plus grave que parler à son voisin ou chanter dans sa voiture.
M. le président Armand Jung. Les kits mains libres ne seront donc plus autorisés, car qui dit oreillettes, dit manipulation.
M. Jérôme Lambert. Non, il existe des dispositifs de décrochage automatique.
M. le ministre. Cette question se situe à la frontière de la sécurité routière et de l’acceptabilité. Mais dès lors que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut éviter la manipulation manuelle, les techniciens définiront les technologies nécessaires.
M. le président Armand Jung. Monsieur le ministre, tout signe incitant à augmenter la vitesse sur les autoroutes et les voies rapides sans risque de sanction est un problème qui nous divise.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Il est rassurant de constater qu’il y a une grande identité de vues entre le Gouvernement et notre mission.
Le président l’a dit : il n’y a pas de seuil incompressible du nombre de tués sur nos routes. Néanmoins, le palier auquel nous sommes arrivés depuis 2006 – environ 4 000 morts par an – est plus difficile à faire baisser. Il faut donc non seulement maintenir les règles dont l’efficacité a été prouvée, mais aussi trouver d’autres pistes. Quelles sont les grandes idées en la matière ? Même si le nombre de contrôles d’alcoolémie aux points sensibles est important – 11 millions par an, ce dont je félicite les forces de l’ordre –, le conducteur lambda n’y est pas souvent soumis. Ces contrôles peuvent-ils être renforcés, sachant que l’alcoolémie est la première cause d’accident ?
S’agissant du contrôle automatisé, n’est-on pas arrivé à la limite de l’exercice, sachant que la moitié des infractions constatées ne sont pas sanctionnées ? En particulier, dans la mesure où les trois quarts des radars flashent les véhicules de dos, un certain nombre de clichés concernant les automobilistes sont inexploitables. Comment rééquilibrer les choses ?
Au regard du souci d’acceptabilité sociale, et afin de lutter plus durement contre les grands excès de vitesse et l’alcoolémie, n’y a-t-il pas lieu de tenir compte des comportements les moins graves ? Je pense aux petits excès de vitesse sur autoroutes et voies rapides qui pourraient entraîner, comme la mission le propose, une amende la première fois, puis la perte de points la deuxième fois. Vous évoquez un sursis. C’est une piste à laquelle il faut réfléchir.
Une autre piste évoquée par notre mission est l’octroi d’un bonus par les compagnies d’assurance aux bons conducteurs par le biais d’une réduction de la prime.
Par ailleurs, la mesure autorisant les vélos à rouler à contresens vous paraît-elle devoir être maintenue au regard de l’effet de surprise que cette pratique entraîne chez les automobilistes et les piétons ?
Enfin, quelles mesures devraient être prises pour rendre la route plus lisible, sachant qu’un grand nombre de tronçons présente des changements de vitesse inexpliqués ?
M. le ministre. Il est effectivement nécessaire de lutter plus sévèrement contre les grands excès – alcoolémie et grandes vitesses –, car ils sont manifestement délibérés. Rouler à 190 kilomètres à l’heure sur autoroute ou avec un taux de 0,8 gramme d’alcool par litre de sang n’est pas le fait du hasard !
L’idée du bonus accordé par les compagnies d’assurance est très intéressante. On pourrait même imaginer que ces dernières tiennent compte de la qualité de la conduite.
L’équipement systématique des véhicules d’un éthylotest me semble être une mesure de bon sens, car elle ne coûterait pas cher – un euro – et permettrait de responsabiliser les automobilistes.
Depuis que les cyclistes sont autorisés à rouler à contresens, très peu d’accidents ont été recensés – seulement huit en trois ans. Mais cette question mérite d’être évaluée.
Enfin, l’amélioration de la lisibilité de la route nécessite de confier aux commissions départementales de sécurité routière un travail de terrain. En effet, les changements de vitesse sur certains tronçons rendent difficile le respect des limitations de vitesse, même pour les conducteurs attentifs, mais aussi l’utilisation du limiteur de vitesse.
M. Christian Vanneste. Cette mission a atteint ses objectifs, ce dont il faut féliciter le président et le rapporteur. À l’origine de sa création, figurent un certain nombre d’annonces, justifiées par l’augmentation du nombre de morts, mais reçues par l’opinion comme une douche froide dans la mesure où, en plaçant la vitesse comme première raison de la sanction, elles ont donné l’impression à un grand nombre d’automobilistes que l’on passait au tout répressif.
Le travail entrepris a abouti à des solutions. En particulier, monsieur le ministre, la notion de radar pédagogique permet de passer du répressif au pédagogique. Ainsi, le texte sur lequel nous devrions déboucher devrait mettre l’accent sur l’accompagnement des conducteurs plutôt que sur la répression.
Pour assurer une meilleure visibilité de la route à l’intention des automobilistes, il faut supprimer toutes ces annonces de vitesses différentes que l’on peut voir sur certains tronçons du réseau routier. Mais il faut aussi assurer la lisibilité de la circulation en ville et, à cet égard, je tiens à dire que les cyclistes qui roulent sur les trottoirs mettent en danger les piétons, notamment les personnes âgées ! Ce faisant, ils font preuve d’une totale méconnaissance des règles de l’utilisation du deux-roues en ville ! Les gens doivent savoir ce qu’ils ont le droit de faire et de ne pas faire !
En outre, certaines mesures doivent viser à sécuriser les conducteurs, à les protéger, y compris contre eux-mêmes. À cet égard, il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur toutes les mesures très concrètes qui permettent aux usagers d’éviter l’accident ; je pense en particulier au système LAVIA – limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée – pour lequel vous avez montré beaucoup d’intérêt, monsieur le président.
Les utilisateurs de deux-roues doivent être visibles, mais également protégés en cas de choc. C’est pourquoi les tenues airbag devraient devenir obligatoires à terme.
Le problème de l’endormissement – cause de 30 % des morts sur autoroute – impose un gros effort de recherche et de publicité sur les équipements dans l’automobile ; il milite aussi pour la pose de bandes rugueuses bruyantes le long des différents réseaux.
Enfin, un contrôle médical de l’aptitude à la conduite, par exemple tous les cinq ans, me semble important. Si cette mesure est mal reçue par nos concitoyens, elle existe dans plusieurs pays, comme l’Espagne et les Pays-Bas, où elles ne concernent pas uniquement les personnes âgées.
M. Gérard Voisin. Même si le parc automobile français est bon état, il faut renforcer son contrôle car certains accidents mortels ou graves sont attribués à la fois à l’alcool et à des ruptures mécaniques.
Les directives européennes sont insuffisamment exploitées, notamment en ce qui concerne les STI, les systèmes de transport intelligents. En effet, l’adoption de normes via ces directives permettrait de renforcer la sécurité active ; je pense en particulier au système anti-endormissement.
Les dispositions prises avec divers pays de l’Union européenne ne régleront pas le problème des sanctions à l’encontre des étrangers qui ne respectent pas les limitations de vitesse en France. Sans interception après le contrôle radar, ces personnes rentrent chez elles.
« Le nouveau Coyote : plus de sécurité pour la communauté », peut-on lire sur le site de cet assistant d’aide à la conduite, qui a suscité beaucoup de polémiques. Je pense qu’une réflexion doit être menée sur cet engin.
Enfin, je ne suis pas d’accord avec Christian Vanneste : la réglementation permet aux cyclistes de circuler sur les trottoirs, à condition que ces derniers comportent une matérialisation de la mixité piétons-cyclistes.
M. Christian Vanneste. Je demande une clarification, et non une interdiction.
M. Jérôme Lambert. Je pratique la moto régulièrement – j’ai été à l’origine de la création de la Fédération française des motards en colère (FFMC) –, je suis cycliste à Paris, et automobiliste comme vous tous.
S’il est parfois nécessaire de prendre des mesures de rupture – comme l’ont été l’obligation du port de la ceinture de sécurité et l’instauration des limitations de vitesse – pour faire progresser la sécurité sur les routes, il convient aussi de pas revoir systématiquement toutes les mesures de la politique de sécurité routière à l’aune exclusive du nombre des morts dans les accidents de la circulation. Autrement dit, il ne faut pas se focaliser sur les mauvais chiffres car, nous l’avons constaté, ils évoluent.
La confiscation immédiate des véhicules des auteurs de délit est impossible à mettre en œuvre s’il s’agit de véhicules de société. Comment remédier à ce problème ?
Certes, les motards représentent 2 % du trafic et 24 % des tués, mais ce sont des hommes jeunes pour la plupart. Il convient donc de ne pas stigmatiser cette population, les chiffres pouvant être affinés.
La visibilité des motocyclistes peut, bien sûr, être améliorée – les casques comportent d’ores et déjà des dispositifs réfléchissants –, mais il ne faut pas se focaliser sur cet aspect. Récemment, un gendarme à moto, dont les feux étaient allumés, a été tué à un carrefour par un automobiliste lui ayant refusé la priorité à un stop. Quand bien même il aurait été habillé en jaune, cela n’aurait rien changé...
Tous les motards ne pratiquent pas la conduite en inter-file de la même façon. La conduite sur le périphérique à 120 km/h au lieu de 80 km/h, ou à 80 km/h entre tous les véhicules à l’arrêt, est extrêmement dangereuse et doit être sanctionnée. Elle n’a rien à voir avec les dépassements lents.
L’autorisation de conduire une grosse cylindrée à vingt-quatre ans est intéressante, mais rouler sur une 350 cm3 à 170 km/h est bien plus dangereux – compte tenu de la légèreté de l’engin – qu’avec une machine de 1 200 cm3.
La vitesse autorisée de 45 km/h pour les cyclomoteurs est-elle réellement adaptée à la circulation en zone urbaine, sachant qu’ils y sont continuellement dépassés, à leur droite et à leur gauche, par des voitures qui roulent à 50 km/h ? Il me semble moins dangereux de rouler à la même vitesse que le flot des véhicules.
Enfin, le préfet de Charente, Jacques Millon, délivre lui-même les permis de conduire à l’occasion d’une cérémonie solennelle qu’il organise une fois par mois et au cours de laquelle il tient un discours sur la sécurité routière. Que pensez-vous de cette initiative, monsieur le ministre ?
M. Alfred Trassy-Paillogues. D’abord, il faut lutter contre le débridage et le démontage des silencieux sur les deux-roues, ne serait-ce qu’au regard de l’effet anxiogène qu’ils provoquent.
Ensuite, un recensement systématique des points noirs me semble indispensable. Il peut être initié par les services de l’État et par les forces de l’ordre qui connaissent parfaitement le réseau.
Enfin, il est nécessaire de développer la production et la commercialisation des technologies nouvelles, en particulier les techniques d’assistance à la conduite, afin de les démocratiser. Je pense aux détecteurs d’obstacles et de signalisations horizontales, aux régulateurs et limiteurs de vitesse, et même aux « boîtes noires » dont sont équipées un grand nombre de flottes de poids lourds et de véhicules d’entreprises de livraison, pour lesquels les assurances acceptent une baisse de la prime.
Mme Françoise Hostalier. Je tiens à rendre hommage au président et au rapporteur pour la qualité du travail accompli par cette mission, dont le rapport traduit un vrai consensus.
Monsieur le ministre, j’ai apprécié le caractère apaisé de vos propos. Aujourd’hui, l’important est que l’arsenal visant à garantir la sécurité routière soit utilisé de manière efficace et avec discernement.
À cet égard, la pédagogie est un élément essentiel, et j’espère que le Délégué à la sécurité routière y sera attaché. En tant qu’inspecteur général de l’éducation nationale, j’ai travaillé à la mise en place du brevet de sécurité routière dans les collèges. Je pense qu’une telle formation devrait être mise en place dans les lycées, mais aussi être en accès libre sur Internet pour sensibiliser le grand public. La sécurité routière renvoie en effet à l’éducation, au respect, et doit amener chacun d’entre nous à se sentir responsable quand nous montons dans notre voiture.
Mme Marie-Line Reynaud. Il est très difficile de supprimer les points noirs sur les routes nationales. On nous répond souvent qu’il n’y a pas assez de morts ! Que faut-il prendre en compte : les accidents légers, les accidents avec blessés graves, avec morts ? Certes, la mise en œuvre du schéma national des infrastructures a permis de travailler beaucoup sur ce sujet, mais il me semble nécessaire de prendre des mesures rapides, sachant que beaucoup d’accidents sont dus, non pas aux conducteurs, mais au mauvais état des routes ou à des signalisations inadaptées.
Par ailleurs, les tests de dépistage du cannabis devraient être plus précis. En effet, des personnes peuvent être dépistées positives, alors qu’elles n’ont fumé du cannabis que trois semaines auparavant. Dans ces cas-là, la consommation de drogue n’est pas en cause dans l’accident.
M. Jacques Myard. Il y a quelques mois, j’avais le sentiment que la répression de la vitesse, grâce aux radars automatiques, avait atteint ses limites. Or, si notre pays a connu une hausse de 10 % des tués sur ses routes au premier trimestre, la RFA a enregistré une hausse de 13 %, la Finlande de 17 % et la Suède de 25 %. C’est bien la preuve que ce n’est pas l’assouplissement du permis à points qui a donné un mauvais signal ; il s’est passé quelque chose que nous ne savons pas encore analyser.
Notre mission a parfaitement démontré que les causes des accidents sont multiples : la vitesse tue, mais beaucoup plus lorsqu’elle est associée à la consommation d’alcool et de cannabis.
Les cyclistes font preuve d’une indiscipline croissante dont se plaignent très fréquemment les piétons. Comme Christian Vanneste, je suis persuadé de la nécessité de rappeler les règles.
Par ailleurs, quid de la position du Gouvernement sur le bridage des véhicules ?
Enfin, la sécurité routière étant une cause nationale, elle implique des campagnes nationales renouvelées. Quelle sera la prochaine campagne, monsieur le ministre ?
M. le président Armand Jung. La technologie LAVIA, que notre mission a expérimentée, est tout à fait maîtrisée et ne coûte pas très cher. Son installation pourrait constituer une peine complémentaire obligatoire, en cas de sanction liée à un délit concernant la vitesse. Quant à la boîte noire - technique également maîtrisée - elle indique la plupart des causes des accidents.
M. le ministre. La sécurité routière est en effet une grande cause nationale. Il est donc important qu’une mission de l’Assemblée nationale ait pu travailler sur cette question pendant plusieurs mois et faire des propositions. J’ai noté avec satisfaction que l’ambition partagée est de continuer à progresser, et ce dans un état d’esprit dépassionné et constructif. À cet égard, je retiens le terme utilisé par Mme Hostalier de nécessaire « discernement », la mission des forces de l’ordre étant de faire respecter la règle, et non de piéger les conducteurs. Ce terme figure d’ailleurs dans l’instruction que j’ai adressée aux forces de police et de gendarmerie pour leur demander de renforcer leur vigilance.
Les technologies nouvelles sont très intéressantes. Les progrès qu’elles ne vont pas manquer d’accomplir nous permettront d’améliorer encore la sécurité routière. N’oublions pas que nos véhicules sont devenus plus sûrs et que la mortalité a diminué parce que les véhicules encaissent mieux les chocs et disposent de dispositifs de freinage plus performants. Le système LAVIA est une assistance très intelligente à la conduite et permettra aux utilisateurs d’être sûrs de ne plus dépasser les limitations de vitesse, ce qui constitue un progrès considérable.
Les dispositifs de dépistage du cannabis doivent être améliorés. Sans doute pouvons-nous espérer des progrès en ce domaine, sachant qu’actuellement, seul un contrôle médical apporte la certitude scientifique.
S’agissant des équipements de sécurité des motocyclistes, des systèmes d’airbag auraient l’immense avantage de protéger les vertèbres cervicales. Néanmoins, ils sont chers – à peu près 500 euros – et ne sont pas totalement satisfaisants d’un point de vue technologique. Cela étant, j’ai bon espoir qu’une fois mis au point, ils seront diffusés, puisque la Fédération des motards en colère, qui assure la plupart des motocyclistes, accordera sans aucun doute les bonus nécessaires permettant leur acquisition.
Les avertisseurs communautaires, comme le « Coyote », présentent de nouvelles fonctionnalités, par exemple la lutte contre l’endormissement. Il s’agit là, également, d’une amélioration considérable.
L’état d’esprit du Gouvernement n’est absolument pas de stigmatiser les motards, d’autant qu’ils paient un plus lourd tribut que la moyenne des usagers aux accidents de la route, et ne sont pas responsables des sinistres dans la moitié des cas. Notre objectif est de sauver des vies, sachant que beaucoup de jeunes gens figurent parmi les victimes.
Comme je l’ai dit, la progressivité dans l’accès à la puissance pour les conducteurs de motos est prévue par une directive européenne. Nous devrons transposer cette disposition.
Si la coopération européenne est insuffisante dans le domaine des poursuites transfrontières, elle fonctionnera parfaitement après la transposition de la directive les concernant. Pour en avoir fait l’expérience personnelle, je puis vous dire que la coopération entre la France et l’Italie, s’agissant des contraventions de stationnement, est une réalité !
Il faut bien sûr mettre un terme au débridage des deux-roues. C’est un problème de sécurité routière, mais aussi de tranquillité publique, le bruit engendré par ces engins, a fortiori la nuit, étant insupportable.
L’impossibilité de procéder à une confiscation immédiate des véhicules de société est une injustice. Je vais demander l’étude de ce point précis.
Pour le traitement des points noirs, les commissions départementales de sécurité routière font des suggestions pertinentes, et des lignes budgétaires spécifiques sont prévues à cet effet, au moins pour les voiries nationales. Quant à l’information sur les points noirs, nous procédons actuellement, sous l’égide du Délégué à la sécurité routière, à leur recensement systématique sur l’ensemble du territoire, afin qu’ils puissent être signalés aux utilisateurs d’avertisseurs communautaires, ces derniers présentant, comme je l’ai dit, de nouvelles modalités de fonctionnement.
Le bridage des véhicules serait raisonnable, mais ne peut relever que d’une décision européenne. En effet, le bridage de nos véhicules à 130 km/h entraînerait une baisse de leurs ventes en Allemagne !
Les campagnes de sensibilisation sont très importantes, car elles ont un impact réel sur nos concitoyens si elles sont de bonne qualité. Le film « Insoutenable », déjà diffusé sur Internet et qui a eu un retentissement fort sur les jeunes, sera diffusé, dans une version plus courte, sur toutes les chaînes de télévision, avant les vacances de la Toussaint.
Toujours en matière de communication, nous devrons porter notre effort sur les réseaux sociaux, comme Twitter, les publics fragiles que sont les jeunes étant très consommateurs d’informations par ce biais.
L’initiative du préfet de Charente est intéressante, mais ne me semble pas devoir être généralisée. En effet, 740 000 nouveaux permis de conduire sont délivrés chaque année en France. Par ailleurs, nous nous sommes fixés comme objectif de délivrer les nouveaux permis beaucoup plus rapidement.
Pour finir, une campagne de sensibilisation contre l’alcool sera lancée en décembre.
M. le président Armand Jung. Dans le cadre de nos débats, une personne a proposé l’instauration d’une opération qui pourrait s’intituler « week-end de la Toussaint – zéro mort », ce week-end étant le plus meurtrier, au cours de l’année, sur nos routes. Nous a également été suggérée la mise en œuvre d’un système inspiré du dispositif « Alerte enlèvement », avec le déclenchement d’une alerte en cas de dépassement d’un niveau moyen d’accidents, niveau moyen fixé grâce à un calcul sur l’année ou par week-end.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Ce sont les hommes qui, pour les trois quarts, causent les accidents. Je pense qu’une communication devrait être prévue en la matière.
M. le président Armand Jung. Notre mission rendra ses conclusions mercredi prochain. Si des réformes peuvent être conduites en intervenant dans le domaine réglementaire, une grande partie des mesures revient à la loi. Nous pouvons nous mettre d’accord pour déterminer ce qui dépend de tel ou tel ministère et du Parlement. Nous souhaitons réellement que notre rapport soit suivi d’effets.
M. le ministre. Comme vous, le Gouvernement souhaite voir reculer l’accidentalité et la mortalité sur nos routes. Nous sommes parvenus à un corps de doctrine assez commun sur ce qu’il convient de faire. Des mesures pourront être mises en route rapidement. Pour la partie parlementaire, les créneaux sont désormais limités, à moins d’une vraie unanimité, auquel cas les choses pourraient aller très vite.
M. le président Armand Jung. Quoi qu’il en soit, nos travaux s’inscrivent dans la durée.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie beaucoup pour la qualité, la franchise et la transparence de nos débats. J’espère que notre rapport contribuera à faire diminuer le nombre des personnes tuées sur les routes.
*
* *
Déplacement à Strasbourg le 28 juillet 2011
Compte rendu de la réunion de 11 heures avec les services de police, des CRS et de la gendarmerie
l La mission d’information a entendu, à l’Hôtel de police, les représentants de la Sécurité publique (assurant la police dans la zone urbaine de Strasbourg), de la gendarmerie (assurant la police dans la zone péri-urbaine) et des CRS (assurant la police sur les autoroutes).
l M. Armand Jung, président, M. Philippe Houillon, rapporteur, et M. Rudy Salles leur ont posé des questions sur la confection des statistiques de police dans le domaine des accidents de la circulation et sur les remarques et les enseignements qu’ils pouvaient déduire de cette activité en matière de sécurité routière.
l Les services de police ont apporté, en réponse, les précisions suivantes :
– la police urbaine réalise trois grands types de tableaux statistiques, les tableaux ATBH (tableaux recensant les Accidents où figurent les Tués, les Blessés ou les personnes Hospitalisées) qui sont fabriqués tous les jours ; les tableaux en données consolidées, qui sont réalisés tous les 30 jours ; et les tableaux BAAC (Bulletins d’Analyse des Accidents Corporels de la Circulation) qui sont réalisés tous les 15 jours, passé un délai de 45 jours (ces 45 jours permettant d’inclure les 30 jours nécessaires pour la fabrication des tableaux de données consolidées).
– Toutes ces données concernent les zones urbaines ; elles ne visent pas les accidents matériels mais exclusivement les accidents corporels (sauf si les accidentés se bornent à établir un constat amiable). Il est entendu que les services de gendarmerie réalisent, à leur niveau, les mêmes types de tableaux statistiques pour les zones péri-urbaines et les CRS pour les zones autoroutières. À noter cependant que, pour les ATBH, les CRS et la gendarmerie procèdent à une transmission hebdomadaire et non à une transmission journalière comme la police urbaine.
– S’agissant des causes d’accidents, la synthèse journalière prévoit quelques catégories très simples : défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite sous l’emprise de stupéfiants, refus de priorité… En fait, c’est une synthèse des procès-verbaux de constatation. Il peut manquer encore beaucoup d’éléments (notamment en cas de décès) qui n’apparaîtront qu’à l’issue de l’enquête judiciaire.
– Les synthèses à 30 jours (ou à 45 jours), intervenant après transmission du résultat des enquêtes, sont plus approfondies en matière de causes des accidents de la circulation. On y voit le nombre de blessés et de tués pour un mois donné et la comparaison avec le même mois de l’année précédente ; le résultat des contrôles routiers tant automatisés qu’effectués par les forces de l’ordre (nombre d’infractions à la vitesse, nombre de dépistages positifs à l’alcoolémie, verbalisation pour non-respect de la signalisation routière, pour usage du téléphone portable, etc.) et également le résultat des enquêtes routières. On peut donc établir des corrélations entre les morts et les blessés et les résultats des investigations des forces de l’ordre (par exemple en matière de stupéfiants).
– Mais ce sont les fiches BAAC qui sont les plus complètes. Elles sont dressées au moyen du logiciel PROCÉA (pour la police et les CRS) et du logiciel BAAC (pour la gendarmerie). À noter que les fiches sont remplies par ceux qui ont fait l’enquête judiciaire (la brigade des accidents de la police ou le service équivalent pour les CRS) et non pas par ceux qui ont fait les premières constatations sous contrôle du Parquet (les rédacteurs des procès-verbaux « de transport, des constatations et des mesures prises »). Seuls les gendarmes ont la faculté de se livrer aux premières constatations puis de réaliser l’enquête judiciaire. En règle générale, les gendarmes qui ont constaté les accidents sont donc aussi ceux qui saisissent les fiches BAAC.
– Les fiches BAAC sont très descriptives (on détaille le jour de l’accident, l’heure, le type de voie, l’âge des victimes, etc.) ; on peut également distinguer jusqu’à 3 types de causes pour un même accident, une principale et deux secondaires (par exemple le refus de priorité et l’alcool ; ou encore la mauvaise maîtrise du véhicule combinée à l’absorption d’alcool et de stupéfiants …).
– En pratique, ce sont les fiches BAAC qui sont les plus utilisées pour la tenue des statistiques officielles de la sécurité routière.
– À noter néanmoins que la cause éventuelle d’un accident liée à l’usage d’un téléphone portable ou d’un kit mains libres n’est pas bien renseignée dans les fiches BAAC. Même remarque pour le mauvais état de la voirie. (Plutôt que de parler de la voirie, la fiche a tendance à mentionner une inadaptation de la vitesse par rapport aux circonstances).
– Une fois les statistiques réalisées, la police urbaine les transmet à la direction départementale des services de police (DDSP) qui, elle-même, les transmet au préfet et à la direction centrale des services relevant du ministère de l’intérieur, à Paris. Les CRS transmettent leurs statistiques à l’état-major des CRS à Metz. Metz renvoie les chiffres à la préfecture et les envoie également à la direction centrale des CRS à Paris, direction qui dépend du ministère de l’intérieur.
La gendarmerie adresse également ses chiffres à la préfecture et au ministère de l’intérieur.
– La préfecture ne retravaille pas fondamentalement les données. Mais elle exerce une centralisation des chiffres et elle établit des synthèses, toutes unités de police confondues. Les synthèses sont réalisées par la direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT). Il y a des synthèses « rapides » ; des synthèses mensuelles et des synthèses à 6 mois plus complètes. Elles sont établies sous l’autorité d’un sous-préfet qui, au cabinet du préfet, est spécialement chargé de la sécurité routière. Elles servent de supports aux actions de communication conduites par la préfecture dans le domaine de la prévention routière.
– La police, en zone urbaine, n’impute pas fondamentalement l’accidentologie à telle ou telle zone qui serait plus particulièrement accidentogène. Elle reconnaît, en revanche, qu’en ville, les causes des accidents sont souvent complexes. Il est vrai qu’au niveau des premières constatations, on tend à simplifier les choses et à incriminer souvent a priori telle ou telle grande cause (notamment la vitesse). Néanmoins, après l’enquête judiciaire, les différentes causes apparaissent de manière plus distincte et il est parfois possible de faire des propositions à la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), par exemple pour améliorer la lisibilité de la route. On peut ainsi mentionner la modification des limitations de vitesse demandée récemment rue des Trois Maires).
– La gendarmerie et les CRS, en zones péri-urbaines, relèvent souvent la présence de l’alcool comme cause importante de l’accidentologie. La gendarmerie tend à constater, plus que la police, des zones plus particulièrement accidentogènes (par exemple, certaines portions de départementales). Elle aussi fait des propositions aux pouvoirs publics pour améliorer la lisibilité de la route (par exemple, recul des arbres sur certains axes routiers).
– Les CRS, responsables du suivi des autoroutes, n’imputent pas nécessairement les accidents mortels sur ces types de voies à un défaut global d’attention, et notamment à une distraction liée à l’emploi du téléphone portable. Les accidents mortels sur autoroutes sont très peu nombreux dans la région Alsace. Ils donnent lieu à des enquêtes extrêmement approfondies où, en particulier, il est possible de vérifier, avec les opérateurs de téléphonie mobile, si la victime téléphonait ou non au moment de l’accident. Le résultat des enquêtes ne permet pas d’aboutir à des conclusions définitives sur le rôle joué par le téléphone mobile ou le kit mains libres dans les accidents mortels sur autoroutes.
– La police rappelle enfin les phénomènes de culture locale dans les modes de conduite. Les habitants des différentes régions peuvent avoir des habitudes dans leur façon de conduire dont il faut parfois se souvenir avant de verbaliser (par exemple, en région parisienne, les automobilistes s’arrêtent pile devant les feux de signalisation ou les passages protégés pour les piétons et ne respectent pas d’intervalles). De telles spécificités sont néanmoins rares en Alsace et les conducteurs sont assez disciplinés.
l M. Rudy Salles rappelle que dans sa région, les Alpes-Maritimes, deux phénomènes sont à déplorer qui sont très certainement accidentogènes. D’une part, la conduite extrêmement rapide des conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger, qui ne semblent craindre ni les amendes du contrôle sanction automatisé (CSA), ni le retrait du permis de conduire ; et, d’autre part, l’absence d’éclairage sur les bretelles d’entrée et de sortie des autoroutes qui est, très clairement, une cause possible de circulation à contre-voie.
*
* *
Compte rendu de la réunion de 14 h 30 avec les services intéressés par les problèmes des infrastructures (conseil général, communauté urbaine de Strasbourg, ville de Strasbourg, direction départementale des territoires du Bas-Rhin, pôle « maîtrise d’ouvrage pour les investissements routiers » : DREAL, service des réseaux autoroutiers du Bas-Rhin : DIREST)
l La mission d’information a entendu, à la préfecture (Hôtel du préfet-Petit Broglie), les représentants du conseil général, de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), de la ville de Strasbourg (service de l’entretien des voies et cellule « sécurité, aménagement et équipement »), de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT), du pôle « maîtrise d’ouvrage pour les investissements routiers » (DREAL) et du service des réseaux autoroutiers du Bas-Rhin (DIREST).
À noter que les trois derniers services sont des services de la préfecture et que la DIREST gère les autoroutes non concédées.
l M. Armand Jung, président, M. Philippe Houillon, rapporteur, et M. Rudy Salles leur ont posé des questions sur la politique conduite en matière d’infrastructures, sur les différents partenariats existants et sur la réduction des zones accidentogènes, tant dans la ville de Strasbourg que dans le département du Bas-Rhin.
l En réponse, les différents intervenants ont apporté les éléments d’information suivants :
– Il existe, à Strasbourg, une très bonne collaboration entre les services de police et les organes relevant des différentes collectivités (département, ville, communauté urbaine, sachant que les services de la ville et de la communauté urbaine ne font qu’une seule administration). Cette collaboration se traduit par le fait que tous les services concernés par les infrastructures reçoivent effectivement, de la part des services de police, les fiches BAAC. De même, les élus spécialisés, au sein de leurs collectivités, dans les problèmes de sécurité routière reçoivent également les fiches BAAC. Ils sont ainsi très bien informés sur la nature et la localisation géographique des accidents de la circulation. Ils n’attendent plus la presse, comme autrefois, pour en avoir connaissance.
– Le conseil général – qui, historiquement, a toujours été très concerné par les infrastructures routières – a mis au point cinq grands types de politique en matière de prévention routière : une politique de formation et de prévention tournée vers les plus jeunes ; une politique visant à améliorer les itinéraires et la lisibilité de la route ; une politique visant à éradiquer les zones accidentogènes ; une politique visant à favoriser le vélo en ville ; et, enfin, une politique visant à promouvoir le concept de « vitesse dynamique » sur autoroute (dans le cadre d’une réduction générale des vitesses autorisées).
On doit noter que ces différents volets portent actuellement leurs fruits puisque, depuis quelques années, les accidents ont baissé de 48 % (dont 10 % en rase campagne, zone toujours très accidentogène). Le nombre d’accidents constatés est aujourd’hui le plus bas depuis 1995. Par ailleurs, on enregistre moins de 1 000 morts par an sur les routes dans le département du Bas-Rhin.
– S’agissant du secteur prévention et formation, secteur tourné vers les plus jeunes, le conseil général exerce un suivi portant sur environ 20 000 enfants, qui, de la maternelle au CM2, passent l’examen APER, puis, au collège, les brevets SSR1 et SSR2. Le conseil général accorde une grande importance à la formation des jeunes, les jeunes ayant vocation à être les conducteurs de demain.
– En ce qui concerne l’amélioration des itinéraires, il s’agit d’une œuvre de longue haleine car le département du Bas-Rhin compte quelque 3 700 km de routes départementales. L’idée, en ce domaine, est déjà d’améliorer systématiquement les carrefours. Ensuite, on tente de favoriser des logiques d’itinéraires, c’est-à-dire que l’on incite les conducteurs, en fonction de la densité du trafic, à abandonner certaines habitudes et certains tronçons peu adaptés et à les remplacer par d’autres trajets plus aux normes. On doit noter, cependant, que les changements d’habitude sont très lents. Les modifications d’itinéraires peuvent prendre parfois 10 ans. Elles permettent néanmoins de diminuer l’accidentologie avec très peu de crédits.
– Dans le Bas-Rhin, on doit relever en effet qu’il existe des itinéraires qui, du fait de la présence d’un certain nombre d’arbres, sont susceptibles de générer des accidents. Ces arbres sont des arbres fruitiers qui étaient autrefois soumis à adjudication par les pouvoirs publics ; et surtout des platanes que la Seita avait incité à planter au bord des voies, dans le but de fabriquer des allumettes. Aujourd’hui, tous ces arbres sont en fin de vie. Ils posent des problèmes pour la circulation et il faudrait les supprimer. Cela ne peut se faire, cependant, que de manière très lente, pour ne pas froisser les sensibilités écologiques. En attendant, dans les zones les plus sinueuses et les plus délicates, on tâche de modifier les itinéraires. Dans cette activité, le conseil général est aidé par les élus municipaux qui, dans chaque canton, peuvent faire remonter des informations locales qui sont d’un grand intérêt.
– Le conseil général s’efforce également d’éradiquer les sites accidentogènes. Pour cela, on se sert des fiches BAAC. On établit des cartes, qui couvrent tout le département, et, en remontant jusqu’à 10 ans en arrière avec ces fiches, en accumulant des points noirs sur certains tronçons, qui correspondent à des accidents, on finit par prendre conscience qu’il peut y avoir des difficultés particulières sur telle ou telle partie du réseau routier. On essaie alors d’améliorer les choses en modifiant l’infrastructure, en améliorant la signalisation et aussi en installant des radars fixes. Dans certains cas en effet (par exemple les tournants) l’installation d’un radar peut compenser un défaut d’infrastructure. En pratique, les solutions concrètes en vue de parvenir à diminuer l’accidentologie liée à une zone à risque sont formalisées, le plus souvent, au cours de la réunion annuelle de la commission chargée également de mettre en place les nouveaux radars au niveau du département.
– La DREAL insiste néanmoins sur le fait que le département est, aujourd’hui, en quelque sorte, victime de son succès. Il y a quelques années, les zones accidentogènes c’était au moins 10 accidents (voire plus) sur un même tronçon, avec un très bref recul dans le temps. Actuellement, compte tenu des statistiques, on peut dire que les « zones noires » en tant que telles ont été traitées. On est passé aux « zones grises », avec une faible accumulation d’accidents, et sur plus de 10 ans. En fait, il n’y a plus assez d’accidents pour que l’on puisse parler vraiment de zones accidentogènes. Et si l’on utilise des statistiques à plus de 10 ans, elles peuvent faire référence à des situations dépassées à cause de l’implantation, entre-temps, des radars. Le département finit ainsi par avoir du mal à faire mieux en matière de diminution des zones à risques. En effet, moins il y a d’accidents et plus il est difficile d’exploiter l’accidentologie pour arriver à une situation plus favorable.
l M. Houillon, rapporteur, a demandé si, dans le cadre de ces différents programmes, il existait, au sein de structures dédiées, des procédures de validation des décisions avec les services décentralisés ou déconcentrés de l’État. Est-ce que l’inventaire et le diagnostic des actions à conduire sont réalisés de manière commune (comme, par exemple, dans les groupements locaux de prévention de la délinquance) et est-ce que les tâches sont réparties, à la suite de décisions communes, par niveaux de responsabilité ; ou est-ce que les partenariats relèvent plutôt des synergies et des bonnes volontés locales ? Cette question est particulièrement importante, d’une part, du point de vue de l’émergence d’une logique départementale de sécurité routière, et, d’autre part, pour la cohérence des politiques suivies au niveau national, chaque structure dédiée départementale pouvant être coordonnée, par exemple par la délégation ou le délégué interministériel à la sécurité routière.
l Les différents intervenants ont répondu qu’actuellement, la coordination relevait plutôt d’une logique d’acteurs que de structures dédiées. Il y a des réunions, trois fois par an, de comités ad hoc consacrés à la sécurité routière ; il y a des réunions de la commission consultative des usagers de la route ; il y a, enfin, la réunion annuelle de la commission de concertation qui décide, notamment, de l’implantation et de l’emplacement des radars. Toutes ces commissions sont plutôt des lieux d’information et de débats, plus que des lieux de décision. Néanmoins, on peut aboutir, dans leurs enceintes, à des opérations concertées. De toute façon, il est vrai que, d’une certaine manière, la coordination s’exerce par elle-même, dans la mesure où le conseil général est l’organe délibérant principalement responsable et où la politique départementale ne peut ignorer les orientations définies au niveau de l’État.
l M. Houillon a avancé l’idée qu’il pourrait être souhaitable, indépendamment des bonnes relations d’acteurs qui existent dans le département, de disposer d’une structure d’échanges et de décision unique. Cela améliorerait la compréhension et la lisibilité de la politique départementale de sécurité routière et cela permettrait de renforcer, au niveau national, la cohérence des actions conduites, notamment sous l’égide du délégué interministériel à la sécurité routière.
l Les intervenants ont reconnu qu’il n’y avait pas de correspondants de la délégation à la sécurité routière dans les différentes réunions ou les différents partenariats locaux.
l S’agissant de la politique consacrée au développement des vélos, les représentants des différents services ont apporté les précisions suivantes :
– Actuellement l’usage des vélos se développe dans le cadre des parties de la ville de Strasbourg placées en zone 30.
– Dans les rues placées en zone 30, les vélos peuvent même rouler à contre-sens.
– En revanche, dans les autres parties de la ville, cette facilité n’existe pas.
– Par ailleurs, on note que les vélos jouissent d’une certaine tolérance pour emprunter les trottoirs et que la ville a autorisé le « tourner à droite » cycliste (sans marquer de temps d’arrêt au feu rouge).
– Il n’a pas été constaté de difficultés particulières, dans ces pratiques, avec les piétons ou avec les automobilistes. En revanche, on note des difficultés pour bien intégrer, dans la circulation, le « tourner à gauche » cycliste. Dans le « tourner à gauche », le cycliste reste insuffisamment vu par les automobilistes et, même, sa vision personnelle du trafic est trop limitée. La CUS voudrait remédier à ce problème en créant des sas à vélos directement placés au bout d’un marquage au sol correspondant à une file de voitures (et non pas au bout d’une file dédiée aux vélos avant les sas, ce qui pose des problèmes multiples).
– La CUS souligne également qu’indépendamment des sas à vélos, elle réfléchit, pour l’aménagement de la zone péri-urbaine, à améliorer l’implantation des radars et à modifier, sur certaines portions des routes départementales, le marquage au sol, lorsqu’il s’agit de lignes jaunes discontinues. Pour le premier point, on doit noter qu’actuellement, il est difficile de placer des radars automatiques à plus de 1 500 mètres d’une maison (à cause du câblage EDF). Cette contrainte ne permet pas l’optimisation dans l’installation des radars fixes. La CUS voudrait mettre fin à cette contrainte, en recourant par exemple à des fibres optiques. S’agissant des lignes discontinues, celles-ci paraissent trop incitatives aux dépassements, quelles que soient les circonstances. La CUS est, aujourd’hui, plutôt favorable à un marquage au sol favorisant systématiquement la ligne continue, quitte à autoriser certaines latitudes dans les dépassements en cas de nécessité (par exemple véhicules lents).
– Enfin, la question des autoroutes a été abordée. La DIREST a indiqué qu’elle procédait à de nombreuses enquêtes sur les réseaux (en recourant à des ingénieurs étrangers à la ville de Strasbourg afin de bénéficier d’un œil neuf) et également à des enquêtes systématiques en cas d’accidents mortels (les services de la DIREST sont dans les mêmes locaux que ceux des CRS de Strasbourg, ce qui facilite les échanges). Actuellement la DIREST concentre son action sur l’amélioration de la signalisation des fortes pentes et également sur une meilleure signalisation des bretelles d’entrée et de sortie des autoroutes, afin d’éviter les voitures qui les empruntent à contre-sens. À noter que les entrées à contre-sens sur les autoroutes sont souvent liées à des conduites sous l’emprise d’un fort taux d’alcoolémie.
l M. Jung a posé une question sur la vitesse qui serait la plus adaptée sur autoroute.
l La DIREST a répondu qu’elle était à la recherche, en quelque sorte, d’une gestion « dynamique » des vitesses sur ce type de voies :
– Il y a, comme partout, des tronçons à 130 (par exemple, en direction de Sélestat) ;
– Il y a des tronçons à 110 (en direction de Lauterbourg et aussi entre Colmar et Sélestat où la chaussée n’est pas excellente) ;
– Il y a enfin des tronçons à 90 (autour de Strasbourg où l’autoroute est en fait une sorte de périphérique) ;
– La DIREST voudrait, par ailleurs, faire passer à 90 l’axe Sélestat-Saint-Dié, y compris pour les bus qui empruntent beaucoup ce trajet.
– Au fond, l’idée, dans le département du Bas-Rhin, est plutôt de faire baisser la vitesse sur les autoroutes non concédées, en modulant par tronçons pour garantir à l’usager la fluidité du trafic.
– De ce point de vue, il y a deux théories : soit on procède globalement au niveau de la région Alsace et on abaisse uniformément toutes les vitesses de 10 km/h en faisant un mini-code de la route pour le réseau autoroutier (qui serait, en gros, limité à 90 au lieu de 80 km/h actuellement). Cette solution est aisée pour les pouvoirs publics et implique une forte visibilité pour les usagers. Soit on procède par tronçon pour maintenir absolument la fluidité du trafic. C’est cette seconde solution qui a été choisie. Elle est non moins claire pour l’usager, à condition d’être bien explicitée.
– L’idéal, de ce point de vue, serait une vitesse évolutive en permanence, en fonction de l’évolution du trafic. Une expérience est conduite en ce sens à Porcheville, en s’appuyant sur des panneaux à diodes.
l M. Rudy Salles s’est montré réservé sur cette dernière idée. Une réglementation qui change trop souvent est une incitation aux abus et un facteur d’incompréhension pour les automobilistes. Il a souligné que, dans les Alpes-Maritimes, la réglementation sur autoroute était uniformément limitée à 110, sauf le contournement de la ville de Nice qui est limité à 90.
*
* *
Compte rendu de la réunion de 16 heures avec avec les associations des usagers de la route ou d’aide aux victimes des accidents de la circulation
l La mission d’information a entendu, à la préfecture (Hôtel du préfet-Petit Broglie), les représentants de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), de l’Association d’Aide aux Victimes de la Route (AIVAR), de l’Automobile Club, de la Prévention Routière et du Collège français de médecine du trafic. Participait également à la réunion la direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT).
l M. Armand Jung, président, M. Philippe Houillon, rapporteur, et M. Rudy Salles leur ont posé des questions sur la façon dont ils avaient accueilli les mesures préconisées par le comité interministériel de sécurité routière, le 11 mai dernier, et sur leurs souhaits ou leurs propositions en matière de prévention routière.
l En réponse, MM. Ienan et Besenval, pour la FFMC, Mme Muhlmann-Weil, pour le Collège français de médecine du trafic, Mme Fritz, pour l’AIVAR, M. Bollecker, pour l’Automobile Club, M. Rich, pour la Prévention Routière, et Mme Pataud ainsi que M. Daniel, pour la DDT du Bas-Rhin, ont apporté les précisions suivantes :
– La FFMC a souligné que le CISR du 11 mai dernier avait été suivi, du côté des motards, par d’importantes manifestations qui s’étaient déroulées le 18 juin dans toute la France. Les manifestations ont prouvé le mécontentement des deux-roues motorisés face à des mesures qui leur paraissaient à la fois inadaptées et par trop répressives. Parmi les différentes propositions du CISR, deux dispositions ont particulièrement cristallisé le mécontentement des motocyclistes. Il s’agit du port du gilet orange (qui n’est pas très utile dans la mesure où tous les blousons de moto disposent déjà de bandes réfléchissantes) et de l’augmentation de la taille de la plaque d’immatriculation à l’arrière (qui n’a aucun lien avec la sécurité mais témoigne d’une politique répressive – une plus grande plaque facilitant les contrôles radars – alors que l’Allemagne, par exemple, vient de décider de diminuer la taille des plaques d’immatriculation de 7 cm).
– La FFMC est hostile à la stigmatisation des motocyclistes au motif qu’ils participeraient grandement aux effectifs concernés par les statistiques, actuellement en hausse, des victimes de la route (tués ou blessés). Elle souligne que, depuis quelques années, le trafic des deux-roues motorisés a crû de 65 %. Si les accidents augmentent dans cette catégorie, ce qui est vrai, ils doivent être mis en relation avec la hausse de l’utilisation des deux-roues.
l M. Jung a posé une question sur l’utilisation éventuelle par les motards du blouson équipé d’un air-bag.
– La FFMC a répondu que l’essentiel, dans le domaine de la protection en cas de chute, était de bien apprendre à se coucher et à tomber lors d’un dérapage. On déplore, à l’heure actuelle, que beaucoup de motards ne soient pas équipés de l’habillement minimum (blouson, bottes, gants). L’achat du blouson à air-bag (qui peut s’élever à une somme variant entre 500 et 800 €) ne concernera qu’une toute petite minorité de motards : ceux qui ont les moyens financiers pour le faire et qui sont déjà sensibilisés à la sécurité. En revanche, cet achat ne pourra pas avoir une incidence forte sur l’accidentologie. Bien plutôt vaudrait-il mieux agir sur la formation.
– De ce point de vue, la FFMC demande qu’une heure par semaine soit consacrée à l’enseignement de l’éducation routière au collège. De la sorte, lorsque le jeune se présentera à l’examen du permis, il aura déjà pas loin de 700 heures d’enseignement derrière lui. En outre, il aura tous les bons réflexes. Sinon, la FFMC estime que l’enseignement de la conduite, et spécialement de la conduite des deux-roues motorisés, intervient trop tard en France. Les jeunes qui débutent leur apprentissage à 25 ans n’ont plus le temps de se former de manière approfondie. Ils survolent les domaines et ne peuvent pas avoir une conduite totalement maîtrisée.
– S’agissant des différentes commissions concernant la sécurité routière et animées par le département, la FFMC a reconnu y être associée et avoir la possibilité d’y présenter ses analyses. Malheureusement, elle a estimé qu’elle était insuffisamment entendue dans ces enceintes.
– En ce qui concerne la possibilité d’instaurer, pour les automobilistes, et spécialement les automobilistes âgés, un bilan de santé permettant, selon une périodicité régulière, de vérifier le maintien de leur aptitude à la conduite, la FFMC a estimé que l’idée gagnerait certainement à être creusée, par analogie avec le dispositif existant pour les conducteurs de poids lourds qui sont contraints à une visite médicale de contrôle tous les 5 ans.
– La FFMC a enfin signalé qu’elle ne cautionnait pas ceux, parmi les titulaires du permis A, qui roulaient à une vitesse trop élevée. Néanmoins, elle était d’avis que ces comportements devaient être réprimés par des contrôles policiers adaptés et non par des mesures générales pénalisant tous les motards. Elle a déploré que, dans l’ensemble, les mesures préconisées en matière de sécurité routière soient toujours des mesures onéreuses et répercutées sur les usagers (blousons à air-bag, aides à la conduite pour les automobiles, renouvellement des permis, etc.). Elle a souligné qu’à terme, cette politique allait finir par poser un vrai problème d’accessibilité financière aux conducteurs.
– L’AIVAR indique que, selon elle, les décisions du CISR ont été mal accueillies parce qu’elles avaient un peu pris les citoyens à froid et par surprise. Il faudrait essayer de créer une sorte de cohérence dans les discours officiels, accompagnée d’actions de communication basées sur une perception claire des risques encourus par chacun lorsqu’il se déplace. On pourrait ainsi bien comprendre les buts poursuivis par les pouvoirs publics.
– De ce point de vue, on doit remarquer que beaucoup d’actions de communication conduites par la délégation interministérielle à la sécurité routière n’étaient pas bien ciblées, ni très efficaces.
– La formation et l’éducation dans le milieu scolaire sont très importantes. Il est très probable que les formations ASSR1 et ASSR2 ont une durée insuffisante.
– D’autres types de cours pourraient d’ailleurs venir renforcer les cours spécialement consacrés à la prévention routière. Par exemple, les cours de physique. Dans le cadre de ces cours, on pourrait très clairement exposer aux élèves qu’un choc de face, à 65 km/h, avec un obstacle fixe, a toutes les chances possibles d’être mortel. Même remarque avec un choc latéral à 35 km/h.
– En fait, la formation est essentielle car l’éducation réintroduit de l’humain dans les comportements. Or, on observe que cette dimension humaine fait souvent défaut, paradoxalement, dans le domaine de la sécurité routière.
– Des actions sont encore à conduire, du point de vue de la sociologie, pour modifier les images qui sont associées à la conduite et à la possession de certains types de véhicules. C’est là une démarche préalable au bridage des moteurs, quelle que soit la cyclindrée.
– L’AIVAR est favorable à l’augmentation générale du nombre des radars fixes sur route, qu’ils soient signalés ou non.
– Elle est favorable à une étude et éventuellement à une réglementation spécifique pour mieux circonscrire la circulation des tracteurs sur route, notamment dans la zone péri-urbaine de Strasbourg.
– En ce qui concerne les différentes commissions de sécurité routière animées par la préfecture, l’AIVAR déplore l’absence de cohérence, de pouvoir décisionnel et de suivi qui les caractérise la plupart du temps. Les politiques suivies procèdent souvent par à-coups ; les associations sont à la recherche d’interlocuteurs et souvent de décideurs pour telle ou telle action. La structure qui paraît la plus pertinente est celle qui élabore le PDASR (plan départemental d’action en matière de sécurité routière).
l Mme Muhlmann-Weil déclare, au nom du Collège français de médecine du trafic, que l’éducation routière n’est pas sans lien avec l’éducation à la citoyenneté. L’incivilité généralement répandue dans notre pays, notamment au niveau de certaines franges de la population, peut avoir une incidence sur la délinquance routière. Il faut multiplier les actions de prévention et de formation, dès le plus jeune âge, à l’école, dans les familles, dans les associations familiales, et même dans les maternités. (Les femmes sont de très bons vecteurs pour enseigner les comportements pertinents sur la route car, dans les statistiques qui concernent les pertes de permis, ¼ seulement des chiffres visent les femmes, contre ¾ les hommes).
l Mme Muhlmann-Weil indique, d’autre part, qu’il faudrait améliorer le dépistage et le traitement des conduites à risque. La perte de points à répétition, la multiplication des excès de vitesse témoignent, au fond, chez un individu coutumier de ces faits, d’une accoutumance à la prise de risque, au passage à l’acte, qui pourrait relever, en définitive, de la pathologie, et donc de la médecine.
– Elle relève qu’il n’est pas forcément nécessaire, ni souhaitable, du point de vue du Collège français de médecine du trafic, de supprimer les panneaux indiquant la présence d’un radar fixe. Des réflexions intéressantes dans ce domaine figurent dans le livre de M. Fabrice Hamelin : Les radars et nous (L’Harmattan éditeur).
– Une amélioration de l’accidentologie viendra, très certainement, dans l’avenir, de l’informatique embarquée, permettant aux voitures d’être plus « communiquantes » et de rendre, sur route, des services plus sophistiqués.
– On doit noter, par ailleurs, que le poids des véhicules (combiné à la vitesse) a un rôle dans les accidents. Malheureusement, le poids des véhicules n’est pas très homogène en France. Il sera donc difficile de se prononcer, à l’avenir, sur des règles générales et pertinentes en matière de vitesse, sur routes ou sur autoroutes, tant que les poids des véhicules, par constructeurs, n’auront pas fait l’objet d’études approfondies.
l Enfin, Mme Muhlmann-Weil déclare qu’il conviendrait d’améliorer (comme cela a été fait récemment en Autriche) le cursus de formation des moniteurs d’auto-écoles.
– La Prévention routière déclare que les automobilistes, en général, ne se concentrent pas assez sur la conduite, contrairement aux pilotes d’avion. Dans l’ensemble, pour diminuer les accidents, il faut supprimer, autour du conducteur, tout ce qui peut diminuer son attention. Cela peut aller jusqu’à la suppression des kits mains-libres.
– L’Automobile Club fait part des observations suivantes :
– La sécurité routière joue, en principe, sur trois niveaux : le conducteur, la voiture et les infrastructures. Toutefois, depuis très longtemps déjà, les pouvoirs publics n’agissent plus que sur la répression à l’égard du conducteur ; du coup, les nouvelles mesures, largement répressives, du CISR du 11 mai 2011 ont été très mal accueillies, un peu comme des brimades supplémentaires servant de catalyseur au mécontentement.
– Il n’aurait pas fallu supprimer les panneaux indicateurs de radars, étant entendu que les panneaux pédagogiques, disséminés ici et là, ne présentent pas grand intérêt.
– Il aurait fallu agir sur la formation, initiale et surtout continue. En Autriche, 30 % des gains dans les statistiques de l’accidentologie ont été obtenus, sur une période récente, grâce à la pratique de stages, c’est-à-dire grâce à la formation continue. Il faudrait développer ces stages aussi en France, par exemple en les finançant au titre du congé individuel de formation (CIF), au titre d’actions bonifiées par l’État (stages à 1 euro) ou au titre de dépenses dont les frais sont avancés par les particuliers mais sont récupérables sur le paiement des primes d’assurance.
– L’Automobile Club organise, lui-même, des stages de formation (sur pistes). Cependant, ceux-ci ne sont pas assez suivis. Ils le seraient davantage, incontestablement, si les titulaires des certificats de stages se voyaient décerner un ou deux points supplémentaires sur leur permis. Une telle disposition serait spécialement profitable pour les jeunes qui, les premières années, ne disposent que de six points au titre de leur permis B spécifique.
– D’autre part, le fait de rendre les stages plus incitatifs pourrait aussi avoir un sens au regard de l’évolution même de la réglementation du permis. À partir de 2013, les permis, aux termes d’une directive européenne (non encore transposée), ne seront plus valables que 15 ans. Ensuite, il y aura une procédure de renouvellement. Les stages accomplis pourraient faciliter les renouvellements, même si, par ailleurs, la reconduction du permis ne manquera pas de comporter une certaine part d’automaticité.
l M. Bollecker, pour l’Automobile Club, relève par ailleurs que le nombre de conducteurs sans permis est très important en France. Les chiffres du Fonds de garantie, où l’intervenant est administrateur, font état d’un nombre de 1,1 million d’automobilistes à rouler sans permis, toutes causes confondues. La conduite sans permis est parfois liée à l’origine rurale d’un certain nombre de conducteurs (on a l’habitude de conduire, sans permis, le tracteur, y compris sur route ; on franchit le pas pour un véhicule de tourisme…). Mais l’essentiel des conducteurs sans permis est constitué par des personnes qui ont perdu tous leurs points. La pratique est ainsi très corrélée avec le système du permis à points.
– En ce qui concerne l’installation de boîtes noires dans les véhicules, de régulateurs de vitesse ou de détecteurs de radars embarqués, l’Automobile Club se montre favorable, de manière générale, à tout ce qui peut favoriser l’aide à la conduite. Cela dit, tous ces équipements constitueront très certainement, à l’avenir, des options assez coûteuses. On pourrait compenser leurs coûts en instituant, sur les prix de vente des véhicules, des bonus ou des malus sécurité. Néanmoins, même ainsi, des obstacles peuvent subsister : la boîte noire peut tout à fait sortir, chez les constructeurs, avec un prix, même de série, assez prohibitif. Le Lavia peut être un facteur de somnolence ; il ne pourra se développer que dans le cadre d’un programme européen (EuroRAP) ; il posera certainement problème en cas de séjour à l’étranger, c’est-à-dire dans un contexte où son réglage ne sera plus valide. De même le « coyote », devenu maintenant un indicateur de zones à risques, mis à jour par disquettes ou sur internet selon une formule pay per view, peut avoir un prix de revient qui augmente sensiblement. À noter, par ailleurs, que l’Automobile Club serait très favorable à l’installation dans les véhicules, en première monte de série, d’un système avertisseur en cas de changement de voies. Il est à craindre, néanmoins, que, là aussi, le prix (environ 2 000 €) ne soit un facteur dissuasif.
– S’agissant du bridage des véhicules, l’Automobile Club estime que ce dispositif serait extrêmement nuisible pour l’industrie française à l’exportation.
l S’agissant enfin de l’instauration, de manière périodique, d’un contrôle de santé pour vérifier l’aptitude à conduire de certains conducteurs, par exemple les personnes âgées, M. Bollecker estime cette mesure quasiment irréalisable. En effet, compte tenu du nombre de conducteurs âgés, il faudra recourir à l’expertise des médecins généralistes qui se prononceront ou non sur l’aptitude à la conduite des seniors. Or, il y a peu de chances qu’un médecin généraliste en vienne à retirer son permis à l’un de ses clients.
l M. Rudy Salles fait part, néanmoins, de son intérêt pour cette disposition qui existe aux États Unis au niveau de la législation de certains états.
*
* *
Déplacement à Montlhéry le jeudi 15 septembre 2011 : compte rendu
Démonstration d’équipements de sécurité sur le site de l’UTAC
(Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle)
Autodrome de Montlhéry
(Renault et PSA Peugeot Citroën)
• Participants :
Assemblée nationale :
MM. Armand Jung et Philippe Houillon, président et rapporteur de la mission
M. Olivier Marty, administrateur
Renault :
M. Jacques Faure, expert leader sécurité passive
M. Xavier Chalendon, expert leader IHM (Interface homme machine)
M. Jean-Yves Le Coz, expert leader sécurité routière
M. Jean-Christophe Beziat, affaires publiques
M. Bernard Dumondel, véhicule électrique
PSA Peugeot Citroën :
M. Brice Henry, responsable synthèse sécurité routière
M. Jean-François Huere, responsable sécurité routière affaires publiques
M. Alexandre Fromion, maître expert télématique
M. Vincent Abadie, maître expert sécurité véhicule
M. Lionel Clermont, architecte électronique embarquée
CCFA (Comité des constructeurs français d’automobiles) :
Mme Stéphanie de Saint-Germain, directrice de la sécurité routière
• Démonstrations effectuées par MM. les Président et Rapporteur :
- Renault Fluence ZE : essai dynamique d’un véhicule tout électrique
- Renault Mégane : démonstrations de freinage d’urgence (système AFU) sur circuit
- Renault Laguna : démonstration du LAVIA informatif en conditions normales de circulation
- Citroën DS 4 : essai dynamique, rétroviseur anti-angle mort, alerte au franchissement involontaire de ligne continue (système AFIL)
- Peugeot 3008 Hybrid 4 : essai dynamique du premier véhicule hybride électrique/diesel commercialisé, équipé d’un radar anti-collision
- Présentation des systèmes de sécurité passive équipant une Renault Scénic
*
* *
Déplacement à Bruxelles le 28 septembre 2011 : compte rendu
I- Compte rendu de la réunion de10 h 30 avec Mme Isabelle KARDACZ, Chef de l’unité sécurité routière et transport des matières dangereuses (Direction générale de la mobilité et des transports – Commission européenne).
Dans les orientations politiques sur la sécurité routière (2011-2020), ont été définis 7 axes pour les 10 années à venir :
- Améliorer l’éducation et la formation des usagers de la route. C’est l’idée d’une éducation et d’une formation tout au long de la vie. Pour les conducteurs professionnels, la formation continue existe déjà, mais ce n’est pas encore le cas pour les particuliers. En Belgique, à partir de 70 ans, les seniors ne peuvent conduire que dans un rayon de 50 km autour de leur domicile. Au Luxembourg, à partir de 80 ans, ils doivent repasser le permis. Certaines villes françaises organisent des cours de conduite pour les seniors. Il faudrait aussi mieux former les ressortissants de l’Union européenne aux nouvelles technologies et aux évolutions du code de la route ;
- Améliorer le contrôle de l’application de la réglementation. C’est le sens de la directive sur les contrôles transfrontières qui va entrer en vigueur dans deux ans. Un groupe à haut niveau sur la sécurité routière va être mis en place, qui se réunira deux fois par an. M. Nevache, Délégué interministériel à la sécurité routière, participera aux travaux de ce groupe et y représentera la France. Le travail portera sur les stratégies de mise en œuvre des réglementations existantes (nationales ou européennes) ;
- Rendre les infrastructures plus sûres ;
- Rendre les véhicules plus sûrs (par le biais notamment du contrôle technique, de la sécurité active et passive des véhicules, du développement des véhicules électriques…) ;
- Promouvoir l’utilisation de la technologie routière pour améliorer la sécurité routière (échanges d’informations entre véhicules et infrastructures, ecall…) ;
- Améliorer les services d’urgence et la prise en charge des blessés. Ce chantier ne fait que commencer. Le nombre de blessés au niveau européen est de 1,5 millions en 2009 pour 35 000 morts. Le coût de l’insécurité routière pour la société est de 130 milliards d’euros par an ;
- Mieux terni compte des usagers vulnérables (campagnes publicitaires sur le partage de la route…).
Il existe, d’ores et déjà, une importante législation en matière de sécurité routière, que l’unité sécurité routière et transport des matières dangereuses se charge de faire appliquer par les États membres. Ces textes sont divisés en trois groupes : la sécurité des véhicules, les infrastructures et les usagers.
1. La sécurité des véhicules
Le travail est réalisé en collaboration avec la Direction générale entreprises, qui met régulièrement à jour un règlement sur la mise en circulation des véhicules, lequel comprend les éléments de sécurité devenant obligatoires sur les véhicules neufs selon une périodicité régulière (airbag, système d’avertissement de franchissement de ligne…). Il s’agit du règlement concernant les prescriptions pour l’homologation relative à la sécurité générale des véhicules à moteur (n°661-2009), règlement qui vise les quatre roues. Pour certains équipements, un échéancier très précis est fixé. Pour les deux-roues motorisés, une telle liste est en train d’être discutée au Parlement et au Conseil.
La Direction générale transports gère les dispositions relatives à l’immatriculation des véhicules (il existe une directive qui prévoit que l’immatriculation doit être reconnue dans tous les États membres) et au contrôle technique (une directive explicite ce qui doit être vérifié dans le cadre d’un contrôle technique).
La Direction générale transports est également compétente pour les prescriptions concernant les véhicules existants. Récemment, a été adoptée une directive sur les rétroviseurs, en vue de diminuer les angles morts. La Direction générale entreprises avait prévu l’équipement des autobus et des camions neufs. Le dispositif a été généralisé aux autobus et aux camions anciens.
Sur le bridage des véhicules, tous les pays producteurs de véhicules y sont opposés. Une réflexion est menée au niveau européen, mais le lobby automobile est très puissant. La réflexion est conduite dans le cadre de l’initiative Cars 21, qui a aussi pour objectif d’améliorer la sécurité routière, mais ce sont les pays producteurs de véhicules qui y participent de manière prépondérante (France, Allemagne, Italie…). S’agissant de la question du bridage, il existe déjà une obligation d’installer des limiteurs sur les camions et sur les autobus. On s’oriente actuellement sur l’extension de cette obligation aux camionnettes (utilitaires entre 2,8 et 3,8 t). Il n’a jamais été question d’imposer de limiteur pour les véhicules privés et il est peu probable de réaliser cet objectif au niveau européen.
Sur les systèmes de transport intelligent, le programme de travail de la Direction générale prévoit prochainement une communication sur ce thème. Il est possible que le LAVIA soit abordé dans ce cadre, comme l’ecall, afin de réfléchir sur la possibilité d’une réglementation.
Sur les plaques d’immatriculation, il ne paraît pas envisageable de réglementer leur taille. La réglementation européenne ne régit que la mention du pays.
2. Les infrastructures
Il existe une directive sur la sécurité des tunnels routiers, actuellement en cours de mise en oeuvre, pour les tunnels de plus de 500 mètres.
Une autre directive, sur la sécurité des infrastructures routières, entrée en vigueur en décembre 2010, est également en cours de mise en œuvre par les États membres. Elle prévoit, lorsque les infrastructures ont bénéficié de fonds européens, qu’un audit de sécurité routière devra être réalisé, avant la création d’un nouveau tronçon routier, et que des inspections de sécurité routière devront être menées sur les tronçons existants. Les États membres peuvent choisir de généraliser ces évaluations aux autres réseaux. Cependant, la Commission n’étant pas compétente pour ces derniers, elle se contente d’éditer des Guidelines, notamment sur les points noirs et sur les points blancs.
3. Les usagers
Il existe une législation sur le permis de conduire. A partir du 19 janvier 2013, sera institué un permis de conduire européen unique. Cette directive (la troisième sur les permis de conduire) doit être transposée en 2011. La France ayant, actuellement, effectué une transposition qui demeure partielle, une procédure d’infraction est en cours. On en est au stade de l’avis motivé, bientôt à celui de la Cour.
Avec cette directive, les catégories de permis de conduire des deux-roues motorisés sont beaucoup plus détaillées. Il y a une catégorie AM pour les cyclomoteurs de moins de 50 cm3 (elle était pour l’instant optionnelle pour les États membres). La catégorie A est divisée en fonction de la puissance des véhicules, afin d’adapter la formation des conducteurs et d’organiser l’accès graduel à la puissance. Il y aura une double condition d’âge et d’expérience pour la conduite des véhicules les plus puissants. Cependant, le permis de conduire reste un permis national : il est donc possible d’en faire un permis à points ou pas, et le droit de conduire reste délivré seulement par l’État membre.
La durée de délivrance sera de 10 ans, mais sans obligation de remplir une condition lors du renouvellement. Les États membres peuvent décider d’avoir un renouvellement administratif ou de faire passer des tests. Le réseau européen des permis de conduire va être mis en place : quand un État membre échangera, émettra, suspendra un permis de conduire, les autres États membres pourront en être informés. Le permis pourra être équipé d’une puce électronique (qui pourrait mentionner, notamment, le nombre de points restant sur le permis).
Par ailleurs, des orientations sont en cours d’élaboration sur l’aptitude à la conduite. Ce sont des orientations médicales, qui recommandent des contrôles réguliers pour les cas de diabète, de défauts dans la vision, etc. Cette réflexion est menée par des groupes d’experts médicaux.
Une directive est également en vigueur sur les conducteurs professionnels, qui les oblige à suivre une formation initiale et continue.
Enfin, la directive sur les poursuites transfrontières vient d’être adoptée, le 29 septembre, par le Conseil compétitivité, pour faciliter la transmission d’informations entre États membres, lorsqu’une infraction est commise par un étranger sur le territoire d’un État membre. À noter que le document du permis de conduire est lié au lieu de résidence. L’article 11 de la directive rappelle que, si l’on vit plus de 185 jours dans un autre pays que celui dont on possède le permis, il faut l’échanger. Cependant, beaucoup de conducteurs ne le font pas, notamment pour ne pas perdre de points, et ils ne sont guère inquiétés. On peut observer le même comportement pour la carte grise.
En matière d’alcoolémie, il y a une recommandation de 2004 qui préconise de fixer le seuil à 0,8 g/l au plus. Il convient de relever qu’en Grande-Bretagne, si le taux retenu est bien de 0,8 g, le système de sanction est très sévère. En fait, à la moindre infraction, le contrevenant s’expose à la prison. Aujourd’hui, on note une quasi-harmonisation des taux légaux dans les différents États
Concernant les piétons et les cyclistes, ces derniers sont pris en compte dans le cadre de la stratégie sur les usagers vulnérables. La Commission ne peut pas légiférer sur le domaine urbain, car il s’agit d’une compétence nationale et/ou locale. Elle se contente donc de financer des projets locaux (qui peuvent déboucher sur la rédaction de lignes directrices plus globales). Par exemple, la Commission a contribué au financement de plans de mobilité urbains à Toulouse, à Nantes, à Lyon, etc. Cette aide a permis de réaliser le tramway, le vélib, ainsi que différents systèmes de transports collectifs propres.
4. Autres questions
L’unité sécurité routière a également un budget qui permet de signer des contrats (il en existe actuellement une trentaine) en vue de financer des études devant déboucher sur la définition et la diffusion de bonnes pratiques. La priorité est donnée aux usagers vulnérables (personnes âgées, piétons, cyclistes, deux-roues motorisés). A terme, l’objectif est de définir une stratégie européenne pour la protection des usagers vulnérables.
L’unité conduit également des actions de communication. Des documents d’information sont régulièrement édités, ainsi qu’une note sur les « orientations politiques sur la sécurité routière » (2011-2020), qui est une feuille de route concernant cette période (orientations et objectifs). Un forum européen des jeunes a été organisé, de même qu’un forum européen des motards… Un manuel sur la formation des motards a été édité. Des vidéos ont été faites à destination des formateurs, qui visent à diffuser les bonnes pratiques définies au sein des États membres.
Des directives sont en préparation. En particulier, le futur règlement sur le contrôle technique constituera un travail législatif important pour l’année qui vient. La Commission propose d’étendre le contrôle technique aux deux-roues motorisés pouvant aller au-delà de 40 km/h et de calquer les obligations de contrôle technique sur les éléments minimum de sécurité qui sont prévus par les règlements actuels. La proposition de règlement va être publiée à la fin de l’année 2011.
*
* *
Déjeuner avec M. Bertrand de LACOMBE, Conseiller chargé des transports à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
*
* *
II- Compte rendu de la réunion de 15 heures avec Mme Françoise LE BAIL, Directrice générale (Direction générale de la justice - Commission européenne).
La Direction générale justice travaille actuellement sur la prescription civile pour les dommages causés par les accidents de la circulation, afin de faire en sorte que les ressortissants étrangers ne soient pas désavantagés, s’ils sont victimes d’un accident. Une étude est conduite pour recenser les législations en la matière. Elle pourrait déboucher sur la fixation de standards minimaux. L’évaluation du nombre de victimes est en cours auprès des assureurs nationaux.
Il existe une décision cadre 2005-514 sur la reconnaissance des sanctions pécuniaires. Mais tous les pays ne l’ont pas encore transposée, car elle faisait partie des mesures liées au « troisième pilier », qui ne s’imposaient pas à tous les États membres. Les procédures d’infraction pourront être lancées à partir de 2014, date à laquelle la transposition devra avoir été faite.
*
* *
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
© Assemblée nationale