

![]()
N° 895
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2008.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34 et 35 DU PROJET DE LOI, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, de modernisation de l’économie (N° 842),
PAR M. Éric CIOTTI,
Député.
——
Voir les numéros : n° 908 et 905
INTRODUCTION 9
I. – DES MESURES EN FAVEUR D’UNE CONCURRENCE PLUS EFFECTIVE EN VUE D’UNE CROISSANCE PLUS FORTE 11
A. L’APPROFONDISSEMENT DE LA RÉFORME DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION AU SERVICE DES CONSOMMATEURS 11
1. La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente 11
a) Une législation actuelle qui favorise l’inflation tarifaire et dissuade la concurrence 12
b) Une réforme devenue nécessaire dans l’intérêt des consommateurs 14
2. Une révision du cadre juridique de l’équipement commercial 15
B. LA CRÉATION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 18
1. La fin d’une singularité française 19
a) La dichotomie actuelle des compétences du Conseil de la concurrence et du ministre chargé de l’économie 19
b) Une situation relativement marginale en Europe 21
2. Le gage d’une régulation concurrentielle plus efficace 22
II. – UN TEXTE INCITATIF POUR LA CRÉATION ET L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 24
A. LA SIMPLIFICATION DU STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL 25
1. Un cadre juridique, social et fiscal actuellement handicapant 25
a) Les principales caractéristiques de l’entreprise individuelle 25
b) Une forme de création d’activité en perte de vitesse 26
2. Les voies de réforme envisagées 28
B. L’AMÉLIORATION DU RÉGIME JURIDIQUE ET FINANCIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 29
1. Des délais de paiement plus courts et encadrés 30
2. Des marchés publics plus accessibles : les prémices d’un Small Business Act à la française 33
a) Une réglementation nationale actuelle qui pénalise, de fait, les PME 34
b) La réservation de certains marchés publics aux PME innovantes : une ouverture expérimentale qui va dans le bon sens 37
3. Des modalités de fonctionnement assouplies 38
a) Des formalités moins contraignantes pour les sociétés à responsabilité limitée et par actions simplifiées 38
b) Une indexation des loyers des baux commerciaux plus favorable 39
III. – LE RÉAJUSTEMENT, PAR ORDONNANCE, DES PROCÉDURES COLLECTIVES : PRIVILÉGIER LE REBOND DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 41
A. DES PROCÉDURES AMIABLES À CONFORTER 42
1. Mandat ad hoc et conciliation : deux procédés au succès indéniable 42
2. Une conciliation qui offre une réelle souplesse mais présente certaines limites 43
a) Une ouverture entourée d’un formalisme assez contraignant et dissuasif 43
b) Vers un alignement partiel des avantages de la conciliation constatée sur ceux de la conciliation homologuée 44
c) Le renforcement, en corollaire, du rôle du ministère public 45
B. LA NÉCESSITÉ DE RENDRE LA SAUVEGARDE PLUS ATTRACTIVE 46
1. Une procédure utile 46
a) La mise en place, sous contrôle du juge, de mesures transitoires destinées à éviter l’insolvabilité et à pérenniser l’activité 46
b) Le maintien d’un rôle actif pour le débiteur 49
c) Une efficacité avérée dans les faits 51
2. Une procédure sous-employée 55
a) Le poids infime des sauvegardes ouvertes au regard des redressements et liquidations judiciaires 55
b) Un déclenchement visiblement trop tardif 58
3. Une procédure à améliorer 59
a) L’aménagement des conditions d’ouverture 59
b) La revalorisation du rôle du débiteur 61
c) Le recentrage des organes de la procédure sur leurs missions essentielles 62
d) La nécessité de simplifier la consultation des obligataires 63
e) L’impératif d’une meilleure prise en compte des évolutions du refinancement des entreprises endettées 64
C. LE BESOIN D’UN RÉAMÉNAGEMENT PLUS GLOBAL DES PROCÉDURES COLLECTIVES 66
1. Assurer un meilleur continuum entre la sauvegarde et le redressement judiciaire 67
2. Coordonner plus efficacement la liquidation judiciaire et son volet simplifié 68
a) La systématisation de la liquidation judiciaire simplifiée pour les débiteurs de petite envergure 68
b) L’extension du champ de la liquidation judiciaire simplifiée 69
3. Rendre les sanctions plus proportionnées et moins dissuasives 70
IV. – L’AMÉNAGEMENT DES INCAPACITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES : DONNER UNE SECONDE CHANCE AUX ENTREPRENEURS 72
A. UN RÉGIME JURIDIQUE TOILETTÉ MAIS DEMEURANT PERFECTIBLE 72
B. UN SIGNAL À DONNER POUR ENCOURAGER L’ESPRIT D’ENTREPRISE 74
V. – DES DISPOSITIONS RENFORÇANT DE MANIÈRE NOTABLE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE 75
A. DES CONDITIONS DE RÉSIDENCE PLUS ATTRACTIVES POUR LES ÉTRANGERS CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE 75
B. L’OPTIMISATION DES MOYENS CONSACRÉS À LA VALORISATION DU TERRITOIRE EN VUE DE LA LOCALISATION D’ACTIVITÉS NOUVELLES 77
1. Le caractère stratégique de la politique régionale européenne 77
2. La nécessité d’une plus grande décentralisation de la gestion des crédits européens 80
a) Les marges de manœuvre offertes par les règlements communautaires 80
b) Donner une assise juridique claire aux modalités de gestion et d’expérimentation en vigueur 81
C. LA MODERNISATION ET LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 82
1. L’harmonisation de la législation française avec les dernières évolutions retenues dans la convention sur le brevet européen 83
a) Le succès du brevet européen 83
b) Des aménagements substantiels du droit matériel des brevets 84
2. La nécessité de prendre en compte les autres avancées et simplifications prévues par le droit international 85
EXAMEN EN COMMISSION 87
EXAMEN DES ARTICLES 89
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS 89
Chapitre Ier : Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel 89
Article 3 (art. L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 1600 du code général des impôts, art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982) : Dispense d’immatriculation pour les petites activités en cumul d’une activité salariale 89
Article 4 (art. L. 443-11, art. L. 631-7, art. L. 631-7-2, art. L. 631-7-4 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Assouplissement des conditions d’utilisation des locaux d’habitation en locaux commerciaux 92
Article 5 (art. L. 526-1, art. L. 526-3 du code de commerce, art. L. 330-1, art. L. 332-9 du code de la consommation) : Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel 94
Article additionnel après l’article 5 (art. L. 145-1 du code de commerce) : Extension du bénéfice des baux commerciaux aux personnes simplement mentionnées au registre du commerce ou au répertoire des métiers 97
Chapitre II : Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises 98
Article 6 (art. L. 441-6, art. L. 442-6 du code de commerce) : Plafonnement des délais de paiement dans les relations professionnelles privées 98
Article 7 (art. L. 214-41 du code monétaire et financier) : Expérimentation temporaire d’une attribution préférentielle aux PME innovantes d’une certaine proportion de marchés publics technologiques 101
Chapitre III : Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises 105
Article 11 (art. L. 112-3 du code monétaire et financier) : Nouvel indice de révision des baux commerciaux 105
Article 13 (art. L. 141-1, art. L. 210-5, art. L.223-1, art. L. 223-27, art. L. 223-31, art. L. 232-22 du code de commerce) : Mesures de simplification du fonctionnement des SARL 106
Article additionnel après l’article 13 (art. L. 225-25, art. L. 225-72, art. L. 225-124 et art. L. 228-15 du code de commerce) : Simplification du régime juridique des sociétés anonymes 111
Article 14 (art. L. 227-1, art. L. 227-2, art. L.227-9, art. L. 227-9-1 [nouveau], art. L. 227-10 du code de commerce) : Mesures de simplification du fonctionnement des sociétés par actions simplifiées 112
Article additionnel après l’article 14 (art. L. 123-6 du code de commerce) : Transmission par voie électronique à INPI des inscriptions effectuées auprès du greffe des tribunaux à compétence commerciale 116
Chapitre IV : Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond » 117
Article 18 (Chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à aménager, par ordonnance, le régime des incapacités commerciales et industrielles 117
Article 19 (Livre VI du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à moderniser, par ordonnance, les procédures issues de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et la fiducie 120
Article additionnel après l’article 19 (art. L. 643-11 et art. L. 653-11 du code de commerce) : Extension du bénéfice des règles sur l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et sur le relèvement des interdictions de gérer 128
Article additionnel après l’article 19 (art. L. 515-27 et art. L. 515-28 du code monétaire et financier) : Application des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises aux sociétés de crédit foncier 129
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE 130
Chapitre Ier : Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales 130
Article 21 (art. L. 441-2-1, art. L. 441-6, art. L. 441-7 du code de commerce) : Instauration d’une négociabilité des conditions générales de vente 130
Article 22 (art. L. 442-6 du code de commerce) : Exonération des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente du régime des sanctions des pratiques abusives 134
Chapitre II : Instaurer une Autorité de concurrence 139
Article 23 (Livre IV du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à réformer, par ordonnance, le cadre actuel de régulation de la concurrence 139
Après l’article 23 143
Chapitre III : Développer le commerce 143
Article 26 (art. L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Mobilisation du FISAC en faveur des commerces en milieu rural, dans les halles et marchés et les quartiers prioritaires de la politique de la ville 144
Article additionnel après l’article 26 (art. 8 [nouveau] de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) : Taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat 146
Article 27 (art. L. 750-1, art. L. 751-1, art. L. 751-2, art. L. 751-3, art. L. 751-6, art. L. 751-9, art. L. 752-1, art. L. 752-2, art. L. 752-3, art. L. 752-4, art. L. 752-5, art. L. 752-6, art. L. 752-7 à L. 752-11, art L. 752-13, art. L. 752-14, art. L. 752-15, art. L. 752-16, art. L. 752-17, art. L. 752-18, art. L. 752-19, art. L. 752-22, art. L. 752-23 [nouveau], intitulé du titre V du livre VII, intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce) : Réforme de l’équipement commercial 147
Après l’article 27 157
TITRE III : MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE 157
Chapitre II : Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France 157
Article 32 (art. L. 314-14, art. L. 314-15 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assouplissement des conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers contribuant significativement à la croissance française 157
Article 33 (art. 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) : Délégation à certaines collectivités territoriales de la fonction d’autorité de gestion et de certification de fonds structurels, pour la période 2007-2013 159
Chapitre III : Mesures relatives au développement de l’économie de l’immatériel 164
Article 34 (art. L. 611-10, art. L. 611-11, art. L. 611-16, art. L. 612-12, art. L. 613-2, art. L. 613-24, art. L. 613-25, art. L. 614-6, art. L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) : Transposition des améliorations apportées par l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens 164
Article 35 : Habilitation du Gouvernement à simplifier et à adapter, par ordonnances, le code de la propriété intellectuelle aux engagements de la France 167
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 171
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 179
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS 183
La modernisation de l’économie française constitue l’un des principaux chantiers auxquels le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement se sont attelés depuis le début de cette XIIIème législature. En moins d’un an, un certain nombre de réformes essentielles ont ainsi vu le jour, qu’il s’agisse de l’allègement de la fiscalité des heures supplémentaires (1), de la modification de la définition du seuil de revente à perte en vue d’une répercussion des « marges-arrière » dans les prix facturés aux consommateurs (2), de la possibilité de conversion en rémunération des jours de réduction du temps de travail afin de redistribuer du pouvoir d’achat aux salariés (3), de la fusion de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) (4), ou encore de la réduction des effectifs de la fonction publique de 22 000 postes dans le budget en cours d’exécution (5).
Toutes ces réformes ont d’ores et déjà commencé à donner des résultats positifs, comme en atteste la diminution très sensible du taux de chômage, qui s’établissait, fin 2007, à 7,5 % de la population active, ainsi que le nombre de créations d’emplois dans le secteur marchand l’an passé, de l’ordre de 328 000. Elles ne constituent, néanmoins, qu’un commencement au regard de l’ampleur des défis posés à notre pays par la mondialisation et la concurrence accrue des pays émergents.
Le présent projet de loi marque à cet égard une nouvelle étape. Les mesures qu’il comporte sont notamment le fruit de multiples réflexions engagées depuis plusieurs mois, tant au sein de la Commission pour la libération de la croissance, présidée par M. Jacques Attali, que par des personnalités reconnues pour leurs compétences sur des sujets bien précis, à l’instar de M. Lionel Stoléru, ancien ministre et président du conseil de développement économique durable de Paris, pour ce qui concerne l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence, s’agissant de la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, ou encore de M. François Hurel, délégué général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur une meilleure reconnaissance du travail indépendant.
La Commission des Lois de l’Assemblée nationale a décidé de se saisir pour avis de plusieurs dispositions du texte, qui relèvent directement de ses domaines de compétence ainsi que de ses centres d’intérêt habituels.
Il en va ainsi, premièrement, de nombreuses dispositions du titre Ier, relatif à la dynamisation de la création et de l’expansion de nos entreprises, et plus particulièrement de celles concernant le statut de l’entrepreneur individuel (articles 3 à 5), la réduction des délais de paiement pour les fournisseurs (article 6), la réservation d’une partie des marchés publics de hautes technologies aux PME innovantes (article 7), la fixation de nouvelles modalités d’indexation des baux commerciaux (article 11), la simplification du fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée ou par actions simplifiées (articles 13 et 14), et des dispositions visant à faciliter le rebond des entrepreneurs ainsi qu’à réformer la loi de sauvegarde des entreprises, – « une bonne loi », « une panoplie d’outils utiles », pour reprendre les propres termes de Mme Perrette Rey, ancien président du Tribunal de commerce de Paris (6) –, dans le sens des propositions formulées sur le sujet en 2007 par la Commission des Lois (7) (articles 18 et 19).
Il en va également de plusieurs articles du titre II, portant plus spécifiquement sur la rénovation du cadre concurrentiel de l’économie française, et notamment de ceux instaurant la négociabilité des conditions générales de vente dans le commerce (articles 21 et 22), créant une Autorité de la concurrence aux contours plus vastes que l’actuel Conseil de la concurrence (article 23) et révisant en profondeur les règles de l’urbanisme commercial (articles 26 et 27).
Il en va, enfin, de certains articles du titre III, ayant trait tout à la fois à l’encouragement à l’installation en France de cadres étrangers de haut niveau (article 32), à la décentralisation régionale des responsabilités d’autorité de gestion et de certification des programmes menés dans le cadre des fonds structurels européens pour la période 2007-2013 (article 33), à la mise en conformité de notre droit de la propriété intellectuelle avec les modifications récemment apportées à la convention sur le brevet européen (8) (article 34) ou encore à la modernisation, par ordonnances, des procédures de délivrance ou d’enregistrement des titres de propriété industrielle et de l’exercice des droits qui en découlent (article 35).
Aux termes d’un accord avec le Président de la Commission des Affaires économiques, il a été décidé que la Commission des Lois examinerait « au fond » les articles 13, 14, 19, 32, 33, 34 et 35 du projet de loi, qui entrent directement dans son champ de compétences.
D’emblée, il apparaît que le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale répond à des besoins avérés par une variété de mesures fortes et, souvent, très attendues. Il met également un terme à des exceptions françaises préjudiciables pour le dynamisme de notre économie, plusieurs pays étrangers ayant mis en œuvre des mesures similaires avec des résultats probants à la clé. Pour toutes ces raisons, il ne peut que recevoir l’aval global du Parlement.
Les incertitudes qui pèsent sur le contexte macroéconomique, notamment en ce qui concerne les effets de la crise des subprimes aux États-Unis, rendent plus que jamais nécessaire la mise en place de mesures d’accompagnement de la croissance nationale. Les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) relatifs à la croissance enregistrée en France en 2007, fixant définitivement celle-ci à 2,2 %, ont montré que les initiatives volontaristes engagées dès l’été dernier en faveur du travail, de la croissance, et du pouvoir d’achat ont porté leurs fruits. Il convient néanmoins d’en amplifier les effets. Tel est justement l’objet du présent projet de loi qui tend, d’une part, à restaurer les conditions d’une concurrence plus efficace dans le secteur de la distribution et, d’autre part, à améliorer les mécanismes de contrôle et de régulation de la compétition commerciale.
La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dont l’un des principaux objectifs était de permettre aux distributeurs de répercuter les marges-arrière consenties par leurs fournisseurs dans le prix de vente aux consommateurs, a rouvert le débat de la pertinence des normes régissant les rapports contractuels et l’urbanisme commerciaux. Le Gouvernement ne s’était d’ailleurs pas caché, lors des discussions parlementaires, de préparer une réforme plus profonde dans ses implications.
Le texte en discussion est effectivement d’une toute autre portée que la loi promulguée au début de l’année car il vise, d’une part, à transformer totalement la nature de la négociation commerciale en plaçant la détermination du prix facturé au consommateur au cœur du dialogue entre fournisseur et distributeur et, d’autre part, à placer la concurrence entre distributeurs au centre des principes guidant les décisions relatives aux nouvelles implantations commerciales. La conjugaison de ces deux leviers est supposée avoir des effets positifs pour le consommateur, qui redeviendrait ainsi l’arbitre du processus de fixation des prix.
À trop vouloir encadrer les relations commerciales afin de concilier la protection des fournisseurs avec la recherche des meilleures conditions tarifaires pour les consommateurs, le titre IV du livre IV du code de commerce a visiblement créé les conditions d’une concurrence ne s’exerçant que marginalement sur les prix et, de ce fait, renforcé la nature oligopolistique du marché de la distribution. Il convient donc de revenir sur cette situation.
Les relations entre distributeurs et fournisseurs font l’objet d’un encadrement juridique spécifique, au titre IV du livre IV du code de commerce, en raison des déséquilibres induits par la situation oligopolistique des distributeurs. L’influence de ceux-ci s’exerce par l’intermédiaire de leurs centrales d’achat, dont le nombre est très réduit au regard des quelque 35 000 fournisseurs existants. Pour mémoire et à titre de comparaison, le groupe d’experts sur les relations entre industrie et commerce présidé par M. Guy Canivet en 2004 a mis en exergue que cinq centrales d’achat (Lucie, pour Leclerc et Système U, Carrefour, Auchan, Casino et Intermarché, par ordre d’importance) se partageraient plus de 86 % de parts de marché dans le domaine de l’alimentation.
Conscient de cette situation et de ses implications potentielles, le législateur a prévu un ensemble de règles visant à garantir et à contrôler la transparence des relations commerciales, à savoir :
– l’obligation de facturation écrite, selon un formalisme précis, de tout achat de produits ou de prestations de services à finalité professionnelle (article L. 441-3 du code de commerce) ;
– la communication des conditions générales de vente par tout producteur ou prestataire de services à tout acheteur ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle (article L. 441-6 du même code) ;
– l’identification des services de coopération commerciale rendus par le distributeur à son fournisseur en contrepartie de marges-arrière au sein d’une convention écrite, par définition contrôlable (article L. 441-7) ;
– l’interdiction d’une revente à perte, afin d’empêcher que les distributeurs fixent des prix extrêmement bas sur des produits d’appel pour évincer du marché les petits commerces dont les économies d’échelle sont nécessairement moindres (article L. 442-2) ;
– enfin, la prohibition expresse d’un ensemble de pratiques censées correspondre aux principales dérives que tout rapport de force déséquilibré pourrait occasionner, au premier rang desquelles figure la discrimination selon les distributeurs des prix, délais de paiement, conditions de vente ou modalités de vente et d’achat sans contrepartie justifiée (article L. 442-6).
En dépit de ces contraintes, le droit actuel n’exclut pas, du moins en théorie, la négociabilité des tarifs des fournisseurs : non seulement l’article L. 441-6 du code de commerce n’affirme pas le principe d’une primauté des conditions générales de vente, qui constituent seulement une base de départ à la négociation commerciale, mais de surcroît il reconnaît qu’elles peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Il reste que l’interdiction de la discrimination tarifaire et des conditions générales de vente prévue à l’article L. 442-6 du même code est largement venue contrebalancer la souplesse de l’article L. 441-6, inhibant de ce fait les intéressés dans leurs pratiques et conduisant à une inflation tarifaire inéluctable.
Comme l’a très clairement souligné dans un récent rapport remis au Gouvernement, au nom du groupe de travail qu’elle a présidé sur le sujet, Mme Marie-Dominique Hagelsteen : « ce dispositif juridique et l’interprétation qui en est faite par les parties conduisent à un déplacement de la négociation commerciale vers l’arrière et favorisent la rigidité tarifaire » (9). En 2005, les marges-arrière des distributeurs, dont le schéma ci-après explique la composition, s’élevaient en moyenne à 33,5 % du prix net facturé des articles et s’échelonnaient, selon les produits, de 5 à 70 %. Elles ont continué de croître, en dépit de nombreux ajustements de notre législation, en passant à 37 % en 2006.
DÉFINITION SCHÉMATIQUE DES MARGES-ARRIÈRE
PRIX |
NÉGOCIATION |
MARGES | ||
Prix de vente au consommateur |
||||
|
||||
Remises acquises lors de la vente |
Marges-avant | |||
Prix net sur facture |
||||
|
||||
Remises conditionnelles non acquises lors de la vente |
||||
Prix « double net » |
||||
Coopération commerciale |
Marges-arrière | |||
Services spécifiques |
||||
Services distincts |
||||
Prix « triple net » |
||||
Source : rapport du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, p. 11.
Si la définition du seuil de revente à perte a indéniablement joué un rôle important dans cette évolution, l’interdiction de toute différenciation tarifaire vis-à-vis des distributeurs a également pesé.
Tout d’abord, l’obligation faite aux producteurs ou aux prestataires de services de communiquer leurs conditions générales de vente à tout acheteur professionnel a pu faciliter les ententes entre fournisseurs en vue d’un renchérissement de leurs prix facturés aux distributeurs. La transparence rendant facilement décelable tout écart tarifaire, de telles ententes sont devenues crédibles pour leurs participants, qui y avaient tout intérêt.
Ensuite, l’absence d’individualisation des tarifs des fournisseurs selon les distributeurs a incontestablement gêné la concurrence entre ces derniers. Tout fournisseur souhaitant adapter ses tarifs à la situation d’un distributeur s’en est vu empêché, sauf à procéder à une modification identique pour ses autres clients. Ainsi que le groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen l’a observé, « cela signifie que le fournisseur peut d’autant plus facilement augmenter ses tarifs qu’il est en mesure d’assurer à chacun de ses clients que ses concurrents ne sont pas avantagés. De l’autre côté, la non-négociabilité des tarifs dissuade les distributeurs d’exiger des rabais et des ristournes » (10), puisque celles-ci auraient vocation à s’appliquer également à leurs concurrents et qu’ils n’en tireraient ainsi aucun avantage comparatif.
Pour toutes ces raisons, il est donc devenu indispensable de revoir l’économie générale des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce.
Les consommateurs français s’estiment victimes d’une inflation injustifiée s’agissant des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Les premiers résultats des enquêtes conduites sous l’égide de l’observatoire des prix et des marges, créés le 25 février 2008, corroborent ce sentiment, puisqu’une hausse moyenne de 4,69 % des prix de quelque 100 000 produits de grande consommation a été identifiée sur la période allant de février 2007 à février 2008 (11). Le Parlement ne peut donc que partager ce constat du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen : « il devient difficile de défendre le maintien d’un dispositif juridique qui, en premier lieu, conduit à ne pas placer les prix au cœur de la négociation commerciale, en deuxième lieu, favorise le développement de contrats portant sur des prestations fictives et, enfin, entretient des rigidités à la baisse des prix au consommateur sans apporter de gains d’efficacité » (12).
La reconnaissance juridique d’une possibilité de différencier les conditions générales de vente ainsi que les tarifs en fonction des distributeurs ne constitue d’ailleurs pas un saut dans l’inconnu, dans la mesure où certains pays européens ont infléchi leur législation en ce sens, pour le plus grand profit des consommateurs. Dès lors qu’une telle discrimination reste assujettie au droit des pratiques anticoncurrentielles, c’est-à-dire qu’elle est sanctionnée lorsqu’elle résulte d’une entente et qu’elle a pour effet d’exclure des concurrents du marché, elle n’est pas condamnable en soi, bien au contraire.
L’exemple de l’Irlande suffit à s’en persuader. Depuis le Groceries Order Act de 1987, la différenciation tarifaire était interdite et le seuil de revente à perte (pratique elle aussi prohibée) n’incluait pas les marges-arrière. En 2005, le ministère irlandais du commerce a mené une consultation qui a conclu à l’inefficacité de la législation nationale, laquelle n’avait empêché ni la concentration des fournisseurs en amont, ni celle des distributeurs en aval, tout en favorisant l’augmentation des prix des produits de grande consommation. En 2006, le Groceries Order Act fut donc abrogé, l’Irlande autorisant désormais la différenciation tarifaire sans autres limitations que celles tenant au droit de la concurrence et à la revente à perte.
Les résultats de cette réforme parlent d’eux-mêmes. L’office statistique central irlandais, qui avait souligné que les prix des biens soumis aux interdictions du Groceries Order Act avaient augmenté de 7,4 % entre juin 2001 et juin 2005 alors que les prix des autres biens avaient baissé de 5,1 % sur la même période, a en effet observé un net infléchissement de tendance depuis mars 2006. Entre mars 2006 et novembre 2007, les prix des biens relevant auparavant de la loi de 1987 n’ont augmenté que de 1,2 % tandis que ceux des autres biens se sont accrus de 3,9 % et que l’inflation générale a atteint 6,1 %. En outre, ni les commerçants, ni les consommateurs n’ont jusqu’alors évoqué quelque effet pervers de la nouvelle législation. C’est dire que la réforme entreprise en 2006 semble avoir totalement atteint son objectif.
Cette illustration montre que l’augmentation sensible des prix des produits de grande consommation enregistrée ces derniers mois en France n’est pas une fatalité. Certes, le contexte international, marqué par une recrudescence importante de la demande intérieure des pays en voie de développement, conduit à un renchérissement des matières premières et des biens de consommation ; pour autant, l’envolée des prix constatée dans notre pays résulte également de problèmes structurels auxquels le législateur se doit d’apporter une solution.
Afin de protéger le petit commerce, la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973 (13), confortée et durcie par la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat du 5 juillet 1996 (14), a soumis à une autorisation administrative l’implantation de nouvelles surfaces commerciales ainsi que l’extension des surfaces existantes. Auparavant, seule l’obtention du permis de construire était requise alors que, désormais, toute création ou extension d’établissement dont la surface est supérieure à 300 m2 doit être approuvée par une commission départementale d’équipement commercial (CDEC), comprenant des élus locaux, des membres de la chambre de commerce et d’industrie ainsi que de la chambre des métiers et des représentants des consommateurs.
L’organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a elle-même démontré que notre pays était l’un de ses membres qui pose le plus de barrières réglementaires à l’entrée dans le commerce de détail, comme en atteste le graphique ci-après.
INDICATEURS SYNTHÉTIQUES DE LA RÉGLEMENTATION DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL*
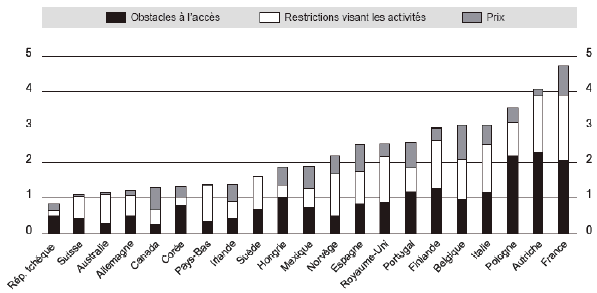
*Les indicateurs sont exprimés du degré le moins restrictif au degré le plus restrictif (échelle de 0 à 6)
Source : OCDE
Les lois Royer et Raffarin ont indéniablement freiné l’essor des implantations ex nihilo (le taux de croissance moyen du nombre d’hypermarchés étant passé de 8 % sur la période 1986-1996 à 2,5 % entre 1997 et 2004) ainsi que l’arrivée sur le marché national des hard discounters. Pour autant :
– d’une part, elles n’ont pas consolidé les positions des petits commerces, les grands groupes misant sur l’installation en centre ville de supérettes de moins de 300 m2 ;
– d’autre part, elles ont indirectement conforté les parts de marché acquises localement par les distributeurs installés avant 1996, l’essentiel des autorisations administratives portant sur des extensions de surfaces existantes.
Parallèlement, les distributeurs ont procédé à des regroupements, accroissant ainsi leur domination sur certaines zones de chalandise. C’est ainsi que les cinq premiers grands groupes de distribution (Auchan, Leclerc, Carrefour, Casino et Intermarché) contrôleraient, selon l’association UFC-Que choisir, environ 67 % du marché des produits de grande consommation. Une récente étude du cabinet spécialisé Asterop, publiée dans le quotidien « La Tribune » le 6 mars 2008, conforte d’ailleurs ce constat : dans 57 % des 630 bassins de consommation français étudiés, un seul et même distributeur alimentaire dominerait avec une part de marché de plus de 25 %, supérieure de quinze points à son principal concurrent. A peine 27 % de ces zones de consommation accueilleraient deux distributeurs importants, tandis que la concurrence jouerait réellement sur seulement 13 % du territoire.
RECENSEMENT DES POSITIONS DOMINANTES
DES GROUPES DE DISTRIBUTION SELON ASTEROP
Distributeurs |
Carrefour |
Leclerc |
Système U |
Mousquetaires |
Auchan |
Casino |
Cora |
Nombre de zones de leadership |
119 |
101 |
57 |
46 |
17 |
13 |
7 |
Source : Asterop, La Tribune. | |||||||
Pour toutes ces raisons, une évolution de la législation française sur l’équipement commercial est devenue incontournable. Dans un récent avis sur le sujet, le Conseil de la concurrence a d’ailleurs mis en exergue « ses effets distorsifs sur les acteurs présents, sur leur nombre, sur leur choix en matière d’investissement, de localisation, de mode de développement et donc sur la structure concurrentielle du marché » (15).
La Commission européenne ayant estimé notre législation contraire au principe de liberté d’établissement et de prestation de services ainsi qu’à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (16), dans un avis motivé adressé à la France fin 2006, il a été mis en place une commission de modernisation de l’urbanisme commercial qui a formulé des propositions en février 2007. Depuis lors, le Conseil de la concurrence et la Commission de libération de la croissance française ont milité pour une réforme plus profonde du système, assortie de garde-fous. Leurs propositions consistent essentiellement, d’une part, à appliquer plus largement le droit de la concurrence classique, notamment par un abaissement des seuils de contrôle des concentrations d’enseignes de distributeurs et l’octroi au ministre chargé de l’économie de la possibilité d’examiner d’office les opérations de croissance externe qui apparaissent susceptibles de porter atteinte à la concurrence et, d’autre part, à prendre davantage en considération les effets des implantations d’équipements commerciaux au niveau du permis de construire avec l’insertion d’une section qui leur serait dédiée dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT), sur le modèle des actuels schémas de développement commercial.
Le Gouvernement a finalement opté pour une réforme moins tranchée mais qui transformera néanmoins sensiblement le régime juridique de l’équipement commercial en le rendant compatible avec les exigences communautaires. C’est ainsi que, pour répondre aux enjeux d’une concurrence effective, de l’aménagement du territoire et du développement durable tout en fluidifiant les procédures, le projet de loi prévoit :
– de renouveler les critères sur la base desquels les autorisations d’implantation ou d’extension des équipements commerciaux sont prises, de manière à mieux cerner les effets des projets sur l’aménagement du territoire et le développement durable ;
– de simplifier et de cantonner les procédures aux opérations les plus significatives, grâce à un relèvement des seuils d’application (à 1 000 m2 notamment, pour toute implantation nouvelle), à une réduction par deux des délais d’examen des dossiers et à l’exonération pour certains secteurs, comme l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant ou les concessions automobiles, de l’obligation de recourir à une autorisation préalable d’implantation ou d’extension ;
– enfin, de renforcer le rôle des élus dans les procédures, ceux-ci détenant désormais la majorité des sièges (cinq sur neuf) au sein des nouvelles commissions départementales qui prendront leurs décisions à la majorité absolue de leurs membres présents.
L’enjeu de cette réforme dépasse le strict cadre de l’urbanisme commercial. En effet, elle va de pair avec la modernisation des modalités de négociation tarifaire car, comme l’a fort justement souligné le rapport du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « une faible intensité concurrentielle risque de limiter les effets de la négociabilité des tarifs à un transfert de marge du fournisseur vers le distributeur » (17).
La régulation de la concurrence en France répond à un schéma institutionnel relativement complexe et, il faut bien le reconnaître, insatisfaisant. Dans le prolongement de la loi du 19 juillet 1977 (18), instituant une commission de la concurrence disposant d’un rôle consultatif en matière d’ententes et d’abus de position dominante, l’ordonnance du 1er décembre 1986 (19) a confié à une autorité administrative indépendante – le Conseil de la concurrence – le soin de qualifier et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, le ministre chargé de l’économie demeurant compétent en matière de contrôle des concentrations.
Cette dualité constitue un particularisme en Europe, le Luxembourg étant le seul pays à avoir conservé un système identique au nôtre. Depuis plusieurs années, de nombreuses réflexions sur le sujet ont prôné un alignement sur l’organisation qui prévaut dans vingt-cinq des États membres de l’Union européenne. La dernière en date émane de la Commission pour la libéralisation de la croissance française, qui y a consacré ses décisions 187 à 190 (20).
Le regroupement sous la houlette d’une même autorité des pouvoirs de régulation des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations est devenu indispensable pour au moins deux raisons essentielles.
La première de ces justifications a trait à la mise en cohérence du dispositif national avec les autres composantes du réseau des autorités européennes de concurrence (REC), créé en octobre 2002. Or, comme l’a indiqué M. Bruno Lasserre, président du Conseil de la concurrence, à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu lors du vingtième anniversaire de l’institution : « Comment fonctionner durablement en symbiose si l’on est trop différent ? » (21). La seconde raison réside dans une recherche d’efficacité accrue, la concurrence la plus libre et parfaite possible favorisant, selon la théorie économique, la fixation des prix à leur niveau le plus juste ainsi qu’une croissance plus robuste.
Depuis que l’Espagne a confié, en 2007, la mission d’assurer la régulation concurrentielle à une seule et même autorité indépendante, la France est le dernier grand pays européen à dissocier la sanction des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations. Ce particularisme est source de complexité, voire de confusion. Plus qu’une simple normalisation de la situation française, la réforme proposée par le Gouvernement vise à lui donner davantage de cohérence.
a) La dichotomie actuelle des compétences du Conseil de la concurrence et du ministre chargé de l’économie
Le Conseil de la concurrence n’est actuellement pas la seule autorité nationale compétente pour apprécier l’application de l’ensemble du droit de la concurrence.
Il joue un rôle décisionnel pour le règlement des litiges en matière d’ententes (aux termes de l’article L. 410-1 du code de commerce) et d’abus de position dominante (selon l’article L. 410-2 du même code), pratiques prohibées au regard desquelles il instruit les affaires dont il se saisit d’office ou dont il peut être saisi par le ministre chargé de l’économie, par les organismes professionnels ou par une entreprise. Un de ses rapporteurs est alors chargé de l’instruction du dossier mais l’enquête préalable reste du ressort de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui seule dispose des effectifs – 995 équivalents temps plein affectés à cette mission, aux termes de la loi de finances pour 2008 – et du maillage territorial nécessaires pour mener des investigations approfondies : chaque année, ses enquêteurs détectent ainsi plus de 550 indices de pratiques anticoncurrentielles, dont près de 150 donnent lieu à des enquêtes ; sur la base de celles-ci, le ministre chargé de l’économie saisit le Conseil entre quinze et vingt fois par an (22).
Investi de pouvoirs quasi-juridictionnels, le Conseil de la concurrence peut prononcer, lorsque l’instruction conclut à une violation de la loi, des sanctions prenant soit la forme d’injonctions de mettre un terme aux pratiques reconnues comme illégales, soit des amendes à l’égard des entreprises mises en cause (celles-ci ayant atteint le total de 221 millions d’euros en 2007). Il use de telles prérogatives dans plus de 50 % des affaires qui lui sont soumises par les services de la DGCCRF.
En matière de contrôle des concentrations, en revanche, le rôle du Conseil n’est que consultatif. En effet, l’article L. 430-3 du code de commerce dispose que les opérations de concentration doivent être notifiées au ministre chargé de l’économie, c’est-à-dire à la DGCCRF. La saisine du Conseil n’intervient, dans les faits, que s’il existe une crainte d’atteinte sensible à la concurrence ; elle a pour effet d’allonger automatiquement la procédure de quatre à cinq mois. Dans ce cadre, les services d’enquête de la DGCCRF se trouvent placés à la disposition du Conseil mais, pour des raisons d’indépendance, ses rapporteurs peuvent exciper des mêmes pouvoirs d’investigation. L’avis de l’autorité administrative indépendante ne lie aucunement le ministre, qui rend seul une décision d’autorisation ou de refus des concentrations n’excédant pas le seuil au-delà duquel la Commission européenne est compétente.
Depuis l’adoption de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 (23), qui a notamment rendu obligatoire la notification des concentrations au ministre chargé de l’économie, le nombre de saisines du Conseil de la concurrence a considérablement diminué, passant d’une douzaine chaque année à trois en 2005 puis deux en 2006 et en 2007. Ainsi que l’indique le rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance française : « Ce chiffre est deux à quatre fois inférieur à celui constaté dans les États membres de l’UE dont la population, le niveau de richesse, le tissu entrepreneurial et le marché sont comparables à la France (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni). Cette situation ne permet pas aux acteurs du contrôle des concentrations d’être aussi performants qu’ailleurs. » (24).
La réforme envisagée par le présent projet de loi tient compte des préoccupations qui avaient initialement conduit le législateur, en 1977, et le groupe d’experts pour l’élaboration d’un nouveau droit de la concurrence, présidé par M. Jean Donnedieu de Vabres, en 1986, à confier au pouvoir politique un droit de regard sur les concentrations. Nul ne saurait en effet contester que l’État doive conserver la possibilité d’avoir une appréciation politique des situations, grâce à l’intervention du ministre chargé de l’économie. Toutefois, il est tout aussi indéniable que l’enquête de la DGCCRF et l’instruction du Conseil gagneront à davantage de synergies, ce qui n’empêchera pas que le politique ait le dernier mot, comme en Allemagne où l’office fédéral des cartels (Bundeskartellamt) apprécie le bilan concurrentiel de la concentration et où le ministre chargé de l’économie ne statue qu’ensuite sur son bien-fondé, en fonction du bilan économique et social de l’opération.
Le 28 janvier 2005, une charte de coopération entre le Conseil et la DGCCRF a été signée afin de formaliser les objectifs de délais incombant à chacun, ainsi que les prérogatives respectives des enquêteurs et des rapporteurs. Cette démarche a donné des premiers résultats intéressants ; il faut y voir un encouragement à la réforme proposée au Parlement aujourd’hui, qui va jusqu’au bout de la logique du rapprochement initialement engagé tout en recentrant la décision finale du ministre sur les aspects stratégiques des opérations.
Au sein de l’Union européenne, la structure des autorités nationales de concurrence varie d’un pays à l’autre. Dans certains États membres, un seul organisme instruit les affaires et adopte tous les types de décisions. Dans d’autres, les rôles sont répartis entre deux organismes, l’un chargé d’instruire les affaires, l’autre – souvent un collège – chargé de statuer. Enfin, dans certains États membres, les décisions d’interdiction ou infligeant une amende ne peuvent être prises que par une juridiction.
Dans ce contexte, alors que notre droit de la régulation concurrentielle était considéré en 1986 comme précurseur, – nombre d’autres États membres de ce qui constituait alors la Communauté économique européenne l’ayant pris pour modèle –, il n’en va plus ainsi aujourd’hui. Dernier pays aux caractéristiques similaires au nôtre à avoir conservé un contrôle ministériel spécifique sur les concentrations, l’Espagne vient en effet de se rallier au modèle d’une autorité de la concurrence unique avec la promulgation, le 3 juillet 2007, d’une loi de défense de la concurrence (loi 15/2007). Désormais, seul le Luxembourg a un système identique à la France, en vertu d’une loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence.
En théorie, cette singularité française ne pose pas de difficulté particulière s’agissant de la coopération et de la coordination des autorités nationales avec leurs homologues européennes, appartenant au réseau européen de la concurrence. En effet, l’article 35 du règlement (CE) 1/2003 (25), qui a institué un régime de compétences parallèles permettant à la Commission européenne et aux États membres de veiller collégialement au respect des dispositions des traités en matière de concurrence, autorise les vingt-sept à choisir le ou les organismes désignés comme autorités nationales de concurrence et à leur assigner leurs compétences. Ainsi que l’a remarqué M. Émile Paulis, directeur général adjoint de la concurrence auprès de la Commission européenne, lors d’un récent colloque : « la flexibilité des règles est clairement la clé de la réussite. Le système n’aurait jamais fonctionné si les règles avaient été rigides. » (26).
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE RÉGULATION CONCURRENTIELLE
EN VIGUEUR DANS L’UNION EUROPÉENNE
Nature du système de régulation concurrentielle en vigueur |
Autorité unique de la concurrence |
Système dual (autorité indépendante + contrôle ministériel) |
Pays |
Belgique (Autorité de la concurrence) ; Bulgarie (Commission de la protection de la concurrence) ; République tchèque (Office pour la protection de la concurrence) ; Danemark (Autorité de la concurrence) ; Allemagne (Office fédéral des cartels) ; Estonie (Autorité de la concurrence) ; Grèce (Commission de la concurrence) ; Espagne (Commission nationale de la concurrence) ; Irlande (Autorité de la concurrence) ; Italie (Autorité garante de la concurrence et du marché) ; Chypre (Commission pour la protection de la concurrence) ; Lituanie (Office de la concurrence), Lettonie (Conseil de la concurrence de la République) ; Hongrie (Autorité de la concurrence) ; Malte (Office de la concurrence équitable) ; Pays-Bas (Autorité de la concurrence) ; Autriche (Autorité fédérale de la concurrence) ; Pologne (Office de la concurrence et de la protection des consommateurs) ; Portugal (Autorité de la concurrence) ; Roumanie (Conseil de la concurrence) ; Slovénie (Office de protection de la concurrence) ; Slovaquie (Office anti-monopoles) ; Finlande (Autorité de la concurrence) ; Suède (Autorité de la concurrence) ; Royaume-Uni (Office du commerce équitable). |
France (Conseil de la concurrence et DGCCRF) Luxembourg (Conseil de la concurrence et inspection de la concurrence) |
Source : Commission européenne. | ||
Il reste que les subtilités du schéma institutionnel actuellement en vigueur en France ne sont pas toujours suffisamment bien perçues par les autres autorités nationales de la concurrence, avec lesquelles le Conseil de la concurrence et la DGCCRF sont censés coopérer. Ce constat est d’ailleurs largement partagé par le président du Conseil de la concurrence qui, à l’occasion du colloque précédemment mentionné, posait ouvertement la question suivante : « Comment être à l’aise dans un réseau si l’on est pas relativement semblable aux autres ? » (27).
En définitive, une autre organisation de la régulation concurrentielle s’impose. La réforme envisagée apparaît d’autant plus justifiée et équilibrée que le pouvoir politique conservera un droit de regard, à l’image des solutions retenues en Espagne et en Allemagne, où le ministre chargé de l’économie reste responsable du bilan économique et social des concentrations et peut ainsi passer outre les conclusions de l’autorité de la concurrence, sur la base de raisons d’intérêt général qui priment sur la logique concurrentielle.
La création de la nouvelle Autorité de la concurrence, reprenant les attributions du Conseil de la concurrence tout en intégrant des compétences auparavant du ressort du ministre chargé de l’économie, vise à renforcer substantiellement les conditions d’exercice de la compétition économique en France. Cette démarche n’est donc pas dictée par un quelconque esprit de conformisme mais bien par un souci d’efficacité, faisant écho à ce constat sans appel de M. Bruno Lasserre : « l’esprit de la réforme de 1986 n’a pas été complètement respecté. Les auteurs de l’ordonnance voyaient dans les deux autorités qu’ils ont mises sur pied l’occasion de les faire travailler ensemble. Or, que constatons-nous aujourd’hui ? Chaque autorité s’est spécialisée dans un domaine : le Conseil dans les pratiques anticoncurrentielles et le Ministre dans le contrôle des concentrations. » (28).
Attribuer à la seule Autorité de la concurrence le contrôle des opérations de concentration, au regard de leurs incidences concurrentielles (et non de leur opportunité), aura pour effet non seulement de simplifier considérablement les procédures mais aussi de lever tout doute sur l’impartialité de l’autorité assumant la régulation concurrentielle. Sur ce dernier aspect, comme l’a souligné le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française : « la confusion des rôles entretient la suspicion : l’analyse du ministre s’expose en effet à la critique de dissimuler des considérations extérieures à la concurrence derrière un raisonnement concurrentiel, comme l’a souligné l’OCDE. Cela nuit considérablement à la crédibilité des décisions de concentration et rejaillit sur l’influence des autorités de concurrence françaises, tant auprès de nos partenaires européens que vis-à-vis de la Commission européenne. » (29).
Dans ce contexte, un rapprochement plus étroit des enquêteurs de la DGCCRF avec les rapporteurs du Conseil de la concurrence apparaît inéluctable. Leurs activités sont en effet indissociables et entraînent des interactions permanentes, sur le fond comme dans le temps.
Le choix de conférer à la nouvelle Autorité de la concurrence la possibilité de donner de sa propre initiative des avis sur les effets concurrentiels de mesures législatives et administratives répond, quant à lui, à une aspiration des membres de l’actuel Conseil de la concurrence. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, le Conseil ne peut en effet donner son point de vue que s’il est sollicité à cet effet par le Gouvernement ou des personnes habilitées. C’est ainsi, par exemple, qu’il n’a pu émettre ses observations sur la loi Galland de 1996 que plus de huit ans après sa promulgation, sa saisine sur le sujet par l’UFC-Que Choisir étant intervenue en 2004 (30). En vertu de la réforme permise par le présent projet de loi, une telle situation ne devrait plus se reproduire.
Au total, la nouvelle Autorité de la concurrence sera pourvue d’un vaste éventail de compétences, avec une capacité élargie d’autosaisine. Elle pourra aussi assumer plus facilement ses attributions et exercer un contrôle plus efficace, pour le plus grand profit de l’économie française en général.
Sous la XIIème législature, le Parlement s’était déjà évertué à favoriser la création d’entreprises. Les dispositions introduites notamment dans la loi du 1er août 2003 (31), pour l’initiative économique, ainsi que dans la loi du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (32), ont porté leurs fruits, comme en attestent les chiffres de INSEE, retracés dans le graphique ci-après. Le nombre de créations d’entreprises est en effet passé de quelque 170 000, en 1998, à plus de 328 000, fin 2007.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES DEPUIS 1998
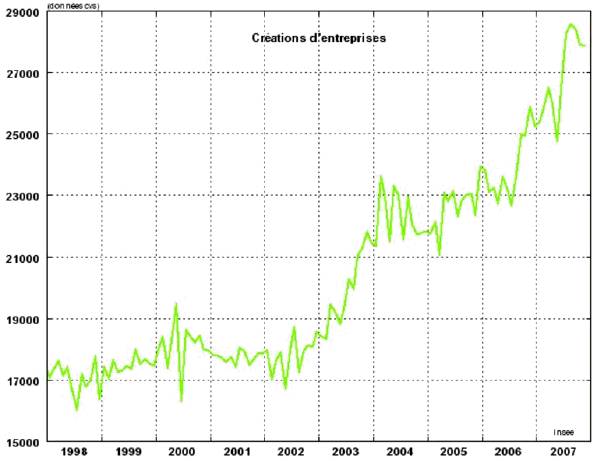
Ces résultats encourageants ne doivent pas pour autant occulter que l’exacerbation de la concurrence internationale a également pour effet la disparition d’un nombre plus important de sociétés : les procédures collectives ont ainsi augmenté de 4,9 % en 2007 par rapport à 2006. Les mesures du présent projet de loi en faveur de la simplification de l’environnement des entreprises françaises et de la création d’activités nouvelles apparaissent donc, à cet égard, bienvenues.
Par besoin d’autonomie ou parce que le marché de l’emploi ne leur donne pas satisfaction, certaines personnes décident un jour de lancer leur propre activité et de devenir travailleur indépendant (« freelance » selon la terminologie anglo-saxonne). Ce faisant, elles se trouvent tout à la fois entrepreneur, propriétaire (de leurs moyens de production) et employé. Maîtres de leurs décisions, elles répondent néanmoins à certaines spécificités juridiques, sociales et fiscales qui, dans certains cas, ne sont pas sans soulever quelques difficultés au quotidien.
Telle est notamment la raison pour laquelle l’évolution des entreprises individuelles en France tend à marquer le pas, alors que dans les pays occidentaux elle participe très activement à la création de richesse nationale. Sur la base des constats dressés le 10 janvier 2008 par M. François Hurel, dans un rapport remis au Gouvernement, le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale vise justement à lever les obstacles les plus pénalisants.
En la matière, le constat de M. François Hurel est parfaitement clair : « Si les besoins immédiats sont immenses, et si les chiffres d’auto-entrepreneurs restent encore trop modestes malgré une croissance de 12 % entre 2001 et 2005 selon l’ACOSS, c’est sans doute parce que la situation légale, réglementaire ou les mentalités françaises n’ont toujours pas permis l’émergence d’un tissu d’indépendants susceptibles de répondre à des demandes notamment ponctuelles » (33).
L’entrepreneur individuel est une personne physique (commerçant, artisan ou profession libérale) qui désire exercer une activité professionnelle de façon lucrative et indépendante. Pour réaliser son activité, il peut :
– en premier lieu, opter pour l’entreprise individuelle à proprement dite, dont le régime juridique est marqué par une grande souplesse (absence de statuts à rédiger mais immatriculation au registre du commerce et des sociétés, absence d’associés, pas de capital mais un apport personnel) et, corrélativement, par l’absence de personnalité juridique et de patrimoine distincts de l’entrepreneur. Dans ce cadre, la responsabilité de ce dernier est solidaire et indéfinie vis-à-vis des dettes de l’entreprise (les droits qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale pouvant toutefois y échapper depuis 2003) et, de surcroît, il ne peut en être le salarié. Découle de cette dernière caractéristique l’assujettissement des bénéfices réalisés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
– en second lieu, créer une société, dont la forme juridique peut dans certains cas être unipersonnelle. Il en va ainsi, notamment, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, instituée par la loi du 11 juillet 1985 (34) et de la société par actions simplifiée unipersonnelle, créée par la loi du 12 juillet 1999 (35).
Seule la première partie de l’alternative correspond aux auto-entrepreneurs dont le projet de loi entend améliorer le statut et les conditions d’exercice de leur activité. Dans les faits, l’atout principal de l’entreprise individuelle réside dans la simplicité de sa mise en place. Bien qu’il n’ait pas à constituer un capital, ni à élaborer des statuts, l’entrepreneur peut passer des actes aussi essentiels que la signature d’un bail commercial ou la souscription d’une location-gérance d’un fonds de commerce existant. Depuis la loi du 1er août 2003, il peut même déclarer comme adresse commerciale celle de son local d’habitation et y exercer une activité sans limitation de durée, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose. Autre avantage potentiel, l’entrepreneur individuel peut cumuler son statut avec celui de salarié d’un autre employeur, sous réserve qu’il ne se trouve pas, dans le premier cas, dans un rapport de subordination équivalent au second.
En dépit de ces avantages, le statut de l’entreprise individuelle semble présenter moins d’attrait que celui des sociétés. Quatre grandes motivations expliquent que, de plus en plus, les créations d’activités nouvelles s’orientent vers la forme sociale. La première est financière, puisque la présence d’associés est le gage d’un apport de fonds. La deuxième est patrimoniale, dès lors que la société a une personnalité et un patrimoine propres et que la responsabilité des associés peut y être limitée à leurs apports. La troisième est fiscale, l’imposition sur le revenu pouvant atteindre un taux marginal plus élevé (de l’ordre de 40 %) que celui de l’impôt sur les sociétés (33,3 %), en cas de bénéfices significatifs ; dans le même ordre d’idées, la transmission d’une société est fiscalement plus avantageuse que la revente d’une entreprise individuelle. Enfin, sauf à être salarié en dehors de son affaire, l’entrepreneur individuel ne peut bénéficier des avantages accordés aux salariés en ce qui concerne l’assurance maladie et l’assurance vieillesse, alors qu’il en va autrement de l’entrepreneur salarié de sa société.
La France comptait, fin 2007, quelque 2,9 millions d’entreprises, dont plus de 2 millions employant moins de 20 salariés. Selon l’INSEE, 1,07 million d’entre elles seraient des entreprises individuelles mais, comme l’a souligné M. François Hurel, « une seule petite partie d’entre elles pourrait se classer dans la catégorie des auto-entrepreneurs, c’est-à-dire ceux qui ont créé une activité pour répondre à un besoin immédiat, et pas une entreprise au sens où on l’entend le plus souvent, c’est-à-dire dans la perspective du long terme » (36). À titre de comparaison, 76 % des 23,5 millions d’entreprises américaines, 75 % des 3,6 millions d’entreprises britanniques et 70 % des quelque 3 millions d’entreprises espagnoles relèveraient de la définition des auto-entrepreneurs (« self employment » ou « autonomos »).
Dans une étude publiée récemment (37), l’INSEE a souligné que si le nombre des entreprises de moins de 20 salariés avait augmenté de 12,4 % entre 1993 et 2006, la forme juridique des sociétés avait largement été privilégiée sur celle des entreprises individuelles. En effet, en valeur absolue, le nombre des entreprises individuelles aurait diminué de 150 000 sur cette période tandis que celui des sociétés aurait progressé de 390 000.
ÉVOLUTION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES (E.I.) AU REGARD DE CELLE DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES (1) SUR LA PÉRIODE 1993-2006
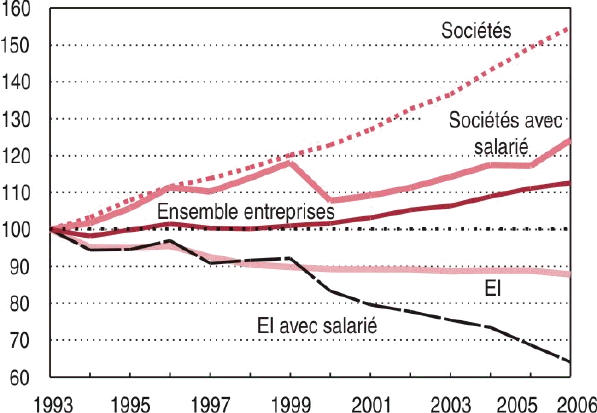
(1) Taux de croissance annuel moyen (base 100 en 1993).
Source : INSEE.
Cette évolution apparaît relativement plus sensible depuis le début de l’actuelle décennie puisque le nombre d’entreprises individuelles diminuerait désormais de 0,3 % chaque année alors que celui des sociétés progresserait de près de 4 % par an. Ce faisant, la part des entreprises individuelles dans l’ensemble des entreprises de moins de 20 salariés serait passée de 63 % en 1993 à 49 % en 2006.
Les tendances mises à jour par l’INSEE souffrent néanmoins quelques nuances, puisque les entreprises individuelles s’adressent surtout à des activités recourant à peu de main d’œuvre : 98 % d’entre elles emploient en effet moins de 10 salariés contre 83 % des sociétés et, en 2006, elles représentaient 63,6 % des entreprises sans salarié. Or, depuis 2000, les entreprises individuelles sans salarié – c’est-à-dire celles correspondant à la catégorie des auto-entrepreneurs – augmentent de 1,5 % par an.
Si cette progression du nombre des auto-entrepreneurs paraît relativement modeste (surtout vis-à-vis de nos voisins étrangers), elle montre toutefois qu’il convient de faire porter prioritairement les efforts sur cette catégorie d’entreprises individuelles qui répond visiblement le mieux aux besoins et aux attentes.
Pour beaucoup de Français, créer son entreprise ressemble assez souvent à un saut dans l’inconnu. Il existe effectivement une crainte forte de passer à l’acte, alors qu’une proportion non négligeable de nos concitoyens déclare vouloir créer une entreprise. Pour satisfaire ces aspirations tout en apaisant les inquiétudes, il apparaît indispensable de prévoir un statut de l’auto-entrepreneur qui permette de ne pas courir de risques inconsidérés pour l’intéressé et sa famille. C’est justement ce à quoi s’emploie le présent projet de loi.
Nonobstant les volets social et fiscal de la démarche, auxquels le succès de la réforme est assurément lié mais qui ne relèvent pas du champ de l’avis de la Commission des Lois, plusieurs aménagements juridiques importants sont prévus pour donner un nouveau souffle à l’activité individuelle en France.
Le principal consiste à élargir l’assiette du patrimoine de l’entrepreneur bénéficiant de l’insaisissabilité actuellement cantonnée à la résidence d’habitation, afin de rendre le patrimoine personnel de l’entrepreneur moins vulnérable vis-à-vis des créances obtenues à titre professionnel. Ainsi que l’explique M. François Hurel : « qu’on le veuille ou non, les grands échecs de grandes entreprises conduisent rarement leurs dirigeants à combler le passif, alors que les petites faillites des petits entrepreneurs conduisent souvent à des désastres qui impliquent non seulement l’entreprise mais aussi la famille de son dirigeant. On peut ainsi affirmer que le risque de l’activité indépendante, même s’il est légitime, n’en est pas moins disproportionné voire inversement proportionnel à la dimension économique et aux capitaux engagés sur le projet. » (38).
Concrètement, des modifications seront apportées à l’article L. 526-1 du code de commerce afin de prévoir la possibilité pour les entrepreneurs individuels d’inclure tout bien foncier bâti ou non bâti parmi les biens insusceptibles d’être saisis par les créanciers. Cette idée n’est pas nouvelle, puisqu’elle est le prolongement d’une réforme engagée en 2005, à travers le vote de la loi en faveur des PME.
De la même manière, le projet de loi vise à améliorer l’utilisation d’un lieu d’habitation à des fins professionnelles. Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans certains départements, l’article 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation impose un certain nombre de conditions : en l’espèce, il faut que l’activité considérée soit exercée par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans le local d’habitation et ne conduise à y recevoir ni clientèle, ni marchandise. Dans les habitations à loyer modéré (HLM), cette mixité d’usage est considérée comme interdite, en raison de l’article L. 311-3 du même code.
Ces restrictions devraient être contournées dans un certain nombre de cas, grâce à divers aménagements portés à plusieurs dispositions du code de la construction et de l’habitation, permettant entre autres aux organismes d’habitation à loyer modéré d’autoriser sous conditions un locataire à exercer une activité professionnelle pérenne, y compris commerciale, dans le local situé au rez-de-chaussée qui lui est attribué. Parallèlement, les conditions d’autorisation de l’exercice d’une activité, y compris commerciale, dans tout ou partie de la résidence principale (hors HLM) seront-elles aussi allégées de manière à rendre de telles éventualités moins hypothétiques. L’ensemble de ces mesures devrait élargir de manière substantielle le public susceptible de créer son entreprise en la domiciliant chez soi.
La place des PME dans l’économie française est significative. En 2005, elles employaient 9 millions de personnes (dont 6,9 millions de salariés), soit 54 % de l’emploi privé et 39 % de l’emploi salarié privé. A cette même date, elles réalisaient 42 % de la valeur ajoutée marchande. C’est dire l’utilité de la mise en œuvre de mesures susceptibles d’amplifier le dynamisme de ces entreprises, telles que celles contenues dans le présent projet de loi.
Ainsi que s’y était engagé le Président de la République lors de l’assemblée générale des entrepreneurs à Lyon, le 7 décembre 2007, le présent projet de loi traite de l’épineuse question des délais excessifs de paiement dans notre pays. Comme l’illustre l’histogramme suivant, le niveau de ces délais constitue indéniablement un problème macroéconomique si l’on en juge la proportion (de l’ordre de 25 %) qu’ils représentent dans le total du bilan comptable de la Nation.
ÉVOLUTION DU POIDS DES CRÉANCES COMMERCIALES DANS LE TOTAL DU BILAN DE 7 PAYS EUROPÉENS (EN 1991, 2001 ET 2005)
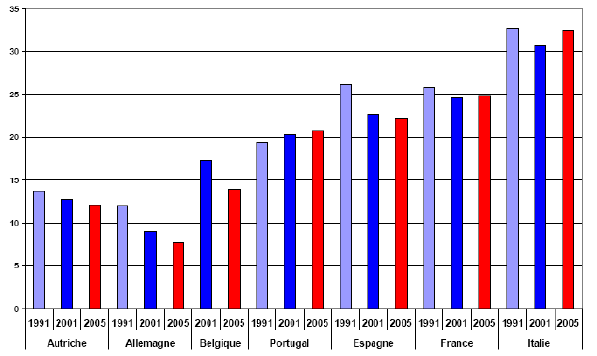
Source : Banque de France, observatoire des entreprises, base Bach.
Par ailleurs, dans ses rapports de 2006 et 2007, l’observatoire des délais de paiement a mis en lumière la situation particulière dans laquelle se trouve la France : ces délais y sont plus longs que dans les autres pays européens alors que les entreprises facturant des intérêts de retard y sont moins nombreuses, en termes relatifs. Un tel constat, dont on mesure les effets nuisibles sur la trésorerie du tissu économique national, et notamment sur celles des très petites entreprises (TPE) et des PME, appelle incontestablement des corrections.
En moyenne, les délais de paiement aux entreprises fournisseurs avoisinent, en France, 65 jours. De ce fait, ils excèdent largement ceux constatés au Danemark (35 jours), en Allemagne (52 jours) et au Royaume-Uni (47 jours). Le tableau ci-après démontre que la situation est contrastée selon les catégories d’entreprises. Si les plus petites se situent en deçà de la moyenne, du fait de leur faible puissance commerciale, les grandes PME et les très grandes entreprises la dépassent de sept à neuf jours. Par voie de conséquence, les très petites et les petites entreprises doivent se constituer un fonds de roulement important pour faire face aux variations de trésorerie alors même qu’elles sont, par définition, les plus exposées aux aléas commerciaux et au risque de restriction du crédit bancaire.
ÉVOLUTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT AUX FOURNISSEURS
ET DES DÉLAIS PAIEMENTS AUX CLIENTS DEPUIS 1990
Nature des entreprises |
TPE |
PME |
Intermédiaires |
Grandes (plus de 500 salariés) |
Toutes tailles (moyenne) | |
Délais d’encaissement des créances contractées par les clients (en jours de chiffre d’affaires) |
1990 |
57,2 |
70,5 |
79,4 |
74,8 |
64,2 |
2005 |
52,0 |
63,4 |
68,0 |
63,9 |
56,2 | |
2006 |
52,4 |
63,7 |
67,4 |
63,7 |
56,5 | |
Délais de paiement auprès des fournisseurs (en jours d’achat) |
1990 |
72,3 |
76,0 |
74,8 |
74,2 |
74,1 |
2005 |
63,6 |
68,0 |
73,3 |
74,2 |
65,1 | |
2006 |
63,5 |
68,0 |
72,7 |
74,1 |
65,2 | |
Solde commercial (en jours de chiffre d’affaires) |
1990 |
4,9 |
22,9 |
33,9 |
28,5 |
14,4 |
2005 |
11,4 |
21,5 |
22,1 |
18,3 |
15,0 | |
2006 |
12,2 |
21,8 |
21,2 |
17,5 |
15,6 | |
Source : rapport de l’observatoire des délais de paiement, 18 décembre 2007. | ||||||
Il ressort des chiffres mis à jour par l’observatoire des délais de paiement que, en l’espace de quinze ans, les entreprises intermédiaires et les grands groupes ont réussi à accélérer les paiements de leurs clients sans pour autant raccourcir le règlement de leurs créances auprès de leurs fournisseurs. A l’inverse, les petites entreprises ont diminué les délais d’encaissement des dettes de leurs clients tout en accélérant le paiement de leurs fournisseurs, exposant ainsi davantage leur propre trésorerie voire même leur survie. A ces fluctuations selon la taille des entreprises s’ajoutent des variations en fonction des secteurs d’activité. Dans son rapport pour 2007, l’observatoire des délais de paiement a ainsi mis en exergue que :
– dans le secteur des biens intermédiaires (chimie, métallurgie, composants électriques et électroniques), les clients paient avec retard (entre 60 et 120 jours), tandis que les fournisseurs sont payés relativement plus tôt ;
– le grand commerce et le commerce spécialisé bénéficient de délais de paiement assez longs (entre 30 et 60 jours) alors même que leurs clients paient comptant ;
– certains secteurs sont marqués par des pratiques hétérogènes, à l’instar du bâtiment où les délais de paiement des clients et ceux des fournisseurs sont très variables.
Malgré tout, bien peu de secteurs donnent l’exemple. En outre, l’État, qui est un client majeur de l’économie française, ne montre pas toujours la voie à suivre. Le délai global avec lequel il honore ses créances vis-à-vis des entreprises est certes inférieur à ceux des entreprises débitrices mais il reste important puisqu’il excède un mois. Pour cette raison, un effort particulier doit également intervenir au niveau des administrations publiques.
LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Délais moyens d’ordonnancement |
Délais moyens de transmission |
Délais moyens de paiement |
Délais globaux, en moyenne | |
2005 |
27,6 jours |
3,5 jours |
1,3 jour |
32,3 jours |
2006 |
37,1 jours |
2,9 jours |
1,5 jour |
41,5 jours |
2007 (1) |
20,8 jours |
2,7 jours |
1,1 jour |
24,7 jours |
(1) Au 31 juillet. Source : rapport de l’observatoire des délais de paiement, 18 décembre 2007. | ||||
Le présent projet de loi entend limiter à 60 jours calendaires – et non 60 jours dits « fin de mois », dont la computation ne débuterait qu’à la fin d’un mois civil – ou 45 jours « fin de mois » les délais de paiement des entreprises à leurs fournisseurs. Dans le même temps, par voie réglementaire, les délais de paiement pour les marchés publics ont récemment été ramenés de 45 à 30 jours (39).
Parallèlement, les pénalités de retard applicables, actuellement fixées à une fois et demie le taux d’intérêt légal, se verront fortement majorées, afin de dissuader les mauvais payeurs de persévérer dans leurs comportements préjudiciables à l’économie toute entière. Encore faut-il que les entreprises victimes de délais de paiement abusifs se saisissent des instruments que le législateur va mettre à leur disposition, 11 % seulement d’entre elles facturant des intérêts de retard en 2005 contre 54 % en Allemagne, 39 % en Belgique et 25 % en Espagne.
L’idée sous-jacente au dispositif soumis à l’examen du Parlement consiste à mettre rapidement un terme aux abus, tout en incitant les intéressés à échafauder, par la négociation, un système permettant à notre pays de converger avec la moyenne européenne d’ici 2009.
Ce type d’encadrement n’est pas en soi inédit, l’article 26 de la loi du 5 janvier 2006 (40) ayant introduit dans l’article L. 441-6 du code de commerce une disposition spécifique au transport routier de marchandises prévoyant que « les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture ». La généralisation de ce type de règles relève, en revanche, d’une démarche nouvelle mais, à en juger par la rapidité des résultats obtenus dans le secteur des transports, une telle intervention législative apparaît parfaitement justifiée.
LES EFFETS RAPIDES DES MODIFICATIONS DE LA LOI
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
Nature des entreprises |
TPE |
PME |
Intermédiaires |
Grandes (plus de 500 salariés) |
Toutes tailles (moyenne) | |
Délais d’encaissement des créances contractées par les clients (en jours de chiffre d’affaires) |
2005 |
66,2 |
68,9 |
59,6 |
57,6 |
67,3 |
2006 |
58,6 |
60,5 |
50,3 |
53,2 |
59,3 | |
Délais de paiement auprès des fournisseurs (en jours d’achat) |
2005 |
54,2 |
57,1 |
63,3 |
64,9 |
56,0 |
2006 |
49,1 |
52,5 |
57,9 |
62,6 |
51,2 | |
Solde commercial (en jours de chiffre d’affaires) |
2005 |
29,8 |
34,6 |
22,4 |
19,0 |
31,9 |
2006 |
26,2 |
29,2 |
16,6 |
16,6 |
27,4 | |
Champ : entreprises de plus de 0,75 million d’euros de chiffre d’affaires. Source : rapport de l’observatoire des délais de paiement, 18 décembre 2007. | ||||||
Sur la seule année 2006, les délais de paiement des entreprises de transport vis-à-vis de leurs fournisseurs ont été réduits, en moyenne, de cinq jours, la tendance apparaissant plus marquée au niveau des TPE et des PME. Corrélativement, cette évolution a conduit à une diminution de la part des concours bancaires dans les dettes et à une réduction du crédit de court terme pour les entreprises concernées, de sorte que leur situation de trésorerie s’est sensiblement améliorée. De telles incidences militent par elles-mêmes en faveur d’un élargissement du plafonnement légal des délais de paiement.
Le montant global de la commande publique représente environ 130 milliards d’euros en France et près de 1 500 milliards d’euros en Europe. Ce faisant, l’enjeu de l’accès aux marchés publics est capital car ils représentent tout à la fois une ressource potentielle pour les entreprises qui les décrochent et une forme de reconnaissance, c’est-à-dire un label à l’exportation.
Dans son rapport au Président de la République sur l’accès des PME aux marchés publics, M. Lionel Stoléru le résume en des termes un peu triviaux mais qui ont le mérite de la clarté : « pour vendre à Hong-Kong, mieux vaut être fournisseur de la Reine d’Angleterre que de M. Smith » (41). Or, un tel constat mérite de retenir toute l’attention dès lors que seulement 5 % des PME françaises sont présentes sur des marchés internationaux, contre 12 % de leurs homologues allemandes.
L’importance de l’obtention d’une part significative des marchés publics par les PME est plus ou moins bien prise en considération par les législations et réglementations des États. Pour beaucoup, les États-Unis (qui appliquent le Small Business Act du 30 juillet 1953) font figure de référence en la matière.
Affirmant que « le Gouvernement doit (…) assurer qu’une proportion équitable des marchés publics soit passée avec les petites entreprises », leur législation impose aux administrations fédérales de réserver certains de leurs marchés, en totalité ou partiellement, aux entreprises de moins de 500 salariés (seuil porté à 1 500 pour l’industrie manufacturière), qui enregistrent un chiffre d’affaires oscillant entre 5 millions de dollars (pour les services) et 17 millions de dollars (pour la construction). La réalisation des quotas fixés est vérifiée chaque année. Parallèlement, les grandes entreprises bénéficiaires de marchés publics se voient obligées de sous-traiter aux petites entreprises.
La France, dont les règles nationales – à savoir le code des marchés publics, dont la dernière version remonte à 2006 (42) – obéissent aux prescriptions communautaires – en particulier deux directives du 31 mars 2004 (43) –, est tenue par un certain nombre d’exigences juridiques (au premier rang desquels l’égalité de traitement des candidats) qui empêchent actuellement la mise en œuvre de discriminations préférentielles générales en faveur des PME. La procédure varie selon la nature de l’appel d’offres (travaux ou fournitures de services), selon le montant estimé du marché (selon des tranches) ainsi qu’en fonction de la collectivité publique à l’origine du marché (État ou collectivité locale).
SCHÉMA DES PROCÉDURES ACTUELLES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Seuils (en euros hors taxes) |
Collectivités |
Type de marché |
Passation |
Support de publicité |
De 4 000 à 90 000 € |
Toutes |
Adaptée |
Presse écrite, Internet ou affichage | |
Avis de mise en concurrence avec publicité dans la presse obligatoire | ||||
De 90 000 à 133 000 € |
État |
Fournitures, services |
Adaptée |
journal local agréé pour la publication des annonces légales (JAL), bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et, éventuellement, parution spécialisée |
De 90 000 à 206 000 € |
Collectivités territoriales |
Fournitures, services | ||
Toutes |
Travaux | |||
De 90 000 à 412 000 € |
Opérateurs réseaux |
Fournitures, services, travaux | ||
Appel d’offres avec publicité dans la presse réglementée obligatoire | ||||
Supérieur à 133 000 € |
État |
Fournitures, services |
Ouvert, restreint, négocié, dialogue compétitif |
BOAMP, journal officiel de l’Union européenne (JOUE), avec formulaire NB : pré-information au JOUE si marché d’un montant supérieur à 750 000 euros |
Supérieur à 206 000 € |
Collectivités territoriales | |||
Supérieur à 412 000 € |
Opérateurs réseaux |
Fournitures, services, travaux | ||
De 206 000 à 5,15 millions € |
Toutes |
Travaux |
JAL + parution spécialisée (éventuelle) | |
Au-delà de 5,15 millions € |
Toutes |
Travaux |
Ouvert, restreint, négocié, dialogue compétitif |
BOAMP, JOUE (avec formulaire) NB : pré-information au JOUE |
La conséquence de la rigidité des textes applicables en France se traduit par les chiffres mis en exergue par l’observatoire économique de l’achat public pour l’année 2006. Cet organisme a en effet constaté que les PME, au sens communautaire du terme (c’est-à-dire présentant un nombre de salariés inférieur à 250, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et l’absence d’une participation de 25 % et plus au capital d’une entreprise ne correspondant pas à la définition des PME, de manière à écarter les filiales de grands groupes), ont obtenu 64 % du nombre de marchés publics passés mais seulement 27 % de leur montant global. En outre, la situation apparaît plus dégradée du côté de l’État que de celui des collectivités territoriales, les PME ayant décroché 40 % des marchés de celles-ci en valeur, en 2006, contre 12 % seulement de ceux passés par les administrations régaliennes.
MONTANT DES MARCHÉS PUBLICS ET PART DES PME EN 2006
PME |
Grandes entreprises |
Total | ||||
Valeur absolue |
Pourcentage |
Valeur absolue |
Pourcentage | |||
État |
Nombre de marchés |
10 121 |
52 % |
9 258 |
48 % |
19 379 |
Montant total |
3,06 milliards € |
12 % |
23,23 milliards € |
88 % |
26,29 milliards € | |
Collectivités territoriales |
Nombre de marchés |
96 657 |
65 % |
51 535 |
35 % |
148 192 |
Montant total |
12,46 milliards € |
40 % |
18,67 milliards € |
60 % |
31,13 milliards € | |
Total |
Nombre de marchés |
106 778 |
64 % |
60 793 |
36 % |
167 571 |
Montant total |
15,52 milliards € |
27 % |
41,90 milliards € |
73 % |
57,42 milliards € | |
Source : Observatoire économique de l’achat public. | ||||||
Autre constat riche d’enseignements, le montant unitaire des marchés semble jouer un rôle d’éviction à l’égard des PME. En effet, ainsi que l’illustre le graphique ci-après, la présence des PME dans la commande publique décroît en fonction de la valeur des contrats : à peine 25 % des marchés de l’État supérieurs à 1 million d’euros échoient ainsi à des petites entreprises.
PART DES PME DANS LE NOMBRE DE MARCHÉS
PUBLICS EN 2006, PAR TRANCHES DE MONTANT
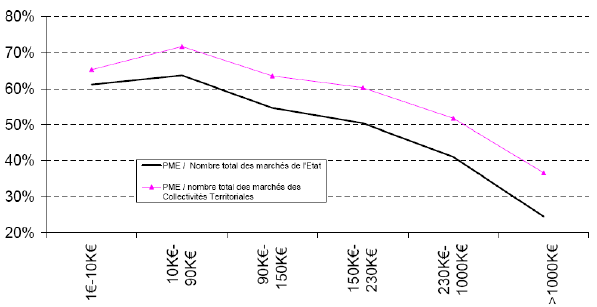
Source : Observatoire économique de l’achat public.
Les raisons sont multiples : outre un défaut d’information des PME sur les marchés en cause, il faut vraisemblablement y voir aussi l’expression de certaines réticences administratives à contracter avec des entreprises moins connues que certains groupes institutionnels, ce que le comité Richelieu, association française des PME de hautes technologies, qualifie de « discrimination négative » (44). La préconisation d’une sensibilisation générale des services de l’État à ce problème crucial, par voie de circulaire du Premier ministre – en complément des dispositions prévues au présent projet de loi –, n’en apparaît que plus justifiée.
b) La réservation de certains marchés publics aux PME innovantes : une ouverture expérimentale qui va dans le bon sens
Selon le Conseil d’analyse économique, les PME françaises ont été sept fois moins nombreuses que leurs homologues américaines à parvenir au sommet de la hiérarchie de leur secteur d’activité depuis 1980 (45). Alors que 40 % des cent premières entreprises américaines ont été créées après 1976, seulement 10 % de leurs homologues françaises se trouvent dans la même situation.
Une partie de l’explication de ce constat tient, selon le comité Richelieu, à ce que les entreprises innovantes ne bénéficient pas suffisamment des marchés publics de recherche et développement (R&D), notamment dans les secteurs aussi essentiels que la défense, l’aéronautique, les énergies et les technologies de l’information (46). A contrario, un récent rapport britannique a qualifié l’investissement public américain dans la R&D de « plus grand fonds de capital risque du monde » (47), mettant ainsi en exergue le fort soutien des États-Unis au développement des entreprises se situant sur des créneaux d’activité ou des technologies jusqu’alors inexplorés.
Il est plus que temps de prendre des initiatives pour remédier, au moins en partie, à cet état de fait en introduisant certains aménagements juridiques dans notre droit des marchés publics. Tant le rapport du comité Richelieu que celui de M. Lionel Stoléru ont souligné que l’introduction dans la législation et la réglementation nationales d’une exception ciblée et bien définie à l’égalité de traitement des candidats aux marchés publics était juridiquement permise par les directives de 2004. Dès lors qu’elles ne sont pas envisagées sous l’angle de leur nationalité, les PME innovantes – c’est-à-dire celles qui investissent un pourcentage significatif de leur chiffre d’affaires dans la recherche –, dont le nombre n’excède pas 5 000 entreprises en France, répondent à ce profil.
Sur la base de cette analyse, le projet de loi prévoit d’autoriser, à titre expérimental et pour une durée limitée à cinq ans, les pouvoirs adjudicateurs qui consacrent un effort particulier à la R&D de réserver aux PME innovantes 15 % du montant annuel moyen de leurs marchés inférieurs aux seuils des procédures formalisées, sur la base d’une moyenne calculée sur les trois années précédentes. Ce mécanisme, selon les propres termes de M. Lionel Stoléru, s’analyse moins comme un quota de marchés à réserver aux PME concernées que comme « une dérogation de procédures pour amener plus facilement les acheteurs publics vers ces PME » (48).
Une telle disposition est importante et nécessaire, quand bien même elle reste transitoire et ne règlera pas tous les problèmes. Elle ouvre la voie à d’autres initiatives que le Président de la République entend prendre au niveau européen, lors de la présidence française de l’Union européenne au second semestre de cette année 2008, en vue de l’adoption d’un Small Business Act européen facilitant l’accès des PME aux marchés publics des États membres.
A l’instar de la plupart de nos concitoyens, les commerçants et artisans ainsi que les dirigeants de PME se plaignent de la complexité croissante des formalités auxquelles ils sont confrontés. L’objectif de simplification de ces formalités apparaît donc en lui-même un moyen de donner un nouveau souffle à l’activité économique, dont une grande partie résulte précisément de ces acteurs.
a) Des formalités moins contraignantes pour les sociétés à responsabilité limitée et par actions simplifiées
Au 30 décembre 2006, on dénombrait quelque 1,55 million de sociétés et d’entreprises à responsabilité limitée (respectivement, SARL et EURL) en France. C’est dire l’adaptation de ce type de sociétés aux besoins des petits entrepreneurs dans notre pays.
Les SARL et les EURL présentent de nombreuses similitudes sauf sur un point : le nombre d’associés, puisque les premières en comportent au minimum deux quand les secondes peuvent n’en avoir qu’un seul. Un certain nombre de caractéristiques intrinsèques expliquent le succès rencontré auprès des créateurs d’entreprise par ces deux catégories de personne morale :
– un coût de constitution faible ou négligeable ;
– l’absence de commissaire aux comptes dès lors que le montant total du bilan n’excède pas 1,55 million d’euros, que le montant hors taxes du chiffre d’affaires est inférieur à 3,1 millions d’euros et que l’effectif ne dépasse pas 50 salariés ;
– la limitation de la responsabilité juridique des associés au montant de leurs apports ;
– enfin, une réelle facilité d’organisation interne, la gestion pouvant être confiée à un ou plusieurs gérants non nécessairement choisis parmi les associés.
La loi du 1er août 2003 a substantiellement accentué ces attraits. En effet, désormais, le capital social est librement fixé par les statuts et aucun minimum légal n’est requis – il était de 7 600 euros auparavant –, de sorte qu’une SARL ou une EURL peut être constituée avec un apport se réduisant à un euro seulement. Parallèlement, l’accès de ces entreprises à des ressources financières s’est trouvé facilité par la création des fonds d’investissement de proximité tandis que l’étalement sur cinq ans du paiement des charges de leurs premières années d’activité a été rendu possible.
Il reste que, sur le plan financier, les SARL s’adressent d’abord aux entreprises familiales et qu’elles s’avèrent inadaptées pour lever des capitaux extérieurs. Ce faisant, elles ne conviennent pas aux entreprises qui ont besoin de faire appel au marché financier pour se développer. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les sociétés par actions simplifiées (SAS), dont le fonctionnement interne relève pour une bonne part de la seule volonté des associés, attirent de plus en plus les PME aujourd’hui, et notamment les plus innovantes puisque leur profil majoritaire est une association d’entrepreneurs et d’investisseurs dans le cadre d’opérations de capital-risque (leverage buy out - LBO). Depuis que la loi du 12 juillet 1999, précédemment mentionnée, a assoupli leurs conditions de création, leur nombre va croissant au point de rattraper progressivement celui des sociétés anonymes : alors qu’elles étaient 4 500 en 2000 (contre 225 000 sociétés anonymes), elles ont atteint le chiffre de 100 000 en 2003 (contre 160 000 sociétés anonymes).
En visant l’amélioration du fonctionnement de ces deux catégories de sociétés (SARL et SAS), le projet de loi ne se trompe pas de cible. Faciliter leur création et alléger le poids des contraintes qui pèsent sur leur vie quotidienne (par une diminution des formalités de publicité, une utilisation plus aisée de statuts types ou un recours à des instruments de téléconférence pour faciliter le fonctionnement des organes sociaux, pour les premières, et par un assouplissement du recours aux commissaires aux comptes ainsi que des exigences de capital minimum, pour les secondes) constituent autant de simplifications indispensables au renforcement de leur attractivité juridique et pratique. Une telle démarche apparaît effectivement indispensable car une bonne part de la croissance française de demain réside dans la vitalité et le dynamisme de ces vecteurs juridiques de nos PME familiales et innovantes.
Bien que l’existence d’échoppes commerciales assimilables à de véritables fonds de commerce remonte au Moyen-âge, ce n’est qu’en 1804 qu’est apparu dans le code civil un régime juridique sur le contrat de louage des choses faisant état de bail à loyer. La valeur économique du fonds de commerce ne sera reconnue qu’en 1909 et les droits du locataire ne se verront formalisés qu’en 1926, avant d’être renforcés par le décret du 30 septembre 1953 (49), qui – codifié désormais au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce – constitue aujourd’hui encore le socle juridique des baux commerciaux.
Les baux commerciaux portent sur la location d’un local dans lequel un fonds de commerce est exploité par une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Afin de préserver le preneur, leur durée ne peut être inférieure à neuf ans ; toutefois, le preneur dispose de la faculté de les résilier à l’expiration d’une période triennale, dans les formes convenues à l’article L. 145-9 du code de commerce (congé donné six mois à l’avance, notamment).
Si le loyer d’origine est librement fixé, son évolution se trouve régie par la suite soit par des modalités conventionnelles d’indexation (appelées clauses d’échelle mobile et jouant à la hausse comme à la baisse), soit par un régime de révision légal (prévu aux articles L. 145-34, L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce). Jusqu’à présent, l’indice retenu dans le second cas était celui du coût de la construction (ICC), plutôt favorable aux bailleurs puisque, entre 2000 et 2006, il a conduit à une augmentation moyenne de 32 % des loyers quand, dans le même temps, le chiffre d’affaires des commerçants et artisans ne progressait que de 18 %.
Le 20 décembre 2007, les principaux représentants des propriétaires et des utilisateurs de locaux commerciaux ont signé un accord sur un nouveau mode de révision des loyers, reposant sur un indice de calcul composé à 50 % de l’indice des prix à la consommation (IPC), à 25 % de l’ICC et à 25 % de l’indice du chiffre d’affaires de vente du commerce de détail (ICAV). Ce nouvel indice doit mieux tenir compte des contraintes des commerçants et artisans sans léser les propriétaires des locaux commerciaux ; ce faisant, il devrait contribuer à dynamiser l’activité du petit commerce dans les zones urbaines.
Le projet de loi vise à favoriser le recours à ce nouvel indice, en modifiant pour ce faire les dispositions du code monétaire et financier qui, actuellement, empêchent de s’y référer.
III. – LE RÉAJUSTEMENT, PAR ORDONNANCE, DES PROCÉDURES COLLECTIVES : PRIVILÉGIER LE REBOND DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS
Il a fallu attendre l’année 2005 pour que la France accorde une plus large place, dans la loi, à la prévention des difficultés des entreprises. La consécration du mandat ad hoc, la modernisation du règlement amiable à travers la conciliation et, surtout, la création d’une procédure judiciaire préventive – la sauvegarde – s’inspirant du titre XI du chapitre XI de la législation américaine sur les faillites (US bankrupcy Code) ont représenté des avancées considérables pour notre droit des sociétés. Privilégiant l’accompagnement du chef d’entreprise, la recherche de solutions négociées et le maintien de l’activité, ces innovations de la loi du 26 juillet 2005 (50) avaient pour objectif d’inverser – du moins d’infléchir – l’exception française qui consistait à laisser plus de 70 % des procédures collectives concernant des entreprises défaillantes déboucher sur une liquidation judiciaire. Cependant, ainsi que l’a souligné le Président de la République lors de son allocution du 6 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Paris, à l’occasion de l’exposition nationale sur le bicentenaire du code de commerce :
« La loi de sauvegarde de 2005 a constitué un premier pas dans la bonne direction. Mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d’audace en matière de prévention des difficultés.
Lors du vote de la loi, on s’est à tort, me semble-t-il, réjoui de n’avoir adapté en droit français qu’une partie du chapitre 11 de la loi américaine. Il a en effet été décidé d’imposer aux entrepreneurs de respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le résultat était prévisible ; il est avéré : cette demi-innovation n’est même pas demi-utilisée. »
Ce constat est largement partagé par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale qui, dès janvier 2007 (51), avait examiné et autorisé la publication d’un rapport sur l’application de la loi de sauvegarde des entreprises. Ce document soulignait, d’une part, le caractère limité du nombre de procédures judiciaires préventives ouvertes depuis l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles le 1er janvier 2006 et, d’autre part, les imperfections du cadre législatif retenu dix-huit mois plus tôt.
Dans un contexte de croissance atténuée, il importe de transcrire rapidement dans la loi les aménagements qui s’avèrent nécessaires pour rendre la prévention des difficultés des entreprises plus efficace. Or, eu égard aux réformes ambitieuses actuellement en débat, le calendrier parlementaire ne laisse pas suffisamment de marges de temps pour permettre la discussion approfondie d’un projet de loi retouchant les dispositifs introduits en 2005 dans le livre VI du code de commerce. C’est la raison pour laquelle, faisant primer l’objectif de résultat sur les modalités de la réforme, le Gouvernement a décidé de solliciter du Parlement qu’il l’habilite à mettre en œuvre les modifications qui s’imposent par voie d’ordonnance, comme l’y autorise l’article 38 de la Constitution.
Outre la création de la procédure de sauvegarde, la loi n° 2005-845 a procédé à une refonte générale des procédures applicables aux entreprises en difficultés, tant dans leur volet amiable (avec la consécration du mandat ad hoc et la transformation du règlement amiable en conciliation) que dans leur aspect judiciaire (avec la création de la liquidation judiciaire simplifiée, notamment). Ces innovations, particulièrement pour ce qui concerne le traitement amiable des difficultés, ont eu des résultats tangibles. Elles n’en comportent pas moins quelques imperfections que la pratique s’est chargée de révéler et qui appellent de légers correctifs.
Le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures amiables qui préexistaient à la loi du 26 juillet 2005 mais qui ont pris une nouvelle dimension, suite à leur consécration juridique et aux améliorations qui leur ont été apportées par le législateur.
D’origine prétorienne – puisque résultant essentiellement d’initiatives du tribunal de commerce de Paris lors de l’éclatement de la crise immobilière des années 1990 –, le mandat ad hoc est désormais généralisé à l’ensemble des juridictions commerciales. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance ou de commerce a ainsi la faculté de désigner un mandataire, dont il détermine la mission, invariablement brève. Une négociation peut alors avoir lieu avec les principaux créanciers et débouche, le plus souvent, sur un accord rééchelonnant les créances exigibles.
Régie par les articles L. 611-4 à L. 611-12 du code de commerce, la procédure de conciliation, quant à elle, est issue de l’ancien règlement amiable, dont elle a repris nombre d’attributs. Ouverte dès lors que le débiteur éprouve une difficulté avérée ou prévisible ou s’il se trouve en situation de cessation des paiements depuis moins de 45 jours – ce qui constitue sa principale innovation par rapport à l’ancien règlement amiable –, elle reste confidentielle en l’absence d’homologation par le juge mais le ministère public est informé de son ouverture. Ce faisant, les difficultés rencontrées par le débiteur ne sont pas dévoilées, ce qui peut s’avérer un véritable atout vis-à-vis d’une clientèle potentielle qui, dans le cas contraire, pourrait s’en détourner en constatant que son futur cocontractant est fragile financièrement ou risque de déposer le bilan. La conciliation présente également l’intérêt, pour le dirigeant, de lui permettre de conserver l’intégralité de ses prérogatives et, pour les créanciers, lorsqu’elle est homologuée par le juge, d’éviter tout risque d’annulation des actes passés en période suspecte. En outre, les créanciers qui facilitent la poursuite de l’activité bénéficient d’un privilège de paiement dénommé « privilège de l’argent frais », qui leur permet d’être payés avant les créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation.
Ces multiples avantages ont naturellement favorisé le recours à ces deux procédures. Compte tenu de leur nature confidentielle, les statistiques sur le sujet demeurent partielles. Néanmoins, en 2006, la conférence générale des juges consulaires de France a enregistré une progression de 125 % du nombre de conciliations ouvertes par rapport aux anciens règlements amiables de l’année 2005 (754 contre 335 un an plus tôt). Quant aux mandats ad hoc, en dépit d’un léger tassement ces derniers temps, cette procédure connaît un véritable engouement depuis la fin des années 1990, puisqu’elle est passée de 741 à près de 1 300.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MANDATS AD HOC ET DE RÈGLEMENTS AMIABLES-CONCILIATIONS OUVERTS PAR LES TRIBUNAUX DE COMMERCE DEPUIS 1999
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | |
Mandats ad hoc |
741 |
818 |
809 |
1141 |
1237 |
1446 |
1635 |
1287 |
Règlements amiables/conciliations |
308 |
254 |
245 |
316 |
277 |
314 |
335 |
754 |
Source : confédération générale des juges consulaires de France : statistique des activités de 1995 à 2006 (12 octobre 2007). | ||||||||
Malgré un intérêt certain, qui se traduit par une progression très significative du nombre de procédures ouvertes, la conciliation reste frappée de défauts qui, sans être rédhibitoires, entravent sans doute un développement plus important encore. La réforme envisagée par le Gouvernement vise opportunément à lever ces contraintes sans pour autant révolutionner le subtil équilibre qui caractérise actuellement le régime juridique de la conciliation.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal peut, afin de parfaire sa connaissance de la situation financière, économique et sociale du débiteur qui sollicite l’ouverture d’une conciliation :
– obtenir communication, auprès du commissaire aux comptes (s’il en a été désigné un), ainsi que des membres et représentants du personnel, des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale ou des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements lui permettant d’avoir une connaissance exacte sur la situation du débiteur. Cette démarche, par nature intrusive à l’égard d’un justiciable nécessairement méfiant vis-à-vis de toute investigation judiciaire et administrative à son sujet, constitue à bien y regarder un facteur plutôt dissuasif pour bon nombre de chefs d’entreprises ou de professionnels concernés, alors même qu’ils ont le monopole de l’initiative de la procédure ;
– désigner l’expert de son choix pour lui remettre un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur.
Sur ces différents aspects, plusieurs aménagements intéressants sont envisagés. Pour ce qui concerne le recours à l’expertise, le débiteur aura toujours l’obligation d’exposer, dans sa requête, sa situation économique, sociale et financière, ainsi que ses besoins de financement et ses moyens d’y faire face, mais le président du tribunal ne pourra plus désigner d’expert qu’après sa décision d’ouvrir la conciliation. Ce changement dans la chronologie de la procédure n’est pas anodin ; il favorisera son accélération et, par voie de conséquence, son efficacité. De même, la collecte d’informations complémentaires auprès d’interlocuteurs ou d’administrations diverses au contact du débiteur interviendra également après l’ouverture de la conciliation, de sorte que le débiteur n’aura pas à craindre une forme d’inquisition judiciaire lorsqu’il se décidera à solliciter l’aide des juridictions commerciales. Cette évolution prend opportunément en compte la dimension psychologique sous-jacente à la problématique de l’anticipation et de la prévention des difficultés des entreprises. On peut ainsi supposer que les chefs d’entreprise ou les professionnels concernés seront plus nombreux à franchir le pas.
b) Vers un alignement partiel des avantages de la conciliation constatée sur ceux de la conciliation homologuée
La loi du 26 juillet 2005 a créé deux catégories d’accords de conciliation : les accords constatés par le tribunal, qui leur donne ainsi force exécutoire sans néanmoins entraîner publication ni recours de la décision ; les accords homologués à la demande du débiteur, après audition d’un certain nombre d’intéressés (créanciers, représentants des salariés, conciliateur, ministère public et le débiteur lui-même), qui font l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal et sont susceptibles d’être consultés.
A la différence des premiers, les seconds sont assortis d’un certain nombre d’avantages qui justifient la transparence dont ils font l’objet : en premier lieu, ils suspendent toute action en justice ou poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, pendant la durée de leur exécution ; en second lieu, ils suspendent pour la même durée les délais impartis aux créanciers qui en sont partis prenantes, à peine de résolution des droits afférents à leurs créances ; en troisième lieu, ils entraînent la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ; enfin, ils ouvrent la possibilité aux créanciers qui acceptent de soutenir le débiteur par des concours financiers nouveaux, après l’ouverture de la conciliation, d’être remboursés par privilège sur les créanciers antérieurs (en vertu du privilège dit de la « new money »). A noter également que les personnes physiques coobligées ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des stipulations d’un accord homologué.
En dépit de ces avantages comparatifs assez marqués – et octroyés à dessein –, la conciliation par homologation n’a pas rencontré le succès escompté par le législateur. En effet, dans près de 90 % des cas, le jugement d’homologation n’est pas sollicité, par souci de confidentialité. Ne pas tenir compte de cette situation irait immanquablement à l’encontre de la volonté de favoriser une application plus large de cette procédure dont les résultats, en termes de maintien de l’activité et des emplois, apparaissent très satisfaisants.
Aux termes du projet d’ordonnance transmis à votre rapporteur pour avis, n’importe quel accord constaté devrait lui aussi, désormais, interrompre ou interdire toute action en justice et pourrait arrêter ou interdire toute poursuite individuelle sur les meubles comme sur les immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement de créances concernées par ce même accord. Par ailleurs, les coobligés ainsi que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie pourraient également se prévaloir de l’accord constaté. Ces évolutions contribueront à conforter les effets juridiques de la grande majorité des conciliations réussies. Par voie de conséquence, elles devraient inciter un plus grand nombre de débiteurs en difficultés à s’orienter vers ce type de procédures dès l’apparition de leurs premiers problèmes de trésorerie.
Mais s’ils atténuent les différences entre accords constatés et accords homologués, les aménagements prévus ne les réduisent pas pour autant à néant. En effet, contrairement aux revendications de certains créanciers (les établissements de crédit, notamment), le privilège de l’argent frais demeurera un monopole de la conciliation homologuée. En outre, la levée de l’interdiction d’émettre des chèques mis en œuvre à l’occasion d’un rejet de chèque émis antérieurement à l’ouverture de la procédure restera réservée aux effets des accords de conciliation homologués. La diversité du dispositif actuel ne se trouvera ainsi nullement remise en cause, les parties étant parfaitement libres d’opter soit pour un mécanisme a minima (désormais bien plus attractif, cependant) mais confidentiel, soit pour une procédure offrant davantage de garanties mais publique.
La contrepartie des assouplissements envisagés au niveau des effets des différentes formes de conciliation réside dans une implication plus grande du ministère public dans la procédure. Actuellement, aux termes de l’article L. 611-6 du code de commerce, celui-ci est seulement tenu informé de la décision du président du tribunal d’ouvrir une procédure de conciliation. En soi, cette information est importante dans la mesure où la prévention des difficultés de toute entreprise revêt un intérêt public, notamment dans la perspective d’un phénomène de contagion à tout un bassin d’activité ou d’emplois. De même, le parquet possède souvent des informations qui lui sont propres (couvertes, le cas échéant par le secret de l’instruction) et qui peuvent s’avérer importantes au moment où s’engage la conciliation.
Pour autant, le ministère public ne peut, en l’état, influencer le cours de la procédure car il n’est avisé qu’a posteriori de son ouverture et il ne peut former un quelconque recours à son encontre. Le Gouvernement entend rompre avec cette situation, en offrant la possibilité au ministère public – et à lui seul – d’interjeter appel, voire pourvoi en cassation, de la décision du président du tribunal. Dans le même ordre d’idées, le jugement homologuant l’accord de conciliation, jusqu’à présent uniquement susceptible de tierce opposition aux termes de l’article L. 611-10 du code de commerce, sera également susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du ministère public.
Appréciée à sa juste valeur pour les avantages qu’elle présente, la sauvegarde n’est pas pour autant plébiscitée dans la pratique. La raison de ce constat tient principalement à un ensemble de handicaps ou de limites juridiques, qu’il convient de lever sans attendre.
Créée de toutes pièces à la frontière des mesures amiables concernant les créances non recouvrées, d’une part, et du redressement judiciaire, d’autre part, la sauvegarde a apporté la preuve de son intérêt en l’espace de quelques mois d’existence seulement. Lors de l’examen de la loi du 26 juillet 2005, le législateur s’est attaché à donner à la procédure des attraits bien réels pour les entreprises et les débiteurs concernés, à savoir : une mise à l’abri des poursuites des créanciers, l’institutionnalisation d’un cadre de discussions avec ces derniers – à travers des comités spécifiques –, et le maintien pour le dirigeant social d’un certain nombre de ses prérogatives.
a) La mise en place, sous contrôle du juge, de mesures transitoires destinées à éviter l’insolvabilité et à pérenniser l’activité
L’objectif essentiel de la procédure de sauvegarde est la survie d’un débiteur en difficultés économiques et financières. Dans cette optique, le législateur a adopté des dispositions permettant, d’une part, d’éviter que les créanciers dont le titre de créance est antérieur à l’ouverture de la procédure puissent menacer la pérennité du débiteur en exigeant la liquidation de leur dû et, d’autre part, d’octroyer des concours financiers nouveaux favorisant la poursuite de l’activité.
• Pour tout débiteur se trouvant dans des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et susceptibles de le conduire à une cessation des paiements, c’est-à-dire à un dépassement de son actif disponible par son actif exigible (critères d’ouverture de la sauvegarde posés par l’article L. 620-1 du code de commerce), le desserrement de l’étau financier apparaît primordial. C’est la raison pour laquelle le législateur a adopté un certain nombre de dispositions qui lèvent ou allègent, pendant la période d’observation et jusqu’à l’adoption d’un plan destiné à la continuation de l’activité, les contraintes immédiates de remboursement des créances et qui suspendent les poursuites susceptibles d’affecter le débiteur.
L’article L. 622-7 du code de commerce dispose ainsi que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement. Il s’agit là d’une règle d’ordre public. Cette disposition, qui souffre quelques exceptions limitées par la loi (52), est à mettre en relation avec l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution, prévue à l’article L. 622-21 du même code. Celui-ci interrompt et interdit en effet toute action en justice engagée de la part de tout créancier, dans le but de condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ou de résoudre un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Par cohérence, les voies d’exécution sur les biens meubles ou immeubles sont elles-mêmes suspendues ou interdites. Ce faisant, le débiteur en difficultés se trouve clairement protégé contre les initiatives qui pourraient démanteler son actif et faire ainsi échouer tous les efforts entrepris pour sa survie.
Le législateur ne s’en est pas tenu au seul débiteur, en la matière, puisqu’il a prévu, à l’initiative de l’Assemblée nationale, que le jugement d’ouverture de la sauvegarde suspend également jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Innovation importante de la loi du 26 juillet 2005, cette disposition permet d’éviter que ces personnes, qui jouent un rôle crucial de garantie pour les dirigeants de petites ou moyennes entreprises (notamment familiales), ne soient poursuivies par les créanciers du débiteur pour le montant du principal de sa dette, assorti des intérêts.
À ces mesures, s’ajoutent des dispositions complémentaires importantes puisque :
– en premier lieu, l’article L. 622-29 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la sauvegarde ne rend pas exigibles les créances échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est même réputée non écrite. Par voie de conséquence, à titre d’illustration, tout débiteur ayant emprunté de l’argent sous forme de prêt échelonné conserve le bénéfice des échéances conventionnelles, ce qui évite un alourdissement brutal de son passif exigible et un handicap pour son redressement futur ;
– en second lieu, l’article L. 622-28 du même code dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que celui de tous les intérêts de retard et majorations. Cette règle, qui ne s’applique ni aux intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, ni aux contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, peut désormais être excipée par les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome.
L’ensemble de ces règles n’a pas pour objet de priver les créanciers de leurs droits mais bien de privilégier, au cours d’une période transitoire, toutes les possibilités de poursuite de l’activité et de pérennisation du débiteur, de manière à rééchelonner in fine, de manière contractuelle, le paiement des créances dans un plan négocié et accepté par les comités des fournisseurs et des établissements de crédit, aux termes de l’article L. 626-30 du code de commerce. Ce plan de sauvegarde, qui met un terme à la période d’observation et est censé élaborer une véritable stratégie de redressement, mentionne un certain nombre d’engagements portant tout à la fois sur l’activité (avec, le cas échéant, la prévision de cessions), les modalités de financement et de règlement du passif né avant l’ouverture de la procédure ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Arrêté par le tribunal, il ouvre à proprement parler la phase de rétablissement du débiteur.
• L’incitation à l’octroi de nouvelles facilités de trésorerie en cours de procédure est une autre caractéristique majeure de la sauvegarde. Le souci de garantir l’accès des débiteurs en difficultés, notamment les entreprises, à des financements nouveaux destinés à favoriser la continuation de leur activité n’est pas nouveau. Déjà, l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (53) s’était évertué à prévoir un sort préférentiel aux partenaires acceptant de consentir un crédit après jugement d’ouverture du redressement judiciaire. La loi du 26 juillet 2005 s’est inspirée de cette logique en la faisant intervenir toutefois plus en amont, dans un but d’efficacité accrue.
C’est ainsi que l’article L. 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture soit pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation – notion qui recouvre les frais de justice, les honoraires divers et les frais résultant de l’exécution des contrats en cours, notamment –, soit en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle – catégorie englobant, par exemple, les livraisons de biens ou de services ainsi que la mise à disposition d’argent frais (new money) – sont payées à leur échéance. Ainsi, les créanciers qui acceptent de soutenir le débiteur en difficultés au cours de la mise en œuvre de la sauvegarde, afin de lui permettre de continuer l’exécution des contrats en cours et de rechercher parallèlement une solution négociée sur ses dettes antérieures, bénéficient d’un droit au paiement de leurs créances à l’échéance, contrairement aux autres créanciers. Ils échappent à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu’il leur est loisible d’exercer des poursuites ou d’exiger des voies d’exécution contre le débiteur défaillant.
L’article L. 622-17 envisage également l’hypothèse selon laquelle ces mêmes créances nées régulièrement après l’ouverture de la sauvegarde ne sont pas payées à l’échéance. Il précise que, dans ce cas, elles sont réglées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. Ce faisant, les créanciers apportant leur appui financier ou matériel à la continuation de l’activité d’un débiteur, après l’ouverture d’une sauvegarde, conservent un avantage vis-à-vis des créanciers antérieurs. On le voit, le caractère attractif de la procédure est bien réel.
Trois exceptions logiques affectent toutefois le privilège des créances nées régulièrement après l’ouverture de la sauvegarde. Elles concernent respectivement :
– les « super privilèges » des salariés (rémunérations dues au titre des 60 jours de travail précédant le jugement d’ouverture, indemnités de congés payés et rémunérations de toute nature dues au titre des 90 derniers jours de travail des marins et des voyageurs, représentants, placiers) ;
– les frais de justice (honoraires du liquidateur, des huissiers et des commissaires priseurs ainsi que frais de publicité des décisions) ;
– les créances liées au privilège de l’argent frais concédé dans le cadre d’une conciliation homologuée par un jugement (crédits mais aussi avances de compte, facilités de caisse et découverts).
L’ordre de paiement fixé par la loi conforte cette hiérarchisation : il situe les prêts ainsi que les créances résultant des délais de paiement consentis pour l’exécution des contrats poursuivis lors de la période d’observation au troisième rang, derrière les créances de salaires dont le montant n’est pas couvert par l’assurance générale des salaires (AGS) et les frais de justice. Les sommes avancées par l’AGS viennent néanmoins ensuite, de même que les autres créances, payées selon leur rang prévu par le droit civil général, de sorte que le financement de la poursuite de l’activité en cours de sauvegarde bénéficie tout de même de garanties juridiques significatives et incitatives.
Le traitement des difficultés des entreprises et, de manière générale, de toute activité économique revêt une dimension psychologique essentielle : en effet, l’efficacité de la prévention repose sur la démarche des gestionnaires alors même qu’ils sont bien souvent peu enclins à admettre leur incapacité à faire face aux créances et à solliciter les conseils ainsi que l’aide de la justice commerciale. Comme l’a souligné la mission d’information que la commission des Lois avait constituée sous la XIIème législature sur la réforme du droit des sociétés, dans un rapport sur la question : « Aucune adaptation du droit (…) ne saurait se traduire par un effet positif réel si les acteurs, et surtout les sujets potentiels des procédures que sont les dirigeants des entreprises, ne se les approprient pas eux-mêmes » (54). Conscient de cet impératif, le législateur a prévu, dans la loi du 26 juillet 2005, un certain nombre de dispositions de nature à rassurer les intéressés sur leur rôle futur et leur participation à la mise en œuvre des mesures de rétablissement.
• L’article L. 620-1 du code de commerce dispose ainsi que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut être sollicitée que par le débiteur (commerçant, personne immatriculée au répertoire des métiers, personne morale de droit privé et personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé). Seul un débiteur correspondant à la définition légale a donc la possibilité de choisir de bénéficier d’un traitement judiciaire de ses difficultés. La conséquence d’une telle disposition est qu’il a l’assurance que la procédure ne peut être demandée par un créancier ou ouverte d’office par le tribunal, même en cas d’échec d’une conciliation préalable ou en cas de résolution de l’accord qui l’avait conclue.
Ce faisant, la sauvegarde se rapproche, dans son esprit, des mesures contractuelles de prévention en ce que, comme le mandat ad hoc et la conciliation, nul autre que la personne physique ou morale en difficultés n’en a l’initiative. Elle revêt également un caractère incitatif par rapport au redressement et à la liquidation judiciaires, susceptibles d’être ouverts à la diligence d’un créancier, du ministère public ou, le cas échéant, d’office par le tribunal : en effet, s’il attend trop et que ses difficultés le conduisent en cessation des paiements, le débiteur n’aura plus prise sur les événements alors que la procédure de sauvegarde lui conserve des prérogatives de gestion significatives.
• Dans cette même logique incitative, la loi de sauvegarde des entreprises a minimisé, autant que possible, les atteintes susceptibles d’être portées aux prérogatives naturelles des débiteurs lorsque ceux-ci demandent l’ouverture d’une procédure judiciaire préventive.
Le I de l’article L. 622-1 du code de commerce affirme ainsi d’emblée que l’administration de l’entreprise placée en période d’observation, consécutivement à l’ouverture d’une sauvegarde, est assurée par son dirigeant. Il s’agit là d’un trait caractéristique de la procédure par rapport au redressement judiciaire, dans le cadre duquel l’article L. 631-12 du même code précise que les administrateurs peuvent être chargés d’assurés seuls et entièrement l’administration de l’entreprise en difficultés.
Le principe de la continuation de l’administration de l’entreprise en période d’observation par son dirigeant est certes tempéré par le II de l’article L. 622-1, aux termes duquel le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs chargés de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tout ou partie de ses actes de gestion. En outre, en application de l’article L. 622-7 du même code, le dirigeant se voit contraint d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour l’accomplissement des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (cessions d’actions, de fonds de commerce), la constitution d’hypothèques ou de nantissements, ainsi que la conclusion d’un compromis ou d’une transaction. Néanmoins, il convient d’observer au sujet de ces restrictions de compétence :
– d’une part, que les missions des administrateurs se cantonnent, pour la surveillance, à vérifier que les actes de gestion du dirigeant ne compromettent pas les intérêts des créanciers ou le rétablissement de l’entreprise et, pour l’assistance, à contresigner l’acte de gestion ;
– d’autre part, que le débiteur continue d’exercer sur son propre patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur, en vertu du premier alinéa de l’article L. 622-3 du code de commerce ;
– enfin, que la désignation du ou des administrateurs judiciaires reste facultative pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 millions d’euros et employant moins de 20 salariés.
Mais le rôle du dirigeant de l’entreprise placée sous sauvegarde ne s’arrête pas à l’extinction de la période d’observation, spécialement quand un plan de sauvegarde a pu être négocié avec les créanciers puis entériné par le tribunal. Dans ce cas, il revient au plan de désigner les personnes chargées de l’appliquer, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce. Ce faisant, le dirigeant, lorsqu’il a réussi à conserver suffisamment de crédibilité auprès de ses créanciers, peut être appelé à jouer encore un rôle important. Le tribunal nomme toutefois, pour la durée du plan, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Au total, le dirigeant de l’entreprise en difficultés, lorsqu’il opte pour la procédure de sauvegarde dans un but de prévention, réussit à davantage préserver sa fonction que s’il s’expose au redressement judiciaire en misant sur un hypothétique rétablissement par ses seules démarches.
Un peu plus de deux ans après son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, il est désormais possible de dresser un premier bilan objectif de la procédure de sauvegarde. Les chiffres de 2007 montrant une certaine continuité par rapport à ceux de 2006, les constats dressés par la Commission des Lois l’an passé demeurent plus que jamais d’actualité.
• En l’espèce, bien que les cas les plus retentissants de sauvegarde ont concerné des entreprises de taille importante, comme le journal Libération par exemple, et parfois de dimension internationale, à l’instar d’Eurotunnel, cette procédure collective nouvelle s’adresse majoritairement, depuis 2006, aux petites voire aux très petites entreprises. En effet, les trois-quarts (76 %) des procédures ouvertes en 2007 ont concerné des entreprises de moins de 20 salariés. Un tel constat n’est pas en soi surprenant, compte tenu de la prépondérance des entreprises de moins de 5 salariés en France, qui représentent environ 90 % du total des sociétés enregistrées.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DES ENTREPRISES PLACÉES SOUS SAUVEGARDE
Effectifs |
2006 |
2007 |
Variation, en % |
De 1 à 5 salariés |
232 |
223 |
- 4 % |
De 6 à 9 salariés |
65 |
66 |
+ 1,5 % |
De 10 à 49 salariés |
128 |
162 |
+ 26,5 % |
Plus de 50 salariés |
64 |
51 |
- 20 % |
Source : « Les défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, bilan 2007 », Altares. | |||
L’analyse du statut des entreprises placées en sauvegarde conforte le profil ainsi mis à jour. En 2007, selon le bilan dressé par l’institut Altares, 11,5 % d’entre elles étaient des affaires en nom propre (58 des cas recensés) et 52,5 % des sociétés à responsabilité limitée (266 procédures). Le reste se répartissait entre sociétés anonymes et par actions simplifiées, par définition d’envergure plus conséquente compte tenu de leur appel public à l’épargne.
RÉPARTITION DES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE OUVERTES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
SECTEURS |
2006 |
2007 |
Variation 2007/2006 | ||
Nombre |
Part du total (%) |
Nombre |
Part du total (%) | ||
Industrie |
133 |
26,2 % |
124 |
24,1 % |
- 6,8 % |
– industrie agroalimentaire |
18 |
3,6 % |
23 |
4,5 % |
+ 27,8 % |
– industrie des biens de consommation |
36 |
7,1 % |
29 |
5,6 % |
- 27,0 % |
– industrie des biens d’équipement |
22 |
4,3 % |
29 |
5,6 % |
+ 19,4 % |
– industrie des biens intermédiaires |
54 |
10,7 % |
42 |
8,2 % |
- 22,2 % |
Commerce |
100 |
19,7 % |
94 |
18,3 % |
- 6,0 % |
– commerce et réparation automobile |
20 |
3,9 % |
9 |
1,8 % |
- 55,0 % |
– commerce de gros |
26 |
5,1 % |
40 |
7,8 % |
+ 53,8 % |
– commerce de détail |
54 |
10,7 % |
45 |
8,8 % |
- 16,7 % |
Services aux entreprises |
93 |
18,3 % |
84 |
16,3 % |
- 9,7 % |
Services aux particuliers |
60 |
11,8 % |
63 |
12,3 % |
+ 5,0 % |
– cafés, hôtels, restaurants |
45 |
8,9 % |
48 |
9,3 % |
+ 6,7 % |
Construction |
36 |
7,1 % |
50 |
9,7 % |
+ 38,9 % |
Agriculture |
25 |
4,9 % |
27 |
5,3 % |
+ 8,0 % |
Transport |
21 |
4,1 % |
13 |
2,5 % |
- 38,1 % |
Autres (immobilier, finance, santé) |
39 |
7,7 % |
59 |
11,5 % |
+ 51,3 % |
Source : « La procédure de sauvegarde en quelques chiffres », étude de Me Thierry Montéran, publiée dans la Gazette du Palais des 23 et 24 janvier 2008, p. 22. | |||||
Le tableau ci-dessus montre que, dans tous les cas, l’industrie est restée le secteur d’activité le plus concerné, avec plus du quart des procédures ouvertes en 2006 (26,2 %) comme en 2007 (24,1 %). Le commerce apparaît, lui aussi, comme l’un des principaux bénéficiaires de la réforme de 2005 (avec 19,7 % des procédures en 2006 et 18,3 % en 2007), suivi par les services aux entreprises et aux particuliers (respectivement 18,3 % et 11,8 % des procédures en 2006, puis 16,3 % et 12,3 % en 2007).
• Les résultats semblent également encourageants, en termes de continuation de l’activité. Selon les données relatives à 2006, environ la moitié des procédures de sauvegarde ouvertes – 43,4 % très exactement – aurait trouvé une issue favorable : 17 ont été clôturées tandis que 203 ont abouti à un plan de sauvegarde (55). En soi, ces seuls chiffres apparaissent intéressants en ce qu’ils révèlent une proportion non négligeable d’entreprises sauvées grâce à la nouvelle procédure.
Pour autant, d’autres motifs de satisfaction méritent d’être soulignés. En premier lieu, toutes les catégories d’entreprises placées en sauvegarde, sans exclusive, semblent avoir réussi la conclusion de plans permettant un rééchelonnement de leurs créances et une continuation de leur activité en contrepartie de mesures de rétablissement de leur compétitivité. C’est notamment le cas d’une entreprise individuelle sur deux. En second lieu, en termes relatifs, la sauvegarde a été utilisée par une proportion non négligeable d’entreprises économiquement et géographiquement bien implantées, de manière à prévenir réellement des difficultés passagères et à éviter – avec succès si l’on en juge la proportion des mêmes sociétés dans les statistiques de défaillances globales – le redressement et la liquidation. En effet, comme en attestent les différents tableaux et graphiques ci-après :
– tout d’abord, plus de 10 % des sociétés placées sous sauvegarde en 2006 et 2007 employaient davantage que 50 salariés ;
PROFIL DES ENTREPRISES SOUS PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
SELON LEUR NOMBRE DE SALARIÉS
EFFECTIFS |
ENTREPRISES EN SAUVEGARDE |
TYPOLOGIE DES ENTREPRISES FRANÇAISES |
ENTREPRISES DÉFAILLANTES (en %) | |
2006 |
2007 | |||
De 1 à 5 salariés |
46,4 % |
44,1 % |
89 % |
90 % |
De 6 à 9 salariés |
13,0 % |
13,0 % |
8 % |
7 % |
De 10 à 49 salariés |
25,6 % |
32,0 % |
2 % |
2 % |
50 salariés et plus |
15,0 % |
10,9 % |
1 % |
1 % |
– ensuite, environ 80 % d’entre elles réalisaient un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros (supérieur même à 7,5 millions d’euros pour 8,2 %) alors que 89 % de leurs homologues en liquidation affichaient, elles, un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros ;
PROFIL DES ENTREPRISES SOUS PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
SELON LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES
Tranche de chiffre d’affaires |
2006 |
2007 |
Variation 2007/2006 | ||
Nombre |
Proportion |
Nombre |
Proportion | ||
Inférieur à 500 000 € |
102 |
20,4 % |
108 |
21,3 % |
+ 5,9 % |
De 500 000 € à 1,5 million d’€ |
104 |
20,8 % |
101 |
20,0 % |
- 2,9 % |
De 1,5 à 3 millions d’€ |
59 |
11,8 % |
52 |
10,3 % |
- 11,9 % |
De 3 à 7,5 millions d’€ |
35 |
7,0 % |
45 |
8,9 % |
+ 28,6 % |
De 7,5 à 15 millions d’€ |
23 |
4,6 % |
20 |
3,9 % |
- 13,0 % |
De 15 à 30 millions d’€ |
9 |
1,8 % |
10 |
1,9 % |
+ 11,1 % |
De 30 à 75 millions d’€ |
11 |
2,2 % |
8 |
1,6 % |
- 27,3 % |
Supérieur à 75 millions d’€ |
9 |
1,8 % |
4 |
0,8 % |
- 55,6 % |
Source : Altarès. | |||||
– enfin, elles avaient également une antériorité supérieure – 44,4 % ayant plus de dix ans en 2007 – à celles qui se trouvent en redressement ou en liquidation judiciaires, dont l’ancienneté moyenne avoisine cinq ans.
PROFIL DES ENTREPRISES SOUS PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
SELON LEUR ÂGE
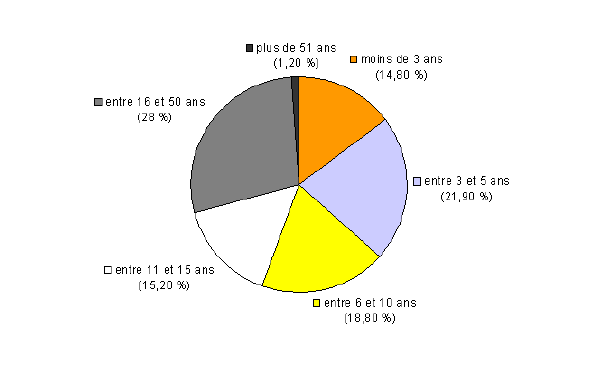
Au total, la sauvegarde a réellement concerné des entreprises pourvoyeuses d’emplois et d’activité économique. Ainsi, comme le soulignait le rapport de la Commission des Lois sur l’application de la loi du 26 juillet 2005, « le législateur ne peut que se féliciter d’avoir vu juste en créant cette procédure destinée à préserver l’emploi et l’activité durables » (56).
Lors de l’adoption de la réforme de 2005, le législateur nourrissait de grands espoirs à l’égard du développement de la sauvegarde au détriment des règlements et liquidation judiciaires. Les faits ne semblent pas, pour l’instant, avoir exaucé ce vœu. Cette situation ne remet nullement en cause le bien-fondé de la nouvelle procédure mise en place mais révèle à tout le moins que les principaux intéressés – en l’occurrence, les débiteurs – ne se la sont pas suffisamment appropriée pour en exploiter tous les avantages.
Selon les chiffres de la délégation de l’UNEDIC auprès de l’AGS, 507 procédures de sauvegarde ont été ouvertes en 2006 et 514 autres en 2007.
ÉVOLUTIONS MENSUELLES DU NOMBRE D’OUVERTURES DE SAUVEGARDES
EN 2006 ET 2007
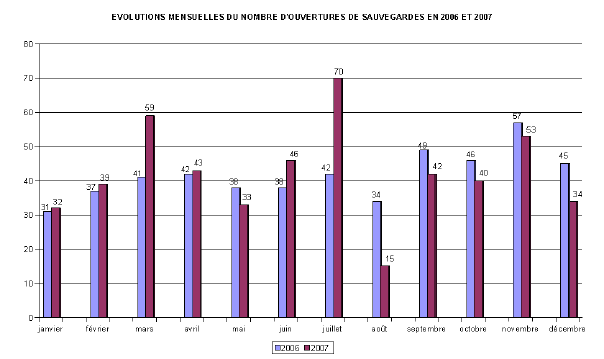
Source : « Les défaillances et sauvegardes d’entreprises en France », bilan 2007, Altarès.
NB : Ces données affichent un écart annuel de 7 procédures sur 2006 et 2007 par rapport aux chiffres de l’UNEDIC.
Si la relative modestie de ces chiffres pouvait s’expliquer en 2006, première année de mise en œuvre de la loi du 26 juillet 2005, par la nouveauté du dispositif aux yeux des praticiens et des intéressés, le constat de stagnation affectant l’année 2007 conduit à de toutes autres conclusions. En effet, force est de reconnaître que malgré ses qualités, la procédure de sauvegarde ne fait pas recette car, dans le même temps, le nombre de défaillances d’entreprises a progressé de 4,9 %, en passant de 47 091, en 2006, à 49 400, en 2007. De la sorte, la procédure de sauvegarde n’a concerné que 1 % de ces défaillances, les procédures collectives demeurant dominées par le redressement judiciaire (un tiers environ des procédures ouvertes) et la liquidation judiciaire (les deux tiers restant).
Selon la base de données Infogreffe, qui recense les statistiques de l’activité des seuls tribunaux de commerce (et non de l’ensemble des juridictions compétentes en matière commerciale), le nombre de redressements judiciaires ouverts en 2006 et 2007 est resté sans commune mesure avec celui des sauvegardes, puisqu’il a respectivement atteint, pour les tribunaux de commerce, les chiffres de 11 042 et 12 684. Ainsi, la part relative des sauvegardes ouvertes par rapport aux redressements judiciaires a sensiblement fléchi alors même que la logique voulait qu’elle augmente. Cette situation ne correspond évidemment pas aux ambitions initiales du législateur. Il est heureux que, tirant les leçons d’une application qui a déjà fait l’objet de plusieurs commentaires, à travers les travaux parlementaires ou divers colloques, il soit question de procéder aux ajustements juridiques nécessaires pour dynamiser le recours à la procédure de sauvegarde dès les mois à venir.
Ainsi que l’avait souligné la Commission des Lois en janvier 2007, le recours à la nouvelle procédure n’est pas aussi fréquent d’une région à l’autre. Le palmarès dressé en 2006 se retrouve d’ailleurs en 2007, puisque les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’azur devancent encore l’Île de France. Les raisons de cette disparité géographique du nombre de procédures de sauvegarde ouvertes sont multiples. En l’occurrence, les fluctuations de dynamisme économique d’une région à l’autre peuvent expliquer certaines variations constatées. Cependant, on ne saurait exclure que la politique juridictionnelle propre à chaque tribunal à l’égard de la recevabilité des demandes des débiteurs ait une part d’explication importante.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que le nombre de sauvegardes à considérablement augmenté dans les régions où, en 2007, le nombre de redressements et de liquidations judiciaires a peu progressé ou stagné, à savoir en Haute Normandie (+ 0,4 % de redressements et liquidations judiciaires), en Champagne-Ardennes (+ 0,9 %) ainsi qu’en Midi-Pyrénées (+ 1,3 %). De même, la plupart des régions où les ouvertures de sauvegardes se sont très nettement accrûes ont recensé une progression des défaillances d’entreprises inférieure à la moyenne nationale, qui elle s’est établie à 4,9 % : ce fut notamment le cas de la Basse Normandie (+ 2,5 %), de la Bourgogne (+ 3,3 %), de l’Auvergne (+ 4,7 %), du Languedoc-Roussillon (+ 0,5 %) et de Rhône-Alpes (+ 0,4 %). Corrélativement, bon nombre de régions dans lesquelles les jugements d’ouverture de sauvegardes ont diminué ont enregistré une évolution des défaillances d’entreprises supérieure à la moyenne nationale, à l’instar de l’Île de France (+ 6,6 %), du Centre (+ 9,7 %), de la Bretagne (+ 13,7 %) ou de la Franche-Comté (+ 8,8 %).
RÉPARTITION, PAR RÉGIONS, DU NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
RÉGIONS |
Ouvertures de sauvegardes |
Plans de sauvegarde | |||||
2006 |
2007 |
Évolution 2007/2006 |
2006 |
2007 | |||
Nombre |
Proportion du total |
Nombre |
Proportion du total | ||||
Rhône-Alpes |
87 |
17,2 % |
99 |
19,0 % |
+ 13,7 % |
39 |
4 |
PACA |
80 |
15,8 % |
71 |
13,8 % |
- 11,2 % |
32 |
5 |
Île de France |
44 |
8,7 % |
38 |
7,4 % |
- 13,6 % |
19 |
6 |
- tribunal de commerce de Paris |
20 |
4,0 % |
13 |
2,5 % |
- 35,0 % |
8 |
0 |
Aquitaine |
31 |
6,1 % |
28 |
5,4 % |
- 9,6 % |
18 |
0 |
Basse-Normandie |
18 |
3,6 % |
28 |
5,4 % |
+ 55,6 % |
3 |
0 |
Midi-Pyrénées |
12 |
2,4 % |
25 |
4,9 % |
+ 108,3 % |
7 |
0 |
Haute-Normandie |
8 |
1,5 % |
24 |
4,7 % |
+ 200,0 % |
1 |
1 |
Languedoc-Roussillon |
20 |
4,0 % |
23 |
4,5 % |
+ 15,0 % |
4 |
1 |
Bretagne |
23 |
4,6 % |
22 |
4,3 % |
- 4,3 % |
9 |
1 |
Pays de Loire |
20 |
4,0 % |
20 |
3,9 % |
+ 0,0 % |
5 |
0 |
Bourgogne |
15 |
3,0 % |
17 |
3,3 % |
+ 13,3 % |
6 |
2 |
Poitou-Charentes |
12 |
2,4 % |
16 |
3,1 % |
+ 33,3 % |
3 |
1 |
Lorraine |
22 |
4,4 % |
15 |
2,9 % |
- 31,8 % |
9 |
0 |
Champagne-Ardennes |
6 |
1,2 % |
14 |
2,8 % |
+ 133,3 % |
4 |
0 |
Auvergne |
11 |
2,2 % |
13 |
2,6 % |
+ 18,2 % |
4 |
0 |
Centre |
21 |
4,2 % |
12 |
2,3 % |
- 42,3 % |
5 |
1 |
Franche-Comté |
21 |
4,2 % |
12 |
2,3 % |
- 42,3 % |
9 |
0 |
Picardie |
13 |
2,6 % |
10 |
1,9 % |
- 23,1 % |
5 |
1 |
Nord-Pas de Calais |
16 |
3,2 % |
9 |
1,8 % |
- 43,8 % |
7 |
1 |
Alsace |
12 |
2,4 % |
6 |
1,2 % |
- 50,0 % |
6 |
0 |
ROM |
7 |
1,4 % |
4 |
0,8 % |
- 42,8 % |
3 |
0 |
Limousin |
4 |
0,8 % |
4 |
0,8 % |
+ 0,0 % |
3 |
0 |
Corse |
2 |
0,4 % |
4 |
0,8 % |
+ 200,0 % |
2 |
0 |
Certes, il serait incontestablement hasardeux de conclure à une corrélation parfaite entre évolution des procédures judiciaires de prévention et évolution des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaires. Cependant, force est de reconnaître qu’un maniement à bon escient de la procédure par les juridictions compétentes a pu influer sur la sinistralité effective des difficultés financières des entreprises.
Environ 31 % des procédures ouvertes en 2006 – 42 % des procédures ayant débouché sur un plan ou converties – auraient conduit à un redressement ou à une liquidation judiciaires (69 reconverties en redressement, 69 en liquidation et 22 en redressement puis en liquidation). Sur l’année 2007, les chiffres sont trop partiels pour pouvoir donner lieu à des conclusions définitives, même si 82 redressements et liquidations judiciaires sont d’ores et déjà recensés. En moyenne, les reconversions en redressement ou en liquidation judiciaires, en raison de l’apparition d’une cessation des paiements, seraient intervenues respectivement cinq et neuf mois après le jugement d’ouverture de la sauvegarde.
Selon Altarès, la raison des échecs est le caractère trop tardif du recours des chefs d’entreprises en difficultés à la procédure. À l’ouverture de celle-ci, près de la moitié des débiteurs concernés (50,2 % en 2006 et 47,9 % en 2007) aurait accusé des retards de paiement de plus de quinze jours auprès de leurs fournisseurs, une proportion non négligeable (13,2 % en 2006 et 9,8 % en 2007) affichant même des délais supérieurs à un mois et, corrélativement, une forte probabilité de cessation des paiements, Altarès évaluant à une multiplication par six l’éventualité d’une telle issue dans ces circonstances.
RETARDS DE PAIEMENT ACCUSÉS PAR LES ENTREPRISES PLACÉES
EN SAUVEGARDE, AU MOMENT DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Tranches de retards de paiement |
2006 |
2007 |
90 jours de retard et plus |
2,5 % |
3,4 % |
De 60 à 89 jours de retard |
2,9 % |
1,7 % |
De 30 à 59 jours de retard |
7,8 % |
4,7 % |
De 15 à 29 jours de retard |
37,0 % |
38,1 % |
Moins de 15 jours de retard |
30,0 % |
34,7 % |
Aucun retard |
19,8 % |
17,4 % |
Source : Altarès. | ||
Les praticiens rejoignent cette analyse. Dans un récent article consacré au problème crucial du choix des procédures les plus adaptées aux difficultés des entreprises, Me Daniel Valdman, administrateur judiciaire, n’hésitait pas à conclure : « Malheureusement, les cas les plus fréquemment rencontrés ne laissent pas le choix entre une procédure de prévention, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Lorsqu’elles se présentent devant les juridictions commerciales, la dégradation de la trésorerie et du chiffre d’affaires des entreprises est souvent telle qu’il ne peut être envisagé d’autre solution que l’arrêt immédiat de l’activité dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Si le choix de la procédure [est] stratégique, l’absence de choix a des effets dramatiques. » (57).
Ces constats soulignent que l’efficacité intrinsèque de la procédure de sauvegarde est bien moins la cause de son succès relatif dans la pratique que l’insuffisante connaissance par les chefs d’entreprises en difficultés des recours juridiques que le titre II du livre VI du code de commerce leur offre pour éviter la cessation des paiements. L’apparition d’une telle situation comptable signifiant l’impossibilité de se placer ou de rester dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, les démarches engagées auprès du tribunal, pour avoir une quelconque chance de succès, doivent être les plus précoces possible.
Les conclusions du Président de la République, selon lesquelles la procédure de sauvegarde ne va pas assez loin et n’est pas suffisamment flexible pour répondre dans les faits aux ambitions qui ont accompagné sa création, sont totalement justes. Deux ans après sa création, il apparaît indispensable de corriger certains défauts révélés par la pratique, sous peine d’empêcher cette bonne innovation d’atteindre pleinement ses objectifs.
Dans la loi du 25 janvier 1985, l’état de cessation des paiements était le critère déterminant le régime procédural applicable : avant que soit avérée cette situation comptable dans laquelle les créances exigibles excèdent l’actif disponible, les procédures amiables restaient possibles ; une fois la cessation des paiements constatée, les procédures collectives (règlement et liquidation judiciaires) devenaient inéluctables. Pour tenir compte des cas de figure dans lesquels des sociétés fondamentalement viables et solvables peuvent techniquement se trouver en cessation des paiements – en raison d’un décalage entre des échéances de créances et des rentrées régulières de trésorerie, par exemple –, la loi de sauvegarde des entreprises a cherché à relativiser l’effet couperet de cette notion : désormais, il est possible d’ouvrir une procédure de conciliation si l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé depuis moins de 45 jours ; à l’inverse, l’ouverture d’une sauvegarde, nouvelle procédure collective, est conditionnée par l’absence de cessation des paiements et la perspective d’y parvenir si rien n’est fait.
L’article L. 620-1 du code de commerce exige en effet que le débiteur à l’origine du processus « justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ». Sur le seul fondement de ces critères, on pourrait considérer que la sauvegarde se place plus en amont que la conciliation dans le traitement des entreprises en difficultés. Il n’en est rien, toutefois, car sa publicité oblige le chef d’entreprise à n’y recourir que dans des situations financières ou des perspectives économiques plus dégradées.
Certains praticiens, ont vu dans le cumul des conditions posées à l’article L. 620-1 du code de commerce – et notamment dans le lien direct entre l’impossibilité de surmonter les difficultés rencontrées et les perspectives de cessation des paiements – un obstacle réel au développement de la sauvegarde, aux motifs que, d’une part, pour être admise au bénéfice de la procédure, une entreprise ne doit pas avoir de dettes fiscales, sociales et salariales arriérées, tandis que ses dettes vis-à-vis de ses fournisseurs ne sauraient excéder 90 jours et, d’autre part, une entreprise en difficultés tire peu d’avantages de trésorerie à se mettre en sauvegarde, sauf pour le passif à échoir au moment de l’ouverture, les encours fournisseurs et les échéances fiscales et sociales du mois en cours.
Au total, comme l’indique Me Daniel Valdman dans un article précédemment cité : « L’application stricte de la loi ne laisse[…] pas beaucoup de place à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Et l’intéressé d’ajouter que, dans les faits, la procédure est « limitée à des situations où l’entreprise a conscience qu’elle ne pourra pas faire face à une échéance importante, voire très importante. […] Mais il s’agit de situations plutôt exceptionnelles » (58).
Pour ce qui concerne le critère rédhibitoire que représente l’état de cessation des paiements, on rappellera que le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, notre ancien collègue Xavier de Roux, s’était fait l’écho des controverses juridiques sur la pertinence de la définition légale de la cessation des paiements, certains auteurs considérant que le renvoi au passif exigible restreignait fortement les possibilités de recourir à une procédure judiciaire préventive. Des assouplissements de la définition retenue au premier alinéa de l’article L. 631-1 du code de commerce, qui privilégieraient le passif effectivement exigé au passif exigible, ont pu être suggérés sans pour autant recueillir de consensus.
S’interrogeant dans un article récent sur la question, Me Georges Teboul a considéré, pour sa part, que « la jurisprudence a beaucoup travaillé sur le sujet, et les contours de la définition apparaissent à présent relativement clairs » (59). C’est ainsi, notamment, que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le juge doit se placer au jour où il statue sur l’ouverture de la sauvegarde pour apprécier l’état comptable du débiteur (60), ce qui permet à ce dernier de travailler à la disparition éventuelle de ses difficultés de trésorerie d’ici là, et que le passif pris en compte est celui exigible à la date du jugement d’ouverture (61). La Cour a également souligné que des immeubles non encore vendus ne constituent pas un actif disponible et que des créances faisant l’objet d’un moratoire sont exclues du passif exigible (62).
Le projet de réforme élaboré par le Gouvernement ne remettra pas en cause la condition de non-cessation des paiements pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il devrait néanmoins apporter deux clarifications importantes, d’une part, en rectifiant la définition légale de la cessation des paiements pour tenir compte du pragmatisme de la Cour de cassation (63) et, d’autre part, en mettant fin à l’exigence d’un risque avéré de cessation des paiements pour l’ouverture de la procédure.
L’esprit d’entreprise fait la part belle à l’initiative. De ce fait, tous les protagonistes du commerce sont viscéralement attachés au respect de leur rôle et de ce qu’ils ont créé ou développé. Par voie de conséquence, pour renforcer le caractère incitatif de la sauvegarde, il apparaît indispensable de préserver un peu plus qu’elles ne le sont déjà leurs compétences au cours du déroulement de la procédure. Tel est justement l’objet poursuivi par la réforme envisagée.
La suppression de la possibilité d’éviction du dirigeant ou de la cession forcée de parts lors de la période d’observation de la sauvegarde constitue une bonne illustration des mesures pouvant avoir un fort effet psychologique sur le public auquel s’adresse la procédure. Certes, l’état du droit encadre fortement ces éventualités puisque l’article L. 626-4 du code de commerce restreint au ministère public l’initiative d’une demande de remplacement d’un ou de plusieurs dirigeants de la société en difficultés, la décision revenant au tribunal qui ne peut en aucun cas y donner suite si le débiteur exerce une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Cependant, à tort ou à raison, la menace d’une éviction en cours de sauvegarde, alors même que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, a de quoi faire réfléchir certains entrepreneurs jaloux de leurs prérogatives. En y mettant un terme, ils n’auront plus de réserves à avoir sur ce point.
Dans le même ordre d’idées, l’affirmation d’une forme de prééminence du débiteur dans l’élaboration et la présentation du plan de sauvegarde constitue un signal fort de son implication active dans le rétablissement de son affaire. L’administrateur judiciaire continuera évidemment à intervenir, mais il apportera seulement son concours à la formulation de propositions destinées aux créanciers. D’ailleurs, à l’avenir, seul le débiteur pourra désormais proposer à ses créanciers la substitution de garanties équivalentes à celles qu’ils détiennent.
Enfin, la mise en place d’un mécanisme de cession complète à l’initiative du chef d’entreprise ou du professionnel placé sous sauvegarde, afin de résoudre les difficultés financières de l’entreprise, devrait elle aussi conforter l’attractivité de la procédure à l’égard du débiteur. Le choix d’une option aussi radicale resterait de la seule compétence du dirigeant ou du professionnel concerné. Il leur permettra d’apurer leurs dettes afin d’envisager un nouveau départ.
Corrélativement au renforcement de la place du débiteur dans la procédure, les organes de celles-ci doivent connaître certains ajustements à leurs missions.
Il en va ainsi du commissaire-priseur, dont la nomination par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la sauvegarde en vue de dresser un inventaire et une prisée ne se justifie pas toujours. Ainsi que l’a expliqué Me Thierry Montéran dans un récent article au titre évocateur : « Le législateur accorde sa confiance à l’entreprise qui sait anticiper ses difficultés. Sa comptabilité sert à déterminer la composition des comités de créanciers ; pourquoi donc imposer un inventaire et une prisée alors qu’il n’y a pas de cession forcée ? » (64). En l’occurrence, l’inventaire demeurera exigé pour l’ouverture de la procédure, mais il sera à présent l’apanage du débiteur, à moins que celui-ci n’opte pour la désignation d’un officier public à cet effet.
De même, le cantonnement du rôle de l’administrateur judiciaire à une mission de surveillance, et non plus d’assistance – plus directive –, au moment de l’ouverture de la procédure constitue une évolution aussi significative qu’incitative pour le débiteur. L’assistance de l’administrateur judiciaire demeurera possible mais elle n’interviendra plus que de manière subsidiaire, à la demande du dirigeant ou du parquet.
D’autres modifications, suggérées par la doctrine (65), pourraient sans doute être envisagées d’ici la publication de l’ordonnance. À titre d’illustration, il est permis de s’interroger sur la pertinence de la nomination d’un contrôleur en sauvegarde. Traditionnellement, un tel organe intervient à l’occasion de la reconstitution de l’actif au cours de la période suspecte et en matière de sanctions personnelles, pécuniaires ou pénales ; or, la sauvegarde exclut la période suspecte – et donc la reconstitution de l’actif – ainsi que les sanctions. En outre, le débiteur ne se trouvant pas en cessation des paiements et étant venu se placer spontanément sous la protection du tribunal, une telle exigence est de nature à inspirer sa méfiance en ce que chaque contrôleur a nécessairement accès à l’ensemble des informations le concernant.
Les obligataires détiennent des titres négociables d’un débiteur personne morale (le plus souvent une société de capitaux). Aux termes de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, ces titres, lorsqu’ils sont issus d’une même émission, leur confèrent des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
Catégorie spécifique de créanciers, ils ont fait l’objet d’un traitement à part dans la loi du 26 juillet 2005. Alors même que l’une des principales innovations de la réforme consistait à mettre en place des comités de créanciers appelés à se prononcer, selon des modalités de décision permettant d’éviter les blocages d’une minorité réfractaire, sur un plan de sauvegarde destiné à faciliter la survie de l’entreprise, les obligataires ont conservé leur propre régime de délibération, particulièrement lourd et – en définitive – inadapté à l’objet de la sauvegarde. En effet, en application des articles L. 228-44 à L. 228-89 du code de commerce, l’organisation des obligataires en masse dotée de la personnalité civile conduit à ce qu’ils soient représentés par un à trois mandataires élus lors d’une assemblée générale. De surcroît, chaque émission d’obligations donne lieu à la constitution d’une masse.
Dans le cas de la sauvegarde, l’article L. 626-32 du code de commerce, introduit en 2005, n’a pas prévu de modalités simplifiées de consultation de ces masses. Il s’est borné à exiger l’information de leurs mandataires, concomitamment aux comités de créanciers, sur le contenu du plan de sauvegarde, avant de poser le principe d’une délibération des assemblées générales des obligataires, sans même préciser les conditions de quorum et de majorité requises ni renvoyer aux règles de la section 5 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code (l’article L. 228-65, en l’occurrence).
Or, comme l’a souligné le rapport de la Commission des Lois sur l’application de la loi du 26 juillet 2005 : « Il faut bien reconnaître qu’il a échappé au législateur, en 2005, que la multiplication potentielle des masses d’obligataires pouvait représenter un handicap sérieux, dès lors que l’accord de chacune est nécessaire à l’approbation du plan de sauvegarde. » (66). L’affaire Eurotunnel, dont le montant des créances obligataires avoisinait 2,8 milliards d’euros répartis dans deux séries de trois contrats d’émission en euros et en livres sterling, a illustré les complications susceptibles de découler d’une interprétation pointilleuse des règles prévues par notre droit.
En l’espèce, l’adoption du plan de sauvegarde de la société se heurtait aux réticences, non dénuées d’arrière-pensées, d’une minorité d’obligataires alors qu’une majorité semblait se dégager parmi leurs homologues et qu’un consensus émergeait du côté des autres créanciers. Pour lever ces obstacles, les administrateurs judiciaires de la société se sont appuyés sur les dispositions du droit anglais, qui ne prévoit pas de régime des masses, au motif exact que la plupart des obligataires de la société répondaient de ce régime.
Si le législateur avait fait le choix, dès 2005, d’instituer un comité de créanciers obligataires aux côtés des comités de fournisseurs et des établissements de crédit, de telles difficultés ne seraient sans doute pas apparues. Comme l’a suggéré la Commission des Lois l’an passé, cette erreur devrait être prochainement réparée. Il faut s’en réjouir car, fatalement, le précédent d’Eurotunnel ne restera pas un cas d’école compte tenu de l’internationalisation croissante des créances, y compris auprès des PME d’envergure significative. En l’espèce, le projet d’ordonnance préparé par le Gouvernement distingue deux cas de figure :
– celui dans lequel le débiteur aura émis exclusivement des obligations en France. Le droit en vigueur continuera alors à s’appliquer, moyennant deux aménagements fondamentaux résidant, d’une part, dans une information commune des représentants des différentes masses d’obligataires sur le contenu du projet de plan de sauvegarde et, d’autre part, dans l’absence de quorum pour la délibération des assemblées générales d’obligataires ;
– celui dans lequel le débiteur aura émis des obligations à l’étranger. Les obligataires d’une même émission devraient alors être réunis dans un comité statuant sur les propositions du débiteur et prendre leur décision à la majorité des deux tiers des voix.
e) L’impératif d’une meilleure prise en compte des évolutions du refinancement des entreprises endettées
La mise en œuvre de la procédure de sauvegarde a révélé que les bonnes intentions initiales du législateur, s’agissant notamment de la consultation des créanciers au sujet de la continuation de l’activité du débiteur à l’issue de sa période d’observation, ont été contournées dans les faits. La complexité croissante des modes de financement des entreprises ainsi que les évolutions marquées du profil des créanciers n’ont visiblement pas suffisamment été prises en considération, de sorte que des correctifs semblent aujourd’hui indispensables.
• Le schéma juridique des comités de créanciers reflète une vision traditionnelle du financement des entreprises, dans laquelle les établissements bancaires et les fournisseurs occupent une position prédominante et immuable. Dans la très grande majorité des cas, notamment pour les PME, cette conception est avérée. Pour autant, pour des entreprises tournées vers l’international – cas de figure de plus en plus fréquent, du fait de la mondialisation –, de nouveaux acteurs spéculatifs interviennent : les hedge funds. Spécialisés le plus souvent sur un type bien particulier d’opération (les produits dérivés ou le redressement d’entreprises en difficultés par exemple), ces derniers affichent des performances souvent déconnectées de la tendance générale des marchés d’actions ou d’obligations.
Les banques elles-mêmes, dont la frilosité – pour ne pas dire l’aversion au risque – est bien connue, n’hésitent plus à céder leurs titres de créances de grandes entreprises en sérieuses difficultés, voire même de grosses PME, à ces fonds d’investissement qui fonctionnent à la manière d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). En 2005, quelque 8 000 hedge funds géraient un encours global de 1 070 milliards d’euros et 5 % des actifs des fonds européens étaient placés en France, notre pays étant de ce fait leur seconde priorité européenne.
La procédure de sauvegarde d’Eurotunnel, cas d’école à plus d’un titre, a soulevé l’importante question de la qualification juridique de ces créanciers particuliers. L’enjeu résidait en l’espèce dans l’application des mêmes règles de majorité qualifiée et, en cas de manœuvres abusives pour empêcher l’aboutissement du plan de sauvegarde, de responsabilité qu’aux créanciers appartenant aux comités de l’article L. 626-30 du code de commerce.
Si les termes retenus dans la loi par le législateur étaient suffisamment larges pour permettre une assimilation des hedge funds à des établissements de crédit, l’article 164 du décret d’application du 28 décembre 2005 (67) (codifié depuis à l’article R. 626-55 du code de commerce) leur a donné une interprétation restrictive, en se référant aux articles L. 511-1 et L. 518-1 du code monétaire et financier, c’est-à-dire aux établissements exerçant des opérations de banque au sens le plus traditionnel et pour lesquels le ministère chargé de l’économie et des finances a donné son agrément. Les fonds concernés par la procédure d’Eurotunnel ne manquèrent pas de s’appuyer sur ces dispositions pour réclamer leur assimilation à des obligataires, relevant de l’article L. 626-32 du code de commerce. Si le tribunal leur avait donné raison – ce qu’il n’a pas fait au motif qu’en achetant des créances en cours, les fonds spéculatifs participent à une opération de banque et sont de ce fait assimilables à un établissement de crédit visé à l’article L. 626-30 –, les perspectives d’adoption du plan de sauvegarde auraient sans doute été quasi-inexistantes, au regard des ambiguïtés entourant la consultation des obligataires, dont il a été précédemment question.
La Commission des Lois s’était inquiétée, en janvier 2007, des incertitudes juridiques résultant des contradictions entre les articles L. 626-30 et R. 626-55 du code de commerce. Le projet de réforme du Gouvernement devrait apporter une réponse sensiblement différente de celle suggérée dans le rapport d’application de la loi du 26 juillet 2005, mais vraisemblablement efficace elle aussi : il serait en effet spécifié dans la loi que l’obligation ou la faculté de faire partie des comités de créanciers constitue un accessoire de la créance existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs. De ce fait, ce n’est pas tant la qualité des créanciers que la nature de la créance qu’ils détiennent qui déterminera leur appartenance aux comités prévus à l’article L. 626-30 du code de commerce.
• Lors de son examen de l’application de la loi de sauvegarde des entreprises, la Commission des Lois avait également souligné les failles des dispositions législatives et réglementaires en vigueur s’agissant des modalités de prise de décision des comités de créanciers, notamment au regard de la circulation rapide des créances aujourd’hui. Ce problème apparaît d’autant plus délicat qu’il soulève un risque d’inadéquation, lors du vote du plan de sauvegarde, entre les pouvoirs et la situation réelle de certains participants à la décision, dont le montant des créances peut ne plus être en rapport avec les droits qui leur ont été reconnus quelques jours voire quelques semaines plus tôt.
En effet, l’article R. 626-58 du code de commerce prévoit seulement que le montant des créances pris en compte pour le calcul des droits de vote est arrêté par l’administrateur judiciaire, au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l’expert comptable, au plus tard huit jours avant la consultation des comités de créanciers sur le plan de sauvegarde. Dans les faits, très fréquemment, la date retenue pour effectuer ce calcul est celle du jugement d’ouverture de la procédure. Or, à l’heure de la finance immatérielle, les transactions de titres de créance s’effectuent en temps quasi-réel. Certaines dettes présentent également une nature évolutive, à l’instar de l’affacturage.
Devant le silence de la loi et de ses décrets d’application sur l’hypothèse d’une évolution du poids respectif des créanciers après le calcul des droits de vote et avant le vote du plan de sauvegarde, les administrateurs judiciaires et les créanciers de bonne foi ou leurs mandataires se trouvent démunis. Ainsi, « de manière assez pernicieuse, certains affactureurs initialement dotés d’un poids prépondérant dans le comité des établissements de crédit adoptent une position d’autant plus intransigeante à l’égard des solutions proposées par les mandataires de justice pour assainir leur débiteur en difficultés qu’ils ont récupéré, entre-temps, la plus grande partie de leurs concours financiers » (68).
Une telle situation ne doit, ni ne peut durer. En précisant explicitement que le créancier dont la créance est éteinte perd sa qualité de membre des comités de l’article L. 626-30 du code de commerce, la réforme préparée par le Gouvernement lèvera une sérieuse hypothèque sur le bon fonctionnement des comités de créanciers et sur l’issue même des procédures.
De toutes les procédures collectives, la sauvegarde est la plus récente et, à bien des égards, la plus novatrice. Il n’est donc pas étonnant que les ajustements juridiques à mettre en œuvre, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la concernent plus particulièrement. Pour autant, la sauvegarde ne peut ni s’apprécier, ni être mise en œuvre de façon totalement indépendante des autres procédures applicables aux entreprises en difficultés, qu’il s’agisse des procédures amiables (en amont) ou des redressement et liquidation judiciaires (en aval). Aussi, par cohérence avec les objectifs poursuivis dans la réforme de la sauvegarde, les autres procédures collectives sont elles aussi appelées à connaître des évolutions, ne serait-ce que dans un but de coordination. Sur le fond, néanmoins, compte tenu de la proximité du règlement judiciaire avec la sauvegarde, les modifications les plus importantes doivent concerner la liquidation judiciaire, et notamment son volet simplifié.
À l’occasion de l’examen parlementaire de la loi de sauvegarde des entreprises, certaines voix s’étaient élevées pour suggérer le remplacement pur et simple du redressement judiciaire par la nouvelle procédure, qualifiée parfois de « redressement judiciaire anticipé » (69). Il est vrai que la sauvegarde emprunte beaucoup de mécanismes au redressement (jugement d’ouverture, période d’observation, bilan économique et social et plan de continuation de l’activité), même si elle s’en distingue sur un point fondamental en ce qu’elle ne peut pas intervenir une fois l’état de cessation des paiements constaté.
De fait, il n’était pas acquis, lors de l’adoption de la réforme de 2005, que la sauvegarde puisse trouver sa place dans le paysage des procédures collectives. Si les faits ont – certes timidement – infirmé cette crainte, ils n’en ont pas moins révélé que l’articulation entre les différentes procédures judiciaires existantes en matière de traitement des difficultés des entreprises n’est certainement pas optimale.
En effet, le régime actuel de la sauvegarde permet sa reconversion en règlement judiciaire dans des hypothèses strictes : tout d’abord, en cas de constatation d’un état de cessation des paiements a posteriori de l’ouverture de la procédure (article L. 621-12 du code de commerce) ; ensuite, dans l’éventualité d’une apparition de cette cessation des paiements au cours de la période d’observation (article L. 622-10 du même code). En revanche, l’aggravation des difficultés de l’entreprise au cours de l’exécution du plan de sauvegarde, si elle se traduit par une cessation des paiements, ne laisse pas le choix au tribunal puisque celui-ci doit alors automatiquement reconvertir la procédure en liquidation judiciaire (article L. 626-27 du code de commerce). Aucune passerelle entre la sauvegarde et le redressement judiciaire n’est prévue dans ce cas précis.
Cet effet couperet de l’apparition d’une cessation des paiements en cours d’exécution du plan de sauvegarde est d’autant plus surprenant que les mêmes difficultés comptables n’impliquent pas nécessairement la liquidation judiciaire pour les débiteurs qui n’ont pas fait la démarche volontaire de se placer sous sauvegarde. Il y a donc, semble-t-il, une contradiction avec le souci initial du législateur d’inciter les chefs d’entreprises et les professionnels en difficultés à solliciter plus tôt une assistance judiciaire pour rétablir leur situation.
Le projet d’ordonnance préparé par le Gouvernement entend rompre avec cet aspect dissuasif, en permettant au tribunal de recourir, si les conditions fixées à l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, à l’ouverture d’un règlement judiciaire après l’apparition d’une cessation des paiements en cours d’exécution du plan de sauvegarde. Par cette mesure, il n’est pas question de prolonger à l’infini les procédures mettant le débiteur à l’abri de ses créanciers, surtout si le terme de l’activité apparaît inéluctable ; bien au contraire, il s’agit simplement d’offrir au tribunal davantage de possibilités pour gérer au mieux les conséquences des difficultés de l’intéressé. D’ailleurs, afin d’éviter tout abus, cette éventualité restera subordonnée à l’avis du parquet.
A travers de telles dispositions, la réforme envisagée par le Gouvernement apportera donc une souplesse nouvelle dans le déroulement des procédures, y compris pour une réalisation optimale de la liquidation judiciaire du débiteur dont l’état de cessation des paiements se serait déclaré moins de 45 jours après le début de l’exécution du plan de sauvegarde. En effet, l’expérience montre que la cession dans le cadre de la liquidation judiciaire nécessite une poursuite d’activité peu propice à la pérennisation de l’outil industriel. Le fait de favoriser l’ouverture d’un redressement judiciaire par le tribunal, dont l’issue sera la mise en place d’une cession suivie d’une liquidation, répondra aussi davantage aux besoins.
L’institution, par la loi du 26 juillet 2005, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée procédait d’un louable souci d’accélération du traitement des dissolutions de petites entreprises ayant des actifs facilement réalisables et de faible valeur. Il s’agissait, par la même occasion, de réduire les frais engendrés par ce type de liquidations. L’expérience montre que les ambitions du législateur n’ont pas été satisfaites par le dispositif en vigueur. De l’aveu de tous les praticiens et des principaux intéressés, la faute en incombe à la trop grande complexité de la mise en œuvre de cette procédure nouvelle. La réforme envisagée par le Gouvernement entend bien apporter des réponses appropriées à cette situation.
a) La systématisation de la liquidation judiciaire simplifiée pour les débiteurs de petite envergure
Partant du constat qu’une majorité d’entreprises soumises à la liquidation judiciaire étaient des PME, le législateur a institué pour elles un régime simplifié (article L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce), caractérisé par un formalisme moindre et une accélération des opérations, qui se déroulent dans un délai maximum d’un an. Cette procédure qui, aux termes du second alinéa de l’article L. 641-2 et de l’article R. 641-10 du code de commerce, s’adresse aux débiteurs ne disposant pas d’un actif immobilier, réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 750 000 euros et employant un effectif salarié inférieur ou égal à cinq personnes au cours des six mois précédant l’ouverture, n’a malheureusement pas rencontré le succès espéré.
Les raisons de ce désintérêt résident principalement dans les modalités du déclenchement de la procédure, lequel passe par l’ouverture préalable d’une liquidation judiciaire de droit commun et implique, de ce fait, la présence du débiteur à deux audiences rapprochées (celle sur l’ouverture de la liquidation et celle sur l’application des règles de la procédure simplifiée). Contraires aux objectifs de simplification et de rapidité poursuivis par le législateur, ces contraintes ont partiellement été levées par la Cour de cassation, dans un avis du 10 juillet 2006. Celle-ci a en effet souligné que : « L’application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l’ouverture de la procédure » (70). L’article R. 644-1 du code de commerce conforte cette interprétation, en disposant que le tribunal statue d’office sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dès qu’il reçoit le rapport du liquidateur.
Ces aménagements jurisprudentiels et règlement aires ont certes assoupli le formalisme conditionnant le recours à la liquidation simplifiée mais, comme l’avait souligné le rapport de la Commission des Lois sur l’application de la loi de sauvegarde des entreprises, « le régime de la liquidation simplifiée engendre des diligences trop complexes au regard des enjeux, notamment du fait de la multiplicité des jugements et de l’exigence d’un état de répartition ou de créance » (71). En conséquence, il est devenu nécessaire d’envisager des changements plus radicaux, au niveau de la loi elle-même. Tel est justement l’un des objets du projet de réforme du Gouvernement qui devrait rendre automatique et systématique le recours à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, dès lors que le débiteur concerné correspondra aux critères actuellement prévus aux articles L. 641-2 et R. 641-10 précités.
Les critères actuellement posés pour l’éligibilité des entreprises à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont, il faut bien le reconnaître, un peu réducteurs. Ils répondent néanmoins au souci de ne pas exonérer les entreprises les plus significatives, tant en termes d’emplois que d’activité, des garanties procédurales offertes à leurs créanciers par la procédure normale de liquidation judiciaire. En conséquence, si le pragmatisme recommande d’assouplir le profil des débiteurs concernés par le volet simplifié de la liquidation judiciaire, l’équité appelle à la prudence en la matière. Cette préoccupation explique justement le dispositif envisagé pour étendre le champ de la procédure sans pour autant conduire à un affaiblissement des droits des créanciers, en général.
Le projet d’ordonnance préparé par le Gouvernement envisage d’octroyer au tribunal la faculté – et non l’obligation – d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée, dès lors que le débiteur ne possède pas de biens immobiliers (à l’instar du critère fixé au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce) et lorsque le nombre de ses salariés ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes demeurent inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État. En l’espèce, c’est à la juridiction commerciale qu’il reviendra d’apprécier l’utilité de suivre la voie normale de la liquidation judiciaire ou, compte tenu des actifs du débiteur et de son envergure, de l’intérêt de son volet simplifié.
Cet assouplissement encadré est de nature à permettre un traitement plus rapide et efficace des cas dans lesquels les préjudices des créanciers sont les plus faibles. Le juge jouera un rôle essentiel dans l’examen des conditions d’ouverture de ces liquidations simplifiées que l’on pourrait qualifier d’« élargies » (par contraste avec celles de droit commun, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 641-2 précité).
À noter que la distinction entre liquidation judiciaire simplifiée de droit commun et liquidation judiciaire simplifiée élargie ne devrait pas rester sans conséquence quant aux marges de manœuvre du liquidateur. En effet, dans le premier cas, la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant le jugement d’ouverture, sera automatique. Dans le second, c’est le tribunal ou son président qui devrait déterminer les biens du débiteur pouvant faire l’objet de telles cessions, dans un délai identique.
L’habilitation demandée par le Gouvernement au Parlement pour prendre une ordonnance couvre le régime des sanctions imposées aux dirigeants des entreprises. Il est en effet question de le clarifier, de le moraliser et de le rendre plus cohérent. Cette démarche apparaît nécessaire pour encourager les débiteurs de bonne foi à s’adresser en confiance aux juridictions commerciales, la crainte d’une sanction bien souvent mal connue et incomprise constituant indéniablement un facteur d’hésitation.
Parmi les sujets que la réforme devrait concerner, figure notamment le régime des sanctions pour insuffisance d’actifs, défini à l’article L. 651-2 du code de commerce. Actuellement, lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une telle insuffisance d’actifs causée en tout ou partie par une faute de gestion, le tribunal peut décider que les dettes de cette personne morale sont supportées par ses dirigeants de droit ou de fait. La réforme devrait restreindre l’étendue de cette sanction financière au montant de l’insuffisance d’actifs, ce qui serait plus conforme à la nature de la faute commise et adapté à la réalité, compte tenu de la situation pécuniaire personnelle dans laquelle se trouvent le plus souvent les dirigeants d’une entreprise liquidée. Les règles de prescription, de trois ans, resteront inchangées.
Pour ce qui concerne le régime de l’obligation aux dettes sociales, les sommes recouvrées devraient désormais entrer dans le patrimoine du débiteur au lieu d’être directement affectées au désintéressement des créanciers selon l’ordre de leurs sûretés. Elles se verront réparties au marc le franc entre tous les créanciers, exception étant faite de ceux qui auraient été condamnés en application du premier alinéa de l’article L. 652-1. Cette dernière précision a son importance et participe du rééquilibrage des sanctions entre les différentes parties impliquées dans le passé de l’entreprise liquidée.
Enfin, certains aménagements porteront sur les mesures d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, voire une exploitation agricole. C’est ainsi, notamment, que ces mesures ne seront plus prononcées en cas d’absence de déclaration, par le débiteur, de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation ; elles interviendront, à la place, en cas d’omission de demande d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans que le débiteur ait, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Sur le fond, la substitution ne changera rien quant à la sanction de l’inaction du dirigeant ou du professionnel en état de cessation des paiements ; sur la forme, en revanche, il lui sera sans doute plus naturel – et donc facile – de se tourner vers le tribunal pour s’enquérir des procédures à entreprendre pour sauver ce qui peut encore l’être ou au contraire pour mettre un terme définitif aux difficultés rencontrées.
À noter enfin que l’ordonnance devrait également corriger certaines ambiguïtés s’agissant, entre autres, du régime de la banqueroute. À titre d’illustration, il ne s’applique actuellement qu’aux débiteurs ayant effectué des achats en vue d’une revente au dessous du cours ou ayant employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le seul but de retarder l’ouverture d’un redressement judiciaire, et non à ceux qui auraient fait de même pour retarder l’ouverture d’une liquidation judiciaire. De même, au titre des autres infractions, n’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros (peines de l’abus de confiance, aux termes de l’article 314-1 du code pénal) que le fait pour les parents et alliés des chefs d’entreprises ou professionnels en difficultés de détourner, divertir ou receler des effets dépendants de l’actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le cas de la liquidation ne se trouvant ainsi pas couvert. De telles singularités sont appelées à disparaître afin de redonner aux sanctions leur plénitude à l’égard de ceux qui enfreignent délibérément et de manière malhonnête la loi.
IV. – L’AMÉNAGEMENT DES INCAPACITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES : DONNER UNE SECONDE CHANCE AUX ENTREPRENEURS
L’exercice d’activités commerciales et industrielles est assorti d’un certain nombre d’exigences de probité et de moralité justifiées et compréhensibles. Pour l’essentiel, elles remontent au décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société, d’une part, et à la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles (72), d’autre part. Elles ont été codifiées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce (articles L. 128-1 à L. 128-6) par l’ordonnance du 6 mai 2005 (73), prise sur le fondement de l’article 28 de la loi du 9 décembre 2004 (74) de simplification du droit.
Bien qu’elles aient opportunément fait l’objet d’un encadrement temporel (sanctions limitées à dix ans, alors qu’elles étaient perpétuelles auparavant, en contradiction avec le principe de nécessité des peines formulé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et d’un toilettage (notamment sur le champ des causes conduisant à leur application), les dispositions régissant les incapacités d’exercer une activité commerciale ou industrielle comportent encore des imperfections. Le présent projet de loi vise justement à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour les retoucher, afin de rendre plus aisée la reprise d’activité privée pour ceux qui, ayant assumé leurs erreurs et tiré les leçons de leur sanction, réclament la possibilité d’un nouveau départ professionnel.
Ainsi que l’avait remarqué le rapporteur de la loi de simplification du droit précitée (75), le régime des incapacités commerciales et industrielles résultant du décret-loi de 1935 et de la loi de 1947 était manifestement inconstitutionnel pour deux raisons : en premier lieu, il ne prévoyait que des interdictions d’exercice définitives, c’est-à-dire des sanctions peu ciblées et en totale disproportion avec certains des délits visés, de sorte que le juge ne disposait d’aucun moyen de moduler la peine en fonction de la nature de l’infraction ou, plus généralement, des circonstances de l’espèce qui la motivaient ; en second lieu, l’automaticité de ces mêmes interdictions entrait en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les incapacités automatiques, telle qu’elle ressort d’une décision du 15 mars 1999 (76). Pour ces raisons, leur codification à droit constant au sein de la partie législative du code de commerce, envisagée en 2000, s’est avérée impossible.
C’est l’ordonnance du 6 mai 2005 qui, tout en rassemblant les dispositions pertinentes sous un chapitre spécifique figurant dans le titre II du livre Ier du code de commerce, en a revu le contenu pour le rendre davantage conforme aux principes fondamentaux qui structurent notre ordonnancement juridique. Elle a tout d’abord limité à dix ans la durée d’incapacité professionnelle pouvant être prononcée par le juge, à compter de la condamnation définitive du commerçant ou de l’industriel fautif. Elle a ensuite recentré l’objet des causes de la sanction sur trois grandes catégories : tout d’abord, les crimes ; ensuite, les condamnations définitives à la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel ; enfin, certains délits économiques limitativement énumérés (escroquerie, abus de confiance, recel, faux, blanchiment, trafic de stupéfiant, notamment) et ayant donné lieu à une condamnation à au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis.
En dépit des observations formulées par le Parlement en 2004, l’automaticité des incapacités a été maintenue, un délai de trois mois seulement étant laissé aux intéressés pour se conformer à la sanction, une fois celle-ci devenue définitive. Il reste néanmoins que, en application de l’article 132-21 du code pénal, l’aménagement par le juge de chaque incapacité, au cas par cas, demeure possible, « y compris en ce qui concerne la durée ».
Ce point de l’automaticité de la sanction est l’un de ceux, avec la durée des dix ans, qui font le plus débat. Dressant un parallèle avec le régime des incapacités d’exercice d’une fonction publique élective en cas de faillite personnelle (sanction facultative et limitée à cinq ans par la loi de sauvegarde des entreprises), le professeur Haritini Matsopoulou, dans un récent article consacré à l’interdiction de gérer, a estimé qu’« Il est regrettable que les auteurs des ordonnances aient cru devoir se référer au système ancien de la peine accessoire et n’aient pas pris en considération les avis émis par les rapporteurs de la loi d’habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, qui demandaient qu’une incapacité commerciale ne soit pas attachée automatiquement à une condamnation » (77). Le même auteur a par ailleurs qualifié, dans le même article, d’« abstrait et arbitraire » le délai de dix ans prévu à l’article L. 128-1 du code de commerce.
Le fait que cette question soit de nouveau soulevée devant le législateur, quatre ans après l’habilitation de 2004, montre que les critiques émises à l’encontre du dispositif en vigueur sur les incapacités commerciales et industrielles ne sont sans doute pas si infondées que cela. Il est néanmoins dommage que, alors que la procédure des ordonnances n’a manifestement pas donné entière satisfaction dans le passé récent, le débat parlementaire se réduise une fois de plus à la portion congrue. Le sujet est certes technique mais on peut supposer que la confrontation des points de vue à travers un débat de fond sur le détail des mesures envisagées aurait permis de parfaire un dispositif que l’ordonnance du 6 mai 2005 n’a pas mis à l’abri de toute contestation.
L’habilitation sollicitée par le Gouvernement a notamment pour objet de rendre complémentaires ou alternatives, ainsi que le permettent les articles 131-6 et 131-10 du code pénal, les sanctions d’incapacité d’exercer une activité commerciale ou industrielle prononcées jusqu’alors sur le fondement de l’article L. 128-1 du code de commerce. En l’espèce, il s’agit de favoriser la réinsertion professionnelle et sociale des personnes qui ont purgé leur peine criminelle ou leur délit financier antérieurs et qui en ont tiré tous les enseignements.
Cette mesure constitue un message important à l’adresse de ceux qui veulent entreprendre ou qui entreprennent dans notre pays. Eux aussi ont droit à une seconde chance, dès lors qu’ils ont assumé leurs fautes. On ne saurait en effet contester que la commission de certaines infractions actuellement énumérées à l’article L. 128-1 du code de commerce ne justifie pas systématiquement le prononcé d’une interdiction commerciale ou industrielle qui, bien souvent, hypothèque les possibilités de réinsertion de l’intéressé. Le juge doit donc se voir reconnaître la possibilité de faire preuve de discernement.
La société et l’économie française y ont d’ailleurs tout à gagner car le principe de la sanction des fautes demeure. En outre, l’interdiction d’exercer son activité professionnelle reste, en soi, suffisamment pénalisante et dissuasive.
C’est donc à un rééquilibrage, et non à une atténuation des sanctions, que le Gouvernement entend procéder. En aucune manière, les modifications envisagées ne conduiront à baisser la garde contre les pratiques délétères ou condamnables. Bien au contraire, sans remettre en cause la condamnation des écarts inacceptables, elles contribueront à désinhiber les entrepreneurs en activité ou ceux qui souhaitent le devenir, pour le plus grand profit du dynamisme et de la croissance de la France.
Dans une économie mondialisée, affranchie de la plupart des barrières douanières, la compétition s’exerce à tous les niveaux. Si les entreprises doivent être en mesure de se mesurer à leurs concurrentes, les États ont également un rôle à jouer en favorisant l’implantation sur leur territoire des investissements productifs et en créant les conditions de l’épanouissement des relais de croissance de demain. La France, même si elle a davantage pris en compte cette problématique ces dernières années, demeure pénalisée par de réels handicaps (35 heures, niveau des prélèvements obligatoires, dette, etc.). La résolution de tous les problèmes ne passe pas par le présent projet de loi, mais force est de reconnaître que les dispositions qu’il contient revêtent un intérêt majeur en ce qu’elles ambitionnent de placer la France aux premiers rangs des pays qui innovent et valorisent les atouts de leur propre territoire.
A. DES CONDITIONS DE RÉSIDENCE PLUS ATTRACTIVES POUR LES ÉTRANGERS CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE
Dans la lettre de mission qu’ils ont adressée au ministre chargé de l’immigration le 9 juillet 2007, le Président de la République et le Premier ministre ont fixé un objectif d’immigration économique représentant 50 % du total des entrées à fin d’installation durable en France d’ici la fin de l’actuelle législature. Aujourd’hui, cette catégorie d’immigration ne représente qu’environ 7 % des flux d’entrée contre 23,5 %, par exemple, pour un pays comme le Canada.
ÉVOLUTION DES PREMIERS TITRES DE SÉJOUR (1)
DÉLIVRÉS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE EN MÉTROPOLE DEPUIS 2003
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | |
Actif non salarié |
411 |
426 |
624 |
747 |
Scientifique |
1 376 |
1 274 |
1 318 |
1 407 |
Artiste |
398 |
316 |
328 |
230 |
Salarié |
7 152 |
6 322 |
6 802 |
6 563 |
Temporaire |
5 248 |
4 917 |
4 573 |
4 524 |
TOTAL |
14 585 |
13 255 |
13 645 |
13 471 |
(1) Ressortissants des États membres de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires inclus. Source : 4ème rapport au Parlement sur les orientations de la politique d’immigration, octobre 2007. | ||||
Privilégier l’immigration économique est un moyen de conforter la croissance car, d’une part, la venue d’actifs ou d’entrepreneurs étrangers diplômés permet d’enrichir le capital humain au service du développement de la France et, d’autre part, certains secteurs de production de biens ou de services ne disposent pas toujours des personnels dont ils ont besoin, de sorte que le recours à des immigrés à forte employabilité s’avère indispensable.
Conscient des enjeux avant même son élection à la tête de l’État, Nicolas Sarkozy avait esquissé, dans ses fonctions de ministre de l’intérieur, une réorientation salutaire de notre politique de maîtrise des flux migratoires tenant davantage compte des nécessités économiques de notre pays. C’est ainsi que la loi du 24 juillet 2006 (78), relative à l’immigration et à l’intégration, a mis en place les cartes « compétences et talents » (valables trois ans pour les porteurs de projets de développement) et « salariés en mission » (facilitant la mobilité des salariés des grands groupes internationaux entre divers établissements) et qu’elle a assoupli les conditions de recrutement des étrangers dans les métiers et les zones en tension (par la levée de l’opposabilité de l’emploi). Dans le même ordre d’idées, une circulaire interministérielle du 15 mars 2006 (79) a créé une procédure « cadre dirigeant et de haut niveau » – accessible désormais à tous les salariés en mission – dans le but de simplifier l’immigration professionnelle.
Beaucoup a donc déjà été fait en la matière et, à travers l’adoption de la loi du 20 novembre 2007 (80), le Gouvernement a procédé à de nouveaux assouplissements bienvenus. Pour autant, l’ampleur du hiatus entre le niveau actuel de l’immigration économique et les objectifs fixés par les plus hautes autorités de l’État appelle de nouvelles mesures pour pouvoir parvenir à une proportion plus substantielle du nombre de titres de séjour délivrés pour motif économique. C’est dans ce contexte qu’interviennent les nouveaux aménagements ciblés, notamment en direction des cadres étrangers de haut niveau, prévus par le projet de loi.
L’assurance de pouvoir résider pendant une durée relativement longue sur le territoire français influence nécessairement la décision d’implantation des créateurs d’activité et des investisseurs étrangers. Or, à l’heure actuelle, la délivrance de la carte de résident, valable dix ans, n’est de plein droit que pour les enfants étrangers de Français ou pour les étrangers qui ont été admis au statut de réfugié, en application de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle peut également avoir lieu à la discrétion des autorités préfectorales pour les étrangers qui justifient une résidence ininterrompue d’au moins cinq ans en France et qui démontrent leur volonté de s’insérer dans la société française, conformément à l’article L. 314-8 du même code. Les cadres de haut niveau et les investisseurs étrangers, qui relèvent de cette seconde catégorie, doivent ainsi remplir une condition de séjour préalable assez contraignante, pour ne pas dire rédhibitoire.
Il est heureux que le projet de loi entende rompre avec cette exigence, dans le cas bien précis des étrangers appelés à contribuer au développement économique de la France. Naturellement, des garanties sont prévues pour que l’assouplissement envisagé ne porte pas atteinte à l’ordre public puisque ni les individus en situation irrégulière, ni ceux frappés d’une condamnation pénale ne pourront prétendre au nouveau régime ainsi mis en place.
B. L’OPTIMISATION DES MOYENS CONSACRÉS À LA VALORISATION DU TERRITOIRE EN VUE DE LA LOCALISATION D’ACTIVITÉS NOUVELLES
La France, comme l’ensemble des États membres de l’Union européenne, bénéficie de crédits alloués par l’Union européenne au titre de la politique régionale de cohésion économique et sociale. Ces financements, qui ont atteint plus de 16 milliards d’euros sur la période 2000-2006 et sont évalués à plus de 12,7 milliards d’euros sur celle couvrant les années 2007 à 2013, sont principalement gérés par l’État, à un niveau déconcentré.
La réglementation européenne permettant de confier la gestion de programmes relevant des fonds structurels à des collectivités territoriales ainsi qu’à des organismes publics ou privés, certaines collectivités françaises et des établissements publics nationaux se sont vus déléguer l’utilisation de tels crédits à titre expérimental depuis 2000. La loi du 13 août 2004 (81) a donné une base légale à ces initiatives, tout en prévoyant leur évaluation. Le 6 mars 2006, le comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIADT) a estimé que ces expérimentations étaient encore trop récentes pour donner des résultats probants. Leur poursuite, à titre expérimental, s’avère donc nécessaire et le projet de loi entend y donner une base légale en modifiant, pour ce faire, l’article 44 de la loi du 13 août 2004.
La politique européenne de cohésion économique et sociale repose sur quatre piliers : la programmation pluriannuelle des aides, leur concentration sur des objectifs prioritaires, un co-financement par les États membres ainsi qu’un partenariat entre la Commission et les États s’agissant de la définition, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes. Le montant global des sommes en jeu n’a cessé de croître depuis 1988, en passant de 45 milliards d’écus (prix 1989) pour la période 1989-1993 à 213 milliards d’euros (prix 1999) pour la période 2000-2006 et 308 milliards d’euros (prix 2004) pour la période 2007-2013.
Ainsi que l’a remarqué la sénatrice Catherine Troendle, dans son rapport sur le projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, déposé au Sénat le 19 octobre 2006, qui poursuivait le même objet que l’article 33 du présent projet de loi et n’a pu achever sa navette avant l’expiration de la précédente législature, ce qui l’a rendu caduc : « La politique européenne de cohésion constitue, depuis son origine, une source importante de financements pour la France » (82). Il est vrai que le détail des transferts dont a bénéficié notre pays depuis 1988 se passe de commentaire, la France ayant obtenu :
– 6,9 milliards d’écus (prix courants) sur la période 1989-1993, soit 0,14 % du produit intérieur brut (PIB) national ;
– 14,9 milliards d’écus (prix 1993) sur la période 1994-1999, soit 0,22 % du PIB ;
– 16,1 milliards d’euros (prix 2004) sur la période 2000-2006, soit 0,2 % du PIB.
En raison de l’aggravation des disparités régionales au sein de l’Union liées à l’arrivée des nouveaux États membres, d’une part, et de la volonté des contributeurs nets de stabiliser leurs abondements au budget communautaire, d’autre part, il a été acté que la France recevra désormais moins de crédits en provenance de la politique régionale au cours des années à venir. En contrepartie, les objectifs des aides seront plus ciblés et leurs conditions d’octroi simplifiées. Pour la période 2007-2013, ce sont ainsi quelque 12,7 milliards d’euros (prix 2004) qui devraient échoir à notre pays, soit 4,1 % de l’ensemble des crédits de la politique de cohésion.
L’impact de ces transferts sur l’économie française n’est pas négligeable, loin s’en faut. Dans un rapport d’information réalisé au nom de la délégation du Sénat à l’aménagement et au développement du territoire, les sénateurs Jean-François Poncet et Jacqueline Gourault mettaient d’ailleurs en exergue « l’important effet de levier des fonds structurels en France, tant sur les financements publics (1,56 euro par euro dépensé au titre de l’objectif 2 [reconversion des zones en difficultés NDLR], selon des données transmises par la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne), que sur les fonds privés (0,94 euro par euro dépensé) » (83). De fait, il est indéniable que les transferts de l’Union européenne permettent, dans les régions les plus touchées par des difficultés économiques, de réaliser des projets de reconversion qui, sans l’appui financier européen, n’auraient aucune chance d’aboutir. Autrement dit, les conditions d’utilisation de ces enveloppes constituent bien un enjeu d’attractivité.
Trois objectifs prioritaires ont été assignés à la politique de cohésion pour la période 2007-2013.
Le premier, qui mobilise plus de 81,5 % des crédits de l’enveloppe globale, concerne la convergence des États et des régions les plus pauvres avec le niveau moyen de développement de l’Union. En France, seules quatre régions d’outre-mer sont éligibles à ces aides, pour un montant total de 2,8 milliards d’euros.
Le deuxième, absorbant près de 16 % des dotations prévues par la Commission, a trait à la compétitivité régionale et à l’emploi, objet en rapport direct avec la problématique de l’attractivité économique du territoire. Il appartient, en la matière, aux États membres de présenter la liste des régions susceptibles de bénéficier de ces crédits, qui s’élèvent à 9,1 milliards d’euros pour la France.
Le dernier, auquel ne sont affectés que 2,5 % du budget de la politique de cohésion, relève de la coopération territoriale européenne. Sa mise en œuvre peut être confiée à un nouvel instrument de coopération, le groupement européen de coopération territoriale, dont le Parlement a récemment reconnu l’existence dans notre code général des collectivités territoriales en adoptant définitivement une proposition de loi en ce sens de M. Marc-Philippe Daubresse (84). Le montant attribué à la France à ce titre est plus modeste, puisqu’il s’élève seulement à 773 millions d’euros.
RÉPARTITION DES CRÉDITS ALLOUÉS À LA FRANCE
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE COHÉSION
(en millions d’euros)
Période 2000-2006 |
Période 2007-2013 | ||
Objectif 1 (développement et ajustement structurel des régions en retard) |
2 939 |
Convergence |
2 831 |
Soutien transitoire |
498 |
Compétitivité régionale et emploi |
9 101 |
Objectif 2 (reconversion économique et sociale des zones en difficultés) |
6 679 | ||
Objectif 3 (modernisation des systèmes d’éducation, de formation et d’emploi) |
5 013 | ||
Initiatives communautaires |
1 016 |
Coopération territoriale européenne |
773 |
TOTAL |
16 145 |
TOTAL |
12 704 |
En vertu des marges de manœuvre laissées par l’Union aux États membres pour organiser le pilotage et la gestion des fonds structurels européens, la France a jusqu’à présent fait le choix d’une responsabilité incombant à l’État, bien que largement déconcentrée au niveau régional. Ce choix n’a pas été remis en cause par le CIADT qui s’est tenu le 6 mars 2006. Pour autant, dans le prolongement de la volonté politique d’une décentralisation plus importante de responsabilités en rapport avec le fonctionnement au quotidien des collectivités territoriales, il n’a pas non plus été prévu de revenir sur l’expérimentation en cours, notamment dans la région Alsace, le recul manquant avant de prendre toute décision définitive sur la question. Or, c’est justement pour laisser à un tel processus la possibilité de produire tous ses effets (un bilan étant prévu fin 2010), que le projet de loi vise à reconduire les bases juridiques sur lesquelles il repose.
Les règlements communautaires laissent aux États membres une grande latitude pour la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion économique et sociale. C’est ainsi que :
– pour la période 2000-2006, les articles 9 et 15 du règlement du Conseil du 21 juin 1999 (85) laissaient la possibilité à toute autorité nationale compétente désignée par l’État au niveau national, régional ou autre d’élaborer les documents de programmation, les fonctions d’autorité de gestion pouvant être dévolues à toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre, ainsi que celles d’autorité de paiement à un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désigné par l’État membre ;
– pour la période 2007-2013, les articles 32 et 59 du règlement du Conseil du 11 juillet 2006 (86) prévoient, quant à eux, que chaque programme opérationnel peut être établi par toute autorité désignée par l’État membre, l’autorité de gestion pouvant être une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre et l’autorité de certification, une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l’État membre.
De surcroît, la possibilité de déléguer la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, « y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales » est explicitement mentionnée à l’article 42 du règlement du 11 juillet 2006.
De la sorte, il est permis de décentraliser assez largement la gestion des enveloppes des fonds structurels européens. Les seules limites posées à la liberté de désignation des États membres résident en fait dans l’unicité de l’autorité de gestion et le respect d’un champ géographique en rapport avec l’objectif poursuivi (en l’espèce, les niveaux national et régional pour l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi). Pour la période 2007-2013, sur vingt-sept États membres, l’État a exclusivement été désigné dans seize pays, les régions dans sept autres, et un système mixte, confiant la gestion de certains fonds à l’État et d’autres aux régions, a été adopté dans les quatre derniers.
OPTIONS DE GESTION DES CRÉDITS DES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS PRISES PAR LES 27 ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PÉRIODE 2007-2013
État |
Régions |
Systèmes mixtes |
Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France (sauf Alsace, par expérimentation), Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovénie Suède, Roumanie. |
Allemagne (Länder), Belgique, Irlande, Italie, Pologne, République tchèque. |
Autriche (Länder pour le FEDER, État pour le FSE), Pays-Bas (Provinces pour le FEDER État pour le FSE), Slovaquie (région de Bratislava et État pour le reste), Royaume-Uni (État, sauf pour le Pays de Galles). |
NB : FEDER : Fonds européen de développement régional ; FSE : Fonds social européen. Source : Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. | ||
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels et, plus récemment, à l’occasion de l’adoption par le Sénat de la proposition de loi précitée de M. Marc Philippe Daubresse, la sénatrice Catherine Troendle s’est interrogée sur l’obligation d’adopter une disposition législative spécifique visant à permettre la poursuite du transfert expérimental des fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de certification des crédits de programmes ou de fonds européens destinés à certaines collectivités territoriales sur la période 2007-2013. En effet, aux termes de l’article 131 de la loi du 13 août 2004, le préfet de région met en œuvre les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’État, et non plus les politiques communautaires concernant le développement économique et social ainsi que l’aménagement du territoire, en général.
Les rapporteurs de la loi de 2004, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ont estimé que la nouvelle rédaction de l’article 21-1 de la loi du 5 juillet 1972 (87), définissant la compétence des préfets de région, n’apportait pas de changement de fond quant aux prérogatives de l’intéressé vis-à-vis de la mise en œuvre des politiques communautaires relevant de l’État. Mme Catherine Troendle, quant à elle, y a vu la fin d’une compétence exclusive du préfet de région, susceptible de permettre de confier aux collectivités territoriales, en toute sécurité juridique, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement des fonds structurels pour la période 2007-2013.
Mais le Gouvernement n’a pas rejoint cette interprétation, conforté en cela par le Conseil d’État qui, par deux fois, n’a pas infirmé la présentation de dispositions législatives spécifiques (en 2006, à l’occasion du dépôt du projet de loi finalement resté en déshérence, puis cette année, à travers le présent projet de loi). Son attitude de prudence ne saurait être critiquée, tant les compétences de l’État et des collectivités locales restent enchevêtrées. Comme l’admettait d’ailleurs elle-même Mme Catherine Troendle, dans son rapport sur le projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens : « Si nombre d’opérations financées par les fonds structurels semblent pouvoir relever de [la compétence] des régions, certaines d’entre elles pourraient être rattachées, par exemple, à la politique de l’emploi qui est restée nationale. Mieux vaut donc prévenir tout risque de contentieux » (88).
Le droit de la propriété industrielle s’est construit au fil de l’histoire, en France. A certains égard, il procède en partie de l’héritage des privilèges accordés à partir du XIVème siècle aux artisans et inventeurs réputés, leur conférant un droit exclusif de fabrication, dérogatoire des normes corporatives. La première loi française sur les brevets remonte au 7 janvier 1791 ; rompant avec l’attribution arbitraire d’un privilège exclusif, elle posa le principe d’un droit de l’inventeur, fondé sur des conditions objectives.
Il faudra attendre la loi sur les brevets d’invention du 5 juillet 1844 pour que soit mis en place un système d’enregistrement administratif des demandes de brevets. Progressivement, le mécanisme acquerra des perfectionnements sans que, pour autant, les principes de la loi de 1844 ne soient remis en cause. Depuis la seconde moitié du XXème siècle, en revanche, la relative stabilité du cadre juridique de la protection des droits de propriété industrielle a cédé le pas à une évolution périodique, dictée tantôt par le souci de compléter l’étendue de la protection, tantôt par la nécessité de mieux prendre en compte l’évolution du cadre international des droits de propriété industrielle, à l’image de la loi du 13 juillet 1978 (89) destinée à harmoniser notre droit interne avec la convention de Munich sur la délivrance des brevets européens (CBE), du 5 octobre 1973.
Les dispositions prévues par le présent projet de loi en matière de propriété industrielle ont elles mêmes un objet similaire, puisqu’elles tendent tout à la fois à tirer les conséquences de changements importants introduits dans la CBE, tout en améliorant et en simplifiant les procédures d’enregistrement, de délivrance des titres et de mise en œuvre des droits par leurs titulaires, dans le prolongement d’autres engagements internationaux plus récents encore.
1. L’harmonisation de la législation française avec les dernières évolutions retenues dans la convention sur le brevet européen
Jusqu’à la signature de la CBE, la protection par brevet en Europe supposait le dépôt d’une demande de brevet dans chaque pays, selon une procédure à chaque fois spécifique. Entrée en vigueur le 7 octobre 1977, la convention de Munich a créé l’organisation européenne des brevets, qui regroupe actuellement trente-deux États (à savoir l’ensemble des États membres de l’Union européenne, la Turquie, la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et Monaco), et centralise la procédure de délivrance des brevets européens via l’office européen des brevets (OEB).
Le premier brevet européen a été délivré en 1980. Depuis cette date, plus de 2,2 millions de demandes ont été adressées à l’OEB. Il convient de préciser que le brevet européen n’est pas un titre commun à l’ensemble des membres de l’organisation européenne des brevets ; il s’agit simplement d’une demande centralisée, dont la délivrance donne lieu à la subdivision en autant de brevets nationaux qu’il y a de pays désignés sur la demande.
La CBE conduit donc davantage à une uniformisation des aspects formels et procéduraux des titres de propriété industrielle en Europe qu’à leur unification sur le plan matériel, au niveau européen.
Le nombre de demandes reflète la forte croissance du travail de l’OEB : alors que, depuis sa création, 100 000 demandes lui avaient été adressées à la fin de 1983, puis 500 000 fin 1992 et 1 million fin 1998, l’office a traité 208 000 demandes sur la seule année 2006. Le nombre de dossiers augmente ainsi de 5 % par an.
S’agissant du nombre de titres délivrés, l’OEB en recense, à ce jour, quelque 760 000. En 2006, plus de 135 000 procédures de délivrance ont été engagées, dont près de la moitié ont émané des États parties à la CBE, un quart des États-Unis et un sixième du Japon.
Même si les brevets européens et français sont clairement distincts, leurs régimes juridiques restent nécessairement liés. Ainsi, les récentes modifications apportées à la CBE par l’acte de révision adopté à Munich fin novembre 2000, dont la ratification a été autorisée par une loi du 17 octobre 2007 (90), doivent faire l’objet d’une intégration en droit national, pour les principales d’entre elles. Tel est justement l’objet du projet de loi, qui comporte trois modifications d’ordre matériel pour notre droit des brevets.
La première réside dans le cantonnement des inventions brevetables aux domaines technologiques. Cette précision n’engendre pas de changement fondamental par rapport aux principes jusqu’alors en vigueur, dans le code de la propriété intellectuelle. Elle lève cependant toute ambiguïté, à l’instar des principaux engagements souscrits par la France en matière de propriété intellectuelle, que ce soit dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce ou au niveau de l’organisation européenne des brevets.
La seconde évolution, plus notable cette fois-ci, concerne la protection des applications thérapeutiques nouvelles de composants et de substances déjà connus et brevetés. L’acte de révision de la CBE a en effet explicitement prévu, pour favoriser le développement des applications industrielles de méthodes et d’associations thérapeutiques inédites, la brevetabilité de telles innovations en dépit de la protection qui aurait pu être antérieurement accordée à leurs composantes. Aux termes de la rédaction actuelle de l’article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle la législation française avait jusqu’à présent privilégié une interprétation plus restrictive. Compte tenu des risques d’insécurité juridique encourus par les titulaires de droits devant les juridictions d’autres pays membres de l’organisation européenne des brevets, un alignement sur les dispositions nouvelles de la CBE s’impose.
La dernière modification, quant à elle, consiste à assouplir les conditions dans lesquelles un titulaire de droits pourra limiter ou révoquer son brevet, ainsi que le prévoit la nouvelle version de la CBE. En l’espèce, les titulaires de brevets disposeront d’un panel plus varié d’options juridiques à leur disposition pour défendre et exploiter les droits conférés par leurs titres.
Au total, cet ensemble de dispositions devrait encourager l’innovation, en allégeant certaines contraintes sans pour autant affaiblir, loin s’en faut, le niveau de protection garanti aux titulaires de brevets.
2. La nécessité de prendre en compte les autres avancées et simplifications prévues par le droit international
Le projet de loi ne se borne pas à mieux coordonner les dispositions de droit interne relatives aux brevets avec celles de la CBE, telles que modifiées en 2000. Il comporte également un article d’habilitation du Gouvernement à prendre deux ordonnances, afin :
– d’une part, d’adapter le code de la propriété intellectuelle aux prescriptions des traités sur le droit des brevets du 1er juin 2000 et sur le droit des marques du 27 mars 2006, ainsi qu’aux nécessités découlant de l’adoption d’un emblème additionnel par la Croix rouge dans un protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
– d’autre part, à simplifier et à améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété intellectuelle, tout en garantissant mieux l’exercice des droits par leurs titulaires.
À la différence de la réforme envisagée de la loi de sauvegarde des entreprises, votre rapporteur pour avis n’a pas eu communication des projets d’ordonnances du Gouvernement relatifs à ces deux aspects. Il n’en reste pas moins convaincu de l’utilité de la démarche retenue.
Dans le premier cas, en effet, les traités visés comportent tous des formalités de dépôt allégées et plus modernes, tandis que les conditions de remise en cause devant la justice des droits des titulaires de titres de propriété industrielle se trouvent durcies. Dans le second, il s’agit d’amplifier la démarche de simplification et de renforcement de la protection accordée aux créateurs d’inventions. La conjugaison de toutes ces modifications du droit actuel devrait donc singulièrement revaloriser l’intérêt des droits de propriété industrielle aux yeux des intéressés (et tout particulièrement des jeunes créateurs et des PME), alors même que leur attractivité fait actuellement un peu défaut en France puisque le nombre de dépôt de brevets, notamment, y est moindre que dans d’autres pays d’Europe tels que l’Allemagne ou le Royaume-Uni. En pleine compétition des économies du savoir, ces ajustements sont plus que nécessaires au développement de la croissance de notre pays.
La Commission a examiné les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34 et 35 du projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842), au cours de sa séance du jeudi 15 mai 2008. Après l’exposé du rapporteur pour avis, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.
M. Serge Blisko s’est interrogé sur les conséquences des dispositions relatives à l’équipement commercial qui traduisent un accroissement effréné du libéralisme dans ce domaine. Il a estimé que dans les centres-villes, il est peu probable que se passer de l’avis de la commission départementale de l’équipement commercial pour les implantations de surfaces de vente nouvelles inférieures à 1 000 mètres carrés permettra de remédier aux difficultés des commerces. Il a jugé que cette réforme n’est pas adaptée aux commerces de centre-ville qui s’adressent généralement à une clientèle captive, notamment les personnes âgées ou ne disposant pas d’un véhicule automobile, alors même que la France n’est nullement en retard en ce qui concerne l’implantation de grandes surfaces sur son territoire. Toutefois, il a pris acte de la volonté exprimée par le rapporteur pour avis de renforcer l’action du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC).
Il a ensuite critiqué la disposition de l’article 32 créant une carte de résident pour les étrangers qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France. S’interrogeant sur l’opportunité de la création de cette nouvelle carte, au détour d’un projet de loi de modernisation de l’économie, alors que de très nombreuses nouvelles cartes de séjour ont été créées par les récentes lois sur l’immigration, il a considéré que la disposition en cause révèle une vision uniquement utilitariste de l’immigration qui est déplaisante, en créant une procédure plus avantageuse pour ceux qui disposent de moyens financiers. Il s’est montré convaincu qu’il aurait été possible de délivrer à ces étrangers la carte « compétences et talents » créée par la loi du 24 juillet 2006 et a indiqué que le groupe SRC demandera certainement la suppression de cet article.
M. Thierry Lazaro a indiqué qu’il adhérait à la philosophie générale du projet de loi mais a formulé quelques réserves sur la libéralisation de l’implantation des grandes surfaces. Il s’est interrogé sur les études tendant à montrer qu’il y aurait un déficit d’équipement commercial dans la région Nord-Pas-de-Calais. Citant l’exemple de sa commune, il a craint que le développement de grandes surfaces, dont deux sont déjà installées à quelques kilomètres et une troisième devrait bientôt être créée, ne fragilise la situation de l’unique supérette présente existante. Il estimé, plus globalement, qu’il était légitime de s’interroger sur la pertinence des procédures en vigueur, les trois quarts des avis des commissions départementales de l’équipement commercial se trouvant contredits par la commission nationale de l’équipement commercial.
En réponse aux intervenants, le rapporteur pour avis a indiqué qu’il souhaitait garantir le caractère équilibré des dispositions du projet de loi et il s’est déclaré convaincu que le débat sur les amendements qu’il soumettait à la Commission, notamment au sujet de l’urbanisme commercial, offrirait l’occasion d’apporter de plus amples précisions sur les points soulevés ainsi que sur les inquiétudes exprimées.
La Commission est alors passée à l’examen des articles dont elle s’est saisie pour avis.
TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
Le titre Ier du projet de loi s’avère particulièrement dense sur la forme et le fond, puisqu’il comporte près de la moitié des articles de la version initiale du texte. Il traite d’un aspect essentiel de la croissance, à savoir la création, le développement et la pérennisation des entreprises.
Chapitre Ier
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel
Comme cela a été souligné précédemment, l’entrepreneur individuel français jouit d’un statut bien moins avantageux que le gérant d’une société. Ceci explique, entre autres, l’essor des sociétés à responsabilité limitée au détriment des entreprises individuelles, alors même que les secondes offrent à bien des égards davantage de souplesse, notamment dans la perspective d’un cumul d’activités (salariat et création d’une entreprise personnelle, notamment). Dotant l’auto-entrepreneur d’un véritable statut, le chapitre Ier de ce projet de loi répond donc à un véritable besoin juridique. Il reprend d’ailleurs l’essentiel des propositions formulées sur le sujet par M. François Hurel, dans son rapport remis au Gouvernement le 10 janvier 2008.
Article 3
(art. L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce,
art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 1600 du code général des impôts,
art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982)
Dispense d’immatriculation pour les petites activités
en cumul d’une activité salariale
Cet article du projet de loi poursuit un salutaire objectif de simplification des démarches et de réduction des charges pour les salariés ou les retraités qui exercent une activité individuelle complémentaire générant, à titre accessoire et provisoire, de faibles ressources. En l’espèce, il s’agit d’encourager l’esprit d’initiative de personnes que leur situation d’inactif ou de salarié ne satisfait pas totalement au plan professionnel ou qui souhaitent exploiter une idée susceptible d’engendrer de l’activité et, par répercussion, un complément de revenus.
En l’état actuel du droit, ces personnes sont aujourd’hui obligées de procéder à leur immatriculation :
– au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de l’Alsace-Moselle, si elles n’emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat ;
– éventuellement, de manière cumulative, au registre du commerce et des sociétés, dès lors qu’elles ont la qualité de commerçant, aux termes de l’article L. 123-1 du code de commerce.
Outre leur caractère contraignant sur le plan administratif, ces obligations emportent des conséquences significatives sur le plan financier puisqu’elles sont assorties de frais d’actes (de greffe et d’immatriculation) et d’effets fiscaux, à travers un assujettissement à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres des métiers et de l’artisanat (123 euros de droits fixes pour ces seules dernières en 2007). Dans bien des cas, les montants exigés s’avèrent rédhibitoires et découragent ceux qui n’ont d’autre perspective que de tirer des revenus limités de leur démarche, du moins à court terme.
En fait, l’immatriculation aux registres de publicité légale n’apparaît pas indispensable dès lors que les activités en cause ne sont pas susceptibles d’excéder les seuils de chiffre d’affaires actuellement fixés pour le régime des micro-entreprises (soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 27 000 euros pour les prestations de services et inférieur à 76 300 euros pour la vente de marchandises, objets, fournitures ou denrées ainsi que de logement), surtout si les tiers sont pleinement informés par d’autres moyens. Telle est justement la raison pour laquelle, les paragraphes I et II de cet article instaurent une dérogation au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (par la création d’un article L. 123-1-1) et au sein de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (en son article 19).
Cette dérogation est assortie de deux conditions précises. En premier lieu, le bénéficiaire devra être salarié ou percevoir une pension de retraite. En second lieu, son activité indépendante ne devra pas excéder un seuil, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourrait correspondre à 50 % des plafonds annuels prévus pour le régime de la micro-entreprise. Il appartiendra également au décret en Conseil d’État précité de définir les modalités de déclaration d’activité des intéressés auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), étant précisé que toute dispense d’immatriculation devra également être signalée en lieu et place du numéro d’immatriculation afin de permettre aux tiers d’être pleinement informés.
Si, dans le cas de la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de l’Alsace-Moselle, la conséquence directe du II de cet article est la suppression des frais d’actes et de la taxe perçue au profit des chambres de métiers et d’artisanat, il n’en va pas de même vis-à-vis des chambres de commerce et d’industrie du seul fait de la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prévue au I. En l’espèce, une modification de l’article 1600 du code général des impôts est indispensable, ce qui explique le paragraphe III du présent article.
Actuellement, onze catégories de personnes physiques ou morales sont exonérées de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d’industrie. Le I de l’article 1600 du code général des impôts énumère, entre autres, les loueurs de meublés, les sociétés d’assurance mutuelle, les artisans non portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription, les caisses de crédit agricole ou mutuel, les sociétés coopératives agricoles ou encore les artisans pêcheurs. Y sera désormais adjointe la catégorie des personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.
Afin d’atténuer les effets de franchissement des seuils prévus à l’article L. 123-1-1 du code de commerce et au V de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996, le paragraphe IV du présent article du projet de loi vise à exonérer de l’obligation de stage de préparation à l’installation toute personne exerçant une activité artisanale individuelle qui, du fait de son succès, dépasserait le niveau de chiffre d’affaires requis pour demeurer dispensé d’immatriculation. L’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 (91), qui prévoit cette obligation de formation préalable à l’immatriculation (à travers une initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique ainsi qu’une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale), énumère actuellement trois exceptions limitées : les cas de force majeure (qui ne donnent lieu qu’à un report de la formation, et non à son annulation) ; les formations antérieures au moins équivalentes ; l’exercice d’activités requérant un niveau de connaissance au moins équivalent pendant trois ans minimum.
Il apparaît tout à fait logique d’inclure dans le champ de ces exceptions, les personnes qui, même si elles n’ont pas exercé leur micro-activité à titre principal, ont accompli des tâches de gestion de manière suffisamment efficace pour permettre à leur chiffre d’affaires de dépasser les seuils en deçà desquels elles se situaient peu de temps auparavant. Une telle mesure s’apparente à une simplification bienvenue et l’on ne peut évidemment qu’y souscrire.
Le rapporteur pour avis a présenté deux amendements étendant le dispositif de l’auto-entrepreneur aux conjoints et personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité.
M. Bertrand Pancher a demandé si le dispositif de l’article 3 était applicable aux fonctionnaires, dont beaucoup souhaiteraient pouvoir disposer de compléments de revenu.
Après que le rapporteur pour avis eut répondu que ce n’était pas le cas, la Commission a adopté ces amendements (amendements n° 67 et 68).
La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis (amendements n°s 69 et 70), puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.
Article 4
(art. L. 443-11, art. L. 631-7, art. L. 631-7-2, art. L. 631-7-4 [nouveau]
du code de la construction et de l’habitation)
Assouplissement des conditions d’utilisation des
locaux d’habitation en locaux commerciaux
Le rapport de M. François Hurel en faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant, remis au Gouvernement le 10 janvier 2008, insiste particulièrement sur les difficultés rencontrées par les personnes physiques locataires de logements pour y localiser leur activité. Ce problème constitue l’un des aspects d’un enjeu beaucoup plus vaste, qui concerne l’assouplissement des modalités de transformation de locaux d’habitation en locaux commerciaux ou à usage mixte.
Le présent article du projet de loi s'attelle justement à trouver des réponses adaptées en la matière, en apportant des aménagements ciblés au code de la construction et de l’habitation qui se traduiront par de réelles simplifications pour les locataires soucieux de créer leur entreprise mais ne pouvant disposer de locaux qui y soient dédiés, faute de moyens.
À cet effet, le paragraphe I, tout d’abord, aménage sensiblement le régime applicable aux occupants d’habitations à loyer modéré (HLM). Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’HLM de quartiers sensibles ou prioritaires de la politique de la ville peuvent d’ores et déjà louer, à titre temporaire, des locaux situés en rez-de-chaussée en vue d’y exercer des activités économiques. Le caractère temporaire de cette location constitue, assurément, une restriction que le I du présent article entend opportunément lever, étant entendu que le bail d’habitation de ces locaux ne sera nullement soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, relatives au régime des baux commerciaux, ni ne s’apparentera à un élément constitutif du fonds de commerce.
Le II introduit, pour sa part, une exception au régime d’autorisation administrative préalable du changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de la petite couronne de Paris (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis), posé à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, les locaux situés au rez-de-chaussée et ne relevant pas des organismes d’HLM pourront faire l’objet d’une utilisation commerciale sans que leur locataire y ait été auparavant autorisé.
Le III assouplit et élargit très notablement les conditions requises pour que puisse s’exercer une activité professionnelle dans la résidence principale. L’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit actuellement deux exigences très strictes puisque :
– d’une part, l’autorisation ne peut être délivrée par le préfet que si l’utilisation à des fins professionnelles porte sur une partie seulement de la résidence principale ;
– d’autre part, de manière cumulative, la profession exercée ne doit revêtir à aucun moment un quelconque caractère commercial, c’est-à-dire qu’elle ne saurait s’apparenter à la réalisation d’actes réputés de commerce aux termes des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.
La nouvelle rédaction de l’article L. 631-7-2 précité modifie en profondeur le cadre actuel, en étendant aux activités professionnelles commerciales le bénéfice du régime de l’autorisation préfectorale (sauf pour les locaux d’HLM), tout en maintenant l’exigence d’une utilisation à cette fin d’une partie seulement de la résidence principale et en posant la réserve qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle du bail ou du règlement de copropriété ne s’y oppose. Le texte est également assorti de garde-fous importants pour la copropriété, en imposant que l’activité ainsi exercée n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni désordre pour le bâti. De tels critères avaient été suggérés par M. François Hurel dans son rapport du 10 janvier dernier. Une fois encore, le bail ne pourra être assimilé, dans ce cadre, à un bail commercial ni être considéré comme un élément constitutif du fonds de commerce.
Enfin, le IV introduit un régime d’autorisation générale de l’exercice d’activités professionnelles pouvant revêtir une nature commerciale et conduire à recevoir de la clientèle et des marchandises dans une partie des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée (hors HLM, dont le cas est réglé par l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation), dès lors que leurs occupants qui y ont leur résidence principale sont les seuls à exercer ces activités. Parmi les conditions posées, figurent là aussi l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles du bail ou du règlement de copropriété qui soient contraires, ainsi que le défaut de nuisances, de danger pour le voisinage et de désordres pour le bâti. De nouveau, le bail n’est pas assimilé, dans de telles conditions, à un bail commercial et il ne peut être considéré comme un élément constitutif du fonds de commerce.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.
Article 5
(art. L. 526-1, art. L. 526-3 du code de commerce,
art. L. 330-1, art. L. 332-9 du code de la consommation)
Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel
Le présent article vise à renforcer et à étendre les protections dont l’entrepreneur individuel peut bénéficier, s’agissant d’un patrimoine personnel qui se confond largement avec celui de l’entreprise.
a) L’extension du champ de l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur individuel
La loi du 1er août 2003 a introduit une atténuation importante à l’impossibilité juridique de constituer un patrimoine d’affectation pour une entreprise individuelle ou une activité libérale, agricole ou artisanale, qui soit distinct du patrimoine personnel du titulaire de cette entreprise ou de cette activité. Les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce définissent en effet un régime d’insaisissabilité des droits – c’est-à-dire de la pleine propriété ou des démembrements du droit de propriété, tels que la jouissance ou la nue-propriété – sur l’immeuble où est fixée l’habitation principale de toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
Dérogeant à l’article 2285 du code civil, en vertu duquel « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers », cette insaisissabilité, opposable uniquement aux créances professionnelles, n’allait pas de soi. Et pourtant, elle a substantiellement conforté les petits entrepreneurs qui, ne bénéficiant pas de la protection offerte par la forme sociétaire, exposaient auparavant leur propre toit et celui de leur famille à une saisie au profit de leurs créanciers.
Il faut d’ailleurs reconnaître que le législateur a assorti ce nouveau régime de garanties importantes, notamment à travers l’exigence d’une déclaration d’insaisissabilité par acte authentique (à peine de nullité), avec publication au bureau des hypothèques. Cette publication, incontournable s’agissant de droits immobiliers, détermine la date à partir de laquelle le bien est soustrait au gage des créanciers professionnels. D’autres mesures de publicité ont également été prévues pour assurer l’information, et donc la protection, des tiers : c’est ainsi que la mention de la déclaration est portée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel lorsque la personne est immatriculée et, qu’en l’absence d’exigence d’immatriculation dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département où est exercée l’activité professionnelle, faute de quoi le déclarant ne peut se prévaloir de l’insaisissabilité de son bien.
Le présent article du projet de loi entend aller, en la matière, beaucoup plus loin que la loi de 2003 sans pour autant créer de véritable patrimoine d’affectation de l’entreprise individuelle, démarche qui comporterait trop de conséquences bouleversantes pour notre droit civil. À cet effet, il prévoit d’élargir, à l’article L. 526-1 du code de commerce, le champ de l’insaisissabilité dont peut jouir l’entrepreneur individuel, l’agriculteur ou le titulaire d’une profession libérale à l’ensemble de ses biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel. Ce faisant, l’exercice d’une activité indépendante et la création d’une entreprise individuelle verront leur attractivité juridique notablement accrue, puisque les personnes physiques concernées jouiront d’une protection patrimoniale étendue à l’ensemble de leurs biens immobiliers non professionnels.
En contrepoint, de manière à conserver de réelles possibilités pour les intéressés d’offrir des sûretés en contrepartie des crédits qu’ils pourraient être amenés à souscrire pour développer leur activité, il est également prévu d’aménager le régime de renonciation à l’insaisissabilité, prévu à l’article L. 526-3 du code de commerce. Actuellement, la renonciation – qui résulte elle-même, comme la déclaration, d’un acte notarié et fait l’objet des mêmes mesures de publicité – intervient de manière forcément globale puisque l’insaisissabilité ne porte que sur un seul type de bien. À partir du moment où l’étendue de l’insaisissabilité peut être élargie, il convient d’assouplir le mécanisme de renonciation en permettant qu’elle soit partielle, c’est-à-dire qu’elle puisse porter sur un seul bien immeuble, et qu’elle intervienne au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, expressément désignés par l’acte de renonciation. L’acte authentique de renonciation devra naturellement mentionner le consentement à l’inscription d’une sûreté sur le ou les biens concernés.
b) L’inclusion de l’entrepreneur individuel parmi les bénéficiaires des procédures liées au surendettement et permettant le rétablissement personnel
Toujours dans le souci d’améliorer substantiellement le régime juridique des petits entrepreneurs, le présent article du projet de loi apporte des aménagements au champ du surendettement et à la procédure de rétablissement personnel, afin de les en faire bénéficier. En effet, aux termes du premier aliéna de l’article L. 330-1 du code de la consommation, le dirigeant impécunieux qui s’est porté caution d’une dette de son entreprise ne peut relever du cadre juridique du surendettement ni de la liquidation judiciaire si son entreprise revêt une forme sociétaire (du fait de la distinction de patrimoines). Pour y remédier, il est donc proposé de supprimer la condition selon laquelle, pour pouvoir relever du régime du surendettement, la personne qui ne peut assumer l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une société ne doit pas en être le dirigeant ni en droit, ni en fait.
Ce faisant, le petit entrepreneur impécunieux pourra désormais bénéficier des mêmes dispositions que les particuliers surendettés. Son dossier sera, le cas échéant transmis à la commission départementale de surendettement pour parvenir à un plan de redressement négocié avec les créanciers, qui comportera des mesures de rééchelonnement des échéances, de remise de dettes ou de réduction de taux d’intérêt. En cas d’échec de la conciliation entre le créancier et ses débiteurs, la commission départementale de surendettement pourra formuler des recommandations visant à alléger ou à rééchelonner la dette, auxquelles le juge de l’exécution donnera force exécutoire en cas d’absence de contestation par l’une des parties.
Cette nouvelle possibilité offerte aux dirigeants impécunieux de relever du régime du surendettement est également importante en ce qu’elle leur permettra de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, mise en place en 2003 et inspirée du système de la faillite civile en vigueur dans plusieurs États européens ainsi qu’en Alsace-Moselle. Lorsque la commission départementale de surendettement constate, dès l’instruction ou en cours d’exécution du plan ou de ses recommandations, que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, elle doit saisir le juge en vue de placer l’intéressé, avec son accord, sous rétablissement personnel. Les effets de la mesure ne sont pas sans rappeler ceux des procédures collectives : suspension automatique des poursuites, dessaisissement du débiteur (qui ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou d’un mandataire), effacement des dettes autres qu’alimentaires. Une vérification des créances a lieu et, après avoir statué sur les éventuelles contestations à ce sujet, le juge peut prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, à l’exclusion des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle (article L. 332-8 du code de la consommation).
A l’issue de la liquidation du patrimoine, deux situations sont envisagées par l’article L. 332-9 du même code : soit l’actif permet de désintéresser les créanciers et le juge prononce alors la clôture de la procédure de rétablissement personnel ; soit l’actif est insuffisant ou inexistant et le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Toutefois, compte tenu de la rédaction actuelle du second alinéa de l’article L. 332-9, le deuxième cas de figure intervient dans un nombre de situations limitativement énumérées. Par cohérence avec l’élargissement du bénéfice de la procédure aux dirigeants surendettés qui se sont portés caution de leur propre entreprise, il convient donc de les mentionner explicitement parmi les bénéficiaires potentiels de l’effacement judiciaire de la dette en cas d’insuffisance de l’actif réalisé pour désintéresser les créanciers. Tel est justement l’objet de la dernière disposition prévue au présent article.
Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un amendement étendant aux immeubles à usage mixte l’insaisissabilité dont peuvent bénéficier les entrepreneurs individuels, notamment les artisans, sous réserve d’une désignation de la partie non affectée à un usage professionnel dans un état descriptif de division.
Après que le rapporteur pour avis a donné un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 71).
Le rapporteur pour avis a ensuite présenté un amendement dont la philosophie, comme le précédent, est d’assurer une meilleure protection des entrepreneurs individuels en précisant que l’expiration de l’insaisissabilité de l’immeuble d’habitation est reportée au décès du conjoint survivant de l’entrepreneur.
Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 72), la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 5 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 5
(art. L. 145-1 du code de commerce)
Extension du bénéfice des baux commerciaux aux personnes simplement mentionnées au registre du commerce ou au répertoire des métiers
Actuellement, l’article L. 145-1 du code de commerce prévoit que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc du droit au renouvellement d’un bail de ce type, le preneur doit être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Lorsque le bail est établi au nom de plusieurs colocataires ou lorsque le preneur est une indivision, cette obligation d’immatriculation s’étend à tous les colocataires à titre personnel, y compris ceux qui n’exploitent pas le fonds commercial ou artisanal. C’est d’ailleurs ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007, estimant qu’une simple mention ne suffisait pas.
Les copropriétaires non exploitants d’un fonds commercial ou artisanal, titulaires d’un bail commercial, sont donc dans l’obligation de demander leur immatriculation à titre personnel alors qu’ils n’ont pas d’activité commerciale ou artisanale.
Or, les textes relatifs au répertoire des métiers ne permettent pas d’immatriculer à titre personnel des personnes qui n’exercent pas d’activité artisanale. Le droit au renouvellement de leur bail ne peut donc pas leur être préservé. L’obligation d’immatriculation aboutit également à priver du droit au renouvellement les héritiers ou ayants droit du chef d’une entreprise artisanale qui choisissent au moment du décès de celui-ci de demander le maintien momentané de son immatriculation pour les besoins de la succession. Un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 janvier 2008 vient de préciser que, dans ce cas, la simple mention des héritiers ne pouvait être assimilée à une immatriculation. Il convient donc de lever toutes ces difficultés.
Le rapporteur pour avis a présenté un amendement faisant bénéficier du statut des baux commerciaux les personnes simplement mentionnées au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 73).
Chapitre II
Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises
En France, près de 97 % des entreprises recensées sont des PME de moins de dix salariés. C’est dire que la création d’activité dépend pour beaucoup de l’environnement juridique et fiscal de cette catégorie d’entreprises. Si de nombreuses mesures ont été mises en œuvre en leur faveur ces dernières années, notamment avec l’adoption des lois du 1er août 2003 pour l’initiative économique et du 2 août 2005 en faveur des PME, il n’en demeure pas moins que leur compétitivité reste aujourd’hui encore menacée par nombre de barrières législatives et réglementaires. Ce chapitre II vise opportunément à en lever quelques-unes, notamment en ce qui concerne les problèmes cruciaux des délais de paiement et de l’accès aux marchés publics.
Article 6
(art. L. 441-6, art. L. 442-6 du code de commerce)
Plafonnement des délais de paiement
dans les relations professionnelles privées
L’article L. 441-6 du code de commerce, essentiellement consacré aux conditions générales de vente et à la relation contractuelle entre les fournisseurs de biens et de services, d’une part, et les distributeurs ou importateurs, d’autre part, comporte un ensemble assez disparates de dispositions, sur lesquelles plusieurs articles du présent projet de loi visent à apporter des modifications.
Le paragraphe I du présent article vise, pour sa part, à y insérer de nouveaux alinéas encadrant les délais de paiement observés dans le contexte d’une relation commerciale.
a) L’instauration d’un plafond légal de portée générale : une nécessité incontestable
Actuellement, aux termes du huitième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, les délais de règlement d’une somme due dans le cadre d’une relation commerciale sont fixés contractuellement et, à défaut de disposition inscrite dans les conditions générales de vente ou convenue entre les parties, un délai supplétif de 30 jours s’applique. Certains secteurs d’activité et certaines catégories de marchandises font l’objet de régimes particuliers plus restrictifs : c’est le cas, notamment, des produits alimentaires périssables et de certaines boissons alcoolisées (aux termes de l’article L. 441-3 du code de commerce, notamment), et des transports (régis par le neuvième alinéa de l’article L. 441-6, depuis la loi du 5 janvier 2006).
Ainsi que cela a été précédemment souligné, les conclusions de l’observatoire des délais de paiement sont sans appel : en moyenne, les délais de paiement aux fournisseurs ont excédé 65 jours en 2006 (niveau supérieur à celui constaté dans la plupart des autres pays européens, qui s’établit en moyenne à 57 jours), ce qui a nécessairement eu de fâcheuses répercussions sur la trésorerie et la compétitivité des PME. En effet, en 2006, les créances des clients au-delà de 60 jours de chiffre d’affaires représentaient 139 milliards d’euros, soit 30 % de l’ensemble de ce type de créances ; les dettes vis-à-vis des fournisseurs au-delà de 60 jours d’achat, quant à elles, avoisinaient 104 milliards d’euros, soit 26 % de l’ensemble de ces mêmes dettes.
Certes, en 2005 et 2006, grâce à des négociations interprofessionnelles, des avancées ont été obtenues dans certains secteurs d’activité tels que celui de la production d’automobiles. Pour autant, les résultats mis en exergue par l’observatoire des délais de paiement dans son rapport pour 2007 montrent que seule la contrainte législative s’avère efficace en la matière. Suite à la loi du 5 janvier 2006, les délais moyens de paiement des entreprises de transport à leurs fournisseurs sont passés de 56 jours (sur l’année 2005) à 51,2 jours (sur l’année 2006), soit une durée bien moindre que la moyenne générale des délais de paiement observés tous secteurs confondus.
Le 1° du I de cet article du projet de loi tire les conclusions de ce constat. Il introduit dans l’article L. 441-6 du code de commerce, deux alinéas :
– l’un, plafonnant de manière générale les délais de paiement à 45 jours fin de mois, c’est-à-dire dont la computation ne commence qu’à la fin du mois, ou 60 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture ;
– l’autre, permettant l’extension à l’ensemble des opérateurs d’un secteur donné de l’opposabilité des accords interprofessionnels qui abaisseraient ce plafond. En l’espèce, fidèle au pragmatisme qu’il a toujours affiché, le Gouvernement souhaite inciter les intéressés à négocier des accords qui aillent plus loin que le plafond légal, laissant entendre que si rien n’évoluait en la matière, une nouvelle modification législative pourrait intervenir ultérieurement.
De la même manière, le III introduit une certaine souplesse dans le mécanisme instauré à l’article L. 441-6 du code de commerce, en autorisant un dépassement transitoire du plafond légal des délais de paiement qui serait négocié dans un accord interprofessionnel, dans des circonstances bien précises. En l’occurrence, il importe de tenir compte des spécificités de certains secteurs, tels que l’automobile ou le bricolage par exemple, confrontés à des rotations de stocks relativement lentes. La nouvelle règle instituée au présent article, qui vise à mettre un terme à certains abus vis-à-vis des fournisseurs, ne saurait en effet, par une extrême rigidité, tomber dans l’excès inverse à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de services.
Les termes posés par le texte ont leur importance, puisque la justification de la dérogation interprofessionnelle doit reposer sur des « raisons économiques objectives et spécifiques » au secteur concerné. En outre, cette exception ne pourra avoir des effets que temporaires – limités par le texte jusqu’au 1er janvier 2012 – et l’accord interprofessionnel devra prévoir une convergence progressive avec le délai légal, ce qui signifie que le secteur d’activité concerné ne sera pas exonéré d’efforts pour revenir le plus rapidement possible à la normale.
b) Des sanctions beaucoup plus dissuasives qu’elles ne le sont aujourd’hui
Nonobstant quelques modifications de coordination prévues aux 2° et 4° du I, il est également prévu au 3° du même paragraphe, pour assurer le respect du plafond légal de droit commun institué, d’accroître très significativement le niveau des pénalités de retard fixé par l’article L. 441-6 du code de commerce. Celles-ci passeront ainsi d’une fois et demi à trois fois le taux d’intérêt légal mis en œuvre par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (soit un taux proche de 10 % aux conditions de marché actuelles), la majoration qui lui est appliquée passant quant à elle de sept points de pourcentage à dix points de pourcentage.
Parallèlement, le paragraphe II double cet effet financier dissuasif d’une conséquence juridique non moins importante puisqu’il assimile, au 7° du I de l’article L. 442-7 du code de commerce, tout délai de paiement supérieur au délai maximal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours calendaires à une condition de règlement abusive ouvrant la voie à l’engagement de la responsabilité civile du débiteur. Actuellement, les dispositions en vigueur à ce 7° restent relativement évasives quant au caractère manifestement abusif des délais de paiement, lequel s’apprécie au regard des bonnes pratiques et des usages commerciaux. Dans ces conditions, compte tenu de la difficulté d’apporter la démonstration du préjudice subi, il n’est pas étonnant que les dispositions actuelles du 7° du I de l’article L. 442-7 soient peu invoquées dans la pratique. Il est probable que les modifications apportées par le II du présent article du projet de loi infléchissent cette situation. À tout le moins, elles auront un puissant effet dissuasif à l’égard des entreprises qui s’obstineraient à ne pas respecter le plafond fixé par la loi.
L’entrée en vigueur du plafond des délais de paiement et des nouvelles modalités de sanction financière et juridique des retards subis est fixée au 1er janvier 2009. Le Gouvernement évalue à 4 milliards d’euros, les financements susceptibles d’être dégagés au profit d’investissements productifs à la suite de l’adoption de ces dispositions, dès lors que les délais de paiement moyens seraient ramenés à 57 jours.
Le rapporteur pour avis a présenté un amendement visant à permettre à un secteur d’activité de déroger, par un accord interprofessionnel, à la règle de la computation des délais de paiement à compter de la date d’émission de la facture. Il a expliqué que certains secteurs, tels que celui de la distribution, souhaiteraient en effet que la computation des délais de paiement ne débute qu’à la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 74).
Puis elle a rejeté un amendement de M. Claude Bodin ayant pour objet de mentionner les manœuvres dilatoires utilisées pour ne pas respecter le délai contractuel de paiement au titre des abus d’une relation de dépendance justifiant la réparation du préjudice causé, après que le rapporteur pour avis a émis un avis défavorable à cet amendement.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis ayant pour objet de permettre une dérogation par voie réglementaire à la date butoir au-delà de laquelle les dérogations prévues en matière de délais de paiement ne seront plus acceptées (amendement n° 75), ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 76).
La Commission a alors émis un avis favorable à l’adoption de l’article 6 ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 214-41 du code monétaire et financier)
Expérimentation temporaire d’une attribution préférentielle aux PME innovantes d’une certaine proportion de marchés publics technologiques
Cet article est la traduction juridique de l’engagement politique pris par la majorité de permettre aux PME d’accéder plus facilement aux marchés publics, notamment dans les secteurs à forte valeur technologique. En la matière, le législateur se doit d’adopter une démarche prudente, dans la mesure où un certain nombre de prescriptions de portée supra-législative s’imposent à lui.
a) Le cadre juridique de la commande publique : des exigences de niveaux multiples
La commande publique est régie par plusieurs normes de droit international et national, à savoir :
– l’accord multilatéral sur les marchés publics (AMP), signé dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC) le 15 avril 1994 ;
– le droit communautaire, et tout particulièrement les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004 précédemment évoquées, qui ont repris un certain nombre de principes et de règles générales de l’AMP ;
– enfin, au niveau national, le code des marchés publics du 1er août 2006, à valeur réglementaire.
Si l’article III de l’AMP est généralement interprété comme interdisant d’inclure, comme condition d’attribution d’un marché public, des critères tels que le respect de certaines conditions sociales (participation à la réinsertion professionnelle, emploi de chômeurs de longue durée notamment), du fait que ces critères pourraient être considérés comme étant discriminatoires par rapport à des entreprises étrangères, il n’interdit pas formellement d’adopter une mesure de discrimination positive en faveur des PME dès lors qu’il serait avéré que cette mesure ne présente pas d’effet équivalent à une restriction aux échanges. Or, comme l’a indiqué le rapport du comité Richelieu sur l’accès des PME innovantes aux marchés publics : « Précisément, s’agissant des PME innovantes, dont certaines sont des acteurs du marché mondial, on pourrait démontrer que des mesures de discrimination positive ne constituent pas une application déguisée de la préférence nationale » (92).
De manière quelque peu similaire, le droit communautaire pose le principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans la passation des marchés publics. À la différence du droit national (le code des marchés publics, en l’occurrence), qui vise à garantir le meilleur usage de l’argent des contribuables en veillant à ce que les collectivités publiques achètent au meilleur rapport qualité-prix, il a pour objectif d’assurer la transparence des marchés publics des États membres pour toutes les entreprises européennes. Cela ne signifie pas pour autant que des critères non-économiques ne puissent pas être pris en considération, notamment s’agissant des conditions d’exécution des marchés, comme la directive 2004/18/CE l’a implicitement admis, dans son considérant 33 et son article 26.
Au plan national, enfin, le Conseil constitutionnel a adopté une position qui, à la différence de la jurisprudence du Conseil d’État, n’exclut pas de discriminer, dans certaines circonstances et conditions, entre entreprises soumissionnaires. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 13 mai 1987 (93), a développé une interprétation stricte des principes communautaires en annulant une circulaire ministérielle qui donnait explicitement pour directive à des services de faire prévaloir, dans le choix des entreprises appelées à soumissionner, une certaine relation entre la dimension des marchés à traiter et la taille des entreprises, tout en veillant à ce que cette situation ne se traduise pas par une absence de concurrence. Il faut reconnaître que la généralité de la discrimination ainsi prévue ne laissait sans doute guère le choix au juge administratif.
À l’occasion d’un recours présenté contre la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), le Conseil constitutionnel a d’ailleurs lui aussi annulé une disposition réservant un quart des lots des marchés visés par le code des marchés publics à la mise en concurrence entre structures associatives ou coopératives, au motif « que ces dispositions, tant par leur ampleur que par leur imprécision, portent au principe d’égalité devant la loi une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général qui s’attache au développement de l’économie sociale » (94). Pour autant, dans la même décision, le Conseil a ajouté que « le législateur peut, dans le but de concilier l’efficacité de la commande publique et l’égalité de traitement entre les candidats avec d’autres objectifs d’intérêt général (…), prévoir un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, en faveur de certaines catégories de candidats [ou] réserver l’attribution d’une partie de certains marchés à des catégories d’organismes précisément déterminées (…) pour une part réduite, pour des prestations définies et dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d’intérêt général ainsi poursuivis ».
Dès lors, il apparaît que la loi peut, sans heurter de principes constitutionnels, soit réserver une part réduite de marchés publics particuliers à une catégorie de soumissionnaires précisément déterminée, dès lors que les trois exigences posées par le Conseil constitutionnel sont remplies, soit prévoir un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes. Or, tel est précisément l’objet du présent article du projet de loi.
b) L’instauration, à titre expérimental, d’un traitement préférentiel limité et conforme aux exigences du droit constitutionnel, pour les PME innovantes
Le I instaure, dans un but expérimental et pour une durée limitée à cinq ans à compter de la publication de la loi, la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics – principalement l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics – ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 (95) – les organismes de droit privé créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, la Banque de France, l’Institut de France, la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises publiques réalisant une activité d’opérateur de réseaux, entre autres – d’attribuer de manière préférentielle, à des PME innovantes, des marchés publics de haute technologie, de R&D et d’études technologiques dont le montant n’excède pas le seuil des procédures formalisées
– c’est-à-dire 133 000 euros hors taxes pour l’État et 206 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales, de tels plafonds paraissant toutefois excessivement limités – dans la limite de 15 % de leur montant annuel moyen au cours des trois années précédentes. Les modalités de cette réservation ou de ce traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes ainsi que le dispositif d’évaluation du procédé ainsi mis en place se verront précisés par décret en Conseil d’État et viendront, vraisemblablement, prendre place au sein du code des marchés publics.
En l’espèce, il n’est pas question de mettre en place un dispositif de portée définitive, dans la mesure où son efficacité dépendra pour une large part des prolongements que l’Union européenne pourrait lui donner au niveau communautaire. D’ailleurs, dans son rapport remis le 22 avril 2008 au Premier ministre, M. Lionel Stoléru, chef du projet de Small Business Act européen que la France souhaite promouvoir lors de sa présidence de l’Union, propose d’étendre cette mesure à l’ensemble des autres États membres, afin d’en conforter l’assise juridique et les effets économiques. D’ici cinq ans, il apparaît probable que cette disposition pourra être pérennisée en tenant compte de son impact objectif et de l’accueil qui lui aura été réservé en Europe.
Il convient par ailleurs de souligner que la mesure soumise au vote du Parlement porte sur un droit limité à une part réduite (la proportion de 15 % se situant bien en deçà des 25 % que le Conseil constitutionnel avait jugé excessifs en 2001) de marchés spécifiques (ceux réservés aux hautes technologies, à la R&D et aux études technologiques). En outre, la catégorie de soumissionnaires
– explicitée au II, à travers des modifications apportées à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier – est elle aussi très particulière, afin de ne pas comporter d’effet discriminatoire au regard du droit communautaire.
La définition des PME innovantes bénéficiaires du régime préférentiel d’attribution de 15 % des marchés publics de hautes technologies se trouve en fait inscrite dans les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de placement dans l’innovation. Seront ainsi éligibles au régime institué par le I, les entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et 2 millions d’euros, comptant moins de 2 000 salariés et dont le capital n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale et – là étant la précision apportée par le présent article – ayant réalisé des dépenses de recherche, au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts sur le crédit d’impôt recherche, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Les PME innovantes à caractère industriel se trouveront ainsi avantagées par rapport aux autres PME innovantes.
Pour éviter toute ambiguïté, le texte précise également comment s’appréciera le critère du caractère industriel des PME innovantes concernées. Se définissent ainsi comme entreprises à caractère industriel celles qui exercent une activité concourant directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, des matériels ou de l’outillage nécessaire à la réalisation de ces activités est prépondérant. A noter qu’à aucun moment il n’est précisé que les PME bénéficiaires doivent avoir leur siège statutaire en France, de sorte que la préférence ainsi prévue n’est aucunement contraire aux prescriptions communautaires.
Aux termes du paragraphe III du présent article, se trouveront concernés par ce régime préférentiel d’attribution aux PME innovantes, les marchés publics à forte valeur technologique pour lesquels soit la négociation a été engagée, soit l’avis d’appel à concurrence a été publié postérieurement à la publication de la loi de modernisation de l’économie.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à inclure l’ensemble des marchés publics de haute technologie inférieurs aux seuils nationaux dans le calcul du montant annuel moyen des marchés publics auquel s’applique la part de marchés publics de haute technologie réservée aux PME innovantes (amendement n° 77).
La Commission a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de l’article 7 ainsi modifié.
Chapitre III
Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises
La simplification du droit constitue un chantier majeur de la XIIIéme législature. Sous l’impulsion de son président, M. Jean-Luc Warsmann, la Commission des Lois s’est engagée à toiletter les lois en vigueur, afin de les rendre plus lisibles et, par conséquent, plus légitimes aux yeux des principaux intéressés. Le droit économique, en général, et commercial, en particulier, n’échappe pas au champ de cette entreprise. Dès lors, votre rapporteur pour avis ne peut qu’être satisfait de voir que le présent projet de loi comporte un volet dédié à cette préoccupation, s’agissant plus particulièrement du fonctionnement des PME, très sensibles à ce type de mesures.
Article 11
(art. L. 112-3 du code monétaire et financier)
Nouvel indice de révision des baux commerciaux
Pour éviter un trop grand décalage entre le montant du loyer initialement déterminé par les parties, en début de bail commercial, et la valeur locative réelle en cours de bail, le loyer dû par le titulaire d’un bail commercial peut être révisé. Les modalités de cette révision sont définies par les contractants qui optent soit pour une indexation conventionnelle, appelée clause d’échelle mobile – qui permet une révision plus rapide et dénuée de tout formalisme, en ce qu’il n’y a pas de délai particulier à respecter pour y procéder, sous réserve d’une périodicité convenue à l’avance et de l’application d’un indice de référence licite –, soit pour une révision légale encadrée par les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce. Ces deux derniers articles se réfèrent à une revalorisation (en début de loyer, puis sur une base triennale) ne pouvant pas excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, publié par l’INSEE. Or, sur le fondement de cet indice, le montant des loyers des locaux commerciaux a augmenté de 32 % entre 2000 et 2006.
À l’instar de ce qui a été réalisé par l’article 9 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat s’agissant des loyers d’habitation, avec l’indexation de leur indice de référence sur l’indice des prix à la consommation hors tabacs et loyers, il importe d’atténuer l’impact inflationniste de l’indice de référence pour l’évolution des loyers des baux commerciaux. Une solution technique a d’ailleurs été trouvée par les représentants des commerçants et des propriétaires de locaux commerciaux, le 20 décembre 2007, lesquels ont élaboré d’un commun accord un nouvel indice pour les loyers commerciaux. Celui-ci résulte en fait d’une péréquation entre l’indice des prix à la consommation (pour 50 %), l’indice trimestriel du coût de la construction (pour 25 %) et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail (pour les 25 % restants).
Ce nouvel indice de révision des loyers est effectivement plus favorable aux occupants de locaux commerciaux puisque, alors que l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction a crû de 5,05 % entre le premier trimestre 2006 et le premier trimestre 2007, lui n’a progressé que de 2,7 % sur la même période. Mais pour permettre sa généralisation aux baux commerciaux en cours ou nouveaux, il convient de modifier l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, qui énumère limitativement les catégories de revenus (livrets, comptes, loyers) pouvant être indexés, en totalité ou partiellement, sur l’indice des prix à la consommation.
Tel est justement l’objet du présent article, qui vise à insérer, dans le 9° de l’article L. 112-3 précité, les loyers prévus par les conventions portant sur un local à caractère commercial, parmi les dérogations à l’interdiction d’indexation automatique dans les contrats dont le principe est posé à l’article L. 112-1 du même code.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.
Article 13
(art. L. 141-1, art. L. 210-5, art. L.223-1, art. L. 223-27,
art. L. 223-31, art. L. 232-22 du code de commerce)
Mesures de simplification du fonctionnement des SARL
La SARL issue du modèle allemand de la GmbH de 1892, a été créée en France par la loi du 7 mars 1925. Elle est aujourd’hui régie par les articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce, modifiés par une ordonnance du 25 mars 2004 (96) et par la loi en faveur des PME du 2 août 2005. Comme la société anonyme, la SARL est une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés. De nature hybride, elle est à la fois une société de personnes (associés peu nombreux, intuitu personae, parts sociales non négociables, mécanisme légal d’agrément) et de capitaux (organisation juridique proche par de nombreux aspects de celle de la société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne). Depuis la loi du 11 juillet 1985, elle peut ne comporter dès sa création qu’un associé unique, et prend, dans ce cas, la forme de l’EURL (pendant français de l’« Einman GMbH » allemande).
La SARL a, dès le départ, connu un franc succès qui ne s’est pas démenti depuis puisque, fin 2006, cette forme de société représentait 47,82 % des sociétés immatriculées en France. Les raisons de son attrait tiennent à sa simplicité et aux économies qu’elle permet de réaliser par rapport au formalisme de la société anonyme. Conçue prioritairement pour les PME, elle subit néanmoins de plus en plus la concurrence de la société par actions simplifiées (SAS), qui présente l’avantage d’être encore plus facile d’emploi.
Il reste que, particulièrement adaptée pour limiter les risques financiers des entrepreneurs individuels, la SARL mérite d’être confortée dans notre droit commercial et, quand le besoin s’en fait sentir, améliorée. Cette ambition légitime est justement poursuivie par le présent article qui procède à plusieurs aménagements bienvenus.
a) Des statuts-types érigés au rang de référence de droit commun
Il est tout d’abord question de reconnaître aux statuts-types prévus par la loi pour la SARL à associé unique une valeur de référence de droit commun alors qu’aujourd’hui ils n’ont qu’une portée supplétive, l’article L. 223-1 du code de commerce disposant en l’espèce que les intéressés peuvent y recourir. C’est la loi du 2 août 2005 qui, pour accroître l’attractivité de la SARL vis-à-vis des entrepreneurs individuels, a prévu la mise en place de tels statuts-types, dont le modèle est fixé par décret, pour les associés uniques cumulant la gérance. L’idée était de simplifier le plus possible les démarches afférentes à la rédaction du contrat de société, lequel comporte nécessairement des clauses techniques liées à la description des modalités de fonctionnement interne de la personne morale qu’il crée.
La modification apportée au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce par le 1° du présent article tend à faire des statuts-types un modèle à suivre systématiquement pour chaque associé unique décidant de constituer une SARL dont il assumera la gérance. Pour autant, l’associé conservera la possibilité d’y apporter les modifications de son choix et même la faculté de produire des statuts totalement différents lors de sa demande d’immatriculation. Une telle disposition a indéniablement une forte portée en termes de simplification, à la fois pour les entrepreneurs mais également en termes d’uniformisation des statuts des SARL destinées à exercer une activité individuelle.
b) L’assouplissement des contraintes de publicité auxquelles est soumis l’associé unique exerçant seul la gérance
La réduction des contraintes de publicité pesant sur l’associé unique qui exerce seul la gérance de la SARL constitue un objectif important de cet article du projet de loi. Trois événements sont plus particulièrement visés, en la matière :
• Il s’agit, en premier lieu, de l’immatriculation de la société. Celle-ci est actuellement soumise à trois obligations de publicité légale : l’insertion dans un journal local agréé pour la publication des annonces légales (JAL), afin d’informer le public au niveau local ; l’inscription au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), qui permet officiellement l’information du public au niveau national ; l’immatriculation au registre du code de commerce et des sociétés (RCS), auquel chacun peut s’adresser pour vérifier la réalité de l’existence juridique de la société et ses principales caractéristiques.
S’il ne saurait être question de remettre en cause l’immatriculation au RCS, qui confère à la société l’opposabilité de son existence aux tiers, il en va tout autrement de la publicité au BODACC dès lors que les données du RCS sont désormais consultables en ligne, surpassant largement en cela le bénéfice résultant de la possibilité actuelle de se référer à un avis papier de portée nationale. Afin de réduire les coûts de constitution et de gestion de la SARL à associé unique, il est donc prévu d’inscrire à l’article L. 223-1 du code de commerce, que par dérogation aux obligations de publicité légale actuelles qui continueront à prévaloir pour les autres SARL, des formalités allégées concernant tout acte ou événement ayant tait aux SARL à associé unique, personne physique, assumant la gérance seront fixées par décret (a) du 2° du présent article).
Une précision de conséquence est également insérée au début de l’article L. 210-5 du même code pour prévoir que le délai au terme duquel les actes et indications de la société deviennent opposables aux tiers n’ayant pas eu connaissance de l’immatriculation court à compter de la date de leur inscription au RCS (b) du 2°).
Ces aménagements doivent entrer en vigueur à la date de publication du décret fixant le modèle de statuts-types, dont la publication ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 (c) du 2°).
• Il est question, en deuxième lieu, du dépôt au RCS du rapport annuel de gestion. Les règles de publicité en la matière résultent des exigences posées par la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 (97), modifiée notamment par la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 (98). Bien que l’article 47 de cette dernière offre la faculté aux États membres de prévoir que le rapport de gestion ne fasse pas l’objet de publicité, le code de commerce dispose d’une publicité obligatoire.
La pertinence de cette obligation pour les SARL à associé unique exerçant seul la gestion est sujette à caution. Pour cette même raison, il est envisagé (au 4° du présent article) de spécifier, au paragraphe I de l’article L. 232-22 du code de commerce, que l’associé unique qui assume la gérance n’est plus tenu de déposer le rapport de gestion au RCS, étant précisé toutefois qu’il doit le tenir à la disposition de toute personne qui en ferait la demande, comme le prévoit la directive de 1978.
• Se trouve enfin concernée la mention du dépôt des comptes annuels au RCS dans le registre tenu en application du troisième alinéa de l’article L. 223-31 du code de commerce. Pour simplifier les formalités de l’associé unique de la SARL exerçant directement la gérance, la loi du 2 août 2005 a rationalisé l’approbation des comptes annuels en une procédure unique consistant à exiger le dépôt des différents documents comptables revêtus de la signature du gérant au RCS. Il est prévu d’aller au bout de la logique de simplification de 2005, au 5° du présent article, en supprimant l’obligation pour le gérant et associé unique de SARL de porter, en retour, au registre des décisions de la société le récépissé du dépôt des pièces comptables au RCS, délivré par le greffe du tribunal de commerce.
c) La modernisation des conditions de tenue des assemblées ordinaires d’associés à travers la reconnaissance de la participation par visioconférence
Il est projeté, à travers le 3° du présent article, de donner une reconnaissance juridique à la participation par visioconférence ou par télécommunication des associés non physiquement présents à l’assemblée générale ordinaire de la SARL non-unipersonnelle. Cette pratique est déjà admise dans les sociétés anonymes par l’article L. 225-107 du code de commerce, de sorte qu’il sera mis fin à une inégalité devenue injustifiable du fait des progrès des technologies de l’information et des communications.
Dans la lignée des exigences posées par l’article R. 225-97 du code de commerce pour les sociétés anonymes, ces moyens de participation par visioconférence ou par télécommunication, dont la nature et l’application seront elles aussi précisées par décret en Conseil d’État, devront transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant une retransmission continue et simultanée des délibérations.
Aux termes de l’article L. 223-27 du code de commerce, les décisions relatives aux SARL (approbation du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, notamment) sont en principe prises en assemblée, le cas échéant par consultation écrite. Les associés, qui peuvent atteindre la centaine, exercent également un contrôle sur la désignation, la révocation et les conditions de rémunération du gérant, ainsi que sur les actes prévus par les statuts. Compte tenu de l’importance de ces missions, il ne saurait être question de permettre la validité de la visioconférence ou du recours aux télécommunications pour tous types de prises de décision de l’assemblée générale.
Du fait de la disposition introduite à l’article L. 223-27 du code de commerce, le règlement intérieur ne pourra pas autoriser cette modalité particulière de participation aux décisions pour l’approbation des comptes de clôture de l’exercice (qu’il s’agisse des comptes de la société ou du groupe auquel elle pourrait appartenir). En outre, les statuts conserveront la possibilité de restreindre davantage cette possibilité, le droit pouvant même être accordé à certains associés de s’opposer à ce qu’une délibération déterminée de l’ordre du jour puisse être débattue selon un tel moyen.
d) L’harmonisation des obligations de visa des livres de comptabilité, en cas de cession d’un fonds de commerce
En l’espèce, l’article L. 141-1 du code de commerce prévoit que, en cas d’une telle cession, le vendeur fournit un certain nombre d’informations à l’acquéreur de manière à garantir une connaissance la plus complète possible de ce dernier sur le contenu et la valeur financière du fonds. Dans l’acte constatant la cession, le vendeur est ainsi tenu d’indiquer le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation. Selon une finalité identique de sécurisation de la vente, l’article L. 141-2 du même code dispose que, le jour de la cession, les parties visent les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
De fait, les deux articles L. 141-1 et L. 141-2, s’ils poursuivent un même but à l’égard des parties, ne se réfèrent pas à la même période puisque l’exercice comptable ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile. Il y a là, indéniablement, une source potentielle de confusion, contraire à l’effet recherché par le législateur. Le 6° du présent article du projet de loi se propose opportunément d’y remédier en se basant désormais, à l’article L. 141-1 du code de commerce, uniquement sur les exercices comptables, notion qui présente le mérite d’être la plus claire du point de vue de la situation financière du fonds. La durée de référence sera celle de la possession du fonds, si d’aventure elle est inférieure à trois ans.
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis (amendement n°s 78, 79 et 80) ainsi qu’un amendement du même auteur visant à élargir aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) le bénéfice des allègements formels prévus pour les SARL (amendement n° 81).
Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis corrigeant des erreurs de référence (amendement n°s 82 et 83).
Après avoir adopté un amendement du même auteur ayant pour objet d’appliquer aux assemblées d’associés de SARL les modalités de représentation et de participation par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication prévalant pour les délibérations des assemblées générales d’actionnaires des sociétés anonymes, plutôt que celles applicables aux délibérations du conseil d’administration (amendement n° 84), la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis (amendement n° 85).
La Commission a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de l’article 13 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 13
(art. L. 225-25, art. L. 225-72, art. L. 225-124 et art. L. 228-15 du code de commerce)
Simplification du régime juridique des sociétés anonymes
Le projet de loi comporte des mesures de simplification bienvenues pour les SARL et les SAS mais pas pour les sociétés anonymes, alors même que cette forme sociale constitue l’aboutissement logique du développement d’une entreprise à forte expansion. Le droit qui leur est applicable n’est d’ailleurs pas exempt de lourdeurs ou d’ambiguïtés et c’est pourquoi il est légitime d’envisager d’y apporter quelques retouches à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie.
Il en va ainsi, notamment, de la règle selon laquelle les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme non cotée doivent détenir un certain nombre d’actions de celle-ci.
Il ne fait aucun doute que les administrateurs de sociétés cotées doivent détenir un certain nombre d’actions. En effet, les organisations professionnelles des entreprises recommandent dans le code de gouvernement d’entreprise qu’elles ont élaboré en 2003 que l’administrateur soit actionnaire à titre personnel et possède un nombre relativement significatif d’actions. Cette exigence a d’ailleurs été renforcée, pour les dirigeants mandataires sociaux, par la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié (99) qui a introduit des dispositions de conservation des actions gratuites ou des actions issues des levées d’options. En revanche, cette disposition constitue une formalité inutile dans les autres sociétés, en particulier lorsqu’il s’agit de filiales de groupe. Il semble donc judicieux, pour les sociétés non cotées, de renvoyer aux statuts le soin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’actions de la société dont chaque administrateur et chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire.
Corrélativement, il apparaît utile de porter de trois à six mois le délai permettant aux administrateurs et membres du conseil de surveillance de se mettre en conformité avec cette exigence, notamment pour les ceux nouvellement désignés dans les organes dirigeants de sociétés qui exigent qu’ils détiennent un nombre important d’actions.
Une clarification semble également nécessaire en s’agissant du droit de vote double en cas de fusion, scission, et apport de la société actionnaire.
L’article L. 225-124 du code de commerce dispose que le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de deux ans requis pour bénéficier d’un droit de vote double. En revanche, la loi ne précise rien lorsqu’une société actionnaire qui disposait du droit de vote double vient à être absorbée par une autre société. Malgré la transmission universelle qui résulte d’une fusion, la doctrine considère que cette opération ne pouvant être assimilée à une succession, la société absorbante ne peut prétendre exercer ce droit de vote double dès l’inscription, sur les registres de la société émettrice, du transfert résultant de la fusion. Cette interprétation apparaît discutable.
En conséquence, il serait souhaitable de préciser que si une société détenant des droits de vote double dans une autre société se trouve absorbée, l’entité absorbante bénéficie des droits de vote double de l’entité absorbée dans la société tierce.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 228-11 et L. 228-15 du code de commerce qu’il peut être créé des actions de préférence sous réserve de respecter la procédure de désignation d’un commissaire aux avantages particuliers. Or, en cas de création d’une catégorie d’actions de préférence suivie lors d’une assemblée ultérieure d’une nouvelle émission d’actions de préférence de la même catégorie, il y a une incertitude sur le point de savoir si cette nouvelle émission doit être considérée comme une création d’actions de préférence soumise à la procédure des avantages particuliers alors même que la procédure a déjà été suivie lors de la création initiale de la catégorie. Il convient donc de préciser qu’en cas d’émission subséquente d’actions de préférence de même catégorie, la procédure des avantages particuliers ne s’applique pas.
Le rapporteur pour avis a présenté un amendement ayant pour objet de simplifier le régime juridique des sociétés anonymes, en assouplissant la règle selon laquelle les administrateurs doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, en maintenant un droit de vote double en cas de fusion, scission et apport de la société actionnaire et en clarifiant le régime des actions de préférence.
La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 86).
Article 14
(art. L. 227-1, art. L. 227-2, art. L.227-9, art. L. 227-9-1 [nouveau],
art. L. 227-10 du code de commerce)
Mesures de simplification du fonctionnement des sociétés par actions simplifiées
Instituée en 1994, la SAS vise à offrir à ses utilisateurs une forme d’organisation de l’entreprise qui soit aussi proche que possible d’une société-contrat, dont l’essentiel des règles de fonctionnement procèderait de la convention des parties. C’est ainsi que les associés déterminent librement, dans les statuts, la nature et les fonctions des organes de direction ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives ; ils peuvent également aménager comme ils l’entendent les conditions de leur sortie du capital. Les assouplissements apportés en 1999 au régime de la SAS ont indéniablement accéléré son développement, de sorte qu’on dénombrait 110 276 immatriculations d’entreprises sous cette forme sociale en France, au 1er janvier 2007. Les nouveaux aménagements de son régime juridique, prévus au I du présent article, cherchent à amplifier cette dynamique ; toutefois, aux termes du II, ils n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2009.
a) L’assouplissement des exigences ayant trait au montant et à la nature du capital social
Ainsi que cela a été précédemment souligné, la SAS concerne aujourd’hui principalement les PME innovantes. On peut néanmoins supposer que, moyennant quelques nouveaux ajustements, elle se révèle tout aussi appropriée pour d’autres catégories d’entreprises. C’est justement la raison pour laquelle les 1° à 3° du I du présent article du projet de loi apportent quelques changements importants aux articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de commerce, qui fixent le régime juridique de base de ce type de sociétés.
Du fait des renvois opérés à certaines dispositions applicables à la société anonyme, la SAS doit, entre autres, disposer d’un capital social d’au moins 37 000 euros, compte tenu de la prohibition de l’appel public à l’épargne prévue à l’article L. 227-2. En soi, un tel montant restreint substantiellement le public pouvant prétendre à la constitution d’une telle société. Il est, en outre, relativement arbitraire compte tenu du fait que cette catégorie n’a pas la même finalité que celle des sociétés anonymes et qu’elle se rapproche plus, dans sa cible, des SARL dont l’exigence de capital minimal a été abandonnée en 2005. De manière logique, le 1° du I de cet article 14 du projet de loi procède donc, par le rajout de la référence à l’article L. 224-2 du code de commerce parmi les dispositions ne s’appliquant pas aux SAS, à la suppression d’un montant de capital social minimum exigé. Par cohérence, le 3° du même paragraphe précise, à l’article L. 227-2, que le montant du capital social de la SAS est à chaque fois fixé par les statuts.
À l'instar du régime en vigueur pour la société anonyme, le capital de la SAS représente la somme des apports réalisés en numéraire, en nature – ils sont alors vérifiés par un tiers indépendant, à savoir le commissaire aux apports –, en propriété ou en jouissance. Il reste que les apports en industrie, tels que définis par l’article 1843-2 du code civil, sont proscrits, en application de l’article L. 225-3 du code de commerce. Cette dernière règle apparaît restrictive, ce qui justifie que le 2° du I de cet article 14 y mette un terme en insérant un nouvel alinéa qui prévoit exactement le contraire dans l’article L. 227-1. Des spécificités entoureront néanmoins les actions en industrie, dont l’attribution et la répartition seront régies par les statuts : en l’espèce, ces titres resteront inaliénables et ils auront une durée de vie limitée à dix ans.
b) La simplification de certaines modalités d’information des associés
Dans un but de simplification, le 1° du I du présent article exclut également du régime de la SAS l’application des dispositions du I de l’article L. 233–8 du code de commerce, relatives à l’information des actionnaires de société anonyme et des associés de SAS, dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire, sur le nombre de droits de vote existants. Il est vrai que, si cette exigence de publication semble justifiée pour une société anonyme pouvant comporter de très nombreux actionnaires et dont la composition du capital social évolue quasi quotidiennement (du fait des transactions boursières), il en va différemment pour une structure aussi ramassée et souple que la SAS, à plus forte raison du fait de l’abandon d’un montant minimal de capital social significatif.
c) Un recours moins systématique aux commissaires aux comptes
Les dernières évolutions prévues aux 4° à 6° du I du présent article concernent le contrôle de la SAS par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actuellement exigé dans les mêmes conditions que pour la société anonyme.
En l’état actuel, le ou les commissaires aux comptes de la SAS sont désignés par décision collective, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, sur proposition du président ou d’un autre organe de direction désigné par les statuts (article L. 225-228 du même code, sur renvoi de l’article L. 227-1). Le nombre de ces commissaires, les conditions de leur nomination, la durée de leurs fonctions, leurs attributions, leur rémunération et leur responsabilité sont les mêmes que pour la société anonyme. Cette identité de régime de la SAS avec la société anonyme apparaît d’autant moins fondée que la SAS s’adresse à des activités et à des cas de figure plus proches de ceux de la SARL, qui jouit en la matière d’obligations plus souples et adaptées. À bien des égards, de surcroît, ces exigences peuvent constituer un frein financier à la constitution de SAS.
Un alignement – à tout le moins, un rapprochement – des modalités du contrôle des commissaires aux comptes dans la SAS sur les règles en vigueur pour la SARL apparaît dès lors souhaitable. Le 5° du I s’y emploie, à travers l’insertion d’un article L. 227-9-1 dans le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce, dont la rédaction est calquée sur celle de l’article L. 223-35 du même code, relatif à la SARL.
Désormais, la désignation d’au moins un ou de plusieurs commissaires aux comptes sera une simple faculté offerte aux associés, sauf en cas de franchissement de certains seuils fixés par décret en Conseil d’État, relatifs au total du bilan, au montant hors taxe du chiffre d’affaires et au nombre moyen de salariés au cours d’un exercice. Ces seuils seront vraisemblablement identiques à ceux prévus aux articles R. 221-5 et R. 223-27 du code de commerce, à savoir : un total de bilan inférieur à 1,55 million d’euros, un montant hors taxes du chiffre d’affaires n’excédant pas 3,1 millions d’euros et un nombre moyen de salariés inférieur à 50.
Deux autres éventualités impliqueront, de manière impérative, la désignation d’un commissaire aux comptes :
– tout d’abord, le cas de la SAS qui détient directement ou indirectement 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société, situation qui justifie même l’intervention d’« au moins » un commissaire aux comptes ;
– ensuite, toute demande formulée devant les juridictions commerciales par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital, quand bien même les seuils fixés par la voie réglementaire ne seraient pas atteints par la SAS.
Certaines modifications de conséquence sont également apportées dans un but de cohérence aux articles L. 227-9 et L. 227-10 du code de commerce par les 4° et 6° du même paragraphe de cet article, la plus importante consistant à transférer au président de la société, dès lors qu’aucun commissaire aux comptes n’a été désigné, la responsabilité de présenter le rapport aux associés sur les conventions intervenues entre la SAS et ses dirigeants ainsi que ses associés les plus importants.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à étendre aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la simplification prévue pour les SARL en matière de formalités de publicité (amendement n° 87).
Puis elle a rejeté un amendement de M. Marcel Bonnot ayant pour objet de maintenir l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour les sociétés par actions simplifiées.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la disposition simplifiant la procédure d’approbation des comptes des SARL à associé unique (amendement n° 88).
La Commission a également adopté un amendement corrigeant une erreur de référence (amendement n° 89) ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 90).
Puis elle a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la disposition permettant de déroger à l’obligation de dépôt du rapport de gestion, à l’instar de ce que prévoit l’article 13 pour les SARL à associé unique (amendement n° 91).
La Commission a alors émis un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 14
(art. L. 123-6 du code de commerce)
Transmission par voie électronique à INPI des inscriptions
effectuées auprès du greffe des tribunaux à compétence commerciale
Le registre national du commerce et des sociétés permet l’accès aux informations clés sur les entreprises françaises (l’identité complète de l’entreprise ainsi que les éléments financiers). Celles-ci sont tenues de déclarer leurs principales caractéristiques économiques et juridiques auprès du registre du commerce et des sociétés lors de leur immatriculation, leurs modifications et, le cas échéant, leur radiation. Le registre du commerce et des sociétés comporte également les comptes annuels à l’issue de chaque exercice social ainsi que les actes de sociétés prévus au code de commerce (statuts, certains procès-verbaux d’assemblées, notamment).
Les registres locaux sont tenus par les greffes des tribunaux à compétence commerciale et le registre national par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Les immatriculations, modifications et radiations peuvent être déposées auprès des centres de formalités des entreprises, qui les communiquent aux greffes des tribunaux à compétence commerciale, ou directement auprès de ces derniers. Les actes et comptes annuels sont déposés auprès des greffes des tribunaux à compétence commerciale.
Les greffes ont seuls la compétence juridique pour valider l’ensemble des dépôts. Pour chaque dépôt de formalité est prévu un double original transmis par chaque greffe à l’INPI. L’ensemble de ces doubles originaux constitue le registre national du commerce et des sociétés tenu par l’Institut.
Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un amendement ayant pour objet de généraliser la transmission par voie électronique à l’Institut national de la propriété industrielle des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. Il a expliqué qu’une mesure plus radicale que ce dispositif, qui devrait cependant permettre de générer des économies à hauteur de 6 millions d’euros par an sur le coût de production des bases de données de l’INPI, avait été adoptée par voie d’amendement gouvernemental à l’occasion de l’examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, mais qu’elle avait ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de sa jurisprudence sur les amendements dénués de tout lien avec l’objet du texte en discussion.
La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 92).
Chapitre IV
Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »
Ce dernier chapitre du titre Ier du projet de loi vise, notamment, à faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises confrontés à des difficultés. Bien que ce sujet soit essentiel sur le fond, le Parlement ne sera pas amené à en débattre dans le détail puisque le Gouvernement souhaite procéder aux réformes nécessaires par voie d’ordonnances. Cette procédure présente le mérite de la rapidité, l’attente de résultats apparaissant forte en la matière.
Article 18
(Chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce)
Habilitation du Gouvernement à aménager, par ordonnance,
le régime des incapacités commerciales et industrielles
Cet article est le premier d’une série de demandes d’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin de procéder à des modifications de nature législative.
a) Le régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution
Il n’est pas inutile de rappeler, à titre liminaire, le régime juridique des ordonnances. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le « Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cet empiétement du pouvoir exécutif sur les prérogatives naturelles du pouvoir législatif, qui constitue une dérogation au principe d’interdiction des délégations de compétence en droit public, est nécessairement encadré ; c’est ainsi qu’une loi ordinaire d’habilitation doit préalablement être adoptée par le Parlement pour :
– en premier lieu, préciser les matières législatives dans lesquelles le Gouvernement peut prendre des ordonnances ;
– en deuxième lieu, fixer également le délai pendant lequel le Gouvernement peut prendre ces mêmes ordonnances ;
– en dernier lieu, déterminer le délai imparti au Gouvernement pour déposer au Parlement un projet de loi de ratification des ordonnances prises.
Sur le plan formel, toute ordonnance est délibérée en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État. Le recours à cette procédure est pour le moins fréquent puisque, depuis 1978, 340 textes de cette nature ont été pris sur des sujets le plus souvent très techniques, comme c’est le cas de l’objet du présent article, ainsi que sur des questions dont le Parlement aurait légitimement pu débattre mais relevant de l’urgence de la mise en œuvre du programme gouvernemental (maintien de l’ordre en Algérie, privatisations, législation du travail, etc.).
Le fait est que, depuis deux législatures, le recours aux ordonnances s’est accentué. Pour la première fois depuis 1958, le nombre d’ordonnances prises en 2004 et 2005 a même dépassé celui des lois promulguées car 53 ordonnances et 40 lois ont été publiées au journal officiel en 2004, puis 85 ordonnances et 50 lois en 2005. Cette évolution illustre notamment la technicisation et la complexification croissantes de notre droit : en effet, nombre d’ordonnances récemment prises ont permis de transposer des directives européennes et ont eu pour objet de simplifier notre législation, sans que de tels buts ne soient pour autant épuisés.
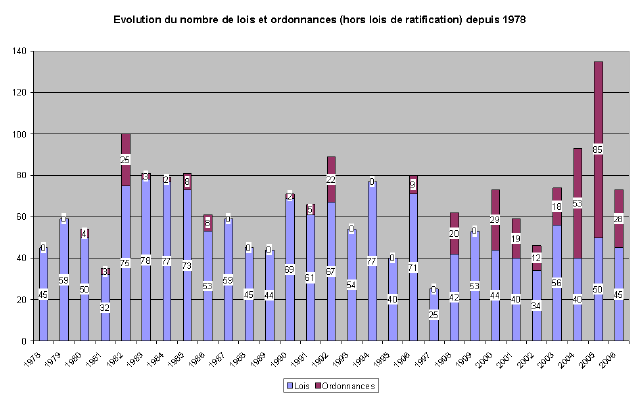
Le Parlement ne peut évidemment pas se satisfaire d’un recours de plus en plus généralisé à une procédure initialement conçue comme relativement exceptionnelle. Néanmoins, certains sujets de même que certaines circonstances se prêtent plus que d’autres à un tel procédé. Et c’est notamment le cas, en l’espèce, compte tenu de l’encombrement de l’ordre du jour par des réformes très importantes, telles que la modernisation du marché du travail ou l’aménagement du régime de la participation salariale, et le fait que l’objet de l’habilitation sollicitée vise essentiellement à retoucher des procédures créées elles-mêmes par ordonnance, en 2005.
b) L’objet de l’habilitation demandée : la réforme du régime des incapacités commerciales et industrielles
Sur le fond, il est prévu que le Gouvernement soit habilité à prendre, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi de modernisation de l’économie, une ordonnance substituant à l’actuel chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce (articles L. 128-1 à L. 128-6) de nouvelles dispositions législatives visant :
– en premier lieu, à créer pour les infractions actuellement prévues à l’article L. 128-1 sus-mentionné (à savoir, entre autres : vol ; extorsion ; escroquerie ; abus de confiance ; détournement de gage ou d’objet saisi ; organisation frauduleuse de son insolvabilité ; recel ; blanchiment ; corruption active ou passive ; trafic d’influence ; soustraction et détournement de biens ; faux ; participation à une association de malfaiteurs ; trafic de stupéfiant et proxénétisme ; prêt usuraire ; fraude fiscale ; infraction à la législation sur la loterie et certaines infractions aux codes de la consommation et du travail), une peine complémentaire – et donc, non automatique – d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Il convient d’observer que le champ de l’ordonnance ne permettra pas de minorer l’étendue des infractions ouvrant la voie à cette peine complémentaire ;
– en deuxième lieu, à prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour les infractions de l’article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n’était pas prévue ;
– en dernier lieu, à instaurer une peine alternative à l’emprisonnement consistant en l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Compte tenu du renvoi à l’article 131-6 du code pénal, cette interdiction ne pourra excéder une durée de cinq ans.
Tant que l’ordonnance ne sera pas entrée en vigueur, les articles L. 128-1 à L. 128-6 du code de commerce continueront à s’appliquer. L’utilité de la réforme que le Gouvernement entend mettre en œuvre en la matière, aussi bien en termes de réinsertion sociale que de stimulation de l’esprit d’entreprendre, est indéniable. Désormais, les tribunaux seront appelés à se prononcer au cas par cas sur l’opportunité et la justification d’une peine d’interdiction d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale. La sanction ne sera ainsi plus automatique ; elle n’interviendra que si les tribunaux estiment qu’une incapacité commerciale ou industrielle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction commise au principal.
c) Le délai de dépôt du projet de loi de ratification
L’article 38 de la Constitution dispose que les ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation ». Il indique également qu’à l’expiration du délai prévu par la loi d’habilitation pour leur publication, celles-ci « ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».
Le présent article du projet de loi fixe à trois mois le délai au terme duquel, faute de dépôt d’un projet de loi de ratification sur le Bureau de l’une des deux assemblées, l’ordonnance dont l’habilitation est sollicitée deviendrait caduque. Il s’agit là d’un délai raisonnable, conforme à ceux sollicités par le Gouvernement pour des textes appelés à intervenir dans des matières techniques.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.
Article 19
(Livre VI du code de commerce)
Habilitation du Gouvernement à moderniser, par ordonnance, les procédures issues de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et la fiducie
Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour procéder à deux réformes majeures : celle de la procédure de sauvegarde et du régime juridique du traitement des difficultés des entreprises, d’une part (au 1° du I) ; celle de la fiducie et du gage sans dépossession, d’autre part (au 2° du I).
Bien que le projet d’ordonnance connaisse un état d’avancement assez conséquent, le présent article 19 prévoit qu’elle devra avoir été publiée par le Gouvernement dans les huit mois suivant la promulgation de la loi de modernisation de l’économie. Eu égard aux nombreuses consultations déjà réalisées avec les principaux intéressés et à l’urgence mise en avant pour réaliser les aménagements envisagés, il est permis de croire qu’une durée de six mois serait suffisante, d’autant plus qu’elle coïnciderait à peu de choses près au début de l’année 2009.
a) Les finalités de la réforme de la procédure de sauvegarde et du traitement des difficultés des entreprises
Sur ce point, on rappellera que le Conseil constitutionnel exerce son contrôle sur les lois d’habilitation comme sur n’importe quelle loi ordinaire qui lui est déférée. Il a ainsi précisé un certain nombre de principes essentiels que le Parlement doit garder à l’esprit quand il examine de tels projets. Parmi eux, figure l’exigence, pour le Gouvernement, d’indiquer avec précision dans le projet de loi d’habilitation « quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre » (100). Cet impératif constitue d’ailleurs une constante des préoccupations du Conseil constitutionnel même si, pour autant, le Gouvernement n’est pas obligé de divulguer le contenu des ordonnances qu’il envisage de prendre, leur teneur pouvant dépendre des résultats de travaux et d’études dont les conclusions interviendraient postérieurement à l’adoption du projet de loi d’habilitation (101).
Dans le cas présent, votre rapporteur pour avis se félicite que la Chancellerie lui ait transmis le projet d’ordonnance que le Gouvernement envisage de prendre pour modifier le droit des entreprises en difficultés. Il est incontestable que cette méthode améliore l’information du Parlement lors de l’examen du projet de loi d’habilitation, son vote intervenant non à l’aveugle mais en quasi-connaissance de cause.
Le degré de précision du champ de l’habilitation demandée par le Gouvernement constitue un second motif de satisfaction. Pas moins de quatorze items sont énumérés par cet article, qui identifie notamment chaque procédure de prévention ou collective dont le régime se verra aménagé (en l’occurrence la conciliation, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires) ainsi que les aspects transversaux devant faire l’objet de modifications de cohérence ou de fond (tel le régime des contrats, celui des créances, les sanctions, ou encore le rôle du ministère public).
Les principaux aménagements prévus ayant déjà été présentés plus haut, il ne saurait être question ici d’en détailler le contenu. Pour autant, il n’est pas inutile de mettre en regard les caractéristiques essentielles des changements législatifs susceptibles d’intervenir avec chaque objectif avancé par le projet de loi d’habilitation.
Le a) du 1° du I indique que l’ordonnance aura pour ambition d’inciter à recourir à la procédure de conciliation, en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement. En la matière, il est indéniable que l’extension de certaines des caractéristiques de l’accord homologué à l’accord constaté (interruption des actions en justice et arrêt ou interdiction des poursuites individuelles) favorisera un recours plus marqué des débiteurs en difficultés à cette procédure, dont la souplesse et, dans le cas d’un simple accord constaté, la confidentialité, constituent des attraits certains. En outre, lors des troisièmes entretiens de la sauvegarde qui se sont déroulés le 28 janvier 2008, Mme Pascale Fombeur, directrice des affaires civiles et du Sceau a précisé les intentions de la Chancellerie en indiquant : « Le caractère essentiellement amiable et la confidentialité font la spécificité de cette procédure. Ils sont unanimement appréciés et doivent être conservés. Le ministère de la Justice n’est donc pas favorable aux mesures qui permettraient de passer outre l’absence de consentement des créanciers. Par ailleurs, les attraits de la conciliation ne doivent pas conduire à prolonger la procédure au-delà du raisonnable, au risque, en cas d’échec, de compromettre définitivement l’avenir du débiteur. Il doit donc être veillé au respect des limitations de durée fixées par le législateur. » (102).
Le b) précise que l’ordonnance s’attachera à rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, grâce à l’assouplissement des conditions de son ouverture, à l’extension des prérogatives du débiteur et à l’amélioration des conditions de réorganisation de l’entreprise, afin de favoriser le traitement anticipé de ses difficultés. Sur ce point, plusieurs aspects méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, la suppression du lien direct entre l’ouverture de la procédure et la perspective de cessation des paiements facilitera les démarches anticipatrices, les débiteurs ayant jusqu’alors des difficultés à apporter la preuve de l’inéluctabilité de la suspension de leurs capacités de trésorerie si aucune procédure de sauvegarde n’était engagée. Il reste que l’exigence de gravité de la situation, soumise à l’appréciation du tribunal, demeurera de manière à éviter que l’assouplissement ainsi prévu ne conduise certains débiteurs à détourner la procédure à des fins de facilité de gestion.
D’autre part, les dispositions les plus dissuasives pour la sauvegarde devraient être considérablement aménagées. C’est ainsi que le chef d’entreprise ne se trouvera plus écarté de la gestion de celle-ci à l’issue de la période d’observation, que ses pouvoirs d’actionnaire ou d’associé ne se verront pas neutralisés, qu’il jouera un rôle plus actif dans l’élaboration et la présentation du plan de sauvegarde et que l’administrateur judiciaire aura pour mission principale de le surveiller et non plus de l’assister. De même, la prisée de l’actif du débiteur sera supprimée car elle n’a pas sa place dans une procédure visant à pérenniser l’activité.
Le c) indique que l’ordonnance permettra aussi d’améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Il s’agit là d’un sujet effectivement crucial, pour éviter que des difficultés similaires à celles rencontrées dans le cas d’Eurotunnel ne surgissent à l’avenir. Certains créanciers actuels ne relèvent pas de la catégorie des établissements de crédit et, de surcroît, le développement du marché secondaire de la dette ainsi que le phénomène de circulation des créances doivent également être pris en compte. Le fait d’assimiler le détenteur d’une créance détenue à l’origine par un établissement de crédit à l’un des créanciers du comité des établissements de crédit permettra, à cet égard, de lever bien des ambiguïtés. L’institution de comités d’obligataires, en cas d’émissions de titres à un niveau international, et l’assouplissement de la consultation des masses d’obligataires, en cas d’émissions de titres en France, représentent également des avancées attendues que le Parlement lui-même a contribué à échafauder.
Le d) porte, quant à lui, sur le redressement judiciaire, dont il est question d’aménager le régime juridique afin de le rendre plus efficace et d’en coordonner le contenu avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde. Le redressement judiciaire est, statistiquement, la procédure collective la plus utilisée. La doctrine et la pratique s’accordent à reconnaître pourtant qu’il présente une faible dimension anticipative et, de ce fait, débouche bien plus rarement que la sauvegarde ou la conciliation, sur un rétablissement du débiteur. Au regard du contenu des dispositions du projet d’ordonnance sur le sujet, qui s’apparentent davantage à des clarifications et à des coordinations avec le régime de la sauvegarde, il est peut-être un peu présomptueux d’en attendre une amélioration sensible de l’efficacité en termes de survies d’entreprises placées en redressement. Pour autant, les dispositions envisagées apportent certaines améliorations, notamment dans le déroulement de la procédure.
Le e) souligne, pour sa part, que l’ordonnance devrait préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire, notamment pour améliorer le sort des créanciers munis de sûretés, accroître le recours au régime de la liquidation judiciaire simplifiée et alléger sa mise en œuvre. Sur le dernier point, les apports de l’ordonnance devraient effectivement être substantiels dans la mesure où la liquidation judiciaire simplifiée deviendra désormais obligatoire pour les très petites entreprises et pourra être engagée au-delà du cadre actuel, dans des conditions précisées par la voie réglementaire. Parallèlement, les modalités de mise en œuvre se trouveront moins nombreuses et formalistes, de sorte que le tribunal pourra procéder à l’ensemble des opérations requises dans le délai d’un an actuellement imparti.
Le f) est quelque peu lié au e) dans la mesure où il fixe pour objectif le fait de favoriser et de sécuriser les cessions d’entreprises et d’actifs en liquidation judiciaire. De fait, cette ambition permettra elle aussi d’améliorer la liquidation judiciaire. En l’espèce, il est essentiellement question de remplacer la possibilité pour le tribunal d’assortir le plan de cession d’une clause d’inaliénabilité temporaire de tout ou partie des biens cédés par l’assujettissement, pour une durée déterminée, de la cession de certains biens à son autorisation préalable.
Le h) concerne, quant à lui, le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’il est question de simplifier, et le g), le régime des contrats en cours, en vue d’une clarification et d’une adaptation aux spécificités de chaque procédure. C’est ainsi, notamment, que l’obligation pour le débiteur de payer comptant les sommes dues en exécution des contrats poursuivis pourrait être supprimée, afin que lui soit substituée un paiement conforme aux stipulations contractuelles, gage d’une amélioration sensible de trésorerie. Il est également envisagé d’assouplir le régime de l’exécution des contrats, en permettant, d’une part, à l’administrateur de solliciter du juge-commissaire le prononcé de leur résiliation, en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire, et d’autre part, au liquidateur de les faire résilier sur simple demande.
Le i) poursuit l’objectif d’améliorer l’efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective. Cette préoccupation est légitime dans la mesure où la fiducie, instituée par la loi du 19 février 2007 (103), a été juridiquement consacrée dans nos droits civil et commercial après l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises. De fait, toutes les implications de cette nouvelle forme de sûreté n’ont manifestement pas été suffisamment prises en compte au niveau des procédures collectives, ce que l’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés s’attellera à corriger. D’autres dispositions spécifiques aux sûretés, de portée plus générale en ce qu’elles ne concernent pas uniquement la situation d’entreprises en difficultés, sont également envisagées au 2°, dont le détail sera exposé plus bas.
Le j) évoque une œuvre de précision, d’actualisation et de renforcement de la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective. L’ordonnance devrait restreindre l’étendue de la sanction actuelle pour insuffisance d’actifs au montant de cette insuffisance et non plus à l’ensemble des dettes. Ainsi que cela a été souligné précédemment, des aménagements devraient concerner les mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler tandis que certaines ambiguïtés entourant actuellement le régime de la banqueroute et les autres infractions se verraient opportunément levées. En tout état de cause, les sanctions ne seront pas amoindries mais plus adaptées à la gravité des faits reprochés.
Le k) devrait permettre d’améliorer les règles procédurales du livre VI du code de commerce. Les dispositions générales de procédure seraient ainsi précisées, notamment aux articles L. 661-1, L. 661-6, L. 661-7 du même code s’agissant, d’une part, des décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation et, d’autre part, des parties pouvant exercer de tels recours.
Le l) a pour objet de renforcer le rôle du ministère public dans les procédures et d’accroître ses facultés de recours. De manière générale, l’intervention du parquet apporte un certain nombre de garanties dans le déroulement de la procédure. Il est prévu d’approfondir cette implication dès la conciliation, dont l’ouverture et le jugement d’homologation pourront désormais faire l’objet d’un appel voire d’un pourvoi en cassation du ministère public. Dans le même ordre d’idées, à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le parquet pourra proposer un liquidateur à la désignation du tribunal, ce qui permettra d’éviter, dans certains cas, toute suspicion. Lorsque le tribunal ne fera pas droit à cette proposition, il devra alors statuer par jugement spécialement motivé. Enfin, le ministère public pourra, à toute époque de la liquidation judiciaire, requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le m) prévoit que l’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés comportera un certain nombre de dispositions destinées à améliorer la cohérence des livres VI et VIII du code de commerce et à élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires. Il est ainsi envisagé, dans le cadre de la sauvegarde et du redressement judiciaire, que les administrateurs et mandataires judiciaires, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, puissent confier sous leur propre responsabilité une partie des tâches relevant de leur mandat à des tiers. Cette possibilité est destinée à fluidifier l’exécution des procédures.
Dans le même ordre d’idées, enfin, le n) vise à permettre à l’ordonnance de procéder à diverses actualisations au sein du livre VI du code de commerce, en assurant leur coordination avec les autres dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûreté (au sein du code civil, notamment). Certaines clarifications rédactionnelles pourront intervenir à cette occasion.
Au total, sans le révolutionner, l’ordonnance dont le Gouvernement sollicite l’habilitation par le présent article 19 modernisera et adaptera sensiblement le droit des entreprises en difficultés tel qu’il a été établi par la loi du 26 juillet 2005. Les leçons des carences et des ambiguïtés relevées depuis plus de deux ans seront ainsi rapidement tirées, de sorte que l’on peut espérer que la culture de l’anticipation et de la prévention des défaillances des entreprises se généralise enfin dans notre pays.
b) L’amélioration du régime de la fiducie et du gage sans dépossession
Le 2° du I du présent article confère un second objet à l’ordonnance que le Gouvernement souhaite publier, dans la mesure où il est question de permettre à l’exécutif de prendre des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à certains ajustements du droit des sûretés et du régime juridique de la fiducie. Contrairement au 1°, l’énumération des items est, cette fois-ci, plus courte. Elle tient, en effet, en deux alinéas de substance et de portée juridiques inégales.
Le a) porte sur le régime juridique de la fiducie. Ce type de contrat, instauré au titre XIV du livre III du code civil par la loi du 19 février 2007, permet à un constituant de donner en sûreté ou de faire gérer par un tiers – appelé fiduciaire – un patrimoine d’affectation destiné à revenir à un bénéficiaire, au terme d’une durée ne pouvant excéder 33 ans. Qualifiée parfois par la doctrine de « mère des sûretés », la fiducie procure de sérieux avantages au fiduciaire puisqu’elle organise à son bénéfice un transfert de propriété, même temporaire. Il n’en demeure pas moins qu’elle reste actuellement peu utilisée, justifiant par là même que le Gouvernement souhaite favoriser le recours qui peut y être fait. A cet effet, l’ordonnance prévue au présent article devrait :
– allonger la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire. Pour ce faire, l’article 2018 du code civil serait modifié afin de la porter à 99 ans. Il n’est pas anodin de constater que la version initiale de la proposition de loi instituant la fiducie prévoyait déjà une telle durée, que le Sénat avait ramenée à 33 ans à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Robert Badinter. Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, notre ancien collègue Xavier de Roux s’était d’ailleurs interrogé sur les motivations de ce raccourcissement sans pour autant obérer l’issue d’un vote conforme, nécessaire à l’aboutissement d’une réforme longtemps attendue (104) ;
– sécuriser pour les bénéficiaires de la fiducie l’usage ou la jouissance par le constituant des biens ou des droits transférés et clarifier le régime de l’opposabilité aux tiers des cessions de créances. C’est ainsi que deux articles seraient insérés à la suite de l’article 2018 du code civil pour, d’une part, prévoir que la convention permettant au constituant de conserver l’usage ou la jouissance d’un immeuble à usage commercial ou industriel transféré dans le patrimoine fiduciaire n’est pas soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce (relatives au bail du fonds de commerce) et, d’autre part, préciser que la cession des créances réalisée dans le cadre d’une fiducie n’est opposable aux tiers qu’à la date du contrat de fiducie ;
– aménager les conditions de remplacement du fiduciaire. L’article 2027 du code civil serait retouché afin de permettre plus explicitement l’adoption de clauses contractuelles prévoyant une telle éventualité et de favoriser le transfert du patrimoine fiduciaire au fiduciaire remplaçant ;
– préciser enfin les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin, notamment en spécifiant à l’article 2029 du code civil que le contrat prend aussi fin de plein droit – en plus des cas de survenance du terme, de réalisation de l’objectif poursuivi et de révocation par le constituant de l’option pour l’impôt sur les sociétés – lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie.
Toutes ces évolutions de la législation existantes ne révolutionnent pas le dispositif adopté par le Parlement il y a moins de dix-huit mois. Elles peuvent néanmoins le rendre plus accessible et intéressant. En ce sens, elles apparaissent légitimes.
Le b) du 2° du I de cet article 19 concerne, quant à lui, le gage sans dépossession, dont l’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés doit renforcer l’efficacité. Depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 (105), une personne peut affecter au profit de son créancier, en garantie d’une dette, un bien tout en en conservant l’usage. Afin de le rendre opposable aux tiers, ce gage doit faire l’objet d’une publicité sur un registre tenu par le greffier du tribunal de commerce dans des conditions fixées par décret. Les aménagements prévus concernant cette sûreté, instaurée elle-même par voie d’ordonnance, devraient rester mineurs dans leur ampleur mais significatifs dans leurs effets. En l’espèce, il est question d’insérer le bénéficiaire d’un gage sans dépossession parmi les personnes pouvant se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, en vertu de l’article 2286 du code civil.
c) L’espoir d’un débat parlementaire à l’occasion du dépôt du projet de loi de ratification
A l’instar de ce qui est prévu à l’article 18, le paragraphe II du présent article fixe à trois mois, au plus tard, le délai de dépôt du projet de loi portant ratification de l’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés.
Il convient de souligner en l’espèce que, lorsqu’il dépose un projet de loi de ratification, le Gouvernement peut choisir de le soumettre au vote du Parlement, afin de conférer une valeur législative à ses ordonnances, ou de ne pas solliciter de débat parlementaire, auquel cas les ordonnances en question demeurent des actes de l’autorité réglementaire. En l’espèce, même non ratifiées, elles peuvent être soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir (106). Par ailleurs, avant leur ratification, les dispositions de nature législative définies par le Gouvernement suivent le régime contentieux des actes réglementaires ; toutefois, jusqu’à cette échéance, elles ne peuvent pas pour autant être modifiées par décret et, passé le délai de l’habilitation, elles ne peuvent plus l’être que par la loi. En outre, le Conseil d’État vérifie leur constitutionnalité, d’abord, de manière obligatoire, à titre consultatif, puis, le cas échéant, à l’occasion d’un contentieux. Enfin, si le Conseil constitutionnel est saisi d’une loi ratifiant explicitement ou implicitement tout ou partie d’une ordonnance, il sera à son tour appelé à contrôler le contenu même des ordonnances (107).
Quand bien même il ne serait pas juridiquement indispensable, un débat parlementaire sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés sera souhaitable. Les récentes discussions sur la ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007, relative à la codification de la partie législative du code du travail (108), qui ont débouché sur des compléments utiles et intéressants, ont démontré les limites d’une production normative unilatérale et souvent hâtive. Dans des domaines aussi importants que ceux des procédures collectives ou du droit des sûretés et, compte tenu de la qualité des travaux parlementaires conduits sur le sujet ces dernières années, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, il est permis de croire qu’une telle discussion conforterait les avancées de la réforme envisagée et permettrait de l’ancrer dans le temps.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant de six à huit mois, après promulgation de la loi de modernisation de l’économie, le délai au terme duquel l’ordonnance réformant la sauvegarde et le traitement des difficultés des entreprises ainsi que la fiducie devra être publiée (amendement n° 93).
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du même auteur (amendements n°s 94, 95 et 96), la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 19 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 19
(art. L. 643-11 et art. L. 653-11 du code de commerce)
Extension du bénéfice des règles sur l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et sur le relèvement des interdictions de gérer
La loi du 26 juillet 2005 a étendu aux procédures de liquidation de biens en cours, sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967 (109), le bénéfice de l’article L. 643-11 du code de commerce, qui prévoit l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers hors de certains cas précisément énumérés caractérisés notamment par la fraude ou la récidive. Ces procédures, régies par la loi de 1967 précitée, ont toutes été ouvertes antérieurement au 1er janvier 1986 et, si leur nombre demeure important, il ne dépasse pas plusieurs centaines. Or, les nombreuses personnes physiques qui ont été soumises à des liquidations de biens, clôturées antérieurement au 1er janvier 2006, continuent à subir, plus de vingt ans après l’ouverture de ces procédures, les effets de la reprise des poursuites de leurs créanciers. Il serait donc très opportun d’amplifier les effets de la loi de sauvegarde des entreprises en la rendant applicable, pour cette disposition, non seulement aux procédures en cours mais également aux situations en cours.
De même, la loi du 26 juillet 2005 a étendu aux procédures en cours le bénéfice de l’article L. 653-11 du code de commerce, qui permet le relèvement des interdictions de gérer lorsque les personnes qui y sont soumises présentent toutes les garanties démontrant leur capacité à diriger ou contrôler une entreprise. Antérieurement à cette loi seule une contribution suffisante au paiement du passif pouvait permettre un tel relèvement. Une telle mesure, de nature à permettre le rebond de nombreuses personnes devenues aptes à gérer une entreprise mais ne disposant pas de ressources suffisantes pour contribuer au paiement d’un passif de façon qui puisse être jugée suffisante, pourrait utilement être généralisée aux situations résultant de procédures clôturées à la date d’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis ayant pour objet d’étendre aux procédures de liquidation de biens ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006 le bénéfice des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises relatives à l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer.
Après qu’une rectification rédactionnelle suggérée par M. Philippe Houillon a été portée à cet amendement portant article additionnel, la Commission l’a adopté (amendement n° 97).
Article additionnel après l’article 19
(art. L. 515-27 et art. L. 515-28 du code monétaire et financier)
Application des dispositions de la loi de sauvegarde
des entreprises aux sociétés de crédit foncier
Toutes les conséquences des changements apportés par la loi de sauvegarde des entreprises n’ont pas nécessairement été tirées dans les autres codes que le code de commerce. Dans la mesure du possible, il apparaît nécessaire de procéder aux coordinations qui s’imposent, spécialement quand elles peuvent avoir des répercussions importantes sur certains secteurs d’activité.
M. Bertrand Pancher a présenté deux amendements visant à éviter l’extension à une société de crédit foncier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires affectant une société qui détient des actions de celle-ci.
Son auteur a précisé qu’il s’agissait par le biais du premier de ces amendements de remédier aux imperfections de l’ordonnance du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier (110), laquelle n’avait pas entièrement tiré les conséquences de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sur le droit applicable aux sociétés de crédit foncier. Il a également indiqué que l’amendement suivant s’inscrivait dans la même démarche, en permettant la résiliation immédiate des contrats chargeant une société de gérer ou de recouvrer des ressources pour le compte d’une société de crédit foncier, lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le rapporteur pour avis a indiqué qu’il était favorable aux changements ainsi proposés et a suggéré de fusionner les dispositions de ces deux amendements en un seul article additionnel.
Son auteur ayant accepté cette rectification et annoncé qu’il retirait son second amendement, la Commission a adopté le premier amendement ainsi rectifié, portant article additionnel (amendement n° 98).
TITRE II
MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
Le présent titre II porte moins sur les capacités de l’offre (objet du titre Ier) que sur les modalités de sa diffusion sur le marché. En l’espèce, il s’agit pour le législateur de garantir un fonctionnement le plus concurrentiel possible de secteurs qui, en raison de barrières législatives et réglementaires en vigueur, sont marqués par des dysfonctionnements qui se répercutent sur le niveau général des prix. Grâce à une concurrence plus loyale et contrôlée de manière plus efficace par la puissance publique, les consommateurs devraient réaliser de réelles économies et consommer davantage. Par voie de conséquence, la croissance française se verra confortée car la consommation constitue l’un de ses principaux leviers.
Chapitre Ier
Mettre en œuvre la deuxième étape
de la réforme des relations commerciales
En redéfinissant les modalités de calcul du seuil de revente à perte afin de permettre aux distributeurs d’y réintégrer, le cas échéant, l’intégralité de leurs marges-arrière, la loi du 3 janvier 2008 a parachevé la première étape de la réforme de la loi Galland du 1er juillet 1996 (étape engagée par la loi en faveur des PME du 2 août 2005). Pour autant, ainsi que le Gouvernement l’avait annoncé devant le Parlement à l’automne 2007, une réforme plus profonde encore doit intervenir pour rétablir durablement les effets positifs d’une concurrence saine et non faussée sur les prix facturés aux consommateurs. Tel est justement l’objet de ce chapitre Ier du titre II du projet de loi, qui vise notamment à instaurer le cadre d’une véritable négociabilité des conditions générales de vente entre fournisseurs et distributeurs.
Article 21
(art. L. 441-2-1, art. L. 441-6, art. L. 441-7 du code de commerce)
Instauration d’une négociabilité des conditions générales de vente
Lors de l’examen parlementaire de la loi du 3 janvier 2008 précédemment évoquée, les représentants des distributeurs avaient demandé l’instauration immédiate d’une négociabilité totale des conditions générales de vente, arguant que l’interdiction de différenciation entre distributeurs, posée à l’article L. 441-6 du code de commerce, produisait par elle même de forts effets inflationnistes en incitant les fournisseurs à majorer unilatéralement leurs tarifs, parfois en dehors de toute justification commerciale. Souscrivant à cet objectif, le Gouvernement avait indiqué qu’il souhaitait étudier au préalable les conditions juridiques de la mise en place d’un tel mécanisme qui, il faut bien le reconnaître, constitue une véritable révolution du cadre des relations commerciales.
a) Une négociabilité des tarifs désormais permise
Dans sa première étude publiée le 21 mars dernier, l’observatoire des prix et des marges institué par le Gouvernement a démontré que les tensions à la hausse sur les prix des produits alimentaires (chiffrées à 4,69 % entre février 2007 et février 2008) excèdent, dans la plupart des cas, l’inflation moyenne (atteignant actuellement les 3 %).
GLISSEMENT ANNUEL DES PRIX PAR TYPE DE MAGASIN
ET PAR TYPE DE MARQUES, À LA FIN FÉVRIER 2008
Tous produits |
Marques nationales |
Marques de distributeur |
Marques premiers prix | |
Hypermarchés |
+ 4,68 % |
+ 4,41 % |
+ 4,94 % |
+ 6,47 % |
Supermarchés |
+ 4,93 % |
+ 4,37 % |
+ 5,78 % |
+ 7,21 % |
Ensemble |
+ 4,69 % |
+ 4,30 % |
+ 5,19 % |
+ 6,78 % |
Source : DGCCRF, 21 mars 2008. | ||||
GLISSEMENT ANNUEL DES PRIX PAR TYPE DE MARQUES (1)
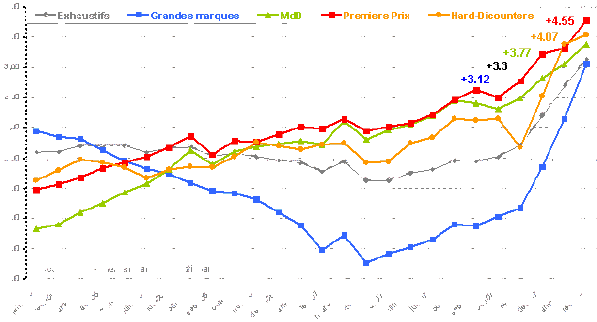
(1) Du 1er janvier 2006 au 16 février 2008. Données Nielsen.
L’observatoire des prix et des marges a souligné qu’une partie des renchérissements relevés incombait incontestablement à l’augmentation des cours des matières premières agricoles, notamment pour les produits alimentaires. Dans le même temps, il a mis en exergue que la moyenne arithmétique des prix de revente aux consommateurs des produits examinés aurait augmenté de 7,1 % entre novembre 2007 et janvier 2008, c’est-à-dire plus fortement que la hausse des prix nets facturés par les fournisseurs (+ 6,7 %) mais moins sensiblement que celle des prix tarifés dans les conditions générales de vente (+ 8,1 %).
Il ressort de ces constats qu’il existe bel et bien, aujourd’hui, un biais concurrentiel dans le secteur de la distribution, lié notamment aux modalités de détermination des prix. Conscient de l’importance de cette question et de ses implications potentielles pour de nombreuses PME travaillant pour les distributeurs, le Gouvernement a souhaité prendre le temps de la réflexion afin d’élaborer un dispositif qui apporte le plus de garanties possibles aux consommateurs ainsi qu’à l’équilibre de la filière concernée. C’est ainsi qu’un rapport sur le sujet a été élaboré par un groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence, pour esquisser les solutions juridiques les plus appropriées.
On l’a déjà souligné, la négociabilité tarifaire est actuellement très strictement encadrée par l’article L. 441-6 du code de commerce, qui la limite à des différenciations entre catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de services (à savoir les grossistes ou les détaillants, par exemple), à charge pour un décret – non publié à ce jour – d’expliciter ces catégories en fonction du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution des intéressés. De fait, il n’est quasiment pas recouru à cette possibilité par les fournisseurs, alors même qu’elle présente de nombreux avantages pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution :
– pour les consommateurs, en premier lieu, elle est susceptible de favoriser de sensibles diminutions de prix, si les distributeurs répercutent intégralement les réductions obtenues auprès des fournisseurs sur leurs prix de vente nets ;
– pour les fournisseurs, en deuxième lieu, elle peut permettre de gagner des parts de marché auprès des distributeurs pour lesquels la demande finale du ou des produits en question est faible et qui ne les auraient pas achetés à un prix uniforme ;
– pour les distributeurs, enfin, elle incite nécessairement à un retour vers la compétitivité tarifaire et à une réorientation de leurs investissements vers l’activité commerciale (c’est-à-dire les promotions aux consommateurs), au détriment des prestations aux fournisseurs (logistique, catalogues), génératrices jusqu’à présent de marges-arrière qui, de facto, n’auront plus autant de poids à l’issue de la réforme.
Le dispositif proposé par le présent article du projet de loi afin de favoriser la différenciation tarifaire dans les conditions générales de vente s’appuie sur les suggestions du rapport remis au Gouvernement par Mme Marie-Dominique Hagelsteen. De fait, il n’est pas envisagé de remettre en question le principe selon lequel le fournisseur doit communiquer à tout acheteur professionnel ses conditions générales de vente, celles-ci constituant le socle de la négociation commerciale. Ainsi que le précise le rapport susmentionné : « La crainte fréquemment exprimée est que la négociabilité des tarifs ne conduise la grande distribution, compte tenu des rapports de force existants, à déposséder le fournisseur de sa capacité à déterminer sa propre politique commerciale et tarifaire. (…) Le dispositif actuel, en tant qu’il confère aux conditions générales de vente, et notamment aux tarifs, le statut de base de départ des négociations, présente un avantage pour le fournisseur : la négociation commerciale s’engage à partir de ses propres propositions. » (111).
La principale modification prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce réside dans la suppression du renvoi actuel à un décret pour préciser les critères selon lesquels sont déterminées les différentes catégories d’acheteurs pouvant faire l’objet de différenciations tarifaires. Le silence du pouvoir réglementaire ayant conduit le minimum de souplesse prévu jusqu’à présent par la loi à rester lettre morte, une telle suppression est de nature à lever l’obstacle juridique qui empêchait les acteurs de la relation commerciale à négocier, au cas par cas, les prix pratiqués. Désormais, tout fournisseur disposera d’une véritable liberté d’appréciation des différenciations tarifaires qu’il pourra proposer à ses interlocuteurs. Par coordination, la mention des détaillants et des grossistes est elle aussi retirée du texte de l’article L. 441-6, de manière à éviter toute interprétation restrictive de son champ d’application.
Mais, pour être réellement attractive, la différenciation tarifaire ne saurait être contrainte par une quelconque obligation de devoir justifier les raisons pour lesquelles les conditions consenties à tel distributeur ne le sont pas à tel autre, même s’il présente pourtant les mêmes caractéristiques. C’est la raison pour laquelle il est également prévu de supprimer les exigences auxquelles l’article L. 441-6 du code de commerce subordonne la mise en œuvre des conditions particulières de vente. Ces conditions particulières, négociées, sont le cadre juridique naturel de la différenciation tarifaire que le projet de loi entend développer. À l’heure actuelle, elles doivent être justifiées par « la spécificité des services rendus ». En totale cohérence avec son objectif de flexibilisation du régime de négociation tarifaire, le présent article du projet de loi supprime cette exigence.
b) Un cadre contractuel entre fournisseurs et distributeurs encore plus explicite
Depuis la loi du 2 août 2005, un contrat écrit formalise chaque année les engagements réciproques des fournisseurs et des distributeurs dans le cadre de leur relation commerciale, sur la base des solutions élaborées par la jurisprudence (112) et de certaines circulaires ministérielles (113). Avec l’adoption de la loi du 3 janvier 2008, le contrat de coopération commerciale a été remplacé par une convention unique, au contenu clarifié et simplifié, prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce. Aux termes de ce même article, la coopération commerciale s’articule autour de trois catégories de services : les services rendus à l’occasion de la revente des produits aux consommateurs, ceux permettant de favoriser la commercialisation des produits et les services distincts.
Détaillant ces différentes prestations, un tel document présente donc un intérêt certain, en ce qu’il facilite les contrôles exercés par la DGCCRF. Il convient de tenir compte des conséquences de la négociabilité des conditions générales de vente sur l’objet même de cette convention, notamment en prévoyant qu’elle mentionne les obligations convenues en vue de favoriser la relation commerciale entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services. Tel est notamment l’objet des modifications apportées par le 2° du II de cet article 21.
L’occasion est également saisie par ce même 2° du II pour adapter les dispositions relatives à la date limite de conclusion de la convention unique ou du contrat-cadre annuel, aujourd’hui fixée au 1er mars, au cas spécifique des produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l’année civile. Pour ces derniers, la convention unique ou le contrat-cadre annuel pourront être conclus dans les deux mois suivant le point de départ de la période annuelle ou infra-annuelle de commercialisation.
Le 1° de ce paragraphe II tend, quant à lui, à préciser que les contreparties financières correspondant aux services distincts figurent sur les factures du fournisseur. Il s’agit là d’un gage de transparence important, qui démontre que les modifications apportées n’ont clairement pas pour objectif de faire table rase des instruments de contrôle.
Enfin, dans un même but, le paragraphe III prévoit que le contrat écrit portant sur la vente de produits agricoles périssables (fruits et légumes) ou issus de cycles courts de production (volaille), d’animaux vifs (œufs, lait), de carcasses (porc à la découpe) et les produits de la pêche et de l’aquaculture figurant sur une liste établie par décret devra indiquer dorénavant les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Le deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce se trouve complété à cet effet.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.
Article 22
(art. L. 442-6 du code de commerce)
Exonération des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente du régime des sanctions des pratiques abusives
Cet article du projet de loi est étroitement lié au précédent, dont il découle en quelque sorte. Il aménage le régime de mise en cause des parties à une relation commerciale pour, d’une part, exclure la discrimination tarifaire négociée de ses motifs de mise œuvre et, d’autre part, rendre les sanctions civiles des pratiques prohibées beaucoup plus efficaces.
a) L’exonération des conditions exonératoires des conditions générales de vente du champ de la responsabilité civile des parties à une relation commerciale
Comme l’a souligné le rapport du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « Il serait illusoire d’ouvrir la possibilité d’une négociation des tarifs par la modification de l’article L. 441-6, si le principe de l’interdiction “per se” des discriminations était maintenu » (114). Un tel principe est posé par le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, qui dispose actuellement qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage dans la concurrence.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation datant du 6 avril 1999 (115), l’avantage ou le désavantage dans la concurrence est présumé dès lors que la pratique discriminatoire est établie. Par voie de conséquence, il n’a plus à être démontré. En vertu de ces dispositions, toute modulation tarifaire non justifiée par des contreparties se trouve donc interdite ; au surplus, il ne suffit pas que des contreparties existent, puisque celles-ci doivent être proportionnées. Bien que huit décisions de justice aient été rendues sur son fondement entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, il faut bien reconnaître que le 1° du I de l’article L. 442-6 conduit les acteurs de la distribution à éviter autant que possible de différencier leurs conditions tarifaires, y compris dans les limites permises par le droit. Dès lors, seule sa suppression paraît de nature à garantir la pleine effectivité des modifications apportées précédemment à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Cette démarche, qui rompt avec un principe qui est resté au cœur du régime juridique des relations commerciales depuis les années 1950, ne remet aucunement en cause l’application des autres principes de non-discrimination qui gouvernent ces mêmes relations commerciales, notamment les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qui prohibent les pratiques discriminatoires susceptibles de fausser la concurrence.
Outre qu’il procède à une renumérotation rendue nécessaire par la suppression du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le présent article du projet de loi tend à clarifier la cause d’abus de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente à l’égard d’un partenaire commercial (actuel b) du 2° du I de l’article L. 442-6) en lui substituant la notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », à bien des aspects plus parlante et générale. En l’espèce, il ne s’agit pas d’affaiblir la portée d’un instrument dédié à la préservation des petits fournisseurs contre les grands distributeurs, mais d’éviter que ses termes ne réduisent considérablement l’effet pratique de la négociabilité tarifaire. Cette initiative répond d’ailleurs à l’une des préoccupations du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen.
De même, de manière à tirer pleinement les conséquences des changements apportés à l’article L. 441-6 du même code, il est prévu de réécrire le 4° du I de l’article L. 442-6, afin de faire disparaître la référence à l’obtention ou à la tentative d’obtention, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, de conditions manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. La négociabilité des conditions générales de vente impliquant la possibilité de dérogations, il serait effectivement contradictoire de maintenir la sanction de la recherche de conditions spécifiques ; la menace de rupture brutale ne devrait ainsi plus trouver son fondement, comme c’est le cas actuellement aujourd’hui, dans de telles circonstances. En revanche, la recherche de conditions manifestement abusives sous la menace d’une rupture totale ou partielle des relations commerciales demeurera reconnue au titre des causes de mise en jeu de la responsabilité civile de son auteur.
b) La modernisation des sanctions civiles des pratiques prohibées
Au titre des sanctions des pratiques prohibées, le présent article du projet de loi apporte plusieurs modifications de portée très significative.
Il élargit, tout d’abord, les causes de nullité aux clauses ou contrats prévoyant la possibilité, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par un cocontractant. Cette disposition, qui viendra compléter le II de l’article L. 442-6, vise à rendre caduques et inopposables les clauses contractuelles qui pourraient être rédigées afin de contourner les effets concurrentiels de la négociabilité des conditions générales de vente en obligeant un fournisseur à aligner ses tarifs sur ceux qu’il aurait éventuellement consentis à d’autres distributeurs, à l’issue d’une différenciation tarifaire. Il s’agit là d’une mesure de bon sens, qui confortera les effets de la réforme.
Il révise, ensuite, le mécanisme de l’amende civile éventuellement appliquée aux auteurs de pratiques prohibées par le I de l’article L. 442-6. Actuellement, ceux-ci peuvent être condamnés à réparer le préjudice causé et à restituer les sommes indûment perçues mais aussi à verser une amende civile, dont le montant est actuellement plafonné à 2 millions d’euros. Or, comme l’a souligné le groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « le montant de l’amende civile susceptible d’être infligé aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif » (116). Compte tenu de l’ampleur des profits indus qui peuvent être réalisés et du préjudice supporté par les consommateurs, il n’est pas inopportun d’envisager une majoration de l’amende par trois fois le montant des sommes indûment perçues par l’auteur de la pratique prohibée.
Le groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen préconisait, pour sa part, un système s’inspirant des sanctions pécuniaires infligées par le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce notamment, s’agissant des pratiques anticoncurrentielles. En l’espèce, il était question d’appliquer un pourcentage du chiffre d’affaires national hors taxes, réalisé au cours d’un des exercices clos antérieurs. La majoration finalement retenue par le 7° du présent article semble, pour sa part, d’une application moins simple et efficace dans la mesure où la proportion du montant indûment perçu ne pourra être appliquée qu’une fois que la preuve de ce montant aura été apportée au juge. Il n’en demeure pas moins que les sanctions financières des pratiques prohibées seront sensiblement aggravées et joueront, dans la plupart des cas, leur rôle de dissuasion.
La juridiction au fond, désignée par décret – il s’agira vraisemblablement, à l’instar de celle des pratiques anticoncurrentielles, de l’un des tribunaux de grande instance ou de commerce dont la liste est fixée par le tableau de l’annexe 4-1 du livre IV de la partie règlementaire du code de commerce, en première instance, et de la cour d’appel de Paris, en second ressort ; dans un souci de sécurité juridique, le juge saisi de litiges relatifs à l’article L. 442-6 du code de commerce avant la parution du décret susmentionné demeurera compétent jusqu’au bout pour statuer au fond de l’affaire –, pourra également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, de même que leur insertion dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise, aux frais de la personne condamnée. Cette dernière possibilité présente une portée très significative, tant vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des marchés financiers, sur l’image de l’acteur économique qui pourrait se trouver, à l’avenir, ainsi sanctionné pour s’être adonné à des pratiques commerciales prohibées.
Par ailleurs, de manière à offrir au juge un panel de moyens d’action aussi large que possible, des astreintes sont également prévues. L’avant-projet de loi était, sur ce point, plus précis que la version du texte déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, puisqu’il indiquait que ces astreintes étaient fixées dans la limite d’une fraction de l’amende infligée, par jour de retard, et liquidées par la juridiction qui en fixait le montant définitif.
c) Le possible éclairage du juge par l’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales
Étant donné les implications potentielles des sanctions se trouvant désormais à la disposition du juge, celui-ci pourra dorénavant recourir à l’expertise de la commission d’examen des pratiques commerciales pour éclairer ses décisions. Instance consultative placée auprès du ministre chargé de l’économie, cette commission est composée d’un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs, en même temps que de parlementaires (un député et un sénateur), de magistrats, de fonctionnaires et de personnalités qualifiées. Chargée, aux termes de l’article L. 440-1 du code de commerce, de veiller à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs au regard de la législation en vigueur, elle examine pour ce faire les documents commerciaux ou publicitaires, les contrats et toutes pratiques susceptibles d’être considérées comme abusives dans la relation commerciale.
Sa compétence technique, pour seconder le juge en matière de pratiques commerciales abusives, ne fait donc aucun doute. Le dernier alinéa du 8° du présent article souligne néanmoins que le recours à cette consultation est facultatif et que l’avis de la commission ne saurait lier la juridiction statuant au fond.
Il est également précisé que la saisie de la commission d’examen des pratiques commerciales n’est pas susceptible de recours et que, dans l’attente de son avis ou de l’expiration du délai de quatre mois dont elle disposera pour se prononcer, il devra être sursis à toute décision sur le fond de l’affaire. À titre conservatoire, néanmoins, des mesures urgentes pourront être prises ; en l’espèce, le juge devrait ainsi pouvoir enjoindre la cessation de certaines pratiques dûment constatées, dans l’attente de la détermination d’un préjudice éventuel.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis visant à renforcer le caractère dissuasif des sanctions financières applicables aux commerçants auteurs de pratiques abusives ou déloyales. Son auteur a rappelé que le rapport remis le 12 février 2008 par le groupe de travail sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente avait constaté le caractère insuffisamment dissuasif, face à de tels comportements, du système actuel d’amendes civiles forfaitaires et avait préconisé, comme le propose l’amendement, d’y substituer une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires national hors taxes de l’entreprise concernée. Il a considéré qu’une répression plus efficace des pratiques commerciales anticoncurrentielles favoriserait la baisse des prix.
Le Président Jean-Luc Warsmann s’est interrogé sur l’impact d’un tel dispositif vis-à-vis des distributeurs indépendants, compte tenu du mode de calcul proposé pour la détermination de l’amende, et a suggéré de relever plutôt le plafond des amendes, selon le cas, de 2 à 10 millions d’euros et du triple au quintuple du montant des sommes indûment versées.
Le rapporteur pour avis ayant accepté de le rectifier en ce sens, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 99).
Puis, elle a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur pour avis (amendement n° 100), et émis un avis favorable à l’adoption de l’article 22 ainsi modifié.
Chapitre II
Instaurer une Autorité de concurrence
Depuis plusieurs années, nombreuses sont les voix à s’être interrogées sur la pertinence de l’organisation de la régulation concurrentielle en France. Dès le vingtième anniversaire de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui créa le Conseil de la concurrence dans sa forme actuelle, le président de cette autorité administrative indépendante, M. Bruno Lasserre, appela à une évolution des compétences respectives du Conseil et du ministre chargé de l’économie en la matière. Plus récemment, lors du débat de la loi du 3 janvier 2008, l’opposition elle-même s’est prononcée, par l’intercession de M. Jean-Yves Le Déaut (117), en faveur d’une solution alors tout juste esquissée par la Commission pour la libération de la croissance française, à savoir la création d’une autorité nationale de la concurrence aux pouvoirs élargis. Preuve en est, donc, que, sur l’objectif poursuivi par ce chapitre II du titre II du projet de loi, un consensus est possible.
Article 23
(Livre IV du code de commerce)
Habilitation du Gouvernement à réformer, par ordonnance,
le cadre actuel de régulation de la concurrence
Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, afin de moderniser le cadre de la régulation de la concurrence en France. Les délais prévus pour la publication de l’ordonnance et le dépôt du projet de loi de ratification sont classiques, puisque l’ordonnance transformant le Conseil de la concurrence devra être prise dans les six mois de la publication de la loi de modernisation de l’économie, à charge pour le Gouvernement de déposer un projet de loi de ratification dans les trois mois ultérieurs.
Sur la forme, il convient de reconnaître que l’habilitation demandée n’est pas exempte de justifications, ni même de précédents en la matière. En effet, le régime actuellement en vigueur ainsi que les dispositions définissant les compétences respectives du Conseil de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, s’agissant des contrôles à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration, sont largement issus de l’ordonnance du 1er décembre 1986, elle-même déjà modifiée par ordonnance (118). En outre, s’agissant du seul Conseil de la concurrence, pas moins de 98 articles du code de commerce font expressément référence à cette autorité administrative indépendante, de sorte que sa réforme nécessite forcément un texte volumineux, par essence incompatible avec le souhait d’une effectivité rapide affiché par le Gouvernement.
Compte tenu du regard relativement consensuel que porte l’ensemble de la représentation nationale sur la nécessité de réorganiser les procédures françaises de régulation de la concurrence en s’inspirant des pratiques adoptées par la quasi-totalité des autres États membres de l’Union européenne, il n’est pas choquant que le Parlement soit a appelé à se prononcer sur l’objectif politique de la réforme davantage que sur sa déclinaison technique. La méthode retenue en 1986, à travers la mise en place du groupe d’experts pour l’élaboration d’un nouveau droit de la concurrence, présidée par M. Jean Donnedieu de Vabres, a d’ailleurs démontré qu’en la matière, la réflexion de juristes spécialisés pouvait conduire à un résultat de grande qualité. À présent que le texte issu de l’ordonnance de 1986 a vieilli, il n’est nullement incohérent de recourir à un procédé identique.
Sur le fond, le présent article assigne à l’ordonnance dont le Gouvernement sollicite l’habilitation un double objectif consistant, d’une part, à transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence et, d’autre part, à rendre plus efficace l’articulation des compétences de la nouvelle Autorité avec celles du ministre chargé de l’économie. Le champ des modifications prévues afin d’atteindre le premier de ces objectifs porterait plus particulièrement sur quatre aspects :
– tout d’abord, l’élargissement des compétences du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations économiques, de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;
– ensuite, la mise en adéquation des moyens d’enquête du Conseil avec ses nouvelles attributions d’Autorité de la concurrence ;
– corrélativement, la rénovation de la composition, de l’organisation et des règles de fonctionnement du Conseil ;
– enfin, l’extension des capacités d’ester en justice du Conseil.
• Sur le premier aspect, ainsi que cela a été précédemment souligné, le titre III du livre IV du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie la compétence d’autoriser les concentrations économiques relevant du droit national, le cas échéant après avoir demandé l’avis du Conseil de la concurrence. En revanche, le Conseil, lui, contrôle et sanctionne les pratiques anticoncurrentielles (abus de position dominante, ententes essentiellement), aux termes du chapitre II du titre VI du livre IV du même code. La pertinence de cette répartition des rôles a fait long feu puisque, désormais, seul le Luxembourg, dans l’Union européenne, dissocie la compétence de la régulation concurrentielle entre deux autorités administratives distinctes. L’ordonnance envisagée par le présent article devrait donc permettre à la France d’adopter un dispositif similaire à celui de ses principaux partenaires économiques et commerciaux, qui sera plus simple et plus lisible pour les entreprises, mais aussi plus efficace.
En l’espèce, la nouvelle Autorité de la concurrence sera appelée à examiner toutes les demandes d’autorisation de concentrations, même si le ministre chargé de l’économie pourra ne pas suivre sa décision pour des motifs d’intérêt général qu’il lui incombera de détailler et de faire connaître. S’agissant de la détection des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, le ministre chargé de l’économie aura également la faculté de saisir l’Autorité de la concurrence des cas les plus significatifs.
Compte tenu de la rédaction du champ de l’ordonnance, les possibilités de consultation du Conseil sur les questions de concurrence se verront accrues, afin de faire suite aux revendications de ses membres et aux suggestions de la Commission pour la libération de la croissance française. La future Autorité continuera à donner son avis, à leur demande, au Gouvernement, au Parlement, aux collectivités territoriales, aux organisations professionnelles et syndicales, aux organisations agréées de consommateurs, aux chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture et des métiers sur les problèmes de concurrence relevant des intérêts dont tous ont la charge, mais elle devrait également pouvoir formuler des avis spontanés, dont la publicité lui conférera une audience plus forte et, indéniablement, une autorité supplémentaire vis-à-vis des acteurs économiques.
• Sur le deuxième point, en application des articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce, il convient de préciser que les investigations relatives à des affaires relevant du Conseil sont actuellement menées par des agents de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, service à compétence nationale rattaché à la DGCCRF. Les rapporteurs du Conseil ont les mêmes pouvoirs d’enquête que les agents de la DGCCRF, mais leur capacité d’investigation est nécessairement plus limitée. Dès lors que l’Autorité de la concurrence est appelée à récupérer certaines attributions actuellement dévolues au ministre chargé de l’économie en matière de contrôle des concentrations, cette dichotomie de moyens n’a plus lieu d’être. Les agents de la direction nationale des enquêtes de la DGCRFF seront donc naturellement mis à la disposition de la nouvelle Autorité de la concurrence. L’ordonnance doit justement tirer les conséquences juridiques de cette réorganisation.
La détection, l’instruction et le jugement des pratiques anticoncurrentielles pourront ainsi être réalisés plus rapidement et, surtout, sans risque de déperdition d’information.
• Pour ce qui concerne la composition, l’organisation et les règles de procédure, on rappellera que le Conseil de la concurrence est composé de dix-sept membres nommés pour six ans par décret du ministre chargé de l’économie. Outre huit membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, il comprend cinq personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans le secteur de la production, de la distribution, de l’artisanat ou des professions libérales, ainsi que quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation.
En application de l’article L. 461-3 du code de commerce, le Conseil siège en formation plénière, en sections ou en formation permanente, cette dernière regroupant le président et les trois vice-présidents. Un décret du 30 avril 2002 (119) a apporté plusieurs précisions quant à l’organisation de ces formations : l’institution ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit membres en formation plénière, trois membres en sections (chacune d’entre elles étant présidée par l’un des vice-présidents ou le membre le plus ancien de la section). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. De fait, l’extension des missions du Conseil lors de sa transformation en Autorité de la concurrence nécessitera des ajustements au niveau de l’ensemble de ces règles, notamment pour garantir les droits de la défense.
• Enfin, s’agissant des capacités d’ester en justice, il convient de rappeler que la compétence actuelle du Conseil de la concurrence n’est pas exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire pour l’application des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce (relatifs à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles) : si le Conseil a le pouvoir d’imposer une amende et de prononcer des injonctions, le juge peut, quant à lui, annuler des dispositions contractuelles, condamner l’auteur de pratiques illicites à payer des dommages-intérêts et prononcer lui aussi des injonctions. En outre, les sanctions du Conseil sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de Paris.
En l’espèce, une clarification des procédures interviendra certainement, sans pour autant que soit remis en cause la juridiction d’appel des sanctions du Conseil (votre rapporteur pour avis a eu des assurances à ce propos), seul l’appel des décisions de la future Autorité de la concurrence dans sa formation relative au contrôle des concentrations étant susceptible de relever du Conseil d’État, à l’instar des décisions du ministre chargé de l’économie actuellement.
Saisi pour avis du projet d’ordonnance relatif à la réforme du système français de régulation de la concurrence, le Conseil de la concurrence a porté une appréciation globalement positive sur les dispositions envisagées, en évoquant des « progrès, qui font consensus (…) notables et bienvenus » (120). Il a toutefois assorti son appréciation d’observations techniques intéressantes, ayant trait tout à la fois à l’articulation des missions des différentes parties prenantes du contrôle concurrentiel des concentrations, au champ des possibilités de transactions offertes aux services de l’État en matière de pratiques anticoncurrentielles, à la gouvernance de la future Autorité et, enfin, aux modalités de remplacement du collège du Conseil par celui de la future Autorité. Votre rapporteur, qui a pu prendre connaissance du projet d’ordonnance, considère que l’avis du Conseil est souvent étayé et dicté par des raisons de bon sens ; aussi, il recommande au Gouvernement d’en tenir le plus grand compte lors de l’élaboration de son ordonnance.
Sous cette réserve, la réforme prévue s’annonce d’ampleur. Elle est avant tout dictée par le souci de renforcer le rôle et les missions d’une autorité administrative indépendante qui a progressivement acquis une réelle légitimité, notamment grâce à son travail sur des dossiers aussi sensibles que la concurrence dans le domaine des télécommunications mobiles. En visant, en outre, à rendre l’institution plus efficace et réactive, cette réforme contribuera à dynamiser une économie française marquée encore aujourd’hui par une méconnaissance, pour ne pas dire par une certaine forme de méfiance, à l’égard des vertus d’une concurrence véritable.
La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur pour avis (amendement n° 101), puis émis un avis favorable à l’adoption de l’article 23 ainsi modifié.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin interdisant aux juridictions, statuant sur une action en dommages et intérêts qui concerne une pratique définitivement jugée comme anticoncurrentielle par les autorités chargées de la régulation de la concurrence, de rendre une décision remettant en cause l’existence d’une telle infraction.
Chapitre III
Développer le commerce
La réforme de l’équipement commercial se trouve rattachée aux mesures du projet de loi relatives au développement du commerce mais elle aurait tout aussi bien pu figurer parmi les dispositions visant à conforter et amplifier la concurrence entre enseignes de distribution. Issue pour une large part des lois « Royer » (1973) et « Raffarin » (1996), précédemment mentionnées, la législation en vigueur comporte en elle-même un certain nombre d’effets pervers auxquels tant les institutions communautaires que le Conseil de la concurrence appellent le législateur à mettre un terme. L’assouplissement des conditions d’implantation de nouveaux centres commerciaux devrait non seulement mettre fin aux incompatibilités du droit national avec les exigences communautaires, mais de surcroît il rétablira la concurrence là où elle fait défaut, pour le plus grand profit des consommateurs.
Néanmoins, le projet de loi ne se contente pas d’encourager une concurrence accrue entre commerces. Il prévoit aussi des dispositions d’accompagnement financier pour les commerces de proximité présents dans certains lieux d’habitation rencontrant des difficultés, à l’instar des communes rurales et des quartiers sensibles.
Article 26
(art. L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce)
Mobilisation du FISAC en faveur des commerces en milieu rural, dans les halles et marchés et les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Cet article du projet de loi vise principalement à permettre la participation du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce à des actions de soutien à la modernisation des commerces de proximité, de manière à accompagner et à lisser les effets concurrentiels accrus, qui seront induits par la réforme de l’urbanisme commercial prévue à l’article suivant. Concrètement, aux termes du paragraphe I, un article L. 750-1-1 doit être inséré au début du titre V du livre VII du code de commerce, afin de rendre les mesures de soutien aux commerces de proximité présents en milieu rural, dans les halles et marchés, ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, éligibles aux concours du FISAC. Cette disposition répond aux attentes exprimées par les élus et ne peut que recueillir, dans son principe, l’adhésion.
Le FISAC a été créé par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (121), pour répondre aux menaces pesant sur l’existence de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, ces menaces étant liées à la désertification de certains espaces ruraux, au développement de la grande distribution (en particulier à la périphérie des villes), ainsi qu’aux difficultés des zones urbaines sensibles. Reposant sur le principe d’une solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, le dispositif était alimenté jusqu’en 2002 par un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA), acquittée par les entreprises de distribution d’une surface de vente supérieure à 400 m2. Depuis la loi de finances pour 2003 (122), le produit de la TACA est affecté au budget général.
Le FISAC vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d’entreprises de proximité, et principalement des très petites entreprises en raison du plafond de chiffre d’affaires retenu, actuellement fixé à 800 000 euros hors taxes. À cet effet, il mène d’ores et déjà quatre grands types d’opérations :
– des opérations collectives, aux niveaux rural et urbain ;
– des opérations individuelles, à destination des entreprises en milieu rural ;
– des études ;
– des actions spécifiques, décidées par le ministre chargé du commerce et de l’artisanat.
Afin d’éviter toute ambiguïté, l’article L. 750-1-1 définit les nouvelles opérations qui pourront elles aussi, désormais, bénéficier des concours financiers du FISAC. Il s’agit en l’espèce des projets destinés à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’article L. 750-1-1 précise également que le FISAC assure le versement d’aides financières pour la réalisation des nouveaux objectifs qui lui seront ainsi assignés. Toutefois, c’est le ministre chargé du commerce et de l’artisanat qui décidera, à l’instar des procédures actuelles, des attributions de ces aides sur la base des projets instruits au plan local par les préfectures de département et après avis des délégués régionaux du commerce et de l’artisanat. À titre d’illustration, en 2006, 856 décisions d’aide ont été prises, pour un montant total de 93,33 millions d’euros. Il est à souhaiter, compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FISAC, que les procédures d’instruction dont la Cour des comptes a critiqué la faible sélectivité et la lourdeur en 2005 (123) soient rapidement améliorées. En dépit de leurs observations sur le sujet, les magistrats de la Cour ne semblent malheureusement pas avoir été entendus jusqu’à présent.
Le Gouvernement s’est engagé à compléter ces dispositions par des mesures règlementaires, afin de permettre une mise en œuvre rapide du recentrage du FISAC sur les actions les plus utiles, y compris celles destinées au maintien de l’activité en milieu rural ou dans les quartiers prioritaires. Cet engagement apparaît naturellement essentiel car il conditionne en grande partie la portée du mécanisme ainsi prévu au I.
Le II de cet article du projet de loi supprime le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, visé à l’article 1er de la loi « Royer » du 27 décembre 1973, au motif que « le Gouvernement a uniquement mis en œuvre ce programme de soutien au travers du FISAC ». De fait, dès lors qu’il est envisagé d’élargir le fondement législatif du Fonds, le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales n’a effectivement plus lieu d’être.
En revanche, il convient de souligner que la rédaction de l’article L. 750-1-1 maintient la gestion comptable déléguée à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), instaurée par la loi du 31 décembre 1989. Cette mesure serait justifiée, selon l’exposé des motifs, par la souplesse de gestion que le dispositif en vigueur apporterait au FISAC, notamment en termes de coûts, de délais de paiement (ces derniers pouvant, en cas d’urgence, être limités à quelques jours), et de pluriannualité. La Cour des comptes estime, pour sa part, que si cette procédure pouvait se justifier lorsque le FISAC était financé par une taxe affectée à la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce (ORGANIC), il n’en est plus de même depuis que le Fonds est financé par l’État.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.
Article additionnel après l’article 26
(art. 8 [nouveau] de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat
Le projet de loi prévoit une majoration substantielle des ressources du FISAC, de l’ordre de 20 millions d’euros. Ces nouveaux moyens devraient utilement contribuer à la dynamisation et à l’aide au maintien des commerces de cœur de ville, dont la coexistence avec les grandes surfaces est absolument indispensable pour les consommateurs et l’aménagement urbain. Cependant, même porté à 120 millions d’euros, le montant du FISAC apparaît relativement limité au regard de l’ampleur des missions qui lui sont assignées.
Un abondement supplémentaire des ressources du Fonds apparaît d’autant plus indispensable, qu’il est la légitime contrepartie de la libéralisation des conditions d’implantations de commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2, à l’article 27. À cet égard, une taxe additionnelle à la TACA, dont le taux pourrait être fixé à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 m2, ouverts à partir du 1er janvier 1960, permettrait de recueillir quelques dizaines de millions d’euros supplémentaires, sans pour autant déstabiliser les commerces de petite ou de moyenne dimension.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis instituant une taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, d’un taux égal à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe des grands magasins de détail, et destinée au soutien des commerces de centre-ville et des petits commerces de proximité.
Son auteur a souligné qu’il s’agissait ainsi de répondre aux préoccupations précédemment exprimées par MM. Serge Blisko et Thierry Lazaro sur les difficultés du petit commerce, dont le déclin pourrait effectivement menacer la cohésion sociale au cœur des villes. Il a fait valoir que ce tissu commercial constitue un outil important d’animation des centres villes, sans lequel les cités dortoirs risqueraient de se multiplier. Estimant que la législation protectrice précédemment mise en place, à travers la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat dite « loi Royer », la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales dite « loi Galland » et la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dite « loi Raffarin », a paradoxalement abouti à une dégradation de la situation des commerces de centre-ville, plus marquée que dans les autres pays européens, il a jugé que la taxe qu’il est proposé d’instituer contribuera à inverser cette tendance en finançant des projets dynamisant les commerces de centre-ville et en renforçant les moyens financiers dont dispose le FISAC pour soutenir les petits commerces de proximité.
Répondant à une question de M. Serge Blisko sur l’évaluation du produit attendu de cette nouvelle taxe, le rapporteur pour avis a indiqué qu’il serait probablement compris entre 30 et 50 millions d’euros, somme correspondant à une augmentation substantielle des moyens du FISAC.
La Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 102).
Article 27
(art. L. 750-1, art. L. 751-1, art. L. 751-2, art. L. 751-3, art. L. 751-6,
art. L. 751-9, art. L. 752-1, art. L. 752-2, art. L. 752-3, art. L. 752-4, art. L. 752-5, art. L. 752-6, art. L. 752-7 à L. 752-11, art L. 752-13, art. L. 752-14, art. L. 752-15, art. L. 752-16, art. L. 752-17, art. L. 752-18, art. L. 752-19, art. L. 752-22, art. L. 752-23 [nouveau], intitulé du titre V du livre VII, intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII
du code de commerce)
Réforme de l’équipement commercial
La législation française sur l’équipement commercial est issue de textes successifs qui, depuis 1969, ont tous eu pour ambition de favoriser un développement harmonieux des différentes formes de commerce et de préserver les petits établissements de proximité. Elle se trouve néanmoins aujourd’hui mise en cause, tant par les institutions communautaires que par les principaux intéressés, du fait de son bilan plutôt insatisfaisant.
a) Une législation nationale complexe, aux effets paradoxaux
C’est la loi du 31 décembre 1969 (124) qui a institué une procédure d’examen préalable à la délivrance du permis de construire, le seuil se situant alors au niveau des surfaces commerciales de plus de 3 000 m2. Cette procédure a été transformée par la loi « Royer » du 27 décembre 1973 en autorisation d’ordre économique distincte du droit de l’urbanisme, exigible pour toute extension de plus de 200 m2 des commerces d’une surface de plus de 1 000 m2 dans les communes de moins de 40 000 habitants et de plus de 1 500 m2 dans les communes de plus de 40 000 habitants. Une commission départementale fut alors créée afin de délivrer ces autorisations ; elle existe toujours, même si sa dénomination a évolué et est appelée à le faire de nouveau, aux termes du présent projet de loi.
La loi « Raffarin » du 5 juillet 1996, tout en complétant les objectifs pris en considération pour les autorisations délivrées, a abaissé à 300 m2 le seuil rendant indispensable une autorisation de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC), tout en faisant entrer dans le champ du régime applicable les changements d’activité, les activités hôtelières ainsi que les ensembles de salles de cinéma.
Ainsi que l’a souligné le Conseil de la concurrence dans un avis rendu en 2007 sur la législation de l’équipement commercial, ce cadre normatif a eu des effets paradoxaux. Le nombre des petits libres-services alimentaires a diminué de 7 % entre 1996 et 2003 alors que celui des grandes surfaces (magasins de 400 m2 et plus) a progressé de 45,3 % entre 1992 et 2004. La faute en revient notamment au renchérissement induit par l’accroissement du nombre de demandes exigées par la loi, le coût moyen d’une demande d’extension oscillant entre 10 et 15 euros par m2 pour une grande surface de plus de 1 000 m2 alors qu’il s’établirait entre 30 et 50 euros par m2 pour un petit commerce de moins de 1 000 m2.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS
EXAMINÉS PAR LES CDEC ENTRE 1997 ET 2005
Années |
Total des dossiers |
Taux d’autorisation |
Surface moyenne des projets | |
Nombre |
Surface de vente | |||
1997 |
1 757 |
1 724 266 m2 |
64 % |
981 m2 |
1998 |
2 355 |
2 618 453 m2 |
65 % |
1 112 m2 |
1999 |
3 053 |
3 626 995 m2 |
69 % |
1 190 m2 |
2000 |
3 276 |
3 962 894 m2 |
71 % |
1 210 m2 |
2001 |
2 939 |
3 386 492 m2 |
73 % |
1 152 m2 |
2002 |
3 280 |
3 611 099 m2 |
72 % |
1 100 m2 |
2003 |
3 322 |
3 712 805 m2 |
77 % |
1 118 m2 |
2004 |
3 578 |
4 051 074 m2 |
76 % |
1 131 m2 |
2005 |
3 743 |
4 589 223 m2 |
78 % |
1 226 m2 |
Source : DCASPL. | ||||
Parallèlement, la nature des petits commerces a évolué, les services se développant au détriment des magasins alimentaires de proximité, sous réserve d’une résurgence récente du phénomène des supérettes que les grandes enseignes ont réactivées pour augmenter leurs surfaces de vente sans qu’il en résulte pour autant un accroissement de la concurrence. Enfin, le développement des magasins de maxi-discompte a été particulièrement touché par la loi « Raffarin ». Selon le Conseil de la concurrence, « la législation est intervenue alors que ce type de format de vente était en pleine expansion et connaissait une croissance supérieure aux autres formats, dont le concept était plus mûr » (125). Ce faisant, les consommateurs ont été les grands perdants d’une législation qui se voulait, avant tout, au service de la satisfaction de leur besoins et d’un développement maîtrisé de l’urbanisme commercial.
b) Une législation nationale qui n’est pas sans rappeler certaines législations européennes
Les comparaisons avec les législations en vigueur dans les autres États membres de l’Union européenne ne sont pas aisées car il n’existe pas de cadre harmonisé en la matière, chaque pays étant compétent pour définir les modalités de réalisation des implantations de surfaces commerciales tout en respectant les principes communautaires de liberté d’établissement et de libre prestation des services. Pour autant, il est possible d’identifier deux conceptions : celle des pays d’Europe du nord (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège et Suède), consistant à n’instruire les demandes d’implantation commerciale qu’à l’occasion de l’examen du permis de construire ; celle des pays d’Europe du sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France et – bien que ce pays ne soit pas géographiquement situé dans le sud de l’Europe – Belgique), conditionnant la délivrance du permis de construire à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale préalable.
Tandis que les pays d’Europe du nord insistent sur la réalisation d’objectifs d’aménagement du territoire et environnementaux, les pays d’Europe du sud privilégient la régulation de la diversité des formes de commerces.
Cette différence de philosophie explique que, dans un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, les zones attribuées au commerce soient fixées par les plans d’urbanisme locaux, en conformité avec des documents de référence locaux (Planning policy guidances). L’Allemagne, pour sa part, n’exige que l’obtention du permis de construire pour l’ouverture ou l’extension des magasins dont la surface de vente excède 700 m2 ou dont la surface construite est supérieure à 1 200 m2, sous réserve que ces opérations aient lieu dans des zones pré-identifiées et répondent à des critères économiques et environnementaux.
En revanche, en Espagne, la loi du commerce de 1996 a fixé un seuil minimal de soumission à autorisation (actuellement de 2 500 m2), lequel est décliné ensuite par les communautés autonomes, seules compétentes en matière d’urbanisme commercial (il est de 1 500 m2, par exemple, dans la région de Madrid). De même, en Italie, la loi « Bersani » du 31 mars 1998 a défini un ensemble de critères économiques et qualitatifs à prendre en compte, tels que les besoins commerciaux, la densité de l’équipement actuel et l’intégration dans l’environnement ; en outre, un seuil de soumission à autorisation a été fixé à 150 m2 ou, selon le nombre d’habitants, 250 m2 pour les commerces de proximité. Enfin, en Belgique, la législation a été modifiée en 2004 afin d’abaisser le seuil de soumission à autorisation à 400 m2, en contrepartie d’un allègement du processus décisionnel.
De manière commune à tous les pays européens précités, la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est toujours une compétence largement décentralisée. Ainsi, en Allemagne, le service d’urbanisme de la commune d’implantation instruit la demande et consulte pour avis la chambre de commerce et d’industrie avant de délivrer un permis de construire ; pour tout projet dont la surface construite est supérieure à 6 000 m2, le permis de construire est délivré par la direction régionale de planification compétente en matière d’aménagement au niveau du Land. En Italie, pour les grandes structures, l’autorisation est délivrée par une conférence des services composée d’un représentant de chacune des collectivités concernées (commune, province, région), après consultation des associations de consommateurs et des organisations professionnelles ; un simple avis est formulé pour les moyennes surfaces pour lesquelles, comme pour les commerces de proximité, les communes sont compétentes. En Belgique, enfin, au-delà d’une surface commerciale nette de 1 000 m2, le collège des bourgmestres et échevins statue sur avis consultatif du comité socio-économique national pour la distribution, dans un délai de 70 jours ; à défaut de décision dans le délai imparti, sa décision est réputée favorable.
En définitive, la France n’est pas le seul pays à avoir opté pour un mécanisme de régulation de l’équipement commercial destiné à préserver certains équilibres. Pour autant, les législations des autres pays européens semblent évoluer vers davantage de libéralisme et plusieurs systèmes qui imposent eux aussi l’obtention d’une autorisation préalable au permis de construire sont, à l’instar de celui de la France, remis en cause par la Commission européenne. C’est le cas, notamment, de l’Espagne et du Portugal, mis en demeure en 2004, pour la première, de cesser de permettre la discrimination à l’encontre d’opérateurs d’autres provinces et, pour le second, d’ouvrir davantage son marché.
c) Une conformité de la législation nationale aux règles communautaires qui se trouve aujourd’hui contestée
Le 5 juillet 2005, la Commission européenne a adressé une mise en demeure aux autorités françaises mettant en cause certaines dispositions de la loi du 27 décembre 1973 (loi « Royer »), telle que modifiée par la loi du 5 juillet 1996 (loi « Raffarin »). Les griefs de la Commission résidaient dans l’incompatibilité de ces textes avec les principes de liberté d’établissement et de liberté de prestation de services, dont le respect est imposé par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne (devenus les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, issu du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007).
Le 12 décembre 2006, la Commission a engagé la deuxième étape de cette procédure précontentieuse en adressant à la France un avis motivé. Aux termes de celui-ci, la directive du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (126), remet également en question la législation française sur l’équipement commercial en interdisant
– d’une part, dans le paragraphe 5 de son article 14, « l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve économique de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande de marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente » ;
– d’autre part, dans le paragraphe 6 de ce même article 14, la participation d’opérateurs économiques concernés dans les instances chargés de délivrer des autorisations sur un marché, y compris au sein d’un organe consultatif (aspect qui concerne plus particulièrement la composition des CDEC, au sein desquelles siègent des membres des chambres des métiers et des chambres de commerce et d’industrie, représentant les intérêts de commerçants déjà installés).
Conscientes de la nécessité de modifier la législation en vigueur, les autorités françaises ont tout d’abord mis en place une commission de modernisation de l’urbanisme commercial, chargée de proposer une réforme de la procédure et des critères de délivrance des autorisations de nouveaux équipements commerciaux. Présidée par le ministre des PME et de l’artisanat d’alors et constituée de parlementaires, d’élus locaux et de nombreux représentants des professions concernées, elle a formulé, en février 2007, plusieurs propositions.
Elle a tout d’abord appelé au maintien d’une législation spécifique sur le sujet, tout en rénovant les critères sur lesquels les dispositions du code de commerce s’appuient avec l’introduction d’un critère de concurrence (pour éviter toute exploitation abusive d’une position dominante), d’un critère d’aménagement du territoire, d’un critère d’esthétique, de qualité de l’urbanisme et de développement durable, et un enfin celle d’un critère de satisfaction des besoins des consommateurs. La commission a ensuite préconisé un rapprochement du régime de l’urbanisme commercial sur celui de l’urbanisme en général, en transformant l’actuelle procédure d’autorisation en une consultation obligatoire d’une commission départementale qui prolongerait de deux mois le délai de droit commun d’instruction des demandes de permis de construire. Elle a enfin suggéré d’améliorer le contenu, la force juridique et les modalités d’élaboration des schémas de développement commercial.
Dans un avis rendu le 11 octobre 2007, le Conseil de la concurrence a formulé un point de vue relativement plus audacieux que ces propositions, en envisageant notamment la suppression pure et simple de l’autorisation préalable à la délivrance du permis de construire. Cette option n’a finalement pas été retenue dans le cadre de la réforme proposée dans le présent projet de loi, qui se contente de rendre le système actuel compatible avec les exigences communautaires tout en assouplissant significativement les contraintes qu’il fait peser sur les intéressés.
d) Les enjeux et la teneur de la réforme
Trente années d’évolution de la grande distribution démontrent que les règles en vigueur n’ont pu préserver un équilibre stable entre les différentes formes de commerce, malgré de réels efforts. Une réforme, digne de ce nom, ne saurait se contenter de simples ajustements. Sans nécessairement révolutionner le cadre actuel, les dispositions du projet de loi vont au-delà d’un simple toilettage du titre V du livre VII du code de commerce.
• Au-delà de certaines clarifications et simplifications rédactionnelles, telles celles initialement prévues au sujet des objectifs assignés par l’article L. 750-1 du code de commerce aux implantations, extensions et transferts d’activités existantes ou changements d’activité d’entreprises commerciales et artisanales, le texte vise principalement à réformer en profondeur la composition des CDEC. Ainsi, aux termes des modifications apportées à l’article L. 751-2 du même code, elles ne seront plus composées de trois mais de cinq élus locaux, de manière à ce que le président du conseil général ou son représentant ainsi que le président du conseil régional ou son représentant – dans le cas de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant – y siègent ; à Paris, les membres actuels se verront complétés par deux conseillers régionaux d’Île-de-France désignés par le conseil régional. Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, lorsque l’un des élus membres d’une CDEC détiendra plusieurs mandats locaux, le préfet désignera un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée, l’idée étant d’assurer une représentation équilibrée des intérêts des communes concernées. Aux termes des modifications ainsi apportées, les élus disposeront de la majorité absolue des voix au sein des CDEC, dans leur nouvelle configuration.
Parallèlement, il est mis fin à la présence, au titre des personnalités qualifiées, du président de la chambre de commerce et d’industrie et du président de la chambre des métiers dont les circonscriptions territoriales comprennent la commune d’implantation (ou de leurs représentants respectifs) ainsi qu’à celle du représentant des associations de consommateurs du département, les nouveaux 2° des II et III de l’article L. 751-2 renvoyant à trois personnalités qualifiées en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable et d’aménagement du territoire. Précision est également apportée que, lorsque la CDEC se réunira pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, elle comprendra parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique, c’est-à-dire une personne aux compétences reconnues en matière culturelle.
Le texte précise également, à l’article L. 751-3 du code de commerce, qu’aucun membre de la CDEC ne pourra délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties.
La commission nationale d’équipement commercial, qui examine les recours à l’encontre des décisions des CDEC, voit, quant à elle, les compétences des quatre personnalités qualifiées qui y siègent élargies aux domaines de l’urbanisme et du développement durable. Sa composition se trouvera également adaptée, en cas de recours sur des décisions d’aménagement cinématographique, avec la présence d’un inspecteur général des services du ministère de la culture, d’une personne qualifiée en matière de distribution cinématographique et du président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
De manière quelque peu surprenante, il est envisagé de supprimer les observatoires départementaux d’équipement commercial, actuellement prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce. Cette éventualité apparaît d’autant moins acceptable que les dispositions de l’article L. 751-9 du code de commerce, unique article de la section susmentionnée, se réfèrent aussi aux schémas de développement commercial, qui permettent de définir des objectifs précis d’évolution de l’urbanisme commercial sur un territoire donné.
• Une autre innovation de la réforme réside dans l’élévation à 1 000 m2 du seuil de surface de vente dont l’implantation ou l’extension est envisagée, au-delà duquel une autorisation de la CDEC s’avère nécessaire. Ce nouveau régime s’appliquera aussi à tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 000 m2. Se trouveront exonérés de l’exigence d’autorisation, alors qu’ils y étaient soumis jusqu’alors : la création ou l’extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants ; la réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente libérée à la suite d’une autorisation de création de magasin par transfert d’activités existantes ; la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans ; les établissements hôteliers d’une certaine capacité.
Le seuil au-delà duquel tout regroupement d’activités non-alimentaires ainsi que l’affectation d’une partie du domaine public des gares de centre-ville supposeront désormais une autorisation des CDEC est lui aussi substantiellement réévalué, en passant de 1 000 à 2 500 m2. Quant aux exonérations totales d’autorisation, prévues par le II de l’article L. 752-2 du code de commerce, elles bénéficieront désormais aussi aux commerces de véhicules automobiles et de motocycles, en sus des pharmacies qui seules en jouissaient jusqu’à présent. Corrélativement, les formalités, relativement lourdes, qui accompagnaient les demandes d’autorisation (entre autres, l’exigence d’enquête publique pour tout projet portant sur un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 6 000 m2) sont supprimées du fait de l’abrogation des articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce.
Au total, les conditions d’implantation de nouvelles surfaces de vente et d’extension des surfaces existantes se trouveront très notablement libéralisées et assouplies, notamment s’agissant des commerces de taille moyenne.
• Sur le plan procédural, les critères pris en considération par la CDEC lors de l’examen des dossiers font l’objet d’une actualisation bienvenue, à l’article L. 752-6 du code de commerce. La commission se verra désormais appelée à se prononcer sur :
– les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, en faisant plus spécialement porter son attention sur les conséquences attendues sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, d’une part, et les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, d’autre part ;
– ses effets sur les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (prévues à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti) et l’enquête publique préalable aux opérations touchant une zone d’aménagement concerté (prévue à l’article L. 123-11 du code de l’urbanisme) ;
– et sa qualité environnementale (c’est-à-dire son impact en termes de pollution, notamment).
Dans le même but de simplification des procédures, un certain nombre d’exigences sur l’utilité desquelles on pouvait s’interroger seront remplacées et synthétisées au sein du nouvel article L. 752-14 du code de commerce. Celui-ci dispose d’une règle de décision à la majorité absolue des présents (le préfet ne prenant pas part au vote), le vote de chacun étant indiqué dans le procès verbal des séances. La décision de la commission départementale devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la saisine, son silence à l’issue de cette durée valant autorisation – à l’instar du régime en vigueur en Belgique –, par analogie avec un principe couramment appliqué en droit administratif. Les membres de la commission devront avoir connaissance de leurs dossiers dix jours au moins avant de statuer et leur décision sera notifiée dans les dix jours au maire, au pétitionnaire et, dans le cas des aménagements cinématographiques, au médiateur du cinéma. Ces précisions, qui constituent de réels ajouts par rapport au droit actuellement applicable, constituent une avancée pour les commerçants. Elles favoriseront une prise de décision rapide, ce qui apparaît souhaitable dans le monde des affaires.
Dans le même ordre d’idées, les voies de recours prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce sont sensiblement aménagées par le projet de loi. Alors que le recours à la commission nationale d’équipement commercial était jusqu’alors réservé aux membres de la CDEC, dans les deux mois de sa décision, un tel recours sera désormais ouvert à toute personne ayant intérêt à agir, c’est-à-dire aussi aux pétitionnaires déboutés (ainsi qu’au préfet, au maire et au médiateur du cinéma, dans le cas des dossiers d’aménagement cinématographique), dans le mois suivant la décision de la commission départementale. Dans un souci de bonne administration de la justice, ce recours constituera un préalable obligatoire à tout recours contentieux ; de ce fait, le raccourcissement du délai s’explique par la volonté de retarder le moins possible la décision définitive.
Des précisions liées à la formation de la commission nationale en cas d’examen de dossiers d’aménagement cinématographique sont également prévues, afin de permettre, notamment, la présence d’un commissaire du Gouvernement qui soit nommé par le ministre chargé de la culture aux séances de la commission. Toutefois, ce commissaire du Gouvernement, y compris lorsqu’il sera désigné par le ministre chargé du commerce, ne pourra plus rapporter en raison des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par ailleurs, il est expressément indiqué que pour toute autorisation délivrée en raison d’un projet de programmation cinématographique présenté par le demandeur, ce projet doit répondre aux exigences de l’article 90 de la loi du 29 juillet 1982, notamment en termes de respect de la concurrence (127).
• Enfin, outre un renvoi à un décret en Conseil d’État le soin de détailler sa mise en œuvre, la réforme comporte deux ultimes aménagements, d’ordres distincts :
– le premier consiste à confier à un décret le soin de préciser la date de mise en œuvre de la réforme, qui interviendra de toute manière au plus tard le 1er janvier 2009. Une dérogation est néanmoins prévue pour les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 m2, les assouplissements législatifs les concernant ayant un effet immédiat ;
– le second concerne la dénomination des CDEC et de la commission nationale d’équipement commercial. Elles prendront respectivement les titres de commissions départementales d’aménagement commercial et de commission nationale d’aménagement commercial, de manière à mieux refléter leurs préoccupations nouvelles.
La Commission a adopté trois amendements du rapporteur pour avis, le premier rédactionnel (amendement n° 103), le deuxième de précision (amendement n° 104) et le troisième transférant au ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement le soin de nommer une des personnalités qualifiées de la commission nationale d’aménagement commercial (amendement n° 105).
Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur tendant à maintenir les actuels observatoires départementaux d’équipement commercial, tout en modifiant leur dénomination. Son auteur a souligné que ces observatoires devaient rester chargés d’élaborer, après consultation des différents acteurs et avec une vision globale au niveau départemental, les schémas de développement commercial car ces derniers s’avèrent très utiles pour orienter l’évolution territoriale des équipements commerciaux.
La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 106).
Puis, le rapporteur pour avis a retiré un amendement permettant au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés de saisir la commission départementale d’aménagement commercial d’un projet d’implantation ou de réaménagement d’une surface de vente comprise entre 500 et 1 000 m2. Son auteur a indiqué que des solutions plus élaborées, ainsi qu’un autre projet d’amendement visant à intégrer les règles d’urbanisme commercial au droit commun de l’urbanisme, étaient actuellement étudiés par la commission des Affaires économiques. Il a remarqué que, s’agissant des règles d’urbanisme, il conviendrait de tenir compte du délai de trois ans probablement nécessaire pour parvenir à la généralisation des schémas de cohérence territoriale. Il a ajouté qu’il pourrait être utile de faciliter l’ouverture de surfaces commerciales de hard discount, les expériences étrangères montrant que de telles installations conduisent à une baisse des prix pratiqués par les grandes surfaces avoisinantes.
La Commission a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur pour avis (amendement n° 107).
Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur pour avis précisant que, lorsqu’elle apprécie la qualité environnementale des projets qui lui sont soumis, la CDAC se réfère notamment aux normes de haute qualité environnementale, son auteur précisant que cela permettrait sans doute de limiter la dégradation de l’environnement urbain résultant de l’urbanisme commercial.
M. Serge Blisko a estimé que cette préoccupation environnementale était contradictoire avec la volonté de développer les implantations d’enseignes de hard discount, dont les magasins, de conception rudimentaire, dégradent le cadre de vie plus nettement encore que les autres grandes surfaces. Il a également jugé peu engageante la nature des relations économiques établies entre ces enseignes et leurs fournisseurs et s’est inquiété de l’effet d’un développement de cette forme de distribution sur la situation du petit commerce.
Le rapporteur pour avis a jugé souhaitable d’étendre les compétences communales en matière d’urbanisme et de favoriser l’émergence de nouvelles enseignes commerciales, capables d’entrer en concurrence avec les six grands groupes de distribution établis qui se partagent actuellement 70 % du marché. Il a ajouté que cette concurrence était actuellement d’autant moins forte que les principales enseignes du hard discount sont le plus souvent, en France, des filiales de ces grands groupes de distribution.
La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 108).
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis prévoyant la possibilité de consultation des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie par chaque CDAC (amendement n° 109).
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 110), la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 27 ainsi modifié.
Ainsi qu’il l’avait annoncé précédemment, le rapporteur pour avis a retiré un amendement intégrant le droit de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2012.
TITRE III
MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE
Dans une économie mondiale globalisée et affranchie de barrières douanières, attirer les capitaux, la matière grise, et les actifs dont notre économie a besoin est devenu un enjeu primordial pour consolider la compétitivité des entreprises françaises et, par voie de conséquence, améliorer les positions économiques et commerciales de la France. A travers ce titre III, le présent projet de loi propose un ensemble d’initiatives fortes et bienvenues, misant notamment sur les hautes technologies, l’attractivité du territoire national vis-à-vis des investissements productifs et le développement de l’économie de l’immatériel.
Chapitre II
Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France
La question de l’attractivité économique du territoire français est effectivement un élément essentiel de la croissance, dans la mesure où les décisions d’investissements étrangers dans notre pays en dépendent. Plusieurs instruments peuvent être activés en la matière : l’outil fiscal, en premier lieu, comme y recourt d’ailleurs ce chapitre II du titre III du projet de loi pour attirer les cadres étrangers de haut niveau à s’installer en France, mais aussi les fonds structurels européens, dont l’utilisation est désormais largement décentralisée. Encore faut-il, dans ce dernier cas, que les régions puissent assumer le rôle d’autorité de gestion de programmes opérationnels.
Article 32
(art. L. 314-14, art. L. 314-15 [nouveau]
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Assouplissement des conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers contribuant significativement à la croissance française
Une carte de séjour est obligatoire pour tout étranger résidant en France pour une durée supérieure à trois mois. Elle est à demander dans les deux mois suivant l’entrée sur le territoire national.
Il existe différentes cartes de séjour, toutes délivrées dans un but défini et conférant chacune un statut bien particulier. La carte de séjour temporaire autorise une résidence en France d’une durée maximale d’un an et peut être renouvelée. Elle peut être attribuée pour différents motifs (« vie privée et familiale », « visiteur » – ce qui exclut les causes d’emploi –, « étudiant » – permettant de travailler à 60 % –, « salarié », notamment). Il existe également des cartes de séjour temporaires réservées aux scientifiques, aux professions artistiques et culturelles, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
Depuis la loi du 24 juillet 2006, une carte de séjour spécifique, intitulée « compétence et talents », temporaire elle aussi mais d’une durée relativement plus longue que les cartes de séjour classiques (trois ans, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) peut être délivrée à un étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité (article L. 315-2 du même code). Ce dispositif reste encore insuffisamment attractif pour les étrangers porteurs d’investissements et d’opérations économiques importantes dans notre pays, de sorte qu’il est devenu nécessaire d’envisager un mécanisme se rapprochant de la carte de résident de longue durée.
La carte de résident de longue durée-CE (ce dernier acronyme désignant la Communauté européenne) autorise en effet à vivre plus longtemps en France puisqu’elle est valable dix ans et renouvelable. Aux termes des articles L. 314-8 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seuls peuvent y prétendre :
– de plein droit, les enfants étrangers de ressortissants Français, ainsi que, notamment, les étrangers titulaires d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et ceux ayant servi dans une unité combattante de l’armée française ou de la Légion étrangère ;
– à la discrétion des autorités préfectorales, les détenteurs d’une carte de séjour disposant d’une assurance maladie. Dans ce cas, il leur est impératif d’attester de cinq ans de résidence ininterrompue en France et de revenus suffisants. Toutefois, en application de l’article R. 314-1-1 du même code, les absences ne dépassant pas six mois consécutifs et n’excédant pas une durée totale de dix mois sont prises en compte dans le calcul de la durée de résidence.
Afin d’encourager des cadres étrangers de haut niveau exerçant des responsabilités décisionnelles importantes dans des sociétés étrangères ou des investisseurs individuels non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne à venir investir en France et à y exercer leur activité pour le plus grand bénéfice de l’économie nationale, le I du présent article du projet de loi insère, au sein du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une sous-section 5 constituée d’un article L. 314-15, destiné à assouplir les conditions de résidence préalable actuellement exigées de ces derniers pour que leur soit délivrée une carte de résident. Les intéressés se trouveront également dispensés des exigences d’intégration républicaine posées à l’article L. 314-2 du même code, et notamment de celle d’une connaissance suffisante du français.
Concrètement, le nouvel article L. 314-15 disposera que tout étranger qui apporte à la France une contribution économique « exceptionnelle » (terme qui donne en l’espèce un large pouvoir d’appréciation à l’autorité préfectorale) peut se voir délivrer une carte de résident à la condition que son séjour soit régulier, c’est-à-dire qu’il excipe d’un visa en cours de validité ou d’une carte de séjour temporaire en bonne et due forme. Le texte précise également que les motifs pour lesquels la carte peut être retirée ainsi que les modalités d’application de ce régime de séjour nouveau sont prévus par décret en Conseil d’État.
Cette démarche répond à un réel besoin, à un moment où les capitaux sont extrêmement mobiles et où leur fixation géographique dépend de plus en plus des possibilités offertes à leurs détenteurs de s’installer sans contrainte ni formalisme excessifs. Les flux migratoires concernés sont en outre relativement faibles (quelques dizaines au plus, au regard d’un total de 24 113 cartes de résident délivrées en 2006).
Le II du présent article du projet de loi, quant à lui, procède à une coordination de références au sein de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux modalités d’attribution d’une carte de résident permanent aux titulaires d’une carte de résident temporaire venant à expiration, afin d’y inclure un renvoi au nouvel article L. 314-15 créé par le I.
La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.
Article 33
(art. 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales)
Délégation à certaines collectivités territoriales de la fonction d’autorité de gestion et de certification de fonds structurels, pour la période 2007-2013
Cet article a pour objet de proroger, pour la période 2007-2013, le transfert – jusqu’alors autorisé pour la période 2000-2006 par l’article 44 de la loi du 13 août 2004 précédemment mentionnée –, des fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de certification de programmes relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale (instrument récemment institué pour se substituer aux groupements d’intérêt public antérieurs poursuivant une même finalité). D’un strict point de vue formel, il propose une rédaction nouvelle du paragraphe I de l’article 44 précité, assortie d’une disposition complémentaire figurant à part.
Soucieux d’optimiser les conditions d’utilisation des crédits des fonds structurels européens en en décentralisant une partie de la gestion jusqu’alors déconcentrée, le législateur avait prévu un dispositif expérimental dont le fondement juridique a expiré au début de l’année 2007. Reconnaissant disposer d’un manque de recul pour pouvoir tirer toutes les conséquences de la démarche engagée, le Gouvernement souhaite que soit reconduite l’expérimentation en cours, de manière à permettre une évaluation en bonne et due forme en 2011, soit un peu plus de deux ans avant le début de la mise en œuvre des fonds structurels portant sur la période 2014-2020.
a) Une expérimentation ciblée dans son objet, ses modalités et ses moyens
Pour le bon usage des fonds structurels, les articles 60 et 61 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006, précédemment mentionné, distinguent les autorités de gestion des autorités de certification d’un programme opérationnel éligible aux crédits des fonds structurels. Cette dissociation vise une spécialisation des tâches dans un but de contrôle approfondi, aussi bien sur la mise en œuvre des programmes communautaires que sur la gestion financière des enveloppes destinées aux États membres.
Schématiquement, l’autorité de gestion est responsable de l’efficacité, de la régularité de la gestion et de la mise en œuvre d’un programme ; elle est aussi responsable de la sélection des opérations et du dispositif d’évaluation. L’autorité de certification, quant à elle, certifie les dépenses et assure l’appel des crédits communautaires auprès de la Commission européenne ; destinataire de ces crédits, elle est ensuite chargée de leur versement à leurs bénéficiaires.
Si l’étendue des collectivités territoriales susceptibles de se voir déléguer les responsabilités d’autorité de gestion ou de certification apparaît relativement vaste, le texte se référant aux régions et à la Corse – prioritaires si elles en font la demande – mais aussi aux autres collectivités territoriales situées sur leur territoire ainsi qu’à leurs groupements et aux groupements européens de coopération territoriale, le champ de l’expérimentation et sa durée restent en revanche limités, comme dans la rédaction de 2004, afin de satisfaire aux exigences posées à l’article 37-1 de la Constitution. Il porte en effet :
– d’une part, sur l’objectif de coopération territoriale européenne, qui recouvre la coopération transfrontalière entre zones contiguës, la coopération transnationale entre autorités nationales, régionales et locales et la coopération interrégionale. Financé par le seul Fonds européen de développement régional, il devrait permettre aux collectivités territoriales françaises de bénéficier de 870 millions d’euros (en prix courants) sur la période 2007-2013 ;
– d’autre part, sur l’instrument européen de voisinage et de partenariat, institué par un règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 (128), afin de fournir une assistance aux pays partenaires de l’Union européenne, allant de la Russie jusqu’aux pays tiers méditerranéens. Les crédits affectés à cet instrument sont plus modestes, puisque de l’ordre de 10,8 millions d’euros.
Une différence notable est introduite, néanmoins, par rapport au texte de 2004, puisque l’expérimentation s’étendra également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre et de veiller à l’application des réglementations, tant nationale que communautaire, afférentes aux programmes de coopération territoriale ainsi que de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française.
La priorité accordée aux régions s’explique à la fois par le périmètre géographique des espaces de coopération territoriale au sein de l’Union européenne et par l’expérience acquise par ces collectivités dans la gestion des programmes antérieurs. Il n’est pas étonnant, d’ailleurs, que ce soit ces collectivités qui aient jusqu’à présent été retenues comme autorités de gestion de programmes relevant de la période 2007-2013 : outre l’Alsace et la Corse, on mentionnera à cet égard le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que la Guyane, la Réunion et la Guadeloupe. Bien que d’autres collectivités territoriales soient également prévues par cette nouvelle mouture de l’article 44 de la loi du 13 août 2004, ce sont essentiellement les structures de coopération décentralisée qui devraient, à titre subsidiaire, se révéler les plus à même d’assumer des délégations d’autorité de gestion ou de certification.
Le transfert reste facultatif dans tous les cas de figure puisque, d’une part, les collectivités territoriales et les groupements bénéficiaires doivent formuler une demande expresse auprès de l’État et, d’autre part, ce dernier ne sera pas tenu d’accéder à cette demande. La formalisation du transfert interviendra dans une convention mentionnant le programme concerné et les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. Il convient de souligner que, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, la charge des corrections et des sanctions financières décidées à la suite de contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes sera supportée par la collectivité ou le groupement désigné comme autorité de gestion, cette charge constituant une dépense obligatoire au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit là de permettre à l’État de se retourner, par une disposition récursoire, contre les personnes publiques à l’origine d’un manquement pour lequel la Commission européenne, qui n’entretient de relations officielles qu’avec les pays membres de l’Union, lui infligerait une sanction financière.
À noter enfin que, conformément à une disposition déjà existante en 2004, l’autorité de certification pourra elle-même être déléguée, par voie de convention écrite, par son titulaire désigné à un nombre restreint d’organismes ou de personnes morales spécialisés, à savoir : le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), une institution financière spécialisée figurant parmi celles définies à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier comme un établissement de crédit auquel l’État a confié une mission permanente d’intérêt public et qui ne peut effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission (Agence française de développement, Caisse de développement de la Corse, Caisse de garantie du logement locatif social, Euronext, par exemple), ou des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque au sens de l’article L. 518-1 du même code (à savoir le Trésor public, la Banque de France, La Poste, les Instituts d’émission d’outre-mer et d’émission des départements d’outre-mer, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations). Au cours de la période 2000-2006, les autorités déléguées de certification ont, le plus souvent, eu recours à la Caisse des dépôts et consignations pour accomplir cet aspect technique de leurs responsabilités.
b) Le cas particulier de l’Alsace : un bilan plutôt positif
Depuis 2002, la région Alsace est le creuset d’une expérimentation pilote en matière de délégation élargie de gestion des fonds structurels (en l’occurrence une enveloppe de 110 millions d’euros destinée à une zone recouvrant 40 % du territoire régional, allant de Mulhouse au nord-ouest de la région, en passant par la vallée vosgienne, et un peu moins de 30 % de la population). Un protocole d’accord fut signé en ce sens le 6 septembre 2002, avant que la convention précisant les modalités de mise en œuvre du transfert des fonctions d’autorité de gestion et de paiement, signée le 15 février 2003, ne soit officialisée par approbation de la Commission européenne le 17 mars suivant.
Pour assumer ses nouvelles responsabilités, la région alsacienne s’est dotée d’une équipe affectée à la gestion de ces crédits, composée de dix-sept personnes au plus fort de ses effectifs. Les fonctions d’autorité de paiement (ancienne dénomination de l’autorité de certification actuelle), quant à elles, furent déléguées à la Caisse des dépôts et consignations. Parallèlement, le pilotage politique de la gestion fut ouvert à une représentation la plus large possible des élus locaux et des acteurs économiques et sociaux.
Les résultats obtenus parlent d’eux-mêmes. L’instauration d’un guichet unique et la mise en place d’équipes d’animation territorialisées ont permis d’accroître substantiellement le nombre de dossiers de demande de subvention traités puisque, entre le 1er janvier 2003 et le 17 octobre 2006, ils sont passés de 1 358 à 1 749. En outre, à l’automne 2006, le montant de la dotation globale était effectivement liquidé à 90 %. Enfin les délais d’instruction, de conventionnement et de paiement, ont respectivement diminué à moins de six mois, 46 jours et deux jours ouvrés pour le FEDER et le FSE.
Ce bilan, largement positif, ne peut qu’inciter à poursuivre une telle démarche sur la période de programmation 2007-2013. À cet effet, le paragraphe II du présent article 33 autorise spécifiquement la prorogation de la convention signée le 15 février 2003. Les fonds concernés relèveront, cette fois-ci, de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi ». Là réside d’ailleurs la spécificité du cas alsacien, puisque la collectivité régionale sera la seule à bénéficier d’un champ de délégation excédant l’objectif de coopération territoriale et l’instrument de voisinage et de partenariat, auxquels les délégations concernant les autres collectivités territoriales devront quant à elles se limiter.
c) Une évaluation courant 2011
Les ultimes dispositions de la nouvelle rédaction du I de l’article 44 de la loi du 13 août 2004 visent à permettre un retour d’expérience, via les préfets de région, avant le 31 décembre 2010. Chaque collectivité ou groupement bénéficiaire d’une délégation d’autorité de gestion ou de certification devra ainsi transmettre au représentant de l’État dans la collectivité régionale un bilan des expérimentations qu’il ou elle aura effectuées. Ces différents bilans seront ensuite transmis, avec les observations du préfet de région, au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités territoriales, afin que le Gouvernement puisse élaborer un rapport dressant une synthèse générale des expérimentations conduites, remis au Parlement au cours du premier semestre 2011.
Le texte reste muet sur les conséquences de la remise de ce rapport, de sorte que, en l’absence de réaction du Parlement, les expérimentations se poursuivront jusqu’au terme de la période de programmation en cours, c’est-à-dire jusqu’en 2013. En outre, compte tenu de la lourdeur du processus de désignation des autorités de gestion ou de certification décentralisées, dont la validation par la Commission européenne est requise, leur changement en cours de programmation apparaît peu vraisemblable. Ainsi que le soulignait Mme Catherine Troendle, sur une disposition similaire du projet de loi de 2006 relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, « Le rapport du Gouvernement aura donc plutôt vocation à éclairer en amont les choix à effectuer lors de la prochaine période de programmation » (129).
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis (amendements n°s 111, 112 et 113), la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 33 ainsi modifié.
Chapitre III
Mesures relatives au développement de l’économie de l’immatériel
Aujourd’hui plus qu’hier – et demain peut-être encore davantage –, l’économie de l’immatériel prend une place incontournable dans les pays développés. La spécialisation internationale croissante des économies rend en effet impérieux que la France, pour se préparer à l’intensification prévisible de la concurrence des pays en voie de développement, prenne des mesures favorisant le dynamisme des innovations. Or, en la matière, force est de reconnaître que le code de la propriété intellectuelle (qui fut l’un des premiers codes modernes des années 1990) n’est pas toujours suffisamment adapté, notamment au regard des engagements pris au niveau international par notre pays. Il est donc indispensable de remédier à cette situation, comme s’y emploie ce chapitre III du titre III du projet de loi.
Article 34
(art. L. 611-10, art. L. 611-11, art. L. 611-16, art. L. 612-12, art. L. 613-2, art. L. 613-24, art. L. 613-25, art. L. 614-6, art. L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle)
Transposition des améliorations apportées par l’acte portant révision
de la convention sur la délivrance de brevets européens
Cet article intègre un certain nombre d’améliorations au régime juridique des brevets, afin notamment de tenir compte des modifications apportées à la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) du 5 octobre 1973 (plus communément désignée comme la convention sur le brevet européen ou la convention de Munich) par l’acte de révision adopté à l’issue d’une conférence diplomatique qui s’est tenue à Munich du 20 au 29 novembre 2000 (dit « CBE 2000 »), ratifié par la France à la fin de l’année dernière. Outre le fait que les modifications prévues par le projet de loi visent à une plus grande harmonisation entre les droits matériels national et international des brevets, elles devraient rendre plus efficace la protection des droits des titulaires de tels titres de propriété intellectuelle et plus pertinentes les conditions d’exercice de ces mêmes droits, grâce à la transposition des principales avancées de l’acte de révision.
a) La clarification du champ de la brevetabilité
L’article 52 de la convention sur le brevet européen a été modifié en 2000 afin de préciser qu’un brevet européen peut être délivré pour une invention dans tous les domaines technologiques, par alignement sur les dispositions de l’article 27 de l’annexe à l’accord de Marrakech (130), relative aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC). Ne relèvent pas de cette catégorie : les découvertes, les théories scientifiques, les créations esthétiques et les programmes d’ordinateurs (classés parmi les œuvres littéraires par l’annexe ADPIC).
Le projet de loi tire les conséquences de cette précision à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les critères de brevetabilité des inventions (à savoir la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle), ainsi que les exceptions prévues pour les inventions satisfaisant ces critères (découvertes, théories scientifiques, créations esthétiques, programmes d’ordinateurs et présentations d’informations). Le principe et la pratique actuels, selon lesquels seules les inventions techniques peuvent bénéficier d’une protection par brevet, se verront ainsi confortés par la loi, grâce à l’ajout d’une référence explicite sur la nature des nouveautés brevetables.
b) La protection des applications thérapeutiques ultérieures
Aux termes de l’article 53 c) de la convention de Munich, les substances ou compositions chimiques déjà connues sont considérées comme nouvelles si elles sont utilisées pour la première fois dans une méthode thérapeutique inappliquée jusqu’alors. Ce principe compense partiellement toute impossibilité de brevetabilité des méthodes thérapeutiques et tend à faciliter l’exercice par les médecins de leur profession.
Une controverse jurisprudentielle est apparue au sujet des applications thérapeutiques ultérieures, communément appelées « deuxièmes applications thérapeutiques ». Dans une décision de 1984, la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets a conclu en faveur de la brevetabilité de telles applications, au titre de leur nouveauté, dans la mesure où elles concernent l’utilisation d’une substance ou d’une composition chimique pour la fabrication d’un médicament destiné à un usage thérapeutique précis (131). Si les tribunaux allemands et britanniques se sont ralliés à cette interprétation, il n’en est pas allé de même des juridictions néerlandaises (132) et françaises, dont les décisions se sont montrées moins tranchées.
Afin de mettre un terme à l’insécurité juridique qui résultait de cette situation, l’article 54 de la CBE a été modifié par l’ajout d’un paragraphe 5 permettant désormais sans équivoque d’obtenir un brevet européen pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d’une substance ou composition déjà connue comme médicament. Depuis la ratification par la France de cette modification, il revient au législateur d’adapter les dispositions de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la définition de l’état de la technique, pour les retranscrire en droit interne.
Au regard des alinéas modifié (par le 1° du II) et inséré (par le 2° du II) dans cet article L. 611-11, les compositions ou substances nécessaires à la mise en œuvre d’une méthode chirurgicale ou thérapeutique sur le corps humain ou animal ou susceptibles d’une utilisation chirurgicale ou thérapeutique spécifique pourront être brevetées même si elles étaient déjà connues en l’état de la technique ; seule leur utilisation devra comporter un caractère novateur au regard de l’état de la technique.
c) L’assouplissement des conditions de protection des inventions
Les nouveaux articles 105 bis à 105 quater de la convention sur le brevet européen permettent désormais au titulaire d’un brevet de limiter ou de révoquer l’application de ses droits de propriété industrielle, avec effet rétroactif et de manière centralisée. Or, en France, aux termes de l’actuel article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’un brevet ne peut exercer un tel droit de renonciation que dans des conditions beaucoup plus contraignantes, pour ne pas dire maximalistes.
En effet, la possibilité lui est seulement offerte de renoncer, par écrit auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, à l’intégralité de son brevet ou à plusieurs – c’est-à-dire plus d’une – revendications de son titre de propriété industrielle. En outre, il ne lui est pas reconnu de faculté de limiter uniquement, de sa propre initiative, son titre en modifiant le libellé de ses revendications.
La nouvelle rédaction de cet article L. 613-24, prévue au VI de cet article du projet de loi, met en cohérence la législation française avec les nouvelles prescriptions de la CBE. Les modalités de la requête en renonciation ou en limitation d’une ou plusieurs revendications du brevet seront désormais présentées auprès de l’INPI selon des modalités prévues par la voie réglementaire, l’exigence d’un écrit devant vraisemblablement être maintenue. La recevabilité de la demande sera examinée par le directeur de l’INPI. Alors que la renonciation ne prenait effet jusqu’à présent qu’au jour de sa publication, elle devrait désormais, tout comme la limitation des revendications, entrer en vigueur à la date de dépôt de la demande du brevet, c’est-à-dire avec un effet rétroactif.
Les nouvelles possibilités offertes par l’article L. 613-24 devraient améliorer sensiblement les garanties juridiques au profit des utilisateurs du système des brevets français. Par ailleurs, la procédure de limitation, placée sous le contrôle de l’INPI, répondra à des besoins jusqu’alors insatisfaits de titulaires de droits souhaitant permettre une utilisation plus aisée de leurs inventions et elle évitera également que naissent certains litiges sur la validité même des brevets.
d) Une nouvelle cause de nullité du brevet en cas de procédure de limitation conduisant à une extension de la portée du titre
Les aménagements prévus à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle visent à introduire une nouvelle cause de déclaration de nullité du brevet, prononcée par le juge, à savoir : l’éventualité d’une extension de la portée de la protection conférée par le titre alors même que les revendications de celui-ci auraient été limitées par son titulaire. Cette précision tend à limiter autant que possible l’insécurité juridique dans laquelle les tiers pourraient en effet se trouver, du fait de l’assouplissement des conditions de limitation des revendications, à l’article L. 613-24. Cet ajout emporte également des conséquences directes sur les contentieux puisque la Cour de cassation a estimé que les causes de nullité d’un brevet pouvant être opposées à une demande de condamnation pour contrefaçon sont limitativement énumérées par la loi (133).
Il est en outre précisé, sur le plan procédural, que le titulaire du brevet pourra, au cours de l’action en nullité, modifier ses revendications, le juge se prononçant alors sur la base du brevet limité. Néanmoins, des garde-fous sont posés puisque toute partie procédant de manière dilatoire ou abusive à plusieurs limitations de son brevet au cours d’une procédure sera passible d’une amende civile de 3 000 euros, ce montant ne préjugeant aucunement les dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés par ailleurs.
Par cohérence, des aménagements procéduraux similaires sont apportés à la procédure relative à l’action en nullité du brevet européen, engagée sur le fondement de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, pour l’un des motifs de l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich.
e) L’harmonisation du droit matériel des brevets avec les dispositions de la CBE
Les modifications prévues aux articles L. 611-16, L. 612-2, L. 613-2 et L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle poursuivent un objectif d’harmonisation des formules rédactionnelles de ces dispositions avec celles de la convention sur le brevet européen. Cette démarche apparaît en effet nécessaire pour permettre une application uniforme des dispositions en cause à l’échelle européenne.
Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur pour avis (amendement n° 114), la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 34 ainsi modifié.
Article 35
Habilitation du Gouvernement à simplifier et à adapter, par ordonnances, le code de la propriété intellectuelle aux engagements de la France
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre deux ordonnances, en application de l’article 38 de la Constitution, afin de modifier certaines dispositions législatives du code de la propriété intellectuelle dans un délai de six mois après la publication de l’article d’habilitation. Les projets de loi de ratification, quant à eux, devront être déposés sur le Bureau de l’une des deux assemblées parlementaires dans les trois mois suivants la publication de chacune de ces deux ordonnances.
a) Un objectif d’adaptation du code de la propriété intellectuelle à plusieurs textes de droit international importants
La première de ces ordonnances vise à intégrer dans le code de la propriété intellectuelle les dispositions législatives rendues nécessaires par deux traités internationaux et un protocole additionnel à des conventions internationales, que la France a signés sans les avoir encore nécessairement, à ce jour, ratifiés. Il s’agit, en l’occurrence :
– du traité d’harmonisation sur le droit des brevets (patent law treaty ou PLT), adopté à Genève le 1er juin 2000, entré en vigueur le 28 avril 2005 ;
– du traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 et actuellement ratifié par Singapour (le 26 mars 2007) ainsi que la Suisse (le 6 juillet 2007) et auquel la Bulgarie a adhéré (le 21 janvier 2008) ;
– du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (plus communément dénommé « protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et au sujet duquel le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi autorisant sa ratification (134).
Le PLT de 2000 comporte un certain nombre de règles destinées à rationaliser et à harmoniser les exigences de forme imposées par les offices de brevets nationaux ou régionaux, s’agissant du dépôt et du traitement des demandes de brevets. Pour améliorer la délivrance des brevets, il prévoit notamment une simplification de l’attribution de la date de dépôt (élément essentiel, car servant à calculer la durée minimale de protection de tout brevet) : celle-ci n’est ainsi plus conditionnée que par la remise de la description de l’invention, celle des revendications de l’inventeur sur la portée du monopole qu’il demande pouvant intervenir ultérieurement. Le traité tend aussi à faciliter et à inciter au dépôt de titres, en limitant les cas de recours à un mandataire et en allégeant le formalisme de certaines procédures. Enfin, pour garantir la protection des droits, il empêche que l’inobservation de certaines conditions de forme débouche sur une perte de droits matériels. Il s’agit donc d’un instrument juridique avantageux à plus d’un titre, tant pour les inventeurs et déposants que pour les conseils et les offices nationaux et régionaux de brevets.
Le traité de Singapour de 2006, quant à lui, traite de droits de propriété industrielle différents, à savoir les marques. A la différence du traité sur le droit des marques de 1994, ce texte présente un champ d’application assez large puisqu’il concerne aussi les marques hologrammes et les signes non visibles. Dans un souci de simplification évident, il offre la possibilité pour les États parties de permettre aux titulaires de droits de réaliser leur dépôt par voie électronique. Il prévoit, en outre, que le défaut d’inscription sur le registre national des marques est sans effet sur le droit, pour le preneur de licence, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir des dommages-intérêts ; de la sorte, chaque titulaire de marque se trouve mieux protégé dans l’éventualité d’un préjudice résultant d’une contrefaçon.
Enfin, le protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif, vise à l’adoption d’un nouvel emblème par la Croix rouge internationale, dénué de toute connotation religieuse (un losange rouge évidé, dénommé « cristal rouge »). Entré en vigueur en janvier 2007, il a été ratifié par au moins dix-huit États signataires, dont les États-Unis, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Slovaquie et la Suisse. Alors que les États parties aux conventions doivent assurer une protection des emblèmes de l’organisation internationale, le protocole III comporte un article réservant les droits antérieurs acquis par les tiers. L’ordonnance sollicitée par le Gouvernement a vocation à mettre en œuvre cette réserve au niveau national.
L’habilitation demandée par le Gouvernement à prendre une ordonnance visant à mettre en conformité le code de la propriété intellectuelle avec des engagements internationaux non ratifiés et parfois même non entrés en vigueur (cas du traité de Singapour) peut paraître prématurée. Compte tenu des délais prévus au III du présent article du projet de loi, le Parlement devra rapidement autoriser la ratification de tous ces instruments de droit international, faute de quoi l’ordonnance prévue n’aura plus véritablement de raison d’être. Pour autant, il convient de rester confiants dans la détermination du pouvoir exécutif à tenir les délais envisagés, car le projet de loi autorisant la ratification du protocole III est déjà déposé au Sénat et les projets de loi autorisant la ratification des deux autres traités ont été transmis au Conseil d’État, laissant ainsi augurer leur prochain examen par le Parlement. La représentation nationale ne peut donc que se trouver satisfaite, tant sur la forme que sur le fond, notamment en raison de l’intérêt pour les titulaires de droits qu’il y a à harmoniser le plus rapidement possible le droit interne avec ces engagements internationaux.
A noter que si le champ de l’ordonnance concerne au premier chef le code de la propriété intellectuelle, il englobe également la législation qui lui est liée, les répercussions des modifications introduites au sein du premier devant être prises en compte dans la seconde.
b) La simplification des conditions de délivrance et d’enregistrement des titres
La deuxième ordonnance dont le Gouvernement demande l’habilitation du Parlement, poursuit un objectif de simplification et d’amélioration des procédures de délivrance ou d’enregistrement des titres de propriété industrielle. Se trouvent également explicitement visés les droits qui en découlent.
Tous les droits de propriété industrielle, quels qu’ils soient, ont une caractéristique commune : leur protection est subordonnée à un système de dépôt administratif. Alors que la propriété littéraire et artistique naît du seul fait de la création, la propriété industrielle implique généralement une démarche volontaire du titulaire, se traduisant par l’accomplissement de certaines formalités administratives, parfois coûteuses, nécessaires pour bénéficier de la protection légale. Pour le seul cas des brevets, les quelque 150 000 demandes déposées annuellement par des Français font l’objet d’une instruction et d’une délivrance de titres par deux institutions : l’INPI, s’agissant des brevets relevant uniquement du droit national, et l’office européen des brevets, situé à Munich, pour les brevets européens obtenus par des ressortissants français.
L’objet de la seconde ordonnance prévue à cet article du projet de loi vise non pas à revoir les conditions de fond qui président à l’octroi de titres de propriété industrielle mais à améliorer les exigences de forme ainsi que les modalités d’enregistrement et de délivrance. On peut supposer, ce faisant, que le recours aux nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC) sera pris en compte, avec notamment la possibilité d’un dépôt par voie électronique, par exemple. De manière plus générale, le Parlement ne peut que souscrire à cette volonté de faciliter le dépôt de titres en simplifiant les démarches des inventeurs.
La simplification des conditions d’exercice des droits de propriété industrielle constitue elle aussi un objectif louable, dès lors qu’elle renforcera l’attractivité des dépôts de titres de propriété intellectuelle. De trop nombreux petits entrepreneurs ou particuliers hésitent actuellement à défendre leurs droits légitimes en raison de la complexité et de la lourdeur des procédures. En toilettant les règles du code de la propriété intellectuelle en la matière, l’ordonnance ainsi sollicitée ne pourra que faire œuvre utile.
La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur pour avis (amendement n° 115), puis elle a ainsi émis un avis favorable à l’adoption de l’article 35 ainsi modifié.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Amendements nos 67 à 70 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées » les mots : « ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensés ».
• Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées » les mots : « ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensés ».
• Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « celles », les mots : « les modalités de déclaration d’activité ».
• Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot : « celles », les mots : « les modalités de déclaration d’activité ».
Article 5
Amendement n° 71 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division." »
Amendement n° 72 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit." »
Après l’article 5
Amendement n° 73 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 145-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« "III. — les copropriétaires non exploitants d’un fonds de commerce ou artisanal, mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers bénéficient des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour les héritiers ou ayants droits d’un chef d’entreprise décédé, qui choisissent de demander le maintien de son immatriculation pour les besoins de la succession." »
Article 6
Amendements nos 74 à 76 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 de cet article, les trois phrases suivantes :
« Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. »
• Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :
« c) Que sa durée soit limitée et n’excède pas, à l’exception d’un report autorisé par décret, le 1er janvier 2012 ».
• Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots : « après le », les mots : « à compter du ».
Article 7
Amendement n°77 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « moyen » le mot : « total ».
Article 13
Amendements nos 78 à 85 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « sociétés », le mot : « société ».
• Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « reçoivent application », les mots : « s’appliquent ».
• I. – Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « Les sociétés », les mots : « La société ».
II. – En conséquence, dans la même phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « sont soumises », les mots : « est soumise ».
• Dans l’alinéa 6 de cet article, après les mots : « responsabilité limitée », insérer les mots : « et les sociétés par actions simplifiées ».
• Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer à la référence : « II », les références : « a) et b) du 2° ».
• Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « au 1° qui ne pourra être postérieure au », les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et au plus tard le ».
• Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :
« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
• Dans l’alinéa 11 de cet article, après le mot : « unique », insérer les mots : « , personne physique, ».
Après l’article 13
Amendement n° 86 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Insérer l’article suivant :
« I. — Le code de commerce est ainsi modifié :
« A. — L’article L. 225-25 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Art. L. 225-25. — Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent." » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "six".
« B. — L’article L. 225-72 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Art. L. 225-72. — Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent." » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "six".
« C. — Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-124, après le mot : "successible", sont insérés les mots : ", ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d’une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double,".
« D. — Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15, les mots : "de ces actions", sont remplacés par les mots : "d’actions de préférence d’une autre catégorie".
« II. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »
Article 14
Amendements nos 87 à 91 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• I. — Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
II. — En conséquence, après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
• Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, il est inséré la phrase suivante : "Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu au présent alinéa le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce." »
• Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer à la référence : « L. 227-29 », la référence : « L. 227-9 ».
• Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots : « ces conditions », les mots : « les conditions prévues aux deux alinéas précédents ».
• Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande." »
Après l’article 14
Amendement n° 92 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Le greffier transmet par voie électronique à l’Institut national de la propriété industrielle les inscriptions effectuées au greffe et les actes et pièces qui y sont déposés, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire." »
Article 19
Amendements nos 93 à 96 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer au mot : « huit », le mot : « six ».
• Compléter l’alinéa 4 de cet article par les mots : « des entreprises ».
• Dans l’alinéa 13 de cet article, après le mot : « Améliorer », insérer les mots : « et clarifier ».
• Dans l’alinéa 15 de cet article, après la référence : « VIII », insérer les mots : « du même code ».
Après l’article 19
Amendement n° 97 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Insérer l’article suivant :
« I. — L’article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d’une procédure de liquidation judiciaire dont les opérations ont été clôturées antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.
« II. — Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 653-11 du même code sont applicables à l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d’une procédure clôturée avant la date de cette entrée en vigueur. »
Amendement n° 98 présenté par M. Bertrand Pancher :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 515-27 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 515-27. — Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société détenant des actions d’une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier." ;
« 2° L’article L. 515-28 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 515-28. — En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce." »
Article 22
Amendements nos 99 et 100 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Après les mots : « supérieur à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de cet article : « 10 millions d’euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. »
• Compléter l’alinéa 14 de cet article, par les mots : « équivalente à une fraction de l’amende, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe. L’astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif. »
Article 23
Amendement n° 101 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « étendue d’agir en justice », les mots : « de se pourvoir en cassation ».
Après l’article 26
Amendement n° 102 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Insérer l’article suivant :
« Le titre Ier de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un article 8 ainsi rédigé :
« "Art. 8. — Il est institué une taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, assise sur 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 mètres carrés, ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
« Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l’article 3 le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
« Les redevables de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d’exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu’assujettis à la déclaration.
« Le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.
« Le montant de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est exigible le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 2009." »
Article 27
Amendements nos 103 à 110 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « aux articles », les mots : « à l’article ».
• À la fin de l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « de ce code », les mots : « du code de l’industrie cinématographique ».
• Compléter l’alinéa 30 de cet article par les mots : « et les mots : "de l’emploi", sont remplacés par les mots : "de l’urbanisme et de l’environnement". »
• Rédiger ainsi l’alinéa 33 de cet article :
« VI. – Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII et l’article L. 751-9, le mot : "équipement", est remplacé par le mot : "aménagement" ».
• Rédiger ainsi le début de l’alinéa 52 de cet article :
« Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale … (le reste sans changement) ». »
• Compléter l’alinéa 56 de cet article, par les mots : « , notamment au regard des normes de haute qualité environnementale »
• Après l’alinéa 56 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial peut recueillir l’avis des chambres consulaires. »
• Dans l’alinéa 58 de cet article, substituer aux mots : « dans le cadre des principes définis à », les mots : « sur l’autorisation prévue par ».
Article 33
Amendements nos 111 à 113 présentés par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
• Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « leur application », les mots : « l’application de ces mêmes règlementations ».
• Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « L’autorité publique expérimentatrice », les mots : « La personne publique chargée de l’expérimentation ».
• Dans la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, après les mots : « de l’objectif », insérer le mot : « communautaire ».
Article 34
Amendement n° 114 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « d’une méthode visée », les mots : « des méthodes visées ».
Article 35
Amendement n° 115 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis :
Rédiger ainsi cet article :
« I. — Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
« 1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
« a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
« b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
« c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
« 2° Les mesures d’adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
« II. — Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s’avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.
« III. — Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance. »
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 6
Amendement présenté par M. Claude Bodin :
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les trois alinéas suivants:
« I bis. — Dans le b du 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, après les mots : "ou de vente", sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«" — en refusant ou en retardant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, la réception, l’expédition ou le retrait des marchandises, de l’ouvrage ou des prestations dans le temps ou le lieu convenu ;
«" — en faisant obstacle ou en différant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, l’émission ou la délivrance de la facture par le vendeur ou prestataire de services ou en différant le point de départ du délai de règlement ; "».
Article 14
Amendement présenté par M. Marcel Bonnot :
Supprimer les alinéas 7 à 13 de cet article.
Après l’article 23
Amendement présenté par M. Claude Bodin :
Insérer l’article suivant :
« Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-9 ainsi rédigé :
« "Art. L. 464-9. — Les juridictions devant statuer sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée à l’article 81 ou 82 du Traité CE ou encore à l’un des articles du titre II du présent code, sur laquelle l’Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l’existence d’une infraction à ces articles ne peuvent prendre de décision qui irait à l’encontre de cette décision." »
Article 27
Amendement présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur [retiré] :
Substituer à l’alinéa 40 de cet article les quatre alinéas suivants :
« 4° Le II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« "II. — Sont également soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsque le maire de la commune concernée ou le président de l’établissement de coopération intercommunale dont elle est membre en formulent la demande auprès de la commission mentionnée à l’article L. 751-1, les projets ayant pour objet :
« "1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
« "2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 500 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2." »
Après l’article 27
Amendement présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur [retiré] :
Insérer l’article suivant :
« I. — Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« A. — L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
« 1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "Les schémas de cohérence territoriale comportent des dispositions spécifiques relatives à l’implantation des activités commerciales." ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "les schémas de développement territorial" sont supprimés.
« B. — Après l’article L. 122-8-1, sont insérés trois articles L. 122-8-2, L. 122-8-3 et L. 122-8-4 ainsi rédigés :
« "Art. L. 122-8-2. — Le schéma de développement et d’aménagement commercial, intégré au schéma de cohérence territoriale, est élaboré par une commission de développement et d’aménagement commercial présidée par le préfet et composée :
« "1° Dans les départements autres que Paris :
« "a) Du maire de la commune d’implantation ;
« "b) Du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« "c) Du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« "d) Du président du conseil général ou de son représentant ;
« "e) Du président du conseil régional ou de son représentant ou, dans la collectivité territoriale Corse, du président exécutif ou de son représentant ;
« "f) De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« "Lorsque l’un des membres de la commission détient plusieurs des mandats mentionnés aux a à e, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise afin de représenter de manière équilibrée les intérêts des communes concernées.
« "2° À Paris :
« "a) Du maire de Paris ou de son représentant ;
« "b) Du maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ou de son représentant ;
« "c) D’un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« "d) De deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« "e) De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« "Art. L. 122-8-3. — Au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 et des orientations générales définies par l’organisme élaborateur du schéma de cohérence territoriale, la commission de développement et d’aménagement commercial est compétente pour déterminer :
« "1° À partir de quelle surface de vente les règles qu’elle élabore s’appliquent, cette surface ne pouvant être inférieure à 500 mètres carrés ;
« "2° Les zones dans lesquelles les commerces excédant la surface mentionnée au 1° peuvent être implantés ;
« "3° Les règles précises et objectives d’implantation de ces commerces, ces règles devant faire l’objet d’un nouvel examen tous les trois ans.
« "Art. L. 122-8-4. – Les règles élaborées par la commission de développement et d’aménagement commercial sont intégrées au schéma de cohérence territoriale. Elles sont directement applicables à la délivrance des autorisations d’urbanisme prévues au livre IV du présent code.
« "II. — Le titre V du livre VII du code de commerce est abrogé.
« "III. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. " »
PERSONNES ENTENDUES PAR
LE RAPPORTEUR POUR AVIS
• Cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
— M. Philippe GRAVIER, conseiller technique en charge de l’innovation, du capital risque et de la propriété intellectuelle
— M. Renaud RICHÉ, conseiller technique en charge des PME, de l’artisanat et du commerce
• Conseil de la concurrence
— M. Bruno LASSERRE, président
— M. Fabien ZIVY, chef de cabinet
• Groupe de travail sur la négociabilité des conditions générales de vente
— Mme Marie-Dominique HAGELSTEEN, conseillère d’État, présidente de la section des travaux publics du Conseil d’État, ancienne présidente du Conseil de la concurrence et présidente du groupe de travail sur la négociabilité des conditions générales de vente
• Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
— M. Bruno PARENT, directeur général
— Mme Virginie BEAUMEUNIER, sous-directrice politique de la concurrence
— M. Joël TOZZI, chef du bureau B pratiques restrictives de concurrence et affaires juridiques
• Association des régions de France
— M. François PATRIAT, ancien ministre, président de la région Centre, président de la commission économique de l’ARF
• Institut national de la propriété intellectuelle
— M. Laurent MULATIER, chef du service des affaires juridiques et contentieuses
• Conseil supérieur du notariat
— M. Jean-Claude PAPON, membre du bureau chargé des affaires juridiques
— M. Frédéric ROUSSEL, notaire à Lille
— M. Alain DELFOSSE, directeur des affaires juridiques
— M. Didier COIFFARD, notaire à Oyonnax
— Mme Ingrid MARÉCHAL, attachée parlementaire
• Compagnie nationale des commissaires aux comptes
— M. Vincent BAILLOT, président
— M. Antoine MERCIER, vice-président
— M. François HUREL, délégué général
• Mouvement des entreprises de France
— M. Bernard FIELD, président de la commission juridique
— Mme Agnès LEPINAY, directrice des affaires économiques, financières, de la recherche et des nouvelles technologies
— Mme Isabelle TREMEAU, juriste
— Mme Karine GROSSETÊTE, chargée des relations avec le Parlement
• Association française des entreprises privées
— M. Jean-Charles SIMON, directeur
— Mme Odile de BROSSES, directrice des affaires juridiques
• Association des chambres françaises de commerce et d’industrie
— M. Jean-François BERNARDIN, président
— M. Jean-Christophe de BOUTEILLER, directeur général
• Assemblée permanente des Chambres de métiers
— M. François MOUTOT, directeur général
— Mme Béatrice SAILLARD, chargée des relations institutionnelles
• Comité Richelieu
— M. Emmanuel LEPRINCE, délégué général
• Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
— M. Jérôme BÉDIER, président
— Mme Nathalie VATINE, responsable juridique
• Institut de liaisons et d’études des industries de consommation
— M. Olivier DESFORGES, président
— M. Dominique de GRAMONT, délégué général
• Conseil national des centres commerciaux
— M. Éric RANJARD, président
— M. Jean-Michel SILBERSTEIN, délégué général
• Association nationale des industries alimentaires
— Mme Elsa CHANTEREAU, chargée des relations institutionnelles
— Mme Rachel BLUMEL, chef de projet affaires économiques, commerciales et juridiques
• Association syndicale professionnelle d’administrateurs judiciaires
— M. Christophe THÉVENOT, président
— M. Xavier HUERTAS, administrateur judiciaire à Nice
• Union professionnelle artisanale
— M. Pierre MARTIN, président
— M. Pierre BURBAND, secrétaire général
• Union du grand commerce de centre ville
— M. Jacques PERRILLIAT, président exécutif
— M. Jean-Luc BARTHARES, secrétaire général
• Conseil du commerce de France
— M. Bertrand PAILLAT, délégué général