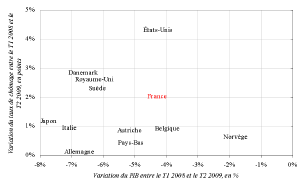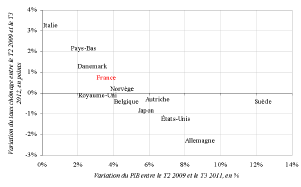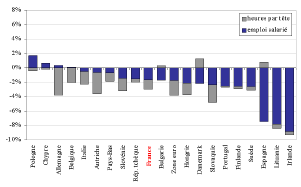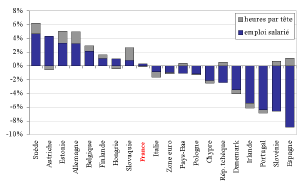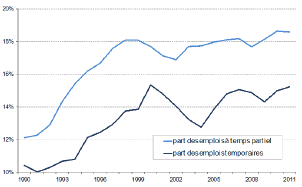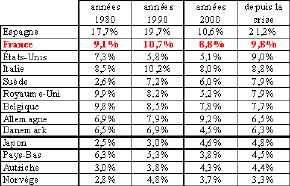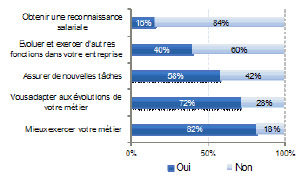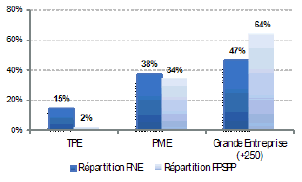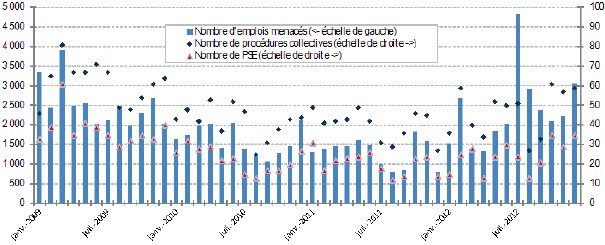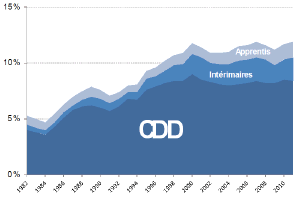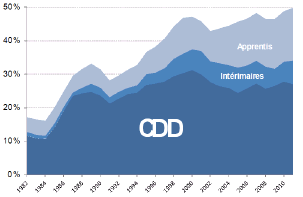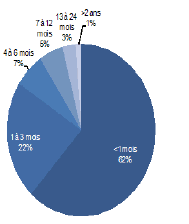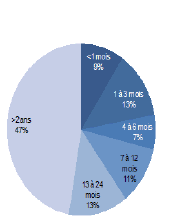|
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi |
Etude d’impact |
5 mars 2013 |
Préambule
Ce projet de loi s’inscrit dans la dynamique lancée par le Président de la République lors de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 pour trouver les leviers permettant de faire face au défi le plus exigeant, celui du chômage et de la précarité.
Conformément à la feuille de route sociale qui précisait que « face à la forte dégradation de la situation de l’emploi, dont les principales victimes sont les salariés précaires et ceux qui sont touchés par des licenciements économiques, le Gouvernement invite les partenaires sociaux à négocier au niveau national interprofessionnel les conditions d’une meilleure sécurisation de l’emploi » et en application de l’article L.1 du code du travail, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel ont été saisis le 7 septembre 2012 d’un document d’orientation.
Ce document les invitait à négocier pour trouver les outils permettant au marché du travail d’offrir une meilleure sécurisation des parcours professionnels, de façon à concilier la nécessaire adaptation des entreprises aux évolutions de l’activité et la légitime aspiration des salariés à plus de protection. Il s’agissait plus particulièrement de chercher à lutter contre la précarité en dégageant les leviers pour réduire le recours aux formes atypiques de contrats de travail et proposer les voies d’une protection des actifs en mobilité ; améliorer l’anticipation les évolutions de l’activité, de l’emploi et des compétences ; rénover les dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas conjoncturels, pour éviter les licenciements et les pertes de compétences ; et adapter les procédures de licenciements collectifs pour concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés.
Cette négociation, à laquelle ont participé de bout en bout l’ensemble des partenaires sociaux, s’est conclue par un accord le 11 janvier 2013, abordant l’ensemble des points du document d’orientation et signé par six des huit organisations professionnelles.
Conformément aux engagements du Président de la République et du Premier ministre, le projet de loi présenté par le Gouvernement entend retranscrire fidèlement et loyalement cet accord national interprofessionnel en apportant les clarifications parfois nécessaires. Cette loi permettra de faciliter le maintien de l’emploi et les créations d’emplois, de faire reculer la précarité et d’ouvrir des droits nouveaux aux salariés.
Table des matières
Partie I - Les faiblesses structurelles du marché du travail 8
Section 1 - Un marché du travail qui détruit des emplois 9
2. Le chômage atteint désormais des niveaux historiquement élevés 11
3. Les outils d’adaptation de l’activité ne jouent pas pleinement leur rôle 13
4. Les licenciements collectifs sont des procédures peu orientées vers l’obtention d’un accord 28
5. Une procédure prud’homale qui gagnerait à favoriser la conciliation 36
Section 2 - Un marché du travail qui génère une précarité croissante des parcours professionnels 43
1. Le développement croissant du recours aux formes atypiques de contrat 43
2. Des emplois à temps partiel trop souvent précaires et subis 48
Section 3 - Un marché du travail qui n’offre pas une protection suffisante à ces parcours heurtés 52
1. Un accès à la couverture santé complémentaire collective qui peine à se généraliser 52
3. Des droits à la formation professionnelle peu transférables 57
Partie II - Créer des droits nouveaux pour les salariés 63
Section 1 - De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours 64
2. Créer un compte personnel de formation 71
3. Créer un conseil en évolution professionnelle 75
4. Permettre une période de mobilité externe volontaire et sécurisée 77
Section 2 - De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés 80
1. Améliorer l’information et la consultation des Institutions Représentatives du Personnel 80
2. Associer les salariés à la stratégie des grandes entreprises 83
Partie III - Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi 87
1. Instaurer des « droits rechargeables » à l’assurance chômage 88
3. Une modulation des cotisations sur les contrats précaires pour inciter à recourir au CDI 95
4. Des protections plus fortes et une meilleure rémunération pour les salariés à temps partiel 101
Partie IV - Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques 109
Section 1 - Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences 110
1. Mieux anticiper pour sécuriser les parcours professionnels 110
2. Des conditions négociées de mobilité interne des salariés 116
1. Maintenir l’emploi en améliorant le dispositif d’activité partielle 120
2. Permettre de préserver l’activité par des accords majoritaires de maintien de l’emploi 126
1. Un meilleur encadrement des licenciements collectifs 128
2. Obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site 136
3. Allonger la durée du congé de reclassement 137
Partie V - Dispositions diverses issues de l’accord du 11 janvier 2013 141
1. Développer la conciliation aux prudhommes 142
3. Expérimenter l’applicabilité directe du recours au contrat de travail intermittent (CDI-I) 145
Partie VI - Modalités d’application de la réforme 148
Section 1 - Consultations préalables obligatoires 149
Section 2 - Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer 151
Section 3 - Conditions et modalités de mise en œuvre 156
Section 4 - Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 160
PARTIE I - LES FAIBLESSES STRUCTURELLES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
1. S’ils ont pu partiellement jouer leur rôle pendant la crise, les dispositifs visant à limiter l’ampleur des destructions d’emplois ont atteint leurs limites
Pendant la crise, l’activité économique a relativement mieux résisté en France que dans la moyenne des pays de l’OCDE, notamment durant les trimestres de récession, entre le 1er trimestre de 2008 et le 2ème trimestre de 2009 : le PIB a baissé de -4,3 %, comme aux Etats-Unis sur la même période, contre -5,6 % pour l’Union européenne dans son ensemble ou encore -7,7 % au Japon. L’augmentation du taux de chômage français s’est retrouvée néanmoins dans une position médiane en comparaison des principaux pays développés (cf. figure 1) : ainsi, avec des récessions d’une ampleur comparable ou supérieure à celle éprouvée par la France, un certain nombre de pays d’Europe continentale comme l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Autriche ont enregistré une hausse du taux de chômage deux fois moindre (et nulle dans le cas de l’Allemagne).
À l’inverse, depuis la fin de la récession au printemps 2009, les évolutions du taux de chômage sont étroitement liées au rebond de l’activité, en France comme dans le reste des pays développés (cf. figure 2). Ce rebond de l’activité (+3,6 %) a été insuffisant pour empêcher la poursuite de l’ajustement du marché du travail et amorcer une baisse durable du taux de chômage ; avec l’atonie de l’activité depuis le 2ème trimestre de 2011, le taux de chômage est même reparti à la hausse.
Les entreprises ont mobilisé de façon intensive pendant la crise l’ensemble des outils de d’adaptation « interne » à leur disposition : recours au chômage partiel, diminution des heures supplémentaires, réduction du temps de travail. Ainsi, le nombre d’emplois salariés détruits (-1,7 %) a été sensiblement inférieur à la baisse du volume horaire de travail (-3,0 %) durant les trimestres de récession (cf. figure 3). Toutefois, l’exemple de certains pays comme l’Allemagne montre que le recul de l’activité aurait pu être amorti de façon plus importante encore par l’ajustement des heures travaillées, et atténuer ainsi d’autant plus les destructions d’emplois1.
Par ailleurs, les dispositifs existants ont atteint leurs limites en sortie de crise. S’ils ont permis d’amortir les destructions d’emplois durant les trimestres de récessions, entre le 1er trimestre de 2008 et le 2ème trimestre de 2009, ils ne sont pas adaptés à un environnement économique durablement atone comme celui observé depuis lors. Les heures travaillées par tête n’ont plus contribué à la variation du volume horaire de travail depuis la fin de la récession (cf. figure 4), alors que les entreprises continuent de faire face à une demande déprimée.
Les dispositifs actuels de maintien de l’emploi se sont ainsi révélés insuffisants et en inadéquation avec les besoins des entreprises et des salariés. Ils sont par ailleurs ciblés sur les salariés en contrat à durée indéterminée, et n’offrent qu’une protection limitée pour les emplois précaires. Ainsi, plus de la moitié des emplois détruits entre 2008 et 2009 étaient des emplois temporaires, alors qu’ils ne représentaient que 14,9 % de l’emploi salarié. Outre la précarité intrinsèque supportée par ce type d’emploi, de par leur caractère temporaire, les salariés concernés sont les plus exposés lorsque l’activité se contracte.
En sortie de crise, les entreprises réembauchent prioritairement en contrats précaires, en raison des incertitudes pesant sur leurs perspectives. De tels comportements ont effectivement été observés depuis la fin de la récession : la part des emplois temporaires dans l’emploi salarié (15,2 %) a ainsi dépassé son niveau d’avant-crise en 2011 (cf. figure 5). Si ce comportement devait se pérenniser, il pourrait conduire à une précarisation accrue du marché du travail.
Au-delà de la nature des contrats de travail, une autre forme de précarité s’étend depuis la sortie de crise : le recours au temps partiel est en effet reparti à la hausse après s’être stabilisé pendant toutes les années 2000 (cf. figure 5). Le temps partiel peut permettre aux entreprises, en période de récession, de réduire la durée travaillée de leurs salariés afin de préserver l’emploi. Il doit cependant rester un choix pour les salariés, et leur assurer un revenu du travail décent. La sécurisation de l’emploi doit répondre à l’ensemble des situations de précarité sur le marché du travail, et prévenir leur extension.
Enfin, les évolutions de l’emploi et du chômage depuis le début de la crise ne doivent pas masquer les faiblesses structurelles du marché du travail français. Le taux de chômage est en effet demeuré parmi les plus élevés des principaux pays développés depuis plus de 30 ans (cf. figure 6). Le retour de la croissance ne résoudra pas à lui seul les problèmes structurels du marché du travail en France ; la sécurisation des parcours professionnels constitue un levier puissant pour s’y attaquer.
Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) est en hausse continue depuis 20 mois, quasi continue depuis mi-2008, et s’approche du niveau record de janvier 1997. En outre, il n’y a jamais eu autant de demandeurs d’emploi tenus à une recherche active d’emploi (catégories ABC) inscrits à Pôle emploi (cf. figure 7) : la part des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie B ou C a en effet doublé depuis le milieu des années 19902.
Figure 7: Effectif des demandeurs d'emploi en catégorie A et ABC
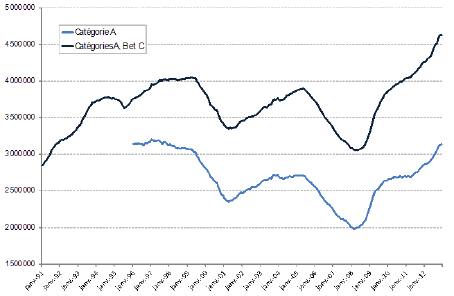
Source : Dares - Pôle emploi, France métropolitaine
Les catégories B et C de demandeurs d’emploi, qui exercent une activité réduite tout en restant inscrits à Pôle emploi, sont caractérisées par des allers et retours fréquents entre l’emploi et le chômage, en raison de la précarité des emplois qu’ils occupent, le plus souvent temporaires ou à temps partiel. Ces allers et retours ne sont pas toujours bien pris en compte dans les règles d’indemnisation de l’assurance-chômage : pour une même période de travail, deux salariés peuvent bénéficier de droits différents selon que cette période a été continue ou discontinue.
Les flux d’entrée et de sortie diminuent depuis 2009, et atteignent en décembre un niveau proche des points bas historiques à la fin des années 1990 (cf. figure 8). Cela signifie notamment que les délais de sortie des listes s’allongent, avec un risque d’éloignement durable du marché du travail : la durée moyenne d’inscription sur les listes s’est en effet établie fin 2012 à près de 16 mois, et la part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an est proche de 40 %, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2000.
Figure 8: Taux d’entrée et de sortie sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C
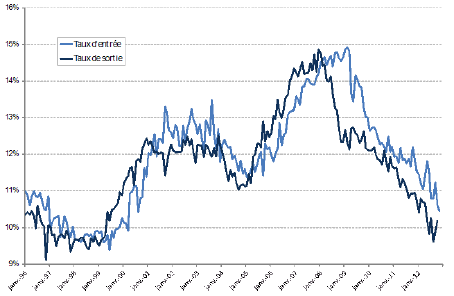
Source : Dares - Pôle emploi, France métropolitaine
Lecture : Le taux d’entrée (respectivement de sortie) correspond au nombre d’entrées (respectivement de sorties) constatées sur un mois par rapport à l’effectif d’inscrits en début de mois
Parallèlement, le taux de chômage, à savoir la part des actifs sans activité et à la recherche d’un emploi, approche des 10% en France métropolitaine (9,9% au 3ème trimestre 2012, cf. figure 9). Celui des 15-24 ans avec 24,2% ne connaît pas de précédent.
Figure 9: Taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT)
en France métropolitaine depuis 1975
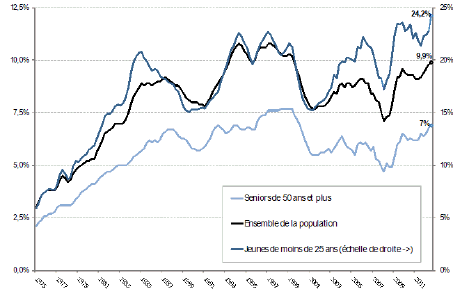
Source : Insee, Enquête emploi. Dernier point : 3ème trimestre 2012.
3.1. Le recours à l’activité partielle reste limité
3.1.1. Etat des lieux
Le système d'indemnisation publique de l’activité partielle (ou chômage partiel selon la terminologie du code du travail) a été initié au début des années 1930 avec la création d’une allocation publique de chômage partiel. Cette allocation publique a permis à l’Etat d’être partie prenante à un mécanisme d’indemnisation qui était auparavant financé exclusivement par les entreprises confrontées à des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Par la suite, le dispositif a été étendu aux entreprises qui connaissent des périodes de baisse d’activité du fait de la conjoncture économique.
Il a donc été conçu comme un outil de prévention des licenciements économiques permettant de maintenir les salariés en emploi et de conserver ainsi des compétences, voire de mettre à profit cette période de moindre activité pour les renforcer, afin de permettre à l’entreprise et ses salariés de bénéficier du redémarrage de l’activité dans les meilleures conditions. Il est destiné à compenser la perte de revenu occasionnée, soit par la réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale de 35 heures, soit par la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement (dans la limite de 1 000 heures par an et par salarié, soit l’équivalent des 2/3 d’une année à temps plein).
À la différence des autres pays européens, l’activité partielle en France n’est pas un mécanisme assurantiel adossé au régime d’assurance chômage. Pour autant, ce sont les partenaires sociaux qui ont défini les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle (accord national interprofessionnel du 21 février 1968) et les évolutions intervenues depuis 2009 ont renforcé leur place dans le financement du dispositif.
Figure 10 : Coûts budgétaire activité partielle (AS+APLD) 2008-2012
(hors coûts relatifs aux exonérations de cotisations)
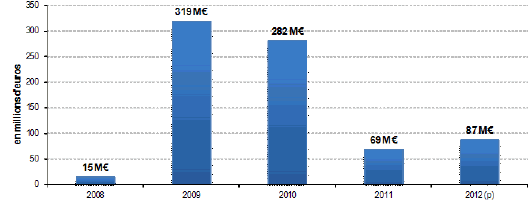
Source : DGEFP.
En effet, en 2007, le dispositif était quasiment tombé en désuétude, en raison du développement d’autres modes d’ajustement des coûts de la main d’œuvre dans les entreprises. Dans le contexte de la crise économique et financière de 2008, l’activité partielle a été redécouverte en tant que mode de préservation des compétences et de la capacité de production d’une entreprise, et mode de prévention du licenciement économique. Elle a été réformée afin de la rendre plus attractive. L’activité partielle de longue durée (APLD) a ainsi été créée en mai 2009 afin de répondre à des périodes de sous-activité prolongée et les partenaires sociaux ont décidé d’y participer financièrement à hauteur de 150 M€.
Un dispositif redécouvert lors de la crise de 2008 …
Lors de la crise de 2008-2012, l’activité partielle a été remobilisée à des niveaux importants et jamais vus depuis sa création.
Le nombre d’heures consommées a bondi de 4 millions en 2007 à 87 millions en 2009 ; pour le seul deuxième trimestre de 2009, 275 000 salariés ont été concernés (1% de la population active3).
Figure 11 : Nombres d'heures d'activité partielle (AS+APLD) consommées entre 2002 et 2012
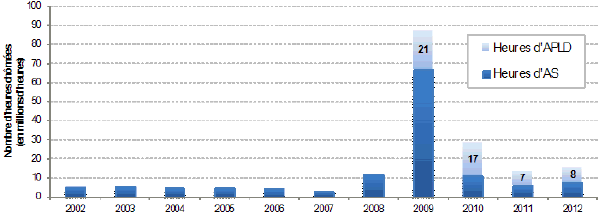
Source : DGEFP.
… mais qui s’est révélé moins protecteur pour l’emploi qu’à l’étranger
Figure 12 : Effets des systèmes d’indemnisation du chômage partiel sur l’emploi permanent,
proportionnellement et en chiffres absolus, entre le début de la crise et le T3 2009
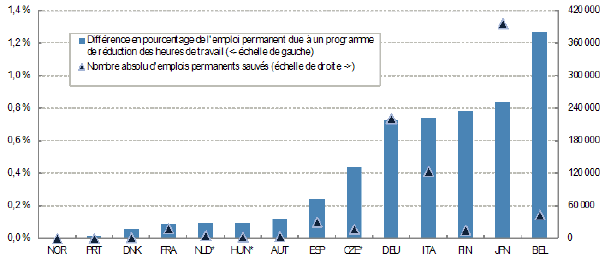
Source : OCDE
* signale les pays ayant instauré un nouveau dispositif d’indemnisation du chômage partiel en réaction à la crise. L’impact estimé sur l’emploi concerne la période entre le moment où le dispositif est devenu opérationnel et la fin du T3 2009.
En 2008-2009, 18 000 emplois ont été préservés selon l’OCDE4 entre le début de la crise et le 3ème trimestre 2009, en France. Pour autant, le modèle français s’est révélé l’un des moins capables de préserver l’emploi.
Des pays comme la Finlande, l’Italie et l’Allemagne et la Belgique semblent disposer de systèmes d’activité partielle plus efficaces quand il s’agit de maintenir les salariés dans l’emploi suite à une période d’activité partielle.
Les hommes, les salariés les moins diplômés et ceux ayant une plus grande ancienneté sont les plus touchés par le chômage partiel.
L’enquête Emploi de l’Insee repère les salariés déclarant avoir été absents au travail ou avoir réduit leur temps de travail pendant la semaine de référence pour raison de chômage partiel ou d’intempéries. D’après cette source, le chômage partiel concerne davantage les hommes, les moins diplômés et les salariés les plus anciens dans l’entreprise. Les salariés du secteur privé déclarant avoir été au chômage partiel entre le 4e trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010 sont beaucoup plus souvent ouvriers. Ils ont plus fréquemment des horaires de travail atypiques. Enfin les salariés concerné par le chômage partiel un trimestre donné se sont retrouvés plus fréquemment au chômage au cours des trimestres suivants que le reste des salariés.
Une utilisation concentrée en termes d’heures consommées dans les entreprises de grandes tailles et dans le secteur industriel
Le secteur automobile élargi (incluant les sous-traitants) a ainsi totalisé 24 % des heures consommées en 2012.
En ajoutant les trois autres principaux secteurs utilisateurs de l’activité partielle (fabrication de produits métalliques, métallurgie et fabrication de machines et équipements), la proportion passe à 38% des heures consommées.
Figure 13 : Répartition des heures d'activité partielle par secteurs d'activité en 2012
(top 10 sur 38 secteurs)
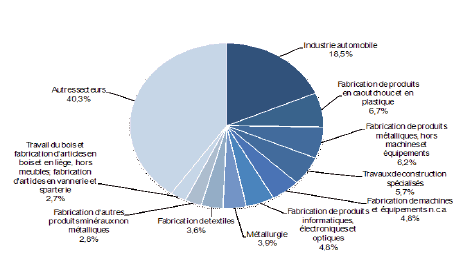
Note : les 10 secteurs les plus utilisateurs ont été sélectionnés dans la nomenclature d’activité à 38 secteurs.
Un outil insuffisamment utilisé par les entreprises qui en auraient besoin
L’utilisation de l’activité partielle en France n’a pas connu un développement équivalent à celui qu’elle connaît dans d’autres pays, notamment en Allemagne comme le signalait la cour des comptes dans son rapport de 2010. Pour autant, cette différence s’explique pour partie par des facteurs plus structurels dont notamment les trois principales raisons suivantes :
1. En France, l’ajustement en cas de baisse d’activité porte d’abord sur le non renouvellement des CDD et des intérimaires, en particulier dans l’industrie, c'est-à-dire en privilégiant la « flexibilité » externe. L’Allemagne à l’inverse connaît de fortes pénuries de main-d’œuvre et privilégie tant que possible le maintien des salariés en place par le recours à diverses mesures de « flexibilité » interne.
2. Les particularités du tissu économique allemand : l’industrie est beaucoup plus développée en Allemagne qu’en France. La part dans ce secteur dans l’emploi total est de 14% en France, et de 21% en incluant la construction (soit 5,4 millions d’actifs occupés). Or en Allemagne, la part de la population active employée dans l’industrie (construction comprise) est de 27% et elle représente 11 millions d’actifs. Si dans les deux pays près de 85% des heures chômées le sont dans l’industrie, l’industrie allemande pèse globalement 2 fois plus que l’industrie française en nombre de salariés. En outre, l’industrie allemande est plus orientée vers les biens d’équipement pour lesquels la demande fluctue plus fortement en fonction des évolutions conjoncturelles internationales que pour les biens de consommation. Elle est donc plus susceptible de recourir aux réductions/suspensions d’activité en cas de ralentissement économique. La récession de 2009 a par ailleurs été nettement plus forte en Allemagne qu’en France (respectivement -5,1% et -3,1% en 2009).
3. Un système d’activité partielle, plus simple et plus souple et qui se révèle moins généreux pour les salariés allemands dont l’indemnisation est entièrement prise en charge par un mécanisme de type assurantiel. Un salarié allemand voit son taux de remplacement garanti à 60% ou 67% du salaire net en Allemagne, à comparer aux taux de remplacements français qui varient entre 74% et 92% du salaire net (taux respectifs pour le régime de base et pour l’activité partielle de longue durée). En France, malgré l'exonération totale de charges sociales, l'employeur français a toujours un « reste à charge » plus important que son homologue allemand, à l'exception du cas spécifique des salariés proches du SMIC5.
Figure 14 : Répartition des mesures mises en œuvre pour réduire le temps de travail
en Allemagne en 2008 et 2009
Recours à l’activité partielle (Kurzarbeit) |
25% |
Réductions du temps de travail à l’initiative de l’employeur |
23% |
Réduction des heures supplémentaires |
21% |
Déstockage des comptes individuels temps de travail |
14% |
Augmentation de la part des temps partiels |
17% |
Source : Service économique de l’ambassade de France à Berlin, à partir de données de l’IAB
Lecture : Le recours à l’activité partiel a représenté ¼ des mesures de réduction du temps de travail.
Cependant, ces différences de nature structurelle n’expliquent pas en totalité l’insuffisante mobilisation de cet outil par les entreprises rencontrant des difficultés, notamment les plus petites d’entre elles.
3.1.2. Les limites du dispositif actuel
Les conditions de recours à l’activité partielle couvrent aujourd’hui un champ large, à savoir les difficultés liées à une conjoncture économique défavorable (9 cas sur 10), mais aussi les difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, ainsi que les sinistres ou les intempéries et toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Pourtant, le recours à l’activité partielle reste trop peu important tant au regard du nombre d’entreprise qui auraient pu mobiliser cet outil avec profit alors qu’elles faisaient face à des difficultés que du dispositif mobilisé.
Cette mobilisation insuffisante peut s’expliquer de plusieurs façons :
a) Un manque de lisibilité du dispositif du fait de son « architecture », ainsi que des taux d’indemnisation, de remplacement et de financement
Le dispositif d’activité partielle repose depuis le début des années 1970 sur l’imbrication relativement complexe de trois étages relevant de plusieurs sources de droit, qui induit des niveaux d’indemnisation multiples et des garanties de salaire (taux de remplacement) différentes :
Un premier étage d’allocation appelé « allocation spécifique »
L’allocation spécifique est accordée après autorisation des services de l’Etat, elle est accordée pour un nombre de salariés et pour une période préalablement déterminés. Elle est avancée par l'entreprise et remboursée par l'Etat (dispositif légal et réglementaire) et garantit une indemnité minimum à tous les salariés en activité partielle.
Cette allocation spécifique est forfaitaire et plus élevée pour les PME depuis 2001. Elle est versée pour toute heure chômée. Le montant de l’allocation spécifique est depuis le 1er mars 2012, de 4,84 € par heure chômée par salarié pour les entreprises de 250 salariés et moins, et de 4,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
De son côté, l’employeur, s’il relève du champ de l’ANI du 21 février 1968, s’engage à verser une indemnité complémentaire qui porte l’indemnisation globale du salarié à 60 % de sa rémunération brute, soit environ 74% du salaire net.
En effet, les allocations versées aux salariés placés au chômage partiel ne sont pas assujetties à cotisations sociales mais uniquement à la CSG et la CRDS, ce qui contribue à alléger nettement le reste à charge pour l’employeur et à assurer au salarié un taux de remplacement de son salaire net plus élevé que le taux facial indiqué dans l’ANI de 1968 ou dans le code du travail.
En tout état de cause, le montant de l’allocation globalement perçue par le salarié ne peut légalement en aucun cas être inférieur à un plancher fixé à 6,84 €/heure (l’équivalent du SMIC en décembre 2009).
Un deuxième étage conventionnel prévoit un niveau d’indemnisation plus élevé. Il est proportionnel au salaire brut, avec un minimum forfaitaire qui vient en complément de l’allocation spécifique.
Ce deuxième étage peut être de deux natures différentes :
- Le conventionnement dit « classique »
Lorsque les entreprises connaissent des difficultés particulières économiques spécifiques, le conventionnement classique peut être accordé. Le principe est de mieux indemniser les entreprises dans la limite du plafond fixé par l’ANI (6,84 €). Deux taux sont en vigueur, depuis 2005 (contre 3 précédemment) : 80 % avec la possibilité, sur accord conjoint du ministre de l'emploi et du ministre du budget, de le porter à 100% en cas de situation de catastrophe naturelle.
Suivant le taux retenu, l’Etat indemnise l’employeur à hauteur de 80% ou 100% de 6,84 €. L’employeur doit en contrepartie de cette aide complémentaire maintenir les salariés concernés par la convention dans l’emploi pendant une durée équivalente à la durée de la convention.
Dans les faits, les conventions « APLD » se sont substituées aux conventions « classiques ». La convention dite « 100% » continue cependant d’exister mais n’est mobilisée que dans les cas de catastrophes naturelles.
- Le conventionnement dit « longue durée » (APLD)
Mise en place par un décret du 29 avril 2009, l’activité partielle de longue durée (APLD), est destinée à permettre une meilleure indemnisation des salariés subissant une réduction d'activité pendant une période de longue durée (2 mois minimum renouvelables sans que la durée totale puisse excéder 12 mois).
L’aide apportée aux entreprises est ainsi accrue de manière significative puisqu’en sus de l’allocation de base, l’UNEDIC verse 2,90 € supplémentaires par heure chômée.
De leur côté, les salariés concernés se voient garantir un niveau d’indemnisation minimal de 75% de leur rémunération brute antérieure, soit environ 92% du net.
L’employeur doit en contrepartie de cette aide complémentaire maintenir les salariés concernés par la convention dans l’emploi pendant une durée équivalente au double de convention et organiser un entretien avec chaque salarié en vue de mettre en place des actions de formation.
La rémunération minimale mensuelle (RMM)
Dans le cas où l’indemnisation du salarié est inférieure au SMIC suite à des périodes d’activité partielle, l’employeur doit compléter son salaire afin d’atteindre la rémunération mensuelle minimum (« RMM »). Selon certaines modalités, l’Etat peut participer à cet effort financier supplémentaire en prenant à sa charge éventuellement jusqu’à 50 % de ce montant.
Figure 15 : Taux de remplacement pour les salariés et taux d'effort pour les entreprises
pour des salaires compris entre 1 et 3 Smic
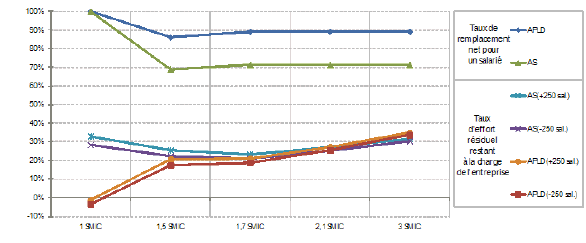
Lecture : En cas de signature d’une convention d’APLD, un salarié habituellement rémunéré 3 Smic horaire, percevra 90% de son salaire net par heure chômée et ne coûtera à l’entreprise que de l’ordre de 1/3 de son coût du travail horaire habituel.
b) Une trop grande complexité administrative
En sus d’une première demande au titre de l’allocation spécifique, l’entreprise devra également faire, si elle souhaite bénéficier de l’APLD, une demande supplémentaire de convention. Pour les entreprises, cette deuxième demande est souvent source d’incompréhension puisqu’elles ont déjà fait des démarches pour bénéficier du premier étage. En outre, si cette demande de conventionnement n’est pas concomitante à celle de l’allocation spécifique, des périodes d’autorisation doivent nécessairement concorder, ce qui oblige régulièrement à procéder à des ajustements des périodes autorisées pour l’allocation spécifique.
Le moindre recours à l’activité partielle peut également s’expliquer par une complexité administrative importante, due au fait que les heures d’activité partielle à indemniser sont calculées en fonction des différentes modes d’aménagements du temps de travail applicables dans les entreprises.
c) Un recours insuffisant à la formation pendant les heures chômées
L’étude commandée par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) démontre toute la pertinence d’associer de la formation aux heures chômées, et de développer cette pratique.
En effet, les entreprises qui ont mis en place des heures chômées et qui ont été interrogées pour l’évaluation reconnaissent toutes l’avantage de pouvoir former pendant les périodes de réduction d’activité.
Figure 16 :
Source : FSPPP |
Figure 17 : Part des d’heures de chômage partiel ayant donné lieu à formation par taille des établissements
|
Plusieurs types d’effets ont été observés :
- une contribution au maintien ou au renforcement de la formation professionnelle dans les entreprises ;
- des effets sur les compétences ;
- parfois des effets sur l’activité des entreprises ou sur le climat social dans les entreprises touchées par des réductions d’activité.
Les entreprises soulignent qu’en période de moindre activité, les rythmes de production sont moins perturbés par les départs en formation. Certaines estiment que ces formations permettent de garder un rythme soutenu de production hors période de formation, ce qui facilite ensuite la reprise d’activité. Pour d’autres, l’arrêt du travail de nuit ou d’un cycle de travail sur une chaîne permet de mobiliser les machines pour les formations.
L’enquête relève aussi que les PME et les grandes entreprises bénéficient plus, en proportion, des opérations de formation pendant l’activité partielle que ce n’est le cas pour les TPE.
Figure 18 : Durée des formations financées
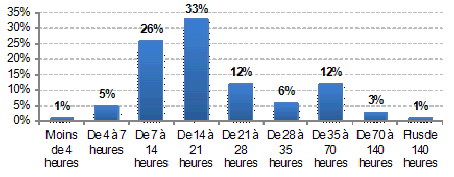
Source : FSPPP
Les formations au titre de l’activité partielle sont courtes : 83% durent une semaine ou moins, dont deux tiers moins de 3 jours.
40% des établissements ayant recouru à l’activité partielle ont bénéficié d’opérations de formation en 2009, 64% en 2010 et 17% en 2011.
Figure 19 : Nombre de formations et de salariés formés pendant l’activité partielle
Nombre de formations par année |
Nombre de salariés formés | |
2009 |
20 690 |
19 192 |
2010 |
114 734 |
82 137 |
2011 |
55 161 |
40 108 |
Source : FPSPP
Plusieurs obstacles ont limité le recours à la formation pendant les périodes d’activité partielle :
- Des périodes d’activité partielle courtes :
En moyenne, la réduction d’activité est de 30 heures par salarié chaque mois entre 2007 et 2010. Pour autant, il est difficile de planifier et d’organiser des formations sur des périodes d’activité partielle qui prennent souvent la forme d’une réduction de quelques heures par jours.
- Des taux de remplacements insuffisamment différenciés qui n’incitent pas à choisir la voie de la formation :
Les salariés voient leurs rémunérations tant dans le seul cadre de l’AS que dans celui de l’APLD pendant les périodes de sous-activité, maintenues à des niveaux élevés. Les différentes études ont démontré que cela n’incitait pas, de fait, les salariés à se former, sachant que les actions de formations ne se font que sur la base du volontariat. Afin d’introduire un différentiel financier positif pour les salariés qui souhaitaient se former, en mars 2012, il a été décidé de porter le niveau de rémunération à 100% du salaire net de référence mais pour la seule APLD qui ne représente que 50% des heures chômées.
Pour autant, la différence de rémunération introduite (10%) avec la réforme de mars 2012 est trop faible pour se révéler réellement attractive.
- Des actions de formations limitées dans le cadre de l’AS :
Depuis mars 2012, l’APLD permet d’organiser tous les types de formations prévus pendant le temps de travail et la rémunération est portée à 100% du salaire net. En revanche, les actions de formations pendant les périodes d’AS relèvent du seul champ des formations dites « hors temps de travail » qui sont très limitées en termes d’offres et qui sont également restreintes en termes d’heures mobilisables (contingentement de 120 heures au maximum).
d) Un recours à l’APLD qui reste difficile, notamment pour les PME et TPE
Le taux d’utilisation de l’APLD croît avec la taille de l’établissement. Ainsi, les établissements de moins de 50 salariés représentent seulement 13 % des heures consommées d’APLD alors qu’ils ont au total consommé 28 % des heures d’activité partielle.
Figure 20 : Nombre d’heures consommées d’APLD et taux d’utilisation de l’APLD
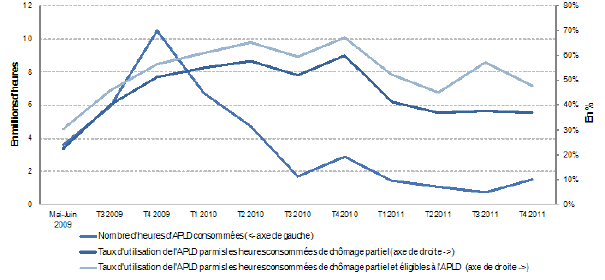
Note : Sont considérées comme éligibles à l’APLD les heures d’activité partielle consommées entre le 3ème trimestre 2009 et le 4ème trimestre 2011 dans le cadre de demandes d’une durée au moins égale à trois mois.
Avertissement : Les taux d’utilisation de l’APLD sont fortement sensibles à la consommation d’APLD des très gros usagers de chômage partiel.
En définitive, 90% des heures d’APLD auront été consommées par des établissements industriels entre 2009 et décembre 2011.
Plusieurs raisons peuvent expliquer le recours limité à l’APLD des établissements de plus petite taille, parmi lesquelles le manque d’information, le manque de prévisibilité dans lequel les placent leurs donneurs d’ordres et l’obligation de maintien dans l’emploi pendant une période minimale de 6 mois (le double de la période de conventionnement) qui est considérée comme dissuasive par certaines entreprises6. En effet, d’une part elles ne souhaitent pas souscrire des obligations dont la durée est difficilement compatible avec les incertitudes entourant la conjoncture économique et qu’elles ne sont pas certaines de pouvoir respecter ; d’autre part elles ne veulent pas encourir les sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation.
La réduction de la durée minimale de conventionnement à deux mois, faisant suite à l’expérimentation du 1er mars 2012, ne semble pas avoir rassuré suffisamment les entreprises, qui se montrent toujours aussi réticentes à s’engager dans le maintien dans l’emploi de salariés pour une durée de 4 mois minimum7.
Un autre effet mis en évidence, notamment par le rapport de l’ASP est la difficulté pour les salariés de reprendre le travail à la fin d’une période d’activité partielle étendue sur plusieurs mois. En effet, le taux de remplacement garanti par l’APLD (environ 90% du salaire net) se révèle être un frein à la remobilisation des salariés quand il s’agit de reprendre le travail.
Depuis la crise économique intervenue en 2008, l’activité partielle a fait l’objet de nombreuses réformes, mais celles-ci n’ont pas permis d’améliorer le recours à ce dispositif et de préserver ainsi des emplois.
Figure 21 : Les réformes du dispositif d’activité partielle intervenue entre 2008 et 2012
2008 |
Un avenant du 15 décembre 2008 à l'ANI du 21 février 1968 a prévu de mieux indemniser les salariés placés en activité partielle en portant le taux de remplacement à 60% du salaire brut de référence. Cet avenant précisait également qu’un salarié ne pouvait pas recevoir une indemnisation inférieure à 6,84 € par heure chômée à compter du 1er janvier 2009. Dans le contexte de la crise économique, l’arrêté du 30 décembre 2008 a permis de renforcer le dispositif en augmentant le contingent d’heures chômées autorisées par an et par salarié qui a ainsi été porté, de 600 à 800 heures pour l’ensemble des branches professionnelles. Le contingent annuel a été encore plus fortement majoré (1 000 heures) pour le textile, l’habillement-cuir et pour l’automobile, ses sous-traitants (ceux qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires) et le commerce de véhicules. Le décret du 22 décembre 2008 a prévu d’augmenter la durée maximale de mise au chômage partiel total qui a été portée de quatre à six semaines consécutives. Au-delà, les salariés, considérés comme privés d’emploi, pouvaient désormais s’adresser à Pôle emploi et bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi. |
2009 |
La création de l’allocation d’activité partielle de longue durée Compte tenu du recours massif à l’activité partielle lors du premier trimestre 2009, l’Etat et les partenaires sociaux ont créé l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD), à compter de mai 2009 afin de mieux indemniser les entreprises qui connaissent des périodes de sous-activité longues tout en garantissant aux salariés une meilleure indemnisation des salariés en fixant le taux de remplacement à 75% de leur salaire brut de référence (contre 60% avec l’AS). Ce dispositif complémentaire à l’allocation spécifique, cofinancé par l’Etat et l’Unédic visait aussi à inciter les entreprises à former leurs salariés pendant les périodes de sous-activité. Pour faciliter cet objectif, l’employeur s’engageait à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention, un entretien individuel en vue d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourrait être engagées durant la période d’activité partielle. Parallèlement, l’employeur devait maintenir dans l’emploi, les salariés pour une durée égale au double de la durée de la convention. Par ailleurs, le décret du 29 janvier 2009 a prévu de porter de montant de l’allocation spécifique à 3,84 euros par heure pour les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 3,33 euros pour celles de plus de 250 salariés, soit dans les deux cas, une augmentation d’1,20 € par heure chômée. Enfin, dans le cadre de l’ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, les partenaires sociaux ont souhaité : - Autoriser la mise en activité partielle par roulement des salariés dans les établissements de plus de 250 salariés ; pour cela, une convention d’APLD devait être signée. Cette disposition a été prévue par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Réduire le délai de réponse de 20 à 10 jours de l'administration et d’accélérer parallèlement la procédure de remboursement des entreprises. Des instructions ont été données aux services en ce sens ; - Considérer les périodes d’activité partielle, pour le calcul de l'intéressement et de la participation, comme des périodes où le salarié aurait perçu sa rémunération de référence. - Augmenter le contingent d'heures à 1000 heures pour tous les secteurs. Quant à lui, l’ANI du 2 octobre 2009 relatif au chômage partiel précisait que : - l'indemnité horaire est calculée sur la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ; - les périodes d’activité partielle sont prises en compte en totalité pour le calcul des droits à congés payés. |
2010 |
La convention Etat-Unédic relative à l’APLD, en date du 1er mai 2009, a été renouvelée le 4 décembre 2009 au titre de l’année 2010 inscrivant durablement cette allocation complémentaire dans le dispositif d’activité partielle. |
2011 |
Afin de réduire les délais d’indemnisation des entreprises, dans le cadre de la RGPP, il a été prévu de transférer la charge du paiement de l’activité partielle a à l’agence de service de paiement (ASP) pour décharger les services de l’Etat de tâches de gestion tout en modernisant le système et en améliorant la qualité du service rendu. |
2012 |
Pour renforcer l’attractivité du dispositif dans un contexte marqué par la crise, et suite au constat que le recours à l’activité partielle stagnait fin 2011, il a été décidé de poursuivre le mouvement de réforme de l’activité partielle. Les partenaires sociaux dans le cadre de deux ANI ont décidé de créer des conditions favorables à un recours plus intensif à l’activité partielle, dans le but en particulier d’en faciliter l’accès aux petites et moyennes entreprises. L’ANI du 13 janvier 2012 posait les principes suivants : - L'indemnité horaire serait calculée sur la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ; - Les périodes de chômage partiel seraient prises en compte en totalité pour le calcul des droits à congés payés ; - Pour le calcul de l'intéressement et de la participation, les périodes de chômages partiel sont neutralisées et considérées comme si le salarié avec perçu sa rémunération de référence ; - Tous types de formation pourront être mis en œuvre pendant l'APLD et le salarié serait indemnisé à 100% de son salaire net de référence pendant ces périodes de formation ; - Réduire le délai de réponse de l'administration qui passerait de 20 à 10 jours ; - Suppression de l'autorisation préalable si une entreprise connait une dégradation forte et subite de l'activité de l'entreprise ; - Raccourcir les délais de versement des indemnités de chômage partiel pour que l'entreprise n'ait plus à en faire l'avance ; - Maintenir à 1000 heures le contingent annuel d'heures de chômage partiel. L’ANI du 6 février 2012 instaurait : - Un financement exclusif de l’APLD par l'Unédic à compter de la première heure ; - Un complément d’allocation pour les heures chômées au titre de l’APLD fixé à 2,90 € ; - Une réduction de la durée minimale de conventionnement APLD qui passerait de 3 à 2 mois à titre expérimental jusqu'au 30 septembre 2012 ; - Les IRP seraient consultés également lors de la signature d'une convention d'APLD sur les actions de formation susceptibles d'être engagées ; - La mise en place d'un dispositif d'évaluation de l'ensemble du dispositif prévue à fin 2012. S’appuyant sur ces deux ANI, la réforme du 1er mars s’est articulée autour de 4 objectifs : - Simplifier les procédures de recours à l’activité partielle (suppression du caractère préalable de la demande d’indemnisation au titre du régime de base de l’allocation spécifique) et renforcer le dialogue social en instaurant l’obligation d’informer les IRP sur la mise en activité partielle ; - Rendre l’activité partielle plus attractive financièrement (revalorisation de 1 euro de l’allocation spécifique et de l’APLD (forfait complémentaire unique de 2,90€ par heure chômée dès la première heure alors que les cinquante premières heures ne bénéficiaient auparavant que d’un complément d’indemnisation de 1,90€ à la charge de l’Etat, l’Unédic prenant en charge l’indemnisation à compter de la cinquante-et-unième heure à un forfait de 3,90€) ; - Faciliter l’organisation de formations pendant les périodes d’activité partielle (en APLD, toutes les actions de formation, même au titre du plan de formation, peuvent être organisées) ; - Faciliter l’accès à l’APLD. À titre expérimental, il a été prévu, jusqu’au 30 septembre 2012, de permettre la conclusion d’une convention sur une durée de 2 mois (au lieu de 3 initialement). De ce fait, la durée de maintien dans l’emploi a été ramenée mécaniquement à 4 mois (au lieu de 6 précédemment). Ces demandes ont été reprises dans le cadre des décrets du 7, 28 février et du 9 mars 2012. À l’issue d’une réunion organisée entre l’Etat et les partenaires sociaux le 1er octobre 2012, il a été décidé d’adopter en urgence, sans attendre la conclusion de la négociation sur la sécurisation de l’emploi, les trois mesures suivantes : - Rétablir une autorisation administrative préalable pour sécuriser les entreprises dans le recours à l’activité partielle. Dans le souci cependant de permettre un recours rapide à cet outil, une procédure d’acceptation tacite a été mise en place. Passé un délai de quinze jours ouvrés et sans réponse des services de l’Etat, l’autorisation sera tacitement accordée, ce qui permettra à l’entreprise de placer, rapidement et en toute sécurité, ses salariés en activité partielle. - Prolonger l’expérimentation de la durée minimale de conventionnement APLD. L’expérimentation qui autorisait la réduction à 2 mois (au lieu de 3) de la durée minimale de conventionnement au titre de l’activité partielle de longue durée, afin d’inciter les entreprises à y recourir plus systématiquement, a été prolongée jusqu’au 31 mars 2013. - Mettre en œuvre un plan de mobilisation en vue du développement de l’activité partielle. Les dernières mesures prises en février 2012 afin de rendre l’activité partielle plus attractive n’ont pas été suffisamment portées à la connaissance des entreprises et notamment des très petites entreprises, ainsi qu’à un certain nombre de secteurs d’activité qui y recourent très peu. |
3.2.1. Le rapport récent de l’IGAS
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a réalisé une évaluation du dispositif français8. Elle estime qu’à la veille de la crise de 2008, le système français d’activité partielle était dans une situation paradoxale : il était l’un des plus anciens en Europe (1919) ; mais aussi un des plus circonscrits (aux grandes entreprises de l’industrie pour la quasi-totalité des demandes) et son attractivité pour les employeurs comme pour les salariés ainsi que son lien avec les actions de formation étaient faibles. Malgré la violence de la crise, sa mobilisation a été moins forte et réactive en France que chez ses principaux partenaires : entre 2007 et 2009, la part des salariés en ayant bénéficié a représenté moins de 0,85 % de la population active contre plus de 3 % en Italie et en Allemagne. Si l’activité partielle a été moins mobilisée que chez ses voisins, c’est d’abord parce que d’autres dispositifs lui sont préférés en France9. La mobilisation du chômage partiel souffre, par ailleurs, de modalités complexes de prise en charge qui sont sources de complications supplémentaires : parce qu’il s’agit d’un dispositif à trois étages10, peu lisible pour les employeurs et parce qu’il s’organise à partir des réglementations du temps de travail11.
À l’aune de ce constat, les partenaires sociaux se sont réunis avec le ministère du travail et de l’emploi le 1er octobre 2012 et ont convenu de l’opportunité de la réintroduction de l’autorisation administrative préalable. Ceci est intervenu par décret le 21 novembre 2012.
3.3. Des accords d’entreprises permettent également de maintenir l’emploi face à une baisse temporaire d’activité mais nécessitent un meilleur encadrement juridique
Dans une économie mondialisée, soumise à des chocs conjoncturels de plus en plus nombreux, les entreprises doivent pouvoir, par accord collectif d’entreprise, ajuster rapidement, et pour un temps limité, leur organisation collective du travail aux variations d’activité, tout en préservant au maximum l’emploi. Ainsi, en cas de choc économique négatif, et pour limiter les ajustements sur l’emploi (adaptabilité externe), il doit être possible pour les entreprises de s’adapter à la baisse de la demande par la mobilisation de mécanismes d’ajustements temporaires (adaptabilité interne).
De manière générale, dans les pays où la réactivité du marché du travail est faible et le délai moyen d’ajustement de l’emploi élevé, les entreprises préfèrent attendre la confirmation du retournement, en mobilisant des outils d’ajustements temporaires, avant de procéder à des réductions d’effectifs. Elles font donc le choix de recourir à la flexibilité interne, en jouant notamment sur le temps de travail et les salaires lorsqu’elles en ont la possibilité, plutôt qu’à des destructions massives d’emplois.
Or la France a longtemps négligé ces mécanismes au profit d’un ajustement de l’emploi à la baisse. Ainsi, en 2009, la plus forte réactivité du marché du travail français explique la répercussion rapide de la crise économique sur l’emploi, ce qui s’est traduit notamment par un rythme très important de destructions d’emplois dans le secteur marchand12. Pourtant, le recours à des mécanismes d’ajustements temporaires, permettant de garantir l’emploi en contrepartie de la possibilité de baisses transitoires de la durée du travail et des salaires, peut s’avérer fructueux dans des situations de crises aigües, lorsque la survie même de l’entreprise est en jeu, en raison de la conjoncture.
L’exemple de l’Allemagne est particulièrement éclairant. Le pays est ainsi parvenu à limiter la dégradation du marché du travail malgré une activité fortement touchée. Le marché du travail allemand est traditionnellement l’un des marchés où l’emploi réagit le moins aux chocs conjoncturels parmi les pays développés, du fait de la forte flexibilité du temps de travail. L’Allemagne dispose en effet d’un ensemble de mécanismes permettant de moduler le temps de travail. Le système allemand se caractérise depuis 2004 (convention de Pforzheim) par la possibilité de déroger aux conventions de branches, en concluant des accords établissant un équilibre entre modération salariale contre garanties en matière d’emplois ou baisse temporaire du temps travaillé et donc du coût du travail contre garantie de maintien de l’emploi. Ces compromis ont notamment permis à notre voisin de faire face à la crise et de maîtriser la hausse du chômage. Le taux de chômage est passé de 7,3% à 7,5% entre 2008 et 2009 contre 7,8 et 9,4% en France. Les heures travaillées ont baissé de 3,2% en 2009, le tiers de cette baisse étant expliqué par l’utilisation du chômage partiel et 40% environ par une baisse du temps travaillé. La masse salariale pendant la même période a légèrement baissé, dans une moindre mesure. C’est en partie pour cela que le chômage a été contenu, grâce à cette souplesse, cette réactivité et cette capacité des partenaires sociaux dans l’entreprise à travailler ensemble. Ce sont aussi ces ajustements qui permettent, quand la situation est meilleure, d’augmenter les salaires, comme cela a été négocié en 2012 dans la métallurgie en Allemagne avec une hausse de 3,8 %. Par ailleurs, un ajustement à la baisse des rémunérations a bien eu lieu par l’intermédiaire des parts variables (heures supplémentaires, primes individuelles et collectives).
Les entreprises allemandes ont donc parié sur l’avenir en plébiscitant une baisse du temps de travail afin de conserver intactes leurs capacités de production et le niveau de qualification de leur main d’œuvre, dans la perspective d’une reprise rapide de l’activité.
Figure 22 : Une comparaison des différentes stratégies d’ajustement face à la crise
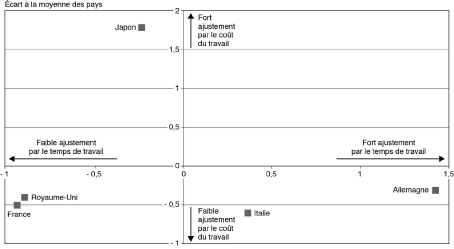
Lecture : ce graphique montre l’évolution du temps de travail et des coûts salariaux unitaires (CSU) entre le 1er trimestre de 2008 et le 2ème trimestre de 2010, relativement à la moyenne des pays de l’échantillon. L’évolution du temps de travail en France a dépassé de 0,9 point la moyenne des pays, et celle des CSU de 0,5 point sur la période.
Source : OCDE, calculs OFCE.
Figure 23 : Recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel en France
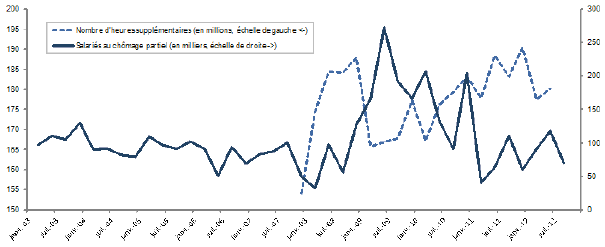
Sources : Insee, Acoss.
Si de tels accords sont possibles aujourd’hui en France, comme l’ont montré plusieurs exemples, leur développement peut être encouragé en levant les blocages qui conduisent aujourd’hui trop souvent à préférer licencier plutôt que s’adapter temporairement dans un cadre collectif négocié.
Les licenciements pour motif économique ne constituent qu’une part réduite des ruptures de contrat. En effet, ils n’ont représenté en 2012 que 2,6% des inscriptions comme demandeurs d’emploi, d’après les statistiques publiées chaque mois (cf. figure 24).
Figure 24 : Répartition des inscriptions mensuelles à Pôle emploi par motif (en %)
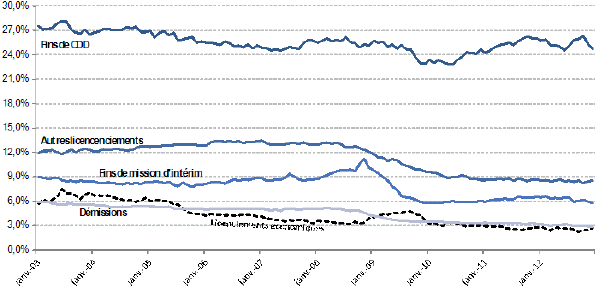
Source : Dares-Pôle emploi, Statistique Mensuelle du Marché du Travail.
Cependant, cette source présente des fragilités, car 40% des entrées sont classées dans la catégorie « autres cas ». Il s’agit notamment des motifs non renseignés.
C’est pourquoi cette source est complétée par une enquête régulière sur les « entrants au chômage » réalisée par Pôle emploi, où les « autres cas » ne représentent plus que 8% (cf. figure 25). Ainsi, la part des entrées à Pôle emploi suite à un licenciement économique est estimée à 6,9% lors de la dernière vague de décembre 2010.
Figure 25 : Répartition des inscriptions à Pôle emploi par motif (en %)
Enquête « entrants au chômage » |
Statistique Mensuelle du Marché du Travail | |||
Motif d’entrée |
Déc. 2008 |
Déc. 2010 |
Déc. 2010 |
Motif d’entrée |
Licenciement économique |
8,1% |
6,9% |
3,3% |
Licenciement économique |
Autres licenciements |
15,2% |
17,1% |
9,0% |
Autres licenciements |
Démission |
7,1% |
6,5% |
3,0% |
Démission |
Fin de CDD |
27,4% |
25,9% |
23,2% |
Fin de CDD |
Fin de mission d’intérim |
15,5% |
10,5% |
7,7% |
Fin de mission d’intérim |
Fins d’études |
9,9% |
10,8% |
4,7% |
Première entrée |
Reprise d’activité |
7,8% |
10,7% |
7,6% |
Reprise d’activité |
Fin arrêt maladie, maternité |
3,0% |
3,6% | ||
Autre cas+NSP |
6,0% |
8,0% |
41,5% |
Autres cas |
Total |
100% |
100% |
100% |
Total |
Source : Pôle emploi, Repères et analyses n°32, octobre 2011.
NB : L’écart se répartit sur les motifs clairement identifiés dont la part est systématiquement sous-estimée dans la statistique administrative. Une exception doit être signalée : la proportion d’entrées suite à une fin de CDD s’établit à des niveaux proches selon les deux sources d’information.
Parmi ces licenciements pour motif économique, moins de la moitié entraîne le déclenchement d’une procédure de licenciement collectif. En effet, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être organisé lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés envisage 10 licenciements ou plus sur une période de 30 jours. Or, de l’ordre de 45%13 des licenciements économiques ont lieu dans des entreprises de moins de 50 salariés. En outre, les autres n’entrainent pas nécessairement la mise en œuvre d’un PSE (moins de 10 licenciements). Par ailleurs, parmi les PSE, la part des entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (RJ-LJ) est importante14.
En dehors de l’année 2009 qui fut exceptionnelle, le nombre de PSE notifiés à l’administration est stable sur les 20 dernières années (autour de 1000 à 1 200 PSE par an, cf. figure 27 et figure 28). Seulement de l’ordre du tiers de ces plans ont concerné plus de 50 licenciements.
Figure 27 : Nombre de Plans de Sauvegarde de l'Emploi notifiés annuellement
par les entreprises à l'administration
Année |
Moyenne |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Nombre de PSE |
1274 |
958 |
1 058 |
2 244 |
1 185 |
954 |
Source : DARES
Figure 28 : Nombre de Plans de Sauvegarde de l'Emploi notifiés trimestriellement
par les entreprises à l'administration
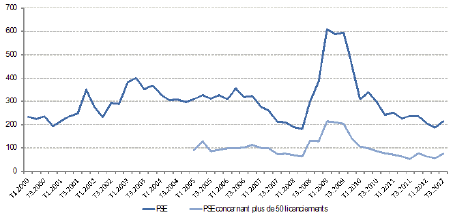
Source : Dares-UT, remontées rapides. France métropolitaine.
Pour autant, les restructurations menées en France se traduisent souvent par des conflits et des procédures judiciaires parfois longues, sans que la recherche d’un accord ne soit pour autant privilégiée.
Ce constat traduit la difficulté d’établir des relations de confiance entre les acteurs et bien souvent un manque d’anticipation. Le dialogue social se réduit à un dialogue formel, sans débat de fond sur la situation de l’entreprise et les solutions alternatives à construire, dans un délai légal maximum ne permettant pas de les approfondir.
Une telle situation entraîne une insécurité juridique pour les entreprises (sur les délais de procédure, sur le coût des restructurations) comme pour les salariés (incertitude sur leur devenir, difficultés à se projeter…) et une insatisfaction des représentants du personnel sur les conditions d’exercice d’un réel dialogue au sein de l’entreprise.
4.1. Une insécurité juridique pour les entreprises compte tenu de l’importance des contentieux engagés qui traduisent un manque de dialogue social
Le droit du licenciement en France se caractérise pourtant par des délais de procédure légaux et des montants d’indemnités légales de licenciement équivalents à ceux de nos principaux partenaires européens. Mais la pratique s’en éloigne, notamment pour les délais.
Les contentieux individuels en matière de licenciement économique sont proportionnellement peu nombreux, à la différence de ceux pour motif personnel : 2,8 % des licenciements économiques font l’objet d’un recours devant les conseils de prud’hommes (CPH), contre 25 % des licenciements pour motif personnel. Les augmentations observées en 2009 et 2010 s’expliquent par un nombre plus importants de licenciement pour motif économique dans le contexte de la crise économique de 2008.
Figure 29 : Évolution des demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail
pour motif économique formées devant les conseils des prud’hommes (2007-2011)
Année |
Total |
dont fond |
dont référé |
2007 2008 2009 2010 2011 |
3 460 2 941 4 875 5 489 2 909 |
3 389 2 866 4 726 5 360 2 825 |
71 75 149 129 84 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
Figure 30 : Evolution de la part des demandes d’indemnités liées
à la rupture du contrat de travail pour motif économique (%)
sur l’ensemble des demandes formées devant les conseils des prud’hommes
Année |
CPH (fond+référé) | ||
Total |
dont poste 80B | ||
Nombre |
% | ||
2007 2008 2009 2010 2011 |
192 864 202 103 228 901 217 661 205 296 |
3 460 2 941 4 875 5 489 2 909 |
1,8 1,5 2,1 2,5 1,4 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
NB : Dans la nomenclature des affaires civiles (NAC), les « demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique » sont enregistrées au poste 80B.
À l’inverse, les restructurations, c'est-à-dire les projets collectifs de licenciement - plus de 10 salariés dans une période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus - appellent un constat différent :
4.1.1. La procédure est complexe et en pratique dépasse les délais légaux sans que cela constitue une garantie en termes de sécurité juridique :
Un projet de licenciement collectif exige a minima deux consultations du comité d’entreprise, l’une sur le projet de restructuration, l’autre sur le projet de licenciement collectif.
Au-delà de la consultation du CE, d’autres acteurs peuvent intervenir : le comité central d’entreprise (CCE) lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) si la restructuration a des conséquences sur les conditions de travail, les délégués syndicaux parfois, le comité d’entreprise européen si la restructuration affecte des implantations de plusieurs pays. Plusieurs experts peuvent aussi être nommés au cours de la procédure. L’employeur doit également élaborer dans cette phase un plan de sauvegarde de l’emploi qui a pour objectif de limiter les licenciements. Il doit proposer des mesures de mobilité interne au sein de l’entreprise et du groupe. Il prévoit des actions de reclassement avec des aides à la formation (adaptation et reconversion) et des aides à la création d’entreprise dans le cadre des reclassements externes.
L’administration du travail est informée du projet de licenciement et peut jouer un rôle de veille et d’accompagnement. Mais son pouvoir repose pour l’essentiel sur la formulation d’observations visant à améliorer les mesures d’accompagnement du PSE.
4.1.2. La judiciarisation des procédures de licenciement collectif est la marque d’un déficit de dialogue social :
- Les juges compétents sont multiples : outre le conseil des prud’hommes qui peut être saisi de chaque cas individuel, le tribunal de grande instance (TGI) peut être saisi par le CE ou les organisations syndicales et le juge pénal peut condamner l’employeur pour « délit d’entrave » lorsqu’il se rend coupable de n’avoir pas respecté les prérogatives des représentants du personnel.
- Les contentieux collectifs sont nombreux et engendrent des délais importants : si en valeur absolue, le nombre de recours est limité, en proportion du nombre de plans de sauvegarde de l’emploi, le taux de recours (cf. figure 33) en première instance, devant un tribunal de grande instance, est très important.
Figure 31 : Evolution des demandes relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi
Année |
Total |
dont TGI fond |
dont TGI référé | ||||
total |
82K |
82E |
total |
82K |
82E | ||
2007 2008 2009 2010 2011 |
167 168 257 230 195 |
63 79 128 110 97 |
1 3 26 2 6 |
62 76 102 108 91 |
104 89 129 120 98 |
8 1 8 5 9 |
96 88 121 115 89 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
Note : Dans la nomenclature des affaires civiles (NAC), les contestations des plans sociaux est décomposée en deux postes : 82K s’agissant des « demandes relatives à un PSE » et 82E s’agissant des « autres demandes des représentants du personnel ».
Figure 32 : Evolution de la part des demandes relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi (%)
sur l’ensemble des demandes formées devant les TGI (2007-2011)
Année |
Total demandes |
dont PSE | |
Nombre |
% | ||
2007 2008 2009 2010 2011 |
911 593 921 597 948 665 952 412 942 841 |
167 168 257 230 195 |
0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
Rapporté en effet au nombre de plans de sauvegarde de l’emploi, le contentieux des restructurations est très important:
Figure 33 : Part des PSE des entreprises « in bonis »*
donnant lieu à un contentieux devant le TGI
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Part des PSE contestés |
29% |
27% |
19% |
32% |
34% |
Source : Calculs DGEFP
* Une société in bonis désigne une entreprise en bonne santé sur le plan financier.
Les chances de voir la demande acceptée par le juge restent relativement élevées, essentiellement en référé (acceptation totale ou partielle dans 45% des cas en 2011, cf. figure 34).
Figure 34 : Résultat des demandes relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi devant les TGI (2011)
Résultat |
Total |
Fond |
Référé | ||||||
Nombre |
% pour 100 affaires terminées |
% pour 100 décisions statuant |
Nombre |
% pour 100 affaires terminées |
% pour 100 décisions statuant |
Nombre |
% pour 100 affaires terminées |
% pour 100 décisions statuant | |
TOTAL |
182 |
|
|
84 |
|
|
98 |
|
|
Total hors jonction |
175 |
100 |
81 |
100 |
94 |
100 |
|||
Décisions ne statuant pas sur la demande |
41 |
23,4 |
25 |
30,9 |
16 |
17 |
|||
Désistement |
19 |
10,9 |
12 |
14,8 |
7 |
7,4 |
|||
Radiation |
8 |
4,6 |
2 |
2,5 |
6 |
6,4 |
|||
Retrait du rôle |
6 |
3,4 |
4 |
4,9 |
2 |
2,1 |
|||
Incompétence |
3 |
1,7 |
3 |
3,7 |
0 |
||||
Décisions statuant sur la demande |
134 |
76,6 |
100,0 |
56 |
69,1 |
100,0 |
78 |
83 |
100,0 |
Rejet |
54 |
30,9 |
40,3 |
28 |
34,6 |
50,0 |
26 |
27,7 |
33,3 |
Acceptation partielle |
34 |
19,4 |
25,4 |
26 |
32,1 |
46,4 |
8 |
8,5 |
10,3 |
Acceptation totale |
46 |
26,3 |
34,3 |
2 |
2,5 |
3,6 |
44 |
46,8 |
56,4 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
En appel des décisions des TGI et des cours d’appels, les taux de recours sont proportionnellement importants. (cf. figure 35).
Figure 35 : Taux d’appels contre les décisions relatives à un PSE rendues par les TGI (en 2011)
Total |
Fond |
Référé | |
Décisions rendues par les TGI statuant sur la demande Appels Taux d’appel (%) |
134 53 39.6 |
56 24 42.9 |
78 29 37.2 |
Source : RGC, SDSE et DACS, PEJC
Le taux de cassation des décisions des cours d’appel sur les restructurations est de 45,0 %, contre 35,0 % en moyenne en matière sociale et de 28,8 % en général.
Les délais de jugement en matière de licenciement économique sont longs :
Ces délais s’élèvent à 11 mois en moyenne aujourd’hui devant le TGI, un ou 2 ans en appel, 2 ans pour la cassation avec le risque d’annulation tardif du plan de sauvegarde de l’emploi et de tous les licenciements. Les décisions de justice favorables aux salariés peuvent parfois intervenir plusieurs années après les licenciements, comme cela a été le cas pour la biscuiterie Lu. Cette entreprise avait annoncé sa restructuration en 2001 mais les licenciements ne sont intervenus qu’en 2004 et 2005. Les salariés ont obtenu de la Cour d’appel de Paris la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse en 2011, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’entreprise en 2012.
4.2. Une difficulté à établir un dialogue social dans la gestion des restructurations
Lorsque l’employeur informe les représentants du personnel pour satisfaire à son obligation légale, c’est souvent avec un projet déjà abouti sur lequel les marges de discussion peuvent être réduites. Il engage alors une procédure « d’information – consultation » organisée précisément par le code du travail, qui définit le nombre de réunions du comité d’entreprise, les délais qui séparent les réunions ou encore les conditions de recours à l’expert.
Le conflit social et le recours au juge sont souvent des alternatives au défaut ou à la mauvaise qualité du dialogue social.
Les législations des pays voisins de la France sont davantage orientées vers la conclusion d’un accord, même si la décision finale reste toujours du ressort de l’employeur. En Allemagne, l’accord collectif est indispensable pour arrêter le contenu des mesures d’accompagnement social. En Espagne, il permet de garantir l’obtention de l’autorisation administrative de licenciement. En Italie, il permet d’éviter l’intervention directe de l’administration : faute d’accord à l’issue des délais légaux, l’administration du travail intervient pour tenter de concilier les parties. En Suède, l’employeur est incité à conclure un accord s’il veut s’affranchir de la règle du « dernier entré, premier sorti » et, en pratique, 90% des restructurations donnent lieu à un accord collectif.
En France, des bonnes pratiques se sont développées pour construire des relations sociales organisées y compris dans le contexte délicat de restructurations d’ampleur, en mettant l’accent sur l’anticipation et la négociation. .
En 2003, le législateur a créé la possibilité, pour les entreprises, de négocier des accords de méthode qui ont vocation à fixer les conditions d’une meilleure consultation des instances représentatives du personnel - notamment par la définition du calendrier de la procédure d’information et de consultation - et à anticiper la mise en œuvre de certaines mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les accords de méthode couvrent aujourd’hui près de 15% des restructurations et 25% des restructurations hors redressement et liquidation judiciaire. Ces accords peuvent être négociés en amont de la restructuration.
De façon majoritaire, ces accords traitent de l’information et de la consultation des représentants du personnel et prévoient un allongement des délais de procédure dû à une augmentation du nombre de réunions. La place accordée à l’organisation de la procédure de licenciement témoigne de la volonté des organisations syndicales signataires de dépassionner les débats et de créer les conditions nécessaires à un dialogue social de qualité.
Au-delà de ces deux thématiques, les accords de méthode n’abordent pas ou peu trois sujets pourtant essentiels : les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise peut formuler des propositions alternatives au projet de licenciement (aucun accord de méthode ne le prévoit alors même que le comité d’entreprise y a intérêt), l’implication des salariés (les modalités d’information des salariés sur le contenu de l’accord sont minoritaires), et le suivi de l’application de l’accord.
Si la portée de ces accords n’est pas négligeable, elle ne semble pas cependant suffisante.
4.3. Le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi doit être proportionné aux moyens financiers de l’entreprise ou du groupe auxquels elle appartient.
Des mesures sont différentes selon la taille du groupe à laquelle l’entreprise concernée appartient :
- Les entreprises appartenant à un groupe d’au moins 1 000 salariés en Europe supportent entièrement le coût des licenciements. Ces entreprises doivent proposer au salarié licencié pour motif économique un congé de reclassement. D’une durée de 4 à 9 mois, il est rémunéré par l’entreprise (au moins 65 % du salaire brut). Le salarié est suivi par une cellule d’accompagnement jusqu’à la rupture du contrat de travail à l’issue du congé. Ces mêmes entreprises sont également soumises à l’obligation de revitalisation des territoires.
- Un dispositif public d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique cofinancé par le régime d’assurance chômage, l’Etat, et les entreprises (dans une moindre mesure) a été créé en 2011 : le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le CSP est obligatoirement proposé par l’employeur au salarié et lui permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé mis en œuvre par Pôle emploi (formations, aide à la création d’entreprise…), combinant actions de réorientation, périodes de formation et de travail, ainsi que d’une allocation équivalente à 80 % de son salaire brut pendant 12 mois. Les adhésions au CSP sont nombreuses (en moyenne 9 000 adhésions mensuelles en 2012).
Néanmoins, les mesures actives d’accompagnement des salariés licenciés sont généralement moins au cœur des négociations que les indemnités de licenciement dites « supra légales ». La juridicisation importance des procédures collectives pour motif économique déplace le débat sur le terrain de la réparation des préjudices subis par les salariés concernés par les licenciements au détriment de la sécurisation de leurs parcours professionnels.
Ces dernières années, la tendance semble avoir été à la surenchère indemnitaire, notamment dans les grandes entreprises, au profit des salariés ayant une forte ancienneté qui nécessitent pourtant une plus grande attention en matière d’accompagnement social.
En 2009, le montant des indemnités extra-légales de licenciement prévu dans les plans de sauvegarde de l’emploi s’est élevé en moyenne à 27 000 € par salarié (source : échantillon MAAPSE de la DGEFP concernant 27 PSE), et peut atteindre jusqu’à 70 000 €, et parfois bien au-delà, souvent à la suite d’un conflit social se traduisant par des procédures judiciaires ou des menaces de procédures.
Le recours aux indemnités extra-légales représente aussi un levier incitatif aux ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre d’un plan de départs volontaires. C’est alors l’équilibre du contenu du PSE qui est remis en cause. En effet, les salariés les plus fragiles peuvent être sensibles au montant des indemnités offertes par l’entreprise, sans percevoir l’intérêt à bénéficier de mesures d’accompagnement leur permettant de se réinsérer sur le marché du travail.
Cette sensibilité peut être accrue s’agissant de salariés dont l’âge de liquidation de la pension de retraite peut être plus ou moins proche.
Face à ces pratiques, les modalités d’intervention de l’administration lors de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont limitées. L’État intervient à un double titre dans les procédures de restructurations :
- S'il n’exerce plus un contrôle administratif a priori sur les restructurations depuis la suppression de l’autorisation administrative de licenciement en 1987 (à l’exception notable du licenciement des salariés protégés qui reste soumis à l’autorisation préalable de l’administration), il intervient encore aujourd’hui en tant que garant de la qualité des mesures de reclassement mises en place par l’employeur. Il contrôle ainsi le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi que lui notifient les employeurs, il peut formuler des observations et peut émettre un constat de carence quand il estime que les mesures sont insuffisantes. Le constat de carence, qui doit cependant être établi dans les 8 jours qui suivent la notification du projet de licenciement – à un moment où le plan de sauvegarde de l’emploi est discuté – n’emporte pas de conséquences juridiques. Il est cependant un élément important à l’appui duquel le juge peut prononcer l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
- Par ailleurs, l’État peut venir enrichir le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi en proposant à une entreprise de cofinancer certaines mesures d’accompagnement. Pendant longtemps, la principale mesure financée par l’Etat a été les préretraites publiques dites ASFNE. Leur recours a été fortement restreint ces dernières années et elles ont été définitivement supprimées par la loi de finances pour 2012. Demeurent aujourd’hui deux mesures d’accompagnement que l’Etat peut cofinancer, principalement dans les entreprises en RJ –LJ, la cellule d’appui à la sécurisation des parcours professionnels et les allocations temporaires dégressives visant à compenser le reclassement d’un salarié licencié dans un emploi moins bien rémunéré. Dans le cadre de l’allocation temporaire dégressive, l’Etat peut participer pour partie au financement de cette allocation dans les entreprises in bonis si l’entreprise n’appartient pas à un groupe et que l’entreprise offre une participation financière conséquente.
Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti (art. L.1411-1 du code du travail).
C’est une juridiction composée pour moitié de représentants des employeurs et pour moitié de représentants des salariés. Les conseillers prud’hommes employeurs et salariés sont élus respectivement par leurs pairs.
Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. Les sections autonomes sont : la section de l’encadrement, la section de l’industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l’agriculture, et la section des activités diverses (art. L.1423-1 du code du travail).
Les conseillers prud’hommes, qui statuent toujours en nombre pair, doivent prendre leurs décisions à la majorité des voix. Si cette majorité ne peut se former, l’affaire est renvoyée devant la même formation mais présidée par un juge d’instance.
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
- lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par le décret du 20 septembre 2005 (4 000 euros) ;
- lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
5.1.1. Données chiffrées
Depuis la réforme de la carte judiciaire, 210 conseils des prud’hommes sont répartis sur le territoire national, sans compter les juridictions spécifiques à l’Outre-mer. En 2010, les conseils de prud’hommes ont enregistré 205 000 affaires nouvelles (fond et référé).
Sur les 160 000 affaires au fond, 96 % portent sur une contestation relative à la relation individuelle de travail. Parmi celles-ci, 96 % constituent une demande en termes de salaire ou d’indemnité.
En 2010, le contentieux prud’homal représente 20 % de l’activité des cours d’appel, avec un taux d’appel particulièrement important de 58 %, soit presque 5 fois plus que le taux enregistré pour les tribunaux de grande instance.
5.1.2. Eléments critiques
De manière récurrente, des critiques sont formulées à l’encontre de la juridiction prud’homale.
Alors que la spécificité de cette juridiction repose depuis son origine sur la conciliation, la part de celle-ci ne représente plus que 7 % des affaires terminées (2010).
Cette évolution marque une radicalisation de la confrontation qui s’exprime également par la progression constante de la départition (12 %).
Ces éléments, combinés avec les moyens dévolus aux juridictions, entretiennent une durée moyenne de jugement de 14 mois.
Il est indéniable que les décisions favorables à plus de 70 % aux salariés constituent un facteur d’attractivité de la phase de jugement de la procédure prud’homale.
De manière plus prosaïque, les critiques formulées touchent aux domaines suivants.
- l’absence de l’employeur, ou le défaut de représentants mandatés pour négocier – dans un cas sur deux, l’employeur est absent ;
- le traitement accéléré de l’audience de conciliation – 10 minutes en moyenne ; temps bien moindre que ce qui est requis pour une médiation (1 h 30 à 2 h) ;
- le défaut de formation des conseillers à la négociation et à la médiation ;
- la contagion de l’échec de la médiation. Avec un taux de réussite de moins de 10 %, les parties ne placent pas beaucoup d’espoir dans les chances de succès de la conciliation ;
- le renvoi automatique en bureau de jugement.
5.1.3. Les propositions formulées en 2010
Suite aux échanges organisés en 2010 par la direction des affaires civiles et du Sceau avec les organisations syndicales d’employeurs et de salariés, différentes suggestions ont été formulées. De manière générale, les organisations ont manifesté leur souhait de conserver le statu quo, y compris s’agissant du maintien de la phase préalable obligatoire de la conciliation.
Des propositions périphériques ont été toutefois formulées :
- systématiser la formation des conseillers à la négociation et à la médiation ;
- permettre le recours aux médiateurs ;
- élargir le champ de l’échange durant l’audience de conciliation, pour éviter que la discussion se limite au seul montant de l’indemnisation ;
- instituer une obligation effective de présence des parties ;
- sanctionner les absences, voire les recours abusifs, par la condamnation à des amendes civiles.
6. Plus généralement, une réelle culture du dialogue et de l’anticipation doit encore se développer dans l’entreprise
6.1. L’information des salariés et des représentants du personnel en matière économique
L’enquête REPONSE donne un aperçu de l’information diffusée aux salariés et aux représentants du personnel dans les établissements de 11 salariés et plus du secteur marchand non agricole, selon les représentants des directions, les représentants du personnel et les salariés interrogés.
D’après les directions, dans neuf établissements sur dix, l'information sur « les stratégies et les orientations de l'entreprise » (ou le cas échéant du groupe), ainsi que celle sur la « situation économique de l'entreprise » est diffusée à l'ensemble des salariés (cf. figure 36). Cependant cette pratique reste occasionnelle dans les deux tiers des cas. Dans presque autant d'établissements (89%) et dans huit établissements sur dix, les salariés seraient informés respectivement des « perspectives d'évolution de l'emploi » ou de « l’évolution des salaires dans leur établissement ». Ces dernières informations seraient diffusées un peu plus régulièrement.
Figure 36 : Fréquence de la diffusion de l’information économique et sociale à l’ensemble des salariés
En % d’établissements |
occasionnellement |
régulièrement |
jamais |
Les stratégies et orientations de l’entreprise ou du groupe |
63 |
28 |
9 |
La situation économique de l’entreprise |
63 |
27 |
10 |
L’impact social et environnemental de l’activité de votre entreprise |
45 |
35 |
20 |
Les perspectives d’évolution de l’emploi dans l'établissement (ou entreprise) |
55 |
34 |
11 |
L’évolution des salaires dans l’entreprise |
50 |
31 |
19 |
Les possibilités de formation |
72 |
24 |
4 |
Les perspectives de changements technologiques ou organisationnels |
48 |
38 |
14 |
Source : REPONSE 2010-2011, DARES – Questionnaire « représentants des directions »
Champ : établissements de 11 salariés et plus du secteur marchand non agricole y c. associations 1901
Interrogés sur les activités des instances représentatives dans leur établissement et/ ou entreprise, les représentants du personnel (RP) se sont entre autre exprimés sur la place de « l'information économique générale sur l'entreprise », ainsi que sur celle de l'information et de la consultation sur les décisions d'investissement ou sur les effectifs (cf. figure 40). Alors que l'information économique et celle sur les effectifs sont qualifiées « de très ou assez importantes » dans l'activité des CE (instances analogues ou DUP) des deux tiers des établissements qui en sont dotés, cette instance est un peu moins souvent informée et consultée sur les « décisions d'investissement » (51% des établissements ayant un CE).
Figure 37 : Importance dans l’activité du Comité d’Entreprise (instance analogue ou DUP),
de différents thèmes d’information selon les représentants du personnel
En % d’établissements |
Très ou assez important |
Peu ou pas important |
Sans objet ou pas d'information |
L’information économique générale sur l’entreprise |
77 |
20 |
2 |
L’information et la consultation sur les décisions d’investissements |
51 |
42 |
7 |
L’information et la consultation sur les effectifs |
74 |
22 |
4 |
L’information et la consultation sur la formation professionnelle |
69 |
27 |
4 |
L’information et la consultation sur les changements technologiques et les innovations organisationnelles |
55 |
39 |
5 |
La négociation/gestion de l’épargne salariale |
52 |
30 |
19 |
La négociation sur d’autres thèmes |
55 |
30 |
16 |
La gestion des activités sociales et culturelles |
78 |
19 |
4 |
Source : REPONSE 2010-2011, DARES – Questionnaire « représentants du personnel »
Champ : établissements de 11 salariés et plus du secteur marchand non agricole y c. associations 1901 dotés de CE, ou instance analogue ou DUP
Dans près de la moitié des établissements où un RP a pu être interrogé, l'information qu’en 2010 la direction a fourni aux représentants du personnel en matière de « stratégie et orientations de l’entreprise » ou « d'évolution de l'emploi » est considérée « insatisfaisante ou inexistante » (cf. figure 38). En revanche celle sur la situation économique de l'entreprise est jugée « satisfaisante » dans une majorité d'établissements (61%).
Figure 38 : Qualité de l’information fournie en 2010 par la direction aux représentants du personnel,
selon les RP interrogés
En % d’établissements |
Satisfaisante |
Insatisfaisante |
Inexistante |
NSP* |
Les stratégies et orientations de l’entreprise ou du groupe |
52 |
30 |
18 |
1 |
La situation économique de l’entreprise |
61 |
26 |
13 |
0 |
L’impact social et environnemental de l’activité de l’entreprise |
52 |
21 |
25 |
2 |
Les perspectives d’évolution de l’emploi |
45 |
29 |
24 |
1 |
Les évolutions de salaires |
30 |
41 |
29 |
1 |
Les possibilités de formation |
61 |
27 |
12 |
0 |
Les perspectives de changements technologiques ou organisationnels |
47 |
27 |
24 |
2 |
Source : REPONSE 2010-2011, DARES - Questionnaire « représentants du personnel »
Champ : établissements de 11 salariés et plus du secteur marchand non agricole y c. associations 1901
*Ne se prononce pas.
Par ailleurs, dans plus d'un tiers des établissements dotés de CE (d'une instance analogue ou d'une DUP), l’information économique sur l’établissement ou l’entreprise suscite le recours de cette instance à des experts extérieurs au moins une fois dans les trois ans qui précèdent l’enquête (cf. figure 39).
Figure 39 : Recours par le Comité d’Entreprise (instance analogue ou DUP) à des experts extérieurs,
au cours de la période 2008- 2010
En % d’établissements |
|
Plusieurs fois |
22 |
Une fois |
12 |
Jamais |
60 |
Ne se prononce pas |
6 |
Source : REPONSE 2010-2011, DARES - Questionnaire « représentants du personnel »
Champ : établissements de 11 salariés et plus du secteur marchand non agricole y c. associations 1901 dotés de CE, ou instance analogue ou DUP
Enfin, les salariés se considèrent un peu plus souvent « bien informés » sur les « salaires, primes, classifications » (51%) que sur l'emploi (45%). Ce dernier vient d’ailleurs en dernière position après le temps de travail, les salaires, les conditions de travail et les possibilités de formation (cf. figure 40).
Figure 40 : Proportion de salariés qui considèrent avoir été bien informés de la situation dans leur établissement en 2010, par l’encadrement, les représentants du personnel ou des collègues
|
OUI |
NON |
NSP |
Salaires, primes classifications |
51 |
40 |
9 |
Temps de travail (durée, aménagement...) |
58 |
30 |
12 |
Emploi (embauche, licenciement, préretraite, etc.) |
45 |
40 |
15 |
Conditions de travail |
51 |
37 |
12 |
Possibilité de suivre une formation |
49 |
39 |
12 |
Source : REPONSE 2010-2011, DARES - Questionnaire auto-administré salariés
Champ : salariés des établissements de 11 salariés et plus ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 12 mois
6.2. Les accords sur la GPEC
Depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés, ainsi que les entreprises ou les groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement de 150 salariés en France, sont soumis à l’obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
La GPEC est une démarche anticipative et préventive pour ajuster dans la durée en fonction des mutations de l’environnement et des choix de stratégie, les besoins de l’entreprise et ses ressources humaines. C’est une démarche permanente, marquée par des rendez-vous périodiques dans ses deux dimensions collective et individuelle.
Elle doit être dissociée des procédures de licenciement pour motif économique comme l’article 9 de l'ANI du 11 janvier 2008 sur la Modernisation du Marché du travail l’indique : « En tant que démarche globale d'anticipation, la GPEC doit être entièrement dissociée de la gestion des procédures de licenciement collectif et des PSE ».
Selon l’enquête REPONSE, un tiers des établissements de 11 salariés et plus ont connu une négociation sur le thème de la GPEC sur la période 2008-2010. Cette proportion varie selon la taille de l’entreprise : 19% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 35% pour les entreprises de 50 à 299 salariés, et 71% pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Sur les 5 000 entreprises ayant engagé des négociations, 3 000 ont signé des accords sur la période 2005-2011.
6.3. L’absence d’obligation et de candidatures sont les principales raisons de l’absence de toute instance élue du personnel dans les établissements.
Selon l’enquête REPONSE 2010-2011, quatre établissements sur dix de 11 salariés et plus déclarent n’avoir aucune instance représentative du personnel (IRP) élue. Il s’agit, dans la presque totalité, de structures de moins de 50 salariés (63 % ont moins de 20 salariés et 35 % ont entre 20 et 49 salariés).
Selon les directions de la moitié de ces établissements (49%), l’absence de toute instance élue (DP, CE ou DU) s’expliquerait principalement par des problèmes de carence de candidatures à l’occasion des dernières élections professionnelles. Un peu plus d’un tiers déclare que l’établissement n’est pas assujetti à l’obligation d’organiser des élections professionnelles et 14 % « qu’aucune élection n’a été organisée » dans l’établissement.
L’absence de salariés prêts à endosser le rôle de représentant de personnel est plus souvent évoquée dans les entreprises mono-établissements de 20 à 49 salariés (65 %) que dans des établissements de même taille appartenant à des entreprises plus larges (54%).
Les deux tiers des établissements industriels dépourvus d’IRP élue évoquent des problèmes de carence de candidatures. À l’opposé, les établissements des services sans IRP élue se considèrent plus souvent non soumis à l’obligation d’organiser des élections. Des effectifs importants mais à temps partiel, plus fréquents dans les activités de service que dans les activités industrielles peuvent aussi justifier l’absence d’élections professionnelles dans ces établissements. Du fait des modalités de calcul des effectifs déterminant l’obligation, pour les établissements et les entreprises, d’organiser des élections professionnelles, un décalage peut exister entre nombre de salariés en personnes physiques à une date donnée et celui des effectifs en équivalent temps plein, mesure associée au seuil de l’obligation15.
Par ailleurs, le degré d’autonomie dans la gestion de l’activité et du personnel ainsi que dans l’organisation du travail (« établissement distinct ou non »), constitue un critère décisif pour déterminer si des établissements appartenant à des entreprises multi-établissements doivent ou non organiser des élections professionnelles (DP et CE ou DUP).
Section 2 - Un marché du travail qui génère une précarité croissante des parcours professionnels
Au cours des 30 dernières années, le développement des contrats courts s’est accompagné d’une augmentation tendancielle de la mobilité sur le marché du travail, touchant en premier lieu les jeunes, les non qualifiés et les peu diplômés. Ces évolutions sont généralement interprétées comme le signe d’un dualisme accru du marché du travail français. La notion de dualisme ou de segmentation du marché du travail renvoie en effet à une représentation du marché du travail dans lequel coexisteraient un marché « primaire » caractérisé par des salaires élevés, des perspectives de carrière et des conditions d’emploi favorables, et un marché « secondaire » aux caractéristiques inverses (précarité des emplois et faibles rémunérations en particulier).
Si la précarité de l’emploi s’est accrue depuis le début des années 80, elle consiste surtout ces dernières années en un raccourcissement de la durée des contrats. Cette précarité est en proportion plus importante dans les petites entreprises. Elle semble propre à un nombre limité de secteurs où le turn-over est particulièrement élevé tant sur des contrats précaires, souvent très courts, que sur des CDI rompus rapidement.
1.1. La part des « formes particulières d’emploi » 16 a doublé en 30 ans
Le recours aux formes précaires d’emploi s’est considérablement développé ces dernières décennies, offrant certainement plus de souplesse aux entreprises mais entraînant concomitamment une plus grande précarité pour les actifs sur lesquels pèse l’ajustement.
Entre 2000 et 2010, le nombre total de déclarations d’embauche, hors intérim, a progressé de 42 %. Cette hausse est tirée par la forte croissance des contrats de moins d’un mois (+ 88 %, cf. figure 41) et notamment celle des CDD de moins d’une semaine (+120 %). A contrario, les embauches de plus d’un mois (CDD et CDI) diminuent de 1,7% sur dix ans.
Figure 41 : Evolution du nombre de déclarations d’embauche et de l’emploi salarié
entre 2000 et 2011 (base 100 en 2000)
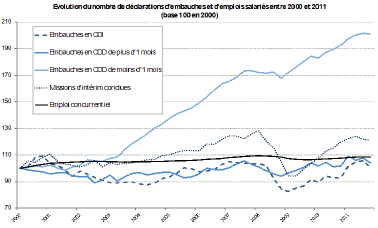
Source : Acoss-Urssaf, Pôle emploi.
.
La forte augmentation des embauches en CDD de moins d’un mois s’observe principalement dans le tertiaire et plus particulièrement dans les secteurs autorisés par la loi à conclure des contrats « d’usage », qui bénéficient d’un régime dérogatoire (ni durée maximale, ni délai de carence, ni indemnité de précarité).
Ainsi depuis 2000, la part des CDI dans les embauches est passée de 30 à 20%.
La part des « formes particulières d’emploi » a doublé en 30 ans, de 6% de l’emploi salarié en 1982 à 12% en 2011 (cf. figure 42). Ce phénomène est particulièrement sensible chez les jeunes actifs : moins d’un jeune en emploi sur deux occupe un CDI en 2010 contre plus de 3 sur 4 en 1982.
...tous âges confondus |
...chez les 15-24 ans |
Source : Insee, Enquête emploi en continue, 1982-2011.
Cette précarité accrue, qui touche une faible part des salariés – en 2010, 2% des personnes embauchées concentrent près d’un tiers des embauches hors intérim –, a de multiples conséquences pour ceux-ci :
- ils connaissent plus fréquemment des périodes de chômage avec les risques de déqualification inhérents ;
- en sus d’un revenu généralement plus faible17 et moins régulier, ils accumulent moins de droits à retraite ;
- cette précarité empêche de se projeter dans l’avenir et de construire des projets de vie, notamment par l’impossibilité d’accéder à un logement, de subvenir aux besoins d’une famille ou encore d’obtenir des crédits auprès des banques.
Le coût de cette souplesse pour les entreprises repose sur la collectivité à de multiples égards :
- sur le régime d’assurance chômage : de l’ordre d’un tiers des volumes d’allocations versées bénéficient à des inscrits suite à une fins de CDD et d’une mission d’intérim quand ces types d’emploi ne représentent que 8% des contributions versées ;
- sur les régimes de solidarité (RSA, ASS, Minimum vieillesse,…).
1.1.1. Une précarité plus fréquente dans les petites entreprises
La part des « formes particulières d’emploi » est décroissante avec la taille de l’entreprise (cf. figure 43). Elle passe ainsi de 17% dans les TPE à moins de 10% dans les entreprises de plus de 200 salariés. Ce constat est observé dans tous les secteurs (cf. figure 44).
Figure 43 : Part des contrats courts dans l'emploi salarié par taille d'entreprise
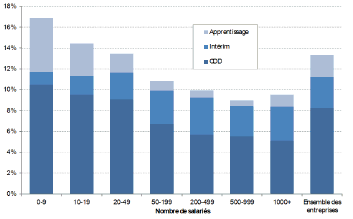
Source : Enquête emploi 2011, calculs Dares.
Figure 44 : Part des contrats courts (CDD, intérim et apprentissage) dans l'emploi salarié
en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise
|
0-9 |
10-19 |
20-49 |
50-199 |
200-499 |
500-999 |
1000+ |
Ensemble des entreprises |
Agriculture |
23,1% |
31,8% |
21,9% |
21,4% |
20,2% |
25,8% | ||
Industrie |
17,0% |
11,1% |
10,3% |
11,1% |
10,8% |
10,5% |
10,1% |
12,2% |
Construction |
17,6% |
15,3% |
13,7% |
11,4% |
11,7% |
8,2% |
12,3% |
16,3% |
Tertiaire |
16,1% |
14,3% |
13,9% |
10,5% |
9,1% |
8,3% |
9,1% |
12,8% |
Ensemble des secteurs |
16,9% |
14,4% |
13,5% |
10,8% |
9,9% |
9,0% |
9,5% |
13,3% |
Source : Enquête emploi 2011, calculs Dares.
1.1.2. Spécificités sectorielles : un recours important aux contrats courts concentré sur un nombre limité de secteurs.
Les secteurs d’activité présentent une forte hétérogénéité dans le recours aux contrats courts (cf. figure 45). L’industrie et le tertiaire présentent un niveau équivalent (12,2% et 12,8%) mais se distinguent par la répartition entre CDD et intérim (50/50 contre 90/10).
Les secteurs recourant le plus aux contrats courts sont essentiellement : l’agroalimentaire (18%), la construction (16%), l’hôtellerie restauration (18%) et les autres activités de services18 (20%).
Figure 45 : Part des contrats courts dans l'emploi salarié en fonction du secteur
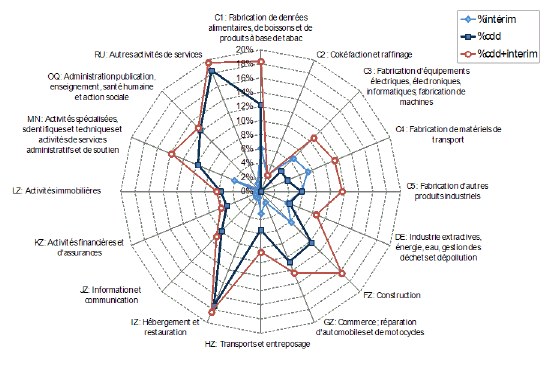
Source : Enquête emploi 2011, calculs Dares. NB : Les CDD incluent l’apprentissage.
Champ : Actifs occupés BIT salariés du privé, des entreprises publiques et intérimaires dans le secteur utilisateur. France métropolitaine.
1.1.3. Durée des contrats échus : les contrats très courts sont concentrés dans un nombre restreint de secteurs
L’approche par durée des contrats échus montre logiquement une nette différenciation entre contrats courts et CDI : si 30% des CDI rompus en 2011 avaient été conclus moins de 6 mois auparavant, cette part atteint 90% s’agissant des CDD19.
Figure 46 : Répartition des durées des contrats échus en 2011 … | |
… en CDD et apprentissage |
… en CDI |
|
|
Source : Enquêtes DMMO et EMMO – Calculs Dares
Champ : Etablissements du secteur concurrentiel (hors agriculture) en France métropolitaine.
Les DMMO/EMMO ne permettent pas de recenser tous les CDD de moins de 1 mois dont la déclaration n'est pas obligatoire.
Tout comme le taux de recours, l’embauche de salariés en contrats très courts est essentiellement le fait d’un petit nombre de secteurs. Ainsi, 6 secteurs sur une décomposition en 16 secteurs (cf. figure 47), où la part des CDD très courts (moins de 3 mois) est la plus importante, représentent à eux seuls près de 90% des CDD rompus en 2011.
Figure 47 : Classement des secteurs selon la part des CDD très courts en 2011
Rang |
Secteur |
Part des CDD de moins de 3 mois |
Part cumulée des secteurs dans les CDD rompus |
Part du secteur dans l’emploi marchand |
1 |
Information et communication |
91% |
4,4% |
3,9% |
2 |
Administration publique, santé et action sociale |
89% |
30,0% |
10,7% |
3 |
Autres activités de services |
89% |
44,2% |
7,4% |
4 |
Activités spécialisées et activités de services administratifs |
86% |
62,7% |
16,3% |
5 |
Hébergement et restauration |
83% |
73,5% |
5,3% |
6 |
Commerce ; réparation de véhicules |
82% |
88,1% |
16,7% |
Source : Enquêtes DMMO et EMMO – Calculs Dares
Lecture : Le secteur HCR, qui représente 5,3% de l’emploi marchand, est le 5ème secteur le plus utilisateur en CDD très courts puisque 83% des CDD échus en 2011 y avaient été conclus pour moins de 3 mois. Ces 5 secteurs les plus utilisateurs ont signé 73,5% des CDD échus en 2011, alors qu’ils n’emploient que 60% des salariés du secteur marchand.
Certains secteurs, souvent les mêmes (cf. figure 48), pratiquent également un recours aux CDI pour une courte durée. C’est notamment le cas du secteur HCR où 40% des CDI, rompus20 en 2011, auront duré moins de 3 mois.
Figure 48 : Classement des secteurs selon la part des CDI rompus très rapidement
Rang |
Secteur |
Part des CDI de moins de 6 mois |
Part cumulée des secteurs dans les CDI rompus en 2011 |
Part du secteur dans l’emploi marchand en 2011 |
1 |
Hébergement et restauration |
51% |
13% |
5,3% |
2 |
Activités immobilières |
31% |
15% |
1,3% |
3 |
Activités spécialisées et activités de services administratifs |
29% |
33% |
16,3% |
4 |
Commerce ; réparation de véhicules |
27% |
53% |
16,7% |
5 |
Fabrication de denrées alimentaires |
27% |
56% |
3,0% |
6 |
Autres activités de services |
26% |
60% |
7,4% |
Source : Enquêtes DMMO et EMMO – Calculs Dares
Lecture : Le secteur HCR est le secteur le plus utilisateur en CDI très courts puisque 51% des CDI rompus en 2011 y avaient duré moins de 6 mois. Ce secteur a signé 13% des CDI rompus en 2011 quand il ne représente que 5% de l’emploi marchand.
a) Le développement des contrats d’usage (CDDU)
Une ordonnance de 1982 a reconnu la possibilité de conclure des CDD dérogeant au droit commun21 :
L. 1242-2 (3°) : « Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Ces CDD d’usage sont exonérés du versement de l’indemnité de précarité (10% des salaires versés), du délai de carence entre deux contrats sur un même poste et de la limitation du nombre de renouvellements.
Près d’une trentaine de secteurs sont concernés définis pour moitié par voie législative et pour moitié par voie conventionnelle.
En 2011, le nombre de salariés en CDD dans les secteurs éligibles au CDD d’usage était de l’ordre de 300 000, soit 16% des salariés de ces secteurs.
Au total, il est possible d’estimer qu’un CDD sur 5 est signé dans un secteur autorisant le recours aux CDD d’usage.
Les secteurs les plus utilisateurs en termes relatifs sont : « spectacles, action culturelle et activités foraines » (taux de recours au CDD de 52 %), « activité d’IAE exercé par des associations intermédiaires » (44 %), « audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique », « sport professionnel » et « convention collective des métiers de l’animation commerciale et de l’accueil » (30 % pour chacun).
Les secteurs les plus utilisateurs en termes absolus sont : « l’hôtellerie restauration » (110 000 CDD), « l’enseignement » (70 000 CDD), « spectacles, action culturelle et activités foraines » (40 000 CDD), « audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique » (30 000 CDD).
Ce type de contrat est en développement constant depuis le début des années 2000, lorsque la jurisprudence a limité les risques de requalification en CDI. Sur les 17 millions de déclarations d’embauche en CDD enregistrées en 2011, la moitié l’ont été dans des secteurs recourant aux CDD d’usage. En 2000 et 2011, la quasi-totalité de la hausse du nombre de CDD correspond à des CDD de moins d’un mois, dont près de 60% sont des CDD d’usage.
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale, aux durées conventionnelles ou à celles pratiquées dans l'entreprise.
L’emploi à temps partiel s’est diffusé largement en France entre les années 1980 et 2000. Après cette phase d’essor, il a connu une baisse entre 1999 et 2002 (cf. figure 49). Il a légèrement progressé sur la dernière décennie. Il s’est ainsi replié en 2008 au début de la crise (17,2 %22 après 17,7 % en 2007), avant de se redresser à nouveau à partir de 2009. En 2011, il atteint 18,7 %.
Figure 49 : Taux de temps partiel entre 1982 et 2011
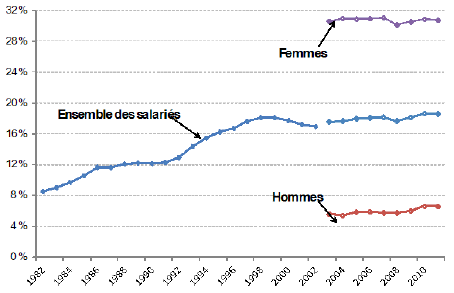
Champ : ensemble des salariés ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi annuelles jusqu'en 2002 (EEA) et en continue au-delà (EEC) d’où la rupture de série en 2003; calculs Dares.
En France comme ailleurs en Europe, les salariés à temps partiel sont très majoritairement des femmes (82 %). En 2011, 31 % des femmes et moins de 7 % des hommes occupaient un emploi à temps réduit.
2.1. Les statuts d’emploi, les secteurs d’activité
Des emplois plus précaires et moins qualifiés que les temps complets
79 % des contrats de travail à temps partiel sont à durée indéterminée, contre 88 % pour l’ensemble des emplois salariés. Alors qu’en 2011, 11 % de l’ensemble des emplois salariés étaient des contrats à durée déterminée ou des missions d’intérim, c’était le cas de 17 % des emplois salariés à temps partiel. Il en est de même pour les contrats aidés, souvent à durée déterminée, qui représentent 4 % de l’emploi à temps partiel contre 1 % de l’emploi total.
Les salariés à temps partiel sont très majoritairement des employés (55 %) alors que ceux-ci représentent moins d’un tiers de l’emploi total. En 2011, près d’un employé sur trois est à temps partiel ; cette proportion, est même de l’ordre de la moitié pour les employés des services directs aux particuliers.
Un peu plus de 24 heures hebdomadaires en moyenne, avec la multi-activité
Dans leur emploi principal, les salariés à temps partiel travaillent en moyenne 23,2 heures par semaine en 2011, soit les deux tiers de la durée légale des salariés à temps complet. Un quart connaît une durée égale ou inférieure à 18 heures et un autre travaille 30 heures et plus, la durée médiane s’établissant à 24 heures.
Pour compenser la durée du travail de leur emploi principal qu’ils jugent insuffisante, 16,5 % des salariés à temps partiel occupent un ou plusieurs autres emplois, soit en exerçant la même profession chez un autre employeur, soit en exerçant une profession différente. Ce sont dans les emplois de personnels de services aux particuliers que ces situations de multi-activité sont les plus fréquentes (près de la moitié des salariés). De même, bien que dans une moindre mesure, les agents du nettoyage travaillant en entreprise et les salariés relevant des activités récréatives, culturelles et sportives ont aussi plusieurs employeurs.
Alors que les salariés mono-actifs effectuent 23,9 heures de travail hebdomadaire dans leur emploi principal, les multi-actifs en réalisent moins de 20. Mais, ces derniers travaillent en moyenne au moins 27 heures par semaine toutes activités confondues23. Au total, les salariés à temps partiel travailleraient au moins 24,4 heures en moyenne, en prenant en compte la multi-activité.
9 salariés à temps partiel sur 10 dans le secteur tertiaire
Le temps partiel est plus largement diffusé dans le secteur tertiaire (22 % des emplois) que dans l’industrie (7 %) et la construction (5 %). Le tertiaire regroupe ainsi 92 % des salariés à temps partiel contre 78 % de l’ensemble des salariés. C’est également dans ce secteur que le temps partiel est le plus féminisé.
Les activités de services les plus utilisatrices de ce type d’emploi sont l’hébergement et la restauration, l’éducation, la santé et l’action sociale, le commerce, et surtout les aides à domicile et les services domestiques. L’activité salariée à temps partiel est ainsi fortement développée chez les particuliers employeurs (52 %), ainsi que dans les collectivités locales (26 %).
2.2. Les motifs de l’emploi à temps partiel
Près d’un temps partiel sur trois « faute de mieux »
37 % des hommes et 31 % des femmes déclarent travailler à temps partiel parce qu'ils n’ont pas trouvé d’emploi à temps complet. Cette forme de temps partiel « subi » est beaucoup plus représentée dans les emplois peu qualifiés (employés de particuliers mais aussi ouvriers non qualifiés, employés de la fonction publique, employés de commerce). Alors que les salariés à temps partiel de l’État et des hôpitaux publics connaissent relativement peu le temps partiel subi, ils sont relativement nombreux parmi les salariés des collectivités locales (37 %), ainsi que des particuliers employeurs (39 %).
Les salariés, ne parvenant pas à trouver un emploi à temps complet, occupent des emplois dont la durée hebdomadaire moyenne est inférieure à celle des salariés qui sont à temps partiel pour d’autres raisons : 22 heures en moyenne contre 24 heures pour les autres. Logiquement, les salariés à temps partiel - faute d’emploi à temps complet - sont de fait plus nombreux à déclarer qu’ils travaillent moins que ce qu’ils souhaiteraient : 60 % d’entre eux souhaitent travailler davantage (contre 27 % en moyenne).
Des raisons différentes pour les femmes et les hommes
Les raisons qui incitent à travailler à temps partiel varient fortement en fonction du genre. Ainsi, 18 % des hommes déclarent le faire pour exercer une autre activité professionnelle ou pour suivre des études ou une formation, contre seulement 7 % des femmes.
À l'inverse, 34 % des femmes – et à peine 7 % des hommes – disent travailler à temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents.
2.3. La rémunération des salariés à temps partiel
La moitié des salariés à temps partiel ont un salaire net inférieur à 850 € par mois
En 2011, la moitié des salariés à temps partiel déclarait percevoir un salaire mensuel net, primes et compléments compris, inférieur à 850 € par mois. Le salaire mensuel net moyen des salariés à temps partiel est de 996 € par mois contre 1 995 € pour ceux à temps complet. Les salaires des temps partiels sont par ailleurs beaucoup plus dispersés que ceux des salariés à temps complet. Cette plus forte dispersion tient surtout à des durées hebdomadaires du travail moins homogènes.
La faiblesse des salaires à temps partiel est liée aux faibles durées (23,2 heures par semaine) et au type d’emploi, le temps partiel étant particulièrement répandu dans des emplois peu qualifiés et dans des professions à faibles rémunérations : nettoyage, aide à domicile, commerce. La moitié des salariés à temps partiel subi gagnent moins de 713 € et leur salaire moyen est à peine supérieur aux deux-tiers de celui des autres personnes à temps partiel.
Plus d’un quart des salariés à temps partiel des entreprises sont rémunérés sur la base du SMIC horaire
D’après les déclarations des employeurs à l’enquête Acemo, au 1er janvier 2011, 25 % des salariés à temps partiel des entreprises du secteur marchand non agricole sont rémunérés sur la base du SMIC horaire (contre 10,6 % de l’ensemble des salariés de ces entreprises).
Les salariés à temps partiel ont un salaire horaire plus faible que celui des temps complets. En moyenne, en 2011, le salaire horaire des salariés à temps partiel se situerait aux alentours de 1,3 SMIC, contre 1,8 SMIC pour les salariés à temps complet.
Section 3 - Un marché du travail qui n’offre pas une protection suffisante à ces parcours heurtés
1.1. Encore trop de salariés n’ont pas accès à une complémentaire d’entreprise
Si l’assurance maladie obligatoire constitue toujours le pilier fondamental en matière d’accès aux soins, la place de la couverture complémentaire s’est progressivement accrue, en particulier pour certains soins tels que l’optique, les prothèses dentaires ou auditives.
Or pour ceux des assurés qui ne bénéficient pas de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l’absence ou l’insuffisance d’assurance complémentaire est un facteur significatif de renoncement aux soins. Environ 15% de la population adulte déclarait avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois en 2008 pour des raisons financières, les plus concernés étant les soins dentaires (10 %) et, dans une moindre mesure, l’optique (4,1 %)24.
La couverture collective organisée au niveau des branches ou des entreprises représente un levier réel pour favoriser l’accès de tous les salariés à une complémentaire santé. D’une part, elle permet au salarié de bénéficier du cofinancement de l’employeur, dans le cadre d’un régime d’exonération de cotisations sociales et de déductibilité fiscale avantageux25. D’autre part, le cadre collectif de la couverture a pour avantage d’organiser une mutualisation du risque, à une échelle particulièrement large s’agissant des accords de branche, qui favorise l’accès de tous à une couverture à meilleur coût, quel que soit leur situation de santé ou leur âge.
Pourtant, malgré son développement (ainsi, le nombre de régimes de branche a doublé en 5 ans et dépasse aujourd’hui la cinquantaine) cette couverture complémentaire collective est loin d’être généralisée. Aujourd’hui, près d’un quart des salariés déclarent ne pas avoir accès à une couverture collective proposée au niveau de leur branche ou de leur entreprise26. Pour n’évoquer que la couverture de branche, seules 34 des 145 plus grandes branches en termes d'effectif ont défini un régime santé pour tout ou partie de leurs salariés27, ce qui représente 3 millions de salariés sur les 10 millions de salariés concernés.
Lorsqu’ils ne sont pas couverts par le biais de leur branche ou de leur entreprise, les salariés peuvent l’être en tant qu’ayant droit au titre de la couverture de branche ou d’entreprise de leur conjoint (10,6 % des salariés déclarent être dans ce cas), ou de la couverture de leur conjoint fonctionnaire (3,7 %). Dans les autres cas, les salariés souscrivent une assurance individuelle ou renoncent à toute couverture complémentaire (cf. figure 50).
Figure 50 : Nature et origine de la complémentaire santé des salariés
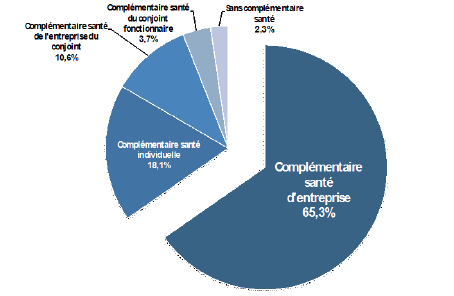
Source : DSS/6C à partir de l’enquête PSCE 2009 de l’IRDES
En outre, cette couverture demeure inéquitablement répartie. Elle concerne ainsi moins souvent :
- les salariés non-cadres et ceux à bas revenus (seuls 55 % des salariés ayant un salaire mensuel net entre 1 065 € et 1 468 € ont accès à une couverture complémentaire au titre de leur entreprise ou de leur branche, contre respectivement 70 % et 80 % parmi ceux ayant un salaire mensuel net entre 1 469 € et 1 941 € et entre 1 942 € et 2 763 €) ;
- les salariés à temps partiel (51% contre 68% pour les salariés à temps complet) ou en CDD (25% contre 66% pour les CDI) ;
- les salariés des TPE/PME, pour lesquelles, à défaut de mutualisation dans le cadre de la branche (à l’exemple des secteurs de la boulangerie, des hôtels, cafés, restaurants, ou de l’aide à domicile), les coûts d’adhésion et les tarifs potentiellement plus élevés constituent des obstacles importants.
1.2. Un maintien encore relativement limité de la couverture santé collective aux salariés ayant perdu leur emploi
Un mécanisme de « portabilité » de la couverture santé et prévoyance a été mis en œuvre par les partenaires sociaux par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant n°3 conclu le 18 mai 2009.
Ce mécanisme prévoit, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, le maintien des droits à la couverture santé et prévoyance dont bénéficient les salariés de l’entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. Il a donc pour objectif d’éviter une rupture de droits entre le moment où il est mis fin au contrat et celui où le salarié concerné reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
Le financement de la garantie est assuré, soit par l’employeur et l’ancien salarié selon la répartition applicable avant la rupture du contrat de travail, soit de manière mutualisée (donc sans cotisation de l’ancien salarié) mais seulement si l’accord de branche ou l’accord d’entreprise le prévoit.
2. Un système d’assurance chômage qui appréhende encore imparfaitement l’alternance entre emploi et chômage
Les règles de l’assurance chômage ont été ajustées aux évolutions du marché de l’emploi au cours des 30 dernières années notamment pour tenir compte de l’accroissement substantiel des contrats à durée déterminée depuis 1982.
Ainsi, après des phases expérimentales, ont été instaurées des règles de cumul d’allocations et de salaires pour inciter à la reprise d’emploi. Dans la même perspective, une règlementation particulière a été mise en place pour les travailleurs intermittents (contrats de travail temporaires et CDD d’usage). Ces mesures qui visent à faciliter l’insertion ou le retour à l’emploi en permettant aux bénéficiaires de maintenir un contact avec le marché du travail concernent près de la moitié des allocataires de l’assurance chômage.
Ainsi les dispositions du règlement général conçues initialement sur le paradigme d’une carrière linéaire ont été adaptées dans le cadre de ces interventions.
2.1. Les prestations dans le cadre du régime général
Après la rupture involontaire de son contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, démission légitime), un salarié est indemnisable par l’assurance chômage s’il a cotisé au moins 4 mois au cours des 28 mois précédents.
La durée des droits est calculée selon la règle « 1 jour cotisé = 1 jour indemnisé ». Autrement dit, le nombre de jours travaillés au cours des 28 derniers mois ouvre droit à autant de jours d’indemnisation dans la limite de 2 ans (3 ans pour les 50 ans et plus).
Le montant de l’indemnité est calculé par l’application d’un taux de remplacement au salaire antérieur (moyenne des 12 derniers mois travaillés). Ce taux brut est de 57,4% de droit commun et plus favorable pour les bas salaires (plafonné à 75%). Le taux de remplacement net après impôt est plus logiquement élevé : de l’ordre de 85% au niveau du Smic et proche de 70% pour les salaires au-delà de 1,5 Smic.
L’indemnité mensuelle est aujourd’hui plafonnée à 6 600€ (brut), car les contributions d’assurance chômage ne s’appliquent que sur la partie des salaires inférieure à un montant équivalent à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 344 € au 1er janvier 2013.
Encadré 1 : Illustrations - Un jeune diplômé, dont le premier contrat est un CDI rompu par l’employeur au bout de 2 mois au cours de la période d’essai, ne sera pas indemnisable. - Un salarié n’ayant travaillé que 6 mois en CDD au Smic à temps plein (1 426 € brut par mois) au cours des 28 derniers mois se verra ouvrir un droit à indemnisation de 6 mois à hauteur de 920 € brut par mois (65% de son ancien salaire). - Un salarié ayant travaillé 4 ans avec un salaire de 2500 € brut mensuel bénéficiera d’une allocation de 1435 € pendant 24 mois (57,4% de son ancien salaire brut). - Un salarié senior signant une rupture conventionnelle à 59 ans, après 30 ans de carrière, rémunéré à 3 Smic par mois (4 280 € brut) la dernière année, se verra ouvrir un droit à indemnisation de 3 ans à hauteur de 2 442 € brut par mois. |
À la fin des droits, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) peut prendre le relais28. Versée sous condition de ressource et différentielle, son montant de base est de 470€.
2.2. Reprise de droit et réadmission dans le régime général
Lorsqu’après avoir repris un emploi, un demandeur d’emploi se retrouve à nouveau au chômage, il y a trois configurations possibles :
- Les droits de la première indemnisation sont épuisés : sont comptabilisées, pour l’admission et le calcul des droits éventuels, les périodes d’activité postérieures à la précédente indemnisation suivant la règle de droit commun.
- S’il lui restait un reliquat de droit de la 1ère indemnisation et que l’emploi repris ne lui a pas ouvert de nouveau droit (durée inférieure à 4 mois), il s’agit d’une reprise de droit : l’indemnisation reprend là où elle s’était interrompue. La période d’activité non prise en compte pourra l’être ultérieurement, si elle se cumule à une autre pour atteindre plus de 4 mois.
- S’il lui restait un reliquat de droit à indemnisation et que l’emploi repris lui a ouvert de nouveaux droits (durée supérieure à 4 mois), il s’agit d’une réadmission. Pôle emploi procède à une comparaison entre le nouveau droit et le reliquat, retient le montant global29 le plus important et lui verse l’indemnisation journalière la plus élevée. Toutes les périodes d’activité prises en compte dans cette comparaison ne pourront plus ouvrir de droits ultérieurement. Il y a donc bien dans ce cas des périodes cotisées qui n’ouvriront pas de droits.
Encadré 2 : Illustrations - Un salarié en fin de droits, indemnisé à l’ASS, se voit proposer un contrat aidé de 6 mois. À l’issu de celui-ci, il se réinscrit à Pôle emploi et bénéficie d’un nouveau droit à indemnisation de 6 mois. - Après 10 ans au sein de la même entreprise, un salarié est licencié et se voit ouvrir un droit à indemnisation de 24 mois. Après un an de recherche infructueuse, il décroche un CDD de trois mois qui n’est pas reconduit. Cette courte période d’activité ne lui permet pas d’ouvrir un nouveau droit, il effectue une reprise de droit en se réinscrivant à Pôle emploi et bénéficie de son reliquat de 12 mois d’indemnisation. Ces 3 mois pourront être pris en compte plus tard, en complément d’une nouvelle période travaillée. - Un autre demandeur d’emploi dans la même situation a lui décroché un CDD de 6 mois, moins bien rémunéré que son emploi initial. À sa réinscription, il dispose d’un reliquat de droit (12 mois avec une indemnité haute) et d’un nouveau droit (6 mois avec une indemnité plus basse). Dans ce cas, il est réadmis avec son ancien droit, plus favorable, et le nouveau droit est effacé, les périodes d’activité ne seront pas comptabilisées ultérieurement. - Après 20 mois d’indemnisation, un demandeur d’emploi approche de la fin de ses droits. Il accepte un CDD de 8 mois, moins rémunéré que son emploi initial (75%). À l’issue, il se réinscrit et dispose d’un reliquat de droit (4 mois) et d’un nouveau droit (8 mois avec une indemnité moindre). Dans ce cas, il est réadmis avec un droit global à indemnisation correspondant à son nouveau droit mais avec l’ancienne indemnisation journalière, plus haute, et donc une durée intermédiaire (6 mois). Les périodes d’activité ne seront plus comptabilisées ultérieurement. |
2.3. Les règles de reprise et de réadmission dans le cadre du régime propre aux intérimaires et du dispositif d’activité réduire
Le régime d’assurance chômage comporte des dispositions spécifiques pour des salariés qui travaillent de manière discontinue.
En outre, la mise en œuvre des règles de l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation et d’une rémunération (activité réduite), en principe, limite les réadmissions dans la mesure où le droit initial est servi pendant la durée de l’emploi reprise. Il en est de même des règles applicables aux travailleurs intérimaires.
2.4. Conséquence sur la « couverture » du régime
À peine plus de la moitié des demandeurs d’emploi sont indemnisables au titre de l’assurance chômage et près de 40% en bénéficient effectivement (cf. figure 51). Cette part s’améliore avec l’âge, ainsi la part des indemnisés passe de 36% chez les moins de 25 ans à 48% chez les 55 ans et plus. Au demeurant, les parts des demandeurs d’emploi ne bénéficiant d’aucune indemnisation et n’exerçant aucune activité est faible (640 000 personnes, soit 12 % du total)30. Ces derniers sont souvent des jeunes (40% ont moins de 30 ans) qui ne satisfont donc pas au critère d’éligibilité aux minima sociaux (25 ans pour le RSA, 5 ans d’activité pour l’ASS notamment).
Figure 51 : Répartition des demandeurs d'emploi en catégories A, B, C, D, E (indemnisables ou non) et dispensés de recherche d'emploi indemnisables suivant le statut au regard de l’indemnisation
Population totale |
Moins de 25 ans |
25 à 49 ans |
50 ans et plus |
dont 55 ans et plus | ||||||||
Total |
|
|
5 307 980 |
862 130 |
3 328 610 |
1 117 240 |
642 650 | |||||
Indemnisables par l'assurance chômage |
54% |
|
52% |
55% |
55% |
57% |
||||||
dont ARE |
|
51% |
49% |
51% |
52% |
55% |
||||||
|
Indemnisés |
|
39% |
36% |
38% |
44% |
48% | |||||
|
indemnisés sans activité réduite |
|
29% |
28% |
28% |
34% |
39% | |||||
|
indemnisés avec activité réduite |
|
10% |
7% |
10% |
10% |
9% | |||||
|
Non indemnisés |
|
12% |
13% |
13% |
9% |
7% | |||||
|
non indemnisés pour cause d'activité réduite |
|
10% |
10% |
11% |
6% |
5% | |||||
dont AREF |
|
1% |
3% |
1% |
0% |
0% |
||||||
dont CRP-CTP-CSP |
2% |
1% |
2% |
2% |
2% |
|||||||
Indemnisables par d'autres allocations |
9% |
|
2% |
8% |
20% |
24% |
||||||
Non indemnisables |
|
36% |
46% |
38% |
25% |
19% |
||||||
dont catégories ABC |
30% |
41% |
30% |
20% |
16% |
|||||||
dont catégories DE |
7% |
6% |
8% |
5% |
4% |
|||||||
Source : Données Pôle emploi (échantillon au 1/10ème du FHS) et Unédic (segment D3), Calcul Dares, France entière, effectifs au 30 septembre 2011.
Les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi reflètent logiquement leurs épisodes d’emploi passés. Parmi les « nouveaux droits » ouverts à l’ARE (entrées sans reliquat, soit en première indemnisation, soit à l’issue d’une fin de droits, soit lorsqu’il s’est écoulé trop de temps depuis la précédente fermeture de droit et que le reliquat est déchu), moins de la moitié sont ouverts avec la durée de droit maximale. À l’inverse, un peu plus de 30 % de ces nouveaux droits sont ouverts avec une durée d’un an ou moins, ce qui reflète des durées cotisées faibles. De fait, plus du tiers des inscriptions sur les listes de Pôle emploi font suite à une fin de CDD ou de mission d’intérim.
La récurrence dans l’indemnisation est relativement fréquente : la moitié des entrants à l’ARE ont déjà été indemnisés par cette allocation au cours des trois années précédant leur ouverture de droit, avec une durée moyenne légèrement inférieure à 300 jours indemnisés.
Si, dans le système actuel, les droits ne sont pas explicitement « rechargeables », ils ne se déchargent pas non plus. La reprise d’un emploi ne conduit jamais à une réduction, en montant global, des droits à indemnisation chômage. Cependant, il existe des situations où, l’allocation la plus élevée étant retenue, la durée d’indemnisation peut être réduite par rapport à ce qu’elle était avant la reprise d’emploi et, par ailleurs, que certaines périodes d’emploi ne soient pas retenues pour ouvrir des droits.
Le système d’assurance chômage tel qu’il existe aujourd’hui repose sur le paradigme d’une carrière linéaire : longue période d’activité puis passage plus ou moins long par l’indemnisation chômage suite à un accident de parcours et reprise d’un nouvel emploi.
Il s’accommode mal des parcours très heurtés, alternant fréquemment période d’activité et chômage. Ceux-ci ne concernent certainement qu’une faible partie des actifs mais tendent à se développer depuis une décennie et forment une part non négligeable des inscrits à Pôle emploi.
Depuis plus de 40 ans, la formation professionnelle continue évolue pour mieux répondre à ses objectifs : offrir aux actifs la possibilité d'accéder à la formation pour développer des compétences, en vue d'exercer un emploi, de progresser en qualification au sein de son environnement de travail, ou de changer de trajectoire professionnelle.
3.1. Architecture de la formation professionnelle
Le système actuel est largement issu de la loi de 1971 sur la formation professionnelle qui a institué, à côté des financements publics, une participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle constitue depuis une « obligation nationale » qui vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Le financement de la formation professionnelle continue est aujourd’hui assuré par l’État, les régions et Pôle emploi, dont les interventions se concentrent sur l’apprentissage, les jeunes en insertion professionnelle et les demandeurs d’emploi plutôt que les actifs occupés (cf. figure 52). Les dépenses des entreprises bénéficient dans une très large mesure aux actifs occupés.
La participation obligatoire des entreprises à l’effort de formation et les modalités selon lesquelles elles peuvent s’en acquitter varient en fonction de leur taille. Surtout, les actions qui peuvent être financées par la participation des employeurs sont définies par la loi : il s’agit essentiellement des actions de formation, de la validation des acquis de formation et des bilans de compétences.
Figure 52 : Dépense globale par financeur final, y compris investissement, en 2010 (en M€).
Financeur |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Part 2010 |
Évol. 10/09 |
Entreprises* |
9 532 |
9 757 |
9 867 |
10 932 |
11 546 |
12 439 |
13 234 |
13 533 |
13 142 |
41% |
-2,9% |
État |
4 524 |
4 639 |
4 242 |
4 129 |
4 135 |
3 835 |
4 083 |
4 423 |
4 734 |
15% |
+7,0% |
Régions |
1 933 |
2 056 |
2 711 |
3 406 |
3 787 |
4 138 |
4 212 |
4 482 |
4 450 |
14% |
-0,7% |
Autres collectivités territoriales |
21 |
24 |
39 |
38 |
43 |
45 |
56 |
65 |
64 |
0% |
-1,5% |
Autres administrations publiques |
216 |
144 |
155 |
153 |
166 |
191 |
204 |
302 |
284 |
1% |
-5,9% |
Unédic/Pôle emploi |
1 032 |
1 198 |
1 296 |
1 184 |
1 040 |
1 131 |
1 200 |
1 465 |
1 528 |
5% |
+4,3% |
Ménages |
998 |
892 |
915 |
930 |
972 |
1 017 |
1 081 |
1 041 |
1 127 |
4% |
+8,3% |
Fonctions publiques pour leurs agents |
4 859 |
4 872 |
4 990 |
4 974 |
5 113 |
5 433 |
5 808 |
6 192 |
6 176 |
20% |
-0,3% |
TOTAL |
23 115 |
23 582 |
24 215 |
25 746 |
26 802 |
28 229 |
29 878 |
31 503 |
31 505 |
100% |
+0% |
Source : PLF 2013, jaune budgétaire Formation professionnelle, données France entière.
* Les chiffres concernant les dépenses directes des entreprises issues du formulaire 24-83 ont été réévalués à la hausse entre 2005 et 2009, suite au recalcul des pondérations. Les évolutions 2004-2005 sont donc à prendre avec précaution.
Cette politique relève donc de la compétence partagée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Les demandeurs d’emploi et les jeunes sans qualification bénéficient de la politique publique mise en œuvre par les régions à titre principal, avec des interventions complémentaires de Pôle emploi, de l’Etat, et depuis la réforme de 2003, des partenaires sociaux.
Les dispositifs de formation professionnelle continue se sont multipliés au cours du temps. Ces derniers se répartissent schématiquement en deux catégories :
- À l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ou de périodes de professionnalisation ; le plan de formation de l’entreprise qui rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise ; les périodes de professionnalisation permettent de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l’emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrats aidés.
- À l’initiative du salarié, avec l’accord de son employeur dans certaines conditions, dans le cadre du droit individuel formation (DIF) ou du congé individuel formation (CIF). Ces dispositifs permettent à tout travailleur, sous certaines conditions, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation.
3.2. Bénéficiaires de la formation professionnelle
Sur les 22,6 millions de stagiaires de 2010, la grande majorité est salariée (69 %), 12 % sont demandeurs d’emploi et 5 % sont des particuliers qui financent eux-mêmes leur formation (cf. figure 53). Les demandeurs d'emploi sont les principaux bénéficiaires du financement de stages par les pouvoirs publics (cf. figure 53). 3,6 milliards leur sont consacrés sur les 6,6 milliards que les pouvoirs publics consacrent à la formation professionnelle continue, hors celle de leurs agents).
Figure 53 : Dépense pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage des financeurs finaux
par type de bénéficiaires en 2010 (en Milliards d’euros)
|
Apprentis |
Jeunes en insertion professionnelle |
Demandeurs d'emploi |
Actifs occupés du privé |
Agents publics |
Total |
Entreprises |
1,12 |
1,1 |
0,1 |
10,9 |
- |
13,1 |
État |
2,3 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
2,9 |
7,7 |
Régions |
2,1 |
0,8 |
1,1 |
0,4 |
0,2 |
4,6 |
Autres collectivités territoriales |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
2,4 |
2,5 |
Autres administrations |
0,1 |
- |
1,7 |
0,0 |
0,7 |
2,5 |
Ménages |
0,2 |
- |
0,2 |
0,7 |
- |
1,1 |
Total |
5,8 |
2,7 |
3,9 |
12,9 |
6,2 |
31,5 |
Lecture : en 2010, les entreprises ont dépensé 1,12 milliard d’euros pour les apprentis, 1,06 milliard pour les jeunes en insertion professionnelle (alternance, accompagnement…), 10,89 milliards pour la formation continue des salariés du privé, etc. | ||||||
Source : Dares. Champ : France entière. |
|
|
|
|
|
|
Les salariés les plus qualifiés (cadres, professions intermédiaires) et les salariés des grandes entreprises ou de la fonction publique sont ceux qui se forment le plus. Ainsi en 2010, 57% des cadres des entreprises de 10 salariés et plus ont suivi une formation, contre seulement 33% des ouvriers. C’est également le cas de 52% des salariés des entreprises de plus de 500 salariés, contre 16% dans les entreprises de 10 à 19 salariés. Ces inégalités d’accès sont renforcées par le fait que certains individus tendent à accumuler au cours du temps l’investissement en formation, alors que d’autres y échappent durablement. Les formations suivies par les salariés sont généralement très courtes et sont souvent des formations d’adaptation ponctuelles au poste de travail.
L’employeur est le plus souvent à l’initiative du départ en formation des salariés. L’accès des salariés à la formation se fait principalement dans le cadre du plan de formation. Le recours aux dispositifs mis en place suite à la loi de 2004, DIF et période de professionnalisation, se développe mais reste limité (respectivement 6,4 % et 2,2 % des salariés en 2010).
Le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une formation a cru continûment depuis le milieu des années 1970 pour atteindre son maximum en 1992. Depuis le désengagement continu de l’Etat n’a été que partiellement compensé par l’intervention des régions. En 2010, 600 000 demandeurs d’emploi sont entrés en formation. Certains stagiaires ayant effectué plusieurs stages dans l’année, 683 000 entrées en formation ont été enregistrées au total, soit le plus haut niveau depuis 2005. 57 % des stages de demandeurs d’emploi ont été financés par les Régions, 17 % par Pôle emploi et 13 % par l’Etat.
Figure 54 : Nombre d'entrées en formation de chômeurs suivant le financeur principal
de la formation depuis 1973
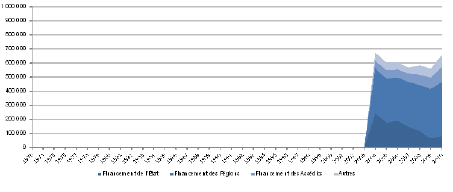
Source : Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, DARES, France métropolitaine.
NB : Rupture de série en 2004, la nouvelle base BREST recouvrant un champ plus restrictif.
Les demandeurs d’emploi accèdent moins souvent à la formation que les salariés (32 % contre 44 % au cours des 12 derniers mois d’après une enquête de 2006), mais les stages qu’ils suivent sont généralement assez longs (un peu moins de 5 mois en moyenne).
3.3. La genèse du dispositif du droit individuel à la formation
Le droit individuel à la formation résulte de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle repris par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
En préambule, les signataires de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 constataient que, malgré un investissement financier des entreprises pour la formation largement supérieur au minimum légal, l’accès des salariés à la formation professionnelle continue dépendait trop souvent de leur niveau de formation initiale, de la taille de leur entreprise, du secteur professionnel dans lesquels ils exercent leur activité, de la catégorie socio professionnelle correspondant à leur emploi ou de la nature de leur contrat de travail.
Les entretiens professionnels et le droit individuel à la formation étaient, aux yeux des partenaires sociaux, de nature à permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle et de réduire les inégalités d’accès à la formation.
3.3.1. Les évolutions du dispositif depuis l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
D’une manière générale, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail faisait état de ce que la formation tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels.
Dans le cadre de la portabilité de certains droits, l’accord a prévu en son article 14 que, sans préjudice des dispositions de l’accord du 5 décembre 2003 (et notamment de celles relatives à la « transférabilité » du droit individuel à la formation), en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, les intéressés pourront mobiliser le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu pour le contrat de professionnalisation en l’absence d’accord conventionnel en la matière (soit 9,15 €) selon les modalités suivantes :
1. En accord avec le référent chargé de leur accompagnement dans le cadre du service public de l’emploi et en priorité pendant la première moitié d’indemnisation du chômage, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de mesures d’accompagnement ;
2. En accord avec leur nouvel employeur pendant les deux années suivant leur embauche, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience organisées dans le cadre de la formation continue du salarié.
L’accord du 11 janvier 2008 a prévu par ailleurs le financement de cette mesure par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la formation professionnelle continue selon les modalités suivantes :
- L’OPCA dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abonde le financement des actions mises en œuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
- L’OPCA dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché abonde le financement des actions mises en œuvre dans la nouvelle entreprise.
Les modalités de financement de ces abondements sont définies par accord de branche. À défaut d’un tel accord, ces abondements sont imputés au titre de la section professionnalisation de l’OPCA concerné.
L’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels a repris les stipulations de l’accord du 11 janvier 2008.
Par ailleurs, cet accord a prévu que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pouvait, en cas de besoin, abonder les ressources des OPCA pour le financement de la portabilité du droit individuel à la formation.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie s’est inscrite dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels des 11 janvier 2008 et 7 janvier 2009 et a prévu à cet effet les dispositions législatives relatives à la portabilité du droit individuel à la formation qui s’inspirent des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 a précisé les mentions qui devaient figurer dans le certificat de travail sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non utilisés dans le cadre de l’entreprise.
3.3.2. Quelques éléments statistiques et financiers relatifs au droit individuel à la formation.
Dans son rapport sur le droit individuel à la formation de juin 2008, la Cour des comptes évaluait le nombre de bénéficiaires potentiels de la portabilité du droit individuel à la formation à environ 1 500 000 personnes par an.
Selon l’annexe formation professionnelle au projet de loi de finances pour 2013, le droit individuel à la formation a bénéficié à un nombre limité de salariés en 2010 : 6,4 % des salariés contre 6,2 % en 2009 et 5,5 % en 2008. Considérant le peu de salariés concernés et la durée moyenne des formations (22 heures), il apparaît qu’une grande partie des droits ne sont pas utilisés.
20,2 % des entreprises de dix salariés et plus ont eu recours au droit individuel à la formation en 2011 (données provisoires).
L’usage du droit individuel à la formation se diffuse donc modestement et la progression reste sans commune mesure avec celle des droits ouverts.
En 2011, les OPCA ont pris en charge 474 869 stagiaires au titre du DIF dont 19 401 demandeurs d’emploi utilisant la portabilité du droit individuel à la formation. Parmi ces stagiaires, 48,4 % sont des hommes, 34 % sont âgés de 35 à moins de 45 ans et 36 % de 45 ans et plus ; 52 % sont des employés ou des ouvriers, 25 % des ingénieurs et cadres. La formation des droits individuels à la formation financés par les OPCA dure en moyenne 26 heures par stagiaire (24 heures en 2010).
En définitive, il apparaît que le droit individuel n’a pas connu l’essor auquel on pouvait s’attendre et que la portabilité du droit n’a lui-même connu qu’un usage limité en raison notamment de la complexité du dispositif et de droits limités au regard des besoins de formation en vue notamment d’une reconversion.
PARTIE II - CRÉER DES DROITS NOUVEAUX POUR LES SALARIÉS
Section 1 - De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours
1. Généraliser la couverture complémentaire santé d’entreprise et permettre une portabilité de la couverture santé et de prévoyance
L’article 1er du projet de loi prévoit à la fois la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi. Cet article traduit les articles 1 et 2 de l’ANI du 11 janvier 2013.
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
1.1.1. Généralisation de la couverture complémentaire santé d’entreprise
a) La mise en œuvre d’une couverture collective obligatoire pour l’ensemble des salariés
Aujourd’hui, la mise en place d’une couverture collective obligatoire relève de la libre décision des partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche ou de l’entreprise, ou de l’employeur dans le cadre d’une décision unilatérale.
Face au constat d’une couverture collective encore insuffisante, les parties signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 ont souhaité rendre obligatoire la mise en œuvre par l’employeur d’une couverture de l’ensemble de ses salariés, et ce avec un niveau minimal de garanties, au 1er janvier 2016 lorsqu’ils ne sont pas couverts à ce titre par un accord de branche ou d’entreprise. Une disposition législative est requise pour généraliser cette obligation à l’ensemble des entreprises et en préciser les modalités, ainsi que les signataires ont invité les pouvoirs publics à le faire.
b) La priorité donnée au dialogue social de branche et d’entreprise
Il n’existe pas aujourd’hui d’obligation de négocier sur la couverture complémentaire santé ou de prévoyance au niveau de la branche. Les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail imposent aux branches professionnelles une obligation de négocier limitée aux champs des salaires, de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, des conditions de travail et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, des classifications, de l’épargne salariale et des travailleurs handicapés. Une disposition législative est donc requise pour imposer aux branches de lancer une négociation en vue de la généralisation de la couverture santé obligatoire à horizon 2016 (cf. infra).
Si, au niveau de l’entreprise, le code du travail impose déjà à l’employeur dont les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, d’engager chaque année une négociation sur ce thème (art. L. 2242-11), une disposition législative est également requise afin de préciser et d’articuler dans le temps cette obligation de négocier par rapport à celle prévue pour les branches (cf. infra).
c) Le renforcement de la transparence du choix de l’assureur désigné ou recommandé
Lorsqu’ils définissent un régime de frais de santé, les partenaires sociaux peuvent soit choisir de recommander aux entreprises de recourir à un (ou plusieurs) assureur(s) avec lequel ils ont en pratique échangé pour définir les règles du régime, sans force contraignante (« clause de recommandation »), soit imposer aux entreprises de recourir à cet (ou ces) assureur(s) afin de mettre en œuvre une mutualisation (« clause de désignation »).
Cette faculté n’est aujourd’hui soumise à aucune obligation en matière de mise en concurrence ni à aucune procédure particulière si ce n’est, dans le cas des clauses de désignation, à l’obligation d’un réexamen dans un délai maximal de 5 ans (cf. article L. 912-1 du code de la sécurité sociale)31. Une disposition législative est donc requise pour imposer cette obligation.
1.1.2. Généralisation de la portabilité de la couverture santé et de prévoyance
L’article 2 de l’ANI du 11 janvier 2013 améliore le dispositif de portabilité, issu de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 (cf. supra), à deux égards. D’une part, il prolonge la durée maximale de portabilité, qui passe de 9 à 12 mois. D’autre part, il rend désormais obligatoire le financement mutualisé de ce mécanisme.
L’inscription dans la loi de la portabilité permettra également de faire bénéficier de la portabilité des droits les chômeurs relevant de secteurs qui en étaient exclus. En effet, si les stipulations de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant n°3 ont bien été étendues (respectivement par arrêté du 23 juillet 2008 et par arrêté du 7 octobre 2009), cette extension n’a eu pour effet que de les rendre applicables dans les branches au sein desquelles il existe une ou plusieurs organisations patronales représentatives adhérentes au Medef, à l’UPA ou à la CGPME signataires de cet ANI et de son avenant.
1.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
1.2.1. Généralisation de la couverture complémentaire santé d’entreprise
a) La couverture collective doit être prioritairement négociée au niveau de la branche afin de favoriser la solidarité entre les entreprises, et de manière subsidiaire au niveau des entreprises
Le projet de loi reprend ici les stipulations de l’article 1er de l’ANI du 11 janvier 2013 aux termes desquelles :
- les branches professionnelles doivent ouvrir des négociations en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture.
- en cas d’échec des négociations de branche, les entreprises non couvertes par un accord au 1er juillet 2014 ouvriront des négociations, sur la base de l’article L. 2242-11 du code du travail, afin d’aboutir à un accord avant le 1er janvier 2016.
Dans le cas où les négociations de branche puis d’entreprise n’auraient pas abouti à la conclusion d’un accord, s’appliquera, à compter du 1er janvier 2016, l’obligation faite aux entreprises, par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur, de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective minimale en matière de frais de santé.
Le projet de loi précise certaines des questions qui devront obligatoirement être abordées au cours des négociations de branche, en reprenant celles mentionnées à l’article 1er de l’ANI du 11 janvier 2013. En particulier, sans préjudice de la liberté de négociation collective dont bénéficient les partenaires sociaux des branches, la négociation examinera la manière dont les entreprises peuvent être laissées libres de recourir à l’organisme assureur de leur choix, ainsi que le délai laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles (dont les signataires de l’ANI ont souhaité qu’il ne puisse être fixé en deçà de 18 mois, dans la limite de la date de généralisation à tous les salariés fixée au 1er janvier 2016).
Reprenant les stipulations de l’article 1er de l’ANI du 11 janvier 2013, le projet de loi réserve la possibilité de dispenses d’affiliation pour certaines catégories de salariés, dont la liste sera précisée par décret, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Seront concernés les salariés couverts en tant qu’ayants-droit par le régime collectif de leur conjoint, des salariés apprentis ou à temps partiel pour lesquels la cotisation obligatoire représenterait une part excessive de leur revenu, ou encore des salariés assurés à titre obligatoire au régime complémentaire applicable en Alsace-Moselle. Ces catégories rejoignent celles définies par l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale pour lesquelles la dispense d’affiliation ne fait pas obstacle à la qualification de régime obligatoire pour le bénéfice des exonérations sociales.
L’obligation faite à tout employeur d’assurer la couverture de ses salariés à défaut d’accord d’entreprise ou de branche au 1er janvier 2016 jouera sans préjudice de l’application de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en vertu duquel, lorsque les garanties ont été définies par une décision unilatérale de l’employeur, les salariés embauchés avant la mise en place de ces garanties peuvent demander à en être dispensés.
b) La généralisation de la complémentaire santé doit s’accompagner d’un encadrement du niveau des garanties
Suivant les stipulations de l’article 1er de l’ANI du 11 janvier 2013, le projet de loi précise que la couverture collective obligatoire qui devra être mise en place au 1er janvier 2016 devra respecter un niveau minimal de garanties.
La fixation d’un niveau minimal paraît d’autant plus nécessaire que les critères de responsabilité fixés par le cahier des charges des « contrats responsables » – qui permet aux entreprises de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux rattachés à ces contrats – n’imposent aujourd’hui qu’un niveau très faible de garanties.
Le contenu précis de ces garanties minimales sera défini par voie réglementaire, la loi fixant les grandes catégories de dépenses qui devront être couvertes en tout ou partie.
Le Gouvernement veillera à ce que les dispositions fixant les garanties minimales pour les contrats collectifs soient compatibles avec celles qui seront retenues lors du renforcement du contenu des contrats responsables annoncé par le Président de la République dans le cadre de son engagement en faveur de la généralisation d’une couverture complémentaire de qualité.
Un décret d’application fixera également la part minimale de la cotisation devant être prise en charge par l’employeur, les partenaires sociaux signataires de l’ANI ayant souhaité qu’elle soit partagée par moitié entre salariés et employeurs.
c) Le choix éventuel des branches de recourir à un assureur désigné ou recommandé doit s’effectuer dans un cadre ouvert et transparent
La faculté pour les branches de désigner ou de recommander un assureur n’est aujourd’hui soumise à aucune obligation en matière de mise en concurrence préalable (cf. supra). S’il est justifié que ces clauses, par leur objet, demeurent extérieures au champ des appels d’offres régis par le code des marchés publics, il importe en revanche que les branches puissent déterminer leur choix de la manière la plus transparente possible et qu’elles puissent retenir l’offre présentant la meilleure adéquation coût/garanties.
Les parties signataires de l’accord du 11 janvier 2013 ont décidé de constituer un groupe de travail paritaire, dont l’objet sera « de définir, dans un délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture [frais de santé] que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés. »
C’est pourquoi le projet de loi prévoit le principe d’une mise en concurrence préalable, dont les modalités seront définies par décret. Ce texte d’application sera rédigé en tenant compte des résultats auxquels sera parvenu le groupe de travail mis en place par les partenaires sociaux. Parmi les principales règles de cette procédure pourraient ainsi figurer, sans présager de l’issue des discussions à venir entre les partenaires sociaux :
- Une publicité préalable obligatoire, permettant à tous les opérateurs potentiels de candidater lors de la création ou du renouvellement de l’accord ;
- Les modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation (formations techniques, recours à des experts) ;
- Les règles en matière de conflits d’intérêts (partenaires sociaux exerçant un mandat ou ayant un lien avec l’organisme assureur candidat) ;
- Les modalités de suivi du régime en cours de contrat (commission de suivi, obligations d’information de la part de l’assureur).
1.2.2. Ouverture de négociations sur la généralisation de la couverture prévoyance
La généralisation de la couverture prévoyance constitue un objectif de plus long terme. Comme le relève l’IRDES, elle apparaît aujourd’hui davantage diffusée que la couverture santé dans les entreprises et moins inégalement répartie parmi les salariés, en raison notamment de son existence plus ancienne sur le marché de la protection sociale complémentaire d’entreprise32.
Les signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 ont souhaité que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l’issue du processus de généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de prévoyance à l’attention des salariés qui n’en bénéficient pas (article 1er, note n°3). Le III de l’article 1er du projet de loi fixe donc une obligation en ce sens.
1.2.3. Généralisation de la portabilité de la couverture santé et de prévoyance
L’article 1er du projet de loi rend applicable à l’ensemble des salariés le dispositif de portabilité que les signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 ont défini en apportant deux améliorations majeures par rapport au dispositif actuel issu de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 : le passage de 9 à 12 mois de la durée maximale de portabilité et la mutualisation du financement.
Suivant les termes de l’ANI du 11 janvier 2013, un délai de mise en œuvre est aménagé pour permettre aux branches et aux entreprises de mettre en place la mutualisation du financement, soit une entrée en vigueur de l’obligation au 1er juin 2014 pour la couverture en matière de frais de santé et au 1er juin 2015 pour la couverture en matière de prévoyance.
À chacune de ces dates, les branches ou les entreprises qui auront mis en place des couvertures collectives obligatoires devront garantir le bénéfice de la portabilité aux salariés couverts. Le projet de loi reprend les conditions d’ouverture de droit définies par l’ANI du 11 janvier 2008, notamment la règle selon laquelle les anciens salariés doivent justifier de leur situation auprès de leur ancien employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service.
Par ailleurs, par souci de cohérence, ce même article complète les articles 2, 4 et 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 afin d’étendre le champ d’application des garanties définies par ces articles aux bénéficiaires du dispositif de portabilité.
En effet, l’article 4 de la loi Evin réglemente la sortie des contrats de complémentaire santé de groupe à caractère obligatoire. Il impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre à ces assurés de conserver auprès du même assureur, à titre individuel, une couverture complémentaire santé à un tarif encadré. L’ancien salarié dispose de six mois à compter de la rupture de son contrat de travail pour demander le bénéfice de cette disposition.
Ce délai s’articule difficilement avec le bénéfice de la portabilité, qui permettra désormais à l’ancien salarié de continuer à bénéficier de la couverture de son ancienne entreprise sans s’acquitter de cotisations pendant 12 mois. L’écart entre les deux délais peut conduire l’ancien salarié, soit à renoncer de manière anticipée au régime de la portabilité, soit à perdre le bénéfice de l’article 4 de la loi Evin.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi précise que le délai durant lequel le salarié peut demander le maintien de la complémentaire santé à titre individuel expire soit six mois à compter du départ de l’entreprise, soit, si cela est plus favorable, à l’expiration de la période durant laquelle le salarié bénéficie du mécanisme de portabilité.
L’article 2 de la loi Evin, ainsi que l’article 5 à titre corollaire, sont également mis en cohérence. L’article 2 consacre le principe selon lequel l’assureur doit prendre en charge toutes les conséquences des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, c’est-à-dire toutes les situations, non connues ou connues, laissant apparaître un trouble de l’état de santé de l’assuré. Toutefois, il ne s’applique qu’aux salariés. Le projet de loi étend donc le bénéfice des dispositions de l’article 2 de la loi Evin aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité. Ainsi, en cas de changement d’organisme assureur, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité introduit par le nouvel article du code de la sécurité sociale seront également pris en charge par le nouvel organisme.
1.3. Impact attendu
a) Impacts sanitaires et sociaux :
La généralisation de la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés favorisera l’accès aux soins pour les personnes qui n’étaient aujourd’hui pas, ou insuffisamment, couvertes. Par ailleurs, les salariés actuellement couverts par d’autres types de complémentaires pourraient voir leur prise en charge améliorée si les partenaires sociaux faisaient le choix de garanties de bon niveau, supérieures à leurs garanties actuelles.
S’il n’est pas a priori possible d’évaluer le nombre de salariés dont les garanties seront accrues ou dont la prime d’assurance sera moins coûteuse, il est acquis que les 400 000 salariés qui aujourd’hui renoncent à disposer d’une complémentaire santé, y auront accès demain.
Pour ces 400 000 personnes, la généralisation de la couverture santé complémentaire permettra d'accéder à une couverture santé à un meilleur rapport qualité/prix du fait de la mutualisation que doit permettre la couverture collective.
En effet, le coût d'accès à une complémentaire santé collective sera en moyenne inférieur au coût d'une complémentaire santé individuelle grâce à la mutualisation. Ce gain sera d'autant plus important, notamment, pour les salariés les plus âgés où résidant dans des zones à forts dépassements d'honoraires du fait d'une cotisation plus réduite par rapport à leurs niveaux de risques.
En outre les salariés qui disposeront d'une couverture santé collective bénéficieront d'une participation de leur employeur (fixée, a minima, à la moitié de la cotisation globale) ainsi que du dispositif de solidarité permis dans le cadre des contrats collectifs.
b) Impacts financiers :
En matière de finances sociales, les contributions des employeurs au régime de santé complémentaire de leur salarié (obligatoire et collectif) ouvrent actuellement droit à exemption d’assiette de cotisations de sécurité sociale33. Elles sont toutefois soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux dérogatoire de 8 % pour les entreprises d’au moins 10 salariés.
Le coût pour la sécurité sociale34 de la généralisation de la protection sociale complémentaire collective, sous plusieurs hypothèses de niveau de prise en charge et d’abondement de l’employeur serait compris entre 300 et 430 M€, selon le champ d’extension retenu (24 % des salariés versus 34,7 % des salariés – cf. infra). La généralisation de la portabilité en mutualisation sur 12 mois maximum se traduirait par un coût supplémentaire compris entre 75 et 110 M€ pour la sécurité sociale.
L’extension de la couverture à 24 % des salariés concerne les 2,3 % de salariés non couverts par une complémentaire santé quelle qu’elle soit, les 18,1 % de salariés couverts uniquement par une complémentaire santé individuelle et les 3,7% de salariés qui ont accès à la complémentaire de leur conjoint fonctionnaire (cf. figure 50). L’extension à 34,7 % des salariés inclut également les salariés qui ont accès à la complémentaire d’entreprise de leur conjoint (soit 10,6 % des salariés)35.
En matière de finances publiques (Etat), la généralisation de la protection sociale complémentaire collective à tous les salariés devrait également se traduire par un manque à gagner pour l’Etat en termes d’impôt sur le revenu, les abondements salariés et employeurs n’étant pas soumis à cet impôt à la différence des cotisations ou primes d'adhésion individuelle à la complémentaire santé36. Le manque à gagner pour l’Etat se situera à deux niveaux :
- sur les nouveaux abondements salariés qui se traduisent par une baisse du salaire net imposable,
- sur les nouveaux abondements employeurs s’ils se substituaient partiellement à des éléments de rémunération.
L'Etat aura également un manque à gagner en termes d'impôt sur les sociétés.
Globalement, pour l’ensemble des finances publiques, le coût pourrait être estimé entre 1,5 et 2,1 Md €, selon le champ d’extension retenu37.
En matière d'impact sur les entreprises, la généralisation de la protection sociale complémentaire collective à tous les salariés se traduira également par des abondements supplémentaires de cotisations à la charge des employeurs, qui peuvent être évalués au total entre 2 Md€ et 3 Md€ [selon le champ d’extension retenu : 24% des salariés versus 34,7 % des salariés – cf. infra].
A titre d'illustration des effets individuels potentiels, parmi les 34 branches professionnelles comptant plus de 10.000 salariés ayant mis en place un régime frais de santé, la cotisation (patronale et salariale) s'élève en moyenne à 443€ par an, soit 37 € par mois. Sur ce périmètre, dans 8 cas sur 10, l’employeur prend au moins en charge plus de la moitié des cotisations. En moyenne, la participation employeur est de 54 %.
Ces chiffres sont une évaluation des coûts de cette mesure à l'issue de sa montée en charge, sa mise en œuvre (d'ici à 2016) étant progressive.
L’évaluation des impacts financiers présente nécessairement un caractère très estimatif du fait du caractère incertain des hypothèses retenues pour ce calcul.
c) Impacts sur l’égalité des femmes et des hommes
Le projet de loi concerne tous les salariés et donc de façon égalitaire les hommes et les femmes. En pratique, il peut contribuer à diminuer les écarts en termes d’accès à une couverture santé entre hommes et femmes, dès lors que ces dernières sont surreprésentées parmi les catégories les moins bien couvertes aujourd’hui par les couvertures collectives, en particulier pour les travailleurs à temps partiel.
d) Impacts sur les personnes handicapées
Au même titre que les autres salariés, les salariés handicapés seront plus nombreux à bénéficier d’une couverture complémentaire santé obligatoire. La mutualisation de la couverture assurantielle au niveau de la branche est notamment susceptible de leur permettre de bénéficier d’une couverture à meilleur coût.
L’article 2 du projet de loi prévoit la création d’un compte personnel de formation et d’un conseil en évolution professionnelle, conformément aux articles 5 et 16 de l’accord national interprofessionnel.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
a) Les dispositions générales
Aux termes des articles L.6323-1-1 à L.6323-16 du code du travail, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis. Par ailleurs, les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier du droit individuel à la formation sous réserve qu’ils aient quatre mois d’ancienneté au cours des douze derniers mois.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l’action de formation est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur. La formation peut se dérouler pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur d’une allocation de formation d’un montant égal à 50% de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
b) La portabilité du droit individuel à la formation.
Au regard des articles L.6323-17 à L.6323-21 du code du travail tels qu’ils résultent de l’article 6 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, il convient de distinguer trois cas de figure en la matière :
1. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-17 du code du travail en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde ;
2. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un demandeur d’emploi ;
3. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un salarié qui fait sa demande auprès d’un nouvel employeur.
c) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-17 du code du travail en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde.
L’article L.6323-17 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur. Lorsque l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
Par ailleurs, l’article L.6323-19 prévoit que dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Il convient de relever que le salarié licencié peut utiliser son droit individuel à la formation dont il décide seul la nature. La seule condition est que la demande soit faite avant la fin du préavis.
d) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un demandeur d’emploi.
L’article L.6323-18 du code du travail prévoit à cet égard qu’en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17 (portabilité du droit individuel à la formation en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde), multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer, lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé pendant sa période de chômage.
Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle l’intéressé a acquis des droits. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
Par ailleurs, l’article L.6323-21 prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19 les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue. Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail précise que celui-ci doit comporter le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde et l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser les sommes dues.
e) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un salarié qui fait la demande auprès d’un nouvel employeur.
L’article L.6323-18 prévoit à cet égard qu’en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17 (portabilité du droit individuel à la formation en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde), multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer, lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur au cours des deux années suivant son embauche soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies pour le droit individuel à la formation par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.
Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule en dehors du temps de travail et l’allocation de formation n’est pas due par l’employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
Par ailleurs, l’article L.6323-21 prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19 les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail précise que celui-ci doit comporter le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le droit individuel à la formation bénéficie à un nombre limité de salariés : 6,4 % des salariés en 2010. Considérant le peu de salariés concernés et la durée moyenne des formations (22 heures), il apparaît qu’une grande partie des droits ne sont pas utilisés. L’usage du droit individuel à la formation se diffuse donc trop modestement et la progression reste sans commune mesure avec celle des droits ouverts.
En 2011, les OPCA ont pris en charge la formation de seulement19 401 demandeurs d’emploi au titre de la portabilité du droit individuel à la formation.
En définitive, il apparaît que le droit individuel n’a pas connu l’essor auquel on pouvait s’attendre et que la portabilité du droit n’a elle-même connu qu’un usage limité en raison notamment de la complexité du dispositif et de droits limités au regard des besoins de formation en vue notamment d’une reconversion.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 2 prévoit la création d’un compte personnel de formation conformément à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel.
Celui-ci prévoit qu’afin de franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la formation, il est instauré dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de l’accord un compte personnel.
Le principe de la création du compte personnel de formation est posé à l’article L. 6111-1 du code du travail. Les concertations prévues par l’accord national interprofessionnel, associant les partenaires sociaux, les régions et l’Etat, ainsi que les travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, permettront d’en préciser rapidement les modalités de mise en œuvre et de financement. Ces concertations débuteront dans les plus brefs délais.Le compte personnel de formation devra posséder les trois grandes propriétés suivantes :
- Il est universel : toute personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite ;
- Il est individuel : chaque personne bénéficie d’un compte, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi ;
- Il est intégralement transférable : la personne garde le même compte tout au long de sa vie professionnelle et quel que soit son parcours professionnel. Le compte n’est jamais débité sans l’accord exprès du salarié et ne peut jamais être diminué du fait d’un changement d’employeur, quelle que soit la fréquence des changements.
Il s’inspirera des lignes directrices fixées par l’ANI :
- Les droits acquis par le salarié au titre du compte le sont à raison de 20h/an pour les salariés à temps plein38. Des proratas sont effectués pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation ;
- Le compte est mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi ;
- La transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ;
- Le salarié peut mobiliser son compte personnel avec l’accord de l’employeur. Celui-ci lui notifie sa réponse dans un délai d’un mois. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord de l’employeur n’est pas nécessaire lorsque le salarié entend bénéficier d’un congé individuel de formation. Lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte en dehors du congé individuel de formation, l’employeur peut abonder le compte du salarié au-delà du nombre d’heures créditées sur le compte de manière à permettre au salarié d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante ;
- Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences tel que défini par les articles 39 et 40 de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.
Les partenaires sociaux adapteront les stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur impactées par ces dispositions.
2.3. Impact attendu
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoyant la transformation du DIF en compte individuel de formation constitue un indéniable progrès par rapport à la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la portabilité des droits à la formation : le compte personnel de formation est intégralement transférable, la personne gardant le même compte tout au long de sa vie professionnelle quel que soit son parcours professionnel et quelle que soit la fréquence des changements dans son parcours.
En outre, l’invitation des partenaires sociaux à une concertation avec l’Etat et les régions pour la mise en place du compte personnel de formation permet d’envisager :
- une universalité du compte qui soit ouvert non seulement aux salariés et aux demandeurs d’emploi qui ont acquis des droits lorsqu’ils étaient salariés mais aussi aux primo demandeurs d’emploi et à la formation initiale différée ;
- une articulation des différents acteurs de la formation professionnelle (partenaires sociaux, Etat, régions) à travers un même outil (le compte personnel de formation) pour conjuguer les efforts en faveur de la formation professionnelle tout au long de la vie et plus particulièrement des formations concourant à la sécurisation des parcours professionnels ;
- de replacer la personne au centre de la formation professionnelle et de réduire ainsi la complexité et les cloisonnements qui la caractérisent.
3.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Le chapitre IV du titre I du livre III de la sixième partie du code du travail pose les principes du droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles. En particulier, l’article L.6314-1 y affirme que « tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre à son initiative une formation permettant quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court et moyen terme. »
Le code du travail définit ensuite les prestations dont peuvent disposer ces personnes en recherche d’une nouvelle orientation professionnelle ou d’une formation : le bilan d’étape professionnel, le passeport orientation formation, le bilan de compétences, ou encore le recours au congé individuel de formation ou au droit individuel formation.
En revanche, et particulièrement s’agissant du public salarié, le code du travail ne précise pas quelle offre d’accompagnement en orientation ce public peut mobiliser, en dehors de l’entreprise, afin de bénéficier des conseils et de l’accompagnement individualisé nécessaire à l’éclairer utilement en amont des choix d’orientation ou de développement de compétences qu’il souhaite réaliser.
La création d’un conseil en évolution professionnelle comme souhaité par les partenaires sociaux nécessite donc l’introduction d’une disposition législative au sein de ce chapitre IV.
3.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
La disposition portant sur le conseil en évolution professionnelle a pour ambition de faciliter l’accès des salariés, notamment des petites et moyennes entreprises, à une offre de service d’accompagnement de proximité hors de l’entreprise, visant l’évolution et la sécurisation des parcours professionnels.
Ce conseil permettra au salarié :
- d’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ;
- de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier le cas échéant les compétences utiles à acquérir pour poursuivre son parcours professionnel ;
- d’identifier les offres d’emploi adaptées à ses compétences ;
- d’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour consolider son parcours professionnel.
Ainsi, la synergie de ce nouveau conseil avec les objectifs du service public de l’orientation défini à l’article L.6111-3 du code du travail est immédiate. C’est la raison pour laquelle le conseil en évolution professionnelle devrait être mis en œuvre dans le cadre du service public de l’orientation après concertation avec l’État et les régions dans le cadre de la prochaine loi de décentralisation.
Le compte personnel de formation pourra également être mobilisé pour accéder à un conseil en évolution professionnelle.
3.3. Impact attendu
Avec la création et la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle au sein des réseaux OPACIF et APEC, les partenaires sociaux responsables de leur gouvernance ont décidé de préciser la nature des services de conseil en évolution professionnelle attendus, tout en assurant la convergence de ces travaux et directives avec le service public de l’orientation jusqu’à présent essentiellement composé d’opérateurs de la sphère publique.
Selon l’ANI, le conseil en évolution professionnelle doit permettre au salarié :
- « d’être mieux informé sur son environnement professionnel (évolution des métiers sur les territoires...),
- de mieux connaître ses compétences, pouvoir les valoriser et identifier les compétences nécessaires à acquérir,
- de repérer des offres d’emploi adaptées à ses compétences. »
Le service public de l'orientation tout au long de la vie quant à lui « est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux » selon les termes de l’article L.6111-3 du code du travail.
La convergence des objectifs est donc manifeste. Comme le précise l’ANI, les débats politiques qui ne manqueront pas d’avoir lieu autour de la prochaine loi de décentralisation seront l’occasion de préciser les liens opérationnels entre les réseaux des OPACIF et de l’APEC et le service public de l’orientation.
La présente étape marque en tout état de cause une nette avancée vers la structuration d’un accompagnement des transitions dans une perspective de sécurisation des parcours professionnels. En effet, si le développement des modalités individuelles d’accès à la formation permet de replacer l’individu au centre du système, il reste de la responsabilité des pouvoirs publics (État et régions notamment) et des partenaires sociaux de structurer les garanties collectives propres à aider les personnes désireuses ou contraintes de s’engager dans une mobilité professionnelle à faire des choix de parcours en étant le mieux éclairées possible sur les conséquence de leur possible décision d’orientation.
Or ces transitions concernent chacun, dès la sortie de l’enseignement initial jusqu’à la retraite : la synergie des services en orientation tout au long de la vie, susceptible de conseiller les individus quel que soit leur statut, dans un cadre suffisamment cohérent en termes de qualité de service et de méthode de conseil est un enjeu essentiel. Il relève d’une responsabilité partagée et de la concertation entre l’Etat, les régions et les partenaires sociaux réunis au sein du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
L’article 3 du projet de loi, déclinant l’article 7 de l’ANI, crée une période de mobilité externe sécurisée dans les entreprises de plus de 300 salariés.
4.1. Eléments de droit et nécessité de légiférer
Il n’existe aujourd’hui aucun cadre juridique qui organise la possibilité pour un salarié qui le souhaite de travailler dans une autre entreprise tout en ayant un droit au retour dans son entreprise d’origine.
D’ores et déjà, des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) prévoient des dispositifs de mobilité qui se font à l’extérieur de l’entreprise. Ils organisent un processus de transfert du salarié d’une entreprise à l’autre en décrivant parfois précisément les étapes de la mobilité. Celle-ci peut se faire sans rupture du contrat de travail avec l’entreprise d’origine : détachement, prêt de main d’œuvre à but non-lucratif, congés exceptionnels... Lorsqu’elle implique ou peut conduire à une rupture du contrat de travail initial, les accords, faute de support juridique, ne procèdent pas à la qualification juridique de l’opération.
Le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée va fournir un cadre sécurisé, aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié à des pratiques qui existent déjà au sein de certaines entreprises, comme permettre leur développement dans une logique de sécurisation des mobilités.
4.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
Au regard de l’instabilité de l’emploi, des caractéristiques du marché du travail et des mutations économiques, l’idée d’une sécurisation des trajectoires individuelles des travailleurs s’est progressivement imposée.
La mobilité sécurisée va permettre au salarié, au-delà de sa formation initiale et de la formation professionnelle continue, de développer ses compétences par une expérience en situation de travail effectif dans une autre entreprise au bénéfice de son entreprise d’accueil comme de son entreprise d’origine. En favorisant la mobilité des salariés, ce dispositif renforce leur employabilité, leur maintien dans l’emploi et permet aux entreprises de bénéficier de personnels aux compétences élargies et donc davantage aptes à répondre à la variété de leurs besoins. En outre, le salarié pourra choisir de revenir dans son entreprise d’origine, comme de rester dans la nouvelle.
La période de mobilité volontaire sécurisée serait mise en œuvre par accord entre l’employeur et le salarié, se concrétisant par un avenant au contrat de travail ayant pour effet de suspendre le contrat de travail durant la période en cause et prévoyant l’objet, la durée et la date de prise d’effet de cette période de mobilité.
Au cas où le salarié se verrait opposer par son employeur deux refus successifs, il aurait droit à un accès privilégié au congé individuel formation.
En cas d’acceptation de la demande de mobilité du salarié, celui-ci bénéficierait d’un droit au retour dont il devrait, le cas échéant, informer son employeur d’origine dans un délai de prévenance fixé à l’avenant au contrat de travail. À défaut d’information avant le terme de la période de mobilité, le salarié serait présumé avoir choisi de revenir dans son entreprise d’origine.
Si par principe le retour anticipé du salarié ne pourrait intervenir que d’un commun accord entre le salarié et son employeur d’origine, ce commun accord pourra avoir été établi d’emblée dans l’avenant au contrat de travail.
En cas d’exercice de son droit au retour, le salarié serait réintégré sur son emploi antérieur ou sur un emploi similaire, avec une qualification et une rémunération qui ne peuvent pas être inférieures à celles de son emploi antérieur, ainsi que le maintien à titre personnel de sa classification.
Si cette période est concluante et que le salarié ne souhaite pas revenir dans son entreprise d’origine, la rupture du contrat de travail n’aurait pas le caractère d’un licenciement mais celui d’une démission. Cette rupture du contrat de travail ne serait donc soumise à aucun préavis, ni à aucune des obligations attachées à un licenciement pour motif économique.
Cette disposition s’applique de plein droit aux salariés présentant plus de deux ans d’ancienneté des entreprises de 300 salariés et plus, plus à même du fait de leur taille d’accepter la clause de retour.
4.3. Impact attendu
Ce dispositif permettra de répondre à une demande des entreprises qui souhaitent sécuriser des dispositifs déjà existants.
Les salariés pourront s’inscrire dans des trajectoires professionnelles continues sans craindre les ruptures inhérentes, aujourd’hui, aux changements d’entreprises. Un droit à une période de mobilité volontaire sécurisée permettra en effet au salarié de développer ses compétences dans une autre entreprise, tout en ayant la garantie de pouvoir retrouver son emploi d’origine ou un emploi similaire en termes de qualification et de rémunération.
A titre d’exemple, un salarié qui démissionne pour intégrer une nouvelle entreprise et qui voit son contrat rompu dans un délai inférieur à 61 jours (en cas de rupture de période d’essai notamment) ne sera pas pris en charge par l’assurance chômage, s’il avait moins de 3 ans d’ancienneté dans son entreprise d’origine. Cette règle peut être insécurisante, notamment pour un jeune qui fait le pari d’une mobilité. Demain, il pourra bénéficier, dès 2 ans d’ancienneté, de cette période de mobilité pour mieux appréhender les conditions de travail dans la nouvelle entreprise et surtout sans prendre le risque de se retrouver au chômage et sans indemnisation.
Section 2 - De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
L’article 4 du projet de loi porte sur l’amélioration de l’information et des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel, transcrivant l’article 12 de l’accord du 11 janvier 2013.
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
1.1.1. La consultation des représentants des salariés sur les orientations stratégiques
Jusqu’à présent, le modèle est celui de l'information/consultation des représentants du personnel sur des projets de décisions ou des accords, c'est-à-dire sur la mise en œuvre d'une stratégie décidée par l’employeur. Le comité d’entreprise a en effet pour mission d’assurer une expression collective des salariés afin de permettre la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L.2323-1 du code du travail).
Pour ce faire, l’employeur informe et consulte régulièrement le comité sur son activité, sa situation économique et financière et les conditions d’emploi de ses salariés. À l’occasion de réunions trimestrielles ou annuelles, il soumet ces données et l’analyse qu’il en fait (rapports annuels, bilan social dans les plus grandes entreprises) à l’avis du comité et est par ailleurs amené à procéder à des consultations périodiques du comité sur des sujets spécifiques tels que la politique de recherche de l’entreprise ou l’élaboration du plan de formation des salariés.
Parallèlement, le comité est ponctuellement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle (article L.2323-6 du code du travail). À titre d’exemple, il est appelé à donner son avis en cas de projet de modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, de restructuration et de compression d’effectifs, de projets ayant des incidences sur les conditions de travail des salariés.
1.1.2. L’encadrement des expertises : un encadrement des délais et des coûts.
Le code du travail prévoit plusieurs cas de recours par le comité d’entreprise (CE) à un expert : les cas légaux (expert-comptable et expert technique pris en charges par l’entreprise) et d’autres cas d’expertise facultative, laissés à l’appréciation du comité et pris en charge par lui-même.
a) Les cas de recours à l’expert-comptable dans le code du travail
Il s’agit d’une faculté offerte à tous les CE.
Désignation de l’expert : c’est le CE qui décide de l’expertise et désigne l’expert-comptable de son choix. En pratique, la décision de recourir à une expertise et le choix de l’expert donnent lieu à un seul et même vote. La décision est en général adoptée par un vote à la majorité des voix exprimées (comme toute décision relative au fonctionnement du comité). Tout désaccord sur la nécessité d’une expertise et litige sur la rémunération de l’expert-comptable relève du président du TGI statuant en urgence. L’expert-comptable empêché d’accomplir sa mission peut saisir le président du TGI statuant en urgence.
Missions de l’expert : elles sont listées à l’article L.2325-35. L’expert-comptable assiste le CE dans : l’examen des comptes annuels de l’entreprise, l’examen des documents comptables, l’examen du rapport annuel sur la participation, le cadre des opérations de concentration, la procédure d’alerte économique, et dans les procédures de licenciement économique collectif.
L’étendue de la mission de l’expert est fixée par le CE. Les litiges sur ce point relèvent de la compétence du TGI qui statue en la forme des référés.
- Modalités d’accomplissement de la mission de l’expert
La loi ne fixe pas le temps nécessaire à l’expertise. Il a pu être jugé par un TGI que la direction d’une société n’avait pas le droit de limiter à l’avance la durée de la mission de l’expert-comptable. (Déc. TGI de Bourges de 1983)
L’expert est rémunéré par l’entreprise. Aucun texte ne réglemente la fixation des honoraires de l’expert-comptable. Seule l’ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant la profession d’expert-comptable précise que le montant des honoraires doit être « équitable et constituer la plus juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ». Il en résulte qu’une contestation ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la mission. En cas de litige sur ces honoraires, une procédure de conciliation organisée par le Conseil régional de l’Ordre existe. À défaut d’accord, le président du TGI est compétent.
Quant aux tarifs des experts comptables de CE, ils s’élèvent généralement entre 900 à 1200 euros par jour. Ce coût est à comparer à des prestations d’audit pour une direction qui sont généralement facturées deux fois plus cher. En droit français, l’employeur a le droit de vérifier si les honoraires facturés correspondent au travail effectué par des personnes possédant la nature et le niveau de compétences correspondant aux spécificités de l’entreprise. Il ressort en effet de la jurisprudence que l’entreprise dispose du droit de vérifier que les honoraires facturés correspondent au travail effectué par des personnes possédant la nature et le niveau de compétences correspondant aux spécificités de l’entreprise (CA du 13 septembre 2000, CPCT). Si l’employeur estime que ce n’est pas le cas il doit saisir le TGI qui statue en référés mais il ne peut pas refuser de payer car ce serait une entrave au fonctionnement normal du CE.
Il arrive que certains CE (le plus souvent CCE) procèdent par appel d’offre pour choisir leur expert-comptable en invitant plusieurs cabinets à soumissionner. Dans ces cas, moins disant financier ne veut pas nécessairement dire mieux disant. Il incombe donc aux représentants du personnel d’être vigilants quant à la qualité de l’expertise car ils sont seuls à pouvoir déterminer la mission de l’expert et à en contrôler l’exécution.
b) Les autres cas de recours à un expert
L’expert technique
Il s’agit d’une faculté du CE dans les entreprises de 300 salariés et plus, en cas de projet important d’introduction de nouvelles technologies.
- Désignation de l’expert : Le principe de l’expertise, le choix de l’expert et l’étendue de la mission d’expertise doivent faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du comité. À défaut d’accord, c’est le président du TGI qui est compétent pour désigner l’expert.
- Mission de l’expert : elle est définie par l’accord entre le chef d’entreprise et les élus. La loi n’a fixé aucune limite à la mission de l’expert.
- Modalités d’accomplissement de sa mission : l’expert technique est rémunéré par l’entreprise.
Les experts libres (expertises non encadrées par la loi)
Le principe en la matière est posé par l’article L.2325-41 du code du travail : le comité peut recourir à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.
- Désignation : L’appel à l’expert fait l’objet d’une délibération du comité d’entreprise.
- Mission : l’expert peut avoir une mission relativement large (champ de compétence limité au seul champ d’intervention du CE), mais il n’a pas accès directement aux documents de l’entreprise. Il travaille sur les documents détenus par le CE.
- Rémunération : l’expert est payé par le CE sur sa subvention de fonctionnement ou son budget des activités sociales et culturelles selon la nature des travaux qui lui sont demandés. Sa rémunération est fixée librement. En cas de litige, le TGI est compétent.
1.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’accès à une information complète et actualisée est un enjeu majeur pour l’implication des institutions représentatives du personnel (IRP) dans la marche de l’entreprise. Aujourd’hui, l’information fournie est morcelée dans différents rapports. Elle n’est en outre pas accessible et actualisée en permanence. En outre, l’avis des IRP est trop souvent considéré comme un passage obligé, une obligation formelle retardée au maximum, sans réelle prise sur le processus même de décision. C’est le cas notamment lorsque l’avenir d’un site est en cause.
Sur ce point, l’accord prévoit un certain nombre d’innovations importantes pour bâtir une culture de la confiance, et que le projet de loi reprend:
- la mise en place d’une nouvelle consultation périodique du comité d’entreprise, portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la possibilité de prévoir par décret ou accord collectif des délais de consultation des IRP, au terme desquels celles-ci seront réputées avoir été consultées ; ce délai ne pourra être inférieur à quinze jours et devra permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence ;
- la constitution d’une base de données économiques et sociales unique, accessible et actualisée en permanence, regroupant l’ensemble des informations sur la marche et la situation financière de l’entreprise et du groupe, en intégrant une dimension prospective. Cette base de donnée sera ainsi un outil de diagnostic et de dialogue sur la situation objective de l’entreprise permettant une plus grande anticipation des évolutions ; elle pourra dans certains cas, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, valoir communication au comité d’entreprise des rapports et informations qui lui sont périodiquement fournies ;
- un accès facilité à l’expertise pour les IRP afin de disposer d’une lecture extérieure approfondie de l’ensemble des informations fournies et de leurs implications opérationnelles et prospectives.
- la possibilité, pour les projets concernant plusieurs établissements, de mettre en place une instance de coordination des CHSCT, chargée d’organiser une expertise unique, et qui pourra rendre un avis ; celui-ci, si un accord d’entreprise le prévoit, pourra se substituer aux avis des CHSCT.
L’article 5 du projet de loi complète cette meilleure association et information des salariés à la stratégie de l’entreprise, en prévoyant la participation aux conseils d’administration (ou de surveillance) des grandes entreprises de représentants des salariés avec voix délibérative, conformément à l’article 13 de l’accord du 11 janvier 2013.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Aujourd’hui, les salariés ne disposent que très rarement d’une représentation au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises – conseil d’administration ou conseil de surveillance – avec les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs. Or, c’est dans ces instances que sont arrêtées les grandes orientations stratégiques sur l’avenir de l’entreprise ; il est donc nécessaire de remédier à cette situation.
Au-delà du dispositif prévu à l’article L.2323-62 du code du travail, qui prévoit la présence, avec voix consultative, de deux salariés membres du comité d’entreprise au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, plusieurs mécanismes spécifiques permettent aujourd’hui en droit français une représentation des salariés avec voix délibérative au sein des organes de gouvernance des entreprises :
- L’article L. 225-27 du code de commerce donne la faculté aux entreprises de modifier leurs statuts afin de prévoir l’élection comme administrateurs de représentants des salariés. Le nombre de représentants des salariés est d’au moins deux dans la limite de cinq et du tiers du nombre des autres administrateurs. Ce régime facultatif est toutefois très peu utilisé, notamment dans les grandes entreprises.
- La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit également un régime spécifique de participation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises publiques. Le nombre de représentants est de six (soit un tiers du conseil) dès lors que les personnes publiques détiennent plus de 90% du capital, et d’au moins deux dans les autres cas.
- La loi n°86-912 du 6 août 1986 visant les entreprises privatisées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 organise également un régime de représentation des salariés dans les instances dirigeantes (deux représentants dans les conseils de moins de quinze membres, et trois représentants à partir de quinze membres). Ce dispositif ne concerne toutefois qu’un nombre limité d’entreprises.
Par ailleurs, les articles L.225-23 et L.225-71 du code de commerce prévoient l’élection obligatoire d’administrateurs représentant les salariés actionnaires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance lorsque les salariés détiennent plus de 3% du capital social. Cette représentation des salariés actionnaires au sein des instances dirigeantes relève toutefois d’une logique distincte, les salariés représentant également les intérêts des actionnaires.
Les exemples de représentation des salariés au sein des organes de gouvernance, au-delà du cas particuliers des administrateurs salariés, sont rares dans les autres pays européens :
- En Allemagne, les salariés sont représentés au sein des conseils dans une proportion allant d’un tiers (pour les entreprises de 500 à 2000 salariés) à la moitié (dans les entreprises ayant plus de 2 000 salariés) des membres. Toutefois, ces structures de gouvernance s’apparentent à un conseil de surveillance et non à un conseil d’administration en vertu du système dualiste allemand et les représentants des salariés ne participent donc pas directement à l’administration des entreprises, mais davantage à la définition des grandes orientations.
- En Suède, les salariés ont le droit d’avoir des représentants au conseil d’administration, avec voix délibérative, mais il s’agit d’une simple faculté.
- Aux Pays-Bas, les comités d’entreprise ont la possibilité de présenter un candidat au conseil de surveillance dont les membres sont désignés par l’assemblée générale.
Il n’existe en revanche pas de dispositifs prévoyant la participation des salariés au sein des organes de gouvernance en Espagne, au Royaume-Uni ou en Italie.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
Le projet de loi prévoit une représentation obligatoire des salariés dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des grandes entreprises avec les mêmes droits et devoirs que les autres administrateurs. Par leur vote, les représentants des salariés pourront donc désormais peser sur les décisions stratégiques pour l’avenir de l’entreprise, là où les décisions se prennent.
2.3. Impact attendu
Le dispositif prévu s’appliquera aux entreprises (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions) dont les effectifs totaux sont au moins égaux à 5 000 salariés appréciés à l’échelle de la France ou à 10 000 salariés appréciés à l’échelle mondiale.
En 2011, le nombre d’entreprises de plus de 5 000 salariés employés en France était d’environ 200 - il s’agit de groupes composés eux-mêmes de plusieurs sociétés - employant environ 4 millions de salariés, soit 1 salarié du secteur privé sur 4. S’il est difficile d’évaluer le nombre d’entreprises ne dépassant pas 5 000 salariés en France mais ayant plus de 10 000 dans le monde, il est probable que celui-ci soit limité et ne dépasse pas une vingtaine d’entreprises et donc ne modifie pas substantiellement le nombre de salariés concernés par cette mesure.
PARTIE III - LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS L’EMPLOI ET DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI
L’article 6 du projet de loi décline tout d’abord l’article 3 de l’accord national interprofessionnel, par lequel « les parties signataires conviennent de la mise en place d’un dispositif de droits rechargeables dans le cadre du régime d’assurance chômage ».
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Le fonctionnement du régime d’assurance chômage est encadré par les articles L.5422-1 à L.5422-24 du code du travail (chapitre II « Régime d’assurance »). L’article L.5422-20 confie la définition des mesures d’application à « des accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés », agréés par le ministre chargé de l’emploi.
Il appartient donc au législateur de fixer le cadre d’intervention des conventions conclues entre les partenaires sociaux.
L’introduction d’une disposition législative complétant l’article L.5422-2 du code du travail a pour objet de poser le principe des droits rechargeables tel que prévu par l’ANI du 11 janvier 2013. L’alinéa 1er de l’article L.5422-2 encadre les conditions d’éligibilité permettant de bénéficier d’une première ouverture de droit à l’allocation d’assurance chômage. L’ajout d’un alinéa 2 vient compléter ces conditions d’éligibilité pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation lorsque les droits antérieurement ouverts ne sont pas totalement épuisés.
1.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
Le régime d’assurance chômage contribue à la sécurisation des parcours des salariés, tant en leur assurant un revenu de remplacement qu’en leur permettant de bénéficier des dispositifs d’accompagnement destinés à accéder à des emplois durables.
Ce dispositif des « droits rechargeables » consiste pour les salariés, en cas de reprise d’emploi consécutive à une période de chômage, à conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d’assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d’emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la période d’activité ouverte par cette reprise d’emploi.
Cela revient à modifier les règles de la réadmission : lorsqu’un demandeur d’emploi se réinscrit après une période d’activité suffisante pour se voir ouvrir de nouveaux droits, ceux-ci ne sont pas comparés avec les précédents mais cumulés, en tout ou partie.
Encadré : Illustration en cas de cumul total des durées - Après 10 ans au sein de la même entreprise, un salarié est licencié et se voit ouvrir un droit à indemnisation de 24 mois. Après un an de recherche infructueuse, il décroche un CDD de 6 mois qui n’est pas reconduit. À sa réinscription, il dispose d’un reliquat de droit (12 mois avec une indemnité haute) et d’un nouveau droit (6 mois avec une indemnité plus basse). Dans ce cas, il est réadmis avec un droit à indemnisation de non pas 12 mois mais cette fois-ci, par exemple, de 18 mois. |
En premier lieu, il s’agit de d’assurer aux demandeurs d’emploi que, dans tous les cas, la reprise d’un emploi aura un effet positif sur leur prise en charge par l’assurance chômage. Cette incitation devrait encourager la reprise d’emploi et limiter ainsi le risque d’un éloignement durable du marché du travail.
Par ailleurs, l’adaptation progressive des règles d’indemnisation au fonctionnement du marché du travail conduit à des conditions d’indemnisation différentes pour des situations semblables. La mise en place des droits rechargeables pourrait conduire à des règles plus homogènes, quelles que soient la nature ou la durée du contrat de travail.
1.3. Impact attendu
a) Impact financier
L’objet de la disposition proposée est d’inscrire le principe des droits rechargeables comme cadre à la convention d’assurance, laquelle en arrêtera les modalités pratiques.
Avec ce dispositif, les demandeurs d’emploi seront mieux indemnisés par l’assurance chômage notamment s’ils ont repris un emploi de courte durée entre deux périodes de chômage. C’est une avancée importante de la couverture des demandeurs d’emploi, quand aujourd’hui moins d’un sur deux est indemnisé.
Qui sont les allocataires en réadmission ?
En 2010, l’assurance chômage a enregistré 270 000 entrées en indemnisation par mois en moyenne. Ces entrées peuvent être rangées en quatre catégories :
§ Admission (36 % des entrées) ;
§ Réadmission sur reliquat de droit nul (« nouvelle admission ») (14 %) ;
§ Reprise de droit (29 %) ;
§ Réadmission avec comparaison du capital (22 %), à savoir :
- Le nouveau droit est retenu (68 % des comparaisons) ;
- L’ancien droit est retenu (32 %).
Sur la période, les parts respectives dans les entrées restent relativement stables.
S’agissant des réadmissions :
- Les personnes pour lesquelles le nouveau capital est sélectionné, soit 68 % des réadmissions, avaient 7 mois de reliquat et ont travaillé 14 mois, en moyenne.
- Les personnes ayant repris leur reliquat, soit 32 % des réadmissions, avaient 16 mois de reliquat au moment de leur sortie et ont travaillé 9 mois, en moyenne.
Figure 55 : Répartition des allocataires en réadmission
suivant la durée relative du reliquat de droit et du nouveau droit à indemnisation en 2010
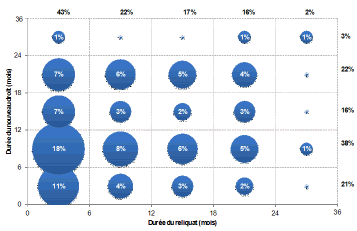
Source : Unédic
Lecture : En 2010, 18% des allocataires réadmis présentait un reliquat de droit inférieur à 6 mois et un nouveau droit entre 6 et 12 mois. Ceux-ci ont été réadmis sur la base de leur nouveau droit et l’ancien annulé.
Ainsi pour près d’un tiers des entrées en indemnisation, concernant donc plus de 700 000 allocataires, il existe des périodes d’emploi non retenues pour le calcul des droits. La masse de droits potentiels à indemnisation annulés par cette procédure est estimée à 6,6 Md€ pour l’année 2010. Ce potentiel reste théorique car les allocataires ne consomment pas tous l’intégralité des droits ouverts.
En effet, en moyenne, les chômeurs indemnisés sortis du régime d’assurance chômage au cours de l’année 2011 ont utilisé 61 % de l’intégralité de leur droit (cf. figure 56). La part du droit consommée est plus importante chez les 50 ans et plus et pour ceux qui ont des durées maximales d’indemnisation faibles ou élevées.
Figure 56 : Taux d’utilisation des droits à l’assurance chômage
Moins de 50 ans |
50 ans ou plus |
Ensemble | ||||
Droit potentiel |
Utilisation du droit |
Durée consommée (en jours) |
Utilisation du droit |
Durée consommée (en jours) |
Utilisation du droit |
Durée consommée (en jours) |
4 à 8 mois |
80% |
144 |
85% |
152 |
81% |
145 |
8 à 12 mois |
70% |
221 |
80% |
265 |
71% |
226 |
12 à 16 mois |
61% |
257 |
74% |
307 |
62% |
260 |
16 à 20 mois |
54% |
295 |
70% |
382 |
55% |
302 |
20 à 24 mois |
55% |
391 |
68% |
465 |
55% |
393 |
24 à 28 mois |
|
|
60% |
476 |
60% |
476 |
28 à 32 mois |
|
|
43% |
390 |
43% |
390 |
32 à 36 mois |
|
|
62% |
679 |
62% |
679 |
TOTAL |
59% |
277 |
65% |
528 |
61% |
311 |
Source : Fichier national des allocataires (Unédic/Pôle emploi), échantillon au 1/40.
Champ : allocataires sortis de l’indemnisation Assurance chômage en 2011, hors annexe 8 et 10, France entière.
Hors effet sur les comportements, cette mesure pourrait représenter un coût pour le régime d’assurance chômage, du seul fait des demandeurs d’emploi qui pourront bénéficier de droits plus longs à indemnisation. Néanmoins, cet effet peut être contrebalancé par une meilleure incitation à la reprise d’emploi du fait de la perspective d’une meilleure indemnisation ultérieure.
L’évaluation de l’impact de la mesure dépendra à la fois des modalités précises à définir dans la convention d’assurance chômage et des effets à attendre sur les comportements de retour à l’emploi des allocataires. Les partenaires sociaux se sont par ailleurs engagés dans l’ANI du 11 janvier 2013 à veiller à ce que cette mesure ne vienne pas aggraver le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage.
Quelles que soient les modalités de calcul retenues par les partenaires sociaux, l’introduction des droits rechargeables permettra d’accroître la couverture du régime au bénéfice des plus précaires et par là d’améliorer la sécurisation de leurs parcours professionnels.
b) Impact sur les personnes physiques
Avec ce dispositif, les demandeurs d’emploi seront mieux indemnisés par l’assurance chômage notamment s’ils ont repris un emploi de courte durée entre deux périodes de chômage.
Impact sur les personnes morales :
- Les entreprises :
Pas d’impact.
- Unédic :
L’évaluation précise de l’impact de la mesure dépend à la fois des modalités précises à définir dans la convention d’assurance chômage et des effets à attendre sur les comportements de retour à l’emploi des allocataires.
Impact sur les administrations publiques
- Impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information
Cette mesure impliquera pour Pôle emploi des coûts supplémentaires administratifs liés à l’application de la nouvelle procédure telle qu’elle sera définie par les partenaires sociaux (paramétrage des systèmes d’information relatifs au recouvrement des cotisations, information des employeurs, questions-réponses…). Compte-tenu des sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
- Impact budgétaire
Les employeurs publics qui n’ont pas adhéré au RAC prennent en charge l’indemnisation chômage de leurs anciens agents. À ce titre, ils pourront être touchés par cette nouvelle mesure.
L’évaluation précise de l’impact de la mesure dépend à la fois des modalités précises à définir dans la convention d’assurance chômage ainsi que des effets à attendre sur les comportements de retour à l’emploi des allocataires.
2. Améliorer l’indemnisation des demandeurs d’emploi adhérents au Contrat de Sécurisation Professionnelle à l’issue d’un contrat court
L’article 6 du projet de loi vise également à améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi en transposant l’article 8 de l’accord du 11 janvier 2013 qui prévoit la création d’une aide versée au septième mois d’accompagnement pour les bénéficiaires expérimentaux du contrat de sécurisation professionnelle engagés dans une formation certifiante ou qualifiante et dont les droits à l’assurance chômage s’éteignent avant la fin de la formation engagée.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 de développement de l’alternance et de sécurisation des parcours professionnels (articles L.1233-65 à L.1233-70 du code du travail).
Ce dispositif est ouvert aux salariés en CDI licenciés pour motif économique des entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un congé de reclassement, celles de moins de 1 000 salariés (ou de 1 000 salariés et plus mais en redressement ou liquidation judiciaires).
Le CSP garantit aux bénéficiaires un revenu de remplacement élevé (avec le quasi maintien du salaire antérieur pendant 12 mois) qui permet, pendant cette période, de suivre un parcours d’accompagnement personnalisé, avec un accès facilité aux formations, dans une optique de reconversion professionnelle.
À titre expérimental, l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au CSP a prévu que : « le contrat de sécurisation professionnelle pourra être ouvert aux demandeurs d’emploi en fin de CDD, en fin de mission d’intérim ou en fin de contrat de chantier visé à l’article L.1236-8 du code du travail, sur un bassin d’emploi donné ».
L’article 43 de la loi du 28 juillet 2011 a transcrit cette possibilité et a prévu que les anciens titulaires de contrats courts peuvent, sur certains territoires, bénéficier de l’offre de service proposée aux bénéficiaires de CSP en matière d’accompagnement vers l’emploi. L’article 43 précise : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L.1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L.1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L.1233-68 dudit code ».
Sur le plan opérationnel, un comité de pilotage national réunissant l’Etat et les partenaires sociaux définit le cadre et les paramètres de cette expérimentation. Il en suit la mise en œuvre de façon régulière et s’assure que le coût de cette expérimentation, à laquelle les partenaires sociaux ont convenu de consacrer une enveloppe financière dédiée comprise entre 2 et 3 millions d’euros, ne génère pas de dépassement de l’enveloppe financière globale dédiée au financement du CSP.
Conformément à ce que prévoit la loi, le cahier des charges définissant le cadrage de l’expérimentation, adopté le 23 janvier 2012 par le comité de pilotage national du CSP, limite l’application du CSP au volet accompagnement sans adapter les modalités d’indemnisation des bénéficiaires.
Ceux-ci peuvent donc prétendre à un accompagnement renforcé mis en œuvre par un référent unique et suivre des formations cofinancées par le FPSPP mais sont indemnisés en allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans les conditions du droit commun.
À la différence des bénéficiaires du CSP suite à un licenciement économique, leur durée d’indemnisation dépend donc entièrement de leur durée de cotisation à l’assurance chômage. Ils n’ont donc pas d’allocation garantie pendant 12 mois.
La mise en œuvre du CSP dans toutes ses dimensions pour les contrats précaires n’était pas immédiatement envisageable pour les raisons suivantes :
- Son coût élevé : les inscriptions sur les listes de demandeurs d’emploi à la suite d’une fin de contrat à durée déterminée ou de contrat d’intérim représentent environ 30 % des inscriptions alors que les entrées pour motif de licenciement économique ne représentent que moins de 10 % des entrées (cf. figure 25).
L’éligibilité des titulaires de contrat courts au CSP aurait induit une dépense d’allocation très importante pour l’assurance chômage, d’autant que pour ce public, l’employeur ne peut pas contribuer au financement du dispositif par le reversement de l’équivalent de leur préavis de licenciement.
- Des interrogations sur l’adéquation entre le public visé et l’accompagnement proposé. En effet, du point de vue du demandeur d’emploi issu de l’intérim ou d’un CDD, l’adhésion au dispositif d’accompagnement nécessite de renoncer à accepter une nouvelle mission ou un nouveau CDD et de se contenter d’allocation pendant les quelques mois du dispositif. Il a donc été choisi de l’expérimenter sur certains territoires uniquement.
Les bénéficiaires de l’expérimentation, en revanche, peuvent prétendre à la rémunération de fin de formation (dite R2F) à la suite de l’ARE quand Pôle emploi leur a prescrit une formation leur permettant d'acquérir une qualification reconnue et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. Cette rémunération est plafonnée à 652 € par mois, ce qui ne paraît pas suffisant pour convaincre un public qui a l’habitude de saisir toutes les opportunités d’emploi (et donc de revenus) de s’inscrire dans un parcours de formation long.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 8 de l’ANI du 11 janvier 2013 prévoit la mise en place d’une prime de 1 000 € à destination des adhérents au CSP expérimental qui suivent une formation et qui n’ont pas les droits à assurance chômage suffisants pour disposer de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) jusqu’au bout de cette formation. Elle sera versée au 7ème mois d’accompagnement.
Le versement d’une prime de 1 000 € permettrait d’assurer une sécurisation financière plus importante, notamment en complément de la R2F.
À titre d’exemple, sachant qu’il faut 3 mois en moyenne pour entrer en formation, un bénéficiaire qui disposerait de 6 mois de droit à assurance chômage au moment de son adhésion et qui entrerait en formation pour 6 mois aurait un revenu garanti d’environ 1 000 € par mois pendant les 3 dernier mois de sa formation en cumulant les 652 € de R2F et la prime de 1 000 € lissée sur 3 mois.
La loi du 28 juillet 2011 limitant le bénéfice du CSP aux anciens contrats courts au volet accompagnement, une adaptation législative est nécessaire pour permettre aux partenaires sociaux d’instaurer cette prime.
2.3. Impact attendu
a) La loi répond au besoin d’accompagnement des anciens titulaires de contrats courts
L’expérimentation d’un dispositif d’accompagnement renforcé au bénéfice des anciens titulaires de contrats précaires s’inspirant de celui du CSP pour les licenciés économiques répond au constat que cette catégorie de salariés est la première victime des restructurations et des retournements de conjoncture.
Ainsi, à titre d’exemple, la baisse des effectifs dans l’intérim a atteint 248 000 postes entre mars 2008 et mars 2009 alors que l’emploi salarié s’est replié au cours de la même période de 295 000 emplois.
Par ailleurs, dans le même temps, intérimaires et titulaires de contrat à durée déterminée passent au travers des dispositifs dédiés à la prise en charge des salariés licenciés pour un motif économique et, plus largement, à l’accompagnement des mutations économiques.
En donnant la possibilité aux partenaires sociaux de sécuriser financièrement le parcours de retour à l’emploi des adhérents à l’expérimentation, la loi vise à enrichir l’offre de service à destination des salariés précaires.
b) La loi devrait renforcer l’attractivité du dispositif
Les premiers mois de mise en œuvre de l’expérimentation démontrent les problèmes d’attractivité du dispositif. En effet, le taux d’adhésion (nombre d’adhésions / nombre de personnes convoquées aux réunions d’information au cours desquelles l’adhésion est proposée) est faible, aux alentours de 34 %39. Les retours d’expérience indiquent en outre que les abandons en cours de parcours sont nombreux. Par ailleurs, le dispositif est beaucoup plus attractif auprès des CDD que des contrats de travail temporaire (CTT) qui ne veulent pas déplaire aux agences d’intérim, lesquelles souhaitent qu’ils soient disponibles pour accepter une éventuelle mission.
Cette situation semble très fortement liée au problème du maintien des ressources sur la durée du parcours puisque 57% des bénéficiaires ont des droits à l’ARE inférieurs à 12 mois40. L’absence de revenu pendant l’ensemble du parcours constitue donc un frein à la sortie de la précarité.
Le projet de loi se propose donc de donner aux partenaires sociaux la possibilité de sécuriser davantage financièrement les bénéficiaires du CSP expérimental afin d’encourager l’adhésion et le maintien dans le dispositif ainsi que d’inciter le public ciblé à suivre des formations longues qui lui permettront de sortir de la précarité.
c) La loi devrait avoir un impact positif sur la qualité des emplois repris par d’anciens salariés précaires
Si l’expérimentation a pour objectif de répondre à la problématique des fins de missions d’intérim en cas de crise conjoncturelle et cible donc les « permanents » de l’intérim (nombreux dans le secteur automobile, notamment), la mise en place d’un dispositif ciblé sur le public précaire répond, en dehors de ces périodes, à la nécessité d’améliorer la qualité de l’emploi en sortant certains salariés de la précarité.
L’expérimentation menée a ainsi pour objectif de favoriser les changements de statut sur le marché du travail par la construction de parcours professionnels cohérents pour les travailleurs « ajustés » et à faible niveau de qualification.
En donnant la possibilité aux partenaires sociaux de sécuriser financièrement le parcours de retour à l’emploi des adhérents à l’expérimentation, la loi permettra tout particulièrement aux salariés les plus précaires de bénéficier d’un accompagnement qui pourra, par le biais de formations et de périodes en entreprise, donner de la cohérence à leur parcours professionnel.
d) L’impact de la loi sur les finances publiques devrait être limité
Le coût de la mesure est difficile à évaluer sans connaître les modalités d’application de la mesure qui seront retenues par les partenaires sociaux : application aux nouveaux entrants uniquement ou également à ceux qui font déjà partie du stock de bénéficiaires.
Par ailleurs, l’expérimentation est déjà engagée et durera jusqu’à ce que l’enveloppe financière consacrée par les partenaires sociaux à l’expérimentation soit atteinte. Le coût dépendra donc en partie de la volonté des signataires de prolonger et éventuellement d’étendre la convention du 19 juillet 2011 qui expirera au 31 décembre 2013.
Le financement du dispositif est pour l’instant prévu pour accompagner 8 570 personnes, l’Etat prenant en charge 900 € par entrée et l’Unedic 700 € par entrée au titre de l’accompagnement. Au total, l’enveloppe prévisionnelle est donc fixée à 6 M€ à la charge de l’Unedic et 6,3 M€ pour l’Etat.
Le comité de pilotage du CSP, qui décide des territoires et des potentiels de bénéficiaires du dispositif, a déjà fixé un objectif de 7 250 bénéficiaires sur 37 bassins d’emploi. Les entrées au 15 janvier 2012 s’élevaient à 5 190.
Compte-tenu des conditions fixées dans l’accord des partenaires sociaux pour bénéficier de la prime, c'est-à-dire être en formation et être privé de ressources au cours de cette formation, et dans une hypothèse maximaliste de 1 000 bénéficiaires, le coût de la mesure s’élèverait donc à 1 M€.
L’article 7 du projet de loi pose les bases de la modulation des cotisations au régime d’assurance chômage pour lutter contre la précarité, et favoriser l’embauche en CDI. Les partenaires sociaux ont prévu à l’article 4 de leur accord que les contributions des employeurs seraient renchéries pour les contrats à durée déterminée de courte durée, qui expliquent la majeure partie de l’augmentation de la part des embauches en CDD ces dix dernières années.
3.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
L’assurance chômage est le régime de protection des salariés du secteur privé contre la perte d’emploi dont les règles sont régulièrement négociées par les partenaires sociaux.
Le législateur a entendu confier aux partenaires sociaux le soin de définir les règles de cotisation et d’indemnisation de l’assurance chômage et d’assurer la gestion financière du régime. À ce titre, l’Unédic est l’organisme paritaire chargé d’assurer la gestion de l’assurance chômage. Ainsi l’article L.5422-20 du code du travail précise que « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L.5422-14 à L.5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ». Régulièrement, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel renégocient la convention d’assurance chômage, laquelle fixe les caractéristiques des cotisations et de l’indemnisation du régime. L’actuelle convention arrive à échéance au 31 décembre 2013.
Le code du travail définit le cadre du financement de l’assurance chômage. Ainsi, « l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. » (article L.5422-9) et « Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. » (article L.5422-12). Sur cette base, les partenaires sociaux fixent un taux de cotisation uniforme pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de l’assurance chômage, décomposé en une part employeur et une part salarié.
L’instauration d’un régime de contribution spécifique à une profession − notamment concernant les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle (annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage) − est permise par l’article L.5422-6 (anciennement L.351-14) du code du travail. Celui-ci précise que « lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L.5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat. »
De la même manière, mettre en place une modulation des contributions sur la base d’autres critères que la profession, s’agissant des salariés relevant du régime général, nécessite d’inscrire dans la loi une disposition autorisant les partenaires sociaux à l’introduire dans la convention d’assurance chômage.
3.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
La feuille de route de la grande conférence sociale de juillet 2012 indiquait que la négociation à venir comporterait « un volet ayant trait à la lutte contre la précarité excessive du marché du travail (contrats précaires, temps partiel voire très partiel subi,…), ainsi qu’à la prise en charge par le service public de l’emploi des publics concernés » et que « dans le cadre de la renégociation de la convention d’assurance chômage, les partenaires sociaux tiendront compte à la fois de la situation financière du régime, du marché du travail dégradé et des évolutions induites par les négociations précédemment évoquées, en particulier en vue de la modulation des cotisations. »
Par suite, le document d’orientation de septembre « pour une meilleure sécurisation de l’emploi » invitait les partenaires sociaux à « trouver des leviers pour que le CDI demeure ou redevienne la forme normale d’embauche, notamment en prenant en considération les coûts induits par les différentes formes de contrat, et en en tirant les conséquences sur la modulation des taux de cotisation, qui aura ensuite vocation à être déclinée dans la convention d’assurance chômage. »
La modulation des taux, consistant en un renchérissement des contrats courts, peut poursuivre deux objectifs non exclusifs :
- créer une incitation financière à la conclusion d’un CDI ou à un contrat plus long là où l’employeur aurait privilégié un CDD plus court ou de l’intérim pour bénéficier de plus de souplesse ;
- accroître la contribution au régime d’assurance chômage (RAC) des employeurs et des secteurs qui, par leurs pratiques ou spécificités, coûtent en proportion plus cher au régime ; ce surcroît de recettes, s’il n’est pas l’objectif premier de la mesure, permettra de financer une exonération au bénéfice des jeunes nouvellement embauchés en CDI.
3.3. Impact attendu
a) Situation actuelle
Aujourd’hui, les cotisations d’assurance chômage sont acquittées sur la base d’un taux fixe de 6,4 % - 4 % à la charge de l’employeur et 2,4 % à la charge du salarié - applicable au salaire brut dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (12 344 €/mois en 2013).
Le recours aux formes précaires d’emploi est déjà en partie renchéri : un CDD de droit commun (remplacement et accroissement temporaire d’activité) ou une mission d’intérim donne lieu au versement d’une prime de précarité (égale à 10 % des salaires versés41), sauf embauche en CDI à l’issue et dérogations spécifiques (CDD saisonniers et « d’usage »). En outre, le taux de cotisation est accru pour les intermittents du spectacle : 10,8 % - dont 7 % pour l’employeur et 3,8 % pour le salarié- qui se décompose en une contribution interprofessionnelle de 5,4 % et une contribution spécifique de 5,4 %.
b) Modalité de réforme
Le projet de loi ne définit pas les contours précis de la modulation des taux de contribution à l’assurance chômage. Il en pose le principe afin de permettre aux partenaires sociaux de pouvoir introduire dans la convention d’assurance chômage les termes de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Cet accord prévoit :
- Le maintien de la contribution employeur sur les CDI, les contrats d’intérim ainsi que les CDD de remplacement et saisonniers à 4 % ;
- Une hausse de 3 points de cotisation pour les CDD de moins d’1 mois, hors CDD d’usage (soit un passage de 4 % à 7 %) ;
- Une hausse de 1,5 point de cotisation sur les CDD de 1 à 3 mois, hors CDD d’usage (soit un passage de 4 % à 5,5 %);
- Une hausse de 0,5 points de cotisation sur les CDD d’usage de moins de 3 mois (soit un passage de 4 % à 4,5 %).
Cette surcotisation, par rapport au taux de base de 4 %, n’est pas due ou sera remboursée lorsque le salarié est embauché en CDI à l’issue de ce CDD.
Parallèlement, serait introduite une exonération de cotisations patronales pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans pour les 3 premiers mois d’emploi (4 mois dans les PME de moins de 50 salariés).
c) Estimation de l’impact financier
Hausse de la cotisation sur les CDD courts
Compte-tenu des sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer l’exemption de surcotisation dont bénéficient les CDD saisonniers et les CDD pour remplacement d’un salarié absent. De même, il n’est possible d’estimer finement le manque à gagner d’un remboursement de la surcotisation en cas de transformation du CDD en CDI.
Aussi cette évaluation constitue un majorant de la recette supplémentaire que pourrait générer l’instauration d’un tel barème.
Dans ces conditions, le rendement attendu d’un tel barème, appliqué à l’ensemble des CDD courts, peut être évalué de 150 à 200 millions d’euros par an, dont un quart provenant des CDD dits d’usage.
Détails de l’évaluation :
L’évaluation est réalisée en réunissant deux sources :
- Les Déclarations Préalables à l’Embauche (DPAE) de l’Acoss constatées en 2011 ;
- L’évaluation des salaires horaires moyens des CDD, exprimés en part de Smic, dans les déclarations annuelles de données sociales (DADS) de l’Acoss, actualisé du Smic horaire pour 2013.
Il convient de rappeler que cette évaluation reste nécessairement fragile et constitue un majorant puisque les déclarations ne donnent pas systématiquement lieu à embauche effective.
Figure 57 : Estimation du nombre de salariés concernés et de leur rémunération
Nombre de Contrats |
Durée moyenne en jours |
Nombre d'emplois |
Salaire mensuel brut moyen | |||||||
Durée des CDD |
CDD |
dont CDD ordinaires |
dont CDD d'usage |
Total (en milliers) |
dont CDD ordinaires |
dont CDD d'usage |
Ensemble des CDD (en €) |
dont CDD ordinaires |
dont CDD d'usage | |
<= 1 semaine |
9 486 493 |
4 172 444 |
5 314 049 |
2,5 |
65 |
29 |
36 |
2 159 |
1 902 |
2 360 |
1 semaine à 14 jours |
1 290 553 |
567 585 |
722 968 |
10 |
35 |
16 |
20 |
2 159 |
1 902 |
2 360 |
15 jours à 1 mois |
2 461 674 |
1 082 644 |
1 379 030 |
22,5 |
152 |
67 |
85 |
2 159 |
1 902 |
2 360 |
1 à 2 mois |
970 840 |
708 713 |
262 127 |
45 |
120 |
87 |
32 |
2 026 |
1 902 |
2 360 |
2 à 3 mois |
696 337 |
508 326 |
188 011 |
75 |
143 |
104 |
39 |
2 026 |
1 902 |
2 360 |
CDD toute durée |
17 310 923 |
8 795 382 |
8 515 541 |
46 |
2 181 |
1 519 |
662 |
2 041 |
1 902 |
2 360 |
Source : Acoss, DPAE 2011 |
Source : Dads 2009, actualisé du Smic horaire 2013 | |||||||||
Lecture : En 2011, 5,3 M d’embauches en CDD de moins d’une semaine ont été déclarés dans les secteurs éligibles aux contrats d’usages, correspondant à 36 000 ETP en moyenne annuelle. Le salaire moyen des CDD d’usage est estimé à 2 360€ brut par mois.
Note : S’agissant des salaires moyens, il n’a été possible que d’évaluer en part de Smic le salaire moyen des CDD dans les secteurs éligibles au contrat d’usage et dans les autres secteurs (« CDD ordinaires »). Cela sans pouvoir introduire une distinction par durée.
Figure 58 : Estimation du surcoût en année pleine
Barème |
Surcoût en M€ | |||||
Durée des CDD |
Total (moyenne) |
dont CDD ordinaires |
dont CDD d'usage |
Total |
dont CDD ordinaires |
dont CDD d'usage |
<= 1 semaine |
1,47% |
3,0% |
0,5% |
25 |
20 |
5 |
1 semaine à 14 jours |
1,47% |
3,0% |
0,5% |
13 |
11 |
3 |
15 jours à 1 mois |
1,47% |
3,0% |
0,5% |
58 |
46 |
12 |
1 à 2 mois |
1,19% |
1,5% |
0,5% |
34 |
30 |
5 |
2 à 3 mois |
1,19% |
1,5% |
0,5% |
41 |
36 |
5 |
CDD toute durée |
0,32% |
0,41% |
0,16% |
172 |
142 |
30 |
Note de lecture :
- La ligne « CDD toute durée » correspond à l’ensemble des contrats signés en 2011 et indique que la surcotisation totale est équivalente à une hausse de la cotisation de l’ensemble des CDD de 0,32 point, soit celles des CDD ordinaires de 0,41 point et celles des CDD d’usage de 0,16 point.
- Celle du barème « total » traduit la surcotisation équivalente à appliquer à l’ensemble des CDD d’une même durée. Ainsi surtaxer les CDD ordinaires de moins d’un mois de 3 point et ceux d’usage de 0,5 point est équivalent, en rendement, à une surcotisation de 1,47 point sur l’ensemble des CDD de moins d’un mois.
Cette évaluation est affectée par deux biais jouant en sens opposés :
- d'un côté, l’exclusion des CDD saisonniers et de remplacement d’un salarié absent n’est pas possible, faute de données fiables ;
- de l'autre, l’évolution à attendre du nombre global d’embauches par rapport à 2011, et en particulier en contrats courts, du fait du retour de la croissance.
Au total, en tenant compte de ces deux effets contraires, une fourchette de 150 à 200 M€ apparaît un ordre de grandeur raisonnable de la recette attendue.
Baisse de cotisation sur les embauches de jeunes en CDI
Introduire une exonération de cotisations patronales d’assurance chômage (4 points) pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI pendant leurs 3 premiers mois de contrat représenterait une perte de recettes de 150 à 200 M€.
En effet, 650 000 embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDI ont été constatées en moyenne entre 2007 et 2009 dans l’ensemble des entreprises. Le taux de rupture avant la fin de la première année est de 25 %, ce qui correspond approximativement à 600 000 emplois équivalent-temps plein (ETP) en première année de CDI. Le salaire moyen des jeunes embauchés en CDI est d’1,4 Smic.
Ainsi 150 M€ représentent 1 % d’une masse salariale éligible de l’ordre de 15 Md€ si l’exonération était valable sur l’ensemble de la première année. Limitée aux 3 premiers mois, cela correspond donc à une baisse de 4 %.
Cependant, les embauches de jeunes en CDI sont particulièrement sensibles à la conjoncture. En outre, la majoration à 4 mois de l’exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés conduirait à accroître l’enveloppe de l’ordre de 20 %.
Au total, compte tenu des aléas, il est raisonnable d’estimer le coût de cette exonération entre 150 et 200 M€.
Au total, ces deux mesures s’équilibrant, l’impact sur le solde financier de l’assurance chômage devrait être globalement neutre.
d) Impacts sociaux
Hausse de la cotisation sur les CDD courts
Ce dispositif constitue une incitation financière à l’allongement des CDD de courte durée. Il permettra de réduire le nombre de contrats précaires sur le marché du travail.
Baisse de cotisation sur les embauches de jeunes en CDI
Ce dispositif constitue une incitation financière à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI. Il permettra de réduire le chômage des jeunes de moins de 26 ans et de les intégrer durablement dans le monde du travail.
e) Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes concernées
Hausse de la cotisation sur les CDD courts
Impact sur les personnes physiques :
La mesure doit permettre de réduire, toutes choses égales par ailleurs, le nombre de CDD de moins de trois mois et notamment ceux de moins d’un mois. Elle permettra ainsi d’accroître la durée moyenne des CDD et de réduire la précarité excessive du marché du travail.
Impact sur les personnes morales :
- Les entreprises :
Le surcoût que représente cette mesure pour les entreprises peut être évalué de 150 à 200 millions d’euros par an, dont un quart provenant des CDD dits d’usage (cf. impact financier).
Ce surcoût est équivalent à une hausse moyenne des contributions de CDD, quelle que soit leur durée, de l’ordre de 0,3 point de cotisation.
- Les URSSAF :
Cette mesure impliquera pour les URSSAF des coûts supplémentaires liés à l’application des nouveaux taux prévus par la législation (paramétrage des systèmes d’information relatifs au recouvrement des cotisations, information des employeurs, questions-réponses…). Selon les sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
- Les collectivités territoriales :
Cette mesure augmentera le coût du travail des collectivités territoriales, des EPIC et des GIP des collectivités territoriales qui adhèrent au régime d’assurance chômage lorsqu’elles ont recours à des CDD de moins de trois mois. Eu égard aux sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
Impact sur les administrations publiques :
- Impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information
Pôle emploi recouvre les contributions dues pour l’emploi des intermittents et des expatriés. Cette mesure impliquera donc pour l’opérateur des coûts supplémentaires liés à l’application des nouveaux taux prévus par la législation (paramétrage des systèmes d’information relatifs au recouvrement des cotisations, information des employeurs, questions-réponses…). Ce coût devrait être négligeable.
- Impact budgétaire
Cette mesure augmentera le coût du travail des établissements publics de l’Etat qui utilisent des CDD de moins de trois mois et qui ont opté pour l’adhésion au régime d’assurance chômage. Sur la base des sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
Baisse de cotisation sur les embauches de jeunes en CDI
Impact sur les personnes physiques
La mesure doit permettre de réduire le nombre de jeunes de moins de 26 ans au chômage et de les intégrer durablement dans le monde du travail en les faisant bénéficier d’un CDI.
Impact sur les personnes morales :
- Les entreprises :
Introduire une exonération de cotisations patronales d’assurance chômage (4 points) pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI pendant leurs 3 premiers mois de contrat représenterait une économie de 150 à 200 M€ pour les entreprises.
- Les URSSAF :
Cette mesure impliquera pour les URSSAF des coûts supplémentaires liés à l’application des nouveaux taux prévus par la législation (paramétrage des systèmes d’information relatifs au recouvrement des cotisations, information des employeurs, questions-réponses…). Les sources disponibles ne permettent pas d’évaluer ce coût.
- Les collectivités territoriales :
Cette mesure permettra de baisser le coût du travail des collectivités territoriales, des EPIC et des GIP des collectivités territoriales qui embaucheront des jeunes de moins de 26 ans en CDI et qui ont adhéré au régime d’assurance chômage. Eu égard aux sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
Impact sur les administrations publiques
- Impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information
Pôle emploi recouvre les contributions dues pour l’emploi des intermittents et des expatriés. Cette mesure impliquera donc pour l’opérateur des coûts supplémentaires liés à l’application des nouveaux taux prévus par la législation (paramétrage des systèmes d’information relatifs au recouvrement des cotisations, information des employeurs, questions-réponses…). Ce coût devrait être négligeable.
- Impact budgétaire
Cette mesure permettra de baisser le coût du travail des établissements publics de l’Etat qui embaucheront des jeunes de moins de 26 ans en CDI et qui ont adhéré au régime d’assurance chômage. Compte tenu des sources disponibles, il n’est pas possible d’évaluer ce coût.
L’article 8 du projet de loi réforme la réglementation du travail à temps partiel afin d’améliorer la situation des salariés dont la durée de travail est inférieure à un temps complet.
La grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 a mis en lumière le fait que le développement croissant du temps partiel subi était un facteur de précarisation et une source de contraintes majeures pour les salariés concernés, en particulier pour les femmes qui représentent 80 % des salariés employés à temps partiel. Le temps partiel contribue ainsi à lui seul à près de la moitié des différences de salaire mensuel entre les hommes et les femmes : l’écart de rémunération mensuelle brute moyenne est de 24 % entre femmes et hommes dans le secteur privé, alors que l’écart de salaire horaire est de 14 %.
Le temps partiel subi y contribue d’autant plus qu’il correspond à des emplois moins qualifiés, et par conséquent, moins rémunérés, que le temps partiel « choisi » ou le temps complet. En moyenne, le salaire horaire d’un salarié à temps partiel subi était en 2011 de 9,3 euros, contre 12,3 euros pour salarié un temps partiel choisi et 14,8 euros pour un salarié à temps complet (dans le cadre de leur activité principale). Parmi les 4,2 millions de salariés à temps partiel (tous secteurs confondus, y compris public), 31,7 % déclarent l’être faute d’avoir trouvé un emploi à temps complet, soit 1,3 millions.
C’est donc pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et tendre vers une plus grande égalité professionnelle que les partenaires sociaux se sont emparés de la question du temps partiel.
Figure 59 : Salaire mensuel et horaire net et durée hebdomadaire pour l’emploi principal.
Moyenne |
Médiane |
Limite du 1er décile |
Limite du 9e décile |
Limite du 1er quartile |
Limite du 3e quartile | |
Salaire mensuel net, y compris primes, pour l'emploi principal (en euros) | ||||||
Salariés à temps partiel |
996 |
850 |
300 |
1 802 |
560 |
1 267 |
- Salariés à temps partiel « subi » |
746 |
719 |
282 |
1 143 |
522 |
940 |
- Salariés à temps partiel « choisi » |
1 122 |
988 |
322 |
2 016 |
600 |
1 480 |
Salariés à temps complet |
1 997 |
1 700 |
1 170 |
3 100 |
1 374 |
2 261 |
Salaire horaire net, y compris primes, pour l'emploi principal (en euros/heure)(1) | ||||||
Salariés à temps partiel |
11,2 |
9,0 |
6,6 |
16,9 |
7,5 |
11,9 |
- Salariés à temps partiel « subi » |
9,3 |
7,9 |
6,2 |
12,3 |
7,1 |
9,5 |
- Salariés à temps partiel « choisi » |
12,1 |
9,8 |
6,8 |
17,9 |
7,8 |
12,9 |
Salariés à temps complet |
14,8 |
10,5 |
7,6 |
18,3 |
8,7 |
13,6 |
Durée hebdomadaire dans l'emploi principal (en heures) | ||||||
Salariés à temps partiel |
23,2 |
24,0 |
10,0 |
32,0 |
18,0 |
30,0 |
- Salariés à temps partiel « subi » |
22,0 |
22,0 |
10,0 |
31,0 |
17,5 |
28,0 |
- Salariés à temps partiel « choisi » |
23,9 |
25,0 |
12,0 |
32,2 |
18,0 |
30,0 |
Salariés à temps complet |
39,6 |
38,0 |
35,0 |
50,0 |
35,0 |
40,0 |
(1) Le salaire horaire est le rapport entre le salaire mensuel net et les heures correspondant à cette rémunération. Ces deux variables étant déclarées par la personne interrogée, elles peuvent parfois contenir des erreurs de mesure, ce qui peut entraîner dans certains cas des faux bas salaires horaires, inférieurs au Smic horaire net.
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011 ; calculs Dares.
4.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
a) Négociation collective en matière de temps partiel
La conclusion d’un accord collectif n’est pas obligatoire pour mettre en place des horaires à temps partiel. Il est en effet possible pour un employeur d’instaurer des horaires à temps partiel, même en l’absence d’accord collectif, dans le respect des dispositions du code du travail, notamment des conditions posées en termes de délai de prévenance en cas de modification d’horaire, d’interruption d’activité dans la même journée, ou encore des heures complémentaires.
En revanche, un accord collectif peut définir des modalités plus souples d’organisation des horaires de travail à temps partiel.
Certaines activités étant structurellement organisées autour du temps partiel, il semble nécessaire de renforcer le rôle des partenaires sociaux de ces branches dans la définition des modalités d’exercice du temps partiel. Les principales branches professionnelles concernées de manière structurelle par le temps partiel sont notamment celles des commerces de détail à prédominance alimentaire, des commerces d’habillement, des entreprises de propreté, de la restauration rapide, des commerces, des cafétérias, de la distribution directe, du portage de presse, de la vente à distance, des cabinets dentaires, etc.
b) Durée hebdomadaire minimale de travail et meilleure organisation des horaires de travail
À l’heure actuelle, le code du travail n’impose pas de durée hebdomadaire minimale de travail, ni de durée minimale de travail continu s’agissant du temps partiel : ainsi, un employeur peut embaucher un salarié pour la durée de travail qu’il souhaite et proposer des horaires éclatés dans la semaine ou sur la journée.
Si les partenaires sociaux ont négocié une durée minimale au contrat dans certaines branches professionnelles, telles la propreté ou la restauration rapide, cela n’est pas le cas dans toutes les branches.
L’objectif général du dispositif mis en place est de passer d’une logique où le temps partiel est utilisé comme variable d’ajustement de l’organisation du travail à une logique dans laquelle l’organisation du travail doit être adaptée pour favoriser un temps partiel choisi et non pénalisant plutôt qu’un temps partiel subi.
La généralisation du principe d’un socle minimal d’heures et l’exigence d’une organisation du travail fondée sur des journées ou des demi-journées complètes ou régulières doivent permettre de favoriser l’accès à tous les travailleurs à temps partiel aux droits sociaux et faire reculer sensiblement la précarité des salariés à temps partiel. La combinaison d’horaires contractuels faibles et du morcellement des heures de travail est en effet le principal facteur de précarité des salariés à temps partiel en ce qu’elle rend impossible ou très difficile la poly-activité, et qu’elle induit des charges annexes (transport, garde d’enfants, etc.).
En donnant aux négociateurs de branche – qui constitue le niveau pertinent pour concilier la prise en compte des caractéristiques sectorielles de l’activité et l’harmonisation des conditions générales d’emploi – les leviers pour bâtir un socle conventionnel qui organise dans le même temps une durée contractuelle de référence et le regroupement ainsi que la régularité des horaires, le dispositif cible les sources du temps partiel subi.
Au-delà, les négociations de branche qui s’ouvriront donneront l’occasion aux négociateurs, compte-tenu de l’obligation de repenser l’organisation générale du travail à l’aune du nouveau cadre légal, d’interroger les stipulations conventionnelles actuelles relatives aux amplitudes de travail ou encore aux délais de prévenance en cas de changements d’horaires
c) Heures complémentaires
À l’heure actuelle, en l’absence d’accord collectif, des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat sans donner lieu à majoration. Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut porter cette limite au tiers de la durée contractuelle avec une majoration de 25 % pour les seules heures effectuées au-delà du dixième de cette durée.
Il convient de noter que toutes les branches fortement utilisatrices de temps partiel ont conclu un accord permettant de porter au tiers de la durée fixée au contrat de travail le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par leurs salariés.
En revanche, seules quelques branches ont négocié une majoration dès la première heure complémentaire accomplie. Par exemple, dans la branche des « hôtels, cafés, restaurants », une majoration de 5 % est prévue pour les heures effectuées en deçà de la limite du dixième de la durée au contrat.
Créer une obligation de majoration de l’ensemble des heures complémentaires accomplies va permettre d’améliorer le niveau de rémunération des salariés à temps partiel.
Outre cet effet direct sur le pouvoir d’achat des salariés à temps partiel, la majoration dès la première des heures complémentaires vient renforcer l’incitation à une augmentation des bases horaires contractuelles. En effet, l’absence de majoration des premières heures complémentaires favorisait des logiques de sous-quantification de l’horaire contractuel au regard des besoins réels. Désormais, l’existence d’un coût direct associé à la réalisation d’heures complémentaires renforce l’incitation à proposer des horaires contractuels plus élevés.
Compléments d’heures
Le cadre législatif actuel permet de modifier la durée de travail d’un salarié à temps partiel par avenant au contrat de travail. Un avenant écrit au contrat de travail peut préciser au salarié concerné la nature du complément d’heures attribué, permanent ou temporaire.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé, dans différents cas de figure, les limites à donner à cette pratique. Dans son arrêt du 7 décembre 2010, elle a qualifié d’heures complémentaires toutes les heures accomplies en complément de l’horaire initial y compris par le biais d’un avenant temporaire.
Des dispositifs spécifiques de complément d’horaire ou de passage à temps complet ou de passage à temps partiel par avenant écrit au contrat de travail – permanent ou temporaire – ont été négociés par des branches, notamment celles qui sont fortement consommatrices de travail à temps partiel (propreté, restauration rapide, commerce de détail à prédominance alimentaire, etc.). L’objectif poursuivi est de limiter le recours aux CDD et de privilégier les salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leurs horaires de travail.
4.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
En matière de temps partiel, l’encadrement législatif doit concilier l’objectif de lutter contre le temps partiel subi tout en répondant aux contraintes d’activité de certains secteurs et à l’aspiration à un temps partiel choisi garantissant un niveau de protection sociale non discriminant. Il doit enfin être un outil permettant de lutter contre le temps partiel subi.
C’est dans cet esprit qu’il est proposé au législateur de procéder à une modification de la réglementation actuelle en matière de temps partiel.
Le texte instaure un noyau dur en matière d’encadrement du temps partiel via l’instauration d’une durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures et d’une rémunération majorée de toutes les heures complémentaires, garantissant ainsi aux salariés une durée de travail plus importante à même de leur assurer un accès aux droits sociaux et une augmentation de leur rémunération.
Il ne sera possible de déroger à cette durée minimale par une convention ou un accord de branche ou à la demande du salarié qu’à la condition que cette dérogation s’accompagne de la mise en œuvre d’une répartition des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes afin notamment de permettre de cumuler plusieurs emplois et d’ainsi atteindre une durée de travail plus importante.
En ce qui concerne les heures complémentaires, le texte modifie la réglementation actuelle imposant une majoration de 10 % dès la première heure effectuée, tout en prévoyant la possibilité pour un accord de branche de fixer le taux de majoration pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée prévue au contrat, sans pour autant que ce taux ne puisse être inférieur à 10 %.
Toujours dans cette même logique d’offrir la possibilité aux salariés à temps partiel d’augmenter leur temps de travail, tout en accordant à l’employeur la faculté d’adapter son organisation en fonction de l’activité, le texte prévoit la possibilité, par accord de branche étendu, d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés par avenant au contrat.
4.3. Impact attendu
Le projet de loi améliore la situation des salariés à temps partiel, en particulier celle des femmes - huit salariés à temps partiel sur dix étant des femmes - en contribuant à réduire l’écart avec les salariés à temps plein (majoritairement des hommes) via l’instauration d’une durée minimale au contrat ou d’une organisation permettant de cumuler plusieurs emplois -générant ainsi une augmentation de la durée de travail des salariés à temps partiel - et l’alignement du régime des heures complémentaires sur celui des heures supplémentaires.
a) Impacts économiques
Sachant que près d’un tiers des salariés à temps partiel déclarent travailler à temps partiel faute d’avoir trouvé un temps complet, les dispositifs mis en place par l’accord visent à renforcer les leviers pour lutter contre le temps partiel subi.
Figure 60 : Modalités d'organisation hebdomadaire du temps partiel selon les raisons du temps partiel
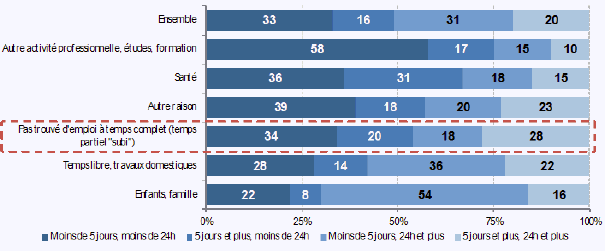 Champ : ensemble des salariés, hors apprentis et contrats en alternance ; France métropolitaine.
Champ : ensemble des salariés, hors apprentis et contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011 ; calculs Dares.
Figure 61 : Le temps partiel selon la taille de l’entreprise (en %)
Taille de l'entreprise(1) |
Proportion de salariés à temps partiel |
Part dans le temps partiel |
Part dans le temps partiel « subi » |
Part dans le temps partiel « choisi » |
Part dans le temps complet |
Moins de 10 salariés |
24,9 |
28,8 |
32,8 |
26,5 |
15,8 |
10 à 19 salariés |
16,7 |
9,0 |
11,5 |
8,1 |
8,2 |
20 à 49 salariés |
15,6 |
10,8 |
12,3 |
10,3 |
10,6 |
50 à 199 salariés |
14,4 |
11,5 |
11,2 |
11,9 |
12,5 |
200 à 499 salariés |
12,5 |
6,1 |
4,4 |
6,7 |
7,7 |
500 salariés ou plus |
12,0 |
33,8 |
27,9 |
36,5 |
45,1 |
Ensemble |
18,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
(1) Cette variable n'est renseignée que si l'employeur est une entreprise publique ou privée, ou une association. Elle correspond au nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi actuel déclaré par les personnes interrogés. Elle peut parfois contenir des erreurs de mesures et les chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Une autre variable sur l'effectif de l'entreprise est récupérée dans SIRENE, mais souffre d'un nombre important de valeurs manquantes.
Lecture : 24,9% des salariés employés dans un TPE (moins de 10 salariés) sont à temps partiel. Ils représentent 28,8% du total des salariés à temps partiel, alors qu'ils représentent 15,8% des salariés à temps complet.
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011 ; calculs Dares
L’instauration d’une durée minimale à laquelle il ne peut être dérogé que dans un cadre strict (demande individuelle ou accord de branche), couplée au renchérissement des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle, renforce les incitations à limiter le temps très partiel.
Les dérogations prévues à cette durée minimale devant être assorties d’horaires regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, cette organisation du travail facilitera la poly-activité et la conciliation des vies privée et professionnelle.
Au final, l’obligation de négocier portant sur les branches professionnelles les plus concernées par le travail à temps partiel permettra d’accroître la capacité de négociation des organisations syndicales vis-à-vis des organisations patronales et favorisera une amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés concernés.
En 2010, 34% des salariés à temps partiel des entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé ont effectué des heures complémentaires (en moyenne 38 heures sur l’année pour ceux qui en ont effectué). Ce nombre est à comparer au nombre moyen d’heures travaillées annuellement par un salarié à temps partiel qui aurait été employé toute l’année, soit 980 heures.
Figure 62 : Heures complémentaires effectuées de 2007 à 2010
Part de salariés à temps partiel faisant des heures complémentaires (en %) |
Nombre moyen d’heures comp. par salarié et par an |
Nombre moyen d’heures comp. par salarié et par an, pour ceux en ayant effectuées | |
2007 |
37% |
17 h |
46 h |
2008 |
38% |
17 h |
45 h |
2009 |
35% |
15 h |
42 h |
2010 |
34% |
13 h |
38 h |
Lecture : en 2010, 34 % des salariés à temps partiel ont effectué des heures complémentaires rémunérées; le nombre moyen d'heures complémentaires rémunérées effectuées dans l'année est, en moyenne, de 13 heures pour l’ensemble des salariés à temps partiel et de 38 heures en moyenne pour ceux à temps partiel qui ont fait au moins une heure dans l’année.
Champ : salariés à temps partiel des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, non agricole, hors apprentis, stagiaires et alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee-Dares, Ecmoss 2007, 2008, 2009, 2010 ; calculs Dares.
En 2010, les 29,1 millions d’heures complémentaires effectuées dans les entreprises de 10 salariés et plus ont été majorées selon un taux moyen de 17,2 %. Considérant l’absence de majoration légale des heures complémentaires correspondant au 1/10ème des heures travaillées (et donc sans prendre en compte d’éventuels accords de branche ou d’entreprises) et un taux majoré à 25% au-delà, on pourrait conclure que 30,8% des heures complémentaires ne sont pas majorées et le seraient désormais.
Figure 63 : Volume d’heures complémentaires et majoration dans les entreprises de 10 salariés ou plus
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Volume d’heures complémentaires, en millions |
27,9 h |
33,3 h |
28,6 h |
29,1 h |
Taux de majoration moyen des heures complémentaires |
18,4 % |
19,1 % |
18,3 % |
17,2 % |
Source : salariés à temps partiel des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, non agricole, hors apprentis, stagiaires et alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee-Dares, Ecmoss 2007, 2008, 2009, 2010 ; calculs Dares.
Au-delà des éléments de rémunération immédiats pour les salariés à temps partiel qui en bénéficieront, la réforme permettra d’augmenter le salaire différé de ces salariés, c’est-à-dire les pensions de retraite, travailler à temps partiel étant souvent une situation relativement permanente.
b) Impacts sociaux
La réforme de la réglementation du travail à temps partiel participe du développement du dialogue social en créant une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel et en renforçant le rôle des partenaires sociaux dans l’organisation des modalités d’exercice du temps partiel.
31 branches de plus de 5 000 salariés recourent structurellement au temps partiel, c’est-à-dire comptent plus de 30 % de leurs emplois à temps non complet (cf. figure 65). Toutes tailles de branches confondues, 3 millions de salariés travaillent dans des branches concernées, qui comptent 1,4 millions de salariés à temps non complet (cf. figure 64).
Figure 64 : Nombre de salariés appartenant à des branches structurellement concernées par le temps partiel
|
Effectifs |
Proportion de femmes |
Proportion de temps non complet | ||
Femmes |
Hommes |
Ensemble | |||
Branches de moins de 5 000 salariés | |||||
Moins de 30 % |
287 200 |
38,2 |
20,6 |
8,5 |
13,1 |
Plus de 30 % |
66 400 |
54,8 |
50,9 |
43,6 |
47,6 |
Ensemble |
353 600 |
41,3 |
28,1 |
13,6 |
19,6 |
Branches de 5 000 ou plus | |||||
Moins de 30 % |
11 948 100 |
37,3 |
25,2 |
8,4 |
14,7 |
Plus de 30 % |
2 947 700 |
70,0 |
53,6 |
32,3 |
47,2 |
Ensemble |
14 895 800 |
43,7 |
34,2 |
11,0 |
21,1 |
Toutes branches confondues | |||||
Moins de 30 % |
12 235 300 |
37,3 |
25,1 |
8,4 |
14,6 |
Plus de 30 % |
3 014 100 |
69,7 |
53,5 |
32,7 |
47,2 |
Ensemble |
15 249 400 |
43,7 |
34,1 |
11,0 |
21,1 |
Source : DADS 2010, calculs DARES.
c) Impact financier
La réforme de la réglementation du travail à temps partiel, en augmentant la durée de travail accomplie par les salariés concernés et en majorant l’ensemble des heures complémentaires pourrait contribuer à améliorer les recettes fiscales et sociales.
d) Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées
Impact sur les personnes physiques
La réforme va contribuer à la mise en œuvre d’horaires de travail plus réguliers sur des journées ou demi-journées complètes, luttant ainsi contre l’éclatement des périodes de travail, et améliorant de ce fait les conditions de travail des salariés à temps partiel, en fonction des négociations de branche qui se tiendront par la suite.
Impact sur les administrations publiques
Néant car la réforme ne s’accompagne pas de la mise en place d’une nouvelle procédure administrative.
Figure 65 : Branches de plus de 5 000 salariés structurellement concernées par le travail à temps partiel en 2010
Convention collective (Code IDCC) |
Effectif salarié au 31/12/2010 |
Part de salariés à temps partiel | |
Ensemble des conventions collectives de branche |
15 249 400 |
21,1 | |
02372 |
Entreprises de distribution directe |
25 100 |
79,9 |
02683 |
Portage de presse |
8 600 |
75,3 |
01031 |
Associations Familles rurales |
6 400 |
68,4 |
01501 |
Restauration rapide |
138 800 |
66,4 |
03043 |
Entreprises de propreté et services associés |
360 500 |
60,3 |
02408 |
Ets enseignement privé |
58 700 |
59,1 |
02691 |
Enseignement privé hors contrat |
12 200 |
57,7 |
02060 |
Cafétérias |
19 800 |
57,4 |
02511 |
Sport |
59 900 |
51,2 |
01875 |
Cabinets et cliniques vétérinaires |
13 700 |
50,2 |
01043 |
Gardiens concierges employés d'immeubles |
79 200 |
47,8 |
01147 |
Cabinets médicaux |
82 200 |
47,7 |
00468 |
Succursales du commerce de détail en chaussure |
20 600 |
47,7 |
01619 |
Cabinets dentaires |
36 900 |
45,2 |
01516 |
Organismes de formation |
74 800 |
45,0 |
01307 |
Exploitations cinématographiques |
10 200 |
44,1 |
00675 |
Succursales de vente au détail d'habillement |
95 200 |
42,0 |
01285 |
Entreprises artistiques et culturelles |
24 300 |
41,2 |
01996 |
Pharmacie d'officine |
119 100 |
40,5 |
02642 |
Production audiovisuelle |
5 800 |
38,3 |
01505 |
Commerce de détail fruits légumes épicerie |
63 400 |
35,6 |
01314 |
Succursale d'alimentation gérants |
5 200 |
35,3 |
00897 |
Services interentreprises de médecine du travail |
15 200 |
34,8 |
02216 |
Commerce détail et gros à prédominance alimentaire |
652 200 |
34,7 |
01483 |
Commerce de détail habillement textiles |
78 600 |
33,5 |
02336 |
Foyers et services pour jeunes travailleurs |
5 500 |
32,6 |
01000 |
Cabinets d'avocats |
33 100 |
32,3 |
00959 |
Laboratoires d'analyses médicales |
42 800 |
31,7 |
00733 |
Détaillants en chaussure |
10 100 |
31,6 |
02156 |
Grands Magasins et magasins Populaires |
39 900 |
30,8 |
01801 |
Assistance |
9 100 |
30,4 |
Source : DADS 2010, calculs DARES. Certains regroupements de convention collective ont été effectués : se reporter au Dares-Analyse 2012-017 « Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en 2009 », pour les identifier.
PARTIE IV - FAVORISER L’ANTICIPATION NÉGOCIÉE DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Section 1 - Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences
L’article 9 du projet de loi porte sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) en déclinant l’article 14 de l’ANI.
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
a) L’obligation légale de négocier la GPEC
La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 précise que la négociation porte sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les mesures qui lui sont associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique (articles L.2242-15 à L.2242-18 du code du travail).
La négociation porte également sur les modalités d'information et de consultation du comité d’entreprise, sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires. S'y ajoutent un volet sur l'emploi et la formation des salariés âgés et une négociation sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.
De façon facultative, la négociation peut porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, et peut être l'occasion de conclure un accord de méthode.
Si elles le souhaitent, les PME ou les TPE, non assujetties à cette obligation, peuvent mettre en place un plan de GPEC et bénéficier d’une prise en charge financière par l’Etat des coûts supportés pour la conception et l'élaboration du plan de GPEC, dans le cadre de conventions d'aide au conseil signée par le préfet, et pouvant aller jusqu'à 50 %.
Comme souligné par le rapport remis par Henri Rouilleault en août 2007, cette obligation n’a pas été créée ex nihilo mais s’inscrit dans un mouvement de longue durée de meilleure prise en compte par l’employeur des mutations de l’emploi et de meilleure information des salariés sur ce sujet. Depuis longtemps, l’employeur est en effet tenu par différentes obligations de fond et de procédure, bien au-delà de la seule obligation triennale de négocier sur la façon d’informer et de consulter sur la stratégie et ses conséquences prévisibles, et sur la mise en place d’un dispositif de GPEC.
Le préambule de l’ANI du 14 novembre 2008 sur la GPEC indique que « la finalité de la GPEC est d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications, liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques prévisibles, au regard des stratégies d'entreprises, pour permettre à celles-ci de renforcer leur dynamisme et leur compétitivité et aux salariés de disposer des informations et des outils dont ils ont besoin pour être les acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité interne. »
Son article 7 précise que la GPEC « (...) n'est donc pas une étape préalable aux procédures de licenciements collectifs et aux PSE qui obéissent à des règles spécifiques et doit, de ce fait, être dissociée de leur gestion. Pour autant, une GPEC conduite dans l'esprit et les conditions du présent accord doit permettre de consolider l'emploi et, le cas échéant, de mieux armer les salariés confrontés à des restructurations. »
Le nouveau code du travail a retiré la GPEC des chapitres relatifs à la « Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des difficultés économiques » et à la « Négociation obligatoire », pour l’insérer dans le chapitre 2 : « Négociation obligatoire en entreprise » du Titre IV. La GPEC est donc dissociée des dispositions traitant des licenciements collectifs pour motif économique et est ramenée au rang de négociation obligatoire « classique ».
b) Les obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle continue liées à la GPEC
En matière de formation professionnelle continue, l’article L.6321-1 du code du travail pose l’obligation de principe, pour l’employeur, d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Plusieurs obligations matérielles sont à la charge de l’employeur :
- Participer à son financement, par le biais d’une contribution dont le taux varie selon la taille de l’entreprise ;
- Consulter les représentants des salariés : tous les ans, le comité d’entreprise (ou s’il n’existe pas, les délégués du personnel) doit être informé et consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise.
c) Les mobilités professionnelles externes à l’entreprise dans le cadre de la GPEC
En matière de mobilité externe, a été créé fin 2006 un congé de mobilité (articles L.1233-77 à L.1233-83 du code du travail).
Le congé de mobilité est un dispositif d’accompagnement des projets de mobilité externe pour les entreprises d’au moins 1000 salariés ou pour celles appartenant à un groupe employant au moins 1000 salariés dans l’Union européenne qui ont négocié un accord collectif de GPEC prévoyant expressément les modalités et conditions de bénéfice du congé de mobilité.
Il permet aux salariés volontaires pour une mobilité externe de bénéficier d’un accompagnement, de prestations de formation, et de réaliser des périodes de travail au sein ou en dehors de son entreprise pour sécuriser son projet de mobilité professionnelle.
Sa durée est fixée par l’accord collectif, la loi n’imposant ni durée minimale ni durée maximale. Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité fixée par l’accord collectif excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté jusqu’à la fin du congé de mobilité, de même que ce terme peut être reporté en cas de périodes de travail.
Le salarié entre volontairement en congé de mobilité et perçoit une indemnisation au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois et qui ne peut être inférieure à 85 % du SMIC brut. Les cotisations sociales patronales et salariales ne sont pas dues sur le montant de l’allocation versée pendant les 9 premiers mois.
À l’issue du congé, le contrat de travail est automatiquement rompu. Il s’agit d’une rupture amiable pour motif économique, soumise aux règles applicables aux ruptures pour motif économique. Les indemnités de rupture ne peuvent être inférieures à celles dues en cas de licenciement pour motif économique.
Depuis la loi de finances pour 2011 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, ces indemnités de rupture, qui étaient auparavant exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu relèvent du même régime que celui applicable aux indemnités versées en cas de départ volontaire du salarié à la retraite.
En cas d’échec de la mobilité externe, le salarié peut s’inscrire à Pôle emploi et bénéficie, en fonction des droits accumulés, d’une indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
d) Une appropriation de la démarche de GPEC dans les entreprises qui traduit la nécessité d’aller plus loin
Sur les 5 000 entreprises ayant engagé des négociations, 3 000 ont signé des accords sur la période 2005-2011.
Il n’en existe pas d’étude exhaustive. Mais des études monographiques, conduites notamment sous l’égide de la DARES (études cabinet OASYS et Groupe Alpha), et des bilans établis par la DGEFP ont permis de mesurer le contenu des accords et la portée des engagements y figurant. Des enquêtes d’opinion auprès d’un panel large d’entreprises (plus de 400) ont par ailleurs permis de connaître la perception de directions et des représentants des personnels en entreprise.
L’accord de GPEC est perçu comme un outil d’anticipation par les acteurs de l’entreprise, directeurs des ressources humaines comme membres des instances représentatives du personnel (IRP). Cependant, la perception des objectifs visés par cette anticipation diffère assez nettement entre les représentants de la direction de l’entreprise et les représentants des IRP42 .
Si, au sein des entreprises ayant signé un accord, les directeurs des ressources humaines voient en majorité la GPEC comme un moyen d’accompagner, sur le plan de la gestion des ressources humaines, la vision stratégique à long terme de l’entreprise, les représentants du personnel voient plutôt dans la GPEC une aide à l’anticipation des restructurations, voire à la mise en œuvre des PSE, et un processus répondant davantage aux besoins de la direction qu’à ceux des salariés.
On peut distinguer en pratique plusieurs types d’accords GPEC :
- des accords de GPEC qui ne contiennent pas de "menaces" à terme des emplois au sein de l’entreprise,
- des accords de mobilité, encourageant ainsi les salariés à une mobilité géographique dans l’objectif de maintenir des emplois ou certains types de métiers,
- des accords de GPEC qui traitent de suppressions d’emplois (accompagnés de formations ou de requalifications des salariés concernés).
Sur le plan qualitatif, certains accords prévoient le recours à des outils intéressants qui, tant sur le plan de la formation continue que sur celui de la gestion des ressources humaines, contribuent à la sécurisation de l’emploi, même si très souvent ces actions sont basées sur des dispositifs auxquels le salarié a légalement droit. Les accords de GPEC présentent également l’intérêt d’organiser la mobilité des salariés, de les accompagner vers un autre poste dans l’entreprise et de sécuriser les mobilités vers d’autres entreprises.
Les entreprises ont bien pris la mesure de l’intérêt de la conclusion d’accords ou la mise en œuvre de démarches de GPEC pour sécuriser la mobilité.
Ainsi, en 2010, la totalité des accords envisagent la mobilité des salariés, prévoyant à 89 % à la fois la mobilité interne et la mobilité externe.
La mobilité externe donne des résultats satisfaisants lorsqu’un véritable processus d’accompagnement du salarié est mis en place avant la mobilité (formation, conseils sur l’orientation) et pendant la phase d’intégration sur le nouveau poste43.
La mobilité interne est surtout abordée sous l’angle de l’information sur les métiers, leurs évolutions et les passerelles possibles vers d’autres fonctions. La construction de référentiels des métiers et des compétences est l’outil le plus répandu, bien que la fréquence de leurs mises à jour fasse courir un risque d’obsolescence.
L’accès aux outils de type « bourse de l’emploi » s’est fortement étendu.
76 % des DRH et 59 % des IRP estiment que les informations apportées par la GPEC portent sur l’évolution des métiers44.
En 2009 et 2010, une majorité d’accords organise l’information et la consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur les emplois, ce qui n’était pas le cas dans les premiers accords de GPEC datant de 2005 et 200645.
Néanmoins, les analyses et bilans de ces accords font apparaître les limites de la démarche.
Malgré ses qualités d’anticipation reconnues par les acteurs de l’entreprise, le bilan de la GPEC reste mitigé.
Sur le plan qualitatif, bon nombre d’accords ne sont qu’une réponse formalisée à l’obligation légale de négocier.
Cette situation ne résulte pas principalement du fait que l’obligation de négocier n’est pas assortie d’une obligation de conclure. Elle s’explique par le manque de visibilité des négociateurs sur la stratégie de l’entreprise et sur l’évolution de son environnement. Plus la situation est difficile, plus l’entreprise est dépendante de facteurs lui échappant, plus elle est contrainte de raisonner à court terme et d’adapter à courte échéance sa stratégie.
Sur le champ des salariés visés et des thématiques abordées, ces accords ont principalement pour cible les emplois menacés et les salariés fragilisés.
La dimension de prévision globale sur les évolutions des besoins en métiers et en compétences, et les actions d’adaptation, d’anticipation, de formation et de mobilité interne est assez peu prise en compte, alors qu’elle s’inscrit dans la même logique que l’obligation de maintien de l’employabilité des salariés prévue à l’article L.6321-1.
Les modalités de mise en œuvre des accords témoignent d’une individualisation de la responsabilité d’anticiper les évolutions de l’emploi et des compétences.
Si le curseur varie d’une entreprise et d’une culture d’entreprise ou de secteur à l’autre, les démarches de GPEC prétendent de moins en moins gérer les parcours. Au-delà d’un repérage des emplois en déclin probable et des emplois en tension, elles renoncent à produire des prévisions chiffrées. Les notions de passerelles ou de proximités professionnelles ont reculé au profit des « Projets Personnels Professionnels », y compris pour des parcours potentiellement inattendus ou en tous cas souvent non « anticipés ». Si elles proposent encore des espaces de travail prospectif cohérents avec les perspectives d’évolution des groupes de métiers, elles mettent surtout à disposition, sur un mode plus ou moins volontariste, des outils d’accompagnement de mobilités pour des parcours dont le salarié devient le premier responsable.
Le salarié est appelé à prendre davantage l’initiative et à se mettre en appétence individuelle pour la mobilité professionnelle et la gestion de son propre parcours, dans l’entreprise ou en dehors d’elle.
Les actions de GPEC s’articulent encore insuffisamment avec les politiques classiques de gestion des ressources humaines, en particulier avec la formation professionnelle continue.
La GPEC est parfois abordée exclusivement comme une affaire de techniciens de la gestion des ressources humaines et des relations sociales, autour de la construction d’un référentiel des métiers et des compétences, de la mise en place d’un observatoire. Les salariés, ainsi que l’encadrement opérationnel de proximité ont une trop faible connaissance des dispositifs de GPEC.
Malgré les intentions et les textes des accords, la GPEC n’est souvent en pratique que peu articulée aux processus de décision de GRH de l’entreprise (formation, recrutement, mobilité et, a fortiori, organisation du travail).
Si, dans certains cas, une part des dépenses de formation est réservée aux emplois sensibles et en reconversion, dans d’autres cas, des DIF sont autorisés sur le temps de travail « au nom de la GPEC », le gros de la formation restant géré dans le cadre des plans habituels.
Il conviendrait ainsi de mieux distinguer ce qui relève de la formation à l’usage de l’entreprise et des formations (ou parcours) finalisées sur un plan de sécurisation professionnelle débouchant ou non sur une mobilité. Il s’agirait ici de renforcer un droit/devoir à l’élaboration permanente de projets professionnels pour tous les salariés, avec une priorité pour ceux identifiés par les accords et les processus de GPEC comme « emplois sensibles », avant que la suppression d’emploi pour motif économique ne soit envisagée.
Pour cela, il conviendrait de :
- renforcer les liens entre l’obligation de négocier sur la GPEC et celle de consulter les IRP sur le plan de formation en instaurant une obligation de négocier sur les grandes orientations du plan de formation.
- aller au bout de la logique de la GPEC, avec le développement des formations leviers d’employabilité, en globalisant la négociation sur la GPEC et en faisant coïncider les calendriers de consultation des IRP avec l’ouverture des négociations sur la GPEC et sur les grandes orientations du plan de formation.
Les actions de GPEC des entreprises ne sont pas suffisamment articulées avec la gestion des emplois et des compétences dans les entreprises sous-traitantes.
Dernière difficulté, les démarches de GPEC sont mises en œuvre entreprise par entreprise alors même que l’ensemble de la chaîne de sous-traitance est souvent soumise à des évolutions convergentes ou liées aux décisions stratégiques de l’entreprise donneuse d’ordre. L’absence de partage d’information et d’association autour de dispositifs de GPEC partagés constitue un frein majeur au développement de l’anticipation chez les sous-traitants.
Ainsi, puisque l’évolution quantitative et qualitative des métiers et des compétences de ces entreprises dépend directement des orientations stratégiques et de la situation économique de leur donneur d’ordre, la négociation triennale relative à la GPEC devrait offrir la possibilité d’associer donneur d’ordre et sous-traitants autour d’une information partagée et d’un dispositif de GPEC interentreprises.
e) Une nécessité de légiférer
Le recours à la loi s’impose dans la mesure où les obligations imposées aux personnes morales ou physiques sont du domaine législatif. C’est le cas notamment en matière de négociation obligatoire et en matière d’obligations de formation professionnelle continue à la charge des employeurs.
1.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 9 du projet de loi portant sur la GPEC vise à définir et améliorer son articulation avec plusieurs exercices :
- la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques créée à l’article 4 du projet de loi ;
- la négociation sur la mobilité interne créée à l’article 10 ;
- la politique de formation professionnelle au sein de l’entreprise et en particulier le plan de formation qui s’inscrira dans le cadre des orientations triennales négociées dans l’entreprise ;
- la politique de lutte contre la précarité, en inscrivant dans la négociation GPEC les perspectives de recours aux différentes formes de contrat de travail.
Il ouvre aussi la voie à une meilleure articulation des orientations stratégiques et de la GPEC d’une entreprise avec celles de ses entreprises sous-traitantes, qui manquent souvent de perspectives sur l’évolution nécessaire de leurs métiers et de leurs compétences.
a) Mieux articuler le dispositif de GPEC avec les choix réalisés par l’entreprise en matière de formation professionnelle de ses salariés
L’obligation de négocier sur la GPEC serait liée de manière plus étroite avec l’établissement du plan de formation afin de les mettre réciproquement au service l’une de l’autre et d’articuler plus directement les choix de formation dans l’entreprise aux constats réalisés en matière d’évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences.
Pour ce faire, la négociation triennale sur la GPEC traiterait nécessairement des orientations triennales de formation professionnelle de l’entreprise. Les orientations annuelles, ainsi que le plan de formation devront alors être cohérents avec ces orientations triennales. Cette cohérence sera vérifiée au moment des procédures d’information et de consultation déjà existantes relatives à la formation professionnelle dans les entreprises.
b) Intégrer dans le champ de la GPEC des éléments qui sont intrinsèquement liés à la gestion des carrières et des parcours dans l’entreprise
La négociation triennale porterait ainsi nécessairement sur les conditions de mobilité professionnelle et géographique interne à l’entreprise ainsi que sur les perspectives de recours aux différentes formes de contrat de travail.
Ayant à la fois une vocation à rationaliser les obligations de négociation et à donner une cohérence globale à une négociation visant à poser le cadre conventionnel de construction des parcours et des mobilités dans l’entreprise, la loi permettrait ainsi de donner au dispositif de GPEC une ambition nouvelle et une cohérence renforcée.
c) Ouvrir la voie à la construction de dispositifs de GPEC partagés permettant aux sous-traitants de mieux anticiper
La négociation triennale dans l’entreprise pourrait désormais porter sur les conditions dans lesquelles ses entreprises sous-traitantes peuvent être informées de ses orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences, ainsi que sur les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
1.3. Impact attendu
Le projet de loi vise à renforcer les actions de GPEC ayant un effet direct sur l’adaptation des salariés aux évolutions des emplois et des besoins en compétences résultant des mutations de l’activité économique. L’ensemble des dispositions prises doit permettre de mieux anticiper pour éviter les désajustements brutaux et les annonces tardives et donc réduire le nombre de licenciements pour motif économique et sécuriser les parcours professionnels.
Cette mesure doit être mise en lien avec les nouvelles modalités de mobilité sécurisée prévues par le projet de loi, qu’elles soient internes ou externes.
Articulées avec la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ces mesures doivent permettre à l’entreprise de mieux anticiper ses besoins et aux salariés d’être mieux informés, formés et accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel dans ou hors de l’entreprise.
L’article 10 du projet de loi, déclinant l’article 15 de l’accord du 11 janvier 2013, vise à faire de la mobilité interne dans l’entreprise un instrument négocié et articulé avec la GPEC pour mettre en place des mesures collectives d’organisation du travail et d’évolution des salariés, en dehors de tout projet de licenciement. La mobilité interne se caractérise par un changement de poste et/ou de lieu de travail au sein de la même entreprise.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
La mobilité professionnelle est un enjeu particulièrement important.
- 29% des personnes en emploi en 1998 et en 2003 ont changé de métier au moins une fois,
- 21% ont changé de domaine professionnel,
- 8% ont changé de métier en restant dans le même domaine professionnel. Le changement de métier s’accompagne souvent d’autres types de mobilité. Il dépend des caractéristiques individuelles des personnes et du métier initialement exercé.
Les changements fréquents d’employeurs vont souvent de pair avec une évolution des métiers exercés. Plus le temps passé hors de l’emploi est important, plus les changements de métier sont nombreux.
Les changements de poste et les promotions au sein de l’entreprise ou de l’administration s’accompagnent aussi souvent de mobilités entre métiers.
Le changement de métier est plus fréquent pour les jeunes et pour les hommes.
- Parmi les personnes de 20 à 29 ans en emploi en 1998 et encore en emploi en 2003, 31% ont changé de domaine professionnel. 12% ont changé de métier au sein du domaine initial.
- Parmi les personnes en emploi en 1998 et 2003 : 74% des femmes ont gardé le même métier, pour 69% en ce qui concerne les hommes.
En revanche, la fréquence des changements de métier varie peu selon le niveau d’études.
En début de carrière, la mobilité professionnelle sous toutes ses formes est plus fréquente.
À toutes les étapes de la vie professionnelle, d’importantes différences de parcours s’observent entre hommes et femmes.
Les disparités de trajectoires professionnelles résultent de caractéristiques et de choix individuels différenciés mais aussi de l’exercice de métiers différents.
Les mobilités professionnelles internes à l’entreprise
Un nouveau lieu de travail peut être imposé au salarié dans deux hypothèses :
- lorsque le nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique que l'ancien,
- ou lorsque le salarié est soumis à une clause de mobilité.
L'employeur peut imposer au salarié un nouveau lieu de travail lorsque cela n'entraîne qu'une simple modification des conditions de travail, le nouveau lieu de travail se situant dans le même secteur géographique.
La notion de « secteur géographique » reste floue. Le changement de secteur géographique doit s'apprécier au cas par cas par le juge en cas de litige (qualité de desserte du nouveau lieu de travail, nouvelle distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le nouveau lieu de travail, durée moyenne de trajet des salariés de l'entreprise, etc.). Il permet de déterminer si la mutation entraîne un changement substantiel du contrat du travail ou seulement un changement des conditions de travail.
L'employeur peut imposer au salarié un nouveau lieu de travail si une clause de mobilité figure dans son contrat de travail ou si la convention collective prévoit la mise en œuvre obligatoire d'une clause de mobilité et si le salarié a été mis en mesure d'en prendre connaissance.
La clause de mobilité n’est cependant valide qu’à condition de définir de façon précise sa zone géographique d'application, d’être proportionnée au but recherché, et d’être indispensable à l'intérêt de l'entreprise.
L'employeur ayant omis de définir le cadre géographique de la clause de mobilité ne peut pas imposer au salarié une mutation sur un autre lieu de travail. Il doit lui demander son accord car il s'agit alors d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
L'employeur est présumé mettre en œuvre de bonne foi la clause de mobilité. En cas de changement de lieu de travail dans le même secteur géographique et de la mise en œuvre d'une clause de mobilité, l'employeur ne peut pas exiger une mutation immédiate du salarié qui a droit à un délai raisonnable de mutation.
Le refus du salarié de la mise en œuvre de cette clause de mobilité peut faire l'objet d'une sanction allant jusqu'au licenciement pour faute grave.
L’employeur ne peut pas imposer de mobilité au salarié lorsque son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité et que la mutation intervient dans un secteur géographique différent du lieu de travail.
Dans ce cas, l'accord du salarié est nécessaire et l'employeur devra respecter certaines règles de procédure selon que le motif invoqué pour justifier la mutation est d'ordre économique ou non.
S’il s’agit d’un motif économique, l'employeur doit envoyer au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception la demande de modification envisagée, en précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
En cas de refus du salarié, l'employeur peut alors procéder au licenciement du salarié pour motif économique. S’il ne respecte pas cette procédure, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S’il s’agit d'une mutation pour un autre motif, l'employeur n'est tenu à aucune formalité particulière si ce n’est de laisser un délai raisonnable au salarié pour accepter ou refuser la mutation. En cas de refus du salarié, l'employeur pourra procéder au licenciement s'il dispose d'une cause réelle et sérieuse.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
La mobilité des salariés peut aujourd’hui être freinée par les incertitudes pesant sur les conditions de son exercice.
L’accord offre de nouvelles perspectives de mobilité dans un cadre sécurisé, que la loi décline. Outre la période de mobilité volontaire sécurisée prévue à l’article 3 de la loi, celle-ci prévoit en effet à son article 10 la mise en place d’une négociation triennale obligatoire sur les conditions de mobilité professionnelle et géographique interne à l’entreprise.
L’obligation de négocier sur les mesures d’accompagnement des mobilités professionnelles et géographiques serait précisée. La mobilité interne recouvrirait les mesures collectives d’organisation courante, hors donc les cas de licenciement, entraînant des changements de poste ou de lieu de travail au sein d’une même entreprise.
Elle devrait notamment comporter :
- Des précisions quant aux mesures d’accompagnement, notamment les actions de formation et les aides à la mobilité géographique apportées par l’employeur,
- Les limites à cette mobilité géographique et la définition de la zone géographique de l’emploi du salarié,
- Des dispositions visant à permettre de concilier vie professionnelle et privée dans le cadre de ces mobilités.
Ces mobilités professionnelles comme géographiques ne pourraient entraîner ni baisse du niveau de rémunération ni baisse de la classification professionnelle du salarié. Elles devraient également garantir a minima le maintien, voire l’amélioration de sa qualification professionnelle.
Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord de mobilité interne conclu seraient suspendues. Le refus du salarié de voir appliquer les stipulations de l’accord à son contrat de travail pourra justifier son licenciement individuel pour motif économique.
2.3. Impact attendu
a) Impacts économiques
Un meilleur accompagnement des mobilités participe d’un fonctionnement plus efficient du marché du travail.
b) Impacts sociaux
La négociation en entreprise sur la mobilité – qui dans les entreprises des 300 salariés et plus s’intègre à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – constitue un outil négocié d’anticipation des évolutions de l’entreprise. Elaborée dans un cadre collectif sans projet de licenciement, elle permet d’offrir un encadrement juridique aux mesures d’accompagnement à la mobilité, aux limités posées à celles-ci ainsi qu’aux mesures permettant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.
c) Impact financier
Aucun.
Section 2 - Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles
L’article 11 du projet de loi, reprenant les principes fixés par l’article 19 de l’accord du 11 janvier 2013, pose les bases d’un nouveau régime d’activité partielle, fusionnant et simplifiant les régimes antérieurs de chômage partiel.
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Alors que le dispositif d’activité partielle a été réformé à de multiples reprises depuis 2008 (cf. page 23), la nécessité de refondre globalement le dispositif afin d’en faire enfin un outil inscrit de manière pérenne dans la pratique des entreprises apparaît largement partagée.
Par l’article 19 de l’accord du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité en fixer les grandes orientations puis renvoyer à une négociation spécifique avec l’Etat les aspects relevant de son champ de compétence. Une réunion s’est tenue le 7 février 2013 permettant de convenir des dispositions à inscrire dans ce projet de loi.
Ce projet se révèle être une opportunité pour doter la France d’un système d’activité partielle attractif et modernisé, qui réponde pleinement aux besoins des entreprises confrontées à un paysage économique durablement dégradé.
Le chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie du code du travail pose les principes du dispositif de chômage partiel (articles L.5122-1 à L.5122-5). Afin de porter l’ambition d’un outil simplifié et unifié, le recours à la loi s’impose pour réécrire ce chapitre.
1.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 11 du projet de loi permettra de disposer d’un outil répondant aux aspirations suivantes :
a) Un dispositif unifié, lisible et avec des engagements adaptés
Il s’agit de créer un dispositif unique d’indemnisation en fusionnant les régimes de l’allocation spécifique et des allocations complémentaires de chômage partiel (en particulier APLD) sans nécessité de conventionnement.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des engagements et contreparties pourront être demandées à l’entreprise. Ces engagements seront adaptés et modulés en fonction de la récurrence du recours au dispositif.
Les allocations spécifiques et d’APLD seront regroupées et prises en charge dans les mêmes conditions par l’Etat et l’Unédic. Actuellement, au titre de l’APLD, l’entreprise perçoit de l’Etat 4,33 € ou 4,84 € par heure chômée en fonction de sa taille et l’Unedic complète ce montant à hauteur de 2,90 € par heure, soit un total de 7,23 € ou de 7,74 € par heure chômée. La répartition du coût de l’activité partielle ne serait pas modifiée. Les modalités de cette prise en charge seront déterminées par une convention entre l’État et l’Unédic.
b) Un accès facilité à tout type de formation pendant les périodes chômées
La possibilité d’organiser des actions de formation, des bilans de compétence ou des actions de VAE, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation sera étendue à toutes les heures chômées et non plus seulement réservée à la seule APLD, comme c’est actuellement le cas. Le salarié qui bénéficiera de ces actions de formation verra son taux de remplacement majoré dans des proportions précisées par décret en Conseil d’Etat.
c) Un cadre social et fiscal maintenu
Le régime fiscal et social de la nouvelle allocation d’activité partielle obéira comme c’est le cas actuellement aux règles de l’article L.5422-10 du code du travail. Cet article précise également le caractère cessible et saisissable de l’allocation.
d) Le solde lié à la rémunération mensuelle minimum (RMM) sera désormais à la charge exclusive de l’employeur
Si suite à une période d’activité partielle, le salarié est indemnisé à un niveau inférieur au SMIC horaire, le mécanisme de la rémunération minimale mensuelle permet de garantir au salarié un revenu qui sera équivalent au SMIC horaire. Il prenait la forme d’un solde couvrant la différence entre l’allocation d’activité partielle et le niveau du SMIC horaire. L’Etat participait jusqu’à 50% au financement de ce solde. La réforme supprime cette participation et laisse le financement de ce solde à la seule charge de l’employeur, ces situations étant assez marginales.
Dans les faits, la nécessité de mettre en œuvre la RMM se présente rarement (4 à 5 cas par an) dans la mesure où le niveau de l’allocation est proportionnellement élevé par rapport au taux du SMIC horaire actuel. Pour autant, il apparaît opportun que les crédits dédiés à l’activité partielle soient avant tout centrés sur le financement de la seule allocation.
Une simplification administrative des circuits d’indemnisation découlera de la suppression du financement pour partie de ce solde.
1.3. Evaluation et impacts de la mise en œuvre de la loi
a) Impact du contexte économique prévisionnel pour l’année 2013 sur la consommation d’activité partielle
Les heures de chômage partiel suivent globalement de manière contra cyclique les évolutions de la conjoncture économique, avec un décalage de l’ordre d’un à deux trimestres (cf. figure 66). Ainsi, la consommation d’heures chômées n’a augmenté significativement que lors des épisodes de récession marquée. Si les prévisions macroéconomiques n’anticipent pas une nette reprise de l’activité en 2013, elles semblent exclure un nouveau ralentissement d’ampleur. Ainsi, le nombre d’heures chômées ne devrait pas augmenter de manière sensible, à cadre législatif inchangé, du seul fait de la seule conjoncture économique.
Figure 66 : Chômage partiel autorisé et consommé et taux de croissance du PIB
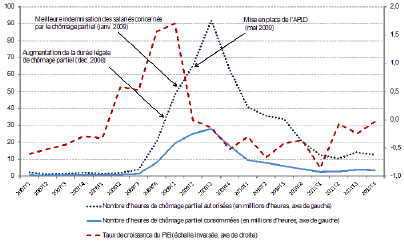
Source : DARES
La hausse du nombre d’heures chômées, souhaitée pour prévenir des destructions d’emploi, pourra par conséquent venir des réformes structurelles du dispositif qui devraient permettre d’augmenter le nombre d’entreprises recourant à l’activité partielle mais également, dans une proportion plus marginale, de la simplification des modes de calcul des heures à indemniser.
b) Impact de la réforme structurelle sur le niveau de consommation de l’activité partielle
Le principal objectif de la réforme est de permettre de lever les obstacles administratifs et indemnitaires liés au calcul des heures indemnisables afin d’inciter plus largement les entreprises qui connaissent des difficultés à y recourir.
Les grandes entreprises y ayant recours, notamment celles du secteur industriel, ne devraient pas voir leur nombre significativement augmenter, dans la mesure où elles utilisent déjà massivement l’activité partielle (cf. figure 67). La réforme vise avant tout à faire rentrer dans le dispositif les TPE/PME et les ETI.
Figure 67 : Nombre de salariés ayant effectué du chômage partiel par taille d’établissement
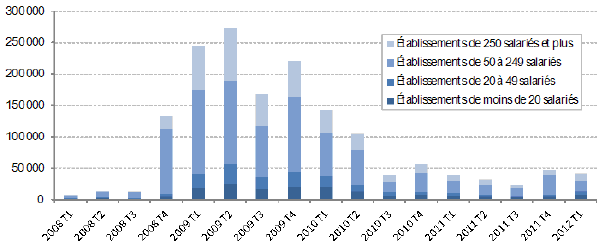
Source : Dares-DGEFP, extraction Silex. Données brutes, France entière.
c) Impacts budgétaires
Pour l’Etat
Avec la réforme, une heure chômée ne coûtera pas plus cher à l’Etat, dans la mesure où la répartition du financement entre l’Etat et l’UNEDIC n’est pas modifiée.
Le coût global de l’activité partielle ne sera renchéri que du fait de l’accroissement attendu du nombre d’heures chômées suite à la réforme mise en œuvre.
Pour l’UNEDIC
L’UNEDIC finance actuellement une partie de l’activité partielle au titre de l’APLD : 2,90 € par heure, à comparer à la prise en charge par l’Etat qui est de 4,33 ou 4,84 € par heure chômée en fonction de la taille de l’entreprise.
En 2012, 46% des heures chômées au titre de l’activité partielle (allocation de base et APLD) l’ont été au titre de l’APLD. Du fait de la fusion, l’heure chômée serait de 7,23 € et 7,74 €.
Sur le volume d’heures de 2012, le nombre d’heures à indemniser à la charge de l’UNEDIC serait donc multiplié par 2.
Figure 68 : Impact financier pour l’Unédic
Heures à indemniser au titre de l’APLD par l’UNEDIC | |
2012 |
5 766 399 heures |
Projection 2013 avec l’hypothèse d’un volume d’heures équivalent à 2012 |
12 513 086 heures |
Source : DGEFP
d) Impacts attendus en termes de préservation d’emploi
L’OCDE estime que « les systèmes d’indemnisation du chômage partiel ont un impact économique important vis-à-vis de la préservation de l’emploi en phase de ralentissement de l’économie ». Cependant, il faut tenir compte du fait que l’efficacité maximale d’un outil comme l’activité partielle se situe surtout en début de phase de ralentissement de l’activité, au moment où le taux de licenciement tend à être le plus élevé.
Comme évoqué en première partie, le modèle allemand a évité la contraction de l’emploi permanent de l’ordre de 0,75 point de pourcentage par rapport à ce qu’elle aurait été en l’absence des mesures de chômage partiel. Ce pourcentage monte à 0,77 avec le modèle italien. En France, il tombe à 0,08 % soit environ 10 fois moins. S’il est nécessaire de prendre en compte les particularités de chaque pays en terme de composition de la population active ainsi que de tissu économique, le système français tel qu’existant en 2008/2009 n’a pas permis de maintenir durablement les salariés placés en activité partielle dans l’emploi. Cela signifie qu’au plus fort de la crise, les entreprises ont préféré licencier plutôt que de conserver ou de faire entrer en activité partielle leurs salariés.
La réforme prévue par le projet de loi, qui autorisera un dispositif rénové tant dans son architecture qu’avec un niveau d’indemnisation porté au maximum du seuil d’intensité dès la première heure chômée (par rapport au modèle actuel), devrait rendre le dispositif plus efficace en terme de préservation de l’emploi puisqu’il devrait attirer de nouveaux publics d’entreprises qui jusqu’à présent préféraient envisager de se séparer de leurs collaborateurs plutôt que de les placer en activité partielle.
L’ensemble de ces mesures qui agissent sur les niveaux d’indemnisation et sur les taux d’effort des entreprises, revus à la baisse dans un cadre rénové, unifié et simplifié, devrait de manière certaine renforcer l’efficience du modèle français grâce à une convergence vers les meilleurs modèles européens.
e) Impacts de la réforme sur la capacité à mettre en œuvre des formations
En créant un cadre permettant d’organiser tous les types de formations pendant les heures chômées, comme c’est actuellement le cas pour la seule APLD (qui ne représente que 50% des heures chômées), le projet de loi permettrait que les entreprises ne soient plus soumises aux contraintes fortes résultant de l’obligation de ne pouvoir organiser que des formations dites « hors temps de travail » qui présentent le double inconvénient d’être limitées en termes d’offres mais également en termes d’heures mobilisables. En outre, grâce à la suppression des obstacles identifiés -à savoir l’obligation de conclure une convention pour pouvoir accéder à tous types de formations- et à une meilleure indemnisation des salariés, les entreprises, notamment les TPE devraient recourir davantage à la formation. En effet, jusqu’à présent les formations sont principalement mises en œuvre par les entreprises de taille importante (ETI et grands groupes).
Les entreprises qui ont mis en place des heures chômées et qui ont cherché à former pendant ces heures chômées y trouvent des avantages :
- mobilisation optimale du temps disponible ;
- moindre césure avec l’environnement de travail pour le salarié et en conséquence moindre inquiétude éventuelle de licenciement ;
- utilisation pour la formation des machines à l’arrêt.
Le bilan, qui fait suite à l’enquête sur les formations menées pendant des périodes d’activité partielle, a révélé que les périodes d’activité partielle ont été l’occasion pour certaines entreprises de déployer des actions de formation qui leur sont, habituellement, peu accessibles. La réforme devrait accentuer cet effet.
Les périodes d’activité partielle devraient, en définitive, conduire à une forte augmentation de l’effort de formation dans les PME, et à un maintien - ou plus exceptionnellement à une augmentation - du volume de formation dans les grandes entreprises (dont l’effort aurait sans doute baissé si de nouvelles mesures n’avaient pas été mises en œuvre46).
Ce triple effet volume, accélération (dans les grandes entreprises) ou encore élargissement des thématiques de formation (dans les PME) conduira nécessairement à renforcer ou à maintenir la place et le rôle de la formation dans les entreprises pendant les périodes chômées.
Concernant la durée, les formations au titre de l’activité partielle sont courtes : 83 % durent une semaine ou moins, dont deux tiers moins de 3 jours. Si pour les premières périodes de sous-activité, la durée des formations ne devrait pas évoluer, en revanche, pour les périodes prolongées de sous-activité, la durée des formations, et donc leur impact, devrait être augmentés.
Figure 69 : Utilité de la formation pour obtenir un emploi dans une autre entreprise
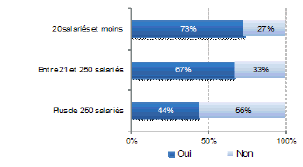
Source : FPSPP
En effet, préalablement à toute période d’activité partielle assortie de contreparties et d’engagements, un diagnostic approfondi de la situation de l’entreprise pourra être effectué avec les services de l’Etat et les IRP, ce qui devrait permettre de faciliter et d’anticiper la mise en place de formations qualifiantes - voire diplômantes - et ainsi renforcer encore les compétences et l’employabilité des salariés.
f) Impacts administratifs
Pour les entreprises :
L’impact principal sera constitué par la dématérialisation complète de l’ensemble des procédures de demande et de paiement d’activité partielle. Actuellement toutes les démarches exigent de remplir un document papier puis de le transmettre par courrier, télécopie ou courriel (obligation de le numériser).
Initialement prévu, cet objectif n’a pu être conduit à terme dans la mesure où le cadre réglementaire a été modifié à plusieurs reprises depuis septembre 2011, date qui avait clôturé une première phase d’expression des besoins. Il bénéficiera d’un cadre sécurisé avec cette réforme législative pérenne.
Pour les services de l’Etat :
Le rôle des DIRECCTE sera très largement recentré sur le conseil, l’appui et l’accompagnement des entreprises dans la mesure où elles seront déchargées de toutes les phases de gestion. Compte tenu de leur connaissance des entreprises et des compétences acquises, elles continueront d’instruire les demandes d’activité partielle. Avec l’extranet, des gains significatifs de temps seront réalisés, ce qui permettra également de mieux suivre les entreprises dans leur phase de recours à l’activité partielle.
Pour l’Agence de Services et de Paiement (ASP) :
L’ASP a été chargée de la maîtrise d’œuvre du futur extranet « activité partielle ». Il permettra de dématérialiser complètement l’instruction et le paiement de l’activité partielle. Si actuellement, l’ASP procède aux seuls paiements de l’activité partielle, la mise en place de l’extranet renforcera son rôle dans le dispositif. En effet, elle instruira également, en lieu et place des services de l’Etat, les états nominatifs de remboursement qui permettent d’établir le nombre d’heures à indemniser pour chaque salarié.
L’article 12 du projet de loi crée une nouvelle catégorie d’accords d’entreprise afin de permettre, dans les entreprises qui font face à de graves difficultés conjoncturelles, d’aménager temporairement l’équilibre global temps de travail-salaire-emploi.
2.1. Objectifs poursuivis par le projet de loi
La mesure proposée consiste à permettre à un accord collectif d’entreprise, pour assurer la pérennité de l’activité et des emplois, d’aménager directement les modalités d’organisation et de répartition de la durée et des horaires de travail ainsi que les rémunérations.
Cet accord doit fixer les garanties en matière d’emploi que l’entreprise est tenue de mettre en œuvre. Le non-respect de ces garanties peut conduire le juge, statuant en la forme des référés, à suspendre temporairement ou définitivement les effets de l’accord. Ainsi, pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut notamment procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique des salariés entrant dans son champ d’application.
Les éléments du contrat de travail qui seraient contraires aux nouvelles modalités d’aménagement définis par l’accord sont suspendus avec l’accord du salarié pendant la durée de celui-ci.
Cette mesure a donc pour objet de permettre temporairement aux entreprises, face à une chute conjoncturelle de la demande, de négocier dans le cadre de l’entreprise des accords, signés avec une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, pouvant suspendre des éléments du contrat de travail en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération, dans le respect de l’ordre public social.
Aussi, les mécanismes d’ajustements temporaires prévus par la mesure ne modifient pas de manière pérenne, le contrat de travail ; ils se limitent à suspendre pendant un temps défini les éléments du contrat de travail qui pourraient être contraires à l’accord négocié dans le cadre de l’entreprise. L’ordre juridique n’est donc pas modifié et la sécurité juridique des salariés est ainsi assurée.
La loi prévoit également qu’en l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise, l’accord puisse être négocié par des salariés expressément mandatés par des organisations syndicales. Dans ce cas, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par référendum.
2.2. Impact attendu
a) Impacts économiques
Au niveau macroéconomique, les accords de maintien de l’emploi permettent, en cas de baisse de la demande, de limiter les destructions d’emploi et, par conséquent, d’accroître le potentiel de reprise, une fois le choc conjoncturel surmonté.
Au niveau microéconomique, dans un contexte de crise, le recours à des mécanismes d’ajustements négociés doit permettre de préserver l’emploi tout en garantissant la survie des entreprises, par l’amélioration des coûts de production. Ces accords offrent ainsi la possibilité à une entreprise dont les coûts de production s’avèrent trop élevés lorsque la demande est déprimée, d’une part, de réduire son activité pour baisser ses coûts d’exploitation afin de palier des pertes de recettes, d’autre part, de couvrir ses besoins de trésorerie liés à l’augmentation du stock.
En échange de l’adaptation transitoire du temps de travail et des salaires, les entreprises s’engageront sur les conséquences d’une amélioration de la situation économique sur la situation des salariés, à l’issue de la période d’application de l’accord, en particulier sur la juste répartition des bénéfices des efforts consentis par les salariés. En effet, le maintien voire l’accroissement de la productivité permis par l’accord pendant cette période doit notamment permettre aux entreprises de poursuivre les efforts d’investissement dans l’innovation et l’amélioration de la compétitivité de leurs produits afin de préserver ou d’accroître leurs parts de marché.
En outre, ces accords, à l’image de l’activité partielle, permettront de préserver des compétences et des savoirs faire au sein des entreprises et d’éviter ainsi un des aspects négatifs du recours au licenciement, qui prive l’entreprise des compétences nécessaires à son redémarrage en cas d’amélioration de la situation économique.
b) Impacts sociaux
La mesure favorise le dialogue social dans les entreprises en vue d’adapter au mieux l’organisation collective du travail aux fluctuations de l’activité. Elle participe au renforcement du droit conventionnel, dans les limites de l’ordre public social et dans le respect des exigences conventionnelles de branches.
L’ampleur des adaptations transitoires de la durée du travail et des rémunérations est limitée par l’impossibilité de réduire les rémunérations égales ou inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) majoré de 20 % ni de porter la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil, ou de déroger aux dispositions conventionnelles de branche ou aux dispositions d’ordre public en matière de temps de travail (durées maximales, repos, congés).
c) Impact financier
En cas de choc économique négatif, le recours à des mécanismes temporaires d’ajustement présente l’avantage de préserver l’emploi et d’éviter ainsi une hausse du chômage.
d) Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes concernées
Impact sur les personnes physiques
La mesure doit permettre de réduire le nombre de licenciements, notamment les licenciements économiques et les PSE, en période de crise économique.
Impact sur les administrations publiques
Les services de l’État recevront les accords déposés, selon la procédure habituelle applicable à l’ensemble des accords collectifs. Les tribunaux de grande instance pourront en outre être mobilisés, à la demande de l’un de ses signataires.
En outre, le développement de ces accords devrait permettrait d’éviter des procédures de licenciements collectifs et donc amoindrir la saisine des services de l’État et des juridictions, contrebalançant ainsi leur implication nouvelle vis-à-vis de ces accords.
Section 3 - Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
L’article 13 du projet de loi, qui traduit les orientations fixées par l’article 20 de l’accord du 11 janvier 2013, procède à une refonte profonde des procédures de licenciements collectifs.
Les licenciements collectifs constituent une épreuve collective et individuelle qui peut durablement marquer les parcours professionnels des salariés. Aussi, le renforcement des mesures d’accompagnement tout comme la sanction des pratiques abusives constituent un enjeu majeur.
L’accord construit le cadre pour des procédures plus encadrées et fournissant des garanties effectives pour les salariés concernés :
- par la création d’une voie négociée entre partenaires sociaux pour traiter les plans de sauvegarde de l’emploi, en lieu et place de la décision unilatérale de l’employeur qui est le cadre actuel ;
- par la mise en place d’un mécanisme d’homologation des plans de sauvegarde permettant à l’administration du travail d’apprécier la pertinence des mesures d’accompagnement envisagées par l’employeur dans des délais brefs.
1.1. L’article 13 du projet de loi reprend la philosophie de l’article 20 de l’accord
La nouvelle procédure constitue une rupture majeure dans l’encadrement des restructurations d’entreprise. L’accord national interprofessionnel prévoit en effet deux modalités d’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi - par accord collectif majoritaire ou par un document unilatéral de l’employeur – dans un calendrier par ailleurs allongé et encadré.
Ce nouveau droit de la procédure de licenciement collectif offre aux salariés et aux entreprises une meilleure visibilité sur l’opération de restructuration :
- les partenaires sociaux connaissent à l’avance les modalités de la procédure, qu’ils peuvent aménager par accord, ainsi que le délai permettant un examen plus approfondi qu’auparavant des projets (deux à quatre mois en fonction du nombre de licenciements envisagés) ;
- la négociation sociale est encouragée en offrant une alternative à une procédure unilatérale à l’initiative de l’employeur.
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail pose les principes du licenciement pour motif économique. En particulier, la section IV précise les modalités du licenciement de dix salariés et plus dans une même période de trente jours.
Le projet de réforme, qui constitue une refonte profonde de l’organisation des plans de sauvegarde de l’emploi, nécessite une réécriture d’un nombre important d’articles de ce chapitre.
1.2. L’objectif de sécurisation des parcours professionnels des salariés a conduit à adapter la procédure, à tirer les conséquences des stipulations de l’ANI et à préciser d’autres éléments de procédure.
a) Les adaptations
Alors que l’accord national interprofessionnel place l’homologation de l’administration en amont de la procédure de consultation des représentants du personnel, le projet de loi dispose que l’administration intervient après que le comité d’entreprise a rendu son avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi définitif.
Au regard de l’objectif de sécurisation des parcours professionnels, il est apparu opportun que l’autorité administrative se prononce une fois que le projet définitif est stabilisé et après que les représentants du personnel ou les organisations syndicales représentatives se sont exprimés. En instaurant un contrôle de l’administration à l’issue de la procédure, le projet de loi donne plus de force aux observations formulées tout au long de la procédure d’information et de consultation. Par ailleurs, la possibilité d’obtenir une décision favorable d’homologation ou de validation sera d’autant plus forte que des échanges itératifs auront été menés également avec l’administration tout au long de la procédure, dans l’objectif de construire un plan de sauvegarde de l’emploi de qualité, dans le cadre d’une procédure respectueuse du dialogue social.
Le projet de loi prévoit que l’administration se prononce sur le plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre d’un contrôle différencié selon la nature du PSE - document unilatéral de l’employeur ou accord collectif. Ainsi, l’accord collectif ne sera pas « homologué », mais il fera l’objet d’une « validation ». En cas d’accord collectif issu du dialogue social dans l’entreprise et reposant donc sur un équilibre social négocié en son sein, le contrôle effectué par l’administration sera restreint. Le champ de l’appréciation de l’accord et le délai de la validation sont en conséquence limités : l’administration disposera d’un délai de 8 jours pour apprécier la validité de l’accord, contre 21 jours pour homologuer le document présenté par l’employeur. Dans ce délai court, le contrôle restreint de l’administration portera sur la légalité de l’accord et sur le respect des dispositions relatives au licenciement collectif :
- la légalité de l’accord : respect des règles de signature de l’accord, représentativité des signataires, signature à 50 % des organisations syndicales représentatives. L’accord ne doit pas déroger à certaines dispositions légales telles que l’obligation de reclassement incombant à l’employeur ;
- le contenu de l’accord : il doit comprendre le plan de sauvegarde de l’emploi
b) Les conséquences à tirer de l’ANI et précision sur les éléments de la procédure
Le projet de loi a tiré la conséquence de la création d’une possibilité de négocier sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, en articulant cette possibilité avec l’existence des accords de méthode (articles L.1233-21 et suivants du code du travail) dont l’utilité n’est pas remise en cause mais dont le contenu doit être adapté.
L’accord de méthode est signé dans les conditions de droit commun et porte sur l’organisation de la consultation du comité d’entreprise. Il est négocié et signé en amont du projet de restructuration, tandis que l’accord créé par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 porte sur le projet de restructuration et doit être signé par la majorité absolue des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Ces deux dispositifs ont donc chacun leur utilité et pourront le cas échéant être complémentaires.
Sur les aspects de procédure et de contentieux, le projet de loi a entendu allonger significativement les délais légaux maxima de consultation, mais en les rendant davantage certains.
1.3. Le nouveau droit du licenciement économique collectif
L’entreprise peut désormais établir le plan de sauvegarde de l’emploi selon deux modalités différentes. Elle peut soit négocier un accord avec les organisations syndicales soit décider d’élaborer un document unilatéral, dans le respect de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
a) Négociation d’un accord à la majorité absolue
Objet de la négociation
Lorsque l’entreprise décide d’ouvrir une négociation, celle-ci porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi qui en constitue le socle minimum à défaut duquel le régime de l’accord collectif majoritaire tel que créé par la loi ne s’applique pas.
Au-delà, l’accord peut porter sur les autres thèmes mentionnés à l’article L.1233-24-2 : les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, la pondération des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement. Dans le cas où un accord ne peut être trouvé sur ces thèmes, l’existence de l’accord portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas remise en cause, mais les autres thèmes doivent figurer dans un document établi par l’employeur. Dès lors, le contrôle de l’administration est mixte : la validation s’effectuera sur l’accord collectif qui arrête le plan de sauvegarde de l’emploi (contrôle restreint de validité) tandis que le document établi par l’employeur est soumis à l’homologation.
Règles de validité de l’accord
L’opposabilité de cet accord est conditionnée par sa signature à la majorité absolue (50 %) des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette majorité spécifique apporte une garantie supplémentaire aux salariés.
Dans le cadre de ses compétences en matière de restructurations, le comité d’entreprise est consulté sur le projet d’accord collectif majoritaire.
b) Elaboration par l’employeur d’un document portant sur le projet de licenciement, dans le cadre d’une information/consultation rénovée
La procédure est encadrée dans le temps par des délais qui tiennent compte de l’ampleur du projet de licenciement : fixation d’un nouveau délai maximum allongé d’examen du projet en fonction du nombre de suppressions de poste envisagées, sauf si un accord collectif prévoit plus de temps. Ces délais sont de 2 mois lorsque le projet de licenciement concerne 10 à 99 salariés, 3 mois de 100 à 249 licenciements, ou 4 mois (plus de 250 licenciements).
Dans ce délai, les deux réunions minimum du comité d’entreprise et le cas échéant du comité central d’entreprise doivent être organisées.
Lors de la première réunion, le comité d’entreprise décide de recourir à l’assistance d’un expert. Celui-ci dispose de 21 jours à compter de sa désignation pour demander les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur lui répond dans les 15 jours. L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant la dernière réunion du comité d’entreprise.
Par ailleurs, dans le cas où le CHSCT serait saisi, il devrait rendre son avis, le cas échéant après avoir mandaté un expert, dans le délai de la procédure.
À la fin du délai de procédure, l’accord ou le document sont adressés à l’autorité administrative pour validation ou homologation. À réception du dossier complet, l’autorité administrative – la Direccte en pratique – dispose de 8 jours pour se prononcer sur la validité de l’accord et de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. À défaut de décision expresse motivée dans ces délais, la décision tacite est favorable.
Afin de donner une portée à cette procédure de contrôle, les notifications des licenciements aux salariés et la mise en œuvre du PSE ne pourront intervenir qu’au lendemain de la décision favorable d’homologation. À défaut de décision favorable, les licenciements qui seraient toutefois prononcés seraient nuls.
En cas de refus de validation ou d’homologation, l’employeur peut présenter une nouvelle demande qui devra, dès lors, tenir compte des motifs de refus mentionnés dans cette décision.
- -- - - --
En ce qui concerne la mise en œuvre du droit du licenciement économique collectif dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, les nouvelles dispositions s’appliquent, avec des adaptations afin, d’une part, de conserver les spécificités procédurales applicables actuellement, d’autre part, de prévoir les délais de validation ou d’homologation qui ont été fortement réduits. Par cohérence, certaines dispositions du code du commerce ont été modifiées.
Les deux figures qui suivent synthétisent la procédure de licenciement économique dans le cadre d’un PSE avant et après la réforme.
Figure 70 : Schéma simplifié de la procédure de licenciement économique dans le cadre d’un PSE avant 2013
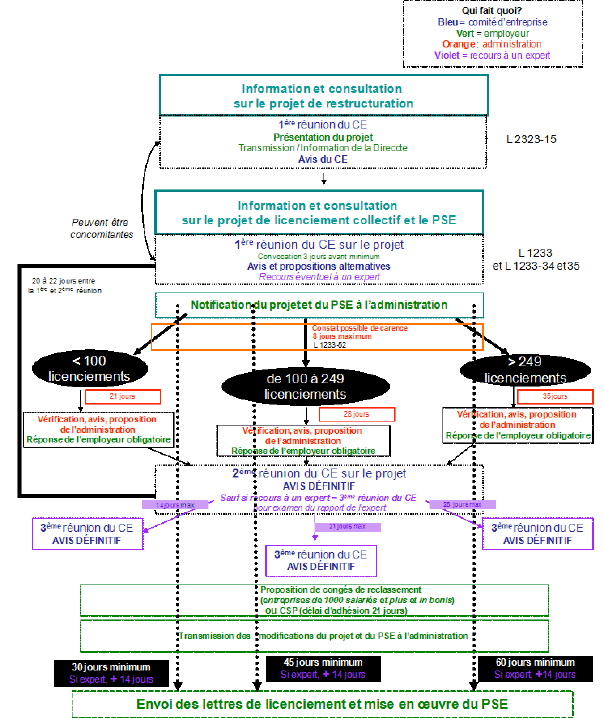
Figure 71 : Schéma simplifié de la procédure de licenciement économique après 2013
(entreprises de 50 salariés et plus)
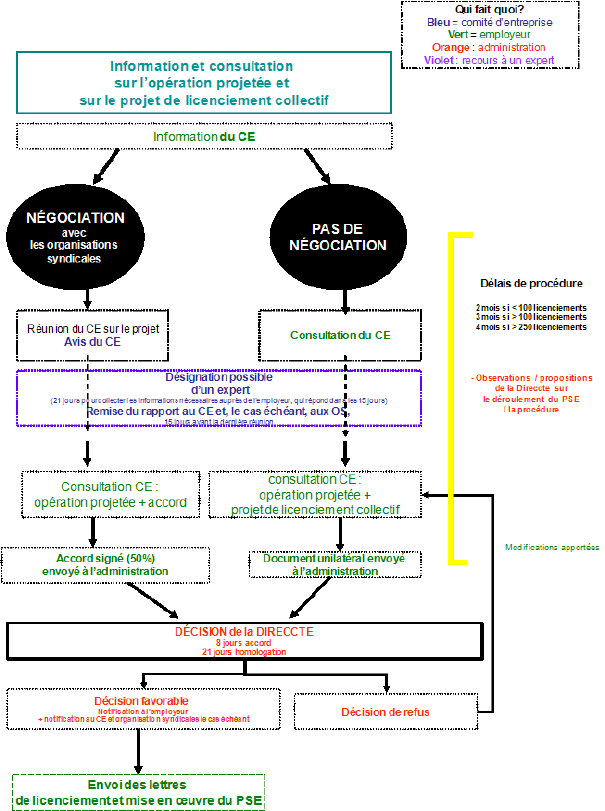
1.4. Les recours contentieux dans le cadre de la nouvelle procédure
a) Pendant la procédure d’information consultation
Dans le cadre de la nouvelle procédure, la possibilité pour les parties d’agir en référé en cours de procédure ne paraît plus justifiée dans la mesure où l’instauration de la procédure de validation / homologation renforce le rôle de l’administration. Au-delà de son information et de sa capacité à faire des propositions, l’autorité administrative s’impose comme un interlocuteur privilégié pouvant, le cas échéant, être un intermédiaire entre les parties. Ce repositionnement donne une autorité particulière à ses observations, voire à ses injonctions dans la mesure où, si elles ne sont pas suivies d’effet, elles exposent l’employeur au risque de refus d’homologation.
Par ailleurs, afin de garantir le respect des délais de l’information consultation, cette procédure est souple et facile à mettre en œuvre.
Les décisions de l’administration dans cette phase sont susceptibles d’être contestées devant le juge à l’occasion d’un recours éventuel formé contre la décision de validation / homologation.
b) À la fin de la procédure d’information consultation, au moment où le plan de sauvegarde de l’emploi fait l’objet d’une décision administrative
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les motifs de contentieux relatifs à la procédure de licenciement pour motif économique sont regroupés dans une action en justice unifiée autour de la compétence du tribunal administratif. En effet, la décision de validation ou d’homologation du PSE est une décision administrative susceptible de faire grief à l’ensemble des parties prenantes (employeur, représentants du personnel, délégués syndicaux et salariés).
Par ailleurs, cette décision figeant le contenu du PSE, les droits de recours ne peuvent s’exercer qu’à partir du moment où la décision est connue : soit à compter de sa notification, soit à compter du moment où naît une décision implicite favorable, à charge pour l’employeur d’organiser, comme le prévoit le projet de loi, l’information des différentes parties.
Le délai de recours contre la décision de l’administration est le délai de droit commun (2 mois).
De plus, le projet de loi crée une procédure spécifique et accélérée devant la juridiction administrative, facteur de visibilité rapide et de sécurité juridique : le délai de jugement du tribunal administratif est fixé à 3 mois. À l’issue de ce délai, s’il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, la cour administrative d’appel est compétente et doit statuer dans un délai de 3 mois. À l’issue de ce délai, si la CAA ne s’est pas prononcée, ou en cas de pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat est saisi du litige.
En ce qui concerne le contentieux individuel intenté par le salarié sur le motif économique de son licenciement ou sur l’application du PSE, le salarié aura naturellement la possibilité de contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
En raison de l’instauration de la procédure d’homologation / validation pouvant être contestée devant le juge administratif, le juge judiciaire ne pourra plus se prononcer sur la validité du PSE. Le projet de loi prévoit les cas dans lesquels le licenciement sera nul, en particulier lorsque l’annulation de la décision d’homologation ou de validation aura pour motif l’insuffisance du PSE.
1.5. Impact pour l’administration
Aujourd’hui, il n’y a pas d’organisation préconisée en matière de contrôle des PSE. En droit, la notification du projet de licenciement s’effectue auprès du DIRECCTE. En pratique, compte tenu des délais, elle intervient également auprès des directeurs régionaux adjoints de l’unité territoriale qui peut ensuite déléguer cette compétence.
Deux types d’intervention de l’autorité administrative sont possibles :
- les lettres d’observations, adressées tout au long de la mise en œuvre de la procédure d’information consultation du PSE relèvent, en général, de la compétence du service mutations économiques.
- le constat de carence, outil plus marginal, est en général dressé par le service mutations économiques. L’avis de l’inspecteur du travail peut être sollicité. Le constat de carence est signé par le responsable de l’unité territoriale.
Les services du ministère du travail sont donc déjà impliqués dans la procédure des PSE, dans la mesure où 80% des PSE donnent lieu actuellement à des lettres d’observation.
Dans le cadre de la procédure de validation/homologation, le DIRECCTE assumera cette nouvelle compétence. Sous l’autorité du DIRECCTE, cette compétence pourrait être déléguée aux directeurs régionaux adjoints des unités territoriales.
L’autorité administrative sera chargée :
- d’accompagner la mise en œuvre de la future procédure d’homologation en encourageant notamment le développement du dialogue social sur ces questions ;
- de procéder à la validation de l’accord ou l’homologation du document du PSE après la mise en œuvre d’une procédure d’information et d’échanges renforcées avec les entreprises. La création d’une procédure d’injonction tout au long de la procédure doit permettre de préparer l’avis final. Sur le fond, au moment de l’homologation, il conviendra d’être vigilant sur les points suivants :
o veiller à l’effectivité du dialogue social (au niveau des organisations syndicales comme au niveau des instances représentatives du personnel) et à sa bonne foi ;
o garantir la qualité des mesures sociales d’accompagnement prévues pour accompagner une restructuration, eu égard au projet mis en œuvre,
o veiller à la proportionnalité des moyens d’accompagnement mis en place au regard des moyens dont dispose l’entreprise,
- de s’assurer de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, la qualité des mesures d’un plan se mesure aussi au regard de ses effets en termes de retour à l’emploi.
Le changement de procédure va surtout résider dans le rôle conféré à l’administration et nécessitera une organisation fluide et efficace entre les échelons régionaux et territoriaux, comme entre les services en charges des mutations économiques et ceux en contact avec les entreprises.
Par ailleurs, et afin de renforcer la professionnalisation des services, la réforme va conduire à l’élaboration d’un référentiel qui permettra aux services de se doter très vite de bonnes pratiques tant sur le déroulement de la procédure que sur le contenu d’un PSE. En outre, cela implique un vaste programme de formation pilotée par l’INTEFP.
L’article 14 du projet de loi crée, conformément à un paragraphe spécifique de l’article 12 de l’accord du 11 janvier 2013, une obligation pour l’entreprise qui envisage la fermeture d’un de ses établissements de rechercher un repreneur, en lien avec son obligation de revitalisation.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Sur 3 300 procédures de licenciement collectif notifiées à l’administration depuis le 1er janvier 2011, 42% ont donné lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Sur ces 1 390 PSE, 210 ont été élaborés par des entreprises de plus de 1 000 salariés et ont menacé 43 500 postes (sur 143 000 des suppressions de postes envisagées au total par les 3 300 procédures collectives notifiées depuis janvier 2011).
Le nombre des PSE effectués par les entreprises potentiellement soumises à l’obligation de revitalisation – c’est-à-dire de 1 000 salariés et plus – est faible (15 % des PSE) mais leur conséquences sur l’emploi est deux fois plus important (30% des suppressions d’emploi).
Les fermetures d’établissement sont en nombre limité au regard des destructions d’emplois, mais ont des conséquences durables pour les salariés et les territoires. Ils s’inscrivent cependant dans des configurations différentes
Plusieurs cas type de fermetures de sites peuvent être identifiés :
- Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (RJ/LJ) qui en représentent une part importante. Elles ne sont pas soumises à l’obligation de revitalisation et, sous réserve de disposer d’une trésorerie suffisante, font l’objet d’une recherche de repreneur pour tout ou partie de l’activité.
- Les cessations d’exploitation pour insuffisance de rentabilité, fin de vie des produits ou désengagement d’une activité jugée non stratégique : dans ce cas, la recherche de repreneurs est souvent engagée sur des bases volontaires par les grands groupes dans un souci de « bonne gestion patrimoniale » et dans une démarche de responsabilité sociale et territoriale.
- Les cessations d’activité pour transfert d’activité : les entreprises souhaitent consolider leur empreinte industrielle et saturer leurs sites de production. Les activités réalisées dans le site fermé ne sont pas abandonnées. Elles sont transférées vers d’autres sites en France ou à l’étranger. Dans ce cas, l’entreprise est prête à trouver un repreneur pour le site, mais ne souhaite pas à y laisser l’activité dont elle a besoin ailleurs.
- Les cessations d’activité pour réduire les capacités de production du secteur : L’entreprise entend réduire les capacités de production du secteur afin de limiter la concurrence des prix. Dans ce cas, l’entreprise ne souhaite pas favoriser l’arrivée d’un nouvel entrant sur le marché qui récupérerait son outil de production.
Dans certains cas, la recherche de repreneurs n’étant pas obligatoire, des opportunités de poursuite d’activité sont perdues, alors même qu’une fermeture a des effets de long terme.
En raison de leurs effets structurants sur les territoires, ces fermetures ont des répercussions qui dépassent le seul nombre d’emplois directement supprimés.
Outre les effets sur l’emploi direct (salariés licenciés suite à la fermeture du site et fin des contrats d’intérimaires et de salariés en CDD), la disparition de l’activité entraîne la fin des contrats de sous-traitance et a donc des effets indirects (baisse des commandes et chiffre d’affaires des partenaires qui peut entraîner des suppressions de postes). Elle a également des effets induits sur l’économie locale : risque de suppression de postes dans les commerces et les équipements de proximité, impact sur les finances locales, etc. Tout l’écosystème d’un territoire peut être bouleversé par une fermeture.
Si l’obligation de revitalisation a instauré une contribution des entreprises pour compenser les conséquences de leurs décisions sur les territoires, ces interventions sont trop tardives pour pouvoir favoriser les reprises d’activité. En produisant ses effets la plupart du temps après les licenciements, elles laissent peu de chances à la continuation d’activités connexes.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
Les fermetures d’établissements ont des impacts important sur leur territoire d’implantation, et si le dispositif de revitalisation a prouvé son utilité pour les territoires, il n’intervient aujourd’hui le plus souvent qu’une fois que les licenciements ont eu lieu. L’obligation de recherche de repreneur vise ainsi à prévenir et limiter les effets négatifs sur l’emploi et le territoire. Elle s’inscrit, par anticipation, dans le cadre de la revitalisation, qui vise à réparer les impacts des licenciements collectifs sur le bassin d’emploi.
Le dialogue social sur ce sujet est renforcé afin de limiter les situations conflictuelles et de faire émerger une solution mutuellement avantageuse. Aussi le comité d’entreprise est informé de cette recherche. Il peut recourir à un expert pour se faire assister dans ce processus. Il est informé des offres éventuelles de reprise, sur lesquelles il peut émettre un avis. Les informations communiquées sont réputées confidentielles.
2.3. Impact attendu
L’obligation de recherche d’un repreneur généralisera les bonnes pratiques observées. En donnant l’opportunité de trouver une alternative à la fermeture et/ou en anticipant la reconversion de l’appareil de production, elle évitera non seulement des licenciements, mais elle maintiendra un potentiel de croissance à long terme du territoire concerné.
En effet, une fermeture a des effets profonds qui rendent bien plus difficiles la création de nouvelles activités que le redéveloppement d’un site dont la taille a été réduite.
La recherche d’un repreneur poursuit le même but que les actions de revitalisation. La continuité de l’activité, même de façon partielle ou adaptée, permet de limiter les effets négatifs des licenciements collectifs sur le territoire. Cette proposition est un renforcement des pratiques actuelles, même si les conventions de revitalisation prévoient déjà des actions pour la reconversion de site, telles que, par exemple, l’aménagement de site en vue de sa reconversion, (autres que ceux devant être mis en œuvre en application de dispositions légales ou réglementaires) ou des actions de prospection d’un ou plusieurs repreneurs du site en cas de fermeture.
En évitant des fermetures d’entreprise, cette disposition renforce le potentiel de croissance à long terme du territoire.
L’article 15 du projet de loi reprend l’article 21 de l’accord du 11 janvier 2013 qui prévoit que la durée maximale du congé de reclassement applicable dans les entreprises et les groupes de plus de 1 000 salariés augmenterait de 9 à 12 mois.
3.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Le congé de reclassement a été créé par l’article 119 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, codifié aux articles L.1233-71 et suivants du code du travail. Son objectif était de responsabiliser les entreprises dans l’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique, dans un contexte où la collectivité publique supporte le coût humain, social et financier des licenciements.
Ce dispositif est la conséquence de la reconnaissance d’une obligation générale des entreprises à pourvoir au reclassement des salariés qu’elles licencient pour des motifs économiques. Ce principe est considéré par le Conseil constitutionnel comme un élément du bloc de constitutionnalité découlant du droit de chacun d’obtenir un emploi, tel qu’il résulte du préambule de la Constitution47.
Pour permettre un reclassement rapide du salarié, la loi a prévu plusieurs dispositifs qui tiennent compte de la situation des salariés mais surtout des possibilités des entreprises et de leur taille. Ces dispositifs ont en commun d’accompagner les salariés licenciés pour motif économique pour leur permettre de retrouver rapidement un emploi en mettant en place, dès le début de la procédure de licenciement, un dispositif associant les possibilités de formation et une aide à la recherche d’emploi dans un cadre défini avec le salarié et axé sur son projet professionnel. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé peuvent bénéficier, lorsqu’ils réunissent les conditions, du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Dans les entreprises et les établissements de 1 000 salariés et plus, comme les entreprises appartenant à un groupe de 1 000 salariés et plus, l’article L.1233-71 du code du travail impose la mise en place d’un congé de reclassement. Celui-ci a pour objet de permettre à chaque salarié dont le licenciement est envisagé de bénéficier des prestations d’une cellule de reclassement pour retrouver un travail et de percevoir un revenu de remplacement équivalent au minimum à 65% du salaire perçu antérieurement, pour une durée minimum de 4 mois (article R.1233-31 du code du travail) incluant le préavis.
Si le salarié accepte le congé, son contrat de travail n’est pas rompu mais seulement suspendu. Son licenciement est donc reporté à la fin du congé de reclassement, qui débute pendant le préavis de licenciement. Pendant la durée du préavis, l’adhérent perçoit son salaire. Pour la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le bénéficiaire perçoit une allocation équivalente au minimum à 65 % de son salaire antérieur.
L’alinéa 2 de l’article L.1233-71 précise que : « La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois ».
3.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
Les partenaires sociaux ont proposé, dans l’article 21 de l’accord sur la sécurisation de l’emploi, que la durée maximale du congé de reclassement soit portée de 9 à 12 mois, afin d’harmoniser sa durée avec celle des contrats de sécurisation professionnelle, ce que traduit l’article 15 du projet de loi.
Afin de permettre cette évolution, une adaptation de l’article L.1233-71 du code du travail est nécessaire.
3.3. Impact attendu
a) La volonté des partenaires sociaux est de permettre l’alignement plus systématique de la durée d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du congé de reclassement sur celle du CSP
La prolongation de 9 à 12 mois devrait inciter les entreprises à mettre en place des congés de reclassement dont la durée concorde avec celle du CSP, qui est de 12 mois maximum. Ainsi, une durée plus longue permettra de mieux accompagner les publics les plus fragiles dont la reconversion est la plus complexe, afin de sécuriser leurs parcours professionnels.
Dans le cadre d’une instruction DGEFP n°2011-24 du 21 octobre 2011, l’attention des services a été appelée sur la nécessité de convaincre les entreprises d’allonger la durée du congé de reclassement, en l’alignant si possible sur la durée du CSP, plutôt que de majorer le niveau d’allocation sur la période minimale.
b) Une convergence des durée CR / CSP
Les offres de services déployées en CSP et en congé de reclassement peuvent être assez semblables et mobilisent un accompagnement renforcé avec un référent dédié, un accès facilité à la formation (dans le cadre des budgets formations prévus dans le PSE pour le congé et dans le cadre du financement assuré par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour le CSP) et des possibilité de périodes de travail en entreprise (possibilité ouverte, pour le congé de reclassement, par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels).
En revanche, cette offre de service n’est pas garantie sur la même durée. Même dans le cas d’un congé de 9 mois, la durée ne paraît pas suffisante pour permettre la mise en place d’un parcours de reconversion passant par une formation longue.
PARTIE V - DISPOSITIONS DIVERSES ISSUES DE L’ACCORD DU 11 JANVIER 2013
L’article 16 du projet de loi l introduit, pour le contentieux des licenciements, conformément à l’article 25 de l’accord du 11 janvier 2013 et dans le but de favoriser les conciliations, le principe d’une proposition d’accord entre les parties lors du passage devant le bureau de conciliation, proposition qui serait effectuée en référence à un barème d’indemnités tenant compte de l’ancienneté du salarié. En second lieu, l’article 16 reprend les dispositions de l’article 26 de l’accord sur les délais de prescription.
1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Dans les affaires portées devant les conseils des prud’hommes seuls 7% des litiges sont réglés par la conciliation.
En cas de licenciements considérés comme irréguliers, l’existence de montants minimaux d’indemnisation du salarié, de niveaux variables, incite à la poursuite du contentieux par les salariés pour obtenir du juge une condamnation au moins équivalente au plancher légal. Pour les employeurs, poursuivre le contentieux, dans l’espoir qu’il leur donne raison, est la seule possibilité de réduire le risque, le juge n’ayant pas la possibilité de fixer une indemnisation inférieure au minimum légal en cas de condamnation.
Dans ces cas, le recours à la transaction, toujours possible, demeure exceptionnel.
La sécurisation des parcours professionnels c’est aussi, dans toute la mesure du possible, de prévenir l’aggravation des contentieux en favorisant la recherche d’une solution rapide aux litiges naissants. La voie de la conciliation est le plus souvent préférable à celle du jugement.
En prévoyant un barème, fonction de l’ancienneté du salarié, pouvant être appliqué dans la plupart des cas d’irrégularité du licenciement, les partenaires sociaux ont souhaité qu’il soit possible, plus fréquemment qu’aujourd’hui, d’éteindre le contentieux devant les bureaux de conciliation.
C’est pourquoi, ils ont souhaité que l’accord des parties sur l’application du barème d’indemnités soit conclu au stade de la conciliation de la procédure devant le conseil de prud’hommes, procédure dont le principe figure à l’article L.1411-1 du code du travail.
En matière de prescription, le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire est aujourd’hui de cinq ans (article L. 3245-1). Les partenaires sociaux ont souhaité revoir ce délai.
1.2. Objectifs poursuivi par la mesure
L’objectif est de favoriser l’accord des parties sous l’égide du bureau de conciliation pour les litiges relatifs aux contestations touchant à régularité du licenciement, qu’il s’agisse de la procédure ou de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’indemnisation, qui a pour objet de réparer le préjudice lié à la rupture du contrat de travail, n’inclut pas les indemnités de licenciement dues par l’employeur, ni les indemnités liées à des contentieux spécifiques. Ne sont ainsi pas concernés les cas de discrimination, de harcèlement ou d’inaptitude.
Le projet de loi ramène ce délai à trois ans, conformément à la volonté des partenaires sociaux. Il institue par ailleurs un délai de prescription de deux ans pour les autres actions portant sur l’exécution du contrat de travail ou portant sur sa rupture, sans préjudice des délais plus courts actuellement prévus par le code du travail et en prévoyant des exceptions à ce délai.
1.3. Impact attendu
La mesure permettra d’éviter, de manière rapide et consensuelle, des contentieux plutôt que de suivre la voie juridictionnelle par nature plus longue et plus coûteuse pour le salarié comme pour l’employeur.
De plus, celle-ci devrait conduire à la réduction du nombre des contentieux portés devant le bureau de jugement et donc d’amoindrir la charge de travail des tribunaux.
2. Accompagnement du franchissement des seuils d’effectif par les TPE/PME s’agissant de la mise en place des IRP
L’article 17 du projet de loi, qui transcrit l’article 17 de l’accord du 11 janvier 2013, vise à accompagner dans le temps les franchissements des seuils pour les petites et moyennes entreprises s’agissant de la mise en place des institutions représentatives du personnel.
2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
L’obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel (DP, CE) ne s’impose qu’aux entreprises ayant un effectif stabilisé sur une certaine période.
Le code du travail subordonne ainsi la création de ces instances au franchissement d’un seuil adapté d’effectif durant une période de référence. L’article L. 2312-2 prévoit que la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois au cours des 3 années précédentes. L’article L. 2322-2 conditionne la création du comité d’entreprise au franchissement d’un seuil d’effectif de 50 salariés au moins pendant 12 mois au cours des 3 années précédentes.
Ce lissage des effets de seuil en matière de représentation du personnel vise à faciliter la mise en place d’une représentation du personnel adaptée dans des entreprises dont l’effectif stable permet l’instauration d’un dialogue social.
Toutefois, les effets de seuils demeurent importants, notamment pour les entreprises dont l’effectif atteint 50 salariés, d’autant que les obligations en matière de représentation du personnel s’ajoutent à d’autres obligations en matière fiscale et sociale48. Selon plusieurs études récentes, cette situation affaiblirait le potentiel de croissance des entreprises autour de 49 salariés.
Par ailleurs, la mauvaise anticipation par certaines PME de la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’est pas favorable à un dialogue social serein et constructif, outre qu’elle peut favoriser, dans la pratique, une mise en œuvre lacunaire des obligations d’informations et de consultation.
2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 17 du projet de loi vise à accompagner les entreprises dans la mise en place des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles franchissent pour la première fois les seuils de 11 et 50 salariés.
L’organisation du processus électoral étant une source de complexité, le texte se propose d’allonger le délai dont dispose l’employeur pour organiser le premier tour du scrutin, uniquement en cas de première mise en place des DP ou d’un CE.
Afin d’organiser l’élection de ces instances en accord avec les organisations syndicales et de permettre l’engagement de négociations pré-électorales opérantes au sein de l’entreprise, le code du travail prévoit actuellement que le premier tour du scrutin doit se tenir, au plus tard, le 45ème jour suivant le jour de l’affichage par l’employeur, de l’annonce des élections.
S’imposant y compris en cas de renouvellement de l’instance, ce délai doit permettre à l’employeur de proposer aux partenaires sociaux un calendrier relativement serré des opérations électorales, et d’organiser donc rapidement les élections. En pratique, ce délai est fréquemment aménagé, pour tenir compte des difficultés d’organisation rencontrées par le chef d’entreprise (en cas de nouvelle mise en place des instances) ou du temps nécessaire aux négociations pré-électorales avec les organisations syndicales, qui peuvent conduire à organiser plusieurs réunions préparatoires à la mise en place de l’instance.
L’allongement de ce délai de 45 jours supplémentaires facilitera, pour l’employeur comme pour les syndicats, l’organisation des opérations préélectorales. Il ne s’agit pas toutefois de se passer d’un encadrement dans le temps puisqu’il ne pourra être dérogé à une durée maximale de trois mois. Par ailleurs, le texte ne modifie pas les conditions de mise en place des instances de représentation du personnel, et notamment son obligation de mettre en place une représentation du personnel, prévue aux articles L.2312-2 et L.2322-2 demeure.
Le texte propose, à titre complémentaire, d’aménager pour les entreprises un délai d’un an à compter du franchissement du seuil, pour satisfaire aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Ce délai ne bénéficiera pas seulement aux entreprises, mais aussi à la qualité du dialogue social de manière générale. Entre la date de leur élection et celle où toutes les consultations seront devenues obligatoires, les représentants du personnel bénéficieront de tous les moyens habituellement alloués pour se préparer au plein exercice de leur mandat (crédits d’heures, mise à disposition de locaux, liberté de circulation et d’affichage dans l’entreprise).
Ce dispositif ne porte pas atteinte au fonctionnement même du comité d’entreprise (réunions, activités sociales et culturelles), ni aux droits d’action des élus vis-à-vis des salariés. De même, l’information-consultation du comité d’entreprise sur des sujets ponctuels, notamment les événements qui affectent la marche de l’entreprise, comme par exemple un projet de licenciement, n’est pas affectée. Enfin, les attributions des délégués du personnel ne sont pas concernées.
2.3. Impacts attendus
- Impact financier : aucun
- Impact sur les personnes morales :
Cet aménagement permettra aux petites et moyennes entreprises, en phase de croissance, de disposer de délais adéquats pour mettre en place un dialogue social interne de qualité et facilitera ainsi la bonne marche de l’entreprise.
L’article 18 du projet de loi, qui reprend l’article 22 de l’accord, prévoit une expérimentation, limitée aux seules entreprises de moins de 50 salariés, appartenant à trois secteurs, permettant d’expérimenter le recours direct au contrat de travail intermittent sans obligation de conclure préalablement un accord collectif mais après information des délégués du personnel.
3.1. Etat du droit et nécessité de légiférer
Le travail intermittent est défini par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées pour des activités qui, par nature, induisent une telle alternance.
La conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDI-I) est soumise à l’existence d’un texte conventionnel de branche étendu ou d’un accord d’entreprise qui en définissent le cadre d’application, et en particulier précisent des emplois permanents pour lesquels ce type de contrat peut être conclu (cf. articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail).
Plus d’une vingtaine de conventions collectives, couvrant près de 400 000 salariés dans des secteurs aussi divers que ceux de l’artisanat, du commerce, des services, de l’immobilier, de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur, du tourisme ou de l’agriculture, prévoient d’ores et déjà la possibilité de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (cf. figure 72).
Branches |
IDCC |
Effectif |
Acteurs du lien social |
1261 |
<5 000 |
Pompes funèbres |
759 |
16 800 |
Experts comptables commissaires aux comptes |
787 |
128 200 |
Produits du sol, engrais – négoce et industrie |
1077 |
|
Pâtisserie |
1267 |
16 000 |
Tourisme social et familial organismes |
1316 |
12 900 |
Vins de champagne |
1384 |
<5 000 |
Animation |
1518 |
<5 000 |
Immobilier |
1527 |
142 800 |
Jeux jouets industries |
1607 |
6 200 |
Hôtellerie de plein air |
1631 |
10 900 |
Espaces de loisirs d’attractions et culturels |
1790 |
37 400 |
Cabinets d’expertise automobile |
1951 |
5 200 |
Prestataires de services du secteur tertiaire |
2098 |
112 400 |
Thermalisme |
2104 |
<5 000 |
Enseignement écoles supérieures ingénieurs (FESIC) |
2163 |
<5 000 |
Hospitalisation privée médico-social |
2264 |
|
Enseignement privé hors contrat |
2691 |
10 000 |
Entreprises techniques création événements |
2717 |
12 700 |
Esthétique cosmétique, esthétique et de l'enseignement |
3032 |
<5 000 |
Industries alimentaires diverses |
3109 |
|
Coopératives de céréales, meunerie |
7002 |
|
Caves coopératives vinicoles |
7005 |
|
Coopératives de fleurs, fruits et légumes |
7006 |
Source : DGT
L’ANI du 11 janvier 2013 ouvre à titre expérimental la possibilité de recourir directement au CDI intermittent sans accord collectif préalable pour les trois branches suivantes :
- La branche des organismes de formation (à l’exception des salariés formateurs en langue) – IDCC 1516 – avec des effectifs couverts de 95 300 salariés ;
- La branche du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs – IDCC1557 – avec effectif couverts de 54 400 salariés ;
- La branche des détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie – IDCC 1286 – avec des effectifs couverts de 10 100 salariés.
3.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi
L’article 18 du projet de loi permettra, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2014, aux entreprises des trois branches visées dans l’accord, et qui seront désignées par un arrêté du ministre chargé du travail, de conclure des CDI intermittents sans qu’un accord de branche ait été au préalable conclu et étendu.
L’expérimentation prévue par l’ANI devra permettre de mesurer l’intérêt d’une telle mesure et d’envisager alors d’y mettre fin ou de l’étendre à d’autres branches.
3.3. Impact attendu
Le CDI-I apporte au salarié comme à l’employeur un certain nombre de garanties qui pourront favoriser son développement, voire sa substitution à d’autres contrats qui, tout en permettant de répondre aux mêmes types de situation, sont par essence plus précaires, notamment les CDD.
Il offre l’avantage d’être à durée indéterminée, ce qui favorise la stabilité de l’emploi recherchée par les salariés, y compris par ceux exerçant des activités par essence intermittentes.
Par ailleurs, la rémunération peut être lissée sur l’année, ce qui permet au salarié d’éviter les ruptures de salaires puisque les périodes creuses ne donnent pas aujourd’hui lieu à une prise en charge par l’Unédic, le salarié n’étant pas involontairement privé d’emploi.
Ce lissage sur l’année, allié à la stabilité du contrat, peut contribuer à améliorer l’accès à certains droits essentiels tels que le logement ou le crédit.
Enfin, le salarié sous CDI-I bénéficie dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. La totalité des périodes non travaillées est donc prise en compte pour les droits tirés de l’ancienneté (primes, indemnités de licenciement, droit à certains congés…).
L’employeur, de son côté, ne sera plus contraint d’établir des contrats successifs, sources de complication, et pourra compter sur un personnel fidélisé et formé aux méthodes de l’entreprise. En contrepartie, toute cessation du contrat de travail sera soumise aux procédures du licenciement.
1.1. Le Conseil national de l’emploi (CNE)
En application de l’article L. 5112-1 du code du travail, le conseil national de l’emploi doit être consulté pour tout projet de loi relatif à l’emploi.
La consultation du CNE est intervenue le 20 février 2013.
1.2. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)
En application du 3° de l’article L. 6123-1 du code du travail, le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie doit être consulté sur tout projet de loi en matière de formation professionnelle initiale et continue.
La consultation du CNFPTLV est intervenue le 19 février 2013.
1.3. La Commission nationale de la négociation collective (CNNC)
En application du 2° de l’article L. 2271-1 du code du travail, la commission nationale de la négociation collective doit être consultée pour tout projet de loi portant sur les relations individuelles ou collectives de travail, en particulier sur la négociation collective.
La consultation de la CNNC est intervenue le 18 février 2013.
1.4. Le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP)
En application de l’article R. 1431-3 du code du travail, le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :
1° À l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;
2° À l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;
3° À la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes.
Les dispositions du projet de loi concernant les règles relatives au licenciement appellent ainsi la consultation du CSP.
La consultation du CSP est intervenue le 27 février 2013.
1.5. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA)
En application de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel exerce les attributions conférées aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques, à l’égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Les dispositions du projet de loi concernant les règles relatives au licenciement collectif introduisent un nouveau recours contentieux devant la juridiction administrative, qui aura un impact sur l’organisation du corps et nécessite de ce fait la consultation du CSTACAA.
La consultation du CSTACAA est intervenue le 19 février 2013.
1.6. Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT)
En application du 2° de l’article R. 4641-2 du code du travail, le conseil d’orientation sur les conditions de travail doit être consulté sur les projets de loi relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements de droit privé.
Les dispositions du projet de loi concernant les modalités de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) appellent ainsi la consultation du COCT.
La consultation du COCT est intervenue le 20 février 2013.
1.7. Le Conseil supérieur de la mutualité
En application de l’article L. 411-1 du code de la mutualité, le conseil supérieur de la mutualité est consulté sur tout projet de texte législatif relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations.
Les dispositions du projet de loi concernant les complémentaires santés appellent ainsi la consultation du conseil supérieur de la mutualité. En effet, le projet de loi complète les articles 2 et 4 de la loi Evin et modifie à ce titre les règles applicables à l’ensemble des familles d’assureurs.
La consultation du CSM est intervenue le 25 février 2013.
1.8. Le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF)
En application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier et de l’article L. 411-2 du code des assurances, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis de tout projet de loi traitant de questions relatives au secteur de l'assurance.
Les dispositions du projet de loi concernant les complémentaires santés appellent ainsi la consultation du CCLRF. En effet, le projet de loi complète les articles 2 et 4 de la loi Evin et modifie à ce titre les règles applicables à l’ensemble des familles d’assureurs.
La consultation du CCLRF est intervenue le 25 février 2013.
Section 2 - Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer
1.1. Champ d’application géographique.
Le projet de loi a pour objet d’assurer la base législative permettant l’application des engagements de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Les dispositions du projet de loi ont vocation à s’appliquer aux collectivités ultra-marines régies par le code du travail, cadre normatif de l’accord, à savoir les départements d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’application du projet de loi à Mayotte, qui est régi par un code du travail spécifique, appelle un certain nombre d’adaptations. Le Gouvernement souhaite y procéder par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution. Une habilitation est prévue à cet effet dans le projet de loi.
Le projet de loi ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ni dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont régies par des codes du travail spécifiques qui, contrairement à celui en vigueur à Mayotte, n’ont pas vocation à prévoir des dispositions équivalentes à celles applicables dans l’hexagone et dans les départements d’outre-mer. En outre, dans certaines de ces collectivités, le droit du travail n’est pas une compétence de l’Etat.
1.2. Consultations obligatoires.
Dans la mesure où son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon n’appelle aucune adaptation, aucune consultation des assemblées locales de ces collectivités n’est obligatoire.
En ce qui concerne Mayotte, il est de jurisprudence constante qu’un article d’habilitation n’appelle pas la consultation obligatoire de l’assemblée locale.
C’est le projet d’ordonnance qui prévoira l’application avec adaptations du texte dans cette collectivité qui fera l’objet de la consultation du conseil général du Département de Mayotte.
1.3. L’application du projet de loi dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’application du projet de loi n’appelle pas de disposition particulière d’adaptation.
Le code du travail s’applique de plein droit dans chacune de ces collectivités, tout comme le code de la sécurité sociale et le code de commerce.
La seule exception intéresse le droit de la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon qui dispose d’un régime de protection sociale particulier. Cependant, les dispositions de l’article 1er du présent texte, y compris celles qui complètent le code de la sécurité sociale, s’appliqueront localement de plein droit dès lors qu’il s’agit de dispositions nouvelles intéressant la protection sociale complémentaire et la mutualité, et dont l’application n’est contrariée par aucun texte spécifique à l’archipel.
En toute rigueur, les partenaires sociaux n’ayant pas respecté les formes prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail, l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2013 n’est applicable que dans l’hexagone (sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de la possibilité de déterminer la volonté des parties sur cette question). La volonté du Gouvernement est néanmoins d’appliquer le projet de loi à toutes les collectivités soumises au code du travail.
1.4. L’article d’habilitation permettant l’extension du projet de loi à Mayotte.
Le recours à une ordonnance s’explique par le nombre d’adaptations qui sont nécessaires pour aligner les normes du code du travail applicable à Mayotte sur celles en vigueur dans l’hexagone avant de pouvoir faire bénéficier les entreprises et les salariés de Mayotte des dernières évolutions prévues par le projet de loi.
Ainsi, pour ne citer que trois exemples :
- la législation applicable à Mayotte ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les entreprises locales pourront bénéficier des accords nationaux interprofessionnels ou de branche. La rédaction actuelle du code local, sauf exceptions déterminées par la loi, ne permet pas l’application à Mayotte de ces accords nationaux ;
- le régime de chômage et de chômage partiel applicable localement, s’il s’est considérablement rapproché de ceux en vigueur dans l’hexagone, doit encore être modernisé pour pouvoir accueillir les dernières modifications prévues par le présent texte ;
- enfin, si le code local connaît le travail à temps partiel, il ne le réglemente pas et l’insertion des dispositions du projet de loi sur le travail à temps partiel suppose l’encadrement législatif préalable de ce type d’organisation du travail.
1.5. Les justifications de la non-application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Outre le fait que l’accord national interprofessionnel ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des raisons d’ordre statutaire, juridique et social interdisent l’application du présent projet de loi dans ces collectivités.
Les dispositions du présent texte intéressent à titre principal le droit du travail, mais aussi le droit de la mutualité – protection sociale complémentaire - (II de l’article 1er notamment), le droit des sociétés (article 5 notamment) ainsi que quelques dispositions touchant à l’office du juge, donc à l’organisation judiciaire. Par détermination des statuts de chacune de ces collectivités, certaines de ces compétences relèvent de la compétence de l’Etat, d’autres de la compétence des assemblées locales.
Cependant, compte tenu de l’organisation du projet de loi, les dispositions qui ne relèvent pas directement du droit du travail sont indissociables de celles qui intéressent cette matière (pas d’extension de la couverture sociale complémentaire conventionnelle sans droit de la négociation et des conventions collectives, pas d’organisation de la représentation d’administrateurs salariés sans organisation d’institutions représentatives du personnel, etc.). Dès lors, c’est, à une exception près, la compétence en matière de droit du travail qui détermine, pour l’ensemble du texte, si l’Etat est ou non compétent pour intervenir dans telle ou telle collectivité.
Une fois l’obstacle statutaire levé, l’application d’une disposition dépend, d’une part, de l’état du droit du travail applicable localement, d’autre part, de la pertinence des mesures au regard de la situation économique et sociale locale.
En Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’est plus compétent en matière de droit du travail et de protection sociale. Le projet de loi ne peut donc pas y trouver effet.
Les précédentes extensions en Nouvelle-Calédonie des dispositions du code de commerce relatives à la participation de représentants des salariés aux conseils d’administration des entreprises permettent cependant de déduire qu’il est juridiquement possible de rendre applicable localement ces dispositions bien que la compétence en droit du travail échappe à l’Etat en séparant les dispositions relevant du droit commercial de celles intéressant le droit du travail.
Ce n’est pas le choix fait par le Gouvernement qui estime que cette extension est inopportune compte tenu de l’absence de concertation avec les partenaires sociaux de la Nouvelle-Calédonie, d’étude spécifique sur la question et du transfert prochain de la compétence en matière de droit commercial à la Nouvelle-Calédonie en application de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial (application du transfert de compétence le 1er juillet 2013 si les conventions prévues par la loi statutaire sont publiées avant cette date, sinon, le transfert prend effet le 1er jour du quatrième mois qui suit leur réalisation et au plus tard le 14 mai 2014).
En Polynésie française, l’Etat n’est plus compétent en matière de droit du travail, de protection sociale et de droit commercial ou de droit des sociétés. Le projet de loi ne peut donc pas s’y appliquer.
À Wallis-et-Futuna, l’Etat est compétent en matière de droit du travail. La situation économique et sociale locale ainsi que les dispositions du code du travail applicable localement (loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée) sont cependant trop différentes pour que le présent projet de loi puisse trouver une traduction locale sans étude préalable, consultation des partenaires sociaux locaux et refonte du droit du travail applicable localement.
Sans rien dire sur l’écart entre la situation économique et sociale locale et celle qui, dans l’hexagone, a présidé à la négociation ayant abouti à l’accord du 11 janvier 2013, il est possible de souligner ici que le droit du travail applicable localement ne connaît pas de régime d’assurance chômage, de régime de chômage partiel, d’accords interprofessionnels ou de branche prévoyant une couverture complémentaire collective « santé ou prévoyance », de possibilité d’application des conventions ou accords nationaux de travail, d’organisation de la formation professionnelle équivalente à celle appliquée dans les départements, de comité d’entreprise, de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de réglementation du travail à temps partiel, d’obligations de reclassement des salariés licenciés pour motif économique et dispose d’une organisation des tribunaux du travail et de la conciliation pré-contentieuse particulière. Dès lors, l’application du présent projet de loi n’est pas, en l’état, possible.
Dans les TAAF, l’Etat est compétent dans toutes les matières mentionnées plus haut, mais, outre les considérations sur le droit du travail applicable à Wallis-et-Futuna qui sont également valables pour cette collectivité, cette dernière ne connaît aucun travailleur permanent, si on exclut les marins et officiers travaillant sur les quelques navires de pêche toujours immatriculés dans la collectivité. Compte tenu de la géographie des lieux, tous les salariés de droit privé qui effectuent une activité dans cette collectivité y sont envoyés en mission et leur statut relève du droit applicable à l’entreprise qui les emploie.
1.6. Points particuliers.
a) Les dispositions modifiant le code de commerce.
L’article 5 du projet de loi crée dans le code de commerce les articles L.225-27-1, L.225-28-1, L.225-34-1, L.225-79-2 et modifie ses articles L.225-29 à L.225-34 et L.225-80.
Les dispositions du XXIX de l’article 13 modifient les articles L.631-17, L.631-19, L.641-4 et L.642-5 du même code.
Les chapitres contenant les articles précités s’appliquent sans adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions nouvelles insérées dans le code de commerce sont désormais applicables de plein droit à Mayotte en application du principe d’assimilation législative, moyennant les adaptations déjà prévues dans ce code, notamment aux articles L.920-4 et L.920-5 du code de commerce. Cependant, pour permettre une application pleine et entière du projet de loi, il aurait également été nécessaire de prévoir d’autres adaptations et de reprendre dans le code du travail applicable à Mayotte des dispositions équivalentes à celles introduites dans le code du travail. Ce travail d’adaptation sera fait dans le cadre de l’ordonnance prévue par le présent projet de loi. Dans l’attente de la publication de cette ordonnance, ce seront toujours les dispositions actuelles du code de commerce qui s’appliqueront à Mayotte.
En l’absence de mention expresse d’application, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ni à Wallis-et-Futuna.
Les mots « territoire français » qui figurent dans certains des articles ne peuvent pas être considérés comme une mention expresse d’application.
En application du 7° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 qui prévoit que les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit commercial sont applicables de plein droit dans les TAAF, les dispositions précitées seront donc applicables dans le silence de la loi, mais elles n’y trouveront aucun effet utile dans la mesure où aucune entreprise n’y est domiciliée.
Aucune des dispositions précitées ne s’applique en Polynésie française. La collectivité étant compétente en matière de droit commercial, les dispositions figurant au titre IV du livre IX du code de commerce ne sont plus d’actualité.
Les dispositions relatives à l’application du code de commerce en Polynésie française figurant encore actuellement au livre IX de ce code datent d’avant le transfert de cette compétence à la collectivité en 2004.
Il aurait été possible en droit, au prix de quelques adaptations (et d’une consultation des assemblées locales), d’appliquer les dispositions du projet de loi modifiant le code du commerce en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Eu égard aux spécificités de ces territoires, tel n’a cependant pas été le choix du Gouvernement.
b) La référence au crédit d’impôt compétitivité emploi.
Les dispositions des VII à IX de l’article 4 intéressent l’information du comité d’entreprise sur les sommes reçues par l’entreprise dans le cadre du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 28 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Dans la mesure où le crédit d’impôt compétitivité emploi n’est pas applicable aux entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont compétentes en matière de fiscalité, ces dispositions y resteront lettre morte.
Il n’est cependant pas nécessaire de toiletter le code du travail pour son application dans ces collectivités, l’application du principe d’assimilation législative admet que certaines dispositions applicables localement ne trouvent pas d’effet en pratique.
c) Le nouveau régime de chômage partiel.
Actuellement le régime du chômage partiel prévu par le code du travail n’est pas appliqué dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon car l’accord national interprofessionnel de 1968 n’est applicable que dans l’hexagone. Les nombreuses modifications de cet accord initial de 1968 n’ont pas modifié son champ d’application géographique.
Ce n’est que récemment que le dispositif a pu trouver pleinement effet, après la signature et l’extension d’accords régionaux interprofessionnels sur le chômage partiel dans chacun des départements d’outre-mer (accords du 23 mai 2001 en Guadeloupe, du 16 février 2007 en Martinique et du 16 décembre 2008 à La Réunion). Cependant, ces accords ne tiennent pas compte de l’évolution récente du droit conventionnel hexagonal relatif au chômage partiel.
Le nouveau texte est l’occasion pour le Gouvernement de réaffirmer sa volonté de voir le même régime légal et conventionnel appliqué dans l’hexagone et outre-mer.
Il appartiendra désormais aux partenaires sociaux nationaux de faire cesser cette différence entre l’hexagone et l’outre-mer qui, si elle pouvait se justifier au début des années 1970 lorsque le salaire minimum applicable outre-mer était différent de celui en vigueur dans l’hexagone, n’est plus d’actualité, en précisant clairement dans le nouvel accord en cours de négociation qu’il s’applique dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1.7. L’ajout d’un article d’habilitation pour l’application du projet de loi à Mayotte.
Bien qu’il existe d’autres habilitations actuellement en cours pour moderniser le code du travail applicable à Mayotte (notamment le 4° du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer du 20 décembre 2012), ces habilitations ne couvrent pas le domaine du droit commercial et du régime complémentaire assuré par une couverture conventionnelle collective. En outre, un délai supplémentaire est nécessaire à l’administration de réaliser dans un premier temps les adaptations permettant au droit local d’être équivalent au droit du travail actuellement applicable dans l’hexagone, notamment en matière de convention collective et de travail à temps partiel.
Article 1 - Généralisation de la couverture complémentaire santé et portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d’emploi
La mise en œuvre de l’obligation faite aux entreprises non couvertes par le biais d’accords de branches ou d’entreprises de garantir la couverture des frais de santé de leurs salariés à compter du 1er janvier 2016 appellera des textes réglementaires d’application (pris en application de l'article L.911-7 nouveau du code de la sécurité sociale) visant à déterminer le contenu précis et le niveau minimal des garanties, à fixer la part minimale de la cotisation devant être prise en charge par l’employeur et à définir les cas de dispenses d’affiliation, en particulier pour celles déjà couvertes par le biais d’autres dispositifs obligatoires (cf. supra).
Le Gouvernement s’attachera néanmoins à prendre ces textes d’application suffisamment tôt avant cette échéance du 1er janvier 2016 pour éclairer les négociateurs de branche et d’entreprise quant au niveau minimum de garantie devant être couvert. En outre, le contenu de ce décret sera articulé, ainsi qu’il a été rappelé, avec la réflexion que le Gouvernement entend mener dans les prochains mois sur les évolutions du contrat responsable.
La mise en œuvre de l’obligation pour les branches de procéder à une mise en concurrence préalable à la définition de clauses de désignation ou de recommandation appelle un décret simple pris en application de l'article L.912-1 modifié par le présent projet de loi.
Le Gouvernement tiendra compte à cet égard des propositions élaborées par le groupe de travail que les signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 ont souhaité mettre en place, en veillant néanmoins à ce que le texte soit pris suffisamment tôt pour s’appliquer aux accords de branche qui seront négociés pour mettre en œuvre la couverture des frais de santé.
Les dispositions relatives à la portabilité des garanties n’appellent pas de dispositions règlementaires nécessaires à leur application. Conformément à l’article 1er du projet de loi, elles entreront en vigueur au 1er juin 2014 (pour les frais de santé) et au 1er juin 2015 (pour la prévoyance). Ce délai a pour objet de laisser le temps nécessaire aux branches et aux entreprises d’organiser la mutualisation du financement de ces garanties conformément au projet de loi.
Article 2 - Création d’un compte personnel de formation et création d’un conseil en évolution professionnelle
La mise en œuvre d’un compte personnel de formation appellera des dispositions légales et réglementaires complémentaires en lien avec la concertation partenaires sociaux / Etat / Régions prévue par l'accord du 11 janvier, ainsi qu'une adaptation par les partenaires sociaux des dispositions conventionnelles au niveau interprofessionnel impactées par la création de ce compte.
Le conseil en évolution professionnelle ne nécessite pas de mesure d’application complémentaire. Il sera mis en œuvre notamment par les OPACIF et le réseau APEC après adoption de la loi.
Article 3 - Période de mobilité externe sécurisée
Application directe dès promulgation de la loi.
Article 4 - Information et consultation anticipée des IRP
Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires :
Nature du texte |
Contenu |
Qui |
Décret en CE |
Fixer les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus et leurs modalités de computation |
DGT |
Décret en CE |
Déterminer le contenu des informations de la base de données |
DGT |
Décret en CE |
Fixer les conditions dans lesquelles la mise à disposition des informations issues des rapports et informations transmises au comité d’entreprise valent communication au comité de ces rapports et informations. l |
DGT |
Décret en CE |
Fixer le délai de remise du rapport de l’expert-comptable ou technique |
DGT |
Décret en CE |
Déterminer le délai dans lequel l’expert désigné par le CE peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande |
DGT |
Décret en CE |
Fixer les délais dans lesquels l’instance de coordination se prononce le cas échéant |
DGT |
Décret en CE |
Date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L.2323-7-3 |
DGT |
La base de données prévue à l’article L.2323-7-2 est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi dans les entreprises de 300 salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Article 5 - Représentation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête de l’entreprise
S’agissant des modalités de mise en œuvre, il n’y a pas besoin de décret d’application. Le dispositif légal prévu décrit en effet précisément les modalités de désignation des représentants des salariés et renvoie pour le reste directement aux statuts des sociétés. À titre de comparaison, le mécanisme optionnel de l’article 225-27 existant aujourd’hui est entièrement décrit dans la loi et n’a pas de déclinaison réglementaire.
Article 6 - Création de droits rechargeables à l’assurance chômage et accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle des demandeurs d’emploi ex-salariés précaires
Les conventions actuelles - convention pluriannuelle tripartite entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unédic et la convention bipartite Pôle emploi-Unédic - permettent la mise en œuvre des règles d’assurance chômage présentes et à venir (y compris, par conséquent, celles relatives aux droits rechargeables).
S’agissant de l’indemnisation des bénéficiaires du CSP, la signature d’une convention entre l’Unédic et Pôle emploi, ou une modification de la convention Etat / Unédic / Pôle emploi sur le financement du CSP, sera nécessaire.
Article 7 - Modulation des cotisations d’assurance chômage
Les partenaires sociaux négocieront d’ici au 1er juillet 2013 un avenant à la convention d’assurance chômage actuelle afin de mettre en œuvre les modalités décidées à l’article 4 de l’accord du 11 janvier 2013.
L’Unédic et de l’Acoss ont déjà commencé à travailler aux adaptations nécessaires de leurs services d’information.
Les autres conventions actuelles (convention pluriannuelle tripartite entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unédic et la convention bipartite Pôle emploi-Unédic) permettent la mise en œuvre des règles d’assurance chômage présentes et à venir.
Article 8 - Encadrer le travail à temps partiel
Les nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de vingt-quatre heures est applicable si les salariés en font la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2016, les nouvelles règles s’appliquent intégralement.
Article 9 - Articulation GPEC et plan de formation
Aucun texte d’application n’est requis pour ce texte.
Article 10 - Mobilité interne
Application directe dès promulgation de la loi.
Article 11 - Recours à l’activité partielle
Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires :
Nature du texte |
Action |
Contenu |
Qui |
Décret en CE |
Fixation du pourcentage de la rémunération antérieure versée aux salariés et majoration de ce pourcentage en cas de formation du salarié |
DGEFP | |
Décret en CE |
Modalités selon lesquels sont souscrits les engagements spécifiques de l’employeur |
DGEFP | |
Arrêté |
DGEFP | ||
Arrêté APLD |
Supprimer |
DGEFP | |
Circulaire d’application |
DGEFP | ||
Convention financière avec l’UNEDIC |
Modalités de financement de l’allocation |
DGEFP/UNEDIC |
Le décret en Conseil d’Etat précisera les contours du futur outil, notamment :
- la nature et les conditions de mises en œuvre des contreparties. L’autorisation de mise en activité partielle distinguera la première demande des suivantes :
o La première demande qui vise à permettre à une entreprise qui connaît des difficultés économiques temporaires de bénéficier de l’activité partielle sans que des contreparties ne soient exigées, au-delà du seul maintien dans l’emploi des salariés pendant la période d’indemnisation.
o En revanche, toute demande consécutive intervenant dans les 36 mois suivant la précédente sera assortie de contreparties définies entre l’autorité administrative et l’employeur, en tenant compte d'un éventuel accord collectif d'entreprise.
- le mode de calcul des heures à indemniser :
o Une formule de calcul unique reposant sur une logique d’indemnisation de toute heure chômée et applicable à tous les modes d’organisation et de répartition du temps de travail pourrait être retenue.
- le niveau d’indemnisation des salariés, qui aura été fixé par les partenaires sociaux.
Le décret en Conseil d’Etat permettra également de rationnaliser et de simplifier certaines modalités de mise en œuvre de l’activité partielle (supprimer le plafond des 6 semaines consécutives de fermeture, supprimer le cas particulier de l’activité partielle congés payés et du régime indemnitaire des apprentis pendant les heures chômées).
Article 12 - Accords de maintien dans l’emploi
Aucun texte d’application n’est requis pour ce texte.
Article 13 - Procédures de licenciement collectif
Les dispositions actuelles prévues en R et en D feront l’objet d’adaptations. Au-delà, un référentiel permettant aux Direccte de valider les accords ou homologuer les plans de sauvegarde de l’emploi devra être élaboré. Il devra permettre également aux services d’apprécier la qualité des mesures d’accompagnement social.
Article 14 - Obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Aucun texte d’application n’est requis pour ce texte.
Article 15 - Dispositions diverses sur le licenciement économique
Aucun texte d’application n’est requis pour ces deux dispositions.
Article 16 - Prudhommes
Un décret déterminera le barème d’indemnisation des litiges relatifs à la rupture du contrat de travail portés devant le bureau de conciliation.
Des mesures transitoires ont été prévues pour les nouvelles règles de prescription, sur le modèle de celles qui figuraient dans la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Article 17 - Seuils IRP
Application directe dès promulgation de la loi pour le I et III.
Un décret en CE déterminera les modalités dans lesquels l’employeur se conforme aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Article 18 - Contrat de travail intermittent
Application directe dès promulgation de la loi et publication de l’arrêté du ministre chargé du travail fixant les secteurs concernés.
Section 4 - Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Article 1 - Généralisation de la couverture complémentaire santé et portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d’emploi
S’agissant de l’obligation faite aux branches professionnelles et aux entreprises de négocier en vue de généraliser la couverture collective obligatoire des frais de santé, le Gouvernement suivra attentivement le déroulement et l’issue des négociations, en particulier dans le cadre de l’examen des accords de branche dont les partenaires sociaux demanderont l’extension.
Article 2 - Création d’un compte personnel de formation et création d’un conseil en évolution professionnelle
Le gouvernement va lancer dans les plus brefs délais la négociation tripartite partenaires sociaux / Etat / régions afin de pouvoir compléter le dispositif légal et réglementaire qui permettra la mise en œuvre du compte personnel de formation.
En outre, dans le cadre de la prochaine loi relative à la décentralisation, la réforme du service public de l'orientation va permettre d'expliciter l'articulation du conseil en évolution professionnelle OPACIF et Apec avec le service public de l'orientation conformément aux termes mêmes de l'article 16 de l'ANI.
Article 3 - Période de mobilité externe sécurisée
Aucune modalité particulière n’est envisagée, s’agissant d’une mesure de gré à gré.
Article 4 - Information et consultation anticipée des IRP
Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur les conditions d’utilisation du crédit d’impôt avant le 31 décembre 2016.
Article 5 - Représentation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête de l’entreprise
La désignation des administrateurs doit intervenir au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication de la loi.
Article 6 - Création de droits rechargeables à l’assurance chômage et accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle des demandeurs d’emploi ex-salariés précaires
La nouvelle convention d’assurance chômage qui sera négociée d’ici à la fin de l’année 2013 par les partenaires sociaux précisera les modalités d’applications des « droits rechargeables ».
Article 7 - Modulation des cotisations d’assurance chômage
Le suivi de la mesure sera permis par la publication trimestrielle des Déclarations Préalables à l’Embauche (DPAE) par l’Acoss.
Article 8 - Encadrer le travail à temps partiel
Son application ne fera pas l’objet d’un suivi formalisé par la loi. Toutefois, le suivi statistique d’ores et déjà assuré par la DARES sur les effectifs des branches de plus de 5 000 salariés permettra d’identifier les branches soumises à une obligation de négociation car occupant plus d’un tiers de son effectif à temps partiel.
Article 9 - Articulation GPEC et plan de formation
Dans le cadre du bilan annuel de la négociation collective, l’évolution du contenu des accords de GPEC fera l’objet d’une attention particulière.
Article 10 - Mobilité interne
Son application ne fera pas l’objet d’un suivi formalisé par la loi. Une attention particulière sera portée aux accords signés dans les entreprises concernées.
Article 11 - Recours à l’activité partielle
Campagne de communication :
Le plan de communication et de mobilisation déjà mis en œuvre sur la fin du dernier trimestre 2012 sera prolongé et amplifié dès l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Une stratégie de communication plus globale, média et hors média, sera développée pour accompagner les évolutions de l’activité partielle, issues de la réflexion engagée par l’Etat et les partenaires sociaux.
Suivi de la disposition :
Le suivi du déploiement sera effectué par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Elle assurera l’exploitation des données recueillies par l’extranet dans un infocentre dédié et pourra ainsi évaluer les effets de la réforme.
Deux indicateurs pourraient être plus particulièrement suivis :
- Pourcentage d’entreprises de 1 à 49 salariés recourant au dispositif ;
- Pourcentage d’heures de formation réalisées pendant les heures chômées pour les entreprises de 1 à 49 salariés et de 50 à 249 salariés.
Article 12 - Accords de maintien dans l’emploi
Une remontée des accords déposés auprès des Unités territoriales des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) sera effectuée.
Article 13 - Procédures de licenciement collectif
Le système d’information actuel relatif aux procédures de licenciement économique devra évoluer afin notamment de rendre compte des décisions de validation ou d’homologation et des raisons qui ont pu conduire à des décisions de refus. Il devra également permettre de retracer plus précisément le contenu des mesures d’accompagnement social, ce qui permettra d’apprécier l’évolution de la qualité des mesures.
Au-delà, c’est la question de l’évolution du dialogue social au cours de la procédure d’information consultation qu’il serait intéressant de documenter ainsi que l’évolution de la phase contentieuse.
Article 14 - Obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Cette disposition devra être prise en compte dans le cadre des travaux mentionnés au point précédent.
Article 15 - Dispositions diverses sur le licenciement économique
Cette disposition devra être prise en compte dans le cadre des travaux mentionnés au point précédent.
Article 16 - Prudhommes
L’impact des dispositions sera mesuré à travers les statistiques produites par la Chancellerie.
Article 17 - Seuils IRP
Aucune modalité particulière n’est prévue.
Article 18 - Contrat de travail intermittent
Le projet de loi prévoit une évaluation de ce dispositif expérimental avant le 31 décembre 2014, à travers un rapport du Gouvernement au Parlement. Ses conclusions permettront de déterminer les suites qui seront réservées à l’expérimentation.
1 Voir également le rapport public thématique de la Cour des comptes, « Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques », 22 janvier 2013.
2 Cf. « Quand les demandeurs d’emploi travaillent : avec la crise, le nombre de demandeurs d’emploi en activité atteint son plus haut niveau », Dares Analyse n°002 (janvier 2013)
3 Rapport de la cour des comptes – février 2011
4 Rapport « Perspectives de l’OCDE 2010 - Sortir de la crise de l’emploi ». La méthodologie employée reste particulièrement frustre et les résultats doivent être utilisés plus pour comparer l’efficacité respective des dispositifs que pour quantifier les emplois sauvegardés.
5 Cf. « Chômage partiel, activité partielle, Kurzarbeit : quelles différences entre les dispositifs publics français et allemand ? », TrésorEco, n°107, Novembre 2012.
6 Etude de l’Agence de Services et de Paiements (ASP), 2012
7 Enquête DGEFP/DARES/UNEDIC auprès des DIRECCTE du 21 septembre 2012
8 Rapport de l’IGAS, « Evaluation du système français d'activité partielle dans la perspective d'une simplification de son circuit administratif et financier », Juillet 2012.
9 Son recours vient après la baisse du nombre d’intérimaires, des CDD, de l’annualisation du temps de travail, des plans de départ volontaire, des congés de reclassement, etc.
10 Une allocation spécifique de chômage partiel dite « classique »; une indemnité complémentaire fixée par accord collectif ; depuis 2009, une allocation forfaitaire éventuelle dans le cadre d’une convention d'activité partielle de longue durée (APLD) si la réduction du temps de travail se poursuit pendant plus de 3 mois.
11 Qui oblige à opérer la distinction entre les périodes relevant du chômage partiel et celles relevant des autres dispositifs (annualisation, modulation). Résultat : la superposition de plusieurs dispositifs en fonction de la durée de l’activité partielle se traduit par des niveaux d’indemnisation différents pour les salariés et des niveaux de prise en charge différents pour les entreprises.
12 Les marchés du travail dans la crise, M. Cochard, G. Cornilleau et E. Heyer, Economie et statistique, n° 438, 2010.
13 Calcul d’après les déclarations des mouvements de main d’œuvre (Dares).
14 43% des PSE dans des entreprises envisageant le licenciement de plus de 50 salariés (période 2002-2005, d’après Dares PS n°28.2)
15 Plusieurs critères sont retenus pour le calcul des effectifs :
Ø les seuils d’effectifs prévus doivent avoir été atteints pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 années précédant les élections ;
Ø certains statuts d’emploi sont exclus du calcul de l’effectif ;
Ø selon leur degré d’intégration, des salariés mis à disposition par d’autres entreprises peuvent être comptabilisés dans les effectifs du corps électoral.
16 L’Insee se réfère aux « formes particulières d'emploi » − à savoir les contrats à durée déterminée (CDD), les missions d’intérim, les contrats aidés et les contrats d’alternance − par opposition aux contrats à durée indéterminée (CDI).
17 Si, à caractéristiques données, le salaire moyen en CDD est proche du salaire moyen d’embauche en CDI, les salariés en emploi temporaire ne bénéficient pas des avantages liés à l’ancienneté dans l’emploi, et ne peuvent prétendre à de véritables carrières salariales à la hauteur de l’expérience et des savoir-faire accumulés.
18 Cette section comprend les activités des organisations associatives, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ainsi que diverses activités de services personnels non classées ailleurs dans la nomenclature (notamment des types de services comme la blanchisserie-teinturerie, la coiffure et les soins de beauté, les services funéraires et les activités connexes).
19 Et même en réalité certainement plus car l’enquête sur les mouvements de main d’œuvre n’est pas exhaustive s’agissant des CDD de moins d’1 mois.
20 Il n’est pas possible à ce stade de savoir qui est à l’origine de la rupture lorsqu’il s’agit d’une « fin de période d’essai ».
21 Article L.1242-1 du code du travail : « Un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
22 Ensemble des salariés, hors apprentis et contrats en alternance, dans la fonction publique, les entreprises et chez les particuliers.
23 En toute rigueur, l’enquête Emploi permet de recenser les durées des activités auprès des trois premiers employeurs du même métier et par ailleurs les durées des activités éventuelles dans trois autres métiers différents.
24 IRDES, « Le renoncement aux soins pour raisons financières : une approche économétrique, Questions d’économie de la santé », n°170, novembre 2011.
25 Depuis la loi du 21 août 2003, les primes versées aux organismes assureurs ne sont pas assujetties à cotisations sociales, dès lors que le régime est collectif et obligatoire.
26 « La protection sociale complémentaire d'entreprise en 2009 », Les rapports de l'IRDES, n°1890, juillet 2012.
27 Données DSS (décembre 2012).
28 Modulo notamment la condition de 5 années d’activité sur les 10 dernières années.
29 C'est-à-dire l’indemnisation totale potentielle (durée * montant journalier).
30 Cf. Dares Analyse, n°013, « Les demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage en 2011», février 2013.
31 Des actions contentieuses ont été engagées contre certains accords de branche procédant à la désignation d’organismes assureurs au motif qu’ils n’avaient pas donné lieu à une procédure formalisée d’appel à la concurrence, qui ont abouti à des solutions divergentes de la part des juridictions de premier et second degré. Ni la Cour de cassation ni la Cour de justice de l’Union européenne n’ont encore été amenées à se prononcer sur cette question.
32 IRDES, Questions d’économie de la santé, « Panorama de la complémentaire santé collective en France en 2009 et opinions des salariés sur le dispositif », n°181, novembre 2012.
33 Les contributions des employeurs pour la prévoyance complémentaire (couverture des risques maladie, maternité ou accident) sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n’excédant pas un montant égal à : 6 % du plafond de la Sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du plafond de la Sécurité sociale (cf. Annexe 5 du PLFSS).
34 Coût net des prélèvements de CSG-CRDS et de forfait social.
35 Selon l’article 1 de l’ANI, le champ d'extension de la généralisation de la PSCE est laissé pour partie à la discrétion des entreprises ("les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d'affiliation tels que définis à l'article R.242-1-6 du code de la Sécurité sociale"), notamment pour les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d'ayant droit. Les deux hypothèses d’extension de champ retenues constituent donc deux hypothèses polaires.
36 Le gain net pour l'Etat en termes de TSCA n'est pas estimé.
37 Coût en termes de cotisations et contributions sociales (champ Sécurité sociale et hors Sécurité sociale), en termes d’impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et incluant le coût de l’extension de la portabilité en santé aux chômeurs sur 12 mois. Cette estimation ne tient pas compte de l’impact en termes de TSCA.
38 Lorsque des dispositions conventionnelles plus favorables à l’accumulation des heures de DIF existent, elles s’appliquent automatiquement au compte personnel de formation.
39 Données janvier 2012.
40 Cf. rapport IGAS, « Le contrat de sécurisation professionnelle : Premier bilan d’un dispositif individualisé de retour à l’emploi et d’accès à la formation, analyses et préconisations », 2010.
41 Ce taux, fixé à 6% depuis 1990, est passé à 10% avec la loi de modernisation sociale de janvier 2002. Il peut néanmoins être ramené à 6 % si une convention ou un accord collectif prévoit qu’un accès privilégié à la formation professionnelle est prévu pour les salariés en CDD, sous réserve de l’effectivité de cet accès (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2008).
42 Enquête 2010 « Regards croisés RH et partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la GPEC », réalisée par le cabinet de conseil Oasys Consultants sur la bases des réponses de 407 DRH et 499 Représentants du personnel
43 « Comment sécuriser les mobilités externes » Entreprises et Carrières février 2011 n° 1037
44 Enquête 2010 « Regards croisés RH et partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la GPEC » réalisée par le cabinet de conseil Oasys Consultants sur la bases des réponses de 407 DRH et 499 Représentants du personnel
45 Bilan de la mise en œuvre de l’obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2009-2010
46 Cf. conclusions du rapport commandé par le FPSPP au cabinet GESTE.
47 Conseil constitutionnel, n°2004-509, 13 janvier 2005, point 28
48 À partir de onze salariés :
- versement d’une indemnité minimale de 6 mois de salaires en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
- obligation d’organiser l’élection d’un délégué du personnel, sans obligation de résultat (seuil dépassé pendant 12 mois consécutif au cours des trois dernières années). Le délégué dispose d’un crédit de 10h par mois pour ses activités de représentation.
À partir de 50 salariés :
- obligation de mettre en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de former ses membres (seuil dépassé pendant 12 mois au cours des trois dernières années) ;
- obligation de mettre en place un comité d’entreprise avec réunion au moins tous les deux mois (seuil dépassé pendant 12 mois au cours des trois dernières années) ;
- affichage de consignes d’incendie dans les établissements où sont réunis plus de 50 salariés ; obligation de mise en place d’une participation aux résultats (seuil dépassé pendant six mois au cours de l’exercice comptable, délai d’un an après la fin de l’exercice pour conclure un accord);
- obligation de recourir à un plan social en cas de licenciement économique concernant 9 salariés et plus.
© Assemblée nationale