


ÉTUDE D’IMPACT
PROJET DE LOI
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties
de la procédure pénale
NOR : JUSD1532276L/Bleue-1
2 février 2016
SOMMAIRE
Article 1er Perquisitions de nuit 14
1. Etat des lieux et diagnostic 14
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 16
1. Etat des lieux et diagnostic 18
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 20
Article 3 Sonorisation et captation de données 21
1. Etat des lieux et diagnostic 21
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 24
1. Etat des lieux et diagnostic 25
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 26
Article 5 Témoignage à huis clos 28
1. Etat des lieux et diagnostic 28
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 28
Article 6 Protection des témoins 30
1. Etat des lieux et diagnostic 30
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 32
Article 7 Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes 33
1. Etat des lieux et diagnostic 33
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 34
Articles 8 à 10 Législation sur les armes 35
1. Etat des lieux et diagnostic 35
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 41
Article 11 Cybercriminalité 43
1. Etat des lieux et diagnostic 43
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 46
Article 12 Trafic de biens culturels et financement du terrorisme 47
1. Etat des lieux et diagnostic 47
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 48
Article 13 Cartes prépayées 49
1. Etat des lieux et diagnostic 49
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 49
Article 14 Appel à vigilance de TRACFIN 51
1. Etat des lieux et diagnostic 51
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 51
1. Etat des lieux et diagnostic 53
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 53
Article 16 Blanchiment douanier 55
1. Etat des lieux et diagnostic 55
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 56
Article 17 Dispositions relatives à la fouille des bagages lors de contrôles d’identité 60
1. Etat des lieux et diagnostic 60
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 61
Article 18 Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs administratifs Retenue administrative à l’occasion d’un contrôle d’identité 62
1. Etat des lieux et diagnostic 62
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 66
Article 19 Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs Usage des armes par les forces de l’ordre 67
1. Etat des lieux et diagnostic 67
3. Options et nécessite de légiférer 74
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 74
Article 20 Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs Contrôle administratif de retours sur le territoire national 76
1. Etat des lieux et diagnostic 76
3. Options et nécessite de légiférer 78
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 82
Article 21 « GRANDS EVENEMENTS » 84
1. Etat des lieux et diagnostic 84
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 88
5. Consultations et modalités d’application 90
Article 22 Clarification du rôle du procureur de la République 91
1. Etat des lieux et diagnostic 91
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 93
Article 23 Procédure disciplinaire d’urgence 94
1. Etat des lieux et diagnostic 94
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 97
Article 24 Renforcement des garanties a l’issue de l’enquête 99
1. Etat des lieux et diagnostic 99
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 103
5. Modalités d’application 106
1. Etat des lieux et diagnostic 107
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 112
5. Modalités d’application 112
Article 26 Renforcement des garanties en matiere de détention provisoire 113
1. Etat des lieux et diagnostic 113
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 116
5. Modalités d’application 116
Article 27 Renforcement des garanties en cas de garde à vue a la suite d’une arrestation en mer 117
1. Etat des lieux et diagnostic 117
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 119
5. Modalités d’application 119
Article 28 Simplification du regime des habilitations des Officiers de police judiciaire 120
1. Etat des lieux et diagnostic 120
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 122
5. Consultations et modalités d’application 123
Article 29 Simplification en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire 124
1. Etat des lieux et diagnostic 124
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 129
5. Modalités d’application 129
Article 30 Dispositions simplifiant le jugement 130
1. Etat des lieux et diagnostic 130
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 131
5. Modalités d’application 133
Article 31 Extension des contrôles d’identité et des recherches des personnes en fuite 134
1. Etat des lieux et diagnostic 134
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 136
5. Modalités d’application 137
Article 32 Dispositions diverses « Caméras piétons » 138
1. Etat des lieux et diagnostic 138
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 142
4. Consultations menées et modalités d’application 143
Article 33 Dispositions diverses Habilitation à légiférer 144
Tableau synoptique des textes d’application du projet de loi 190
Le présent projet de loi poursuit un triple objectif.
En premier lieu, il tend à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et notamment le terrorisme, non seulement par des mesures spécifiques de droit pénal et de procédure pénale améliorant la répression judiciaire, mais également par des mesures préventives relevant de l’action administrative et qui permettront de mieux détecter et surveiller la menace terroriste. Ces dispositions figurent dans le titre Ier du projet de loi. Ce titre comporte cinq chapitres, respectivement consacrés aux dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires, aux dispositions renforçant la protection des témoins, aux dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et la cybercriminalité, aux dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et aux dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs. Ces dispositions complètent celles de la loi du n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Si ce texte a accru et encadré tout à la fois, les possibilités de recueil du renseignement, cet arsenal de prévention doit en effet être complété par un volet judiciaire.
Elles complètent également les dispositions de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, qui donne des moyens d’action par nature limité dans le temps, en instituant des dispositions pérennes.
En deuxième lieu, le projet de loi tend à renforcer les garanties au cours de la procédure pénale, spécialement au cours de l’enquête et de l’instruction, afin de rendre notre procédure totalement conforme aux exigences constitutionnelles et européennes. Ces dispositions figurent dans le chapitre Ier du titre II du projet de loi. Le renforcement des garanties porte sur le rôle du procureur de la République et sur le déroulement des enquêtes et des instructions. Il s’inspire à la fois de propositions figurant dans le rapport sur le ministère public de la commission présidée par l’ancien procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal et le rapport de la commission présidée par le procureur général Jacques Beaume. Il est aussi rendu nécessaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme.
En troisième lieu, le projet de loi tend à procéder, à tous les stades de la procédure, à des simplifications qui faciliteront le travail des enquêteurs et des magistrats. Ces dispositions, qui figurent dans le chapitre II du titre II du projet de loi, s’intègrent dans un plan de simplification plus vaste de la procédure pénale mis en œuvre par le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur qui comportera également des modifications réglementaires et des préconisations pratiques diffusées par circulaire.
Ce triple objectif permet ainsi d’assurer l’accessibilité, l’équité et l’efficacité de notre procédure pénale.
Le projet de loi permet par ailleurs de rétablir la cohérence des équilibres, qui ont évolué depuis plus de vingt ans (et notamment depuis la loi du 4 janvier 1993 ayant très sensiblement renforcé le caractère contradictoire de l’instruction), existant entre :
- police administrative et police judiciaire,
- magistrats du parquet et magistrats du siège, et spécialement procureur de la République, juge d’instruction et juge des libertés et de la détention,
- parquet et police judiciaire.
S’agissant du premier équilibre, on peut observer que la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électronique savait réglementé et autorisé à la fois les interceptions des communications à titre administratif et à titre judiciaire, que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité puis celle du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure avaient permis ces interceptions, pour une durée limitée, au cours de l’enquête, à la demande du procureur et sur décision du juge des libertés et de la détention, tout en permettant d’autre atteintes à la vie privée (sonorisation, puis captations de données informatiques), mais uniquement au cours de l’instruction, et enfin que la loi du sur le renseignement du 24 juillet 2015 a permis le recours à ces différentes mesures, ainsi qu’à des mesures spécifiques d’IMSI catcher, à titre administratif.
Il en découle aujourd’hui que, de façon paradoxale, des mesures d’investigations qui sont possibles au titre de la police administrative, avant l’engagement d’une procédure judiciaire, soit ne peuvent plus être utilisées lors de la phase d’enquête, mais peuvent ensuite à nouveau être utilisées lors de la phase d’instruction, soit ne peuvent pas du tout être utilisées au cours d’une procédure judiciaire. Le projet de loi met donc fin à cette incohérence, en permettant le recours à ces mesures tant lors de la phase administrative qu’en matière judiciaire, soit au cours de l’enquête soit au cours de l’instruction, tout en respectant les exigences constitutionnelles puisqu’elles sont autorisées par un juge, et en les encadrant de façon adaptée, notamment dans leur durée, afin de respecter les équilibres entre le parquet et le juge d’instruction.
S’agissant en effet de ce second équilibre, il convient de rappeler que, depuis vingt ans, il résulte de l’évolution à la fois des pratiques et des textes, que s’est progressivement réduite la proportion d’informations confiées au juge d’instruction par rapport aux enquêtes dirigées par le procureur de la République, dont les pouvoirs d’investigations ont été accrus, avec l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette évolution a pu conduire certains à envisager la suppression pure et simple du juge d’instruction. Une telle suppression ne paraît cependant pas souhaitable, car l’intervention d’un juge du siège indépendant, et saisi in rem, agissant dans le cadre d’une procédure pleinement contradictoire, se justifie, dans une société démocratique, non seulement dans les affaires criminelles mais également dans les dossiers correctionnels graves et complexes, notamment ceux exigeant des mesures de sûreté contre les personnes ou dans les affaires économiques et financières les plus complexes. Elle est donc écartée par le Gouvernement qui considère en revanche que, pour rétablir un meilleur équilibre entre les procédures d’enquête et d’instruction, il convient de renforcer le caractère contradictoire de certaines enquêtes, de simplifier le déroulement des instructions, et de n’étendre que pour une durée très limitée et uniquement en matière de délinquance et de criminalité organisées, les pouvoirs d’investigations au cours de l’enquête. Ainsi, le recours à ces mesures n’aura pas pour conséquence d’empiéter sur les instructions, mais simplement de permettre des premières investigations de nature à déterminer si une instruction doit être ouverte ou si les soupçons à l’origine de l’enquête sont en réalité sans fondement, ce qui évitera d’ouvrir des informations inutiles. Ces évolutions complètent la suppression des instructions individuelles, qui ont été prohibées par la loi du 25 juillet 2013.
S’agissant enfin du troisième équilibre, il importe, au regard de l’augmentation des prérogatives données à la police judiciaire, de clarifier le rôle du procureur de la République en matière de direction des enquêtes, afin d’assurer la juste distance entre ce magistrat et les enquêteurs, tout en renforçant les pouvoirs de contrôle de l’autorité judiciaire, en l’espèce le procureur général, sur la discipline des officiers et agents de police judiciaire et des autres fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire.
ARTICLE 1ER
PERQUISITIONS DE NUIT
1. Etat des lieux et diagnostic
L’article 59 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que des perquisitions et visites domiciliaires peuvent être réalisées entre 6 heures et 21 heures. A titre dérogatoire, si l’enquête préliminaire porte sur des faits de délinquance et criminalité organisée, l’article 706-90 CPP ouvre la faculté au procureur de la République de solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention pour être autorisé à procéder des perquisitions en dehors des heures légales, dès lors que ces opérations ne portent pas sur des locaux d’habitation. Par conséquent, la perquisition domiciliaire nocturne dans le cadre d’une enquête préliminaire n’est pas prévue par notre code de procédure pénale.
1.2 Perquisitions de nuit en matière d’instruction
Aux termes de l’article 706-91 du CPP, le juge d’instruction peut autoriser la perquisition de nuit d’un lieu privé qui ne serait pas un local d’habitation, lorsque les nécessités d’une information judiciaire relevant de la criminalité et de la délinquance organisées l’exigent.
En cas d’urgence, le juge d’instruction peut également autoriser que les perquisitions de nuit soient réalisées dans un local d’habitation, dès lors qu’il se trouve dans l’une des trois hypothèses suivantes : en cas de crime ou d'un délit flagrant, en cas de risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ou encore s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 CPP.
2.1 Perquisitions de nuit en préliminaire
La modification proposée tend à étendre la possibilité pour le procureur de la République d’opérer, en enquête préliminaire, des perquisitions nocturnes dans les locaux d’habitation uniquement en matière d’infractions de nature terroriste visées à l’article 706-73 11° du CPP, en cas d’urgence et lorsque la réalisation de cette opération avant 6h ou après 21 h est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Le régime juridique applicable est identique à celui des autres perquisitions actuellement prévues au premier alinéa de l’article 706-90 du CPP (perquisitions nocturnes en dehors de locaux d’habitation) : il s’agit d’une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, selon les modalités définies à l’article 706-92 du CPP.
2.2 Perquisitions nocturnes dans des locaux d’habitation en matière d’instruction
En matière de criminalité organisée, les perquisitions dans des locaux d’habitation réalisées en dehors des heures légales sont actuellement encadrées par l’article 706-91 du CPP qui vise, outre l’urgence, trois hypothèses restrictives dans lesquelles le magistrat instructeur peut ordonner la réalisation de perquisitions domiciliaires nocturnes.
Les modifications proposées tendent à élargir les possibilités pour le magistrat instructeur de décider la réalisation de perquisitions nocturnes dans des locaux d’habitation en ajoutant un nouveau cas de figure, tenant à l’existence d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique mais limité aux seules infractions de nature terroriste visées à l’article 706-73 11° du CPP.
3.1 Perquisitions de nuit en préliminaire
Concernant la détermination des infractions pour lesquelles la réalisation de perquisitions domiciliaires nocturnes seront désormais ouvertes, deux options ont été envisagées, celle d’inclure l’ensemble des infractions liées à la criminalité organisée et visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP (option écartée) ou bien celle, plus restrictive, de limiter ces perquisitions dérogatoires aux seules infractions terroristes (articles 706-73 11° du CPP).
Dans sa décision n°2004-492 du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité, dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de criminalité organisée, de procéder à des perquisitions nocturnes sous réserve qu’elles ne concernent pas des locaux d’habitation. Dans cette même décision, il a considéré, s’agissant des perquisitions domiciliaires nocturnes réalisées dans le cadre d’une information judiciaire, que ces mesures apparaissaient justifiées par la recherche d’infractions particulièrement graves ou la nécessité ou la nécessité d’intervenir dans des locaux où sont en train de se commettre de telles infractions en faisant la réserve d’interprétation suivante : la condition liée au risque immédiat de disparition de preuves ou d’indices matériels doit s’entendre comme ne permettant au juge d’instruction d’autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans les heures légales.
Afin de tenir compte de la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel et de la nécessité de ne pas porter une atteinte excessive aux principes de l’inviolabilité du domicile et de la vie privée, il a été décidé de poser une double restriction aux perquisitions domiciliaires nocturnes : elles ne seront possibles que pour les infractions terroristes et lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
3.2 Perquisitions nocturnes dans des locaux d’habitation en matière d’instruction
L’extension du champ des perquisitions domiciliaires nocturnes réalisées dans le cadre d’une information judiciaire pouvait s’inscrire dans les cadres juridiques suivants : aligner le régime avec celui applicable aux perquisitions diligentées en enquête de flagrance (article 706-89 du CPP prévoyant une autorisation du juge des libertés et de la détention) ou bien conserver le régime juridique actuel permettant au juge d’instruction d’ordonner seul la réalisation de perquisitions domiciliaires nocturnes dans des hypothèses déterminées, tout en ajoutant une quatrième hypothèse en matière d’infractions de nature terroriste visées à l’article 706-73 11° lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Cette seconde option a été retenue, compte tenu d’une part, de la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2004 qui a validé les dispositions de l’article 706-91 du code de procédure pénale autorisant le magistrat instructeur à recourir en cas d’urgence aux perquisitions domiciliaires nocturnes dans trois hypothèses déterminées et, d’autre part, de la volonté de conserver une souplesse pour le magistrat instructeur qui peut agir seul sans passer par l’autorisation d’un juge des libertés et de la détention .
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La création de nouvelles hypothèses permettant de recourir, en matière d’infractions terroristes, aux perquisitions domiciliaires nocturnes au sein de locaux d’habitation devrait permettre d’une part d’accroître l’efficacité des enquêtes pénales et, d’autre part, d’assurer la sécurité des concitoyens et des forces de l’ordre lors de la réalisation de ces opérations délicates.
L’élargissement des possibilités de procéder à des perquisitions de nuit n’aura pas d’impact sur les services judiciaires dans la mesure où elles seront effectuées à l’initiative des magistrats concernés et, concernant les demandes du parquet, sur autorisation du juge des libertés et de la détention de permanence.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, qui nécessitera des développements). Ces évolutions seront disponibles avant la fin de l’année 2016 et leur coût devrait être inférieur à 50 K€.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
1. Etat des lieux et diagnostic
Le recours aux « IMSI catcher » a été autorisé dans le cadre de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le régime juridique applicable étant défini aux articles L. 851-6 et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Les dispositions de cette loi sont particulièrement larges puisqu’elles permettent d’utiliser l’IMSI catcher dans toutes ses fonctionnalités (recueil de données de connexion, géolocalisation, interception de communication). Elles ont été validées par le Conseil d’Etat, réuni en Assemblée générale le 12 mars 2015 (n° 389.754) puis par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-713 du 23 juillet 2015.
L’IMSI catcher est une technique intervenant en complément des surveillances physiques ou pour préparer des investigations techniques. C’est un dispositif qui se comporte comme une antenne-relais téléphonique fictive dans une zone donnée. En faisant écran aux antennes-relais, il capte les données émises par les téléphones en activité dans la zone. Il s’agit des données techniques de connexion, comme les numéros de téléphone, les émetteurs et destinataires des appels.
Certains IMSI catcher sont également équipés de fonctionnalités leur permettant de procéder à la géolocalisation des terminaux de télécommunication et d’intercepter les communications. Ces deux dernières fonctionnalités ne sont pas nécessaires aux enquêtes judiciaires, le code de procédure pénale contenant déjà des dispositions spécifiques aux mesures de géolocalisation et à l’interception des correspondances.
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet d’identifier les moyens de communication de la personne et ses identifiants téléphoniques. Une fois cette identification opérée, le service de police judiciaire saisi pourra procéder aux réquisitions utiles permettant, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, d’obtenir l’historique des données de connexion, les données de géolocalisation en temps réel, ainsi que l’interception des communications.
Dans un contexte où les personnes mises en cause changent souvent de vecteurs de télécommunication, utilisent plusieurs téléphones acquis sous une fausse identité, il est nécessaire de recourir à cette technique pour identifier le numéro de téléphone qui devra être surveillé.
A l’heure actuelle et compte tenu de son utilité, il arrive que l’IMSI catcher soit mis en œuvre dans certaines procédures présentant une particulière gravité (terrorisme, criminalité organisée de haut niveau).
Néanmoins, en l’absence de dispositions autorisant spécifiquement l’IMSI catcher et compte tenu de la portée limitée que reconnaît désormais la jurisprudence de la Cour de cassation à l’article 81 du code de procédure pénale1, il apparaît qu’il faut consolider le socle juridique permettant l’usage de ces dispositifs indispensables à la conduite des enquêtes portant sur la criminalité organisée.
Dans ces conditions, l’utilisation de l’IMSI catcher est relatée de façon plus ou moins variable, certaines procédures occultant totalement son existence, d’autres évoquant de façon peu explicite des « investigations téléphoniques ».
Pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme et sécuriser les procédures d’un point de vue juridique, il est prévu d’introduire au sein du code de procédure pénale la possibilité pour les enquêteurs de recourir à un dispositif technique de proximité dit IMSI catcher, consistant à placer une fausse antenne relais à proximité de la personne dont on souhaite intercepter les échanges électroniques afin de capter les données transmises entre le périphérique électronique et la véritable antenne relais.
La mesure envisagée vise à créer, uniquement en matière de criminalité organisée et de terrorisme, c’est-à-dire pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, un régime juridique encadrant le recours, par le procureur de la République ou le magistrat instructeur, à l’utilisation de dispositifs techniques de proximité uniquement pour capter directement les données de connexion nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur.
Le dispositif retenu est distinct selon le cadre d’enquête :
- dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée d’un mois renouvelable une fois. En cas d’urgence, le procureur de la République pourra autoriser seul les enquêteurs à recourir à l’IMSI-catcher pour une durée de 24 heures puis devra saisir le juge des libertés et de la détention ;
- dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner le recours à l’IMSI-catcher pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois.
Le dispositif juridique précité n’inclut pas les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications lesquelles demeurent régies par les dispositions des articles 100 à 100-7 du CPP (juge d’instruction) et 706-95 du CPP (procureur de la République).
Le dispositif juridique précité n’inclut pas les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications lesquelles demeurent régies par les dispositions des articles 100 à 100-7 du CPP (juge d’instruction) et 706-95 du CPP (procureur de la République).
Il a été décidé de n’utiliser que la première possibilité permettant d’identifier les numéros de téléphone utilisés par des personnes soupçonnées d’être les auteurs d’infractions grâce au recoupement de données de connexion recueillies par le biais de l’utilisation de plusieurs IMSI-catcher placés en différents lieux.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La création d’un cadre juridique spécifique à l’utilisation du dispositif IMSI-catcher est de nature à sécuriser les procédures judiciaires et à garantir un usage qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Le champ d’application étant restreint aux enquêtes en matière de criminalité organisée, l’impact en terme de charge de travail pour les magistrats ayant à traiter ces procédures devrait être limité.
Le coût d’un IMSI-catcher est évalué, à l’unité, aux alentours de 100 000 euros. Le développement du recours à cette technique est donc susceptible d’avoir un impact sur les dépenses des services enquêteurs spécialisés mais la disposition du projet de loi qui clarifie le cadre d’utilisation n’emporte pas en elle-même une dépense supplémentaire.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, qui nécessitera des développements. Ces évolutions seront disponibles avant la fin de l’année 2016 et leur coût devrait être inférieur à 50 K€.
Ces dispositions nécessitent un décret simple déterminant la liste des services, unités ou organismes placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur pouvant procéder à l’utilisation du dispositif IMSI catcher.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur extension à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 3
SONORISATION ET CAPTATION DE DONNÉES
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 Recours aux sonorisations, fixation d’images et captation de données informatiques
Les sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules sont autorisées par les articles 706-96 à 706-102 du CPP qui permettent de surveiller, par un dispositif technique spécifique, les auteurs potentiels des infractions dont la preuve est recherchée, alors qu'ils se trouvent dans des lieux ou véhicules privés. Ces techniques d'enquête ne sont applicables qu'en cas d'ouverture d'une information judiciaire.
Il en est de même s'agissant de la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 à 706-102-9 du CPP et réservée aux seules enquêtes faisant l'objet d'une information judiciaire.
1.2 Interception de courriels déjà archivés
Les dispositions de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisent la captation des données informatiques « telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».
En l’état, ces dispositions ne permettent pas de capter à distance les données stockées dans un ordinateur ou sur un serveur de type « cloud ».
Afin de pallier ces difficultés, les magistrats instructeurs autorisaient notamment la saisie des messages électroniques conservés dans un système de traitement automatisé de données au visa des articles 100 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux interceptions de correspondance.
Par un arrêt en date du 8 juillet 2015, la Cour de cassation est néanmoins clairement venue énoncer que si les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale permettaient d’enregistrer les courriels envoyés et reçus postérieurement à l’autorisation d’interception, ils ne pouvaient en revanche pas servir à consulter ceux conservés au sein d’une boite de courrier électronique (Crim., 8 juillet 2015, n° 14-88457).
Les services répressifs sont par conséquent contraints, pour prendre connaissance de cette correspondance électronique mais également pour accéder à tout autre élément stocké dans un système de traitement automatisé de données, de procéder à une perquisition en respectant la procédure applicable à cette mesure, à savoir la présence du mis en cause ou de deux témoins.
Les règles relatives à la perquisition s’avèrent particulièrement inadaptées aux contraintes des enquêtes diligentées pour des faits de criminalité organisée ou de terrorisme dès lors qu’elles ne permettent pas de procéder à l’interception des données conservées à l’insu du propriétaire.
2.1 Recours aux sonorisations, fixation d’images et captation de données informatiques
Dans le cadre des enquêtes diligentées par le parquet, l’impossibilité actuelle de recourir, pour un temps limité, aux techniques d’enquête que sont les sonorisations, la fixation d’images et la captation de données informatiques, soulève des difficultés lorsque leur mise en œuvre présente un caractère d’urgence, parfois difficilement compatible avec l’ouverture d’une information judiciaire et, plus généralement, ne permet pas d’ouvrir l’information judiciaire dans des conditions pleinement satisfaisantes, faute d’avoir pu procéder aux premières vérifications nécessaires et préciser les contours de l’affaire.
La présente mesure vise à permettre la mise en œuvre immédiate et en urgence de ces techniques d’enquête lorsque les faits l’imposent, qui seront poursuivies le cas échéant dans le cadre d’une information judiciaire et, de manière plus générale, de permettre une ouverture d’information judiciaire dans de meilleures conditions après réalisation des premiers actes d’enquêtes visant à vérifier a minima la réalité et les contours de l’affaire.
Il est donc proposé dans cette perspective d’élargir au procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois et pour les seules infractions entrant dans le champ des articles 706-73 et 706-73-1, la possibilité de recourir à ces techniques d'enquête sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
Parallèlement, il est proposé d’encadrer la durée pendant laquelle une telle mesure peut être autorisée dans le cadre d’une information judiciaire, en prévoyant une durée globale maximale de deux ans, par périodes de quatre mois renouvelables.
2.2 Interception de courriels déjà archivés
Dans le cadre de procédures relatives à la criminalité organisée ou au terrorisme, il est proposé de modifier l’article 706-102-1 du code de procédure pénale afin que la captation des données informatiques ne soit plus réservée à celles qui s’affichent sur un écran ou sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels, mais également étendue à celles qui sont stockées dans un système informatique. Cette possibilité est par ailleurs déjà prévue dans le cadre des activités de renseignement par l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
3.1 Recours aux sonorisations, fixation d’images et captation de données informatiques
3.1.1 Option écartée
N’a pas été retenue l’option consistant à ouvrir au procureur de la République la faculté d’autoriser lui-même, sans recourir au juge des libertés et de la détention, les enquêteurs à procéder dans le cadre de leurs investigations à des sonorisations, fixation d’images et captation de données informatiques, dans la mesure où il s’agit d’une atteinte significative au principe du respect de la vie privée justifiant le contrôle de cette mesure par le juge des libertés et de la détention.
3.1.2 Option retenue
L’autorisation du juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, est requise pour pouvoir procéder à des sonorisations, fixation d’images et captation de données informatiques.
L’intervention de ce magistrat permet de garantir que l’atteinte portée aux libertés individuelles est justifiée par les nécessités de l’enquête.
La durée pour laquelle peuvent être autorisées ces techniques d’enquêtes est différenciée selon qu’elles interviennent dans le cadre de l’enquête préliminaire ou dans le cadre d’une information judiciaire : dans le cadre d’une enquête parquet, cette durée est limitée à un mois renouvelable une fois, tandis qu’elle est de quatre mois renouvelables dans la limite de deux ans dans le cadre d’une information judiciaire. Le choix a été fait d’harmoniser ce régime pour l’ensemble de ces techniques d’enquête, dans la mesure où elles portent une atteinte de même nature aux libertés individuelles.
3.2 Interception de courriels déjà archivés
3.2.1 Option écartée
La première option qui consistait à prévoir la faculté d’intercepter les données informatiques conservées dans un système information uniquement dans le cadre d’une information judiciaire n’a pas été retenue.
3.2.2 Option retenue
Afin de renforcer l’efficacité de l’ensemble des enquêtes, la possibilité d’accéder aux données informatiques stockées a été ouverte au magistrat instructeur ainsi qu’au procureur de la République, sur autorisation du juge de la liberté et de la détention.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces modifications législatives, qui accroissent les pouvoirs d’enquête sous le contrôle du juge, devraient permettre de renforcer l’efficacité des investigations judiciaires.
Si la mise en œuvre de ces techniques d’enquête nécessite l’intervention de l’autorité judiciaire, elles devraient représenter un volume restreint d’affaires ne modifiant pas de manière significative la charge de travail des services judiciaires.
S'agissant d'une nouvelle prestation non tarifée (interception de données informatiques stockées), des répercussions en matière de frais de justice sont à envisager mais il est difficile en l’état actuel de les chiffrer précisément.
Jusqu’à présent les dispositions légales existantes sont peu utilisées, notamment en raison de l’absence de prestataires offrant cette technique.
L’extension aux données stockées pourrait susciter un regain d’intérêt pour cette disposition et un repositionnement de certains prestataires. Le coût journalier de ce type de prestation sera certainement très supérieur au coût des prestations actuelles relatives aux interceptions judiciaires (triple ou quadruple).
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, qui nécessitera des développements. Ces évolutions seront disponibles avant la fin du premier trimestre 2016 et leur coût devrait être inférieur à 50 K€.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 4
COMPÉTENCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DE PARIS POUR LES CONDAMNÉS TERRORISTES JUGÉS PAR PARIS
1. Etat des lieux et diagnostic
La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et comportant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a inséré dans le code de procédure pénale l’article 706-22-1 afin de centraliser auprès des juridictions de l'application des peines du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Cette mesure est venue compléter l'organisation judiciaire française en matière de lutte contre le terrorisme fondée sur la compétence nationale des magistrats parisiens en matière de poursuite, d'instruction et de jugement.
En matière de poursuites, d'instruction et de jugement, l'article 706-17 du code de procédure pénale a prévu une compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées.
Le législateur a en revanche écarté une telle option au stade de l’application des peines, considérant qu’une fois la condamnation prononcée, il ne pouvait plus y avoir de débat sur la qualification terroriste des faits en cause et qu’il était dès lors logique de prévoir une compétence exclusive en matière d'application des peines.
Ainsi, l'article 706-22-1 du code de procédure pénale prévoit une compétence exclusive du juge de l'application des peines de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et enfin, en appel, de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour des faits de terrorisme (donc entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale), quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est cependant venue élargir dans des proportions significatives le champ des infractions qualifiées de terroriste.
En effet, la loi précitée a sorti du champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes pour les introduire dans le code pénal dans un nouvel article 421-2-5. Ces infractions sont donc désormais considérées comme des actes de terrorisme au visa de l’article 706-16 du code de procédure pénale, entrant par voie de conséquence dans le champ de compétence des juridictions parisiennes au titre de l’article 706-17 du code de procédure pénale.
Si sous l’empire de l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, les délits de provocation à la commission d’actes de terrorisme et d’apologie de tels actes ont été sanctionnés à 14 reprises entre 1994 et 2014, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 13 novembre 2014 et des multiples faits d’apologie et de provocation au terrorisme commis dans le prolongement des attentats de Paris des 7, 8 et 9 janvier 2015, de nombreuses poursuites ont été engagées au visa des nouvelles dispositions de l’article 421-2-5 du code pénal.
185 affaires concernant 201 personnes ont été recensées, des peines d’emprisonnement ferme ayant été prononcées à l’encontre de 23 auteurs déclarés coupables par les juridictions de tels faits.
En application des dispositions de l’article 706-17 prévoyant une compétence concurrente au stade de la poursuite et du jugement, ces infractions ont été très largement poursuivies et jugées par des juridictions au regard des critères habituels de compétence prévus par le code de procédure pénale. La section antiterroriste du parquet de Paris n’a retenu sa compétence en application de l’article 706-16 du code de procédure pénale que dans les hypothèses de faits d’apologie et de provocation s’inscrivant dans une démarche organisée et structurée, soit au principal à la suite de l’identification de ressortissants français sur des films de propagande diffusés par des organisations terroristes.
En revanche, la compétence exclusive des juridictions de l’application de Paris conduit à ce que l’ensemble des personnes condamnées pour ces faits soient suivies à Paris. Cela implique une charge très importante pour les juridictions de l'application des peines de Paris.
En outre, le suivi des personnes condamnées pour des faits de cette nature n’apparaît pas devoir, de manière exclusive, ressortir de la compétence du seul juge d’application des peines spécialisé en matière de terrorisme. En effet, le profil général de ces condamnés milite pour un suivi au titre de l’application des peines au niveau local
Il apparaît donc nécessaire de ne prévoir, par une modification de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, une compétence exclusive des juridictions de l’application des peines parisiennes en matière de terrorisme que lorsque l’affaire a été poursuivie et jugée par le Procureur de la République et les juridictions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 706-17 du même code.
Le projet de loi vise à supprimer la compétence exclusive des juridictions de l’application des peines du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris pour les infractions terroristes qui ont été poursuivies et jugées par une juridiction en application des règles de compétence de droit commun.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Dans la mesure où la disposition n’accroît pas le nombre d’affaires et eu égard au nombre limité d’affaires concernées, l’impact des mesures envisagées est neutre pour les services judiciaires.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 5
TÉMOIGNAGE À HUIS CLOS
1. Etat des lieux et diagnostic
Devant les juridictions françaises, rien n’est prévu pour protéger le témoin lors du procès et le huis clos ne peut être ordonné pour ce motif alors qu’il pourrait se révéler particulièrement nécessaire lors des procès pour crime contre l’humanité, délits de guerre ainsi que pour les infractions relevant du régime de la criminalité et la délinquance organisée.
En l’état du droit positif, les articles 306 et 400 du code de procédure pénale ne prévoient la possibilité de recourir au huis clos que dans des hypothèses limitativement énumérées liées à des considérations étrangères à la sécurité des témoins.
Lorsqu’il s’agit de juger un crime, le huis clos peut être ordonné dans les cas où la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Il est de droit lorsqu’en cas de poursuites pour des faits de viol, ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles la victime partie civile le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ne s’y oppose pas.
Lorsqu’il s’agit de juger un délit, le huis clos peut être ordonné dans les cas où la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.
La Cour pénale internationale dispose quant à elle d’une telle possibilité (article 64 du statut de Rome). Le huis clos est alors utilisé afin de recueillir des témoignages dans des conditions garantissant la protection des témoins.
Pour les infractions relevant de la compétence du pôle crime contre l’humanité de Paris, ainsi que les crimes et délits relevant de la criminalité et la délinquance organisées, il est proposé de permettre à la juridiction de jugement d’ordonner le huis clos le temps de l’audition d’un témoin lorsqu’il existe des risques de représailles à son encontre ou à celle de sa famille ou de ses proches.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces modifications législatives devraient permettre d’encourager les témoignages et de renforcer ainsi l’efficacité de la procédure pénale.
Elles ne devraient pas avoir de conséquence significative sur les services judiciaires.
Des développements informatiques de Cassiopée seront nécessaires pour un coût qui devrait être limité. Ces évolutions pourront être disponibles au premier semestre 2017.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 6
PROTECTION DES TÉMOINS
1. Etat des lieux et diagnostic
Devant les juridictions françaises, la protection des témoins est assuré à ce jour par les dispositions du titre vingt et unième intitulé « De la protection des témoins » inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (articles 706-57 à 706-63). En particulier, l’article 706-58 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de recueillir en procédure, un « témoignage sous X » pour les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque l’audition de la personne est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches.
Cependant, la force probante attachée aux témoignages recueillis selon la procédure prévue par l’article 706-58 du code de procédure pénale peut être plus facilement remise en cause. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ces témoignages (article 706-62 du code de procédure pénale).
En outre, la protection du témoin ne peut pas toujours être assurée de manière satisfaisante. L’article 706-60 du code de procédure pénale exclu la possibilité de recourir au témoignage sous X si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de ce dernier est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
1.2 Amélioration de la protection des témoins
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2011 relative à la sécurité quotidienne a inséré, dans la partie législative du code de procédure pénale, un titre vingt et unième relatif à la protection des témoins. Les dispositions de ce titre permettent notamment aux personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction de pouvoir témoigner sans que leur identité apparaisse dans le dossier de la procédure, lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, celle des membres de leur famille ou de leurs proches. Il s’agit d’une protection ponctuelle applicable uniquement à la procédure concernée.
Le recours au témoignage anonyme démontre un besoin de protection des témoins dont les auditions sont souvent déterminantes pour la résolution des enquêtes pénales. Cette protection doit être renforcée dans les procédures de crime contre l’humanité, de crime et délit de guerre et pour celles liées à la criminalité et délinquance organisées (y compris les infractions de terrorisme), particulièrement susceptibles d’entraîner des mesures de représailles contre les témoins.
Surtout, le code de procédure pénale prévoit déjà des mesures de protection et de réinsertion des personnes qui ont tenté de commettre une infraction ou participé à sa commission, lorsque leur témoignage a permis, soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction ou d’éviter la production d’un dommage ou d’identifier les coauteurs ou complices. Il apparaît par conséquent souhaitable d’accorder au témoin une protection au moins équivalente à celle prévue pour les repentis.
Il s’agit de compléter l’arsenal de mesures de protection déjà existant en offrant la possibilité de moduler l’intensité du degré de protection accordé à un témoin en fonction des circonstances, tant au stade de l’information judiciaire que du jugement, sans systématiquement recourir au témoignage sous X prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale, dont la force probante peut être plus aisément remise en cause et qui nécessite une procédure plus lourde.
Il est prévu que les témoins exposés à un risque de représailles soient publiquement identifiés sous un numéro, comme cela se fait devant la Cour pénale internationale. Ce nouveau dispositif, distinct de celui du témoignage sous X prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale, prévoit que l’identité du témoin apparaît dans la procédure et est donc connue des parties, mais qu’elle n’est pas rendue publique. Cette procédure, garantissant totalement l’exercice des droits de la défense, concerne tous les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour lesquels le témoignage sous X, plus attentatoire aux droits de la défense, est déjà autorisé. Le dispositif prévu, articulé autour de la notion de « témoin confidentiel » a pour corollaire l’interdiction de faire état de son identité à l’occasion de toute audience publique sous peine de poursuites pénales.
2.2 Amélioration de la protection des témoins
Le titre vingt et unième du code de procédure pénale est complété par un article 706-62-2 afin de prévoir des mesures de protection et de réinsertion des témoins dont on peut craindre qu’il existe un risque pour leur sécurité. Ce nouvel article précise qu’ils peuvent être ainsi autorisés à utiliser une identité d’emprunt et bénéficier de mesures de protection et de réinsertion définies par une commission nationale dont les modalités de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Il s’agit d’un dispositif pérenne destiné à assurer la protection du témoin pour l’avenir. Il est également applicable à sa famille et à ses proches. Ce dispositif de protection, qui s’inspire largement de celui en vigueur pour les repentis, est par ailleurs complété par la création d’un délit spécifique de révélation l’identité d’emprunt ou de tout élément permettant l’identification ou la localisation du témoin protégé.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les modifications législatives envisagées devraient permettre d’encourager les témoignages et de renforcer ainsi l’efficacité de la procédure pénale.
Le coût de ces mesures de protection des témoins est difficile à évaluer à ce stade en l’absence notamment de données sur le nombre de témoins susceptibles d’être protégés.
A titre de comparaison, un dispositif de financement a été mis en place pour la protection des repentis, qui est de même nature. La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a modifié l'article 706-161 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour l’AGRASC de contribuer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Une dotation de 450 K€ par an a été prévue à titre expérimental pour les années 2015 à 2017.
La désignation d’un témoin sous un numéro nécessitera par ailleurs une évolution importante de Cassiopée, qui ne pourra être disponible qu’au cours du 1er semestre 2017. Son coût est estimé à environ 170 K€.
Les dispositions relatives à la protection et à la réinsertion des témoins prévues par le nouvel article 706-62-2 du code de procédure pénale nécessitent un décret en Conseil d’Etat s’agissant de la création de la commission nationale chargée de définir les mesures de protection dont peuvent bénéficier ces témoins.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS AMELIORANT LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIERE D’ARMES
1. Etat des lieux et diagnostic
Actuellement, une condamnation judiciaire pour une des infractions, limitativement énumérées par la loi n’emporte pas de conséquence directe et automatique sur la capacité des personnes définitivement condamnées à acquérir et détenir une arme.
Par ailleurs, les préfets peuvent prononcer des mesures d’interdiction d’une arme dans le cadre d’une procédure de remise, prévue par les articles L. 312-7 et suivants du CSI (si l’état de santé ou le comportement présente un danger grave pour l’intéressé ou pour autrui) ou celle d’un dessaisissement prévue par les articles L. 312-11 et suivants du CSI (pour motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes).
Le dispositif de contrôle de l’accès aux armes, combinant la mesure administrative d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes avec l’inscription au fichier nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), n’est effectif que pour les personnes déjà détentrices d’arme et non celles candidates à une acquisition ou détention.
Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer le contrôle de l’accès aux armes et munitions, en procédant à plusieurs modifications de la législation existante.
Les modifications proposées dans le code de la sécurité intérieure visent notamment à durcir les conditions d’acquisition et de détention des armes.
Le 1° de l’article 7 du projet de loi pose une interdiction générale d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D aux personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations judiciaires énumérée par la loi. Parallèlement, ces personnes seront inscrites au FINIADA (a) du 5°.
Le 2° de cet article ouvre aux préfets une possibilité de prononcer une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à l’encontre des personnes faisant l’objet d’un signalement en raison d’un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. L’interdiction préfectorale pourra donc être prononcée préventivement, sans attendre que la personne concernée soit en possession d’une arme. En outre, ces personnes seront inscrites au FINIADA par le biais d’une extension des personnes recensées dans ce traitement, au titre de l’article L. 312-16 du CSI.
Enfin, le 3° et le 4° de l’article 7 visent à rendre cohérentes les dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention d’armes. Ainsi, la modification prévue au 4° vise à ne pas permettre l’acquisition et la détention de toutes les armes de catégorie C sur présentation du seul certificat médical, sauf exceptions définies par décret en Conseil d’Etat. Au contraire, la modification du 3° permet de ne pas systématiser la présentation d’une licence de tir pour les autorisations d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B lorsque l’acquisition est réalisée pour un motif autre que sportif.
Il apparaît nécessaire de légiférer sur ce sujet afin de renforcer le dispositif mis en œuvre par la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Cette réforme s’inscrit dans le cadre de l’article 5 de la directive n°91/477/CEE modifiée du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes précise que les Etats membres « ne permettent pas l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui […]- ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou la sécurité publique ; Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger. »
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Si elles ambitionnent de clarifier le dispositif actuel de contrôle de l’accès aux armes, les dispositions envisagées n’ont pas vocation à modifier d’une part les conséquences attachées à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes ni, d’autre part, les modalités de consultation du FINIADA par les armuriers, l’office national de la chasse et de la faune sauvage et des représentants de la Fédération nationale des chasseurs.
Il est précisé que les agents des services préfectoraux et les greffes des tribunaux judiciaires seront chargés de la mise en œuvre pratique des dispositions relatives au FINIADA, qui recense aujourd’hui plus de 5 000 personnes.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
La création d’un compteur au sein du code de la sécurité intérieure (CSI) est également prévue pour la Polynésie française (article L. 344-1 CSI), la Nouvelle-Calédonie (L. 345-1 CSI), les îles Wallis et Futuna (L. 346-1 CSI) et les TAAF (article L. 347-1 CSI).
Elles nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL.
ARTICLES 8 À 10
LÉGISLATION SUR LES ARMES
1. Etat des lieux et diagnostic
Actuellement, la législation pénale permet de recourir à des techniques spéciales d’enquête (écoutes téléphoniques en préliminaire, sonorisation etc…) ou de confier un dossier à une juridiction interrégionale spécialisée, dès lors que sont commises des infractions de détention, cession et acquisition d’armes de catégories A et B commises en bande organisée.
L’organisation des trafics d’armes, qui implique souvent peu de protagonistes et est de faible ampleur, rend difficile la caractérisation d’une bande organisée dès le début de l’enquête. Cette condition fait parfois obstacle à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête, affectant le déroulement et la réussite des investigations.
Autorisé dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants, le « coup d’achat », qui permet aux enquêteurs, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, d’acquérir des stupéfiants ou de mettre à disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique, financier, ainsi que des moyens de transport, de dépôt ou d’hébergement (article 706-32 du code de procédure pénale), n’est pas prévu pour les trafics d’armes dont la révélation de l’existence s’avère tout aussi délicate. Ces faits ne doivent en aucun cas constituer une incitation à la commission de l’infraction. Conformément à l’article 67 Bis-1 du code des douanes, les opérations de « coup d’achat » réalisées par les services douaniers sont également limitées à ce jour aux infractions douanières portant sur les produits stupéfiants, le tabac ou les contrefaçons.
L’article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure réprime de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’acquisition, la cession ou la détention sans autorisation d’armes de catégories A ou B. Outre que la peine encourue apparait relativement faible au regard de la gravité du trouble à l’ordre public que sont susceptibles de causer les trafics d’armes, lesquels apparaissent comme les corollaires d’activités criminelles, cette sanction apparait également insuffisante d’un point de vue procédural. En effet, la peine d’emprisonnement encourue ne permet pas de solliciter l’autorisation de réaliser une perquisition sans assentiment lors d’une enquête préliminaire ou de mettre en œuvre une mesure de géolocalisation, le seuil de 5 ans d’emprisonnement requis n’étant pas atteint. Cela limite donc considérablement les capacités d’action des services répressifs.
L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure punit de 5 ans d’emprisonnement le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, une ou plusieurs armes de catégorie A ou B et de 2 ans d’emprisonnement le port ou le transport d’une arme de catégorie C. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions, les peines d’emprisonnement étaient également portées à 10 ans d’emprisonnement lorsque l’auteur des faits avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. La suppression de cette circonstance aggravante apparait regrettable. Elle permettait en effet de réprimer sévèrement le port d’arme commis par une personne ayant déjà fait la preuve de sa dangerosité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un projet criminel attaché à ce port d’arme.
Elle était notamment fréquemment utilisée lorsque des personnes appartenant au grand banditisme étaient interpellées en possession d’une arme.
• Données sur les condamnations (infraction principale), source casier judiciaire national - données 2014 provisoires :
Entre 2010 et 2014, les condamnations en infraction principale2 les plus nombreuses concernent les infractions d’acquisition, détention ou cession d’armes de catégorie A ou B, aggravées ou non, qui se situent, avec une certaine stabilité dans le temps, aux environs de 1000 par an, passant de 1103 en 2010 à 831 en 2014. Les condamnations pour les mêmes infractions principales à la législation sur les armes, mais liées au terrorisme, sont peu nombreuses, avec un maximum de 6 atteint en 2011 et 3 en 2014.
Viennent ensuite les condamnations en infraction principale pour port et transport d’armes de catégorie A ou B, aggravées ou non, oscillant entre environ 320 et 350 par an, avec une relative stabilité dans le temps puisque leur nombre s’élève à 348 en 2010 et 347 en 2014. Là aussi, les condamnations pour les mêmes infractions principales liées au terrorisme sont très peu nombreuses : aucune en 2010 et 2014 et 3 seulement en 2012 et 2013.
1/ Les infractions d’acquisition/cession/détention d’armes de catégories A et B et d’explosifs
On observe que les infractions d’acquisition, détention ou cession d’armes de catégorie A ou B et d’explosifs sans circonstance aggravante représentent entre 800 et 1000 condamnations en infraction principale par an, passant de 1005 en 2010 à 726 en 2014. Parmi elles, ce sont les infractions de détention illicite qui dominent largement (87%), avec 635 condamnations en infraction principale en 2014 ; viennent ensuite les acquisitions illégales, avec 82 condamnations.
L’aggravation de ces infractions réside dans les antécédents judiciaires de l’auteur (lorsqu’il a déjà été condamné à une peine privative de liberté) ou dans la commission des faits en bande organisée : si les condamnations pour ce dernier cas sont infimes (seulement 1 en 2014 et 5 en 2011), ce sont les condamnations en infraction principale aggravée par le fait que l’auteur a déjà été condamné à une peine privative de liberté qui dominent, avec une centaine par an et une relative stabilité dans le temps entre 2010 et 2014. Parmi elles, on retrouve toujours très majoritairement (80% en 2014) les condamnations pour détention illicite : en 2014, on compte ainsi 83 condamnations pour infraction principale de détention illicite d’arme de catégorie A ou B par personne déjà condamnée, sur un total de 104 condamnations.
Condamnations (infraction principale) |
Groupe |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| ||
CSI L.317-4 acquisition cession détention armes cat A et B |
Délit |
Infraction non aggravée |
1 005 |
871 |
911 |
870 |
726 |
| |
Délit |
Commise par personne déjà condamnée à une peine privative de liberté |
98 |
106 |
120 |
108 |
104 |
| ||
Délit |
Commise en bande organisée |
0 |
1 |
5 |
2 |
1 |
| ||
Total |
1 103 |
978 |
1 036 |
980 |
831 |
| |||
|
|||||||||
Condamnations (infraction principale) |
Groupe |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |||
CSI L.317-4 acquisition cession détention armes cat A et B Terrorisme |
Délit |
Infraction non aggravée |
1 |
6 |
2 |
5 |
2 | ||
Crime |
Commise en bande organisée |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 | |||
Total |
1 |
6 |
2 |
5 |
3 | ||||
2/ Les infractions de port et transport d’armes de catégorie A ou B et d’explosifs
S’agissant ensuite des infractions de port et transport d’armes de catégorie A ou B et d’explosifs sans circonstance aggravante, les condamnations en infraction principale s’élèvent à 324 en 2014. Si les condamnations pour transport d’armes de catégorie A ou B sont stables entre 2010 et 2014, aux environs de 130, on observe une légère augmentation, de 13%, pour celles concernant les ports d’armes de ces catégories, légèrement plus nombreuses, qui passent de 175 en 2010 à 197 en 2014. La très grande majorité de ces condamnations de port d’armes concerne des armes de catégorie B, avec 170 condamnations en 2014. On retrouve une proportion similaire pour les transports d’armes de catégorie B.
L’aggravation de ces infractions réside dans le nombre de personnes commettant les faits, avec une aggravation lorsqu’ils sont commis par au moins deux personnes (une dizaine de condamnations en infraction principale par an entre 2010 et 2014), et, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 juin 2013, dans les antécédents judiciaires de l’auteur, lorsque celui-ci avait été condamné à une peine privative de liberté : les infractions aggravées par le fait que leur auteur ait déjà été condamné ont donné lieu à une trentaine de condamnations en infraction principale par an entre 2010 et 2013, et concernaient en majorité des ports d’armes. Il s’agit là aussi majoritairement de condamnations pour port d’armes de catégorie B.
Condamnations (infraction principale) |
Groupe |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
CSI L.317-8 1° port transport armes cat A et B |
Délit |
Port d'arme de catégorie A ou B |
175 |
160 |
170 |
160 |
197 |
Délit |
Transport d'arme de catégorie A ou B |
128 |
126 |
117 |
133 |
127 | |
Délit |
Port d'arme de catégorie A ou B par au moins deux personnes |
4 |
3 |
0 |
3 |
1 | |
Délit |
Transport d'arme de catégorie A ou B par au moins deux personnes |
8 |
10 |
4 |
5 |
11 | |
Délit |
Port d'arme de catégorie A ou B : personne déjà condamnée |
24 |
19 |
16 |
17 |
6 | |
Délit |
Transport d'arme de catégorie A ou B : personne déjà condamnée |
9 |
7 |
11 |
6 |
5 | |
Total |
348 |
325 |
318 |
324 |
347 |
Condamnations (infraction principale) |
Groupe |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
CSI L.317-8 1° port transport armes cat A et B Terrorisme |
Délit |
Port d'arme de catégorie A ou B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Délit |
Transport d'arme de catégorie A ou B |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 | |
Crime |
Port d'arme de catégorie A ou B par au moins deux personnes |
0 |
0 |
0 |
|||
Crime |
Transport d'arme de catégorie A ou B par au moins deux personnes |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 | |
Total |
0 |
1 |
3 |
3 |
0 |
• Données sur les peines (infraction unique), source casier judiciaire national données 2014 provisoires
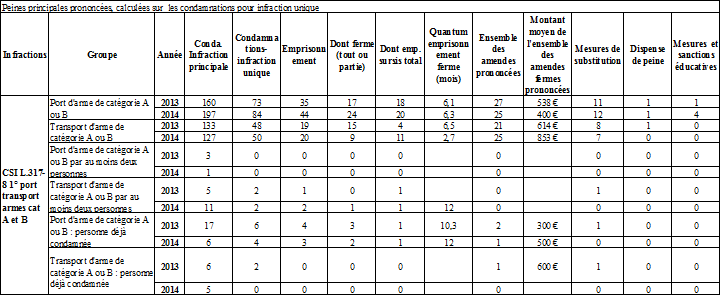
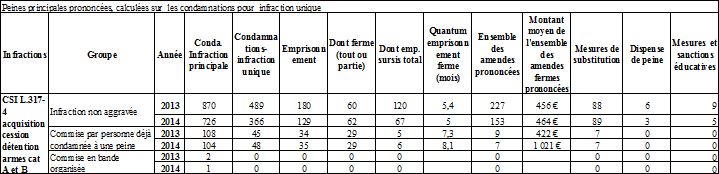
• Sur la circonstance aggravante de commission des faits par une personne déjà condamnée à une peine privative de plus d’un an pour une infraction entrant dans le champ de l’article 706-73 du CPP (source casier judiciaire national données 2014 provisoires) :
Chaque année entre 20 et 25 personnes sont condamnées pour port ou transport d’armes de catégorie A et B alors qu’elles ont été condamnées dans les cinq dernières années à une peine privative de liberté d’un an ou plus pour une infraction entrant dans le champ de l’article 706-73 du CPP.
2.1 Il est proposé d’étendre à l’ensemble des trafics d’armes de catégorie A et B le recours au régime dérogatoire prévu en matière de criminalité organisée sans qu’il soit nécessaire de caractériser la bande organisée.
Cette extension concerne à la fois les faits de détention, cession et acquisition d’armes de catégorie A et B mais également les faits de port et de transport de celles-ci. Ces infractions figurent par conséquent dans un nouveau 12° Bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale qui détermine le champ des infractions pour lesquelles s’applique le régime dérogatoire de la criminalité et la délinquance organisée.
Face à la difficulté de déceler les trafics d’armes, il apparaît nécessaire de favoriser le travail d’initiative de la part des services enquêteurs et de permettre le recours au « coup d’achat » pour les infractions à la législation sur les armes relevant du régime de la criminalité et la délinquance organisées de l’article 706-73 du code de procédure pénale. Il est proposé de compléter le régime procédural applicable à la délinquance et la criminalité organisée par un nouvel article 706-106-1 qui autorise, sous certaines conditions, les enquêteurs à procéder à « un coup d’achat » pour les trafics d’armes les plus graves relevant de ce régime particulier.
Il est envisagé de porter la peine d’emprisonnement encourue à 5 ans afin d’assurer d’une part, une meilleure répression des trafics d’armes de catégories A ou B et d’autre part, de ne pas limiter les moyens procéduraux dont disposent les enquêteurs et les magistrats.
Le rétablissement d’une telle circonstance aggravante pourrait être très utile pour réprimer le port d’arme constaté chez des personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité et la délinquance organisées (par exemple des actes de terrorisme). Il est proposé de la rétablir, en la limitant cependant, d’une part aux seuls faits de port ou transport d’armes les plus dangereuses, et d’autre part pour les personnes déjà condamnées pour des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Il est proposé d’harmoniser le niveau des montants des amendes en fonction des peines d’emprisonnement à l’article L. 317-7, relatif aux sanctions pénales en matière de détention d’un dépôt d’armes ou de munitions.
Le projet de loi conduit également à modifier le code de la défense afin de sanctionner pénalement le transfert d’armes sans autorisation. En effet, l’article L. 2339-10 ne sanctionne actuellement que l’importation sans autorisation.
2.2 Pour clarifier la nature des infractions susceptibles de donner lieu à inscription au FNAEG, le présent projet de loi reprend les termes du projet de loi n°1378 ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité intérieure, qui comportait une nouvelle rédaction de l’article 706-55 5° et tenait compte de l’ensemble des réformes législatives précitées a été déposé le 18 septembre 2013 à l’Assemblée Nationale.
2.3 Enfin, de manière complémentaire et en vue de donner des moyens d'action homogènes à l'action de l’ensemble des services de l'Etat, dans le contexte actuel de menace terroriste et de développement de la délinquance organisée où l'usage d'armes à feu est récurrent, il est envisagé de renforcer les moyens d’action des agents des douanes en élargissant le champ d’application des articles 67 bis (infiltrations) et 67 bis-1 (coups d’achat) du code des douanes aux armes à feu, à leurs éléments, aux munitions et aux produits explosifs, selon les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues en droit commun.
En effet, la douane, et notamment la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est un acteur important de la lutte contre le trafic d'armes.
Ainsi, elle a procédé en 2014 à la saisie de 830 armes à feu et 67 848 munitions. En 2015, les résultats de la douane seront sensiblement supérieurs. Parmi ces armes à feu figurent des fusils d'assaut de type kalachnikov, dont celui en possession de M. Nemouche lors de son arrestation par la brigade des douanes de Marseille en 2014.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces modifications législatives, qui accroissent les quanta de peines encourus et les pouvoirs d’enquête, devraient permettre de renforcer l’efficacité des investigations judiciaires et d’améliorer ainsi la lutte contre les trafics d’armes.
Ces dispositions ne devraient pas avoir directement de conséquence sur les emplois des services judiciaires. Elles devraient en revanche en avoir sur les dépenses de fonctionnement et les frais de justice.
L’ouverture à l’ensemble des trafics d’armes de catégorie A et B du recours au régime dérogatoire prévu en matière de criminalité organisée (sans qu’il soit nécessaire de caractériser la bande organisée) ainsi que la possibilité offerte aux enquêteurs, sur autorisation, de recourir aux coups d’achats, entraînera nécessairement une augmentation sensible du nombre de saisie d’armes.
Or, la destruction de ces armes, une fois confisquées, générera un coût supplémentaire :
• en premier lieu, en terme de fonctionnement courant pour assurer le transport, par le biais d’un transporteur sécurisé privé, jusqu’à un centre de déminage désigné par la Direction de la sécurité civile (une récente modification de l’article L.612.2 du code de la sécurité intérieure permet le recours aux transporteurs de fonds pour le transport des scellés sensibles). Un chiffrage du recours au secteur privé a permis d’évaluer à 0,32M€ sur crédits de fonctionnement la dépense pour 187 missions, soit un coût moyen de 1676€ par mission. Le renforcement de la réglementation et de la saisie des armes aura donc un impact certain.
• en second lieu, en termes de frais de justice, pour assurer la destruction elle-même. Un chiffrage n’est cependant pas envisageable, compte tenu de l’inconnue que constitue le pourcentage d’augmentation de saisie d’armes et de l’absence de données fiables sur le coût annuel en fonctionnement courant et en frais de justice lié à cette activité de transport et de destruction d’armes.
Enfin, ces dispositions impactent le système de référence justice et s’intégreront automatiquement dans les applications CASSIOPEE et MINOS. La mise en œuvre de ces dispositions sera disponible en mars 2016.
4.1 Les dispositions de l’article 8 du présent projet de loi ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
4.2 Les dispositions de l’article 9 ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Pour le I, la création d’un compteur au sein du code de la sécurité intérieure (CSI) est également prévue pour la Polynésie française (article L. 344-1 CSI), la Nouvelle-Calédonie (L. 345-1 CSI), les îles Wallis et Futuna (L. 346-1 CSI) et les TAAF (article L. 347-1 CSI).
Pour le II, il est nécessaire de codifier l’applicabilité outre-mer de la modification de l’article L. 2339-10 du code de la défense en y introduisant le texte compteur dans les articles L. 2441-1 (WF), L. 2451-1 (PF), L. 2461-1 (NC), L. 2471-1 (TAAF).
Ces ajouts sont également prévus au titre IV du présent projet de loi.
4.3 En ce qui concerne l’article 10 du présent projet de loi, les articles 67 bis et 67 bis 1 du code des douanes articles ont, dans leur dernière version issue de la loi 2014-315 du 21 mars 2014, été rendus applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. Il convient donc d’y étendre également la rédaction issue des modifications apportées par le présent projet de loi. Cette extension est réalisée via l’article 34, qui rend la présente loi applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 La cybercriminalité présente des particularités nécessitant une adaptation des règles de compétence afin de disposer d’un critère certain qui soit de nature à sécuriser les procédures d’un point de vue juridique notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée et contre le terrorisme.
En premier lieu, la détermination du lieu de commission de l’infraction et la localisation de l’auteur sont délicates et l’infraction est fréquemment commise depuis l’étranger.
En second lieu, les victimes ne déposent pas systématiquement une plainte, or celle-ci est nécessaire au regard des dispositions de l’article 113-8 du code pénal pour pouvoir poursuivre les infractions commises hors du territoire de la République.
A cet égard, le « rapport Robert » sur la cybercriminalité3 souligne qu’en l’état du droit positif, sauf exception tenant à la nature de la cyber-infraction, il est peu aisé de déterminer son lieu de commission, compte-tenu des difficultés tenant à l’identification de la personne ou de la société en cause, notamment lorsque l’auteur utilise des ordinateurs « rebonds » (VPN ou proxy) donnant, dans un premier temps, une fausse indication quant à l’adresse IP de l’ordinateur responsable de l’attaque. Quant à la localisation du serveur informatique utilisé par l’auteur, il est difficile dans les premiers temps d’une enquête de déterminer, avec exactitude, sa localisation, d’autant plus qu’elle s’avère souvent évolutive. En outre, il n’est pas toujours possible de trouver un élément constitutif commis en France pour fonder la compétence de la loi nationale.
Dès lors, les praticiens se heurtent à des difficultés d’interprétation et leurs interrogations sont nombreuses. Même si la jurisprudence adopte, généralement, une conception extensive, en retenant ordinairement la compétence des juridictions françaises dès lors que les contenus illicites diffusés via Internet sont accessibles en France, des doutes subsistent encore pour d’autres infractions, notamment la contrefaçon.
C’est pourquoi le « rapport Robert » estime opportun de lever toute équivoque en préconisant un nouveau critère de compétence prévoyant que toute infraction commise par le biais d’un réseau de communication électronique, de nature criminelle ou de nature correctionnelle mais punissable d’un emprisonnement, lorsqu’elle est tentée ou commise au préjudice d’une personne, physique ou morale, de nationalité française au moment de sa commission, est réputée avoir été commise en France (recommandation n°30).
Par ailleurs, le « rapport Robert » rappelle, qu’en l’état du droit positif, dans la grande majorité des cas, le parquet est saisi d’une cyber-infraction soit par plainte, soit par dénonciation (par exemple, d’un professionnel), sans que l’on connaisse ordinairement l’identité de l’auteur supposé et, a fortiori, son lieu de résidence.
Dès lors, en droit et par référence aux dispositions de l’article 43 du code de procédure pénale, seul le critère du lieu de commission de l’infraction peut fonder la compétence judiciaire.
Or, si les infractions dites de presse peuvent être souvent considérées comme étant commises sur l’ensemble du territoire (lieu de diffusion d’internet), si, selon la nature de certaines infractions, une partie des éléments constitutifs sont commis dans un lieu donné (par exemple au siège de l’entreprise victime, ou le lieu de livraison en matière de vente à distance), si la compétence spéciale reconnue, pour certaines infractions, à la juridiction parisienne ou aux juridictions inter-régionales spécialisées est aussi attributive de compétence, le critère de compétence de droit commun lié au lieu de commission peut s’avérer impuissant à saisir la cyber-infraction.
Pour ces motifs le « rapport Robert » préconise, là encore, de tenir compte de la spécificité de la cybercriminalité, en créant un nouveau critère de compétence territoriale relatif à la victime, de nature à renforcer la sécurité des procédures et à faciliter le travail des services d’enquête et des parquets (recommandation n°31).
Enfin, s’agissant des moyens d’investigations, si le droit actuel permet la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête en matière d’infractions aux systèmes automatisés de données commises en bande organisée, et la compétence des JIRS pour traiter les affaires d’une grande complexité dans ce domaine, les textes souffrent d’un manque de lisibilité.
1.2 L’utilisation de ces techniques spéciales d’enquête n’est en revanche pas autorisée en matière d’évasion en bande organisée, ce qui peut se révéler préjudiciable dans la conduite des investigations, en privant les services répressifs de moyens juridiques décisifs pour prévenir la réalisation d’une évasion en bande organisée (ex sonorisation), ou pour y répondre lorsqu’un tel fait se produit (écoutes téléphoniques en urgence).
Ces deux sujets touchant au champ d’application des techniques spéciales d’enquête et de compétence des JIRS et impliquant la modification d’une seule et même disposition du code de procédure pénale, ont été regroupés au sein d’un article unique.
2.1 Le projet de loi propose de prévoir des règles de compétence particulières adaptées au domaine de la cybercriminalité comportant deux volets, conformément aux recommandations n°30 et 31 du rapport Robert.
En premier lieu, il est prévu d’étendre la compétence des juridictions françaises aux infractions commises par le biais d’un réseau de communication électronique, même hors du territoire de la République, à l’encontre d’une victime résidant en France et sans exiger la condition d’une plainte préalable de cette dernière posée par l’article 113-8 du code pénal. Cet objectif est atteint par la création d’un nouvel article 113-2-1 du code pénal prévoyant que toute infraction commise par le biais d’un réseau de communication électronique est réputée commise en France.
En second lieu, concernant les infractions commises sur le territoire national, le présent projet de loi propose la création d’un nouveau critère de compétence du procureur de la République, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel lié au domicile de la victime en complément des critères de compétence habituels existant. Ce second volet implique la modification de la rédaction des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
En troisième lieu, il est proposé d’abroger le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale permettant le recours aux techniques spéciales d’enquête en matière d’infraction aux systèmes de traitement automatisé de données commises en bande organisée et de réintroduire ces dispositions à l’article 706-73-1 du même code, afin de rationaliser la présentation des infractions permettant le recours à ces techniques et la saisine des juridictions interrégionales spécialisées pour les affaires de grande complexité dans ce domaine.
2.2 L’extension des techniques spéciales d’enquête au délit d’évasion commis en bande organisée, qui suppose la modification de la même disposition du code de procédure pénale, est insérée au même article du projet de loi.
Le présent article autorise en effet le recours aux techniques spéciales d’enquête prévues aux articles 706-81 à 706-102-9 du code de procédure pénale, à l’exception de la garde à vue de 96 heures. Il permet de recourir pour ces deux infractions aux techniques d’enquête suivantes :
- infiltration (articles 706-81 et s.)
- perquisition de nuit (articles 706-89 et s.)
- écoutes téléphoniques en flagrance ou préliminaire (articles 706-95 et s.)
- sonorisations et fixations d’images (articles 706-96 et s.)
- captation de données informatiques (articles 706-102 et s.)
Une telle modification législative est conforme aux exigences constitutionnelles dans la mesure où le délit d’évasion en bande organisée répond parfaitement à la double condition de gravité et de complexité fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
3.1 Option écartée
L’option consistant à créer une ou plusieurs juridictions spécialisées en matière de cybercriminalité n’a pas été retenue dans la mesure où la compétence des JIRS pouvait utilement répondre aux affaires les plus complexes en cette matière.
3.2 Option retenue
Il a été décidé de maintenir le champ de compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière d’infractions aux systèmes de traitement automatisé de données commises en bande organisée et présentant un caractère de grande complexité.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La clarification envisagée des règles de compétence territoriale permettra de rationaliser le traitement de ce contentieux de masse, en évitant les dessaisissements successifs entre parquets liés à l’absence de critère clair de compétence, et de renforcer ainsi la sécurité des procédures et de faciliter le travail des services d’enquête et des parquets.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 12
TRAFIC DE BIENS CULTURELS ET FINANCEMENT DU TERRORISME
1. Etat des lieux et diagnostic
Daesh contrôle des territoires qui comprennent notamment l'ancienne Mésopotamie, berceau de civilisations antiques. Dans des régions riches d'un patrimoine préislamique inestimable pour l'humanité, Daesh ne se contente pas de détruire, pour des raisons idéologiques et religieuses et de manière médiatisée, des sites archéologiques, tels que Palmyre, ou des œuvres dans divers musées, comme celui de Mossoul, mais, selon des sources concordantes, organise aussi à son profit, le pillage et le trafic des objets archéologiques pour en tirer de substantiels revenus.
A cet égard, il apparaît de plus en plus certain que ces « antiquités du sang » servent à financer les activités de l'organisation islamiste et se retrouvent in fine, après des reventes successives et leur écoulement par des filières criminelles, sur les marchés de l'art en Europe.
En l’état actuel du droit, aucune infraction ne permet de réprimer ce trafic de manière satisfaisante.
Il est proposé de créer une infraction spécifique pour compléter l'arsenal juridique destiné à combattre le trafic de biens culturels, qui permet à Daesh de financer et poursuivre ses exactions. Dans un objectif de dissuasion et de répression, la nouvelle disposition sanctionne la participation intentionnelle à un trafic de biens culturels provenant de zones d'implantation d'organisations terroristes.
Cette nouvelle infraction est insérée dans la partie du code pénal relative au terrorisme afin d’indiquer clairement le lien existant entre ces activités criminelles. Certaines particularités procédurales attachées aux infractions terroristes sont toutefois exclues pour assurer le respect des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale (exclusion du régime dérogatoire de garde à vue et de celui de la prescription de l’action publique).
Par souci de cohérence des diverses dispositions relatives au trafic de biens culturels, la formulation proposée s'inspire très largement de la rédaction de l'article L. 111-9 du code du patrimoine, introduit par le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, tel qu'il vient d'être voté le 6 octobre dernier par l'Assemblée nationale en 1ère lecture.
Cette disposition ne vise en revanche ni les biens provenant de zones devenues ultérieurement des zones d’implantation d’organisations terroristes, ni les biens dont l’origine licite peut être justifiée.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La création d’une incrimination spécifique qui réprime le trafic des biens culturels en provenance de théâtres d’opérations de groupements terroristes devrait permettre ainsi de combattre l’une des sources de financement du terrorisme.
Les procédures judiciaires pour l’application de cette nouvelle incrimination ne devraient pas présenter une masse susceptible d’avoir de conséquence significative sur les services judiciaires.
Cette disposition impacte le système de référence justice et s’intégrera automatiquement dans l’application CASSIOPEE. La mise en œuvre de ces dispositions sera disponible en mars 2016.
Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
1. Etat des lieux et diagnostic
Les cartes pré-payées permettent la circulation discrète d’importantes sommes d’argent, avec la possibilité de faire passer le support (similaire à celui-ci d’une carte bancaire) de main en main, y compris par-delà les frontières.
La monnaie électronique sous forme de cartes prépayées est donc susceptible d’être utilisée massivement par les groupes criminels et terroristes car elle permet la circulation de fonds en marge du système bancaire ainsi que la possibilité d’effectuer des achats en toute discrétion (armes, billets d’avions etc).
Par ailleurs, les dispositions du code monétaire et financier relatives à la monnaie électronique ne comprennent pas de dispositions permettant de limiter la capacité de stockage maximale des cartes prépayées ni de règles imposant aux émetteurs de monnaie électronique de recueillir et de conserver les informations et données techniques en lien avec l’activation et l’utilisation de ces cartes.
Les mesures envisagées ont pour objet de limiter les possibilités d’utilisation des cartes prépayées à des fins illicites en limitant la capacité d’emport des cartes et en assurant la traçabilité des opérations.
Cette disposition constitue une accroche législative à des mesures de plafonnement de cartes et de traçabilité lors de l’utilisation de ces cartes par voie réglementaire.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Cette disposition a un impact neutre sur les finances publiques.
Elle devrait également permettre une lutte plus efficace contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en renforçant les informations accessibles notamment à TRACFIN sans pour autant fragiliser le secteur de la monnaie électronique.
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières a été consulté.
Les mesures envisagées nécessitent la prise d’un décret simple pour fixer la valeur monétaire maximale qu’il sera possible de stocker.
Elles ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Un compteur est également introduit pour l’application des dispositions du I au sein du code monétaire et financier.
Les lois statutaires régissant respectivement la Polynésie française (8° de l’article 7 de la LO 2004-192) et la Nouvelle-Calédonie (8° de l’article 6-2 de la LO 99-209) prévoient en outre que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme sont applicables de plein droit dans ces deux collectivités.
ARTICLE 14
APPEL A VIGILANCE DE TRACFIN
1. Etat des lieux et diagnostic
TRACFIN dispose d’informations sur certaines situations à risque qu’il souhaite pouvoir porter à la connaissance des professionnels assujettis afin que ceux-ci mettent en œuvre des mesures de vigilance adaptées à ces risques identifiés.
En pratique, TRACFIN a d’ores et déjà réalisé deux « appels à vigilance » publics à destination des professionnels assujettis (à l’occasion des événements du printemps arabe en 2011 et au regard de la situation politique et sécuritaire en Ukraine en 2014). Ces signalements avaient conduit les professionnels déclarants à adapter l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de toutes les opérations financières susceptibles de se rapporter à ces événements et avaient montré leur efficacité (hausse des déclarations de soupçon en lien avec ces problématiques).
Il paraît à présent nécessaire de donner un cadre légal à ces pratiques, ceci afin, notamment, d’y inclure des « appels à vigilance » concernant des personnes (physiques ou morales) et de protéger la confidentialité des informations transmises dans cette hypothèse.
Le projet de loi vise à permettre à TRACFIN de signaler aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations générales ou individuelles présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue de la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées à ces risques.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les professionnels seront tenus de garder confidentielles les identités des personnes physiques ou morales qui leur auront été communiquées dans ce cadre, comme ils le sont déjà s’agissant des personnes faisant l’objet d’un droit de communication de la part de TRACFIN.
Pour les professionnels assujettis (y compris les 18 caisses de crédit municipales) l’impact financier devrait être limité, les obligations de vigilance et de signalement à TRACFIN existant déjà.
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et le Conseil national d’évaluation des normes préalable ont été consultés, à titre facultatif.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application de cette disposition.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Les lois statutaires régissant respectivement la Polynésie française (8° de l’article 7 de la LO 2004-192) et la Nouvelle-Calédonie (8° de l’article 6-2 de la LO 99-209) prévoient en outre que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme sont applicables de plein droit dans ces deux collectivités.
ARTICLE 15
DROIT DE COMMUNICATION A L’EGARD DES ENTITES CHARGEES DE GERER LES SERVICES DE PAIEMENT
1. Etat des lieux et diagnostic
TRACFIN dispose d’un droit de communication à l’égard des établissements financiers, lesquels sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et L. 561-26 du code monétaire et financier notamment).
Un tel droit n’existe pas à l’égard des entités (sociétés, associations, groupements, etc.) chargées de gérer les systèmes de paiement (ex : le GIE CB, Visa), d’où l’impossibilité pour TRACFIN d’accéder rapidement aux informations utiles sur les opérations réalisées au moyen de cartes bancaires ou de cartes prépayées. Ceci est particulièrement préjudiciable dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, laquelle nécessite une grande réactivité.
L’accès aux informations détenues par ces entités permettrait à TRACFIN d’accéder directement, donc plus rapidement, au détail de toutes les opérations ou tentatives d’opérations financières réalisées au moyen de cartes, qu’il s’agisse de cartes adossées à un compte bancaire ou de cartes prépayées (ex : date, heure et lieu d’utilisation).
Par ailleurs, l’interdiction de divulguer les informations communiquées à TRACFIN s’applique également à ces groupements et réseaux.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les entités chargées de gérer les services de paiement devront être en mesure de fournir à TRACFIN les détails de toutes les opérations ou tentatives d’opérations financières réalisées au moyen de cartes, qu’il s’agisse de cartes adossées à un compte bancaire ou de cartes prépayées. Ceci ne devrait pas avoir d’impact financier significatif, dans la mesure où elles communiquent d’ores et déjà ces informations aux services de police judiciaire.
Cela permettra de renforcer significativement les moyens d’enquête de TRACFIN pour une lutte efficace contre le financement du terrorisme dans le souci du respect de la confidentialité des données.
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières a été consulté.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Les lois statutaires régissant respectivement la Polynésie française (8° de l’article 7 de la LO 2004-192) et la Nouvelle-Calédonie (8° de l’article 6-2 de la LO 99-209) prévoient en outre que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme sont applicables de plein droit dans ces deux collectivités.
ARTICLE 16
BLANCHIMENT DOUANIER
1. Etat des lieux et diagnostic
La Direction générale des douanes et droits indirects est chargée de s'assurer du respect de l'obligation qui s'impose à tout individu franchissant les frontières du territoire français avec une somme supérieure ou égale à 10 000 € de déclarer ce transfert physique. La constatation du non-respect de cette obligation (qualifiée de manquement à l'obligation déclarative) permet de mettre au jour, en temps réel, des activités occultes, mais constitue également un levier juridique majeur pour développer des enquêtes administratives ou judiciaires, notamment en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs, la Direction générale des douanes et droits est habilitée à constater le délit douanier de blanchiment prévu par l'article 415 du code des douanes, délit établi dès lors qu'une personne réalise ou tente une opération financière entre la France et l'étranger par voie d'importation, d'exportation, de transfert ou de compensation portant sur des fonds provenant, directement ou indirectement, d'un délit prévu par le code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et que cette personne a la connaissance coupable de l'origine illicite de ces fonds.
Le nombre de dossiers de blanchiment douanier notifiés par la douane en 2015 est en progression de plus de 300 % par rapport à celui de 2014 qui s’élevait à 18.
Les dispositions actuelles ne sont pas suffisantes pour permettre aux agents des douanes de constater efficacement un délit prévu par le code des douanes ou une infraction à la législation sur les stupéfiants et que cette personne a la connaissance de l'origine illicite de ces fonds, alors même que ce constat résulte d’éléments évidents indiquant que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine de ces fonds.
Or, dans le contexte actuel où prévaut la volonté de renforcer les moyens juridiques de lutte contre le terrorisme, il apparaît essentiel d’assouplir en matière douanière la charge de la preuve du délit de blanchiment, à l’instar du délit de blanchiment pénal (article 324-1-1 du code pénal).
Cette mesure rendra également plus facile la confiscation des sommes issues des trafics (stupéfiants, contrefaçons, tabacs...) qui concourent au financement du terrorisme.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Le projet de loi conduit à modifier la rédaction de l'article 415-1 du code des douanes en assouplissant la charge de la preuve sans modifier les éléments constitutifs de l'infraction douanière de blanchiment.
Il ne s'agit pas de créer une présomption de constitution du délit douanier de blanchiment mais uniquement d'un renversement de la charge de la preuve de l'infraction concernant l'origine illicite des fonds. Cette présomption simple pourra donc être combattue par la preuve contraire apportée par tout moyen.
L'adoption d’un tel dispositif facilitera l'action des agents des douanes en phase administrative et celle des agents du service national de douane judiciaire ainsi que des services de police judiciaire et ainsi, le traitement par l’ensemble de la chaîne pénale de contentieux portant, tant sur des faits de blanchiment de toute nature, y compris en matière terroriste, que sur des activités en lien direct ou indirect avec des réseaux terroristes (ex : trafics d’armes).
Le mode de fonctionnement de ce nouveau dispositif peut se résumer le la manière suivante :
Dès lors que le service d’enquête (douane administrative ou service de police judiciaire / service national de douane judiciaire) aura mis en lumière suffisamment d’éléments permettant de présumer que des sommes ont un lien direct ou indirect avec une infraction en matière de stupéfiants ou d’un délit douanier, l’infraction de délit douanier de blanchiment pourra être retenue, sous réserve que les autres éléments matériels du délit prévu à l’article 415 du code des douanes soient réunis (élément intentionnel et existence d’une opération financière avec l’étranger).
En pratique, trois hypothèses sont possibles :
1) les fonds ont une origine licite prouvée par la personne.
A titre d’exemple, l’enquête peut porter sur des faits de blanchiment de sommes issues d’activités liées à des opérations d’importation de marchandises contrefaisantes et la personne peut prouver que lesdites marchandises ne sont pas contrefaisantes (expertise) ;
2) la personne prouve que les fonds ont une origine illicite sans lien avec une infraction en matière de stupéfiants ou d’un délit douanier (ex : les fonds seraient le produit d’un vol ou d’une infraction en matière de travail illégal).
Dans cette hypothèse, le principe de présomption d’innocence est préservé dans la mesure où :
- la personne peut apporter la preuve de l’existence d’une infraction d’origine qu’elle n’a pas commise. En effet, l’infraction de blanchiment et l’infraction d’origine sont autonomes. La personne peut apporter la preuve de l'origine certes illicite au regard du droit commun des sommes mais sans implication de sa part (infraction d'origine commise par un tiers). Dans ces conditions, la personne ne participera pas à sa propre incrimination ;
- l'hypothèse où un service d'enquête arrive à la conclusion que les conditions matérielles, financières ou juridiques de réalisation de l'opération financière en cause ne peuvent que laisser penser à une origine illicite des sommes en lien avec une infraction en matière de stupéfiants ou d’un délit douanier puisse être combattue par le fait que les sommes seraient en réalité uniquement le produit d'une infraction de droit commun, est assez théorique.
1er cas d’espèce : absence de déclaration des sommes (100 000 €) lors du passage frontière constitutive d’un manquement à l’obligation déclarative (articles 464 et 465 du code des douanes) et sommes dissimulées dans des roues, avec conditionnement typique du trafic de stupéfiants, présence de plusieurs téléphones portables etc...
2ème cas d’espèce : constatation d’un manquement à l'obligation déclarative de 260 400 € à l’encontre d’un ressortissant étranger sur un flux tiers Suisse/France :
- fonds pour partie transportés dans des sacoches bananes de type ventral, spécialement dédiées au transport d'espèces sous les habits ;
- impossibilité de communiquer un quelconque justificatif quant à l'origine et la destination des sommes (propos liminaires non justifiés) ;
- certaines liasses de billets découvertes avec des bagues d'origine désignant une filiale turque de la Banque du Koweit ;
- découverte dans les affaires personnelles de l’infracteur d’une carte de visite d’un marchand d'armes réputé de nationalité tuniso franco luxembourgeoise ;
- antécédent douanier pour importation en contrebande d’une arme ;
- l’intéressé oppose systématiquement une fin de non-recevoir au service d’enquêtes ne permettant pas de l’auditionner ni de s’expliquer sur l’origine des fonds.
La présomption de preuve résultant de l’article 415-1 pourrait permettre de considérer qu’il y a au cas particulier une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds présumés provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu à l’article 414 du code des douanes portant sur du trafic d’armes.
3ème cas d’espèce : constatation d’un manquement à l’obligation déclarative des sommes titres ou valeurs (articles 464 et 465 du code des douanes) de 580 110 € à l’export depuis la France vers la Chine :
- les fonds sont, sous forme d’agent liquide, dissimulés dans un camion ;
- l’enquête permet de démontrer que les fonds litigieux appartiennent à une société exerçant une activité commerciale internationale d’achat/revente de textile en France ;
- le gérant de la société est connu en Italie et en Allemagne pour des activités liées à de la contrefaçon ;
- l’enquête permet d’établir que le propriétaire des fonds litigieux a en outre organisé d’autres transferts physiques transfrontaliers de capitaux depuis la France vers la Chine ;
- le propriétaire des fonds déclare que ces fonds sont le produit de son activité commerciale en France ;
- il ne peut toutefois pas expliquer pourquoi de telles sommes sont envoyées, sous forme liquide, de manière récurrente vers la Chine. Il ne fournit aucune indication sur le destinataire des sommes en Chine.
Dans une telle affaire, il n’y a pas de justification rationnelle sur les conditions de réalisation de l’opération financière. La présomption de preuve instaurée par l’article 415-1 du code des douanes permettrait de considérer que les sommes sont le produit direct ou indirect d’un délit à l’article 414 du code des douanes portant sur des contrefaçons. La présomption de preuve résultant de l’article 415-1 pourrait permettre de considérer qu’il y a au cas particulier une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds présumés provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu à l’article 414 du code des douanes portant sur du trafic d’armes.
Le nouvel article 415-1 proposé dans le code des douanes précise les conditions d’application de l’article 415 de ce même code. L’article 415 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Il convient donc de rendre également applicable l’article 16 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.
Les dispositions de l’article 415 et du nouvel article 415-1 du code des douanes relèvent des règles relatives au domaine des pouvoirs de recherche et de constatation d’infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière qui relèvent de la compétence de l'Etat.
L’article 415 a bien été étendu dans les collectivités susmentionnées en vertu des dispositions suivantes :
* la loi 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a rendu applicable à Wallis-et-Futuna (article 38) et Saint-Pierre-et-Miquelon (art 52) le titre XII du code des douanes.
* l'article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer qui rend applicable ce même Titre XII en Nouvelle-Calédonie.
* l'article 2 de l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon rend le titre XII applicable en Polynésie française. L'article 1 confirme l’extension en Nouvelle-Calédonie. L'article 3 fait de même pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
La dernière modification de l’article 415 a été apportée par le 3° de l'article 109 de la loi 2011-267 du 14 mars 2011, et étendue par l'article 125 de cette même loi.
L’extension de cet article est prévue par l’article 34 – I du présent projet de loi, qui prévoit l’application du texte à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 17
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FOUILLE DES BAGAGES LORS DE CONTRÔLES D’IDENTITE
1. Etat des lieux et diagnostic
En l’état actuel du droit, aucune disposition du code de procédure pénale ne régit spécifiquement le contrôle des bagages par les forces de police et de gendarmerie.
Les juridictions judiciaires assimilent la fouille des bagages à une perquisition (Crim.15 octobre 1984 à propos de la fouille d’un portefeuille par des agents douaniers) en ce qu’elle implique une recherche par les forces de l’ordre dans un « lieu » normalement clos d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction. Or, une telle mesure ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’une enquête préliminaire (article 76 CPP), d’une enquête de flagrance (article 56 CPP) ou d’une information judiciaire (article 94 et suivants).
La fouille d’un bagage ne peut donc pas intervenir dans le cadre d’un contrôle d’identité sauf à ce qu’un tel contrôle révèle l’existence d’une infraction qui permette d’appliquer les dispositions régissant la perquisition.
Cette jurisprudence ne s’applique toutefois qu’à la fouille du bagage, mesure qui implique que les forces de l’ordre procèdent d’eux-mêmes à la mesure et accèdent à tous les recoins du bagage mais ne concerne pas l’inspection visuelle des bagages (ouverture du bagage par son propriétaire et regards circulaires de l’agent) qui n’emporte pas intrusion des forces de l’ordre dans un « lieu » et qu’elle relève davantage d’une mesure de sécurité que d’une mesure d’investigation. En l’état du droit, il est donc possible de considérer que l’inspection visuelle peut être effectuée par les forces de l’ordre dans le cadre d’un contrôle d’identité.
La fouille de bagages se trouvant dans un véhicule
La question de la possibilité de procéder à la fouille de bagages se trouvant dans un véhicule dans le cadre d’un contrôle d’identité dépend de l’interprétation faite du terme « visite de véhicules ».
Aucune jurisprudence n’existe sur ce point particulier. On peut simplement observer que les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et à la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure emploient parfois le terme de "fouille" au lieu de celui de "visite" de véhicules, le premier paraissant plus extensif que le second.
A défaut de jurisprudence, au regard des objectifs assignés à la visite des véhicules sur réquisition du procureur de la République (recherche des actes de terrorisme, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive, d'armes et d'explosifs, de vol visées, de recel ou des faits de trafic de stupéfiants), l’esprit de la loi ne semble pas aller dans le sens d’une limitation de la mesure à la seule ouverture du coffre, du capot et des portières du véhicule, sans pouvoir en inspecter le contenu, ce qui réduirait considérablement l'utilité du dispositif puisqu'il suffirait, pour soustraire les objets illicites aux recherches, de les dissimuler dans des sacs, bagages, cartons…
L’objectif poursuivi est de définir un cadre juridique à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille opérées par les OPJ, assistés le cas échéant d’APJ et des APJA mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21.
L’article 17-1° du présent projet de loi a vocation à pallier l’absence de textes régissant la fouille de bagages et à sécuriser, au plan juridique, la réalisation des inspections visuelles de bagages dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Ajouter dans le texte une référence à la fouille des bagages constitue donc une clarification rédactionnelle (pour les bagages se trouvant dans un véhicule) et une extension (pour ceux détenus par un piéton ou le passager d'un transport public).
Il est proposé de modifier l’article 78-2-2 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République d’ordonner par réquisition, outre les contrôles d’identité et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, l’inspection visuelle et la fouille des bagages.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Cette disposition renforcera les prérogatives des forces de sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur autorisation du procureur de la République.
Cette disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Aucun texte de nature réglementaire n’est nécessaire à l’application de cette disposition.
ARTICLE 18
DISPOSITIONS RENFORCANT L’ENQUETE ET LES CONTROLES ADMINISTRATIFS
RETENUE ADMINISTRATIVE À L’OCCASION D’UN CONTRÔLE D’IDENTITÉ
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 Aux termes de l’article 78-1 du code de procédure pénale, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne contrôlée de justifier de son identité, les articles 78-3, 78-4 et 78-5 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de vérification d’identité ont vocation à s’appliquer quelle que soit la nature du contrôle effectué, qu’il soit judiciaire ou administratif.
Il ressort de l’article 78-3 du code de procédure pénale que si la personne interpellée ne veut ou ne peut justifier de son identité, les autorités de police peuvent la retenir pendant une durée n’excédant pas quatre heures, à compter du début du contrôle d’identité, soit sur place, soit dans un local de police.
Les agents chargés de cette vérification peuvent alors procéder à toutes les investigations utiles en vue d’établir l’identité de la personne retenue, en consultant notamment des fichiers. Lorsque l’identité est établie ou, en tout état de cause, à l’expiration du délai de quatre heures, la personne doit être libérée.
La vérification peut toutefois être suivie d’une mesure de garde à vue sous réserve que les conditions légales d’une telle mesure soient réunies. La durée de la rétention s’impute alors sur celle de la garde à vue.
Plusieurs garanties visant à assurer la protection des droits des personnes soumises à une vérification d’identité sont prévues.
Ainsi, l’intéressé doit être présenté à un officier de police judiciaire dès le début de la procédure de vérification lequel l’informe des deux droits suivants :
- Prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ;
- Faire aviser le procureur de la République, cette formalité étant obligatoire dès le début de la rétention s’il s’agit d’un mineur.
Le mineur de dix-huit ans doit également, sauf impossibilité, pouvoir être assisté de son représentant légal.
A l’issue de la vérification, un procès-verbal doit être dressé et mentionné les motifs justifiant le contrôle. Il retrace également l’ensemble des opérations effectuées.
Lorsque la vérification n’est pas suivie d’une procédure d’enquête, le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire est adressé au parquet et l’intéressé se voit remettre une copie.
1.2 Le fichier des personnes recherchées (FPR) trouve ses origines dans le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. En recensant toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de recherche ou de vérification de leur situation juridique, le FPR a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives.
Le FPR est divisé en différentes fiches correspondant aux motifs de la recherche de la personne concernée.
Au nombre de ces motifs d’inscription figurent les personnes « faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ». Iil s’agit des fiches dites « S » (Sûreté de l’Etat. Les inscriptions dans cette catégorie concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que celles entretenant ou ayant des relations directes et non fortuites avec ces personnes.
La découverte des individus surveillés doit être signalé au service demandeur avec le maximum de rapidité et toute la discrétion souhaitée eu égard à la nature des recherches. Sans trop éveiller l’attention de l’individu sur le fait qu’il est l’objet d’investigations de renseignement, le contrôle, effectué principalement aux postes frontières ou dans le cadre d’opérations de contrôle en application des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, doit surtout permettre de connaître les accompagnants de l’individu, l’immatriculation du véhicule utilisé, ses lieux de séjour ou points de chute.
Certaines catégories de fiches S font exception à cette règle de discrétion. Elles sont utilisées dans tous les cas où il apparaît absolument nécessaire de localiser rapidement l’intéressé et/ou de procéder à un entretien dans la mesure où la rétention de l’individu nécessite un contact immédiat avec le service demandeur.
Il est ainsi actuellement recommandé aux services de police et de gendarmerie lorsqu’ils contrôlent certaines personnes faisant l’objet de ces catégories de fiches S de les retenir et d’aviser sans délai le service ayant inscrit ces personnes au FPR pour recueillir ses instructions. La retenue des personnes faisant l’objet d’une fiche S est parfois indispensable pour assurer la surveillance efficace de ces personnes et prévenir ainsi leur passage à l’acte.
Or, cette retenue ne repose actuellement sur aucun fondement juridique. En effet, les conditions légales prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale relatif aux vérifications d’identité, qui permet de retenir les personnes pendant une durée maximale de quatre heures, ne sont pas nécessairement réunies. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette brève retenue pourrait s’assimiler à un détournement de procédure dès lors qu’elle serait utilisée dans un autre objectif que celui de la vérification d’identité.
2.1 Le nouvel article 78-3-1 du code de procédure pénale vise à instaurer un mécanisme similaire de vérification de la situation administrative quand bien même la personne concernée serait susceptible de justifier de son identité. Il tient compte dans sa rédaction du cadre constitutionnel en matière de mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative.
Le Conseil constitutionnel considère en effet que certaines mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution, si la contrainte poursuit un objectif d’ordre public, a un caractère conservatoire et est limitée dans le temps.
Par ailleurs, si l’article 66 de la Constitution impose l’intervention de l’autorité judiciaire dans le cadre des mesures privatives de liberté, il n’exige pas que ce contrôle soit toujours préalable (Décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation d’office] (Cons.20).
Notamment eu égard à leur brièveté et à leur caractère conservatoire, certaines mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative peuvent, sans méconnaître l’article 66, échapper au contrôle de l’autorité judiciaire (Décision n°2012 253 QPC du 8 juin 2012, M. Mickaël D. [Ivresse publique] ou CC 2003-467 du 13 mars 2003 LSI cons. 15 et 16 [retenue, pendant 30 minutes, du conducteur qui s’oppose à la fouille de son véhicule, dans l’attente des instructions du procureur de la République].
Enfin, au nom du principe de bonne administration de la justice, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité d’un placement en rétention des étrangers en situation irrégulière, sans autorisation préalable du juge judiciaire et sans contrôle du juge judiciaire avant le 6ème jour (Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 relative à la loi sur l'immigration, l'intégration et la nationalité, consid. n°26).
La possibilité d’une retenue de courte durée sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire a d’ailleurs été admise s’agissant des retenues pour vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le parquet en étant informé mais ne l’autorisant pas, sauf si la retenue s’accompagne de la prise d’empreintes ou de photographies. En revanche, il peut y mettre fin à tout moment.
2.2 Le présent article propose donc de créer, en plus de la retenue pour vérification d’identité, un nouveau cas de retenue pour examen de la situation administrative des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles représentent une menace pour la sûreté de l’Etat ou qu’elles sont en relation directe et non fortuite avec de telles personnes. Cette retenue, sur place ou dans un local de police ou de gendarmerie, permettrait non seulement d’aviser le service assurant le suivi de la personne concernée, de recueillir ses instructions, de consulter les informations sur cette personne figurant dans les fichiers de police autres que le FPR (TAJ notamment), d’envisager le prononcé de mesures administratives (par exemple d’interdiction de sortie du territoire en cas de contrôle aux frontières), le cas échéant de l’auditionner afin de recueillir des renseignements à des seules fins administratives voire de diligenter des mesures de surveillance comme la pose d’une balise sur son véhicule.
La mesure de vérification d’identité est une mesure de police administrative qui poursuit un objectif d’ordre public justifiée par l’existence de raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique ou à la sureté de l’Etat suite à la consultation du FPR effectuée lors d’un contrôle ou d’une vérification d’identité et de la découverte de l’existence d’une fiche S. Limitée dans le temps, elle peut être décidée par l’officier de police judiciaire qui constate matériellement l’existence d’une fiche S concernant la personne contrôlée, sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire dès lors que l’ensemble des garanties dont bénéficie la personnes est suffisant au regard de l’atteinte portée à sa situation et que le but poursuivi est suffisamment clair.
Les garanties visant à assurer la protection des droits des personnes soumises à une vérification de situation administrative sont équivalentes à celles prévues dans le cadre d’une vérification d’identité (article 78-3 et suivants du code de procédure pénale).
Cette retenue, qui a lieu sur place ou dans le local de police, ne peut excéder quatre heures. Elle est par ailleurs entourée de plusieurs garanties comme l’information du droit de faire aviser le procureur de la République, le droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix, ou la possibilité pour le procureur d’y mettre fin à tout moment.
Le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire, contenant les motifs justifiant la vérification de situation administrative, est dans tous les cas transmis au procureur de la République.
Lorsque la retenue concerne un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Le mineur doit également, sauf impossibilité, pouvoir être assisté de son représentant légal.
Enfin, comme pour la retenue décidée en cas de refus ou d’impossibilité pour l’intéressé de justifier de son identité, la durée de la retenue pour vérification de la situation administrative s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
La vérification de situation administrative poursuit clairement un objectif d’ordre public puisqu’elle permet de retenir une personne lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. C’est une mesure de police administrative proportionnée et nécessaire puisqu’elle s’effectue le temps strictement nécessaire à l’examen de sa situation, ce qui peut comprendre la consultation plus extensive de fichiers de police, la vérification de sa situation administrative et la consultation des services à l’origine du signalement sur la conduite à tenir. Au fond, la finalité de cette vérification de situation est l’obtention du renseignement, notamment sur la localisation de la personne. Ce renseignement est précieux pour le suivi d’un certain nombre de réseaux, pour lesquels les éléments recueillis demeurent insuffisants pour la judiciarisation.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les impacts de cette disposition seront marginaux en termes de ressources humaines, compte tenu du nombre limité de personnes concernées, et rapporté aux effectifs de la police et de la gendarmerie nationales.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 19
DISPOSITIONS RENFORCANT L’ENQUETE ET LES CONTROLES ADMINISTRATIFS
USAGE DES ARMES PAR LES FORCES DE L’ORDRE
1. Etat des lieux et diagnostic
Le principe de la légitime défense est prévu par l'article 122-5 du code pénal, qui figure ainsi parmi les causes d'irresponsabilité pénale, au même titre que l'abolition du discernement, la contrainte, l'erreur de droit, l'autorisation de la loi et l'état de nécessité.
Aux termes de cet article, la légitime défense suppose la réunion de plusieurs facteurs: une agression injuste de soi-même ou d'autrui; une réaction immédiate, nécessaire et proportionnée à cette agression. La légitime défense permet ainsi à la personne agressée de se défendre ou de défendre un tiers d'une atteinte injustifiée. Elle doit être nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt menacé, proportionnée et surtout concomitante à l'atteinte. Dès lors que le danger a cessé (par exemple si l'agresseur prend la fuite) l'intervention ne se justifie plus et il ne s'agit plus de légitime défense. En d'autres termes, la défense tardive ne saurait être justificative.
La doctrine relève d’ailleurs que l'appréciation par la jurisprudence de l'actualité de l'agression dans le cadre de la légitime défense peut s’avérer problématique lorsque comparée aux circonstances effectives de l’agression4. En effet, la jurisprudence peut et a pu se borner à exiger une agression strictement actuelle pour retenir la légitime défense. Or, l’appréciation stricte de la concomitance de l’agression et de la riposte soulève certaines difficultés d’appréciation notamment en cas de fuite de l’agresseur et en cas d’évolution de l’agression dans un espace de temps, même très bref.
D’une part, il est relevé que la fuite ne peut être considérée dans tous les cas comme la cessation de l’agression et de toute agression aussi bien vis-à-vis de la victime que de tiers rencontrés, ni comme un renoncement des auteurs des faits à l’usage de leurs armes.
D’autre part, l’appréciation de l’actualité de l’agression fait aussi problème lorsque, dans des situations de grande violence caractérisées également par une extrême rapidité de réalisation, l’atteinte et la riposte prennent des formes différentes et successives. En principe, la légitime défense n’est envisagée qu’à partir d’un modèle instantané ou quasi instantané de réalisation : la loi ne tient pas compte d’intervalles de temps, même très brefs, pouvant exister entre l’agression et la riposte.
Or, une agression peut soit être instantanée, soit durer un temps suffisant pour qu’elle se traduise par une série d’actes matériels identiques ou différents. De même, un agresseur peut soit se retrouver momentanément désarmé et continuer à se battre pour réaliser un dessin meurtrier, soit s’éloigner légèrement de la victime en raison de circonstances temporaires sans perdre de sa volonté criminelle. Une interprétation jurisprudentielle stricte de l’exigence de concomitance entre l’agression et la riposte peut dès lors s’avérer problématique dans certains cas de figure.
L'article 122-6 du code pénal prévoit, en outre, deux hypothèses dans lesquels la légitime défense est présumée: d'une part, lorsque l'auteur de l'acte a repoussé, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; d'autre part, lorsqu'il s'est défendu contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption est toujours réfragable.
Selon un schéma proche de celui de la légitime défense, l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal est une cause d'irresponsabilité pénale qui peut se définir comme « la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il est détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux » (FORIERS, thèse 1951). Il suppose que soit caractérisé un danger actuel et imminent, si le danger menace l'auteur, autrui ou un bien et si la réaction constitue le seul moyen d'assurer la sauvegarde d'une personne ou d'une bien. Comme pour la légitime défense, cette cause n'est pas retenue quand il y a disproportion entre le danger et la réaction.
Même si la lettre de l'article 122-7 du code pénal n'exclut pas que cette notion puisse justifier l'usage de la force armée, la construction prétorienne préexistente et l'esprit du législateur de 1994 étaient que la danger ne devait pas provenir d'une agression humaine, laquelle relevait plutôt de la légitime défense, et que la valeur sacrifiée devait être inférieure à la valeur sauvegardée (par exemple, commission d'un excès de vitesse pour conduire une personne devant être opérée de toute urgence à l'hôpital).
La législation et l’application jurisprudentielle qui en est faite apparait insuffisamment explicite et prévisible, et par conséquent sécurisante, pour permettre aux policiers de mesurer l’étendue de leur action lorsqu’ils sont appelés à agir dans un temps distinct de la menace immédiate à la vie d’autrui ou à leur vie et alors que la valeur sacrifiée peut être considérée comme équivalente.
En effet, une seule décision de la Cour de cassation fait application de l’état de nécessité dans le cadre de l’usage d’une arme par un policier (Crim 16 juillet 1986). Dans ce cas d’espèce, un policier a tiré un coup de feu au sol blessant par ricochet un individu armé qui avait précédemment faut usage de son arme et se trouvait dans un état d’excitation violente. La Cour de cassation note que par ce geste, le policier a cherché à intimider l’individu et non à l’atteindre et en déduit que cet acte lui avait été commandé par la nécessité réelle ou urgente de l’appréhender et que le risque pris en tirant un coup de feu à terre pour l’intimider apparaît en rapport avec le danger créé par ce dernier.
La flagrance représente un cadre d’enquête qui résulte du constat d’un trouble à l’ordre public et permet à la police judiciaire de recourir à des mesures d’investigations coercitives. Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale, est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L’urgence de la situation de flagrance justifie alors que le droit d’arrestation soit accordé à tout agent de la force publique ainsi qu’à tout citoyen conformément à l’article 73 du code de procédure pénale.
La jurisprudence précise que l’acte de civisme commandé par l’assistance à personne en péril imminent ou par le risque de laisser s’enfuir l’auteur d’une atteinte aux biens, ne doit pas transformer le citoyen en auxiliaire de police. Dès lors, il ne peut intervenir que de manière impromptue d’une part, et se doit de conduire la personne arrêtée devant l’officier de police judiciaire « le plus proche » d’autre part, sous peine d’être lui-même pénalement poursuivi (Crim, 21 mars 1989).
Les dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale visent en effet les conditions d’appréhension et d’arrestation de l’auteur présumé d’une infraction flagrante aux fins de sa remise à la justice, et non au sens strict les règles de droit permettant de faire bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale la personne qui riposte à une agression ou à une violence injuste.
Les dispositions de l’interpellation en flagrance ne représentent pas à proprement parler un cadre légal d’usage des armes ou d’irresponsabilité pénale. Les juges du fond apprécient ainsi in concreto la légitimité du recours à la force ou de l’usage de l’arme de l’agent interpellateur. Ce dernier ne pourra être exonéré de sa responsabilité que s’il est établi que les violences étaient nécessaires au regard des circonstances liées à l’arrestation, c’est-à-dire en fonction de la plus ou moins grande résistance opposée par l’auteur de l’infraction et à la seule condition qu’elles demeurent strictement proportionnées pour y faire face. Seules les conditions particulières de l’interpellation du délinquant, nécessairement différentes d’une espèce à l’autre, sont donc susceptibles de justifier l’ampleur des moyens coercitifs utilisés dans l’œuvre de justice.
Ainsi, sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale et après avoir estimé que la légitime défense ne pouvait trouver à s'appliquer, la Cour de cassation a admis l'usage de la contrainte, voire de la force, pour l'interpellation de l'auteur présumé d'une infraction flagrante en exigeant toutefois que, l'usage, à cette fin, de la force soit nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation. (Crim., 13 avril 2005, G., n° 04-83.939, Bull. crim. n° 131 ; D., 2005, p. 2920, note J.-L. Lennon, confirmé par Crim. 28 mars 2006, n°05-81706, Bull. crim. n° 88).
Se rend ainsi coupable de violences avec arme le propriétaire d’un appartement qui tire des coups de feu sur un cambrioleur, lors d’une tentative de cambriolages, à l’extérieur de l’immeuble alors que celui-ci s’enfuyait (Crim. 13 avril 2005). Encourt la censure l’arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef d’homicide involontaire énonce que le comportement de celui-ci a eu pour objet d’immobiliser les auteurs d’un délit flagrant dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, sans rechercher si le fait d’approcher de la portière d’un véhicule occupé un fusil armé avec le doigt sur la queue de détente était absolument nécessaire en l’état des circonstances (Crim. 28 mars 2006).
La législation et l’application jurisprudentielle qui est faite de l’interpellation en flagrance visent les circonstances de l’interpellation de l’auteur d’une infraction pénale aux fins de remise à la justice et ne peuvent ainsi être interprétées comme une extension des règles de droit commun en matière d’usage des armes ou de légitime défense. De même que pour l’état de nécessité, les dispositions de l’interpellation en flagrance apparaissent insuffisantes pour permettre aux policiers d’agir dans un temps distinct de la menace immédiate pour empêcher la réitération de crimes.
L’usage de la force pourrait s’entendre de l’usage des armes, d’autant que l’alinéa 2 de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales affirme que la mort n’est pas considérée comme infligée en violation du principe du droit à la vie posé par l’alinéa précédent, pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire, pour effectuer une arrestation régulière.
La Cour estime qu’en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 107, CEDH 2005-VII).
En revanche, le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs de l’article 2 peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des évènements, même si elle se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de la vie des autres et de la leur (Mc Cann c/ Royaume-Uni du 27 septembre 1995 §200).
Il faut que la cour puisse se convaincre que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, que les mesures qui d’un point de vue raisonnable, permettaient de pallier ce risque (Osman c/ RU 1998 §116).
Enfin, elle a estimé, à propos de l’opération antiterroriste à Moscou (prise d’otages par des séparatistes tchétchènes et décision de mettre les terroristes hors d’état de nuire et de libérer les otages en diffusant un gaz) que compte tenu du profil des terroristes, de leur caractère déterminé, des conséquences potentielles de l’opération terroriste que celle-ci était nécessaire et conforme à l’article 2 alors même que les autorités ne pouvaient savoir avec certitude si les terroristes auraient effectivement mis leur menace à exécution (Finogenov c. Russie 2011 §200).
Aussi, en fonction des circonstances de l’espèce et dès lors que l’usage des armes aura été rendu absolument nécessaire pour procéder à l’arrestation du ou des auteurs d’un ou plusieurs homicides volontaires, celui-ci pourra constituer un cas d’autorisation de la loi, exonérant l’auteur de cet acte de toute responsabilité pénale, conformément aux dispositions de l’article 122-4 du code pénal.
Les règles d'engagement des armes à feu, quant à elles, ne font pas l'objet d'un cadre commun à la police nationale et à la gendarmerie. Plus précisément, au tronc commun que constituent les dispositions du code pénal s'ajoute un volet particulier spécifique aux gendarmes régis par le code de la défense.
Aux termes de l’article L. 2338-3 du code de la défense5, les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont autorisés à déployer la force armée pour, après sommations, arrêter une personne cherchant à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne pouvant être contrainte de s'arrêter que par l'usage des armes ou lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Ce cadre, borné par la loi et complété par les instructions de la gendarmerie, répond aux exigences de la CEDH en ce qu’il est clair, lisible, suffisamment borné.
Toutefois, au-delà des textes, la particularité du domaine de l’usage de la force armée est d’avoir été considérablement forgée, dans un sens restrictif, par la jurisprudence. C’est pourquoi, s’il existe une différence du traitement législatif entre policiers et gendarmes, la jurisprudence développée tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour de cassation, à l’aune des critères de l’absolue nécessité et de proportionnalité, en atténue largement la portée et tend par conséquent à assimiler les cas d’usage légitime des armes pour les deux forces.
L'arsenal législatif actuel ne permet pas explicitement d'appréhender toutes les situations. La légitime défense doit être concomitante à l'atteinte. Elle suppose un acte immédiat et proportionné, en réaction à une agression grave et actuelle contre soi-même ou autrui. Ce cadre juridique de la légitime défense ne semble cependant plus adapté au contexte actuel.
L'analyse des menaces et modes opératoires terroristes actuels démontre que les terroristes radicalisés commettent des actions débutant, la plupart du temps, par des assassinats de masse et/ou des prises d'otages meurtrières et s'achevant quasi-systématiquement par un retranchement afin de mener une confrontation armée volontaire avec les unités d'intervention. Toutefois, les policiers peuvent se heurter, dans la pratique, à la législation régissant la légitime défense.
En effet, les forces de l'ordre se retrouvent de plus en plus souvent confrontées à des assauts dynamiques et continus où le rôle des policiers "primo-intervenants" peut s'avérer essentiel. Par ailleurs, ces individus retranchés - volontairement ou à la suite d'une opération de police - ne se rendent jamais préférant, comme ils le revendiquent eux-mêmes, "mourir les armes à la main".
La combinaison de ces deux tendances conduit à une situation observée à plusieurs reprises:
- les terroristes commettent de véritables tueries de masse très rapides où les plus nombreuses victimes sont abattues dans les premières minutes de l'action ;
- avant de se retrancher, dès qu'une résistance leur est opposée ou afin d'attirer les policiers dans un piège, pour se préparer à affronter les forces de l'ordre, voire monter à l'assaut.
Par ailleurs, lors d’une tuerie de masse planifiée voire d’une prise d’otages meurtrière, les terroristes n’hésitent plus aujourd’hui à massacrer les civils sans défense qu’ils croisent au gré de leurs déplacements, le plus souvent au moyen d’armes à feu puissantes de type fusils d’assaut (cf. récents attentats sur des terrasses de café à Paris le 13 novembre dernier ou sur une plage en Tunisie ou un centre commercial au Kenya). Entre deux coups de feu, il arrive que les individus déambulent sans menacer quiconque au sens strict de la loi (canon de l'arme baissée, aucune victime particulièrement visée). Cependant leur périple n'en demeure pas moins meurtrier puisqu'ils passent de nouveau à l'acte dès qu'ils le peuvent. Leur mode opératoire consiste ainsi en une succession d'assassinats multiples entrecoupés de périodes ne permettant pas stricto sensu de retenir la légitime défense pour autrui.
Passée l'action de tir, qui peut être de très courte durée, la légitime défense ne peut toujours être retenue. Or, les dernières attaques le démontrent, les terroristes tirent sur leurs victimes au gré de leurs déplacements, leur agression "grave et injuste" étant finalement constituée d'une succession d'assassinats multiples, entrecoupés de périodes ne permettant pas de retenir la légitime défense pour autrui.
A titre d’illustration, le cheminement meurtrier du trio de terroristes embarqués à bord d’une Seat noire le vendredi 13 novembre 2015 a été le suivant :
- 21h25 : tirs à l’angle des rues Bichat et Alibert (10e), les terroristes ouvrent le feu sur les terrasses du restaurant le Petit Cambodge et du bar Le Carillon, faisant 15 morts.
- 21h32 : tirs rues de la Fontaine-au-Roi (10e), les terroristes ouvrent le feu devant le restaurant Casa Nostra et la brasserie La Bonne Bière, faisant 5 morts.
- 21h36 : tirs rue de Charonne (11e), ces mêmes terroristes mitraillent la terrasse du café La Belle Equipe, tuant 19 personnes.
Le cadre juridique actuel ne permet donc pas aux agents, en dehors des cadres généraux d’irresponsabilité pénale insuffisamment explicite, de neutraliser ces individus dans le laps de temps où ils ne menacent plus matériellement une victime mais s’apprêtent à le faire à nouveau dans un temps très voisin. Afin d’agir en toute sécurité juridique, les policiers et les gendarmes primo-intervenants ou les opérateurs des unités d’intervention placés dans la même configuration, par exemple tireurs de haute précision, pourraient alors être contraints d’attendre un acte pouvant entraîner l’usage de la force pour pouvoir intervenir. Le cadre juridique actuel contraint donc en pratique les policiers et les gendarmes à se placer volontairement dans une situation de légitime défense avec les risques que cela pourraient comporter pour eux, pour les otages ou pour les passants en cas d’échanges de feu sur la voie publique.
Les événements récents montrent combien il devient nécessaire de faire évoluer l’état du droit afin de prendre en compte les nouvelles menaces constituées par les tueurs de masse et les périples meurtriers.
L’un des objectifs poursuivis par le projet de loi est de doter, en dehors et dans un cadre distinct de celui de la légitime défense, les policiers et les gendarmes du pouvoir de neutraliser un individu armé venant de commettre plusieurs meurtriers ou tentatives et dont on peut légitimement supposer qu’il se prépare à en commettre d’autres. Il s’agit du pouvoir d’intervenir sans attendre qu’il y ait un nouveau commencement d’exécution.
Cela permettrait donc aux primo-intervenants et aux opérateurs des unités d’intervention de neutraliser un individu armé y compris dans un laps de temps où il ne menacerait matériellement plus personne, sans attendre donc que les éléments constitutifs d’une nouvelle situation de légitime défense traditionnelle ne soient réunis.
Il s’agit donc à travers une disposition précise, déclinant un cas particulier caractérisant l’état de nécessité, de répondre à un besoin opérationnel et au légitime souci de sécurité juridique des forces de l’ordre, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, dont les formes sont évolutives.
3. Options et nécessite de légiférer
Dans le cadre des travaux préparatoires du projet de loi, les options suivantes ont été envisagées.
1ère option : Instauration d'une présomption de légitime défense au profit des forces de l’ordre.
Une telle modification du code pénal ne modifierait ni n’étendrait le périmètre qui autorise à faire usage de l’arme. Elle aurait seulement pour effet de renverser la charge de la preuve sans rien ajouter au droit du recours aux armes lui-même, ni réduire le risque de mise en cause pénale. Loin de constituer une garantie supplémentaire pour les membres des forces de l’ordre, elle constituerait au contraire un leurre qui les exposerait davantage juridiquement sans mieux les protéger sur le plan opérationnel.
2ème option : Création d'un régime juridique de l’usage des armes par les forces de sécurité intérieure s’appuyant sur l’état de nécessité.
Il s’agirait d’introduire un article L.434-2 après l’article L.434-1 du code de la sécurité intérieure. Cet article viserait à construire un cadre légal d’usage des armes permettant de traiter les cas ne rentrant pas dans le cadre juridique existant de la légitime défense, mais caractérisant un cas particulier d’état de nécessité. L’usage de l’arme par le fonctionnaire de la Police nationale ou par le militaire de la gendarmerie nationale serait strictement encadré. L’usage de l’arme devra être rendu absolument nécessaire pour mettre hors d’état de nuire conformément à la jurisprudence de la CEDH. L’individu sur lequel il pourra être fait usage de l’arme devra avoir été identifié comme l’auteur d’un ou plusieurs homicides volontaires, et il devra exister des raisons sérieuses et actuelles de penser que cet individu est susceptible de réitérer ces crimes dans un temps très voisin des premiers actes.
Il sera introduit un article L.4123-12 du code de la défense afin d’étendre ce régime aux forces armées et un article L.434-2 du code de la sécurité intérieure afin de l’étendre aux agents des douanes.
Cette option a été retenue dans le présent projet de loi.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La création d’un régime juridique spécifique d’usage des armes par les forces de l’ordre, faisant référence aux dispositions de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal) et conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, permet de doter les policiers d’un cadre légal d’usage de la force armée ; par ailleurs, elle répond aux difficultés opérationnelles de réponse de l’ensemble des forces de l’ordre aux tueries de masse et aux périples meurtriers. Il est à la fois de nature à garantir la sécurité juridique des forces de l’ordre pouvant être amenés à intervenir lors de telles opérations ainsi que la sécurité physique des citoyens susceptibles d’être victimes de tels agissements.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Pour ces collectivités, le code de la sécurité intérieure et le code de la défense listent de manière exhaustive les articles du titre Ier du livre II qui leur sont applicables. Une mise à jour est donc également prévue selon la technique du « compteur » pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises s’agissant des I et II du présent article.
Les dispositions modifiant le code des douanes sont également rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy via l’extension à l’ensemble du territoire de la République.
CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE RETOURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
1. Etat des lieux et diagnostic
Une personne résidant légalement sur le territoire national et suspectée de revenir d’un théâtre d'opérations de groupements terroristes à l’étranger ne peut être poursuivie par l’autorité judiciaire que sur le fondement de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, sur le fondement de l’article 421-2-1 du code pénal, ou de l’entreprise terroriste individuelle, sur le fondement de l’article 421-2-6 du même code.
Or, la mise en œuvre de chacune de ces infractions suppose que soient réunies des conditions qu’il n’est pas systématiquement possible de réunir lorsqu’une personne est soupçonnée de revenir d’une telle zone.
Ainsi, l’article 421-2-1 suppose-t-il de « participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ».
De même, l’article 421-2-6 précise que « Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. »
La mise en œuvre de ces deux infractions suppose donc de disposer d’autres éléments que le seul retour d’un théâtre d’opérations terroriste, voire le retour avéré d’une zone d’où le trajet vers des théâtres d’opérations terroristes est aisé.
Si la politique de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est de judiciariser les individus dont on sait qu'ils évoluent en zone syro-irakienne, ce qui se traduit par l’émission d’un mandat d'arrêt international, permettant leur arrestation à leur retour sur le territoire, un dossier peut ne pas être judiciarisé, les deux infractions pénales ci-dessus décrites étant insuffisamment caractérisées. En particulier, l’infraction pénale d’entreprise individuelle terroriste nécessite deux conditions cumulatives dont l’une est le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. La mesure de police administrative proposée vise donc à combler un vide juridique et n’a aucunement vocation à se substituer à une procédure judiciaire.
A défaut de disposer d'éléments attestant du passage d'une personne en Syrie ou de son implication au sein de groupes de combattants, une période d’observations en France, accompagnée de mesures coercitives, permettrait soit de lever favorablement le doute sur les activités de cette personne dans la zone turco-syrienne soit, au contraire, de les conforter par des éléments matériels permettant l'ouverture d'une enquête judiciaire.
Il s’agit donc de renforcer le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.
Pour que ce contrôle soit efficace, il faut qu’il comporte la possibilité, dans un temps proche de la connaissance du retour en France et pour une période brève, de s’assurer que la personne réside dans un lieu déterminé, afin de prévenir tout mouvement tant que la personne concernée fait l’objet d’enquêtes évaluant sa dangerosité.
La dangerosité établie permettra de judiciariser la personne. Dans le cas contraire, ce contrôle peut être allégé, mais doit demeurer, pour une période permettant de s’assurer qu’elle ne risque pas de porter atteinte à la sécurité publique, de sorte que la localisation de cette personne soit alors possible, par exemple lorsqu’un risque terroriste est signalé.
Cette disposition est nécessaire pour lutter contre la tendance constatée consistant, pour beaucoup de ceux qui sont passés à l’acte, à se fondre dans un certain anonymat au retour, tout en conservant des contacts en vue de la préparation d’actes sur le territoire national.
Pour qu’elle soit proportionnée, elle doit être adaptée à la situation de la personne faisant l’objet de la mesure, c'est-à-dire qu’elle doit pouvoir prendre en compte le profil particulier de la personne, en permettant à l’autorité à l’origine de la mesure de retenir les modalités de contrôle les plus efficaces par rapport à ce profil.
La proportionnalité s’apprécie également par le délai imparti à la mise en œuvre : il faut en effet que ce contrôle intervienne rapidement après que la personne aura été identifiée comme étant revenue d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
3. Options et nécessite de légiférer
Une première option serait de poser des conditions au retour en France de personnes y résidant.
Or, le 4ème Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 16 septembre 1963, ratifié par la France, dispose, en son article 3, que « 1 Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
2 Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. »
Aussi, il est conventionnellement impossible d’interdire à un Français d’entrer en France.
Toutefois, cette entrée, si elle est inconditionnelle, n’interdit pas à l’Etat de prévoir des sanctions ou des contrôles spécifiques.
Une deuxième option consisterait à élargir les pouvoirs de l’autorité judiciaire, par une incrimination plus large que l’entreprise terroriste individuelle ou l’association de malfaiteurs à caractère terroriste.
Toutefois, cette option se heurterait aux mêmes difficultés de précision de la loi pénale, alors qu’il s’agit d’incriminations particulièrement graves, dont l’interprétation doit être la plus réduite possible.
Une troisième option est de considérer que le contrôle de ces personnes relève bien de la prévention des actes de terrorisme, et constitue donc, à ce titre, une mesure de police administrative.
C’est l’option retenue, qui prévoit la mise en œuvre de différentes mesures de police administrative à l’égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle ont quitté le territoire français pour accomplir soit des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, soit des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, ou qui ont tenté de se rendre sur un tel théâtre, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Le contrôle administratif à l’égard de ces personnes comporte plusieurs types d’obligations à la charge de la personne concernée.
Afin d’approfondir l’évaluation de la situation des personnes revenant sur le territoire national dans de telles conditions, le ministre d’intérieur peut, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine du retour sur le territoire national :
- assigner à résidence dans un lieu qu’il fixe et qui permet à la personne concernée de poursuivre une vie professionnelle et familiale, assignation qui peut être assortie d’une astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation dans la limite de 8 heures par tranche de 24 heures ;
- faire obligation à la personne de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine.
Cette possibilité est limitée à une durée d’un mois, non renouvelable.
Le contrôle administratif peut également comporter, de manière cumulative ou alternative, les obligations suivantes :
1) la déclaration de son domicile ainsi que tout moyen de communication électronique dont elle dispose ;
2) le signalement de ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre défini par l’autorité administrative, ne pouvant être inférieur à la commune ;
3) l’interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Cette mesure de police administrative ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, ainsi que vient de le confirmer le Conseil constitutionnel s’agissant de l’assignation à résidence prononcée dans le cadre de l’état d’urgence (décision QPC n° 2015-527 du 22 décembre 2015: « cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution » ( consid. 5) y compris lorsqu’elle est assortie d’une mesure d’astreinte à domicile « que la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution » (consid. 6).
Cette mesure portant toutefois atteinte à la liberté d’aller et venir telle que garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le projet de loi prévoit un certain nombre de garanties :
- elle ne peut être prononcée qu’à l’égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle ont quitté le territoire français pour accomplir soit des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, soit des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, ou qui ont tenté de se rendre sur un tel théâtre, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
- la mesure de contrôle administratif est décidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant ;
- la personne concernée est mise à même de présenter ses observations, tout en préservant l’utilité de la mesure par une procédure contradictoire postérieure à sa notification, pour éviter que la période du contradictoire ne puisse être mise à profit pour échapper au contrôle. La possibilité de ce contradictoire a posteriori a déjà été admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-490 QPC du 14 octobre 2015 interdiction de sortie du territoire.
- ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure ;
- sa durée est par ailleurs limitée à une durée de trois mois, renouvelable une fois de façon expresse et motivée, pour une même durée, si les conditions du contrôle administratif sont de nouveau réunies.
- le contrôle est levé dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou lorsque la personne se soumet à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté dans un centre habilité à cet effet.
- enfin, le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit, grâce à un contrôle de droit commun, notamment dans le cadre de procédure d’urgence (référé liberté).
Le non-respect de l’ensemble des obligations prévues par l’autorité administrative est puni de sanctions pénales allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité de l’interdiction administrative de sortie du territoire (article L.224-1 du code de la sécurité intérieure), qui est le corollaire de cette disposition. Il a notamment indiqué (décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015) « qu'en donnant au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire à tout Français de sortir du territoire de la République dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français, le législateur a entendu renforcer les pouvoirs de police administrative de l'État en matière de lutte contre le terrorisme ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public ». Il s’agit, par le dispositif envisagé, de prévenir des atteintes à l’ordre public, finalité qui est de la compétence de l’autorité administrative.
Outre l’interdiction administrative de sortie du territoire et l’assignation à résidence, il existe en droit français d’autres mesures de police administrative qui peuvent également avoir pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de ressortissants français.
Ainsi, le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou son retrait aux ressortissants dont les déplacements à l’étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique peut être prononcé par l’autorité administrative sur le fondement du décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 et au regard de l’interprétation qu’en a donné le conseil d’Etat dans un avis n° 350924 du 12 janvier 1991. Aux termes de cet avis : « la liberté d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter. Il en découle que l'autorité administrative ne peut refuser un passeport que si les déplacements à l'étranger de celui qui le demande sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique. »
En outre, le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit la possibilité pour le préfet de prendre une opposition à sortie du territoire des mineurs. Cette mesure d’urgence et conservatoire prise par le préfet permet ainsi d’empêcher le déplacement d’un mineur à l’étranger contre la volonté de l’un de ses parents ou de son représentant légal. Cette mesure est dite conservatoire car elle est limitée à une durée de 15 jours pendant laquelle une interdiction de sortie du territoire (IST) doit être sollicitée et peut être obtenue du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants.
Par ailleurs, il existe également dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des dispositions permettant de prendre des mesures de police administrative qui peuvent également avoir pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de ressortissants étrangers. Il s’agit de :
- L’expulsion des étrangers dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public- le motif tiré du comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités à caractère terroriste permettant d’expulser des catégories d’étrangers bénéficiant d’un protection quasi-absolue à raison de leur vie privée (article L. 521-3 du CESEDA) ;
- l’assignation à résidence : L’article L. 561-1 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence dans les lieux qui sont fixés par l’autorité administrative et qu’il ne peut quitter sans autorisation. Pour les terroristes et islamistes radicaux, le périmètre de l’assignation est limité au territoire d’une commune, choisie sur proposition de la DCRI. En outre, l’article L. 523-3 du même code prévoit qu’une mesure d’assignation à résidence peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois. Dans sa décision DC n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que la mesure d'assignation à résidence prévue par l’article L. 562-1 du CESEDA « se substitue à une mesure de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une telle mesure, placée sous le contrôle du juge administratif qui en apprécie la nécessité, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir » ;
- le placement sous surveillance électronique mobile : L’article L. 571-3 du CESEDA habilite l’autorité administrative à ordonner le placement sous surveillance électronique de l’étranger assigné à résidence « condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste » ;
- L’interdiction d’entrer en relation avec des individus nommément désignés est prévue par l’article L. 563-1 du CESEDA ;
- L’interdiction administrative du territoire pour les étrangers ne résidant pas habituellement en France (articles L. 241-1 et suivants du CESEDA), mesure permettant de refuser l'entrée sur le territoire national de ressortissants étrangers, dont la présence représenterait une menace grave pour l'ordre public, notamment en raison de leur participation à des activités de groupes terroristes.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les impacts attendus de cette disposition sont d’abord de s’assurer d’une meilleure appréciation sur la dangerosité des personnes revenant de théâtres d’opérations de groupements terroristes. Cette appréciation nécessite du temps, tant pour effectuer les enquêtes nécessaires que pour vérifier le comportement de la personne à son retour. Le dispositif envisagé permet de répondre à cette préoccupation.
Ce dispositif doit également permettre, par voie de conséquence, de judiciariser davantage des personnes revenant de ces théâtres, en disposant du temps nécessaire pour obtenir des faits matériels permettant les poursuites.
Financièrement, ainsi qu’en matière de ressources humaines, l’impact de cette disposition est négligeable.
Ces dispositions supposent, pour entrer en vigueur, un décret en Conseil d’Etat.
Elles ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Pour ces collectivités, les articles L. 285-1 (PF), L. 286-1 (NC), L. 287-1 (WF) et L. 288-1 (TAAF) du code de la sécurité intérieure listent de manière exhaustive les articles du titre Ier du livre II qui leur sont applicables. Une mise à jour est donc également prévue selon la technique du « compteur ».
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat du droit
En application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
L’article L. 234-1 du même code dispose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. La liste des décisions pouvant donner lieu à ces enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, l’accès aux installations d’importance vitale fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’opérateur, laquelle peut être précédée d’une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel. En application de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre6 est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat7. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ».
1.2 Difficultés rencontrées
En l’état du droit actuel, les dispositions du code de la sécurité intérieure précitées ne permettent pas aux organisateurs, publics ou privés, de grands événements de solliciter l’autorité administrative pour avis afin qu’elle procède à une enquête administrative à l’encontre d’une personne susceptible d’accéder à tout ou partie d’un établissement ou installation accueillant lesdits événements.
En effet, en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative ne peut être effectuée que préalablement à l’intervention d’une décision administrative de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, qui est elle-même expressément prévue par un texte législatif ou réglementaire. Sont concernés soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit les autorisations d’accès à des lieux protégés en raison de l’activité qui s’y exerce, soit les autorisations ou agréments relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique.
Or la décision par laquelle un organisateur, personne privée, procède au recrutement des personnels intervenant dans lesdits établissements n’est pas une « décision administrative de recrutement » au sens de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, pouvant être précédée d’une enquête administrative comportant la consultation des fichiers de police. De même, les établissements et installations susceptibles d’accueillir des grands événements ne sont pas au nombre des lieux protégés en raison de l’activité qui s’y exerce.
Il ne pourrait être envisagé de se borner à compléter l’article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure qui dresse la liste des autorisations d’accès à certains sites pouvant être précédées d’une enquête administrative, en y ajoutant un alinéa relatif aux établissements ou installations accueillant les grands événements. Cela impliquerait nécessairement de prévoir également une disposition législative spécifique organisant un régime d’autorisation ou d’habilitation dans le cadre duquel cette enquête administrative serait sollicitée.
Les établissements et installations susceptibles d’accueillir de grands événements ne constituant pas davantage des installations d’importance vitale, les enquêtes administratives qui sont réalisées préalablement à l’autorisation d’accéder à ces sites ne peuvent avoir pour fondement juridique l’article L. 1332-2-1 du code de la défense.
Pour ces raisons, il importe donc de procéder à la modification du code de la sécurité intérieure.
La présente disposition vise à renforcer les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant de grands événements (manifestations sportives telles que l’Euro 2016 ou, les Jeux Olympiques, rencontres internationales), qui sont exposés par leur ampleur ou leurs circonstances particulières à un risque exceptionnel de menace terroriste.
L’objectif est de permettre la mise en œuvre d’un dispositif efficace et proportionné garantissant la sécurité des spectateurs, des participants et de l’ensemble des personnels déployés, pendant la durée de ces événements et au cours de leur préparation.
Option 1 : La création d’un régime dans lequel les services de l’Etat émettraient un avis simple transmis à un employeur privé qui en tirerait librement des conséquences en application du droit du travail. En d’autres termes, à la demande d’un recruteur privé, l’Etat fournirait un avis sur la compatibilité entre le comportement d’un candidat et la nature de l’emploi postulé au sein de l’établissement ou de l’installation accueillant de grands événements. L’employeur tirerait librement des conséquences de cet avis, dans le cadre du droit du travail.
Une telle option soulève plusieurs difficultés. D’une part, l’autorité administrative pourrait, après consultation des traitements de données utilisables dans le cadre de la police administrative, transmettre à un recruteur un avis binaire (favorable / défavorable) sur l’opportunité d’un recrutement dans une profession donnant accès à un établissement ou une installation sensible. Avec un système d’avis binaire, il convient toutefois de prévoir qu’en cas de contentieux, l’autorité administrative devra fournir au juge les éléments ayant justifié un avis défavorable. Les candidats devraient être informés de l’existence de cette procédure. L’article L. 1221-8 du code du travail dispose en effet que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard ». L’article L. 1221-9 du même code dispose qu’« aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
D’autre part, le critère susceptible d’être retenu pour déterminer l’avis pourrait être celui de l’existence de risques éventuellement posés par le comportement de l’intéressé au regard de la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité publique ou de la sûreté de l’Etat.
Par ailleurs, la mise en place d’un tel régime pose la question de la capacité des services de l’Etat à traiter ces procédures d’avis.
Enfin et surtout, se pose la question du niveau de norme nécessaire pour mettre en place un tel régime. Certes ce régime, qui ne prévoit pas d’autorisation administrative, ne semble pas remettre en cause des droits et libertés constitutionnellement garantis. Si le droit à l’emploi prévu par le préambule de 1946 fait bien partie du bloc de constitutionnalité8, le droit à l’emploi ne peut être assimilé à un droit à être recruté. L’instauration d’un tel régime ne contredit pas d’autres règles de nature législative au sein du code du travail. L’article L. 1132-1 dudit code pose, certes, un principe de non-discrimination : « nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs (…), de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses (…) ». Sur ce fondement, la jurisprudence considère que les événements tirés de la vie privée du salarié ne peuvent, en principe, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Des exceptions sont toutefois admises par la jurisprudence lorsque les faits reprochés sont de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, compte tenu de la fonction exercée par le salarié. Il pourrait donc être considéré que ce régime ne relève pas du législateur. Toutefois, la mise en place d’un tel régime pourrait être regardée comme instaurant implicitement un régime réglementé. En effet, si le recruteur est libre de tenir compte ou non de l’avis transmis par les services de l’Etat, il est néanmoins probable qu’il ne s’écartera pas d’un avis défavorable, surtout si celui-ci ne détaille pas les motifs justifiant un tel avis. Par ailleurs, un tel régime repose sur l’identification, par les services de l’Etat, de professions sensibles ou à risque au sein de l’établissement ou installation accueillant de grands événements. Cette démarche pourrait être assimilée à une forme de réglementation des professions concernées, supposant dès lors l’intervention du législateur.
Ainsi, force est de constater que cette option soulève de nombreuses incertitudes tant au regard de la nature juridique de la mesure que de ses conséquences. Aussi, il apparaît plus opportun de créer un régime ad hoc d’autorisation administrative.
Option 2 : La création d’un régime d’autorisation ou d’habilitation dans le cadre duquel une enquête administrative sera sollicitée.
Un tel dispositif repose sur deux mesures différentes :
- En amont, une disposition législative est nécessaire pour soumettre à autorisation préalable l’accès au lieu concerné.
La mise en place d’un tel régime d’autorisation constituant une limitation de la liberté d’exercer une profession, elle relève bien du domaine de la loi conformément à l’article 34 de la Constitution.
La liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est une liberté à valeur constitutionnelle (n° 81-132 DC du 16 janvier 1982), qui s'exerce dans le cadre d'une réglementation instituée par la loi (n° 85-200 DC du 16 janvier 1986). Le législateur peut y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010).
De même, le Conseil d’État considère que la liberté du commerce et de l’industrie figure parmi les libertés publiques placées par l’article 34 de la Constitution sous la sauvegarde du législateur (CE, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye) et que le Gouvernement ne peut porter atteinte au « libre accès à l’exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n’ayant fait l’objet d’aucune limitation légale » (CE, 22 juin 1963, Syndicat du personnel soignant de la Guadeloupe). Il juge en conséquence que l’autorité de police administrative ne peut pas soumettre l’exercice d’une telle activité à une autorisation préalable (CE, 22 juin 1951, Daudignac ; 27 juillet 2009, Girard, n° 300964) ou à une déclaration préalable (CE, 8 déc. 1999 Commune de Pont-à-Mousson, n° 154395). Il a, dans son arrêt de principe « Daudignac » précité, censuré un arrêté municipal subordonnant l’exercice de la profession de photographe-filmeur à Montauban à la délivrance d’une autorisation.
- En aval, un système d’enquête administrative est mis en place pour éclairer les décisions individuelles prises dans le cadre de ce régime d’autorisation préalable.
Cette enquête administrative a pour objet de vérifier que le comportement et les agissements des personnes ayant accès aux sites ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. Cette enquête administrative peut donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel.
L'utilisation de fichiers de police judiciaire dans le cadre d'enquête administrative n'est de nature à méconnaître les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que, si par son caractère excessif, elle porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des personnes concernées. Le Conseil constitutionnel a reconnu que tel n'était pas le cas lorsque le législateur a fixé précisément les motifs des consultations ainsi que les restrictions et précautions dont ces consultations sont assorties telles que les finalités de l'enquête administrative ou l'information de la personne concernée (n° 2003-467 DC du 13 mars 2003). La consultation de données à caractère personnel ne méconnaît pas la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 lorsqu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et mise en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (n° 2012-652 DC du 22 mars 2012).
Tel est l’objet du présent projet de loi.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1 Impacts juridiques
La disposition envisagée a pour objet de subordonner l’accès de toutes les personnes, autres que les spectateurs ou les participants, à de grands événements, exposés à un risque de menace terroriste, à une autorisation accordée par les organisateurs publics ou privés desdits grands événements.
Le dispositif envisagé comporte plusieurs garanties propres à concilier l’exercice des libertés publiques, et notamment la liberté d'entreprendre et le droit au respect de la vie privée, et les nécessités liées aux objectifs poursuivis.
Un décret désignera les grands événements, les établissements ou installations accueillant lesdits événements ainsi que les organisateurs concernés.
Ces organisateurs devront donc soumettre l’accès aux sites désignés à une autorisation pendant l’événement et sa préparation. Avant de délivrer cette autorisation, l’organisateur devra obligatoirement recueillir l’avis de l’autorité administrative. Le caractère obligatoire de l’avis de l’autorité administrative est justifié par l’objectif poursuivi de prévention du terrorisme.
Cet avis sera rendu à la suite d’une enquête administrative, laquelle pourra donner lieu à la consultation de certains fichiers relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Pourront donc être consultés les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. La liste des traitements pouvant être consultés sera fixée par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’autorité administrative ne pourra émettre un avis défavorable que s’il résulte de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. La loi définit ainsi explicitement les finalités de l’enquête administrative.
L’avis rendu par l’autorité administrative est un avis simple, qui ne lie pas l’organisateur. Le pouvoir d’autoriser ou de refuser l’accès aux établissements ou installations ainsi désignés appartient au seul organisateur, éclairé par cet avis.
Les personnes seront informées qu’elles font l’objet d’une enquête administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
4.2 Impacts budgétaires
La consultation des traitements sera effectuée par les services et unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dans le respect des règles propres à chaque traitement et au moyen des outils informatiques déjà existants.
L’impact budgétaire est difficilement quantifiable dans la mesure où il dépendra de l'ampleur de l'événement, de la durée durant laquelle sa préparation et son déroulement vont avoir lieu et du volume d'enquêtes administratives à réaliser. Par ailleurs, le temps nécessaire pour procéder à une enquête administrative varie en fonction des procédures mises en œuvre et des résultats obtenus. Le temps moyen est évalué à :
- 48H à 72H pour une personne qui n’est pas inscrite dans les fichiers ;
- une semaine à dix jours pour une personne qui est inscrite dans un ou plusieurs fichiers.
Il peut être réduit à quelques heures, dans l’hypothèse où les services gestionnaires des fichiers ont été avisés de l’urgence et de la nécessité d’une réponse rapide (procédure exceptionnelle).
Il n’est pas envisagé en l’état de doter les services et unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale de moyens humains et techniques supplémentaires. La disposition envisagée impliquera, pour chaque grand événement, une répartition différente des charges de travail pour les services concernés.
5. Consultations et modalités d’application
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixera les modalités d’application de l’article et aura notamment pour objet de déterminer les fichiers qui feront l’objet d’une consultation au cours de l’enquête administrative, les catégories de personnes concernées ainsi que les garanties d’information ouvertes à ces personnes.
L’article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Pour ces collectivités, le code de la sécurité intérieure liste de manière exhaustive les articles du titre Ier du livre II qui leur sont applicables. Une mise à jour est donc également prévue selon la technique du « compteur ».
ARTICLE 22
CLARIFICATION DU RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
1. Etat des lieux et diagnostic
Le rôle essentiel du procureur de la République en matière de direction de l’enquête judicaire est affirmé de façon laconique par les dispositions du code de procédure pénale.
L’article 12 du code de procédure pénale précise que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur.
L’article 41 du code de procédure pénale indique que ce magistrat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale et qu’à cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Hors ces deux dispositions et hors les précisions concernant le contrôle de la garde à vue (notamment le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 62-3, qui précisent le contrôle de légalité, de proportionnalité et d’opportunité de la garde à vue), le rôle général du procureur, en tant que garant des libertés individuelles, n’est pas plus explicité.
A cet égard, la comparaison avec l’article 81 du code concernant le juge d’instruction est éclairante.
Le premier alinéa de cet article dispose en effet que le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes, cet alinéa précise que ce juge « instruit à charge et à décharge », mais cette formule d’origine doctrinale, parait caractériser le juge d’instruction depuis sa création.
L’article 81 ne traitant que du juge d’instruction, on pourrait a contrario considérer que l’action du procureur n’est pas - aussi - encadrée par la loi, et que sa mission n’est pas de chercher la vérité, mais uniquement d’enquêter à charge pour permettre de poursuivre une personne devant les juridictions.
Or, si le procureur a également un rôle d’accusateur public, il n’en demeure pas moins que, dans sa mission de direction des investigations, il est tenu aux mêmes obligations de légalité, d’équité et d’objectivité que le juge d’instruction (dont la fonction comporte du reste également une mission d’accusation, résultant de la mise en examen et l’ordonnance de renvoi).
Si la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique est venue renforcer l’indépendance et l’objectivité des magistrats du parquet, en supprimant les instructions individuelles du ministre de la justice et en rappelant dans l’article 31 que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu », il demeure que le rôle du procureur comme directeur d’enquête est trop souvent sujet, dans l’opinion publique, à des critiques infondées.
Ces critiques ont été favorisées d’une part, par la confusion possible entre le procureur et les enquêteurs de police judiciaire – le procureur étant considéré comme une sorte de super-enquêteur – et, d’autre part, par la jurisprudence de la CEDH opposant le procureur au juge.
La CEDH a en effet considéré que, dans la mesure où il est à la fois accusateur, donc non objectivement impartial dans cette mission de poursuites, et hiérarchisé, donc non indépendant comme l’est un juge du siège, il ne pouvait être considéré comme un juge, au sens de l’article 5 de la convention pour contrôler, après 48 heures, la privation de liberté résultant d’une garde à vue (29 mars 2010, Medvedyev contre France, 23 février 2011, Moulin contre France).
Le projet de loi ambitionne de de mieux préciser le rôle du parquet en matière de direction d’enquête, afin de mettre en évidence :
- Que le procureur ne doit pas être confondu avec les enquêteurs, dans la mesure où il dirige leur action mais n’est pas lui-même un enquêteur ;
- Que s’il ne doit être confondu avec un juge du siège, au sens de l’article 5 de la CEDH, il n’en demeure pas moins un magistrat dont l’action, en matière de direction des investigations, est en réalité très proche de celle d’un magistrat instructeur, et qu’elle obéit à des règles déontologiques similaires.
Comme le préconise le « rapport Beaume », cette clarification justifie l’insertion d’un article explicatif dans le code de procédure pénale.
Il est ainsi proposé d’insérer dans le code de procédure pénale, un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. - Dans ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il peut adresser aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigations au regard de la nature et de la gravité des faits, l’opportunité de conduire l’enquête dans telle ou telle direction ainsi que la qualité de son contenu.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge».
Le « rapport Beaume » proposait une rédaction ne faisant état, ni de la recherche de la vérité, ni des investigations à charge ou à décharge, ni des droits du suspects et de la victime. Cette rédaction a paru pouvoir être complétée.
Le texte retenu paraît mieux décrire, dans toutes ses dimensions, la réalité du rôle du procureur de la République en tant que directeur d’enquête.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La clarification opérée par cette disposition, qui présente une portée principalement symbolique, mais d’une force particulière, participe du nécessaire rétablissement de la confiance de l’opinion publique dans le ministère public et donc, dans l’institution judiciaire.
Le nouvel article 39-3 du code de procédure pénale n’est cependant pas dénué de portée normative, en permettant de préciser les critères de choix et de décision du procureur lorsque, dans le cadre de la procédure contradictoire de règlement des enquêtes de plus d’un an prévue par les nouveaux articles 77-1 et 77-2 du code de procédure pénale résultant du présent projet de loi (cf. infra), des observations auront été faites par le suspect ou la victime.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 23
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE D’URGENCE
1. Etat des lieux et diagnostic
En application des articles 13 et 224 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction est chargée de la discipline des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire.
La procédure disciplinaire devant la chambre de l’instruction est prévue par les articles 225 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi, lorsque l’activité d’un officier ou d’un agent de police judiciaire est mise en cause, la chambre de l’instruction peut être saisie soit à la demande du procureur général ou de son président, soit d’office. Elle fait alors procéder à une enquête et entend l’intéressé. Ce dernier doit, au préalable, avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister d’un conseil. Par la suite, et sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, la chambre de l’instruction peut lui adresser des observations, ou décider qu’il ne pourra exercer, temporairement ou définitivement, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur le territoire national, ses fonctions d’officier ou d’agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement et est notifiée aux autorités dont dépend l’officier ou l’agent de police judiciaire.
La procédure disciplinaire relevant de la chambre de l’instruction permet donc à cette dernière d’interdire à un officier ou un agent de police judiciaire d’exercer temporairement ou définitivement ses fonctions. Elle est d’ailleurs applicable aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Elle se distingue de la procédure disciplinaire dévolue au procureur général en application de l’article 38 du code de procédure pénale. En effet, les pouvoirs disciplinaires du procureur général ne s’exercent qu’à l’encontre des officiers de police judiciaire et sanctionnent uniquement l’habilitation de ces derniers. Ils constituent le pendant « sanction » du pouvoir d’habilitation du procureur général.
A cet égard, il peut être précisé que la procédure disciplinaire devant le procureur général se présente de la manière suivante : lorsqu’un officier de police judiciaire est mis en cause dans une enquête judiciaire ou administrative, le procureur général peut, en application des articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale, suspendre ou retirer son habilitation d’officier de police judiciaire en cas de manquement professionnel ou d’atteinte à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante.
Pour ce faire, l’officier de police judiciaire doit être préalablement entendu par le procureur général et peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d’un conseil. L’existence de la faute commise ainsi que sa gravité sont laissées à l’appréciation du procureur général. Il lui appartient d’estimer l’incidence éventuelle de celle-ci sur la capacité de l’officier de police judiciaire à exercer ses missions de manière satisfaisante. La décision de suspension ou de retrait d’une habilitation prend la forme d’un arrêté individuel motivé, qui est exécutoire de plein droit, nonobstant l’exercice de voies de recours. Par la suite, le procureur général peut à tout moment abréger la durée d’une suspension d’habilitation en application des articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale. Et deux voies de recours sont ouvertes à l’officier de police judiciaire faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’habilitation :
- en application des dispositions de l’article 16-1 du code de procédure pénale, dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de son habilitation, l’officier de police judiciaire peut saisir le procureur général afin de voir rapportée la décision. Celui-ci doit alors statuer dans le délai d’un mois. A défaut, son silence vaut décision implicite de rejet de la demande ;
- en application des dispositions de l’article 16-2 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire dispose ensuite d’un nouveau délai d’un mois, à compter de la décision précitée du procureur général, pour former un recours devant la Commission de recours en matière d’habilitation des officiers de police judiciaire près la Cour de cassation.
La procédure disciplinaire relevant du procureur général permet donc à ce dernier de sanctionner les habilitations qu’il délivre aux officiers de police judiciaire lorsqu’il leur est reproché des manquements professionnels ou des atteintes à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur leur capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante. Cette sanction présente un caractère temporaire dans la mesure où l’officier de police judiciaire dont l’habilitation est suspendue ou retirée peut dans le premier cas, la recouvrer à l’issue de la mesure de suspension, ou dans le second cas, solliciter une nouvelle habilitation.
En pratique, la procédure disciplinaire relevant de la chambre de l’instruction est peu mise en œuvre tant à l’encontre des officiers de police judiciaire, que des agents de police judiciaire.
Elle se juxtapose souvent aux procédures judiciaires relevant du procureur de la République et disciplinaires relevant de l’autorité administrative et il n’est pas rare d’observer un décalage temporel, parfois regrettable entre la mise en cause d’un officier ou d’un agent de police judiciaire pour des manquements professionnels ou des atteintes à l’honneur ou à la probité et la sanction prononcée par la chambre de l’instruction.
Or, il peut sembler nécessaire dans certaines hypothèses de sanctionner en urgence tout officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, agent de police judiciaire adjoint ou fonctionnaire ou agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire qui serait mis en cause pour des faits d’une particulière gravité, ce que la procédure prévue aux articles 225 et suivants du code de procédure pénale ne permet pas de satisfaire.
Le constat dressé et les difficultés recensées quant à la mise en œuvre des dispositions actuelles rendent nécessaire leur modification. S’agissant des articles 225 et suivants du code de procédure pénale, seul un texte législatif permet de les modifier.
Il est proposé de créer une procédure disciplinaire d’urgence à l’égard des personnels de police judiciaire afin de pouvoir les sanctionner sans délai lorsqu’il leur est reproché des faits d’une particulière gravité.
3.1 Option écartée
Il aurait pu être proposé d’étendre aux agents de police judiciaire la procédure disciplinaire applicable aux officiers de police judiciaire relevant du procureur général, plus souple que celle relevant de la chambre de l’instruction.
Toutefois, cette option a été écartée dans la mesure où elle aurait supposé de créer pour les agents de police judiciaire un dispositif d’habilitation semblable à celui existant pour les officiers de police judiciaire. Or, le très grand nombre d’APJ (au moins 150.000 personnes) rendrait irréaliste la création d’un tel dispositif.
Il n’est pas davantage apparu opportun de transférer au procureur général les pouvoirs de la chambre de l’instruction, au regard notamment de la gravité accrue des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard des agents et officiers de police judiciaire.
3.2 Option retenue
Il est proposé de créer une procédure disciplinaire d’urgence pour les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, dans les situations où la gravité des faits reprochés à ces derniers nécessite qu’ils soient immédiatement sanctionnés au niveau de l’exercice de leurs fonctions, pour une durée maximale d’un mois.
Cette procédure d’urgence pourra être mise en œuvre sur initiative du procureur général de la cour d’appel où l’intéressé exerce habituellement ses fonctions.
Le président de la chambre de l’instruction pourra suspendre, pour une durée maximale d’un mois, sans procédure contradictoire, l’exercice des missions de police judiciaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire lorsque des manquements graves à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante auront été constatés à son encontre.
Cette décision prendra effet immédiatement et sera notifiée par le procureur général aux autorités de l’intéressé.
La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général vaudra saisine de la chambre de l’instruction prévue par les articles 225 et suivants du code de procédure pénale.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1. Impacts juridiques
La modification envisagée s’accompagnera d’une modification des textes réglementaires du code de procédure pénale relatifs à la discipline des officiers de police judiciaire et notamment des articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale, pour prévoir une procédure similaire de suspension en urgence de l’habilitation délivrée par le procureur général.
4.2. Impacts sur les services judiciaires
La charge de travail des présidents de chambres de l’instruction sera augmentée, dans la mesure où une nouvelle compétence leur est dévolue.
Cette augmentation sera toutefois limitée dans la mesure où les hypothèses dans lesquelles des officiers ou des agents de police judiciaire sont mis en cause pour des faits d’une particulière gravité sont rares. Il en va de même pour les parquets généraux qui seront à l’initiative des saisines du président de la chambre de l’instruction.
En effet, comme le montrent les tableaux suivants, en 2015, l’activité disciplinaire de l’ensemble des procureurs généraux a représenté 39 suspensions et 34 retraits d’habilitation d’officier de police judiciaire. Pour la chambre de l’instruction, seules 5 saisines ont été recensées. Elles ont concerné uniquement des agents de police judiciaire et ont conduit à 5 interdictions temporaires d’exercer des fonctions de police judiciaire.
CA répondantes |
34 (91,9%) |
|||||||
Nombre total d'OPJ fin 2015 |
64 488 |
|||||||
-> Autorité de compétence : Procureur Général |
||||||||
Procureur Général |
||||||||
Nombre total de suspensions d'habilitation OPJ |
39 |
|||||||
Nombre total de retraits d'habilitation OPJ |
34 |
|||||||
-> Autorité de compétence : Chambre de l'Instruction |
||||||||
Chambre de l'Instruction |
||||||||
Nombre total de saisines de la CI en application des articles 224 et suivants |
5 | |||||||
dont OPJ |
0 | |||||||
dont APJ |
5 | |||||||
dont APJA |
0 | |||||||
dont agents de police municipale |
0 | |||||||
dont autres agents |
0 | |||||||
Nombre total de décisions adressant des observations |
0 | |||||||
dont OPJ |
0 | |||||||
dont APJ |
0 | |||||||
dont APJA |
0 | |||||||
dont agents de police municipale |
0 | |||||||
dont autres agents |
0 | |||||||
Nombre total de décisions d'interdiction temporaire d'exercer des fonctions de PJ |
5 | |||||||
dont OPJ |
0 | |||||||
dont APJ |
5 | |||||||
dont APJA |
0 | |||||||
dont agents de police municipale |
0 | |||||||
dont autres agents |
0 | |||||||
Nombre total de décisions d'interdiction définitive d'exercer des fonctions de PJ |
0 | |||||||
dont OPJ |
0 | |||||||
dont APJ |
0 | |||||||
dont APJA |
0 | |||||||
dont agents de police municipale |
0 | |||||||
dont autres agents |
0 | |||||||
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 24
RENFORCEMENT DES GARANTIES A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE
1. Etat des lieux et diagnostic
L’enquête peut être définie comme « l’ensemble des actes effectués par la police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, avant toute décision sur la poursuite, aux fins de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » (Traité de procédure pénale, Desportes Lazerges-Cousquer, Economica, 2015, n° 1526).
Cette définition découle à la fois de l’article 14 du code de procédure pénale, qui définit la mission de la police judiciaire et des articles 12, 41,53 et 77-3 fixant le rôle du procureur de la République.
Les enquêtes peuvent être juridiquement classées en plusieurs catégories, en faisant l’objet de trois distinctions.
La distinction principale et traditionnelle est celle de l’enquête préliminaire et de l’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance, qui est prévue par les articles 53 à 73, n’est possible qu’en cas de constatation d'une infraction flagrante (art. 53 CPP), lorsqu’il s’agit d’un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement (art. 67 CPP). Sa durée est limitée à huit jours, durée qui peut être doublée par le procureur de la République dans certains cas. Elle est caractérisée par des pouvoirs de coercition plus élevés, notamment en cas de perquisition.
L'enquête préliminaire, qui est en réalité l’enquête de droit commun lorsque les conditions de la flagrance n’existent pas ou n’existent plus, est régie par les articles 75 à 78.
Il existe une distinction secondaire entre l’enquête sur instructions du parquet (art. 75 et 75-1) et l’'enquête d'initiative ou enquête d'office (art. 75 et 75-1, al.2)
Enfin, il existe une distinction récente datant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, entre l’enquête de droit commun et l’enquête concernant la criminalité et la délinquance organisées (art. 706-73 et s. CPP) qui donne plus de pouvoirs aux enquêteurs.
L’un des principales caractéristiques communes aux différentes enquêtes est son caractère non contradictoire, qui l’oppose à l’instruction.
Les personnes faisant l’objet d’une enquête, comme mis en cause ou victime, n’ont ainsi, contrairement à ce qui existe pour le mis en examen, le témoin assisté ou la partie civile au cours d’instruction, pas le droit par eux-mêmes ou leurs avocats, d’avoir accès à l’ensemble du dossier de la procédure, de pouvoir faire des demandes d’actes ou de nullité ou de contester les décisions prises au cours de l’enquête.
Cette absence traditionnelle du caractère contradictoire de l’enquête s’est toutefois atténuée à l’occasion de différentes réformes.
L’article 60 dernier alinéa, permet ainsi depuis 1999 au procureur de la République de communiquer aux suspects ou aux victimes le résultat des examens techniques, c’est-à-dire des expertises réalisées au cours de l’enquête.
Les articles 77-1 et 77-2 permettent, depuis janvier 2001, à une personne ayant été gardée à vue puis libérée six mois auparavant d’interroger le procureur sur l’état de l’enquête. Il n’est toutefois plus prévu que la poursuites de l’enquête doive alors être autorisée par le juge des libertés et de la détention, cette exigence ayant été supprimée en 2002.
L’article 706-105 prévoit, depuis 2004, que dans les enquêtes en matière de délinquance ou de criminalité organisée qui se prolongent plus de six mois après une garde à vue, la personne gardée à vue puisse demander à ce que son avocat ait accès au dossier avant de nouvelles auditions.
Par ailleurs, en cas de garde à vue, depuis de nombreuses réformes intervenues à partir de 1999, puis en cas d’audition libre depuis la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, la personne suspecte peut être assistée lors de son audition par un avocat, qui a accès à certaines pièces de la procédure.
Depuis cette même loi, en cas de défèrement à l’issue de l’enquête, une phase contradictoire est prévue par l’article 393 du code de procédure pénale avant que le procureur ne prenne sa décision sur l’action publique.
Cet article prévoit en effet, que l'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et que l'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.
Le caractère non contradictoire ou très peu contradictoire de l’enquête, spécialement dans les enquêtes longues et complexes, soulève depuis des années d’importantes critiques aux regard notamment de l’exigence de procès équitable posée par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il n’a toutefois donné lieu à aucune condamnation de la France par la Cour de Strasbourg, ni par la Cour de cassation (hors le cas de la question spécifique des droits de la personne gardée à vue).
En particulier, la Cour de cassation considère que l’absence d’accès au dossier ne prive pas d’un procès équitable, puisque que cet accès est garanti devant les juridictions d’instruction ou de jugement (Crim., 26 juin 2013, n° 13-81491, Bull. Crim. n°164). .
De même la Cour européenne des droits de l’homme, dissipant les interrogations qui avaient pu résulter de certains arrêts (tel que CEDH 13 octobre 2009, Dayanan c/Turquie) n’impose pas la mise à disposition du dossier, dès le premier interrogatoire de police (CEDH 9 avril 2015, ATC/ Luxembourg).
Il demeure que la question reste ouverte pour les enquête longues et complexes, lorsque celle-ci donnent lieu directement à la saisine de la juridiction de jugement.
C’est notamment pourquoi le rapport Nadal de novembre 2013 sur le ministère public préconise « d’introduire une phase de contradictoire à l’issue des enquêtes longues ».
L’objectif poursuivi par le projet de loi est d’instaurer une phase contradictoire à l’issue des enquêtes longues, dans des conditions qui ne viennent pas complexifier de façon excessive le déroulement des procédures et amoindrir par la même leur efficacité.
Cette réforme est rendue nécessaire non seulement pour prévenir d’éventuelles condamnations par la CEDH mais aussi pour renforcer la cohérence de notre procédure, puisqu’actuellement cette phase contradictoire existe, mais uniquement en cas de défèrement.
Il convient par ailleurs de préserver le rôle du procureur directeur d’enquête, au regard de la clarification de son rôle résultant de l’article du projet de loi, sans confondre les attributions de celui-ci avec celles des juges du siège et notamment, celle du juge des libertés et de la détention.
Il est ainsi proposé d’instituer une phase contradictoire dans les enquêtes complexes durant plus d’un an, sur demande des personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’audition libre, de garde à vue, ou de saisie de leurs biens, ou sur demande de leurs avocats, cette demande pouvant être faite au procureur de la République six mois après cette mesure.
Avant de prendre sa décision sur l’action publique, ce magistrat sera alors tenu de communiquer à ces personnes, ainsi qu’à la victime, l’intégralité du dossier de la procédure, pour recevoir leurs observations et leurs éventuelles demandes d’actes. Cette communication du dossier et ce recueil d’observations pourra également intervenir à tout moment en cours de procédure, même en l’absence de demande, à l’initiative du procureur.
Cette procédure sera prévue par les articles 77-2 et 77-4, qui viendront remplacer les dispositions existantes, peu employées et peu utiles en pratique.
Le nouvel article 77-2 dispose ainsi que lorsqu’une enquête sera en cours depuis au moins un an, toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158, pourra, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.
Sauf s’il décidede, l’ouverture d’une information ou s’il fait application des dispositions de l’article 393 sur le défèrement contradictoire, lorsqu’il estimera que le dossier de l’enquête est communicable, le procureur de la République avisera la personne ou son avocat de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois. Il avisera alors également la victime de ce droit.
Pendant ce délai d’un mois, le procureur ne pourra prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393.
Si le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci devra être informée, au moins dix jours avant cette audition, qu'elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier sera alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne.
Même en l’absence de demande dans le délai de six mois, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
Les observations de la personne ou de son avocat, qui seront versées au dossier de la procédure, pourront notamment porter (de façon similaire à celles prévues en cas de défèrement par l’article 393) sur la régularité de la procédure, sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et comporter le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le procureur de la République appréciera les suites devant être apportées à ces observations, conformément aux principes exposés par lenouvel article 39-3, qui demande au procureur de rechercher la vérité et d’enquêter à charge et à décharge. Il en informera les personnes concernées. Ses décisions ne pourront faire l’objet d’un recours, de la même façon qu’aucun recours n’est possible contre celle prise à l’issue d’un défèrement.
L’article 77-3 précise, quant à lui, que la demande mentionnée à l’article 77-2 sera faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés à cet article a été réalisé, ce magistrat devant alors adresser sans délai la demande au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Ces dispositions sont très similaires à celles de l’actuel article 77-3.
3.1 Options écartées
Plusieurs options ont été écartées car elles aboutissaient à un déséquilibre manifeste de la procédure :
- Rendre la procédure contradictoire systématique, dans toutes les enquêtes ;
- Laisser au seul procureur le soin de décider ou non du recours à la procédure contradictoire à l’issue de l’enquête ;
- Rendre la procédure contradictoire systématique dans les enquêtes de plus d’un an, même en l’absence de demande des intéressés ;
- Placer la procédure contradictoire sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui aurait été le juge du recours contre les décisions du procureur.
3.2 Options retenues
- Procédure contradictoire obligatoire pour les enquêtes de plus d’un, à la demande de la personne ayant fait l’objet d’un acte depuis au moins six mois ;
- Hors cette hypothèse, possibilité pour le procureur de recourir à la procédure contradictoire.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1. Impacts sur les services judiciaires
Les impacts pour les parquets et les greffes sont difficilement quantifiables, car le Gouvernement ne dispose d’aucune statistique sur la durée des enquêtes.
L’évaluation de cette durée ne peut faire l’objet que d’une estimation indirecte et très imparfaite à partir des statistiques sur les délais écoulés entre la date des faits (nécessairement antérieur au début de l’enquête), et la date du 1er jugement correctionnel (nécessairement postérieur à la fin de l’enquête). Les délais d’audiencement en cas de poursuites d’une personne libre étant d’au minimum 3 mois après l’issue de l’enquête, les statistiques faisant état d’une durée globale de procédure d’au moins 15 mois peuvent servir de base à l’estimation.
Détail des délais de procédure de 15 mois et plus selon la peine prononcée pour les condamnations au tribunal correctionnel (hors le cas de détention provisoire)
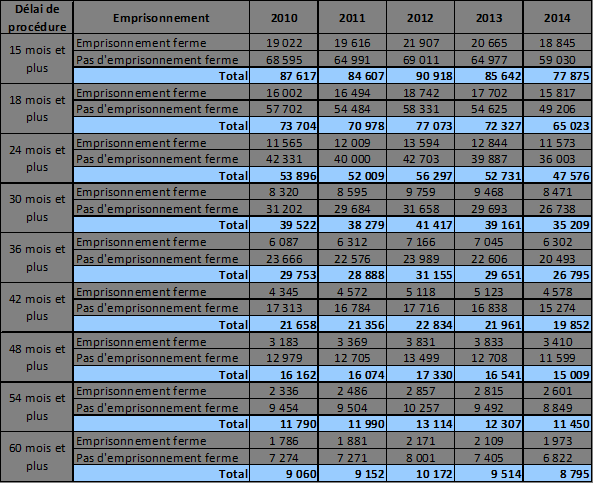
Source: CJN
En pratique, si on considère que les dispositions de l’article 77-2 ont vocation à s’appliquer dans des affaires qui, majoritairement, ne donneront pas lieu à des peines fermes, on peut extrapoler à partir des chiffres concernant des procédures ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement avec sursis ou des peines autres que l’emprisonnement.
S’agissant d’affaires complexes, les délais d’audiencement seront plus proches de 6 mois ou d’un an que de trois mois, d’autant que ces dossiers peuvent donner lieu à des renvois avant jugement.
On peut ainsi estimer que c’est dans une partie de 36 000 procédures ayant donné lieu à une condamnation autre que l’emprisonnement ferme plus de deux ans après les faits qu’ont eu lieu des enquêtes de plus d’un an susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 77-2.
Par ailleurs, en pratique, c’est très vraisemblablement dans moins de la moitié de ces procédures, donc dans 18 000 enquêtes, que des personnes auront été entendues, librement ou en garde à vue, ou auront fait l’objet d’une perquisition, six mois avant la décision de poursuites du parquet.
En effet, dans la plupart des cas, la durée de l’enquête résulte soit du fait que les premiers actes ont débutés tardivement, en raison de l’encombrement des services enquêteurs, soit que la première mise en cause d’un suspect n’est intervenue que tardivement.
Enfin, il est très vraisemblable que ce n’est que dans une faible part de ces 18 000 enquêtes que les personnes suspectées, susceptible de former la demande prévue par l’article 77-2, le feront effectivement. Le fait que les dispositions de l’article 706-107 ne sont en pratique pas appliquées, de même que celles de l’actuel article 77-2 (permettant à une personne gardée à vue depuis plus de six mois d’interroger le procureur), conforte cette analyse (même si les dispositions du nouvel article 77-2 présenteront, à la différence de celles de l’actuel article, un intérêt réel pour l’exercice des droits de la défense). Une personne qui n’est pas à nouveau l’objet d’actes d’enquête la concernant personnellement est du reste logiquement réticente à demander au procureur où en est la procédure la concernant.
On peut dès lors estimer que c’est dans largement moins de 10 % de ces 18 000 enquêtes, principalement dans des dossiers portant sur des affaires économiques ou financières, que des demandes seront formées en application de l’article 77-2, soit dans quelques centaines de procédures par an.
En tout état de cause, il convient d’observer que la réforme ne fait que déplacer en amont la phrase contradictoire de la procédure et notamment, l’accès au dossier, qui intervient en tout état de cause dès que les poursuites sont engagées.
4.2. Impacts sur les services enquêteurs
Cette modification législative n’aura aucun impact direct sur les services d’enquête, sauf lorsque le procureur leur demandera de procéder à de nouveaux actes à la suite des observations qu’il aura reçues, mais de telles instructions de complément d’enquête sont déjà possibles et fréquentes.
Il convient de noter que les observations seront faites au procureur et non directement aux enquêteurs et que la consultation du dossier se fera dans les locaux de la juridiction et non dans ceux des services d’enquête.
4.3. Impacts sur les particuliers
La réforme améliore les droits des justiciables – suspect et victimes - en leur permettant de faire valoir leur point de vue avant l’engagement des poursuites.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (modifications significatives dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, qui nécessitera des développements).
Ces évolutions seront disponibles au plus tard pour le premier trimestre 2017 et leur coût est estimé entre 50 et 220 K€.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 25
RENFORCEMENT DES GARANTIES AU COURS DE L’INSTRUCTION EN MATIERE D’INTERCEPTIONS DE COMMUNICATIONS
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 L’interception de communications au cours d’une procédure d’instruction est régie par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale. Elle n’est possible que pour l’instruction des crimes et des délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement.
La décision d’interception ne peut être prise que par le juge d’instruction. Elle doit être écrite, identifier précisément la ligne téléphonique concernée et préciser la durée de l’écoute, qui ne peut excéder quatre mois. Elle peut toutefois être indéfiniment renouvelée, sous les mêmes conditions de forme et de durée.
Les conversations utiles à la manifestation de la vérité sont retranscrites sous le contrôle du juge d’instruction. A peine de nullité, ne peuvent être retranscrits les échanges entre une personne et son avocat relevant de l’exercice des droits de la défense – sauf à ce qu’ils révèlent la participation du conseil à la commission d’une infraction – ni ceux permettant d’identifier la source d’un journaliste.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur, sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé, sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sans que le bâtonnier en soit informé, sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile, sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
S’il ne s’est jamais prononcé sur la constitutionnalité des interceptions ordonnées au cours de l’instruction, le Conseil constitutionnel a néanmoins pu préciser les garanties générales requises en la matière dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, relative notamment aux interceptions ordonnées par le juge des libertés et de la détention lors des enquêtes ouvertes en matière de délinquance organisée. Après avoir rappelé qu’il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés », il considère le régime satisfaisant, dès lors que les écoutes « doivent être exigées par les besoins de l'enquête et autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République ; que cette autorisation est délivrée pour une durée maximale de quinze jours, qui n'est renouvelable qu'une fois, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ».
Il convient d’observer que le Conseil a validé les écoutes lors de l’enquête au motif notamment qu’elles sont limitées dans le temps, ce qui n’est pas le cas des écoutes au cours de l’instruction.
1.2 Adopté avec la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme9, le régime actuel des interceptions de communications ordonnées par le juge d’instruction pourrait aujourd’hui apparaître insuffisamment protecteur eu égard à l’évolution des exigences européennes et de la législation pénale.
Ces exigences sont résumées dans un considérant de la CEDH dans son arrêt Uzun c/ Allemagne du 2 septembre 2010 :
« 65. Quant à la prévisibilité de la loi et à sa compatibilité avec la prééminence du droit, la Cour note d’emblée que dans ses observations le requérant s’appuie fortement sur les garanties minimales contre les abus que la loi doit renfermer d’après sa jurisprudence relative à l’interception de télécommunications. Conformément à ces critères, la loi doit définir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la durée maximale de l’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements (Weber et Saravia, décision précitée, § 95, avec d’autres références). »
Mais dans l’arrêt Uzun, la CEDH n’impose pas d’exigences nouvelles : elle insiste sur le fait que la géolocalisation était prévue par la loi, n’a pas été fait d’emblée mais après plusieurs autres investigations. Elle note de surcroît que la mesure a été de courte durée et a concerné une infraction particulièrement grave. Elle en conclut que la mesure était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2. Il est donc difficile d’en tirer des exigences précises en matière d’écoutes téléphoniques, autres que les garanties procédurales applicables doivent assurer leur caractère nécessaire et proportionné, ce qui exige notamment de limiter leur durée totale.
Des améliorations peuvent dès lors être envisagées concernant les modalités selon lesquelles elles peuvent être ordonnées, la limitation de leur durée et la protection spécifique devant être accordée à certaines professions.
1) Sur la limitation du domaine d’application des interceptions de communication
La CEDH n’impose pas de seuil minimum en terme d’infraction - ainsi elle admet des écoutes d’un avocat pour violation du secret de fonction (arrêt Kopp c/Suisse du 25 mars 1998) , des perquisitions dans un cabinet d’avocat pour insulte à magistrat (arrêt Niemietz c/ Allemagne du 16 décembre 1992) même si, de façon générale, elle veille dans son contrôle in concreto à la proportionnalité d’une ingérence étatique avec l’infraction poursuivie (ex en matière de perquisition d’un journal, elle avait noté qu’il ne s’agissait que de l’infraction de violation du secret de l’instruction et avait censuré la perquisition comme disproportionnée (arrêt Ressiot c/ France du 28 juin 2012).
Notre droit ne permettant les écoutes qu’en cas de crime ou délit puni d’au moins deux ans – ce qui n’est pas le cas de la violation du secret de l’instruction, puni d’un an d’emprisonnement - il n’est dès lors ni nécessaire, ni opportun de modifier ces seuils.
2) Sur la limitation de la durée des interceptions de communication
Même si la Cour européenne des droits de l'homme n’impose pas et n’apprécie pas la durée maximale d’écoutes -tout dépend de la complexité de l’affaire (arrêt KENNEDY c/ Royaume Uni 2010) -, elle veille à ce que la loi ou la jurisprudence prévoient des durées.
D’une façon générale, il est donc évident qu’en application du principe conventionnel de proportionnalité des atteintes à la vie privée qui se déduit de l’article 8 de la Convention, l’interception d’un individu qui se prolongerait trop longtemps serait nécessairement considérée comme irrégulière.
Afin de sécuriser davantage le dispositif, il paraît donc nécessaire de limiter dans la loi la durée des interceptions, en fixant une durée maximale d’un an, tout en prévoyant qu’à l’issue de ce délai et pour les infractions commises en bande organisée, leur prolongation soit autorisée, dans les mêmes conditions, par le juge des libertés et de la détention.
3) Sur la protection spécifique de certaines professions
La Cour européenne des droits de l'homme impose, quand il s’agit de certaines professions (journalistes, avocats…) des garanties procédurales particulières et renforcées (information ou présence d’un représentant de l’ordre des avocats, exclusion des correspondances entre un client et son avocat relatives à l’exercice des droits de la défense) et exige que l’atteinte au secret professionnel ne soit pas disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans l’arrêt Niemetz c/ Allemagne, elle estime ainsi que les saisies doivent être très limitées en cas de perquisition.
Dans l’arrêt Kopp c/ Suisse du 25 mars 1998 sur les interceptions téléphoniques d’un avocat, la Cour est assez exigeante sur les garanties de prévisibilité que doit avoir la loi en la matière. Si elle n’interdit pas les interceptions téléphoniques d’un avocat, elle semble imposer, au nom des droits de la défense, que, lors d’une écoute téléphonique, le tri entre ce qui relève de la relation avocat-client couverte par le secret professionnel et le reste des conversations soit opéré par un magistrat indépendant.
1.3 Statistiques concernant l’évolution du recours aux interceptions téléphoniques :
A partir des réponses fournies par les opérateurs de communications électroniques les chiffres suivants peuvent être donnés :
Nombres d’interceptions :
Année 2006 : 20 483
Année 2007 : 21 977
Année 2008 : 26 056
Année 2009 : 29 267
Année 2010 : 31 801
Année 2011 : pas de chiffre connu
Année 2012 : 35 001
Année 2013 : 47 545
Année 201410 : 47 507.
Durée moyenne :
Année 2006 = 48 jours
Année 2012 = 56 jours.
2.1 Instituer une exigence de motivation des décisions
L’article 100-1 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que les décisions du juge d’instruction ordonnant l’interception de communications doivent être motivées.
Cette motivation permet d’assurer que seules les écoutes nécessaires seront ordonnées et de faciliter leur contrôle juridictionnel.
2.2 Limiter la durée maximale des interceptions
Tout en maintenant à quatre mois la durée maximale de la décision initiale, l’article 100-2 est modifié pour prévoir que l’écoute d’une même ligne téléphonique ne puisse désormais excéder une année.
Toutefois, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit commis en bande organisée prévu à l’article 706-73, la durée totale de l’interception pourra atteindre deux ans.
2.3 Renforcer la protection des professions protégées
L’article 100-7 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que les interceptions concernant la ligne d’un parlementaire, d’un avocat ou d’un magistrat ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles laissant penser que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction.
Le juge d’instruction devra par ailleurs communiquer une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, selon les cas, soit au président de l’assemblée nationale ou du Sénat, soit au bâtonnier, soit au premier président ou au procureur général.
Le maintien du droit existant
Il n’existe certes aucune décision judiciaire ayant déclaré les dispositions encadrant les interceptions de communications ordonnées par un juge d’instruction contraires aux exigences conventionnelles ou constitutionnelles.
Néanmoins, il apparaît nécessaire de moderniser un régime adopté il y a vingt-cinq ans, afin de tenir compte de l’élévation du niveau d’exigence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de proportionnalité des atteintes à la vie privée.
Une limitation du domaine des interceptions
Afin d’améliorer les garanties de proportionnalité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction, il était envisageable de limiter leur domaine d’application, d’une part en rehaussant le seuil de peine encourue permettant d’y recourir, d’autre part en interdisant purement et simplement la mise sur écoute de certains professionnels, tels les avocats.
Ces restrictions apparaissent excessives au regard de l’objectif constitutionnel d’élucidation des infractions. En outre, instituer une forme d’immunité au profit de certaines profession s’avère contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Le choix a été fait de renforcer l’encadrement des interceptions de communication, en exigeant une décision motivée du juge d’instruction, en limitant dans le temps les écoutes et en confiant à un juge extérieur à l’enquête le pouvoir d’ordonner l’interception des communications d’un avocat, d’un magistrat ou d’un parlementaire.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1 Impacts sur les services judiciaires
En leur conférant de nouvelles attributions, la présente réforme est de nature à accroître la charge de travail des juges des libertés et de la détention. Toutefois, cet impact sera très limité car les écoutes concernant des avocats, des parlementaires ou des magistrats sont exceptionnelles.
4.2 Impacts sur les justiciables
En améliorant les garanties de proportionnalité des interceptions de communication, la présente réforme est de nature à renforcer l’effectivité du droit à la protection de la vie privée du citoyen.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, qui nécessitera des développements). Ces évolutions seront disponibles avant la fin de l’année 2016 et leur coût est estimé à environ 50 K€.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 26
RENFORCEMENT DES GARANTIES EN MATIERE DE DÉTENTION PROVISOIRE
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 Etat des lieux et difficultés concernant l’article 179 du code de procédure pénale
Dans ses rapports annuels de 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, la Cour de cassation demande une clarification législative des délais sanctionnés par la mise en liberté, notamment en cas de décision de renvoi devant le tribunal correctionnel prise en application de l’article 179 du code de procédure pénale.
Elle indique que « la question de l’incidence de voies de recours irrecevables sur la computation des délais qui continuent de courir se pose avec le plus d’acuité. On observe en effet une tendance forte à voir frapper d’appel, puis de pourvoi, des décisions de renvoi devant une juridiction de jugement correctionnelle, en principe non susceptibles de recours, sauf cas particuliers (ordonnances mixtes ou statuant sur la compétence). »
La réforme demandée consiste à traduire législativement les solutions arrêtées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 février 2014 (n° 13-87.372, Bull. crim n° 36 et 13-87.897, Bull. crim. n°37).
Dans le premier arrêt, la Chambre criminelle a jugé que la chambre de l’instruction qui statue sur appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) n’était pas soumise aux règles gouvernant la durée de la détention provisoire pendant l’instruction. En effet, le juge s’est dessaisi par son ORTC. Quant au délai de comparution devant la juridiction de jugement dans le délai de deux mois (art. 179 al. 4 du code de procédure pénale), il ne saurait commencer à courir, alors que l’ORTC n’est pas définitive du fait de l’appel interjeté.
Dans le second arrêt, elle a jugé que si le parquet, par prudence, a fait comparaître la personne devant la juridiction de jugement pour voir sa détention provisoire prolongée de deux mois, cette juridiction n’était compétente à aucun titre, l’ORTC n’étant pas définitive.
Dans ces circonstances, le seul délai restant applicable est le délai raisonnable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il pourrait donc être utile d’enfermer le déroulement de la procédure dans des délais mieux précisés.
1.2 Etat et difficultés concernant les articles 148-2 et 194 du code de procédure pénale
Dans son rapport pour 2014, la Cour de cassation rappelle que la chambre criminelle ayant connu de situations à l’occasion desquelles des demandes de mise en liberté avaient fait l’objet d’un examen par la juridiction de renvoi, alors qu’un délai important s’était écoulé depuis des arrêts de cassation et qu’il avait été proposé au Rapport 201311 de compléter les articles 148-2 et 194 du code de procédure pénale afin de rendre applicables les délais prévus par ces dispositions aux cas dans lesquels doit statuer une juridiction saisie sur renvoi après cassation par la chambre criminelle. Il était aussi suggéré de prévoir une fixation du point de départ de ces délais à la date de réception par la juridiction de renvoi de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. Un parallélisme serait ainsi établi avec le point de départ du délai imposé à la chambre criminelle par l’article 567-2 du code de procédure pénale pour statuer sur un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire.
Il peut être observé que la question a fait l’objet de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015 (décision n° 2014-446 QPC), décision ayant déclaré conforme l’article 194 du code de procédure pénale, sous la réserve que l’examen par la juridiction de renvoi doit intervenir dans les délais les plus brefs.
Cette validation ne remet toutefois pas en cause l’opportunité d’une modification législative, elle la rend au contraire plus justifiée, compte tenu de la notion floue de « délais les plus brefs ».
1.3 Etat et difficultés concernant l’article 199 du code de procédure pénale
Dans ses rapports 2013 et 2014, la Cour de cassation observe que lorsque la chambre de l’instruction statue sur l’appel du ministère public à la suite d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière à l’audience n’est pas prévue comme étant de droit à l’article 199 du code de procédure pénale. Ainsi, si le président de la chambre de l’instruction n’a pas ordonné la comparution personnelle du mis en examen, il n’est pas fait obligation à la chambre de permettre à celui-ci, avisé de la date d’audience et qui se présente, d’y assister et d’y présenter ses observations.
Elle a proposé en conséquence12, pour un plein respect des droits de la défense et du principe du procès équitable, que la comparution personnelle soit de droit si l’intéressé ou son avocat en fait la demande.
Les présentes dispositions ont pour objectif de répondre aux demandes formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels et de tirer les conséquences de plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation.
Elles procèdent à plusieurs modifications du code de procédure pénale qui ont une incidence directe ou indirecte en matière de durée de détention provisoire.
Elles fixent le délai - de deux mois - dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le renvoi d’un dossier devant le tribunal correctionnel (art. 186-4), et le délai - de trois mois - dans lequel la chambre criminelle doit statuer en cas de pourvoi (art. 574-1), ce qui consacre la jurisprudence (Crim., 18 août 2010, n°10-83656, Bull. crim. n°125) tout en comblant une lacune de notre droit, puisque ces délais ne sont aujourd’hui prévus qu’en cas de renvoi devant la cour d’assises.
Elles prévoient par cohérence que le délai de deux mois dans lequel, en cas d’ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel doit statuer court à compter, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel non frappé de pourvoi (art. 179).
Elles précisent qu’en cas d’appel – et le cas échéant de pourvoi – les délais de détention provisoire relatifs au déroulement de l’information ne s’appliquent plus (art. 186-5) - ce qui consacre la jurisprudence (Crim., 5 février 2014, n°13-87.372 et n°13-87.897, Bull. crim. n°36 et 37) - puisque s’appliquent désormais les délais de deux mois d’examen de l’appel et de trois d’examen du pourvoi.
Elles précisent également qu’en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction, si la chambre criminelle casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre chambre, la juridiction de renvoi devra alors statuer dans les mêmes délais que ceux qui étaient impartis à la première chambre saisie (art. 194-1). Cette précision tire donc les conséquences de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, qui a considéré que le fait que les dispositions de l’article 194, (prévoyant que la chambre de l’instruction, doit, en matière de détention provisoire, statuer dans les 15 jours ou les 20 jours de l’appel) ne fixait pas actuellement de délai dans cette hypothèse n’était pas contraire à la Constitution, mais que la chambre de renvoi devait alors statuer dans les délais les plus brefs. Il est toutefois prévu que, en cas de demande de comparution personnelle du mis en examen devant la chambre, l’augmentation de ces délais, actuellement de cinq jours, sera portée à dix jours (art. 199).
Elles prévoient enfin qu’en cas d’appel d’une décision de refus de mise en liberté, la personne doit être avisée de l’audience et peut comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction (art. 199).
Il convient d’observer que ces dispositions avaient déjà été adoptées par amendement par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit européen, avant d’être censurées comme cavalier par le Conseil constitutionnel.
Il aurait été possible de ne pas réglementer le délai d’examen des demandes de mise en liberté après une décision de cassation, en laissant à la chambre criminelle le soin de modifier sa jurisprudence pour déclarer elle-même que les délais initialement prévus recommencent à courir. Cette évolution jurisprudentielle était d’autant plus envisageable et possible que dans sa décision QPC du 29 janvier 2015 le Conseil constitutionnel n’a pas censuré l’article 194 du code de procédure pénale.
Il a cependant paru préférable de modifier la loi en inscrivant cette règle dans le code, non seulement dans un souci de sécurité juridique, mais également parce que cela permet de préciser que dans un tel cas, si la personne avait demandé sa comparution personnelle, les délais seront augmentés non pas simplement de cinq jours, mais de dix jours. Ce délai plus long est effet justifié par le fait que la chambre de l’instruction de renvoi peut être plus éloignée du lieu de détention que la chambre initialement saisie, et qu’il doit donc être tenu compte des délais nécessaires pour organiser le transfèrement de la personne.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces différentes dispositions constituent à la fois un renforcement des garanties en matière de détention, mais également une sécurisation des règles applicables dans un domaine très sensible, susceptible de donner lieu à des erreurs procédurales.
En répondant à des demandes des praticiens, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, elles sont ainsi de nature à éviter de telles erreurs, qui peuvent avoir pour conséquences la remise en liberté de personnes détenues dangereuses.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (modification des règles de gestion dans le système d’information pénal, Cassiopée- première instance et du module Cour d’appel et Cour d’assise (CACASS) et au niveau des échanges inter-applicatifs).
Ces évolutions seront disponibles au plus tard d’ici la fin de l’année 2016 pour les échanges inter-applicatifs et au premier semestre 2017 pour le module CACASS. Leur coût devrait être limité.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 27
RENFORCEMENT DES GARANTIES EN CAS DE GARDE À VUE A LA SUITE D’UNE ARRESTATION EN MER
1. Etat des lieux et diagnostic
Lorsque l’Etat exerce ses pouvoirs de police en mer, les personnes se trouvant à bord d’un navire suspect peuvent être placées sous des régimes de contrainte prévus par les articles L. 1521-11 à L. 1521-15 du code de la défense et faire l’objet de mesures de coercition, de restriction ou de privation de liberté. La mise en œuvre de ces mesures est laissée à la libre appréciation du commandant du navire.
La prolongation au-delà de quarante-huit heures, des mesures de restriction ou de privation de liberté suppose toutefois une autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce juge peut autoriser la prolongation de ces mesures pour une durée de cinq jours renouvelable.
L’article L. 1521-18 du code de la défense précise que, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. Leur arrivée sur le sol français permet à l’autorité judiciaire de mettre en œuvre, le cas échéant, les règles de procédure pénale aux fins de recherche et de constatation des infractions et d’identification de leurs auteurs, et notamment la garde à vue à l’encontre de ces personnes lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement. Cette mesure de garde à vue peut par conséquent succéder à une mesure de coercition prévue par le code de la défense.
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c/ France et Hassan et autres c/ France) a sanctionné la France pour violation de l’obligation de traduction du suspect arrêté ou détenu à un juge prévue à l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dans ces arrêts, la CEDH a considéré qu’aucune circonstance exceptionnelle ne s’opposait à la présentation des suspects à un juge dès leur arrivée sur le sol français après avoir subi une durée de privation de liberté de plusieurs jours en mer. Il convient de rappeler par ailleurs, que la CEDH n’assimile pas le procureur de la République à un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, faute pour ce dernier de remplir l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif (CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/ France).
La présente mesure vise à mettre notre droit en conformité avec les exigences posées par la CEDH en prévoyant que les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de coercition en mer sont présentées dans les plus brefs délais au juge des liberté et de la détention sur réquisitions du parquet ou, dans l’hypothèse d’une ouverture d’information judiciaire, au juge d’instruction, qui peut ordonner leur remise en liberté.
3.1 Options écartées
Il aurait pu être envisagé de ne plus placer en garde à vue les personnes à l’issue d’une mesure de coercition en mer. Cette option a été écartée pour plusieurs raisons.
D’une part, la garde à vue constitue une mesure coercitive contribuant à l’efficacité des enquêtes et dont il apparaît difficile de se priver dans tous les cas, y compris s’agissant de faits particulièrement graves comme, par exemple, des faits de piraterie maritime ou de trafics de stupéfiants.
D’autre part, la garde à vue permet de garantir le maintien de la personne soupçonnée à la disposition de la justice et apparaît particulièrement indiquée s’agissant de personnes arrêtées en haute mer qui sont souvent des ressortissants étrangers ne disposant pas de garanties suffisantes de représentation. La fin des gardes à vue aurait probablement conduit les parquets à ouvrir des informations judiciaires dès l’arrivée des personnes sur le territoire national aux fins de leur mise en examen et leur placement en détention provisoire sans que le juge d’instruction puisse disposer d’éléments recueillis par les officiers de police judiciaire figurant dans la procédure.
A l’inverse, il aurait pu être envisagé de prévoir une présentation obligatoire de toute personne ayant fait l’objet d’une mesure de coercition en mer devant le juge des libertés et de la détention sous le contrôle duquel cette mesure s’est déroulée. Cependant, cette solution n’apparaissait pas adaptée dans la mesure où toute mesure de coercition n’est pas motivée par la commission d’infractions pénales et que toutes les personnes ainsi retenues n’ont pas vocation à être remises à l’autorité judiciaire française.
3.2 Option retenue
La solution retenue prévoit que les personnes placées en garde à vue à l’issue d’une mesure de coercition en mer sont présentées dans les plus brefs délais au juge des libertés et de la détention sur réquisitions du parquet ou, dans l’hypothèse d’une ouverture d’information judiciaire, au juge d’instruction, qui peut ordonner leur remise en liberté. Les dispositions du code de la défense sont complétées en ce sens.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les modifications législatives envisagées permettront de placer en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire national les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, notamment pour des actes de piraterie maritime, après avoir fait l’objet d’une mesure de coercition en mer.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, création d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée), ce qui nécessitera des développements. Ces évolutions seront disponibles au plus tard au premier trimestre 2017 et leur coût devrait être d’environ 25 K€.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ce que prévoit l’article 34.
Il est nécessaire de codifier l’applicabilité outre-mer de la modification de l’article L. 1521-18 du code de la défense en y introduisant le texte compteur dans les articles L. 1641-1 (WF), L. 1651-1 (PF), L. 1661-1 (NC), L. 1671-1 (TAAF).
ARTICLE 28
SIMPLIFICATION DU REGIME DES HABILITATIONS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
1. Etat des lieux et diagnostic
Les articles 13 et 38 du code de procédure pénale attribuent au ministère public des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur les officiers de police judiciaire (OPJ). Cette surveillance se traduit par l’habilitation, la notation et le pouvoir disciplinaire du procureur général vis-à-vis des officiers de police judiciaire. Chargé de leur discipline, il a également la faculté de retirer ou suspendre une habilitation préalablement octroyée.
En application des articles 16, R.14 et R.15-3 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit être habilité par le procureur général du ressort dans lequel il exerce habituellement ses fonctions pour pouvoir exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire. Cette habilitation doit être renouvelée à chaque changement de service ou d’unité d’affectation.
Les articles 18 et D.12 du code de procédure pénale prévoient également qu’une habilitation temporaire doit être délivrée par le procureur général en cas de mise à disposition temporaire d’un officier de police judiciaire dans un service ou une unité autre que celui ou celle où il exerce habituellement ses fonctions, ou encore lorsqu’il est amené à suppléer un officier de police judiciaire d’un autre service ou d’une autre unité.
La mission d’habilitation constitue, pour la plupart des parquets généraux, une charge de travail conséquente, compte tenu du nombre important d’officiers de police judiciaire et des modalités désuètes d’habilitation des officiers de police judiciaire.
Ce constat est dressé depuis plusieurs années par les parquets généraux et, notamment, à l’occasion des rapports de politique pénale pour l’année 2012. Plus précisément, chaque année, les parquets généraux instruisent environ 5.000 demandes d’habilitation d’officiers de police judiciaire. Ces actes sont généralement traités par échanges de courriers entre les directions du ministère de l’intérieur et les parquets généraux. Ils génèrent des coûts humains et matériels, mais également des délais de traitement, qui sont supportés par l’ensemble des acteurs de la chaîne. Il arrive ainsi d’ailleurs parfois qu’un officier de police judiciaire nouvellement affecté attende plusieurs mois avant de disposer d’une habilitation pour exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire.
Mais surtout, les modalités actuellement en vigueur en matière d’habilitation des officiers de police judiciaire ne permettent pas aux parquets généraux d’avoir une réelle connaissance de la qualité et des compétences professionnelles des officiers de police judiciaire qu’ils habilitent et ne fait en réalité l’objet que d’un contrôle assez formel.
Le constat dressé et les difficultés recensées quant à la mise en œuvre des dispositions actuelles rendent nécessaire la modification du régime actuel de l’habilitation pour prévoir une habilitation unique des officiers de police judiciaire.
Il est par ailleurs proposé de simplifier l’actuelle procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire afin d’alléger la charge de travail des parquets généraux en la matière et leur permettre de se recentrer sur leurs autres pouvoirs de contrôle et de surveillance des officiers de police judiciaire, notamment la notation et la discipline des officiers de police judiciaire.
3.1 Option écartée
Il aurait pu être envisagé de mettre en place un dispositif où l’habilitation d’un officier de police judiciaire vaut tant que sa compétence territoriale demeure la même. Dans cette hypothèse, l’habilitation n’aurait pas à être renouvelée en cas de changement de service ou d’unité d’affectation dont la compétence territoriale est inchangée. Ainsi, un fonctionnaire de police affecté dans une circonscription de sécurité publique habilité avec une compétence départementale n’aurait pas à renouveler son habilitation s’il est muté dans une autre circonscription de sécurité publique ou dans tout autre service de police judiciaire du même département.
Cette option a cependant été écartée dans la mesure où les changements d’affectation des officiers de police judiciaire impliquent souvent un changement de compétence territoriale, de sorte que la charge de travail des parquets généraux n’aurait été que partiellement allégée. En outre, cette option ne pallierait pas le fait que le travail d’habilitation des parquets généraux résulte en réalité d’un contrôle relativement formel, d’autant que le procureur général saisi d’une demande d’habilitation se trouve dans l’ignorance, hormis les éléments du dossier de l’officier de police judiciaire, de ses qualités dans sa manière de servir.
3.2 Option retenue
Il est proposé de mettre en place un dispositif d’habilitation unique qui n’aura pas à être renouvelée en cas de changement temporaire ou définitif de service ou d’unité d’affectation de l’officier de police judiciaire.
Cette habilitation sera délivrée par le procureur général du premier lieu d’exercice des fonctions de l’officier de police judiciaire, à condition que ce dernier ait la qualité d’officier de police judiciaire et exerce des missions de police judiciaire au sein d’un service ou d’une unité de police judiciaire mentionnés aux articles R.15-18 et suivants du code de procédure pénale.
La suppression envisagée de l’alinéa 6 de l’article 18 du code de procédure pénale permet également de mettre fin à la redondance existante entre cette hypothèse de suppléance d’un OPJ par un autre et la mise à disposition temporaire d’un OPJ au sein d’un service ou d’une unité autre que celui ou celle où il est habituellement affecté, envisagée à l’alinéa 2 de ce même article 18.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La simplification de la procédure d’habilitation envisagée ne conduira pas à un amoindrissement du contrôle exercé par le ministère public sur les officiers de police judiciaire, dans la mesure où elle sera assortie d’une obligation pour les services de police ou les unités de gendarmerie d’adresser périodiquement aux parquets généraux et aux parquets une liste actualisée et exhaustive des officiers de police judiciaire relevant de leur compétence et sans délai toutes informations utiles concernant la situation administrative de ces officiers de police judiciaire.
Cette garantie doit permettre aux parquets généraux d’être avisés des changements temporaires ou définitifs d’affectation des officiers de police judiciaire exerçant dans leur ressort dans un autre service ou unité de police judiciaire, mais également de tout changement d’affectation ayant des incidences sur les activités de police judiciaire des intéressés.
En outre, l’habilitation unique pourra, comme c’est actuellement le cas, être suspendue ou retirée par le procureur général territorialement compétent en cas de besoin. En cas d’affectation dans un service ou une unité n’ayant pas de compétence judiciaire, l’habilitation sera suspendue de fait.
Enfin, la modification envisagée s’accompagnera d’une modification des textes réglementaires du code de procédure pénale relatifs à l’habilitation des officiers de police judiciaire et notamment, des articles R.14 et suivants et D.12 du code de procédure pénale.
4.2 Impacts sur les services judiciaires
La charge de travail des parquets généraux sera allégée, dans la mesure où ils ne procèderont plus aux renouvellements d’habilitation des officiers de police judiciaire à chaque changement d’affectation définitif ou temporaire de ces derniers.
5. Consultations et modalités d’application
L’ensemble de ces modifications devra être précisé par un décret en Conseil d’Etat et par un décret simple.
Il est toutefois précisé qu’une modification préalable de l’article 18 du code de procédure pénale s’impose, en ce qu’il prévoit en son alinéa 6 une habilitation spécifique du procureur général en cas de suppléance d’un OPJ par un autre.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 29
SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET DE DÉTENTION PROVISOIRE
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 Demande de mise en liberté
1.1.1 En application de l’article 148 du code de procédure pénale, une personne détenue dans le cadre de l’instruction préparatoire peut à tout moment demander sa mise en liberté.
Sauf s’il entend donner une suite favorable à la demande, le juge d’instruction dispose alors, à compter de la communication du dossier au Procureur de la République, d’un délai de cinq jours pour saisir le Juge des libertés et de la détention qui, lui-même, dispose d’un délai de trois jours pour statuer.
Si aucune décision n’a été rendue dans ces délais (donc en pratique, compte tenu du délai de communication au parquet, dans les 8 à 10 jours suivants le dépôt de la demande), la personne peut alors saisir directement la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans les vingt jours, faute de quoi la personne est remise en liberté.
Dans l’hypothèse où il n’a pas encore été statué sur une précédente demande ou l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté et qu’il est adressé une nouvelle demande de mise en liberté, l’article 148 du code de procédure pénale prévoit deux mécanismes de nature à alléger la procédure.
D’une part, les délais pour statuer ne commencent à courir qu’à compter du jour où le Juge des libertés et de la détention ou la cour d’appel rend sa décision.
D’autre part, il est possible de répondre à l’ensemble des demandes par une décision unique.
Ces règles n’empêchent toutefois certains détenus de multiplier des demandes successives de mise en liberté, y compris en en déposant une chaque jour et de faire systématiquement appel des refus ou de saisir directement la chambre en cas d’omission du juge, dans le seul but d’obtenir leur libération parce que la chambre de l’instruction aura omis de statuer dans le délai de 20 jours.
1.1.2 Le Conseil constitutionnel s’est directement prononcé sur la question des demandes de mise en liberté dans sa décision 86-215 DC du 3 septembre 1986. Dans cette décision, le Conseil a précisément statué sur les dispositions qui modifiaient les articles 148 et 148-2 du code de procédure pénale relatifs aux demandes de mise en liberté, en ayant pour objet, en cas de demandes réitérées, de reporter le point de départ du délai imparti pour se prononcer sur une nouvelle demande à la date à laquelle il a été statué sur la précédente demande. Il a considéré que « ces dispositions, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction, saisi d'un fait nouveau à l'appui de toute demande, statue immédiatement ; que, dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du respect des droits de la défense ».
Par ailleurs, le Conseil a, dans plusieurs décisions, validé les dispositions en matière de détention provisoire en rappelant que la personne pouvait demander à tout moment sa mise en liberté (V. par exemple la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 faisant état de « la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées »).
Il arrive parfois qu’en raison du non-respect des délais dans lesquels il doit être statué en matière de détention provisoire, la détention de la personne devient irrégulière et celle-ci doit être remise en liberté. Cette remise en liberté est alors ordonnée par la juridiction saisie, si c’est elle qui constate l’irrégularité de la détention, et par le ministère public dans les autres cas. Ce magistrat intervient en tant que garant des libertés individuelles conformément à l’article 66 de la Constitution, et au regard également des dispositions de l’article 432-5 du code pénal. Cet article prévoit en effet que « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie ».
Cette remise en liberté n’interdit pas, si les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies, de décider à nouveau d’une mise en détention. La question d’un nouveau placement en détention après une détention irrégulière a en effet fait l’objet d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 30 avril 2002, la chambre criminelle impose des circonstances nouvelles pour justifier un nouveau placement en détention provisoire (Crim., 30 avr. 2002, n° 02-81.201).
Toutefois, deux décisions plus récentes de la chambre criminelle indiquent que « aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsqu'un mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dans la même information et à raison des mêmes faits » (Cass. crim., 3 sept. 2003 : Juris-Data n° 2003-020364 ; Bull. crim. 2003, n° 152. – Cass. crim., 1er févr. 2005 : Juris-Data n° 2005-026961 ; Bull. crim. 2005, n° 33). La Cour de cassation précise que dans cette hypothèse, le juge des libertés et de la détention peut délivrer un nouveau mandat sans qu'il soit besoin d’établir l’existence de circonstances nouvelles.
Il importe cependant d’observer qu’un nouveau placement en détention ne peut être ordonné au moment même où l’irrégularité de la détention est constatée, mais ultérieurement, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Le présent projet de loi ne traite pas de cette question, puisqu’elle est réglée par la jurisprudence et qu’il n’est par ailleurs pas possible de modifier la loi pour permettre un nouveau placement en détention intervenant immédiatement à la suite de la constatation de l’irrégularité de la détention. En effet, un nouveau placement en détention exige un débat contradictoire avec présentation de la personne et, surtout, convocation préalable de son avocat dans les délais légaux.
Il résulte ainsi de la jurisprudence et de la nécessité de respecter les garanties légales que si un nouveau placement en détention est possible, il ne peut être immédiat et suppose donc en pratique que la personne n’ait pas pris la fuite. La question se pose dès lors de savoir si un placement immédiat de la personne sous contrôle judiciaire n’est pas possible.
La chambre criminelle a considéré, dans un arrêt du 9 janvier 2013 (n° 12-87016), qu’une chambre de l’instruction qui constatait l’irrégularité d’une détention au motif qu’elle n’avait pas statué dans le délai de deux mois prévus par l’article 148-1 sur une demande de mise en liberté formée par un accusé condamné pour crime mais qui avait interjeté appel, ne pouvait placer la personne sous contrôle judiciaire.
Que cette décision puisse être justifiée par le fait que l’instruction étant terminée, la chambre de l’instruction ne disposait pas des pouvoirs qu’elle détient au cours de l’information, ou qu’elle doive être considérée comme applicable à toutes les phases de la procédure, elle justifie une réforme législative afin d’autoriser expressément un contrôle judiciaire en cas de détention irrégulière.
2.1 Limiter les demandes dilatoires de mise en liberté
Afin de prévenir les demandes purement dilatoires, il est proposé de rendre irrecevables les demandes de mise en liberté adressées tant que la décision du juge des libertés et de la détention refusant une précédente demande n’a pas été rendue dans les délais fixés par la loi et notifiée à la personne.
Une telle évolution serait de nature à sécuriser les procédures, sans amoindrir les garanties du justiciable puisqu’en l’état du droit positif la personne détenue ne peut d’ores et déjà pas exiger qu’il soit statué sur sa nouvelle demande, tant qu’il n’a pas été statué sur la première demande. Elle n’interdira pas qu’une personne dépose des demandes tous les huit ou dix jours, notamment s’il existe des éléments nouveaux.
Cette évolution n’est pas incompatible avec la décision précitée du Conseil constitutionnel de 1986. Elle prévoit en effet simplement l’irrecevabilité des nouvelles demandes intervenant avant que le JLD ne statue – donc déposées dans tous premiers jours suivants la première demande, vu le bref délai dans lequel le JLD doit statuer – alors qu’actuellement il doit être certes être répondu à ces toutes demandes, mais uniquement après la décision d’appel sur la précédente demande (ce qui peut, en cas d’appel, différer l’exigence de réponse de plusieurs semaines, puisque la chambre de l’instruction doit statuer dans les 15 jours de l’appel – article 194 – plus 5 jours en cas de demande de comparution personnelle – art. 199 – sans compter le renvoi possible en cas de vérification – art. 194).
Or la décision du Conseil de 1986 apportait une réserve d’interprétation à des dispositions permettant de ne pas examiner une demande de mise en liberté pendant un temps assez long, puisque jusqu’à la décision en appel, comme indiqué plus haut, alors que le projet ne prévoit une irrecevabilité que jusqu’à la décision du JLD, donc pendant quelques jours au plus.
Par ailleurs, l’irrecevabilité de ces demandes n’interdit nullement au juge d’instruction, en cas de fait nouveau justifiant que, sans attendre la décision du JLD, d’ordonner d’office la mise en liberté de l’intéressé sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 144-1 (qui date du reste de 1996 et n’existait donc pas en 1986).
En pratique, lorsque lui sera notifiée la décision de rejet d’une précédente demande, la personne aura le choix entre déposer une nouvelle demande ou interjeter appel de ce refus. Rien ne lui interdira de faire les deux, mais, comme le prévoit le droit actuel, le délai pour statuer sur la nouvelle demande ne commencera alors à courir qu’à compter de la décision rendue par la cour d’appel.
Il est proposé de permettre que soit placée sous contrôle judiciaire une personne dont la libération est ordonnée à la suite de la constatation de l’irrégularité de sa détention provisoire. Cette possibilité sera prévue par une disposition transversale du code de procédure pénale, dans un nouvel article 803-7.
Le contrôle judiciaire pourra être décidé de deux manières :
- Soit par la juridiction saisie, lorsqu’elle ordonnera la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire apparaît irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par la loi.
- Soit par le juge des libertés et de la détention, lorsque, hors le cas ci-dessus, le procureur de la République ordonnera la libération d’une personne dont la détention provisoire lui apparaît irrégulière. Le procureur pourra alors saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant à son placement immédiat sous contrôle judiciaire.
3.1 En ce qui concerne les demandes de mise en liberté faite de façon répétée, il n’a pas été prévu de prévoir l’irrecevabilité d’une nouvelle demande tant qu’il n’a pas été statué sur la précédente demande par la chambre de l’instruction, le cas échéant de façon définitive . En effet, compte tenu de la possibilité de faire appel d’un refus du juge des libertés et de la détention, puis de faire un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, cela aurait privé la personne détenue, présumée innocente, de redemander sa libération pendant une très longue période, alors même que des éléments nouveaux peuvent justifier la demande. Il aurait donc fallu, sauf à porter une atteinte excessive à la présomption d’innocence et à la liberté individuelle contraire aux exigences constitutionnelles rappelées en 1986, instituer une irrecevabilité sauf en cas « d’éléments nouveau », ce qui aurait créé un contentieux spécifique, source potentielle de nullités, sur cette notion.
Cette option a donc été écartée et a été retenue celle prévoyant l’irrecevabilité de la nouvelle demande ne vaut donc que jusqu’à la décision du juge des libertés et de la détention sur la précédente demande. Ce juge devant statuer à bref délai, il est ainsi inutile de prévoir une exception en cas d’élément nouveau, d’autant qu’une mise en liberté d’office est toujours possible.
La solution proposée opère une conciliation équilibrée entre les exigences de la bonne administration de la justice, qui justifie de prévenir les demandes qui sont immédiatement réitérées dans un but dilatoire, et les garanties concernant les atteintes à la liberté individuelle, qui justifie que les demandes de mise en liberté puissent intervenir à tout moment.
3.2 En ce qui concerne les détentions irrégulières, n’ont pas été retenues les options suivantes, considérées comme portant une atteinte excessive à la liberté individuelle :
• Permettre d’ordonner immédiatement à nouveau la détention lorsqu’est constatée l’irrégularité de la détention en cours : cette solution ne permet en effet pas de respecter les conditions premières d’un placement en détention, qui constituent des garanties légales répondant à des exigences constitutionnelles, à savoir la tenue d’un débat contradictoire en présence de la personne et de son avocat préalablement convoqué.
• Donner un délai aux juridictions pour régulariser la détention à partir du moment où elles sont informées de son caractère irrégulier : cette solution conduirait en effet à prolonger une détention irrégulière.
• Permettre également le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE); cette solution ne peut être retenue, car l’ARSE exige l’accord de la personne (et par nature on ne voit pas pourquoi la personne le donnerait) et elle exige également un débat contradictoire après convocation de l’avocat. L’ARSE ne peut donc être ordonnée le jour même où est constatée l’irrégularité de la détention.
La solution retenue, permettant un placement immédiat sous contrôle judiciaire, ne remettant pas en cause la nécessaire libération de la personne et constitue ainsi un équilibre entre les objectifs de la répression et la liberté individuelle.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces dispositions sont de nature à prévenir les erreurs de procédures conduisant à la remise en liberté de personnes pouvant présenter un caractère dangereux.
Par ailleurs, si la personne est libérée, les obligations de son contrôle judiciaire seront de nature à éviter sa fuite, des pressions sur les témoins ou victimes ou des modifications de preuves. Ce contrôle pourra être de nature à éviter la réincarcération de la personne si les obligations s’avèrent suffisantes. Si la personne ne respecte pas ses obligations, sa réincarcération sera plus facilement ordonnée pour violation du contrôle judiciaire.
Ces mesures auront par ailleurs un impact sur les systèmes d’information (insertion dans le système de référence justice, modification d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée) et nécessiteront des évolutions qui seront disponibles d’ici la fin de l’année 2016 et dont le coût est estimé à environ 25 K€.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 30
DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE JUGEMENT
1. Etat des lieux et diagnostic
Trois séries de difficultés ont été signalées par les juridictions.
La convocation en justice prévue par l’article 390-1 du code de procédure pénale exige en pratique l’intervention des services d’enquête, ce qui est parfois considéré par ces derniers comme une charge contestable lorsque cette convocation n’intervient pas immédiatement à l’issue d’une garde à vue mais exige de convoquer la personne.
La procédure de comparution immédiate est source de complexités pratiques lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi parce que le tribunal ne peut se réunir le jour même, ne place pas la personne en détention. Le procureur doit en effet attendre la décision du juge pour faire à nouveau comparaître la personne et lui notifier une date d’audience. S’il y a d’autres prévenus détenus, en pratique plusieurs audiences de jugement devront être organisées.
Le mode de notification des ordonnances pénales contraventionnelles est différent de celui des ordonnances pénales délictuelles, en exigeant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que des notifications groupées par les délégués du procureur sont aussi possibles dans le deuxième cas.
2.1 Convocation en justice par le délégué du procureur, sur instructions de ce magistrat
Il s’agit d’une demande ancienne des praticiens, utile en cas d’échec d’une procédure alternative aux poursuites (par exemple refus de la médiation par la personne). Le délégué doit alors faire un rapport au procureur de la République, qui engagera des poursuites, soit par huissier, soit, le plus souvent, en faisant convoquer la personne par un OPJ ou un APJ.
En permettant au délégué de faire lui-même cette convocation, sur instructions préalables du procureur de la République, on simplifie à la fois la tâche des parquets et celles des enquêteurs
2.2 Simplification des modalités pratiques de comparution devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de comparution immédiate
Ces modifications ont été demandées par plusieurs juridictions.
Elles permettent que si, en cas de procédure concernant plusieurs co-prévenus, le juge des libertés et de la détention en place un en détention, mais en libère d’autres, ces derniers pourront comparaître à la même audience rapprochée que le prévenu, ce qui évite une disjonction des procédures et deux procès, ou un renvoi du 1er procès avec le prévenu détenu à la date fixée pour la comparution des détenus libres.
Elles permettent que si le juge ne place pas la personne en détention, lui ou son greffier communique la date d’audience au prévenu, évitant au parquet d’attendre la décision et de devoir, avec son greffier, attendre le retour de la personne pour lui notifier cette date.
2.3 Amélioration de la procédure de jugement des contraventions en permettant la notification des ordonnances pénales contraventionnelles par les délégués du procureur, comme pour les ordonnances délictuelles.
3.1 Aucune option significative n’a été identifiée dans les modifications proposées concernant les convocations par délégués du procureur et la notification des ordonnances pénales.
3.2 En ce qui concerne la comparution immédiate, il n’a pas été retenu l’option consistant à prévoir que, de façon générale, même si le juge des libertés et de la détention ne plaçait pas la personne en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, dans le délai alors fixé à trois jours ouvrables, l’audience aurait cependant lieu dans ce délai. En effet, cela aurait porté une atteinte excessive et injustifiée aux droits de la défense.
L’option retenue consiste à prévoir que c’est uniquement s’il existe d’autres prévenus, placés eux en détention et devant alors comparaître dans les 3 jours, que ce même délai s’appliquera à la personne laissée en liberté. En effet dans cette hypothèse, l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice justifie la tenue d’un procès unique. En tout état de cause, chacun des prévenus ne sera jugé lors de cette audience que si, en présence de son avocat, il donne son accord, conformément à l’article 397, à défaut de quoi l’affaire sera renvoyée.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1 Impact sur les frais de justice :
4.1.1 Impacts des convocations en justice par le délégué du procureur. Jusqu'à présent, le coût de la convocation en justice en matière de frais de justice est de 4,50€, ce à quoi il faut ajouter les frais d'affranchissement pour une citation ; aucun frais n’était s'il s'agit d'une convocation par officier de police judiciaire ni s’il s’agit d’une CPV ou d’une CI.
L’instauration d’une convocation en justice par le délégué du procureur pourrait être source d'un accroissement de la dépense en matière de frais de justice.
Le nombre de mesures concernées a été estimé à partir des 170 000 mesures alternatives et des 100 000 propositions de compositions pénales traitées par les délégués chaque année.
Ce sont donc 30 700 mesures concernées qui pourraient faire l'objet d'une convocation en justice par les délégués du procureur de la République. Aussi, dans l’hypothèse où la délivrance de la convocation nécessiterait une tarification au sein des articles R. 92 et suivants du code de procédure pénale, le coût en terme de frais de justice, sur la base d’un tarif à hauteur de 10 € serait d’environ de 0,3 M €.
Toutefois, l’impact de cette mesure devrait être beaucoup plus limité si les convocations sont délivrées à l’issue immédiate du refus exprimé par le mis en cause de la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites ou du constat de l’échec de la mesure alternative proposé et acceptée par le mis en cause (rappel à la loi, composition pénale, médiation pénale).
En effet, dans ce cas, le délégué perçoit déjà une indemnité pour la mesure alternative et la délivrance de la convocation en cas d’échec pourrait être incluse dans sa mission initiale.
4.1.2 Impacts de la notification d’ordonnance pénale contraventionnelle par le délégué du procureur. Cette disposition peut conduire à un accroissement des frais de justice. En comparaison du coût d’une lettre recommandée avec accusé de réception, financé en fonctionnement courant, le coût de la notification par un délégué du procureur de la République pris sur le budget des frais de justice, est quasiment le double pour une personne physique (8 €) ou le triple pour une personne morale (12 €).
Une évaluation du nombre de décisions potentiellement concernées a été menée sur la base de deux hypothèses :
- Hypothèse 1 : Les ordonnances pénales délictuelles notifiées par le délégué du procureur de la République représentent une quote-part de 47% du nombre total d'ordonnances pénales au tribunal correctionnel.
Si l'on applique cette même quote-part au tribunal de police, on obtient pour l'assiette des ordonnances pénales de 1ère à 4ème classe (311 288) et de 5ème classe (25 175) : 336 463 *47% = 158 000 ordonnances susceptibles d'être notifiées par le délégué du procureur de la République.
- Hypothèse 2: La structure du contentieux fournie par MINOS permet d'isoler les différentes classes de contravention.
Si l'on retient uniquement le champ des contraventions de 4ème (95 857 hors affaires non pénales) et de 5ème classe (25 480 hors affaires non pénales), on obtient 121 337 contraventions.
L'application de la quote-part estimative de 47% conduit à 57 000 ordonnances susceptibles d'être notifiées par le délégué du procureur de la République.
Sur la base de cette dernière hypothèse, qui semble la plus réaliste car limitée aux deux dernières catégories de contravention, le coût estimatif en terme de frais de justice s’établit à environ 0,6 M€, sur la base des tarifs applicables pour les ordonnances pénales correctionnelles (8 € pour une personne physique et 31 € pour une personne morale) en tenant compte de la répartition des missions confiées aux personnes physiques (90%) et aux associations (10%).
4.2 Impacts informatiques
Les mesures envisagées auront un impact sur les systèmes d’information (modifications d’éditions dans le système d’information pénal, Cassiopée, et dans l’applicatif Minos pour les ordonnances pénales).Les évolutions de Cassiopée seront disponibles en mars 2016 et leur coût devrait être d’environ 35 K€.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 31
EXTENSION DES CONTRÔLES D’IDENTITÉ ET DES RECHERCHES DES PERSONNES EN FUITE
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1 Contrôle d’identité
En application des alinéas 1 à 5 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Par ailleurs, l’article 34 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a renforcé les pouvoirs des services de police et des unités de gendarmerie (perquisition, interception de correspondances, géolocalisation) en cas de violation par une personne placée sous main de justice des obligations auxquelles elle est astreinte dans le cadre de l’exécution d’une peine, d’une mesure pré-sentencielle (contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique) ou post-sentencielle (mesure d’aménagement de peine, mesure de sûreté).
En outre, cette loi a complété la liste des obligations et interdictions devant être inscrites au fichier des personnes recherchées (article 230-19 du code de procédure pénale) et étendu les possibilités de placement en retenue, en cas de violation des obligations prononcées dans le cadre d’une peine, d’une mesure d’aménagement de peine, d’une mesure de sûreté post-sentencielle (article 709-1-1 du code de procédure pénale), d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique (141-4 du code de procédure pénale).
Le contrôle d’identité de police judiciaire, que les services de police et unités de gendarmerie peuvent réaliser d’initiative, dès lors qu’une personne se trouve dans l’une des quatre situations prévues à l’article 78-2 du code de procédure pénale, constitue souvent le préalable à certaines vérifications (passage au FPR, palpation de sécurité…), qui peuvent, lorsqu’elles sont positives, justifier une interpellation et un placement en garde à vue.
Or, s’agissant de la violation des obligations auxquelles une personne est soumise en vertu d’une peine ou d’un contrôle judiciaire, si les services d’enquête disposent de moyens juridiques comparables pour procéder à des vérifications (inscription au FPR) et prendre des mesures de coercition (appréhension et placement en rétention judiciaire), ils sont en revanche dépourvus de la possibilité de contrôler l’identité d’une personne sur le seul fondement de la suspicion qu’elle viole ses obligations. En effet, en l’absence d’élément permettant de caractériser la suspicion d’une infraction (art. 78-2 alinéas 2 à 4 du CPP) ou l’existence de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (art. 78-2 alinéa 5 du CPP), l’identité d’une personne suspectée de violer les obligations auxquelles elle est astreinte, ne peut être contrôlée.
1.2 Recherche des personnes en fuite
L’article 74-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
L’article 74-2 comporte une omission, en ne permettant pas la recherche, lorsqu’elles sont en fuite, des personnes ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement, en cas de violation des obligations et interdictions résultant de leur peine.
Les contrôles d’identité, en ce qu’ils constituent une mesure attentatoire à la liberté individuelle, nécessitent d’être prévus et encadrés par une mesure législative. L’omission de l’article 74-2 doit être réparée.
L’objectif de la mesure est de donner aux services de police et unités de gendarmerie un fondement légal aux contrôles d’identité diligentés à raison de la suspicion de la violation de ses obligations par une personne placée sous main de justice dans le cadre de la peine prononcée à son encontre ou de la mesure de sûreté pré-sentencielle (contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique) à laquelle elle est astreinte, et ce afin de renforcer le contrôle du respect des décisions de justice.
Il convient de compléter l’article 74-2 comme indiqué plus haut.
3.1 Option écartée
Etendre l’article 74-2 à tous les condamnés. Il paraît préférable de limiter cette procédure dans les cas où la décision de retrait ou de révocation a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an.
3.2 Option retenue
Il convient de compléter l’article 78-2 du code de procédure pénale afin de prévoir que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a violé les obligations ou interdictions prononcées à son encontre dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines.
Il convient d’étendre l’article 74-2 aux personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La modification législative envisagée, qui touche essentiellement aux pouvoirs des forces de l’ordre, ne devrait pas directement impacter les services judiciaires, sauf à améliorer l’efficacité du contrôle des décisions de justice.
Toutefois, la possibilité de procéder à des contrôles d’identité en cas de suspicion de violation des obligations prononcées dans le cadre d’une peine, d’une mesure d’aménagement de peine, d’une mesure de sûreté, d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique devrait conduire mécaniquement à une augmentation du nombre de placements en retenue décidés d’office par les services de police ou unités de gendarmerie.
Ces mesures nécessitent, comme pour les mesures de garde à vue, que le magistrat compétent en soit avisé, qu’il en contrôle le déroulement et qu’il apprécie les suites à y donner, étant rappelé que cette mesure n’est pas susceptible de prolongation.
La majorité des placements en retenue devrait intervenir dans le cadre de l’application des peines et de l’instruction, donc sous le contrôle des juges de l’application des peines et des juges d’instruction.
Les dispositions envisagées ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
1. Etat des lieux et diagnostic
Le cadre juridique de la vidéoprotection est issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et est désormais codifié aux articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
En application de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, un système de vidéoprotection permettant l’enregistrement d’images prises sur la voie publique peut être installé par les autorités publiques compétentes, sous réserve d’assurer l’une des neuf finalités limitativement énumérées :
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
- la régulation des flux de transport ;
- la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières ;
- la prévention d'actes de terrorisme ;
- la prévention des risques naturels ou technologiques ;
- le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
- la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
Les commerçants peuvent également être autorisés à mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique mais uniquement afin d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Le même article ouvre enfin la possibilité pour les autorités publiques d’installer un système de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public qui sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Le système de vidéoprotection doit être autorisé par le préfet du département, après avis consultatif de la commission départementale de la vidéoprotection. L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable, sachant que la conservation des enregistrements ne peut excéder un mois. Conformément à l’article L. 251-1 du même code, les enregistrements visuels de vidéoprotection, qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier directement ou indirectement des personnes physiques, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En revanche, l’enregistrement d’images prises dans des lieux privés n’est pas prévu. L’article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure impose que les opérations de vidéoprotection de la voie publique ne conduisent pas à la visualisation des images de l’intérieur des immeubles d’habitation, ni de façon spécifique, leurs entrées.
Par ailleurs, l’article 226-1 du code pénal réprime « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. / Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
1.2 Difficultés rencontrées
Suite à une annonce faite par le ministre de l’intérieur à la fin de l’année 2012, l’utilisation de caméras individuelles portées sur les uniformes dites « caméras piétons » a fait l’objet d’une expérimentation par les agents de la police nationale et par les militaires de la gendarmerie nationale et d’un déploiement du matériel dans plusieurs zones de sécurité prioritaires à compter de 2013.
A l’occasion de cette expérimentation, les dispositions relatives au droit au respect de la vie privée (article 226-1 du code pénal) avaient été rappelées aux services par le biais d’instructions internes. Un suivi régulier de l’expérimentation a été assuré par un comité de pilotage réunissant les services techniques et opérationnels.
Compte tenu du bilan positif de l’expérimentation, le Premier ministre a annoncé le 26 octobre 2015, à l’occasion du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté, la généralisation des caméras piétons, lesquelles ont vocation à devenir un équipement de droit commun des patrouilles et unités de police et de gendarmerie en intervention opérationnelle.
En l’état actuel du droit, le cadre juridique applicable à la vidéoprotection susmentionné n’est pas adapté aux finalités des caméras-piétons et à leurs modalités d’utilisation.
Premièrement, les caméras-piétons n’ont pas uniquement pour finalités de prévenir des troubles à l’ordre public, de protéger la sécurité des personnes et des biens ou de constater des infractions. Elles ont également pour objet d’offrir une garantie, tant aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qu’aux personnes contrôlées ou appréhendées, quant aux conditions de déroulement des opérations en cause. Elles pourront également être utilisées en cas d’éventuelles poursuites disciplinaires des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’en vue de la formation des forces de l’ordre.
Deuxièmement, la vidéoprotection n’est réglementée que « sur la voie publique » et « dans des lieux et établissements ouverts au public » alors que les caméras piétons ont vocation à être utilisées dans tous les lieux légalement accessibles aux agents qui les portent, y compris dans des lieux privés.
Troisièmement, l’usage des caméras-piétons est réservé aux seules forces de l’ordre, contrairement à la vidéoprotection qui peut être mise en œuvre par toutes les autorités publiques compétentes ainsi que par les commerçants.
Quatrièmement, les caméras de vidéoprotection enregistrent des images en continu dans des lieux considérés comme nécessitant une surveillance ou une protection sans distinction préalable des personnes filmées et via des dispositifs pérennes et fixes. A l’inverse, les caméras piétons procèdent à un enregistrement des images et des sons de manière ponctuelle en cas d’interaction avec une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables. Elles se caractérisent par leur mobilité, en fonction des déplacements et des interventions des agents.
Cinquièmement, le régime de l’autorisation préalable qui est délivrée installation par installation par l’autorité préfectorale est trop restrictif et difficilement applicable pour les caméras individuelles, qui ont vocation à être utilisées par chaque patrouille sur l’ensemble du territoire.
Pour toutes ces raisons, il importe donc de procéder à la modification du code de la sécurité intérieure.
L’objectif recherché par l’introduction d’une nouvelle disposition au code de la sécurité intérieure est de tirer les conséquences de l’expérimentation positive de l’usage des caméras piétons et de fixer un cadre légal encadrant les conditions et modalités d’usage des caméras piétons ainsi que le traitement des enregistrements audiovisuels.
L’expérimentation des caméras piétons menée depuis 2013 par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et le déploiement de ce matériel dans les zones de sécurité prioritaire se sont inscrits dans une double démarche de rapprochement entre les forces de l’ordre et la population et de sécurisation des interventions des agents et des militaires.
L’effet modérateur du dispositif a été constaté par les forces de l’ordre : il permet souvent d’apaiser une situation tendue ou tendant à se dégrader. Dans la quasi-totalité des zones concernées, les forces de l’ordre ont constaté que la population s’était rapidement habituée à la présence de la caméra, ne cherchant plus à se dissimuler ou à s’extraire de son champ. D’une manière générale, la captation d’images et de sons tend à dissuader les mauvais comportements et les écarts de langage des personnes contrôlées. Enfin, les caméras piétons représentent un outil utile pour l’identification de mis en cause et permet d’accréditer les propos des policiers lors des interpellations, notamment pour les faits d’outrage et rébellion.
La pérennisation et la généralisation de l’utilisation des caméras piétons par les forces de l’ordre imposent de définir un cadre juridique adéquat et proportionné permettant de concilier les objectifs poursuivis et les droits et libertés des personnes enregistrées, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
D’une part, l’enregistrement audiovisuel des images et des paroles des personnes filmées ainsi que la conservation de données à caractère personnel, en ce qu’elles se rapportent à des individus identifiés ou identifiables est de nature à constituer une ingérence dans la vie privée.
L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », dont les libertés garanties par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Or le Conseil constitutionnel juge que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (n° 2012-652 DC du 22 mars 2012).
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’admet l’ingérence d’une « autorité publique » dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance que si cette ingérence est, d’une part, prévue par la loi et, d’autre part, constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La Cour européenne des droits de l’homme juge ainsi que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 (26 mars 1987 Leander c/ Suède ou 16 février 2000 Amann c/ suisse). Or la notion de vie privée au sens de l’article 8 comprend les éléments se rapportant au droit à l’image (11 janvier 2005 Sciacca c/ Italie n°50774/99 §29).
D’autre part, l’enregistrement audiovisuel issu des caméras piétons peut être utilisé comme un moyen de procéder à différents contrôles, d’aider à la répression des incidents et de constater des infractions par la collecte de preuves : il se rattache ainsi à la procédure pénale, dont l’article 34 de la Constitution réserve aussi au législateur la compétence pour en fixer les règles.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge de manière constante que « la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle » et « il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties » au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée ainsi que l'inviolabilité du domicile.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
3.1 Impacts juridiques
La mesure envisagée emporte des impacts juridiques. Elle conduit à la création d’un article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure qui réserve l’usage des caméras piétons aux seules forces de police nationale et de gendarmerie nationale dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes et des biens et de police judiciaire. Les agents pourront y procéder en tous lieux, y compris privés, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées.
L’utilisation des caméras piétons doit permettre d’apporter une garantie quant au contrôle du déroulement des opérations et d’offrir une protection tant aux personnes filmées qu’aux forces de l’ordre dans la mesure où l’enregistrement permet de disposer d’un moyen de preuve du comportement respectif des intéressés. Le dispositif envisagé comporte ainsi plusieurs garanties propres à concilier l’exercice des libertés publiques, et notamment le droit au respect de la vie privée et les nécessités liées aux objectifs poursuivis :
- Les finalités des enregistrements sont expressément définies par la loi. L’utilisation des caméras piétons poursuit quatre objectifs : prévenir les incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ; constater les infractions et aider à la répression de leur auteur par la collecte de preuves ; contribuer au respect par les agents et militaires des obligations leur incombant ; être utilisées pour la formation des forces de l’ordre ;
- Les caméras individuelles sont portées de manière apparente et comportent un signal visuel indiquant qu’elles enregistrent afin que l’enregistrement ne soit pas effectué à l’insu des personnes enregistrées ;
- L’utilisation des caméras piétons fera l’objet d’une information. D’une part, le ministère de l’intérieur organisera une information générale sur l’emploi de ce matériel. D’autre part, la personne enregistrée est informée préalablement au déclenchement de l’enregistrement, sauf si les circonstances y font obstacle ;
- Les agents ne peuvent accéder directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin d’éviter tout risque de modification ;
- La durée de conservation des enregistrements est limitée à six mois, sous réserve de leur utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
- Les modalités d’application du dispositif et d’utilisation des données collectées seront précisées par un décret en Conseil d’Etat, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le cadre juridique envisagé permettra à moyen terme d’équiper chaque patrouille intervenant sur le terrain de ce dispositif. Ce déploiement aura donc des conséquences financières importantes.
À titre indicatif, le coût d’une caméra est actuellement de 1 200 €, avec des tarifs préférentiels en cas de commande de masse. A la fin de l’année 2015, les services de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police étaient dotés de 1 584 caméras piétons. Un budget de 875.000 euros a été dégagé en 2015. En 2016, 373 caméras supplémentaires seront livrées.
Une généralisation du déploiement pour les agents de la police nationale dès 2016 peut être estimée à 1,2M € par an en cas de maintien du rythme initialement prévu de 1 000 caméras par an, avec au surplus un coût de 150k€ annuels pour les serveurs de stockage.
4. Consultations menées et modalités d’application
La Commission nationale de l’informatique et des libertés devra être consultée avant l’adoption du décret en Conseil d’Etat, qui aura pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 32 et d'utilisation des données collectées.
Cet article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel et nécessitera la production d’un décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. L’article 34 prévoit leur application à l’ensemble du territoire de la République.
Pour ces collectivités, les articles L. 285-1 (PF), L. 286-1 (NC) et L. 287-1 (WF) du code de la sécurité intérieure listent de manière exhaustive les articles du livre II qui leur sont applicables. Une mise à jour est donc également prévue selon la technique du « compteur ».
DISPOSITIONS DIVERSES
HABILITATION À LÉGIFÉRER
La nécessité de modifier, sur des points techniques, de nombreuses dispositions législatives dans des délais brefs, impose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
ARTICLE 33
I. Mise en conformité du droit français avec la directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) n°2015/847 sur l’information accompagnant les transferts de fonds
1. Analyse des difficultés à résoudre
1.1 Genèse de la réforme européenne
1.1.1 Les grands jalons de la négociation
La réglementation actuelle concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme résulte de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite « 3ème directive anti-blanchiment et financement du terrorisme », transposée en droit français par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, et du règlement n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
La Commission européenne a adopté le 5 février 2013 une nouvelle proposition législative pour une « 4ème directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » et une proposition de règlement relative aux informations accompagnant les transferts de fonds. La base juridique retenue pour ces deux textes est le paragraphe 1 de l’article 114 TFUE.
Ce « Paquet anti-blanchiment et financement du terrorisme » s’inscrit dans un contexte caractérisé par deux éléments importants :
• la prise en compte des conclusions d’un rapport des services de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre de la 3e directive. Ce rapport relève en particulier la persistance de pratiques divergentes entre Etats-membres dans certains domaines importants de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et la nécessité de renforcer l’harmonisation de ces pratiques ;
• l’adoption par le Groupe d’action financière (GAFI) en février 2012 de nouvelles recommandations qui consacrent notamment une approche par les risques visant à affecter prioritairement les moyens tant des pays que des institutions financières là où les risques sont les plus élevés.
A l’occasion de la consultation lancée par la Commission européenne en avril 2012 sur son rapport d’application de la 3e directive, la France avait indiqué que, si la conformité aux nouveaux standards du GAFI constituait un point de départ important pour la nouvelle directive, elle ne devait pas constituer le seul objectif de la révision de ce texte. La France avait souligné que la nouvelle directive devait répondre aux risques de blanchiment de capitaux auxquels le marché intérieur était particulièrement exposé, tels ceux qui découlent notamment de la liberté d’établissement ou la libre prestation de service qui peuvent parfois faciliter le recours à des circuits de paiement opaques. La France avait alors attiré l’attention de la Commission sur cinq points importants :
• L’élaboration au plan européen d’une réglementation contraignante en matière de transparence pour permettre l’identification, avec certitude, des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des entités juridiques (trusts, fondations, etc.) ;
• La mise en œuvre d’une approche européenne des risques pour coordonner les pratiques au sein du marché intérieur ;
• Une harmonisation et un renforcement des compétences des cellules de renseignements financiers (CRF) afin, en particulier, de développer la coopération entre elles ;
• La nécessité d’une approche globale de la réglementation des paiements en Europe prenant en compte les risques de blanchiment que représentent certaines nouvelles méthodes de paiement anonymes et/ou peu traçables (cartes prépayées ; paiements par Internet ; monnaies virtuelles, etc.)
• La mise en place d’une approche européenne concertée à l’égard des pays tiers permettant de se doter d’outils au plan européen pour lutter contre les juridictions non coopératives.
Avant le début des travaux au Conseil, la France et l’Allemagne ont adressé une lettre commune à la Commission pour lui demander de rehausser l’ambition de la directive proposée, sur laquelle la Commission s’est prononcée favorablement le 6 mai 2013.
Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a appelé à l’adoption du Paquet « anti-blanchiment-financement du terrorisme » avant la fin de l’année 2013. Le Parlement européen a adopté son texte en première lecture le 11 mars 2014 et un texte de compromis a été approuvé au Coreper du 18 juin 2014.
Les travaux tant au Conseil qu’au Parlement européen ont permis de renforcer l’ambition du Paquet et la Présidence italienne est parvenue, conformément à son objectif, à un accord politique avec le Parlement européen lors du trilogue du 16 décembre 2014.
Le Paquet a été adopté par le Conseil en ECOFIN le 27 janvier 2015 (avec l’annexion d’une déclaration française demandant la poursuite des travaux sur certains points en lien plus particulier avec la lutte contre le financement du terrorisme), puis définitivement, après traduction, le 20 avril 2015. Le Paquet a été adopté par le Parlement européen le 20 mai 2015 et publié le 5 juin 2015 ; il devra être transposé d’ici le 26 juin 2017.
1.1.2 Présentation du contenu du « Paquet anti-blanchiment et financement du terrorisme »
a) La « 4ème directive anti-blanchiment »
1/ Un champ d’application développé et précisé
Au regard des dispositions de la 3ème directive, le champ d’application de la 4ème directive comporte des précisions sur la couverture du secteur des jeux d'argent et de hasard : alors que la 3ème directive ne citait que les casinos, les jeux d’argent et de hasard entrent dans le champ d’application de la 4ème directive et les Etats membres ne peuvent désormais exempter du champ d’application les activités relevant de ce secteur que sur le fondement d’une analyse des risques montrant un risque faible (les casinos entrent sans dérogation possible dans le champ d’application de la directive); en outre, des mesures de vigilance sont obligatoires au-delà de 2000 € au stade des gains, des mises, ou des deux. Le seuil au-delà duquel les paiements en espèces sont obligatoirement soumis à vigilance est abaissé de 15 000 € à 10 000 €. Les personnes politiquement exposées (PPE) à l’égard desquelles doivent être appliquées des mesures de vigilances renforcées dédiées sont définies largement : quel que soit leur lieu de résidence y compris sur le territoire national (ce qui va au-delà des standards du GAFI13).
2/ L’analyse des risques comme fondement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme comme le recommande le GAFI (recommandation n°1)
La 4ème directive prévoit qu’une analyse des risques doit être menée au plan national (article 7), pour identifier les risques les plus prégnants dans ce domaine, et permet à chaque Etat membre et aux autorités compétentes de prendre des mesures adaptées à ces risques. L’approche par les risques doit être également adoptée par les organismes assujettis, financiers et non financiers, en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour adapter leurs mesures de vigilance à l’égard de leurs clients personnes physiques ou morales.
La 4ème directive prévoit également le développement d’une « analyse supranationale des risques » qui sera menée par la Commission européenne dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la directive en lien avec les représentants des États membres ainsi que les autorités compétentes et de contrôle, et destinée à évaluer les risques prégnants au plan européen ; cette analyse débouchera sur un rapport et des recommandations de la Commission aux États membres, ceux-ci se servant des conclusions de ce rapport pour effectuer leur analyse des risques au niveau national. Cette analyse supranationale des risques est une disposition innovante et ambitieuse au regard de l’existant.
3/ Une gradation des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en fonction des risques
Les organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont d’ores et déjà astreints à des mesures de vigilances à l’égard de leur clientèle, qu'il s’agisse d’une clientèle en relation d’affaires ou d’une clientèle occasionnelle. Ces mesures de vigilance comprennent :
- des mesures d’identification/vérification d’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires ou des opérations occasionnelles ;
- l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ;
- et l’exercice d’un contrôle continu de la relation d’affaires.
Comme la 3ème directive, la 4ème prévoit que les mesures de vigilance peuvent être modulées en fonction des risques de blanchiment des capitaux/financement du terrorisme :
- mesures simplifiées en cas de risque moins élevé de la relation d’affaires ou de la transaction, sans possibilité d’exonération des mesures de vigilances (possibilité qui était ouverte dans le cadre de la 3ème directive);
- mesures renforcées en cas de risque élevé.
Elle comprend deux annexes portant une liste non exhaustive de facteurs de risques moins élevés ou plus élevés. Les autorités européennes de supervision sont chargées, en outre, de publier, d’ici au 26 juin 2017, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des établissements financiers sur les facteurs de risques à prendre en compte et les mesures à mettre en œuvre en conséquence.
De plus, des mesures de vigilance renforcée sont obligatoires dans certains cas : pour les opérations en lien avec des pays tiers non coopératifs identifiés par la Commission, par des actes délégués (nouveauté importante consacrant une véritable lutte européenne contre les juridictions non coopératives) ; dans le cadre d’opérations de correspondance bancaire en lien avec les établissements clients d’État tiers ; pour les opérations avec des personnes politiquement exposées dont la définition est élargie.
Pour le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, la 4ème directive introduit des mesures de vigilance spécifiques au regard de ce qui était prévu dans la 3ème directive, en particulier si le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée.
4/ La mise en place de registres centralisés des personnes morales et des trusts permettant un accès large à l’information sur les bénéficiaires effectifs
En l’état du droit (3èm directive), l’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts repose au plan européen sur les organismes assujettis. La 4ème directive place l’Union européenne au premier plan en matière de transparence de l’accès à l’information sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts en prévoyant un accès centralisé et largement ouvert à cette information. Les États membres devront ainsi tous détenir l’information sur les bénéficiaires effectifs au sein d’un registre centralisé, dont l’accès sera ouvert aux autorités compétentes et cellules de renseignement financiers sans restriction, aux organismes assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance et, pour les personnes morales, aux tiers (tels les journalistes et les ONG), sous réserve d’un intérêt légitime. Le texte n’interdit pas aux États membres de prévoir un accès entièrement public s’ils le souhaitent.
La directive prévoit également une étude de la Commission menée sur une interconnexion au niveau européen des registres des bénéficiaires effectifs des personnes morales comme des trusts dont le résultat devra être présenté au Parlement européen et au Conseil ,assorti, le cas échéant, d’une mesure législative dans les quatre ans suivant la publication de la directive.
5/ Un encadrement strict de la monnaie électronique anonyme
Le régime actuel (3ème directive) prévoit que les organismes assujettis peuvent ne pas vérifier l’identité de leur client et n’exercer aucune mesure de vigilance si les conditions suivantes sont remplies : i) les cartes prépayées non rechargeables sont d’un montant de moins de 250 euros (ou 500 euros sur option d’un Etat Membre), ii) les cartes rechargeables ont un montant annuel allant jusqu’à 2500 euros, iii) le remboursement d’une carte prépayée d’un montant unitaire ou cumulé sur un an ne peut dépasser 1000 euros.
La 4ème directive prévoit un encadrement plus strict de la monnaie électronique anonyme : certaines mesures de vigilance dont la vérification d’identité (mais non la surveillance des transactions ou des relations d’affaires) peuvent ne pas s’appliquer sur la base d’un risque faible établi par l’Etat Membre seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies : i) les cartes ne sont pas rechargeables, ou le montant mensuel maximum de transactions est de 250 euros dans un seul Etat Membre, ii) le montant maximum stocké ne peut dépasser 250 euros (qui peut être porté à 500 euros si la carte est utilisable dans un seul État Membre), iii) la carte ne peut être alimentée par de la monnaie électronique anonyme. De plus, le remboursement en espèces à partir d’une carte prépayée est soumis à une obligation de vérification d’identité à partir de 100 euros.
6/ Un renforcement des prérogatives des Cellules de renseignements financiers
La 4ème directive comprend davantage de dispositions sur les Cellules de renseignements financiers (CRF) que la 3ème directive et met en particulier l’accent sur l’indépendance opérationnelle et l’autonomie de ces dernières, conformément aux standards du GAFI. Elle prévoit également des dispositions visant à renforcer la coopération entre les cellules de renseignements financiers au plan européen.
7/ Contrôle et supervision : l’introduction du principe de l’approche par les risques en matière de supervision (nouveauté par rapport à la 3ème directive)
L’autorité de contrôle devra évaluer le profil de risque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des organismes financiers soumis à son contrôle et le revoir régulièrement, ou en cas de survenance d’événements ou d’évolutions importants dans la gestion et les opérations des organismes. L’intensité et la fréquence des contrôles devront être définies notamment au regard du profil de risque.
La 4ème directive reconnaît la supervision consolidée au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle confère des pouvoirs spécifiques au superviseur de l’entité-mère du groupe si la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre efficace du dispositif LCB-FT défini au niveau du groupe par les filiales ou les succursales qui y sont implantées. En effet, l’autorité de contrôle de l’entité-mère pourra demander, en cas de difficulté persistante, de ne pas établir ou de mettre fin à des relations d’affaires dans ce pays tiers, voire de fermer son implantation à l’étranger.
Par ailleurs, la 4ème directive rappelle le principe de territorialité selon lequel il appartient à l’autorité compétente du pays d’accueil de s’assurer du respect des règles LCB-FT par l’organisme exerçant en libre établissement dans ce pays d’accueil (sous la forme d’une succursale mais aussi sous une autre forme, i.e. via des agents ou distributeurs pour les établissements de paiement et de monnaie électronique qui peuvent y avoir recours). Elle rappelle également que les autorités compétentes du pays d’accueil doivent néanmoins coopérer avec celles du pays d’origine (siège social).
S’agissant des établissements de paiement (EP) et des établissement de monnaie électronique (EME) européens qui ont recours à des agents ou distributeurs dans un autre Etat membre, elle reconnaît la possibilité pour le pays d’accueil d’exiger la désignation d’un représentant permanent (selon le modèle du dispositif français actuel) et renvoie à un règlement délégué de la Commission européenne la définition des critères de désignation d’un tel représentant et de ses missions. L’élaboration de ce règlement a été confiée aux autorités européennes de supervision.
8/ Innovations concernant les pouvoirs de sanctions des autorités compétentes vis-à-vis des établissements assujettis aux règles LCB-FT
Afin de mettre fin à des pratiques divergentes au sein de l’Union, la 4ème directive harmonise, a minima, les sanctions administratives applicables en cas de violation « sérieuse, répétitive ou systématique » par les organismes assujettis des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration de soupçon, de conservation des données et des dispositions relatives au contrôle interne.
Ainsi, la directive prévoit pour les établissements financiers :
- pour les personnes morales, un plafond d’au moins 5 millions d’euros (soit bien inférieur à celui applicable en France de 100 millions d’euros pour la plupart des organismes des secteurs de la banque et de l’assurance, mais supérieur à celui d’un million d’euros actuellement en vigueur à l’égard des changeurs manuels) ou un pourcentage de 10% du chiffre d’affaires annuel (comme prévu en France en matière prudentielle à la suite de la transposition de la directive CRD4);
- pour les personnes physiques, dirigeants effectifs des établissements financiers, un plafond d’au moins 5 millions d’euros (ce qui correspond au plafond actuellement prévu dans le code monétaire et financier pour les organismes des secteurs de la banque et de l’assurance, mais ce plafond va au-delà de celui d’un million d’euros prévu pour les dirigeants des changeurs manuels). La 4ème directive ne restreint pas la sanction pécuniaire aux dirigeants des établissements financiers, mais l’étend également aux personnes responsables du manquement à la réglementation (le responsable du dispositif LCB-FT ou de la conformité, en particulier).
b- Le règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds
Le règlement relatif à l’information accompagnant les transferts de fonds met le droit européen en conformité avec les standards du GAFI (recommandation 16 sur les transferts de fonds, qui requiert la transmission de l’information relative au donneur d’ordre et au bénéficiaire de ces transferts) et comporte deux ajouts majeurs au regard du règlement 1781/2006 actuel :
i) il impose aux prestataires de services de paiements (PSP), dans le cadre des transferts de fonds, une obligation d’information sur le bénéficiaire en plus de celle sur le donneur d’ordre (seule prévue par le droit actuel comme dans le précédent règlement) ;
ii) il impose aux PSP du donneur d’ordre et du bénéficiaire de vérifier l’identité de leur client, soit respectivement l’identité du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire en cas de transfert de fonds effectué à partir de monnaie électronique anonyme ou en espèces sans condition de seuil, soit pour toute transmission de fonds (le règlement actuel prévoit un seuil de 1000 euros).
1.2 Principaux effets attendus aux plans européen et national
1.2.1 Effets concernant la directive
Les précisions sur le champ d’application de la directive et sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle renforceront aux plans européen et national les mesures exercées par les acteurs de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La directive ne prévoit plus (contrairement à la 3ème directive) d’exonération des mesures de vigilance en cas de risque faible.
Les nouvelles règles permettront aux plans européen et national d’encadrer et de limiter les flux en espèces (vérification d’identité pour les paiements en espèces de plus de 10 000 euros, au lieu de 15 000 euros prévus par la « 3ème directive ») et en monnaie électronique anonyme en durcissant les possibilités d’utilisation de la monnaie électronique anonyme. Il s’agit d’une avancée, tant en matière de lutte contre le blanchiment que de lutte contre le financement du terrorisme, alimenté par des flux financiers souvent opaques.
Le renforcement de l’exigence de l’analyse des risques aux plans européen et national permettra une meilleure appréhension des risques transfrontaliers au niveau de l’UE et des risques nationaux. Cela se fera au plan européen par une analyse européenne (supra nationale) des risques et une liste européenne des juridictions non coopératives. Au plan national, la conduite d’une analyse nationale des risques est désormais requise des États membres. Cette analyse nationale des risques permettra de mettre à jour et d’enrichir le « rapport sur la menace » menée par le Comité d’orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) en 2012, qui constitue un premier exercice en la matière.
Le renforcement de la transparence de l’information sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts, via la mise en place de registres centralisés détenant l’information sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts, permettra à l’Union européenne et à la France d’être au premier plan dans ce domaine, leur donnant la légitimité d’inciter les autres pays, notamment dans le cadre des discussions en G20, à faire de même.
Concernant les Cellules de renseignements financiers (CRF), la 4ème directive appelle à une plus grande harmonisation des pratiques des CRF des Etats membres, ainsi qu’une meilleure coopération entre elles, notamment concernant l’échange d’informations sur les « cross-border situations » (cas de flux suspects impactant plusieurs Etats membres) et l’exercice des droits de communication par une CRF d’un Etat membre auprès de l’un de ses assujettis, pour le compte d’une CRF d’un autre Etat membre.
1.2.2 Effets concernant le règlement
Le règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds est d’application directe. Il renforcera le droit européen concernant les informations accompagnant les transferts de fonds y compris vers les pays tiers et les exigences de vérification d’identité par les établissements financiers, qui devront intervenir dès le premier euro pour les transferts de fonds à partir d’espèces ou de monnaie électronique anonyme.
1 – Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne
En matière de mesures de vigilance, le droit national est directement impacté en ce qui concerne les personnes politiquement exposées et les mesures de vigilance pour la monnaie électronique anonyme. De plus, la directive relève le niveau des mesures de vigilance dans le domaine de l’assurance. Etant d’harmonisation minimale, la directive est une opportunité pour les pouvoirs publics de renforcer leur réglementation en particulier sur les paiements en espèces et les jeux, pour faire face aux nouvelles menaces en matière de blanchiment et financement du terrorisme. Sur l’ensemble de ces points, des mesures législatives et réglementaires sont à prévoir en particulier dans le code monétaire et financier.
Les dispositions relatives à l’analyse des risques devraient susciter peu de modification de la législation française. S’agissant de l’analyse nationale des risques, la réglementation prévoit déjà une institution chargée de mener cette analyse : le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), qui est une enceinte nationale de coordination instituée par décret du 18 janvier 2010 et qui réunit l’ensemble des services de l’État et les autorités de contrôle concernés. Il est probable en revanche qu’une disposition indique que cette analyse nationale des risques sera établie en tenant compte de l’analyse européenne des risques menée par la Commission.
S’agissant des registres centralisés des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts, cette exigence se traduira, en plus des registres des fiducies et des trusts, ce dernier étant en cours de création, par l’insertion de l’information sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales au sein d’un registre centralisé largement ouvert qui nécessitera une modification substantielle de la législation nationale.
En ce qui concerne les CRF, le droit français est déjà très largement en conformité avec les dispositions de la 4ème directive. Il conviendra néanmoins d’adapter certaines dispositions notamment afin de consacrer l’indépendance et l’autonomie opérationnelle de la cellule de renseignement financier, de renforcer les possibilités d’échanges avec les CRF des autres Etats membres et de préciser les conditions de dissémination des informations ainsi échangées.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la supervision, la législation nationale pourrait être revue : pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à compléter ; désignation d’un représentant permanent auprès des autorités compétentes et de contrôle des établissements de paiement et de monnaie électronique dont le siège est dans un autre Etat membre et intervenant sur le territoire national via un ou plusieurs agents ou distributeurs (cf supra).
S’agissant des dispositions en matière de sanction, même si le droit national prévoit d’ores et déjà des dispositions contraignantes dans le code monétaire et financier, la 4ème directive pourrait permettre de prendre des dispositions législatives de nature à renforcer les prérogatives des autorités de contrôle et de sanction.
Le droit national n’aura pas à être modifié par les dispositions concernant les vérifications d’identité qui sont déjà requises au plan réglementaire dès le premier euro pour les transmissions de fonds effectuées par des établissements financiers vis-à-vis d’un client occasionnel en vertu du II de l’article R. 561-10 du code monétaire et financier. Il convient de noter que le règlement devra être appliqué par Monaco, qui a conclu un accord monétaire avec la France en vertu de la décision de la Commission n°2010/259/CE, et qui devra se mettre en conformité d’ici le 26 mars 2017 avec ses dispositions, sous peine de voir cette décision dénoncée par la Commission. Le droit national devrait être également impacté par les dispositions concernant les dispositions relatives aux sanctions.
2. Autres mesures liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mais non directement liées à la transposition du Paquet
(2°, 4°, 6° et 7° de l’article 33 – I)
Si les 1° et 3° de l’article 33 – I ont pour objet de prévoir la transposition et la mise en conformité du droit français avec le Paquet européen, les 2°, 4°, 6° et 7° de l’article 33 – I sont des dispositions connexes, visant à étendre la liste des entités assujetties à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme au-delà du champ d’application express de ces textes (2°), modifier et/ou renforcer les règles qui régissent les autorités de contrôle et de sanction ainsi que de TRACFIN (2°, 4°, 6°) et apporter certaines modifications formelles aux textes du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un souci d’intelligibilité et de cohérence du droit (7°).
Ainsi, le 2° prévoit des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la définition des modalités d’assujettissement, de contrôle et de sanction de certaines entités non visées par le champ d’application de la directive. Le Gouvernement souhaite en effet pouvoir étendre les dispositions de la directive à certaines professions au-delà de ce que prévoit ce texte. La directive autorise cette extension dans son article 4 ; cette extension est également possible en vertu du principe d’harmonisation minimale énoncé à l’article 5. D’ores et déjà, le droit actuel (article L. 561-2 du code monétaire et financier) prévoit que la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’applique aux vendeurs de métaux précieux et agents sportifs qui ne sont cités ni par la 3ème directive, ni par la 4ème directive. De plus, il conviendra de soumettre à une autorité de contrôle et à une autorité de sanction les nouvelles professions assujetties.
Le 4° prévoit des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires au renforcement des règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions mentionnée à l’article L.561-38. Le Gouvernement souhaite en particulier renforcer le rôle de cette commission compétente pour des professions non financières, le GAFI ayant, lors de son évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme le 25 février 2011, souligné qu’un renforcement du respect du dispositif LCB-FT par ces professions était nécessaire. Dans ce cadre, son activité est conduite à se développer. Afin de lui permettre d’exercer pleinement sa compétence, l’ajustement de certaines règles d’organisation pourrait contribuer à simplifier et sécuriser son fonctionnement. Ainsi, il pourrait être prévu que la personne mise en cause puisse se faire représenter à l’audience en cas de nécessité ou que la Commission puisse demander à la personne mise en cause la transmission des informations nécessaires à son activité.
Le 6° autorise le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi afin de mieux protéger le contenu et l’origine des informations détenues par TRACFIN et tendant à élargir les possibilités, pour ce service, de recevoir et de communiquer des informations. Ces finalités sont conformes aux orientations préconisées par le GAFI. En effet, selon les recommandations de cette institution, afin de renforcer l’action des cellules de renseignement financier (CRF), il est nécessaire de leur ouvrir un accès à la gamme la plus large possible d’informations, notamment financières et administratives, et de leur permettre de disséminer des informations à toutes les autorités compétentes impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.
Le 7° est une disposition permettant au Gouvernement de revoir et d’adapter certaines dispositions législatives en matière d’obligation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans un souci d’intelligibilité et de cohérence du droit.
3. Habilitation à prendre d’autres mesures en matière de gel des avoirs
Le 5° du projet d’ordonnance concerne les mesures de gel d’avoirs prises à titre national (en vertu de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier) ou en application d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies ou d’une décision de l’Union Européenne (article L.562-2). Il vise à mettre le droit français pleinement en conformité avec les exigences internationales issues des résolutions du Conseil de sécurité des Nations-unies 1267(1999) et suivantes, et 1373(2001) et suivantes.
En effet, les « fonds, instruments financiers et ressources économiques » susceptibles de faire l’objet d’une mesure de gel sont définis à l’article L.562-4 comme « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers » : il s’agit d’une définition large qui reprend la définition européenne figurant à l’article 1er du Règlement UE 2580/2001 du 27 décembre 2011 modifié. Toutefois, aux termes des articles L.562-1 et L. 562-2, seuls les avoirs « détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 » (personnes assujetties au respect de la législation anti-blanchiment et financement du terrorisme) peuvent être gelés : en conséquence, seuls les avoirs détenus en compte peuvent être gelés. Cette situation n’est pas conforme avec les exigences internationales car elle implique notamment que les avoirs immobiliers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de gel.
En pratique, la mesure de gel étant systématiquement accompagnée d’une interdiction de mise à disposition des fonds en vertu de l’article L. 562-5, la vente d’une bien immobilier appartenant à une personne dont les avoirs en compte sont gelés ne peut normalement pas conduire à ce que les fonds résultant de cette opération lui soient effectivement transmis. Toutefois, des détournements peuvent être organisés. Aussi, le Gouvernement envisage de modifier les dispositions du chapitre I et II du titre VI du Livre V du code monétaire et financier afin que la mesure de gel appréhende l’ensemble des avoirs et notamment les avoirs immobiliers. De même, le Gouvernement envisage de permettre le gel des avoirs non seulement détenus mais aussi contrôlés, directement ou indirectement, par une personne visée par la mesure de gel. Aujourd’hui, une personne dont les avoirs sont gelés et qui a un pouvoir sur autre compte bancaire dont les fonds ne lui appartiennent pas, peut, à partir de ce compte, effectuer toutes les opérations qu’elle souhaite puisque les articles L. 562-1 et L. 562-2 ne vise que les avoirs « détenus » par la personne gelée. Il est en conséquence nécessaire de pallier ces lacunes du droit français, ce qui permettra à ce dernier d’être en parfaite conformité avec les exigences internationales (résolution 1373 des Nations-Unies notamment).
Cette extension nécessitera d’élargir le champ des personnes soumises au respect de la mesure de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, défini à l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, au-delà des seules personnes définies à l’article L. 561-2, en particulier certaines entités publiques, pour empêcher le contournement de la mesure de gel. En outre, le Gouvernement envisage d’élargir le champ de l’article L. 562-8 qui ne permet dans sa rédaction actuelle la levée du secret bancaire que dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre d’une mesure de gel. Ainsi, pour que le secret bancaire soit levé, il convient que les autorités françaises prennent un arrêté de gel. Le secret bancaire est donc maintenu lorsque le gel est préparé et mis en œuvre en application d’un règlement européen, ce qui n’est pas opportun.
Enfin, les articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux mesures de gels d’avoirs ne mentionnent pas la possibilité offerte au ministre chargé de l’Economie et au ministre de l’Intérieur de débloquer , en vertu de l’article R. 562-1, une partie des sommes gelées «destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. ». Cette possibilité se déduit de la rédaction de l’article L.562-1 qui indique que peuvent être gelés « tout ou partie » des fonds. Dans un souci d’intelligibilité du droit et de conformité avec les exigences internationales, il convient que la loi précise explicitement cette possibilité, dont les modalités resteront définies dans la partie règlementaire du code monétaire et financier.
4. Applicabilité des modifications législatives en outre-mer
(8°, 9° et 10° de l’article 33 – I)
Le 8° de l’article 33 – I permet, d’une part, de rendre applicables dans les collectivités régies par « le principe de spécialité législative » c’est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 8°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder si nécessaire, aux adaptations de ces articles dans les collectivités soumises à « l’identité législative » (application en principe de plein droit) en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le 9° a pour objectif de rendre applicable à Wallis-et-Futuna toutes les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’au gel des avoirs, qui ne le seraient pas encore. La présente habilitation permettra donc de s’assurer que toutes les dispositions nationales prises dans ces domaines s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
Le 10° vise à étendre dans les collectivités d’outre-mer qui ne font pas partie de l’Union européenne le règlement UE n°2015/847 du 20 mai 2015 relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds dont les dispositions ne feront pour la plupart pas l’objet d’adaptations des codes au regard de leur champ d’application métropolitain. L’extension de ce règlement outre-mer devrait en revanche nécessiter une modification, en particulier du code monétaire et financier qui comprend un certain nombre de dispositions d’adaptation outre-mer concernant le règlement (CE) n° 1781/2006, abrogé par le nouveau règlement.
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
Le délai de transposition de la directive n° 2005/60/CE est de deux ans à compter de la date d’effet de la publication du Paquet européen intervenue le 26 juin 2015.
Il paraît opportun de prendre une ordonnance unique sur l’ensemble des sujets de procédure pénale prévus par le II de l’article 33. En conséquence le délai prévu pour prendre cette ordonnance est fixé à 6 mois.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE N°2013/48/UE DU 22 OCTOBRE 2013
1. Analyse des difficultés à résoudre
La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires a été adoptée le 22 octobre 2013 et doit être transposée avant le 26 novembre 2016.
Elle vise à instituer des garanties minimales en matière d’assistance d’un avocat au cours de l’enquête ou des poursuites et de droit à la communication avec un tiers pour les personnes privées de liberté. Elle présente également des dispositions spécifiques à l’exécution des mandats d’arrêts européens.
1.1. Droit à l’assistance d’un avocat pour les personnes suspectées ou poursuivies.
L’article 3 de la directive impose aux Etats de prévoir que les suspects ou les personnes poursuivies aient accès à un avocat « sans retard indu ». L’application de ce droit peut être exclue s’agissant des infractions n’étant pas sanctionnées d’une peine privative de liberté.
Sous cette réserve, il doit être garanti aux suspects et aux prévenus :
• avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;
• lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une confrontation, une reconstitution ou une séance d’identification de suspects ;
• après toute privation de liberté;
• lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.
Le système juridique actuel prévoit aujourd’hui le droit à l’assistance d’un avocat au bénéfice des personnes poursuivies, qu’elles soient présentées ou convoquées devant un juge d’instruction (article 116 du code de procédure pénale) ou prévenues devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police (articles 390 et 417 du code de procédure pénale).
Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti à chaque fois que la personne est entendue au cours du procès pénal, que l’audition ou la confrontation soit conduite par le juge d’instruction (article 114 du code de procédure pénale) ou par le Procureur de la République lorsqu’il décide de se faire présenter la personne en application de l’article 393 du code de procédure pénale. S’agissant des interrogatoires ou des confrontations réalisés par les services de police, l’assistance de l’avocat a été instituée par la loi du 14 mars 2011 s’agissant des personnes placées en garde à vue (article 63-4-2 du code de procédure pénale).
Transposant pour partie la directive du 22 octobre 2013, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales a étendu ce droit, à compter du 1er janvier 2015, à l’ensemble des personnes suspectées d’un crime ou un délit puni d’emprisonnement et entendues hors garde à vue, lors d’une « audition libre » (article 61-2 du code de procédure pénale).
En revanche, notre droit ne prévoit aujourd’hui le droit à l’assistance d’un avocat pour la personne retenue en exécution d’un mandat d’arrêt ou d’amener délivré par un juge.
Par ailleurs, l’assistance de l’avocat n’est prévue lors d’une reconstitution de scène de crime que lorsque cet acte a lieu au cours d’une instruction préparatoire.
Enfin, notre droit ne reconnaît à aucun stade de la procédure la possibilité de demander à ce qu’un avocat assiste à une séance d’identification de suspects.
1.2. Le droit des personnes privées de liberté à la communication avec un tiers
En droit français, les personnes suspectées ou prévenues privées de liberté se trouvent soit en garde à vue – ou soumises à une mesure dont le régime lui est assimilé, telle la rétention pour exécution d’un mandat – soit en détention provisoire.
1°) le droit à l’information d’un tiers
En son article 5, la directive impose aux Etats de garantir, d’une façon générale le droit de ces personnes privées de liberté à l’information d’un tiers. Lorsque la personne privée de liberté est mineure, la directive exige l’information de son représentant légal ou, en cas de défaillance, de tout autre adulte compétent.
Elle précise qu’il ne peut être dérogé à ce droit que pour « prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ». La décision doit être prise au cas par cas, par une autorité judiciaire ou dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant une autorité judiciaire.
D’une façon générale, l’article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté doit se voir remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant ses droits et notamment la possibilité d’informer au moins un tiers de la mesure privative de liberté à laquelle elle est soumise.
L’article 63-2 du code de procédure pénale reconnaît par ailleurs le droit pour la personne placée en garde à vue d’informer de la mesure un membre de sa famille et son employeur. Toutefois, l’officier de police judiciaire peut, sur autorisation non circonstanciée du Procureur de la République, ne pas faire droit à cette demande.
L’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose en outre que, lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit immédiatement en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Il peut cependant être dérogé à cet avis sur autorisation non circonstanciée du Procureur de la République, pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
2°) Le droit à la communication avec un tiers
En son article 6, la directive impose aux Etats de garantir le droit des personnes suspectées ou poursuivies privées de liberté de communiquer avec un tiers, en précisant que les États peuvent limiter ou reporter son exercice « eu égard à des exigences impératives ou à des besoins opérationnels proportionnés ».
Un droit de visite est aujourd’hui reconnu au bénéfice des personnes placées en détention provisoire par l’article 145-4 du code de procédure pénale ainsi que l’article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, dite pénitentiaire. Les articles 39 et 40 de cette loi leur reconnaissent par ailleurs le droit de téléphoner et de correspondre avec des tiers.
Le juge d’instruction peut toutefois s’opposer à l’exercice de ces différents droits. Si l’interdiction de correspondre ne peut excéder vingt jours, le juge d’instruction peut refuser sans motif toute demande de permis de visite émanant d’une autre personne qu’un membre de la famille du détenu ou toute demande d’usage du téléphone. Enfin, aucun recours n’est prévu dans l’hypothèse où il ne répond pas à une telle demande.
Par ailleurs, lorsqu’une personne est placée en garde à vue, aucun droit de communiquer avec les tiers ne lui est aujourd’hui reconnu.
3°) Les relations avec les autorités consulaires
L’article 7 de la directive donne une importance particulière au droit des personnes suspectées ou poursuivies d’informer et de communiquer avec les autorités consulaires, en ce sens qu’il ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.
D’une façon générale, l’article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté doit se voir remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant ses droits et notamment la possibilité d’informer les autorités consulaires de la mesure privative de liberté à laquelle elle est soumise.
Si cette faculté n’est pas prévue lors d’une garde à vue, notre droit permet la délivrance aux autorités consulaires d’un permis de visite des personnes placées en détention provisoire. Toutefois, le juge d’instruction peut toujours refuser de le délivrer.
1.3. Dispositions spécifiques à l’exécution des mandats d’arrêts européens.
L’article 10 de la directive impose aux Etats le respect d’un certain nombre de garanties précises s’agissant de l’assistance d’un avocat au bénéfice des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen. D’une part, le droit à l’assistance d’un avocat doit être assuré sans retard indu après la privation de liberté et comporter notamment le droit de s’entretenir avec la personne et de participer aux auditions. D’autre part, la personne arrêtée doit être mise en mesure de désigner un avocat non seulement dans l’Etat d’exécution du mandat, mais également dans celui d’émission.
En droit français, l’article 695-27 du code de procédure pénale garantit le droit de la personne interpellée à l’assistance d’un avocat, qui peut consulter le dossier, s’entretenir librement avec le justiciable et l’assister tout au long de la procédure d’exécution du mandat et notamment lorsqu’il est entendu par le Procureur général puis la chambre de l’instruction.
Aucune disposition ne permet en revanche la désignation, par la personne arrêtée en France, d’un avocat dans le pays d’émission.
2. OBJECTIF POURSUIVI
Si le droit français est globalement conforme aux exigences de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, sa transposition nécessite que notre législation soit modifiée, par le biais d’une habilitation donnée au Gouvernement à prendre une ordonnance, pour étendre le droit d’accès à l’avocat au cours de l’enquête, renforcer le droit de communication avec un tiers et permettre la désignation d’un avocat dans l’Etat d’émission d’un mandat d’arrêt européen.
2.1. Etendre le droit à l’assistance d’un avocat au cours de l’enquête
L’article 135-2 du code de procédure pénale est modifié afin de prévoir le droit à l’assistance d’un avocat au bénéfice de la personne interpellée en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
Il est également créé un article 61-3, aux termes duquel toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles permettant de soupçonner qu’elle a participé en tant qu’auteur ou complice à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement pourra demander qu’un avocat l’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ou soit présent auprès des personnes participant à une séance d’identification des suspects.
Par ailleurs, afin de renforcer l’effectivité de ce droit, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé sont définies de façon plus restrictive. Ainsi, les articles 63-4-2 et, s’agissant des crimes et délits commis en bande organisée, 706-88, sont modifiés afin de prévoir qu’outre l’hypothèse de la conservation des éléments de preuves, le procureur de la République ne peut reporter le droit à l’assistance d’un avocat que pour prévenir une atteinte « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Enfin l’article 64 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour permettre aux personnes justifiant des conditions de ressources idoines de bénéficier de l’aide à l’assistance d’un avocat lors d’une séance d’identification de suspect ou d’une reconstitution de scène de crime.
2.2. Renforcer le droit à la communication avec un tiers.
L’article 63-2 du code de procédure pénale est modifié afin de prévoir que la décision du Procureur de la République différant l’information du parent ou de l’employeur de la personne gardée à vue doit être prise « au regard des circonstances de l’espèce […] afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Par ailleurs, il est désormais précisé que si la garde à vue est prolongée au-delà de la quarante-huitième heure, le report de cette information doit être confirmé par le juge des libertés et de la détention.
L’article 63-2 est enfin complété pour permettre à la personne gardée à vue de demander à communiquer avec un parent, un employeur ou les autorités consulaires de son pays. Sauf en ce qui concerne ces dernières, l’officier de police judiciaire peut toutefois s’y opposer si cette communication lui apparaît incompatible avec les objectifs de la garde à vue ou si elle risque de permettre une infraction pénale.
S’agissant des mineurs, l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 est modifié pour prévoir que la décision du Procureur de la République ou du juge chargé de l’information différant l’avis donné au représentant légal du mineur devra également être prise « au regard des circonstances de l’espèce […] afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Enfin, l’article 145-4 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée à chaque fois qu’il refuse un permis de visite ou une autorisation de téléphoner. Il est en outre désormais précisé qu’après la clôture de l’information, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le Procureur de la République.
2.3. Permettre la désignation d’un avocat dans l’Etat d’émission d’un mandat d’arrêt européen.
L’article 695-27 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que, lorsqu’une personne est interpellée en France en exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle peut demander à être assistée dans l’Etat d’émission par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office.
Il est par ailleurs créé un article 695-17-1 qui dispose que, lorsque le Procureur de la République est avisé qu’une personne arrêtée à l’étranger en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par un juge français demande l’assistance d’un avocat en France, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat, ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier.
3. Options
3.1. Une réforme limitée à la transposition stricte de la directive
Alors que notre droit est pour l’essentiel conforme aux exigences de la directive du 22 octobre 2013, il pourrait être envisageable de se limiter à la simple transposition des règles énoncées par le texte européen.
Toutefois, il est apparu que la mise en œuvre des nouvelles garanties en faveur de la personne suspectée risquait, au cours de l’enquête, d’introduire un déséquilibre au préjudice des victimes.
3.2. Une réforme étendant certaines garanties aux victimes
Afin de garantir aux victimes des droits équivalents à ceux des personnes suspectées au cours des actes d’enquête nécessitant leur présence, le droit à l’assistance d’un avocat leur est reconnu lorsqu’elles participent à la reconstitution d’une scène de crime ou une séance d’identification de suspect.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1 Impacts sur l’aide juridictionnelle
Assistance d’un avocat en cas d’interpellation en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt :
Le nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la mesure s’avère très faible au vu des retours tant des magistrats instructeurs que des services d’enquête.
Il est en tout état de cause difficilement mesurable. L’impact de cette mesure peut être estimé à moins de 100 K €.
Assistance d’un avocat lors des reconstitutions :
Les reconstitutions ont lieu en général à l’instruction, où l’avocat est déjà présent. Lors de la phase d’enquête, elles sont peu fréquentes et concernent principalement, voire exclusivement, des personnes en garde à vue. L’avocat étant déjà rétribué forfaitairement pour l’assistance de la personne ou de la victime lors de cette phase, l’impact en termes d’aide juridictionnelle est donc négligeable.
Assistance d’un avocat lors des séances d’identification :
Les cas où la victime demandera à assistée par un avocat lors de séances d’identification des suspects devraient rester rares.
Par conséquent, l’impact de cette mesure peut être estimé à moins de 100 K€.
Assistance d’un avocat en cas de mandat d’arrêt européen émis en France
L’assistance de l’avocat peut déjà être prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle lorsque la France est le pays d’exécution du mandat d’arrêt européen depuis la parution du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l’aide juridique.
Au 31 octobre 2015, 39 interventions ont été rétribuées pour un montant de 8 192 euros (statistiques UNCA), soit 210 € en moyenne.
Cela correspond à 60 interventions sur une base annuelle, pour environ 800 personnes mises en état d’arrestation en France sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, soit 7,5% du nombre de mandats d’arrêt européens exécutés en France.
En appliquant ce ratio de 7,5 % aux 1.070 mandats d’arrêt européens émis par les juridictions françaises en 2014 (statistiques DACG), le nombre d’interventions qui bénéficieront de l’aide juridictionnelle peut être évalué à 80. Chaque intervention étant rémunérée en moyenne 210 € TTC, le coût de la mesure nouvelle est estimé à 17 000 € environ.
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/41/UE DU 3 AVRIL 2014
1. Analyse des difficultés à résoudre
La France applique aujourd’hui ces différents textes pour l’émission et l’exécution des demandes d’entraide pénale avec les autres pays de l’Union européenne.
En 2014, les autorités françaises ont reçu 805 mandats d'arrêt européens (contre 1034 en 2014, 1044 en 2012 et 1102 en 2011), qui ont donné lieu au même nombre d’interpellations et à 665 remises effectives. Par ailleurs, la durée moyenne de la procédure entre l’interpellation et la date de la décision définitive ordonnant la remise s’est allongée. En effet, ce délai a été de 19 jours pour les consentants (contre 13 jours en 2013 et 14 jours en 2012) et de 34 jours pour les non-consentants (contre 30 jours en 2013 et 37 jours en 2012).
Selon les données transmises par les juridictions françaises à la Direction des affaires criminelles et des grâces, celles-ci ont procédé à l'émission de 1070 mandats d'arrêt européens, (contre 1099 en 2013, 1156 en 2011 et 1087 en 2014) qui ont abouti à 411 remises.
Les données recueillies par la section centrale de coopération opérationnelle policière de la Direction centrale de la police judiciaire pour l’année 2014, révèlent que 945 mandats d’arrêt européens émis par les juridictions françaises ont été diffusés via le Système d’Information Schengen (contre 1200 en 2013) et ont donné lieu à 489 interpellations dans des Etats étrangers (contre 509 en 2013).
Seulement, la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, qui a été adoptée le 3 avril 2014 et qui doit être transposée avant le 22 mai 2017 , institue un dispositif de reconnaissance mutuelle des demandes d’enquête émises par les autorités d’un Etat membre à destination d’un autre Etat membre. Elle a vocation à remplacer les dispositions correspondantes de :
- la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen;
- la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et le protocole à celle-ci ;
Le passage à une logique de reconnaissance mutuelle, qui pose le principe de l’exécution des demandes d’enquête sauf exceptions limitativement énumérées par la directive, impose de modifier notre législation afin de préciser à quelles conditions de fond et de forme une demande émanant d’un Etat membre pourra être refusée.
2. Objectif poursuivi
L’habilitation donnée au Gouvernement permettra de modifier le code de procédure pénale afin de prévoir que l’exécution d’une décision d’enquête européenne ne peut être refusée que pour l’un des motifs fixés à l’article 11 de la directive (immunité, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, mesure ne pouvant être ordonnée en droit national, faits n’ayant pas été commis sur le territoire de l’Union ou ne constituant pas une infraction).
La procédure applicable sera également définie, en particulier les délais dans lesquels le Procureur de la République ou le juge d’instruction devront statuer sur un éventuel refus d’exécution.
Enfin, les conditions particulières à l’exécution des demandes de transfèrement temporaire de personnes détenues, d’audition par vidéoconférence ou téléconférence, d’informations relatives aux comptes ou opération bancaires, d’enquête discrète ou d’interception de communication seront précisées.
3. options
A une transposition littérale du texte de la directive, il sera privilégié une transposition constructive, laissant à la loi le soin de définir les principes et les conditions générales relatives à l’exécution des demandes d’enquête, et à la circulaire la détermination des modalités d’émission des décisions d’enquête adressées par la France.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Le principal impact de la transposition de la directive du 3 avril 2014 est de modifier le cadre juridique d’émission et de réception des demandes d’enquête pénale au sein de l’Union européenne, sans augmentative prévisible de l’activité d’entraide pénale des juridictions.
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
II DE L’ARTICLE 33 (dispositions concernant les saisies, mises sous scellés et confiscations)
a) DU 3° DU II DE L’ARTICLE 33
Transposer la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014
1. Analyse des difficultés à résoudre
La directive relative au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne a été adoptée le 3 avril 2014 et doit être transposée avant le 4 octobre 2016. Elle vise à harmoniser les procédures de saisie et de confiscation des produits du crime au sein de l’Union européenne.
La législation française a été significativement renforcée dans ce domaine au cours des cinq dernières années, notamment avec l’adoption de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a instauré l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), complétée à plusieurs reprises depuis, dernièrement par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
2. Objectif
La directive précise le champ d’application des mesures de gel et de confiscation des avoirs criminels, augmente l’étendue des pouvoirs de confiscation et de gel et instaure des garanties procédurales à l’égard des personnes concernées par ces mesures. Bien que le droit français soit déjà largement conforme, plusieurs modifications sont rendues nécessaires.
Ø Sort des biens saisis en l’absence de condamnation pénale et exécution des mesures de confiscation prononcées dans le cadre d’une condamnation par défaut
L’article 4 paragraphe 2 de la directive impose, lorsqu’une condamnation à une peine de confiscation, même par défaut, est rendue impossible en raison de d'une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits de l’infraction lorsque ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice.
En droit interne, une condamnation comportant une décision de confiscation des instruments ou produits de l’infraction peut être prononcée par défaut en cas de fuite du suspect ou de la personne poursuivie. Il est cependant nécessaire de prévoir les modalités d’exécution de la confiscation, lorsque la vente avant jugement n’a pas été possible, afin de garantir que le condamné ne pourra pas revendiquer la restitution des biens confisqués à l’expiration du délai de prescription de la peine.
Ø Recours contre les décisions de confiscation
Au terme de l’article 8 paragraphe 1 de la directive, les personnes concernées par les mesures de confiscation ont droit à un recours effectif et à un procès équitable. A cet égard, notre droit est conforme à ces exigences, sauf en ce qui concerne la procédure applicable devant la cour d’assises.
Ø Confiscation des biens saisis en cas d’extinction de l’action publique pour cause de décès de la personne suspectée ou poursuivie.
La présente mesure vise à dépasser les exigences de la directive en prévoyant, aux différents stades de l’enquête et des poursuites, un mécanisme permettant de refuser la restitution de biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction nonobstant l’extinction de l’action publique consécutive au décès de la personne soupçonnée ou poursuivie.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Ces mesures visent à renforcer l’efficacité de la procédure et les garanties accordées aux justiciables, en clarifiant le sort des biens saisis qui constituent le produit de l’infraction lorsque la personne est condamnée en son absence ou que l’action publique est éteinte avant qu’il ne soit statué sur la confiscation.
La gestion des avoirs criminels saisis, leur traçabilité et le transfert de leur propriété à l’Etat seront ainsi facilités, contribuant à une meilleure administration de la justice et une meilleure gestion budgétaire en limitant les cas dans lesquels le statut juridique des biens saisis est incertain et en favorisant leur aliénation et le versement du produit de la vente au budget de l’Etat.
4. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
b) DU 3° DU II DE L’ARTICLE 33
SIMPLIFIER ET RENFORCER L’EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SAISIES ET CONFISCATIONS, ET ÉTENDRE LES MISSIONS ET LES PRÉROGATIVES DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
1. Analyse des difficultés à résoudre
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis (ci-après AGRASC), créée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, dispose actuellement de prérogatives définies notamment au titre trentième du livre IV du code de procédure pénale et par les articles 707-1 et 695-9-50 du code de procédure.
Ses principales missions sont la gestion des biens saisis et confisqués, l’aliénation de ces biens sur autorisation, la publication des formalités d’hypothèques pour les saisies immobilières, l’information des victimes et administrations publiques et le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués, l’aide et l’assistance aux juridictions, et les missions relevant de la coopération pénale internationale.
L’AGRASC a suggéré, dans son rapport annuel 2014, certaines pistes d’amélioration de la législation entourant ses missions.
2. Objectif
Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif et d’augmenter l’aide que l’AGRASC peut apporter aux juridictions, il est proposé de clarifier les pouvoirs de l’agence et d’en étendre les missions. Il s’agit notamment d’une part de clarifier ses missions dans le cadre de la gestion des biens confisqués avant leur aliénation, dans l’aide juridique et technique qu’elle peut apporter aux juridictions en matière de saisie et confiscation, d’autre part d’étendre ses pouvoirs de gestion des biens saisis dans l’hypothèse de saisie de biens nécessitant des formalités de publication, de gestion des biens saisis menaçant ruine, de rationaliser la gestion des fonds en organisant leur abondement au budget général de l’Etat lorsque l’identification de leur statut n’a pas pu être établie, et enfin d’améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes et d’actions récursoires qui peuvent s’exercer de la part de l’Etat ou du fonds de garantie dans ces cas.
• Pouvoir d’intervention d’initiative de l’AGRASC :
L’objectif est de permettre à l’AGRASC d’intervenir auprès du parquet compétent ou de la juridiction pénale, spontanément ou à leur demande, pour favoriser l’exécution d’une saisie ou d’une confiscation sollicitée sur le territoire national par un Etat étranger ou par les autorités judiciaires nationales, ou sur le territoire d’un Etat étranger par une autorité judiciaire française.
De fait, l’AGRASC remplit déjà cette dernière mission en application des articles 695-6-50 à 53 du code de procédure pénale (transposition de la décision du Conseil du 06 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres de l'Union Européenne en matière de dépistage et d'identification des produits du crime) mais les textes ne lui reconnaissent pas ce rôle de manière suffisamment explicite puisqu’ils ne font état que de la possibilité d’un échange d’informations alors que l’assistance prêtée va très au-delà, notamment par l’aide à la préparation des certificats de gel ou de confiscation ou l’aide à la coordination entre enquêtes françaises et étrangères.
• Monopole de l’AGRASC pour la publication des saisies de fonds de commerce :
L’objectif est de conférer à l’AGRASC un monopole en matière de publication des saisies de fonds de commerce afin d’améliorer la capacité statistique et de prévenir les mesures ruineuses relatives aux saisies des fonds de commerce.
Dans son rapport annuel 2014, l’agence souligne l’intérêt qu’il y a à créer un tel monopole à son profit en la matière à l’image de ce qui existe déjà pour les saisies immobilières, les saisies de fonds de commerce étant soumises comme les saisies immobilières au formalisme de la publicité.
A cet égard, il permettrait de décharger les juridictions de l’accomplissement de ces formalités. L’AGRASC se propose de définir avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce une procédure unique applicable sur l’ensemble du territoire national. Enfin, cette mesure permettra de satisfaire aux objectifs généraux de centralisation des mesures de saisies et d’établissement d’un bilan statistique.
La mise à exécution des premières saisies de fonds de commerce engendre des frais très importants pour l’Etat, et leur gestion centralisée pourrait être vecteur d’économies.
• Rapatriement du solde non identifié de l’AGRASC au budget général de l’Etat :
La présente mesure a pour objectif d’étendre aux cours d’appels et aux tribunaux d’instance le mécanisme de remontée au budget général de l’Etat des sommes détenues et pour lesquelles l'identification de leur statut juridique, saisies ou confisquées, ne peut plus être établi, à l’instar du mécanisme qui avait été mis en place pour les tribunaux de grande instance et qui avait permis la remontée au budget général de près de 100 millions d’euros en 2014.
Il est par ailleurs souhaitable d’instaurer un mécanisme pérenne de rapatriement au budget général de l’Etat de la partie du solde de l’AGRASC pour laquelle l'identification du statut de ces sommes, saisies ou confisquées, reste non établie à l’issue d’un délai de 4 ans après réception des fonds.
• Interdiction du recours subrogatoire du FGTI contre l’AGRASC :
L’objectif est d’interdire le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre l’AGRASC.
Le texte actuel de l’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
Comme le souligne le rapport annuel 2014 de l’AGRASC, « l’Agence n’a jamais été conçue comme une assurance ou une caisse de garantie ». Il n’entre pas dans son rôle d’utiliser ses fonds propres pour indemniser, même via un recours subrogatoire, les victimes d’infractions.
• Clarification des pouvoirs de l’AGRASC pour la gestion des biens confisqués :
L’objectif est de clarifier les pouvoirs de gestion de l’AGRASC portant sur les biens confisqués, entre le moment de la réception de la décision de confiscation et celui de l’aliénation effective de ce bien, en conférant à l’Agence chargée de l’exécution des confiscations tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des actes de gestion, de conservation et de valorisation du bien qu’elle est tenue de réaliser dans la phase qui se situe entre le moment où une décision définitive de confiscation lui est communiquée pour exécution par un parquet et le moment où intervient effectivement la vente du bien concerné.
Ces mesures concernent principalement la gestion des biens immobiliers (parfois habités par des locataires ou des occupants sans titre) et des entreprises en activité qui ne peuvent être laissés à l’abandon pendant plusieurs mois et pour lesquels des décisions importantes ne peuvent être prises sans fondement juridique. Mais ces mesures peuvent aussi concerner des biens mobiliers dits « complexes » qui, quoique n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de gestion particulière pendant la phase préalable au procès, peuvent être confiés pour la première fois par les parquets à l’Agence en vue de l’exécution de la confiscation, c’est-à-dire pour leur vente.
• Aliénation avant jugement des biens menaçant ruine :
La présente mesure a pour objectif de renforcer la bonne gestion des biens saisis confiés à l’AGRASC, en permettant à cette agence de les vendre avant jugement au fond, lorsque les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à leur valeur en l’état.
Le système actuel de l’article 706-143 instaure la responsabilité financière du détenteur du bien ou de son propriétaire pour la charge de la conservation du bien, sauf lorsqu’il est défaillant ou indisponible, l’Agence pouvant être chargée de sa « valorisation ».
Ce texte ne concerne que les biens saisis, et dont la propriété n’a donc pas été transférée à l’État.
La notion de « valorisation » peut s’entendre, soit de tout acte d’entretien ou d’exploitation qui engendrerait des profits ou une augmentation de la valeur du bien, soit de toute dépense réalisée dans ce même objectif. Autant il peut sembler cohérent de confier à l’Agence la mission de valoriser des biens immobiliers appartenant à l’État (ce qui est le cas des biens confisqués) ou celle de valoriser , à peu de frais, des biens mobiliers saisis ne lui appartenant pas, dans la perspective d’assurer leur vente dans de meilleures conditions (tant dans l’intérêt immédiat de leur propriétaire que dans celui éventuel de l’État), autant il est difficile de concevoir que l’État, par l’intermédiaire de l’AGRASC, puisse investir des fonds dans des travaux de valorisation d’un bien immobilier qui ne lui appartient pas.
Il apparaît pourtant que certaines collectivités publiques sur le territoire desquelles des biens immobiliers ont été saisis et confiés à l’Agence dans le cadre d’un mandat de gestion, s’appuient sur les dispositions de ce texte pour solliciter de l’Agence des actes de valorisation, c’est notamment la tentation lorsqu’il s’agit d’immeubles classés.
S’il apparaît nécessaire donc, d’exclure les actes de valorisation des immeubles par simples impenses de l’Agence, cette notion de valorisation semble devoir être maintenue, notamment pour permettre une gestion optimale des biens meubles destinés à la vente.
La solution consiste donc à exclure du champ d’application de ce texte les biens saisis, quelle que soit leur nature, dont les frais de gestion sont ruineux pour l’Etat.
• Amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes par l’AGRASC :
La présente mesure a pour objectif d’améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes par l’AGRASC en précisant les étapes procédurales de ce mécanisme.
L’AGRASC a souligné dans son rapport annuel de 2014 les imprécisions de l’actuel article 706-164 qui définit cette procédure particulière d’indemnisation, en ce qui concerne la détermination de l’assiette du paiement, du délai imparti pour saisir l’AGRASC, et de la répartition des fonds à effectuer entre les différentes parties civiles lorsque les biens confisqués sont insuffisants pour toutes les indemniser.
La loi du 9 juillet 2010 susmentionnée a attribué à l’agence un rôle majeur d’indemnisation des victimes parties civiles, outre les recours habituels contre l’auteur des faits et des mécanismes de solidarité que sont la Commission d’indemnisation et d’aide aux victimes (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI). Dans sa rédaction actuelle, ce texte pose de nombreuses difficultés, qui ne permettent pas une mise en œuvre efficace de ce mécanisme d’indemnisation.
L’esprit du texte était de limiter l’obligation mise à la charge de l’AGRASC au seul versement des sommes ou valeurs liquidatives des biens qu’elle détenait. L’Agence n’a jamais été conçue comme une assurance ou comme une caisse de garantie.
Mais les ambiguïtés rédactionnelles du texte peuvent inspirer des lectures et des analyses différentes dont les conséquences seraient, non seulement inéquitables, mais lourdes de conséquences financières pour l’établissement :
L’indication que la partie civile est indemnisée « prioritairement » sur les biens confisqués, ce qui traduisait simplement une volonté du législateur de 2010 de préférer les intérêts de la victime à ceux de l’État, pourrait conduire à une lecture erronée laissant entendre que l’AGRASC pourrait indemniser « prioritairement » sur les biens confisqués, puis subsidiairement et à défaut de fonds confisqués suffisants, sur ses fonds propres.
Faute de délai imparti pour agir, l’Agence pourrait indéfiniment attendre d’hypothétiques demandes de parties civiles et donc ne jamais verser les sommes confisquées à l’État.
Enfin, il paraîtrait opportun d’exclure les services de l’État du bénéfice de ces dispositions. Il semble en effet peu pertinent de reconnaître à l’État, sur les mêmes sommes, la double qualité de créancier et de débiteur ; en pratique, l’admettre, revient dans bien des cas à dispenser le condamné de son obligation à l’égard de la partie civile.
Dans cette perspective, l’article 706-164 sera modifié afin de transcrire dans la loi les précisions nécessaire à la détermination des biens pouvant servir d’assiette à l’indemnisation des victimes, ainsi que la détermination d’une procédure applicable, en établissant un juste équilibre entre les droits et intérêts des victimes et la préservation des intérêts de l’Etat par la recette attendue sur les biens confisqués.
• Accès à CASSIOPEE par l’AGRASC
L'AGRASC, dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi du 9 juillet 2010, déclare nécessiter un accès direct aux données de Cassiopée. L’AGRASC est actuellement destinataire d’informations Cassiopée, au titre de l’article R15-33-66-9 CPP, et obtient ainsi, au cas par cas, un accès aux informations contenues dans l’application via un magistrat ou un fonctionnaire habilité en juridiction, par le biais de copies écran. L’AGRASC explique que, pour remplir les missions qui sont les siennes, elle est contrainte de solliciter en permanence les greffes des juridictions pour obtenir de l’information actualisée sur l’état des procédures. Elle sollicite donc un accès direct à Cassiopée afin d’accéder à l'information manquante sans solliciter les greffes des juridictions pour un volume d'affaires extrêmement conséquent, s'assurer du développement de la procédure.
L’introduction d’une disposition en ce sens par voie règlementaire a été envisagée mais le 27 octobre 2015, le Conseil d'Etat, examinant le projet de décret relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé Cassiopée, a disjoint l’article correspondant au motif que la création d’un droit d’accès direct à Cassiopée au bénéfice de l’AGRASC relevait nécessairement du domaine de la loi et non du niveau réglementaire.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Les modifications portant sur la clarification des pouvoirs de l’AGRASC et l’extension de ses missions sont de nature à améliorer l’efficacité du dispositif de saisie et confiscation des biens.
Elles auront ainsi un impact sur les finances publiques :
- Les sommes enregistrées et non identifiées en comptabilité de l’AGRASC en 2011 et qui seraient susceptibles d’être versées au budget général de l’Etat représente à ce jour 1,2 M€. L’extension aux cours d’appel et aux tribunaux d’instance du mécanisme de remontée au budget général des sommes détenues pour lesquelles le statut juridique ne peut être identifié devrait conduire à une recette supplémentaire pour l’Etat de quelques millions d’euros.
- Plusieurs mesures sont de nature à accélérer certaines ventes et à diminuer les frais de gestion de certains biens (extension du pouvoir d’intervention de l’AGRASC, aliénation avant jugement des biens menaçant ruine, monopole de publication des saisies de fonds de commerce).
- La clarification des prérogatives de l’AGRASC permet d’éviter des risques de contentieux (interdiction du recours subrogatoire du FGTI contre l’AGRASC, amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes).
- L’accès direct de l’AGRASC à Cassiopée lui permettrait d’avoir une connaissance plus rapide des décisions de justice, sans avoir besoin de saisir les juridictions d’une demande, et d’accélérer ainsi la valorisation des biens.
4. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
c) DU 3° DU II DE L’ARTICLE 33
MISE EN CONFORMITE DE NOTRE DROIT AVEC LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 16 OCTOBRE 2015 RELATIVE A LA RESTITUTION DES OBJETS PLACES SOUS SCELLE AU COURS DE L’INSTRUCTION
1. Analyse des difficultés à résoudre
Dans sa décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale.
Le Conseil a en effet estimé que s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction, en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer, conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif.
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017.
2. Objectif
L’habilitation donnée au Gouvernement permettra de modifier l’article 99 du code de procédure pénale pour prévoir qu’en l’absence de réponse du juge d’instruction à une demande de restitution d’un objet placé sous scellé, la personne peut, à l’issue d’un délai d’un mois à compter du dépôt de sa requête, en saisir directement le président de la chambre de l’instruction.
3. Options
Il est envisagé soit de se limiter à la modification de l’article 99 du code de procédure pénale, soit d’instituer en outre dans le code de procédure pénale une disposition transversale accordant d’une façon générale un droit de recours devant l’autorité compétente à toute personne ayant formulé, en application des dispositions de ce code, une requête nécessitant une décision motivée et susceptible d’appel, lorsqu’il n’a pas été répondu à cette requête.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La réforme projetée est de nature à renforcer les garanties des justiciables et à accroître très modérément la charge de travail des juridictions, car il est actuellement exceptionnel qu’il ne soit pas répondu par les juges d’instruction à des demandes de restitution de scellés.
5 Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
d) DU 3° DU II DE L’ARTICLE 33
MISE EN CONFORMITE DE NOTRE DROIT AVEC LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 21 MARS 2014 RELATIVE À LA PROCÉDURE D’IMMOBILISATION DES NAVIRES ET LA FIXATION DU CAUTIONNEMENT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DES POLLUTIONS MARITIMES
1. Analyse des difficultés à résoudre
Dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014 le Conseil constitutionnel a jugé qu’au « au regard des conséquences qui résultent de l’exécution de la mesure de saisie, la combinaison du caractère non-contradictoire de la procédure et de l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété » (cons. 14).
2. Objectif
La procédure d’immobilisation des navires en matière de pollution maritime sera en conséquence complétée par l’instauration d’un recours contre la décision d’immobilisation pour tous les types de pollutions maritimes, en précisant le rôle du juge de la liberté et de la détention en matière de cautionnement, en créant un recours contre la décision de ce juge, ainsi qu’un référé suspension en cas de remise en circulation du navire.
Ces dispositions sont adaptées de celles figurant au code rural et de la pêche maritime, et insérées aux articles L. 218-30, L. 218-55 et L. 218-68 du code de l’environnement afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
3. Option
L’habilitation donnée au Gouvernement permettra d’organiser un recours effectif dans le cadre des saisies de navires en matière de pollutions maritimes qui permette de maintenir le système de cautionnement actuellement prévu par les textes et qui apparat particulièrement adapté à ce type de contentieux.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La réforme projetée est de nature à renforcer les garanties des justiciables.
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
MISE EN CONFORMITE DE NOTRE DROIT AVEC LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 20 NOVEMBRE 2015 RELATIVE A L’ENREGISTREMENT SONORE DES DEBATS D’ASSISES
1. Analyse des difficultés à résoudre
Dans sa décision 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution le dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, qui dispose que l’enregistrement sonore des débats devant la Cour d’assises n’est pas prescrit à peine de nullité.
Le Conseil a plus exactement estimé que « que le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises ; qu’en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d’inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 [relatives au droit au recours effectif] ».
Le Conseil constitutionnel a en effet relevé que l’enregistrement sonore des débats en cours d’assises peut faire l’objet d’une large utilisation puisqu’il peut être utilisé jusqu’au prononcé de l’arrêt, devant la cour d’assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
Il a en outre relevé que, devant la cour d’assises, cette utilisation peut être ordonnée d’office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l’accusé ou de la partie civile. Ainsi, toute partie peut saisir le président d’une demande d’utilisation d’un enregistrement et le contester. L’enregistrement des débats étant obligatoire et pouvant donner lieu à des demandes d’utilisation faisant l’objet d’un éventuel contentieux, le Conseil constitutionnel a jugé que ce droit ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a différé l’effet de sa décision d’inconstitutionnalité au 1er septembre 2016, en précisant que les arrêts d’assises rendus jusqu’à cette date ne pourront être contestés sur le fondement de sa décision.
2. Objectif
L’article 308 du code de procédure pénale sera modifié afin de préciser que les règles édictées par cet article autres que l’obligation d’enregistrement (l’interdiction du filmage ou les règles relatives à l’ouverture des enregistrements sous scellés) ne sont pas prescrites à peine de nullité.
3. Options
Ainsi que l’indique le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel, la mise en conformité de notre droit avec la décision du Conseil constitutionnel pourrait également conduire à décider de renoncer à l’enregistrement sonore obligatoire des débats des cours d’assises.
Si cette option n’est pas envisagée, il pourrait cependant être décidé de préciser dans la loi que les parties peuvent renoncer à l’enregistrement, et/ou de limiter son caractère obligatoire aux procès tenus en appel, car ce caractère obligatoire a été institué par le législateur en vue de faciliter les éventuelles procédures de révision, dont la probabilité est quasi-inexistante si l’accusé a reconnu les faits ou n’a pas fait appel de sa condamnation.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
Quelle que soit la solution législative retenue, et dès lors qu’il n’est pas envisagé de supprimer totalement le principe de l’enregistrement obligatoire, il résulte directement de la décision du Conseil qu’à la date du 1er septembre 2016, toutes les cours d’assises devront être équipées d’un dispositif d’enregistrement fonctionnel. Le déploiement de ces enregistreurs est en cours. Au vu d’une enquête effectuée en septembre 2015, environ la moitié des salles d’audience dédiées aux assises étaient équipées d’un matériel d’enregistrement sonore (dans 29 cours ayant répondu). Un tiers environ des audiences d’assises tenues entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015, dans 24 cours, ont fait l’objet d’un enregistrement sonore, sachant que le coût de l’installation d’enregistreur sonore dans l’ensemble des salles d’assises s’élève à environ 1M€.
5 Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
MISE EN CONFORMITE DE NOTRE DROIT AVEC LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 4 DECEMBRE 2015 RELATIVE AU SECRET DU DELIBERE
1. Analyse des difficultés à résoudre
Dans sa décision n° 2015-506 du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que le secret du délibéré découlait du principe d'indépendance de la justice garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, n'a point de Constitution". Autrement dit, il convient de considérer que le secret du délibéré est attaché au principe à valeur constitutionnelle que constitue le principe d'indépendance de la justice ;
Dès lors, la saisie en flagrance par les enquêteurs d'éléments couverts par le secret du délibéré dans les conditions actuelles des articles 56 et 57 du code de procédure pénale porte atteinte au principe d'indépendance et qu'elle doit être soumise par le législateur à des conditions et modalités qui permettent une mise en œuvre proportionnée. Or, aucune disposition, et notamment l'article 56 qui se borne à imposer à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie "toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense", ne précise les conditions de réalisation de cette saisie qui soient susceptibles de garantir le principe d'indépendance des juridictions.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé contraires à la Constitution le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ainsi que les mots "sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense" qui figurent à l'article 57.
Il a reporté les effets de l'inconstitutionnalité au 1er octobre 2016 tout en affirmant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 ne permettaient plus, à compter de la publication de la décision, la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré.
2. Objectif
L’habilitation donnée au Gouvernement doit lui permettre d’instituer un régime de perquisition prévoyant, en matière d’atteinte au secret du délibéré, des garanties très similaires à ce qui est prévu par les articles 56-1 et 56-2 pour les perquisitions dans les cabinets d’avocat, les entreprises de presse ou le domicile des journalistes.
3. Options
Le Conseil constitutionnel n’ayant pas censuré les dispositions correspondantes à l’instruction au motif qu’elles avaient été adoptées avant 1958, il pourrait être envisageable de se limiter à modifier les dispositions applicables à l’enquête.
Cependant, dans un souci de cohérence et d’égalité devant la loi, les règles spécifiques à la saisie de documents couverts par le secret du délibéré seront applicables tant au cours de l’enquête que de l’instruction.
4. analyse des Impacts des dispositions envisagées
Outre un accroissement très modéré de la charge de travail des magistrats qui seront conduits à superviser les perquisitions menées en la matière, compte tenu du caractère en pratique exceptionnel de ces perquisitions, le principal impact de la réforme envisagée sera le renforcement des garanties du justiciable.
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
MODIFIER L’ARTICLE 230-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE AFIN DE TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION N°2010/10 DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 18 SEPTEMBRE 2014
1. Analyse des difficultés à résoudre
1.1 Le droit des fichiers de police judiciaire a été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui a notamment introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un nouveau chapitre II relatif aux fichiers de police judiciaire.
Ces dispositions, qui constituent le régime général applicable aux fichiers d’antécédents, sont complétées par le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 (codifié aux articles R.40-23 et suivants du code de procédure pénale) relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier commun à la police et à la gendarmerie nationales qui a remplacé les fichiers STIC et JUDEX.
L’article 230-8 du code de procédure pénale distingue les suites judiciaires susceptibles de donner lieu à effacement des données, de celles donnant lieu à l’ajout d’une mention, qui en interdit l’accès dans le cadre des enquêtes administratives :
▪ Les décisions de relaxe ou d’acquittement ayant acquis un caractère définitif entraînent l’effacement des données sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier ; dans ce cas, elles font l’objet d’une mention.
▪ Les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République prescrit l’effacement des données.
▪ Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention inscrite au fichier.
1.2 Hormis les hypothèses de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, pour lesquelles l’effacement des données est érigé en principe, l’article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle ne précise pas les critères d’appréciation qui doivent être pris en compte par le procureur de la République pour décider de l’effacement ou du maintien des données dans le fichier.
A l’inverse, en cas de relaxe ou d’acquittement, il est indiqué que la décision de maintien des données est prise au regard de la finalité du fichier.
L’imprécision du texte n’invite donc pas le procureur de la République à effacer des données d’un fichier, dont l’intérêt opérationnel repose précisément sur le nombre de personnes qui y sont enregistrées.
En conséquence, l’autorité judiciaire n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle réellement efficient sur les requêtes en effacement qui lui sont soumises. Au surplus, les pratiques peuvent être très variées d’un ressort à un autre.
Par ailleurs, en l’état, seules les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges peuvent donner lieu à un effacement par le procureur de la République territorialement compétent.
En conséquence, dans toutes les autres hypothèses de classement sans suite (mise en œuvre d’une alternative aux poursuites, poursuites inopportunes, classement pour des motifs juridiques), le procureur de la République ne peut ordonner l’effacement des données alors que sa décision de ne pas engager de poursuites témoigne a priori de la moindre gravité des faits.
Cette situation a été jugée inconventionnelle par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt Brunet c/ France, rendu le 18 septembre 201414.
Au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatif au droit au respect à la vie privée, la Cour a rappelé, s’agissant d’une personne mise en cause, que l’appréciation du caractère proportionné de la durée de conservation au regard du but poursuivi dépend de l’existence d’un contrôle indépendant de la justification de leur maintien dans le fichier, fondé sur des critères précis tels que : la gravité de l’infraction, les arrestations antérieures, la force des soupçons pesant sur la personne, ou toute autre circonstance particulière.
La Cour a également relevé que les règles nationales ne tirent aucune conséquence, quant à la durée de conservation des données, de l’absence de déclaration de culpabilité.
Enfin, en l’état des dispositions applicables, en dehors des hypothèses de relaxe, d’acquittement, de non-lieu et de classement sans suite pour insuffisance de charges, l’autorité chargée d’examiner les requêtes en effacement de données ne peut ordonner l’effacement des données du fichier ; la durée de conservation apparaît dès lors comme une norme et non un maximum.
Or, selon la Cour, la conventionalité du régime des fichiers doit être appréciée au regard des possibilités d’effacement des données avant l’expiration de leur durée de conservation, a fortiori, lorsque ces durées de conservation sont longues.
La Cour a donc sanctionné la France au regard de l’impossibilité pour l’autorité judiciaire d’ordonner l’effacement des données en cas de classement sans suite motivée autrement que par l’insuffisance de charges.
2. Objectifs
Il importe de légiférer afin de mettre le droit interne en conformité avec les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il est envisagé de détailler les critères pris en compte par l’autorité judiciaire pour décider de l’effacement ou du maintien des données dans le fichier. Comme pour le fichier automatisé des empreintes digitales, dont le régime a été récemment modifié par le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015, il est prévu d’indiquer que ces décisions seront prises en fonction des finalités du fichier appréciées au regard de la nature et des circonstances de commission de l’infraction et de la personnalité de l’intéressé.
Il est par ailleurs envisagé de prévoir la possibilité pour le procureur de la République de procéder à l’effacement des données du fichier quel que soit le motif de classement sans suite et non plus comme actuellement uniquement lorsque celui-ci est motivé par l’absence de charges.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La définition de critères précis à prendre en compte dans l’examen des requêtes en effacement est de nature à faciliter la tâche des parquets et du magistrat-référent, mais ne devrait pas avoir d’incidence sur leur charge.
En revanche, la création de nouvelles possibilités d’effacement du fichier est de nature à entraîner une augmentation du nombre de requêtes en effacement des données transmises aux procureurs de la République.
4. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
COMPLÉTER LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2012/13/UE DU 22 MAI 2012
1. Analyse des difficultés à résoudre
La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, dont le délai de transposition a expiré le 2 juin 2014, impose aux Etats de garantir à tout suspect l’information de droits procéduraux dont dispose ce dernier au plus tard avant le premier interrogatoire officiel.
La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui est entrée en vigueur le 2 juin 2014, a introduit dans le code de procédure pénale un article 61-1 modifiant les modalités d’audition libre d’une personne soupçonnée au cours d’une enquête ou sur commission rogatoire. Cet article impose, avant toute audition de suspect, la notification par procès-verbal des droits mentionnés dans la directive.
2. objectif
Les dispositions de l’article 61-1 ne sont pas, en l’état, applicables aux enquêtes diligentées par les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire et qui les exercent dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois, relevant des dispositions de l’article 28 du code de procédure pénale.
Néanmoins, s’agissant de pouvoirs de police judiciaire, ces polices dites spéciales entrent dans le champ d’application de la directive susmentionnée qui concerne tout suspect, c’est-à-dire toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dont l’appréciation doit se faire in concreto.
Il apparaît par conséquent nécessaire de compléter la transposition de cette directive dans notre droit interne par des dispositions applicables aux polices spéciales afin que celles-ci respectent les garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale lorsqu’elles procèdent à des auditions de personnes effectivement suspectées, les procès-verbaux établis étant alors susceptibles de fonder des poursuites.
3. Options
L’habilitation dont bénéficiera le Gouvernement lui permettra de modifier les dispositions de l’article 28 du code de procédure pénale, communes à l’ensemble des polices spéciales, et de procéder à l’introduction de dispositions miroir dans les codes spécialisés applicables à chacune de ces polices, dans un souci de lisibilité de la loi.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
La réforme projetée est de nature à renforcer les garanties des justiciables.
L’extension de l’audition libre aux enquêtes spéciales aura un coût négligeable eu égard notamment au type de contentieux visés qui ne concernent pas la population éligible à l’aide juridictionnelle (lutte contre le travail illégal, infractions en matière de droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle ou de droit de l’environnement).
5. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
MODIFIER LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET LE CODE DES DOUANES AFIN DE RENDRE OBLIGATOIRE LE RECOURS À LA PLATE-FORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES
1. Analyse des difficultés à résoudre
1.1 Le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » a mis en place la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui a pour objet de fournir aux services d’investigations un outil adapté aux évolutions des technologies de communications électroniques.
Pour tenir compte de la spécificité du traitement, l’article premier du décret a introduit les articles R.40-42 à R.40-56 dans un chapitre III bis au titre IV du livre premier du code de procédure pénale (CPP).
Placée sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice et sous le contrôle d’une personnalité qualifiée désignée par arrêté du garde des sceaux15, la PNIJ est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires (DIJ).
La PNIJ est un traitement automatisé de données à caractère personnel qui permet aux magistrats, aux officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ainsi qu'aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, de requérir les opérateurs de communications électroniques (OCE) et de recevoir directement les données relatives au trafic et au contenu de l’ensemble des communications électroniques. Système centralisé, la PNIJ se situe, dans la chaîne de transmission des réquisitions de communications électroniques, entre les requérants et les OCE.
Cet outil permet de transmettre les réquisitions de communications électroniques émanant de l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse :
- d’interceptions judiciaires de communications électroniques ;
- de prestations annexes;
- et dans une version ultérieure de la plate-forme, de données de géolocalisation en temps réel (art.R.40-46).
La PNIJ couvre l’ensemble de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, de l’internet fixe, de l’internet mobile ainsi que les données de data fixe et mobile.
La PNIJ permet une transmission automatisée des demandes et des réponses des OCE constituant un gain de temps important pour le traitement des réquisitions.
Actuellement en cours de déploiement, elle a vocation à se substituer progressivement aux centrales d’écoutes mises en place dans les services de police et unités de gendarmerie par les prestataires actuels ainsi qu’au système de transmission des interceptions judiciaires (STIJ) mis en œuvre par le ministère de la justice et dont l’objet est l’interception des SMS.
La mise en service de la PNIJ a commencé par une « phase pilote » à compter du 9 février 2015 pour les prestations annexes et, à compter du 9 juin 2015, pour les interceptions judiciaires de communications électroniques. Cette expérimentation a concerné une quinzaine de services de police et d’unités de gendarmerie situés dans le ressort des cours d’appel de Paris, Rouen et Versailles.
Le déploiement national de la PNIJ a débuté le 12 octobre 2015 et se poursuit selon un calendrier défini en concertation avec les services du ministère de l’intérieur par zone de défense. Il s’achèvera le 11 avril 2016 avec l’ouverture de la PNIJ aux départements et collectivités d’outre-mer.
1.2 Le cadre juridique ci-dessus décrit souffre toutefois de certaines difficultés.
D’une part, le code de procédure pénale pose, aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du CPP, un principe de liberté de réquisition, faisant obstacle à l’obligation de recourir à la PNIJ pour l’obtention des interceptions judiciaires, des prestations annexes ou des données de géolocalisation.
D’autre part, l’article R.40-49 du code de procédure prévoit que les données relatives aux interceptions judiciaires et aux mesures de géolocalisation en temps réel sont placées sous scellés au sein de la PNIJ. La PNIJ joue ainsi le rôle d’un coffre-fort numérique, permettant de dématérialiser et de conserver numériquement les scellés des données interceptées. Sont ainsi placées sous scellés les données de trafic (fadets), les communications interceptées et les données de géolocalisation. Elles ne sont alors plus accessibles, dans la plate-forme, que pour le magistrat16 ayant ordonné l’interception. A la clôture de l’enquête, les données relatives aux prestations annexes, ainsi que les signatures vocales sont détruites (art.R.40-49). L’établissement et la reproduction de scellés via le portail « gestion des scellés » de la PNIJ se fait sous la responsabilité de la délégation aux interceptions judiciaires (art.R.40-51). Le traitement garantit ainsi l’intégrité des scellés qui y sont conservés et la traçabilité des consultations.
Or, les articles 100-3 et 230-38 du CPP imposent en l’état le placement sous scellés fermés des enregistrements relatifs à ces deux mesures.
L’article 97 alinéa 6 du CPP prévoit quant à lui que, dans le cadre d’une information judiciaire, ces scellés ne peuvent être ouverts qu’en présence du mis en examen assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ainsi que, le cas échéant, en présence du tiers chez lequel la saisie a été opérée.
Au regard des fonctionnalités de la PNIJ et des garanties qu’elle offre, le recours à la notion de scellés fermés n’est plus opérante.
De plus, dans le cadre de la PNIJ, la destruction des enregistrements est automatique à l’expiration du délai de prescription de l’action publique (article R.40-49 CPP). Or, les articles 100-6 et 230-43 du code de procédure pénale prévoient que les enregistrements relatifs aux interceptions et aux géolocalisations sont détruits à la diligence du procureur de la République et du procureur général, et qu’il en est dressé procès-verbal.
Dans un souci d’allégement de la charge de travail des parquets, ces dispositions doivent être modifiées.
Enfin, l’article 230-2 du code de procédure pénale prévoit la saisine d’un organisme technique17 soumis au secret de la défense nationale pour procéder à la mise au clair des données chiffrées ou cryptées.
Ce texte, de même que l’article 230-3 du code de procédure pénale, ne prennent pas en compte les fonctionnalités de la PNIJ, et notamment les modalités pratiques de saisine du centre technique d’assistance et de transmission des réponses aux réquisitions qui lui ont été transmises.
2. Objectifs
L’objectif poursuivi est à la fois de sécuriser les interceptions judiciaires, renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire sur ces mesures, réduire les frais de justice et alléger la charge de travail des juridictions par une simplification des procédures applicables en la matière.
Il est ainsi prévu de rendre la PNIJ obligatoire et d’adapter les textes relatifs aux scellés d’une part et au déchiffrement des données d’autre part aux fonctionnalités de la PNIJ.
Les dispositions relatives au recours obligatoire à la plateforme n’entreront toutefois en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1 Impacts juridiques
Les modifications envisagées s’accompagneront d’une modification des textes réglementaires du code de procédure pénale relatifs à la PNIJ.
4.2 Impacts sur les services judiciaires
La charge de travail des juridictions sera allégée du fait de la simplification du traitement des réquisitions et de la gestion des scellés.
4.3 Impacts sur les finances publiques
Le recours obligatoire à la PNIJ permettra de générer une économie de frais de justice grâce à la suppression définitive du recours aux sociétés privées de location de matériel d'interception :
- hors géolocalisation, la dépense en matière de location de matériel d'interception s'est élevée à 36 M€ en 2013 et 43 M€ en 2014.
- la dépense de location de matériel de géolocalisation (société Deveryware) représente 8,9 M€ en 2013 et 10,5 M€ en 2014.
4. Justification du délai d’habilitation sollicité
La réforme envisagée implique des concertations et des adaptations justifiant le délai prévu par le présent projet de loi avant la prise de l’ordonnance.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LOI
Articles du projet de loi renvoyant à des mesures réglementaires |
Nature du texte réglementaire |
Objet du texte réglementaire |
Article 2 |
Décret simple |
Liste des services, unités ou organismes placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur pouvant procéder à l’utilisation du dispositif IMSI catcher |
Article 6 |
Décret en Conseil d’Etat |
Composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale définissant les mesures de protection |
Article 7 notamment en ce qu’il modifie l’article L. 312-16 du CSI |
Décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL |
Conditions d’autorisation d'acquisition et de détention d’armes, d’éléments d'armes et de munitions de catégorie B et de déclaration d’acquisition et de détention d’armes de catégorie C |
Article 13 |
Décret simple |
Valeur monétaire maximale stockée sous une forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique |
Article 14 |
Décret en Conseil d’Etat |
Conditions d’application des « appels à vigilance » effectués par TRACFIN à destination des assujettis |
Article 21 |
Décret en Conseil d’Etat |
Déterminer les modalités d’application de cet article, notamment la désignation des événements, établissements, installations et organisateurs concernés, les fichiers qui feront l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information |
Article 28 |
Décret en Conseil d’Etat et décret simple |
Modification des textes réglementaires du code de procédure pénale relatifs à l’habilitation des OPJ |
Article 32 |
Décret en Conseil d’Etat |
Modalités d’application de l’enregistrement audiovisuel au moyen de caméras individuelles des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale |
1 Article 81 du Code de procédure pénale : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. »
2 L’infraction principale est celle qui, notamment en cas de pluralité d’infractions, apparaît au premier rang dans le jugement et donc au casier judiciaire.
3 Rapport issu d’un groupe de travail interministériel sur la cybercriminalité présidé par M. Robert, procureur général près la Cour d’appel de Riom, remis le 30 juin 2014 aux ministres de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances et au ministre délégué chargé de l’Économie numérique, dans lequel plusieurs propositions ont été formulées pour protéger les internautes
4 V. par exemple, Roger BERNARDINI, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, pp. 11-14 de la rubrique « Légitime défense », Actualité de l’agression
5 L’article 25 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a abrogé l’ancienne règle résultant de l’article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le fonctionnement de la gendarmerie.
6 Chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 de la partie législative du code de la défense.
7 Décret n° 2012-491 du 16 avril 2012 relatif à l'accès aux points d'importance vitale
8 (DC n°83-156 du 28 mai 1983 : « Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et détermine les principes fondamentaux du droit du travail ; qu’à ce titre, il lui appartient de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre possible d’intéressés »).
9 Cour EDH, Huvig c/France, 24 avril 1990.
10 Il n’existe pas de statistiques plus récentes.
11 Rapport 2013 p.83.
12 Rapport 2013 p.84.
13 La 3ème directive n’allait pas au-delà des standards du GAFI. En effet la recommandation n°12 du GAFI impose aux institutions financières de prendre des mesures de vigilances particulières à l’égard des PPE étrangères définies comme « les personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques. ».
14 Dans cette affaire, le requérant, mis en cause dans le cadre d’une procédure de violences volontaires à l’encontre de sa concubine clôturée par un classement sans suite consécutif à une mesure de médiation pénale réussie en 2008, sollicitait l’effacement de la mention le concernant enregistrée au STIC. Par courrier du 1er décembre 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry rejetait sa demande, au motif que la procédure avait été classée sans suite sur un motif autre que celui résultant d’une insuffisance de charges, seul motif de classement ouvrant droit à effacement.
15 Mme M. Imbert-Quaretta a été désignée par arrêté du 27 novembre 2015.
16 Et à terme par le greffier (article R.40-47 III du CPP).
17 Le centre technique d’assistance (CTA) a été créé par décret n°2002-1073 du 7 août 2002.
© Assemblée nationale