

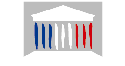
N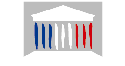
° 1408
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 octobre 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE relative aux éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de l’économie et des finances, de l’intérieur et de la justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement
Président
M. Charles de COURSON
Rapporteur
M. Alain CLAEYS
Députés.
——
La commission d’enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de l’économie et des finances, de l’intérieur et de la justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement est composée de : MM. Charles de Courson, président ; Alain Claeys, rapporteur ; Christian Assaf, Dominique Baert, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Étienne Blanc, Emeric Bréhier, Sergio Coronado, Jacques Cresta, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Patrick Devedjian, Christian Eckert, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, Hugues Fourage, Jean-Marc Germain, Jean-Pierre Gorges, Mmes Estelle Grelier, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Philippe Houillon, Guillaume Larrivé, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-René Marsac, Pierre Morel-A-L'huissier, Hervé Morin, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Saint-André, Thomas Thévenoud, Mme Cécile Untermaier.
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS DE M. CHARLES DE COURSON, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 7
INTRODUCTION 9
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SURVENUS ENTRE LE 2 DÉCEMBRE 2012 ET LE 4 AVRIL 2013 13
I. AU 4 DÉCEMBRE 2012, LES INFORMATIONS DONT POUVAIENT DISPOSER LES SERVICES DE L’ÉTAT SONT RESTÉES SANS SUITES, FAUTE DE SAISINE DANS LES FORMES APPROPRIÉES 15
A. EN 2000, L’ENREGISTREMENT N’EST PAS TRANSMIS À LA JUSTICE PAR MICHEL GONELLE 15
1. Les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires a été réalisé 16
2. L’absence de saisine de la Justice 17
B. EN 2001, LE SIGNALEMENT INDIRECT AUX SERVICES FISCAUX N’ABOUTIT PAS 18
1. Une saisine inappropriée des services fiscaux 18
2. Les vérifications entreprises en 2001 sont demeurées étonnamment superficielles 19
3. Le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac est conservé pendant sept ans, sans raison apparente, à Bordeaux 21
C. IL N’EST PAS DÉMONTRÉ QUE LES DOUANES ONT ÉTÉ INFORMÉES, NI EN 2001, NI EN 2008 21
D. EN 2006, L’ENREGISTREMENT N’EST APPAREMMENT PAS UTILISÉ PAR JEAN-LOUIS BRUGUIÈRE 24
E. LA MENTION, EN 2008, DU COMPTE DANS LE « MÉMOIRE EN DÉFENSE » DE RÉMY GARNIER N’A JAMAIS ÉTÉ SIGNALÉE AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX 27
1. Un inspecteur des impôts en conflit avec sa hiérarchie 27
2. Quelle était la crédibilité de la note du 11 juin 2008 ? 28
3. Le contenu de la note du 11 juin 2008 n’a pas été porté à la connaissance du DGFiP ou des ministres, avant les révélations de Mediapart 30
II. DANS LES SEMAINES SUIVANT LES RÉVÉLATIONS DE MEDIAPART, L’APPAREIL D’ÉTAT RÉAGIT DANS LE RESPECT DE LA LÉGALITÉ 33
A. L’ADMINISTRATION FISCALE TIRE LES CONSÉQUENCES DU DÉPORT DE SON MINISTRE DE TUTELLE 33
1. L’établissement très rapide de la « muraille de Chine » 33
2. La poursuite de l’examen de la situation fiscale de Jérôme Cahuzac 35
3. L’envoi à Jérôme Cahuzac d’une demande type de renseignements dans la perspective d’une éventuelle saisine des autorités suisses 37
B. LA JUSTICE N’EST SAISIE QUE DE DEUX PLAINTES EN DIFFAMATION 41
1. La question de la base juridique de la plainte en diffamation du 6 décembre 2012 41
2. La seconde plainte et le déroulé normal de la procédure 43
C. LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR INTERROGE LA DIRECTION CENTRALE DU RENSEIGNEMENT INTÉRIEUR 44
1. L’incident mettant en cause la direction départementale de la sécurité publique du Lot-et-Garonne 44
2. La question de la « note blanche » de la direction centrale du renseignement intérieur 47
D. LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE INVITE MICHEL GONELLE À SAISIR LA JUSTICE DES INFORMATIONS QU’IL DÉTIENDRAIT 49
1. La conversation téléphonique entre Michel Gonelle et le directeur de cabinet adjoint du président de la République 51
2. Les suites de cette conversation 53
a. Le compte rendu au président de la République et la réaction de celui-ci 54
b. L’absence de second échange téléphonique 55
c. La révélation, par la presse, de la conversation du 15 décembre 56
d. La lettre adressée par Michel Gonelle au juge Daïeff 57
III. À COMPTER DE L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE, LA JUSTICE N’EST NI ENTRAVÉE, NI RETARDÉE 61
A. L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE EST MENÉE AVEC EFFICACITÉ 61
1. L’ouverture de l’enquête, déclenchée par le courrier d’Edwy Plenel 61
a. L’initiative prise par Edwy Plenel 61
b. La décision du parquet de Paris 63
2. Une enquête conduite avec diligence 65
a. Les principales étapes de l’enquête préliminaire 65
b. Le rôle déterminant des expertises de l’enregistrement 67
3. Une enquête menée en toute autonomie par le parquet de Paris 68
a. La remontée d’informations au sein de la hiérarchie judiciaire 68
b. Le suivi de l’affaire par le ministère de la Justice 71
c. Le rôle du ministère de l’Intérieur 74
B. LA DEMANDE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À LA SUISSE ÉTAIT-ELLE OPPORTUNE ET BIEN FORMULÉE ? 76
1. L’échange de renseignements : une procédure à la disposition de l’administration fiscale 76
a. Depuis 2009, l’évolution positive du cadre de l’échange de renseignements bancaires avec l’administration fiscale suisse 76
b. Une démarche fiscale indépendante des procédures judiciaires, conformément au principe de spécialité 81
c. Cette démarche a abouti à une réponse rapide des autorités suisses 83
2. Était-il opportun de saisir les autorités suisses d’une demande d’assistance administrative ? 84
a. Un instrument qui reste d’un maniement délicat 84
b. Une procédure qui n’était pas sans risques 85
i. Jérôme Cahuzac a été averti du lancement de la procédure, en marge du conseil des ministres 85
ii. Le ministre du budget a été informé du contenu de la demande par ses avocats suisses 86
iii. Une tentative de manipulation : la publication dans la presse de la réponse au début du mois de février 88
c. La transmission de la réponse à la Justice n’allait pas de soi 89
i. La question de la transmission de la réponse à la Justice a donné lieu à controverse 89
ii. La DGFiP n’avait pas informé le parquet de Paris de la question, mais elle a transmis rapidement la réponse 89
3. L’administration fiscale a-t-elle utilisé toutes les possibilités ouvertes par la procédure d’échange de renseignements ? 91
a. Quelles banques devaient être visées dans la demande ? 91
i. Un seul établissement est visé 91
ii. Une demande non ciblée, théoriquement possible, aurait probablement été jugée non pertinente 93
b. La période visée par la demande pouvait-elle être plus large ? 93
c. La référence à la notion d’ayant droit économique était-elle opérante ? 94
d. Pourquoi l’administration fiscale française n’a-t-elle pas également interrogé Singapour ? 95
CONCLUSION 97
EXAMEN EN COMMISSION 101
CONTRIBUTIONS 113
ANNEXES 119
AVANT-PROPOS DE M. CHARLES DE COURSON,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Au moment de la création de cette commission d’enquête, « chargée de déterminer les éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de l’économie et des finances, de l’intérieur et de la justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement », j’ai énuméré (1) les points, nombreux, sur lesquels je souhaitais que les travaux de la commission fassent la lumière, afin de répondre au besoin de transparence de nos concitoyens : raisons pour lesquelles le ministre de l’Économie et des finances, sur décision du Président de la République, avait formulé une demande d’entraide fiscale à la Suisse deux semaines après l’ouverture, par le parquet de Paris, d’une enquête préliminaire, contenu de cette demande, choix de ne pas interroger les autorités singapouriennes, éventuelle instrumentalisation de l’administration fiscale, existence possible, au sein de cette administration ou dans d’autres services de l’État, d’éléments antérieurs aux révélations de Mediapart sur l’existence du compte à l’étranger non déclaré de Jérôme Cahuzac, actions du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice à la suite de ces révélations et pendant l’enquête préliminaire, degré d’information des plus hautes autorités de l’État quant à la détention d’un compte à l’étranger par Jérôme Cahuzac.
Je considérais en effet que les pouvoirs d’une commission d’enquête devaient permettre d’obtenir des réponses sur tous ces points.
Après plusieurs mois de travail, j’estime que les travaux de la commission d’enquête ont été utiles. Nous avons pu entendre les principaux protagonistes de « l’affaire Cahuzac », certains même par deux fois, ainsi que ceux, membres du Gouvernement et fonctionnaires, qui ont été concernés par la gestion de cette affaire, et nous avons rassemblé un nombre important de documents. Je regrette que la majorité des membres de la commission d’enquête ait écarté deux auditions, que je jugeais pertinentes, celle du Premier ministre et celle de Patricia Cahuzac, l’épouse de Jérôme Cahuzac. Nous avons néanmoins réuni de nombreuses informations qui nous ont conduits à mieux comprendre l’enchaînement des événements et les choix faits par les uns et les autres.
On peut discuter du fait de qualifier telle ou telle action de dysfonctionnement : ce qui n’apparaît que comme une maladresse à certains peut constituer une erreur pour les autres. C’est ainsi que mon appréciation diffère de celle du Rapporteur de la commission d’enquête sur un certain nombre de points, en particulier en ce qui concerne la réaction de la présidence de la République fin décembre 2012 – ou plutôt ce que je perçois comme une absence critiquable de réaction – et l’action de l’administration fiscale, sur décision du président de la République, que je juge inopportune et dont l’issue était à mon avis parfaitement prévisible. Le Rapporteur a le mérite de signaler, dans ses développements, les sujets sur lesquels les opinions des membres de la commission d’enquête sont différentes voire opposées. Je préciserai mon analyse dans la contribution de mon groupe.
En revanche, je partage la présentation faite par le Rapporteur des raisons pour lesquelles l’existence des avoirs dissimulés de Jérôme Cahuzac est restée dans l’ombre, en dépit de sa découverte par Michel Gonelle à la fin de l’année 2000. Comme lui, je rends hommage au travail de la Justice dans cette affaire et je constate que les travaux de la commission n’ont pas révélé d’interférences de la part de la chancellerie ou du ministère de l’Intérieur.
Sans partager toutes les conclusions du présent rapport, je salue le travail accompli par la commission d’enquête. Il est vrai que des questions importantes restent posées, telle que celle relative à l’inaction du président de la République fin décembre 2012 alors qu’il disposait d’informations privilégiées permettant de douter de la véracité des affirmations de Jérôme Cahuzac de non-détention d’un compte à l’étranger, mais il ne peut en être fait reproche à la commission. Le respect de la séparation des pouvoirs, le périmètre bien défini de l’enquête et le refus de Jérôme Cahuzac de répondre aux questions – et pas seulement à celles qui étaient extérieures au strict champ de nos travaux – faisaient obstacle à ce que nous obtenions des révélations sur l’origine des fonds, leurs montants et les montages financiers utilisés ; c’est à l’enquête judiciaire en cours de faire la lumière sur ces points. Cette commission d’enquête a fait ce qu’elle devait, dans le cadre et dans les limites de ses pouvoirs : remplacer la rumeur, poison de la démocratie, par la vérité, quel que soit le jugement que l’on porte sur celle-ci.
« Je démens catégoriquement les allégations figurant sur le site Mediapart. Je n’ai pas, monsieur le député, je n’ai jamais eu de compte à l’étranger, ni maintenant, ni auparavant. Je démens donc ces accusations, et j’ai saisi la justice d’une plainte en diffamation, car ce n’est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu’ils avancent.
« Et c’est donc devant la justice que je m’expliquerai face à ces contradicteurs, en attendant d’eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m’avoir permis de le dire devant la représentation nationale. »
Interrogé, ce mercredi 5 décembre, par l’un de nos collègues (2) au début de la séance des questions au Gouvernement, le ministre délégué au budget, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, proteste de son innocence et rejette dans les termes les plus nets les accusations parues la veille dans la presse. Il expliquera plus tard (3) avoir trompé, avec la même assurance, le président de la République et le Premier ministre, qui l’avaient questionné quelques heures auparavant.
Ce mensonge proféré devant la Représentation nationale, Jérôme Cahuzac l’a renouvelé à maintes reprises dans les médias, au cours des semaines suivantes. Ses aveux à la justice, quinze jours après sa démission du Gouvernement, ont choqué nos concitoyens, comme ils ont choqué l’ensemble des responsables politiques.
Il est vrai que, au-delà du mensonge, les agissements de l’ancien ministre délégué au budget sont particulièrement condamnables : il s’est rendu coupable de fraude fiscale alors même qu’il était, de par ses fonctions, le garant de la légalité fiscale et qu’il s’était fait le champion de la lutte contre la fraude.
*
Très peu de temps après ces aveux, des accusations graves ont été portées quant à l’action des services de l’État dans la gestion de cette affaire. Il revenait, dès lors, au Parlement de « substituer à la rumeur la vérité, dans le cadre de la mission de contrôle qui est [la sienne], tout en respectant la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice » (4).
Sur la proposition du groupe UDI (5), l’Assemblée nationale a ainsi décidé, dès le 24 avril, la création d’une commission d’enquête, de trente membres, chargée de déterminer les éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de l’Économie et des finances, de l’Intérieur et de la Justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement.
Cette commission s’est rapidement mise au travail, procédant en cinq mois à trente-six auditions. Elle a entendu pendant plus de cinquante heures de réunions cinquante-deux témoins, dont trois l’ont été à deux reprises. Usant des prérogatives que lui reconnaît l’ordonnance du 17 novembre 1958 (6), le Rapporteur de la commission d’enquête s’est fait communiquer de nombreux documents, sans que le secret fiscal ne puisse lui être opposé.
*
Le champ des investigations de la commission était strictement limité d’abord par le texte de la résolution mais, surtout, par le principe de séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d’une commission d’enquête de porter « sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ». L’ouverture, par le parquet de Paris, le 8 janvier dernier, d’une enquête préliminaire, puis, le 19 mars, d’une information judiciaire pour « blanchiment de fraude fiscale » et « blanchiment de fonds provenant de la perception par un membre d’une profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale » à l’encontre de Jérôme Cahuzac et, enfin, l’annonce de sa première mise en examen le 2 avril, interdisaient à la commission de s’intéresser au volet judiciaire de cette affaire.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas à la commission d’éclairer l’origine des fonds dissimulés par l’intéressé à l’étranger. La légalité des activités de consultant de Jérôme Cahuzac, entre 2002 et 2008, n’entrait pas non plus dans le champ de l’enquête parlementaire.
En revanche, les travaux de la commission ont porté sur l’existence ou non de dysfonctionnements au sein de l’appareil d’État afin de répondre aux interrogations de nos concitoyens. Le Président et le Rapporteur, d’un commun accord, ont retenu une interprétation large du champ de la commission d’enquête. Ils ont étendu à la présidence de la République les investigations, dans les limites posées par l’article 67 de la Constitution (7) ; le directeur adjoint du cabinet du président de la République a ainsi pu déposer (8) devant les commissaires. Le champ temporel retenu par la résolution créant la commission a également été compris avec souplesse, permettant de remonter le temps jusqu’à l’enregistrement d’une conversation téléphonique de Jérôme Cahuzac – la première preuve matérielle, dans cette affaire – à la fin de l’année 2000.
*
Du point de vue des commissaires, trois questions principales se posaient au début des travaux de la commission d’enquête :
1°/ Les services de l’État disposaient-il, avant le 4 décembre 2012, d’éléments matériels permettant de caractériser une fraude fiscale de la part de Jérôme Cahuzac ?
2°/ En dehors de l’intéressé, d’autres membres de l’exécutif, ou leurs collaborateurs, étaient-ils, avant les aveux du 2 avril, informés de la véracité des faits allégués par Mediapart et ont-ils cherché à peser sur le déroulement de l’affaire ?
3°/ Après la révélation de l’affaire, les services de l’État, et en particulier ceux du ministère de l’Économie et des finances, du ministère de l’Intérieur et de la Chancellerie, ont-ils agi opportunément et conformément à la légalité ? Leur action a-t-elle entravé, en quoi que ce soit, la bonne marche de la justice ?
En suivant ce fil conducteur, la commission a tâché de faire œuvre de transparence en démêlant les faits, parfois confus ou imprécis, relatés par la presse. Elle a entendu les acteurs de cette affaire (9) et rassemblé les documents permettant de recouper les faits allégués, dans le respect des limites des poursuites judiciaires en cours.
Se fondant exclusivement sur des éléments objectifs et vérifiables, le Rapporteur a examiné l’action du Gouvernement et des services de l’État au cours de ces quatre mois. Le présent rapport livre ses conclusions.
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SURVENUS
ENTRE LE 2 DÉCEMBRE 2012 ET LE 4 AVRIL 2013
4 décembre 2012 : Mediapart fait état de la détention par Jérôme Cahuzac d’un compte bancaire en Suisse. Selon le site, ce compte, non déclaré, détenu à l’UBS de Genève aurait été clos en 2010 et les avoirs transférés à l’UBS de Singapour.
5 décembre 2012 : interrogé par Daniel Fasquelle, au cours de la séance des questions au Gouvernement, sur la véracité des informations publiées la veille, Jérôme Cahuzac proteste solennellement de son innocence. Mediapart met alors en ligne un enregistrement, présenté comme un échange entre Jérôme Cahuzac et Hervé Dreyfus, son gestionnaire de fortune en 2000, qui corroborerait ces informations.
10 décembre 2012 : une note signée Jérôme Cahuzac, dite « muraille de Chine », le met à l’écart de toute procédure relevant de l’administration fiscale pouvant concerner sa situation.
11 décembre 2012 : Mediapart mentionne pour la première fois les liens familiaux entre Hervé Dreyfus et le fondateur de Reyl et Cie.
14 décembre 2012 : l’administration fiscale adresse à Jérôme Cahuzac une demande type de renseignements l’invitant à fournir des informations sur les comptes bancaires et les avoirs qu’il détiendrait à l’étranger.
15 décembre 2012 : Michel Gonelle, ancien maire RPR de Villeneuve-sur-Lot, prend contact avec Alain Zabulon, directeur adjoint du cabinet du président de la République pour lui révéler qu’il est le détenteur de l’enregistrement publié par Mediapart, et lui expliquer comment il était entré en sa possession.
27 décembre 2012 : le président de Mediapart, Edwy Plenel, adresse une lettre au Procureur de Paris, François Molins, pour demander l'ouverture d’une enquête.
8 janvier 2013 : le Parquet ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale, confiée à la Division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF) de la police judiciaire.
16 janvier 2013 : à l’issue du Conseil des ministres, un échange a lieu entre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’Économie et des finances et Jérôme Cahuzac, au cours duquel ce dernier est informé de la décision de lancer une demande d’assistance administrative auprès des autorités Suisses.
24 janvier 2013 : l’administration fiscale adresse la demande d’assistance administrative aux autorités suisses.
31 janvier 2013 : l’administration fiscale reçoit la réponse des autorités helvétiques à sa demande : elle indique que Jérôme Cahuzac n’a pas détenu de compte à l’UBS de Genève pour la période courant à partir du 1er janvier 2006.
Du 6 au 9 février 2013 : le Journal du dimanche et le Nouvel Observateur font état de la réponse négative apportée par la Suisse, réponse couverte par le secret fiscal.
19 mars 2013 : le Parquet ouvre une information judiciaire contre X pour « blanchiment de fraude fiscale, et perception par un membre d’une profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la Sécurité sociale, blanchiment et recel de ce délit ». Jérôme Cahuzac démissionne du Gouvernement en réaffirmant son innocence.
2 avril 2013 : Jérôme Cahuzac déclare à la justice qu'il détient un compte non déclaré à l'étranger. Il est mis en examen.
I. AU 4 DÉCEMBRE 2012, LES INFORMATIONS DONT POUVAIENT DISPOSER LES SERVICES DE L’ÉTAT SONT RESTÉES SANS SUITES, FAUTE DE SAISINE DANS LES FORMES APPROPRIÉES
Pour pouvoir juger des éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État entre la révélation, par Mediapart, du compte non déclaré qu’aurait détenu en Suisse celui qui était alors ministre délégué en charge du budget, et les aveux de l’intéressé devant la Justice, il est essentiel de savoir de quelles informations l’administration, voire les membres du Gouvernement eux-mêmes, pouvaient alors disposer. Certains, dans les milieux médiatique et politique, ont affirmé que l’existence de ce compte était connue depuis longtemps par un nombre important de personnes, et notamment par les plus hautes autorités de l’État. Aucune preuve n’en a cependant jamais été apportée, et les travaux de la commission d’enquête n’ont pas non plus permis de confirmer de telles assertions.
En revanche, la commission d’enquête a pu établir que cette information a été communiquée, à deux occasions, d’ailleurs liées entre elles, à des agents de l’administration fiscale, mais dans des conditions qui n’ont pas permis sa vérification. Les travaux de la commission d’enquête ont en outre conduit à mettre très sérieusement en doute l’affirmation selon laquelle la douane aurait aussi été informée de l’existence de ce compte.
Dans tous les cas, la circulation de cette information est la conséquence de l’utilisation qui a été faite de l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires, réalisé fin 2000. Or cette utilisation a beaucoup surpris les membres de la commission d’enquête. En effet, chacune des initiatives qui ont été prises par le détenteur de l’enregistrement pour en faire connaître le contenu peut être qualifiée d’« oblique », pour reprendre la formule utilisée par un membre de la commission d’enquête (10). C’est très clairement le choix de ces voies détournées qui explique qu’elles n’aient jamais eu de suites.
A. EN 2000, L’ENREGISTREMENT N’EST PAS TRANSMIS À LA JUSTICE PAR MICHEL GONELLE
Si l’enquête de Mediapart ne s’est pas résumée à la découverte de cet enregistrement, dont M. Fabrice Arfi n’avait pas connaissance lorsqu’il l’a engagée (11), il a joué un rôle clé dans le déclenchement de l’affaire – comme il en a joué un dans l’enquête préliminaire, le Rapporteur y reviendra infra. Il est donc utile de comprendre dans quelles conditions il a été réalisé, avant de préciser l’utilisation qui en a été faite.
1. Les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires a été réalisé
Mediapart a, dès le 5 décembre 2012, mis en ligne des extraits de cet enregistrement et expliqué son origine, sans citer le nom de Michel Gonelle. Ce dernier a, devant la commission d’enquête (12), confirmé le récit publié par Mediapart. Fin 2000, à la suite d’un message laissé par Jérôme Cahuzac sur son téléphone portable relatif à la venue à Villeneuve-sur-Lot du ministre de l’Intérieur pour l’inauguration d’un commissariat de police, Michel Gonelle, qui en est alors le maire, découvre l’enregistrement d’une conversation entre le député du Lot-et-Garonne et une autre personne qu’il n’a pas identifiée – et qui se révélera être Hervé Dreyfus, son gestionnaire de fortunes et chargé d’affaires – à propos d’un compte détenu par Jérôme Cahuzac en Suisse, à la banque UBS.
Devant la commission d’enquête, Michel Gonelle a présenté sa réaction à cette découverte dans les termes suivants : « De tels enregistrements sont conservés dans la mémoire du téléphone pendant quatorze jours. À l’époque maire d’une commune de 23 000 habitants – ne sachant pas si j’allais le demeurer –, j’ai immédiatement compris le caractère sensible et choquant du message. Je n’ai donc pas souhaité que ce document disparaisse. » Il demande donc à un ingénieur du son qu’il connaît de bien vouloir sauvegarder cette conversation, ce qui est fait au cours des jours suivants. Le spécialiste réenregistre cet échange sur un minidisque, le support couramment utilisé à cette époque par les professionnels pour les enregistrements audios de qualité.
Interrogé par écrit par le Rapporteur (13), l’ingénieur du son concerné confirme qu’il a enregistré sur un minidisque la totalité du message – l’échange avait commencé avant le début de l’enregistrement sur le répondeur et le message s’interrompt brutalement – et qu’il n’en a pas conservé de double. Il se souvient avoir effectué cette opération fin 2000 pendant la période de Noël. Il indique clairement n’avoir remis à Michel Gonelle qu’une copie, sur un seul minidisque, alors que celui-ci affirme en avoir reçu deux exemplaires, sur deux minidisques identiques (14).
Parallèlement, selon ses dires, Michel Gonelle fait écouter l’enregistrement à « un petit cercle d’amis – moins de cinq personnes ». Parmi ces personnes, la commission a pu identifier un ancien gendarme devenu détective privé et un inspecteur des finances publiques, qu’elle a entendus (15), ainsi qu’un huissier de Justice. Le premier et le troisième semblent avoir entendu l’enregistrement depuis le portable de Michel Gonelle, le deuxième à partir de la copie faite sur minidisque.
2. L’absence de saisine de la Justice
À la question du Rapporteur relative aux initiatives qu’il avait prises ensuite, Michel Gonelle a apporté la réponse suivante : « Trois voies étaient possibles. La première consistait à en parler devant les médias : je l’ai immédiatement rejetée. La deuxième, d’une certaine façon, s’imposait à moi, mais je ne l’ai pas choisie : c’était celle de l’article 40 du code de procédure pénale, c’est-à-dire aller trouver le procureur de la République de mon département pour lui signaler ce qui constituait un fait délictueux. J’ai adopté une autre voie [celle d’un signalement à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un agent de cette administration, voir infra]. »
Il a justifié ce choix ainsi : « Nous étions à la veille des élections, et je détenais un document sensible. Je n’avais aucune assurance, en l’écoutant, que le compte à l’étranger dont il était fait mention n’était pas déclaré, même si j’avais une forte présomption. Si j’avais livré ce document sur la place publique en plein débat électoral, je me serais probablement exposé à une action en diffamation ou, plus grave encore, en dénonciation calomnieuse. »
Il ne fait pourtant aucun doute que, comme il le reconnaît lui-même, Michel Gonelle aurait dû transmettre l’enregistrement au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le deuxième alinéa de cet article dispose en effet que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Michel Gonelle était alors maire de Villeneuve-sur-Lot, et donc « autorité constituée ». Il est vrai que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les prescriptions du second alinéa de l’article 40 du code précité ne sont assorties d’aucune sanction pénale (16), seules des sanctions disciplinaires pouvaient être encourues par les fonctionnaires ou les magistrats. Un élu qui ne respecte pas ces dispositions ne peut être sanctionné, mais elles n’en constituent pas moins une obligation, à laquelle M. Gonelle n’aurait pas dû manquer. Le contenu de la conversation enregistrée ne laissait en fait guère de doute sur le caractère non déclaré du compte en question (17).
Toujours au cours de sa première audition par la commission d’enquête, Michel Gonelle ajoute ensuite de nouveaux arguments pour justifier le fait qu’il n’avait pas saisi la Justice : « À un point de l’enregistrement, on entend M. Cahuzac dire qu’il n’y a plus rien sur le compte (18). Ce détail a pesé sur ma décision. Beaucoup d’entre vous pensent que j’aurais dû agir de façon plus énergique, saisir le procureur, par exemple. Mais mettez-vous un instant à ma place : il s’agissait d’un compte ouvert à l’étranger, sur lequel il ne restait plus d’argent. J’étais dans l’embarras. Je craignais une action en retour contre moi, de surcroît dans un contexte de campagne électorale. Ne me faites pas grief de n’avoir pas utilisé ce document dans la bataille électorale, selon ma conception, ce n’est pas le lieu de tels déballages. Elle est faite pour évoquer des idées, des projets, les positions politiques respectives des candidats. ».
Le fait que l’argent qui avait été déposé sur ce compte ait été soit dépensé, soit transféré ailleurs n’avait nullement pour effet de faire disparaître l’éventuel délit de fraude fiscale constitué par son placement illégal en Suisse. Saisie de l’enregistrement, la Justice aurait pu soit transmettre cette information à l’administration fiscale, soit ouvrir une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale, comme elle l’a fait en janvier 2012. Il semble que ce soit bien moins un raisonnement juridique que la crainte que lui inspirait Jérôme Cahuzac – dont il n’a pas fait mystère au cours de cette audition –, qui conduit Michel Gonelle à ne pas aviser le procureur de la République et à choisir une autre voie, celle du signalement auprès de l’administration fiscale.
Mais, au lieu de s’adresser directement à cette administration, il recourt à des intermédiaires, ce qui a eu pour effet de rendre sa démarche inefficace.
B. EN 2001, LE SIGNALEMENT INDIRECT AUX SERVICES FISCAUX N’ABOUTIT PAS
Les travaux de la commission d’enquête ont permis d’éclairer les conditions dans lesquelles des soupçons relatifs aux avoirs détenus par Jérôme Cahuzac à l’étranger ont été, une première fois, portés à la connaissance d’agents de l’administration fiscale.
1. Une saisine inappropriée des services fiscaux
Plutôt que d’utiliser l’article 40 du code de procédure pénale, Michel Gonelle s’est tourné à la toute fin de l’année 2000 ou au début de l’année 2001 vers un inspecteur des impôts, Jean-Noël Catuhe, alors en poste à Villeneuve-sur-Lot et avec lequel il entretenait une relation de confiance. Cet ami a fait partie du petit cercle de familiers auxquels Michel Gonelle a laissé écouter l’enregistrement qu’il avait réalisé.
Comme il l’a expliqué lors de son audition (19), Jean-Noël Catuhe se souvient d’avoir proposé, lors d’un entretien auquel Michel Gonelle l’avait convié à son cabinet, « de faire un signalement et de transmettre l’information au service ad hoc, qui se chargerait de faire une enquête ». Il a ainsi pris contact avec l’un de ses anciens condisciples à l’École nationale des impôts, Christian Mangier, qui travaillait à la brigade interrégionale d’intervention (BII) de Bordeaux, dépendant de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF).
La saisine de cette direction nationale, au-delà du caractère officieux de la procédure suivie par MM. Catuhe et Gonelle, paraît surprenante. S’il n’y a pas de compétence d’attribution stricte en matière de recherche des infractions fiscales, la DNEF a plutôt vocation à prendre en charge des opérations collectives centrées non sur un contribuable en particulier mais sur une thématique (par exemple, les carrousels en TVA et la fraude internationale, au cours des trois dernières années), comme l’a rappelé lors de son audition l’un de ses anciens directeurs (20). Les BII, à Bordeaux ou ailleurs, n’ont donc pas vocation à procéder à l’examen de la situation fiscale personnelle des contribuables : une telle mission relève d’autres services au sein de l’administration fiscale, sauf sur demande expresse de la direction générale – ce qui n’était pas le cas, en l’espèce.
Un inspecteur des impôts chevronné, comme Jean-Noël Catuhe, ne pouvait ignorer que son signalement du début de l’année 2001 aurait dû être adressé au centre des impôts de Paris Sud, en charge du dossier fiscal personnel des époux Cahuzac demeurés domiciliés à Paris, ou à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), qui était le service à compétence nationale spécialisé en matière de fiscalité personnelle. Il faut sans doute voir dans le choix de se tourner vers la DNEF, moins le « hasard » (21) d’une rencontre avec un ancien camarade de promotion que la recherche délibérée d’une voie informelle. Cette option initiale peut expliquer, en tout cas, l’impasse sur laquelle déboucheront finalement les vérifications de Christian Mangier.
2. Les vérifications entreprises en 2001 sont demeurées étonnamment superficielles
Si la commission d’enquête n’a pu entendre ce fonctionnaire de la DNEF, aujourd’hui décédé, elle a convoqué trois de ses anciens collègues, en fonction à Bordeaux entre 2000 et 2007. Leurs témoignages attestent de l’absence de toute entrave. Ils révèlent cependant de stupéfiantes lacunes dans le fonctionnement de ce service.
Interrogé par le Rapporteur, Patrick Richard, le contrôleur des finances publiques qui travaillait alors en binôme avec Christian Mangier, a confirmé que son collègue l’avait informé, en février 2001, d’un renseignement reçu « sur la détention, par M. Cahuzac, d’un compte bancaire en Suisse, lequel lui aurait permis de financer ses activités électorales ». Comme c’est l’habitude en la matière, M. Mangier a demandé (22) communication du dossier fiscal du contribuable concerné, afin de démarrer leurs vérifications mais également pour s’assurer que celui-ci ne faisait pas l’objet d’une enquête par un autre service.
Le centre des impôts de Paris Sud a adressé sans délai l’intégralité du dossier fiscal des époux Cahuzac, par voie postale. Lorsque le dossier est arrivé, il a été examiné pour vérifier en premier lieu que le contribuable n’avait jamais déclaré de compte bancaire à l’étranger. Patrick Richard a indiqué aux commissaires avoir ensuite discuté de son contenu avec son collègue et émis le souhait de rencontrer la source du renseignement afin d’« en évaluer la crédibilité avant d’entamer quelque action que ce soit » (23). Jamais pourtant il ne rencontrera Jean-Noël Catuhe, ni même ne connaîtra son nom.
Cette manière de procéder conduit à un premier dysfonctionnement. Lorsque l’informateur était un fonctionnaire d’une autre administration et a fortiori un collègue de la direction générale des impôts, les deux hommes avaient en effet coutume de recevoir ensemble, dans les locaux de l’administration, la personne ayant donné le renseignement, afin « de mesurer sa proximité avec la source principale, de comprendre par quel moyen l’information lui était parvenue, de rechercher de premières pistes pour commencer l’enquête [ ;] en général, ce que l’un savait, l’autre le savait aussi, car avant de prendre une décision ou d’ouvrir une enquête, nous en discutions entre nous ». En l’espèce, Patrick Richard a indiqué, lors de son audition, que la source avait requis l’anonymat, ce que démentent les intéressés. Disposant de peu d’éléments, et ne pouvant interroger plus avant leur source, les fonctionnaires de la DNEF ont rapidement interrompu leurs investigations sur Jérôme Cahuzac.
L’absence d’information de l’autorité hiérarchique constitue une autre anomalie. Comme il l’a expliqué aux membres de la commission d’enquête, l’ancien chef de la brigade de Bordeaux de 1998 à 2003, Olivier André, n’a jamais été averti par ses deux subordonnés. Il aurait pourtant dû être avisé dans la mesure où ce renseignement concernait une personnalité exerçant des fonctions électives et non pas un contribuable ordinaire (24) : « Dans le cas d’espèce, et dans la mesure où il s’agissait d’une « notoriété », la règle – qui n’a pas été respectée – voulait que l’enquêteur vienne me demander l’autorisation de se faire communiquer le dossier. Je la lui aurais certainement accordée, et j’aurais informé ma hiérarchie, à Pantin. ».
Comme l’a confirmé sous serment Patrick Richard (25), Christian Mangin et lui n’ont transmis ni à leur chef de service, ni à aucune autorité de l’État les renseignements qu’ils avaient recueillis en 2001 sur le député Jérôme Cahuzac. La commission d’enquête n’a découvert aucun élément accréditant l’hypothèse d’une information des ministres de l’époque en charge de l’économie ou du budget, et encore moins la preuve d’une intervention politique pour faire cesser l’enquête de la BII. Le Rapporteur en conclut que c’est l’insuffisance des renseignements ainsi que les réticences de MM. Catuhe et Gonelle à utiliser les voies officielles qui, principalement, expliquent que ce premier signalement n’ait pas abouti.
3. Le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac est conservé pendant sept ans, sans raison apparente, à Bordeaux
Les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence une dernière anomalie. Les bordereaux de transmission du dossier fiscal ont en effet mis en évidence que ce dossier était demeuré jusqu’en 2007 dans les locaux de la BII. Aucune justification à la conservation de ces pièces pendant sept ans n’a pu être fournie par l’administration fiscale (26) ; seule la négligence paraît pouvoir expliquer pareil enlisement. Apparemment, comme cela a été confirmé au Rapporteur (27), le traitement des déclarations d’impôts des époux Cahuzac n’a pas été entravé pour autant : – un nouveau dossier avait été ouvert à partir de la transmission en 2001, – mais il n’a pas non plus permis de détecter le délai anormalement long de conservation du dossier à Bordeaux.
C. IL N’EST PAS DÉMONTRÉ QUE LES DOUANES ONT ÉTÉ INFORMÉES, NI EN 2001, NI EN 2008
La commission d’enquête s’est efforcée de faire la lumière sur les informations relatives à la détention à l’étranger par Jérôme Cahuzac d’un compte non déclaré qu’auraient pu avoir les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Cette direction générale est en effet mise en cause par certaines des personnes qu’elle a entendues.
C’est d’abord Fabrice Arfi qui y a fait allusion : au cours de son audition (28), il a invité la commission d’enquête à « aller chercher des documents » auprès, notamment, des douanes, où, selon lui, « des gens ont des choses à dire » ; dans son livre sur l’affaire, il parle d’« un correspondant de la DCRI et des douanes qui [lui] parle de la connaissance du compte suisse de Cahuzac par ces deux services de renseignements français » (29).
Michel Gonelle abonde dans le même sens. Il a ainsi déclaré à l’AFP, qui l’a publié dans un communiqué du 3 avril 2013 : « Selon ce que je sais de bonne source et qui m’a été rapporté, un haut fonctionnaire des douanes avait identifié le compte en 2008 », avant de préciser, toujours selon l’AFP : « ce haut fonctionnaire est élu d’une ville de l’Oise ».
Au cours de sa première audition par la commission d’enquête (30), M. Gonelle est interrogé par le Rapporteur sur cette déclaration. Sa réponse est la suivante : « En réalité, il y a une erreur dans la transcription de mes propos, car cette administration le savait bien avant 2008. J’ai entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le service compétent des douanes, le chef du 4ème bureau de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières - une des divisions de la DNRED - avait obtenu ce renseignement dès 2001, même si j’ignore de quelle façon. Selon mes informations, dont j’ai tout lieu de penser qu’elles sont sérieuses, ce cadre de haut niveau, administrateur civil d’origine, a été interrogé par plusieurs journalistes sur ce fait, sans jamais le démentir ni le confirmer. » À la demande du président de la commission d’enquête, il donne son nom : il s’agirait de Thierry Picart – qui est élu local dans le Val d’Oise.
Entendu à son tour par la commission d’enquête (31), M. Picart, aujourd’hui chef du bureau de lutte contre la fraude à la DGDDI, a très vivement contesté cette affirmation. Il a démontré que le changement de la date de la prétendue information des douanes (2008 dans un premier temps, 2001 ensuite) était loin d’être anodin. Il a d’abord contesté que la mention de l’année 2008 ait pu être une erreur de transcription puisque Michel Gonelle mentionne cette même année dans un entretien à BFM TV. Il a souligné que certains journalistes (32) avaient alors déduit de cette date que l’information serait parvenue jusqu’au ministre du budget de l’époque, Éric Woerth, qui l’aurait enterré.
Pourtant, en 2008, Thierry Picart ne pouvait absolument pas avoir rédigé une note sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac dans la mesure où il avait été affecté, depuis septembre 2006, à la direction du budget, où il était chargé du suivi des crédits de la mission « Aide publique au développement », fonction qu’il n’a quittée qu’en juillet 2009, pour rejoindre son poste actuel à la DGDDI. Il pense donc que Michel Gonelle a prétendu que l’information de la douane ne datait pas de 2008 mais de 2001 pour rendre crédible le reste de ses affirmations : en 2001, M. Picart dirigeait la quatrième division d’enquête de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, chargée notamment de lutter contre les mouvements financiers illicites ; il pouvait donc, éventuellement, avoir connaissance de transferts de fonds vers un compte non déclaré détenu en Suisse par Jérôme Cahuzac.
Interrogé par le Rapporteur sur le point de savoir s’il avait eu connaissance, dans l’exercice de ses fonctions passées, à quelle que date que ce soit, d’éléments relatifs à la situation financière ou fiscale de Jérôme Cahuzac, Thierry Picart a avoué ne pas pouvoir répondre à cette question parce que « le travail habituel de cette division était justement d’enquêter sur des personnes ayant transféré physiquement des avoirs à l’étranger ». Il voyait donc plusieurs centaines de dossiers par an de personnes ayant investi ou transféré des comptes à l’étranger. Dans ces conditions, il ne peut ni confirmer ni infirmer avoir eu à traiter du cas de Jérôme Cahuzac, n’ayant « aucun souvenir de chacun des dossiers » que lui-même ou son service a traités à cette époque. Il a en outre précisé que le système d’information « Lutte contre la fraude » conservait au maximum pendant dix ans des informations nominatives relatives à des auteurs de fraude constituant un délit d’une certaine gravité – les durées étant moins longues en cas de suspicion sans infraction contestée ou de délit mineur (33). Il a néanmoins concédé qu’il se serait probablement souvenu du dossier d’un député-maire, sauf si celui-ci n’avait pas mentionné ses mandats et s’il ne bénéficiait que d’une faible notoriété.
Lors de son audition par la commission d’enquête (34), Jérôme Fournel, qui a été directeur général des douanes et des droits indirects entre février 2007 et février 2013, a confirmé que des contrôles et des vérifications avaient été faits, après le déclenchement de l’affaire, sur les données informatiques disponibles et que le nom de Jérôme Cahuzac n’y avait pas été trouvé.
Lors de sa seconde audition (35), Michel Gonelle a reconnu qu’il s’était trompé lorsqu’il avait parlé d’un signalement à la douane en 2008 et que la date exacte était 2001, et a répété qu’il tenait ces informations de sources journalistiques.
L’année 2001 est aussi celle pendant laquelle Christian Mangier est informé, par l’intermédiaire de Jean-Noël Catuhe, de la conversation interceptée par Michel Gonelle à propos du compte de Jérôme Cahuzac : peut-être la concomitance des deux prétendus signalements ne relève-t-elle pas du hasard. Lors de son audition (36), M. Catuhe a indiqué qu’il avait revu Christian Mangier, son ancien condisciple, quelque temps auparavant, alors que celui-ci « était en mission dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot pour une affaire de fraude assez importante, en liaison avec les personnels des douanes ». Il n’est pas impossible que certains aient déduit de cette proximité professionnelle entre l’inspecteur des impôts et des agents des douanes que ces derniers avaient aussi été informés de l’existence du compte en Suisse non déclaré de Jérôme Cahuzac.
Quelle que soit l’origine des assertions publiées dans la presse et relayées par Michel Gonelle, la commission d’enquête n’a pas pu établir que les services de la DGDDI avaient eu connaissance, à un moment ou un autre, de l’existence de ce compte.
Afin de compléter l’information de la commission d’enquête, le Rapporteur a interrogé par courrier, le 25 juin 2013, Jean-Baptiste Carpentier, le directeur de TRACFIN. Celui-ci lui a indiqué que « avant le 4 avril 2013, le service ne détenait aucune information se rapportant directement ou indirectement à l’affaire dont est saisie [la] commission ».
D. EN 2006, L’ENREGISTREMENT N’EST APPAREMMENT PAS UTILISÉ PAR JEAN-LOUIS BRUGUIÈRE
Après l’échec de ce signalement indirect, Michel Gonelle indique ne plus avoir utilisé l’enregistrement jusqu’à ce qu’« une autre opportunité » se présente à lui « le 12 novembre 2006, avec la venue de Jean-Louis Bruguière » (37). Cette entrevue a eu lieu dans le cabinet d’avocat de Michel Gonelle, alors que le juge anti-terroriste envisageait de se présenter contre Jérôme Cahuzac à l’élection législative du printemps 2007.
Michel Gonelle a décrit à la commission d’enquête avec beaucoup de détails son entrevue avec Jean-Louis Bruguière et les conditions dans lesquelles il lui a remis une copie de l’enregistrement (38). Au cours de ses deux auditions (39), Jean-Louis Bruguière a fait part de ses souvenirs, nettement moins précis, de cet entretien. Ces deux récits présentent un certain nombre de différences ; c’est pour tenter d’y voir plus clair que la commission d’enquête a décidé, après leur première audition, d’entendre les deux hommes une nouvelle fois. Ces différences portent notamment sur la question de savoir si M. Bruguière a demandé une copie de l’enregistrement, M. Gonelle n’ayant plus l’équipement technique nécessaire pour le lui faire entendre, ou s’il a simplement pris la copie qui lui était offerte. L’ancien magistrat a, devant la commission d’enquête, regretté d’avoir accepté d’emporter cet enregistrement. Il ne se souvient pas avoir été informé par M. Gonelle des conditions dans lesquelles l’enregistrement avait été effectué et nie lui avoir indiqué qu’il disposait des moyens d’en améliorer la qualité ; il conteste aussi qu’il se soit agi d’un simple prêt.
En tout état de cause, ces différences ne portent pas sur l’essentiel : Jean-Louis Bruguière a effectivement eu en sa possession une copie de l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires et il en connaissait, en substance, le contenu. Reste à savoir ce qu’il en a fait.
Devant la commission d’enquête, il a confirmé les informations qu’il avait données à un journaliste de Paris-Match le 23 décembre 2012 : il n’a jamais écouté l’enregistrement, n’en a parlé à personne, et, peu de temps après, l’a jeté « dans la poubelle familiale », à son domicile lot-et-garonnais. Il explique ce qui peut apparaître, au minimum, comme un manque de curiosité par la conception qu’il se fait de la politique.
Son mandataire financier et directeur de campagne, Gérard Paqueron a indiqué à la commission d’enquête (40) n’avoir jamais entendu parler, avant décembre dernier, ni de cet enregistrement, ni d’un compte que Jérôme Cahuzac aurait détenu illégalement à l’étranger. Il a aussi confirmé que Jean-Louis Bruguière n’avait jamais voulu utiliser les rumeurs qui courraient alors sur son adversaire politique (41) et que M. Gonelle ne faisait pas partie de son équipe de campagne.
M. Bruguière a en effet expliqué que ce qu’il a perçu comme une tentative d’instrumentalisation de la part de l’avocat, ajouté à d’autres incidents, avait contribué à détruire la confiance qu’il accordait à M. Gonelle, ce qui l’avait conduit à se passer de son aide pour sa campagne électorale. Ce dernier a infirmé cette thèse et fourni à la commission des documents qui prouveraient le contraire. Ceux-ci montrent qu’il figurait dans un organigramme de la future équipe de campagne du magistrat, en janvier 2007, et qu’il était associé à la préparation de cette campagne. Mais, à une exception près (42), ces documents datent de janvier et février. En outre, à l’occasion de sa seconde audition (43), Jean-Louis Bruguière a indiqué que cet organigramme n’avait pas été mis en œuvre. Il ne fait en tout cas aucun doute que les deux hommes se sont éloignés l’un de l’autre, même si le candidat malheureux a adressé une lettre de remerciement à l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot après sa défaite et sa décision de renoncer à toute activité politique.
La commission d’enquête n’a aucun moyen de s’assurer de la véracité du récit de l’ancien magistrat mais elle ne dispose d’aucun élément susceptible de conduire à la mettre en doute. Michel Gonelle, qui dément être celui qui a fourni l’enregistrement à Mediapart – ce qui a été confirmé à la commission par Edwy Plenel (44) –, explique ainsi l’origine de sa transmission à la presse : « Dès lors que ce n’est pas mon exemplaire qui a été transmis à Mediapart, puisque je l’ai donné à la police judiciaire, il s’agit forcément de l’autre qui a circulé. Je n’imagine pas une seconde que M. Bruguière ait donné à Mediapart l’exemplaire qu’il détenait. Je ne pense pas, en effet, que les relations qu’il entretient avec ce journal soient au beau fixe. Mon hypothèse est qu’à l’époque, en 2006 et 2007, ce disque a dû circuler entre les mains de plusieurs personnes avant d’aboutir à Mediapart. Je n’en ai cependant aucune preuve. » (45) Jean-Louis Bruguière répond, quant à lui, qu’il n’avait aucune raison de le faire (46).
Force est de constater que les travaux de la commission d’enquête n’ont permis de trouver ni une quelconque trace de l’utilisation que l’ancien magistrat aurait pu faire de l’enregistrement, ni une personne à laquelle il l’aurait fait écouter.
Ils ont en revanche mis en évidence le manque de sincérité de Michel Gonelle lorsqu’il laisse entendre que l’ancien juge anti-terroriste aurait joué un rôle dans la circulation de l’enregistrement.
La déduction présentée par Michel Gonelle repose sur un élément déterminant : le nombre de copies de l’enregistrement dont il dit être en possession depuis fin 2000. Comme mentionné supra, l’ingénieur du son indique n’avoir alors effectué qu’une seule copie. Puisqu’il est établi que Michel Gonelle en a remis au moins un exemplaire à Jean-Louis Bruguière – sur un support dont ce dernier ne se souvient pas du type – et un autre à la police judiciaire – celui qui a été expertisé, qui était en effet un minidisque (47) –, si le souvenir de l’ingénieur est exact, alors il devient évident que Michel Gonelle a fait réaliser au moins une autre copie de l’enregistrement de décembre 2000. Comment, dans cette hypothèse, être sûr qu’il n’en a pas fait faire plusieurs ?
La suite du témoignage de l’ingénieur du son met encore plus directement en cause le discours tenu par Michel Gonelle devant la commission d’enquête (48). Le spécialiste indique, en effet, qu’il a effectué, le 1er décembre 2012, à la demande de l’avocat, une copie numérique et une copie sur CD audio du contenu du minidisque sur lequel il avait sauvegardé, fin 2000, l’échange entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires. Il précise que la copie numérique permet l’expédition du fichier par courrier électronique. S’il dit la vérité – et le Rapporteur ne voit pas pourquoi il mentirait –, les accusations formulées par Michel Gonelle contre Jean-Louis Bruguière perdent toute crédibilité.
M. Gonelle n’a jamais fait la moindre allusion à cet épisode et a encore répété devant la commission, le 9 juillet, qu’il avait « réalisé en tout et pour tout 5deux sauvegardes de cet enregistrement. La première a été remise le 12 novembre 2006 à Jean-Louis Bruguière, la seconde le 16 janvier 2013 à la police judiciaire ». Interrogé par courrier par le Président et le Rapporteur le 4 septembre 2013, l’avocat a reconnu avoir fait faire ces copies supplémentaires, tout en affirmant, sans plus de précision, qu’elles « n’ont rien à voir avec la publication par le site Mediapart », ce qui ne peut que laisser dubitatif étant donné la concordance des dates.
Le but de la commission d’enquête n’est pas de retrouver la « source » de Mediapart, mais le recoupement du témoignage de l’ingénieur du son et du contenu des auditions de Michel Gonelle par la commission d’enquête jette le soupçon sur les propos qu’il a tenus devant elle, alors qu’il avait prêté serment, et entretient le doute sur le nombre total de copies de l’enregistrement.
E. LA MENTION, EN 2008, DU COMPTE DANS LE « MÉMOIRE EN DÉFENSE » DE RÉMY GARNIER N’A JAMAIS ÉTÉ SIGNALÉE AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Dès le 4 décembre 2012 (49), les journalistes de Mediapart ont cité, à l’appui de leur enquête, un document qui à leurs yeux établissait que les agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) avaient eu connaissance des soupçons relatifs aux avoirs détenus à l’étranger par Jérôme Cahuzac, au moins à compter de 2008. C’était placer une confiance excessive dans l’attention que les services centraux avaient prêté à une note, très allusive, produite par un agent aujourd’hui à la retraite, à l’appui d’une des onze instances qui l’opposaient ou l’avaient opposé à son administration.
1. Un inspecteur des impôts en conflit avec sa hiérarchie
L’acteur-clé de ce nouvel épisode est un ancien inspecteur des impôts, Rémy Garnier, en poste dans le Lot-et-Garonne jusqu’en 2010. Auditionné par la commission d’enquête, celui-ci a raconté en détail les circonstances dans lesquelles « [son] destin a croisé celui de Jérôme Cahuzac ».
Le premier épisode remonte à 1999, après que Rémy Garnier a notifié deux redressements fiscaux à une coopérative fruitière du Lot-et-Garonne
– France Prune – en décembre 1998. Le député de la circonscription, Jérôme Cahuzac, intercède alors auprès du secrétaire d’État au budget de l’époque, Christian Sautter. Cette démarche est justifiée à l’époque par la crainte que ces redressements ne se traduisent par des licenciements (50). Le 2 juin 1999, le secrétaire d’État donne instruction à ses services d’abandonner les redressements ; l’inspecteur Garnier proteste, refuse d’exécuter la consigne relayée par sa hiérarchie avant de recevoir un ordre écrit qui ne lui laisse d’autre possibilité que d’obtempérer. Ses relations avec sa hiérarchie se dégradent par la suite et il est sanctionné, comme il l’a lui-même expliqué devant la commission d’enquête : « je suis réinvesti contre mon gré, en dépit d’un document dans lequel j’explique pourquoi il est inutile de procéder à une nouvelle vérification sur place [de France Prune] [...]. Mes supérieurs profitent d’une lettre de dénonciation dont le contenu ne me sera révélé que cinq ans plus tard [...] pour me dessaisir avec la plus grande brutalité et pour me déplacer d’office de la direction régionale Sud-Ouest vers un placard de la direction départementale à Agen. C’est mon premier placard, j’en connaîtrai trois ».
Déplacé dans l’intérêt du service, Rémy Garnier passe six années (d’octobre 2001 à juillet 2006 (51)) dans ce nouveau poste, à la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne. Il conteste la légalité de cette mutation et obtient du juge administratif, en juin 2006, le droit d’être réintégré dans le service où il était précédemment affecté, l’antenne d’Agen de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest. Il n’est toutefois pas réintégré dans ses anciennes fonctions de vérificateur, mais lui sont confiées des missions d’enquête et de programmation. À ce titre, il obtient un accès à l’application informatique Adonis de l’administration fiscale ; le 9 mars 2007, il utilise cet outil pour consulter le dossier fiscal des époux Cahuzac, toujours domiciliés à Paris. Estimant qu’il n’avait aucune raison professionnelle de consulter ces données, son directeur Joseph Jochum engage une enquête disciplinaire au terme de laquelle, en juin 2008, il propose à l’administration centrale d’infliger un avertissement. L’avertissement est entériné par un arrêté ministériel du 17 décembre 2008, dont la signature est déléguée au directeur adjoint au directeur général des finances publiques.
C’est dans le cadre de la phase administrative de cette procédure disciplinaire que Rémy Garnier formule ses observations, le 11 juin 2008, sous la forme d’une note au ministre du budget intitulée « S’adonner à Adonis », qu’il transmet par la voie hiérarchique normale. Une fois l’avertissement prononcé, Rémy Garnier conteste la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2008 devant le tribunal administratif de Bordeaux, puis interjette appel du rejet de sa requête en annulation devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La note du 11 juin 2008 est versée au dossier contentieux (52) mais, contrairement à ce qui a été souvent dit ou écrit, il ne s’agit pas à proprement parler d’un « mémoire en défense » (53) devant une juridiction puisqu’il est antérieur même à la sanction contestée. Dans les mois qui suivent, Rémy Garnier écrit à de nombreuses reprises aux ministres du budget successifs : à Éric Woerth le 13 février 2009, à François Baroin le 23 septembre 2010, le 29 mars 2011 et le 2 mai 2011, à Valérie Pécresse le 8 mai 2012, sans toutefois jamais renouveler ses révélations concernant Jérôme Cahuzac.
2. Quelle était la crédibilité de la note du 11 juin 2008 ?
Au début de ses travaux, la commission d’enquête s’est intéressée au contenu exact de la note du 11 juin 2008, mise en avant par Mediapart sans pour autant la publier. Il s’agissait pour les commissaires de mesurer la précision et la crédibilité des informations incidemment portées à la connaissance de l’administration. Dans ce document de douze pages (plus les annexes) Rémy Garnier réfute, point par point, les griefs soulevés contre lui ; une première partie rappelle les faits et résume les étapes de la procédure disciplinaire, tandis qu’une seconde partie de la note critique, avec virulence, les contradictions qu’il a relevées dans le fonctionnement de l’administration fiscale. Sont incidemment évoquées les irrégularités qu’auraient commises cinq cadres – ils ne sont pas nommés, mais probablement identifiables par leurs collègues – et un élu local : Jérôme Cahuzac. Les éléments qui concernent ce dernier sont détaillés en pages 9 et 10 de la note ; ils tiennent sur cinq paragraphes, reproduits ci-dessous.
EXTRAIT DE LA NOTE DU 11 JUIN 2008 DE RÉMY GARNIER
« Élu politique
« Il se nomme Jérôme CAHUZAC et son statut d’élu semble lui conférer une immunité fiscale à vie.
« Les informations recueillies proviennent de plusieurs sources extérieures à l’Administration fiscale et convergent vers les mêmes conclusions.
« Cet élu local a acquis son appartement parisien situé ………………………….., PARIS 7ème, pour le prix de six millions et demi de francs, financé comptant, en début de carrière, à hauteur de quatre millions dont l’origine reste douteuse. Alors qu’il exerce ses activités au Cabinet de Claude ÉVIN, Ministre de la santé, il ouvre un compte bancaire à numéro en SUISSE. À l’époque, il était chargé des relations avec les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre des procédures d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de nouvelles spécialités. Les profits considérables de certains laboratoires dépendaient de ses décisions.
« J’ai ouï dire qu’il possède un patrimoine immobilier important :
- Villa en Corse héritée de son père ;
- Villa à MARRAKECH au MAROC ;
- Résidence à LA BAULE.
« Il emploie une salariée d’origine philippine sans papiers, à la fois à son service domestique et en qualité d’auxiliaire médicale dans sa clinique de chirurgie esthétique. En 2007, il a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de PARIS et il a été dispensé de peine.
« Les constatations effectuées sur ses déclarations fiscales ne permettent pas de valider ni d’infirmer ces renseignements, à défaut d’investigations plus poussées dans le cadre d’un Examen approfondi de situation fiscale personnelle.
(Rémy Garnier fait ensuite état de deux anomalies dans les déclarations de revenus de Jérôme Cahuzac. Ces déclarations sont confidentielles et leur contenu ne saurait être divulgué par la commission sans méconnaître le secret fiscal.)
Il y est écrit que les informations contenues dans cette note proviendraient de plusieurs aviseurs, « extérieur[s] à l’administration fiscale ». En réalité, la commission d’enquête a pu établir que la source de Rémy Garnier était la même qui, en 2001, a signalé les faits à l’antenne bordelaise de la DNEF. C’est un inspecteur des impôts – Jean-Noël Catuhe –, par ailleurs ami commun avec Michel Gonelle, qui révèle à Rémy Garnier « en 2002 ou 2003 » les circonstances de l’enregistrement de la conversation téléphonique de 2000 et son contenu. Ce dernier n’utilise pas cette information – pour la transmettre au service de contrôle fiscal compétent ou encore saisir le Procureur de la République – mais, lorsqu’en 2006, M. Gonelle devient son conseil dans le volet pénal du contentieux l’opposant à l’administration, il lui demande confirmation de l’existence de l’enregistrement.
Au cours des auditions, plusieurs témoins ont pointé le caractère excessif du contenu de la note, doutant que les lecteurs aient, à l’époque, accordé du crédit aux révélations de Rémy Garnier. La directrice de cabinet de l’ancien ministre du budget, Amélie Verdier, a pris connaissance du document au lendemain de la publication du premier article de Mediapart. Elle résume l’impression retirée de cette lecture dans les termes suivants (54) : « Les informations contenues dans le mémoire ne sont pas celles que l’on trouve habituellement dans le mémoire d’un inspecteur des impôts effectuant un contrôle. On peut y lire : " Il se nomme Jérôme Cahuzac, son statut d’élu semble lui conférer une immunité à vie ". Au milieu d’informations fantaisistes, dont il concède qu’il ne les a pas lui-même vérifiées, et fausses pour certaines, comme il l’a reconnu ultérieurement, est mentionnée l’ouverture d’un compte bancaire à numéro en Suisse. »
3. Le contenu de la note du 11 juin 2008 n’a pas été porté à la connaissance du DGFiP ou des ministres, avant les révélations de Mediapart
La commission d’enquête s’est efforcée d’identifier les destinataires réels de cette note afin d’établir si, comme cela a été parfois écrit, l’administration fiscale ne pouvait pas ignorer à compter de 2008 les soupçons pesant sur Jérôme Cahuzac. Les auditions successives ont permis d’établir que ce type de document était logiquement traité par le bureau RH 2B chargé de la déontologie, de la protection juridique et du contentieux au sein de la sous-direction RH 2 du service des ressources humaines de la DGFiP.
D’après les déclarations faites à la commission d’enquête, le reste de l’administration fiscale, en dehors de ces agents, n’a découvert que le 4 décembre 2012, dans l’article de Mediapart, que Rémy Garnier justifiait ses recherches sur Adonis par le fait qu’il avait eu une information relative à la détention d’un compte en Suisse. Le chef du contrôle fiscal, Alexandre Gardette, a ainsi indiqué (55) avoir interrogé son prédécesseur, qui lui a confirmé que sa sous-direction n’en avait pas été informée. L’actuel directeur général des finances publiques ainsi que son prédécesseur (56) d’avril 2008 à août 2012 ont confirmé, sous serment, n’avoir jamais eu connaissance de ce mémoire ou de son contenu ; Bruno Bézard a souligné que « les mémoires disciplinaires de tous les agents, y compris ceux mettant en cause différentes autorités – dont le député de la circonscription – ne remont[ai]ent évidemment pas au directeur général ! ».
Le principal intéressé semble, lui-même, avoir tout ignoré des accusations portées dans sa note du 11 juin 2008 par Rémy Garnier. Le 26 octobre 2012, Jérôme Cahuzac effectue un déplacement officiel dans le Lot-et-Garonne et il en profite pour recevoir l’ancien inspecteur des impôts qui a sollicité son soutien dans les nombreuses procédures qu’il avait engagées contre l’administration et contre ses collègues. Les deux notes (57) qui lui sont préparées en vue de cette rencontre ne font pas allusion aux accusations portées par M. Garnier (58) ; elles se bornent à dresser l’historique des contentieux engagés par l’ancien inspecteur des impôts. Auditionnés successivement, les deux hommes ont affirmé à la commission que la note du 11 juin 2008 n’avait pas été évoquée lors de cette entrevue (59) alors même, semble-t-il, que Jérôme Cahuzac a éconduit son interlocuteur.
Une fois les premières révélations de Médiapart publiées, le ministre du budget en exercice tente même de vérifier si ses prédécesseurs ont eu connaissance de ces accusations. Jérôme Cahuzac a ainsi expliqué à la commission : « je suis allé voir M. Woerth le mardi 4 ou le mercredi 5 décembre pour lui demander s’il avait été informé par un courrier que j’aurais détenu un compte non déclaré à l’étranger. Il m’a répondu qu’il n’avait pas reçu de courrier de cette nature ; ce fait n’est contesté par personne ».
Cette seconde occasion manquée a, plus encore que la première, suscité le soupçon. Les travaux de la commission d’enquête n’ont toutefois pas permis d’établir que les allusions contenues dans la note – ou le mémoire – de Rémy Garnier aient été, en 2008 ou en 2012, prises en considération par les agents qui ont eu à en connaître. Aucune preuve ne permet non plus d’affirmer que l’un ou l’autre des ministres qui se sont succédé à Bercy ait eu connaissance des accusations contenues dans cette note à l’encontre de Jérôme Cahuzac.
*
La commission d’enquête n’a pas à porter de jugement sur la manière dont Michel Gonelle a utilisé, depuis qu’il l’a obtenue, fin 2000, l’information de la détention par Jérôme Cahuzac d’un compte non déclaré à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que les choix qu’il a faits au cours des douze dernières années ont considérablement retardé la révélation de la vérité : c’est le cas entre fin 2000 et la publication du premier article de Mediapart sur le sujet ; c’est encore le cas de l’initiative qu’il prend, le 15 décembre 2012, de dévoiler au directeur de cabinet adjoint du président de la République son rôle dans la sauvegarde de la conversation téléphonique évoquée par le journal en ligne, le Rapporteur y reviendra (60). Ce constat ne doit pas pour autant faire oublier les erreurs commises par certains agents de l’administration fiscale, en particulier à la BII de Bordeaux, en 2001.
Après avoir examiné les différents moments auxquels l’existence d’un compte non déclaré à l’étranger de Jérôme Cahuzac a été l’objet d’une forme de publicité, la commission d’enquête observe que chacun de ces épisodes a tourné court : pour diverses raisons, cette information semble n’avoir jamais été communiquée qu’à un très petit nombre de personnes, qui n’ont pas pu ou pas voulu l’utiliser. La commission d’enquête n’a recueilli aucun élément qui puisse laisser penser qu’elle ait atteint, à un moment ou à un autre, une autorité administrative ou politique qui serait intervenue pour l’étouffer. Les accusations formulées par certains médias lui apparaissent donc infondées.
II. DANS LES SEMAINES SUIVANT LES RÉVÉLATIONS DE MEDIAPART, L’APPAREIL D’ÉTAT RÉAGIT DANS LE RESPECT DE LA LÉGALITÉ
D’emblée, les rumeurs d’instrumentalisation de l’administration, voire d’investigations clandestines, ont circulé. La première préoccupation de la commission d’enquête a donc consisté à vérifier la régularité des actions conduites par les membres de l’exécutif, ou sous leur autorité, liées aux informations publiées par Mediapart.
A. L’ADMINISTRATION FISCALE TIRE LES CONSÉQUENCES DU DÉPORT DE SON MINISTRE DE TUTELLE
Avec la publication, le 4 décembre 2012, du premier article de Mediapart la direction générale des finances publiques (DGFiP) a été confrontée à une situation « non seulement probablement inédite mais potentiellement difficilement gérable », selon les mots de son directeur Bruno Bézard (61).
1. L’établissement très rapide de la « muraille de Chine »
Les accusateurs de Jérôme Cahuzac dénonçaient un cas de fraude fiscale ; leurs allégations portaient donc sur une matière relevant étroitement du champ de compétences du ministre du budget. Afin de protéger l’administration fiscale, il a été décidé d’exclure le contribuable concerné de toute procédure pouvant potentiellement concerner sa situation : ce mécanisme de déport, rapidement baptisé « muraille de Chine » par analogie peut-être avec certaines règles internes des banques d’investissement, a été mis en œuvre dès le surlendemain des révélations de Mediapart et expressément formalisé le 10 décembre.
Lors de son audition (62), Bruno Bézard a longuement expliqué aux membres de la commission d’enquête les raisons qui l’avaient convaincu de préconiser un tel déport : « [s]on souhait éta[it] d’éliminer le conflit d’intérêts potentiel entre un ministre, responsable hiérarchique de l’administration fiscale, et le contribuable faisant potentiellement l’objet d’investigations de la part de cette même administration. […] Une administration est au service de l’État et non de personnalités politiques ». Il a retracé très précisément la chronique de la mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi, le 5 décembre – alors que l’après-midi même Jérôme Cahuzac réitère, devant la Représentation nationale, ses dénégations –, le directeur général des finances publiques met au point avec la directrice des affaires juridiques du ministère un projet de note pour organiser le déport. Le lendemain, il indique aux deux directeurs de cabinet qu’il juge indispensable d’ériger cette « muraille de Chine » « afin de pouvoir travailler dans des conditions incontestables » ; à compter de cette date, il est fait application du dispositif de déport, même si celui-ci n’est pas encore formalisé. Au terme de quelques échanges, la rédaction est finalisée le 7 décembre au cours d’une réunion chez la directrice de cabinet du ministre du budget, Amélie Verdier. Le texte est formellement signé par Jérôme Cahuzac, le 10 décembre.
La rédaction retenue est assez courte (six paragraphes) et factuelle (63). De l’avis du Rapporteur de la commission d’enquête, cela ne lui enlève rien de sa portée. Le ministre du budget en exercice y insiste sur son souci de « ne pas porte[r] atteinte au fonctionnement et à la réputation de l’administration placée sous [s]a responsabilité ». Le déport repose concrètement sur trois décisions :
– le ministre ou son cabinet ne formuleront aucune demande de documents à la DGFiP ; celles-ci devront être effectuées par ses avocats aux seules fins de préparer la défense de Jérôme Cahuzac ;
– les informations concernant la situation fiscale personnelle du ministre seront directement transmises à ses avocats ou à ses conseils, dans les conditions habituelles applicables à tout contribuable ;
– les informations relatives à la banque UBS, qui auraient à être portées à la connaissance du ministre délégué au budget, seront directement soumises à son ministre de tutelle, Pierre Moscovici.
La question du signataire de cette décision de déport a été débattue entre les membres de la commission d’enquête. Certains ont argué du parallélisme des formes pour défendre l’idée que c’était au Premier ministre de signer le document, comme il l’avait fait pour le décret relatif aux attributions déléguées au ministre chargé du budget (64). D’autres ont estimé que c’était au ministre plein, Pierre Moscovici, de décider le déport. Force est toutefois de constater qu’il y a « peu ou pas de précédent » (65) d’un membre du Gouvernement mis en cause sur un fait entrant aussi directement dans son domaine de compétence. Dans la mesure où aucun bloc de compétence n’était ôté à Jérôme Cahuzac et où il s’agissait d’une décision individuelle de mise en retrait, le Rapporteur de la commission d’enquête estime que la forme choisie était adéquate. Un cadre supérieur au sein d’une entreprise, publique ou privée, ou un dirigeant d’une administration centrale ne pratique pas autrement lorsqu’il estime préférable d’éviter un conflit d’intérêts en ne traitant pas, par exemple, un dossier relatif à une société dont il a pu être administrateur dans une période récente.
Cette décision a permis de mettre, dès les tout premiers jours de l’« affaire Cahuzac », les agents de l’administration fiscale à l’abri d’un conflit de loyautés.
2. La poursuite de l’examen de la situation fiscale de Jérôme Cahuzac
Incarnant la continuité de l’action publique, confortée par la mise en place le 6 décembre 2012 de la « muraille de Chine », la DGFiP a poursuivi l’examen de la situation fiscale de Jérôme Cahuzac, en dépit des révélations de Mediapart.
La tradition républicaine commande en effet que l’administration fiscale procède à un examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement, y compris le Premier ministre, à l’occasion de leur nomination. En 2007 et en 2012, le président de la République et son prédécesseur ont souhaité se soumettre aux mêmes vérifications.
Cet examen ne constitue cependant pas une procédure de contrôle au sens juridique mais « une sorte de "regard" sur le respect des règles fiscales », selon la description faite par l’ancien directeur général des finances publiques, Philippe Parini (66).
L’EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Depuis 2007, ce processus d’examen a été formalisé de la manière suivante :
1. Sur instruction de l’administration centrale, un examen initial et complet du dossier (essentiellement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de solidarité sur la fortune) est effectué par la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente, en fonction du lieu du domicile, à partir des éléments déjà en sa possession ;
2. En cas d’interrogations ou d’anomalies, le directeur territorial, après en avoir informé l’administration centrale (service du contrôle fiscal), prend personnellement contact avec l’intéressé, afin qu’il apporte les précisions ou les justifications nécessaires ;
3. Le cas échéant, le directeur territorial, en accord avec l’administration centrale, lui propose de mettre en conformité son dossier par le dépôt de déclarations rectificatives (hors donc toute procédure juridiquement contraignante) et apporte toutes les précisions utiles sur le paiement des impositions supplémentaires. Les compléments de droits résultant de ces nouvelles déclarations sont bien évidemment assortis des intérêts de retard ainsi que, le cas échéant, des pénalités légalement exigibles.
4. En cas de difficulté (anomalies importantes, problématique complexe…) ou de désaccord sur les modalités de la régularisation, le dossier remonte au niveau de l’administration centrale pour expertise supplémentaire.
En ce qui concerne le(s) ministre(s) chargé(s) du budget, c’est le directeur général des finances publiques qui se charge, si nécessaire, de l’(les) informer de leur situation.
Un bilan nominatif est remis annuellement au(x) ministre(s) chargé(s) du budget.
Source : DGFiP.
Dans le cas qui intéresse la commission d’enquête, les opérations liées à l’examen « républicain » du dossier personnel du foyer fiscal Cahuzac débutent, comme pour les autres ministres, le 6 juin 2012, avec l’envoi au ministre de l’économie et des finances ainsi qu’au ministre délégué en charge du budget d’une note sur le processus d’examen de la situation fiscale des membres de l’exécutif. Le 22 juin, la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Paris transmet à l’administration centrale le compte rendu demandé, sous la forme d’une fiche dont le Rapporteur a pu prendre connaissance. Ce compte rendu est remis, entre autres fiches, au ministre du budget par le directeur général des finances publiques alors en poste, Philippe Parini, le 24 juillet. Il ne comporte aucune mention relative à l’absence de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger.
De juillet à novembre 2012, la DRFiP de Paris et les époux Cahuzac échangent des courriers visant à régulariser des anomalies liées « [à] la valorisation de biens immobiliers et [à] l’existence d’un foyer fiscal commun » (67). Le 23 novembre, à l’occasion d’un point d’étape sur le processus d’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement, le directeur général, désormais Bruno Bézard, évoque la situation personnelle du ministre du budget avec celui-ci. Le 19 décembre, le comptable des époux Cahuzac, Gérard Ranchon, est reçu, à sa demande, au pôle Sud-Ouest de la DRFiP de Paris pour évoquer les difficultés persistantes ; interrogés par le Rapporteur, les agents concernés (68) ont confirmé que les éventuels avoirs à l’étranger de Jérôme Cahuzac, dont la presse a révélé l’existence deux semaines plus tôt, n’avaient pas été évoqués.
Le 21 décembre 2012, le site d’information Mediapart publie un article intitulé « Les mensonges de Jérôme Cahuzac », qui détaille le contenu de l’entretien accordé l’avant-veille par la DRFiP à l’expert-comptable de ce dernier et évoque « les vérifications approfondies actuellement en cours de sa propre administration fiscale ». En écrivant cela, Mediapart confond deux procédures : à la différence de l’examen sur pièces, basé sur les renseignements et documents figurant au dossier du contribuable, la vérification approfondie a pour objet de s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites en les confrontant avec des éléments extérieurs ; elle a donc une logique inquisitoriale totalement distincte. La DGFiP réagit à cette confusion en publiant le lendemain au soir un communiqué de presse (dont le texte figure dans l’encadré suivant) démentant l’engagement d’une procédure de contrôle approfondie du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, tout en rappelant que l’examen de la situation des membres du Gouvernement était effectivement en cours.
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
(EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2012)
« Aucun contrôle ou enquête n’est en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement.
« Comme c’est l’usage pour chaque nouveau Gouvernement, le ministre délégué chargé du budget a demandé à la DGFiP de procéder à un examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement. C’est cette procédure qui est en cours et qui vise notamment à assurer que la situation de chacun des membres du Gouvernement est irréprochable et exemplaire ».
Source : DGFiP, AFP.
Toutefois, une lecture littérale du communiqué – dont le titre paraît rétrospectivement maladroit – peut donner le sentiment qu’aucun contrôle ou enquête n’est en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Contrairement aux habitudes, ce communiqué n’est pas non plus mis en ligne sur le site de la DGFiP (69) : Mediapart y voit matière à entretenir les soupçons d’instrumentalisation de l’administration fiscale, et publie, le 23 décembre, un nouvel article intitulé « Les questions du fisc à Jérôme Cahuzac ».
3. L’envoi à Jérôme Cahuzac d’une demande type de renseignements dans la perspective d’une éventuelle saisine des autorités suisses
Tandis que l’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement suit son cours, l’administration fiscale a entrepris, à compter du 5 décembre, d’approfondir les révélations publiées par Mediapart, sans que la commission n’ait pu relever d’interférence des ministres ou de leurs cabinets.
Les travaux de la commission n’ont pas permis de trouver trace d’investigations sortant du cadre strict des procédures fiscales. En particulier, l’hypothèse, avancée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles, d’une mission secrète à Genève d’« une quinzaine de fonctionnaires » de la DGFiP à la fin du mois de décembre 2012, n’est nullement étayée. Au terme d’un contrôle conjoint sur place, le 11 avril 2013, les présidents des commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, avaient eux-mêmes reconnu que cette éventualité leur paraissait « peu probable ». Entendu par la commission d’enquête, le ministre de l’économie et des finances s’est défendu d’avoir diligenté de telles investigations (70) : « Je ne reviens pas sur les accusations d’un magazine, Valeurs actuelles, selon lequel j’aurais fomenté une opération spéciale en Suisse. […] J’ai porté plainte en diffamation contre ces allégations absurdes et indignes. ».
C’est donc dans le cadre des procédures que prévoit la loi que, dès le 6 décembre, des précisions sont demandées à la DRFiP Île-de-France et Paris sur des contrôles dont Jérôme Cahuzac avait fait l’objet en 1991. La centrale interroge également les directeurs successifs de la DIRCOFI Sud-Ouest sur les allégations contenues dans la note du 11 juin 2008 de Rémy Garnier.
Le service du contrôle fiscal de la DGFiP prépare, sous la responsabilité de son chef Alexandre Gardette, un projet de demande de renseignements – sous la forme habituelle d’un imprimé n° 754 (71) – qui est transmis, le 13 décembre, à la DRFiP de Paris. Le courrier est adressé par celle-ci aux époux Cahuzac, le 14 décembre, leur demandant d’indiquer les références bancaires des comptes qu’ils pourraient détenir à l’étranger, ainsi que le montant des avoirs et des revenus figurant sur ces comptes.
Ce courrier était rédigé dans les termes suivants : « Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants : ». Il était notamment précisé : « Cette demande ne revêt pas de caractère contraignant. Elle est établie conformément aux dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales qui permet à l’administration fiscale de demander aux contribuables des renseignements sur les éléments qu’ils ont déclarés. Afin de traiter votre dossier dans les meilleures conditions, je vous remercie de m’adresser votre réponse si possible dans un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. » Le détail des éléments demandés, renvoyé en annexe, était ainsi libellé : « Selon des informations récemment parues dans la presse, vous seriez ou auriez été détenteur d’un compte bancaire ouvert à l’étranger. Or l’examen de votre dossier fiscal a permis de constater que vous n’aviez pas déclaré l’existence de compte(s) ouvert(s) à l’étranger, ni sur les déclarations de revenus que vous avez déposées au titre des années 2006 2009, ni sur l’impôt de solidarité sur la fortune. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants :
– l’identification des comptes bancaires ouverts, clos ou utilisés à l’étranger en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
– le montant des avoirs figurant sur ces comptes au 1er janvier 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
– le cas échéant, le montant des revenus de source étrangère y afférant au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. »
Comme l’ont expliqué MM. Bézard et Gardette aux membres de la commission d’enquête (72), l’objet de cette demande n’était pas de faire signer par Jérôme Cahuzac une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’avait pas de compte à l’étranger, mais de répondre à un document administratif ainsi rédigé : « Vous seriez ou auriez été détenteur d’un compte bancaire ouvert à l’étranger. L’examen de votre dossier fiscal a permis de constater que vous n’avez pas déclaré l’existence de comptes ouverts à l’étranger sur les déclarations de revenus que vous avez déposées au titre des années 2006 à 2011. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants […] ».
Plusieurs commissaires se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la DGFiP avait eu recours à cette procédure ; le chef du service du contrôle fiscal, Alexandre Gardette, a mis en avant deux justifications à l’envoi d’un imprimé n° 754. La première tenait à l’examen concomitant de la situation fiscale des époux Cahuzac au titre de ses nouvelles fonctions ministérielles ; il paraissait donc « normal de se situer dans ce cadre pour interroger le contribuable ». La seconde raison était le souci de laisser une trace du fait que l’administration fiscale française purgeait les voies internes d’interrogation du contribuable.
Dressant devant la commission des finances du Sénat le bilan de deux contrôles sur place des 11 avril et 30 mai 2013 (73), son Président, Philippe Marini, s’est pour sa part étonné de l’absence de relance du contribuable concerné, à l’expiration du délai de trente jours et en l’absence de réponse de sa part : « La version officielle consiste à présenter cette procédure, et l’absence de réponse du contribuable dans le délai de trente jours, comme des non-événements […] Selon l’administration, l’objectif de cette procédure était de purger les voies internes afin de rendre juridiquement possible une demande d’assistance administrative à la Suisse. D’un point de vue administratif, ce raisonnement est convaincant. Il en va différemment sur le plan politique ». Pourtant, dès lors que Jérôme Cahuzac niait tous les jours publiquement détenir un compte à l’étranger, il paraît difficile d’imaginer qu’il fournirait des informations dans le cadre d’une procédure non contraignante ; dès lors, il est compréhensible que l’administration fiscale n’ait pas tenté de relancer l’intéressé.
Comme le Rapporteur se l’est fait préciser, cette démarche était un préalable indispensable à la demande d’assistance administrative à la Suisse car la convention bilatérale le prévoit explicitement. Si la demande d’assistance administrative avait été lancée trop vite, la partie suisse aurait très probablement demandé à vérifier que les voies internes avaient été épuisées.
À aucun moment, les cabinets des ministres ne sont informés de cette démarche administrative, comme l’ont assuré sous serment MM. Bézard et Gardette. L’administration fiscale a fait application, jusqu’à la fin du mois de décembre 2012, de la circulaire (74) dite « Baroin » du 2 novembre 2010 qui proscrit l’évocation des situations fiscales individuelles auprès du ou des ministres en charge du budget. Il n’y a donc pas, là non plus, d’instrumentalisation mais un délai incompressible – peut-être trop long aux yeux de certains – lié aux procédures fiscales.
B. LA JUSTICE N’EST SAISIE QUE DE DEUX PLAINTES EN DIFFAMATION
Au cours des premières semaines qui ont suivi les révélations de Mediapart, la Justice est saisie de deux plaintes en diffamation déposées par Jérôme Cahuzac contre ce journal. La formulation de la première plainte, en date du 6 décembre et dirigée contre l’article du 4 décembre 2012 intitulé « Le compte suisse du ministre du budget Jérôme Cahuzac », révèle immédiatement le caractère exceptionnel de l’affaire qui commence.
1. La question de la base juridique de la plainte en diffamation du 6 décembre 2012
Le 6 décembre 2012, Jérôme Cahuzac demande à la garde des Sceaux l’ouverture de poursuites pour « diffamation envers un membre du Gouvernement », en application du 1° bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet alinéa, introduit en 2000 (75), dispose que « dans les cas d’injure ou de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la Justice ». La directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac a indiqué à la commission d’enquête (76) qu’elle s’était entretenue avec son homologue au ministère de la justice afin de s’assurer de la procédure à suivre pour la plainte en diffamation que le ministre délégué entendait déposer.
Il apparaît pourtant très rapidement que le choix de ce fondement juridique pose problème. En effet, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 précitée dispose, en son premier alinéa, que sera punie d’une amende de 45 000 euros la diffamation commise « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère (…) », avant de préciser, dans son second alinéa : « La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après », cet article étant relatif à la diffamation commise envers les particuliers. Or, les accusations de Mediapart dans l’article en cause étaient antérieures à la nomination de Jérôme Cahuzac au Gouvernement et portaient sur des faits qui lui incombaient à titre personnel.
Marie-Suzanne Le Quéau, la directrice des affaires criminelles et des grâces, a expliqué à la commission (77) que, dès la transmission, par le directeur de cabinet de la garde des Sceaux, de la plainte du ministre délégué, sa direction avait constaté qu’elle était « rédigée en termes confus » et que Jérôme Cahuzac aurait pu s’adresser directement au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article 32 de la loi précitée. Sa direction a effectué des recherches mais n’a pas trouvé de jurisprudence excluant formellement le recours à l’article 48 en matière de diffamation publique commise envers un membre du Gouvernement pour des faits ne relevant pas de ses fonctions ministérielles. La directrice a ajouté deux arguments : « Si un ministre [de la Justice] n’a pas de compétence liée en la matière, l’expérience montre que depuis plusieurs années, tous les ministres ont transmis au procureur général, pour le procureur de la République territorialement compétent, les plaintes qu’ils ont reçues sur le fondement du 1° bis de l’article 48. En effet, sans une transmission de la plainte, le ministre lui-même ne peut pas mettre en mouvement l’action publique, car il ne peut pas se constituer partie civile ni agir par voie de citation directe. De surcroît, dans la mesure où la garde des Sceaux a indiqué qu’elle n’interviendrait plus dans les affaires individuelles – et c’est le cas dans lequel nous nous trouvions –, la transmission s’imposait. » La plainte a donc été transmise au procureur général de Paris, qui l’a adressée au procureur de Paris.
Le 7 décembre, un échange a lieu entre la direction des affaires criminelles et des grâces et le procureur de Paris, via le procureur général de Paris, sur cette question. M. François Molins a fait part à la commission d’enquête de la conclusion qu’il en a tirée (78) : « Contrairement à l’analyse de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) et au regard de la jurisprudence de la dix-septième chambre du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, spécialisée en matière de presse, nous avons estimé qu’il s’agissait d’une diffamation publique envers un particulier, et que le visa dans la plainte de l’alinéa 1er bis de l’article 48 pouvait constituer une confusion, voire le moment venu une cause de nullité des poursuites, dans le cas où l’affaire serait venue devant le tribunal correctionnel. Nous avons alors pris l’initiative de requalifier l’affaire et de ne viser que les articles strictement utiles à la poursuite d’une diffamation publique envers un particulier. » Ceci fait, la plainte est transmise le jour même à la brigade de répression de la délinquance sur la personne (BRDP) de la police judiciaire de Paris pour qu’elle procède à une enquête préliminaire.
Lors de son audition par la commission (79), Edwy Plenel s’est vivement ému de ce qu’il considère comme un « détournement de procédure », dénonçant un conflit d’intérêts dans le fait que, selon lui, « la direction des affaires criminelles et des grâces n’a vu aucun problème à transmettre une plainte contre Mediapart par cette voie, comme si l’ensemble du Gouvernement en était solidaire » et évoquant le « déséquilibre des armes pour défendre une liberté fondamentale, la liberté de la presse ».
Les travaux de la commission d’enquête ont permis d’établir qu’il y avait bel et bien eu un débat sur la base juridique de cette plainte entre la DACG et le procureur de Paris dès que le ministre délégué au budget a transmis sa demande de dépôt de plainte à la garde des Sceaux – et non à cause de la protestation de M. Plenel lors de son audition par la police judiciaire, le 17 décembre, comme il l’a indiqué – et que l’affaire avait été requalifiée par le procureur, comme il avait la faculté de le faire, avant l’ouverture de l’enquête préliminaire. Par ailleurs, Mme Le Quéau a expliqué que le fondement de la plainte – l’article 31 ou l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse – ne changeait rien à la suite de la procédure : le procureur de la République pouvait, dans tous les cas, choisir de classer l’affaire ou d’ouvrir une enquête.
2. La seconde plainte et le déroulé normal de la procédure
En matière de diffamation, les pouvoirs d’enquête du magistrat instructeur sont très limités et portent essentiellement sur l’établissement de la date précise des propos rapportés et la teneur exacte des propos qualifiés de diffamatoire, l’élément de publicité et l’auteur des propos. La preuve des faits diffamatoires doit en effet être apportée à l’audience, la charge de la preuve reposant exclusivement sur les parties (80). Tel est l’objet de la convocation d’Edwy Plenel par la police judiciaire le 17 décembre 2012. Mais à peine cette procédure est-elle commencée, que Jérôme Cahuzac en déclenche une nouvelle.
Le 18 décembre, il dépose en effet entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique contre un particulier, en application des articles 23, 29 et 32 de la loi sur la liberté de la presse. Cette plainte vise non seulement l’article du 4 décembre 2012, mais aussi celui du 11 décembre 2012, intitulé « Affaire Cahuzac : le gestionnaire de fortune qui sait tout ».
Comme le procureur Molins l’a indiqué à la commission d’enquête (81), le parquet, à qui cette plainte est communiquée, prend un réquisitoire introductif le 15 février, à la suite du versement de la consignation, et fait comme toujours dans ce cas de figure : une enquête étant déjà lancée, il demande aux services de police de lui retourner la procédure d’enquête préliminaire, ce qui a été fait le 19 février, puis il joint la procédure d’enquête préliminaire à la procédure d’instruction, l’adressant au juge d’instruction, puisque celui-ci est désormais seul compétent pour instruire ces faits.
Le procureur général de Paris informe la direction des affaires criminelles et des grâces des grandes étapes de la procédure : de sa propre initiative, le 7 décembre, il lui indique que la plainte est transmise à la BRDP aux fins d’enquête préliminaire ; le 11 décembre 2012, il lui transmet le rapport de synthèse du parquet de Paris rendant compte de l’ouverture d’une enquête préliminaire ; le 20 décembre, il l’informe du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; le 22 février 2013, il lui indique l’ouverture d’une information judiciaire en date du 15 février. Parallèlement, le procureur général répond à quelques questions formulées par la DACG à la demande du cabinet de la garde des Sceaux, sur la fixation de la consignation, le 27 décembre 2012, puis sur le développement de la procédure, les 1er mars et 15 mars 2013.
Il s’avère que, finalement, aucun acte d’instruction ne sera effectué. Le conseil de la partie civile se désiste de sa plainte le 26 avril 2013 et des réquisitions de non-lieu sont prises le 3 juin 2013.
Une fois passées les hésitations des 6 et 7 décembre sur la base juridique de la plainte, lesquelles n’ont pas eu de conséquences, la Justice a traité les deux plaintes dans le respect des procédures applicables, en informant la chancellerie, conformément à la pratique habituelle pour les affaires sensibles, le Rapporteur y reviendra.
C. LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR INTERROGE LA DIRECTION CENTRALE DU RENSEIGNEMENT INTÉRIEUR
La presse a prêté au ministère de l’Intérieur un certain nombre d’initiatives à la suite des révélations de Mediapart. La commission d’enquête s’est efforcée de faire la lumière à ce sujet.
1. L’incident mettant en cause la direction départementale de la sécurité publique du Lot-et-Garonne
L’idée d’une enquête secrète menée par le ministère de l’Intérieur est apparue dans Mediapart le 21 décembre 2012 (82), après la découverte d’un courriel adressé à Jérôme Cahuzac par sa chef de cabinet, Marie-Hélène Valente. Le journal en ligne s’en inquiète vivement, ce qui justifie l’intérêt de la commission d’enquête pour cet incident.
Le texte du message, remis à la commission d’enquête par Fabrice Arfi
– Mme Valente n’en avait elle-même pas gardé trace –, figure dans l’encadré suivant.
COURRIEL DU 11 DÉCEMBRE 2012, À 15 h 18, DE MARIE-HÉLÈNE VALENTE À
JÉRÔME CAHUZAC ET YANNICK LEMARCHAND (1)
Objet : « Pour vous détendre un peu »
« Je viens d’être appelée par le dir’cab’ du préfet pour me raconter la chose suivante : vendredi soir, se trouvant au tribunal à Agen, Gonelle [Michel Gonelle, détenteur de l’enregistrement], en panne de portable, emprunte celui d’un policier qu’il connaît bien ; or c’est le portable de permanence du commissariat, et la messagerie a enregistré quelques heures plus tard le message suivant : " n’arrivant pas à vous joindre, je tente au hasard sur tous les numéros en ma possession. Rappelez Edwy Plenel. " J’ai demandé de consigner le message à toutes fins utiles. J’attends la copie du rapport officiel du DDSP [directeur départemental de la sécurité publique]. Il va falloir être prudents dans la remontée de l’info pour que celui-ci puisse être le cas échéant une preuve utilisable. »
Signé : « Marie-Hélène ».
(1) Yannick Lemarchand est un collaborateur de Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot.
Son auteur a été convoqué par la commission pour s’en expliquer (83). Elle a rapporté les faits dans les termes suivants : « Le 11 décembre, en début d’après-midi, je reçois un appel du directeur de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne qui, en guise de préambule, me demande de l’excuser de me déranger pour une affaire qui n’a sans doute pas grand intérêt. Il me dit avoir hésité à me prévenir de l’épisode survenu quelques jours plus tôt, le 7. Il s’agissait d’un message téléphonique destiné à Maître Gonelle, déposé tout à fait fortuitement sur le portable d’un policier. Les propos du directeur de cabinet sont relatés à la virgule près, ou presque, dans le mail dont vous avez eu connaissance et Maître Gonelle en a confirmé la teneur lors de son audition. Il lui était demandé de rappeler la rédaction de Mediapart. Je n’ai donc été que la courroie de transmission d’une information insignifiante qui n’a connu, de surcroît, aucune suite, d’aucune sorte. Le seul commentaire du ministre, quand il a reçu mon mail, a été : " C’est comique ". C’est ainsi qu’il a clos le chapitre. Et il n’a pas été rouvert depuis. Je m’étonne devant vous que le mail du ministre n’ait pas connu la même notoriété que le mien. »
Michel Gonelle, qui indique pour sa part que les faits se sont produits le 11 décembre, a apporté des précisions sur ce qu’il considère comme un « incident anecdotique » : « Je me trouvais en audience au tribunal correctionnel d’Agen quand j’ai reçu un message de Mediapart – c’était le premier contact que j’avais avec ce journal – me demandant de rappeler. Comme la batterie de mon téléphone était déchargée, j’ai demandé au chef d’escorte présent sur place, que je connais depuis longtemps, de me prêter le sien. J’ai tenté à deux reprises de contacter mon interlocuteur à Mediapart, tombant à chaque fois sur le répondeur, avant de renoncer et de rendre l’appareil à son propriétaire. Par la suite, le policier – d’après ce que l’on m’a raconté – a reçu un appel depuis le numéro que j’avais appelé. Apprenant qu’il s’agissait d’Edwy Plenel et de Mediapart, et craignant sans doute des ennuis, il a décidé de rédiger un rapport succinct à l’intention de son chef de service. Ce dernier, semble-t-il, a jugé préférable d’en avertir le préfet, qui lui-même a dû estimer nécessaire d’en référer au ministre du budget. » (84)
Edwy Plenel et Fabrice Arfi ne voient nullement cet incident comme dépourvu d’intérêt ; ils y voient au contraire la preuve du fait que « sept jours après le premier article de Mediapart, alors qu’il y a des déclarations publiques de soutien à M. Cahuzac, le ministère de l’intérieur mobilise des services de police pour faire des rapports sur les relations téléphoniques entre un journaliste et l’un des protagonistes de l’affaire ; on parle de " remonter l’info ", qui doit pouvoir servir de " preuve " – et c’est cela qui doit détendre l’atmosphère du cabinet ? » (85)
Appelée par la commission d’enquête à s’expliquer, Marie-Hélène Valente a concédé qu’elle avait « sans doute fait preuve d’une conscience professionnelle exagérée et utilisé un vocabulaire peu adapté au sujet. Si erreur il y a eu, elle est là. » Elle a indiqué n’avoir jamais reçu le « rapport officiel du DDSP » « parce que ce rapport n’existe pas en tant que tel », avant de préciser : « Les services de police et de gendarmerie font remonter au ministère de l’Intérieur des événements qui leur paraissent avoir une signification quelconque. La plupart du temps, les comptes rendus aboutissent chez le permanencier. Il ne s’agit pas de rapports proprement dits, remis au ministre. » Plus loin dans son audition, elle a reconnu cependant ignorer « totalement ce qui s’est passé entre la direction départementale de la sécurité publique, ou le préfet, et le ministère de l’Intérieur ».
Pour ce qui est du sens de la dernière phrase de son message, elle a avoué être en peine de l’expliquer : « Le ministre avait engagé une action en diffamation et je ne savais pas si cette information pourrait servir dans ce cadre. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c’est qu’après coup, je me suis dit qu’il ne fallait pas procéder ainsi. J’ai donc rappelé le directeur de cabinet du préfet pour lui dire de ne pas m’envoyer de copie et de ne plus en parler. Il m’a répondu qu’il en était arrivé à la même conclusion. »
Lors de son audition, Pascal Lalle, le directeur central de la sécurité publique (86), a confirmé que le rapport en question existait bel et bien, mais qu’il n’avait pas été rédigé immédiatement après les faits : il a demandé sa rédaction au directeur département de la sécurité publique de Lot-et-Garonne dans le courant du mois de mai. Ce rapport d’une page (87), qui a été transmis à la commission d’enquête, est en effet daté du 21 mai 2013. Le directeur départemental y confirme que les faits datent du vendredi 7 décembre 2012 et précise qu’il n’en a été informé que le lundi 10 décembre 2012 en fin de soirée ; après avoir, le lendemain, procédé à des vérifications sur le journal d’appel du téléphone, il a décidé de faire remonter l’information au cabinet du préfet et à la direction centrale. Devant la commission, M. Lalle a évoqué la « culture du compte rendu » de la police nationale et jugé tout à fait normal que, dans le contexte médiatique de l’époque, le directeur départemental rende compte de l’incident. Le ministre de l’Intérieur a quant à lui qualifié cet incident de « banal » (88).
Quant au fait que le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne en informe la chef de cabinet de Jérôme Cahuzac, cela relève, selon les termes utilisés par Mme Valente, de la « tradition républicaine constante » selon laquelle « lorsqu’un ministre est élu dans un département, […] le préfet le tien[t] régulièrement informé des événements qui s’y déroulent, a fortiori quand le ministre lui-même est concerné. Nous étions parfaitement dans ce cas de figure ».
À l’issue de ses travaux, la commission d’enquête a donc la conviction que ce courriel est un « non-événement », tout comme l’incident sur lequel il porte. Il relève du fonctionnement normal des services de l’État et ne révèle pas de mobilisation des services de police pour découvrir la « source » de l’organe de presse qui est à l’origine du déclenchement de l’affaire.
2. La question de la « note blanche » de la direction centrale du renseignement intérieur
La thèse d’une enquête secrète conduite par le ministère de l’Intérieur réapparaît au printemps 2013, mais elle s’appuie à nouveau sur des faits qui se seraient prétendument déroulés en décembre.
Dans son édition du 27 mars 2013, Le Canard enchaîné affirme qu’une note blanche émanant du ministère de l’Intérieur aurait été remise au président de la République dès le mois de décembre, laquelle indiquait que la bande n’aurait « pas été trafiquée et que la voix est proche de celle du ministre du budget ». Le Point parle, le 3 avril, d’une « note blanche confirmant les accusations de Mediapart sur l’existence d’un compte en Suisse ». Le 4 avril, le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, est aussi interrogé par Libération sur la rumeur selon laquelle la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) aurait « authentifié en off la voix de Jérôme Cahuzac » : il dément de la manière la plus catégorique ces allégations, ainsi que celle, qui circulait aussi, selon laquelle la DCRI possédait dans ses fichiers des renseignements sur le compte étranger du ministre du budget. Il reconnaît en revanche avoir interrogé, mi-décembre, le directeur central du renseignement intérieur pour savoir si le nom du ministre délégué au budget apparaissait dans les notes ou les fichiers de la direction centrale.
La commission d’enquête a entendu Patrick Calvar, le directeur central du renseignement intérieur, sous le régime du secret, le 11 juin 2013 (89), afin qu’il présente les actions que la DCRI avait menées à la suite des révélations de Mediapart. Ces propos sont cohérents avec ceux qu’a tenus le ministre devant la commission quelques semaines plus tard (90).
Comme Manuel Valls l’a expliqué, c’est sur une initiative conjointe de celui qui était alors son directeur de cabinet, Jean Daubigny, et du directeur central du renseignement intérieur, que la DCRI a vérifié si elle disposait d’éléments archivés relatifs soit à la banque UBS, soit à M. Cahuzac. Le ministre a indiqué que la recherche avait donné un résultat négatif concernant ce dernier, mais que, en revanche, la DCRI avait retrouvé, dans sa documentation, la copie d’une dénonciation relative à la possible existence d’un système de fraude fiscale au sein de la banque UBS. Cette dénonciation remontait à avril 2009 et avait été complétée en février 2011. Considérant que la Commission bancaire, devenue depuis l’Autorité de contrôle prudentiel, était compétente en la matière (91), la DCRI n’avait pas engagé d’enquête de renseignement. Le 19 décembre 2012, la DCRI a transmis au ministère de l’Intérieur une note d’une page résumant ces éléments avec, en annexe, les dénonciations de 2009 et de 2011.
À la demande du Rapporteur, cette note (92), puis ses annexes, qui étaient, comme l’ensemble des écrits émanant de la DCRI, classées confidentiel défense, ont été déclassifiées par le ministre de l’Intérieur et transmis à la commission d’enquête. Si des noms sont effectivement cités dans les annexes, celui de Jérôme Cahuzac n’y figure pas. Manuel Valls a en outre précisé à la commission qu’il avait transmis cette note au président de la République et au Premier ministre, au moment où il l’avait reçue.
Pour ce qui est d’une expertise de l’enregistrement par la DCRI, M. Calvar a assuré, lors de son audition par la commission d’enquête, que sa direction centrale n’avait jamais eu l’enregistrement et que, quand bien même elle l’aurait eu, elle n’avait pas les moyens techniques nécessaires à un tel travail. En outre, avant qu’il ne soit remis à la police judiciaire par Michel Gonelle le 16 janvier (voir infra), aucun service de l’État ne disposait de cet enregistrement, sauf à imaginer qu’il lui aurait été fourni par Mediapart, ce qui est peu vraisemblable.
Le responsable de la DCRI, celui de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) (93), et le ministre ont d’ailleurs indiqué qu’il n’était de la compétence ni de l’un ni de l’autre de ces services de mener des enquêtes sur les élus ou les personnalités politiques (94). Aucune demande en ce sens n’a été formulée par le ministère de l’Intérieur dans le contexte de l’affaire qui nous occupe, conformément à ce qu’affirmait un communiqué de presse de ce ministère publié le 3 avril 2013.
Les membres de la commission d’enquête ayant connaissance de la tenue, par les services des préfectures, de « dossiers départementaux » comportant des éléments relatifs à la vie politique départementale et à ses principaux acteurs, le Rapporteur a demandé au préfet du Lot-et-Garonne de bien vouloir lui adresser une copie de toutes les notes détenues par les services de la préfecture du Lot-et-Garonne ou ceux de la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot depuis 1997, relatives à la situation de M. Jérôme Cahuzac, et en particulier du contenu de ce qui est communément désigné par l’expression « dossier départemental ».
Le préfet lui a transmis copie des six différents « dossiers départementaux » élaborés sur la période – datés respectivement de 1999, 2000, 2002, 2004, 2011 et 2013 –, ainsi que la notice biographique de Jérôme Cahuzac. L’ancien ministre délégué au budget ne fait pas l’objet d’un intérêt particulier et il n’y figure aucune information sensible à son sujet.
Selon les témoignages recueillis par la commission d’enquête, le ministère de l’Intérieur ne disposait d’aucune information relative à la détention, par Jérôme Cahuzac, d’un compte non déclaré à l’étranger avant les révélations de Mediapart, et n’a pas cherché à en obtenir par des voies souterraines, ni avant, ni
– le Rapporteur y reviendra infra – après l’ouverture de l’enquête préliminaire dont les investigations ont été confiées à la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF). Il n’a pas non plus fait enquêter sur l’informateur de Mediapart.
D. LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE INVITE MICHEL GONELLE À SAISIR LA JUSTICE DES INFORMATIONS QU’IL DÉTIENDRAIT
S’il ne fait désormais guère de doute que le ministre de l’Intérieur n’a pas été en mesure de transmettre au président de la République des éléments confirmant l’existence du compte caché du ministre délégué au budget, faute d’avoir connaissance de tels éléments, il convient de vérifier de quelles autres sources d’informations le chef de l’État aurait pu disposer.
Lors de son audition (95), Edwy Plenel a laissé entendre que les plus hautes autorités de l’État avaient connaissance du sérieux des accusations parues dans le journal qu’il préside. S’il indique ne pas avoir discuté directement de l’affaire avec le président de la République (96), il affirme d’abord : « À l’époque de nos révélations, des collaborateurs, des entourages du pouvoir exécutif, du Premier ministre, du président de la République, s’approchent de Mediapart et nous interrogent sur le sérieux et la solidité de notre enquête. Nous leur détaillons notre travail et leur disons combien nous sommes sûrs de notre fait. » Il précise ensuite avoir rencontré quelques-uns des collaborateurs du président de la République le 18 décembre et pense que Jean-Pierre Mignard (97), l’avocat de Mediapart et un proche du Président Hollande, lui en a certainement parlé : « Je n’ai pas demandé à Jean-Pierre Mignard la teneur de ses conversations [avec le président de la République], mais il ne fait pour moi aucun doute qu’il a été contacté par le Président, ou son entourage, pour savoir si l’enquête de Mediapart était sérieuse et solide. Et je connais la réponse de Jean-Pierre Mignard. De tradition, Mediapart ne publie rien de sensible sans consulter son avocat, qui est un grand défenseur de la liberté de la presse. »
S’il est vrai que des informations sur l’enquête de Mediapart, provenant de personnes proches du journal en ligne, sont arrivées jusqu’à la présidence de la République et que de tels éléments pouvaient être de nature à faire naître ou à entretenir le doute dans l’esprit du Président, ils ne constituaient nullement la preuve de la culpabilité du ministre délégué au budget.
Le Président devait-il, sur ces seuls fondements, demander la démission de Jérôme Cahuzac, alors que celui-ci avait protesté solennellement de son innocence devant lui, et devant le Premier ministre et la Représentation nationale ? Ce n’est pas l’avis du Rapporteur même si certains membres de la commission d’enquête semblent le penser. En tout état de cause, une telle décision, prise en décembre 2012, serait allée bien au-delà de la « jurisprudence Bérégovoy-Balladur », volontiers évoquée en la matière, qui n’a jamais conduit qu’à la démission de ministres à la veille ou au lendemain de leur mise en examen par la Justice, mais pas à la suite d’une simple mise en cause dans la presse, aussi sérieusement étayée fût-elle.
De même, le fait que Michel Gonelle a contacté la présidence de la République à propos de l’enregistrement qu’il détenait a nourri la thèse selon laquelle l’Élysée savait dès le mois de décembre que Jérôme Cahuzac détenait un compte non déclaré à l’étranger, mais n’en avait pas tiré les conséquences. Cette information pouvait certes étayer les accusations de Mediapart, mais le contexte et les modalités de sa transmission étaient si inhabituels, que sa crédibilité était incertaine et que la présidence ne pouvait en faire aucun usage.
1. La conversation téléphonique entre Michel Gonelle et le directeur de cabinet adjoint du président de la République
Le 15 décembre, Michel Gonelle a appelé Alain Zabulon, qui était alors le directeur de cabinet adjoint du président de la République. Comme ils l’ont expliqué à la commission d’enquête, les deux hommes se connaissaient depuis que M. Zabulon avait été, entre juillet 1997 et février 2000, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, ville dont M. Gonelle était le maire. Ayant œuvré ensemble à la création de la communauté de communes du Villeneuvois, ils avaient alors des relations cordiales. Ils n’avaient néanmoins eu pratiquement aucun contact depuis cette période lorsque Michel Gonelle a décidé d’appeler le directeur de cabinet adjoint du Président Hollande.
Au cours de leurs auditions respectives, Michel Gonelle et Alain Zabulon (98) ont chacun raconté cet échange téléphonique.
LES DEUX RÉCITS DE LA CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE
MM. G NELLE ET ZABULON (1)
« M. Michel Gonelle. Lorsque j’étais sous le feu du déchaînement médiatique, pendant les dix jours qui ont suivi le 4 décembre, je ne savais pas trop quoi faire. Certains me sommaient de dire que j’étais le détenteur de l’enregistrement – ce qui était vrai –, d’autres, que j’étais la source de Mediapart – ce qui était faux. Un samedi matin, le 15 décembre, alors que je me trouvais à Paris – à l’hôtel de Harlay, place Dauphine – dans le cadre de mes fonctions de vice-président de la Caisse de retraite des avocats, j’ai décidé d’appeler Alain Zabulon en vue de le rencontrer, non à son bureau, mais plutôt en ville, afin de lui remettre un pli manuscrit que j’avais préparé à l’intention de M. le président de la République, dans lequel j’expliquais ce qui s’était passé en donnant tous les détails que j’étais seul à connaître.
Après avoir connu quelques difficultés pour trouver le numéro, j’ai donc appelé le standard de l’Élysée et demandé à parler à Alain Zabulon. On m’a répondu que l’on ne pouvait pas me le passer. J’ai dit que c’était plutôt urgent, et la standardiste a noté mon numéro de téléphone portable en m’indiquant que le directeur de cabinet adjoint me rappellerait dès qu’il trouverait un moment disponible.
Alain Zabulon m’a rappelé dans les trois minutes qui ont suivi. Après quelques échanges de politesses – nous n’avions plus eu de contact depuis le moment où il avait quitté Villeneuve-sur-Lot -, je lui ai dit précisément ceci : « Vous vous doutez de la raison de mon appel », et il m’a répondu : « Je m’en doute, en effet. ». Je lui ai donc à nouveau expliqué ma démarche, mon souci de transmettre au président de la République le plus de détails possible sur ce qui s’était passé, et ma conviction absolue que la voix entendue sur cet enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac, dès lors qu’il faisait suite, avec le même numéro d’appel, à un autre appel officiel, celui-là, de Jérôme Cahuzac.
[M. Gonelle raconte comment la conversation téléphonique a été enregistrée sur son répondeur] Pour moi, il n’y avait donc aucun doute – j’insiste sur ce point – sur l’origine de cet appel, d’autant que j’ai reconnu les intonations de la voix de Jérôme Cahuzac, dont je connais tous les registres, qu’il s’agisse d’une conversation en privé ou d’un discours public. C’est en effet une personne que je côtoyais presque tous les jours. Je le répète, je n’avais aucun doute, et c’est ce que je souhaitais faire savoir au président de la République.
[…] J’ai donc voulu dire au président François Hollande ce qui s’était passé, comment cela s’était passé, et pourquoi j’étais sûr de l’origine du message. C’est ce que j’ai expliqué à Alain Zabulon.
Ce dernier m’a dit qu’il s’agissait d’une affaire extrêmement sensible et qu’il devait en référer, ce que je comprenais parfaitement. Il n’avait pas le temps de me rencontrer, étant l’organisateur de l’arbre de Noël de l’Élysée, qui avait lieu dans l’après-midi. Il m’a donc assuré qu’il me rappellerait, et je n’avais pas de raisons de penser qu’il ne tiendrait pas parole. Au sujet de la lettre, il m’a demandé de ne rien faire dans l’immédiat et d’attendre qu’il me rappelle. C’est pourquoi je ne l’ai pas postée. » […]
« M. Alain Zabulon. En ce samedi 15 décembre au matin, je suis à mon domicile lorsque le standard de la présidence de la République m’appelle pour me dire que Michel Gonelle, ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, qui affirme bien me connaître, souhaite me parler. Je le fais aussitôt rappeler et prends la communication. Dans un premier temps, il me demande s’il nous est possible de nous rencontrer en ville. Je n’en avais malheureusement pas le temps, étant attendu à la Présidence où nous devions porter la main aux derniers préparatifs de l’arbre de Noël, événement important dans la vie de l’Élysée. Je pouvais en revanche prendre dix minutes ou un quart d’heure pour converser avec M. Gonelle et l’écouter, puisqu’il avait pris la peine de m’appeler. Il me dit alors que depuis les révélations de Mediapart sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, une dizaine de jours plus tôt, il fait l’objet d’une forte pression des journalistes qui l’accusent de détenir le fameux enregistrement par lequel « le scandale » arrive. Il me dit vivre très mal cette pression, n’être pour rien dans cette affaire et souhaiter se confier à moi. Et là suit un récit, une sorte de confession, où il m’indique que fin 2000, à la suite d’une conversation téléphonique avec Jérôme Cahuzac, dans laquelle celui-ci l’informe de la venue du ministre de l’intérieur pour l’inauguration du nouveau commissariat de Villeneuve-sur-Lot, le portable de Jérôme Cahuzac aurait malencontreusement rappelé le sien. C’est ainsi que s’est retrouvé sur sa messagerie un échange entre une personne présumée être Jérôme Cahuzac – c’est du moins ce qu’il affirme – et un tiers au sujet de ce fameux compte en Suisse.
« Bien, et alors ? », lui dis-je. Il m’indique qu’il a conservé cet enregistrement, l’a fait graver sur CD en deux exemplaires et l’a conservé pendant de nombreuses années dans un tiroir. Il me dit qu’il n’avait absolument pas l’intention de s’en servir contre Jérôme Cahuzac, avec qui ses relations sont désormais apaisées, qu’il est retiré de la vie politique et que ce ne sont pas là ses méthodes, ni des méthodes en général. Il a conservé ces deux exemplaires de l’enregistrement et fin 2006-début 2007, les a remis au magistrat Jean-Louis Bruguière, candidat à la députation en 2007 contre Jérôme Cahuzac. « Mais je pense qu’il ne s’en est pas servi », ajoute-t-il aussitôt. J’écoute tout cela avec beaucoup d’attention. Il m’annonce aussi qu’il disposerait d’une lettre qu’il pourrait remettre si nécessaire au président de la République et me demande en quelque sorte quels sont mes conseils, mes instructions.
À la fois je mesure l’importance des informations qui sont portées à ma connaissance et je m’interroge – j’y reviendrai dans quelques instants. Je ne prends pas de position sur-le-champ, ne lui dis pas « Faites ceci ou ne faites pas cela », mais : « Monsieur Gonelle, je vais d’abord référer en interne, dans ma maison, des informations que vous venez de porter à ma connaissance. Convenons que nous nous rappelons la semaine prochaine. »
(1) Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013, et audition de M. Alain Zabulon, le 18 juin 2013.
Les deux récits sont très proches l’un de l’autre : Michel Gonelle explique les conditions dans lesquelles il a eu connaissance de l’échange entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires et l’a fait sauvegarder ; il affirme que la voix enregistrée est bien celle du ministre délégué et propose d’adresser un courrier au président de la République ; M. Zabulon reconnaît la sensibilité de cette information et indique qu’il va en référer ; ils conviennent de se rappeler.
Le seul point sur lequel ces deux versions divergent est celui du conseil donné par Alain Zabulon à Michel Gonelle sur ce qu’il convenait de faire dans l’immédiat : M. Gonelle affirme que M. Zabulon lui a demandé « de ne rien faire dans l’immédiat » « au sujet de la lettre » qu’il voulait faire parvenir au Président et d’attendre son appel, alors qu’Alain Zabulon indique avoir simplement convenu avec lui d’un nouvel échange téléphonique. En tout cas, Michel Gonelle n’a semble-t-il effectivement rien fait, dans les jours qui ont suivi, de la lettre qu’il avait préparée pour le Président Hollande, et qu’il a remise à la commission d’enquête (99) : il ne l’a ni postée, ni déposée à l’Élysée, ni confiée à quiconque.
2. Les suites de cette conversation
L’important est de savoir quel usage a été fait de l’information relative à l’origine de l’enregistrement fourni par Michel Gonelle à Alain Zabulon. Ce dernier l’a expliqué très clairement à la commission d’enquête.
a. Le compte rendu au président de la République et la réaction de celui-ci
Devant la commission d’enquête, Alain Zabulon a présenté dans les termes suivants le compte rendu qu’il en a fait et la réaction du président de la République :
« Je me rends à la Présidence, comme il était prévu. Je vais voir le secrétaire général de la Présidence, Pierre-René Lemas, à qui je commence à expliquer ce que je viens d’entendre. Il me propose que nous allions voir ensemble le président de la République. " Cela devrait évidemment l’intéresser au plus haut point ", dit-il. Dans le bureau du Président, je rends alors compte en détail au Président et au secrétaire général de l’entretien que je viens d’avoir avec Michel Gonelle. Le Président est très attentif à ce que j’expose et me demande ce que j’en pense. À la fin de l’entretien, il me dit, et ce sans aucune hésitation : " Si vous avez un nouveau contact avec M. Gonelle, s’il doit vous rappeler ou si vous devez le rappeler, dites-lui que ces informations doivent être sans délai portées à la connaissance de la Justice. " Il ne me donne aucune autre instruction que celle-ci, ajoutant : " Si ce fameux courrier arrive, nous le transmettrons à la Justice, car c’est une affaire qui relève de la Justice. " »
Le directeur de cabinet adjoint ajoute ensuite qu’il a le jour-même, après en avoir averti le Président, passé un coup de fil à Jérôme Cahuzac pour lui faire part de cet entretien avec Michel Gonelle. Il dit avoir agi par loyauté et parce qu’il se doutait que la presse allait en révéler l’existence. Dans son souvenir, la réaction du ministre a été la suivante : « Il m’a écouté, notre conversation a été brève – il était, je crois, en rendez-vous ou occupé. Il m’a remercié de ces informations. Il n’avait pas l’air plus surpris que cela. » Jérôme Cahuzac l’a présentée ainsi : « J’ai pris acte de ce qu’il m’indiquait, et nous avons convenu que la démarche était curieuse et que si M. Gonelle avait des choses à dire, il devait saisir en priorité la Justice. » (100)
Le contexte dans lequel la conversation téléphonique a eu lieu mérite d’être rappelé : d’abord, le 5 décembre, Jérôme Cahuzac nie devant les plus hautes autorités de l’État puis devant l’Assemblée nationale les faits dont Mediapart l’accuse ; la plupart des observateurs sont alors très prudents et s’interrogent sur la réalité de ces accusations ; enfin, comme Alain Zabulon l’a rappelé, le récit que lui fait Michel Gonelle est en totale contradiction avec les propos que celui-ci a tenus quelques jours plus tôt et qui ont été publiés le 10 décembre dans Sud Ouest (101), selon lesquels il n’aurait « absolument rien à voir avec cette affaire ». Dans ces conditions, les interrogations du directeur de cabinet adjoint sur la crédibilité du récit qui vient de lui être fait peuvent apparaître légitimes.
Alain Zabulon y voit même une instrumentalisation de la présidence de la République : « J’en suis arrivé à la conclusion que l’on a peut-être instrumentalisé la présidence de la République en y produisant un témoignage qui, à l’évidence, aurait dû être porté à la connaissance de la Justice, et depuis longtemps, puisque, je le rappelle, l’enregistrement date de 2000. On l’a utilisée pour révéler le rôle de Michel Gonelle en cette affaire. L’attitude constante de la Présidence a été de considérer qu’il appartenait à la Justice, et à elle seule, de démêler les fils de la vérité. » (102) Il insiste : « Il [Michel Gonelle] n’ignore pas que ce n’est pas la voie normale, qu’il devrait soit parler publiquement, comme Mediapart l’incite à le faire, soit saisir la justice, comme il aurait d’ailleurs dû le faire depuis des années. J’ai l’impression qu’en m’appelant, il cherche une solution, une porte de sortie – qui se trouve juste être celle de la présidence de la République. Porte de sortie quelque peu singulière ! »
Face à cette démarche pour le moins surprenante et dont les motivations profondes demeurent obscures, l’instruction donnée par le président de la République est claire : adresser les éventuels éléments de preuve à la Justice. Si la lettre rédigée par Michel Gonelle à l’attention du Président était arrivée à l’Élysée, elle aurait pu être adressée par la Présidence au procureur de Paris, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Sans cette lettre, la Présidence ne pouvait rien faire, contrairement au détenteur de l’enregistrement. Le Rapporteur partage l’analyse d’Alain Zabulon : « En ce qui concerne la saisine de la justice, il ne faut pas inverser les rôles. C’est celui qui détient les informations qui doit les porter à la connaissance de la Justice, pas celui auquel elles sont rapportées. Lorsque Michel Gonelle me fait connaître le 15 décembre quel a été son rôle en cette affaire, je ne dispose pas de preuves tangibles, seulement d’un témoignage oral, lequel diffère d’ailleurs de ce qu’il a déclaré cinq jours auparavant. Si quelqu’un devait saisir la justice, c’était l’intéressé, pas la Présidence. » Le Rapporteur estime que le contenu de la conversation entre Michel Gonelle et le directeur de cabinet adjoint du président de la République ne suffisait pas à fonder le recours par ce dernier à l’article 40 du code de procédure pénale (103), contrairement à ce que pensent certains membres de la commission d’enquête.
b. L’absence de second échange téléphonique
À l’issue de son entrevue avec le président de la République, Alain Zabulon a donc instruction de renvoyer Michel Gonelle vers la Justice dans le cas où il serait amené à lui parler à nouveau. Cette occasion ne se présentera finalement pas, en dépit de plusieurs tentatives.
Michel Gonelle a, devant la commission d’enquête, reproché à Alain Zabulon de ne pas l’avoir recontacté, contrairement à ce dont ils avaient convenu ; M. Zabulon indique qu’ils se sont « ratés ». Le témoignage de M. Gonelle laisse penser que c’est l’Élysée qui a pris l’initiative de le rappeler, le mardi ou le mercredi suivant (soit le 18 ou le 19 décembre) ; selon M. Zabulon, M. Gonelle aurait essayé de le recontacter dans la matinée du lundi 17 décembre et son secrétariat aurait échoué à le joindre le même jour (104) – le cahier d’appels de son poste, dont il a présenté une copie à la commission d’enquête, en atteste. Après ces tentatives non abouties, les deux hommes n’ont plus essayé de se contacter.
Michel Gonelle a dit qu’il « attendait encore » que la secrétaire d’Alain Zabulon le rappelle, comme elle s’était engagée à le faire. M. Zabulon a reconnu que sa secrétaire avait peut-être dit qu’elle rappellerait M. Gonelle et qu’elle ne l’a pas fait. Il explique d’abord que cela n’empêchait nullement Michel Gonelle de faire une nouvelle tentative, « dès lors qu’il était demandeur et souhaitait des indications de [s]a part », et, surtout qu’il n’a pas souhaité le recontacter dans la mesure où il s’interrogeait sur la crédibilité de son témoignage et où la presse venait de rendre compte des propos qu’ils avaient échangés le 15 décembre.
En effet, comme Alain Zabulon le prévoyait le jour même, la presse n’a pas tardé à révéler le contenu de la conversation téléphonique entre les deux hommes.
c. La révélation, par la presse, de la conversation du 15 décembre
C’est le 21 décembre que plusieurs journaux, parmi lesquels Le Monde, Libération et Mediapart, confirment que le détenteur de l’enregistrement publié par le journal en ligne est bien Michel Gonelle et qu’il en a informé l’Élysée le 15 décembre. Les articles se réfèrent à la réponse donnée par les services de la Présidence, interrogés par l’AFP : « Nous confirmons que Michel Gonelle a bien eu, il y a quelques jours, un contact avec le directeur de cabinet adjoint de François Hollande, Alain Zabulon. » Estimant qu’il « n’y avait aucun élément tangible », la présidence a indiqué inviter l’intéressé « à remettre tous les éléments à la Justice ».
Lors de son audition, M. Zabulon a précisé les circonstances dans lesquelles le chargé de communication de l’Élysée a été amené à donner oralement ces informations à un journaliste de l’AFP : « Lorsqu’en milieu de semaine, la teneur de mon entretien avec Michel Gonelle commence de se répandre dans la presse, le chargé de communication de la Présidence me demande ce qu’il en est de cet entretien dont on parle. Je lui dis que je le confirme. Et nous convenons de répondre la stricte vérité : premièrement, cet entretien, au cours duquel Michel Gonelle a communiqué certaines informations, a bien eu lieu ; deuxièmement, ces informations ont vocation à être transmises à la Justice. » (105)
La presse rapporte que les mêmes services de la Présidence auraient ajouté : « S’il [Michel Gonelle] dispose réellement d’éléments, qu’il s’adresse à la Justice puisqu’il y a une procédure judiciaire. » Cette affirmation a retenu l’attention de Mediapart (106), qui n’a pas manqué d’observer qu’il n’existait alors aucune procédure judiciaire sur le fond de l’affaire. Dans la mesure où la presse rapporte le contenu d’un échange téléphonique entre le service de communication de l’Élysée et l’AFP et donc en l’absence d’un véritable communiqué écrit émanant de la présidence, il n’est pas possible de savoir si les propos du chargé de communication ont été transcrits avec exactitude.
Ce qui est certain, c’est que Michel Gonelle pouvait parfaitement saisir la Justice même en l’absence de procédure judiciaire en cours, ce qu’il fera d’ailleurs finalement début janvier 2013 (voir infra).
Pour le directeur adjoint de cabinet du président de la République, il ne fait guère de doute que c’est Michel Gonelle qui a parlé à la presse de leur conversation téléphonique, après s’être entretenu, le 14 décembre, avec Edwy Plenel et lui avoir dit qu’il n’allait pas dévoiler qu’il était le détenteur de l’enregistrement mais, « s’y prendre autrement ». Michel Gonelle accuse pour sa part très directement l’Élysée d’avoir révélé cet échange téléphonique. (107)
Il n’est pas du rôle du Rapporteur de trancher cette question. Mais il ne voit pas très bien pourquoi la Présidence aurait d’elle-même souhaité rendre publique la conversation téléphonique entre MM. Zabulon et Gonelle. En revanche, cette manière détournée de révéler son rôle comme détenteur initial de l’enregistrement avait l’avantage de faire retomber la pression que subissait Michel Gonelle – il parle lui-même de « déchaînement médiatique » sous le feu duquel il se trouvait – depuis le 4 décembre.
On peut en revanche reconnaître que, conformément à ce que lui recommandait de faire la présidence de la République, M. Gonelle a finalement décidé de s’adresser à la Justice. Mais, cette fois encore, il s’y prend d’une manière curieuse : au lieu de saisir le procureur de la République, il s’adresse au juge Daïeff.
d. La lettre adressée par Michel Gonelle au juge Daïeff
Lors de sa première audition par la commission d’enquête, Michel Gonelle a expliqué comment il s’était finalement tourné vers la Justice :
« Lorsque Le Monde a publié ce communiqué de la présidence de la République dans lequel on m’enjoignait, si je disposais d’éléments, de les transmettre à la Justice, j’ai pris contact avec le juge Daïeff, chargé de l’enquête sur la banque UBS et l’évasion fiscale. L’ayant joint au téléphone, je lui ai demandé s’il voulait recueillir mon témoignage. On était à la veille de Noël. Il m’a répondu qu’il devait consulter le juge avec lequel il travaillait sur cette affaire, et qu’il reviendrait vers moi en janvier. Et c’est ce qu’il a fait, le 3 janvier. Il m’a dit : " mon collègue est d’accord pour vous entendre, mais vous devez nous envoyer une lettre pour proposer votre témoignage ". Je la lui ai envoyée le jour même. Mais le lendemain, le procureur ouvrait l’enquête préliminaire, et il n’a donc plus été question de témoigner. »
M. Gonelle a remis à la commission d’enquête copie de la lettre qu’il avait envoyée, le 3 janvier 2013, à ce magistrat, en charge du dossier dit « UBS France » dans lequel cette banque est poursuivie pour des faits d’évasion et de fraude fiscales. Il fait état, dans ce courrier, de deux conversations téléphoniques, en date du 20 décembre 2012 et du 3 janvier 2013. L’article du Monde auquel il fait allusion – dans lequel la Présidence l’invite à transmettre à la Justice les éléments dont il disposerait – a été publié le 21 décembre 2012 à 13 heures 10, comme Michel Gonelle l’indique lui-même au cours son audition par la commission : sauf à ce qu’il se soit trompé dans le courrier au juge Daïeff, il est donc difficile de croire que cette démarche, antérieure d’une journée, soit une réaction au contenu de la réponse apportée par l’Élysée à l’AFP.
Elle est en revanche inspirée par la même logique que celle défendue par Mediapart, qui a plaidé pour que le juge Daïeff puisse être supplétivement saisi de l’enquête sur les avoirs que Jérôme Cahuzac détiendrait illégalement à l’étranger. C’est ce que suggère Edwy Plenel au procureur de Paris dans le courrier du 27 décembre 2012, sur lequel le Rapporteur va revenir. Lors de son audition, le directeur de Mediapart a indiqué : « Le bâtonnier Gonelle aura d’ailleurs la même idée et, en l’absence de réaction de l’Élysée, entrera en contact avec le juge Daïeff. Ce processus sera interrompu par l’ouverture de l’enquête préliminaire. » Il n’est pas impossible que cette démarche ait été suggérée à l’avocat par les journalistes de Mediapart, qui ont indiqué avoir conseillé à Michel Gonelle d’assumer les faits et de reconnaître publiquement qu’il détenait cet enregistrement (108).
Dans sa lettre au juge, M. Gonelle confirme sa « disponibilité pour être entendu en qualité de témoin dans l’information […] » relative à l’affaire « UBS France » et propose de se rendre au cabinet du juge à l’occasion de l’un de ses prochains séjours à Paris ou d’être entendu dans le cadre d’une commission rogatoire.
L’ouverture de l’enquête préliminaire par le parquet de Paris, décidée par le procureur de Paris le 4 janvier 2013 et rendue publique le 8 janvier, met effectivement un terme à cette démarche, et ouvre une nouvelle phase de l’« affaire Cahuzac ».
*
Au cours des semaines qui ont suivi les révélations de Mediapart et les dénégations solennelles de Jérôme Cahuzac, l’État ainsi s’est efforcé d’agir avec sérénité, dans le respect de la légalité.
III. À COMPTER DE L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE, LA JUSTICE N’EST NI ENTRAVÉE, NI RETARDÉE
Alors que l’année 2012 s’achève, Mediapart réaffirme régulièrement ses accusations contre Jérôme Cahuzac et critique l’absence de réaction des pouvoirs publics. À quelques exceptions près, la classe politique accorde sa confiance au ministre délégué chargé du budget. La situation est très délicate et semble bloquée. C’est l’ouverture d’une enquête préliminaire, début 2013, qui va permettre de commencer à faire la lumière sur le fond de l’affaire.
A. L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE EST MENÉE AVEC EFFICACITÉ
Si la commission d’enquête ne peut inclure dans ses travaux les faits qui sont l’objet de poursuites devant la Justice, elle peut en revanche porter une appréciation sur la manière dont l’institution judiciaire a fonctionné pendant la période relevant de son champ de compétence.
Elle doit saluer l’excellent travail effectué par le parquet de Paris et le fait que son autonomie a été parfaitement respectée. Cela ne veut pas dire que le Gouvernement se soit désintéressé d’une affaire aussi délicate : il s’est tenu informé, dans le respect des règles, de l’avancée de l’enquête, mais il n’est pas intervenu dans son déroulement et aucune instruction n’a été donnée au parquet.
1. L’ouverture de l’enquête, déclenchée par le courrier d’Edwy Plenel
Au mois de décembre, les seules plaintes, liées à cette affaire, dont la Justice a été saisie sont les deux plaintes en diffamation déposées les 6 et 18 décembre par Jérôme Cahuzac, contre Mediapart. Un courrier adressé par le président de ce journal au procureur de la République de Paris, fin décembre, va permettre à ce dernier de franchir une nouvelle étape, qui s’avérera décisive pour la révélation de la vérité.
a. L’initiative prise par Edwy Plenel
Le 27 décembre 2012, Edwy Plenel écrit à François Molins, le procureur de la République de Paris. Après avoir présenté le contexte, il en vient au cœur de sa démarche :
« En l’état, aucune procédure judiciaire ne vise donc à satisfaire la vérité. D’où la question que nous nous posons dans un souci de manifestation de cette vérité, et sur laquelle nous aimerions connaître votre réponse : pourquoi ne pas confier à un juge indépendant les investigations qu’appellent les informations qui, aujourd’hui, font l’objet du débat public sur ce qui est devenu " l’affaire Cahuzac " ? Pourquoi ne pas permettre au juge d’instruction déjà en charge des procédures en cours visant la banque UBS pour des faits d’évasion et de fraude fiscales, M. Guillaume Daïeff, d’enquêter sur ces faits nouveaux, sur la base d’un supplétif que vous lui accorderiez et qui étendrait son champ d’investigation ?
« Les faits révélés par Mediapart sont à l’évidence contigus à ceux sur lesquels enquête ce juge : il s’agit de la même banque suisse, UBS, et d’évasion fiscale concernant un résident et ressortissant français. De surcroît, le fait que le ministère du Budget, en tant qu’autorité de tutelle de l’administration fiscale, soit d’ores et déjà partie civile dans ce dossier judiciaire légitime d’autant plus que le juge concerné clarifie lui-même ce qui pourrait s’avérer une situation flagrante de conflits d’intérêts de l’actuel titulaire de ce ministère. » (109)
Devant la commission d’enquête, Edwy Plenel a reconnu le caractère exceptionnel de cette démarche, qu’il définit comme une « interpellation au procureur de la République de Paris ». C’est la première fois qu’il recourt à ce procédé, en accord avec l’avocat du journal. Il le justifie en ces termes : « Je l’ai fait pour défendre nos droits, à cause du détournement de procédure. Autre point très important : à l’époque, nous entendions dire jusqu’au sommet de l’État que la justice était saisie, ce que relayaient les médias. Or, dans les faits, elle n’était saisie de rien. » (110) (Le « détournement de procédure » auquel il est fait allusion est l’erreur dans le fondement de la première plainte en diffamation de Jérôme Cahuzac (111) ; la mention d’une prétendue saisine de la Justice renvoie aux informations parues dans la presse sur la conversation téléphonique entre Michel Gonelle et Alain Zabulon (112).) Le but de cette interpellation est donc de mettre un terme à ce qu’Edwy Plenel considère comme « l’immobilisme de la Justice ».
Il appelle non seulement le procureur de Paris à l’action, mais il lui conseille aussi la voie à suivre, celle d’une extension du domaine de compétence des juges d’instruction saisis du dossier d’UBS France pour y intégrer la situation du ministre délégué au budget. Le directeur de Mediapart a expliqué à la commission pourquoi cette solution avait sa préférence : « comme enquêteurs, nous savons que le parquet n’est pas indépendant et que les enquêtes préliminaires sont parfois à la diligence du pouvoir exécutif – ce qui, j’en donne acte au pouvoir exécutif actuel, ne sera pas le cas. Selon nous, il eût cependant été plus logique de donner un réquisitoire supplétif au juge Guillaume Daïeff. »
Si le procureur de Paris a choisi une autre solution, il est incontestable que le courrier d’Edwy Plenel, qui constituait une dénonciation (113), lui a fourni l’occasion d’agir.
b. La décision du parquet de Paris
Au cours de leurs auditions respectives, le procureur général de Paris, François Falletti, et le procureur de Paris, se sont défendus de l’accusation d’« immobilisme » ou d’« inertie » de la Justice formulée par Edwy Plenel. Ce dernier a notamment déclaré devant la commission d’enquête : « Si Mediapart, ou tout autre média, avait révélé un trafic de drogue en banlieue ou des agressions dans le métro, le procureur se serait saisi de ces informations et aurait lancé des vérifications. En l’occurrence rien ne s’est passé : au mois de décembre, la Justice est seulement saisie d’une plainte qui est un détournement de procédure et qui porte atteinte à nos droits de journalistes ! »
François Falletti a insisté sur le fait que « au mois de décembre, nous sommes encore en présence de ce qui peut être qualifié de campagne de presse. Or nous n’ouvrons pas une enquête sur chaque campagne de presse » (114). François Molins a fait part de l’embarras dans lequel se trouvait le parquet de Paris : « Nous nous trouvions donc face à un vrai problème : les allégations de Mediapart donnaient lieu à un débat public, mais le fond de ce débat ne pourrait être judiciairement évoqué avant le premier trimestre 2014, compte tenu des délais d’audiencement actuels devant la dix-septième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Le parquet était bien sûr conscient de cette situation : j’avais commencé à me demander s’il fallait agir, et comment. En restant inactifs, nous prenions le risque de faire apparaître le parquet de Paris comme faisant obstacle à la manifestation de la vérité ; or la Justice est plutôt là pour aboutir au résultat inverse… » (115)
L’« interpellation » d’Edwy Plenel a mis un terme à cet embarras, en induisant ce que François Falletti considère comme un « changement de perspective » : « L’élément nouveau est la dénonciation faite explicitement au procureur de la République. Je note d’ailleurs que si cette dénonciation s’était révélée mensongère, elle serait tombée sous le coup de la loi. C’est à ce moment que la décision est prise d’aller de l’avant et d’ouvrir l’enquête. » En effet, comme il le souligne, « dans ce contexte, où une démarche est effectuée auprès d’une autorité judiciaire investie du pouvoir de poursuivre et d’engager une enquête, le procureur a une responsabilité particulière et il est nécessaire de préserver les éléments de preuve. »
François Molins reconnaît lui aussi le rôle du courrier d’Edwy Plenel : « Je n’ai pas pris ma décision à cause du courrier de M. Plenel, mais il est évident que celui-ci a contribué à accélérer les choses : dès lors que j’étais destinataire d’une lettre, il fallait que je prenne une position. » Il a expliqué à la commission d’enquête comment la réflexion du parquet de Paris avait alors cheminé.
Il a d’abord exclu l’hypothèse, suggérée par Edwy Plenel, de l’ouverture d’une information chez le juge d’instruction saisi de l’affaire contre UBS car « les faits allégués n’entraient pas, contrairement à ce qu’écrivait Mediapart, dans la saisine des juges d’instruction, puisque celle-ci était limitée aux personnes qui détenaient des comptes ouverts chez UBS à la suite d’opérations de démarchage illicite, élément que l’on ne retrouvait absolument pas dans ce dossier. »
Le procureur général a ajouté d’autres arguments : « C’est une affaire de démarchage qui remonte à des années bien antérieures. En outre, il apparaît assez rapidement que la question ne concerne peut-être pas que l’UBS. Trop d’affaires arrivant à la cour d’appel de Paris ont vingt ans d’âge. Éviter les dossiers tentaculaires, sérier les questions, avancer pas à pas, c’est aussi une des responsabilités du parquet. Lorsque les dossiers comportent des éléments de nature très différente, les délais s’allongent et l’on s’expose à une multiplication d’incidents de procédure sur des points particuliers qui retardent l’ensemble de l’affaire. Le parquet se doit de centraliser ce qui doit l’être, certes. Mais, en l’espèce, ce n’était pas du tout indispensable. »
François Molins a ensuite abordé la question du fondement sur lequel diligenter une enquête préliminaire : « Sur la fraude fiscale, le parquet ne pouvait rien faire puisqu’une plainte du ministre du budget, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, est nécessaire. En revanche, depuis un arrêt de février 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’en matière de blanchiment de fraude fiscale, la plainte préalable du ministre du budget, comme le filtre de la commission des infractions fiscales, n’ont pas à s’appliquer, et que le parquet a toujours la possibilité d’enquêter et de poursuivre le délit de blanchiment, infraction générale distincte et autonome, qui n’est donc pas soumise aux règles de procédure du livre des procédures fiscales. »
Le parquet de Paris a enfin estimé qu’une action de sa part pouvait se fonder sur l’enregistrement rendu public par Mediapart : « soit c’était bien la voix de Jérôme Cahuzac que l’on entendait, et l’enregistrement devenait alors un indice très important de la commission d’une infraction et de la réalité des allégations de Mediapart ; soit au contraire l’enregistrement était un montage, et c’était une manipulation qui aurait pu valoir à ses auteurs des poursuites pour dénonciation calomnieuse ou pour dénonciation d’un délit imaginaire. Si l’enquête ne débouchait sur rien, la procédure serait classée sans suite ; si à l’inverse les allégations de Mediapart s’avéraient fondées, il resterait à décider des suites procédurales les plus appropriées : poursuite d’enquête préliminaire ou ouverture d’une information judiciaire. » On voit donc que, dès fin décembre 2012, le procureur de Paris pressent le rôle décisif que l’enregistrement – et son éventuelle authentification – va jouer dans la suite de la procédure.
Le 31 décembre 2012, François Molins fait part au procureur général de sa décision d’ouvrir d’une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale » et de la confier à la division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF) ; le 4 janvier 2013, il signe un rapport en ce sens ; le 8 janvier, dans l’après-midi, après que Mediapart a publié l’information, un communiqué de presse du parquet de Paris annonce officiellement la nouvelle.
Le choix, par le parquet de Paris, de confier l’enquête à la DNIFF, et plus précisément à la brigade de répression de la délinquance financière, apparaît parfaitement logique, au regard de la sensibilité et de la nature de l’affaire. Comme Mme Christine Dufau, chef de la DNIFF, l’a expliqué à la commission d’enquête (116), cette division est spécialisée dans la délinquance financière et prend en charge des enquêtes sensibles et complexes. Un groupe de la brigade de répression de la délinquance financière a été chargé de l’enquête dans la mesure où cette brigade est compétente pour la lutte contre les infractions au droit des affaires (principalement abus de biens sociaux, problèmes de financement de parti politique, faux, délits boursiers) et où la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ne peut être saisie que sur plainte pour fraude fiscale déposée par la direction générale des finances publiques devant les magistrats du parquet, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
À partir de la décision rendue publique le 8 janvier, l’enquête préliminaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec diligence, et sans intervention extérieure.
2. Une enquête conduite avec diligence
L’enquête préliminaire va permettre d’obtenir suffisamment d’éléments pour justifier l’ouverture d’une information judiciaire le 19 mars, soit à l’issue de moins de deux mois et demi de travail des enquêteurs.
a. Les principales étapes de l’enquête préliminaire
Les différentes auditions auxquelles la commission d’enquête a procédé ainsi que les documents qui lui ont été transmis permettent de reconstituer la chronologie des principales étapes de l’enquête préliminaire, que le procureur général Falletti résume en ces termes : « Du 16 janvier, date de la première audition – celle de M. Michel Gonelle –, à la mi-mars, une dizaine d’auditions sont effectuées, ainsi que des actes de saisie et quelques perquisitions. » (117)
La première audition se déroule donc le 16 janvier. Elle permet aux enquêteurs d’obtenir de Michel Gonelle une copie, sur minidisque, de l’enregistrement rendu public par Mediapart. Selon Éric Arella, le sous-directeur de la police technique et scientifique (SDPTS), sa sous-direction, située à Écully, a reçu deux réquisitions, la première concernant principalement la retranscription du contenu du minidisque, la seconde, datant du 25 janvier 2013, visant à procéder à une comparaison de voix. Le minidisque lui a été remis dans les jours qui ont suivi l’obtention du support sonore par la DNIFF. François Falletti a indiqué que « après des vérifications préalables sur sa qualité et sur les possibilités de l’exploiter, il est porté à la connaissance du parquet que l’approfondissement de l’expertise prendra un certain temps : quinze jours en utilisant certaines méthodes, un mois pour d’autres. Début février, donc, nous savons que l’enquête se prolongera jusqu’à début mars, puisqu’elle dépend en grande partie des résultats de cette expertise effectuée par le laboratoire de police d’Écully. »
Les auditions des principaux protagonistes de l’affaire se déroulent entre la toute fin janvier et fin février.
Le 1er février, la DNIFF reçoit de la DGFiP la réponse apportée par les autorités suisses à la demande d’entraide administrative qui leur a été adressée le 24 janvier, réponse selon laquelle Jérôme Cahuzac ne détenait pas de compte à la banque UBS de Genève entre 2006 et 2012. Elle la transmet immédiatement au procureur de Paris. Comme il l’a indiqué à la commission d’enquête, celui-ci n’avait pas été informé de l’envoi de cette demande mais, au cours de l’après-midi du 31 janvier, avait été interrogé par la presse à son sujet (118). Il a reconnu que, après la publication dans la presse d’un article affirmant que les Suisses « blanchissaient Jérôme Cahuzac », il avait « eu quelques doutes », mais qu’il avait décidé de poursuivre la « démarche sérieuse » entreprise par le parquet, qui reposait sur l’élément fondamental que constituait l’enregistrement. Le Rapporteur reviendra infra sur cet épisode. Il est clair que la réponse négative des autorités suisses à la demande de l’administrative fiscale française n’a eu aucune incidence sur la procédure judiciaire, qui s’est poursuivie normalement.
Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête permettent au parquet de Paris de formuler, le 12 mars 2013, une demande d’entraide pénale auprès des autorités judiciaires de Genève, en application de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 dans le cadre du Conseil de l’Europe et d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter cette convention, signé à Berne le 28 octobre 1996. Interrogé par le Rapporteur sur la possibilité d’avoir eu recours à cet instrument plus tôt, le procureur Molins a apporté la réponse suivante :
« Cela aurait été possible, mais ç’aurait été une mauvaise chose : pour qu’une demande d’entraide internationale soit efficace, particulièrement dans le domaine fiscal ou parafiscal, il faut qu’elle soit solidement étayée pour pouvoir avancer rapidement. Nous sommes sur des terrains très sensibles, où la coopération pénale internationale n’a pas toujours la même efficacité qu’en matière de droit commun : nous avons donc pour habitude d’éviter d’irriter nos partenaires étrangers par des demandes incomplètes, qui entraînent des demandes complémentaires. Au début de l’enquête, en concertation avec la DNIFF, nous avons d’abord imaginé faire cette démarche rapidement, puis nous avons changé d’avis et préféré attendre.
« Le 12 mars, nous disposions d’éléments suffisants pour que notre demande soit complète : nous pouvions alors tirer les conséquences des auditions et viser, non seulement des délits comme la fraude fiscale ou le blanchiment de fraude fiscale, mais aussi le délit de blanchiment lié à des revenus versés par des entreprises pharmaceutiques. Cela permettait notamment de sortir du champ strictement fiscal et d’éviter des difficultés. J’ai alors appelé mon collègue de Genève. »
François Molins a insisté sur le contenu de cette demande d’une « dizaine de pages », très différente de la demande d’entraide administrative, « qui tient sur une page » : « la demande ne se borne pas à demander si M. Cahuzac est titulaire d’un compte ou possède des avoirs ; elle est beaucoup plus large. Elle pose des questions mais vise aussi à obtenir des documents, et elle demande surtout à l’autorité judiciaire suisse d’effectuer des actes – auditions, perquisitions… »
Il a précisé que, une fois l’information judiciaire ouverte, le juge d’instruction, qui n’avait pas jugé utile de formuler une nouvelle demande, avait obtenu la réponse des autorités judiciaires de Genève au bout de quelques jours.
La dernière étape importante de l’enquête préliminaire est la communication au parquet de Paris, le 18 mars 2013, des conclusions des expertises de l’enregistrement.
b. Le rôle déterminant des expertises de l’enregistrement
Il a été décidé de charger le laboratoire d’analyse et de traitement de signal (LATS) du service central de l’informatique et des traces technologiques (SCITT), qui est l’un des services centraux de la SDPTS, de mettre en œuvre deux méthodes de comparaison de voix. Comme l’a indiqué son sous-directeur (119), le service a d’emblée estimé le temps nécessaire à la finalisation des deux analyses à un mois et demi. Par convention, chaque expert procède à son analyse de son côté, chacun selon sa méthode, un bilan des deux expertises étant dressé dans un rapport final.
M. Arella a ajouté que, au cours de l’expertise, les deux experts avaient été gênés par la difficulté de trouver un support de voix de M. Cahuzac proche de la date supposée d’origine du document. Il a donc été nécessaire de procéder, le 21 février, à une réquisition auprès de l’Institut national de l’audiovisuel pour obtenir un document vocal daté des environs de 2000. Un enregistrement de 2002 d’une émission de LCI a été trouvé, dont la SDPTS a reçu un échantillon le 4 mars.
Finalement, le rapport sur les conclusions des deux experts a été transmis par la DNIFF au parquet de Paris le 18 mars, ce qui est considéré comme « rapide » par Éric Arella et comme « raisonnable » par François Molins. Les experts y estiment que « sur une échelle de - 2 à + 4, la comparaison se situait à + 2 et que, sans une certitude absolue, le résultat de l’analyse renforçait de manière très significative l’hypothèque que Jérôme Cahuzac était le locuteur inconnu de l’enregistrement litigieux » (120).
Avant la transmission de ce rapport à la Justice, Edwy Plenel affirmait, le 6 mars, dans le cadre d’une interview diffusée sur Yahoo, que les résultats de l’expertise étaient arrivés et confirmaient qu’il s’agissait de la voix de Jérôme Cahuzac.
Le jour même de la réception du rapport des experts, le procureur Molins adresse au procureur général un rapport présentant sa décision d’ouvrir une information judiciaire. Il a expliqué à la commission que, compte tenu de ces éléments, ses collaborateurs et lui avaient estimé que l’information judiciaire constituait désormais un cadre plus approprié pour continuer les investigations, puisqu’ils disposaient d’un indice tangible de la commission d’une infraction et que, par ailleurs, il était nécessaire de formuler, à court terme, une autre demande d’entraide pénale internationale, cette fois auprès de Singapour.
Un communiqué de presse détaillé est rédigé, contenant les éléments objectifs recueillis au cours de l’enquête, et annonçant l’ouverture d’une information judiciaire « contre personne non dénommée des chefs de blanchiment de fraude fiscale, perception par un membre d’une profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, blanchiment et recel de ce délit ». Il est diffusé le 19 mars en milieu d’après-midi, juste après la signature du réquisitoire introductif.
Quelques heures plus tard, le président de la République annonce qu’il a « mis fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac à sa demande ».
3. Une enquête menée en toute autonomie par le parquet de Paris
La présentation à la commission d’enquête du déroulement de l’enquête préliminaire par le procureur général de Paris, le procureur de Paris et les policiers responsables a montré que les différents acteurs de la procédure avaient collaboré dans de très bonnes conditions et avaient, chacun à sa place, fait leur travail avec sérieux et diligence. Aucun d’entre eux n’a signalé d’interférence extérieure dans cette enquête. Chacun a en revanche, comme il se doit, rendu compte à sa hiérarchie. Que celle-ci ait été particulièrement attentive à cette affaire n’a rien d’étonnant, vu son caractère sensible.
a. La remontée d’informations au sein de la hiérarchie judiciaire
Comme le procureur général de Paris, le procureur de Paris et la directrice des affaires criminelles et des grâces l’ont expliqué à la commission d’enquête au cours de leurs auditions respectives, leurs relations institutionnelles et la circulation des informations entre eux sont régies par des règles précises (121), qui ont été respectées dans cette affaire.
Les relations entre le procureur et le procureur général relèvent du dialogue institutionnel au sein du ministère public, prévu par le code de procédure pénale. Comme le procureur François Molins l’a rappelé, « le procureur de la République a des pouvoirs de direction de l’action publique ; parmi ceux du procureur général figure celui de donner des instructions positives, de poursuite, aux procureurs » (122). Pour ce faire, le procureur général doit disposer d’un certain nombre d’informations, que lui transmet le procureur, sous des formes diverses (comptes rendus téléphoniques, courriels, rapports écrits). C’est ce qui a été fait en l’espèce. Le procureur de Paris a décrit ses relations avec le procureur général dans les termes suivants : « Dans la conduite de ce dossier, le parquet de Paris n’a eu de relations qu’avec le parquet général ; il n’y a eu, à aucun moment, aucune instruction d’aucune sorte. J’ai toujours pris mes décisions après analyse et réflexion, avec mes collègues de la section financière, et toujours après avoir respecté les règles du dialogue institutionnel que j’évoquais, et qui doivent exister entre un procureur et son procureur général. J’ai donc toujours indiqué à mon supérieur hiérarchique quelles étaient mes intentions, afin qu’il soit toujours en mesure de faire valoir son point de vue, et éventuellement de donner des instructions positives, ce qui n’est pas arrivé. » Il a précisé que le parquet général n’avait jamais été informé à l’avance des actes importants de l’enquête préliminaire mais avait reçu ensuite des résumés de la teneur des auditions ou des éléments recueillis lors des perquisitions. Le tableau de synthèse des échanges d’informations transmis par le procureur général à la commission d’enquête (123) montre néanmoins que le parquet général a été avisé de la tenue de certaines auditions avant qu’elles aient été réalisées.
Pour les affaires que l’on peut qualifier de sensibles, certaines de ces informations sont ensuite transmises par le procureur général à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Cette remontée d’informations doit respecter le protocole régissant la circulation de l’information entre la direction des affaires criminelles et des grâces et les parquets généraux, du 27 novembre 2006, mis à jour le 12 septembre 2008, et actuellement en cours d’actualisation pour tenir compte de la suppression des instructions individuelles du garde des Sceaux dans la conduite de l’action publique (124). En effet, la prohibition des instructions du garde des Sceaux dans les affaires individuelles, qui vient de trouver une traduction législative (125), ayant été établie par circulaire du 19 septembre 2012, était déjà applicable à l’affaire qui nous intéresse. François Molins a indiqué à plusieurs reprises au cours de son audition qu’il n’avait, en l’espèce, reçu aucune instruction, ni du procureur général – qui reste autorisé à donner des instructions positives, en application de l’article 36 du code de procédure pénale (126) –, ni de la garde des Sceaux.
Comme l’a expliqué le procureur général de Paris, le devoir d’information, notamment de la chancellerie, demeure pour les affaires présentant un caractère particulièrement significatif ou se trouvant amplement médiatisées : « L’essentiel de cette remontée d’informations se fait aujourd’hui par voie de courriel. Les échanges téléphoniques ne sont plus motivés, en général, que par la complexité de telle ou telle question ou par l’urgence. Dans le cas qui nous intéresse, l’information remonte de la division des affaires économiques et financières du parquet vers le parquet général, puis, à la chancellerie, vers la direction des affaires criminelles et des grâces, en l’espèce vers son bureau des affaires économiques et financières. Cette information se fait de manière régulière et par la voie hiérarchique. » (127) Il a précisé que les éléments d’information qui concernent les actes ou auditions présentant un intérêt particulier font l’objet de comptes rendus ou de rapports, mais que les pièces de procédure ne sont pas adressées au ministère, et que, si les remontées se font souvent à l’initiative du parquet et du parquet général, il peut y avoir dans certains cas – et ce fut le cas en l’espèce – des demandes de précision ou d’éclaircissement de la part de la DACG, par exemple pour lever des équivoques après la diffusion d’informations par voie de presse à propos du dossier.
Lors de son audition, Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces, a apporté les précisions suivantes : « Dans ses rapports de transmission, le procureur général doit indiquer à ma direction s’il partage l’analyse juridique et les orientations du procureur de la République ; il peut également solliciter notre analyse juridique. […] Si tous les comptes rendus que nous recevons des parquets généraux ne sont pas systématiquement adressés au cabinet du garde des Sceaux, ma direction informe naturellement ce dernier des développements des dossiers sensibles. C’est le conseiller pénal qui représente notre interlocuteur privilégié, mais dans cette affaire, nous avons également adressé les comptes rendus au conseiller diplomatique, comme nous le faisons toujours en cas de développements à l’international. Enfin, vu l’importance du dossier, nous avons également inclus parmi les destinataires le directeur et le directeur adjoint de cabinet, conformément aux règles de fonctionnement fixées par le cabinet de la ministre. » (128)
Tous les acteurs de cette remontée d’informations ont indiqué que les règles avaient été strictement respectées dans cette affaire. Mme Le Quéau a reconnu avoir contacté directement le procureur de Paris, une fois, le 18 mars 2013, c’est-à-dire la veille de l’ouverture de l’information judiciaire, pour avoir des précisions sur les conclusions des experts : « Ce jour-là, la plupart des journaux affirmaient que la voix entendue sur l’enregistrement pouvait être identifiée avec certitude comme celle de Jérôme Cahuzac. Or, nous avions cru comprendre, au terme de l’expertise, que l’on ne pouvait pas conclure à une certitude absolue. À la demande du cabinet, et pour obtenir plus de précisions, j’ai donc téléphoné personnellement au procureur de la République de Paris. Mais je ne le fais que très rarement, en cas d’urgence, à cause de la taille et de l’organisation du parquet général. Cette façon de procéder est tout à fait exceptionnelle, et les magistrats placés sous ma responsabilité ne le font pas. »
b. Le suivi de l’affaire par le ministère de la Justice
Si le rôle de chacun et les règles ont été respectés, les membres de la commission d’enquête ont néanmoins été surpris par la densité des échanges entre le procureur général de Paris et la direction des affaires criminelles et des grâces, et surtout par le nombre des questions posées au parquet général à la demande du cabinet de la garde des Sceaux.
Le procureur général de Paris et la directrice des affaires criminelles et des grâces ont en effet, chacun, transmis à la commission d’enquête, à sa demande, un récapitulatif des courriers électroniques en lien avec cette affaire reçus et adressés dans le cadre du processus de remontée de l’information. Les deux tableaux récapitulatifs (129) ne suivent pas exactement les mêmes principes (l’un recense les messages reçus et les messages envoyés, l’autre seulement les messages reçus, en précisant s’ils ont été adressés par le parquet général spontanément, ou à la demande de la DACG, le cas échéant sur sollicitation du cabinet de la ministre) et ne couvrent pas la même période (le tableau du parquet général couvre la période entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, celui de la DACG celle du 7 décembre 2012 au 2 avril 2013) mais les informations qu’ils contiennent sont tout à fait cohérentes entre elles.
Si on s’en tient au décompte effectué par Mme Le Quéau, « entre le 6 décembre 2012 et le 2 avril 2013, le parquet général de Paris a adressé 56 comptes rendus à (s)a direction, laquelle en a transmis 54 au cabinet. Les deux comptes rendus restants – datés du 7 décembre 2012 – concernaient, d’une part, l’analyse juridique, par le parquet de Paris, de la plainte en diffamation qu’[elle lui avait] transmise la veille par le biais du parquet général, et d’autre part, l’information selon laquelle la brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) avait été saisie de l’enquête du chef de diffamation.
« Sur les 54 comptes rendus adressés au cabinet, six portaient sur le volet diffamation – trois résultant d’une demande adressée par [s]a direction au parquet général de Paris et trois relevant de l’initiative de ce dernier – et 48, sur le volet blanchiment – douze répondant à une demande de [s]a direction et 36 relevant de l’initiative du parquet général. »
La directrice précise ensuite la part des demandes émanant de son service qui ont été sollicitées par le cabinet de la garde des Sceaux : dans le volet diffamation, c’est le cas des trois demandes d’actualisation, adressées par le cabinet le 27 décembre 2012, le 1er mars et le 15 mars 2013 ; dans le volet blanchiment, sur les douze demandes adressées par la DACG au parquet général, dix l’ont été à la demande du cabinet. En effet, « le 8 janvier 2013, le cabinet a souhaité se voir confirmer l’ouverture d’une enquête préliminaire et savoir quand la DNIFF serait saisie du " soit transmis " aux fins d’enquête. Le même jour, il a également demandé de se faire transmettre le communiqué de presse du parquet de Paris annonçant l’ouverture de l’enquête préliminaire. Le 10 janvier, le cabinet a voulu obtenir des renseignements sur les auditions et investigations envisagées. Le 1er février, il a demandé [à la DACG] de préciser les termes contenus dans la demande adressée par l’administration fiscale française aux autorités fiscales helvétiques. Le 6 février, il [lui] a adressé une demande d’actualisation et de précisions sur les éléments transmis par les autorités suisses. Le 7 mars, le cabinet a souhaité savoir quand serait achevée l’expertise de l’enregistrement téléphonique confiée au laboratoire d’Écully. Le 15 mars, il a demandé des renseignements sur le coût de l’enquête, les moyens engagés et l’existence de liens éventuels avec l’affaire UBS, et le 19 mars, sur l’existence d’un communiqué de presse du parquet de Paris annonçant l’ouverture d’une information judiciaire. Le 2 avril, il a adressé [à la DACG] une demande d’actualisation, souhaitant se voir confirmer que Jérôme Cahuzac était ce jour-là convoqué par le juge d’instruction pour la mise en examen. Enfin, le même jour, le cabinet [lui] a demandé de préciser si une mesure de contrôle judiciaire avait été prise à l’encontre de Jérôme Cahuzac à l’issue de sa mise en examen. »
Certains médias, au premier rang desquels Le Canard enchaîné puis Mediapart (130), se sont étonnés du grand nombre de messages transmis au cabinet de la ministre sur cette affaire, calculant même que cela représentait un compte rendu toutes les 48 heures. Il faut préciser qu’il est fréquent que, notamment lors des grandes étapes de la procédure judiciaire, plusieurs messages soient échangés le même jour : le 8 janvier, la DACG reçoit et transmet au cabinet quatre messages électroniques du parquet général, dont deux à la demande du cabinet de la ministre ; elle en reçoit et fait suivre trois le 6 février et autant le lendemain, à la suite du nombre important d’auditions effectuées à ces dates ; six messages électroniques, qui sont adressés immédiatement au conseiller pénal de la ministre, lui parviennent entre le 19 et le 20 mars et cinq au cours de la seule journée du 2 avril.
En outre, comme le procureur général de Paris l’a indiqué, certaines des demandes de précision ou d’éclaircissement visaient à lever des équivoques après la diffusion d’informations par voie de presse à propos du dossier.
Au cours de son audition (131), Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a elle-même justifié la densité de ces échanges par la « médiatisation intense de l’affaire », le souci de s’assurer que les informations circulant dans la presse sur la procédure judiciaire correspondaient à la réalité, et la nécessité d’être en mesure, le cas échéant, de répondre à la Représentation nationale ou au Premier ministre.
Elle a indiqué précisément l’usage qu’elle avait fait de ces éléments : « Je n’ai transmis aucune information au président de la République, ni aux autres ministres, y compris l’intéressé. À quatre reprises – trois fois par texto, une fois par le biais d’un appel –, j’ai brièvement informé le Premier ministre des grandes avancées de la procédure, notamment de l’ouverture effective de l’enquête préliminaire, que la presse avait annoncée deux jours plus tôt. Le procureur et le procureur général vous ont d’ailleurs confirmé qu’ils n’avaient pas reçu d’instruction individuelle dans ce dossier, et qu’ils ne m’ont pas transmis les informations à l’avance. »
Pour ce qui est du volume des informations transmises par les parquets généraux à la chancellerie, la ministre a estimé que, d’une manière générale, il « se justifiait à une époque où le garde des Sceaux pouvait donner au parquet des instructions individuelles ; avec leur disparition, et pour soulager les parquets, les parquets généraux et l’administration, de la masse d’informations à collecter ou à traiter, nous estimons possible de le diviser au moins par deux ». Cette préconisation n’est pas contradictoire avec la nécessité, dans une affaire aussi sensible médiatiquement et politiquement, de disposer rapidement d’informations précises.
Au final, le Rapporteur partage le jugement porté par la ministre sur le fonctionnement de la Justice dans cette affaire : « La justice a-t-elle été diligente ? Incontestablement, oui. Le seul mérite de la chancellerie, c’est d’avoir suivi les engagements du président de la République, de ne pas avoir entravé la justice. Nous avons même facilité son travail puisque nous sommes vigilants à affecter les effectifs et les moyens en fonction des procédures sensibles. Mais l’essentiel du mérite revient au ministère public. »
Les travaux de la commission d’enquête ont effectivement permis d’établir que la remontée d’informations au sein de la hiérarchie judiciaire puis de la chancellerie s’était effectuée sans aucun dysfonctionnement, chacun remplissant son rôle dans le respect des règles, et sans que la moindre instruction ne soit donnée au parquet de Paris qui a pris ses décisions de manière autonome. Edwy Plenel a lui-même, au cours de son audition (132), « donné acte au pouvoir exécutif actuel » du fait qu’il n’est pas intervenu dans le déroulement de l’enquête préliminaire.
c. Le rôle du ministère de l’Intérieur
Le parquet de Paris a conduit l’enquête préliminaire, dont il avait décidé l’ouverture, sans instruction ni intervention de la garde des Sceaux. La commission d’enquête a souhaité savoir quelles avaient été les relations entre les policiers en charge de cette enquête et leur ministre de tutelle.
Christine Dufau, la chef de la DNIFF, a expliqué qu’elle rendait compte à son supérieur hiérarchique direct, Bernard Petit, le sous-directeur de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière, « non pas des détails, mais des actes principaux ». Elle suppose que lui-même rend compte au directeur central de la police judiciaire (133). Il est logique de penser que celui-ci transmet certaines informations au directeur général de la police nationale, qui en fait part, en tant que de besoin, au cabinet du ministre de l’Intérieur, ce que le ministre lui-même a confirmé.
Lors de son audition, M. Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, a clairement posé les limites de son rôle : « […] en aucun cas je ne peux m’immiscer dans les enquêtes judiciaires, conduites par les officiers de police judiciaire sous le contrôle des magistrats. J’ai appliqué cette règle de conduite pour toutes les affaires judiciaires, a fortiori pour celle-ci : elle concernait un membre du Gouvernement, un de mes collègues. » (134)
Il a affirmé avec force qu’aucune enquête parallèle n’avait été lancée au sein de son ministère : « Dans notre pays, c’est heureux, les procureurs font appel à la police judiciaire, et les policiers, dont l’engagement est tout à fait remarquable, respectent le travail des procureurs. Un lien de confiance s’établit entre eux. Si j’avais demandé à la DCRI ou à un autre service de mener une enquête parallèle et que le procureur de la République de Paris – qui traite d’autres affaires, notamment de terrorisme, avec la DCRI – l’avait appris, alors on casse tout lien de confiance. C’est d’ailleurs arrivé, dans le passé. Il convient au contraire que le parquet et la police judiciaire travaillent ensemble dans les meilleures conditions de confiance. Il en va des intérêts fondamentaux du pays et de nos concitoyens. »
Mais cela ne signifie pas qu’aucune information relative à une affaire en cours ne soit jamais transmise au ministre. Comme Manuel Valls l’a expliqué : « il arrive que des informations synthétiques sur les enquêtes en cours me soient transmises – comme à tous mes prédécesseurs – par la voie hiérarchique, c’est-à-dire par le directeur général de la police nationale. C’est notamment le cas lorsqu’elles concernent des affaires intéressant le maintien de l’ordre public ou ayant un fort retentissement médiatique. Il convient en effet de s’assurer que tous les moyens nécessaires sont bien consacrés à ces enquêtes. »
Le ministre a donc reconnu que de telles informations – qui n’étaient accompagnées d’aucune pièce de procédure – lui avaient effectivement été communiquées par le directeur général de la police nationale, par l’intermédiaire de son cabinet. Selon la liste qu’il a fournie à la commission d’enquête, à la demande de celle-ci (135), douze messages lui sont parvenus, entre le 9 janvier et le 20 mars 2013, l’informant après coup – le lendemain, en général – des principales phases de la procédure judiciaire et des actes, tels que les auditions, les plus importants.
Mais Manuel Valls a assuré n’avoir ni demandé, ni fait demander des précisions, et n’avoir pas été immédiatement tenu au courant des résultats des expertises de l’enregistrement – le message sur ce sujet date du 20 mars, seulement, selon la liste précitée. Il a également réfuté les propos tenus devant la commission d’enquête par Pierre Condamin-Gerbier selon lesquels il aurait été informé du contenu de l’audition de ce dernier, effectuée à Annecy le 20 février
– audition par la brigade financière, dans le cadre de « l’affaire Cahuzac », au cours de laquelle il dit avoir expliqué qui était Hervé Dreyfus et avec quel établissement il entretenait des liens familiaux et d’affaires, sans toutefois se prononcer sur la certitude d’une faute de M. Cahuzac. (136)
Il a également affirmé que ni Jérôme Cahuzac, ni son entourage n’avaient eu de contact avec lui ou ses collaborateurs à propos de l’enquête.
Il reconnaît en revanche en avoir discuté avec le président de la République et avec le Premier ministre, mais sans jamais être en mesure de leur donner des preuves de la culpabilité du ministre délégué chargé du budget : « Comme je l’ai indiqué, j’ai toujours dit au président de la République et au Premier ministre que je ne disposais d’aucun élément attestant la véracité des informations publiées par Mediapart relatives à la détention d’un compte en Suisse par Jérôme Cahuzac. J’ai rappelé la chronologie des faits dans mon propos liminaire. Si j’avais des éléments à communiquer au président de la République et au Premier ministre, je les leur transmettais. »
Le ministre de l’Intérieur est donc resté strictement dans son rôle. Destinataire d’informations synthétiques provenant de la direction générale de la police nationale qui ne constituaient pas des preuves contre Jérôme Cahuzac – aucune véritable preuve n’ayant été recueillie au cours de l’enquête préliminaire –, il en a fait un usage limité, ne les communiquant qu’aux deux plus hautes autorités de l’État.
B. LA DEMANDE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À LA SUISSE ÉTAIT-ELLE OPPORTUNE ET BIEN FORMULÉE ?
Particulièrement délicate à manier, l’assistance administrative a suscité, dans l’affaire Cahuzac, de nombreux commentaires. Mediapart a avancé que l’administration fiscale n’avait pas su poser les bonnes questions. Pierre Condamin-Gerbier a, pour sa part, dispensé à la commission d’enquête des conseils sur la manière de rédiger les demandes d’assistance administrative et d’interpréter les réponses alors que ces documents, couverts par le secret, ne sont jamais rendus publics.
1. L’échange de renseignements : une procédure à la disposition de l’administration fiscale
Le recours à la demande d’assistance administrative était le seul instrument dont disposait l’administration fiscale pour confirmer ou infirmer les révélations de Mediapart.
En effet, comme Pierre Moscovici l’a expliqué à la commission d’enquête, Jérôme Cahuzac n’était pas parvenu à obtenir de l’UBS de Genève une « attestation négative » confirmant qu’il n’y détenait aucun compte non déclaré. Jérôme Cahuzac a indiqué à la commission (137) que son avocat suisse avait formulé une telle demande, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse, ce qui n’était guère surprenant puisque la banque avait déjà indiqué à ses conseils, qui lui avaient posé une question de principe, qu’elle ne faisait jamais d’attestation de ce type. Certains estiment que cette absence de réponse résultait de la manière dont la question avait été formulée et qu’il aurait fallu la poser différemment.
Quoi qu’il en soit, en l’absence d’un tel document émanant de la banque, le recours à l’échange de renseignements offrait une chance d’en savoir plus. Il était juridiquement possible, et ce même en parallèle de la procédure judiciaire.
a. Depuis 2009, l’évolution positive du cadre de l’échange de renseignements bancaires avec l’administration fiscale suisse
L’avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 a constitué un premier pas vers l’échange d’informations entre les administrations fiscales française et suisse, en dépit de divergences d’interprétation persistantes.
Comme l’a rappelé l’ancienne directrice de la législation fiscale, Marie-Christine Lepetit (138), le cadre juridique de l’échange de renseignements à des fins fiscales avec la Suisse était, jusqu’en 2009, très restrictif. Les autorités helvétiques défendaient une conception étroite en la matière et l’échange était limité aux renseignements nécessaires à l’application des conventions signées par la Confédération, notamment la convention de 1966 qui concerne l’élimination des doubles impositions mais pas la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. C’est pourquoi l’avenant de 2009 est apparu – à juste titre – comme un important progrès.
Lors de son audition, Pierre Condamin-Gerbier (139) a expliqué que la perspective de l’entrée en vigueur de cet avenant, qui visait à permettre l’échange de renseignements postérieurs au 1er janvier 2010, avait conduit de nombreux détenteurs de comptes en Suisse non déclarés à déplacer leurs avoirs fin 2009. Les travaux de la commission d’enquête ayant montré que Jérôme Cahuzac s’était rendu à Genève, non pas début 2010, comme la presse l’a indiqué, mais au cours de l’automne 2009, il est possible que ce déplacement soit lié à ce changement dans le droit franco-suisse ; un lien avec sa future accession à la présidence de la commission des finances est en revanche exclu, puisque celle-ci est consécutive au remplacement de Philippe Séguin par Didier Migaud comme Premier président de la Cour des comptes, ce qui n’était alors pas prévisible.
Cet avenant a inséré dans la convention un nouvel article 28 conforme au modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). La liste des informations que la France doit transmettre à la Suisse lorsqu’elle lui adresse une demande d’échange de renseignements est renvoyée au point XI du protocole additionnel à cette convention.
ARTICLE 28 DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU 3 DÉCEMBRE 1969, DU 22 JUILLET 1997 ET DU 27 AOÛT 2009
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
POINT XI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE 1966 MODIFIÉE
Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’État requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’État requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les États contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
La partie suisse a ensuite fait savoir qu’elle considérait qu’en cas de demande de renseignements sur des avoirs bancaires l’identification de la banque devait être suffisamment précise, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de la pêche aux renseignements et de proportionnalité contenus dans l’article 28. Le Conseil fédéral helvétique a donc exigé des clarifications supplémentaires et, dans l’attente de leur obtention, a suspendu la procédure législative de ratification, faisant obstacle à l’entrée en vigueur du dispositif.
Afin de débloquer cette situation, et de permettre la ratification puis l’entrée en vigueur de l’avenant, la France a consenti un échange de lettres interprétatives en date du 11 février 2010. Ces lettres ont restreint la portée de l’avenant du 27 août 2009 en précisant à quelles conditions l’administration fiscale française pouvait interroger les autorités suisses sans connaître le nom de la banque concernée. Elles rappelaient par ailleurs que la « pêche aux renseignements » était proscrite, conformément aux commentaires du modèle de convention de l’OCDE. Ce sont ces concessions qui ont permis d’obtenir la ratification de l’avenant par la Suisse ; de ce strict point de vue, l’échange de lettres interprétatives constituait un progrès.
Devant la commission (140), l’ancienne directrice de la législation fiscale a confirmé que le but de cet échange était bien « d’obtenir l’application des standards de l’OCDE, la levée du secret bancaire et la possibilité pour la France d’interroger les autorités suisses sans que le nom de la banque concernée soit mentionné [ ;] c’est d’ailleurs cette interprétation qui [a] guid[é] la rédaction du communiqué de presse du 12 février 2010 et qui [a été] communiquée à la représentation nationale au cours du processus de ratification de l’avenant [ ;] c’[était] la lecture de la France au moment où elle signe ce document ».
Toutefois, après l’entrée en vigueur de l’avenant, les autorités suisses se sont appuyées sur les précisions contenues dans l’échange de lettres pour juger certaines demandes de renseignements françaises « non pertinentes », rendant délicate l’utilisation de cet instrument.
L’écart entre l’optimisme affiché par l’administration fiscale en 2010 et les possibilités réelles d’interroger la Suisse qui ont découlé de cet échange de lettres a pu susciter des malentendus : s’appuyant sur une lecture littérale, le président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale avait ainsi estimé dans un courrier au ministre de l’économie et des finances que, dans le cas d’espèce, « l’avenant à la convention fiscale permettait d’élargir la recherche à tous les établissements bancaires » (141). Ce faisant, notre collègue Gilles Carrez ne remettait, d’ailleurs, nullement en cause l’opportunité de la décision de recourir à l’assistance administrative.
C’est d’ailleurs pour mettre fin à cette application restrictive, comme l’a rappelé le ministre de l’économie lors de son audition (142), qu’un nouveau protocole, annexé à l’avenant du 11 juillet 2013 à une autre convention franco-suisse en matière d’impôts sur les successions, doit prochainement entrer en vigueur.
L’AVENANT DU 11 JUILLET 2013 À LA CONVENTION FRANCO-SUISSE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS
1. La nouvelle convention fiscale sur les successions entre la France et la Suisse tient compte des attentes des deux États en matière fiscale
La France et la Suisse sont liées par une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions datant du 31 décembre 1953.
Nombre de dispositions de la fiscalité du patrimoine françaises adoptées postérieurement à la conclusion de cette convention étaient rendues inopérantes par les stipulations de cette dernière, sans pour autant que les biens échappant à l’impôt français soient taxés en Suisse. Initialement conçue pour éviter les doubles impositions, elle avait donc dans les faits pour conséquence de provoquer des doubles exonérations et des pertes de bases imposables au détriment des finances publiques françaises. Elle était par ailleurs éloignée des principes internationaux du modèle OCDE, qui a été développé postérieurement.
Compte tenu de la préférence des autorités suisses de voir conserver un système bilatéral d’élimination des doubles impositions avec la France, des échanges, débutés en mai 2011, ont conduit les deux gouvernements, à signer le 11 juillet 2013, une nouvelle convention qui, après ratification, se substituera à la convention de 1953.
Cette convention s’inscrit pleinement dans le cadre des recommandations du modèle de l’OCDE en matière de successions. Tout en garantissant l’élimination des éventuelles doubles impositions, elle permet, en effet, de traiter équitablement l’ensemble des successions, qu’elles interviennent dans un contexte national ou dans un contexte transfrontalier franco-suisse.
Elle maintient le principe international de répartition des droits d’imposer les successions entre l’État de résidence du défunt, et, pour certains biens, l’État de situation de ces derniers et autorise, sous certaines conditions, l’imposition des biens en France si l’héritier y a sa résidence. Le mécanisme d’élimination de la double imposition applicable dans ce cas prévoit, conformément aux recommandations du modèle de convention de l’OCDE, que la France, en tant qu’État de résidence de l’héritier imputera sur son propre impôt l’impôt collecté en Suisse.
2. Elle tient également compte des exigences internationales en matière d’échange de renseignements
L’article 14 du projet de nouvelle convention sur les successions relatif à l’échange de renseignements renvoie à l’article 28 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par l’avenant du 27 août 2009 et à son protocole.
De plus, le protocole additionnel annexé à ce projet de nouvelle convention sur les successions vient préciser les modalités de mise en œuvre de l’échange de renseignements. Il explicite les modalités de mise en œuvre de l’article 14 précité de la convention relative aux successions tout en comportant un alinéa qui précise que l’ensemble des clarifications ainsi apportées valent également pour l’application de l’article « échange de renseignements » de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de son protocole.
L’application de ces stipulations avait précédemment fait l’objet d’un échange de lettres du 11 février 2010, portant notamment sur les informations bancaires. Le nouveau protocole permet une adaptation aux standards de l’OCDE tels qu’ils ont été modifiés en juillet 2012, en indiquant notamment qu’un État peut formuler une demande de renseignements à son partenaire sans nécessairement indiquer le nom du contribuable dès lors qu’il vise un groupe de contribuables identifié (demandes groupées).
Par ailleurs, les précisions mentionnées dans l’échange de lettres du 11 février 2010 sur les conditions dans lesquelles un État est autorisé à formuler une demande de renseignements bancaires à son partenaire sans mention du nom de l’établissement de crédit concerné n’y figurent pas.
Ainsi que le précise la déclaration commune de M. Pierre Moscovici et de Mme Évelyne Widmer Schlumpf du 11 juillet 2013, ce projet de nouveau texte met ainsi fin aux conditions posées par l’échange de lettres du 11 février 2010 au regard de l’identification des détenteurs d’informations bancaires. Il rappelle enfin le principe selon lequel les stipulations de l’article relatif à l’échange de renseignements figurant dans la convention doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
Source : DGFiP.
b. Une démarche fiscale indépendante des procédures judiciaires, conformément au principe de spécialité
Lors de son audition devant la commission d’enquête (143), Edwy Plenel a affirmé que « dès lors qu’une enquête préliminaire [était] en cours, il ne [pouvait] pas y avoir de manœuvres secrètes d’une autre administration sur les faits qui font l’objet d’une enquête de police », renouvelant ainsi une critique déjà publiée sur le site de Mediapart.
Les travaux conduits par le Rapporteur prouvent que ce reproche n’est pas fondé.
Comme l’a rappelé (144) le chef du service du contrôle fiscal, Alexandre Gardette, il existe un principe de spécialité qui gouverne les conventions d’échange de renseignements entre les pays. En l’espèce, l’article 28 de la convention fiscale franco-suisse prévoit l’échange et l’utilisation d’informations dans un but fiscal, c’est-à-dire pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature. Il stipule que les informations obtenues doivent être tenues secrètes conformément à la législation interne de l’État qui les reçoit et prévoit ensuite qu’elles « ne sont communiquées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts […], par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle [fiscal] ».
En vertu du même principe, les conventions d’échange d’informations judiciaires entre la France et la Suisse (145) font obstacle à ce que les éléments obtenus dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire soient transmises à la DGFiP « en vue de fiscaliser le compte concerné », selon les termes de M. Gardette. Il faut donc « que les informations en provenance de Suisse […] soient communiquées [à la DGFiP] par l’administration fiscale [de l’État requis] pour pouvoir les faire valoir dans une procédure fiscale ».
Dans ces conditions, la demande d’assistance du 24 janvier 2013 formulée par l’administration fiscale française n’était pas incompatible avec l’enquête préliminaire qui venait de s’ouvrir, le 8 janvier 2013. Les deux procédures pouvaient être menées en parallèle, même si une aussi étroite concomitance est sans précédent comme l’a démontré l’audition de la directrice des affaires criminelles et des grâces (146) :
« M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en à la demande de coopération adressée par l’administration française alors qu’une enquête préliminaire était déjà ouverte. Vous n’avez pas connaissance d’un précédent comparable ?
« Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il ne m’en vient aucun à la mémoire.
« M. Alain Claeys, rapporteur. Jugez-vous la procédure anormale ?
« Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Elle est inédite, mais correspond à une situation également inédite. Normalement, en matière de fraude fiscale, l’administration effectue des vérifications, avant, le cas échéant, de déposer une plainte, ce qui va conduire le dossier dans le champ judiciaire. En l’espèce, les choses ne se sont pas passées ainsi : il s’agissait d’une affaire de blanchiment, d’autant plus délicate qu’elle concernait au premier chef le ministre du budget, lequel détient le pouvoir de déposer plainte, au nom de l’administration fiscale, auprès de l’autorité judiciaire – en l’occurrence, le procureur de Paris. C’est un cas sans précédent. »
c. Cette démarche a abouti à une réponse rapide des autorités suisses
Afin de se donner un maximum de chances d’obtenir une réponse, le ministre Pierre Moscovici s’est entretenu à deux reprises avec son homologue suisse, Mme Eveline Widmer-Schlumpf, afin de la prier de traiter cette demande avec le plus de diligence possible, et de remonter aussi loin que possible dans le temps. Au niveau administratif, des contacts ont également été noués afin de s’assurer que la demande soit jugée par les autorités helvétiques « vraisemblablement pertinente », c’est-à-dire acceptable (147).
Saisies le 24 janvier, les autorités suisses ont répondu en sept jours à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (148), ce qui prouve que les efforts déployés par le ministre de l’économie, Pierre Moscovici, ont porté leurs fruits.
Cette réponse très courte, dont la presse a déjà révélé la teneur malgré son caractère secret, tient en deux points. Premièrement, l’Administration fédérale des contributions (AFC) informe la DGFiP que, selon les indications fournies par l’UBS, Jérôme Cahuzac n’a pas disposé d’avoirs auprès dudit établissement bancaire, que ce soit à titre de titulaire ou d’ayant droit économique, pour les années 2010 à 2012. Sur la période 2006-2009, après avoir souligné que sa réponse s’inscrivait dans une démarche de bons offices et qu’elle avait recueilli le consentement des avocats de l’intéressé, elle précise que l’UBS ne détenait pas non plus d’avoirs dont Jérôme Cahuzac était titulaire ou ayant droit économique.
Le Rapporteur constate que la réponse des autorités suisses est catégorique et qu’elle fait explicitement référence à la notion d’ayant droit économique, sur l’ensemble de la période 2006-2012. À la lecture de cette formulation affirmative, l’administration fiscale française était en droit de considérer que les autorités suisses comme la banque UBS avaient accompli les diligences nécessaires pour apporter une réponse exacte et complète à la question qui leur était posée.
Une mention supplémentaire, ajoutée par la banque UBS et reprise par l’AFC, a toutefois retenu l’attention des membres de la commission d’enquête : « au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises ». Lors de son audition, le chef du service du contrôle fiscal a estimé qu’il s’agissait là « d’une sorte de " disclaimer ", de protection juridique justifiée par le fait que nous étions remontés antérieurement au 1er janvier 2010 » (149). La DGFiP n’a cependant pas trouvé d’autres occurrences dans les réponses à une procédure d’assistance administrative avec la Suisse ou un autre pays. Afin de lever l’ambiguïté de cette mention, le Rapporteur a interrogé la partie suisse sur la signification de celle-ci ; sans entrer dans une interprétation du cas d’espèce, l’AFC a corroboré les suppositions de M. Gardette, précisant que « lors de la fourniture des informations requises, le détenteur de renseignements peut apporter des précisions sur l’étendue des recherches qu’il a effectuées, notamment en considération des éléments suivants : la non-rétroactivité des nouvelles conventions contre les doubles impositions ; ses obligations de droit privé à l’égard de son client, notamment le respect du secret professionnel pour les années non couvertes par la convention applicable ; et le caractère éventuellement sensible de la demande d’assistance » (150).
2. Était-il opportun de saisir les autorités suisses d’une demande d’assistance administrative ?
Si au plan strictement juridique la demande était possible, la commission d’enquête a longuement débattu des risques auxquels s’était exposé le ministre de l’économie et des finances, en choisissant de lancer le 24 janvier 2013 une demande d’assistance administrative auprès de la Suisse, alors qu’une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris.
Deux interprétations différentes ont été exprimées au sein de la commission. Le Rapporteur et la majorité des membres estiment que l’échange de renseignements était le seul instrument légal à la disposition de l’administration fiscale permettant de confirmer ou d’infirmer les informations publiées par Mediapart ; il devait donc être utilisé par le ministre, en dépit de son maniement délicat, afin de vérifier les dires de Jérôme Cahuzac. Certains membres estiment en revanche que l’administration fiscale a sous-estimé la complexité des montages dissimulant les avoirs et la rigidité de la procédure d’assistance administrative ; ils jugent que le ministre aurait dû s’abstenir de recourir à cet instrument.
a. Un instrument qui reste d’un maniement délicat
L’interrogation des autorités suisses est un exercice sans garantie et l’obtention d’une réponse de leur part reste aléatoire, comme le montre le succès très relatif de ce type de demandes.
Selon les données communiquées lors de son audition (151) par le directeur de cabinet du ministre de l’économie, Rémy Rioux, les autorités françaises ont formulé, entre le 1er janvier 2011 et le 15 avril 2013, 426 demandes de renseignements portant sur des banques suisses. Elles n’ont reçu que 29 réponses, soit 6,5 % du total – les autres demandes étant jugées « non pertinentes » par les autorités suisses –. Sur ces 29 réponses l’administration fiscale française a estimé que seulement 6 étaient satisfaisantes. En outre, celles-ci ont été produites à l’issue de délais très longs. Le Rapporteur a lui-même pris connaissance de l’ensemble des réponses des autorités suisses depuis l’entrée en vigueur de l’avenant de 2009 et il témoigne du traitement vétilleux apporté par celles-ci aux demandes d’assistance administrative françaises.
Comme l’a souligné le Président de la commission d’enquête, la variété des véhicules d’interposition utilisés – compte groupé dit « omnibus » ou « compte maître », trust, fondation, société – est telle qu’on pouvait craindre que le nom de Jérôme Cahuzac n’apparaisse pas parmi ceux des clients avec lesquels la banque entretenait une relation contractuelle.
La France n’était pas non plus fondée à recourir en l’espèce au « dispositif exceptionnel » qui permet à l’administration fiscale d’interroger les autorités suisses sans disposer d’informations lui ayant permis d’identifier avec certitude la banque concernée (cf. infra 3, a) dans la mesure où justement l’identification précise de l’établissement dépositaire cité dans la presse ne posait pas, en tant que telle, de difficultés et elle n’aurait pas pu non plus demander à la Suisse d’interroger l’ensemble de la place bancaire, sans tomber dans la pêche aux renseignements. Elle ne pouvait concrètement, au mois de janvier 2013, saisir les autorités suisses que d’une demande concernant l’UBS – ce qu’elle a fait avec le résultat que l’on connaît.
b. Une procédure qui n’était pas sans risques
Les circonstances singulières dans lesquelles la procédure a été lancée
– l’identité du contribuable concerné, d’abord, même s’il ne pouvait pas interférer avec la procédure, mais aussi l’attention portée par la presse à cette affaire et la concomitance d’une enquête préliminaire – constituaient autant de facteurs de complication, voire de risque, dont les auteurs de la demande d’assistance devaient tenir compte.
Les travaux menés par la commission d’enquête ont permis d’établir les points suivants :
i. Jérôme Cahuzac a été averti du lancement de la procédure, en marge du conseil des ministres
Au cours de son audition (152), le ministre de l’Économie et des finances, Pierre Moscovici, a confirmé (153) qu’une entrevue s’était tenue le 16 janvier 2013, à l’issue du conseil des ministres, à laquelle avaient pris part le président de la République, le Premier ministre, le ministre délégué au budget et lui-même. Il en a rappelé le contexte : « Jérôme Cahuzac se fai[sait] fort d’obtenir de l’UBS la confirmation qu’il n’avait pas détenu un compte en Suisse chez eux. Et cette confirmation tardait à venir. Dès lors en effet, il y a eu non pas une réunion mais quelques mots dans la salle à côté du Conseil des ministres, à l’issue du Conseil des ministres… ».
Il a dressé le compte rendu de cette entrevue dans les termes suivants :
« À l’occasion de cet échange, le président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l’utiliser. Pourquoi l’avoir fait ? D’une part, parce que M. Jérôme Cahuzac était alors ministre du Gouvernement, d’autre part, parce que, aux termes de la convention, les avocats conseils de M. Cahuzac devaient être informés du lancement de la procédure.
« M. Jérôme Cahuzac s’est dit serein ; il a souhaité que la demande couvre la période la plus large possible. Au-delà de cette information de principe, il n’a évidemment pas été associé à la décision, du fait de la “ muraille de Chine” : il n’a pas su quand la procédure avait été lancée – autrement que par ses conseils –, il n’a pas été associé à la rédaction de la demande, il n’a pas été informé du contenu précis de la réponse, qu’il n’a jamais détenue.
« Voilà très précisément ce qui s’est passé. »
Même si Jérôme Cahuzac a indiqué lors de sa deuxième audition (154) n’en avoir aucun souvenir, la commission n’a pas de doute sur le fait que cet échange a bien eu lieu et donc que le ministre délégué a été informé qu’une demande de renseignements le concernant allait être formulée.
Certains membres de la commission ont trouvé surprenant que Jérôme Cahuzac ait pris part à l’entrevue, alors qu’une « muraille de Chine » avait été érigée depuis le 6 décembre. Il faut cependant faire observer – comme l’a rappelé Pierre Moscovici – que ce déport ne valait que pour le fonctionnement de l’administration fiscale (155). De surcroît, la présence de Jérôme Cahuzac à cette rencontre ne le mettait pas, pour autant, en situation de pouvoir influer sur le contenu de la demande ; il s’agissait, à ce stade, d’une information sur le recours à la procédure d’entraide administrative.
ii. Le ministre du budget a été informé du contenu de la demande par ses avocats suisses
La loi française n’impose pas à l’administration fiscale d’informer la personne concernée par une demande d’assistance administrative, à quelque stade que ce soit de la procédure. En l’espèce, les directives particulières posées par la « muraille de Chine », impliquaient que le ministre du budget, Jérôme Cahuzac, soit tenu à l’écart de la préparation de cette demande par les services.
Le directeur général des finances publiques, Bruno Bézard, a d’ailleurs insisté lors de son audition sur l’autonomie dont avait pu jouir l’administration fiscale française pour préparer sa demande aux autorités suisses. Comme il l’a ensuite précisé par écrit (156), « la DGFiP n’a jamais contacté les conseils de M. Cahuzac avant l’envoi de la demande d’assistance administrative [ ;] elle n’a pas non plus contacté ces personnes après réception de la réponse [ ;] elle n’a d’une façon générale, à aucun moment, eu aucun contact avec les conseils de M. Cahuzac ».
Le directeur général a toutefois admis qu’à une occasion, qu’il situe entre le 24 et le 31 janvier, le ministre du budget avait tenté de lui demander des détails sur cette procédure d’entraide administrative, sans obtenir de réponse de sa part: « En ce qui concerne M. Cahuzac, il a effectivement essayé de me demander des détails sur cette procédure d’entraide administrative [ ;] je ne lui ai pas répondu et lui ai indiqué que je n’avais pas à lui répondre [ ;] je ne me souviens pas de la date précise, mais c’était entre le 24 et le 31 janvier » (157). Jérôme Cahuzac a confirmé cet échange.
En droit interne suisse, en revanche, la procédure d’assistance administrative est régie par la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale.
ÉTAPES DU TRAITEMENT DES DEMANDES FRANÇAISES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PAR LES AUTORITÉS SUISSES
1ère étape : l’Administration fédérale des contributions (AFC) examine les demandes reçues et rejette celles ne répondant pas aux critères de recevabilité, en particulier celles jugées « non vraisemblablement pertinentes ».
2ème étape : si la demande est jugée recevable, elle est transmise à la personne susceptible de détenir les renseignements sollicités (banque, société, service local des impôts…)
3ème étape : l’AFC contacte le contribuable français – ou son représentant légal en Suisse, notamment son avocat – et l’informe de la nature et de l’étendue des renseignements collectés. Cette information offre au contribuable la possibilité d’engager des recours devant les juridictions helvétiques pour s’opposer à la transmission des informations.
4ème étape : si le contribuable concerné donne son accord, ou ne répond pas dans le délai de trente jours, la réponse est transmise à l’administration fiscale française.
Source : AFC, DGFiP.
Les modalités d’information des personnes visées par ce type de demande sont réglées par l’article 14 de cette loi. Celui-ci dispose que l’Administration fédérale des contributions (AFC) doit informer « la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ». Selon les précisions communiquées par l’AFC au Rapporteur, la demande d’assistance est transmise à la personne concernée ou à son avocat, à tout le moins un résumé de celle-ci ; le détenteur de renseignements ne reçoit quant à lui aucune information sur les circonstances mentionnées dans la demande puisqu’il est simplement requis de fournir les informations demandées.
Les avocats suisses de Jérôme Cahuzac ont donc été précisément informés du contenu de la demande de l’administration fiscale française.
iii. Une tentative de manipulation : la publication dans la presse de la réponse au début du mois de février
Reçue le 31 janvier 2013, la réponse des autorités suisses est tenue secrète, comme le prévoit la convention franco-suisse de 1966. Malgré ces précautions, la teneur de la réponse est divulguée par la presse quelques jours plus tard. Le 6 février d’abord, l’information est dévoilée, en des termes prudents, sur le site du Nouvel Observateur. Aussitôt après cette parution, l’agence Reuters publie une dépêche rapportant que, d’après une source judiciaire, l’interprétation de la réponse suisse, telle qu’elle était rapportée par le Nouvel Observateur, était inexacte. Le 9 février, le Journal du dimanche publie un article intitulé « Les Suisses blanchissent Cahuzac », dans lequel la réponse négative est interprétée
– sans toutefois que le texte exact soit reproduit ou cité – comme une preuve de l’innocence de Jérôme Cahuzac. Après cet article, Reuters publie une nouvelle dépêche faisant état d’une source judiciaire déclarant toutefois qu’il fallait interpréter avec précaution les informations fournies par la Suisse. Comme l’a résumé Fabrice Arfi devant la commission, « il était notoire qu’il fallait les prendre avec des pincettes. » (158)
L’article du Journal du dimanche fait parler non seulement l’entourage du ministre de l’économie, mais également « une source administrative à Bercy »
– alors même que Bruno Bézard s’est défendu de tout contact avec la presse.
Lors de son audition par la commission d’enquête, le ministre de l’Économie et des finances, Pierre Moscovici, a confié avoir « ressenti une certaine colère en lisant, dans le JDD, cet éloge qui semblait innocenter complètement Jérôme Cahuzac – un sentiment que j’ai partagé avec le directeur général des finances publiques [ ;] je craignais que l’article ne soit interprété par le procureur comme une pression et par Mediapart comme une agression » (159).
La commission d’enquête a cherché à déterminer le responsable de cette manipulation de l’information. Sur ce point, elle n’est pas parvenue à lever définitivement les doutes. Jérôme Cahuzac devant la commission d’enquête a nié avoir informé qui que ce soit du sens de la réponse des autorités suisses, laquelle lui avait été transmise par ses avocats en Suisse, ajoutant : « je me suis longuement demandé qui avait pu faire cette démarche dont je ne jugeais pas à cet instant qu’elle pouvait m’aider [ ;] je n’ai pas de réponse ».
Le Rapporteur observe cependant que cette tentative de manipulation
– même si elle a pu brièvement troubler le procureur de Paris – n’a pas entravé le travail de la justice, comme l’a confirmé ce dernier (160).
c. La transmission de la réponse à la Justice n’allait pas de soi
Les travaux de la commission d’enquête sur l’assistance administrative en matière fiscale ont mis en évidence son caractère complémentaire, et non pas concurrent, de l’entraide judiciaire. Les modalités de la transmission de la demande adressée aux autorités suisses, et de leur éventuelle réponse, n’étaient pas pour autant réglées.
i. La question de la transmission de la réponse à la Justice a donné lieu à controverse
Deux interprétations ont été défendues par les témoins auditionnés devant la commission d’enquête. La directrice des affaires criminelles et des grâces (161), Marie-Suzanne Le Quéau, ainsi que le procureur de Paris, François Molins, ont estimé que l’utilisation dans une procédure pénale des renseignements obtenus par le biais de cette convention est exclue, à moins que les autorités suisses ne l’aient expressément autorisée. En effet, en application du principe de spécialité de la convention administrative fiscale de 1966, il aurait fallu soit présenter la même demande par voie de commission rogatoire, dans le cadre d’une demande d’entraide pénale, soit solliciter de la part des autorités suisses l’autorisation de verser leur réponse à la procédure judiciaire – ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (162).
La DGFiP a fait valoir une interprétation plus nuancée (163) selon laquelle la convention permet la transmission à d’autres autorités de l’État requérant, y compris des autorités judiciaires, dès lors que l’objectif qu’elles poursuivent est fiscal, ce qu’elle considère être le cas de la répression de la fraude fiscale et de son blanchiment. Dans ces conditions, l’administration fiscale considère qu’elle a pu à bon droit transmettre, de son propre chef, à l’autorité judiciaire des éléments obtenus dans le cadre de l’assistance administrative à l’appui d’une information judiciaire ouverte pour fraude fiscale (164).
ii. La DGFiP n’avait pas informé le parquet de Paris de la question, mais elle a transmis rapidement la réponse
Dans l’affaire qui concerne la commission, la DGFiP n’a cependant pas suffisamment anticipé, au moment de la demande d’assistance administrative, la transmission de la réponse au parquet de Paris, qui avait ouvert une enquête préliminaire. De plus, le procureur François Molins, et ses services, n’ont appris que de manière fortuite l’existence d’une demande d’assistance administrative relative aux faits qui ont motivé l’ouverture d’une enquête préliminaire. En effet, le 31 janvier, le Parquet a reçu un appel téléphonique d’un journaliste qui lui demandait confirmation de la transmission par la Suisse de documents relatifs à l’affaire Cahuzac.
Ce n’est que le lendemain matin, 1er février, que le commissaire chef de la DNIFF transmet, par courriel, au parquet la réponse que l’Administration fédérale des contributions helvétiques a adressé à la DGFiP. Selon les témoins auditionnés, celle-ci avait spontanément envoyé ce document à la DNIFF quelques minutes plus tôt. Le commissaire a ensuite appelé le chef de la section financière du parquet, qui lui a donné instruction de solliciter de la DGFiP la communication du texte de la demande adressée à la Suisse par les autorités françaises dont elle n’avait pas eu connaissance. La demande faite à la Suisse a finalement été adressée par la DGFiP, par courriel en début d’après-midi.
En dépit d’un déficit de communication avec le parquet, ces éléments ont finalement pu être versés au dossier pénal. Lors de son audition (165), le procureur de Paris, François Molins, a ainsi précisé : « J’ai estimé que, dans la mesure où l’autorité judiciaire n’avait pas réclamé ce document mais qu’il était, un peu par accident, arrivé jusqu’à la DNIFF qui nous l’avait communiqué et que le parquet n’était pas l’auteur de la violation de la Convention, ce document constituait un renseignement comme un autre. Dans un souci de loyauté et de transparence, et en vue d’enquêter à charge comme à décharge, j’ai préféré intégrer la réponse des autorités suisses à la procédure. J’ai donc poursuivi l’enquête préliminaire ».
Pas plus que le fait d’avoir procédé à une demande d’assistance administrative, la transmission après coup de la réponse par la DGFiP n’a retardé la recherche de la vérité par la Justice.
Le Rapporteur estime d’une part que, si l’administration fiscale n’avait pas fait usage de la possibilité d’interroger les autorités suisses, il aurait pu lui en être fait reproche, et, d’autre part, que son souci de transparence vis-à-vis de la Justice – en dépit des maladresses dans sa mise en œuvre – traduisait sa volonté de contribuer à l’établissement de la vérité, même si celui-ci relevait in fine de l’autorité judiciaire.
C’est pourquoi le Rapporteur ne partage pas le reproche, formulé par certains membres de la commission d’enquête, d’incohérence entre le recours à l’échange de renseignements fiscaux et l’invitation, formulée par la présidence de la République à l’attention de Michel Gonelle, de remettre à la Justice les éléments de preuve qu’il détiendrait. Si les autorités suisses avaient confirmé l’existence du compte révélée par la presse, l’initiative de l’administration fiscale aurait alors été unanimement saluée car elle aurait permis d’accélérer la découverte de la vérité. Demander à Michel Gonelle de remettre au parquet de Paris les éléments de preuve qu’il affirmait détenir relevait de la même logique : permettre à la seule autorité compétente pour faire procéder à leur expertise de disposer, le plus rapidement possible, de tous les éléments susceptibles de conduire à la révélation de la vérité.
3. L’administration fiscale a-t-elle utilisé toutes les possibilités ouvertes par la procédure d’échange de renseignements ?
La demande d’assistance administrative adressée le 24 janvier 2013 par la France aux autorités suisses a porté sur les avoirs dont Jérôme Cahuzac aurait été « le titulaire ou l’ayant droit économique » à l’Union des banques suisses (UBS) de Genève, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012.
a. Quelles banques devaient être visées dans la demande ?
i. Un seul établissement est visé
La demande d’assistance n’a porté que sur la seule UBS, à l’exclusion de toute autre banque. Auditionnés par la commission d’enquête, le directeur général des finances publiques, Bruno Bézard, et le chef du service du contrôle fiscal, Alexandre Gardette, ont souligné que, de leur point de vue, à la date à laquelle la demande d’assistance administrative a été adressée (le 24 janvier 2013) aucun des éléments connus de la DGFiP – éléments parus dans la presse et donc vérifiables par la partie suisse – ne mentionnait la détention d’un compte dans un établissement autre que l’UBS.
Le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, n’a pas d’autre banque à l’esprit lorsqu’il écrit – quinze jours avant l’envoi de la demande à la Suisse – au procureur de Paris pour suggérer de confier au juge Daïeff, qui enquête sur les pratiques commerciales de l’UBS, les investigations relatives à l’affaire Cahuzac (166).
Les travaux de la commission ont effectivement démontré que Mediapart n’avait formulé que postérieurement à cette demande l’hypothèse, selon laquelle les avoirs de Jérôme Cahuzac étaient gérés par Reyl et Cie – un établissement financier genevois devenu banque – sur un compte-maître ouvert à l’UBS. Avant le 24 janvier 2013, la presse étrangère se bornait, de son côté, à reprendre les informations de Mediapart ; seul le quotidien suisse le Temps ajoute, le 12 décembre 2012, une information nouvelle, en mentionnant les liens familiaux entre Hervé Dreyfus, le gestionnaire de fortune de Jérôme Cahuzac, et Dominique Reyl, fondateur de Reyl et Cie.
MENTION DE DREYFUS ET DE REYL DANS LES ARTICLES DE PRESSE
AVANT LE 24 JANVIER 2013
L’article de Mediapart du 5 décembre 2012 mentionne pour la première fois un certain Marc D, présenté comme l’un des correspondants de Jérôme Cahuzac à l’UBS. Le 10 décembre ce même Marc D est présenté comme « le gestionnaire du compte de Jérôme Cahuzac à l’UBS ». (Il s’agit, en fait, de Marc Dreyfuss)
L’article de Mediapart du 11 décembre 2012 mentionne pour la première fois le nom d’Hervé Dreyfus. Il est présenté comme le « gestionnaire de fortune » de Jérôme Cahuzac et son interlocuteur dans l’enregistrement de 2000. Il « l’aurait aidé à gérer son importante fortune personnelle, constituée pour partie d’avoirs non déclarés ». Il est indiqué que Hervé Dreyfus : « a donné son nom à deux sociétés différentes mais répondant à la même dénomination : Hervé Dreyfus Finance. La première créée en 1994 est une société de services dans le domaine financier en France et dans tous les pays. En 2011, les avoirs de cette société ont été transférés vers la deuxième société, une holding chargée de gérer des participations ». Il est également fait mention du fait qu’Hervé Dreyfus serait depuis 1994 l’un des administrateurs et associé du groupe RJAMI, groupe dans lequel il occupe les fonctions de chargé de clientèle. Hervé Dreyfus aurait été présenté à Jérôme Cahuzac par son frère Antoine. Dans cet article du 11 décembre est également mentionné pour la première fois le financier suisse Dominique Reyl comme « ayant été au capital de la Société Dreyfus finance à sa création ». Il est précisé que Dominique Reyl est « le fondateur à Genève de la Compagnie financière d’études et de gestion, devenue Reyl et Cie en 1988 et qui compte aujourd’hui des filiales à Hong Kong, à Singapour et au Luxembourg ».
Le 12 décembre 2012, le journal Suisse Le temps publie un article titrant : « Les liaisons genevoises de Jérôme Cahuzac ». Cet article reprend les informations de Mediapart en précisant que « Hervé Dreyfus et Dominique Reyl sont demi-frères. »
Le 26 décembre 2012 dans un point sur l’affaire (et dans les articles suivants), Mediapart s’en tient toujours à un compte à « l’UBS de Genève qui sera clos en 2010 » et les avoirs financiers transférés vers Singapour. Marc D, employé d’UBS est identifié comme le gestionnaire du transfert.
La mention la plus précise sur la banque Reyl figure dans un article de Mediapart du 17 janvier (cité par Edwy Plenel lors de son audition). Dans cet article consacré au démarrage de l’enquête préliminaire et à l’audition de Michel Gonelle, il est indiqué qu’Hervé Dreyfus, présenté depuis le début des articles comme le gestionnaire de la fortune de Jérôme Cahuzac, est « associé depuis 1994 au banquier Suisse Dominique Reyl. »
Lors de son audition, Edwy Plenel a également précisé que Mediapart avait publié un témoignage plus précis sur le rôle de Reyl, le 1er février, sur le blog d’Antoine Peillon, journaliste à La Croix. Il précise que c’est un banquier dont on connaît aujourd’hui l’identité, Pierre Condamin-Gerbier, qui parle.
Dans ces conditions, même si son statut de négociant en valeurs mobilières avant novembre 2010 n’empêchait pas d’interroger les autorités suisses sur Reyl et Cie, l’administration fiscale manquait objectivement d’éléments pour justifier, en janvier 2013, une demande portant sur une autre banque que UBS. Celle-ci aurait encouru le risque d’être jugée non pertinente par les autorités suisses. Rien ne garantit non plus que, pour autant, la réponse des autorités suisses sur Reyl et Cie eût été positive car les montages financiers utilisés par Jérôme Cahuzac ne sont pas connus.
ii. Une demande non ciblée, théoriquement possible, aurait probablement été jugée non pertinente
Aux termes de l’avenant du 27 août 2009, lorsque la France a connaissance du nom de l’établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné, elle doit communiquer cette information à la Suisse. Dans le cas où l’autorité compétente présumerait qu’un contribuable détient un compte bancaire en Suisse sans pour autant disposer d’informations lui ayant permis d’identifier avec certitude la banque concernée, elle doit fournir tout élément en sa possession de nature à permettre l’identification de cette banque.
Du point de vue de la France, ce dernier élément signifiait que l’État requérant n’avait à communiquer le nom de la banque que dans la mesure où cet élément était connu. Or, c’est évidemment l’information qui est la plus difficile à établir.
Afin de mesurer la portée exacte de l’échange de lettres, le Président et le Rapporteur ne se sont pas contentés d’auditionner les responsables de l’administration fiscale française mais ils ont interrogé directement leurs homologues suisses, qui lui ont précisé leur propre interprétation : « Cet accord bilatéral visait donc à préciser le principe selon lequel la France indiquera les nom et adresse du détenteur des renseignements lorsqu’elle en dispose mais pourra, dans des cas spécifiques, interroger l’administration suisse sans spécifier le nom d’un établissement de crédit pour autant qu’elle fournisse des éléments alternatifs permettant d’identifier cet établissement. Cette règle s’applique sous réserve du respect des principes de l’interdiction de la pêche aux renseignements et de proportionnalité. Il en va de même dans le cas d’une demande étendue à d’autres établissements. Cette précision correspond d’ailleurs à la pratique suisse, en ce qu’une suite est donnée aux demandes d’assistance qui certes ne mentionnent pas les nom et adresse du détenteur des renseignements mais l’un des éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : nom, adresse, numéro de compte ou emplacement géographique spécifié, aboutissant à son identification. »
Ainsi, les autorités helvétiques considèrent qu’elles ne seraient pas en mesure de répondre à une demande d’assistance ne permettant pas « d’identifier clairement » la banque détentrice de l’information (167) ; par ailleurs, il n’est pas possible de formuler une demande portant sur toutes les banques car cela reviendrait à une pêche aux renseignements (168) strictement prohibée.
b. La période visée par la demande pouvait-elle être plus large ?
Aux termes de la convention franco-suisse, modifiée par l’avenant du 5 février 2010, la demande d’assistance administrative ne pouvait remonter avant l’entrée en vigueur de l’avenant. La période utile sur laquelle l’administration fiscale française pouvait interroger les autorités suisses était donc limitée aux trois dernières années, soit de 2010 à 2012.
Il était toutefois à craindre, comme la presse en avait formulé l’hypothèse, que les avoirs de Jérôme Cahuzac détenus en Suisse aient pu être transférés dans un autre pays ou territoire à la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010. C’est pourquoi, la DGFiP a proposé au ministre Pierre Moscovici de solliciter son homologue suisse, afin que l’administration fiscale suisse accepte, alors même qu’elle n’y était tenue par aucune obligation juridique, de remonter jusqu’au 1er janvier 2006. Cette date constituait un maximum, correspondant au délai de prescription sexennale applicable au droit de reprise de l’administration en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.
La lettre de couverture accompagnant la demande précise donc que si le contribuable concerné et la banque en étaient d’accord – condition nécessaire au regard de la législation interne suisse, cf. infra –, la France souhaiterait obtenir l’information jusqu’en 2006. Dans la mesure où elle considérait qu’aucune disposition de la convention n’y faisait obstacle et que la personne concernée y avait expressément consenti, l’Administration fédérale des contributions helvétique a, dans « un esprit de bons offices » (169), accepté de se faire l’intermédiaire et de transmettre ces renseignements supplémentaires. La DGFiP a ainsi obtenu que les autorités suisses remontent au 1er janvier 2006, au lieu du 1er janvier 2010.
c. La référence à la notion d’ayant droit économique était-elle opérante ?
La demande d’assistance administrative ne s’est pas cantonnée à rechercher si Jérôme Cahuzac était ou avait été titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts à l’UBS.
L’objet de cette demande a été élargi pour savoir s’il était ou avait été ayant droit économique d’un ou de plusieurs comptes ouverts dans cette même banque et à obtenir le document formel (dit « formulaire A » dans la législation anti-blanchiment suisse) sur lequel cette information doit être consignée.
Le Rapporteur a toutefois souhaité savoir dans quelle mesure ce type d’assistance administrative permettait d’identifier l’ayant droit réel d’un compte clientèle collectif (compte-maître), comme celui qui a peut-être été ouvert par le gestionnaire de fortune Reyl (agréé comme négociant en valeurs mobilières en 1999) dans les livres de l’UBS et aurait abrité les avoirs de Jérôme Cahuzac, entre autres clients, notamment entre 2006 et 2009. Interrogés sur l’hypothèse dans laquelle un établissement bancaire suisse ne pourrait, sur la seule base des éléments en sa possession, donner suite à une demande visant à l’identification d’un ayant droit économique, les services de la DGFiP n’ont trouvé dans la réglementation publique suisse aucune disposition qui fasse obstacle à ce que cet établissement répercute ladite demande auprès de ses correspondants, y compris pour des relations d’affaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 10 octobre 1997 (170).
d. Pourquoi l’administration fiscale française n’a-t-elle pas également interrogé Singapour ?
Dès le 5 décembre 2013, soit le lendemain des premières révélations de Mediapart, la presse évoquait la possibilité que le compte de Jérôme Cahuzac, à l’UBS de Genève ait été « clos en 2010 et transféré à cette date à l’UBS de Singapour par le truchement d’un complexe montage financier off shore » (171).
De fait, notre pays est lié à Singapour par une convention fiscale du 9 septembre 1974, qui a fait l’objet d’un avenant du 13 novembre 2009, ayant introduit un dispositif d’échange de renseignements. Cet avenant s’interprète au regard des seuls commentaires de l’OCDE, et il ne comporte pas d’exigence particulière quant aux informations bancaires à fournir.
Deux éléments peuvent contribuer à rendre plus complexe qu’il n’y paraît à première vue l’assistance administrative avec Singapour. En premier lieu, les autorités requises informent systématiquement le contribuable, ou ses conseils, de l’existence de la demande – c’est cependant également le cas de la Suisse. Surtout, il est nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire pour toute demande relative à des données bancaires, comme l’a rappelé devant la commission d’enquête le chef du service du contrôle fiscal, Alexandre Gardette (172). Du point de vue du Rapporteur, ces difficultés objectives ne sont toutefois pas insurmontables ; même s’ils sont peu nombreux, les précédents témoignent plutôt de l’efficacité de l’assistance administrative avec les autorités singapouriennes (173).
Dans le cas d’espèce, les informations rendues publiques concernant un éventuel transfert des avoirs vers Singapour étaient limitées mais pas inexistantes. Il aurait été techniquement possible de saisir, dès le mois de janvier 2013, les autorités singapouriennes d’une demande visant les avoirs détenus par Jérôme Cahuzac à l’UBS de Singapour, voire dans l’ensemble des établissements financiers du territoire.
Le directeur général des finances publiques, Bruno Bézard, a fait valoir l’ajout dans la demande à la Suisse d’une mention relative au transfert des avoirs dans un pays tiers : « Si nous n’avons pas interrogé Singapour, c’est que le point que nous souhaitions vérifier était l’existence d’un transfert d’UBS vers cet État, en 2010. La demande que nous avons adressée à la Suisse couvrait tout transfert d’UBS vers tout autre pays, ce sur une période infiniment plus large
– allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 – que celle mentionnée par la presse dans ses allégations. ». Au regard de la convention franco-suisse, cet ajout était plus informatif que réellement opérant ; le Rapporteur est, dès lors, fondé à regretter que la DGFiP n’ait pas, par souci d’exhaustivité, saisi parallèlement la Suisse – pays d’origine des fonds – et Singapour – pays de destination, selon les allégations de Mediapart. Il faut néanmoins admettre que rien ne permet d’affirmer qu’un juge singapourien aurait autorisé la mise en œuvre de la procédure d’assistance, dans la mesure où les informations publiées à l’époque par la presse étaient beaucoup moins précises qu’aujourd’hui.
Plus généralement, le Rapporteur estime qu’il appartient désormais à la justice, et non à la commission d’enquête, de déterminer précisément le montage juridique qui a dissimulé les avoirs de Jérôme Cahuzac à l’étranger. Il faudra alors se garder de tout jugement rétrospectif. L’administration fiscale, avec aussi peu d’éléments à sa disposition, n’avait d’autre choix que de procéder pas à pas.
*
Il reste que l’utilisation de l’échange de renseignements avec la Suisse par l’administration fiscale, si elle n’a pas suffi à la manifestation de la vérité dans cette affaire, témoigne de son souci de réagir à une situation inédite dans le respect des règles de droit.
Usant de son droit d’obtenir communication de tout document, le Rapporteur de la commission d’enquête a pu vérifier que l’administration fiscale avait poursuivi ses démarches pour permettre de soumettre à l’impôt et aux pénalités en vigueur les sommes frauduleusement soustraites par Jérôme Cahuzac. Il a ainsi pris connaissance de nouvelles demandes d’assistance administrative adressées à la Suisse et à Singapour au mois de juin.
Au terme de ses travaux, la commission d’enquête est parvenue à éclairer les principales zones d’ombre, non pas du fond de l’« affaire Cahuzac », ce qui n’était pas son objet, mais de la manière dont celle-ci a été gérée par le Gouvernement et les services de l’État, entre les premières révélations de Mediapart, le 4 décembre 2012, et la mise en examen de Jérôme Cahuzac, le 2 avril 2013. Elle s’est en effet attachée à vérifier le bien-fondé des accusations formulées contre certaines administrations, contre des ministres, voire contre les plus hautes autorités de l’État, qui, selon la presse, auraient été au courant de la détention d’un compte non déclaré à l’étranger par le ministre délégué chargé du budget de l’époque, et auraient cherché à le « couvrir » ou le « blanchir », ou auraient tenté d’en avoir le cœur net en faisant mener des investigations cachées.
La commission d’enquête s’est d’abord efforcée de faire le point sur les informations dont pouvaient disposer les services de l’État au moment où l’affaire a éclaté. Selon les éléments qu’elle a recueillis, il n’est absolument pas établi que la direction générale des douanes et des droits indirects ait eu connaissance de l’existence de ce compte. L’information est en revanche parvenue aux services fiscaux à deux reprises, en 2001 puis en 2008, mais sous des formes détournées qui ont empêché son utilisation, et sans que la hiérarchie administrative – en raison d’un dysfonctionnement, en 2001 – ou les ministres successifs n’en soient avisés. La commission d’enquête n’a obtenu aucun élément permettant d’étayer l’hypothèse selon laquelle Jean-Louis Bruguière, informé de l’affaire par Michel Gonelle à la fin de l’année 2006, l’ait divulguée à quiconque, tandis qu’elle a la conviction que l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot ne lui a pas dit toute la vérité au cours de ses deux auditions. Les travaux de la commission ont en effet conduit à la découverte de l’existence de copies de l’enregistrement réalisées à la demande de M. Gonelle, le 1er décembre 2012 – soit quelques jours avant les révélations de Mediapart, ce que l’avocat n’a pas démenti. Il n’a cependant pas fourni d’explication sur leur utilisation.
Dans les semaines qui ont suivi la révélation de l’affaire, la presse a, logiquement, suivi avec une extrême attention les initiatives prises par l’appareil d’État. Certains éléments ont alors été interprétés comme devant induire le soupçon, ce que ne retient pas la commission d’enquête. On peut citer à ce titre l’erreur dans le fondement de la première plainte en diffamation de Jérôme Cahuzac contre Mediapart, immédiatement corrigée, sans conséquence, par le parquet de Paris ; le contenu maladroit du message de la chef de cabinet de Jérôme Cahuzac relatif à l’emprunt du téléphone portable d’un policier par Michel Gonelle, dans lequel certains ont vu la preuve de la mobilisation des services de police pour espionner les relations téléphoniques entre un journaliste et un protagoniste de l’affaire ; et la révélation d’une « note blanche » de la DCRI, qui, s’est avérée, au vu du document transmis à la commission d’enquête, être une note ne mentionnant pas le nom de Jérôme Cahuzac et résumant seulement des informations anciennes relatives à certaines pratiques de la banque UBS en France.
Les initiatives de l’administration fiscale, administration dont Jérôme Cahuzac exerçait la tutelle, ont suscité une attention toute particulière. Très rapidement, des mesures ont été prises, sous la forme de la désormais fameuse « muraille de Chine », afin que le ministre délégué soit tenu à l’écart de tout ce qui touchait, de près ou de loin, à l’affaire : le Rapporteur juge cette décision bienvenue. L’administration fiscale a pendant cette période poursuivi l’examen de la situation fiscale des ministres, et a adressé à Jérôme Cahuzac un formulaire de renseignements l’interrogeant sur les comptes qu’il détiendrait à l’étranger. D’après les informations recueillies par la commission d’enquête, le ministre de l’Économie et des finances n’a pas été informé de cet envoi, pas plus que de l’absence de réponse de son ministre délégué à ce formulaire. Il est vrai que, en application de la circulaire dite « Baroin », l’administration fiscale n’avait pas à le faire.
D’aucuns ont tenté de démontrer que la présidence de la République savait, dès les premiers jours qui ont suivi les révélations de Mediapart, que ces accusations étaient fondées. Il ne fait guère de doutes que des informations sur l’enquête de Mediapart, provenant de personnes proches du journal en ligne, sont parvenues à la Présidence. Celle-ci a publiquement reconnu la démarche de Michel Gonelle auprès du directeur de cabinet adjoint du président de la République, et lui a demandé de transmettre à la Justice les preuves qu’il prétendait détenir. Il ne faut pas perdre de vue que ces éléments étaient en contradiction absolue avec les déclarations d’innocence solennelles répétées du principal intéressé et que Michel Gonelle s’était défendu, quelques jours plus tôt, d’avoir quoi que ce soit à voir avec cette affaire.
C’est à partir du moment où la Justice ouvre une enquête préliminaire, à la suite d’un courrier du président de Mediapart au procureur de Paris, que la situation se débloque. Le Rapporteur tient à saluer ici le travail de la Justice, et en particulier du parquet de Paris. En l’absence de toute immixtion de la part de la ministre de la Justice ou du ministre de l’Intérieur – les deux se tenant naturellement informés de l’avancée des investigations –, l’enquête préliminaire a débouché sur l’ouverture d’une information judiciaire, après que les expertises ont conclu qu’il était probable que la voix de l’enregistrement était bien celle du ministre délégué.
Une part importante des travaux de la commission d’enquête a porté sur l’initiative, prise par le ministre de l’Économie et des finances, d’interroger les autorités suisses sur la réalité des révélations de Mediapart. Des reproches contradictoires ont été formulés à l’encontre de cette demande de renseignements, certains estimant qu’il ne fallait pas la lancer, d’autres – en fait souvent les mêmes – jugeant que son champ aurait dû être plus large et qu’il avait, volontairement, été limité afin d’obtenir une réponse négative, favorable au ministre délégué ; le ministre de l’Économie s’est ainsi vu taxé tantôt d’amateurisme, tantôt de machiavélisme.
Le Rapporteur estime que, en dépit du caractère délicat de son maniement, le ministre de l’Économie et des finances a eu raison de mettre en œuvre cet instrument, le seul à sa disposition pour tenter de confirmer ou d’infirmer les dires de la presse et que rien ne lui interdisait de le faire, même si cela reste sans précédent, en parallèle de l’enquête judiciaire. À la date de son envoi, le champ de la demande adressée à la Suisse ne pouvait pas être plus large, sauf à courir le risque qu’elle soit considérée comme non pertinente. Le Rapporteur regrette que la DGFiP n’ait pas aussi adressé une demande de renseignements aux autorités de Singapour, alors que Mediapart affirmait que les avoirs du ministre délégué au budget y avaient été transférés. Il n’est pas certain que les informations alors disponibles auraient été suffisantes pour qu’un juge singapourien autorise la mise en œuvre de la procédure, mais le souci d’exhaustivité aurait dû conduire à tenter d’utiliser également cette possibilité.
La transmission par l’administration fiscale à la Justice de la réponse
– négative – des autorités suisses, obtenue en quelques jours, n’allait pas de soi, mais le document a finalement été intégré à la procédure, qui s’est poursuivie normalement.
En revanche, la tentative d’instrumentalisation de cette réponse par sa publication dans la presse est très choquante : la commission d’enquête n’est pas parvenue à savoir qui en était responsable, mais elle a établi que Jérôme Cahuzac et ses conseils avaient été informés par les autorités suisses de la teneur de leur réponse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur a la conviction que, confrontés à une situation inédite et particulièrement délicate, les services de l’État et le Gouvernement ont agi dans le respect de la légalité. Il faut souligner que moins de deux mois et demi se sont écoulés entre le déclenchement de l’enquête préliminaire et la démission de Jérôme Cahuzac, le jour de l’ouverture de l’information judiciaire.
La commission d’enquête considère cependant qu’ont été constitutifs de dysfonctionnements le traitement du signalement effectué en 2001 auprès d’un inspecteur des impôts de la brigade interrégionale d’intervention de Bordeaux et la décision de la DGFiP de ne pas transmettre immédiatement au procureur de Paris la demande d’entraide administrative adressée aux autorités suisses, alors qu’elle lui a fait parvenir sans tarder, par l’intermédiaire de la police judiciaire, la réponse apportée à cette demande.
Par ailleurs, la communication à la presse du contenu de la réponse des autorités fiscales suisses alors qu’elle était couverte par le secret, même si elle ne concerne pas le fonctionnement des services de l’État, relève également du dysfonctionnement grave.
Les membres de la commission restent partagés sur un sujet : le recours à la convention d’entraide administrative franco-suisse. Le Rapporteur considère que ce débat ne porte pas sur un dysfonctionnement, mais relève, comme il vient de l’exposer, d’un jugement d’opportunité.
*
Depuis l’ouverture d’une information judiciaire, puis les mises en examen de Jérôme Cahuzac, le Gouvernement et le législateur ont eu à cœur de faire en sorte qu’une telle affaire ne soit plus possible. Deux séries de réformes ont été accélérées : l’une visant à renforcer la transparence de la vie publique, l’autre à améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Les différents projets de loi viennent d’être adoptés définitivement par le Parlement. Ils ont été enrichis de nombreux amendements, parmi lesquels certains faisaient directement écho aux travaux, alors en cours, de la commission d’enquête. C’est le cas, en particulier, des précisions apportées, sur proposition de son Président, à l’article donnant une existence législative à l’examen de la situation fiscale des ministres récemment nommés, ainsi que des mesures prises pour mieux articuler le travail de la Justice et celui de l’administration fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale. Parallèlement, le Gouvernement a négocié une modification du droit franco-suisse applicable à l’échange de renseignements en matière fiscale afin de lever certaines des conditions qui le restreignent. La Commission souhaite que la ratification de cette modification puisse intervenir rapidement. Les autorités suisses n’ont pas encore accepté le passage à l’échange automatique d’informations, mais ce sujet n’est plus tabou, et Singapour vient de signer la convention multilatérale d’assistance mutuelle en matière fiscale de l’OCDE, ce qui devrait conduire à une simplification des procédures.
Pendant que la procédure judiciaire se poursuivait, le Gouvernement et le Parlement ne sont donc pas restés inactifs, démontrant, si besoin était, leur souci de tirer toutes les conséquences de cette déplorable affaire. Des progrès restent à faire, en particulier pour améliorer encore les conditions des échanges de renseignements entre les administrations fiscales. La commission d’enquête estime que la France devra continuer de jouer un rôle moteur dans ce domaine, notamment afin de mettre en œuvre la déclaration en ce sens faite le 18 juin 2013 par les chefs d’État et de gouvernement des États membres du G8.
La commission d’enquête a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 8 octobre 2013.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous concluons aujourd’hui les travaux de notre commission d’enquête. Je tiens d’abord à vous remercier pour votre participation. En dépit du nombre élevé de nos réunions – 38 réunions, dont 36 auditions –, vous y avez toujours assisté en nombre et posé de nombreuses questions aux personnes entendues, ce dont attestent nos 55 heures de réunion et les 600 pages de comptes rendus qui figureront en annexe du rapport.
Le secrétariat de la Commission a en outre reçu deux contributions, celle du groupe UDI et celle de M. Gorges, qui seront également jointes au rapport.
Les travaux de la Commission d’enquête auront été utiles. Nous avons pu entendre les protagonistes de « l’affaire Cahuzac » – dont certains par deux fois –, ainsi que les membres du Gouvernement et les fonctionnaires qui avaient été concernés par la gestion de cette affaire, et nous avons rassemblé un grand nombre de documents. Je regrette toutefois que la majorité des membres de la Commission ait écarté deux auditions que je jugeais intéressantes : celle du Premier ministre et celle de Mme Patricia Cahuzac. Il reste que les informations que nous avons réunies nous permettent de mieux comprendre l’enchaînement des événements et les choix de chacun.
Notre rapporteur, M. Alain Claeys, va d’abord nous présenter ses conclusions, puis je vous ferai part des miennes, qui divergent sur un certain nombre de points. Je donnerai ensuite la parole à ceux qui souhaiteront intervenir.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je regrette que nos collègues de l’UMP, qui ont participé – et, pour certains d’entre eux, activement – à cette commission, aient choisi aujourd’hui la politique de la chaise vide. En revanche, je me félicite que le président de Courson et moi-même ayons travaillé en bonne intelligence – même si nous avons eu un désaccord sur le choix de deux auditions. Ce fut un atout majeur pour la Commission d’enquête.
Le but de celle-ci était de faire la lumière, non sur le fond de l’affaire elle-même, mais sur sa gestion, par le Gouvernement et les services de l’État, entre les premières révélations de Mediapart, le 4 décembre 2012, et la mise en examen de M. Jérôme Cahuzac, le 2 avril 2013. Je crois que nous y sommes parvenus, autant que nous le permettaient les pouvoirs qui nous étaient impartis.
La Commission a auditionné 52 témoins, dont 3 à deux reprises. Nous avons, après avoir sollicité l’Élysée, pu entendre le directeur général adjoint de la Présidence de la République, M. Alain Zabulon. Seules les éventuelles auditions du Premier ministre et de Mme Patricia Cahuzac ont donné lieu à des discussions, à la suite desquelles la Commission a décidé de ne pas y procéder.
Le rapport commence par faire le point sur les informations dont disposaient les services de l’État lorsque l’affaire a éclaté. Il n’est pas établi que la direction générale des douanes et des droits indirects ait eu connaissance de l’existence du compte à l’étranger non déclaré de M. Jérôme Cahuzac ; en revanche, l’information est parvenue aux services fiscaux à deux reprises, en 2001 puis en 2008, mais sous des formes détournées, ce qui a empêché son utilisation, et sans que la hiérarchie administrative ou les ministres successifs en aient été avisés. Nous avons établi qu’en 2001, le signalement effectué auprès de la brigade interrégionale d’intervention (BII) de Bordeaux n’avait pas été conforme aux règles et qu’en raison d’un dysfonctionnement, le responsable de ladite brigade n’avait pas été averti des accusations portées contre M. Jérôme Cahuzac.
Nos travaux ne nous ont pas permis d’étayer l’hypothèse selon laquelle M. Jean-Louis Bruguière, informé de l’affaire par M. Michel Gonelle à la fin de l’année 2006, l’aurait divulguée, alors qu’ils ont montré que l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot ne nous avait pas dit toute la vérité lors de ses auditions. Nous avons en effet découvert que des copies de l’enregistrement avaient été faites à la demande de M. Michel Gonelle, le 1er décembre 2012, soit quelques jours avant les révélations de Mediapart ; interrogé par courrier, l’avocat, qui avait toujours affirmé n’avoir détenu que deux exemplaires réalisés fin 2000, n’a pas démenti, mais il n’a fourni aucune explication sur leur utilisation.
Sur cet état des lieux, il me semble que la Commission est unanime.
Dans les semaines qui ont suivi la révélation de l’affaire, la presse a suivi avec une attention extrême les initiatives prises par l’appareil d’État. Certains faits ont éveillé des soupçons qui me semblent infondés : ainsi, le mauvais fondement juridique de la première plainte en diffamation déposée par M. Jérôme Cahuzac contre Mediapart, erreur sans conséquence immédiatement corrigée par le parquet de Paris ; le contenu maladroit d’un courriel de la chef de cabinet de M. Jérôme Cahuzac relatif à l’emprunt par M. Michel Gonelle du téléphone portable d’un policier, dans lequel certains ont vu la preuve d’une mobilisation des services de police à seule fin d’espionner les relations téléphoniques entre un journaliste et un protagoniste de l’affaire ; ou encore, la révélation de l’existence d’une « note blanche » de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) – mais il s’est avéré que ce document, qui nous a été transmis, ne mentionnait pas le nom de Jérôme Cahuzac et n’était qu’une synthèse d’informations anciennes relatives à certaines pratiques de la banque UBS en France.
Les initiatives de l’administration fiscale, placée sous la responsabilité de M. Jérôme Cahuzac, ont suscité une attention toute particulière. Très rapidement, des mesures ont été prises, sous la forme de la désormais fameuse « muraille de Chine », afin que le ministre délégué soit tenu à l’écart de tout ce qui touchait, de près ou de loin, à l’affaire qui le concernait. Cette décision était heureuse à mon sens. Pendant cette période, l’administration fiscale a poursuivi l’examen de la situation fiscale des ministres et elle a adressé à M. Jérôme Cahuzac un formulaire l’interrogeant sur les comptes qu’il aurait pu détenir à l’étranger. D’après les informations que nous avons recueillies, le ministre de l’économie et des finances n’a pas été informé de cet envoi, ni de l’absence de réponse de son ministre délégué à ce formulaire. Même si cela peut paraître étonnant, il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement, puisqu’en application de la circulaire « Baroin », l’administration fiscale n’avait pas à rendre compte de cette démarche au ministre de l’économie et des finances.
D’aucuns ont tenté de démontrer que la Présidence de la République savait, dès les premiers jours qui ont suivi les révélations de Mediapart, que celles-ci étaient fondées. Il ne fait guère de doute que des informations sur l’enquête de Mediapart, provenant de personnes liées au journal en ligne, sont parvenues à la Présidence. Celle-ci a fait savoir qu’une démarche avait été entreprise par M. Michel Gonelle auprès du directeur de cabinet adjoint du Président de la République et qu’il avait été demandé à M. Gonelle de transmettre à la justice les éventuelles preuves en sa possession. Il ne faut pas perdre de vue que cet épisode semblait en totale contradiction avec les déclarations d’innocence répétées du principal intéressé et que M. Michel Gonelle s’était défendu, quelques jours plus tôt, d’avoir quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Dans ces conditions, j’estime que le Président de la République a fait ce qu’il convenait.
C’est à la suite d’un courrier du président de Mediapart au procureur de Paris que la justice a ouvert une enquête préliminaire.
Nos travaux ont montré que, malgré l’extrême sensibilité de l’affaire, ni la ministre de la justice, ni le ministre de l’intérieur ne s’étaient immiscés dans cette enquête ; ils se sont tenus informés de l’avancée des investigations, comme il convient pour toute affaire exposée médiatiquement. L’enquête préliminaire a débouché sur l’ouverture d’une information judiciaire, les expertises ayant conclu que la voix de l’enregistrement était probablement celle du ministre délégué.
Je salue le travail de la justice, en particulier celui du parquet de Paris – je pense que la Commission d’enquête est également unanime sur ce point. Le président du groupe UMP a beau prétendre que cela serait hors sujet, je me félicite que la justice ait pu agir sans entrave et sans retard, car cela n’a pas toujours été le cas dans le passé
– notamment récent – et il entrait dans notre mission de repérer d’éventuels dysfonctionnements au sein de la Chancellerie. L’examen des échanges de courriels entre le cabinet du ministre, la direction des affaires criminelles et des grâces, le procureur général et le procureur de la République nous a permis de conclure qu’il n’y en avait pas eu – toutes ces pièces figurent en annexe.
Une part importante de nos travaux a porté sur l’initiative prise par le ministre de l’économie et des finances d’interroger les autorités suisses quant au bien-fondé des révélations de Mediapart. Ce sujet faisant débat entre nous, j’ai essayé d’être le plus exhaustif possible et de ne cacher aucun point de vue, afin que tout le monde puisse se reconnaître au moins dans l’exposé des problèmes.
Des reproches contradictoires ont été formulés à l’encontre de cette demande de renseignements : certains estimaient qu’il n’aurait pas fallu la lancer, d’autres – ou parfois les mêmes – jugeaient que son champ aurait dû être plus large et qu’il avait été volontairement limité afin d’obtenir une réponse négative, favorable au ministre délégué.
D’autre part, nous avons eu des discussions au sujet de l’entrevue du 16 janvier à l’Élysée, en marge du Conseil des ministres, au cours de laquelle M. Jérôme Cahuzac a été informé du recours à la procédure de demande d’assistance administrative. N’avait-on pas à cette occasion donné un coup de canif à la muraille de Chine ?
J’estime que le ministre de l’économie et des finances a eu raison de mettre en œuvre cette procédure qui, bien que de maniement délicat, était le seul instrument dont il disposait pour tenter de confirmer ou d’infirmer les dires de la presse ; même si sa mise en œuvre en parallèle d’une enquête judiciaire était sans précédent, rien ne lui interdisait de le faire. À la date de son envoi, le champ de la demande adressée à la Suisse ne pouvait être plus large, sous peine d’être considérée comme non pertinente.
En revanche, je regrette que la direction générale des finances publiques (DGFiP) n’ait pas également adressé une demande de renseignements aux autorités de Singapour, alors que Mediapart affirmait que les avoirs du ministre délégué au budget y avaient été transférés. Il n’est pas certain que les informations alors disponibles auraient été suffisantes pour qu’un juge singapourien autorise la mise en œuvre de la procédure, mais le souci d’exhaustivité aurait dû conduire à utiliser cette possibilité. Je regrette que le président du groupe UMP n’ait pas tenu compte de cette partie du rapport.
La transmission par l’administration fiscale à la justice de la réponse négative des autorités suisses n’allait pas de soi, mais le document a finalement été intégré à la procédure, qui s’est poursuivie normalement ; on peut néanmoins reprocher à l’administration fiscale de n’avoir transmis la demande que postérieurement à la réponse, et non dès son envoi. Par contre, la tentative d’instrumentalisation de cette réponse par sa publication dans la presse est très choquante : nous ne sommes pas parvenus à savoir qui en était responsable, mais nous avons établi que M. Jérôme Cahuzac et ses conseils avaient été informés par les autorités suisses de la teneur de cette réponse.
Au vu de ces éléments, j’ai la conviction que, confrontés à une situation inédite et particulièrement délicate, les services de l’État et le Gouvernement ont agi dans le respect de la légalité. Il faut souligner que moins de deux mois et demi se sont écoulés entre le déclenchement de l’enquête préliminaire et la démission de M. Jérôme Cahuzac, provoquée par l’ouverture de l’information judiciaire.
En résumé, je considère qu’ont été constitutifs de dysfonctionnements le traitement du signalement effectué en 2001 auprès d’un inspecteur des impôts de la BII de Bordeaux et la décision de la DGFiP de ne pas transmettre immédiatement au procureur de Paris la demande d’entraide administrative adressée aux autorités suisses.
D’autre part, la communication à la presse du contenu de la réponse des autorités fiscales suisses alors qu’elle était couverte par le secret, même si elle ne concerne pas le fonctionnement des services de l’État, relève elle aussi du dysfonctionnement grave.
Nous restons partagés sur un sujet : le recours à la convention d’entraide administrative franco-suisse. Je considère toutefois que le débat ne porte pas sur un dysfonctionnement, mais sur l’opportunité d’une décision.
Enfin, depuis le 2 avril, le Gouvernement et le Parlement ne sont pas restés inactifs, bien au contraire : ils ont eu à cœur de faire en sorte qu’une telle affaire ne puisse plus se reproduire. Deux projets de loi ont été adoptés : l’un tendant à renforcer la transparence de la vie publique, l’autre visant à améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Ces textes ont été enrichis par des amendements qui se faisaient l’écho de nos travaux : ainsi des précisions apportées, sur proposition du président de Courson, à l’article donnant une existence législative à l’examen de la situation fiscale des ministres récemment nommés, ainsi que des mesures prises pour mieux articuler le travail de la justice et celui de l’administration fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Dans le domaine international aussi, des progrès ont été enregistrés : le Gouvernement a négocié une modification du droit franco-suisse applicable à l’échange de renseignements en matière fiscale, afin de lever certaines des conditions qui le restreignent ; Singapour vient de signer la convention multilatérale d’assistance mutuelle en matière fiscale de l’OCDE, ce qui devrait conduire à une simplification des procédures ; des discussions ont été amorcées, notamment avec les autorités suisses, en vue du passage à l’échange automatique d’informations.
Il reste beaucoup à faire, en particulier pour améliorer les échanges de renseignements entre les administrations fiscales. J’estime que la France devra continuer de jouer un rôle moteur dans ce domaine, notamment pour que soit mise en œuvre la déclaration faite le 18 juin 2013 par les chefs d’État et de gouvernement des États membres du G8.
M. le président Charles de Courson. Nous avons quelques points de divergences, le rapporteur et moi. Notre commission d’enquête avait pour objet de déterminer s’il y avait eu des dysfonctionnements dans la gestion de l’« affaire Cahuzac » et si oui, lesquels. Selon moi, il n’y eut aucun dysfonctionnement dans l’action de la justice, mais le Gouvernement n’y est pour rien.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Ah oui ?
M. le président Charles de Courson. Oui, ce n’est pas le Gouvernement qui a saisi la justice, mais M. Edwy Plenel ! Il n’y a eu de problème ni du côté du ministère de l’intérieur, ni du côté de la justice, dont l’indépendance a été respectée.
En revanche, j’ai relevé quatre dysfonctionnements.
Sur le premier dysfonctionnement, tout le monde semble d’accord : les services fiscaux n’ont pas traité avec diligence le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, ni en 2001, ni en 2008, pour des raisons qui sont expliquées dans le rapport. À cela s’ajoute l’incroyable audience accordée en octobre 2012 par M. Jérôme Cahuzac à M. Rémy Garnier : on a transmis au ministre un dossier dans lequel on ne l’avertissait pas que, dans un mémoire conservé dans les locaux même du ministère, cet inspecteur des impôts l’accusait de détenir un compte en Suisse – il faut dire que les directeurs généraux eux-mêmes ne semblaient pas au courant !
Deuxième dysfonctionnement : l’actuel directeur des finances publiques a très mal conseillé son ministre – ce qui n’exonère en rien ce dernier à qui il revient de décider en dernier ressort.
Tout d’abord, il ne l’informe ni de l’envoi à M. Cahuzac du formulaire n° 754, ni de la non-réponse de celui-ci au terme du délai d’un mois. Notre rapporteur estime que la circulaire « Baroin » ne lui permettait pas de le faire ; pourtant, le ministre ne se serait pas mêlé du dossier : le directeur général se serait contenté de lui transmettre une information cruciale !
Surtout, le directeur général des finances publiques n’a pas averti son ministre qu’une saisine de l’administration fiscale suisse posait plusieurs problèmes.
Il ne lui a dit ni que les services fiscaux n’avaient jamais saisi une administration fiscale étrangère après l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni qu’une réponse négative était hautement probable, vu que, dans le cadre de l’application de l’avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1996, on n’avait obtenu, en deux ans et demi, que six réponses considérées comme satisfaisantes sur 426 demandes. Il ne lui a pas signalé que la période d’interrogation de l’administration fiscale suisse était limitée à la période 2010-2012, sauf accord du contribuable concerné – alors que les informations existantes évoquaient le transfert, fin 2009, du compte vers Singapour. Il ne lui a pas dit non plus que l’administration fiscale suisse informait le contribuable concerné de l’existence d’une demande de renseignement et du contenu de sa réponse – laquelle devait au surplus être soumise au secret fiscal, alors que le maintien de celui-ci dans une telle affaire paraissait intenable. Il a soutenu qu’une saisine de l’administration fiscale de Singapour n’avait pas lieu d’être puisqu’il avait saisi l’administration fiscale suisse de l’existence d’un transfert, en omettant de préciser que si ce transfert avait eu lieu antérieurement à 2009 ou depuis une autre banque que l’UBS, une telle démarche serait utile. Enfin, il ne lui a pas proposé d’élargir la saisine à la banque Reyl, alors que le journal suisse Le Temps avait fait état d’une telle hypothèse dès le 12 décembre 2012.
Les deux autres dysfonctionnements graves sont apparus au sein de l’appareil gouvernemental.
Il est incontestable – et le rapporteur en a convenu – que le Président de la République avait été le mieux informé sur cette affaire, grâce à trois sources : deux amis et, à la suite de cette incroyable conversation téléphonique avec M. Michel Gonelle – dont nous n’avons toujours pas compris la motivation –, le préfet Zabulon. Ces trois sources auraient pu le faire arriver, dès la fin décembre, à la conclusion que les dénégations de M. Jérôme Cahuzac étaient douteuses – d’autant plus qu’il avait demandé le 5 décembre à ce dernier de lui fournir une attestation de non-détention de compte à l’UBS et que les choses traînaient en longueur. Pourquoi n’a-t-il rien fait ? Cette affaire n’aurait pas pris la dimension qu’on lui connaît, au détriment de l’ensemble de la classe politique, si le Président avait mis fin aux fonctions ministérielles de M. Jérôme Cahuzac afin qu’il assure sa défense !
Quant à la prétendue « muraille de Chine », parlons-en. C’est par l’intermédiaire d’une interview du Président publiée dans un livre qu’on a appris l’existence de la réunion du 16 janvier 2013 ! M. Pierre Moscovici a menti devant la Commission des finances quand il a affirmé, en avril dernier, que le Président n’avait joué aucun rôle dans cette affaire ; il a par la suite reconnu devant nous que cette réunion avait bien eu lieu.
Pour conclure, il me semble qu’on peut tirer trois leçons de cette affaire.
La première est qu’il est nécessaire, dans un souci de transparence financière, de mettre en place une autorité vraiment indépendante dotée de larges pouvoirs d’investigation et de sanction, lui permettant enquêter sur d’éventuels enrichissements anormaux des élus nationaux et des grands élus territoriaux. Une des conséquences positives de cette affaire fut l’adoption d’un texte qui, sans cela, n’aurait jamais vu le jour.
La seconde leçon est qu’il est impératif de lutter contre la fraude fiscale et qu’il convient de renforcer le contrôle fiscal sur les membres de l’exécutif, en particulier sur le ministre chargé des services fiscaux, qui devrait avoir un statut dérogatoire : on ne peut être à la fois juge et partie !
Il faudrait également renforcer les conventions de coopération fiscale, notamment avec la Suisse – autre point de divergence avec le rapporteur.
M. le rapporteur. C’est pourtant écrit dans le rapport !
M. le président Charles de Courson. Oui, mais en présentant l’avenant à la convention comme une « évolution positive » – ce qui est excessif, l’affaire Cahuzac ayant montré les limites de cet instrument. L’ambassadeur de Suisse en France soutient qu’il fallait s’en prendre moins à l’État qu’aux banques suisses – ce qui est partiellement exact : celles-ci n’ont cessé d’anticiper l’évolution de la réglementation pour s’adapter et mieux dissimuler les avoirs non-déclarés.
Troisième leçon : il est urgent de supprimer le monopole de la saisine de la justice pénale via la commission des infractions fiscales au ministère des finances en matière de fraude fiscale et d’établir une règle législative simple d’interdiction de la saisine d’une administration fiscale étrangère dès lors qu’une enquête préliminaire est ouverte. Nous avons essayé de mettre en pratique le premier point, mais, hélas !, notre amendement n’a pas été adopté. Quant au second, peut-être faudrait-il songer à présenter un texte en ce sens, après cette affaire si malheureuse pour la crédibilité de nos services fiscaux.
Voilà les observations que m’inspirent nos travaux.
M. Hervé Morin. À l’instar du président et du rapporteur, je prends acte que le Gouvernement a laissé la justice fonctionner. Tel n’a pas toujours été le cas dans l’histoire de la Ve République ! Les auditions ont montré que la garde des Sceaux s’est tenue informée de la procédure via le procureur général de Paris, mais qu’elle n’a en rien tenté de la contrôler ni de la verrouiller. C’est un élément de réelle satisfaction.
En revanche, je m’interroge sur l’inertie de l’exécutif. Certaines des personnes auditionnées ont tenu des propos surprenants : l’exécutif ne se serait jamais préoccupé de l’affaire. Soit c’est de la langue de bois, soit il a décidément fallu beaucoup de temps au nouveau gouvernement pour construire une relation avec l’administration ! Le directeur de cabinet du ministre de l’Économie et des finances dit n’avoir eu aucun échange avec le directeur général des Finances publiques, ce qui n’est guère crédible. Il est également étonnant que le ministre de l’Intérieur n’ait pas demandé d’enquête à la DCRI. Sans parler de l’inertie du Président de la République et du Premier ministre, qui n’ont pas demandé à M. Cahuzac de fournir des éléments prouvant qu’il ne détenait pas de compte en Suisse.
Cette inertie constitue selon moi un dysfonctionnement. L’exécutif semble avoir craint d’être accusé de chercher à contrôler le cours des choses. Pourtant, un ministre est chef de son administration. Il n’y aurait donc rien eu de choquant à ce que tel ou tel ministre ou son directeur de cabinet donnât des instructions précises, le cas échéant par écrit pour prévenir toute controverse. En particulier, le ministre de l’Économie et des finances aurait pu s’informer de l’état d’avancement des procédures fiscales ou demander à la DGFIP d’interroger Singapour. Le Gouvernement n’avait aucune raison de ne pas mobiliser les services de l’État pour tenter d’établir la vérité au plus vite.
Le rapporteur et la majorité sont dans leur rôle : ils cherchent à protéger l’exécutif. Il conviendrait pourtant de souligner son inertie face à cette affaire, qui a constitué un choc pour la République.
En adoptant la loi sur la transparence de la vie publique, qui permettra de mieux contrôler l’évolution du patrimoine des élus, nous venons de tirer un premier enseignement de cette affaire. Mais le Parlement devrait surtout inciter le Gouvernement à renégocier très rapidement la convention fiscale avec la Suisse. Le texte actuel ne permet pas à la France de lutter efficacement contre la fraude fiscale : le nombre de réponses exploitables de l’administration suisse – à peine supérieur à 1 % – est notoirement insuffisant.
M. le rapporteur. S’agissant de la convention fiscale franco-suisse, je suis disposé à ajouter dans le rapport une phrase allant dans votre sens, monsieur Morin. Un avenant à la convention a été signé en juillet dernier. Si la commission d’enquête en est d’accord, nous pouvons recommander qu’il soit ratifié rapidement par la France et par la Suisse.
M. le président Charles de Courson. Je vous suggère en outre, monsieur le rapporteur, de modifier l’un des sous-titres : au regard des résultats – seulement six réponses satisfaisantes de la Suisse pour 436 demandes adressées par la France –, on ne peut guère parler d’évolution « positive ». Avec Singapour, en revanche, la procédure d’entraide fiscale fonctionne : la France a reçu 25 réponses satisfaisantes sur 29 demandes.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je partage l’analyse de M. Morin, mais je n’en tire pas la même conclusion. Conformément à la tradition républicaine, l’administration – y compris les services fiscaux – est placée sous les ordres du pouvoir politique, qui la dirige. Je n’aurais donc pas été choquée, pour ma part, que l’exécutif cherchât à être mieux informé ou qu’il donnât davantage de directives à l’administration. Mais on peut comprendre aussi le souci d’installer une sorte de cordon sanitaire entre elle et lui.
Quoi qu’il en soit, une plus grande implication du pouvoir politique n’aurait sans doute rien changé. Compte tenu de la réaction rapide de l’administration – que le rapport a mise en lumière –, le pouvoir politique n’aurait guère pu la pousser à agir plus vite. Il n’aurait pu que freiner son action.
M. le président Charles de Courson. Pourtant, si le directeur général des finances publiques avait informé le ministre de l’économie et des finances que l’administration fiscale avait adressé le formulaire n° 754 à M. Cahuzac et que celui-ci n’y avait pas répondu dans le délai imparti d’un mois, cela aurait sans doute inquiété le ministre, et l’aurait conduit à interroger M. Cahuzac.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Certes, mais M. Cahuzac, avec l’art consommé du mensonge que nous lui connaissons désormais, aurait bien trouvé quelque chose à lui répondre. Et cela n’aurait probablement rien changé au résultat : les procédures engagées se seraient déroulées de la même manière.
D’autre part, je ne suis pas tout à fait d’accord avec le rapporteur lorsqu’il déplore – certes en termes modérés – que l’administration fiscale n’ait pas interrogé Singapour. Notre Commission d’enquête doit être prudente dans ses appréciations et les critères qu’elle fixe, notre travail ayant valeur de précédent. À partir de quel moment l’administration doit-elle agir ? Dès qu’une information est publiée dans la presse et quel que soit son degré de fiabilité ? Si l’administration fiscale a adressé une demande d’entraide fiscale à la Suisse, c’est qu’elle accordait un certain crédit aux révélations de Mediapart. Mais les allégations concernant un éventuel transfert du compte de M. Cahuzac à Singapour étaient beaucoup plus floues.
Dans l’affaire Clearstream, un organe de presse avait accusé plusieurs responsables politiques de premier plan de détenir des comptes bancaires secrets. Aurait-il fallu, dès lors, déclencher immédiatement des procédures administratives, d’une part, et saisir la justice, d’autre part ?
M. le président Charles de Courson. C’est bien ce qui a été fait : une plainte a été déposée.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Oui, mais dans quel délai ?
M. le président Charles de Courson. Si l’on suit votre raisonnement, il n’était guère plus justifié d’interroger la Suisse. Les informations concernant le transfert du compte à Singapour ont été publiées par le même organe de presse.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mais elles étaient moins précises, comme l’écrit le rapporteur.
M. le rapporteur. Je maintiens que l’administration fiscale aurait dû saisir Singapour. Au moment où elle a adressé la demande d’entraide fiscale à la Suisse, Singapour était mentionnée dans la presse au même titre qu’UBS. D’autre part, la convention fiscale entre la France et Singapour est moins contraignante que celle entre la France et la Suisse : elle n’oblige pas à préciser le nom des établissements bancaires en cause.
M. Sergio Coronado. En acceptant la constitution de notre Commission d’enquête à la demande de l’opposition, la majorité a fait preuve d’ouverture. C’est un changement de pratique par rapport aux législatures précédentes, qui va dans le sens d’un renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement et qui mérite, à ce titre, d’être souligné.
En outre, notre Commission a pu œuvrer en toute liberté et entendre les personnes de son choix, même s’il y a eu débat sur une éventuelle audition du Premier ministre. Enfin, le rapport reflète assez fidèlement les travaux de la Commission, et j’y souscris en grande partie : il n’y a pas eu – en dépit de certaines anomalies – de dysfonctionnement de l’administration, ni d’entrave à l’action de la justice.
Toutefois, à l’instar de M. Morin, je m’interroge sur l’attitude des plus hautes autorités de l’État : alors qu’un ministre de la République faisait l’objet d’accusations d’autant plus graves qu’il était lui-même chargé du budget, le Président de la République et le Premier ministre ont semblé considérer que cette affaire revêtait une dimension non pas politique, mais seulement administrative et judiciaire. C’est pourquoi le groupe écologiste a décidé de ne pas s’associer au vote du rapport.
M. Hugues Fourage. Il est bon en effet de le souligner, cette Commission d’enquête a été demandée par l’opposition. Et notre commission a bien travaillé, quels qu’aient pu être nos débats. La décision de ne pas auditionner le Premier ministre a fait l’objet d’un vote et n’a donc pas été prise à la légère.
Je salue, monsieur le président, monsieur le rapporteur, la qualité de votre travail respectif. Il n’était pas simple de réaliser un tel rapport, très attendu par les Français. Or, il a été rédigé avec pondération et finesse, ce qui ne l’empêche nullement de fixer des lignes de conduite.
Quant aux éventuels dysfonctionnements, même M. Morin l’a reconnu : le Gouvernement a laissé la justice fonctionner ; il n’a tenté à aucun moment de verrouiller la procédure. C’est là le point essentiel.
Enfin, en ce qui concerne l’« inertie » de l’exécutif, je ne partage pas l’avis de MM. Morin et Coronado. Lorsqu’on exerce de hautes responsabilités, les choses ne sont pas si évidentes.
Le Président de la République a indiqué très clairement que les éventuels éléments concernant M. Cahuzac devaient être transmis à la justice et qu’il appartenait à celle-ci de trancher. Quel qu’ait pu être son degré d’information, il a scrupuleusement respecté la séparation des pouvoirs. Toute autre manière d’agir aurait constitué un dysfonctionnement. En outre, la présomption d’innocence doit s’appliquer tant que la preuve de la culpabilité n’a pas été faite. Il est arrivé que des ministres soient contraints de démissionner à la suite d’une allégation, avant d’être finalement disculpés. L’exécutif a pris en compte l’ensemble de ces principes.
Mme Cécile Untermaier. Je vous remercie, monsieur le président, de la manière dont vous avez conduit les débats et vous, monsieur le rapporteur, pour la qualité du rapport : il est exhaustif et précis ; il aborde les problèmes délicats et y apporte des réponses.
Je ne partage pas vos réserves, monsieur le président. S’il y a bien eu dysfonctionnement au sein des services fiscaux d’Aquitaine – qui n’ont pas transmis une information sensible à leur autorité hiérarchique –, ce constat sort du champ de notre Commission d’enquête. S’agissant de l’attitude du directeur général des finances publiques, elle tient sans doute à sa personnalité et à la manière dont il concevait son rôle dans le cadre fixé par la « muraille de Chine ». Quant à la mention de la banque Reyl dans la demande d’entraide administrative adressée à la Suisse, elle n’était guère envisageable, Mediapart n’ayant pas encore évoqué ladite banque à l’époque.
Enfin, gardons-nous de réécrire l’histoire et souvenons-nous du contexte : nous étions tous persuadés que M. Cahuzac ne détenait pas de compte en Suisse.
M. le président Charles de Courson. Pas moi, vous le savez.
Mme Cécile Untermaier. Jamais nous n’avions été témoins d’un tel parjure devant la représentation nationale. Et M. Cahuzac – il l’a dit lui-même – s’était montré convaincant avec le Président de la République et le Premier ministre.
Quoi qu’il en soit, le Président de la République a rompu avec les pratiques du passé et nous a montré la voie à suivre : il convient de se garder de toute ingérence dans un sens ou dans un autre. Telle est la leçon que l’on peut tirer de cette Commission d’enquête. Prétendre qu’il aurait fallu inciter la justice à agir dans ce cas, c’est dire aussi qu’on pourrait la dissuader d’agir dans d’autres.
En revanche, je souscris à vos préconisations concernant la convention fiscale franco-suisse, monsieur le président : nous devons améliorer l’efficacité de la procédure d’échange de renseignements entre les deux pays.
La Commission d’enquête adopte le rapport.
Contribution du Groupe UDI
Comme le Président de la Commission d’enquête l'a souligné dans son avant-propos, l'objet de cette Commission d'enquête était de substituer la vérité à la rumeur, dans le traitement par le Gouvernement et les services de l'Etat de l'affaire dite "CAHUZAC".
C'est dans cet esprit que le Président du Groupe UDI, a déposé la proposition de résolution qui a permis, par un vote à l’unanimité, la création de la Commission d'enquête. La commission devait répondre à deux questions fondamentales : de quelles informations disposaient dans cette affaire les services de l’Etat et l’Exécutif, y compris le Président de la République ? Les décisions prises par l’Exécutif ou les Directeurs d’administrations centrales étaient-elles adaptées ?
L'actuelle majorité s'est honorée en votant avec l’opposition en faveur de la création d'une Commission d’enquête parlementaire sur cet évènement dramatique, mettant en cause l’image de l’ensemble de la classe politique. Cependant, de graves dysfonctionnements sont apparus dans l'appareil gouvernemental ainsi que dans les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
I- De sérieux dysfonctionnements dans les services du Ministère de l’Economie et des Finances
S'il n'y a pas eu de dysfonctionnements des services des Ministères de l'Intérieur et de la Justice, dont l'indépendance a été respectée dans cette affaire, il n'en demeure pas moins qu'au sein du Ministère de l'Economie, non seulement le Directeur général des finances publiques n'a pas correctement informé et conseillé le Ministre de l’Economie, mais les services de la DGFIP ont également connu de graves dysfonctionnements.
A) Les services fiscaux n’ont pas traité avec diligence le dossier fiscal de Jérôme CAHUZAC
Tout d'abord, Christian MANGIER, inspecteur à la brigade interrégionale d’intervention de Bordeaux (BII), qui avait bénéficié d’une information, en 2001, quant à la détention par Jérôme CAHUZAC d’un compte non déclaré à l’UBS, via un de ses anciens collègues, lui aussi inspecteur des impôts, lui-même directement informé par Michel GONELLE, n’a pas avisé ses supérieurs hiérarchiques de cette information, ni du fait qu’il avait demandé et obtenu le transfert du dossier fiscal de Jérôme CAHUZAC, pendant 7 ans et jusqu’en 2007, sans que personne ne s’en inquiète dans les services fiscaux à Paris.
En second lieu, il est pour le moins étonnant que le mémoire en défense du 11 juin 2008 de l’inspecteur des impôts, Rémy GARNIER, dans lequel figurait l’accusation de la détention d’un compte non déclaré à l’UBS de Genève par Jérôme CAHUZAC, information obtenue par la même source et confirmée à l’intéressé par Michel GONELLE, qui était devenu son conseil, n’ait pas été porté à la connaissance des deux directeurs généraux successifs des finances publiques, entre 2008 et 2013, alors que ce document existait au sein de cette direction.
En troisième lieu, alors que le Ministre du Budget Jérôme CAHUZAC avait rencontré en octobre 2012 dans sa mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT, l’inspecteur Rémy GARNIER, la DGFIP ne lui avait fourni aucune information sur le contenu des accusations graves portées par ce dernier à son égard dans son mémoire du 11 juin 2008.
B) L’actuel Directeur des finances publiques a mal conseillé son Ministre
Plusieurs critiques peuvent être adressées à l’actuel Directeur général des finances publiques, qui le concernent personnellement, et non aux fonctionnaires de la DGFIP qui ont répondu très précisément aux questions de la commission d’enquête.
Tout d’abord, ce dernier n’a informé le Ministre de l’Economie Pierre MOSCOVICI ni de la saisine le 15 décembre 2012 de son collègue du Budget du formulaire 754, dans lequel ce dernier devait préciser tous les actifs détenus en France ou à l’étranger, ni de sa non-réponse un mois plus tard, alors même que la décision de saisir l’administration fiscale suisse n’était pas prise. Or l’envoi de ce formulaire constituait un préalable au lancement de la procédure de demande d’entraide, prouvant l’épuisement des voies de recours interne.
En second lieu, le Directeur général des finances publiques qui avait conseillé au Ministre de l’Economie de saisir l’administration fiscale Suisse, ce qui fut fait le 24 janvier 2013, n’a pas informé ce dernier :
– que jamais les services fiscaux n’avaient saisi une administration fiscale étrangère après l’ouverture d’une enquête préliminaire par la Justice pour éviter d’éventuelles contradictions ;
– que la probabilité d’une réponse négative était très élevée puisque les mécanismes de dissimulations des comptes sont très sophistiqués, et que le taux de réponses satisfaisantes était très faible dans le cadre de l’avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 (6 sur 426 demandes entre 2011 et avril 2013) ;
– que la période d’interrogation de l’administration fiscale suisse était limitée à la période 2010-2012, sauf accord du contribuable concerné pour élargir la période, alors que les informations existantes évoquaient le transfert, fin 2009, de son compte Suisse vers Singapour ;
– que l’administration fiscale suisse informe le contribuable concerné par une demande de renseignement, de l’existence de cette demande et du contenu de sa réponse, réponse au surplus soumise au secret fiscal ; que le maintien du secret fiscal dans une telle affaire n’était pas crédible ;
– qu’il ne proposait pas au Ministre la saisine de l’administration fiscale de Singapour alors que des informations existaient selon lesquelles Jérôme CAHUZAC avait transféré fin 2009 son compte à SINGAPOUR, et que la coopération fiscale franco-singapourienne est efficace : entre 2011 et juillet 2013, 25 réponses jugées satisfaisantes par l’administration fiscale française sur 29 demandes ;
– qu’il ne proposait pas l’élargissement de la saisine à la banque REYL alors que le journal suisse « le Temps » avait fait état, dès le 12 décembre 2012, des liens existants entre cet établissement et le gestionnaire de fortune en Suisse de Jérôme CAHUZAC, Hervé DREYFUS. Il est à noter que l’élargissement de la saisine n’avait d’intérêt que si la période sous revue avait été élargie à la période de 2006-2009, ce qui supposait l’accord de Jérôme CAHUZAC !
La multiplication des dysfonctionnements du fait du Directeur général des finances publiques pourrait s’expliquer par le caractère récent de sa nomination, le 12 août 2012, dans cette fonction, mais surtout par sa carrière antérieure dans des fonctions tout à fait étrangères à l’administration fiscale.
II- Des dysfonctionnements graves au sein de l’appareil gouvernemental
A) Alors qu’il disposait, dès le mois de décembre 2012, d’informations mettant en doute les affirmations répétées d’innocence de Jérôme CAHUZAC, le Président de la République n’a pas mis fin à ses fonctions ministérielles
Dès le 5 décembre 2012, le lendemain de la publication par MEDIAPART de l’accusation de détention, en Suisse, par Jérôme CAHUZAC d’un compte non déclaré, le Président de la République a demandé à ce dernier, à l’issue du Conseil des Ministres et en présence du Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT, d’obtenir de la banque UBS une attestation de non-détention d’un compte dans l’établissement. Ce dernier a essayé d’obtenir ce document, via ses avocats en Suisse, mais l’UBS a refusé de le lui délivrer. Cependant, Jérôme CAHUZAC s’est bien gardé d’en informer le Président et le Premier Ministre, et a continué à faire croire qu’il négociait l’obtention de ce document.
Le commencement des doutes du Président de la République n’a pu qu’être accentué par trois sources d’informations réunies :
– la première source est celle de Jean-Pierre MIGNARD, avocat de MEDIAPART et ami personnel du Président qui, d’après les déclarations d’Edwy PLENEL, aurait informé l’entourage présidentiel voire, le Président en personne, aux environs du 4 décembre, des graves indices qui pesaient quant à la véracité des affirmations concernant Jérôme CAHUZAC ;
– la seconde source est celle du Directeur adjoint de cabinet du Président, le Préfet Alain ZABULON, qui l’a informé dès le 15 décembre 2012, que Michel GONELLE l’avait contacté pour lui remettre une lettre dans laquelle il prétendait détenir l’original de l’enregistrement de la conversation de fin 2000, dans laquelle Jérôme CAHUZAC reconnaissait détenir un compte à l’UBS à Genève. L’ordre donné par le Président à Alain ZABULON d’indiquer à Michel GONELLE qu’il saisisse la justice n’était pas opérationnel car, à cette date, il n’y avait pas d’enquête préliminaire ouverte (elle le sera le 8 janvier 2013) ;
– La troisième source est celle d’Edwy PLENEL lui-même, qui a informé, le 18 décembre 2012, l’entourage du Président, voire le Président en personne, ainsi que l’entourage du Premier Ministre, de l’existence de preuves ou de faisceau d’indices de la détention d’un compte en Suisse par Jérôme CAHUZAC.
La question est donc de savoir pourquoi le Président n’a pas mis fin aux fonctions ministérielles de Jérôme CAHUZAC pour protéger le Gouvernement. Les travaux de la Commission n’ont pas permis de répondre à cette question.
B) La muraille de Chine n’était qu’un paravent
La prétendue « muraille de Chine » créée le 10 décembre 2012 par la décision du Ministre du Budget de ne plus s’occuper de son dossier fiscal s’est effondrée du fait de la participation de Jérôme CAHUZAC à la réunion du 16 janvier 2013, à l’issue du Conseil des Ministres, en présence de Jérôme CAHUZAC, du Président de la République, du Premier Ministre, et du Ministre de l’Economie.
Tout d’abord, c’est le Président de la République en personne qui a donné son accord au lancement de la procédure de demande d’entraide fiscale avec la Suisse, alors que le Ministre de l’Economie avait déclaré devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le 17 avril 2013, soit sept jours avant le vote relatif à la création de la Commission d’enquête, que le Président n’était pas intervenu dans cette affaire.
En second lieu, d’après les déclarations du Ministre de l’Economie, c’est sur la suggestion de Jérôme CAHUZAC que la saisine de l’administration fiscale suisse a été étendue à la période 2006-2009, ce qui montre bien son implication dans la décision et la volonté de Jérôme CAHUZAC de tromper ses collègues puisqu’il avait transféré, semble-t-il, en novembre 2009, son compte suisse à Singapour, comme en témoigne la date de ses billets de train Paris-Genève, qui avaient été pris au service des transports de l’Assemblée nationale.
*******
En conclusion, dans l’affaire CAHUZAC, des dysfonctionnements importants sont apparus, non seulement dans les services fiscaux déconcentrés d’Aquitaine mais également dans les services centraux du fait du comportement du Directeur général des finances publiques, mais également, et c’est là le plus grave, dans l’appareil gouvernemental tout à la fois au sommet de l’Etat et à la tête du Ministère de l’Economie.
Par-delà, les dysfonctionnements constatés dans l’affaire CAHUZAC, certaines leçons peuvent en être tirées.
La première relève de la transparence financière de la vie publique et de la nécessité de doter une autorité vraiment indépendante de larges pouvoirs d’investigation et de sanction, quant à d’éventuels enrichissements anormaux des élus nationaux et des grands élus locaux.
La seconde leçon relève de la lutte contre la fraude fiscale et de la nécessité d’un contrôle fiscal renforcé sur les membres de l’exécutif et en particulier sur le Ministre en charge des services fiscaux. Le renforcement des conventions de coopération fiscale avec les pays servant de refuge aux capitaux doit faire l’objet d’un examen approfondi.
La troisième leçon relève de l’urgence de supprimer le monopole de la saisine de la Justice pénale via la Commission des infractions fiscales au Ministère des finances en matière de fraude fiscale, et d’établir une règle législative simple d’interdiction de la saisine d’une administration fiscale étrangère lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte.
Contribution de Jean-Pierre GORGES (Député UMP d’Eure-et-Loir)
La Commission d’enquête n’a pas mis au jour d’informations sur un dysfonctionnement des services de l’Etat, dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». La Commission a quand même ressenti chez les hauts fonctionnaires auditionnés le poids d’une certaine omerta, qui se traduisait souvent par des absences de mémoire du genre, « je ne me souviens pas ».
L’information nouvelle est venue de Pierre Moscovici quand il a révélé l’existence d’une réunion tenue à l’Elysée le 16 janvier 2013, à l’issue du Conseil des Ministres, avec, autour du Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget, alors Jérôme Cahuzac.
Cette réunion a eu pour objectif de déclencher la demande d’entraide administrative auprès des autorités suisses, en présence du principal intéressé. C’est une rupture manifeste de la ligne soutenue jusqu’alors par le Directeur adjoint du Cabinet de François Hollande. Monsieur Zabulon avait rendu compte au Président de la République des informations livrées par Monsieur Gonelle et il avait transmis à ce dernier le conseil donné par le Président de la République : saisir la Justice.
La réunion du 16 janvier a donc révélé la connaissance par le Ministre du Budget des démarches entreprises par les responsables de l’Etat afin de démêler l’affaire dont il était le principal protagoniste. Plus de « muraille de Chine », mais au contraire une association étroite de Jérôme Cahuzac à la procédure en cours, son dimensionnement et sa chronologie.
On peut donc déplorer infiniment que la majorité socialiste de la Commission d’enquête ait refusé de faire auditionner le Premier Ministre, lequel aurait pu et du apporter des éléments d’informations supplémentaires.
Les travaux de la Commission d’enquête ont également été gênés par le chevauchement de ses travaux avec ceux de l’enquête judiciaire. Trop souvent, cette dernière a servi de prétexte à certains auditionnés, qui refusaient d’en dire davantage, « réservant leurs informations à la Justice ».
La Commission d’enquête reste donc sur sa faim, certaines questions, et des plus troublantes, restant à ce jour sans réponse.
La première porte sur l’origine des fonds collectés par Jérôme Cahuzac. L’ancien Conseiller de Claude Evin a manifestement placé en Suisse des sommes provenant de laboratoires pharmaceutiques.
Comment et pourquoi ces fonds sont-ils restés si longtemps hors circuit ?
Deuxièmement, qui a informé Médiapart, et pour quelles motivations ?
Troisièmement, à quoi a servi tout cet argent pendant la période où il a été dissimulé ?
En Suisse, puis à Singapour, puis peut-être ailleurs ?
Ces questions sans réponse alimentent des rumeurs nuisibles au climat public. Certaines vont jusqu’à laisser entendre que tout ou partie de ces fonds auraient pu servir à la campagne présidentielle du Parti Socialiste…
Il est donc nécessaire que l’enquête judiciaire puisse démonter le processus complet de l’affaire, en amont comme en aval.
Sinon, il restera à l’Assemblée Nationale à provoquer la création d’une nouvelle Commission d’enquête, aux pouvoirs élargis (dans le temps, en amont comme en aval), pour être capable de mettre au jour l’ensemble de l’affaire Cahuzac.
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique de séances tenues par la commission d’enquête (toutes les auditions ont donné lieu à un compte-rendu public, à l’exception de celle de M. Patrick Calvar, directeur central du renseignement intérieur, le 11 juin 2013 qui s’est tenue sous le régime du secret).
SOMMAIRE DES AUDITIONS
______
Pages
Auditions du 21 mai 2013
À 8 heures 45 : MM. Edwy Plenel, président de Mediapart, et Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. 121
À 16 heures 30 : M. Michel Gonelle, avocat 148
À 18 heures 30 : Mme Amélie Verdier, directrice du cabinet de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, MM. Guillaume Robert, directeur-adjoint du cabinet, et Frédéric Bredillot, conseiller spécial chargé de la fiscalité 171
Auditions du 28 mai 2013
À 8 heures 45 : MM. Rémy Rioux, directeur du cabinet, Jean Maïa, conseiller juridique, et Mme Irène Grenet, conseillère en charge de la politique fiscale, au cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances 192
À 10 heures 30 : M. Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, accompagné de MM. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, et Gradzig El Karoui, chef de la mission affaires fiscales et pénales 213
À 16 heures 15 : M. Philippe Parini, directeur régional des finances publiques Île-de-France et Paris (DRFIP), Mme Janine Pécha, administratrice générale des finances publiques, responsable du pôle fiscal Paris sud-ouest, MM. André Bonnal, administrateur des finances publiques, adjoint de la responsable, et Pascal Pavy, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de division 236
À 18 heures : Mme Véronique Bied Charreton, directrice de la législation fiscale, accompagnée de M. Pierre-Olivier Pollet, administrateur des finances publiques au bureau E1 250
Auditions du 4 juin 2013
À 8 heures 45 : M. Alexandre Gardette, chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques 259
À 16 heures 30 : MM. Olivier Sivieude, directeur des vérifications nationales et internationales (DVNI), et Bernard Salvat, ancien directeur national des enquêtes fiscales (DNEF), et Mme Maïté Gabet, directrice nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) 279
À 17 heures 30 : M. Thierry Picart, chef du bureau D 3 de lutte contre la fraude à la direction générale des douanes et des droits indirects 290
À 18 heures 30 : Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, et M. Jérôme Fournel, inspecteur général des finances, ancien directeur général des douanes et des droits indirects 299
Audition du 5 juin 2013
À 16 heures 45 : Mme Marie-Hélène Valente, sous-préfète, ancien chef de cabinet du ministre délégué chargé du budget 307
Audition du 11 juin 2013
À 8 heures 45 : Mme Christine Dufau, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF), et M. Éric Arella, contrôleur général de police à la sous-direction de la police technique et scientifique (SDPTS) 318
Auditions du 12 juin 2013
À 16 heures 30 : M. François Falletti, procureur général de Paris 328
À 18 heures : M. Rémy Garnier, inspecteur des impôts à la retraite 339
Auditions du 18 juin 2013
À 8 heures 45 : M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président
de la République 365
À 16 heures 30 : MM. Laurent Habert, inspecteur principal, chef de la brigade d’intervention interrégionale d’Orléans, Olivier André, administrateur des finances publiques, pilote d’accompagnement du changement à la délégation Ouest de la DGFiP, et Patrick Richard, contrôleur des finances publiques à la retraite 385
Auditions du 19 juin 2013
À 14 heures : M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire 396
À 16 heures 30 : M. François Molins, procureur de Paris 421
Audition du 26 juin 2013
À 16 heures 30 : M. Jérôme Cahuzac 434
Audition du 2 juillet 2013
À 8 heures 45 : MM. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, et Christian Hirsoil, sous-directeur de l’information générale 460
Auditions du 3 juillet 2013
À 14 heures : M. Pierre Condamin-Gerbier, gestionnaire de fortune, ancien associé-gérant de Reyl Private Office. 466
À 16 heures 30 : M. Jean-Noël Catuhe, inspecteur des impôts à la retraite 483
Auditions du 9 juillet 2013
À 9 heures : Mme Marie-Christine Lepetit, chef du service de l'inspection générale des finances, ancienne directrice de la législation fiscale 502
À 10 heures : M. Michel Gonelle, avocat 514
À 17 heures : Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces 536
Auditions du 16 juillet 2013
À 11 heures : Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux 546
À 17 heures : M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur 563
À 18 heures 15 : M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances 579
Auditions du 17 juillet 2013
À 14 heures 30 : M. Gérard Paqueron, ancien mandataire financier de M. Jean‑Louis Bruguière 613
À 15 heures 30 : M. Stéphane Fouks, président de Havas Worldwide France 624
Auditions du 23 juillet 2013
À 9 heures 30 : Mme Marion Bougeard, conseillère pour la communication et les relations extérieures au cabinet de M. Jérôme Cahuzac 636
À 16 heures 45 : M. Jérôme Cahuzac 649
Auditions du 24 juillet 2013
À 14 heures 30 : MM. Alain Letellier et Florent Pedebas, détectives privés 679
À 16 heures 30 : M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire 704
Audition du mardi 21 mai 2013
À 8 heures 45 : MM. Edwy Plenel, président de Mediapart, et Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie, messieurs, de vous être rendus rapidement disponibles pour cette toute première audition de la commission d’enquête. C’est l’enquête que vous avez conduite, monsieur Arfi, et les articles qui ont été publiés par le journal d’information numérique Mediapart, qui ont révélé la détention, par celui qui était alors ministre délégué au budget, d’un compte bancaire non déclaré à l’étranger.
Il n’est évidemment pas question de vous demander de dévoiler vos sources – d’une part parce que nous respectons le principe de leur secret, et d’autre part parce que ce n’est pas l’objet des travaux de cette commission d’enquête. Elle vise à faire toute la lumière sur les informations dont auraient pu disposer les membres du Gouvernement et les services de l’État quant à la détention par Jérôme Cahuzac d’un compte non déclaré, et à quelles dates, ainsi que sur les initiatives qu’ils auraient pu prendre pour obtenir des informations sur ce point, ou faire en sorte que les informations existantes ne soient pas divulguées, voire pour chercher à détourner les soupçons.
Monsieur Plenel, vous êtes le président et le directeur de Mediapart, dont vous êtes aussi le fondateur. Monsieur Fabrice Arfi, vous travaillez depuis 2008 comme journaliste, chargé des enquêtes, pour ce journal numérique. Votre témoignage nous sera précieux.
Cette audition est ouverte à la presse. Elle fait l’objet d’un enregistrement et d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Je vous rappelle que la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui en sera fait. Ce compte rendu vous sera préalablement communiqué, et les observations que vous pourriez faire seront soumises à la Commission qui pourra également décider d’en faire état dans son rapport.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatives aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Plenel et Arfi prêtent serment.)
M. Edwy Plenel, président de Mediapart. Nous avons déféré à votre convocation d’autant plus volontiers, monsieur le président, que c’est pour nous une obligation. Nous venons devant vous comme journalistes avec nos règles professionnelles, que sont la vérité des faits et la rigueur mais nous avons aussi une responsabilité démocratique.
Votre commission s’interroge sur un mensonge, qui a couvert une fraude qui portait gravement atteinte au crédit de l’État, du Gouvernement, de l’administration. Dans un texte provoqué par le choc des révélations des « Documents du Pentagone » à propos de la guerre du Viêtnam, Du mensonge en politique, la philosophe Hannah Arendt expliquait l’importance considérable de la mission d’une « presse libre et non corrompue », au service du « droit à une information véridique et non manipulée, sans quoi la liberté d’opinion n’est plus qu’une cruelle mystification ». Telle est la ligne de Mediapart : apporter des informations d’intérêt public aux citoyens, afin qu’ils soient libres et autonomes. Notre première obligation est à l’égard des citoyens. Notre première rigueur est le respect de la vérité. Notre première discipline est la vérification.
La seule limite de notre témoignage sera, vous l’avez dit, le respect du secret des sources, qui protège les citoyens eux-mêmes, ces lanceurs d’alerte qui permettent que des vérités parfois dérangeantes soient mises au jour.
Par un heureux hasard de dates, Mediapart a rassemblé dans un livre, L’Affaire Cahuzac en bloc et en détail, l’ensemble des quatre mois d’enquête de Fabrice Arfi et des presque quatre mois durant lesquels il a fallu défendre cette enquête afin que la vérité soit enfin reconnue.
M. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Je vais essayer de raconter l’enquête de Mediapart, avant et après l’article initial du 4 décembre.
L’enquête est née de l’affaire Bettencourt, que nous avons révélée en juin 2010, et des questions engendrées à ce moment-là par la clémence, la pudeur, voire la complaisance dont faisait preuve à l’égard de M. Éric Woerth, alors ministre du budget et mis en cause dans cette affaire, celui qui était alors président socialiste de la commission des finances de l’époque : Jérôme Cahuzac. Ainsi, le 20 juin 2010, M. Cahuzac disait au micro de Radio Judaïca : « Il n’y a pas d’affaire Bettencourt. Woerth est un honnête homme. »
Deux ans plus tard, l’un des premiers actes de M. Cahuzac – devenu ministre du budget dans la période de crise, d’austérité, de chômage que nous connaissons – est de commander à un ami, Philippe Terneyre, professeur à l’université de Pau, un rapport d’une quinzaine de pages dont la moitié concernaient le sujet : l’affaire de l’hippodrome de Compiègne, à laquelle M. Woerth est partie prenante. Ce rapport, qui a blanchi Éric Woerth, a été fait à l’aveugle – le professeur Terneyre ne disposait d’aucune pièce du dossier – alors que les trois experts de la Cour de justice de la République, qui enquêtaient depuis des mois, avaient rendu un rapport autrement plus consistant de 155 pages et accablant pour M. Woerth. C’est de ces relations étranges entre deux ministres du budget, l’un ancien et l’autre en exercice, que part l’enquête de Mediapart, au mois de juillet 2012.
J’assume parfaitement que, dans mon métier, il faut parfois avoir l’esprit mal tourné. Quand on a vu juste, on parle d’intuition ; quand on se trompe, on parle d’a priori. À Mediapart, nous avons créé les conditions de notre obsession : le journalisme, y compris quand il doit déranger. J’ai donc eu du temps pour le « perdre », pour enquêter sur M. Cahuzac, sur ses réseaux, son passé, ses activités professionnelles, son travail de parlementaire, ses liens avec l’industrie pharmaceutique… De fil en aiguille, j’ai pu découvrir le compte suisse de M. Cahuzac.
La découverte du compte s’est appuyée sur un élément dont on a beaucoup parlé : l’enregistrement, qui montrait que celui qui parlait le mieux du compte suisse de Jérôme Cahuzac était encore Cahuzac Jérôme – un enregistrement que beaucoup, pendant de longues semaines, n’ont pas voulu entendre. Lorsque nous avons publié notre article, nous en savions bien sûr tout : qui le détenait et quelles étaient les circonstances tout à fait rocambolesques de son obtention.
Au cours de mon enquête, j’ai aussi pu avoir accès à un mémoire d’un agent du fisc, que l’on a voulu pendant de longues semaines décrédibiliser : Rémy Garnier, qui était pourtant l’un des inspecteurs du fisc les mieux notés de France lorsqu’il travaillait dans le Lot-et-Garonne. Dans un mémoire du 11 juin 2008, adressé à Éric Woerth, il écrivait avoir reçu de deux aviseurs extérieurs à l’administration fiscale des informations selon lesquelles M. Cahuzac détenait un compte caché à l’étranger. Il écrivait avoir consulté le dossier fiscal de M. Cahuzac, mais ne pas disposer des moyens de confirmer ou d’infirmer cette information. Il demandait donc une enquête fiscale approfondie afin d’établir la vérité des faits. Cette enquête – l’administration fiscale est alors sous l’autorité de M. Woerth – lui a été refusée.
Dans une enquête journalistique, il y a toujours des sources, que nous devons protéger. Nous ne le faisons pas par corporatisme ou pour faire n’importe quoi : ce ne sont pas les journalistes que sert la protection des sources, mais bien les sources elles-mêmes, c’est-à-dire les citoyens qui décident un jour d’alerter la presse. À nous ensuite, une fois vérifiées les informations, d’en assumer les conséquences, y compris judiciaires le cas échéant.
J’ai rarement eu autant de sources pour recouper une information. Elles étaient bancaires, financières, liées aux services de renseignement, dans les entourages de la personne concernée, fiscales et politiques.
Le 4 décembre 2012, nous publions donc un article intitulé « Le compte suisse de Jérôme Cahuzac ».
Nous avons ensuite poursuivi notre enquête pendant de longs mois, dans un climat de défiance médiatique à l’égard de Mediapart tout à fait étonnant, voire extravagant. Je comprends que l’on soit prudent – personne ne peut s’emparer sans précaution d’une information comme celle-là, mais que nous soyons devenus les accusés numéro un de notre propre enquête, et considérés par des hommes politiques ou par certains de mes confrères comme des « procureurs au petit pied », comme des « journalistes de bûcher », comme un « danger pour la démocratie », c’est stupéfiant, et révélateur d’un déficit culturel vis-à-vis d’un journalisme qui crée parfois de l’intranquillité !
Je vais maintenant me livrer à un récit chronologique factuel.
Le 5 décembre, Mediapart publie un article intitulé « L’aveu enregistré », révélation de l’enregistrement dans lequel M. Cahuzac s’inquiète, à la fin du mois de décembre 2000, de l’existence de son compte à l’UBS. Nous avions authentifié la voix grâce à des personnes appartenant à l’entourage de l’intéressé. De plus, la personne qui parlait envisageait de devenir maire, or Jérôme Cahuzac est bien devenu maire de Villeneuve-sur-Lot en 2001.
Le 6 décembre, le ministre du budget annonce le dépôt d’une plainte en diffamation contre Mediapart, sur le fondement de l’alinéa 1er bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c’est-à-dire en tant que membre du Gouvernement diffamé, ce qui oblige légalement la garde des sceaux à mettre en branle l’action publique. Une enquête est donc ouverte. Curieusement, la plainte ne vise que l’article du 4 décembre et pas celui du 5, qui révèle l’enregistrement. Celui-ci ne sera d’ailleurs jamais contesté en justice par le ministre du budget.
La semaine suivante, une autre plainte sera déposée par M. Cahuzac, cette fois avec constitution de partie civile, ce qui provoque la désignation d’un juge d’instruction et allonge considérablement le temps d’enquête. La perspective d’un procès est donc repoussée, alors que la première plainte aurait sans doute débouché sur un procès quelques semaines plus tard. J’ai tendance à penser que M. Cahuzac ne voulait pas de procès public sur nos informations.
Le 11 décembre, Mediapart publie son troisième article de révélations sur cette affaire : il porte sur M. Hervé Dreyfus, que nous avons appelé « L’homme qui sait tout », puisqu’il est le gestionnaire de fortune de M. Cahuzac. Paradoxalement, je crois que Jérôme Cahuzac n’est pas le personnage principal de l’affaire qui porte son nom. C’est dans cet article que nous parlons pour la première fois non seulement d’Hervé Dreyfus, mais de la société pour laquelle il travaille : Reyl & Cie, qui a permis la dissimulation fiscale des avoirs de M. Cahuzac – et d’autres fortunes françaises. Nous abordions également dans cet article les ramifications de Reyl, jusqu’à Singapour.
Ce jour-là, il s’est passé plusieurs choses que nous n’apprendrons que plus tard : d’une part, un avocat suisse, Edmond Tavernier, qui fut également l’avocat de Mme Bettencourt, fait une demande étrange, et anonyme, à l’UBS : si la question lui était posée, la banque pourrait-elle lever le secret bancaire et donner une sorte de brevet de moralité fiscale à Jérôme Cahuzac ? La réponse de l’UBS est positive : il existe une manière de formuler cette question pour obtenir réponse. Mais contrairement à ce qu’il a annoncé publiquement, Jérôme Cahuzac n’a jamais formulé cette demande. Il suffisait pourtant d’un papier blanc et d’un stylo. L’UBS aurait alors répondu qu’il existait bien, depuis 1992, un compte au nom de M. Cahuzac.
D’autre part, ce même 11 décembre, à 15 heures 18 exactement, la chef de cabinet de M. Cahuzac, Marie-Hélène Valente, adresse à M. Cahuzac ainsi qu’à M. Yannick Lemarchand, également membre du cabinet, un courrier électronique dont l’objet est « Pour vous détendre un peu ». En voici le texte : « Je viens d’être appelée par le dir’cab’ du préfet pour me raconter la chose suivante : vendredi soir, se trouvant au tribunal à Agen, Gonelle [Michel Gonelle, détenteur de l’enregistrement], en panne de portable, emprunte celui d’un policier qu’il connaît bien ; or c’est le portable de permanence du commissariat, et la messagerie a enregistré quelques heures plus tard le message suivant : “n’arrivant pas à vous joindre, je tente au hasard sur tous les numéros en ma possession. Rappelez Edwy Plenel.” J’ai demandé de consigner le message à toutes fins utiles. J’attends la copie du rapport officiel du DDSP [directeur départemental de la sécurité publique]. Il va falloir être prudents dans la remontée de l’info pour que celui-ci puisse être le cas échéant une preuve utilisable. Marie-Hélène. »
La police est donc mise en branle pour surveiller les rapports téléphoniques du directeur de Mediapart avec le détenteur de l’enregistrement qui accable Jérôme Cahuzac ! Nous avons, sans le citer, parlé de ce mail. Cela concerne pleinement votre commission d’enquête : sept jours après le premier article de Mediapart, alors qu’il y a des déclarations publiques de soutien à M. Cahuzac, le ministère de l’intérieur mobilise des services de police pour faire des rapports sur les relations téléphoniques entre un journaliste et l’un des protagonistes de l’affaire ; on parle de « remonter l’info », qui doit pouvoir servir de « preuve » – et c’est cela qui doit détendre l’atmosphère du cabinet ?
Le 12 décembre, Le Temps, dont la réputation n’est plus à faire à Genève, publie un article intitulé « Les liaisons genevoises de Jérôme Cahuzac », s’appuyant sur les révélations faites la veille par Mediapart. Reyl est à nouveau cité.
Le 13 décembre, le directeur éditorial de Mediapart, François Bonnet, dans un article intitulé « Les non-réponses du ministre », cite à nouveau la société de gestion Reyl, devenue banque en novembre 2010. Elle le sera encore le 17 janvier.
Le 14 décembre, Edwy Plenel et moi-même rencontrons Michel Gonelle pour débattre de sa situation. Pour nous, la vérité est en marche : il faut assumer les faits ; il doit reconnaître publiquement qu’il détient cet enregistrement. Le lendemain, M. Gonelle prend contact avec l’Élysée.
Ce même 14 décembre, la direction générale des finances publiques (DGFiP) demande à Jérôme Cahuzac de signer un document administratif officiel attestant qu’il n’avait jamais détenu de compte à l’étranger. On lui demande en quelque sorte de confirmer officiellement ce qu’il a dit quelques jours plus tôt à la représentation nationale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand l’apprenez-vous ?
M. Fabrice Arfi. Nous avons confirmation de la rumeur qui circule lorsque Martine Orange et Laurent Mauduit, de Mediapart, réalisent une interview de Pierre Moscovici, le 14 avril.
Jérôme Cahuzac, vous le savez, avait trente jours pour signer cette déclaration. Il refuse de le faire, mais demeure ministre.
Le 19 décembre, il dément – pour la première fois ! – lors d’un déjeuner informel avec nos confrères de France Inter, que ce soit sa voix que l’on entend sur l’enregistrement : son frère Antoine – ancien président de HSBC Private Bank en France –, dit-il, ne l’a pas reconnu. Interrogé sur d’éventuels liens avec Hervé Dreyfus par une de nos consœurs de France Inter, il dit ne pas voir pourquoi il devrait répondre à une telle question.
Le 20 décembre, Mediapart révèle dans un article intitulé « Jérôme Cahuzac, “l’ami” du roi des labos pharmaceutiques » – il s’agit de Daniel Vial, un lobbyiste réputé dans le monde de la santé publique – les liens que l’on pourrait considérer comme incestueux entre Jérôme Cahuzac et les laboratoires pharmaceutiques.
Le 21 décembre, j’écris un article intitulé « Les mensonges de Jérôme Cahuzac ». Il révèle que, le 15 décembre, M. Gonelle a contacté la Présidence de la République : celui que l’on voulait alors faire passer pour un corbeau avoue au premier magistrat de France être le détenteur de l’enregistrement. Il confirme que tout est authentique et qu’il est prêt à en répondre. Dans un communiqué très bref, l’Élysée confirme notre information et affirme avoir conseillé à M. Gonelle de contacter la justice. Le problème, c’est qu’il n’y a alors – hormis une plainte en diffamation contre Mediapart – aucune enquête judiciaire. Cet article révèle également le mail de Mme Valente, mais cette information passe inaperçue. Il révèle enfin que le fisc a diligenté des vérifications approfondies sur les déclarations de patrimoine de M. Cahuzac, notamment sur la question du financement de l’achat de son appartement.
À cette date, les pouvoirs publics, les administrations, connaissaient en détail l’affaire Cahuzac. Derrière son ton péremptoire, la défense de M. Cahuzac était déjà chaotique : on n’a pas voulu, je crois, voir ce qui était en réalité sur la table.
M. Edwy Plenel. Au 21 décembre, tout ce qui est aujourd’hui au cœur de l’instruction judiciaire en cours est donc connu ; les établissements bancaires et les intermédiaires sont nommés, y compris Marc Dreyfuss, installé à Singapour ; la chronologie est donnée ; la question de l’origine des fonds et celle des laboratoires pharmaceutiques sont soulevées – vous savez qu’elle est liée à celle du financement politique illicite, comme ce fut le cas avec le pétrole, avec l’affaire Elf, ou avec les ventes d’armes, avec aujourd’hui l’affaire Karachi ; le conflit d’intérêts est public. Les vérifications fiscales approfondies du patrimoine de M. Cahuzac sont en cours ; le fait que l’administration dispose d’éléments importants dans ses archives est notoire. Rémy Garnier, malgré les calomnies dont il fait l’objet, précise à nos confrères du Parisien : « Dans le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, j’ai noté des anomalies apparentes et chiffrées. Des revenus omis. Une déduction fiscale d’un montant important puisque, même si cela ne représentait pas grand-chose pour quelqu’un comme Cahuzac, elle représentait le salaire annuel d'un ouvrier. Il manquait aussi des justificatifs. Je ne comprends pas que le fisc ne demande rien à un tel contribuable sous prétexte qu’il est député. »
Tout cela, nous l’avons dit et répété. Le 26 décembre, le directeur éditorial de Mediapart écrit une synthèse : « L’affaire Cahuzac pour ceux qui ne veulent pas voir ».
Nous sommes à ce moment convaincus que la vérité sera reconnue très rapidement. D’abord, Mediapart a acquis en cinq ans d’existence, sous deux majorités différentes, un certain crédit et démontré son indépendance.
Ensuite, il m’est arrivé de débattre de la question des révélations journalistiques et de leurs conséquences sur la vie publique avec celui qui est aujourd’hui devenu Président de la République, François Hollande. Dans un livre, Devoirs de vérité, paru en 2006, je l’interroge sur la gestion des affaires par un pouvoir exécutif, à partir d’un cas précis : celui des Irlandais de Vincennes, en 1983, première affaire d’État que j’ai connue comme journaliste. François Hollande était alors directeur de cabinet du porte-parole du Gouvernement de l’époque, chargé de faire contre-feu et donc de mentir. François Hollande savait que je lui disais alors combien la communication qu’il était amené à mettre en œuvre était inexacte. Voici sa réponse : « De cette brève expérience, je retiens qu’à l’origine de toute affaire, au-delà de son contenu même, il y a d’abord un mensonge. La vérité est toujours une économie de temps comme de moyens. La vérité est une méthode simple. Elle n’est pas une gêne, un frein, une contrainte ; elle est précisément ce qui permet de sortir de la nasse. Même si, parfois, […] le vrai est invraisemblable. »
À l’époque de nos révélations, des collaborateurs, des entourages du pouvoir exécutif, du Premier ministre, du Président de la République, s’approchent de Mediapart et nous interrogent sur le sérieux et la solidité de notre enquête. Nous leur détaillons notre travail et leur disons combien nous sommes sûrs de notre fait. Nous sommes convaincus que la vérité sera reconnue. Nous leur faisons même remarquer qu’une absence de réaction des pouvoirs publics ne sera absolument pas comprise lorsque la vérité éclatera : personne ne comprendra que l’État n’ait pas les moyens de savoir mieux que le petit Mediapart ce qu’il en était.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ?
M. Edwy Plenel. Non, cela relève du secret des sources. J’ai bien sûr rencontré des responsables et des membres des cabinets de l’Élysée et de Matignon à cette époque : ce sont des relations normales, habituelles. D’expérience, les membres de cabinet – plus que les ministres qu’ils servent – aident le travail journalistique.
M. le président Charles de Courson. Et ce sont bien eux qui vous ont contacté ?
M. Edwy Plenel. Oui, parce que je les connais.
C’est dans ce contexte que nous finissons, le vendredi 14 décembre, par rencontrer Michel Gonelle, qui fut député RPR de 1986 à 1988. Je précise encore une fois qu’il n’est pas notre source, mais que nous savons qu’il est le détenteur initial de l’enregistrement de fin 2000. Nous le voyons démentir ce fait dans la presse régionale, et nous nous rapprochons de lui. Nous lui disons qu’il doit prendre ses responsabilités et reconnaître l’authenticité de l’enregistrement, ce que connaissaient d’ailleurs beaucoup d’autres témoins – un huissier, un ancien gendarme, un ancien colonel de la DGSE et un ancien magistrat, candidat malchanceux en 2007 dans la même circonscription, Jean-Louis Bruguière. M. Gonelle, ancien bâtonnier, connaît le droit, et décide de se manifester.
M. le président Charles de Courson. C’est bien vous qui le contactez ?
M. Edwy Plenel. Oui. Nous apprendrons par la suite qu’il a, dès le lendemain, appelé Alain Zabulon, directeur adjoint du cabinet du Président de la République, qu’il a connu préfet du Lot-et-Garonne. Il a alors proposé d’écrire au chef de l’État pour attester de l’authenticité de l’enregistrement. Il se déclare à la disposition de la justice.
Malgré tout ce qui est connu à la mi-décembre, rien ne se passe. Pourtant, différentes familles politiques sont au courant de l’existence du compte : M. Gonelle en a parlé à différents membres de sa famille politique, l’UMP ; le compte, nous l’apprendrons par la suite, a été ouvert par un cadre du Front national, proche de Marine Le Pen. La police est au courant : vous pourriez très utilement entendre notre confrère Antoine Peillon, auteur d’un livre intitulé Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur de l'évasion fiscale, et qui montre dans son enquête que la police avait de nombreux éléments à sa disposition. Il en sait plus que nous sur ce sujet.
Mais ce qui se passe, ce sont des manœuvres, des intimidations, des diversions. Je me contente de les constater, je ne désigne pas de responsable.
Premièrement, le fameux mail l’atteste, l’administration policière est instrumentalisée pour porter atteinte au secret des sources journalistiques et aux méthodes d’enquête de Mediapart.
M. le président Charles de Courson. Comment un membre d’un cabinet ministériel qui n’a pas la police sous son autorité peut-il s’adresser à un représentant de la police sans passer par le ministre de l’intérieur ?
M. Fabrice Arfi. Nous ne savons pas si le ministre de l’intérieur en personne est au courant. Mais le mail contient un élément d’information : le directeur de cabinet du préfet – je présume que c’est le préfet du Lot-et-Garonne – a appelé Mme Valente. S’est-il contenté d’alerter le cabinet de M. Cahuzac, ou bien l’information est-elle remontée jusqu’au ministre de l’intérieur ? Nous n’en savons rien. Mais il est question d’un rapport du DDSP, qui est bien sous l’autorité du ministère de l’intérieur.
M. Edwy Plenel. Ayant suivi longtemps les questions de police, je sais que l’administration policière est très verticale, très centralisée. S’il existe vraiment un rapport du DDSP du Lot-et-Garonne – ceci se passe à Agen –, il est sans doute remonté, mais vous avez bien plus de moyens que nous pour obtenir une réponse sur ce point des administrations concernées.
Il y a ensuite la question de la plainte contre Mediapart annoncée par M. Cahuzac. Elle donne lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle je suis convoqué pour être entendu par la police judiciaire le 17 décembre. On me fait lire la plainte ; je me contente de répondre sur mon identité et d’assumer ce que nous avons publié ; mais je découvre un détournement de procédure, qui porte atteinte à l’indépendance et à la liberté de la presse : la plainte est rédigée sur le fondement de l’alinéa 1er bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose : « Dans les cas d’injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice. » La garde des sceaux transmet donc la plainte au procureur de la République, lequel diligente les vérifications d’usage sur le journal ainsi que sur l’identité de son directeur et de l’auteur de l’article.
Je fais acter sur le procès-verbal de police ma protestation : la plainte qui vient de m’être signifiée est un détournement de procédure, car M. Cahuzac n’est pas mis en cause ici en tant que ministre, mais en tant qu’individu. Si vous vous interrogiez sur l’inconscience totale qui règne sur la question centrale du conflit d’intérêts, en voici une illustration : la direction des affaires criminelles et des grâces n’a vu aucun problème à transmettre une plainte contre Mediapart par cette voie, comme si l’ensemble du Gouvernement en était solidaire.
À cause de ma protestation, la place Vendôme demandera à M. Cahuzac de rédiger une autre plainte – la garde des sceaux vous dira peut-être qui le lui a dit. M. Cahuzac parle de deux plaintes, mais celles-ci ne s’ajoutent pas l’une à l’autre : la première est remplacée par la seconde, une plainte ordinaire pour diffamation avec constitution de partie civile. Vous le savez, il n’y a alors aucune investigation sur le fond : on se contente de vérifier qui a publié l’information. Le procès se déroule ensuite un à deux ans plus tard.
M. le président Charles de Courson. La première a-t-elle été retirée ?
M. Edwy Plenel. Je n’en sais rien. Nous ne savons pas non plus ce qu’il est advenu de la seconde. Elle ne nous a jamais été signifiée.
M. Fabrice Arfi. Je parle sous le contrôle des juristes ici présents, mais je crois que la plainte avec constitution de partie civile et l’action publique qui en résulte annule, écrase en quelque sorte la première plainte. Les actes d’enquête diligentés à l’occasion de la première plainte sont joints au dossier ouvert dans le cadre de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile. Elle n’a donc pas à être formellement retirée.
M. Patrick Devedjian. Non, l’une ne fait pas disparaître l’autre.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je rappelle que la commission d’enquête ne peut se pencher sur des procédures judiciaires. La seule question qui vaille pour nous est celle des éventuels dysfonctionnements de l’appareil de l’État.
M. Edwy Plenel. Monsieur le rapporteur, si la vérité est connue aujourd’hui, c’est parce que Mediapart a interpellé publiquement le procureur de la République. On entend dire que la justice a fonctionné. Certes, il n’y a eu ni campagne de calomnies, ni procureur essayant d’entraver la marche de la justice. Mais la justice n’a pas fonctionné ! Pendant le premier mois de nos révélations, la justice est restée inerte.
Si Mediapart, ou tout autre média, avait révélé un trafic de drogue en banlieue ou des agressions dans le métro, le procureur se serait saisi de ces informations et aurait lancé des vérifications. En l’occurrence rien ne s’est passé : au mois de décembre, la justice est seulement saisie d’une plainte qui est un détournement de procédure et qui porte atteinte à nos droits de journalistes !
S’ajoute à l’instrumentalisation des services de police et de la justice, celle de l’administration fiscale. Le 21 décembre, Mediapart révèle que les déclarations de revenus et de patrimoine de M. Cahuzac posent problème. Très mystérieusement, vers vingt-deux heures dans la soirée du samedi 22 décembre, l’AFP diffuse un communiqué de la DGFiP, qui dépend du ministre du budget, affirmant qu’aucun contrôle ou enquête n’est en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Contrairement aux habitudes, ce communiqué est introuvable sur le site de la DGFiP : ce n’est qu’un mail transmis aux permanenciers de l’AFP.
Cela nous amènera, le lendemain, dimanche 23 décembre, sous la signature de Fabrice Arfi, à donner des informations sur les vérifications fiscales en cours : nous avions la preuve que, le mercredi 19 décembre, l’expert-comptable de M. Cahuzac s’était rendu à une réunion organisée à la direction régionale des finances publiques de Paris-Sud pour se voir notifier des observations sur les déclarations du ministre du budget.
La presse enfin est instrumentalisée. Le 26 décembre, une nouvelle dépêche de l’AFP intitulée « Cahuzac a priori solidement installé au Gouvernement, selon des experts » est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Cette dépêche cite deux experts : l’un, Gérard Grunberg, a été membre du cabinet de Michel Rocard, Premier ministre, quand Jérôme Cahuzac était membre du cabinet de Claude Évin, ce que la dépêche ne précisait pas ; l’autre, Jérôme Fourquet, présenté comme travaillant pour un institut d’opinion, est le co-auteur avec Jérôme Cahuzac d’un livre paru en 2011 à la Fondation Jean-Jaurès, dirigée par Gilles Finchelstein, collaborateur du ministre de l’économie, ce que la dépêche ne précisait pas plus.
Le 27 décembre, nous nous trouvions donc devant une situation stupéfiante : manipulation de la police, instrumentalisation de la justice et de l’administration fiscale avec un conflit d’intérêts manifeste, manipulation médiatique évidente. Pourtant, tout était sur la table et tous ceux qui, au cœur du pouvoir exécutif, voulaient savoir, savaient le sérieux de notre enquête.
Tel est le contexte de mon interpellation au procureur de la République de Paris, lancée le 27 décembre et rendue publique quelques jours plus tard. Jusque-là, la justice n’était saisie que d’une plainte qui portait atteinte à nos droits. L’inégalité des armes était flagrante, et nous comprenions d’autant moins l’immobilisme de la justice qu’un juge d’instruction, M. Guillaume Daieff, enquêtait depuis plus d’un an sur des liens entre des clients français et l’UBS, et donc sur des faits de fraude fiscale.
Cette lettre, vous le savez, a fait son chemin : le 8 janvier, le procureur de la République de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire. Ce n’était pas ce que nous aurions recommandé : comme enquêteurs, nous savons que le parquet n’est pas indépendant et que les enquêtes préliminaires sont parfois à la diligence du pouvoir exécutif – ce qui, j’en donne acte au pouvoir exécutif actuel, ne sera pas le cas. Selon nous, il eût cependant été plus logique de donner un réquisitoire supplétif au juge Guillaume Daieff. Le bâtonnier Gonelle aura d’ailleurs la même idée et, en l’absence de réaction de l’Élysée, entrera en contact avec le juge Daieff. Ce processus sera interrompu par l’ouverture de l’enquête préliminaire.
Qui voulait savoir pouvait savoir. Le 29 décembre, à l’appui de notre lettre au procureur de la République, nous publions un entretien avec notre avocat, Jean-Pierre Mignard, dont chacun sait qu’il a, comme citoyen, des engagements politiques à gauche, et qu’il connaît fort bien le Président de la République. Il y explique le sérieux de l’information de Mediapart et redit que toute la lumière doit être faite sur cette affaire.
Le 8 janvier, une enquête préliminaire est ouverte. La veille, vous le savez, M. Cahuzac est à la télévision, en mission de communication au nom du Gouvernement. Il n’a jamais posé de question à l’UBS ; sa seconde plainte ne nous est pas signifiée.
Commence alors cette étrange manœuvre de la mauvaise question posée à la Suisse, qui ne pouvait apporter qu’une réponse fausse.
Nous avons à plusieurs reprises, dès le mois de décembre, mentionné la société Reyl, devenue établissement bancaire à l’automne 2010 et interlocuteur financier durant toute cette histoire. Certes, nous avons publié un témoignage plus précis sur le rôle de Reyl, le 1er février, sur le blog d’Antoine Peillon, journaliste à La Croix, le meilleur spécialiste sans doute des questions d’évasion fiscale. C’est un banquier dont on connaît aujourd’hui l’identité, Pierre Condamin-Gerbier, qui parle. Mais nous mentionnions bien Reyl dès le mois de décembre. Singapour est également mentionné. La chronologie est précise.
Cette entreprise de communication que vous connaissez se développe pourtant : autour d’une réponse, que personne n’a jamais lue, qui aurait été donnée par la Suisse à la France. On lit même dans un hebdomadaire que « les Suisses blanchissent Cahuzac ».
C’est une nouvelle instrumentalisation de l’administration fiscale, puisque c’est dans le cadre d’une convention d’entraide que cette question a été posée. Les responsables d’administration sont aussi comptables de leurs actes, et cela pose la question de leur attitude. Ils ont lu Mediapart, et donc vu mentionner Reyl et Singapour ; ils savent que cette question n’est pas la bonne et qu’elle est imprécise ; ils la cautionnent pourtant.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi pensez-vous cela ?
M. Edwy Plenel. Il s’agit ici d’une procédure qui se déroule entre les administrations.
Dans le respect du contradictoire, nous avons rencontré Pierre Moscovici, à deux reprises. Je l’ai moi-même rencontré en tête-à-tête, à sa demande et je l’ai convaincu de nous rencontrer pour une interview. Le ministre de l’économie plaide la bonne foi : pour lui, nous n’avons parlé de Reyl que le 1er février. Je lui montre que ce n’est pas vrai – votre cabinet vous a sans doute mal informé, lui dis-je, puisque Mediapart ne traîne pas sur les bureaux comme un journal ordinaire : Reyl a été mentionné à plusieurs reprises, et le rôle central d’Hervé Dreyfus a été aussi mentionné ; vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.
C’est à ce moment que M. Moscovici nous confirme ce que nous entendions dire depuis plusieurs jours : dès le 14 décembre, après avoir établi un « mur » entre le ministre du budget et l’administration fiscale pour « éviter le conflit d’intérêts », celle-ci a demandé à M. Cahuzac de confirmer officiellement ce qu’il a déclaré dans l’enceinte du Palais-Bourbon. C’est tout simple, après tout : le contribuable signe un document, couvert par le secret fiscal, dans lequel il ne fait que confirmer ce qu’il a dit au Président de la République, au Premier ministre, à la représentation nationale, aux médias. Il a trente jours pour le faire ; au 14 janvier, il ne l’a pas signé.
Néanmoins, une démarche est faite. M. Moscovici vous expliquera que c’est justement l’absence de réponse qui est à l’origine de la démarche, mais on peut aussi l’interpréter différemment : comment, dès lors que le contribuable Cahuzac refuse de signer cette confirmation écrite, n’a-t-on pas considéré qu’il se mettait en tort vis-à-vis de l’administration fiscale ? Soit il y a là de l’amateurisme, de la légèreté, des vérifications insuffisantes ; soit il y a une hypothèse d’instrumentalisation, peut-être à l’insu du ministre de l’économie – qui l’a d’ailleurs lui-même laissé entendre –, pour une communication dont chacun a pu voir l’ampleur, notamment dans le Journal du dimanche.
M. Moscovici m’a fait part de son émotion et de sa colère face à cette instrumentalisation par l’entourage de M. Cahuzac de la réponse suisse.
M. le président Charles de Courson. Comment l’entourage de M. Cahuzac a-t-il pu instrumentaliser cette réponse, puisque juridiquement il n’a pas le droit d’en connaître ?
M. Edwy Plenel. C’est le cœur du sujet. Nous l’avons souligné dès la parution de l’article du Journal du dimanche : celui-ci s’appuie sur un document que les journalistes n’ont pas lu. Nous avons écrit combien le Gouvernement se mettait lui-même en difficulté : ou bien le secret fiscal est sacré, et M. Moscovici, M. Cahuzac et leurs collaborateurs ne peuvent commenter ce document ; ou bien M. Cahuzac décide, ce qu’il peut à l’évidence, de faire toute la lumière sur sa situation fiscale, et ce document doit être publié.
M. Alain Claeys, rapporteur.L’attitude du ministre de l’économie est au centre de notre enquête : soyons très précis, même s’il doit y avoir des désaccords entre nous.
Dans l’interview qu’il accorde à Mediapart, vous écrivez : « Il nous a par ailleurs révélé une importante information sur un épisode de cette affaire, qui a fait l’objet de rumeurs ces derniers jours, mais qui n’était pas encore confirmé : dès le 14 décembre, soit dix jours après le premier article de Mediapart, l’administration des impôts a demandé à Jérôme Cahuzac de signer un document attestant qu’il n’avait pas de compte caché en Suisse, mais ce dernier n’a pas donné suite à cette demande. » On peut en tirer l’enseignement que l’administration a fait son travail.
La première question que lui posent Martine Orange et Laurent Mauduit est intéressante : « Une enquête préliminaire a été ouverte le 8 janvier contre Jérôme Cahuzac par le parquet de Paris. Vous avez cependant sollicité par l’intermédiaire de votre administration une entraide avec la Suisse seize jours plus tard. Cette enquête diligentée par vous sur des accusations qui visent un autre membre du Gouvernement n’est-elle pas en soi une atteinte évidente au principe de séparation des pouvoirs puisque la justice avait déjà lancé ses propres investigations ? » À ce moment-là, la critique que vous adressez au ministre, c’est donc de lancer une enquête administrative alors qu’une procédure judiciaire est en cours.
Pierre Moscovici répond très clairement : « Comme ministre, j’accordais ma confiance à mon ministre délégué, qui m’avait juré à de multiples reprises qu’il n’avait pas de compte en Suisse. […] Mais, en même temps, mon devoir était de contribuer à établir la vérité. Quand je lance cette convention d’entraide avec la Suisse, c’est parce que cela fait trop longtemps que la question est posée et est toujours sur la table. Il n’était pas logique de le faire avant : entre le 14 décembre et le 14 janvier, la direction des finances publiques a fait une demande à Jérôme Cahuzac sur d’éventuels comptes à l’étranger, demande à laquelle il n’a pas répondu. Je rappelle que notre convention avec la Suisse prévoit que les voies administratives nationales doivent être épuisées avant de demander l’entraide et qu’en règle générale, c’est nettement plus en aval des investigations de l’administration fiscale que ces demandes sont envoyées et qu’elles prennent environ un an. »
Je pense qu’il n’y a pas là de contestation possible.
M. Edwy Plenel. L’objet de votre commission est de comprendre pourquoi la vérité n’a pas été obtenue par les voies normales. Vous ne l’avez pas obtenue comme parlementaires, et malgré la bonne foi dont il se prévaut, M. Moscovici ne l’a obtenue non plus. Il a même obtenu un mensonge redoublé.
Nous disions, en effet, dès cette époque que, dès lors qu’une enquête préliminaire est en cours, il ne peut pas y avoir de manœuvres secrètes d’une autre administration sur les faits qui font l’objet d’une enquête de police coordonnée par le parquet de Paris. Car je rappelle que ces faits qui serviront à la communication organisée pour M. Cahuzac par EuroRSCG, étaient à l’époque totalement secrets ! Personne ne pouvait juger ni la formulation de la question, ni celle de la réponse. Et, dans cette procédure, pour obtenir une réponse de l’UBS, il fallait que le correspondant suisse de l’avocat du client concerné ait donné son aval : M. Cahuzac était au courant, par ses avocats, ce qu’il a d’ailleurs dit lui-même.
L’inégalité des armes était totale et la confusion complète. Vous-mêmes, début février, avez dû vous dire à ce moment-là que Mediapart s’était trompé ! Je veux bien croire à la bonne foi de M. Moscovici, mais qu’il reconnaisse qu’il a été dupe ! Et s’il l’a été, c’est bien parce qu’il a accepté le conflit d’intérêts. Comment a-t-il pu accepter que le patron de l’administration fiscale fasse l’objet d’un débat public permanent sur une fraude qui concerne l’administration qu’il dirige et les faits qu’il est lui-même chargé de réprimer ? Il y a bien eu une instrumentalisation. Faut-il rappeler le petit communiqué d’un samedi soir, communiqué mensonger et introuvable sur le site de la DGFiP ? Vous poserez vous-même la question au directeur général. Nous avons essayé de joindre la DGFiP mais elle ne nous a pas répondu.
M. Fabrice Arfi. Les faits, rien que les faits. Comment se fait-il qu’à partir des mêmes informations, Bercy obtienne une réponse selon laquelle M. Cahuzac n’a pas de compte en Suisse, et le parquet de Paris obtienne la réponse inverse ? Les questions posées à l’administration fiscale suisse sont objectivement de mauvaise foi ! N’importe quel enquêteur fiscal ou juge anti-corruption vous le dira. On connaît la complexité des montages off-shore : il ne fallait bien sûr pas poser des questions seulement sur M. Cahuzac comme ayant droit, bénéficiaire économique direct ou indirect ; il fallait poser des questions autour de lui, sur son gestionnaire de fortune, sur Reyl, qui est cité. M. Moscovici a dit qu’il voulait la vérité ; on voit avec quel succès il l’a eue !
Le 7 février, M. Moscovici dit sur l’antenne de France Inter qu’il n’avait pas de doute lorsqu’il a posé la question. Et nous sommes au moment de l’article du Journal du dimanche, au moment où l’affaire est terminée ! Le président de l’Assemblée nationale dit d’ailleurs à ce moment-là que Mediapart doit arrêter, que la preuve est faite que M. Cahuzac n’avait pas de compte en Suisse. On voit bien qu’il y a eu une entreprise de communication, menée sur le dos de l’administration, des pouvoirs publics, pour mettre un terme à cette affaire. Le parquet de Paris, avec les mêmes informations, a obtenu la réponse inverse de celle obtenue par Bercy.
M. Edwy Plenel. Ce qui ruine la démocratie ne saurait réjouir des journalistes attachés au bon fonctionnement de la République. Notre témoignage ne cherche pas à désigner des individus ; nous n’accablons pas l’homme Cahuzac. Mais il n’est pas normal dans une démocratie qu’un journal doive se battre à ce point pour que soit reconnue la vérité de ses informations. Il s’en est fallu de peu que le mensonge ne l’emporte : si nous n’avions pas, pour défendre nos droits de journalistes, interpellé le procureur de la République, il n’y aurait peut-être pas eu d’enquête préliminaire ; si nous n’avions pas accepté, après avoir pris conseil auprès de notre avocat d’apporter aux inspecteurs concernés la même offre de preuves que nous aurions apportée dans le cadre d’un procès en diffamation, cette enquête préliminaire n’aurait sans doute pas prospéré.
J’ai été entendu à Nanterre, par la police judiciaire, le 31 janvier ; Fabrice Arfi le 5 février. Il se savait alors dans l’administration, notamment au ministère de l’intérieur, que Mediapart apportait ses éléments de preuve à la police judiciaire – au moment même où se déroulait l’opération de communication sur la mauvaise réponse suisse.
Cette histoire illustre d’immenses dysfonctionnements démocratiques. Le pouvoir exécutif a été tétanisé : le ministre de l’intérieur n’a pas trouvé le moyen –la police, les services de renseignements,… – d’en savoir plus que Mediapart ; l’administration fiscale, malgré une lecture attentive de Mediapart, n’a pas su poser les bonnes questions. La justice ne s’est pas mise en branle spontanément. Le pouvoir législatif s’est coalisé ; M. Cahuzac a été soutenu à droite comme à gauche, et on a refusé de voir. Pourtant, il y a une famille politique qui était bien placée, grâce à M. Gonelle, pour connaître la réalité des faits. Le pouvoir médiatique enfin est un contre-pouvoir, il ne concerne pas cette commission.
M. Alain Claeys, rapporteur.Le point de départ de votre curiosité, vous le confirmez, est en quelque sorte le cadeau fait, à la surprise de son propre camp, par Jérôme Cahuzac à Éric Woerth, à qui avait été adressé le rapport de Rémy Garnier.
M. Fabrice Arfi. Il est à l’intention de M. Éric Woerth et de la hiérarchie de M. Garnier.
M. Edwy Plenel. L’hippodrome de Compiègne faisait déjà l’objet d’un rapport de trois experts mandatés par la Cour de justice de la République. Et M. Jérôme Cahuzac en a sollicité un autre, qu’il avait déjà utilisé dans sa propre ville, pour blanchir son adjoint aux finances, accusé des faits similaires et qui a été définitivement condamné.
M. Alain Claeys, rapporteur.Est-ce la première fois, monsieur Plenel, que vous interpellez le procureur de la République ?
M. Edwy Plenel. Oui, et en accord avec notre avocat. Je l’ai fait pour défendre nos droits, à cause du détournement de procédure. Autre point très important : à l’époque, nous entendions dire jusqu’au sommet de l’État que la justice était saisie, ce que relayaient les médias. Or, dans les faits, elle n’était saisie de rien.
M. Alain Claeys, rapporteur.Vous interpellez le procureur le 27 décembre, et c’est le 8 janvier que le parquet ouvre une enquête préliminaire. Ça a été rapide.
Laissons le mail de la chef de cabinet du ministre du budget, sur lequel nous nous pencherons, et j’en reviens à l’attitude de Pierre Moscovici envers les autorités suisses, parce que je ne trouve pas vos explications convaincantes ; elles sont même, à mon avis, contradictoires. D’une part, vous contestez l’opportunité de saisir les autorités suisses alors que la procédure judiciaire est en cours ; d’autre part, vous estimez qu’elles ont été saisies mais de façon incomplète. Le ministre ne devait-il pas attendre l’expiration du délai d’un mois laissé à Jérôme Cahuzac, pour signer sa déclaration ?
M. Fabrice Arfi. Et la séparation des pouvoirs ? Une enquête judiciaire est en cours, avec les moyens que cela implique pour le procureur de la République et les policiers de la division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF). Pourtant, les moyens de l’État sont mobilisés par un ministre qui appelle le ministre du budget « mon ami ». Non seulement la séparation des pouvoirs n’est pas respectée, mais en plus le ministre pose de mauvaises questions. Comment se fait-il, monsieur le rapporteur, que la justice ait obtenu, elle, la bonne réponse, et l’administration la mauvaise ?
M. Alain Claeys, rapporteur.Avez-vous lu la lettre ?
M. Fabrice Arfi. Elle a été rendue publique par Frédéric Ploquin, sur Marianne.
M. Alain Claeys, rapporteur.Sur France Culture, la semaine dernière, vous dites que deux services de renseignements savaient, depuis le début des années 2000, que Jérôme Cahuzac avait placé de l’argent à l’étranger. Pouvez-vous nous éclairer ?
M. Fabrice Arfi. Depuis le début des années 2000, l’appareil d’État avait reçu des informations sur l’existence d’avoirs cachés du député Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Sur quels documents vous fondez-vous ?
M. Fabrice Arfi. Sur des sources, et je me dois de les protéger.
M. le président Charles de Courson. Je ne vous demande pas de les révéler, mais avez-vous connaissance de notes, de lettres que nous pourrions retrouver ?
M. Fabrice Arfi. À ma connaissance, les services de renseignements français sont bien renseignés ainsi que l’administration fiscale.
M. Edwy Plenel. En matière de fraude et d’évasion fiscales, plusieurs services peuvent recevoir des signalements, de la part de TRACFIN, de la douane, de la DGSE. Notre collègue Antoine Peillon dont le livre et sa propre enquête ont conduit à l’ouverture de l’enquête sur UBS, affirme que la DCRI avait des informations très précises sur cette banque, dans laquelle M. Cahuzac avait un compte.
Je comprends le sens de la question de M. le rapporteur et je suis prêt à croire M. Moscovici quand il invoque sa bonne foi, mais elle ne le prémunit ni contre la maladresse, ni contre la naïveté, ni contre un mauvais fonctionnement de l’État. M. Moscovici n’a pas forcément été le complice d’une manœuvre destinée à étouffer la vérité, mais il a mal travaillé.
En termes de responsabilité politique d’abord. Imaginez-vous membre d’un gouvernement qui vit sa première épreuve morale. L’un de vos collègues a juré devant la représentation nationale qu’il est innocent de ce dont on l’accuse, mais il refuse de confirmer en signant un document confidentiel couvert par le secret fiscal. Il y a un problème de responsabilité politique et un gouvernement investi d’autorité en tirerait les conséquences. C’est le premier point, mais il n’est pas très pertinent pour la chronologie puisque nous n’en avons eu confirmation qu’après.
Nous sommes très à l’aise sur le sujet puisque nous avions soulevé la question dans les mêmes termes à propos de M. Woerth, au moment de l’affaire Bettencourt, à savoir les conflits d’intérêt. Nos révélations ont d’ailleurs donné naissance à une commission qui a fait des recommandations. Depuis le premier jour, nous avons écrit que le ministre du budget – et le Gouvernement avec lui – est pris dans un conflit d’intérêts manifeste. Comment peut-il donner des consignes à l’administration fiscale alors qu’il est lui-même mis en cause ? Comment son administration peut-elle lui faire crédit quand il refuse de s’expliquer devant elle ? Et qu’il l’utilise, en particulier avec le petit communiqué de ce fameux samedi soir 22 décembre, avant la manœuvre suisse ?
Je ne peux que constater qu’en décembre, tout est sur la table, que tout pourrait se dénouer rapidement dans une démocratie normale. À partir du moment où l’enquête préliminaire commence, où le cabinet du ministre de l’intérieur – et pas seulement le parquet – est informé de son déroulement, où les enquêteurs entendent nos témoins, y compris le banquier suisse, on fait à la Suisse une demande mal formulée, secrète, confidentielle, et dont la publicité qui est faite autour est instrumentalisée à des fins de communication. Il suffirait d’admettre qu’il y a eu erreur – même de bonne foi. C’est tout ce que nous demandons à M. Pierre Moscovici. Et il serait bon que toutes les familles politiques en tirent les conséquences.
M. le président Charles de Courson. Vous nous avez dit avoir informé l’entourage de Matignon et de l’Élysée, à l’occasion de contacts dont vos interlocuteurs ont pris l’initiative. À quel moment ? Avant fin décembre ?
M. Edwy Plenel. J’ai fait un livre avec l’actuel Président de la République, qui était alors premier secrétaire du Parti socialiste. On m’a donc demandé si je l’avais rencontré. J’ai rencontré d’autres personnes de son entourage dans d’autres fonctions, il y a plus de trente ans. Je n’ai donc pas besoin de voir le Président pour qu’il sache le sérieux du travail de Mediapart. J’ai rencontré quelques-uns de ses collaborateurs, exactement à la même période où M. Gonelle appelait la Présidence de la République, le 18 décembre exactement.
M. le président Charles de Courson. Vous avez longuement évoqué l’instrumentation de la réponse des autorités fiscales suisses. Deux journaux l’ont relayée : le Journal du dimanche et le Nouvel Observateur. Ils parlent de « Bercy ». D’après ce que vous savez, qui a leur a livré l’information ?
M. Fabrice Arfi. Une source administrative.
M. le président Charles de Courson. Le ministre Moscovici dit que ce n’est pas lui. D’aucuns disent que c’est l’entourage de Jérôme Cahuzac. Qu’en savez-vous ?
M. Fabrice Arfi. Je ne vous surprendrai pas en disant que nos relations avec le cabinet de M. Cahuzac et avec celui de M. Moscovici n’étaient pas des plus simples. Nous ne savons pas qui, et quand bien même nous le saurions, nous n’en dirions rien. Je suis jaloux du secret des sources, y compris celles de mes confrères, même s’ils ont publié des informations erronées.
M. le président Charles de Courson. La réponse était couverte par le secret fiscal. Alors qui ?
M. Fabrice Arfi. Nous ne pouvons pas vous répondre. Avant l’article du Journal du dimanche, il y a eu en effet un petit encart sur le site du Nouvel Observateur, qui était un peu plus prudent car il utilisait le conditionnel. Aussitôt sa parution, l’agence Reuters a publié une dépêche rapportant que, d’après une source judiciaire, l’interprétation de la réponse suisse, telle qu’elle était rapportée par le Nouvel Observateur, était inexacte. Celui-ci fait état, après l’article du JDD, d’une source judiciaire déclarant qu’il fallait prendre avec beaucoup de précautions les informations fournies par la Suisse. Autrement dit, il était notoire qu’il fallait les prendre avec des pincettes. La vérité, que nous ne cessons de répéter, est que les questions ont été objectivement mal posées.
M. Edwy Plenel. Ce qui m’importe, en tant que citoyen, c’est de comprendre ce qui se passe quand ce genre de manœuvres survient. L’une de mes batailles, c’est d’arriver à l’équivalent d’un Freedom of Information Act (FOIA) voté en 1966 aux États-Unis, et qui existe dans d’autres démocraties modernes. Un texte qui obligerait l’administration à rendre public ce qui est d’intérêt public, et qui créerait une culture démocratique de la réponse.
En l’occurrence, je reviens sur la dépêche nocturne renvoyant à un communiqué de la DGFiP. Nous avons appelé cette direction pour en savoir plus, mais nous n’avons reçu aucune réponse. Aux États-Unis, une administration se comporterait de la même façon envers des journalistes qui enquêtent, elle se mettrait en tort. En pareil cas, ils peuvent saisir la justice, sur la base du FOIA, et contraindre l’administration à leur répondre. Tout récemment encore, sur un sujet important, Mediapart s’est vu refuser par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les comptes de Nicolas Sarkozy, malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). S’il y avait eu un FOIA dans ce pays, l’affaire Cahuzac aurait été réglée en quelques semaines.
M. le président Charles de Courson. Vous avez accusé Jérôme Cahuzac d’avoir financé pour partie l’acquisition de son appartement par ce compte en Suisse, ce qu’il a démenti. Mais vous avez déclaré avoir le double de l’acte de vente.
M. Fabrice Arfi. Nous n’avons jamais écrit que l’appartement a été financé par les avoirs cachés de M. Cahuzac. Ce soupçon figure dans le rapport de M. Rémy Garnier, qui comportait des erreurs. D’ailleurs, l’auteur lui-même reconnaissait pouvoir se tromper ; il demandait seulement à pouvoir enquêter pour vérifier ses informations. On ne peut pas reprocher à M. Garnier d’avoir écrit des choses fausses, il ne prétendait pas détenir la vérité.
Comme nous l’avons écrit dans le premier article paru sur la question, M. Cahuzac, au moment de l’élection municipale de 2001, et dans un souci de « transparence », a fait des déclarations sur le financement de son appartement. Or les chiffres qui ont été publiés, concernant l’apport en numéraire, ne correspondaient pas à ceux de l’acte notarié. Nous nous posions donc des questions. Cet élément tangible était de nature à mettre en doute le rapport à l’argent et à la vérité de M. Cahuzac. Et, dans les questions posées mi-décembre par l’administration fiscale, on retrouve des questions sur le mode de financement de l’appartement, et notamment sur un prêt paternel qui n’a pas été déclaré à l’ISF, ce qui a permis d’en réduire l’assiette fictivement, pendant plusieurs années.
M. le président Charles de Courson. Vous avez en effet contesté le communiqué officiel de Jérôme Cahuzac, mais c’est Jérôme Cahuzac lui-même qui a déclaré qu’il n’avait pas financé cet achat par un compte en Suisse, en indiquant : « Un média en ligne prétend pouvoir affirmer que cet argent dissimulé sur un compte en Suisse m’aurait permis de financer de manière illicite mon appartement parisien… ». Vous dites, vous, dans votre article, que vous n’avez rien dit de tel, mais que vous confirmez que ce que qui a été déclaré n’est pas la réalité.
M. Fabrice Arfi. L’affaire Cahuzac est un théâtre d’ombres où se joue une guerre à mort entre la communication et l’information. Trop longtemps, la première l’a emporté sur la seconde. M. Cahuzac a démenti ce que nous n’avons jamais dit pour être sûr d’avoir raison.
M. Dominique Baert. Pourquoi ces révélations ? Et pourquoi maintenant ? À la lecture de l’ouvrage que vous avez cité, on a l’impression que le compte de Jérôme Cahuzac à l’étranger était un secret de Polichinelle. On a du mal à comprendre comment, vous qui êtes à la pointe de la recherche d’informations, n’avez pas été informés auparavant. Et si vous l’avez bien été, pourquoi ne pas en avoir parlé si votre objectif est de porter à la connaissance du public des informations d’intérêt public ? Vous nous avez dit vous-même que qui voulait savoir pouvait savoir.
Deuxième question, la place d’Éric Woerth. Une alerte fiscale a été lancée au printemps 2008, avec la note de l’inspecteur des impôts. Et les relations entre l’ancien et le nouveau ministre du budget vous ont intrigués. Avez-vous la conviction que M. Woerth était informé dès 2008 ? En avez-vous la preuve ?
Troisième question : quand Jérôme Cahuzac répond devant la représentation nationale qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais eu de compte à l’étranger, quelle est votre réaction ? Entrez-vous en contact avec l’une de vos connaissances dans l’appareil d’État pour faire part de vos soupçons ?
M. Edwy Plenel. Mediapart a pour particularité de faire des enquêtes d’initiative. La facilité, c’est le journalisme de procès-verbal : on se contente de servir de relais aux fuites de telle ou telle partie dans un dossier judiciaire. Qu’il s’agisse de l’affaire Tapie, de l’affaire Karachi, de l’affaire Bettencourt, de l’affaire Takkiedine ou Khadafi, chaque fois, Mediapart a pris l’initiative, en fonction de ce que nous disaient nos sources ou de nos propres intuitions. C’est le nose for news des Anglo-Saxons : on sent la piste. L’ensemble de nos enquêtes a pour point commun, et c’est l’effet positif de l’affaire Cahuzac, l’évasion, la fraude et les paradis fiscaux. Je l’ai résumé dans un article de septembre, repris en conclusion du livre sur l’affaire Cahuzac, et intitulé « Combattre la mafia de l’évasion fiscale ». Dans le contexte de crise que nous vivons, l’enjeu, à la fois démocratique, politique, financier, est considérable. Il y a 26 000 milliards d’avoirs financiers dans les paradis fiscaux, c’est plus que le PIB des États-Unis et du Japon réunis.
Au départ, nous ne savons rien de M. Cahuzac, à tel point que j’ai été moi-même très surpris de découvrir, juste après nos révélations du 4 et 5 décembre, que c’était l’homme le plus important, le plus solide du Gouvernement. Au lendemain des élections, quand la nouvelle majorité se met en place, nous découvrons le cadeau fait par M. Cahuzac à M. Woerth. Nous ne comprenons pas, d’autant que nous avions rendu public le rapport des experts sur l’hippodrome de Compiègne.
M. Dominique Baert. Vous n’aviez entendu parler ni des notes DCRI, ni de celle de l’administration fiscale de 2008 ?
M. Edwy Plenel. À cette date, nous ne savons rien, sinon que M. Cahuzac a une clinique d’implants capillaires et qu’il est assez fortuné. Simplement, ce cadeau est incompréhensible, et nous relevons le conflit d’intérêts : l’expertise des trois experts de la Cour de justice de la République est beaucoup plus embarrassante pour M. Woerth. Dans ce contexte précis, Fabrice Arfi décide de s’intéresser à Jérôme Cahuzac et il découvre cette vieille histoire. Mais ce n’est pas nous qu’elle interpelle, monsieur le député, c’est vous tous. Comment se fait-il qu’elle ait dormi depuis lors ? Ce n’est pas nous qui sommes responsables. Les protagonistes appartiennent à plusieurs familles politiques. Y a-t-il eu des arrangements autour de cette vieille histoire ? Qu’a fait le juge Bruguière de l’enregistrement en 2007 ?
Après la déclaration solennelle le 5 décembre, devant l’Assemblée nationale, nous nous retournons vers nos sources, qui ne voulaient pas que nous mentionnions l’enregistrement. Nous n’avions cité dans notre article du 4 décembre, qu’« une conversation – dont il existe une trace… » et la phrase « Ça me fait chier d’avoir un compte ouvert là-bas, UBS, c’est quand même pas la plus planquée des banques. » Nous ne parlons pas d’un enregistrement et nos sources ne voulaient pas qu’il sorte.
Devant l’ampleur du mensonge, nous devons sortir un élément de preuve supplémentaire. Le soir du 5, nous mettons en ligne l’enregistrement qui, je le rappelle, ne fera l’objet d’aucune poursuite, ni pour faux, ni pour faux témoignage de M. Gonelle. Nous en avions vérifié l’authenticité techniquement, et avions fait reconnaître la voix par des sources. Depuis, et c’est dans notre offre de preuves, nous avons appris que, dans la journée du 5 décembre, M. Cahuzac, communiquant par écrit avec certains de ses proches, fait état de cet enregistrement, alors que nous n’en avions pas encore parlé. Loin d’en nier l’existence, il parle d’une « mauvaise blague sorti du contexte », ou une formule de ce genre.
M. Fabrice Arfi. Pourquoi l’information ne s’était-elle pas sue depuis que les services de renseignement l’avaient ? Tout simplement, parce qu’il n’y a pas de relais permanent entre les policiers et les journalistes ! Au début des années 2000, Mediapart n’existait pas.
Que savait Éric Woerth ? Je ne réponds que de ce que j’ai écrit. Je ne suis pas là pour vous donner ma conviction, même si, à Mediapart, nous nous faisons forts d’en savoir plus que ce que nous publions. Cela ne se recoupe pas toujours. Si, de bonne foi, Éric Woerth dit ne pas savoir qu’il y avait des soupçons à propos de M. Cahuzac, je dis qu’au vu des documents que nous avons publiés, notamment l’alerte de l’inspecteur Garnier, c’est qu’il a déployé beaucoup d’énergie pour ne pas savoir. On ne peut que s’interroger sur les déclarations de M. Cahuzac vis-à-vis de M. Woerth au moment de l’éclatement de l’affaire Bettencourt, sur l’attitude de M. Cahuzac, ministre du budget, qui commande à l’un de ses amis un rapport fait à l’aveugle et qui blanchit Éric Woerth que les trois experts de la Cour de justice de la République accablent. C’est cela qui déclenche notre enquête, et qui nous a donné l’occasion de réveiller de vieilles affaires.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je vous remercie de la précision de votre exposé.
Sur un plan général, vous qui avez eu à connaître de nombreuses affaires, y a-t-il un canon quant à la réactivité du Gouvernement, quand l’un de ses membres est mis en cause ? Si oui, quand doit-il réagir : quand les informations sorties dans la presse sont suffisamment précises pour que le débat devienne public, ou quand la justice est saisie ?
À cet égard, j’ai retenu, dans votre exposé, trois dates utiles : le 26 décembre, où, selon vous, « tout est sur la table », ce qui laisse penser que vous optez pour ma première hypothèse ; le 8 janvier, quand la justice ouvre l’enquête préliminaire ; le 15 janvier, quand il est avéré que M. Cahuzac ne signera pas la déclaration proposée par l’administration, ce qui vous fait dire que, le 1er février, c’était déjà tard. Pourtant, à cette date, la justice était saisie. Dans ces conditions, deviez-vous vous attendre à une réponse d’ordre juridique de la part du ministre de l’économie ?
Concernant l’instrumentalisation de la justice et la manipulation des autorités policières, j’ai eu recours, dans le cadre de fonctions passées puisque j’ai travaillé au cabinet du garde des sceaux, à l’article 48-1 bis de la loi de 1881, pour une petite affaire, des insultes échangées entre un ministre et un dirigeant de club de foot. J’ai saisi le directeur des affaires criminelles et des grâces, qui m’a dit qu’il n’y avait jamais eu, sous la Ve République, de filtre, autrement dit que la justice était saisie d’une plainte pour diffamation dès qu’un ministre était mis en cause.
Pour ma bonne compréhension, pourriez-vous confirmer que le cabinet de M. Cahuzac a saisi le préfet, lequel a sûrement demandé un rapport à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), parce que, à l’origine M. Gonelle avait emprunté le portable d’un policier ? M. Gonelle est partout à tu et à toi avec les autorités policières. C’est une ambiance tout de même curieuse.
M. Fabrice Arfi. La question, madame la députée, n’est pas de savoir quel téléphone M. Gonelle a utilisé. Nous disons qu’un rapport a été demandé à la DDSP pour pouvoir l’utiliser ensuite contre nous. Je relis le mail de la chef de cabinet de M. Cahuzac : « Je viens d’être appelée par la préfecture, par le dir’cab’ du préfet, pour me raconter la chose suivante […] J’ai demandé de consigner le message à toutes fins utiles. J’attends la copie du rapport officiel du DDSP. Il va falloir être prudent dans la remontée de l’info pour que cela puisse, le cas échéant, être une preuve utilisable. » On a donc utilisé les services de police pour faire un rapport sur les conversations téléphoniques entre un journaliste avec le protagoniste d’une affaire qui agite le Gouvernement, et qu’il puisse être utilisé contre nous.
Mme Marie-Françoise Bechtel. J’avais compris, je vous interrogeais sur le fait initiateur, l’emprunt d’un téléphone par M. Gonelle.
M. Edwy Plenel. Votre question pose celle de notre culture démocratique commune. La démocratie, ce sont des institutions, mais aussi des pratiques et habitudes. En panne de batterie, M. Gonelle demande un portable à quelqu’un qu’il connaît – Agen est une petite ville, il y a été bâtonnier – qui se trouve être un policier qui ignore qui va être appelé avec son téléphone. Ce policier laisse un message sur mon portable, suivi d’un message me demandant de rappeler M. Gonelle. J’ai donc à mon tour laissé un message sur ce téléphone, demandant à être rappelé, puisque je cherchais à joindre M. Gonelle.
M. Gonelle est un ancien élu, de l’actuelle opposition, qui s’est finalement retrouvé à informer la justice. Comme pour les lanceurs d’alerte et les sources l’important, est de savoir s’ils disent factuellement la vérité, peu importe leur motivation.
Vous avez rappelé que la direction des affaires criminelles et des grâces ne voit pas de problème à faire jouer l’article 48-1 bis quand un ministre est concerné, même s’il n’est pas mis en cause en tant que tel. En effet, Christian Vigouroux, alors directeur de cabinet de Mme la garde des sceaux, m’a confirmé que la plainte de M. Cahuzac a été transmise parce que la direction des affaires criminelles et des grâces n’y voyait pas de problème.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Cela se fait depuis plus de trente ans !
M. Edwy Plenel. D’après mes informations, la garde des sceaux a eu vent, mais peut-elle ne vous le confirmera-t-elle pas, de ma déclaration sur procès-verbal, à moins que ce ne soit le procureur. À ce moment-là, ils s’en sont émus. Il y avait là un déni, compte tenu du déséquilibre des armes pour défendre une liberté fondamentale, la liberté de la presse.
Dernier point, suffit-il que la presse publie pour réagir ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Ce n’est pas tout à fait ma question.
M. Edwy Plenel. C’est sans doute un désaccord entre nous. Cela fait trente-cinq ans que je suis un porteur de mauvaises nouvelles, sous des majorités différentes. Je maintiens, et je l’ai écrit le 10 décembre, que, ne serait-ce que pour se défendre, ce qui est le droit sacré de tout justiciable et parce que toute personne mise en cause, y compris coupable, a le droit de mentir, il aurait fallu que le ministre se démette ou soit démis, libérant le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire du risque d’être pris en otage de sa bataille personnelle. Quand il y a des faits de presse, consistants, rigoureux, publics, la bonne administration de notre vie démocratique voudrait que la personne se déporte, et qu’elle ne reste pas en conflit d’intérêts. Il y a eu un précédent, qui s’est terminé par un non-lieu, c’est la mise en cause de M. Dominique Strauss-Kahn, sous Lionel Jospin, à propos de la MNEF, après une manchette assez spectaculaire du Monde. Tout en déclarant se sentir innocent, M. Strauss-Kahn a estimé qu’il ne devait pas entraîner avec lui son administration, son ministère et le Gouvernement, et il s’est déporté.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Une manchette n’est pas, à mes yeux, un critère tout à fait satisfaisant, y compris à l’aune de la démocratie. Il faudrait vérifier les vérificateurs !
M. Edwy Plenel. C’est, encore une fois, un problème de culture démocratique. Les règles de financement de la vie politique aujourd'hui acceptées sont liées à nos informations.
M. Gérald Darmanin. Mme Valente a-t-elle bien utilisé son mail professionnel ?
M. Fabrice Arfi. marie-helene.valente@cabinets.finances.gouv.fr.
M. Gérald Darmanin. Connaissez-vous les réactions à ce mail ? Qu’en est-il du rapport attendu par Mme Valente ?
M. Fabrice Arfi. Nous n’en savons pas plus. Nous sommes très respectueux du principe du contradictoire et, avant de publier une information, nous contactons toujours les personnes concernées, libres à elles de nous répondre ou non. Mais l’administration n’a pas la culture de la réponse. J’ai eu Marie-Hélène Valente au téléphone avant de publier l’article le 21 décembre, intitulé « Les mensonges de Jérôme Cahuzac ». Elle a été excessivement sèche, mais c’est son droit. Elle m’a dit avoir « des rapports normaux avec le ministère de l’intérieur ». La conversation s’est arrêtée là après qu’elle m’a fait comprendre que je n’étais pas à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires mais il ne s’est rien passé. Je n’ai écrit que la vérité.
M. Gérald Darmanin. Monsieur Plenel, vous avez anticipé une question, en reconnaissant bien connaître François Hollande, avoir eu des contacts avec quelques-uns de ses collaborateurs, et partager un ami commun en la personne de Me Mignard. Depuis les faits, avez-vous rencontré le Président de la République ou bien en avez-vous parlé à Me Mignard qui aurait pu, lui, l’avoir rencontré ?
M. Edwy Plenel. Je n’ai pas demandé à Jean-Pierre Mignard la teneur de ses conversations, mais il ne fait pour moi aucun doute qu’il a été contacté par le Président, ou son entourage, pour savoir si l’enquête de Mediapart était sérieuse et solide. Et je connais la réponse de Jean-Pierre Mignard. De tradition, Mediapart ne publie rien de sensible sans consulter son avocat, qui est un grand défenseur de la liberté de la presse.
J’ai vu une fois M. le Président de la République, devant témoin, aux vœux présidentiels. Nous nous sommes salués de loin, sans échanger un mot. Pour la petite histoire, il a terminé en faisant de l’humour sur la protection des sources des journalistes, en disant que l’actuelle majorité allait la renforcer, qu’il fallait les protéger, car, en cherchant, on s’apercevrait qu’elles sont parfois très haut placées. Un humour très « hollandais » !
M. Fabrice Arfi. Voici exactement la réponse de Marie-Hélène Valente : elle entretient « des rapports normaux avec les services du ministère de l’intérieur », refusant de démentir ou de confirmer nos informations.
M. Christian Eckert. La question, c’est la qualité de la demande faite par les services fiscaux à leurs homologues suisses. J’ai relu tous vos articles. Celui du 4 décembre mentionne un compte de Jérôme Cahuzac auprès d’UBS, détenu jusqu’en 2010. Le 11 décembre, vous parlez de M. Dreyfus et de ses relations, y compris avec M. Reyl et avec la société financière Reyl. À aucun moment, vous n’écrivez que le compte de M. Cahuzac aurait été transféré de l’UBS à la société financière Reyl, ou après, quand elle est devenue banque à l’automne 2010. À quel moment avez-vous appris que le compte de M. Cahuzac, sous quelque forme que ce soit, et qui reste à préciser, n’était plus à l’UBS ? La convention fiscale entre la Suisse et la France nécessite non seulement que l’ensemble des moyens nationaux ait été mis en œuvre, mais aussi que, lorsque l’on possède des informations sur la personne qui détient le compte, elles soient transmises à l’administration suisse. La lecture que j’en fais, c’est que les services fiscaux ne pouvaient pas interroger les Suisses sur une autre banque qu’UBS, puisque vous avez toujours déclaré que le compte était ouvert dans cette banque. On peut ensuite discuter de la période, mais la convention est entrée en vigueur en 2010. La lettre du ministre de l’économie porte sur une période antérieure, la plus longue possible compte tenu du délai de prescription, qui est, pour l’ISF et l’impôt sur le revenu, de six ans maximum.
J’ai vu la lettre de M. Moscovici et la réponse, car, bien que couvertes par le secret fiscal, elles sont accessibles au président et au rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais savoir à quel moment vous avez appris que Reyl avait été dépositaire des avoirs de M. Cahuzac. Si vous étiez au courant, pourquoi n’en avoir rien dit ? Vous avez bien mentionné le nom de Reyl, mais parmi beaucoup d’autres, qui ne sont pas forcément liés à l’affaire.
M. Fabrice Arfi. Nous avons appris avec précision les différents habillages successifs du compte, dans le sillage des découvertes de la justice, comme n’importe qui.
Tout de même. Quand nous publions l’article « L’homme qui sait tout », sur le gestionnaire de fortune Hervé Dreyfus, nous le présentons comme celui qui a organisé la dissimulation fiscale de M. Cahuzac. Nous ne parlons pas de Dominique Reyl comme d’une simple connaissance de sa part, mais comme son associé en France. Et nous expliquons ce qu’est la société de gestion Reyl & Cie. Je maintiens que si l’administration fiscale avait posé des questions à propos de Reyl, elle aurait peut-être eu les mêmes réponses que le parquet. Je vous retourne la question : comment se fait-il qu’avec les mêmes informations, Bercy obtienne une mauvaise réponse et le parquet une bonne ?
M. Christian Eckert. Leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes !
Vous discutez de l’opportunité de l’intervention de l’administration fiscale, mais qu’aurait-on dit si l’administration fiscale n’avait rien demandé ! Elle agit, je le rappelle, dans le cadre d’une convention et d’échanges de lettres concernant les modalités de sa mise en œuvre. La justice intervient dans un cadre différent et le champ des investigations est beaucoup plus large. Vous connaissez les difficultés qu’il y a pour l’administration à obtenir des renseignements de la part de la Suisse. Pour moi, la question centrale, c’est la nature de la demande et de la réponse, réponse que d’aucuns ont qualifiée d’ambiguë. Non, la réponse est précise tant quant au contenu qu’aux périodes et même à ses limites : elle porte sur UBS et sur deux périodes, la première en vertu de la convention, et la seconde à titre exceptionnel, avec l’information du client, ou de ses avocats.
M. le président Charles de Courson. Nous auditionnerons le service de la législation fiscale et, sous réserve de leur accord, les autorités suisses pour qu’elles nous donnent leur version de la fameuse lettre interprétative de l’accord.
M. Fabrice Arfi. Qu’est-ce qui empêchait l’administration française de poser des questions sur M. Dreyfus, sur la société Reyl, sur Dominique Reyl et sur Patricia… (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) C’est vous qui êtes en train de nous reprocher de ne pas avoir été assez bien informés !
M. Edwy Plenel. Au vu des informations de Mediapart, vous considérez qu’il n’était pas possible de poser d’autres questions que celles qui ont été posées. Je maintiens qu’à partir du moment où une enquête préliminaire était ouverte, c’était une aggravation des conflits d’intérêts déjà existants.
Ce que vous ne voulez pas voir, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’une petite mise en scène médiatique. L’administration fiscale, qui est parfaitement au courant de la convention OCDE, est consciente du problème posé par les politically exposed people, qui doivent être signalés par les établissements bancaires et à qui on doit demander l’origine des fonds. C’est pour ça que M. Cahuzac demande le transfert à Singapour. Il peut mentir d’autant plus qu’il sait que le compte n’est pas au nom de Cahuzac. Un mois et demi après nos révélations, l’administration fiscale, qui connaît les règles et qui, je l’espère, nous a lus en détail, laisse poser la mauvaise question. Au même moment, des sources judiciaires anonymes du parquet disent que c’est un simple renseignement, qui n’a pas d’autre valeur. Le parquet n’a pas fait de démarche compliquée auprès de la Suisse puisqu’il s’agissait d’une enquête préliminaire et pourtant il avait les moyens de se rendre compte que ce n’était pas la bonne question.
Après la démission de M. Cahuzac, le Nouvel Observateur a écrit que l’entourage de M. Cahuzac avait tenté de retarder l’ouverture de l’enquête préliminaire, de façon à ce que la réponse suisse arrive avant. Le coeur du problème est là. Si nous ne nous étions pas entêtés, le mensonge serait aujourd'hui la vérité.
M. Daniel Fasquelle. Si certains doutaient de l’intérêt d’une commission d’enquête, leurs doutes sont d’ores et déjà dissipés. Je remercie Edwy Plenel et Fabrice Arfi d’avoir répondu à nos questions. Mais il faut aller au fond des choses. Selon Alain Claeys, l’attitude du ministre de l’économie est au cœur de l’affaire. Non, c’est celle de l’ensemble des responsables politiques de l’État, de Christiane Taubira, de Manuel Valls, de Jean-Marc Ayrault et même François Hollande. Il s’agit d’une affaire d’État.
C’est moi qui ai interrogé Jérôme Cahuzac le 5 décembre. Par la suite, dans une émission de LCP, je me suis demandé si Jérôme Cahuzac ne pouvait pas faire la lumière lui-même et le dire devant nous, tout simplement en interrogeant sa banque en Suisse, l’UBS ? Confirmez-vous qu’il aurait pu poser la question lui-même et qu’il aurait eu la réponse ? Si tel est bien le cas, comment se fait-il que les membres du Gouvernement et le Président n’aient pas demandé à Jérôme Cahuzac d’interroger sa banque ? Le problème aurait été réglé en quelques jours. Avez-vous posé cette question ?
M. Fabrice Arfi. En effet, sans mettre en branle les moyens de l’État, M. Cahuzac aurait pu écrire à UBS, d’autant que la banque avait dit qu’elle répondrait à condition que la question soit bien formulée au regard des textes suisses : « voulez-vous me donner toutes les informations concernant notre relation client ? » Il faut une démarche affirmative pour saisir la banque, et l’autoriser à lever le secret bancaire. Or cela n’a pas été fait. Au lieu de quoi, le 11 décembre, Edmond Tavernier, le correspondant suisse de Gilles August, l’avocat de Jérôme Cahuzac, a écrit aux services juridiques d’UBS, sans dire qui il représentait, pour demander, d’après le document qui a été rendu public, si la banque répondrait si l’un de ses clients l’interrogeait pour avoir la confirmation négative de l’existence d’un compte. La banque a répondu qu’elle ne donnait pas de confirmation négative – c’est l’expression utilisée – mais qu’elle répondrait à d’autres questions. Elle a d’ailleurs précisé à ma consœur de Challenges, Gaëlle Macke que, si la bonne question lui était posée, elle y répondrait. Or elle ne sera jamais posée, de même que ne sera jamais signée la déclaration du 14 décembre par Jérôme Chauzac, ni contestée devant les tribunaux la réalité de l’enregistrement. Jérôme Cahuzac mettra quinze jours à le démentir en avançant que son frère n’a pas reconnu sa voix. Bref, derrière les dénégations péremptoires de M. Cahuzac, il ne manquait pas d’indices exposés sur la place publique pour voir qu’il faisait tout pour que la vérité n’éclate pas.
M. Alain Claeys, rapporteur.Les services de l’État ont pris deux décisions. Sont-elles contestables ou ont-elles été prises à contretemps ?
Premièrement, le 14 décembre, ils demandent officiellement à Jérôme Cahuzac s’il a un compte à l’étranger. Il a trente jours pour répondre, et le 14 janvier, ils n’ont reçu aucune réponse. Cette démarche de l’administration ne semble pas contestable.
Deuxièmement, la suite donnée par le ministre de l’économie, et qui est sujette à interprétation. En l’absence de réponse, il saisit la Suisse. Les critiques à son encontre me semblent contradictoires. L’une est de dire qu’il n’aurait pas dû le faire à cause de la procédure judiciaire ; l’autre est de dire que la démarche est incomplète.
M. Fabrice Arfi. Je ne vois pas la contradiction. Théoriquement, il n’aurait pas dû et, en plus, il s’y est mal pris.
M. Alain Claeys, rapporteur.Alors, aurait-il dû écrire, ou pas ?
M. Fabrice Arfi. À mon sens, non, si l’on est respectueux de la séparation des pouvoirs. Alors que la justice enquête et que le parquet et la DNIFF ont les moyens d’interroger la Suisse, le pouvoir exécutif, en mettant en branle les moyens de l’État parce que l’un de ses membres est mis en cause, viole la séparation des pouvoirs.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Absolument pas !
M. le président Charles de Courson. Nous en discuterons avec les responsables des services fiscaux suisses et français.
M. Daniel Fasquelle. M. Claeys se place sur un terrain technique, moi sur le terrain politique. Il suffisait de poser un ultimatum politique à Jérôme Cahuzac : si vous n’apportez pas de réponse vous prenez vos responsabilités.
M. le président Charles de Courson. Cela ne concerne pas Mediapart.
M. Daniel Fasquelle. La commission d’enquête doit comprendre le pourquoi de ce qui s’est passé, et établir les responsabilités, à la fois techniques et politiques. Je trouve qu’on parle peu du rôle de Christiane Taubira et de Manuel Valls. Il paraîtrait que l’intérieur a fait remonter à l’Élysée début décembre une note blanche qui authentifierait l’enregistrement, même si, officiellement, les notes de la DCRI n’existent plus depuis 2002. Manuel Valls a démenti catégoriquement, Jean-Marc Ayrault aussi. Avez-vous eu connaissance de cette note ? Existe-t-elle, ou non ? Avez-vous enquêté à son sujet ?
M. Fabrice Arfi. Mediapart ne répond que de ce qu’il a publié. Or nous n’avons rien publié sur cette note.
M. Edwy Plenel. Pour vous répondre, nous ne pouvons que nous en tenir à la chronologie. À partir du moment où il y a enquête préliminaire, selon la logique administrative du ministère de l’intérieur, le procureur de la République est informé, tout comme la hiérarchie policière. Or l’enquête avance dans le sens de Mediapart. Dès le début, les policiers portent crédit à notre offre de preuves. J’insiste beaucoup sur la chronologie pour la question posée par Bercy. La médiatisation de cette réponse secrète était à l’évidence une pression sur l’enquête préliminaire et sur le travail des policiers, une manipulation. Nous les connaissons, nous avons été entendus par eux, et c’est ainsi qu’ils l’ont ressentie. Ils ont dû se battre encore plus pour convaincre le procureur de la République du sérieux de leurs éléments matériels et de la nécessité d’ouvrir une information judiciaire indépendante. C’est la raison pour laquelle le communiqué du procureur de la République est si inhabituellement circonstancié, évoquant l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit pas d’accabler une personne, mais une culture dans laquelle les voyants rouges n’ont pas fonctionné.
M. Jean-Pierre Gorges. Je vous félicite pour cette enquête rondement menée. Les conclusions sont claires, précises.
Vous répétez que, dès le 4 décembre, vous avez déjà des preuves et, dans chacun de vos articles, vous annoncez que vous en aurez encore. Pourquoi ne pas avoir tout posé d’emblée sur la table ? Vous distillez l’information jour après jour, comme dans un feuilleton. D’ailleurs, à un moment, Claude Bartolone s’emporte : « Mediapart, ça suffit ! » Ne pensez-vous pas que votre façon de traiter l’information ait eu une incidence sur le comportement que l’on pourrait reprocher à quelques fonctionnaires ou à quelques ministres ? Le déroulé des événements n’est pas pour rien dans les réactions suscitées. Je m’interroge sur la méthode, d’autant, monsieur Arfi, que je vous ai vu à la télévision déclarer que l’affaire Cahuzac n’est qu’un début. On sent bien que vous voulez tirer les ficelles et parler du médicament. Si vous avez des éléments, il faut les donner maintenant. Allez-vous nous jouer un second film, au risque de jeter la suspicion sur tout le monde ? On a déjà la ficelle Woerth : savait-il ? La presse n’est pas tenue de citer ses sources mais vous l’êtes de dire ce que vous savez.
M. Mignard est très proche de vous, mais aussi de M. Hollande. Pensez-vous qu’il a omis de le mettre en garde quand il l’a croisé ?
M. Fabrice Arfi. Le principe du « feuilletonnage » ne me pose aucun problème. Nous sommes une toute petite barque face à des paquebots tels que l’État, les services de renseignement, le monde politique, l’industrie de la communication,… Il n’est pas interdit – parfois – d’être un peu malin, et d’en garder « sous la pédale », pour voir qui réagit, qui ment, comment ça se passe. Le Canard Enchaîné le fait sans arrêt, sans que cela gêne personne. Et, dans l’affaire du Watergate, deux ans se sont écoulés entre le premier article – juin 1972 – et la démission de Richard Nixon. A-t-on reproché au Washington Post d’avoir « feuilletonné » ? L’information s’obtient en marchant.
Dans le cas précis de l’affaire Cahuzac, l’élément le plus spectaculaire que nous avions était l’enregistrement, mais nous n’avions pas, dans le pacte sacré qui nous lie à nos sources, « l’autorisation » de le publier. Nous ne nous attendions pas à une réaction aussi véhémente de M. Cahuzac qui est allé jusqu’à menacer de poursuivre toute personne qui reprendrait notre information sur Twitter. Il dément à l’Assemblée nationale. Nous étions en quelque sorte au pied du mur. Les sources nous ont alors donné leur feu vert pour diffuser l’enregistrement. Nous donnons l’impression de publier un feuilleton, mais nous n’en avions pas l’intention. Et quand bien même ç’aurait été notre intention, ce n’est pas un problème.
M. Edwy Plenel. Nous ne nous attendions pas du tout, dans cette histoire, à devoir assumer pendant trois mois ce que vous appelez un feuilleton, et nous, une bataille, une épreuve. Seules trois rédactions nous ont accompagnés : celles de France Culture, qui a mené des investigations en Suisse, de La Croix et de Sud-Ouest, qui connaissait le terrain local. Et vous connaissez le débat public. Dans notre candeur, nous n’excluions pas que M. Cahuzac, quand nous l’avons contacté le lundi 3 décembre, admette avoir eu ce compte, l’avoir fermé ou oublié de le faire, et s’en explique. Mediapart n’est pas du côté de ceux qui proclament « Tous pourris ». Nous portons crédit aux fonctions que vous occupez. Il arrive que l’on fasse des erreurs. Il reste à l’admettre et à en rendre compte. D’où l’importance essentielle du conflit d’intérêts. Il ne faut pas entraîner ceux dont on a la charge, sa famille politique, le Gouvernement dans son mensonge.
Quant au côté « à suivre… », notre rôle est de faire connaître les informations d’intérêt public, et d’essayer de comprendre. Or, nous ne comprenons pas pourquoi il a été si difficile d’accepter cette vérité, nous ne comprenons pas ces liens transcourants entre familles politiques. Et nous ne comprenons pas le point de départ de l’affaire. C’est l’enjeu de l’information judiciaire. Nous avons révélé il y a peu que M. Cahuzac, quatre mois après avoir quitté le cabinet de M. Claude Évin, où il s’occupait de la pharmacie et du médicament – vous connaissez l’importance des autorisations de mise sur le marché et du remboursement par la sécurité sociale –, avant d’ouvrir sa clinique ou de lancer de manière très active son cabinet de conseil qui traite ce qu’il traitait au nom de l’État, intervient pour éviter le déremboursement d’un médicament discutable contre la fatigue des femmes. Grâce à lui, le laboratoire a gagné trois ou quatre ans, et des dizaines de millions. D’où vient donc l’argent du compte puisque c’est ni de la clinique, ni de son activité de conseil ? Pourquoi travaille-t-il sur les mêmes sujets que quand il était dans un cabinet ministériel ? Qu’en était-il à cette période ?
Enfin, je vous redis ce que j’ai déjà dit, toute personne liée à Mediapart – salarié, avocat ou actionnaire – pouvait dire à son interlocuteur, fût-il Président de la République, que Mediapart était solide et prêt à assumer toutes les conséquences de ses informations.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Merci, monsieur le président, de mener les débats avec autant de rectitude. Je salue également M. Plenel et M. Arfi, et je me réjouis que les parlementaires puissent enquêter sur ce qui se passe dans notre démocratie.
Vous avez dit, et même répété, parlant de manipulation, que tout se savait en décembre et vous vous êtes interrogé sur la réelle volonté politique. Quelle va être la position de Mediapart tout au long de nos travaux ? Allez-vous continuer à enquêter et à diffuser des renseignements, pour aller au fond des choses ?
Avez-vous, d’ores et déjà, fait l’objet de pressions, qui auraient pu entraver vos investigations dans ce dossier, et limiter vos déclarations ? Il existe, avez-vous dit, de nombreuses sources, d’origine bancaire, fiscale ou politique. Avez-vous saisi la CADA pour avoir communication de certains documents administratifs ? Si vous ne l’avez pas fait, quelles sont les pistes que vous nous suggérez de suivre dans l’administration ?
Enfin, vous avez parlé de dysfonctionnements administratifs au ministère des finances, de la justice et de l’intérieur. Tel est bien notre sujet, mais nous ne pouvons pas enquêter sur la procédure pénale et la fraude fiscale. Or, si j’ai bien compris ce que vous avez dit, plusieurs fonctionnaires sont en cause pour n’avoir pas respecté l’article 40 du code de procédure pénale. Où est la limite, ténue à mes yeux, entre le dysfonctionnement administratif et la recherche sur la fraude fiscale ?
M. Fabrice Arfi. Le non-recours à l’article 40 vous interroge vous, le législateur. Nous sommes en pleine hypocrisie française. Tout dépositaire de l’autorité publique qui est témoin d’une infraction, d’un délit ou d’un crime, est tenu d’alerter le procureur de la République, mais le non-respect de cette obligation n’est pas sanctionné. Il est donc très peu utilisé. Si la contrainte qui pèse sur les fonctionnaires et les sanctions qu’ils encourent étaient plus fortes, peut-être certains d’entre eux y auraient-ils eu davantage recours.
Profitez de votre liberté pour aller chercher les documents là où ils sont. Allez voir la DCRI, l’ex-DST, la douane, la DGSE. Il y a des gens qui ont des choses à vous dire.
Mediapart n’a pas eu à subir, sous la présidence Hollande, et depuis cette première grande affaire du quinquennat, de pressions, y compris de violences verbales comme nous en avions connues sous la présidence Sarkozy quand nous avons révélé l’affaire Bettencourt, l’affaire Karachi, l’affaire Tapie ou l’affaire Khadafi-Takieddine. Nous avions été traités par plusieurs membres du Gouvernement de « fascistes », accusés d’être une « officine du PS » – on voit ce que ça donne –, d’être des « justiciers » et des « procureurs ». Mediapart a été cambriolé, comme d’autres rédactions, au moment de l’affaire Bettencourt. Nous avons été surveillés par les services de renseignement sous la présidence Sarkozy, ce que Le Canard enchaîné a raconté, et ce qu’ont écrit des confrères dans un livre très documenté, L’Espion du Président. Nous n’avons rien connu de tel. En revanche, nous avons connu une solitude médiatique extravagante.
Et nous entendons beaucoup le mot « mensonge ». Comme si l’affaire tournait autour du mensonge d’un homme. On entend bien éléments de langage qui sont derrière : c’est la « faute d’un homme », c’est une « faute personnelle ». Mais un homme peut mentir, surtout s’il est mis en difficulté et c’est même son droit. Un mis en examen a le droit de mentir.
M. le président Charles de Courson. Pas devant une commission d’enquête parlementaire.
M. Fabrice Arfi. Bien sûr, c’est mal de mentir, mais le sujet n’est pas le mensonge, c’est la manière dont il a été écouté, et accompagné par une partie du système médiatique. Je ne dis pas qu’il y a Mediapart et le reste de la presse. J’ai travaillé avec des journalistes d’autres rédactions sur cette affaire. Mais, oui, le commentaire et la communication ont tenté de tuer l’information et ce mensonge a été accompagné par une partie de l’administration et des pouvoirs publics. On voit bien les conséquences de l’article « Les Suisses blanchissent Cahuzac ». Le président de l’Assemblée nationale dit stop parce que le ministre n’a pas eu de compte en Suisse. L’affaire a failli être enterrée. La question, c’est l’accompagnement du mensonge et comment cela est possible dans un pays moderne. Pourquoi n’y a-t-il pas suffisamment de contre-pouvoirs pour empêcher quelqu’un qui fraude le fisc depuis plus de vingt ans de devenir ministre du budget ?
Nous ne voulons pas accabler un homme. L’homme Cahuzac n’est pas le problème. Jean-François Kahn a eu une formule qui a fait florès : « D’abord on lèche, ensuite on lâche, et puis on lynche ». C’est exactement ce qui est en train de se passer. On nous dit que c’est la faute d’un homme, mais les faits sont là. D’un côté, on met en cause un individu, mais, de l’autre, on annonce la création d’un super-procureur contre la corruption, d’un office central de lutte contre la corruption, une lutte contre les paradis fiscaux et plus de transparence sur le patrimoine des élus. Bien sûr que ce n’est pas que la faute d’un homme ! L’affaire Cahuzac n’est que la partie visible d’un iceberg poisseux, celui de la corruption, des paradis fiscaux et des montages offshore. Ne pas le reconnaître, ce serait entretenir l’aveuglement et, à mon sens, l’irresponsabilité du monde politique. C’est le résultat d’un système.
M. Edwy Plenel. Fabrice a conclu excellemment, mais vous m’avez demandé ce que ferait Mediapart à propos de la commission d’enquête. Nous essayons d’éviter le conflit d’intérêts. Le site diffuse la retransmission en direct. Le journaliste parlementaire rendra compte de vos travaux. Et, pendant ce temps, nous menons nos enquêtes sur l’ensemble des questions soulevées par l’affaire, en particulier celle du secret bancaire, plus dur à percer que le secret défense pour des enquêteurs indépendants.
Les policiers de l’office dont a parlé Fabrice nous disent qu’il faut, pour en venir à bout, les techniques de la lutte anti-mafia. Il faudrait un statut de repenti, pour que les gens parlent. Le point commun de tous nos dossiers, encore une fois, c’est l’ampleur du détournement de la richesse nationale vers les paradis fiscaux. Il leur faudrait des moyens pour les infiltrer, comme cela se fait dans les organisations secrètes. Donnez-les leur !
Et donnez des moyens à tous. La CADA, qui a été citée, n’a pas autorité sur toutes sortes d’autres autorités administratives indépendantes, qui refusent de suivre ses avis. Votez une grande loi sur la liberté de l’information. Faites ce FOIA à la française que toute notre profession réclame depuis des années, et qui permettrait l’accès public à l’information. Au temps du numérique, de l’open data, ce serait essentiel, et constituerait le ferment d’une culture démocratique.
J’ai bien vu qu’il y avait des opinions différentes parmi vous, mais j’aimerais vraiment, quand nous révélons des faits qui dérangent la majorité, quelle qu’elle soit, ne pas recevoir chaque fois le soutien de l’opposition qui, redevenue majoritaire, nous combat, et inversement. J’aimerais que se dégage une majorité d’idée sur cette question. Que ceux qui nous font aujourd'hui des compliments se rendent compte combien nos révélations sous la présidence précédente étaient utiles aussi et que les autres se souviennent de l’approbation qu’ils nous donnaient alors. En rester à un affrontement partisan autour de nos révélations, à la défense d’un camp plutôt que des principes, mine la démocratie. Nous révélons des faits dans l’espoir de la faire progresser et de la renforcer, pas de la décrédibiliser. Si cette commission d’enquête, la première en trente-cinq ans sur une affaire que j’ai contribué à révéler – il n’y en a pas eu sur l’affaire des Irlandais de Vincennes, ni sur l’affaire Greenpeace, ni sur l’affaire Pechiney,… – pouvait tirer la démocratie vers le haut, le travail de Mediapart n’aura pas été inutile.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie tous les deux, mais, avant de lever la séance, une dernière question.
M. Philippe Houillon. Avez-vous, ou non, monsieur Plenel, évoqué l’affaire Cahuzac, y compris ses conséquences politiques, avec Me Mignard ? Si oui, à quelle date ?
M. Edwy Plenel. J’évoque toutes les affaires de Mediapart avec Me Mignard. Nous nous sommes connus quand nous étions étudiants, au début des années 1970, bien avant qu’il connaisse François Hollande. Et il fut mon avocat quand j’ai eu un service militaire agité.
M. Philippe Houillon. Dès le début de l’affaire ?
M. Edwy Plenel. Oui. Je lui parle de tout ce qui concerne Mediapart, y compris de cette audition.
M. le président Charles de Courson. La réponse est claire. Je vous remercie.
Audition du mardi 21 mai 2013
À 16 heures 30 : M. Michel Gonelle, avocat.
M. le président Charles de Courson. La commission d’enquête, qui a commencé ses travaux ce matin en auditionnant deux journalistes de Mediapart, Edwy Plenel et Fabrice Arfi, a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements de l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de l’affaire Cahuzac. Il s’agit, dans un souci de transparence, d’identifier précisément qui savait quoi, et à quel moment, quelles initiatives ont été prises, et par qui.
Il nous a semblé logique de vous entendre, monsieur Gonelle, parmi les tout premiers témoins, car c’est bien l’enregistrement effectué en 2000, dont vous êtes un des détenteurs et dont Mediapart a révélé l’existence le 5 décembre 2012, qui constitue le point de départ de cette affaire. Je vous remercie donc de vous être rendu rapidement disponible pour cette audition.
Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises dans les médias sur les conditions dans lesquelles vous êtes entré en possession de cette bande-son et sur les relations que vous entreteniez avec M. Cahuzac, votre adversaire politique à Villeneuve-sur-Lot. Il reste toutefois des zones d’ombres et des interrogations.
Je vous laisse d’abord la parole pour une quinzaine de minutes. Puis le rapporteur vous interrogera. Ensuite, nos collègues poseront leurs propres questions.
Auparavant, il me revient de rappeler que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Gonelle prête serment.)
M. Michel Gonelle. J’ai quitté la vie publique depuis plusieurs années, et n’étant plus impliqué dans la vie politique, je ne suis plus l’adversaire de qui que ce soit. Par conséquent, tout ce qui a été dit, en termes souvent excessifs, sur l’esprit de vengeance ou de haine qui m’animerait, est complètement stupide. Je n’ai jamais éprouvé de tels sentiments.
On a également beaucoup glosé sur le temps qui s’est écoulé entre la fin de l’année 2000, lorsque j’ai reçu fortuitement, sur la boîte vocale de mon appareil téléphonique mobile, l’enregistrement d’une conversation de Jérôme Cahuzac, et le moment où son existence a été révélée, à la fin de l’année 2012. Or rien ne permet d’affirmer sérieusement que je n’aurais pris aucune initiative lorsque j’ai reçu cet enregistrement, même si, bien entendu, je ne me suis adressé ni aux médias, ni au procureur de la République – bien que je fusse autorité constituée à l’époque. J’ai pris des initiatives. Ces initiatives sont d’ailleurs connues des services enquêteurs de la police judiciaire, qui ont fait un travail remarquable depuis le mois de janvier. L’enquête sur commission rogatoire actuellement en cours attestera de ce que j’ai fait ou fait faire, et à quel moment.
Je souhaite enfin préciser mon attitude lorsque l’affaire a été révélée, le 4 décembre 2012. J’ai été surpris par l’annonce de cette publication dans laquelle je n’ai joué aucun rôle. Ma surprise et mon désarroi ont été suffisamment importants pour que je déclare que je n’étais pour rien dans la publication, mais pas, évidemment, dans le fait que la conversation, dont j’ai été le premier auditeur, ait été enregistrée sur ma boîte vocale et avait été conservée comme une archive sensible.
De tels enregistrements sont conservés dans la mémoire du téléphone pendant quatorze jours. À l’époque maire d’une commune de 23 000 habitants – ne sachant pas si j’allais le demeurer –, j’ai immédiatement compris le caractère sensible et choquant du message. Je n’ai donc pas souhaité que ce document disparaisse.
Telles sont les déclarations que je souhaitais faire en préambule afin de démentir un certain nombre de critiques qui m’ont été faites au début de la révélation de l’affaire. Les dix ou quinze premiers jours qui ont suivi le 4 décembre, en particulier, n’ont pas été pour moi une sinécure.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelles sont donc les initiatives que vous avez prises lorsque vous avez obtenu cet enregistrement ?
M. Michel Gonelle. Trois voies étaient possibles. La première consistait à en parler devant les médias : je l’ai immédiatement rejetée. La deuxième, d’une certaine façon, s’imposait à moi, mais je ne l’ai pas choisie : c’était celle de l’article 40 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aller trouver le procureur de la République de mon département pour lui signaler ce qui constituait un fait délictueux.
J’ai adopté une autre voie. J’avais, dans mon entourage très proche, et même dans mon intimité, un fonctionnaire des impôts. Avec mon accord, il a écouté le message et pris une initiative qui me semble la plus républicaine : informer de ce message et de ce qu’il avait appris avec mon intermédiaire, aussi avec mon accord, le service compétent en la matière, c’est-à-dire la représentation régionale, située à Bordeaux, de la Direction nationale des enquêtes fiscales – DNEF.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cela s’est passé à quel moment ?
M. Michel Gonelle. Au printemps 2001, c’est-à-dire presque aussitôt après la réception du message.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous nous dire qui est la personne dont vous parlez ?
M. Michel Gonelle. Elle n’a pas souhaité révéler son identité. Cependant, des traces de sa démarche demeurent à la DNEF, et les enquêteurs de la police judiciaire ont pu la reconstituer.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Tout cela se passait au moment des élections municipales ?
M. Michel Gonelle. Vous êtes tous des élus, et vous pouvez me comprendre. Nous étions à la veille des élections, et je détenais un document sensible. Je n’avais aucune assurance, en l’écoutant, que le compte à l’étranger dont il était fait mention n’était pas déclaré, même si j’avais une forte présomption. Si j’avais livré ce document sur la place publique en plein débat électoral, je me serais probablement exposé à une action en diffamation ou, plus grave encore, en dénonciation calomnieuse.
En outre, je ne voulais pas polluer le débat électoral avec ce type de polémique, d’autant que Jérôme Cahuzac était un adversaire redoutable. Ainsi, pendant la campagne de 2001, lorsque trois de mes colistiers, médecins, l’ont mis en cause par écrit au sujet des largesses distribuées par certains laboratoires pharmaceutiques aux associations sportives de la ville, sa réponse a été extrêmement cinglante, à l’égard de ces colistiers et de moi-même, en tant que tête de liste. Je ne voulais pas multiplier ce type d’incidents, qui rendent le débat électoral nauséabond. Je n’ai donc pas révélé ce que je savais. De même, je n’ai pas saisi le procureur, ne sachant pas si le compte était déclaré ou non. L’infraction n’aurait été constituée que dans le second cas.
Le signalement a donc été fait au service compétent. Depuis le début de cette affaire, mon entourage et moi-même avons donc eu – pardonnez-moi de le dire – une attitude parfaitement républicaine.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissez-vous Rémy Garnier, et dans l’affirmative, vous a-t-il fait part de ses soupçons à l’égard de Jérôme Cahuzac ?
M. Michel Gonelle. À ce moment, je ne le connaissais pas du tout. Rémy Garnier est un inspecteur des impôts en conflit avec sa hiérarchie depuis qu’il a été interrompu dans le contrôle fiscal qu’il effectuait sur une grande coopérative de pruniculteurs, France Prune. Ce fonctionnaire était pourtant l’un des mieux notés de France. Il a fait rentrer des millions d’euros dans le Trésor en identifiant des fraudes. Mais les intérêts économiques liés à la coopérative agricole avaient conduit le parlementaire de la circonscription à demander, comme cela se pratique, l’indulgence du ministère du budget, qu’il a d’ailleurs obtenue. Il en a résulté toute une polémique sur laquelle je ne reviendrai pas.
Quoi qu’il en soit, Rémy Garnier est devenu mon client beaucoup plus tard, aux environs de 2003, après qu’un de mes confrères du barreau de Bordeaux, Me Boulanger, eut refusé d’assurer sa défense.
M. le président Charles de Courson. Vous ne le connaissiez pas auparavant ?
M. Michel Gonelle. Absolument pas.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est donc pas à lui, mais à un autre fonctionnaire des impôts que vous avez fait écouter l’enregistrement.
M. Michel Gonelle. En effet, c’est à un fonctionnaire qui fait depuis longtemps partie de mon entourage, et que j’aime beaucoup. Il a été président de la Ligue des droits de l’homme. Il est aujourd’hui à la retraite, mais je le fréquente toujours autant.
M. le président Charles de Courson. Vous ne voulez pas nous donner son nom ?
M. Michel Gonelle. Pas sans son accord.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez indiqué avoir contacté le directeur de cabinet adjoint du Président de la République, M. Alain Zabulon, au sujet de cet enregistrement. À combien de reprises avez-vous été en contact ? Qu’avez-vous très exactement dit, et que vous a répondu M. Zabulon ?
M. Michel Gonelle. Je connais Alain Zabulon depuis longtemps, puisqu’il a été sous-préfet dans ma ville. Nous avons partagé une aventure exaltante, la création de la communauté de communes du Villeneuvois. M. Zabulon m’a accompagné lors de nombreuses soirées passées devant les membres de conseils municipaux de petites communes, afin de les rassurer et de leur apporter la parole de l’État. Il a contribué à la création de cette communauté, qui est aujourd’hui une réussite.
Nous avions donc des relations de confiance mutuelle, et j’éprouve encore pour lui, au moment où je vous parle, le plus grand respect. Il est devenu préfet, ce qui est tout à fait mérité, car c’est à mon avis un fonctionnaire de grande qualité.
Lorsque j’étais sous le feu du déchaînement médiatique, pendant les dix jours qui ont suivi le 4 décembre, je ne savais pas trop quoi faire. Certains me sommaient de dire que j’étais le détenteur de l’enregistrement – ce qui était vrai –, d’autres, que j’étais la source de Mediapart – ce qui était faux. Un samedi matin, le 15 décembre, alors que je me trouvais à Paris – à l’hôtel de Harlay, place Dauphine – dans le cadre de mes fonctions de vice-président de la Caisse de retraite des avocats, j’ai décidé d’appeler Alain Zabulon en vue de le rencontrer, non à son bureau, mais plutôt en ville, afin de lui remettre un pli manuscrit que j’avais préparé à l’intention de M. Président de la République, dans lequel j’expliquais ce qui s’était passé en donnant tous les détails que j’étais seul à connaître.
Après avoir connu quelques difficultés pour trouver le numéro, j’ai donc appelé le standard de l’Élysée et demandé à parler à Alain Zabulon. On m’a répondu que l’on ne pouvait pas me le passer. J’ai dit que c’était plutôt urgent, et la standardiste a noté mon numéro de téléphone portable en m’indiquant que le directeur de cabinet adjoint me rappellerait dès qu’il trouverait un moment disponible.
Alain Zabulon m’a rappelé dans les trois minutes qui ont suivi. Après quelques échanges de politesses – nous n’avions plus eu de contact depuis le moment où il avait quitté Villeneuve-sur-Lot –, je lui ai dit précisément ceci : « Vous vous doutez de la raison de mon appel », et il m’a répondu : « Je m’en doute, en effet. ». Je lui ai donc à nouveau expliqué ma démarche, mon souci de transmettre au Président de la République le plus de détails possible sur ce qui s’était passé, et ma conviction absolue que la voix entendue sur cet enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac, dès lors qu’il faisait suite, avec le même numéro d’appel, à un autre appel officiel, celui-là, de Jérome Cahuzac.
J’ai en effet reçu deux messages sur ma boîte vocale fermée. Lors du premier appel, composé avec un numéro que j’ai reconnu être celui de Jérôme Cahuzac, ce dernier m’annonçait que Daniel Vaillant avait accepté de venir à Villeneuve-sur-Lot pour inaugurer le nouveau commissariat de police, et demandait à me rencontrer pour mettre au point les détails de la réception. Nous avions en effet collaboré sur ce dossier, lui en tant que député et moi comme maire. C’était donc notre œuvre commune, réalisée à la plus grande satisfaction des policiers de la ville, auparavant très mal logés.
Après ce premier message, dans lequel il me demandait de le rappeler, venait un autre message – qui n’en était pas vraiment un –, avec le même numéro d’appel. Pour moi, il n’y avait donc aucun doute – j’insiste sur ce point – sur l’origine de cet appel, d’autant que j’ai reconnu les intonations de la voix de Jérôme Cahuzac, dont je connais tous les registres, qu’il s’agisse d’une conversation en privé ou d’un discours public. C’est en effet une personne que je côtoyais presque tous les jours. Je le répète, je n’avais aucun doute, et c’est ce que je souhaitais faire savoir au Président de la République.
Je suis avocat depuis quarante ans et quatre mois. J’ai exercé ce métier avec passion, sans jamais m’attirer la moindre remontrance de la part du conseil de l’ordre. Je suis un homme sincère. Je crois à ce que je fais. J’ai exercé mes fonctions électives du mieux que j’ai pu. J’ai donc voulu dire au président François Hollande ce qui s’était passé, comment cela s’était passé, et pourquoi j’étais sûr de l’origine du message. C’est ce que j’ai expliqué à Alain Zabulon.
Ce dernier m’a dit qu’il s’agissait d’une affaire extrêmement sensible et qu’il devait en référer, ce que je comprenais parfaitement. Il n’avait pas le temps de me rencontrer, étant l’organisateur de l’arbre de Noël de l’Élysée, qui avait lieu dans l’après-midi. Il m’a donc assuré qu’il me rappellerait, et je n’avais pas de raisons de penser qu’il ne tiendrait pas parole. Au sujet de la lettre, il m’a demandé de ne rien faire dans l’immédiat et d’attendre qu’il me rappelle. C’est pourquoi je ne l’ai pas postée.
Le mardi ou le mercredi suivant, la secrétaire de mon cabinet a voulu me passer une communication de M. Zabulon depuis l’Élysée. J’ai donc eu en ligne la secrétaire de ce dernier, qui a d’abord dit qu’elle allait me le passer, puis, quinze secondes plus tard, m’a indiqué qu’il venait de prendre une autre communication et qu’il me rappellerait. J’attends encore.
Cela se passait le mardi. Le lendemain, le site lemonde.fr publiait un article documenté par des déclarations du service de presse de la présidence de la République, et dont le contenu m’a blessé. J’en cite un extrait : « L’Élysée a confirmé avoir été contacté : “Michel Gonelle a bien eu il y a quelques jours un contact avec le directeur de cabinet adjoint de M. François Hollande, Alain Zabulon”, a-t-on déclaré dans l’entourage du président. “Nous l’invitons à remettre tous les éléments à la justice”, a-t-on précisé de même source, estimant toutefois qu’“il n’y avait aucun élément tangible”. “S’il dispose réellement d’éléments, qu’il s’adresse à la justice puisqu’il y a une procédure judiciaire”, a ajouté l’entourage du chef de l’État. »
Pour ma part, je n’ai obtenu aucune réponse de l’Élysée. Pour répondre précisément à votre question, monsieur le rapporteur, je n’ai eu qu’une seule conversation avec M. Zabulon : celle que je vous ai décrite.
Un autre article mentionne que mes propos avaient été qualifiés de confus. Depuis quarante ans, pourtant, mes clients ne me font pas un tel reproche ! Cette affirmation est ce qui m’a le plus blessé. J’ai pensé qu’une porte se fermait, et j’en ai été extrêmement déçu. J’avais pensé être un témoin recevable, et que le premier magistrat de France pouvait écouter ce que j’avais à lui dire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle est la date du communiqué de l’Élysée ?
M. Michel Gonelle. Apparemment, n’y a pas de communiqué de l’Élysée. J’ai cherché parmi les communiqués officiels publiés sur le site internet de l’institution, et je n’en ai pas trouvé trace.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quel document faites-vous référence, dans ce cas ?
M. Michel Gonelle. À un article publié le 21 décembre 2012 à 13 heures 10 sur le Monde.fr et signé : « Le Monde avec l’AFP ». Je n’ai pas eu la curiosité de rechercher la dépêche de l’AFP correspondante.
M. le président Charles de Courson. Je vous prie de nous en remettre une copie.
Par ailleurs, avez-vous encore la lettre que vous souhaitiez remettre au Président de la République, et si oui, pouvez-vous nous la transmettre ?
M. Michel Gonelle. Certainement. Je ne l’ai pas sur moi, mais je ne pense pas l’avoir détruite.
M. le président Charles de Courson. Par ailleurs, pourquoi, lorsque vous avez découvert cet enregistrement sur votre téléphone portable, n’avez-vous pas saisi le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, comme le ferait tout citoyen ? Nous-mêmes, députés, il nous arrive de recevoir des dénonciations. Lorsqu’elles ne sont pas signées, c’est évidemment différent. Mais en l’occurrence, l’origine des informations était établie. Pourquoi n’avoir pas écrit, dès 2001, une lettre au procureur en expliquant que vous aviez reçu cette information à votre corps défendant ? Pourquoi l’avoir gardée pendant onze ans ? Étiez-vous d’ailleurs le seul à la conserver ? D’autres personnes en ont-elles pris connaissance, en plus de celle que vous avez citée ?
M. Michel Gonelle. Les enquêteurs de la police judiciaire ont auditionné toutes les personnes qui ont écouté l’enregistrement, et qui sont moins nombreuses que les doigts d’une seule main.
Vous avez raison, monsieur le président : j’aurais pu recourir à l’article 40. Je ne l’ai pas fait pour deux raisons : premièrement, je n’étais pas sûr que le compte ne fût pas déclaré, et deuxièmement, me trouvant en campagne électorale, je ne souhaitais pas mélanger les genres. Si j’avais transmis cette information au Parquet, je prenais le risque qu’elle soit connue par l’opinion publique. J’ai donc opté pour une autre voie, celle du signalement auprès du service compétent de l’administration fiscale. J’ai jugé que cette voie était la plus « normale », le meilleur moyen de vérifier que le compte en banque n’était pas déclaré. J’avais en outre une grande confiance dans mon messager. J’ai appris que le fonctionnaire à qui l’information avait été apportée avait demandé la transmission à Bordeaux du dossier fiscal de M. Cahuzac.
Quelque temps plus tard, j’ai également appris – toujours par le biais de mon ami, inspecteur des impôts à Villeneuve – que Bercy avait refusé la communication du dossier au service demandeur, pourtant compétent en matière de fraude ou d’évasion fiscale. L’explication qui m’a été donnée – je ne sais pas si elle est vraie – est qu’il existe une procédure particulière pour les hommes politiques, les footballeurs et les cadres de haut niveau de l’administration fiscale visés par une enquête fiscale.
M. le président Charles de Courson. Vous vous êtes contenté de cette réponse ? Vous êtes pourtant un homme de droit.
M. Michel Gonelle. Je n’ai pas voulu aller plus loin lorsque j’ai vu que cette porte se fermait. Une autre opportunité s’est cependant présentée à moi, le 12 novembre 2006, avec la venue de Jean-Louis Bruguière.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est à ce moment qu’il a obtenu une copie de l’enregistrement.
M. Michel Gonelle. Ce haut magistrat, que tout le monde connaît, envisageait d’être candidat aux élections législatives dans le Villeneuvois. Il faisait donc le tour des responsables et anciens responsables afin de vérifier si ses chances étaient réelles et s’il pourrait obtenir des soutiens. Je l’ai reçu très longuement dans mon bureau. Nous avons parlé de ses chances, mais aussi de son adversaire principal, qui serait inévitablement Jérôme Cahuzac, dans la mesure où celui qui l’avait battu en 2002, Alain Merly, ne se représentait pas. Nous avons donc passé en revue les qualités, nombreuses, mais aussi les défauts de M. Cahuzac. Nous avons en particulier évoqué les questions qui se posaient sur son train de vie, les subventions apportées par des laboratoires pharmaceutiques aux associations sportives de la ville, ou le grand rassemblement organisé à Villeneuve, fin 1999 ou début 2000, par le laboratoire Lilly. C’est à ce moment que j’ai parlé de l’enregistrement à Jean-Louis Bruguière, et d’une certaine façon, je le regrette, car il n’a pas fait un bon usage de cette information.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce lui qui a transmis l’enregistrement à Mediapart ?
M. Michel Gonelle. Vous allez trop vite, monsieur le rapporteur. En outre, je n’ai pas la réponse à cette question.
Lorsque j’ai demandé à Jean-Louis Bruguière s’il savait que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, il a aussitôt voulu savoir comment j’en étais informé. Je lui ai donc raconté l’anecdote du téléphone. Apprenant que j’avais conservé l’enregistrement, il a voulu l’écouter. Mais le support était un mini-CD, dont on avait l’usage au début des années 2000, et je n’avais pas avec moi l’appareil permettant de le lire. Il m’a donc dit : « Confiez-le moi, je l’écouterai, puis je vous le rendrai. » Quand je l’ai averti que le son était de très mauvaise qualité, il m’a répondu qu’il avait à sa disposition des gens capables de l’améliorer. Je l’ai cru, car ce juge antiterroriste avait mené de nombreuses enquêtes impliquant des écoutes téléphoniques.
Bien que ne le connaissant pas très bien à l’époque, je lui ai fait confiance, car il était auréolé du prestige lié à son titre de premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Je lui ai donc donné l’un des deux mini-CD que je détenais. Il ne me l’a jamais rendu – alors que j’en étais le légitime propriétaire –, ni ne m’a dit ce qu’il en avait fait. Lorsque l’affaire a été révélée, il a eu des propos – rapportés, je crois, par Paris Match – absolument ignobles et mensongers à mon égard. Il a ainsi prétendu qu’il avait détruit l’enregistrement sans l’écouter, et qu’il m’avait congédié sur le champ de son équipe de campagne. Or, non seulement cette équipe n’était pas constituée en novembre 2006, mais il m’a écrit plus tard de façon louangeuse afin de me remercier pour les bons et loyaux services que je lui avais rendus pendant cette campagne. Visiblement, il ne se rappelait plus avoir envoyé cette longue lettre manuscrite, que j’ai depuis remise aux enquêteurs. Ce qu’il a raconté à la presse est donc complètement faux, et je lui en veux beaucoup de ce mensonge qui ne l’honore pas.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi, à votre avis, a-t-il eu cette attitude ?
M. Michel Gonelle. C’est à lui qu’il faut poser la question. Pour ma part, je ne m’explique un tel mensonge proféré par un haut magistrat.
M. le président Charles de Courson. Comment, selon vous, les journalistes de Mediapart ont-ils obtenu l’enregistrement ? Est-ce vous qui le leur avez fourni, ou bien quelqu’un à qui vous l’auriez transmis ? Quelle est votre hypothèse ?
M. Michel Gonelle. Je le répète, j’ai fait écouter cet enregistrement à un petit cercle d’amis – moins de cinq personnes –, et j’en ai donné copie à une seule personne, Jean-Louis Bruguière. Dès lors que ce n’est pas mon exemplaire qui a été transmis à Mediapart, puisque je l’ai donné à la police judiciaire, il s’agit forcément de l’autre qui a circulé. Je n’imagine pas une seconde que M. Bruguière ait donné à Mediapart l’exemplaire qu’il détenait. Je ne pense pas, en effet, que les relations qu’il entretient avec ce journal soient au beau fixe. Mon hypothèse est qu’à l’époque, en 2006 et 2007, ce disque a dû circuler entre les mains de plusieurs personnes avant d’aboutir à Mediapart. Je n’en ai cependant aucune preuve.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est donc pas vous qui avez fourni l’enregistrement ?
M. Michel Gonelle. Non, les journalistes de Mediapart l’ont confirmé à de nombreuses reprises.
M. le président Charles de Courson. Ils nous l’ont répété ce matin. Résumons-nous. Il n’existait que deux exemplaires. Vous en avez conservé un, que vous avez remis…
M. Michel Gonelle. …aux enquêteurs, qui ont fait un scellé.
M. le président Charles de Courson. Le second, vous l’avez donné à M. Bruguière, futur candidat aux élections législatives, qui a déclaré dans la presse l’avoir détruit.
M. Michel Gonelle. En effet.
M. le président Charles de Courson. Entre le moment où il l’a obtenu et sa destruction, des copies n’ont-elles pas été faites ?
M. Michel Gonelle. Je ne sais pas.
M. Jean-Pierre Gorges. Il faudra le demander à M. Bruguière !
M. Michel Gonelle. Pour ma part, je ne l’ai pas beaucoup revu.
M. Christian Eckert. Je souhaitais vous demander combien d’exemplaires il existait de cet enregistrement, mais il ressort de vos propos qu’il n’y en avait que deux : le vôtre, que vous avez remis à la police, et celui du juge Bruguière. C’est d’ailleurs ce que vous aviez affirmé à la presse. Le confirmez-vous ?
M. Michel Gonelle. Oui. J’ajoute que les deux supports étaient absolument identiques, des mini-CD insérés dans un étui de plastique rigide. Le technicien qui a procédé à la sauvegarde de l’enregistrement, entendu par la police judiciaire, a expliqué en détail comment il s’y était pris.
M. Hervé Morin. En 2001, après avoir indirectement informé l’antenne régionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales, vous n’avez jamais cherché à savoir où en était l’enquête. N’est-ce pas surprenant ? Vous disposez d’informations majeures sur Jérôme Cahuzac, qui était devenu parlementaire, et à aucun moment vous n’en avez fait part à quiconque entre 2001 et 2012.
À partir de 2002, nous étions à nouveau dans la majorité. Il n’aurait pas été difficile de passer un coup de fil à un conseiller technique au ministère du budget afin de lui demander ce qui avait été fait. Pourtant, vous n’avez rien entrepris pendant dix ans. C’est curieux.
M. Michel Gonelle. J’ai lancé une alerte, ce que je jugeais normal, auprès du service qui me paraissait adéquat. On m’a dit que Bercy avait refusé de transmettre le dossier. Il y avait bien un ministre en charge du budget à l’époque !
Je n’ai pas, en effet, suivi l’état de la procédure. Peut-être n’ai-je pas l’âme d’un enquêteur ou d’un procureur. Peut-être me suis-je trop conduit en avocat. Je n’ai pas fait davantage, c’est vrai.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je ne mets pas votre bonne foi en doute, mais je voudrais comprendre. Vous avez obtenu l’enregistrement à la fin de l’année 2000. Les élections municipales ont eu lieu en 2001. Pourquoi ne pas avoir eu recours à l’article 40 du code de procédure pénale après la campagne ?
Votre défense comprend deux points. Tout d’abord, vous n’étiez pas sûr que le compte ne fût pas déclaré. Mais je crois me rappeler que Jérôme Cahuzac, dans la conversation qui a été enregistrée, dit de la banque UBS qu’elle « n’est quand même pas forcément la plus planquée des banques ». On peut imaginer que le compte n’était pas déclaré, si bien que ce premier argument ne tient pas.
Le deuxième est que vous ne vouliez pas rendre cette information publique. Cependant, si vous aviez saisi le procureur au titre de l’article 40, compte tenu des éléments importants dont vous disposiez, cela aurait certes pu entraîner une enquête, mais votre démarche n’aurait pas été connue du grand public.
Je comprends que vous n’ayez pas souhaité emprunter la première voie – le recours aux médias –, mais je ne vois pas pourquoi vous n’avez pas eu recours à l’article 40, surtout à partir du moment où vous avez constaté que votre démarche auprès de l’administration fiscale n’avait rien donné.
M. Michel Gonelle. Il me semble l’avoir déjà dit : je n’ai pas eu recours à l’article 40, c’est un fait. Vous n’avez pas eu la chance d’avoir, comme moi, un homme tel que Jérôme Cahuzac comme adversaire. C’est un adversaire particulier.
Lorsque mes colistiers ont fait une très légère allusion aux subventions données par les laboratoires pharmaceutiques aux associations sportives de la ville en période préélectorale,– d’une certaine façon, cela constituait un financement illégal, dans la mesure où les entreprises concernées, en remettant devant la presse des images de chèques en grand format, contribuaient à valoriser l’action du député –, la réponse de M. Cahuzac a été cinglante : « puisque nous sommes traités de corrupteurs, il n’y aura désormais plus aucune subvention de la part des laboratoires. Si les clubs sportifs ne sont plus aidés financièrement, ce sera de la faute des conseillers municipaux d’opposition ».
Jérôme Cahuzac n’est pas un adversaire comme les autres. Au moindre pas de travers, il sait répliquer. Je n’ai donc pas trouvé opportun de m’acharner pour obtenir une enquête de la part de services qui, manifestement, ne voulaient pas enquêter. Je ne suis pas sûr que le procureur de la République eût fait mieux que la Direction nationale des enquêtes fiscales. Dois-je présenter des excuses ? S’il le faut, je le ferai volontiers. Mais il n’est pas dans mon tempérament de poursuivre quelqu’un inlassablement. J’ai fait ce qu’il fallait en lançant une alerte au moment où il le fallait.
M. Hervé Morin. Pourquoi, alors, avoir cherché à contacter l’Élysée en novembre 2012 ?
M. Michel Gonelle. Mais en 2012, tout le monde m’est tombé dessus !
M. Christian Assaf. Pardonnez-moi d’insister, mais je suis de l’avis de mes collègues. Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez tout de suite compris le caractère sensible et choquant de cet enregistrement, ce qui vous a conduit à le conserver. D’ailleurs, vous affirmez que vous n’avez pas voulu vous acharner, mais vous avez tout de même gardé ce document plus de dix ans.
M. Michel Gonelle. Je ne l’ai pas détruit, en effet.
M. Christian Assaf. Parmi les trois voies qui s’offraient à vous, vous avez choisi de confier à un de vos intimes, un fonctionnaire des impôts en qui vous aviez confiance, le soin d’informer le service compétent, à savoir l’antenne bordelaise de la DNEF. Savez-vous quelle forme a pris cette alerte ? Existe-t-il une lettre, un dossier ?
M. Michel Gonelle. Tout cela figure dans l’enquête judiciaire.
M. Christian Assaf. En dehors de cette initiative de 2001, vous en avez pris une autre en 2006, avec le juge Bruguière.
M. Michel Gonelle. C’est cela.
M. Christian Assaf. Vous avez dit que la campagne électorale n’était pas un moment propice pour dévoiler cette affaire. Mais après les élections, qui ont conduit à la victoire de Jérôme Cahuzac, et malgré le silence de l’administration, vous ne tentez rien. En 2002, M. Cahuzac perd l’élection législative, mais vous ne cherchez pas à relancer la procédure. Il en est de même lorsqu’il est nommé président de la Commission des finances, quand il fait partie de l’équipe de campagne du candidat François Hollande, et enfin quand il devient ministre. Tout cela est troublant.
M. Michel Gonelle. Je n’ai pas été un accusateur assez zélé, selon vous.
M. Christian Assaf. Je trouve ce comportement incompatible avec le fait de garder cet enregistrement pendant plus de dix ans.
M. Michel Gonelle. Je n’ai exercé de mandat que jusqu’en 2004, date à laquelle je suis sorti de la vie publique. Je ne pense pas à Jérôme Cahuzac matin, midi et soir. Je vous livre ces faits sous serment : c’est la vérité, il n’y en a pas d’autre.
M. Christian Assaf. Vous n’avez plus l’enregistrement à votre disposition ?
M. Michel Gonelle. Non.
M. Gérald Darmanin. Je souhaite en revenir à l’objectif de notre commission d’enquête, déterminer si l’appareil d’État était informé de cette affaire.
Vous avez dit à Mme Dalloz qu’elle n’avait pas eu la chance d’avoir un adversaire tel que Jérôme Cahuzac. De même, beaucoup d’entre nous n’avons pas eu la chance d’avoir un opposant tel que vous : bien que disposant d’un tel document, vous n’en faites usage à aucun moment, ni pendant, ni après la campagne électorale. On peut porter à votre crédit de n’avoir pas voulu faire preuve d’acharnement à l’égard de M. Cahuzac.
Vous avez dit plusieurs fois, à propos de ce dernier, qu’il était un adversaire particulier. N’avez-vous pas eu peur de lui, de ses réseaux, de ses relations et de sa façon de faire de la politique ? Les chèques remis aux associations sportives constituent en effet une pratique étonnante, mais ils ne suffisent pas à expliquer ce qualificatif, « particulier ». Avez-vous d’autres exemples en tête, qui nous permettraient de comprendre pourquoi vous n’avez pas, même après la campagne électorale, fait un choix qui vous aurait permis d’assouvir une petite vengeance tout en servant le pays et l’intérêt général ? Qu’est-ce qu’un « candidat particulier » ?
M. le président Charles de Courson. Plus généralement, quelle était la nature de vos relations avec M. Cahuzac ?
M. Michel Gonelle. Sur ce point également, beaucoup de bêtises ont été publiées dans la presse.
M. Jérôme Cahuzac est arrivé à la fin de l’année 1996 dans le Villeneuvois, parrainé par le maire de Marmande, Gérard Gouzes, comme lui d’origine rocardienne. Or on a dit – et même écrit – que j’avais favorisé son installation à Villeneuve-sur-Lot. Cependant, lorsqu’il s’est présenté aux législatives en 1997, j’étais moi-même candidat indépendant. Le député UDF sortant, Daniel Soulage, élu cinq ans auparavant avait obtenu le soutien de l’UDF comme du RPR. Je n’avais donc pas l’investiture de mon parti. Néanmoins, la majorité de mon conseil municipal a estimé que le maire de la ville chef-lieu devait être candidat, et j’ai accepté de me lancer, avec tous les inconvénients liés à l’absence d’investiture.
J’ai obtenu 15 % des voix au premier tour. Le soir même, j’ai rédigé le texte annonçant mon désistement en faveur de Daniel Soulage, qui a été publié dès le lendemain matin. D’ailleurs, les mêmes qui aujourd’hui m’accusent d’avoir été un soutien de Cahuzac me reprochaient à l’époque de me désister trop vite.
Par la suite, ayant appris que François Bayrou venait à Villeneuve-sur-Lot soutenir le député sortant, j’ai fait savoir à M. Soulage que je les recevrais volontiers à la mairie. J’ai accueilli M. Bayrou conformément à son statut d’homme politique de premier plan, en compagnie du candidat, de son suppléant et de mes colistiers.
De même, au cours de la semaine précédant le deuxième tour, nous avons multiplié les démarches en faveur de Daniel Soulage, au point que ce dernier a obtenu dans la commune de Villeneuve le même résultat, soit 53 %, que celui dont il a bénéficié dans son fief politique, le canton de Monflanquin. Cela signifie que l’affirmation, rapportée par Le Nouvel Observateur et Le Point, selon laquelle j’aurais favorisé l’arrivée de Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot, est une fable. Ce mensonge a été inventé par l’un de mes anciens adjoints, qui m’a d’ailleurs quitté en 2001 pour présenter une liste contre moi. Je rappelle que M. Cahuzac a été élu maire dans le cadre d’une triangulaire, avec 42 % des voix.
Telles étaient mes relations avec Jérôme Cahuzac. J’étais un adversaire courtois, et non pas un adversaire tordu.
M. le président Charles de Courson. En d’autres termes, les affirmations publiées dans la presse pour illustrer la complexité de vos relations sont inexactes.
M. Michel Gonelle. C’est ce que montrent les faits que je viens de vous rapporter.
M. Gérald Darmanin. D’après ce que nous ont dit ce matin Edwy Plenel et Fabrice Arfi, vous auriez utilisé, à Agen, l’appareil d’un policier que vous connaissiez pour tenter de contacter M. Plenel, à qui vous avez demandé de vous rappeler. Plus tard, le commissariat en a informé le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne, lequel a prévenu la chef de cabinet du ministère du budget, elle-même indiquant dans un courrier électronique destiné à M. Cahuzac qu’elle attendait d’autres informations de la part du directeur départemental de la sécurité publique. Cela reviendrait à dire que les services du ministère de l’intérieur étaient informés.
Décidément, vous n’avez pas beaucoup de chance avec les téléphones. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été conduit à utiliser celui d’un policier pour appeler M. Plenel ?
M. Michel Gonelle. Il s’agit d’un incident assez anecdotique, qui s’est produit le 11 décembre, à un moment où, harcelé par la presse écrite et audiovisuelle – aux sollicitations de laquelle je n’ai jamais refusé de répondre –, je devais consacrer une part déraisonnable de mon temps au téléphone. Je me trouvais en audience au tribunal correctionnel d’Agen quand j’ai reçu un message de Mediapart – c’était le premier contact que j’avais avec ce journal – me demandant de rappeler. Comme la batterie de mon téléphone était déchargée, j’ai demandé au chef d’escorte présent sur place, que je connais depuis longtemps, de me prêter le sien. J’ai tenté à deux reprises de contacter mon interlocuteur à Mediapart, tombant à chaque fois sur le répondeur, avant de renoncer et de rendre l’appareil à son propriétaire. Par la suite, le policier – d’après ce que l’on m’a raconté – a reçu un appel depuis le numéro que j’avais appelé. Apprenant qu’il s’agissait d’Edwy Plenel et de Mediapart, et craignant sans doute des ennuis, il a décidé de rédiger un rapport succinct à l’intention de son chef de service. Ce dernier, semble-t-il, a jugé préférable d’en avertir le préfet, qui lui-même a dû estimer nécessaire d’en référer au ministre du budget.
M. Hervé Morin. C’est en effet fort probable !
M. Michel Gonelle. C’est ainsi que l’information est parvenue à Mme Valente, qui l’a transmise dans un courrier à Jérôme Cahuzac.
M. Gérald Darmanin. Une dernière question : pouvez-vous confirmer que M. Zabulon ne vous a jamais rappelé et qu’il ne vous a pas conseillé de saisir la justice ?
M. Michel Gonelle. J’ai oublié de préciser tout à l’heure que M. Zabulon m’avait demandé si je détenais encore l’enregistrement. Je lui ai répondu que c’était le cas. À la fin de la conversation, il m’a dit : « Ne faites rien. Attendez que je vous rappelle. » Je suis resté sur cette injonction. Par la suite, il a tenté de me rappeler, mais je ne l’ai jamais eu en ligne.
M. Jean-Pierre Gorges. Merci pour ces explications : peu à peu, nous comprenons mieux le déroulement des faits.
Quelles ont été vos relations avec Mediapart depuis le 4 décembre ? Quand avez-vous été contacté, et quels ont été vos échanges ? Ce matin, les journalistes nous ont donné un certain nombre d’éléments, et j’aimerais croiser les agendas.
M. Michel Gonelle. Notre premier contact a eu lieu le 11 décembre, dans les circonstances un peu cocasses que je viens de décrire. L’enquêteur de Mediapart et son patron ont demandé à me rencontrer, et nous nous sommes vus le vendredi 14 décembre à Paris, dans mon hôtel. Ils souhaitaient que je me dévoile. Je leur ai répondu que je n’avais pas l’intention de le faire de la façon à laquelle ils pensaient, sans leur préciser mon intention de m’adresser au Président de la République.
M. Thomas Thévenoud. Si redoutable que soit Jérôme Cahuzac, on a du mal à comprendre que vous soyez resté pendant dix années en possession d’un mini-CD contenant ce que vous considériez comme étant l’enregistrement de sa voix, et que vous n’ayez pas fait le choix, sur ce sujet sensible, de saisir la justice, le gouvernement ou le président de la République alors en fonction. Quel espoir placiez-vous dans la démarche que vous avez effectuée auprès de M. Zabulon ?
Que vouliez-vous dire par « ce que j’ai fait ou fait faire » ? Pouvez-vous préciser ce que vous avez « fait faire » ?
Enfin, où ont été conservés les enregistrements pendant toute cette période ?
M. Michel Gonelle. En contactant Alain Zabulon, j’espérais qu’il pourrait remettre en mains propres au Président de la République la lettre que je lui destinais. Tel était mon but.
M. Thomas Thévenoud. Mais pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?
M. le président Charles de Courson. Beaucoup de nos collègues ont du mal à comprendre que vous ayez conservé une preuve matérielle aussi longtemps. Si vous aviez pensé qu’elle n’avait pas de valeur, vous auriez pu la détruire, mais vous nous avez justement dit, à l’inverse, que vous étiez sûr de l’identité de la personne enregistrée.
M. Michel Gonelle. Monsieur le président, a-t-on le droit de se montrer impertinent devant votre commission ?
M. le président Charles de Courson. Pourvu que vous nous disiez la vérité.
M. Michel Gonelle. L’enregistrement a été diffusé par Mediapart le 4 décembre. À ce moment, la quasi-unanimité de la classe politique – et dans tous les groupes – a pris la défense de Jérôme Cahuzac. Ceux qui étaient mis en accusation dans la presse, c’était plutôt – dans cet ordre – les journalistes de Mediapart, l’inspecteur Rémy Garnier et votre serviteur. Nous avons dû subir au quotidien des pressions, des insultes et des quolibets. Un journaliste travaillant pour un hebdomadaire paraissant le dimanche m’a ainsi – littéralement – donné un nom d’oiseau et m’en rendra raison : l’action en diffamation que j’ai intentée sera examinée demain.
Peut-être n’avais-je pas été un procureur suffisamment zélé, mais après la diffusion de l’enregistrement, j’ai été soumis à une pression invraisemblable. Et j’ai ressenti une grande colère à l’égard des élus et de la presse qui, influencés par une agence de communication fort habile, ont pris fait et cause pour quelqu’un que je savais être un fraudeur. Je peux admettre que l’on me reproche de n’avoir pas agi assez vite, mais n’oublions pas que lorsque Mediapart a porté son accusation, tout le monde, ou presque, s’est placé du côté de la défense.
Si j’ai parlé de ce que j’ai fait ou fait faire, c’est parce que je n’ai pas personnellement rencontré le responsable de la DNEF qui était en poste à Bordeaux lors de la première alerte, M. Mangier ; c’est l’inspecteur des impôts dont j’ai déjà parlé qui l’a fait avec mon accord.
M. le président Charles de Courson. M. Mangier était le directeur régional des services fiscaux ?
M. Michel Gonelle. Je l’ignore, mais c’était la personne idoine.
M. Thomas Thévenoud. L’intermédiaire dont vous ne voulez pas révéler l’identité a-t-il fait écouter l’enregistrement à M. Mangier ?
M. Michel Gonelle. Non, car il ne l’a jamais eu en sa possession.
Vous m’avez demandé où était conservé cet enregistrement. Il n’a jamais été confié à un notaire – c’est une fable ridicule –, mais était tout simplement rangé dans un tiroir, dans mon cabinet d’avocat. D’ailleurs, lors de la révélation de l’affaire, le 4 décembre, lorsque j’ai recherché l’exemplaire resté en ma possession, j’ai mis trois jours à le trouver.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez déclaré ne plus faire partie de la vie publique depuis 2004. Mais vous avez reçu en 2006 M. Bruguière, à qui vous avez donné un élément qui pouvait se révéler très important pour sa future campagne. À mes yeux, cela revient à participer à la vie publique.
J’ai par ailleurs du mal à comprendre qu’au moment de la révélation de l’existence de l’enregistrement, le 4 décembre, vous n’ayez pas souhaité crier la vérité que vous déteniez depuis dix ans, afin de vous dégager de cette affaire, ni porter une lettre au procureur de la République.
Je répète la question de mon collègue Thévenoud : qu’attendiez-vous du Président de la République ? Ce n’était, à l’évidence, pas lui que vous deviez approcher, mais plutôt le procureur.
M. Michel Gonelle. Je ne suis pas de votre avis sur ce dernier point.
Quant à votre première question, madame la députée, je considère que participer à la vie publique, c’est être élu. Or je n’exerçais plus aucun mandat après 2004. Jean-Louis Bruguière a souhaité me rencontrer pour recueillir mon avis de citoyen disposant d’une influence. En outre, la remise de l’enregistrement n’était pas une démarche totalement volontaire de ma part : M. Bruguière avait manifesté avec insistance le désir de l’entendre, et il m’a demandé de le lui remettre en me promettant qu’il le rendrait. Il n’était pas question d’une publication. Et après tout, Jean-Louis Bruguière n’était pas un candidat comme les autres : premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris, le premier de France, c’était un haut magistrat, doté d’une réputation importante au Palais de justice. J’ai donc pensé pouvoir placer en lui ma confiance même si ce n’était pas le procureur de la République d’Agen.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans une interview du 3 avril, vous indiquez que l’administration des douanes aurait eu connaissance dès 2008 de l’existence du compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac. Comment le saviez-vous ?
M. Michel Gonelle. En réalité, il y a une erreur dans la transcription de mes propos, car cette administration le savait bien avant 2008. J’ai entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le service compétent des douanes, le chef du 4ème bureau de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières - une des divisions de la DNRED - avait obtenu ce renseignement dès 2001, même si j’ignore de quelle façon. Selon mes informations, dont j’ai tout lieu de penser qu’elles sont sérieuses, ce cadre de haut niveau, administrateur civil d’origine, a été interrogé par plusieurs journalistes sur ce fait, sans jamais le démentir ni le confirmer.
M. le président Charles de Courson. Quel est son nom ?
M. Michel Gonelle. Thierry Picart.
M. Jean-Marc Germain. Beaucoup d’entre nous sont troublés par votre témoignage. En 2001, vous ne vouliez pas utiliser cette information contre un adversaire politique, mais c’est pourtant ce que vous avez fait lors de l’élection suivante, sans être capable de nous expliquer ce qui vous a fait changer d’avis. M. Bruguière était un candidat potentiel face à M. Cahuzac. Nous ne comprenons toujours pas, alors que cette audition dure depuis une heure et demie, pourquoi vous n’avez pas transmis les informations que vous déteniez, soit au titre de l’article 40 du code de procédure civile, soit en saisissant formellement, en votre nom, l’administration fiscale. C’était votre devoir de maire et de citoyen. Or, vous n’avez pas donné d’explication convaincante.
Ce qui me trouble également, c’est le luxe de détails dans lequel vous entrez sur certains points de votre témoignage, comme lorsque vous évoquez vos contacts avec M. Zabulon ou le devenir de l’enregistrement. Vous avez d’abord dit que le support était une petite disquette, et que vous ne pouviez pas le faire écouter à M. Bruguière parce qu’il fallait une grande disquette ; puis qu’il existait deux disquettes identiques ; enfin, que vous aviez la disquette sous la main, dans votre tiroir, mais que vous avez mis trois jours à la trouver…
Pouvez-vous nous redire précisément comment vous avez transféré l’enregistrement de votre téléphone portable vers une disquette, puis comment vous êtes passé de ce support, que je comprends être une petite disquette, vers une plus grande disquette destinée à M. Bruguière. C’est le premier point troublant.
Par ailleurs, il ressort de vos propos que vous avez une grande proximité avec des agents du fisc : vous êtes l’avocat de l’un d’entre eux, un autre est un de vos amis très proches, à qui vous demandez de transmettre à Bordeaux les informations dont vous disposez. Par la suite, vous obtenez, en retour, des informations – qui relèvent pourtant du secret fiscal – sur les suites données à cette démarche. De même, vous avez apparemment des relations très proches avec des agents des douanes qui, dès 2001, vous confirment l’existence du compte en banque. Pouvez-vous nous expliquer cette grande proximité avec des agents de l’État, qui vous permet d’obtenir en permanence des informations que vous êtes apparemment le seul à connaître sur Jérôme Cahuzac ?
M. Michel Gonelle. Monsieur le député, il n’y a pas de trouble dans mon esprit. La police judiciaire a entendu le technicien qui a sauvegardé l’enregistrement : ce dernier a fabriqué deux minidisques identiques que j’ai conservés. J’en ai remis plus tard un exemplaire à Jean-Louis Bruguière – qui, du reste, ne s’en est pas servi plus que moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’en savez-vous ?
M. Michel Gonelle. M. Bruguière n’a pas non plus saisi le procureur de la République en vertu de l’article 40 ! Il a même dit qu’il avait détruit l’enregistrement !
M. le président Charles de Courson. Les membres de la commission d’enquête se demandent comment les journalistes de Mediapart ont obtenu l’enregistrement. Ces derniers nous ont confirmé ce matin que ce n’était pas vous qui le leur aviez remis. Or il n’existait que deux exemplaires.
Ce matin, M. Plenel et M. Arfi n’ont pas voulu révéler par quel moyen ils ont obtenu l’enregistrement. En tant que journalistes, ils ne sont pas obligés de révéler leurs sources. C’est sans doute en auditionnant M. Bruguière que nous saurons ce qu’il a fait de son exemplaire. Sur ce point, nous ne pouvons que formuler des hypothèses.
M. Jean-Marc Germain. Comment l’enregistrement a-t-il été transféré depuis votre téléphone ? Y a-t-il eu, dès le départ, deux copies de faites, et pourquoi ? Comment se fait-il qu’il ait fallu trois jours pour retrouver un support qui se trouvait dans un tiroir, à portée de main ?
M. Michel Gonelle. Il s’est écoulé six années entre ma rencontre avec M. Bruguière et la révélation de l’affaire par Mediapart. En 2006, les deux disquettes se trouvaient, ensemble, dans un tiroir de mon bureau. J’en ai remis une à Jean-Louis Bruguière, qui ne me l’a pas rendue. En 2012, l’exemplaire restant ne se trouvait pas au même endroit, ce qui est assez banal.
Puis-je me montrer encore impertinent, monsieur le président ?
M. le président Charles de Courson. Vous êtes un homme libre : cette commission ne vous demande que de dire la vérité.
M. Michel Gonelle. Je croyais que cette commission avait pour but de pointer les dysfonctionnements de l’État.
M. le président Charles de Courson. C’est en effet notre objectif.
M. Michel Gonelle. Si je suis en accusation, dites-le moi ! J’ai l’habitude de faire face.
M. Jean-Marc Germain. Pas du tout, monsieur Gonelle. Mais les nombreuses relations que vous entretenez avec des fonctionnaires s’inscrivent pleinement dans le cadre de cette commission d’enquête.
M. Michel Gonelle. Je ne vous ferai pas l’injure de penser que vous-même n’avez pas d’excellentes relations avec de nombreux fonctionnaires des impôts. Cela fait partie de votre mission.
M. Jean-Marc Germain. Pas des relations de cette nature, non.
M. le président Charles de Courson. Vous êtes élu de la région parisienne, monsieur Germain. En province, nous n’avons pas le même type de relations avec les agents de l’État que dans une grande agglomération.
M. Jean-Marc Germain. Mais tout le monde applique l’article 40 quand il doit le faire.
M. Philippe Houillon. Pour ma part, monsieur Gonelle, je vous remercie pour la clarté de votre exposé, la cohérence de vos réponses, mais aussi pour la patience dont vous faites preuve en répondant avec constance à des questions déjà posées plusieurs fois.
Selon vous, M. Cahuzac pouvait-il se douter que vous déteniez cet enregistrement, ou du moins une information à propos de son compte en Suisse ? Il s’est en effet passé beaucoup de temps avant la révélation de l’affaire par Mediapart, et plusieurs personnes étaient dans la confidence, même si elles n’étaient pas nombreuses.
M. Michel Gonelle. Merci pour votre amabilité, Monsieur le bâtonnier. Non, M. Cahuzac ne l’a jamais su. Nous n’en avons jamais parlé, bien que nous ayons continué à dialoguer après que j’ai quitté la vie publique. Mon dernier entretien avec Jérôme Cahuzac a eu lieu dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, c’est-à-dire en octobre 2012. Mais nous n’avons jamais abordé cette question qui, pour moi, était un peu enfouie dans les mauvais souvenirs de ma vie publique.
M. Philippe Houillon. Je suppose, monsieur le président, que notre commission entendra également M. Bruguière ?
M. le président Charles de Courson. Nous le souhaitons tous les deux, le rapporteur et moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est la commission dans son ensemble qui décide des auditions.
M. le président Charles de Courson. Si tout le monde en est d’accord, nous recevrons donc M. Bruguière.
M. Hervé Morin. Il faudrait également convoquer M. Mangier.
M. Michel Gonelle. C’est impossible, car il est décédé. Mais les enquêteurs ont interrogé son entourage.
M. le président Charles de Courson. Nous nous tournerons donc vers ses collaborateurs.
M. Dominique Baert. L’objet de cette commission d’enquête concerne en effet le fonctionnement de l’État. Elle se demande qui savait et, le cas échéant, pourquoi ceux qui savaient n’ont pas agi.
Mediapart, entre autres, confirme que vous avez remis à la police la copie de l’enregistrement le mercredi 16 janvier 2013.
M. Michel Gonelle. C’est exact.
M. Dominique Baert. Ce qui nous intéresse tous, c’est ce qui s’est passé pendant les années antérieures. En 2001, vous étiez celui qui savait. Au printemps 2001, Jérôme Cahuzac vous bat aux élections municipales : cela ne peut que laisser amer, d’autant qu’il poursuit son ascension et s’installe durablement dans ses fonctions municipales.
Vous saisissez indirectement l’administration fiscale, sans savoir ce qui en résulte. Puis il ne se passe plus rien. Vous vous éloignez ensuite de la vie politique en 2004. Nous avons beaucoup de peine à comprendre qu’entre 2001 et 2004, vous n’ayez pas cherché à vous rapprocher de l’administration pour tenter de comprendre pourquoi votre initiative n’a pas eu de suites – même si la direction nationale n’avait pas voulu accéder à la demande de l’antenne régionale.
En 2006, un candidat se présente soudain à vous et vous lui donnez l’information que vous détenez, sans que cela conduise à l’interpellation des pouvoirs publics. Pendant ce temps, Jérôme Cahuzac continue à grimper les échelons, devient une des grandes voix de la commission des finances, puis son président, tout en exerçant des fonctions éminentes au sein du parti socialiste.
Pourquoi, à votre avis, M. Bruguière, candidat aux législatives, n’a-t-il pas fait connaître les éléments dont il disposait ? Vous me répondrez sans doute que c’est à lui qu’il faut poser la question. Mais pensez-vous raisonnablement qu’il ne les a pas transmis, soit à l’administration fiscale, soit à la justice, voire qu’il ne les a pas exploités politiquement ? Vous-même avez dit ne pas vouloir suivre cette voie compte tenu du contexte, mais M. Bruguière aurait-il eu les mêmes préventions ?
M. Michel Gonelle. Vous devez lui poser la question. C’est à sa demande que je lui ai remis l’enregistrement, après lui avoir parlé de ce compte à l’étranger et des circonstances dans lesquelles ce document était entré en ma possession. Cela n’était pas un acte prémédité de ma part. Je suis un électeur comme les autres : le fait qu’il ait voulu me voir n’implique pas que j’étais dans l’action politique. Il a rencontré des dizaines de personnes dans le même but : savoir s’il avait des chances de remporter l’élection législative en 2007.
Peut-être n’aurais-je pas dû lui remettre ce document. Est-ce ce que vous voulez me faire dire ?
M. Dominique Baert. Ce n’était pas le sens de ma question. Vous avez expliqué que vous ne souhaitiez pas aller au-delà d’une alerte destinée à l’administration fiscale. Cinq ans plus tard, vous informez quelqu’un d’autre, sans plus de résultats d’ailleurs.
M. le président Charles de Courson. Nous poserons la question à M. Bruguière, puisque nous avons prévu de l’auditionner.
M. Dominique Baert. Par ailleurs, ne vous paraît-il pas surprenant que pendant onze ans, alors que se succédaient tant de ministres du budget ou de l’intérieur, cette information n’ait jamais été rendue publique, alors même qu’elle était connue de plusieurs personnes ?
M. Michel Gonelle. Il y a eu plusieurs alertes : celle de 2001, lancée à mon initiative, et celle de 2008, lorsque Rémy Garnier a rédigé – sans que je le sache à ce moment – une note sur ce sujet, pour laquelle il a été sanctionné. J’ai lu aujourd’hui dans Le Monde que la majorité actuelle souhaitait protéger les fonctionnaires « lanceurs d’alerte ». Elle a bien raison, car Garnier, après avoir signalé cette anomalie, a été sanctionné par sa hiérarchie. Enfin, je rappelle que le 4 décembre, lors de la diffusion de l’enregistrement, la majorité de la classe politique s’est placée du côté de Jérôme Cahuzac. Et voilà que l’on me reproche, aujourd’hui, de ne pas en avoir fait assez !
M. le président Charles de Courson. Bien que faisant partie de la petite minorité qui ne l’a pas défendu, j’estime que tel n’est pas l’objet de nos débats. Nous gagnerions, mes chers collègues, à poser des questions plus ciblées.
M. Hugues Fourage. Pourquoi M. Gonelle, sachant que vous étiez auditionné par une commission d’enquête, pourquoi n’êtes vous pas venu avec la lettre qu’il souhaitait remettre au Président de la République ?
M. le président Charles de Courson. Il nous a dit qu’il nous la donnerait.
M. Michel Gonelle. Je n’ai pas reçu officiellement la convocation à cette réunion On m’en a remis une copie tout à l’heure, et il est vrai qu’elle précise que l’on peut apporter des documents. Mais c’est la première fois que j’assiste à une commission d’enquête. Par conséquent, je n’ai rien apporté d’autres que quelques coupures de presse.
M. le président Charles de Courson. L’important est que vous nous transmettiez cette lettre dès que possible.
M. Hugues Fourage. Vous êtes devenu en 2003 l’avocat de Rémy Garnier. Avez-vous évoqué l’affaire Cahuzac avec ce dernier ?
M. Michel Gonelle. Non. Rémy Garnier connaissait déjà l’existence du compte en Suisse, et ce n’est pas moi qui la lui ai apprise. Mes relations avec lui sont couvertes par le secret professionnel, mais je peux vous préciser qu’il a gagné tous ses procès, sans exception.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne voudrais pas que notre commission d’enquête ne perde de vue son véritable objet : y a-t-il eu, ou non, dysfonctionnement de la part des autorités de l’État ou de l’administration ? Cependant, il est intéressant de constater que vous avez eu recours à cette dernière de manière oblique, voire détournée. À cet égard, nous sommes au cœur du sujet.
On a dit que vous n’aviez rien fait pendant dix ans. En réalité, vous avez fait deux choses. Tout d’abord, vous avez recours à un copain – pardonnez-moi l’expression –, qui se trouve être inspecteur des impôts, pour lui demander de faire remonter l’information et d’aller voir si Bercy ne veut pas transférer le dossier de M. Cahuzac. Ce n’est pas une saisine de l’administration fiscale ! Pour autant, celle-ci ne semble pas avoir de secrets pour vous, puisqu’elle vous laisse savoir que le dossier ne sera pas transféré à Bordeaux. C’est une première surprise.
Votre deuxième initiative est tout aussi oblique. Vous remettez un exemplaire de l’enregistrement à un haut magistrat, quelqu’un dont vous dites qu’il est peut-être encore plus important qu’un procureur. Une telle affirmation est stupéfiante dans la bouche d’un avocat, qui connaît pourtant bien le monde judiciaire. Vous avez reçu non un magistrat ès qualités, mais le candidat à une élection. Les bras m’en tombent !
Non seulement vous ne saisissez officiellement la justice à aucun moment, mais à aucun moment non plus vous ne saisissez officiellement l’administration. Mieux, comme l’a dit M. Germain, vous obtenez d’elle des informations que vous ne devriez pas connaître, car elles violent le secret fiscal, et plus généralement le secret professionnel auquel sont soumis les agents de l’État. Votre copain inspecteur des impôts n’était certainement pas autorisé à vous rendre compte de la façon dont l’information a suivi la voie hiérarchique jusqu’à Bercy. Je trouve tout cela stupéfiant.
Ma question est la suivante : ne pensez-vous pas, en tant qu’avocat, que les dysfonctionnements qui ont peut-être eu lieu au sommet de l’État ont commencé au bas de la chaîne, lorsque vous avez fait le choix de procédures détournées ? Ne voyez-vous pas une relation entre les deux ?
M. Michel Gonelle. Vous avez rappelé en préambule que cette commission recherchait des dysfonctionnements au sein de l’État. Pour ma part, je n’ai pas la prétention d’incarner l’État. J’exerce une profession libérale, et je suis moi-même soumis au secret professionnel. Mon bâtonnier pourrait vous confirmer à cet égard que je n’ai jamais encouru le moindre reproche de la part de mon conseil de l’ordre.
Je ne vois pas l’intérêt de votre question. Vous instruisez mon procès, à votre aise ! Mais dans cette affaire, ce n’est pas moi, je pense, qui ai commis les actes les plus graves. Alors que nous parlons de fraude, de blanchiment de fraude, de mensonges proférés devant toute l’Assemblée nationale et devant le Président de la République, c’est moi que vous souhaitez mettre en accusation ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Nous parlons d’une fraude que vous n’avez pas dénoncée par les moyens appropriés qui étaient à votre portée.
M. Michel Gonelle. Vous avez employé le mot « copain » : je récuse ce terme. Ce fonctionnaire des impôts, qui a une très bonne réputation, était en mesure de transmettre l’information à son collègue de Bordeaux. Tout cela est de la polémique !
M. le président Charles de Courson. Restons-en là. Comme vous le savez tous, le droit français ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de l’article 40 du code de procédure pénale.
M. Michel Gonelle. Quant à M. Bruguière, vous savez bien qu’il occupe un grade très élevé dans la hiérarchie judiciaire.
M. Stéphane Saint-André. Connaissez-vous le contenu du message que le journaliste de Mediapart – probablement Edwy Plenel – a laissé sur le portable que vous aviez emprunté au policier ? Je pose la question parce que je me demande ce qui a pu motiver son geste de rédiger un rapport à l’intention de sa hiérarchie.
M. Michel Gonelle. Je n’en connais pas le contenu, ne l’ayant pas entendu. Je suppose que M. Plenel cherchait simplement à me joindre.
M. Stéphane Saint-André. Mais si ce dernier s’est contenté de s’identifier et de demander que vous le rappeliez, pourquoi le policier a-t-il éprouvé le besoin d’en référer à ses supérieurs ?
M. Michel Gonelle. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce point.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. À plusieurs reprises, vous avez qualifié M. Cahuzac d’adversaire particulier, d’opposant redoutable. Lorsque vous déteniez cet enregistrement, avez-vous craint de le dévoiler ? Avez-vous subi des pressions ?
M. Michel Gonelle. J’avais une crainte, en effet. À un point de l’enregistrement, on entend M. Cahuzac dire qu’il n’y a plus rien sur le compte. Ce détail a pesé sur ma décision. Beaucoup d’entre vous pensent que j’aurais dû agir de façon plus énergique, saisir le procureur, par exemple. Mais mettez-vous un instant à ma place : il s’agissait d’un compte ouvert à l’étranger, sur lequel il ne restait plus d’argent. J’étais dans l’embarras. Je craignais une action en retour contre moi, de surcroît dans un contexte de campagne électorale.
Ne me faites pas grief de n’avoir pas utilisé ce document dans la bataille électorale, selon ma conception, n’est pas le lieu de tels déballages. Elle est faite pour évoquer des idées, des projets, les positions politiques respectives des candidats.
M. le président Charles de Courson. Je pense que mon collègue souhaite savoir si vous craigniez, en révélant ce document, des conséquences négatives pour vous-même ou vos affaires.
M. Michel Gonelle. Une réplique de l’intéressé aurait pu entraîner des conséquences négatives, bien sûr.
M. Jean-Marc Germain. De quelle nature ?
M. Michel Gonelle. uUne plainte en diffamation ou en dénonciation calomnieuse qui n’aurait rien eu d’agréable.
M. Hervé Morin. Craigniez-vous un contrôle fiscal ?
M. Michel Gonelle. Non, rien de tel.
M. Michel Gonelle. De même, je n’ai jamais subi de pressions de la part de qui que ce soit.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Avez-vous eu peur d’une action de Jérôme Cahuzac après votre contact avec M. Zabulon et la publication, dans Le Monde, de cet article dont vous dites qu’il vous a blessé ?
Qu’est-ce qui explique, selon vous, le silence de M. Zabulon après cet échange, dans la mesure où vous nous avez dit partager avec lui une relation de confiance ? Comment interprétez-vous l’appréciation portée par l’entourage élyséen ?
Enfin, qu’attendiez-vous du Président de la République dans l’hypothèse où il aurait pris connaissance de votre lettre ?
M. Michel Gonelle. Ma confiance envers M. Zabulon est intacte, mais à la place qu’il occupe, je sais qu’il est soumis à sa hiérarchie !
J’ai en effet été mortifié de la réponse apportée le mercredi par la présidence, tant elle n’était pas à la hauteur des circonstances. De fait, j’ai pensé que l’État était en train de dysfonctionner, et j’en ai été extrêmement déçu. Je l’ai été encore davantage quelques jours plus tard, le 19 décembre, lorsque j’ai lu dans le Journal du dimanche que la Suisse « blanchissait » Jérôme Cahuzac à la suite de la demande d’entraide administrative !
M. Alain Claeys, rapporteur. Une nouvelle fois, à ce moment, vous refusez de vous adresser à la justice. Voilà ce qui m’étonne.
M. Michel Gonelle. A cet égard, j’ai oublié un point important. Lorsque Le Monde a publié ce communiqué de la présidence de la République dans lequel on m’enjoignait, si je disposais d’éléments, de les transmettre à la justice, j’ai pris contact avec le juge Daïeff, chargé de l’enquête sur la banque UBS et l’évasion fiscale. L’ayant joint au téléphone, je lui ai demandé s’il voulait recueillir mon témoignage. On était à la veille de Noël. Il m’a répondu qu’il devait consulter le juge avec lequel il travaillait sur cette affaire, et qu’il reviendrait vers moi en janvier. Et c’est ce qu’il a fait, le 3 janvier. Il m’a dit : « mon collègue est d’accord pour vous entendre, mais vous devez nous envoyer une lettre pour proposer votre témoignage ». Je la lui ai envoyée le jour même. Mais le lendemain, le procureur ouvrait l’enquête préliminaire, et il n’a donc plus été question de témoigner.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous nous fournir une copie de cette lettre ? Le nom de M. Daïeff a en effet été abondamment cité lors de l’audition de ce matin.
M. Michel Gonelle. Oui, d’autant que je l’ai avec moi. (M. Gonelle remet un document au président.)
M. Daniel Fasquelle. Je retiens de cette audition quatre informations très importantes.
Nous cherchons à savoir si l’État a connu des dysfonctionnements. Or, il se peut qu’il y en ait eu un premier dès 2001, quand vous avez informé l’administration fiscale. À l’époque, Laurent Fabius était ministre de l’économie et des finances, et Florence Parly secrétaire d’État chargée du budget. Pensez-vous que l’information soit remontée jusqu’à eux ?
Par ailleurs, nous avons désormais la certitude qu’à partir du 15 décembre, le Président de la République était au courant de toute cette affaire. Il ne s’agit donc plus seulement de l’affaire Cahuzac mais, de plus en plus, de l’affaire Hollande.
Autre information clé : vous avez dit que vous étiez certain de l’authenticité de l’enregistrement, car le même numéro de téléphone a été composé lors des deux messages successifs. Edwy Plenel avait-il la même certitude lorsque vous avez été en contact avec lui ? Est-ce pour vérifier ce point qu’il a cherché à vous joindre ?
Enfin, le 18 décembre, sur France Inter, Jérôme Cahuzac affirmait que la voix de l’enregistrement n’était pas la sienne. Pourquoi n’avez-vous pas réagi aussitôt à ce mensonge que vous auriez pu démonter facilement ?
M. Michel Gonelle. En 2001, Florence Parly était en effet en charge du budget. Si la décision de refuser le transfert du dossier à la DNEF de Bordeaux existe, tous ces faits seront décortiqués par la police judiciaire et cela sera rendu public !
Mme Marie-Françoise Bechtel. Oui, mais de façon légale !
M. Michel Gonelle. Quoi qu’il en soit, à l’époque, c’est bien Florence Parly qui se trouvait à l’autre bout de la chaîne.
M. le président Charles de Courson. Voulez-vous dire que d’après vos informations, c’est la secrétaire d’État au budget qui a demandé le classement du dossier ?
M. Michel Gonelle. Je ne sais pas. Mais d’un point de vue hiérarchique, elle se situait au sommet.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas la même chose ! De toute façon, nous auditionnerons les responsables de l’époque.
M. Michel Gonelle. Il s’agissait tout de même d’un parlementaire. Je ne peux pas imaginer que l’on n’ait pas informé le cabinet du ministre.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est qu’une supposition.
M. Thomas Thévenoud. Dans ces conditions, il conviendrait d’auditionner tous les secrétaires d’État au budget, les ministres des finances et les présidents de la République qui se sont succédé depuis 2001 !
M. le président Charles de Courson. Soyons rigoureux : nous devons entendre ceux qui étaient en charge en 2001 ou 2002.
M. Michel Gonelle. Pour répondre à vos autres questions, lorsque j’ai rencontré M. Plenel – je ne l’avais jamais vu auparavant –, je n’ai pas eu le sentiment qu’il était animé par le doute, bien au contraire. Ce qu’il voulait, c’est que je me dévoile en tant que détenteur initial de l’enregistrement. Mais cela ne me plaisait pas beaucoup de me jeter en pâture à l’opinion publique – même si j’ai finalement été obligé de le faire.
Je note au passage – puisqu’il s’agit d’identifier les dysfonctionnements de l’État, que c’est la présidence de la République qui, avant tout le monde, a révélé mon appel, et donc le fait que j’étais le détenteur de l’enregistrement. Cela m’a étonné, car mon coup de fil n’était pas destiné à être rendu public. J’ai dû en assumer les conséquences comme j’ai pu.
Enfin, Jérôme Cahuzac a très souvent affirmé que la voix figurant dans l’enregistrement n’était pas la sienne. Si j’avais voulu contester toutes les déclarations de M. Cahuzac, j’y aurais passé tout mon temps. Il a même prétendu qu’il s’agissait d’un montage.
Mme Estelle Grelier. Pouvez-vous nous confirmer qu’avant le 4 décembre 2012, date de la révélation de l’affaire par Mediapart, vous n’avez pas pris contact avec ses journalistes, ni fait part à des proches d’un souhait de les contacter ?
M. Michel Gonelle. Non. J’avais beaucoup à faire, on me téléphonait sans arrêt. Je ne suis pas allé vers Mediapart, c’est Mediapart qui est venu vers moi.
M. le président Charles de Courson. Ce matin, les représentants de Mediapart ont confirmé qu’il n’était pas leur source. Il nous reste donc une chose à éclaircir : qui leur a donné le deuxième exemplaire de l’enregistrement ?
M. Christian Assaf. C’est en effet une des raisons pour lesquelles nous avons collégialement décidé d’auditionner le juge Bruguière. Mais dans l’immédiat, j’aimerais vous demander, monsieur Gonelle, qui, à votre connaissance, aurait pu avoir accès à cet enregistrement en dehors du juge. Pourrait-il s’agir de quelqu’un de son entourage ? Du technicien qui a procédé au transfert ?
Vous avez dit qu’après 2006 l’enregistrement n’était plus forcément dans le tiroir de votre bureau. Quelqu’un aurait-il pu y avoir accès à votre insu ?
M. Michel Gonelle. C’est impossible, car le support ne comportait aucune étiquette, aucun signe distinctif. Personne ne pouvait savoir de quoi il s’agissait.
M. le président Charles de Courson. C’est donc l’autre voie que nous devons explorer, quand nous auditionnerons le juge Bruguière.
Mes chers collègues, je vous félicite de votre implication, mais nous avons dépassé de plus d’une heure le temps prévu pour cette audition.
Merci, monsieur Gonelle, d’avoir longuement répondu à toutes nos questions.
Audition du mardi 21 mai 2013
À 18 heures 30 : Mme Amélie Verdier, directrice du cabinet de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, M. Guillaume Robert, directeur-adjoint du cabinet, et M. Frédéric Bredillot, conseiller spécial chargé de la fiscalité.
M. le président Charles de Courson. Je précise que les trois témoins que nous accueillons ont rempli auprès de M. Jérôme Cahuzac, jusqu’en mars dernier, les fonctions qu’ils exercent à présent auprès de M. Bernard Cazeneuve.
Madame, messieurs, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements du Gouvernement et des services de l’État dans l’affaire Cahuzac. En votre qualité de proches collaborateurs du ministre, la commission a un certain nombre de questions à vous poser, sur lesquelles elle attend de votre part des réponses précises.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de bien vouloir chacun à votre tour lever la main droite et dire « je le jure ».
(Mme Amélie Verdier, M. Guillaume Robert et M. Frédéric Bredillot prêtent serment successivement)
Madame, Messieurs, pourriez-vous nous exposer pour commencer les actions qui ont été les vôtres depuis le 4 décembre 2012, et nous préciser la nature des informations dont vous disposiez.
Mme Amélie Verdier, directrice du cabinet de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Mes collaborateurs et moi-même souhaitons répondre le plus complètement possible à vos interrogations sur l’action du gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion de l’affaire ayant abouti à la démission de M. Jérôme Cahuzac.
D’abord, je tiens à préciser que les situations fiscales individuelles des ministres ne sont du ressort d’aucun membre du cabinet du ministre chargé du budget, ni du directeur-adjoint, ni du conseiller spécial chargé de la fiscalité ici présents. J’ai été la seule à connaître certains éléments de la situation fiscale du ministre avant les révélations de Médiapart.
Par ailleurs, pendant l’essentiel de la période visée par votre commission d’enquête, s’appliquait une instruction, dite « muraille de Chine », qui a organisé le déport du ministre du budget et donc de son cabinet, de la gestion par l’administration fiscale de cette affaire.
M. le président Charles de Courson. La lettre formalisant cette instruction date du 10 décembre.
Mme Amélie Verdier. L’instruction, adressée à la direction générale des finances publiques, a en effet été signée le 10 décembre. Elle s’accompagnait d’une autre instruction à mon attention émanant du ministre.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous nous remettre une copie de cette dernière, car nous ne disposons que de la première note ?
Mme Amélie Verdier. La deuxième note est très brève : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de la note que j’adresse ce jour à M. le directeur général des finances publiques pour mise en œuvre ».
M. le président Charles de Courson. Donc, aucun membre du cabinet, à l’exception de vous-même, n’avait à connaître des situations fiscales individuelles.
Mme Amélie Verdier. Tout à fait, je n’ai eu du reste pour ma part qu’à en connaître très peu de chose.
Le principe d’une instruction a été évoqué dès le 6 décembre avec le directeur général des finances publiques. Le 7, le ministre a confirmé son intention de signer une telle note, ce qu’il a fait le 10 décembre. Entre le 4 et le 10, ma seule action concernant l’affaire a consisté à m’entretenir avec mon homologue au ministère de la justice afin de m’assurer de la procédure à suivre pour la plainte en diffamation que M. Jérôme Cahuzac entendait déposer. Aucune action relative à la situation fiscale du ministre n’a été menée pendant cette période.
Du 10 décembre à la démission de Jérôme Cahuzac, l’instruction a été strictement respectée. Ni les membres du cabinet, ni moi-même, ni à ma connaissance M. Cahuzac n’ont été informés des actes de l’administration aux fins d’enquêter sur sa situation.
Depuis le 20 mars, en tant que directrice de cabinet de M. Bernard Cazeneuve, j’ai eu connaissance d’éléments, peu nombreux, que j’ignorais antérieurement, ayant trait à l’action de l’administration pendant la période passée.
Je veux dire enfin nos interrogations sur un point : dans quelle mesure sommes-nous tenus dans nos réponses au secret professionnel ou fiscal ? Si j’ai le moindre doute à cet égard, monsieur le président, monsieur le rapporteur, j’en appellerai à votre interprétation. Il convient aussi de savoir si les réponses que nous souhaitons, en tout état de cause, vous apporter, doivent être rendues publiques.
M. le président Charles de Courson. Le secret fiscal ne concerne que les membres de l’administration fiscale à laquelle aucun des membres du cabinet n’appartient. Vous ne pourriez donc pas nous objecter le secret fiscal.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous nous préciser la manière dont fonctionne le cabinet du ministre délégué au budget ? Parmi les conseillers du ministre de l'économie et des finances, quels sont ceux qui remplissent les mêmes fonctions auprès du ministre délégué au budget ? Comment ces « doubles casquettes » sont-elles mises en œuvre ?
En quoi a consisté « l'examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement » ? Quels ont été la durée et le degré d'approfondissement de celui-ci ? À la demande de qui et par qui a-t-il été réalisé ? Quelle forme prennent les conclusions de cet examen ? Ses résultats sont-ils communiqués au ministre du budget ? Pouvez-vous nous dresser la chronique de cet examen dans le cas de M. Jérôme Cahuzac ?
Étiez-vous au courant des questions posées à M. Cahuzac par la direction régionale des finances publiques pour l'Ile-de-France et Paris à propos de sa déclaration de patrimoine faite au titre de l'impôt sur la fortune ?
Mme Amélie Verdier. Il est vrai que certains membres du cabinet du ministre délégué sont aussi conseillers auprès du ministre de l’économie et des finances. Dans le domaine fiscal, deux conseillers sont communs. Ils ne traitent pas des situations fiscales individuelles, a fortiori de celles des ministres. Ils n’en ont donc été à aucun moment saisis. Au quotidien, le fonctionnement des deux cabinets en matière fiscale est très intégré, pour la préparation des projets de lois de finances notamment. Ce mode de fonctionnement n’a eu aucune influence sur la gestion de l’affaire Cahuzac, et aucun conseiller commun n’a eu à connaître, avant ou après le 10 décembre, d’éléments concernant la situation fiscale du ministre.
M. le président Charles de Courson. Seules deux personnes, vous-même et votre homologue auprès de M. Pierre Moscovici, connaissaient donc la situation individuelle du ministre ?
Mme Amélie Verdier. Je ne peux pas répondre pour mon homologue. Les informations sur la situation fiscale des membres du gouvernement sont à destination des ministres. Je vais y revenir. Quant au processus de vérification de la situation des ministres, j’ai été le seul membre du cabinet à être informé de son déroulement.
M. le président Charles de Courson. Vous ne répondez pas pour votre homologue mais je suppose que vous avez eu des échanges avec lui après le 10 décembre.
Mme Amélie Verdier. Je n’ai eu aucun échange avec lui après le 10 décembre à ce sujet.
J’en arrive à la seconde question du rapporteur. Conformément à la tradition républicaine, à l’arrivée d’un nouveau gouvernement, l’administration fiscale procède, en toute indépendance, à un examen de la situation fiscale de chacun des ministres. Cette vérification, effectuée dans les jours qui suivent la nomination du gouvernement, s’appuie sur les déclarations des membres du gouvernement et sur tous les éléments qui pourraient être portés à la connaissance de l’administration par la presse ou par des tiers.
J’ai retrouvé une note du 6 juin 2012 qui décrit ce processus et en propose la mise en œuvre, proposition pour la forme puisqu’il s’agit d’une tradition républicaine. L’administration s’assure de l’exactitude de la valorisation des biens mobiliers ou immobiliers, de l’exhaustivité des revenus déclarés ou de la cohérence des déclarations successives et vérifie toutes les informations reçues par d’autres moyens.
Par courtoisie, le ministre du budget prévient ses collègues de cette procédure.
Le ministre du budget a confirmé qu’il fallait faire cette vérification. Je n’ai pas eu connaissance des résultats de la vérification. Je sais, ayant accès à l’agenda du ministre, qu’un rendez-vous entre lui et le directeur général des finances publiques a donné lieu à un premier point de situation fin juillet. Il a été suivi de contacts pour étudier les questions soulevées.
Les vérifications sont menées par les services locaux, habituellement chargés de l’examen des dossiers fiscaux ; elles ne font pas l’objet d’une procédure dérogatoire.
S’agissant du ministre du budget lui-même, je n’ai pas eu connaissance de l’ensemble du dossier. En raison de sa situation personnelle complexe – je vous fais part de cette information possiblement attentatoire au respect de la vie privée puisque vous m’y avez invitée, Monsieur le président – je disposais d’informations sur sa déclaration de patrimoine.
M. le président Charles de Courson. Qu’entendez-vous par « complexe » ?
Mme Amélie Verdier. La complexité découlait de problèmes de valorisation de biens immobiliers et de l’existence d’un foyer fiscal commun. En disant cela, il me semble aller un peu loin en ce qui concerne le secret fiscal mais j’ai entendu ce que vous m’avez indiqué, Monsieur le président, à savoir que vous considérez que j’en suis déliée.
M. le président Charles de Courson. Le secret fiscal ne s’applique pas aux membres du cabinet.
Mme Amélie Verdier. On pourrait faire valoir pourtant la théorie du secret partagé, ainsi que nous l’a exposé la direction des affaires juridiques du ministère.
M. le président Charles de Courson. Madame, ce ne sont pas vos collaborateurs qui définissent les règles. Vous témoignez devant les représentants du peuple français.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je reviens à ma troisième question : étiez-vous au courant des questions posées à M. Jérôme Cahuzac par la direction régionale des finances publiques pour l'Ile-de-France et Paris à propos de sa déclaration de patrimoine faite au titre de l'impôt sur la fortune ?
Mme Amélie Verdier. J’étais au courant de certaines des questions posées.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous réagi ? Des instructions ont-elles été données ?
Mme Amélie Verdier. En vertu de la circulaire Baroin, le ministre s’abstient d’intervenir dans une procédure fiscale individuelle, d’autant moins dans son propre cas. Je vous confirme qu’aucune instruction, de quelque nature que ce soit, n’a été donnée, ni à la direction générale des finances publiques, ni aux services locaux chargés du dossier du contribuable Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je pourrai, dans le cadre de mes prérogatives de rapporteur, demander par écrit les renseignements fiscaux utiles au travail de la commission.
Mme Amélie Verdier. Je vous répondrai volontiers.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous expliquer à la commission comment a fonctionné la « muraille de Chine » ?
Mme Amélie Verdier. La « muraille de Chine » a été élevée dès les premiers jours de l’affaire. Alors que le premier article de Mediapart avait paru le 4 décembre, j’ai le souvenir d’une première conversation avec le directeur général des finances publiques, le 6 décembre, sur la nécessité de formaliser une organisation naturelle qui permet que le ministre ne puisse être soupçonné de gérer cette affaire. Le 7 décembre, un rendez-vous avec le directeur général des finances publiques et la directrice des affaires juridiques a été consacré à la rédaction de l’instruction.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour la bonne information des membres de la commission, l’instruction du 10 décembre sera distribuée.
Mme Amélie Verdier. Cette note traite, d’abord, de la situation fiscale du ministre. Son esprit général est de s’assurer qu’aucune information ne soit transmise au contribuable Cahuzac qui ne le serait pas à tout contribuable visé par une procédure fiscale. Afin d’éviter toute confusion, l’instruction précise que toutes les demandes de documents ou les informations relatives à la procédure devront être adressées exclusivement à ses avocats et non à son cabinet. Il est demandé que son dossier soit géré par l’administration comme celui d’un contribuable quelconque et que celle-ci ne rende compte, directement ou indirectement, ni au ministre, ni à son cabinet, de l’avancement du dossier.
Le second sujet traité par la note concerne la banque UBS. Cette affaire, qui est sans lien avec celle qui vous occupe, se trouvait déjà sur la place publique. Afin de lever tout soupçon d’instrumentalisation, il semblait important de préciser que le ministre était privé de toute information sur son avancement. Je cite le paragraphe : « Tout dossier dont la DGFiP (direction générale des finances publiques) aurait à connaître relatif à la banque UBS, sera, s'il nécessite d'être porté à la connaissance du ministre, directement soumis au ministre de l'économie et des finances par l'intermédiaire de son directeur de cabinet. » Ni le ministre chargé du budget, ni son cabinet ne devaient être informés du travail de l’administration.
Cette note a été scrupuleusement respectée. Non seulement aucune instruction n’a été donnée à l’administration sur le dossier fiscal du ministre, mais, à partir du 10 décembre, comme cela avait été le cas depuis mai 2012, le cabinet ignorait le déroulement de la procédure qui s’y rapportait.
Les seuls éléments portés à ma connaissance sur la situation patrimoniale du ministre, que j’évoquais précédemment, étaient antérieurs à cette note.
M. le président Charles de Courson. Le ministre du budget est délégué auprès du ministre de l’économie et des finances ; les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier le sont au moyen d’un décret. Je m’étonne donc que la note soit signée du seul ministre délégué. Pourquoi M. Pierre Moscovici ne signe-t-il pas l’instruction qui retire une compétence à son ministre délégué pour garantir l’étanchéité de l’action de l’administration fiscale ? Pouvez-vous éclaircir le montage juridique ayant abouti à cette étrangeté, qui modifie un décret par une note unilatérale ?
Mme Amélie Verdier. Nous avions à cœur de mettre fin aussitôt à une situation d’ambiguïté potentielle. Or, la modification d’un décret est une procédure longue.
Sur le plan juridique, le ministre de l’économie et des finances est destinataire de toutes les notes du directeur général des finances publiques. En outre, cette instruction ne prévoit pas le renvoi de la compétence pour la totalité d’une matière. Il ne s’agit pas pour le ministre de se dessaisir de la fiscalité mais de demander à ne pas être informé sur certains sujets.
M. le président Charles de Courson. Comment expliquer que M. Pierre Moscovici ne signe pas une note concernant les compétences qu’il a déléguées au ministre du budget ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. L’instruction ne porte pas sur l’organisation des compétences. Elle organise le retrait du ministre délégué de certains dossiers pour des raisons déontologiques. Elle est sans rapport avec les décrets d’attribution. Je ne vois pas l’ombre d’un problème.
M. le président Charles de Courson. Chère collègue, je m’étonne simplement que M. Pierre Moscovici ne soit pas signataire ou cosignataire.
Mme Marie-Françoise Bechtel. M. Cahuzac pouvait décider seul de se décharger de certaines responsabilités.
Mme Amélie Verdier. De toute façon, les décrets d’attribution ne sont pas signés des seuls ministres. S’il s’était agi de la réorganisation des compétences, la signature du ministre de l’économie et des finances n’aurait pas suffi. Par cette instruction au directeur général des finances publiques, le ministre du Budget demandait seulement à ne pas connaître les informations relatives à sa situation personnelle ou à la banque UBS dont disposait l’administration fiscale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans le cadre de la « muraille de Chine », le cabinet du ministre du Budget n’a donc joué aucun rôle dans la demande d’entraide fiscale adressée à la Suisse au sujet d’un éventuel compte de M. Jérôme Cahuzac ?
Mme Amélie Verdier. Je le confirme. Je n’avais même pas connaissance du projet et du calendrier de l’administration sur cette question. À compter du 10 décembre, la gestion de cette affaire m’était étrangère.
M. le président Charles de Courson. Le ministre ne vous en a jamais parlé ?
Mme Amélie Verdier. Les seuls éléments portés à ma connaissance par le ministre sont ceux dont ses avocats lui avaient fait part.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez jamais évoqué la saisine de l’administration fiscale helvétique ?
Mme Amélie Verdier. Le ministre ne pouvait pas le faire.
M. le président Charles de Courson. Et le directeur général des finances publiques qui était placé sous son autorité ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai jamais assisté à un entretien entre le ministre et le directeur général des finances publiques, ni eu moi-même un entretien avec ce dernier, au cours duquel cette question aurait été abordée. Depuis le 10 décembre, la question de la situation fiscale du ministre était exclue de nos échanges.
M. le président Charles de Courson. Vous avez appris par la presse que le directeur général des finances publiques sollicitait les services fiscaux helvétiques ?
Mme Amélie Verdier. Le ministre m’a dit que ses conseils avaient été sollicités par l’administration fiscale suisse, ce qui laissait penser qu’une demande d’entraide avait été formulée. Il me semble qu’il en a fait état publiquement. Je n’ai reconstitué le déroulement de la procédure qu’une fois mes fonctions prises auprès de M. Bernard Cazeneuve.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ma question suivante s’adresse à M. Guillaume Robert : savez-vous quel était le but du séjour à Genève de M. Jérôme Cahuzac début 2010 ? Agissait-il dans le cadre de ses fonctions de président de la commission des finances ?
M. Guillaume Robert, directeur-adjoint du cabinet. Je ne sais pas à quelle date aurait eu lieu ce déplacement. Je suis devenu conseiller de M. Cahuzac à compter du 23 février 2010, date de la démission de M. Didier Migaud de la présidence de la commission des finances.
M. le président Charles de Courson. Le ministre a reconnu être allé à Genève. Selon la presse, ce déplacement aurait eu lieu deux jours avant son élection à la présidence de la commission des finances. Vous n’étiez pas informé de ce déplacement ?
M. Guillaume Robert. Si ce déplacement a eu lieu deux jours avant l’élection de M. Jérôme Cahuzac, mon employeur était encore M. Didier Migaud. Je n’ai donc pas eu à connaître cette information.
M. le président Charles de Courson. Ce matin, nous avons obtenu copie d’un mail adressé par sa chef de cabinet à M. Jérôme Cahuzac le 11 décembre 2012, et intitulé : « pour vous détendre un peu ». Je vous en donne lecture : « Je viens d'être appelée par le dir cab du préfet pour me raconter la chose suivante : "vendredi soir se trouvant au Tribunal à Agen, Gonelle en panne de portable emprunte celui d'un policier qu'il connaît bien. Or, c'est le portable de permanence du commissariat et la messagerie a enregistré quelques heures plus tard le message suivant ; "n'arrivant pas à vous joindre, je tente au hasard sur tous les numéros en ma possession. Rappelez Edwy Plenel ". J'ai demandé de consigner le message à toutes fins utiles… j'attends la copie du rapport officiel du DDSP ; il va falloir être prudent dans la remontée de l’info pour que celui-ci puisse être le cas échéant une preuve utilisable. Signé : Marie-Hélène ». Mme Valente, qui était, en tant que chef de cabinet, placée sous votre autorité, a t-elle fait état de ce mail auprès de vous ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas eu connaissance de ce mail. Mme Valente m’a fait part d’un appel, dans mon esprit émanant de la préfecture du Lot-et-Garonne au sujet d’un contact entre M. Edwy Plenel et M. Gonelle, qui lui paraissait étonnant car ce dernier affirmait alors qu’il n’avait pas fourni l’enregistrement à Médiapart. C’est cet échange qui a été porté à ma connaissance.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous été destinataire du rapport établi par le directeur départemental de la sécurité publique ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas souvenir d’un rapport. À la lecture du mail, je pense que l’expression « preuve utilisable » renvoie peut-être à la possibilité d’identifier la source de l’enregistrement diffusé par Médiapart, puisque M. Gonelle niait être cette dernière.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu connaissance du mémoire rédigé par M. Rémy Garnier en 2008 dans lequel il faisait état de soupçons sur l’existence d’un compte détenu par M. Cahuzac ?
Mme Amélie Verdier. Je profite de votre question pour établir la chronologie du « dossier Garnier ». Celui-ci, inspecteur des impôts à la retraite, a sollicité un rendez-vous avec le ministre pour évoquer sa situation personnelle et la procédure disciplinaire engagée à son encontre par l’administration fiscale. Afin de préparer la rencontre qui a eu lieu en octobre 2012 dans le Lot-et-Garonne, deux notes, que je tiens à votre disposition, avaient été rédigées, récapitulant les différentes procédures le concernant. Nous n’avions alors connaissance ni du mémoire en défense ni des multiples courriers qu’il avait adressés aux ministres successifs. Sans entrer dans le détail de ce dossier, il s’agit d’un homme sollicitant le soutien du ministre dans les nombreuses procédures qu’il avait engagées contre l’administration et contre ses collègues.
Je n’ai pas assisté à l’entretien – sur lequel M. Fabrice Arfi nous a interrogés – mais je sais que le ministre n’a pas souhaité se mêler de la procédure visant M. Rémy Garnier. Vous le comprendrez, si je vous lis quelques extraits de la lettre adressée par M. Garnier au ministre le 16 mai 2012 : « Vive la République exemplaire, le règne sans partage d’une droite insolemment décomplexée aura duré deux législatures, dix années d’un saccage sans précédent des services publics dont le champ de ruines s’élargit sans cesse, n’épargnant aucun secteur ; l’administration fiscale en sort doublement meurtrie par la perte progressive de ses moyens matériels et humains et surtout par l’altération de ses valeurs essentielles héritées de la Révolution de 1789. Dès le 14 juillet 2002, je protestais contre mon déplacement d’office d’une brutalité inouïe par un communiqué en octobre 2001 au titre évoquant la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et plus particulièrement le principe d’égalité devant l’impôt… »
M. Rémy Garnier écrit donc à M. Jérôme Cahuzac le 16 mai 2012 pour dénoncer la responsabilité du chef de l’administration dans sa situation. Dans les documents dont nous disposons alors, il n’est nullement fait état d’un supposé compte suisse de M. Cahuzac.
Lorsque l’article de Mediapart paraît, il est demandé au directeur général des finances publiques d’examiner le dossier disciplinaire. C’est à cette occasion qu’apparaît le mémoire produit en défense lors de l’une des nombreuses instances auxquelles M. Rémy Garnier était partie.
À cette date, j’ai eu connaissance de ce mémoire, daté du 11 juin 2008. Sur les douze pages qu’il comporte, une est consacrée à M. Jérôme Cahuzac, les autres à divers collaborateurs ou supérieurs hiérarchiques de M. Garnier. Sous le titre « S’adonner à Adonis », il fait référence à l’application informatique permettant de consulter des comptes. M. Rémy Garnier s’est ainsi affranchi des règles du secret fiscal et des instructions de sa hiérarchie puisque, à aucun moment, le dossier de M. Jérôme Cahuzac ne lui a été confié.
Les informations contenues dans le mémoire ne sont pas celles que l’on trouve habituellement dans le mémoire d’un inspecteur des impôts effectuant un contrôle. On peut y lire : « Il se nomme Jérôme Cahuzac, son statut d’élu semble lui conférer une immunité à vie ». Au milieu d’informations fantaisistes, dont il concède qu’il ne les a pas lui-même vérifiées, et fausses pour certaines, comme il l’a reconnu ultérieurement, est mentionnée l’ouverture d’un compte bancaire à numéro en Suisse.
Je ne sais pas si ce mémoire avait été porté à la connaissance des ministres précédents. Je peux dire que cela n’a pas été le cas pour M. Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Des notes internes à l’administration fiscale ont-elles été rédigées pour avertir votre ministre du contenu de ce mémoire et des informations le concernant ? Avez-vous interrogé les services sur l’information dont disposaient les ministres précédents ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas eu connaissance de telles notes. À cette période, nous avions mis en place la « muraille de Chine ». Je n’ai donc pas engagé plus de recherches sur le cas de M. Rémy Garnier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je m’étonne, à l’instar du président, que le ministre délégué ait signé lui-même un courrier pour se retirer une compétence. Un tel courrier aurait dû être, au minimum, cosigné par son ministre de tutelle. Cette manière de procéder me paraît en complet décalage par rapport à ce qui se fait d’ordinaire.
Je m’étonne également que le ministre délégué ait accepté de rencontrer M. Rémy Garnier en octobre 2012, à Villeneuve-sur-Lot bien qu’il ait eu connaissance du mémoire rédigé par celui-ci le 11 juin 2008.
Mme Amélie Verdier. Il n’en avait pas connaissance.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez pourtant déclaré que vous lui aviez préparé un dossier pour cette rencontre. Ces informations n’y figuraient-elles donc pas ?
Mme Amélie Verdier. Non.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le 3 décembre 2012, veille de la révélation de Mediapart, vous étiez informée, vous l’avez dit tout à l’heure de la révélation de Mediapart avant sa publication.
Or, le 3 décembre, nous avons siégé dans l’hémicycle de 21 heure 30 à minuit – la séance a été levée, ce soir-là, beaucoup plus tôt que les jours précédents – pour examiner le projet de loi de finances rectificative pour 2012, et le ministre délégué a passé toute la soirée au téléphone. Nous avons bien senti qu’il se passait quelque chose. Je crois me souvenir que vous étiez assise au banc derrière lui. De quelle information avez-vous disposé à ce moment-là ?
Mme Amélie Verdier. S’agissant de votre première question, je le répète : l’instruction du 10 décembre 2012 visait non pas à retirer une compétence au ministre délégué, mais à organiser le travail de manière pratique pour éviter tout conflit d’intérêt. Elle a été rédigée sur la suggestion du directeur général des finances publiques en lien avec la directrice des affaires juridiques, laquelle s’est appuyée sur des cas de conflits d’intérêts potentiels qu’elle avait eu à traiter dans le passé et qui ne concernaient d’ailleurs pas le domaine fiscal. Nous avons intégralement repris le texte proposé par le directeur général des finances publiques et la directrice des affaires juridiques. De mémoire, je n’ai suggéré qu’une seule modification : enlever le prénom « Gilles » dans l’intitulé du cabinet August et Debouzy. Nous avons, en outre, discuté de la rédaction du paragraphe relatif à la banque UBS : nous souhaitions qu’elle soit suffisamment large pour éviter toute ambiguïté dans la manière dont le ministre se déportait des affaires relatives à la banque.
Quant à votre deuxième question, peut-être n’ai-je pas été suffisamment claire : la DGFiP a réalisé deux notes au mois d’octobre, la première pour préparer la rencontre du ministre avec M. Garnier, la seconde, après ladite rencontre, pour faire état d’un article de presse. Dans aucune de ces deux notes, il n’a été mentionné que M. Garnier avait, dans l’un des nombreux mémoires qu’il avait rédigés, mis en cause le ministre délégué.
Je n’ai pas procédé à la réalisation de ces notes. Le fait que M. Garnier ait adressé de nombreux courriers à tous les ministres successifs, le caractère quelque peu fantaisiste des éléments qui y figuraient, le manque de cohérence de l’ensemble – je ne le dis nullement pour lui porter préjudice – ne plaidaient guère en faveur de son dossier.
Le ministre a accepté le rendez-vous. Il disposait, dans les notes, d’une présentation de la procédure disciplinaire. Je n’ai pas participé à l’entretien et n’en ai pas eu d’écho particulier. Je doute cependant que les allégations faites par M. Garnier en 2008 aient été évoquées. Ce n’est donc qu’après cet entretien que nous avons eu connaissance du mémoire en défense de M. Garnier.
Pour répondre à votre troisième question, le 3 décembre dans l’après-midi, un journaliste de Mediapart a cherché à joindre le ministre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre du cabinet chargé de la communication. J’ai été informée de ce contact. J’étais en effet assise derrière le ministre délégué pendant une partie des débats. Il était soucieux de savoir de quoi il retournait et s’interrogeait sur l’opportunité de rencontrer ce journaliste. Je me souviens lui avoir demandé – plusieurs fois, d’ailleurs – si les allégations de Mediapart étaient fausses ; il m’a immédiatement répondu que oui. Il a passé effectivement sa soirée au téléphone. Cela dit, je n’ai pas été présente tout le temps.
M. le président Charles de Courson. J’étais également présent dans l’hémicycle et confirme les propos de Mme Dalloz.
Mme Amélie Verdier. Dans mon souvenir, les échanges ont simplement porté sur l’opportunité de rencontrer le journaliste de Mediapart et sur le meilleur moment pour le faire.
M. Gérald Darmanin. Je cherche à comprendre comment le ministère et, plus largement, le Gouvernement ont été informés de l’affaire.
S’agissant, premièrement, de l’organisation de votre cabinet, quelles étaient les relations entre le ministre délégué et son conseiller aux affaires réservées, M. Lemarchand, dont le nom a été cité ce matin par Mediapart et qui était en copie du message électronique adressé au ministre délégué par la chef de cabinet ? D’autre part, vous avez indiqué plusieurs fois que vous n’assistiez pas à tous les rendez-vous, ce qui peut tout à fait se comprendre. Quelle était la répartition des dossiers au sein du cabinet ? Doit-on comprendre que vous ne vous occupiez pas des affaires politiques ou réservées du ministre et que les sujets politiques n’étaient pas abordés devant les conseillers techniques ?
Deuxièmement, l’affaire a-t-elle été évoquée au cours des réunions de cabinet que vous teniez ? Établissiez-vous des relevés de décisions de ces réunions et, dans l’affirmative, pouvez-vous les communiquer à la Commission ?
De même, vous participiez en principe chaque semaine à une réunion avec les directeurs de cabinet des autres ministres sous l’autorité du directeur de cabinet du premier ministre, en présence du secrétaire général du Gouvernement – lequel rédige un compte rendu qu’il ne verse qu’aux archives nationales. Au cours de cette réunion, avez-vous, le directeur de cabinet de M. Moscovici ou vous-même, évoqué les complications de l’affaire Cahuzac ou été interrogés à ce sujet ?
Mme Amélie Verdier. Pour répondre à votre première question, M. Yannick Lemarchand n’était pas membre du cabinet du ministre délégué chargé du budget.
M. le président Charles de Courson. Quelles étaient ses fonctions ?
Mme Amélie Verdier. Il exerçait des fonctions à Villeneuve-sur-Lot. À mon avis – mais je n’ai pas eu à en connaître directement –, il travaillait pour le suppléant de M. Cahuzac ou, plus probablement, pour la mairie.
M. le président Charles de Courson. Il travaillait donc au sein du cabinet du maire de Villeneuve-sur-Lot ?
Mme Amélie Verdier. Je ne peux pas le dire précisément. En tous les cas, il travaillait dans le Lot-et-Garonne et n’a jamais assisté aux réunions de cabinet que j’ai organisées. En revanche, lorsque le ministre délégué se rendait dans sa circonscription, la chef de cabinet, qui était chargée de préparer ces déplacements, était en contact avec lui, notamment pour dresser la liste, comme c’est l’usage en pareil cas, des sujets à aborder et des personnes à rencontrer.
Je n’ai pas bien compris, monsieur le député, votre question sur le partage entre sujets politiques et techniques au sein du cabinet.
M. le président Charles de Courson. Les réunions des cabinets se tiennent traditionnellement le mercredi matin pendant que les ministres participent au Conseil des ministres. En outre, conformément à une tradition bien établie, pour coordonner l’action gouvernementale, le directeur de cabinet du Premier ministre réunit tous les directeurs de cabinet, une fois par semaine ou tous les quinze jours. L’affaire Cahuzac a-t-elle été évoquée au cours de l’une ou l’autre de ces réunions ? Des comptes rendus ont-ils été établis ?
Mme Amélie Verdier. L’affaire Cahuzac a en effet été évoquée en réunion de cabinet. Au lendemain de la publication de l’article de Mediapart, j’ai réuni l’ensemble des membres du cabinet. Je leur ai indiqué, très simplement, qu’il y avait eu des révélations, que j’avais moi-même interrogé le ministre délégué sur leur véracité et qu’il m’avait répondu n’avoir jamais détenu de compte en Suisse. J’ai précisé qu’il n’y avait pas de vérité établie au sein du cabinet, et invité chacun des membres à se faire sa propre opinion, voire à interroger le ministre délégué. Ces allégations ne mettant pas en cause l’action du ministre délégué en tant que tel, j’ai encouragé chacun à poursuivre sa tâche à son service.
Il n’est pas fait de compte rendu écrit des réunions de cabinet. Vous pouvez néanmoins interroger les deux membres du cabinet ici présents, qui y ont participé.
Pour votre parfaite information, monsieur le président, les réunions du cabinet du ministre de l’économie et des finances se tiennent en effet le mercredi, mais celles du cabinet du ministre délégué ont lieu le lundi.
En revanche, le sujet n’a pas été abordé, à ma connaissance, lors des réunions de directeurs de cabinet présidées par le directeur de cabinet du Premier ministre. Il n’y avait pas lieu de commenter une affaire qui concernait M. Cahuzac en tant que personne. Le travail avait été organisé de cette manière, et c’est bien comme cela que les choses se sont passées au cours de cette période. Comme je l’ai indiqué précédemment, les questions qui concernaient la situation de M. Cahuzac lui étaient adressées directement. En tant que ministre, il s’en était déchargé.
M. le président Charles de Courson. La communication ou l’attitude à adopter sur cette affaire n’ont donc jamais été évoquées, ni au cours des réunions de cabinet, ni au cours des réunions des directeurs de cabinet ?
Mme Amélie Verdier. Non. Comme je l’ai indiqué, j’ai organisé, au lendemain de la publication de l’article – ce devait être, pour le coup, un mercredi –, la réunion exceptionnelle que j’ai mentionnée. C’est la seule fois où l’affaire a été évoquée en réunion de cabinet. Ensuite, j’ai à nouveau réuni le cabinet de manière exceptionnelle le 19 mars.
M. Gérald Darmanin. Si un parlementaire ou une personnalité politique éminente fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’administration le signale-t-elle au cabinet et, le cas échéant, à vous-même ou au ministre délégué ? Je pose la question non pas à propos de l’affaire Cahuzac, mais de manière générale. Quelle est la pratique ? Cela s’est-il produit au cours de la période pendant laquelle vous avez dirigé le cabinet de M. Cahuzac ?
D’autre part, dans un article du 12 avril 2013, le journal Libération a fait état d’un contrat signé par MM. Cahuzac et Moscovici avec une agence de communication, qu’ils auraient chargé d’organiser leur communication. Si les informations de Libération sont exactes, cette relation contractuelle aurait duré jusqu’à la fin du mois de janvier pour M. Cahuzac. De plus, la conseillère chargée de la communication de M. Cahuzac travaillait directement ou indirectement avec cette agence avant de prendre ses fonctions au sein de votre cabinet. Cette conseillère ou cette agence, rémunérée par Bercy et chargée de la communication de M. Cahuzac en plein cœur de l’affaire, ont-elles pu influencer la manière dont les services fiscaux ont interrogé les banques suisses ou la façon dont M. Moscovici ou son cabinet ont répondu aux parlementaires, à la justice ou, le cas échéant, au cabinet du Président de la République à la suite des révélations de M. Gonelle ?
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous également préciser le nom de cette agence ?
Mme Amélie Verdier. S’agissant de votre première question, comme je l’ai indiqué précédemment, les ministres ne donnent aucune instruction sur des dossiers individuels, même pour programmer un éventuel contrôle fiscal. Les ministres sont en revanche tenus informés régulièrement des contrôles engagés sur des dossiers particulièrement signalés. Il revient au directeur général des finances publiques d’apprécier les contrôles qu’il convient de signaler et de décider de la périodicité de cette information.
Quant à votre deuxième question, un contrat portant sur l’appui à la définition d’une stratégie de communication avait en effet été conclu par les deux ministres.
M. le président Charles de Courson. Avec quelle agence ?
Mme Amélie Verdier. Avec Euro RSCG et, plus précisément, avec M. Gilles Finchelstein.
Ce marché a été essentiellement mis en œuvre pendant la période d’examen des lois de finance. En pratique, il a été très peu utilisé par le ministre délégué. Quelques prestations, quelques rendez-vous communs portant sur la stratégie financière globale ont été organisés avec la conseillère communication. À aucun moment, ce contrat n’a été utilisé pour « gérer » l’affaire Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Quels sont les éléments qui vous permettent de l’affirmer ?
Mme Amélie Verdier. Comme je l’ai indiqué, les quelques prestations fournies – j’ai d’ailleurs participé à l’une de ces réunions – correspondaient bien à l’action de M. Cahuzac en tant que ministre délégué. Le secrétaire général a ensuite attesté le service fait qui correspondait bien à l’action du ministre.
M. le président Charles de Courson. L’agence a-t-elle perçu une rémunération forfaitaire ou à la prestation ?
Mme Amélie Verdier. Il s’agissait d’un contrat-cadre avec un prix plafond. Chaque mois, un relevé des prestations réalisées était établi, sur la base duquel était attesté le service fait. Nous avons donc une connaissance précise des prestations, ce qui me permet de répondre de manière assez catégorique.
M. Hervé Morin. M. Gonelle indique avoir transmis l’enregistrement de la conversation de M. Cahuzac à la direction régionale des finances publiques en 2001. Selon lui, l’administration centrale aurait décidé de ne pas donner suite. Des éléments relatifs à cet épisode figuraient-ils dans le dossier fiscal de M. Cahuzac au moment de sa prise de fonctions ?
Vous avez évoqué la « muraille de Chine » et la réunion de crise que vous avez légitimement tenue avec l’ensemble des membres du cabinet. Cependant, entre le 4 et le 10 décembre 2012, la « muraille de Chine » n’était pas encore en place. Au cours de cette période, l’affaire a-t-elle été évoquée dans des discussions internes au ministère ou avec des collaborateurs du Premier ministre ou du Président de la République ?
À votre connaissance, même si vous ne gériez pas l’agenda de M. Cahuzac, le ministre délégué a-t-il eu des rendez-vous à ce sujet à l’Élysée ou à Matignon ? Si oui, lesquels ?
Compte tenu de votre expérience de Bercy, trouvez-vous naturel qu’un ministre délégué chargé du budget rencontre, à titre personnel, un simple inspecteur des impôts ? Cela ne doit pas être fréquent ! De plus, celui-ci avait commis de très nombreux courriers et rapports, dont certains passages sont en effet sujets à caution.
Enfin, à partir de quel moment avez-vous, vos collègues et vous-même, nourri des doutes ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas eu accès à l’intégralité du dossier fiscal du ministre délégué. Je n’ai pas eu connaissance d’éléments qui auraient été transmis au directeur régional, puis au directeur général des finances publiques, ou auxquels celui-ci n’aurait pas donné suite.
M. le président Charles de Courson. Pour être plus précis, les informations qui nous ont été communiquées par M. Gonelle concernent les années 2001 et 2002.
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas d’éléments à vous indiquer à ce sujet.
Du 4 au 10 décembre 2012, la « muraille de Chine » a été respectée comme si elle existait déjà. Certes, elle n’a été formalisée que le 10 décembre, mais aucune instruction d’aucune sorte concernant l’affaire n’a été donnée ni avant ni après cette date. Et aucune information particulière relative au dossier fiscal de M. Cahuzac n’a été communiquée au cabinet entre le 4 et le 10 décembre.
M. Hervé Morin. Avez-vous été amenés, un membre du cabinet ou vous-même, à rédiger des notes pour M. Cahuzac ou à lui donner des conseils, compte tenu de votre expérience ?
Mme Amélie Verdier. À quel sujet ?
M. Hervé Morin. Au sujet de l’affaire qui éclate le 4 décembre.
Mme Amélie Verdier. Comme je l’ai indiqué, aucun membre du cabinet en dehors de moi-même n’a eu connaissance de la situation fiscale de M. Cahuzac. Encore n’ai-je eu accès, comme je l’ai précisé, qu’à certains éléments. Je n’ai pas eu à me prononcer ni à donner de conseils sur la gestion de son dossier, sauf sur les questions que j’ai évoquées précédemment : son foyer fiscal qui pouvait l’amener à réaliser certains paiements de manière distincte. Tels sont les seuls éléments que j’ai été amenée à traiter.
La « muraille de Chine » a été formalisée le 10 décembre, mais elle a été élevée dès le déclenchement de l’affaire. Nous n’avons rédigé aucune note, ni rien transmis de particulier au ministre délégué à ce sujet.
Je n’ai pas eu connaissance de rendez-vous dédiés à l’affaire entre le ministre délégué et le Premier ministre ou le Président de la République. Il va de soi qu’il avait des entretiens avec eux. J’ai assisté à certains d’entre eux, mais l’affaire n’a pas été abordée en ma présence. Je n’ai pas d’autres éléments à vous communiquer à ce sujet.
S’agissant du caractère normal ou non de la rencontre entre le ministre délégué et M. Garnier, il convient de préciser que celui-ci est un inspecteur des impôts à la retraite, résidant dans le Lot-et-Garonne et relativement connu localement – la revue de presse réalisée par la DGFiP, qui figurait dans le dossier que j’ai visé au mois d’octobre, montrait qu’il s’était autoproclamé « Colombo » et qu’il se disait victime d’un acharnement. De plus, M. Garnier demandait à rencontrer le ministre délégué dans le cadre de son dossier disciplinaire. Pour être franche, je me suis dit, comme tout directeur de cabinet, que cet entretien faisait partie de la série de rendez-vous locaux qui font perdre un peu de temps au ministre dans le traitement des dossiers de fond. Néanmoins, il ne m’a semblé ni étonnant, ni illogique qu’il ait lieu.
M. le président Charles de Courson. Cependant, en remettant au ministre délégué le dossier que vous allez nous communiquer, vous n’avez pas appelé son attention sur les accusations qu’avait portées M. Garnier contre lui ?
Mme Amélie Verdier. Je le répète : nous n’en avions pas connaissance à ce moment-là ; elles ne figuraient pas dans les notes que je vais vous remettre.
M. le président Charles de Courson. Quand avez-vous eu connaissance du dossier pendant devant les tribunaux ?
Mme Amélie Verdier. Les notes reprenaient les procédures en cours : M. Garnier les détaillait à longueur de correspondance, y compris celles qu’il avait lui-même engagées à l’encontre de ses collègues et de ses supérieurs. L’objet de l’entretien était, pour M. Garnier, de demander au ministre délégué de lui accorder une protection fonctionnelle. À ma connaissance, le ministre délégué lui a répondu qu’il ne souhaitait pas intervenir dans cette affaire, ni dans un sens ni dans l’autre. D’autant plus que la plupart des procédures opposaient M. Garnier à ses supérieurs et à l’administration. M. Garnier considérait notamment que, n’ayant pas été promu, il avait fait l’objet d’une sanction. C’était, somme toute, un dossier disciplinaire classique.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour que les choses soient bien claires : avant ce rendez-vous avec M. Garnier, vous avez préparé un dossier pour le ministre délégué.
Mme Amélie Verdier. C’est, plus précisément, la chef de cabinet qui s’en est chargée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans ce dossier ne figurait pas le mémoire de douze pages dans lequel M. Garnier porte des accusations contre M. Cahuzac.
Mme Amélie Verdier. C’est exact.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand avez-vous eu connaissance de ce mémoire ?
Mme Amélie Verdier. L’article paru le 4 décembre ayant fait référence à ce mémoire, l’administration l’a alors recherché. Au bout d’un certain temps – M. Garnier ayant produit de nombreux documents –, elle l’a retrouvé.
M. Christian Assaf. Donc, dans les deux notes rédigées par la DGFiP pour préparer le rendez-vous du mois d’octobre, il n’est fait mention à aucun moment des accusations portées par M. Garnier contre le ministre délégué.
Mme Amélie Verdier. Nullement, en effet.
Je reprends les notes – Un seul lien avait été établi à l’époque avec le ministre délégué : M. Garnier avait infligé un redressement fiscal à une entreprise située dans sa circonscription.
M. le président Charles de Courson. Il s’agit de la fameuse coopérative France Prune.
Mme Amélie Verdier. Les notes font également état du fait que M. Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire dans le traitement de certains dossiers. Je ne pense pas utile de vous refaire tout l’historique, sauf si vous le souhaitez.
M. le président Charles de Courson. Vous nous remettrez le dossier complet à la fin de l’audition.
Mme Amélie Verdier. Quant aux éventuels doutes que nous avons pu nourrir, compte tenu de la nature de l’information publiée le 4 décembre, j’ai interrogé clairement le ministre délégué. Il m’a répondu de manière très directe qu’il n’avait jamais détenu de compte en Suisse. J’ai regardé le lendemain son intervention lors de la séance des questions au Gouvernement et c’est elle qui m’a, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, convaincue. D’abord, il est normal d’avoir confiance dans le ministre avec lequel on travaille, sinon on ne reste pas à son service. Ensuite, pour avoir exercé mes fonctions auprès de M. Cahuzac au quotidien pendant plusieurs mois, j’avais pu mesurer l’importance que revêtait pour lui le Parlement. Pour moi, il n’était donc pas imaginable qu’il tienne de tels propos s’ils n’étaient pas exacts.
À mesure que les révélations paraissaient dans la presse, nous avons pu nourrir des doutes à certains moments, et interroger à nouveau le ministre délégué. Nous avons, évidemment, été ébranlés par le communiqué du procureur de la République publié le 19 mars : les faits devenaient assez précis. Le lendemain, M. Cahuzac m’a répété qu’il ne fallait jamais douter et qu’il n’avait jamais détenu de compte en Suisse.
Mme Cécile Untermaier. La « muraille de Chine » est édifiée le 10 décembre. Le 14 décembre, l’administration fiscale demande à M. Cahuzac d’attester qu’il n’a pas de compte en Suisse. Existe-t-il un lien entre les deux événements ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas eu connaissance de la demande de l’administration fiscale : elle a appliqué l’instruction et n’est pas passée par moi pour interroger M. Cahuzac. Je ne vois pas de lien, ni n’en imagine, entre la question posée et la « muraille de Chine ». En tout cas, l’administration a fait son travail, peut-être même un peu plus rapidement que d’habitude : une information de presse ayant fait état d’un possible compte en Suisse, elle a demandé à l’intéressé s’il détenait ou non un tel compte. Mais ce sont là des éléments dont j’ai eu connaissance ultérieurement, après être devenue directrice de cabinet de M. Cazeneuve.
M. Jean-Marc Germain. Je voudrais revenir sur la question du secret fiscal. Dès lors que la directrice de cabinet a eu connaissance de dossiers fiscaux individuels, la question du respect du secret fiscal se pose également pour elle. Néanmoins, la solution que vous avez retenue, monsieur le président, me paraît sage : le secret fiscal s’arrête lors de la présente audition publique, et le rapporteur pourra nous communiquer les informations complémentaires qu’il aura recueillies.
Madame la directrice, depuis que vous dirigez le cabinet de M. Cazeneuve, vous avez sans doute pu reconstituer un historique du dossier fiscal de M. Cahuzac. Je prolonge la question de M. Morin : existe-t-il, dans ce dossier, des traces d’une saisine de l’administration fiscale qui aurait été suivie d’une enquête fiscale ? M. Gonelle nous a dit avoir saisi les services fiscaux de manière informelle en 2001, et le juge Bruguière, qui a également détenu une copie de l’enregistrement, a pu le faire à nouveau en 2006.
Par ailleurs, même si ce n’est pas vous, mais le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances qui a pris la décision, quel a été le rôle de l’administration fiscale à partir du moment où la justice a été saisie le 8 janvier 2013 ? De manière générale, sur le plan juridique, les services fiscaux peuvent-ils ou, le cas échéant, doivent-ils poursuivre leur enquête une fois que la justice est saisie ?
Mme Amélie Verdier. À aucun moment je n’ai eu connaissance des éléments qui auraient été transmis à l’administration fiscale en 2001, 2002, 2006 ou 2007.
M. Jean-Marc Germain. N’y avait-il rien dans le dossier ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas connaissance du dossier fiscal de M. Cahuzac.
M. Jean-Marc Germain. Même a posteriori ?
Mme Amélie Verdier. Non.
M. le président Charles de Courson. M. Germain soulève une question que nous avons longuement évoquée ce matin : une enquête judiciaire et une enquête administrative peuvent-elles se dérouler en parallèle ? Ou bien la seconde doit-elle être suspendue ? Existe-t-il une jurisprudence ou une pratique en la matière ? Cette question ne concerne pas spécifiquement l’affaire Cahuzac.
Mme Amélie Verdier. Je confirme que je n’ai été ni de près ni de loin associée aux décisions prises. Je rappelle les faits : la justice a ouvert, le 8 janvier 2013, une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Pour sa part, l’administration a enquêté – j’en ai eu la confirmation ultérieurement – sur l’existence d’une éventuelle fraude fiscale.
M. Jean-Marc Germain. Si vous ne vous étiez pas déportée et si l’affaire avait concerné un autre ministre, auriez-vous recommandé à votre propre ministre, une fois la justice saisie, de poursuivre ou d’arrêter l’enquête administrative ? J’aborde là un cas d’école.
Mme Amélie Verdier. Comme je l’ai indiqué précédemment, ni le ministre délégué ni le cabinet ne donne l’instruction d’engager ou d’arrêter un contrôle, ni de prendre quelque acte que ce soit dans un dossier individuel.
S’agissant de la procédure suivie par l’administration fiscale et des actes pris par celle-ci pendant la période que vous évoquez, je ne peux pas vous répondre, dans la mesure où je n’en ai eu qu’une connaissance partielle, a posteriori.
M. Jean-Marc Germain. Mais, d’une manière générale, les enquêtes fiscales sont-elles interrompues lorsque la justice est saisie ou se poursuivent-elles en parallèle du travail effectué par la justice ?
Mme Amélie Verdier. J’avais commencé à vous répondre. D’abord, comme je l’ai précisé, la justice a ouvert, le 8 janvier, une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Ce chef d’inculpation est distinct de celui de fraude fiscale à proprement parler, même si l’un est la conséquence de l’autre.
Ensuite, s’agissant du cas théorique, il n’est pas exclu que la justice et l’administration fiscale coopèrent. Cela s’est d’ailleurs produit en l’espèce, j’en ai eu la confirmation ultérieurement.
M. le président Charles de Courson. Nous poserons à nouveau la question au directeur général des finances publiques, lorsque nous l’auditionnerons.
Mme Amélie Verdier. Si je puis apporter un commentaire plus général, il me semble a posteriori, au vu des actes pris par l’administration fiscale, qu’elle a, comme c’est normal, essayé d’exploiter toutes les informations en sa possession pour analyser la situation du contribuable concerné et tenter d’établir s’il y avait eu ou non fraude fiscale.
M. Philippe Houillon. Le 4 décembre, Mediapart a publié l’article que l’on connaît. Le lendemain, à l’Assemblée, le ministre délégué a été obligé de mentir en répondant à la question d’un de nos collègues. Ensuite, l’affaire a pris petit à petit de l’ampleur. Elle a abouti à l’ouverture d’une enquête préliminaire le 8 janvier 2013, puis à la démission du ministre délégué. Or, vous décrivez tout cela, madame la directrice, comme un non-événement. Je prendrai, à cet égard, deux exemples.
Premièrement, je m’étonne que M. Garnier ait demandé une protection fonctionnelle, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet, au ministre qu’il avait lui-même mis en cause dans son mémoire en défense !
Deuxièmement, vous passez très rapidement sur le contrat à propos duquel notre collègue vous a interrogée. Le montant de ce contrat, signé le 9 octobre pour une durée de trois mois, s’élevait à 136 000 euros : ce n’est pas rien ! Il a été conclu avec M. Finchelstein, collaborateur de M. Fouks, patron de Havas Worldwide. Si j’en crois le document que j’ai sous les yeux, il portait sur les objets suivants : prestation de conseil pour la mise en place d’une stratégie de communication ; suivi de l’opinion ; soutien à l’expression du ministre ; coaching. Or, une « bombe atomique » est tombée et le prestataire – qui a touché tout ou partie des 136 000 euros – ne serait même pas intervenu ! Et ce, alors même que l’affaire Cahuzac devenait la préoccupation première non seulement de Bercy, mais du Gouvernement ! Cela ne laisse pas de m’étonner.
Bien sûr, je suis en partie convaincu par vos propos, madame la directrice : le ministre délégué vous a répondu clairement et si vous avez continué à travailler avec lui, c’est que vous aviez confiance en lui. Mais, tout de même, l’affaire était un sujet quotidien au sein de votre ministère. Je n’imagine pas que vous n’ayez pas été davantage associée à sa gestion. J’aimerais donc en savoir un peu plus sur l’ambiance, ainsi que sur l’action des prestataires en communication. À en juger par ce que j’ai entendu depuis le début de cette audition, il ne se serait rien passé !
M. Alain Claeys, rapporteur. Je comprends votre préoccupation, cher collègue. Madame la directrice a répondu en partie : il s’agit d’un contrat-cadre avec un prix plafond, les paiements étant débloqués, si j’ai bien compris, en fonction des prestations fournies. Mais la Commission peut aller plus loin en demandant au ministère de l’économie et des finances de préciser la nature des prestations.
M. le président Charles de Courson. Je vous invite donc, madame la directrice, à nous communiquer copie du contrat et à nous indiquer les prestations réalisées dans ce cadre.
M. Philippe Houillon. Le contrat a été passé avec M. Finchelstein, conjointement par MM. Moscovici et Cahuzac. Il est donc nécessaire qu’on nous explique la manière dont les deux ministres travaillaient en la matière. Peut-être n’apprendrons-nous rien, mais il nous faut une réponse sur ce point.
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas ici toutes les pièces relatives à ce contrat, mais nous vous les transmettrons.
Vous m’avez interrogée, monsieur le député, sur l’ambiance. Bien sûr, nous parlions de cette situation perturbatrice et difficile à vivre. Mais le cabinet travaillait au service du ministre délégué, non pour M. Cahuzac. La seule manière de faire – tel avait été mon conseil après en avoir discuté avec le directeur général des finances publiques – était de séparer les choses. Cela vaut aussi pour le contrat que vous évoquez : il a été signé par les deux ministres en vue de les aider à définir leur stratégie de communication ; il n’avait nullement vocation à être utilisé par M. Cahuzac pour l’affaire dans laquelle il était mis en cause.
D’autre part, lorsque le ministre délégué intervenait sur une radio, nous savions, bien sûr, qu’il pouvait être interrogé sur cette affaire. Certes, il nous est arrivé d’en discuter avec lui, de voir comment il sentait les choses. Mais aucune réunion n’a été dédiée à ce sujet, et il définissait seul sa position. La gestion de cette affaire ne relevait pas du cabinet, en tout cas telles que je concevais son rôle. Je ne dis pas que cette affaire n’était pas présente à notre esprit, mais que le cabinet s’est consacré, au cours de cette période, à l’action du ministre délégué, en particulier aux textes qui relevaient de sa compétence.
Mme Marie-Françoise Bechtel. J’ai été très intéressée par toutes les questions posées. Je vais essayer de formuler, moi aussi, des questions factuelles.
Je témoigne ma sympathie aux fonctionnaires ici présents. Nous avons tout lieu de penser qu’ils sont compétents et honnêtes. Malgré la sobriété de leurs propos, ils ont dû vivre une période particulièrement difficile.
À l’instar de M. Houillon, je m’interroge sur la communication de M. Cahuzac. Les explications fournies sur la manière dont les deux ministres ont utilisé le contrat qu’ils avaient conclu avec Euro RSCG me paraissent assez claires. Néanmoins, M. Cahuzac n’a-t-il pas fait appel à des services de communication, dédiés à sa personne, pour gérer l’affaire qui le concernait, à partir du mois de décembre ou de janvier ? Si tel est le cas, sur quels fonds ces prestations ont-elles été rémunérées ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai eu connaissance d’aucun contrat ou action particulière visant à recruter une agence de communication dédiée à la gestion de crise pour les besoins de M. Cahuzac.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Donc, rien de tel n’est passé par le cabinet ?
Mme Amélie Verdier. Rien, en effet.
Mme Marie-Françoise Bechtel. M. Cahuzac a vécu une période très délicate entre janvier et mars. Compte tenu de ce que vous savez de lui, excluez-vous qu’il ait pu recourir, sur ses fonds propres, aux services d’une agence ou de conseillers en communication spécialisés ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai connaissance de rien de tel. Je pense qu’il aurait été amené à m’en parler, mais je ne peux rien exclure. En tous les cas, aucune réunion avec une équipe remplissant les fonctions que vous décrivez ne s’est tenue dans les locaux du ministère.
Mme Marie-Françoise Bechtel. S’agissant de la « muraille de Chine », il ne fait pas de doute que le ministre délégué pouvait, en toute légalité, donner une instruction de cette nature. En revanche, il serait intéressant de savoir s’il l’a fait spontanément ou si son ministre de tutelle a inspiré cette démarche. Qu’en est-il, à votre connaissance ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai pas nécessairement eu connaissance de tous les contacts entre le ministre délégué et son ministre de tutelle. La « muraille de Chine » m’a été suggérée par le directeur général des finances publiques. Nous en avons discuté très rapidement, mais cela a pu faire suite à des échanges qu’il aurait eus lui-même avec le ministre de l’économie et des finances. Donc, je n’écarte, ni ne confirme votre hypothèse.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Les deux cabinets n’ont-ils pas échangé à ce sujet ?
M. le président Charles de Courson. Je me pose la même question : le ministre de l’économie et des finances a-t-il, au moins, donné son accord ? Le directeur général des finances publiques a proposé cette instruction et vous avez contribué à sa rédaction. Avez-vous appelé votre homologue, directeur du cabinet de M. Moscovici ? Vous a-t-il donné son accord ou en a-t-il parlé à son ministre ? Nous poserons aussi la question à M. Moscovici, lorsque nous l’auditionnerons.
Mme Amélie Verdier. J’ai informé le directeur de cabinet de M. Moscovici que le ministre délégué allait signer cette instruction. Puis je la lui ai transmise, une fois signée.
M. le président Charles de Courson. Vous a-t-il donné son accord au nom de son ministre ?
Mme Amélie Verdier. Il n’avait pas à le faire.
M. le président Charles de Courson. Mais les dossiers dont M. Cahuzac se déchargeait revenaient dès lors à M. Moscovici ?
Mme Amélie Verdier. De toute façon, par ses compétences, il était déjà saisi de ces dossiers.
Mme Marie-Françoise Bechtel. M. Moscovici n’avait pas nécessairement, sur le plan légal, à donner son accord. Néanmoins, compte tenu des liens entre les deux ministres, il est surprenant qu’il n’ait pas été au courant de cette initiative du directeur général des finances publiques.
Mme Amélie Verdier. Je n’affirme rien de tel. Mais, s’il en a été informé, ce n’est pas moi qui en ai pris l’initiative : je n’en ai pas discuté au préalable avec son directeur de cabinet. Je comprends votre interrogation. Cependant, notre préoccupation était de mettre en place la « muraille de Chine » le plus vite possible. Nous avons d’ailleurs appliqué l’instruction avant même qu’elle ne soit signée par le ministre délégué.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Sans en savoir davantage, vous n’excluez donc pas que l’idée ait pu venir de M. Moscovici ?
Mme Amélie Verdier. Je ne l’exclus pas.
M. Thomas Thévenoud. D’où vient l’expression « muraille de Chine » ?
Mme Amélie Verdier. À ma connaissance, le directeur général des finances publiques. Il revenait d’ailleurs de mission en Chine.
M. le président Charles de Courson. Je crois me souvenir que l’expression a été employée par le ministre de l’économie et des finances devant l’Assemblée.
Mme Amélie Verdier. C’est par ailleurs un terme couramment utilisé dans le domaine financier, lorsqu’il s’agit d’éviter les conflits d’intérêts.
M. Jean-Pierre Gorges. Les directeurs de cabinet sont généralement au courant de tout. Un point nous étonne : l’administration fiscale a adressé une demande d’entraide à la Suisse alors qu’une enquête judiciaire avait été ouverte. Avez-vous été informée de cette procédure ? Avez-vous appelé l’attention sur le fait qu’une enquête judiciaire était ouverte ?
Peut-être l’enquête administrative ne nuisait-elle pas à l’enquête judiciaire. Mais la question posée à la Suisse était fermée et, pour tout dire, orientée : on connaissait la réponse à l’avance. Avez-vous eu connaissance de la formulation de la question ? Avez-vous donné un avis sur ce point ?
Enfin, au vu de la réponse reçue, beaucoup – jusqu’au président de l'Assemblée nationale – ont considéré que M. Cahuzac était blanchi. M. Plenel l’a dit ce matin : l’affaire a bien failli être close à ce moment-là. De votre point de vue, y a-t-il eu une opération « Il faut sauver le soldat Cahuzac » ? Les faits que j’ai rappelés le laissent penser compte tenu de la façon dont a procédé Mediapart dans la diffusion des informations qu’il détenait. Sans doute le ministre délégué avait-il encore l’espoir de passer au travers des mailles du filet à ce moment-là.
Mme Amélie Verdier. Je n’ai jamais évoqué la question de savoir ce que devait ou ne devait pas faire l’administration fiscale sur le dossier de M. Cahuzac pendant cette période, ni avec le directeur général des finances publiques, ni avec le ministre de l’économie et des finances, ni avec son directeur de cabinet. Je ne sais rien d’une éventuelle opération « Il faut sauver le soldat Cahuzac ». Si une telle opération a eu lieu, je n’y ai été associée ni de près ni de loin. Je n’ai pas eu connaissance du moindre échange avec le ministre délégué à ce sujet.
Maintenant, si vous m’interrogez sur mon sentiment personnel, dès lors que le ministre délégué m’avait affirmé que les informations de Mediapart n’étaient pas exactes, j’avais évidemment envie que cette affaire s’arrête.
A posteriori, il me semble que l’administration fiscale a fait son travail en lançant une procédure d’entraide fiscale. Le parquet de Paris la mentionne d’ailleurs dans son communiqué du mois de mars. Il faudrait voir ce qu’en dit le parquet, mais je n’ai pas l’impression qu’elle ait ralenti en quoi que ce soit le cours de la justice.
M. le président Charles de Courson. Je signale à l’attention de mon collègue que M. Cahuzac était non pas un soldat, mais un général !
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Compte tenu de ma connaissance des cabinets, je m’étonne que vous n’ayez rien vu ni rien su. Je souhaiterais que vous le confirmiez devant la Commission : cela s’est-il bien passé ainsi ? N’y avait-il aucune archive au cabinet ? M. Gonelle nous a cité des noms, en particulier celui de M. Mangier, fonctionnaire de la direction nationale d’enquêtes fiscales à Bordeaux. Il aurait eu connaissance du compte de M. Cahuzac, mais n’aurait rien fait remonter, à moins qu’on ne lui ait interdit de mener une enquête.
Mme Amélie Verdier. Je vous confirme que je n’ai eu connaissance de rien de tel. Les cabinets détruisent leurs archives, seule l’administration fiscale a pu, le cas échéant, conserver des traces. Lorsque j’ai pris mes fonctions au mois de mai 2012, je n’ai trouvé qu’un seul document sur mon bureau : le programme de stabilité.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je suis tout de même étonné. Vous étiez la directrice de cabinet du ministre mis en cause ! N’y avait-il vraiment aucune trace des enquêtes menées antérieurement ? N’avez-vous à aucun moment été informée, ne serait-ce que de manière informelle ?
Mme Amélie Verdier. Les choses se passent de manière non pas informelle, mais organisée : le processus de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement que j’ai décrit précédemment aboutit, le cas échéant, à ce que certaines questions soient posées. Tout cela est, au contraire, très formel. En outre, l’organisation du travail n’est pas dictée par la nécessité d’examiner tel ou tel élément découvert subitement.
M. Daniel Fasquelle. Reste à savoir si la « muraille de Chine » n’était pas plutôt une ligne Maginot ! Il revient à notre commission d’enquête de le déterminer.
Vous avez dit, madame la directrice, que vous aviez envie que cette affaire s’arrête. Or, il y avait un moyen très simple pour ce faire : il suffisait que M. Cahuzac demande à la banque UBS d’indiquer s’il détenait ou non un compte auprès d’elle. Le Canard enchaîné avait évoqué cette possibilité, et je l’avais moi-même fait, dès le 5 décembre. Nous en avons d’ailleurs parlé à nouveau avec Mediapart ce matin. Pourquoi n’avez-vous pas conseillé cette procédure au ministre délégué ? Ne me dites pas que vous n’avez à aucun moment évoqué cette affaire avec lui !
Mme Amélie Verdier. Je n’ai rien dit de tel. Le ministre délégué m’a informée de certains éléments, mais il ne me revenait pas de lui dire ce qu’il devait faire, à titre personnel. Tout avait été organisé, justement, pour que sa situation fiscale soit traitée séparément.
M. Daniel Fasquelle. La séparation portait non pas sur vos échanges avec le ministre délégué, mais sur le fait que vous ne deviez pas donner d’instruction particulière à l’administration. En tant que directrice de cabinet, votre rôle était de conseiller le ministre délégué. Or, l’affaire aurait pu prendre fin en quelques jours s’il avait écrit à la banque UBS. Lui avez-vous conseillé de le faire ?
M. le président Charles de Courson. Madame la directrice, le ministre délégué vous avait affirmé ne pas détenir de compte auprès de la banque UBS et vous l’avez cru. Lui avez-vous conseillé d’écrire à la banque ?
M. Daniel Fasquelle. Et si vous ne l’avez pas fait, pourquoi ?
Mme Amélie Verdier. Les débats sur la bonne formulation de la question à poser à la banque ont en effet agité la presse et, peut-être, l’hémicycle. Pour ma part, je ne suis pas spécialiste de droit bancaire suisse. Comme je l’ai indiqué précédemment de manière très spontanée, le ministre délégué a en effet évoqué avec moi les conseils que lui donnaient ses avocats sur ce point. Nous avons discuté ensemble de la meilleure manière de procéder.
M. Daniel Fasquelle. Encore une fois, il y avait une question toute simple à poser à la banque. Lui avez-vous conseillé de le faire, oui ou non ?
Mme Amélie Verdier. Je vous demande pardon : quelle question ?
M. le président Charles de Courson. Je me permets de reformuler la question de M. Fasquelle. M. Cahuzac aurait pu adresser la question suivante à la banque UBS : « Pouvez-vous me confirmer que je détiens un compte auprès de vous ? ». La banque aurait répondu par oui ou par non.
Mme Amélie Verdier. M. Cahuzac traitait ce point avant tout avec ses avocats. Mais je confirme qu’il l’a également évoqué avec moi. Je lui ai indiqué qu’un tel courrier me semblait absurde : sortie de son contexte, la phrase « Pouvez-vous me confirmer que je détiens un compte auprès de vous ? » risquait d’être considérée comme un aveu.
M. Daniel Fasquelle. Il convenait de poser la question suivante : « Pouvez-vous me confirmer que je ne détiens pas de compte auprès de vous ? ».
M. le président Charles de Courson. Si vous adressez la question ainsi formulée à la banque UBS, elle ne vous répondra pas.
Mme Amélie Verdier. Je trouve intéressant que vous débattiez entre vous de la bonne manière de poser la question…
M. le président Charles de Courson. Notre collègue vous a posé une question précise : avez-vous conseillé au ministre délégué d’écrire à la banque UBS en lui posant la question dans les formes, à savoir « Pouvez-vous me confirmer que je détiens un compte auprès de vous ? »
M. Daniel Fasquelle. Cette éventualité a nécessairement été évoquée à un moment ou à un autre. Si le ministre délégué ne l’a pas fait, pourquoi donc en a-t-il été ainsi ? Cela aurait dû vous mettre la puce à l’oreille.
Mme Amélie Verdier. Je confirme que la question a été évoquée. Sauf erreur, M. Cahuzac a fini par poser la question ainsi formulée : « Pouvez-vous me confirmer que ni un de mes ayants droit ni moi n’avons détenu un compte auprès de vous ? ». Je crois que la banque n’a pas répondu, mais je ne connais pas le détail de cette correspondance.
Je le répète : M. Cahuzac décidait de sa stratégie avec ses avocats. Ce n’est pas moi qui ai été chargée de faire une analyse juridique sur ce point. Le débat étant sur la place publique, nous nous sommes bornés à dire au ministre délégué qu’il fallait faire quelque chose et tenter d’obtenir au plus vite une réponse de la banque.
M. le président Charles de Courson. Ne vous êtes-vous pas inquiétée, madame la directrice, lorsque vous avez découvert, dans la presse, que M. Cahuzac refusait de signer une déclaration attestant qu’il ne détenait pas de compte en Suisse ? Cela a d’ailleurs duré plus d’un mois.
Mme Amélie Verdier. Je n’étais pas au courant qu’une telle question lui avait été posée, ni qu’il avait tardé à y répondre.
M. Alain Claeys, rapporteur. La presse n’a fait état de ces informations qu’au mois d’avril. M. Plenel l’a rappelé ce matin.
Mme Amélie Verdier. En effet, je n’ai pas souvenir que cette information ait été publiée lorsque M. Cahuzac était ministre délégué.
M. le président Charles de Courson. Je pose ma question différemment : n’étiez-vous pas au courant que la DGFiP avait demandé à M. Cahuzac de signer une telle attestation ?
Mme Amélie Verdier. J’ai déjà répondu à cette question. Je confirme que non.
M. le président Charles de Courson. Ne vous en a-t-il jamais parlé lui-même ?
Mme Amélie Verdier. Non.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Au sein de l’administration, en particulier à la DGFiP, personne ne vous en a donc parlé ?
Mme Amélie Verdier. Une instruction très claire avait été donnée : ni le ministre délégué ni sa directrice de cabinet n’avaient à connaître des actes que l’administration prenait pour traiter cette affaire.
Mme Marie-Françoise Bechtel. C’est juste. Et personne au cabinet de M. Moscovici ne vous a donné d’information à ce sujet ?
Mme Amélie Verdier. Je n’ai jamais évoqué ce sujet avec M. Moscovici ni avec son cabinet tant que M. Cahuzac a été ministre.
M. le président Charles de Courson. M. Moscovici était, lui, au courant : il le déclare dans la presse. Nous l’interrogerons à ce sujet lorsque nous l’auditionnerons.
M. Christian Assaf. M. Fasquelle a posé à M. Cahuzac une question désormais fameuse lors de la séance des questions au Gouvernement, le 5 décembre. Avez-vous su ou pressenti qu’une telle question serait posée au ministre délégué ? Si oui, le cabinet a-t-il préparé une réponse et dans quelles conditions l’avez-vous fait ? La réponse prononcée par le ministre délégué a-t-elle été fidèle à celle que vous aviez proposée ?
À quelle date avez-vous eu connaissance, madame la directrice, monsieur Robert, de l’existence du compte de M. Cahuzac ?
Mme Amélie Verdier. Le ministre délégué s’attendait à être interrogé lors de la séance des questions au Gouvernement du 5 décembre. Nous ne lui avons pas préparé de réponse et n’avons tenu aucune réunion spécifique à ce sujet. Il avait prévu d’expliquer qu’il n’avait jamais détenu le compte évoqué par la presse. Il a dû s’interroger sur l’opportunité de préciser « en Suisse » ou, de manière générale, « à l’étranger ». De mémoire, je crois qu’il a finalement mentionné les deux.
Comme je l’ai indiqué, j’ai nourri quelques doutes, mais je n’ai eu la confirmation explicite de l’existence du compte que lorsque M. Cahuzac a lui-même reconnu les faits.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie, madame la directrice, messieurs.
Audition du mardi 28 mai 2013
À 8 heures 45 : MM. Rémy Rioux, directeur du cabinet, et Jean Maïa, conseiller juridique, et Mme Irène Grenet, conseillère en charge de la politique fiscale, au cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances.
M. le président Charles de Courson. Nous poursuivons les travaux de la commission d’enquête avec l’audition de trois membres du cabinet de M. Pierre Moscovici : M. Rémy Rioux, directeur de cabinet, M. Jean Maïa, conseiller juridique, et Mme Irène Grenet, conseillère en charge de la politique fiscale.
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Les différentes initiatives prises par le ministère de l’économie et des finances entre la publication du premier article relatif à cette affaire, le 4 décembre 2012, et les aveux de Jérôme Cahuzac, le 2 avril 2013, nous intéressent donc tout particulièrement. En votre qualité de très proches collaborateurs du ministre de l’économie et des finances, vous êtes certainement en mesure de nous éclairer sur de nombreux points, et je ne doute pas que les membres de la commission d’enquête aient de nombreuses questions à vous poser.
Auparavant, il me revient de rappeler que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous remercie de bien vouloir, chacun à votre tour, lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(M. Rémy Rioux, M. Jean Maïa et Mme Irène Grenet prêtent successivement serment.)
Je vous prie de nous exposer pour commencer les actions qui ont été les vôtres après le 4 décembre et la nature des informations dont vous disposiez.
M. Rémy Rioux, directeur du cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances. Je suivrai un fil chronologique pour vous expliquer ce que j’ai su et fait sur ce dossier à la place qui est la mienne. J’espère vous convaincre de notre bonne foi et de la rigueur de notre travail.
Sans doute serai-je conduit à répéter des éléments déjà exposés par le ministre de l’économie et des finances lors de son audition devant la Commission des finances de votre Assemblée le mercredi 17 avril.
Permettez-moi de formuler tout d’abord trois remarques sur la situation qui précède le 4 décembre, date de la parution du premier article de Mediapart.
Au sein du Gouvernement, le ministre de l’économie et des finances et ses deux ministres délégués – Jérôme Cahuzac, à l’époque des faits, et Benoît Hamon – constituent un pôle. Pour tenir compte du choix, réalisé au moment de la composition du Gouvernement, de réunifier les compétences de l’économie, des finances, du budget et des comptes publics, nous avons mis en place dès notre arrivée, au mois de mai 2012, un fonctionnement intégré. Tout d’abord, toutes les notes adressées par l’ensemble des services placés sous l’autorité du ministre passent par le directeur de son cabinet avant d’être attribuées aux conseillers des différents cabinets – lesquels, pour éviter de perdre du temps, en reçoivent parallèlement une copie dématérialisée. Comme Mme Amélie Verdier vous l’a dit la semaine dernière, nous nous sommes aussi efforcés, par souci d’efficacité, de cohérence et d’économie, d’avoir autant que possible des conseillers communs aux différents ministres. Cela a été le cas avec les cabinets de MM. Cahuzac et Hamon, mais aussi avec celui de Mme Nicole Bricq lorsque celle-ci a été nommée ministre du commerce extérieur.
Il existait quatre conseillers communs avec le cabinet de Jérôme Cahuzac : les deux conseillers en charge de la politique fiscale, le conseiller budgétaire et social et le conseiller juridique. Deux d’entre eux sont à mes côtés ce matin : Mme Irène Grenet, qui est plus particulièrement en charge de la fiscalité des personnes, de la fiscalité locale et de la fiscalité internationale, et M. Jean Maïa, conseiller juridique, qui suit également les sujets de fraude fiscale.
Je tiens à préciser que mes deux collaborateurs n’ont été associés en rien au suivi du dossier qui fait l’objet de votre commission d’enquête. Compte tenu de son caractère très sensible, je suis le seul à l’avoir suivi auprès du ministre.
Je précise également que le recours à l’agence Havas Worldwide, précédemment Euro RSCG, s’inscrivait dans ce cadre de travail en commun entre les différents cabinets. Il s’agissait, pour être clair, de bénéficier des conseils de M. Gilles Finchelstein. Ce contrat n’a aucun lien avec le dossier qui nous occupe.
Deuxième remarque : dès notre arrivée, nous avons évidemment décidé de suivre la tradition républicaine sur deux sujets, à savoir la vérification de la situation fiscale des ministres du nouveau gouvernement et la confirmation qu’il n’y aurait pas d’instructions de la part des ministres sur les procédures fiscales individuelles de contrôle et de recouvrement ainsi que sur les éventuelles poursuites pénales, conformément à la circulaire dite « Baroin » du 2 novembre 2010 concomitante à la suppression de la cellule fiscale qui existait au sein du cabinet du ministre en charge du budget.
Troisième remarque : aucun indice permettant de soupçonner la détention par Jérôme Cahuzac d’un compte en Suisse n’était parvenu jusqu’à moi avant le 4 décembre 2012. En particulier – puisque l’on a évoqué ces sources d’information potentielles à divers stades de l’affaire –, le rapport rédigé par M. Rémy Garnier en 2008 n’a pas été porté à ma connaissance. Puisque toutes les notes transitent par mon intermédiaire, j’ai dû être destinataire des deux notes préparatoires à l’entretien que Jérôme Cahuzac a eu avec Rémy Garnier en octobre, mais je vous avoue que je n’y ai pas prêté attention. Cela n’est guère surprenant : je les ai relues hier et ai constaté qu’elles ne disaient rien de la situation du ministre délégué.
Je n’ai eu aucune information en provenance des douanes – sachant que M. Michel Gonelle a soulevé ce point le 3 avril dernier et a repris ses propos dans son audition du 21 mai. J’ai interrogé au début du mois d’avril la directrice générale des douanes et des droits indirects, que votre commission d’enquête entendra également. Elle m’a indiqué ne pas avoir trouvé trace de cette prétendue enquête. Je crois pouvoir dire que la direction générale des douanes et des droits indirects a également apporté une pleine coopération à la police judiciaire sur ce dossier.
Un autre service du ministère, Tracfin, ne m’a jamais transmis d’information concernant Jérôme Cahuzac. Je rappelle que le code monétaire et financier donne obligation à Tracfin de transmettre au procureur de la République tout soupçon d’infraction dont il aurait connaissance.
J’en viens à la période qui s’ouvre le 4 décembre et qui s’achève avec la démission de Jérôme Cahuzac le 19 mars. On peut distinguer trois actions principales.
Premièrement, une « muraille de Chine » a été mise en place le 10 décembre, date de la signature par Jérôme Cahuzac de l’instruction aux services et de l’instruction à son cabinet – les pièces vous ont été transmises. Dans les faits, cette « muraille » existait dès la semaine précédente. Nous avons suivi, en l’occurrence, la recommandation que les services du ministère – direction générale des finances publiques et direction des affaires juridiques – ont formulée dès le 6 décembre en s’appuyant sur des précédents, le ministère ayant connu par le passé d’autres situations, sinon comparables, du moins complexes d’un point de vue déontologique et juridique. Mme Amélie Verdier m’en a parlé, j’en ai informé le ministre.
Cette « muraille de Chine » concernait Jérôme Cahuzac lui-même et tout ce qui concernait la banque UBS. Elle a été immédiatement effective et strictement respectée jusqu’au 19 mars. En particulier, je n’ai eu aucun échange avec ma collègue Amélie Verdier sur ces sujets, ni, a fortiori, avec Jérôme Cahuzac.
Il ne s’agissait pas, comme cela a pu être dit au cours de vos auditions de la semaine dernière, de revoir les compétences du ministre délégué, puisque toutes les compétences procèdent in fine du ministre de l’économie et des finances, mais de mettre en place clairement, rapidement et efficacement un mécanisme de déport pour éviter tout risque de conflit d’intérêts.
Du reste, le jour même de la mise en place, le directeur général des finances publiques m’a saisi d’une demande concernant le dossier de la banque UBS en général, demande que j’ai traitée moi-même. C’est bien la preuve que les décisions relevant du champ de l’instruction signée par Jérôme Cahuzac ont été immédiatement mises en œuvre.
Deuxièmement, l’administration fiscale a fait son travail. De mon point de vue, la direction générale des finances publiques (DGFiP) s’est comportée de façon exemplaire dans un contexte particulièrement délicat pour une direction d’administration centrale. Je tiens à dire qu’il n’y a eu, de la part du cabinet du ministre de l’économie et des finances, aucune manipulation de ce grand service de l’État. Le ministre et moi-même avons respecté un principe simple : nous avons laissé l’administration fiscale agir, dérouler ses procédures et coopérer pleinement avec la police judiciaire après que celle-ci eut été saisie, le 8 janvier 2013. Le contraire eût été condamnable. Bref, le cabinet du ministre n’a pas mené d’« enquête parallèle » sur le ministre délégué chargé du budget, il n’a pas fomenté d’opération spéciale, comme l’hebdomadaire Valeurs actuelles a pu l’alléguer le 11 avril.
En revanche, l’administration fiscale a rapidement pris en compte les accusations de Mediapart. Le 14 décembre 2012, sur instruction de l’administration centrale, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris adresse à Jérôme Cahuzac le formulaire dit « 754 ». Cette démarche correspond à la procédure normale dès lors que l’administration fiscale a connaissance, le cas échéant par voie de presse, de l’existence possible d’un compte à l’étranger non déclaré. Les responsables de la DGFiP vous le confirmeront. Je précise que je n’ai pas été personnellement informé de cette demande au moment où elle a été envoyée.
M. le président Charles de Courson. À quelle date en avez-vous été informé ?
M. Rémy Rioux. Très tard dans la procédure.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire ?
M. Rémy Rioux. Je ne me rappelle plus la date exacte. Probablement au moment de la démission de Jérôme Cahuzac. Il s’agit de procédures internes à l’administration fiscale.
Troisièmement, la demande d’entraide adressée aux autorités suisses marque une nouvelle étape dans la démarche pour connaître la vérité. C’est l’acte principal sur lequel le ministre est intervenu.
Là encore, il ne s’agissait pas de lancer une enquête parallèle mais de vérifier l’information produite par Mediapart et constamment réaffirmée dans ses articles depuis le 4 décembre : la détention, par Jérôme Cahuzac, d’un compte ouvert à l’UBS, en Suisse, et transféré à Singapour à l’occasion d’un déplacement à Genève au début de l’année 2010. C’est l’accusation précise qui a été plusieurs fois réaffirmée par cet organe de presse.
Pour pratiquer cette vérification, l’administration fiscale disposait d’un instrument juridique délicat à manier mais que le ministre a décidé d’utiliser, la convention passée en 1966 entre la France et la Suisse, qui a fait l’objet d’un avenant le 27 août 2009 puis d’un protocole additionnel et d’un échange de lettres le 11 février 2010. Il ne s’agissait nullement de tenter de « sauver le soldat Cahuzac » mais bien de contribuer à la manifestation de la vérité. Comme l’a dit le ministre devant la Commission des finances, l’affaire durait depuis longtemps et nous avions la possibilité de mettre en œuvre cette procédure.
L’administration fiscale, que vous interrogerez, a préparé la demande avec le plus grand soin à partir de la fin de l’année 2012. Comme il l’a indiqué, le ministre est intervenu personnellement, par téléphone, auprès de son homologue suisse Mme Eveline Widmer-Schlumpf, trois jours avant l’envoi de la demande officielle par les services fiscaux le 24 janvier. Je n’ai pas assisté moi-même à cet entretien important. Nous voulions une réponse claire, quelle que soit sa nature, de la part des autorités suisses.
La préparation méticuleuse de cette requête et le signal politique donné par le ministre étaient pleinement justifiés. Contrairement à ce que certains ont pu écrire, il est très difficile d’obtenir de telles réponses. Au 15 avril 2013, les autorités françaises avaient formulé 426 demandes de renseignement au sujet des banques suisse. Nous n’avions reçu que 29 réponses, soit 6,5 % du total – les autres demandes étant jugées « non pertinentes » par nos collègues suisses –, et l’administration fiscale a jugé que 6 d’entre elles seulement étaient satisfaisantes. En outre, ces réponses sont produites après des délais très longs.
Bref, il est très difficile d’obtenir des informations précises dans le cadre des procédures d’entraide administrative qui lient nos deux pays.
Comme l’a également expliqué le ministre, les questions posées à l’administration fiscale suisse se fondaient sur les informations dont nous disposions à cette date. De ce fait, elles étaient les plus larges possible.
Dans leur objet d’abord : la DGFiP a interrogé les autorités suisses sur l’existence, la clôture et le transfert éventuels d’un compte dont Jérôme Cahuzac aurait été soit titulaire, soit ayant droit économique, ce qui incluait, le cas échéant, l’intervention d’intermédiaires.
Dans l’espace ensuite : la demande portait également, de façon explicite, sur l’éventualité d’un transfert du ou des comptes vers un autre pays et, le cas échéant, demandait d’indiquer quel était ce territoire de destination « afin de permettre la mise en œuvre des dispositions d’assistance administrative qui lieraient la France avec ces États ou territoires ». Notre question incluait bien, ab initio, l’éventualité d’un transfert à Singapour ou ailleurs.
Dans le temps enfin, comme l’a reconnu notamment le président de la Commission des finances, M. Gilles Carrez : alors que nous ne pouvions, en droit, demander des informations ne remontant qu’au 1er janvier 2010, nous avons réclamé avec insistance que l’administration suisse aille jusqu’à 2006, date de prescription applicable à la fois, en France, aux deux impôts concernés dans ce dossier, l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune. S’agissant de l’ISF, la date est plutôt 2007, mais nous avons essayé de remonter le plus loin possible.
J’ajoute que l’administration fiscale a considéré qu’il n’était pas possible d’interroger la Suisse sur toutes ses banques, contrairement à ce que l’on a pu affirmer. Dans le cadre de notre convention avec ce pays, un protocole précise que toutes les informations de nature à identifier avec certitude la banque concernée doivent être transmises. Une question ouverte aurait très certainement été jugée non pertinente par les autorités suisses, entraînant une réponse soit négative, soit dilatoire. Nous voulions surtout éviter cette situation.
Le porte-parole du secrétariat d’État aux questions financières internationales de la Confédération helvétique a d’ailleurs déclaré, le 12 avril, qu’il est possible de formuler une demande sur plusieurs banques éventuelles mais pas sur toutes, car cela reviendrait à une « pêche aux renseignements » interdite par la convention.
Quant à savoir pourquoi l’administration fiscale n’a pas interrogé les autorités suisses sur l’hypothèse d’un compte chez Reyl et compagnie, la réponse est simple : cette hypothèse n’a commencé à se développer qu’au mois de février, après l’envoi de notre demande d’entraide et après la réponse des autorités suisses le 31 janvier. À la date de la requête, nous n’avions pas d’informations de nature à identifier une banque autre que l’UBS. L’administration fiscale a mentionné celle-ci parce que la convention l’exigeait et parce que c’était le seul établissement dont nous avions connaissance.
Je veux souligner l’exceptionnelle rapidité de la procédure. La réponse, je l’ai dit, nous a été adressée le 31 janvier. La DGFiP aura donc mis seulement sept jours pour l’obtenir, et ce moins de deux mois après la parution de l’article de Mediapart.
Tout au long de cette procédure, nous avons suivi les analyses de nos services, sans jamais chercher à les manipuler. J’en veux pour preuve que je n’ai pas contribué à la rédaction de la demande d’entraide préparée par les services compétents et que je n’ai pas vu physiquement la réponse des autorités suisses, remise dès le lendemain de sa réception à la police judiciaire par la direction générale des finances publiques.
Vous vous posez sans doute des questions sur l’épisode malheureux du Journal du dimanche du 9 février. Je m’en pose moi aussi, d’autant que mon nom a été évoqué ultérieurement comme une des sources possibles de cette information et que l’article cite « l’entourage du ministre de l’économie ». Je tiens à dire devant vous que je n’ai aucune responsabilité dans cette opération. Je n’ai évidemment pas commenté auprès de journalistes un document couvert par le secret fiscal et je partage la colère que le ministre a éprouvée à la lecture de cet article et dont il a fait part à la Commission des finances.
Après le départ de Jérôme Cahuzac le 19 mars, nous avons coopéré rapidement et pleinement avec le Parlement. Des courriers ont été adressés successivement aux présidents des deux Commissions des finances, avec copie aux rapporteurs généraux et, en annexe, toutes les pièces utiles que nous pouvions transmettre. Nous avons également rectifié les affirmations inexactes et les amalgames, notamment dans l’article de Valeurs actuelles dont j’ai fait état.
Pour conclure, je me permettrai de citer les propos de Pierre Moscovici devant la Commission des finances : « L’administration fiscale a fait tout ce qu’elle devait faire, tout ce qu’elle pouvait faire, avec diligence et rigueur. Nous avons à chaque étape trouvé le juste équilibre entre la confiance normale et nécessaire au sein d’une équipe gouvernementale et l’obligation de faire preuve d’un doute par principe, d’un doute méthodique pour contribuer à la recherche de la vérité face aux graves accusations, finalement justes, de Mediapart. À chaque étape, nous avons agi dans le respect des institutions de ce pays et conformément aux principes républicains qui les gouvernent. »
Une procédure judiciaire était engagée et des éléments de nature administrative pouvaient contribuer à la manifestation de la vérité. Ma conviction est que le ministre de l’économie a fait ce qu’il devait faire dans ce cadre.
Nous avons agi avec des moyens juridiques imparfaits. Tout le débat ultérieur sur l’échange automatique d’informations pour lutter contre la fraude fiscale, nous l’avons en quelque sorte expérimenté avec la procédure engagée au mois de janvier, qui est très délicate et complexe à manier si l’on veut obtenir une réponse. Fort heureusement, l’autorité judiciaire dispose de moyens tout autres.
Enfin, l’information que nous avons vérifiée était pour partie inexacte, ce qui explique la réponse que nous avons obtenue à l’issue de cette procédure.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Maïa, madame Grenet, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que nous passions aux questions ?
M. Jean Maïa, conseiller juridique au cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances. Non.
Mme Irène Grenet, conseillère en charge de la politique fiscale au cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je souhaite revenir sur la période s’écoulant entre le 14 décembre, date de la demande faite à Jérôme Cahuzac sur l’éventuelle détention d’un compte à l’étranger, et le 31 janvier, date de la réponse des autorités suisses. Vous dites n’être pas au courant, à l’époque, de la demande du 14 décembre, et n’en avoir pris connaissance que début avril. S’agit-il d’un formulaire type ? Quelle est la valeur juridique de ce document ? Quel est le fondement juridique du délai de trente jours accordé, si l’on en croit la presse, pour répondre ? Que se passe-t-il en cas de non-réponse de l’intéressé ?
D’après vos propos, le ministre est intervenu au moment de la demande d’entraide fiscale. Donc vous nous confirmez qu’au moment où il fait cette démarche, il n’est pas informé de la demande adressée à Jérôme Cahuzac pour savoir s’il avait évebtuellement un compte à l’étranger. Quoi qu’il en soit, comment la demande d’entraide fiscale a-t-elle été préparée ? Si je comprends bien, elle n’a pas été évoquée au moment de la remise à Jérôme Cahuzac de la demande relative à la détention éventuelle d’un compte à l’étranger. Pourriez-vous nous éclairer sur cette séquence ?
M. le président Charles de Courson. Vous affirmez avoir traité seul de ce dossier. Est-ce à dire que vous n’avez jamais parlé de cette affaire aux deux conseillers qui vous accompagnent aujourd’hui ?
M. Alain Claeys, rapporteur. J’y insiste : quelle est la valeur juridique de cette demande et que se passe-t-il en cas de non-réponse. Confirmez-vous que le ministre n’est pas informé de la demande et de la non-réponse de Jérôme Cahuzac lorsqu’il décide de recourir à l’entraide fiscale ?
M. Rémy Rioux. La demande qui a été faite est une demande tout à fait normale dans les procédures de l’administration fiscale : le formulaire 754-SD est adressé dès qu’une information est susceptible de révéler une situation anormale pour un contribuable. Le directeur général des finances publiques vous expliquera plus en détail les modalités de mise en œuvre de la procédure.
Je confirme que je n’étais pas informé de cette demande – et je ne suis pas certain que j’avais à l’être, d’ailleurs, car il s’agit, je le répète, de la procédure normale et je n’ai pas connaissance, dans ce cas de figure, des éléments – déclarations d’impôt, etc. – du dossier fiscal du contribuable.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle procédure l’administration suit-elle lorsque celui-ci n’apporte pas de réponse ?
M. Rémy Rioux. Il est bien précisé dans le formulaire que cette demande ne revêt pas de caractère contraignant. Je ne crois pas que l’absence de réponse soit sanctionnée en tant que telle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque l’on a constaté, au bout d’un mois, qu’il n’y avait pas de réponse de Jérôme Cahuzac, on n’en a pas informé le ministre ?
M. Rémy Rioux. Non. Le formulaire prévoit explicitement le délai de trente jours. Mais au moment de l’expiration de ce délai, on est déjà passé à l’étape ultérieure : la question décisive posée aux autorités suisses.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez donc que vous n’êtes pas informé de la non-réponse de Jérôme Cahuzac ?
M. Rémy Rioux. Je le confirme. Il ne faut pas accorder une importance excessive à cette procédure qui est la procédure normale. La réponse avait été donnée à plusieurs reprises par Jérôme Cahuzac, de façon éclatante et manifeste devant votre Assemblée mais aussi au ministre de l’économie et des finances. À la mi-janvier, on a mis en œuvre la demande auprès des autorités suisses.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qui a eu connaissance de leur réponse et qui a pris l’initiative de la transmettre à la justice ?
M. Rémy Rioux. C’est une réponse d’administration fiscale à administration fiscale, dont M. Bruno Bézard a été par conséquent le destinataire. Il en a informé le ministre. Il est le seul détenteur de ce document, dont il a transmis une copie à la police judiciaire dès le lendemain matin.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les conseils de Jérôme Cahuzac ont été informés de la procédure. L’ont-ils été de la réponse des autorités suisses ?
M. Rémy Rioux. Par le cabinet du ministre ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Non, par les autorités suisses.
M. Rémy Rioux. Cela, je l’ignore. Mais nous avions accepté que l’administration fiscale suisse prévienne le contribuable de la démarche engagée par les autorités françaises. Il y a souvent, en la matière, des éléments qui retardent ou empêchent l’échange d’informations entre la Suisse et la France, le droit interne suisse prévoyant l’obligation, pour l’administration fiscale de ce pays, de prévenir le contribuable.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jérôme Cahuzac a donc été informé de la démarche française. L’a-t-il été des réponses apportées par la Suisse ?
M. Rémy Rioux. Je l’ignore. Il faudra que vous interrogiez l’administration fiscale suisse.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous été informé ?
M. Rémy Rioux. Le ministre a été informé et Bruno Bézard m’a dit le sens de la réponse. Mais je n’ai pas vu le document.
M. le président Charles de Courson. Et le ministre ?
M. Rémy Rioux. Sur un écran, je crois, mais il ne l’a pas eu physiquement entre ses mains. Comme il se doit pour les procédures administratives, le document est toujours resté dans les services.
M. le président Charles de Courson. Vos deux collaborateurs le connaissaient-ils ?
M. Jean Maïa. Non. Je n’ai pas été associé à la gestion de cette procédure. Du fait de l’organisation rappelée par Rémy Rioux au début de l’audition, nous n’avons pas à connaître des dossiers fiscaux individuels.
Mme Irène Grenet. Ma réponse est la même, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Le directeur du cabinet ne vous en a pas informé ?
Mme Irène Grenet. Absolument pas. Je n’ai été associé à aucun moment, ni de près ni de loin, au traitement du dossier de M. Cahuzac.
M. Rémy Rioux. J’étais en relation directe avec le directeur général des finances publiques, M. Bruno Bézard. Cela n’a rien d’anormal dans le fonctionnement du ministère.
M. le président Charles de Courson. Vous n’en avez jamais parlé à la presse ? À aucun journaliste ? À personne ? Vous êtes formel ?
M. Rémy Rioux. À personne. Je suis formel.
M. le président Charles de Courson. Vous dites que vous n’étiez pas au courant de la demande faite à Jérôme Cahuzac de remplir un imprimé attestant qu’il n’avait pas de compte en Suisse. Mais n’avez-vous pas demandé à vos collaborateurs ici présents, dont c’est la spécialité, s’il existait une telle procédure ? Et vous, monsieur Maïa et madame Grenet, la connaissiez-vous ?
M. Jean Maïa. Je confesse que je ne la connaissais pas.
Mme Irène Grenet. Je ne la connaissais pas non plus.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez donc pas informé votre directeur et votre ministre qu’elle était susceptible d’être mise en place…
M. Alain Claeys, rapporteur. Étiez-vous informé, monsieur Rioux, des questions posées à Jérôme Cahuzac par la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et de Paris à propos de sa déclaration de patrimoine faite au titre de l’impôt sur la fortune ?
Par ailleurs, l’AFP a publié dans la soirée du 22 décembre 2012 un communiqué de la direction générale des finances publiques indiquant qu’aucun contrôle ou enquête n’était en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement, tout en mentionnant l’examen de la situation fiscale desdits membres. En étiez-vous informé ? Savez-vous qui a pris l’initiative de ce communiqué ?
M. Rémy Rioux. À ma connaissance, il s’agit plutôt d’éléments de langage par lesquels la direction générale des finances publiques expliquait la procédure en cours. Comme l’a expliqué Mme Amélie Verdier la semaine dernière, cette procédure ne consiste pas en un contrôle ou une enquête sur les ministres, mais en une « vérification de bureau », un examen du dossier fiscal par les services locaux de la DGFiP portant, pour l’essentiel, sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt de solidarité sur la fortune. La presse ayant parlé de « contrôle » des dossiers des ministres, la direction générale des finances publiques a souhaité apporter cette précision en transmettant des éléments de langage à l’AFP.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour justifier son intervention auprès des autorités suisses, le ministre a fait état des rumeurs qui couraient au sujet de Jérôme Cahuzac mais aussi de l’absence de réponse à la demande faite le 14 décembre.
M. Rémy Rioux. Le fait que l’administration fiscale ait fait cette demande et qu’elle n’ait pas reçu de réponse au milieu du mois de janvier était certainement un élément d’appréciation qui a conduit à rechercher la vérité par les moyens dont nous disposions, à savoir la mobilisation de la convention passée avec la Suisse.
M. le président Charles de Courson. Le directeur général des finances publiques ne vous a pas averti, dites-vous, que le ministre délégué n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
M. Rémy Rioux. Il ne m’en a pas informé. En revanche, nous avons discuté dans le courant du mois de janvier de cette requête, qui était le moyen d’établir la vérité.
M. le président Charles de Courson. Ne vous a-t-il pas, précisément, proposé cette solution en raison de l’absence de réponse du ministre délégué à l’administration ?
M. Rémy Rioux. Non. C’est un élément qui intervient probablement dans l’instruction de la demande adressée aux autorités suisses, de même que la lecture attentive de la convention, de son avenant et de l’échange de lettres de 2010. Mais ce n’était pas un élément d’information dont je disposais.
M. le président Charles de Courson. Vous pensez que votre réponse est crédible ?
M. Rémy Rioux. Vous interrogerez le directeur général des finances publiques sur ce point.
M. Hervé Morin. Je comprends mal que le directeur général des finances publiques vous informe du fait que l’on va interroger la Suisse mais ne vous indique pas que cette démarche est consécutive à l’absence de réponse de M. Cahuzac.
Plus généralement, avez-vous été amené à évoquer ces sujets avec des collaborateurs de Matignon et de l’Élysée ?
Avez-vous regardé, de près ou de loin, le contrat passé avec Havas qui concernait tout à la fois la communication de Jérôme Cahuzac et celle de Pierre Moscovici ?
Avez-vous eu des réunions de travail sur le dossier de la vente de l’hippodrome de Compiègne ?
M. Rémy Rioux. Je me suis déjà expliqué sur le premier point.
Par ailleurs, je n’ai pas eu d’échanges sur ce dossier avec des collaborateurs de Matignon et de l’Élysée pendant la période concernée.
Le dossier Havas est sans lien, je l’ai dit, avec l’affaire qui nous réunit. Je l’ai suivi de près. Le ministère dispose d’un contrat cadre datant de 2010, renouvelé en 2013, et permettant de faire appel à différentes sociétés de conseil en communication. C’est dans ce cadre qu’il a passé un appel d’offres en 2012 et a finalement accordé le contrat à Havas Worldwide pour des prestations de conseil en stratégie de communication pour Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac. Le besoin s’en était fait ressentir au cours de la préparation de la loi de finances et des différents textes portés par le ministre et son ministre délégué. Si votre commission le souhaite, je lui communiquerai les pièces de ce dossier.
M. le président Charles de Courson. Mme Amélie Verdier nous a dit qu’elle le ferait. Nous disposerons du contrat et de toutes les pièces comptables des paiements auxquels il a donné lieu.
M. Rémy Rioux. Il s’agit d’un marché de prestation. Chaque mois fait l’objet d’un paiement en fonction des services fournis.
M. le président Charles de Courson. Nous vous avons adressé un courrier à ce sujet.
M. Rémy Rioux. Nous y répondrons très précisément.
M. Hervé Morin. Et s’agissant de la vente de l’hippodrome de Compiègne ?
M. Rémy Rioux. Les sujets relatifs aux domaines publics étaient clairement dans la délégation du ministre délégué chargé du budget. En raison du fonctionnement que j’ai exposé, j’ai été informé, mais le dossier a été géré par le ministre délégué et son cabinet.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le point central est la date à laquelle le ministre demande le déclenchement de l’entraide franco-suisse et la nature de cette demande. On pourrait énoncer ainsi les critères que la commission d’enquête est train de se fixer : premièrement, le Gouvernement a-t-il réagi à la bonne date, c’est-à-dire assez tôt ? Deuxièmement, a-t-il réagi de la bonne manière, compte tenu des instruments à sa disposition ?
Je souhaiterais, à cet égard, que vous apportiez des éclaircissements complémentaires.
S’agissant de la demande d’entraide, vous avez affirmé que le ministre avait pris cette initiative en raison d’informations « constamment réaffirmées » dans la presse. Cette réitération vous paraît-elle une raison nécessaire et suffisante ? M. Plenel, à qui j’ai posé la question, semble pour sa part penser qu’il faut déclencher les procédures dès qu’une information apparaît dans le débat public. Je crois percevoir une certaine contradiction lorsque vous laissez entendre par ailleurs que le ministre a lancé la demande d’entraide en raison de l’absence de réponse au formulaire. Quel est celui des deux critères qui a déclenché l’initiative ?
Le ministre a utilisé le seul instrument légitimement à sa disposition, la convention franco-suisse : il ne disposait pas d’autres instruments ou d’autres informations qui auraient pu le pousser à agir vis-à-vis de son ministre délégué, par exemple en lui posant un certain nombre de questions. Les services qui envoient le formulaire n’informent pas les cabinets, lesquels ne demandent pas non plus d’informations. Diriez-vous que cette étanchéité est propre à Bercy et qu’elle est traditionnelle ? On peut en effet en être surpris, mais pas outre mesure pour ceux d’entre nous qui ont déjà eu affaire à Bercy.
M. Rémy Rioux. En parlant d’informations « constamment réaffirmées » par la presse, je parlais de l’information apportée par Mediapart et je voulais répondre au sujet de la banque Reyl, sur lequel je me suis également expliqué. Le 10 février, c’est-à-dire le lendemain de la parution de l’article du Journal du dimanche, un communiqué de Mediapart réaffirme encore que Jérôme Cahuzac détenait un compte à l’UBS et l’avait transféré lors d’un déplacement en 2010. C’est cette affirmation, qui revenait sans cesse sur la place publique, que nous avons cherché à confirmer ou à infirmer par notre requête.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Les critères sont donc bien la réaffirmation et la constance dans le contenu ?
M. Rémy Rioux. Absolument. Il fallait aussi, compte tenu des contraintes juridiques de la procédure d’entraide, que nous posions une question précise.
Du fait de la répétition des articles de Mediapart tout au long de décembre – avec un récapitulatif à la fin du mois –,ces éléments étaient versés au débat public. La presse s’était également fait l’écho de démarches ou de tentatives de démarche de Jérôme Cahuzac et de ses avocats pour obtenir eux-mêmes des réponses des autorités suisses. Le doute persistait donc dans le débat public, et peut-être dans l’esprit de l’administration fiscale en raison de la procédure en cours. C’est dans ce climat que, dans le courant de janvier, il est apparu que le débat durait depuis trop longtemps et qu’il était nécessaire d’obtenir une réponse. L’administration fiscale et le ministre lui-même ont déployé tous les efforts et pris toutes les précautions nécessaires pour que la démarche soit couronnée de succès – ce qui a été le cas, mais dans la limite de la question que nous avions posée et qui reprenait l’information fournie par Mediapart.
Le sujet des dossiers fiscaux à Bercy est toujours très délicat. Les informations sur des situations fiscales individuelles de contribuables sont couvertes par le secret professionnel et ne circulent pas de façon large dans les cabinets. Nous mettons le plus grand soin à éviter tout risque de divulgation. Le ministère des finances a toujours eu des procédures spécifiques – naguère une cellule au cabinet, aujourd’hui un lien organisé avec la direction générale des finances publiques – pour éviter que des situations fiscales individuelles soient connues d’un trop grand nombre de personnes.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez pas répondu à une des questions du rapporteur : que saviez-vous, le 4 décembre, de la situation fiscale de Jérôme Cahuzac après l’examen auquel la situation de chaque ministre est soumise après la nomination d’un gouvernement ? Vous aviez certainement des informations, au moins celles qui sont parues dans la presse. Notre commission entendra bientôt, du reste, les responsables de cet examen.
D’autre part, il est inexact d’affirmer que l’administration a saisi les autorités suisses du seul cas de l’UBS parce qu’il n’y avait pas d’informations concernant la banque Reyl dans la presse. Je tiens à votre disposition les articles en question – dont certains dans la presse suisse –, qui évoquent le deuxième établissement dès le 11 décembre.
Enfin, vous ne répondez pas au sujet de Singapour. Pourquoi n’avez-vous pas suggéré au ministre et au directeur général des finances publiques de saisir aussi ce pays, avec lequel la France a également une convention ?
M. Rémy Rioux. S’agissant de la banque Reyl, il faut reprendre, comme je l’ai fait, l’ensemble des articles mentionnant M. Reyl. À ma connaissance, il n’a jamais été fait précisément mention de la possibilité de la détention d’un compte par Jérôme Cahuzac dans cet établissement. M. Reyl a été cité comme un intermédiaire potentiel dans l’ouverture d’un compte à l’UBS, sa banque ne l’a jamais été comme l’établissement financier dans lequel Jérôme Cahuzac aurait pu avoir un compte. Nous n’avions pas cette information, donc nous ne pouvions pas poser la question aux autorités suisses. Celles-ci l’auraient jugée non pertinente – puisqu’elle n’apparaissait pas dans le débat public – et n’y aurait pas répondu.
L’hypothèse en question apparaît dans un article de M. Antoine Peillon le 1er février, donc après la réponse des autorités suisse. Mais, dans les annexes de cet article qui retracent les démarches effectuées par M. Peillon auprès des différents intermédiaires pour vérifier l’information de Mediapart, on trouve la question que le journaliste avait posée au groupe Reyl : « Pouvez-vous me confirmer que Jérôme Cahuzac, actuel ministre du budget en France, a été l’ayant droit économique bénéficiaire d’un compte ouvert à l’UBS par vos services ? » Il est donc toujours question d’un compte à l’UBS !
Quoi qu’il en soit, notre question sur les ayants droit économiques pouvait permettre aux autorités suisses de répondre sur d’éventuels intermédiaires ou prête-noms.
M. le président Charles de Courson. Et Singapour ?
M. Rémy Rioux. Je vous ai répondu : nous avons demandé aux autorités suisses si le compte avait été transféré dans un autre État entre 2006 et 2012, de manière à mettre en œuvre nos procédures d’entraide administrative avec Singapour en cas de confirmation de cette information.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi n’avez-vous pas saisi ce pays directement ?
M. Rémy Rioux. On entre alors dans un autre débat, que votre commission a commencé à poser la semaine dernière, sur la frontière entre enquête administrative et enquête judiciaire. Dès lors qu’une enquête judiciaire est engagée – ce qui est le cas à partir du 8 janvier 2013 –, jusqu’où le ministre de l’économie et des finances et l’administration fiscale sont-ils légitimes pour développer leur propre enquête ?
M. le président Charles de Courson. Vous l’avez fait pour la Suisse.
M. Rémy Rioux. Nous avons estimé que la réponse des autorités suisses, immédiatement transmise à l’autorité judiciaire, était suffisamment claire pour que nous n’ayons pas à ajouter des actes de procédure et nous engager dans une autre voie. La requête auprès de Singapour était techniquement possible mais elle ne nous a pas paru opportune compte tenu de la clarté de la réponse suisse.
M. Dominique Baert. Comme le président, je souhaiterais savoir ce qui est remonté à votre niveau lors de l’examen de la situation fiscale des membres du nouveau gouvernement.
Dans les auditions précédentes, on a fait état de deux alertes de l’administration fiscale concernant Jérôme Cahuzac, en 2001 et en 2008. Au moment où vous prenez connaissance de la situation fiscale des nouveaux ministres, confirmez-vous que vous n’avez été informé en aucune manière de ces alertes par votre administration ?
M. Rémy Rioux. Comme l’a dit Mme Amélie Verdier, nous avons reçu le 6 juin 2012 une note du directeur général des finances publiques de l’époque, M. Philippe Parini, qui expliquait la tradition ancienne et républicaine voulant que l’on soumette la situation fiscale des ministres à une vérification de bureau, de manière à repérer, le cas échéant, des écarts, des oublis de déclaration, des problèmes de valorisation, et à permettre aux intéressés de déposer des déclarations rectificatives pour ne pas être attaqués sur ce plan. Cette note, adressée aux deux ministres, les informe de la mise en œuvre – sauf instruction contraire – de la procédure. Le sujet faisant partie de sa délégation, c’est au ministre chargé du budget qu’il a été rendu compte de l’état de la procédure.
M. le président Charles de Courson. On ne peut pas être juge et partie. Y a-t-il eu des remontées concernant le ministre du budget, dont vous auriez forcément eu connaissance puisque tout passait par vous ? Si tel a été le cas, M. Moscovici aurait dû être informé.
M. Rémy Rioux. Après la mise en place de la « muraille de Chine » début décembre, j’ai eu en effet à connaître des informations relatives au dossier fiscal de Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Rien avant le mois de décembre ?
M. Rémy Rioux. Non.
M. le président Charles de Courson. Vous nous avez expliqué que tout transitait par votre cabinet avant d’être transmis au cabinet du ministre délégué. Comment se fait-il, dès lors, que ces informations n’aient pas remonté vers vous avant le début de l’affaire ?
M. Rémy Rioux. Elles n’ont pas fait l’objet de notes dont j’aurais eu connaissance.
M. le président Charles de Courson. Qui en a eu connaissance ?
M. Rémy Rioux. Le directeur général des finances publiques, qui était en charge de ces vérifications de bureau auprès des membres du Gouvernement, et, je pense, le ministre délégué chargé du budget, auquel il a rendu compte.
M. le président Charles de Courson. Je le répète, on ne peut être juge et partie. Cela ne signifie-t-il pas qu’il existe une faille dans le dispositif ?
M. Rémy Rioux. Avant le 4 décembre, on n’a aucune information, ni même aucun doute, sur la situation de Jérôme Cahuzac. Rien ne permet de soupçonner qu’il puisse détenir un compte non déclaré en Suisse.
M. le président Charles de Courson. Mais il y avait peut-être d’autres problèmes.
M. Rémy Rioux. Je ne peux que vous renvoyer à ce que j’ai indiqué dans mon exposé introductif.
M. Dominique Baert. J’en reviens à ma question initiale : au moment où la situation fiscale des membres du Gouvernement est examinée, avez-vous été informé des alertes de 2001 et de 2008 ?
M. Rémy Rioux. Non. Je n’ai eu aucune information avant le 10 décembre.
M. Gérald Darmanin. Avez-vous parlé de cette affaire lors des réunions de cabinet à Bercy ? De même, au cours des réunions de directeurs de cabinet à Matignon, avez-vous eu à évoquer le sujet lors du traditionnel tour de table du directeur de cabinet du Premier ministre, notamment entre décembre et janvier ?
Sauf erreur de ma part, monsieur Maïa, vous étiez conseiller en matière de lutte contre la fraude à la fois pour le cabinet de M. Cahuzac et pour celui de M. Moscovici. Avez-vous eu à viser, dans vos fonctions auprès de M. Moscovici, une lettre ou un document traitant des questions posées aux autorités suisses, dont nous savons que M. Rioux ne les a pas rédigées ? Après la mise en place de la « muraille de Chine », vous êtes-vous mis en retrait du cabinet de M. Cahuzac ?
Si j’ai bien compris vos propos, monsieur Rioux, vous n’avez jamais lu la réponse transmise par la Suisse, vous ne l’avez même jamais eue entre les mains. Pourtant, le Journal du dimanche vous cite nommément parmi les quatre personnes qui ont lu ce document par lequel, selon l’article, « les Suisses blanchissent Cahuzac ». Pourquoi n’avez-vous pas publié un démenti officiel pour éviter de laisser à penser que vous portiez crédit à cette information ?
M. Rémy Rioux. Ma réunion de cabinet a lieu le mercredi, pendant le Conseil des ministres. Elle rassemble les membres du cabinet de Pierre Moscovici mais y assistent également les directeurs de cabinet des ministres délégués, ainsi que les directeurs adjoints du cabinet du ministre chargé du budget. Compte tenu de l’extrême sensibilité du dossier et de la mise en place de la « muraille de Chine », nous n’en avons jamais débattu au cours de ces réunions et je n’ai jamais divulgué la moindre information dans ce cadre.
A fortiori, je n’en ai jamais parlé lors de la réunion des directeurs de cabinet de l’ensemble des ministres, qui a lieu à Matignon le lundi à 15 heures.
M. le président Charles de Courson. Le directeur de cabinet du Premier ministre ne vous a jamais pris à part pour vous demander ce qui se passait ?
M. Rémy Rioux. Non.
M. Jean Maïa. Je confirme que je n’ai pas été consulté sur l’interrogation des autorités suisses. Aux termes de la circulaire « Baroin », du reste, les conseillers n’ont pas à connaître des dossiers fiscaux individuels.
Par ailleurs, la lutte contre la fraude entre en effet dans mes attributions et j’ai continué à travailler sur le sujet pour les deux ministres dans la période concernée. Le ministre délégué ne s’était pas déporté du traitement de l’ensemble de ces questions. En décembre encore, il présentait au Parlement le « paquet antifraude » de la dernière loi de finances rectificative pour 2012. Nous avons également préparé la tenue du comité national de lutte contre la fraude, présidé le 11 février par le Premier ministre.
M. Rémy Rioux. Il est assez rare que les directeurs de cabinet fassent des démentis. L’article du Journal du dimanche du 9 février ne mentionne d’ailleurs que l’« entourage » du ministre de l’économie. C’est un article ultérieur de l’hebdomadaire qui me désigne nommément comme une des quatre sources potentielles. Je le démens, évidemment, avec la plus grande force. Mais, je vous le concède, je n’ai pas publié de communiqué de démenti au moment de la parution.
M. Daniel Fasquelle. Nous cherchons à établir s’il y a eu les bonnes réactions au bon moment. Je suis assez surpris par vos propos. Les auditions que nous avons déjà menées font clairement apparaître que Mediapart avait révélé l’existence d’Hervé Dreyfus et de la banque Reyl. Le 12 décembre, le journal Le Temps publiait un article intitulé « Les liaisons genevoises de Jérôme Cahuzac ». Le 15 décembre, M. Gonelle prenait contact avec l’Élysée. Et Edwy Plenel estime qu’au 21 décembre, les pouvoirs publics connaissaient en détail l’affaire Cahuzac, y compris le rôle d’Hervé Dreyfus et de la banque Reyl. Finalement, tout le monde était au courant, sauf le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances ! C’est d’autant plus surprenant qu’Edwy Plenel nous a indiqué que les cabinets du Premier ministre et du Président de la République l’avaient approché le 26 décembre sur cette affaire. Pouvez-vous sérieusement affirmer que, pendant ce temps, vous n’aviez pas d’indices ou de doutes ?
Vous avez laissé l’administration fiscale agir, dites-vous. Mais est-il normal, dans un tel dossier et compte tenu des informations que vous aviez, de laisser se dérouler une enquête dont Edwy Plenel a dit qu’elle était en réalité biaisée ? On savait très bien que les questions posées conduiraient à blanchir Jérôme Cahuzac, et cela a failli fonctionner : l’article du Journal du dimanche concluait à l’absence de compte en Suisse.
Il était également possible, a dit M. Plenel, de demander à Jérôme Cahuzac d’interroger lui-même la partie suisse, de manière à obtenir une réponse qui aurait mis un terme à l’affaire dès le mois de décembre. Pourquoi ne pas l’avoir fait ?
N’est-il pas surprenant, enfin, que Jérôme Cahuzac signe lui-même l’instruction relative à la « muraille de Chine » ? N’appartenait-il pas à Pierre Moscovici de le faire ?
M. Rémy Rioux. Je maintiens que nous avons eu les bonnes réactions dans le bon calendrier. Nous avons obtenu la réponse des autorités suisses dans un délai très rapide : deux mois à peine après l’article initial de Mediapart et une semaine après la formulation de la demande. Dès lors que Jérôme Cahuzac affirmait et réaffirmait qu’il n’avait pas de compte en Suisse – le ministre lui-même indique qu’il lui a posé la question à de très nombreuses reprises –, la seule façon d’en avoir infirmation ou confirmation était bien cet acte auprès des autorités suisses.
L’administration fiscale a eu elle aussi les bonnes réactions, puisqu’elle a versé ses différents actes au dossier.
On peut toujours, a posteriori, affirmer que l’on aurait pu faire autrement et plus rapidement. Je ne le crois pas. À la fin du mois de décembre, je le répète, nous n’avions absolument pas l’information que Jérôme Cahuzac détenait un compte en Suisse. Croyez à ma bonne foi !
Quant à la « muraille de Chine », je ne vois pas où est le débat. Un mécanisme de déport est organisé pour des raisons déontologiques et le ministre délégué chargé du budget, qui a autorité hiérarchique sur l’administration fiscale et sur son cabinet, en donne lui-même l’instruction. Il en a été de même dans les précédents que les services ont conservés concernant des cas de ce genre. Il ne s’agit pas de retirer une compétence au ministère de l’économie et des finances, ce qui supposerait un décret signé du Premier ministre. Mais la « muraille de Chine », je peux en témoigner, a été effective à la date de la signature, et même dans les jours qui l’ont précédée.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous discuté avec votre homologue, la directrice de cabinet de M. Cahuzac, ou les ministres ont-ils discuté entre eux de cette instruction signée du seul Jérôme Cahuzac ?
M. Rémy Rioux. J’ai bien sûr le souvenir d’en avoir parlé avec Amélie Verdier. Ces mesures me paraissaient une évidence. Il fallait les prendre le plus rapidement possible. J’en ai ensuite tenu informé le ministre, qui, de la même façon, a considéré qu’il était évident de procéder au déport du ministre du budget.
M. le président Charles de Courson. M. Cahuzac était ministre délégué. Il est curieux que le ministre dont il dépend ne prenne pas lui-même la décision.
M. Rémy Rioux. C’était Jérôme Cahuzac qui était mis en cause. Il a de lui-même signé un document…
M. le président Charles de Courson. Cela ne vous choque pas ?
M. Rémy Rioux. Non. Ce qui m’aurait choqué, c’est que nous ne le fassions pas ou que nous mettions quinze jours à mettre en place les procédures. On a pris un acte extrêmement rapide…
M. le président Charles de Courson. « On », c’est en l’occurrence Jérôme Cahuzac, pas votre ministre. Pourquoi ?
M. Rémy Rioux. Le ministère des finances s’est mis en position de ne pas être en conflit d’intérêts sur les dossiers ayant trait, de près ou de loin, à la situation de Jérôme Cahuzac.
S’agissant de la banque Reyl, je vous invite à relire plume à la main, comme je l’ai fait, l’ensemble des articles qui mentionnent Dominique Reyl. Nous n’avions pas la matière pour interroger les autorités suisses sur un éventuel compte de Jérôme Cahuzac à la banque Reyl. Pour couvrir la question des intermédiaires, nous avons indiqué dans la demande que Jérôme Cahuzac pouvait être l’ayant droit économique du compte, ce qui voulait bien dire qu’il n’en était pas nécessairement le titulaire. C’est ainsi que nous avons couvert cette hypothèse. Mais cet élément n’était pas présent dans le débat public de manière extrêmement forte à ce moment-là.
M. le président Charles de Courson. Vos conseillers juridiques et fiscaux ici présents vous ont-ils mis en garde sur le fait que cette lettre risquait de n’avoir d’autre réponse que négative ? Dans les mécanismes de fraude, c’est le compte maître et non pas le sous-compte qui apparaît lorsque l’on interroge la banque, ou bien un compte détenu par une fondation domiciliée au Liechtenstein.
Monsieur Maïa, madame Grenet, connaissez-vous ces mécanismes ?
M. Jean Maïa. Je ne prétendrai pas les connaître parfaitement…
M. le président Charles de Courson. C’est pourtant votre métier.
M. Jean Maïa. Mon métier est de conseiller les ministres dans l’élaboration de la politique de lutte contre la fraude.
S’agissant du dossier de M. Cahuzac, je n’étais pas associé à la procédure, si bien que je n’ai pas alerté le directeur de cabinet en quoi que ce soit.
M. le président Charles de Courson. Le directeur ne vous a pas consulté sur les chances d’obtenir une réponse positive de la Confédération helvétique après l’avoir saisie en application de la convention ?
M. Jean Maïa. Cette question ne m’a pas été posée.
M. le président Charles de Courson. Qu’auriez-vous répondu si elle l’avait été ?
M. Jean Maïa. Il aurait fallu que j’approfondisse le sujet car je n’avais pas nécessairement la réponse immédiatement à l’esprit.
M. le président Charles de Courson. Alors que vous êtes spécialiste de la fraude !
Qu’en est-il pour vous, madame la conseillère fiscale ?
Mme Irène Grenet. La question tient à l’organisation même du cabinet. Comme on l’a indiqué, nous ne traitons pas des affaires particulières. En l’occurrence, une demande d’entraide administrative est une affaire particulière, ce qui explique que je n’aie même pas été informée qu’une telle demande était en cours. Les seules informations que j’ai eues étaient celles de la presse.
M. le président Charles de Courson. Et vous, monsieur le directeur, connaissez-vous un peu les mécanismes de fraude fiscale ?
M. Rémy Rioux. Je ne sais pas très bien quelle conception vous vous faites du fonctionnement du ministère, monsieur le président, et des relations entre le cabinet du ministre et les directions générales. L’expertise, la responsabilité, l’analyse des précédents dans nos échanges avec la Suisse, la façon de poser les questions, la connaissance précise des mécanismes de fraude fiscale se trouve essentiellement dans les services de la DGFiP en charge de ces missions. Le premier conseiller du ministre sur de tels sujets – et c’est d’ailleurs ce qui s’est passé –, c’est le directeur général des finances publiques.
M. le président Charles de Courson. À quoi servent les cabinets, alors ? Vous avez deux spécialistes auprès de vous et vous ne les interrogez pas. Ne trouvez-vous pas cela étonnant ?
M. Rémy Rioux. Je le redis, il s’agissait d’un dossier individuel.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous savez certainement que l’administration gère les précédents, monsieur le président !
M. le président Charles de Courson. Qu’il s’agisse d’un dossier individuel n’est pas la question. Avant de prendre une décision, on s’entoure de précautions, on interroge, etc.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ces questions trouveront naturellement leur place tout à l’heure, lorsque nous auditionnerons le directeur général des finances publiques.
M. Jean-Marc Germain. Mes questions concernent les règles applicables par l’administration quand la justice est saisie. Vous avez parlé de l’« équilibre » à trouver en la matière.
Quelles sont ces règles ? Avez-vous eu l’occasion d’éclairer le ministre – puisque, si j’ai bien compris, vous étiez son seul conseiller vis-à-vis de l’administration fiscale – sur l’opportunité de recourir à la demande d’entraide alors qu’une procédure judiciaire était en cours depuis le 8 janvier.
Il apparaît aussi que l’administration fiscale a respecté l’instruction donnée dès la mise en place du Gouvernement pour ce qui est des dossiers individuels. Le directeur général des finances publiques a utilisé les moyens de l’État pour rechercher des informations sans qu’il y ait, de votre part, des instructions en continu. J’aimerais avoir plus de précisions sur ce point.
A-t-on mis un terme à la « muraille de Chine » le 19 mars, date de la démission du ministre délégué ? La directrice de cabinet de M. Cazeneuve a-t-elle repris le dossier en main ? Continuerez-vous d’être informé ?
Avez-vous eu connaissance du dossier fiscal de M. Cahuzac une fois la « muraille de Chine » en place ? Y avait-il trace, dans ce dossier, d’une procédure dont on a fait état, à savoir la saisine de la direction régionale de Bordeaux sur l’information contenue dans l’enregistrement de M. Gonelle ?
Ce que je crois comprendre, finalement, c’est que M. Cahuzac a été ayant droit de Reyl qui avait un compte à l’UBS – puisque Reyl n’est devenu une banque qu’à partir de 2010. Vous avez interrogé les Suisses sur la période 2006-2013. Comment se fait-il qu’ils ne vous aient pas dit que, de 2006 à 2009, M. Cahuzac était ayant droit d’un compte de Reyl hébergé à l’UBS ? La question que vous aviez posée aurait dû induire cette réponse.
M. le président Charles de Courson. Commençons par la dernière question, qui est la plus importante.
M. Rémy Rioux. Je ne sais pas où en est l’instruction du dossier. Ce que je suppose, c’est que le compte n’était plus à l’UBS en 2006. Il avait déjà été transféré ailleurs. La réponse des autorités suisses est alors exacte.
M. le président Charles de Courson. Il semblerait que le transfert soit intervenu en 2009. Mais nous nous posons tous la même question: comment se fait-il que les autorités suisses répondent négativement et que, deux mois plus tard, Jérôme Cahuzac avoue qu’il avait bien un compte ? Quel mécanisme a joué ? Celui des « comptes maîtres » divisés en sous-comptes ? Celui de la détention du compte par le biais d’une fondation ? Les spécialistes de la fraude décrivent ces procédés. C’est bien pourquoi certains affirment dès l’envoi de la lettre que la réponse ne pourra être que négative.
M. Rémy Rioux. Je pense que l’instruction en cours établira ces éléments. Je vous ai fait part de ma propre conclusion, compte tenu des informations qui nous sont parvenues.
M. le président Charles de Courson. Mais comment expliquez-vous l’écart entre la réponse et la réalité,
M. Rémy Rioux. Pour ma part, je comprends que Jérôme Cahuzac n’avait plus de compte aux dates indiquées par les autorités suisses.
M. le président Charles de Courson. D’après ce qu’on lit dans la presse, il semble que ce ne soit pas l’explication.
M. Rémy Rioux. Ce débat nous renvoie à la question de l’équilibre entre procédure administrative et enquête judiciaire. Aucune règle n’interdit de prendre des actes administratifs dès lors qu’une procédure est confiée à la police judiciaire. Dans de nombreux cas, les mêmes faits ou les mêmes soupçons ont donné lieu concomitamment à différentes procédures. L’autorité administrative peut utiliser certains moyens juridiques dont ne dispose pas le juge, sachant que ce dernier, en revanche, dispose de moyens d’investigation, d’audition et de perquisition autrement puissants que ceux, en l’espèce, de l’administration fiscale.
Lorsqu’il existe une telle concomitance, la prudence est d’informer immédiatement la police judiciaire des résultats des démarches administratives. C’est ce que nous avons fait dès le lendemain de la réception de la réponse. La police judiciaire a fait l’usage qu’elle devait faire de cet élément, ses moyens d’investigation lui permettant d’aller plus loin.
L’autre aspect est la préservation de la confidentialité de ces informations.
J’en viens au sujet de la position du cabinet par rapport à l’administration fiscale. Là encore, c’est une question d’équilibre. J’ai entendu, notamment la semaine dernière, que le ministre et son cabinet avaient « manipulé » l’administration fiscale. Je crois vous avoir montré ce matin que nous l’avons au contraire laissée travailler et développer ses analyses et ses procédures. Il me semble que nous avons trouvé la bonne distance, s’agissant d’un dossier fiscal aussi sensible.
Après la démission de Jérôme Cahuzac le 19 mars, la « muraille de Chine », de fait, n’existe plus. Depuis lors, le ministre, l’administration fiscale et moi-même avons conservé la gestion et le suivi du dossier, compte tenu des attaques qui ont été lancées et des très nombreuses réponses que nous avons dû apporter depuis les aveux de Jérôme Cahuzac le 2 avril.
M. Jean-Marc Germain. La procédure engagée en 2001 figure-t-elle dans le dossier fiscal de M. Cahuzac ?
M. Rémy Rioux. Je n’en ai pas connaissance.
M. le président Charles de Courson. Les notes relatives à l’entretien entre Jérôme Cahuzac et l’inspecteur des impôts Rémy Garnier sont passées entre vos mains mais vous n’y avez pas prêté attention, avez-vous dit.
M. Rémy Rioux. Elles ne mentionnent pas cet élément, comme Mme Verdier vous l’a indiqué la semaine dernière.
M. le président Charles de Courson. Nous avons pour notre part le document de Rémy Garnier, que je tiens à la disposition des membres de la commission d’enquête : il y a presque une page sur le sujet.
M. Jean-Pierre Gorges. D’après Mediapart, est à l’origine du dossier Cahuzac la façon étrange dont celui-ci, à peine nommé, donne un blanc-seing à la procédure qui a permis la vente de l’hippodrome de Compiègne. Cela a attiré l’attention de cet organe de presse qui s’est mis à tirer la pelote. On se demande même s’il ne s’agissait pas là d’un renvoi d’ascenseur entre ministres détenant des informations.
M. Woerth a indiqué qu’il avait eu communication d’une liste de 3 000 noms de personnes qui détenaient des comptes en Suisse. La façon dont il se l’était procurée avait soulevé un débat mais il existe des éléments, à Bercy, qui retracent cette liste.
Lorsque vous êtes arrivé aux commandes, avez-vous pris connaissance de ces éléments ? Pensez-vous que M. Woerth, lorsqu’il a été question de cette liste, était au courant que M. Cahuzac détenait un compte à l’étranger ?
Avez-vous des informations sur la gestion précédente ? Estimez-vous que les ministres du budget précédents pouvaient être au courant ?
Par ailleurs, estimez-vous plausible que l’on ouvre un compte en Suisse pour 600 000 euros et qu’on le garde ainsi pendant vingt ans ? Selon M. Arfi de Mediapart, ce n’est que le début d’une affaire plus complexe qui conduit à s’interroger sur l’origine de cet argent plutôt que sur la procédure. On parle de laboratoires pharmaceutiques. M. Gonelle a affirmé différentes choses concernant 2001. Bref, pour éviter que les commissions d’enquête ne se multiplient, j’aimerais savoir ici quelles procédures vous avez engagées.
M. le président Charles de Courson. Je rappelle que cette question est hors du champ de notre commission d’enquête.
M. Rémy Rioux. Nous sommes en effet dans le champ couvert par le secret de l’instruction.
M. Jean-Pierre Gorges. Vous donnez l’impression que l’on n’enquête qu’à partir du 4 décembre. Mais il est intéressant pour nous de savoir si, au moment de votre installation au ministère, vous prenez connaissance de questions fiscales soulevées en 2008 et en 2009.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je comprends votre démarche, mais je rappelle que notre commission d’enquête a pour objet d’établir d’éventuels dysfonctionnements du Gouvernement ou de l’appareil d’État entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013.
M. Jean-Pierre Gorges. Ce qui se passe avant peut expliquer les agissements au cours de la période concernée.
M. le président Charles de Courson. Vous posez en réalité de nombreuses questions. La première, si je comprends bien, concerne d’éventuels liens entre Éric Woerth et Jérôme Cahuzac.
M. Jean-Pierre Gorges. Ma question est très précise : au moment de l’installation du nouveau Gouvernement, récupère-t-on les éléments des ministères précédents ? La liste des 3 000 noms a défrayé la chronique. Comprend-elle le nom de M. Cahuzac ?
M. le président Charles de Courson. Je rappelle qu’il s’agissait de comptes ouverts à HSBC.
M. Jean-Pierre Gorges. Peu importe.
M. le président Charles de Courson. Êtes-vous au courant de cette fameuse liste dite « Falciani » monsieur le directeur ?
M. Rémy Rioux. Bien sûr. Mais avant le 4 décembre, je le répète, le ministre et son cabinet n’avaient aucune information sur l’éventuelle détention d’un compte en Suisse par Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Permettez-moi de rappeler l’affaire : un informaticien à HSBC a livré le nom de 40 000 détenteurs de compte dans cette banque en Suisse mais il n’a jamais été fait état d’un compte de Jérôme Cahuzac à HSBC.
M. Rémy Rioux. Votre rapporteur général a eu connaissance de cette liste, qui a fait l’objet de procédures de l’administration fiscale.
Permettez-moi de préciser qu’un membre de cabinet, lorsqu’il prend ses fonctions, ne trouve pas une seule feuille de papier dans le bureau où il entre. Les dossiers sont dans les services et ils y sont bien traités, y compris le dossier HSBC.
M. le président Charles de Courson. J’en conclus que la réponse est non.
M. Rémy Rioux. Bien sûr.
S’agissant de l’hippodrome de Compiègne, je suis un peu gêné pour répondre car des instructions sont en cours devant plusieurs juridictions. En avril 2012 est parvenue une demande d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2010 autorisant la cession de l’hippodrome, émanant du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel. Il était prévu que Jérôme Cahuzac, dont la délégation comprenait ce secteur, se prononce, mais on a décidé de désigner un expert pour apporter des éléments objectifs.
M. le président Charles de Courson. Le tribunal administratif de Paris se prononcera très prochainement. Laissons la justice opérer !
Mme Cécile Untermaier. Contrairement à ce que nous avons entendu lors de l’audition de M. Plenel et à ce que nous avons lu dans la presse, la question posée par l’administration à la Suisse est une question ouverte qui permet une réponse.
Pour ma part, je voudrais savoir quel était l’état d’esprit du cabinet à partir du 4 décembre, compte tenu de la pression médiatique. Quel était l’état d’esprit de chacun d’entre vous dans la période qui s’est écoulée depuis la parution de l’article de Mediapart jusqu’à la demande faite par Pierre Moscovici aux autorités suisses ?
M. Rémy Rioux. Je confirme que nous avons posé la question la plus large possible eu égard aux informations dont l’administration fiscale disposait et aux contraintes juridiques fortes qui encadrent notre coopération avec la Suisse en la matière. S’il existait un transfert automatique, nous ne serions pas dans cette situation – d’où les travaux de votre Assemblée et de l’exécutif sur ce point.
Pour qualifier notre état d’esprit, on peut parler de surprise ou de sidération face à ce qu’on hésitait, à l’époque, à qualifier d’information. Aucun élément préalable ne nous permettait d’imaginer que cet article allait sortir. Il nous a fallu par la suite, comme l’a dit le ministre, trouver un équilibre entre la confiance indispensable au travail quotidien d’une équipe ministérielle – nous avons d’ailleurs mené ensemble beaucoup de travaux avec les assemblées – et le « doute méthodique » nécessaire à la manifestation de la vérité.
Mme Irène Grenet. Les conseillers n’ont pas eu connaissance de la demande d’entraide administrative de Pierre Moscovici. Pour nous, donc, la période s’achève à la date des aveux de Jérôme Cahuzac, le 2 avril. M. Rioux a bien décrit notre état d’esprit. Lors d’une réunion exceptionnelle, la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac, tout en nous laissant nous forger notre propre opinion, nous avait demandé de poursuivre notre travail de la manière la plus sereine qui soit. C’est ce que nous avons fait jusqu’au 2 avril.
M. Jean Maïa. Je le confirme. Le travail de cabinet étant, comme l’a écrit Olivier Schrameck, un travail de conscience, un élément important pour moi est que le travail sur la lutte contre la fraude n’a été en rien interrompu durant cette période.
Mme Marie-Christine Dalloz. Êtes-vous, monsieur Rioux, à l’origine du document remis à Jérôme Cahuzac pour préparer sa rencontre avec Rémy Garnier ?
M. le président Charles de Courson. La directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac a indiqué que la note préparée par les services en vue de cet entretien a seulement transité chez M. Rioux.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quoi qu’il en soit, l’administration française a une mémoire dont j’ai souvent constaté l’efficacité. Comment se fait-il, dès lors, qu’il n’y ait rien au sujet de Rémy Garnier, qui a lui-même constitué un dossier sur Jérôme Cahuzac ?
M. Rémy Rioux. Sauf erreur de ma part, l’entretien a eu lieu en octobre, donc avant les révélations. Pour ma part, je n’ai aucune information sur Rémy Garnier – que je ne connais pas. La note de la DGFiP ne contient aucun élément d’alerte.
Mme Marie-Christine Dalloz. Confirmez-vous qu’elle ne contient rien sur les révélations de Rémy Garnier ?
M. Rémy Rioux. Oui. Les documents sont à votre disposition
M. le président Charles de Courson. La directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac nous a transmis le document de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest en date du 11 juin 2008, dans lequel il est fait état de la possibilité de l’existence d’un compte en Suisse. Vous n’avez donc pas eu connaissance de ce document et la note, d’après vos souvenirs, ne reprenait pas ces éléments ?
M. Rémy Rioux. Absolument.
M. Alain Claeys, rapporteur. Étant donné la nature de ce document, où il y a tous les éléments, notre commission d’enquête devrait auditionner M. Rémy Garnier.
Mme Marie-Christine Dalloz. S’agissant maintenant de la « muraille de Chine », vous avez indiqué qu’« il fallait déporter » le ministre délégué chargé du budget. Mais, dans le dispositif adopté, non seulement le ministre délégué se déporte lui-même sans intervention de son ministre de tutelle, mais il déporte, en quelque sorte, son ministre de tutelle puisqu’il vous désigne comme interlocuteur privilégié sur ce dossier. C’est à dessein que je pousse les choses à l’extrême, car la lecture du dernier paragraphe est pour le moins surprenante !
M. Rémy Rioux. Permettez-moi de citer ledit paragraphe : « Tout dossier, s’il nécessite d’être porté à la connaissance du ministre, sera directement soumis au ministre de l’économie et des finances par l’intermédiaire de son directeur de cabinet. » C’est la pratique courante : tous les services envoient leurs notes au directeur de cabinet et celui-ci en informe le ministre.
M. Hervé Morin. L’objet de notre commission est de chercher les éventuelles interactions entre les cabinets ou le pouvoir politique et l’action de l’administration. En somme, vous nous expliquez que vous n’avez rien fait jusqu’au 14 janvier. Alors que l’affaire prend une ampleur considérable et met le Gouvernement en grande difficulté, vous ne prenez quasiment aucune décision, aucun acte directif vis-à-vis de votre administration. N’avez-vous pas le sentiment d’avoir plutôt péché par omission ?
M. Rémy Rioux. Je n’ai pas du tout ce sentiment. La semaine dernière, on nous a accusés d’avoir manipulé l’administration fiscale ; aujourd’hui, on nous accuse d’avoir péché par omission. Compte tenu de ces deux accusations, j’ai la faiblesse de penser que nous étions peut-être sur le bon chemin.
Sous l’autorité du ministre, l’administration fiscale a fait les diligences nécessaires. Et, lorsque nous avons eu besoin d’une intervention pour obtenir une réponse de la part des autorités suisses, le ministre a fait les démarches nécessaires. La réponse – quels que soient ses défauts – est arrivée dans un délai très rapide. Je n’ai donc le sentiment ni d’avoir mal agi, ni d’avoir mal travaillé, ni d’avoir manipulé qui que ce soit, ni d’avoir péché par omission.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie.
Audition du mardi 28 mai 2013
À 10 heures 30 : M. Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, accompagné de MM. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, et Gradzig El Karoui, chef de la mission affaires fiscales et pénales.
M. le président Charles de Courson. Nous commençons une série d’auditions de responsables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en recevant son directeur général, M. Bruno Bézard, qui a souhaité se faire accompagner de M. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal, et de M. Gradzig El Karoui, chef de la mission affaires fiscales et pénales.
Cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Les différentes initiatives prises par le ministère de l’économie et des finances entre la publication du premier article relatif à cette affaire, le 4 décembre 2012, et les aveux de Jérôme Cahuzac, le 2 avril 2013, nous intéressent donc tout particulièrement. Étant donné son champ de compétence, la DGFiP a visiblement joué pendant cette période un rôle important, que votre témoignage nous permettra de mieux comprendre.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de bien vouloir chacun à votre tour lever la main droite et dire « je le jure ».
(M. Bruno Bézard, M. Bastien Llorca et M. Gradzig El Karoui prêtent successivement serment.)
Pourriez-vous nous exposer pour commencer les actions qui ont été les vôtres depuis le 4 décembre 2012 et nous préciser la nature des informations dont vous disposiez ?
M. Bruno Bézard, directeur général des finances publiques. Il est devenu habituel, lors d’une audition, de commencer en affirmant que l’on est heureux d’être là : jamais je ne l’aurai pensé aussi fort qu’aujourd’hui. Nous vivons en effet une époque formidable où il est possible de tout dire sans nul besoin de connaître la matière – bien au contraire ! – et sans aucune limite : ainsi ceux qui n’avaient encore jamais vu de demande d’assistance administrative internationale dissertent-ils sur les plateaux de télévision sur la façon dont elles doivent être rédigées. Ceux qui n’avaient jamais vu auparavant de dossier de contrôle fiscal expliquent avec autorité la façon dont les formulaires doivent être remplis et le sens d’un délai non contraignant. On m’invente des missions secrètes en Suisse. J’ai même appris, il y a quelques jours, que j’avais fait pilonner les 38 millions de documents, signés par les ministres de l’économie et du budget, qui accompagnent habituellement les déclarations de revenus pour expliquer aux contribuables le sens de l’impôt, ce parce qu’ils portaient le nom de M. Jérôme Cahuzac : intéressant lorsqu’on sait que j’ai moi-même fait demander aux ministres de renoncer à cet envoi, en faisant valoir que ces lettres ne sont jamais lues et dans un souci d’économie !
Voilà quelques exemples de ce que l’on peut lire aujourd’hui dans la presse. Pour résumer : ceux qui ne savent pas parlent tandis que ceux qui savent ne peuvent pas parler, liés qu’ils sont par le secret fiscal et par la tradition peut-être excessive de silence de l’administration. Celle-ci perd ainsi toutes les batailles de communication parce qu’elle se refuse à les livrer – étant entravée par le secret professionnel. C’est pourquoi, après avoir refusé toutes les sollicitations médiatiques – fort pressantes depuis quelques semaines –, je suis vraiment heureux de pouvoir m’exprimer dans la seule enceinte qui me paraisse appropriée – devant la représentation nationale – et, non pas d’être délié du secret fiscal dans une audition qui est publique, mais d’avoir, comme les textes le prévoient, la possibilité et même le devoir de répondre aux questions du rapporteur et de lui transmettre des documents.
Cela fait aujourd’hui exactement vingt-cinq ans que je me consacre avec énergie et passion au service de l’État. J’ai choisi cette voie, dont je n’ai jamais dévié, car ce choix est avant tout celui de l’éthique et de la rigueur au service du pays et celui du respect d’une seule boussole, celle de l’éthique et de la déontologie – quelles que soient la situation, les injonctions ou les sollicitations « amicales ». Il m’est donc assez insupportable d’entendre répéter – parfois par incompétence, par mauvaise information ou pour alimenter des jeux politiques – que l’administration dont j’ai pris la responsabilité le 5 août dernier n’aurait pas fait son travail, soit par inertie, soit parce qu’elle était placée sous la responsabilité de M. Cahuzac – pour voler, donc, à son secours –, soit pour toute autre raison. De tels propos sont intolérables à double titre : premièrement, parce que si l’on ne parle guère des 115 000 agents dont je suis responsable, ils sont pourtant les premières victimes de l’affaire Cahuzac. Compte tenu de la culture de loyauté qui est celle de Bercy, ils viennent en effet de subir un choc psychologique majeur et sont aujourd’hui l’objet des invectives de contribuables en difficulté leur opposant le très mauvais exemple du ministre du budget de l’époque, alors en charge de la lutte contre la fraude. Et deuxièmement, parce que ces suggestions, insinuations et affirmations sont totalement contredites par les faits, dès lors que l’on accepte de faire l’effort intellectuel de se replacer dans la situation qui prévalait entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 et de consulter les documents existants.
La vérité est que mon équipe, spécialement M. Gardette que vous allez entendre, et moi-même nous sommes totalement mobilisés sur ce dossier depuis le début avec comme obsession absolue de faire en sorte que l’administration fiscale ne puisse à aucun moment se voir reprocher soit de ne pas avoir effectué son travail, soit de l’avoir effectué de façon non conforme à l’éthique républicaine. Ce point n’a cessé d’être au cœur de notre démarche. Et chaque fois que l’on m’a proposé une action ou que j’en ai moi-même suggéré une, j’ai systématiquement demandé que l’on me confirme sa totale conformité à la pratique suivie pour tout autre contribuable.
En outre, dès le premier jour, j’ai précisément veillé à ce que l’on ne puisse jamais accuser la DGFiP d’avoir été instrumentalisée ou d’avoir participé à une instrumentalisation. J’entends depuis plusieurs semaines que la DGFiP aurait été instrumentalisée par le pouvoir politique. Or j’affirme solennellement et sous serment que jamais cela n’a été le cas : il n’est pas vraiment dans mes habitudes d’accepter d’amicales pressions, voire de me faire instrumentaliser, sans m’en apercevoir. Je crois faire partie de cette école de la fonction publique qui considère que le devoir de loyauté cesse lorsque la légalité ou l’éthique s’interpose. D’autres dossiers d’actualité bien connus illustrent ma capacité à dire non lorsque je l’estime nécessaire – on me fait plutôt le reproche d’une rigidité osseuse excessive, mais je considère qu’un haut fonctionnaire doit disposer d’une colonne vertébrale ! Je mets donc au défi quiconque de démontrer une instrumentalisation de la DGFiP, pour la simple et bonne raison que du 4 décembre 2012 au 2 avril 2013, mais aussi après, je n’ai cessé un seul instant de penser que mon rôle et mon honneur étaient de l’éviter.
J’ai également entendu dire, tantôt que notre demande d’assistance administrative avait été trop tardive, tantôt qu’elle avait été trop précoce, que nous aurions dû la formuler de manière encore plus large, mais en même temps qu’elle n’était pas nécessairement compatible avec l’existence d’une enquête judiciaire, ou encore qu’elle était trop large ou trop restreinte parce qu’elle relevait à l’évidence de la volonté de « sauver le soldat Cahuzac ». J’ai même entendu dire de la part de commentateurs qui ne l’avaient jamais lue qu’elle était mal rédigée, que la question posée était de mauvaise foi ou que nous en connaissions déjà la réponse lorsque nous l’avons posée. La seule chose que je n’ai pas encore entendue – mais cela ne saurait tarder –, c’est que M. Cahuzac lui-même l’aurait rédigée à la place de mes collaborateurs. On nous a même reproché le caractère secret de cette demande d’assistance administrative – comme si le secret fiscal n’existait pas en France.
En réalité, mon équipe et moi-même avons précisément étudié la façon d’utiliser cet outil – imparfait mais néanmoins utile – dans le respect d’un droit conventionnel contraignant et obtenu de couvrir la période temporelle la plus large possible, puisque nous sommes remontés jusqu’au 1er janvier 2006, en nous appuyant sur l’argument de la prescription en France qui n’avait aucune conséquence juridique dans une relation bilatérale. Nous avons également visé les ayants droit économiques de M. Cahuzac : il n’est donc pas de demande d’assistance administrative plus large que celle-là, cela n’existe pas. Et bien que la simple lecture des statistiques montre à quel point le bilan de notre relation administrative avec la Suisse est peu satisfaisant, c’est dans un délai sans précédent, de sept jours, que nous avons obtenu la réponse à notre demande.
De fait, lorsque nous avons étudié la possibilité de requérir l’assistance administrative de la Suisse, la première réaction de nos équipes a été le scepticisme quant à notre capacité d’obtenir une réponse, compte tenu de la pratique de la Suisse et du caractère peu documenté de notre demande – nous ne disposions en effet à l’époque d’aucun autre élément que les allégations de Mediapart. Nous nous sommes néanmoins donné le maximum de chances d’y parvenir, c'est-à-dire obtenir une réponse quelle qu’elle soit : j’ai notamment provoqué un appel du ministre Pierre Moscovici à son homologue suisse, Mme Eveline Widmer-Schlumpf. M. Gardette et moi-même avons également eu deux conversations avec nos homologues – M. Tanner, directeur de l’administration fiscale, et son responsable des relations internationales, M. Alexandre Dumas – afin de les prier de traiter cette demande avec le plus de diligence possible, et de remonter le plus possible dans le temps. Nous avons ainsi obtenu qu’ils remontent au 1er janvier 2006, au lieu du 1er janvier 2010 alors qu’ils n’étaient tenus par aucune obligation juridique.
J’ai reçu cette réponse par courriel le 31 janvier dans l’après-midi et ne l’ai communiquée dès le lendemain matin qu’à une seule personne d’une seule institution : le service de police judiciaire conduisant l’enquête : la division nationale des investigations financières (DNIF). J’en ai en outre immédiatement informé Pierre Moscovici, à qui je n’ai toutefois pas communiqué le document et qui ne me l’avait d’ailleurs pas demandé. Je communiquerai à votre rapporteur la demande d’assistance que nous avons adressée à la Suisse ainsi que la réponse précise que nous avons obtenue.
On nous demande également pourquoi notre interrogation n’a porté que sur UBS : mais parce que c’était là le seul et unique sujet en cause au moment de notre demande d’assistance ! L’accusation portée par Mediapart, qui l’a répétée quelques jours avant l’envoi de notre demande à la Suisse, et même encore après réception de la réponse, ne faisait état que d’un compte chez UBS, fermé puis transféré à Singapour en 2010. Jamais un compte dans une autre banque n’a été mentionné dans cette période, c'est-à-dire avant l’envoi de la demande d’assistance, le 24 janvier.
Certains réécrivent l’histoire en soutenant que la simple mention, dans quelques articles, de personnes physiques, MM. Dreyfus et Reyl, gravitant autour de M. Cahuzac – tout comme de quelques autres résidents fiscaux français – valait affirmation nouvelle, selon laquelle le compte en question se serait trouvé, non pas chez UBS, mais à l’établissement Reyl. Or cela est inexact ! Il suffit pour s’en rendre compte de relire les articles publiés à l’époque.
Notre demande d’assistance administrative a porté sur une période de temps commençant bien avant janvier 2010 : nous avons voulu remonter en deçà de cette date, à laquelle nous aurions pu nous tenir, pour « capturer plus large ». Et si nous avions eu connaissance à la mi-janvier de l’implication d’un autre établissement bancaire, nous aurions bien évidemment également interrogé les Suisses sur celui-ci, étant entendu que, comme nous l’avons amplement démontré au cours de longs débats avec les présidents des commissions des finances de votre assemblée ainsi que du Sénat – et comme cela a d’ailleurs été confirmé par le gouvernement suisse – , nous ne pouvions formuler d’interrogation générale : il nous fallait spécifier le nom de la banque concernée.
Si nous n’avons pas interrogé Singapour, c’est que le point que nous souhaitions vérifier était l’existence d’un transfert d’UBS vers cet État, en 2010. La demande que nous avons adressée à la Suisse couvrait tout transfert d’UBS vers tout autre pays, ce sur une période infiniment plus large – allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 – que celle mentionnée par la presse dans ses allégations. Et si nous avons pu obtenir une réponse portant sur ces sept exercices, au lieu de trois comme le prévoit la convention fiscale qui nous lie à la Suisse, c’est parce que nous avons insisté !
Pouvions-nous adresser une demande de coopération administrative alors même que la justice était saisie ? Oui, bien sûr ! Rien ne s’oppose, et c’est heureux, à ce que l’administration fiscale poursuive son travail pendant une enquête préliminaire. Il peut d’ailleurs arriver, même lorsqu’une information judiciaire est ouverte et qu’un juge d’instruction est désigné, que nous adressions ce type de demande d’entraide administrative en étroite articulation avec le juge ou à sa demande, en vertu du principe de spécialité selon lequel on distingue le canal fiscal du canal judiciaire. Nous avons en revanche estimé devoir transmettre immédiatement à la justice – et à elle seule – le texte de la réponse suisse, dès que nous l’avons reçue. Nous avons d’ailleurs travaillé depuis le début à livre totalement ouvert avec la justice, et en particulier avec le service de police judiciaire de la DNIF en charge de l’enquête préliminaire, auquel nous avons donné accès, dès sa demande à la mi-janvier – soit au tout début de l’enquête préliminaire –, à l’intégralité du dossier de M. Cahuzac depuis plus de vingt ans.
Avant de répondre à vos questions, je souhaiterais vous dire exactement comment les choses se sont déroulées et vous préciser quelles ont été notre philosophie et notre règle de conduite depuis le début.
C’est le 4 décembre dernier, lorsque l’article de Mediapart a été publié, que j’ai entendu pour la première fois une allégation concernant M. Cahuzac. Consternation. Incrédulité. Très vite, la quasi-totalité de la classe politique et des médias prend la défense de l’intéressé, critique les méthodes d’investigation de Mediapart et estime que les allégations sont infondées et diffamatoires. J’ai le souvenir d’un imitateur de talent parodiant cet événement en produisant un enregistrement inaudible dans lequel on ne saisissait que le mot « aéroport » et en déduisant dans l’hilarité générale que M. Cahuzac était responsable des attentats du 11 septembre !
Ce même 4 décembre, M. Cahuzac affirme à son cabinet et à son administration que de telles accusations sont totalement infondées et diffamatoires. Je ne rappellerai pas ici les termes utilisés par l’intéressé pour qualifier le journal en question. Le lendemain, devant la représentation nationale, il nie solennellement et avec force avoir jamais eu un compte à l’étranger. Nous sommes donc tous consternés et choqués par ces accusations à l’égard d’un responsable politique, par ailleurs encensé sur tous les bancs, qui hurle son innocence – et qui, accessoirement, est mon supérieur hiérarchique direct. Oui, mais ! Ma vie en général et ma carrière au service de l’État m’ont cependant appris que l’impensable ne peut jamais être totalement exclu, si choquant soit-il. C’est pourquoi je me dis immédiatement, le 5 décembre, que le rôle précis de la DGFiP sera évidemment un sujet de débat public dans cette affaire et qu’il nous faut donc faire preuve d’exemplarité et documenter dès le début toute notre action.
Le 5 décembre, je décide de demander le déport de M. Cahuzac de tout sujet pouvant le concerner personnellement – mon souhait étant d’éliminer le conflit d’intérêts potentiel entre un ministre, responsable hiérarchique de l’administration fiscale, et le contribuable faisant potentiellement l’objet d’investigations de la part de cette même administration. Cela nous conduit à aborder la question de la « muraille de Chine ». Le même jour, j’annule tous mes engagements et je me mets personnellement à la rédaction d’une note écartant le ministre Cahuzac, non seulement du traitement de ce qui devenait « l’affaire Cahuzac » mais aussi de toute information relative au traitement d’un dossier a priori sans lien mais dont le point commun est le nom d’une banque – UBS. Et si nous avions disposé d’informations concernant une autre banque au cours de cette période, je l’y aurais ajoutée. Discutant de cette note avec la directrice juridique du ministère – qui a elle-même eu à gérer quelques affaires complexes liées à la prévention des conflits d’intérêts –, nous tombons d’accord sur une rédaction.
Le 6 décembre, j’indique aux deux directeurs de cabinet que je considère comme tout à fait indispensable d’ériger cette « muraille de Chine » afin de pouvoir travailler dans des conditions incontestables. Une administration est au service de l’État et non de personnalités politiques. Au terme de quelques échanges, le principe est retenu, le texte quasiment inchangé est finalisé à ma demande le 7 décembre au cours d’une réunion chez la directrice de cabinet de M. Cahuzac, en présence de la directrice des affaires juridiques et de moi-même. Ce texte me revient alors formellement signé le 10 décembre.
En vingt-cinq ans de carrière, et après avoir eu à traiter des dossiers parfois fort délicats, c’est la première fois que j’ai estimé devoir écarter mon patron direct d’un dossier le concernant, alors même qu’il venait la veille de réaffirmer son innocence. Peut-être pourrait-on considérer que cela ressemble davantage à de l’audace, voire à du courage, qu’à une attitude servile ou à celle de quelqu’un prompt à se laisser manipuler. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à trouver des déclarations, émises entre le 4 et le 10 décembre, allant dans le sens des accusations de Mediapart : vous n’en trouverez guère. Et pourtant nous avons fait tout ce que je viens de dire.
Des questions ont été posées quant au principe et à la forme de la « muraille de Chine ». Je réaffirmerai tout d’abord que c’est moi qui en ai pris l’initiative et qui ai utilisé cette dénomination. Il s’agit en effet d’une procédure très classique dans toutes les entreprises et organisations où se pose ce type de problèmes – comme j’en ai fait l’expérience lorsque j’ai eu la responsabilité d’entreprises publiques : un responsable pouvant se trouver dans une situation de conflit d’intérêts ponctuelle ou plus longue se déporte alors au profit d’une autre personne. Dans la forme, il ne s’agit jamais d’un retrait de délégation à l’initiative d’une autorité supérieure, mais d’un acte individuel de déport au profit d’une personne désignée, signé par la personne concernée par le conflit d’intérêts – et en l’occurrence, fortement suggéré par son directeur général des finances publiques.
Enfin, je ne vois guère en quoi la brièveté du texte en réduirait la portée. Je pense en général que la force des propos est inversement proportionnelle à leur volume. Votre président ayant relevé que la véritable « muraille de Chine » a souvent été contournée – ce qui est historiquement exact –, je peux témoigner devant vous qu’après le passage furtif de tel ou tel éclaireur, je n’ai pas vu d’envahisseur mongol s’aventurer près de cette construction, qui a donc tenu.
Cependant, ce 10 décembre, tout Paris, à quelques exceptions près, croit encore à l’innocence de M. Cahuzac…
Que faisons-nous, pourtant ? Le 14 décembre, à la demande de notre administration centrale, la direction régionale des finances publiques de Paris adresse une demande formelle portant en langage fiscal le nom de « 754 » à M. Cahuzac : il s’agit pour lui, non pas du tout de nous confirmer qu’il n’a pas de compte à l’étranger, mais de bien vouloir nous fournir toutes les informations nécessaires, et notamment les avoirs, sur le ou les comptes qu’il détiendrait ou aurait détenus à l’étranger. J’ai entendu dire à tort que nous avions demandé à M. Cahuzac, comme à tous les ministres, de nous confirmer dans un délai impératif de trente jours qu’il n’avait pas de compte en Suisse : c’est totalement inexact. D’abord, cette requête fut limitée à M. Cahuzac, dans le cadre d’une procédure dite « procédure 754 », par laquelle nous lui avons demandé de nous donner toutes les informations possibles sur ce compte, et non pas de nous confirmer qu’il n’en avait pas ! La différence est majeure. Je fournirai ce document à votre rapporteur à l’issue de cette audition.
Cette procédure n’a rien à voir avec le processus d’examen de la situation fiscale de l’ensemble des membres du Gouvernement : il s’agit là, je le répète, d’une demande spécifique adressée au seul Jérôme Cahuzac. D’ailleurs, entre nous, afin de préserver la « muraille de Chine », nous appelions celui-ci « le contribuable concerné », et non plus « le ministre », sur ces sujets-là. Nous lui avons adressé cette demande en ne disposant que d’éléments très limités : à savoir l’article de Mediapart, sans aucun autre élément de documentation. Ce fut la première fois dans l’histoire de l’administration fiscale – nous avons estimé que l’importance du sujet le justifiait – que l’on envoyait un formulaire 754 sur le fondement d’un dossier aussi peu étayé.
Une telle demande était une pièce de procédure nous permettant ensuite de passer à l’étape suivante – celle de l’assistance administrative avec la Suisse – car il nous fallait d’abord épuiser les voies internes.
Le vendredi 21 décembre, Mediapart titre en page 3 : « L’administration fiscale enquête sur son propre ministre », expliquant que la direction régionale des finances publiques de Paris enquête depuis quelques jours sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de M. Cahuzac – sous-entendant qu’en sus des révélations sur un compte éventuel en Suisse, nous aurions par ailleurs déclenché un contrôle fiscal de M. Cahuzac. Souhaitant rectifier les faits, nous publions le lendemain, soit le samedi 22 décembre, en fin de soirée, les termes précis de notre intervention, indiquant : « Aucun contrôle ou enquête n’est en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Comme c’est l’usage pour chaque nouveau Gouvernement, la DGFiP procède à un examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement. C’est cette procédure qui est en cours et qui vise à assurer que la situation de chacun des membres du Gouvernement est irréprochable et exemplaire. » Cela est parfaitement exact et tout à fait incontestable. Nous ne nions aucunement que des investigations soient en cours sur la personne de M. Cahuzac, comme d’ailleurs sur d’autres membres du Gouvernement. Mais il ne s’agit juridiquement et techniquement ni d’une enquête ni d’un contrôle – notions qui correspondent à des procédures de droit fiscal bien précises puisque encadrées par le livre des procédures fiscales. Mediapart semble très frappé par cette mise au point puisque le journal publie dès le lendemain un nouvel article et M. Edwy Plenel lors de son audition de mardi dernier évoque ce sujet à cinq reprises. Y est sous-entendu que la DGFiP aurait été instrumentalisée pour voler au secours de son ministre, qu’elle est tellement peu fière de son texte qu’elle l’a publié nuitamment et qu’elle a évité la voie formelle d’un communiqué en dictant des mots à des agences afin d’éviter toute traçabilité. Tout cela est absolument faux, si ce n’est le fait que nous ayons travaillé tard ce samedi 22 décembre. Nous n’avons rien dicté oralement à des agences mais envoyé un courriel, que je vous remets. C’était donc parfaitement traçable. Le texte que nous avons publié est parfaitement exact techniquement. Nous y affirmons clairement que des travaux sont effectivement en cours sur la situation fiscale de certains membres du Gouvernement. Cela est bien normal puisqu’il s’agit là de la procédure générique d’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement. Ce communiqué ne « noie » donc absolument pas « le poisson » ! Au contraire, il réaffirme que cette procédure est en cours et je vous rappelle qu’elle ne portait pas que sur M. Cahuzac.
Je reviens à présent sur la date du 14 janvier, qui a pris une importance extraordinaire depuis quelques semaines. Si l’on en parle, c’est parce qu’elle se situe trente jours après la date d’envoi du formulaire 754 à Jérôme Cahuzac. Il nous a été demandé indirectement quelles conclusions nous tirions de l’absence de réponse de sa part. Or, celui-ci venant devant la représentation nationale et sur tous les plateaux de télévision de confirmer avec force, « les yeux dans les yeux », « en bloc et en détail », que ces allégations étaient mensongères, imaginez-vous une seule seconde que nous nous attendions à ce qu’il envoie à son centre des impôts un document indiquant qu’il s’était trompé devant l’Assemblée nationale et qu’il possédait bel et bien des comptes en Suisse ? Le délai de trente jours mentionné dans ce formulaire n’étant absolument pas contraignant – il mentionne même « si possible », l’administration ne peut, s’il n’est pas respecté, en tirer de conséquences juridiques sous forme d’une taxation d’office – contrairement à ce qui se passe habituellement en l’absence de réponse d’un contribuable. Il ne se passe donc strictement rien le 14 janvier. Et je n’en parle même pas au ministre, à qui je n’ai d’ailleurs rien dit de l’envoi de ce formulaire, dans la mesure où je n’ai pas à lui rendre compte de l’ensemble des diligences de l’administration fiscale relatives à des dossiers individuels – fût-ce celui du ministre délégué au budget – ; Sauf sur un point : j’ai estimé que lorsqu’il s’agit de contacter un État étranger, il convenait d’en parler au Gouvernement
Le 14 janvier, nous étions en train de préparer notre demande d’assistance administrative : ce jour correspond donc à un non-événement. Et que M. Cahuzac répondît ou pas, nous aurions adressé cette demande de toute façon. Il nous fallait simplement attendre de purger la procédure interne puisque les conventions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoient qu’un État ne s’adresse pas à un autre sans avoir appliqué les mesures internes dont il dispose.
À la date du 24 janvier, nous avons déjà beaucoup travaillé à la rédaction du texte et pris la précaution de rajouter l’expression d’« ayant droit économique ». J’ai eu deux conversations téléphoniques avec mon homologue et son collaborateur les 22 et 23 janvier pour leur annoncer notre intention de leur faire parvenir cette demande et les prier de la traiter rapidement et d’accepter de remonter dans le temps. Nous recevons leur réponse par courriel le jeudi 31 janvier.
Pour terminer, je souhaiterais revenir sur un épisode détestable, qui m’a beaucoup marqué, au cours du week-end des 9 et 10 février. Un journal paraissant précisément le week-end titre alors : « Les Suisses blanchissent Cahuzac ». Cet article fait parler non seulement l’entourage du ministre de l’économie, mais surtout, sous le sceau de la confidence, « une source administrative à Bercy » – alors même qu’aucun contact n’a eu lieu avec nous, et pour cause. Curieuse méthode ! Le rôle de la DGFiP consiste à assurer, avec les moyens dont elle dispose, l’application de la loi fiscale, et non pas de communiquer ni de contribuer à la communication des membres du Gouvernement. Non seulement nous n’avons eu aucun contact avec la presse postérieurement à l’arrivée de la réponse suisse – ni antérieurement d’ailleurs –, mais j’ai précisément refusé de prendre au téléphone ce journaliste qui, mystérieusement, avait obtenu mon numéro de portable. Le moins que l’on puisse dire, c’est donc que la DGFiP n’a été à l’origine d’aucune opération de communication, ni n’y a participé, directement ou indirectement. Ce n’est pas notre rôle. Vous comprendrez donc ma fureur en lisant cet article ! J’avais d’ailleurs recommandé aux autorités politiques la plus grande discrétion sur la réponse suisse dès réception de celle-ci, rappelant tout d’abord les contraintes du secret fiscal mais aussi le fait que cette réponse, bien que précise, était nécessairement partielle. Mardi dernier, l’un des intervenants a indiqué que cette réponse suisse était à l’évidence à prendre avec des pincettes. Je suis tout à fait d’accord sur ce point et c’est d’ailleurs exactement ce que nous avons fait : nous l’avons mise au coffre, transmise à la justice et prise avec des pincettes.
Les questions relatives à la situation fiscale de M. Cahuzac ne se limitent pas à la détention de comptes à l’étranger non déclarés mais concernent également d’autres aspects partiellement divulgués par la presse, notamment dans des articles des 21 et 23 décembre – points sur lesquels je souhaiterais pouvoir informer votre rapporteur et lui remettre un ensemble de documents. La DGFiP a mené ses diligences sur cette autre partie du dossier conformément aux textes qui régissent le secret fiscal. Et je puis dire sans déroger au secret fiscal que toutes les anomalies détectées à l’examen du dossier à l’été ont été portées à la connaissance du contribuable, d’abord par mon prédécesseur, puis par moi-même, avant d’être directement traitées à notre demande par le service local avec le conseil du contribuable, dans les conditions de droit commun.
Tel est le témoignage aussi précis que possible que je tenais à porter devant vous. J’ai eu l’occasion depuis le dénouement partiel du 2 avril, date à laquelle j’ai appris la nouvelle, de me demander en mon âme et conscience si nous avions bien agi à tout moment. J’ai revu chaque étape et j’affirme aujourd’hui sous serment que oui : je considère que, dans ce dossier très difficile qui mettait directement en cause son patron, la DGFiP a été extrêmement rigoureuse. Elle a certes été discrète mais c’est là son devoir. Elle a également été particulièrement proactive, comme l’illustre le simple énoncé de la chronologie, et a veillé à la neutralité républicaine qui s’impose à toute administration.
M. Alain Claeys, rapporteur. S’agissant de la « muraille de Chine », la demande de déport que vous avez rédigée le 5 décembre et transmise le 7, et qui a été signée le 10, a-t-elle fait l’objet d’une note ?
M. Bruno Bézard. Pas d’une note formelle comme on en rédige dans l’administration à l’attention du ministre, mais d’un document que j’ai rédigé moi-même et transmis aux deux directeurs de cabinet en leur indiquant quel était mon souhait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans la dépêche de l’AFP, vous affirmez qu’aucun contrôle ou enquête n’était en cours à l’encontre d’un membre du Gouvernement, tout en mentionnant l’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement. Comment qualifier la démarche entreprise par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France le 21 décembre ?
M. Bruno Bézard. La démarche entreprise par la direction régionale n’est que la poursuite normale du processus d’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement, tradition républicaine en vertu de laquelle, dès la nomination d’un Gouvernement, les services locaux de l’administration fiscale examinent sur pièces – sous notre coordination – les dossiers des ministres et nous signalent d’éventuelles anomalies, qui correspondent en fait, dans 95 % des cas, à des questions que l’on résout : il peut s’agir par exemple de s’assurer que le contribuable n’a pas sous-évalué sa résidence principale, ou de vérifier le nombre d’enfants à charge qu’il a déclarés, ou encore de lui signaler que s’il a déclaré une pension alimentaire, l’administration fiscale ne dispose pas de son jugement de divorce. Il peut y avoir aussi des sujets plus lourds évidemment.Nous rendons compte au ministre sous forme d’une note, que je tiens à votre disposition, du résultat de cet examen sur pièces – qui ne permet nullement de détecter un compte à l’étranger – et qui se déroule en plusieurs étapes. Il arrive en effet que l’on demande à certains membres du Gouvernement d’expliquer ou de justifier certains points. Ces échanges prennent donc un certain temps. Cet examen ne constitue pas véritablement une procédure prévue explicitement dans le livre des procédures fiscales. Nous avons d’ailleurs fait des propositions au Gouvernement en vue d’améliorer ce dispositif.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quant à la « procédure 754 », vous nous avez précisé qu’elle ne consistait pas à demander au contribuable s’il détenait un compte à l’étranger, mais quels sont les avoirs qui seraient détenus à l’étranger. Quelle est la valeur juridique de ce document ?
M. Bruno Bézard. Il commence dans les termes suivants : « Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants : ». Suit une liste dans laquelle figurent les termes : « identification des comptes bancaires ouverts, clos ou utilisés à l’étranger (voir feuillet joint). » Il est précisé : « Cette demande ne revêt pas de caractère contraignant. Elle est établie conformément aux dispositions de l’article L10 du livre des procédures fiscales qui permet à l’administration fiscale de demander aux contribuables des renseignements sur les éléments qu’ils ont déclarés. Afin de traiter votre dossier dans les meilleures conditions, je vous remercie de m’adresser votre réponse si possible dans un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. » Le détail de la demande, figurant en annexe, était ainsi libellé en l’espèce : « Selon des informations récemment parues dans la presse, vous seriez ou auriez été détenteur d’un compte bancaire ouvert à l’étranger. Or l’examen de votre dossier fiscal a permis de constater que vous n’aviez pas déclaré l’existence de compte(s) ouvert(s) à l’étranger, ni sur les déclarations de revenus que vous avez déposées au titre des années 2006-2009, ni sur l’impôt de solidarité sur la fortune. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants :
– l’identification des comptes bancaires ouverts, clos ou utilisés à l’étranger en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
– le montant des avoirs figurant sur ces comptes au 1er janvier 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
– le cas échéant, le montant des revenus de source étrangère y afférant au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. »
Ces termes ne correspondent donc pas au propos de ceux qui affirment que nous avons demandé au ministre Cahuzac de bien vouloir nous confirmer qu’il ne disposait bien sûr d’aucun compte à l’étranger. Ce type de document n’étant pas contraignant, le fait que nous ne recevions pas de réponse n’emporte pour nous aucune conséquence.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette demande « 754 » ayant été faite par votre direction, le ministre n’en était pas informé ?
M. Bruno Bézard. Cette demande a été adressée par le service local des finances publiques à la demande de la direction générale des finances publiques – dont vous auditionnerez le directeur régional. Et je vous confirme que je n’en ai pas informé le ministre car je n’ai pas à le faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans quelle mesure cette demande constituait-elle un préalable indispensable à la demande d’assistance administrative à la Suisse ?
M. Bruno Bézard. En trois ans, nous avons procédé à plus de 4 500 demandes d’assistance administrative dans le monde entier. Ce sont donc des professionnels qui en sont chargés. Les conventions OCDE, qui constituent le modèle sur la base duquel nous déclinons nos conventions bilatérales, prévoient que l’on ne contacte pas un État étranger sans avoir purgé les voies internes. C’était donc ce qu’il convenait que nous fassions : n’adresser cette demande d’assistance administrative à la Suisse qu’une fois écoulé le délai non contraignant de trente jours.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque vous adressez cette demande à la Suisse, le ministre de l’économie en est informé : lui précisez-vous alors que les voies internes ont été purgées ?
M. Bruno Bézard. Non, car je n’ai pas à entrer dans ce détail technique. Lorsqu’il me demande si l’on peut faire une demande d’assistance administrative, je lui réponds que c’est techniquement possible mais qu’il sera difficile d’obtenir une réponse, compte tenu des statistiques, que cela n’aura d’effet que s’il appelle sa collègue, Mme Widmer-Schlumpf et que, même dans ce cas, il n’est pas certain que nous obtenions une réponse rapide et claire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous affirmez que, lorsque vous recevez cette réponse, le seul service à en être informé est le service de la police judiciaire. Dès lors, quel est le degré d’information dont bénéficie Jérôme Cahuzac ? On nous dit que ses conseils sont informés de la procédure par les autorités suisses : est-il également informé de ses résultats ?
M. Bruno Bézard. J’ai transmis à la police, et à elle seule le document proprement dit. J’ai effectivement transmis l’information à M. Moscovici. Et M. Cahuzac est manifestement parfaitement informé par ses conseils de la question, mais aussi du sens de la réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez pris vos fonctions à la direction générale des finances publiques le 5 août 2012. Entre cette date et le mois de décembre de la même année, avez-vous été informé de l’existence d’un rapport rédigé par Rémy Garnier ?
M. Bruno Bézard. Sans doute obtiendrez-vous davantage d’informations sur ce point de la part de mon prédécesseur, qui a eu à traiter du contentieux disciplinaire dont cet agent a fait l’objet. Je n’ai pour ma part jamais été informé du fait que, dans son mémoire du 11 juin 2008, M. Garnier mettait en cause M. Cahuzac par une phrase. Je n’ai donc appris l’allégation relative à la détention par M. Cahuzac d’un compte en Suisse que le 4 décembre, comme tout le monde.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez pas répondu précisément à la question de savoir si l’examen de la situation fiscale des ministres était borné dans le temps. La directrice de cabinet de M. Cahuzac a demandé aux services en octobre 2012 de lui préparer une note pour un entretien du ministre avec Rémy Garnier. Le dossier est donc remonté au cabinet pour établir ce document. L’administration était donc au courant de la note de Rémy Garnier en date du 11 juin 2008 qui évoque un compte en Suisse. Et vous n’étiez pas au courant ?
M. Bruno Bézard. Ceux qui gèrent au sein de l’administration les procédures disciplinaires étaient évidemment au courant du mémoire qui a été adressé le 11 juin 2008 à l’administration dans le cadre d’une procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Je n’ai pas cette information lorsque je transmets les deux notes pour répondre à une demande tendant à faire le point de la procédure disciplinaire concernant M. Garnier. J’ignorais d’ailleurs à ce moment-là qu’elles étaient destinées à préparer un rendez-vous avec Rémy Garnier. Les mémoires disciplinaires de tous les agents, y compris ceux mettant en cause différentes autorités – dont le député de la circonscription – ne remontent évidemment pas au directeur général ! Si tel avait été le cas, je l’aurais évidemment indiqué au ministre par une mention manuscrite sur la note.
M. le président Charles de Courson. Lorsque vous recevez la réponse des autorités suisse vous en informez M. Moscovici – vous ne lui remettez pas cette réponse.
M. Bruno Bézard. Je lui montre sur mon Ipad – la seule et unique personne à qui je transmets le document c’est à la police judiciaire. C’est M. Gardette qui l’a fait, le lendemain matin auprès de Mme Dufau, directrice de la division nationale des investigations financières et fiscales, la DNIFF.
M. le président Charles de Courson. L’article du JDD mentionne « l’entourage du ministre de l’économie ».
M. Bruno Bézard. Il cite aussi des sources administratives ! Vous voyez la coupe est pleine.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez pas fait de démenti ?
M. Bruno Bézard. On ne fait pas de démenti à chaque fois que la presse écrit quelque chose d’inexact. Le seul démenti que j’ai fait c’est quand la presse a écrit que j’avais conduit une mission en Suisse en décembre.
M. le président Charles de Courson. Les avocats de Jérôme Cahuzac ont-ils eu communication de la réponse par l’administration suisse ?
M. Bruno Bézard. Posez la question aux deux parties concernées. La seule chose que je peux vous dire, c’est que le droit suisse prévoit que le contribuable est averti de la réception d’une demande d’assistance administrative. Ils sont d’ailleurs en train de modifier ce point à notre demande et à celle de la communauté internationale.
M. le président Charles de Courson. Ma question porte sur la réponse de l’administration suisse. A-t-elle été transmise aux avocats de M. Cahuzac.
M. Bruno Bézard. Je n’en sais rien mais tout laisse à penser que oui.
M. le président Charles de Courson. Je reviens à la question de savoir si l’examen de la situation fiscale des ministres est borné dans le temps.
M. Bruno Bézard. Cet examen n’est pas borné dans le temps – c’est d’ailleurs là un point qu’il faudrait changer.
M. le président Charles de Courson. Est-ce à dire que cet examen se fait en dehors de tout cadre juridique ?
M. Bruno Bézard. Oui, mais il ne faut pas y voir malice. Tous les gouvernements ont adopté cette pratique et c'est plutôt bien ainsi. Dans les autres pays, les pratiques sont très variables. Celle de la France est saine et républicaine, mais il faut l'améliorer.
M. le président Charles de Courson. Il n'est pas normal que le ministre responsable de l’administration fiscale soit informé du contrôle le concernant. C'est là un défaut de cet examen fiscal, auquel la loi sur la transparence donnera peut-être une base juridique.
M. Bruno Bézard. Les propositions qui sont actuellement sur la table tendent à remédier à ce défaut en instituant une haute autorité. Cependant, lorsque l'administration fiscale sent qu'un conflit d'intérêts est possible, elle s'organise et met en place la « muraille de Chine ».
M. Christian Eckert. L'article 10 de l’avenant à la convention avec la Suisse dispose dans son deuxième paragraphe que les échanges ne peuvent intervenir qu'une fois utilisées les sources habituelles de renseignements prévues par la procédure fiscale interne - c’est le mécanisme que vous avez décrit et qui impliquait le respect du délai d'un mois.
D’autre part, l’alinéa e) de cet article dit explicitement que la demande doit comporter « dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ». L'échange de courriers intervenu entre les deux administrations fiscales en vue de la mise en œuvre de la convention précise de même que l'État requérant doit absolument transmettre toutes informations en sa possession permettant d'identifier l’établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné. Je tenais à rappeler ces dispositions, cruciales s’agissant d’apprécier l’action de l'administration dans cette affaire.
Je terminerai par une question : M. Cahuzac vous a-t-il interrogé sur la procédure d'échange d'informations en cours entre les deux administrations fiscales ?
M. le président Charles de Courson. Dans l'échange de lettres du 11 février 2010 entre les deux administrations fiscales, pouvez-vous expliquer ce que signifie la mention : « Dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'État requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque » ?
M. Bruno Bézard. Ces deux questions appellent des réponses précises. Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur général, l'architecture juridique de nos relations avec la Suisse, mais il y a de la part de ce pays une assez forte différence entre les intentions exprimées dans les textes et la pratique. J’ai évoqué les statistiques effrayantes des délais de réponse et, surtout, des absences de réponse. Nous sommes ici pour parler du droit mais, en Suisse, la pratique est totalement déconnectée du droit.
La convention est encadrée par un échange de lettres en date du 11 février 2010, effectué à la demande du gouvernement de la Confédération. Celui-ci refusait en effet de signer l’avenant sans cet échange, qui restreint le texte de la convention. Le paragraphe 6 de la lettre adressée par l’administration fiscale suisse est ainsi rédigé : « Dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'État requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'État requis donnera suite à une telle demande à la condition que celle-ci soit conforme au nouvel article 28 de la convention, notamment au principe de proportionnalité… ». Ce paragraphe était du reste inutile car, même sans cela, les Suisses auraient toujours refusé de communiquer ces renseignements hors ces conditions, mais il stipule précisément qu'on ne peut formuler de demande générale qui ne vise spécifiquement une banque, ni sans donner un minimum d'informations. Il s'agit là de l'état du droit entre la France et la Suisse.
Par ailleurs, le gouvernement suisse, par la voix de son secrétaire d'État a déclaré dans un article récemment publié par le journal Le Temps que cette convention, assortie de l’échange de lettres, ne permettait en aucune façon d’aller à la pêche aux renseignements sans identifier formellement une banque. Le dossier est d’une clarté cristalline.
M. Christian Eckert. Sans esprit de polémique, j’observe que ce point d’une importance cruciale fait l’objet de divergences entre nous. Ainsi, M. Gilles Carrez, président de la Commission des finances, qui a participé, avec d’autres, à la négociation de cet avenant ou de l’échange de lettres, avait considéré que ces instruments élargissaient le champ de la convention d’échange d’informations. Votre interprétation, monsieur le directeur général, à laquelle je souscris, est tout à fait inverse : cet échange de lettres restreint la possibilité d’interrogation.
M. Bruno Bézard. Le 12 avril 2013, le gouvernement suisse a déclaré – et cette déclaration n'est nullement « off » mais complètement officielle – que, « dans le cas d’une demande d’entraide administrative, le nom de la banque ne doit être mentionné que dans la mesure où celui-ci est connu. Il faut cependant que le principe de proportionnalité soit respecté, raison pour laquelle il est possible de formuler une demande portant sur plusieurs banques éventuelles, mais pas sur toutes, car cela reviendrait à une pêche aux renseignements ».
M. le président Charles de Courson. Vous auriez donc pu ajouter la compagnie Reyl.
M. Bruno Bézard. S'il y avait eu alors sur la place publique des informations sur l'existence d'un compte à la banque Reyl, c’est bien sûr ce que nous aurions fait.
En ce qui concerne M. Cahuzac, il a effectivement essayé de me demander des détails sur cette procédure d'entraide administrative. Je ne lui ai pas répondu et lui ai indiqué que je n'avais pas à lui répondre.
M. le président Charles de Courson. À quelle date ?
M. Bruno Bézard. Je ne me souviens pas de la date précise, mais c'était entre le 24 et le 31 janvier.
M. le président Charles de Courson. Vous avez déclaré que vous n'aviez pas saisi l'administration fiscale de Singapour parce que vous aviez fait figurer dans votre saisine des autorités helvétiques la mention : « et tout autre pays dans le cadre d'un transfert ». Votre réponse n'épuise pas la question. Pourquoi n'avez-vous pas fait, pour plus de sûreté, deux demandes – l’une à la Suisse et l’autre à Singapour ? Mais pouviez-vous le faire en application de la convention entre la France et Singapour ?
M. Bruno Bézard. La convention conclue avec Singapour est moins restrictive que celle que nous avons avec la Suisse car elle n’a pas été assortie du même échange de lettres et permet donc, en théorie, d'interroger sur un ensemble de banques. En pratique, après vérification de l'ensemble des demandes d'assistance administrative, il apparaît que nous ne l’avons jamais fait et je ne pense pas qu’aucun pays l’ait jamais fait avec Singapour. Ce pays est, comme d’autres, en train de changer sa procédure depuis certaines affaires, notamment Offshore Leaks, mais il devait jusqu’ici demander l’autorisation d’un juge pour chaque investigation, dans chaque banque. Chaque fois que mes collaborateurs ont demandé à leurs homologues de Singapour s’ils pouvaient les interroger de façon générique – ce que, je le répète, la convention n’interdit pas –, la réponse était positive, mais soulignait qu’il n’existait pas de fichier centralisé et que les autorités devraient interroger 700 à 800 banques, en recourant chaque fois à un juge. Je ne suis donc pas sûr que nous aurions eu une réponse.
Quant à votre première question, il me semble, même si je respecte votre point de vue, que notre démarche épuise techniquement le débat, car nous avons précisément interrogé la Suisse sur tout transfert vers tout autre pays.
M. le président Charles de Courson. Je ne partage pas votre sentiment.
Je voudrais vous poser aussi la question déjà posée à plusieurs reprises par M. Jean-Marc Germain – au point que nous la désignons désormais comme la « question Germain » – : comment expliquer que la réponse des autorités suisses ait été négative alors qu’il est apparu deux mois plus tard que M. Cahuzac détenait un compte en Suisse ?
M. Bruno Bézard. Cette question, il nous faudra nous la reposer dans quelques semaines, lorsque l’instruction aura suffisamment avancé ou lorsque nous saurons exactement ce qui s’est passé – ce que j’ignore actuellement – grâce à des mécanismes juridiques tels que celui qui figure à l’article L101 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration fiscale d’obtenir des informations par la justice. Attendons donc de savoir ce que les juges auront trouvé.
En interrogeant les autorités suisses sur M. Cahuzac, j’ai demandé que la question soit élargie à ses ayants droit économiques. Ayant, par un hasard de ma carrière, négocié la création de Tracfin et les accords internationaux relatifs à ces questions, je me souvenais en effet que nous avions alors introduit cette notion – en anglais « beneficial owner » – et j’ai donc demandé à mes collaborateurs, le 22 ou 23 janvier, de vérifier si cette notion était encore valide et pouvait être employée pour « ratisser » le plus largement possible afin d’éviter de nous faire piéger par un prête-nom.
Oui, monsieur le président, cette question est intéressante et nous aurons plus d’éléments pour y répondre lorsque la justice aura achevé son travail.
M. le président Charles de Courson. Vos collaborateurs ont-ils des hypothèses pour répondre à cette question que nous nous posons tous ?
M. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. Comme l’a indiqué le directeur général, les éléments dont nous disposons actuellement sont beaucoup trop ténus pour formuler des conjectures. Nous nous fondions alors uniquement sur des affirmations ou allégations de la presse évoquant un compte à l’UBS – dont rien ne disait qu’il n’était pas ouvert dans une autre banque. Dès lors qu’étaient mentionnés dans la demande les éventuels ayants droit économiques, si le compte était ouvert à l’UBS et si la structure interposée a bien respecté le droit suisse qui lui fait obligation, en contractant avec une autre banque, d’indiquer l’ayant droit économique, l’UBS aurait été en mesure de nous communiquer l’information.
M. le président Charles de Courson. Ma question était plus large. Pour avoir procédé à 426 saisines pour la Suisse, vous avez une certaine pratique de cette procédure. Que découvrez-vous concrètement ?
M. Bastien Llorca. Sur 426 demandes adressées à la Suisse, nous n’avons obtenu satisfaction que dans 29 cas, que la réponse ait été qu’il n’existait pas de compte ou, au contraire, qu’il en existait. En outre, la réponse ayant été le plus souvent de la première sorte, une faible proportion seulement de ces 29 s’est révélée fiscalement exploitable. Les éléments obtenus sur d’éventuels montages par le biais de la coopération administrative – dans le domaine bancaire du moins – sont donc assez minces.
L’absence de réponse de la part de la Suisse résulte souvent de blocages procéduraux que nous nous employons à lever au moyen de discussions précises avec nos homologues. Le directeur général et son homologue suisse se sont d’ailleurs entretenus du sujet à plusieurs reprises.
M. Bruno Bézard. Notre demande – dont je vous remettrai tout à l’heure le texte – comportait notamment la question suivante : « M. Cahuzac est-il ou a-t-il été 1) titulaire d'un compte ou de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque UBS ou 2) l'ayant droit économique de ce ou ces comptes ? » Nous demandions ensuite la référence du ou des comptes bancaires et les « relevés de fortune », comme on dit dans ce jargon. La dernière question, sur laquelle j'appelle votre attention, consistait à demander, « en cas de transfert du ou des comptes visés au point qui précède, la date de transfert et l’État ou territoire de destination ».
M. le président Charles de Courson. Cela ne signifie-t-il pas que cette convention bilatérale est en fait inapplicable et donc inefficace ? Si vous nous répondez plutôt oui, cela m’amènera à vous soumettre à une question au deuxième degré : fallait-il, comme le demandent certains, saisir les autorités suisses, sachant de quelle utilité pourrait être la réponse ?
M. Bruno Bézard. Merci, monsieur le président, de souligner vous-même le piège logique dans lequel vous essayez de m’entraîner !
Il fallait assurément formuler cette demande d'assistance administrative. Du reste, ne seriez-vous pas le premier, monsieur le président, à nous reprocher de ne pas l'avoir fait ?
De surcroît, cette procédure n’est certainement pas sans utilité : si, à la suite des 426 demandes adressées à la Suisse, très peu de poissons sont revenus dans nos filets, quelques-unes de ces prises étaient intéressantes. Elle est clairement imparfaite mais, pour le dire en termes choisis, c'est son application qui n'est pas totalement conforme à l'esprit de la convention. Avec certains pays, l'application est plus proche du droit : il en est qui ne nous répondent pas à chaque fois que notre demande n’est pas pertinente.
Pour lutter demain contre la grande fraude fiscale internationale, qui rapporte des millions de dollars à des avocats et à des banques d'affaires – et à d’autres encore, car je ne veux stigmatiser aucune profession – pour cacher des fraudes au cinquième degré, grâce à cinq, dix ou vingt structures interposées, ces instruments relevant d'une philosophie qui était celle de l’OCDE voilà 40 ans ne sont évidemment plus adéquats. C’est la raison pour laquelle nous plaidons pour l’échange automatique d’informations.
J’ai assisté voilà quinze jours, pour la première fois, à une réunion de mes homologues du monde entier ou presque et nous avons évoqué cette question. Il se présente aujourd’hui une opportunité politique de faire bouger les choses. Même Singapour, qui pendant des années a refusé tout mouvement à cause du lobbying de ses banques, a changé de pied. Certains pays d’Europe n’ont pas encore compris cette leçon de l’histoire, mais il faut évidemment améliorer nos instruments. Nous avons quant à nous essayé d’utiliser au mieux ceux dont nous disposions et je crois pouvoir vous dire qu’une demande d’assistance plus large, présentée plus rapidement et reposant sur un dossier aussi peu étayé n’existe tout simplement pas.
M. le président Charles de Courson. Et la réponse ?
M. Bruno Bézard. Le juge dira si elle était conforme à la réalité.
M. Émeric Bréhier. Monsieur le président, ce qui intéresse notre commission d’enquête, c’est la manière dont étaient posées les questions.
M. le président Charles de Courson. J’évoquais la réponse de la Suisse.
M. Christian Eckert. Je voudrais brièvement revenir sur le choix de la période sur laquelle la demande portait, certains l’ayant également mis en cause. Une demande d’assistance administrative doit avoir un motif – ici la taxation d’un avoir qui aurait été dissimulé. Nous ne pouvons donc agir que pour recouvrer de l’impôt sur le revenu, ce qui est difficile si l’on ne connaît pas les comptes et les flux, ou de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour lequel le délai de prescription est de six ans. C’est précisément la raison pour laquelle la question a été posée à partir de 2006, date avant laquelle nous n’avions pas intérêt à agir. La réponse de la Suisse est formulée en deux temps : au titre de la convention pour la période de 2010 à 2012 et au titre d’une mission de bons offices pour la période antérieure.
M. le président Charles de Courson. Le problème de fond est plutôt celui de la portée de cette convention.
M. Thomas Thévenoud. La commission d’enquête a pour objet les éventuels dysfonctionnements survenus dans l’action du Gouvernement et des services de l’État en France, et non la qualité de la réponse de l’administration fiscale suisse.
Je tiens à vous remercier, monsieur le directeur général, de la précision et de la clarté de vos réponses et je regrette que nos collègues de l’opposition ne soient pas plus nombreux pour les écouter. Je confirme que, comme vous l’avez évoqué en préambule, certains fonctionnaires des finances publiques subissent en ce moment, à la suite de cette déplorable affaire, des réactions agressives de la part des contribuables qu’ils sont amenés à interroger.
Comment s’est faite, lorsque vous êtes entré en fonctions au mois d’août dernier, la transmission d’informations entre votre prédécesseur et vous-même ? Si j’ai bien compris, vous aviez déjà l’un et l’autre connaissance de certaines anomalies dans le dossier fiscal de M. Cahuzac, mais pas d’un compte à l’étranger. Avez-vous évoqué la situation fiscale de ce ministre et les demandes d’informations sur les autres membres du Gouvernement ?
M. Bruno Bézard. La tradition dans l’administration française n’est pas de ménager une longue période de recouvrement entre celui qui part et celui qui arrive. Je le regrette, car une telle mesure pourrait améliorer la continuité du service public, comme c’est le cas dans certains pays où ce recouvrement peut durer plusieurs semaines. Pour nous, la transition a duré une journée. C’est bref, mais cette journée a été suffisante pour aborder les dossiers importants. M. Parini, que vous entendrez tout à l’heure, pourra vous confirmer qu’il a évoqué la situation des membres de l’exécutif. Il avait d’ailleurs signé le 24 juillet, soit peu de temps avant la passation de pouvoirs – qui a eu lieu le 5 août –, une note dans laquelle il évoquait la situation de l’ensemble des membres de l’exécutif sous l’angle de cette procédure que j’ai rappelée tout à l’heure. Il a également mentionné, à propos de M. Cahuzac, un sujet que je ne peux pas évoquer ici à cause du secret fiscal, mais pour lequel votre rapporteur aura accès à tous les documents. J’affirme solennellement, et M. Parini pourra vous le confirmer, qu’à aucun moment un compte occulte à l’étranger n’a été évoqué lors de cet entretien – tout simplement parce que M. Parini, même si ce n’est pas à moi de le dire à sa place, n’en savait rien.
M. Thomas Thévenoud. Le nom de M. Garnier a-t-il été cité lors de cet entretien ?
M. Bruno Bézard. Absolument pas.
M. Thomas Thévenoud. Lorsque M. Cahuzac a tenté d’avoir connaissance de la réponse des autorités helvétiques, l’a-t-il fait lui-même ou par l’intermédiaire de ses conseils ? Quels ont été vos contacts avec ces derniers ?
M. Bruno Bézard. Aucun contact. Je m’y suis refusé. J’ai dit dans mon introduction que ma « muraille de Chine », à la différence de son modèle historique, avait résisté malgré les passagers furtifs qui s’en étaient approchés pour en évaluer la solidité : c’est précisément à ces tentatives que je faisais allusion. M. Cahuzac a effectivement tenté d’entrer dans le débat sur la demande d’assistance administrative et de voir par exemple comment cette demande était rédigée, mais je le lui ai refusé, comme j’ai refusé tout contact avec toute personne de l’entourage, y compris les conseils – avocats ou toute autre personne – du « contribuable concerné ».
M. Thomas Thévenoud. M. Cahuzac vous a invité à le rencontrer au ministère pour évoquer cette question ?
M. Bruno Bézard. M. Cahuzac était mon ministre et je le voyais donc régulièrement au ministère.
M. Thomas Thévenoud. Vous a-t-il fait venir spécifiquement?
M. Bruno Bézard. Non, pas spécifiquement. Il m’a posé des questions, auxquelles j’ai dit que je ne répondrais pas, et il n’a pas insisté.
M. le président Charles de Courson. Cela a-t-il eu lieu à l’occasion des contacts que vous aviez avec votre ministre ? Par téléphone ?
M. Bruno Bézard. Un ministre a des contacts par tous moyens avec ses directeurs généraux – par téléphone ou à l’occasion d’une réunion, par exemple. Il est classique, dans une entreprise comme dans un ministère, que le patron voie de temps à autre son « N-1 », fort heureusement.
M. le président Charles de Courson. Cela s’est donc passé fin janvier ?
M. Thomas Thévenoud. Fin janvier, à une seule reprise et M. Cahuzac n’a pas fait d’autre tentative, si je vous ai bien compris.
M. Bruno Bézard. Je ne peux pas vous donner la date précise, mais M. Cahuzac a essayé d’entrer dans la question. Je lui ai dit que c’était impossible et je dois reconnaître à sa décharge qu’il n’a pas insisté.
M. Hervé Morin. Tout d’abord, que répondez-vous à ceux qui vous disent que le seul moyen d’avoir la certitude que M. Cahuzac avait un compte en Suisse était de l’inciter à poser la question lui-même pour passer le barrage du secret bancaire suisse ?
En deuxième lieu, vous avez déclaré dans votre propos liminaire que c’était la première fois qu’un « 754 » était mis en œuvre à partir d’une information de presse. Pourquoi avez-vous considéré que le cas de M. Cahuzac le justifiait ? À quels « autres développements » à venir faites-vous allusion ?
En troisième lieu, M. Gonelle a laissé entendre la semaine dernière, lors de son audition par notre commission d’enquête, qu’en 2001, lorsqu’un inspecteur des impôts avait signalé à la direction régionale des impôts l’éventualité que M. Cahuzac détienne un compte en Suisse, une intervention de la direction nationale ou une intervention politique avait empêché toute investigation fiscale. De telles pratiques existent-elles dans la maison dont vous avez la charge depuis un an ?
En quatrième lieu, le directeur de cabinet de M. Moscovici déclare – et cela me semble très surprenant – qu’il n’a rien fait et n’a même qu’à peine évoqué ce dossier avec vous. Est-ce une pratique courante, voire une règle, que le cabinet ne s’intéresse pas aux dossiers personnels ?
Enfin, n’avez-vous à aucun moment été amené à informer Matignon ou l’Élysée de ce dossier ?
M. Bruno Bézard. L’ancien ministre que vous êtes sera à même de juger de la pertinence des réponses que je vais faire sur le rôle d’un directeur de cabinet.
En premier lieu, je n’ai participé à aucun moment aux débats visant à savoir si M. Cahuzac devait poser la question lui-même. Il a en effet déclaré dans la presse que les informations publiées étaient mensongères et qu’il allait lui-même le démontrer en écrivant à UBS – des spécialistes du droit bancaire suisse ont d’ailleurs publié alors des tribunes indiquant comment il convenait de rédiger la question. Mes collaborateurs et moi-même ne faisons pas partie de ces spécialistes.
Il me semble cependant comprendre, en lisant la presse, qu’une telle démarche n’est pas si simple : même lorsque les faits allégués sont faux – ce qui ne semble pas être le cas ici –, il semble assez difficile pour un contribuable qui n’a pas de compte en Suisse d’en obtenir la preuve négative. Il est en tout cas bien documenté dans la presse que M. Cahuzac a déclaré à plusieurs reprises qu’il était en train de mettre en œuvre cette procédure.
M. Hervé Morin. Mais parfois aussi qu’il y était hostile.
M. Bruno Bézard. Il a en effet aussi déclaré que, pour faire une telle demande, il devrait d’abord déclarer qu’il possédait un compte avant de le démentir – c’étaient des circonvolutions logiques qui défiaient l’entendement. Mais je ne vous réponds sur ce point qu’à la lumière de ce que j’ai lu dans la presse.
Le recours au formulaire 754 dans ce cas précis s’explique par le fait que nous voulions purger la procédure interne avant d’adresser à la Suisse une demande d’assistance administrative. En outre, il était tout à fait souhaitable de consigner par écrit les interrogations de l’administration fiscale, même si la dénégation de l’existence d’un compte avait été faite devant un public infiniment plus noble qu’un modeste fonctionnaire des impôts.
Il me semble, en effet, qu’il y aura d’autres développements, car lorsque l’Assemblée nationale, le Sénat, le grand public et l’administration fiscale sauront ce qui s’est réellement passé, nous apprendrons peut-être des choses intéressantes qui nous permettront de lancer des procédures, et peut-être pas à l’encontre du seul M. Cahuzac.
Quant à M. Gonelle, que je ne connais pas, mais dont j’ai écouté l’audition avec une grande attention, il a indiqué que, selon ses informations, un inspecteur de la brigade d’intervention interrégionale (BII) de Bordeaux – structure relevant de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) –, décédé depuis lors, aurait demandé à Paris, à l’instigation de M. Gonelle et de son ami inspecteur des impôts dont il n’a pas voulu donner le nom, communication du dossier fiscal de M. Cahuzac et que cette communication lui aurait été refusée par l’administration centrale. Je n’étais évidemment pas là à l’époque, mais nos dossiers ne contiennent pas les mêmes souvenirs.
M. le président Charles de Courson. Quels souvenirs avez-vous dans vos dossiers ?
M. Bruno Bézard. Précisément l’inverse. Nos dossiers, que j’ai tous remis à la police, comprennent une fiche de prélèvement du dossier dit « 2004 » – ce qui n’est pas une date, mais l’appellation générique des dossiers des contribuables dans les centres des impôts. Le dossier était destiné à M. Mangier, l’inspecteur aujourd’hui décédé de la BII de Bordeaux. Mystérieusement, ce dossier est resté à peu près sept ans à Bordeaux, du 9 juillet 2001 au 7 février 2007.
M. le président Charles de Courson. Qu’est-ce qui a été transmis ?
M. Bruno Bézard. Pour transmettre le dossier à la police judiciaire, ce qui a été fait entre le 12 et le 14 janvier, mes collaborateurs sont allés le chercher dans les services où il se trouvait, à Paris. L’un d’entre eux, M. Gardette, que vous aurez l’occasion d’entendre, s’est étonné qu’une partie en soit restée très longtemps à Bordeaux. Je suis donc très surpris qu’on nous indique aujourd’hui que le dossier n’y est pas allé. En réalité, cela n’a aucune importance, mais je suis là pour répondre à vos questions et j’y réponds donc.
M. le président Charles de Courson. Une partie seulement du dossier a été transmise à Bordeaux. Que s’est-il passé ensuite ?
M. Bruno Bézard. Je n’en sais strictement rien. Peut-être pourriez-vous auditionner les directeurs de la DNEF de l’époque.
M. le président Charles de Courson. Nous l’avons envisagé.
M. Bruno Bézard. Je récuse l’information curieuse selon laquelle il n’aurait pas été transmis – bien sûr en sous entendant, – du fait des pressions d’un ministre de l’époque. Deuxièmement, cela n’a en réalité aucune importance. Troisièmement, d’après l’un de mes prédécesseurs, que j’ai consulté voilà deux jours, ce dossier n’aurait jamais dû être transmis, le contribuable ayant sa résidence fiscale à Paris.
Quant au rôle du directeur de cabinet, ce n’est pas à moi de répondre. Vous l’avez auditionné et vous savez très bien, monsieur Morin, comment fonctionne un cabinet. Il est classique et normal que les directeurs généraux aient un contact direct avec le ministre. Les cabinets ne sont pas là pour faire écran. J’ai eu des contacts directs avec M. Moscovici, et c’est bien normal. À d’autres moments, le directeur de cabinet était là, certes un peu par le hasard de l’agenda. Il serait injuste à son égard de dire qu’il n’a rien fait.
M. Hervé Morin. Il n’a pas fait grand-chose.
M. Bruno Bézard. Il vous a expliqué son attitude – mais ce n’est pas à moi de répondre à ces questions.
Enfin, je n’ai eu aucun contact avec Matignon ni avec l’Élysée sur ce dossier.
Mme Cécile Untermaier. Merci aux intervenants pour la clarté de leurs propos.
Au terme du délai de trente jours laissé pour répondre au formulaire 754, l’absence de réponse est-elle réputée signifier que le contribuable concerné n’a pas de compte en Suisse ? Alors que la réponse des autorités suisses a été obtenue très rapidement, comment expliquer que l’on ait attendu ces trente jours avant de les interroger ? Est-ce lié au délai de retour du formulaire ? Avez-vous évoqué avec votre entourage ou avec le ministre cette absence de réponse ?
En deuxième lieu, après avoir reçu une réponse négative à propos d’UBS, est-ce parce que l’affaire est entre les mains de la justice que vous n’envisagez pas d’interroger à nouveau les autorités suisses, cette fois sur la banque Reyl ?
M. Bruno Bézard. En droit fiscal, le fait qu’une non-réponse vaut confirmation d’un fait doit être spécifié par écrit. Si ce n’est pas écrit, ce n’est pas le cas. Le formulaire 754, qui n’appelait pas de réponse binaire puisqu’il demandait simplement des indications sur des comptes détenus en Suisse, accordait pour cette réponse un délai non contraignant de trente jours – le tout assorti de la mention « si possible ». Il n’indiquait nullement qu’à l’expiration du délai, le contribuable serait réputé détenir un compte qui ferait l’objet d’une taxation d’office.
Mme Cécile Untermaier. Ce n’est pas ce que j’imaginais, mais comment interprétez-vous ce silence ? En tant que contribuable, je veille à renvoyer sans tarder à l’administration ses demandes d’information, en biffant au besoin les questions qui n’ont pas d’objet.
M. le président Charles de Courson. Le fait que M. Cahuzac ne réponde pas au bout d’un mois ne vous a-t-il pas inquiété ?
M. Bruno Bézard. Bien sûr que non, car il a répondu dès le lendemain à l’Assemblée nationale en déclarant qu’il n’avait pas de compte. Nous n’avons engagé cette procédure que pour apurer les procédures internes.
Mme Cécile Untermaier. On aurait tout de même pu penser que M. Cahuzac répondrait au formulaire avant trente jours.
M. Bruno Bézard. S’il avait répondu « non », j’aurais quand même fait la demande d’assistance administrative, car je ne l’aurais pas cru.
Quant à votre deuxième question, dès lors qu’une information judiciaire a été ouverte – indépendamment même de la démission du ministre –, nous ne relançons pas la mécanique de la demande d’assistance internationale, mais je vous invite à reprendre les articles de presse pour voir à quel moment ils mentionnent la banque Reyl. Je souligne cependant, sans pouvoir être beaucoup plus précis – sinon à l’égard du rapporteur –, que, dans le déroulement des investigations judiciaires en cours depuis les « aveux » de M. Cahuzac, le 2 avril, l’administration fiscale n’est pas restée inactive.
M. le président Charles de Courson. C’est un peu contradictoire avec ce que vous avez déclaré tout à l’heure lorsque nous vous interrogions sur l’articulation entre la procédure administrative et fiscale et la procédure judiciaire.
M. Bruno Bézard. Permettez-moi de revenir sur ce point, car il n’y aucune contradiction. Vous avez demandé s’il était possible de mener des procédures d’assistance administrative lorsque la justice s’était saisie. Je vous ai dit que nous l’avions fait alors qu’une enquête préliminaire était lancée. Je vous ai dit aussi que, dans certains cas de figure, à l’étape suivante, lorsque des juges sont nommés, nous le faisons à leur demande.
Nous n’avons pas considéré, et je l’assume parfaitement, qu’il fallait faire des enquêtes parallèles et que, dès lors que nous entrions dans une phase lourde d’investigations judiciaires, l’administration fiscale, à qui on aurait reproché de chercher à sauver le soldat – ou le « général », selon votre mot – Cahuzac, pouvait se livrer à ce type d’investigations.
Mme Cécile Untermaier. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le directeur général, de nature à dissiper les accusations de passivité qui auraient pu être adressées à l’administration.
M. Bruno Bézard. Si nous avons été passifs, il faut m’expliquer ce que ce serait que d’être actifs !
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Lorsque M. Gonelle a été en possession de l’enregistrement, il pouvait saisir les médias ou agir conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. Il a préféré utiliser son entourage – en l’espèce, un ami fonctionnaire des impôts dont il ne déclare pas le nom – et solliciter la DNEF de Bordeaux.
Vous avez rappelé que vous êtes à la tête d’une très grosse administration, qui emploie 115 000 agents. Que pensez-vous de l’attitude du fonctionnaire ami de M. Gonelle, qui a utilisé une information de manière informelle sans appliquer l’article 40 ? Y a-t-il une trace quelconque d’une note administrative adressée à sa hiérarchie pour l’informer qu’il avait été saisi d’un enregistrement curieux, puisque, selon M. Gonelle, il en aurait pris connaissance ? Comment une administration qui cultive une certaine rectitude, comme vous nous l’avez dit, peut-elle ne pas garder trace d’un élément qui peut se révéler assez grave ?
M. Bruno Bézard. Je n’ai jamais dit que l’administration ne gardait pas trace de quoi que ce soit et il se trouve que, dans la tradition républicaine, quand un gouvernement change, le cabinet change aussi : je puis vous confirmer qu’en arrivant, on trouve un bureau vide. L’administration, en revanche, s’efforce d’assurer la continuité républicaine.
Je ne dispose pas d’éléments suffisants sur les propos de M. Gonelle – je n’étais pas là à l’époque – pour savoir ce qui s’est exactement passé. Je suis un peu surpris – peut-être certains membres de la commission d’enquête le sont-ils également – du caractère informel que donnent à cette affaire les connivences locales. Ce n’est pas ainsi que l’on travaille habituellement dans l’administration. Ces procédures sont un peu bizarres. Quand un inspecteur des impôts veut programmer un contrôle fiscal, il doit utiliser une fiche « 3909 » : on ne décide pas d’un contrôle fiscal parce que la tête d’un restaurateur ne vous revient pas, mais on suit une procédure traçable. Ainsi, lorsqu’un inspecteur des finances publiques propose la vérification d’une entreprise ou d’un particulier et que sa hiérarchie la refuse, cela laisse une trace.
L’affaire que nous évoquons ne se situe manifestement pas dans ce cadre. Même si je n’ai pas examiné toutes les archives de mon administration, on ne m’a pas signalé de note à ce propos. Il est un peu étrange, je le rappelle, qu’on nous dise que le dossier n’a pas été transféré à Bordeaux et que l’inverse soit attesté – je rappelle également la surprise de M. Gardette en le découvrant.
M. Christian Assaf. Il ne faut pas négliger cette information, qui est en effet l’argument majeur en faveur d’un dysfonctionnement supposé qui incriminerait votre administration depuis 2001. Faisons toute la lumière sur la forme sous laquelle l’administration régionale a été saisie et a saisi l’administration nationale pour récupérer le dossier, ainsi que sur les raisons pour lesquelles ce dernier est resté sept ans à Bordeaux. Cette déclaration un peu floue laisse penser que votre administration aurait été détentrice de cette information, et l’aurait cachée, depuis 2001.
M. Bruno Bézard. Je vous remercie de poser cette question. Je n’étais pas là à l’époque : j’ai pris mes fonctions le 5 août dernier. Cependant, l’administration n’a rien caché à personne et n’a empêché personne de faire des enquêtes dans les domaines de compétence respectifs de chacun. L’administration fiscale n’est pas un ensemble d’individus qui ont le droit d’aller regarder dans les dossiers fiscaux des parlementaires locaux. Il y a des procédures.
M. le président Charles de Courson. Plusieurs collègues ont réagi à une information que vous nous avez donnée en se demandant pourquoi une partie du dossier de M. Cahuzac avait été transférée à la direction régionale de Bordeaux, où elle est restée des années sans que personne s’en préoccupe. C’est là un point que nous aurons à éclaircir. Le rapporteur et moi-même avions prévu d’auditionner le directeur régional. Il est hélas décédé, mais nous pourrons entendre ses collaborateurs. Peut-être pourrez-vous nous aider dans cette enquête.
M. Bruno Bézard. Deux précisions. Tout d’abord, la question qui m’a été posée aujourd’hui n’était pas de savoir pourquoi le dossier avait été transféré à Bordeaux, mais pourquoi il ne l’avait pas été. Or, à ma connaissance, il l’a été.
M. le président Charles de Courson. En partie.
M. Bruno Bézard. J’ignore si c’est en partie ou en totalité.
Quant à savoir s’il y a un dysfonctionnement derrière tout cela… La question des transferts et des dates n’a pas une très grande importance, car ce n’est pas ainsi que fonctionne le contrôle fiscal dans notre pays.
M. Étienne Blanc. Au cœur de ce dossier se trouve la convention de 1966 qui, si elle ne donne pas satisfaction à la France, s’explique bien quand on connaît le droit suisse et l’importance donnée dans ce pays à la protection des libertés individuelles, à travers la protection du patrimoine – d’où le fait que le secret bancaire y soit protégé constitutionnellement.
Il est difficile d’obtenir des renseignements de la part de la Suisse, mais tout est plus rapide dès que l’affaire devient pénale et qu’une enquête préliminaire est ouverte, surtout si la personne concernée est un ministre important de la République et que circulent des informations selon lesquelles son compte aurait été alimenté dans des conditions méritant enquête. Dès lors, n’avez-vous pas le sentiment qu’on a tardé à lancer une procédure dans le cadre pénal ? N’aurait-on pu, en agissant beaucoup plus tôt de la sorte, éviter à la République un scandale majeur ?
M. Bruno Bézard. La mise en œuvre de l’action pénale n’est pas de mon ressort, mais je puis vous répondre que nous ne pouvons diligenter des poursuites pénales qu’après avoir mené des contrôles sur place. Si respectable que soit le journal concerné, un article de presse ne suffit pas. Nous procédons préalablement à un contrôle approfondi et totalement contradictoire sur le contribuable – examen de situation fiscale personnelle (ESFP) pour un particulier ou vérification de comptabilité pour une entreprise – et diligentons une action pénale si les faits sont suffisamment graves, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales qui doit rendre un avis conforme. Nous ne pouvions absolument pas diligenter d’action pénale dans ce cas, mais nous avons fait ce que nous pouvions faire, et ce le plus vite possible. Après nous avoir reproché d’avoir été trop lents, on nous reproche maintenant d’avoir été trop rapides.
En réalité, nous avons fait très vite : l’article a été publié le 4 décembre et, le 1er février, j’avais la réponse de la Suisse sur une interrogation plus large que dans aucun autre dossier d’assistance administrative dans notre histoire. Nous sommes donc allés le plus vite et le plus en profondeur possible, et cela avec beaucoup de rigueur. Je crois vraiment qu’aucune administration en France n’a été aussi rapide et proactive.
M. Émeric Bréhier. Je vous remercie d’avoir répondu avec autant de patience et de diligence.
À vous écouter, vous n’avez lancé la procédure du formulaire 754 – dont finalement peu vous importait la réponse – que pour être en mesure, au terme du délai de trente jours, de montrer à l’administration suisse que l’administration fiscale française avait satisfait à l’ensemble des procédures prévues par la convention et précisées par l’échange de lettres de février 2010, se trouvant ainsi en droit d’engager une démarche de demande d’assistance. On a donc le sentiment que, dès le 14 décembre, le formulaire 754 a pour seul but de conduire à cette demande.
D’autre part, les informations dont vous nous faites part quant au transfert à Bordeaux du dossier fiscal de M. Cahuzac viennent semer quelque doute sur la sincérité des déclarations faites la semaine dernière par le témoin Gonelle.
M. Bruno Bézard. Les documents qu’on m’a donnés semblent montrer qu’il a été procédé à un prélèvement du dossier aux dates que je vous ai indiquées. Nous avons transmis ces documents à la police : ce n’est pas à moi d’effectuer les vérifications nécessaires et je ne puis donc être formel. M. Gardette pourra vous confirmer que, lorsque nous avons regardé ce dossier pour le donner à la police, ce transfert et sa durée l’ont surpris.
Vous avez assez bien résumé le rôle de la procédure du formulaire 754 et je suis surpris de l’importance technique et politique qu’on veut lui donner – le politique n’est pas mon champ d’action et l’absence de réponse au bout de 30 jours n’a aucune importance sur le plan technique. J’ajoute à votre résumé que j’ai voulu formaliser les choses. Le contribuable concerné nous disant face à face qu’il n’avait pas de compte à l’étranger et n’en avait jamais eu, il m’a semblé souhaitable qu’il puisse aussi nous l’écrire – en lui demandant, je le répète, non pas de confirmer qu’il n’avait pas de compte, mais de nous indiquer quels étaient ses avoirs en Suisse, ce qui n’est pas du tout la même chose.
M. le président Charles de Courson. En informant M. Moscovici d’une saisine administrative des autorités fiscales suisses, lui avez-vous également indiqué que son collègue Jérôme Cahuzac n’avait pas répondu au 754 ?
M. Bruno Bézard. On m’a posé trois fois cette question aujourd’hui. Je vous le répète : non.
M. le président Charles de Courson. Il est très étrange de ne pas informer son ministre.
M. Bruno Bézard. Puisque vous semblez accorder une importance particulière à cette question, permettez-moi d’y répondre plus longuement. L’administration fiscale n’a pas à rendre compte à son ministre de l’ensemble des étapes de la procédure qu’elle mène à propos d’un contribuable – et c’est heureux.
M. le président Charles de Courson. Vous avez tout de même un devoir de loyauté à l’égard du ministre.
M. Bruno Bézard. Ce devoir ne signifie pas qu’il faille l’informer à chaque étape de la procédure.
M. le président Charles de Courson. Trois fois on vous pose la question, et trois fois vous répondez que vous n’avez rien dit au ministre.
M. Bruno Bézard. Trois fois, je vous réponds la vérité. Lisez la circulaire signée de M. Baroin qui précise comment l’administration fiscale s’organise sur les dossiers internes. Fort heureusement, je n’ai pas besoin d’aller demander au ministre ce qu’il pense de l’idée d’envoyer un formulaire 754, ni de l’informer que ce formulaire n’est pas revenu.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas la question qui vous est posée. Vous n’informez donc pas votre ministre au terme du délai d’un mois ?
M. Bruno Bézard. Voilà une heure que je vous explique que ce délai d’un mois n’a aucune importance.
M. le président Charles de Courson. Monsieur le directeur général, je vous remercie. Si nous avons des questions complémentaires, en particulier sur le point que vous venez d’évoquer, nous vous les ferons parvenir par écrit.
Audition du mardi 28 mai 2013
À 16 heures 15 : M. Philippe Parini, directeur régional des finances publiques Île-de-France et Paris (DRFIP), Mme Janine Pécha, administratrice générale des finances publiques, responsable du pôle fiscal Paris sud-ouest, MM. André Bonnal, administrateur des finances publiques, adjoint de la responsable, et Pascal Pavy, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de division.
M. le président Charles de Courson. Nous reprenons le fil de nos auditions et nous recevons aujourd’hui plusieurs hauts fonctionnaires des finances.
Je rappelle que cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de l’affaire Cahuzac. À ce titre, les modalités de l’examen de la situation fiscale de M. Cahuzac après sa nomination au Gouvernement nous intéressent particulièrement. Il en va de même des conditions dans lesquelles la direction régionale des finances publiques Paris Île-de-France a été amenée, au cours de l’automne, à demander au ministre du budget, ainsi qu’à son expert-comptable, des éclaircissements sur l’évaluation de son patrimoine taxable à l’impôt sur la fortune.
Avant d’aller plus loin, il me revient de rappeler que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Parini, Mme Pécha, M. Bonnal et M. Pavy prêtent successivement serment.)
M. le président Charles de Courson. Je vous laisse la parole pour une courte introduction. M. le rapporteur vous interrogera ensuite, puis les autres commissaires.
M. Philippe Parini, directeur régional des finances publiques Île-de-France et Paris. Je serai bref, puisque le directeur général des finances publiques vous a déjà expliqué l’organisation du contrôle fiscal des ministres effectué lors de l’installation d’un nouveau gouvernement. Mes collègues, et en particulier Mme Pécha, pourront vous décrire plus précisément la procédure.
C’est à partir de juin 2012, alors que je ne suis pas encore à sa tête, que la direction régionale d’Île-de-France et de Paris – comme d’ailleurs les autres directions départementales éventuellement concernées – s’est vu demander par l’administration centrale du contrôle fiscal de préparer, pour les contribuables relevant de sa zone de compétence, ce que nous appelons les « fiches ministres ». L’examen du dossier correspondant au foyer fiscal Cahuzac s’inscrit donc dans ce cadre. Les fiches seront ensuite transmises à l’administration centrale du contrôle fiscal puis au directeur général des finances publiques.
Ce que réalise alors la DRFIP, c’est un examen sur pièces, « du bureau », à partir des éléments dont elle dispose. Cela consiste à décrire une situation fiscale, à noter un certain nombre d’observations, et le cas échéant à indiquer les questions qui pourraient se poser.
Vient ensuite, pour M. Cahuzac comme pour tous les membres du Gouvernement concernés, une seconde phase, marquée par un échange, sur initiative du contribuable, entre ce dernier et l’administration fiscale de proximité – en l’occurrence, la direction départementale des finances publiques. Cette phase s’étale sur le dernier trimestre de l’année 2012. Bien entendu, nous pourrons vous indiquer des dates plus précises si vous le souhaitez.
Même si, comme vous l’avez vous-même noté lors d’une autre audition, monsieur le président, tous les fonctionnaires présents sont soumis au secret professionnel, les pièces du dossier sont à la disposition de votre rapporteur, et nous pourrons répondre, de manière non publique, à d’éventuelles questions couvertes par ce secret.
En quoi consiste le contrôle fiscal exercé sur les membres du Gouvernement ? Il ne s’apparente pas à l’ESFP – examen de la situation fiscale personnelle –, qui est un contrôle approfondi dont l’administration fiscale, lorsqu’elle a des doutes ou des soupçons, prend l’initiative afin d’obtenir du contribuable les renseignements dont elle a besoin. Le contrôle effectué sur les ministres n’est d’ailleurs pas prévu par des textes. C’est une pratique progressivement construite par l’administration dans le but de veiller à ce que les membres d’un gouvernement soient, du point de vue fiscal, dans une situation d’exemplarité. Elle consiste à rassembler les éléments d’information dont dispose l’administration et à poser au contribuable concerné des questions de toute nature.
J’en viens à l’organisation de la procédure. L’ensemble de la démarche est coordonné, piloté par l’administration centrale du contrôle fiscal : c’est elle qui déclenche le processus, qui demande de préparer les fiches, qui centralise ces dernières et qui s’informe régulièrement de l’avancée des opérations. Mais c’est le service de base, c’est-à-dire la direction départementale, qui instruit le dossier. Dans un certain nombre de cas, l’administration centrale peut décider que tel aspect du dossier devra faire l’objet d’une action particulière. C’est ce qui s’est passé pour le dossier fiscal en cause, de manière tout à fait normale.
D’une manière générale, lors de la gestion de ce dossier comme des autres dossiers ministres relevant de la direction départementale, je n’ai observé aucune situation anormale qu’il s’agisse du déroulement des opérations, des orientations données par l’administration centrale ou de la façon dont les services ont exercé leur mission.
Mme Janine Pécha, administratrice générale des finances publiques, responsable du pôle fiscal Paris Sud-Ouest. Permettez-moi de décrire la méthode employée pour l’examen des dossiers des ministres, afin de vous donner une idée du type de recherches que nous sommes amenés à faire.
Nous avons d’abord reçu une note de l’administration centrale accompagnée d’une liste des membres du Gouvernement résidant dans la circonscription dont le pôle fiscal Paris sud-ouest a la responsabilité.
Elle nous chargeait d’effectuer un contrôle sur les années non prescrites, tant en matière d’impôt sur le revenu que d’impôt sur la fortune. Dans de tels cas, nous examinons d’abord la situation déclarative, c’est-à-dire que nous vérifions que toutes les déclarations ont été effectuées sur la période non prescrite. De même, nous prenons en compte la taxe d’habitation et la taxe foncière dont sont redevables les contribuables concernés, y compris, le cas échéant, pour des résidences secondaires. Depuis la fusion entre le Trésor et les impôts, nous sommes également en mesure de vérifier rapidement la situation en matière de recouvrement : nous nous assurons ainsi que les échéances fiscales ont été respectées, et qu’il ne reste pas à recouvrer tel ou tel impôt.
Il s’agit là d’un contrôle sur pièces, approfondi, permettant d’apprécier la situation globale du contribuable. « Sur pièces » signifie que nous travaillons à partir des éléments connus de l’administration, tels que les bulletins de recoupement, les actes de vente ou d’acquisition, les courriers dans lesquels le contribuable a pu justifier son interprétation d’une disposition fiscale, etc. En matière d’impôt sur la fortune, nous comparons l’évaluation de la valeur des biens immobiliers avec les chiffres dont nous disposons. Plus généralement, nous vérifions la cohérence entre les revenus et le patrimoine. Pendant cette phase, nous n’avons aucun contact, oral ou écrit, avec les intéressés.
À l’issue de ces travaux, nous établissons, dans les délais serrés qui nous sont assignés, une fiche de synthèse que nous transmettons à l’administration centrale, incluant nos axes de questionnement. Nous examinons avec elle les réponses données à ces questions.
Puis l’administration centrale peut nous demander de procéder à la régularisation du dossier en liaison avec le ministre concerné. Au niveau local, cette régularisation est utile parce qu’elle nous permet de donner des précisions sur les dates de mise en recouvrement, des explications sur les pénalités que nous sommes éventuellement conduits à appliquer, etc. À l’issue de ce traitement, nous informons l’administration centrale que le dossier a été régularisé conformément aux directives que nous avons reçues. Il y a donc un échange permanent entre les deux échelons.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez été directeur général des finances publiques du 9 avril 2008 au 5 août 2012. Avez-vous eu connaissance, dans le cadre de vos fonctions, d’un rapport rédigé par Rémy Garnier ?
M. Philippe Parini. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc pas été amené à transmettre ce rapport à votre successeur.
M. Philippe Parini. Pour être plus précis, durant l’été 2008, peu de temps après mon arrivée, j’ai été informé par mon directeur adjoint, en charge des ressources humaines, qu’une procédure disciplinaire avait été engagée par mon prédécesseur à l’égard d’un agent et qu’elle devait être confirmée. À cette occasion, j’ai pris connaissance d’une note destinée à cet adjoint, laquelle n’évoquait que le niveau de la sanction à prendre – blâme, avertissement, etc. La demande de sanction avait d’abord été formulée par le responsable régional, puis transmise à la Direction générale des impôts, qui l’avait validée. Mon prédécesseur l’avait confirmée. Il convient de rappeler que nous procédions à l’époque à la fusion du Trésor public et des impôts. Une des préoccupations était donc d’harmoniser les règles propres aux deux administrations, qui étaient différentes dans presque tous les domaines. Cela explique que des questions de principe se soient posées à cette occasion, alors qu’en temps normal, un dossier de ce type ne remonte pas jusqu’au directeur général.
La note faisait mention d’un mémoire en défense présenté par l’agent mis en cause. Elle indiquait également les raisons de la procédure disciplinaire : il avait consulté de manière anormale les dossiers d’un certain nombre de responsables ainsi que le dossier fiscal d’un élu local. C’est tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’y avait pas de nom ?
M. Philippe Parini. Aucun nom ne figurait dans la note qui m’a été transmise. On ne parlait que de la consultation des dossiers de supérieurs hiérarchiques et de celui d’un élu local, député de la circonscription. Surtout, aucune allusion n’était faite au contenu du mémoire présenté par l’agent mis en cause. Je ne savais donc pas que ce dernier y dénonçait une fraude fiscale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’aviez donc pas connaissance de l’accusation portée au sujet de M. Cahuzac ? Vous ne pouviez donc transmettre à votre successeur, Bruno Bezard, aucune information spécifique ?
M. Philippe Parini. En effet. Je n’avais pas connaissance de cette accusation. Je n’ai donc ni agi, ni transmis d’information à M. Bezard. La même réponse vaut d’ailleurs pour les ministres qui se sont succédé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque vous avez quitté vos fonctions de directeur général des finances publiques, le 5 août 2012, aviez-vous reçu toutes les fiches ministres ?
M. Philippe Parini. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre successeur en a donc eu connaissance.
M. Philippe Parini. En effet. Je parle de mémoire, n’ayant plus accès aux différentes pièces constituées à l’époque.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais quand vous étiez encore directeur général, vous avez eu connaissance du résultat de l’examen de la situation fiscale des ministres.
M. Philippe Parini. Bien sûr. D’ailleurs, par exemple, Mme Pécha a reçu, pour Paris, du service central du contrôle fiscal l’instruction de les faire préparer puis remonter. J’ai reçu la totalité des fiches ministres, et je les ai transmises au ministre du budget, afin qu’il en informe les membres du Gouvernement et que le processus soit engagé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je vais faire appel à votre mémoire. Avez-vous été amené, en tant que directeur général, à faire jouer la procédure 754, c’est-à-dire à demander à un contribuable de préciser les avoirs qu’il détient à l’étranger ? Quelle est, selon vous, la valeur juridique de ce document : est-il contraignant ?
M. Philippe Parini. Je n’ai pas le souvenir d’avoir signé une telle demande.
Mme Janine Pécha. Je le confirme.
M. Philippe Parini. Cela étant, il s’agit d’une procédure classique. Une telle demande, lorsqu’elle est formulée, prévoit un délai pour la réponse, mais celui-ci n’a pas un caractère contraignant.
Mme Janine Pécha. La procédure 754 ne concerne pas uniquement la recherche de comptes bancaires à l’étranger. C’est une demande de renseignements, qu’il convient de distinguer de la demande de justification. La seconde est contraignante ; la première ne l’est pas.
Une demande de renseignements ne peut être adressée que par le gestionnaire du dossier. Celle qui a été envoyée par le pôle fiscal Paris sud-ouest a été signée par M. Pavy, mais rédigée, dans ce cas particulier, par l’administration centrale. Nous étions en effet dans un contexte où la presse s’était fait l’écho de l’existence de comptes à l’étranger. L’administration centrale a donc estimé qu’il fallait en demander confirmation, connaître leur numéro ainsi que le montant des sommes qui y étaient éventuellement placées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Une telle démarche était-elle un préalable nécessaire pour demander l’assistance administrative de la Suisse ?
Mme Janine Pécha. L’assistance administrative internationale est demandée par l’administration centrale et non par les services locaux. Nous n’en connaissons donc pas les modalités. Si nous avons un doute, nous devons nous adresser au bureau CF 3 de Bercy, celui des affaires internationales. Mais une telle procédure n’est pas courante, d’autant qu’en application des conventions fiscales, une demande d’assistance internationale ne peut être formulée que si toutes les recherches nécessaires ont été faites au niveau local.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Parini, en tant que directeur général des finances publiques, vous avez été associé à la rédaction de l’avenant à la convention fiscale franco-suisse. Quelle est votre interprétation de cet avenant ?
M. Philippe Parini. J’y ai été associé, en effet, mais pour l’essentiel, ce document a été élaboré par la direction de la législation fiscale et mes collaborateurs du service du contrôle fiscal.
Pouvez-vous me préciser le sens de votre question ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Pensez-vous que cet avenant apportait un surcroît de contrainte par rapport à l’état antérieur du droit, ou était-il au contraire moins contraignant ? Nous avons eu, ce matin, un débat sur la nature des informations que la France était en droit de demander à l’administration suisse.
M. le président Charles de Courson. M. le rapporteur évoque plus précisément l’échange de lettres entre les deux administrations fiscales qui faisait suite à la conclusion de l’accord franco-helvétique et en précisait l’interprétation.
M. Alain Claeys. Cet échange date de février 2010.
M. Philippe Parini. Il faudrait que je relise ces documents.
La problématique, à l’époque, était d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale, notamment dans le contexte de l’exploitation des fichiers HSBC. L’objectif des ministres et de l’administration était d’obtenir de la part des autorités suisses des renseignements utilisables sans être astreints à d’excessives contraintes. De fait, grâce au nouveau dispositif, il a été possible d’interroger plus facilement l’administration helvétique. Cela étant, je me souviens avoir fait, avant de quitter mes fonctions, un premier bilan de l’application de l’accord avec le directeur de la fiscalité : nous n’avions pas de réponses à la totalité des questions posées, et il fallait donc continuer à travailler sur le sujet afin d’améliorer la lutte contre la fraude.
M. Alain Claeys, rapporteur. Merci beaucoup. Je serai amené, en tant que rapporteur, à vous poser des questions plus précises sur la situation fiscale de M. Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Vous avez dit que l’ensemble des « fiches ministres » étaient transmises au ministre délégué au budget – M. Cahuzac, en l’occurrence. Celui-ci ne pouvait pourtant pas être à la fois juge et partie. Même si la procédure n’a pas de base législative, l’usage n’aurait-il pas dû prévoir que le ministre de l’économie, et non le ministre délégué, examine la fiche de ce dernier ?
Plus généralement, quelle suite est donnée à l’élaboration de ces fiches ?
M. Philippe Parini. Comme vous l’avez rappelé, il n’existe pas de réglementation sur le sujet. Pour ma part, c’était la première fois que j’étais confronté à l’exercice, car je n’étais pas directeur des finances publiques en 2007. Mon premier réflexe a donc été d’informer les ministres de l’existence de cette procédure et de demander des instructions. On ne peut en effet prendre seul, dans son coin, l’initiative d’examiner la situation fiscale des membres d’un gouvernement ! J’ai donc rédigé une première note, après quoi j’ai attiré l’attention de mon ministre de tutelle, le ministre du budget, en lui demandant de prendre position sur cette question. M. Cahuzac m’a ensuite appelé pour me demander d’engager la procédure et de lui adresser le jeu de fiches dès qu’il serait prêt.
M. le président Charles de Courson. Cela se passait quand ?
M. Philippe Parini. Au mois de juin. Aussitôt que le ministre m’a donné cette instruction, j’ai demandé à mes collaborateurs du contrôle fiscal de les répercuter dans les services locaux. Lorsque j’ai obtenu la totalité des fiches, je les ai apportées au ministre délégué.
M. le président Charles de Courson. Quand ?
M. Philippe Parini. Vers le 23 ou le 24 juillet.
M. le président Charles de Courson. Il y avait donc 38 fiches.
M. Philippe Parini. J’ai remis au ministre le jeu de fiches sans leur apporter la moindre modification. L’idée sous-jacente, en confiant l’instruction aux services de base, était d’apporter une garantie de professionnalisme : il s’agit, si j’ose dire, de « leurs » contribuables, et ils avaient l’habitude de ces dossiers.
J’ai donc remis les documents au ministre sans faire de commentaire particulier, mais en lui rappelant qu’il devait informer les autres membres du Gouvernement de l’existence de cette procédure, afin que ces derniers se rapprochent de l’administration fiscale. Très peu de temps après, je n’étais plus en fonction, et on entrait dans une autre phase, celle de la mise en œuvre, par les services, du traitement du dossier de chacun des ministres.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette phase a été lancée à la suite d’une instruction de la direction générale.
M. Philippe Parini. En effet.
M. le président Charles de Courson. A-t-elle été donnée par le ministre ou par le directeur général des finances publiques ?
M. Philippe Parini. Le ministre a donné pour instruction de mettre en œuvre la procédure.
Après l’installation du nouveau gouvernement, j’ai adressé au ministre une première note indiquant la procédure prévue et demandant l’autorisation de l’engager. En réponse, M. Cahuzac m’a donné oralement l’instruction de demander aux services locaux de préparer les fiches, et de les lui apporter quand elles seraient prêtes, à la fin du mois de juillet, lui-même se chargeant d’en assurer la diffusion auprès des membres du gouvernement.
La note à laquelle Mme Pécha a fait allusion date de la mi-juin, lorsque, suivant l’instruction du ministre, j’ai demandé aux services locaux de préparer les fiches.
M. le président Charles de Courson. Il a donc fallu environ six semaines pour que les 38 fiches soient adressées par les services locaux à leur directeur central.
M. Philippe Parini. En vérité, on leur laisse moins de temps que cela : le ministre avait imposé un délai court, dans la mesure où les vacances se profilaient.
M. le président Charles de Courson. À quoi servent ces fiches ? Vous nous avez dit que le ministre du budget, après les avoir reçues, les transmettait à chacun des ministres. Et ensuite ?
M. Philippe Parini. Rappelons d’abord que l’administration fiscale détient aussi l’information : le dossier est détenu par le service central du contrôle fiscal et par chacune des directions départementales concernées. Des interrogations sont formulées, portant parfois sur des choses très modestes, d’autres fois sur des éléments plus importants. Il appartenait donc au ministre non seulement de transmettre à chacun de ses collègues la fiche correspondante, mais aussi de leur demander de prendre contact avec leur administration de proximité afin d’apporter des réponses aux questions posées.
Les services de base traitent les dossiers, et de façon régulière, l’administration centrale s’enquiert de l’avancée de la procédure. Si les choses durent exagérément, le service local doit demander de procéder aux régularisations.
M. le président Charles de Courson. Mais cela ne remontait pas à la direction générale ?
M. Philippe Parini. Si. S’agissant de la situation fiscale des ministres, l’administration centrale était nécessairement informée de façon régulière de l’état d’avancement des dossiers.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous confirmer, Monsieur Bonnal, qu’une réunion concernant le dossier Cahuzac a eu lieu le 19 décembre 2012, en présence de son expert-comptable ?
M. André Bonnal, administrateur des finances publiques, adjoint de la responsable du pôle Paris Sud-Ouest. Je le confirme.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’était une conséquence de la transmission par le directeur général au ministre de l’ensemble des fiches ministres.
M. André Bonnal. Des échanges ont eu lieu entre juillet et novembre. Et en décembre, une réunion a été organisée pour régler les derniers problèmes en suspens.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je vous demanderai de me fournir les détails de la procédure.
M. le président Charles de Courson. Nous en venons aux questions des députés.
M. Gérald Darmanin. Monsieur le directeur, depuis les révélations de Mediapart, le 4 décembre 2012, avez-vous eu un contact, oral ou écrit, avec un membre du cabinet de M. Moscovici ou de M. Cahuzac ?
M. Philippe Parini. Pas sur le sujet qui nous occupe.
M. Gérald Darmanin. Quelles sont vos relations avec l’administration des douanes ? Lors de la première journée d’auditions, on nous a dit qu’un de ses responsables, M. Picart, était informé de ce que l’on reprochait à M. Cahuzac.
Or, j’ai cru comprendre que la douane et les services fiscaux étaient amenés à échanger certains renseignements. Avez-vous été destinataire d’un signalement adressé par les douanes en rapport avec l’affaire Cahuzac ? Pouvez-vous nous éclairer, à partir de votre expérience, sur les raisons qui conduisent l’administration fiscale à donner ou non suite à un signalement de la douane ?
M. Philippe Parini. Je n’ai jamais été informé de cela, ni en tant que directeur général, ni en tant que directeur régional.
Mme Janine Pécha. Nous n’avons en effet obtenu aucun élément de la part de la douane.
M. le président Charles de Courson. Par ailleurs, ni vous, ni M. Bonnal ou M. Pavy n’avez eu connaissance de la note du 11 juin 2008 rédigée dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre Rémy Garnier, et dans laquelle ce dernier portait un certain nombre d’accusations à l’encontre de Jérôme Cahuzac ?
Mme Janine Pécha. Non. Nous n’avions d’ailleurs aucune raison de connaître un document – en l’occurrence, un mémoire présenté devant le tribunal administratif – élaboré dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée dans une autre direction territoriale. Cette information ne pouvait que remonter vers les services de ressources humaines de l’administration centrale.
M. le président Charles de Courson. L’actuel directeur général des finances publiques nous a dit ce matin qu’une partie du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac avait été envoyée à Bordeaux, où elle est restée entre 2001 et 2007. Le saviez-vous ?
Mme Janine Pécha. Oui. M. Cahuzac étant domicilié dans le 7è arrondissement de Paris, nous détenons son dossier fiscal personnel. Dans ce dossier, que l’on appelle le n° 2004, est insérée une fiche indiquant tous les mouvements qu’il a pu connaître. Lorsque nous avons communiqué le dossier aux autorités judiciaires, nous avons en effet constaté qu’il avait été, à une certaine époque, transféré à la brigade interrégionale d’intervention – BII – de Bordeaux. À la réflexion, cela n’avait rien de surprenant : la BII est un service déconcentré de la Direction nationale des enquêtes fiscales – DNEF –, chargé d’effectuer des recherches et d’évaluer l’opportunité, sur certains dossiers, de programmer une opération de contrôle fiscal. Il n’a donc rien d’inhabituel à ce qu’elle nous réclame la communication d’un dossier. Dans une telle hypothèse, nous remplaçons ce dernier par une « fiche verte » afin de garder une trace du transfert. Les déclarations parvenant après la date de transmission du dossier sont agrafées à cette fiche, si bien que le dossier est peu à peu reconstitué.
Le fait que l’antenne de Bordeaux ait conservé le dossier pendant une longue durée n’était pas très gênant pour nous, gestionnaire principal. Cela ne l’aurait été que si nous avions eu besoin de rechercher des pièces plus anciennes, pour des besoins de contrôle. Dans ce cas, la fiche verte nous aurait permis de savoir que le dossier était détenu par la BII. Il se trouve que nous n’en avons pas eu besoin, dans la mesure où nous assurions la gestion année par année.
M. le président Charles de Courson. Saviez-vous pour quelle raison la BII avait demandé ce dossier ?
Mme Janine Pécha. Non.
M. le président Charles de Courson. Ni pourquoi elle l’a conservé pendant six ans ?
Mme Janine Pécha. Cela ne signifie pas qu’elle l’a examiné pendant tout ce temps. On peut supposer que ses fonctionnaires ont oublié qu’ils détenaient ce dossier.
M. le président Charles de Courson. Les bureaux interrégionaux n’ont donc pas besoin de justifier leurs demandes de communication d’un dossier ?
Mme Janine Pécha. Non.
M. le président Charles de Courson. Et vous n’avez pas le droit d’en réclamer les motifs ?
Mme Janine Pécha. Non, d’autant qu’à ce moment, le dossier de M. Cahuzac ne faisait pas l’objet d’une attention particulière : il ne se trouvait pas en direction centrale, mais dans un centre des impôts – aujourd’hui centre des finances publiques. Or, un tel service n’a pas vocation à demander à un service de contrôle sur quel fondement ce dernier lui réclame un dossier. En revanche, un tel envoi est effectué en recommandé, afin d’être certain de l’identité du destinataire et d’éviter tout risque de perte.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez jamais eu la curiosité d’appeler vos collègues de la BII pour leur demander ce qu’ils recherchaient ? Cela aurait pu vous aider dans votre propre travail.
Mme Janine Pécha. Nous ne nous sommes posé la question qu’au moment de remettre le dossier aux autorités judiciaires. Le dossier a été transmis en 2001 : cela signifie qu’il contenait les déclarations de 2000, 1999 et 1998, concernant une période prescrite depuis longtemps. Je n’ai donc pas eu cette curiosité.
M. le président Charles de Courson. Est-il habituel que les BII vous demandent des dossiers ?
Mme Janine Pécha. Ils nous en demandent régulièrement.
M. Hervé Morin. Cette fois, pourtant, il ne s’agissait pas de n’importe qui : c’était un député.
Mme Janine Pécha. Je ne me permettrais pas d’affirmer qu’un député est n’importe qui. Pour autant, nous considérons que tous les citoyens doivent être traités de la même façon.
M. Hervé Morin. Bien entendu, mais le dossier d’un député peut susciter un peu plus d’intérêt, et on pourrait imaginer que la direction générale soit informée de sa transmission vers un autre service.
Mme Janine Pécha. S’agissant d’un traitement particulier à appliquer aux députés ou aux sénateurs, nous n’avons des directives que depuis 2010 – pas avant.
M. le président Charles de Courson. Quelles sont-elles ?
Mme Janine Pécha. Nous devons nous assurer que les déclarations sont bien déposées et les impôts recouvrés.
M. Hervé Morin. Monsieur Parini, nous avons lu dans la presse que le seul moyen pour l’administration fiscale de savoir avec certitude si M. Cahuzac avait, ou non, un compte en Suisse, était, compte tenu des règles de cet État en matière de secret bancaire, que l’intéressé pose lui-même la question. Partagez-vous cette analyse ?
Par ailleurs, même si vous n’avez pas eu, avant 2012, à superviser l’élaboration des fiches ministres pour tous les membres d’un gouvernement, de nombreux remaniements ont eu lieu sous la précédente législature. Les fiches correspondantes étaient-elles déjà adressées au seul ministre du budget, ou bien d’autres autorités politiques en avaient-elles connaissance ?
M. Philippe Parini. Il n’est pas aisé de répondre à la première question. Un tel sujet doit faire l’objet d’une expertise par des spécialistes, comme mes anciens collaborateurs du service central du contrôle fiscal. D’une manière générale, le principal obstacle auquel se heurte la lutte contre la fraude est la difficulté à obtenir des informations. C’est pourquoi il est nécessaire d’avancer en matière de transmission automatique et de coopération internationale.
S’agissant des fiches ministres, M. Cahuzac a fait le choix, lors de la mise en place du nouveau gouvernement, d’un système global. Au cours des années précédentes, en cas de remaniement, le service central du contrôle fiscal interrogeait directement le nouveau ministre et évaluait sa situation fiscale. Je n’étais informé que lorsqu’une difficulté particulière se présentait ou si une procédure de régularisation prenait trop de temps. Dans ce cas, il m’est peut-être arrivé d’en tenir informé le ministre du budget.
M. Hervé Morin. Vous ne transmettiez donc pas ces fiches à Matignon ou à l’Élysée.
M. Bonnal a confirmé la tenue, le 19 décembre 2012, d’une réunion concernant la situation fiscale de M. Cahuzac, laquelle ne devait donc pas être parfaitement claire, même si le secret professionnel nous empêche d’en savoir plus. Le ministre du budget a donc mis des mois à fournir à l’administration fiscale des informations qui, de toute évidence, n’étaient pas complètes. Imaginons que Mediapart n’ait jamais révélé l’affaire : à quelle procédure le directeur général des finances publiques pourrait-il recourir pour faire en sorte que son propre patron finisse par donner les informations qui lui sont réclamées ?
M. Philippe Parini. Je répondrai plutôt à titre personnel. Nous parlons d’une procédure mise en œuvre depuis plusieurs années par l’administration fiscale, sans pouvoir, sur le fond comme sur la procédure, se fonder sur un texte de référence. À mon avis, il appartient au Gouvernement de préciser les choses.
Quant au ministre destinataire des fiches, il n’est pas réellement juge et partie, dans la mesure où l’administration fiscale, qui l’a rédigée, connaît le contenu de sa propre fiche. Si elle n’obtenait pas les informations qu’elle demande, je ne doute pas qu’elle en alerterait sa direction générale, auquel cas le directeur général se tournerait vers une autre autorité.
M. le président Charles de Courson. Laquelle ?
M. Philippe Parini. Le Premier ministre, en toute logique, puisqu’il est chef du Gouvernement.
M. le président Charles de Courson. Mais un directeur général ne peut s’adresser directement au Premier ministre : il doit respecter une hiérarchie.
M. Philippe Parini. Je ne fais que répondre à la question posée.
M. le président Charles de Courson. Nous avons évoqué plusieurs fois cette question du statut fiscal du ministre en charge de la fiscalité.
M. Alain Claeys, rapporteur. Même si nous sommes un peu hors sujet, la question est importante, en effet.
Au-delà du cas particulier de M. Cahuzac, où en est l’examen de la situation fiscale des membres du Gouvernement ? Toutes les interrogations ont-elles fait l’objet de réponses ? Y a-t-il encore des contentieux ?
Mme Janine Pécha. Des contentieux, non.
M. le président Charles de Courson. Bien entendu, nous ne vous demandons pas des renseignements d’ordre individuel. Mais on nous a dit qu’une dizaine de ministres dépendaient du pôle Paris sud-ouest. Où en est l’examen de leur situation ?
M. André Bonnal. À ma connaissance, une question de droit est encore en cours d’examen, soit au service juridique, soit à la Direction de la législation fiscale. Il s’agit d’une question compliquée que nous ne parvenions pas à trancher définitivement.
M. Christian Assaf. Pardonnez-moi si je suis redondant, mais nous tentons de dissiper tous les doutes.
Nous avons appris la semaine dernière qu’à la suite de la réception fortuite d’une conversation sur un répondeur téléphonique, des informations avaient été transmises à la direction régionale des impôts de Bordeaux, laquelle aurait réclamé le dossier de Jérôme Cahuzac par l’intermédiaire du bureau dont vous avez parlé. Ce dossier serait resté au sein de la direction régionale entre 2001 et 2007. À cette occasion, ainsi qu’au moment de la circulation du rapport de M. Garnier, dont vous avez affirmé ne pas avoir eu connaissance, des informations auraient pu remonter vers l’administration centrale.
Lorsque vous étiez directeur général des finances publiques, M. Cahuzac n’était pas un inconnu : il a été président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, puis ministre du budget. Aviez-vous le moindre soupçon, le moindre doute sur la détention par ce dernier d’un compte en Suisse ou ailleurs à l’étranger ? Si oui, en avez-vous informé votre successeur, M. Bezard, lorsque vous avez quitté vos fonctions, le 5 août 2012 ?
M. le président Charles de Courson. La question s’adresse aussi au directeur régional que vous êtes depuis cette date.
M. Philippe Parini. Je n’avais absolument aucune information.
M. Christian Assaf. Vous auriez pu vous apercevoir que le dossier de M. Cahuzac était incomplet – puisqu’une partie se trouvait à Bordeaux jusqu’en 2007 – et vous poser des questions à ce sujet.
Ma seconde question est un peu plus précise. Nous avons un débat sur la qualité de la demande adressée par la France à la Suisse sur le compte qu’aurait détenu Jérôme Cahuzac auprès de la banque UBS. Compte tenu de l’avenant à la convention fiscale franco-suisse, à l’élaboration duquel vous avez contribué, et de l’échange de lettres qui en a précisé l’interprétation, estimez-vous que la question posée par l’administration française aux services suisses était suffisamment précise ?
M. Philippe Parini. Lorsque j’ai rencontré mon successeur à la direction générale, je lui ai bien entendu présenté de la façon la plus complète possible l’activité de cette dernière, et je lui ai indiqué quels dossiers devaient être suivis en priorité. Il devait en particulier se faire communiquer rapidement le dossier relatif à la situation fiscale des ministres, et veiller à ce que la procédure arrive à son terme. J’ai également signalé certaines situations qui, à mon avis, méritaient d’être regardées de près. Mais nous n’avons pas parlé de compte en Suisse, dans la mesure où je ne connaissais rien de cette affaire. Cela ne figurait d’ailleurs pas dans la fiche du ministre concerné.
S’agissant de la demande adressée par la France aux autorités suisses, il est délicat de vous répondre, dans la mesure où je n’étais pas informé du contenu de la question posée, et encore moins de la réponse. Ce dont je suis certain, c’est que les fonctionnaires de la DGFiP, et en particulier ceux de la direction centrale du contrôle fiscal, ont fait preuve du plus grand professionnalisme. Mais il s’agit d’une question très pointue, sur laquelle je ne dispose pas d’élément.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. M. Gonelle nous a dit avoir eu recours à une procédure informelle, par l’intermédiaire d’un ami fonctionnaire des impôts, pour saisir les services de la BII de Bordeaux. Or, si les directeurs de cabinet que nous avons auditionnés nous ont dit que leurs archives étaient amenées à disparaître, il n’en est pas de même des archives administratives, notamment au sein de l’administration fiscale. Lorsque vous avez transmis le dossier de Jérôme Cahuzac à la police, le 13 janvier 2013, contenait-il une note indiquant comment la Direction nationale des enquêtes fiscales, et plus particulièrement le BII, avaient été saisis ? Il règne en effet un certain flou sur cette question.
Mme Janine Pécha. Nous n’avions pas de telle note, mais seulement une trace du mouvement du dossier.
Lorsque la BII de Bordeaux nous en a demandé communication en 2001, ce qui n’avait rien d’exceptionnel, nous lui avons envoyé les déclarations dont nous disposions, c’est-à-dire correspondant à la période non prescrite, de 1997 à 2000. En lieu et place du dossier, nous avons inséré une fiche indiquant que ce dernier avait été transmis à la BII. Les documents que nous avons donnés à la police judiciaire incluaient donc cette fiche, qui précisait à quelle date le dossier fiscal personnel de M. Cahuzac avait été envoyé à Bordeaux et à quelle date il en était revenu.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Ce matin, on a évoqué une « fiche 3909 ». De quoi s’agit-il ?
Par ailleurs, des recherches sur ce sujet ont-elles été effectuées dans les archives de Fontainebleau ?
Mme Janine Pécha. Je n’ai pas vu une telle fiche dans le dossier. Une « fiche 3909 » est établie par les services spécialisés dans la recherche de fraudes fiscales – brigades de contrôle et de recherche, pôles de contrôles et d’expertise, BII, DNEF, etc. – et retrace tous les faits susceptibles de justifier la programmation d’un contrôle fiscal. Elle est rédigée par un inspecteur des impôts – cadre A – ou un contrôleur – cadre B –, puis soumise au supérieur hiérarchique, un inspecteur principal, lequel vérifie que le contrôle fiscal se justifie par des motifs valables. Il transfère ensuite la fiche à un responsable de division du contrôle fiscal. Selon la nature du contrôle envisagé, il s’agira d’un fonctionnaire relevant d’une direction départementale ou régionale, voire d’un responsable national. Ce responsable de division, qui programme le contrôle fiscal, n’est toutefois pas la personne qui décide du lancement de l’opération de contrôle fiscal externe.
Pour résumer, la fiche 3909 est rédigée par un inspecteur, visée par un inspecteur principal, reprise au niveau d’un directeur divisionnaire et mise au programme d’une brigade de vérification. Il n’y a donc pas de raison qu’elle soit insérée dans un dossier fiscal individuel.
M. Dominique Baert. Monsieur Parini, quelles étaient vos fonctions en 2006 ?
M. le président Charles de Courson. Votre biographie indique que vous étiez, entre le 31 décembre 2004 et avril 2008, receveur général des finances et trésorier-payeur général de la région Île-de-France.
M. Philippe Parini. Je vous fais confiance.
M. Dominique Baert. Si je pose la question, c’est parce qu’en 2006, le juge Bruguière a reçu un exemplaire de l’enregistrement qui a été à l’origine des révélations de Mediapart. Nous ignorons encore ce qu’il en a fait et auprès de qui il a pu se tourner. Le juge aurait-il pu chercher à entrer en contact avec vous à un moment ou un autre de votre carrière ?
M. Philippe Parini. Non. Nous parlons d’une époque où le Trésor public était encore séparé de l’administration des impôts. Le juge Bruguière n’aurait eu aucune raison de se tourner vers un trésorier-payeur général.
M. Dominique Baert. En 2008, vous étiez directeur général des finances publiques, et Éric Woerth était ministre du budget. A-t-il un jour évoqué avec vous le dossier fiscal de M. Cahuzac ?
M. Philippe Parini. Non, jamais.
M. Jean-Marc Germain. Pouvez-vous nous confirmer que le dossier personnel de M. Cahuzac ne contenait aucune information sur le signalement effectué en 2001 auprès de la BII de Bordeaux, ni sur l’enregistrement qui a circulé en 2006, ni sur le rapport de M. Garnier ?
Par ailleurs, qui a pu consulter ce dossier dans son intégralité ?
M. Philippe Parini. Vous évoquez des périodes très différentes – 2001, 2006, et même 2008 s’agissant d’un dossier disciplinaire. Or, il faut distinguer les services qui gèrent les dossiers de ceux qui réalisent des contrôles fiscaux. Quant à la procédure disciplinaire, elle a été proposée par le responsable d’une direction régionale de contrôle fiscal ; c’est donc quelqu’un qui connaît les règles déontologiques que les fonctionnaires doivent respecter et les critères permettant de juger de l’opportunité d’engager une opération de contrôle.
Derrière l’unité fiscale, vous évoquez donc des périodes et des services différents. Cela étant, si la réalisation d’un contrôle fiscal donne lieu à redressement…
Mme Janine Pécha. Dans ce cas, un rapport de vérification peut figurer dans la partie permanente du dossier fiscal.
Mais pour répondre à votre question, le dossier ne comportait aucune pièce relative aux événements que vous évoquez.
M. Jean-Marc Germain. Le signalement de 2001 a pourtant donné lieu à une procédure de vérification assez longue – même s’il est peu probable, en effet, que la BII ait examiné le dossier pendant sept ans. Vous paraît-il normal qu’il n’en subsiste aucune trace dans le dossier fiscal personnel, censé regrouper toutes les informations fiscales sur une longue période ? À deux reprises, des informations ont été apportées qui auraient pu permettre le déclenchement d’un contrôle et, le cas échéant, de repérer l’existence d’un compte à l’étranger. Or, selon vous, ces informations ne figurent pas dans le dossier fiscal de M. Cahuzac.
Mme Janine Pécha. Les réponses doivent être recherchées auprès de la direction régionale du contrôle fiscal – DIRCOFI – concernée, en supposant que les archives correspondantes aient été conservées. Je peux toutefois formuler une hypothèse : des recherches ont été menées au niveau de la DIRCOFI, mais on a estimé que les éléments d’information apportés – d’ailleurs d’une manière peu claire – n’étaient pas assez sûrs pour justifier une procédure de contrôle. Cela expliquerait qu’aucune trace ne figure dans le dossier. On ne lance pas un contrôle à partir d’une allégation.
M. Jean-Pierre Gorges. Une remarque de forme, monsieur le président. Ce matin, on ne m’a pas permis de poser une question concernant des faits survenus avant le 4 décembre 2012, au motif que la période concernée par la commission d’enquête s’étend de cette date jusqu’au 2 avril 2013. Or, cet après-midi, toutes les discussions portent sur des événements ayant eu lieu avant le 4 décembre. Le fait est que, pour comprendre ce qui s’est passé entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, il faut s’intéresser à la période antérieure. D’ailleurs, plusieurs collègues ont posé ce matin des questions similaires à la mienne…
M. le président Charles de Courson. Ce matin, vous avez posé plusieurs questions, dont l’une concernait le fichier HSBC.
M. Jean-Pierre Gorges. J’ai demandé si les informations détenues par M. Woerth avaient été transmises aux membres du cabinet de M. Moscovici, car une telle continuité de l’information aurait expliqué bien des choses. Rappelons que c’est en s’intéressant à Éric Woerth que Mediapart a été amené à enquêter sur Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour bien comprendre les événements qui ont eu lieu entre le 4 décembre et le 2 avril, il n’est pas inutile, en effet, de s’interroger sur les informations dont l’administration pouvait disposer auparavant.
M. Jean-Pierre Gorges. Précisément. D’ailleurs, on finira peut-être par s’apercevoir que les services de l’État ont bien fonctionné entre le 4 décembre et aujourd’hui, mais qu’ils ont connu de graves dysfonctionnements en 2001. Je sais que les fonctionnaires que nous auditionnons ne sont pas concernés mais ils sont bien placés pour nous expliquer comment nous pourrions trouver des informations sur ces faits qui se sont déroulés en 2001 et quelles sont les personnes à interroger.
De même, nous voudrions savoir si, en 2006, des contacts ont eu lieu entre les services fiscaux et des gens qui, comme le juge Bruguière, détenaient des informations. La situation est en effet étrange : malgré les deux alertes de 2001 et 2006, il a fallu attendre onze ans avant que l’affaire entre en ébullition. D’après vous, y avait-il des gens qui, du fait de leurs fonctions, connaissaient la situation de M. Cahuzac et auraient pu livrer ces informations le moment venu ?
M. Philippe Parini. La majeure partie des questions portait en effet sur la période antérieure au 4 décembre 2012 mais je crois avoir répondu de bonne grâce et décrit, en tant que directeur régional et ancien directeur général, la façon dont les choses se passaient.
Il serait dommage de déduire des faits évoqués l’impression que l’administration travaillerait dans un certain désordre. La Direction générale des finances publiques, héritière de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique, est une administration extrêmement professionnelle, efficace et organisée, qui suit des procédures rigoureuses. Mme Pécha l’a dit, la décision de programmer un contrôle n’est pas prise à la légère : elle doit être étayée, et implique plusieurs personnes. C’est d’ailleurs une forme de protection pour le contribuable. L’administration fiscale est neutre, objective et impartiale ; elle se doit de traiter tout le monde de la même façon.
Mais – et je réponds ainsi à votre question – c’est aussi une administration bien organisée, qui garde une trace de ses procédures. Lorsque vous viendrez consulter le dossier, monsieur le rapporteur, vous pourrez constater qu’il est très précisément documenté.
Bien entendu, plus on remonte dans le temps, plus la qualité des archives risque d’être altérée.
M. le président Charles de Courson. Alors qu’une partie du dossier a été envoyée à la DIRCOFI du Sud-Ouest, vraisemblablement à la suite des informations transmises à la BII, comment se fait-il qu’il ne soit pas remonté au service auquel est rattaché le domicile du contribuable, accompagné d’une fiche de liaison précisant que des vérifications ont eu lieu, mais n’ont rien donné, qu’il subsiste des doutes, ou que sais-je encore ? Un tel cloisonnement pose question.
Nous devrions cependant en savoir plus en auditionnant les fonctionnaires de la DIRCOFI Sud-Ouest – même si le directeur général de l’époque est hélas décédé.
Notre collègue a évoqué l’année 2001, où l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot aurait transmis l’information à la BII, et l’année 2008, celle de l’affaire Garnier. Pourquoi n’y a-t-il pas, dans le dossier du contribuable, c’est-à-dire dans un document unique, une synthèse de toutes ces accusations, fondées ou non ?
Mme Janine Pécha. Nous gardons une trace des procédures engagées, mais pas de celles qui sont laissées de côté ou non suivies d’effets. L’absence d’action de la part de l’administration fiscale ne donne pas lieu à motivation. Du fait que nous travaillons toujours plus ou moins dans une perspective contentieuse, nous devons pouvoir expliquer dans quelles conditions nous avons engagé une action. En revanche, nous ne gardons aucune trace des initiatives non suivies d’effets – parce que le renseignement n’était pas suffisamment précis, par exemple.
M. André Bonnal. D’une certaine façon, il y a deux dossiers : celui de la direction qui gère le dossier du contribuable, à Paris, et éventuellement celui de la direction de contrôle. Nous avons la trace de la transmission du dossier de M. Cahuzac à une direction de contrôle. Si le travail de cette dernière aboutit à quelque chose, le dossier de gestion détenu à Paris conservera une trace de la procédure qui a été conduite et achevée. Mais si la direction de contrôle, après un premier examen, estime qu’il n’y a pas lieu d’agir, il en restera peut-être des traces dans ses propres archives, sous la forme de documents de travail – et encore, tout dépend de leurs règles d’archivage, car nous parlons tout de même de l’année 2001 –, mais rien ne figurera dans le dossier du contribuable.
M. le président Charles de Courson. Je trouve néanmoins curieuse l’absence de fiche de liaison entre les deux services, expliquant ce qui a été fait ou ce qui n’a pas été fait.
M. André Bonnal. Le dossier permanent du contribuable garde la trace d’un acte fait par la direction de contrôle, mais ce qui n’est pas fait n’est pas tracé.
M. Jean-Pierre Gorges. En tout état de cause, le rapporteur doit examiner le dossier avec les personnes compétentes.
M. le président Charles de Courson. C’est prévu. De même, nous entendrons les collaborateurs de l’ancien directeur régional, afin de savoir ce qui a été entrepris au sein du BII.
Je vous remercie, Madame, Messieurs, d’avoir répondu à nos questions avec précision.
Audition du mardi 28 mai 2013
À 18 heures : Mme Véronique Bied Charreton, directrice de la législation fiscale, accompagnée de M. Pierre-Olivier Pollet, administrateur des finances publiques au bureau E1.
M. le président Charles de Courson. Nous poursuivons nos auditions en recevant Mme Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation. Vous avez souhaité, madame la directrice, être accompagnée par M. Pierre-Olivier Pollet, chef de section à la sous-direction E « Prospective et relations internationales » de la Direction de la législation fiscale (DLF).
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, s’agissant de la gestion de « l’affaire Cahuzac ». L’un des moments-clés de cette gestion a été la demande d’assistance administrative adressée, le 24 janvier 2013, aux autorités fiscales suisses. On se souvient que les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, ont été reçus par M. Bézard et vous-même, afin de prendre connaissance de la réponse donnée à cette demande.
Beaucoup a été dit et écrit sur les conditions dans lesquelles cette procédure de coopération entre administrations fiscales a été mise en œuvre. Il nous appartiendra en particulier d’analyser les limites posées par l’avenant du 27 février 2009 à la convention fiscale franco-suisse, ainsi que l’interprétation qui en ressort, suite à l’échange de lettres du 11 février 2010.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie donc de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et dire : « Je le jure ».
Mme Véronique Bied-Charreton et M. Pierre-Olivier Pollet prêtent successivement serment.
Mme Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale. La DLF est responsable de la conception et de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité, ainsi que de leur interprétation. En matière de fiscalité internationale, ma direction est en charge, au sein de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, de la négociation des conventions fiscales internationales – y compris pour ce qui concerne les échanges de renseignements –, ainsi que des négociations sur ces sujets au sein des instances internationales, notamment l’OCDE. À ce titre, la DLF est également chargée de l’interprétation des conventions fiscales internationales, mais non de leur application, laquelle est du ressort à d’autres services de la DGFiP. Ce n’est donc pas la DLF qui met en œuvre l’échange de renseignements.
La DLF, en ma personne ou en celle de l’un de mes collaborateurs, n’a été ni associée à la gestion du dossier de M. Cahuzac, ni sollicitée dans ce cadre par un autre service de la DGFiP ou par le cabinet du ministre pendant la période du 4 décembre 2012 au 2 avril 2013. Le fait que la DLF n’ait pas été sollicitée par le service du contrôle fiscal pour rédiger ou relire la demande de renseignements adressée aux autorités suisses est normal, dans la mesure où cette demande s’inscrivait dans le cadre du droit conventionnel positif avec la Suisse, connu et pratiqué à de nombreuses reprises par les services du contrôle fiscal dans les conditions évoquées par M. Bézard ce matin. J’ai reçu seulement, le 10 décembre 2012, un courriel de la DGFiP m’adressant une copie de l’instruction, dite « muraille de Chine ».
Depuis les aveux de Jérôme Cahuzac, la DLF a néanmoins participé à la rédaction des réponses aux questions de droit posées par les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au ministre de l’économie et des finances, afin de préciser l’interprétation des différentes conventions, protocoles et échanges de lettre entre la France et la Suisse en matière d’échange de renseignements.
La France et la Suisse sont liées par une convention d’élimination de la double imposition en date du 9 septembre 1966. L’un des articles de ce texte précise les modalités d’assistance administrative entre les deux États en matière d’échange de renseignements. Avant l’entrée en vigueur de l’avenant du 27 août 2009, de tels échanges étaient totalement exclus pour les informations bancaires. Le 13 mars 2009, à l’annonce de la publication prochaine, dans le cadre du G20, d’une liste d’États n’ayant pas adopté les standards de l’OCDE en matière d’échange de renseignements, la Suisse a fait part de sa volonté d’amender son réseau conventionnel. La France a alors engagé avec elle des négociations, afin d’introduire dans la convention des dispositions conformes aux standards les plus récents de l’OCDE : ce fut l’objet de l’avenant du 27 août 2009, qui amendait la rédaction de l’article 28 de la convention, en précisant notamment que les États contractants ne peuvent refuser de communiquer des renseignements au seul motif que ceux-ci sont détenus par une banque.
L’avenant insère également un nouveau point XI au protocole additionnel à la convention – protocole ayant la même valeur juridique que la convention, et soumis comme elle à ratification – qui, s’inspirant des commentaires de l’OCDE alors en vigueur, précise que les demandes de renseignements sont effectuées après utilisation par l’État requérant de ses sources habituelles de renseignements ; que la « pêche aux renseignements » n’est pas autorisée ; que l’État requis peut appliquer ses procédures internes relatives aux droits des contribuables concernés sans que toutefois ces droits n’entravent ou ne retardent indûment l’échange de renseignements ; qu’enfin, la convention n’impose pas aux États de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Nous sommes donc dans un cadre d’échange de renseignements sur demande.
Le protocole additionnel stipule également que toute demande adressée à la Suisse doit mentionner le nom et l’adresse du contribuable visé comme des personnes susceptibles de détenir une information – par exemple, un établissement bancaire –, lorsque ces coordonnées sont connues. La France, dès lors que la convention et son protocole sont interprétés conformément aux standarts de l’OCDE dont ils reprennent les termes, serait fondée à adresser une telle demande quand bien même elle ne disposerait pas d’éléments d’identification de l’établissement bancaire ; mais telle n’était pas la lecture des autorités suisses, qui ont donc annoncé, lors d’une conférence de presse le 16 décembre 2009, la suspension de la procédure de ratification de l’avenant, exigeant que les deux administrations fiscales s’entendent préalablement sur sa portée exacte, s’agissant notamment des demandes d’assistance relatives à des données bancaires. L’échange de lettres du 11 février 2010 a eu pour objet de lever le blocage suisse en précisant que, « dans tous les cas où l’État requérant aura connaissance du nom de l’établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné, il communiquera cette information à l’État requis », et que, « dans le cas exceptionnel où l’autorité requérante présumerait qu’un contribuable détient un compte bancaire dans l’État requis sans pour autant disposer d’informations lui ayant permis d’identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l’identification de cette banque ».
Du point de vue des autorités suisses, l’échange de lettres confirme que la convention exclut toute demande non accompagnée d’éléments permettant d’identifier la banque. Un porte-parole de l’administration fiscale l’a encore rappelé, dans le journal Le Temps, au sujet de l’affaire qui nous occupe. D’autres éléments confortent cette analyse. En premier lieu, lors des débats parlementaires sur la ratification, le Gouvernement suisse avait indiqué que « faute de la mention spécifique des éléments nécessaires permettant l’identification du détenteur des informations, il est clair qu’en tout cas du côté suisse, on ne sera pas en mesure de donner une suite concrète à une demande de renseignements. En particulier, à défaut des indications nécessaires permettant la désignation de la banque en sa qualité de détentrice des informations dans la demande de renseignements, il ne sera pas possible de transmettre les données bancaires ».
Dans un communiqué de presse publié le 12 février 2010, les autorités suisses ont par ailleurs indiqué que les solutions trouvées par la France sur l’interprétation de l’avenant de 2009 et sur l’affaire HSBC permettaient, de l’avis du Département fédéral des finances, de reprendre le processus de ratification. Peu de temps après, le ministère des finances français a également précisé que cet accord permettait à ses yeux la reprise de la ratification par la Suisse. La convention est finalement entrée en vigueur le 4 novembre 2010.
Il ne fait donc guère de doute que cet échange de lettres, avec les concessions qu’il supposait, a permis non seulement de reprendre le processus de ratification en Suisse, mais aussi d’obtenir des renseignements bancaires, ce qui était jusqu’alors impossible.
M. Alain Claeys, rapporteur. Même si, nous l’avons bien noté, vous n’avez pas participé à la rédaction de la demande adressée aux autorités suisses, vous avez sans doute un avis sur les correspondances entre la France et la Suisse au sujet de l’affaire Cahuzac. Au regard du protocole additionnel et de l’échange de lettres du 11 février 2010, la demande formulée par la France vous semble-t-elle correspondre à l’esprit de l’avenant à la convention ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Oui, je le pense.
M. Alain Claeys, rapporteur. Une demande plus précise eût-elle été assimilée à une « pêche aux renseignements » ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Pas tout à fait, mais c’était aller au-delà de ce que permet l’accord entre les deux États.
M. Alain Claeys, rapporteur. Que recouvre exactement l’expression de « pêche aux renseignements » ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Toute demande générale quant à des comptes détenus par des Français dans une banque en suisse.
M. Alain Claeys, rapporteur. La demande faite à Jérôme Cahuzac le 14 décembre 2012, s’agissant de la déclaration d’éléments permettant l’identification d’un compte à l’étranger, était-elle, au regard de l’avenant à la convention, un préalable indispensable à la demande d’assistance administrative ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Aux termes du protocole additionnel, « les demandes de renseignements sont effectuées après utilisation par l’État requérant de ses sources habituelles de renseignements ». La demande dont vous parlez attestait que nous avions respecté cette obligation.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le contribuable dispose-t-il un délai pour répondre à une telle demande ? Que se passe-t-il si le contribuable ne répond pas ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Cette question, à laquelle le directeur général des finances publiques me semble avoir répondu ce matin, ne relève pas des attributions de mon service. La DLF n’est compétente que sur les questions de législation fiscale, non sur la procédure fiscale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les autorités suisses, dans leur réponse, font l’observation suivante : « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises ».
S’agit-il d’une mention habituelle dans ce genre de réponse ?
Mme Véronique Bied-Charreton. La DLF ne rédigeant pas de demandes d’échanges de renseignements, elle ne reçoit pas les réponses qui y sont faites. Je ne puis donc vous dire si une telle mention est habituelle ou non. Cela dit, la Suisse a un droit relativement protecteur pour les personnes faisant l’objet de demandes de renseignements bancaires. Les termes de la réponse pourraient donc signifier que celle-ci porte sur la période visée, et sur elle seule.
M. le président Charles de Courson. La DGFiP aurait-elle pu, sur la base des textes existants, interroger les services fiscaux helvétiques sur l’éventuelle détention d’un compte par Jérôme Cahuzac – ou d’un de ses ayants droit – au sein de la compagnie Reyl, lorsque cette information est parue dans la presse ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Le protocole additionnel autorise, dès lors qu’est identifié un établissement détenteur d’un compte, l’interrogation de plusieurs banques.
M. le président Charles de Courson. Une information parue dans la presse suffit-elle à fonder une telle demande, au regard de l’interprétation que les services fiscaux helvétiques font du protocole additionnel ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Il n’est pas nécessaire, ce me semble, de justifier des sources qui motivent la demande. Je répondrais donc plutôt par l’affirmative.
M. le président Charles de Courson. Comment expliquez-vous la réponse négative des services helvétiques, alors que deux mois plus tard, l’intéressé reconnaissait lui-même détenir un compte en Suisse ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Je n’ai pas d’explications sur ce point, qui fait l’objet d’une enquête judiciaire.
M. le président Charles de Courson. Selon des spécialistes de la fraude fiscale internationale, deux types de montage permettent d’échapper aux enquêtes des services fiscaux suisses : le premier est celui des « comptes omnibus », ou « comptes maîtres », c’est-à-dire des comptes qui, ouverts par un homme d’affaires – en général de nationalité suisse –, abritent des « sous-comptes » au nom de ses clients ; le second est l’ouverture de comptes pour des fondations dans un pays tiers, notamment au Liechtenstein.
Da ns sa rédaction actuelle, la convention franco-suisse permet-elle d’espérer des réponses positives des autorités helvétiques lorsqu’on les interroge sur l’existence d’un compte bancaire ?
Mme Véronique Bied-Charreton. La demande des autorités françaises portait sur M. Cahuzac ou ses ayants droit. Elle était donc suffisamment large pour permettre aux autorités helvétique de rechercher qui détenait effectivement les fonds
M. le président Charles de Courson. Mais, compte tenu des montages que j’évoquais, la convention permet-elle d’obtenir une réponse conforme à la réalité ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Les obligations touchant à l’échange de renseignements dépassent, pour l’État requis, le champ de la législation fiscale ; autrement dit, si la Suisse dispose d’informations relevant d’une autre législation, telle que le droit bancaire ou la lutte contre le blanchiment, elle est censée les transmettre. Si la Suisse applique ce genre de dispositifs, ceci devrait permettre de lever - par la demande portant sur des ayant-droits - l’opacité résultant de la présence d’intermédiaires.
M. le président Charles de Courson. Puisque vous participez à la négociation des conventions, je suppose que vous avez aussi à évaluer leur efficacité. Pas un spécialiste de la réglementation fiscale, jusqu’à présent, n’a été capable de répondre à la question dite « Germain », du nom de notre collègue, c’est-à-dire de nous expliquer pourquoi la réponse des autorités suisses a été négative, alors que M. Cahuzac reconnaissait l’existence d’un compte deux mois plus tard.
Mme Véronique Bied-Charreton. L’administration fiscale suisse a été interrogée sur l’existence d’un compte ouvert dans un établissement bancaire à une période donnée, comme vous l’avez observé. À ce stade, nul ne sait si M. Cahuzac a effectivement détenu des fonds au sein de cet établissement pendant ladite période.
M. le président Charles de Courson. Il faut bien entendu attendre les conclusions de l’enquête judiciaire, mais certaines déclarations, y compris de M. Cahuzac, laissent supposer l’existence d’un compte au sein de la banque UBS jusqu’en 2009, avant que les avoirs ne soient transférés à la société Reyl, puis déplacés à Singapour en 2010 ; nous sommes donc dans la période visée par la réponse des autorités suisses. Dans ces conditions, on est en droit de se demander si la convention fiscale n’a pas été signée à seule fin de permettre à l’État suisse de faire croire qu’il était devenu probe en la matière. Étiez-vous consciente que ce texte serait d’un apport limité ? Le directeur général des finances publiques nous a communiqué le taux et la qualité des réponses : ils s’avèrent particulièrement faibles.
Mme Véronique Bied-Charreton. Le texte conventionnel doit d’abord permettre un échange de renseignements avec le moins de restrictions possibles. Le forum mondial auquel nous participons évalue les pratiques des États en ce domaine, et notre législation interne va au-delà du cadre conventionnel puisqu’elle dresse une liste des États non coopératifs. Il n’est évidemment pas satisfaisant de voir une convention non appliquée ; mais le préalable est d’assurer la conformité de tels textes aux standards de l’OCDE ; après quoi leur application effective passe au crible des instances internationales comme de notre législation interne. L’absence d’effectivité peut justifier le cas échéant, la mise en place de sanctions.
Présidence de Mme Cécile Untermaier, vice-présidente
M. Hervé Morin. Vous venez de nous expliquer, en somme, que la réponse des banques ou des autorités suisses est sans valeur, et que l’on ne peut s’y fier.
Mme Véronique Bied-Charreton. Je ne pense pas du tout avoir dit cela.
M. Hervé Morin. Je comprends votre prudence de fonctionnaire, mais c’est tout de même ce qui ressort de vos propos.
Mme Véronique Bied-Charreton. Nous sommes en quelque sorte « corsetés » dans les demandes que nous pouvons adresser aux autorités suisses ; mais dans ce cadre, dont j’ai rappelé les termes, la Suisse nous a clairement répondu.
Le problème que nous rencontrons avec les autorités suisses, le directeur général des finances publiques vous l’a expliqué, est le faible taux de réponses, sachant que ces autorités peuvent bloquer la procédure dès lors que nous leur demandons de ne pas informer la personne concernée de la demande de renseignement. Le problème est plus lié au taux de réponse qu’à la qualité de la réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Cahuzac ou ses conseils ont visiblement été informés par les autorités suisses de la demande française…
Mme Véronique Bied-Charreton. Je n’en sais rien, car cela ne relève pas des échanges conventionnels. Reste que la transparence est de rigueur en Suisse, car la législation suisse ouvre des voies de recours aux personnes visées par les demandes de renseignements – ce qui ne va pas sans poser de sérieux problèmes. Récemment, la Suisse a tenté de mettre sa législation en conformité avec les standards de l’OCDE en votant une loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale, mais cette loi n’est entrée en vigueur que le 1er février 2013. Et aux termes de son article 17, d’ailleurs, l’autorité fiscale suisse « notifie à chaque personne habilitée à recourir, une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Il est donc prévu d’informer la personne visée, non seulement de la demande, mais aussi de la réponse…
Mme Véronique Bied-Charreton. Cela semble possible, en effet ; mais j’ignore si ce fut le cas dans l’affaire qui nous occupe.
M. Jean-Pierre Gorges. Comment avez-vous vécu le fait de ne pas être consultée sur ce dossier, alors que vous êtes une spécialiste en la matière ? Auriez-vous formulé la demande dans les mêmes termes ?
Quelle a été votre réaction en apprenant les aveux de M. Cahuzac ? Ce résultat n’a pas été obtenu grâce à la demande adressée aux autorités suisses, mais grâce à l’enregistrement d’un entretien téléphonique : sans cet élément, comme l’a observé Mediapart, M. Cahuzac aurait été blanchi.
Mme Véronique Bied-Charreton. Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, la DLF ne fait qu’interpréter les dispositions juridiques relatives à la fiscalité, celles de notre droit interne comme des conventions internationales : elle n’est pas consultée sur une procédure comme celle que vous évoquez dès lors qu’elle ne soulevait pas de question nouvelle d’interprétation.
La DLF n’étant pas davantage chargée de l’application des textes, je n’ai aucune expérience en matière de formulation des demandes de renseignements, laquelle est de la compétence du service du contrôle fiscal. Je puis avoir un avis sur la rédaction d’un texte réglementaire, ou législatif, mais pas sur le point que vous avez soulevé.
Enfin, notre service n’ayant pas été associé à la gestion du dossier de M. Cahuzac, les informations dont nous disposons sont celles qui sont parues dans la presse. L’enquête judiciaire déterminera ce qu’il faut penser de la réponse des autorités suisses.
M. Alain Claeys, rapporteur. Essayons de clarifier nos débats. On peut s’étonner que la demande faite par l’administration fiscale française n’ait pas donné de résultats, et partant sous-entendre, comme le font certains membres de la commission, qu’elle était inutile ou, pis encore, conçue pour rester sans suite. Cela dit, deux questions se posent. La première est de savoir si la demande pouvait porter sur l’existence d’un compte dans une autre banque ; mais ce point, qui fait débat entre nous, concerne la chronologie des faits telle que la présente Mediapart. En revanche, vous pouvez nous éclairer sur les termes utilisés par l’administration française dans sa demande : était-il juridiquement possible d’aller plus loin ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Cette demande, me semble-t-il, allait aussi loin que possible dans le cadre de nos accords internationaux.
L’administration française a désigné la banque concernée et fourni l’identité du contribuable ; sur la base de ces éléments, elle pu obtenir une réponse couvrant une période plus large que celle de la prescription, et formuler une demande portant sur la détention d’un compte, sa fermeture ou son transfert par le contribuable ou ses éventuels ayants droit. Je ne vois pas ce qu’elle aurait pu demander de plus.
Mme Cécile Untermaier, présidente. La mention de la compagnie Reyl, que très peu d’éléments pouvaient alors fonder, aurait-elle fragilisé la demande ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Je ne le pense pas mais l’administration fiscale, à cette époque, n’avait aucun indice sur le transfert d’avoirs vers la banque Reyl.
Mme Cécile Untermaier, présidente. Est-ce à dire qu’une allusion un peu hasardeuse à l’existence d’un compte dans une autre banque aurait pu nuire à cette demande, dont on a bien compris que chaque terme devait être pesé ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Je ne puis me prononcer sur la psychologie de l’autorité suisse ; reste que la demande ne pouvait viser « UBS et toute autre banque ». Il n’était pas impossible de l’élargir à une autre banque, mais il aurait fallu des éléments pour cela.
M. Jean-Pierre Gorges. La demande, dites-vous, a été la plus large possible, la période visée ayant d’ailleurs été étendue jusqu’en 2006. Elle fait cependant référence à « M. Cahuzac ou ses ayants droit », omettant que M. Cahuzac était peut-être l’ayant droit d’un autre compte que le sien.
Le transfert des fonds de la banque UBS vers la compagnie Reyl est intervenu en 2009, c’est-à-dire pendant la période visée. Comment expliquer que la banque UBS n’ait pas révélé que M. Cahuzac détenait un compte chez elle ? Aurait-elle menti ?
M. Alain Claeys, rapporteur. L’année 2009 n’est pas celle du transfert des avoirs de la banque UBS vers la compagnie Reyl, mais de l’éventuel déplacement de ces avoirs vers Singapour.
M. Jean-Pierre Gorges. Le président de Courson nous a expliqué que le transfert d’UBS vers Reyl avait eu lieu avant le déplacement des fonds vers Singapour, intervenu quant à lui en 2010. Quoi qu’il en soit, nous sommes dans la période visée par une demande rédigée Si elle a été rédigée de la façon la plus large possible, comment se fait-il que la réponse de la Suisse ait été négative ? Là est tout le mystère.
Mme Véronique Bied-Charreton. Je ne puis vous répondre, n’étant pas à la place de l’administration suisse. Celle-ci a donné une réponse claire. L’enquête déterminera si elle aurait dû être en sens contraire mais à ce jour, nous ne disposons pas des éléments pour en juger.
M. Étienne Blanc. Si je vous ai bien compris, rien dans la convention de 1966 n’interdisait à UBS de répondre précisément à la question posée par la France…
Mme Véronique Bied-Charreton. Dans l’état actuel du droit et de nos relations avec la Suisse, rien ne l’interdisait, en effet.
M. Étienne Blanc. Rien n’interdit non plus, à vous entendre, de viser plusieurs banques : ce que la convention interdit, c’est une question générale sur l’éventuelle possession d’un compte dans une banque suisse non identifiée.
La demande doit également reposer sur des éléments précis. En d’autres termes il était possible de poser à propos de la compagnie Reyl la même question que sur UBS, puisque l’article publié le 4 décembre 2012 par Mediapart mentionne explicitement ces deux établissements bancaires.
Mme Cécile Untermaier, présidente. S’agissant de Reyl, l’article parle de « prestataire financier », non de « banque ».
M. Étienne Blanc. Mais rien n’interdisait de demander si M. Cahuzac possédait un compte dans cette compagnie.
Mme Véronique Bied-Charreton. Effectivement, mais je crois savoir que l’administration fiscale n’avait, à la date de la demande, aucune information dans la presse qui aurait pu la conduire à poser cette question. En tout état de cause, ce point dépasse le domaine de la législation.
M. Étienne Blanc. Certes, mais il est permis de s’interroger sur les pratiques de certains établissements bancaires ou financiers au regard de la convention de 1966.
Selon vous, était-il possible de poser d’autre part une question sur les actes commis par une personne physique en l’occurrence par M. Dreyfus, qui, selon l’article de Mediapart, aurait reçu un mandat ? À mon sens, rien ne l’interdit dans la convention de 1966.
Mme Véronique Bied-Charreton. Je ne puis vous répondre, d’autant que, pour tout vous dire, c’est la première fois que j’entends parler de M. Dreyfus.
M. Étienne Blanc. D’une façon générale, peut-on interroger les autorités suisses sur des maniements de fonds effectués par un particulier dans le cadre d’un contrat de mandat, de la constitution d’une fondation ou de tout autre véhicule ?
Mme Véronique Bied-Charreton. Il faudrait que je dispose d’éléments plus précis pour vous répondre. La notion de proportionnalité des recherches, que la Suisse a introduite dans l’échange de lettres, suppose que les investigations requises par les questions posées ne soient pas trop lourdes.
M. Christian Assaf. Je m’étonne également de la réponse faite par la Suisse au regard des aveux ultérieurs de M. Cahuzac, mais l’explication a été partiellement donnée, ce matin, par le directeur de cabinet du ministre et le directeur général des finances publiques : il n’est pas prouvé, à ce jour, que M. Cahuzac ait possédé un compte chez UBS de 2006 à 2009. Cela ne signifie pas qu’il n’en a pas possédé un dans une autre banque, mais l’administration française ne peut interroger l’administration suisse qu’en désignant une banque précise. Or l’article de Mediapart daté du 4 décembre ne dit pas que M. Cahuzac détient un compte au sein de la compagnie Reyl.
M. Jean-Pierre Gorges. De fait, à ce jour, la seule personne ayant déclaré posséder un compte en Suisse est M. Cahuzac. Les établissements suisses, eux, ne le disent pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Cahuzac n’a pas dit qu’il avait un compte « en Suisse » au cours de la période visée. L’enquête judiciaire nous apportera peut-être des éléments sur ce point. Il avait peut-être un compte ailleurs.
M. Jean-Pierre Gorges. Je le répète, la seule personne à avoir déclaré posséder un compte en Suisse est M. Jérôme Cahuzac. Aucune autorité suisse n’a confirmé cette information.
Mme Cécile Untermaier, présidente. On peut en conclure que la convention n’est peut-être pas aussi performante qu’elle le devrait…
M. Jean-Pierre Gorges. Il faut attendre les conclusions de l’enquête judiciaire, mais personne, aujourd’hui, ne dit que M. Cahuzac a eu un compte en Suisse, excepté lui-même – et bien entendu les articles publiés par Mediapart.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Cahuzac a fait la déclaration suivante : « Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs. Ce que je sais, c’est que la justice française aura tous les documents concernant les activités illicites que j’ai pu avoir hors de nos frontières. J’ai déjà dit aux juges ce qu’était le montant de ce compte à l’étranger. J’ai indiqué ce montant et c’est la raison pour laquelle je vous le confirme : 600 000 euros. » M. Cahuzac ne parle donc pas de la Suisse.
Mme Cécile Untermaier, présidente. Madame la directrice, je vous remercie.
Audition du mardi 4 juin 2013
À 8 heures 45 : M. Alexandre Gardette, chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous entamons aujourd’hui notre troisième semaine d’auditions. Beaucoup d’éléments ayant déjà été portés à la connaissance de notre commission, nos questions se feront désormais plus précises ; elles porteront notamment sur la demande d’assistance administrative adressée, le 24 janvier 2013, par la France aux autorités suisses.
Nous accueillons ce matin M. Alexandre Gardette, chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
Monsieur le chef de service, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête, qui a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». Beaucoup a été dit et écrit sur les conditions dans lesquelles la procédure de coopération entre administrations fiscales a été mise en œuvre. Il nous appartient d’éclairer plus particulièrement les limites posées par l’avenant du 27 février 2009 à la convention fiscale franco-suisse et l’interprétation de celui-ci, telle qu’elle résulte de l’échange de lettres datées du 11 février 2010.
Je vais d’abord vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes, afin que vous nous présentiez les actions que vous avez menées après le 4 décembre 2012 et les informations dont vous disposiez à l’époque, puis le rapporteur, M. Alain Claeys, vous interrogera ; ensuite, les collègues qui le souhaiteront poseront leurs propres questions.
Auparavant, je vous rappelle que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(M. Alexandre Gardette prête serment.)
M. Alexandre Gardette, chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, j’essaierai de vous apporter les éléments les plus précis possibles, en restant factuel, en remettant des documents au rapporteur et, comme j’ai suivi les auditions précédentes, en focalisant mon propos sur les questions qui m’apparaissent les plus prégnantes. Il va de soi que, si je ne faisais pas le tour du sujet, je serais à votre disposition pour répondre à vos questions.
Au préalable, je tiens à dire que je partage les propos tenus par le directeur général des finances publiques, M. Bruno Bézard, dans son exposé liminaire la semaine dernière – non parce qu’il est mon supérieur hiérarchique, mais parce que nous avons vécu ces événements ensemble, que nous avons travaillé avec professionnalisme et que les accusations d’incompétence ou de connivence nous sont insupportables. Je veux d’ailleurs saluer la dizaine de milliers d’agents plus particulièrement chargés de la mission de contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui essaient de faire correctement leur travail dans un pays où l’appétence pour l’impôt n’est pas la première qualité des habitants et où la passion pour la lutte contre la fraude est assez récente…
Même si je rends hommage au travail d’investigation de la presse en général et de Mediapart en particulier, deux déclarations de MM. Plenel et Arfi devant votre commission, il y a quinze jours, nous ont été particulièrement désagréables : « Dès lors qu’une enquête préliminaire est en cours, il ne peut pas y avoir de manœuvres secrètes d’une autre administration sur les faits qui font l’objet d’une enquête de police », a dit M. Plenel ; et M. Arfi a ajouté : « Les questions posées à l’administration fiscale suisse sont objectivement de mauvaise foi ». Ces propos m’ennuient, car l’essentiel du travail de Mediapart était de très grande qualité, et MM. Plenel et Arfi n’avaient pas besoin d’attaquer l’administration fiscale pour démontrer qu’ils avaient raison sur le fond.
Mon propos liminaire comportera quatre points. Comme j’ai cru comprendre qu’à l’issue d’un débat interne, vous vous êtes autorisés à sortir du cadre chronologique strictement compris entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 au nom de la nécessaire manifestation de la vérité et de votre volonté de comprendre comment nous en étions arrivés là, je me permettrai de consacrer les deux premiers points aux années 2001 et 2007.
M. Gonelle a déclaré, lors de son audition par votre commission d’enquête : « Le fisc savait depuis 2001 ». Reprenons la chronologie des faits. De quand date l’enregistrement ? On ne le sait pas exactement, mais dans son article du 4 décembre, Mediapart indique « la fin de l’année 2000 ». Durant son audition, M. Gonelle vous a expliqué que, pour le rendre public, trois voies s’offraient à lui : alerter les médias, se conformer à l’article 40 du code de procédure pénale et saisir le procureur de la République, ou signaler le fait au service compétent de l’administration fiscale. Il a dit qu’il avait choisi cette troisième voie mais il l’a fait d’une manière inhabituelle, car l’administration fiscale ne traite pas les informations qui lui parviennent de manière anonyme : cela fait des années que nous travaillons ainsi, et cela a été confirmé en 2010 par la circulaire dite « Baroin » que je remettrai à votre rapporteur.
M. Gonelle explique qu’il a fait appel à un « ami » qui travaillait à l’époque à la direction générale des impôts, que cet ami était lui-même entré en contact avec une connaissance, et que cette dernière personne s’était penchée sur le dossier fiscal des époux Cahuzac au début de l’année 2001. Je précise que la brigade d’intervention interrégionale (BII) de Bordeaux, qui relève de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), était pleinement compétente pour faire venir ce dossier depuis le service gestionnaire – qui, en l’occurrence, se trouvait à Paris.
Pour reconstituer l’historique, j’ai demandé à deux directeurs successifs de la DNEF, M. Bernard Salvat, que vous auditionnerez cet après-midi, et M. Frédéric Iannucci, qui a pris ses fonctions au début du mois de mai, d’interroger les agents qui étaient en poste à l’époque ; en revanche, nous n’avons pas pu rencontrer l’inspecteur qui avait fait venir le dossier de Paris et qui a demandé à un collaborateur de l’étudier, M. Mangier, car il est décédé l’année dernière. Voici ce qu’il ressort de cette enquête.
D’abord, on peut être très précis sur les dates : M. Mangier, inspecteur des impôts à la BII de Bordeaux, qui était apparemment la personne actionnée par l’ami de M. Gonelle, a reçu le dossier fiscal de M. Cahuzac et de son épouse le 12 février 2001 – nous disposons du bordereau d’envoi du dossier.
M. le président Charles de Courson. Ce n’était pas le responsable de la BII ?
M. Alexandre Gardette. Non, et je vais y venir : son chef de brigade, que nous avons interrogé, nous a donné des éléments intéressants.
M. Mangier, donc, avait formulé sa demande de transmission le 9 février 2001, en cochant la case « consultation » pour renseigner le motif – parmi quatre possibilités : « vérification », « consultation », « contentieux » ou « autre ». Le dossier ne sera retourné au service de gestion parisien que le 7 février 2007 – je remettrai tous ces documents à votre rapporteur.
Le 15 janvier dernier, j’ai rassemblé l’intégralité du dossier fiscal des époux Cahuzac à l’administration centrale en prévision de la visite, le 18, de Mme Dufau, commissaire à la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF), qui venait, sur réquisition, récupérer ces éléments. J’ai interrogé à cette occasion M. Salvat – j’interrogerai ensuite son successeur. Il ressort de l’enquête auprès des personnes qui ont vécu cette époque que le collaborateur immédiat de M. Mangier – je préfère ne pas donner son nom car cette audition est retransmise …
M. le président Charles de Courson. Donnez-le, ce n’est pas un problème.
M. Alexandre Gardette. Il s’agit de M. Patrick Richard.
Ce contrôleur des impôts – grade en dessous de celui d’inspecteur – a travaillé plusieurs années en binôme avec M. Mangier. Il est à la retraite depuis quelques mois. Lors de son audition par le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Nanterre en février 2013, il a dit – et il nous a confirmé ces informations – que M. Mangier avait reçu une information verbale relative à l’existence d’un compte en Suisse que M. Cahuzac aurait utilisé pour le financement de sa campagne électorale. Selon M. Richard, cette information n’aurait pas été transmise par un autre agent de la direction générale des impôts, mais par une personne appartenant à la sphère privée de M. Mangier. M. Richard en est convaincu car, contrairement à ce qui se passait dans des cas similaires, M. Mangier n’a pas souhaité que M. Richard rencontre cette personne.
On constate donc une conception plutôt curieuse du renseignement : les agents qui font ce métier ont l’habitude d’avoir des contacts informels, mais s’ils veulent fiscaliser un dossier, il leur faut amener des éléments précis et savoir qui donne les informations. Ce n’est pas le cas ici ; l’information ne comportait aucune précision : ni le nom de la banque, ni la période durant laquelle les fonds auraient été versés, ni le solde du compte. Le dossier avait été prélevé, à toutes fins utiles, pour savoir si le contribuable avait déclaré un compte à l’étranger et s’il était à jour de ses obligations déclaratives.
M. Richard conserve le souvenir d’un dossier peu épais. Aucune pièce en provenance du service gestionnaire n’a été versée au dossier par la BII de Bordeaux après sa réception en février 2001. Le contrôleur a rapidement constaté qu’il ne pourrait pas exploiter l’information reçue – pas de contact avec la source, aucune précision sur le compte à l’étranger – et il en a informé M. Mangier. Aucune suite n’a été donnée à l’affaire et le dossier personnel de M. Cahuzac n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé par la BII de Bordeaux. Selon M. Richard, dont les propos ont été confirmés par les deux chefs de brigade en fonction sur la période 2001-2007, il n’existe aucune trace écrite des raisons du prélèvement du dossier et de la justification de l’absence de suite. Et comme il n’y a pas eu de suite, le chef de la BII de Bordeaux de l’époque, M. Olivier André n’a pas été informé du prélèvement du dossier. Il en aurait été informé, comme il se doit, si l’on avait voulu établir une « fiche 3909 » pour programmer un contrôle fiscal.
M. Laurent Habert, qui a succédé à M. André de 2003 à 2009, a confirmé que le dossier était resté par négligence à la BII de Bordeaux jusqu’au 7 février 2007, date à laquelle il a été renvoyé à Paris, sans avoir fait l’objet d’aucune action concrète ni d’aucune alimentation complémentaire par le service gestionnaire. Je précise que MM. André et Habert ont également été auditionnés par le SRPJ de Nanterre en février dernier.
Ce que je retiens de ce premier épisode, c’est que la hiérarchie n’a pas été informée du prélèvement du dossier, que le contrôleur a fait correctement son travail en constatant qu’il ne pouvait rien en tirer et que le dossier est resté à la BII de Bordeaux manifestement par négligence. Toutefois, comme Mme Pécha vous l’a expliqué la semaine dernière, cela n’a pas empêché le service gestionnaire de continuer à recevoir les déclarations annuelles d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune des époux Cahuzac, et à traiter correctement leur dossier, c’est-à-dire à fiscaliser ce qu’ils déclaraient.
M. le président Charles de Courson. Selon votre analyse, il y aurait donc eu des dysfonctionnements au sein de l’administration fiscale ?
M. Alexandre Gardette. Il s’agit plutôt d’un témoin clé, M. Gonelle, qui dispose d’un élément essentiel, un enregistrement, et qui ne prend contact ni avec le procureur de la République, ni avec l’administration fiscale au sens institutionnel, mais qui en discute avec un ami qui connaît un ami, lequel ami, qui se trouve être inspecteur des impôts, fait venir le dossier sans en référer à sa hiérarchie.
M. le président Charles de Courson. Vous parlez de M. Mangier ?
M. Alexandre Gardette. Oui. M. Mangier demande à son adjoint d’examiner le dossier ; le contrôleur fait son travail et conclut qu’il ne peut rien en faire. M. Mangier ne rend pas compte à sa hiérarchie du fait qu’il a demandé le dossier d’une personnalité sensible – M. Cahuzac était à l’époque député – et ne prend même pas la peine de retourner le dossier qu’il avait prélevé.
M. le président Charles de Courson. M. Mangier étant un membre des services fiscaux, on peut donc conclure à un dysfonctionnement du service !
M. Alexandre Gardette. Non, d’une personne du service.
M. le président Charles de Courson. Certes, mais cette personne a des supérieurs hiérarchiques.
M. Patrick Devedjian. Et en plus, elle est morte…
M. Alexandre Gardette. Dois-je comprendre que vous trouvez « pratique » que M. Mangier soit décédé, messieurs les députés ? Il faudrait dire les choses clairement !
M. le président Charles de Courson. Poursuivez, monsieur Gardette.
M. Alexandre Gardette. J’en arrive à 2007. C’est en avril de cette année-là que l’inspecteur des impôts Rémy Garnier procède à sa dernière consultation du compte de M. Cahuzac sur le logiciel Adonis – sachant qu’il en a consulté une trentaine d’autres, principalement ceux de sa hiérarchie… M. Garnier est à l’époque affecté à la direction interrégionale de contrôle fiscal (DIRCOFI) du Sud-Ouest. Le siège de celle-ci est à Bordeaux, mais M. Garnier est en poste à Agen. Le 24 mai 2007, il a un premier entretien avec son directeur, qui l’interroge sur les raisons de sa consultation dans ce logiciel de dossiers dont il n’avait pas à s’occuper.
Si je m’attarde sur ce point, c’est qu’on nous dit qu’à cette époque nous ne pouvions pas ne pas savoir. Sans revenir sur le contentieux qui a pu exister par le passé, c'est-à-dire avant 2007, entre M. Garnier et M. Cahuzac – il y a eu des procédures disciplinaires et la Cour d’appel a rendu un jugement la semaine dernière à ce propos –, je souhaiterais préciser ce que M. Garnier savait à cette époque et ce qu’il nous a dit pour que nous puissions examiner ensemble s’il y a eu ou non dysfonctionnement de l’administration fiscale.
Dans son mémoire en défense rédigé en 2008, M. Garnier écrit : « J’ai ouï dire que… », et : « Des informations d’origines diverses me permettent d’affirmer que… ». Bien évidemment, cela ne peut pas suffire pour engager un contrôle fiscal approfondi ! Nous sommes dans un pays démocratique : il nous faut un peu plus qu’une source anonyme pour travailler sur des sujets de ce type.
Nous avons interrogé dès le 5 décembre 2012, soit le lendemain de la publication de l’article de Mediapart, les trois directeurs successifs de la DIRCOFI du Sud-Ouest entre 2007 et aujourd’hui : MM. Joseph Jochum, Jean-Guy Dinet et Victor Le Blanc. Après consultation de leurs archives, ils nous ont dit qu’en 2007, M. Garnier ne disposait pas d’autre élément qu’une information externe dont il ne souhaitait pas donner la source. De qui s’agit-il ? De M. Gonelle ? De M. Bruguière ? De quelqu’un d’autre ? Peut-être finira-t-il par le révéler, mais toujours est-il qu’à l’époque, il refuse de donner le nom à sa hiérarchie. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons qu’en 2001, il est considéré qu’il n’est pas possible de lancer un contrôle fiscal.
M. Alain Claeys, rapporteur. En juin 2008, vous étiez sous-directeur de l’encadrement et des relations sociales de la direction générale des finances publiques. À cette époque, avez-vous eu connaissance du mémoire de Rémy Garnier ?
M. Alexandre Gardette. Non, car le service des ressources humaines de la DGFiP comportait deux sous-directions : les sujets disciplinaires et déontologiques ne relevaient pas de la mienne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et la deuxième sous-direction a-t-elle été informée ?
M. Alexandre Gardette. À partir de 2008, le sujet remonte jusqu’au bureau chargé de la déontologie et du disciplinaire ; je suis donc presque certain que mes collègues du bureau RH 2 ont eu connaissance du mémoire de M. Garnier. En revanche, j’ai interrogé mon prédécesseur à la sous-direction du contrôle fiscal, qui m’a dit que celle-ci n’en avait pas été informée. Nous ne découvrirons que le 4 décembre 2012, dans l’article de Mediapart, que M. Garnier justifiait ses recherches par le fait qu’il avait eu une information relative à la détention d’un compte en Suisse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Soyons précis, s’il vous plaît. Vous dites qu’en juin 2008, dans les fonctions qui étaient les vôtres, vous n’avez pas été informé de l’existence du mémoire car cela ne relevait pas de votre sous-direction. Mais quid de l’autre sous-direction ? A-t-elle eu le document ?
M. Alexandre Gardette. La sous-direction des ressources humaines l’a certainement eu.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je vous remercie. Vous pouvez poursuivre.
M. Alexandre Gardette. En résumé, au cours de cette période 2001-2007, on voit que l’information arrive à deux reprises de manière anonyme et sans les précisions qui figureront dans l’article de Mediapart le 4 décembre : nom de la banque, périodes de versements, existence d’un enregistrement. Enfin, puisque l’objectif de votre commission est également de vérifier que la DGFiP n’a pas été instrumentalisée, je noterai que cette information sort une première fois en 2001, à quelques semaines des élections municipales à Villeneuve-sur-Lot, puis en 2007, à quelques semaines des élections législatives de 2007, à l’issue desquelles M. Cahuzac sera à nouveau élu député. Je n’en tire aucune conséquence, mais je trouve cette chronologie étonnante…
J’en viens à l’envoi le 14 décembre 2012 d’une demande de renseignements à M. Cahuzac, suivant la procédure dite « 754 ».
J’ai adressé personnellement le 13 décembre 2012 le projet d’imprimé n° 754 à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Île-de-France et Paris. Le document a été rédigé au sein de mes services et il va de soi que j’assume totalement et sa préparation, et son contenu. Comme vous l’a expliqué M. Bézard la semaine dernière, et contrairement à ce qui a pu se dire ailleurs, il s’agissait de demander à M. Cahuzac, non pas de signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’avait pas de compte à l’étranger, mais de répondre à un document administratif ainsi rédigé : « Vous seriez ou auriez été détenteur d’un compte bancaire ouvert à l’étranger. L’examen de votre dossier fiscal a permis de constater que vous n’avez pas déclaré l’existence de comptes ouverts à l’étranger sur les déclarations de revenus que vous avez déposées au titre des années 2006 à 2011. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants (…) ».
On s’est beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles nous avions recouru à cette procédure.
La première, c’est que, comme MM. Bézard et Parini vous l’ont expliqué, nous étions en cours d’examen de la situation fiscale de M. Cahuzac au titre de ses nouvelles fonctions ministérielles ; il était donc normal de se situer dans ce cadre pour interroger le contribuable. En revanche, il eût été difficile de se contenter d’une réponse orale, d’autant plus qu’il avait déclaré quelques jours auparavant devant vous qu’il n’avait pas de compte à l’étranger : en matière fiscale, une déclaration orale ne suffit pas.
Deuxième raison : nous souhaitions laisser une trace du fait que nous purgions les voies internes d’interrogation du contribuable.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette démarche était-elle vraiment un préalable indispensable à la demande d’assistance administrative à la Suisse ?
M. Alexandre Gardette. Oui, car notre convention avec la Suisse le prévoit explicitement. Si la demande d’assistance administrative était arrivée trop vite dans le processus, les Suisses nous auraient demandé si nous avions épuisé les voies internes.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le cabinet du ministre avait-il été informé de cette démarche administrative ?
M. Alexandre Gardette. Non, pour la bonne et simple raison que jusqu’à la fin du mois de décembre 2012, nous appliquions la circulaire dite « Baroin » relative à l’évocation des situations fiscales individuelles auprès du ministre du budget – laquelle disposait : « Il appartient à l’administration fiscale de gérer au quotidien les relations avec les contribuables dans les différentes missions dont elle a la charge. J’entends m’abstenir de toute intervention dans le cours des procédures individuelles de contrôle et veillerai simplement à ce qu’elles soient mises en œuvre avec l’efficacité, la compétence et le souci déontologique qui sont ancrés dans la culture de vos services » – et que la nouvelle circulaire en vigueur depuis le 31 décembre 2012 reprend, sinon la lettre, du moins l’esprit de la précédente – « Il revient donc dans ce cadre à vos administrations de gérer au quotidien les relations avec les usagers dans les différentes missions dont elle a la charge ».
Permettez-moi d’insister sur un point essentiel. Dès le 4 décembre, et surtout à partir du 10, avec la mise en place de la « muraille de Chine », il y a « deux » Jérôme Cahuzac : le ministre du budget, qui reste en fonction pour l’ensemble des missions dont il a la charge, et le contribuable, sur lequel nous avons un doute, que M. Moscovici a qualifié de « méthodique », et que nous allons nous employer à essayer de lever.
La procédure qui est engagée vise donc le foyer fiscal, c’est-à-dire le couple, et s’inscrit complètement dans le cadre de la circulaire que je viens de citer. Il n’aurait pas été normal que M. Bézard tienne M. Moscovici informé du déroulement de ces procédures.
M. le président Charles de Courson. Est-il normal que votre administration n’ait pas informé M. Moscovici de la non-réponse de M. Cahuzac ?
M. Alexandre Gardette. Dans la mesure où celui-ci maintenait publiquement ses dénégations, où il disait essayer d’obtenir de l’administration suisse une réponse directe à sa demande, et où nous avions commencé à réfléchir à une demande d’assistance administrative dès la mi-décembre, la non-réponse à ce formulaire non contraignant – j’y insiste – n’était pas un événement de nature à justifier l’information de M. Moscovici. En raison du déport de M. Cahuzac à partir du 10 décembre, M. Moscovici était désormais le patron direct de l’administration fiscale sur ces sujets ; en tant que tel, ce qui lui importait était de savoir si oui ou non le ministre délégué détenait un compte à l’étranger. La non-réponse de M. Cahuzac n’était une preuve ni dans un sens, ni dans l’autre puisque le document n’était pas contraignant.
D’autre part, comme vous l’a dit M. Bézard, il est bien évident que même si M. Cahuzac avait répondu à ce document, nous aurions quand même envoyé une demande d’assistance administrative à la Suisse ; en effet, notre objectif n’était pas judiciaire – disculper ou incriminer un membre du Gouvernement –, mais fiscal : fiscaliser le compte éventuellement détenu à l’étranger par un contribuable. Pour ce faire, il nous fallait des informations – période d’utilisation, versements, solde – que seule la banque étrangère pouvait nous transmettre.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment cette demande d’assistance administrative s’articulait-elle avec l’enquête préliminaire ouverte le 8 janvier par le procureur de Paris ?
M. Alexandre Gardette. C’est précisément l’objet de mon quatrième point.
Il faut savoir qu’il existe un principe de spécialité concernant les conventions d’échange d’informations judiciaires entre les pays. En vertu de ce principe, la convention d’échange d’informations judiciaires entre la France et la Suisse fait obstacle à ce que les informations obtenues par MM. Van Ruymbeke et Le Loire nous soient transmises en vue de fiscaliser le compte concerné. Bien entendu, nous disposerons d’informations utiles qui nous permettront de reformuler des demandes d’assistance administrative précisément orientées vers certains établissements « financier » – car avant 2010 Reyl n’était pas une banque. Il reste qu’il faut que les informations en provenance de Suisse nous soient communiquées par l’administration fiscale si nous voulons pouvoir les faire valoir dans une procédure fiscale.
J’estime donc que ma démarche du 24 janvier 2013 n’était pas en contradiction avec l’enquête préliminaire qui venait de s’ouvrir. J’ai d’ailleurs tenu Mme Dufau informée de la demande et de la réponse. Je ne lui ai pas dit que cette réponse purgeait le sujet et qu’elle nous permettait de penser que M. Cahuzac ne possédait pas de compte ; je lui ai simplement donné ces éléments de manière à ce que dans le cadre de l’enquête préliminaire, ils puissent se rendre compte qu’il ne s’agissait pas d’un compte classique détenu chez UBS. En tout cas, c’est ce que dit la réponse des autorités helvétiques.
M. Alain Claeys, rapporteur. Venons-en la notion d’ayant droit. Que recouvre exactement cette notion appliquée à la convention bancaire franco-suisse ?
M. Alexandre Gardette. C’est en effet une question centrale ; je remettrai au rapporteur des textes législatifs et un exemplaire d’une convention sur le sujet.
Nous avons retrouvé la trace d’une loi du 30 septembre 1991, qui prévoyait la fin de l’ouverture de comptes anonymes en Suisse. Mais le premier texte essentiel sur le sujet est la loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997, dont l’article 4 prévoit sur l’identification de l’ayant droit économique que « l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l’ayant droit économique si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou s’il y a un doute à ce sujet ». Si la société Reyl a déposé de l’argent chez UBS en tant que gestionnaire des comptes de M. Cahuzac, on se trouve bien dans cette situation ; en d’autres termes, UBS doit requérir de Reyl une déclaration écrite indiquant que l’ayant droit économique est M. Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avant 2010, la société Reyl est négociante en valeurs mobilières ; or cette obligation ne semble pas s’appliquer aux comptes ouverts par de telles structures. Le confirmez-vous ?
M. Alexandre Gardette. Je confirme que nous ne pouvions pas adresser une demande d’assistance administrative bancaire aux autorités helvétiques concernant les établissements Reyl jusqu’au 1er novembre 2010, date à laquelle ils se sont transformés en établissement bancaire. En revanche, la convention entre les banques suisses et l’association suisse des banquiers du 7 avril 2008 – que je vous remettrai – contient le même type de disposition que le texte que je viens de citer.
Concernant l’identification de l’ayant droit économique, l’article 3 de cette convention indique ainsi : « La banque – en l’espèce UBS – peut présumer que le cocontractant est aussi l’ayant droit économique. Lorsque le cocontractant – en l’espèce Reyl – n’est pas l’ayant droit économique – en l’espèce M. Cahuzac – ou lorsqu’il y a doute à cet égard, la banque exige une déclaration écrite au moyen d’un formulaire A indiquant qui est l’ayant droit économique ». Dans la demande d’assistance administrative que j’ai adressée le 24 janvier 2013 à l’administration fiscale helvétique, nous mentionnons bien évidemment la notion juridique d’ayant droit économique, ainsi que ce formulaire « A » – dont je vous laisserai deux exemplaires types : un où il est fait simplement mention que le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, et un plus sophistiqué où une structure du type trust est interposée entre le cocontractant et l’ayant droit économique final.
Si M. Bézard nous a recommandé d’ajouter le terme « ayant droit économique », c’est donc pour des raisons tant juridiques que de clarté. Dans les demandes d’assistance que nous avions adressées à la Suisse précédemment, nous n’avions pas utilisé formellement la terminologie « ayant droit économique » parce que nous demandions systématiquement le formulaire A et que nous considérions que les deux choses étaient réductibles.
M. Alain Claeys, rapporteur. La question est : Reyl a-t-il réellement rempli ce document ?
M. Alexandre Gardette. Je me pose la question depuis le 2 avril. Je n’ai pas encore la réponse : nous attendons les éléments qu’aura obtenus l’instruction judiciaire. Il existe de mon point de vue trois possibilités.
Soit UBS a menti à l’administration fiscale helvétique ; c’est possible, mais peu plausible compte tenu de ce que je sais par ailleurs du dossier UBS – j’y travaille d’assez prêt avec un juge français. En agissant ainsi, UBS se serait mis en contravention avec les règles internes suisses et aurait pris un risque considérable.
Soit les établissements Reyl n’ont pas respecté la législation helvétique et ont menti à la banque qui détenait l’argent de M. Cahuzac avant qu’il ne soit transféré à la fin 2009 à Singapour. Cette hypothèse me semble plus robuste, mais je n’ai aucune preuve pour la vérifier.
En revanche, notre interprétation du droit interne suisse et de la convention franco-suisse me conduit à penser que, contrairement à ce qui a été dit, notre demande était extrêmement large et qu’elle aurait dû nous permettre d’accéder à cette information. Certes, on peut toujours nous reprocher de ne pas avoir interrogé une autre banque qu’UBS, mais lorsque j’ai signé la demande d’assistance administrative, le 24 janvier, seule cette dernière était mentionnée dans les articles en tant que gestionnaire du compte.
Troisième hypothèse, qui est pure conjecture : on ne sait pas le fin mot de l’histoire et quelque chose se serait s’interposé avant 2006 entre Reyl et UBS. Je suis particulièrement irrité par les leçons de rédaction des demandes administratives que M. Condamin-Gerbier nous donne depuis quelques semaines. Tant mieux si ce gestionnaire de fortune est pétri de remords et souhaite donner une multitude d’informations sur des Français titulaires de comptes non déclarés en Suisse, mais c’est quand même quelqu’un qui a participé à l’opacité du système et au détournement des procédures quand il travaillait pour Reyl entre 2006 et 2010 ; et le voilà qui vient nous expliquer que nous n’avons pas rempli la demande comme nous le devions ! Notre demande était large, elle visait l’ayant droit économique, le droit suisse prévoit que les établissements financiers comme les banques doivent nous donner cette information – et pourtant nous avons reçu une réponse négative.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qui a eu connaissance de la réponse des autorités suisses ? En particulier, les conseils de M. Cahuzac ont-ils été informés de la démarche française et de la réponse adressée à l’administration française ?
M. Alexandre Gardette. Il est assez probable qu’ils aient été informés de la démarche. En effet, le droit suisse prévoit que les banques suisses doivent informer systématiquement leurs clients lorsqu’une demande provient d’un autre État. Surtout, dans la mesure où nous demandions à l’administration helvétique de remonter antérieurement au 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur de l’avenant à la convention, j’avais signé une lettre de couverture accompagnant la demande précisant que si le contribuable concerné et la banque en étaient d’accord – condition nécessaire –, nous souhaiterions obtenir l’information jusqu’en 2006. Il est donc normal qu’ils aient informé le client ou ses conseils de cette question.
Quant à la réponse, M. Cahuzac n’en a été informé ni par moi, ni par mes collaborateurs – et nous n’en avons pas informé non plus le Journal du dimanche. En revanche, je ne saurais vous dire si UBS ou – mais c’est plus douteux – l’administration helvétique a informé le contribuable du sens de la réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Que signifie la mention : « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises » dans la réponse des autorités suisse ? Est-ce une mention habituelle dans des réponses de ce type ?
M. Alexandre Gardette. Les Suisses répondent si peu à nos demandes d’assistance bancaire que nous ne pouvons guère parler d’« habitude » ! Nous avons comparé avec les quelques réponses que nous avions reçues avant celle-ci, et nous n’y avons pas trouvé une telle formule. Toutefois, la réponse à une demande d’assistance bancaire n’est pas normée, et nos collègues de l’administration fiscale helvétique se contentent en général de recopier la réponse que la banque leurfait ; or, à chaque fois, les banques étaient différentes. Nous avons interprété cette mention comme une sorte de « disclaimer », de protection juridique justifiée par le fait que nous étions remontés antérieurement au 1er janvier 2010.
M. le président Charles de Courson. Quelques questions complémentaires.
Vous nous avez apporté des précisions importantes sur ce qui s’était passé au début des années 2000 ; notamment, vous avez expliqué le fait que le dossier de Jérôme Cahuzac ait été envoyé à Bordeaux. Pourtant, est-il normal qu’on envoie sans motif à Bordeaux le dossier d’un contribuable parisien et que ledit dossier ne soit renvoyé que six ans plus tard sans que personne ne s’en inquiète ? N’existe-t-il aucune note clôturant cet examen ? Comment la hiérarchie peut-elle ne pas être au courant ? Il y a là un dysfonctionnement interne à l’administration fiscale ! Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?
M. Alexandre Gardette. Je vais essayer, mais je crains de ne pas avoir d’explication supplémentaire à vous fournir.
La DNEF est un service d’enquête. Ce que l’on aurait dû mener, c’est ce qu’on appelle dans le jargon interne une « enquête », c’est-à-dire une procédure qui tend à examiner les documents internes – le dossier fiscal –, ainsi que toute information d’origine externe, et qui aboutit éventuellement à la proposition d’engagement d’un contrôle. La BII, bien que sise à Bordeaux, avait une compétence nationale. Le service de gestion qui a répondu à cette sollicitation en 2001 a donc parfaitement appliqué les procédures internes : il n’avait pas à demander les motifs de la demande, ni à s’opposer au prélèvement du dossier.
M. le président Charles de Courson. Et cela vous semble normal qu’on puisse transférer un dossier du lieu de domiciliation du contribuable vers un BII sans qu’il y ait de justification à apporter ?
M. Alexandre Gardette. Non, mais un grand nombre de dossiers dits « à fort enjeu », c’est-à-dire ceux des personnes plutôt favorisées en matière de patrimoine ou de revenu, habitent dans les quartiers sud-ouest de Paris. Le pôle fiscal Paris sud-ouest, qui gère, en plus des dossiers « communs », une très grande quantité de dossiers de cette nature, n’a matériellement pas la possibilité d’interroger les services d’enquête ou de contrôle quand ceux-ci viennent prélever un dossier – ce qui est en proportion relativement rare. De mon point de vue, il est donc normal qu’en 2001, le service de gestion n’ait pas eu d’information sur le motif de la demande d’envoi.
Comme je vous l’indiquais tout à l’heure, il y a une case à cocher pour renseigner le motif de la demande. Dès lors que M. Mangier l’avait cochée, il avait formellement fait ce qu’il fallait faire pour obtenir le dossier.
C’est quand le dossier arrive à Bordeaux que les choses commencent à ne plus fonctionner normalement. Au début, cela va encore : l’inspecteur confie à son collaborateur direct, le contrôleur, le soin de rassembler des éléments d’information. Le contrôleur fait son travail – soit à peu près la même chose que ce que fera M. Garnier quelques années plus tard : il vérifie les obligations déclaratives et les obligations de paiement. Puis il revient vers son inspecteur en lui disant qu’il ne dispose pas d’élément lui permettant d’aller plus loin.
À partir de là commencent les conjectures. Au lieu de se retourner vers sa source pour savoir si elle a d’autres éléments à apporter ou d’en parler avec l’inspecteur principal chef de brigade, l’inspecteur laisse le dossier en l’état. Je regrette vraiment que le principal intéressé soit décédé l’année dernière. Je ne suis pas certain qu’il ait mal fait son travail, mais je vous concède qu’il n’est pas normal qu’il n’ait pas informé sa hiérarchie. En revanche, il est normal que cela n’ait pas abouti à un contrôle à partir du moment où l’on ne disposait que d’une information anonyme non étayée.
M. le président Charles de Courson. Venons-en à « l’affaire Garnier ». D’après ce que vous avez retrouvé dans les dossiers, quand commence-t-il à avoir des informations ?
M. Alexandre Gardette. Sur l’éventuelle détention par M. Cahuzac d’un compte en Suisse ?
M. le président Charles de Courson. Oui.
M. Alexandre Gardette. Si je me permets de vous demander cette précision, c’est que le contentieux entre les deux hommes débute bien avant…
M. le président Charles de Courson. Ce qui nous intéresse, monsieur Gardette, c’est la situation fiscale de Jérôme Cahuzac.
M. Alexandre Gardette. Fort bien. M. Garnier est réaffecté à la DIRCOFI du Sud-Ouest, au service d’enquête et de programmation, en septembre 2006. Il se voit attribuer un accès général à Adonis, ce qui est normal vu ses fonctions, et commence à la fin 2006 à consulter la situation fiscale d’un certain nombre de ses collègues – en l’occurrence, plutôt des supérieurs hiérarchiques. La dernière trace informatique que nous ayons d’une consultation du compte fiscal de M. Cahuzac date d’avril 2007.
M. le président Charles de Courson. Et la première ?
M. Alexandre Gardette. J’en ignore la date précise, mais ce qui est certain, c’est que c’est entre septembre 2006 et avril 2007. Je ne sais pas en revanche qui lui a donné la piste.
M. le président Charles de Courson. Vous nous avez dit qu’il avait refusé de donner l’origine de son information à sa hiérarchie. Est-ce normal ? Un inspecteur des impôts peut-il refuser de donner sa source à sa hiérarchie ?
M. Alexandre Gardette. De mon point de vue, non : comme je vous l’ai dit, nous ne pouvons pas engager de contrôle sur la base d’informations anonymes. Cela bloquait donc le processus. Néanmoins, il faut comprendre l’état d’esprit de M. Garnier à ce moment-là : il est convoqué le 24 mai 2007 par son directeur pour se voir reprocher d’avoir consulté, à tort, les dossiers fiscaux d’une trentaine de personnes dans l’application Adonis, et c’est le début d’une procédure disciplinaire à son encontre. Je suppose qu’il n’était pas dans un état d’esprit très favorable à l’égard de l’administration…
M. le président Charles de Courson. Dans son « Mémoire en défense » de juin 2008, M. Garnier fait mention d’informations étonnamment précises. Il écrit notamment : « Cet élu a acquis son appartement parisien situé 35 avenue de Breteuil Paris 7e pour le prix de 6,5 millions de francs, financés comptant, en début de carrière, à hauteur de 4 millions ». Comment a-t-il pu obtenir ces données ? A-t-on accès au patrimoine immobilier par Adonis ?
M. Alexandre Gardette. Oui, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Il évoque ensuite l’existence éventuelle d’un compte en Suisse. Mais comment peut-il affirmer : « J’ai ouï dire qu’il possède un patrimoine immobilier important : villa en Corse héritée de son père, villa à Marrakech, résidence à La Baule » ? Il a accès à l’origine des biens ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Encore faudrait-il vérifier la validité de ces affirmations.
M. le président Charles de Courson. Et encore : « Il emploie une salariée d’origine philippine sans papiers à son service domestique. En 2007, il a été condamné pour ses faits par le tribunal correctionnel de Paris et il a été dispensé de peine. » Comment M. Garnier peut-il connaître ces faits ?
M. Alexandre Gardette. Il est clair que ces informations ne figurent pas dans le dossier fiscal des époux Cahuzac, soit parce qu’elles ne sont pas de nature fiscale – la situation de l’employée philippine –, soit parce qu’elles ne correspondent pas à la réalité du patrimoine des intéressés – votre rapporteur pourra le vérifier.
M. Garnier revenait en septembre 2006 après une première sanction disciplinaire, qui avait été prise à son encontre en 2004 : comme il avait gagné devant la justice administrative, il avait été réintégré dans sa direction d’origine, la DIRCOFI. Inutile de vous dire qu’une situation de ce type est très délicate à gérer. Monsieur Garnier avait été affecté à la brigade d’enquête et de programmation, mais il avait assez peu de travail. Je pense donc qu’il a beaucoup utilisé Internet pour obtenir des informations de toute nature sur M. Cahuzac, qui semblait l’obséder.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président, pour que la Commission soit complètement éclairée sur le sujet, il faudrait qu’elle auditionne M. Garnier. En outre, je vous informe qu’en tant que rapporteur, je demanderai à consulter le dossier fiscal de M. Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. C’est entendu, monsieur le rapporteur.
S’agissant de la réponse négative de l’administration helvétique, monsieur Gardette, vous avez fait trois hypothèses. Mais le gouvernement helvétique a informé le gouvernement français qu’il y avait eu pour 80 milliards d’euros de dépôts sur des comptes de résidents français non déclarés à l’administration fiscale française. On considère qu’il y a deux manières d’échapper aux enquêtes : la première est la constitution d’un compte « omnibus », ou « écran », c’est-à-dire un compte détenu par un chargé d’affaires abritant des sous-comptes ; la seconde est un système plus raffiné, qui passe par la création d’une fondation à l’étranger, notamment au Lichtenstein, laquelle détient le compte en Suisse. De toute évidence, la convention franco-suisse ne permet pas de lutter efficacement contre ce type de fraude.
D’ailleurs, votre directeur général nous a donné les chiffres : 4 500 consultations, 6 % de réponse, qui n’ont débouché que dans trois à quatre cas. Avec des montages de ce type, la convention actuelle n’aboutit-elle pas à des réponses systématiquement négatives de la part des autorités helvétiques ?
M. Alexandre Gardette. Une précision, pour commencer : je pense que les autorités helvétiques étaient d’autant plus enclines à informer la France et le grand public des dépôts effectués dans leurs banques qu’elles souhaitaient promouvoir un accord de type « Rubik ». J’ignore si 80 milliards d’euros ont été déposés dans les caisses des banques suisses par des résidents français ; en revanche, je suis certain que la France n’a pas souhaité signer avec la Suisse un accord de type « Rubik », qui consistait à opérer un prélèvement forfaitaire sur ces sommes et à blanchir ou exonérer d’impôt le reste.
Les deux montages que vous avez mentionnés existent. Toutefois, comme je vous l’ai indiqué, je remettrai à votre rapporteur deux exemples de formulaire A, qui montrent que si les acteurs helvétiques respectent la loi suisse au moins depuis 1997, ces deux types de montages ne devraient pas faire obstacle à une réponse sur l’ayant droit économique réel. J’ai ainsi un exemple de formulaire A, dans lequel un intermédiaire, du même type que les établissements Reyl, ouvre un compte dans une banque qui comprend des sous-comptes au nom de plusieurs ayants droit économiques. Je vous transmettrai un deuxième exemple, plus sophistiqué, qui mentionne des structures interposées comme celles auxquelles vous faisiez référence, et qui peuvent être domiciliées non seulement au Lichtenstein, mais aussi au Panama, par exemple. Ce qui est en cause, ce n’est pas la manière dont on a formulé la demande, ni celle dont est rédigée notre convention avec la Suisse depuis l’avenant de 2009, mais le respect de la loi helvétique et la surveillance de ces établissements par les autorités locales.
M. le président Charles de Courson. L’affaire Cahuzac ne prouve-t-elle tout de même pas qu’en raison de ces montages, notre convention avec la Suisse ne nous permet pas de détecter les fraudeurs ?
M. Alexandre Gardette. Il est pour nous évident depuis longtemps que la seule solution serait un échange automatique d’informations entre tous les États sur les titulaires effectifs de comptes, qui nous informerait de leurs soldes. Aujourd’hui, nous ne disposons que d’une assistance à la demande, et nous dépendons de celui qui nous répond.
M. le président Charles de Courson. Et pourquoi n’avez-vous pas saisi simultanément Singapour ?
M. Alexandre Gardette. Nous nous sommes bien évidemment posé la question.
D’une part, les informations dont nous disposions faisaient état d’un transfert en 2010. Nous avons réussi à convaincre les autorités helvétiques de remonter jusqu’au 1er janvier 2006, car je craignais que les informations révélées par Mediapart le 4 décembre ne soient également imprécises sur la chronologie et que si le transfert avait eu lieu fin 2009 – et il semble apparaître que ce soit le cas –, nous ne couvrions pas ce créneau. Or, dès lors que l’on couvrait la période 2006-2012 et qu’il n’y avait pas de transfert vers l’étranger pendant cette période, je pense qu’il aurait été difficile de convaincre les autorités singapouriennes de nous répondre – ce pourquoi nous ne l’avons pas fait.
Il faut en effet savoir que la convention avec Singapour est en théorie moins restrictive que celle avec la Suisse – on a la possibilité de faire une recherche sur la totalité des banques –. Mais, en pratique, comme les autorités singapouriennes ne disposent pas d’un fichier national des comptes bancaires, elles sont obligées d’interroger individuellement les 600 ou 700 établissements bancaires et, surtout, un juge doit accepter la demande française pour chacune des opérations.
Ces éléments combinés : la pratique de l’assistance administrative avec Singapour et le fait que nous avions une réponse négative sur le transfert nous ont amenés à ne pas interroger Singapour en février.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez dit que l’administration fiscale n’ouvrait pas d’enquête dès lors que les éléments apportés étaient anonymes. Toutefois, lorsqu’en juin 2008 M. Garnier rédige son mémoire en défense, même si les sources elles-mêmes restent anonymes, il écrit avoir ouï dire que Jérôme Cahuzac détenait un compte en Suisse. Qu’on ne prenne pas en compte cette déclaration écrite me semble choquant !
À plusieurs reprises, vous avez donné plusieurs réponses possibles aux interrogations soulevées. À la question : « Les conseils de M. Cahuzac ont-ils été informés de la démarche française et de la réponse des autorités suisses ? », vous avez répondu : « Il est assez probable qu’ils aient été informés de la démarche ». Cette formulation est étonnante : soit ils en étaient informés, et vous le savez, soit ils ne l’étaient pas, parce qu’il y avait une autre « muraille de Chine ». Quant à votre allusion à l’information publiée par le Journal du Dimanche, transmise « ni par moi, ni par mes collaborateurs », mais probablement par UBS ou par l’administration helvétique, franchement, il faudrait être plus clair ! Vous ouvrez une piste, mais il n’y a pas de certitude.
M. Alexandre Gardette. S’agissant de l’information donnée par le Journal du Dimanche dans son édition du 10 février 2013, sauf erreur, le site du Nouvel Observateur avait publié quelques jours auparavant une observation de même nature, qui donnait déjà le sens de la réponse. Je maintiens – puisque le directeur général des finances publiques m’a déjà posé la question et qu’il m’a demandé de la poser aux trois collaborateurs qui ont travaillé avec moi sur ce dossier et ont reçu la réponse – que la source des médias n’émanait pas du service du contrôle fiscal. Je ne peux évidemment pas m’engager pour d’autres, mais je ne pense pas non plus qu’il s’agisse du directeur général, évidemment. Je ne peux donc pas vérifier l’origine de cette fuite dès lors qu’elle ne vient pas de chez moi.
J’ai donné le sens de la réponse et la réponse des autorités helvétiques à deux personnes : à M. Bézard, qui s’est expliqué devant vous la semaine dernière sur ce qu’il en avait fait, et, le lendemain, à la police judiciaire, en la personne de Mme Dufau ; bien évidemment, je ne suspecte pas la police judiciaire d’être à l’origine de cette fuite. Je ne peux donc pas répondre à cette question, madame la députée, et croyez bien que j’en suis désolé.
Quant à l’information des conseils de M. Cahuzac, je maintiens également ce que j’ai dit : je ne peux pas être certain de ce qui s’est passé entre une partie privée et un établissement bancaire suisse. Là encore, croyez bien que je regrette de ne pas disposer de ce genre d’informations. Toutefois, si le chef du service du contrôle fiscal que je suis aimerait bien évidemment accroître ses informations sur les contribuables, le citoyen que je suis aussi pose des limites à ce que le chef du service du contrôle fiscal souhaiterait…
Soyons précis : la législation suisse permet à un contribuable d’avoir connaissance d’une demande provenant d’un État étranger quand celle-ci le concerne. C’est une première raison interne à la Suisse qui peut expliquer le fait que M. Cahuzac ait eu connaissance du fait que nous interrogions les autorités helvétiques. En outre, dans la lettre de couverture que j’ai signée, j’avais autorisé l’administration helvétique à utiliser cette procédure interne suisse sur les années 2006 à 2009 dans la mesure où nous étions en dehors du cadre de l’avenant à la convention. Il était normal que nous permettions que la banque et les conseils du contribuable soient informés de la demande. Il s’agissait, non pas d’un passe-droit, mais d’un moyen d’obtenir des informations sur une période non couverte par la convention.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’était donc une demande de votre part ?
M. Alexandre Gardette. Tout à fait ; ma lettre de couverture comporte un paragraphe qui dit en substance : « Nous souhaitons, s’il y a accord du contribuable et de l’établissement bancaire concerné, que vous nous donniez les éléments sur une période non couverte par l’avenant à la convention, c’est-à-dire 2006-2009 ». Lors de nos conversations téléphoniques avec nos homologues helvétiques, les 22 et 23 janvier, nous avons bien évidemment évoqué le sujet. Ce que nous demandions n’étant pas prévu par la convention, il était normal que nous ne refusions pas l’application du droit suisse sur ce point.
M. Christian Eckert. Je crois que la réponse des autorités helvétiques contient la réponse à notre question : « Après consentement de Maître Edmond Tavernier, représentant M. Jérôme Cahuzac, la banque nous a informés… ». Il y a donc bien eu information de M. Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’ai souhaité avoir cette précision parce qu’il était important qu’il soit dit devant la Commission d’enquête qu’une demande avait été faite en ce sens.
M. le président Charles de Courson. Cela nous amène à une question plus large : pourquoi, alors qu’il sait qu’il a un compte en Suisse, M. Cahuzac autorise-t-il l’élargissement de la recherche à une autre période ? N’est-ce pas parce qu’il sait que la réponse ne peut être que négative ?
M. Alexandre Gardette. Permettez-moi de préciser une chose : le droit suisse, tel qu’il est en vigueur, fait obligation d’informer le contribuable ou son conseil qu’une interrogation porte sur lui. Je pense donc que même si je n’avais pas sollicité la Suisse sur la période 2006-2009, M. Cahuzac en aurait été informé.
M. le président Charles de Courson. De la demande, oui, mais pas forcément de la réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Rien ne figure dans le droit concernant la réponse ?
M. Alexandre Gardette. Nous comprenons du droit suisse que la banque n’a pas l’obligation d’informer le contribuable du sens de la réponse quand celle-ci est négative.
M. le président Charles de Courson. Ce qui était le cas en l’espèce. Nous devrions pouvoir vérifier ce point, puisque nous avons demandé à auditionner le responsable de l’administration fiscale suisse.
M. Alexandre Gardette. Concernant le mémoire de M. Garnier, il faut prendre en considération deux éléments.
Tout d’abord, le contexte, qui est très important : l’intéressé, qui faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, était en opposition ouverte avec sa hiérarchie ; la situation n’était donc pas « normale ».
Ensuite, nos procédures : j’ai interrogé les trois directeurs successifs de la DIRCOFI du Sud-Ouest et, en particulier le directeur qui était en poste en 2007. Il m’a indiqué qu’après évaluation des informations recueillies par M. Garnier, ils avaient jugé impossible d’engager un contrôle approfondi sur de telles bases. Je rappelle, en effet, que dans son mémoire, M. Garnier précise que « les informations recueillies proviennent de plusieurs sources extérieures à l’administration fiscale » et parle, un peu plus loin, de « ouï-dire ». Franchement, je trouve préférable que notre administration fiscale refuse d’engager un contrôle sur des informations provenant d’une source anonyme, plutôt qu’elle lance des contrôles approfondis à chaque fois qu’elle obtient ce type d’information !
M. Patrick Devedjian. Et vous avez raison !
M. Jean-Pierre Gorges. Manifestement, M. Gonelle a bien du mal à se faire entendre : à trois reprises, il parle, et, à trois reprises, il se heurte à un mur.
D’abord, en 2001 : vous vous en expliquez avec précision, indiquant que l’administration a fait son travail – et je suis d’accord avec vous : ce n’est pas sur dénonciation que l’on doit agir. Une précision tout de même : M. Mangier était-il autorisé à ne rien dire sur ce classement sans suite ou devait-il en rapporter à la hiérarchie ?
Ensuite, en 2006, M. Gonelle donne à M. Bruguière un document qui prouve que M. Cahuzac a un compte en Suisse : l’enregistrement. M. Bruguière a-t-il contacté l’administration fiscale ? Il était soumis à l’article 40 du code de procédure pénale – c’est d’ailleurs ce qui avait justifié le choix de M. Gonelle : il s’est dit qu’un juge de cette trempe valait davantage qu’un petit juge de province.
M. le président Charles de Courson. Et qu’il connaissait l’article 40 !
M. Jean-Pierre Gorges. Mais, comme vous l’avez fait remarquer, on était alors en pleine période électorale…
Troisième épisode : M. Gonelle transmet l’information à M. Zabulon, qui, a priori, en discute avec le Président de la République. On dispose désormais de faits précis, les protagonistes sont identifiés, il y a matière à agir. Que se passe-t-il alors ?
On nous dit qu’en interrogeant la Suisse, on a obtenu une réponse négative – information qui a d’ailleurs été exploitée beaucoup trop rapidement par certaines personnes, dont Claude Bartolone. Mais à ce jour, qui dit que M. Cahuzac possède un compte en Suisse, excepté l’intéressé lui-même ? Je n’ai vu aucune pièce indiquant que M. Cahuzac détient ou a détenu un tel compte ! La seule personne à l’avoir déclaré est Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il a parlé, non pas d’un compte en Suisse, mais d’un compte à l’étranger.
M. Alexandre Gardette. Le fait que M. Gonelle ait eu du mal à se faire entendre en 2001 est de mon point de vue une des conséquences de la procédure qu’il a retenue pour prendre contact avec l’administration fiscale : en parler à une connaissance qui va joindre un ami au sein de l’administration fiscale, ce n’est pas l’idéal… Il semble que cette connaissance semble être M. Mangier, et je confirme bien volontiers qu’il ne me paraît pas normal que ce dernier n’ait pas informé sa hiérarchie, d’abord du fait qu’il avait demandé ce dossier, puis du fait qu’il n’en ferait rien, faute d’élément utile.
Nous n’avons trouvé aucune trace d’une transmission par M. Bruguière d’une information relative à l’enregistrement en 2006-2007 – ni dans les années suivantes, bien entendu. On ne peut pour autant exclure que M. Bruguière soit la ou l’une des sources de M. Garnier. Puisque vous allez l’auditionner, vous pourrez lui demander de préciser ce point.
M. le président Charles de Courson. Il est quand même étonnant qu’un inspecteur des impôts se permette d’utiliser Adonis et qu’il refuse de donner ses sources quand on les lui demande !
M. Alexandre Gardette. Comme je vous l’ai expliqué, il était en conflit ouvert avec sa hiérarchie. Je ne l’excuse pas, mais il faut comprendre le contexte. Il reste qu’en tant que chef du service du contrôle fiscal, comme vous je trouve cela anormal.
Bien évidemment, l’entourage du chef de l’État – en l’espèce, un membre de son cabinet – n’a pas transmis non plus l’information à l’administration fiscale durant la période concernée, c’est-à-dire entre décembre 2012 et janvier 2013.
S’agissant de la Suisse, vous avez raison : nous devons être prudents s’agissant d’informations qui nous sont données principalement par le contribuable lui-même via son blog ; le fait qu’il reconnaisse maintenant un fait qu’il a nié pendant des mois, voire des années, ne nous suffit pas à fiscaliser le dossier. Comme je vous l’ai expliqué, en raison du principe de spécialité, les informations recueillies par les juges nous seront utiles pour travailler, mais nous ne pouvons pas les utiliser directement ; nous serons donc amenés à utiliser toutes les procédures administratives à notre disposition à l’égard de tous les États que nous jugerons utiles d’interroger pour fiscaliser ce ou ces comptes.
M. Jean-Marc Germain. Trois questions.
Premièrement, confirmez-vous que vous excluez totalement l’hypothèse qu’UBS ou les autorités helvétiques n’aient pas apporté une réponse positive à votre question parce qu’ils ne sentaient pas tenus de répondre sur la période 2006-2009 qui n’était pas couverte par la convention franco-suisse ?
Deuxièmement, qui a décidé d’utiliser la convention d’entraide avec la Suisse, et à quel moment ? Il semble ressortir de vos propos que vous êtes à l’origine de la démarche.
Enfin, confirmez-vous que, dans le dossier fiscal de M. Cahuzac, il n’existe aucune information concernant l’existence d’un tel compte, la circulation de rumeurs à son sujet ou le lancement d’opérations de vérification ? Si tel est le cas, cela vous paraît-il normal ?
M. Alexandre Gardette. Je n’exclus pas totalement qu’UBS ait menti à l’administration fiscale suisse ; en revanche, compte tenu du contexte général, cette hypothèse ne me semble pas la plus probable parmi les trois que j’ai formulées.
C’est dès la mi-décembre que nous commençons à envisager la possibilité de faire appel à la Suisse. Je crois me souvenir que ce n’est pas moi qui ai fait cette proposition, mais que Bruno Bézard nous a interrogés sur les possibilités techniques d’avoir recours à une assistance administrative. Nous lui avons répondu que les chances d’obtenir un résultat positif étaient faibles parce que les Suisses risquaient de juger la demande non pertinente compte tenu du fait qu’elle était basée principalement sur un article de presse.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous fait une note à votre directeur général sur le sujet ?
M. Alexandre Gardette. Non, il s’agissait d’un échange oral.
Lorsque j’ai consulté le dossier fiscal complet des époux Cahuzac en janvier dernier, il n’y figurait aucun élément relatif à l’éventuelle détention d’un compte bancaire à l’étranger. Dans la mesure où les informations qui nous ont été transmises, d’abord en 2001 par M. Gonelle interposé, ensuite en 2007 par M. Garnier, avaient à l’époque été écartées par nos services, je ne trouve pas anormal qu’elles ne figurent pas dans le dossier fiscal. Si nous refusions d’utiliser des informations d’origine anonyme tout en les conservant dans les dossiers, au bout d’un temps, on risquerait de penser que tout est vrai.
M. Dominique Baert. Vous avez dit que la demande de dossier fiscal avait été reçue le 9 février et que le coupon d’envoi était daté du 12 février 2001 : c’est très rapide ! Dans ces conditions, comment expliquez-vous que lors de son audition, M. Gonelle ait affirmé qu’il n’y avait pas eu de transmission du dossier ? De toute évidence, les soupçons d’interférence politique à cette période ne tiennent pas. Qu’en pensez-vous ?
Le 23 mai 2013, dans l’émission Compléments d’enquête diffusée sur France 2, un inspecteur des impôts interviewé anonymement, et qui n’est pas Rémy Garnier, déclarait qu’il avait demandé à la DNEF de se procurer le dossier de Jérôme Cahuzac en janvier 2001 et que la direction nationale le lui avait refusé. Comment réagissez-vous à ces propos ?
M. Alexandre Gardette. N’accusant pas M. Gonelle de mentir, puisqu’il a prêté comme moi serment devant votre commission, j’imagine qu’il vous a répété ce que quelqu’un lui a dit en 2001. Je considère pour ma part que nous avons en notre possession des documents administratifs qui prouvent que le dossier a bien été envoyé et retourné aux dates que je vous ai indiquées ; si les documents inclus dans le dossier fiscal de l’intéressé ne sont pas véridiques, je ne peux plus répondre de grand-chose…
Vous me demandez de faire une conjecture sur ce qui a pu être dit à M. Gonelle. Je m’y livrerai donc, bien que j’ignore ce qui s’est réellement passé. Peut-être que, bien qu’« actionné » par la mystérieuse « connaissance » de M. Gonelle, qui a fait l’interface entre ce dernier et la BII de Bordeaux, M. Mangier, par professionnalisme, n’a pas voulu lui indiquer les suites qui avaient été données à une sollicitation de nature amicale, et lui a répondu qu’il n’avait pas récupéré le dossier ou que Paris n’avait pas voulu le lui transmettre.
Autre hypothèse : c’est à une tierce personne que M. Gonelle avait donné l’information – il s’agit peut-être de la personne interrogée dans Compléments d’enquête, mais je n’en ai retrouvé aucune trace. Ne travaillant pas dans un service d’enquête à compétence nationale, cette personne n’aurait pas eu le droit de consulter un dossier géré à Paris, non parce que le contribuable concerné était un député ou une personnalité sensible, mais parce que nos directions de contrôle ont des compétences géographiques – exception faite de la direction nationale des enquêtes fiscales.
M. Dominique Baert. Vous confirmez donc que le dossier a été demandé le 9 février 2001 et expédié le 12 sans aucune interférence politique ?
M. Alexandre Gardette. Absolument.
M. le président Charles de Courson. L’intermédiaire devrait être facile à retrouver, dans la mesure où, s’il a refusé de donner son nom, M. Gonelle a indiqué qu’il avait été président de la Ligue des droits de l’homme de Villeneuve-sur-Lot.
M. Dominique Baert. Dans Complément d’enquête, l’inspecteur des impôts qui s’exprime n’est pas M. Mangier, puisqu’il est décédé, ni M. Garnier, ni le président de la Ligue des droits de l’homme que vous évoquez ; il y a donc encore une autre personne…
M. Alexandre Gardette. Il me semblait que trois personnes étaient impliquées : M. Gonelle, qui avait l’information, un intermédiaire et un agent des impôts. Il est désormais acquis, à la suite de nos recherches, que ce dernier était M. Mangier ; néanmoins, j’avais compris que l’intermédiaire faisait également partie de l’administration fiscale, bien que ne travaillant pas à la BII.
M. le président Charles de Courson. J’avais compris la même chose.
M. Alexandre Gardette. Et je précise que nos agents ont parfaitement le droit d’être concomitamment inspecteur des impôts et président de la Ligue des droits de l’homme du département : ce n’est pas contradictoire !
Quant à votre deuxième question, je ne suis pas capable d’y répondre. J’ai regardé l’émission, mais je n’ai pas réussi à identifier cette personne. J’ignore s’il s’agit de l’intermédiaire en question, ou de quelqu’un d’autre encore.
M. Thomas Thévenoud. Ce qui est frappant, c’est que M. Gonelle parle beaucoup, mais il ne s’adresse jamais aux bonnes personnes… Et que dire de M. Bruguière ? Il est quand même incroyable qu’à aucun moment dans cette affaire, il n’ait été fait application de l’article 40 ! J’espère, monsieur le Président, que nous auditionnerons M. Bruguière.
Existe-t-il une trace du fait que M. Mangier, après avoir constaté qu’il n’avait pas assez d’éléments, a arrêté la procédure ?
Jugez-vous logique que M. Garnier ait été réintégré dans sa direction d’origine avec droit d’accès illimité à Adonis, alors qu’il sortait d’un contentieux avec sa hiérarchie et son administration ? Est-ce conforme aux usages de l’administration fiscale ?
Vous avez dit que vous aviez examiné le dossier des époux Cahuzac en janvier de cette année. Quelles relations votre administration entretient-elle avec Mme Cahuzac ou avec ses conseils ?
Le formulaire « 754 » est-il un document normalisé ? L’avez-vous modifié ou enrichi – en d’autres termes ?
M. Alexandre Gardette. Malheureusement, M. Mangier n’a laissé aucune trace autre que la réexpédition du dossier en février 2007. Il est bien évident que je ne trouve pas cela normal et, afin d’éviter que cela se reproduise, nous nous efforçons de mettre en place des applications informatiques qui fassent le suivi à la fois de la recherche et des contrôles fiscaux. Il ne me semble pas acceptable qu’en 2013, on n’ait pas à rendre compte d’une activité aussi sensible, soit au corps de contrôle, soit au Parlement.
M. Thomas Thévenoud. M. Mangier arrête l’examen du dossier en 2001 et il met six ans pour le réexpédier ?
M. Alexandre Gardette. Je comprends votre incrédulité : j’ai eu la même réaction lorsque j’ai pris connaissance du dossier complet des époux Cahuzac en janvier dernier. Je ne saurais dire à quelle date précise il arrête ses investigations, mais, d’après le compte rendu que nous a fait son ancien collaborateur, je pense que c’est dans les semaines qui suivent la réception du dossier : son collaborateur a procédé aux opérations de contrôle dans les semaines qui ont suivi la réception du dossier – donc au printemps 2001 – et, ne trouvant rien, il a demandé à son supérieur hiérarchique s’il avait des informations complémentaires ou s’il était possible de rencontrer sa source ; comme la réponse de M. Mangier fut négative, cela s’est arrêté là. Quant à savoir pourquoi le dossier est resté jusqu’en 2007 à la BII de Bordeaux, je ne vois pas d’autre explication que la négligence.
M. Garnier avait été muté d’office à la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne. Il a attaqué cette décision, a gagné et a donc obtenu le droit d’être réintégré dans le service où il était précédemment affecté, l’antenne d’Agen de la DIRCOFI du Sud-Ouest ; il y était auparavant vérificateur, et c’est dans ce cadre qu’il avait contrôlé France Prune. Pour des raisons évidentes, il fut jugé impossible de le réintégrer dans les mêmes fonctions, et c’est pourquoi on lui a confié des missions d’enquête et de programmation. À ce titre, il était logique de lui donner accès à Adonis. Était-ce une bonne idée ? Rétrospectivement, je ne le pense pas.
Nos relations avec Mme Cahuzac sont normales. Lorsqu’on examine la situation fiscale d’un ministre qui vient de prendre ses fonctions, on prend en considération le dossier de l’ensemble du foyer fiscal. Il est de notoriété publique que la situation du couple Cahuzac n’était pas tout à fait « normale », et nos services – notamment la DRFIP 75 – avaient quelques difficultés à obtenir les renseignements voulus. C’est pourquoi, à la fin novembre ou au début décembre, nous avons indiqué aux contribuables qu’il serait souhaitable qu’ils nomment un conseil qui parlerait en leur nom commun ; maître Ranchon, expert-compable des deux membres du foyer, a donc rencontré le 19 décembre l’administration fiscale de Paris, qui lui a posé une série de questions, lesquelles ont été reproduites le lendemain dans un article bien informé de Mediapart… Nos relations avec Mme Cahuzac étaient donc les mêmes que celles que nous avions avec M. Cahuzac, au sens où nous lui posions des questions sur des sujets fiscaux par son conseil interposé.
Le « 754 » est un formulaire globalement normalisé, qui est utilisé dans des circonstances précises. En revanche, la rédaction de sa deuxième page est assez libre : chaque fonctionnaire des impôts l’adapte aux questions qu’il souhaite poser au contribuable. En ce sens, le service du contrôle fiscal y a effectivement mis sa « patte ». Les services parisiens auraient bien entendu été capables de le faire, mais, dans la mesure où le formulaire concernait le ministre du budget, il m’a semblé normal que l’administration centrale prenne la responsabilité de le rédiger.
M. Christian Eckert. D’aucuns ont mis en avant le fait que la banque UBS faisait dès cette époque l’objet d’un certain nombre de procédures administratives, judiciaires et autres. Avez-vous subi une pression de quelque nature que ce soit sur ce dernier dossier ? Y a-t-il eu interférence de M. Cahuzac dans l’affaire UBS ?
M. Alexandre Gardette. Aucunement. Le dossier concernant la banque UBS était expressément mentionné dans l’instruction dite « muraille de Chine » du 10 décembre 2012 : il faisait partie des dossiers que nous ne pouvions plus évoquer avec le ministre délégué de l’époque. J’ai en mémoire une note générale sur ce dossier envoyée au directeur de cabinet de M. Moscovici le 11 décembre, sur le bordereau d’envoi de laquelle notre directeur général avait écrit à la main : « Adressée uniquement au ministre de l’économie compte tenu de la procédure « muraille de Chine » – laquelle avait été adoptée la veille. À partir du moment où l’instruction « muraille de Chine » a été connue, nous n’avons rendu compte d’éventuels éléments nouveaux dans l’affaire UBS qu’au « 6e étage », c’est-à-dire au ministre de l’économie.
M. Christian Eckert. Et auparavant, à votre connaissance, le ministre délégué avait-il eu à intervenir dans cette affaire ?
M. Alexandre Gardette. Il faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas que nous ayons adressé de note aux ministres sur ce dossier avant celle du 11 décembre. Mais si cela avait été le cas, nous l’aurions adressée aux deux ministres ; ce dont je suis certain, c’est qu’il n’y a eu aucune interférence de M. Cahuzac dans le dossier UBS général.
Mme Cécile Untermaier. Il y avait eu des alertes sur la situation fiscale de Jérôme Cahuzac en 2001, 2006 et 2008. Je crois savoir que M. Garnier avait dénoncé des sous-évaluations. Au-delà de la question de l’enregistrement et du compte en Suisse, dans quel état d’esprit se trouve l’administration fiscale à l’égard d’une situation aussi problématique ?
Vous dites qu’il existe un délai, non contraignant, de trente jours pour renvoyer le formulaire 754. Vous attendiez-vous à une réponse rapide de la part de M. Cahuzac, de manière à ce que l’assistance administrative à la Suisse puisse être demandée rapidement ? Qu’avez-vous pensé quand vous avez constaté qu’il ne répondrait pas ?
M. Alexandre Gardette. En 2001, l’information ne portait que sur la détention d’un compte, non déclaré, à l’étranger et elle n’était pas remontée à la hiérarchie. Elle ne figure pas dans le dossier ; le service d’enquête n’avait pas proposé de contrôle approfondi : il n’y avait par conséquent aucune raison que cela ait des suites.
En 2006, l’information ne parvient pas à l’administration fiscale : c’est M. Bruguière qui est informé par M. Gonelle ; nous n’en entendons pas parler.
En 2008, le service du contrôle fiscal ne tire pas de conclusions du mémoire de M. Garnier sur le dossier fiscal de M. Cahuzac, puisqu’il n’en a pas connaissance ; quant aux directeurs locaux, ils considèrent que les informations ne sont pas suffisantes pour ouvrir une procédure.
Quand il prendra connaissance du dossier fiscal de l’intéressé, votre rapporteur constatera qu’il y a bien eu des contrôles effectués depuis 1991 : le dossier n’est pas resté à l’écart de toute procédure, bien au contraire.
S’agissant du formulaire 754, il est vrai que nous n’attendions pas véritablement de réponse ; mais, je le répète, nous aurions de toute façon fait une demande d’assistance administrative. Simplement, si nous avions eu la réponse le 20 décembre, nous l’aurions lancée trois semaines plus tôt.
Mme Cécile Untermaier. Dans un tel contexte de pression médiatique, attendre trente jours, c’est très long !
M. Alexandre Gardette. Dans l’administration, trente jours n’est pas un délai très long – non que l’on travaille lentement, mais il y a des procédures de contrôle ! Nous nous attendions à ce que les Suisses mettent six mois à nous répondre. M. Moscovici ayant beaucoup insisté auprès de Mme Widmer-Schlumpf, de même que M. Bézard auprès de son homologue, nous espérions une réponse rapide – mais pas en sept jours ! Nous avions engagé une procédure fiscale ayant pour objectif de taxer, si compte il y avait, des avoirs à l’étranger ; notre préoccupation première n’était pas la gestion du temps médiatique. Nous laissions cela aux autorités politiques et au Gouvernement.
Mme Cécile Untermaier. M. Moscovici n’a pas été informé de la non-réponse dans le délai de trente jours ?
M. Alexandre Gardette. Je vous le répète : le ministre n’en a pas été informé.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Gardette, je vous remercie pour la précision de vos propos.
Audition du mardi 4 juin 2013
À 16 heures 30 : MM. Olivier Sivieude, directeur des vérifications nationales et internationales (DVNI), et Bernard Salvat, ancien directeur national des enquêtes fiscales (DNEF), et Mme Maïté Gabet, directrice nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre Commission d’enquête. Messieurs, Madame,vous dirigez ou avez dirigé jusqu’à une date récente les trois directions à compétence nationale de la DGFiP spécialisées dans le contrôle fiscal : la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), qui procède au contrôle fiscal des entreprises les plus importantes, la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), chargée de la recherche de la fraude, et la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), qui contrôle les personnes physiques dotées d’un patrimoine important ou dont la situation est jugée sensible.
Nous cherchons à savoir si, au-delà des services centraux, vos trois directions ont été sollicitées pour enquêter sur la situation financière ou fiscale de M. Cahuzac.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie de bien vouloir lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(M. Olivier Sivieude, M. Bernard Salvat et Mme Maïté Gabet prêtent serment.)
M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications nationales et internationales (DVNI). Je suis à la tête de la DVNI depuis 2008, c’est-à-dire depuis cinq ans. Celle-ci contrôle les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 150 millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires excède 75 millions, soit un total de 3 500 groupes ou entreprises établis en France et, si l’on y ajoute leurs filiales, de 70 000 entreprises.
Mes 500 collaborateurs procèdent à 1 400 contrôles par an. En 2012, le montant des rappels, droits et pénalités, portant essentiellement sur les impôts dus par les sociétés s’est élevé à 4,6 milliards. La DVNI, qui ne s’intéresse pas à la situation des particuliers, ne réalise pas d’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) et ne contrôle pas l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Elle n’effectue de rappel sur l’impôt sur le revenu (IR) que dans le cadre du contrôle des entreprises, quand la situation des dirigeants est vérifiée, pour savoir, par exemple, s’ils ont bénéficié d’avantages en nature, si leur rémunération est excessive et s’ils ont déclaré des plus-values sur des titres ou des stock-options. C’est seulement dans ce cadre que nous pouvons être amenés à effectuer des rappels sur l’IR.
Je suis interrogé par votre Commission d’enquête parce qu’un article de Valeurs actuelles a affirmé que des vérificateurs de la DVNI auraient participé, dans le cadre de l’affaire Cahuzac, à une enquête en Suisse. C’est faux, voire grotesque : nous ne contrôlons jamais les particuliers ; de plus, nous n’avons pas le droit d’aller à l’étranger. Aucune administration de contrôle fiscal, de quelque pays qu’elle soit, ne peut faire de contrôle hors de son territoire national. Enfin, la DVNI n’effectue ni recherche, ni enquête. Ni moi ni mes collaborateurs ne sommes donc concernés par cette affaire.
M. Bernard Salvat, ancien directeur national des enquêtes fiscales (DNEF). L’action de la DNEF s’inscrit dans les orientations données par la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui nous adresse des lettres de mission. Depuis trois ans, c’est-à-dire depuis le début de mon mandat, la direction nous a prescrit de renforcer la lutte contre les fraudes graves, notamment dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Nos cibles principales sont les carrousels en TVA et la fraude internationale. Nous disposons de différents droits : du droit de communication au droit d’enquête, ainsi que de la possibilité d’effectuer des vérifications, voire des perquisitions. Au terme de l’enquête, la comptabilité des entreprises est vérifiée par les directions partenaires, comme la DVNI ou les directions de contrôle fiscal, très rarement par la DNEF. La procédure est calée sur le plan juridique. Nos opérations sont rarement censurées par les tribunaux, tant au stade de l’enquête qu’à celui de l’exploitation des renseignements que nous fournissons pour vérification.
Conformément aux orientations que nous avons reçues, nous avons nettement accru notre production. En trois ans, nous avons multiplié par deux et demi le nombre des contrôles et amélioré la qualité de nos travaux, comme en témoigne l’élévation du taux d’aboutissement de nos propositions de contrôle. En matière de résultats financiers, de recouvrement et de suites pénales, l’évolution est très favorable. Nous avons également développé des actions préventives, notamment pour les carrousels, car l’affaire du CO2 est encore dans nos mémoires. La prévention concerne les secteurs sensibles que sont l’énergie, la téléphonie ou le commerce des véhicules d’occasion. Nos travaux sont montés en gamme, ce qui se concrétise par une importante programmation – une centaine d’affaires – au profit de la DVNI. Dans le secteur de l’économie numérique, nous avons mené des opérations lourdes. Depuis trois ans, la DNEF n’a donc été ni passive, ni en retrait. Elle soutient honorablement la comparaison avec ses homologues italien, allemand et britannique. C’est une direction très active mais en matière de fiscalité des entreprises.
Par rapport aux personnes physiques, la DNEF est en retrait pour des raisons tant techniques que juridiques. Quand l’administration fiscale entreprend des recherches extérieures approfondies pour apprécier la cohérence de la situation fiscale d’un contribuable, en particulier en matière d’impôt sur le revenu, elle commence un ESFP et lui adresse un avis de vérification. De ce fait, le rôle de la DNEF est extrêmement limité, sauf à créer les conditions d’un vice de forme qui pourrait être exploité au niveau contentieux et qui compromettrait l’imposition finale.
Nous ne sommes présents que dans des opérations collectives centrées non sur un contribuable en particulier mais sur une thématique. Ainsi, nous avons lancé, sur la base de l’article L.96-A du Livre des procédures fiscales, plusieurs actions sur la thématique des comptes à l’étranger et obtenu des banques la liste des opérations à destination de paradis fiscaux au-delà d’un certain seuil. La DNEF joue donc un rôle important en matière de lutte contre la fraude des personnes physiques, notamment à l’international, mais son action ne vise que très peu de cas particuliers. L’administration peut procéder à un contrôle sur pièces, comme le font les directions gestionnaires ou la DNVSF sur les dossiers haut de gamme, mais on créerait un risque juridique en procédant autrement. Les actions collectives, qui sont inscrites dans la feuille de route de la DNEF, ne concernent que deux brigades et occupent moins de vingt personnes sur un effectif de 300.
Nous travaillons peu sur les particuliers. Quand un contribuable relève d’une catégorie sensible, nous n’agissons pas sur initiative. Nous passons systématiquement par un contact préalable avec l’administration centrale et par une commande. C’est à cette famille de dossiers sensibles qu’appartient le dossier des parlementaires. Avant juin 2011, la DNEF n’était pas habilitée à interroger nos fichiers à leur sujet. Ceci donne une idée de l’orientation de nos travaux : nous ne nous intéressons aux personnes physiques d’un certain niveau que lorsque nous recevons une commande précise de la direction générale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment expliquez-vous que la direction de l’antenne de Bordeaux de la DNEF ait demandé au centre des impôts parisiens le dossier fiscal de M. Cahuzac ? En poste depuis 2009, avez-vous eu connaissance de ce prélèvement ? Est-il habituel qu’un service procède par lui-même à des investigations sur un contribuable domicilié à Paris ? Pourquoi le dossier n’est-il revenu à Bordeaux qu’en 2007, alors même que son prélèvement n’aurait eu aucune suite ?
M. Bernard Salvat. En matière de recherche, il n’y a pas de compétence d’attribution stricte. Tous les services de recherche bénéficient d’informations, à partir desquelles ils tirent des fils. La règle est de laisser faire le service qui a reçu l’information.
M. Alain Claeys, rapporteur. Bordeaux était à l’origine de l’information ?
M. Bernard Salvat. Oui, c’est possible.
M. Alain Claeys, rapporteur. Utilisez-vous des informations anonymes ?
M. Bernard Salvat. Vous connaissez la doctrine de la DGFiP à cet égard : en principe, nous n’exploitons pas d’informations anonymes. (Exclamation de M. Hervé Morin.)
M. le président Charles de Courson. Elle est récente !
M. Bernard Salvat. Il y a eu une évolution.
Le travail des enquêteurs n’est pas sectorisé. Celui qui dispose d’informations tire les fils de l’enquête, qu’il mène jusqu’au bout. Les brigades de la DNEF, réparties sur le territoire national, ne sont pas cloisonnées par régions. Quand on se saisit d’un dossier, on n’en connaît pas encore les ramifications. Le cloisonnement induirait une perte de compétences et d’efficacité. La règle est que l’enquêteur va au bout de son travail, avec tout l’encadrement administratif nécessaire. Si la brigade de Bordeaux a bénéficié d’une information grâce à des personnes localisées dans le Sud-Ouest, elle pouvait consulter le dossier parisien. C’est plus simple aujourd’hui, puisque nous utilisons une application informatique, qui est cependant tracée. Quoi qu’il en soit, pour la DNEF, dont les enquêteurs bénéficient d’une compétence nationale, le fait que la brigade de Bordeaux ait demandé un dossier à Paris ne constitue pas une anomalie.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu l’occasion de regarder ce dossier de plus près ? Pourquoi, parti à Bordeaux en 2001, n’en est-il revenu qu’en 2007 ?
M. Bernard Salvat. Resituons-nous dans le contexte : en 2001, M. Cahuzac n’avait pas la notoriété qu’il a acquise par la suite.
M. le président Charles de Courson. Il était député entre 1997 et 2002. Battu en 2002, il a été réélu en 2007. Il a été élu maire de Villeneuve-sur-Lot en 2001.
M. Bernard Salvat. En demandant le dossier, la brigade a fait une démarche officielle, qui a été tracée, comme le montre le document qui vous a été remis ce matin. Il ne s’est donc rien passé d’anormal.
M. le président Charles de Courson. Ce matin, nous avons découvert que, lorsque le dossier a été transmis, votre subordonné n’en a même pas informé son chef de brigade.
M. Bernard Salvat. Je ne me prononcerai pas sur ce point.
M. le président Charles de Courson. Confirmez-vous qu’il s’agit d’un dysfonctionnement administratif, comme on nous l’a dit ce matin ?
M. Bernard Salvat. Il y a plusieurs degrés dans l’approche d’un dossier. Quand on s’en saisit parce qu’on identifie une piste de recherche, on ignore s’il va prospérer ou si l’enquête va rapidement s’arrêter. Il faut commencer par l’examiner.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi, en 2001, votre antenne de Bordeaux s’intéresse-t-elle à une personne physique, alors que vous contrôlez essentiellement des entreprises ?
M. Bernard Salvat. Avant d’être ministre, M. Cahuzac était chirurgien. L’enquêteur a pu penser qu’il existait un lien entre cette activité et l’information dont il disposait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Sachant qu’il y avait eu une demande à Bordeaux, avez-vous mené votre enquête au niveau de la direction ?
M. Bernard Salvat. Non. La DNEF n’a pas été sollicitée par la direction générale. Nous n’avons jamais travaillé sur le dossier Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous êtes-vous demandé pourquoi ce dossier avait été demandé en 2001 et pourquoi il était revenu en 2007 ?
M. Bernard Salvat. Nous ne prenons les dossiers des personnalités que si la direction générale nous le demande, ce qu’elle n’a pas fait depuis 2009.
M. Alain Claeys, rapporteur. Fallait-il une autorisation de la direction générale pour que le dossier soit transféré à Bordeaux ?
M. Bernard Salvat. Les faits remontent à 2001. Je ne peux parler que de la période que j’ai connue.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites pourtant que, pour travailler sur le dossier d’une personne physique, il faut l’autorisation de la direction générale.
M. Bernard Salvat. Actuellement, nous la demandons pour les dossiers sensibles.
M. le président Charles de Courson. Depuis quand ? Depuis la circulaire Baroin ?
M. Bernard Salvat. C’est généralement la direction générale qui nous demande de traiter les dossiers. C’est plutôt dans ce sens-là que les choses se passent.
M. le président Charles de Courson. Depuis quand ?
M. Bernard Salvat. C’est comme ça depuis mon installation, en septembre 2009.
M. le président Charles de Courson. Et auparavant ?
M. Bernard Salvat. Je ne sais pas.
M. le président Charles de Courson. Allons, monsieur le directeur, il y a une continuité de l’État…
M. Bernard Salvat. Vous m’avez fait prêter serment de dire la vérité. C’est ce que je fais.
M. le président Charles de Courson. Vous pouviez vous renseigner sur ce qui se passait avant votre arrivée.
M. Bernard Salvat. Je connais la période où j’ai été en poste. Pour le reste, je n’ai rencontré mon prédécesseur que pendant deux heures. Je ne peux donc pas vous en dire plus.
M. le président Charles de Courson. Vous pouviez l’interroger.
M. Bernard Salvat. Je ne suis plus directeur de la DNEF. Vous avez interrogé ce matin M. Alexandre Gardette, ainsi que d’autres responsables de la DGFiP. Nous n’avons pas travaillé sur le dossier Cahuzac. Je ne m’y suis donc pas intéressé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Depuis décembre 2012, votre direction n’a donc jamais eu à regarder les interférences avec Bordeaux ?
M. Bernard Salvat. J’ignorais qu’il y avait eu une interférence avec Bordeaux. Je l’ai appris lors de l’ouverture de l’enquête judiciaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous été sollicité dans le cadre de l’enquête ?
M. Bernard Salvat. Pas personnellement. On m’a seulement demandé quel était le chef de brigade.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qui vous l’a demandé ?
M. Bernard Salvat. L’officier de police judiciaire qui s’est rapproché de nous.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quelle époque ? Après le 5 décembre ?
M. Bernard Salvat. Je ne souviens plus de la date exacte. L’enquête était déjà lancée. Quand on m’a demandé quel était le chef de brigade alors en poste à Bordeaux, j’ai chargé mes services de retrouver son nom, que j’ai communiqué à la direction générale. Celle-ci a dû prendre l’attache des services de police.
M. Alain Claeys, rapporteur. En tant que directeur national, saviez-vous que ce dossier n’était revenu qu’en 2007 ?
M. Bernard Salvat. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Même quand vous avez été sollicité par la police judiciaire, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi le dossier était parti à Bordeaux ?
M. Bernard Salvat. Nous avons répondu aux questions qu’on nous a posées, mais je n’ai pas enquêté personnellement sur l’affaire Cahuzac.
En tant que directeur de la DNEF, je disposais d’un tableau de bord recensant les affaires pouvant présenter un enjeu fiscal important, celles présentant ce qu’on peut appeler un « risque médiatique » ou une originalité en matière de fraude. Ce document opérationnel, qui portait sur une période de deux ans, ne permettait pas de savoir que le dossier Cahuzac avait été prélevé en 2001.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce parce que M. Cahuzac possédait une société de conseil que vos services de Bordeaux pouvaient s’intéresser à lui ?
M. Bernard Salvat. C’est une hypothèse. Sur les personnes physiques qui n’ont pas d’activité professionnelle, nous intervenons peu, alors que nous regardons le dossier des dirigeants d’entreprise. Je suppose que l’agent qui s’est intéressé à celui de M. Cahuzac l’a fait à raison de l’activité professionnelle de ce dernier. Alors, il n’était pas infondé à le regarder. Si ce n’est pas le cas, de nos jours, sous mon mandat, nous n’examinons le dossier des particuliers que sur demande expresse.
Mme Maïté Gabet, directrice des vérifications de situations fiscales (DNVSF). La troisième direction nationale, celle des vérifications de situations fiscales (DNVSF), est chargée de contrôler le dossier des personnes physiques les plus significatives.
Créée en 1983, elle a pour mission historique le contrôle fiscal externe des personnes physiques, c’est-à-dire la mise en œuvre de l’ESFP et, le cas échéant, la vérification de comptabilité, lorsque ce dossier est lié à celui d’une entreprise ou d’une activité professionnelle. Son périmètre d’intervention s’apprécie en fonction de différents critères : importance, complexité, dimension internationale et notoriété du dossier. À ce titre, elle ne dispose pas d’un portefeuille qui lui serait réservé, alors que la DVNI a compétence exclusive pour contrôler les multinationales, au-delà d’un certain chiffre d’affaires. N’ayant pas de compétence dédiée ou exclusive, la DNVSF agit en fonction des propositions qui remontent des services territoriaux, des services d’enquête ou des services de l’ordre judiciaire, dans le cadre de l’exercice des droits de communication respectifs.
Récemment, la DNVSF s’est vue confier une nouvelle mission : la surveillance et le contrôle corrélé revenus-patrimoine des dossiers à très fort enjeu, pour les personnes dont le revenu global dépasse 2 millions d’euros ou dont l’actif brut à l’ISF dépasse 15 millions. Nous recevons, dans ce cadre, des ordres de mission stratégiques de l’administration, et bénéficions d’une compétence exclusive de contrôle sur pièces. Nous ne procédons pas nécessairement au contrôle approfondi qu’est l’ESFP, mais nous avons l’obligation de couvrir notre portefeuille sur une période triennale qui correspond au délai de prescription en matière d’impôt sur le revenu. Pour ce faire, nous disposons d’une compétence juridique nationale qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble du territoire. Notre direction, qui n’est pas une direction d’enquête mais de contrôle, possède 300 agents répartis sur une quinzaine de brigades. Je suis à sa tête depuis mai 2012.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous participé à une mission en Suisse ?
Mme Maïté Gabet. Non. Pour mon travail, je n’ai pas le droit de quitter le territoire national.
M. le président Charles de Courson. L’avocat de M. Cahuzac dit avoir alimenté le compte en Suisse de son client grâce à des versements en espèces effectués par des patients de la clinique et à des versements provenant des entreprises pharmaceutiques Servier, Fabre et Lilly. Avez-vous contrôlé celles-ci ou découvert des anomalies dans les comptes de la clinique de M. Cahuzac ? Je vous rappelle que nous cherchons à découvrir ce que les administrations savaient, le 4 décembre, et quelles informations avaient pu remonter auprès des ministres chargés de ces questions.
M. Olivier Sivieude. Le 4 décembre, la DVNI ne savait rien. Les sommes perçues par une clinique ne concernent, a priori, pas notre niveau de compétence, puisque nous travaillons sur les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 150 millions et sur les prestataires de services dont le chiffre d’affaires excède 75 millions. En revanche, nous vérifions la situation des laboratoires pharmaceutiques et ceux cités sont clairement dans notre domaine de compétence.
M. le président Charles de Courson. Vous contrôlez alors le groupe ? Pouvez-vous identifier des versements effectués par une filiale soit en Suisse soit dans un autre pays sur le compte d’une personne ou d’une entreprise située en France ?
M. Olivier Sivieude. Les vérificateurs se demandent si des commissions ont été versées à des prestataires et si celles-ci sont justifiées, ou, selon la formule d’usage, si elles ont été versées « dans l’intérêt de l’entreprise ». Nous sommes particulièrement vigilants à l’égard des versements effectués dans des pays à fiscalité privilégiée, cependant nous procédons non de manière exhaustive mais par sondage. J’ajoute que, pour acquitter ces rémunérations, les groupes peuvent utiliser des filiales établies hors de France, qui échappent à notre domaine de contrôle.
Quant à savoir si des contrôles ont permis, en l’espèce, de repérer quelque chose, je n’en sais rien. J’ignore à quelle date les versements se sont produits. Ils semblent être assez anciens. Je n’ai aucune connaissance à cet égard.
M. le président Charles de Courson. D’après la presse, les faits remontent aux années quatre-vingt-dix, mais les versements ont pu perdurer.
M. Olivier Sivieude. Pour une période aussi ancienne, nous n’avons même plus les dossiers.
M. le président Charles de Courson. Nous cherchons à savoir de quelles informations disposaient les services de l’État. Vous êtes-vous intéressé à d’éventuels versements d’honoraires, via des filiales, à la Société Cahuzac conseil, dont le siège était en France ?
M. Olivier Sivieude. Pensant que vous me poseriez la question, j’ai interrogé mes services. Ils m’ont répondu que nous n’avions plus les dossiers et qu’on ne trouvait pas trace de recherches concernant ce contribuable.
M. Bernard Salvat. Nous n’avons pas enquêté sur ce dossier. En outre, quand des filiales étrangères versent des commissions, nous n’en avons pas nécessairement connaissance en France.
Lorsqu’une entreprise française qui fait du commerce international ne possède qu’une filière française, nous exploitons sa déclaration, qui mentionne l’ensemble des versements. Nous nous intéressons alors aux commissions qui seraient versées dans les paradis fiscaux. Mais quand des fonds transitent par une filiale possédant une autonomie fiscale et située dans un pays étranger, nous n’avons pas l’information. C’est généralement ce canal qu’utilisent les fraudeurs. Si les groupes effectuent un versement par le biais d’une filiale étrangère, la probabilité que nous l’apprenions est quasiment nulle. Seule une enquête approfondie permet de rassembler l’information qui se trouve dans les fichiers de manière passive, mais nous ne remontons pas très loin dans le temps. Tous nos fichiers sont validés par la CNIL, qui ne nous permet pas de conserver une information plus de dix ans.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand vous entendez les déclarations de M. Gonelle – vous étiez encore Directeur –, vous n’avez pas la curiosité de savoir ce qui s’est passé à Bordeaux ?
M. Bernard Salvat. Si la direction générale m’avait demandé d’enquêter, je l’aurais fait, mais elle traitait elle-même le dossier. Dès lors, je n’ai pas à m’immiscer dans sa gestion, puisqu’elle était dans les meilleures mains. Je rappelle que toute intervention est tracée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez pas anticipé une question éventuelle de la direction générale ?
M. Bernard Salvat. Dans les dossiers de cette nature, on n’anticipe jamais. Les services appliquent strictement la règle : nous travaillons sur commande de la direction générale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’aurait pas été anormal que le directeur de la DNEF se demande pourquoi un dossier a été transféré à Bordeaux, où il est resté six ans.
M. Bernard Salvat. Je ne sais pas que le dossier a été transféré en 2001, puisqu’aucun fichier ne recense les prélèvements.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il existe au moins un accusé de réception, qu’on nous a transmis ce matin. Il atteste qu’un dossier parti en 2001 est revenu six ans plus tard.
M. Bernard Salvat. Les prélèvements sont tracés à l’adresse où le dossier est géré, mais ne sont pas recensés dans un fichier qui serait à la disposition du directeur de la DNEF. C’est pourquoi celui-ci ne peut pas faire de requête sur des faits qui remontent à huit ans.
Mme Cécile Untermaier. À la différence de la DNEF, les brigades interrégionales d’intervention (BII) contrôlent le dossier des particuliers. Est-ce une brigade de ce type qui a demandé le dossier de M. Cahuzac ?
M. Bernard Salvat. Les BII peuvent mener des enquêtes et, si besoin, formuler une demande de perquisition, qui doit être validée par la direction. Les brigades nationales d’investigation (BNI), situées à Pantin, effectuent des recherches, sans aller toutefois jusqu’à la perquisition. Si celle-ci s’avère nécessaire, elles passent le relais aux BII.
Quand un service fait de la recherche de renseignements, il possède une part d’initiative. Par exemple, la découverte d’un véhicule suspect peut déclencher une enquête permettant d’aller très loin. Quand une affaire est anodine, elle peut passer par des rouages administratifs sans remonter au plus haut niveau, à moins que le dossier ne mérite d’être soumis à un visa hiérarchique élevé.
Qu’un enquêteur de Bordeaux disposant d’une information ait eu le réflexe d’examiner un dossier, pour savoir ce qu’on pouvait en faire, n’a rien de choquant. Il l’a gardé sept ans. C’est un peu long, mais il arrive que des dossiers restent longtemps dans nos armoires, parce qu’ils ont une vie faite de contentieux. Quoi qu’il en soit, le transfèrement est tracé, jadis sur le papier, aujourd’hui sur une application informatique. Si le service d’origine avait eu besoin du dossier, il l’aurait réclamé à la BII de Bordeaux.
Depuis 2002, tout étant dématérialisé, les dossiers papiers ne récupèrent plus d’information intéressante. Le dossier ne présentait donc quasiment plus d’intérêt sur le plan fiscal depuis 2005.
M. Jean-Pierre Gorges. À ceci près que, pour dématérialiser un dossier, il faut l’avoir à un moment donné !
M. Bernard Salvat. La logique était que tout vérificateur détenait le dossier papier. C’était une manière d’affirmer sa responsabilité. Cette logique est caduque, puisque nous travaillons désormais sur des données dématérialisées.
M. Jean-Pierre Gorges. Manifestement, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, les fonctionnaires semblent avoir agi de manière très professionnelle, mais cela n’a pas toujours été le cas, auparavant. M. Gonelle s’est fait trois fois fermer la porte au nez.
En 2001, quand il prend contact avec des gens qui étudient le dossier, trois élus pointent le fait que M. Cahuzac organise des manifestations avec les laboratoires pharmaceutiques. Celui-ci menace de les attaquer. Telle était l’ambiance qui planait sur Villeneuve-sur-Lot ! C’est dans ce contexte que M. Gonelle va transmettre l’enregistrement par l’intermédiaire d’amis. Ce n’est sans doute pas la bonne procédure, mais le dossier ne met que trois jours pour descendre de Paris. Malheureusement, l’homme qui a eu le dossier est décédé. À l’époque, contrairement à ce que vous avez affirmé, M. Cahuzac est connu. L’affaire commence donc rapidement, avec un fonctionnaire qui n’informe personne et qui gardera le dossier jusqu’en 2007, ce qui est pour le moins mystérieux.
En 2006, l’enregistrement se retrouve dans les mains d’un juge très connu.
Vient alors l’épisode Garnier : quelqu’un travaille sur le sujet, passe l’information, mais les portes se ferment.
Enfin, après le 4 décembre 2012, M. Gonelle prend contact avec une personnalité qu’il connaît, M. Zabulon, qui travaille à l’Élysée. Il lui explique la situation. La porte se ferme à nouveau. Quelqu’un est-il intervenu pour empêcher le dossier d’avancer ? Comment un fonctionnaire a-t-il pu détenir un dossier sans jamais en informer personne ?
M. Bernard Salvat. Je ne pense pas qu’il y ait eu une intervention, car je n’en ai jamais vu en trois ans. Les enquêtes sont menées dans les règles de l’art et les dossiers aboutissent.
Ma lecture est la suivante. Quelqu’un possède une information sur l’éventualité qu’un contribuable possède à l’étranger un compte non déclaré, à une l’époque où il n’est pas obligatoire de déclarer ce type de comptes et où la convention avec la Suisse exclut toute possibilité de poser des questions. Dans le dossier, le vérificateur ne trouve aucune information relative à l’existence de ce compte, ce qui se produit par exemple quand le contribuable fait état d’un crédit d’impôt étranger. Il ne trouve sans doute pas non plus de déclaration d’honoraires effectuée par la filiale étrangère d’un groupe pharmaceutique. Il est donc dans une impasse, puisque je doute fort qu’un élément du dossier atteste la présence de ce compte et qu’il n’a pas le moyen juridique de trouver l’information. Le dossier reste donc en l’état.
M. le président Charles de Courson. Nous auditionnerons M. Garnier le 12 juin, ce qui devrait nous permettre d’en savoir un peu plus.
M. Bernard Salvat. Encore que…
Mme Marie-Christine Dalloz. Depuis une semaine, je me demande s’il arrive à la DGFiP, à la DVNI, à la DNEF et à la DNVSF d’organiser des réunions de travail. Il semble que, même si chacun respecte sa procédure, celles-ci suivent des tunnels qui ne se croisent jamais. C’est sans doute une des clés de ce dossier.
M. Bernard Salvat. Je l’ai dit : nous sommes chargés de plus de cent affaires vérifiées par la DVNI. Les groupes de travail sont nombreux. Nous développons des axes de recherche avec le concours de vérificateurs. Nous sommes également en lien avec la DNVSF. Autant dire que les trois directions nationales font collaborer de manière très étroite le renseignement, la recherche et le contrôle, qui se divise en deux branches – entreprises haut de gamme et personnes physiques.
M. Olivier Sivieude. Nous avons conscience qu’en unissant nos forces, nous gagnons en efficacité. C’est pourquoi nous menons conjointement information, coordination et formation. Des vérificateurs de la DVNI et de la DNVSF travaillent sur les mêmes dossiers.
Mme Maïté Gabet. Le service du contrôle fiscal dirigé par M. Gardette, que vous avez entendu ce matin, comporte une mission de coordination et de pilotage des trois directions nationales.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Dans cette administration où prévalent, nous a-t-on dit, rectitude et rigueur, je trouve étrange qu’un fonctionnaire de l’administration fiscale ait pu analyser un dossier sans saisine formelle. Est-il vrai que les dossiers des politiques sont traités à part ? Quelles sont vos relations avec TRACFIN et avec les groupes d’intervention régionaux (GIR), qui intègrent des fonctionnaires des douanes, des services fiscaux, de la police et de la gendarmerie ? Qui coordonne l’ensemble ? Enfin, je m’étonne que, lorsque des dysfonctionnements sont constatés, nul ne semble s’y intéresser.
M. Bernard Salvat. Quand on prend un dossier sur la base d’une information semblable à celle qu’a divulguée M. Gonelle, on ne peut savoir s’il débouchera sur une véritable enquête. On le consulte pour savoir de quoi il retourne. À ce stade, c’est une opération simple, qui est tracée. Elle n’est donc pas informelle. Nous nous assurons, par ailleurs, que la vérification obéit à une motivation strictement professionnelle.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Connaît-on le nom du fonctionnaire qui était ami avec M. Gonelle ?
M. Bernard Salvat. On connaît celui de l’agent qui a demandé le dossier à Paris et qui l’a reçu. Une fiche mentionne en outre la période pendant laquelle il l’a conservé.
On sait toujours qui a fait quoi. Le fonctionnaire qui a demandé le dossier en devient responsable, et on peut l’interroger sur ses motivations. En l’espèce, après avoir vu le dossier, le vérificateur ne l’a pas exploité. Il s’est contenté de le garder, sans doute un peu trop longtemps. Si l’enquête avait prospéré, il y aurait eu formalisation, et des éléments nous seraient remontés. C’est parce que l’affaire n’a pas débouché sur une enquête que rien n’est parvenu jusqu’à nous.
Mon tableau de bord pour 2009-2012 ne mentionne pas toutes les consultations de dossiers. Quand on se saisit de celui d’une entreprise, on regarde la situation des dirigeants et de leurs associés. On vérifie rapidement sept ou huit dossiers sans aller plus loin. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une enquête ; c’est quand la consultation débouche sur des enquêtes périphériques qu’il apparaît dans le tableau de bord, et que l’information remonte jusqu’à moi.
Tout le monde consulte des dizaines de dossiers. Je ne suis averti que quand on dépasse ce stade. Il n’est donc pas étonnant, puisque la consultation de Bordeaux n’a pas eu de suite, que la direction n’en ait pas été avisée. Il n’y a pas lieu de faire de rapport sur tous les dossiers.
M. le président Charles de Courson. Vous n’empêcherez pas la Commission de s’interroger, puisque, selon M. Gonelle, il y aurait eu une intervention pour classer l’affaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle a une caractéristique : il ne passe jamais par des voix officielles. Il faut toujours qu’il s’adresse à un ami, voire à l’ami d’un ami, ce qui complique notre travail.
M. Bernard Salvat. Je n’ai eu à connaître aucune intervention. D’autre part, on ne rédige pas un rapport chaque fois qu’on ouvre un dossier, même pour dire qu’on n’y a rien trouvé. S’ils veulent en savoir plus, les chefs de brigade effectuent un contrôle interne. Nous réduisons la paperasserie, qui coûte cher et diminue notre efficacité.
Par ailleurs, nous prenons toutes les précautions pour éviter la curiosité malsaine. Depuis plus de dix ans, sont classés « sensibles », à l’initiative des directions déconcentrées qui en définissent les critères, le dossier des parlementaires et des personnalités locales du monde des affaires ou du monde médiatique. L’accès aux données est filtré et ces dossiers sont traités non par les services mais en direction, bien qu’ils soient examinés aussi régulièrement et avec la même impartialité que les autres. Quand il s’agissait de dossiers papiers, ils étaient conservés dans des coffres, un registre consignant la date de la consultation, le motif qui la justifiait et l’identité de la personne qui l’effectuait. À présent que nous travaillons sur informatique, la traçabilité est incluse dans les applications, afin d’éviter des fuites. Enfin, il existe un traitement pour les élus qui accèdent à des fonctions ministérielles.
La DNEF reçoit toutes les dénonciations que TRACFIN transmet à la direction générale des finances publiques. Nous travaillons les dossiers, en recherchant le moyen de les exploiter selon les procédures fiscales, après quoi ils sont transmis aux services pour contrôle. Nous recevons de TRACFIN quelque 150 dossiers par an. Dans la plupart des cas, ils sont envoyés à la justice.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez jamais reçu de TRACFIN une information concernant M. Cahuzac ?
M. Bernard Salvat. Non.
M. Étienne Blanc. Les hauts fonctionnaires, hauts magistrats ou hauts responsables d’administration sont-ils classés comme « personnes sensibles » ?
M. Bernard Salvat. Les directions peuvent inclure dans cette catégorie des personnes dont le dossier présente une sensibilité locale ou nationale. La seule limite est que les directions doivent ensuite les gérer, notamment ressaisir les déclarations, alors que leurs effectifs ne leur permettent pas de se charger d’un grand nombre de dossiers.
M. Étienne Blanc. Le responsable d’une question critique dans un cabinet ministériel est-il considéré comme « personne sensible » ?
M. Bernard Salvat. À ma connaissance, non.
M. Jean-Pierre Gorges. La déclaration de patrimoine qu’établit un parlementaire en début et en fin de mandat est-elle transmise au fisc ?
M. Bernard Salvat. Non.
M. Jean-Pierre Gorges. Le dossier demeure à Bordeaux à l’époque où M. Cahuzac n’est plus parlementaire, et remonte à Paris en 2007, quand il est réélu. Peut-on établir un lien entre les faits ?
M. Bernard Salvat. Non. C’est quand le nouveau chef de brigade prend ses fonctions qu’il découvre le dossier et prend l’initiative de le renvoyer. Il n’y a pas d’interférence entre nos services et le monde politique. Les déclarations de patrimoine faites par les parlementaires ne sont pas exploitées par les services fiscaux. Nous recevons leur déclaration de patrimoine s’ils sont assujettis à l’ISF. S’ils ne le sont pas, nous n’avons pas à connaître leurs actifs.
M. le président Charles de Courson. À votre connaissance, la situation de M. Cahuzac avait-elle été contrôlée avant qu’il devienne ministre ?
Mme Maïté Gabet. Non.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie.
Audition du mardi 4 juin 2013
À 17 heures 30 : M. Thierry Picart, chef du bureau D 3 de lutte contre la fraude à la direction générale des douanes et des droits indirects 173.
M. le président Charles de Courson. Nous poursuivons nos auditions en accueillant M. Thierry Picart, chef du bureau D 3 de lutte contre la fraude à la direction générale des douanes et des droits indirects.
Je vous remercie, monsieur, d’avoir accepté d’être entendu par notre commission d’enquête chargée de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de l’affaire Cahuzac.
Lors de son audition par notre commission le 21 mai dernier, M. Michel Gonelle a indiqué avoir « entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le chef de la direction des enquêtes douanières – une des divisions de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) – avait obtenu le renseignement dès 2001 » [de la détention par M. Cahuzac d’un compte à l’étranger]. Il vous a ensuite nommément désigné. Nous souhaitions donc vous offrir la possibilité de vous expliquer sur ce point.
Avant d’aller plus loin, il me revient de rappeler que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Picart prête serment)
M. le président Charles de Courson. Je vous laisse la parole pour nous livrer vos explications.
M. Thierry Picart, chef du bureau D 3 de lutte contre la fraude à la direction générale des douanes et des droits indirects. J’avais d’abord décidé de répondre directement à vos questions. Puis, après réflexion, j’ai estimé qu’il pouvait être utile de tenter quelques premières clarifications. Je vous remercie donc, monsieur le président, de me donner la possibilité de m’exprimer aujourd’hui.
Si mon nom a été rendu public lors de l’audition de M. Gonelle ce 21 mai, c’est depuis le 3 avril, date de ses premières déclarations à l’AFP, que j’ai été contacté par de nombreux journalistes. Si mon nom n’était pas public, en tout état de cause il circulait bel et bien. Comme je ne pouvais pas leur répondre, certains ont vu dans mon silence une validation implicite de leurs déclarations, parfois contradictoires.
À l’instar de M. Gardette, que vous avez auditionné ce matin, je peux reprendre à mon compte la quasi-totalité du propos introductif de M. Bézard, directeur général des finances publiques, lors de son audition du 28 mai.
Ce n’est pas aux membres de votre commission que je rappellerai que tout fonctionnaire est soumis au secret professionnel, destiné à protéger les citoyens et à éviter que des informations collectées à leur encontre ne soient diffusées publiquement. Tout fonctionnaire est également soumis aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve. Tout manquement à ces obligations, rappelées expressément par des dispositions spécifiques du code des douanes, est susceptible de faire l’objet d’une sanction pénale. Dois-je rappeler également que les relations du fonctionnaire avec son employeur, en l’occurrence l’État, ne sont pas régies par une convention, mais par un statut qui protège le fonctionnaire ?
Comme il semble que c’est mon action dans des fonctions antérieures et non à mon poste actuel qui a été évoquée, je pense utile de rappeler brièvement les étapes de mon parcours professionnel.
Je suis entré dans l’administration il y a longtemps, comme inspecteur des douanes. Je suis donc douanier d’origine. De 2000 à 2003, j’ai dirigé la quatrième division d’enquêtes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED, chargée notamment de lutter contre les mouvements financiers illicites. Je n’y étais pas enquêteur chargé des investigations, mais, comme tout chef de service, j’avais une fonction de pilotage. Je pourrai revenir ultérieurement, si vous le souhaitez, sur les missions, l’activité et le fonctionnement de ce service.
De janvier 2004 à juillet 2005, j’ai été mis à disposition du ministère des affaires étrangères. Là encore, je pourrais, si vous le souhaitez, vous fournir toutes les précisions utiles.
Après un très bref retour au sein de la direction générale des douanes, et après avoir réussi la sélection d’accès au grade d’administrateur civil et suivi quelques mois de scolarité à l’ENA, j’ai été affecté à la direction du budget en septembre 2006, où j’ai été chargé du suivi des crédits de la mission « Aide publique au développement ». Les membres de la commission des finances de votre Assemblée confirmeront que la gestion des programmes 110, 209 et 301 n’amènent pas vraiment à entretenir d’étroites relations avec la direction générale des douanes et des droits indirects.
Je suis revenu à cette direction en juillet 2009 au poste de chef du bureau de lutte contre la fraude, que j’occupe actuellement.
Votre commission a souhaité m’entendre après que Maître Gonelle, lors de son audition le 21 mai dernier, a cité mon nom – j’ai entre les mains une transcription que j’ai effectuée moi-même de cette audition. Les questions que vous lui avez posées faisaient suite à ses déclarations à l’AFP le 3 avril 2013.
Je ne reprendrai que deux paragraphes de ce communiqué, qui fait plusieurs dizaines de lignes : « Selon ce que je sais de bonne source et qui m’a été rapporté, un haut fonctionnaire des douanes avait identifié le compte en 2008, a déclaré à l’AFP l’ancien maire RPR et rival politique de l’ex-ministre du budget en Lot-et-Garonne. Ce haut fonctionnaire est élu d’une ville de l’Oise, selon M. Gonelle, qui l’a invité à se faire connaître des magistrats instructeurs. »
Comme beaucoup de personnes intéressées, directement ou indirectement, par votre commission d’enquête, j’ai écouté l’audition de Maître Gonelle. J’y ai relevé quelques différences avec des déclarations antérieures. Même si ce n’est pas l’objet de mon propos, je pourrais vous en faire part. Cela pourrait apporter quelques éléments de contexte intéressants. Mais j’ai aussi relevé au cours de cette audition, des inexactitudes me concernant directement, que je vais corriger, si vous le permettez.
Comme je l’ai dit dans mon propos introductif, je ne suis pas administrateur civil d’origine, mais douanier. Cette erreur, factuelle, n’est pas très grave. C’est néanmoins une petite erreur.
Je n’ai pas dirigé le quatrième bureau, mais la quatrième division, au sein de la DNRED. Là encore, c’est une petite erreur sans gravité, qui peut être facilement corrigée, et qu’une personne pas nécessairement au fait de l’organisation administrative, est susceptible de commettre.
Mais Maître Gonelle est également revenu sur la date des faits allégués. Il a affirmé, je le cite : « Il y a une petite erreur dans la relation qui a été faite de cette interview [ l’interview de l’AFP ]. En réalité, ce n’est pas 2008. C’est bien avant, en 2001 [ que ce fonctionnaire a eu connaissance de l’existence du compte ].
M. Alain Claeys, rapporteur. Voici la teneur exacte de nos échanges durant l’audition de M. Gonelle. Je lui demande : « Dans une interview du 3 avril 2013, vous indiquez que l’administration des douanes aurait eu connaissance dès 2008 de l’existence du compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac. Comment le saviez-vous ? » Il me répond : « En réalité, il y a une erreur dans la transcription de mes propos, car cette administration le savait bien avant 2008. J’ai entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le chef de la direction des enquêtes douanières - une des divisions de la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières -, avait obtenu ce renseignement dès 2001, même si j’ignore de quelle façon. Selon mes informations, dont j’ai tout lieu de penser qu’elles sont sérieuses, ce cadre de haut niveau, administrateur civil d’origine, a été interrogé par plusieurs journalistes sur ce fait, sans jamais le démentir ni le confirmer. » Le président lui demande alors : « Quel est son nom ? ». Il répond : « Thierry Picart. ».
M. Thierry Picart. Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, Maître Gonelle a dit « il y a une petite erreur » parlant de 2008 versus 2001. Il a surtout dit que ce n’était pas lui qui avait commis cette erreur, mais le journaliste.
Si Maître Gonelle est « avocat, et non procureur ou enquêteur », comme il l’a dit, je suis, pour ma part, enquêteur de formation. Je me suis donc livré à quelques vérifications. Le premier communiqué AFP, qui évoque 2008, a été repris quasiment in extenso par plusieurs journaux. On pourrait penser qu’y est reprise une erreur initiale. Seulement dans d’autres interviews, à d’autres dates, dans Le Courrier picard, Marianne ou Rue 89, c’est aussi la date de 2008 qui est citée. On pourrait évoquer une erreur de transcription. Mais il suffit d’aller sur YouTube, comme je l’ai fait, pour y visionner la vidéo d’une interview à BFM TV, et il ne peut y avoir là d’erreur de transcription. Maître Gonelle, qui met d’ailleurs également en cause la Cour des comptes dans cette interview, y parle bien de 2008. Ce n’est pas une « petite erreur », et si c’est une erreur, ce n’est pas une erreur du journaliste, mais de Maître Gonelle.
S’agit-il d’une « petite erreur » ? Je vais reprendre les articles de presse que j’évoquais tout à l’heure. Il est en effet intéressant de voir la théorie échafaudée derrière la date de 2008. Permettez-moi de donner lecture de quelques-uns de ces articles qui sont à la fois des narrations et des réflexions de journalistes, mais aussi des confirmations des propos de M. Gonelle. Dans Le Courrier picard du 5 avril 2013, on lit : « Selon un haut fonctionnaire des douanes, élu d’une ville de l’Oise (…) ». Je suis élu, mais pas de l’Oise. L’article poursuit : « Quoi qu’il en soit, Gonelle maintient ces affirmations sur le fond. Pour lui, le compte suisse de Jérôme Cahuzac a bien été mis sous l’éteignoir sous la droite au gouvernement. On peut considérer qu’à cette époque, en 2008, il y avait deux sources possibles d’information pour le gouvernement de l’époque. Laissons faire les magistrats instructeurs. »
Presque une semaine plus tard, on peut lire dans Marianne : « Deux autres sources convergent à l’époque vers le puissant ministre du budget et ancien trésorier de la campagne, Éric Woerth. L’une est douanière, l’autre est fiscale. Côté douanes, un spécialiste de l’évasion fiscale, élu depuis dans une ville du Val d’Oise [ l’erreur a été corrigée] rédige une note dans laquelle il mentionne l’existence du compte suisse de Cahuzac, une note sensible qui ne manque pas de remonter jusqu’à la cellule fiscale de Bercy, autrement dit au cabinet du ministre. » Le journaliste de poursuivre : « C’est la clé de l’affaire, avance M. Gonelle. On ne comprend rien si on ne prend pas en compte la relation entre Éric Woerth et Jérôme Cahuzac… »
M. Alain Claeys, rapporteur. De quand date cette interview ?
M. Thierry Picart. Du 13 avril 2013, dans le numéro 834 de Marianne. Soit largement plus d’une semaine après les premières déclarations à l’AFP. Si la date de 2008 avait été une erreur initiale, elle aurait été corrigée. Je reprends : « On ne comprend rien si on ne prend pas en compte la relation entre Éric Woerth et Jérôme Cahuzac qui dira du premier : « En dépit de toutes les enquêtes judiciaires en cours, il est un parfait honnête homme. » Deux rapports enterrés contre une dose de bienveillance future. »
Je vous fais grâce de la lecture de l’article de Rue 89, qui reprend à peu près les mêmes éléments.
2008, une « petite erreur » ? La théorie qui repose derrière cette date est que j’aurais rédigé un rapport, que celui-ci serait parvenu au ministre, lequel, par connivence, ne l’aurait pas diffusé et n’y aurait donné aucune suite.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand M. Gonelle change-t-il de dates pour la première fois ?
M. Thierry Picart. Lors de son audition.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je souhaiterais que l’on vérifie si la date de 2001 n’apparaît bien que lors de son audition.
M. Thierry Picart. Dernier élément important, et ce n’est certainement pas une mise en cause des journalistes de Mediapart qui, comme le disait ce matin sans ironie aucune mon collègue Gardette, ont fait un travail remarquable. Regardons les déclarations faites devant votre commission et ce qui est rapporté dans le livre que j’ai ici entre les mains. Je pourrais reprendre les déclarations de M. Arfi à votre commission. Il a en effet clairement indiqué que ce sont précisément d’éventuelles relations entre M. Woerth et M. Cahuzac qui ont éveillé sa curiosité. La date de 2008 est donc importante.
Cela me fait penser à ces jeux graphiques d’enfant consistant à relier différents points, pour que, petit à petit, apparaisse une figure. Le prochain point devait laisser apparaître Picart, fonctionnaire des douanes. Si ce n’est que Picart n’était pas fonctionnaire des douanes en 2008 ! Alors, Maître Gonelle a dit devant vous qu’il s’agissait d’une « petite erreur » et que c’était en fait en 2001 que j’avais eu connaissance de l’existence du compte et que j’avais rédigé un rapport. En 2001 en effet, j’étais fonctionnaire des douanes. Je dirigeais la 4ème division d’enquêtes qui a vocation à enquêter sur ce type d’affaires. Mais en 2001, le ministre du budget n’était pas le même, si bien que la théorie qui voudrait que le rapport ait été enterré, tombe. 2001 ou 2008, il y a des incohérences dans les deux versions.
Voilà ce que je souhaitais vous exposer avant, bien évidemment, de répondre à vos questions.
M. le président Charles de Courson. Merci de cette introduction. Nous allons maintenant attaquer le fond de l’affaire qui est de savoir si vous avez ou non rédigé un rapport.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il faudra éclaircir ce problème de dates et notamment, monsieur le président, demander à ce que M. Gonelle soit de nouveau auditionné.
M. le président Charles de Courson. En effet. Il n’y a d’ailleurs pas que ce point à éclaircir.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous ne pourrons pas continuer nos travaux si sur plusieurs points demeurent des ambiguïtés.
En dépit de vos explications, monsieur Picart, je vais quand même vous poser mes questions. Avez-vous eu connaissance dans l’exercice de vos fonctions passées – je ne précise pas de date – d’éléments relatifs à la situation financière ou fiscale de Jérôme Cahuzac ? Si oui, quand et dans quelles circonstances ?
M. Thierry Picart. Avant de répondre à votre question, peut-être pourrais-je présenter rapidement l’activité de la 4ème division d’enquêtes de la DNRED que je dirigeais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Oui, mais pouvez-vous répondre clairement à ma question ?
M. Thierry Picart. Je ne le peux pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour quelles raisons ?
M. Thierry Picart. Tout simplement parce que le travail habituel de cette division était justement d’enquêter sur des personnes ayant transféré physiquement des avoirs à l’étranger. C’était là mon cœur de métier. Je voyais plusieurs centaines de dossiers par an de personnes ayant investi ou transféré des comptes à l’étranger.
M. Alain Claeys, rapporteur. De quelle date à quelle date avez-vous exercé ce métier ?
M. Thierry Picart. De 2000 à 2003.
M. Alain Claeys, rapporteur. De 2000 à 2003, avez-vous eu à traiter, d’une façon ou d’une autre, le cas de Jérôme Cahuzac ? Je vous demande de répondre à cette question.
M. Thierry Picart. Je ne peux ni le confirmer ni l’infirmer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour quelles raisons ?
M. Thierry Picart. Tout simplement parce que je n’ai aucun souvenir de chacun des dossiers que j’ai traités ou que mon service a traités à cette époque-là.
Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Je n’ai peut-être pas été assez clair dans mon propos liminaire. Si j’ai souhaité évoquer le statut des fonctionnaires, c’est pour dire qu’il protège les fonctionnaires, ce qui leur donne une certaine liberté. Si j’avais la certitude que j’avais travaillé ou que mon service avait travaillé sur ce compte ou reçu un renseignement à ce sujet, je vous le dirais bien sûr.
M. le président Charles de Courson. Votre réponse à la question claire de notre rapporteur est donc : « Je ne me souviens pas d’avoir vu un tel document, eu une telle information. »
M. Thierry Picart. C’est bien ma réponse. Permettez-moi une comparaison, même si elle est exagérée. C’est comme demander à un juge ayant jugé en comparution immédiate s’il a, douze ans auparavant, eu à traiter du cas d’un délinquant ? Il répondra : « Bien sûr, c’est mon métier, je traite tous les jours le cas de délinquants. »
M. Alain Claeys, rapporteur. Il pourrait exister dans votre service une traçabilité à même d’aider votre mémoire.
M. Thierry Picart. Il existe au sein de l’administration des douanes un système d’information « Lutte contre la fraude » dans lequel sont conservées les informations, dix ans au plus, au nom de la protection des libertés individuelles. Les personnes ont droit à l’oubli.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si le nom de Jérôme Cahuzac était apparu dans ce système, il en aurait de toute façon disparu aujourd’hui.
M. Thierry Picart. Oui, si cela était antérieurement à 2003.
M. Alain Claeys, rapporteur. En revanche, si la date est 2008, le nom figure encore.
M. Thierry Picart. Bien sûr. Sans méconnaître la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, je puis vous dire que l’autorité judiciaire s’est posé la question.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire qu’elle vous a interrogée ? Nous faites-vous aujourd’hui la même réponse que vous lui avez faite ? Il arrive que l’on évolue dans ses déclarations, que l’on redécouvre des éléments…
M. Thierry Picart. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je ne dirai pas que je consacre tout mon temps à ce qui nous occupe car cela signifierait que je ne fais pas mon travail – que je m’efforce de faire le mieux possible. Mais régulièrement, je sollicite ma mémoire et me demande si nous avons pu traiter ce type de dossier. Pour 2008, les choses sont simples, car cela est factuellement impossible. Pour 2001 en revanche, c’est le type de dossier que nous traitions. Pour autant, cela pouvait ne pas appeler mon attention plus que cela, car c’était notre travail quotidien.
M. Alain Claeys, rapporteur. S’il s’agissait de 2001, le nom de Jérôme Cahuzac aurait disparu des systèmes informatiques de ce service. S’il s’agissait de 2008, le nom devrait encore y figurer.
M. Thierry Picart. Je dois apporter une précision. Pour des raisons de protection des libertés individuelles, tout dépend de la nature des informations. Conformément à la réglementation de la CNIL, s’il n’y a que suspicion de fraude sans infraction constatée, la durée de conservation est limitée à trois ans, au terme desquels les données doivent être effacées – sauf si la suspicion est toujours assez forte, auquel cas la conservation peut être reconduite pour trois ans. S’il s’agit d’une contravention ou d’un délit mineur, la durée de conservation est de cinq ans et c’est seulement lorsqu’il s’agit d’un délit relativement grave, qu’elle est portée à dix ans.
M. Alain Claeys, rapporteur. En tant que citoyen, comment expliquez-vous que M. Gonelle ait changé de date au cours de son audition ?
M. Thierry Picart. Ce n’est pas en tant que citoyen, monsieur le rapporteur, que je vous répondrai, mais en tant qu’intéressé direct. En 2008, les faits allégués ne sont tout simplement pas possibles. Je n’ai pas pu rédiger de rapport. En effet, j’étais alors chargé du suivi des crédits de l’aide publique au développement à la direction du budget. Je ne travaillais pas dans l’administration des douanes et n’avais aucun contact avec elle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si M. Gonelle veut associer votre nom à cette affaire, il faut qu’il change les dates ?
M. Thierry Picart. Exactement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissiez-vous M. Gonelle ?
M. Thierry Picart. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’existe donc pas de contentieux entre vous ?
M. Thierry Picart. Non, en tout cas pas jusqu’à il y a dix minutes. Ce que j’ai dit le fâchera peut-être.
M. le président Charles de Courson. Comment peut-il connaître votre nom ?
M. Thierry Picart. Si je le savais, cela me rassurerait.
M. Dominique Baert. Vous n’avez pas pu en 2008 rédiger de rapport sur M. Cahuzac, comme le dit M. Gonelle, puisque vous n’étiez pas en fonction là où il prétend que vous étiez. Seule pourrait donc être concernée la date de 2001. Vous dites n’avoir pas gardé la mémoire des dossiers que vous avez traités à l’époque. Mais Jérôme Cahuzac était déjà député-maire de Villeneuve-sur-Lot. Si vous aviez vu passer entre vos mains son dossier, cela vous aurait un tant soit peu interpellé. Si vous ne vous souvenez de rien aujourd’hui, tout laisse à penser que vous n’avez pas rédigé de rapport sur Jérôme Cahuzac à cette époque. Avez-vous, à un moment ou à un autre dans votre carrière, rédigé en quoi que ce soit un rapport sur un compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac ?
M. Thierry Picart. Je pourrais vous dire, en effet, que le fait que je ne m’en souvienne pas signifie que nous n’avons pas vu passer de dossier relatif à la personne en question. À ce point, permettez-moi de vous faire part de notre expérience. Lorsque nous avons affaire à des personnes connues ou qui ont une certaine importance, il existe chez celles-ci deux attitudes. Certaines nous font savoir qui elles sont, espérant obtenir un traitement de faveur ou différent. D’autres, pour éviter toute publicité autour de leur nom, ne nous disent pas réellement qui elles sont. Vous parlez de mandat, monsieur. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre activité, c’est la profession de la personne, dont nous regardons si elle peut justifier les capitaux dont elle dispose.
Pour vous répondre, il y a en effet de fortes chances que si j’avais vu passer le nom d’un député-maire, je m’en souviendrais. Mais peut-être ce député-maire n’a-t-il pas excipé de ses qualités. Sans trahir le secret professionnel, je me souviens très bien de certains noms. Mais j’ai également découvert la notoriété de certaines personnes tardivement.
M. Dominique Baert. Pouvez-vous répondre à ma deuxième question ?
M. Thierry Picart. Il faut s’entendre sur le terme « rapport ». Je ne fais pas de « rapports ». La chaîne de traitement des dossiers est qu’un binôme d’enquêteurs traite une affaire, à la suite de quoi je fais un petit résumé. Mais de « rapport » destiné à une autorité quelconque, nous n’en faisons pas.
Pour répondre de façon limpide à votre question, je n’ai aucun souvenir, c’est-à-dire je pense n’avoir jamais rédigé le moindre rapport destiné à une autorité politique sur l’existence du compte dont nous parlons.
M. Hervé Morin. Vous arrivait-il de faire des rapports à une autorité politique ?
M. Thierry Picart. À des autorités politiques, non. Comme tout fonctionnaire soumis au devoir de loyauté, il arrivait simplement que j’appelle l’attention de mes supérieurs sur le caractère particulier d’une personne que nous avions en face de nous. Je ne suis qu’un fonctionnaire je ne dirai pas subalterne, mais intermédiaire. Je transmets l’information à ma hiérarchie, et cela s’arrête là.
Mme Cécile Untermaier. L’enregistrement dont Mediapart a révélé l’existence aurait-il suffi pour que vos services puissent le prendre en considération dans la chaîne de traitement que vous évoquez et fassent remonter l’information ?
M. Thierry Picart. Pour resituer votre question dans son contexte, il faut rappeler qu’à une époque, l’administration des douanes était chargée du contrôle des changes et que dans ce cadre en effet, une information relative à la détention d’un compte à l’étranger était intéressante. Mais le contrôle des changes a été supprimé en 1988. Dans le domaine financier, l’administration des douanes s’intéresse aujourd’hui essentiellement au transfert physique de capitaux. La détention d’un compte à l’étranger n’est pas en soi une information capitale. Si ce compte est alimenté par des virements à l’étranger, qu’il est débité par un système de compensations comme cela a été décrit par ailleurs et comme c’est le cas dans une affaire qui a défrayé la chronique il y a peu compte tenu des personnes en cause, cela n’a absolument aucun intérêt pour l’administration des douanes.
Mme Cécile Untermaier. Mais cela pouvait-il déclencher une enquête ?
M. Thierry Picart. La plupart du temps, non. Qu’aurait-on fait ? On aurait convoqué la personne pour lui demander : « Avez-vous un compte bancaire à l’étranger ? Donnez-nous ses relevés, de façon que nous vérifiions comment il est alimenté. Expliquez-nous qu’il l’a été par des transferts physiques non déclarés à l’administration des douanes. »
M. Hugues Fourage. Vous avez été extrêmement précis et rigoureux, monsieur Picart, dans votre propos liminaire, pour lequel vous avez effectué un certain nombre de recherches. Vous ne vous souvenez pas d’avoir eu à traiter d’un dossier concernant Jérôme Cahuzac, mais vous aviez des collaborateurs. Après les déclarations de M. Gonelle, n’êtes-vous pas entré en contact avec vos anciens collaborateurs pour leur demander si l’un d’entre eux se souvenait si votre division avait eu à connaître de ce dossier en 2001 ?
M. Thierry Picart. Plusieurs éléments de réponse. Le premier est que les faits remontent à plus de douze ans et que les fonctionnaires ne restent pas en poste au même endroit ad vitam aeternam. En douze ans, la division que j’ai dirigée a été presque totalement renouvelée. Les fonctionnaires en poste à cette époque-là sont aujourd’hui éparpillés sur l’ensemble du territoire et pour certains, à la retraite et injoignables.
Deuxième élément : si j’avais fait cela, je pense que d’une certaine façon, j’aurais été en conflit d’intérêts. Je ne l’ai donc pas fait. Je crois savoir que certains l’ont fait et que la réponse est négative.
M. Hugues Fourage. « Certains », qu’est-ce que cela signifie ?
M. Thierry Picart. Nous souhaitions apporter l’information la plus précise à l’autorité judiciaire. Lorsqu’à la suite d’une réquisition, certains services ont été interrogés, la DNRED a fait des recherches, à la fois dans le fichier informatique et dans les documents papier pour voir s’il pouvait y avoir trace d’un dossier. Elle a également interrogé tous les enquêteurs qui étaient joignables sur l’existence ou non d’un dossier.
M. le président Charles de Courson. Et quel a été le résultat ?
M. Thierry Picart. Négatif.
M. Jean-Pierre Gorges. Le fait que vous ne vous souveniez pas d’un dossier ne veut pas dire qu’il n’a pas existé. Nous sommes bien d’accord ?
M. Thierry Picart. C’est très clair.
M. Jean-Pierre Gorges. Comment meniez-vous vos enquêtes ? Lorsque vous aviez une information, vous convoquiez la personne pour un entretien, un peu comme le ferait un service de police. Mais à l’époque, disposiez-vous d’outils du type de ceux aujourd’hui à disposition pour savoir si M. Cahuzac possède un compte à l’UBS ? Vous auriez pu disposer de cette information précise puisque le nom de cette banque figurait dans l’enregistrement.
M. Thierry Picart. Comment travaillions-nous ? Nos dossiers débutaient fréquemment avec l’interception par nos collègues en uniforme d’un passeur de capitaux à l’entrée ou à la sortie de Suisse ou d’un autre pays. Nous vérifiions alors, comme le prévoient les textes, l’origine des fonds et recherchions une infraction éventuelle, douanière ou autre. Il y avait donc un pré-requis : il fallait qu’une infraction ait été commise et que des éléments aient été réunis. Il existait parfois une autre source d’information, consistant en la mise en œuvre d’un droit de communication auprès d’intermédiaires financiers, prévu par le code des douanes. Ensuite, nous convoquions la personne pour l’auditionner et, en vertu de dispositions du code des douanes, lui demandions communication de documents, essentiellement liés à des comptes bancaires français.
La deuxième partie de votre question a trait à la possibilité de mise en œuvre d’une assistance. Il existe en effet, soit dans un cadre bilatéral d’État à État, soit dans le cadre d’un accord conclu entre l’Union et les États membres, une assistance administrative mutuelle internationale, équivalent de l’assistance fiscale. La seule difficulté est que l’administration française des douanes a une particularité, en ce qu’elle est la seule à être organisée de la sorte et à posséder ce type de pouvoirs. Nos homologues étrangers sont presque exclusivement des fiscalistes chargés de collecter les droits et taxes sur les marchandises entrant dans l’Union européenne. Sauf erreur de ma part, il existe une convention entre l’Union européenne et la Suisse portant exclusivement sur les échanges de marchandises.
M. Hervé Morin. Où êtes-vous élu, monsieur Picart ?
M. Thierry Picart. Je suis adjoint aux finances à Montmorency, commune du Val d’Oise.
M. le président Charles de Courson. Il nous reste, monsieur Picart, à vous remercier d’être venu devant notre commission.
Audition du mardi 4 juin 2013
À 18 heures 30 : Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, et M. Jérôme Fournel, inspecteur général des finances, ancien directeur général des douanes et des droits indirects.
M. le président Charles de Courson. Nous achevons notre journée d’auditions en accueillant Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, et M. Jérôme Fournel, son prédécesseur dans ces fonctions. Je vous remercie tous deux d’avoir accepté d’être entendu par notre commission d’enquête chargée de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de l’affaire Cahuzac. Au cours des deux dernières semaines d’audition, l’administration des douanes a été citée à plusieurs reprises comme ayant été destinataire dès 2001 de renseignements accréditant l’hypothèse d’un compte détenu à l’étranger par M. Jérôme Cahuzac. Aussi avons-nous souhaité vous entendre afin d’obtenir quelques éclaircissements.
Avant d’aller plus loin, il me revient de rappeler que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Crocquevieille et M. Fournel prêtent successivement serment)
M. le président Charles de Courson. Madame, Monsieur, je vous laisse la parole.
Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects. J’ai été nommée directrice générale des douanes et des droits indirects le 27 février 2013, fonctions dans lesquelles j’ai succédé à Jérôme Fournel. Je venais d’un autre ministère en arrivant à la tête de cette direction et n’avais connaissance de l’affaire objet de la présente audition que par voie de presse, sans autre information particulière, l’essentiel des développements ayant d’ailleurs eu lieu avant mon arrivée. Je me suis enquis auprès de collaborateurs proches des éléments qui avaient pu être portés à leur connaissance. Je n’ai obtenu que des réponses négatives quant à la possibilité qu’il ait existé ou qu’il existe au sein de l’administration des douanes des documents ou des faits en lien avec l’affaire citée.
Je vais, si vous le permettez, monsieur le président, laisser la parole à Jérôme Fournel, mon prédécesseur. Sauf à répondre à des questions plus précises, sur le fond, en effet, je n’ai pas grand-chose d’autre à vous dire.
M. Jérôme Fournel, inspecteur général des finances, ancien directeur général des douanes et des droits indirects. J’ai été en poste avant Hélène Crocquevieille. Pour autant, cela ne remonte pas jusqu’à 2001. Je vais essayer de vous expliquer ce que l’administration des douanes a pu connaître de l’affaire Cahuzac, pour autant que je le sache.
Cela tient en peu de mots. Au moment où cette affaire a éclaté, la première question était de savoir si la douane judiciaire serait saisie dans le cadre de l’enquête judiciaire qui avait été ouverte. Tel n’a pas été le cas. Le sujet de l’affaire Cahuzac ne se posait donc pas pour l’administration des douanes.
Deux réquisitions judiciaires successives, le 5 puis le 12 février, ont été adressées aux services centraux de la douane, ainsi qu’ensuite à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). L’administration des douanes y a naturellement répondu, comme il était normal. Mais elle n’avait pas d’éclairage particulier sur le sujet.
Parallèlement, un journaliste de Mediapart, M. Arfi, a contacté l’un de mes collaborateurs, que vous venez d’auditionner. Celui-ci m’en a rendu compte aussitôt. Il ne savait pas pourquoi il était contacté, même si on savait que M. Arfi travaillait sur l’affaire Cahuzac. Il m’a dit qu’il ne pensait pas avoir d’éléments liés à cette affaire. Je lui ai conseillé, comme je le fais toujours dans le cas de sollicitations de la presse, de faire preuve de prudence et de discrétion, surtout dans une affaire aussi médiatisée, qui se trouvait de surcroît dans une phase judiciaire. Les choses, en tout cas pour moi, se sont arrêtées là. C’était autour de la mi-février. Quelques jours après seulement, je quittais mes fonctions.
Je m’en tiens aux éléments factuels en ma possession. Les éléments concernant l’affaire Cahuzac se limitent à très peu de chose pour l’administration de la douane. Une autre question, naturelle, est de savoir si une administration comme celle des douanes, chargée du contrôle des flux de marchandises mais aussi des flux financiers, pouvait avoir connaissance d’autres éléments. Il faut savoir que la douane visualise essentiellement des flux physiques, de marchandises ou financiers. Depuis fin 2006, Tracfin n’est plus rattaché à la direction générale des douanes, alors que jusqu’alors, le directeur général des douanes était aussi secrétaire général de Tracfin. Chargée de contrôler des transferts physiques, la douane peut naturellement être conduite à connaître d’éléments relatifs à des transports de fonds. Cela nous arrive très fréquemment. Des centaines, voire des milliers, de manquements à l’obligation déclarative sont constatés chaque année. Les flux sont interceptés à l’occasion de transports matériels de fonds par des personnes. Ce peut être à la frontière d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Le manquement à l’obligation déclarative est alors sanctionné. Dans le cas qui nous occupe, aucun élément de ce type n’est connu des services douaniers.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans la période où vous avez été directeur général des douanes, c’est-à-dire de 2007 à 2013, vous n’avez pas eu d’information relative à un éventuel compte de Jérôme Cahuzac à l’étranger, ni de la part de vos services ni directement ?
M. Jérôme Fournel. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition juste avant vous, votre collaborateur nous a parlé des systèmes informatiques dans lesquelles sont stockées certaines informations. Y avez-vous effectué des contrôles ou des vérifications ?
M. Jérôme Fournel. Oui, des contrôles et des vérifications ont été faits sur ces données-là, dans la limite naturellement du délai de conservation des données. Tout récemment, la durée d’archivage des données portant notamment sur les manquements à l’obligation de déclaration des transferts de fonds a été portée à vingt ans. Sa durée maximale était auparavant de dix ans, dans les cas de contentieux n’ayant pas donné lieu à transaction, et de niveau national, et non régional. Les délais de conservation des données nous sont imposés par la réglementation de la CNIL, qui vise à garantir le respect des libertés publiques.
Dans ce champ-là et compte tenu de ces délais de conservation, aucune donnée dans les systèmes d’information douaniers ne permettait de retrouver la présence de M. Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Madame la directrice générale, avez-vous pris des initiatives pour défendre votre collaborateur ?
Mme Hélène Crocquevieille. Des initiatives de nature juridique, non. Des temps d’écoute et d’échange avec lui, oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous excluez toute démarche juridique ?
Mme Hélène Crocquevieille. Il n’en a pas eu besoin pour le moment. La tension a été la plus vive pour lui au moment où l’affaire était la plus bruyante sur le plan médiatique et où la presse cherchait à obtenir des informations. C’était peu de temps après ma prise de fonctions.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il a été nommément mis en cause dans une commission où les personnes auditionnées prêtent serment. L’administration a-t-elle pris des initiatives pour le défendre ?
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas seulement la personne du chef de bureau qui est mise en cause, mais le service. Devant notre commission, M. Gonelle a en effet déclaré « avoir entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le chef de la direction des enquêtes douanières – une des divisions de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) – avait obtenu le renseignement dès 2001 ». M. Gonelle avait d’ailleurs déjà tenu des propos analogues dans la presse en évoquant l’année non pas 2001, mais 2008. L’accusation est plutôt que ce fonctionnaire aurait eu l’information, aurait rédigé un rapport qui serait remonté jusqu’au directeur… Ses propos devant notre commission le 21 mai dernier ne vous ont pas inquiétée ?
Mme Hélène Crocquevieille. Pour l’instant, ce collaborateur a été entendu par la police judiciaire. À ma connaissance, il a simplement été entendu. Il n’a pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Aucune démarche juridique n’a donc été entreprise à ce titre. En revanche, des temps d’échange ont été pris avec lui, avec son sous-directeur actuel pour voir comment faire face à la pression médiatique qui s’exerce sur lui.
M. le président Charles de Courson. En l’espèce, ce n’est pas ce fonctionnaire ès qualités qui est accusé, mais un service, car si ce fonctionnaire avait eu une information et avait rédigé un rapport, il n’y aurait là rien de répréhensible : il n’aurait fait que son devoir. Les accusations implicites portées le 21 mai dernier devant notre commission, si nous les avons bien comprises, sont que des informations existaient, que la douane en a eu connaissance, qu’un fonctionnaire a rédigé un rapport et que ce rapport a été enterré.
Mme Hélène Crocquevieille. M. Picart s’en est expliqué.
M. le président Charles de Courson. La question de notre rapporteur est de savoir pourquoi, en tant qu’actuelle directrice de ce service, vous ne l’avez pas défendu. M. Picart se sent peut-être un peu seul. Il est fonctionnaire et nous n’avons rien à lui reprocher.
Mme Hélène Crocquevieille. M. Picart sait que la porte de mon bureau ainsi que celle de sa hiérarchie immédiate lui sont ouvertes. J’ai eu de nombreux temps d’échange avec lui et avec les différents services pouvant lui apporter un conseil en la matière. Encore une fois, lui-même n’a pas souhaité bénéficier d’une protection fonctionnelle à ce stade et n’en a pas, à ma connaissance, besoin sur le plan juridique. S’il sollicitait cette protection, elle serait bien évidemment examinée en fonction de la nature de sa demande.
Mme Marie-Christine Dalloz. Madame Crocquevieille, à qui rendez vous des comptes ? Comment cela se passe-t-il ? À qui et comment faites-vous remonter les informations ?
Monsieur Fournel, en quoi ont consisté les réquisitions dont vous avez fait état ? Quelles réponses y avez-vous apportées ?
Mme Hélène Crocquevieille. Le service des douanes et des droits indirects est placé sous la double autorité du ministre de l’économie et des finances, M. Moscovici, et du ministre du commerce extérieur, Mme Bricq, chacun pour les domaines le concernant. Au sein du ministère des finances, le ministre délégué au budget est, traditionnellement et opérationnellement, l’interlocuteur qui suit les affaires de la douane. Nous rendons plutôt compte à Mme Bricq ou à son cabinet, pour les problèmes ayant trait à la compétitivité à l’exportation ou de relation avec certains secteurs économiques. Lorsque la problématique est davantage douanière, organisationnelle, fiscale ou de tutelle sur les secteurs économiques suivis par la douane, nous rendons plutôt compte au ministre délégué au budget ou à son cabinet.
Mme Marie-Christine Dalloz. La « muraille de Chine » vous concernait-elle ou non ?
Mme Hélène Crocquevieille. Je crains de ne pas comprendre la question.
M. le président Charles de Courson. M. Jérôme Cahuzac avait signé une instruction enjoignant de déporter son dossier ainsi que le dossier UBS. C’était Pierre Moscovici qui en était chargé. Voilà ce qui a été improprement appelé « la muraille de Chine ».
Mme Hélène Crocquevieille. Nous n’avons pas connaissance évidemment de ces éléments-là.
M. Jérôme Fournel. Cela me permettra une transition car de fait, il existe plusieurs « murailles de Chine ». Il y a celle que vous rappeliez, monsieur le président, qui a été instaurée, s’agissant d’une enquête fiscale administrative. Il y en a d’autres, classiques, institutionnelles, constitutionnelles même, sur les affaires faisant l’objet d’une enquête judiciaire, et ce, en vertu de la séparation des pouvoirs.
En l’occurrence, les réquisitions sont des demandes de l’autorité judiciaire aux services administratifs d’apporter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire. Naturellement, à chaque réquisition, sauf sujet couvert par le secret défense, l’administration des douanes apporte les éléments de réponse qu’elle doit à l’autorité judiciaire. C’est ce que nous avons fait, mais il se trouve que nous n’avions pas d’éléments particuliers à communiquer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avant d’évoquer pour la première fois la date de 2001 lors de son audition par notre commission, M. Gonelle avait auparavant parlé de 2008 dans de nombreuses interviews. Avez-vous été interrogé en tant que directeur ? Avez-vous fait un rapport au ministre ?
M. Jérôme Fournel. Non. Je n’ai pas été interrogé par le ministre ni son cabinet sur le sujet. M. Gonelle a varié dans ses déclarations s’agissant des dates, en tout cas d’après ce qui en a été rapporté dans la presse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il a varié dans les dates le jour de son audition.
M. Jérôme Fournel. Un point était important pour nous. En effet, il semblait que M. Picart ait été destinataire de documents. Or, cela était impossible vu la date indiquée par M. Gonelle – en tout cas telle que rapportée dans la presse – puisqu’en 2008, M. Picart n’était pas en poste à la direction générale des douanes.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Picart nous a rafraîchi la mémoire tout à l’heure.
Toutes les interviews évoquaient 2008. C’est l’époque où vous étiez directeur. Alors que je l’interroge sur les dates, M. Gonelle me répond qu’il y a une erreur, que ce n’est pas 2008 mais 2001. Le président lui demande alors s’il connaît le nom du fonctionnaire visé. Il cite alors le nom de M. Picart. Mais avant cela, M. Gonelle n’avait jamais parlé que de 2008. Quelles initiatives avez-vous prises dans votre service ?
M. Jérôme Fournel. Quand il a été fait état de la date de 2008, nous avons recherché si nous pouvions trouver des notes ou des éléments remontant à cette époque-là. Personnellement, je ne me souvenais pas d’une telle note. Or, il se trouve que sur les notes présentant une certaine sensibilité, j’ai rarement un défaut de mémoire aussi profond. Le nombre de services de l’administration des douanes pouvant avoir à connaître de ce type de faits est relativement limité. Ce n’est pas une direction régionale, mais la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui généralement en traite. Celle-ci a dit qu’elle ne possédait aucun élément. Les choses se sont arrêtées là.
Puis est sorti le nom de Thierry Picart, et là sont apparues des incohérences de date. Constatant ce défaut de cohérence, nous n’avons pas poussé les recherches plus loin. Si on se replace dans le contexte de 2001, il faut des éléments consistants pour qu’un fonctionnaire des douanes qui reçoit une information, avec beaucoup de précaution vu les incertitudes l’entourant, – information qui de surcroît ne relève pas de son champ de compétences puisqu’il s’agit ni de fiscalité des marchandises ni même de flux financiers, mais de fiscalité personnelle – la transmette à la justice au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ou dans le cadre d’une démarche apparentée. J’ignore la véracité des dires autour de cette information qui aurait été transmise en 2001. Mais il faut garder en tête ce que je viens de dire.
M. le président Charles de Courson. Ce qui trouble notre rapporteur est que vous ne défendiez pas, l’un puis l’autre, votre direction, qui est accusée dans la presse d’avoir possédé une information à laquelle il n’aurait pas été donné de suite. Pourquoi n’avez-vous pas publié un démenti pour dire : « Tout cela est inexact, pour la simple raison que M. Picart n’était pas chef du bureau en question en 2008. Nous avons effectué des recherches dans le service. Il n’y a aucune note de ce type. Ces informations sont fausses. » ? Vous auriez pu aussi adresser une note à votre ministre de tutelle pour dire la même chose. Il est curieux que votre service se trouvant mis en cause, le cabinet, ou le ministre directement, ne vous l’ait pas demandé ou que vous n’en ayez pas pris l’initiative.
M. Jérôme Fournel. La douane a en effet été citée à plusieurs reprises dans divers articles, de manière toujours très floue. Il existe deux façons de gérer ce type de situation sur le plan médiatique. Soit on joue la discrétion, soit on met les pieds dans le plat pour dire « On a fait des recherches. On n’est pas concerné, etc » et fournir des éléments. Il faut voir qu’en cette affaire d’une part, s’il s’agit de 2001, d’éventuelles données n’auraient même pas été conservées – je ne reviens pas sur les durées d’archivage –, d’autre part, une enquête judiciaire est parallèlement en cours.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si une enquête judiciaire est en cours, l’administration ne fait rien ?
M. Jérôme Fournel. On respecte la procédure judiciaire. On suspend les investigations et on se place au service de l’institution judiciaire en recherchant les éléments éventuels qu’elle nous demande.
M. le président Charles de Courson. Pour l’administration des douanes, le principe est donc de suspendre son action en cas d’enquête judiciaire ? Votre collègue de la direction générale des finances publiques (DGFiP) nous a dit, lui, que son administration agissait en toute indépendance : aucun texte ne lui imposait de suspendre ses enquêtes au déclenchement d’une enquête judiciaire. C’est d’ailleurs ce qui a été fait pour le volet fiscal de l’affaire qui nous occupe.
M. Alain Claeys, rapporteur. Des enquêtes administratives ont-elles été engagées à l’administration des douanes ?
M. Jérôme Fournel. Il y a une grande différence entre le droit fiscal et le droit douanier. La plupart des affaires douanières commencent par une phase administrative mais débouchent rapidement sur la caractérisation d’infractions pénales. Le dialogue entre l’administration et la justice ne se pose pas du tout, me semble-t-il, dans les mêmes termes en matière douanière qu’en matière fiscale.
M. le président Charles de Courson. Il y a le droit et l’application du droit. Êtes-vous tenu de suspendre une enquête douanière si une enquête judiciaire est en cours sur les mêmes faits ? Si la réponse est non, pourquoi alors cette pratique ?
Mme Hélène Crocquevieille. Votre question est large. Tout dépend de l’objet de l’enquête judiciaire.
M. le président Charles de Courson. Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe de la détention ou non d’un compte non déclaré, en Suisse ou ailleurs ?
Mme Hélène Crocquevieille. Ceci ne relève pas de la compétence de l’administration des douanes. Celle-ci n’a pas à investiguer sur l’existence ou non de comptes illicites à l’étranger. Elle n’en a d’ailleurs pas le pouvoir. Elle peut avoir connaissance de tels faits à l’occasion d’un manquement à l’obligation déclarative ou d’une enquête de nature douanière. Dans ce cas, les éléments du dossier, s’il est de nature strictement fiscale ou financière, est transmis aux autorités judiciaires compétentes.
Après que certaines allégations ont été reprises dans la presse, un premier niveau d’investigations a eu lieu à la DNRED ainsi qu’à la direction générale des douanes, qui n’a pas permis de trouver d’éléments, ni dans les systèmes d’information, ni dans les documents papier. Dans ces conditions-là et sachant par ailleurs qu’une enquête judiciaire était en cours, il n’y a pas eu d’enquête particulière.
M. le président Charles de Courson. Pourriez-vous, madame, rédiger une note à l’intention de notre rapporteur, afin de répondre précisément à la question juridique qu’il a posée et à laquelle vous n’avez pas répondu ? L’administration des douanes est-elle tenue, en droit, de suspendre toute enquête douanière si une enquête judicaire est en cours ?
Mme Hélène Crocquevieille. Oui. La phase administrative de l’enquête s’arrête. Ce sont les services enquêteurs de la police judiciaire qui prennent le relais et interviennent alors sur réquisition du parquet compétent.
M. le président Charles de Courson. Est-ce une pratique ou une disposition législative vous l’impose-t-il ?
Mme Hélène Crocquevieille. Je pense que cela est prévu dans les textes mais je préfère vérifier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur Fournel, avez-vous informé votre hiérarchie, en l’espèce le ministre de l’économie, des deux réquisitions successives de février ?
M. Jérôme Fournel. On a fait jouer une « muraille de Chine » aussi pour ces deux réquisitions. C’est une pratique générale. Lorsque la douane judiciaire, laquelle est placée sous l’autorité du directeur général ainsi que, fonctionnellement, du ministre, traite d’affaires judiciaires, instruisant au quotidien les enquêtes que les parquets lui confient, elle agit de façon autonome. Il n’est pas de tradition dans l’administration des douanes de faire remonter ces informations jusqu’au ministre. De même, cette administration répond aux réquisitions judiciaires, sans en référer préalablement au ministre.
M. le président Charles de Courson. Là encore, est-ce une pratique ou une disposition législative vous l’impose-t-il ?
M. Jérôme Fournel. Une question est de savoir jusqu’où peut aller la confidentialité des enquêtes judiciaires en regard des pouvoirs du ministre. Le principe retenu par l’administration des douanes, conforme, je le pense, aux dispositions du code de procédure pénale, est que le ministre n’a pas à connaître les éléments relatifs aux enquêtes judiciaires.
Mme Marie-Christine Dalloz. Votre réponse m’interpelle car en l’espèce, il s’agit du ministre du budget. On peut choisir de laisser aveugle son ministre de tutelle. On peut aussi choisir de l’informer des réquisitions formulées.
M. le président Charles de Courson. Lorsque votre collègue de la DGFiP nous a dit qu’il n’avait pas informé le ministre qu’il avait lancé la procédure du formulaire 754, laquelle laissait un mois à Jérôme Cahuzac pour répondre, délai à l’issue duquel celui-ci n’a pas répondu, nous lui avons aussi demandé s’il avait averti son ministre. Il nous a répondu que non. Il faut reconnaître qu’il est délicat pour un ministre, surtout quand il est quotidiennement interrogé sur le sujet, de ne pas savoir ce qui se passe dans ses services. Il ne s’agit bien sûr pas qu’ils influencent les services, mais dans une démocratie, les ministres sont à la tête de leur administration.
M. Jérôme Fournel. J’avais indiqué antérieurement, de manière générale, et l’ai redit à l’occasion de cette affaire, que l’administration des douanes répondrait aux réquisitions judiciaires qui lui seraient adressées. Je l’ai dit, y compris à la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac.
Indépendamment de cela, sur des réquisitions judiciaires concernant une affaire dans laquelle le ministre était potentiellement impliqué, il me paraît normal d’avoir érigé une « muraille de Chine » sur la phase judiciaire de l’enquête entre l’administration des douanes et le ministre lui-même, comme cela avait été fait à la DGFiP.
Mme Marie-Christine Dalloz. La « muraille de Chine » dont il était initialement question consistait à « déporter » Jérôme Cahuzac. Mais en l’espèce, vous avez également « déporté » le ministre de l’économie et des finances. C’est en tout cas le sentiment que l’on a, et cela m’interpelle.
M. le président Charles de Courson. Les directeurs ont dit ne pas l’avoir informé, conformément à une pratique constante. Les décrets d’attribution n’avaient pas placé l’administration des douanes sous l’autorité de M. Cahuzac ?
M. Jérôme Fournel. Elle est placée sous la double autorité de Pierre Moscovici et Nicole Bricq.
Audition du mercredi 5 juin 2013
À 16 heures 45 : Mme Marie-Hélène Valente, sous-préfète, ancien chef de cabinet du ministre délégué chargé du budget.
M. le président Charles de Courson. Nous accueillons Mme Marie-Hélène Valente, qui était le chef de cabinet du ministre délégué au budget Jérôme Cahuzac jusqu’à ce qu’il démissionne.
Madame la sous-préfète, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission, d’autant que vous vous apprêtez à prendre de nouvelles fonctions en Côte d’Or, comme secrétaire générale de la préfecture.
Nous cherchons à faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’Etat entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013. Le rôle joué par le cabinet de l’ancien ministre du budget dans la gestion de l’affaire dite « Cahuzac » nous intéresse tout particulièrement. Nous souhaiterions notamment savoir de quelles informations vous disposiez, dans vos fonctions.
Mme Marie-Hélène Valente prête serment.
Mme Marie-Hélène Valente. Mesdames, messieurs les députés, je suis satisfaite de pouvoir enfin vous donner la version authentique et complète d’un épisode très ténu du dossier, mais qui, à mon grand étonnement, a suscité d’amples réactions. J’ai été très directement mise en cause parce que, sans avoir pris aucune initiative, j’ai reçu de la préfecture de Lot-et-Garonne une information, qui attestait très indirectement d’un contact téléphonique entre la rédaction de Mediapart et Maître Gonelle. Ce dernier, que vous avez auditionné, était l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, et c’est lui qui est à l’origine de l’enregistrement des propos de Jérôme Cahuzac, faisant allusion à la détention d’un compte bancaire en Suisse.
Malgré l’intérêt limité de cette information, il était de mon devoir de transmettre l’information à son destinataire final, le ministre délégué au budget. Je lui ai envoyé un mail puisqu’il était à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de loi de finances. C’est ce courriel qui a été intercepté et qui a connu la notoriété que l’on sait. Il a été estimé que ce geste portait atteinte aux sources journalistiques et d’aucuns y ont vu un dysfonctionnement de l’appareil d’État.
Depuis, Maître Gonelle a précisé la nature de l’information, et partant son insignifiance, et les modalités rocambolesques de son recueil, qui ne doivent rien à une dérive administrative. Le principal intéressé a décrit les faits de façon très détaillée, les jugeant « cocasses », sans leur donner plus d’importance qu’ils n’en méritaient. Et son récit a été pour lui l’occasion de rappeler ce qu’il dit depuis le début, c’est-à-dire qu’il n’est pas la source de Mediapart. Il me semble que ses déclarations mettent un terme définitif au débat.
Pour autant, même s’il n’y avait pas matière, je me suis trouvée publiquement mise en cause, et sans ménagement, – j’en ai été évidemment affectée – pour n’avoir fait au fond que mon devoir le plus élémentaire de fonctionnaire, à savoir transmettre à l’autorité une information qui lui était destinée.
Il me semble, à la réflexion, qu’il s’agit surtout d’un malentendu d’ordre « culturel ». L’attitude qui consiste à rendre compte est considérée par les uns comme un dysfonctionnement sévère des services de l’État, alors que pour les autres, les fonctionnaires, elle est la simple mise en œuvre du principe hiérarchique auquel ils sont soumis. La réaction suscitée par ce mail me paraît surtout traduire la méconnaissance des relations ordinaires entre les services territoriaux et l’administration centrale. Cela n’a rien d’étonnant, puisqu’il s’agit du fonctionnement interne de l’administration.
J’en profiterai donc pour rappeler quelques fondamentaux et expliquer le rôle des acteurs. Que le préfet du Lot-et-Garonne rende compte au ministre du budget n’a rien que de très banal. Les préfets de département sont les représentants locaux de tous les ministres même s’ils rendent compte prioritairement au ministre de l’intérieur, qui est leur autorité de tutelle. De ce fait, des rapports adressés par les préfets au ministre du budget, qu’ils passent ou non sous le couvert de l’intérieur, sont légion. J’en ai reçu moi-même un grand nombre.
Lorsqu’un ministre est élu dans un département, il est de tradition républicaine constante que le préfet le tienne régulièrement informé des événements qui s’y déroulent, a fortiori quand le ministre lui-même est concerné. Nous étions parfaitement dans ce cas de figure.
Vous le savez, le circuit habituel va du cabinet du préfet à celui du ministre. Concrètement, le directeur de cabinet du préfet échange des messages écrits ou oraux avec le chef de cabinet du ministre. La plupart du temps, ils sont tous les deux membres du corps préfectoral, ce qui facilite les relations. Quand les informations sont particulièrement importantes, voire confidentielles, le préfet en réfère directement au ministre, sans le truchement des collaborateurs. Dans le cas qui vous intéresse, c’est la procédure ordinaire qui a été suivie.
Mais derrière les rouages se cachent des individualités. En ce qui me concerne, Jérôme Cahuzac a fait appel à moi pour être son chef de cabinet, parce que j’avais été sous-préfète de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, de 2005 à 2007. C’est à cette occasion que nous nous sommes connus. De surcroît, je suis lot-et-garonnaise d’origine et j’ai même exercé à la préfecture, comme attachée, de 1984 à 1993, avant d’entrer à l’ENA.
J’avais donc une très bonne connaissance du territoire et de ses acteurs, tant politiques qu’économiques et j’ai eu l’occasion de rencontrer, à un moment ou à un autre, tous les « protagonistes » locaux de l’affaire. Par ailleurs, avant d’entrer au cabinet, j’étais directeur général des services du département du Gers, ce qui m’avait permis de me familiariser avec la problématique des finances locales, et particulièrement celles des départements. Dans l’esprit du ministre de l’époque, mes origines professionnelles et personnelles constituaient un atout essentiel puisque, en tant que chef de cabinet, j’étais le relais naturel entre l’administration centrale et le terrain, c'est-à-dire toutes les préfectures, à commencer par celle du Lot-et-Garonne, d’autant que j’avais un rôle de conseiller territorial du ministre.
Voilà donc les faits tels qu’ils se sont déroulés. Le 11 décembre, en début d’après-midi, je reçois un appel du directeur de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne qui, en guise de préambule, me demande de l’excuser de me déranger pour une affaire qui n’a sans doute pas grand intérêt. Il me dit avoir hésité à me prévenir de l’épisode survenu quelques jours plus tôt, le 7. Il s’agissait d’un message téléphonique destiné à Maître Gonelle, déposé tout à fait fortuitement sur le portable d’un policier. Les propos du directeur de cabinet sont relatés à la virgule près, ou presque, dans le mail dont vous avez eu connaissance et Maître Gonelle en a confirmé la teneur lors de son audition. Il lui était demandé de rappeler la rédaction de Mediapart. Je n’ai donc été que la courroie de transmission d’une information insignifiante qui n’a connu, de surcroît, aucune suite, d’aucune sorte. Le seul commentaire du ministre, quand il a reçu mon mail, a été : « C’est comique ». C’est ainsi qu’il a clos le chapitre. Et il n’a pas été rouvert depuis. Je m’étonne devant vous que le mail du ministre n’ait pas connu la même notoriété que le mien.
La teneur du message ne présentait pas d’autre intérêt. Le destinataire était sans aucune ambiguïté Me Gonelle, en sa qualité d’ancien maire de Villeneuve. Cela se déduisait à l’évidence de la présentation qui était faite du recueil de cet enregistrement. C’était limpide pour tout le monde à Villeneuve. D’ailleurs, Me Gonelle vous a dit lui-même combien il avait été, à partir du 5 décembre – aussitôt connu l’enregistrement en sa possession – pris dans une tempête médiatique. À tel point que la batterie de son portable n’a pas résisté, et qu’il a dû emprunter celui du chef d’escorte, avec les conséquences que l’on sait.
Alors, me demanderez-vous, si l’information était aussi futile, pourquoi l’avoir communiquée au ministre, en des termes « courants » ? J’ai sans doute fait preuve d’une conscience professionnelle exagérée et utilisé un vocabulaire peu adapté au sujet. Si erreur il y a eu, elle est là. Mais, pour vous faire mieux comprendre l’état d’esprit des uns et des autres, il faudrait vous remettre dans le contexte du moment. Nous étions en pleine discussion de la loi de finances, qui succédait à cinq autres textes à caractère financier depuis le mois de juillet. Le ministre était sans relâche en première ligne, au Parlement. Cette affaire de compte non déclaré dans une banque suisse, à laquelle, je dois à la vérité de le dire, nous n’accordions aucun crédit, c’était le fardeau de trop à un moment où le nécessaire redressement des finances publiques mobilisait toutes les énergies. Dans ces conditions de tension extrême, j’avoue ne pas avoir longtemps réfléchi avant de transmettre au ministre ces informations communiquées par la préfecture de Lot-et-Garonne. J’ai agi de façon presque automatique. Le ministre eût été dans son bureau, je lui en aurais parlé et l’affaire en serait restée là. Et elle ne méritait pas mieux.
Cependant, avec le recul, ma fonction ne m’imposait-elle pas de rendre compte ? Si je ne l’avais pas fait, on aurait peu me reprocher d’être déloyale. Il est très difficile de trancher, surtout ex post. Il ne s’agissait, j’y insiste, que d’un compte rendu, sans qu’il y ait eu aucune recherche d’information. Et elle n’a donné lieu à aucune exploitation.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourrions-nous avoir la réponse du ministre à votre mail ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je ne l’ai pas, pas plus que le mien ! Je n’ai pas vidé mon ordinateur de Bercy et on doit pouvoir facilement retrouver ce mail. En tout cas, le ministre qui, parfois, tape un peu vite, a répondu : « Fait comique. », au lieu sans doute de « C’est comique. »
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous recevez, du directeur cabinet du préfet, un coup de fil le 11 décembre 2012, le lendemain de la mise en place de la « muraille de Chine ». Jérôme Cahuzac a signé la lettre en question le 10 décembre. Malgré tout, vous prenez la communication qui concernait l’affaire Cahuzac.
Mme Marie-Hélène Valente. Le directeur de cabinet m’informe systématiquement. Il m’arrive certaines semaines de l’avoir au téléphone quasi quotidiennement. Par ailleurs, la « muraille de Chine » concernait les services techniques du ministère du budget. Le chef de cabinet n’est pas au cœur des affaires fiscales.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je rappelle les termes du mail que vous adressez : « Je viens d’être appelée par le dir’cab’ du préfet pour me raconter la chose suivante : vendredi soir, se trouvant au tribunal à Agen, Gonelle, en panne de portable, emprunte celui d’un policier qu’il connaît bien. Or, c’est le portable de permanence du commissariat et la messagerie a enregistré le message suivant : “N’arrivant pas à vous joindre, je tente au hasard, sur tous les numéros en ma possession, rappelez Edwy Plenel.” J’ai demandé de consigner le message à toutes fins utiles, j’attends la copie du rapport officiel du DDSP [directeur départemental de la sécurité publique]. Il va falloir être prudent dans la remontée de l’info pour que celle-ci puisse être, le cas échéant, une preuve utilisable. »
Avez-vous eu reçu un rapport du DDSP ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non, monsieur le rapporteur. C’est la preuve que le vocabulaire que j’ai utilisé n’est pas tout à fait le bon, parce que ce rapport n’existe pas en tant que tel. Les services de police et de gendarmerie font remonter au ministère de l’intérieur des événements qui leur paraissent avoir une signification quelconque. La plupart du temps, les comptes rendus aboutissent chez le permanencier. Il ne s’agit pas de rapports proprement dits, remis au ministre.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous expliquer la dernière phrase de votre message ?
Mme Marie-Hélène Valente. J’aimerais bien ! Le ministre avait engagé une action en diffamation et je ne savais pas si cette information pourrait servir dans ce cadre. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c’est qu’après coup, je me suis dit qu’il ne fallait pas procéder ainsi. J’ai donc rappelé le directeur de cabinet du préfet pour lui dire de ne pas m’envoyer de copie et de ne plus en parler. Il m’a répondu qu’il en était arrivé à la même conclusion.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand vous êtes interrogée par Mediapart, vous dites, selon Fabrice Arfi, entretenir « des rapports normaux » avec les services du ministère de l’intérieur. Avez-vous eu des contacts avec lui, en l’espèce ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non, évidemment. Je ne me souviens pas avoir utilisé cette expression. En substance, je voulais dire qu’il n’y avait pas d’interférence. La « norme », je vous l’ai expliquée dans mon propos liminaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. En tant qu’interface entre le niveau central et le niveau local, avez-vous participé à la préparation et à l’organisation de la rencontre entre Jérôme Cahuzac et Rémy Garnier en circonscription ? Avez-vous assisté à l’entrevue ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non. Il y a seulement une note qui est remontée des services. Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici se sont rendus en visite officielle le 26 octobre en Lot-et-Garonne, et ils devaient se retrouver à Agen. Auparavant, Jérôme Cahuzac s’est rendu à Villeneuve et il a rencontré Rémy Garnier. Curieusement, j’accompagnais donc Pierre Moscovici. Je n’ai donc pas assisté à l’entretien, ni personne d’autre.
En revanche, j’ai bien lu la note de Bruno Bézard, rappelant la situation de Rémy Garnier. Ayant été sous-préfet à Villeneuve, les relations de Rémy Garnier avec l’administration fiscale ne m’étaient pas inconnues.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’est-ce à dire ?
Mme Marie-Hélène Valente. Elles m’étaient connues surtout par la voie médiatique, Rémy Garnier s’étant beaucoup exprimé dans la presse. Au-delà, quand j’étais sous-préfet de Villeneuve, il avait eu des démêlés assez vifs avec le directeur local des services fiscaux.
M. Alain Claeys, rapporteur. Aviez-vous lu le rapport que M. Garnier aurait envoyé à sa hiérarchie, dans lequel Jérôme Cahuzac est mis en cause ?
Mme Marie-Hélène Valente. C’est à cause de lui que j’ai été mêlée à l’affaire. Le 4 décembre, je participais à un déjeuner de chefs de cabinet à Paris et j’ai été rappelée à Bercy par la directrice de cabinet qui était à la recherche d’un courrier, dont on ne m’a pas dit la teneur – en tant que chef de cabinet, je fais office de « gare de triage » du courrier entrant. Je n’ai eu connaissance que de la date – le 11 juin 2008. On m’a seulement appris qu’il s’agissait d’un courrier de dénonciation signé. Mes recherches étant restées infructueuses, je suis allée voir la directrice de cabinet dans son bureau qui m’a dit avoir trouvé le document. C’était normal puisqu’il avait été transmis par la voie interne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel circuit ce mémoire, dans lequel M. Garnier se défend, et qui contient deux pages sur M. Cahuzac, a-t-il suivi ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je l’ignore. L’administration locale a dû le faire parvenir à l’administration centrale. J’imagine qu’il y a des échanges internes à la DGFiP (direction générale des finances publiques), mais je ne connais que le courrier qui arrive de l’extérieur.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi s’intéresser, le jour même des révélations, c'est-à-dire le 4 décembre, à Rémy Garnier ?
Mme Marie-Hélène Valente. Son nom était cité par Mediapart.
M. Alain Claeys, rapporteur. Savez-vous comment la directrice de cabinet a obtenu ce rapport ? Et l’avez-vous lu ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non, je ne lui ai pas demandé. Mais elle m’a remis ce rapport, et je l’ai lu.
M. le président Charles de Courson. Sur votre exemplaire, avez-vous remarqué un tampon ou une griffe quelconques, indiquant l’origine ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non, je ne me souviens pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mediapart écrivait : « L’existence du compte secret de M. Cahuzac avait été évoquée dès le mois de juin 2008 par un agent du fisc du Sud-Ouest,… ». Qu’en était-il à cette date ?
Mme Marie-Hélène Valente. À cette époque, j’étais secrétaire générale de la Vendée. Toutefois, j’entends dire maintenant que tout le monde savait. Je dois être particulièrement sourde parce que, à mon poste de sous-préfet, je n’avais jamais entendu parler de cette affaire. J’ai découvert le rapport le 4 décembre 2012, comme tout le monde.
M. Alain Claeys, rapporteur. À votre poste de sous-préfète, vous n’avez entendu parler de rien ?
Mme Marie-Hélène Valente. De rien. Et chaque fois que Rémy Garnier a cherché à joindre Jérôme Cahuzac, c’était pour avoir son soutien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Entre 2005 et 2007, vous avez connaissance de conversations entre M. Cahuzac et M. Garnier ?
Mme Marie-Hélène Valente. Des conversations, je ne sais pas. Quand M. Cahuzac a retrouvé son siège de député, M. Garnier l’a sollicité pour l’aider à faire valoir ses droits. Et, quand j’arrive à Bercy, l’un des premiers courriers que je reçois émane de M. Garnier qui fait part de son « espérance » d’être réhabilité. Et c’était l’objet de l’entretien du 26 octobre, entre les deux hommes, même si le terme de « réhabilitation » n’a pas de signification juridique.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Garnier, pendant toute cette période, voulait que M. Cahuzac, en tant que parlementaire puis en tant que ministre, s’intéresse au contentieux qui l’opposait à sa propre administration ?
Mme Marie-Hélène Valente. Exactement. M. Garnier plaçait ses espoirs dans M. Cahuzac. À l’issue de la rencontre, le ministre m’a simplement dit qu’il lui avait dit qu’il soutiendrait son administration.
M. Alain Claeys, rapporteur. En somme, la seule interrogation qui subsiste concerne la façon dont le rapport Garnier est arrivé chez la directrice de cabinet.
Comme chef de cabinet, étiez-vous au courant des questions posées à Jérôme Cahuzac par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, à propos de sa déclaration de patrimoine au titre de l’impôt sur la fortune ?
Mme Marie-Hélène Valente. Oui, la directrice de cabinet m’a montré la liste des questions.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand ?
Mme Marie-Hélène Valente. Le 4 décembre également, ou le 5. L’idée était de fournir les éléments demandés le plus vite possible.
M. Alain Claeys, rapporteur. Soyons précis. Nous parlons bien des renseignements demandés à la suite des déclarations de patrimoine des membres du Gouvernement ?
M. le président Charles de Courson. Vous avez vu la « fiche ministre » ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je ne l’ai pas vue. J’ai simplement eu en main une feuille blanche sur laquelle étaient listées les trois ou quatre demandes, et les réponses qu’il convenait d’apporter. Il m’a alors été demandé de réunir les éléments, via le comptable du ministre. C’est à ce moment-là qu’a été érigée la fameuse « muraille de Chine ». Et nous ne sommes pas allés au bout.
M. Alain Claeys, rapporteur. En tant que rapporteur, j’ai eu connaissance des quatre ou cinq demandes concernant les déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune. Elles n’ont pas de lien avec l’affaire qui nous intéresse.
M. le président Charles de Courson. Revenons à M. Garnier, qui a, avez-vous dit, pris contact avec M. Cahuzac dès sa nomination. Mais l’avait-il fait avant ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je ne saurais l’affirmer, puisque je n’étais pas sur place à l’époque, mais il me semble qu’il l’a beaucoup sollicité, avant même que M. Cahuzac soit nommé ministre.
M. le président Charles de Courson. Mme la directrice de cabinet nous a dit lui avoir donné un conseil à propos de l’entretien entre M. Cahuzac et M. Garnier. Vous aussi ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non. Je n’y étais pas forcément favorable. Le soir, le ministre avait une réunion publique, à laquelle il tenait. Il m’a dit préférer le voir avant, pour éviter les questions en réunion publique. L’entrevue du 26 octobre a dû être très brève.
M. Étienne Blanc. Vous avez parlé d’une note de Bruno Bézard sur Rémy Garnier. De quoi s’agit-il ?
Mme Marie-Hélène Valente. D’une note administrative, signée par M. Bézard mais qu’il n’a pas rédigée, rappelant tous les contentieux – une douzaine environ – ayant opposé Rémy Garnier aux services fiscaux, de son entrée aux impôts jusqu’à sa retraite. La note doit faire deux pages et a dû vous être communiquée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous avons les deux notes, et vous pourrez, chers collègues la consulter.
M. Étienne Blanc. Quand donc la « muraille de Chine » a-t-elle été édifiée ? Qui a donné les instructions ? Et lesquelles exactement ?
Mme Marie-Hélène Valente. Encore une fois, je n’avais pas à en connaître puisqu’il s’agissait de protéger le ministère de façon à ce qu’il ne soit pas soupçonnable. La lettre dans laquelle Jérôme Cahuzac se déporte a dû être signée le lundi suivant, mais elle a commencé à être discutée dès le 6 décembre.
M. Étienne Blanc. Il n’y a pas eu de réunion de cabinet, pas eu d’échanges entre collaborateurs.
Mme Marie-Hélène Valente. Non, il n’y a pas eu de réunion de cabinet. J’ai été informée, mais je n’étais pas directement concernée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous transmettrons à tous la note signée par Jérôme Cahuzac sur la « muraille de Chine ».
M. le président Charles de Courson. La note, datée du 1er octobre, qui prépare l’entretien du 26 octobre avec M. Garnier, ne fait pas état des accusations portées contre le ministre. « Alors qu’il exerçait des fonctions de vérificateur à la DIRCOFI [direction de contrôle fiscale] Sud-Ouest, M. Rémy Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire dans un contexte conflictuel qu’il entretenait depuis des années avec sa hiérarchie, à la suite d’une vérification de la société France Prune. […] Il avait notamment accumulé les dérapages verbaux et les attaques de plus en plus virulentes contre sa hiérarchie immédiate, et supérieure, mettant systématiquement en cause dans des notes et pamphlets insultants l’action de son administration qu’il accusait d’être de connivence avec les fraudeurs, et adressant aux agents extérieurs au service des courriels dans lesquels ils détaillaient les péripéties et les suites de vérification fiscale qu’il avait menées. » Il n’est nulle part fait mention des graves accusations de M. Garnier contre M. Cahuzac, alors qu’on évoque le contentieux devant le tribunal administratif.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous apprenons par le biais de votre audition, madame, que le cabinet de Jérôme Cahuzac prend connaissance du mémoire de M. Garnier lorsque, « par voie interne », la directrice de cabinet l’obtient le 5 décembre.
Mme Marie-Hélène Valente. J’ai prêté serment et je l’atteste sur l’honneur.
M. le président Charles de Courson. C’était le 4, puisque le 3 Mediapart avait informé le cabinet de la parution de l’article.
Mme Cécile Untermaier. Dans les dernières lignes de votre message à M. Cahuzac, vouliez-vous laisser entendre que vous étiez persuadée que la source de Mediapart était M. Gonelle ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non, j’étais persuadée qu’il était l’auteur de l’enregistrement. Je pensais aux suites judiciaires que l’affaire ne manquerait pas d’avoir, et particulièrement à la plainte pour diffamation du ministre.
Mme Cécile Untermaier. Avez-vous aidé le ministre à remplir le formulaire 754, même s’il n’a jamais signé cette déclaration ?
Mme Marie-Hélène Valente. Non seulement il ne m’en a pas parlé, mais je ne savais pas qu’il existait. J’ai appris qu’il ne l’avait pas rempli en écoutant les premières auditions. Je n’ai vu, je le répète, que les questions posées par les services fiscaux et les réponses qu’il fallait y apporter, consignées sur papier libre.
M. le président Charles de Courson. Il y a eu une réunion entre l’expert-comptable de M. et Mme Cahuzac et les services fiscaux. Vous avez réuni les pièces pour répondre aux cinq questions que vous avez vues sur un papier.
Mme Marie-Hélène Valente. Je m’apprêtais à aider à les réunir, notamment en contactant l’expert-comptable, quand il a été décidé que nous n’interviendrions pas, et que ce seraient MM. Bonnal et Gardette, et les services locaux, qui seraient les interlocuteurs. Je n’ai donc pas participé à la réunion en question, même si j’ai appris qu’elle s’était tenue.
Mme Cécile Untermaier. Étiez-vous en relation régulière avec le cabinet de M. Moscovici ? Et avez-vous parlé de cette affaire ?
Mme Marie-Hélène Valente. Étant un ministère délégué, nous étions évidemment en relation avec le cabinet du ministère de l’économie. Nous avons une réunion de cabinet commune. Mais nous n’avons absolument pas parlé de l’affaire. J’aimerais vous faire comprendre que le sujet n’était pas abordé. Par respect pour le ministre, par conviction, personne ne se serait permis d’en parler.
M. Jean-Pierre Gorges. Quel jour exactement avez-vous vu la lettre de M. Garnier ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je crois, sans en être tout à fait certaine, que c’était le 4 au soir. Ou, au plus tard, le 5 décembre au matin.
M. Jean-Pierre Gorges. M. Cahuzac avait-il connaissance de cette lettre ?
Mme Marie-Hélène Valente. Il n’en a pris connaissance que lorsque nous l’avons eue en main.
M. le président Charles de Courson. Vous a-t-il dit qu’il ne la connaissait pas ?
Mme Marie-Hélène Valente. Oui. Comprenez bien que Rémy Garnier n’était pas crédible aux yeux de l’administration fiscale. Je suis convaincue que personne n’a tenu compte de son courrier.
M. Jean-Pierre Gorges. La directrice de cabinet essaie-t-elle d’établir un lien entre ce document et l’information de Mediapart ? D’ailleurs, la question de savoir qui a donné l’information à Mediapart n’a toujours pas de réponse.
Quand, en octobre 2012, M. Cahuzac rencontre M. Garnier, auteur du mémoire de juin 2008, il ignore donc l’existence d’une lettre vieille de plus de quatre ans ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous parlons bien du mémoire en défense adressé par M. Garnier à l’administration, et qui comporte des allégations à l’encontre de M. Cahuzac. Mme Valente nous a dit en avoir pris connaissance le 4 décembre. Quant aux notes rédigées par M. Bézard, en vue de l’entretien avec M. Garnier en circonscription, elles ne l’évoquent pas.
Mme Marie-Hélène Valente. Mon intime conviction est que le ministre n’en avait pas connaissance. D’après ce que je sais, il considérait M. Garnier comme un honnête homme, qui se laissait aller parfois à des outrances verbales, mais qui avait sûrement été un vérificateur de qualité. Sans doute déçu par les positions de son administration, il avait franchi la ligne jaune.
M. Jean-Pierre Gorges. Vous avez rencontré M. Cahuzac avant sa rencontre avec M. Garnier, et partant sa réunion publique. Comment était-il après ? Avait-il l’air d’avoir été l’objet d’un chantage, ou de menaces ? Était-il serein ?
Mme Marie-Hélène Valente. Le ministre est allé à Villeneuve où il avait plusieurs audiences. Il nous a rejoints à dix-sept heures à l’Agropole à Agen et il était parfaitement serein. Et le soir, il a tenu sa réunion à Casseneuil, devant 600 personnes, où il s’est montré exceptionnel. Je ne lui ai parlé de l’entretien avec Rémy Garnier que plus tard, et nous n’avons échangé sur le sujet que quelques mots, dont je vous expliqué la teneur.
M. Jean-Pierre Gorges. Quand avez-vous appris que Jérôme Cahuzac avait un compte à l’étranger ?
Mme Marie-Hélène Valente. Le 2 avril, dans l’après-midi, par l’appel du sous-préfet de Villeneuve et j’ai pensé, alors que j’ai toute confiance en lui, qu’il avait mal compris. Et, toute la nuit, j’ai écouté l’information en boucle pour m’en persuader. J’ai été frappée d’hébétude et de sidération.
M. le président Charles de Courson. Vous n’aviez jamais eu de doute jusque-là ?
Mme Marie-Hélène Valente. Jamais. Je connaissais les acteurs locaux, j’avais lu le rapport qui se référait à des « ouï-dires » … Le 5 décembre au matin, Jérôme Cahuzac nous avait reçues, la directrice de cabinet et moi, et je vous assure qu’on ne pouvait pas ne pas croire ce qu’il nous disait. J’ai même l’impression, monsieur le président, qu’il y croyait lui aussi. Nous sommes restés tous les trois une dizaine de minutes et il a été plus que convaincant. Ne pas le croire aurait été faire preuve de déloyauté à son égard. Le même jour, en suivant la Chaîne parlementaire, je l’ai entendu à l’Assemblée. Or je connais le lien très fort qu’il avait avec elle puisque c’était là qu’il avait fait ses premières armes et qu’il s’était révélé. Avoir des doutes était proprement impensable.
Mme Marie-Christine Dalloz. La note, qui avait été préparée à l’intention du ministre avant sa rencontre avec M. Garnier, en octobre 2012, ne faisait pas état d’un conflit à propos du dossier fiscal de M. Cahuzac, mais il était question de France Prune. Or chacun sait à quel point ce dernier était investi dans ce dossier.
Mme Marie-Hélène Valente. La considération de Jérôme Cahuzac pour Rémy Garnier vient de là. Lorsqu’il a fait la vérification de France Prune, il a sûrement bien travaillé. Pour autant, un redressement se serait traduit par des suppressions d’emploi et des licenciements. Le député est donc intervenu – il n’est pas certain non plus que son action ait été déterminante – auprès de M. Sautter, ministre à l’époque, comme le font souvent les élus.
M. le président Charles de Courson. Je vous lis la note préparatoire : « M. Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire dans un contexte conflictuel qu’il entretenait depuis des années avec ses hiérarchie, à la suite d’une vérification de la société France Prune. » En nota bene, il est écrit : « À la suite de la vérification, courant 1998, de la société France Prune, M. Garnier avait notifié à l’entreprise des redressements que celle-ci avait contestés auprès de M. Sautter, alors secrétaire d’État au budget. Ce dernier, par une décision du 2 juin 1999, avait en fin de compte décidé l’abandon des redressements envisagés. »
Mme Marie-Christine Dalloz. M. Cahuzac ne pouvait ignorer ce conflit qu’il a eu avec M. Garnier au sujet de France Prune.
M. Christian Assaf. Peut-être la question vous a-t-elle déjà été posée, mais je souhaitais comprendre ce que vous entendiez par « une preuve utilisable » ?
Mme Marie-Hélène Valente. Oui, j’ai déjà répondu. Je pensais que l’information pourrait servir à une enquête judiciaire ultérieure. Il y en avait d’ailleurs déjà une de lancée parce que le ministre poursuivait Mediapart pour diffamation. C’était à titre de précaution, en quelque sorte.
M. Christian Assaf. Lorsque vous avez appris les circonstances « loufoques » qui ont permis d’avoir connaissance du message, avez-vous procédé à des vérifications ?
Mme Marie-Hélène Valente. J’ai pris pour argent comptant ce que m’a dit le directeur de cabinet.
M. le président Charles de Courson. Vous nous avez déclaré qu’il n’y avait jamais eu de rapport sur ce point.
Mme Marie-Hélène Valente. J’ignore totalement ce qui s’est passé entre la direction départementale de la sécurité publique, ou le préfet, et le ministère de l’intérieur.
M. Christian Assaf. Je pensais que vous auriez pu vous faire confirmer la version selon laquelle la défaillance de la batterie du téléphone de M. Gonelle l’aurait poussé à demander le sien à un officier de police, surtout pour rappeler un journaliste.
Mme Marie-Hélène Valente. Je n’ai pas fait de recoupements et je pense que M. Gonelle a raconté les choses exactement comme elles se sont passées.
M. Gérald Darmanin. Sud Ouest, dans son édition du 29 mars 2013, révèle qu’après avoir quitté le cabinet de M. Cahuzac, vous seriez nommée chef de cabinet de Mme Taubira, la garde des Sceaux. Confirmez-vous que M. Cahuzac l’a appelée pour vous recommander, vu vos états de service ?
Mme Marie-Hélène Valente. Je vous réponds volontiers, même si c’est une histoire douloureuse. Comme je suis la seule en cause, je suis libre de vous en faire part. Après la démission du ministre, un autre est nommé, qui arrive avec son propre chef de cabinet. Je suis donc reversée dans mon corps d’origine. Or, il se trouve que le poste de chef de Mme Taubira est libre. Celle-ci ayant demandé au ministère de l’intérieur de lui proposer un sous-préfet, il a donc spontanément proposé ma candidature, sans doute avec l’accord de Matignon et de l’Élysée.
Je me suis présentée le lundi suivant le 19 mars à Mme Taubira. Elle a trouvé que j’avais le profil qui convenait et a souhaité que je prenne la succession de Jean-Louis Géraud, officiellement en congé jusqu’au 2 avril. Les choses n’ont donc pas été formalisées. Et, deux jours plus tard, la directrice de cabinet prenait ses fonctions et elle s’est interrogée sur la compatibilité de ces deux postes successifs, compte tenu de l’affaire. Nous étions alors avant les aveux. Après mûre réflexion, tout le monde a pensé, et moi la première, que pour la sérénité du cabinet de la ministre de la justice, il valait sans mieux recruter un chef de cabinet qui fût neutre. Mais nos relations sont restées intactes puisque, ce matin, dans le train, j’ai reçu de beaucoup de membres du cabinet de Mme Taubira des félicitations. Je suis restée pratiquement une semaine place Vendôme.
Non seulement Jérôme Cahuzac n’est pas intervenu auprès de Mme Taubira, mais c’est moi-même qui, après que mon affectation avait reçu l’accord de Mme Taubira, aie envoyé un SMS à Jérôme Cahuzac pour le lui faire savoir. Il m’a répondu qu’il en était heureux pour moi et qu’il m’en félicitait.
M. le président Charles de Courson. Madame, il ne me reste plus qu’à vous remercier.
Audition du mardi 11 juin 2013
À 8 heures 45 : Mme Christine Dufau, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF), et M. Éric Arella, contrôleur général de police à la sous-direction de la police technique et scientifique (SDPTS).
M. le président Charles de Courson. Nous accueillons Mme Christine Dufau, chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales, et M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique et scientifique. Mme Dufau est responsable du service auquel ont été confiées les investigations sur la détention d’un compte à l’étranger par M. Cahuzac depuis l’ouverture, par le parquet de Paris, le 8 janvier 2013, d’une enquête préliminaire sur celui qui était alors ministre délégué chargé du budget pour « blanchiment de fraude fiscale ». M. Arella est à la tête du service de la police technique et scientifique, installé à Écully, qui a été chargé d’expertiser l’enregistrement de 2000 dans lequel Jérôme Cahuzac mentionnait l’existence d’un compte en Suisse.
Nous attendons de vous que vous nous expliquiez le rôle que vous-même ou votre service a joué dans l’enquête, depuis le début de l’enquête préliminaire et jusqu’à ce que Jérôme Cahuzac reconnaisse la détention de comptes à l’étranger.
Mme Christine Dufau et M. Éric Arella prêtent serment successivement.
Mme Christine Dufau, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF). Mesdames, messieurs les députés, après avoir brièvement présenté la division dont j’ai la responsabilité, je rappellerai les principales étapes chronologiques de la procédure visée par votre commission d’enquête. Je précise qu’il me sera impossible d’entrer dans le détail des actes effectués dans le cadre de cette enquête, en raison du secret de l’instruction auquel je suis tenue.
Le 8 janvier 2013, le procureur de la République de Paris a annoncé la saisine de la division nationale d’investigations financières et fiscales pour enquêter sur des faits de blanchiment de fraude fiscale susceptibles de mettre en cause M. Jérôme Cahuzac. La DNIFF, dont j’ai la responsabilité, est un des services centraux à la Direction centrale de la police judiciaire, qui est spécialisé dans la délinquance financière et prend en charge des enquêtes sensibles et complexes. Elle est composée de plusieurs brigades : la brigade centrale de lutte contre la corruption, composée de policiers et de gendarmes, qui est principalement chargée des atteintes à la probité – corruption, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence ; la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, composée de policiers et d’agents de la Direction générale des finances publiques ayant acquis la qualification d’officiers fiscaux judiciaires les habilitant à faire de la procédure pénale, qui est principalement chargée de lutter contre la fraude fiscale complexe ; la brigade de répression de la délinquance financière, qui est chargée de la lutte contre les infractions au droit des affaires – principalement abus de biens sociaux, problèmes de financement de parti politique, faux, délits boursiers. C’est à un groupe de cette brigade que j’ai confié l’enquête qui était susceptible de mettre en cause M. Cahuzac.
Je précise que je n’ai pas confié le dossier à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, parce que celle-ci ne peut être saisie que sur plainte pour fraude fiscale déposée par la Direction générale des finances publiques devant les magistrats du parquet. En l’espèce, il s’agissait de blanchiment de fraude fiscale, pas d’une plainte émanant de la DGFiP. Quoi qu’il en soit, tous les officiers de police judiciaire de la division, dans quelque brigade qu’ils soient affectés, ont à traiter des enquêtes sensibles et techniques. Cela ne posait donc aucune difficulté.
Dans les domaines que je viens d’évoquer, la division, qui a une compétence nationale, est chargée de dossiers particuliers qui soit présentent un caractère de sensibilité, des enjeux significatifs ou un caractère international important, soit sollicitent une charge d’enquête très lourde. Comme pour tous les dossiers confiés à la division, j’ai supervisé les investigations en liaison avec les magistrats du parquet de Paris. Tous les actes d’enquête – auditions, perquisitions, exploitations techniques, par exemple, de supports informatiques – se sont déroulés jusqu’au 18 mars 2013, date à laquelle M. le procureur de la République de Paris nous a demandé de mettre fin à l’enquête préliminaire. J’ai été en contact très régulier avec les magistrats du parquet de Paris avec lesquels nous faisions des points quasi quotidiens sur les investigations que nous menions.
Le 19 mars 2013, M. le procureur de la République de Paris a annoncé, dans un communiqué de presse, l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale, perception par un membre de profession médicale ou une autorité sanitaire d’avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, blanchiment de fonds et recel. Deux juges d’instruction ont été désignés, M. Roger Le Loire, vice-président en charge de l’instruction, et M. Renaud Van Ruymbeke, premier juge chargé de l’instruction. Ils nous ont délivré une commission rogatoire le 21 mars 2013, date depuis laquelle nous poursuivons les actes d’enquête dans ce cadre.
M. Éric Arella, contrôleur général de police à la sous-direction de la police technique et scientifique. La sous-direction de la police technique et scientifique est l’une des quatre sous-directions de la Direction centrale de la police judiciaire. Notre mission consistant spécifiquement à apporter une aide à l’enquête grâce à des moyens techniques, la DNIFF nous a sollicités pour procéder à deux actes de cette nature. Dans un premier temps, il s’agissait de retranscrire la conversation contenue sur le minidisque placé sous scellés et à nettoyer le contenu de cette cassette. Dans un deuxième temps, nous avons eu à procéder à une comparaison de voix entre le contenu de la cassette et des échantillons de voix désignés de M. Jérôme Cahuzac. La mission nous a été attribuée à la fin du mois de janvier. Je l’ai confiée à deux techniciens du Laboratoire d’analyse et de traitement de signal (LATS) du Service central de l’informatique et des traces technologiques (SCITT), qui est l’un des services centraux de la SDPTS et qui a l’habitude de procéder à ce genre d’analyse, pour mettre en œuvre deux méthodes de comparaison de voix.
La mission devait être exécutée assez rapidement. D’emblée, nous avons estimé le temps nécessaire à la finalisation des deux analyses à un mois et demi. Par convention, chaque expert procédait à son analyse de son côté, chacun selon sa méthode, un bilan des deux expertises étant dressé dans un rapport final. Ce rapport a été remis à la DNIFF le 18 mars.
M. Alain Claeys, rapporteur. Madame Dufau, c’est le 8 janvier que le parquet ouvre une enquête préliminaire et qu’il confie ce dossier à la DNIFF. Vous avez parlé à plusieurs reprises d’enquêtes sensibles. Est-ce la complexité de l’affaire qui a justifié qu’elle soit confiée à votre service ou la mise en cause d’un ministre a-t-elle pu jouer un rôle dans ce choix ?
Mme Christine Dufau. M. le procureur de la République de Paris serait le plus à même de répondre. Avec d’autres collègues de la préfecture de police de Paris, nous sommes, dans notre service, organisés et formés pour traiter des dossiers complexes ou sensibles. Dans ce dossier précis, la sensibilité est liée à la personnalité de M. Cahuzac. Il me semble tout à fait logique que le procureur de la République de Paris saisisse un des services formé et habitué à traiter des dossiers dans lesquels des personnalités sont mises en cause. La procédure suivie est habituelle, mais elle est entourée de certaines précautions dès lors qu’un ministre en exercice est impliqué.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelles sont ces précautions ?
Mme Christine Dufau. Nos enquêteurs agissent avec beaucoup de professionnalisme et en toute discrétion, de manière à éviter la divulgation des actes auxquels nous procédons. Pour notre part, nous nous attachons à monter la procédure logiquement, en recueillant des témoignages aussi précis que possible. La procédure pénale est une procédure écrite. C’est sur la base des procès-verbaux que nous aurons recueillis ou des constatations que nous serons parvenus à faire que le procureur de la République décidera au final si, oui ou non, une infraction est constituée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans le même temps, l’administration fiscale effectue une demande d’échange d’informations auprès de la Suisse. Trouvez-vous cette démarche normale alors que l’enquête préliminaire est ouverte ?
Mme Christine Dufau. Je n’ai pas à trouver cela normal ou pas normal. L’administration fiscale a répondu à toutes les demandes que nous lui avons adressées et a, de son côté, mené un certain nombre d’investigations. Elle m’a adressé sa demande aux autorités suisses et la réponse de celles-ci ; je les ai mises en procédure en avisant immédiatement le procureur de la République de Paris. Dans le cadre de l’enquête administrative qu’elle conduit, l’administration fiscale agit en toute responsabilité.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez que la réponse apportée, le 31 janvier, par les autorités suisses à l’administration française vous a été transmise immédiatement par Alexandre Gardette, le chef du service du contrôle fiscal.
Mme Christine Dufau. Oui. Il m’a envoyé la réponse quand il l’a eue. Je l’ai mise en procédure en avisant les magistrats du parquet, comme on le fait de tout renseignement obtenu dans le cadre d’une enquête. Ce n’est pas à moi de juger si l’administration fiscale était en droit ou pas de faire sa demande. Elle me l’a transmise ; je l’ai mise en procédure. C’est un renseignement comme un autre et ce n’est pas à moi de juger si je le mets ou pas en procédure.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans le cadre du travail de votre service, avez-vous connaissance de cas de réponse négative de la Suisse à une demande d’entraide fiscale contredite par la suite de vos investigations mettant en évidence l’existence d’un compte caché dans ce pays ?
Mme Christine Dufau. Non.
M. le président Charles de Courson et M. Alain Claeys, rapporteur. Aucun cas ?
Mme Christine Dufau. Non. Cela dit, je n’ai pas forcément connaissance du traitement administratif des dossiers par l’administration fiscale pendant une enquête pénale ou à la suite de celle-ci.
M. Alain Claeys, rapporteur. Sur un dossier de ce type, est-il de tradition que l’administration fiscale vous transmette toute information dont elle dispose ?
Mme Christine Dufau. Normalement oui, mais beaucoup de dossiers sur lesquels nous enquêtons vont avoir des incidences fiscales, et il reviendra à l’administration fiscale de traiter le volet fraude fiscale sans que nous en soyons forcément informés. Je n’ai pas connaissance de dossiers où la Suisse avait donné une réponse négative alors qu’il y avait un compte, mais peut-être y en a-t-il eu.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon Mediapart, une demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses le 12 mars dans le cadre de l’enquête préliminaire. Confirmez-vous cette date ?
Mme Christine Dufau. Je savais qu’il y aurait une demande d’entraide et je savais qu’elle avait été envoyée, mais je ne peux pas donner la date exacte à laquelle elle a été transmise aux autorités suisses. Mieux vaut le demander au procureur de la République de Paris.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous su la réponse ?
Mme Christine Dufau. J’ai su la réponse mais je ne peux pas vous en donner le contenu.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous au moins donner la date à laquelle vous avez été informée ?
Mme Christine Dufau. Pas la date exacte. C’était après l’ouverture de l’information judiciaire, soit après le 19 mars.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Arella, à quelle date votre sous-direction a-t-elle été chargée d’expertiser l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires ?
M. Éric Arella. Nous avons reçu deux réquisitions, la première concernant principalement la retranscription du contenu du minidisque, la seconde, datant du 25 janvier 2013, visant à procéder à une comparaison de voix.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quelle date avez-vous eu le support à votre disposition ?
M. Éric Arella. Les échanges entre le service enquêteur, la DNIFF, et les experts du SCITT de la SDPTS se sont noués dans les jours qui ont suivi la première réquisition, avec la remise du document.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’enregistrement avait-il pour support un minidisque ?
M. Éric Arella. Tout à fait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le récit fait par Michel Gonelle des conditions dans lesquelles il aurait été réalisé vous semble-t-il plausible ?
M. Éric Arella. Je suis désolé, je ne connais pas ce monsieur.
Mme Christine Dufau. Quand nous avons requis les collègues de la SDPTS, nous leur avons uniquement donné le support sans expliquer dans quelles conditions M. Gonelle avait fait l’enregistrement. Nous leur avons demandé si le support avait été modifié ou pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans le cadre de cette expertise, avez-vous pu dater l’enregistrement ou son transfert sur son support actuel ?
M. Éric Arella. Je n’avais pas compris le nom de M. Gonelle, que, bien sûr, j’ai lu dans les médias mais que la SDPTS n’a pas eu à connaître.
Pour répondre à votre question, nous n’avons pas pu dater l’enregistrement ou son transfert.
M. Alain Claeys, rapporteur. Outre les personnes chargées de l’enquête, qui avez-vous informé des résultats de cette expertise ?
M. Éric Arella. Seule la DNIFF a été informée in fine du résultat de l’expertise.
M. Alain Claeys, rapporteur. En dehors de votre direction, personne ne vous a interrogé sur ce dossier ?
M. Éric Arella. Nous n’avons reçu aucune sollicitation de quiconque.
M. Alain Claeys, rapporteur. Confirmez-vous que votre étude sur cet enregistrement a duré un mois et demi ?
M. Éric Arella. Effectivement, il a fallu un mois et demi pour finaliser les deux méthodes de comparaison que nous avons voulu associer pour le traitement de cette expertise. C’est même un temps rapide par rapport à certains dossiers que nous avons pu traiter.
M. le président Charles de Courson. Madame Dufau, je reviens sur le moment du déclenchement de l’enquête préliminaire. Alors que vous êtes spécialisés dans la lutte contre la fraude financière et fiscale, c’était un blanchiment qui était envisagé, avez-vous dit. Cela signifie-t-il que votre saisine n’était pas évidente ou n’ai-je pas bien compris ?
Mme Christine Dufau. Notre saisine en blanchiment de fraude fiscale est tout à fait logique ; nous avons d’autres dossiers de ce type. Mon propos était d’expliquer que la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale n’avait pas été saisie, car elle ne peut l’être que sur plainte de l’administration fiscale pour fraude fiscale. La DGFiP n’ayant pas déposé plainte, cette brigade ne pouvait pas enquêter.
M. le président Charles de Courson. Vous êtes-vous étonnée de ne pas être saisie par la Direction générale des finances publiques ?
Mme Christine Dufau. Pour qu’elle dépose plainte, il aurait fallu qu’elle ait des présomptions. Les magistrats du parquet nous saisissent de dossiers en blanchiment de fraude fiscale alors qu’il n’y a pas de plainte de la Direction générale des finances publiques qui, parfois, se joint au dossier après. Ce n’est pas une anomalie, nous avons d’autres dossiers qui nous arrivent de la même façon.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Arella, M. Gonelle nous a expliqué qu’il avait eu deux messages sur son portable : celui de Jérôme Cahuzac relatif à l’inauguration du nouveau commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot, puis une conversation. La commission s’est demandé pourquoi il n’avait pas gardé l’enregistrement total. Vos analyses n’ont bien porté que sur la deuxième partie, la première n’a pas été conservée ?
Mme Christine Dufau. En fait, M. Gonelle n’a fait enregistrer que la partie qui est sur le minidisque. Le premier appel est resté dans son téléphone qui a disparu.
M. le président Charles de Courson. Moi-même, j’ai compris qu’il n’avait pas pu le prendre au téléphone et qu’il avait trouvé un message.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et moi, qu’il l’avait eu et qu’après avoir fermé son téléphone, il le rappelle par inadvertance.
M. le président Charles de Courson. Comme nous avons décidé de l’auditionner à nouveau, nous éclaircirons ce point. Précisément, quand vous examinez l’enregistrement, êtes-vous techniquement capables de déceler que quelque chose a été coupé avant ?
M. Éric Arella. C’est l’un des objets de l’expertise, qui conclut de manière presque catégorique qu’il n’y a pas eu de manipulation sur le support audio qui a été mis à notre disposition.
M. le président Charles de Courson. Là, ce n’est pas un problème de manipulation. Avez-vous pu voir, dans ce qui vous a été donné, qu’il y avait, avant cette conversation, un message qui a été coupé ?
M. Éric Arella. Je ne sais pas.
M. Christian Assaf. Comme le président, j’ai eu le sentiment, qu’il manquait à ce message un début et une fin, qu’il était partiel. Non pas qu’il y ait eu manipulation, mais qu’il s’agissait de l’enregistrement d’un bout de conversation, pas de l’intégralité.
M. Éric Arella. C’est effectivement possible, mais ce n’est pas certain non plus.
M. Patrick Devedjian. Monsieur Arella, vous avez été nécessairement informé des conditions dans lesquelles l’enregistrement a été opéré, de manière réelle ou prétendue. On ne vous a pas donné le document sans vous dire quelle était son origine expliquée par celui qui l’a recueilli. Ces explications vous paraissent-elles crédibles techniquement ?
M. Éric Arella. Des éléments de contexte ont effectivement été communiqués aux deux experts qui ont été missionnés pour comprendre l’origine. Il était notamment absolument nécessaire de connaître la période à laquelle ce support avait pu être enregistré. Pour l’instant, rien ne nous permet de douter des éléments qui nous ont été fournis.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans le compte rendu de l’audition de Michel Gonelle, il a bien reçu deux messages : « J’ai en effet reçu deux messages sur ma boîte vocale fermée. Lors du premier appel, composé avec un numéro que j’ai reconnu être celui de Jérôme Cahuzac, ce dernier m’annonçait que Daniel Vaillant avait accepté de venir à Villeneuve-sur-Lot pour inaugurer le nouveau commissariat de police, et demandait à me rencontrer pour mettre au point les détails de la réception. […] Après ce premier message, dans lequel il me demandait de le rappeler, venait un autre message […] ».
M. le président Charles de Courson. C’est en effet ce que j’avais compris. L’expertise n’a pas pu déceler qu’il y avait eu un message avant. La cassette ne contenait que la partie de la conversation qui s’était retrouvée sur le portable.
M. Éric Arella. On ne peut pas être précis là-dessus. Effectivement, à la lecture on pourrait dire qu’il s’agit d’une suite de deux enregistrements ou d’un enregistrement dédoublé.
M. le président Charles de Courson. M. Gonelle nous a dit être sûr d’avoir reconnu M. Cahuzac comme l’un des protagonistes de cette conversation parce que le même numéro s’était affiché. Techniquement, pouviez-vous, à partir de la cassette, identifier le numéro de portable duquel provenait le message ?
M. Éric Arella. La recherche de numéro de téléphone ne faisait pas partie de nos missions, qui consistaient, je le rappelle, à améliorer le son du support, à retranscrire la conversation et à procéder à une comparaison de voix. Je ne peux donc répondre à cette question.
Mme Christine Dufau. C’est M. Gonelle qui a fait l’enregistrement du minidisque qui nous a été remis. Nous n’avons pas le téléphone qui a reçu le message, à partir duquel l’enregistrement a été fait. Il est matériellement impossible de connaître le numéro d’appel.
M. Patrick Devedjian. L’enregistrement n’est pas manipulé, vous êtes catégorique ?
M. Éric Arella. C’est effectivement un des éléments de conclusion de notre expertise qui prétend, sans l’exclure totalement, que probablement le support à notre disposition n’a pas fait l’objet de manipulation.
M. le président Charles de Courson. À votre connaissance, une fois vos conclusions rendues, le ministre dont vous dépendez en est-il informé ?
Mme Christine Dufau. Quand j’ai eu le rapport de la sous-direction, j’en ai informé le magistrat du parquet de Paris qui était mon correspondant ainsi que ma hiérarchie.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire qui ?
Mme Christine Dufau. Mon sous-directeur, M. Bernard Petit, contrôleur général, dont je dépends directement. Nous avons rendu la procédure le 18 mars et le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire le 19 mars.
M. le président Charles de Courson. Votre supérieur hiérarchique ne vous a pas dit ce qu’il en a fait ?
Mme Christine Dufau. Non.
Mme Cécile Untermaier. Sur l’enquête préliminaire du 8 janvier, à qui rendez-vous compte régulièrement de l’avancée de l’enquête ?
Mme Christine Dufau. Je ne rends pas compte directement au procureur de la République mais à un des vice-procureurs en charge de la section qui nous a confié matériellement le dossier. Ce sont des échanges réguliers, quotidiens. Du côté de la hiérarchie policière, je rends compte à mon sous-directeur, non pas des détails, mais des actes principaux.
Mme Cécile Untermaier. Dans les enquêtes préliminaires de cette nature, pensez-vous possible que des informations transitent entre le cabinet du ministre et les services chargés de l’enquête ?
Mme Christine Dufau. Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je rends compte à mon supérieur qui lui-même rend compte, je le suppose, au directeur central de la police judiciaire, dont il paraît normal, en qualité de responsable de l’activité des services de police judiciaire, qu’il sache ce que font les services placés sous son autorité. À qui lui-même rend-il compte, je n’en sais rien.
Mme Cécile Untermaier. Monsieur Arella, vous avez été chargé, le 25 janvier, de l’analyse des voix. Comment expliquez-vous le délai entre le déclenchement de l’enquête préliminaire, le 8 janvier, et cette commande passée le 25 ?
M. Éric Arella. En matière d’expertise, ce temps d’enquête est rapide. Au cours de l’expertise, les deux experts ont été gênés par la difficulté de trouver un support de voix de M. Cahuzac le plus proche possible de la date supposée d’origine du document que nous avions sur le minidisque. C’est ainsi qu’il a été nécessaire de procéder à une réquisition ultérieure à l’Institut national de l’audiovisuel pour trouver un document vocal daté des environs de 2000. Nous avons retrouvé un enregistrement de 2002 d’une émission de LCI. Cette réquisition a été faite par la DNIFF à l’INA le 21 février ; nous avons reçu l’échantillon de 2002 le 4 mars. Celui-ci a permis de valoriser notre temps d’expertise et de le rendre plus rapide que la moyenne.
Mme Cécile Untermaier. Je ne visais pas le délai de l’expertise mais la date de commencement de l’expertise. L’enquête préliminaire est ouverte le 8 janvier mais vous n’attaquez l’identification que le 25 janvier.
Mme Christine Dufau. Le 8 janvier, nous ne disposions pas du support. Nous avons suivi une démarche normale en entendant des gens, en recueillant des pièces et nous avons eu des discussions pour savoir si l’expertise était faisable ou pas.
Mme Cécile Untermaier. À quel moment l’avez-vous eu ?
Mme Christine Dufau. M. Gonelle nous l’a remis dans le courant du mois de janvier, mais je ne saurais dire la date exacte.
M. le président Charles de Courson. M. Gonelle a remis aux policiers de la DNIFF une copie de l’enregistrement téléphonique le 16 janvier, et il a été auditionné, à cette occasion, pendant plusieurs heures.
M. Christian Assaf. Au cours des semaines d’instruction, avez-vous la conviction qu’il s’agit bien de Jérôme Cahuzac avant d’avoir procédé à une vérification complète ? Si oui, faites-vous un rapport intermédiaire à votre hiérarchie ?
M. Gonelle nous a dit qu’il est allé voir un technicien, dont il n’a pas voulu révéler le nom, qui s’est occupé de cet enregistrement. Est-ce une société qui a pignon sur rue ? Avez-vous pu rencontrer la personne qui a fait cet enregistrement ? Nous nous interrogeons sur la possibilité de fuites, essayant de savoir à quelle étape cette fuite a pu se produire. L’entreprise qui a procédé au transfert de l’enregistrement vous paraît-elle digne de confiance ? La connaissiez-vous ? Est-elle agréée ?
M. Éric Arella. Il n’y a eu aucun rapport intermédiaire entre le service d’expertise et le service d’enquête ou qui que ce soit. Il y a simplement eu un échange verbal au moment où le besoin s’est fait sentir de se procurer un échantillon de voix de M. Cahuzac plus proche de l’année 2000. C’est quasiment le seul échange qui a eu lieu. Aucun rapport intermédiaire faisant état d’une orientation de l’enquête dans un sens ou un autre n’a été produit.
M. Christian Assaf. À ce moment-là, votre idée est faite. Dites-vous à votre interlocuteur qu’il vous semble qu’il s’agit bien de Jérôme Cahuzac mais qu’il vous faut un enregistrement plus proche en date ? Si oui, à qui le demandez-vous et à quelle date ?
M. Éric Arella. Très franchement, aucun sentiment n’a été exprimé à aucun moment hormis le besoin de supports supplémentaires pour avoir les meilleurs éléments et fournir l’expertise la plus aboutie possible.
Mme Christine Dufau. La société qui a transféré l’enregistrement a été entendue dans le cadre de l’enquête, mais je ne peux pas vous communiquer ce qu’elle a dit.
M. le président Charles de Courson. Vous avez donc retrouvé l’entreprise qui a transféré l’enregistrement de la cassette vers le disque. L’opération est-elle compliquée techniquement ?
Mme Christine Dufau. La société a fait l’enregistrement à partir du téléphone.
M. le président Charles de Courson. Madame Dufau, vous dites avoir informé votre sous-directeur, M. Bernard Petit, le 18 mars. S’agit-il du sous-directeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, qui lui-même dépend du directeur central de la police judiciaire ?
Mme Christine Dufau. C’est cela.
M. Étienne Blanc. La saisine de vos services peut avoir deux origines : le parquet ou la DGFiP. Je n’ai pas bien compris.
Mme Christine Dufau. Nous sommes toujours saisis par des magistrats, soit des procureurs, soit des juges d’instruction. En matière de fraude fiscale, la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, qui a été créée en 2010, ne peut être saisie par des magistrats que si eux-mêmes ont été destinataires d’une plainte de la Direction générale des finances publiques sur des présomptions de fraude fiscale. La DGFiP ne nous saisit pas directement, elle dépose plainte auprès des magistrats du parquet, qui nous saisissent.
M. le président Charles de Courson. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, nous avons éclairci ce point tout à l’heure.
Une question de technique pour M. Arella. Êtes-vous les seuls, en France, à avoir la capacité d’examiner le contenu d’un message enregistré, à identifier des voix ?
M. Éric Arella. Au sein de la police nationale, pour ne parler que des services publics, je pense que nous sommes les seuls à disposer d’experts suffisamment pointus pour procéder à ce type de comparaison de voix. Il en existe aussi dans la gendarmerie nationale.
M. le président Charles de Courson. Connaissez-vous des sociétés privées qui fassent ce genre de travaux ?
M. Éric Arella. Je n’ai pas souvenir que les magistrats saisissent un laboratoire privé, comme cela peut se faire en matière génétique, par exemple. En matière de comparaison de voix, en général, c’est le SCITT de la SDPTS qui est principalement saisi. Je n’ai pas l’impression qu’il existe un laboratoire privé véritablement reconnu.
M. le président Charles de Courson. Les deux journalistes de Mediapart que nous avons auditionnés nous ont dit qu’eux-mêmes avaient fait faire une comparaison par un organisme privé dont ils ne nous ont pas donné le nom. D’où notre question sur l’existence de sociétés compétentes en matière de reconnaissance vocale.
M. Éric Arella. Ce n’est pas impossible, mais personne dans le privé ne me paraît avoir de notoriété sur ce point. Que je sache, aucun laboratoire privé n’est saisi de ce type d’analyse, comme cela peut être fréquemment le cas dans le domaine génétique.
M. le président Charles de Courson. Vos conclusions font-elles état d’un taux de probabilité que l’enregistrement est celui de la voix de M. Untel ou Mme Unetelle ?
M. Éric Arella. Oui. Les deux types d’analyse effectués s’appuient sur une grille de un à sept, et la conclusion rendue établit un rapport de probabilité plus ou moins fort résultant de la comparaison entre le support initial et la voix de M. Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Madame Dufau, lorsque vous avez informé votre sous-directeur des conclusions, le 18 mars, vous avez fait état des probabilités ?
Mme Christine Dufau. Sans rentrer dans le détail de l’analyse, je lui ai donné un résumé des conclusions.
M. le président Charles de Courson. Sur cette échelle de un à sept, à partir de quel échelon considérez-vous la probabilité comme très élevée ?
M. Éric Arella. Le bas de l’échelle permet de discriminer totalement la comparaison. La voix n’est pas un élément comme l’empreinte digitale ou génétique. On ne parle pas d’empreinte vocale mais de signature vocale, ce qui permet d’avoir une probabilité de comparaison mais pas de certitude absolue. En l’occurrence, la probabilité est assez forte mais pas totale.
M. le président Charles de Courson. Madame Christine Dufau, monsieur Éric Arella, merci d’avoir répondu à notre invitation.
Audition du mercredi 12 juin 2013
À 16 heures 30 : M. François Falletti, procureur général de Paris.
M. le président Charles de Courson. Hier, notre commission d’enquête a reçu les services de police qui ont joué un rôle dans l’enquête préliminaire qui a conduit à l’ouverture de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris, le 19 mars 2013. Avec l’audition de M. François Falletti, procureur général de Paris, nous abordons le volet strictement judiciaire de l’affaire. Le procureur Molins, qui est directement en charge du dossier, sera entendu le 19 juin.
Comme vous le savez, monsieur le procureur général, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Nous souhaitons donc mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été traitée, notamment par la justice, mais sans aborder les éléments de fond de l’enquête, qui relèvent du secret de l’instruction.
Avant d’aller plus loin, il me revient de vous préciser que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. François Falletti prête serment.)
Pourriez-vous nous expliquer le rôle que vous avez joué dans le traitement judiciaire de cette affaire, depuis les premières révélations parues dans Mediapart et jusqu’à ce que Jérôme Cahuzac reconnaisse la détention d’un compte à l’étranger ?
M. François Falletti, procureur général de Paris. Être entendu par une commission d’enquête parlementaire est un exercice inhabituel pour un procureur général. Vous l’avez rappelé, monsieur le président, l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre dispose qu’une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires et il est bien précisé, dans les travaux préparatoires à la création de votre commission et dans son intitulé même, que son objet est de déterminer comment les circuits d’information et de décision ont été assurés, sans toucher au fond puisque l’affaire est concernée par le secret de l’instruction – un secret qui sera bien entendu levé si les poursuites sont portées devant un tribunal, dans le cadre d’un débat public et contradictoire.
Avant d’entrer dans le détail du cheminement de l’affaire entre décembre 2012 et avril 2013, permettez-moi de préciser certains mécanismes qui régissent les relations entre le parquet, le parquet général et le ministère de la justice.
En premier lieu, la circulaire du 19 septembre 2012 prohibe les instructions du garde des sceaux dans les affaires individuelles. Le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, en cours de navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat, reprend cette disposition.
Pour autant, le devoir d’information auquel sont soumis les magistrats du ministère public demeure très prégnant, dans le but d’éclairer les différents échelons de la hiérarchie judiciaire – singulièrement la chancellerie – sur le déroulement d’enquêtes, voire d’instructions judiciaires, présentant un caractère particulièrement significatif ou se trouvant amplement médiatisées. Il est évident que l’affaire en question est de celles-là.
L’essentiel de cette remontée d’informations se fait aujourd’hui par voie de courriel. Les échanges téléphoniques ne sont plus motivés, en général, que par la complexité de telle ou telle question ou par l’urgence. Dans le cas qui nous intéresse, l’information remonte de la division des affaires économiques et financières du parquet vers le parquet général, puis, à la Chancellerie, vers la direction des affaires criminelles et des grâces, en l’espèce vers son bureau des affaires économiques et financières. Cette information se fait de manière régulière et par la voie hiérarchique.
De par l’évolution des pratiques, le garde des sceaux n’adresse pas d’instructions et s’interdit d’émettre des avis sur le cours des procédures. Entre le parquet général et le parquet, en revanche, des échanges de cette nature ont lieu. Le procureur général conserve le pouvoir d’adresser une instruction de poursuite au procureur de la République.
En deuxième lieu, les éléments d’information qui concernent les actes ou auditions présentant un intérêt particulier dans telle affaire font l’objet de comptes rendus ou de rapports, mais les pièces de procédure ne sont pas adressées au ministère : elles demeurent au niveau juridictionnel, sauf, bien entendu, pour certaines pièces dont la transmission ne présente pas de difficulté particulière – réquisitoires définitifs, ordonnances ou arrêts juridictionnels.
Certaines mesures programmées à caractère coercitif et pour lesquelles une confidentialité particulière s’impose, comme les perquisitions, sont en principe laissées à la discrétion des autorités du parquet. Elles ne font l’objet d’une remontée qu’au moment où elles sont réalisées.
En troisième lieu, si les remontées se font bien souvent à l’initiative du parquet et du parquet général, il peut y avoir dans certains cas – dont, bien sûr, celui-ci – des demandes de précision ou d’éclaircissement, par exemple pour lever des équivoques après la diffusion d’informations par voie de presse à propos du dossier.
C’est ce schéma qui a été suivi dans l’affaire qui vous occupe et dont j’évoquerai maintenant le déroulement.
Avant la date du 4 décembre, l’affaire n’existe pas. Pour nous, le processus débute par une transmission de la direction des affaires criminelles et des grâces, le 6 décembre, deux jours après les révélations de Mediapart. Il s’agit d’une plainte pour diffamation envers un membre du Gouvernement. L’article 48 de la loi sur la liberté de la presse prévoit en effet que c’est le garde des sceaux qui dépose plainte dans un tel cas. En pratique, une analyse a été effectuée et il s’est avéré que la diffamation présumée portait non pas sur l’activité de M. Cahuzac en tant de membre du Gouvernement, mais sur des faits qui lui incombaient à titre personnel. C’est dans ce sens qu’a été orientée l’enquête, laquelle, je le rappelle, est interruptive de prescription, ce qui doit être souligné en matière de presse où le délai de prescription est très bref.
Le 20 décembre, le parquet de Paris nous a informé du dépôt d’une nouvelle plainte en diffamation, cette fois-ci par M. Cahuzac lui-même.
Une consignation a été déposée un peu plus tard. Mais, par la suite, un désistement est intervenu. Il appartient maintenant au magistrat instructeur de le constater.
M. le président Charles de Courson. À quelle date le désistement a-t-il été enregistré ?
M. François Falletti. La consignation date du 15 février. Le désistement est postérieur.
M. Jean-Marc Germain. A-t-il été effectué après le 2 avril ?
M. François Falletti. Je le pense. Je vous transmettrai la date précise car je ne l’ai pas ici.
Le 27 décembre, un signalement est effectué auprès du procureur de la République de Paris – alors en congé –, puis divulgué dans les médias. Cette information est portée officiellement à ma connaissance le 31 décembre. Le 4 janvier, après un échange avec le procureur, nous décidons du principe de l’ouverture d’une information judiciaire et nous faisons remonter cette décision en temps réel à la direction des affaires criminelles et des grâces.
Le 8 janvier, le parquet général complète cette transmission par un rapport dans lequel il formule son appréciation sur cette ouverture d’enquête. Le même jour, de façon quelque peu précipitée, un communiqué de presse est publié à ce sujet dans l’après-midi car les éléments qui commençaient à circuler dans la presse appelaient une clarification.
La direction des affaires criminelles et des grâces nous a demandé un certain nombre de précisions sur le service d’enquête saisi et sur les axes de travail. Le 9 janvier, ces axes sont précisés lors d’une réunion de travail du parquet et des enquêteurs et portés à la connaissance de la direction en question.
Du 16 janvier, date de la première audition – celle de M. Michel Gonelle –, à la mi-mars, une dizaine d’auditions sont effectuées, ainsi que des actes de saisie et quelques perquisitions. La priorité est de recueillir la pièce principale, le fameux enregistrement qui est à l’origine de toute l’affaire et que les enquêteurs prennent en charge dès le 16 janvier. Après des vérifications préalables sur sa qualité et sur les possibilités de l’exploiter, il est porté à la connaissance du parquet que l’approfondissement de l’expertise prendra un certain temps : quinze jours en utilisant certaines méthodes, un mois pour d’autres. Début février, donc, nous savons que l’enquête se prolongera jusqu’à début mars, puisqu’elle dépend en grande partie des résultats de cette expertise effectuée par le laboratoire de police d’Écully.
Les auditions des principaux protagonistes se déroulent pendant le mois de février et au début du moins de mars. L’identité des personnes entendues, communiquée je ne sais par qui, fait l’objet d’un large écho médiatique. Chaque fois qu’un acte significatif est pris, le parquet établit un compte rendu que le parquet général analyse et retransmet à la direction des affaires criminelles et des grâces. La place Vendôme est donc informée en temps réel et, parfois, elle est amenée à formuler des demandes de précision ou d’éclaircissement.
Le 1er février, nous prenons connaissance d’un courrier du ministère de l’économie et des finances. Nous faisons remonter l’information à la direction des affaires criminelles et des grâces, le courrier lui-même restant en possession des services de police de la division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF). Cette information est détaillée mais la direction des affaires criminelles et des grâces demande un approfondissement afin d’être bien certaine d’avoir tous les éléments. Elle nous demande aussi si nous détenons le courrier de saisine des autorités fiscales suisses, ce qui n’est pas le cas.
Quant aux débats ultérieurs sur le lien entre enquête fiscale et enquête pénale et sur la portée de la convention franco-suisse récemment modifiée, je ne pense pas qu’il présente un intérêt immédiat pour notre réflexion.
Au début du mois de mars, M. Plenel affirme dans un média que les résultats de l’expertise seraient arrivés et confirmeraient qu’il s’agit de la voix de M. Cahuzac. En l’état de nos informations, nous ne pouvons que démentir auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le 6 mars, pour nous, l’expertise n’est pas terminée : elle le sera plus tard.
Le 12 mars, le procureur de Paris transmet au parquet de Genève une demande d’entraide internationale afin d’éclaircir différents points. Si la démarche intervient à cette date, c’est qu’il fallait recueillir au préalable, pour qu’elle soit utile, des éléments précis.
Le 15 mars, la direction des affaires criminelles et des grâces nous demande des informations sur les effectifs consacrés à l’enquête et sur son coût. Nous apportons les réponses dans la journée : les expertises étant réalisées par un laboratoire public, le coût n’est pas significatif, et l’enquête mobilise, à temps partiel, trois enquêteurs. On nous interroge également sur l’existence d’une demande de réquisitoire supplétif formulée par un magistrat instructeur, M. Daïeff, pour étendre au dossier Cahuzac son instruction concernant le démarchage de l’UBS. Nous confirmons que le parquet a reçu cette demande – à une date plus ancienne semble-t-il – et qu’il y a répondu par la négative, considérant qu’il n’y avait pas de lien entre l’affaire de démarchage et les ouvertures de comptes effectuées dans les conditions que l’information judiciaire est en train de déterminer.
Le lundi 18 mars, le parquet de Paris nous informe que l’expertise de l’enregistrement est terminée et qu’elle démontre qu’il existe une probabilité de 2 sur une échelle de -2 à 4 que la voix enregistrée soit celle de M. Cahuzac. Cette information remonte immédiatement à la direction des affaires criminelles et des grâces. Le 19 mars, le parquet général informe cette même direction de l’ouverture d’une information judiciaire, au vu des éléments rassemblés par l’enquête. Dans son communiqué de presse, le procureur a souhaité porter à la connaissance du public de nombreux détails du résultat des investigations.
M. Alain Claeys, rapporteur. Permettez-moi de reprendre le calendrier.
Le 8 janvier 2013, le parquet de Paris décide d’ouvrir une enquête préliminaire, confiée à la division nationale des investigations financières et fiscales. Le 16 janvier, l’enregistrement est recueilli. Le 1er février, vous êtes informé de la réponse des autorités helvétiques à la demande de Bercy.
M. François Falletti. C’est aux enquêteurs de la DNIFF et non au procureur que cette réponse est remise, mais elle remonte aussitôt.
M. Alain Claeys, rapporteur. En effet : ils ont eux-mêmes reçu la réponse le 31 janvier.
M. François Falletti. Au niveau du parquet, c’est le 1er février qui compte.
M. Alain Cleys, rapporteur. L’enregistrement, quant à lui, est transmis pour examen à un bureau d’étude début février.
M. François Falletti. Il est transmis plus tôt pour un premier examen technique destiné à vérifier, par exemple, que le bruit de fond peut être supprimé. Mais je ne suis pas compétent dans ce domaine. Ce que je sais, c’est que l’on nous dit le 6 février que la méthode la plus approfondie nécessite un mois.
M. Alain Claeys, rapporteur. À la suite de quoi l’enregistrement est envoyé au laboratoire le 16 février. Le 18 mars, le rapport de la police technique et scientifique vous parvient et, le 19 mars, le parquet ouvre une information judiciaire contre X.
Je souhaite maintenant vous interroger sur vos relations avec la chancellerie. Votre interlocuteur, vous l’avez dit, est la direction des affaires criminelles et des grâces et, plus précisément, le bureau des affaires économiques et financières. Au-delà de ce contact, avez-vous parlé de cette affaire avec un membre du cabinet de la garde des sceaux, voire du cabinet de la présidence de la République ?
M. François Falletti. Je suis formel : non. À 95 %, dirais-je, les échanges ont lieu entre les services du parquet, du parquet général et du bureau des affaires économiques et financières, étant entendu que je suis systématiquement informé et que j’émets mon appréciation et mon orientation en interne. Cela dit, à des moments cruciaux comme l’ouverture de l’enquête, l’ouverture de l’information, la réception de la réponse des autorités helvétiques, j’avais un contact direct avec le procureur. J’ai pu rencontrer, car cela arrive quelquefois, la directrice des affaires criminelles et des grâces, mais c’est insignifiant ou anecdotique. Je n’ai eu aucun contact direct, s’agissant de cette affaire, avec le cabinet de la garde des sceaux ou d’autres cabinets.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les échanges, avez-vous dit, se font essentiellement par courriel. La commission d’enquête pourrait-elle y avoir accès ?
M. François Falletti. Je n’ai rien à cacher à votre commission. Néanmoins, je tiens à respecter le secret de l’instruction. Certains éléments de ces courriels sont factuels et relèvent de l’instruction en cours. Mais je peux vous remettre des indications détaillées quant à ces échanges.
M. le président Charles de Courson. Nous n’avons aucune intention d’interférer avec l’instruction. Ce qui nous intéresse, ce sont les relations avec votre hiérarchie. Si des éléments vous semblent couverts par le secret de l’instruction, libre à vous de les masquer.
M. François Falletti. Pour ne rien vous cacher, nous avons déjà commencé à travailler à un tableau synthétique – quoique relativement développé – retraçant le contenu de chaque courriel destiné à éclairer la place Vendôme sur le cours de l’enquête. Certains messages ne présentent pas de problèmes. Pour d’autres, je crains que la question du secret de l’instruction ne se pose.
M. le président Charles de Courson. Vous ferez pour le mieux. Notre objectif est de savoir la nature des informations qui sont remontées, et jusqu’à quel niveau.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 8 janvier 2013, le parquet de Paris décide l’ouverture d’une enquête préliminaire. Pourquoi avez-vous choisi cette solution plutôt que celle qui aurait consisté à élargir le champ d’investigation du juge d’instruction chargé d’enquêter sur les pratiques de la banque UBS ?
M. François Falletti. C’est une affaire de démarchage qui remonte à des années bien antérieures. En outre, il apparaît assez rapidement que la question ne concerne peut-être pas que l’UBS.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-il exact que le juge d’instruction saisi de cette affaire, M. Daïeff, a écrit au parquet de Paris pour indiquer qu’il n’était pas opposé à un réquisitoire supplétif qui lui aurait permis d’élargir son instruction au cas du ministre, comme l’affirme Mediapart le 15 mars ?
M. François Falletti. J’ai déjà évoqué ce point. La décision d’élargir ou non la saisine du juge d’instruction relève de la compétence du ministère public. En l’occurrence, je crois que le choix de centrer l’enquête sur une seule affaire a été le bon.
Trop d’affaires arrivant à la cour d’appel de Paris ont vingt ans d’âge. Éviter les dossiers tentaculaires, sérier les questions, avancer pas à pas, c’est aussi une des responsabilités du parquet. Lorsque les dossiers comportent des éléments de nature très différente, les délais s’allongent et l’on s’expose à une multiplication d’incidents de procédure sur des points particuliers qui retardent l’ensemble de l’affaire. Le parquet se doit de centraliser ce qui doit l’être, certes. Mais, en l’espèce, ce n’était pas du tout indispensable.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jugez-vous normal que l’administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d’échange d’informations auprès de la Suisse, alors que l’enquête préliminaire était en cours ?
M. François Falletti. Tout ce que je puis répondre est qu’il existe une autonomie du droit fiscal. Pour notre part, nous avons découvert la démarche le 1er février.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon Mediapart, vous transmettez une demande d’entraide judiciaire pénale aux autorités suisses le 12 mars.
M. François Falletti. C’est exact.
Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ?
M. François Falletti. Pour qu’une telle demande ne soit pas rejetée d’emblée et soit suivi d’effets, il faut des éléments précis, notamment en matière de blanchiment et s’agissant de ce qui a été un des motifs d’ouverture de l’information judiciaire, à savoir l’éventuel versement d’argent par des laboratoires pharmaceutiques. Or ces éléments sont apparus au cours de l’enquête. Il aurait été contreproductif d’adresser une demande d’entraide dès le mois de janvier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Sans lever le secret de l’instruction, pouvez-vous indiquer le contenu de la réponse des autorités suisses ?
M. François Falletti. Non, puisque l’information judiciaire a été ouverte le 19 mars et que les juges d’instruction saisis du dossier ont pris les choses en main.
M. Alain Claeys, rapporteur. La réponse n’est pas remontée ?
M. François Falletti. Les juges d’instruction ont pris le relais une semaine plus tard. D’une certaine manière, la demande d’entraide a pâti de la communication des résultats de l’expertise de l’enregistrement le 18 mars.
M. Alain Claeys, rapporteur. Donc la réponse n’est pas chez vous…
M. François Falletti. Elle est chez les juges d’instruction.
M. le président Charles de Courson. D’après votre expérience, la procédure d’entraide judiciaire franco-helvétique est-elle plus rapide et plus efficace que la procédure d’entraide entre les administrations fiscales ?
M. François Falletti. Il faut que la demande soit suffisamment détaillée. Si l’on va « à la pêche » auprès des autorités helvétiques, on s’expose à un échec. Mais si l’on parvient à démontrer des éléments suffisamment précis, la procédure en matière pénale peut être assez rapide. Notre collaboration avec les magistrats suisses est bonne. S’agissant de l’entraide fiscale, je ne veux pas sortir de ma sphère de compétence.
M. le président Charles de Courson. Dans certains dossiers, l’administration fiscale vous a peut-être transmis les réponses qu’elle avait reçues de la Suisse pour vous permettre de poursuivre au pénal. Je vous pose la question parce que l’efficacité de la convention fiscale franco-helvétique soulève des interrogations. Vous n’avez jamais entrepris de comparer, avec l’administration fiscale, les délais et la qualité des réponses ?
M. François Falletti. Le dispositif d’entraide fiscale a été modifié récemment. Je pense que l’enquête pénale permet d’aller davantage au fond des choses, là où l’enquête fiscale est bâtie sur l’urgence. L’entraide fiscale peut aider à débroussailler le terrain pour peu que la question posée soit suffisamment précise.
M. le président Charles de Courson. Au début de l’affaire, après que Jérôme Cahuzac eut saisi la chancellerie pour demander des poursuites en diffamation selon la procédure définie à l’article 48 de la loi sur la liberté de la presse, vous avez considéré que les allégations n’étaient pas liées à l’exercice de sa fonction, si bien que l’on a basculé dans une procédure de droit commun. La première démarche de Jérôme Cahuzac vous a-t-elle surpris, les faits dénoncés par Mediapart étant antérieurs à son entrée au Gouvernement et sans lien avec son activité ministérielle ?
M. François Falletti. Il est assez fréquent que le parquet reçoive de plaintes émanant de membres du Gouvernement sur la base de l’article 48. Nous nous sommes vite rendu compte qu’il fallait rectifier le tir et considérer l’affaire comme relevant du droit applicable aux particuliers.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous informé la ministre ou la chancellerie de cette erreur de procédure ?
M. François Falletti. Bien sûr, j’en ai informé la direction des affaires criminelles et des grâces.
M. le président Charles de Courson. J’en reviens à ma question sur l’efficacité relative de l’entraide judiciaire et de l’entraide fiscale avec la Suisse.
M. François Falletti. La réponse n’est pas facile. Il n’y a pas de règle. Les choses se sont assurément améliorées, alors qu’il fut un temps où certaines demandes de commission rogatoire prenaient des mois, les décisions pouvant faire l’objet de recours en Suisse. On peut aujourd’hui obtenir en quelques mois des éléments de réponse – pas forcément à toutes les questions – permettant, le cas échéant, de procéder à une demande complémentaire ou de réorienter la démarche. Le déplacement du magistrat permet d’accélérer sensiblement le processus et de réduire les délais à quelques semaines. C’est sans aucun doute ce qui se serait produit si les choses ne s’étaient pas précipitées le 19 mars.
M. Jean-Marc Germain. S’agissant de la plainte en diffamation, est-il absolument certain que le ministre n’aurait pas dû saisir la justice en tant que membre du Gouvernement ? On sait bien que toutes sortes de rumeurs, y compris sur des affaires privées, circulent contre des personnalités politiques parce que ce sont des personnages publics.
Par ailleurs, à quel moment de l’enquête vous êtes-vous forgé l’intime conviction que M. Cahuzac avait bien un compte en Suisse ? Le document que Bercy a reçu des autorités helvétiques a-t-il joué un rôle, ou avez-vous considéré qu’il n’apportait pas de réponse dans la mesure où le compte avait pu être transféré antérieurement à la période sur laquelle portait la question ?
M. François Falletti. Il est évident que des imputations à l’encontre d’un personnage public seront renforcées à proportion de son exposition médiatique. On peut le regretter mais c’est ainsi, et ladite exposition fait que l’on a aussi un certain devoir. Cela dit, qu’il s’agisse d’un membre du Gouvernement ou de toute autre autorité ne change rien au fait que les imputations portaient sur le comportement personnel d’un particulier.
Quant à la réponse des autorités helvétiques à l’administration fiscale, nous avons considéré qu’elle apportait des informations par rapport à une période donnée. Par parenthèse, la notion d’« avoirs » se distingue de celle de « compte ». Ce document était un élément important mais il ne mettait pas un terme à la discussion : il fallait poursuivre les investigations.
Que dire à propos de l’« intime conviction » et du moment où elle se serait forgée ? Ce qui permet d’être sûr de son affaire, c’est le résultat de l’expertise de l’enregistrement, le 18 mars. Auparavant, les auditions ont certes contribué à dresser le paysage mais la logique de la démarche du parquet, depuis le début du mois de janvier, est de savoir ce qu’il en est de l’enregistrement. Lorsque nous avons le retour de l’expertise deux mois et demi plus tard, il est tout à fait cohérent que nous en tirions les conséquences.
M. Hervé Morin. Comme il est normal, vous avez fait remonter en permanence les informations à la direction des affaires criminelles et des grâces. Lors de vos conversations avec vos correspondants, est-il arrivé que l’un d’entre eux vous dise que le cabinet du ministre demande telle ou telle information, tel ou tel élément complémentaire ?
Vous avez été vous-même directeur des affaires criminelles et des grâces. À votre connaissance, cette direction transmet-elle au cabinet les informations qu’elle recueille sur les dossiers en cours ?
M. François Falletti. La direction des affaires criminelles et des grâces est tenue au même devoir d’information à l’égard du cabinet du ministre que le parquet général à son égard. Si l’affaire ne présente pas un grand intérêt, j’imagine qu’elle ne remonte pas au niveau du cabinet. Des éléments d’information qui illustrent, par exemple, les interrogations juridiques que l’on se pose sur une technique d’infiltration, d’interception ou de sonorisation dans une affaire de crime organisé peuvent rester à son niveau. Par contre, dans une affaire à ce point médiatisée, il est évident que les informations ont vocation à être portée à la connaissance du cabinet.
Quant à savoir si l’on m’a dit que le cabinet voulait savoir telle ou telle chose, je ne me le rappelle plus dans cette affaire. Mais cela peut arriver.
M. le président Charles de Courson. Nous poserons directement la question à l’actuelle directrice des affaires criminelles et des grâces, puisque notre commission l’auditionnera.
M. Hervé Morin. La réponse de M. Falletti confirme ce que nous savons mais qu’il est bien de répéter publiquement : quand une information est à la direction des affaires criminelles et des grâces, elle remonte sur le bureau du ministre.
M. Hugues Fourage. Ce n’est pas tout à fait ce qu’a dit M. le procureur général.
M. François Falletti. La direction des affaires criminelle et des grâces fait logiquement remonter les informations concernant les affaires médiatiques et sensibles. Mais je ne peux affirmer que cela a été fait en l’espèce. Seule la directrice pourra vous le dire.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez souligné l’importance de l’expertise de l’enregistrement. Cette expertise fait-elle suite aux plaintes déposées le 6 décembre puis le 20 décembre ?
M. Edwy Plenel a affirmé lors de son audition que c’est en raison de son insistance qu’une enquête préliminaire a été ouverte. Quel est, selon vous, le facteur déclenchant ?
M. François Falletti. L’information ouverte sur constitution de partie civile en diffamation n’a pas d’effet direct sur la procédure d’expertise. La consignation, je l’ai dit, n’a été versée que le 16 février. Auparavant, rien ne se passe. Dans une action en diffamation, la personne qui s’estime diffamée agit et il revient au média ou à la personne visés par la plainte de faire son offre de preuve et d’apporter des éléments. L’enregistrement n’avait vocation à intervenir qu’à ce moment-là.
Votre deuxième question porte sur le changement de perspective à la fin de décembre. Jusqu’alors, le parquet et le parquet général se fondaient sur un article de presse – et beaucoup d’articles de presse circulent, même si, dans cette affaire, il apparaît au fur et à mesure que les langues se délient que beaucoup de gens auraient entendu parler de cet enregistrement. Au mois de décembre, nous sommes encore en présence de ce qui peut être qualifié de campagne de presse. Or nous n’ouvrons pas une enquête sur chaque campagne de presse.
L’élément nouveau est la dénonciation faite explicitement au procureur de la République. Je note d’ailleurs que si cette dénonciation s’était révélée mensongère, elle serait tombée sous le coup de la loi. C’est à ce moment que la décision est prise d’aller de l’avant et d’ouvrir l’enquête.
M. le président Charles de Courson. Y a-t-il eu une démarche de M. Plenel auprès du parquet pour que la justice se saisisse de cette affaire et, le cas échéant, cette démarche a-t-elle influencé votre décision ?
M. François Falletti. M. Plenel écrit au procureur le 27 décembre. Si la décision d’ouvrir une enquête est prise le 4 janvier, c’est qu’il y a ce signalement explicite auprès du procureur de la République. Ce n’est pas la même chose que des articles de presse. Dans ce contexte, où une démarche est effectuée auprès d’une autorité judiciaire investie du pouvoir de poursuivre et d’engager une enquête, le procureur a une responsabilité particulière et il est nécessaire de préserver les éléments de preuve.
Il arrive aussi que le parquet se saisisse d’office, par exemple en matière de publicité mensongère. Mais, dans le cas d’espèce, une dénonciation explicite est faite, conduisant à considérer qu’il faut avoir le cœur net au sujet de cet enregistrement.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Compte tenu de votre expérience passée, confirmez-vous que vous avez connu une période où l’information donnée à la direction des affaires criminelles et des grâces par le parquet ou le parquet général remontait systématiquement au cabinet et que des éléments redescendaient par la même voie ? En tant que procureur général, vous est-il arrivé d’informer directement le cabinet ?
M. François Falletti. Je le répète, le parquet général transmet des informations à la direction des affaires criminelles et des grâces. Évidemment, je ne saurais affirmer qu’il n’y a jamais de court-circuitages et qu’il n’y a jamais aucune relation directe – toutes époques confondues, du reste. Cela dépend des attitudes des uns et des autres. Le passage par la direction des affaires criminelles et des grâces correspond au schéma tel qu’il est conçu.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Votre mode de fonctionnement aurait-il été le même en 2010, date à laquelle vous avez été nommé aux fonctions que vous occupez actuellement, qu’en 2012, après que la garde des sceaux du nouveau Gouvernement eut fait savoir qu’elle se refusait à donner des instructions au parquet ?
M. François Falletti. Le parquet et le parquet général sont investis d’une responsabilité qui repose véritablement sur leurs épaules dès lors qu’il n’y a pas de directives particulières. Les mauvais comportements et les mauvais réflexes consistant à court-circuiter la procédure normale et à aller directement vers l’autorité politique, généralement dans le but de se faire valoir, perdent un peu de leur sens. Mais c’est sans doute plus une question de pratique qu’une question institutionnelle. Cette pratique, encore une fois, est de faire remonter les informations à la direction des affaires criminelles et des grâces, laquelle les transmet au cabinet du garde des sceaux suivant les instructions qu’elle a de le faire ou non.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Ressentez-vous une responsabilité plus importante, voire une solitude plus grande, depuis que la culture de gouvernement a quelque peu changé et que le parquet a plus de latitude ? Cela a-t-il eu des répercussions sur la gestion de l’affaire Cahuzac, concernant notamment la décision d’ouvrir l’enquête préliminaire ?
M. François Falletti. Ces sujets, je le crains, relèvent d’abord du tempérament des personnes. On doit ne donner des informations que dans le cadre du processus hiérarchique que je vous ai exposé. Il peut arriver que certains souhaitent se faire valoir par des contacts directs. Pour le reste, cela fait déjà un certain temps que les procureurs et les procureurs généraux se sentent investis d’une responsabilité directe et personnelle dans l’ouverture et la conduite des enquêtes.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il y a une évolution, j’entends bien. Mais pouvez-vous affirmer que la décision d’ouvrir une enquête préliminaire, et la date à laquelle vous l’avez prise, eussent été exactement les mêmes un an auparavant ?
M. le président Charles de Courson. Notre collègue vous propose un exercice de « jurisfiction ».
M. François Falletti. J’avoue avoir du mal à me situer dans la fiction.
Mme Marie-Françoise Bechtel. L’environnement a-t-il changé ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Le parquet prend deux décisions, l’une le 8 janvier, l’autre le 19 mars. Pouvait-on aller plus vite ? Sauf erreur de ma part, monsieur le procureur général, vous considérez l’expertise de l’enregistrement comme un élément primordial et vous prenez votre décision le lendemain de la remise du rapport d’expertise.
Reste à savoir si vous n’auriez pas pu envoyer plus tôt la demande d’entraide aux autorités suisses.
M. François Falletti. Je vous ai déjà répondu : si l’on veut qu’une demande d’entraide pénale ait des chances de réussir, on doit la fonder sur des données précises. Ces données, nous les avons recueillies au fil de la dizaine d’auditions que nous avons menées en janvier et février. Je doute que nous ayons pu gagner quinze jours. Une telle demande doit être construite !
M. Hervé Morin. Avez-vous eu des relations directes avec le cabinet sur ce dossier ? Et, lorsque vous étiez procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avez-vous eu des instructions directes émanant de l’autorité politique en place avant 2012 ?
M. François Falletti. Je le répète : je n’ai pas eu de contact avec le cabinet du garde des sceaux dans l’affaire qui nous occupe, ni avec aucun autre cabinet. Lorsque j’exerçais à Aix-en-Provence, je n’ai pas eu non plus de contact particulier.
M. Christian Assaf. Ce qui importe, c’est de déterminer ce que savait le Gouvernement avant le 19 mars. Entre l’ouverture de l’enquête préliminaire et cette date, avez-vous donné des informations à votre hiérarchie qui auraient permis au Gouvernement de savoir ce que vous alliez faire ?
M. François Falletti. L’essentiel dépendait de l’analyse de l’enregistrement. Sans doute, si les résultats avaient été moins nets, l’enquête se serait-elle poursuivie sur la base d’autres éléments. Sans doute l’information judiciaire aurait-elle pu être ouverte un peu plus tard. Mais, tout bien pesé, il valait mieux l’ouvrir le 19 mars, d’autant que certains éléments concernant Singapour commençaient à apparaître. Il était clair que le dossier devenait de plus en plus complexe et que le cadre de l’information judiciaire était incontournable.
M. Gérald Darmanin. À votre connaissance, le juge Bruguière a-t-il essayé d’informer la justice, d’une manière ou d’une autre, depuis le début de l’affaire ?
Sous quelle forme faisiez-vous passer l’information que vous délivriez « à chaque étape » à la direction des affaires criminelles et des grâces ? Accessoirement, combien y a-t-il eu d’étapes et de contacts ?
Sur cette affaire particulièrement importante et médiatisée, la direction des affaires criminelles et des grâces s’est-elle montrée plus pressante qu’à l’habitude ?
M. François Falletti. Il y avait évidemment un intérêt, l’affaire étant, Dieu merci, particulière !
Il n’y a pas eu de contacts, à mon niveau en tout cas, avec Jean-Louis Bruguière, et aucune remontée du parquet n’a évoqué un quelconque contact.
M. Christian Eckert. Concernant la réponse des Suisses à la demande d’entraide fiscale des autorités française, vous avez fait une distinction entre la notion d’« avoirs » et celle de « compte ». Pourriez-vous préciser ?
M. François Falletti. Je ne souhaite pas m’avancer au sujet d’un courrier qui est versé au dossier. Il est possible d’ouvrir un compte avec un prête-nom, on peut avoir un compte sans détenir des avoirs… Bref, à notre sens, la réponse ne refermait pas le chapitre. En toute hypothèse, il fallait continuer les investigations.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie d’avoir répondu à nos questions.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mes chers collègues, au cours de cette audition, j’ai reçu du ministre de l’intérieur une lettre comprenant la note de la DCRI déclassifiée aujourd’hui même. Peut-être serons-nous amenés à demander d’autres éléments, mais, à ce stade, je peux indiquer que la note ne cite ni directement ni indirectement le nom de Jérôme Cahuzac.
Audition du mercredi 12 juin 2013
À 18 heures : M. Rémy Garnier, inspecteur des impôts à la retraite.
M. le président Charles de Courson. Nous poursuivons nos travaux en recevant M. Rémy Garnier, inspecteur des impôts à la retraite.
Je vous remercie, monsieur, d’avoir répondu à l’invitation de notre commission.
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ».
Mediapart a révélé, dès le 4 décembre, que vous aviez fait état de soupçons relatifs à la détention par Jérôme Cahuzac d’un compte à l’étranger dans un mémoire en défense daté du mois de juin 2008. Nous souhaitons donc comprendre quelles informations étaient en votre possession et qui a eu connaissance des révélations contenues dans ce mémoire.
Avant d’aller plus loin, il me revient de vous préciser que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous remercie de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »
M. Rémy Garnier, inspecteur des impôts à la retraite. Je le jure sous réserve du respect du secret professionnel et de l’anonymat de certains aviseurs.
M. le président Charles de Courson. L’article précité couvre cette hypothèse : « Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée (…) Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Les articles 226-13 et 226-14 fixent les conditions de protection du secret professionnel. Vous pouvez donc prêter serment sans restriction.
M. Rémy Garnier. Un de mes aviseurs ne souhaite pas que son nom soit révélé. L’administration fiscale, je le précise, a recours à des aviseurs qu’elle rémunère parfois et dont elle garantit l’anonymat.
M. le président Charles de Courson. Pour l’instant, je vous demande de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »
M. Rémy Garnier prête serment.
M. Rémy Garnier. En préambule, je souhaite réagir aux propos tenus devant vous par certains représentants de la direction générale des finances publiques et par des responsables de leur ministère de tutelle. À les en croire, personne n’a rien vu, rien lu, rien entendu. Pour ma part, je suis en mesure de vous livrer les noms d’une dizaine de personnes qui étaient au courant, ou auraient dû l’être si elles avaient fait correctement leur travail, depuis 2008, 2011 ou 2012. Pour elles, les révélations de Mediapart le 4 décembre 2012 n’auraient pas dû être une découverte : mon mémoire du 11 juin 2008 est en effet passé entre un certain nombre de mains.
Je souhaite en particulier réagir aux propos méprisants, insultants et mensongers de Mme Amélie Verdier, prononcés ici même sous la foi du serment. Mme Verdier m’a décrit comme un « Columbo autoproclamé ». Je la mets au défi de produire une seule déclaration ou un seul écrit où je m’affuble de ce surnom, plutôt flatteur, que je dois davantage à mes résultats qu’à mon imperméable un peu défraîchi !
Mme Verdier qualifie également mon mémoire de « fantaisiste ». Elle m’accuse d’avoir produit des écrits « incohérents » et me décrit comme un « procédurier » contre sa propre administration et contre de nombreux collègues. C’est un mensonge par action, par omission et par insinuation malveillante. Elle oublie de préciser que j’ai engagé ces procédures contre l’administration pour me défendre contre des sanctions disciplinaires arbitraires, répétées et injustes. Et je la mets au défi de produire la liste des collègues que j’aurais poursuivis : c’est un mensonge pur et simple !
Mme Verdier m’accuse également d’avoir pris des libertés avec le secret fiscal et de m’être affranchi des instructions de ma hiérarchie. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 30 mai dernier, lui apporte un cinglant démenti : elle reconnaît que j’avais parfaitement le droit de consulter ce dossier en me servant du seul outil qui m’était laissé, l’application informatique Adonis, alors que j’étais dans un placard depuis une dizaine d’années.
Mme Verdier reprend des « éléments de langage » émis par divers communicants du ministre Jérôme Cahuzac, par son avocat, Me Gilles August, ou par une certaine presse satirique paraissant le mercredi, et malheureusement répercutés dans tous les médias. Pendant six mois, j’ai subi le tir croisé de ces attaques odieuses. Mais le pire était à venir : interrogé par un hebdomadaire de Lausanne, L’Hebdo, M. Daniel Richer, président du tribunal administratif de Bordeaux, m’a accusé, dans un courrier électronique publié en partie par la journaliste, de délation et effectue rien de moins qu’une comparaison avec la délation sous l’occupation nazie. Il est heureux que tous les magistrats de Bordeaux ne soient pas de ce bois-là ! Je rends d’ailleurs hommage à ceux qui m’ont donné raison dans les quelque douze procédures que j’ai gagnées devant la justice administrative. J’ai également gagné devant la Cour européenne des droits de l’homme et gagné à deux reprises en cassation.
En matière fiscale, je totalise aujourd’hui vingt-huit dégrèvements faisant suite à des impositions abusives. L’administration n’a jamais été en mesure de me redresser d’un centime !
Je veux donc lancer un cri de colère car, pendant ce temps, les fraudeurs rigolent dans notre dos ! Des vérificateurs comme moi se font quotidiennement insulter et menacer. Il y a deux ans, on a menacé un collègue d’Agen de le tuer à l’arme blanche. Un vérificateur a été assassiné à Marseille dans l’indifférence de la hiérarchie et de la direction générale des finances publiques. Je le dis à M. Parini : c’est une honte pour la démocratie, une honte pour la République, une honte pour la France !
Dans un tel contexte, et au risque de passer pour un provocateur, je vous avoue que M. Cahuzac me paraît sympathique, quelle que soit la gravité des fautes qu’on a pu lui reprocher : il a fait des aveux, il a demandé pardon à ceux qu’il avait offensés – j’en fais partie – et, surtout, il a reconnu le piège que l’administration m’avait tendu en 2001 dans le prolongement de l’affaire France Prune, du nom de cette union de coopératives de pruniculteurs que j’avais vérifiée en 1999. Il l’a déclaré dans le journal Sud-Ouest daté du 30 octobre 2011 et il me l’a répété lors de notre entretien du 26 octobre 2012.
Mon destin a croisé celui de Jérôme Cahuzac en trois occasions.
La première fois, c’était en 1999, dans le cadre de l’affaire France Prune.
La deuxième en 2008, au sujet de l’avertissement disciplinaire qu’on m’avait infligé pour avoir consulté son dossier avec l’application Adonis.
La troisième en 2012, pour un entretien en tête à tête.
J’articulerai mon propos autour de ces trois dates, non sans préciser que je laisse à la disposition de votre commission une série de documents qui apportent des preuves manifestes à l’appui de ce que je dis.
En 1999, après que j’ai notifié des redressements à France Prune en décembre 1998, Jérôme Cahuzac, député du Lot-et-Garonne, intervient au plus haut niveau, celui du secrétariat d’État au budget tenu à l’époque par M. Christian Sautter. La vérification étant en cours, cette intervention est quelque peu intempestive.
Dans une note confidentielle dont je vous remets ici une copie, le service juridique de la direction générale des impôts valide d’abord mon analyse du service sans la moindre ambiguïté : « Les pratiques de l’union de coopératives et de sa filiale s’inscrivent manifestement en contradiction avec les usages commerciaux les plus élémentaires. À cet égard, l’intérêt du groupe ne saurait justifier à lui seul de telles pratiques. » Cela n’empêchera pas ma hiérarchie, deux ans après, d’instruire mon procès en soutenant que j’avais fait une application personnelle de la loi fiscale. Sans doute ignorait-elle que j’avais eu ce document confidentiel entre les mains, ce qui lui permettait de raconter n’importe quoi !
M. le président Charles de Courson. Quel est ce document ?
M. Rémy Garnier. Le projet de réponse du secrétaire d’État au député pour rejeter sa requête, préparé par la direction générale des impôts et qui valide intégralement ma position après une analyse approfondie du service juridique – analyse au cours de laquelle, soit dit en passant, je n’ai pas été consulté.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Comment vous l’êtes-vous procuré ?
M. Rémy Garnier. Par fuite, sans aucun doute. Il m’a été remis par mon chef de brigade, lequel n’aurait pas dû me le remettre.
Cet épisode a lieu en mars 1999. En juin de la même année, à mon insu, tous les redressements sont abandonnés à l’issue d’une enquête où l’on ne m’a même pas entendu et dont les conclusions sont à l’opposé de ce qui avait été écrit en mars.
M. le président Charles de Courson. Il s’agit de la décision du 2 juin 1999 de M. Christian Sautter.
M. Rémy Garnier. C’est exact. Le problème est que la vérification est toujours en cours. Ce qui met fin à une vérification, c’est la réponse aux observations du contribuable. Je ne serai informé de l’annulation des redressements qu’en novembre, et sommé de répondre dans le sens souhaité par le secrétaire d’État. Dans un premier temps, il s’agit d’un ordre verbal. Je refuse. Je reçois ensuite l’ordre écrit et je n’ai d’autre possibilité que d’accepter, en émettant toutefois des réserves qui seront interprétées plus tard comme quelque peu désobligeantes pour le secrétaire d’État. À l’époque, ma hiérarchie valide ces réserves intégralement et par écrit. Deux ans après, on prétendra le contraire. Je détiens les pièces qui prouvent non seulement qu’elle a approuvé ma position, mais aussi qu’elle a abondé dans mon sens ! Cette affaire m’a valu des félicitations écrites et une augmentation de ma note de 18,25 à 18,5, ce qui me plaçait parmi les meilleurs de ma catégorie – inspecteur du 12e échelon – au niveau national. Contrairement à ce que laisse entendre Mme Amélie Verdier, je n’étais pas le dernier de la classe !
J’ai d’ailleurs apporté une feuille de notation qui montre que j’ai été considéré comme « excellent », voire « exceptionnel », jusqu’à l’affaire France Prune : « vérificateur exceptionnel par sa puissance de travail, par l’approfondissement de ses investigations et analyses » ; « son travail d’une clarté exemplaire et ses facultés de synthèse dans les cas les plus difficiles en font un agent dont la collaboration est particulièrement appréciée » ; « apte au grade supérieur » ; « excellent » dans toutes les cases.
Pour en terminer avec France Prune, je suis réinvesti contre mon gré, en dépit d’un document dans lequel j’explique pourquoi il est inutile de procéder à une nouvelle vérification sur place – document que l’administration, devant le conseil de discipline, prétendra avoir perdu. Mes supérieurs profitent d’une lettre de dénonciation dont le contenu ne me sera révélé que cinq ans plus tard – une « lettre cachée » conduisant à une « lettre de cachet », pour reprendre l’expression des syndicats à l’époque – pour me dessaisir avec la plus grande brutalité et pour me déplacer d’office de la direction régionale Sud-Ouest vers un placard de la direction départementale à Agen. C’est mon premier placard, j’en connaîtrai trois.
J’en viens à la deuxième affaire où mon parcours croise celui de Jérôme Cahuzac, l’« affaire Adonis ». Le 3 avril 2008, après une pré-enquête qui a duré plus d’un an, une procédure disciplinaire est ouverte à mon encontre pour avoir consulté, le 9 mars 2007, le dossier fiscal de M. Cahuzac par le moyen de l’application informatique Adonis. Cette ouverture est décidée par la direction générale à mon insu : je n’en serai informé qu’après la clôture de l’instruction, et c’est à ce moment que je rédige le mémoire intitulé « S’adonner à Adonis », dans lequel il est question du compte suisse de Jérôme Cahuzac et de diverses anomalies dans ses charges et ses revenus déclarés. Ce mémoire dresse le contexte de ces anomalies : les rapports avec les laboratoires pharmaceutiques, l’activité passée au cabinet de Claude Évin, le financement douteux, à hauteur de 4 millions de francs, de l’appartement situé 35, avenue de Breteuil, l’emploi de la femme de ménage sans papiers qui a valu à M. Cahuzac une reconnaissance de culpabilité sans peine. Tous les faits évoqués se sont révélés exacts, à l’exception de la possession de biens à Marrakech et à La Baule – encore étaient-ce là des informations dont je reconnaissais avoir seulement « ouï dire » et dont je demandais la vérification.
Pour ce qui est du compte suisse, je n’utilise pas le conditionnel car mes sources sont fiables. Je pense notamment à un collègue qui a eu l’enregistrement en sa possession et qui m’en a avisé en 2002 ou 2003 – je ne suis pas absolument certain de la date : placé dans un placard, menacé de révocation, définitivement écarté du contrôle fiscal, j’avais à l’époque d’autres chats à fouetter.
En 2006, lorsque je suis affecté à mon troisième et dernier placard, la brigade d’études et de programmation, j’ai tout le loisir d’approfondir la question. Comme il se trouve que Maître Gonelle est aussi mon avocat, je lui pose la question lors d’une rencontre qui n’avait rien à voir avec M. Cahuzac. C’est moi qui l’interroge sur ce compte suisse et non l’inverse. Il me confirme l’existence de l’enregistrement dont il possède deux CD, le contenu précis dudit enregistrement, le fait qu’il en a remis une copie au juge Bruguière. Tout cela me conforte dans l’idée que l’information est solide. Je n’ai pas l’ombre d’un doute quant à la véracité de l’enregistrement et de son contenu.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au moment où vous interrogez M. Gonelle, comment savez-vous qu’il détient cet enregistrement ?
M. Rémy Garnier. Il se trouve que le fonctionnaire qui m’a avisé en 2002 ou 2003 est un ami commun.
M. le président Charles de Courson. Le fameux « monsieur X », qui est à la retraite.
M. Rémy Garnier. En effet, mais dont l’épouse est fonctionnaire en activité et craint des représailles, ce qui est parfaitement compréhensible quand on connaît mon parcours.
M. le président Charles de Courson. M. Gonelle nous a même précisé qu’il s’agit de l’ancien président de la Ligue des droits de l’homme de Villeneuve-sur-Lot.
M. Rémy Garnier. C’est le moyen de remonter jusqu’à l’homme.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cet ami vous informe donc de l’existence de l’enregistrement et du fait qu’il est en possession de M. Gonelle.
M. Rémy Garnier. Oui. Comme je vous l’ai dit, j’ai alors d’autres préoccupations mais je relance l’affaire lorsque j’ai l’occasion d’en parler avec Michel Gonelle en 2006 et je consulte le dossier de M. Cahuzac le 9 mars 2007.
M. le président Charles de Courson. Ce collègue, d’après vos dires, a eu l’enregistrement en sa possession…
M. Rémy Garnier. Il s’agissait d’une cassette audio.
M. le président Charles de Courson. L’avez-vous vue ?
M. Rémy Garnier. Je n’ai jamais vu ni entendu cet enregistrement avant les révélations de Mediapart.
M. le président Charles de Courson. Votre honorable correspondant vous a cependant dit qu’il en avait un exemplaire.
M. Rémy Garnier. Oui. Mais, comme Maître Gonelle, il s’est montré réticent à me le remettre. La raison en est simple : il savait, étant donné ma réputation, que je l’aurais utilisé tout de suite !
J’en reviens à mon mémoire du 11 juin 2008. Comme vous pouvez le constater, il est adressé à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, selon la dénomination de l’époque…
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ne saisissez-vous pas plutôt le procureur de la République ?
M. Rémy Garnier. J’ai déjà donné et déjà payé ! En l’an 2000, j’avais saisi le procureur de la République en raison de l’urgence, avec l’accord verbal de ma hiérarchie. Peu après, une note du 8 août 2000, signée par le directeur divisionnaire en charge du contrôle fiscal à la direction spécialisée de contrôle fiscal (Dircofi) Sud-Ouest, indique que « les transmissions directes d’informations au parquet sont exclues ». Une deuxième note du 26 septembre 2000 va plus loin : « les transmissions directes d’informations au parquet sont proscrites ».
Mme Marie-Françoise Bechtel. Que dit la suite de ces notes ?
M. Rémy Garnier. Je lis la première : « Les transmissions directes d’informations au parquet sont exclues, sauf circonstances très particulières dont la direction doit être préalablement informée. »
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il est normal de passer par la direction.
M. Rémy Garnier. Non. L’article 40 du code de procédure pénale dit tout autre chose. Or l’agent qui transmet des informations au parquet se voit sanctionné !
M. Alain Claeys, rapporteur. Par la suite, vous écrivez à de nombreuses reprises aux ministres du budget successifs : à Éric Woerth le 13 février 2009, à François Baroin le 23 septembre 2010, le 29 mars 2011 et le 2 mai 2011, à Valérie Pécresse le 8 mai 2012. Confirmez-vous dans ces courriers les révélations concernant Jérôme Cahuzac ?
M. Rémy Garnier. Absolument pas. Permettez-moi de revenir un instant sur l’article 40 du code de procédure pénale. Pour justifier de mauvaises appréciations littérales, mon chef de brigade écrit sur ma feuille de notation pour 2002 : « Il convient de souligner que, dans cette affaire qui s’est conclue finalement par un accord dont il s’attribue seul les mérites, M. Garnier avait dans un premier temps, comme il le rappelle lui-même, saisi directement le procureur de la République. » Comme si c’était une tare !
M. le président Charles de Courson. Vous confirmez qu’il s’agissait d’une autre affaire que l’affaire Cahuzac ?
M. Rémy Garnier. Oui. Ce que je veux montrer, c’est que le système est parfaitement verrouillé lorsque le dysfonctionnement que l’agent veut dénoncer met en cause son supérieur hiérarchique. Je me suis trouvé dans cette situation à maintes reprises puisque j’ai dénoncé une quarantaine d’affaires scandaleuses mettant parfois en cause l’honnêteté la plus élémentaire de certains membres de la haute hiérarchie. Si vous saisissez directement le procureur, on vous sanctionne pour défaut de loyauté ; si vous ne le saisissez pas…
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous avons entendu votre réponse, monsieur Garnier.
M. Rémy Garnier. Il y a plus grave : le procureur lui-même estime que l’administration est dans son droit !
M. Alain Claeys, rapporteur. Notre commission, je le rappelle, enquête sur une période précise et sur des faits précis qui concernent le fonctionnement de l’État. Nous ne sommes pas ici pour refaire tout le contentieux qui vous a opposé à votre administration et je n’ai pas de jugement à porter sur cette question.
M. Rémy Garnier. J’entends bien, mais j’ai juré de dire toute la vérité !
Comme lors de l’audition de M. Gonelle, vous semblez croire que la saisine du procureur est la panacée. Vous ne savez pas comment cela se passe à Agen ! Agen, c’est Outreau-sur-Garonne, monsieur !
Laissez-moi vous lire la réponse du procureur : « En ce qui concerne les informations que vous avez transmises au parquet dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, il m’apparaît que le fait de demander aux fonctionnaires de ce service de ne pas transmettre d’informations au parquet ne constitue pas une infraction. » En d’autres termes, le procureur se dépossède lui-même de ses prérogatives.
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en aux faits. Quand avez-vous fait la connaissance de Michel Gonelle ?
M. Rémy Garnier. En 2003 ou 2004 – je ne me rappelle pas la date précise –, lorsque j’ai fait appel à lui pour me défendre au pénal.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est à ce moment-là qu’il devient votre avocat ?
M. Rémy Garnier. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Donc ce n’est pas lui qui vous a parlé en premier d’un compte détenu en Suisse par Jérôme Cahuzac : c’est un ami commun dont vous ne souhaitez pas donner le nom.
M. Rémy Garnier. Je n’en ai pas l’autorisation. Sans doute avez-vous la possibilité de remonter jusqu’à lui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Après que cette personne vous a informé en 2002 ou 2003, vous demandez confirmation à M. Gonelle, sachant que c’est un ami commun.
M. Rémy Garnier. Je demande cette confirmation en 2006, lorsque je suis investi d’une mission de recherche. À mon sens, la recherche consiste à ratisser large, pas à suivre les directives précises d’une hiérarchie.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est par cet ami, qui a dû avoir accès à l’enregistrement, que vous apprenez que M. Cahuzac a un compte en Suisse ?
M. Rémy Garnier. Oui, et Me Gonelle me confirme en tous points cette information à la fin de 2006.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre mémoire du 11 juin 2008 consacre deux pages à Jérôme Cahuzac, avec des informations qui peuvent se révéler justes mais aussi des ouï-dire.
M. Rémy Garnier. Deux ouï-dire. Ils tombaient un peu à côté de la plaque, je le reconnais, mais je les ai présentés comme des ouï-dire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jusqu’à quel niveau hiérarchique ce mémoire est-il remonté ?
M. Rémy Garnier. La première phase est interne et administrative dans le cadre de l’instruction disciplinaire, la seconde est juridictionnelle, devant le tribunal administratif de Bordeaux en première instance puis devant la cour administrative d’appel. Tout au long de ce cheminement de plusieurs années, au moins une dizaine de personnes, plus ou moins élevées dans la hiérarchie de la direction générale des finances publiques, du ministère du budget et du ministère des finances, ont lu ou auraient dû lire ce document, puisqu’il a été utilisé contre moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au départ, il est adressé à la direction des ressources humaines de votre ministère ?
M. Rémy Garnier. Je m’adresse au ministre du budget sous couvert de M. Joseph Jochum, directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. C’est une obligation déontologique : on ne peut passer par-dessus son supérieur hiérarchique.
Le 19 juin 2008, M. Jochum rédige un rapport qu’il adresse à Mme Gabrielle Rochmann, au bureau RH2B (ressources humaines) de la direction générale des finances publiques à Paris.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous ce rapport ? Pouvez-vous nous le communiquer ?
M. Rémy Garnier. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle est la fonction de Mme Rochmann ?
M. Rémy Garnier. Elle est aux ressources humaines. Je n’ai pas d’autre précision. Mon directeur, M. Jochum, se montre plutôt réservé sur ma culpabilité. Il propose un simple avertissement disciplinaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les ressources humaines accusent-elles réception du rapport de M. Jochum ?
M. Rémy Garnier. Oui, bien sûr.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous cet accusé de réception ?
M. Rémy Garnier. Non car c’est à la Dircofi qu’il est adressé.
Le 17 décembre 2008, M. Philippe Rambal, directeur adjoint au directeur général des finances publiques Philippe Parini, prend un arrêté ministériel – par délégation de signature, bien entendu – visant mon mémoire en défense du 11 juin 2008 et prononçant un avertissement pour abus de fonction. J’ai du mal à croire que M. Parini n’a jamais été au courant de cette sanction.
M. le président Charles de Courson. Le directeur adjoint au directeur général des finances publiques a donc eu votre mémoire entre ses mains, puisque ce document est visé par un arrêté signé de sa main.
M. Rémy Garnier. Tout à fait. À ce stade, nous en sommes à cinq personnes : M. Éric Woerth – puisque je m’adresse au ministre et que, s’il n’a pas été saisi, il aurait dû l’être –, M. Jochum, Dircofi Sud-Ouest, Mme Rochmann, bureau RH2B, M. Rambal et M. Parini.
J’en viens à la phase juridictionnelle. La procédure de recours contre un avertissement pour excès de pouvoir est une procédure contradictoire. Tous les mémoires que j’adresse dans ce cadre à la juridiction sont aussitôt communiqués au ministère de l’économie et des finances, notamment au secrétariat général et à la direction des ressources humaines, sous-direction des ressources humaines ministérielles, bureau des services juridiques DRH1A. Cela fait encore quatre personnes qui auraient dû connaître l’existence de ce document, puisqu’elles ont rédigé pour le ministre des mémoires en défense qui m’accusent lourdement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour l’information de notre commission d’enquête, permettez-moi de lire un extrait du compte rendu de l’audition de M. Philippe Parini :
« M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc pas été amené à transmettre ce rapport à votre successeur.
« M. Philippe Parini. Pour être plus précis, durant l’été 2008, peu de temps après mon arrivée, j’ai été informé par mon directeur adjoint, en charge des ressources humaines, qu’une procédure disciplinaire avait été engagée par mon prédécesseur à l’égard d’un agent et qu’elle devait être confirmée. À cette occasion, j’ai pris connaissance d’une note destinée à cet adjoint, laquelle n’évoquait que le niveau de la sanction à prendre – blâme, avertissement, etc. La demande de sanction avait d’abord été formulée par le responsable régional, puis transmise à la Direction générale des impôts, qui l’avait validée. Mon prédécesseur l’avait confirmée. Il convient de rappeler que nous procédions à l’époque à la fusion du Trésor public et des impôts. Une des préoccupations était donc d’harmoniser les règles propres aux deux administrations, qui étaient différentes dans presque tous les domaines. Cela explique que des questions de principe se soient posées à cette occasion, alors qu’en temps normal, un dossier de ce type ne remonte pas jusqu’au directeur général.
« La note faisait mention d’un mémoire en défense présenté par l’agent mis en cause. Elle indiquait également les raisons de la procédure disciplinaire : il avait consulté de manière anormale les dossiers d’un certain nombre de responsables ainsi que le dossier fiscal d’un élu local. C’est tout.
« M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’y avait pas de nom ?
« M. Philippe Parini. Aucun nom ne figurait dans la note qui m’a été transmise. On ne parlait que de la consultation des dossiers de supérieurs hiérarchiques et de celui d’un élu local, député de la circonscription. Surtout, aucune allusion n’était faite au contenu du mémoire présenté par l’agent mis en cause. Je ne savais donc pas que ce dernier y dénonçait une fraude fiscale.
« M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’aviez donc pas connaissance de l’accusation portée au sujet de M. Cahuzac ? Vous ne pouviez donc transmettre à votre successeur, Bruno Bézard, aucune information spécifique ?
« M. Philippe Parini. En effet. Je n’avais pas connaissance de cette accusation. Je n’ai donc ni agi, ni transmis d’information à M. Bézard. La même réponse vaut d’ailleurs pour les ministres qui se sont succédé. »
M. Rémy Garnier. Il est bien écrit, à la page 9 de mon mémoire : « Il se nomme Jérôme Cahuzac. » Cela ne correspond pas, semble-t-il, avec les explications de M. Parini.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon M. Parini, aucun nom ne figurait dans la note de synthèse qu’on lui avait faite.
Vous avez consulté plusieurs dossiers fiscaux, dont ceux de supérieurs hiérarchiques. Quelle était votre motivation ?
M. Rémy Garnier. Lorsqu’un aviseur m’informe, avec tous les éléments de preuve, qu’un directeur triche sur ses frais professionnels, ou commet de graves insuffisances d’évaluation sur des biens de succession, ou déduit 90 000 euros sans que personne ne lui demande de comptes, alors que ces mêmes directeurs m’ont poursuivi pendant des années – à ce jour, je totalise vingt-huit dégrèvements, parfois pour des sommes dérisoires –…
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en à Jérôme Cahuzac, s’il vous plaît.
M. Rémy Garnier. Ce procès que vous me faites a déjà été tranché par la cour administrative d’appel, qui valide intégralement ma position.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Garnier, je ne suis ni juge ni procureur et je ne fais pas de procès ! Je suis un simple parlementaire, comme tous les membres de cette commission.
La troisième et dernière fois que votre chemin croise celui de Jérôme Cahuzac, c’est une rencontre le 26 octobre 2012 à votre demande…
M. Rémy Garnier. Pas à ma demande. Vous vous fondez sur les déclarations de Mme Verdier, qui sont fausses.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est donc Jérôme Cahuzac qui a souhaité vous rencontrer ? Avez-vous évoqué, lors de cet entretien, les accusations formulées contre lui dans votre mémoire du 11 juin 2008 ?
M. Rémy Garnier. Non, à aucun moment. Ce n’était pas l’objet de ma visite.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites pourtant que vous n’avez pas demandé à le rencontrer.
M. le président Charles de Courson. Expliquez-nous toutes les circonstances de cette rencontre.
M. Rémy Garnier. Avant cela, il aurait été préférable d’en terminer avec le deuxième épisode. J’étais sur le point de vous donner le nom d’autres personnes qui ont eu le dossier entre les mains.
Mais je réponds à votre question. Le 30 mai 2012, au moment de la campagne des législatives, M. Cahuzac anime une réunion publique dans mon chef-lieu de canton, Laroque-Timbault. Alors que je suis présent dans la salle, un tiers l’interpelle de manière assez virulente sur l’affaire France Prune et sur mon propre sort. M. Cahuzac dit que cette intervention tombe bien puisque M. Garnier, qui est dans la salle, pourra y répondre. Je lance à mon tour une charge contre l’administration fiscale, en rappelant à M. Cahuzac qu’il est désormais le ministre chargé du budget, qu’il y a continuité de l’État, que les litiges pendants devant les juridictions administratives sont intitulés « Rémy Garnier contre le ministre du budget » et que, à ce titre, il se doit de prendre ses responsabilités en mettant un terme à ce scandale qui dure depuis plus de dix ans.
M. le président Charles de Courson. M. Cahuzac vous connaît ?
M. Rémy Garnier. C’était la première fois que je le voyais physiquement.
M. le président Charles de Courson. Alors comment pouvait-il vous reconnaître ?
M. Rémy Garnier. Les journaux ont largement débattu de l’affaire France Prune, ma photo était partout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Bref, il vous reconnaît.
M. Rémy Garnier. Avant l’ouverture de la réunion, je me suis trouvé le premier à lui serrer la main au moment où il est descendu de voiture. C’est lui qui est venu vers moi.
M. le président Charles de Courson. Vous êtes donc un homme connu ?
M. Rémy Garnier. Malheureusement. L’affaire France Prune a été un séisme. Au moins une centaine d’articles sont parus dans la presse locale.
M. le président Charles de Courson. Et que vous dit-il ?
M. Rémy Garnier. Après que je l’ai interpellé – ce qui est un peu gonflé de ma part, j’en conviens, mais c’est ma nature –, il me fait la promesse, devant la centaine de personnes qui assistaient à la réunion, de me recevoir dès qu’il en aura la possibilité. Un de ses directeurs de cabinet à la mairie de Villeneuve-sur-Lot vient aussitôt prendre mes coordonnées, me donner son numéro de téléphone mobile, etc.
À partir de ce moment, je fais le siège de la mairie pour obtenir un rendez-vous. Je suis d’abord reçu par M. Yannick Lemarchand. À cet égard, les déclarations de Mme Verdier sont consternantes : comment peut-elle ignorer les fonctions de cette personne ?
M. Lemarchand me reçoit le 16 juillet 2012 pendant deux heures trente, au cours desquelles je lui remets une épaisse liasse de documents comprenant tous les détails du fameux piège que m’avait tendu la hiérarchie au moment de l’affaire France Prune.
M. Alain Claeys, rapporteur. À aucun moment vous ne parlez du dossier du ministre ?
M. Rémy Garnier. À aucun moment je ne parle du compte suisse de Cahuzac. Je ne viens pas pour régler les problèmes de Cahuzac mais pour régler les miens !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lui remettez-vous le mémoire ?
M. Rémy Garnier. Non. Je n’apporte que les dossiers concernant mon contentieux personnel avec l’administration fiscale. Je fais valoir que l’administration perd tous ses procès, qu’elle vient de perdre en appel…
M. Alain Claeys, rapporteur. Le mémoire est quand même une pièce importante.
M. Rémy Garnier. Je n’ai pas à mélanger les affaires. Peu avant mon entretien avec M. Lemarchand, la cour administrative d’appel avait confirmé un jugement du tribunal administratif annulant mon exclusion de fonctions prononcée en 2004. C’était une peine gravissime. Savez-vous ce que cela représente, d’être exclu pendant un an sans traitement, sans avoir la possibilité de travailler et en devant supporter des frais d’avocat et de déplacement considérables ?
J’avais gagné mon premier procès en octobre 2009. Qu’à cela ne tienne ! M. Woerth a fait immédiatement appel. Et il a perdu de nouveau !
Ce que je venais dire à M. Lemarchand, c’est qu’il était temps que l’administration tire les conclusions de ces épisodes. Mes revendications tenaient en cinq points.
Premièrement, la sanction des coupables. Chez Renault, quand on a accusé des cadres supérieurs d’espionnage industriel contre leur propre entreprise, l’affaire a été pliée en trois mois ; et moi, au bout de douze ans, j’en suis toujours au même point !
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en à notre sujet.
Vous rencontrez donc M. Lemarchand pendant deux heures et demie. Que se passe-t-il ensuite ?
M. Rémy Garnier. Je fais bien comprendre à M. Lemarchand que je ne vais pas m’en tenir là. Je continue à faire le siège de la mairie, notamment auprès de Mme Vidal, secrétaire. On m’informe que le dossier que j’avais remis à M. Lemarchand a été transmis à Mme Marie-Hélène Valente, chef du cabinet du ministre et, de ce fait, placée sous l’autorité directe de Mme Amélie Verdier.
Or Mme Valente a déclaré la semaine dernière à votre commission que, selon M. Cahuzac, j’étais un honnête homme et un bon investigateur. Le confirmez-vous ?
M. le président Charles de Courson. Vous aurez communication du compte rendu de son audition.
M. Rémy Garnier. La divergence de vues entre Mme Valente et Mme Verdier à mon sujet à de quoi surprendre !
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous en étions à la transmission du dossier à Mme Valente.
M. Rémy Garnier. On me dit alors qu’elle me contactera pour fixer le rendez-vous.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est elle qui le fixe ?
M. Rémy Garnier. Non. Je n’ai jamais eu personnellement Mme Valente au bout du fil. C’est sans doute une secrétaire qui me donne le rendez-vous avec M. Cahuzac le 26 octobre, pour une durée déjà fixée à trente minutes.
Le jour J, à l’heure H, j’arrive avec mon dossier sous le bras – le même que celui que j’avais présenté à M. Lemarchand – et j’expose à M. Cahuzac les tenants et les aboutissants de ce fameux piège, en lui montrant les pièces écrites qui prouvent que l’administration s’est comportée de façon détestable. Et je peux mettre des noms, d’autant que vous avez entendu certaines de ces personnes. M. Olivier Sivieude, par exemple : il s’est fondé sur des éléments manifestement faux, sur un dossier d’accusation truqué de A à Z, pour faire virer un agent dont le seul tort était de révéler des dysfonctionnements dans son administration.
M. le président Charles de Courson. Revenons-en à notre affaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le secrétariat de Jérôme Cahuzac vous fixe ce rendez-vous pour le 26 octobre.
M. Rémy Garnier. À la mairie de Villeneuve-sur-Lot, je le précise.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avant cela, avez-vous reçu la visite du détective Alain Letellier, comme l’affirme le journal L’Express dans son édition du 15 avril 2013 ? Si oui, pour quelles raisons venait-il vous voir ?
M. le président Charles de Courson. On prétend que M. Letellier aurait été mandaté par Mme Cahuzac.
M. Rémy Garnier. Le 14 septembre 2012, je reçois un appel téléphonique de M. Florent Pedebas, gendarme à la retraite travaillant comme agent de renseignement privé en collaboration avec M. Letellier. Il m’indique que M. Letellier et lui-même souhaiteraient me voir. Rendez-vous est pris le 3 octobre 2012 à Laroque-Timbault. Je les conduis alors à mon domicile.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel était l’objet de ce rendez-vous et qui les mandatait ?
M. Rémy Garnier. D’après ce que j’ai cru comprendre, ils étaient mandatés par Mme Cahuzac. Du reste, dès le début de l’entretien, j’ai senti que je n’étais pas concerné : l’objet était de savoir quelles étaient les relations de Jérôme Cahuzac avec Florence Parly.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi vous posaient-ils ces questions ?
M. Rémy Garnier. Des gens souhaitent un rendez-vous, je le leur accorde. Même à la retraite, je suis preneur d’informations pour peu qu’elles puissent servir ma cause. Ce que j’attendais, c’était des informations précises sur les activités suisses. Quoi qu’il en soit, je leur fais comprendre que cela ne m’intéressait pas. Aussitôt, ils en viennent à l’aspect financier du dossier, en particulier aux relations entre Jérôme Cahuzac et les laboratoires pharmaceutiques – dont certains ont été cités – en rapport avec le compte suisse, dont ils connaissaient l’existence. Je crois même me souvenir qu’ils avaient effectué un voyage à Singapour neuf mois plus tôt.
M. le président Charles de Courson. Quel est le but de leurs questions ?
M. Rémy Garnier. Ils veulent que je leur donne des renseignements. En l’occurrence, j’ai pris tous les renseignements qu’ils m’ont fournis et je n’en ai donné aucun.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Letellier est donc au courant du compte suisse.
M. Rémy Garnier. Oui. Ces personnes avaient même des documents sous les yeux, dont une liste de laboratoires qui auraient alimenté le fameux compte. Ils n’ont pas voulu me donner cette liste.
M. le président Charles de Courson. Vous ont-ils dit quelles étaient leurs motivations ? Avaient-ils des instructions ?
M. Rémy Garnier. C’était dans le cadre de la procédure de divorce.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi venir vous voir, alors ?
M. Rémy Garnier. Parce qu’ils pensent que j’ai des éléments à leur donner.
M. le président Charles de Courson. Comment savent-ils que vous existez ?
M. Rémy Garnier. M. Florent Pedebas travaillait auparavant à la brigade de recherche de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. Il connaît donc tous mes démêlés avec l’administration fiscale à propos de l’affaire France Prune.
M. Alain Claeys, rapporteur. Villeneuve-sur-Lot est une grande famille !
M. le président Charles de Courson. Comment sait-il que Jérôme Cahuzac détient un compte en Suisse ?
M. Rémy Garnier. D’après ce que je peux déduire, M. Alain Letellier le sait de Mme Patricia Cahuzac. Comme je vous l’ai dit, j’ai compris qu’il s’agissait d’une affaire de divorce, d’autant qu’ils ont ensuite abordé les aspects financiers, me laissant entendre qu’ils avaient fait un voyage à Singapour.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous préciser ?
M. Rémy Garnier. M. Letellier, en tout cas, aurait fait un voyage à Singapour, et mes deux interlocuteurs m’ont fait comprendre qu’ils étaient eux-mêmes « filochés » par d’autres détectives privés.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette rencontre a lieu début octobre. Vous voyez M. Cahuzac le 26 du même mois. Quel est l’objet de cet entretien ? Vous ne parlez absolument pas de l’affaire ?
M. Rémy Garnier. Absolument pas. Encore une fois, je viens pour dire à M. le ministre, qui a la haute main sur toute l’administration fiscale, qu’il a reconnu publiquement dans Sud-Ouest que cette administration m’avait tendu un piège et je lui demande d’en tirer toutes les conséquences, à savoir, comme chez Renault : sanction des coupables, réhabilitation et juste indemnisation de la victime, abandon des procédures en cours et, surtout, mise en place d’une protection effective des agents chargés du contrôle fiscal, tant ceux-ci sont parfois maltraités dans l’indifférence totale de la haute hiérarchie.
M. le président Charles de Courson. Que vous répond M. le ministre ?
M. Rémy Garnier. Que j’ai raison sur toute la ligne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous le sentiment qu’il connaît le mémoire ?
M. Rémy Garnier. Je suis convaincu que non. Je m’attends pourtant au pire : je sais que c’est un boxeur et que, s’il est au courant, il risque de se fâcher !
M. Jean-Marc Germain. Vous ne lui parlez pas du compte ? C’est incompréhensible !
M. Rémy Garnier. Je prends rendez-vous pour régler mes problèmes, pas pour régler ceux du divorce de Cahuzac ! Les tribunaux m’ayant donné raison, je demande au ministre d’en tirer les conséquences. Cela s’arrête là. Je considère que je n’avais pas à parler d’un compte suisse car je serais alors passé pour un maître chanteur, ce que je ne suis pas. Ce n’est pas mon style. Moi, je défends mon honneur. Cela s’arrête là !
M. le président Charles de Courson. Que vous répond le ministre ?
M. Rémy Garnier. « Vous avez raison, l’administration vous a tendu un piège en 2001. » Cela ne fait que confirmer ce qu’il a déjà dit à Sud-Ouest mais cela fait plaisir à entendre ! « Vous gagnerez en justice sur l’essentiel, peut-être pas sur la totalité, de l’avis de mon cabinet. »
M. Alain Claeys, rapporteur. Le cabinet avait en effet demandé une note vous concernant avant ce rendez-vous.
M. Rémy Garnier. À entendre Mme Verdier, il n’a retenu que les appréciations très négatives à mon égard, négligeant complètement tous les éléments que j’avais produits.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous ne rencontrez plus M. Cahuzac après cette date ?
M. Rémy Garnier. Non.
Mais j’ai juré de dire toute la vérité, alors laissez-moi terminer. M. Cahuzac achève l’entretien en m’indiquant que j’ai raison mais que c’est une question d’honneur : « Dans votre propre intérêt, vous devez aller en justice où vous gagnerez, et moi, je n’interviendrai pas. » L’entretien a duré les trente minutes prévues. Le ministre a été parfaitement courtois. Au moment de nous séparer, je lui dis que je suis très déçu et que j’attendais beaucoup mieux.
Circonstance aggravante pour la DGFiP, je reçois peu de temps après des mémoires à charge contre moi émanant du bureau DRH1A et datés du 25 octobre. Les décisions étaient prises avant même mon entretien avec le ministre ! Me sentant trahi, j’écris une lettre ouverte à Cahuzac intitulée « De la posture à l’imposture ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous nous transmettre ce document ?
Une dernière question : les journalistes de Mediapart vous contactent-ils ?
M. Rémy Garnier. M. Fabrice Arfi me téléphone pour prendre rendez-vous avec moi le 14 novembre 2012. Je vais à sa rencontre à la gare TGV et l’emmène chez moi, où nous discutons pendant trois heures.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avait-il déjà votre mémoire ou est-ce vous qui le lui remettez ?
M. Rémy Garnier. Quand je l’ai rencontré, il était au courant de mon mémoire. Je lui en ai remis un exemplaire après m’être autocensuré : je réécris un paragraphe où j’évoque des anomalies dans les déclarations fiscales de Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est donc vous qui remettez le document à Mediapart.
M. Rémy Garnier. Je crois me souvenir que je remets à M. Arfi un exemplaire ainsi autocensuré.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lui parlez-vous de l’enregistrement ?
M. Rémy Garnier. Il en a été question. Je n’ai pas de souvenirs très précis là-dessus.
M. le président Charles de Courson. Lui donnez-vous toutes les informations que vous avez livrées à notre commission ?
M. Rémy Garnier. Je sais qu’il y a un enregistrement. Sans doute M. Arfi est-il revenu voir diverses personnes, mais il ne m’a pas tenu au courant.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il est néanmoins reparti avec votre mémoire.
M. Rémy Garnier. Il est reparti avec mon mémoire autocensuré.
M. le président Charles de Courson. Lui avez-vous dit que M. Gonelle vous avait confirmé la véracité des informations de votre aviseur ?
M. Rémy Garnier. Je le pense, même si je n’ai pas le souvenir du détail de ce que je lui ai dit.
M. le président Charles de Courson. Envoyez-vous votre mémoire du 11 juin 2008, adressé à M. Éric Woerth, directement au ministère ?
M. Rémy Garnier. Non. Je l’adresse à la Dircofi Sud-Ouest car le document doit suivre la voie hiérarchique.
M. Hervé Morin. Dans ce cas, le ministre ne risquait pas de le recevoir !
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez aucune certitude que le mémoire soit remonté au-delà des bureaux des ressources humaines ?
M. Rémy Garnier. Aucune.
M. Hervé Morin. Vous n’avez pas terminé votre témoignage concernant l’année 2008.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Oui, vous souhaitiez citer quelques noms.
M. Rémy Garnier. Nous en étions à la phase juridictionnelle et aux mémoires que les fonctionnaires du bureau DRH1A avaient rédigés contre moi, allant jusqu’à m’accuser d’outrage. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur lequel ils se fondent a été cassé par deux fois, la première pour vice de forme avec renvoi devant ladite cour, la seconde sur le fond. Pourtant, l’administration fait comme si de rien n’était, au mépris de l’autorité de la chose jugée par la plus haute juridiction, et m’accuse d’outrage. Lorsque, pour ma part, j’accuse mon directeur d’avoir commis des faux témoignages en justice et d’avoir suborné des témoins, j’apporte des preuves. Ce n’est pas un outrage, c’est la vérité !
On m’a objecté que « l’exception de vérité ne fait pas obstacle à l’outrage », bref, n’importe quoi ! La Cour de cassation m’a donné raison par deux fois. L’administration n’a pas le droit de se référer à des condamnations annulées ainsi. Outrageants ou pas, je maintiens mes propos dans leur intégralité.
M. le président Charles de Courson. Vous écrivez à Éric Woerth le 13 février 2009, à François Baroin le 23 septembre 2010, le 29 mars 2011 et le 2 mai 2011, et à Valérie Pécresse le 8 mai 2012. Pour le coup, vous vous adressez directement au ministre.
M. Rémy Garnier. En effet. Ce n’est pas la même chose.
M. Alain Claeys, rapporteur. Évoquez-vous la situation de M. Cahuzac dans ces courriers ?
M. Rémy Garnier. Non. Je défends d’abord mon honneur. Chez Renault, je le répète, M. Carlos Ghosn a dû réintégrer ou indemniser les cadres injustement accusés et en licencier les coupables. C’est ce que je demande depuis dix ans à tous les ministres du budget. Le dossier Cahuzac n’est plus mon problème.
J’en viens aux noms que vous demandiez. Au bureau DRH1A, un mémoire est rédigé par M. Pascal Meyrignac…
M. le président Charles de Courson. Vous nous remettrez tous les documents. Les membres de la commission pourront ainsi les consulter.
M. Hervé Morin. Les noms que M. le rapporteur ne vous a pas laissé le temps de citer sont ceux de fonctionnaires des impôts ?
M. Rémy Garnier. Il s’agit d’un élu local et de plusieurs fonctionnaires des impôts.
M. Hervé Morin. Qui est l’élu local ?
M. Rémy Garnier. Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Nous adresserons aux membres de la commission ce mémoire dans lequel M. Garnier évoque les actions répréhensibles qu’auraient commises certains de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que le cas d’un élu, Jérôme Cahuzac.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Puisque cette audition est ouverte à la presse, il est important que M. Garnier donne les noms.
M. le président Charles de Courson. Évitons les confusions. Les accusations de M. Garnier à l’égard de différents membres de la hiérarchie des services des impôts figurent dans son mémoire du 11 juin 2008. Cet aspect est hors du champ de notre commission d’enquête, mais il peut apporter des éclaircissements sur l’affaire qui nous occupe.
M. Rémy Garnier. Bien que la question soit en effet hors champ, il apparaît qu’un certain nombre de personnes sont au courant. Dans ces conditions, l’étonnement général qui a suivi les révélations de Mediapart le 4 décembre a de quoi intriguer.
J’ai indiqué quelles personnes étaient informées dans la phase administrative puis dans la phase juridictionnelle. Au ministère des finances, donc, M. Pascal Meyrignac rédige contre moi un mémoire en défense daté du 5 mai 2011, M. Marc Le Roux en signe un autre le 25 octobre 2012. Concernant ma demande en indemnisation, Mme Évelyne Ranuccini produit un mémoire en date du 22 novembre 2012 qui se réfère à cette affaire pour me refuser toute indemnisation. Il y a enfin la directrice des ressources humaines, Mme Michèle Féjoz.
M. Gérald Darmanin. Lors de votre long entretien avec M. Lemarchand, directeur de cabinet à la mairie de Villeneuve-sur-Lot et chargé, si j’ai bien compris, des affaires réservées de M. Cahuzac, ne faites-vous pas comprendre à votre interlocuteur que vous connaissez l’existence du compte en Suisse pour obtenir un rendez-vous avec le ministre ?
M. Rémy Garnier. Absolument pas. Ces démarches, je le répète, ont trait à ma propre situation.
M. Gérald Darmanin. En instance de divorce, Mme Cahuzac mandate des détectives privés pour rassembler des preuves et obtenir, on l’imagine, un jugement favorable. Vous nous dites qu’il serait question d’une liaison entre M. Cahuzac et une ancienne Secrétaire d’Etat au budget.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous n’avons pas à formuler de telles allégations.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, comme l’hypothèse en a été formulée lors de l’une de nos auditions, la première information, celle de 2001, aurait pu avoir été bloquée par une intervention de la secrétaire d'État au budget de l’époque. Nous auditionnerons les personnes qui se sont occupées de l’affaire à la brigade interrégionale d’intervention (BII) de Bordeaux. S’il faut remonter dans la hiérarchie, nous le ferons. Mais la vie privée de M. Cahuzac ne nous concerne pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Toute autre démarche que celle proposée par le président nous ferait sortir de l’esprit de notre commission, mon cher collègue.
M. Hervé Morin. Le dossier de M. Cahuzac est demandé par la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest en 2001 et y reste bloqué pendant six ans, alors que l’intéressé dépend de l’administration fiscale de Paris. Pourquoi ?
Par ailleurs, les deux détectives privés vous indiquent-ils directement qu’ils connaissent l’existence d’un compte en Suisse, ou est-ce vous qui avez cru comprendre qu’ils le savaient ?
Jusqu’à la rédaction de votre mémoire de 2008, l’existence de ce compte vous est connue parce que M. Gonelle vous a affirmé qu’il détenait un enregistrement. Au cours de la consultation de la base informatique qui vous vaudra la procédure disciplinaire, trouvez-vous des éléments qui corroborent cette affirmation ?
M. Rémy Garnier. On ne trouve sur la base accessible par l’application Adonis que les déclarations d’impôt sur le revenu, la situation du recouvrement, les éventuelles déclarations des tiers déclarants – employeurs, par exemple –, la situation en matière d’impôts locaux. Aujourd'hui, on peut également y consulter des renseignements relatifs au patrimoine – déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Mais on n’y trouve que cela. En consultant le dossier Cahuzac, je savais très bien que je n’avais aucune chance d’y trouver des preuves au sujet d’un compte en Suisse.
M. Hervé Morin. Vous n’aviez pas d’autres sources ?
M. Rémy Garnier. J’avais les informations concordantes émanant de mon collègue et de M. Gonelle.
L’aviseur dont j’ai parlé est allé voir à Bordeaux un collègue aujourd’hui décédé, M. Mangier, qui travaillait à la BII, c'est-à-dire à l’antenne locale de la DNEF (direction nationale d’enquêtes fiscales), non rattachée à la Dircofi. Il lui fait part de ses forts soupçons sur M. Cahuzac et sur le compte suisse. Je précise que les agents de recherche peuvent conduire des investigations sans se cantonner à un territoire ou à une période. À la suite de cette visite, M. Mangier aurait réclamé le dossier.
M. le président Charles de Courson. C’est exact.
M. Rémy Garnier. D’après ce que m’a révélé la DNIF (division nationale des investigations financières) lorsque j’ai été moi-même interrogé, il existe deux versions différentes. La version de M. Mangier, telle qu’il l’a rapportée à mon collègue d’Agen, est qu’il a demandé le dossier mais que Bercy ne le lui a jamais remis.
M. le président Charles de Courson. C’est faux.
M. Rémy Garnier. Mangier étant décédé, on ne peut plus vérifier.
La version donnée par Bercy à la DNIF est que le dossier a été effectivement transmis à Bordeaux, où il est resté six ans sans faire l’objet d’aucune exploitation, avant de revenir à Bercy. Malheureusement, je n’en sais pas plus.
Quant aux détectives, ils avaient l’air sûrs qu’il y avait un compte en Suisse.
M. Hervé Morin. Vous l’ont-ils dit ?
M. Rémy Garnier. Oui, en Suisse ou à Singapour. Ils enquêtaient des deux côtés.
M. le président Charles de Courson. Dans votre mémoire, vous exposez les détails du financement de l’appartement parisien de M. Cahuzac et vous faites état de l’origine douteuse d’un apport de 4 millions de francs. Comment avez-vous eu accès à ces informations ?
M. Rémy Garnier. M. Cahuzac avait donné le plan de financement de l’appartement. Pour un professionnel du contrôle fiscal comme moi, un tel plan paraît tout de suite suspect : la justification ne fait que déplacer le problème, puisqu’elle appelle une justification plus en amont. Il ne suffit pas de dire qu’un parent vous a donné 2 millions, encore faut-il savoir d’où sortent ces millions.
M. le président Charles de Courson. Ces données ne sont pas tirées d’Adonis, je suppose…
M. Rémy Garnier. Je vous remettrai un mémoire que j’ai intitulé « En bloc et en détail » et qui répond entièrement à votre question. J’y explique pourquoi les suspicions que j’avais en 2008 se sont vérifiées après coup.
M. Jean-Marc Germain. Nous ne vous accusons pas d’avoir fait du chantage. Cela étant, nous sommes un peu surpris que, le 30 mai 2012, vous ne parliez pas à M. Cahuzac de la conviction que vous aviez acquise très tôt de l’existence d’un compte en Suisse. Vous ne parlez pas non plus de ce compte à M. Lemarchand lorsque vous le rencontrez en juillet 2012. Et il n’en est toujours pas question lors de votre entretien avec le ministre en octobre 2012. Pourquoi ne faites-vous pas état de cette information ? Il ne s’agit pas d’exercer un chantage, mais d’avoir un échange franc avec lui.
Lorsqu’ils vous rencontrent le 3 octobre 2012, les détectives vous indiquent qu’ils se sont rendus à Singapour. Eux-mêmes sont suivis, nous dites-vous, par une autre équipe d’enquêteurs privés. Avez-vous idée de qui a pu mandater cette deuxième équipe ?
M. Rémy Garnier. Ce sont eux qui m’ont dit qu’ils étaient suivis. Ce n’était pas du tout mon sujet. Leurs problèmes ne m’intéressent pas.
M. le président Charles de Courson. Comment pouvez-vous cependant, en tant qu’inspecteur des impôts, alors que vous détenez l’information et que M. Gonelle vous la confirme en 2006, rencontrer une personne dont vous savez que c’est un fraudeur sans lui en parler ?
M. Rémy Garnier. Premièrement, je suis en retraite. J’ai consacré quarante ans de ma vie au contrôle fiscal, j’ai enfin le droit d’aller à la pêche à la ligne !
Deuxièmement, je viens régler un problème qui concerne ma propre situation. Je ne viens pas faire un contrôle fiscal chez M. Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Vous pouviez simplement lui dire que vous aviez la preuve qu’il détenait un compte en Suisse.
M. Rémy Garnier. J’ai une intime conviction. Ce n’est pas une preuve. Certains journaux ont affirmé que je n’excluais pas l’innocence de Cahuzac. Ce que j’ai dit, c’est que je ne l’exclus pas à 100 %. Je l’exclus à 99 %.
Pour le reste, j’ai fini ma carrière. On m’a assez maltraité comme cela, je ne vais pas m’occuper de ce qui ne me regarde pas. Il existe des services chargés du contrôle fiscal. Je ne vais quand même pas faire leur boulot gratuitement alors qu’on m’a foutu dehors !
Par contre, j’ai un lourd contentieux à régler avec l’administration, qui m’a plus que maltraité. Il n’était pas question, pour autant, de demander à Cahuzac de régler ce problème en échange de mon silence sur son compte.
M. le président Charles de Courson. Nous l’avons bien compris : vous n’avez pas fait de chantage.
M. Rémy Garnier. Non. J’ai seulement dit à M. Cahuzac qu’il avait le pouvoir de décision pour mettre fin à une situation scandaleuse, la mienne. Qu’il ait un compte ou pas… Après tout, je présume qu’il n’est pas le seul à en avoir un !
M. Jean-Marc Germain. Qu’en est-il de la deuxième équipe d’enquêteurs, à laquelle Le Canard enchaîné fait également allusion ?
M. Rémy Garnier. Je n’ai aucune information. Cette équipe, si elle existe, n’a pas cherché à me contacter.
M. le président Charles de Courson. Les deux détectives que vous recevez ne vous disent pas qui peuvent être ceux qui les suivent ?
M. Rémy Garnier. J’ai entendu un nom, un dénommé Moreau, peut-être, à Bordeaux. Ils ont aussi parlé d’agents de renseignement missionnés par un laboratoire pharmaceutique. Mais je n’ai rien de précis à ce sujet.
M. le président Charles de Courson. Un laboratoire qui aurait craint des révélations sur le financement du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac ? L’actuel avocat de M. Cahuzac, M. Jean Veil, a affirmé que l’alimentation de ce compte avait deux sources : au moins trois laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des versements en espèces en provenance de la clinique d’implantation capillaire.
M. Rémy Garnier. J’ai en effet cru comprendre que les « filochards » étaient missionnés par des laboratoires pharmaceutiques.
M. le président Charles de Courson. On ne vous a pas donné de noms ?
M. Rémy Garnier. Non.
M. Philippe Houillon. Je trouve « gonflé » d’aller demander à un ministre de vous aider à régler votre situation alors même que la consultation de son dossier fiscal est un des éléments qui sont à l’origine de ladite situation et que vous déposez, au cours de la procédure, un mémoire où vous le mettez en cause.
Par ailleurs, vous répétez depuis le début de cette audition que tout le monde savait ou aurait dû savoir. N’avez-vous pas dans l’idée, au moment où vous allez voir M. Cahuzac, que celui-ci sait que vous l’avez mis en cause. Qu’est-ce qui vous pousse à aller lui demander un service alors que vous pouvez légitimement penser qu’il y a un risque qu’il sache que vous êtes au courant ?
Selon les deux détectives que vous avez rencontrés, le compte en Suisse aurait été alimenté par les laboratoires. Avez-vous plus de précisions ?
M. Rémy Garnier. Selon vous, je serais allé demander un service à M. Cahuzac. Je récuse le terme avec virulence. Je viens demander l’application de la loi telle qu’elle a déjà été prononcée à onze reprises par les juridictions administratives ! Chaque fois qu’on me déplace d’office et que la justice ordonne ma réintégration, on me redéplace d’office aussitôt. Après avoir été écarté de la brigade où j’ai exercé le métier de vérificateur avec passion pendant trente ans, il faudra dix ans pour que j’y sois réintégré, deux ans après ma retraite. C’est scandaleux ! Onze condamnations de l’État, vous trouvez cela normal ?
M. Philippe Houillon. Je retire le terme de « service ». Néanmoins, vous vous attendez sans doute à ce que M. Cahuzac vous parle du compte en Suisse.
M. Rémy Garnier. J’ai évidemment prévu le coup. Je pensais qu’il devait être au courant, étant donné que la rencontre avait été préparée pour lui par ses collaborateurs M. Lemarchand, Mme Valente et Mme Verdier.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous eu le sentiment qu’il savait que vous saviez ?
M. Rémy Garnier. M. Cahuzac a peut-être des défauts mais il a aussi quelques qualités que tout le monde lui reconnaît : il est franc.
M. le président Charles de Courson. Nous vous laissons la responsabilité de cette appréciation !
M. Rémy Garnier. Il l’a été avec moi, du moins. Je suis absolument convaincu que s’il avait su que je savais, il en aurait parlé. A contrario, le fait qu’il n’en ait pas parlé m’incite à penser qu’il n’était pas au courant. Et, s’il ne l’était pas, c’est parce que la direction générale des finances publiques l’a enfumé. Elle a d’ailleurs enfumé tout le monde, en haut comme en bas, et j’en suis la première victime.
M. le président Charles de Courson. Qu’en est-il des laboratoires ?
M. Rémy Garnier. Il ne faut pas oublier l’affaire de la société Cahuzac Conseil, qui a facturé, de 1993 à 1997 ou 1998, environ 5 millions de francs de prestations.
M. le président Charles de Courson. Comment connaissez-vous ce chiffre ?
M. Rémy Garnier. M. Fabrice Arfi m’a laissé prendre copie des données essentielles des comptes, année par année. Ce n’est un secret pour personne puisque les sociétés ont obligation de les publier : il suffit de se rendre au greffe du tribunal de commerce de Paris. M. Arfi avait ces documents.
M. le président Charles de Courson. Il s’agit de la partie française des versements.
M. Rémy Garnier. Oui, c’est la partie émergée de l’iceberg. On constate d’ailleurs que le chiffre d’affaires baisse année après année, ce qui amène à se demander s’il n’y a pas un phénomène de vases communicants, les versements augmentant en Suisse à mesure qu’ils baissent en France. Mais nous sommes là en pleine supposition.
Mme Marie-Christine Dalloz. Au moment de l’affaire France Prune, Michel Gonelle est maire de Villeneuve-sur-Lot et concurrent de Jérôme Cahuzac. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous le choisissez comme avocat, sachant que vous étiez en conflit dès 1999 avec M. Cahuzac ? En quelle année parlez-vous avec lui de manière précise de l’enregistrement ?
M. Rémy Garnier. En 2006.
Mme Marie-Christine Dalloz. Les problèmes rencontrés avec France Prune se traduisent par une première mesure disciplinaire à votre encontre.
M. Rémy Garnier. La première mesure disciplinaire remonte à 2001, et M. Cahuzac n’a rien à voir là-dedans.
Mme Marie-Christine Dalloz. En 2002 ou 2003, vous apprenez l’existence d’un enregistrement. Or vous attendez 2006 pour demander à M. Gonelle des précisions à ce sujet.
M. Rémy Garnier. Oui.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pourtant, il est votre avocat avant cette date.
M. Rémy Garnier. Je vous vois venir : je suis le suspect idéal !
Mme Marie-Christine Dalloz. Pas du tout ! Je souhaite seulement comprendre.
M. Rémy Garnier. Je suis le suspect idéal pour trois raisons.
Premièrement, puisque Cahuzac a effacé des redressements en 1999, on m’accuse d’avoir voulu me venger. Deuxièmement, je mentionne le compte suisse dans mon mémoire de 2008. Troisièmement, je suis encore censé vouloir me venger après le rendez-vous du 26 octobre, puisqu’il n’a pas donné suite à ma requête.
J’en reviens à votre question.
En 1999, M. Cahuzac était député, et n’importe quel député de quelque bord que ce soit aurait fait la même démarche. Je n’ai jamais eu le moindre grief contre Cahuzac personnellement. Mais je considère que son intervention et le coup d’éponge donné par Christian Sautter étaient parfaitement illégaux. Je tiens d’ailleurs à votre disposition un document qui confirme mon analyse. Il s’agit d’une ordonnance d’irrecevabilité faisant suite à une de mes plaintes contre la plus haute hiérarchie, signée par Mme Corinne Goetzmann, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris : « Ces interventions ministérielles que la partie civile contestait n’étaient pas susceptibles d’être assimilées à une transaction normale. Elles étaient susceptibles de constituer les délits d’abus d’autorité dirigé contre l’administration, de concussion et d’opposition à fonctions. »
Mme Marie-Christine Dalloz. Confirmez-vous par ailleurs que le mémoire en défense rédigé par M. Marc Le Roux, du bureau DRH1A, contre votre propre mémoire de 2008 est daté du 25 octobre 2012, soit la veille de votre rencontre avec le ministre Jérôme Cahuzac ?
M. Rémy Garnier. Tout à fait.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Votre avocat Maître Gonelle et vous-même avez un ami commun, désigné tantôt comme inspecteur des impôts, tantôt comme aviseur, tantôt comme contrôleur. Choisissant une voie informelle, et non l’article 40 du code de procédure pénale ou la divulgation à la presse, Me Gonelle a informé cet ami du message mentionnant le compte en Suisse.
M. Rémy Garnier. J’ai en effet pour avocat Me Gonelle, ancien député-maire RPR de Villeneuve-sur-Lot, ce qui me fait considérer comme suspect. Or, politiquement, je me situe aux antipodes de M. Gonelle : je suis un militant syndical CGT et mon précédent avocat était Me Gérard Boulanger, lui-même président d’une section locale de la Ligue des droits de l’homme. On peut appartenir à des bords différents et posséder un plus petit commun dénominateur, à savoir le respect des lois de la République, de la déontologie et de l’égalité des citoyens devant l’impôt.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’administration fiscale a-t-elle demandé la suppression de tel ou tel passage des mémoires successifs que vous lui avez adressés, au motif qu’ils seraient injurieux ou diffamatoires ? De même, est-il arrivé qu’une juridiction administrative biffe certains passages pour le même motif, ou transmette le mémoire au procureur de la République, estimant que des éléments pouvaient être caractéristiques d’infractions pénales ?
M. Rémy Garnier. Dans une décision qui par ailleurs me donnait raison, le tribunal administratif a censuré deux passages qu’il jugeait diffamatoires. Cela m’a amené à faire appel alors que j’avais obtenu gain de cause. Après deux ans d’instruction et d’échanges de mémoires, la cour administrative d’appel a considéré qu’elle n’était pas compétente en appel et a transmis le dossier en cassation au Conseil d’État. Il m’a alors été demandé de désigner un avocat. J’ai considéré que je m’étais assez ruiné comme cela pendant ces douze années de procédure. Habituellement, je me défends tout seul, sauf au pénal où je suis assisté par Me Gonelle. Bref, je n’ai pas voulu payer un avocat, d’autant plus qu’il n’y avait pas, à mon sens, de motif valable de cassation.
Le premier passage considéré comme diffamatoire concerne un chef de brigade, qui m’a fait virer en 2001…
M. le président Charles de Courson. Je comprends, vu ce que vous avez enduré, que vous soyez très impliqué dans cette affaire. Mais, pour notre part, nous nous occupons de l’affaire Cahuzac et je ne crois pas qu’il y ait de lien.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il y a un lien ! Dans un de vos mémoires, monsieur Garnier, vous dévoilez l’existence d’un compte suisse. L’administration fiscale demande-t-elle la suppression de ce passage ?
M. Rémy Garnier. Non.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Donc l’administration accepte ce passage. Il est important de le savoir.
Quant aux deux passages que vous évoquez, est-ce le juge qui les supprime d’office sans que l’administration l’ait demandé ?
M. Rémy Garnier. Oui. L’administration n’avait pas soulevé cette question.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. MM. Letellier et Pedebas vous auraient indiqué en passant que le compte suisse était alimenté par des versements réalisés par des laboratoires. Pourriez-vous préciser ?
M. Rémy Garnier. Leur dossier était ouvert. Ils ont affirmé avoir la liste des laboratoires qui ont alimenté le compte. Je leur ai demandé s’ils avaient les montants laboratoire par laboratoire, ils m’ont répondu par la négative.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Et le montant global ?
M. Rémy Garnier. Non, même si, à un moment donné, il a été question de 1,5 million d’euros.
M. le président Charles de Courson. Les juges d’instruction auront la réponse par la voie judiciaire.
M. Rémy Garnier. Je précise : il était question de 1 million d’euros au départ, puis de 1,5 million.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Je peux comprendre votre amertume et je veux bien croire que vous avez essayé de faire correctement votre travail avant d’être confronté à des blocages.
Cela étant, si l’on considère la chronologie depuis l’affaire France Prune, on se demande pourquoi, neuf ans après, vous faites mention de M. Cahuzac dans un mémoire en défense qui concerne un contentieux vous opposant à votre hiérarchie. Et pourquoi ne mettez-vous en cause qu’un seul élu local ?
M. Rémy Garnier. Mes actions devant la justice administrative répondent à des sanctions que je conteste. Dans ce cadre, je me défends tout seul, sans Me Gonelle. Celui-ci n’est intervenu que sur les dossiers au pénal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Lorsque vous rencontrez M. Gonelle, vous devez bien lui demander confirmation de ce que vous avez ouï dire par un ami commun. Or, d’un seul coup, plus personne n’en parle, et c’est en 2008 que vous revenez à la charge. Pourquoi Cahuzac réapparaît-il à ce moment-là ?
M. Rémy Garnier. Depuis 2001, je vis sous la menace permanente d’une révocation. Croyez-vous que, dans ce contexte-là, le compte suisse de Cahuzac soit ma préoccupation première ?
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Alors pourquoi en parlez-vous en 2008 ?
M. Rémy Garnier. Lorsque je suis investi de nouveau d’une mission de recherche, je reviens à mon cœur de métier.
À cet égard, il convient de distinguer la mission de recherche, qui consiste à « ratisser large » pour alimenter les brigades de vérification, et la vérification proprement dite. Pour ma part, je suis chargé des recherches, même si l’on ne m’en donne ni les moyens juridiques ni les moyens matériels.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Pouvez-vous récapituler les personnes à qui vous avez dit ou laissé entendre que M. Cahuzac aurait un compte en Suisse ?
M. Rémy Garnier. J’ai rédigé ce document en 2008 mais je n’ai parlé à personne. J’estime avoir fait mon boulot. L’affaire est entre les mains de ma hiérarchie. Moi, j’ai assez à faire à m’occuper de ma défense devant les juridictions. C’est une occupation à plein temps, y compris depuis trois ans que je suis à la retraite. Le compte suisse de Cahuzac, ce n’est pas mes oignons : je défends mon honneur !
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je comprends. Néanmoins, n’en avez-vous pas parlé localement, par exemple à la gendarmerie ou à certains de vos amis ?
M. Rémy Garnier. J’ai déjà évoqué l’article 40 du code de procédure pénale et la façon dont la justice fonctionnait à Agen. Mais il y a mieux…
M. le président Charles de Courson. Répondez précisément à la question précise de Mme Bechtel.
M. Rémy Garnier. Je n’ai pas parlé du compte, sauf, évidemment, entre personnes partageant le même secret.
M. le président Charles de Courson. Qui sont ces personnes ?
M. Rémy Garnier. Me Gonelle…
M. Philippe Houillon. Et le président de la Ligue des droits de l’homme ?
M. Rémy Garnier. Bien sûr.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mais pas de nouveaux enquêteurs ?
M. Rémy Garnier. Si, lorsque j’ai été interrogé par la DNIF au début de janvier 2013, par exemple.
Permettez-moi tout de même faire une observation sur le fonctionnement de la justice. J’ai signalé au procureur de la République un cas de faux en écritures publiques commis par un officier de police judiciaire, c'est-à-dire non pas un délit mais un crime. Le procureur l’a classé sans suite. La justice ne fonctionne pas comme elle le devrait !
Mme Marie-Françoise Bechtel. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question, qui est purement factuelle ?
M. Rémy Garnier. Je le répète, je n’ai jamais parlé à personne. J’ai rédigé un mémoire et cela s’est arrêté là.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Absolument personne ?
M. Rémy Garnier. À l’exception des enquêteurs de la DNIF, de M. Arfi, de M. Letellier.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Personne dans l’administration fiscale locale ?
M. Rémy Garnier. À ma connaissance, non.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Aucun membre du cabinet de M. Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot ?
M. Rémy Garnier. Absolument pas.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Aucun gendarme ?
M. Rémy Garnier. Non. Je ne vois pas où vous voulez en venir.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Garnier, merci pour ces précieuses informations.
Audition du mardi 18 juin 2013
À 8 heures 45 : M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République.
M. le président Charles de Courson. Nous recevons M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République.
Nous avons demandé à vous entendre, monsieur Zabulon, car il a été fait état d’une conversation téléphonique que vous avez eue, le 15 décembre 2012, avec M. Michel Gonelle, à propos de l’enregistrement dans lequel M. Jérôme Cahuzac parle de son compte suisse avec son chargé d’affaires. M. Gonelle, au cours de son audition, le 21 mai dernier, a indiqué vous avoir appelé pour attester auprès du Président de la République de l’authenticité de cet enregistrement. Tel est du moins le récit qu’il nous a fait de cet échange téléphonique.
Nous souhaiterions donc connaître votre version de cet épisode et savoir quelles suites vous lui avez données.
(M. Zabulon prête serment)
M. le président Charles de Courson. Je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Puis, notre rapporteur, Alain Claeys, vous interrogera. Ensuite, nos collègues vous poseront leurs questions.
M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, merci de m’avoir convié devant votre commission pour vous apporter les éclaircissements et les informations que vous attendez sur l’échange téléphonique que j’ai eu avec Michel Gonelle.
En ce samedi 15 décembre au matin, je suis à mon domicile lorsque le standard de la présidence de la République m’appelle pour me dire que Michel Gonelle, ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, qui affirme bien me connaître, souhaite me parler. Je le fais aussitôt rappeler et prends la communication. Dans un premier temps, il me demande s’il nous est possible de nous rencontrer en ville. Je n’en avais malheureusement pas le temps, étant attendu à la Présidence où nous devions porter la main aux derniers préparatifs de l’arbre de Noël, événement important dans la vie de l’Élysée. Je pouvais en revanche prendre dix minutes ou un quart d’heure pour converser avec M. Gonelle et l’écouter, puisqu’il avait pris la peine de m’appeler. Il me dit alors que depuis les révélations de Mediapart sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, une dizaine de jours plus tôt, il fait l’objet d’une forte pression des journalistes qui l’accusent de détenir le fameux enregistrement par lequel « le scandale » arrive. Il me dit vivre très mal cette pression, n’être pour rien dans cette affaire et souhaiter se confier à moi. Et là suit un récit, une sorte de confession, où il m’indique que fin 2000, à la suite d’une conversation téléphonique avec Jérôme Cahuzac, dans laquelle celui-ci l’informe de la venue du ministre de l’intérieur pour l’inauguration du nouveau commissariat de Villeneuve-sur-Lot, le portable de Jérôme Cahuzac aurait malencontreusement rappelé le sien. C’est ainsi que s’est retrouvé sur sa messagerie un échange entre une personne présumée être Jérôme Cahuzac – c’est du moins ce qu’il affirme – et un tiers au sujet de ce fameux compte en Suisse.
« Bien, et alors ? », lui dis-je. Il m’indique qu’il a conservé cet enregistrement, l’a fait graver sur CD en deux exemplaires et l’a conservé pendant de nombreuses années dans un tiroir. Il me dit qu’il n’avait absolument pas l’intention de s’en servir contre Jérôme Cahuzac, avec qui ses relations sont désormais apaisées, qu’il est retiré de la vie politique et que ce ne pas là ses méthodes, ni des méthodes en général. Il a conservé ces deux exemplaires de l’enregistrement et fin 2006-début 2007, les a remis au magistrat Jean-Louis Bruguière, candidat à la députation en 2007 contre Jérôme Cahuzac. « Mais je pense qu’il ne s’en ait pas servi », ajoute-t-il aussitôt. J’écoute tout cela avec beaucoup d’attention. Il m’annonce aussi qu’il disposerait d’une lettre qu’il pourrait remettre si nécessaire au Président de la République et me demande en quelque sorte quels sont mes conseils, mes instructions.
À la fois je mesure l’importance des informations qui sont portées à ma connaissance et je m’interroge – j’y reviendrai dans quelques instants. Je ne prends pas de position sur-le-champ, ne lui dis pas « Faites ceci ou ne faites pas cela », mais : « Monsieur Gonelle, je vais d’abord référer en interne, dans ma maison, des informations que vous venez de porter à ma connaissance. Convenons que nous nous rappelons la semaine prochaine. »
Je me rends à la Présidence, comme il était prévu. Je vais voir le secrétaire général de la Présidence, Pierre-René Lemas, à qui je commence à expliquer ce que je viens d’entendre. Il me propose que nous allions voir ensemble le Président de la République. « Cela devrait évidemment l’intéresser au plus haut point. », dit-il Dans le bureau du Président, je rends alors compte en détail au Président et au secrétaire général de l’entretien que je viens d’avoir avec Michel Gonelle. Le Président est très attentif à ce que j’expose et me demande ce que j’en pense. À la fin de l’entretien, il me dit, et ce sans aucune hésitation : « Si vous avez un nouveau contact avec M. Gonelle, s’il doit vous rappeler ou si vous devez le rappeler, dites-lui que ces informations doivent être sans délai portées à la connaissance de la justice. » Il ne me donne aucune autre instruction que celle-ci, ajoutant : « Si ce fameux courrier arrive, nous le transmettrons à la justice, car c’est une affaire qui relève de la justice. »
Le week-end se passe. Le lundi 17 décembre au matin, après notre traditionnelle réunion d’agenda à 9 heures, je constate qu’entre-temps j’ai reçu quelques appels, dont l’un de Michel Gonelle. Je demande à ma secrétaire de me passer ces correspondants, dont Michel Gonelle. Et là se produit quelque chose que je vais détailler car j’ai vu que Michel Gonelle l’avait expliqué avec un luxe de détails dont certains pourraient éventuellement laisser penser à je ne sais quelle manœuvre de ma part. Les choses sont très simples : au moment où ma secrétaire va me passer Michel Gonelle, dont elle a composé le numéro, je reçois en interne un appel du Palais. Je décroche, la conversation dure un peu, et je ne prends pas Michel Gonelle. Je rate l’appel. Ma secrétaire lui dit : « Je ne vais pas vous faire attendre. Entre-temps, M. Zabulon a pris une communication. Rappelez plus tard ou je vous rappellerai ». Bref, nous nous sommes ratés – j’imagine que ce genre de situation a déjà dû vous arriver.
Je n’ai donc pas M. Gonelle au téléphone en cette matinée du 17 décembre. Le reste de ma journée de travail s’enchaîne, entre réunions et rendez-vous. Je me dis que vraisemblablement M. Gonelle, qui cherche à me joindre, qui attend de ma part une position, une réponse, des instructions, ne manquera pas de me rappeler. Il ne m’a jamais rappelé.
En ce lundi 17 décembre, je me pose quand même des questions. Tout cela s’est décanté dans mon esprit. L’entretien date du samedi. J’ai immédiatement informé le Président de la République. Je précise que le samedi 15, j’ai également passé un coup de fil à Jérôme Cahuzac, auquel j’ai fait part de cet entretien avec Michel Gonelle. Pourquoi l’ai-je fait ? À la mi-décembre – les informations livrées par Mediapart sont toutes récentes –, la majorité des commentateurs et des observateurs donnent crédit à Jérôme Cahuzac de sa bonne foi. On en accorde peu à l’époque aux affirmations de Mediapart. J’ai considéré loyal, en tant que collaborateur du Président de la République, d’informer Jérôme Cahuzac de la teneur de cet échange. Il m’a écouté, notre conversation a été brève – il était, je crois, en rendez-vous ou occupé. Il m’a remercié de ces informations. Il n’avait pas l’air plus surpris que cela. Je me disais déjà à ce moment qu’il était probable que de toute façon, la teneur de cet échange ne reste pas très longtemps confidentielle. La suite l’a d’ailleurs prouvé.
Après cet appel raté du 17 décembre, dès le milieu de la semaine, on commence à parler dans la presse de cet échange avec Michel Gonelle. Je n’ai pas retrouvé précisément d’articles mais en tout cas, le vendredi 21 décembre, tout l’entretien se retrouve dans les journaux. Durant cette semaine du 17 décembre, au fur et à mesure que je réfléchis aux déclarations qui m’ont été faites, je me pose deux ou trois questions. Lesquelles ?
Tout d’abord, je vous le dis très franchement, je m’interroge sur la crédibilité qu’il convient d’apporter à ce récit. En effet, ce qui m’a été exposé le 15 décembre est contraire à ce que Michel Gonelle a affirmé quelques jours plus tôt, et dont je vous donne lecture – je crois qu’il s’agit d’un article de Sud-Ouest, daté du 9 ou 10 décembre. On y cite le nom de Michel Gonelle, ex-maire de Villeneuve-sur-Lot, comme étant le détenteur du fameux enregistrement. « Je n’ai absolument rien à voir avec cette affaire. C’est une plaisanterie. J’aurais gardé un enregistrement pendant douze ans dans un carton sans m’en servir avant ? Puis mes relations avec Jérôme Cahuzac sont très sereines, indique Me Gonelle, qui voit plutôt dans ces soupçons envers sa personne une manœuvre de communication ou de diversion. » Il va plus loin – je cite toujours : « La thèse d’une origine lot-et-garonnaise de cet enregistrement est une manière habile de brouiller les pistes. C’est une grande manipulation. » Je m’interroge : quand Michel Gonelle dit-il la vérité ? Le 10 décembre, lorsqu’il nie être en quoi que ce soit responsable de cette affaire ? Le 15 décembre, lors de sa « confession » téléphonique auprès de moi ?
Je suis également perplexe que Michel Gonelle ait conservé cet enregistrement, l’ait gravé sur CD, tout en disant n’avoir pas eu l’intention de s’en servir, enfin l’ait communiqué à un tiers – qui n’était pas n’importe qui –, Jean-Louis Bruguière, candidat à la députation.
Enfin, Michel Gonelle, que j’ai connu et côtoyé pendant les deux ans et demi où j’ai été sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, est un avocat, un homme de loi. Ancien député et ancien maire, il connaît le droit. Pourquoi juge-t-il utile de passer par la présidence de la République plutôt que par la justice pour contribuer à la manifestation de la vérité ? On aurait pu imaginer que face à la pression médiatique, il s’exprime publiquement et explique au cours d’une conférence de presse quel avait été son rôle dans cette affaire, ce qui aurait contribué de manière spontanée et transparente à la manifestation de la vérité.
Je me demande enfin s’il n’y a pas eu là – je pèse mes mots – une forme d’instrumentalisation pour faire connaître, par présidence de la République interposée, le rôle qui a été le sien. Telle est mon analyse en cette semaine du 17 décembre. Lorsque je découvre l’intégralité de nos échanges dans la presse, en particulier dans Mediapart, je me dis que l’affaire prend une autre dimension. Et je n’aurai plus jamais aucun autre contact avec Michel Gonelle.
J’en suis arrivé à la conclusion que l’on a peut-être instrumentalisé la présidence de la République en y produisant un témoignage qui, à l’évidence, aurait dû être porté à la connaissance de la justice, et depuis longtemps, puisque, je le rappelle, l’enregistrement date de 2000. On l’a utilisée pour révéler le rôle de Michel Gonelle en cette affaire. L’attitude constante de la Présidence a été de considérer qu’il appartenait à la justice, et à elle seule, de démêler les fils de la vérité.
Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments factuels que j’ai cru utile de porter à votre connaissance et que j’ai complétés de quelques éléments d’analyse. Je suis bien entendu maintenant prêt à répondre à vos questions.
M. Alain Claeys, rapporteur. Soyons très précis. C’est le samedi 15 décembre que vous recevez l’appel de M. Gonelle. Il ne vous est pas possible de le rencontrer. Il vous expose sa version des faits et vous dit qu’il a un document pour le Président de la République.
M. Alain Zabulon. Il aurait un courrier manuscrit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce document n’est jamais parvenu à la Présidence de la République ?
M. Alain Zabulon. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce même samedi 15, vous avertissez le secrétaire général de l’Élysée et évoquez le sujet avec le Président de la République. Il vous est répondu que si l’intéressé a des documents, il doit les transmettre à la justice. À cette époque, il n’y a qu’une procédure judiciaire en cours, celle intentée par M. Cahuzac pour diffamation.
Vous souhaitez de nouveau joindre M. Gonelle au téléphone le 17 décembre. Mais pris par une autre communication, vous ratez son appel. Vous ne le rappelez pas ?
M. Alain Zabulon. Non, je ne le rappelle pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qui a déclaré à l’AFP que la Présidence demandait à M. Gonelle de « saisir la justice » ?
M. Alain Zabulon. Lorsqu’en milieu de semaine, la teneur de mon entretien avec Michel Gonelle commence de se répandre dans la presse, le chargé de communication de la Présidence me demande ce qu’il en est de cet entretien dont on parle. Je lui dis que je le confirme. Et nous convenons de répondre la stricte vérité : premièrement, cet entretien, au cours duquel Michel Gonelle a communiqué certaines informations, a bien eu lieu ; deuxièmement, ces informations ont vocation à être transmises à la justice. Il n’y a pas eu de communiqué de presse de la présidence de la République à proprement parler. C’est une réponse orale qui a été faite à des journalistes interrogeant la Présidence sur la teneur de cet entretien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans cet entretien, M. Gonelle vous indique qu’il a fait copier cet enregistrement en deux exemplaires et que fin 2006-début 2007, il les a remis à Jean-Louis Bruguière ? Les deux ?
M. Alain Zabulon. Il m’a dit qu’il lui en avait remis un. J’ignore ce qu’il est advenu du deuxième. Il me dit tout cela, je l’entends, mais je ne peux pas en juger.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous par la suite entrepris quoi que ce soit pour obtenir des informations sur la réalité des affirmations de Mediapart ?
M. Alain Zabulon. Non, je n’ai eu aucun autre contact sur cette affaire. Que les choses soient claires, le Président de la République ne m’a pas chargé de suivre à son cabinet ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». Si je suis aujourd’hui devant vous, c’est parce que j’ai été concerné de manière indirecte, à travers un coup de fil que j’ai reçu. Le Président ne m’a pas demandé de mener des investigations, de faire des vérifications, de passer des coups de fil sur quoi que ce soit. Mon implication dans cette affaire est strictement limitée à ce que je vous ai exposé ce matin.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi n’avoir pas rappelé M. Gonelle après le 17 décembre ? Il aurait été simple de lui dire : « Si vous avez des éléments, transmettez-les à la justice. »
M. Alain Zabulon. Après que nous nous sommes ratés le 17 décembre au matin dans les conditions que j’ai indiquées, je m’interroge, je me demande ce qu’il y a derrière tout cela. Je me dis qu’inévitablement il va me rappeler. La plupart des personnes qui n’arrivent pas à me joindre à un moment donné me rappellent un peu plus tard.
Michel Gonelle vous a dit lors de son audition que la présidence de la République ne l’avait pas rappelé. Je peux tout aussi bien dire qu’il ne m’a pas rappelé. Nous avions convenu de nous joindre de nouveau dans le courant de la semaine. Il n’avait pas été formellement précisé lequel de nous deux devait appeler. Dès lors qu’il était demandeur et souhaitait des indications de ma part, je m’attendais assez naturellement à ce qu’il me rappelle. Il ne l’a pas fait et comme, je le redis, je m’interrogeais sur la crédibilité de son témoignage, j’ai considéré qu’il était préférable d’attendre qu’il rappelle. S’il m’avait rappelé, j’aurais bien évidemment pris la communication et lui aurais dit ce qu’il était prévu que je lui dise, à savoir qu’il devait saisir la justice. Je n’en ai pas eu le temps puisque très vite, notre entretien a commencé d’être connu à l’extérieur.
Je me suis demandé comment la teneur de cet entretien, censé être confidentiel, avait pu être ainsi dévoilée. Il est un élément dont je n’avais pas connaissance le 15 décembre et que je n’ai appris que récemment, lorsque j’ai regardé, avec attention comme vous pouvez l’imaginer, la déposition de Me Gonelle devant vous. J’ai appris que le 14 décembre, Edwy Plenel et Michel Gonelle s’étaient rencontrés. Edwy Plenel, il l’a confirmé devant votre commission, lui a dit de se dévoiler, de dire la vérité, d’assumer le rôle qui a été le sien dans cette affaire. Michel Gonelle lui a répondu : « J’ai une autre idée ». Et le lendemain, le 15 décembre, il appelle – je cite – « une vieille connaissance de l’Elysée », votre serviteur.
Le 10 décembre, il déclare n’être pour rien dans cette affaire. Le 14 – mais cela, je ne le savais pas le 15 –, il rencontre Edwy Plenel, auquel il indique qu’il ne va pas se dévoiler mais « s’y prendre autrement ». Le 15, il m’appelle. Et en milieu-fin de semaine, la teneur de notre conversation se retrouve sur la place publique. Voilà la chronologie des faits sur laquelle il ne m’appartient pas de tirer de conclusions – c’est le rôle de votre commission. Mais quand j’ai parlé tout à l’heure d’instrumentalisation, de manœuvres, d’utilisation de la Présidence de la République pour révéler une partie de la vérité sur cette affaire, j’ai le sentiment de ne pas être très loin de la réalité.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’y a qu’un point de divergence avec la déclaration de M. Gonelle devant nous le 21 mai. Il prétend en effet que votre secrétariat lui aurait dit que vous le rappelleriez.
M. Alain Zabulon. Ce n’est même pas un point de divergence. Je ne saurais pas vous dire précisément ce qu’a répondu ma secrétaire. A-t-elle dit « M. Zabulon vous rappellera » ou « Rappelez cet après-midi » ? Honnêtement, je n’en sais rien. Peut-être a-t-elle dit « M. Zabulon vous rappellera. » Ayant vu que M. Gonelle avait donné force détails sur ce point, j’ai tenu à vous expliquer précisément les conditions dans lesquelles nous nous sommes ratés le 17 au matin. La journée a ensuite passé. Réfléchissant à tout cela, je me suis dit que si Michel Gonelle souhaitait me parler, il avait mon numéro et savait où me joindre. Il savait aussi que je prendrais son appel puisque, la preuve, j’avais moi-même essayé de l’appeler le lundi matin. S’il avait voulu me parler, il n’aurait pas manqué de me rappeler, comme il avait su le faire le samedi matin et le lundi matin.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous nous dites n’avoir pas eu de contacts pour vous informer plus avant sur cette affaire. Des informations vous sont-elles remontées ?
M. Alain Zabulon. Ma connaissance de cette affaire, je le dis avec solennité, rappelant que je témoigne sous serment, se limite à ce que j’ai lu dans la presse et à l’échange que j’ai eu avec Michel Gonelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque vous occupiez des fonctions dans la région de Jérôme Cahuzac, avez-vous, à un moment ou un autre, eu connaissance d’informations laissant entendre que celui-ci pouvait avoir un compte en Suisse ?
M. Alain Zabulon. Je n’avais jamais entendu parler de cette affaire jusqu’aux révélations de Mediapart.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez rien entendu non plus concernant son dossier fiscal qui serait remonté dans la région ?
M. Alain Zabulon. Je n’ai eu aucune information là-dessus.
Je suis nommé sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot en août 1997. Jérôme Cahuzac vient d’être élu député en juin, Michel Gonelle est maire de la ville. Ce sont deux personnalités politiques importantes de l’arrondissement. Les deux hommes affichent une courtoisie républicaine de bon aloi. Les choses se passent bien. Le sous-préfet que je suis perçoit bien qu’il y aura, tôt ou tard, un rendez-vous entre les deux hommes aux municipales. Jérôme Cahuzac a de l’ambition. À l’époque, les commentateurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’un homme politique talentueux, manifestement en train de réussir son implantation dans le Lot-et-Garonne. Il est très présent. Il ferraille avec Jean François-Poncet, à l’époque sénateur et président du conseil général. Bref, c’est là la vie politique locale ordinaire d’un département, un peu agitée car on a du tempérament dans le Sud-Ouest. Mais à aucun moment, je n’entends parler de quoi que ce soit de trouble ou d’illégal concernant Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu connaissance de la note de la DCRI, demandée par le ministre, sur la banque UBS ?
M. Alain Zabulon. Je n’ai jamais eu connaissance de cette note, dont j’ignore d’ailleurs si elle existe. Et je n’ai jamais eu entre les mains le moindre document écrit sur « l’affaire Cahuzac ». Je n’ai ici que des coupures de presse annotées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je rappelle aux membres de la commission que le ministre de l’intérieur nous a transmis cette note la semaine dernière. Je confirme que le nom de Jérôme Cahuzac n’y figure mais c’est une note sur la banque UBS.
M. le président Charles de Courson. Vous avez été, monsieur Zabulon, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot du 9 juillet 1997 au 4 février 2000. Quelle était la nature de vos relations avec M. Gonelle ? Après votre départ du Lot-et-Garonne, avez-vous continué à avoir des relations avec celui qui était encore pour quelque temps maire de Villeneuve-sur-Lot ?
M. Alain Zabulon. Pendant mes fonctions à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot, mes relations avec Michel Gonelle sont bonnes. Nous avons géré ensemble plusieurs dossiers lourds dans l’arrondissement, notamment la création d’une communauté de communes. Nous avons aussi dû faire face à une situation économique pas facile. J’ai avec lui, de même qu’avec le député de la circonscription et l’ensemble des élus, de bonnes relations, constructives et de travail. J’ai quitté Villeneuve-sur-Lot en février 2000 et n’ai pas revu Michel Gonelle depuis, ni n’ai eu aucun contact avec lui.
M. le président Charles de Courson. Aucun contact entre le 4 février 2000 et le 15 décembre 2012 ?
M. Alain Zabulon. Non.
M. le président Charles de Courson. Jamais ? Aucun ?
M. Alain Zabulon. Pardon, en janvier ou février 2006, alors que sous-préfet d’Antony, je viens d’être nommé préfet délégué auprès du préfet de l’Essonne, il me passe un rapide coup de fil pour me féliciter.
M. le président Charles de Courson. Comment expliquez-vous que M. Gonelle vous appelle ce 15 décembre ? Ce n’est pas anodin.
M. Alain Zabulon. Je n’ai pas d’explication sur-le-champ. Je suis surpris. C’est d’ailleurs pourquoi je suis très peu disert pendant l’échange, je l’écoute mais interviens très peu. À la réflexion, mon analyse est que Michel Gonelle porte depuis des années un fardeau, ce fameux enregistrement gravé sur CD qu’il a rangé dans un tiroir. Début décembre, il est sous la pression de la presse qui le somme de dire la vérité, Edwy Plenel l’a dit lui-même devant votre commission. Michel Gonelle cherche une issue. Peut-être a-t-il vu en ma personne, parce qu’il est vrai que j’avais des relations cordiales avec lui, une solution en se disant : « Je connais Zabulon à l’Elysée, il sera sûrement de bon conseil, je vais l’appeler. » Si ce n’est que Michel Gonelle est un homme de loi avisé. Ce n’est pas un débutant ne connaissant pas encore bien les institutions ni les circuits. Il n’ignore pas que ce n’est pas la voie normale, qu’il devrait soit parler publiquement, comme Mediapart l’incite à le faire, soit saisir la justice, comme il aurait d’ailleurs dû le faire depuis des années. J’ai l’impression qu’en m’appelant, il cherche une solution, une porte de sortie – qui se trouve juste être celle de la Présidence de la République. Porte de sortie quelque peu singulière !
M. le président Charles de Courson. D’après vos souvenirs, vous a-t-il dit qu’il avait préparé une lettre pour le Président de la République qu’il voulait vous remettre pour que vous la lui transmettiez ?
M. Alain Zabulon. Il m’a parlé à coup sûr d’un courrier destiné au Président. Souhaitait-il le remettre à moi en personne ou l’envoyer ? Je ne sais plus précisément. Mais je confirme qu’il avait bien un courrier à l’intention du Président.
M. le président Charles de Courson. Accompagné de l’enregistrement ?
M. Alain Zabulon. Non, un courrier simplement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Courrier qui n’est jamais parvenu à la Présidence.
M. Alain Zabulon. Non. En tout cas, pour ma part, je ne l’ai jamais vu. Je n’ai certes pas rappelé Michel Gonelle le 17 décembre. Mais rien ne l’empêchait de déposer ce courrier à la boîte aux lettres du 55, rue du faubourg Saint-Honoré ou de l’envoyer par la Poste. Or, celui-ci n’est jamais arrivé.
Dans le courant de la semaine, en même temps que tout cela se décante dans mon esprit, je constate tout d’abord qu’il ne me rappelle pas, ensuite qu’aucun courrier ne me parvient, mais qu’en revanche, assez vite, la presse évoque notre entretien. Je cite « Interrogé sur cet échange, Michel Gonelle déclare : « Je ne démens pas » »
M. le président Charles de Courson. Vous évoquez une instrumentalisation de la Présidence de la République…
M. Alain Zabulon. Supposition de ma part.
M. le président Charles de Courson. À quel type d’instrumentalisation pensez-vous ?
M. Alain Zabulon. Quelles étaient les voies possibles pour Michel Gonelle ? Saisir la justice, ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, quand bien même aucune instruction n’était ouverte ni aucune procédure lancée. À ma connaissance, il n’est pas nécessaire qu’une procédure soit engagée pour saisir la justice de faits susceptibles de constituer une infraction.
Deuxième voie possible : rendre public son rôle dans l’affaire, organiser une conférence de presse où il aurait confirmé être le détenteur de l’enregistrement et indiqué ce qu’il en avait fait. Il n’a utilisé ni l’une ni l’autre de ces voies, mais une troisième, faisant appel, dit-il, à « une vieille connaissance ».
Mme Marie-Christine Dalloz. En préalable, je voudrais rappeler que cette commission d’enquête n’a pas vocation à s’intéresser à Me Gonelle spécifiquement. Il est étonnant que ce matin nous ne cessions de revenir sur lui.
M. Alain Claeys, rapporteur. La seule raison pour laquelle nous avons demandé à M. Zabulon de venir témoigner devant nous est que M. Gonelle a pris contact avec lui dans ses fonctions de directeur adjoint du cabinet du Président de la République. Voilà pourquoi nous avons parlé de M. Gonelle.
Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur Zabulon, le 15 décembre, vous étiez occupé par les préparatifs de l’arbre de Noël de l’Élysée. Pour autant, la conversation téléphonique que vous avez avec Me Gonelle a dû être assez longue puisqu’il a eu le temps de vous livrer les deux éléments clés de cette affaire, à savoir la façon dont il s’est retrouvé en possession de l’enregistrement et comment un exemplaire a été donné à M. Bruguière. Il faut un certain temps pour raconter toutes ces péripéties. Il nous a dit qu’il vous avait rappelé le mardi 18 décembre. Vous dites, vous, que c’est le lundi 17. Qu’en est-il précisément ?
Vous avez jugé préférable que ce soit lui qui vous rappelle, mais il avait déjà fait deux démarches : il vous avait appelé, puis rappelé. Lorsqu’on connaît un peu Me Gonelle – nous l’avons auditionné –, il était évident qu’il ne reviendrait pas à la charge une troisième fois. Il est un peu facile de dire que vous attendiez qu’il vous rappelle. Si vous n’aviez d’autre message à lui faire passer que « Saisissez la justice » – conformément aux ordres que vous avait donnés le Président de la République –, vous auriez parfaitement pu l’appeler, vous, et lui dire que le Président souhaitait qu’il transmette à la justice tous les éléments dont il disposait.
M. Alain Zabulon. Notre conversation a duré un quart d’heure, vingt minutes environ. J’ai pris le temps de l’écouter très attentivement, sans l’interrompre.
Je confirme qu’il m’a rappelé le lundi 17 au matin, et non pas le mardi 18. J’ai ici une photocopie de la page du cahier d’appels – j’ai tenu à vérifier ce point.
Après avoir tenté de le rappeler et l’avoir raté dans les conditions que je vous ai expliquées, j’ai en effet considéré qu’il pouvait sans difficulté me rappeler, et d’ailleurs pensé qu’il le ferait assez vite. J’aurais bien sûr pris son appel et lui aurais fait part de la position du Président de la République sur cette affaire. Le temps en a manqué puisque dès le lendemain ou le surlendemain, on commençait à parler dans la presse de cet entretien, censé avoir été confidentiel. Si je ne l’ai pas rappelé, madame la députée, c’est pour ne pas alimenter un feuilleton « Échanges Zabulon/Gonelle » à l’intérieur d’une affaire déjà assez sensible et assez compliquée. Michel Gonelle n’avait pas besoin de recevoir des instructions ni des conseils de la Présidence de la République pour remplir son office de citoyen qui détenait des informations sur une affaire alors à la une.
M. Guillaume Larrivé. Vous êtes un éminent professionnel de l’action publique, expérimenté et reconnu comme tel. Vous avez été nommé préfet délégué par décret du Président Chirac en 2006 ; préfet de département par décret du Président Sarkozy à deux reprises, en Corrèze puis dans les Landes. Vous êtes désormais directeur adjoint du Président Hollande et, si l’on en croit la presse, vous pourriez être nommé demain en Conseil des ministres coordonnateur national du renseignement, preuve de la très grande confiance personnelle du Président de la République à votre endroit.
Mes questions portent sur les instructions qu’il vous a données le 15 décembre, et peut-être postérieurement. Vous nous avez expliqué que, dans son bureau, le 15 décembre, lorsque vous lui rendez compte, en présence du secrétaire général de l’Élysée, de votre entretien avec Me Gonelle, il vous dit « Si vous avez un nouveau contact [avec M. Gonelle], dites-lui que ces informations doivent être portées à la connaissance de la justice. » L’avez-vous par la suite informé de l’absence de nouveau contact ? Y a-t-il eu une note, un compte-rendu sur le fait que vous aviez échoué à entrer en contact avec Me Gonelle ? Avez-vous eu un entretien avec la directrice de cabinet, le secrétaire général de la Présidence ou le Président de la République lui-même à ce sujet ?
La présidence de la République a-t-elle envisagé de porter à la connaissance de la justice la teneur de l’entretien téléphonique dont vous rendez compte aujourd’hui pour la première fois publiquement devant notre commission ? Pourquoi ne pas avoir transmis un compte-rendu succinct à l’autorité judiciaire, peut-être sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ?
Vous nous avez dit, monsieur le directeur, n’avoir pas été chargé par le Président de la République de suivre pendant les semaines qui ont suivi cet entretien, ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». Qui, à l’Élysée, en a été chargé ? Je ne peux imaginer qu’aucun collaborateur du Président de la République ne l’ait tenu personnellement, directement et précisément, informé des suites de cette affaire ? Si ce n’est pas vous, qui devons-nous auditionner ? Sylvie Hubac, sa directrice de cabinet ? Pierre-René Lemas, secrétaire général de l’Élysée ?
M. Alain Zabulon. S’agissant de votre première question, en milieu ou en fin de semaine, à l’occasion d’une réunion de travail, le Président de la République m’a demandé si j’avais eu un nouveau contact avec Michel Gonelle. Je lui ai répondu que non. Il m’a dit : « De toute façon, cet entretien est maintenant rapporté dans la presse, je ne vois pas l’utilité de le rappeler. S’il rappelle, parlez-lui. » J’ai bien informé le Président de ce que Michel Gonelle ne m’avait pas rappelé et que je ne l’avais pas moi-même appelé.
En ce qui concerne la saisine de la justice, il ne faut pas inverser les rôles. C’est celui qui détient les informations qui doit les porter à la connaissance de la justice, pas celui auquel elles sont rapportées. Lorsque Michel Gonelle me fait connaître le 15 décembre quel a été son rôle en cette affaire, je ne dispose pas de preuves tangibles, seulement d’un témoignage oral, lequel diffère d’ailleurs de ce qu’il a déclaré cinq jours auparavant. Si quelqu’un devait saisir la justice, c’était l’intéressé, pas la Présidence.
Pour ce qui est du suivi de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac », j’imagine que le Président de la République, homme avisé, a eu les moyens de se renseigner s’il le souhaitait, a eu des contacts ou échangé sur cette affaire avec qui il le souhaitait. Mais dans l’organigramme de la présidence de la République, aucun collaborateur n’est chargé de rédiger chaque semaine une note sur « l’affaire Cahuzac ». Comme le Président l’a rappelé de manière constante, cette affaire, bien que présentant une dimension politique évidente, relève avant tout de la justice. Et le Président respecte la séparation des pouvoirs.
M. Guillaume Larrivé. Je ne voudrais pas que votre réponse laisse sous-entendre que sur les bancs de l’opposition, il y aurait un flottement sur ce point. Il va de soi que le Président de la République est le garant de l’indépendance de la justice. Ma question n’était pas de savoir si le chef de l’État avait donné instruction d’intervenir dans le cours de la procédure. Mais il va aussi de soi, Monsieur le directeur, sauf à envisager que le Président de la République collecte lui-même les éléments d’information et élabore lui-même ses revues de presse, qu’un collaborateur – en tout cas je veux le croire pour le bon fonctionnement de la Présidence – lui rend compte des différents développements de l’affaire.
M. Alain Zabulon. De ce qui figure dans la presse, oui. J’ai moi-même ici une revue de presse complète, comme tout le monde. Chaque jour a amené son lot de révélations dans cette affaire. Bien évidemment, le service de presse de l’Élysée, qui fait son travail, n’a pas manqué de communiquer les éléments de presse, pas seulement au Président de la République d’ailleurs, mais à tous les collaborateurs.
M. Jean-Pierre Gorges. Je voudrais revenir un instant sur les dates. J’en étais moi aussi resté à la date du mardi 18 pour le deuxième échange. Il me semble bien qu’il dit que lors du premier entretien, vous lui dites que vous le rappellerez, que vous l’avez rappelé le mardi mais que la communication, établie avec la standardiste, s’est coupée. Ce n’est pas lui qui a eu l’initiative du rappel, mais vous.
M. Jean-Marc Germain. M. Zabulon a expliqué que c’était l’inverse.
M. Jean-Pierre Gorges. Je reviens à ma question : qui a eu l’initiative du second appel ?
Deuxième question : l’affaire Cahuzac n’est pas banale, il s’agit tout de même d’un ministre. Maire depuis longtemps, il m’est arrivé que l’on me communique des informations sur tel conseiller municipal ou tel adjoint. Je n’invite pas les informateurs à s’adresser à la police, je leur pose des questions, je m’entretiens aussi avec la personne concernée en lui rapportant « qu’on m’a dit que… ». Ce sont là choses courantes. Comment, entre le 15 décembre, date à laquelle la Présidence a eu connaissance de votre échange avec M. Gonelle, et la date à laquelle M. Cahuzac a reconnu qu’il avait un compte – il a d’ailleurs jusqu’à présent été le seul à le dire, personne ne l’a encore démontré –, le Président de la République a-t-il pu vivre avec cela, comme on marcherait avec un clou dans sa chaussure ?
Troisième question : vous-même, Monsieur Zabulon, depuis votre entretien avec M. Gonelle – lequel n’a pas été très « sympa », disons, de vous envoyer ainsi la balle –, comment vivez-vous cela ? Au moment où la France ne bruisse que de cette affaire et en oublie même la situation économique, conservez-vous le secret total ou avez-vous des échanges avec des collègues ? Vous interrogez-vous ?
M. Alain Zabulon. Pour ce qui est de votre première question, je tiens à la disposition de la commission la photocopie du cahier d’appels. Dans ce cahier, on peut voir que Michel Gonelle a rappelé le lundi 17 décembre au matin. Comme je l’ai déjà dit, je suis à ce moment-là en réunion d’agenda. Lorsque je remonte dans mon bureau, ma secrétaire me signale que j’ai eu deux ou trois appels, dont l’un de Michel Gonelle. Je lui demande de rappeler ces correspondants. Au moment où elle s’apprête à me passer Michel Gonelle, dont elle a donc composé le numéro à ma demande, je prends un appel en interne et je rate Michel Gonelle. Je repars ensuite en réunion et en rendez-vous, vous imaginez aisément le rythme soutenu d’une journée au cabinet du Président de la République. En fin de journée, lorsque je fais le point sur mes appels, je constate que Michel Gonelle ne m’a pas rappelé. Peut-être s’attendait-il à ce que je le rappelle, soit. En tout cas, il n’y a pas eu de nouveau contact avec lui. Compte tenu de ce dont nous avions convenu le samedi 15, il aurait logiquement dû me rappeler. D’ailleurs, il l’a fait le lundi 17 au matin. Comme je n’étais pas à mon bureau à ce moment-là, je l’ai fait rappeler. Il n’a plus rappelé. Et le surlendemain, la teneur de notre échange a fuité dans la presse. À partir de là, je me devais d’être prudent, ne souhaitant pas alimenter un feuilleton où tout ce que je pourrais éventuellement dire à Michel Gonelle risquait de se retrouver dans la presse, dans une affaire, la suite l’a prouvé, susceptible de connaître un développement judiciaire. J’ai considéré que s’il ne me rappelait pas, c’est qu’il avait de bonnes raisons, que j’ai d’ailleurs comprises par la suite.
Vous me demandez ensuite comment le Président de la République a vécu avec cette information. Je le redis, dans le contexte du 15 décembre, où l’affaire est toute récente, les accusations de Mediapart ne remontant qu’à dix jours, où le ministre n’est ni mis en examen ni même cité à comparaître, où la seule procédure judiciaire en cours est sa plainte en diffamation, nous n’accordons qu’avec beaucoup de prudence crédit à ce témoignage à charge de Michel Gonelle, embarrassant pour le ministre. Est-il vrai que Michel Gonelle a détenu cet enregistrement et qu’il l’a donné à Jean-Louis Bruguière ? Rien ne le prouve. Je n’en sais rien, je ne dispose d’aucun élément pour en juger. Le rôle de la Présidence de la République n’est pas de mener des investigations. On aurait presque reproché au Gouvernement de n’avoir pas diligenté je ne sais quelle enquête par des moyens détournés. Nous prenons l’information qui nous a été donnée comme un témoignage, à ce stade non avéré, non prouvé. Voilà comment nous avons vécu cette période, jusqu’à ce que la vérité ensuite se révèle. À la mi-décembre, la plupart des observateurs sont très prudents et s’interrogent sur la réalité des accusations. Nous sommes dans un contexte où on considère que l’on peut donner crédit au ministre de sa bonne foi.
Mme Cécile Untermaier. Comment la presse a-t-elle pu avoir connaissance de la teneur de votre entretien avec M. Gonelle ?
Que vous dit Jérôme Cahuzac lorsque vous lui relatez ce témoignage tout de même très embarrassant ? Je n’imagine pas qu’il l’ait balayé d’un revers de main.
Avez-vous évoqué votre entretien avec Me Gonelle avec des membres du cabinet de Jérôme Cahuzac ou de Pierre Moscovici ?
M. Alain Zabulon. J’ignore comment Mediapart a eu connaissance de l’échange que j’ai eu avec Michel Gonelle et qui lui en a communiqué la teneur. Edwy Plenel a déclaré devant votre commission que c’était « de source officielle ». Journaliste, il possède un privilège que je n’ai pas : il a le droit de ne pas révéler ses sources. Il m’est donc difficile de le contredire. Je puis en revanche vous certifier que ce n’est pas moi qui ai informé la presse. Je ne vois d’ailleurs pas quel intérêt aurait eu la Présidence de nourrir un mauvais feuilleton et de donner une dimension de roman policier à cette affaire.
Lorsque j’appelle Jérôme Cahuzac pour l’informer de l’échange que j’ai eu avec Michel Gonelle, je sens un homme quelque peu sous pression – on le serait à moins : les accusations portées contre lui par Mediapart sont graves, sa vie privée aussi est étalée sur la place publique. L’entretien est bref. Il me remercie de l’avoir prévenu et ne fait pas+ de commentaires.
S’agissant de votre dernière question, je suis toujours resté discret sur cette affaire. Bien sûr, une fois cet échange abondamment commenté dans la presse, nous en avons parlé en interne au cabinet. Lorsqu’un collègue m’interrogeait, je répondais qu’en effet j’avais eu Michel Gonelle au téléphone et que ce que rapportait la presse correspondait dans les grandes lignes à ce qu’il m’avait dit. Nous en avons parlé, comme nous parlons tous les jours autour du café des sujets ou des affaires d’actualité. Mais rien de plus. Et je n’ai eu aucun contact ni avec le cabinet de Jérôme Cahuzac ni avec celui de Pierre Moscovici. J’y insiste, je ne suis pas chargé de suivre « l’affaire Cahuzac » au cabinet du Président de la République.
M. Étienne Blanc. Monsieur le directeur, l’article 40 du code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. ». Lors de votre échange téléphonique avec M. Gonelle, vous apprenez que M. Cahuzac pourrait détenir, directement ou indirectement, un compte bancaire en Suisse ou être bénéficiaire d’un tel compte. Vous apprenez qu’une preuve circule. Vous apprenez même le nom d’un magistrat qui la détient. Et vous nous dites que ce n’était pas à vous, collaborateur du Président de la République, de saisir la justice. Un courrier simple aurait suffi : c’est d’ailleurs souvent ainsi que sont saisis les procureurs sur des faits en apparence parfois très banals et qui, après enquête préliminaire, se révèlent majeurs. Selon vous, il appartenait à M. Gonelle, ancien parlementaire, ancien maire, qui avait donc été officier public, de saisir le procureur. Qu’une autre autorité ait été susceptible de saisir le Parquet ne vous dispensait pas, vous, haut fonctionnaire, de surcroît l’un des plus haut placés dans l’organisation de l’État, de le faire.
L’article 40 du code de procédure pénale vous imposait – cet article ne dit pas « peut », mais « est tenu de » – de saisir sans délai la justice des faits délictueux dont vous veniez d’avoir connaissance. Vous ne l’avez pas fait. On entendra sans doute au cours de nos auditions qu’il y avait une autre voie, celle de la convention fiscale franco-suisse de 1966, parfaite illustration de l’art d’établir une convention internationale pour qu’elle ne soit jamais appliquée. Cette voie-là est très insuffisante pour rechercher la vérité. Je suis de ceux qui pensent que la voie la plus appropriée est la voie pénale et la saisine du Parquet.
Au moment de votre entretien avec Michel Gonelle, connaissiez-vous bien les dispositions de cet article 40 et toutes les opportunités qu’elles offrent ? Si oui, pourquoi n’avez-vous pas saisi le procureur de la République ? En quelques jours, en tout cas bien avant les fêtes de Noël, la vérité aurait pu éclater au grand jour.
M. Alain Zabulon. Je considère, pour ma part, que sur la base de ce seul témoignage oral, dont, le 15 décembre, on peut douter de la crédibilité et de la cohérence puisqu’il dit le contraire de ce qui a été déclaré cinq jours auparavant, il n’y a pas d’élément pour que la présidence de la République saisisse la justice. Si M. Gonelle avait envoyé le courrier dont il m’a parlé, les choses auraient été différentes. Devant une lettre de dénonciation, on est tenu d’agir. Il est fréquent que la présidence de la République en reçoive, sur des faits divers les plus banals. Mais en l’espèce, quel est l’élément tangible et solide sur le fondement duquel la Présidence aurait pu saisir le procureur ? On n’aurait pas manqué de nous dire que nous agissions avec bien peu d’éléments en mains. C’était à M. Gonelle qu’il appartenait de saisir la justice. Il aurait d’ailleurs dû le faire depuis 2000 où il était entré en possession de cet enregistrement.
M. Étienne Blanc. Dans notre procédure pénale, c’est le procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites, pas le haut fonctionnaire ou le détenteur de l’autorité publique qui reçoit l’information.
Dans l’affaire qui nous occupe, on a l’impression que l’administration s’est substituée au Parquet pour juger que les éléments dont elle avait connaissance n’étaient pas suffisants pour décider d’aller plus loin. C’est là que le système a dysfonctionné. La haute fonction publique, avec tout le respect qu’on lui doit, a pris le rôle du Parquet, alors qu’une enquête aurait permis d’établir très vite la vérité. Il eût mieux valu qu’une enquête diligentée par le Parquet ne débouche sur rien plutôt que l’administration ne se taise.
M. Alain Zabulon. Sauf erreur de ma part, l’enquête préliminaire a été engagée début janvier, soit un petit mois seulement après les révélations de Mediapart. On a connu la justice plus lente dans certaines affaires. Edwy Plenel lui-même a reconnu devant votre commission que la justice avait pu travailler sans entrave, c’est tout dire.
Peut-être pensez-vous, monsieur le député, que le Président de la République a voulu étouffer l’affaire. En ce cas, il ne m’aurait pas donné l’instruction de dire à M. Gonelle de saisir la justice. Il m’aurait dit : « Récupérez cette lettre, prenez le CD et placez le au coffre. »
M. Alain Claeys, rapporteur. Un mot à l’intention de notre collègue sur le calendrier. L’enquête préliminaire a été lancée le lendemain même du jour où a été établie l’authenticité de l’enregistrement. L’administration a fait son travail et la justice a ouvert l’enquête sans délai.
M. Étienne Blanc. M. Falletti a dit en effet qu’à partir du moment où la justice est saisie, les choses vont très vite. J’ai toujours considéré que la convention franco-suisse de 1966 était très formelle et ne permettait pas d’établir la vérité dans des affaires précises. Pour bien connaître ces questions, étant député de l’Ain, département frontalier de la Suisse, j’ai constaté en revanche – c’est d’ailleurs pourquoi le procès fait à la Suisse est particulièrement injuste – que lorsqu’un juge d’instruction français lance une commission rogatoire et adresse une demande de coopération au procureur de la République de Genève, M. Bertossa, reconnu comme un homme d’exception en matière de coopération dans la lutte contre le crime, la réponse peut être obtenue en 48 heures quand l’affaire le justifie.
On ne peut pas s’empêcher de penser qu’à un moment, l’article 40 aurait pu être utilisé. En décembre dernier, mais aussi peut-être avant, depuis une sous-préfecture du Lot, ou depuis des services fiscaux où est passée entre les mains de nombreux hauts fonctionnaires une note comportant le nom de M. Cahuzac.
Ce n’est pas, comme vous le dites, que je suspecterais le Président de la République. Mais nous sommes ici dans une commission d’enquête. Nous ne jugeons pas des intentions, mais des faits. Nous cherchons à repérer les éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et les services de l’État.
M. le président Charles de Courson. N’anticipons pas sur les conclusions de notre commission.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous serons amenés à reparler de la convention fiscale avec la Suisse. C’est un sujet important, mais différent.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Monsieur Zabulon, vous avez été sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot de 1997 à 2000. Durant ces trois années, vous avez connu deux préfets, M. Vacher et M. Jacquet ; vous avez vu le directeur des services fiscaux, le trésorier-payeur général, les services de gendarmerie et de police ; vous avez rencontré le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République. Pouvez-vous nous dire sous serment qu’à aucun moment, vous n’avez entendu une rumeur sur le train de vie de M. Cahuzac ?
M. Alain Zabulon. Sous serment, je vous réponds que je n’ai jamais entendu la moindre rumeur de cette nature sur Jérôme Cahuzac à cette époque.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Certaines des questions qui vous ont été adressées, monsieur le préfet, traduisent une certaine confusion quant à la répartition des pouvoirs et au rôle de chacun.
Vous avez confirmé que votre entretien avec M. Gonelle a duré au moins un quart d’heure et qu’au cours de cet entretien, il a été amené à vous dire qu’il possédait l’enregistrement depuis une bonne dizaine d’années…
M. Alain Zabulon. Depuis 2000.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous aviez conservé de M. Gonelle, nous avez-vous dit, un souvenir plutôt cordial. Dix ans plus tard, il se manifeste auprès de vous à propos de faits un peu tordus, pardonnez-moi l’expression. Je ne sais pas quelle image vous vous faites de lui à ce moment-là. Mais pour ma part, je ne vois pas comment devant un tel interlocuteur, vous pourriez vous dire en tant que membre du cabinet du Président de la République, que vous devriez saisir la justice ou suggérer au Président de le faire. Je n’ai pas bien compris si notre collègue Blanc voulait dire que, haut fonctionnaire, vous auriez dû saisir vous-même la justice ou demander au Président de le faire, – alors que, soit dit au passage, cela aurait plutôt incombé au Gouvernement.
J’essaie de me mettre à votre place, monsieur Zabulon. À la suite d’un tel entretien avec une telle personne, même si vous aviez conservé d’elle un souvenir plutôt positif, comment auriez-vous pu considérer disposer d’assez d’éléments pour saisir la justice ? Serait-ce le fonctionnement normal d’une présidence de la République ? Cela signifierait-il alors que, dès qu’un membre de cabinet du Président reçoit des informations, et Dieu sait si certains ont dû en recevoir par le passé et si d’autres en recevront dans l’avenir, il doit saisir la justice, indépendamment de la crédibilité du témoignage ?
M. le président Charles de Courson. Est-ce une question, madame Bechtel ? Et à qui est-elle adressée ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. À M. Zabulon. Je lui demande si, au vu de son expérience, c’est l’image qu’il pourrait se faire du fonctionnement normal de la présidence de la République.
M. Alain Zabulon. Je partage votre analyse, madame la députée. Sur la base des éléments qui me sont communiqués le 15 décembre, je considère qu’il n’y a pas matière à saisir le procureur. Je ne dispose que d’un témoignage incertain, sans preuves. Je n’ai entre les mains ni courrier de dénonciation ni je ne sais quelle disquette prouvant je ne sais quoi – à supposer d’ailleurs que j’en ai eu une, il aurait fallu faire expertiser la voix enregistrée. Ce n’est pas là le rôle de la présidence de la République. Le Président est très attaché à la séparation des pouvoirs, il l’a montré en cette affaire. L’instruction qu’il m’a donnée est la seule, à laquelle je m’attendais d’ailleurs, qu’il pouvait me donner. C’est à celui qui détient ou croit détenir des informations importantes dans une affaire susceptible de déboucher sur une procédure judiciaire, de les porter à la connaissance de la justice. Voilà le mode de fonctionnement normal des institutions. Je le redis, entre le moment où Mediapart révèle cette affaire et celui où est déclenchée l’enquête préliminaire, il ne se passe qu’un mois, trêve des confiseurs comprise. On a vu des affaires où les processus ont été beaucoup plus lents.
M. Dominique Baert. Monsieur le directeur, lorsque vous étiez sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, vous avez pu constater, nous avez-vous dit, que Michel Gonelle et Jérôme Cahuzac entretenaient des relations républicaines très courtoises. D’évidence, ils se supportaient l’un l’autre sans trop de difficulté. N’êtes-vous pas surpris lorsque Michel Gonelle vous appelle dans une affaire mettant en cause celui avec lequel il avait ce type de relations ?
Michel Gonelle a-t-il évoqué avec vous le contenu de la lettre qu’il souhaitait envoyer ou faire remettre au Président de la République ? En effet, au cours de l’entretien qu’il a avec vous, il vous dit l’essentiel de ce qu’il a à vous dire. Quelles informations supplémentaires pouvait contenir cette lettre ? Vous en a-t-il parlé ? Vous-même, n’avez-vous pas eu envie de savoir ce qu’elle pouvait contenir de plus ?
Vous l’avez dit vous-même, Michel Gonelle est un homme de loi avisé. N’avez-vous pas pensé que l’on avait cherché à vous piéger et à piéger la présidence de la République de manière un peu grossière ?
M. Alain Zabulon. À votre dernière question, la réponse est oui. J’ai eu le sentiment qu’il pouvait y avoir, je l’ai dit, une forme d’instrumentalisation – je n’ai pas parlé de piège, ne souhaitant pas être désobligeant à l’égard de Michel Gonelle. Ma conviction que ce coup de fil n’était pas seulement un coup de fil à une « vieille connaissance » a été renforcée par ce qu’il vous a déclaré ici même : « L’enquêteur de Mediapart et son patron ont demandé à me rencontrer, et nous nous sommes vus le vendredi 14 décembre à Paris, dans mon hôtel. Ils souhaitaient que je me dévoile. Je leur ai répondu que je n’avais pas l’intention de le faire de la façon à laquelle ils pensaient, sans leur préciser mon intention de m’adresser au Président de la République. ». Je ne suis pas totalement naïf, quand bien même j’avais eu en son temps des relations tout à fait cordiales et constructives avec cet élu dans l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot.
S’agissant de la lettre, ce que j’ai compris des propos de Michel Gonelle est que son contenu ne faisait que formaliser par écrit ce qu’il m’avait expliqué oralement. Il ne m’a pas dit qu’elle contiendrait d’autres révélations. Il m’a seulement dit qu’il avait préparé ou allait préparer – sur ce point, je ne sais plus exactement – un courrier expliquant tout cela.
Pour ce qui est des relations entre Michel Gonelle et Jérôme Cahuzac, je vais vous dire ce que j’en ai connu et ce que j’en ai vu. Pendant la période où je suis sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, les deux hommes ont une relation que je qualifierais de courtoisie républicaine. Dans les inaugurations ou les manifestations publiques, ils se respectent. Comme vous le savez, selon le protocole, c’est toujours le sous-préfet qui s’exprime en dernier. Il arrive parfois que les deux élus qui prennent la parole avant lui « s’écharpent » : j’ai connu de telles situations. À Villeneuve-sur Lot à l’époque, ce n’est pas le cas. Je perçois bien néanmoins que se profile un rendez-vous pour les municipales de 2001, rendez-vous qui a d’ailleurs eu lieu. Ayant quitté le Lot-et-Garonne en février 2000 mais continuant à suivre de loin la vie politique du département, comme de tous les lieux où j’ai occupé un poste, j’ai vu que la campagne de 2001 avait sans doute quelque peu dégradé les relations entre les deux hommes. Mais je n’en sais rien, car je n’ai de contact ni avec l’un ni avec l’autre. Je me souviens avoir dit au préfet avant de quitter le département que ce rendez-vous des municipales risquait d’être un peu musclé.
Quelques jours avant le 15 décembre, j’avais lu dans la presse que Michel Gonelle disait ses relations avec Jérôme Cahuzac « apaisées », maintenant qu’il était retiré de la vie politique. Je cite, je ne sais pas s’il a dit quelque chose de tel, en tout cas c’est ce que met un journaliste dans sa bouche sur le mode ironique : « Il lui est reconnaissant d’avoir remporté la mairie en 2001. » Peut-être n’est-ce qu’une boutade.
Si les relations entre les deux hommes sont « apaisées » et si Michel Gonelle, comme il le dit, ne souhaite pas nuire à Jérôme Cahuzac, pourquoi a-t-il conservé cet enregistrement pendant sept ans et surtout, pourquoi l’a-t-il donné à Jean-Louis Bruguière ? Avec lequel il a d’ailleurs échangé quelques noms d’oiseau à la suite des révélations de Mediapart. C’est tout de même donner un CD à l’adversaire politique déclaré de Jérôme Cahuzac. Si on veut du bien à quelqu’un, on ne fait pas cela. C’est pourquoi lorsque je reçois son témoignage, pardon d’y insister, je suis plus que circonspect sur sa crédibilité. Je m’interroge et dis d’ailleurs au Président de la République : « Sur ce que j’ai entendu ce matin, prudence ! » C’est là qu’il me répond : « Courrier, CD, ce n’est pas à nous d’enquêter. Que Michel Gonelle saisisse la justice. » Le 15 décembre et les jours qui suivent, je m’interroge vraiment sur la crédibilité de ce témoignage, je vous le dis en toute honnêteté.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire que vous n’y croyez pas ?
M. Alain Zabulon. Je m’interroge.
M. Jean-Marc Germain. Après votre entretien téléphonique avec M. Gonelle, vous vous interrogez fortement sur la crédibilité de son témoignage. Vous avez convenu de reprendre contact. Il a promis de vous remettre un courrier comportant des éléments plus précis. Je partage l’avis de M. Gorges, nous avons tous connu dans nos fonctions respectives des situations de cette nature, où nous essayons de repérer ce qui pourrait constituer une instrumentalisation. Puis le contact du lundi matin avorte. Ensuite, si j’ai bien compris, le mercredi, l’Élysée fait une communication – vous avez fait état d’un contact avec le chargé de communication – dans laquelle la Présidence confirme que cet échange a eu lieu mais surtout dit publiquement, y compris donc aux yeux de la justice, à M. Gonelle, dont on sait à ce moment-là qu’il détient l’enregistrement, de saisir la justice.
Je reviens sur le débat qui s’est engagé tout à l’heure, anticipant d’ailleurs les conclusions de notre commission d’enquête : fallait-il ou non mettre en œuvre l’article 40 ? L’Élysée a fait une communication officielle. Le chargé de communication a-t-il eu des contacts avec le secrétaire général de la Présidence pour ca ler les éléments de langage ? En tout cas, il a été officiellement acté que vous aviez bien eu un contact avec M. Gonelle et qu’on l’invitait à saisir la justice. Est-ce bien ainsi que les choses se sont passées ?
Vous connaissez bien M. Gonelle. Pour notre part, nous l’avons auditionné et avons même décidé de l’entendre de nouveau car certaines de ses déclarations sont incompatibles avec ce que nous avons appris par la suite. Avez-vous eu par le passé l’occasion par le passé de prendre avec réserve ce qu’il pouvait vous dire, compte tenu de sa personnalité ? Si oui, lorsqu’il vous appelle le 15 décembre, avez-vous le même réflexe ?
Dernière question, dont je ne sais si vous pourrez y répondre mais que je vous pose parce que vous avez été trois ans sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot. Pourquoi, à votre avis, M. Gonelle n’a-t-il pas utilisé cet enregistrement directement ni en 2000 ni en 2006, alors qu’il l’a utilisé deux fois indirectement, la première en le faisant écouter à un ami inspecteur des impôts, la deuxième en le remettant au juge Bruguière, à chaque fois à l’approche d’échéances électorales ? Les relations « cordiales » dont il est fait état entre M. Gonelle et M. Cahuzac et que M. Gonelle se soit félicité que son opposant ait gagné la mairie, tout cela paraît étrange. Comment l’expliquez-vous ?
M. Alain Zabulon. Dès lors que je ne sais plus quel journaliste demande à la présidence de la République si elle confirme qu’il y a bien eu un contact entre Michel Gonelle et un collaborateur du Président, elle n’a aucune raison de ne pas le confirmer.
M. Jean-Marc Germain. C’est devenu un communiqué de l’AFP.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il y a eu une dépêche AFP, mais ce n’est pas une déclaration de l’Elysée.
M. le président Charles de Courson. Je vous donne lecture de la pièce : « L’enregistrement des propos prêtés au ministre du budget et évoquant un compte en Suisse appartiendrait à l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, Michel Gonelle, évincé par Cahuzac aux municipales de 2001 ». C’est le titre de la dépêche.
On lit ensuite : « Le détenteur de la bande enregistrée sur laquelle le ministre du budget Jérôme Cahuzac avouerait détenir un compte en Suisse est bien son ancien rival Michel Gonelle, selon Mediapart, et il a contacté l’Élysée, a confirmé vendredi la présidence, interrogée par l’AFP « Nous confirmons que Michel Gonelle a bien eu, il y a quelques jours, un contact avec le directeur de cabinet adjoint de François Hollande, Alain Zabulon », a-t-on déclaré dans l’entourage du Président. « Nous l’invitons à remettre tous les éléments à la justice », a-t-on précisé de même source, estimant toutefois qu’il « n’y avait aucun élément tangible ». « S’il dispose réellement d’éléments, qu’il s’adresse à la justice puisqu’il y a une procédure judiciaire », a ajouté l’entourage du chef de l’État. »
Mme Marie-Christine Dalloz. Tout dépend de ce qu’on entend par « tangible » !
M. le président Charles de Courson. En effet.
M. Alain Zabulon. À la date du 15 décembre, nous ne connaissons pas encore la suite. De quoi disposons-nous ? Un organe de presse a porté une accusation. Ce média certes documente, explique, fait révélation après révélation, mais c’est tout. Je n’ai ni courrier ni CD. C’est ce que nous voulons dire par « aucun élément tangible », à ce stade.
Pour répondre à votre question, monsieur le député, sur la communication de la Présidence, je confirme ce que vient de lire le président de Courson. Interrogée par la presse, la Présidence confirme que ce contact a bien eu lieu – il n’y avait aucune raison de le dissimuler – et que Michel Gonelle est invité à saisir la justice.
Comment ai-je perçu le témoignage de Michel Gonelle ou son attitude ? Pendant deux ans et demi, nous avions collaboré de manière fructueuse dans l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot. Depuis vingt ans que j’exerce dans la préfectorale, j’ai toujours eu de bonnes relations avec les élus, avec M. Gonelle comme avec les autres. Nous avons fait avancer ensemble des dossiers. Mais depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts, Jérôme Cahuzac a ravi la mairie, a été battu aux législatives en 2002 avant d’être réélu en 2007. Ayant quitté le Lot-et-Garonne, je suis cela de très loin. Lorsque je reçois ce coup de fil le 15 décembre, j’ai plutôt en tête ce que Michel Gonelle a déclaré quelques jours auparavant – car j’ai lu ses déclarations où il dit n’avoir jamais détenu cet enregistrement et qualifie cette histoire d’invraisemblable. Je m’attends plutôt à ce qu’il me confirme qu’il n’est absolument pour rien dans cette affaire. C’est d’ailleurs pourquoi, lorsqu’il me dit « Vous vous doutez de l’objet de mon appel ? », je lui réponds « Oui, je m’en doute ». Le contenu du témoignage qu’il me livre me surprend donc et me laisse perplexe car c’est le contraire de ce qu’il a déclaré quelques jours plus tôt. Quelles qu’aient pu être nos relations cordiales par le passé, je suis pour le coup prudent et attentif. Je ne me vois pas prendre ce témoignage pour argent comptant et aller le présenter sans autre forme de procès si j’ose dire, au Président de la République, dont je suis le collaborateur. J’ai pris ce témoignage avec une grande prudence, et dans les jours qui ont suivi, mon attitude a été la même.
J’ai déjà eu l’occasion de répondre sur l’instrumentalisation. C’est en effet un peu le sentiment que j’ai eu. Pourquoi Michel Gonelle n’a-t-il pas, comme Edwy Plenel l’invitait à le faire, révélé publiquement son rôle et assumé ses responsabilités en confirmant qu’il avait détenu cet enregistrement et en indiquant ce qu’il en avait fait ? Il aurait ainsi contribué de manière ouverte à la manifestation de la vérité. Pourquoi avoir choisi de passer par la présidence de la République où il a une « vieille connaissance » ? Pourquoi ce biais ? Tout cela m’incite à la prudence et à la retenue devant son témoignage.
M. Jean-Marc Germain. Comment expliquez-vous qu’il n’ait jamais porté cette information à la connaissance de la justice ? Existe-t-il des liens particuliers entre Michel Gonelle et Jérôme Cahuzac qui pourraient l’expliquer ?
M. Alain Zabulon. Lorsque vous l’avez questionné sur ce point, Michel Gonelle a dit que Jérôme Cahuzac était « un adversaire redoutable ». A-t-il eu peur ? A-t-il eu des scrupules ? Ne savait-il pas comment faire ? Pourquoi n’a-t-il rien fait durant des années ? Honnêtement, je n’en sais rien. Et je ne me sens pas autorisé à faire l’exégèse de sa pensée. Ma certitude en revanche est qu’il ne suivait pas la bonne procédure en m’appelant.
M. le président Charles de Courson. Est-ce à votre initiative ou à celle du Président de la République ou du secrétaire général de la Présidence que vous avez contacté Jérôme Cahuzac le 15 décembre, après votre entretien avec le Président ?
M. Alain Zabulon. Lorsque je rends compte au Président de mon échange avec Michel Gonelle, il me donne l’instruction que je vous ai indiquée. Je lui dis : « Monsieur le Président, j’ai de bonnes raisons de penser que cela ne va pas rester secret longtemps, car les choses se savent. Cela va nécessairement circuler. Je pense qu’il serait bon que le ministre soit informé de ce témoignage. » Je le redis, nous sommes à la mi-décembre, date à laquelle la majorité des observateurs pensent que Jérôme Cahuzac est de bonne foi. J’ajoute donc : « Si vous m’y autorisez, je veux bien lui passer un coup de fil ».
M. le président Charles de Courson. Le Président vous autorise donc à le faire ?
M. Alain Zabulon. Il me dit : « En effet, c’est peut-être mieux. Prévenez-le ». C’est ce que j’ai fait, dans le contexte qui était celui de l’époque.
M. le président Charles de Courson. Quelles informations exactes avez-vous donné à Jérôme Cahuzac ?
M. Alain Zabulon. La teneur de l’échange que j’avais eu avec Michel Gonelle.
M. le président Charles de Courson. En totalité ?
M. Alain Zabulon. Oui, la totalité des informations.
M. Jean-Pierre Gorges. Que vous a-t-il répondu ?
M. le président Charles de Courson. C’était ma troisième question, cher collègue.
M. Alain Zabulon. Il me remercie de l’avoir informé. Je le sens quelque peu tendu – la pression est forte. Il était, je crois, assez pressé, peut-être entre deux rendez-vous, je n’en sais rien. Pour le coup, l’entretien est bref, beaucoup plus court qu’avec Michel Gonelle. Il a pris acte de ces informations et n’a pas fait de commentaire.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez pas eu de ressenti particulier ?
M. Alain Zabulon. Honnêtement, non.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez pas ressenti que cela l’inquiétait ?
M. Alain Zabulon. Que cela l’inquiète, certainement. Il m’écoute, mais nous n’avons pas d’échange approfondi sur la nature de ce témoignage. La veille ou l’avant-veille, il a porté plainte en diffamation.
Je me doutais que la teneur de mon entretien avec Michel Gonelle se retrouverait rapidement dans la presse. Jérôme Cahuzac l’aurait appris ainsi et n’aurait pas manqué d’appeler la Présidence pour savoir ce qu’il en était. En ce 15 décembre, je l’informe donc, à charge pour lui d’en faire ce qu’il veut. Il n’a pas fait de commentaire particulier sur les informations que je lui ai communiquées.
M. le président Charles de Courson. Il n’a pas eu de réaction particulière ? Il n’a pas dit par exemple : « C’est très ennuyeux. » ?
M. Alain Zabulon. Non. Je l’ai senti inquiet tout de même. Nous sommes à l’époque où l’on parle de son divorce, de tout cela.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez plus eu aucun contact avec lui par la suite ?
M. Alain Zabulon. Aucun, ni avec Jérôme Cahuzac ni avec Michel Gonelle.
M. Hervé Morin. Étant arrivé en retard à cette audition, je vous prie de m’excuser si je pose des questions qui ont déjà été posées.
Je comprends très bien votre prudence, monsieur Zabulon. Lorsqu’on est directeur adjoint du cabinet du Président de la République, on ne peut pas se prêter à n’importe quoi. Il n’en reste pas moins que le manque de réaction du pouvoir politique, son inertie, face à cette affaire, me stupéfie. Le directeur de cabinet de Pierre Moscovici – c’est le comble – dit qu’il n’a jamais passé un coup de fil à ce sujet, n’a jamais cherché à s’informer sur l’état d’avancement du dossier ni sur ce que faisait la DGFiP. Les collaborateurs du chef de l’État n’ont jamais été tentés, eux non plus, de faire éclater la vérité le plus rapidement possible ? Il n’a jamais été question de cette affaire lors des réunions de cabinet ? Nul n’a jamais eu la volonté d’avancer plus vite que la justice, dont on sait la lenteur des procédures, ou de devancer la presse, qui divulguait ses informations une à une ? C’est presque une faute. Comment le directeur de cabinet d’un ministre de l’économie et des finances peut-il soutenir ne s’être jamais préoccupé de cela ? D’une part, je suis sûr que ce n’est pas vrai. D’autre part, si c’était le cas, ce serait une faute.
Avez-vous – quand je dis vous, je vise l’ensemble des collaborateurs du Président de la République –, à un moment ou à un autre, envisagé, vu ce qu’est le secret bancaire en Suisse, de demander à M. Cahuzac d’interroger lui-même la banque, afin de savoir s’il détenait ou non un compte dans ce pays ? Personne n’y a pensé ?
M. Alain Zabulon. À mon niveau de responsabilité, je n’ai pas participé à des réunions, des échanges ou des analyses sur « l’affaire Cahuzac ». Vous dire qu’il n’y en a pas eu, je n’en sais rien. Que tel ou tel ait cherché à s’informer, peut-être. En tout cas, pas à mon niveau. Je l’ai dit avant votre arrivée, monsieur le député, je n’étais pas, je ne suis pas chargé du suivi de « l’affaire Cahuzac » au cabinet du Président de la République. Des échanges ou des recherches d’information ont-ils lieu ? Des analyses ont-elles été confrontées ? Je n’en sais rien. C’est possible. Entre nous, entre collègues, sûrement, mais rien qui puisse déboucher sur une formalisation administrative.
Vous l’avez compris, je suis loin de détenir toutes les clés de cette affaire. Toute la partie Bercy m’échappe complètement. Je n’ai pas de contact avec le cabinet de Pierre Moscovici ni avec celui de Jérôme Cahuzac. Mais, comme je l’ai dit tout à l’heure, entre le moment où Mediapart dévoile ses informations et celui où la justice ouvre une enquête préliminaire, il ne s’est écoulé qu’un petit mois. Il est donc sévère, monsieur le député, de parler « d’inertie » ou de frein, lorsqu’on sait le temps qu’il a parfois fallu pour que certaines affaires sortent. En l’espace d’un mois, l’enquête s’ouvre, la justice fonctionne, Edwy Plenel a d’ailleurs reconnu devant vous qu’elle a travaillé sans entrave. La suite, vous la connaissez. La justice a pu faire son travail, et c’est heureux pour notre démocratie.
Quant à savoir pourquoi on n’a pas demandé à Jérôme Cahuzac d’interroger lui-même la banque, je n’ai pas, à mon niveau de responsabilité, la réponse à cette question.
M. le président Charles de Courson. Monsieur le directeur, nous vous remercions.
Audition du mardi 18 juin 2013
À 16 heures 30 : MM. Laurent Habert, inspecteur principal, chef de la brigade d’intervention interrégionale d’Orléans, et Olivier André, administrateur des finances publiques, pilote d’accompagnement du changement à la délégation Ouest de la DGFiP, et Patrick Richard, contrôleur des finances publiques à la retraite.
M. le président Charles de Courson. Messieurs, vous étiez tous les trois en fonction, au sein de la Direction nationale des enquêtes fiscales, à la brigade interrégionale d’intervention de Bordeaux (BII), entre 2000 et 2007. Or, selon les affirmations de M. Michel Gonelle, c’est en 2000 qu’il a fait transmettre un signalement à cette brigade, concernant les avoirs détenus à l’étranger par M. Jérôme Cahuzac. Nous avons, par ailleurs, appris que le dossier fiscal de ce dernier avait été envoyé de Paris à Bordeaux en 2001 et était demeuré à la BII jusqu’en 2007.
Il est important pour nous de mieux comprendre cet épisode et de savoir pourquoi ce signalement n’a débouché sur aucun contrôle de la situation fiscale de M. Jérôme Cahuzac.
M. Habert, M. André et M. Richard prêtent successivement serment.
M. Patrick Richard, contrôleur des finances publiques à la retraite. Je me bornerai à rappeler le contenu de nos missions, en tant qu’enquêteurs de la BII de Bordeaux, ainsi que le rôle joué dans cette affaire par mon collègue Christian Mangier, aujourd’hui décédé.
La brigade interrégionale d’intervention n’a pas vocation à procéder à des vérifications de comptabilité ni à l’examen de la situation fiscale personnelle des contribuables : de telles missions relèvent d’autres services. La nôtre était d’enrichir la programmation de contrôles fiscaux par la recherche de renseignements, soit auprès de sources internes – qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou d’autres services de l’État – soit de sources externes, lorsque, comme dans le cas qui nous intéresse, des informations sont fournies par des tiers.
M. Mangier et moi-même avons fait équipe pendant plus de vingt-cinq ans. Nous nous connaissions bien et nous faisions mutuellement confiance. En général, ce que l’un savait, l’autre le savait aussi, car avant de prendre une décision ou d’ouvrir une enquête, nous en discutions entre nous.
Il y a eu quelques cas particuliers au cours de cette période. Dans notre métier, les renseignements – et tous sont bons à prendre – ne sont pas nécessairement donnés aux heures d’ouverture des bureaux : ils pouvaient nous être transmis le soir ou le week-end, dans le cercle privé ou familial. S’agissant du cas qui nous occupe, M. Mangier était seul destinataire de l’information. J’en ai donc déduit qu’il l’avait obtenue dans un cadre privé, car si l’informateur avait été un collègue ou un fonctionnaire exerçant dans une autre administration, nous l’aurions rencontré ensemble.
M. le président Charles de Courson. Vous ne connaissez pas le nom de cette personne ?
M. Patrick Richard. Non. Les faits commencent à dater, mais d’après mes souvenirs, M. Mangier m’a dit un jour avoir obtenu une information – qui, selon ses propres termes, n’était pas de première main – sur la détention, par M. Cahuzac, d’un compte bancaire en Suisse, lequel lui aurait permis de financer ses activités électorales. Il ne paraissait pas en savoir beaucoup plus. Nous avons donc fait ce que nous faisons toujours en pareil cas : nous demandons communication du dossier fiscal de la personne concernée, ne serait-ce que pour nous assurer qu’elle ne faisait pas déjà l’objet d’une procédure – comme une vérification de sa comptabilité – ou d’une enquête par un autre service. Puis nous examinons l’environnement professionnel ou fiscal de cette personne, afin d’une part de vérifier la crédibilité des informations, et d’autre part de déterminer si les revenus susceptibles d’avoir alimenté ce compte étaient d’ordre professionnel et entraient donc dans le cadre de notre mission.
M. le président Charles de Courson. À quel moment cela se passait-il ?
M. Patrick Richard. Il y a peu de temps, je n’aurais pu vous répondre avec précision. Mais les policiers qui m’ont entendu récemment, m’ont dit que cela s’était passé en février 2001, et je n’ai pas de raison d’en douter. La procédure était alors très simple : l’agent ayant besoin de consulter un dossier demandait à la secrétaire – nous en avions encore une, à l’époque – de remplir un formulaire, qu’il signait ; la demande partait par courrier, et on recevait le dossier en retour. Le délai était celui de l’acheminement du courrier postal.
Lorsque le dossier est arrivé, nous l’avons examiné sommairement, comme on le faisait toujours, ne serait-ce que pour vérifier que la personne mise en cause n’avait jamais déclaré de compte bancaire à l’étranger. Nous avons ensuite discuté de son contenu. Je voulais rencontrer la personne ayant transmis l’information, car à ce stade, nous ne pouvions rien faire. Des informations sur des comptes en Suisse ou l’exercice de travail dissimulé, nous en recevions facilement ; mais il fallait en évaluer la crédibilité avant d’entamer quelque action que ce soit. Dans ce but, nous avions coutume de recevoir, dans les locaux de l’administration, la personne ayant donné le renseignement, afin de mesurer sa proximité avec la source principale, de comprendre par quel moyen l’information lui était parvenue, de rechercher de premières pistes pour commencer l’enquête. Dans le cas qui nous occupe, M. Mangier m’a dit que la personne ayant transmis l’information n’en savait pas plus et ne souhaitait pas que je la rencontre. La porte était dès lors fermée, ce qui explique pourquoi il n’y a eu – et j’insiste sur ce point – aucune enquête au sens où nous l’entendions : aucune des procédures prévues par les textes n’a été entamée. Nous n’avions aucun moyen de le faire.
La seule anomalie, dans ce dossier, est sans doute que M. Mangier l’ait traité comme s’il ne concernait qu’un contribuable ordinaire, et non une personnalité exerçant des fonctions électives. Il aurait dû, en effet, en informer le chef de service, ce qui n’a pas été fait.
De même, il est anormal que le dossier ait été détenu si longtemps par la BII. En général, lorsque l’on obtient une information de ce type, on garde le dossier quelque temps dans le coffre-fort, en espérant que de nouvelles informations permettront d’entamer une véritable enquête. Si rien ne se passe, on renvoie le dossier. Or, mon collègue ne l’a pas fait. C’est bien plus tard, en faisant de l’archivage, que l’on a retrouvé ce – très mince – dossier, parmi d’autres, dans le coffre. Il a été renvoyé à ce moment.
M. Olivier André, administrateur des finances publiques, pilote d’accompagnement du changement à la délégation Ouest de la Direction générale des finances publiques. Afin de compléter les propos de M. Richard, je décrirai les process en usage à l’époque à la BII de Bordeaux concernant les relations entre les enquêteurs et le chef de service – c’est-à-dire moi-même –, les demandes de communication des dossiers et leur traitement.
Il y avait une différence importante entre les dossiers des « notoriétés » – dont les élus – et ceux des contribuables « lambda », qu’il s’agisse de sociétés, d’entreprises indépendantes, de personnes physiques exerçant une profession libérale, etc.
Lorsqu’une enquête était susceptible d’être ouverte sur un contribuable ne faisant pas partie de la catégorie des « notoriétés », l’usage était que l’enquêteur vienne m’en parler au moment de solliciter l’ouverture d’un premier acte de procédure – droit de communication ou droit d’enquête. Dans le cas d’espèce, et dans la mesure où il s’agissait d’une « notoriété », la règle – qui n’a pas été respectée – voulait que l’enquêteur vienne me demander l’autorisation de se faire communiquer le dossier. Je la lui aurais certainement accordée, et j’aurais informé ma hiérarchie, à Pantin.
M. le président Charles de Courson. Vous étiez déjà chef de service à l’époque ?
M. Olivier André. J’ai été le chef de brigade à Bordeaux de septembre 1998 à août 2003.
M. le président Charles de Courson. C’est donc vous que M. Mangier aurait dû informer.
M. Olivier André. Oui.
M. Laurent Habert, inspecteur principal, chef de la brigade d’intervention interrégionale d’Orléans. Je n’aurai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d’être dit, même si je connais bien le fonctionnement interne de la BII de Bordeaux, pour en avoir été le responsable de septembre 2003 à septembre 2009. Je n’étais pas présent à l’époque des faits, mais je l’étais lorsque le dossier a été renvoyé, en février 2007. Il faisait en effet partie d’un « wagon » de dossiers renvoyés au même moment afin de libérer de la place dans nos armoires. Mais à l’époque, je n’y ai pas prêté attention.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Richard, vous avez parlé de « cas particuliers » traités à cette époque. Aucun autre protagoniste de l’affaire n’a été concerné par des demandes de dossier ou la transmission d’informations ?
M. Patrick Richard. Non. Fort heureusement, nous n’avions que très rarement affaire à des dossiers de personnalités en vue. Dans toute ma carrière, qui a duré 39 ans, le cas ne s’est présenté que deux fois. Mais sans même parler des élus, lorsque le dossier paraissait sensible, nous en parlions très naturellement avec le chef de service, ne serait-ce que pour bénéficier de son expertise sur la façon dont l’enquête devait – ou non – être menée.
En outre, M. Cahuzac n’avait pas, à l’époque, la notoriété qu’il a acquise depuis. À nos yeux, il ne s’agissait que d’un député parmi d’autres, qui briguait la mairie de Villeneuve-sur-Lot.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Mangier ne vous a jamais dit qui était son informateur ?
M. Patrick Richard. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment les choses se passaient-elles lorsque vous obteniez un renseignement de la part d’une personne appartenant à la même administration que vous ?
M. Patrick Richard. Tout d’abord, j’ai oublié de préciser que notre service avait une compétence nationale : il était donc d’usage que l’agent destinataire du renseignement traite le dossier, quel que soit le lieu de résidence de la personne incriminée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans l’hypothèse où la personne ayant transmis le renseignement était un inspecteur des impôts n’exerçant pas dans le même département que vous, n’aurait-il pas dû traiter le dossier ?
M. Patrick Richard. Tout dépend du service auquel il appartenait : les inspecteurs des impôts ont des prérogatives locales, régionales ou nationales, selon la nature de leur mission.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si une information provenait d’un fonctionnaire des impôts exerçant dans un autre département, vous en étiez informé ?
M. Patrick Richard. Oui, en toute logique. Mais dans un tel cas, entre collègues de la même administration, il ne s’agissait pas d’un échange formel, il n’y avait pas de droit de communication.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si cela avait été le cas de l’informateur de M. Mangier, vous auriez donc dû le savoir ?
M. Patrick Richard. En l’occurrence, le Lot-et-Garonne faisait partie de notre circonscription territoriale. Avec M. Mangier, nous nous occupions plus particulièrement de La Rochelle et d’Agen : nos collègues savaient donc que nous étions les interlocuteurs désignés pour tout ce qui concernait ces zones. C’est pourquoi j’ai toujours eu le sentiment
– même si je ne peux en être certain – que l’information venait d’une personne extérieure à l’administration, sans quoi nous l’aurions rencontrée tous les deux, mon collègue et moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est le comportement de M. Mangier, le fait qu’il ne vous ait pas informé de l’identité de son informateur, qui vous amène à penser que ce dernier appartenait à la sphère privée de votre collègue, et non à l’administration.
M. Patrick Richard. En tout cas, si c’était un inspecteur des impôts, il avait avec lui une relation privée. Mais à l’époque des faits – et même jusqu’à une période très récente –, je ne pensais pas que l’informateur puisse être de la maison. Même s’il s’agissait d’un fonctionnaire travaillant dans une autre administration, nous l’aurions rencontré ensemble. Cela étant, je peux me tromper. Il peut s’agir d’un fonctionnaire avec lequel mon collègue avait des relations en dehors du cercle professionnel, lors de rencontres sportives, par exemple – il jouait beaucoup au tennis. Je n’en sais rien. Mais si mon collègue n’a pas souhaité que je rencontre l’informateur, c’est parce que ce dernier l’avait expressément refusé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand votre collègue vous a-t-il prévenu ? Quand il a demandé communication du dossier ?
M. Patrick Richard. J’ai été mis au courant quand la secrétaire nous a apporté le dossier : c’est à ce moment que mon collègue m’en a parlé. Cela n’avait rien d’inhabituel.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez donc été informé lorsque le dossier a été transmis à la demande de M. Mangier.
M. Patrick Richard. Oui, via le secrétariat.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans une telle situation – un contrôle visant un parlementaire – l’autorité de l’État dans le département – le préfet – était-elle prévenue ?
M. Patrick Richard. Au cours de ma carrière, il ne m’est arrivé que deux fois de recevoir une information concernant un parlementaire. Dans une telle situation, nous n’informons pas les autorités : seul le chef de service est informé.
M. Alain Claeys, rapporteur. À votre connaissance, aucune information n’a donc été transmise au préfet ou au sous-préfet ?
M. Patrick Richard. À notre connaissance, personne n’a été informé – même pas M. André, ce qui était une erreur. Nous n’avions de comptes à rendre qu’à notre chef de service.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque le dossier est arrivé dans votre service, à quelles investigations avez-vous procédé ?
M. Patrick Richard. Je vous l’ai dit : dans un tel cas, on examine l’environnement du dossier. S’agissant d’un compte à l’étranger, on pouvait supposer qu’il était alimenté par des revenus non déclarés. Il fallait donc vérifier que la personne incriminée avait des revenus concernés par nos procédures : TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc. La nature de ces revenus devait par ailleurs rendre possible une fraude fiscale importante. Par exemple, un fonctionnaire des finances n’aurait pu dissimuler une part importante de son traitement.
Après cet examen de l’environnement du dossier, nous étions généralement amenés à rencontrer à nouveau la personne ayant transmis l’information, afin de l’interroger sur ses sources, de savoir si elle avait connaissance de la façon dont le compte bancaire était alimenté – soit par son titulaire, soit par un tiers, client ou fournisseur. Mais dans ce cas particulier, nous n’avions aucun angle d’attaque : nous ne connaissions ni le nom de la banque, ni le moment où l’argent avait été versé, ni les enjeux. Nous ne savions rien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous-même ne saviez rien…
M. Patrick Richard. Je suis convaincu que M. Mangier n’en savait pas plus.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous êtes convaincu que l’informateur – qui, selon vous, n’appartenait pas à l’administration fiscale – n’en avait pas dit plus à M. Mangier.
M. Patrick Richard. En effet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au vu de son dossier, des remarques ont-elles été formulées à l’adresse de M. Cahuzac ?
M. Patrick Richard. Non, aucune. En l’absence d’informations nous permettant de démarrer une enquête – car, je le répète : il n’y a pas eu d’enquête, seulement le traitement d’une information brute, et très succincte –, nous avons décidé, d’un commun accord, de ne pas aller plus loin.
M. Alain Claeys, rapporteur. De même, lorsqu’il a été renvoyé à Paris, le dossier ne comportait aucun signalement de votre part ?
M. Patrick Richard. Je n’ai même pas su à quel moment il avait été renvoyé. Lors d’une opération d’archivage, un nombre important de dossiers ont été retournés aux services expéditeurs, parmi lesquels figurait celui de M. Cahuzac. Mais il aurait pu tout aussi bien être renvoyé deux ans plus tôt. Dès lors que la décision avait été prise de ne pas ouvrir d’enquête, l’agent ayant réclamé le dossier était supposé le restituer, sans fournir d’explication.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour en revenir à M. Mangier, vous a-t-il présenté son informateur comme un ami ?
M. Patrick Richard. Il n’a rien dit quant à la qualité de la personne qui lui avait donné l’information. Or, nous avons pour règle de ne pas nous poser de questions : si le collègue souhaitait nous communiquer l’identité de l’aviseur, nous le rencontrions ensemble ; sinon, on n’insistait pas. Du reste, le problème se posait peu tant les aviseurs dignes de ce nom – connaissant le dossier et disposant d’informations suffisamment pertinentes pour que nous puissions engager une enquête – restaient rares. Généralement, nous faisions les recherches nous-mêmes et obtenions l’information en même temps ; de toute ma carrière, il ne m’est arrivé que deux ou trois fois d’être informé par des personnes appartenant à ma sphère privée, et j’ai toujours pu les faire rencontrer à M. Mangier. Mais dans ce cas particulier, il m’a dit que l’aviseur ne souhaitait voir que lui.
M. Alain Claeys, rapporteur. S’il s’agissait d’un inspecteur des impôts travaillant dans un autre département, M. Mangier aurait-il dû vous informer ?
M. Patrick Richard. Il n’en avait pas l’obligation.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais était-ce la tradition ?
M. Patrick Richard. Généralement, lorsqu’il s’agissait d’un collègue, nous le rencontrions à deux ; si M. Mangier en a usé autrement dans ce cas-là, c’est qu’il le considérait comme un ami et non comme un inspecteur des impôts – à supposer que c’en fût un.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ainsi, durant cette période, vous n’avez pas eu d’autres informations concernant Jérôme Cahuzac ?
M. Patrick Richard. Non, jamais.
M. Olivier André. Moi non plus.
M. le président Charles de Courson. Vous avez, l’un comme l’autre, suggéré que deux erreurs avaient été commises dans la gestion de cette affaire. D’abord, M. Mangier n’a pas averti sa hiérarchie. Commettait-il souvent ce genre d’erreurs ? À votre avis, pourquoi n’a-t-il pas averti sa hiérarchie ?
M. Olivier André. Il ne s’agissait pas d’un comportement habituel, dans la mesure où le nombre de personnalités relevant de la compétence des BII – qui s’intéressent surtout aux activités professionnelles – restait négligeable. Ce sont les grandes entreprises qui représentent les notoriétés dans notre domaine, et j’ai toujours été informé de tous les éléments les concernant. Il est probable que M. Mangier aura commis une négligence.
M. le président Charles de Courson. M. Mangier aurait-il subi des pressions pour ne pas poursuivre l’investigation ?
M. Olivier André. Je n’imagine pas, étant donné le contexte de l’époque, qu’il ait pu y en avoir dans le cadre d’une procédure fiscale.
M. Patrick Richard. Je suis certain que non. M. Mangier n’était pas homme à se laisser intimider. Il a pu, en revanche, commettre une négligence.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous connu M. Gonelle ?
M. Patrick Richard. Non, j’ai appris son nom récemment.
M. Olivier André. Je ne l’ai pas connu non plus.
M. Laurent Habert. Moi non plus.
M. le président Charles de Courson. Chers collègues, je voulais vous annoncer que M. le rapporteur et moi-même avons trouvé le nom de l’aviseur ; il sera entendu par la commission d’enquête. Comme MM. Gonelle et Garnier nous l’avaient indiqué, il s’agit, Messieurs, d’un de vos anciens collègues, inspecteur des impôts actuellement à la retraite. Vous ne le saviez pas ?
M. Patrick Richard. Non.
M. le président Charles de Courson. La durée anormale de détention du dossier constitue la deuxième erreur que vous avez notée. Existe-t-il des règles, des instructions en cette matière, prévoyant par exemple qu’au bout d’un ou deux ans, on renvoie un dossier, surtout si l’on n’a trouvé aucune piste ?
M. Olivier André. Pas d’instructions, mais du bon sens et des bonnes pratiques. Dès lors qu’on ne peut plus avancer sur un dossier, on le renvoie au service gestionnaire pour qu’il soit classé, actualisé, mis à jour et conservé.
M. le président Charles de Courson. En le renvoyant, l’accompagnez-vous d’une note précisant que l’information n’a pas débouché sur une enquête ?
M. Olivier André. Aujourd’hui, le dispositif informatique de suivi des dossiers et des demandes laisse forcément des traces. Mais à l’époque, on ne faisait pas de notes. En revanche, toute action menée dans le cadre du livre des procédures fiscales était évidemment enregistrée.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Habert, c’est vous qui étiez en charge en 2007, quand le dossier a été renvoyé. À cette date encore, aucune instruction n’imposait d’y joindre une note expliquant les démarches entreprises et précisant la raison du renvoi ?
M. Laurent Habert. Non. En revanche, de temps en temps – par mesure de bon sens – on se débarrassait des dossiers dont on ne ferait rien. Mais la durée de stockage d’un dossier pouvait varier de six mois à un ou deux ans, les enquêteurs se disant que si une nouvelle information arrivait, ils pourraient le rouvrir facilement. En tout cas, en 2007, lorsque le dossier a été renvoyé – sans doute avec beaucoup d’autres – à son centre des impôts d’origine, il n’était accompagné d’aucune note explicative.
M. Alain Claeys, rapporteur. Depuis que l’affaire a éclaté, avez-vous été entendus par votre administration centrale ?
M. Patrick Richard. Non.
M. Olivier André. Non plus.
M. Laurent Habert. Moi non plus.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et par la police judiciaire ?
M. Patrick Richard. Oui, j’ai été entendu par deux inspecteurs dans les locaux de l’hôtel de police de Bordeaux, en février ou mars dernier.
M. Olivier André. J’ai été entendu le 26 février, à Rennes.
M. Laurent Habert. Je l’ai été en février par les enquêteurs de la Division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF).
M. le président Charles de Courson. Monsieur Richard, vous dites que vous ne connaissiez pas M. Cahuzac ; d’après vous, M. Mangier – votre collègue durant 25 ans –, le connaissait-il ?
M. Patrick Richard. Je ne crois pas. Comme l’a dit M. André, on ne s’intéressait pas tant aux élus ou aux maires qu’aux entreprises, où la fraude pouvait concerner non seulement l’impôt sur les sociétés, mais aussi la TVA. Nos procédures étant très lourdes, les enjeux devaient en valoir la peine. Ne s’intéressant pas particulièrement à la politique, M. Mangier n’avait aucune raison de connaître ce député qui ne faisait pas beaucoup parler de lui à l’époque.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Monsieur Richard, quelqu’un informe M. Mangier de ce que M. Cahuzac a un compte en Suisse ; vous demandez son dossier fiscal, mais n’y trouvez rien de pertinent. Même si vous vous intéressez en priorité aux entreprises, M. Cahuzac n’était tout de même pas un inconnu : n’avez-vous pas conseillé à votre collègue d’en parler à ses supérieurs ?
M. le président Charles de Courson. D’autant plus – vous l’avez dit – qu’il s’agissait de votre premier dossier de notoriété !
M. Patrick Richard. J’ai travaillé avec M. Mangier de 1984 à 2009 ; bien qu’il fût le plus gradé de nous deux, nous entretenions des relations de camaraderie et formions un binôme, partageant toutes les informations. Nous avions une entière confiance mutuelle.
Même si je ne me souviens plus des détails, il s’agissait pour nous d’un dossier comme les autres, et nous l’avons traité en conséquence. J’aurais peut-être pu lui conseiller d’en parler à M. André ; cela aurait d’ailleurs évité que le dossier reste si longtemps dans nos services, car M. André n’aurait pas manqué de nous demander de faire le point sur nos recherches. Aujourd’hui, ce type d’oubli n’arriverait plus : toutes les demandes de dossiers se font via le système informatique, et le chef de service peut à tout moment voir sur quel dossier on travaille. De temps en temps, on reçoit des alertes indiquant qu’on détient un dossier depuis tant de jours et nous demandant si on en a toujours besoin. À l’époque, ce n’était pas le cas ; ces dossiers devenaient d’ailleurs vite inexploitables, car les documents qu’ils contenaient au moment de la demande se prescrivaient avec le temps, et le service ne nous envoyait pas de mises à jour, gardant les nouveaux documents qu’il recevait.
J’assume ma part de responsabilité : j’aurais sans doute dû conseiller à M. Mangier d’en parler, ou bien en parler moi-même, car si c’est mon collègue qui a apporté l’information initiale, nous avons discuté de ce dossier ensemble. Nous n’avons pas averti notre hiérarchie, mais sans aucune malice.
Mme Cécile Untermaier. Aviez-vous l’habitude de vous cacher l’identité de l’aviseur, votre source d’information ? Le silence de votre collègue vous a-t-il surpris ?
M. Patrick Richard. Non. M. Mangier m’a dit que son informateur ne souhaitait rencontrer personne d’autre que lui : j’en ai déduit qu’il s’agissait de quelqu’un de sa sphère privée, et j’ai naturellement fait confiance à mon coéquipier. Ce type de cas arrivait rarement puisque nous ne recevions pas souvent d’informations par ce biais.
Mme Cécile Untermaier. Même si vous ne connaissiez pas l’aviseur, quand votre collègue vous en a parlé, avez-vous eu le sentiment que la source était sérieuse ?
M. Patrick Richard. J’avais surtout la conviction qu’il ne s’agissait pas d’une information de première main, la personne ayant alerté M. Mangier ne faisant que relayer des ouï-dire. Estimant que l’aviseur n’en savait pas plus, je n’ai pas insisté pour le rencontrer. En revanche, j’avais demandé à M. Mangier de voir avec lui si nous pouvions rencontrer la personne dont émanait l’information – on a su depuis que c’était M. Gonelle.
Mme Cécile Untermaier. Avez-vous senti de la part de M. Mangier une réelle détermination à demander le dossier, puis à mener des investigations ?
M. Patrick Richard. Oui, comme avec tout autre dossier. Lorsqu’une information nous paraissait digne d’intérêt, et susceptible d’alimenter le contrôle fiscal, nous nous en saisissions sans états d’âme, quelle que soit la qualité de la personne visée. Dans ce domaine, M. Mangier n’a jamais fait preuve de défaillance ; si l’information lui avait permis de mener des investigations, il l’aurait fait.
Mme Cécile Untermaier. Pensez-vous qu’il a informé l’aviseur de l’échec de vos investigations ?
M. Patrick Richard. Nous avions pour règle de ne pas communiquer à l’informateur les résultats – positifs ou négatifs – de notre travail. Mais je n’exclus pas que, pour mettre un terme aux assauts répétés de cette personne, M. Mangier ait pu lui dire
– comme je l’ai lu dans les comptes rendus des auditions de votre commission d’enquête – qu’il n’avait pas pu obtenir le dossier de M. Cahuzac. J’aurais pu faire de même.
M. le président Charles de Courson. Cela serait à l’origine de la thèse selon laquelle M. Mangier aurait été bloqué dans son étude du dossier ?
M. Patrick Richard. Depuis que l’affaire est sortie, j’y ai beaucoup réfléchi : mon collègue a pu faire cette réponse.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est qu’une hypothèse.
M. Patrick Richard. Tout à fait mais ce n’est pas exclu.
M. Jacques Cresta. Monsieur André, vous avez parlé de bon sens, de bonnes pratiques, de procédures – même si l’une d’elles n’a manifestement pas été respectée. Si vos collaborateurs vous avaient saisi de cette information, quelle procédure auriez-vous déclenchée, quel type de suivi vos services auraient-ils assuré ?
Avez-vous été informé des investigations de vos collaborateurs, et le cas échéant à quel moment ?
M. Olivier André. Tout à l’heure, je parlais des procédures inscrites dans le livre des procédures fiscales. Les informations qui circulent en interne au sein des services relèvent plutôt de règles non écrites. Si M. Mangier m’avait informé, j’aurais immédiatement averti ma hiérarchie – la DNEF de Pantin – de l’ouverture potentielle d’une enquête à l’encontre de M. Cahuzac, et demandé communication de son dossier. Suivant l’usage, nous aurions ensuite examiné tous les trois ce dossier, et les enquêteurs m’auraient proposé – ou non – des pistes à explorer. Si le dossier fiscal de M. Cahuzac avait présenté des anomalies justifiant l’ouverture d’une procédure, j’aurais informé ma hiérarchie, sollicité son autorisation, et l’enquête aurait suivi son cours. En l’espèce, rien ne pouvait être fait ; je suppose donc qu’on aurait refermé le dossier et qu’on l’aurait renvoyé, dans un délai normal, au service gestionnaire.
M. Jacques Cresta. Quand avez-vous su que MM. Richard et Mangier avaient effectué ces démarches ?
M. Olivier André. L’information m’est parvenue par bribes : au mois de février, les officiers de police judiciaire de la DNIFF m’ont fait part de la présence du dossier dans mon ancien service durant une longue période ; puis, au fil des auditions de votre commission, a émergé le nom de M. Mangier, et enfin celui de M. Richard.
M. le président Charles de Courson. Dans le fameux enregistrement que l’aviseur avait – d’après la déclaration de M. Gonelle – écouté, figure explicitement le nom de la banque UBS. D’après vos souvenirs, M. Mangier a-t-il évoqué le nom d’une banque ?
M. Patrick Richard. Je n’en ai pas le souvenir. Cela dit, même s’il le connaissait, il a pu estimer que le nom de la banque n’avait pas d’importance à ce stade du dossier.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous eu des contacts avec M. Garnier ?
M. Patrick Richard. Non. Je connaissais M. Garnier de réputation, ayant appris par la presse syndicale ses démêlés avec sa hiérarchie, mais je n’ai jamais eu de relations avec lui.
M. le président Charles de Courson. Et M. Mangier, à votre connaissance ?
M. Patrick Richard. Non, je ne crois pas.
M. Olivier André. Je n’ai jamais rencontré M. Garnier ; étant à Bordeaux, j’ai entendu parler du différend qui l’opposait à sa hiérarchie à propos des suites d’un contrôle fiscal, mais sans savoir en quoi consistait ce différend.
M. le président Charles de Courson. Et vous, Monsieur Habert ?
M. Laurent Habert. Même réponse. En 2003, on parlait encore des démêlés de M. Garnier avec sa hiérarchie, mais je ne le connaissais pas.
M. le président Charles de Courson. Vous n’étiez donc au courant ni des multiples contentieux devant les tribunaux – en particulier le tribunal administratif de Bordeaux – ni du contenu du dossier ?
M. Laurent Habert. Non, et je ne m’y suis pas intéressé.
Mme Cécile Untermaier. Aviez-vous entendu parler de M. Cahuzac à propos du contentieux qui opposait M. Garnier à sa hiérarchie ?
M. Laurent Habert. Je n’en ai pas le souvenir. De toute façon, à cette époque, M. Cahuzac était un inconnu, un député parmi d’autres. On ne connaît pas, dix ans en avance, le nom des futurs ministres du budget !
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie, Messieurs, pour vos réponses.
Audition du mercredi 19 juin 2013
À 14 heures : M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire.
M. le président Charles de Courson. Nous recevons M. Jean-Louis Bruguière, ancien premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris chargé de l’instruction et de la coordination de la section antiterroriste.
Nous avons souhaité vous entendre, monsieur Bruguière, car c’est à vous que M. Michel Gonelle a confié l’un des deux exemplaires de l’enregistrement dans lequel M. Jérôme Cahuzac évoquait son compte suisse avec son chargé d’affaires. Or si l’on en croît les déclarations qu’il nous a faites sous serment, le 21 mai dernier, ce n’est pas M. Gonelle qui a transmis cet enregistrement à la presse. Ce fait a d’ailleurs été confirmé par les journalistes de Mediapart.
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Nous souhaiterions donc savoir qui pouvait bien disposer de cet enregistrement ou, du moins, connaître son existence avant le 4 décembre dernier.
M. Bruguière prête serment.
M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir convié, à la suite de la polémique entourant cette affaire, me donnant ainsi l’occasion de m’expliquer devant la représentation nationale.
Je souhaite rappeler les conditions dans lesquelles j’ai été amené à m’engager en politique, avant d’y renoncer définitivement, fin juin 2007, après ma défaite aux élections législatives.
En ce qui concerne M. Gonelle, celui-ci n’est ni un ami, ni même une relation. Je l’ai vu pour la première fois dans les années 2000, alors qu’il était encore maire, pour aborder un problème de voirie. Il souhaitait en effet acquérir, dans le but de construire un rond-point, un terrain situé sur une propriété familiale que j’ai à Villeneuve. Par la suite, dans les années 2004-2005, je l’ai revu sporadiquement dans ce que l’on appelle les « dîners en ville » locaux, sans pour autant nouer avec lui des relations amicales. Nous ne nous sommes donc pas côtoyés à cette époque.
Les choses ont changé en 2006, quand j’ai été approché par Michel Gonelle – mais cela, il ne vous l’a pas dit – et Alain Merly, député de la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. Tous deux – avec l’appui, comme je l’ai su plus tard, de M. Jean François-Poncet, qui régnait sur l’ensemble du département – souhaitaient me voir conduire une liste contre M. Cahuzac aux élections municipales de 2008. Ma réponse a été négative, je ne comptais pas faire de la politique et j’étais accaparé par mon activité professionnelle. J’ai donc décliné l’offre. Mais je me rendais régulièrement dans le Lot-et-Garonne, et j’ai donc eu l’occasion de revoir M. Merly, M. Gonelle ou M. François-Poncet.
Ces derniers, supposant sans doute que je n’étais pas intéressé par un mandat local, m’ont proposé de me présenter aux élections législatives de 2007, le député sortant, M. Merly, ayant accepté de ne pas se représenter – ce qui se produit assez rarement, d’après ce que j’ai pu comprendre. C’est donc la droite locale qui a pensé, à tort ou à raison, que je pourrais être, compte tenu de mon activité et de mon aura, un bon candidat pour empêcher la gauche de reprendre la troisième circonscription.
La fin de ma carrière approchait – j’ai pris ma retraite en mai 2008. J’ai donc pensé que je pourrais continuer à assumer une mission de service public car c’est ce qui m’intéressait, en exerçant un mandat électif. À la fin de l’année 2006, après avoir réfléchi, j’ai donc donné un accord de principe. Dès lors, j’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises M. Gonelle et M. Merly.
J’ai lu le compte rendu des déclarations de M. Gonelle et je suis obligé de m’inscrire en faux : ce dernier était l’homme lige, politiquement parlant, de la droite villeneuvoise. Dans la troisième circonscription, il y a Villeneuve, et le reste. Si, sur le plan politique, ceux qui ne sont pas de la ville ont du mal s’y implanter ; de leur côté, les Villeneuvois, politiquement parlant, n’ont pas d’influence dans le reste de la circonscription. Alain Merly me pilotait donc dans les autres cantons, et Michel Gonelle à Villeneuve. En effet, je ne connaissais rien ni personne dans la circonscription : j’avais besoin d’informations sur les rapports de force et les enjeux politiques.
C’est dans ce contexte que m’a été remis l’enregistrement. Quant à la date, M. Gonelle s’est montré très précis – il doit avoir des agendas bien documentés – : il parle du 12 novembre 2006. Pour ma part, j’aurais envisagé un moment plus tardif, en 2007, mais il est possible que je me trompe totalement sur ce point. Je n’ai pas noté le rendez-vous sur mon agenda : à ce stade, cela n’avait pas une grande importance pour moi. Cependant, j’étais bien dans la région à ce moment : la date est donc plausible. Quant au lieu, il s’agissait sans doute de son cabinet d’avocat, où je me suis rendu, au plus, deux ou trois fois. M. Gonelle m’a parlé de ce qui lui tenait à cœur – le Villeneuvois –, mais très rapidement, alors que je voulais aborder les grands sujets pouvant préoccuper les électeurs de la circonscription, la conversation s’est focalisée sur M. Cahuzac. J’ai alors compris que le personnage avait une grande importance aux yeux de M. Gonelle. D’une manière générale, j’ai pu observer une forme de sur-réaction, d’inquiétude à l’égard de M. Cahuzac, considéré comme une personne redoutable, d’une intelligence remarquable – ce qui est d’ailleurs exact –, et comme un adversaire politique difficile à affronter. On m’a même dissuadé de participer au débat de deuxième tour, au risque d’être « pulvérisé », entre guillemets, par mon contradicteur. Bien entendu, je n’ai pas tenu compte de cet avis, et le débat s’est bien passé, même s’il a été rude.
Très rapidement, M. Gonelle a évoqué les défauts, ou ce qu’il appelait les failles de M. Cahuzac : son appétit pour l’argent, ses investissements, sa clinique, etc. Et d’une façon un peu mystérieuse, comme toujours chez lui, il a mentionné l’existence d’un compte en Suisse. C’est à ce moment – je suis formel – que M. Gonelle m’a produit cette cassette. Je ne l’ai pas sollicité en ce sens. Comment aurais-je pu le faire, puisque je ne connaissais pas l’existence d’un tel document ? Je l’ai dit, j’étais politiquement « piloté », entre guillemets, par quelqu’un chargé de faire, d’une certaine façon, ma promotion.
Il est vrai que j’ai pris cet enregistrement. En raison du climat de confiance qui existait à l’époque – et qui sera détruit par la suite –, je n’ai pas eu le réflexe de le refuser. Tel était le contexte.
M. Gonelle a dit avoir parlé du financement, par des laboratoires pharmaceutiques, d’installations sportives de la ville. Je n’en garde aucun souvenir, ni d’ailleurs des circonstances dans lesquelles il disait avoir obtenu l’enregistrement. Je crois qu’il m’a affirmé que celui-ci était probablement de mauvaise qualité, mais c’est tout ce dont je me souviens.
Cette conversation a eu lieu un dimanche, si la date est exacte. Le soir même, je suis rentré à Paris, où j’avais des obligations. Quant à l’enregistrement, je ne me souviens plus quel en était le support. Selon moi, il ne s’agissait pas d’un mini-CD. Une fois de plus, je peux me tromper, mais d’après le souvenir, vague, que j’en ai gardé, il s’agissait plutôt d’une clé USB ou d’une minicassette. Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais écouté le contenu de ce document. Pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que cela ne m’intéressait pas, mais surtout parce que ma vision de la politique n’était pas celle-là. C’est d’ailleurs une des raisons qui m’ont conduit à abandonner définitivement toute ambition politique.
La politique, selon moi, c’est un combat d’idées, de programmes. J’ai cherché les moyens de valoriser la circonscription : j’ai même trouvé des investisseurs américains prêts à apporter 200 à 300 millions de dollars. On m’a alors dit : « Tu perds ton temps, parce que l’emploi, tout le monde s’en fout ! ». J’ai compris à cette occasion que les réalités étaient ailleurs, et que les problèmes posés n’avaient pas nécessairement de rapport avec un programme politique. Dans la mesure où je voulais faire campagne sur un programme et des idées, il allait de soi que je ne pouvais pas faire de l’enregistrement un élément de cette campagne. Le problème n’était pas M. Cahuzac, mais les idées qu’il portait.
Par ailleurs, quand quelqu’un vous dit qu’il détient un enregistrement, vous vous interrogez. Le terme même génère une certaine suspicion. À supposer qu’il existe réellement – car je ne l’avais pas écouté –, je ne voyais pas comment une personne privée pouvait obtenir un tel enregistrement. Tout le background de l’affaire – y compris les personnages gravitant autour, comme M. Garnier –, je ne l’ai découvert qu’en 2012. M. Gonelle ne s’est jamais ouvert auprès de moi de ce qu’il a pu faire entre 2000 et 2007 : je l’ai découvert dans la presse. Et quand j’ai lu ses explications en décembre dernier, je me suis interrogé. Dans toute ma carrière de magistrat, je n’ai jamais vu une opération de ce genre ! Des incidents, des problèmes de procédures, des captations d’information, j’en ai sans doute connus plus que d’autres, mais pas cela.
En tout état de cause, le procédé est, d’un point de vue légal, pour le moins suspect. On pourrait même admettre une certaine qualification pénale. Je le considère en tout cas déloyal, ou au moins indélicat. On ne fait pas de la politique avec des procès de la sorte, c’était ma conception. Je n’ai donc pas utilisé l’enregistrement, ni n’en ai fait de copie. Je l’ai gardé chez moi, et je n’ai pas subi de cambriolage. Par la suite – j’ai consulté mon agenda : je suis revenu à la mi-décembre, puis à la fin du mois –, je m’en suis débarrassé, sans doute après l’avoir détruit physiquement, je ne m’en souviens pas. Je suis en tout cas certain de l’avoir jeté dans la poubelle familiale. Compte tenu de la méthode employée dans les collectivités territoriales pour retraiter les ordures ménagères, je suis donc assuré que cet enregistrement n’a pas pu être récupéré, même si je n’ai pas mis le support au feu ou dans un broyeur.
Afin que les choses soient claires, je répète que je n’ai pas cherché à lire le support d’enregistrement pour en vérifier le contenu. Je m’en suis débarrassé parce que je ne comptais pas l’utiliser. J’ajoute que d’autres éléments de déloyauté dans le comportement de M. Gonelle m’ont conduit à évincer celui-ci du cercle des personnes que je côtoyais dans le cadre de la campagne électorale, quoi qu’il dise à ce sujet – et j’ai des témoins.
Par ailleurs, il est évident que je n’ai pas donné cet enregistrement à Mediapart. Tout le monde sait que mes relations avec Mediapart ne sont pas des meilleures. Depuis le début, ce média a été un contempteur permanent de mes actions et de ma stratégie antiterroriste, et certains de ses articles auraient pu faire l’objet de plaintes en diffamation. Je ne connais pas M. Plenel, avec lequel je n’ai jamais eu le moindre contact téléphonique depuis que ce site d’information existe. De même, je n’ai parlé avec aucun de ses collaborateurs.
Voilà ce que je voulais vous dire sur les faits qui vous intéressent. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Après mon échec électoral, en juin 2007, j’ai annoncé clairement aux électeurs que non seulement je ne me présenterai pas aux élections municipales de 2008, mais que j’abandonnais définitivement la politique. Je m’y suis tenu strictement : je n’ai participé à aucun meeting, bien que revenant très régulièrement à Villeneuve, lieu de séjour familial où je me sens bien. J’y compte quelques amis, mais je suis resté totalement en dehors de la vie politique, ce qui ne me paraît pas être le cas de M. Gonelle : en 2007, il n’était peut-être plus un élu, mais il était actif, au sens où il était un référent. On considérait – y compris M. Jean François-Poncet – que l’on ne pouvait rien faire dans la ville sans passer par lui, car, comme on disait à l’époque, il tenait les réseaux.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez, monsieur Bruguière, que vous ne détenez plus l’enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. À 100 %.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez que vous l’avez détruit en décembre 2007.
M. Jean-Louis Bruguière. Oui, je l’ai détruit à cette époque. Je suis prudent quant à la date, car mon agenda n’est pas aussi précis.
M. le président Charles de Courson. En décembre 2007 ou en décembre 2006 ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je me suis trompé : c’était en décembre 2006, avant les élections, et très peu de temps après la remise.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous l’avez détruit ou jeté ?
M. le président Charles de Courson. Il a dit : « jeté ».
M. Jean-Louis Bruguière. Je veux être précis. À l’époque où il m’a été remis, cet enregistrement n’était pas pour moi un élément essentiel – cela peut paraître surprenant aujourd’hui, si ce n’est qu’il m’a permis de comprendre la psychologie de M. Gonelle : cela a marqué le début de la dégradation de nos relations. Je n’ai en effet pas accepté ce qui pouvait apparaître comme une instrumentalisation. Je l’ai donc écarté.
Le problème est que je ne me rappelle même pas la forme prise par cet enregistrement. Plus j’y réfléchis, et moins je pense qu’il s’agissait d’un CD. Mais je peux me tromper. Je connais les problèmes posés par les témoignages : la mémoire est fragile. Quoi qu’il en soit, je m’en suis débarrassé dans des conditions telles qu’il est impossible que l’on ait pu le récupérer et le dupliquer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mettons-nous d’accord : avant la fin de l’année 2006, vous vous débarrassez de ce que nous appellerons un support audio, lequel finit à la décharge municipale.
Nous avons auditionné M. Michel Gonelle, sous serment, le 21 mai 2013. Je rappelle à la Commission ce qu’il nous a déclaré : « Lorsque j’ai demandé à Jean-Louis Bruguière s’il savait que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, il a aussitôt voulu savoir comment j’en étais informé. Je lui ai donc raconté l’anecdote du téléphone. Apprenant que j’avais conservé l’enregistrement, il a voulu l’écouter. Mais le support était un mini-CD, dont on avait l’usage au début des années 2000, et je n’avais pas avec moi l’appareil permettant de le lire. Il m’a donc dit : “Confiez-le moi, je l’écouterai, puis je vous le rendrai.” Quand je l’ai averti que le son était de très mauvaise qualité, il m’a répondu qu’il avait à sa disposition des gens capables de l’améliorer. Je l’ai cru, car ce juge antiterroriste avait mené de nombreuses enquêtes impliquant des écoutes téléphoniques. »
« Bien que ne le connaissant pas très bien à l’époque, je lui ai fait confiance, car il était auréolé du prestige lié à son titre de premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Je lui ai donc donné l’un des deux mini-CD que je détenais. Il ne me l’a jamais rendu – alors que j’en étais le légitime propriétaire –, ni ne m’a dit ce qu’il en avait fait. Lorsque l’affaire a été révélée, il a eu des propos – rapportés, je crois, par Paris Match – absolument ignobles et mensongers à mon égard. Il a ainsi prétendu qu’il avait détruit l’enregistrement sans l’écouter, et qu’il m’avait congédié sur le champ de son équipe de campagne. Or, non seulement cette équipe n’était pas constituée en novembre 2006, mais il m’a écrit plus tard de façon louangeuse afin de me remercier pour les bons et loyaux services que je lui avais rendus pendant cette campagne. Visiblement, il ne se rappelait plus avoir envoyé cette longue lettre manuscrite, que j’ai, depuis, remise aux enquêteurs. Ce qu’il a raconté à la presse est donc complètement faux, et je lui en veux beaucoup de ce mensonge qui ne l’honore pas. »
Pouvez-vous commenter ces propos ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je m’inscris en faux contre tout cela. J’ai aussi noté qu’il était passé très rapidement sur le rôle joué par Alain Merly…
M. Alain Claeys, rapporteur. Restons-en à ces déclarations. Avez-vous adressé une lettre de remerciements à M. Gonelle ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui, et je vais vous dire pourquoi et dans quel contexte. L’ambiance politique locale, à ce moment, était délétère. Vous savez comment les choses se passent en cas d’échec électoral. On m’en a fait porter l’entière responsabilité, et je l’ai assumée. Mais dans la mesure où je n’avais pas l’intention de me présenter à nouveau, on m’a aussi mis en garde de ne pas adopter une attitude susceptible de pénaliser la droite au moment des élections municipales de 2008. Or, quoi qu’il en dise, la cheville ouvrière de la droite locale était M. Gonelle.
Il a raison : j’avais oublié l’existence de cette lettre, à laquelle je n’ai pas prêté beaucoup d’importance. C’est une question de mise en perspective qui me donne l’occasion de commenter les méthodes de M. Gonelle. Tout juriste sait – et M. Gonelle, avocat, en est un – qu’une lettre a un caractère confidentiel. Même si elle vous appartient juridiquement, son exploitation est interdite par la loi. C’est extraordinaire qu’il ait oublié cela ! Vous pouvez détenir une lettre en tant qu’objet de valeur, mais vous ne pouvez pas l’utiliser sans obtenir l’aval de son auteur. M. Gonelle, cependant, n’a pas pris de telles précautions.
Il en est de même, d’ailleurs, à propos de l’enregistrement…
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez donc lui avoir adressé cette lettre.
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne peux pas ne pas confirmer quelque chose qui est vrai. Du reste, la lettre m’a été présentée lorsque j’ai été entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire, et j’ai pu l’authentifier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au sujet de l’enregistrement, M. Gonelle vous prête ces propos : « Confiez-le moi, je l’écouterai, puis je vous le rendrai. » Les confirmez-vous ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non, parce que je n’étais pas intéressé par ce document.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est donc un mensonge ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. Je n’étais pas intéressé. De même, je n’ai jamais parlé d’expertise…
M. Alain Claeys, rapporteur. « Quand je l’ai averti que le son était de très mauvaise qualité, il m’a répondu qu’il avait à sa disposition des gens capables de l’améliorer. » Tout cela est donc faux ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. Il faut aussi remettre les choses en perspective.
M. Christian Eckert. C’est vrai ou c’est faux ?
M. le président Charles de Courson. Veuillez laisser M. Bruguière répondre.
M. Jean-Louis Bruguière. C’est faux !
Il est important, monsieur le député, de pouvoir apprécier cette déposition à l’aune de ce qui a été dit. J’ai ainsi observé que M. Gonelle, à un certain moment, manipulait ma qualité de premier vice-président et celle de procureur, comme si j’étais venu le voir ès qualités, en tant que magistrat, ce qui n’était pas le cas. En tout état de cause, même si, hiérarchiquement, j’avais la position de procureur, ce n’était pas moi, mais le procureur d’Agen qu’il fallait saisir au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous considérez donc que M. Gonelle a menti, tout en reconnaissant lui avoir adressé une lettre.
M. Jean-Louis Bruguière. Tout à fait. J’avais oublié son existence, jusqu’à ce qu’elle me soit présentée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez déclaré : « Je n’ai jamais transigé sur l’éthique et jamais je n’aurais voulu être élu avec des procédés à mon sens déloyaux. » J’ai donc une question toute simple : pourquoi avoir accepté cet enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. La question est très pertinente. Mais vous connaissez sans doute mieux que moi l’ambiance des campagnes électorales – en ce qui me concerne, c’était la première. Il y avait un climat de confiance, il était là pour m’expliquer les choses, et je n’ai pas eu le réflexe de refuser le document. Mais après coup, mon analyse a été celle que je vous ai indiquée. Il est un point fort sur lequel j’ai toujours été intransigeant : on ne fait pas une campagne électorale ad hominem, en essayant de détruire la réputation de l’adversaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous connaissez le contenu du support audio.
M. Jean-Louis Bruguière. Je le connais aujourd’hui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais M. Gonelle vous en indique le contenu lors de votre conversation, même si, selon vos dires, vous n’avez pas écouté l’enregistrement. Or vous êtes magistrat. Pourquoi, ayant en possession ce document, vous n’avez pas saisi le procureur de la République en vertu de l’article 40 ?
M. Jean-Louis Bruguière. Bonne question. C’est un problème de droit. Je ne sais pas, alors, ce que contient ce document.
M. Alain Claeys, rapporteur. On vous l’a expliqué.
M. Jean-Louis Bruguière. À ce moment, je ne connais que ce que m’en a dit M. Gonelle. Or je ne dispose d’aucun élément pour apprécier la véracité de ses propos – très brefs, au demeurant. Je ne sais pas dans quelles conditions l’enregistrement a été effectué. Je ne sais pas pourquoi et comment…
M. Alain Claeys, rapporteur. Je vous interromps. M. Gonelle dit : « Je lui ai raconté l’anecdote du téléphone. »
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est faux ?
M. Jean-Louis Bruguière. Moi, je n’en ai pas souvenance.
M. Alain Claeys, rapporteur. D’accord : c’est faux.
M. Jean-Louis Bruguière. Attendez, je suis précis : je n’en ai pas souvenance. Lorsque j’ai lu cela dans la presse, j’ai été surpris.
Mais même s’il m’avait raconté cela, selon le principe que l’on appelle en anglais hearsay, ce n’était pas à moi, témoin indirect, d’agir. C’est lui qui était à l’origine du témoignage. Je n’allais pas faire une enquête. Il faut avoir une suspicion suffisamment forte de l’existence d’une infraction pour être fondé, en vertu de l’article 40, à saisir le procureur de la République. Il ne m’appartenait pas, en tant que destinataire, en 2007, d’un document dont je n’avais pas vérifié le contenu – ce que l’on ne peut pas me reprocher –, et donc sur de simples allégations verbales, de considérer qu’il y avait une infraction constituée permettant de saisir le procureur de la République. Telle est mon analyse juridique.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour essayer de résumer vos déclarations, et afin que la Commission soit parfaitement éclairée, je vais vous poser une série de questions courtes.
Vous allez voir M. Gonelle en novembre 2006 pour préparer une éventuelle candidature aux législatives.
M. Jean-Louis Bruguière. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. A-t-il fait partie de votre équipe de campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Il a raison de dire le contraire, puisque je l’ai écarté avant que l’équipe ne soit constituée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon lui, en effet, elle ne l’était pas encore en novembre 2006.
M. Jean-Louis Bruguière. Parler d’« équipe » était un raccourci : je l’ai écarté du cercle des personnes qui m’entouraient, et qui devaient m’aider à comprendre les problèmes de la circonscription avant de m’engager formellement dans la campagne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez par ailleurs sous serment que M. Gonelle ne vous a décrit ni le contexte, ni le contenu de cet enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. Selon le souvenir que j’en ai, il m’a dit que cet enregistrement contenait des informations ou une discussion concernant un compte en Suisse et impliquant M. Cahuzac. Mais je n’ai pas souvenance de détails supplémentaires.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez que ce n’est pas vous qui avez demandé cet enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non, certainement pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Donc, M. Gonelle ment.
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne lui ai pas demandé l’enregistrement : je ne vois pas pourquoi je l’aurais fait alors que j’allais ensuite m’en séparer – sans même l’avoir écouté !
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez donc que vous n’avez pas écouté cet enregistrement.
M. Jean-Louis Bruguière. Formel.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez devant la Commission que vous n’avez pas transmis cet enregistrement à des personnes pour en améliorer le son…
M. le président Charles de Courson. À quiconque ?
M. Jean-Louis Bruguière. Formel. Et je vais plus loin : je n’ai jamais conçu l’idée ni eu l’intention de le faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce que Mediapart a essayé de vous contacter ?
M. Jean-Louis Bruguière. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jamais ?
M. Jean-Louis Bruguière. Jamais. S’ils prétendent le contraire, qu’ils le prouvent avec des fadettes !
M. Alain Claeys, rapporteur. Quels étaient vos rapports avec Rémy Garnier ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne le connaissais pas. J’ai découvert tout ce monde – avec effarement – en 2012. Et si j’ai parlé d’instrumentalisation, c’est parce que je n’ai découvert dans la presse qu’en 2012 tout ce qui entourait l’affaire. Je ne connaissais même pas le nom de Garnier. Je ne savais pas que M. Gonelle était son avocat…
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez dit n’être ni un ami de M. Gonelle, ni même une relation. Mais sur la situation fiscale de M. Cahuzac, sur cet éventuel compte en Suisse…
M. Jean-Louis Bruguière. J’ignorais tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Personne, à Villeneuve-sur-Lot, ne vous en avait parlé.
M. Jean-Louis Bruguière. On ne m’a parlé de rien. Quant à M. Garnier, j’ai découvert son nom dans la presse, de même que sa position, ou le fait qu’il avait été un des clients de M. Gonelle – ce dernier n’avait d’ailleurs pas à le dévoiler, en raison du secret professionnel –, tout cet environnement qui puisait sa source dès l’année 2000.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle déclare sous serment qu’il n’a pas transmis ce support audio à Mediapart. Mediapart confirme ce fait. Avez-vous une idée à ce sujet ?
M. Jean-Louis Bruguière. Tout cela ne m’a bien évidemment pas échappé. Je m’interroge : combien y a-t-il d’exemplaires ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Deux, selon M. Gonelle.
M. Jean-Louis Bruguière. Oui, mais au départ, il dit qu’il n’y en a pas du tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Devant la Commission d’enquête, il dit : deux.
M. Jean-Louis Bruguière. Je me réfère à ses déclarations dans les médias. Comme vous avez pu le constater, je ne suis jamais intervenu dans les médias après le 23 ou le 24 décembre. Je connais suffisamment les médias pour savoir les gérer et refuser systématiquement toute intervention.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre hypothèse est donc…
M. Jean-Louis Bruguière. Je n’ai pas d’hypothèse. Je ne veux pas accuser M. Gonelle, car je n’ai pas d’élément pour le faire. Lui, en revanche, m’a accusé formellement : il a dit « M. Bruguière ne peut pas ne pas être pour quelque chose… »
M. Alain Claeys, rapporteur. Une chose nous surprend. Votre interview à Paris Match a eu lieu le 23 décembre, avant l’audition de M. Gonelle par notre commission. Pourquoi êtes-vous si agressif à son égard ?
M. Jean-Louis Bruguière. Quand quelqu’un dit, la main sur le cœur : « Je ne suis pas un délateur », tout en affirmant avoir remis l’enregistrement à un très haut magistrat qui n’est pas du ressort d’Agen, cela fait sourire toute la presse nationale ! Il aurait été plus honnête qu’il me désigne nommément, mais agir ainsi lui permettait de ne pas passer pour un délateur. M. Gonelle emploie toujours le même procédé : parler à demi-mot, afin de pouvoir nier ensuite. Voilà ce qui m’a fait réagir. Du reste, j’ai aussitôt admis qu’il s’agissait de moi, ce qui lui a permis de prétendre que ses propos étaient validés : « Vous voyez : cela prouve que j’ai raison ! ». Ces petites manipulations ne relèvent pas de mon référentiel éthique.
M. le président Charles de Courson. Avant de donner la parole aux orateurs inscrits, je souhaitais vous interroger sur vos relations avec Jérôme Cahuzac avant la campagne précédant les élections législatives de 2007, quand vous vous êtes porté candidat dans la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. Le connaissiez-vous ?
Par ailleurs, comment avez-vous réagi à sa tentative, en mai 2007, de faire annuler votre candidature en saisissant le tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l’article LO 133 du code électoral, selon lequel un magistrat ne pouvait être élu dans le ressort dans lequel il avait exercé ?
M. Jean-Louis Bruguière. Premièrement, je n’avais jamais vu M. Cahuzac. La première fois que je l’ai vu, c’était lors de ce fameux débat d’avant le deuxième tour.
M. Thomas Thévenoud. Vous ne l’avez jamais croisé au cours de la campagne électorale ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
Bien entendu, il était présent pendant la campagne électorale, mais cela ne signifie pas que je l’ai vu, ni que je lui ai adressé la parole. Chacun organisait ses meetings de son côté. Je n’ai donc pas croisé M. Cahuzac, sauf lors de ce débat.
De même, je ne l’ai pas revu. Peut-être je l’ai croisé de façon fortuite, à Paris, il vivait non loin de mon domicile actuel, mais c’est tout. Je n’avais pas de contact avec lui. Contrairement à ce que dit M. Gonelle, je ne connaissais pas sa voix et j’étais incapable de la reconnaître. Il ne faisait pas partie de mon entourage. Je suis arrivé dans le Villeneuvois dans les conditions que je vous ai expliquées. Je ne connaissais pas M. Cahuzac autrement qu’en tant que maire ou député.
Si, j’ai dû le rencontrer une fois : je suis allé le voir à cause de l’hôpital de Villeneuve. À l’époque, il était député, et souhaitait exproprier une partie de nos terres pour construire un hôpital. Je lui ai fait savoir que nous y étions opposés et que nous ferions valoir nos droits devant la juridiction compétente si une procédure d’expropriation était entamée. C’est tout. Les seuls contacts que j’ai eus avec M. Cahuzac étaient donc des contacts non politiques, en tant que citoyen. Quant aux contacts politiques, ils se résument au débat d’avant le deuxième tour.
M. le président Charles de Courson. Et qu’avez-vous pensé du recours déposé par M. Cahuzac en vue de faire annuler votre candidature ?
M. Jean-Louis Bruguière. À travers ce recours, M. Cahuzac a usé d’un moyen légal pour tenter d’invalider ma candidature et prendre un avantage politique sur une base juridique ; un juriste ne saurait s’insurger contre pareille initiative autrement qu’en combattant avec les mêmes armes. Le tribunal administratif de Bordeaux a tout naturellement prononcé un sursis ; si j’avais été élu, le Conseil constitutionnel aurait été saisi, donnant lieu à une belle affaire. Ce cas aurait fait jurisprudence – inexistante en cette matière – et je regrette que M. Cahuzac ait renoncé à sa démarche ; même s’il n’y avait plus d’enjeu électoral, la décision de justice aurait permis de résoudre un problème de droit complexe.
M. Thomas Thévenoud. Monsieur Bruguière, c’est une véritable Histoire de France racontée aux enfants que vous nous livrez là ! Vous ne vous souvenez plus de rien – ni du support audio de l’enregistrement, ni de la date où il vous a été remis, ni des conditions dans lesquelles vous vous en êtes séparé. Si tous ceux qui sont un jour passés dans votre cabinet de magistrat avaient eu aussi peu de mémoire, vous en auriez été surpris.
Manifestement, entre M. Gonelle et vous, l’un ne dit pas la vérité à la Commission, et nous devrons éclaircir cette question.
Durant la campagne législative de 2006-2007, où vous étiez candidat UMP dans la troisième circonscription du Lot-et-Garonne, quelles étaient vos relations avec l’état-major parisien de l’UMP ?
M. Jean-Louis Bruguière. Monsieur le député, vous me posez une question politique sans réelle relation avec l’objet de cette commission qui porte sur les dysfonctionnements de l’État ; mais j’y répondrai. Je n’ai jamais été – et ne suis toujours pas – membre de l’UMP ; simple sympathisant, j’ai été investi par l’UMP tardivement – même si je ne me rappelle pas la date exacte –, à la suite d’une commission d’investiture. J’oublie les choses peu importantes, mais mémoire sélective n’est pas mémoire partisane. J’ai été investi juste avant ma déclaration de candidature, sans doute en mai.
M. Thomas Thévenoud. Pendant votre campagne électorale – donc après qu’on vous a remis cette disquette –, avez-vous eu des contacts avec le président ou le secrétaire général délégué de l’UMP ?
M. Jean-Louis Bruguière. Donnez-moi des noms précis.
M. Thomas Thévenoud. M. Sarkozy et M. Hortefeux.
M. Jean-Louis Bruguière. M. Hortefeux, non ; dans le cadre de mes fonctions, je voyais souvent – pratiquement toutes les semaines – M. Sarkozy lorsqu’il était ministre de l’intérieur.
M. Thomas Thévenoud. Avez-vous évoqué avec lui votre campagne à Villeneuve-sur-Lot ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui, mais il s’est contenté de m’encourager.
M. Thomas Thévenoud. Lui avez-vous parlé de votre rencontre avec M. Gonelle ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Thomas Thévenoud. Avez-vous eu des contacts avec Mme Cahuzac ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Je ne la connais pas, et je ne l’ai jamais vue ; je ne serais pas capable de la reconnaître.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Monsieur Bruguière, ce que vous dites de la manière dont vous avez abordé cette campagne électorale – vous référant à l’éthique et aux idées et rejetant la délation – inspire le respect.
En revanche, comment interpréter le fait de prendre malgré tout cette cassette – ou ce support audio –, la ramener à Paris et la détruire ? Le candidat que vous étiez refuse de s’en servir – soit, c’est tout à votre honneur ; mais comment le citoyen juriste en vous a-t-il pu n’éprouver aucune envie de l’écouter, afin d’en vérifier le contenu ? N’avez-vous pas été interpellé par la focalisation de M. Gonelle sur M. Cahuzac – votre adversaire électoral – et par sa volonté de vous instrumentaliser ?
M. Jean-Louis Bruguière. Certes, j’aurais pu ne pas prendre l’enregistrement. Mais le climat de confiance qui régnait entre nous m’a conduit à le faire machinalement. Je découvrais alors les campagnes électorales : on travaille ensemble, on se sent soudé par une sorte de solidarité.
Contrairement à ce qu’affirme M. Gonelle, c’est lui qui me « cornaquait ». C’est lui qui est venu me chercher, et non l’inverse, lui qui a organisé des déjeuners à Paris, sachant que je ne pouvais pas toujours descendre dans le Lot-et-Garonne, lui qui m’a présenté à tout le monde. Il a dit par la suite que je m’étais entouré de repris de justice dont il ne donne pas de noms parce que, dit-il, il n’est pas un délateur ; mais qui me les a amenés si ce n’est lui ?
Aujourd’hui, avec le recul, j’estime que j’ai eu tort ; mais ce contexte explique que sur le coup j’aie pris cet enregistrement. Ensuite, je n’ai pas voulu l’écouter, car ce n’est pas ainsi que j’envisageais une campagne ; ce geste a d’ailleurs participé à la dégradation de mes relations avec M. Gonelle. Celui-ci prétend qu’il n’a jamais été évincé de mon entourage, mais des témoins peuvent le contredire : cela s’est passé chez moi, d’une façon assez rude, et il ne peut pas ne pas s’en souvenir. Mais je préfère éviter la polémique.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quels autres éléments ont dégradé vos relations ?
M. Jean-Louis Bruguière. Le dernier fut une réunion politique que M. Gonelle a préparée à mon insu, pour valoriser sa propre position, allant chercher le député d’une autre circonscription et récupérant au passage des membres de mon équipe de campagne en formation. Quand je l’ai appris et m’en suis ouvert à M. Gonelle, celui-ci a mis toute la faute sur le compte d’une seule personne. Lorsque je l’ai revue, je me suis rendu compte que tout cela relevait d’une manipulation. La coupe était pleine et la confiance définitivement rompue.
M. Alain Claeys, rapporteur. Une manipulation pour saboter votre campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. J’ai perdu cette campagne en grande partie à cause de mon camp, même si j’assume ma part de responsabilité dans cet échec.
M. Hervé Morin. Quand on décide de se présenter à une élection législative, l’investiture par une formation politique ne tombe pas du ciel. Comment vous, grand magistrat de la République, êtes-vous devenu candidat ?
Pourquoi M. Gonelle qui vient vous chercher pour vous aider à devenir candidat aux élections législatives devient-il rapidement votre pire ennemi ?
M. Jean-Louis Bruguière. Même si cela vous paraît extraordinaire, on est venu me chercher, et j’ai résisté. En 2006, je me trouvais dans l’exercice de mes fonctions ; je ne souhaitais nullement les abandonner. J’ai compris plus tard pourquoi j’ai été sollicité : cette opération politique fut l’œuvre de M. Jean François-Poncet et qui avait également créé – ou propulsé – Alain Merly. Même s’il ne l’a jamais dit, M. Jean François-Poncet a dû considérer que face à Jérôme Cahuzac, personnage national, il fallait un adversaire lui aussi d’envergure nationale et avec une certaine aura. Mais à la différence de M. Cahuzac, je ne suis pas un homme politique, et mis à part quelques brillantes exceptions, la reconversion des magistrats en politique reste difficile. J’ai compris qu’il s’agissait d’un vrai métier et décidé d’abandonner mes tentatives.
Vous qui êtes un homme politique réputé, ne trouvez-vous pas curieux que M. Alain Merly ne se soit pas représenté aux législatives, alors qu’il est si compliqué d’obtenir une investiture ? Ce n’est pas moi qui l’en ai convaincu ; on lui a demandé de le faire. Au départ, l’opération concernait la mairie de Villeneuve-sur-Lot tenue par M. Cahuzac. M. Gonelle régnait politiquement sur Villeneuve ; même s’il n’était pas directement engagé dans la politique, il y représentait un personnage important, un référentiel. Quand ils ont vu que le mandat municipal ne m’intéressait pas – mon enracinement était d’ordre plus national que local –, ils m’ont proposé de me présenter aux législatives. Quant à M. Merly, il devait ensuite recevoir une compensation aux sénatoriales, mais cela ne lui a pas réussi. Ces équilibres et calculs politiques m’étaient étrangers ; j’ai compris que j’étais perçu comme le candidat « providentiel » capable de remporter les échéances électorales en 2007 et 2008, et utilisé comme tel.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Plusieurs témoignages entendus dans le cadre de cette Commission semblent se contredire. Mais entre celui de M. Gonelle et le vôtre, nous nous trouvons devant un véritable abîme de contradictions sur plusieurs points importants. Quoiqu’ayant déposé sous serment, l’un de vous deux ne dit donc pas la vérité.
M. Gonelle a affirmé qu’il vous connaissait à peine, voire pas du tout, lorsque vous avez débarqué un jour chez lui, cherchant – prétend-t-il – des conseils sur la circonscription. Confirmez-vous que vous l’aviez au contraire déjà rencontré auparavant ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. Je l’ai rencontré pour la première fois lorsqu’il était maire, mais je l’ai revu par la suite. C’est d’ailleurs grâce à lui que j’ai connu M. Jean-Louis Costes…
Mme Marie-Françoise Bechtel. Cette réponse me suffit.
M. le président Charles de Courson. Laissez M. Bruguière vous répondre.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Les réponses de M. Bruguière sont très latérales.
M. Jean-Louis Bruguière. Madame, je ne vous autorise pas à utiliser ce terme. J’ai l’habitude d’être entendu tant par les commissions que par les juridictions, et ce prédicat ne me paraît pas de bon aloi.
J’ai rencontré M. Gonelle plusieurs fois dans des dîners en ville, chez des amis communs, à Villeneuve-sur-Lot. C’est grâce à lui que j’ai connu mon ami Jean-Louis Costes – qui se maintient actuellement au deuxième tour de l’élection partielle de Villeneuve.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je voulais juste que vous confirmiez que vous l’avez rencontré plusieurs fois, contrairement à ce que nous a dit M. Gonelle.
M. Jean-Louis Bruguière. En tant que juriste et magistrat, je connais bien le procédé des auditions ; si vous me posez la question, c’est que vous l’estimez importante. Je vous donne donc des précisions concernant la façon dont j’ai connu M. Gonelle et la nature de nos relations. Cela étant dit, il n’a jamais été ni un ami, ni une relation.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Bruguière, M. Gonelle a dit dans sa déposition devant la Commission : « Nous avons en particulier évoqué les questions qui se posaient sur [le] train de vie [de M. Cahuzac], les subventions apportées par des laboratoires pharmaceutiques aux associations sportives de la ville, ou le grand rassemblement organisé à Villeneuve, fin 1999 ou début 2000, par le laboratoire Lilly ». Confirmez-vous cette information précise ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. En tout cas, je ne me souviens pas qu’il ait parlé de laboratoires, ni à ce stade ni après.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous n’avez pas, dites-vous, écouté l’enregistrement que celui-ci vous a donné. On peut comprendre que l’on garde une cassette et qu’on l’écoute, ou que l’on s’en débarrasse sans l’écouter. Mais pourquoi la garder quelque temps tout en se disant trop vertueux pour l’écouter ?
Vous avez, dites-vous, oublié la lettre que vous aviez envoyée à M. Gonelle. Produite lors de l’enquête préliminaire, elle a été rappelée à votre souvenir. Mais aujourd’hui, dans votre déclaration spontanée, vous l’avez à nouveau oubliée, n’y revenant que lorsqu’on vous en a reparlé. Qu’est-ce qui vous gêne dans le contenu de cette lettre pour l’avoir oubliée dans ces deux moments pourtant cruciaux ?
M. Jean-Louis Bruguière. On n’a pas le temps de tout dire dans une déclaration spontanée qui ne dure que quelque six ou sept minutes, et les omissions ne sont pas forcément volontaires. Tout l’intérêt de cette audition est de permettre, dans une forme de maïeutique, d’aller jusqu’au bout des choses.
J’avais en effet oublié cette lettre, au point d’être surpris lorsque la presse en a parlé. Je m’en suis souvenu seulement quand le policier qui m’a entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire me l’a produite, ce qui montre le peu d’importance que j’y avais accordé au moment de l’écrire. Cet épisode politique a représenté pour moi une parenthèse plutôt négative, même si je garde un très bon souvenir de la campagne elle-même. Le fait d’aller vers les gens, au contact des réalités locales me manquera ; mais le climat local était délétère, et on a naturellement tendance à oublier des épisodes aussi négatifs.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous souvenez-vous du contenu de la lettre ?
M. Jean-Louis Bruguière. Il ne s’agit pas d’un souvenir puisque je l’ai relue.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Votre sentiment, alors ?
M. Jean-Louis Bruguière. En les privant de leader, mon échec aux législatives et ma décision d’arrêter définitivement la politique et de ne pas me présenter aux élections municipales de 2008 ont provoqué la déception, voire le désarroi des militants. Nos relations avec M. Gonelle s’étaient dégradées et je ne le voyais plus à la fin de la campagne ; M. Gonelle lui-même ne niera pas ce fait objectif puisqu’il affirme s’être écarté de moi. La contradiction est donc d’ordre factuel : l’ayant écarté, je lui ai écrit une lettre. Encore sous l’effet de la campagne, je l’ai fait pour ne pas mettre en péril l’élection municipale à venir à laquelle je ne participerais pas et dans laquelle il serait difficile de gagner face à M. Cahuzac. C’était peut-être une mauvaise stratégie.
Mme Cécile Untermaier. Lorsque Me Gonelle vous présente cette cassette en novembre 2006, vous la prenez tout en sachant déjà que vous ne vous en servirez pas ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non, je n’y ai pas réfléchi, je l’ai prise machinalement. Notre discussion ne concernait pas que la cassette, même si nous avons beaucoup parlé de M. Cahuzac, sujet de préoccupation pour M. Gonelle.
Mme Cécile Untermaier. En décembre 2006, soit un mois plus tard, vous jetez cette cassette. Pourquoi le faites-vous, alors que vous savez, en tant que magistrat, qu’elle peut contenir des éléments extrêmement importants concernant M. Cahuzac ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je n’ai pas réagi en tant que magistrat. N’ayant pas été saisi de cette cassette judiciairement, je n’avais pas l’intention de faire une expertise ou de délivrer une commission rogatoire internationale. Peut-être que M. Gonelle le souhaitait, puisqu’il dit dans sa déposition qu’après l’échec de la première tentative de 2000 – où il fait agir, sans succès, un agent du fisc de son entourage dont il refuse de révéler l’identité – l’opportunité s’est reproduite avec M. Bruguière. Le choix du terme « opportunité » en dit long, a posteriori, sur l’instrumentalisation dont j’ai été l’objet. M. Gonelle a dû penser qu’en tant que personnalité importante et magistrat, j’allais faire bon usage de cet enregistrement et le dévoiler à la presse. Mais je n’étais pas dans cet état d’esprit : après l’avoir pris, je me suis dit qu’il ne m’intéressait pas, et je m’en suis débarrassé.
Mme Cécile Untermaier. Quand vous jetez cette cassette en décembre 2006, avez-vous déjà exclu M. Gonelle de votre équipe de campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. L’incident avec M. Gonelle a dû intervenir quelque temps après, sans doute en janvier 2007 – même si je n’ai pas noté ce rendez-vous dans mes agendas. J’ai convoqué M. Gonelle à mon domicile pour lui dire que je ne voulais plus le voir.
Mme Cécile Untermaier. Qui était votre directeur de campagne, et avez-vous parlé avec lui de cet incident ?
M. Jean-Louis Bruguière. Mon directeur de campagne était M. Paqueron, un général de l’armée de l’air à la retraite. Ma campagne ne pouvait pas fonctionner : la lançant mi-mai, je ne pouvais pas gagner aux élections de juin – même si mon score au premier tour ne s’est pas révélé mauvais. Je faisais campagne sur d’autres thématiques, et cet élément qui prend aujourd’hui une grande importance n’en avait pas pour moi à cette époque. Je considérais l’affaire terminée.
Mme Cécile Untermaier. Qui vous a demandé d’écrire la lettre à M. Gonelle ?
M. Jean-Louis Bruguière. On ne m’a pas demandé de l’écrire – c’est moi qui en ai pris l’initiative – mais on m’a demandé de faire en sorte d’atténuer les traces de nos désaccords et de limiter les dissensions dans une équipe et un mouvement déjà très éclatés du fait de mon échec.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez dit tout à l’heure qu’on vous avait demandé d’écrire cette lettre pour calmer les choses en vue des élections de 2008.
M. Jean-Louis Bruguière. Je me suis trompé. J’ai pris cette initiative en pensant qu’il s’agissait du meilleur moyen de panser les plaies politiques.
Mme Cécile Untermaier. Vous n’en avez parlé à personne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne crois pas. Peut-être à M. Costes, mon suppléant.
M. Jean-Marc Germain. Monsieur Bruguière, vous nous avez dit que, d’après vous, M. Gonelle vous avait remis l’enregistrement plus tard, en 2007.
M. Jean-Louis Bruguière. Je pensais au début 2007.
M. Jean-Marc Germain. Ensuite vous avez pourtant affirmé que vous étiez sûr de l’avoir mis à la poubelle en décembre 2006. Mais si vous hésitez sur le moment où vous l’avez reçu, comment pouvez-vous être sûr de celui où vous l’avez détruit ? Il s’agit d’un élément troublant. Magistrat de très haut niveau, vous détenez – contrairement à ce que vous avez dit – une preuve matérielle potentielle d’un délit aussi grave que la détention d’un compte en Suisse. Étant dépositaire de l’autorité publique – même si vous n’avez pas été saisi à ce titre –, pourquoi ne l’avez-vous pas utilisée en novembre 2006, au titre de l’article 40 ? Que vous l’ayez prise sans y réfléchir ou pour en prendre connaissance, vous en étiez ensuite détenteur. Ne souhaitant pas utiliser cette preuve dans la campagne électorale – car cela ne correspondait pas à votre vision de la politique –, vous vous demandiez forcément ce qu’il fallait en faire. Je reste, pour ma part, convaincu que la destruction a pu intervenir beaucoup plus tard. Précisez-nous ce calendrier !
Ayant jeté l’enregistrement à la poubelle, vous vous dites sûr de sa destruction – alors que vous n’en savez rien –, tout en paraissant gêné. Dans quelles conditions et dans quel état d’esprit – car vous connaissiez la valeur de cette preuve – avez-vous procédé à sa liquidation ?
À la suite de ces événements, vous saviez qu’il existait un enregistrement portant sur le compte en Suisse d’une personnalité de plus en plus connue ; à qui avez-vous communiqué cette information ?
M. Jean-Louis Bruguière. Ayant oublié les dates, je me suis basé sur celles qu’avait retenues M. Gonelle. Il a affirmé m’avoir donné l’enregistrement le 12 novembre 2006 ; découvrant dans mon agenda que je me trouvais ce jour-là dans le Lot-et-Garonne, pour le week-end, pourquoi aurais-je contesté cette assertion de M. Gonelle ? Or, comme je n’ai pas pris mon dossier de campagne à Paris, la destruction n’a pu intervenir qu’à l’occasion de mes visites ultérieures dans le Lot-et-Garonne : le 15 décembre, puis à la fin de l’année. Je vous ai donné ces dates en partant non de mes souvenirs, mais des précisions fournies par M. Gonelle – qui, contrairement à moi, a dû noter tous ses rendez-vous – et des vérifications de mes agendas.
Pour le reste, faisons un peu de droit.
M. le président Charles de Courson. Vous confirmez donc que l’enregistrement vous a vraisemblablement été remis le 12 novembre. Et à quelle date l’avez-vous jeté ? Vous avez parlé de fin décembre.
M. Jean-Louis Bruguière. J’ai laissé mon dossier de campagne dans le Lot-et-Garonne ; j’y suis retourné le 15, puis le 29 décembre. Sachant que je n’ai pas gardé l’enregistrement pendant des mois, c’est sans doute lors du premier retour que je me suis débarrassé de ce document.
M. Jean-Marc Germain. Pourtant, entre ces deux week-ends, vous avez dû vous demander pourquoi vous – à la fois juge et candidat – aviez accepté de prendre ce document, quelle en était la nature, et comment vous pouviez vous en débarrasser. Vous vous êtes forcément interrogé sur la solution à adopter puisque vous avez choisi de le détruire plutôt que de le retourner à M. Gonelle.
M. Jean-Louis Bruguière. M. Gonelle affirme m’avoir remis l’enregistrement le dimanche 12 novembre. Mon agenda professionnel étant très précis, je constate a posteriori – sans m’en souvenir – qu’après un lundi chargé, je suis parti le mardi en Grande-Bretagne. Durant cette semaine de travail extrêmement dense, je n’ai pas pensé à cet enregistrement. Loin d’en être obsédé, je n’ai même pas eu la curiosité de l’écouter, ni de chercher le lecteur idoine ; cela ne m’intéressait pas. Lorsque je suis revenu à Villeneuve-sur-Lot le 15 décembre – même si je ne notais pas ces rendez-vous dans mon agenda –, j’ai sans doute rencontré sinon M. Gonelle, du moins des gens faisant partie du même cadre.
M. le président Charles de Courson. Le document était resté à Villeneuve ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui.
M. Jean-Marc Germain. Retrouvant le document sur le bureau, vous avez bien dû vous demander ce que vous deviez en faire !
M. Jean-Louis Bruguière. Je l’avais classé et remisé dans mon bureau à Villeneuve.
M. Jean-Marc Germain. Le détruire a dû représenter une décision difficile.
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Jean-Marc Germain. Vous possédiez une preuve matérielle de la détention par une personnalité importante d’un compte en Suisse ; même si je peux comprendre votre décision – puisque vous n’avez pas été saisi en tant que juge –, la prendre a dû vous en coûter !
M. Jean-Louis Bruguière. Votre perception n’est pas celle du juriste ; une preuve renvoie à quelque chose d’important. Pour un magistrat, cet enregistrement ne représente en rien une preuve, même pas un début de preuve. Ce n’est qu’aujourd’hui, ayant fait l’objet d’une expertise et devenu un scellé judiciaire, qu’il en constitue une, mais à cette époque, ce n’était pas le cas.
Les juges doivent veiller à la protection des libertés publiques, civiles et individuelles ; on m’a assez reproché de faire fi de la présomption d’innocence ou de la liberté individuelle dans le cadre de mes fonctions ; me reprochera-t-on donc de les respecter ? Il ne suffit pas de lancer une accusation pour prouver la culpabilité, même si c’est malheureusement ainsi que fonctionne aujourd’hui la presse, où même le démenti ne fait pas effet. Notre monde – celui de la communication, et donc de la condamnation – impose de rester extrêmement vigilant et prudent.
De plus, ce document m’a été transmis par M. Gonelle ; or je ne sais pas s’il voulait se venger de M. Cahuzac, mais sa surestimation du personnage allait jusqu’à l’obsession existentielle. Cela dit, il n’était pas seul dans ce cas. M. Cahuzac avait réussi à « terroriser » psychologiquement tout l’arrondissement, inhibant les initiatives politiques. Ainsi, tout le monde m’avait dissuadé de participer au débat du deuxième tour – même si je ne me suis pas laissé convaincre. Il est pourtant incroyable, dans un débat démocratique, de refuser d’affronter publiquement votre adversaire sur les enjeux de campagne.
M. le président Charles de Courson. La réponse à la question est précise : le support audio est récupéré le 12 novembre et jeté autour du 15 décembre.
M. Jean-Marc Germain. Mais on ne sait pas toujours pas pourquoi.
M. le Charles de Courson. Qu’est-ce qui motive votre geste ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne fais pas campagne sur une manipulation, ni même sur des attaques personnelles. J’ai eu tort, mais c’est ainsi.
Ensuite, vous me parlez de « preuve », mais je ne sais pas ce que ce support contient, et je ne veux pas le savoir. De toute façon, les éléments n’étaient pas suffisants sur le plan juridique pour invoquer l’article 40. C’est à M. Gonelle qu’il faut poser la question.
M. Jean-Marc Germain. Vous auriez pu transmettre au procureur.
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Pas moi, mais M. Gonelle certainement. Il connaissait les circonstances dans lesquelles il avait recueilli cet enregistrement.
M. Jean-Marc Germain. Avez-vous ensuite l’occasion de faire état des informations dont vous étiez détenteur ? Et si oui, avec qui ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Ce n’était pas un débat de campagne. Après, j’ai tourné la page.
M. Charles de Courson. Même pas avec votre suppléant, ou votre équipe de campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Je ne pense pas, même si, à la fin de la campagne, il y a eu des rumeurs sur les liens supposés de M. Cahuzac avec des laboratoires – les laboratoires Fabre –, et des allusions vagues à un compte en Suisse. Mais je n’ai pas parlé de la cassette.
M. Jean-Marc Germain. Vous n’avez jamais évoqué avec personne ces informations potentielles concernant l’existence d’un compte en Suisse détenu par M. Cahuzac ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je n’ai pas eu d’information sur un compte en Suisse. On m’a dit que…
M. Jean-Marc Germain. Vous n’avez jamais fait aucune allusion ?
M. Jean-Louis Bruguière. La campagne a été courte, je n’ai jamais évoqué la question.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et après ?
M. Jean-Louis Bruguière. Après la campagne, j’ai rompu avec tout le monde et je n’ai plus vu personne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ni pendant, ni après donc. Et au moment où l’affaire sort ?
M. Jean-Louis Bruguière. Dans la presse ? Non.
M. le président Charles de Courson. Seulement dans Paris Match, le 23 décembre 2012, après les déclarations de M. Gonelle.
M. Jean-Louis Bruguière. C’est différent : j’étais mis en cause, et dans des conditions que je ne trouve pas très honnêtes. M. Gonelle ne me cite pas et se défend d’être un délateur, mais il m’oblige à réagir et à m’expliquer. Il s’est répandu dans la presse et a essayé de me salir sur le plan professionnel, s’en prenant même aux services de renseignement français. J’aurais pu l’attaquer.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Une fois l’enregistrement en mains, M. Gonelle nous a dit avoir examiné trois hypothèses : saisir les médias, ce qu’il n’a pas fait ; appliquer l’article 40, ce qu’il n’a pas fait non plus ; et il s’en est remis à un ami pour avertir les services fiscaux. L’interrogeant sur les raisons de son choix, quelque peu étrange pour un bâtonnier, j’ai suggéré des pressions ou la peur. Il a évoqué ses craintes à l’époque, en 2001. Vous parlez de lui comme d’un « homme lige », « incontournable », qui « tenait des réseaux ». J’avoue ne pas comprendre comment un homme puissant pourrait avoir peur. Qu’avez-vous perçu ? De quels réseaux s’agit-il ?
M. Jean-Louis Bruguière. Pas de réseaux occultes – le terme est trop fort –, mais de relations, de contacts politiques. À tort ou à raison, on considérait que, sans M. Gonelle, il était impossible de gagner Villeneuve. Il était inscrit au barreau depuis quarante ans, et il connaissait tout le monde. Il était incontournable.
Quant à M. Cahuzac, tout le monde était au courant de l’affrontement politique à l’issue duquel il avait gagné la mairie de Villeneuve. Dans les échanges que j’ai eus avec M. Gonelle, je n’ai pas eu l’impression qu’il éprouvait du ressentiment envers son rival, ni qu’il était animé d’un esprit de vengeance. Rien ne me laissait penser non plus qu’il nourrissait des craintes qui expliqueraient ce qu’il a fait. Incontestablement, le personnage Cahuzac le fascinait. Probablement était-il devenu pour lui une sorte d’obsession, mais sur un plan psychologique, à cause de son brillant qui impressionnait le Villeneuvois, de ses qualités oratoires, de son art de la dialectique et de sa pugnacité.
Je n’ai rien à reprocher à M. Cahuzac. Le combat politique a été courtois mais rude. Le débat de deuxième tour a été très intéressant car nous étions à peu près à armes égales. Pour une fois, la presse était d’accord sur le caractère équilibré du débat.
Le déséquilibre venait du charisme évident de M. Cahuzac. En outre c’était un gros travailleur qui connaissait ses dossiers par cœur, et il avait réussi à mettre les socialistes en ordre de marche, alors que la droite locale ne cessait de se déchirer.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Nous avons appris d’un inspecteur des impôts qu’il avait dévoilé, dans des mémoires contentieux, des informations sur un compte bancaire, sur une femme de ménage, sur un logement, c’est-à-dire sur des éléments de train de vie, pouvant paraître de nature injurieuse ou diffamatoire. À aucun moment, l’administration fiscale n’a demandé la suppression de ces passages et, dans les onze jugements rendus par la juridiction administrative, il n’y a jamais eu de saisine du parquet. Dans votre carrière de magistrat, avez-vous eu à connaître des saisines directes du parquet par la juridiction administrative ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Mais des saisines par des instances administratives comme TRACFIN, oui. Les alertes sont d’ailleurs prévues par la loi. En outre, le code pénal fait obligation à un juge qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’une infraction, fiscale notamment, de la dénoncer à l’administration fiscale, laquelle alors a un libre accès à la procédure sans qu’on ne lui oppose le secret de l’instruction.
M. Christian Eckert. Nous confirmez-vous que vous n’avez parlé de l’existence de cet enregistrement ni avant, ni pendant, ni après la période électorale ? Et pas davantage des propos de M. Gonelle sur l’éventuel compte en Suisse de M. Cahuzac ? Jamais, du moins avant que les informations paraissent dans la presse ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je n’avais pas raison d’en parler parce que, pour moi, il s’agissait d’un non-événement. Je ne souhaitais pas en parler et je n’avais pas l’intention de mener la moindre enquête à ce sujet. Ma campagne se focalisait sur d’autres arguments.
M. Christian Eckert. Vous avez fait allusion à des déjeuners que M. Bruguière aurait organisés pour vous à Paris. Avec qui ?
M. Jean-Louis Bruguière. Au moins un avec une personnalité connue à Villeneuve-sur-Lot puisqu’elle avait affronté M. Gonelle. Elle était impliquée dans les conflits politiques locaux des années 2000. J’hésite à donner son nom parce que je ne voudrais pas la mettre en difficulté. Elle est sans doute à l’origine de la défaite de M. Gonelle parce qu’elle avait monté une liste concurrente, provoquant une triangulaire.
M. le président Charles de Courson. C’était son adjoint, n’est-ce pas ?
M. Jean-Louis Bruguière. Voilà. Il était dans l’édition… À l’époque, je ne le connaissais pas, pas même de nom. Mais M. Gonelle a considéré que je ne pouvais pas ne pas le connaître, et j’ai compris par la suite qu’il m’a utilisé pour essayer de se rapprocher de lui. L’intéressé me l’a d’ailleurs confirmé par la suite.
M. Christian Eckert. Vous avez parlé de plusieurs déjeuners.
M. Jean-Louis Bruguière. Il en a eu un avec M. Merly, qui avait l’occasion de venir à Paris, et d’autres ont eu lieu à Villeneuve et à Prayssas, dans le canton de M. Merly.
M. Christian Eckert. Au cours de ces repas, il n’a jamais été fait allusion à la cassette ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Jean-René Marsac. Vous avez, dites-vous, gardé la cassette quelques semaines dans votre bureau. Celui de votre campagne électorale ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non, à mon domicile.
M. Jean-René Marsac. Nous avons tout de même l’habitude des campagnes électorales, et il n’est pas concevable que vous n’ayez pas évoqué, dans votre bureau de campagne, la stratégie que vous deviez adopter vis-à-vis de M. Cahuzac, et débattu de l’hypothèse d’utiliser des informations qui circulaient à son propos !
M. Jean-Louis Bruguière. Si.
M. Jean-René Marsac. Vous avez forcément discuté de l’opportunité…
M. Jean-Louis Bruguière. Globalement, j’ai dit, sans faire référence à un présumé compte, que je n’accepterais pas que l’on utilise des méthodes ou des informations susceptibles de nuire à la réputation de mon adversaire.
M. Jean-René Marsac. Vous avez donc bien parlé des informations qui circulaient à propos de M. Cahuzac dans votre bureau de campagne !
M. Jean-Louis Bruguière. Bien sûr qu’il y avait des rumeurs. Il y avait aussi des informations que je connaissais – mais que je n’ai pas mises sur le devant de la scène –, concernant l’enquête préliminaire dont M. Cahuzac faisait l’objet à l’époque. Mais je ne voulais pas que l’on en parle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle enquête préliminaire ?
M. Jean-Louis Bruguière. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour travail dissimulé.
M. le président Charles de Courson. L’affaire du personnel de maison philippin ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. On aurait souhaité que j’utilise ma position de premier vice-président pour récupérer une copie du dossier pénal. Un, il n’en était pas question ; deux, je ne voulais que cet élément soit utilisé de quelque façon que ce soit. M. le procureur de la République de Paris a d’ailleurs eu la sagesse de ne pas saisir le tribunal avant la fin de la campagne.
M. Dominique Baert. « On » aurait souhaité… De qui s’agit-il ?
M. Jean-Louis Bruguière. Quand le sujet est arrivé sur le tapis, plusieurs personnes – je ne suis pas sûr de me rappeler lesquelles, mais peu importe – considéraient que Jérôme Cahuzac était la cible politique et que la fin justifiait les moyens. Pas moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. En plus de l’enregistrement, vous êtes en train de nous dire qu’il y avait toute une série de rumeurs concernant M. Cahuzac ?
M. Jean-Louis Bruguière. M. Cahuzac était considéré comme un personnage important et il y avait des rumeurs. Mais, pour être clair, je n’ai rien entendu de précis et de documenté à propos d’un compte en Suisse. Cela étant, j’ai découvert ainsi que mon adversaire avait une clinique et un appartement dans le septième arrondissement qui aurait été financé en partie avec du cash.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous maintenez n’avoir jamais rencontré M. Garnier ?
M. Jean-Louis Bruguière. Jamais, je suis formel. J’ignorais son nom jusqu’à présent.
M. Charles de Courson. Les faits sont évoqués dans le mémoire de M. Garnier au ministre en date du 11 juin 2008.
M. Jean-René Marsac. M. Gonelle était « incontournable » à Villeneuve, dites-vous. Alors, comment avez-vous justifié son éviction auprès de votre équipe de campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. J’ai pris ce risque en expliquant que M. Gonelle n’avait pas été loyal, notamment après l’incident final qui avait mis certains acteurs de la campagne en difficulté. On leur avait fait porter la responsabilité d’un événement contraire à mes intérêts politiques.
M. Jean-René Marsac. Précisément ?
M. Jean-Louis Bruguière. Il s’agissait d’une réunion de l’équipe qui était autour de moi, qui s’est tenue dans un autre département, avec un député du Lot sans que j’en aie été avisé et au sujet de laquelle l’équipe devait garder le silence. M. Gonelle avait expliqué sa stratégie pour conquérir la circonscription sans même parler de mon existence. À l’époque, je ne m’étais pas déclaré officiellement. La déloyauté était manifeste et j’ai été obligé de soutenir la personne mise en cause.
M. Georges Fenech. Nous sommes en présence de deux versions des faits radicalement différentes. M. Gonelle nous a expliqué avoir remis ce support à M. Bruguière en lui faisant part de son contenu et en précisant que la qualité de l’enregistrement était médiocre. Il a ajouté que celui-ci aurait dit être en mesure de l’améliorer, ce que M. Bruguière a démenti. Dans l’exercice de vos fonctions de magistrat, auriez-vous pu saisir un laboratoire de police scientifique en dehors de toute procédure judiciaire, à titre personnel ?
M. Jean-Louis Bruguière. Ma réponse est un non catégorique. Le seul laboratoire qui était à l’époque capable de ce genre d’opération était le laboratoire de la police scientifique d’Écully, qui dépend du ministère de l’intérieur, et auquel nous avions recours pour l’ensemble de nos opérations. Vous savez à quel point la procédure est strictement encadrée par la loi : il faut des commissions d’expertise très précises, des scellés, et il est impossible de faire appel à un laboratoire public qu’il s’agisse de celui de la gendarmerie ou celui de la police nationale en se servant de passe-droit, pour quelque raison que ce soit.
Et comment aurais-je pu faire une telle expertise sans un échantillon pour effectuer la comparaison ? Je ne connaissais pas M. Cahuzac à l’époque, ni sa voix.
M. Jean-Pierre Gorges. Nous sommes censés nous pencher sur le fonctionnement de l’État entre le 4 décembre et le mois d’avril, et force est de constater que nos questions concernent d’autres périodes. On en revient toujours à cet enregistrement qui ressurgit au gré des échéances électorales.
Reprenons chronologiquement et précisément. Où déposez-vous l’enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. J’ai à Villeneuve-sur-Lot une propriété de famille où j’ai un bureau. Cette maison est fermée, personne ne peut y accéder. Je n’ai pas de femme de ménage et l’alarme est branchée quand nous partons.
M. Jean-Pierre Gorges. Ce bureau vous sert-il pour votre campagne électorale ?
M. Jean-Louis Bruguière. Absolument pas.
M. Jean-Pierre Gorges. Combien de jours l’enregistrement reste-t-il dans ce bureau ?
M. Jean-Louis Bruguière. La réponse que je vous ai faite est fonction de la date donnée par M. Gonelle. Je vous ai dit une douzaine de jours, mais c’est peut-être un mois puisque je ne suis pas revenu à Villeneuve avant le 15 décembre.
M. Jean-Pierre Gorges. Quel est l’événement qui vous pousse à détruire l’enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je me suis mal expliqué. Il n’y a pas d’événement. Si je me fie aux déclarations de M. Gonelle, il m’a confié la cassette le 12 novembre, sans doute l’après-midi ou en fin de matinée. Il s’agissait d’un dimanche et je rentrais en voiture à Paris, avec la sécurité, en début d’après-midi. Logiquement, j’ai dû repasser rapidement à mon domicile villeneuvois où j’ai déposé la cassette en question. À cause de mes obligations professionnelles, je n’ai pu revenir à Villeneuve qu’un mois plus tard, le 15 décembre.
M. Jean-Pierre Gorges. Pendant ce temps, personne n’a pu avoir accès au bureau ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non. Il était sous alarme.
M. Jean-Pierre Gorges. Je me demandais si le 4 décembre 2012 avait marqué le début de l’opération « Il faut sauver le soldat – le général, pardon, monsieur le président – Cahuzac ». Je me demande maintenant s’il n’y a pas eu une opération « Il faut tuer le général Cahuzac ». En 2001-2002, et en 2006-2007, nous sommes en pleine période électorale. Mais pourquoi 2012, alors que M. Cahuzac est devenu ministre ? Le Canard Enchaîné, fait observer que M. Cahuzac était en train de procéder à des coupes claires dans le budget de la défense, de l’ordre de 8 milliards d’euros au grand dam de bon nombre de personnes. L’une d’entre elles n’aurait-elle pas pu informer Mediapart ? Le nouveau ministre du budget aurait d’ailleurs tendance à défendre ce budget. Vous nous avez dit que votre directeur de campagne en 2006 était un général en retraite. Chez moi, mon directeur de campagne a accès à tout et il fait tout. Que je sois sur place ou non, tout lui est ouvert. Alors, je vous demande « les yeux dans les yeux » si votre directeur de campagne a pu avoir accès à ces éléments, même à votre insu, entre le moment où vous les avez reçus et celui où vous vous en êtes débarrassé.
M. Jean-Louis Bruguière. C’est totalement exclu. J’avais établi un sas entre mes locaux de campagne et mon domicile qui est un sanctuaire. On ne vient pas chez moi ; et j’ai évidemment une confiance absolue dans ma femme.
M. Jean-Pierre Gorges. On pourra poser la question à votre directeur de campagne.
M. Jean-Louis Bruguière. Si vous le souhaitez.
M. Jacques Cresta. M. Gonelle vous a remis l’enregistrement avec le secret espoir que vous l’utiliseriez soit au titre de vos fonctions soit dans le cadre de la campagne. Après les élections, avez-vous été à un moment ou à un autre relancé soit par M. Gonelle, soit par ses proches ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Thomas Thévenoud. Vous avez appris, au cours de la campagne électorale, certaines informations sur le train de vie et les activités professionnelles de Jérôme Cahuzac à Paris. Qui en est à l’origine ? Est-ce M. Gonelle ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Thomas Thévenoud. Des personnes du Lot-et-Garonne ? Ou de Paris ?
M. Jean-Louis Bruguière. À Paris, personne ne m’a dit quoi que ce soit. Ce sont des sources locales, dans le cadre de la campagne officielle. Je ne peux pas être plus précis. Il s’agissait de réunions dans les locaux de campagne. Je ne sais pas si c’est M. Gonelle qu’il m’arrivait de croiser. Même si je me suis séparé de lui, nous nous saluions. Il lui est arrivé de venir à un déjeuner de campagne et je ne l’ai pas mis à la porte. C’était le type de rumeur qui circule dans des locaux de campagne, et que je ne voulais surtout pas utiliser. Je n’ai compris que plus tard qu’une campagne ne se faisait pas uniquement comme je pensais qu’elle se faisait.
M. Philippe Houillon. Une dernière précision. Avez-vous relaté votre entrevue avec M. Gonelle à votre directeur de campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Non.
M. Philippe Houillon. Vous ne lui parlez de rien ?
M. Jean-Louis Bruguière. Le directeur de campagne a été nommé tardivement, pas avant le mois de mai.
Ce qui a fait déraper ma campagne, et ce qui m’a fait comprendre que j’étais instrumentalisé, politiquement parlant, c’est le choix de mon suppléant. En fait, on voulait utiliser l’image du comandante Bruguière, mais on ne voulait surtout pas qu’il prenne une quelconque initiative parce qu’il ne connaissait rien à la politique. Il devait donc exécuter fidèlement les instructions, en particulier celles de M. Jean François-Poncet. Il avait été décidé notamment que mon suppléant serait Alain Merly. Comme je ne trouvais pas très cohérent de choisir pour suppléant le député sortant qui ne se représentait pas, je m’y suis opposé, car cela ne donnait pas une très bonne image. Mon entourage, y compris M. Gonelle, y a vu un casus belli. À partir de là, les difficultés surgissaient de tous les côtés et, d’après ce que j’ai pu comprendre, M. Gonelle a savonné la planche de plus belle. En tout cas, j’ai rencontré de sérieuses difficultés au sein de mon équipe. Cela se passait trois semaines avant le premier tour et je sentais que je ne maîtrisais plus grand-chose.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle souhaitait-il votre venue, pour cette élection législative ?
M. Jean-Louis Bruguière. C’est lui qui est venu me chercher, avec M. Merly ! Ma présence résultait d’une stratégie à laquelle ils ont pris part. L’objectif de départ était que je me présente aux municipales à Villeneuve. M. Merly n’était pas concerné.
M. Dominique Baert. Est-ce que, lorsque l’on est venu vous chercher, on vous a fait miroiter l’idée que, compte tenu de votre stature, vous pourriez devenir ministre, ce qui aurait laissé la place libre à votre suppléant.
M. Jean-Louis Bruguière. Je pense que oui, mais je ne l’ai compris que plus tard. On ne me l’a jamais dit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous ne sommes ni des juges, ni des procureurs. Vous comprenez l’importance pour nous de votre témoignage. Ce soir, vous démentez totalement ce qui a été dit par M. Gonelle et vous affirmez, sous serment, que vous n’avez pas utilisé la cassette, sous quelque forme que ce soit.
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne l’ai pas diffusée, ni dupliquée. Ce n’est pas par mon intermédiaire qu’elle est arrivée dans les mains de Mediapart.
M. le président Charles de Courson. Ni directement,…
M. Jean-Louis Bruguière. …ni indirectement.
M. Jean-Louis Bruguière. Monsieur le président, deux observations si vous me le permettez.
M. le président Charles de Courson. Je vous en prie.
M. Jean-Louis Bruguière. Il s’agit des conditions dans lesquelles je suis venu ici. À aucun moment, je n’ai cherché à me dérober ou à gagner du temps. Je le précise parce que le secrétariat de la commission avec qui j’ai été en contact m’a fait part de votre sentiment que je faisais en sorte de ne pas venir témoigner parce que nous n’arrivions pas à trouver une date. Je tiens à dissiper tout malentendu. J’ai témoigné plusieurs fois devant des commissions parlementaires, y compris aux États-Unis, et j’y ai toujours déféré parce que j’y vois un élément important de la vie démocratique.
Deuxième observation, de nature institutionnelle, voire constitutionnelle. Comme je vous l’ai dit, j’ai été cité par voie d’huissier à comparaître comme témoin devant la cour d’assises d’appel de Paris dans le procès de Carlos, qui se tient du 13 mai au 5 juillet. Le calendrier et le programme des auditions sont définis unilatéralement par le président de la cour d’assises dont le pouvoir dans ce domaine est souverain. Je ne pouvais donc pas connaître exactement ma disponibilité, et le parquet général auquel je me suis adressé m’a indiqué que j’aurais à comparaître le 30 mai après-midi et soir – ce que j’ai fait. Le soir, on m’a notifié que je devrais revenir le 17 et le 18 juin. Nous étions convenus avec vous d’une audition au mois de juillet. Mais à cause de vos contraintes, que je comprends, la date a été modifiée et vous vouliez m’entendre le 18 juin. Je vous ai fait connaître mes obligations envers la justice et la convocation a été repoussée au 19, malgré mon obligation d’être à la disposition de la cour d’assises. Je vous ai transmis à la fois la citation à comparaître et une lettre de l’avocat général.
Alors, oui, il y a bel et bien un conflit d’agenda et le problème n’est pas réglé par la loi. Il est pourtant de nature à avoir une incidence sur le fonctionnement normal d’une juridiction de l’ordre judiciaire, puisque son président se voit privé, dans le cadre d’un procès pénal, de la présence d’un témoin.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Bruguière, puisque vous posez la question, je suis le président et j’assume. Nous avons eu quelques difficultés à trouver une date. Nous avons dû anticiper la date prévue parce que, dans la logique de nos auditions, il était préférable que vous veniez plus tôt.
S’est alors posée une deuxième question sur laquelle M. le rapporteur et moi-même avons la même position. Vous avez suggéré d’être auditionné à huis clos.
M. Jean-Louis Bruguière. Nullement. J’ai dû mal m’exprimer, c’était un problème de sécurité.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas un problème.
M. Jean-Louis Bruguière. Le problème, c’est la publicité autour. En fait, je fais la différence entre une requête de convenance et une autre, à mon avis plus importante, liée à un procès pénal.
M. le président Charles de Courson. Nous nous adaptons, monsieur Bruguière. La preuve, c’est que vous êtes venu.
M. Jean-Louis Bruguière. J’espère seulement que l’on ne me réclame pas au tribunal de grande instance de Paris.
M. le président Charles de Courson. Dans ce cas nous vous aurions libéré immédiatement. Nous sommes trop respectueux de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
M. Jean-Louis Bruguière. Le cas de figure pourrait se reproduire et peut-être le règlement de l’Assemblée pourrait-il résoudre le problème dans le respect de l’indépendance de la justice et l’équilibre des institutions.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Bruguière, je vous remercie.
Audition du mercredi 19 juin 2013
À 16 heures 30 : M. François Molins, procureur de Paris.
M. le président Charles de Courson. Nous entendons aujourd’hui M. François Molins, procureur de Paris.
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Nous souhaitons mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été traitée, notamment par la justice, mais sans aborder les éléments de fond de l’enquête, qui relèvent du secret de l’instruction.
M. François Molins prête serment.
M. François Molins, procureur de Paris. Je vais vous donner les éléments que vous êtes en droit d’attendre, dans le cadre fixé par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 et par l’article 11 du code de procédure pénale, qui m’astreint au respect du secret des investigations et de l’instruction.
Je commencerai par dire quelques mots du fonctionnement du parquet de Paris, ainsi que des règles qui ont été appliquées aux relations qu’il entretient avec le parquet général et avec la chancellerie.
Pour toutes les affaires que l’on peut qualifier de sensibles, le parquet de Paris, comme tous les autres, est amené à renseigner le parquet général, qui est à son tour tenu de transmettre certaines informations à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Il s’agit des affaires significatives, à fortes retombées médiatiques ou qui ont du sens en termes de fixation de la politique pénale. Ces informations fournies par le parquet au parquet général sont nombreuses et précises ; elles doivent être mises à disposition rapidement.
Le procureur général, destinataire de ces informations, a un rôle d’analyse : il indique à la DACG s’il partage l’analyse et les orientations du procureur de la République. Ces informations ont surtout pour rôle de nourrir le dialogue institutionnel qui doit exister au sein du ministère public : le procureur de la République a des pouvoirs de direction de l’action publique ; parmi ceux du procureur général figure celui de donner des instructions positives, de poursuite, aux procureurs.
Dans la conduite de ce dossier, le parquet de Paris n’a eu de relations qu’avec le Parquet général ; il n’y a eu, à aucun moment, aucune instruction d’aucune sorte. J’ai toujours pris mes décisions après analyse et réflexion, avec mes collègues de la section financière, et toujours après avoir respecté les règles du dialogue institutionnel que j’évoquais, et qui doivent exister entre un procureur et son procureur général. J’ai donc toujours indiqué à mon supérieur hiérarchique quelles étaient mes intentions, afin qu’il soit toujours en mesure de faire valoir son point de vue, et éventuellement de donner des instructions positives, ce qui n’est pas arrivé.
Les renseignements donnés au parquet général l’ont été sous des formes diverses : compte rendu téléphonique, courriel, rapports écrits. La DACG, après l’ouverture de l’enquête, nous a demandé quels seraient les actes et les investigations qui nous paraissaient nécessaires dans ce dossier. Nous avons répondu, mais les calendriers n’ont la plupart du temps pas été indiqués à l’avance. En particulier, aucun élément sur les actes importants n’a été donné avant leur réalisation, notamment s’agissant des perquisitions ; le Parquet général n’en a jamais été informé à l’avance. Les comptes rendus sont intervenus après, le plus souvent sous la forme de courriers électroniques contenant des résumés de la teneur des auditions ou des éléments recueillis lors des perquisitions. Il n’y a eu, je l’ai dit, aucune instruction individuelle dans ce dossier.
L’affaire qui nous occupe trouve son origine dans la publication par Mediapart, le 4 décembre 2012, d’un article intitulé « Le compte suisse du ministre du budget Jérôme Cahuzac ». Le 6 décembre, à la suite d’une transmission par le directeur de cabinet de Mme la garde des sceaux, la directrice des affaires criminelles et des grâces saisit le procureur général de Paris d’une dépêche demandant l’engagement de poursuites du chef de diffamation publique contre le directeur de la publication de Mediapart, en application de l’alinéa 1er bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que si la diffamation est dirigée contre un membre du Gouvernement, la poursuite ne peut avoir lieu que si la demande a été adressée au garde des sceaux, à charge pour celui-ci de saisir le parquet général compétent. Or, à notre sens, il s’agissait là d’une diffamation non pas contre un ministre mais contre un particulier, puisqu’à l’époque des faits, M. Cahuzac n’était pas membre du Gouvernement. Contrairement à l’analyse de la DACG et au regard de la jurisprudence de la dix-septième chambre du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, spécialisée en matière de presse, nous avons estimé qu’il s’agissait d’une diffamation publique envers un particulier, et que le visa dans la plainte de l’alinéa 1er bis de l’article 48 pouvait constituer une confusion, voire le moment venu une cause de nullité des poursuites, dans le cas où l’affaire serait venue devant le tribunal correctionnel. Nous avons alors pris l’initiative de requalifier l’affaire et de ne viser que les articles strictement utiles à la poursuite d’une diffamation publique envers un particulier.
Nous avons donc établi un soit-transmis articulant les faits reprochés, interrompant la prescription et saisissant les services de police, en l’occurrence la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la Direction de la police judiciaire de Paris, pour qu’elle procède à une enquête préliminaire.
La polémique, vous le savez, a continué, Mediapart maintenant ses accusations et distillant régulièrement de nouveaux éléments de nature à les accréditer.
Le 18 décembre 2012, M. Cahuzac dépose, entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique contre un particulier, délit puni par les articles 23, 29 et 32 de la loi sur la presse. Le parquet, à qui cette plainte est communiquée, prend un réquisitoire introductif le 15 février et fait ce que l’on fait toujours dans ce cas de figure : une enquête étant déjà lancée, nous avons demandé aux services de police de nous retourner la procédure d’enquête préliminaire, ce qui a été fait le 19 février ; nous avons immédiatement joint la procédure d’enquête préliminaire à la procédure d’instruction, l’adressant au juge d’instruction, puisque celui-ci était désormais seul compétent pour instruire ces faits.
En matière d’infractions à la loi sur la presse, il est essentiel de bien se rappeler que ces enquêtes ne visent jamais à déterminer la vérité ou la fausseté des faits allégués, mais seulement à s’assurer de l’identité de l’auteur incriminé et, pour la presse, de l’identité du directeur de la publication, ainsi que des domiciles de ces personnes, afin de pouvoir leur délivrer le cas échéant une citation à comparaître.
La loi ne permet donc pas au juge d’instruction de rechercher si les faits dénoncés ou relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux : vous le savez certainement, la loi sur la presse dispose que seule la juridiction de jugement peut se prononcer sur ce point, et seulement lorsque le prévenu a été admis à rapporter la preuve la vérité des faits selon les modalités prévues à l’article 55 de cette loi. La preuve des faits ne peut donc résulter que d’un débat contradictoire, qui ne peut pas avoir lieu devant une juridiction d’instruction mais seulement devant une juridiction de jugement.
Nous nous trouvions donc face à un vrai problème : les allégations de Mediapart donnaient lieu à un débat public, mais le fond de ce débat ne pourrait être judiciairement évoqué avant le premier trimestre 2014, compte tenu des délais d’audiencement actuels devant la dix-septième chambre correctionnelle du TGI de Paris.
Le parquet était bien sûr conscient de cette situation : j’avais commencé à me demander s’il fallait agir, et comment. En restant inactifs, nous prenions le risque de faire apparaître le parquet de Paris comme faisant obstacle à la manifestation de la vérité ; or la justice est plutôt là pour aboutir au résultat inverse… Je suis donc parti en congés de Noël avec le dossier.
Le 27 décembre, j’ai lu sur ma messagerie électronique un courriel envoyé à douze heures quatre par M. Edwy Plenel, courriel rendu public peu après, et qui me demande de confier à un juge indépendant les investigations qu’appellent les informations qu’il détenait. Ce courriel va très loin : M. Plenel s’érige en conseiller technique, en me suggérant de confier ces investigations à M. Daïeff, vice-président chargé de l’instruction à Paris, déjà saisi d’une procédure d’information mettant en cause les pratiques de démarchage bancaire illicite et de blanchiment de la banque UBS.
À ce moment, je pouvais ne rien faire et faire dire à Mediapart qu’il lui appartiendrait d’apporter la preuve de ses allégations lors du procès en diffamation – procédure la plus habituelle, puisque le parquet, en général, ne prend pas partie dans ces affaires. Je pouvais aussi diligenter une enquête, mais alors sur quels fondements ?
Sur la fraude fiscale, le parquet ne pouvait rien faire puisqu’une plainte du ministre du budget, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, est nécessaire. En revanche, depuis un arrêt de février 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’en matière de blanchiment de fraude fiscale, la plainte préalable du ministre du budget, comme le filtre de la commission des infractions fiscales, n’ont pas à s’appliquer, et que le parquet a toujours la possibilité d’enquêter et de poursuivre le délit de blanchiment, infraction générale distincte et autonome, qui n’est donc pas soumise aux règles de procédure du livre des procédures fiscales.
J’ai d’abord exclu – et je l’ai fait savoir au juge d’instruction directement – l’hypothèse de l’ouverture d’une information chez le juge d’instruction saisi de l’affaire contre UBS : les faits allégués n’entraient pas, contrairement à ce qu’écrivait Mediapart, dans la saisine des juges d’instruction, puisque celle-ci était limitée aux personnes qui détenaient des comptes ouverts chez UBS à la suite d’opérations de démarchage illicite, élément que l’on ne retrouvait absolument pas dans ce dossier.
J’ai estimé en revanche qu’il y avait dans ce dossier un élément singulier, un élément matériel qui pouvait fonder une action de notre part : le fameux enregistrement d’une voix présentée comme étant celle de Jérôme Cahuzac. Le parquet se doit de n’avoir aucun a priori, de ne rien préjuger. Il est là pour lancer des investigations et rechercher des preuves d’infraction. Or, soit c’était bien la voix de Jérôme Cahuzac que l’on entendait, et l’enregistrement devenait alors un indice très important de la commission d’une infraction et de la réalité des allégations de Mediapart ; soit au contraire l’enregistrement était un montage, et c’était une manipulation qui aurait pu valoir à ses auteurs des poursuites pour dénonciation calomnieuse ou pour dénonciation d’un délit imaginaire. Si l’enquête ne débouchait sur rien, la procédure serait classée sans suite ; si à l’inverse les allégations de Mediapart s’avéraient fondées, il resterait à décider des suites procédurales les plus appropriées : poursuite d’enquête préliminaire ou ouverture d’une information judiciaire.
Après en avoir parlé avec mes collègues de la section financière, puis avec le parquet général, j’ai fait part oralement à mon procureur général de ma décision d’ouvrir une enquête préliminaire et de la confier à la Division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF) – de mémoire, c’était le lundi 31 décembre. J’ai signé un rapport écrit en ce sens le 4 janvier 2013 et l’enquête a été ouverte le 8 janvier, comme l’a annoncé le jour même un communiqué de presse du parquet de Paris.
L’enquête s’est ensuite déroulée normalement, dans les conditions que j’ai indiquées en préambule. Il me paraît important de dire aujourd’hui qu’il y a eu quelques étapes décisives pour l’orientation de la procédure et la stratégie à adopter : l’entraide pénale internationale, les résultats de l’expertise.
Le 24 janvier, le laboratoire de police technique et scientifique nous a confirmé que l’enregistrement n’avait pas été trafiqué et que, bien que de qualité médiocre, il pouvait permettre une comparaison de voix. Nous en avons rendu compte au parquet général le jour même, par un courriel envoyé à 15 h 26.
Le 31 janvier, dans l’après-midi me semble-t-il, la magistrate chargée de la communication du parquet de Paris reçoit un appel téléphonique d’un journaliste qui lui demande si nous confirmons, ou pas, la transmission par le gouvernement suisse de documents relatifs à l’affaire Cahuzac. Nous n’avons pas répondu directement – et nous avons, je crois, bien fait. Nous avons simplement répété que l’enquête judiciaire était en cours et que nous ne communiquions pas sur son contenu.
C’est en réalité seulement le lendemain matin, vendredi 1er février, que le commissaire chef de la DNIFF nous transmet par courriel, à 9 h 16, la réponse que le Département fédéral des finances suisse a adressée la veille à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). La DGFiP a spontanément envoyé ce document à la DNIFF le matin même, à 8 h 55. Le commissaire a ensuite appelé le chef de la section financière du parquet, qui lui donne pour instruction de solliciter de la DGFiP la communication du texte de la demande adressée à la Suisse par les autorités françaises puisque nous n’avions que la réponse. Nous avisons évidemment le parquet général, par un courriel envoyé à 10 h 17. La demande faite à la Suisse nous est adressée par la DGFiP, après que la DNIFF en a demandé communication à notre requête, par courriel dès 14 h 04.
On a pu s’interroger sur la légitimité de la communication de ces pièces par Bercy: la convention d’assistance administrative en matière fiscale signée entre la France et la Suisse prévoit, comme c’est souvent le cas dans ces matières, un principe de spécialité, c’est-à-dire qu’elle interdit l’utilisation des renseignements fournis par l’État requis dans un cadre procédural autre que celui prévu par la convention d’assistance. Or l’article 28 de la Convention prévoit que ces renseignements sont destinés uniquement aux personnes et autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts – assiette, recouvrement ou contentieux administratif sur l’impôt –, qui « ne [les] utilisent qu’à ces fins ». L’utilisation dans une procédure pénale des renseignements obtenus par le biais de cette convention est donc exclue, à moins que les autorités suisses ne l’aient autorisée.
Malgré cette difficulté, j’ai estimé que, dans la mesure où l’autorité judiciaire n’avait pas réclamé ce document mais qu’il était, un peu par accident, arrivé jusqu’à la DNIFF qui nous l’avait communiqué et que le parquet n’était pas l’auteur de la violation de la Convention, ce document constituait un renseignement comme un autre. Dans un souci de loyauté et de transparence, et en vue d’enquêter à charge comme à décharge, j’ai préféré intégrer la réponse des autorités suisses à la procédure. J’ai donc poursuivi l’enquête préliminaire.
Le 12 mars, nous avons adressé aux autorités suisses une demande d’entraide pénale internationale.
Les opérations d’expertise et de comparaison de voix touchaient alors à leur fin ; dès la fin de cette même semaine, des rumeurs annonçant leur résultat ont commencé à circuler dans la presse. Nous n’avons reçu le rapport définitif que le lundi matin 18 mars : les techniciens estimaient que « sur une échelle de -2 à +4, la comparaison se situait à +2 et que, sans une certitude absolue, le résultat de l’analyse renforçait de manière très significative l’hypothèque que Jérôme Cahuzac était le locuteur inconnu de l’enregistrement litigieux ». Le procureur général de Paris en a bien sûr été avisé, par téléphone d’abord, puis par courriel à 12 h 28.
Compte tenu de ces éléments, nous avons repris notre réflexion et estimé que l’information judiciaire constituait désormais un cadre plus approprié pour continuer les investigations, puisque nous disposions désormais d’un indice tangible de la commission d’une infraction. Nous savions, de plus, qu’une autre demande d’entraide pénale internationale, cette fois auprès de Singapour, serait nécessaire à très court terme. J’ai donc avisé le procureur général des résultats des investigations et de ma décision d’ouvrir une information judiciaire ; mon rapport écrit a été adressé au parquet général le lundi soir 18 mars à 20 h 40. Nous avons ensuite préparé un communiqué de presse contenant les éléments objectifs recueillis au cours de l’enquête, et annonçant l’ouverture de l’information. Le projet de communiqué a été adressé par courriel au parquet général le mardi 19 mars à 10 h 25, en précisant qu’il serait diffusé immédiatement après l’ouverture de l’information, qui devait intervenir en début d’après-midi.
Le 19 mars dans l’après-midi, le réquisitoire introductif a été signé, et le communiqué adressé à tous les organes de presse à 15 h 58 précisément.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre exposé a déjà répondu à nombre de nos questions, notamment s’agissant de la plainte en diffamation déposée par Jérôme Cahuzac.
Je voudrais vous interroger sur l’ouverture de l’enquête préliminaire, le 8 janvier 2013 – vous venez alors de recevoir la lettre de M. Plenel ; l’élément que vous retenez est l’enregistrement révélé par Mediapart.
M. François Molins. Tout à fait. Le débat public aurait pu être sans fin, ou en tout cas ne déboucher sur rien de concret pendant des mois : dans notre société démocratique, cela ne va pas sans poser problème. Or la seule personne qui aurait pu saisir la commission des infractions fiscales, c’était le ministre du budget, qui se trouvait être la personne mise en cause. C’était une situation inédite…
Le temps judiciaire n’est ni le temps médiatique, ni le temps politique. Les magistrats sont des gens responsables, et ces décisions ne sont pas de celles qui se prennent à la légère. Ma réflexion avait commencé, mais je n’étais pas encore sûr de ce que j’allais faire : j’attendais de voir comment les choses allaient évoluer.
Je n’ai pas pris ma décision à cause du courrier de M. Plenel, mais il est évident que celui-ci a contribué à accélérer les choses : dès lors que j’étais destinataire d’une lettre, il fallait que je prenne une position.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous déteniez l’enregistrement ?
M. François Molins. À cette date, non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais M. Plenel faisait état de cet enregistrement dans sa lettre ?
M. François Molins. De mémoire, oui ; mais de toute façon, nous suivons le débat public. Les journalistes protègent leurs sources et ne disent pas comment ils ont obtenu l’enregistrement, mais nous savions à ce moment-là que Mediapart le détenait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Trouvez-vous normal, alors qu’une enquête préliminaire est ouverte, que l’administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d’échanges d’informations auprès de la Suisse ?
M. François Molins. Clairement, non.
Je ne suis à la tête du parquet de Paris que depuis un an et demi, mais je me suis renseigné pour savoir s’il existait des précédents. La culture fiscale et la culture pénale sont, vous le savez, très différentes ; elles n’ont pas les mêmes objectifs. Chacun a des obligations : nous avons l’obligation de dénoncer au fisc tous les faits qui sont de nature à constituer des fraudes fiscales ; le fisc a l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire tous les éléments qui pourraient constituer des infractions de droit commun. À Paris, cela fonctionne bien : les signalements sont fréquents dans l’un et l’autre sens.
J’ai néanmoins la faiblesse de penser que, dès lors qu’on est dans un cadre pénal, malgré la sphère d’autonomie du droit pénal et du droit fiscal, quand une autorité judiciaire est chargée de mener des investigations destinées à déterminer si un crime ou un délit a été commis, elle devrait avoir le monopole de l’action et que rien ne devrait se faire sans que l’autorité judiciaire en soit avisée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette démarche administrative a-t-elle retardé la procédure judiciaire ?
M. François Molins. Absolument pas. Elle intervient le 1er février, donc avant la demande d’entraide pénale, qu’elle n’a pas retardée. Nous avons seulement joint la réponse suisse au dossier, et continué les investigations dans notre logique propre, où l’élément fondamental était de savoir si l’enregistrement était réel, et si la voix du locuteur était bien celle de M. Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. La demande d’entraide pénale est adressée à la Suisse le 12 mars : avez-vous reçu une réponse ?
M. François Molins. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette demande aurait-elle pu être faite plus tôt ?
M. François Molins. Cela aurait été possible, mais ç’aurait été une mauvaise chose : pour qu’une demande d’entraide internationale soit efficace, particulièrement dans le domaine fiscal ou parafiscal, il faut qu’elle soit solidement étayée pour pouvoir avancer rapidement. Nous sommes sur des terrains très sensibles, où la coopération pénale internationale n’a pas toujours la même efficacité qu’en matière de droit commun : nous avons donc pour habitude d’éviter d’irriter nos partenaires étrangers par des demandes incomplètes, qui entraînent des demandes complémentaires. Au début de l’enquête, en concertation avec la DNIFF, nous avons d’abord imaginé faire cette démarche rapidement, puis nous avons changé d’avis et préféré attendre.
Le 12 mars, nous disposions d’éléments suffisants pour que notre demande soit complète : nous pouvions alors tirer les conséquences des auditions et viser, non seulement des délits comme la fraude fiscale ou le blanchiment de fraude fiscale, mais aussi le délit de blanchiment lié à des revenus versés par des entreprises pharmaceutiques. Cela permettait notamment de sortir du champ strictement fiscal et d’éviter des difficultés. J’ai alors appelé mon collègue de Genève.
Comme c’est toujours le cas, nous avons envoyé cette demande à Genève directement, avec copie par la voie hiérarchique. L’information judiciaire a été ouverte une semaine plus tard : la demande d’entraide a été jugée tellement bien faite que le juge d’instruction n’a pas estimé utile d’en faire une nouvelle ; il l’a laissé prospérer telle quelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous l’envoyez le 12 mars. Quand arrive la réponse ?
M. François Molins. Elle arrive quelques jours après l’ouverture de l’information mais à ce moment-là, les choses se passent entre le juge d’instruction saisi du dossier et le procureur de Genève.
Je souligne que la demande ne se borne pas à demander si M. Cahuzac est titulaire d’un compte ou possède des avoirs ; elle est beaucoup plus large. Elle pose des questions mais vise aussi à obtenir des documents, et elle demande surtout à l’autorité judiciaire suisse d’effectuer des actes – auditions, perquisitions… Je ne peux évidemment pas rentrer ici dans les détails.
M. Alain Claeys, rapporteur. La réponse qui vous a été apportée est complète.
M. François Molins. Oui.
M. le président Charles de Courson. Vous est-elle parvenue rapidement ? Quel est le délai normal ?
M. François Molins. On peut rencontrer des situations très diverses, mais cela se passe aujourd’hui plutôt mieux qu’avant. Avec la Suisse, tout dépend de la qualité de la demande : si celle-ci ne porte que sur une fraude fiscale, il y a souvent des difficultés d’exécution ; si elle renvoie à du blanchiment ou à d’autres délits, c’est plus facile. Ici, cela a bien fonctionné.
M. Alain Claeys, rapporteur. Considérez-vous que l’expertise du support audio a été réalisée dans des délais raisonnables ?
M. François Molins. Je ne saurais pas fixer une norme, mais je crois qu’effectivement le délai était raisonnable. L’enregistrement est vieux – plus de dix ans –, même s’il a semble-t-il été réalisé par un professionnel.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour résumer, vous avez expliqué le traitement de la plainte et l’ouverture le 8 janvier d’une enquête préliminaire. Vous nous faites part de vos réserves sur la demande administrative mais vous dites qu’elle n’a pas retardé l’enquête judiciaire. C’est le résultat de l’expertise qui vous conduit, le 19 mars, à ouvrir une information judiciaire.
M. François Molins. Absolument.
M. le président Charles de Courson. Juridiquement, il y a une autonomie du droit fiscal, vous l’avez dit ; mais vous avez semblé regretter l’absence d’articulation entre les poursuites fiscales et les poursuites de droit commun. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ? Y a-t-il eu des contacts entre vous-même et le directeur général des finances publiques, qui saisit l’administration fiscale, ou son entourage ?
M. François Molins. Nous n’avons eu aucun contact avec la DGFiP.
M. le président Charles de Courson. J’ai cru comprendre que vous avez été quelque peu étonné de découvrir la demande d’entraide administrative envoyée à la Suisse par la DGFiP.
M. François Molins. J’ai effectivement été étonné de découvrir l’existence de cette démarche par des appels de journalistes, qui visiblement savaient, eux, qu’une demande avait été envoyée aux autorités suisses. Ce sont leurs questions qui nous ont mis la puce à l’oreille.
M. le président Charles de Courson. En revanche, vous êtes informé immédiatement du contenu de la réponse, le 31 janvier.
M. François Molins. La réponse des Suisses arrive à la DNIFF le 1er février à 8 h 50 et nous en sommes informés à 9 h 15.
M. le président Charles de Courson. Et c’est là une procédure normale ?
M. François Molins. Je n’en sais rien ! Je n’ai pas d’exemple, dans le fonctionnement de la section économique et financière du parquet de Paris, d’enquête diligentée dans ces matières où, parallèlement à l’enquête judiciaire, Bercy ait effectué ce type de demande. Pour nous, c’est une première !
M. le président Charles de Courson. Ce n’est jamais arrivé ?
M. François Molins. Non, pas dans les relations que nous avons avec la DGFiP. Mais je ne peux évidemment pas commenter le fonctionnement de la DGFiP.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je voudrais tout de même redire, pour l’édification de la commission, qu’il existe en France, État de droit, un principe très ancien qui remonte aux lois des 16-24 août 1790 : il peut y avoir un parallélisme parfait, une étanchéité totale, entre une procédure administrative – dont la procédure fiscale est une branche – et la procédure judiciaire. C’est la raison pour laquelle, par exemple, il peut y avoir en parallèle une procédure disciplinaire et une procédure judiciare contre un fonctionnaire. Qu’en tant que représentant de l’autorité judiciaire, M. Molins éprouve quelque chagrin à voir que la procédure judiciaire ne recouvre pas tout, je peux parfaitement le comprendre. Mais, encore une fois, cette concurrence est parfaitement conforme à toutes nos traditions et à tous nos principes depuis plus de deux siècles !
M. le président Charles de Courson. Merci de le rappeler, ma chère collègue…
Mme Marie-Françoise Bechtel. Nous perdons notre temps à nous arrêter sur des problèmes qui n’en sont pas.
Monsieur le procureur, notre commission recherche les critères qui permettent de déterminer à quel moment il est pertinent que le Gouvernement, l’administration, et l’autorité judiciaire agissent lorsque surgit une affaire sensible, mettant en cause un homme politique. D’après votre expérience, la date du 8 janvier est-elle la plus juste ? Auriez-vous pu agir différemment, plus vite ou plus lentement ?
M. François Molins. Il est très difficile de vous répondre. Globalement, j’ai le sentiment que si c’était à refaire, je referais exactement la même chose. Il aurait été difficile d’agir plus tôt – la décision n’était pas facile.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Avez-vous en tête d’autres éléments de comparaison ?
M. François Molins. Je ne vois pas d’autre cas où un ministre en exercice aurait été mis en cause de cette façon.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Peut-être avec d’anciens ministres…
M. François Molins. De mémoire, non. Franchement, pour moi, c’était une situation tout à fait inédite.
M. Charles de Courson. Le fait que M. Cahuzac ait eu la responsabilité des services fiscaux pose, nous l’avons vu, des problèmes particuliers.
M. Hervé Morin. Avez-vous eu des conversations avec des collaborateurs d’autorités politiques ?
Avez-vous eu des désaccords d’appréciation avec le procureur général ?
Avez-vous transmis la réponse des Suisses à la demande d’entraide pénale à la chancellerie ?
M. François Molins. Je n’ai eu aucun contact que ce soit avec des collaborateurs politiques, que ce soit du ministère de la justice, de Matignon ou de l’Élysée. Le seul contact que j’aie eu avec la chancellerie est une conversation téléphonique d’une minute à peu près, le 18 mars en début d’après-midi : c’est d’ailleurs quelque chose de tout à fait normal ; dans une chaîne hiérarchique, il n’est pas choquant que l’on ait besoin d’un renseignement immédiat et que l’on aille directement à la source. En l’occurrence, la DACG m’a demandé les conclusions de l’expertise et ce que j’envisageais de faire : j’ai répondu que j’allais ouvrir une information judiciaire. Nous en sommes restés là.
Je n’ai reçu à aucun moment le moindre message politique que j’aurais pu de quelque façon que ce soit interpréter comme un frein à ce que j’allais faire.
Mes relations avec mon procureur général sont bonnes ; nous respectons le dialogue institutionnel. Je ne lui ai pas demandé d’instructions ; je l’ai toujours informé de mes intentions, le mettant en mesure de faire valoir ses observations. Il n’a jamais cherché à contrecarrer les décisions que j’avais prises. C’est, je crois, un fonctionnement très harmonieux.
M. Charles de Courson. Un procureur libre dans un parquet libre ?
M. François Molins. On peut le dire comme ça !
J’ajoute que, si je parle ici à la première personne du singulier, mes analyses correspondaient à celles de mon procureur adjoint financier et à celles de la section économique et financière : le travail du parquet est un travail de groupe.
S’agissant de l’entraide, nous ne transmettons aucune pièce de procédure. C’est la meilleure façon de conserver le secret, même cette notion est un peu galvaudée de nos jours… Nous avons, par contre, transmis – le jour où nous l’avons reçu, c’est-à-dire le 1er février – le résultat de la demande fiscale transmis à la DNIFF par la DGFiP mais, de mémoire, c’est la seule pièce que nous ayons transmise au parquet général.
M. Patrick Devedjian. Vous l’avez transmise au parquet, mais pas à la chancellerie.
M. François Molins. Il n’y a pas eu de relations avec la DACG.
M. Philippe Houillon. Vous avez parlé d’un enregistrement assez professionnel ; cela nous a étonnés, car à notre connaissance il a été réalisé plutôt par inadvertance. Pourriez-vous développer ce point ?
M. François Molins. Mon propos manquait de précision : ce n’est pas l’enregistrement lui-même, mais sa copie qui a été réalisée par un professionnel.
Mme Cécile Untermaier. Avez-vous connaissance d’autres demandes administratives faites à la Suisse ? Quelle est votre analyse du contenu de la demande rédigée par Bercy ?
M. François Molins. Je n’ai pas connaissance d’autres demandes. Quant à votre seconde question, il m’est bien difficile de commenter cette demande : encore une fois, nous agissons dans des cadres très différents. En matière fiscale, on demande si la personne est titulaire d’un compte ou d’avoirs ; c’est, je pense, assez formaté. En matière pénale, c’est complètement différent. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais vous comprendrez qu’il n’y a guère de points communs entre une demande d’assistance qui tient sur une page et se résume à quelques questions, et une demande d’entraide pénale internationale qui fait une dizaine de pages, rappelle des faits, pose des questions nombreuses. Ce sont deux procédures difficilement comparables.
Mme Cécile Untermaier. Cela expliquerait que les réponses soient différentes…
M. Charles de Courson. Comprenez, monsieur le procureur, que nous sommes troublés par le fait que la réponse à la demande d’entraide fiscale ait été négative, quand votre demande d’entraide judiciaire obtenait une réponse positive.
M. François Molins. Les questions ne sont vraiment pas posées de la même façon. Les demandes judiciaires comprennent notamment des questions sur le blanchiment : dans certains pays, notamment la Suisse, on n’est pas titulaire d’un compte d’où l’on retire facilement de l’argent ; les pratiques sont diverses et nombreuses : noms d’emprunt avec les master accounts, fausses domiciliations, ouvertures de compte au nom d’un établissement financier qui divise les comptes en sous-comptes, mécanismes d’empilage… Les questions sur ces sujets sont très précises : cela a été le cas dans ce dossier comme dans tous les autres où interviennent les juges d’instruction financiers.
M. Jean-Pierre Gorges. La copie que vous expertisez est-elle celle fournie par M. Gonelle ?
M. François Molins. Je ne peux pas vous répondre : ces informations sont couvertes par le secret de l’instruction.
M. Jean-Pierre Gorges. Pouvez-vous nous dire de quel type de support il s’agit ?
M. François Molins. Je ne peux pas non plus répondre à cette question.
M. Jean-Pierre Gorges. Je vous pose la question parce que j’étais surpris que M. Bruguière ne se rappelle pas si l’enregistrement était sur une clé USB, une disquette ou une cassette. Par ailleurs, il est toujours possible, quel que soit le système d’exploitation, de connaître la date à laquelle l’enregistrement a été fait. Avez-vous obtenu ce renseignement ?
M. François Molins. Je ne peux toujours pas vous répondre…
M. Jean-Pierre Gorges. Vous l’avez compris, il y a un débat au sein de la commission d’enquête : était-il opportun de lancer une enquête administrative dont le champ sera nécessairement très réduit par rapport à celui de l’enquête judiciaire ?
Comment avez-vous réagi en lisant l’article du Journal du Dimanche qui blanchissait M. Cahuzac, puis en entendant le Président de l’Assemblée nationale, notamment, estimer qu’il fallait cesser de parler de cette histoire ?
M. François Molins. Encore une fois, les questions posées par la DGFiP n’ont pas gêné le déroulement de l’enquête préliminaire. Ce qui est gênant, c’est d’être questionné par des journalistes qui sont en possession d’informations qui donnent à penser que des demandes ont été faites et que des réponses vont arriver : si elle répond, l’autorité judiciaire peut se trouver en porte-à-faux. J’ai donc totalement refusé de répondre à ces questions.
Il y a eu, vous avez raison, un déchaînement médiatique : je vous avoue qu’en lisant le Journal du Dimanche, j’ai eu quelques doutes ! Nous sommes des gens responsables, nous imaginons bien les conséquences politiques, le tohu-bohu qui peuvent résulter de telles affaires. Mais je savais ma démarche sérieuse.
M. Jean-Pierre Gorges. L’article du Journal du Dimanche ne pouvait-il pas arrêter votre démarche ?
M. François Molins. Non : en réfléchissant, j’en suis revenu à cet élément matériel fondamental qu’était l’enregistrement. La pièce qui revenait de Suisse était de toute façon dans le dossier. Il nous fallait seulement attendre le résultat de l’expertise en cours sur l’enregistrement.
M. le président Charles de Courson. Comment expliquez-vous qu’un journaliste vous interroge, le 31 janvier, sur un retour de l’administration suisse, alors que c’est ce même jour seulement que la DGFiP reçoit l’information ? Autrement dit, d’où peuvent venir les fuites ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président, vous posez des questions dont vous connaissez les réponses…
Monsieur le procureur, savez-vous si la personne concernée est informée de l’existence d’une demande d’entraide administrative à la Suisse ? La réponse elle-même lui est-elle communiquée ?
M. François Molins. Je ne suis pas spécialiste de droit fiscal, mais je pense que la procédure suisse prévoit, en cas de demande de ce type, surtout lorsque la demande peut excéder les termes d’une convention, une information de la personne concernée.
M. le président Charles de Courson. D’où pensez-vous que peut venir la fuite, puisque le DGFiP nous affirme qu’il a seul eu communication de la réponse, qu’il n’aurait montrée, sur écran, qu’à M. Pierre Moscovici et à lui seul ? D’après les affirmations de M. Bézard, faites sous serment, la fuite ne vient pas de la DGFiP.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. le procureur nous dit que M. Cahuzac a été informé par les autorités suisses.
M. François Molins. Je ne sais pas d’où peut venir la fuite, monsieur le président. Les possibilités sont nombreuses. L’emballement médiatique a été immense. Les journalistes ont été très actifs dans ce dossier ! L’un d’eux a pu apprendre qu’une demande était partie, sans pour autant savoir qu’une réponse a été apportée.
M. Jean-Pierre Gorges. Le rapporteur est-il concerné par l’impossibilité d’obtenir des informations sur le support sur lequel se trouve l’enregistrement ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Le secret de l’instruction me sera opposé !
Ce qui nous intéresse, c’est de connaître les droits de celui qui est mis en cause dans le cadre suisse. On a la certitude que Jérôme Cahuzac, ou ses conseils, ont été informés de la demande, mais pas celle qu’ils ont eu communication de la réponse apportée.
M. le président Charles de Courson. Nous devrions recevoir prochainement la réponse des autorités helvétiques sur ce point.
M. François Molins. Je confirme que, dans la mesure où la question porte sur une période qui excède celle de la convention fiscale franco-suisse, la personne concernée a la possibilité de s’opposer.
M. le président Charles de Courson. La réponse le précise, en effet.
Vous avez parlé du principe de spécialité stipulé par la convention fiscale franco-helvétique. Or vous avez eu communication de la réponse. Est-ce normal ?
M. François Molins. Non, je ne crois pas, pas sans l’autorisation de la Suisse. En tout cas, je n’aurais pas eu le droit de la demander, en vertu du principe de spécialité.
M. le président Charles de Courson. Mais alors pourquoi vous l’a-t-on transmise ?
M. François Molins. Je l’ignore, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Et vous ne l’avez pas renvoyée ?
M. François Molins. Non. Nous menons une enquête qui a pour but de parvenir à la manifestation de la vérité : au nom de quoi m’opposerais-je à l’entrée dans la procédure, même si cela peut poser des problèmes, d’un document qui est finalement plus à la décharge de M. Cahuzac qu’à charge ?
M. le président Charles de Courson. D’après votre pratique de ce type d’affaires, comment s’articulent la convention de coopération fiscale et la convention de coopération judiciaire ? Nous commençons à nourrir quelques doutes sur l’efficacité de la première, mais la seconde semble bien fonctionner. Avez-vous souvent découvert par la coopération judiciaire des choses que n’avait pas révélées, ou qu’avait même démenties, la coopération fiscale ?
M. François Molins. Aujourd’hui, nous n’avons pas, au parquet de Paris, d’autre exemple d’une demande d’entraide fiscale faite alors qu’une enquête judiciaire était en cours. Il m’est très difficile de vous répondre : certainement mais il faudrait une étude plus approfondie ; je peux la demander. Encore une fois, ce sont des cadres extrêmement différents qui peuvent expliquer les différences. L’entraide fiscale se limite à la notion de titulaire de compte et d’ayant droit et ne prend pas en compte la dimension du blanchiment.
M. le président Charles de Courson. La notion d’ayant droit est-elle vraiment claire ? Il existe en effet les fiducies, les comptes globaux, omnibus,…
M. François Molins. Vous avez raison, cette notion n’est pas claire, c’est même une nébuleuse ! Elle renvoie à un grand nombre de montages financiers possibles.
M. Étienne Blanc. La mise en place d’un procureur financier indépendant aurait-elle pu accélérer la procédure, améliorer son fonctionnement ? Vous aurait-elle permis d’obtenir plus facilement gain de cause ? Vous ne verrez bien sûr aucune malice dans ma question, qui ne sort pas du sujet : avec un parquet enfin indépendant, rapide et efficace, connaîtrions-nous plus vite la vérité ?
M. Alain Claeys, rapporteur. En l’occurrence, il me semble que le parquet a agi de façon parfaitement indépendante.
M. François Molins. La justice, monsieur le député, n’aurait fonctionné ni mieux ni moins bien. Dans le projet de loi actuellement en discussion, les garanties de compétence et d’indépendance sont strictement identiques à celles de l’actuel procureur de Paris.
M. le président Charles de Courson. Merci, monsieur le procureur, de votre franchise, de votre clarté et de votre précision.
Audition du 26 juin 2013
À 16 heures 30 : M. Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, depuis près de deux mois, notre commission d’enquête entend le témoignage de personnes qui ont joué un rôle dans le déclenchement ou la gestion par les services de l’État de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». Il était logique qu’elle entende également le principal intéressé.
Je tiens cependant à souligner que l’objet de nos travaux est de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de cette affaire et que, comme la garde des Sceaux l’a rappelé dans son courrier adressé au président Claude Bartolone le 9 avril 2013, notre enquête « ne doit pas conduire à mener des investigations sur des aspects relevant de la compétente exclusive de l’autorité judiciaire et des services de l’État ayant pu intervenir à [sa] demande dans ce dossier ». Je vous demande donc de respecter ces principes lorsque vous poserez des questions à M. Jérôme Cahuzac ; à défaut, je me verrais dans l’obligation de vous les rappeler.
(M. Jérôme Cahuzac prête serment)
M. le président Charles de Courson. Si cela vous convient, je vais vous laisser vous exprimer
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le président, je n’ai pas de déclaration liminaire à faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avant de poser mes questions à M. Jérôme Cahuzac, je voudrais revenir sur ce que vient de dire le président de notre commission.
Le champ de nos investigations est strictement limité par le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d’une commission d’enquête de porter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires, aussi longtemps que celles-ci sont en cours. L’ouverture par le parquet de Paris, le 8 janvier dernier, d’une enquête préliminaire, puis, le 19 mars, d’une information judiciaire, enfin l’annonce le 2 avril de la mise en examen de M. Jérôme Cahuzac interdisent à notre commission de s’intéresser au volet judiciaire de cette affaire.
C’est pourquoi, depuis le début de nos travaux, j’ai axé nos investigations sur trois questions principales : les services de l’État disposaient-ils, avant le 4 décembre 2012, d’éléments matériels qui auraient permis de caractériser une fraude fiscale de la part de M. Jérôme Cahuzac ? Après la révélation de l’affaire, les services du ministère de l’économie et des finances ont-ils procédé aux vérifications nécessaires avec la diligence requise et convenait-il d’y procéder ? Des membres de l'exécutif ou leurs collaborateurs ont-ils été informés de la véracité des faits allégués par Mediapart avant les aveux du 2 avril et si oui, y a-t-il eu des tentatives d’entrave à l’exercice de la justice ? Il est évident que toute question qui s’éloignerait de ces trois axes excéderait le champ d’investigation de la Commission d’enquête.
J’en viens à mes questions.
Monsieur Cahuzac, pouvez-vous préciser le rôle que vous avez joué dans la rédaction de l’instruction connue sous le nom de « muraille de Chine », datée du 10 décembre 2012 ? Qui en a pris l’initiative ? A-t-elle été scrupuleusement respectée ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai pas eu l’initiative de cette disposition. Je crois que le mérite en revient au directeur général des finances publiques, M. Bruno Bézard, lequel m’en a informé via ma directrice de cabinet, Mme Amélie Verdier ; j’ai immédiatement donné mon accord pour que toutes les dispositions permettant l’érection de cette « muraille de Chine » puissent être prises dans les meilleurs délais. Si j’ai bonne mémoire, j’ai signé les instructions à cet effet le 10 décembre.
M. Alain Claeys, rapporteur. En avez-vous parlé avec M. Pierre Moscovici ?
M. Jérôme Cahuzac. Non, je n’ai pas parlé de ce principe avec Pierre Moscovici. L’instruction que je donnais avait pour conséquence mon déport immédiat et systématique de toutes les questions relatives à cette affaire. En conséquence, le ministre de l’économie et des finances en avait dorénavant la charge.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous informé le ministre de l’économie et des finances que l’administration fiscale vous avait adressé un formulaire « 754 », afin d’obtenir des informations sur les comptes et les avoirs que vous auriez détenus à l’étranger ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai informé personne que j’avais reçu ce formulaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Bruno Bézard a indiqué, lors de son audition du 28 mai, que vous aviez « tenté d’entrer dans le débat sur la demande d’assistance administrative et de voir par exemple comment cette demande était rédigée ». Il vous avait répondu que cela était impossible, et vous n’aviez pas insisté. Est-ce exact ?
M. Jérôme Cahuzac. Oui. Cet échange n’a duré que quelques secondes. J’ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu’une demande était soit en cours, soit faite. J’en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m’a répondu qu’il n’était pas envisageable que je puisse m’en mêler ; je lui ai donné raison et ne lui en ai plus jamais reparlé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand et par qui avez-vous été informé de cette démarche ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai pas souvenir de la date précise, mais ce sont mes avocats suisses qui m’en ont informé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez donc que vos avocats ont eu connaissance de cette demande ?
M. Jérôme Cahuzac. Forcément, puisqu’ils m’en ont informé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous demandé à vos avocats d’évaluer les probabilités de succès de cette démarche ?
M. Jérôme Cahuzac. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je n’ai pas eu de relations très suivies avec mes avocats suisses. Cela ne fait pas partie des questions que j’ai pu leur poser.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce que vos avocats ou vous-même avez été avertis par les autorités suisses – ou par d’autres – du contenu de leur réponse du 31 janvier ?
M. Jérôme Cahuzac. Pas du contenu précis, mais du sens de la réponse, oui. J’ai appris par mes avocats suisses qu’il revenait de la Confédération helvétique une réponse négative aux questions posées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez donc été informé et de la démarche, et du contenu général de la réponse ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai en effet été informé de la démarche et du sens de la réponse – si j’ai bonne mémoire, une dizaine ou une quinzaine de jours après.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous informé, directement ou indirectement, le Journal du Dimanche, ou d’autres journalistes, du contenu de cette réponse ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai parlé à personne du contenu de la réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous une idée de l’identité de la personne qui l’a fait ?
M. Jérôme Cahuzac. Je me suis longuement demandé qui avait pu faire cette démarche dont je ne jugeais pas à cet instant qu’elle pouvait m’aider. Je n’ai pas de réponse.
M. Alain Claeys, rapporteur. La prochaine question peut être aux frontières du champ d’investigation de notre commission d’enquête et de celui de la procédure judiciaire en cours ; à vous de voir ce que vous pouvez répondre. Notre commission se demande pourquoi les autorités suisses ont répondu par la négative à la question posée par l’administration fiscale française sur l’existence d’un compte à l’UBS de 2006 à 2012. L’une des explications pourrait être un transfert des avoirs du compte à d’autres dates ou à d’autres établissements que ceux dont a parlé la presse. Pourriez-vous préciser ce point ?
M. Jérôme Cahuzac. Votre question se situe en effet aux frontières de la procédure judiciaire et des travaux de votre commission.
Il me semble que les personnes que vous avez précédemment auditionnées ont évoqué deux possibilités : la première est que la banque UBS aurait menti – ce qui me paraît peu plausible, vu les risques que cette banque encourrait ; la deuxième est que la banque UBS a dit la vérité, à savoir que je ne disposais pas de compte à l’UBS durant la période visée par la demande française.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous vous êtes entretenu avec M. Rémy Garnier le 26 octobre dernier, à l’occasion d’un de vos déplacements à Villeneuve-sur-Lot. Depuis quand le connaissiez-vous ?
M. Jérôme Cahuzac. Je l’ai rencontré pour la première fois il y a un peu plus d’un an : il était venu assister à une réunion publique que j’avais organisée dans le cadre de la campagne législative. Je ne l’avais jamais vu auparavant.
Je l’ai revu une deuxième fois, à sa demande : il avait pris rendez-vous. Il faut dire qu’au cours de cette réunion publique, j’avais pris l’engagement de le recevoir s’il le souhaitait. Durant quelque trois quarts d’heure, il m’a exclusivement parlé de son dossier administratif et des procédures qu’il avait engagées contre son administration. Je pense qu’au bout de ce temps, nous n’avions pas examiné le quart ou même le cinquième des actions en cours ! J’ai dû lui dire que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Lorsque je l’ai raccompagné, il m’a dit qu’il souhaitait qu’en tant que ministre, je demande à l’administration que j’avais sous ma responsabilité de cesser toute procédure à son encontre et de reconnaître le caractère erroné des actions engagées contre lui. Je lui ai indiqué que je ne pourrais pas faire cela. Il m’a regardé et a dit : « Dommage ! ». Ce n’est que plus tard que j’ai compris le sens de ce propos.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle suite avez-vous donné à cet entretien ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’y ai pas donné suite. Comme je l’avais dit à M. Garnier, je ne voyais pas comment, au seul motif qu’une personne habitait dans ma circonscription, je pourrais demander à une administration de faire fi de toutes les procédures engagées contre lui – je ne porte pas de jugement sur leur légitimité. Il m’a indiqué qu’il allait en justice ; je lui ai fait remarquer que, pour restaurer ou laver son honneur d’agent du fisc, cette dernière était mieux placée que son ministre de tutelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissiez-vous avant la publication du premier article de Mediapart l’existence du mémoire en défense rédigé par M. Garnier en juin 2008 et son contenu ?
M. Jérôme Cahuzac. À aucun moment je n’avais eu connaissance de ce mémoire. Mais, puisque vous m’interrogez sur mes relations avec M. Rémy Garnier, peut-être un bref rappel historique serait-il utile.
Entre 1997 et 2002, je suis député de la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. Les dirigeants de France Prune viennent un jour me signaler qu’ils font l’objet d’une vérification fiscale qui se conclut par deux demandes de redressement : l’une au titre de l’impôt sur les sociétés, l’autre au titre de la taxe professionnelle.
Après avoir étudié les deux dossiers – ce qui m’a pris dix à quinze jours, car ils étaient complexes –, je les rencontre à nouveau. Je leur indique que le dossier relatif à l’impôt sur les sociétés me paraît plaidable, que je comprends les risques économiques pour leur entreprise si d’aventure les mises en recouvrement étaient opérées et que je me ferai leur porte-parole auprès du cabinet du secrétaire d’État au budget afin de voir comment les choses pourraient s’arranger. Il me semble n’avoir fait là que mon travail de parlementaire. En revanche, pour ce qui est de la taxe professionnelle, je réponds aux dirigeants de France Prune que l’affaire me paraît sérieuse et que je ne suis pas techniquement en mesure de plaider l’annulation de la procédure.
Sur le premier dossier, le secrétaire d’État au budget donne gain de cause à la coopérative à une condition : que celle-ci modifie radicalement ses structures juridiques et commerciales, de sorte que plus jamais à l’avenir il n’existe d’ambiguïtés susceptibles d’occasionner une procédure fiscale. France Prune a tenu ses engagements.
Quant au contentieux relatif à la taxe professionnelle, la coopérative a décidé de contester en justice les conclusions de M. Rémy Garnier et elle a obtenu gain de cause.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand avez-vous pris connaissance du mémoire en défense de M. Garnier ?
M. Jérôme Cahuzac. Dans les jours qui ont suivi la publication de l’article de Mediapart. Lorsque je reçois M. Fabrice Arfi le mardi matin 4 décembre, il m’indique ne pas comprendre pourquoi – je le cite de mémoire – « Éric Woerth a reçu en 2008 un courrier de Rémy Garnier l’informant que je disposais d’un compte non déclaré à l’étranger ». Dans l’après-midi, je demande à M. Éric Woerth s’il a reçu un tel courrier. Il m’assure du contraire, soulignant que si tel avait été le cas, il aurait immédiatement diligenté une enquête.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous vous êtes adressé directement à M. Éric Woerth ?
M. Jérôme Cahuzac. Oui, je suis allé le voir après la séance des questions au Gouvernement.
Comme il n’a pas souvenir de ce courrier et qu’il n’y a aucune trace d’enregistrement, je me demande de quoi il peut s’agir. C’est alors que les services « retrouvent », non pas un courrier ni un rapport, mais un mémoire adressé par M. Rémy Garnier à sa hiérarchie afin de contester les décisions administratives dont il fait l’objet. Ce mémoire comprend une douzaine de pages, dont une m’est consacrée ; d’autres sont dédiées à certains de ses collègues : il en accuse un d’avoir sous-estimé la valeur d’un bien reçu par héritage en Dordogne, un autre de ne pas avoir payé à temps la taxe professionnelle sur un bien détenu à Agen, un troisième de déduire de ses revenus ses frais de transport lors même qu’il « pratique le covoiturage » ; il affirme des choses très désagréables pour sa hiérarchie et certains de ses collègues, mettant en doute à l’occasion leur honorabilité. En ce qui me concerne, il m’accuse de disposer d’une villa à Marrakech, d’un appartement à La Baule et d’un compte non déclaré à l’étranger, sans jamais apporter le moindre commencement de preuve, ces assertions étant introduites par des propositions du type « j’ai ouï dire que… », « on m’a dit que… » ou « je crois savoir que… ». Je ne découvre ce mémoire que dans les jours qui suivent l’article princeps de Mediapart.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon vous, ce mémoire avait-il été porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ?
M. Jérôme Cahuzac. C’est elle qui a reçu ce mémoire, mais j’ignore à quelle sous-direction il a été adressé et qui a pu le lire. Je n’ai pas eu l’impression que beaucoup l’avaient fait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment avez-vous appris l’existence de l’enregistrement détenu par M. Michel Gonelle ?
M. Jérôme Cahuzac. Le jour où Mediapart a décidé de le mettre en ligne. Je n’en avais jamais entendu parler auparavant.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc aucune idée de la personne qui l’a remis à Mediapart ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme vous, je n’ai aucune preuve me permettant d’affirmer que tel ou tel aurait remis cet enregistrement. À la lecture des comptes rendus des précédentes auditions, il me semble que seules deux personnes peuvent l’avoir fait : M. Michel Gonelle ou M. Jean-Louis Bruguière. Tous deux vous ont déclaré sous serment n’y être pour rien. M. Gonelle a même ajouté qu’il n’avait pas souhaité en faire état auparavant afin de ne pas « pervertir » le débat politique. Soit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-il exact que M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République, vous aurait informé le 15 décembre du contenu de l’entretien téléphonique qu’il avait eu le jour même avec M. Michel Gonelle ?
M. Jérôme Cahuzac. Il m’a informé d’un contact téléphonique – le contenu, je n’en suis pas certain, mais la date est exacte.
M. Alain Claeys, rapporteur. Que lui avez-vous répondu ?
M. Jérôme Cahuzac. Que voulez-vous que je lui réponde ? J’ai pris acte de ce qu’il m’indiquait, et nous avons convenu que la démarche était curieuse et que si M. Gonelle avait des choses à dire, il devait saisir en priorité la justice.
M. Alain Claeys, rapporteur. À compter de l’ouverture de l’enquête préliminaire, le 4 janvier, le parquet général a informé la chancellerie de l’avancement des investigations. Avez-vous eu des contacts avec la garde des Sceaux ou avec son cabinet à ce sujet ?
M. Jérôme Cahuzac. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. De même, les policiers chargés de l’enquête préliminaire ont rendu compte de l’avancée de leurs investigations. Avez-vous eu des contacts avec M. le ministre de l’intérieur ?
M. Jérôme Cahuzac. Des contacts avec mes anciens collègues, j’en ai eu, mais pas à ce sujet.
M. le président Charles de Courson. Quelques questions complémentaires.
Pourquoi ne pas avoir répondu au formulaire 754 ? Avez-vous informé Pierre Moscovici de cette non-réponse ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai informé Pierre Moscovici, ni que j’avais reçu le formulaire, ni que je n’y avais pas répondu.
Pourquoi ne pas y avoir répondu ? Il y a tout de même deux tabous que je n’ai pas transgressés. Premièrement, contrairement à ce qui a été écrit, je n’ai jamais juré sur la tête de mes enfants ne pas détenir de compte. Deuxièmement, il m’a semblé impossible de mentir par écrit à l’administration dont j’avais la charge.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous transféré votre compte chez Reyl & Compagnie durant la période 2006-2012 – puisque vous avez dit au rapporteur que vous aviez fermé votre compte à l’UBS avant 2006 ?
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le président, je n’ai pas dit cela. J’ai indiqué au rapporteur qu’il n’y avait que deux solutions possibles – en me gardant bien, car cela empiéterait sur les prérogatives de l’autorité judiciaire, de préciser laquelle me semblait la bonne.
Quant à la question que vous me posez, je suis au regret de vous dire qu’elle me semble empiéter sur l’information judiciaire en cours. Je ne peux donc pas vous répondre.
M. le président Charles de Courson. Certains ont reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir formulé la demande d’assistance administrative de manière plus large, en faisant porter l’interrogation non seulement sur l’UBS, mais aussi sur Reyl & Compagnie. Si vous nous confirmiez que vous aviez bien détenu entre 2006 et 2012 un compte dans cet établissement, cela signifierait que si la demande avait été élargie, elle aurait peut-être reçu une réponse positive. Monsieur Cahuzac, aviez-vous, oui ou non, un compte chez Reyl & Compagnie entre 2006 et 2012 ?
M. Jérôme Cahuzac. Je comprends votre raisonnement, monsieur le président, mais j’espère qu’à votre tour vous comprendrez que je ne peux pas répondre à cette question.
M. le président Charles de Courson. Pourriez-vous alors répondre à cette autre question : à quelle date le compte a-t-il été transféré, soit depuis UBS, soit depuis Reyl & Compagnie, vers une filiale à Singapour du même établissement ?
M. Jérôme Cahuzac. Je suis contraint de vous faire la même réponse, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Vous rendez-vous compte qu’en refusant de répondre à cette question, vous mettez notre commission d’enquête en difficulté, puisque l’une des questions que nous nous posons est de savoir pourquoi l’administration fiscale n’a pas saisi les services fiscaux de Singapour pour leur demander si vous y possédiez un compte ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai lu avec attention les comptes rendus des auditions des responsables d’administrations fiscales. Il m’a semblé que leurs réponses étaient assez convaincantes ; manifestement, elles ne vous ont pas convaincu, et je le regrette.
M. le président Charles de Courson. Je prends acte que vous ne répondez pas à ces questions.
Il nous a été dit que vous auriez effectué au moins un déplacement en Suisse à la fin 2009 ou au début 2010. Pourriez-vous préciser la date et l’objet de ce ou de ces déplacements ?
M. Jérôme Cahuzac. Je le souhaiterais, mais je ne le peux pas, monsieur le président – pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Cahuzac, vous avez déclaré que pour un déplacement au moins vous aviez pris vos billets de train à l’Assemblée nationale – autour du 20 octobre, semblerait-il. Le confirmez-vous ?
M. Jérôme Cahuzac. Il m’a semblé lire dans un précédent compte rendu que vous aviez la certitude que je m’étais déplacé en février 2010 ; s’agirait-il, maintenant, d’octobre 2009 ?
M. le président Charles de Courson. Nous savons – vous l’avez reconnu publiquement – que vous avez fait au moins un déplacement en Suisse, mais nous ignorons quand. De manière à éclairer la commission, pouvez-vous, monsieur Cahuzac, nous préciser la date du ou des voyages que vous avez effectués en Suisse à la fin 2009 ou au début 2010 ?
M. Jérôme Cahuzac. Je vais tenter de vous répondre en veillant à ne pas empiéter sur l’information judiciaire en cours. Je comprends que vous ayez moins le souci que moi du respect de cette information judiciaire, mais j’espère que, réciproquement, vous comprendrez que j’y sois particulièrement attentif.
Il a été dit – j’ignore par qui – que des déplacements en Suisse avaient été organisés afin de ne pas compromettre mon éventuelle élection à la présidence de la Commission des finances. Or, à la date que vous indiquez, Philippe Seguin n’était pas décédé et Didier Migaud n’avait pas encore été nommé à la Cour des comptes ; si cette date était la bonne, j’aurais disposé d’une capacité d’anticipation surprenante !
M. le président Charles de Courson. Vous n’êtes donc pas allé en Suisse ?
M. Jérôme Cahuzac. C’est tout ce que je peux répondre, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Vous avez publiquement reconnu début avril que vous aviez un compte à l’UBS. Pourriez-vous nous indiquer si vous aviez d’autres comptes, soit comme titulaire, soit comme mandataire ?
M. Jérôme Cahuzac. Il ne me semble pas avoir jamais dit ou écrit que j’avais un compte à l’UBS.
M. le président Charles de Courson. Vous n’aviez donc pas de compte en Suisse ?
M. Jérôme Cahuzac. Ce n’est pas ce que je viens de dire. Vous me demandez de confirmer que j’ai dit ou écrit le 2 avril que j’avais un compte à l’UBS. Or, je n’ai rien dit ou écrit de tel.
M. le président Charles de Courson. Vous avez dit « à l’étranger ».
M. Jérôme Cahuzac. Ce n’est pas la même chose, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Si vous entendez par là que vous aviez un compte à Singapour, il faut le dire à la Commission, et préciser quand ce compte a été transféré de la Suisse vers Singapour, puisque cela conditionne une partie de nos conclusions concernant l’efficacité de la mise en œuvre de la convention fiscale franco-suisse !
M. Jérôme Cahuzac. Votre question, formulée sur un ton affirmatif, me prêtait des propos que je n’ai pas tenus ; maintenant, vous évoquez le nom, non plus d’une banque, mais d’un pays. Or, je n’en ai cité aucun le 2 avril. Et tout ce qui concerne la chronologie de cette affaire sera réservé aux juges d’instruction Roger Le Loire et Renaud Van Ruymbeke.
M. le président Charles de Courson. Merci de cette non-réponse.
Quel rôle M. Stéphane Fouks a-t-il joué dans votre communication durant toute cette période ? L’aide qu’il vous a apportée était-elle gratuite ou rémunérée ? Dans ce dernier cas, s’inscrivait-elle dans le cadre du contrat signé par le ministère de l’économie et des finances et celui du budget avec l’agence Havas Worldwide ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président, je vous informe que nous venons de recevoir du ministre de l’économie et des finances le texte des conventions qui liaient cette agence de communication au ministère, ainsi que les factures qui lui ont été payées.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous eu le temps d’examiner ces documents ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Rapidement – mais nous en reparlerons ultérieurement.
M. Jérôme Cahuzac. M. Stéphane Fouks n’a joué aucun rôle dans ma communication. D’abord, aux termes du contrat signé entre le ministère et l’agence, ce n’était pas lui qui était chargé de cette mission. Ensuite, il était un ami très proche ; ne lui ayant pas dit la vérité, je vois mal comment il aurait pu m’aider dans ma communication ! M. Fouks n’a joué aucun rôle institutionnel dans cette affaire.
M. le président Charles de Courson. Ni lui, ni aucun autre membre de l’agence ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’en ai rencontré aucun à cette occasion.
M. le président Charles de Courson. La parole est à M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Monsieur Cahuzac, je vous ai interrogé le 5 décembre dans l’hémicycle. Vous m’avez alors répondu que vous n’aviez pas de compte en Suisse. Ce mensonge a eu des conséquences considérables, tant dans l’opinion publique que sur le fonctionnement de nos institutions. Aujourd’hui, le regrettez-vous ?
Vous auriez dit également, en visant François Hollande : « C’est moins grave de mentir pendant quinze secondes devant 577 députés que depuis un an sur l’état de la France ». Confirmez-vous avoir tenu ces propos ?
Comment expliquez-vous que l’Élysée, informé le 15 décembre par Michel Gonelle, qui vient confirmer les révélations de Mediapart, n’ait pas réagi autrement que par un coup de fil de M. Zabulon renvoyant M. Gonelle à l’institution judiciaire ?
Comment expliquez-vous qu’après les révélations de la fin janvier, quand on annonce à la suite d’une enquête en Suisse que vous n’avez pas de compte, l’Élysée ne réagisse pas ? Pensez-vous que la question posée à la Suisse avait été orientée dans le but de vous blanchir ?
Les dysfonctionnements sont aujourd’hui avérés. Le problème est de savoir pourquoi ils ont eu lieu : s’agit-il d’une simple négligence, d’une forme d’inconscience, ou a-t-on voulu délibérément « sauver le soldat Cahuzac », et avec lui le général Hollande ? Il existe des rumeurs faisant état d’autres comptes et de liens avec le financement de partis politiques. Sont-elles exactes ? Cela pourrait expliquer l’attitude du général Hollande depuis le 15 décembre… (Exclamations sur les bancs de gauche.)
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Fasquelle, jusqu’à présent, les réunions de notre commission se sont toujours déroulées dans de bonnes conditions, et chacun a pu s’exprimer à sa guise. Mais si vous souhaitez parler du Président de la République, nommez-le par sa fonction !
M. Daniel Fasquelle. Laissez-moi finir !
M. le président Charles de Courson. Monsieur Fasquelle, je vous demande d’être concis et de respecter les institutions de notre République.
M. Daniel Fasquelle. Mais je les respecte, monsieur le président ! Il s’agissait d’une simple formule ; je parlais, bien entendu, du Président de la République : nul besoin de se crisper sur ce point…
Monsieur Cahuzac, on peut lire cette semaine dans la presse que le compte était alimenté par des chèques et qu’il y a eu des retraits – alors que vous aviez dit qu’il était dormant. Qu’en est-il exactement ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour être le plus scrupuleux possible, je précise que lorsque nous l’avons auditionné, M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République, nous a déclaré qu’à la suite de l’appel téléphonique de M. Gonelle, il avait informé le secrétaire général de l’Élysée et le Président de la République. La réponse de ce dernier, telle que M. Zabulon nous l’a transmise, aurait été : « Si M. Gonelle a des documents, qu’il les transmette à la justice ». Pour votre information, ni la Présidence de la République ni notre commission ne disposent des documents que M. Gonelle devait transmettre.
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le député, ayant déjà exprimé par écrit le 2 avril le sentiment que j’éprouvais, il ne me semble pas indispensable de me répéter – ce qui n’enlève rien à la sincérité de ce sentiment.
Quant aux raisons pour lesquelles je vous ai menti, eh bien c’est tout simplement parce que dans les heures précédentes, j’avais déjà menti au Premier ministre et au Président de la République !
S’agissant des faits qui concernent l’Élysée, je ne crois pas avoir qualité pour les interpréter, et encore moins pour les juger ou les expliquer.
Quant à vos autres questions, soit elles relèvent clairement de la procédure judiciaire et je ne peux vous répondre, soit elles comportent des critiques à l’encontre de l’administration fiscale et je les crois injustes : l’administration fiscale a fait tout ce qu’elle pouvait, sans jamais m’en informer, et en conscience ; il me semble que les propos que M. Bézard et ses collaborateurs ont tenus devant vous étaient convaincants. Je pense qu’ils ont bien agi et qu’il leur était difficile, sinon impossible, de faire davantage – non pas que des instructions leur auraient été données en ce sens – mais eu égard aux textes en vigueur, notamment ceux qui régissent les relations entre la France et la Confédération helvétique.
Quant aux faits entrant dans le périmètre de la procédure judiciaire en cours, comme votre rapporteur l’a rappelé dans son propos liminaire, je ne peux pas les aborder devant vous. Je comprends votre déception, peut-être votre frustration ou votre agacement, mais je ne peux pas le faire.
De même, je ne peux pas élever de protestations concernant les présupposés factuels inclus dans certaines de vos questions. Je voudrais donc qu’on n’applique pas pour autant l’adage « Qui ne dit mot consent ». Vous voudrez bien considérer, mesdames et messieurs les députés, que mon abstention ne vaut pas approbation du libellé des questions. Le silence m’est imposé par ma situation judiciaire.
Mme Cécile Untermaier. Après l’annonce le 5 décembre par Mediapart de l’existence d’un enregistrement, vous avez porté plainte en diffamation contre le site d’information, mais en n’utilisant pas la bonne procédure, ce qui a nécessité une requalification. Avez-vous été conseillé en la matière ? Avez-vous eu un contact à ce sujet avec la garde des Sceaux ou ses services ?
Vous avez évoqué un entretien avec le Président de la République et le Premier ministre. Pensez-vous que vos dénégations concernant l’existence du compte ont convaincu les intéressés ?
M. Jérôme Cahuzac. S’agissant de la procédure en diffamation, je n’ai eu personnellement aucun contact ni avec la garde des Sceaux, ni avec ses collaborateurs. Deux procédures ont successivement été engagées, la première n’ayant pas été considérée comme valable. Je crois que mes avocats avaient pris contact avec les services du procureur et que la première procédure avait été engagée sans qu’on leur signale qu’elle était erronée. Il s’agit d’un travail assez classique entre les avocats et les services du procureur – mais je ne peux vous en dire davantage car je ne me suis guère occupé de la question.
Quant à ce que vous qualifiez d’« entretien », je me suis contenté de répondre à M. Daniel Fasquelle que j’avais menti à l’Assemblée nationale quelques heures après avoir menti au Président de la République et au Premier ministre.
Mme Cécile Untermaier. Et les avez-vous sentis convaincus par vos propos ?
M. Jérôme Cahuzac. Madame la députée, il est compliqué de faire référence à un sentiment à tant de semaines de distance. Il semble – je ne m’en félicite pas, au contraire, j’ai plutôt tendance à le regretter amèrement – que j’aie pu mettre dans mes dénégations une force de conviction qui en a convaincu plus d’un.
M. le président Charles de Courson. Quand ce contact a-t-il eu lieu ?
M. Jérôme Cahuzac. Quelques heures avant les questions au Gouvernement, donc le mercredi 5 décembre.
M. Georges Fenech. Vous aviez un mois pour répondre au formulaire 754, et vous ne l’avez pas fait, pour la raison que vous avez donnée. C’est à partir de là que votre ministre de tutelle, M. Pierre Moscovici, décide d’interroger la Suisse par le canal administratif. Il s’agit d’une démarche étonnante, et sans précédent, comme nous l’a confirmé le procureur de Paris, M. François Molins, lors de son audition ; en effet, en application du principe de la séparation des pouvoirs, lorsque la justice enquête, l’administration ne peut faire de même de son côté.
M. le président Charles de Courson. Cher collègue, nous avons examiné ce point : en droit, c’est possible ; le procureur nous a simplement dit qu’il n’existait aucun précédent, et qu’il n’y avait eu aucune concertation entre la DGFiP et lui-même sur cette affaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’ajoute qu’à la suite de l’audition du procureur, M. Bruno Bézard a écrit à la Commission. Nous vous donnerons ultérieurement connaissance du contenu de cette lettre.
M. Georges Fenech. Même s’il n’y a pas d’impossibilité légale, il y a quand même des principes – et la séparation des pouvoirs en est un. D’ailleurs, souvenez-vous de ce qu’Edwy Plenel avait déclaré ici même : le tort de Bercy est d’avoir diligenté une enquête administrative en parallèle d’une action judiciaire.
Chacun sait que la question posée, sous l’autorité de Pierre Moscovici, par l’administration française aux autorités suisses était mal formulée ; la preuve en est que la justice obtiendra, elle, une réponse positive, alors que l’administration était en train de blanchir M. Cahuzac – à tel point que le procureur de Paris nous a confié qu’à la lecture de l’article du Journal du Dimanche, il a eu des doutes sur la réalité de ce compte en Suisse.
Monsieur Cahuzac, après le 14 janvier, date d’expiration du délai de renvoi du formulaire 754, le ministre de l’économie et des finances vous a-t-il informé qu’il allait directement interroger la Suisse malgré l’existence d’une enquête judiciaire en cours ? Dans cette hypothèse, vous a-t-il soumis le contenu et le libellé de cette question ? Votre réponse est importante, car elle nous permettra de déterminer si le ministre de l’économie et des finances a cherché délibérément à vous blanchir ou commis une imprudence.
M. Jérôme Cahuzac. M. Pierre Moscovici ne m’a jamais informé de cette procédure. A fortiori, il ne m’a pas communiqué les termes de la demande formulée par l’administration française à son homologue helvétique.
M. Sergio Coronado. Je vais essayer de poser une question à laquelle M.Cahuzac pourra répondre ! Après la publication de l’article de Mediapart qui révélait que vous déteniez depuis de longues années un compte à l’étranger, pourquoi ne pas avoir démissionné pour mieux assurer votre défense ? Auriez-vous jugé que la fonction que vous occupiez vous permettait de vous protéger et d’avoir un œil sur les enquêtes en cours et les investigations de l’administration puisque vous saviez que les allégations de Mediapart étaient vraies ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme je l’ai indiqué, à la suite de cet article princeps, une décision est prise qui me déporte systématiquement de toutes les questions relatives à l’affaire. Elle m’est presque immédiatement suggérée par l’administration, via ma directrice de cabinet, et j’y donne mon accord sans délai. Je ne crois donc pas que vos suppositions soient fondées.
Quant à mes sentiments sur les décisions que j’ai pu prendre, peut-être accepterez-vous que je les garde pour moi.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Monsieur Cahuzac, vous avez récemment déclaré : « Je suis le bouc émissaire idéal de toutes les turpitudes politiques ». Que voulez-vous dire par là ? Faut-il sous-entendre qu’il existerait des ramifications de nature politique à votre affaire, qui pourraient conduire la Commission d’enquête à élargir ses investigations ?
Mediapart a publié un certain nombre d’informations le 4 décembre et M. Zabulon a indiqué que l’Élysée était au courant dès le 15 décembre. Pourquoi être resté au Gouvernement jusqu’au 19 mars 2013 ? Cela pouvait-il servir vos intérêts personnels ou ceux de votre famille politique ?
La Commission pour la transparence financière de la vie politique vous a-t-elle interrogé sur votre situation fiscale ou patrimoniale ?
M. Jérôme Cahuzac. Vous faites référence à ce qui est présenté comme une interview, mais je n’ai pas le souvenir d’en avoir donné une ces derniers jours. Quant à l’expression « bouc émissaire », peut-être a-t-elle été utilisée, non pas de façon générale ou à propos de cette affaire, mais à l’occasion de l’élection législative partielle dans la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. Il peut sembler excessif de faire porter la responsabilité des résultats de cette élection à une seule personne.
Je répète que si je suis resté au Gouvernement, ce n’est évidemment pas pour me protéger, puisque, m’étant déporté quasi immédiatement de cette affaire, je n’ai plus eu autorité sur l’administration dès lors que celle-ci s’intéressait à moi.
M. le président Charles de Courson. Vous avez pourtant déclaré sur Le Monde.fr : « Je suis le bouc émissaire de toutes les turpitudes politiques » !
M. Jérôme Cahuzac. C’était à l’occasion de l’élection législative partielle – qui ne me semble pas être le sujet de votre commission d’enquête.
M. le président Charles de Courson. Mais qu’entendez-vous par « turpitudes » ? Voilà ce que souhaiterait savoir notre collègue – comme beaucoup d’autres qui ont découvert avec étonnement ces propos dans la presse.
M. Jérôme Cahuzac. Pas davantage que d’avoir accordé une interview à Europe 1, je n’ai eu conscience de donner une interview au Monde.fr, monsieur le président.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Quid de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme tout élu, j’ai eu à transmettre un document à cette commission. Dès lors que ce document était « incomplet » – si vous me permettez cet euphémisme –, je me suis efforcé de le compléter.
M. le président Charles de Courson. Qu’est-ce à dire ? Que vous avez écrit une lettre pour dire : « J’ai oublié telle et telle chose » ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne crois pas avoir employé l’expression : « j’ai oublié ». J’ai tenté de faire état de la totalité de mon patrimoine auprès de cette commission.
M. le président Charles de Courson. Vous avez donc rédigé une lettre complémentaire ?
M. Jérôme Cahuzac. Dans la pratique, cela a pris cette forme, oui.
M. le président Charles de Courson. Quand était-ce ?
M. Jérôme Cahuzac. Après mes aveux.
M. le président Charles de Courson. Et pourquoi avoir fait cela ?
M. Jérôme Cahuzac. Je l’ai cru nécessaire.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Quel est votre sentiment aujourd’hui sur cette affaire ? Avez-vous le sentiment d’avoir été « lâché » ?
M. Jérôme Cahuzac. La situation est suffisamment difficile pour que je ne me livre pas à l’étalage de mes sentiments personnels. J’espère que vous le comprendrez.
M. Alain Claeys, rapporteur. En tant qu’ancien ministre du budget, quel regard portez-vous sur la convention fiscale entre la France et la Suisse ?
M. Jérôme Cahuzac. Les statistiques vous ont été données par le directeur général des finances publiques : le nombre de réponses positives obtenues dans le cadre de l’entraide administrative est extraordinairement faible.
M. le président Charles de Courson. Si j’ai bonne mémoire, il y a eu quatre réponses pour 450 saisines.
M. Jérôme Cahuzac. J’avais en tête une proportion de l’ordre de 6 %.
M. le président Charles de Courson. Il y a eu 6 % de réponses, mais qui n’ont permis de détecter que quatre affaires. Mais poursuivez.
M. Jérôme Cahuzac. J’ignore ce que vous attendez de moi ; je connais comme vous le pourcentage incontestablement très faible de succès dans ce type de démarche.
M. le président Charles de Courson. Pour être précis, M. Bruno Bézard a dit : « Au 15 avril 2013, les autorités françaises avaient formulé 426 demandes de renseignement au sujet des banques suisses. Nous n’avons reçu que 29 réponses, soit 6,5 % du total, les autres demandes étant jugées non pertinentes par nos collègues suisses. L’administration fiscale a jugé que six d’entre elles seulement étaient satisfaisantes. »
M. Jean-Marc Germain. Avez-vous reçu une lettre de relance de la part de l’administration fiscale lorsque celle-ci a constaté que vous n’aviez pas rempli le formulaire 754 dans le délai imparti ?
Avez-vous une explication sur la raison pour laquelle MM. Michel Gonelle et Jean-Louis Bruguière n’ont pas saisi la justice au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ? M. Bruguière n’a pas été très clair, mais il a évoqué une conception de la politique qui lui faisait interdiction de l’utiliser ; M. Gonelle a fait état de sentiments partagés, d’un mélange de crainte et de respect à votre endroit. Qu’en pensez-vous ?
L’existence d’un compte non déclaré à l’étranger et la crainte, depuis 2001, qu’elle puisse être révélée à l’opinion publique ont-elles eu une influence sur l’exercice de vos fonctions publiques, notamment en tant que président de la Commission des finances ou ministre du budget ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai reçu aucune lettre de relance.
M. le président Charles de Courson. Et le directeur général des finances publiques ne vous en a pas parlé ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne suis pas certain que lui-même ait su que ce formulaire m’avait été envoyé.
M. le président Charles de Courson. Sur ce point, il nous a répondu.
M. Jérôme Cahuzac. Quoi qu’il en soit, je n’ai reçu aucune lettre de relance et personne ne m’en a parlé.
Concernant la mise en œuvre de l’article 40, M. Jean-Louis Bruguière a fait état de sa considération pour le débat politique pour justifier le fait qu’il n’ait ni écouté, ni, a fortiori, donné cet enregistrement à la justice ; dont acte.
J’ai cru comprendre, en lisant le compte rendu de son audition, que M. Michel Gonelle avait avancé deux arguments pour justifier le fait qu’à aucun moment il n’ait jugé bon de saisir un procureur de cette situation : le premier, que vous avez repris, est qu’il craignait une réponse politique de ma part ; le second, qu’il souhaitait garder au débat politique une certaine dignité. Sachez que nous n’avons peut-être pas la même conception du débat politique. Et pour bien mesurer la valeur des propos que M. Gonelle a pu tenir devant votre commission, je voudrais rappeler quelques faits qui, s’ils sont ignorés à Paris, sont bien connus à Villeneuve-sur-Lot et dans le Lot-et-Garonne.
Tout d’abord, M. Michel Gonelle avait par le passé procédé à un enregistrement audio à l’insu de la personne qui s’exprimait ; il a ensuite fait écouter le document à un tiers, ce qui a provoqué dans les années 1980 une crise politique au sein de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot et des élections anticipées. Cela procède-t-il d’une conception élevée du débat politique ?
Ensuite, je crois que c’est lui qui, en 2006, a saisi le procureur de Paris, après avoir reçu, m’a-t-il dit, une lettre anonyme m’accusant d’employer de façon non déclarée une salariée en situation irrégulière. Cela était exact : avec mon épouse, nous avions croisé une jeune femme dans une détresse rare et nous avions décidé de l’aider, d’abord en lui permettant de vivre, ensuite en acquittant pour elle des frais d’avocat afin de régulariser sa situation – ce qui fut fait, par suite de quoi un contrat à durée indéterminée a été signé. Cette démarche m’a valu à la fin 2007 une procédure devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel m’a déclaré coupable tout en me dispensant de peine et d’inscription au casier judiciaire. Là encore, cela procède-t-il d’une conception élevée du débat politique ?
Quant à la transmission de l’enregistrement, il s’en est lui-même expliqué : il l’a fait passer à un ami qui l’a fait passer à un autre ami, à la suite de quoi une procédure compliquée a été conduite au sein de l’administration fiscale, mais n’a débouché sur rien. Depuis que j’ai appris ces faits – car je les ignorais –, il m’est arrivé de regretter qu’ils n’aient pas débouché à cette époque.
Quant à mon action comme président de la commission des finances, je l’ai conduite sous le contrôle de plusieurs parlementaires qui siègent désormais à vos côtés, monsieur le député. Je ne crois pas qu’ils aient jamais eu le sentiment que mes actes ou mes paroles soient restés, si peu que ce soit, en arrière de la main, bien au contraire. Les faits sont là.
Si vous faites référence à certaines accusations qui, à ma connaissance, ne sont pas susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire – la supposée protection dont aurait bénéficié mon frère lorsque j’étais président de la commission des finances –, je peux vous répondre très simplement : le scandale au sujet de la liste de HSBC Private Bank Suisse a éclaté à un moment où mon frère n’exerçait aucune responsabilité au sein de HSBC Private Bank France. Les services de Bercy s’étaient saisis de cette affaire et le procureur Éric de Montgolfier enquêtait sur elle depuis déjà bien longtemps avant qu’il arrive à HSBC. De plus, à ce jour, HSBC Private Bank France n’a nullement été incriminée. Je n’ai pas protégé mon frère : il n’y avait pas à le faire. On a tenté de le salir, c’est douloureux pour moi.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le 4 décembre 2012, Mediapart a fait les révélations que nous connaissons. La veille, en séance publique, nous avions examiné un projet de loi de finances en nouvelle lecture et nous avions bien senti qu’il y avait un problème. Du 3 décembre 2012 au 19 mars 2013, différentes procédures ont été engagées : les services fiscaux vous ont adressé le formulaire numéro 754 ; vous vous êtes déporté de tous les sujets ayant trait à cette affaire au moyen de la fameuse « muraille de Chine », sur laquelle il y aurait beaucoup à dire ; l’administration centrale a interrogé les autorités helvétiques. Comme beaucoup de Français, j’ai le sentiment d’un certain flottement dans le fonctionnement de l’État et de l’ensemble des ministères entre ces deux dates. Le 19 mars, avez-vous démissionné de votre propre initiative ou le Président de la République vous a-t-il demandé de le faire ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme tous mes collègues, j’ai participé, le 19 mars, à la séance des questions au Gouvernement, au cours de laquelle je n’ai pas été interrogé. Lorsque je suis sorti de l’hémicycle à seize heures ou peu après, un de vos collègues m’a alors dit avoir été interrogé par des journalistes sur une nouvelle enquête que la justice aurait lancée contre moi et m’a demandé de quoi il retournait. Je n’ai pas compris ce dont il me parlait. En consultant ensuite mon téléphone portable, j’ai appris que le procureur de la République de Paris avait ouvert une information judiciaire contre moi. J’ai immédiatement compris que ma situation au sein du Gouvernement devenait intenable. J’ai cherché à joindre le Premier ministre, qui était en déplacement. Lorsque nous sommes parvenus à entrer en contact, je lui ai indiqué que j’allais remettre immédiatement ma démission du Gouvernement.
Il m’est arrivé de penser que les plus hautes autorités de l’État avaient peut-être été informées de la décision du procureur avant qu’il ne publie son communiqué et, donc, que je l’apprenne. Je suppose, dès lors, que le Président de la République et le Premier ministre étaient déjà arrivés à la même conclusion, évidente, que moi. Comme leur charge le leur impose, ils ont dû se demander très vite qui nommer pour me remplacer. Je vous fais part là non pas d’une information précise, mais d’une impression, que les faits postérieurs ont plutôt confirmée. J’ai essayé de faire en sorte que ma démission se déroule de la manière la plus correcte possible.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez dit que le Président de la République et le Premier ministre vous avaient interrogé sur l’existence d’un compte et que vous aviez démenti de manière catégorique, avant de répondre à M. Fasquelle lors de la séance des questions au Gouvernement le 5 décembre. Votre ministre de tutelle, M. Moscovici, vous a-t-il posé la même question, ce jour-là ou un autre ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai pas employé le qualificatif « catégorique ». J’ai indiqué tout à l’heure à M. Fasquelle que j’avais menti à la représentation nationale quelques heures après avoir menti au Président de la République et au Premier ministre. Je n’ai plus en mémoire le moment précis où M. Moscovici et moi avons abordé cette affaire mais, je suis sûr que, pas plus qu’au Président de la République et au Premier ministre, je ne lui ai dit la vérité.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je reviens sur le terme « bouc émissaire » : signifie-t-il que vous vous sentez aujourd’hui une victime, compte tenu de l’évolution du dossier ?
M. Jérôme Cahuzac. Si je suis une victime, madame la députée, je le suis de moi-même, et de personne d’autre.
M. Jean-Pierre Gorges. Je vais essayer – ce n’est pas facile – de poser des questions qui n’empiètent pas sur l’enquête judiciaire.
En 2010, une primaire est organisée au sein du parti socialiste pour désigner le successeur de M. Migaud à la présidence de la commission des finances. Vous êtes, à ce moment-là, dans une dynamique politique intéressante, mais vous êtes conscient que votre situation peut nuire à votre carrière, en particulier si vous obtenez ce poste. Avez-vous envisagé alors de retrouver une virginité fiscale ? Avez-vous essayé de le faire ? En effet, si l’affaire Cahuzac se résume à un compte en Suisse avec 600 000 euros non déclarés, vous l’avez payé bien cher et la France aussi ! Dans ce cas, il conviendrait d’ailleurs de tourner la page rapidement. Ou bien, comme certains le prétendent, la situation était-elle à ce point complexe que vous n’aviez plus de porte de sortie ?
Le site Mediapart – dont on se demande comment il a pu obtenir l’enregistrement, M. Gonelle déclarant ne pas le lui avoir remis et M. Bruguière disant l’avoir détruit – évoque un scénario selon lequel vous vous apprêtiez, dans une période budgétaire difficile, à tailler dans le vif, notamment dans le budget de la défense, qui serait passé, selon l’une des hypothèses, de 1,5 à 1 % du PIB. Cela aurait déplu à une certaine catégorie de personnes, qui seraient intervenues. Or, aujourd’hui, de manière assez étonnante, le budget de la défense dérape. D’autre part, M. Bruguière nous a indiqué que son directeur de campagne lors de l’élection qui vous a opposés tous les deux en 2007 était un général en retraite – nous avons d’ailleurs prévu de l’auditionner. Avez-vous eu des contacts avec lui ? A-t-il pu être informé de votre situation à ce moment-là ou ultérieurement ?
À ce stade de l’enquête, seules vos déclarations constituent une preuve que vous avez détenu un compte à l’étranger. Vous avez souhaité participer à la rédaction de la question adressée aux autorités suisses afin d’obtenir une réponse convenable. Si vous aviez effectivement été chargé de ce dossier, quelle question leur auriez-vous posée afin que la situation de M. Cahuzac soit connue ?
M. Jérôme Cahuzac. La désignation du candidat socialiste à la présidence de la commission des finances a fait l’objet non pas d’une primaire au sein du parti, mais d’un vote au sein du groupe parlementaire.
Pour le reste, vous me demandez de vous livrer et, à travers vous, à la France entière, des sentiments – souvent de honte –, des craintes, des peurs qui ont pu m’agiter. Permettez-moi, monsieur le député, de les garder pour moi. En faire état ne vous satisferait en rien, ni ne faciliterait le travail du rapporteur.
M. Jean-Pierre Gorges. Avez-vous eu des relations avec le directeur de campagne de M. Bruguière ? Il a également pu être informé de votre situation par M. Bruguière lui-même.
M. Jérôme Cahuzac. Aucun élément ne me permet de penser, premièrement, que M. Bruguière ait écouté l’enregistrement ; deuxièmement, qu’il en ait parlé à d’autres personnes ; troisièmement, qu’il l’ait évoqué en particulier avec son directeur de campagne, général de réserve ; quatrièmement, que celui-ci aurait pu m’en parler.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez donc pas eu de contacts avec le directeur de campagne de M. Bruguière ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai naturellement eu des contacts avec lui lorsque M. Bruguière et moi nous sommes opposés lors des élections législatives de 2007, notamment à l’occasion d’un débat entre les deux tours, mais ils ont été très brefs et superficiels. J’ai débattu avec M. Bruguière, non avec son directeur de campagne.
M. Jean-Pierre Gorges. Quelle question auriez-vous posée aux autorités suisses afin de clore, enfin, l’affaire Cahuzac ?
M. Jérôme Cahuzac. Je vous réponds moins dans mon intérêt propre que dans celui de l’administration fiscale, à laquelle on fait, je le répète, un procès très injuste : au regard des informations dont elle disposait objectivement, elle ne pouvait pas mieux poser la question que la façon dont elle l’a effectivement fait. Les accusations portées contre elle, notamment par M. Plenel, sont excessives et injustes.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Je reviens, monsieur Cahuzac, sur votre réaction le 4 décembre 2012 et les propos que vous avez tenus au Président de la République et au Premier ministre. Que leur avez-vous dit « les yeux dans les yeux » ce jour-là ? Que vous ont-ils répondu précisément ?
M. Jérôme Cahuzac. De mémoire, j’ai employé l’expression « les yeux dans les yeux » non pas avec le Président de la République et le Premier ministre, mais avec un journaliste célèbre – j’espère qu’il me le pardonnera un jour. Je leur ai menti à tous les deux. J’ai eu le sentiment qu’ils prenaient acte de mes propos.
M. le président Charles de Courson. Vous avez eu le sentiment qu’ils vous croyaient ?
M. Jérôme Cahuzac. Ils ont pris acte de mes propos.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. En avez-vous parlé à nouveau avec eux avant le 19 mars ?
M. Jérôme Cahuzac. Avec le Président de la République, nous nous sommes vus souvent lors de réunions ou de séminaires de travail. Le sujet a-t-il été abordé au cours d’une conversation personnelle à l’une de ces occasions ? Je ne le crois pas ; en tout cas, je n’en ai pas le souvenir.
Avec le Premier ministre, nous n’avons jamais abordé le fond de l’affaire. Dans la mesure où une question avait été posée et qu’une réponse y avait été donnée, j’imagine qu’il estimait, comme le Président de la République, que l’affaire était réglée entre nous. En revanche, constatant, comme beaucoup d’ailleurs, que l’affaire m’affectait – c’est le moins qu’on puisse dire –, il me demandait régulièrement, de manière compréhensible d’un point de vue humain, si cela allait. Je lui répondais que, bien sûr, cela allait.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Qu’avez-vous dit exactement au Président de la République et au Premier ministre le 19 mars ? Que vous ont-ils répondu ? Quelle conclusion en avez-vous tirée ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme je l’ai indiqué, l’information judiciaire étant lancée, nous avons jugé, d’un commun accord ou en tout cas par un raisonnement simultané, que mon appartenance au Gouvernement n’était plus possible. J’ai dit au Premier ministre que je devais démissionner. Il m’a dit que c’était effectivement le cas. Nous n’avons pas de désaccord. Les seuls points que nous avons abordés, dans ces circonstances évidemment peu plaisantes, ont été des détails pratiques : l’heure à laquelle la lettre de démission devait parvenir ; le moment où le communiqué devait être publié. Ce sont là des questions classiques lorsqu’un membre du Gouvernement doit, pour une raison ou une autre, présenter sa démission au Président de la République, sous couvert du Premier ministre.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Avez-vous éprouvé, pendant tout ou partie de la période sur laquelle porte la commission d’enquête – c’est-à-dire à partir du 5 décembre 2012 –, un sentiment relatif ou absolu d’immunité, tenant au fait que vous déteniez des informations sur la situation fiscale de personnalités de l’opposition ? Avez-vous pensé que vous étiez protégé par la possession de telles informations ? Dans l’affirmative, quand avez-vous cessé de le penser ?
M. Jérôme Cahuzac. Les informations fiscales dont je disposais ne concernaient qu’un nombre très limité de cas les mêmes que ceux auxquels j’avais été amené à m’intéresser lorsque j’étais président de la commission des finances.
Je tiens d’ailleurs à apporter quelques précisions à cet égard. Se saisir spontanément d’un dossier fiscal et se plonger dans son étude seul – le secret fiscal ne pouvant, selon moi, être partagé – n’est pas la chose la plus intéressante, ni la plus excitante que j’ai faite en qualité de président de la commission des finances ou de ministre délégué chargé du budget : je n’ai jamais eu le goût d’entrer dans la vie privée des gens.
J’ai cependant eu à le faire, pour une raison simple : lorsque le ministre de l’économie et des finances ou le ministre du budget du gouvernement Fillon étaient interrogés par des parlementaires de l’opposition sur tel ou tel cas et qu’ils répondaient qu’ils ne comprenaient pas leur suspicion, qu’ils agissaient sous le contrôle du président de la commission des finances, élu de l’opposition, lequel avait tout loisir de vérifier la véracité de leurs propos, j’étais évidemment obligé de le faire. J’entendais d’ailleurs toujours cette réponse-là avec un grand déplaisir : cela signifiait que j’allais à nouveau devoir examiner un dossier. Fort heureusement, les cas n’ont pas été si nombreux.
Lorsque j’ai été nommé ministre délégué chargé du budget, j’ai emporté avec moi les dossiers que j’avais eu à connaître en tant que président de la commission des finances et les ai déposés dans un coffre. Lors de la passation de pouvoirs avec Bernard Cazeneuve, j’ai ouvert le coffre, lui en ai donné la combinaison et lui ai indiqué que ces dossiers étaient désormais à sa disposition.
J’entre dans ces détails pour bien préciser les choses : à aucun moment je n’ai pensé que la connaissance de la situation fiscale de tel ou tel pouvait constituer un levier pour je ne sais quelle fin ou quel but.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous avez confié à M. Terneyre, professeur à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, une mission d’évaluation de la vente de l’hippodrome de Compiègne, dans laquelle M. Woerth est mis en cause. Vous lui aviez d’ailleurs déjà demandé d’autres travaux. Il a conclu dans son rapport à la légalité de la cession, alors que plusieurs autres experts parvenaient à des conclusions inverses. Pourquoi avez-vous demandé ce rapport, alors même que la Cour de justice de la République était saisie de l’affaire ?
M. Jérôme Cahuzac. Certains ont considéré cette demande de rapport comme la preuve d’une collusion entre un ancien ministre du budget, M. Woerth, et moi-même. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, M. Woerth n’a été destinataire d’aucun courrier de dénonciation me concernant. D’autre part, lorsque j’ai estimé, en ma qualité de président de la commission des finances, que le comportement de M. Woerth ne me paraissait en rien répréhensible dans l’affaire Bettencourt, je l’ai dit non pas parce que j’aurais eu à lui adresser un quelconque remerciement pour je ne sais quelle complaisance à mon égard, mais parce que je le pensais. Bien que je lise peu ou pas la presse ces dernières semaines, j’ai d’ailleurs cru comprendre que le parquet était sur le point de renoncer à toute incrimination à l’encontre de M. Woerth dans l’affaire Bettencourt.
Lorsque j’étais ministre délégué chargé du budget, un syndicat de l’Office national des forêts (ONF) m’a adressé un recours hiérarchique, me demandant de prononcer l’illégalité de la vente. Je connaissais un peu ce dossier, et beaucoup estimaient que la vente était probablement litigieuse. La Cour de justice avait effectivement été saisie. Une autre procédure avait été engagée à l’encontre d’agents de l’administration.
Trois solutions s’offraient à moi : ne pas répondre, mon silence valant décision ; donner une suite favorable à ce recours ; y donner une suite défavorable. Il ne m’a pas paru correct de ne pas répondre et de laisser les choses se décider dans le silence. J’ai donc indiqué à mes collaborateurs que je souhaitais répondre et leur ai demandé des éléments à cette fin. L’analyse de la direction des affaires juridiques a conclu que je devais plutôt donner une suite favorable à ce recours hiérarchique, mais que les conséquences de cette décision seraient d’une redoutable complexité sur le plan administratif : pour litigieuse qu’elle fût, la cession avait créé des droits. Je pouvais dès lors donner une réponse défavorable, mais telle n’était pas la solution que je privilégiais : il m’avait semblé, comme parlementaire, que cette vente était effectivement litigieuse, et je n’avais guère changé d’avis comme ministre.
À ce point de mon raisonnement, il m’a été suggéré de demander une étude juridique au professeur Terneyre. Contrairement à ce que certains journalistes ont pu dire, celui-ci était non pas un professeur anonyme d’une obscure faculté, mais un expert faisant autorité en droit administratif, consulté par de nombreuses collectivités territoriales sur des problèmes administratifs compliqués et connu pour les solutions satisfaisantes qu’il y avait apportées. En outre, il m’avait été présenté par un ami alors très proche, dans lequel j’avais toute confiance. Je n’avais donc aucune raison de rejeter la proposition qui m’était faite, bien au contraire. Lorsque j’ai demandé cette étude au professeur Terneyre, j’étais convaincu qu’elle conclurait que je devrais donner une suite favorable au recours hiérarchique. Il se trouve qu’elle a conclu que je devais le rejeter. Or, il eût été absurde de demander un rapport et de ne pas suivre sa conclusion. J’ai donc rejeté le recours.
Le syndicat de l’ONF a contesté ma décision devant la juridiction administrative. Mais il a été considéré comme dépourvu d’intérêt à agir, et sa requête a été rejetée pour une raison de forme.
M. Christian Eckert. Avez-vous conclu, à un quelconque moment, un accord avec vos prédécesseurs au poste de ministre du budget, en particulier avec M. Woerth, afin de vous protéger ou de cacher des informations contenues dans tels ou tels dossiers fiscaux, ou sur certaine liste ? La presse évoque souvent la possibilité d’une telle collusion. Mme Bechtel vient d’ailleurs d’évoquer le rapport sur la vente de l’hippodrome de Compiègne.
Sur le dossier HSBC, j’ai moi-même usé, en tant que rapporteur général, des prérogatives dont vous disposiez en qualité de président de la commission des finances. Je présenterai prochainement un rapport sur le sujet devant ladite commission.
M. le président Charles de Courson. C’est en effet là une question grave.
M. Jérôme Cahuzac. Ces rumeurs sont sans fondement. Vous pouvez, tout comme le président Gilles Carrez, avoir accès à ce qu’on appelle la « liste HSBC ». Il vous est donc assez simple de vérifier ce qu’il en est.
M. Gérald Darmanin. À entendre les différentes personnes auditionnées par cette commission d’enquête, y compris vous, nous avons l’impression que cette affaire a été très peu évoquée au sein du Gouvernement et des services de l’État depuis le 4 décembre, alors que toute la France ne parlait que de cela. Votre directrice de cabinet nous a déclaré qu’elle vous avait interrogé une fois et que l’affaire n’avait jamais été abordée en réunion de cabinet. Elle ne l’a pas davantage été au sein du cabinet de M. Moscovici, ni au cours des réunions de directeurs de cabinet à Matignon.
Vous avez dit que le Président de le République et le Premier ministre vous avaient posé une question de confiance le 5 décembre – détenez-vous ou non un compte ? – et que vous aviez menti en leur répondant par la négative. M. Le Borgn’ vous a demandé s’ils vous avaient posé à nouveau la question, mais vous n’avez pas été très précis dans votre réponse : ils vous auraient juste demandé si cela allait. Au fur et à mesure du feuilleton qu’ont constitué les révélations et les publications de documents ou de témoignages par Mediapart, le Président de la République, le Premier ministre ou votre ministre de tutelle vous ont-ils à nouveau clairement interrogé sur l’existence de ce compte ?
M. Jérôme Cahuzac. Je suis évidemment un peu « juge et partie », s’agissant du travail des journalistes de Mediapart, que vous semblez apprécier. Pour ma part, je suis convaincu que la vérité a éclaté moins grâce à leur action qu’à celle des services du procureur. Si vous vous donnez la peine de relire les articles, vous constaterez que les journalistes n’ont fait que répéter pendant des semaines ce qu’ils avaient dit d’emblée. Mediapart estimait disposer d’un faisceau de trois éléments de preuve, dont je ne peux malheureusement pas parler. Le procès montrera ce qu’ils valaient en réalité.
Dans la mesure où l’enquête a été menée par les services du procureur – qui ont, je le dis objectivement et sans aucune amertume, très bien travaillé –, je ne juge pas choquant qu’aucun membre du Gouvernement n’ait évoqué l’affaire avec moi : le procureur et ses services n’avaient pas à en parler à d’autres. Quoi qu’il en soit, ni la garde des Sceaux ni le ministre de l’intérieur ne m’ont jamais rien dit. Je ne peux naturellement pas savoir ce qu’ils auraient éventuellement pu dire à d’autres.
M. Charles de Courson. Je rappelle que c’est M. Plenel qui a saisi la justice.
M. Thomas Thévenoud. Mme Dalloz a fait allusion à des « flottements », nous nous interrogeons pour notre part sur des « dysfonctionnements ». Or, il aura suffi de 117 jours – entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 – pour que la vérité éclate dans cette affaire. On voudrait qu’il en fût ainsi d’autres affaires politico-judiciaires.
Vous nous avez fait part d’un élément nouveau, monsieur Cahuzac : votre rencontre avec M. Woerth. Vous avez déclaré avoir parlé directement avec lui du rapport de M. Garnier. Pouvez-vous préciser la date et le contenu de cet entretien ? A-t-il eu lieu avant l’ouverture de l’enquête préliminaire le 4 janvier ? M. Woerth vous a-t-il répondu immédiatement ou ultérieurement ? A-t-il dû faire appel à ses souvenirs ?
M. Jérôme Cahuzac. Même si je cherchais à voir M. Woerth, je l’ai rencontré de manière fortuite, après une séance de questions au Gouvernement. Je l’ai interrogé non pas sur le rapport de M. Garnier, mais sur un courrier que celui-ci lui aurait adressé pour me dénoncer comme titulaire d’un compte non déclaré à l’étranger. Ce sont les journalistes de Mediapart qui m’avaient parlé d’un tel courrier ; nous savons désormais que leur affirmation était, à tout le moins, très imprécise. M. Woerth m’a répondu dans l’instant et très clairement qu’il n’avait jamais reçu de courrier de cette nature et que, si tel avait été le cas, il aurait immédiatement lancé une enquête me concernant. Notre conversation a dû avoir lieu au tout début du mois de décembre.
M. Thomas Thévenoud. Après le 4 décembre ?
M. Jérôme Cahuzac. Après ma rencontre avec les journalistes de Mediapart, qui m’ont affirmé que M. Woerth avait reçu un courrier de M. Garnier.
M. le président Charles de Courson. Était-ce avant ou après le 4 décembre ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai rencontré les journalistes de Mediapart le matin du mardi 4 décembre. C’était donc l’après-midi soit du 4, soit du 5 décembre, après la séance des questions au Gouvernement.
M. le président Charles de Courson. C’est donc le jour même ou le lendemain de la publication des révélations par Mediapart.
M. Thomas Thévenoud. Je propose, monsieur le président, que la commission d’enquête auditionne M. Woerth afin de vérifier ces informations auprès de lui.
Pour prolonger la question de M. Le Borgn’, avez-vous eu des contacts directs sur cette affaire avec le Président de la République, le Premier ministre ou un autre membre du Gouvernement entre le 19 mars et le 2 avril ?
M. Jérôme Cahuzac. Depuis ma démission du Gouvernement, je n’ai eu aucun contact avec le Président de la République.
S’agissant du Premier ministre, j’ai reçu un jour un coup de téléphone de Matignon sur mon portable. Je ne sais plus si c’était entre le 19 mars et le 2 avril ou après cette date – cette période est un peu troublée pour moi. On m’a indiqué que le Premier ministre souhaitait me parler. J’étais, naturellement, à sa disposition. Je l’ai alors entendu me dire : « Allô, Bernard ? » Je lui ai répondu que j’étais non pas le nouveau ministre délégué chargé du budget, mais l’ancien. Il s’est alors excusé de sa méprise. C’est, je crois, le seul contact que j’ai eu avec lui après le 19 mars.
M. Hervé Morin. Je suis étonné moi aussi par la passivité des autorités de l’État : entre les mois de décembre et de mars, elles n’ont pas essayé d’en savoir plus. Le directeur de cabinet de M. Moscovici dit ne s’être jamais intéressé à l’affaire. Ni le Président de la République ni le Premier ministre ne vous en ont parlé. Le patron de la direction centrale du renseignement intérieur n’a mené aucune enquête. C’est en quelque sorte un hommage rendu à la force de votre parole, monsieur Cahuzac !
Selon M. Gonelle, l’industrie pharmaceutique a financé beaucoup d’associations ou de manifestations culturelles et sportives dans votre ville ou votre circonscription. À quelle date vos relations, notamment de conseil, avec l’industrie pharmaceutique s’arrêtent-elles ?
M. Jérôme Cahuzac. L’accusation – ou plutôt l’affirmation, dans la mesure où cela n’a rien d’illégal – selon laquelle l’industrie pharmaceutique aurait financé « beaucoup d’associations ou de manifestations culturelles et sportives » est imprécise au point d’être erronée. Deux laboratoires pharmaceutiques ont financé de manière tout à fait transparente, l’un un club de rugby à quinze, l’autre un club de rugby à treize. J’ai bien eu conscience, à l’époque, que cela pouvait agacer certains de mes opposants. Après ma défaite aux élections législatives en 2002, ces sponsorings ont d’ailleurs été arrêtés. Considérez-vous que l’aide apportée sous forme de subventions par deux laboratoires pharmaceutiques à des clubs de ma circonscription constitue « des relations avec l’industrie pharmaceutique » ? Si tel est le cas, ces relations ont cessé en 2002.
M. Charles de Courson. De quels laboratoires s’agissait-il ?
M. Jérôme Cahuzac. Le laboratoire Pierre Fabre pour le club de rugby à quinze, le laboratoire UPSA, installé à Agen, pour le club de rugby à treize. Ces financements revêtaient un caractère on ne peut plus officiel et public. Ils étaient assez appréciés des dirigeants des clubs.
M. Hervé Morin. À quelle date avez-vous mis fin à vos fonctions de conseil de l’industrie pharmaceutique ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai cessé de conclure des contrats avec l’industrie pharmaceutique à partir de mon élection comme député en 1997. De mémoire, les derniers contrats ont été purgés en 1998. Ma société de conseil est en sommeil depuis 2002.
M. Alain Claeys, rapporteur. Notre commission se pose une question centrale : le travail de la justice a-t-il été entravé ? M. Morin dit qu’il ne s’est rien passé entre les mois de décembre et de mars. Or, je souhaite rappeler quatre dates : le 16 janvier 2012, M. Gonelle a remis l’enregistrement à la police ; le 24 janvier, le laboratoire a indiqué au procureur que l’enregistrement n’était pas trafiqué et pouvait permettre une comparaison de voix ; le 18 mars, les experts de la police technique et scientifique ont transmis leur rapport sur l’enregistrement à l’autorité judiciaire ; le lendemain, le parquet a ouvert une information judiciaire. J’en retire un enseignement : à partir du moment où la justice a été saisie de cette affaire, elle a fait son travail et n’a pas été, jusqu’à preuve du contraire, entravée.
M. Charles de Courson. La question de M. Morin ne concernait pas le fonctionnement de la justice.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’ai bien entendu. Je réagissais à la remarque selon laquelle rien ne s’était passé. Nous pourrions au moins nous mettre d’accord sur le fait que la justice a pu travailler correctement. Nous en débattrons ultérieurement.
M. Hervé Morin. Je ne conteste pas que la justice a fait son travail. Toutefois, je trouve assez curieux que personne ne se soit préoccupé davantage d’une affaire aussi lourde de conséquences pour le fonctionnement de l’État.
M. Jérôme Cahuzac. Je reviens sur ma réponse précédente : mes derniers contrats avec l’industrie pharmaceutique ont été purgés en 1998 ou en 1999. Les faits sont trop anciens pour que je m’en souvienne précisément. Bien que la question de M. Morin n’entre pas de manière évidente dans le champ de la commission d’enquête, je ne m’abrite pas derrière la procédure judiciaire en cours et m’efforce d’y répondre.
M. Hervé Morin. Ma question a un lien avec la commission d’enquête : elle concerne les conflits d’intérêts, dont nous avons débattu pendant trois jours et trois nuits la semaine dernière à l’Assemblée nationale.
M. Christian Assaf. Entre le 4 décembre et le 19 mars, à qui vous êtes-vous ouvert : amis, membres de votre famille, avocats, journalistes, collègues, collaborateurs ? À qui avez-vous avoué détenir un compte à l’étranger ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai dit la vérité à personne : ni à mes amis, ni à mes collègues, ni à mes collaborateurs. C’est ainsi. En particulier, je ne l’ai pas dite à mon avocat, qui était aussi un ami et a donc été en droit de s’en formaliser de manière assez vigoureuse, ce que je dois désormais assumer, avec tout le reste.
M. Christian Assaf. Compte tenu de vos déclarations devant la représentation nationale au tout début du mois de décembre et des propos que vous avez tenus au début de la présente audition, selon lesquels il y a deux tabous que vous n’auriez pas transgressés pendant toute la durée de l’affaire – « je n’ai jamais juré sur la tête de mes enfants » ; « il m’a semblé impossible de mentir par écrit à l’administration dont j’avais la charge » –, qu’est-ce qui peut empêcher notre commission de mettre en doute vos déclarations de ce jour ?
M. Jérôme Cahuzac. Je pense que vous avez davantage que moi la réponse à cette question.
M. le président Charles de Courson. À la différence des mensonges prononcés dans l’hémicycle, ceux qui le sont devant notre commission d’enquête peuvent faire l’objet de sanctions pénales, à l’initiative du président. Je ne manquerais pas de faire usage de cette prérogative dans le cas où nous considérerions que l’une des personnes auditionnées nous a menti.
M. Philippe Houillon. M. Cahuzac étant venu avec l’intention de ne pas répondre aux questions de la commission, leur intérêt s’émousse.
Les éditions Robert Laffont ont déclaré que vous alliez publier, à la rentrée de septembre, un livre donnant votre version de l’affaire qui porte votre nom. Est-ce exact ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne crois pas que les éditions Robert Laffont aient dit cela, mais je ne veux pas vous contredire, monsieur le député. Quoi qu’il en soit, si j’ai bien l’intention d’écrire un ouvrage, je n’ai signé aujourd’hui de contrat avec aucun éditeur. J’imagine donc mal que les éditions Robert Laffont puissent affirmer que tel serait le cas. Ceux qui ont diffusé cette information ont cru possible d’indiquer le montant d’un à-valoir sur les droits d’auteur. Ce montant est farfelu.
M. Philippe Houillon. Je prends note que, d’une part, vous n’avez signé aucun contrat, mais que, d’autre part, vous avez le projet – c’est naturellement votre droit – de donner votre version de l’affaire dans un livre. Cependant, en quoi seriez-vous autorisé à le faire dans un livre et non pas devant notre commission d’enquête ? Vous répétez sans cesse que vous ne pouvez pas répondre en raison de la procédure judiciaire en cours. Or, cela est inexact : aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale, la personne mise en examen n’est tenue à aucune forme de secret ; elle a même le droit de mentir !
M. Jérôme Cahuzac. Vous semblez préjugez, monsieur le député, de ce que je souhaite écrire dans ce livre. Si je parviens à mener ce projet à terme, j’espère que vous serez un de mes lecteurs et que vous changerez alors d’avis.
M. Philippe Houillon. Le livre sera sans intérêt par rapport aux questions que nous nous posons ?
M. Jérôme Cahuzac. Alors, je vous l’offrirai, vous n’aurez pas à l’acheter.
M. Hugues Fourage. Monsieur Cahuzac, M. Gonelle parle de l’existence de votre compte depuis plusieurs années. Pourquoi cette affaire a-t-elle éclaté en 2012 et non pas lorsque vous étiez président de la commission des finances ? Avez-vous une explication à ce sujet ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai que des hypothèses. Si j’en crois les déclarations faites sous serment, l’enregistrement a été réalisé à la fin de l’année 2000 et n’a été finalement rendu public qu’à la fin de l’année 2012. Entre-temps, de nombreuses élections se sont déroulées à Villeneuve-sur-Lot, comme ailleurs : municipales, cantonales, législatives. Des propos tenus par l’administration fiscale, je retiens qu’il y aurait eu plusieurs tentatives d’activer ou de réactiver cette affaire : en 2001, en 2006, peut-être même en 2011 ou en 2012. Je regrette sincèrement qu’elles n’aient pas abouti plus tôt. Cela vous aurait évité d’avoir à constituer cette commission d’enquête, monsieur le président ! Mais c’est ainsi : personne n’en a parlé publiquement jusqu’à la publication du premier article de Mediapart signé par Fabrice Arfi, le 4 décembre 2012. Pourquoi à ce moment-là ? Incontestablement, si l’on examine la chronologie des faits de novembre 2000 à décembre 2012, l’affaire a éclaté au moment où elle devait faire le plus mal.
M. le président Charles de Courson. Vous avez reconnu publiquement détenir un compte à l’étranger. Pourriez-vous expliquer son montage juridique à la commission ? D’après les réponses de la DGFiP, plusieurs montages pourraient expliquer l’inefficacité de la procédure engagée dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse : le compte omnibus – un chargé d’affaires ouvre un compte comprenant plusieurs sous-comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiables – et le système plus sophistiqué du trust.
M. Jérôme Cahuzac. Je ne vous en dirai rien, monsieur le président. Je dois ces réponses d’abord aux deux juges d’instruction, quelle que soit l’interprétation de M. Houillon. Cela étant, d’un point de vue général, les explications fournies par les responsables des différents services fiscaux de Bercy m’ont semblé intéressantes, voire convaincantes : telle qu’elle a été formulée, la demande d’entraide administrative permettait d’éviter que de tels artifices juridiques ne masquent la vérité.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas ce que nous a dit l’adjoint du directeur général des finances publiques. Il a formulé les trois hypothèses que vous avez rappelées tout à l’heure : soit la banque UBS a menti – et vous partagez l’opinion que ce soit très peu vraisemblable ; soit un montage juridique a empêché d’identifier le compte – d’où la question que je vous ai posée.
Ce point intéresse la commission d’enquête au regard des conclusions qu’elle rendra sur l’efficacité de l’administration fiscale. La commission a été troublée que l’on trouve un compte à votre nom deux mois après la réponse négative des autorités suisses. Vous ne voulez donc pas répondre à cette question et aider ainsi la commission ?
M. Jérôme Cahuzac. Vous ne posez pas de question, vous faites un constat – l’administration helvétique a fait une réponse négative à l’administration française – et vous vous étonnez qu’il ne soit pas compatible avec la vérité révélée in fine. Quand elle sera connue, la procédure judiciaire fournira une explication qui n’est probablement pas celle à laquelle vous faites référence, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est qu’une hypothèse. Je constate que vous ne répondez pas.
Reconnaissez-vous que la voix sur l’enregistrement réalisé à la fin de l’année 2000 et détenu par M. Gonelle est bien la vôtre ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne l’ai moi jamais reconnue. La police technique et scientifique a estimé que c’était ma voix à 60 %.
M. le président Charles de Courson. Et vous ? Le confirmez-vous ou l’infirmez-vous ? Vous avez fait des déclarations peu claires à ce sujet.
M. Jérôme Cahuzac. J’aimerais, monsieur le président, que l’on ne confonde pas la période antérieure au 2 avril et celle qui l’a suivie. Je vous donne acte que les propos que j’ai pu tenir avant le 2 avril n’ont pas toujours été convaincants, encore qu’ils semblent l’avoir été pour beaucoup. Depuis le 2 avril, les choses ont changé. Je n’ai tenu aucun propos sur cet enregistrement depuis cette date et n’ai pas l’intention d’en tenir, tant que la justice n’aura pas fait toute la lumière sur cette affaire.
M. le président Charles de Courson. Vous ne voulez pas répondre. Pourtant, d’après ce que le procureur a déclaré à la commission, l’enregistrement est la pièce qui l’a convaincu d’ouvrir une enquête préliminaire, puis une information judiciaire. Reconnaissez-vous, oui ou non, qu’il s’agit bien de votre voix sur l’enregistrement qui a été à l’origine de toute cette affaire ?
M. Jérôme Cahuzac. La police technique et scientifique a identifié ma voix à 60 %. C’est tout ce que je peux vous dire.
M. le président Charles de Courson. Et vous, à combien ?
M. Jérôme Cahuzac. À 60 %.
M. Daniel Fasquelle. Vous n’avez pas répondu à l’une de mes questions. Est-il exact que vous ayez prononcé la phrase suivante : « Il est moins grave de mentir quinze secondes devant 577 députés que depuis un an sur l’état de la France… » ?
En outre, avez-vous renoncé à la vie politique ? On vous a prêté des intentions de retour à l’Assemblée nationale et de participation à l’élection législative à Villeneuve-sur-Lot.
M. le président Charles de Courson. Ces questions sortent du champ de notre commission d’enquête.
Je vous remercie, mes chers collègues, de votre forte participation à cette séance – plus des deux tiers des membres de la commission étaient présents – et des nombreuses questions que vous avez posées.
Audition du mardi 2 juillet 2013
À 16 heures 30 : MM. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, et Christian Hirsoil, sous-directeur de l’information générale.
M. le président Charles de Courson. Nous recevons ce matin MM. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, et Christian Hirsoil, sous-directeur de l’information générale.
La commission d’enquête a entendu, le 11 juin dernier, M. Patrick Calvar, le directeur central du renseignement intérieur. Bien que cette audition se soit déroulée sous le régime du secret, je n’en trahis aucun en vous disant que M. Calvar nous a confirmé avoir fait faire des recherches dans les archives de son service, dans le courant du mois de décembre, afin de savoir si celui-ci disposait d’informations relatives à l’affaire Cahuzac. Il nous a indiqué que le nom de celui qui était alors ministre délégué en charge du budget n’y apparaissait nulle part et que la note réalisée à l’issue de ces recherches rapportait exclusivement des informations sur les pratiques de la banque UBS en France. Cette note a d’ailleurs été transmise à notre commission d’enquête et le nom de Jérôme Cahuzac n’y figure effectivement pas.
M. Calvar nous a rappelé les missions confiées à sa direction centrale pour expliquer l’absence d’informations sur cette affaire. Il semble que la sous-direction de l’information générale (SDIG) avait, davantage que la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), vocation à disposer de renseignements dans ce domaine. C’est pourquoi nous avons souhaité vous entendre ce matin : ce que cette sous-direction a fait – ou n’a pas fait – après les révélations du 4 décembre dernier pourrait en effet relever des éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État.
(MM. Pascal Lalle et Christian Hirsoil prêtent serment.)
M. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique. En qualité de directeur central de la sécurité publique, j’ai autorité sur la sous-direction de l’information générale, dont les compétences sont clairement définies : elle est chargée de recueillir des informations, de les analyser et d’informer le Gouvernement et ses représentants dans les départements, sur différentes questions de société – dérives sectaires et religions, racisme et xénophobie, anticipation et prévision des grands rassemblements de foule. Elle travaille également sur des sujets tels que la défense de l’environnement, l’économie locale, la vie des entreprises, les professions réglementées, les activités revendicatives des syndicats… Elle surveille enfin ce qu’il est convenu d’appeler les « dérives urbaines », tâche qui recouvre le suivi des différentes communautés et minorités ainsi que des quartiers « sensibles » où est présente une économie souterraine. J’ajoute qu’un travail du même ordre est assuré outre-mer par une division spécialisée.
En ce qui concerne l’objet de votre commission, nous n’avons pas travaillé sur la situation du ministre délégué chargé du budget ; nous n’avons reçu aucune demande en ce sens.
Le seul événement qui a été porté à notre connaissance s’est déroulé le 7 décembre 2012 au palais de justice d’Agen. Le directeur départemental de la sécurité publique du Lot-et-Garonne a appris que Me Gonelle, avocat, avait, dans les couloirs du palais de justice, sollicité du brigadier-chef chargé d’organiser la surveillance des audiences la permission d’utiliser le téléphone portable de celui-ci, qui a accepté. Ce policier a ensuite reçu un message sur ce même téléphone : il émanait de M. Edwy Plenel, de Mediapart, qui rappelait après avoir lui-même été appelé depuis ce portable. Le policier a rappelé le numéro qui s’affichait pour préciser que ce téléphone avait été prêté à Me Gonelle, qu’il fallait rappeler directement.
Cet événement nous a été rapporté – nous avons, vous le savez, une culture du compte rendu – et j’en ai fait part au directeur de cabinet du directeur général de la police nationale dès que je l’ai appris.
M. Christian Hirsoil, sous-directeur de l’information générale. Je n’ai rien à ajouter, si ce n’est que nous n’avons reçu absolument aucune information du service local d’information générale au sujet de cette affaire. Le domaine politique est, je le rappelle, exclu de notre champ de compétences.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avant la réforme du 1er juillet 2008, vos missions étaient remplies par la direction centrale des renseignements généraux (DCRG). La SDIG a-t-elle récupéré les archives de ce service ?
M. Christian Hirsoil. Nous avons effectivement reçu une partie des archives des anciens renseignements généraux : au 1er juillet 2008, un tri a été effectué dans ces archives pour séparer ce qui revenait à la DCRI de ce qui revenait à la SDIG.
Après l’échec du projet de fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale), nous avons effectué un tri plus prononcé, et toutes les archives comportant des données personnelles qui ne se rapportaient pas strictement à des menaces directes à l’ordre public ont été versées à la mission nationale des archives. À l’heure actuelle, toutes les archives dont nous disposons relèvent donc de notre champ de compétence.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous ne disposez donc plus de renseignements personnels ?
M. Christian Hirsoil. C’est cela.
M. Alain Claeys, rapporteur. S’agissant du fait du 7 décembre, pourquoi êtes-vous alors destinataires d’une note ?
M. Pascal Lalle. Il ne s’agit pas d’une note, mais d’un simple compte rendu du directeur départemental de la sécurité publique du Lot-et-Garonne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous-même faites alors une note pour le directeur de cabinet du directeur général de la police nationale…
M. Pascal Lalle. Non, je lui rapporte les faits par téléphone.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc aucun renseignement concernant Jérôme Cahuzac dans vos archives. Il est étonnant que votre direction n’ait rédigé aucune note, alors que la DCRI – dont ce n’est pas le rôle – en a fait une, à la demande de la direction centrale : comment l’expliquez-vous ?
M. Pascal Lalle. Je ne peux expliquer que ce qui concerne l’activité de ma direction. Nous n’avons reçu aucune demande d’information ou de note spécifique émanant du directeur général de la police nationale ; je n’ai donc pas sollicité de travail sur cette question. Et aucune information ne nous est remontée, de manière spontanée ou non, du service départemental d’information générale du Lot-et-Garonne.
M. Alain Claeys, rapporteur. D’après votre expérience, est-il courant que rien ne soit fait sur des sujets comme celui-ci, alors que la DCRI recueille, de son côté, des renseignements ?
M. Pascal Lalle. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment la DCRI a été sollicitée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc aucune information sur Jérôme Cahuzac, même dans vos archives ? Aucune autre information que celle concernant ce coup de téléphone ne vous est arrivée ?
M. Pascal Lalle. Absolument. C’est le seul événement qui m’ait été relaté.
M. le président Charles de Courson. Dans un message électronique du 11 décembre 2012, dont Mediapart a révélé l'existence, la chef de cabinet de M. Cahuzac, Mme Marie-Hélène Valente, rend compte au ministre délégué d'une conversation téléphonique qu'elle vient d'avoir avec le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne, qui lui a appris que Michel Gonelle avait tenté de joindre Edwy Plenel sur le portable professionnel d'un policier. Elle indique qu'elle « attend la copie du rapport officiel du DDSP », c'est-à-dire du directeur département de la sécurité publique. Lors de son audition, Mme Valente nous a dit qu'elle n'avait jamais eu communication de ce rapport. Ce rapport a-t-il effectivement été rédigé ? S’il l’a été, pourriez-vous nous le communiquer ?
M. Pascal Lalle. Ce rapport existe maintenant, mais il n’a pas été rédigé immédiatement après les faits : je ne l’ai demandé au directeur départemental du Lot-et-Garonne que dans le courant du mois de mai. Il est daté du 21 mai. Je peux bien sûr vous le communiquer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous effectué des recherches sur Jérôme Cahuzac dans vos archives ?
M. Pascal Lalle. Non, monsieur le rapporteur.
Mme Cécile Untermaier. Je suis surprise que vous ayez reçu cette information tout à fait mineure selon laquelle Michel Gonelle aurait utilisé le téléphone d’un brigadier-chef dans la salle des pas perdus d’un tribunal. Comment expliquez-vous que cette information vous revienne ? Pourquoi demandez-vous ensuite un rapport, sur un sujet qui ne relève pas de vos compétences ?
M. Pascal Lalle. Je l’ai dit, la police nationale a une culture du compte rendu. Il est évident que le directeur départemental ne peut pas laisser cette histoire de côté – le 7 décembre, on parle de l’affaire Cahuzac dans la presse. Il fait donc logiquement le lien avec le contexte médiatique, et il est tout à fait normal qu’il en rende compte, ce qu’il fait de manière purement factuelle : il explique pourquoi un téléphone administratif, confié à un brigadier-chef de police qui a une responsabilité dans un tribunal, a pu être utilisé par une personne dont on parle dans les médias.
Mme Cécile Untermaier. Cet incident fait l’objet d’un rapport : celui-ci est maintenant classé quelque part dans vos archives. Vous disposez donc bien d’informations sur une personne.
M. Pascal Lalle. Je remettrai ce rapport à la commission : vous verrez qu’il ne contient pas d’autres informations que celles relatives à l’utilisation du téléphone.
M. Christian Hirsoil. Il faut bien préciser qu’il ne s’agit ici que d’un rapport administratif du directeur départemental de la sécurité publique à M. le directeur central. Ce n’est pas une note d’information générale, et ce rapport n’est donc pas classé parmi nos notes d’information générale.
Mme Cécile Untermaier. Disposez-vous des informations demandées à la DCRI ?
M. Pascal Lalle. Non.
Mme Cécile Untermaier. Peut-on en conclure que la demande faite à la DCRI était fondée ?
M. Pascal Lalle. Je ne suis pas qualifié pour porter une appréciation sur le fondement de cette demande.
Mme Cécile Untermaier. Le ministère de l’intérieur dispose-t-il d’informations sur les ministres, actuels ou anciens ?
M. Pascal Lalle. Ma direction ne dispose pas de fiches sur les ministres.
M. Christian Hirsoil. La SDIG existe depuis cinq ans, et elle n’a jamais disposé de telles fiches. Je n’ai dans mon bureau que l’affiche réalisée par les services de Matignon, avec les photographies des ministres en poste…
M. Hervé Morin. Quel est le sens de la réforme des renseignements généraux, et pourquoi la petite SDIG n’a-t-elle pas rejoint la DCRI comme le reste des RG ?
M. Pascal Lalle. Cela résulte d’une réforme préparée depuis 2007 et entrée en vigueur le 1er juillet 2008, qui avait pour objectif de renforcer la capacité des services de police en matière de protection des institutions et de contre-ingérence. L’ancienne direction de la surveillance du territoire (DST) et l’ancienne DCRG ont donc été fusionnées ; dans ce cadre, certaines des missions naguère dévolues aux renseignements généraux, pour l’essentiel celles qui se déroulent en « milieu ouvert » ou qui concernent le suivi de l’information économique et sociale, sont revenues à la nouvelle SDIG. Celle-ci a été placée sous l’autorité du directeur central de la sécurité publique, puisque ce service travaille en milieu ouvert et a besoin de la forte assise territoriale dont dispose la sécurité publique grâce à ses directions départementales et à ses commissariats de police.
M. Hervé Morin. Le renseignement est recueilli pour l’essentiel en milieu ouvert : je ne comprends donc pas bien la différence entre les missions de la DCRI et celles de la SDIG… Et la DCRI nous dit que d’éventuelles enquêtes politiques ne relèvent pas de ses missions, mais de celles de la SDIG. Il est curieux que le discours tenu par les deux services soit différent.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le directeur de la DCRI a bien précisé qu’une partie des renseignements généraux était demeurée à la SDIG.
M. Hervé Morin. La DCRI a clairement renvoyé la balle à la SDIG.
M. Pascal Lalle. La SDIG n’a jamais eu pour compétence de travailler dans le domaine politique, qu’il s’agisse des partis politiques ou des individus engagés en politique. Même l’ancienne DCRG avait instruction, depuis 1995, de ne plus travailler dans ce domaine-là.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cela veut-il dire qu’aujourd’hui, il n’y a plus aucune enquête sur des sujets sensibles en matière politique ?
M. Hervé Morin. Tout cela, vous le reconnaîtrez, est un peu ubuesque : lorsque j’étais au Gouvernement, je me suis opposé à la création du fichier EDVIGE, qui était tout de même poussé par vos services, et qui visait à rassembler des renseignements très divers, politiques, syndicaux, associatifs, jusqu’à des renseignements extrêmement personnels
– marque de la voiture ou orientation sexuelle ! Entre le fichier EDVIGE que voulait mettre en place Claude Guéant et le discours tenu aujourd’hui, il me semble qu’il y a quelque incohérence…
Mme Marie-Christine Dalloz. Officiellement, personne ne s’occupe de ces sujets, en tout cas. Vous dites qu’il n’y a pas de fiches sur les ministres : j’ai du mal à l’imaginer. Dans chaque préfecture, il y a des fiches sur les parlementaires et sur les maires des grandes villes ! De tels renseignements auraient pu éviter le scandale que nous avons connu.
M. Pascal Lalle. Je confirme que la SDIG ne dispose pas de fiches sur les ministres. En cinq ans d’existence, elle n’en a jamais disposé.
M. le président Charles de Courson. Voici exactement ce que m’a répondu M. Calvar lorsque je lui ai demandé s’il ne disposait pas d’éléments sur Jérôme Cahuzac : « Je suis le chef de la DCRI. Il y a une sous-direction de l’information générale dont cela peut être le travail, mais ce n’est pas le mien. »
M. Pascal Lalle. Je vous confirme que de telles enquêtes ne font pas partie des compétences de la SDIG – ni de la direction centrale de la sécurité publique.
M. le président Charles de Courson. Il n’y a donc plus aucun service de l’État capable d’avertir le Gouvernement que – par exemple – tel ministre pose problème ?
M. Pascal Lalle. D’après mes connaissances, c’est bien cela.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez pas été saisis de cette affaire, mais la DCRI l’a été, alors même qu’elle dit n’avoir pas à connaître ce type d’affaire. Connaissez-vous d’autres cas similaires ?
M. Pascal Lalle. J’ignore totalement ce dont est saisie la DCRI. Lorsqu’elle l’est par la direction générale de la police nationale, je ne suis pas informé de la teneur de la demande.
M. Alain Claeys, rapporteur. N’existe-t-il pas de coordination entre la DCRI et vos propres services ? Rassurez-moi.
M. Pascal Lalle. Un dispositif de liaison et d’échange d’informations dans nos domaines de compétences a été mis en place.
M. Alain Claeys, rapporteur. Fonctionne-t-il de façon optimale ?
M. Pascal Lalle. Il est récent, puisqu’il date du 1er décembre 2012. Il évolue de façon très positive.
M. le président Charles de Courson. Cela veut-il dire qu’avant le mois de décembre 2012, il n’y avait aucune coordination ?
M. Pascal Lalle. Depuis décembre 2012, nous avons renforcé les échanges d’informations entre la DCRI et la SDIG, dans les deux sens, dans des domaines où nos compétences peuvent se chevaucher. En revanche, il n’y a pas de coordination sur les missions : j’ignore totalement quelles commandes sont faites à la DCRI par la direction générale de la police nationale ou par le Gouvernement.
M. Hervé Morin. À aucun moment vous n’avez l’idée de demander une enquête sur l’affaire Cahuzac ou de faire faire des recherches dans les archives, et vous estimez que c’est normal, compte tenu de vos compétences. Mais est-ce qu’il ne pourrait pas venir à l’idée du ministre de l’intérieur d’interroger vos services ?
M. Pascal Lalle. Ni le ministre de l’intérieur, ni le directeur général de la police nationale ne m’ont interrogé.
M. Hervé Morin. Et vous n’agissez pas de vous-même ?
M. Pascal Lalle. Encore une fois, cela ne fait pas partie de nos compétences, et je pense que chacun tient compte de celles-ci pour nous donner des instructions.
M. Étienne Blanc. Une pratique ancienne, qui m’a été confirmée, veut qu’à l’occasion de chaque élection, une sorte de note blanche – quelques pages, non signées, rassemblant des informations très diverses, des bruits, des ouï-dire – soit rédigée sur tous les candidats. Elle est envoyée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Plusieurs personnes m’ont contacté pour souligner qu’il est impensable qu’aucune note de cette nature n’ait existé à propos de M. Cahuzac. Connaissez-vous cette pratique ?
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, ne serait-il pas utile d’interroger les services de l’État pour savoir si cette note existe, et le cas échéant, ne pourrions-nous pas nous la procurer ?
M. Christian Hirsoil. S’agissant du « dossier départemental », nous n’en sommes plus chargés. Les renseignements généraux alimentaient effectivement ce dossier, qui faisait un panorama du département ; ce travail a depuis été repris par les préfectures et sous-préfectures. Il n’y a donc rien de tel dans les archives de la SDIG.
M. Alain Claeys, rapporteur. À qui ces informations sont-elles ensuite transmises ?
M. Christian Hirsoil. Elles remontent jusqu’au préfet, je pense – pas jusqu’au niveau national. Ces fiches concernent l’ensemble des élus du département ; elles présentent aussi le département de façon plus générale : c’est un dossier technique.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous allons de notre côté demander au préfet du Lot-et-Garonne et au sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot s’il existe une fiche au nom de Jérôme Cahuzac.
Audition du mercredi 3 juillet 2013
À 14 heures : M. Pierre Condamin-Gerbier, gestionnaire de fortune, ancien associé-gérant de Reyl Private Office.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie, monsieur Condamin-Gerbier, d’avoir répondu à l’invitation de notre Commission. Afin de mieux apprécier le libellé de la demande d’entraide administrative adressée aux autorités suisses, nous souhaitons vous entendre sur les mécanismes qui permettent de dissimuler les comptes non déclarés détenus à l’étranger. La presse prétend que le compte que M. Cahuzac a reconnu avoir détenu à l’étranger aurait été hébergé dans un premier temps en Suisse, à la banque UBS, puis à la compagnie Reyl, avant d’être transféré à Singapour.
(M. Condamin-Gerbier prête serment.)
M. Pierre Condamin-Gerbier, gestionnaire de fortune, ancien associé-gérant de Reyl Private Office. Dans ce dossier – comme dans bien d’autres qui agitent aujourd’hui l’actualité française –, il était temps d’arrêter d’entendre les discours politiques, les théories académiques et les déclarations d’intention de la part de personnes qui ignorent tout de la réalité des pratiques révélées aujourd’hui, pour laisser s’exprimer les praticiens et les techniciens de terrain. Je n’en suis qu’un parmi tant d’autres qui pourraient, s’ils ne faisaient pas l’objet de pressions importantes, témoigner comme j’essaie de le faire depuis quelques mois.
Le mot « éventuels » à propos de dysfonctionnements, et le fait de mentionner le seul « Gouvernement » dans le libellé de votre Commission, m’ont fait sourire. Français, j’ai grandi et fait mes études en France, avant de travailler dans le monde anglo-saxon, puis en Suisse. Mon métier – le family office – consiste à offrir les services de régisseur ou de secrétaire privé pour gérer tant le quotidien que le patrimoine des grandes familles. Ayant, depuis vingt ans, beaucoup travaillé avec la clientèle française, j’ai pu constater la réalité des pratiques touchant de près ou de loin une partie du personnel politique français, à titre d’enrichissement personnel ou dans le cadre du financement des partis qu’ils représentent, et je défie quiconque ayant cinq à dix ans d’expérience similaire d’ignorer ces dysfonctionnements, sauf à faire preuve d’aveuglement ou de mauvaise foi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous venez de porter sous serment une accusation grave. Qui sont ces responsables politiques dont vous dénoncez les agissements comme étant non conformes à la loi ? On ne peut se contenter d’insinuations.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je ne peux en dire davantage devant une organisation…
M. le rapporteur. Ce n’est pas une organisation, mais le Parlement !
M. Pierre Condamin-Gerbier. …les membres d’un Parlement dans lequel des personnes sont à la fois juges et parties. Je ne m’exprimerai que devant la justice française –à laquelle j’ai transmis hier dans sa grande majorité la liste et les informations dont j’ai fait état dans les médias depuis quelques semaines car elle est la seule institution à pouvoir se prononcer sur ces éléments. Permettez-moi donc de ne pas répondre précisément à votre remarque.
M. le président Charles de Courson. Nous souhaitons que vous nous expliquiez les mécanismes de la fraude fiscale ; la quinzaine de noms de responsables politiques que vous avez évoquée n’entre pas dans notre champ de compétences. Laissons la justice faire son travail. Quant au mot « éventuels » dans le titre de notre Commission, il vise à éviter qu’on nous accuse de préjuger ses conclusions. Soyez très libre dans vos propos.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Vous ferez ce que vous voudrez de mon témoignage : c’est celui d’un homme qui décrit un terrain dont vous ignorez tout, mais qui n’a aucun intérêt à vous mentir. Si je suis malheureusement l’un des seuls à parler aujourd’hui, le développement de cette affaire et le travail de la justice en amèneront d’autres à s’exprimer.
Pour revenir au sujet de l’audition, une petite chronologie permettra d’éclairer mon propos. Reyl Private Office – filiale de Reyl & Cie se spécialisant dans le family office, dont je suis ancien associé-gérant – possède ses propres clients dont certains seulement lui sont communs avec l’établissement principal. J’ignorais si M. Cahuzac figurait dans les livres et les clients de Reyl & Cie, lorsque j’ai lu, le 13 décembre 2012, un article du quotidien suisse Le Temps, signé de l’ancien correspondant parisien du journal, Sylvain Besson. Ce dernier affirmait que l’interlocuteur probable de M. Cahuzac sur l’enregistrement communiqué par Mediapart était M. Hervé Dreyfus, demi-frère de Dominique Reyl, dont je connais parfaitement les fonctions et les relations avec le groupe Reyl. Jusque-là, je restais persuadé que Mediapart n’avait pas vraiment d’éléments solides, qu’il s’efforçait surtout de montrer qu’après avoir attaqué la droite, il pouvait en faire autant avec la gauche mais la lecture de cet article m’a fait comprendre que l’affaire Cahuzac existait réellement.
Quiconque entre le nom d’Hervé Dreyfus dans un moteur de recherche sur Internet peut comprendre ses liens de famille avec les actionnaires du groupe Reyl. Les services de renseignement, les services fiscaux et l’administration française lisent certainement la presse suisse, comme celle des autres pays ; mais rien n’a été fait, le 13 décembre, pour savoir qui est Hervé Dreyfus, quels sont ses liens avec Reyl et le rôle qu’il avait pu jouer.
Ayant gardé mes conclusions pour moi, je suis entendu pour la première fois à la mi-février, à Annecy, par les enquêteurs de la brigade financière, dans le cadre de l’affaire Cahuzac. Je réponds précisément à leurs questions, leur indique qui est Hervé Dreyfus et avec quel établissement il entretient des liens familiaux et d’affaires, sans toutefois me prononcer sur la certitude d’une faute de M. Cahuzac puisque je ne le sais pas.
M. le rapporteur. Pourquoi les enquêteurs vous interrogent-ils à la mi-février ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’en ignore les raisons précises, mais ils m’ont dit qu’en tant que seul ancien associé et co-actionnaire de Dominique et de François Reyl, je peux témoigner.
Le procès verbal de mon audition a été immédiatement transmis au ministère de l’intérieur dans l’heure qui a suivi. Les enquêteurs eux-mêmes m’ont affirmé qu’il serait, compte tenu de la chaîne d’information au sein de l’Etat, quasi-indubitablement transmis au ministère de l’intérieur. Un autre élément l’atteste : l’audition terminée, le PV signé, nous échangeons quelques propos avec les enquêteurs. L’un d’entre eux me dit alors, à titre anecdotique, qu’ils savent que j’ai rencontré Bernard Tapie. Je le confirme : recommandé par une connaissance commune, celui-ci nous avait sollicités lorsqu’il envisageait de s’installer en Suisse. Ils me posent quelques questions, et nous en restons là.
M. le président Charles de Courson. Quel jour exactement avez-vous été entendu ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Le 20 février. Or, le lendemain matin, je reçois un appel d’enquêteurs d’une autre section de la brigade financière, rattachée à la préfecture de Paris. Ils me disent savoir que j’ai mentionné, en off, avoir rencontré Bernard Tapie et souhaitent recueillir mon témoignage dans le cadre de l’affaire qui le concerne. Je suis donc également entendu, une dizaine de jours plus tard – soit fin février ou début mars –, par ces enquêteurs.
Surpris qu’une anecdote évoquée en off, après la signature finale du PV, soit aussi vite transmise à des services directement rattachés à la préfecture de Paris et au ministère de l’intérieur, je m’en ouvre aux enquêteurs. Ils me répondent qu’il en ira ainsi de toutes mes auditions.
Pour en revenir à l’audition du 21 février, j’ai indiqué aux enquêteurs qui était Hervé Dreyfus, quel rôle il tient vis-à-vis de Reyl & Cie, quelles connexions il a entretenu, via son frère, avec le CCF et HSBC – qui ont des liens également avec Jérôme Cahuzac. Je les informe de la fermeture systématique par Reyl de l’ensemble des comptes français non déclarés avant le 31 décembre 2009, à minuit, car à partir du 1er janvier 2010, les Suisses supprimaient la distinction entre évasion et fraude fiscale. Le PV de mon audition mentionne donc l’établissement qui a pu abriter le compte de M. Cahuzac, le lieu probable où le compte a pu être transféré et la forte probabilité de ce transfert.
Or, la demande d’information que les ministres adressent à la Suisse ne contient que le nom d’un seul établissement et ne vise que la Suisse, sans mentionner ni le deuxième établissement, ni Singapour. Cela me laisse perplexe. Que les informations contenues dans le PV d’une audition réalisée par la brigade financière le 20 février n’aient pas été utilisées m’apparaît comme un dysfonctionnement de l’État. Certes, la demande d’information avait déjà été envoyée, et la réponse de l’UBS publiée dans les médias.
M. le rapporteur. Vous avez été entendu en février, la réponse de la Suisse est arrivée le 31 janvier.
M. Pierre Condamin-Gerbier. En effet. Mais dans la mesure où des éléments précis et concrets ont été apportés ensuite, pourquoi une demande complémentaire n’a-t-elle pas été adressée aux autorités suisses ?
M. le rapporteur. Parce que la procédure judiciaire avait été lancée entre-temps.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Les juges d’instruction m’ont pourtant affirmé hier que le caractère particulièrement probant des informations apportées aurait pu motiver une demande complémentaire d’information.
Si j’ignore les spécificités du cas de M. Cahuzac, je peux vous expliquer pourquoi son compte est probablement passé de l’UBS vers Reyl, puis de Reyl Genève vers Reyl Singapour. La pression américaine la poussant à changer en urgence ses procédures, l’UBS a dû rapidement analyser la sensibilité de ses clients classés politically exposed person (PEP) ou « personne exposée politiquement », dont M. Cahuzac faisait certainement partie. Tous les établissements suisses sont obligés de se renseigner sur la nature des liens politiques des clients ou prospects de ce type, et de surveiller particulièrement la source et la destination des fonds reçus et transitant par leurs comptes. Mais dans les petits établissements, les associés décident eux-mêmes si un client doit ou non être classé PEP, et quel type d’information doit être demandé. Dans certains d’entre eux, cette classification n’entraîne donc pas de vérifications plus poussées.
Après ses difficultés avec les États-Unis, l’UBS craint que ses clients PEP français ne fassent également l’objet d’investigations. Les personnes comme M. Cahuzac doivent donc trouver un établissement plus petit dans lequel l’accès direct à l’actionnaire permet de demander un traitement sur mesure et – peu de personnes ayant connaissance de l’existence du compte – un contrôle renforcé de la confidentialité. C’est pourquoi, à mon avis, Hervé Dreyfus a recommandé la société Reyl : demi-frère de Dominique Reyl, il bénéficie d’un accès direct à la direction et à l’actionnaire, et peut piloter la relation avec M. Cahuzac à toutes les étapes.
Quant au transfert à Singapour, je l’ai dit, le phénomène a touché l’ensemble des clients français possédant des actifs non déclarés en Suisse. La renégociation des conventions entre la Suisse et les autres membres de l’OCDE oblige ce pays, depuis le 1er janvier 2010, à répondre aux demandes d’information des autorités étrangères concernant les comptes non déclarés, alors qu’auparavant les cas de soustraction et d’évasion fiscales échappaient à cette obligation. Comme la quasi-totalité des autres établissements, Reyl envoie donc d’urgence l’ensemble des comptes non déclarés hors de Suisse, en l’espèce à Singapour.
M. le rapporteur. Vous dites vouloir sortir des discours politiques et des théories académiques pour représenter la voix d’un praticien. Quel était exactement votre métier ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’ai exercé deux métiers : celui de banquier privé et de family office. J’ai travaillé comme banquier privé auprès de la banque Hambros – rachetée par Société Générale pour devenir SG Hambros –, au sein du groupe EFG – propriété de la famille Latsis pour laquelle j’ai agi à la fois comme banquier privé et comme membre de leur family office –, au Crédit suisse, à l’UBS et chez Reyl & Cie.
M. le rapporteur. Quelle était votre fonction chez Reyl & Cie ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Associé-gérant de Reyl Private Office, filiale détenue majoritairement par le groupe Reyl & Cie, que j’ai dirigée de mai 2006 à juillet 2010, et qui se spécialisait dans le métier de family office.
M. le rapporteur. Vous avez longuement décrit ces expériences dans l’interview que vous avez accordée à Mediapart.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Les éléments publiés par Mediapart relèvent d’un échange à bâtons rompus et non d’une interview.
M. le rapporteur. Quelle activité exercez-vous aujourd’hui ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’exerce toujours mon métier, mais de façon indépendante, sans être rattaché à un quelconque établissement.
M. le rapporteur. Si je vous ai bien compris, avant d’être alerté par l’article du 13 décembre dans Le Temps, vous ne croyez pas à l’affaire Cahuzac.
M. Pierre Condamin-Gerbier. C’est la mention du nom d’Hervé Dreyfus dans cet article qui me laisse à penser qu’il y a vraiment une affaire.
M. le rapporteur. Le parquet ouvre une enquête préliminaire le 8 janvier 2013. Vous êtes pour la première fois entendu par la brigade financière le 20 février – M. Gonelle l’avait été le 16 janvier –, puis à nouveau quelques jours plus tard.
Le praticien que vous êtes devrait pouvoir éclairer la Commission sur les rapports entre la banque UBS et la société Reyl, avant que celle-ci n’obtienne son agrément bancaire.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Avant que Reyl ne devienne une banque en novembre 2010, elle jouissait, selon la terminologie des autorités bancaires suisses, du statut de négociant en valeurs mobilières. Ce statut quasi-bancaire fait l’objet d’une régulation mais n’autorise pas l’établissement à accepter dans ses livres les actifs de clients, l’obligeant à les placer auprès d’un dépositaire – par exemple l’UBS – titulaire d’une licence bancaire.
M. le rapporteur. Ayant ce statut, la société Reyl était-elle obligée de donner le nom de ses clients dans le cadre d’une demande d’information ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Le fait d’avoir le statut de négociant en valeurs mobilières n’exempte en aucune façon la société Reyl de devoir répondre à un juge suisse saisi par un homologue étranger d’une demande d’échange d’informations, comme n’en sont pas non plus exemptés les gérants indépendants qui n’ont même pas un statut quasi-bancaire.
M. le rapporteur. Vous considérez donc que la société Reyl respectait ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment et communiquait à ses banques correspondantes l’identité des ayants droit économiques ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Deux périodes sont à distinguer. Au départ, comme tous les gérants indépendants, Reyl & Cie était titulaire d’un compte en son nom – appelé master account ou compte principal – chez un dépositaire, dont chacun des comptes de ses clients constituait une sous-rubrique. Avant l’entrée en vigueur des lois anti-blanchiment visant les fonds d’origine criminelle, le dépositaire – en l’occurrence l’UBS – pouvait n’avoir et ne connaître qu’un seul client, le gérant indépendant, et ignorer qui se cachait derrière les sous-rubriques de son compte.
M. le rapporteur. Cela veut dire que le montage utilisé par Reyl permettait de masquer les ayants droit économiques ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Les éléments saisis par la justice suisse sur demande de la justice française permettront de le déterminer, car tout dépend de la date d’ouverture du compte. Si celui-ci avait été ouvert avant le milieu des années 1990 – entrée en vigueur des lois anti-blanchiment –, l’UBS aurait pu ne jamais en connaître sinon l’existence, au moins l’identité de l’ayant droit économique. En revanche, si l’ouverture est plus récente, Reyl a probablement été obligé de communiquer ces éléments à l’UBS. Dans ce cas, le côté opaque de la relation a dû être entretenu non par la sous-déposition auprès de l’UBS, mais par d’autres techniques qui permettent aujourd’hui encore d’ouvrir un compte auprès d’une banque suisse sans que l’ayant droit économique soit identifié dans le formulaire A. Il faudrait par exemple savoir si les comptes étaient détenus en nom propre ou via des structures qui peuvent aller de la simple société au trust ou à l’assurance-vie.
M. le président Charles de Courson. Est-ce cela que l’on appelle les comptes omnibus ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Ce terme – inventé par un journaliste – doit désigner le système du compte principal avec des sous-rubriques.
M. le président Charles de Courson. Ceux qui avaient ouvert un master account avant 1995-1996, pouvaient-ils le conserver après ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Avant ce basculement, ils bénéficiaient d’une double protection puisque la relation était répartie entre deux établissements dont le plus régulé – la banque – ignorait l’identité de l’ayant droit économique.
M. le président Charles de Courson. En cas de vérification, dans le cadre de la convention que la France a négociée quelques années plus tard, on ne pouvait donc trouver que le nom de la compagnie Reyl, mais non des détenteurs de chacun des sous-comptes ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Si le compte avait été ouvert sous l’ancien système et qu’une demande d’information adressée par la France à la justice suisse avait obligé la banque UBS à dire si elle comptait monsieur ou madame untel parmi ses clients, elle aurait pu répondre, sans mentir, par la négative.
M. le rapporteur. La réponse que la Suisse fait à la France contient la mention suivante : « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises ». S’agit-il d’une mention habituelle ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Non, à ma connaissance, il s’agit d’une mention tout à fait inhabituelle.
M. le président Charles de Courson. Mais que signifie-t-elle ?
M. le rapporteur. Avez-vous vu d’autres réponses ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Oui. Sans vouloir faire un procès d’intention – mes prises de position sont totalement apolitiques –, il me semble qu’on a volontairement formulé les questions de façon à provoquer la réponse qu’on souhaitait obtenir.
M. le rapporteur. Cette réponse n’est évidemment pas orientée !
M. Pierre Condamin-Gerbier. On peut difficilement me faire un procès d’intention puisque j’ai critiqué dès 2007 des représentants de ma famille politique, MM. Woerth et Devedjian.
M. le rapporteur. Notre Commission concerne les dysfonctionnements de l’État. En quoi le fait que vous soyez entendu par la brigade financière au mois de février, à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire du parquet, en constitue-t-il un ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, monsieur le rapporteur. Comment se fait-il qu’ayant eu connaissance de l’article du 13 décembre, l’administration française n’ait pas cherché à se renseigner sur Hervé Dreyfus ? Comment se fait-il, alors que mon PV d’audition ne relevait pas de l’interprétation mais décrivait des faits précis, et techniques, qu’on ait si longtemps persisté à ne considérer que la Suisse et qu’un seul établissement ?
M. le rapporteur. Nous souhaitons savoir si la justice a pu mener correctement son travail ou si son action a été entravée. Le 8 janvier, le parquet ouvre une enquête préliminaire, et au mois de février, vous êtes entendu dans ce cadre. En quoi cela constitue-t-il une entrave à la justice ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Le fait que je sois entendu ne constitue en rien une entrave. Mais ce qui étonne, c’est que les éléments que j’ai fournis lors de mon audition, et les informations exhibées dans les médias, n’ont pas été utilisés. Le dysfonctionnement réside dans ce qu’on a fait de ce qui a été entendu.
M. le rapporteur. Je ne comprends pas. Nous voulons savoir si avant ou après les révélations de Mediapart, l’État a entravé la justice ou empêché la vérité d’éclater. Une enquête préliminaire ayant été ouverte le 8 janvier, en quoi votre audition du 20 février constituerait-elle une entrave, puisque l’enquête judiciaire s’est poursuivie jusqu’à la décision du parquet du 19 mars ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Pourquoi des éléments d’information manifestes, précis, exploitables et concrets n’ont-ils pas permis de faire très rapidement une demande complémentaire d’information aux autorités suisses ? Pourquoi l’administration française n’a-t-elle ni remarqué, ni exploité l’identification, par les medias suisses, d’un personnage clé de l’affaire ? Si je n’avais pas relié Hervé Dreyfus à Reyl, M. Cahuzac serait encore ministre du budget.
M. le président Charles de Courson. Vous affirmez avoir vu plusieurs réponses de l’administration fiscale suisse à l’administration française. Que signifie la mention « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises » ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. À mes yeux, l’UBS suggère par cet indice que, même si techniquement elle ne peut rien répondre d’autre que ce qu’elle a répondu, elle connaît ou a connu indirectement M. Cahuzac via un établissement tiers, à d’autres périodes ou d’une autre façon. Si l’UBS n’avait jamais eu de relations, même indirectes, avec ce client, elle n’aurait aucune raison de se protéger en ajoutant cette mention. Mais seule l’UBS peut confirmer mon interprétation.
M. le président Charles de Courson. Vous dites avoir vu plusieurs réponses de ce type ; est-ce la première fois que vous voyez un tel paragraphe ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’ai dit seulement que c’était relativement inhabituel. Je n’ai pas dit que c’était la première fois.
M. le rapporteur. Les suites de votre audition ne semblent entachées d’aucune irrégularité. Deux jours plus tard, le 22 février, le compte rendu est envoyé par courriel à la Direction des affaires criminelles et des grâces, suivant le circuit normal.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je vous livre mon sentiment personnel. Lorsque M. Pujadas, au journal télévisé de France 2, dit à M. Valls que les enquêteurs ont entendu un témoin à Annecy, M. Valls ne répond pas. Deux ministres, MM. Moscovici et Valls, répètent sur toutes les antennes qu’ils n’étaient pas au courant. Travaillant depuis vingt ans dans ce milieu, je n’arrive pas à y croire, tout comme je n’arrive pas à saisir pourquoi les enquêteurs, les pouvoirs politiques et les administrations ne se saisissent pas d’un élément d’information essentiel révélé par Le Temps – quotidien lu et reconnu, équivalent du Monde en Suisse –, alors qu’ils scrutent le moindre mot que peut alors publier Mediapart. L’interlocuteur de M. Cahuzac sur l’enregistrement est identifié, et on ne cherche pas à le vérifier !
M. le rapporteur. Monsieur, si d’après vous, tout le monde devait savoir, comment vous croire lorsque vous dites qu’avant l’article du Temps du 13 décembre, vous ignoriez que M. Cahuzac avait un compte en Suisse ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Vos propos sont graves : j’ai juré sur l’honneur de vous dire la vérité et je n’ai aucun intérêt à mentir. J’étais le premier à croire que M. Cahuzac n’était pas client de Reyl & Cie, avant de comprendre, à la lecture de cet article, qu’il l’était.
M. le rapporteur. Si j’ai pu vous sembler vindicatif, ce que je ne suis pas, c’est que, comme tous les membres de cette Commission, je veux comprendre si l’État a – ou non – entravé le fonctionnement de la justice. C’est pourquoi j’ai attaché beaucoup d’importance au calendrier, vérifiant que la date à laquelle vous avez été entendu, celle du coup de téléphone reçu ensuite et celle de la nouvelle audition correspondaient bien au rapport qui est remonté à la Direction des affaires criminelles et des grâces.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Monsieur le rapporteur, je crois vous avoir donné ma réponse personnelle à la question qui vous préoccupe. Cela ne vous choque pas d’entendre deux ministres déclarer dans les médias, fin février ou début mars, qu’ils ignorent ces éléments d’information qui ont été livrés aux enquêteurs alors qu’ils en ont été informés?
M. le président Charles de Courson. Quelles étaient exactement vos fonctions à la délégation de l’UMP à Genève ? Vous poser cette question permettra d’éviter que certains ne vous accusent de manipuler notre Commission pour des raisons politiques.
M. Pierre Condamin-Gerbier. En décembre 2005, j’ai été élu par la communauté française et binationale suisse aux fonctions de délégué de la fédération suisse de l’UMP ; mon mandat achevé en décembre 2008, je ne me suis pas représenté. Votre question est légitime, mais je ne saurais être soupçonné de motivations politiques. En effet, dès 2007, je me suis largement exprimé sur l’attitude de ma famille politique vis-à-vis de notre fédération, dénonçant des pratiques et des prises de position de la part de personnes – dont M. Patrick Devedjian qui fait partie de cette Commission – que nous avions accueillies sur le territoire suisse.
M. le président Charles de Courson. Dans quel cadre l’avez-vous accueilli ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Nous avons reçu MM. Woerth et Devedjian – parmi d’autres cadres seniors de l’UMP – durant la campagne présidentielle, en mars 2007. Nous avons organisé un meeting politique à entrée libre et une soirée en plus petit comité réunissant le premier cercle de l’UMP, où MM. Woerth et Devedjian se sont exprimés et ont échangé avec les représentants de la communauté française fortunée de Suisse et ceux qui avaient fait le voyage de France à Genève pour l’occasion. J’ai dénoncé par la différence entre le discours entendu ce soir-là et les déclarations officielles postérieures à la victoire électorale. J’ai aussi peu apprécié d’entendre MM. Woerth et Devedjian – arrivés dans l’avion privé d’un des soutiens financiers de l’UMP résidant en Suisse – nous dire : « Officiellement, nous sommes venus en train, et vous fermez vos gueules ».
M. le président Charles de Courson. Vous avez donc démissionné ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Non, j’ai choisi de poursuivre mon mandat jusqu’au bout ; mais la déception personnelle m’a conduit à ne pas me représenter. Depuis 2008, je n’ai donc plus aucune forme d’activité politique.
M. le président Charles de Courson. Le journal Agefi a évoqué votre condamnation en 2006 dans une affaire vous opposant à la banque UBS. Qu’en est-il ? Dans quelles conditions avez-vous quitté l’UBS, puis Reyl ? Là encore, vos réponses permettront d’éclairer la commission sur le crédit à porter à votre témoignage.
M. Pierre Condamin-Gerbier. L’Agefi partage un administrateur avec Reyl & Cie qui en est l’un des plus gros annonceurs. L’auteur de l’article, le journaliste Sébastien Ruche, a d’ailleurs publié ensuite un droit de réponse. J’ai en effet quitté l’UBS sous le coup de cette condamnation dont la raison m’a valu d’être également entendu dans le cadre de l’affaire UBS. Ayant découvert l’ensemble des pratiques de cette banque sur le territoire français, je les ai directement critiquées auprès de ma direction. On m’a alors licencié au motif que j’avais réglé un achat avec ma carte professionnelle UBS et non avec ma carte bancaire personnelle. Bien que je l’ai immédiatement corrigé et alors que bon nombre de gestionnaires accumulaient des dépenses personnelles pendant de longs mois pour les régulariser en fin d’année, l’UBS a qualifié cet incident de faute grave pour justifier mon licenciement.
M. le président Charles de Courson. Êtes-vous allé au contentieux ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’aurais certainement dû le faire, mais à cette époque, j’ai préféré réserver mon énergie à mes clients et me concentrer sur mes contacts avec Reyl & Cie qui étaient alors bien engagées. Quant à cet établissement, je l’ai quitté en juillet 2010 à cause d’un désaccord avec la direction et l’actionnariat sur les conflits d’intérêt qui affectent notre métier. Dans le cadre du family office – où nous ne jouons pas le rôle de banquiers mais celui de secrétaires privés de nos clients –, nous devrions pouvoir comparer et critiquer librement l’ensemble de leurs banquiers privés, quels qu’ils soient. Or, pour certains clients communs à Reyl Private Office et à l’établissement Reyl & Cie, on nous avait demandé de ne pas mettre en avant les éléments pour lesquels ce dernier pouvait manquer de compétitivité. À mes yeux, cela remettait en cause mon indépendance professionnelle.
M. le président Charles de Courson. Connaissiez-vous, personnellement ou de nom, M. Jérôme Cahuzac, avant ou après son entrée au Gouvernement en 2012 ? Avez-vous jamais eu connaissance d’avoirs détenus en Suisse dont M. Cahuzac aurait été l’ayant droit économique ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Non.
Mme Cécile Untermaier. Selon l’article du Temps en date du 13 décembre 2012 que vous mentionnez, l’interlocuteur de M. Cahuzac est sans doute Hervé Dreyfus. Mais ni Mediapart, ni le reste de la presse française ne font le rapprochement que vous considérez comme évident. Et c’est assez naturellement vers l’UBS que se tourne l’administration fiscale pour formuler sa demande d’entraide. Pourquoi trouvez-vous cela anormal ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Lorsque je me présente devant les enquêteurs le 20 février, ceux-ci n’ont aucune idée de l’implication de Reyl et compagnie dans ce dossier. C’est mon témoignage qui crée le lien.
D’autre part, je crois comprendre d’Edwy Plenel et de Fabrice Arfi que Mediapart est la source qui a permis à Sylvain Besson de subodorer que l’interlocuteur de M. Cahuzac serait M. Hervé Dreyfus.
Mme Cécile Untermaier. Mais beaucoup plus tardivement.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Non. M. Besson décide de publier son article du 13 décembre sur la base d’un élément d’information qui lui a été fourni par Mediapart.
Mme Cécile Untermaier. À quelles occasions avez-vous pu avoir connaissance de réponses faites par une banque à la suite d’une demande d’entraide ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Quiconque travaille dans un établissement suisse reçoit des publications techniques dans lesquelles on traite de différents dossiers, même si l’on n’y mentionne pas nominativement tel ou tel client ou tel ou tel établissement. À cette occasion, nous avons connaissance des documents transmis. Il arrive aussi que l’on travaille directement pour des établissements qui reçoivent ces demandes, lesquelles, d'ailleurs, ne donnent pas toutes lieu à la transmission d’éléments.
Mme Cécile Untermaier. Pensez-vous que M. Cahuzac se sentait protégé par le dispositif en place ? Cela expliquerait une certaine sérénité dans le mensonge…
M. Pierre Condamin-Gerbier. Plusieurs éléments ont sans doute contribué à ce confort, à ce sentiment qu’il pouvait mentir en toute impunité.
D’abord sa confiance dans le fait que, posant les mauvaises questions, on obtiendrait les mauvaises réponses. Du reste, la première fois que j’ai été interrogé par les enquêteurs, ceux-ci m’ont demandé comment poser la question pour obtenir vraiment toute l’information. Le projet de demande d’information auprès des autorités suisses que j’ai alors rédigé est consigné dans le procès-verbal de mon audition.
Ensuite, M. Cahuzac sait qu’il est entre les mains d’un établissement où son contact a une relation extrêmement proche avec la direction et avec l’actionnaire, si bien qu’il se sent mieux protégé que s’il était le client lambda d’un très gros établissement.
Enfin, il sait que son compte a été déménagé à Singapour avant le 31 décembre 2009. Or la France, semble-t-il, ne s’intéresse qu’à l’élément suisse du dossier. Je pense qu’il a ainsi acquis la certitude qu’on ne trouverait rien, ou qu’on aurait beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit.
M. le président Charles de Courson. M. Cahuzac n’a pas voulu répondre sur le montage de son compte : compte de droit commun, trust ou compte « omnibus » dit aussi master account. Vous privilégiez la troisième hypothèse : c’est Reyl qui aurait détenu ce compte à l’UBS et un balayage des comptes de l’UBS ne permettait pas de remonter jusqu’à Jérôme Cahuzac.
Avez-vous connaissance d’autres montages permettant d’échapper à l’application de la convention franco-suisse ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Ils sont nombreux. Lorsque l’Europe a adopté les textes relatifs à la retenue à la source en matière d’épargne, la première réaction des banquiers suisses – et, je pense, celle de nombreuses places offshore – pour éviter à leurs clients à la fois de donner leur identité et de subir cette retenue qui devait monter progressivement à des taux relativement importants a été de remplacer tous les comptes détenus en nom propre par des comptes de sociétés dites « de domicile » ou sociétés écrans, dépourvue de réalité économique et relevant de juridictions permettant de maintenir l’opacité sur leur actionnariat.
M. le président Charles de Courson. Ces sociétés ne sont donc plus de droit suisse…
M. Pierre Condamin-Gerbier. Non, elles relèvent du droit de places offshore comme les Îles vierges britanniques, Caïman, Bahamas, etc. On ferme le compte détenu en nom propre puis on achète ou crée via un correspondant une petite société, laquelle ouvre elle-même un compte dans le même établissement. On transfère ensuite les actifs d’un compte à l’autre et on ferme le compte d’origine.
Lorsque l’Europe a compris que les mailles du filet étaient trop larges, les textes ont changé pour inclure les comptes détenus par des sociétés. Mais cela a été fait de façon maladroite, si bien que les comptes détenus par des structures de type anglo-saxon comme les trusts – notamment les trusts irrévocables et discrétionnaires – ont largement échappé à ces dispositions.
La deuxième parade a consisté à faire acheter la société offshore par un trust nouvellement créé. Pendant longtemps, sur le formulaire A, censé exposer l’identité et les coordonnées de l’ayant droit économique, on ne faisait figurer comme bénéficiaire réel que le trustee et non les fondateurs ou les bénéficiaires. En dépit des changements réglementaires intervenus en Suisse, cette technique a permis de continuer d’ouvrir des comptes avec un maximum d’opacité.
La Suisse a cependant été contrainte, notamment pour des raisons de lutte contre les avoirs d’origine criminelle, d’introduire un formulaire analogue au formulaire A mais destiné aux trusts, le formulaire T.
Il ne reste donc que très peu de solutions pour ouvrir un compte sans tromper l’établissement – sachant que la pratique consistant à ouvrir un compte en son nom mais avec l’argent d’un autre est passible de recours. Ironie de la chose, la solution principale restante a été involontairement donnée par la France et l’Europe.
Au départ, en effet, l’administration fiscale française donnait deux options à l’acheteur d’un bien immobilier en France au travers d’une structure de droit étranger : soit dire qui est derrière cette structure, auquel cas s’applique l’imposition française habituelle en matière d’immobilier ; soit ne pas le dire, et être taxé à hauteur de 3 % de la valeur vénale du bien chaque année.
Considérant que ce dispositif pouvait porter atteinte à la liberté d’établissement et d’investissement économique, l’Europe a adopté un texte, repris par la France, en vertu duquel, si la société de droit étranger qui acquiert un bien immobilier directement ou via une société civile immobilière française est détenue par une société d’assurance vie de droit européen cotée sur un marché européen, l’administration fiscale se satisfait de savoir que l’ayant droit économique « réel » est la société d’assurance vie elle-même, sans poser aucune question concernant les souscripteurs, les vies assurées et les bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Aujourd'hui, la plupart des investissements en matière d’immobilier de prestige en France sont structurés de cette manière. Bon nombre de grands palaces parisiens et autres fleurons de l’immobilier sont détenus ultimement par des contrats d’assurance vie luxembourgeois.
Les autorités bancaires Suisses ont saisi l’occasion et jusqu’à une date très récente, ont autorisé que l’on ne fasse figurer sur le formulaire A – c'est-à-dire le formulaire d’identification de l’ayant droit économique – que le nom de la société d’assurance vie, généralement luxembourgeoise, qui ouvre le compte. À toute demande d’information réalisée auprès de ces établissements sur la base du nom d’une personne physique, l’établissement pouvait répondre sans mentir qu’il n’avait pas connaissance de la personne en question.
M. Jean-Marc Germain. Savez-vous quelle banque hébergeait le compte de M. Cahuzac entre 2006 et 2010, c'est-à-dire pendant la période sur laquelle porte la demande d’entraide et où Reyl n’était pas encore une banque ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je le répète, je n’avais pas d’informations concernant ce client spécifique à l’époque où je travaillais chez Reyl. Ce qui a été publié dans la presse, c’est que le compte, contracté auprès de Reyl et compagnie, aurait été sous-déposé à l’UBS et transféré avant le 31 décembre 2009 auprès de la filiale singapourienne de Reyl.
M. Jean-Marc Germain. Entre 2006 et 2010, le compte à l’UBS était donc géré par Reyl, avec Jérôme Cahuzac comme ayant droit.
M. Pierre Condamin-Gerbier. D’après ce que je comprends de ce qui est paru dans les medias, il y a d’abord eu un compte directement ouvert à l’UBS, puis un compte à l’UBS via Reyl, puis un compte chez Reyl à Singapour.
M. Jean-Marc Germain. Dans l’hypothèse que nous retenons pour la période 2006-2010, comment expliquez-vous que la question des autorités françaises, qui porte également sur les ayants droit, reçoive une telle réponse de la part de l’UBS ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’ignore si le compte était en nom propre ou détenu à travers une structure qui a permis cette réponse. Par ailleurs, il se peut que l’UBS, bien qu’elle connaisse l’identité de l’ayant droit – ce qui expliquerait, nous y revenons, l’alinéa ajouté dans la réponse –, renvoie la balle à l’établissement régulé dont il est le client, considérant qu’elle n’est elle-même qu’un sous-dépositaire et que c’est cet établissement qui est responsable de la bonne qualité dudit client et qui doit répondre à l’administration si la question lui est posée. L’UBS a toutes les raisons d’estimer qu’il ne lui appartient pas de dire à la France que M. Cahuzac détient un compte chez elle via Reyl. Elle n’a pas à faire le travail d’enquête de la France.
M. Jean-Marc Germain. À votre connaissance, donc, l’UBS n’interroge pas Reyl à ce sujet. Elle s’en tient à ses fichiers.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je l’ignore.
M. le président Charles de Courson. Dans l’hypothèse d’un tel montage, l’administration française aurait-elle obtenu une réponse positive si la question avait été posée à la compagnie Reyl ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Indubitablement. Si elle avait reçu cette demande d’information, Reyl ne pouvait pas dire, à moins de mentir, qu’elle n’avait pas ce client dans ses livres.
M. le président Charles de Courson. Même si le compte a été transféré avant la fin de 2009 ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Si la demande avait été adressée à Reyl dans une formulation telle que : « Avez-vous une relation d’affaires avec M. Jérôme Cahuzac dans le cadre des activités de votre établissement en Suisse ? », et que le compte avait été déjà transféré à Singapour la banque aurait pu répondre par la négative. Sans dire toute la vérité, elle aurait quand même dit la vérité. Mais dans l’hypothèse d’une demande formulée correctement – « Avez-vous eu, à un moment quelconque, une relation directe ou indirecte, en nom propre ou via une autre structure, au sein de votre établissement en Suisse ou dans une de vos filiales à l’étranger » –, la banque Reyl aurait dû fournir une autre réponse. Tout au plus aurait-elle pu botter en touche – ce qui aurait malgré tout donné une indication – en affirmant qu’elle pouvait répondre s’agissant de la Suisse mais non pour ses filiales à l’étranger, la demande devant dans ce cas être adressée à la juridiction de la filiale concernée. Il est néanmoins fort probable que la réponse de Reyl à une question très précisément libellée aurait été oui.
M. Jean-Marc Germain. Vous dites avoir rédigé pour les enquêteurs la bonne question qui aurait conduit à la bonne réponse. Pouvez-vous nous indiquer cette formulation ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. C’est, à peu de chose près, celle que je viens de vous donner.
M. Jean-Marc Germain. Je crains qu’elle ne soit un peu floue. Vous ne vous référez pas à une période donnée et vous faites comme si les autorités françaises s’adressaient directement aux banques suisses, alors qu’elles posent une question aux autorités suisses qui la répercutent aux établissements désignés.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Bien entendu, la France ne pouvait s’adresser directement à Reyl : elle aurait dû passer par l’administration suisse. Mais celle-ci aurait alors transmis le libellé de la question sans y rien changer.
M. Jean-Marc Germain. Vous considérez donc que si la France avait fait porter sa demande à la fois sur l’UBS et sur Reyl, elle aurait obtenu une réponse positive.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Il aurait fallu préciser : maisons mères et filiales, comptes détenus en nom propre avec identification directe sur le formulaire A et tous autres scénarios susceptibles d’avoir été utilisés pour masquer l’identité de M. Jérôme Cahuzac.
M. Jean-Marc Germain. La demande de la France parle de comptes dont Jérôme Cahuzac pourrait être l’ayant droit, ce qui semble couvrir ces cas. À moins que l’on ne veuille ouvrir une discussion juridique sur la signification de la notion d’ayant droit…
M. Pierre Condamin-Gerbier. Croyez bien qu’en Suisse, c’est une notion très précise !
M. le président Charles de Courson. Le procureur de Paris nous a indiqué que la demande aux autorités suisses était très épaisse. Je comprends mieux maintenant : vous l’aviez aidé, via les enquêteurs, dans la rédaction de ce texte.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Les enquêteurs m’ont posé à peu près les mêmes questions que vous : si ce compte n’est pas détenu en nom propre, quels peuvent être les biais utilisés et quelles questions faut-il poser pour couvrir ces scénarios ?
M. le président Charles de Courson. À la différence de la saisine fiscale, qui était assez brève, la saisine judiciaire comportait donc plusieurs pages.
Mais revenons-en à la notion d’ayant droit économique, dont le procureur de Paris estime qu’elle n’est pas claire. D’après la pratique que vous en avez, qu’est-ce qu’un ayant droit économique en droit suisse ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je vous répondrai en praticien, n’étant nullement expert en droit interne suisse.
La dimension fiduciaire est importante dans les relations bancaires en Suisse. Pendant très longtemps n’a existé que le « formulaire B ». Cela dit, même si l’on continue de s’y référer, l’époque des « comptes à numéro », également appelés « comptes numériques » ou « comptes anonymes », est révolue. Le formulaire B a été supprimé.
La relation bancaire impliquait, en plus du banquier, deux autres parties possibles : le fiduciant, qui ouvrait le compte en son nom mais qui reconnaissait que l’argent déposé n’était pas le sien, et le fiduciaire. Il faut donc distinguer le contractant, qui est la partie signataire de la relation juridique avec l’établissement, et le bénéficiaire. On peut rapprocher la notion d’ayant droit économique de celle de bénéficiaire : il s’agit du véritable propriétaire du dépôt, la personne qui en tire un avantage financier et économique. Le co-contractant, qui établit la relation juridique avec la banque et peut, le cas échéant, être poursuivi dans ce cadre, n’est pas forcément le propriétaire réel. On pourrait dresser une analogie, quelque peu abusive d’ailleurs, avec la distinction entre nue-propriété et usufruit. L’ayant droit économique est le bénéficiaire des droits économiques et financiers et c’est lui qui a la possibilité d’utiliser les fonds ou les titres déposés.
M. Jean-Marc Germain. Vous avez remis à la justice une « liste » dont vous parlez depuis un certain temps. Au début de cette audition, vous avez émis des sous-entendus assez graves à l’égard des parlementaires. Je ne vous demande pas cette liste mais, pour la sérénité de nos travaux, je souhaite savoir si des membres de notre commission d’enquête ou des ministres de l’actuel gouvernement y figurent.
M. le président Charles de Courson. Cela est hors de notre champ. Laissons la justice faire son travail ! La seule chose que vous pourriez demander, mon cher collègue, c’est si le nom de M. Cahuzac figure sur la liste.
M. Jean-Marc Germain. M. Condamin-Gerbier a mis en cause la capacité des parlementaires à mener une commission d’enquête.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Absolument pas !
M. Jean-Marc Germain. Je souhaite qu’il nous rassure – ou ne nous rassure pas – sur ce point.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je ne crois pas avoir utilisé le terme de « parlementaires ». J’ai parlé d’hommes et de femmes politiques : on peut l’être sans être nécessairement parlementaire. Et je n’ai aucunement remis en cause la crédibilité et le sérieux de votre commission, loin de là. Ce que j’ai dit, c’est qu’en vingt ans d’expérience, j’ai été le témoin direct ou indirect – et d’autres personnes qui travaillent actuellement avec moi – de différents « dossiers » – mot que je préfère à celui de « liste » : une feuille avec quinze noms dessus ne vaut que le prix du papier sur lequel ces noms sont imprimés !
Bien entendu, ces dossiers sont éminemment techniques. Vu le caractère très sensible de certains noms, les praticiens se sont évidemment employés à beaucoup obscurcir les choses. Pour les enquêteurs, l’écheveau est très complexe. Tout un travail de mise en relation, de consolidation et d’explication de ces informations reste à faire pour qu’elles soient exploitables par la justice.
Concernant les autres aspects de votre question, je ne me prononcerai pas. La justice fera son travail.
M. Philippe Houillon. Reyl et compagnie intervient en quelque sorte comme courtier, puisque les fonds sont physiquement placés à l’UBS. Sélectionne-t-il ses clients ? On parle, s’agissant de ce compte, d’une somme d’environ 600 000 euros. Est-ce habituel pour ce type d’établissement ? Le montant paraît un peu faible par rapport à ce que le profane peut imaginer.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Je précise que Reyl est devenu une banque en novembre 2010 et n’a plus besoin d’envoyer ses clients ailleurs. À l’époque supposée de l’ouverture du compte, l’établissement était maître et propriétaire de la relation mais pas de la partie hardware, si je puis dire, et sa taille était plutôt petite au regard des autres établissements de la place de Genève.
Pour de tels groupes qui souhaitaient assurer un développement commercial rapide et dynamique, il était courant d’accepter des comptes du montant dont vous avez fait état, voire d’un montant plus réduit encore. Il s’agissait de prendre des « parts de marché ». De plus, un établissement comme Reyl sait très bien que les hommes et les femmes politiques ne disposent pas forcément des fortunes les plus considérables. Néanmoins, lorsque l’on a un client comme M. Cahuzac, on s’ouvre des portes, on accède à des réseaux, à des centres d’influence. C’est plus cela que l’on recherche que la rentabilité dégagée sur des avoirs personnels qui, par comparaison avec d’autres clients beaucoup plus fortunés, sont très limités. Accepter ces clients est une manière de préparer l’avenir.
M. Philippe Houillon. La réponse de l’UBS à la demande française précise de manière appuyée que l’information se limite à la période pour laquelle les renseignements ont été demandés. Cela signifie-t-il clairement, a contrario, qu’il existe des éléments concernant une autre période ? Est-ce seulement un message subliminal destiné à laisser entendre qu’il faut peut-être chercher plus loin ? Ou ne s’agit-il que d’une clause de style dépourvue de tout message ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. À mon avis, c’est tout sauf une clause de style. L’UBS sait que le dossier est très sensible et commence à se protéger, ne souhaitant pas qu’on l’accuse plus tard d’avoir menti ou d’avoir fourni la mauvaise réponse. On essaie donc de dire aux gens qui savent lire entre les lignes pourquoi on donne cette réponse et pourquoi on n’avance pas des éléments dont on sait par ailleurs qu’ils existent. Il s’agit avant tout, je crois, d’une protection juridique de la part de l’UBS.
C’est peut-être aussi un appel du pied. La banque sait qu’elle aura à passer sous les fourches Caudines de la justice française et il est possible qu’elle essaie ainsi de montrer sa bonne volonté, sans toutefois pouvoir le faire de façon précise car elle outrepasserait alors ses droits. Mais, je le répète, il s’agit surtout d’une protection de la part de l’UBS.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cela peut en effet se concevoir.
Pour en revenir à la demande d’entraide judiciaire et n’en déplaise au rapporteur, vous semblez avoir une interprétation du fait que l’on a précisément posé la question sous cette forme-là. Pour quelles raisons aurait-on choisi cette formulation qui, selon vous, ne pouvait recevoir d’autre réponse que celle qui a été faite ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Il n’y a que deux scénarios : soit c’est de l’incompétence – mais je crois que l’administration française dispose de suffisamment d’experts pour que les ministres soient tout à fait au courant de ces pratiques et des relations entre la France et la Suisse –, soit il y a une volonté de poser les mauvaises questions pour obtenir les réponses que l’on souhaite.
Dans cette seconde hypothèse, on peut distinguer deux sous-scénarios : soit on est persuadé de l’innocence de la personne mise en cause, auquel cas on souhaite seulement gagner un peu de temps pour faire toute la lumière et obtenir une disculpation totale – mais j’ai du mal à y croire, vu les éléments qui étaient entre les mains des enquêteurs – ; soit on connaît la culpabilité de cette personne et on essaie de l’aider à se dédouaner. Du reste, à peine reçue, cette réponse est brandie dans Le Journal du dimanche.
Pour ma part, je m’en tiens à l’opinion que j’ai déjà exprimée : il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !
Mme Cécile Untermaier. L’enquête administrative se double néanmoins d’une enquête judiciaire autrement plus efficace.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Il est sans doute arrivé un moment où, étant donné les dépositions recueillies, il était difficile d’empêcher les juges de faire leur travail. La période administrative s’est révélée bien commode pour obtenir les réponses désirées. À partir du moment où les juges interviennent, il devient impossible d’orienter les choses.
M. le rapporteur. Vous avez pourtant été entendu lors de l’enquête préliminaire.
M. Pierre Condamin-Gerbier. Nous ressassons les mêmes arguments. Ce que j’essaie de vous dire, c’est que, même au moment où la première demande a été faite, il existait des éléments suffisamment clairs et facilement détectables et exploitables. Si d’aventure il m’arrivait d’être mis en cause comme client d’un établissement suisse, je voudrais que la réponse des autorités suisses concerne l’ensemble des établissements, de manière à ce que l’on ne m’objecte pas, des années après, que l’on avait oublié de poser la question à telle ou telle banque. Et je voudrais que la question soit la plus précise possible afin que la réponse montre que j’ai été victime de calomnie et qu’on me laisse enfin en paix.
Or, ni M. Cahuzac, qui avait pourtant la possibilité d’agir par l’intermédiaire de ses avocats, ni les membres du gouvernement qui l’entouraient n’ont posé la bonne question – et je n’en fais pas un enjeu partisan.
M. le rapporteur. Est-il d’usage d’informer la personne en cause de la demande d’information administrative et de la réponse ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. À ma connaissance, les autorités suisses et les établissements bancaires concernés se doivent d’indiquer au client ou à l’un de ses représentants légaux qu’une question a été posée. Les échanges actuels entre les États-Unis et la Suisse en fournissent de nombreux exemples.
Par contre, il n’existe pas d’obligation de communiquer la nature de la réponse.
M. le président Charles de Courson. Qu’en est-il dans la pratique ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. La pratique suit strictement la loi. Dans le cas des demandes des États-Unis cependant, il a été interdit aux établissements bancaires de faire savoir à leurs clients qu’il existait une demande d’information à leur égard, ce qui pourra donner lieu à des recours en droit interne suisse. Les textes suisses font obligation à l’établissement d’informer le client concerné.
M. le rapporteur. M. Jérôme Cahuzac, à qui nous avons posé la question la semaine dernière, nous a indiqué qu’il avait été informé de l’existence de la démarche des autorités françaises et que lui-même ou ses conseils avaient également été avisés de la tonalité de la réponse.
M. Pierre Condamin-Gerbier. J’en suis surpris. À ma connaissance, il n’existe pas d’obligation d’informer le client de la réponse, et il est très rare qu’on le fasse.
M. le président Charles de Courson. Dans sa réponse, l’administration suisse écrit : « S’agissant des années 2006 à 2009, notre réponse s’inscrit dans une démarche de bons offices faute de base légale pour cette période. Après consentement de Me Edmond Tavernier, représentant M. Jérôme Cahuzac, la banque nous a informés qu’elle ne détenait pas non plus d’avoirs dont M. Jérôme Cahuzac était titulaire ou ayant droit économique sur ces années. » En d’autres termes, les autorités suisses ont élargi le champ de la demande à la période 2006-2009 parce qu’elles ont eu l’accord de l’avocat de M. Jérôme Cahuzac. Ce qui signifie que Jérôme Cahuzac était parfaitement au courant de l’existence d’une demande.
Il nous a affirmé lors de son audition que c’est son avocat – probablement Me Edmond Tavernier – qui a eu connaissance, non pas du texte, mais du sens de la réponse. C’est presque le seul point, d’ailleurs, sur lequel il nous a éclairés !
M. Pierre Condamin-Gerbier. Le seul commentaire que je puisse faire est que cela me semble très inhabituel. Mais comme vous l’avez souligné à juste titre, il s’agissait d’une démarche administrative et non judiciaire. Et, visiblement, les autorités suisses ont emprunté une voie passablement informelle et fondée sur le bon vouloir.
M. le président Charles de Courson. Les « PEP » (personnalités exposées politiquement) auxquelles vous avez fait allusion constituent-elles une catégorie juridique en Suisse, ou s’agit-il d’une pratique interne à certains établissements ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Ce n’est pas une catégorie juridique mais les textes bancaires codifient la notion. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, fixe des critères précis permettant de déterminer si un client est « PEP » ou « non PEP ». Néanmoins, une assez grande liberté est donnée aux établissements : ils se doivent d’avoir des comités de déontologie indépendants qui décident lors de l’ouverture d’un compte si le client doit être classé « PEP » ou pas et, dans le premier cas, quelles informations complémentaires lui demander afin de s’assurer que l’argent crédité n’est pas issu de la corruption ou d’activités illicites en droit suisse.
Dans les établissements de petite taille, ces comités de déontologie ne réunissent qu’une ou deux personnes en plus des actionnaires et des dirigeants. On reste entre soi. Il peut donc arriver qu’un établissement ne classe pas un client dans la catégorie « PEP » alors qu’il l’est, ce qui l’expose néanmoins à des remontrances lors des audits que les autorités bancaires suisses pratiquent sur tous les établissements.
M. le président Charles de Courson. Quelles sont les conséquences de la classification « PEP » ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. À l’ouverture du compte, une demande de documents complémentaires visant à prouver la nature et la source des fonds qui alimentent le compte. Puis, durant toute la vie du compte, une demande systématique de justification des entrées et sorties, de manière à vérifier que les mouvements correspondent à des opérations licites et à pouvoir faire une déclaration précoce aux autorités suisses si l’on suppose des dysfonctionnements.
M. le président Charles de Courson. M. Cahuzac n’était pas encore une personnalité politique à la date supposée de l’ouverture de son compte, au début des années 1990. Qu’en est-il de ce cas de figure ? Y a-t-il un reclassement périodique ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Dès lors qu’il a accédé à des responsabilités politiques importantes, le dossier aurait dû être réexaminé et faire l’objet d’un classement « PEP ».
Mais on a peu parlé d’un autre aspect du dossier : Reyl n’est pas encore banquier lorsqu’il transfère ses premiers clients vers Singapour, avant le 31 décembre 2009 ; il ne peut donc demander une licence bancaire à cet État et est obligé de passer par un statut intermédiaire qui, au départ, ne lui permet d’avoir que trente clients à Singapour. Ce sont donc les clients les plus « sensibles » qui sont partis les premiers.
De plus, comme pour la Suisse, il fallait trouver un sous-dépositaire. Il semble que l’établissement choisi ultimement ait été la banque Julius Baer. Cette dernière a visiblement réagi quand on lui a indiqué le transfert du compte Cahuzac. Elle l’a accepté en sous-dépôt mais a rapidement demandé des informations complémentaires. C’est sans doute ce qui justifie que le sous-dépositaire finalement choisi ait été, non plus Julius Baer, mais probablement l’UBS. Bref, il semblerait que l’on ait présenté à Julius Baer un client sans nécessairement mettre en avant sa nature « PEP », ce qui amène à se demander s’il était classé « PEP » en Suisse.
M. le rapporteur. Le transfert du compte nécessitait-il un déplacement de Jérôme Cahuzac en Suisse ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Si l’établissement veut respecter l’interdiction de démarchage illicite et d’aide au blanchiment de fraude fiscale, ses représentants ne devraient jamais mettre le pied sur le territoire français. En l’espèce, j’ignore ce qui s’est passé. Tout dépend de la manière dont on a ouvert le compte.
Si le compte est en nom propre ou passe par des structures dont M. Cahuzac est identifié comme l’ayant droit, tous les ordres de transfert doivent porter sa signature. Mais je ne peux savoir s’il s’est déplacé à Genève ou si les représentants de l’établissement se sont déplacés sur le territoire français ou à l’étranger.
Si en revanche le compte est détenu par des structures dont les signataires officiels ne sont pas M. Cahuzac – directeur de conseil d’administration, représentant du trustee, représentant d’une société d’assurance vie –, la signature de ce dernier n’est pas requise.
M. le président Charles de Courson. Dans l’enregistrement de ce qui semble être un échange entre M. Dreyfus et M. Cahuzac à la fin de 2000, le premier explique au second qu’il ne peut fermer le compte sans se rendre physiquement en Suisse. Sur le fond, confirmez-vous que M. Cahuzac ne pouvait passer par un mandataire – comme il le suggère dans la conversation – pour fermer et transférer le compte ?
M. Pierre Condamin-Gerbier. Il aurait fallu qu’il donne procuration à ce mandataire, en précisant que cette procuration est également valable pour une ouverture ou une fermeture de compte.
M. le président Charles de Courson. M. Dreyfus insiste pourtant sur la nécessité qu’il aille personnellement à Genève.
M. Pierre Condamin-Gerbier. La pratique générale, en Suisse, est que les établissements demandent une explication sur les motivations de l’ouverture ou de la fermeture d’une relation bancaire, notamment afin de savoir où envoyer la ligne créditrice. C’est sans doute pour cette raison de pratique bancaire que M. Dreyfus incite M. Cahuzac à se déplacer lui-même. Mais, d’un point de vue juridique, l’opération aurait pu se faire à distance. J’imagine aussi que M. Dreyfus ne souhaitait pas que les représentants de l’établissement viennent sur le territoire français au contact d’une personnalité sensible, avec les risques que présente le passage de la douane en possession de documents comportant des informations compromettantes.
M. le président Charles de Courson. Merci, monsieur Condamin-Gerbier, pour cette longue audition.
Audition du mercredi 3 juillet 2013
À 16 heures 30 : M. Jean-Noël Catuhe, inspecteur des impôts à la retraite.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions en recevant M. Jean-Noël Catuhe, expert judiciaire auprès de la cour d’appel d’Agen et inspecteur des impôts à la retraite.
Si nous avons souhaité vous entendre, Monsieur Catuhe, c’est que nous sommes arrivés à la conclusion que vous aviez joué un rôle dans la circulation de l’information selon laquelle M. Jérôme Cahuzac détenait un compte non déclaré à l’étranger. Nous nous interrogeons sur le rôle que vous avez pu jouer dans le déclenchement de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac », en décembre dernier.
(M. Jean-Noël Catuhe prête serment.)
M. le président Charles de Courson. Si cela vous convient, je vais vous laisser vous exprimer durant une dizaine de minutes.
M. Jean-Noël Catuhe. Je ne souhaite pas faire de déclaration liminaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Catuhe, avez-vous écouté l’enregistrement dans lequel on entend M. Cahuzac évoquer un compte qu’il détiendrait à l’étranger ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous préciser dans quelles circonstances ?
M. Jean-Noël Catuhe. Fin 2000 ou début 2001, je suis contacté par M. Michel Gonelle, qui souhaite me rencontrer pour me faire part de quelque chose. Je vais donc le voir à son cabinet, et il me fait écouter cette conversation. Je dois dire que j’ai été passablement stupéfait ! Le début est inaudible, mais assez vite…
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous entendez cette conversation à partir d’un enregistrement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, il me fait écouter un enregistrement sur un ordinateur, dans son bureau.
M. Alain Claeys, rapporteur. La date de cet enregistrement était-elle précisée ?
M. Jean-Noël Catuhe. Cela, je ne m’en souviens plus, monsieur le rapporteur !
M. Gonelle me sollicite parce qu’il sait que j’appartiens à l’administration fiscale.
M. le président Charles de Courson. Vous n’étiez pas encore retraité ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, je le suis depuis le 1er janvier 2007.
M. Gonelle me demande si j’ai reconnu la voix ; je réponds par l’affirmative. Il me dit qu’il ne sait pas quoi faire et que c’est la raison pour laquelle il a sollicité cet entretien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous explique-t-il comment il a obtenu l’enregistrement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui. Possédant un téléphone mobile, j’avais moi-même connu des mésaventures de ce type. Je ne suis donc pas surpris outre mesure par cette histoire de deuxième appel – le premier étant destiné, selon M. Gonelle, à l’informer de la venue du ministre Daniel Vaillant pour l’inauguration du nouveau commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous entendez également ce premier appel ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, je n’entends que l’enregistrement du rappel. Et je reconnais bien entendu la voix de M. Cahuzac – que je connaissais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment aviez-vous connu M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. J’avais fait sa connaissance dès son arrivée à Villeneuve-sur-Lot.
Mon médecin traitant, qui était conseiller municipal et membre du parti socialiste, m’a dit un jour : « Il faut que je te présente quelqu’un que Gérard Gouzes a fait venir ». Peu de temps après, le président Chirac a dissous l’Assemblée nationale et, lorsque j’ai revu mon médecin, celui-ci a rectifié : « Finalement, je ne vais pas te le présenter, vu que c’est plutôt lui qui me présente aux Villeneuvois ! ». Cela vous donne une idée de la rapidité avec laquelle Jérôme Cahuzac avait fait connaissance avec le milieu villeneuvois !
L’attaché parlementaire de l’ancien député Marcel Garrouste étant membre de la section locale de la Ligue des droits de l’homme – dont j’étais le président –, j’allais régulièrement le voir à la permanence du parti socialiste, rue de la Convention. J’y rencontrais Jérôme Cahuzac ; nous discourions de la vie locale – entre autres sujets.
M. le président Charles de Courson. Parmi lesquels la fraude fiscale ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, car je n’y allais pas en tant qu’inspecteur des impôts.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle vous présente comme un ami « intime »…
M. Jean-Noël Catuhe. Nous le sommes devenus au fil des années. Bien que n’étant pas de la même sensibilité politique, nous œuvrons dans des domaines sociaux voisins – à telle enseigne qu’aujourd’hui je suis engagé auprès de lui dans une association relais. À l’époque, lui était maire de Villeneuve-sur-Lot, moi responsable d’association et de syndicat. Nous nous rencontrions fréquemment.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle vous donne donc rendez-vous à son cabinet pour vous faire écouter l’enregistrement sur son ordinateur. Que se passe-t-il ensuite ?
M. Jean-Noël Catuhe. Ce qu’il vous a dit. Il me déclare qu’il est ennuyé compte tenu du contexte préélectoral : c’était quand même gros – d’autant que dans la première partie de l’enregistrement, M. Cahuzac notait qu’il restait peu d’argent sur le compte…
Peut-être est-ce moi qui lui tend alors la perche, en proposant de faire un signalement et de transmettre l’information au service ad hoc, qui se chargerait de faire une enquête. Rien n’indique en effet que le compte soit détenu de manière illégale : il pouvait fort bien être déclaré.
M. Alain Claeys, rapporteur. Où étiez-vous en poste ?
M. Jean-Noël Catuhe. À Villeneuve-sur-Lot, au service de la fiscalité personnelle. Je traitais des dossiers importants, mais M. Cahuzac dépendant de Paris, je n’avais pas à alerter l’administration départementale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous ne conseillez pas à M. Gonelle de saisir le procureur ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, cette idée ne m’effleure même pas. J’en reste à une approche purement professionnelle : le contribuable est-il, ou non, en règle ? Et je veux penser qu’il l’est…
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment se passe un signalement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Très simplement : le signalement est fait à un fonctionnaire, quel qu’il soit, et celui-ci se doit de le transmettre au département ou au service à même de le traiter.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous produit un écrit à cette occasion ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non. J’ai rencontré un collègue, M. Mangier, par hasard et c’est pourquoi cette possibilité se présente tout de suite à mon esprit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si vous décidez, avec M. Gonelle, de faire un signalement, ce n’est pas par hasard que vous rencontrez M. Mangier !
M. Jean-Noël Catuhe. J’évoquais une rencontre antérieure, monsieur le rapporteur.
M. Mangier avait été mon condisciple à l’École nationale des impôts, à Clermont-Ferrand, et je ne l’avais pas revu depuis. Nous avions repris contact fortuitement : il était en mission dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot pour une affaire de fraude assez importante, en liaison avec les personnels des douanes. J’ai appris à cette occasion qu’il travaillait à la brigade interrégionale d’intervention (BII) de Bordeaux, qui dépendait de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF).
Lorsque M. Gonelle me fait écouter l’enregistrement, j’ai donc une solution toute prête à lui proposer : je sais à qui signaler le fait. Et je profite d’un déplacement à Bordeaux, à l’occasion d’un stage de formation ou d’une réunion syndicale – je ne sais plus –, pour me rendre au bureau de M. Mangier, boulevard du Président-Wilson, et lui communiquer l’information.
M. le président Charles de Courson. Quand cela se produit-il ?
M. Jean-Noël Catuhe. Au début de 2001.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Gonelle nous a déclaré qu’il avait su par votre intermédiaire que M. Mangier n’avait pas pu obtenir le dossier fiscal de M. Cahuzac. Est-ce vrai ?
M. Jean-Noël Catuhe. Ce qu’il vous a dit est vrai, mais ce que je lui avais dit était inexact : je me devais en effet de garantir le secret fiscal et, en lui déclarant que le dossier n’avait pas été transféré à Bordeaux, je ne délivrais aucune réponse.
M. le président Charles de Courson. Qu’est-ce à dire ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je n’avais pas à lui dire si le compte était déclaré ou pas. Je ne trahissais pas le secret fiscal si je lui répondais que le dossier n’avait pas été transféré.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ne pas lui avoir tout simplement dit qu’il ne pouvait pas avoir cette information ?
M. Jean-Noël Catuhe. Pour moi, c’était le moyen idéal pour couper court à toute interrogation.
M. Alain Claeys, rapporteur. Car vous aviez l’information ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, j’ignorais ce qu’il en était. Je n’ai fait que transmettre l’information à M. Mangier, qui était la personne ad hoc pour mener l’enquête.
M. le président Charles de Courson. Mais qu’avez-vous dit exactement à M. Mangier ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je lui ai raconté ce qui m’était arrivé – et que le maire de Villeneuve-sur-Lot disposait d’un enregistrement.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous précisé qu’il s’agissait d’un compte à la banque UBS, en Suisse ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, et j’ai même ajouté que ce serait ennuyeux car il s’agissait de notre député – d’autant que j’étais du même bord que lui !
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu en main cet enregistrement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, il était chez Me Gonelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous ne l’avez jamais eu entre les mains ?
M. Jean-Noël Catuhe. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. En avez-vous eu une copie ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, contrairement à ce qui a été prétendu, je n’en possède pas de copie et n’en ai jamais possédé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Afin de couper court à toute discussion avec M. Gonelle, vous lui dites donc que le dossier fiscal de M. Cahuzac n’a jamais été transféré à Bordeaux.
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, car s’il n’a pas été transféré, je ne peux pas donner la réponse et l’on ne peut pas « m’asticoter » pour essayer de savoir ce qu’il en est. D’ailleurs, à l’époque, je n’en sais rien : je n’ai appris que très récemment, grâce aux travaux de votre commission, que le dossier avait bien été transféré et qu’il était resté un temps certain à Bordeaux. À ce moment, l’affaire était close pour moi. Je n’avais plus rien à y voir.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce à dire qu’entre 2001 et 2012, vous n’entendez plus parler de rien ?
M. Jean-Noël Catuhe. De rien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites que vous êtes de la même sensibilité politique que M. Cahuzac. N’avez-vous jamais évoqué cette information avec son entourage ?
M. Jean-Noël Catuhe. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ni avec personne d’autre ?
M. Jean-Noël Catuhe. Peut-être parlerons-nous ultérieurement d’une personne qui a pu en avoir connaissance. Autrement, non.
M. Alain Claeys, rapporteur. À qui pensez-vous ?
M. Jean-Noël Catuhe. À M. Garnier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous le connaissiez ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, très bien, et de longue date.
Un volet de notre travail consiste à programmer des contrôles fiscaux, autrement dit à détecter les contribuables qui devraient être contrôlés parce que l’on a constaté des anomalies. Les dossiers de certains d’entre eux, comme les professions libérales réalisant d’importantes recettes, doivent être transférés à la brigade régionale – en l’occurrence, il s’agissait de M. Garnier. Nous étions donc amenés à nous rencontrer fréquemment pour discuter ; même lorsqu’un contrôle était achevé, il s’inquiétait de savoir si le trésorier faisait bien rentrer l’argent !
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons à M. Gonelle. Après que vous avez communiqué l’information à M. Mangier, vous relance-t-il ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il ne vous en a plus jamais reparlé ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et avec vos amis socialistes, n’avez-vous jamais évoqué cette information ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non. J’ignorais ce qu’il était advenu du signalement – et le fait qu’il ne se passait rien tendait à démontrer que le compte était déclaré. Nous étions dans une région assez proche de l’Espagne, où beaucoup de gens possédent des appartements et des comptes.
M. le président Charles de Courson. N’avez-vous jamais revu M. Mangier ? Ne lui avez-vous pas demandé ce qu’il en était ?
M. Jean-Noël Catuhe. Si, je l’ai revu une fois ou deux à l’occasion de ses déplacements dans le Villeneuvois pour l’affaire dont je vous ai parlé, mais c’est tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand un signalement est fait, l’agent qui en est informé prévient-il ses collaborateurs ?
M. Jean-Noël Catuhe. Ce n’est pas obligatoire. Si le dossier a été transféré de Paris à Bordeaux, c’est que M. Mangier l’a demandé. Dans ce cas, une fiche de liaison a dû être rédigée, avec le motif de sa demande.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous l’avons.
M. Jean-Noël Catuhe. Vous devriez donc pouvoir vérifier le motif de sa demande.
M. Alain Claeys, rapporteur. A priori, il n’avait pas prévenu son supérieur hiérarchique…
M. Jean-Noël Catuhe. Ce n’est pas obligatoire.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas ce que celui-ci nous a dit !
M. Jean-Noël Catuhe. En théorie, M. Mangier aurait dû le faire, mais il est possible que, compte tenu de la personnalité en cause, il ait préféré ne rien dire ; il s’agissait tout de même d’un député !
M. Alain Claeys, rapporteur. Malheureusement, nous ne pouvons pas interroger M. Mangier, puisqu’il est décédé…
M. le président Charles de Courson. Il n’avait même pas révélé qui était sa source à son collègue et ami !
M. Jean-Noël Catuhe. Je pense qu’il s’est abstenu tout simplement parce qu’il s’agissait d’un dossier sensible.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans l’administration, quand il y a des dossiers sensibles, on s’abstient ?
M. Jean-Noël Catuhe. Cela peut être le cas.
M. le président Charles de Courson. Pourtant, son supérieur hiérarchique nous a déclaré qu’il estimait que M. Mangier avait commis une faute en ne l’informant pas. Il ignorait même qu’il avait demandé le dossier !
M. Jean-Noël Catuhe. Et son supérieur se rappelait parfaitement de tout cela en 2013 ?
M. le président Charles de Courson. C’est en tout cas ce qu’il nous a déclaré.
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons à M. Garnier. Depuis quand le connaissez-vous ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je suis arrivé à Villeneuve-sur-Lot en 1979, à peu près en même temps que lui à Agen… donc disons, depuis les années 1983-1985.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand avez-vous pris connaissance du mémoire qu’il a adressé le 11 juin 2008 à son administration centrale ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il m’en a donné communication la veille ou l’avant-veille de son envoi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il vous en a donné communication avant de l’envoyer ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, nous en avons parlé et il m’en a donné lecture.
Je rappelle le contexte : lorsque Rémy Garnier a commencé à avoir des ennuis, en novembre 2001, il s’est constitué un comité de soutien, auquel j’ai appartenu – je suis d’ailleurs l’un des rares à y être resté ; pourtant, à l’origine, toutes les organisations syndicales étaient présentes dans le bureau de Me Gérard Boulanger pour lui demander d’assurer la défense de Rémy Garnier !
M. Alain Claeys, rapporteur. En 2008, celui-ci vous donne donc lecture de son mémoire.
M. Jean-Noël Catuhe. Non, il ne m’en donne pas lecture, il me montre ce qu’il envoie. Je n’ai pas à donner mon avis.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous découvrez à cette occasion une page consacrée à Jérôme Cahuzac ; lui parlez-vous alors de l’information que vous détenez ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, c’est lui qui m’en parle. C’était antérieur.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment ça ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il détenait l’information antérieurement. Celle-ci m’avait échappé dans le cadre d’une discussion sur la fraude et sur les détenteurs de comptes à l’étranger.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est donc vous qui avez informé M. Garnier !
M. Jean-Noël Catuhe. Je l’ai informé… sans l’informer. Il s’avère que l’information m’a échappé dans le cadre d’une discussion entre collègues, dans mon bureau, sur la question des comptes à l’étranger. Je lui ai dit : « Tiens, notre député a dit un jour qu’il avait un compte à l’étranger », il m’a demandé où, et je lui ai répondu : « En Suisse ».
M. le président Charles de Courson. Pour la bonne information de la Commission, permettez-moi de vous lire les déclarations de M. Garnier :
« Pour ce qui est du compte suisse, je n’utilise pas le conditionnel car mes sources sont fiables. Je pense notamment à un collègue qui a eu l’enregistrement en sa possession… »
M. Jean-Noël Catuhe. Non : qui l’a entendu.
M. le président Charles de Courson. « …et qui m’en a avisé en 2002 ou 2003. »
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, c’est certainement cela.
M. le président Charles de Courson. C’est six ans avant l’envoi du mémoire !
M. Garnier poursuit : « Je ne suis pas absolument certain de la date : placé dans un placard, menacé de révocation, définitivement écarté du contrôle fiscal, j’avais à l’époque d’autres chats à fouetter. »
M. Jean-Noël Catuhe. L’information lui est délivrée par moi-même dans le cadre d’un échange professionnel : nous sommes alors dans l’enceinte d’un centre des impôts, nous parlons de fraude en général, et je dis, non pas que M. Jérôme Cahuzac a fraudé, mais que j’ai obtenu une information et que j’ai alerté la BII de Bordeaux ; puis nous parlons d’autre chose.
M. le président Charles de Courson. Quand cet échange a-t-il lieu ?
M. Jean-Noël Catuhe. Certainement en 2002, comme M. Garnier vous l’a dit. Mais pas plus que moi, celui-ci ne peut alors donner de suite à cette affaire. C’est à l’administration qui gère le dossier de M. Cahuzac ou à celle qui s’occupe des manquements fiscaux de s’en occuper.
M. Alain Claeys, rapporteur. En dehors de M. Garnier, à qui en parlez-vous ?
M. Jean-Noël Catuhe. À personne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous nous l’assurez ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Sauf à M. Mangier ?
M. Jean-Noël Catuhe. Sauf à M. Mangier, car c’est la personne ad hoc.
M. le président Charles de Courson. Et pourquoi ne dites-vous pas à M. Garnier d’appeler M. Mangier ?
M. Jean-Noël Catuhe. À l’époque, M. Garnier ne peut rien faire – il n’a d’ailleurs rien à faire puisque l’affaire n’est pas de son ressort. Ce n’est que lorsque l’administration l’affecte à la brigade d’études et de programmation qu’il décide de consulter le logiciel Adonis et qu’il ouvre le dossier de M. Cahuzac. A-t-il bien fait ou non, ce n’est pas à moi d’en juger, mais c’est à ce moment-là seulement qu’il vérifie l’information et regarde si la DNEF en a tenu compte. Mais moi, je reste en dehors de tout cela !
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’êtes pas en dehors, monsieur Catuhe, mais bien au cœur de tout cela !
M. Jean-Noël Catuhe. Non, monsieur le rapporteur : je suis au cœur du travail pour lequel l’administration me paie.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce n’est pas une accusation que je porte à votre encontre, mais c’est quand même vous qui prévenez M. Mangier et qui informez M. Garnier !
M. Jean-Noël Catuhe. Disons plutôt que M. Garnier tient l’information de moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous le lui dites dans le cours d’une conversation !
M. Jean-Noël Catuhe. Certes, mais il s’agissait d’une conversation entre collègues chargés de contrôle fiscal et qui sont tenus au secret. Cela n’avait pas vocation à être divulgué à l’extérieur – surtout quand on connaît le contexte villeneuvois ! Le fonctionnaire retraité que vous avez devant vous n’a jamais failli à sa mission.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Catuhe, nous ne sommes pas là pour vous mettre en accusation ; nous essayons simplement de comprendre ce qui s’est passé.
Lorsque Mediapart révèle l’existence de ce compte, en reparlez-vous à M. Gonelle ou à M. Garnier ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, je revois M. Gonelle dans le cadre de l’association dont il est le président, mais nous n’en parlons pas. Quand Mediapart publie l’information, j’éprouve plutôt de la gêne, parce que, si cela s’avérait exact, c’est que notre administration n’aurait pas fait son travail. Que M. Cahuzac avait un compte, je le savais, mais qu’il le détenait illégalement, cela restait à démontrer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et M. Garnier, l’avez-vous revu ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, je le vois régulièrement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Que vous êtes-vous dit ?
M. Jean-Noël Catuhe. Rien de spécial – d’autant qu’il était assailli par les journalistes. Il faut bien comprendre que je suis en dehors de tout cela. Il y a d’un côté, le combat que mène M. Garnier pour se défendre contre l’administration, de l’autre ce qu’on appelle « l’affaire Cahuzac » : ce sont deux choses différentes.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans l’enregistrement, la formulation utilisée par M. Cahuzac laisse tout de même entendre que le compte est illégal…
M. Jean-Noël Catuhe. Il dit également, même si ce n’est peut-être pas aussi audible : « Pour le peu qu’il y a dessus ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Peu importe la somme !
M. Jean-Noël Catuhe. Vous savez, s’il était resté 1 000 francs suisses, je pense que pas grand monde lui aurait tiré les oreilles !
M. le président Charles de Courson. Il s’agissait de 680 000 euros…
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous rencontré M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui, très souvent.
M. Alain Claeys, rapporteur. La dernière fois, quand était-ce ?
M. Jean-Noël Catuhe. À l’occasion du relogement des habitants de la cité Rieu à Villeneuve-sur-Lot ; comme mon épouse et moi défendons les intérêts d’une personne âgée isolée, nous avons assisté à la réunion. Nous l’avons ensuite revu durant la campagne des législatives.
M. Alain Claeys, rapporteur. À Villeneuve-sur-Lot, M. Gonelle et vous étiez les deux seules personnes à avoir eu connaissance de l’information ?
M. Jean-Noël Catuhe. Avec M. Garnier par la suite.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous été entendu par la justice ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous été en contact avec Mediapart ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et avec d’autres journalistes ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lesquels ?
M. Jean-Noël Catuhe. Des journalistes qui ont souhaité savoir s’il y avait eu un signalement en 2001.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand avez-vous été en contact avec eux ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il y a quelques mois.
M. le président Charles de Courson. De qui s’agissait-il ?
M. Jean-Noël Catuhe. Suis-je obligé de répondre ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Un journaliste n’est pas obligé de livrer ses sources, mais vous, vous êtes obligé de répondre !
M. le président Charles de Courson. S’agissait-il de journalistes parisiens ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui. C’était dans le cadre d’une émission de télévision, un très bref passage où il a été simplement dit qu’en 2001 il y avait eu un signalement.
M. le président Charles de Courson. Comment vous ont-ils contacté ?
M. Jean-Noël Catuhe. Probablement par l’intermédiaire soit de M. Garnier, soit de M. Gonelle. J’ai accepté parce que j’ai reçu leur appel le lendemain du jour où M. Cahuzac a affirmé devant votre noble assemblée qu’il n’avait jamais détenu de compte à l’étranger. En tant que citoyen, j’ai très mal supporté ce mensonge ; j’ai donc accepté de confirmer aux journalistes que j’avais signalé le fait à l’administration en 2001.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous pris contact spontanément ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non. J’ai simplement répondu favorablement à leur demande. Jusqu’alors, j’avais toujours refusé.
M. le président Charles de Courson. Comment le journaliste vous connaissait-il ?
M. Jean-Noël Catuhe. Pardonnez cette réponse quelque peu irrévérencieuse, mais comment m’avez-vous connu, monsieur le président ?
M. le président Charles de Courson. Eh bien, je vais vous répondre, monsieur Catuhe, en vous lisant un extrait du compte rendu de l’audition de M. Gonelle :
« M. le président Charles de Courson. Ce n’est donc pas à lui, mais à un autre fonctionnaire des impôts que vous avez fait écouter l’enregistrement.
M. Michel Gonelle. En effet, c’est à un fonctionnaire qui fait depuis longtemps partie de mon entourage, et que j’aime beaucoup. Il a été président de la Ligue des droits de l’homme. Il est aujourd’hui à la retraite, mais je le fréquente toujours autant.
M. le président Charles de Courson. Vous ne voulez pas nous donner son nom ?
M. Michel Gonelle. Pas sans son accord. »
En outre, lors de son audition, votre collègue Garnier a ajouté : « Il a une épouse qui travaille dans le même secteur ».
À Villeneuve-sur-Lot, seule une personne répondait à tous ces critères !
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous été en contact avec le juge Bruguière ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non, je ne l’ai rencontré qu’une fois, il y a très longtemps, alors qu’il était encore en activité, lorsqu’il était venu à Pujols faire une conférence sur le terrorisme. Je ne l’ai jamais revu.
M. Alain Claeys, rapporteur. N’avez-vous jamais eu l’enregistrement en votre possession ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Êtes-vous convaincu que cet enregistrement provient d’un appareil téléphonique ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui. Comme je l’ai dit, j’ai du reste été moi-même piégé plusieurs fois de la sorte. Les circonstances et la voix m’ont permis de reconnaître M. Cahuzac, que je voyais à l’époque très régulièrement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu des différends avec M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Mangier vous a-t-il jamais reparlé de cette affaire ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jamais ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. N’avez-vous jamais eu la curiosité de lui en reparler vous-même ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non. Je n’allais pas m’acharner sur une personne de la même sensibilité politique que moi, ni pour autant lui faire de cadeaux – la preuve : j’ai livré l’information, comme tout citoyen se doit de le faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comme tout citoyen ? M. Gonelle ou vous-même auriez pu faire un signalement au procureur.
M. Jean-Noël Catuhe. J’avoue humblement que j’ignorais à l’époque que ce fût possible. Je sais les ennuis qu’a eus M. Garnier à cet égard et qu’il vous a exposés. Dans une affaire où je l’accompagnais pour procéder à des évaluations patrimoniales chez un industriel, alors que l’administration lui avait affirmé qu’elle le soutenait dans une démarche de signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, M. Garnier a finalement été laissé seul face à tous ces désagréments. Ce n’est qu’après cette affaire que l’administration a rédigé une note prescrivant de passer systématiquement par la voie hiérarchique. C’est à cette occasion que j’ai découvert l’article 40.
M. le président Charles de Courson. M. Garnier a déclaré qu’il avait parlé à M. Gonelle de l’information que vous lui aviez transmise – c’était, sauf erreur de ma part, en 2006. D’après ses déclarations, M. Gonelle lui a confirmé que l’enregistrement existait bien. M. Garnier vous en a-t-il reparlé ?
M. Jean-Noël Catuhe. M. Garnier était surnommé « Columbo » – le monsieur qui fait semblant de partir et qui pose alors la question qui fâche. J’avais même oublié que je lui avais parlé d’un compte bancaire de M. Cahuzac mais, lorsqu’il s’en est souvenu, il a pris la liberté de poser la question à M. Gonelle, qui était désormais son avocat pour toutes les procédures pénales en cours, puis il n’a utilisé le logiciel que lorsque ses fonctions et son poste le lui ont permis.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour couper court à toute discussion avec M. Gonelle, vous lui avez dit que le dossier n’avait pas été transféré.
M. Jean-Noël Catuhe. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, si le dossier n’est pas transféré, on ne sait pas ce qu’il est advenu et il n’y a rien à dire. Je garantissais le secret professionnel – le secret fiscal –, et cela d’autant que je n’avais rien à voir avec cette affaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais si !
M. Jean-Noël Catuhe. Non. Si je m’étais immiscé dans cette affaire ou avais interrogé mon collègue, il y aurait eu violation du secret. Ce serait grave.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous acceptez de faire un signalement parce que vous êtes ami avec M. Gonelle…
M. Jean-Noël Catuhe. Je l’aurais fait même si tel n’avait pas été le cas.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quel titre en avez-vous parlé à M. Garnier ?
M. Jean-Noël Catuhe. À l’occasion d’une discussion sur la fraude. Cela m’a tout simplement échappé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et cela ne vous aurait-il pas échappé une autre fois ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. le président Charles de Courson. N’en avez-vous même pas parlé à votre épouse ?
M. Jean-Noël Catuhe. C’est une question personnelle et délicate…
M. le président Charles de Courson. Elle fait le même métier que vous.
M. Jean-Noël Catuhe. Même si elle le sait, elle a l’obligation de ne rien dire à personne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les choses ne sont pas simples, à Villeneuve-sur-Lot !
M. Jean-Noël Catuhe. Elles sont loin d’être simples, en effet. En arrivant là-bas, venant de la région parisienne, j’ai été ébahi par la vie culturelle, par la vie politique et par bien des choses encore, comme l’absence de fiscalité – c’était un territoire où il n’y avait pas d’impôts, où tout le monde trichait. Lors de la création du centre des impôts en 1981, ça n’a pas été facile.
M. Alain Claeys, rapporteur. Y a-t-il eu, dans le cadre communal, des contentieux entre M. Gonelle et M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. À ma connaissance, non. Je ne pense pas.
M. le président Charles de Courson. Aviez-vous conscience de l’importance que pouvait avoir l’information que vous donniez à M. Garnier ?
M. Jean-Noël Catuhe. Pas du tout. J’ai été à l’origine de contrôles fiscaux visant beaucoup d’autres personnes, d’entreprises importantes ou de contribuables exerçant des professions libérales, à la suite d’exactions ou de non-dépôt de déclaration. Pour moi comme pour M. Mangier, M. Cahuzac n’était qu’un contribuable et la situation ne nous faisait pas peur. Nous sommes là pour appliquer les lois que vous votez et n’avons pas à avoir d’états d’âme.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel est habituellement le cheminement d'un signalement fiscal ?
M. Jean-Noël Catuhe. Si le renseignement provient d’un aviseur anonyme – une « personne digne de foi », selon l'expression de la brigade de contrôle et de recherches au niveau départemental –, il est transmis au service qui gère la fiscalité des professions libérales, des sociétés commerciales, industrielles ou autres – il en était en tout cas ainsi avant la fusion des administrations du Trésor et des impôts. Si le renseignement est immédiatement exploitable, ce service l’exploite. S'il s'agit de diligenter une vérification générale, il faut rédiger un petit rapport pour démontrer l'utilité et le rendement fiscal de cette démarche et mettre en exergue tous les manquements.
M. le président Charles de Courson. La question du rapporteur était de savoir si cette démarche reposait sur un signalement oral ou sur une note écrite.
M. Jean-Noël Catuhe. Je n’ai pas fait de note.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez déclaré avoir une sensibilité politique proche de celle de M. Cahuzac et vous allez voir à son cabinet M. Gonelle, concurrent politique de M. Cahuzac, qui vous dit : « Écoute ça ! » – j’ignore, du reste, si vous vous tutoyez…
M. Jean-Noël Catuhe. Non, pas à l'époque. Quant à M. Cahuzac, il m'a toujours tutoyé et je l'ai toujours vouvoyé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque M. Gonelle vous demande d'écouter cet enregistrement accusateur pour M. Cahuzac, ne le renvoyez-vous pas vers la justice ? Pourquoi M. Gonelle, qui est avocat, vous utilise-t-il au lieu de s'adresser à celle-ci ?
M. Jean-Noël Catuhe. C’est parce que nous sommes en 2013 que nous pouvons aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, parler d'« utilisation ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel était, en 2002, le contexte expliquant cette attitude ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il s'agit d'abord du contexte politique, que M. Gonelle vous a parfaitement exposé – et je souscris pleinement à ses explications. La situation est assez pénible à Villeneuve-sur-Lot en période d’élection, comme on l'a vu encore dernièrement. Il faut souscrire à ces explications. En revanche, l’information selon laquelle il existait un compte et qu'il n'y avait presque rien sur ce compte me décide à conseiller le signalement, car…
M. Alain Claeys, rapporteur. …ce n’est pas grave ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non : car ce compte est certainement déclaré par M. Cahuzac. Quant à dire que ce n’est pas grave, vous n’entendrez jamais ce propos dans la bouche d’un agent des impôts.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez déclaré que vous aviez immédiatement reconnu la voix de M. Jérôme Cahuzac en écoutant l'enregistrement. Le confirmez-vous ?
M. Jean-Noël Catuhe. Oui. Je le confirme.
Mme Cécile Untermaier. Sa voix est donc facilement identifiable ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je voyais régulièrement M. Cahuzac, qui a en effet une voix identifiable, un parler, une diction qui se reconnaissent facilement, surtout dans le Lot-et-Garonne.
M. le président Charles de Courson. Est-ce à dire qu'il parle « pointu » ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il a une voix reconnaissable, comme vous le savez, puisqu'il a été l'un de vos collègues.
Mme Cécile Untermaier. Le collègue de M. Mangier a rapporté que vous souhaitiez conserver l'anonymat en effectuant le signalement. Est-ce exact ?
M. Jean-Noël Catuhe. J’ai rencontré M. Mangier seul dans son bureau.
Mme Cécile Untermaier. Lui avez-vous demandé de conserver l’anonymat ?
M. Jean-Noël Catuhe. Pas du tout.
M. le président Charles de Courson. Le collègue et ami de M. Mangier a déclaré que celui-ci lui avait dit qu’il ne pouvait pas révéler le nom de la personne qui lui avait fourni l’information.
M. Jean-Noël Catuhe. C’est une initiative de M. Mangier. Je ne lui ai nullement demandé de rester anonyme. Au contraire : si l’information faisant l’objet du signalement s’était révélée exacte, j’aurais été interrogé et on m’aurait demandé qui était ma source, ce qui est un cheminement normal.
M. Alain Claeys, rapporteur. En délivrant une fausse information à M. Gonelle, vous mettiez en difficulté votre administration.
M. Jean-Noël Catuhe. Je ne lui ai pas délivré une fausse information, mais une « non-information ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Non. Une non-information aurait consisté à dire que vous n’étiez pas au courant. En revanche, dire que le dossier n’est pas redescendu à Bordeaux est une information : cela signifie, en creux, que l’administration n’a pas fait son travail.
M. le président Charles de Courson. Ou que le dossier a été classé.
M. Jean-Noël Catuhe. Je n’ai pas à répondre à M. Gonelle : ce serait faillir à mon obligation de réserve.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est pourtant ce que vous faites en lui disant que l’administration n’a pas fait redescendre le dossier.
M. Jean-Noël Catuhe. Je considère qu’il s’agit plutôt d’une non-réponse, qui permet d’éluder toute obligation de questionnement sur le contenu du dossier.
M. le président Charles de Courson. M. Gonelle a cru qu’il s’agissait d’une vraie réponse, car il nous en a fait état lors de son audition. Il a même émis des hypothèses sur un éventuel classement du dossier.
M. Jean-Noël Catuhe. Je n’en ai jamais parlé avec M. Gonelle.
Mme Cécile Untermaier. Considériez-vous le signalement auquel vous avez procédé comme une procédure normale, portant votre nom et assortie d’assez d’explications pour permettre l’instruction du dossier fiscal ?
M. Jean-Noël Catuhe. Tout à fait. Cela ne posait aucun problème.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Monsieur Catuhe, vous êtes inspecteur des impôts, fonctionnaire de catégorie A, et venez de déclarer que vous ne connaissiez pas l’article 40 du code de procédure pénale, ce qui est assez étonnant dans une administration de contrôle et de vérification que M. Bruno Bézard décrit comme une administration de rigueur.
M. Jean-Noël Catuhe. C’est en effet une excellente administration.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Après avoir entendu un enregistrement susceptible d’avoir des incidences graves, vous « oubliez » l’article 40 parce que vous ne le connaissez pas et vous ne divulguez pas ce que vous savez au procureur de la République ou à un service judiciaire, ce que le simple souci de votre propre protection justifierait pourtant déjà.
M. Jean-Noël Catuhe. Je crois que j’ai déjà répondu. Vous me faites grief de ne pas avoir connu à cette époque l’article 40 et, en effet, je n’ai appris que plus tard son existence – il faudrait insister davantage là-dessus à l’école nationale des impôts. Je considère cependant que j’ai fait mon travail de fonctionnaire de l’administration fiscale en signalant le fait à la personne qui était à même d’effectuer les contrôles. Je ne pouvais pas faire davantage. Que serais-je allé faire, à l’époque, chez le procureur ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Vous faites donc un signalement sans écrit, sans traçabilité ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je ne sais pas ce qui a été écrit dans ce document, dont vous disposez et dont je n’ai pas eu connaissance. Certains départements opèrent de manière différente, mais il s’agit ordinairement d’un bulletin de liaison demandant la transmission du dossier en exposant les motifs de la demande.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Catuhe, dans ce document, dont nous disposons en effet, la seule case cochée est celle qui porte la mention : « pour consultation », sans aucune explication.
M. Jean-Noël Catuhe. Normalement, M. Mangier aurait dû mentionner le motif de la demande.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ne faisons pas parler quelqu’un qui n’est plus là.
M. Jean-Noël Catuhe. Il est dommage à tous égards que M. Mangier soit décédé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il ne vous a pas demandé à écouter l’enregistrement, pour avoir une preuve ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Votre comportement ne laisse pas de m’étonner : vous êtes inspecteur des impôts, chargé de vérifications, et recherchez des éléments concernant des situations individuelles, mais vous ne prenez pas de précautions de traçabilité, ne passez pas par la voie hiérarchique et ne gardez pas d’éléments qui pourraient être utiles en cas de problème.
M. Jean-Noël Catuhe. Le problème ne peut pas se poser à mon niveau – je regrette d’y insister. C’est la personne informée par moi qui doit rédiger le document et y préciser le motif de sa demande. Lorsque je demandais un dossier, ce n’était pas pour simple consultation – ce serait trop facile. Il faut mentionner sur le dossier s’il est demandé, par exemple, pour un contrôle sur pièces ou pour contrôler le revenu foncier. Lorsque le document sort de l’armoire où il est conservé, une fiche – verte, à cette époque – indique que le dossier est chez M. Catuhe. J’ignore quel est le document dont vous disposez, mais s’il n’a pas été rédigé de manière complète, on ne peut pas m’en accuser, ni me prêter l’intention d’avoir voulu agir d’une manière anormale. Lorsque j’ai suivi ma formation d’inspecteur à l’école nationale des impôts, à Clermont-Ferrand, il n’a jamais été question de l’article 40. Ces dossiers vont devant les tribunaux et une cellule spéciale leur est consacrée : ce n’était pas à l’inspecteur des impôts de s’en charger. M. Garnier, en revanche, vous en parle à juste titre, car il traite de gros dossiers et se situe à une échelle qui n’est pas la nôtre – surtout dans notre région, où les gens ne sont pas très riches.
M. Dominique Baert. La commission d’enquête s’intéresse à l’obtention et à la détention des premiers exemplaires de l’enregistrement, ainsi qu’à la transmission de cette information, c’est-à-dire aussi à la transmission des supports. Vous avez déclaré tout à l’heure que vous aviez écouté cet enregistrement sur l’ordinateur de M. Gonelle, dans son cabinet. Vous souvenez-vous du support de cet enregistrement ? S’agissait-il d’une clé USB ou d’une disquette dans l’ordinateur ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je ne pense pas qu’il s’agissait d’une clé USB. C’était certainement un CD, car ce support était plus répandu à cette époque.
M. Dominique Baert. M. Gonelle ne vous a donc pas proposé de vous confier le support pour écouter l’enregistrement.
M. Jean-Noël Catuhe. Non. Entendre cela était pour moi une surprise – pour ne pas dire un traumatisme. Cela l’était aussi pour lui.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi M. Gonelle vous a-t-il appelé pour vous faire entendre cet enregistrement ? Vous êtes-vous demandé quelles étaient ses motivations ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je ne peux pas répondre à sa place, mais sa démarche ne m’a pas surpris outre mesure. Il avait en face de lui…
M. Jean-Marc Germain. Un ami de M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. Pas un ami, mais une connaissance.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ne pouviez-vous pas vous saisir de ce signalement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour quelle raison ?
M. Jean-Noël Catuhe. M. Cahuzac n’était pas « mon » contribuable. Il ne dépendait pas du Lot-et-Garonne, mais de Paris.
M. le président Charles de Courson. La brigade interrégionale d’intervention (BII) est à Bordeaux et on nous a expliqué que la question relevait de l’antenne locale.
M. Jean-Marc Germain. Si M. Cahuzac était candidat aux municipales, il devait payer des impôts à Villeneuve-sur-Lot.
M. Jean-Noël Catuhe. Il était encore député, mais pas encore conseiller municipal.
M. le président Charles de Courson. Une disposition du code électoral permet à un député de se présenter aux municipales n’importe où dans sa circonscription.
M. Jean-Marc Germain. M. Bruguière et M. Gonelle nous ont tous deux déclaré que ce n’étaient pas eux qui avaient transmis l’enregistrement à la presse. Confirmez-vous que l’enregistrement se trouvait sur un CD ?
M. Jean-Noël Catuhe. Je le pense, car le lecteur d’un ordinateur est un lecteur de CD.
M. Jean-Marc Germain. Avez-vous vu M. Gonelle mettre le CD dans son ordinateur ?
M. Jean-Noël Catuhe. Non. Ce qui m’a marqué, ce sont le contenu – surtout lorsque j’ai reconnu la personne qui parlait – et les circonstances.
M. Jean-Marc Germain. Qu’avez-vous vu de l’ordinateur ? S’agissait-il bien d’un enregistrement audio ?
M. Jean-Noël Catuhe. Comme c’était souvent le cas à l’époque – avant les Mac, où tout est situé dans la partie haute de l’ordinateur –, l’unité centrale se trouvait en bas. Je ne l’ai pas regardée précisément et ne peux pas vous donner plus de précisions.
M. Jean-Marc Germain. M. Gonelle vous a-t-il donné des éléments sur la manière dont il avait obtenu cet enregistrement ?
M. Jean-Noël Catuhe. Il me l’a expliqué à ce moment-là.
M. Jean-Marc Germain. Vous a-t-il dit comment il en avait fait faire la copie ? La personne qui a fait cette copie peut en effet être celle qui a diffusé l’enregistrement. Avez-vous des informations à ce propos ?
M. Jean-Noël Catuhe. Aucune.
M. le président Charles de Courson. Il s’agit là en effet de la troisième piste. Nous interrogerons à nouveau M. Gonelle, car deux ou trois personnes ont détenu l’enregistrement au moment où il a été procédé à la « migration » de celui-ci du téléphone vers le support d’enregistrement.
M. Philippe Houillon. Avez-vous, à un moment ou à un autre, participé à la campagne électorale, municipale ou législative, de M. Cahuzac ?
M. Jean-Noël Catuhe. Lorsque M. Cahuzac a commencé à organiser des réunions pour les élections municipales, j'ai assisté à une ou deux de celles-ci. Ce furent mes deux seules participations. Au moment de voter, j'étais absent de Villeneuve-sur-Lot. Je n'ai pas davantage participé aux campagnes de M. Gonelle. Je ne suis pas politique et j'ai assez d'activités par ailleurs.
Permettez-moi de citer un propos de Billaud-Varenne, qui déclarait en 1793 que « dans tout État civilisé, la première nuance que l'on découvre présente deux classes d'hommes bien distinctes : les citoyens et les individus. Les citoyens sont ceux qui, pénétrés de leurs devoirs sociaux, rapportent tout à l'intérêt public et qui mettent leur bonheur et leur gloire à cimenter la prospérité de leur pays. Les individus, au contraire, sont ceux qui s'isolent, ou plutôt qui savent moins travailler au bien public que calculer leur intérêt particulier ». À mon humble niveau, je revendique appartenir à la première catégorie.
M. le président Charles de Courson. Je sais que vous aviez, en vous rendant à cette audition, quelques inquiétudes pour votre épouse, qui est toujours en activité. Je tiens à vous rassurer. S’il y a un problème, vous viendrez me voir : M. le rapporteur et moi-même nous en occuperons.
M. Jean-Noël Catuhe. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je vous remercie. L’administration m’a servi, car l'État a financé mes études – je ne suis pas entré par vocation à la Direction générale des impôts et je doute, du reste, que ce soit le cas de grand-monde. Je me suis efforcé quant à moi, tout au long de ma carrière, de la servir avec honnêteté et loyauté.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Catuhe, je vous remercie.
(…)
M. Alain Claeys, rapporteur. Je souhaiterais ajouter une mot. J’ai réagi vivement tout à l’heure aux propos choquants de M. Pierre Condamin-Gerbier, qui a publiquement jeté une suspicion sur la commission d’enquête et sur ses membres, citant en outre deux députés, MM. Éric Woerth et Patrick Devedjian, à propos d’une affaire qui n’a rien à voir avec celle dont nous sommes saisis. On ne peut accepter que des membres de cette commission soient mis en cause.
M. le président Charles de Courson. Et cela d’autant moins que le différend évoqué n’avait aucun lien avec notre commission d’enquête.
Audition du mardi 9 juillet 2013
À 9 heures : Mme Marie-Christine Lepetit, chef du service de l'inspection générale des finances, ancienne directrice de la législation fiscale.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous accueillons ce matin Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l’inspection générale des finances et ancienne directrice de la législation fiscale de 2004 à 2012.
Beaucoup a été dit et écrit sur les conditions dans lesquelles la procédure de coopération entre administrations fiscales a été mise en œuvre. Nous souhaiterions toutefois mieux comprendre la portée de l’avenant du 27 août 2009 à la convention fiscale franco-suisse et l’interprétation de celui-ci qui résulte d’un échange de lettres, datées du 11 février 2010, entre vous-même et votre homologue suisse.
(Mme Marie-Christine Lepetit prête serment.)
Mme Marie-Christine Lepetit, chef du service de l’inspection générale des finances, ancienne directrice de la législation fiscale. Ainsi que vous l’avez indiqué, monsieur le président, je suis auditionnée par votre commission au titre de mes anciennes fonctions de directeur de la législation fiscale, que j’ai exercées de 2004 à 2012. Je suis par conséquent dans l’ignorance des conditions de déroulement de la demande d’information qui a eu lieu durant la période couverte par vos travaux. En revanche, dans le cadre de ces fonctions, j’ai eu l’occasion de suivre à de nombreuses négociations et, en particulier, de piloter l’évolution du régime conventionnel de la France pour le compte du Gouvernement. C’est donc sur ce point que je concentrerai mon propos introductif.
Je voudrais tout d’abord rappeler dans quel contexte ont été négociés, en 2009 et dans les mois qui ont suivi, les nouvelles conventions, les modifications des conventions existantes et les accords d’échange de renseignements.
L’évolution du dossier relatif à la transparence fiscale nous causait alors une certaine déception. L’Union européenne d’un côté, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de l’autre, s’efforçaient de faire progresser la transparence et de lutter contre ce qu’on appelle « les pratiques fiscales dommageables », mais cette action – qui faisait d’ailleurs l’objet d’une certaine compétition entre les deux institutions – avait du mal à franchir des étapes significatives. La proposition de modification de la « directive épargne » piétinait et la discussion sur le secret bancaire était close, dans un sens favorable à une acceptation, ou une tolérance, envers les pays hébergeant des places financières importantes ; a fortiori, l’échange automatique d’informations bancaires n’était pas d’actualité !
Au moment du G20, début avril 2009 : les pays membres annoncent le lancement d’une action en faveur de la transparence des pratiques fiscales et des informations afférentes. Dans la crainte de mesures de rétorsion et de la privation d’accès à certains marchés, plusieurs pays ou juridictions déclarent, dans les jours ou les semaines qui entourent la réunion, qu’ils vont se conformer aux standards de l’OCDE. C’est ainsi qu’à la mi-mars 2009, la Suisse se dit prête à discuter avec les pays qui le souhaitent d’une mise à jour de son réseau conventionnel en matière fiscale.
À l’été 2009, les banquiers suisses mènent une contre-offensive en essayant de faire prévaloir une alternative aux standards de l’OCDE ; ils font le pari que certains pays préféreront obtenir des recettes fiscales immédiates par le truchement d’une retenue à la source organisée par la Suisse plutôt que d’organiser un échange d’informations. Entre la mi-2009 et 2010, le projet « Rubik », qui bénéficie du soutien du Royaume-Uni et de l’Allemagne, exerce ainsi une pression inverse à celle du G20. Ne permettant ni la perception d’un impôt personnalisé, ni l’application d’impôts patrimoniaux comme l’ISF – puisqu’il ne portait que sur les revenus –, un accord de ce type serait allé à l’encontre du souhait de la France de voir progresser les échanges de renseignements afin de pouvoir appliquer l’ensemble de la législation fiscale française. C’est un point important pour comprendre le contexte des négociations et les pressions qui s’exerçaient sur les parties prenantes.
J’en viens à l’explication du sens des textes convenus avec la Suisse, d’abord en 2009, puis au début de 2010.
À compter de mars 2009, les négociations avec la Suisse reprennent et elles se concluent assez rapidement, puisqu’un avenant à la convention fiscale franco-suisse est signé par les ministres le 27 août 2009. Cet avenant était conforme aux standards de l’OCDE : il prévoyait un échange de renseignements à la demande, dans les conditions définies par le modèle de convention et ses commentaires. Mais pour qu’il possède une portée juridique, il fallait que les parlements des deux pays en autorisent la ratification.
Or, le processus est bloqué par la Suisse à la mi-décembre 2009 au double motif que celle-ci entend faire plier la France sur l’utilisation des données de la liste HSBC et qu’elle souhaite obtenir une interprétation conforme à ses vœux des standards de l’OCDE. On se retrouve donc dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’avenant ; il faut engager une négociation complémentaire afin de chercher un terrain d’entente pour parvenir à un accord sur un échange de renseignements levant effectivement le secret bancaire.
La négociation se conclut le 11 février 2010 par un échange de lettres entre autorités administratives, faisant suite à une discussion à l’échelon ministériel ; son objet est d’obtenir l’application des standards de l’OCDE, la levée du secret bancaire et la possibilité pour la France d’interroger les autorités suisses sans que le nom de la banque concernée soit mentionné. C’est d’ailleurs cette interprétation qui guide la rédaction du communiqué de presse du 12 février 2010 et qui est communiquée à la représentation nationale au cours du processus de ratification de l’avenant. C’est la lecture de la France au moment où elle signe ce document.
Le texte comporte des dispositions complémentaires. Il vise non seulement à autoriser les échanges de renseignements, mais aussi à améliorer l’assistance de la Suisse en matière de recouvrement – disposition dont d’autres pays ne bénéficiaient pas. La France a fait en sorte que le champ d’application du texte réponde à ses besoins fiscaux.
Pour ce qui est de la mise en pratique de ces dispositions, les informations dont je dispose ne me permettront pas d’éclairer pleinement votre commission. J’ai en effet quitté mes fonctions peu après l’entrée en vigueur de l’avenant et de surcroît, je n’étais pas en charge de l’interrogation concrète des pays dans le cadre de l’assistance administrative – ce sont les services du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui en sont chargés. Toutefois, j’ai préparé le rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements annexé au projet de loi de finances pour les années 2011 et 2012 ; j’ai pu constater dès lors que la Suisse était un pays qui répondait tardivement, voire pas du tout, à nos demandes, et qui avait deux défauts principaux : le premier était d’aviser systématiquement le contribuable des démarches le concernant, ce qui est assez souvent une difficulté majeure dans le cadre d’un contrôle fiscal ; le second, d’appliquer de manière très restrictive le concept de demande « vraisemblablement pertinente » faisant une lecture des demandes d’assistance très étroite comparativement à d’autres pays : les autorités suisses avaient dès cette époque tendance à faire valoir auprès des services du contrôle fiscal que les demandes qui lui étaient adressées ne correspondaient pas à sa propre lecture des documents de l’OCDE et des textes conventionnels.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce bien la période postérieure au 11 février 2010 que vous évoquez ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Oui, mais je précise que je n’ai connu que le début de l’application de l’avenant. Comme on manquait de recul et d’occurrences, les rapports transmis à la représentation nationale ne sont pas « catégoriques » sur la collaboration des autorités de Jersey, de la Suisse, de Singapour et des îles Caïman, officiellement entrés dans des processus de conventionnement ou d’accords. On pouvait difficilement engager une action diplomatique sans disposer de faits concrets suffisants pour l’étayer.
J’ignore quelle est la situation actuelle, mais je crois que la Suisse fait toujours une lecture très singulière des standards de l’OCDE et des accords qu’elle a conclus – en tout cas, ce n’est clairement pas la même que celle qu’avait la France en 2009, puis en 2010. Cette question est très importante : une chose est de disposer de textes juridiques, autre chose de les faire appliquer en respectant l’intention de leurs auteurs !
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous définir en quelques mots la norme de l’OCDE en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Le standard de l’OCDE – du moins tel que je l’ai connu, car il a évolué dans l’intervalle – comporte trois types d’échanges de renseignements : l’échange spontané, l’échange à la demande, l’échange automatique. Seul le deuxième a fait l’objet, d’abord d’annonces de la part du G20, puis d’une adaptation des réseaux conventionnels.
L’échange de renseignements à la demande consiste, à partir d’une demande circonstanciée émise par une partie requérante – et non d’une demande « au petit bonheur » –, à interroger une partie requise pour obtenir un renseignement que la partie requérante ne détient pas et dont elle a besoin pour diligenter une enquête fiscale. Le standard de l’OCDE ne se réduit donc pas, contrairement à ce que paraissent croire certaines autorités suisses, à la validation d’une information déjà acquise.
Ce qui fait parfois débat, c’est de savoir jusqu’à quel point le pays requérant doit documenter la demande ou peut faire état de son absence de connaissance d’une situation tout en mettant l’État saisi dans l’obligation de déployer les moyens lui permettant de répondre. Le standard de l’OCDE propose en effet un subtil équilibre entre l’affirmation de principe que le pays requérant a le droit d’interroger largement le pays requis et d’obtenir de lui une réponse, et une série de précautions encadrant ce principe visant à éviter que soient adressées des demandes au hasard, ou s’écartant du domaine strictement fiscal, ou encore irrespectueuses des règles du pays requis. Ce qui explique que le standard de l’OCDE ne soit pas facilement compréhensible… On retrouve ce même équilibre dans l’avenant à la convention avec la Suisse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites qu’il y a trois conséquences aux échanges de lettres : l’application du standard de l’OCDE, la levée du secret bancaire et la possibilité d’interroger les autorités suisses sans que le nom d’une banque ne soit mentionné. Vous précisez ensuite que la Suisse a une lecture très singulière de cet accord. Cela signifie-t-il que, malgré l’échange de lettres, les autorités françaises et les autorités suisses continuent à faire des interprétations différentes de la convention ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Ayant quitté la direction de la législation fiscale depuis quinze mois, je ne peux pas répondre à cette question ; mais durant la période que j’ai connue, la Suisse était souvent réticente à nous répondre, vraisemblablement parce qu’elle considérait que nos demandes n’étaient pas pertinentes.
M. Alain Claeys, rapporteur. S’agissait-il d’une application restrictive de l’accord matérialisé par l’échange de lettres ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Durant cette période, nous n’avons rencontré aucun cas permettant de tester la Suisse sur ce sujet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans ce cas, pourquoi dites-vous que sa lecture des accords est « très singulière » ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Parce que, dans le cadre de la préparation des rapports sur l’application des conventions destinés au Parlement, on m’a communiqué le nombre de demandes adressées, le nombre de réponses reçues, les délais de réponse et déjà des indications qui montraient que la Suisse faisait une interprétation restrictive des accords.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le point XI, inséré dans le protocole additionnel, prohibe expressément la « pêche aux renseignements » et, de manière générale, ne prévoit pas d’échange de renseignements spontané ou automatique. Qu’en est-il avec les autres pays, hors Union européenne, liés à la France par une convention d’assistance administrative ? En particulier, la « pêche aux renseignements » est-elle possible avec Singapour ?
Mme Marie-Christine Lepetit. La « pêche aux renseignements », qui consiste à interroger « en l’air » une administration fiscale en lui demandant de fournir des informations détaillées à partir de listings insuffisamment documentés, est bannie par le standard de l’OCDE relatif à l’échange à la demande. Le point singulier de l’accord avec la Suisse, ce n’est pas cela, c’est la description inhabituellement détaillée des modalités de demandes de renseignements.
J’ajoute qu’à l’époque, l’Allemagne et la France ne négociaient pas leurs conventions de façon concordante. L’Allemagne souhaitait pouvoir faire porter l’interrogation sur des ensembles de contribuables indéterminés, de manière à diligenter un contrôle fiscal sur les contribuables concernés à partir de la connaissance d’une même opération économique. Une telle exigence crispait les Suisses. La France aurait été intéressée par cette possibilité, mais sa priorité, à l’époque, était de pouvoir adresser une demande de renseignement et obtenir la levée du secret bancaire sans connaître le nom de la banque. Nous souhaitions nous assurer que, si l’on avait épuisé les procédures internes et si le dossier du contribuable était suffisamment documenté, mais si l’on n’avait pas identifié l’établissement financier concerné par une possible fraude fiscale, on pourrait néanmoins interroger la Suisse et obtenir une information permettant d’identifier la banque.
Il est vrai que la notion de « pêche aux renseignements » est quelque peu ambiguë : pour nous, à l’époque, cela concernait l’identification de contribuables ; aujourd’hui, il s’agit plutôt de l’identification de la banque. C’est en fait un peu les deux à la fois, mais le terme n’est pas défini avec précision dans le protocole de l’OCDE.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’apporte l’échange de lettres du 11 février 2010 par rapport à ce qui avait été négocié auparavant ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Par rapport à la convention telle qu’elle a été ratifiée, il permet la levée du secret bancaire et l’application du standard de l’OCDE.
Par rapport à l’avenant d’août 2009, – mais qui n’avait aucune existence juridique puisqu’il n’était pas ratifié et nous savions qu’il ne le serait pas en l’état – il constitue une interprétation limitative, puisqu’il précise à quelles conditions on pourra interroger la Suisse sans connaître le nom de la banque concernée. Le 6e alinéa de la lettre du 11 février, qui commence par « Dans le cas exceptionnel… » permet d’interroger sans connaître le nom de la banque mais limite les conditions dans lesquelles on peut le faire. Par rapport à un avenant générique – qui n’avait aucune réalité et n’en aurait jamais eu – il est restrictif. Par rapport à la situation juridique existante, il permet enfin la levée du secret bancaire avec la Suisse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Aux termes de cet échange épistolaire, il est en effet prévu que « dans tous les cas où l’État requérant (...) aura connaissance du nom de l’établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné, il communiquera cette information à l’État requis. Dans le cas exceptionnel où l’autorité requérante présumerait qu’un contribuable détient un compte bancaire dans l’État requis sans pour autant disposer d’informations lui ayant permis d’identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l’identification de cette banque ».
Cela signifie-t-il qu’en faisant expressément état d’un doute, il est possible, à titre exceptionnel, d’interroger l’administration suisse sans spécifier d’établissement de crédit ou sans se limiter à l’établissement mentionné ? D’après votre expérience, pourquoi, le 24 janvier 2013, l’administration française ne fait-elle pas état d’un doute lorsqu’elle interroge les autorités suisses sur les avoirs de M. Jérôme Cahuzac, alors qu’elle ne dispose que des éléments publiés par la presse ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Ne connaissant pas le dossier de M. Cahuzac, ni la forme qu’a prise l’interrogation de l’administration fiscale française, je ne suis pas en mesure de vous éclairer sur ce sujet, monsieur le rapporteur.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’administration française aurait-elle pu formuler une demande plus large aux autorités suisses ?
Mme Marie-Christine Lepetit. En théorie, au regard des intentions de la France au moment où elle a signé ces documents, et sous réserve que le dossier remplissait les conditions mentionnées à la fois dans la lettre du 11 février et dans le protocole joint à l’avenant, tout était fait pour permettre d’interroger les autorités suisses sans connaître le nom de la banque. Mais je ne sais pas si l’ensemble des conditions restrictives était satisfait par le dossier que vous évoquez.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’administration française a interrogé les autorités suisses pour savoir si, de 2006 à 2012, M. Jérôme Cahuzac avait disposé auprès de la banque UBS Suisse d’avoirs à titre de titulaire ou d’ayant droit économique. Pourquoi avoir visé les avoirs, plutôt que les comptes bancaires ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Ne connaissant pas le dossier, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
M. le président Charles de Courson. Mais pourriez-vous nous dire s’il s’agit d’une pratique habituelle ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Comme je vous l’ai indiqué, je ne suis pas une praticienne de la demande d’assistance administrative ; ce sont les services du contrôle fiscal qui sont chargés de diligenter les interrogations adressées aux pays étrangers. Ce qui est certain, c’est que quand nous négociions une convention, nous nous efforcions de donner la possibilité d’interroger à la fois sur les flux et sur les stocks, puisqu’en France, tant les revenus que le patrimoine sont imposables.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon des informations parues dans la presse, les avoirs en Suisse de M. Jérôme Cahuzac auraient cessé d’être détenus, en direct, sur un compte personnel, au début des années 2000. Dans quelle mesure ce type de demande d’assistance administrative permet-il d’identifier l’ayant droit réel d’un compte collectif, tel celui qui, après avoir été ouvert par le gestionnaire de fortune Reyl dans les livres de l’UBS de Genève, aurait abrité les avoirs de M. Jérôme Cahuzac jusqu’en 2009 ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je le répète, la pratique de l’interrogation ne faisait pas partie du champ de mes responsabilités. Dans le cadre des conventions et des accords d’échange de renseignements que nous avons signés, nous avons toujours eu le souci de faire en sorte que l’on puisse obtenir les informations nécessaires pour taxer correctement les contribuables redevables en France – et cela, même lorsque des structures étaient interposées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Considérez-vous que la notion d’ayant droit économique couvre tous ces champs ?
Mme Marie-Christine Lepetit. En principe, oui, mais il s’agit d’une formule générique. Néanmoins, elle permet de ne pas préjuger de la situation que l’on va rencontrer. Il existe une multiplicité de formes juridiques susceptibles d’organiser des interpositions ; quand on ignore le détail du dispositif utilisé par le contribuable, il est bon d’avoir à sa disposition des formules larges permettant de procéder à des interrogations ouvertes et d’obtenir des réponses loyales.
Je me souviens que ces questions firent l’objet de longues discussions lors de l’examen par le Parlement du nouveau dispositif d’imposition des trusts et qu’il fut bien difficile, dans le cadre d’un texte de droit latin, de mettre au point un dispositif susceptible d’englober l’ensemble des situations.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-il exact qu’avant la mise en place de la législation suisse contre le blanchiment, l’UBS pouvait ne pas connaître l’identité des ayants droit réels des comptes maîtres ouverts dans ses livres ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne sais pas : il s’agit d’une question très technique.
M. le président Charles de Courson. Quelques questions complémentaires.
Lorsque vous avez négocié l’avenant puis la lettre interprétative, vous êtes-vous posé la question de savoir si, eu égard aux pratiques de dissimulation des comptes, comme les comptes détenus par des trusts ou les comptes maîtres évoqués par le rapporteur, l’application de la convention ne serait pas, en pratique, impossible ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Dans mon souvenir, la convention franco-suisse ne comporte aucune particularité en la matière. Les éléments de négociation finaux ont porté, non sur ces questions, mais sur la manière d’interroger les Suisses afin d’obtenir la levée du secret bancaire.
M. le président Charles de Courson. Mais étiez-vous conscients du problème ? Ce point a-t-il fait l’objet de discussions avec les autorités fiscales suisses ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je n’ai pas en tête tout le détail de la discussion avec les Suisses, mais, en général, les textes que nous négociions intégraient cette préoccupation. À ma connaissance, la négociation avec la Suisse n’a pas dérogé à la règle.
Une fois encore, il ne s’agit que d’une règle juridique ; après, il faut considérer la pratique et l’organisation des juridictions. Durant les négociations, notre souci était de nous assurer que l’information que nous souhaitions obtenir existait, qu’elle était accessible aux administrations fiscales et transmissible à des tiers. Or, dans de nombreux cas, ces conditions n’étaient pas réunies ; il fallait donc discuter avec les autorités correspondantes pour savoir quand et comment elles feraient évoluer leur législation.
Par exemple, à Singapour, on doit passer devant un juge, ce qui nuit à l’effectivité de l’échange de renseignements – même si celui-ci est théoriquement permis. Dans d’autres pays, il n’y a pas de droit comptable, ou l’administration n’a pas accès aux informations parce qu’elle n’en a pas besoin, ou encore, comme en Suisse, les contribuables sont informés de la démarche : autant de situations où le droit interne peut constituer un obstacle à la demande de renseignements. Pendant longtemps, on n’a pas engagé de négociations avec la Chine parce que celle-ci appliquait la peine de mort pour fraude fiscale ! Il faut tenir compte de tous ces éléments dans la discussion.
M. Alain Claeys, rapporteur. D’après votre expérience, comment s’articule une demande d’assistance administrative avec une enquête préliminaire ayant le même objet ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne sais pas ; je n’ai pas d’expérience en la matière.
M. le président Charles de Courson. En l’état de notre enquête, il apparaît que juridiquement, il est possible de déclencher une demande d’assistance fiscale postérieurement à une enquête judiciaire. Toutefois, le procureur de Paris nous a dit qu’il n’avait jamais vu cela. Vous êtes-vous déjà posé la question de l’articulation entre procédure fiscale et procédure judiciaire ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Si je ne m’abuse, il y a eu un cas où ont été menés en parallèle un contrôle fiscal et une procédure judiciaire : il s’agit de l’escroquerie à la TVA sur le marché des permis de polluer.
M. le président Charles de Courson. Le procureur de Paris a déclaré sous serment qu’il n’était pas d’usage de déclencher une procédure fiscale postérieurement à une enquête préliminaire. Êtes-vous d’accord ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne saurais vous dire.
M. le président Charles de Courson. L’administration fiscale a adressé à M. Jérôme Cahuzac, le 14 décembre 2012, un formulaire n° 754, non contraignant, de demande d’informations. Dans quelle mesure cette demande constituait-elle un préalable indispensable à une demande d’assistance administrative à la Suisse ? Existait-il d’autres moyens, éventuellement plus rapides, d’épuiser les voies internes ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Cette question relève aussi de la pratique de l’assistance administrative. Lorsque nous avons négocié les accords de 2009 et de 2010, il était pour nous certain qu’avant d’accepter de répondre à une interrogation, la Suisse se montrerait très exigeante sur le fait que la France aurait vraiment épuisé les voies internes. Nos partenaires suisses ont insisté à plusieurs reprises sur ce point.
M. le président Charles de Courson. Comment interprétez-vous le deuxième alinéa de l’article 28 de la convention avec la Suisse : « Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques, de tribunaux ou dans des jugements (…) » ?
Les autorités fiscales françaises pouvaient-elles, en droit, transmettre à la justice la réponse des autorités suisses sans en avoir demandé l’autorisation à la justice française ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Ai-je droit à un deuxième « joker », monsieur le président ? Il s’agit de questions très techniques, sur des domaines que je n’ai jamais pratiqués ! A priori, je répondrais par l’affirmative : cela doit être juridiquement possible – étant précisé que, depuis lors, le standard de l’OCDE a ouvert la possibilité d’un usage à des fins autres que fiscales dans certains cas particuliers ; mais ceci ne s’applique pas au cas d’espèce.
M. le président Charles de Courson. Nous en venons aux questions de nos collègues.
Mme Cécile Untermaier. Au regard des standards de l’OCDE, l’administration fiscale française pouvait-elle, au vu d’éléments circonstanciés, demander des renseignements sur plusieurs banques ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Oui, sous réserve qu’elle disposât bien d’éléments circonstanciés.
Mme Cécile Untermaier. Pouvait-elle faire porter son interrogation sur une période antérieure à 2006 ?
Mme Marie-Christine Lepetit. L’avenant étant entré en vigueur après sa ratification, je considère qu’il concernait une période plus étroite que celle sur laquelle l’interrogation a porté.
Mme Cécile Untermaier. L’administration aurait donc eu une vision large en faisant porter l’interrogation jusqu’en 2006 ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Il me semble.
Mme Cécile Untermaier. Quelle interprétation faites-vous du dernier alinéa de la réponse suisse ?
M. le président Charles de Courson. Je vous en donne lecture : « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises. »
Mme Marie-Christine Lepetit. Je comprends que la banque répond complètement à la question posée, mais pas à des questions qui n’auraient pas été posées !
M. le président Charles de Courson. Avez-vous déjà été confrontée, dans vos fonctions de directeur de la législation fiscale, à ce type de réponse ?
Mme Marie-Christine Lepetit. En droit, préciser qu’une information ne figure pas n’est pas synonyme d’un a contrario ; il est fréquent de trouver dans un texte des éléments empilés sans qu’il y ait nécessairement un sens caché ! Il me paraît assez logique que la banque ait apporté cette précision dans le cadre d’une réponse à une demande étendue à une période non couverte par l’accord.
M. Jean-Marc Germain. À votre connaissance, la Suisse possède-t-elle un fichier des ayants droit des comptes ? À défaut, on aurait du mal à imaginer comment elle pourrait répondre une demande qui ne préciserait pas le nom de la banque !
La France possède-t-elle un fichier de ce type ? Dans le cas de figure – certes improbable ! – où la Suisse ferait une recherche sur un contribuable suisse possédant un compte non déclaré en France, comment l’administration fiscale française procéderait-elle pour lui répondre ?
Mme Marie-Christine Lepetit. J’ignore si la Suisse possède un fichier de ce type, mais la France a mis en place, dans le cadre du nouveau dispositif d’imposition des trusts, un registre permettant d’obtenir ce genre d’informations. D’autre part, l’administration fiscale possède, en sus du fichier des comptes bancaires (Ficoba), un fichier qui permet de repérer les détentions intragroupes et les filiales, donc d’avoir des informations sur l’organisation des groupes économiques. Autant d’éléments qui permettent de tirer des fils et de remonter de proche en proche jusqu’à la source.
M. Jean-Marc Germain. Théoriquement, on peut donc répondre dans un délai bref à une demande de la Suisse désirant savoir si telle personne détient un compte en France ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Oui, sous réserve de la qualité des fichiers dont nous disposons.
M. Jean-Marc Germain. Est-il crédible que l’administration fiscale suisse ait pu répondre dans des délais aussi brefs à la question posée par l’administration française, qui portait non seulement sur l’éventuelle détention par M. Cahuzac d’un compte à l’UBS, mais aussi sur la possibilité qu’il soit l’ayant droit économique d’un tel compte ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne sais pas.
M. Jean-Marc Germain. Je suis quand même étonné qu’à l’occasion de la négociation de l’avenant à la convention, vous n’ayez pas évoqué l’articulation avec d’éventuelles procédures judiciaires – qui, semble-t-il, permettent d’aller beaucoup plus loin que les procédures d’entraide fiscale !
Mme Marie-Christine Lepetit. Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. J’ai dit que je ne connaissais pas le détail de ce qui avait été discuté avec la Suisse ; en revanche, je sais sur quoi la négociation a bloqué, ainsi que ses spécificités.
M. le président Charles de Courson. Le Parlement helvétique a bloqué la ratification de l’avenant à la convention, et de nouvelles négociations ont abouti à la rédaction de la lettre d’interprétation. Le problème est de savoir si ce texte fait ou non l’objet d’interprétations divergentes de la part des autorités françaises et des autorités helvétiques.
Mme Marie-Christine Lepetit. Pour cela, il faudrait que vous auditionniez les Suisses ! Je me souviens fort bien des échanges avec mon collègue suisse : il n’y avait aucun doute que la lettre du 11 février pourrait conduire la France à demander une information sans préciser le nom de la banque et que, sous réserve que l’ensemble des conditions fussent réunies, la Suisse devrait faire diligence pour lui répondre. Dans le cas contraire, l’alinéa commençant par « Dans le cas exceptionnel… » ne voudrait rien dire ! La difficulté que nous avons rencontrée, c’est que la Suisse s’est par la suite montée très exigeante, s’agissant des conditions à satisfaire.
M. le président Charles de Courson. Nous avons demandé à auditionner votre homologue suisse de l’époque, mais nous nous sommes heurtés à un refus ; toutefois, on nous laisse la possibilité de le questionner par écrit. L’interprétation suisse de cet échange de lettres fera bien entendu partie des questions que nous poserons.
Mme Marie-Christine Lepetit. Je suis presque sûre qu’il vous dira le contraire de ce que j’ai dit, car tel est l’intérêt de la Suisse ! Celle-ci a continuellement joué de tous les interstices qui lui permettaient d’échapper à la levée du secret bancaire. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette expérience : négocier avec la Suisse est difficile, car celle-ci ne manque jamais une occasion de gagner du temps.
M. le président Charles de Courson. Il est clair que la Suisse n’a fait que de timides ouvertures, et à chaque fois par suite d’une forte pression internationale et sous la menace de sanctions économiques.
Mme Marie-Christine Lepetit. De fait, lors des négociations de 2009 puis de 2010, nous avions prévu des mesures de rétorsion, et la Suisse savait qu’il y avait de forts enjeux économiques. Cela a pesé sur l’issue des négociations : l’accord que nous avons obtenu était plus proche du standard de l’OCDE que ceux conclus par nos homologues ; nous avions alors la conviction que le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis n’avaient aucune chance d’obtenir des noms de banques. Quatre ans plus tard, le document peut paraître restrictif, mais il s’agissait tout de même du mode d’emploi de la levée du secret bancaire !
M. Jean-Marc Germain. Je repose ma question : dans vos échanges avec votre homologue suisse, n’avez-vous jamais évoqué l’existence d’un fichier des ayants droit économiques qui aurait permis de répondre rapidement aux demandes d’information ? Si l’on ne connaît pas le nom de la banque concernée et qu’un tel fichier n’existe pas, cela peut prendre des années !
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne me souviens pas que j’aie eu cette discussion et je ne crois pas que mes collaborateurs l’aient eue. En revanche, j’ai le souvenir que nous nous étions demandé si la Suisse avait, d’un point de vue strictement opérationnel, la possibilité de répondre à une demande qui ne mentionnerait le nom d’aucune banque et que nous avions répondu par l’affirmative ; la Suisse était outillée pour interroger sa place bancaire – et je ne me souviens pas non plus que la Suisse nous ait déclaré que c’était impossible.
Ce qui était en jeu, ce n’était pas cela ; c’était la posture suisse à l’égard du secret bancaire, le rapport de forces entre la Confédération et son association des banques, et les conséquences d’un tel accord sur le secteur économique et financier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous dites que la Suisse répondait tardivement, voire pas du tout, aux demandes d’informations et qu’elle avisait systématiquement le contribuable des démarches effectuées. En l’espèce, le contribuable a été averti et la réponse à la demande française fut rapide et négative. Est-ce à dire qu’en pratique, une réponse est rapide si elle est négative ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je n’ai pas la pratique de l’interrogation des autorités suisses. Tout ce que je peux dire, c’est que, comme mon collègue de la DGFiP vous l’a indiqué, la réponse a été faite dans un délai inhabituel. J’en déduis que les contacts personnels noués pour que cette demande soit examinée prioritairement ont produit leur effet.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez dit que, dans le cadre d’un échange de renseignements à la demande, il fallait que cette dernière porte sur des éléments circonstanciés. Pourriez-vous préciser les choses ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Il s’agit d’un point de fait qu’il est difficile d’exposer avec concision. Dans les commentaires de l’OCDE, on cite plusieurs exemples de cas qui sont conformes aux standards et de cas qui ne le sont pas – soit que la demande est trop générale, soit que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas assez détaillés. Si vous le souhaitez, je vous transmettrai ces documents.
Parmi les modifications apportées au standard de l’OCDE, on trouve la possibilité de faire une demande sur un groupe de contribuables – je pense que l’Allemagne n’est pas étrangère à cette évolution. Dans ce cas, il faut qu’une transaction économique ait été identifiée et que l’on cherche à mettre des noms derrière les contreparties de la transaction. En d’autres termes, l’administration doit étayer sa demande par des éléments factuels tangibles à fournir et en apportant la preuve que les démarches en droit interne ont été épuisées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je souhaiterais revenir sur l’échange de lettres du 11 février 2010. Vous parlez d’une lecture « très singulière » de la part de la Suisse. Cela signifie-t-il qu’à la suite de cet échange, la Suisse a fait une lecture très restrictive de cet accord ?
Mme Marie-Christine Lepetit. C’est en effet ce que je pense. On voit bien que les propos tenus devant les autorités françaises avec les communiqués de presse du Gouvernement helvétique ou les débats au Parlement suisse, on voit bien que le discours change en fonction des interlocuteurs !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque M. Bézard a déclaré, au cours de son audition : « comme cela a d’ailleurs été confirmé par le gouvernement suisse, nous ne pouvions formuler d’interrogation générale : il nous fallait spécifier le nom de la banque concernée », se réfère-t-il à cette « lecture très singulière » ?
Mme Marie-Christine Lepetit. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c’est que si l’administration fiscale avait fait une demande sur l’ensemble des banques, sans être capable d’en expliquer le motif à la Suisse, elle n’aurait certainement pas obtenu de réponse. Si on voulait interroger sans le nom de la banque ou sur plusieurs banques, il fallait le faire avec des éléments sérieux et démontrables. À défaut, la lettre du 11 février autorisait la Suisse à refuser de répondre. Une interrogation générale sans motifs circonstanciés était vouée à l’échec et juridiquement incorrecte.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous pensez donc que notre collègue Philippe Marini fait erreur lorsqu’il estime que l’on aurait pu interroger l’administration suisse sans préciser la banque concernée ou sans se limiter à la mention d’un seul établissement de crédit ?
Mme Marie-Christine Lepetit. On aurait pu le faire à condition que la demande fût étayée, c’est-à-dire que le dossier comportait un nombre suffisant d’indices tendant à prouver qu’il existait bien un compte en Suisse, mais sans que l’on sache avec précision où. Aux termes de l’échange de lettres de février 2010, il faut en effet apporter à l’appui de la demande des témoignages, une transaction économique identifiée, ou des éléments factuels donnant à penser qu’il y a eu des échanges avec un compte en Suisse mais sans savoir avec quelle banque. En revanche, il est interdit d’interroger la Suisse au simple motif que l’on pense que M. ou Mme Untel y détient un compte.
Il reste que je ne connais pas la situation du dossier qui vous importe et j’ignore si l’administration fiscale possède d’autres informations permettant de savoir quelle est la pratique de la Suisse en la matière. Ce dont je suis sûre, c’est qu’une demande générale est interdite. Une demande étendue étayée est autorisée en droit.
M. le président Charles de Courson. Laissez-moi vous lire la réponse pleine d’humour que nous avait fait M. Alexandre Gardette sur ce point :
« Les Suisses répondent si peu à nos demandes d’assistance bancaire que nous ne pouvons guère parler d’« habitude » ! Nous avons comparé avec les quelques réponses que nous avions reçues avant celle-ci, et nous n’y avons pas trouvé une telle formule. Toutefois, la réponse à une demande d’assistance bancaire n’est pas normée, et nos collègues de l’administration fiscale helvétique se contentent en général de recopier la réponse que la banque leur fait ; or, à chaque fois, les banques étaient différentes. Nous avons interprété cette mention comme une sorte de « disclaimer », de protection juridique justifiée par le fait que nous étions remontés antérieurement au 1er janvier 2010 ».
Madame Lepetit, je vous remercie.
Audition du mardi 9 juillet 2013
À 10 heures : M. Michel Gonelle, avocat.
M. le président Charles de Courson. Nous avons déjà longuement entendu M. Michel Gonelle le 21 mai dernier. Si nous avons collégialement décidé de l’entendre à nouveau, c’est que nous avons observé des différences, sur plusieurs points, entre son témoignage et celui d’autres personnes que nous avons entendues, également sous serment.
Nous souhaitons donc, monsieur Gonelle, que vous nous aidiez à y voir plus clair.
Comme vous le savez, l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Michel Gonelle prête serment.)
M. Michel Gonelle. Au cours des deux heures dix qu’a duré mon audition du 21 mai dernier, j’ai répondu à quelque 62 questions. Cette nouvelle convocation montre qu’il en reste d’autres, auxquelles, bien entendu, je suis tout disposé à répondre.
Du fait de mon activité professionnelle, je n’ai pas pu suivre toutes les auditions de votre commission. J’ai néanmoins suivi celle de M. Alain Zabulon, qui me concerne au premier chef, celle de M. Alain Picard, dont j’ai lu la retranscription, celle de M. Jean-Louis Bruguière et celle de M. Jérôme Cahuzac.
J’apporte à votre commission différents documents.
D’abord celui que vous avez souhaité recevoir, monsieur le président, à savoir la lettre que j’avais prévu de remettre en mains propres à Alain Zabulon si j’avais pu le rencontrer le 15 décembre 2012 comme je l’avais souhaité. En effet, l’objet de mon appel téléphonique n’était pas seulement de lui parler, mais bien de le rencontrer. Je ne souhaitais pas envoyer par la poste ce courrier que je voulais personnel mais le lui remettre, sachant qu’il serait reçu avec toute la discrétion et toute la confidentialité nécessaires. Les circonstances de la fin du mois de décembre ont fait qu’il n’était plus nécessaire de l’adresser. Je ne sais si une lettre non envoyée présente un très grand intérêt.
Ensuite des documents concernant ce que M. Jean-Louis Bruguière a affirmé devant votre commission. L’un d’entre vous a qualifié ses propos d’« Histoire de France racontée aux enfants », et force est de reconnaître qu’il y a beaucoup de choses fausses dans ce qu’il a dit.
Il vous indique en particulier que, très fâché d’avoir reçu le 12 novembre 2006 – date qu’il confirme – le document que j’avais en ma possession, il l’aurait détruit un mois plus tard, le 15 décembre, sans l’avoir écouté dans l’intervalle. Il répète également, comme il l’avait dit à Paris-Match dès le 20 décembre 2012, qu’il m’avait alors immédiatement congédié de son équipe de campagne. C’est totalement faux. Je vous ai apporté un certain nombre de procès-verbaux de réunions de cette équipe ainsi que son organigramme, les messages électroniques que son épouse Catherine m’a envoyés au cours du premier trimestre 2007, et la lettre manuscrite très chaleureuse qu’il m’a adressée le 30 juin 2007 afin de me remercier de ce que j’ai pu faire pour lui durant la campagne électorale. Vous pourrez donc constater que je n’ai nullement été congédié, comme il veut le faire croire de manière puérile : je figurais même parmi les quatre membres du « comité stratégique » de campagne, aux côtés de M. Bruguière lui-même, de M. Alain Merly, le député sortant, et de M. Jean-Louis Costes, qui est aujourd’hui le nouveau député de la circonscription. Cette attribution m’a été signifiée par Alain Merly dans un fax du 17 janvier 2007, avec une lettre de son assistant parlementaire et les comptes rendus des réunions, tous documents portant la même date que le fax. Les comptes rendus des réunions de la fin du mois de janvier figurent en pièce jointe de différents courriers électroniques. Je vous transmets également les lettres de l’épouse de M. Bruguière, celles de son directeur de la communication de l’époque, M. Bardin, ainsi que les messages électroniques de M. Gérard Paqueron, présenté par M. Bruguière à votre commission comme étant son directeur de campagne alors qu’il était plutôt, me semble-t-il, son trésorier.
Tous ces documents montrent que, jusqu’au mois de mai 2007, j’étais destinataire de tous les documents de la campagne et participais aux réunions. La fable selon laquelle on aurait détruit la bande sans l’écouter et congédié l’auteur de cette horreur absolue consistant à avoir sauvegardé l’enregistrement est bien, comme vous l’avez dit, une « Histoire de France racontée aux enfants ».
J’ai également apporté des documents prouvant que Jérôme Cahuzac a tenu devant vous des propos qui ne sont pas exacts. Ce n’est pas moi qui ai signalé au parquet de Paris que la clinique Cahuzac payait en espèces une employée non déclarée, c’est Alain Merly, qui était alors député et qui a écrit le 12 avril 2005 au procureur Jean-Claude Marin pour lui transmettre un courrier qu’il avait reçu au casier de la poste de l’Assemblée nationale.
Beaucoup de choses qui ont été dites sous serment sont factuellement fausses. C’est pourquoi je vous ai apporté tous ces documents pour vous le démontrer.
On a le droit de se tromper mais, en l’occurrence, il s’agit d’autre chose.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les formations politiques s’administrent librement et que ce qui y a trait n’est pas du ressort de notre commission d’enquête.
Il ne vous reste plus d’enregistrement des propos de M. Cahuzac ?
M. Michel Gonelle. J’ai déjà expliqué que j’ai réalisé en tout et pour tout deux sauvegardes de cet enregistrement. La première a été remise le 12 novembre 2006 à Jean-Louis Bruguière, la seconde le 16 janvier 2013 à la police judiciaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’enregistrement n’a jamais été conservé chez un notaire ?
M. Michel Gonelle. Il n’a jamais été conservé chez un notaire. Cela aussi, je l’ai déjà dit.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est pourtant ce que déclarait M. Arfi lors d’une émission sur Mediapart le 14 décembre dernier.
M. Michel Gonelle. Cela n’engage que M. Arfi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous confirmez également que les propos de M. Cahuzac ont été enregistrés à la suite d’une fausse manœuvre ?
M. Michel Gonelle. Oui. Son analyse au cours de l’enquête de police judiciaire est probante « à 60 % », comme le dit élégamment Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Jean-Louis Bruguière a reconnu avoir pris l’une des copies de l’enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé d’affaires, mais il a indiqué ne pas vous avoir sollicité pour que vous le lui donniez. Vous avez pourtant indiqué sous serment, le 21 mai dernier, que, apprenant que vous aviez conservé l’enregistrement, Jean-Louis Bruguière avait voulu l’écouter ; comme vous ne disposiez pas de l’appareil permettant de le lire, il vous aurait prié de le lui confier, ce que vous avez fait. Comment expliquez-vous ces différences ? Maintenez-vous vos propos ?
M. Michel Gonelle. Je les maintiens, bien sûr, et je vous apporte aujourd’hui la preuve que Jean-Louis Bruguière ne vous a pas dit la vérité sur les circonstances de cette remise.
M. Alain Claeys, rapporteur. Donc Jean-Louis Bruguière a menti ?
M. Michel Gonelle. Il y a des preuves matérielles. Oui, hélas, ce magistrat vous a menti.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jean-Louis Bruguière se souvient que vous l’avez prévenu de la mauvaise qualité de l’enregistrement, mais nie vous avoir dit qu’il « avait à sa disposition des gens capables de l’améliorer ». Il a indiqué qu’il était impossible d’obtenir un service de ce type sans respecter une procédure strictement encadrée par la loi. Maintenez-vous vos propos ?
M. Michel Gonelle. C’est sa parole contre la mienne. Je maintiens mes propos et j’apporte la preuve que Jean-Louis Bruguière a raconté une fable à la commission et à la presse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Là aussi, selon vous, M. Bruguière a menti…
M. Michel Gonelle. Il est indiscutable qu’il a menti. Voyez l’article de Paris-Match, où il dit qu’il m’a congédié « aussitôt » – je crois que l’adverbe est dans l’article – alors que je vous apporte la preuve que j’ai continué à participer de façon tout à fait normale à sa campagne électorale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous maintenez donc vos propos : M. Bruguière a dit qu’il avait à sa disposition des gens capables d’améliorer la qualité de l’enregistrement.
M. Michel Gonelle. Je me souviens qu’il m’a parlé de cela. Cela étant, ai-je traduit très fidèlement les propos qu’il m’a tenus ? Je n’en sais rien. C’est moi qui lui ai indiqué que la qualité était mauvaise. Il m’a dit que ce n’était pas un inconvénient. J’étais d’autant plus enclin à le croire que je savais que son métier l’amenait à pratiquer souvent le traitement des écoutes téléphoniques.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment expliquez-vous alors que M. Jean-Louis Bruguière, toujours selon ce qu’il nous a dit, ait jeté l’enregistrement sans l’avoir écouté, quelques semaines après l’avoir obtenu ?
M. Michel Gonelle. Premièrement, je n’y crois pas. Deuxièmement, je n’en sais rien. Il est responsable de ses propos. Je n’étais pas derrière lui. Il affirme l’avoir « jeté dans la poubelle familiale », ce qui prête plutôt à rire !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de votre première audition, vous nous avez dit regretter d’avoir parlé de l’enregistrement à M. Bruguière « car il n’a pas fait un bon usage de cette information ». Quel usage auriez-vous souhaité qu’il en fasse ? M. Bruguière nous a fait part de son sentiment d’une tentative d’instrumentalisation de votre part : qu’en pensez-vous ?
M. Michel Gonelle. Le premier reproche que je fais à Jean-Louis Bruguière est de ne pas m’avoir rendu ce que je lui avais prêté. Je lui avais remis l’enregistrement pour qu’il l’écoute et il était entendu qu’il devait me le restituer, ce qu’il n’a jamais fait.
S’agissant du « bon usage », je souligne que c’est M. Bruguière qui, de toute évidence, voulait entendre cet enregistrement, sans quoi je ne le lui aurais pas remis : ce ne devait pas être pour le plaisir de le poser sur son bureau ! Je ne l’ai quand même pas obligé à s’en saisir, à le mettre dans sa poche et à l’emporter !
M. le président Charles de Courson. Lors de son audition, M. Catuhe nous a dit qu’il avait écouté l’enregistrement sur votre ordinateur. C’était en 2001. Or, vous nous avez déclaré que votre dialogue avec M. Bruguière avait eu lieu chez vous. Pourquoi donc n’avez-vous pas pu le lui faire écouter ?
M. Michel Gonelle. Entre 2001 et 2006 la technologie informatique des cabinets d’avocat a changé. En 2001, nous disposions d’appareils permettant de lire le support de cet enregistrement, à savoir une mini-cassette insérée dans un étui de plastique. En 2006, on est passé aux grands cédéroms sans étui et mon équipement n’est plus le même.
M. le président Charles de Courson. C’est pour cette raison que vous ne pouvez pas faire écouter l’enregistrement à M. Bruguière ?
M. Michel Gonelle. Bien sûr.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans une interview du 2 mai 2013, vous avez indiqué à une journaliste du Point avoir cherché, dans les six mois qui ont suivi l’enregistrement, un cabinet spécialisé à Bordeaux capable de vérifier si le compte évoqué par M. Jérôme Cahuzac était ou non déclaré. Est-ce exact ?
M. Michel Gonelle. C’est exact.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ne pas avoir évoqué cet épisode lors de votre première audition ?
M. Michel Gonelle. Parce que vous ne m’avez pas posé la question. Mais j’en ai fait très largement confidence à la police judiciaire dès mon audition du mois de janvier.
D’ailleurs, je m’interroge sur la façon dont votre commission s’attache à mon comportement alors qu’elle a pour mission de déterminer les éventuels dysfonctionnements de l’État entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013. Je suis, bien entendu, ravi de venir à nouveau déposer devant vous, j’imagine bien que vous voudriez me faire mille et un reproches, mais j’ai révélé moi-même cet élément aux enquêteurs de la police judiciaire. Laissons-les faire leur travail ! Si j’ai commis une infraction, les juges ne manqueront pas de me le reprocher.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je n’ai pas à répondre à vos insinuations. Je vous pose des questions, comme à toutes les personnes auditionnées.
M. Michel Gonelle. Je comprends néanmoins le sens de vos questions. Je ne suis pas tout à fait naïf !
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous fait écouter l’enregistrement aux personnes de ce cabinet spécialisé ?
M. Michel Gonelle. C’est possible mais je n’en ai pas un souvenir précis. La police judiciaire a retrouvé et interrogé la personne en question. Je ne connais pas sa déposition.
M. le président Charles de Courson. Ne prenez pas mal les questions de notre rapporteur. Notre commission est confrontée au problème suivant : Mediapart, qui peut exciper du secret des sources des journalistes, a eu cet enregistrement ; or, MM. Plenel et Arfi nous ont affirmé sous serment que ce n’est pas vous qui le leur avez donné, ce que vous avez confirmé ; comme, d’après vos dires, il n’y avait que deux enregistrements, l’autre piste est celle de M. Bruguière, lequel nous a affirmé sous serment qu’il l’a jeté. Il y a donc une troisième personne…
M. Michel Gonelle. Non.
M. le président Charles de Courson. Ce que se demande le rapporteur, c’est s’il n’y aurait pas eu une fuite, à votre insu, de la part de personnes à qui vous auriez confié l’enregistrement.
M. Michel Gonelle. Sauf lorsque je l’ai remis à M. Bruguière, je ne m’en suis jamais dépossédé. Mais je l’ai fait entendre à M. Catuhe et à un cercle d’une demi-douzaine de personnes tout au plus, comme je l’ai indiqué lors de ma première déposition. Je l’ai fait écouter également au spécialiste de Bordeaux qui m’avait été recommandé, mais je ne crois pas lui avoir remis de copie.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel est ce cabinet ?
M. Michel Gonelle. Le cabinet Rat. Il n’existe plus aujourd’hui mais la police judiciaire a retrouvé son dirigeant. Il s’agissait d’un cabinet d’intelligence économique et ma préoccupation était de savoir si cette histoire de compte en Suisse était vraie ou fausse, s’il y avait de l’argent ou non dessus, si l’affaire était sérieuse ou douteuse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous a-t-il apporté des réponses ?
M. Michel Gonelle. Non. Je n’ai pas accepté le devis qu’il m’a présenté.
M. Philippe Houillon. Un devis de 40 000 euros.
M. Michel Gonelle. Exactement.
M. le président Charles de Courson. N’y avait-il pas une possibilité pour qu’il ait, malgré tout, capté l’enregistrement ?
M. Michel Gonelle. J’ai mis un soin méticuleux à ne pas donner de copies. Si j’en ai remis une à M. Bruguière, c’est parce que je pensais qu’il était digne de confiance. Je le regrette aujourd’hui car il n’est pas digne de confiance !
M. le président Charles de Courson. Qu’attendiez-vous de M. Bruguière ?
M. Michel Gonelle. En premier lieu qu’il me le rende. Il voulait l’écouter, je ne m’y suis pas opposé, mais je pensais qu’il me le rendrait.
M. Alain Claeys, rapporteur. « Il n’a pas fait un bon usage de cette information », dites-vous. Qu’espériez-vous ?
M. Michel Gonelle. D’abord – je le répète – qu’il me rende un enregistrement qui m’appartient. Je n’avais pas prémédité de lui remettre ce document. Il voulait absolument l’écouter. Je ne pouvais le lui permettre sur-le-champ, donc je le lui ai remis pour qu’il l’écoute et me le rende. Voilà !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de votre audition du 21 mai, nous avons eu l’échange suivant à propos des informations dont aurait disposé la douane :
Je vous pose cette question : « Dans une interview du 3 avril, vous indiquez que l’administration des douanes aurait eu connaissance dès 2008 de l’existence du compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac. Comment le saviez-vous ? » et vous me répondez : « En réalité, il y a une erreur dans la transcription de mes propos, car cette administration le savait bien avant 2008. J’ai entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le service compétent des douanes, le chef du 4e bureau de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – une des divisions de la DNRED – avait obtenu ce renseignement dès 2001, même si j’ignore de quelle façon. Selon mes informations, dont j’ai tout lieu de penser qu’elles sont sérieuses, ce cadre de haut niveau, administrateur civil d’origine, a été interrogé par plusieurs journalistes sur ce fait, sans jamais le démentir ni le confirmer. » En réponse à une question du président, vous indiquez ensuite que son nom est Thierry Picart.
La commission d’enquête a auditionné M. Picart le 4 juin 2013. Celui-ci nous a apporté les éléments d’information suivants : « Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, Maître Gonelle a dit “il y a une petite erreur” parlant de 2008 versus 2001. Il a surtout dit que ce n’était pas lui qui avait commis cette erreur, mais le journaliste.
« Si Maître Gonelle est “avocat, et non procureur ou enquêteur”, comme il l’a dit, je suis, pour ma part, enquêteur de formation. Je me suis donc livré à quelques vérifications. Le premier communiqué AFP, qui évoque 2008, a été repris quasiment in extenso par plusieurs journaux.
« On pourrait penser qu’y est reprise une erreur initiale. Seulement dans d’autres interviews, à d’autres dates, dans Le Courrier picard, Marianne ou Rue89, c’est aussi la date de 2008 qui est citée. On pourrait évoquer une erreur de transcription. Mais il suffit d’aller sur YouTube, comme je l’ai fait, pour y visionner la vidéo d’une interview à BFM TV, et il ne peut y avoir là d’erreur de transcription. Maître Gonelle, qui met d’ailleurs également en cause la Cour des comptes dans cette interview, y parle bien de 2008. Ce n’est pas une “petite erreur”, et si c’est une erreur, ce n’est pas une erreur du journaliste, mais de Me Gonelle. »
M. Picart a ensuite cité une série d’articles, et conclu que tous reposaient sur la théorie selon laquelle il aurait « rédigé un rapport en 2008, que celui-ci serait parvenu au ministre, lequel, par connivence, ne l’aurait pas diffusé et n’y aurait donné aucune suite ».
Maintenez-vous cette correction de date que vous avez faite en réponse à une de mes questions ?
M. Michel Gonelle. Bien sûr. Cette information au sujet des douanes m’est parvenue par une source journalistique. Je me suis trompé sur la date et j’endosse pleinement la responsabilité de cette erreur. Lorsque j’ai recoupé l’information, on m’a indiqué qu’il s’agissait bien de 2001 et non de 2008. Je prends cette erreur à mon compte, monsieur le rapporteur. Peut-être en suis-je responsable en totalité ou ai-je mal compris ce qui m’a été rapporté.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce n’est pas neutre. En 2001, M. Picart n’occupait pas les mêmes fonctions qu’en 2008.
M. Michel Gonelle. Peut-être. Je ne connais pas la vie de M. Picart. Par contre, j’ai lu ce qu’il a dit devant votre commission d’enquête et je trouve stupéfiant que vous ne vous soyez pas montré plus curieux, monsieur le rapporteur. Ce monsieur vous dit qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer avoir connu en 2001, dans le cadre de ses fonctions, l’existence de ce compte à l’étranger. Vraiment, il est étonnant qu’un fonctionnaire de cette qualité ne se souvienne pas s’il a eu connaissance du compte qu’un parlementaire détenait à l’étranger !
Il m’arrive fréquemment d’accompagner des clients chez le juge d’instruction pour les infractions qui leur sont reprochées. Ceux qui sont de mauvaise foi répondent souvent au juge : « Je ne me rappelle pas », c’est-à-dire : « Je ne peux confirmer ni infirmer » ! Il aurait été si simple, si l’information était fausse, de dire : « Je n’ai jamais eu connaissance de l’existence d’un compte de M. Cahuzac à l’étranger ». Et cela ne vous a pas choqué outre mesure !
M. Alain Claeys, rapporteur. Permettez-moi de vous le dire très posément et très gentiment, monsieur Gonelle : ni moi ni aucun membre de cette commission ne sommes là pour recevoir des leçons sur les questions que nous avons à poser ou non. Nous faisons tous notre travail correctement. Je n’entends pas recevoir de leçons de quiconque !
M. Michel Gonelle. Moi non plus, monsieur le rapporteur !
M. Alain Claeys, rapporteur. Je ne vous donne aucune leçon !
La date n’est pas neutre. Lorsque l’on relit l’ensemble de vos interviews, on constate que vous citez des ministres en fonction en 2008. Et aujourd’hui, vous remettez en cause tout cela en affirmant que c’était en 2001 ! Je n’ai donc qu’une seule question à poser en notre nom à tous : pourquoi, devant notre commission d’enquête, avez-vous changé pour la première fois la date à laquelle, selon vous, les douanes auraient eu connaissance du compte non déclaré de M. Cahuzac à l’étranger ?
M. Michel Gonelle. C’est très simple : c’est parce que j’ai eu connaissance de l’erreur et que j’ai voulu, tout à fait logiquement, la rectifier. Je n’ai pas été le seul à mettre en cause des ministres, que je sache !
M. Alain Claeys, rapporteur. Donc vous reconnaissez que toutes les accusations et insinuations que vous avez faites à l’encontre de ministres en poste à l’époque sont fausses et que vous vous êtes trompé sur toute la ligne ?
M. Michel Gonelle. Je ne sais plus dans quel monde je suis ! L’enregistrement de la voix de Jérôme Cahuzac est-il un faux ? Le compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac n’existe-t-il pas ? Les aveux de Jérôme Cahuzac sont-ils de faux aveux ? Vraiment, je ne sais plus où j’habite !
Jusqu’à plus ample informé, je suis un citoyen qui n’a jamais été condamné, qui porte la croix de la légion d’honneur et qui n’a pas de leçons d’honnêteté à recevoir !
M. le président Charles de Courson. Votre source, nous avez-vous dit, est une source journalistique.
M. Michel Gonelle. Oui.
M. le président Charles de Courson. Dont acte : vous vous êtes fait l’écho de sources journalistiques. Ce n’est pas une source de première main.
M. Michel Gonelle. Je l’ai toujours dit. Cela implique des précautions. Les sources journalistiques ne sont pas forcément sûres à 100 %, c’est évident !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, la semaine dernière, M. Jean-Noël Catuhe, l’ami par l’intermédiaire duquel vous avez, en 2001, informé l’administration fiscale de l’existence du compte suisse de Jérôme Cahuzac, nous a dit qu’il avait rencontré M. Mangier, auquel il a donné cette information, alors qu’il menait une enquête sur une fraude importante dans le Villeneuvois en collaboration avec la douane. Étiez-vous au courant de ce point ?
M. Michel Gonelle. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce la raison pour laquelle vous en avez conclu que la douane connaissait l’existence de ce compte ?
M. Michel Gonelle. Pas du tout. Cela n’a rien à voir.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au début de l’affaire, vous n’avez pas jugé utile de remettre l’enregistrement à la justice. Mais pourquoi n’avoir pas envoyé à la justice la lettre que vous vouliez faire parvenir, bien plus tard, au Président de la République ?
M. Michel Gonelle. Je me suis déjà expliqué sur ce point. Jusqu’en mars 2001, date à laquelle j’ai cessé d’être autorité constituée, j’aurais pu en effet saisir la justice en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Si je ne l’ai pas fait, c’est que j’entrais en campagne électorale. J’avais le sentiment que, si je signalais cet enregistrement à mon parquet, il pourrait y avoir des fuites dans la presse, ce qui m’aurait exposé à une action en diffamation ou en dénonciation calomnieuse.
Je vous ai également dit que je ne pouvais avoir aucune certitude, même si j’avais des soupçons, sur le fait que le compte n’était pas déclaré. Du reste, sur la transcription de l’enregistrement que j’ai apportée ici, Jérôme Cahuzac est censé dire : « Je n’ai plus rien, normalement, sur ce compte. »
Pour ces raisons, je n’ai pas utilisé l’article 40 comme j’en avais la possibilité. J’ai choisi de demander conseil à M. Catuhe, qui était une relation de confiance et qui est devenu depuis un ami. Il m’a informé de l’existence – que j’ignorais – d’un service spécialisé de lutte contre la fraude fiscale qui disposait d’antennes décentralisées en régions, notamment à Bordeaux, et il a accepté – je ne me rappelle plus si c’est sur sa proposition ou à ma demande – de porter l’alerte à ce service, qui était en mesure de vérifier s’il y avait matière à enquête sur deux points : la déclaration et l’approvisionnement du compte. C’est ce qui a été fait, le reste ne m’appartient pas. À partir du mois de mars, je n’étais plus maire, donc plus autorité constituée. Je me suis étonné qu’aucune nouvelle n’apparaisse mais je n’ai pas fait d’enquête : ma vie continuait !
M. Alain Claeys, rapporteur. De mémoire, je crois que vous avez affirmé lors de votre première audition que le dossier de M. Cahuzac n’était pas descendu de Paris après cette demande de renseignement.
M. Michel Gonelle. Oui. C’est ce que m’a dit M. Catuhe.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourtant ce dossier est descendu de Paris – nous avons l’accusé de réception – et, malheureusement, est resté six ou sept ans à Bordeaux.
M. Michel Gonelle. Je l’ai vu dans les comptes rendus des auditions. À cet égard, le chef du service du contrôle fiscal, M. Gardette, a affirmé devant vous que le renseignement apporté par M. Catuhe n’était pas exploitable parce qu’il était anonyme. C’est totalement inexact. M. Catuhe est allé au-devant d’un fonctionnaire de la BII (brigade interrégionale d’intervention) qui était son camarade de promotion. Il le connaissait donc très bien, il n’y est pas allé à visage masqué et il ne lui a pas dit que lui ou la source qu’il a citée – en l’occurrence moi-même – souhaitaient conserver l’anonymat. J’aurais très volontiers répondu aux questions de la BII, voire à sa demande de lui communiquer l’enregistrement. Cela n’a pas été le cas et je n’y suis pour rien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous donné des informations aux journalistes sur l’entretien téléphonique que vous avez eu avec M. Zabulon ?
M. Michel Gonelle. Mais non ! Vous avez la réponse dans votre dossier !
M. Alain Claeys, rapporteur. Ne vous mettez pas en colère. Si je vous pose la question, c’est que, selon M. Zabulon, les journalistes ont interrogé l’Élysée sur le contenu de cet entretien.
M. Michel Gonelle. La preuve est dans la dépêche AFP !
M. Alain Claeys, rapporteur. Je cite M. Zabulon.
M. Michel Gonelle. Et moi je cite la dépêche AFP.
M. Alain Claeys, rapporteur. « Il n’y a pas eu, à proprement parler, de communiqué de presse de la présidence de la République : c’est une réponse orale faite à des journalistes interrogeant la présidence sur la teneur de cet entretien. »
En conséquence, ma question est simple : avez-vous informé les journalistes de cet entretien ?
M. Michel Gonelle. Non, puisque je voulais que cette démarche reste confidentielle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Merci.
M. Michel Gonelle. Je n’ai pas terminé. Ne faites pas comme si la dépêche AFP n’existait pas, monsieur le rapporteur : « Citant une “source officielle » – je ne suis pas une source officielle –, Mediapart a assuré que M. Gonelle avait appelé le 15 décembre M. Zabulon, l’une de ses “vieilles connaissances”, en tant qu’ancien sous-préfet de Lot-et-Garonne, pour certifier l’authenticité de l’enregistrement. » C’est donc une source officielle qui a informé Mediapart de mon contact avec l’Élysée. Je m’estime un peu trahi. Je voulais que cette démarche reste confidentielle et personnelle vis-à-vis du Président de la République, pour qui j’ai du respect. Elle ne l’a pas été et ce n’est pas de mon fait !
M. Alain Claeys, rapporteur. La source officielle ne fait que confirmer la tenue de l’entretien. Ce que je ne comprends pas – et ne le prenez pas mal ! –, c’est qu’à deux moments importants de cette triste affaire, la justice n’ait pas été saisie. Voilà la question que nous nous posons. Si la justice avait été saisie normalement…
M. Michel Gonelle. Dès le 5 décembre, tous les parlementaires français ayant écouté ce que Mediapart avait mis en ligne auraient dû être dans l’antichambre de M. Molins en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Après tout, vous êtes des autorités constituées comme je l’ai été dans le temps !
Il est absolument anormal que je sois celui que l’on montre du doigt. Le 5 décembre, tout le monde était en train de défendre Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Non.
M. Michel Gonelle. À quelques exceptions près, monsieur le président, les médias et les hommes politiques, de droite comme de gauche, soutenaient que cette accusation était invraisemblable, que Jérôme Cahuzac était le meilleur ministre qu’on ait jamais connu et qu’il était d’une honnêteté irréprochable.
M. le président Charles de Courson. Non
M. Michel Gonelle. La grande majorité des hommes politiques français ont dit cela. Devant votre commission, d’ailleurs, M. Zabulon s’est dit impressionné de l’incrédulité générale face à l’accusation portée par Mediapart. Pourtant, cette accusation était fondée, et il faut que tout le monde l’admette aujourd’hui.
Pour ma part, j’ai été profondément perturbé lorsque cette affaire est sortie, d’abord parce que je ne m’y attendais pas, ensuite parce qu’on m’est rapidement tombé dessus : après qu’Edwy Plenel eut évoqué le déplacement de M. Daniel Vaillant à Villeneuve-sur-Lot, on a fait le lien avec le maire de l’époque, si bien que j’ai été tout de suite montré du doigt. Pendant huit ou dix jours, j’ai essayé – maladroitement, je l’avoue – de dire que je n’y étais pour rien. En réalité, je n’étais pour rien dans la révélation, évidemment pas dans le fait que l’enregistrement existait. Néanmoins, ce n’est pas moi qui avais déclenché ce séisme. Je reconnais avoir pataugé pendant huit jours, mais c’est parce que j’étais un peu en détresse. Tout le monde – à quelques exceptions près, monsieur le président – disait que c’était faux.
M. le président Charles de Courson. Merci de mentionner les quelques exceptions.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous ne sommes pas là pour nous délivrer des prix de je ne sais quoi. En ce qui me concerne, je n’ai fait aucune déclaration.
M. Michel Gonelle. Vous avez bien fait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si la commission a souhaité à l’unanimité vous entendre à nouveau ce matin, monsieur Gonelle, ce n’est pas pour mener une quelconque chasse aux sorcières, c’est tout simplement parce qu’elle a le droit de connaître la vérité. Quand nous nous heurtons à des propos contradictoires, d’où qu’ils viennent, il est de notre devoir de revenir sur les sujets en question.
M. Michel Gonelle. Merci de me le dire comme cela et veuillez m’excuser de mon emportement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je vous le dis avec une grande fermeté et très calmement : je pense que c’est le travail de notre commission et que tous les membres de celle-ci font correctement leur travail.
M. Michel Gonelle. Je ne le conteste pas, mais je voudrais convaincre votre commission de ma parfaite bonne foi et du fait que je n’ai jamais menti devant elle.
M. le président Charles de Courson. Vous avez, dites-vous, prêté l’enregistrement à Jean-Louis Bruguière. Mais lui avez-vous demandé de vous le restituer, en lui envoyant par exemple une lettre ?
M. Michel Gonelle. Non, je ne lui ai pas envoyé de lettre.
M. le président Charles de Courson. Et vous ne l’avez pas appelé ?
M. Michel Gonelle. Je n’en ai parlé à personne d’autre qu’à lui, donc je n’ai pas appelé qui que ce soit.
M. le président Charles de Courson. Je parle de M. Bruguière lui-même.
M. Michel Gonelle. Mes relations avec lui se sont distendues après la campagne électorale. D’ailleurs, il n’est plus venu très souvent à Villeneuve-sur-Lot.
Mais je ne lui ai pas réclamé l’enregistrement, c’est vrai. Peut-être me l’aurait-il restitué si je l’avais fait. Pour ma part, je ne crois pas à la destruction.
M. le président Charles de Courson. Est-il exact que vous avez répondu positivement à M. Garnier lorsqu’il vous a interrogé sur la véracité du compte à l’étranger ?
M. Michel Gonelle. Oui, l’anecdote est exacte. Un jour, il est entré dans mon bureau…
M. le président Charles de Courson. Vers 2006, nous a-t-il dit.
M. Michel Gonelle. Je ne saurais indiquer la date exacte, mais il est entré un jour dans mon bureau et m’a demandé s’il était vrai que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse. Je lui ai répondu que je le pensais.
M. le président Charles de Courson. Lui avez-vous dit que votre conviction s’appuyait sur un enregistrement ?
M. Michel Gonelle. Je ne crois pas lui avoir fait de plus amples confidences.
M. le président Charles de Courson. Vous ne lui avez pas fait écouter l’enregistrement ?
M. Michel Gonelle. Non.
M. le président Charles de Courson. J’en reviens au cabinet Rat. Pour que les spécialistes puissent mettre l’enregistrement sur une cassette, vous avez dû leur confier votre téléphone portable.
M. Michel Gonelle. Non. Cela s’est passé dans le hall du conseil régional d’Aquitaine.
M. le président Charles de Courson. Comment peuvent-ils vous restituer une cassette si vous n’avez pas donné votre portable ?
M. Michel Gonelle. Je pense leur avoir fait écouter l’enregistrement avec un computer qui était à disposition. Mais je ne me rappelle plus très bien. Pour tout vous dire, ce souvenir s’était même effacé de ma mémoire. Je suis allé au-devant de la police judiciaire pour ajouter cet élément dans une deuxième déposition.
M. le président Charles de Courson. L’enregistrement initial s’est fait sur votre téléphone portable. Comment passe-t-on du portable aux cassettes ?
M. Michel Gonelle. Ce n’est pas le cabinet Rat qui a fait la sauvegarde.
M. le président Charles de Courson. Qui, alors ? Nous voulons comprendre comment l’enregistrement est passé de votre portable à ces deux cassettes.
M. Michel Gonelle. Je l’ai expliqué en détail à la police judiciaire. La personne qui a gravé les deux CD l’a fait presque aussitôt, c’est-à-dire dans le délai de quatorze jours au-delà duquel le message s’efface. Nous étions en décembre 2000. C’est un technicien du son qui a réalisé l’opération. J’ai donné son nom à la police judiciaire, laquelle l’a entendu pour vérification. Ce point est donc parfaitement éclairci. Lors d’une de vos auditions, l’hypothèse a été émise qu’il y avait trois personnes. Ce n’est pas le cas.
M. le président Charles de Courson. Cette personne aurait-elle pu garder une copie ?
M. Michel Gonelle. L’opération s’est faite sous mes yeux.
M. le président Charles de Courson. Quand bien même elle se serait faite sous vos yeux, n’y avait-il pas, technologiquement, une possibilité ? Nous souhaitons savoir comment l’enregistrement est parvenu à Mediapart si ce n’est ni vous ni M. Bruguière.
M. Michel Gonelle. Intéressez-vous à ceux qui ont menti à votre commission. Moi, je vous apporte les preuves que Bruguière vous ment.
M. le président Charles de Courson. Donc, pour vous, c’est M. Bruguière.
M. Michel Gonelle. Ce n’est évidemment pas lui qui a donné l’enregistrement à Edwy Plenel. Tout le monde sait que leurs rapports sont exécrables. Mais je pense que cet enregistrement a dû passer de main en main après que je m’en fus dessaisi.
M. le rapporteur. Via le juge Bruguière ?
M. Michel Gonelle. Évidemment. C’est lui qui l’a reçu en premier.
M. Jean-Marc Germain. Il est malgré tout difficile de comprendre les conditions dans lesquelles vous avez fait cet enregistrement. Alors que M. Bruguière veut démontrer à tout prix qu’il ne peut être à l’origine de la diffusion – les services municipaux auraient immédiatement détruit la cassette –, vous évoquez un technicien du son. Comment cela s’est-il passé ? Qui est cette personne ? L’opération a-t-elle eu lieu dans vos bureaux ? Sur quel support ? Était-il impossible de faire une copie à ce moment-là ? Il est important que nous puissions nous faire notre propre opinion…
M. Michel Gonelle. Je suis disposé à répondre à toutes les questions. Aucune ne m’embarrasse mais je n’en comprends pas le sens. Cette période et ce sujet sont complètement en dehors de votre saisine. Si ce technicien du son a « dysfonctionné » sous mes yeux, ce n’est pas une commission d’enquête parlementaire qui pourra le déterminer ! Ce que je peux vous dire, c’est que l’opération s’est faite sous mes yeux, que j’ai révélé le nom du technicien à la police judiciaire et que celle-ci l’a entendu. Un jour, l’affaire viendra devant une juridiction et toutes les pièces du dossier seront rendues publiques. Si je vous donne le nom de ce monsieur, vous allez le convoquer ? C’est ce que vous voulez ? Il vous répondra comme il a répondu à la police judiciaire !
M. le président Charles de Courson. Nous avons ce nom. Ce n’est pas un problème.
M. Michel Gonelle. C’est donc que le dossier de la police judiciaire vous a été transmis.
M. le président Charles de Courson. On trouve beaucoup de choses dans la presse.
M. Michel Gonelle. Le nom du technicien n’est pas dans la presse, monsieur le président !
M. Jean-Marc Germain. Lors de son audition, M. Cahuzac a évoqué votre habitude de pratiquer des enregistrements, y compris pour évincer un ami appartenant à votre famille politique.
Ce dont nous nous apercevons en élargissant notre enquête au-delà de la période indiquée, c’est qu’à plusieurs moments des alertes auraient pu être données et ne l’ont pas été. Vous-même ne nous avez pas répondu quant à vos motivations de ne jamais alerter la justice.
Bref, nous nous attachons à ces différents moments où les alertes auraient pu avoir lieu et aux motivations qui ont fait qu’elles ont été données ou pas.
Qu’avez-vous donc à dire de cette première fois où vous avez enregistré un adversaire politique, avant l’enregistrement fortuit de M. Cahuzac et sachant que vous faites une troisième utilisation un peu surprenante des technologies de l’information lorsque vous appelez un journaliste avec le téléphone portable d’un policier ?
M. Michel Gonelle. Je vais essayer de vous éclairer et de vous dissuader de me prendre pour le spécialiste des enregistrements que je ne suis pas.
Jérôme Cahuzac vous a raconté une anecdote du Villeneuvois qui s’est produite bien avant qu’il n’arrive. Le maire de Villeneuve-sur-Lot à l’époque, Claude Larroche – qui, par parenthèse, a dû quitter ses fonctions après un emprisonnement de quatre mois – avait eu en 1991 ou 1992 une conversation téléphonique avec son directeur de cabinet depuis sa voiture, dotée du réseau Radiocom 2000. Cette conversation fut captée par un radio-amateur qui la distribua à plusieurs personnes – pas à moi, mais néanmoins à quelqu’un qui trouva intelligent de me le confier.
Dans cet enregistrement, Claude Larroche et son directeur de cabinet se moquaient de différents journalistes locaux en tenant à leur sujet des propos absolument ignobles, mais aussi, de manière assez injurieuse, de l’adjoint de Claude Larroche, qui fut aussi le mien par la suite, M. Jean-Luc Barré, plus tard coauteur des Mémoires de Jacques Chirac. Lorsque l’enregistrement m’est parvenu, je l’ai fait écouter à Jean-Luc Barré pour qu’il apprenne comment son maire le considérait.
Cela dit, je ne suis pour rien dans cet enregistrement. C’est un radio-amateur qui l’a fait et je ne suis nullement radio-amateur. Je l’ai reçu dans ma boîte à lettres par une personne qui l’avait elle-même reçu, et dont je connais le nom. Je n’ai rien à voir avec cette histoire.
Mais Jean-Luc Barré, qui est aujourd’hui l’ami de Jérôme Cahuzac et qui est un élu anti-UMP après avoir été longtemps un élu UMP – c’est son droit ! –, a raconté à l’envi à de nombreux journalistes parisiens cette histoire que Cahuzac a prise pour argent comptant et vous a racontée comme si j’étais l’auteur de l’enregistrement. Tous les Villeneuvois savent très bien que je n’ai jamais été mis en cause dans cette affaire, sauf ces derniers temps par parallélisme avec l’affaire qui nous occupe. De même, je n’ai rien à voir avec la plainte déposée devant le parquet de Paris au sujet de l’employée de la clinique Cahuzac.
Aussi, les deux attaques directes que Jérôme Cahuzac a portées contre moi lorsque vous l’avez entendu sont l’une et l’autre infondées. Je regrette ces attaques mais je peux comprendre son amertume.
M. Jean-Marc Germain. Pour quelles raisons n’avez-vous jamais utilisé tous les éléments dont vous disposiez contre lui ? Nous n’avons guère ressenti, lors de son audition, le respect réciproque que vous invoquez. Vous avez également affirmé que vous aviez peur de lui. Or, vous ne donnez pas l’impression d’être un homme craintif, bien au contraire : vous savez utiliser, semble-t-il, tous les leviers possibles pour vous défendre.
Pourquoi, dès lors, même après avoir quitté vos fonctions électives – ce qui vous ôtait la crainte de répercussions politiques – n’avez-vous jamais utilisé ces informations pour éclairer la justice ?
M. Michel Gonelle. Je rappelle une nouvelle fois que, moins de trois mois après avoir reçu cet enregistrement, j’ai suscité une alerte effectuée à visage découvert dans le service adéquat de l’administration fiscale. C’est un fait.
À un autre moment, fin 2001, j’ai voulu savoir si tout cela était vrai, mais j’ai dû y renoncer à cause du devis du cabinet Rat, qui était exorbitant. Du reste, la police judiciaire a examiné attentivement ce devis, interrogé M. Rat et recueilli tous les éléments sur les circonstances de cette démarche.
Ensuite, vous avez raison, monsieur Germain : entre fin 2001 et 2006, je n’ai rien fait.
En 2006, je remets un exemplaire à Jean-Louis Bruguière. Je ne savais pas ce qu’il pouvait faire ou ne pas faire. Il voulait seulement l’écouter, je le lui ai permis. Bien entendu, je ne suis pas naïf et j’ai pu penser à un moment donné qu’il y aurait une suite. Mais je n’ai pas voulu saisir le procureur.
Et, je le répète, j’ai été extrêmement surpris lorsque l’affaire est réapparue en 2012. Je maintiens aussi – ce qu’a d’ailleurs confirmé M. Zabulon – que mes relations avec M. Cahuzac n’avaient rien d’extrêmement conflictuel dans les rapports quotidiens. Toutefois, vous le connaissez aussi bien que moi et vous savez quel adversaire redoutable il est, lorsqu’il est en campagne électorale, lorsqu’il défend son mandat ou son honneur. Je ne dresse pas un portrait à charge, je dis seulement que c’est quelqu’un d’extrêmement énergique, avec qui il vaut mieux être prudent – et je l’ai peut-être été à l’excès. Je n’ai pas souhaité révéler cet enregistrement : c’est mon droit. J’accepte entièrement la critique sur ce point mais, si on me met en cause, je défends mon honneur. Je ne veux pas que l’on raconte des histoires à dormir debout. Or, vous en avez entendu beaucoup ici même !
Mme Cécile Untermaier. Vos propos mettent en lumière au moins un dysfonctionnement, celui qui consiste à ne pas avoir utilisé l’article 40 du code de procédure pénale depuis 2001. Si vous l’aviez utilisé, on n’en serait pas là, il faut le dire avec force et avec consternation !
M. Michel Gonelle. Ce n’est pas un dysfonctionnement de l’État ?
Mme Cécile Untermaier. Depuis 2001, c’est-à-dire pendant douze années, vous conservez par-devers vous un enregistrement dont vous mesurez toute la valeur puisque, contrairement à ce que M. Bruguière dit avoir fait de son exemplaire, vous ne le jetez pas et vous essayez de le glisser à trois reprises.
L’inspecteur des impôts que vous rencontrez en 2001 et à qui vous donnez cet enregistrement reconnaît la voix de M. Cahuzac. Cela ne vous empêche pas de demander ensuite à une entreprise de réaliser l’expertise de cette voix…
M. Michel Gonelle. Non, ce n’est pas cela.
Mme Cécile Untermaier. Quoi qu’il en soit, l’inspecteur des impôts vous indique que le dossier de M. Cahuzac ne redescendra pas de Paris et qu’aucune suite ne sera donc donnée. C’est ce qu’il nous a dit lors de son audition. Comment réagissez-vous à cette annonce ? Ne ressentez-vous pas une certaine incompréhension ?
M. Michel Gonelle. Que faut-il entendre par : « Vous essayez de le glisser à trois reprises » ?
Mme Cécile Untermaier. En 2001, 2006 et 2012.
M. Michel Gonelle. En 2001, je provoque une alerte auprès du service compétent. Je ne « glisse » rien du tout ! Je ne confie même pas la bande-son à la personne qui effectue l’alerte, attendant que l’on m’appelle pour que je donne mon témoignage. Or, personne ne m’appelle. Je suis prêt à endosser bien des dysfonctionnements, mais convenez que celui-ci n’est pas de mon fait : il relève de la responsabilité de celui ou de ceux qui reçoivent cette alerte et ne lui donnent pas suite pour des raisons que j’ignore.
Le dossier, me dit-on, est en réalité redescendu presque aussitôt – au mois de juillet, si j’ai bien lu les comptes rendus. Je ne l’ai pas su. Lorsqu’on m’a dit qu’il n’y avait pas de suite, j’ai été en effet choqué mais que pouvais-je faire ? Aller voir le procureur de la République ? D’abord, depuis le mois de mars, n’étant plus maire, je n’étais plus concerné par l’article 40 du code de procédure pénale. Et je ne suis pas sûr que le procureur de la République aurait pris cet enregistrement plus au sérieux que la BII, voire que M. Zabulon quand je lui en ai parlé au téléphone.
Tout le monde a considéré que l’enregistrement était douteux. Or, il faut bien convenir aujourd’hui qu’il est techniquement irréprochable et que, à 60 % de probabilité, il s’agit de la voix de Jérôme Cahuzac.
Enfin, permettez-moi d’insister encore une fois sur le fait que la démarche auprès de M. Mangier n’était pas anonyme. Elle s’est faite à visage découvert.
Par la suite, en 2006, j’ai en effet glissé l’enregistrement à M. Bruguière. Que ce dernier raconte maintenant des histoires, ce n’est pas mon affaire !
Mme Cécile Untermaier. Il ne connaissait pas l’existence de l’enregistrement. C’est vous qui étiez déterminé à le lui donner. Il est dès lors concevable que votre interlocuteur n’ait pas manifesté plus d’intérêt que cela pour ce document.
Avez-vous évoqué le sujet au sein de l’équipe de campagne de M. Bruguière ? La question était importante : il s’agissait de l’honorabilité de votre adversaire.
M. Michel Gonelle. Je n’étais pas « déterminé » à donner l’enregistrement à M. Bruguière. Au mois de décembre, alors qu’il n’était pas encore candidat – il s’est déclaré au mois de mars, les coupures de presse en font foi –, nous nous sommes rencontrés à l’occasion d’une tournée qu’il faisait auprès des personnes dont il espérait le soutien. Comme je l’ai dit dans ma précédente déposition, nous avons évoqué les qualités et les défauts de son futur adversaire Jérôme Cahuzac, son train de vie qui ne pouvait être qualifié d’anodin, et je lui ai dit à un moment donné : « Savez-vous qu’il a un compte en Suisse ? » Il m’a demandé comment je le savais. Je lui ai raconté l’histoire de l’enregistrement et c’est lui qui m’a demandé à l’écouter. Si j’avais été équipé, j’aurais pu le lui faire écouter sur place. Mais comme ce n’était pas le cas, il l’a emporté.
Je comprends que M. Bruguière veuille aujourd’hui se défausser. Cela étant, le fait qu’il soit une grande personnalité – bien plus grande que moi – ne le dispense pas de dire la vérité.
Mme Cécile Untermaier. La question était : avez-vous évoqué le sujet lorsque vous étiez dans l’équipe de campagne ?
M. Michel Gonelle. Non, à aucun moment.
Mme Cécile Untermaier. À aucun moment cela n’a cessé d’être confidentiel entre M. Bruguière et vous ?
M. Michel Gonelle. À aucun moment.
Mme Cécile Untermaier. J’en viens au jour où vous tentez de joindre M. Zabulon. Alors que vous devez le rappeler, un problème de standard fait que la communication ne passe pas. Vous n’imaginez pas, alors, de le rappeler ?
M. Michel Gonelle. Globalement, et même si je ne suis pas d’accord avec son analyse, je confirme les éléments factuels que vous a exposés Alain Zabulon. Ils correspondent d’ailleurs à ce que je vous avais dit au cours de ma première audition. Sur ce point précis, cependant, je crois que M. Zabulon se trompe tout en étant de bonne foi. Le cahier d’appels qu’il vous a montré est celui du lundi et il est exact que, ce jour-là, c’est moi qui ai appelé. Mais je n’ai pu le joindre car il n’était pas disponible. Son secrétariat m’a assuré qu’il me rappellerait. Or, ce rappel est intervenu, dans mes souvenirs, le mardi. C’est donc le mardi qu’intervient le quiproquo que nous relatons tous deux : sa secrétaire me dit qu’elle va me le passer mais, dans l’intervalle, il avait pris un autre appel. Si je n’ai pas rappelé ensuite M. Zabulon, c’est que sa secrétaire m’avait dit qu’elle me rappellerait. Du reste, M. Zabulon ne l’exclut pas dans sa déposition.
Il n’est pas facile de joindre un membre du cabinet du Président de la République. Sachant que je suis plus disponible que lui, je préfère attendre que ce soit lui qui m’appelle.
Intervient ensuite la dépêche AFP du 21 décembre qui révèle mon contact avec la présidence de la République. Mediapart, qui est à l’origine de cette information, invoque « des sources officielles », si bien que j’ai le sentiment de m’être fait flouer.
M. Zabulon soupçonne pour sa part qu’il a été instrumentalisé. C’est inexact. J’ai du respect pour le préfet Zabulon et je n’ai nullement voulu l’instrumentaliser. Je souhaitais effectuer une démarche confidentielle auprès du premier magistrat de ce pays pour lui dire que je détenais la vérité. Du reste, même s’il ne vous l’a pas dit, la première question qu’Alain Zabulon me pose est : « Détenez-vous encore cet enregistrement ? » Je lui ai répondu par l’affirmative.
Vous n’avez pas non plus demandé précisément à M. Zabulon ce qu’il m’avait conseillé de faire s’agissant de la lettre. Il ne m’a pas invité à l’envoyer. Ce qu’il m’a dit, c’est : « Ne faites rien, je reviens vers vous. ». Ce que l’on retrouve dans sa déposition : « Je ne lui dis pas : “Faites ceci ou ne faites pas cela.” »
M. Thomas Thévenoud. Au rapporteur, qui vous demandait tout à l’heure pour quelles raisons vous n’aviez pas saisi la justice après votre entretien avec M. Zabulon, vous avez répondu en rappelant pourquoi vous ne l’aviez pas fait en 2001 et en signalant que tout parlementaire aurait pu le faire. Mais vous, pourquoi n’avez-vous pas saisi la justice après ce rendez-vous manqué avec M. Zabulon ?
M. Michel Gonelle. Mais je l’ai fait, monsieur le député. Dès que j’ai eu connaissance de la dépêche AFP du 21 décembre, j’ai pris contact avec le juge Daïeff. J’ai du reste remis au président de Courson une copie de cette correspondance.
J’ai parlé avec M. Daïeff et avec sa greffière au téléphone dès avant Noël. Il me demande d’écrire une lettre pour proposer mon témoignage, ce que je fais le 2 janvier. À ce moment-là je voyais bien que c’était absolument indispensable. Ce qui m’a désarçonné, c’est que dans son communiqué repris par l’AFP, l’Élysée me demandait de m’adresser à la justice car une enquête était en cours : or, à part celle que menait Guillaume Daïeff, il n’y avait pas d’enquête en cours. Je n’allais quand même pas apporter ce document au juge saisi de la plainte en diffamation, dont j’ignorais d’ailleurs l’identité.
Bref, contrairement à ce qu’affirmait, la présidence de la République, aucune enquête n’était en cours. Et celle du juge Daïeff, ciblée sur la banque UBS en France, ne pouvait s’étendre au cas de Jérôme Cahuzac que moyennant l’obtention d’un réquisitoire supplétif du parquet. Les juges ne pouvaient accepter mon témoignage sans ce réquisitoire supplétif.
M. Thomas Thévenoud. M. Jean-Louis Bruguière a évoqué des dîners organisés à Villeneuve-sur-Lot ou à Paris, en 2006 et 2007, avec des personnalités du Villeneuvois que vous lui auriez fait connaître. Pourriez-vous apporter des précisions sur la date et le lieu de ces dîners et sur l’identité des participants ? Y a-t-on évoqué la question du compte à l’étranger de Jérôme Cahuzac et de l’enregistrement ?
M. Michel Gonelle. Il y a eu un seul dîner – ou déjeuner –, au restaurant « Chez Françoise », gare des Invalides à Paris. Je ne saurais dire la date. Y participaient Jean-Louis Bruguière, Jean-Luc Barré et moi-même. Le but était de permettre à Jean-Luc Barré de faire la connaissance de Jean-Louis Bruguière, qu’il ne connaissait pas ou très peu, et éventuellement de les rapprocher. Mais je ne sais pas à quelle date cette rencontre a eu lieu.
M. le président Charles de Courson. Y évoque-t-on l’enregistrement et le compte ?
M. Michel Gonelle. Bien sûr que non. D’ailleurs, je ne sais pas du tout si cette rencontre a eu lieu avant ou après que j’ai reçu l’enregistrement.
M. Thomas Thévenoud. Quelles relations avez-vous entretenues et, le cas échéant, entretenez-vous encore avec l’épouse de Jérôme Cahuzac ? Êtes-vous en contact avec elle ou avec ses conseils ?
M. Michel Gonelle. Je crois n’avoir rencontré Mme Cahuzac que trois fois.
La première fois en 1996, avant que Jérôme Cahuzac ne soit candidat aux législatives de 1997, lors d’un dîner chez des amis communs.
Je me souviens aussi d’avoir invité Jérôme Cahuzac et son épouse à déjeuner dans un restaurant villeneuvois – plus précisément dans la commune voisine de Pujols – après son élection à l’Assemblée.
Je l’ai rencontrée une troisième fois quelque temps plus tard, alors qu’elle se promenait – peut-être avec son mari, mon souvenir est assez vague – dans les rues de Villeneuve.
Mais au moment où l’affaire révélée par Mediapart a éclaté, je n’avais pas vu Mme Cahuzac depuis plus de dix ans.
M. Thomas Thévenoud. Vous n’avez pas eu de contacts avec elle et elle n’a pas cherché à entrer en contact avec vous ?
M. Michel Gonelle. Nous n’avons eu aucun contact.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Vous aviez, nous avez-vous dit, trois possibilités concernant l’enregistrement en votre possession : alerter la presse, saisir le procureur dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, ou recourir de manière informelle à un ami.
Or, cet ami – M. Catuhe, puisque notre commission a retrouvé son nom – nous a affirmé qu’il ne vous avait pas dit la vérité concernant la suite donnée au dossier. Alors que le dossier était bien « descendu » de Paris, il a péché par omission en vous indiquant qu’il n’y avait pas eu de suite. Vous n’avez pas relevé de dysfonctionnement de l’État à ce niveau, mais vous auriez pu expliquer à cette occasion l’article 40 du code de procédure pénale à ce fonctionnaire de l’administration fiscale, qui a reconnu devant nous en ignorer l’existence ! Peut-être la procédure aurait-elle eu alors une suite.
Vous entretenez des amitiés curieuses ! Non seulement M. Catuhe demande que son nom n’apparaisse pas et ne vous dit pas la vérité, mais vous ne lui indiquez pas que l’affaire dont vous le saisissez peut avoir une qualification pénale.
M. Michel Gonelle. Est-ce pour me blesser que vous parlez d’« amitiés curieuses » ? Je connais Jean-Noël Catuhe, qui est un homme honorable. À cette époque où j’étais encore maire, je l’ai appelé pour lui demander conseil – ce qui est mon droit –, ne connaissant pas l’administration fiscale aussi bien que lui. Il m’a donc rendu visite, nous avons évoqué ce que je venais de recevoir, je lui ai fait écouter l’enregistrement et je lui ai demandé ce que nous pouvions faire.
J’avais pour ma part exclu de saisir le parquet – je vous l’ai déjà dit, je le confesse et l’assume. Il m’a indiqué qu’il était possible de saisir le service compétent, exclusivement consacré à la lutte contre la fraude, et il a accepté de faire la démarche pour mon compte. Étant alors en campagne électorale, j’ai pensé que cet homme qui était de la maison, si j’ose dire, en était au moins aussi capable que moi. Il l’a fait d’autant plus volontiers qu’un de ses camarades de promotion, M. Mangier, travaillait dans ce service. Il vous a d’ailleurs indiqué qu’il l’avait rencontré peu de temps avant dans le Villeneuvois pour une autre circonstance.
M. Catuhe va donc voir M. Mangier et lui explique l’affaire en lui précisant, bien sûr, que c’était moi qui la lui avais exposée. M. Mangier écoute, puis sollicite la communication du dossier. Il n’y a rien de douteux dans cette procédure. Jusque-là, il s’agit d’une alerte absolument normale – ou alors démontrez-moi qu’elle ne l’est pas !
Je pensais que le dossier n’avait pas été envoyé. Nous savons maintenant que ce n’était pas le cas. M. Catuhe a expliqué qu’il n’avait pas le droit de me dire la suite de sa démarche : dont acte ! Ce n’est pas quelque chose à quoi je pensais tous les jours et je ne l’ai pas harcelé à ce sujet. Il m’a dit que le dossier n’était pas descendu, je l’ai cru. Peut-être ai-je fait preuve de naïveté, mais la suite ne m’appartient plus. À partir du moment où l’administration compétente est saisie, la balle est dans son camp. Il lui appartient de faire ce qu’elle a le devoir de faire dans un cas de signalement de fraude.
Nous apprenons maintenant que ce dossier a malheureusement « fait l’étagère » pendant sept ans. Je suis désolé, mais je ne peux en endosser la responsabilité !
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cela met toutefois en lumière, conformément à l’objet de notre commission d’enquête, les dysfonctionnements de l’administration fiscale à ce sujet dès 2001. Il n’est pas inintéressant de constater qu’un inspecteur des impôts chargé des vérifications ne fait pas usage de l’article 40 du code de procédure pénale et ne cherche pas à savoir la vérité à propos de ce dossier.
M. Michel Gonelle. Je suis d’accord avec vous.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Vous avez été par ailleurs l’avocat de M. Garnier, lequel a fait à son administration onze procès qu’il a tous gagnés. Il semblerait que l’administration fiscale n’a demandé à aucun moment la suppression de tel ou tel passage du mémoire contenant des éléments pouvant conduire à une qualification pénale. De même, aucune juridiction administrative n’a transmis ces éléments au procureur de la République. En tant qu’avocat, que pouvez-vous nous dire sur le suivi de ce dossier ?
M. Michel Gonelle. M. Garnier a en effet gagné onze procédures contre l’administration fiscale, dont les responsables ont pourtant défilé ici même pour affirmer que jamais, au grand jamais elle n’avait commis la moindre faute à son égard.
Cependant, je n’ai pas été le conseil de M. Garnier pour toutes les procédures. J’ai été son avocat au pénal seulement, dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement, dont l’instruction a été très longue, et dans le cadre d’une plainte pour outrage à ses supérieurs – procédure que nous avons gagnée après deux arrêts de la Cour de cassation.
Dans l’affaire de la consultation du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, celle qui a donné lieu au mémoire auquel vous faites allusion, Rémy Garnier, qui est un rédacteur d’expérience, a agi seul. Il a d’ailleurs mené seul beaucoup d’autres procédures.
M. le président Charles de Courson. Vous ne connaissiez pas ce mémoire ? Il ne vous l’a pas donné ?
M. Michel Gonelle. Non, il ne m’en a pas informé. Il n’y pas de dossier ouvert à mon cabinet concernant la sanction…
M. Philippe Houillon. Et le secret professionnel ?
M. Michel Gonelle. Je respecte le secret professionnel, bien sûr. Néanmoins, sans évoquer le contenu des dossiers, je peux vous indiquer que je ne suis intervenu qu’au pénal.
Quoi qu’il en soit, lorsque M. Parini affirme ici même que la direction des ressources humaines ne lui a donné qu’une note au sujet de la procédure disciplinaire relative à cette incursion dans le dossier fiscal de M. Cahuzac, je me dis qu’il aurait été beaucoup plus simple de communiquer le mémoire lui-même. Tout cela paraît un peu étonnant. En tout cas, personne ne s’est intéressé à l’alerte de Garnier, c’est un fait et cela constitue un nouveau dysfonctionnement.
M. Philippe Houillon. Je veux pour ma part vous remercier pour la précision, la constance et la cohérence de vos réponses. J’aimerais que notre commission ait devant d’autres interlocuteurs la même exigence que celle dont elle fait preuve avec vous ! Trop souvent, nous devons nous contenter d’à-peu-près et de réponses amnésiques ou fuyantes, à commencer par celles du principal intéressé, qui a eu à notre égard l’attitude d’un dieu tombé de l’Olympe jugé par des mortels. On ne lui a finalement pas dit grand-chose, sinon qu’il était normal qu’il ne réponde pas aux questions ! Alors que c’est lui qui est au cœur des débats.
Vous nous déclarez que M. Bruguière nous a menti et que les réponses d’autres personnes auditionnées n’étaient pas l’exact reflet de la réalité.
Pourriez-vous dire quelques mots de la personne dont M. Bruguière a affirmé qu’on l’avait désignée comme son directeur de campagne, sans qu’il l’ait choisi, mais qui était plutôt, selon vous, le trésorier de la campagne ? Était-elle très présente aux côtés de M. Bruguière ? Quel était son rôle ? M. Bruguière aurait-il pu évoquer l’enregistrement devant elle ?
M. Michel Gonelle. Je connais le général Paqueron. Il était en effet proche de Jean-Louis Bruguière pendant la campagne électorale. Je pense qu’il était plutôt son trésorier mais je peux me tromper. Il s’agit d’un général d’armée de l’aviation et d’un homme d’honneur. Je n’accorde aucun crédit à la thèse, avancée par des journaux suisses, selon laquelle l’armée aurait voulu se venger de restrictions budgétaires imposées par Jérôme Cahuzac. Cela relève, je crois, du fantasme. Vous pourrez entendre M. Paqueron si vous le souhaitez. C’est un officier de grande qualité. Il serait très étonnant qu’il se soit prêté à une opération de cette nature.
M. le président Charles de Courson. Il est prévu que notre commission entende mercredi 17 juillet M. Gérard Paqueron, qui était le mandataire financier de M. Jean-Louis Bruguière.
M. Michel Gonelle. Je voudrais maintenant adresser des excuses personnelles à M. le rapporteur. J’ai conscience d’avoir été incorrect et lui demande humblement de bien vouloir me pardonner.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je ne connais pas la notion de pardon, monsieur Gonelle, mais je prends acte de vos déclarations.
J’en reviens aux dates 2001 et 2008. Avant votre première audition, vous déclarez que c’est en 2008 que l’administration des douanes est informée de l’existence d’un compte en Suisse. Puis, en réponse à une question que je vous pose lors de cette audition, vous affirmez que la date est 2001.
Faut-il en conclure que Le Courrier picard et Marianne ont mal interprété vos propos ? Je rappelle ce qu’écrit Le Courrier picard dans son édition du 5 avril 2013 : « Quoi qu’il en soit, Gonelle maintient ces affirmations sur le fond. Pour lui, le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac a bien été mis sous l’éteignoir sous la droite au gouvernement. » Et, dans son numéro 834, Marianne vous fait dire : « On ne comprend rien si on ne prend pas en compte les relations entre Éric Woerth et Jérôme Cahuzac. »
Ces propos sont-ils les vôtres ? Ont-ils été déformés ? Le changement de date, vous le comprenez bien, n’est pas neutre. S’il s’agit de 2008, cela vient à l’appui de la thèse que vous développez. Si vous revenez sur cette date, l’analyse est alors différente.
M. Michel Gonelle. Je comprends votre analyse, qui est pertinente. J’ai fait une erreur s’agissant de 2008. Je l’ai corrigée après avoir consulté la source journalistique qui m’avait apporté ces informations. Je m’en excuse auprès de M. Picart. Cela réduit à néant la thèse que j’avais développée et que vous venez d’évoquer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette thèse est donc sans fondement…
M. Michel Gonelle. Elle était de toute façon complètement subjective. Je ne connais à Marianne que M. Ploquin. Je ne sais pas s’il s’agit d’un de ses articles. Par ailleurs, je n’ai jamais eu de contact avec Le Courrier picard. L’article que vous citez est sans doute repris d’une dépêche AFP.
La réponse que M. Picart vous a faite – « Je ne peux ni le confirmer ni l’infirmer. » – n’en reste pas moins singulière !
M. le président Charles de Courson. Comment le nom de M. Picart vous est-il parvenu ?
M. Michel Gonelle. Par la source en question.
M. le président Charles de Courson. La source journalistique ?
M. Michel Gonelle. Oui.
M. Jean-René Marsac. Notre commission d’enquête a besoin de savoir qui dit vrai et qui ne dit pas vrai.
Vous avez beaucoup accusé le juge Bruguière. Vous avez fait partie de son équipe de campagne, dites-vous, jusqu’en mai 2007. Cela signifie-t-il que vous avez été écarté après cette date et que le juge Bruguière a raison de l’indiquer ?
M. Michel Gonelle. J’ai des documents jusqu’en mai 2007, ainsi qu’une lettre extrêmement chaleureuse du 30 juin 2007.
M. Jean-René Marsac. Sur laquelle il s’est expliqué.
M. Michel Gonelle. Il vous a raconté une fable. Permettez-moi de vous lire cette lettre, dont le sujet n’est nullement de réconcilier les militants !
M. Jean-René Marsac. Ce n’est pas ma question. Ce que je vous demande, c’est si vous avez été écarté en mai 2007, et pour quelles raisons.
M. le président Charles de Courson. M. Gonelle est libre de ses réponses. Si vous souhaitez lire ce document, monsieur Gonelle, vous le pouvez.
M. Michel Gonelle. Je réponds d’abord à la question. La campagne de Jean-Louis Bruguière a été singulière. Peut-être vous rappelez-vous l’article que Florence Aubenas lui a consacré dans Le Nouvel Observateur. Du reste, Jérôme Cahuzac a exploité cette façon de circuler dans la circonscription avec voiture blindée, garde rapprochée, sirène sur le toit. C’était ahurissant ! Nous avons été plusieurs – dont Alain Merly – à prendre nos distances vis-à-vis de Jean-Louis Bruguière, qui par ailleurs se promenait dans les rues avec des gens qui avaient un casier judiciaire long comme le bras. « Ne faites pas cela, disions-nous, tous les Villeneuvois les connaissent ! – Mais non, répondait-il, les Villeneuvois ne connaissent que moi ! » À un moment donné, nous avons pensé qu’il était en dérapage.
J’en viens à la lettre qu’il m’adresse le 30 juin 2007, après le deuxième tour : « Je tiens à vous remercier pour votre généreux soutien à notre campagne difficile, qui n’a pas eu l’issue espérée. J’ai bien reçu votre message transmis par Alain [Merly]. J’espère avoir l’occasion de vous revoir pour reparler des enjeux de notre région.
« L’investisseur avec lequel j’étais en contact et qui avait manifesté un intérêt soutenu pour le site que vous avez trouvé [j’avais en effet constitué un dossier pour un investisseur américain, dont il ne m’a jamais dit le nom, qui voulait 50 hectares pour implanter une plateforme logistique] a finalement décidé après l’élection, vu la communication politicienne de Cahuzac, de renoncer alors que nous avions pris pour le 20 juin contact avec le maire de Saint-Antoine [la commune concernée]. Nous étions sur un projet ambitieux pouvant générer entre 500 et 700 emplois. L’investisseur est reparti ailleurs.
« Amicalement, Jean-Louis Bruguière. »
Il n’est pas question, vous le voyez, de la pacification des militants. C’est la lettre qu’un candidat qui vient de perdre adresse à quelqu’un qui s’est investi pour lui afin de lui dire merci. Or, à Paris-Match¸ il affirme : « La réaction a été immédiate. J’ai exclu Michel Gonelle de mon équipe. » Quel est celui qui ment ? Je vous apporte des écrits qui montrent que Jean-Louis Bruguière a raconté une fable !
M. Jean-René Marsac. M. Bruguière et vous-même évoquez les laboratoires pharmaceutiques. Quelle est leur importance dans la campagne électorale à Villeneuve-sur-Lot ?
M. Michel Gonelle. Leur intervention était publique. Les laboratoires Fabre et UPSA, que Jérôme Cahuzac a cités, ont subventionné les clubs de rugby à XV et à XIII de notre ville à des hauteurs telles que la subvention municipale était ridicule par rapport à celle que le député apportait dans sa manche. Avec le recul, je regrette de ne pas m’en être gendarmé plus que je ne l’ai fait. En 2001, plusieurs de mes colistiers ont réagi en écrivant aux associations sportives. La réplique de Jérôme Cahuzac, je vous l’ai déjà dit, a été cinglante : si l’on nous accuse de corruption, a-t-il menacé, il n’y aura plus de subventions de la part des laboratoires et ce sont les sportifs qui en pâtiront.
Le sujet était brûlant. On remettait des chèques grand format devant la presse, comme lorsque la Caisse d’épargne récompense l’association Truc-Machin. Sur la photo, Jérôme Cahuzac tenait par les épaules le président du club d’un côté, le directeur du laboratoire de l’autre. Nous avons vécu cela pendant des mois !
M. Jean-René Marsac. Pas lorsque vous étiez maire ?
M. Michel Gonelle. Si, j’étais maire à l’époque. Un an et demi avant la campagne, les laboratoires ont fait une large promotion de la personne de Jérôme Cahuzac. En décembre 1999 et janvier 2000, le laboratoire Lilly, dont il n’a pas parlé, a tenu à Villeneuve-sur-Lot un colloque sur la santé des Villeneuvois. « Nous allons faire une grande étude sur la santé des Villeneuvois, m’a-t-il dit un jour. C’est l’INSEE qui a choisi Villeneuve. » Je l’ai cru. Et le laboratoire Lilly est venu en avion spécial avec soixante personnes à bord, dont le professeur Le Pen. Un grand dîner a été donné pour un compte rendu d’étude que personne n’a jamais lu. La ministre de la santé elle-même est venue à ce colloque.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qui vous avait informé de la date à laquelle les douanes ont été averties ?
M. Michel Gonelle. La source journalistique que j’ai évoquée. Mais j’ai peut-être mal compris…
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est important. La théorie que vous avez bâtie autour de la date de 2008 n’est pas insignifiante du point de vue des dysfonctionnements de l’État. Vous aviez affirmé qu’en 2008, la droite, et singulièrement son ministre du budget, couvrait Cahuzac. Ce n’est pas rien ! Le scénario est différent s’il s’agit de 2001. La source journalistique que vous évoquez a-t-elle parlé de 2008 ou de 2001 ?
M. Michel Gonelle. C’est peut-être moi qui ai mal compris, puisque j’ai corrigé par la suite.
M. Alain Claeys, rapporteur. Tous les journaux et toutes les dépêches ont repris la date de 2008.
M. Michel Gonelle. C’est possible. C’est à cause de moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je ne vous impute pas toutes les déclarations. Si votre source est journalistique, le journaliste aurait dû corriger son erreur…
M. Michel Gonelle. Il est évident que c’est moi qui ai donné de l’ampleur à cette erreur.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne qui vous a influencé, puisque vous n’aviez, semble-t-il, aucune preuve autre qu’orale ?
M. Michel Gonelle. Je ne vais pas vous donner le nom du journaliste !
M. le président Charles de Courson. Pourquoi ? Ce n’est pas couvert par le secret des sources.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourtant, M. Arfi lui-même indique dans son livre que les relations Woerth-Cahuzac sont le point de départ de l’enquête.
M. Michel Gonelle. Je sais que ces journalistes ont tiré la sonnette de M. Picart, lui ont téléphoné… Mettez-vous à ma place : je ne vais pas mettre en cause un journaliste !
M. le président Charles de Courson. Il n’est pas question de mise en cause. Chacun a le droit de faire des hypothèses.
M. Michel Gonelle. Je connais au moins deux journalistes, travaillant pour des journaux différents, qui ont contacté M. Picart. Lui-même affirme avoir été contacté « par de nombreux journalistes ». Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que le second l’a eu au téléphone.
M. le président Charles de Courson. Donnez-nous son nom. Cela nous intéresse.
M. Michel Gonelle. Non. On ne met pas en cause un journaliste.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas le mettre en cause. Un journaliste a le droit de faire des hypothèses.
M. Michel Gonelle. Cela lui vaudrait de comparaître devant vous et il m’en voudrait jusqu’à la fin de ses jours !
M. le président Charles de Courson. Certains membres de la commission ont pensé qu’à travers cette affaire, alors que vous n’aviez aucune preuve…
M. Michel Gonelle. Je suis convaincu que j’ai accroché quelque chose de vrai. À preuve, la réponse très étonnante de M. Picart.
M. le président Charles de Courson. L’avocat que vous êtes sait qu’il faut des preuves, si possible matérielles. Au demeurant, vous déteniez la preuve matérielle qui a permis enfin que la justice soit saisie. Pourquoi vous mêlez-vous d’une affaire concernant les douanes et construisez-vous une théorie sur ce que vous racontent un ou deux journalistes ?
M. Michel Gonelle. Je ne suis pas sûr d’être l’auteur de la théorie sur les relations Cahuzac-Woerth. Je lis les journaux comme vous, monsieur le rapporteur, et ces relations ont donné lieu à de nombreux commentaires, fondés en particulier sur l’expertise de l’hippodrome de Compiègne par un professeur ami de Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Mais ce sont, si je puis dire, des informations de troisième main. Les journalistes ne vous ont pas fourni de preuves à l’appui d’une hypothèse qui, à ce jour, reste à démontrer. Notre mission étant d’enquêter sur les dysfonctionnements de l’État…
M. Michel Gonelle. La date n’est pas 2008, donc le dysfonctionnement que j’ai mentionné ne tient pas.
M. le président Charles de Courson. C’est plus clair ainsi !
M. Michel Gonelle. Je vois M. le rapporteur qui sourit !
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce que vous venez de dire devant la commission est une certitude ?
M. Michel Gonelle. En tout cas, cela ne vient pas de l’épisode Picart.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Gonelle, merci.
Audition du mardi 9 juillet 2013
À 17 heures : Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces.
M. le président Charles de Courson. Après avoir reçu, au cours des dernières semaines, M. François Falletti, le procureur général de Paris, et M. François Molins, le procureur de Paris, nous entendons Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces.
Madame Le Quéau, cette Commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Sans aborder les éléments de fond de l’enquête, qui relèvent du secret de l’instruction, nous souhaitons mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été conduite, et que vous nous expliquiez le rôle que vous avez joué dans le traitement judiciaire de ce dossier, depuis les premières révélations parues dans Mediapart jusqu’au moment où Jérôme Cahuzac a reconnu détenir un compte à l’étranger.
(Mme Marie-Suzanne Le Quéau prête serment.)
Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces. J’informerai de mon mieux la Commission, dans le respect du secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.
Je commencerai par exposer le cadre général qui régit les relations entre le parquet général et ma direction d’une part, et entre ma direction et le cabinet de la ministre d’autre part. Par circulaire du 19 septembre 2012, la garde des Sceaux a décidé de ne plus adresser d’instructions dans les affaires individuelles afin de mettre fin à toute suspicion d’intervention inappropriée dans l’exercice de l’action publique. Un projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, voté en première lecture par l’Assemblée nationale, reprend ce principe de prohibition des instructions individuelles. Celui-ci ne concerne toutefois que le ministre, les procureurs généraux conservant la possibilité d’émettre des avis ou d’adresser des instructions de poursuite aux procureurs de la République de leur ressort, dans le cadre des règles institutionnelles qui régissent leurs relations.
Pour autant, les magistrats du ministère ont un devoir d’information, qu’ils exercent avec une vigilance particulière dans les affaires significatives ou médiatisées, de manière à éclairer les différents niveaux de la hiérarchie judiciaire – procureur, procureur général, Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), ministre – sur le déroulement des enquêtes ou des instructions judiciaires. Ma direction peut, pour sa part, demander au procureur général – son interlocuteur naturel – des précisions concernant un dossier particulier, à des fins d’information ou d’analyse.
Un protocole sur la circulation de l’information entre la DACG et les parquets généraux – dont la première version remonte au 27 novembre 2006 – impose à ces derniers de transmettre leurs comptes rendus, en fonction de la nature des infractions en cause, au bureau compétent de la DACG – en l’occurrence, le bureau du droit économique et financier (BEFI). Adressés par courriel sur la boîte structurelle du bureau concerné, ces comptes rendus sont directement accessibles pour ses membres. Ils font en outre systématiquement l’objet d’une impression papier par le bureau d’ordre de la DACG, qui les remet physiquement au magistrat de ce bureau chargé du suivi du dossier. En cas d’urgence, l’information peut être communiquée par le parquet général à la DACG par le biais d’un courriel nominatif adressé directement aux magistrats en charge du suivi sur leur boîte professionnelle nominative.
La remontée de l’information s’effectue donc par voie écrite. Les échanges téléphoniques constituent l’exception – en cas d’urgence, ou lorsque la complexité d’un point du dossier rend nécessaires des précisions pour sa bonne compréhension.
Le parquet général nous informe régulièrement des avancées significatives du dossier résultant des actes et des auditions réalisées, mais les pièces de la procédure – à l’exception des réquisitoires définitifs, ordonnances de non-lieu ou de renvoi, jugements et arrêts – ne sont pas transmises à ma direction. De même, la DACG n’est pas informée à l’avance des actes particulièrement importants ou coercitifs comme les perquisitions ou les placements en garde à vue, elle n’est avertie qu’au moment de leur réalisation, voire après coup.
Dans ses rapports de transmission, le procureur général doit indiquer à ma direction s’il partage l’analyse juridique et les orientations du procureur de la République ; il peut également solliciter notre analyse juridique. Dans le cadre de cette affaire, le parquet général a usé une fois de cette possibilité en sollicitant, le 1er février 2013, notre expertise sur les conditions dans lesquelles, au regard du principe de spécialité, la réponse faite par les autorités helvétiques à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre de la convention d’assistance administrative en matière fiscale pouvait être versée à l’enquête préliminaire en cours au parquet de Paris.
Si tous les comptes rendus que nous recevons des parquets généraux ne sont pas systématiquement adressés au cabinet du garde des Sceaux, ma direction informe naturellement ce dernier des développements des dossiers sensibles. C’est le conseiller pénal qui représente notre interlocuteur privilégié, mais dans cette affaire, nous avons également adressé les comptes rendus au conseiller diplomatique, comme nous le faisons toujours en cas de développements à l’international. Enfin, vu l’importance du dossier, nous avons également inclus parmi les destinataires le directeur et le directeur adjoint de cabinet, conformément aux règles de fonctionnement fixées par le cabinet de la ministre.
Les magistrats de ma direction informent le cabinet de l’avancée des procédures qui leur sont signalées au moyen de comptes rendus écrits envoyés par courriel. Ces courriels sont également adressés en copie aux membres du comité de direction de la DACG – moi-même, le directeur adjoint, les deux sous-directeurs et le chef de cabinet –, de manière à ce qu’ils puissent suivre au plus près les dossiers sensibles et répondre aux demandes du cabinet en cas d’urgence. J’ai par ailleurs évoqué cette affaire avec le directeur de cabinet de l’époque au cours de nos entretiens hebdomadaires au même titre que d’autres dossiers sensibles, pour faire un point d’actualisation du dossier.
La DACG transmet au cabinet les éléments factuels qui lui ont été communiqués par le parquet général, ainsi que son analyse juridique si le dossier soulève une question de droit. Dans les cas nécessitant un suivi de long terme, une fiche de synthèse reprenant les principaux événements de l’affaire accompagne le compte rendu envoyé par courriel, afin de faciliter le travail du conseiller pénal.
Par ailleurs, ma direction peut être interrogée par le cabinet sur des points particuliers. Ainsi, dans le cas présent, nous avons été invités à le renseigner à deux reprises, d’abord sur les conditions juridiques du versement de l’enregistrement en possession de M. Gonelle au dossier de diffamation, puis au sujet de la Division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF).
Dans cette affaire – le procureur de la République et le procureur général de Paris vous l’ont confirmé –, la transmission hiérarchique de l’information a scrupuleusement suivi l’ensemble de ces règles. L’affaire a débuté le 4 décembre 2012 avec la publication par Mediapart d’un article intitulé « Le compte suisse du ministre du budget Jérôme Cahuzac ». À partir de là, ce dossier a fait l’objet de comptes rendus sous ses deux aspects : la procédure de diffamation et la procédure de blanchiment.
Entre le 6 décembre 2012 et le 2 avril 2013, le parquet général de Paris a adressé 56 comptes rendus à ma direction, laquelle en a transmis 54 au cabinet. Les deux comptes rendus restants – datés du 7 décembre 2012 – concernaient, d’une part, l’analyse juridique, par le parquet de Paris, de la plainte en diffamation que je lui avais transmise la veille par le biais du parquet général, et d’autre part, l’information selon laquelle la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) avait été saisie de l’enquête du chef de diffamation.
Sur les 54 comptes rendus adressés au cabinet, 6 portaient sur le volet diffamation – 3 résultant d’une demande adressée par ma direction au parquet général de Paris et 3 relevant de l’initiative de ce dernier – et 48, sur le volet blanchiment – 12 répondant à une demande de ma direction et 36 relevant de l’initiative du parquet général. Un tableau récapitulatif de ces courriels – que je peux remettre à la Commission – démontre la parfaite continuité dans la remontée de l’information entre le parquet général de Paris, la DACG et le cabinet de la ministre, à l’exception des deux premiers comptes rendus que j’ai évoqués.
Les principaux développements de ce dossier, qui ont fait l’objet de comptes rendus transmis par ma direction au cabinet de la ministre, vous ont déjà été exposés par le procureur de la République de Paris et le procureur général. Je souhaite en revanche vous préciser la nature des commandes passées à ma direction par le cabinet.
Dans le volet diffamation, trois demandes d’actualisation nous ont été adressées par le cabinet : le 27 décembre 2012, le 1er mars et le 15 mars 2013. À chaque fois, nous y avons répondu le jour même. Dans le volet blanchiment, sur les 12 demandes adressées par la DACG au parquet général, 10 l’ont été à la demande du cabinet. Le 8 janvier 2013, le cabinet a souhaité se voir confirmer l’ouverture d’une enquête préliminaire et savoir quand la DNIFF serait saisie du « soit transmis » aux fins d’enquête. Le même jour, il a également demandé de se faire transmettre le communiqué de presse du parquet de Paris annonçant l’ouverture de l’enquête préliminaire. Le 10 janvier, le cabinet a voulu obtenir des renseignements sur les auditions et investigations envisagées. Le 1er février, il nous a demandé de préciser les termes contenus dans la demande adressée par l’administration fiscale française aux autorités fiscales helvétiques. Le 6 février, il nous a adressé une demande d’actualisation et de précisions sur les éléments transmis par les autorités suisses. Le 7 mars, le cabinet a souhaité savoir quand serait achevée l’expertise de l’enregistrement téléphonique confiée au laboratoire d’Ecully. Le 15 mars, il a demandé des renseignements sur le coût de l’enquête, les moyens engagés et l’existence de liens éventuels avec l’affaire UBS, et le 19 mars, sur l’existence d’un communiqué de presse du parquet de Paris annonçant l’ouverture d’une information judiciaire. Le 2 avril, il nous a adressé une demande d’actualisation, souhaitant se voir confirmer que Jérôme Cahuzac était ce jour-là convoqué par le juge d’instruction pour la mise en examen. Enfin, le même jour, le cabinet nous a demandé de préciser si une mesure de contrôle judiciaire avait été prise à l’encontre de Jérôme Cahuzac à l’issue de sa mise en examen.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour résumer, sur un total de 56 comptes rendus dont cette affaire a fait l’objet, 54 ont été adressés au cabinet, avec pour destinataires le conseiller pénal, le conseiller diplomatique, le directeur et le directeur adjoint de cabinet.
M. le président Charles de Courson. S’agissait-il toujours des mêmes destinataires ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Sur le volet blanchiment, les destinataires au cabinet sont toujours restés les mêmes.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites avoir eu, avec le directeur de cabinet de l’époque, un entretien oral sur ce dossier.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Dans nos entretiens hebdomadaires, nous abordions, parmi d’autres sujets, les dossiers sensibles ou médiatiques – dont évidemment celui concernant M. Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Précisez-nous ce qui s’est passé le 1er février 2013. Est-ce le cabinet ou le procureur qui vous a interrogée sur l’usage que l’on pouvait faire de la réponse suisse à la demande d’entraide administrative ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le 1er février 2013, trois courriels ont été adressés par le parquet général de Paris à ma direction et remontés immédiatement au cabinet de la ministre. Le premier nous informait de la réception, par le procureur de Paris, du courrier que la DGFiP avait reçu le 31 janvier 2013 du département fédéral des finances suisse et transmis à la DNIFF, et nous en précisait, de manière succincte, le contenu.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-il courant ou exceptionnel de voir la procédure administrative et la procédure judiciaire menées en parallèle ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Ces deux procédures, fiscale et judiciaire, étant autonomes, rien ne s’y oppose en principe. Nous n’avons retrouvé aucun autre exemple qui aurait été porté à la connaissance de ma direction. Cette affaire était assez atypique, il est vrai.
M. le président Charles de Courson. Que vous demandait le parquet, et quelle réponse votre direction lui a-t-elle faite ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le parquet général nous a indiqué que la DGFiP avait transmis la réponse suisse au parquet de Paris. Nous lui avons alors demandé quel avait été le contenu de la demande initiale adressée par la DGFiP aux autorités helvétiques. Dans sa réponse, le parquet général de Paris a sollicité notre expertise en nous interrogeant sur les conditions dans lesquelles on pouvait verser ce courrier, obtenu dans le cadre de la convention administrative fiscale, au dossier de la procédure judiciaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. En recevant la réponse suisse, vous ignoriez donc le contenu de la demande ; mais qui vous l’a ensuite communiqué ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Nous ne l’avons jamais obtenu. Nous avons interrogé le procureur général qui s’est lui-même tourné vers le procureur de la République ; celui-ci nous a répondu qu’il ne disposait pas du contenu de la demande initiale.
M. le président Charles de Courson. C’est donc la réponse suisse qui vous a fait découvrir que la DGFiP française avait adressé une lettre aux autorités fiscales helvétiques.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Absolument. Nous avons alors essayé de comprendre ce qui avait justifié cette lettre, et quelle démarche la DGFiP avait engagée vis-à-vis des autorités fiscales helvétiques.
M. Alain Claeys, rapporteur. En avez-vous discuté avec le cabinet de la ministre ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. C’est à la demande du cabinet de la garde des Sceaux, et non à l’initiative de ma direction, que nous avons envoyé, le 1er février, le deuxième courriel au parquet général, l’interrogeant sur le contenu de la demande adressée par la DGFiP aux autorités helvétiques.
Le parquet général a profité de cette occasion pour solliciter notre expertise juridique.
M. le président Charles de Courson. Quelle réponse lui avez-vous faite ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le procureur de Paris a finalement versé ce courrier à la procédure judiciaire, malgré nos réserves. Nous estimions, en effet, qu’en application du principe de spécialité de la convention administrative fiscale de 1966, il fallait soit présenter la même demande par voie de commission rogatoire, dans le cadre d’une demande d’entraide pénale, soit solliciter de la part des autorités suisses l’autorisation de verser leur réponse à la procédure judiciaire. Cela dit, nous pouvions difficilement donner une réponse complète sans connaître le contenu de la demande initiale. En effet, une clause de cette dernière aurait pu permettre d’obtenir l’accord tacite des autorités fiscales suisses sur ce point.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous fini par obtenir connaissance du contenu de la demande initiale ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Pas que je sache.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous évoqué ce sujet avec le cabinet de la garde des Sceaux ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Uniquement dans l’échange de courriels que je vous ai décrit.
M. le président Charles de Courson. Vous avez répondu au parquet que vous étiez réticente, voire hostile, à l’idée de verser la réponse suisse au dossier judiciaire, suggérant d’envisager une autre procédure. Qui alors a décidé de passer outre ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le procureur de la République a estimé qu’il pouvait, de sa propre initiative, verser au dossier cette réponse – qu’il n’avait d’ailleurs pas obtenue directement de la DGFiP.
M. le président Charles de Courson. Qui la lui avait transmise ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il me semble que la Direction nationale des infractions financières et fiscales avait servi d’intermédiaire. Dès lors, n’ayant pas reçu directement ce courrier de la part de la DGFiP, le procureur a estimé qu’il pouvait, sans fragiliser la procédure, le verser à l’enquête préliminaire. Notre position était plus juridique : nous craignions que le versement de ce document ne constitue un moyen de remettre en cause la procédure à travers un contentieux en nullité. C’est cette analyse que nous avons soumise au cabinet de la ministre.
M. le président Charles de Courson. Le cabinet partageait-il cette analyse ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il ne nous a donné aucune indication à ce sujet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en à la demande de coopération adressée par l’administration française alors qu’une enquête préliminaire était déjà ouverte. Vous n’avez pas connaissance d’un précédent comparable ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il ne m’en vient aucun à la mémoire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jugez-vous la procédure anormale ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Elle est inédite, mais correspond à une situation également inédite. Normalement, en matière de fraude fiscale, l’administration effectue des vérifications, avant, le cas échéant, de déposer une plainte, ce qui va conduire le dossier dans le champ judiciaire. En l’espèce, les choses ne se sont pas passées ainsi : il s’agissait d’une affaire de blanchiment, d’autant plus délicate qu’elle concernait au premier chef le ministre du budget, lequel détient le pouvoir de déposer plainte, au nom de l’administration fiscale, auprès de l’autorité judiciaire – en l’occurrence, le procureur de Paris. C’est un cas sans précédent.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jérôme Cahuzac a déposé plainte contre Mediapart sur le fondement du 1o bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont les dispositions concernent les cas d’injure ou de diffamation envers un membre du Gouvernement. Pourquoi la Chancellerie a-t-elle transmis cette plainte au procureur de la République alors que les faits dénoncés par Mediapart étaient antérieurs à l’entrée au Gouvernement de Jérôme Cahuzac et sans lien avec son activité ministérielle ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le 6 décembre 2012, le directeur de cabinet en fonction à l’époque a transmis à ma direction la plainte déposée par M. Cahuzac sur le fondement que vous indiquez. Nous nous sommes rendu compte, à sa lecture, qu’elle était rédigée en termes confus. En effet, dès lors que M. Cahuzac et ses avocats déposaient plainte du chef de diffamation publique envers un particulier, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 leur permettait de s’adresser au procureur de la République territorialement compétent. Mais ils ont eu recours à une autre règle procédurale, celle de l’article 48 1o bis de cette même loi, laquelle prévoit, pour les faits d’injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, que la plainte est adressée par le biais du ministre de la justice.
L’absence de clarté de la plainte nous a conduits à effectuer des recherches au sein de la Direction. Or, nous n’avons pas trouvé de jurisprudence excluant formellement le recours à l’article 48 en matière de diffamation publique commise envers un membre du Gouvernement pour des faits ne relevant pas de ses fonctions ministérielles.
Par ailleurs, si un ministre n’a pas de compétence liée en la matière, l’expérience montre que depuis plusieurs années, tous les ministres ont transmis au procureur général, pour le procureur de la République territorialement compétent, les plaintes qu’ils ont reçues sur le fondement du 1o bis de l’article 48. En effet, sans une transmission de la plainte, le ministre lui-même ne peut pas mettre en mouvement l’action publique, car il ne peut pas se constituer partie civile ni agir par voie de citation directe.
De surcroît, dans la mesure où la garde des sceaux a indiqué qu’elle n’interviendrait plus dans les affaires individuelles – et c’est le cas dans lequel nous nous trouvions –, la transmission s’imposait.
Cela étant, le procureur de la République, qui prend en charge l’action publique, n’a pas de compétence liée en la matière. Il peut choisir de classer le dossier comme d’ouvrir une enquête. En l’espèce, c’est ce dernier choix qui a été effectué, mais le procureur de Paris a requalifié les faits en diffamation publique envers un particulier et saisi la BRDP, sur la base d’un soit transmis détaillé, pour mener les investigations. D’ailleurs, lorsque les journalistes de Mediapart ont été entendus par les services enquêteurs, ils ne l’ont pas été sur le fondement de l’article 31, mais sur celui de l’article 32, c’est-à-dire sur le chef de diffamation publique envers un particulier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, j’ai posé au procureur de Paris, François Molins, la question suivante : « Trouvez-vous normal, alors qu’une enquête préliminaire est ouverte, que l’administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d’échanges d’informations auprès de la Suisse ? ». Sa réponse a été la suivante : « Clairement, non. »
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il vous a également précisé, si je m’en souviens bien, que les investigations conduites dans le champ pénal n’avaient pas été entravées par celles conduites dans le champ fiscal. Là est peut-être l’essentiel.
Les deux demandes d’entraide ont un objet différent et obéissent à des règles différentes.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment interprétez-vous ce : « Clairement, non. » ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Les procureurs de la République n’apprécient guère que des investigations autres que judiciaires soient menées parallèlement aux leurs, de crainte que leur action ne soit entravée par des procédures dont ils n’ont pas connaissance et auxquelles ils n’ont pas accès.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il est vrai qu’à la question : « Cette démarche administrative a-t-elle retardé la procédure judiciaire ? », M. Molins a répondu : « Absolument pas. ».
Nous comprenons mieux le cheminement de l’information : elle va du procureur au procureur général, puis à la Direction des affaires criminelles et des grâces, et enfin au cabinet. Vous nous l’avez dit, la procédure a été strictement respectée. Mais avez-vous eu, directement ou par l’intermédiaire d’un de vos collaborateurs, des contacts avec le procureur de Paris ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Je l’ai contacté directement une fois, le 18 mars 2013, c’est-à-dire la veille de l’ouverture de l’information judiciaire. Ce jour-là, la plupart des journaux affirmaient que la voix entendue sur l’enregistrement pouvait être identifiée avec certitude comme celle de Jérôme Cahuzac. Or, nous avions cru comprendre, au terme de l’expertise, que l’on ne pouvait pas conclure à une certitude absolue. À la demande du cabinet, et pour obtenir plus de précisions, j’ai donc téléphoné personnellement au procureur de la République de Paris. Mais je ne le fais que très rarement, en cas d’urgence, à cause de la taille et de l’organisation du Parquet général. Cette façon de procéder est tout à fait exceptionnelle, et les magistrats placés sous ma responsabilité ne le font pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre direction comporte un bureau de l’entraide pénale internationale. Pourriez-vous nous faire part de son expérience en matière de coopération avec la Suisse ? Les demandes d’entraide pénale internationale sont-elles fréquentes ? Les autorités suisses y répondent-elles rapidement et de manière satisfaisante ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. La France et la Confédération helvétique sont liées, en matière pénale, par onze conventions et accords. Leurs relations sont anciennes – elles ont débuté avec la convention d’extradition de 1957 – et peuvent être, d’une manière générale, qualifiées de bonnes. Cela étant, les infractions fiscales ont toujours posé plus de difficultés. En effet, nous sommes liés avec la Suisse par ce que l’on appelle la « convention mère », c’est-à-dire la convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959, qui fait du caractère fiscal de l’infraction un motif facultatif de refus de l’entraide. Certes, le protocole additionnel du 17 mars 1978 permet un renversement de la charge de la preuve, c’est-à-dire que le caractère fiscal de l’infraction n’est plus un motif de refus, sauf déclaration contraire de l’État répondant à la demande. Mais la Suisse ne l’a pas ratifié, si bien que les autorités helvétiques refusent d’exécuter certaines de nos demandes lorsqu’elles ont un caractère fiscal.
Précisons toutefois que l’article 14 de la loi fédérale oblige les autorités judiciaires suisses à donner suite à une demande d’entraide lorsque les faits sont susceptibles d’être qualifiés en droit helvétique d’escroquerie fiscale, laquelle implique un acte volontaire frauduleux – interposition de sociétés écrans, usage de faux –, correspondant à ce que nous qualifierions en France de fraude fiscale complexe. En revanche, cette disposition ne s’applique pas à l’hypothèse, prévue en droit français, d’une simple soustraction à l’impôt par omission. Elle est donc une source persistante de difficultés, même si la qualité du dialogue entre les deux pays a pu permettre d’obtenir des avancées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’en est-il de la coopération pénale avec Singapour ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Elle n’est pas de la meilleure qualité.
M. le président Charles de Courson. Vous avez été invitée par le cabinet à le renseigner sur les conditions du versement de l’enregistrement de M. Gonelle au dossier de diffamation, ainsi qu’au sujet de la DNIFF. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Indépendamment de la remontée de l’information entre le parquet général, ma direction et le cabinet, ce dernier, à deux reprises, a demandé des précisions à ma direction.
Tout d’abord, le 23 décembre 2012, le cabinet a réclamé une analyse juridique sur la question de savoir si M. Cahuzac pouvait verser l’enregistrement litigieux au dossier de diffamation. Or, dans une telle affaire, le débat sur le fond, après identification des personnes concernées, est renvoyé au tribunal correctionnel. Selon nous, le demandeur ne pouvait donc pas verser dans le cadre de l’instruction ce document qui devrait être évoqué lors du débat au fond.
M. le président Charles de Courson. Je ne comprends pas : M. Cahuzac ne détenait pas l’enregistrement !
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. La demande du cabinet était pourtant celle que je viens de vous exposer : M. Cahuzac pouvait-il verser cet enregistrement, dont on connaissait à ce moment l’existence ? Peut-être s’agissait-il d’une question d’ordre purement théorique.
M. le président Charles de Courson. On ne vous a pas expliqué les raisons ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Non. Le cabinet ne donne pas nécessairement de détail sur le contexte dans lequel il est amené à interroger ma direction.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous formuler précisément la question posée par le cabinet ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Je pourrais vous indiquer les termes précis de la commande, mais il me faut d’abord me référer au message électronique que j’ai reçu à ce sujet.
M. le président Charles de Courson. Vous nous indiquerez non seulement le contenu de la question posée, mais aussi celui de la réponse que vous lui avez donnée.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. La réponse était négative : au regard d’une jurisprudence bien établie, la preuve de faits diffamatoires est faite au niveau du tribunal correctionnel et non au stade de l’instruction, qui consiste essentiellement à déterminer qui est le diffamateur.
M. Philippe Houillon. Dans le cadre d’une plainte pour diffamation, l’exceptio veritatis est en effet établie à l’audience, non pendant l’instruction.
M. le président Charles de Courson. Mais comment M. Cahuzac aurait-il pu verser un enregistrement qu’il ne possédait pas ? Cet enregistrement n’a été versé que le 16 janvier.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il s’agissait peut-être d’une question purement théorique.
M. le président Charles de Courson. Nous interrogerons Mme la ministre à ce sujet.
M. Philippe Houillon. Cette question ne concernait-elle pas plutôt le versement, par Mediapart, de l’enregistrement au dossier de diffamation ? Après tout, l’exceptio veritatis incombe au diffamateur, et non au diffamé.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. J’aimerais pouvoir confirmer cette hypothèse, mais j’ai relu mes notes : la question n’était pas formulée ainsi.
M. Philippe Houillon. C’était sans doute une erreur.
M. le président Charles de Courson. Nous en jugerons en consultant l’échange de courriers électroniques que Mme la directrice nous transmettra.
M. Philippe Houillon. En principe, M. Cahuzac ne possédait pas l’enregistrement à cette époque – ni même après, d’ailleurs.
M. le président Charles de Courson. D’où mon incompréhension. Mais nous éclaircirons ce point plus tard.
Quelle était la deuxième question posée par le cabinet ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Il souhaitait savoir quel service avait été saisi par le parquet de Paris : sa composition, ses missions, son rattachement – une présentation générale de la DNIFF.
Mme Marie-Christine Dalloz. On est loin de la séparation des pouvoirs !
M. le président Charles de Courson. Vous avez évoqué douze demandes adressées à la DACG, dont dix de la part du cabinet. L’une d’entre elles visait à préciser les termes de la demande adressée aux autorités fiscales helvétiques. De quoi s’agissait-il ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Le cabinet souhaitait savoir ce qu’avait précisément demandé la DGFiP aux autorités fiscales helvétiques.
M. le président Charles de Courson. Mais vous ne le saviez pas.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Non. Nous avons répondu que le parquet de Paris, que nous avions interrogé, n’avait pas connaissance de cette demande. Nous non plus, d’ailleurs : les demandes d’entraide adressées à la Suisse ne passent pas par mon bureau, a fortiori dans le domaine fiscal.
M. Christian Eckert. Vous avez fait allusion à des questionnements relatifs à l’interférence entre cette affaire et l’affaire UBS.
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Je pourrais difficilement vous en dire plus à ce sujet car ces affaires sont toujours en cours d’instruction et donc couvertes par l’article 11 du code de procédure pénale. Mais les articles de Mediapart conduisaient à se poser la question de savoir s’il fallait, dans l’affaire UBS, faire un réquisitoire supplétif, c’est-à-dire saisir les juges d’instruction des faits susceptibles de mettre en cause M. Cahuzac. Cependant, comme il vous l’a dit lors de son audition, le procureur de Paris a choisi une autre voie procédurale : poursuivre l’enquête préliminaire et ouvrir une information judiciaire.
M. le président Charles de Courson. Les deux procédures sont donc restées séparées.
M. Christian Eckert. Le nom de HSBC a-t-il été évoqué à un moment donné ?
Mme Marie-Suzanne Le Quéau. Cela ne me dit rien du tout.
M. le président Charles de Courson. Merci, madame la directrice. J’ai pris note que vous alliez nous transmettre la demande que vous a faite le cabinet de la garde des sceaux au sujet du versement de l’enregistrement au dossier de diffamation, la demande d’expertise juridique sur la possibilité de verser la réponse suisse au dossier judiciaire, ainsi que les réponses que vous leur avez apportées. De même, le tableau détaillant vos échanges avec le parquet général et le cabinet serait utile à notre rapporteur.
Audition du mardi 16 juillet 2013
À 11 heures : Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux.
M. le président Charles de Courson. Avant de procéder à l’audition de Mme la garde des Sceaux – que je remercie pour sa présence –, notre rapporteur souhaite faire une déclaration à la Commission.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comme sans doute beaucoup d’entre vous, j’ai reçu hier un courriel de la part de Mediapart m’invitant, le mercredi 17 juillet à onze heures, à une conférence de presse organisée conjointement par Mediapart, M. Charles de Courson, président de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Cahuzac, et M. Yann Galut, rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
Dans un souci de transparence, je tiens à vous informer que je n’irai pas à cette conférence de presse. La presse est libre dans notre pays, et Mediapart a amplement démontré – notamment dans l’affaire Cahuzac – ses capacités de révélation. Cependant, dans le cadre de notre Commission d’enquête, nous avons depuis le départ choisi nos auditions en commun, et je souhaite qu’il en reste ainsi. Si ce support de presse dispose d’informations supplémentaires, nous pouvons en auditionner à nouveau les journalistes. C’est le cadre que je me suis fixé, en tant que rapporteur, et que j’entends respecter jusqu’au bout de notre travail.
M. le président Charles de Courson. J’ai été averti de cet événement samedi. Des journalistes m’ont appris que M. Condamin-Gerbier, que nous avions auditionné, se trouvait en détention provisoire en Suisse, en vertu de l’article 273 du code pénal helvétique qui stipule : « Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée ».
Cet article justifie, certes, l’ouverture d’une instruction pénale contre M. Condamin-Gerbier pour service de renseignements économiques ; en dévoilant certaines informations – notamment la fameuse liste de personnalités impliquées dans la fraude fiscale –, il n’a clairement pas respecté le secret professionnel, même au regard du droit français. Cependant, dans la mesure où il a été auditionné par les commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale, son arrestation pose problème en matière de relations entre la France et la Confédération helvétique. Hervé Falciani – protagoniste d’une autre affaire – a demandé et obtenu la protection des autorités françaises ; si chacun est libre d’aller ou non à cette conférence – qui n’est pas liée à l’activité de notre Commission –, ne devrions-nous pas attirer l’attention du Gouvernement, et notamment de Mme la garde des Sceaux, sur la nécessité d’assurer la protection des personnes auditionnées par les commissions parlementaires ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous étudierons les démarches juridiques nécessaires, en lien avec la garde des Sceaux et le Gouvernement ; mais je n’irai pas à cette conférence de presse où je suis invité en tant que membre de la Commission.
M. le président Charles de Courson. Chacun est libre de ses décisions, mais la conférence n’interfère en rien avec nos travaux. En revanche, la mise en détention provisoire d’une personne qui révèle des pratiques illégales au regard du droit français pose problème, d’autant que M. Condamin-Gerbier est citoyen français. Le Gouvernement ne devrait-il pas mener une action à l’égard de la Confédération helvétique ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il ne faudrait pas se tromper de débat. L’emprisonnement de M. Condamin-Gerbier en Suisse ne concerne pas notre Commission. En revanche, la tenue de cette conférence de presse me paraît grave. Je rejoins notre rapporteur pour exprimer mon étonnement et mon indignation de voir deux députés de cette Assemblée – l’un de la majorité, l’autre de l’opposition – se faire convoquer par Mediapart, un des objets de notre investigation. En effet, nous devons nous prononcer sur le moment que Mediapart a choisi pour révéler ses informations, le caractère complet ou tronqué de ces dernières, et la manière dont ce site d’information s’est comporté vis-à-vis des différents acteurs que nous auditionnons. Cette démarche me semble déontologiquement incompatible avec l’objet de notre Commission, voire avec l’appartenance au Parlement, et vous me voyez navrée du comportement de ces deux députés, et en particulier de notre président. Leur participation à cet événement conduit à préjuger l’issue de nos travaux, d’autant que nous ignorons ce que Mediapart compte annoncer à cette occasion.
M. le président Charles de Courson. Avant de prononcer des jugements aussi péremptoires, vous devriez lire les textes. L’invitation de Mediapart est ainsi formulée : « Nous souhaitons vous associer à cette conférence de presse. En tant que membre de la commission d’enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, votre présence nous semble importante pour mieux informer sur la problématique de la défense des lanceurs d’alerte ». Il s’agit de se pencher sur le statut des salariés des banques suisses qui ont apporté des informations aux autorités françaises. M. Falciani a été emprisonné pour avoir révélé la « liste HSBC », et voilà qu’aujourd’hui M. Condamin-Gerbier se trouve à son tour en détention provisoire. Le problème général des lanceurs d’alerte est indépendant de l’objet de notre Commission d’enquête ; par ailleurs, je respecte la liberté de chacun.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je ne souhaite aucune polémique mais pour les raisons que j’ai évoquées, je n’assisterai pas à cette conférence de presse. Il faut être clair, elle est organisée conjointement par Yann Galut, député socialiste et rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, Charles de Courson, député UDI et président de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Cahuzac, et Mediapart.
M. le président Charles de Courson. La conférence concerne l’opportunité d’accorder aux lanceurs d’alerte un statut protecteur, dont les modalités et l’extension restent à définir. En quoi cela interfère-t-il avec les travaux de notre Commission d’enquête ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Les « textes » que vous avez évoqués se résument donc à une lettre !
M. Georges Fenech. Depuis la commission d’enquête relative à l’influence des sectes, toutes les personnes auditionnées bénéficient d’une immunité totale sur le territoire national. Mais en quoi sommes-nous concernés par la décision d’une autorité judiciaire étrangère ? Je suis moi aussi réservé quant à l’opportunité, pour le président de notre Commission d’enquête, de participer à une conférence de presse liée – même indirectement – à l’objet de notre enquête, et pouvant interférer avec nos travaux.
M. le président Charles de Courson. Mon statut de président de cette Commission d’enquête ne m’empêche pas de rester un homme libre. Le statut juridique des lanceurs d’alerte représente un véritable problème. Pour la deuxième fois – voire davantage, car d’autres exemples ont existé dans le passé –, un citoyen français ayant travaillé en Suisse est mis en détention provisoire pour avoir révélé à l’administration française et au Parlement français des cas de collaboration dans la fraude fiscale. En quoi ce sujet interfère-t-il avec les travaux de notre Commission ?
En revanche, chacun étant maître de ses décisions, je respecte le refus de notre rapporteur de se rendre à cette conférence de presse. Pour ma part, étant libre de mes propos à l’extérieur de cette Commission, j’irai exprimer ce que je pense concernant la nécessaire protection des lanceurs d’alerte.
Madame la ministre, cette Commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Sans aborder les éléments de fond de l’enquête, qui relèvent du secret de l’instruction, nous souhaitons mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été conduite, notamment par la justice.
(Mme Christiane Taubira prête serment.)
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des Sceaux. Je commencerai par vous expliquer la relation qui lie le ministre, le parquet général et le parquet, le rôle que la chancellerie peut tenir dans une affaire comme celle-ci, et les formes possibles d’intervention au cours du déroulement d’une procédure. J’évoquerai également le cadre dans lequel s’est effectuée la remontée d’information du parquet général vers la chancellerie, son contenu et l’usage qui en a été fait.
Votre Commission étend ses investigations sur une période qui s’étend du premier article de Mediapart jusqu’à la fin provisoire de la procédure, c’est bien parce que les faits sont d’abord rendus publics dans les médias, avant de faire l’objet d’un premier acte judiciaire – la plainte en diffamation déposée par le ministre mis en cause. Cette plainte m’est soumise pour transmission au parquet général sur la base du 1° bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, et transmise sous signature de mon directeur de cabinet, mais sous ma responsabilité. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) s’est alors posé la question de savoir si cette transmission devait ou non être effectuée par le garde des Sceaux. La jurisprudence est recherchée, elle n’existe pas. Reste que le rôle du garde des Sceaux en cette occasion consiste à transmettre la plainte sans prendre le risque de dépasser les délais de prescription, et surtout sans entraver la liberté du procureur. La plainte de M. Cahuzac
– qui n’a été rédigée ni par la chancellerie, ni même par le ministre mis en cause, mais par ses avocats, lesquels sont indépendants – est donc transmise par mon cabinet au procureur général, qui la transmet au procureur, qui en a évalué la recevabilité.
De façon générale, la remontée d’information suit un cadre juridique organisé, reposant sur l’article 5 de l’ordonnance de 1958 et sur les articles 30 et suivants du code de procédure pénale. Sa dimension opérationnelle est précisée dans le protocole du 27 novembre 2006, sur lequel nous travaillons depuis que le Gouvernement a décidé d’inscrire dans le code de procédure pénale l’interdiction des instructions individuelles. Un projet de loi en ce sens suit actuellement les étapes de la navette parlementaire, la deuxième lecture au Sénat étant prévue pour cet après-midi.
Le parquet général transmet des notes de synthèse à la DACG, qui en fait suivre quelques éléments au cabinet. Le volume assez conséquent de l’information transmise se justifiait à une époque où le garde des Sceaux pouvait donner au parquet des instructions individuelles ; avec leur disparition, et pour soulager les parquets, les parquets généraux et l’administration, de la masse d’informations à collecter ou à traiter, nous estimons possible de le diviser au moins par deux.
Plusieurs paramètres interviennent dans la sélection des informations par les parquets généraux, puis par l’administration qui les transmet au cabinet, enfin par le cabinet qui me les livre : la gravité des faits, la qualité des personnes pouvant être mises en cause ou celle des victimes, le lieu de l’infraction, le nombre de victimes, le caractère prioritaire de l’incrimination au regard des orientations de politique pénale, sa relation avec un problème juridique particulier, la nécessité d’une entraide internationale, les risques de médiatisation ou une médiatisation effective. Les informations qui me sont transmises servent à préciser les orientations de politique pénale, à déployer des moyens à la mesure d’une affaire – comme dans le procès de la société Poly Implant Prothèse (PIP) –, à répondre à la représentation nationale lors des questions d’actualité, questions orales sans débat ou questions écrites, mais également aux particuliers ou associations qui sollicitent le Président de la République – directement ou par le biais du garde des Sceaux –, à définir des modifications de textes – l’affaire d’Uzbin en Afghanistan a par exemple eu des répercussions sur la loi de programmation militaire –, et à ajuster nos procédures avec les pays étrangers dans le cadre de l’entraide internationale.
Dans le cas de l’affaire Cahuzac, après la transmission par la chancellerie de la plainte en diffamation du ministre du budget au parquet, le procureur de la République a rapidement requalifié la plainte, estimant qu’il s’agissait d’une diffamation publique envers un particulier, et non envers un membre du Gouvernement. Il n’y a aucune conséquence à cela. Quelques temps après, M. Cahuzac a présenté une autre plainte conforme à cette requalification. À partir de là, nous avons été informés des procédures, à titre de confirmation ; en effet, vu la médiatisation intense de cette affaire, nous devions vérifier l’exactitude des informations qui paraissaient dans la presse – par exemple l’annonce d’ouverture d’une enquête préliminaire –, afin, notamment, de pouvoir répondre à la représentation nationale. En revanche, nous ne recevions pas d’informations antérieurement à la réalisation des actes en question.
Plusieurs échanges d’information entre le parquet général et la DACG d’une part, la DACG et le cabinet d’autre part, ont concerné des sujets techniques et juridiques, notamment à propos de la loi du 29 juillet 1881 – la référence juridique de cette affaire –, dont les magistrats s’accordent à reconnaître la complexité, due à de nombreuses mesures dérogatoires. Les informations qui me sont parvenues – et que j’aurais pu utiliser pour répondre à la représentation nationale ou pour permettre au Premier ministre de confirmer ou d’infirmer une annonce – concernaient les grandes avancées de la procédure, lorsqu’elles avaient déjà eu lieu – auditions importantes, ouvertures d’enquête préliminaire ou d’information judiciaire –, ainsi que la date présumée du retour de l’enregistrement du laboratoire où il avait été envoyé pour expertise. Nous nous sommes aussi fait envoyer un communiqué de presse du procureur pour être sûrs que ce qui avait été dit de sa déclaration correspondait bien à la réalité de ces propos.
M. Alain Claeys, rapporteur. Madame la ministre, vous dites avoir été informée de l’évolution des procédures telles que le dépôt, par M. Jérôme Cahuzac, de la plainte en diffamation. Avez-vous transmis ces informations à certains de vos collègues ministres, au Premier ministre ou au Président de la République ?
Mme la garde des Sceaux. Je n’ai transmis aucune information au Président de la République, ni aux autres ministres, y compris l’intéressé. À quatre reprises – trois fois par texto, une fois par le biais d’un appel –, j’ai brièvement informé le Premier ministre des grandes avancées de la procédure, notamment de l’ouverture effective de l’enquête préliminaire, que la presse avait annoncée deux jours plus tôt. Le procureur et le procureur général vous ont d’ailleurs confirmé qu’ils n’avaient pas reçu d’instruction individuelle dans ce dossier, et qu’ils ne m’ont pas transmis les informations à l’avance.
M. Alain Claeys, rapporteur. Entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, M. Jérôme Cahuzac ou ses collaborateurs ont-ils eu, avec vous ou avec votre cabinet, des contacts en lien avec les révélations de Mediapart ?
Mme la garde des Sceaux. Pas du tout. Je n’ai pas discuté de cette affaire avec Jérôme Cahuzac. Le 4 décembre, Mediapart publie son article retentissant ; le 6 décembre, M. Cahuzac dépose plainte ; puis viennent ses dénégations devant l’Assemblée nationale. J’essayais de me faire confirmer les informations publiées dans la presse, de façon à en informer le Premier ministre qui pouvait ensuite en tirer les conséquences et prendre des décisions politiques. En effet, il existe des règles, y compris non écrites, dans notre pays – je pense à la jurisprudence Balladur-Jospin –, l’usage obligeant à écarter un ministre mis en cause. Si cette démarche soulève des questions sur la présomption d’innocence – certains membres du Gouvernement mis en cause ayant ensuite été blanchis par la justice –, l’on ne cependant pas aborder cette question quand elle concerne des responsables au plus haut niveau, qui représentent la France et parlent au nom de la puissance publique, comme on le ferait pour un citoyen.
Mon seul souci a consisté à ne pas être tributaire exclusivement des informations diffusées dans la presse, et à choisir les points sur lesquels il fallait confirmer l’état des procédures au Premier ministre. Je n’en ai pas parlé avec le ministre du budget, d’autant que pas plus que vous, je n’avais de raison d’interroger les déclarations qu’il avait faites devant l’Assemblée nationale. À mes yeux, il fallait simplement que la justice fasse correctement son travail – et elle l’a fait. La diligence avec laquelle cette affaire a été traitée par le parquet, à différentes étapes, est quasiment sans précédent par rapport à des affaires comparables. C’est par exemple le parquet qui a soumis l’enregistrement à l’expertise, et donc la justice qui a apporté la preuve de l’absence de diffamation, alors que dans notre droit, en vertu du principe de l’exceptio veritatis, c’est à la personne qui met en cause de le faire. Je vous affirme sous serment que je n’ai rien transmis à M. Cahuzac, ni discuté de cette affaire avec lui, ni avec son cabinet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre cabinet a interrogé une douzaine de fois la DACG ; a-t-il, à un moment ou un autre, pris contact directement avec le procureur général ou avec le procureur de Paris ?
Mme la garde des Sceaux. Pas que je sache. Le procureur et le procureur général ont dit ne pas avoir eu de contacts avec mon cabinet. Ils en avaient eu un, en revanche, avec la directrice de la DACG, qui vous l’a d’ailleurs confirmé. L’appel de la directrice – justifié par l’urgence et le caractère exceptionnel de la situation – est intervenu le 18 mars, parce que la presse affirmait que la voix sur l’enregistrement avait été identifiée comme étant celle du ministre du budget. Le lendemain, celui-ci a été invité à démissionner.
M. Alain Claeys, rapporteur. Votre cabinet a-t-il demandé à la DACG la liste des auditions et investigations envisagées ?
Mme la garde des Sceaux. À ma connaissance, non. Comme je vous l’ai indiqué, si le parquet transmet des notes de synthèse à la DACG, seules me parviennent des alertes qui le méritent ; à moi de juger ensuite s’il faut ou non en parler au Premier ministre, sans l’informer systématiquement. J’ai, par exemple, estimé utile de transmettre l’information relative à l’audition de M. Gonelle : je suis informé qu’il a été entendu – pas qu’il va l’être – et qu’il a déposé une copie de l’enregistrement que le parquet a décidé de faire expertiser.
M. Alain Claeys, rapporteur. Un point a retenu à plusieurs reprises l’attention de notre Commission. Le 1er février, après avoir eu connaissance de la réponse apportée par les autorités suisses à la demande d’entraide fiscale, le pôle financier du parquet de Paris a demandé à la DACG si cette réponse pouvait être versée à la procédure judiciaire. La DACG a préparé une réponse – qui faisait part de ses réserves – qu’elle a d’abord transmise à votre cabinet, mais celui-ci n’a pas réagi. Faut-il y voir le souci de ne pas intervenir, même très indirectement, dans la procédure ou une approbation tacite du contenu de la note ?
Mme la garde des Sceaux. Lorsqu’elle est nécessaire, l’approbation du cabinet doit toujours être explicite, une approbation tacite reviendrait à renvoyer à l’administration une responsabilité qui relève du cabinet.
Sur la question que vous évoquez, le cabinet n’avait pas à intervenir. Il s’agissait d’une expertise juridique et il est normal que le procureur général ait interrogé la DACG. Je répète aux procureurs qu’ils doivent s’adosser à l’administration – y compris dans les affaires économiques et civiles –, interroger la direction des affaires civiles ou la DACG, et solliciter leur expertise juridique et technique. En juin 2012, quand j’ai demandé au ministère public d’être présent dans les procédures collectives, j’ai rappelé au ministère public qu’il pouvait le faire. Mais, il y a des questions dont le cabinet n’a pas à se mêler et il le sait très bien. En effet, nous avons annoncé dès le début que nous ne ferions pas d’instructions individuelles, ni n’interférerions avec les procédures, et qu’il fallait veiller à ne pas y être amenés même par maladresse ou par inadvertance.
Le cabinet n’avait donc pas à se prononcer sur cette question. Je n’ai su que par la suite que le procureur général l’avait posée à la DACG. Qu’en dépit de l’avis réservé de celle-ci, le procureur de la République ait décidé de verser la pièce au dossier constitue d’ailleurs la preuve de la liberté du parquet général et du parquet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le parquet de Paris a-t-il été informé de la demande d’entraide fiscale ?
Mme la garde des Sceaux. M. Molins a indiqué qu’il n’en avait pas été informé. La chancellerie ne l’a pas été non plus. L’administration n’a eu connaissance de cette demande que du fait de la réponse des autorités suisses.
M. le président Charles de Courson. Estimez-vous normal que votre administration n’ait pas été tenue au courant de la saisine ?
Mme la garde des Sceaux. Même si l’on peut considérer l’administration fiscale aurait pu avertir l’administration de la justice, on ne peut pas lui faire grief de ne pas l’avoir fait, car il s’agit de procédures de nature différente. La jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question remonte à 1974, réitéré ensuite en 1996, 2006 et 2012, preuve d’une véritable constance. La Cour considère que la procédure fiscale qui vise à définir l’assiette et le montant de l’impôt est une procédure administrative, donc autonome par rapport à la procédure pénale. La Cour estime d’ailleurs que cette autonomie est compatible avec les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel s’est également prononcé en 1997, en mettant en avant le principe de proportionnalité : si l’autonomie des procédures fait que la personne mise en cause peut subir des sanctions à la fois pénales et fiscales, le Conseil enjoint de veiller à ce que le total des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Peut-être aurait-elle dû le faire mais l’administration fiscale est parfaitement fondée, en droit, à introduire une procédure sans nous en informer.
M. Alain Claeys, rapporteur. Plus généralement, jugez-vous normal que l’administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d’échange d’informations auprès de la Suisse, alors que l’enquête préliminaire était engagée ?
Mme la garde des Sceaux. En toute sincérité, on aurait sans doute pu avoir un avis sur le moment mais c’était impossible puisqu’on ignorait cette procédure ; le seul enjeu important a posteriori reste de savoir si cette enquête fiscale a, d’une façon ou d’une autre, entravé ou fragilisé l’enquête pénale. La réponse est incontestablement négative. Par conséquent, puisque c’était possible en droit et qu’il n’y a pas eu de préjudice dans les faits, que faut-il reprocher à l’administration fiscale ? D’ailleurs, si elle avait choisi de ne pas introduire de procédure, on n’aurait pas manqué de lui en faire grief.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous connaissance de précédents où une enquête de coopération fiscale ait été déclenchée en même temps qu’une procédure pénale ?
Mme la garde des Sceaux. On ne m’a pas indiqué de précédents contraires. Cette démarche relève de l’usage lors de grands accidents ferroviaires ou d’avion. Ainsi, dans le drame de Brétigny-sur-Orge, à côté des enquêtes pénales d’ores et déjà ouvertes, on mènera une enquête administrative. Les conséquences qu’impliquent les affaires pénales et fiscales sont de nature très différente, et une « négociation fiscale » entre l’administration et une personne convaincue de fraude n’interdit pas une sanction pénale.
M. le président Charles de Courson. Connaissez-vous d’autres cas où le parquet n’aurait pas été informé d’une saisine par voie fiscale ? Existe-t-il des précédents où, comme dans cette affaire, la saisine de l’administration fiscale helvétique serait déclenchée huit ou dix jours après l’ouverture de l’enquête préliminaire ?
Mme la garde des Sceaux. On ne m’a pas rapporté de précédents contraires, qui montreraient que dans cette affaire, on a agi contre le droit ou en dehors des pratiques d’usage. Le ministre de l’économie et des finances en parlera plus savamment, mais cette demande était tout à fait concevable dans le cadre des conventions entre la Suisse et la France. L’administration fiscale avait le droit de faire ce qu’elle a fait, et n’était pas tenue de m’en informer. Je n’ai pas d’exemple.
M. le président Charles de Courson. C’est donc, à votre connaissance, le seul cas où l’on ait agi de la sorte ?
Mme la garde des Sceaux. Non, je pense au contraire que c’est l’usage. Je me renseignerai sur les précédents, et si jamais on trouve un cas où le ministre s’est interdit d’ouvrir l’enquête fiscale, ou bien où le parquet avait été informé, je vous le transmettrai par écrit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 12 mars 2013, le parquet de Paris a adressé aux autorités judiciaires de Genève une demande d’entraide pénale. Comment qualifieriez-vous la coopération pénale avec la Suisse ?
Mme la garde des Sceaux. Je ne crois pas avoir qualité pour le faire. En tant que ministre de la justice, je dirai simplement qu’au regard des termes des conventions franco-suisses, les choses se passent correctement et, dans cette affaire, les délais de procédures ont été particulièrement satisfaisants.
M. Alain Claeys, rapporteur. Êtes-vous intervenue auprès de votre homologue suisse ?
Mme la garde des Sceaux. Non, je n’ai pas eu à le faire et je n’ai pas à le faire. Seules quelques procédures – comme l’extradition – exigent l’intervention du ministre ; l’entraide pénale concernant la collaboration entre deux autorités judiciaires, je n’avais aucune raison de contacter le ministre de la justice suisse. Il revient au procureur ou au procureur général de faire le nécessaire, et éventuellement de nous avertir s’ils rencontrent des difficultés – ce qui n’a manifestement pas été le cas. Ils ont même signalé que les commissions rogatoires internationales sont d’habitude traitées dans des délais plus longs.
En revanche, des progrès restent à faire sur le contenu des conventions qui définissent les obligations mutuelles.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ma dernière question dépasse l’objet de notre Commission d’enquête. Quelle protection la France peut-elle offrir aux lanceurs d’alerte au niveau international, par exemple à travers les conventions avec la Suisse ?
Mme la garde des Sceaux. En matière internationale, la prudence impose de s’en remettre à l’expertise juridique. Le sujet, actuellement débattu à l’échelle nationale, se révèle complexe, certains faisant valoir qu’il ne faudrait pas rendre le statut de lanceur d’alerte trop large, en l’étendant à trop d’infractions, au risque de le diluer ou de le faire subrepticement basculer vers la délation. À l’échelle internationale, nous agissons dans le cadre de nos accords bilatéraux ou multilatéraux ; je veillerai à lancer rapidement une expertise sur la question puisque la décision des autorités suisses de placer M. Condamin-Gerbier en détention provisoire ravive le sujet. Je ne sais d’ailleurs pas s’il doit être considéré comme un lanceur d’alerte ; mais il a fourni des informations qui peuvent permettre à la justice d’identifier des incriminations et leurs auteurs.
M. le président Charles de Courson. À partir de quelle date avez-vous eu des doutes quant à la véracité des déclarations de Jérôme Cahuzac selon lesquelles il ne détenait aucun avoir non déclaré à l’étranger ?
Mme la garde des Sceaux. Puisque j’ai décidé de dire la vérité, je vous dis toute la vérité. Ce n’était pas une préoccupation. Pour moi, il fallait que la justice fasse son travail et je ne me suis pas posée pour me demander si Jérôme Cahuzac était coupable ou non. La justice avançait, Cahuzac niait, je n’ai pas fait d’analyse de ses dénégations. A posteriori oui, mais sur le moment, sincèrement, non. À aucun moment je ne me pose la question. Je me souviens du 18 mars, où s’enchaînent les réunions à la chancellerie. Comme je n’ai presque jamais mon portable, je découvre vers le milieu de l’après-midi, parmi les quatre ou cinq notes qui me sont signalées, le résultat de l’expertise, transmise par la police scientifique et technique à l’autorité judiciaire, et qui se situe à mi-chemin du vraisemblable et du non vraisemblable. Je ne suis donc pas plus avancée et je ne m’interroge pas, même à ce moment-là, d’autant que, je le rappelle, l’information judiciaire est ouverte contre X, ce qui permet de penser que le parquet s’interroge, même après le retour d’expertise. Le Premier ministre prendra alors ses responsabilités puisque le ministre du budget est amené à démissionner. Je ne peux pas vous indiquer à quel moment j’ai commencé à douter parce que ce serait faux. Je ne me suis pas non plus demandé s’il disait vrai, d’ailleurs. Ce n’était vraiment pas mon souci.
Mme Cécile Untermaier. Madame la ministre, merci pour vos propos clairs, notamment concernant les procédures administrative et judiciaire. J’espère que le rapport retiendra l’explication que vous avez donnée, qui est tout à fait satisfaisante. Si dysfonctionnements il y a, ce ne sont pas ceux de la justice. On mesure la qualité des travaux menés depuis mai 2012 dans le sens de l’indépendance de la justice.
En tant que garde des Sceaux, n’avez-vous pas été surprise que Jérôme Cahuzac ne porte pas plainte pour faux et usage de faux à raison de l’enregistrement évoqué par Mediapart dès le lendemain de l’article publié ?
Ne trouvez-vous pas regrettable qu’il ait fallu, même si ce n’est peut-être pas le seul élément, la lettre de Mediapart du 27 décembre pour que l’enquête préliminaire soit ouverte ?
Enfin, on conçoit bien que l’affaire n’ait pas été la préoccupation majeure des membres du Gouvernement, attelés à leur tâche.
Donc je souhaiterais avoir votre avis sur l’articulation entre la procédure judiciaire et la procédure fiscale, au moins pour les préconisations du rapport de la commission d’enquête.
Mme la garde des Sceaux. Franchement, je ne me suis pas posé la question de la plainte pour faux et usage de faux. Je n’ai pas lu la plainte en diffamation, un vrai « pavé ». Je l’ai transmise, c’est mon rôle, comme j’ai transmis pour M. Montebourg il y a quelques mois, ou pour M. Moscovici contre un hebdomadaire aussi. Je n’ai pas poussé plus avant la curiosité, je n’ai d’ailleurs pas la disponibilité de le faire. La plainte a été rédigée par un avocat, sous sa responsabilité et celle du mise en cause.
Il est important de rappeler que l’affaire a démarré sur une base médiatique – et non judiciaire –. La plainte a été déposé à la suite de l’article « Le compte suisse du ministre du budget ». Celui-ci envoie à la garde des Sceaux une plainte à transmettre. La DACG a le réflexe de s’interroger pour savoir si c’est en tant que ministre ou de particulier qu’il est visé. En l’absence de jurisprudence, l’alternative consiste, pour le ministre, soit à prendre le risque d’en construire une, soit à transmettre en neutralité, ce que nous avons fait, en veillant à éviter la prescription – de trois mois dans les deux cas de figure –, et conscients que le procureur a toute liberté pour requalifier la plainte le cas échéant. Ce qui m’a été expliqué, par la suite, c’est que la première plainte faisait référence à plusieurs articles de la loi de 1881 et que le procureur a lui-même sélectionné ceux qui étaient pertinents. À ce moment-là, je ne me suis pas demandé si la procédure suivie était la bonne ou pas.
Et heureusement ! Si j’avais cherché à savoir si c’était, ou non, la bonne qualification, on me reprocherait aujourd'hui de m’être mêlée de l’efficacité de la plainte d’un ministre contre un média. Le risque, c’était tout de même la nullité. Le procureur aurait pu ne pas poursuivre s’il avait jugé que la qualification n’était pas la bonne, mais il a préféré requalifier, comme il en a le droit. Je suis contente de m’en être tenue à une stricte neutralité. Sinon, j’aurais aujourd'hui à expliquer pourquoi j’ai fait du zèle en vérifiant si la plainte était susceptible d’aboutir.
Concernant l’enquête préliminaire, je rappelle que, le 23 décembre, deux plaintes ont été reçues, mais elles n’ont pas encore donné lieu à la fixation de la consignation
– s’agissant de la désignation du juge d’instruction, je ne suis pas sûre. Le procureur aurait déjà pu décider d’ouvrir une enquête préliminaire mais, alors, on n’aurait pas été exactement conforme au droit, c’est ce que j’ai expliqué à propos de l’exceptio veritatis : normalement, c’est à l’accusateur qu’incombe la charge de la preuve. On peut réinterpréter les faits à la lumière de ce qui a suivi, mais, le 23 décembre, il n’y a rien d’autre que les deux plaintes en diffamation. Et le 8 janvier, à la suite de la lettre de Mediapart, le procureur décide d’ouvrir l’enquête préliminaire et d’apporter la preuve, par l’expertise, que l’accusation portée par les médias est fondée.
L’enquête administrative possible en droit n’a pas fragilisé la procédure pénale. Pour le bon fonctionnement de l’État et des institutions, c’était peut-être mieux de les mener en parallèle. C’est d’ailleurs une des questions que nous nous posons dans le cadre des débats sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Avec le ministre du budget, nous avons mis en place un dispositif d’échange d’informations entre l’administration fiscale et la justice à propos des signalements faits par l’administration fiscale, pour améliorer les choses. Cela dit, rien n’interdit de réfléchir à une obligation d’information.
M. le président Charles de Courson. Pensez-vous préférable de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de ne pas interdire de mener parallèlement les deux enquêtes, même si, d’après le procureur de Paris, cela ne se fait pratiquement jamais, ou faut-il suspendre l’enquête fiscale en cas d’enquête préliminaire ?
Mme la garde des Sceaux. Je croyais avoir dit qu’il avait le droit de le faire, même si on peut considérer que ce n’est pas satisfaisant. J’ai évoqué le texte sur la fraude fiscale à la faveur duquel, avec mon collègue du budget, nous préparons une circulaire commune qui, par exemple en incluant des magistrats de l’ordre judiciaire dans la commission des infractions fiscales, mettra en place des dispositifs permettant l’échange d’informations.
Il y a deux questions : l’échange d’informations en respectant l’autonomie des procédures et la suspension de la procédure fiscale en cas de procédure pénale. Je n’ai pas de doctrine en la matière parce qu’on ne manquerait pas de m’objecter la capacité de l’administration fiscale à percevoir l’impôt et les pénalités. Pourquoi la procédure pénale devrait-elle geler les actions en recouvrement, alors que la procédure fiscale n’a pas d’effet délétère sur la procédure pénale ? La réponse n’est pas binaire.
Mme Marie-Françoise Bechtel. La commission a déjà soulevé la question. Il y a dans la conception française de la séparation des pouvoirs une stricte distinction entre la procédure administrative et la procédure judiciaire. Et si, un jour, celle-ci devait suspendre celle-là, on ne pourrait plus, par exemple, engager de poursuites disciplinaires – de nature administrative – contre un fonctionnaire au motif qu’il fait l’objet d’une procédure pénale.
Je remercie Mme la garde des Sceaux de la clarté de ses propos qui n’en a pas altéré l’énergie. C’est la première fois qu’une commission d’enquête intervient a posteriori pour examiner dans quelles conditions le Gouvernement et l’administration ont répondu à la mise en cause d’abord médiatique, ensuite pénale d’un membre du Gouvernement. Nous cherchons des critères quant à la rapidité de leur action. Mes deux questions sont les deux faces d’un même problème.
Vous avez rappelé que, dès votre arrivée au ministère, vous aviez donné des instructions extrêmement claires pour que les parquets agissent en toute indépendance et que seule l’information nécessaire remonte à votre cabinet. Avez-vous eu besoin de rappeler fortement ces consignes, voire de les réitérer, parce que, précédemment, un tel comportement n’allait pas de soi ? En d’autres termes, dans un passé récent, les procédures auraient pu être beaucoup plus longues, voire retardées par le garde des Sceaux.
Avez-vous le sentiment que la justice a agi, dans cette affaire, avec une diligence exceptionnelle ?
Mme la garde des Sceaux. J’ai dit, en arrivant, qu’il fallait être très vigilant sur les comportements et sur les propos, simplement parce que nous rompions avec une pratique qui était totalement légale. Le code de procédure pénale autorisant les instructions individuelles, les parquets et les parquets généraux étaient habitués ou s’attendaient à en recevoir dans les procédures pénales. Il m’a fallu l’expliquer à l’administration, et aussi réunir régulièrement les procureurs et les procureurs généraux, en moyenne tous les deux mois, à partir du mois de juin, pour étudier l’organisation du travail dans ce contexte nouveau. Pour ces raisons, j’ai fait preuve de pédagogie, au strict sens de la répétition. J’ai dit à chacun de se réorganiser sachant qu’il n’y aurait plus d’instruction individuelle, ce qui suppose, de la part des procureurs généraux, une attention plus grande encore, une implication plus forte encore en matière d’animation et de coordination de l’action publique, une responsabilité plus clairement assumée en matière d’instruction données aux parquets – en ce qui les concerne, écrite et versée au dossier, comme le prévoit le code de procédure pénale. Et nous leur exprimons la confiance que nous leur faisons dans la remontée des informations.
Ces dernières années, ont été menées des procédures extrêmement sensibles, à forte intensité médiatique, comme Clearstream, Karachi, les frégates de Taïwan, HSBC, etc., dans lesquelles le garde des Sceaux était fondé à donner des instructions individuelles. Il était donc important de rappeler nos principes mais il a été vite évident que tout le monde avait compris. Pour réorganiser le travail dans le ressort des juridictions, j’ai mis en place des groupes de travail, la commission Nadal, qui étudie le champ de compétence du ministère public, l’organisation des parquets, les relations avec les autres partenaires – la direction de la police financière etc… de façon à pouvoir fonctionner sans instruction individuelle.
La justice a-t-elle été diligente ? Incontestablement, oui. Le seul mérite de la chancellerie, c’est d’avoir suivi les engagements du Président de la République, de ne pas avoir entravé la justice. Nous avons même facilité son travail puisque nous sommes vigilants à affecter les effectifs et les moyens en fonction des procédures sensibles. Mais l’essentiel du mérite revient au ministère public.
M. Georges Fenech. Une simple remarque, d’abord, sur votre analyse, madame la garde des Sceaux. Selon vous, la procédure fiscale, parallèle, voire concurrente à la procédure pénale, n’a pas préjudicié à l’enquête judiciaire. Pourtant, François Molins nous a dit avoir éprouvé des doutes à la lecture du JDD. Il n’y a pas eu préjudice, mais il aurait pu y en avoir un.
Confirmez-vous n’avoir eu aucun contact avec vos collègues du Gouvernement à propos de cette affaire, que ce soit M. Valls ou M. Moscovici ? En somme, une « muraille de Chine » a-t-elle été dressée entre vous et eux ?
Que pensez-vous de l’article 40 du code de procédure pénale étant précisé que la Présidence de la République était manifestement informée, au moins en la personne de son secrétaire général par Me Gonelle de la détention d’un compte à l’étranger par M. Cahuzac ? Disposiez-vous de cette information ? Que pense la garde des Sceaux de la non-application de l’article 40 par les services de l’Élysée ?
Que pensez-vous du Président de la République annonçant des mesures, immédiatement après le déclenchement de l’affaire, notamment la réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ? Estimez-vous, en tant que garde des Sceaux, que le CSM a une quelconque responsabilité dans l’affaire Cahuzac ? A-t-il, dans sa forme actuelle, manqué de vigilance dans son rôle de garant de l’indépendance de la justice ?
Enfin, vous nous avez dit que l’expertise de l’enregistrement avait conclu à une chance sur deux. En réalité, c’est davantage puisque les experts parlent de 60 %. Une fois au courant, puisque c’est à partir du résultat de l’expertise que l’étau judiciaire va se resserrer autour de Jérôme Cahuzac, informez-vous le Premier ministre de ses conclusions de façon que des conséquences politiques puissent être tirées ? On a le sentiment que les membres du Gouvernement sont, pour ainsi dire, tétanisés et qu’ils n’osent pas prendre d’initiative. D’ailleurs, vous déclarez vous-même ne pas vous interroger ! Alors que toute la presse en parle, que l’affaire est évoquée au Parlement, tout semble freiné par la crainte. L’expertise constitue une étape dans le dévoilement du mensonge du M. Cahuzac. Puisque vous en connaissez le résultat, le transmettez-vous au Premier ministre ?
Mme la garde des Sceaux. S’agissant de la procédure fiscale, M. Molins s’est dit surpris d’apprendre l’existence de la procédure, mais il déclare clairement qu’elle n’a pas préjudicié à son enquête. Je veux bien que vous extrapoliez mais le responsable de la procédure vous a déclaré sous serment que cela n’a pas eu de conséquence ! Je veux bien répondre sur ce qu’il faudrait faire à l’avenir, mais, quant à ce qui s’est passé, je ne peux pas mieux dire que M. Molins. Tout le reste n’est qu’hypothèses !
M. Alain Claeys, rapporteur. Je cite la question et la réponse de M. Molins : – question – « Trouvez-vous normal, alors qu’une enquête préliminaire est ouverte, que l’administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d’échange d’informations auprès de la Suisse ? » – réponse de François Molins – « Clairement, non. Je ne suis à la tête du parquet de Paris que depuis un an et demi, mais je me suis renseigné pour savoir s’il existait des précédents. La culture fiscale et la culture pénale sont, vous le savez, très différentes ; elles n’ont pas les mêmes objectifs. Chacun a des obligations : nous avons l’obligation de dénoncer au fisc tous les faits qui sont de nature à constituer des fraudes fiscales ; le fisc a l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire tous les éléments qui pourraient constituer des infractions de droit commun. À Paris, cela fonctionne bien, les signalements sont fréquents dans l’un et l’autre sens. » Je poursuis par une autre question : « Cette démarche administrative a-t-elle retardé la procédure judiciaire ? » Réponse du procureur : « Absolument pas. Elle intervient le 1er février, donc avant la demande d’entraide pénale qu’elle n’a pas retardée. Nous avons seulement joint la réponse suisse au dossier, et continué les investigations dans notre logique propre, où l’élément fondamental était de savoir si l’enregistrement était réel et si la voix du locuteur était bien celle de M. Cahuzac. »
Mme la garde des Sceaux. J’ajoute que les éléments de la procédure pénale ne peuvent pas servir à l’administration fiscale car cela empêcherait la perception de l’impôt.
Enfin, que cela vous étonne ou vous déplaise, monsieur le député, je n’ai pas eu de contacts avec mes collègues ! Je n’ai jamais parlé de cette affaire, ni avec M. Valls, ni avec M. Moscovici. Jamais ! Et ce n’est pas une question de « muraille de Chine ». Ma responsabilité, c’est que la justice fonctionne. Et il se trouve qu’elle a bien fonctionné ! Qu’elle a été efficace ! Qu’elle a été diligente ! Je n’ai pas de conversations avec mes collègues ministres sur les procédures judiciaires. Nous avons autre chose à faire. Que cela change des habitudes, je veux bien en convenir, monsieur le député, mais je vous répète que je n’ai pas eu d’échanges ni avec M. Valls, ni avec M. Moscovici, ni avec M. Cahuzac, ni avec personne d’autre. Et je dépose sous serment.
Avant que vous m’interrogiez, j’ai déclaré que j’estimais de ma responsabilité, lorsque la presse faisait état d’une enquête préliminaire, d’en informer le Premier ministre. Il est à longueur de temps soumis à des questions ; il est donc important qu’il sache si, oui ou non, il y a enquête préliminaire. Plus de huit jours avant le retour de l’expertise, un média a annoncé que la voix de l’enregistrement était bien celle du ministre. Ma responsabilité était bien de tenir le Premier ministre informé de ce que l’expertise ne nous était pas revenue à cette date. C’est tout ! C’est un fonctionnement normal, raisonnable et responsable.
Quant à l’article 40, à ma connaissance, vous avez auditionné une personne dont il a été indiqué qu’elle avait reçu un appel de M. Gonelle. La question vaut pour elle, pas pour les services du Président de la République. Vous avez dû lui poser les questions qui convenaient. Je ne suis pas venue commenter le comportement de tel ou tel.
Vous vous obstinez, monsieur le député, à lier la réforme du CSM à l’affaire Cahuzac. L’engagement n° 51 du Président de la République, pendant sa campagne de réformer le CSM, ne vaut pas pour vous ; les déclarations faites au mois de juin par ma voix, par le Premier ministre et par le Président de la République ne valent pas. L’élaboration du texte en juin 2012, les consultations ouvertes depuis octobre 2012, cela ne vaut pas pour vous ! La présentation du texte au Conseil d’État, avant la procédure Cahuzac, non plus ! Si vous persistez à faire le rapprochement entre la réforme du CSM et l’affaire Cahuzac, c’est votre liberté, mais ne me demandez pas d’inventer un roman ! Le CSM n’est pas concerné, et je ne vais pas faire des gammes sur ce qu’il aurait fait, n’a pas fait, a mal fait ! Cela n’est pas la première fois que vous liez l’affaire Cahuzac à l’engagement pris par le Président de la République, avant le 8 mai 2012, de réformer le CSM.
Concernant l’expertise de l’enregistrement, vous dites 60 %, mais, moi, je n’en sais rien. Je sais seulement que l’expertise est revenue et qu’elle ne concluait pas formellement dans un sens ou dans un autre. C’est pourquoi j’ai dit qu’elle était à mi-chemin.
M. Charles de Courson. L’échelle de l’évaluation va de – 2 à + 4, et la note des experts est + 2. Voilà les faits.
Mme la garde des Sceaux. Pourquoi dire que nous aurions été « tétanisés » ? Je me suis seulement assurée que la justice fonctionnait. Et je suis fière, même si le mérite en revient essentiellement au ministère public, que la justice ait fonctionné de cette façon parce que, en d’autres temps, sur des affaires de ce type, il y aurait risque de démembrement de la procédure, de délocalisation, et d’instruction individuelle – sans qu’elle soit nécessairement écrite ou versée au dossier.
M. Jean-Marc Germain. Une remarque, d’abord. On peut tout à fait suspendre la procédure administrative, comme on le fait pour des contentieux visant des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, quand une enquête pénale est en cours pour pouvoir qualifier les faits. Et c’est ce qui se passe, j’imagine, pour tirer les conséquences en termes de redressement fiscal du compte non déclaré de M. Cahuzac puisque c’est la justice qui va tirer l’affaire au clair.
Vous estimez de votre responsabilité, madame la garde des Sceaux, d’être agnostique à propos de l’existence d’un compte non déclaré au nom de M. Cahuzac, et de laisser travailler la justice. Avez-vous eu connaissance de la réponse à la demande d’entraide administrative, au moins par des moyens indirects comme l’article du JDD ? Comment l’avez-vous analysée ? Et quelle a été votre réaction ?
Mme la garde des Sceaux. Je n’ai pas eu connaissance de la réponse par l’administration fiscale. J’ai su par la suite que le procureur général se demandait si elle devait être versée au dossier. Je me suis juste assurée que les procédures avaient été respectées, c'est-à-dire que l’administration fiscale n’avait pas obligation de nous prévenir. Elle a considéré qu’il était de sa responsabilité de saisir les autorités suisses. Je ne suis pas allée plus loin.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous lu la réponse ?
Mme la garde des Sceaux. Non, même après. Je vais passer pour un animal étrange, mais je ne suis pas en responsabilité des affaires fiscales.
M. le président Charles de Courson. Il y avait une note qui est remontée au cabinet…
Mme la garde des Sceaux. Non ! La note n’est pas remontée au cabinet. Le procureur général a interrogé la DACG – et je n’en ai pas connaissance, ce qui est normal – quant à savoir s’il fallait verser les éléments au dossier. Et la DACG interroge le cabinet sur la question du Procureur, qui ne répond pas. Ce n’est pas une note qui remonte au cabinet.
M. le président Charles de Courson. La division nationale des investigations financières et fiscales (DNIFF) transmet au procureur la réponse – qui n’a pas eu la question. Il hésite et saisit la DACG par une note dont on nous a dit qu’elle avait été transmise à votre cabinet. Notre rapporteur vous a posé la question tout à l’heure, d’où celle de M. Germain, qui est tout à fait légitime : « Avez-vous eu, vous ou votre cabinet, le texte de la réponse ? »
M. Jean-Marc Germain. Comme la réponse était publique avec le JDD, autour du 1er février, je vous demandais si vous aviez eu connaissance directement de ces informations et comment vous aviez réagi. Le procureur général nous a bien dit que cette information n’avait pas eu d’influence sur le cours de l’enquête et il nous a expliqué que son intime conviction s’était forgée au moment du retour de l’expertise de l’enregistrement. Je voulais savoir si vous aviez eu une réaction particulière même si vous vous étiez fixé comme ligne de conduite de ne pas vous faire d’opinion et de laisser travailler la justice.
Mme la garde des Sceaux. Je n’en ai pas eu connaissance, je n’ai pas cherché à savoir. Si je l’avais fait, peut-être aurais-je su mais je ne vois pas quel usage j’en aurais fait.
M. le président Charles de Courson. Peu importe, mais M. Germain est libre de poser des questions.
Mme la garde des Sceaux. Quand on travaille vingt heures par jour, on a autre chose à faire.
M. Jean-Marc Germain. Je partage votre attitude, madame la ministre, et, à votre niveau de responsabilité, il est très important de faire la part de ce qui relève de sa responsabilité en tant que chef d’une administration et des questions d’ordre politique que tout un chacun peut se poser.
Ma deuxième question rejoint celle de M. Fenech à laquelle vous avez largement répondu. À partir du résultat de l’expertise, dont vous avez été informée le 18 dans la soirée, et qui vous laisse partagée, puisqu’il n’est pas formel, comment les événements s’enchaînent-ils, depuis ce moment jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire puis à la démission du ministre ?
Mme la garde des Sceaux. Je ne suis pas informée de l’information judiciaire. J’apprends le 18 mars assez tard dans la journée, du retour de l’expertise, qui était annoncée dans toute la presse pour le 15 mars, et dont un média déclarait depuis dix jours qu’elle confirmait que c’était bien Jérôme Chauzac. L’information judiciaire est ouverte le lendemain. Je le déclare sous serment : je n’ai eu aucune information avant que l’acte ait été accompli. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque le procureur et le procureur général vous l’ont dit aussi. À ce stade, le Premier ministre estime que des décisions doivent être prises vis-à-vis du ministre.
Ça peut vous paraître étonnant que je n’aie pas passé mes journées à suivre l’affaire, mais c’est ainsi. Entre le 19 mars – ouverture d’une information judiciaire contre X, je le répète – et le 2 avril où un média révèle que le ministre serait mis en examen –, je n’ai aucune information. Même lorsque les procédures sont lancées, je n’ai pas d’information. Autant le parquet peut me confirmer qu’il a ouvert une enquête préliminaire, autant les juges d’instruction n’informent pas de leurs actes de procédure. Le 2 avril, la presse sait des choses que le parquet n’est pas en mesure de me confirmer.
M. Daniel Fasquelle. Madame la ministre, nous sommes en droit de vous poser des questions même si certaines d’entre elles vous déplaisent. Vous n’avez pas à répondre sur le ton agressif que vous avez utilisé envers M. Fenech. Nous sommes ici pour avoir un échange et toutes les questions posées méritent une réponse.
La plainte de Jérôme Cahuzac a été déposée sur le fondement de l’article 48 1°bis de la loi de 1881 qui protège les membres du Gouvernement. Or, ce n’est pas en tant que tel que Jérôme Cahuzac était visé, mais à titre personnel à raison d’un compte à l’étranger non déclaré. Vous trouvez qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement et que tout était normal. Il y a tout de même un « conflit d’intérêts » entre le ministre et le contribuable Cahuzac, selon l’expression d’Edwy Plenel qui se demandait pourquoi la DACG avait laissé passer la plainte sans réagir. Il a constaté qu’une deuxième plainte avait été déposée par Jérôme Cahuzac, mais elle n’a jamais été signifiée à Edwy Plenel. Il y a bien là un dysfonctionnement, en dépit de vos affirmations selon lesquelles tout va bien et que tout s’est bien passé.
Vous dites que la plainte a été requalifiée, mais je n’ai pas les moyens de vérifier immédiatement, je ne sais pas si c’était même juridiquement possible, et si elle l’a été. Confirmez-vous ?
Mme la garde des Sceaux. Monsieur le député, j’ai répondu à toutes les questions qui m’ont été posées. Que mes réponses ne vous conviennent pas, je veux bien l’entendre. Mon ton me revient : je réponds sur le fond avec le ton qui sied à une commission d’enquête mais si, comme M. Fenech, on me fait un procès d’intention en mettant en cause le CSM et le Gouvernement, taxé d’opportunisme, je réponds sur le ton qui convient à une accusation répétitive, itérative, obstinée. Que mon ton ne vous plaise pas, j’en suis profondément désolée, mais je mets dans ma réponse l’énergie que je juge nécessaire.
Concernant les plaintes, non, il n’y a pas eu de dysfonctionnement, même si cela vous déplaît aussi, sans doute. Et s’il y en a eu, signalez les moi !
Je ne vois pas le conflit d’intérêts parce qu’une plainte a été transmise selon la voie prévue à l’article 48 1°bis de la loi de 1881.
Oui, le procureur a requalifié et il a la latitude pour le faire. Dans le cas contraire, les avocats de M. Cahuzac auraient invoqué la nullité. Je ne sais pas pourquoi M. Edwy Plenel n’a pas été informé de la deuxième plainte, mais ce n’est pas à moi d’informer les parties à une procédure.
M. Daniel Fasquelle. Sans l’obstination de Mediapart, et si Edwy Plenel n’avait pas interpellé le procureur, en lui fournissant certains éléments, il n’y aurait peut-être pas eu d’enquête préliminaire. Comment expliquer la situation ? J’y vois un très grave dysfonctionnement. La preuve, c’est qu’on a une enquête administrative qui peut susciter les doutes les plus sérieux. De son côté, le Président de la République est informé en décembre par la presse, Michel Gonelle et d’autres canaux – Edwy Plenel dit, et je suis d’accord, que qui voulait savoir pouvait savoir fin décembre. Et le pouvoir ne réagit pas. La question n’est pas de savoir si la justice a subi ou non des pressions, mais de savoir si, informé de faits délictueux extrêmement graves, il a alerté ou non la justice. Pour moi, il y a dysfonctionnement dès lors que le pouvoir n’a pas transmis à la justice les informations qu’il avait. Confirmez-vous qu’on aurait pu, en interrogeant un procureur en Suisse et en passant par la voie judiciaire, faire la lumière beaucoup plus rapidement sur l’affaire Cahuzac ? Pourquoi surtout un tel attentisme de la part du Gouvernement ?
Mme la garde des Sceaux. Je vois où vous voulez en venir : charger le Président de la République de choses qui ne relèvent pas de lui, et le Gouvernement de l’entraide judiciaire et pénale qui ne relève pas non plus de lui. N’ayant pas la moindre chance de vous convaincre, je ne me fixe donc pas cette ambition.
Reprenons les séquences. Lorsque Mediapart écrit le 23 décembre, il y a deux plaintes en diffamation qui n’ont pas encore donné lieu à désignation d’un juge d’instruction et à la fixation d’une consignation. Mediapart insiste et le procureur décide d’ouvrir une enquête financière. Tout le monde fait des hypothèses, moi aussi. Si le ministre du budget avait été innocent, l’enquête préliminaire l’aurait servi. On aurait alors pu accuser le parquet de télescoper une action en diffamation pour blanchir un ministre parce que c’est à la personne qui met en cause d’apporter la preuve de ses affirmations. Je veux bien qu’on refasse l’histoire, mais voilà les faits ! Le parquet agit de façon inhabituelle puisqu’il décide d’ouvrir une enquête préliminaire et de faire émerger des preuves. C’est tant mieux pour tout le monde – parce que cette affaire fait des dégâts considérables – s’il a fallu moins de six mois pour engager une procédure sérieuse.
M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas convaincu, vous vous en doutez, d’autant qu’on confond en permanence la plainte en diffamation et l’action qu’aurait pu, ou dû, engager le Gouvernement au titre de l’article 40, informé qu’il était d’un fait délictueux extrêmement grave.
D’après une journaliste du Point, qui vient d’écrire un livre sur l’affaire Cahuzac, une réunion s’est tenue le 16 janvier 2013, à l’issue du conseil des ministres, autour du Président de la République, en présence du Premier ministre, de Pierre Moscovici et de Jérôme Cahuzac. En avez-vous eu connaissance, madame la ministre ? Comment se fait-il que vous n’y ayez pas participé ?
Mme la garde des Sceaux. Cela aurait été un sacré dysfonctionnement si le Grade des Sceaux y avait participé ! Je n’ai pas eu connaissance de cette réunion et j’en ignore le contenu, et ce qu’il en est sorti. Le 16 janvier, l’enquête préliminaire est déjà ouverte.
Le ministre de l’économie saisit les autorités suisses, et on lui reproche d’ouvrir une procédure fiscale en même temps qu’une procédure pénale. Et là vous reprochez au Gouvernement de n’avoir rien fait. Une enquête préliminaire a été ouverte dans des conditions assez inhabituelles – et tant mieux – le 8 janvier.
M. Philippe Houillon. Une seule question – que je ne poserai pas à Mme la garde des Sceaux de crainte de m’attirer ses foudres – pour me rafraîchir la mémoire.
Monsieur le rapporteur, à propos de cette affaire qui n’intéressait manifestement personne, confirmez-vous que le ministère de la justice, via la DACG, a eu plus de 50 contacts avec le parquet, ainsi que nous l’a déclaré la directrice des affaires criminelles et des grâces ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Les chiffres précis ont été fournis au cours de l’audition, et confirmés par lettre.
M. Philippe Houillon. De mémoire, c’est 56, mais je n’ai plus le chiffre en tête.
M. le président Charles de Courson. « Entre le 6 décembre 2012 et le 2 avril 2013, le parquet général de Paris a adressé 56 comptes rendus à ma direction, – je cite la directrice – laquelle en a transmis 54 au cabinet. »
M. Philippe Houillon. Pas d’autre question, monsieur le président.
Mme la garde des Sceaux. Je connais cet effet de prétoire, pour déconcerter le jury. Je l’ai dit dès le début, les échanges entre le parquet général et la DACG sont fréquents et réguliers. Nous travaillons d’ailleurs depuis plusieurs mois pour les réduire, parce qu’ils prennent beaucoup de temps aux procureurs généraux et aux procureurs. Puisque nous ne donnons pas d’instructions individuelles, il y a beaucoup d’informations dont nous n’avons pas besoin, ou dont nous n’avons besoin qu’à la fin. Mon cabinet peut facilement vous prouver ce qui a changé dans les rapports entre le procureur et la DACG, entre la DACG et mon cabinet, et entre mon cabinet et moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Tout ça nous a été remis. Mais notre collègue Houillon avait peur de perdre la mémoire…
Mme la garde des Sceaux. Aux effets, j’oppose les faits !
M. le président Charles de Courson. Nous sommes donc convenus que vous nous fourniriez une note, madame la ministre, sur les précédents éventuels de saisine de l’administration fiscale dans le cadre de conventions internationales, postérieurement à l’ouverture d’une enquête préliminaire ; et sur les cas de non-transmission à la justice des saisines d’autorités fiscales étrangères. Madame la ministre, je vous remercie d’être venue jusqu’à nous.
Audition du mardi 16 juillet 2013
À 17 heures : M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur.
M. le président Charles de Courson. Après avoir reçu la garde des Sceaux ce matin et avant de recevoir le ministre de l’économie et des finances tout à l’heure, nous auditionnons à présent le ministre de l’intérieur : nous aurons ainsi entendu les trois ministres dont les administrations ont été directement concernées par la gestion de l’affaire Cahuzac.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, notre commission d’enquête a déjà auditionné, au cours des dernières semaines, plusieurs responsables de l’administration dont vous avez la charge : le directeur central du renseignement intérieur ; le directeur central de la sécurité publique ; le sous-directeur de l’information générale ; la chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales ; le sous-directeur de la police technique et scientifique. Ils nous ont indiqué ce que leurs services avaient ou n’avaient pas fait en lien avec cette affaire, dans le respect du secret de l’instruction s’agissant du travail de la police judiciaire. Nous souhaitons donc désormais connaître les initiatives que vous-même ou votre cabinet avez prises en lien avec la même affaire.
M. Manuel Valls prête serment.
M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. Il me revient de répondre à vos questions sur l’attitude du Gouvernement et, plus précisément, du ministère de l’intérieur au cours de l’affaire ayant conduit à la démission de M. Cahuzac. Je souhaite vous faire part des éléments essentiels à cet égard, en respectant la chronologie. Je compléterai ensuite mon propos en répondant, avec le plus de précision possible, à vos questions.
Avant la publication des articles de Mediapart les 4 et 5 décembre 2012, je n’ai pas été informé, ni oralement ni par écrit, de l’hypothèse selon laquelle M. Cahuzac avait ou aurait eu un compte en Suisse ou à l’étranger.
Entre le 5 décembre et le 8 janvier, j’ai comme vous entendu M. Cahuzac le 5 décembre affirmer dans l’hémicycle : « Je n’ai pas, je n’ai jamais eu de compte à l’étranger, ni maintenant, ni auparavant. » Il m’a également affirmé, personnellement, que les allégations de Mediapart étaient fausses.
Dans la mesure où, à la suite de Mediapart, la presse faisait état de nombreuses interrogations concernant M. Cahuzac, la banque UBS et une « note blanche » que la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) m’aurait transmise et, aussi en raison de l’ancienneté des faits, une seule vérification a été menée : savoir si la DCRI disposait dans sa documentation d’éléments archivés relatifs soit à la banque UBS, soit à M. Cahuzac. La recherche a donné un résultat négatif concernant M. Cahuzac. En revanche, la DCRI a retrouvé, dans sa documentation, la copie d’une dénonciation relative à l’existence d’un possible système de fraude fiscale au sein de la banque UBS. Cette dénonciation remontait à avril 2009 et avait été complétée en février 2011. À l’époque, considérant que la Commission bancaire, devenue par la suite l’Autorité de contrôle prudentiel, était la destinataire principale de cette dénonciation et était compétente en la matière, la DCRI n’avait pas engagé d’enquête de renseignement.
Le 19 décembre 2012, la DCRI m’a transmis une note d’une page résumant ces éléments avec, en annexe, les dénonciations de 2009 et de 2011. C’est, selon moi, parce qu’ils ont eu connaissance de l’existence de cette note – qui ne mentionne à aucun moment le nom de M. Cahuzac – que certains journalistes ont indiqué, à tort, que le ministère de l’intérieur et le ministre lui-même avaient pu être informés en amont. Or, il n’en a rien été.
À la demande de votre rapporteur, j’ai procédé à la déclassification de cette note et de ses annexes, et les lui ai transmises le 12 juin dernier, le lendemain de l’audition de M. Patrick Calvar, directeur central du renseignement intérieur. J’y insiste : interroger la documentation existante de la DCRI et mettre en oeuvre des investigations sont deux choses radicalement différentes. En aucun cas je n’ai demandé à la DCRI d’enquêter sur M. Cahuzac. Je n’avais d’ailleurs pas à le faire.
Le 8 janvier 2013, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. En ma qualité de ministre de l’intérieur, je ne pouvais en rien m’immiscer dans une procédure judiciaire conduite par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République de Paris.
En résumé, je n’ai jamais disposé d’aucun élément oral ou écrit démontrant que M. Cahuzac détenait un compte à l’étranger. De même, je n’ai jamais disposé, avant la remise du rapport définitif de la police scientifique et technique au procureur de la République de Paris le 19 mars et les conclusions de l’enquête, d’éléments démontrant que la voix de l’enregistrement était effectivement celle de M. Cahuzac. Je vous renvoie à cet égard aux déclarations des responsables de la police judiciaire devant votre Commission le 11 juin dernier. Enfin, j’ai toujours dit au Président de la République et au Premier ministre que je ne disposais d’aucun élément établissant la véracité des informations de Mediapart relatives à la détention d’un compte en Suisse ou à l’étranger par Jérôme Cahuzac.
D’autre part, comme j’ai tenu à l’indiquer dans un communiqué de presse publié le 3 avril dernier, aucune enquête parallèle n’a été menée par mes services, ni avant ni pendant l’enquête préliminaire conduite depuis le 8 janvier 2013 par les services de la direction centrale de la police judiciaire – division nationale d’investigations financières et fiscales et sous-direction de la police technique et scientifique – sous la direction du procureur de la République de Paris. Je ne les ai d’ailleurs pas rencontrés au cours de cette période.
Jamais je n’ai donné instruction aux services de renseignement de mener de telles investigations. Cela n’entre pas dans leurs missions – je l’ai rappelé dans le communiqué du 3 avril et le confirme à nouveau. Toute conception ou pratique contraire relèverait d’une époque désormais révolue.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le ministre, confirmez-vous que la seule note que vous ayez reçue est celle de la DCRI en date du 19 décembre 2012 ? Pourriez-vous préciser la manière dont la demande avait été formulée ?
M. le ministre. Ce fut une initiative conjointe de mon directeur de cabinet de l’époque, M. Jean Daubigny, et du directeur central du renseignement intérieur, M. Patrick Calvar.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi votre cabinet a-t-il interrogé la DCRI, alors qu’il n’était pas de sa compétence de mener des enquêtes sur des hommes politiques, comme nous l’a indiqué le directeur central du renseignement intérieur lui-même ?
M. le ministre. Des informations relayées par la presse avaient fait état d’une « note blanche » qui pouvait comporter des éléments concernant M. Cahuzac et qui m’aurait été transmise. C’est en raison de ces informations que mon cabinet et le directeur central du renseignement intérieur ont pris cette initiative.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon M. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, la sous-direction de l’information générale (SDIG) n’a en revanche pas été sollicitée par votre cabinet. Le confirmez-vous ?
M. le ministre. Je le confirme : elle n’avait pas à l’être.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cependant, la SDIG a été informée d’un incident mineur : l’utilisation, par M. Gonelle, d’un portable de service pour tenter de joindre M. Plenel. Cette information est-elle remontée jusqu’à votre cabinet ?
M. le ministre. Il s’agit d’un banal concours de circonstance fortuit : un policier a prêté son téléphone portable à une personne qu’il connaissait, en l’espèce M. Gonelle. Lorsque le policier et sa hiérarchie ont réalisé ce qui s’était passé, ils en ont rendu compte, en raison de la médiatisation de l’affaire, ce qui était normal et même nécessaire.
Il est habituel que les préfets – qui représentent chacun des ministres sur un territoire donné – puissent avoir des relations directes avec les cabinets d’autres ministres que celui de l’intérieur. C’est même fréquent lorsque le ministre en question est un élu du département, a fortiori lorsque sa chef de cabinet est une ancienne sous-préfète du même département.
Certains ont allégué que le ministère de l’intérieur aurait porté atteinte au secret des sources ou utilisé les moyens de l’État pour connaître les informateurs de Mediapart. Les explications fournies par Mme Valente à votre Commission et le rapport du directeur départemental de la sécurité publique du Lot-et-Garonne rédigé a posteriori, le 21 mai 2013, ont, de mon point de vue, réduit ces accusations à néant : le policier et sa hiérarchie ont eu connaissance du contact téléphonique entre M. Gonelle et M. Plenel de manière tout à fait fortuite.
Compte tenu de sa banalité, cet incident n’avait donné lieu qu’à une simple remontée d’information : le préfet du Lot-et-Garonne avait adressé un message électronique à la permanence de mon cabinet le 11 décembre 2012. Par la suite, dans le contexte des travaux de la commission d’enquête et des informations publiées par la presse, le directeur départemental de la sécurité publique du Lot-et-Garonne a rédigé le rapport plus formalisé, plus officiel que j’ai mentionné. Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de vous remettre ces deux documents.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi n’avez-vous pas demandé à la SDIG si les archives qu’elle a héritées de la direction centrale des renseignements généraux contenaient des éléments concernant l’éventuelle détention, par M. Cahuzac, d’un compte non déclaré à l’étranger ?
M. le ministre. Tel n’était pas le rôle de la SDIG.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce n’était pas non plus celui de la DCRI.
M. le ministre. Je le répète : la presse évoquait une note concernant la banque UBS et, peut-être, M. Cahuzac. Par précaution, compte tenu des accusations portées, nous avons jugé indispensable de vérifier si la DCRI détenait un tel document dans ses archives.
M. Alain Claeys, rapporteur. La brigade de répression de la délinquance financière, chargée de l’enquête préliminaire ouverte le 8 janvier 2013, est placée sous les ordres de Mme Christine Dufau, chef de la division nationale d’investigations financières et fiscales. Celle-ci nous a indiqué rendre compte des principaux actes de l’enquête au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Quel circuit ces informations suivent-elles ensuite et dans quelle mesure parviennent-elles à votre cabinet ?
M. le ministre. Comme je l’ai indiqué, je n’ai pas rencontré – je n’avais pas à le faire – les responsables chargés de l’enquête.
Mon rôle de ministre de l’intérieur est, je le rappelle, d’assurer la sécurité des Français, de préserver ou de rétablir l’ordre public en utilisant les prérogatives et les moyens de la police administrative. Le recrutement, la formation, l’équipement et la gestion de la police sont de mon ressort. Mais en aucun cas je ne peux m’immiscer dans les enquêtes judiciaires, conduites par les officiers de police judiciaire sous le contrôle des magistrats. J’ai appliqué cette règle de conduite pour toutes les affaires judiciaires, a fortiori pour celle-ci : elle concernait un membre du Gouvernement, un de mes collègues.
Néanmoins, il arrive que des informations synthétiques sur les enquêtes en cours me soient transmises – comme à tous mes prédécesseurs – par la voie hiérarchique, c’est-à-dire par le directeur général de la police nationale. C’est notamment le cas lorsqu’elles concernent des affaires intéressant le maintien de l’ordre public ou ayant un fort retentissement médiatique. Il convient en effet de s’assurer que tous les moyens nécessaires sont bien consacrés à ces enquêtes.
Mais je l’affirme clairement : je ne suis jamais destinataire d’aucune pièce de la procédure. Si tant est qu’elles aient jamais existé, ces pratiques n’ont plus cours. Les seuls éléments dont je peux avoir connaissance sont les synthèses que j’ai mentionnées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ces synthèses peuvent-elles être transmises au Premier ministre et au Président de la République ?
M. le ministre. À ma connaissance, elles ne l’ont pas été en l’espèce. Mais elles peuvent en effet l’être.
M. Alain Claeys, rapporteur. Entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, M. Cahuzac ou ses collaborateurs ont-ils eu des contacts avec votre cabinet ?
M. le ministre. Non.
M. le président Charles de Courson. Au cours des auditions, il nous a été indiqué que les services des préfectures continuaient à alimenter des « dossiers départementaux », qui contiennent des informations relatives aux principaux élus de chaque département. Leur constitution relevait jadis de la direction centrale des renseignements généraux. Avez-vous demandé à avoir communication du dossier de M. Cahuzac ?
M. le ministre. Non, je ne l’ai jamais eu en ma possession. Cependant, je connais bien ces dossiers, qui me sont transmis à l’occasion de mes déplacements dans les départements : généralement très bien faits, ils détaillent la biographie et le parcours politique de tel élu local ou de telle personnalité. Ce sont, du reste, des renseignements que l’on trouve ailleurs, notamment sur Internet, ou que l’on peut acquérir par une bonne connaissance de la carte politique. Mais je le rappelle : aujourd’hui, les responsables politiques et syndicaux n’ont pas à être fichés.
M. le président Charles de Courson. Ces dossiers existent dans tous les départements : ils apportent des informations sur le milieu politique local. La préfecture du Lot-et-Garonne nous transmettra demain ceux qu’elle tient à jour. Confirmez-vous que vous n’avez jamais eu connaissance du dossier de M. Cahuzac ?
M. le ministre. Oui. De toute façon, ce dossier d’information générale n’aurait pas fourni le moindre élément concernant les révélations publiées au mois de décembre 2012.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous, votre cabinet ou vous-même, demandé des précisions sur l’enquête en cours au directeur central de la police judiciaire ou à tout autre service qui y participait directement ?
M. le ministre. Non.
M. le président Charles de Courson. Jamais ?
M. le ministre. Jamais.
M. le président Charles de Courson. N’en avez-vous jamais parlé avec votre directeur ?
M. le ministre. Avec le directeur central de la police judiciaire, jamais.
M. le président Charles de Courson. Et avec votre directeur de cabinet ?
M. le ministre. Nous nous parlons plusieurs fois par jour.
M. le président Charles de Courson. Lui avez-vous parlé de cette affaire ?
M. le ministre. Nous l’avons évidemment évoquée, comme beaucoup l’ont fait à cette époque.
M. le président Charles de Courson. Sans que lui ni vous-même ne sollicitiez les services afin d’obtenir des informations concernant ces accusations ?
M. le ministre. Comme je l’ai indiqué, je n’ai eu connaissance d’aucun élément concernant un éventuel compte de M. Cahuzac à l’étranger ou en Suisse. Les fiches synthétiques qui m’ont été transmises ne contenaient aucun élément relatif à l’existence d’un compte ou laissant penser que la voix de l’enregistrement était celle de M. Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Vous avez donc écouté cet enregistrement ?
M. le ministre. Je ne l’ai jamais écouté personnellement, bien qu’il ait été largement diffusé sur les chaînes de radio. Je n’ai eu connaissance d’aucun élément particulier concernant cet enregistrement et n’en ai jamais demandé. Je vous renvoie à nouveau aux explications précises que vous ont fournies les responsables de la police judiciaire, notamment le sous-directeur de la police technique et scientifique, au sujet de l’expertise et de sa méthode.
M. le président Charles de Courson. À partir de quelle date avez-vous nourri des doutes sur la véracité des affirmations de M. Cahuzac ?
M. le ministre. Je n’avais pas à avoir de doutes particuliers. M. Cahuzac a affirmé ne pas détenir de compte à l’étranger devant la représentation nationale. Je l’ai moi-même interrogé et il m’a fait la même réponse. Dès lors qu’une procédure judiciaire était engagée, mon rôle de ministre de l’intérieur était de la laisser aller jusqu’à son terme. Je n’avais d’ailleurs pas le pouvoir de l’interrompre. J’ai été informé quand la vérité a éclaté. Je n’ai d’ailleurs pas été le seul dans ce cas.
M. le président Charles de Courson. Le laboratoire de police technique et scientifique a procédé en deux temps : il a conclu assez rapidement que l’enregistrement n’avait pas été trafiqué, puis il a déterminé, sur une échelle, le degré de concordance entre la voix de l’enregistrement et celle de M. Cahuzac. N’avez-vous pas été informé du premier ou du second de ces résultats ?
M. le ministre. Non.
Mme Cécile Untermaier. M. Cahuzac vous a affirmé ne pas détenir de compte en Suisse. À quel moment et dans quelles circonstances l’a-t-il fait ? Avec quel degré de conviction ?
M. le ministre. Il l’a affirmé dès le 5 décembre 2012, non seulement devant la représentation nationale, mais à tous ceux qui le connaissaient. Lorsque la presse a publié de nouveaux éléments ou que des interrogations se sont fait jour le concernant, il nous a répété à plusieurs reprises qu’il était innocent, qu’il ne détenait aucun compte à l’étranger. Cela s’est produit au banc des ministres à l’Assemblée et à l’occasion de telle ou telle réunion ou rencontre.
Mme Cécile Untermaier. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, M. Condamin-Gerbier a répondu aux enquêteurs que M. Cahuzac détenait certainement un compte non seulement à UBS, mais également à la banque Reyl. Les enquêteurs lui auraient alors indiqué que le ministre de l’intérieur serait certainement informé de la teneur de ses propos. Cette information est-elle remontée jusqu’à vous ?
M. le ministre. Aucun élément ne peut laisser penser que j’ai pu détenir une telle information. Je n’ai reçu aucun procès-verbal à ce sujet. Je suis catégorique sur ce point, comme sur les autres.
M. Georges Fenech. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour la clarté et la précision de vos réponses. Avez-vous eu communication, au préalable, des questions de M. le rapporteur ? (Exclamations de plusieurs commissaires du groupe SRC.)
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est là le premier incident au cours de nos travaux. J’ai toujours respecté l’ensemble des membres de notre Commission d’enquête. Le président et moi-même sommes les seuls destinataires des questions préparées à notre intention. Comme vous, je suppose, monsieur Fenech, je respecte une certaine éthique dans ma vie politique.
M. le ministre. Non, monsieur Fenech. Il arrive que les ministres, comme les parlementaires, préparent sérieusement les auditions de commission d’enquête. C’est ce que j’ai fait. En outre, au cours des derniers mois, j’ai eu à répondre à plusieurs questions de la presse, dont certaines recoupent celles qui m’ont été posées aujourd’hui. Le ministère de l’intérieur, comme tous les ministères, doit apporter des réponses précises non seulement aux parlementaires, mais aussi à l’opinion. Cette audition est pour moi l’occasion de rappeler le rôle du ministère de l’intérieur, les missions et les objectifs des services de renseignement intérieur et de l’information générale, ce qu’ils peuvent et ce qu’ils ne peuvent pas ou ne doivent pas faire. Sauf en cas de flagrant délit, les enquêtes sont menées sous l’autorité non pas du ministre de l’intérieur, mais d’un procureur de la République.
M. Georges Fenech. Je respecte la parole du ministre de l’intérieur et le remercie à nouveau de la clarté de ses réponses. Mais je n’ai pas obtenu de réponse précise à ma question, monsieur le ministre : avez-vous eu communication, avant l’audition, des questions de M. le rapporteur ? (Vives exclamations des commissaires du groupe SRC.)
M. le ministre. Je vous réponds, monsieur Fenech : non.
M. Georges Fenech. Vous avez fait état d’une dénonciation remontant à avril 2009 et complétée en février 2011. Ces éléments sont donc antérieurs à votre prise de fonction. Pourquoi n’avez-vous pas ressenti le besoin de communiquer spontanément ce document important à notre Commission d’enquête ? Vous ne l’avez fait que le 12 juin dernier.
M. le ministre. Vous relevez avec raison que ces éléments sont antérieurs à la prise de fonction du Gouvernement : si j’avais été informé grâce à un document présent dans la documentation de la DCRI, mes prédécesseurs l’auraient également été.
Cette dénonciation ne mentionnait nullement le nom de M. Cahuzac. Elle n’était donc en rien liée aux accusations qui le visaient. À partir du moment où le directeur central du renseignement intérieur a évoqué ces éléments devant votre Commission d’enquête, j’ai, à la demande de votre rapporteur, déclassifié la note de la DCRI du 19 décembre 2012, ainsi que ses annexes, et les lui ai transmises.
M. le président Charles de Courson. Lorsque le directeur central du renseignement intérieur a mentionné l’existence de cette note, M. le rapporteur a contacté immédiatement M. le ministre, qui l’a déclassifiée. Nous avons reçu la note le lendemain de l’audition et ses annexes quelques jours plus tard.
M. Georges Fenech. Comment avez-vous établi le lien entre M. Cahuzac et cette dénonciation qui ne mentionne pas son nom ?
M. le ministre. Peu après le 5 décembre 2012, la presse a fait état d’une « note blanche » relative à la banque UBS et, peut-être, à M. Cahuzac. Les éléments que j’ai transmis au rapporteur avaient donc déjà fait l’objet d’une diffusion assez large dans la presse. Quand le directeur central du renseignement intérieur a retrouvé les dénonciations de 2009 et de 2011 et me les a communiquées, nous avons conclu qu’il s’agissait à l’évidence des éléments que la presse mentionnait.
M. Georges Fenech. Confirmez-vous n’avoir eu aucun contact, oralement ou par écrit, ni avec M. Moscovici, ni avec Mme Taubira, ni avec M. Cahuzac pendant toute la durée de la procédure ?
M. le ministre. Ma réponse est claire : non.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Monsieur le ministre, vous vous êtes défendu à plusieurs reprises d’avoir été « trop informé ». Néanmoins, est-il absurde qu’un ministre de l’intérieur ou un Gouvernement reçoive des informations sensibles non pas par la voie d’une enquête – encore moins d’une enquête qui interférerait avec une procédure judiciaire en cours –, mais par celle des services de renseignement ? Les renseignements généraux, aujourd’hui intégrés à la DCRI, ont toujours recueilli et porté de tels éléments à la connaissance du ministre de l’intérieur. Vous dites ne pas avoir eu connaissance d’informations particulières relatives à l’affaire Cahuzac et ne pas avoir désiré en obtenir – je vous crois volontiers. Cependant, avez-vous trouvé sur votre bureau d’autres informations sensibles transmises spontanément par la DCRI ? Je pense en particulier à l’une des affaires concernant M. Woerth, qui n’est sans doute pas sans lien, à travers la liste dite « Falciani », avec l’affaire Cahuzac.
M. le ministre. Non, je n’ai jamais été destinataire de tels éléments. Pourquoi aurais-je demandé, lors de ma prise de fonction, des informations de cette nature ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Non pas demandé, mais reçu.
M. le ministre. Je n’en ai pas davantage reçu. Il existe des procédures, des règles, et il convient de les respecter. La police, la gendarmerie, les services de renseignement mènent des enquêtes sous l’autorité de la justice. Je me méfie de tous les éléments d’information liés à des rumeurs.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il existe, au ministère de l’intérieur, un fichier auparavant dénommé EDVIGE et pour partie hérité des renseignements généraux. Il est alimenté par les services de renseignement et contient des informations sensibles sur diverses personnalités. Ce fait n’a rien de choquant, même dans un État de droit, pour peu qu’il soit fait un usage légitime de ces données. Les services de renseignement ne vous ont-ils pas proposé, à un moment ou à un autre, de vous fournir de telles informations ?
M. le ministre. Non, et il est très bien qu’il en ait été ainsi. Je reviens à votre première question : à peine arrivé au ministère de l’intérieur, mon premier souci aurait été de demander des informations sur les personnes dont le nom commençait par la lettre W…
Mme Marie-Françoise Bechtel. Encore une fois : vous n’avez pas nécessairement eu à les demander.
M. le ministre. On ne m’a jamais transmis de telles informations. Des changements ont eu lieu à la tête de la DCRI et de la direction générale de la police nationale. J’ignore quelles étaient les pratiques antérieures et ne veux d’ailleurs porter aucune accusation : il y a une continuité de l’État. Je suis chargé de la sécurité des Français. Il convient d’observer les règles, notamment de respecter les procédures judiciaires. Les services de renseignement n’ont pas à livrer au ministre de l’intérieur des informations pouvant mettre en cause ses concurrents ou ses adversaires politiques.
M. Daniel Fasquelle. Vous dites n’avoir jamais discuté de l’affaire Cahuzac ni avec l’intéressé, ni avec Mme Taubira, ni avec M. Moscovici. Confirmez-vous n’en avoir jamais parlé non plus ni au Président de la République ni au Premier ministre ?
M. le ministre. Je n’ai rien dit de tel. Comme je l’ai indiqué, j’ai toujours dit au Président de la République et au Premier ministre que je ne disposais d’aucun élément attestant la véracité des informations de Mediapart relatives à la détention d’un compte en Suisse ou à l’étranger par Jérôme Cahuzac. J’ai rappelé la chronologie des faits dans mon propos liminaire. Si j’avais des éléments à communiquer au Président de la République et au Premier ministre, je les leur transmettais. J’ai donc discuté à quelques reprises sur ce sujet-là avec l’un et l’autre mais à partir des éléments que je n’avais pas.
M. le président Charles de Courson. Uniquement de manière orale ?
M. le ministre. Absolument.
M. le président Charles de Courson. Vous ne leur avez transmis aucun écrit à ce sujet ?
M. le ministre. Non.
M. Daniel Fasquelle. Il y a donc bien eu des échanges. Quelle était la nature de ces contacts : conversations téléphoniques, échanges au cours de réunions ? Où ont-ils eu lieu ?
M. le ministre. Encore une fois, j’ai donné ces informations qui montraient que je ne disposais d’aucun élément. Le ministre de l’intérieur rencontre régulièrement le Président de la République et le Premier ministre sur de nombreux sujets. Ces échanges ont eu lieu au palais de l’Élysée et à l’hôtel Matignon.
M. Daniel Fasquelle. Au cours de ces échanges, avez-vous envisagé d’engager une action en justice ? Nous avons hélas constaté qu’il a fallu l’acharnement de Mediapart et de M. Plenel pour qu’une enquête judiciaire soit enfin déclenchée au mois de janvier. Pourtant, les affirmations de Mediapart étaient relativement argumentées, et M. Gonelle a informé le directeur de cabinet adjoint du Président de la République dès le 15 décembre. Ce faisceau d’indices pouvait laissait penser que M. Cahuzac détenait bien un compte en Suisse. Nous sommes très surpris qu’il n’y ait eu aucune réaction à l’époque. La question n’est pas seulement de déterminer si des pressions ont été exercées ou non sur la justice pour l’empêcher d’agir, mais aussi de savoir pourquoi on ne l’a pas saisie.
M. Alain Claeys, rapporteur. Cette question se pose aussi pour la période antérieure, à partir de 2001. Je peux rappeler aux membres de la Commission la chronologie des faits.
M. Daniel Fasquelle. Je vous prie, monsieur le rapporteur, de rester neutre. Vous n’avez pas besoin de voler au secours du ministre : il saura se défendre lui-même. Dès qu’un membre de la Commission pose une question un peu gênante, vous intervenez.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je reste parfaitement neutre. Je souhaite simplement dire que la justice a fait son travail, dès qu’elle a été saisie.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas la question que pose M. Fasquelle. Le Gouvernement a-t-il envisagé de saisir la justice ?
M. Daniel Fasquelle. Ma question se rapporte à l’article 40 du code de procédure pénale : lorsqu’on a connaissance d’un tel faisceau d’indices, il serait logique d’agir. Or, le Président de la République, le Premier ministre et la garde des Sceaux n’ont rien fait. Seul M. Moscovici a engagé une procédure administrative, qui a conduit à blanchir M. Cahuzac. Et, de nouveau, il n’y a eu aucune réaction. La démarche n’a pas été poursuivie jusqu’au bout : aucune enquête judiciaire – et non seulement administrative – n’a été lancée. Est-ce parce que M. Cahuzac était membre du Gouvernement ? Nous cherchons à caractériser d’éventuels dysfonctionnements ; ma question entre donc tout à fait dans le champ de notre Commission d’enquête.
M. le ministre. Je rappelle la chronologie : Mediapart a publié ses révélations le 4 et le 5 décembre ; M. Cahuzac est intervenu lors de la séance des questions au Gouvernement, suscitant un certain émoi et de nombreux débats ; en réponse à la vérification que je suis amené à faire, la DCRI m’a adressé une note le 19 décembre ; une enquête préliminaire a été ouverte le 8 janvier. En réalité, les choses se sont passées dans un temps extrêmement rapide.
Votre question n’est en aucun cas gênante, monsieur le député. L’hypothèse que vous mentionnez n’a jamais été évoquée ni avec le Président de la République, ni avec le Premier ministre, ni avec la garde des Sceaux. Quant à une éventuelle initiative de ma part, le ministre de l’intérieur ne pouvait pas engager une telle procédure judiciaire. Tout ceci s’est passé de façon très rapide, dans des délais pas toujours connus dans le passé.
M. Gérald Darmanin. Nous avons appris que M. Gonelle avait contacté M. Zabulon, à l’époque directeur de cabinet adjoint du Président de la République. M. Zabulon est membre du corps préfectoral. Vous a-t-il contacté, vous ou votre cabinet, à la suite de ces révélations ?
M. le ministre. Ma réponse est précise : non. M. Zabulon est certes préfet, mais il était alors collaborateur du Président de la République. C’est donc à celui-ci qu’il devait rendre compte.
M. le président Charles de Courson. Je rappelle que M. Zabulon nous a indiqué avoir contacté M. Cahuzac pour l’informer de l’appel de M. Gonelle. Pour être précis, monsieur le ministre : M. Zabulon n’a eu aucun contact avec vous à ce sujet, ni direct ni indirect ?
M. le ministre. Ni direct ni indirect.
M. Gérald Darmanin. Ni, à votre connaissance, avec votre cabinet ?
M. le ministre. Non.
M. Gérald Darmanin. Lorsqu’un gouvernement entre en fonction, il est de tradition que le ministre chargé du budget demande à tous ses collègues de remplir une déclaration spécifique concernant leur situation fiscale et qu’il informe le Président de la République et le Premier ministre en cas de difficulté particulière. Est-il de coutume, de même, que le ministre de l’intérieur communique au Président de la République et au Premier ministre des informations concernant les membres du Gouvernement, par exemple sur leurs éventuelles condamnations passées, par exemple ?
M. le ministre. Non, rien de tel n’est prévu. D’ailleurs, dans le cadre des débats sur la transparence de la vie publique, il n’est pas non plus envisagé de demander au ministre de l’intérieur de fournir des éléments concernant les membres du Gouvernement. Quant à la communication d’informations sur d’éventuelles condamnations passées, elle ne relèverait pas du ministère de l’intérieur.
M. Gérald Darmanin. Vous estimez heureux que votre rôle ne soit pas de relayer les rumeurs sur tel membre du Gouvernement ou tel homme politique. Toutefois, lorsque la crédibilité d’un ministre important ou celle du Gouvernement dans son ensemble est en jeu, ne pensez-vous pas que certaines rumeurs méritent d’être portées, avec toutes les précautions d’usage, à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre ?
M. le ministre. Je ne peux vous répondre que sur des cas précis, pas de manière générale. J’agis sur des faits. Si des faits ou des informations tangibles étaient portés à ma connaissance, je ne manquerais pas de les transmettre aux plus hautes autorités de l’État. Tout ministre, tout parlementaire, tout citoyen ferait, je l’espère, de même.
M. Dominique Baert. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention liminaire, qui hiérarchise clairement les faits et les informations. Vous avez appris par la rumeur – j’imagine quelle a été votre surprise – qu’une note figurait sans doute dans les archives du ministère. Vous avez demandé à la DCRI de vérifier : la recherche concernant M. Cahuzac n’a donné aucun résultat ; celle portant sur la banque UBS a abouti à la découverte des documents que vous nous avez transmis. Avez-vous une idée de l’origine des éléments qui ont fait l’objet de cette rumeur et ont ainsi été portés à la connaissance de tous ?
M. le ministre. Je ne sais pas s’il faut vraiment parler de surprise. La presse indiquait, de manière insistante, qu’il existait une note de la DCRI concernant UBS, et/ou un éventuel compte de M. Cahuzac dans cette banque. Par précaution, le directeur central du renseignement intérieur et moi-même avons souhaité avoir ces éléments. Ce qui nous est remonté, c’est le document que j’ai déclassifié et transmis à votre rapporteur, à sa demande.
M. Dominique Baert. En avez-vous appris davantage sur l’origine de la rumeur ?
M. le ministre. Pas immédiatement, mais peut-être par la suite. La presse avait livré plusieurs éléments, notamment des noms. Nous avons retrouvé ces noms – qui n’ont pas nécessairement de lien avec le monde politique – sur le document que j’ai transmis au rapporteur.
M. Georges Fenech. Notre Commission d’enquête tente de déterminer si les services de l’État sont responsables, voire coupables de dysfonctionnements. Nous souhaitons également établir s’il y a eu des défaillances ou un manque de réactivité au plus haut niveau de l’État – votre ministère étant évidemment concerné. Telle est la question que tout citoyen doit se poser, au-delà même de notre Commission. Ce matin, Mme Taubira a dit ne pas s’être interrogée. On peut s’en étonner : certes, la garde des Sceaux s’interdit d’adresser des instructions individuelles au parquet, mais certaines informations remontent. Pour votre part, vous nous avez expliqué la différence entre la police judiciaire et la police administrative. Mais qu’en est-il des services de renseignement ? Mme Bechtel les a d’ailleurs évoqués.
Si, comme l’a dit M. Fasquelle, un organe de presse convaincu de détenir la vérité n’avait pas fait preuve d’autant d’opiniâtreté, si le procureur de la République de Paris n’avait pas eu l’audace d’ouvrir une enquête, quelle institution aurait pu prendre une initiative ? Tel aurait dû être le rôle de la DCRI. Il ne s’agissait ni de faire de la basse politique ni de se mêler d’une affaire de mœurs, mais de s’informer sur un ministre du Gouvernement sur lequel pesaient des rumeurs persistantes émanant d’un organe de presse sérieux – M. Plenel n’est pas un journaliste né de la dernière pluie ! Or, nous avons l’impression que le Gouvernement est resté totalement inactif.
En outre, j’ai fait connaître très tôt, dans un communiqué, mon sentiment de parlementaire et d’ancien magistrat : j’ai suggéré que M. Cahuzac se retire momentanément de ses fonctions – non qu’il démissionne – en raison du conflit d’intérêt évident entre ses responsabilités en matière de lutte contre la fraude fiscale et sa situation personnelle. On imagine d’ailleurs l’ambiance qui devait régner au sein de son administration !
En somme, la DCRI s’interdit-elle de mener une enquête dès lors qu’elle concerne un homme politique – qu’il soit de la majorité ou de l’opposition – ou le chef d’une grande entreprise ? À quoi sert-elle dès lors, abstraction faite de sa mission de lutte contre le terrorisme ?
M. le ministre. Votre question est intéressante, monsieur le député, mais révèle, avec tout le respect que je vous dois, une profonde méconnaissance du rôle des services de renseignement. Ou alors, elle nous renvoie à une époque désormais révolue.
On peut éventuellement débattre du temps qui s’est écoulé entre les révélations de Mediapart les 4 et 5 décembre et l’éclatement de la vérité. Les déclarations de M. Cahuzac dans l’hémicycle avaient impressionné, tant au sein de l’opposition que de la majorité. Mais ce qui compte, c’est qu’une procédure judiciaire a été engagée le 8 janvier.
Vous employez, monsieur le député, des « si ». Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu Mediapart ? Mais il y a eu Mediapart, et la presse a un rôle important. S’il n’y avait pas eu procédure judiciaire ? Mais il y a eu procédure judiciaire. S’il n’y avait pas eu un procureur courageux ? Mais il y a eu un procureur, qui a fait son travail. Vous auriez pu ajouter : s’il y avait eu des interventions politiques pour entraver la justice ? Mais il n’y en a pas eu. Les procédures ont été pleinement respectées.
Mon rôle est d’assurer la sécurité des Français. Quant à la DCRI, elle a des missions bien précises, qu’elle conduit sous le contrôle des magistrats. Si j’avais moi-même demandé à la DCRI – pourquoi à elle ? Pourquoi pas à la SDIG ? Tout cela n’a pas de sens ! – de mener une enquête sur les révélations parues dans la presse le 5 décembre, cela aurait été une faute majeure.
Telle est peut-être votre conception du rôle de la DCRI, mais ce n’est pas et ne sera jamais la mienne, je puis vous l’assurer. Sa tâche consiste à lutter contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, contre les violences de l’ultra-gauche ou de l’ultra-droite – elle a encore démontré sa compétence ce matin en arrêtant un individu particulièrement dangereux –, non à mettre sur écoute les hommes politiques ou les journalistes.
M. Georges Fenech. Si tel n’est pas votre rôle, pourquoi la Présidence de la République vous a-t-elle demandé de confirmer ou d’infirmer l’existence du compte de M. Cahuzac ?
M. le ministre. Je ne comprends pas très bien votre question. J’ai eu connaissance de certaines informations par la note de la DCRI dont nous avons parlé. Mais la DCRI n’avait pas à mener d’investigations, à plus forte raison à partir de l’ouverture de l’enquête préliminaire le 8 janvier, sauf si le procureur lui avait lui-même confié une partie de cette enquête. J’ai été destinataire des synthèses que j’ai évoquées et j’ai toujours affirmé que je n’avais aucun élément démontrant que M. Cahuzac détenait un compte à l’étranger. Cela étant, la vérité a éclaté.
M. le président Charles de Courson. Nous avons le sentiment qu’il a fallu l’intervention de personnes totalement extérieures aux services de l’État pour révéler certains faits dans cette affaire. Cela soulève une question plus générale, que plusieurs collègues de sensibilités différentes ont d’ailleurs évoquée : à quels services de l’État le Président de la République et le Premier ministre peuvent-ils faire appel avant de nommer quelqu’un au Gouvernement, afin de s’assurer de sa moralité fiscale ou de vérifier qu’il n’est pas un agent des services secrets étrangers ?
M. le ministre. C’est en effet une question plus générale et sans doute légitime. Néanmoins, elle ne s’est pas posée lors de la nomination du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
M. Philippe Houillon. Entre le 4 décembre et le 2 avril, avez-vous rencontré M. Fouks, qui est, je crois, votre ami ?
M. le ministre. Oui, bien sûr.
M. Philippe Houillon. Une bombe est tombée le 4 décembre. Elle était d’une telle puissance que le Gouvernement a présenté le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, qui comporte des modifications substantielles pour tous les élus. Or, nous avons l’impression, après avoir entendu plusieurs ministres, directeurs de cabinet et directeurs d’administration, que personne n’en a jamais parlé. Mme Taubira nous a déclaré ce matin qu’elle avait mieux à faire. C’est la tonalité générale qui ressort de toutes ces auditions. Vous dites également ne pas en avoir parlé.
M. le ministre. Je n’ai pas dit cela.
M. Philippe Houillon. On répond que l’on n’avait pas à diligenter d’enquête ou qu’il ne fallait pas s’immiscer dans la procédure judiciaire. Soit. Mais il ne me paraît guère crédible que l’on n’ait pas évoqué l’affaire à M. Cahuzac, que l’on n’en ait pas parlé entre soi et que l’on ne s’y soit pas plus intéressé que cela. Une affaire de cette nature constitue un problème politique grave pour n’importe quel gouvernement. Et l’on n’en parle pas pendant quatre mois. N’est-ce pas là un dysfonctionnement ? À moins que l’on ne nous dise pas tout ?
M. le ministre. Il y a une confusion : « en parler », en public ou en privé, est une chose ; les actes en sont une autre. Le 8 janvier, cinq semaines après les révélations de Mediapart, une enquête préliminaire a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Elle a été confiée à la division nationale d’investigations financières et fiscales de la direction centrale de la police judiciaire, qui est placée sous ma responsabilité mais agit, en l’espèce, sous l’autorité du procureur de la République de Paris. Tel est le fait principal. Nous avons respecté les règles.
Il ne me revient pas de vous livrer mes sentiments, ni de participer à un débat général ou à caractère politique. Je pourrais vous répondre, monsieur le député, que ni le Gouvernement ni M. Cahuzac n’ont été débordés de questions par la majorité – on peut le comprendre – ou par l’opposition pendant cette période. En parliez-vous, monsieur le député ? Avez-vous interrogé M. Cahuzac lors des séances de questions au Gouvernement au cours de ces quatre mois ? Non. Pourquoi ? Je ne veux pas le savoir.
M. Philippe Houillon. Une question a bien été posée.
M. le ministre. En effet, le 5 décembre.
Dès lors que l’enquête préliminaire a été ouverte, chacun – moi le premier – se devait de respecter la procédure judiciaire. Elle a été menée de manière claire et indépendante. Les directeurs placés sous ma responsabilité vous ont fourni des explications, notamment sur l’expertise de l’enregistrement. Quand certains éléments ont amené le procureur à ouvrir une information judiciaire, le 19 mars, M. Cahuzac a quitté le Gouvernement. Il ne s’agit pas de parler de l’affaire, mais de rappeler les faits.
Je m’honore d’appartenir à un Gouvernement qui, sous l’autorité du Président de la République et du Premier ministre, a eu cette attitude.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Compte tenu de la conception que vous avez de votre rôle, de votre éthique, avez-vous dit, vous n’avez pas déclenché d’enquête, alors même que nous avons appris un événement important le 4 décembre 2012, confirmé le 15 décembre à M. Zabulon à l’Élysée. Vous êtes une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale. Avez-vous envisagé de faire une note sur la nécessité ou l’obligation, pour tel ou tel agent de l’administration, de saisir l’autorité judiciaire des faits divulgués ? M. Bézard, directeur général des finances publiques, a parlé de « rigueur ». Or, l’administration fiscale ne savait rien, n’a rien vu, n’a rien fait. Le ministère de l’intérieur aurait-il pu utiliser l’article 40 du code de procédure pénale ?
M. le ministre. Non, et encore moins à partir du 8 janvier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Votre réponse m’interpelle. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée est tenue de dénoncer un délit, dès qu’elle en a connaissance. Je ne comprends pas que vos services ne vous aient pas incité à utiliser cet article.
M. le ministre. Sur quelle base, madame la députée ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Sur la base des révélations de Mediapart le 4 et le 5 décembre, qui étaient suffisamment fondées.
M. le ministre. À quel titre, en ce qui me concerne ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Ministre de l’intérieur.
M. le ministre. À quel titre, comme ministre de l’intérieur ? Du simple fait que je peux utiliser l’article 40 ? En invoquant quel fait, madame la députée ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Les révélations du 4 et du 5 décembre. Les Français ne comprennent pas : ces éléments précis mettaient en cause non pas un citoyen lambda, mais le ministre délégué chargé du budget, lui-même responsable de la lutte contre la fraude fiscale. Entre le 4 décembre et l’ouverture de l’enquête préliminaire le 8 janvier, aucune administration ni aucun des ministères concernés – en particulier pas le vôtre – n’a fait quoi que ce soit. Cela vous semble-t-il cohérent et logique ?
M. le ministre. Lorsque je détiens des éléments tangibles, je peux être amené à les transmettre à la justice. Je lui ai ainsi remis, le mois dernier, le rapport d’inspection sur l’usage des frais d’enquêtes par les cabinets ministériels, que j’avais moi-même demandé il y a quelques mois à la suite de révélations parues dans la presse.
S’agissant de l’affaire Cahuzac, dès que la presse a fait état d’une note relative à UBS et, peut-être, à un compte de M. Cahuzac en Suisse ou à l’étranger, le directeur central du renseignement intérieur et moi-même avons demandé une recherche. Or, le document trouvé, qui m’a été transmis le 19 décembre et que vous connaissez, mentionne non pas le nom de M. Cahuzac, mais d’autres noms, sans que sa crédibilité soit d’ailleurs avérée.
Du reste, si la DCRI avait été en mesure de me transmettre d’autres éléments, cela signifierait que mes prédécesseurs auraient également pu en avoir connaissance.
J’éprouve quelques difficultés à suivre votre raisonnement, madame la députée. J’ai agi avec méthode, dans le respect des règles. Je suis convaincu que mes collègues du Gouvernement ont fait de même. Vous pouvez, certes, avoir un avis différent ou une autre conception des règles, c’est votre droit.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez dit, d’une part, que les ministères n’avaient pas à aller au-delà de ce qu’ils ont fait et que, d’autre part, la justice a fait son travail et que la vérité a éclaté. Or, ce sont les aveux de M. Cahuzac lui-même et non un quelconque autre moyen qui nous ont permis de connaître cette vérité.
M. le président Charles de Courson. Non, ma chère collègue. Le procureur de la République de Paris nous a expliqué qu’il avait obtenu une réponse des autorités suisses dans le cadre de la coopération judiciaire et qu’il détenait les preuves de l’existence du compte. En outre, le degré de concordance entre la voix de l’enregistrement et celle de M. Cahuzac avait été évalué à « + 2 » sur une échelle allant de « - 2 » à « + 4 » : il était donc très probable que ce soit bien la sienne.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous allons voter, dans l’urgence, une loi relative à la transparence de la vie publique, que l’on pourrait appeler « loi Cahuzac ». D’autre part, nous avons le sentiment qu’une loi du silence a été imposée. Lorsque vous avez nourri des doutes sur l’usage des frais de cabinets sous un précédent gouvernement, vous avez diligenté une enquête. Pourquoi n’avez-vous pas, de même, en parallèle de l’enquête préliminaire, cherché à en savoir plus en saisissant la DCRI, compte tenu des éléments concordants publiés dans la presse ?
M. le ministre. J’ai évoqué les frais d’enquête parce qu’ils concernaient mon administration. Le ministère de l’intérieur n’était pas concerné par l’affaire Cahuzac. Il l’est depuis le 8 janvier dans la mesure où l’enquête est menée par une division de la direction centrale de la police judiciaire, sous l’autorité du Procureur.
Dans notre pays, c’est heureux, les procureurs font appel à la police judiciaire, et les policiers, dont l’engagement est tout à fait remarquable, respectent le travail des procureurs. Un lien de confiance s’établit entre eux. Si j’avais demandé à la DCRI ou à un autre service de mener une enquête parallèle et que le procureur de la République de Paris – qui traite d’autres affaires, notamment de terrorisme, avec la DCRI – l’avait appris, alors on casse tout lien de confiance. C’est d’ailleurs arrivé, dans le passé. Il convient au contraire que le parquet et la police judiciaire travaillent ensemble dans les meilleures conditions de confiance. Il en va des intérêts fondamentaux du pays et de nos concitoyens. Je ne peux pas vous suivre dans votre raisonnement, madame la députée. Nous emprunterions une voie très dangereuse. Je vous invite à rencontrer les professionnels concernés : ils vous feront part de la manière dont ils conçoivent leur mission.
M. Daniel Fasquelle. Vous avez reconnu avoir évoqué l’affaire Cahuzac au cours de rencontres avec le Président de la République et le Premier ministre. Quand ces rencontres ont-elles eu lieu ? Est-ce dès le mois de décembre ?
M. le ministre. J’ai informé le Président de la République et le Premier ministre des éléments importants, tels que la note de la DCRI du 19 décembre.
M. Daniel Fasquelle. Vous les avez informés, mais les avez-vous rencontrés en décembre ?
M. le ministre. Le 19 décembre, c’est le mois de décembre.
M. Daniel Fasquelle. Ne les avez-vous pas rencontrés ou eu des échanges avec eux avant cette date ?
M. le ministre. Compte tenu des rumeurs évoquées précédemment, qui ont circulé rapidement au cours du mois de décembre, j’ai indiqué au Président de la République et au Premier ministre que je demanderais des éléments à la DCRI. Dès que j’ai obtenu ces éléments, je les leur ai transmis.
M. Daniel Fasquelle. Vous avez donc évoqué ce sujet avec eux avant le 19 décembre ?
M. le ministre. En effet, pour les informer que j’allais demander ces éléments à la DCRI.
M. Daniel Fasquelle. Avez-vous été informé du contact entre M. Gonelle et le directeur de cabinet adjoint du Président de la République le 15 décembre ?
M. le ministre. Non.
M. Daniel Fasquelle. Il est assez étrange que vous ayez eu des échanges et des réunions avec le Président de la République et le Premier ministre et qu’on ne vous ait pas informé du contact avec M. Gonelle. Vous êtes pourtant un pilier du Gouvernement. Cela confirme qu’il s’en est fallu de peu que le mensonge ne l’emporte, comme l’a dit M. Plenel. On ne peut que s’étonner de l’inaction du Gouvernement et de la mauvaise circulation de l’information en son sein sur un sujet aussi important.
M. le ministre. Je ne réagirai pas à votre commentaire, monsieur le député. Je souhaite que nous restions dans le cadre de la Commission d’enquête.
M. le président Charles de Courson. Vous avez évoqué la liste des informations synthétiques transmises par la division nationale d’investigations financières et fiscales à votre cabinet. Pourriez-vous nous en adresser la liste, comme la garde des Sceaux l’a fait ?
M. le ministre. Bien sûr, je le ferai.
M. le président Charles de Courson. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Auditions du mardi 16 juillet 2013
À 18 heures 15 : M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous achevons cette série d’auditions par celle du ministre de l’économie et des finances, M. Pierre Moscovici. Nous aurons ainsi reçu les trois ministres dont les administrations ont été directement concernées par la gestion de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ».
Vous avez déjà eu l’occasion monsieur le ministre, de vous exprimer devant la commission des finances de notre assemblée le 17 avril dernier. Depuis lors, la commission d’enquête a été constituée et elle a procédé à de nombreuses auditions, dont celles des membres des cabinets ministériels, du directeur général des finances publiques, du chef du service du contrôle fiscal et du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Nous avons donc de nouvelles questions à vous soumettre ; plus particulièrement, nous souhaiterions connaître les initiatives que vous-même ou votre cabinet avez prises en lien avec cette affaire.
Avant d’aller plus loin, il me revient de vous préciser que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever, Monsieur le ministre, de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »
(M. Pierre Moscovici prête serment.)
M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances. Je voudrais, pour commencer, indiquer dans quel état d’esprit j’aborde cette audition.
J’ai déjà eu moi-même, en d’autres temps, l’occasion de présider à ce type de travaux, c’était en 2007. Il s’agissait à l’époque de déterminer les conditions de libération des infirmières bulgares détenues en Libye par le colonel Kadhafi. Je considère qu’évidemment, c’est un très bon format pour faire la lumière sur un certain nombre d’événements et je viens devant vous tout simplement pour y contribuer.
La dernière fois que je me suis exprimé sur l’action de mes services dans la gestion de l’affaire Cahuzac, c’était le 17 avril dernier devant les membres de la commission des finances de cette Assemblée et, pour tout vous dire, je n’avais pas eu tout à fait le sentiment, lors de cette audition, de participer à un pur exercice de recherche de la vérité. Il en sera différemment aujourd’hui. Bien sûr, j’ai dit ce jour-là ce que j’avais fait, ce que je savais. Je vais le redire mais l’atmosphère était à la mise en cause plus qu’à l’échange de questions et de réponses, d’interrogations et d’informations.
Nous ne sommes plus le 17 avril. Il y a presque trois mois jour pour jour qui se sont écoulés entre-temps. Les présidents des commissions des finances sont venus procéder à des investigations dans les locaux de Bercy. Philippe Marini, le président de la commission des finances du Sénat, a même demandé accès – ce qui est une chose inédite dans l’histoire de cette administration – aux mails internes échangés entre mon cabinet et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ou même entre collaborateurs de la DGFiP. Les présidents ont rendu public le résultat de leurs investigations et, de son côté, votre commission a procédé à de très nombreuses auditions, recueilli des témoignages, recoupé les faits et peut-être même commencé à former ses propres conclusions.
Nous ne sommes plus le 17 avril et je m’en réjouis parce que je crois que nous pouvons avoir aujourd’hui des objectifs, des échanges plus objectifs parce que vous avez travaillé dans la sérénité, la transparence. Et, de surcroît, rien de ce que j’ai dit ce jour-là n’a été infirmé d’une quelconque manière par les auditions que vous avez menées depuis.
Je vais être plus précis.
Quatre reproches m’ont été adressés au lendemain des aveux de l’ancien ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac, je ne veux en éviter aucun. Ces quatre reproches sont la complicité, la duplicité, l’incompétence et la manipulation. Aucun ne tient aujourd’hui. Je vais revenir devant chacun d’eux et, ce faisant, je veux vous montrer ce qu’a vraiment été l’action que j’ai conduite avec le concours de l’administration fiscale. Et je veux dire la chose suivante pour commencer : nous avons fait tout ce qui était en notre devoir et en notre pouvoir dans cette affaire qui a tant choqué les Français.
Alors on m’a d’abord dit : « Vous saviez. » Sous-entendu, « vous saviez dès le début que Jérôme Cahuzac avait un compte non déclaré en Suisse ». C’est le premier reproche, le reproche de la complicité. Une accusation qui a ceci de commode qu’elle est en phase avec ce cliché qu’il faut éviter dans cette Assemblée, bien ancré du « tous pourris » qui entache trop souvent notre vie politique. Et pourtant – j’ai bien lu tous les travaux qui ont été faits ici –, il résulte clairement de ces travaux qu’aucune interpellation, aucune alerte n’est remontée jusqu’à moi sur ce sujet avant le premier article de Médiapart le 4 décembre 2012. Personne n’a trouvé le moindre embryon de preuve ou même d’indice que je savais quoi que ce soit de ce compte non déclaré en Suisse avant les aveux de Jérôme Cahuzac. Et pour cause, j’ai découvert le 2 avril comme vous tous, de sa bouche même, lorsqu’il a rompu avec son mensonge que c’était le cas.
Je le redis avec force et avec netteté, je n’ai à aucun moment été saisi d’éléments qui auraient dû me conduire à agir autrement que je ne l’ai fait. Toutes les informations que j’avais à ma disposition plaidaient, au contraire, en faveur de mon approche. Cette approche – je vais vous la résumer –, je l’ai appelée le doute méthodique.
Elle résultait de deux éléments : d’abord, de la confiance que j’avais placée en un homme qui était président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui s’est exprimé ici, dans cette enceinte, avec force, dont vous avez tous cru la parole et avec qui, pour ma part, je travaillais au redressement des comptes publics. C’était le premier élément. Mais le deuxième, c’était le devoir qui était le mien, comme ministre de l’économie et des finances, de tout faire pour contribuer à établir la vérité et donc d’être irréprochable. Ce doute méthodique, à tout moment, il a été ma boussole entre le 4 décembre et le 2 avril.
On m’a ensuite accusé d’en avoir trop fait et d’ailleurs mal fait de façon volontaire, d’avoir tenté en somme d’utiliser les procédures existantes pour couvrir – je mets les guillemets – le ministre délégué et même d’avoir abusé de ma fonction pour entraver le bon déroulement de la justice. C’est le deuxième reproche, c’est le reproche de la duplicité.
Je ne reviens pas sur les accusations d’un magazine, Valeurs actuelles, selon lequel j’aurais fomenté une opération spéciale en Suisse. Ces accusations-là sont, au mieux, sorties d’un film de James Bond, pas le meilleur, et au pire, d’un épisode des « Pieds nickelés ». J’ai porté plainte en diffamation contre ces allégations absurdes et indignes.
Les présidents des commissions des finances, qui ont immédiatement – ils ont fait preuve de beaucoup de diligence – procédé à une vérification sur pièce et sur place, ont eux-mêmes reconnu que ce scénario était – je les cite – « peu probable ». Moi, je vais avoir un autre mot un peu plus clair, c’est du pur délire. Balayons ça.
Mais je voudrais relever ici un certain nombre de points qui méritent davantage discussion.
D’abord, les témoignages d’Amélie Verdier, directrice de cabinet du ministre délégué chargé du budget, et de mon propre directeur de cabinet, Rémy Rioux, notamment ont permis d’établir un point sur lequel nous reviendrons si vous le souhaitez, à savoir que la « muraille de Chine » mise en place dès le 10 décembre a parfaitement fonctionné.
Bruno Bézard, le directeur général des finances publiques, a par ailleurs clairement indiqué devant cette commission, dans une audition particulièrement convaincante, comment et pourquoi il était possible et même logique – c’est un point très important – de combiner procédure administrative et procédure judiciaire. Tout d’abord, aucun texte ne l’interdit. Ça a été établi de la manière la plus nette. Le directeur général des finances publiques a confirmé qu’il était légal et approprié d’adresser une demande de coopération administrative alors que la justice est saisie. Ça permet à l’administration fiscale de poursuivre son travail pendant une enquête préliminaire. Et sur ce point, je vous renvoie aux explications fournies par Alexandre Gardette sur un principe important qui est le principe de spécialité de la convention d’échange d’informations judiciaires entre la France et la Suisse et sur la voie à suivre pour que l’administration fiscale puisse faire valoir ces informations dans le cadre d’une procédure fiscale. Voilà les deux procédures en parallèle.
Il ne s’agissait donc en rien de parasiter, d’influence ou de court-circuiter le travail de la justice auquel je veux rendre hommage parce qu’elle a travaillé dans la plus parfaite indépendance et avec beaucoup d’efficacité.
Imaginez a contrario que je n’aie pas fait usage de cet outil d’entraide qui était à notre disposition, qui existe dans notre arsenal juridique, que dirait-on aujourd’hui, que diriez-vous aujourd’hui ? On ne manquerait pas de me dire que j’ai paralysé le déroulement normal de la procédure fiscale. On me reprocherait d’être resté inerte, d’avoir refusé d’utiliser les instruments qui étaient à la disposition de l’administration fiscale. Eh bien je vais vous dire, mesdames et messieurs les députés, si c’était le cas, vous auriez raison. Je préfère avoir agi comme je l’ai fait.
La justice n’a pas été empêchée ni ralentie par notre action. Au contraire. Et ce n’est pas un jugement de valeur que j’exprime mais un constat étayé par des faits. D’abord – et c’est très important aussi –, le texte de la réponse suisse a été transmis immédiatement à ma demande à la justice tout comme nous avons immédiatement transmis à la justice, sur réquisition de sa part – n’oublions pas que l’administration fiscale travaille sur réquisition –, l’ensemble du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, non pas sur un an ou sur cinq ans mais sur une période de vingt ans tout simplement.
D’aucuns ont cru devoir affirmer que, selon la convention franco-suisse, la DGFiP n’aurait pas dû transmettre à la justice la réponse aux autorités suisses. C’est non seulement inexacte en droit puisque la convention le prévoit, mais encore une fois, pas plus le directeur général des finances publiques que moi-même n’avons douté un seul instant qu’il était de notre devoir de le faire. Et imaginez que nous ayons conservé ces informations par devers nous. Là encore, nous serions hautement reprochables.
Arrêtons-nous enfin un instant sur la chronologie de la mise en examen de l’ancien ministre du budget. Le 8 janvier, le parquet ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. À peine plus de deux mois plus tard, le 18 mars, la justice ouvre une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Ce sont des délais extraordinairement brefs, je le redis à nouveau. Qui peut sérieusement prétendre que nous avons cherché à entraver le travail de la justice alors que nous lui avons transmis tous les éléments du dossier qui étaient à notre disposition sans le moindre délai et quand l’enquête a connu une issue aussi rapide ?
Troisième accusation – qui est d’ailleurs en parfaite contradiction avec la précédente même si ce sont parfois les mêmes qui expriment les deux –, j’aurais, au contraire, fait preuve d’une coupable négligence, je n’en aurais pas fait assez pour faire éclater la vérité. C’est le reproche de l’incompétence. Je vous dis ici ce que j’ai dit à de nombreuses reprises, notamment devant la commission des finances de votre Assemblée le 17 avril, les questions que nous avons posées aux autorités suisses, sur la base des informations dont nous disposons à cette date, étaient – je pèse mes mots – les plus larges possible aussi bien dans leur objet que dans l’espace et dans le temps.
On m’a interrogé à de nombreuses reprises sur les contours de cette demande. Vous le referez peut-être. Le directeur général des finances publiques, lui, vous a apporté toutes les réponses donc je veux simplement les confirmer.
Première question : pourquoi UBS seulement ? Parce que, comme l’établissent vos travaux, c’était le seul et unique sujet en cause au moment de la demande d’assistance. Jamais – je dis bien jamais – un compte dans une autre banque – chaque mot a son importance – n’a été mentionné avant l’envoi de la demande d’assistance le 24 janvier. Les présidents des commissions de finances ont cru pouvoir affirmer que l’échange de lettres de 2010 entre administrations fiscales aurait permis que la demande d’entraide porte sur l’ensemble des établissements bancaires domicilié en Suisse. Ce n’est ni ma lecture ou plutôt ni celle de celle de l’administration ni celle des autorités helvétiques.
Je veux faire ici d’ailleurs une incise sur le cadre juridique de cette demande. Je veux vous informer que nous avons signé jeudi dernier, avec la chef du département fédéral des finances de la Confédération helvétique, Mme Éveline Widmer-Schlumpf, une convention fiscale franco-suisse sur les successions. Et quel sera l’effet de cette convention ? Dès sa ratification, comme c’est précisé dans une déclaration commune, elle mettra fin à l’échange de lettres du 11 février 2010 qui restreignait – c’est très clair – la portée des échanges d’informations sur la détention de compte bancaire dont vous avez largement débattu.
Le dispositif actuel donc qui s’appliquait le 24 janvier permet aux Suisses d’ignorer nos demandes pour identifier la banque détentrice en Suisse de l’information et cette restriction-là ne devrait plus être possible à l’avenir après la ratification de la nouvelle convention.
Je tenais à vous en informer pour vous prouver que le Gouvernement s’emploie résolument à combattre la fraude fiscale aussi bien en Europe, au G8, au G20 que dans ses relations bilatérales avec la Suisse.
Deuxième question, Singapour. Pourquoi Singapour n’a-t-il pas fait l’objet d’une demande similaire ? Là, Alexandre Gardette vous a également détaillé les raisons pour lesquelles il en allait ainsi. Je rappelle que l’unique allégation jamais contredite – je dis bien pas une fois – entre le 4 décembre et l’ouverture de l’information judiciaire, était que le compte de Jérôme Cahuzac avait été transféré d’UBS en 2010 vers Singapour. Là aussi, chaque étape compte parce que c’est un processus dont il est question. Toutes les pièces sont donc imbriquées. Il ne s’agissait pas de n’importe quel compte ouvert dans n’importe quelle banque suisse puis transféré dans une banque quelconque de Singapour mais d’un compte précis dans une banque précise – l’UBS – dont nous voulions en quelque sorte suivre la traçabilité. Comment a-t-il été véhiculé en quelque sorte ? Or, nous avons interrogé la Suisse, sur tout transfert d’un compte d’UBS – encore une fois, c’est la seule banque qui était nommée – vers tout pays pendant sept années entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. Donc nous remontons bien en deçà et bien au-delà de 2010. Et à nos questions larges et explicites sur l’éventualité d’un transfert de compte à l’étranger, la réponse des autorités suisses a été clairement sans ambiguïté négative et donc nous n’avions aucun élément pour aller plus loin.
Cette réponse négative interrompt en quelque sorte la traçabilité. Si néanmoins nous l’avions tenté – et ça a pu être envisagé –, après cette réponse négative des autorités suisses, alors qu’une enquête judiciaire est en cours, nous aurions pour le coup été accusés – et, à mon sens, à juste titre – de mener une enquête parallèle à partir d’un raisonnement spéculatif et non d’informations précises. C’eût été contraire à ma volonté absolue de respecter l’indépendance de la justice. Je vous renvoie donc aux propos tenus devant vous par les experts en la matière.
Bruno Bézard l’a dit sans ambiguïté aucune et je le cite : « Il n’est pas de demande d’assistance administrative plus large que celle-là, ça n’existe pas. » Et bien que la simple lecture des statistiques montre à quel point le bilan de notre relation administrative avec la Suisse est peu satisfaisant, c’est dans un délai sans précédent de sept jours que nous avons obtenu la réponse à notre demande. Je rappelle que nous nous sommes donné toutes les chances pour faire aboutir cette demande puisque j’ai appelé moi-même mon homologue suisse, Mme Éveline Widmer-Schlumpf – j’étais à Bruxelles –, le 21 janvier, que je l’ai vue ensuite – c’était prévu – et que j’ai insisté fortement auprès d’elle lors d’une rencontre à Davos le 25 janvier pour avoir au plus vite une réponse quelle qu’elle soit et ça a été fait dans des délais sans aucun précédent puisque nous avons eu une réponse dès le 31 janvier. Donc un délai extraordinairement court.
Je vous redonne les derniers chiffres qui n’ont guère évolué depuis mon audition devant la commission des finances : au 30 juin 2013, sur les seules demandes bancaires, 430 demandes ont été adressées à la Suisse, trente ont reçu une réponse, seules sept sont jugées satisfaisantes. Les délais de réponse sont longs – vous le savez – puisqu’ils durent en moyenne plus de six mois et que pour plus d’une cinquantaine de demandes, il n’y a toujours pas de réponse plus d’un an après qu’elles ont été posées.
Donc vous avez à la fois la demande la plus large qui puisse être et la réponse la plus rapide qui puisse se faire.
Dernier reproche qui m’a été adressé enfin, c’est celui d’avoir dupé mon administration et l’opinion publique. C’est le reproche de la manipulation. Mon directeur de cabinet, Rémy Rioux, vous a dit ce qu’il en était, je le cite aussi : « Tout au long de cette procédure, nous avons suivi les analyses de nos services sans jamais chercher à les manipuler. » Ni lui ni moi, ni aucun de mes collaborateurs n’ont contribué à la rédaction de la demande d’entraide adressée à la Suisse.
Comme Bruno Bézard vous l’a expliqué, c’est lui-même, avec ses services, qui y a procédé. Et le directeur général des finances publiques vous a dit avec la plus grande force lors de son audition qu’il avait précisément veillé à ce qu’on ne puisse jamais accuser la direction générale d’avoir été instrumentalisée par le pouvoir politique. Je peux vous confirmer, pour avoir souhaité la nomination de Bruno Bézard et pour travailler avec lui depuis un an que c’est sa personnalité, que c’est son éthique et que c’est aussi la mienne.
Par ailleurs, vous avez sans doute remarqué – j’ai vu cette audition, c’est la seule que j’ai vue, voyez-vous – que Bruno Bézard, qui a géré en première ligne la réponse de l’administration, n’était pas frêle, docile ou influençable. Le scénario de la manipulation perd toute crédibilité dans ce contexte, me semble-t-il. Tout cela a été détaillé sous serment ici même. Je ne m’y étends donc pas plus.
En vérité – et je m’achemine vers la fin de mon propos –, tout au long de cette procédure, nous avons respecté un principe simple, laisser l’administration fiscale agir, dérouler ses procédures, coopérer pleinement avec la police judiciaire. Et dans cette affaire, ce fut ma règle de conduite, faire tout ce que je devais, tout ce que je pouvais pour concourir à l’apparition de la vérité mais en respectant scrupuleusement à la fois les procédures et le rôle de mon administration.
Je n’hésite pas à redire ici que cette administration a agi sous mon autorité avec probité, efficacité. Bref, de façon exemplaire.
Vous allez me demander : pourquoi n’a-t-elle pas retrouvé la trace du compte de Jérôme Cahuzac à l’étranger, le compte qu’il a finalement reconnu avoir détenu ? C’est à la fois parce que le mensonge fut d’une exceptionnelle ampleur et parce que l’information dont nous sommes partis pour étayer notre demande était non pas inexacte mais incomplète.
Imaginez un instant qu’ait été simplement indiqué avant la demande que Jérôme Cahuzac aurait pu avoir un compte non pas à l’UBS seulement, mais à l’UBS et dans un autre établissement nominativement cité, nous aurions alors évidemment interrogé les autorités suisses sur ces deux hypothèses. La réponse aurait été différente, la vérité aurait éclaté dès la fin janvier grâce à notre action. Hélas, nous ne pouvions pas le faire.
C’est pourquoi, mesdames et messieurs les députés – je sors un peu du cadre de la commission d’enquête –, il est tellement nécessaire de passer à l’échange automatique d’informations. C’est pourquoi il fallait lever les restrictions à l’échange sur demande comme nous l’avons fait avec la Suisse dans la convention sur les successions. C’est un autre débat qui concerne les leçons à tirer de cette affaire non pas en termes de dysfonctionnement de l’administration – c’est ce que vous cherchez dans cette commission d’enquête –, il n’y a pas eu de dysfonctionnement de l’administration, mais en matière d’amélioration des procédures internationales. Et là, cette amélioration est indispensable.
Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments que je voulais partager avec vous aujourd’hui avant de répondre à vos questions. En fait, je n’ai presque plus parlé de l’affaire Cahuzac depuis le 17 avril après m’être longuement expliqué devant la commission des finances et on m’a peu questionné sur le sujet depuis pour une raison très simple qui est que, déjà ce jour-là, je vous ai dit l’essentiel avec précision. Eh bien aujourd’hui, je veux le faire sous serment avec encore plus de rigueur.
Monsieur le président, je m’adresse à vous. Vous avez déclaré dans une interview, c’était le 5 avril, alors que vous n’étiez pas encore à la tête de cette commission d’enquête : « Pierre Moscovici a trompé le peuple français. » Je ne sais pas si vous avez mesuré la portée de cette affirmation à ce moment-là. Je veux croire que vous avez été mal cité. Ça arrive. Mais comprenez une chose – je veux le dire maintenant pour ne pas le répéter –, c’est que la violence de cette mise en cause m’a surpris et même blessé. Une telle assertion quand on est comme moi un homme politique qui sert son pays depuis longtemps et dans des responsabilités significatives, qui tient à son nom – et j’y tiens –, à son honneur – et j’y tiens –, à sa réputation – et j’y tiens –, un homme comme ça ne peut pas laisser passer cette assertion.
J’ai la conviction que vous ne pourriez plus, aujourd’hui, la prononcer. Trois mois plus tard, après votre travail de la commission qui, encore une fois, est de très grande qualité, que reste-t-il de cette assertion ? Et, plus généralement, que reste-t-il des quatre reproches qui m’ont été faits ? C’est le sens de mon introduction là et je vous réponds : rien. Au contraire, il est clairement apparu que l’administration fiscale, sous mon autorité – c’est le sens de la « muraille de Chine » – a fait de bout en bout un travail remarquable, en tout point irréprochable.
Et je vais vous dire – c’est mon dernier mot – que je suis très fier d’avoir cette administration aujourd’hui comme ministre de l’économie et des finances sous ma responsabilité, comme les Français qui nous regardent peuvent être très fiers de la qualité exceptionnelle de cette administration à laquelle je veux rendre hommage.
Ceci étant dit, je suis maintenant totalement à votre disposition, bien sûr.
M. Alain Claeys, rapporteur. Bien que cela dépasse les bornes temporelles du champ d’investigation de la Commission d’enquête, je crois nécessaire de revenir sur ce qui s’est passé entre 2001 et 2012, car certaines initiatives concernent, directement ou indirectement, votre administration : ainsi, l’étude du dossier fiscal de M. Cahuzac au sein de la brigade d’intervention interrégionale (BII) de Bordeaux ou le mémoire que M. Garnier a transmis à vos services.
Quand vous avez découvert, le 4 décembre 2012, les révélations de Mediapart sur les avoirs détenus par M. Jérôme Cahuzac à l’étranger, avez-vous interrogé l’administration fiscale pour savoir si elle détenait des informations sur l’existence d’un tel compte ? Avez-vous effectué une démarche similaire auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects ?
M. le ministre. Pour vous répondre, il me faut rappeler la chronologie des faits à compter de la mise en cause de M. Jérôme Cahuzac par Mediapart.
Le 4 décembre, Mediapart révèle que M. Cahuzac aurait détenu un compte à l’étranger. Le directeur général des finances publiques, M. Bruno Bézard, et M. Jérôme Cahuzac évoquent alors la possibilité de mettre en place la « muraille de Chine », qui séparerait l’exercice par M. Cahuzac de ses fonctions ministérielles, de sa défense personnelle, prise en charge par ses avocats. M. Bézard informe la directrice de cabinet de M. Cahuzac, Mme Amélie Verdier, et mon directeur de cabinet, M. Rémy Rioux, de leur volonté de mettre en place cette « muraille de Chine ». Une instruction est rédigée à cet effet le 7 décembre et, à partir du 10 décembre, en liaison directe avec le directeur général des finances publiques, je reprends la main sur le dossier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Par suite de la directive signée par M. Cahuzac ?
M. le ministre. Oui.
À partir de ce moment-là, j’ai des échanges très fréquents avec M. Bruno Bézard, et je lui demande de m’informer de tous les éléments pouvant être en sa possession. S’agissant de M. Gonelle comme de M. Garnier, à aucun moment des informations particulières ne m’ont été transmises.
Après coup, s’agissant de M. Gonelle, des rumeurs ont couru selon lesquelles un haut fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects aurait identifié le dossier dès 2008, mais l’administration interrogée ne les a pas confirmées et aucune information en ce sens n’a été retrouvée. Je précise que la direction générale des douanes et des droits indirects a elle aussi agi sur réquisition dans le cadre de cette affaire.
Quant au mémoire de M. Rémy Garnier, la DGFiP a considéré qu’il s’agissait d’allégations non documentées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand prenez-vous connaissance de ce mémoire ?
M. le ministre. Jamais vraiment : la question est traitée par l’administration fiscale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez jamais eu entre les mains la page où M. Jérôme Cahuzac est mis en cause ?
M. le ministre. Jamais, jamais, jamais.
M. le président Charles de Courson. Monsieur le ministre, vous nous dites que l’administration fiscale a été exemplaire, mais nous avons investigué ! Et qu’avons-nous découvert ?
D’abord, que dès 2001, la brigade d’intervention interrégionale (BII) de Bordeaux avait été saisie, via une connaissance commune de M. Gonelle et de l’inspecteur des impôts Mangier ; que M. Mangier avait demandé aux services fiscaux de Paris de lui transmettre le dossier de M. Cahuzac et que celui-ci était resté à Bordeaux de 2001 à 2007, sans que jamais M. Mangier ne fasse état auprès de sa hiérarchie, ni de cette information, ni de son origine ; votre propre directeur général ne savait même pas ce qui s’était passé lorsque nous l’avons auditionné. Premier dysfonctionnement ! Quand l’apprenez-vous ?
En outre, en juin 2008, l’inspecteur Garnier, en contentieux avec son administration, a rédigé un mémoire qui a été transmis à votre direction – nous pouvons même vous dire à quel bureau. Second dysfonctionnement ! Quand l’apprenez-vous ?
Enfin, M. Cahuzac a rencontré M. Garnier en octobre 2012, dans sa circonscription, à Villeneuve-sur-Lot. Pour préparer cette rencontre, sa directrice de cabinet a rédigé une note – que nous avons. L’administration fiscale ne l’a même pas informée que le ministre allait rencontrer un inspecteur des impôts qui l’accuse d’avoir un compte en Suisse !
Ce serait là une administration « exemplaire » ? Pourriez-vous nous expliquer en quoi elle l’a été sur ces trois faits ?
M. le ministre. Monsieur le président, permettez-moi de rappeler le titre de votre commission d’enquête : « Commission d’enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement ». Ce que vous évoquez là…
M. le président Charles de Courson. Mais ces faits concernent toujours votre administration, même après le 4 décembre !
M. le ministre. Monsieur le président, si vous m’interrompez sans arrêt, comment puis-je vous répondre ?
M. le président Charles de Courson. Monsieur le ministre, jusqu’à preuve du contraire, c’est moi qui mène les débats.
M. le ministre. Tout ça est très intéressant mais je voudrais quand même rappeler une chose, c’est l’objet même de votre commission d’enquête. Je le cite in extenso : « commission d’enquête parlementaire relative aux éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement. »
Je suis ici pour témoigner de quoi devant vous ? De ce qu’a été mon action et celle de mon administration entre le 4 décembre 2012 – je le précise – et le 2 avril 2013. Ce qui est le cadre de votre commission d’enquête. Je suis ministre de l’économie et des finances depuis un peu plus d’un an maintenant, n’est-ce pas ? Et vous évoquez des faits ou des allégations qui, elles-mêmes, sont extraordinairement anciennes.
Ce que je vous dis, c’est que dans le cadre de cette affaire-là, à partir du 4 décembre 2012, sous mon autorité, l’administration fiscale a fait très exactement ce qu’elle devait faire et que, par ailleurs, là, vous évoquez des débats, des circuits internes à cette administration. C’est au directeur général des finances publiques, j’imagine, que vous avez posé ces questions, et qu’il vous a donné toutes les réponses nécessaires.
M. le président Charles de Courson. Oui, et il nous a fait la même réponse que vous : l’administration a été exemplaire. Pourtant, nous avons découvert qu’il y avait eu de graves dysfonctionnements des services dont vous êtes responsable.
M. le ministre. Mais à quel moment, monsieur le président ?
M. le président Charles de Courson. À l’époque qui nous concerne, le contentieux devant le tribunal administratif est toujours en cours, et il intéresse votre administration, au niveau central. Nous en avons la preuve !
M. le ministre. Lors de ma précédente audition, j’avais évoqué les dangers de « l’uchronie », c’est-à-dire de la réécriture de l’histoire en partant de ce que l’on sait a posteriori ; j’aimerais ne pas avoir à me répéter…
M. le président Charles de Courson. Alors, répondez avec précision aux questions du rapporteur !
M. le ministre. J’essaie de le faire, mais vous m’interrompez continuellement !
M. le président Charles de Courson. Ce qui est mon droit, du fait de ma qualité de président ! Monsieur le rapporteur, poursuivez.
M. Alain Claeys, rapporteur. En l’occurrence, ma question était simple : aucune information ne vous a été transmise par votre administration concernant le rapport Garnier ou l’existence d’éléments relatifs à l’éventuelle détention par M. Jérôme Cahuzac d’un compte en Suisse ?
M. le ministre. Aucune.
M. Alain Claeys, rapporteur. Un ouvrage récemment publié par une journaliste de l’hebdomadaire Le Point révèle qu’une réunion se serait tenue le 16 janvier 2013, à l’issue du conseil des ministres, à laquelle auraient pris part le Président de la République, le Premier ministre, le ministre délégué au budget et vous-même. Au cours de cette réunion, il aurait été décidé, selon l’auteur, de lancer la demande d’entraide administrative avec la Suisse.
Ces allégations sont-elles exactes ? Qui a pris l’initiative de formuler cette proposition ? Pourquoi M. Jérôme Cahuzac a-t-il pris part à cette réunion, alors que la « muraille de Chine » était en place ?
M. le ministre. Peut-être convient-il de remonter un peu plus loin dans le temps. Autour de Noël, peut-être juste ou juste après, Bruno Bézard et moi-même nous interrogeons sur l’opportunité d’avoir recours à une procédure d’entraide administrative en matière fiscale entre la France et la Suisse. À compter de ce moment, la direction générale des finances publiques prépare les conditions qui permettraient de poser les bonnes questions, dans les bons termes, à la Suisse.
M. Alain Claeys, rapporteur. Elle les prépare dès lors qu’est écoulé le délai de trente jours imparti pour répondre au formulaire n° 754 ?
M. le ministre. Non, dès Noël. Pour ce qui est des trente jours, je pense que M. Bruno Bézard vous a expliqué de quoi il retournait : il s’agissait d’une sorte de marqueur que les procédures internes étaient achevées et que, dès lors, il devenait possible de procéder à une interrogation de la Suisse.
M. le président Charles de Courson. Étiez-vous au courant que M. Bruno Bézard avait adressé un formulaire n° 754 à M. Jérôme Cahuzac ?
M. le ministre. Comme M. Bruno Bézard vous l’a dit, absolument pas.
M. le président Charles de Courson. Et vous trouvez cela normal ?
M. le ministre. Tout à fait normal. M. Bruno Bézard est un homme d’une extraordinaire intégrité ; il est le patron de la direction générale des finances publiques. Je voulais respecter les procédures de l’administration, et lui-même voulait faire en sorte que le politique ne soit pas directement aux commandes. Il vous a expliqué comment et pourquoi il ne m’en avait pas informé.
M. le président Charles de Courson. Et il ne vous a pas informé de la non-réponse de M. Cahuzac ?
M. le ministre. A fortiori ! Je n’ai été informé ni de l’existence du formulaire n° 754, ni qu’un tel formulaire avait été envoyé à M. Cahuzac, ni que ce dernier n’y avait pas répondu. M. Cahuzac vous l’a dit lui-même ici.
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons, s’il vous plaît, à cette période de Noël durant laquelle la demande a été préparée.
M. le ministre. Pourquoi est-ce que je reviens à Noël ? Parce qu’à partir de ce moment-là, nous envisageons, le cas échéant, de procéder à l’utilisation de cette procédure d’entraide fiscale et administrative. Je tiens informés le Président de la République et le Premier ministre de la possibilité de faire jouer, le moment venu, cette convention d’entraide fiscale avec la Suisse et – puisque vous me demandez qui en a pris l’initiative – je leur en ai fait la proposition. C’est moi qui en fais la proposition au Président de la République et au Premier ministre, sur la proposition du directeur général des finances publiques. Ils en ont accepté le principe.
En parallèle, Jérôme Cahuzac se fait fort d’obtenir de l’UBS la confirmation qu’il n’avait pas détenu un compte en Suisse chez eux. Et cette confirmation tardait à venir. Dès lors en effet, il y a eu non pas une réunion mais quelques mots dans la salle à côté du Conseil des ministres, à l’issue du Conseil des ministres…
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 16 janvier 2013 ?
M. le ministre. Je pense que la date est exacte.
À l’occasion de cet échange, le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l’utiliser. Pourquoi l’avoir fait ? La « muraille de Chine » n’est pas en cause. D’une part, parce que M. Jérôme Cahuzac était alors ministre du Gouvernement, d’autre part, parce que, aux termes de la convention, les avocats conseils de M. Cahuzac devaient être informés du lancement de la procédure.
M. Jérôme Cahuzac s’est dit serein ; il a souhaité que la demande couvre la période la plus large possible. Au-delà de cette information de principe, il n’a évidemment pas été associé à la décision, c’est le principe même de la « muraille de Chine » : il n’a pas su quand la procédure avait été lancée – autrement que par ses conseils –, il n’a pas été associé à la rédaction de la demande, il n’a pas été informé du contenu précis de la réponse, qu’il n’a jamais détenue.
Voilà très précisément ce qui s’est passé.
M. le président Charles de Courson. Selon vous, cette réunion respectait-elle le principe de la « muraille de Chine » ?
M. le ministre. J’estime que oui, car la « muraille de Chine » ne valait que pour le fonctionnement de l’administration fiscale ; or celui-ci est toujours resté, avec ses propres procédures, sous ma responsabilité directe. Il s’agissait, en l’espèce, d’une simple information de principe sur le recours à la procédure d’entraide administrative.
M. Alain Claeys, rapporteur. La réponse a été transmise au Parquet, mais la demande l’a-t-elle été ?
M. le ministre. Non.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi ?
M. le ministre. Au nom du principe de spécialité que j’ai évoqué.
M. le président Charles de Courson. Dans ce cas, il aurait dû s’appliquer également à la réponse ; pourquoi cette dissymétrie ?
M. le ministre. En vertu du principe de spécialité, l’administration fiscale a le pouvoir et le devoir d’utiliser ses propres outils juridiques : cela a été confirmé par tout le monde – et ce matin encore par la garde des Sceaux. Je pense que là, on entre dans une zone de confusion qui est un peu facile et à laquelle il faut répondre de la manière la plus claire.
Pourquoi ne pas avoir informé la justice de la demande ? Parce que la procédure fiscale suivait son cours et qu’au nom de la séparation des pouvoirs, nous ne voulions aucune interférence avec la procédure judiciaire – même si l’on peut estimer, comme vous l’a dit Mme Christiane Taubira et comme le prévoit le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, qu’à l’avenir il convient d’améliorer la coopération entre l’administration fiscale et la justice. Je n’y vois aucun inconvénient.
En revanche, nous avons transmis la réponse à la justice parce que c’était prévu par la convention franco-suisse et que nous agissions sur réquisition. Je confirme ce que vous a dit M. Bruno Bézard : je n’ai pas eu entre les mains la réponse des autorités helvétiques, mais une copie sur son iPad ; je lui ai dit qu’il fallait transmettre ce document à la police judiciaire.
M. le président Charles de Courson. Quelle fut l’attitude de M. Jérôme Cahuzac durant la réunion du 16 janvier ?
M. le ministre. Je vous redis qu’il s’est montré serein et, dans l’hypothèse où la demande se produirait, il a demandé qu’elle couvre la période la plus large. Ce à quoi nous avons veillé, puisque, alors que la convention prévoyait une interrogation sur trois ans, donc jusqu’à 2010, nous avons fait en sorte de remonter jusqu’en 2006, date de la prescription fiscale sur l’impôt sur le revenu.
M. le président Charles de Courson. Et cela ne vous choque pas qu’il ait été associé à cette décision de procédure fiscale? C’est comme si on demandait à un contribuable ce qu’il pense de la procédure fiscale qui le concerne !
En outre, cela survient postérieurement à la mise en place de ce que l’on appelle – improprement – la « muraille de Chine ». Cela ne vous paraît-il pas contradictoire ?
M. le ministre. « Associé » n’est pas le mot convenable, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Il était présent et vous venez de dire qu’il avait souhaité que la demande soit la plus large possible !
M. le ministre. Je vous répète, monsieur le président, que ce n’est pas le mot convenable. Vous semblez considérer que l’expression « muraille de Chine » est impropre…
M. le président Charles de Courson. Oui : il s’agit en fait d’un acte de déport.
M. le ministre. Quel que soit son nom, une instruction a été adressée par M. Jérôme Cahuzac aux services fiscaux, de façon à opérer une distinction claire entre ses fonctions ministérielles et sa défense personnelle, confiée à ses avocats. Dès lors, j’ai repris la main directement et complètement sur l’administration fiscale, et j’ai rencontré fréquemment le directeur général des finances publiques, M. Bruno Bézard.
Mais le mot « associé », pour le coup, monsieur le président – je connais votre finesse sémantique – est impropre. M. Jérôme Cahuzac n’a en rien été associé à la demande d’assistance administrative ; il a été informé, en tant que ministre, et sans qu’on lui demande son avis, du principe de la demande. Je rappelle que M. Jérôme Cahuzac était tout de même ministre du Gouvernement, qu’il était gravement mis en cause et qu’aussi bien le Président de la République, le Premier ministre que moi-même voulions savoir ce qu’il en était réellement – puisque, contrairement à ce qui a été dit, nous n’en savions rien ; si nous l’avions su, M. Cahuzac aurait aussitôt cessé d’être du membre de Gouvernement, comme cela a d’ailleurs été le cas lorsqu’il eut été mis en examen.
M. le président Charles de Courson. Il a quand même participé à la réunion !
M. le ministre. Il n’a pas participé à la rédaction de la demande, il n’a pas été informé du jour où elle a été envoyée, il n’a pas eu connaissance des échanges avec les autorités suisses, ni de la réponse. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Reprenons la chronologie des faits : l’administration prépare la demande de coopération fin décembre, et c’est vous qui prenez l’initiative de demander au Président de la République et au Premier ministre, en présence de M. Cahuzac, de déclencher la procédure d’entraide administrative ?
M. le ministre. Absolument – et c’est moi qui mène ensuite la procédure à son terme.
M. Alain Claeys, rapporteur. Venons-en à la réponse. Nous confirmez-vous que M. Cahuzac ou ses conseils en ont obtenu la teneur par l’intermédiaire des autorités suisses ?
M. le ministre. Là encore, il faut préciser les choses et c’est là où on voit d’ailleurs encore une fois à quel point le passage à l’échange automatique d’informations est souhaitable.
Dans la procédure telle qu’ils la considèrent, les Suisses mettent en avant la nécessité de prévenir le contribuable. Et on peut estimer d’ailleurs que c’est source d’au moins deux difficultés. La première, c’est qu’il est effectivement informé de quelque chose qui peut le concerner. Et la seconde, c’est qu’en général, ça induit de très longs délais.
Mais comme nous étions pressés – et encore une fois, je rappelle que j’ai moi-même joint deux fois ma collègue chef du département des affaires financières, Madame Éveline Widmer-Schlumpf –, nous avons accepté que Jérôme Cahuzac soit informé de la procédure. Et c’est évidemment par ses conseils qu’il a été informé de la teneur de la réponse. Je crois d’ailleurs que c’est ce qu’il vous a dit ici même. Il l’a confirmé. En revanche, il n’a jamais eu le texte de la réponse, il a été averti par son conseil suisse, informé lui-même par les autorités helvétiques. Voilà comment les choses se sont passées.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment expliquer que cette réponse ait fait l’objet d’un article dans Le Nouvel Observateur, et la une du Journal du dimanche ?
M. le ministre. Je ne me l’explique pas.
Je précise néanmoins qu’aucune déclaration affirmant que M. Jérôme Cahuzac était blanchi par cette procédure n’a émané de moi-même, de mon cabinet ou des services du ministère ; nous nous interdisions, de la manière la plus formelle, d’exercer une quelconque pression sur la justice.
En outre, la réponse des autorités suisses était une réponse précise à une question précise. Question : M. Jérôme Cahuzac a-t-il eu un compte à l’UBS qui aurait été transféré en 2010 à Singapour ? Réponse : non – sans que cela signifiât pour autant qu’il n’eût pas détenu un compte avant 2006, ou dans un autre établissement bancaire, ou que ce compte n’eût pas été transféré à un autre moment ailleurs, à Singapour, par exemple.
Pour ma part, j’ai toujours conservé mon approche du « doute méthodique » : je continuais à faire confiance à M. Jérôme Cahuzac, avec lequel je travaillais…
M. le président Charles de Courson. Vous maniez le paradoxe, monsieur le ministre : vous ne pouvez pas dire que vous appliquiez le principe du doute méthodique tout en faisant confiance ! Quand on doute, on doute – et dans ce cas, on vérifie tout.
M. le ministre. Monsieur le président, je vous ai déjà expliqué comment j’entendais ce principe. L’homme politique que je suis faisait confiance à l’homme avec qui il travaillait au redressement des comptes publics, avec qui il entretenait des relations tout à fait convenables, qui avait été le président de la Commission des finances de cette assemblée et qui avait fait dans l’hémicycle un serment auquel tout le monde avait cru…
M. le président Charles de Courson. Non, pas tout le monde !
M. le ministre. Si vous aviez un doute, il fallait l’exprimer à l’époque…
M. le président Charles de Courson. Cela a été fait.
M. le ministre. Moi, j’avais confiance en Jérôme Cahuzac, mais, en même temps, mon devoir de ministre était d’avoir un doute – par méthode.
Quand j’ai reçu cette réponse, je savais à quoi elle faisait allusion, mais aussi qu’elle ne couvrait pas toutes les éventualités. J’ai donc persisté dans mon doute méthodique.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’avais d’autres questions, mais, comme je ne veux pas monopoliser la parole, je n’en retiendrai qu’une dernière. Elle a trait à la présence d’une mention inhabituelle dans la réponse des autorités suisses : « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises ». Comment interprétez-vous cette phrase ?
M. le ministre. Je comprends qu’il s’agit d’une réponse plus large à une demande plus large que de coutume – toutefois, je le répète, je n’ai pas eu cette réponse entre les mains : j’en ai pris connaissance sur l’iPad de M. Bruno Bézard.
Si nous nous étions tenus à la lettre de la convention, nous n’aurions pas pu remonter au-delà de 2010. C’est pourquoi cela a pris du temps pour rédiger la demande : il fallait trouver les bons termes pour être le plus efficace, remonter le plus loin et aller le plus vite possible. Les services de la DGFiP se sont fondés sur les délais de prescription en droit fiscal pour aller jusqu’en 2006. Quand j’ai évoqué la question avec Mme Widmer-Schlumpf les 21 et 25 janvier, je lui ai confirmé que nous souhaitions remonter le plus loin possible dans le temps et obtenir une réponse rapide. Celle-ci est arrivée au bout de sept jours, et elle précise qu’elle porte bien sur la période 2006-2012. Voilà ce que signifie, à mon sens, cette mention.
M. le président Charles de Courson. Quelques questions complémentaires.
La première concerne le principe du recours à la convention fiscale franco-helvétique. Lorsque le directeur général des finances publiques vous propose cette solution, puis lorsque vous en faites la suggestion au Président de la République, au Premier ministre et à M. Jérôme Cahuzac, vous fait-on remarquer que formuler une telle demande, alors que, depuis le 8 janvier, une enquête préliminaire est ouverte, serait sans précédent ?
M. le ministre. Cette thèse du précédent ne tient pas, ou bien elle s’explique.
En effet, c’est d’ordinaire de Bercy que part ce type de demande, pour la simple raison que l’administration fiscale a le monopole des procédures de poursuite pour fraude fiscale – le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale devrait d’ailleurs maintenir ce principe. Ce n’est que depuis l’arrêt Talmon relatif au délit de blanchiment de fraude fiscale, rendu par la Cour de cassation en 2008, que les choses ont pris une tournure différente.
Ce dont M. Bruno Bézard m’a informé à l’époque, c’est qu’il s’agissait, non pas d’un précédent, mais d’une procédure extrêmement difficile, les réponses étant soit très lentes, soit dilatoires ; il fallait donc faire en sorte que la question soit correctement posée et suffisamment large pour que l’on puisse espérer une réponse rapide et précise.
M. le président Charles de Courson. Pourtant, le procureur de Paris a affirmé qu’il ne connaissait aucun précédent, et nous avons demandé à la directrice des affaires criminelles et des grâces de vérifier ce point : on nous a confirmé que ce n’était pas contraire à la loi, mais que cela ne se faisait jamais. Vous n’étiez pas au courant ?
M. le ministre. Mais, monsieur le président, il me semble que nous sommes face à une affaire qui a elle-même assez peu de précédents !
C’est une affaire exceptionnelle et nous ne nous sommes pas posé la question de savoir s’il y avait eu un précédent, nous avons simplement utilisé l’outil qui était à notre disposition. Si nous ne l’avions pas fait, vous seriez aujourd’hui en train de me le reprocher : « Vous aviez cette convention à votre disposition, pourquoi ne l’avez-vous pas utilisée ? ».
M. le président Charles de Courson. Ne faites pas de procès d’intention monsieur le ministre.
M. le ministre. Il vous est arrivé d’en faire, monsieur le président ! Je ne fais pas de procès d’intention ; je dis simplement qu’on aurait pu me faire le reproche de ne pas avoir recouru à cette possibilité – et on aurait eu raison !
M. le président Charles de Courson. Trouvez-vous normal que le directeur général des finances publiques n’ait pas informé le procureur de la République ou le procureur général de cette saisine ?
M. le ministre. Il avait la possibilité de ne pas le faire.
M. le président Charles de Courson. Dans ce cas, pourquoi avoir transmis la réponse ? Du coup, le procureur de Paris a demandé au ministère s’il avait le droit de l’inclure dans les pièces de la procédure. C’est la dissymétrie de votre attitude qui fait problème : en l’espèce, il s’agit d’un vrai dysfonctionnement !
M. le ministre. Non, absolument pas, car il s’agissait d’une procédure administrative, commandée par l’administration ; c’est le directeur général des finances publiques qui a transmis le document à la police judiciaire. Certes, je lui en avais donné l’instruction, mais, à la vérité, il n’y avait pas besoin de le lui dire et il envisageait de le faire. Il y avait là un fait, qui, s’il n’éclairait pas tout – on s’en rend compte a posteriori –, était d’importance ! Nous avons estimé qu’il pouvait concourir à l’établissement de la vérité, et c’est pourquoi il a été adressé au juge – qui en a fait l’usage qu’il croyait devoir en faire.
M. le président Charles de Courson. Vous avez dit que vous aviez rédigé la demande d’information de la manière la plus large possible, parce qu’à l’époque on ne parlait que d’un compte à l’UBS. Laissez-moi vous lire un extrait d’un article du journal suisse Le Temps, daté du 13 décembre 2012 :
« D’après Mediapart, c’est avec Hervé Dreyfus que Jérôme Cahuzac aurait eu, fin 2000, une conversation téléphonique enregistrée, au cours de laquelle il aurait mentionné l’existence d’un compte en Suisse. Hervé Dreyfus, poursuit le site, a donné son nom à la société Hervé Dreyfus Finance. Au capital de laquelle figurait, à sa fondation, « un influent financier suisse, Dominique Reyl, fondateur de la Compagnie financière d’études et de gestion, devenue Reyl & Cie en 1988 ».
Or, selon nos informations, les liens entre Hervé Dreyfus – homme de réseaux, proche de Nicolas Sarkozy et de son ex-épouse Cécilia – et Dominique Reyl sont bien plus serrés que ne l’écrit Mediapart : ils sont demi-frères. Contacté, le directeur général de Reyl & Cie, François Reyl – fils du président et fondateur – n’a pas tenu à confirmer ces informations : « Nous n’avons pas pour habitude de commenter l’actualité, si ce n’est de notre propre initiative. » »
Qu’est-ce qui vous aurait empêché de faire une demande encore plus large ?
Selon vous, il n’était pas nécessaire de saisir Singapour, parce que dans la demande adressée aux autorités suisses, vous évoquiez la possibilité d’un transfert. Mais pourquoi ne pas avoir essayé de recouper l’information ?
M. le ministre. Deux éléments de réponses.
D’abord il y a des personnes physiques, M. Dominique Reyl, M. Hervé Dreyfus, qui ont été évoquées ou mentionnées dans des articles au mois de décembre aussi bien de Mediapart que celui vous venez de citer. Mais, et c’est pour ça que je vous disais que chaque mot est important dans cette affaire, la possibilité d’un compte dans un autre établissement Reyl & Cie, devenue banque en 2010, n’est apparue que plus tardivement, c’est-à-dire le 1er février après la réponse des autorités suisses. Et donc, le 24 janvier, quand la demande part de la DGFiP, la seule information recoupée, donc légitime pour interroger la Suisse c’est celle de Mediapart du 4 décembre selon laquelle il aurait eu un compte à l’UBS transféré à Singapour en 2010. Et on ne peut pas me dire que le dossier de Mediapart était complet et en même temps de me reprocher d’avoir interrogé l’administration suisse sur ces seules bases !
En vérité j’ai interrogé l’administration suisse sur les bases de ce qu’avait dit Mediapart qui elle-même avait été à l’origine de l’enquête préliminaire qui a été déclenchée le 8 janvier. J’ajoute que nous avons bien pris en compte les informations de Mediapart puisque nous avons aussi visé Jérôme Cahuzac en qualité d’ayant-droit économique du ou des comptes et donc notre demande d’entraide visait à inclure d’éventuels prête-noms. Le cas échéant par exemple ça aurait pu être M. Dreyfus ou M. Reyl, s’ils avaient ouvert des comptes chez UBS pour le compte de Jérôme Cahuzac.
J’ajoute enfin que l’article d’Antoine Peillon du 1er février mentionnait la banque Reyl et indique que son auteur a posé au groupe Reyl la question suivante : « Pouvez-vous nous confirmer que monsieur Jérôme Cahuzac a été l’ayant-droit économique d’un compte ouvert à l’UBS par vos services ? » Donc voilà d’une manière très précise pourquoi nous avons procédé ainsi.
La deuxième chose, on voit bien là qu’on jongle, ce n’est pas seulement de l’uchronie pour le coup, c’est parfois de la contradiction entre les critiques, où on me dit « vous en avez trop fait » d’un côté, « vous n’en avez pas assez fait » de l’autre.
S’agissant de Singapour encore une fois, dans mon esprit, il y avait une chaîne logique : un compte à l’UBS qui aurait en 2010 été transmis à Singapour. Dès lors que les autorités suisses, interrogées non pas seulement sur la période 2010-2012 mais sur la période 2006-2012, nous disent de façon très claire « Non, il n’y a pas eu de compte de cette nature, il n’y a pas eu de transfert et ça concerne aussi monsieur Jérôme Cahuzac comme ayant-droit économique du ou des comptes », la question se pose de savoir s’il faut interroger Singapour.
Mais, si nous avions interrogé Singapour à ce moment-là et, pour le coup, sans avoir d’élément du tout, on aurait procédé à ce qu’on appelle du chalutage et de surcroît on aurait très clairement empiété sur l’information judiciaire. Je pense que ce n’était vraiment pas notre rôle de mener une enquête parallèle. Je m’y suis refusé.
J’ai dit tout à l’heure, j’ai fait ce que je devais et ce que je pouvais, j’ai utilisé autant que je le pouvais, autant que je le devais l’instrument juridique précis qui était en notre possession. Je n’ai pas voulu lui faire faire plus que ce qu’il pouvait, par exemple du chalutage, du fishing comme on dit, c’est-à-dire interroger sur toutes les banques. Cela aurait été, à ce moment-là, dilatoire. Et je n’ai pas voulu non plus poursuivre au-delà de la question posée parce qu’à ce moment-là on m’aurait accusé de mener une enquête en parallèle, alors que je ne voulais pas d’enquête parallèle. Nous nous serions mis en grave difficulté et là encore vous seriez en train de nous le reprocher à juste titre.
M. le président Charles de Courson. Quand nous avons auditionné M. Jérôme Cahuzac, notre collègue Georges Fenech lui a posé la question suivante :
« M. Georges Fenech. Monsieur Cahuzac, après le 14 janvier, date d’expiration du délai de renvoi du formulaire n° 754, le ministre de l’économie et des finances vous a-t-il informé qu’il allait directement interroger la Suisse malgré l’existence d’une enquête judiciaire en cours ? Dans cette hypothèse, vous a-t-il soumis le contenu et le libellé de cette question ? Votre réponse est importante, car elle nous permettra de déterminer si le ministre de l’économie et des finances a cherché délibérément à vous blanchir ou commis une imprudence.
M. Jérôme Cahuzac. M. Pierre Moscovici ne m’a jamais informé de cette procédure. A fortiori, il ne m’a pas communiqué les termes de la demande formulée par l’administration française à son homologue helvétique. »
Quel commentaire avez-vous à faire ?
M. le ministre. Je vous ai déjà répondu sur les conditions dans lesquelles M. Cahuzac avait reçu une information sur le principe de la procédure. Je vous ai dit qu’il n’avait été en rien informé de la procédure elle-même, de sa conduite, de la rédaction de la demande d’information, et de la réponse suisse.
M. le président Charles de Courson. Vous en concluez donc que M. Jérôme Cahuzac nous a menti ?
M. le ministre. Il me semble, monsieur le président, que je viens de vous répondre de manière très précise.
M. le président Charles de Courson. M. Cahuzac ne nous aurait pas menti ?
M. le ministre. Je n’ai pas de jugement à porter ; je le répète, je viens de vous répondre de manière très précise.
M. le président Charles de Courson. C’est en contradiction avec ce que vous nous avez dit tout à l’heure !
M. le ministre. Non, c’est exactement la même chose. Je vous ai dit dans quelles conditions M. Cahuzac avait reçu une information sur le principe de la demande qui pouvait être adressée à la Suisse, et je vous répète – sans que ce soit contradictoire, ni avec ce que je viens de dire, ni avec ses propos – qu’il n’a pas été informé de la procédure, qu’il n’a pas été associé à la rédaction de la demande, qu’il n’a pas été informé de l’envoi de celle-ci, ni de la réponse, et qu’il n’a jamais eu entre ses mains le contenu de cette réponse.
M. le président Charles de Courson. Ce n’est pas clair du tout !
M. Alain Claeys, rapporteur. Il a été informé du sens général de la réponse par les autorités suisses ?
M. le ministre. Non : les autorités helvétiques en ont informé ses conseils en Suisse. La meilleure preuve que tout a été fait dans la plus grande discrétion, c’est que ce document n’a, jusqu’à présent, jamais été publié. Il relève du secret fiscal. Il a été communiqué aux personnes qui ont autorité pour lever ce dernier – en l’espèce, les présidents des commissions des finances et les rapporteurs généraux des deux assemblées. M. Christian Eckert en a eu connaissance, et il a confirmé à plusieurs reprises que la démarche que j’avais suivie était valide. Pour le reste, il n’a jamais été rendu public, nulle part !
M. le président Charles de Courson. Le déport a été mis en œuvre par une note du 10 décembre 2012 signée par M. Jérôme Cahuzac. Je vous en lis l’avant-dernier paragraphe :
« Tout document ou toute information relative à ma situation fiscale personnelle ne devra être porté qu’à la connaissance de mes avocats et conseils. Vous ne transmettrez que les documents ou informations de nature à être portées à la connaissance d’un contribuable quelconque dans le cadre des lois et règlements en vigueur. »
Pensez-vous que sa participation à la réunion du 16 janvier 2013 était compatible avec cette instruction ?
M. le ministre. Oui, car il ne s’agissait pas d’un acte de l’administration fiscale ; il s’agissait de dire à un ministre que l’on avait arrêté le principe d’une procédure qui devrait ensuite être mise en œuvre par l’administration fiscale.
M. le président Charles de Courson. Mais était-il un « contribuable quelconque » ?
M. le ministre. En l’occurrence, il était le ministre !
M. le président Charles de Courson. Il avait lui-même écrit qu’il devait être traité comme un « contribuable quelconque » !
M. le ministre. On se trouve exactement dans ce cadre ; la « muraille de Chine » a parfaitement fonctionné.
M. le président Charles de Courson. Ah, vraiment ?
M. le ministre. Voudriez-vous qu’en plus il y ait eu une « muraille de Chine » politique qui eût fait que M. Jérôme Cahuzac n’eût plus été membre du Gouvernement ?
M. Daniel Fasquelle. La ligne de défense des ministres, qui est de répéter qu’ils n’ont jamais eu aucun échange sur l’affaire Cahuzac, s’est fissurée cet après-midi : Manuel Valls a reconnu avoir eu des réunions avec le Président de la République à l’Élysée et avec le Premier ministre à Matignon. Vous-même venez de reconnaître que Jérôme Cahuzac avait été informé de la procédure d’entraide administrative le 16 janvier, alors qu’il nous avait dit qu’il n’avait eu aucun contact d’aucune sorte avec aucun d’entre vous. À nouveau, c’est grâce à la presse que nous avons obtenu cette information.
Devant la Commission d’enquête, toute la vérité doit être dite, monsieur le ministre. Y a-t-il eu d’autres réunions de ce type, avec le Président de la République, le Premier ministre ou d’autres membres du Gouvernement, durant la période visée par la Commission d’enquête ?
M. le ministre. D’abord, ce que mes collègues Manuel Valls et Christiane Taubira ont dit, et que je confirme, c’est que nous n’avons jamais parlé entre nous de cette affaire.
Ensuite, il s’agissait, le 16 janvier, non d’une réunion ad hoc, mais d’une rencontre en marge du conseil des ministres – comme il arrive souvent que l’on se parle deux minutes dans la salle d’à côté. Et non, il n’y en a pas eu d’autres.
Je suis le ministre de l’économie et des finances. À ce titre, je rencontre très régulièrement le Président de la République et le Premier ministre ; je les ai donc informés de la possibilité de la procédure d’entraide, j’ai fait la proposition d’y recourir et ils en ont accepté le principe.
M. Daniel Fasquelle. Manuel Valls nous a dit qu’il avait assisté à des réunions à l’Élysée et à Matignon au cours desquelles le cas Cahuzac avait été évoqué. Comment expliquez-vous que vous n’y ayez pas été associé, alors que vous étiez le supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac ?
M. le ministre. Je n’ai pas entendu ce qu’a dit Manuel Valls. Je peux simplement déclarer qu’il n’y a pas eu de réunion de cette nature à laquelle j’aie participé.
M. Daniel Fasquelle. Si on peut reprocher à François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira et Manuel Valls d’avoir péché par omission, vous, vous avez péché par action en lançant cette enquête administrative qui a conduit à blanchir Jérôme Cahuzac.
Pourquoi la demande d’entraide administrative a-t-elle été adressée aussi tard à la Suisse, alors que les faits étaient révélés par Mediapart dès le 4 décembre ? Vous avez évoqué Singapour : une des trois questions que j’avais posées dans l’hémicycle le 5 décembre portait sur le transfert du compte en banque vers un paradis fiscal situé en Asie. Or, je tenais mes informations du site d’information en ligne.
De même, pourquoi le champ de la question posée aux autorités suisses n’a-t-il pas été plus large ? Si cela avait été le cas – et c’était possible –, l’enquête administrative se serait révélée utile. Or, ce qui nous trouble, c’est qu’elle a conduit au contraire à la conclusion que Jérôme Cahuzac n’avait pas ouvert de compte en Suisse. La question n’a-t-elle pas été rédigée de façon à recevoir une réponse précise, destinée à « sauver le soldat Cahuzac » ?
M. le ministre. On peut faire tous les reproches dans un sens et dans l’autre. Certains pèchent par omission, d’autres pèchent par action et à l’inverse si je m’étais moi-même livré à l’inaction vous seriez en train de me reprocher d’avoir péché par omission. C’est un peu un raisonnement circulaire, monsieur le député !
Pourquoi n’avoir pas agi plus tôt ? Certes, l’affaire a été mise au jour par Mediapart le 4 décembre, mais jusqu’au 8 janvier, juridiquement, rien ne se passe. Il n’y a même pas d’enquête préliminaire, seulement la mise en cause d’un ministre par un site Internet – même s’il s’agit d’un site important, dont les journalistes sont compétents et bien informés.
Nous prenons toutefois les choses assez au sérieux pour décider d’ériger aussitôt cette « muraille de Chine ». Par la suite, dès le 14 décembre, c’est l’envoi du formulaire no 754 – même si je n’en suis pas informé. À partir de cette date, court le délai de trente jours nécessaire pour épuiser les procédures internes, condition préalable à toute demande d’entraide administrative. Cela nous mène au 14 janvier.
Pendant ce temps, le directeur général des finances publiques s’assure de la faisabilité de la demande d’entraide. Ce n’est pas simple : il faut tenir compte des révélations de Mediapart, mais aussi de l’état du droit, lequel est suffisamment compliqué pour que vous vous soyez interrogés à ce sujet depuis des semaines. Nous voulions avant tout être efficaces, employer les bons termes, afin d’obtenir un résultat.
Ensuite, les contacts politiques avec les autorités suisses ont lieu dès le 21 janvier – soit sept jours après l’expiration du délai –, puis le 25 janvier –après que la demande a été enregistrée –, et la réponse parvient le 31 de ce même mois.
Vous me demandez pourquoi nous n’avons pas agi plus tôt ; je vous réponds qu’en réalité, nous avons été exceptionnellement rapides.
Pourquoi la demande d’assistance administrative n’était-elle pas formulée de façon plus large ? Je le répète, l’état du droit et le contenu de la convention ne le permettaient pas, sauf à prendre le risque de se voir opposer une réponse négative. Elle a été la plus large possible, dans le temps comme dans l’espace, d’autant que les ayants droit étaient pris en compte. Bruno Bézard l’a établi ici de la manière la plus claire.
Quant à votre dernière question, elle tend à me mettre en cause, et je n’accepte pas vos insinuations. Il n’y a eu aucune volonté de sauver un « soldat Cahuzac ». L’approche que j’ai adoptée est celle du doute méthodique : confiance dans le ministre et dans l’homme, mais souci de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour contribuer à la vérité de façon certaine. C’est ce que nous avons fait.
Votre question est soit absurde, soit extrêmement grave. Si vous pensez que le ministre de l’économie et des finances était au courant de l’existence de ce compte et aurait cherché à protéger son titulaire… Au nom de quoi ? Mais si tel avait été le cas, le Président de la République et le Premier ministre ne l’auraient pas toléré une seconde ! Je rappelle qu’il n’a pas fallu une heure, à partir de l’ouverture de l’information judiciaire, pour que Jérôme Cahuzac quitte le Gouvernement ! Vous y étiez : cela se passait pendant les questions d’actualité. Il est donc extrêmement grave de laisser penser que nous l’aurions couvert. Je ne peux laisser passer une telle allégation, et la récuse de la façon la plus forte.
M. le président Charles de Courson. Quand vous avez donné votre accord au directeur général des finances publiques pour formuler une demande en application de la convention fiscale franco-helvétique, pensiez-vous avoir une chance d’obtenir une réponse positive, compte tenu de la complexité des mécanismes généralement employés pour dissimuler des comptes non déclarés – comptes maîtres, trusts, etc. – ? Vous êtes-vous posé la question, vous qui connaissez un peu le droit fiscal ?
M. le ministre. Vous m’avez même prêté, dans l’entretien que j’évoquais tout à l’heure, une maîtrise extrême de cette matière.
Selon moi, la réponse aurait pu être positive dans deux cas de figure : s’il avait été exact que M. Cahuzac détenait entre 2006 et 2010 un compte à l’UBS, plus tard transféré à Singapour ; ou si nous avions pu interroger la Suisse sur un compte ouvert dans un autre établissement bancaire dûment mentionné. Pour le reste, je n’avais aucune idée de la réponse qui nous serait adressée. Certains ont prétendu – et cela a été aussi votre cas –, Monsieur de Courson, que j’avais posé cette question en connaissant d’avance la réponse. C’est faux.
M. le président Charles de Courson. Mais vous connaissez les mécanismes de dissimulation des comptes en Suisse. Vous avez un « lourd passé » dans ce domaine, en tant qu’ancien magistrat à la Cour des comptes, puis ministre des finances.
Quand je parle de « lourd passé », je fais de l’humour, naturellement. Je veux simplement dire que vous n’étiez pas un novice en matière de droit fiscal. Vous êtes-vous demandé si la question que vous posiez pouvait recevoir une réponse autre que négative ?
M. le ministre. Je viens de vous le dire, en posant la question, je pensais qu’une réponse positive était possible, même si j’espérais le contraire, car j’avais confiance en mon collègue. C’est encore une fois le doute méthodique. Oui, je pensais que la réponse pouvait être positive et elle aurait pu l’être, par exemple si le nom de la banque Reyl avait été mentionné plus tôt et si nous avions pu en tenir compte lors de la rédaction de la demande d’assistance administrative.
Quant à la Cour des comptes, vous y étiez également, puisque nous nous y sommes connus il y a vingt-neuf ans. On peut faire de l’humour, mais en la matière, je n’ai ni passé, ni passif !
M. Daniel Fasquelle. Vous avez dit que vous vouliez être efficace. Mais l’enquête administrative est déclenchée si tard, la question posée porte sur un champ si étroit que l’on peut exprimer des doutes sur les réponses qu’il était possible d’obtenir à partir d’une telle demande.
Mais surtout, vous étiez le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac, accusé par Mediapart de détenir un compte en Suisse, alors qu’il était chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Pourquoi ne pas avoir, dès le mois de décembre, signalé au Président de la République à quel point la situation était intolérable ?
Vous dites qu’il a été demandé à M. Cahuzac d’apporter la preuve qu’il n’avait pas de compte en Suisse. À quel moment ? Pourquoi, en l’absence de réponse, n’avoir pas pris des mesures plus énergiques ? Alors qu’il fait traîner les choses, votre seule réaction est de déclencher, fin janvier, une enquête administrative : c’est pour le moins troublant !
Par ailleurs, vous disposiez également de l’arme de la coopération judiciaire, même si celle-ci n’entrait pas dans le périmètre de l’administration fiscale. Vous pouviez vous adresser dans ce but au Président de la République et au Premier ministre. La coopération judiciaire aurait pu permettre de terminer l’affaire Cahuzac dès le mois de décembre. Pourquoi ne pas y avoir eu recours ?
M. le ministre. Là, nous sommes à la fois dans l’uchronie, la spéculation intellectuelle et l’expression de votre intime conviction. J’ai déjà répondu à toutes ces questions.
Je le répète une nouvelle fois, nous avons posé la question la plus large possible dans les délais les plus courts possibles. Je ne reviendrai pas sur la chronologie précise que je viens de retracer, mais ne perdez pas de vue qu’entre le 4 décembre et le 8 janvier, période pendant laquelle nous avons accompli un certain nombre de démarches – ce qui était déjà considérable –, il n’y avait aucun autre élément qu’une mise en cause publiée dans Mediapart. À partir du 8 janvier, nous passions à une autre étape, celle de l’enquête judiciaire. La recherche de la vérité s’est alors accélérée.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour la clarté, l’exhaustivité et la rigueur de vos propos – ce préalable me semble utile.
Edwy Plenel devant nous, et Charlotte Chaffanjon dans son ouvrage, ont témoigné de votre réaction devant l’instrumentalisation de la réponse apportée par la Suisse le 31 janvier. Confirmez-vous avoir ressenti de la colère ? Avez-vous la conviction, à ce moment, que le Journal du dimanche a été informé par l’entourage de Jérôme Cahuzac ? Le livre fait état d’une conversation avec lui sur ce sujet : que lui avez-vous dit, et surtout que vous a-t-il-dit, lui ?
M. le ministre. Un article du Journal du dimanche inférait en effet de la réponse suisse – dont la tonalité était connue de Jérôme Cahuzac via ses conseils –, que ce dernier était blanchi. Or, les autorités suisses n’avaient fait qu’apporter une réponse précise à une question précise : ce que j’en tirais, c’est que M. Cahuzac n’avait pas détenu de compte à l’UBS entre 2006 et 2010 et ledit compte n’avait pas été transféré à Singapour. Pour le reste, je me suis donné une règle, exprimée d’ailleurs dans un entretien à France Inter : il faut laisser la justice faire son travail. Nous ne sommes là que pour concourir à l’établissement de la vérité en lui transmettant les informations disponibles. C’est pourquoi j’ai en effet ressenti une certaine colère en lisant, dans le JDD, cet éloge qui semblait innocenter complètement Jérôme Cahuzac – un sentiment que j’ai partagé avec le directeur général des finances publiques. Je craignais que l’article ne soit interprété par le procureur comme une pression et par Mediapart comme une agression.
J’en ai en effet parlé à Jérôme Cahuzac, qui m’a dit – je crois qu’il vous l’a confirmé – qu’il n’était pas responsable de cette opération. Le reste ressort de mon intime conviction, qui n’a pas beaucoup d’intérêt pour la Commission.
M. le président Charles de Courson. Un peu tout de même, monsieur le ministre. Si ce n’est pas vous, …
M. le ministre. Non, ce n’est pas moi, ni le directeur général des finances publiques, ni mon entourage.
M. le président Charles de Courson. Quelles hypothèses reste-t-il ? Elles ne sont pas très nombreuses.
M. le ministre. Il vous appartient d’enquêter sur ce point. Une source, au moins, est mentionnée dans l’article, celle des conseils. Pour le reste, je n’ai pas l’intention de mettre quiconque en cause sans disposer du moindre élément de preuve.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi la lecture de cet article vous rend-elle furieux ?
M. le ministre. Pour les raisons que je viens de vous expliquer : je crains qu’il ne soit perçu comme une tentative de pression. On fait dire à cette réponse plus que ce qu’elle ne dit.
M. le président Charles de Courson. Cela signifie que vous doutez de cette réponse.
M. le ministre. Des magistrats de la Cour des comptes doivent se montrer précis dans l’usage du vocabulaire. Non, je ne doute pas de la réponse ; je doute de sa portée générale. Elle répond à ma question, pas à tout ; dès lors, il appartenait à la justice de continuer à travailler. C’est pourquoi nous lui avons transmis l’information dont nous disposions.
M. Gérald Darmanin. Ma question, plus générale, concerne votre conception de la responsabilité en politique, car nous ne sommes pas totalement convaincus par votre « doute méthodique ». Vous étiez le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac ; vous aviez en commun des collaborateurs, des conseillers en communication, une administration. Lorsque votre ministre délégué, que vous aviez interrogé plusieurs fois sur ce sujet, a avoué qu’il avait menti à la représentation nationale et au Président de la République, comment est-il possible que vous n’ayez pas eu l’idée de reconnaître que vous aviez failli à votre responsabilité, tout en étant pas le responsable direct ? Parmi les quatre reproches qui vous ont été faits, on peut retenir, sinon l’incompétence, du moins un grand manque de curiosité. Vous auriez pu concevoir différemment votre rôle de ministre de tutelle, et peut-être, dans ce cas, auriez-vous mieux servi le Gouvernement – quitte à ce que le Président de la République et le Premier ministre vous reconduisent finalement dans vos fonctions.
Avez-vous le sentiment que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, en tant que ministre de tutelle, pour connaître la vérité sur le compte de M. Cahuzac ?
M. le ministre. Je constate, monsieur le député, que je ne vous ai pas convaincu. Mais, j’ai une vague impression que vous n’aviez pas envie de l’être. Ce n’est pas le doute méthodique que vous pratiquez, ainsi qu’un certain nombre de vos collègues, mais le doute par principe, parce que vous n’écoutez pas les réponses. Au fond, elles ne vous intéressent pas.
Vous êtes plus jeune que moi. Je suis un homme politique expérimenté, puisque j’ai déjà été ministre il y a quinze ans. Et j’ai, en effet, une certaine conception de la responsabilité en politique. Si j’avais estimé, d’une quelconque façon, avoir failli dans ma mission, j’en aurais tiré les conséquences auprès du Président de la République et du Premier ministre, pour accomplir le geste que vous évoquez. Mais j’ai la conviction d’avoir agi comme je le pouvais, compte tenu des moyens en ma possession, et comme je le devais, au regard de mon éthique et de mes relations avec l’administration fiscale – qui est une fort belle administration – et avec la justice. J’estime que cette administration, sous ma conduite, s’est montrée irréprochable et n’a rien laissé au hasard.
Je le répète, on ne peut à la fois me reprocher d’en avoir trop fait et de ne pas en avoir fait assez.
Mme Cécile Untermaier. Lors de la publication de l’article de Mediapart, le 4 décembre, quelle a été votre réaction ? Vous êtes-vous tourné vers l’administration pour savoir s’il existait des éléments susceptibles de conforter l’accusation ?
M. le ministre. Comme vous, j’imagine, j’ai été frappé par cet article. Même sans être toujours d’accord avec ce qu’ils écrivent, je sais en effet que les journalistes de Mediapart n’affirment rien à la légère. J’ai donc eu une conversation – à son initiative – avec Jérôme Cahuzac, qui m’a dit, comme il vous l’a dit dans cette enceinte, qu’il n’avait jamais eu de compte en Suisse. Il me l’a même répété un grand nombre de fois par la suite. A chacune de nos conversations ou presque, il me répétait son innocence. Je l’ai cru sincère – nous avons d’ailleurs tous pensé la même chose.
M. le président Charles de Courson. Pas tous.
M. le ministre. Du moins un très grand nombre. Je n’ai pas entendu ceux qui doutaient s’exprimer avec force. Mais j’avais d’autres raisons de penser ainsi : je travaillais avec lui à la tâche essentielle de redresser les comptes du pays.
Cela étant, ma réaction a été immédiate : mise en place de la « muraille de Chine », puis lancement, le 14 décembre, de la « procédure 754 » –à l’initiative de l’administration. Nous avons envisagé, dès Noël, un recours à l’entraide administrative. Nous ne sommes donc pas, loin s’en faut, restés inertes. Nous avons mis en marche tout ce qui, du point de vue de l’administration fiscale, permettait d’établir la vérité.
Mme Cécile Untermaier. Dans l’ouvrage de la journaliste du Point, il est fait état d’un engagement de Jérôme Cahuzac à obtenir, de la part des autorités suisses, la confirmation qu’il n’existait pas de compte à son nom à l’UBS. J’imagine que vous en attendiez les résultats. En l’absence de réponse au formulaire no 754 et de confirmation de la part des autorités suisses, vous avez présenté une demande d’entraide administrative. Votre doute ne s’est-il pas renforcé à ce moment ?
M. le ministre. Je le confirme : Jérôme Cahuzac évoquait la possibilité d’obtenir d’UBS, via ses avocats, la confirmation du fait qu’il ne détenait pas de compte dans cette banque. Or, pour des raisons que je ne connais pas – j’imagine que vous l’avez interrogé à ce sujet –, il n’y a pas eu de réponse. C’est pour cette raison, et compte tenu de l’ouverture d’une information judiciaire, de l’épuisement des procédures internes et des travaux préparatoires déjà réalisés en ce sens, que nous avons estimé à ce moment nécessaire de procéder à une demande d’entraide administrative. Cela relève, une fois de plus, du doute méthodique. C’est la volonté de connaître la vérité qui nous motivait – ce qui est d’ailleurs en totale contradiction avec l’accusation selon laquelle nous l’aurions déjà connue et les questions n’ont été posées que dans le but de voir confirmer les hypothèses que nous souhaitions.
Mme Cécile Untermaier. Je considère pour ma part qu’il y a eu addition de compétences, administrative et judiciaire, et non rivalité.
M. le ministre. Vous savez de quoi vous parlez.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous êtes cohérent avec vous-même, monsieur le ministre, puisque vous avez tenu les mêmes éléments de langage devant la Commission des finances. Dans cet océan de cohérence, je relève tout de même une incohérence : vous n’avez pas informé le procureur de la République de la demande d’entraide administrative, mais vous le faites lors de la réception de la réponse. Pourquoi cette différence ?
M. le ministre. Je vous remercie d’avoir salué la cohérence de mes propos. Il ne s’agit pas d’éléments de langage, mais de la conviction d’avoir fait ce que je devais faire, à la tête d’une administration dont le comportement a été impeccable de bout en bout.
Pour le reste, je crois avoir déjà répondu à cette question. Le principe de spécialité s’est appliqué. L’administration fiscale a lancé la procédure qu’elle croyait devoir entreprendre – qu’elle devait entreprendre –, et cela n’était pas un élément qui participait de la vérité. En revanche, la réponse des autorités suisses nous a semblé devoir être communiquée au juge, parce qu’elle apportait un élément nouveau et important. Dans un cas, il s’agissait de procédure, et nous n’avions pas à en informer le procureur ; dans l’autre, il était question d’un élément d’information sur le comportement de Jérôme Cahuzac.
Mme Marie-Christine Dalloz. Soit. Pour ma part, je retiens que le procureur n’est pas informé de la demande, mais seulement de la réponse.
Je souhaite revenir sur trois dates. Le 10 décembre, mise en place de la « muraille de Chine », Jérôme Cahuzac s’auto-déporte des dossiers le concernant. Il n’est donc plus dans la boucle au sujet de la fraude fiscale dont il serait l’auteur. Le 8 janvier, ouverture d’une enquête préliminaire. Enfin, le 16 janvier, une réunion est organisée avec le Président de la République, le Premier ministre, vous-même et Jérôme Cahuzac. Tout le monde, ici, connaît la personnalité de ce dernier : ce n’est pas quelqu’un que l’on assoit dans un coin, le temps de discuter de son dossier. Vous avez dit vous-même tout à l’heure qu’il avait précisé la période sur laquelle pouvait porter la demande d’assistance administrative.
Où est la cohérence ? On ne peut pas déporter quelqu’un le 10 décembre, puis le remettre dans le circuit le 16 janvier pour l’informer de la façon dont va être formulée la question posée aux autorités fiscales suisses.
M. le président Charles de Courson. Quelle est votre question ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Comment expliquer la présence de M. Cahuzac à la réunion du 16 janvier ? Pourquoi l’avoir laissé donner lui-même des indications sur la période à prendre en compte ?
M. le ministre. Sur le plan chronologique, il n’est pas juste de prendre la date du 4 décembre pour point de départ, ni même, d’ailleurs, celle du 10 décembre : il faut partir du 8 janvier, date de l’ouverture de l’enquête judiciaire, qui est un élément accélérateur.
Sur ce qui s’est passé le 16 janvier, j’ai déjà répondu. Au cours de cette rencontre, qui n’a duré que quelques minutes, Jérôme Cahuzac a accueilli avec sérénité ce qui n’était pour lui qu’une information. Cela n’implique pas qu’il ait été associé en quoi que ce soit ni à la demande d’entraide, ni à la conduite de la procédure, ni à la réponse. Il a juste indiqué qu’il souhaitait que la période couverte par la requête soit la plus large possible, mais il n’a pas dicté le contenu de cette dernière – qu’il ignorait.
M. Christian Eckert. Certains profitent de leurs questions pour donner leur point de vue. Pour une fois, je vais en faire autant. Lorsque le ministre a évoqué certains documents dont j’ai été le destinataire, et mes déclarations sur le sujet, j’ai entendu des ricanements. Je vais donc rappeler ce que j’ai dit, et même écrit. J’ai en effet commis, la semaine dernière, un rapport dont certains ont pu dire qu’il avait pour objectif de blanchir M. Woerth ou de valider l’action de M. Parini – ce que les gens dotés d’une certaine mémoire pourraient juger surprenant.
J’essaie simplement de me montrer objectif. J’ai analysé les conventions entre la France et la Suisse et les lettres d’échange au sujet de leur application, et j’ai en effet pris connaissance des questions posées aux autorités suisses et des réponses qui y ont été apportées.
Tout d’abord, il fallait que la France prouve son intérêt à agir. Cet intérêt étant fondé sur la possibilité d’effectuer des poursuites et l’hypothèse d’un redressement fiscal, il était nécessaire de tenir compte des délais de prescription, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune. C’est pourquoi la période considérée ne pouvait courir qu’à partir de 2006.
Comme j’ai pu le constater dans le cadre d’autres affaires – UBS et HSBC –, les Suisses s’abstiennent de répondre lorsque les conditions d’interrogation ne sont pas respectées. Outre l’intérêt à agir, une de ces conditions est que l’administration nationale ait épuisé ses moyens d’action interne avant de recourir à l’entraide administrative. Tel est l’objet de l’envoi, à M. Cahuzac, du formulaire no 754 : c’était le point de départ du délai d’un mois nécessaire pour qu’une requête soit possible.
Par ailleurs, les textes prévoient que l’administration fiscale requérante – la France, en l’occurrence – fournit à la connaissance de l’administration helvétique toutes les informations permettant d’identifier le receleur des avoirs non déclarés détenus en Suisse. Si le nom de la banque UBS, cité par tous les articles de presse, n’avait pas été mentionné dans la demande, les Suisses n’auraient pas répondu.
Enfin, la demande mentionnait d’éventuels ayants droit. Or cette question – nous l’avons vu au cours des auditions – est assez complexe, car l’obligation de déclarer les ayants droit au moment de l’ouverture d’un compte bancaire en Suisse n’a pas toujours été de même nature. Je vous renvoie sur ce sujet aux déclarations de M. Condamin-Gerbier.
La demande adressée à la Suisse était donc conforme aux accords en vigueur. Rappelons que, dans le cadre de l’affaire UBS, 135 demandes similaires ont été effectuées, et que plusieurs mois, voire plusieurs années après, seule une poignée ont reçu une réponse. Il semble même que les Suisses refusent de répondre lorsqu’une adresse est incomplète, quand bien même ils disposeraient de tous les autres éléments nécessaires.
Je pense donc que tout a été fait pour que la demande d’entraide permette d’obtenir les informations.
Je reviens maintenant à la question posée par Mme Untermaier. En lisant le livre de la journaliste du Point, on sent monter une certaine irritation jusqu’à la date du 16 janvier. En se référant précisément à des entretiens entre le Président de la République, le Premier ministre et vous-même, la journaliste souligne que Jérôme Cahuzac a longtemps fait miroiter une éventuelle réponse des Suisses, et que le Président de la République, notamment, l’a plusieurs fois interrogé à ce sujet.
La deuxième source d’irritation est l’absence de réponse au formulaire no 754. C’est ce comportement, et le fait qu’aucune réponse ne venait de la part des Suisses, qui a conduit à lancer la procédure d’entraide – et je continue à penser que s’abstenir de la lancer aurait été de nature à choquer les membres d’une commission d’enquête. Ma question est donc la suivante : à quel moment votre doute méthodique s’est-il transformé en véritable doute ? Quel a été le déclic ?
M. le président Charles de Courson. Je voulais poser également cette question.
M. le ministre. D’abord, je voudrais qu’on se remette un peu dans l’esprit de l’époque : nous sommes attelés à une tâche très compliquée, et la responsabilité, pour le coup, des ministres qui sont à Bercy, notamment du ministre des finances et du ministre du budget, des autres aussi, bien sûr, est lourde, parce qu’il s’agit de redresser les comptes publics. C’est un travail harassant. C’est un travail important accompli par des ministres qui sont évidemment très en vue pour les Français, et qui doivent incarner la confiance.
Le 4 décembre, quand arrive cette mise en cause, elle crée une émotion générale. Je ne vais pas parler d’irritation, je parle d’abord d’émotion, qui culmine avec la séance de questions d’actualité, au cours de laquelle Jérôme Cahuzac vous affirme et à nous aussi, que, il n’a pas eu de compte à l’étranger, à aucun moment.
Et à partir de ce moment-là, cette affaire est évidemment prise au sérieux sur le plan politique : un ministre du budget, qui est au cœur des processus de lois de finances et autres, qui est accusé d’avoir eu un compte à l’étranger, donc avec des conséquences fiscales, ça n’est pas rien. Et donc c’est une affaire qui attire l’attention de tous. D’où la « muraille de Chine », d’où la préparation de la procédure d’entraide administrative, d’où la tension politique constante qui est portée là-dessus. Alors ce qui se passe, je n’utiliserais pas le mot d’irritation, c’est qu’à partir d’un certain moment, il commence à y avoir un peu d’impatience, impatience qui s’accroit encore quand s’ouvre l’enquête préliminaire, le 8 janvier. C’est une nouvelle étape. Il faut accélérer.
Qu’est-ce que nous voulons savoir ? C’est simple, la vérité, contrairement à ce qui a pu être laissé entendre ici ou là. Evidemment, nous n’avons aucune forme d’information qui laisse à penser que Jérôme Cahuzac aurait eu ce compte à l’étranger, autre que les allégations de Mediapart. Nous voulons savoir, nous voulons savoir.
Il est exact qu’à ce moment-là, Jérôme Cahuzac évoque – je crois que d’ailleurs, cela a été mentionné, au moins dans Le Monde, qui avait publié un article disant qu’il avait posé des questions, mais pas forcément les bonnes – je parle de mémoire. Il dit que, via ses avocats, il va interroger l’UBS sur le fait qu’il n’avait pas de compte en Suisse. Comme la réponse ne parvient pas, nous lui disons que nous allons utiliser la procédure qui est entre nos mains, c’est-à-dire la procédure d’entraide. Pour quoi faire ? Toujours la même chose, savoir la vérité.
Vous me demandez à quel moment le doute méthodique s’est transformé en autre chose. Cette formule, qui vaut ce qu’elle vaut, exprime la balance entre, d’un côté, la confiance à un homme qui vous donne sa parole, avec autant de force, qui vous l’a redit, qui vous le répète, qui se montre disponible pour les recherches de la vérité et, de l’autre, le fait de se demander : et si c’était vrai, si c’était vrai ! C’est grave ! On doit donc tout faire pour savoir ce qui s’est vraiment passé.
Mais, ce doute méthodique, je l’ai eu jusqu’au bout, avec des hauts et des bas, avec des moments où effectivement, je pouvais ressentir – je suis un être humain – des sentiments contradictoires. L’article du Journal du dimanche a été un moment pour moi un peu dur. Je n’en ai pas tiré la conséquence que ce qu’il disait n’était pas exact, mais le fait qu’on ait voulu – qui, je ne sais pas – solliciter la vérité, faire dire à la réponse suisse plus ce que ce qu’elle disait.
Mais j’ai toujours éprouvé le doute méthodique du premier au dernier jour. Je peux vous dire, monsieur le Président, que quand j’ai appris, le 2 avril, le mensonge, l’aveu, ça a été un choc terrible pour moi. Il se trouve que, à ce moment-là, je sortais d’ici et je suis allé chez le président de la République, puisque c’est le mardi souvent que je le vois. Choc d’autant plus terrible que j’avais eu confiance dans un homme avec qui je travaillais, qui m’a menti, qui a menti à tout le monde, peut-être un peu plus à moi, parce que j’étais son ministre de tutelle, et que nous avions plus d’occasions d’en parler.
M. le président Charles de Courson. Vous avez évoqué la possibilité, pour Jérôme Cahuzac, d’adresser lui-même une lettre à la banque, afin qu’elle confirme ou non la tenue d’un compte à son nom.
M. le ministre. C’est bien ce dont il s’agit.
M. le président Charles de Courson. Mais il ne voulait pas le faire – c’est ce qu’il nous a expliqué. Or, vous ne l’avez jamais sommé de rédiger une telle lettre. Cela aurait pourtant eu valeur de test : un refus de sa part vous aurait ouvert les yeux.
De même, à propos du formulaire no 754, vous avez affirmé que vous n’étiez pas au courant de son envoi, ni de l’absence de réponse. J’ai posé la question à votre directeur général : pourquoi, alors qu’il a un devoir de loyauté à l’égard de son ministre, ne vous en a-t-il pas informé ? Il a dit qu’il n’avait pas à le faire, mais cela aurait pu alimenter votre doute méthodique.
M. le ministre. Nous sommes toujours dans l’uchronie et la reconstitution a posteriori. J’ai lu ici ou là que j’aurais dû sommer Jérôme Cahuzac de répondre au formulaire no 754. Sur ce point, je ne peux que confirmer la loyauté dont a fait preuve Bruno Bézard. Il s’agissait d’une procédure technique nécessaire, ne serait-ce que pour faire courir le délai à l’issue duquel seraient purgées les procédures internes. Mais cela constituait un non-événement, dans la mesure où une réponse politique et publique avait été apportée à l’Assemblée nationale. Simplement, en l’absence de réponse, nous étions en mesure, au bout d’un mois, de recourir à d’autres procédures.
Jérôme Cahuzac nous a dit qu’il se faisait fort, via ses avocats, d’obtenir une réponse de la part d’UBS. Ne la voyant pas venir, nous sommes passés à la procédure d’entraide administrative.
M. le président Charles de Courson. Il n’y avait pas de danger que cette réponse vienne, puisqu’il n’avait pas saisi la banque !
M. le ministre. C’est bien pour cela que nous avons eu recours à l’assistance administrative internationale.
M. Georges Fenech. Il me semble indispensable, à ce stade, que nous réentendions Jérôme Cahuzac, comme nous avons entendu à nouveau Me Gonelle en raison de la contradiction entre ses propos et ceux de M. Bruguière. En effet, M. Cahuzac nous a clairement répondu qu’il n’était pas informé de la demande d’entraide fiscale adressée à la Suisse. Or M. Moscovici nous a parlé de cette réunion du 16 janvier qui, en raison de la présence de l’ancien ministre du budget, constitue une fissure dans la « muraille de Chine ». Cette réunion constitue un point essentiel de l’affaire, et c’est pourquoi je voudrais en savoir plus. Qui était présent ? Dans quel bureau a-t-elle eu lieu ? Combien de temps a-t-elle duré ? Que s’y est-il dit ? Où étaient placés les uns et les autres ? Il ne s’agit pas de procéder à une reconstitution, mais nous voudrions visualiser la scène
(Exclamations socialistes).
Les bonnes questions vous ennuient ? Vous préférez entendre les convictions de M. Eckert ?
Cela me conduit à une remarque sur le climat de cette commission d’enquête. J’ai déjà participé à des travaux de ce genre, mais j’observe ici un clivage malsain qui ne nous honore pas.
M. Christian Assaf. Vous n’y êtes pas étranger !
M. Georges Fenech. Regardez comme vous me montrez du doigt !
M. le président Charles de Courson. Monsieur Fenech, ne vous adressez pas à vos collègues, mais au ministre.
M. Georges Fenech. Il convient, monsieur le président, de rétablir un peu de sérénité dans nos débats.
M. le président Charles de Courson. J’essaie de m’y employer.
M. Georges Fenech. Regardez mes collègues !
M. Christian Assaf. À qui la faute ?
M. le président Charles de Courson. Monsieur Fenech, nous sommes là pour poser des questions au ministre.
M. Georges Fenech. Ils m’interpellent, ils m’interrompent.
Nous sommes ici pour aider à la manifestation de la vérité, non pour protéger certains ou porter des accusations avec légèreté. Ma question est précise : que s’est-il passé le 16 janvier ? M. Cahuzac a occulté sa présence à cette réunion, là est le nœud du problème.
M. le président Charles de Courson. M. le rapporteur va nous rappeler les déclarations de M. Cahuzac devant la Commission.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je cite – c’est moi qui interpelle M. Cahuzac : « M. Bruno Bézard a indiqué, lors de son audition du 28 mai, que vous aviez tenté d’entrer dans le débat sur la demande d’assistance administrative et de voir, par exemple, comment cette demande était rédigée. Il vous avait répondu que cela était impossible, et vous n’aviez pas insisté. Est-ce exact ? » La réponse de Jérôme Cahuzac est la suivante : « Oui. Cet échange n’a duré que quelques secondes. J’ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu’une demande était soit en cours, soit faite. J’en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m’a répondu qu’il n’était pas envisageable que je puisse m’en mêler ; je lui ai donné raison et ne lui en ai plus jamais reparlé. ».
M. Georges Fenech. Jérôme Cahuzac a clairement dit que M. Moscovici ne l’avait jamais informé de cette démarche.
M. le président Charles de Courson. J’ai lu tout à l’heure sa réponse.
M. Georges Fenech. Or, nous apprenons que la réunion du 16 janvier comprenait également Jérôme Cahuzac. Il y a une contradiction manifeste.
M. le ministre. Tout d’abord, une réflexion sur le climat, peut-être pour rasséréner M. Fenech. J’ai moi-même présidé une commission d’enquête, consacrée à la libération, opérée par M. Claude Guéant et Mme Cécilia Sarkozy, des infirmières bulgares détenues en Libye par le Colonel Khadafi. Au cours de ces travaux, on m’a interdit, par vote, d’entendre un témoin pourtant essentiel, en m’expliquant que Mme Sarkozy était, en quelque sorte, partie non détachable de la fonction du chef de l’État – un motif assez cocasse. J’ai donc été amené à ne pas voter le rapport de la commission. J’espère que cela ne vous arrivera pas, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. Je vous rassure, monsieur le ministre, cela m’est arrivé également.
M. le ministre. Quoi qu’il en soit, je constate que les questions sont posées librement. Il est normal que le sujet soit l’occasion d’exprimer, sinon des passions, du moins des opinions assez tranchées.
Sur le fond, il vous appartient de décider qui vous voulez entendre à nouveau, mais j’ai déjà expliqué par le menu pourquoi il n’y a pas de contradiction entre nos propos. Jérôme Cahuzac n’a pas été informé de la procédure telle qu’elle a été conduite ; il ne l’a été que du principe de son déclenchement, et n’y a été associé en rien.
J’ajoute que je ne suis pas là pour faire de la politique spectacle. J’ai déjà précisé où avait eu lieu la rencontre – dans la salle attenant à celle où se tient le Conseil des ministres, quelle était sa durée – quelques minutes – et qui étaient les personnes présentes.
M. Georges Fenech. Qui était présent ?
M. le ministre. Je vous l’ai déjà dit : le Président de la République, le Premier ministre, moi-même et Jérôme Cahuzac.
M. Georges Fenech. Je suggère donc à notre commission d’entendre les autres participants.
M. le président Charles de Courson. Nous en discuterons après l’audition du ministre.
M. Georges Fenech. En tout état de cause, votre réponse ne me satisfait pas. Il ne s’agit pas uniquement d’information, puisque Jérôme Cahuzac était présent ce jour-là.
M. le ministre. Il s’agissait de l’informer sur le principe, non de le consulter ou de lui indiquer des détails. Nous lui avons dit que nous allions procéder à la demande d’assistance administrative internationale, faute d’avoir obtenu la réponse demandée. C’est tout. Pour le reste, l’administration fiscale, sous mon autorité, a fait ce qu’elle devait faire. C’est sur ma proposition, je dis bien à mon initiative, que cette procédure a été suggérée. Le principe en a été accepté par le Président de la République et le Premier ministre. Jérôme Cahuzac a été informé du principe. Mais la mise en œuvre relevait totalement de la DGFiP, sous mon autorité. Voilà exactement ce qui a été fait.
M. Georges Fenech. À partir du 10 décembre, date de la mise en place de la « muraille », la DGFiP passe sous votre autorité.
M. le ministre. Pour le traitement de ce cas, oui.
M. Georges Fenech. Mais uniquement pour le traitement de ce cas.
M. le ministre. Bien sûr.
M. Georges Fenech. Cela méritait d’être précisé. M. Cahuzac a décidé de s’auto-déporter, ce que vous avez tacitement accepté, sans rien signer toutefois. Je trouve étonnant qu’un ministre décide de lui-même de se défausser d’une partie de ses compétences.
M. le président Charles de Courson. Quelles sont vos questions, monsieur Fenech ?
M. Georges Fenech. Monsieur le président, j’ai attendu toute l’après-midi. Si je ne peux pas m’exprimer…
M. le président Charles de Courson. Vous le pouvez. Mais nous sommes là pour poser des questions.
M. Georges Fenech. Je voudrais faire part comme l’a fait M. Eckert, de ma conviction. En entendant M. Moscovici, j’ai beaucoup souffert pour lui, car la situation dans laquelle il se trouvait – de bonne foi, je veux le croire – était absolument intenable. Il gérait en effet les conséquences de l’absence de décision de la part du Président de la République et du Premier ministre. La mise en place de la « muraille de Chine » est bien la démonstration flagrante que le maintien de Jérôme Cahuzac à la tête de l’administration fiscale constituait un conflit d’intérêts. Il aurait été bien plus responsable, d’un point de vue politique – et au fond, le dysfonctionnement est bien là, tellement flagrant que je me demande si une commission d’enquête était vraiment nécessaire –, de mettre M. Cahuzac en retrait dès que le doute pouvait paraître sérieux. Cela vous aurait facilité la tâche, monsieur le ministre, pour mener l’enquête administrative.
J’en viens à ma question. L’administration fiscale, que je sache, est soit partie jointe, soit partie principale à une enquête ou à une procédure devant le tribunal correctionnel. Vous serez, tôt au tard, partie jointe dans une procédure, si les faits sont finalement avérés. Mais qu’est-ce qui vous empêchait, à l’époque, de dénoncer les faits au parquet afin qu’il déclenche une enquête à votre initiative, et non à celle d’un organe de presse ? Rien ne vous l’interdisait !
Certes, il y a séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et l’administration fiscale. Mais le code de procédure fiscale dispose que l’administration peut saisir le procureur de la République pour faire déclencher une enquête. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?
M. le ministre. Sur le premier point, je vous remercie : il est vrai que la période n’a pas été facile pour moi. Mais je l’ai assumée avec le sens des responsabilités qui est le mien, et en conservant la même attitude à l’égard de mon collègue – un homme qui non seulement était présumé innocent, mais qui, jusqu’au 8 janvier, ne faisait pas l’objet d’une enquête préliminaire –, tout en cherchant à établir la vérité. Je pense que les choses ont été faites d’une façon exemplaire.
Pour le reste, je ne veux pas me livrer à l’uchronie. Je répète que l’administration fiscale a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et une enquête préliminaire a été ouverte le 8 janvier.
M. Thomas Thévenoud. Chacun livre sa propre analyse de cette affaire. Pour ma part, je me contenterai de rappeler un chiffre : il s’est passé 117 jours entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013. On aurait aimé que la vérité éclatât aussi vite dans un certain nombre d’affaires !
Monsieur le ministre, lorsque vous n’étiez pas en déplacement à l’étranger, combien de fois par semaine aviez-vous l’occasion de rencontrer le ministre délégué au budget ?
M. le ministre. Si je tiens compte des fréquents entretiens bilatéraux, des réunions de ministres auxquelles nous participons tous les deux, du Conseil des ministres, des séances de questions d’actualité, des textes que nous avons été amenés à défendre au Parlement – déjà six projets de loi d’ordre financier, qu’il s’agisse de lois de programmation, de lois organiques, de lois de finances ou de loi de finances rectificative –, je crois pouvoir parler de contacts quotidiens, voire plus fréquents encore.
M. Thomas Thévenoud. Pendant ces 117 jours, avez-vous le souvenir du nombre de fois où vous avez personnellement interrogé Jérôme Cahuzac sur l’existence d’un compte à l’étranger ?
M. le ministre. Nous avons eu un échange à ce sujet dès le premier jour, sans que je puisse dire si je l’ai interrogé ou si c’est lui qui m’en a spontanément parlé. Il m’a en tout cas assuré – car, comme tout le monde, j’avais été ébranlé par les informations de Mediapart – ne pas détenir ce compte, ce qu’il a ensuite confirmé devant la représentation nationale. Par la suite, il lui est arrivé un très grand nombre de fois de m’en parler. Il était évidemment très préoccupé par tout cela et tenait souvent à affirmer qu’il n’avait pas détenu ce compte. Nous en parlions, y compris sur le ton de l’amitié. Nous avons eu aussi certains échanges à propos de l’article du Journal du dimanche.
M. Thomas Thévenoud. Justement, cette parution semble avoir provoqué votre irritation, voire votre colère. Peut-on dire qu’à partir de cet événement, le doute s’enracine en vous ? Continuez-vous, par la suite, à interroger Jérôme Cahuzac ?
M. le ministre. Nous en parlons continûment jusqu’au 19 mars, jour où nous passons de l’enquête préliminaire à l’information judiciaire, et où il est amené à quitter le Gouvernement. Le lendemain, je tiens à être présent lors de la passation de pouvoirs, aux côtés du nouveau ministre, pour saluer la qualité du travail que nous avons fait ensemble. À ce moment-là, je ne suis évidemment toujours pas au courant de quoi que ce soit, et je continue de croire en la parole de Jérôme Cahuzac.
La colère, ou le sentiment d’inconfort, que m’a fait éprouver la publication de cet article ne m’a pas conduit à conclure à la culpabilité de M. Cahuzac. Je me suis seulement dit qu’il fallait laisser travailler la justice, refuser toute forme de pression sur le procureur, éviter de provoquer Mediapart, et enfin ne pas faire dire à la procédure utilisée plus que ce qu’elle disait. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle n’avait pas été correcte, ni qu’elle disait moins.
M. Thomas Thévenoud. L’irritation vient du fait que cet article, à vos yeux, pouvait être à l’origine d’une pression exercée sur la justice.
M. le ministre. Il pouvait être interprété comme tel dès lors que M. Cahuzac était présenté comme innocenté. Ce n’est pourtant pas la conclusion que j’avais tirée de la réponse suisse. Je le répète, la Suisse avait apporté une réponse précise à une question précise : il n’avait pas eu de compte à l’UBS entre 2006 et 2010, et donc n’avait pas transféré de compte à Singapour. Rien de plus, rien de moins. Mais ce n’était pas rien ; c’était même très important.
M. Thomas Thévenoud. Dernière question : avez-vous eu des contacts avec Jérôme Cahuzac entre le 19 mars et le 2 avril ?
M. le ministre. Je me suis donc rendu à la passation de pouvoirs, pour rendre hommage à la qualité du travail que nous avions accompli ensemble, ainsi qu’à une certaine qualité relationnelle. Par la suite, je ne l’ai pas revu, mais il m’arrive de recevoir des SMS par lesquels M. Cahuzac exprime les regrets qu’il peut éprouver à mon endroit. Ils ne sont pas nombreux, mais ils me permettent de mesurer l’ampleur de ces regrets.
M. Daniel Fasquelle. Ce qui est troublant, c’est que la vérité a éclaté grâce à l’action de la presse…
M. Thomas Thévenoud. De la justice !
M. Daniel Fasquelle. …et de la justice, mais en aucun cas grâce à celle du Gouvernement.
Monsieur le ministre, à la question précise : « Avez-vous eu des contacts avec le Président de la République et le Premier ministre à ce sujet ? », vous m’avez répondu : « Non. » Puis, nous avons découvert l’existence de la réunion du 16 janvier. Vous avez également avoué tout à l’heure que le principe de l’enquête administrative avait été accepté par le Président de la République.
Bien évidemment, on ne peut imaginer une seule seconde que vous n’ayez pas eu des échanges avant la réunion du 16 janvier. Il y a donc une contradiction dans votre témoignage. Si vous nous dites que vous n’en avez jamais parlé avec le Premier ministre et le Président de la République, cela donne du crédit à l’affirmation selon laquelle vous avez agi de façon isolée, et que l’on ne vous a pas informé du fait que le Président de la République avait été contacté en décembre par Michel Gonelle. Mais vous ne pouvez pas, d’un autre côté, prétendre avoir débattu avec le Président de la République du principe de l’enquête administrative.
Quelque chose ne colle pas dans votre témoignage. Soit vous en avez discuté avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault, et ils vous ont communiqué les informations qu’ils détenaient – et qui les conduisaient forcément à admettre la réalité de ce compte en Suisse–, soit vous avez agi isolément. Mais les deux affirmations ne peuvent pas être vraies ensemble.
M. le ministre. Je n’accepte pas le jugement de valeur selon lequel mon témoignage ne colle pas. Mme Dalloz avait davantage raison en parlant de cohérence.
Je n’ai pas une vision complotiste de l’histoire. J’ai déjà évoqué ce dont j’avais parlé avec le Président de la République et le Premier ministre : je les ai informés de ce que je faisais dans le cadre de mes fonctions de ministre des finances. Je vous confirme donc que ni moi, ni mon cabinet, ni mes services n’avons eu de contacts avec le ministère de l’intérieur ou avec le ministère de la justice. Il n’y a pas eu de réunion globale à l’occasion de laquelle on aurait mis tout à plat. Dès lors que m’a été présentée la possibilité de requérir l’assistance administrative internationale dans le cadre de la convention signée avec la Suisse, j’ai expliqué comment celle-ci fonctionnait et suggéré que l’on y ait recours. Voilà ce que j’ai fait. Et je vous ai dit aussi à qui je l’ai fait.
M. Daniel Fasquelle. Dernière question : le Président de la République et le Premier ministre, à l’occasion de ces contacts, vous ont-ils informé de la démarche effectuée par Michel Gonelle auprès de M. Zabulon ?
M. le ministre. J’ai dit qu’il n’y avait eu aucune réunion de type horizontal, aucun échange entre les différents ministères sur cette affaire. Votre question me donne l’occasion d’être plus spécifique : non, non et non.
M. Daniel Fasquelle. C’est incroyable !
M. le ministre. Pourquoi est-ce incroyable ? Ce qui est incroyable, c’est de penser que c’est incroyable !
M. le président Charles de Courson. Merci, monsieur le ministre, d’avoir répondu à nos questions, même si de temps en temps, cela a été… clair, net et précis.
Audition du mercredi 17 juillet 2013
À 14 heures 30 : M. Gérard Paqueron, ancien mandataire financier de M. Jean‑Louis Bruguière.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous recevons aujourd’hui le général Gérard Paqueron, qui fut le mandataire financier de M. Jean-Louis Bruguière lorsque ce dernier était candidat aux élections législatives de 2007 dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot.
Mon général, je ne crois pas trahir l’impression des membres de cette commission d’enquête en disant que les auditions que nous avons conduites ces dernières semaines nous ont donné l’image d’une vie politique quelque peu « compliquée » à Villeneuve-sur-Lot au cours de la dernière décennie. En particulier, les relations entre M. Jérôme Cahuzac et M. Michel Gonelle d’une part, entre ce dernier et M. Jean-Louis Bruguière d’autre part, nous sont apparues pour le moins complexes. Je ne doute pas que votre témoignage permettra de nous éclairer.
Surtout, nous souhaiterions savoir quel était votre degré d’information sur la détention, par M. Jérôme Cahuzac, d’un compte non déclaré à l’étranger, information dont M. Michel Gonelle avait fait part à M. Jean-Louis Bruguière.
Avant d’aller plus loin, je vous informe que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc de bien vouloir vous lever, lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(M. Gérard Paqueron prête serment.)
M. le président Charles de Courson. Si cela vous convient, je vais vous laisser vous exprimer durant une dizaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Claeys, pour un échange de questions et de réponses. J’inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions.
M. Gérard Paqueron, ancien mandataire financier de M. Jean-Louis Bruguière. J’ai fort peu de choses à dire, si ce n’est que je suis un peu étonné d’être là et je ne m’y attendais pas – mais j’y souscris volontiers et j’essaierai, dans la mesure du possible, de vous apporter les éclairages demandés.
J’imagine que ce qui vous intéresse est, non pas le résumé de ma carrière, mais comment j’ai connu Jean-Louis Bruguière et suis devenu son mandataire financier.
Jean-Louis Bruguière vient très fréquemment à Villeneuve-sur-Lot ; nos enfants fréquentaient le même club hippique, au château de Rogé. En outre, nous sommes tous deux membres de l’Académie de l’air et de l’espace ; nous fréquentons également le Tomato, une association aéronautique qui compte quelque trois cents anciens de l’aéronautique. Lorsque j’ai appris que Jean-Louis Bruguière souhaitait se présenter aux élections législatives, je lui ai fait une offre de service, dans le cas où il aurait eu besoin d’un coup de main pour rédiger des dossiers sur la situation locale.
Depuis juin 2005, je suis retraité complet ; plus précisément, je suis général de la deuxième section. Un général peut occuper trois positions : la première section, la deuxième section – les généraux placés dans la deuxième section peuvent être rappelés par décret pour reprendre leurs fonctions en première section –, ou la mise à la retraite d’office – ce qui est infamant. En son temps, le président Mitterrand avait menacé 50 à 60 généraux et amiraux qui, en 1988, avaient signé un manifeste en faveur de Jacques Chirac de les mettre à la retraite d’office. Bref, ce n’était pas sympa de la part de Jérôme Cahuzac de me traiter de « général de réserve » !
Jean-Louis Bruguière a accepté mon offre. J’ai rédigé quelques fiches sur la ruralité dans le Lot-et-Garonne, puis j’ai vu un jour arriver des gens qui m’ont dit : « On aurait besoin de vos services comme mandataire financier ». Je suis donc allé à la préfecture d’Agen signer un document à cette fin.
Trois semaines environ avant le premier tour, comme cela ne se passait pas bien au sein de la petite équipe de campagne, Jean-Louis Bruguière m’a demandé d’être son directeur de campagne. Pour moi, cela ne pouvait pas s’improviser ! Aussi près de l’échéance, je ne savais trop que faire. J’ai décidé de préparer ses visites dans les municipalités – Jean-Louis Bruguière avait en effet décidé de visiter les 118 communes de la circonscription, canton par canton. Mon rôle s’est donc limité à établir des itinéraires pour essayer de respecter le temps imparti à chaque mairie ; mais ce fut impossible : vous savez bien qu’on ne contrôle pas le temps que l’on passe à discuter avec des élus !
J’ai également fait mon travail de mandataire financier, et mon dossier a été validé, à la réserve d’un redressement de 90 euros – somme qui correspondait aux dépenses engagées pour apporter le dossier à Paris et pour payer un repas sortant du cadre de la campagne électorale – sur un total de 60 000 euros. C’est tout.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez rien d’autre à déclarer ?
M. Gérard Paqueron. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si je comprends bien, vous avez été dans un premier temps mandataire financier, puis vous êtes devenu directeur de campagne trois semaines avant le premier tour, pour essayer d’harmoniser les choses ?
M. Gérard Paqueron. Oui, j’ai assumé les deux fonctions : mandataire et directeur de campagne.
M. Alain Claeys, rapporteur. Michel Gonnelle a fait écouter l’enregistrement concernant Jérôme Cahuzac à Jean-Louis Bruguière, qui en a emporté une copie. Avez-vous eu connaissance de l’existence de cet enregistrement ? L’avez-vous écouté ?
M. Gérard Paqueron. Je serai très ferme sur ce point : j’ai découvert cet enregistrement en décembre 2012, lorsque Mediapart en a révélé l’existence. Je ne l’avais jamais vu ni entendu auparavant.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jean-Louis Bruguière ne vous en avait pas parlé ?
M. Gérard Paqueron. Non, jamais.
En revanche, à une époque, Jérôme Cahuzac a eu des ennuis avec l’URSSAF à cause de l’emploi non déclaré d’une personne en situation irrégulière. On en a parlé deux jours, puis Jean-Louis Bruguière a dit : « On oublie tout ça. Je ne fais pas une campagne électorale de caniveau ! ». Il a été très ferme sur ce point, je vous le garantis.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand était-ce ?
M. Gérard Paqueron. Durant la campagne électorale.
J’ai loué le local de campagne vers le 12 mars. À l’époque, Jean-Louis Bruguière occupait encore ses fonctions de magistrat et il fallait qu’il retourne régulièrement à Paris pour travailler sur le dossier du terroriste Carlos : ce n’était pas facile ! En réalité, nous ne l’avons vu que quatre semaines avant le premier tour. La campagne fut relativement courte.
M. Alain Claeys, rapporteur. Bien entendu, il ne vous a pas parlé de la destruction de cet enregistrement ?
M. Gérard Paqueron. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le local de campagne était-il en dehors du domicile de M. Bruguière ?
M. Gérard Paqueron. Oui. C’est moi, en tant que mandataire financier, qui l’ai loué à une société immobilière, pour une durée de trois mois et demi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelles étaient les relations entre MM. Gonelle et Jean-Louis Bruguière ?
M. Gérard Paqueron. En janvier et en février, nous avons organisé quelques réunions informelles – le local de campagne n’existait pas encore. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais il y eut un « clash » et, à partir de mars, je n’ai plus vu M. Gonelle. Il ne faisait plus partie de l’entourage de Jean-Louis Bruguière.
M. Alain Claeys, rapporteur. Étant directeur de campagne et mandataire financier, vous connaissiez l’atmosphère de la campagne. Selon vous, quelle aurait pu être l’origine de ce « clash » ?
M. Gérard Paqueron. J’en ignore les raisons. Il faut dire que je n’étais pas tout le temps avec eux. Le suppléant de M. Bruguière non plus.
Peut-être est-ce arrivé à la suite d’une discussion entre eux deux ? Tout ce que je sais, c’est que M. Gonelle s’est écarté de la campagne et qu’on ne l’a plus vu.
Mme Cécile Untermaier. À quel moment ?
M. Gérard Paqueron. Vers la fin janvier.
M. Alain Claeys, rapporteur. En quels termes se sont-ils quittés, après les élections ?
M. Gérard Paqueron. Eh bien, ils ne se côtoyaient plus…
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle était l’ambiance durant cette campagne ? La situation a l’air compliquée ?
M. Gérard Paqueron. Oh, vous savez, on parle de « Villeneuve-sur-Vote »… Ce n’était pas facile !
Jean-Louis Bruguière, bien que sa famille habitât Villeneuve-sur-Lot depuis des générations, était considéré comme un « parachuté » – c’était du moins le bruit que les partis adverses faisaient courir. En outre, il y avait là différentes personnes : chacune voulait donner son avis ; la personne qui s’occupait de la communication allait avec l’un, avec l’autre ; au milieu de tout cela, il y avait les harkis – qui sont très nombreux là-bas. C’était – comment dire ?... assez délicat.
Du moins était-ce ainsi à Villeneuve-sur-Lot même, car lors de nos déplacements dans la circonscription, l’ambiance était très sympathique. Chaque jour, nous visitions dix mairies, et nous terminions par un meeting dans le chef-lieu de canton. Sachant qu’il y a quatorze cantons, si l’on excepte les week-ends, presque toute la campagne s’est déroulée ainsi !
Mais, à Villeneuve-sur-Lot, chacun y allait de son conseil ! J’ai fait de mon mieux pour calmer les gens, mais j’étais un peu « le perdreau de l’année » dans cette affaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. La campagne était-elle tendue entre MM. Gonelle et Cahuzac ?
M. Gérard Paqueron. C’était une bonne campagne. M. Cahuzac était bien implanté et, comme vous avez pu en juger, c’est un bon débatteur.
La seule fois où M. Bruguière et lui se sont affrontés directement, c’est entre les deux tours : un face-à-face avait été organisé par la radio locale et par Sud-Ouest. Les deux candidats ont débattu durant deux heures. Sinon, cela s’est toujours fait par radio interposée.
Il y a eu des « piques », c’est vrai, mais pas plus que durant n’importe quelle autre campagne électorale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu le sentiment que M. Gonelle voulait saboter la campagne de M. Bruguière ?
M. Gérard Paqueron. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Laissez-moi vous lire cet extrait de l’audition de M. Bruguière :
« M. Alain Claeys, rapporteur. Quels autres éléments ont dégradé vos relations ?
M. Jean-Louis Bruguière. Le dernier fut une réunion politique que M. Gonelle a préparée à mon insu, pour valoriser sa propre position, allant chercher le député d’une autre circonscription et récupérant au passage des membres de mon équipe de campagne en formation. Quand je l’ai appris et m’en suis ouvert à M. Gonelle, celui-ci a mis toute la faute sur le compte d’une seule personne. Lorsque je l’ai revu, je me suis rendu compte que tout cela relevait d’une manipulation. La coupe était pleine et la confiance définitivement rompue.
M. Alain Claeys, rapporteur. Une manipulation pour saboter votre campagne ?
M. Jean-Louis Bruguière. Oui. J’ai perdu cette campagne en grande partie à cause de mon camp, même si j’assume ma part de responsabilité dans cet échec. »
Qu’en pensez-vous ?
M. Gérard Paqueron. Pour ma part, je n’ai pas eu l’impression qu’on en était arrivé à de telles extrémités.
Il y eut un très grand meeting à Villeneuve-sur-Lot, durant lequel les candidats UMP des trois circonscriptions se sont exprimés : Jean Dionis du Séjour, Michel Diefenbacher et Jean-Louis Bruguière. Michel Gonelle était présent, et il m’a même apporté des contributions financières.
Mais, encore une fois, je n’étais pas tout le temps avec eux !
M. le président Charles de Courson. M. Jean-Louis Bruguière a également déclaré ceci : « Aujourd’hui, avec le recul, j’estime que j’ai eu tort ; mais ce contexte explique que sur le coup j’aie pris cet enregistrement. Ensuite, je n’ai pas voulu l’écouter, car ce n’est pas ainsi que j’envisageais une campagne ; ce geste a d’ailleurs participé à la dégradation de mes relations avec M. Gonelle. Celui-ci prétend qu’il n’a jamais été évincé de mon entourage, mais des témoins peuvent le contredire : cela s’est passé chez moi, d’une façon assez rude, et il ne peut pas ne pas s’en souvenir. Mais je préfère éviter la polémique. ».
Avez-vous assisté à cette réunion ?
M. Gérard Paqueron. Oui.
M. le président Charles de Courson. Que s’est-il passé ?
M. Gérard Paqueron. Il y avait une quinzaine ou une vingtaine de personnes ; on commençait à mettre en place l’équipe de campagne. M. Gonelle, croyant bien faire, avait pris l’initiative d’organiser un repas républicain pour recueillir des fonds. Cela n’a pas passé. La femme de M. Bruguière a fort justement fait remarquer que, d’abord, il eût été préférable d’en parler avant, ensuite, que ce repas risquait d’être imputé dans les comptes de campagne alors que celle-ci n’avait pas commencé. La réaction fut très sèche. Peut-être que les problèmes relationnels entre Gonelle et Bruguière commencèrent à cette occasion.
M. le président Charles de Courson. Il s’agirait donc d’une opposition sur une question liée à l’organisation de la campagne ?
M. Gérard Paqueron. Oui, c’est tout à fait cela.
M. le président Charles de Courson. Il n’y a pas d’autres éléments explicatifs ?
M. Gérard Paqueron. En tout cas, moi, je n’en connais aucun. Mon bureau était juste à côté de celui de Jean-Louis Bruguière et je n’ai jamais entendu d’éclats de voix.
Mme Cécile Untermaier. Général, aviez-vous avec Jean-Louis Bruguière une relation de confiance telle que, s’il avait détenu un enregistrement de cette nature, il vous aurait fait part de ses interrogations à son sujet ?
M. Gérard Paqueron. Je crois pouvoir dire qu’il avait une totale confiance en moi – c’est même devenu de l’amitié ensuite.
En revanche, je ne peux pas vous dire s’il avait confiance en moi au point de me confier qu’il avait écouté une telle cassette. Il ne m’en a jamais parlé.
Mme Cécile Untermaier. A-t-il évoqué avec vous la possibilité d’utiliser des comportements discutables de M. Cahuzac ?
M. Gérard Paqueron. Je répète que, si je n’ai jamais rien su de cette cassette, en revanche, nous disposions d’échos sur la situation d’une personne qu’employait M. Cahuzac. M. Bruguière a été très ferme à ce sujet ; il a dit : « On n’en parle plus. Je ne fais pas une campagne électorale de caniveau ! » – et cela a été terminé.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez bien dit qu’un « clash » entre MM. Bruguière et Gonelle avait eu lieu à la fin janvier ?
M. Gérard Paqueron. Oui, à l’occasion de la réunion dont nous venons de parler.
Mme Cécile Untermaier. À la suite de ce « clash », les deux hommes ont-il cessé toutes relations ?
M. Gérard Paqueron. Leurs relations se sont distendues, puis interrompues.
Mme Cécile Untermaier. On peut donc considérer que maître Gonelle ne participait pas à la campagne qui s’est déroulée après le mois de janvier ?
M. Gérard Paqueron. Non.
Mme Cécile Untermaier. Je vous remercie.
M. Georges Fenech. Mon général, puisque cette hypothèse a été soulevée au sein même de cette commission, je veux, par principe, vous la soumettre.
Il court une rumeur selon laquelle les militaires étant très critiques à l’égard du budget de la défense, vous auriez eu des raisons d’en vouloir au ministre du budget. Il y aurait donc eu un « complot militaire » contre Jérôme Cahuzac, visant à le faire « tomber » pour sauver le budget de la défense.
J’imagine que vous avez entendu parler de cette théorie. Qu’en pensez-vous ?
M. Gérard Paqueron. J’en ai entendu parler parce que la question a été posée à Jérôme Cahuzac lorsqu’il a été auditionné. Cela ferait presque sourire, si ce n’était aussi grave.
Quel que soit le Gouvernement, il y a toujours au moment de la discussion du budget des flèches échangées entre le ministère de la défense et Bercy. Les militaires devraient-ils à chaque fois se sentir en danger ?
Et croyez-vous que, pour paraphraser le général de Gaulle, c’est à mon âge que l’on commence à faire de la dictature ? Mais, pendant qu’on y est, pourquoi ne pas dire que nous étions prêts à faire un putsch ? C’est une affabulation !
Excusez-moi de vous répondre aussi brutalement, mais cette affaire me paraît invraisemblable. Moi, général ayant quitté le service actif depuis 1997, j’utiliserais en sous-main des officines pour faire sauter le ministre du budget ? Vrai, je serais fort !
M. Alain Claeys, rapporteur. Depuis les révélations de Mediapart, avez-vous discuté avec le juge Bruguière ?
M. Gérard Paqueron. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lui avez-vous demandé pourquoi il ne vous avait rien dit durant la campagne électorale de 2007 ?
M. Gérard Paqueron. Non, je lui ai demandé : « Jean-Louis, qu’est-ce que c’est que cette histoire de cassette ? Il y avait une cassette ? ». Il m’a répondu : « Non » – et j’en suis resté là.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il vous a répondu : « Non, il n’y avait pas de cassette » ?
M. Gérard Paqueron. Il ne m’a pas dit qu’il avait une cassette. Il a dit : « Oui, c’est Mediapart… ».
M. Philippe Houillon. C’est « oui » ou c’est « non » ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Mon général vous dites avoir appris l’information par Mediapart, et il n’y a pas de raison de ne pas vous croire. Quand vous en parlez à Jean-Louis Bruguière, celui-ci la confirme-t-il ?
M. Gérard Paqueron. Non, il ne me dit rien.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais lui avez-vous posé la question ?
M. Gérard Paqueron. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire de cassette ? », il m’a répondu : « Oh, ce n’est rien… ». Il a un peu éludé.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’avez-vous senti mal à l’aise ?
M. Gérard Paqueron. Non, pas du tout.
M. le président Charles de Courson. Mais vous a-t-il dit explicitement qu’il n’y avait pas de cassette ?
M. Gérard Paqueron. Non, il est resté évasif.
M. Christian Assaf. Et vous-même, l’avez-vous été ? Autrement dit, avez-vous, à la suite de la parution de l’article de Mediapart, demandé au juge Bruguière si, oui ou non, il détenait cette cassette ?
M. Gérard Paqueron. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire de cassette ? », et il est resté évasif. Je ne lui ai jamais demandé : « As-tu eu la cassette ? ».
Mme Cécile Untermaier. À la fin de la campagne, maître Gonelle a été le destinataire d’une lettre de remerciements signée par M. Bruguière. Tous deux donnent une interprétation différente de cet envoi. Avez-vous eu connaissance de cette lettre ? Savez-vous dans quelles circonstances et dans quel objectif elle a été rédigée ? M. Bruguière vous en a-t-il parlé ?
M. le président Charles de Courson. Afin de préciser les choses, je vous cite la déclaration de M. Bruguière : « En les privant de leader, mon échec aux législatives et ma décision d’arrêter définitivement la politique et de ne pas me présenter aux élections municipales de 2008 ont provoqué la déception, voire le désarroi des militants. Nos relations avec M. Gonelle s’étaient dégradées et je ne le voyais plus à la fin de la campagne ; M. Gonelle lui-même ne niera pas ce fait objectif puisqu’il affirme s’être écarté de moi. La contradiction est donc d’ordre factuel : l’ayant écarté, je lui ai écrit une lettre. Encore sous l’effet de la campagne, je l’ai fait pour ne pas mettre en péril l’élection municipale à venir à laquelle je ne participerais pas et dans laquelle il serait difficile de gagner face à M. Cahuzac. C’était peut-être une mauvaise stratégie. »
M. Gérard Paqueron. Je découvre l’existence de cette lettre !
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand vous parlez de l’enregistrement au juge Bruguière, celui-ci vous répond : « Y’a rien à voir ! ». Depuis, avez-vous revu M. Gonelle ?
M. Gérard Paqueron. Je l’ai revu récemment, le soir du deuxième tour de l’élection partielle, quand il est venu féliciter Jean-Louis Costes à sa permanence.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lui avez-vous parlé de cette cassette ?
M. Gérard Paqueron. Non, jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jamais ?
M. Gérard Paqueron. Non, car j’estime que je n’ai pas à me mêler de cette affaire. Je l’ai apprise par les médias, et je ne tiens pas à en rajouter ; M. Gonelle est déjà interviewé par beaucoup de gens.
Je lui ai dit bonjour, tout le monde était content, Jean-Louis Costes avait gagné : voilà tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous connu M. Garnier ?
M. Gérard Paqueron. Non.
M. Dominique Baert. Mon général, M. Gonelle affirme qu’il a transmis le document informatique à Jean-Louis Bruguière parce que celui-ci avait les moyens de le faire écouter et expertiser par des services spécialisés.
S’agissant de la nature du support, on parle alternativement de cassette, de CD et de clef USB, sans que l’on puisse savoir avec précision ce qu’il en est. Vous qui avez été l’un des plus proches collaborateurs de Jean-Louis Bruguière durant cette campagne, avez-vous le sentiment que celui-ci ait une connaissance fine des supports informatiques ?
La possibilité de faire appel à des services spécialisés que Jean-Louis Bruguière aurait connus dans le cadre de ses fonctions professionnelles a-t-elle été jamais évoquée devant vous – y compris sur un tout autre sujet ?
M. Gérard Paqueron. On n’a jamais évoqué, en ma présence, la possibilité de faire appel à des services spécialisés. Si tel avait été le cas, je me serais inquiété d’en connaître les raisons et, de ce fait, j’aurais été mis au courant de l’histoire de la cassette.
Il est vrai qu’à l’époque, de par ses fonctions, Jean-Louis Bruguière pouvait demander des expertises, mais jamais de plein droit : il fallait une commission rogatoire, bref respecter les règles. Non, la seule chose qu’il continuait à faire, c’était à préparer ce document de 450 pages pour le procès en appel de Carlos. Il voulait absolument terminer cette affaire ; il n’était pas préoccupé par une quelconque cassette !
Quant aux supports informatiques, il en connaît peut-être un peu moins que moi, mais pas beaucoup plus… Pour l’expertise, il existe des services spécialisés.
Il reste qu’une question n’a jamais été posée : puisqu’il paraît que l’on a dupliqué cette cassette, est-on sûr qu’elle ne l’a été qu’une fois ?
M. le président Charles de Courson. Mon général, je vous rassure : nous nous la sommes posée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et vous, pourquoi vous la posez-vous ?
M. Gérard Paqueron. Eh bien, tout en dupliquant, on peut enregistrer la source sur un disque dur et en tirer ensuite autant d’exemplaires que l’on veut : certains auraient pu se retrouver dans la nature – mais je reconnais que cela relève plutôt des investigations policières.
M. Dominique Baert. Quelle est votre hypothèse ?
M. Gérard Paqueron. Je n’ai pas d’hypothèse, je fais une simple constatation : on parle d’une cassette qui a été faite en 2001 et rendue publique en 2012. Pourquoi ce délai de onze ans ?
M. Alain Claeys, rapporteur. ça, nous aimerions bien le savoir !
M. le président Charles de Courson. Il s’est quand même passé des choses entre-temps…
M. Christian Assaf. La réponse du général m’amène à répéter que nous nous entêtons à nous demander qui de M. Gonelle ou de M. Bruguière a transmis l’enregistrement à Mediapart, alors qu’une troisième personne a transféré en 2001 la conversation du téléphone portable sur un support informatique. Je souhaiterais que nous l’auditionnions.
M. le président Charles de Courson. Mon cher collègue, il semblerait que nous sachions qui est cette personne. Elle était seule et habite, je crois, dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot. Les réponses de M. Gonelle, de M. Bruguière et des journalistes de Mediapart nous incitent en effet à creuser la piste du « troisième homme ». Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour le coup, cela nous ferait sortir du champ d’investigation de la Commission d’enquête… En outre, je suppose que le technicien a déjà été entendu par la police judiciaire ?
M. le président Charles de Courson. En effet.
Il est vrai que peu importe qui a transmis l’enregistrement à Mediapart. Ce qui compte, c’est le résultat, car c’est grâce à cela que la justice a pu faire son travail. En revanche, ce qui reste mystérieux, c’est que M. Gonelle ait attendu que tout soit révélé dans la presse pour se manifester.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mon général, comment définiriez-vous les rapports entre MM. Gonelle et Cahuzac ? Existait-il entre eux une complicité malgré leur combat politique ?
M. Gérard Paqueron. Je l’ignore. Michel Gonelle fait partie de ceux qui ont été battus aux élections municipales par Jérôme Cahuzac. Tous deux se livraient un combat politique pour la mairie de Villeneuve-sur-Lot, mais je ne sais pas du tout quels étaient leurs rapports.
M. le président Charles de Courson. Vous vivez tout de même dans la région et vous avez été le directeur de campagne de M. Bruguière – à laquelle, au moins au début, M. Gonelle a participé. Si vous deviez qualifier les relations entre MM. Cahuzac et Gonelle, que diriez-vous ?
M. Gérard Paqueron. Ce qui est sûr, c’est que M. Gonelle ne se heurtait pas avec M. Cahuzac : c’étaient des gens de bonne compagnie, qui se saluaient. Ils étaient adversaires politiques, M. Gonelle avait perdu, mais il n’avait pas de hargne.
M. le président Charles de Courson. Et M. Cahuzac ?
M. Gérard Paqueron. Je l’ai peu connu : je ne l’ai vu que trente secondes entre les deux tours. Il passait pour avoir une attitude assez hautaine, faisant de temps à autre des remarques cinglantes – comme ce « général de réserve »… Pendant le débat d’entre les deux tours, il a dit que Jean-Louis Bruguière était sorti dernier de l’école de la magistrature !
À Villeneuve-sur-Lot, les gens l’aiment bien, mais ils en parlent comme de quelqu’un d’acide, voire de hautain.
M. Philippe Houillon. Vous avez souligné que M. Bruguière était préoccupé par le dossier Carlos, que sa campagne électorale n’avait duré que quatre semaines ; lui-même a déclaré qu’on lui avait trouvé un directeur de campagne et un trésorier, sous-entendant qu’il ne les connaissait pas – alors que votre version est bien différente.
Nous avons tous ici fait une ou plusieurs campagnes électorales. En tant que directeur de campagne, vous avez forcément participé à des réunions stratégiques, à des discussions. M. Bruguière vous a-t-il paru combatif ou semblait-il suivre les événements de loin ? Voulait-il vraiment gagner ? Qu’éprouvait-il envers M. Cahuzac : de la hargne, de l’indifférence ? Vous avez nécessairement vécu cette ambiance !
M. Gérard Paqueron. Il est vrai que je pourrais écrire un livre sur cette campagne !
Pour être franc, Jean-Louis Bruguière n’a jamais quitté sa robe de magistrat : il était le juge antiterroriste, qui arrivait avec une certaine aura. En outre, il a passé sa vie à interroger des malfrats ou des terroristes qui se trouvaient face à lui, entre deux gendarmes. Cela ne pousse pas à être très gai, ni très communicatif !
Durant la campagne, il est resté égal à lui-même. Je me souviens que lorsque je marchais avec lui dans les rues de Villeneuve-sur-Lot, il m’arrivait de le rattraper pour lui dire : « Jean-Louis, regarde : ce couple de petits vieux t’a dit bonjour et tu n’as pas répondu ! ». Il avait la tête ailleurs…
J’ignore s’il était sûr de gagner, mais quand on obtient 41 % des voix au premier tour, on a quand même bon espoir. Jérôme Cahuzac avait 2 500 voix de retard ; en une semaine, il en a gagné 5 000 ! Le soir, il allait dans les cafés, il embauchait à tour de bras des personnes qui étaient au chômage – qu’il a dû licencier quinze jours après, mais qu’importe. Bref : il était sur le terrain. Sans vouloir le trahir, je dois dire que Jean-Louis Bruguière ne m’a pas donné la même impression de hargne.
M. Philippe Houillon. Que disait-il de M. Cahuzac ?
M. Gérard Paqueron. Il n’en parlait pas beaucoup. Il a bien préparé son face-à-face d’entre les deux tours ; ses dossiers étaient solides et Jérôme Cahuzac a été mis en difficulté plusieurs fois. Mais un débat couvert par Radio 4 et l’édition locale de Sud-Ouest, cela ne touche pas grand monde !
Par moments, il s’est trompé de campagne. Un jour, il m’a informé qu’un journaliste du Los Angeles Times allait le suivre pendant 48 heures. Je lui ai demandé : « A ton avis, combien de personnes lisent le Los Angeles Times dans le Lot-et-Garonne ? Ils lisent Le Petit Bleu ! ». Je le répète : il y aurait un livre à écrire !
M. Alain Claeys, rapporteur. Le connaissant comme vous le connaissez, s’il avait été en possession de la cassette, pensez-vous qu’il aurait voulu en savoir davantage ?
M. Gérard Paqueron. Il m’est difficile de vous répondre… Disons que, le connaissant comme je le connais, s’il a eu cette cassette et qu’il n’a pas voulu en savoir plus, c’est absurde.
M. le président Charles de Courson. Il nous a dit qu’il avait accepté de prendre la cassette de M. Gonelle, mais qu’il l’a jetée quelques semaines plus tard. Trouvez-vous cela crédible ?
M. Gérard Paqueron. Là, je ne peux pas vous répondre : il s’agit de son comportement personnel. C’eût été moi, je n’aurais pas pris la cassette !
M. le président Charles de Courson. Mon général, nous vous remercions.
Audition du mercredi 17 juillet 2013
À 15 heures 30 : M. Stéphane Fouks, président de Havas Worldwide France.
M. le président Charles de Courson. Nous poursuivons nos auditions de cet après-midi en recevant M. Stéphane Fouks, qui est le président de Havas Worldwide France, société qui portait auparavant le nom d’Euro RSCG.
Cette société a rempli, à l’automne dernier et au cours des quatre premiers mois de cette année, une mission de conseil en communication auprès du ministère de l’Économie et des finances, en particulier auprès de MM. Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac.
Par ailleurs, monsieur Fouks, vous êtes un proche de Jérôme Cahuzac, et, si on en croit la presse, vous l’avez conseillé après les révélations de Mediapart sur le compte qu’il aurait détenu à l’étranger.
Comme vous le savez, cette commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de « l’affaire Cahuzac ». Certains d’entre eux pourraient avoir consisté en une forme d’instrumentalisation de l’action administrative au sein de la stratégie de communication de l’ancien ministre délégué chargé du budget.
Avant d’aller plus loin, il me revient de vous préciser que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Stéphane Fouks prête serment.)
Si vous le souhaitez, je vais vous laisser la parole pour que vous exposiez quel a été votre rôle dans cette affaire.
M. Stéphane Fouks. Je n’ai pas de déclaration préalable à faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon Fabrice Arfi, c’est vous qui l’avez l’appelé, le 3 décembre 2012, après qu’il a adressé à Jérôme Cahuzac un courriel lui posant cinq questions en lien avec son compte non déclaré à l’étranger. Le confirmez-vous ?
M. Stéphane Fouks. Absolument.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quel titre avez-vous passé ce coup de fil ?
M. Stéphane Fouks. Après avoir reçu ce courriel, Jérôme Cahuzac m’a appelé pour me demander mon avis sur ce qu’il convenait de faire. Je lui ai dit que je voulais d’abord mieux comprendre ce qui se passait. J’ai donc appelé un correspondant chez Mediapart, puis Fabrice Arfi, avec qui j’ai eu une conversation. Cela m’a permis d’organiser la réunion entre Jérôme Cahuzac et Fabrice Arfi, destinée à permettre l’échange d’informations nécessaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quelle date Jérôme Cahuzac vous a-t-il révélé la vérité ?
M. Stéphane Fouks. À la toute fin. Lorsqu’il m’a téléphoné pour me dire qu’il avait pris rendez-vous avec le juge Van Ruymbeke, j’ai compris à demi-mot ce qu’il en était.
M. Alain Claeys, rapporteur. Après avoir aidé à organiser la rencontre avec M. Arfi, avez-vous conseillé Jérôme Cahuzac sur l’attitude à avoir face aux accusations de Mediapart ?
M. Stéphane Fouks. Lors de son premier appel, je lui ai évidemment demandé si ces accusations étaient fondées. C’est la première question que l’on pose en pareil cas, même à un ami. Il m’a répondu, comme il l’a fait à beaucoup d’autres, qu’elles étaient totalement infondées.
J’ai ensuite essayé de comprendre avec Fabrice Arfi jusqu’à quel degré il détenait des preuves. Il a d’ailleurs eu cette formule que j’ai relevée car je l’ai trouvée, à l’époque, savoureuse : « Jérôme Cahuzac peut-il me prouver qu’il n’a pas de compte en Suisse ? » Cette sorte d’inversion de la charge de la preuve est une question qui se pose à la communication – même si, en l’espèce, il faut reconnaître que le travail réalisé par Fabrice Arfi était juste et que ses révélations étaient exactes.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous recommandé à Jérôme Cahuzac de s’adresser directement à l’UBS pour qu’elle confirme qu’il ne détenait pas de compte ?
M. Stéphane Fouks. Je ne suis pas un spécialiste : ma formation de juriste est un lointain souvenir. Dans cette affaire, mon rôle a été de dire à quelqu’un qui s’affirmait innocent de se défendre et d’aller sur les plateaux de télévision et dans les médias pour défendre son innocence, et ce d’autant que les premiers documents publiés par Mediapart¸ il faut se le rappeler, n’étaient pas totalement convaincants. Ainsi, il était fait mention du rapport de cet inspecteur des impôts qui prétendait que Jérôme Cahuzac possédait plusieurs maisons à différents endroits. Le premier papier comprenait des éléments manifestement inexacts, sur la base desquels j’ai conseillé à Jérôme Cahuzac d’aller se défendre.
Par la suite, je suis très peu intervenu dans cette affaire. D’abord parce que, du point de vue de la communication, elle ne se déroulait pas tous les jours et ne nécessitait pas une présence régulière aux côtés de Jérôme Cahuzac.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous êtes intervenu, nous y reviendrons, en tant qu’ami et non dans le cadre du contrat qui liait votre société au ministère de l’économie et des finances.
Le moment où la Suisse répond à la demande française concernant l’éventuelle détention par Jérôme Cahuzac d’un compte à l’UBS entre 2006 et 2010 est important. Nous savons que les autorités suisses ont informé les conseils de Jérôme Cahuzac de la teneur générale de cette réponse. Dans les heures qui ont suivi, l’information selon laquelle la réponse de la Suisse est négative est publiée dans Le Nouvel Observateur et dans un article important du Journal du dimanche. Avez-vous eu cette information sur la réponse de la Suisse ? Si tel est le cas, avez-vous participé à des entretiens avec ces deux hebdomadaires ?
M. Stéphane Fouks. Je n’ai à aucun moment parlé à aucun journaliste du Journal du dimanche sur cette affaire. J’ai en revanche parlé avec la journaliste du Nouvel Observateur.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous connaissiez la réponse ?
M. Stéphane Fouks. J’avais du moins l’information partielle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Par qui ?
M. Stéphane Fouks. Par les conseils de Jérôme Cahuzac. Il s’agissait d’un document dont on ne connaissait pas la teneur exacte, mais qui allait dans le sens de ce que vous avez dit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Bref, vous avez été informé par les conseils de Jérôme Cahuzac de la teneur de la réponse des autorités suisses.
M. Stéphane Fouks. Oui. Et j’ai conseillé à la journaliste du Nouvel Observateur, conformément à mon orientation naturelle en tant que communicant, de ne pas y toucher. Dans une affaire judiciaire, seule la justice peut vous blanchir. Il ne sert à rien de passer par les médias pour tenter de peser d’une manière ou d’une autre sur le cours des choses. Quand des documents existent, mieux vaut les laisser être utilisés et révélés par les voies judiciaires, surtout s’ils sont favorables, que d’en faire quoi que soit.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-ce vous qui informez la journaliste du Nouvel Observateur ?
M. Stéphane Fouks. Non. Elle m’appelle parce qu’elle est au courant et veut discuter de cette information.
M. Alain Claeys, rapporteur. Elle est au courant par un des conseils de Jérôme Cahuzac ?
M. Stéphane Fouks. Elle ne me le dit pas, et je demande rarement aux journalistes quelles sont leurs sources.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les conseils de Jérôme Cahuzac vous ont-ils dit qu’ils ont eu des contacts avec le Journal du dimanche ?
M. Stéphane Fouks. Je ne crois pas qu’ils aient eu de tels contacts. En tout cas, nous n’en avons pas parlé.
M. le président Charles de Courson. Qui a pu donner cette information au Journal du dimanche ?
M. Stéphane Fouks. Je ne sais pas. J’ai découvert l’article dans le journal.
M. le président Charles de Courson. Beaucoup pensaient que c’était vous.
M. Stéphane Fouks. On nous attribue toujours beaucoup de choses.
M. le président Charles de Courson. On ne prête qu’aux riches…
M. Stéphane Fouks. J’allais le dire !
Mais je ne l’aurais de toute façon pas fait car, de mon point de vue, ç’aurait été contraire à l’intérêt de Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi ?
M. Stéphane Fouks. À ce moment-là, je suis persuadé de son innocence. En étant manifestée par la justice et non par les médias, cette innocence aura beaucoup plus de force. Je vous invite à vous reporter à la façon dont j’ai traité d’autres affaires médiatiques : je ne procède pas par fuites dans les médias. Je préfère assumer, parfois, le temps long de la justice pour qu’à la fin les choses soient comme elles doivent être.
Bref, je considérais vraiment qu’il appartenait à la justice, si elle le désirait, de faire sortir ce document, et certainement pas à nous.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu cette discussion avec Jérôme Cahuzac et ses conseils ?
M. Stéphane Fouks. Non.
M. le président Charles de Courson. D’après lui, ce sont ses avocats en Suisse qui l’ont appelé pour lui indiquer, non pas qu’ils avaient lu la lettre, mais que les autorités helvétiques leur avaient indiqué que la réponse était négative. Ces mêmes avocats vous appellent-ils directement ?
M. Stéphane Fouks. Non, c’est Jérôme Cahuzac qui le fait.
M. le président Charles de Courson. Vous dit-il que c’est une bonne nouvelle ?
M. Stéphane Fouks. Oui. Je réponds : « Chouette, il n’y a plus qu’à laisser faire les choses ! »
M. le président Charles de Courson. Pourquoi n’avez-vous pas utilisé l’information ?
M. Stéphane Fouks. Pour la raison que je vous ai donnée. Étant convaincu de l’innocence de Jérôme, je pensais qu’il serait beaucoup plus efficace que l’information soit utilisée et communiquée par la justice que par les médias. Lorsque les médias communiquent une information, il y a toujours – et c’est normal – un doute.
M. le président Charles de Courson. Lors de son audition, j’ai posé à Jérôme Cahuzac les questions suivantes : « Quel rôle M. Stéphane Fouks a-t-il joué dans votre communication durant toute cette période ? L’aide qu’il vous a apportée était-elle gratuite ou rémunérée ? Dans ce dernier cas, s’inscrivait-elle dans le cadre du contrat signé par le ministère de l’économie et des finances et celui du budget avec l’agence Havas Worldwide ? »
Voici ce qu’il me répond : « M. Stéphane Fouks n’a joué aucun rôle dans ma communication. D’abord, aux termes du contrat signé entre le ministère et l’agence, ce n’était pas lui qui était chargé de cette mission. Ensuite, il était un ami très proche ; ne lui ayant pas dit la vérité, je vois mal comment il aurait pu m’aider dans ma communication ! M. Fouks n’a joué aucun rôle institutionnel dans cette affaire. »
Êtes-vous étonné de cette réponse ?
M. Stéphane Fouks. Non, parce qu’il existe une ambiguïté liée au mot « institutionnel ». Il est évident que je n’ai eu aucun rôle institutionnel. Nous ne nous sommes parlé sur ce sujet que trois ou quatre fois pendant cette période. Il a été ensuite douloureux pour moi de découvrir qu’un ami m’avait menti.
Comme les avocats, les communicants ne sont pas forcément responsables des actions ou des turpitudes de leurs clients. Lorsque, en plus, il s’agit d’amis, c’est plus douloureux.
M. le président Charles de Courson. Il vous appelle le 3 décembre. Immédiatement après, vous appelez Laurent Mauduit, puis Fabrice Arfi. La rencontre a lieu dès le 4 au matin, à onze heures trente, d’après les déclarations des intéressés.
M. Stéphane Fouks. Le rendez-vous se fait sans moi.
M. le président Charles de Courson. Vous n’y étiez pas ?
M. Stéphane Fouks. Je n’avais aucune raison d’y être.
M. le président Charles de Courson. Mais c’est vous qui l’avez organisé.
M. Stéphane Fouks. Oui. Je crois avoir convaincu Jérôme Cahuzac, ou contribué à le convaincre, qu’il était préférable de rencontrer les journalistes. Il est toujours mieux d’avoir une discussion avec les personnes qui vous accusent et produisent des éléments contre vous. Mediapart faisant un travail de presse, un échange de points de vue était recommandable, même s’il n’y avait aucune chance que les parties se mettent d’accord. L’attitude consistant à conseiller à un ami ou à un client de rencontrer des journalistes qui l’accusent est normale et naturelle.
M. le président Charles de Courson. Alors pourquoi Jérôme Cahuzac nous répond-il : « M. Stéphane Fouks n’a joué aucun rôle dans ma communication » ?
M. Stéphane Fouks. Aucun rôle institutionnel.
M. le président Charles de Courson. Cela, c’est la dernière phrase de sa réponse.
M. Stéphane Fouks. J’ai toujours indiqué publiquement que Jérôme et moi avions eu évidemment quelques conversations à ce sujet. Quand un de vos amis est accusé et se dit innocent, vous lui dites : « Défends-toi ! »
Cela étant, je ne me suis pas chargé de sa défense, je n’ai pas organisé ses interviews, je n’ai pas parlé aux médias d’une manière proactive. Il a donc formellement raison lorsqu’il affirme que je n’ai joué aucun rôle institutionnel dans sa communication. C’est ce qui a d’ailleurs paru sur le site Le Lab d’Europe 1, selon lequel je n’étais pas effectivement en charge de sa communication.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour ce qui est du Nouvel Observateur, c’est la journaliste qui vous contacte pour avoir la confirmation de l’information ?
M. Stéphane Fouks. Oui. Elle m’appelle pour discuter de ce que je peux en penser. Je lui fais donc part de mon raisonnement, qui est de ne rien en faire parce que, dans ce type d’affaire, il faut laisser le temps de la justice se dérouler normalement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez donc aucun contact avec Le Journal du dimanche ?
M. Stéphane Fouks. Aucun.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quelque niveau que ce soit ?
M. Stéphane Fouks. À quelque niveau que ce soit. Je n’ai jamais parlé de cette affaire avec aucun journaliste du Journal du dimanche.
M. le président Charles de Courson. Lorsque Jérôme Cahuzac vous informe que la réponse de la Suisse est négative, en parlez-vous à des collaborateurs ou à des tiers ?
M. Stéphane Fouks. Non, à personne.
M. le président Charles de Courson. Il se réjouit de cette nouvelle. Je suppose que vous vous en réjouissez aussi puisque vous pensez qu’il est innocent.
M. Stéphane Fouks. Bien sûr.
M. le président Charles de Courson. Et vous n’en faites rien, vous n’en parlez à personne…
M. Stéphane Fouks. Certainement pas à mes collaborateurs. C’était quelque chose de séparé puisque j’agissais comme ami et que l’agence n’était pas en charge de la défense de Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Vous n’en parlez à aucune autre personne ?
M. Stéphane Fouks. Non, à aucune autre personne.
M. le président Charles de Courson. Vous gardez cela pour vous ?
M. Stéphane Fouks. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’en parlez pas aux responsables du groupe ?
M. Stéphane Fouks. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est un métier où l’on apprend à se taire.
M. le président Charles de Courson. En l’occurrence, ce n’était pas dans le cadre de votre métier mais, avez-vous dit, au titre de votre amitié avec Jérôme Cahuzac.
M. Stéphane Fouks. J’exerçais un rôle amical de conseil qui renvoie quand même à des règles professionnelles. Dans ce métier, on apprend à garder les choses pour soi. Nous sommes parfois détenteur des secrets de nos clients et nous sommes tenus à une forme de secret professionnel lorsque nous réalisons des opérations financières ou de communication pour lesdits clients. Depuis longtemps, les communicants – en tous cas les bons – ont appris à se taire.
M. le président Charles de Courson. Vous n’êtes cependant pas soumis au secret professionnel.
M. Stéphane Fouks. Pas au sens des professions régies par un ordre.
M. le président Charles de Courson. Ni au sens de la profession de journalistes.
M. Stéphane Fouks. Il n’y a pas d’ordre chez les communicants. Notre profession n’est pas héritée de Vichy.
M. le président Charles de Courson. Aucune loi ne vous protège de ce point de vue.
M. Stéphane Fouks. Il n’y a pas de texte, en effet, mais il existe un syndicat professionnel qui édicte des règles déontologiques.
M. Alain Claeys, rapporteur. Revenons-en à l’accord-cadre conclu entre votre société et le ministère de l’économie et des finances. Une décision cosignée par MM. Moscovici et Cahuzac confie à Havas une mission de conseil en communication. Pourriez-vous nous décrire cette mission ? Comment est-elle est reconduite ? Pouvez-vous nous éclairer sur son contenu car les sommes versées sont forfaitaires : 16 000 euros chaque mois.
M. Stéphane Fouks. Pas chaque mois. Au total, vous avez quatre factures sur une période d’un an.
Je rappelle que l’appel d’offres a été passé dans le cadre d’un marché lancé par la majorité précédente, qui avait sélectionné différentes agences de communication pour répondre aux éventuels appels d’offres de Bercy.
M. le président Charles de Courson. Il y a six factures, toutes de 16 000 euros. Chacune est accompagnée d’une annexe d’une page décrivant les prestations – note d’éléments de langage, note de stratégie, etc.
M. Stéphane Fouks. Vous avez les pièces. Au total, l’agence aura facturé 64 000 euros dans un marché d’un montant maximum de 130 000 euros. Elle a réalisé de nombreuses notes de cadrage, des travaux sur l’état de l’opinion concernant différents sujets, ainsi que des media trainings visant à préparer les interventions médiatiques des ministres. Bref, sa réponse s’inscrit dans le cadre de ce marché.
M. le président Charles de Courson. Pour votre information, nous avons copie de six factures de 16 000 euros hors taxe, soit 19 136 euros toutes taxes comprises. Le montant est le même mois après mois.
M. Stéphane Fouks. Le montant est en effet forfaitaire mais vous pourrez vérifier que ce n’est pas mois après mois.
M. le président Charles de Courson. J’ai ces documents devant moi. Ce n’est pas vous qui nous les avez communiqués mais l’État, à qui nous les avons demandés.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les personnes qui ont fourni ces prestations ne sont jamais intervenues dans l’affaire Cahuzac ?
M. Stéphane Fouks. Non. Pour ce qui me concerne durant la période, je n’ai participé à une réunion à Bercy qu’une seule fois, pour un déjeuner amical avec Jérôme Cahuzac et un autre ami. Je n’ai participé à aucune réunion avec aucun membre des cabinets. Il n’y a pas eu d’implication de ma part dans ce dossier. L’équipe qui en était chargée connaissait très bien Bercy, elle avait une bonne compréhension de la mécanique qui peut lier ou parfois tendre les relations entre le ministère de l’économie et celui du budget et s’employait à faciliter la nécessaire coordination entre les deux départements. Bien entendu, elle apportait également ses connaissances en matière de problématiques d’opinion et de problématiques médiatiques.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous continué à conseiller amicalement Jérôme Cahuzac après ses aveux.
M. Stéphane Fouks. Non. C’est très difficile… Au fond, il m’a fait mentir. Même si j’ai menti et me suis trompé de bonne foi, c’est forcément très désagréable. Ma réaction, au moment où il m’apprend qu’il m’a menti, est de lui dire que je ne peux plus rien faire. Ayant spontanément expliqué que je croyais à l’innocence de Jérôme, je ne pouvais épouser une thèse totalement opposée. Non seulement j’avais perdu toute crédibilité et toute légitimité pour le faire, mais j’avais aussi perdu toute envie. Un ami qui vous ment, cela rend forcément les choses plus difficiles.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour en revenir à l’article du Journal du dimanche, qui avait intérêt à sa publication ?
M. Stéphane Fouks. De mon point de vue, pas Jérôme Cahuzac. Encore une fois, j’étais convaincu de son innocence. Pour éviter tout soupçon et pour qu’il soit vraiment blanchi, il fallait que l’initiative vienne de la justice et non des médias.
M. Alain Claeys, rapporteur. Nous avons eu deux réactions. Le ministre de l’économie et des finances nous a dit hier que cet article l’avait mis en colère. Le procureur de Paris, lui, nous a indiqué avoir eu un doute. Il est donc légitime que notre commission se demande à qui cela a profité.
M. Stéphane Fouks. Je le répète, pas à Jérôme Cahuzac. En tout cas, je ne le pensais pas à ce moment-là même si, rétrospectivement, l’affaire est bien sûr plus complexe.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissant ce que vous connaissez maintenant, pensez-vous que la publication a pu profiter à Jérôme Cahuzac ?
M. Stéphane Fouks. Oui, mais in fine, non. Nous vivons une époque où il est impossible de cacher la vérité. La question n’est pas de savoir si elle va sortir – elle finit toujours par le faire – mais de savoir, éventuellement, quand et comment elle sortira. Tous les professionnels de la communication le disent : le mensonge est une arme imbécile qui se retourne contre ceux qui l’utilisent.
M. le président Charles de Courson. Combien de contacts avez-vous eu avec Jérôme Cahuzac entre le 3 décembre et le jour où il reconnaît posséder un avoir non déclaré à l’étranger.
M. Stéphane Fouks. Une demi-douzaine tout au plus.
M. le président Charles de Courson. D’un point de vue déontologique, l’existence d’un accord-cadre portant également sur la communication de crise des ministres ne posait-elle pas un problème ? L’entreprise que vous présidez conseillait les deux ministres. N’y avait-il pas un risque de confusion entre ce que vous faisiez à titre amical et les prestations qui étaient facturées ?
M. Stéphane Fouks. La question est légitime. La manière dont j’y ai répondu a été tout d’abord de considérer que l’on ne peut jamais renoncer à défendre un ami. Il faut assumer la charge de ce devoir d’amitié. Pour le reste, comme la crise ne concernait pas le ministère mais la personne, il était clair que le contrat ne jouait pas dans cette affaire. C’est la raison pour laquelle je n’en ai parlé à aucun des collaborateurs de l’agence. Ma relation avec Jérôme Cahuzac n’était qu’amicale. Pour l’essentiel, d’ailleurs, elle consistait à lui dire : « Puisque tu te dis innocent, défends-toi ! Si tu ne te défends pas, personne ne le fera à ta place. »
M. Philippe Houillon. M. Valls nous a dit hier qu’il vous avait vu pendant cette période. Quelles ont été vos réflexions et observations sur l’affaire Cahuzac ?
M. Stéphane Fouks. Nous n’avons pas parlé de cette affaire parce que nous ne pouvions pas en parler : qu’auriez-vous voulu qu’il me dise ? S’il avait des informations, ce n’est pas à moi qu’il devait les donner. J’ai donc évité le grotesque de lui poser des questions auxquelles il n’aurait pas pu répondre. Nous nous sommes vus, nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de politique, mais pas de ce sujet sur lequel nous n’avions rien à échanger.
M. Philippe Houillon. Pas un mot sur Cahuzac pendant quatre mois ?
M. Stéphane Fouks. Pas un mot. Et, croyez-moi, ce n’était pas difficile !
M. Philippe Houillon. Ce qui est difficile, c’est de croire cela !
M. Stéphane Fouks. Nous avons bien d’autres sujets de conversation, et ce depuis des années.
M. Georges Fenech. M. Pierre Moscovici nous a confirmé hier, sous la foi du serment, la tenue d’une réunion à l’Élysée le 16 janvier, à laquelle participaient le Président de la République, le Premier ministre, M. Jérôme Cahuzac et lui-même. Notre commission – faut-il le rappeler ? – est indépendante du pouvoir exécutif et possède des pouvoirs d’enquête importants. Elle travaille sous le regard des Français, qui attendent d’elle qu’elle fasse toute la lumière sur les dysfonctionnements dont elle est saisie. J’émets solennellement le vœu qu’elle aille jusqu’au bout de son enquête. Nous ne devons pas nous arrêter à la porte de Matignon. Il est incontournable que nous entendions le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault. Non seulement il était présent à cette réunion, mais il est celui qui aurait pu démettre Jérôme Cahuzac entre le 4 décembre et le 19 mars. Comme des échanges ont eu lieu avec M. Valls, M. Moscovici et Mme Taubira, il est important pour nous de recueillir sa position sur cette affaire.
En tant que membre de la commission d’enquête, je réitère donc mon souhait d’entendre à nouveau Jérôme Cahuzac en raison de la contradiction, apparue hier au grand jour, avec M. Moscovici, et je demande l’audition du Premier ministre.
M. le président Charles de Courson. Nous en débattrons après l’audition. Le rapporteur et moi en avons parlé. Selon la procédure que nous avons toujours suivie, je vous ferai voter, le cas échéant, sur les auditions à mener.
Avez-vous des questions à poser à M. Fouks ?
M. Georges Fenech. Je n’ai pas de question.
Mme Cécile Untermaier. M. Cahuzac vous a-t-il dit qu’il cherchait à obtenir des autorités suisses une lettre infirmant les propos de Mediapart ?
M. Stéphane Fouks. Je n’ai jamais été impliqué dans la procédure.
Mme Cécile Untermaier. Vous en a-t-il néanmoins parlé, ou le lui avez-vous conseillé comme étant le meilleur moyen pour établir la vérité ?
M. Stéphane Fouks. Non. Je ne suis pas un spécialiste du droit fiscal suisse.
Mme Cécile Untermaier. Ce n’est pas une question de droit fiscal mais de bon sens.
M. Stéphane Fouks. Pour moi, c’était aux autorités judiciaires françaises et suisses d’établir la matérialité du compte de Jérôme Cahuzac. Cela dépasse mes compétences de communicant.
Mme Cécile Untermaier. De même que vous lui avez fait rencontrer M. Arfi, vous auriez pu lui suggérer une démarche en ce sens. Cela n’a pas été jusque là ?
M. Stéphane Fouks. Non.
M. le président Charles de Courson. Mme Untermaier fait allusion à la possibilité que Jérôme Cahuzac avait d’écrire à l’UBS pour lui demander, selon une rédaction soigneusement pesée certes, de confirmer que l’établissement et lui étaient en relation d’affaires et qu’il y détenait un ou plusieurs comptes. D’après ce que M. Moscovici nous a dit hier, cette démarche avait été évoquée. M. Cahuzac vous en a-t-il parlé ?
M. Stéphane Fouks. Non, je vous le confirme.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez parlé d’une demi-douzaine de rencontres avec Jérôme Cahuzac dans la période qui nous intéresse. À quel moment se sont-elles produites ?
M. Stéphane Fouks. Plutôt au début. Nous nous sommes vus le soir de la sortie du papier de Mediapart. Nous avons eu ensuite des échanges téléphoniques, puis, avec l’enquête, l’affaire est pour ainsi dire sortie du champ de la communication pure. D’un certain point de vue, la communication avait atteint son objectif : éviter que la condamnation médiatique ne précède la condamnation juridique. Trop souvent, des personnes attaquées médiatiquement se retrouvent condamnées médiatiquement alors même qu’elles seront peut-être plus tard blanchies par la justice.
J’ai eu aussi Jérôme Cahuzac au téléphone pour préparer son débat avec Jean-Luc Mélenchon et lui donner des éléments de sensibilité et de positionnement sur ces sujets. Après, cela s’est arrêté. Dès lors que nous avions le document du procureur de Paris, il était pour moi assez clair que l’affaire avait pris un autre tour et que la communication n’avait strictement plus aucun rôle à jouer.
Mme Cécile Untermaier. Jusqu’à quand avez-vous été convaincu par l’affirmation de Jérôme Cahuzac selon laquelle il n’avait pas de compte en Suisse ?
M. Stéphane Fouks. Je me suis vraiment trompé de bonne foi. J’ai longtemps cru à son innocence et je n’étais pas convaincu par les affirmations de Mediapart : les éléments apportés posaient des questions mais aucun n’apportait de preuve ; certains – même s’ils étaient rapportés par des personnes interrogées par Mediapart et non affirmés par le média lui-même – étaient même matériellement inexacts. J’ai commencé à avoir beaucoup plus de doutes à partir du moment où le procureur de la République transmet le document. Pour qui sait lire les communiqués de presse comme nous apprenons à le faire, cette personne s’est forgée une conviction très forte, qui va certainement au-delà des éléments exprimés dans le communiqué. Le doute est alors devenu inquiétude.
M. le président Charles de Courson. Ne pensez-vous pas que vous avez participé à convaincre le monde des médias, voire le monde politique, de l’innocence de Jérôme Cahuzac ?
M. Stéphane Fouks. Je pense que Jérôme Cahuzac a réussi à convaincre beaucoup de monde de son innocence, y compris moi.
M. le président Charles de Courson. Vous étiez aussi une victime ?
M. Stéphane Fouks. Je n’ai pas envie de le dire comme cela. En tout cas, nous sommes nombreux à avoir cru à l’innocence de Jérôme Cahuzac.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le soir même de la déclaration de Mediapart, vous rencontrez Jérôme Cahuzac. Un mois après, le 8 janvier, lorsqu’il se déporte de son dossier au ministère, vous informe-t-il de cette décision ?
M. Stéphane Fouks. Non. Je ne suis pas concerné.
Mme Marie-Christine Dalloz. On a suffisamment communiqué autour de cette « muraille de Chine » pour qu’il puisse vous informer de la mesure !
M. Stéphane Fouks. Encore une fois, je ne suis pas entré dans les aspects techniques du dossier auprès de lui. Comme il vous l’a dit, je n’ai pas eu de rôle institutionnel. Donc je n’ai pas examiné avec lui ces détails.
Mme Marie-Christine Dalloz. Selon ce que nous a dit M. Moscovici hier, une réunion se tient le 16 janvier, après le Conseil des ministres. Quatre personnes y participent : le Président de la République, le Premier ministre, Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac.
Lors de la rédaction de la demande d’entraide administrative et fiscale aux autorités suisses, Jérôme Cahuzac est présent. Il semblerait que c’est lui qui élargit le champ de la demande d’investigation. En êtes-vous informé ?
M. Stéphane Fouks. Non. Dans la seule discussion, de cadre plus général, que nous avons à ce moment-là, je lui conseille seulement d’obtenir le plus vite possible la preuve la plus large possible qu’il n’a pas de compte en Suisse. Nous sommes dans cette situation un peu particulière où on demande à la personne que l’on accuse de faire la preuve de son innocence. En soi, cela interroge notre métier et, probablement, vous pose également question. Ce que je fais remarquer à Jérôme Cahuzac, c’est que dans ces conditions il n’a pas d’autre choix que d’obtenir la preuve la plus large et la plus indiscutable possible de son innocence et de l’absence d’un compte en Suisse. Encore une fois, je lui dis cela parce que je suis alors convaincu qu’il n’en a pas.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quand lui donnez-vous ce conseil ?
M. Stéphane Fouks. Au tout début de l’affaire, dans les deux premiers jours.
M. Christian Assaf. Je serai peut-être redondant mais il est important que notre commission fasse litière de certaines rumeurs.
Vous n’êtes pas un expert fiscal helvétique, c’est entendu, mais vous restez néanmoins un expert de la communication jouissant d’une certaine notoriété et d’une certaine expérience en la matière. Entre le 4 décembre et le 19 mars, vous n’avez pas eu d’éléments d’information et d’analyse provenant du monde médiatique ou de la communication vous laissant penser que finalement, comme beaucoup d’entre nous, vous étiez en train de vous faire berner ?
M. Stéphane Fouks. Pas d’éléments qui fussent des preuves. J’ai évidemment rencontré des personnes – journalistes ou autres – qui m’ont fait état de leur conviction que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse. Je les ai entendues, d’autant que l’on ne pouvait pas exclure qu’elles aient raison. Mais ma conviction à ce moment-là est que personne n’a apporté de preuve et je crois la parole de Jérôme Cahuzac, dite avec force, sur son innocence.
M. Christian Assaf. Dès lors, vous ne lui avez jamais conseillé de ne jamais avouer ?
M. Stéphane Fouks. C’est de toute façon la pire des choses à faire. Notre métier est un métier d’exercice de la vérité. Nous travaillons à construire des marques dans le monde entier. Comment construire la confiance sur le mensonge ? Cette problématique vaut aussi, de manière générale, pour les politiques. J’observe par parenthèse que les cultures sont différentes entre le monde de l’entreprise et le monde politique à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, la culture et la discipline de l’agence Havas en matière de communication de crise pour l’ensemble de ses clients dans le monde, c’est d’être toujours dans la vérité.
Nous faisons du reste une différence entre la vérité et la transparence, qui est pour nous un faux ami car elle met tout au même niveau. Dire de quelqu’un qu’il est transparent n’est pas forcément un compliment !
En revanche, la culture de notre métier veut que tout ce qui est dit doit être vrai. C’est d’autant plus important que nous vivons dans une société qui a de la mémoire, que tout se sait et que tout s’entend.
Pour répondre précisément à votre question, si Jérôme Cahuzac m’avait dit qu’il avait un compte en Suisse, je lui aurais bien évidemment conseillé de démissionner et d’expliquer qu’il avait fait une connerie. Alors l’affaire n’aurait pas pris l’ampleur qu’elle a prise aujourd’hui.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Fouks, merci.
Audition du mardi 23 juillet 2013
À 9 heures 30 : Mme Marion Bougeard, conseillère pour la communication et les relations extérieures au cabinet de M. Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Avant de commencer l’audition, j’ai quelques informations à vous donner.
M. le rapporteur et moi-même avons rencontré M. Falciani. L’entretien était intéressant mais nous n’avons rien découvert de très nouveau. Selon la thèse défendue, les banques sont, dans le domaine informatique, toujours en avance sur l’évolution de la réglementation car elles travaillent en amont pour anticiper et inventer de nouveaux mécanismes pour dissimuler les comptes détenus.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et la France collabore avec l’Espagne.
M. le président Charles de Courson. En effet, M. Falciani considère que l’Espagne est en avance par rapport à la France, s’agissant des capacités à extraire des informations utiles à l’administration fiscale. Et nos deux administrations travaillent ensemble pour obtenir des fichiers davantage que les 3 000 noms qu’ils ont déjà révélés, ce que M. Falciani estime possible.
Par ailleurs, Mme Taubira nous a fait parvenir sa réponse aux deux questions que nous lui avons posées et qui vous a été distribuée. Elle confirme grosso modo ce qu’avait dit la directrice de la direction des affaires criminelles et des grâces – et supposé le procureur –, à savoir qu’il n’y avait pas de précédent.
M. le rapporteur et moi-même souhaitions auditionner le technicien du son qui a transposé l’enregistrement conservé sur le téléphone de M. Gonelle. Je le rappellerai en fin de matinée, mais il est réticent à venir s’exprimer devant la Commission, même si les questions que nous lui poserons sont simples, puisqu’elles tourneront autour de l’hypothèse d’une « troisième voie », c'est-à-dire d’un troisième détenteur.
Je vous ai aussi transmis par mail la lettre que m’a adressée Pierre Moscovici, et qui a été publiée par la presse. Ma réponse est prête et sera diffusée dans peu de temps.
Nous entamons ce qui devrait être notre dernière semaine d’auditions, en recevant Mme Marion Bougeard, qui était membre du cabinet de M. Jérôme Cahuzac, en charge de sa communication.
Nous avons déjà reçu plusieurs membres du cabinet de Jérôme Cahuzac, dont sa directrice, ainsi que, la semaine dernière, M. Stéphane Fouks, avec lequel vous avez travaillé à Euro RSCG.
Notre commission d’enquête se demande si, dans la gestion de « l’affaire Cahuzac », certains des services de l’Etat n’auraient pas fait l’objet d’une forme d’instrumentalisation dans le cadre de la stratégie de communication de l’ancien ministre délégué chargé du budget.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de bien vouloir chacun à votre tour lever la main droite et dire « je le jure ».
(M. Marion Bougeard prête serment.)
Mme Marion Bougeard, ancienne conseillère pour la communication et les relations extérieures au cabinet de M. Jérôme Cahuzac. Avant de répondre à vos questions, je crois nécessaire de rappeler pourquoi nous avons cru cet homme. Plusieurs de ses collaborateurs, dont j’étais, avaient travaillé plusieurs années avec lui. Engagés comme militants socialistes, nous avons – nous avions – l’impression de partager des valeurs et des principes qui nous semblaient être communs. C’était un homme qui nous poussait plus loin, qui nous apprenait énormément, qui nous faisait confiance même quand nous maîtrisions les sujets moins bien que lui, qui ne négligeait jamais nos opinions. Il donnait aussi l’impression d’avoir un sens immense de l’amitié. Vous imaginez donc l’émotion d’avoir cru connaître cet homme, de l’avoir cru – nous avions pour lui une admiration incroyable – et la déception immense, la souffrance intense et le sentiment de trahison que nous avons éprouvés. J’insiste parce que, quand vous admirez quelqu’un à ce point, vous vous engagez au point d’y passer vos nuits et vos jours, vous sacrifiez vos week-ends, votre vie de famille, certaines de vos relations, cela s’explique par la force démesurée de sa capacité de conviction.
Je suis désolée de cette digression qui a peu à voir avec d’éventuels dysfonctionnements.
Le 3 décembre, je suis porteuse d’un e-mail envoyé sur une adresse électronique qu’il ne consultait pas, et que j’ai imprimé pour le lui apporter dans l’hémicycle, où s’ouvraient les débats du collectif budgétaire de fin d’année. J’étais attendue au banc puisque les membres d’un cabinet sont présents aux côtés du ministre de façon à rédiger ses réponses. Je lui apporte donc une enveloppe contenant cet e-mail et les questions qu’il pose, et dont j’ai évidemment pris connaissance. J’ai écrit à la main « Quelles sont tes instructions ? » – la question la plus ouverte à mes yeux –, mais j’aurais pu aussi transmettre le message sans l’annoter. Sa réaction immédiate – peut-être certains en ont-ils été témoins – a été de déchirer le papier en mille morceaux et de me les jeter à la figure, à la stupéfaction de ceux qui étaient autour de moi. Il a élevé la voix alors qu’il était dans l’hémicycle. Je pense qu’il était d’emblée résolu à dissimuler la double vie qu’il avait menée pendant des années et qu’il a laissé libre cours à sa colère, pour me convaincre, moi. Avec d’autres personnes, il utilisera d’autres moyens. Il doit imaginer que le fait de le voir ainsi, désireux de se battre, c’est ce dont j’ai besoin pour être convaincue.
Ce soir-là, oui, je l’ai cru. Oui, je lui ai conseillé de se défendre, et de choisir des avocats. Je lui ai proposé deux noms ; il n’en a retenu aucun. Évidemment, je l’ai cru quand il a juré devant vous tous. En ce qui me concerne, je ne peux pas imaginer que l’on mente à la représentation nationale et au Président de la République. C’est peut-être naïf, mais, à aucun moment, je n’ai pensé qu’il osait prendre un tel risque.
Évidemment, j’ai douté. Comment ne pas douter ? Mais il était tellement droit dans ses bottes qu’il aurait été extrêmement compliqué de soutenir une conversation sur un tel doute.
Mon travail au sein du cabinet ne consistait pas à faire la communication de l’homme, mais à porter les messages et assurer la communication de ce que certains d’entre vous ont beaucoup dénoncé, et qui s’appelait le « redressement dans la justice ». L’affaire éclate au moment où nous entamons la lecture du collectif budgétaire. Nous enchaînons avec les deuxièmes lectures du projet de loi de finances, de la loi de programmation des finances publiques et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous passons donc trois semaines entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Mon travail consiste à faire en sorte que le ministre pour lequel je travaille soit prêt pour les débats, dispose de ses réponses, des argumentaires sur les amendements. Parce que j’avais une équipe qui s’occupait beaucoup des relations presse du ministère, ma tâche principale était de travailler les argumentaires, les dossiers de presse et l’ensemble des fiches qui sont à la disposition de tous pour préparer les débats parlementaires.
Oui, j’ai répondu aux médias. Surtout dans cette période très particulière du calendrier budgétaire où nous – plusieurs collaborateurs étaient concernés – étions aux côtés du ministre. J’ai répondu essentiellement sur des éléments biographiques, pour des portraits, car, à ce moment-là, l’intérêt des médias se focalisait sur l’homme qui, même s’il bénéficiait d’une image médiatique importante dans l’équipe gouvernementale, était encore très peu connu du grand public.
Je n’avais de toute façon pas d’information sur l’affaire. Dès lors qu’il a pris un avocat, c'est-à-dire le soir même, et qu’il a eu des réunions quotidiennes, ou hebdomadaires – je ne connaissais pas tout son agenda – avec ses conseils, c’est avec eux qu’il a décidé de sa stratégie. Je n’ai jamais eu à écrire une note, ou ce qu’il est convenu d’appeler « élément de langage » et que j’appelle toujours message clef ; bref, je n’ai jamais eu à écrire quoi que ce soit sur cette affaire, puisque l’essentiel des interventions médiatiques du ministre pour lequel je travaillais portait sur les questions budgétaires et financières de la France. C’était ce pour quoi j’étais rémunérée au sein du cabinet, et le travail d’un membre de cabinet ne diminue pas parce qu’il y a une affaire médiatique. Je n’étais pas déchargée de mon travail parce qu’il se passait quelque chose. La répartition des tâches s’est rapidement faite entre les avocats, chargés de l’homme, et les collaborateurs qui travaillaient pour le ministre et pour le Gouvernement, dans une période où, je le rappelle, une simple circulaire de la direction du budget a fait la une de certains journaux. Dès le mois de janvier, la matière budgétaire était devenue un sujet éminemment appétissant. Dans ce contexte, mon travail n’a pas du tout baissé en intensité – je parle évidemment du travail pour lequel j’étais rémunérée. Non, je n’ai livré aucune information aux médias, tout simplement parce que je n’en avais pas.
Au sein du cabinet – la directrice de cabinet l’a évoqué –, le sujet n’était pas omniprésent puisque notre tâche quotidienne était extrêmement lourde. Les appels que je recevais étaient de ceux que l’on pose traditionnellement à un collaborateur du ministre du budget. Oui, j’ai poursuivi ma tâche, même si cela peut paraître étonnant. Je rappelle qu’au même moment, nous lançons la campagne de communication sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), nous lançons un nouveau site web, nous lançons la refonte du site impots.gouv.fr dans le cadre de la simplification administrative qui sera engagée par le Président de la République quelques semaines plus tard. Nous préparons, je le dis avec une pointe d’ironie, le comité national de lutte contre la fraude avec de nouvelles mesures, ainsi que la publication des statistiques européennes sur le déficit des États membres, etc. Nous n’avions pas à nous préoccuper de la communication de l’homme, d’autant moins que l’agenda de communication du ministre était extrêmement chargé.
Par ailleurs, nous préparions bien évidemment les interventions médias et si je n’ai pas eu le courage de relire les scripts, je peux me fier à ma mémoire : à l’exception des deux premières ou des deux dernières questions d’une interview, 95 % d’entre elles portaient sur les sujets d’actualité budgétaire et financière qui ont, au long du premier trimestre, préoccupé les médias.
Oui, j’ai appris la vérité le 2 avril. J’avais quitté le cabinet le 20 ou le 21 mars, sur les derniers mots de cet homme : « Ne doute jamais de moi. » Je l’ai eu une fois au téléphone la semaine d’après. Il m’a dit : « Ne t’occupe pas de moi, préoccupe-toi de toi. » Au regard des événements qui ont suivi, ces propos prennent tout leur sens et leur saveur. J’ai tout découvert le 2 avril. Un de ses amis a entendu la radio – moi non, car je n’étais pas à Paris – et il m’a appelé pour partager le fardeau d’une vérité qu’il avait apprise de la bouche de cet homme quelques heures auparavant.
Ç’a été, c’est très difficile. On ne se remet pas d’une trahison politique et amicale en un tournemain. Reconnaître qu’on a été abusé est extrêmement difficile. La limite entre l’abus et la manipulation est très fine. Vu la masse de travail que nous avions au sein du cabinet du budget, je peux vous affirmer que non, je n’ai pas été manipulée, mais que j’ai été abusée.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelles étaient vos fonctions auprès de Jérôme Cahuzac, avant votre arrivée au cabinet ?
Mme Marion Bougeard. J’ai rencontré Jérôme Cahuzac au moment où il constituait une équipe pour rédiger ce qu’il appelait le pacte fiscal. Il était à l’époque président de la commission des finances. Je l’avais croisé deux fois auparavant, à l’occasion d’événements qui se déroulaient à l’Assemblée. J’ai donc intégré l’équipe en janvier 2011 puisque le pacte a été présenté en mars 2011. Mon travail consistait essentiellement à rédiger des argumentaires liés à la réforme fiscale qu’il proposait alors, en prévision des primaires. J’avais une spécialité qui était la finance, le monde de la banque et des opérations financières. J’apportais à la fois une expertise du monde du privé, et une plume. Je ne m’occupais pas à l’époque de ses relations presse puisqu’il avait un attaché de presse dans le Lot-et-Garonne.
M. le président Charles de Courson. Vous faisiez ça gratuitement ?
Mme Marion Bougeard. Oui, bénévolement, comme militante socialiste.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous étiez salariée d’EuroRSCG ?
Mme Marion Bougeard. Oui, tout à fait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous dites avoir conseillé deux noms d’avocat à Jérôme Cahuzac, qu’il n’a pas retenus. Quels autres conseils lui avez-vous prodigué pendant la période ?
Mme Marion Bougeard. Essentiellement de dormir. Et de travailler.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pas de s’adresser directement à UBS ?
Mme Marion Bougeard. Très sincèrement, ses avocats avaient pris en charge toute l’affaire et, à l’exception d’une discussion à propos d’un article qui mentionnait cette possibilité, je pense qu’il n’avait pas envie d’en discuter avec moi.
M. le président Charles de Courson. L’idée de s’adresser directement à l’UBS a été évoquée, mais que vous a-t-il répondu ?
Mme Marion Bougeard. Qu’il avait pris des avocats en Suisse, pour formuler cette demande.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les avocats en Suisse avaient entamé les démarches…
Mme Marion Bougeard. C’est ce qu’il m’a indiqué.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel était le rôle de Stéphane Fouks durant cette période ?
Mme Marion Bougeard. Très sincèrement, je pense que Stéphane a joué le rôle d’un ami, stupéfait par les accusations portées. Je n’ai pas été en relations avec lui sur la période, mais je n’ai pas eu l’impression qu’il était particulièrement présent, pour tout vous dire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il a tout de même téléphoné à Mediapart.
Mme Marion Bougeard. Oui. Je l’ai appris dans les médias le lendemain. J’ai alors pris sur moi de démentir l’information selon laquelle il aurait été recruté pour s’occuper de l’affaire. J’ai prévenu Stéphane Fouks et il m’a donné raison car c’était faux.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand vous découvrez le titre du JDD, affirmant que Jérôme Cahuzac n’a pas de compte en Suisse, quelle est votre réaction ?
Mme Marion Bougeard. Je suis assez stupéfaite parce que, toute la semaine, il y avait eu des articles. Je n’avais jamais entendu parler de la demande d’entraide, pour être précise.
M. Alain Claeys, rapporteur. Jamais ?
Mme Marion Bougeard. Jamais. Je l’ai découverte dans le Nouvel observateur. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais c’était un mardi soir vers 19 heures. L’article était en ligne depuis une heure et j’en avais été avertie par un message.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous le découvrez dans le Nouvel observateur, qui annonce que le ministre n’a pas de compte en Suisse.
Mme Marion Bougeard. Exactement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous n’avez pas été informée avant ?
Mme Marion Bougeard. Jamais.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et avant la parution du Nouvel observateur, vous n’avez pas été informée du résultat de la demande d’entraide ?
Mme Marion Bougeard. Jamais.
M. le président Charles de Courson. Vous n’en avez pas parlé avec le ministre, ne serait-ce que pour vous réjouir de cette bonne nouvelle qui l’innocentait ?
Mme Marion Bougeard. Je lui ai plutôt fait part de mon étonnement que les médias aient l’information alors qu’elle était destinée à la justice.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et quelle a été sa réponse ?
Mme Marion Bougeard. Je crois qu’il m’a dit : « Oui, ce n’est pas très bon. »
M. le président Charles de Courson. Vous ne savez pas qui a transmis à la presse ?
Mme Marion Bougeard. Je n’ai aucune information à ce sujet. Pour être extraordinairement précise, le journaliste du JDD m’a contactée en fin de matinée le jeudi. La conversation a été relativement brève puisque je lui ai dit que je n’avais aucune information et qu’il y avait une dépêche de Reuters selon laquelle les faits n’étaient pas si clairs.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quel était l’objet de l’appel ?
Mme Marion Bougeard. Très clairement, de trouver la lettre. J’ai souhaité bon courage à mon interlocuteur.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissait-il la teneur de la réponse ?
Mme Marion Bougeard. Le journaliste ne m’a rien dit à l’époque, mais j’imagine qu’il l’avait lu.
M. le président Charles de Courson. C’était quel jour ?
Mme Marion Bougeard. Le jeudi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Où avait-il lu l’information ?
Mme Marion Bougeard. Je récapitule. Le mardi, l’article du Nouvel observateur sort, suivi le mardi soir par une dépêche Reuters citant des sources proches du procureur et indiquant que ce « n’est pas si clair que ça » – je me souviens de la formule. Le jeudi matin, Pierre Moscovici, interrogé sur France Inter, déclare que la réponse « laisse peu de doutes », mots qu’il a d’ailleurs repris devant vous. Au cours de la journée du jeudi, le journaliste du JDD me contacte et je le renvoie aux conseils juridiques en lui disant que je n’ai pas d’information et en lui souhaitant bonne chance. Comme il s’agit d’un document couvert par le secret fiscal, je ne vois pas comment j’aurais pu y avoir accès.
Je précise que je n’ai jamais eu accès au moindre document de cet ordre car je ne suis pas habilitée au secret fiscal.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est le procureur qui répond aux journalistes que la réponse « n’est pas si claire que ça ». Nous sommes alors le 3 février. Cela correspond à la chronologie puisque le procureur a la teneur de la réponse depuis le 1er février. Pas d’autre contact ?
Mme Marion Bougeard. Aucun autre contact. Je découvre l’article le dimanche. Et je me souviens, le lundi, d’avoir croisé le ministre. Et il n’était pas satisfait de l’article.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour quelle raison ?
Mme Marion Bougeard. Je pense qu’il l’inquiète. Mais je ne peux pas me mettre à la place – pardon pour le terme – d’un menteur de ce niveau. Je ne joue pas au poker et je ne bluffe pas. Il a cru qu’il avait une meilleure main que tout le monde.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 16 janvier, à l’issue du conseil des ministres, a lieu une entrevue entre le Président de la République, le Premier ministre, Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac au cours de laquelle Pierre Moscovici informe le Président de la République de son intention de saisir les autorités suisses. Vous parle-t-il de cette réunion ?
Mme Marion Bougeard. Absolument pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous quittez le cabinet le 20 mars et vous apprenez la vérité le 2 avril…
Mme Marion Bougeard. …à 16 heures. Je m’en souviendrai très longtemps.
M. Alain Claeys, rapporteur.. Au cours de votre passage au cabinet, avez-vous entendu parler de M. Garnier ?
Mme Marion Bougeard. Oui, puisque je suis destinataire de questions de Mediapart, portant sur une entrevue entre le ministre pour lequel je travaillais et M. Garnier qui aurait eu lieu – je n’en étais pas informée à ce moment-là – fin octobre à Villeneuve-sur-Lot.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelles sont les questions que vous pose Mediapart ?
Mme Marion Bougeard. Mediapart veut savoir si la rencontre a bien eu lieu, de quoi il a été question, et connaître la réponse du ministre pour lequel je travaillais aux demandes de M. Garnier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous été associée à la préparation de l’entretien entre les deux hommes ?
Mme Marion Bougeard. Pas du tout, puisque je reçois les questions de Mediapart en novembre. J’ai suivi le circuit classique dans un cabinet, c'est-à-dire que je m’adresse à ma directrice de cabinet et lui transmets les questions. Les réponses prennent un certain délai puisque je m’en excuse auprès du journaliste, et sont faites directement par le ministre dans la semaine. Il confirme qu’il a bien rencontré ce monsieur qui combat pour son honneur, que seule la justice peut laver l’honneur d’un homme, et que le ministre qu’il est « ne peut soutenir la demande d’assistance fonctionnelle en partant du principe que les derniers procès en cours qui permettraient à l’administration de prendre en charge les frais d’avocat de l’inspecteur des impôts en question l’opposent également à ses anciens supérieurs hiérarchiques ». Je cite de mémoire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour en revenir au JDD, que cherchent ceux qui vous contactent ? Confirmation d’un document qu’ils ont entre les mains ?
Mme Marion Bougeard. Pas du tout. Je crois qu’ils cherchent le document, c’est ce que je comprends.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ils connaissent l’information ?
Mme Marion Bougeard. Ils ont lu le Nouvel obs !
M. Alain Claeys, rapporteur. Avec lequel Stéphane Fouks a été en relation. Sont-ils entrés en contact avec le procureur ?
Mme Marion Bougeard. Je ne sais pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. La « muraille de Chine », une fois dressée, a-t-elle concrètement changé quelque chose à votre travail ?
Mme Marion Bougeard. À partir du moment où je n’étais pas habilitée au secret fiscal avant, je ne le suis toujours pas après.
M. le président Charles de Courson. Le ministre ne vous a jamais parlé de la réunion du 16 janvier à l’Élysée, mais en a-t-il évoqué une autre avec vous, celle du mercredi 5 décembre 2012, tenue à l’issue du conseil des ministres, en présence uniquement du Président, du Premier ministre et de Jérôme Cahuzac, et à l’occasion de laquelle il avait indiqué au Président qu’il allait saisir la banque pour prouver son innocence ? De votre côté, lui avez-vous suggéré cette piste après un article que vous aviez lu ? Vous souvenez-vous de la date exacte ?
Mme Marion Bougeard. Très sincèrement, les premiers jours sont un véritable tourbillon. Beaucoup d’entre vous ici ont assisté aux débats parlementaires et nous avons passé quelques journées et quelques nuits difficiles. Non, je ne crois pas qu’il m’ait parlé de l’engagement envers le Président de la République d’obtenir une réponse d’UBS. Dans mon souvenir, la chose avait déjà été discutée avec ses conseils juridiques, puisqu’ils avaient un correspondant au barreau de Genève.
M. le président Charles de Courson. Pouvez-vous situer dans le temps la conversation à ce sujet que vous avez évoquée tout à l’heure en réponse au rapporteur ?
Mme Marion Bougeard. C’était tout début décembre.
M. le président Charles de Courson. Juste après le déclenchement de l’affaire ?
Mme Marion Bougeard. Dans les premiers jours. Dès le mardi, puisque, pour nous, elle date déjà de deux jours : nous sommes prévenus le 3.
Mme Marie-Christine Dalloz. Comment avez-vous appris la décision de Jérôme Cahuzac de se déporter, autrement dit l’existence de la fameuse « muraille de Chine » ? Quand précisément, et comment en avez-vous été informée ?
Mme Marion Bougeard. Je crois que c’était une initiative du directeur général des finances publiques. J’en suis informée quasi accidentellement parce que je suis présente au banc le jeudi – nous sommes à l’Assemblée jusqu’au soir où un autre ministre prendra le relais. Dans l’après-midi, je l’apprends à l’occasion d’un échange de parapheurs. Et j’apprendrai le lundi que le texte a été signé et avalisé, mais cela ne change absolument rien à ma pratique quotidienne.
Mme Cécile Untermaier. D’après vos dires, Jérôme Cahuzac a demandé à ses avocats suisses de faire attester par écrit l’absence de compte en Suisse, juste après le 4 décembre. J’en prends acte.
Vous dites que Jérôme Cahuzac n’était pas satisfait de l’article du JDD. Vous a-t-il expliqué en quoi il le dérangeait alors qu’il le blanchissait ?
Avez-vous senti un changement dans le travail que vous meniez auprès de Jérôme Cahuzac à partir du 4 décembre ? Vos relations avec lui se sont-elles tendues ?
Avez-vous échangé avec les autres membres du cabinet ? Le travail s’en ressentait-il ? Cette affaire vous habitait-elle ?
Mme Marion Bougeard. À propos du JDD, j’ai le souvenir diffus de son agacement, d’abord parce que l’affaire perturbait le fonctionnement quotidien du cabinet. Nous avons continué à faire notre travail, mais l’essentiel de notre tâche consistait à faire en sorte que le ministre pour lequel nous travaillions soit au même niveau qu’auparavant. Ce qui demandait beaucoup de préparation. Son immense mémoire et son grand talent ne le dispensaient pas de bûcher des nuits entières. Avec la multiplication de ses rendez-vous avec ses conseils juridiques, nous avions moins accès à son temps libre. En ce sens, oui, cela générait des discussions au sein du cabinet puisque nous constations qu’il était occupé à autre chose. Néanmoins, nous formions, ils forment une équipe formidable et le travail ne s’en est jamais ressenti.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment se fait-il que le JDD s’adresse à vous ?
Mme Marion Bougeard. Le Nouvel obs ne s’est pas adressé à moi. Je pense que le JDD fait la tournée de tous ceux dont il a le numéro.
M. le président Charles de Courson. Il n’y a pas d’autre interprétation ?
Mme Marion Bougeard. Non, absolument pas. Je ne crois pas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et vous refusez de répondre ?
Mme Marion Bougeard. Je réponds que je n’ai pas la moindre information.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous en avez discuté avec Stéphane Fouks ?
Mme Marion Bougeard. Très sincèrement, non.
Mme Cécile Untermaier. De même que vous n’étiez pas informée de la demande d’entraide suisse, je suppose que vous ignoriez la démarche concernant le formulaire 754.
Mme Marion Bougeard. Pour tout vous dire, le 2 avril, à minuit, j’ai cessé de lire, d’écouter et de regarder quoi que ce soit. Je n’étais pas du tout au courant et j’ai découvert l’existence de cette procédure en lisant les comptes rendus de la Commission d’enquête pour préparer cette audition.
M. Christian Assaf. J’ai retenu de votre déclaration liminaire que vous aviez douté immédiatement. Dès le 3 décembre. Ce doute vous a-t-il habité jusqu’à votre départ, le 20 mars ? A-t-il été étayé par des informations informelles ? Vous aviez des relations avec les journalistes,… Même si votre travail vous prenait énormément de temps, et vous mettait à l’écart de l’affaire qui n’était pas pour vous une obsession, vous en êtes-vous ouverte auprès de quelqu’un ? Des journalistes vous en ont-ils parlé ? Et si oui, de quelle nature étaient vos échanges ?
Mme Marion Bougeard. Oui, j’ai douté. Étonnamment. À partir du 5 décembre où il jure devant la représentation nationale et où je sais qu’à la suite du conseil des ministres, il a un aparté avec le Président de la République à qui il jure solennellement qu’il n’y a rien, qu’il entame les démarches pour rechercher la vérité auprès de l’établissement bancaire suisse, je ne doute pas qu’il dise la vérité pour lui-même. Ce doute ne m’habite pas par rapport à lui. Je ne doute pas qu’il dise la vérité. Pour dire les choses extraordinairement simplement, je suis parfaitement impuissante à l’aider en quoi que ce soit. Et je suis occupée à une tâche qui n’est pas mince. Alors, comme beaucoup d’êtres humains, je m’adapte.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’en reviens au JDD. Trois entités sont au courant de la teneur de la réponse : la direction générale des finances publiques (DGFiP), les services du procureur, et les conseils de Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Et Pierre Moscovici.
M. Alain Claeys, rapporteur. J’ai bien cité la DGFiP.
Qui a intérêt à ce que l’information sorte ?
Mme Marion Bougeard. Très sincèrement, je ne sais pas.
M. le président Charles de Courson. L’hypothèse implicite de notre rapporteur, à savoir que Jérôme Cahuzac aurait donné l’information, mais qu’il vous aurait « manipulée » ou « intoxiquée », en vous faisant croire l’inverse, vous paraît-elle crédible ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Si le rapporteur a des hypothèses, il les exprimera publiquement.
M. le président Charles de Courson. Disons que je reprends celle-là à mon compte.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est inutile. Vous présidez remarquablement, continuez ! Quant à moi, je continuerai à poser les questions comme je l’entends, et j’en tirerai les enseignements que je vous soumettrai ainsi qu’à l’ensemble de la Commission.
M. le président Charles de Courson. Madame ?
Mme Marion Bougeard. L’hypothèse me semble contredite par les mauvaises relations qui existent entre le signataire de l’article et l’homme pour lequel je travaille à l’époque.
M. le président Charles de Courson. Quid alors des deux autres hypothèses ?
Mme Marion Bougeard. Il n’y a pas qu’un seul pays sur la planète.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire ?
Mme Marion Bougeard. Je ne sais pas…
M. le président Charles de Courson. Vous avez dit au rapporteur avoir été au courant de l’explication du 5 décembre entre le Président de la République et votre ministre. Vous en a-t-il parlé ?
Mme Marion Bougeard. J’ai le souvenir qu’il nous en a informés au retour du conseil des ministres, ou peut-être au moment du départ pour l’Assemblée nationale, l’après-midi.
M. le président Charles de Courson. A-t-il été question d’une promesse faite au Président de la République de saisir sa banque ?
Mme Marion Bougeard. Non, mais ça ne veut pas dire que ça n’existe pas.
M. le président Charles de Courson. C’était une simple question.
M. Christian Assaf. Revenons à ma première question. Vous avez répondu avoir douté, mais l’avoir cru sur parole le 5. Vous vous sentiez impuissante à l’aider. Un article du Monde rapporte que vous auriez enquêté, ou du moins recherché des informations, sur le père de Fabrice Arfi, et que vous vous en seriez ensuite excusé auprès de lui. Quels moyens avez-vous utilisés ? Était-ce une initiative de votre part ?
Mme Marion Bougeard. Le terme « enquête » est très surévalué. Pour dire les choses extraordinairement simplement, le 4 ou le 5 décembre, je me trouve plongée dans une véritable histoire de dingues, il n’y a pas d’autres termes, impliquant des personnages rocambolesques. J’apprends à l’occasion les termes lot-et-garonnais de « cornecul ». On n’a pas besoin de m’expliquer le sens, je vois tout de suite de quoi ça parle. On se croirait dans un roman – bon ou mauvais, je ne sais pas – où se croisent des personnages. Dans une conversation privée, on fait état d’une filiation totalement romanesque et sympathique. Ça a été très mal interprété, et j’ai présenté des excuses parce que ça me semblait tout à fait normal. Mais je le répète, c’est plutôt de l’ordre du romanesque. Il est vrai que, dans cette histoire de dingues, je n’avais pas pensé que le plus dingue était assis à mes côtés. Il est rare que le tueur en série dirige l’enquête sur ses propres meurtres, ailleurs que dans les films. C’est pourtant ce que j’ai vécu.
M. le président Charles de Courson. Qu’entendez-vous par « filiation romanesque » ?
Mme Marion Bougeard. Je ne crois pas devoir partager des éléments de la vie privée d’une tierce personne. « Filiation romanesque » s’inscrit dans le registre de cette histoire de fous. On m’a simplement raconté une anecdote familiale, pour être plus précise. Je laisserai l’intéressé choisir et je n’irai pas plus loin.
M. le président Charles de Courson. M. le rapporteur et moi-même sommes un peu perdus.
Mme Marion Bougeard. Je vais préciser et je referai des excuses au journaliste en question. Une ancienne collègue me raconte que le papa de ce journaliste était un grand syndicaliste policier, très reconnu et très engagé. Je n’en sais pas plus. C’est ce qui a été qualifié d’« enquête », et ça n’a aucun intérêt.
M. Christian Assaf. Avez-vous fait remonter l’information au ministre ?
Mme Marion Bougeard. Pas du tout.
M. Christian Assaf. Et entre le 5 décembre et le 19 mars, vous n’avez pas eu d’autre information de ce type ?
Mme Marion Bougeard. Pas du tout.
M. Gérald Darmanin. Entre début décembre et début avril, avez-vous participé à des réunions à Matignon ou à l’Élysée, avec d’autres conseillers en communication, sur la politique gouvernementale ? L’affaire Cahuzac y a-t-elle été évoquée ?
Mme Marion Bougeard. Dans le cadre de mon travail, j’étais convoquée très régulièrement à des réunions de coordination sur les sujets dont j’étais en charge, notamment le lancement de la campagne sur le crédit d’impôt compétitivité emploi. À ce titre, j’ai eu de nombreuses réunions à Matignon et au Commissariat général à l’investissement. Et l’affaire n’était jamais évoquée. On me demandait seulement comment j’allais et je répondais : « Je vais bien. »
M. Gérald Darmanin. Vous avez dit avoir lu tous les comptes rendus des auditions. Avez-vous le sentiment, vous qui avez vécu les événements de l’intérieur du cabinet, que l’une des personnes auditionnées aurait menti ou omis de dire une partie de la vérité ?
Mme Marion Bougeard. Je n’ai pas lu tous les comptes rendus, en tout cas pas celui de l’audition de l’homme pour lequel je travaillais.
M. Gérald Darmanin. Et les autres ?
Mme Marion Bougeard. Non, je n’en ai pas l’impression.
M. Daniel Fasquelle. Vous qui étiez chargée de la communication et des relations extérieures au cabinet de M. Cahuzac, avez-vous eu des contacts avec les membres d’autres cabinets au cours desquels vous auriez pu évoquer l’existence d’un compte, les moyens utilisés par Jérôme Cahuzac pour se défendre, et les informations qui auraient pu circuler entre les différents ministres ?
Mme Marion Bougeard. Sur ce sujet, je n’ai pas eu de contacts avec des homologues.
M. Daniel Fasquelle. Avez-vous eu connaissance de réunions qui auraient pu avoir lieu entre Jérôme Cahuzac et le Premier ministre, ou le Président de la République, concernant cette affaire ? Ou des réunions avec d’autres ministres ? Manuel Valls a avoué qu’il y avait eu des réunions à l’Élysée ou à Matignon à ce sujet.
Mme Marion Bougeard. Non, je n’avais pas d’information.
M. Jean-Marc Germain. Vous nous avez dit, madame, avoir géré les relations presse du ministre et du ministère, pas celles de l’homme Jérôme Cahuzac. Qui donc s’en chargeait, alors qu’il devait avoir tous les jours de nombreuses sollicitations ?
Mme Marion Bougeard. Lui-même : il a son téléphone, les gens l’appellent, il répond. C’était vrai avant, ça l’est sans doute encore aujourd'hui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Stéphane Fouks n’intervient pas ?
Mme Marion Bougeard. À ma connaissance, pas du tout.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et le contrat entre le ministère et EuroRSCG ?
Mme Marion Bougeard. Il n’y a aucune mission qui concerne la gestion de la communication du ministre dans le contrat. Il ne s’agit que la coordination de la communication dans le cadre des débats parlementaires.
M. Jean-Marc Germain. Vous avez parlé du coup de fil d’un journaliste du JDD à la recherche d’un document. J’ai compris que vous n’en aviez pas fait état à M. Cahuzac, ce qui est surprenant compte tenu de la teneur de l’information qui vous est demandée. En avez-vous parlé à d’autres personnes qui auraient pu évoquer directement avec lui cet appel du JDD ?
Mme Marion Bougeard. Quand je reçois l’appel du JDD, nous sommes déjà 48 heures après la révélation de l’existence de ce document et de l’éventualité que la réponse soit négative par le Nouvel observateur. L’informer de l’appel d’un autre média qui cherche cette information n’a aucun intérêt puisque l’information est déjà sur la place publique.
M. Jean-Marc Germain. M. Cahuzac aurait pu vouloir donner le document.
Mme Marion Bougeard. Je ne crois pas, mais il a son téléphone pour passer des appels. Je ne lui faisais pas un compte rendu de l’ensemble des appels que je recevais, pas plus qu’il ne m’en faisait un de l’ensemble des siens.
M. le président Charles de Courson. En l’état actuel de nos informations, Jérôme Cahuzac n’a jamais eu la réponse entre les mains, il dispose uniquement de sa teneur.
M. Jean-Marc Germain. Je voulais seulement m’assurer de ce que Mme Bougeard savait sur les informations dont disposait son ministre. Puisque le journaliste demande le document, il aurait été possible de demander au ministre s’il était en sa possession et s’il souhaitait le transmettre.
Mme Marion Bougeard. Pour tout vous dire, le vendredi matin, le ministre pour lequel je travaillais, indique, en répondant à des questions sur une grande radio, indique qu’il n’a pas le document. Donc, ce que je ne lui demande pas le jeudi, je l’apprends le vendredi matin.
Mme Cécile Untermaier. Les relations du journaliste du JDD avec Jérôme Cahuzac n’étant pas excellentes, on ne peut donc pas imaginer qu’ils aient un échange spontané ?
Mme Marion Bougeard. Je ne peux pas répondre à ce que je ne sais pas. Je n’ai pas la moindre idée de qui a pu contribuer à cet article. Dans mon souvenir, les relations n’étaient pas bonnes entre le signataire et l’homme dont vous parlez.
M. Thomas Thévenoud. Quelles sont vos relations avec les membres du cabinet de Pierre Moscovici, chargés de la communication ?
Mme Marion Bougeard. Nous avons des réunions de coordination une fois par semaine. Ceux qui connaissent les habitudes des cabinets savent que nous déjeunons souvent ensemble. Mais encore une fois, l’affaire n’est pas du tout au cœur de nos préoccupations car nous avons de gros projets en cours. Et comme notre temps est compté, quand nous nous voyons, nous parlons essentiellement de ce que nous avons à faire.
M. Thomas Thévenoud. Y compris après la parution de l’article du JDD ? Qui a déclenché l’irritation, et même la colère du ministre de l’économie et des finances ; il nous l’a dit. En avez-vous eu des échos, via ses conseillers ?
Mme Marion Bougeard. Non. Ses conseillers m’ont demandé si j’avais parlé au JDD. Et je leur ai fait la réponse que je vous ai faite : « Oui, j’ai parlé au JDD. Non, je n’avais pas d’information. Oui, je l’ai renvoyé aux conseils. »
M. le président Charles de Courson. Madame, il ne me reste plus qu’à vous remercier d’être venue jusqu’à nous.
Auditions du 23 juillet 2013
À 16 heures 45 : M. Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, notre Commission d’enquête a déjà reçu M. Jérôme Cahuzac le 26 juin dernier. Si nous avons immédiatement pu déplorer son refus de répondre à nombre de nos questions, nous avons constaté, en poursuivant nos travaux, que ce jour-là, bien qu’il ait prêté serment, M. Jérôme Cahuzac ne nous avait pas dit la vérité, comme il a déclaré ne pas l’avoir dite aux plus hautes autorités de l’État, au Parlement et à ses amis, à propos de ses avoirs non déclarés à l’étranger. Nous vous avons convoqué une deuxième fois, monsieur Cahuzac, pour que vous vous expliquiez et que vous nous apportiez quelques précisions complémentaires.
Avant d’aller plus loin, je précise que, si vous n’êtes pas juridiquement tenu de répondre aux questions empiétant sur l’information judiciaire en cours, rien ne vous interdit non plus de le faire, contrairement à ce que vous aviez laissé entendre le 26 juin. En particulier, comme notre collègue Philippe Houillon vous l’avait signalé, vous n’êtes aucunement tenu par le secret de l’instruction. En droit, si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement nous donner les éléments d’information que vous avez fournis aux juges d’instruction.
(M. Jérôme Cahuzac prête serment.)
M. le président Charles de Courson. Monsieur Cahuzac, désirez-vous faire une déclaration liminaire ?
M. Jérôme Cahuzac. Non, monsieur le président.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Cahuzac, je souhaiterais, au nom de la Commission d’enquête, vous demander des précisions sur vos déclarations lors de votre précédente audition, ainsi que sur des éléments nouveaux issus d’auditions ultérieures – ou d’autres sources.
Tout d’abord, vous nous avez déclaré avoir été informé de l’envoi d’une demande d’entraide administrative aux autorités suisses par vos avocats suisses. Le confirmez-vous ?
M. Jérôme Cahuzac. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Pierre Moscovici ne vous a pas informé de cette démarche ?
M. Jérôme Cahuzac. Je crois comprendre que je comparais à nouveau devant vous car il existerait deux versions divergentes.
La première est livrée par l’auteur d’un ouvrage récent, qui évoque, en citant une source anonyme, une réunion dans le bureau du Président de la République, sous la présidence de ce dernier, à laquelle auraient participé le Premier ministre, Pierre Moscovici et moi-même.
D’autre part, Pierre Moscovici vous a indiqué qu’à l’issue d’un Conseil des ministres, des mots ont été échangés – je crois que ce sont les termes qu’il a utilisés –, en sa présence et en la mienne, avec le Président de la République et le Premier ministre.
Je n’ai aucun souvenir d’une réunion dans le bureau du Président de la République – et ces réunions sont suffisamment rares pour que l’on s’en souvienne –, et je n’ai pas souvenir non plus de l’échange décrit par Pierre Moscovici à l’issue du Conseil des ministres.
Dès lors, y a-t-il divergence entre le ministre de l’économie et des finances et moi-même ? Peut-être pas, si l’on veut bien admettre qu’à l’issue d’un Conseil des ministres, les gens sortent par la même porte et se retrouvent dans le même lieu ; peut-être est-ce à ce moment et dans cet endroit que des instructions ont été données à Pierre Moscovici. Mais je n’en ai pas le souvenir.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’auteure du livre précise que vous auriez demandé, à l’occasion de cette entrevue, que la demande d’entraide porte sur la période la plus large possible. Que répondez-vous ?
M. Jérôme Cahuzac. Dès lors que selon moi, cette réunion n’a pas eu lieu, je vois mal comment je pourrais donner crédit à tel ou tel propos tenu lors de cette supposée réunion !
M. Alain Claeys, rapporteur. La même journaliste indique que le Président de la République vous aurait demandé, le 5 décembre, à l’occasion d’une entrevue en présence du Premier ministre, de vous adresser directement à la banque UBS de Genève, afin que cette dernière confirme que vous n’y déteniez aucun compte. Est-ce exact ?
M. Jérôme Cahuzac. Il s’agit là d’un épisode antérieur de plus d’un mois à celui auquel vous venez de faire référence.
Lors de ma première audition, je vous ai indiqué qu’à l’issue du Conseil des ministres, et alors que nous étions toujours dans le salon Murat, le Président de la République et le Premier ministre étaient venus me demander ce qu’il en était des informations de Mediapart. Je ne crois pas que quiconque à cette occasion ait évoqué une éventuelle procédure pour faire litière des accusations lancées par Mediapart. S’il est vrai que, dans les jours qui ont suivi, j’ai, avec mes conseils, tenté d’obtenir de la banque citée ce que l’on appelle une « attestation négative », je ne me souviens pas que ce soient le Président de la République ou le Premier ministre qui me l’aient suggéré. Ils m’ont simplement posé une question, à laquelle j’ai répondu ; ils semblent m’avoir cru dans l’instant – ce dont je ne me réjouis pas, bien au contraire –, et l’entretien s’est arrêté là.
M. Alain Claeys, rapporteur. Est-il vrai que l’UBS ait indiqué, le 13 décembre 2012, qu’elle n’établissait pas de confirmation négative ?
M. Jérôme Cahuzac. Mes conseils ont posé successivement deux questions à la banque. La première consistait à lui demander, sans citer mon nom, si elle avait pour position de principe de ne jamais faire d’attestation négative – ce qu’elle lui a confirmé. En dépit de cette réponse, mon avocat suisse a demandé à la banque de produire une attestation négative sur la période correspondant à la durée légale de conservation des archives.
M. le président Charles de Courson. C’est-à-dire ?
M. Jérôme Cahuzac. Une dizaine d’années, je crois. À demander plus, nous nous serions exposés à une réponse négative.
M. le président Charles de Courson. Pour approfondir ce point, je vous lis ce qu’écrit cette journaliste, qui a interviewé le Président de la République :
« À 10 heures du matin, mercredi 5 décembre 2012, le premier Conseil des ministres depuis l’article de Mediapart est l’occasion pour Cahuzac de s’assurer de la confiance du Gouvernement. À la sortie de la réunion, au rez-de-chaussée du palais de l’Élysée, François Hollande et Jean-Marc Ayrault convoquent quelques minutes le ministre délégué au budget. “Je vous assure que c’est faux” leur répète Cahuzac. Il est catégorique. “Il y a une seule méthode pour le prouver, c’est de faire la demande directement auprès de la banque pour qu’elle dise qu’aucun compte n’a jamais existé”, explique alors François Hollande. “Je vais le faire”, jure le ministre. »
Vous dites que cela ne s’est pas passé vraiment comme cela, mais que vous avez néanmoins saisi l’UBS, via vos avocats suisses, pour essayer d’obtenir une attestation négative ?
Un peu plus loin, la journaliste indique que, le 13 novembre, la banque UBS répond par la négative à vos avocats : elle ne délivre pas d’attestation. Est-ce ce que vous venez de confirmer ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Je pense que vous vouliez dire « 13 décembre », et non « 13 novembre » ?
M. le président Charles de Courson. J’évoquais le premier Conseil des ministres après le déclenchement de l’affaire, le 5 décembre.
Vous souvenez-vous d’avoir passé quelques minutes en compagnie du Premier ministre et du Président de la République, à qui vous auriez juré que vous n’aviez pas de compte en Suisse ? D’après ce qui est rapporté dans ce livre – suite à une interview du Président de la République –, ce dernier vous aurait demandé d’engager une procédure auprès de votre banque. Ce que vous venez de dire tendrait à le confirmer. Ai-je raison ?
M. Jérôme Cahuzac. Je vais répéter ce que je viens de dire au rapporteur, puisque vous me posez la même question !
À l’issue du Conseil des ministres, alors que les collègues sont en train d’évacuer le salon Murat, le Président de la République et le Premier ministre viennent me voir – ils ne me « convoquent » pas. Je reste avec eux deux ou trois minutes, pas davantage. Ils me posent la question suivante – en substance : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? ». Je leur réponds que ce que prétend Mediapart est faux. Dans mon souvenir, cela s’arrête là ; je suis à peu près certain que ce n’est pas le Président de la République qui m’a demandé d’agir auprès de la banque UBS pour obtenir une attestation négative.
M. le président Charles de Courson. Dans ce cas, à l’initiative de qui l’avez-vous fait ?
M. Jérôme Cahuzac. Ce sont mes avocats qui me l’ont conseillé, à moins que je ne le leur ai demandé, ou que nous ayons eu l’idée en même temps. Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une initiative qui m’était propre, soit directement, soit indirectement. Dans mon souvenir, elle ne provenait pas des plus hautes autorités de l’État.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment la demande d’attestation négative était-elle formulée ?
M. Jérôme Cahuzac. Je crois que c’était ainsi : « Pouvez-vous nous confirmer que M. Jérôme Cahuzac n’a pas détenu de compte dans votre établissement dans la période de conservation légale des archives ? ». Mais elle n’a pas eu de réponse.
M. le président Charles de Courson. Saviez-vous, à l’époque, qu’il fallait poser la question sous une forme positive – par exemple : « Pouvez-vous me confirmer que j’ai un compte chez vous ? » – pour obtenir une réponse ?
M. Jérôme Cahuzac. Il y a eu des débats juridiques tout au long de cette période ; pour ma part, ils ne m’ont pas convaincu que, même posée ainsi, la question pourrait obtenir une réponse ! En tout cas, ce débat est aujourd’hui un peu dépassé…
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous nous avez indiqué, lors de la précédente audition, que vous n’aviez eu aucun rapport « institutionnel » avec Stéphane Fouks. Lors de son audition, celui-ci a reconnu avoir eu une conversation avec Mediapart au début de l’affaire, puis une autre avec une journaliste du Nouvel Observateur. Le confirmez-vous ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ignorais l’existence de la conversation avec la journaliste du Nouvel Observateur, mais si Stéphane Fouks vous l’a dit, c’est sûrement vrai.
La conversation avec un journaliste de Mediapart date du lundi 3 décembre. Ce n’est donc pas « au début de l’affaire », puisque celle-ci n’avait pas encore éclaté : l’article ne sera publié que le lendemain.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 3 décembre, vous avez reçu plusieurs questions de la part de Mediapart.
M. Jérôme Cahuzac. Absolument.
Je dois dire que l’effet de surprise et la gravité des sujets évoqués m’ont amené à solliciter l’avis de personnes que je connaissais depuis longtemps, auxquelles j’étais lié d’amitié et en qui j’avais confiance. Stéphane Fouks en faisait partie ; je l’ai donc appelé pour lui demander quelle était la meilleure attitude à adopter.
J’étais à ce moment-là dans l’hémicycle, au banc du Gouvernement ; les conversations étaient forcément très brèves. Si j’ai bonne mémoire, Stéphane Fouks m’a proposé – à moins que je le lui aie demandé ? – d’appeler quelqu’un chez Mediapart pour savoir ce qu’il en était vraiment.
Tout cela se passait avant la publication de l’article. À compter de ce moment-là, je n’ai plus rien demandé à Stéphane Fouks – sauf si vous considérez qu’il était fautif de demander, à l’occasion, son avis à quelqu’un qui était mon ami depuis des dizaines d’années. Cet avis était toujours le même : « À partir du moment où ce n’est pas vrai, dis ta vérité et les choses se tasseront », me répétait-il. À lui, comme aux autres, je n’avais pas dit la vérité…
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez été informé par vos conseils, non pas de la réponse précise de la Suisse, mais de son contenu. Nous assurez-vous que vos conseils n’ont pas eu de contact avec le Journal du Dimanche ?
M. Jérôme Cahuzac. Je suis incapable de vous répondre. En tout cas, je leur ai demandé de n’avoir aucun contact avec quiconque – mieux : une fois la réponse parvenue de Suisse, je leur ai clairement indiqué qu’il n’était pas de mon intérêt d’assurer la moindre publicité à celle-ci. J’ai du mal à imaginer que des avocats fassent le contraire de ce que leur client leur demande de faire !
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, M. Bruno Bézard nous a indiqué que vous aviez essayé, en vain, d’engager avec lui une discussion sur le contenu de la demande d’entraide à la Suisse ; vous avez vous-même reconnu lui avoir dit « quelques mots ». Vous souvenez-vous quoi ?
M. Jérôme Cahuzac. Restituer les mots précis serait solliciter mes souvenirs exagérément, mais si je me replace dans le contexte psychologique et politique de l’époque, j’ai dû lui demander s’il était envisageable que je lise le document qui serait envoyé aux autorités helvétiques. Il m’a répondu très nettement que cela ne lui paraissait pas possible ; je lui ai instantanément donné raison, et nous n’en avons plus parlé. L’échange a dû durer moins d’une minute.
M. le président Charles de Courson. Mais comment saviez-vous qu’il existait ?
M. Jérôme Cahuzac. Quoi donc ?
M. le président Charles de Courson. Ce document.
M. Jérôme Cahuzac. Je pense que des contacts préalables avaient dû être pris, aux termes desquels mes conseils avaient dû être informés en Suisse qu’une procédure d’entraide serait menée.
Comme je vous l’ai dit lors de ma précédente audition – et je ne vous ai pas menti, monsieur le président ! –, c’est par mes conseils que j’ai su qu’une procédure de cette nature allait être engagée. Une fois celle-ci lancée, il est possible qu’à l’occasion de discussions, notamment avec Pierre Moscovici, cette question ait été évoquée ; cela ne me paraît pas absurde. Mais la procédure était lancée, et la demande partie.
M. Alain Claeys, rapporteur. Les conseils ne pouvaient pas être informés avant l’envoi de la demande.
M. le président Charles de Courson. Mais l’envoi a été fait le 24 janvier : or l’épisode que vous évoquez est antérieur !
M. Jérôme Cahuzac. Je ne me souviens pas de vous avoir donné la date de ma conversation avec M. Bézard. Mais peut être vous l’a-t-il précisée.
M. le président Charles de Courson. Cela sera facile à vérifier.
Est-il exact que vous ayez informé M. Fouks du contenu de la réponse des autorités fiscales helvétiques ?
M. Jérôme Cahuzac. Non, je ne lui ai pas parlé de cela.
Mes conseils m’ont informé de la nature de la réponse. En France, je crois que Pierre Moscovici a été informé de la réponse par Bruno Bézard lui-même. Quant à moi, je me suis efforcé d’être le plus discret possible, car je ne jugeais pas à l’époque de mon intérêt que cette nouvelle fût connue.
En même temps, il est possible qu’en apprenant le sens de cette réponse, j’aie manifesté une forme de soulagement, qui s’est peut-être vue.
M. Alain Claeys, rapporteur. Une dernière question – à laquelle, je crois, un grand nombre de membres de cette commission s’associeront.
Au terme de nos auditions, force est de reconnaître que le climat à Villeneuve-sur-Lot était « particulier ». Tout est parti d’un enregistrement accidentel que M. Gonelle a récupéré. Aujourd’hui, avec le recul, et après avoir suivi nos auditions, avez-vous une conviction sur l’identité de celui ou de celle qui aurait pu transmettre cet enregistrement à Mediapart ?
M. Jérôme Cahuzac. « Is fecit cui prodest » : à qui profite le crime ? Sur ce point, des réponses ont été apportées lors des auditions que vous avez conduites – notamment par Michel Gonelle.
Je ne crois pas que ce qui s’est passé profite en quoi que ce soit à Jean-Louis Bruguière ; en revanche, il me semble que cela réjouit profondément – c’est un euphémisme ! – Michel Gonelle, si j’en juge par l’attitude qui fut la sienne lors de l’élection législative partielle. J’ai également entendu dire qu’il consultait beaucoup en vue des prochaines élections municipales. Celui des deux qui avait le plus intérêt à ce que l’affaire éclate et fasse le plus de mal possible est Michel Gonelle – mais ce n’est naturellement pas une preuve.
L’audition de Michel Gonelle a fait apparaître des éléments troublants. Par exemple, il vous a déclaré sous serment n’avoir jamais rencontré Edwy Plenel, ni parlé avec lui, jusqu’à ce qu’Edwy Plenel vienne le voir avec Fabrice Arfi à son hôtel à Paris pour le convaincre d’authentifier l’enregistrement. Or, je crois avoir compris qu’alors que Michel Gonelle faisait son travail au Palais de justice d’Agen, Edwy Plenel a tenté de le joindre avec insistance. Michel Gonelle affirme que, ne pouvant utiliser son téléphone portable parce que celui-ci n’avait plus de batterie, il a emprunté le téléphone portable d’un officier de sécurité du Palais de justice pour rappeler M. Plenel. Je m’interroge : si son téléphone n’avait plus de batterie, comment pouvait-il savoir le numéro de téléphone d’une personne qu’il affirme ne pas connaître, et avec laquelle il n’avait jamais échangé auparavant ?
M. le président Charles de Courson. Je voudrais compléter la première question du rapporteur.
La réunion du 16 janvier 2013, nous l’avons découverte par des journalistes, mais elle a été attestée lors de l’audition de Pierre Moscovici. Voici ce que ce dernier nous en a dit : « À l’occasion de cet échange, le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l’utiliser. Pourquoi l’avoir fait ? D’une part, parce que M. Jérôme Cahuzac était alors ministre du Gouvernement, d’autre part, parce que, aux termes de la convention, les avocats conseils de M. Cahuzac devaient être informés du lancement de la procédure.
M. Jérôme Cahuzac s’est dit serein ; il a souhaité que la demande couvre la période la plus large possible. Au-delà de cette information de principe, il n’a évidemment pas été associé à la décision, du fait de la « muraille de Chine » : il n’a pas su quand la procédure avait été lancée – autrement que par ses conseils –, il n’a pas été associé à la rédaction de la demande. »
Et un peu plus tard, en réponse à une de mes questions :
« M. le président Charles de Courson. Quelle fut l’attitude de M. Jérôme Cahuzac durant la réunion du 16 janvier ?
M. le ministre. Il s’est montré serein et, dans l’hypothèse où la demande se produirait, il a demandé qu’elle couvre la période la plus large ; nous y avons veillé, puisque, alors que la convention prévoyait une interrogation sur trois ans, nous avons fait en sorte de remonter jusqu’en 2006, date de la prescription fiscale sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et sur l’impôt sur le revenu. »
Vous prétendez ne plus vous souvenir de cette réunion ? Croyez-vous que cette perte de mémoire soit crédible ?
M. Jérôme Cahuzac. S’il s’était agi d’une réunion, monsieur le président, ma perte de mémoire serait peu crédible, mais il me semble que Pierre Moscovici vous a indiqué qu’il s’agissait, non pas d’une réunion, mais d’un échange de mots à l’issue du Conseil des ministres.
Je n’ai aucun souvenir d’une réunion dans le bureau du Président de la République, et il me semble que Pierre Moscovici non plus. Vous avez donc à choisir entre deux témoignages faits sous serment devant votre commission d’enquête, et des propos publiés dans un ouvrage qui, au demeurant, comporte un certain nombre d’erreurs factuelles grossières.
M. le président Charles de Courson. Vous ne pouvez pas dire que Pierre Moscovici ne se souvient pas bien ! Il est très précis dans sa déclaration ; il a même indiqué que vous vous étiez réunis dans le bureau à côté de la salle du Conseil des ministres. Comment se fait-il qu’entre le 16 janvier et maintenant, vous ayez complètement perdu la mémoire de cette réunion « informelle » – pour reprendre les termes de Pierre Moscovici ?
M. Jérôme Cahuzac. Je devine de l’ironie dans vos propos, mais je ne crois pas que Pierre Moscovici ait utilisé le terme de « réunion », fût-il minoré du qualificatif « informelle ». Il me semble qu’il a parlé d’un échange de mots à l’issue du Conseil des ministres, au cours d’un mouvement de sortie générale d’une quarantaine de membres du pouvoir exécutif. Vous pouvez ironiser autant qu’il vous plaira, je n’ai aucun souvenir de cet échange de mots.
M. le président Charles de Courson. M. Fouks a déclaré durant son audition que vous l’aviez informé du sens de la réponse des autorités suisses, laquelle vous avait été transmise, d’après vos dires, par vos avocats en Suisse. Si j’ai bien compris, vous ne vous en souvenez plus – mais lui l’affirme. Pourquoi avoir fait cela ?
M. Jérôme Cahuzac. Je crois que j’ai perdu le fil de votre question ; pourriez-vous la reformuler ?
M. le président Charles de Courson. Lorsque nous l’avons auditionné, M. Fouks a déclaré avoir joué un rôle au démarrage de l’affaire, le 3 décembre, lorsque vous l’avez appelé pour lui demander d’intervenir auprès de Mediapart, et il a dit que c’était lui qui avait organisé la réunion du 4 décembre au matin entre vous et M. Arfi.
M. Jérôme Cahuzac. M. Fouks n’a absolument pas organisé cette réunion ! Il m’a conseillé de recevoir M. Arfi – ce que j’ai fait. M. Arfi était d’ailleurs accompagné d’un de ses confrères de Mediapart.
M. le président Charles de Courson. M. Fouks nous a dit qu’il avait servi d’intermédiaire entre vous et Mediapart.
M. Jérôme Cahuzac. Je tiens à être précis, car je ne souhaite pas que Stéphane Fouks fasse l’objet d’accusations infondées : il n’a absolument pas « organisé » de réunion sur cette affaire. Il m’a conseillé de recevoir les journalistes qui portaient des accusations très graves contre moi, et j’ai suivi son conseil : c’est différent.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais son intervention a bien eu lieu le 3 décembre, le jour où vous avez reçu les questions de Mediapart ?
M. Jérôme Cahuzac. Tout à fait.
Il est assez facile d’imaginer que le SMS ou le courriel que j’avais reçu de Fabrice Arfi m’avait plongé dans une vive inquiétude. J’ai donc appelé Stéphane Fouks, et je lui ai demandé ce qu’il en était vraiment, et quelle était la meilleure attitude à adopter – je rappelle qu’à l’époque, je n’avais aucune idée des éléments dont Mediapart pourrait faire état.
M. le président Charles de Courson. Voici ce qu’a déclaré, sous serment, M. Stéphane Fouks :
« Après avoir reçu ce courriel, Jérôme Cahuzac m’a appelé pour me demander mon avis sur ce qu’il convenait de faire. Je lui ai dit que je voulais d’abord mieux comprendre ce qui se passait. J’ai donc appelé un correspondant chez Mediapart, puis Fabrice Arfi, avec qui j’ai eu une conversation. Cela m’a permis d’organiser la réunion entre Jérôme Cahuzac et Fabrice Arfi, destinée à permettre l’échange d’informations nécessaire. »
M. Jérôme Cahuzac. Ce n’est pas lui qui a choisi le lieu, ni l’horaire ; cela s’est fait en liaison avec mon cabinet, et c’est moi qui ai décidé de recevoir les journalistes le lendemain matin. « Organiser » me paraît donc un terme excessif au regard de la responsabilité réelle de Stéphane Fouks dans ce rendez-vous.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi l’avez-vous informé du contenu de la réponse de l’administration fiscale suisse ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne l’ai pas informé du contenu, pour la simple raison que je l’ignorais : je n’ai vu ni le document posant la question, ni celui apportant la réponse. Toutefois, je n’avais aucun doute quant à la nature de celle-ci, dès lors que la banque interrogée était l’UBS et que la demande portait sur la période non couverte par la prescription – et cela ne pouvait être autrement.
M. le président Charles de Courson. Parce que vous aviez fermé votre compte avant cette période ?
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le président, il faudra vous contenter de la réponse que je viens de faire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pour revenir sur les échanges qui auraient eu lieu à l’issue du Conseil des ministres, je rappelle ce que nous a déclaré Pierre Moscovici :
« C’est pourquoi il y a eu, non pas une réunion, mais quelques mots échangés à l’issue du Conseil des ministres, dans la salle attenante (…) À l’occasion de cet échange, le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l’utiliser. »
Vous affirmez n’avoir fait aucun commentaire sur l’ampleur de la demande d’entraide ?
M. Jérôme Cahuzac. Je répète – en dépit de l’ironie de votre voisin, qui est facile – que je n’ai aucun souvenir de cet échange de mots. Mais quelle que soit la version retenue – réunion dans le bureau présidentiel, échange de mots ou toute autre chose que j’ignore –,la « muraille de Chine » n’a pas été prise en défaut, puisqu’à aucun moment je n’ai été associé aux questions posées à l’UBS via l’administration helvétique.
M. le président Charles de Courson. Mais s’il s’avérait que vous aviez bien participé à cette réunion, cela était-il été conforme à la note du 10 décembre 2012 par laquelle vous vous déportiez de votre dossier fiscal ?
M. Jérôme Cahuzac. La note du 10 décembre s’adressait à l’administration. Je ne crois pas, pendant les mois où j’étais ministre, avoir jamais envoyé de note au Président de la République lui indiquant ce qu’il fallait faire. La « muraille de Chine » concernait l’administration et elle a été scrupuleusement respectée.
M. le président Charles de Courson. Elle ne concernait donc pas les ministres ?
M. Jérôme Cahuzac. En l’espèce, il s’agissait du Président de la République. Je vous confirme que le ministre du budget que j’étais ne donnait pas d’instruction au Président de la République.
M. le président Charles de Courson. Et le fait que vous ayez été associé à cette réunion vous semble-t-il conforme à l’instruction du 10 décembre – même si vous niez ce fait ou dites ne plus vous en souvenir ?
M. Jérôme Cahuzac. « Nier » est un terme que je juge impropre. Vous avez le droit d’ironiser, mais je maintiens que je ne me souviens pas de cette réunion.
Quoi qu’il en soit, je n’ai à aucun moment été associé à la procédure d’entraide administrative avec le Suisse.
M. le président Charles de Courson. Vous pensez vraiment que votre amnésie concernant une réunion qui a eu lieu en janvier de cette année est crédible – ou cela veut-il dire que vous contestez les propos de M. Pierre Moscovici ?
M. Jérôme Cahuzac. Non, cela veut dire que nous n’avons pas les mêmes souvenirs.
M. le président Charles de Courson. On peut aussi interroger le Premier ministre, pour savoir s’il s’en souvient, lui !
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai pas d’avis sur la question.
M. le président Charles de Courson. Nous en venons aux questions de nos collègues.
M. Jean-Marc Germain. Monsieur Cahuzac, la question que je vais vous poser est importante pour notre commission d’enquête, puisque nous cherchons à savoir si l’administration fiscale a pu faire correctement son travail et si elle a correctement interrogé la Suisse. Même si nous avons noté votre souci de bien distinguer ce qui relève de notre travail et ce qui relève de la procédure judiciaire, il me semble que vous devriez pouvoir y répondre.
Lors de votre précédente audition, vous avez dit que l’hypothèse que la banque UBS aurait menti en répondant à l’administration française vous paraissait « peu plausible, vu les risques que cette banque encourrait ». On déduit de cette réponse que vous n’avez pas de compte à l’UBS.
À un autre moment, vous avez estimé que l’administration fiscale avait posé correctement la question. S’agissant de la réalité de votre compte et de son cheminement, vous avez déclaré que « quand elle sera connue, la procédure judiciaire fournira une explication qui n’est probablement pas celle à laquelle vous – c’est-à-dire le président de Courson – faites référence » – l’hypothèse étant que divers montages financiers auraient pu conduire à ce que votre nom n’apparaisse pas.
Monsieur Cahuzac, pouvez-vous nous confirmer que vous n’avez jamais été l’ayant droit économique d’un compte en Suisse chez l’UBS, directement ou indirectement – via Reyl ou tout autre gestionnaire de compte –, durant la période 2006-2009 ?
M. Jérôme Cahuzac. Je comprends votre demande et j’aimerais pouvoir vous répondre de manière simple, mais cela m’est impossible.
L’accusation dont j’ai été l’objet faisait état de la fermeture d’un compte à l’UBS en février 2010 – accusation qui a été reprise, je crois, par votre président lors des premières auditions. Il me semble qu’à partir du moment où tout le monde semble exclure la possibilité que l’UBS ait menti, le fait que, dans le cadre de la procédure d’entraide administrative, la réponse des autorités suisses ait été négative prouve que si le compte n’a pas été fermé en février 2010, c’est tout simplement parce qu’il n’existait pas de compte à l’UBS à cette époque-là.
C’est vraiment la seule chose que je peux vous répondre. J’espère que vous le comprendrez.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous nous confirmez donc la réponse que vous aviez faite lors de votre première audition ?
M. Jérôme Cahuzac. Naturellement !
M. le président Charles de Courson. Avant de passer la parole à M. Fasquelle, je voudrais rappeler la réponse que M. Fouks avait faite à une question que je lui avais posée.
Question : « D’après lui [c’est-à-dire vous, monsieur Cahuzac], ce sont ses avocats en Suisse qui l’ont appelé pour lui indiquer, non pas qu’ils avaient lu la lettre, mais que les autorités helvétiques leur avaient indiqué que la réponse était négative. Ces mêmes avocats vous appellent-ils directement ? »
Réponse : « Non, c’est Jérôme Cahuzac qui le fait. » – M. Fouks affirme donc que vous l’avez appelé.
Question : « Vous dit-il que c’est une bonne nouvelle ? »
Réponse : « Oui. Je réponds : “Chouette, il n’y a plus qu’à laisser faire les choses !” »
M. Jérôme Cahuzac. Quel commentaire attendez-vous de ma part ?
M. le président Charles de Courson. Eh bien, je trouve étrange que vous ne vous souveniez pas de l’avoir appelé !
M. Jérôme Cahuzac. Moi, je ne trouve pas cela « étrange ». Des coups de fil, j’en passais beaucoup, et je n’avais pas que Stéphane Fouks comme ami. Certaines personnes se préoccupaient de cette affaire d’une façon qui me semble assez légitime, dès lors que nous avions des relations amicales très anciennes et très fortes.
Averti par mes conseils suisses que la réponse donnée par la Suisse était bien celle qui me paraissait probable, il m’a semblé possible d’en informer ceux qui pouvaient considérer cela comme une bonne nouvelle ; Stéphane Fouks a dit que je l’avais appelé, je l’ai donc sûrement fait. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je ne vois pas là de dysfonctionnement des services de l’État.
M. le président Charles de Courson. Ce n’était pas l’objet de ma question : nous cherchons à savoir qui a informé le Journal du dimanche.
M. Daniel Fasquelle. Je pense que vous avez conscience, monsieur Cahuzac, que les faits évoqués ici sont d’une exceptionnelle gravité. Ministre du budget, chargé de la lutte contre la fraude fiscale, vous aviez un compte caché à l’étranger : cette révélation a profondément choqué les Français.
Nous vous avons entendu une première fois, et nous avons tous été déçus par cette audition, car vous vous êtes souvent réfugié derrière l’enquête judiciaire. Aujourd’hui, vous avez des trous de mémoire ! Il faudrait vraiment que vous soyez coopératif et nous aidiez à dissiper les zones d’ombre qui subsistent. La démocratie et notre République le méritent.
S’agissant de l’enquête administrative, vous dites que vous n’aviez aucun doute sur la nature de la réponse. Je me pose donc légitimement des questions : Pierre Moscovici pouvait-il, lui, avoir un doute sur la nature de la réponse ? Pourquoi la demande a-t-elle été faite de façon aussi tardive ? Pourquoi avoir retenu ce périmètre ?
Vous dites ne pas vous souvenir de l’échange du 16 janvier rapporté par Pierre Moscovici, mais il s’agit d’un point essentiel ! Au travers de cet échange, vous avez pu orienter l’enquête administrative, qui ne pouvait donner d’autres résultats que celui que nous connaissons. Un de vous deux ment – ou dit la vérité, c’est selon.
Je vous repose donc la question : quel souvenir avez-vous de cet échange ? Avez-vous eu, à un moment ou à un autre, un contact avec Pierre Moscovici, avec le Président de la République et/ou le Premier ministre sur le champ de l’enquête administrative ? Ces derniers pouvaient-ils avoir un doute sur le résultat de cette enquête ?
M. Jérôme Cahuzac. Le doute que les personnalités que vous avez citées auraient pu avoir ne regarde qu’elles : je ne peux pas répondre à leur place.
Ai-je orienté l’enquête administrative ? En aucune manière. Du reste, la déposition de M. Bruno Bézard démontre qu’au moment où la demande d’entraide administrative a été faite, l’administration fiscale ne pouvait pas mieux poser les questions.
Il faut juger ses actions à la lumière, non pas de ce que l’on sait aujourd’hui, mais de ce qui était prétendu à l’époque. Si l’on veut bien faire cet effort, on ne peut qu’arriver à la conclusion que la direction générale des finances publiques a parfaitement travaillé, en respectant scrupuleusement la « muraille de Chine » – pour utiliser le terme consacré – que son directeur avait jugé indispensable d’ériger dans les jours qui ont suivi la publication de l’article princeps de Mediapart.
M. Daniel Fasquelle. Edwy Plenel nous a démontré que quiconque le voulait pouvait savoir dès le mois de décembre ; je m’interroge donc sur les raisons de l’inertie du Président de la République et du Premier ministre.
S’agissant de votre demande d’attestation négative, je n’ai pas trouvé vos explications très claires. Comment expliquez-vous que, face à de telles accusations, le Président de la République et le Premier ministre ne vous aient pas convoqué pour vous demander de vous procurer cette attestation négative ? L’affaire aurait pu être réglée en quelques jours, dès le mois de décembre !
Surtout, informés comme ils l’étaient, comment se fait-il qu’ils aient tant tardé à lancer l’enquête administrative et qu’ils n’aient pas saisi la justice française – qui aurait pu obtenir en quelques jours les informations en Suisse ?
Comment expliquez-vous cette inertie ? Confirmez-vous qu’à aucun moment, vous n’avez été convoqué par le Président de la République et par le Premier ministre pour faire toute la lumière sur cette affaire dès le mois de décembre ?
M. Jérôme Cahuzac. Vous posez des questions qui concernent d’autres personnes ; encore une fois, je ne peux pas répondre à leur place !
Vous jugez que la demande d’entraide administrative fut tardive. Je crois qu’il vous a été démontré que pour être recevable, l’État demandeur de cette aide devait avoir épuisé les moyens d’investigation qui lui sont propres. La demande d’entraide ne pouvait donc être envisagée qu’à partir du moment où je n’avais pas répondu dans le délai d’un mois à un formulaire me demandant de confirmer par écrit ce que j’avais affirmé oralement. Je n’ai plus en mémoire la durée qui s’est écoulée entre la purge de ce délai et le moment où la procédure d’entraide administrative a été déclenchée, mais je ne crois pas qu’elle ait été exagérément longue, bien au contraire.
M. le président Charles de Courson. Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez essayé d’obtenir une attestation négative de l’UBS et que, le 13 décembre, vous aviez reçu une réponse négative à cette demande. En avez-vous informé le Président de la République, le Premier ministre et/ou Pierre Moscovici ?
M. Jérôme Cahuzac. Comme je vous l’ai indiqué, mes avocats suisses ont fait la demande en deux temps : ils ont posé d’abord une question de principe, puis une question me concernant. Je ne crois pas avoir parlé explicitement, ni avec Pierre Moscovici, ni avec le Premier ministre, ni avec le Président de la République, des initiatives personnelles que je pouvais prendre – et qui doivent être distinguées bien entendu de la procédure d’entraide administrative. Les deux démarches n’ont rigoureusement rien à voir, même si elles pouvaient avoir un objet identique, sinon la même finalité.
M. Alain Claeys, rapporteur. Je me dois de préciser, monsieur Cahuzac, que le ministre Pierre Moscovici a déclaré, en réponse à l’une de mes questions : « En parallèle, Jérôme Cahuzac se faisait fort d’obtenir de l’UBS la confirmation qu’il n’avait pas détenu de compte chez eux. Cela tardait à venir… »
M. Jérôme Cahuzac. J’ai déjà fait référence à de tels épisodes, qui furent nombreux ; je suis incapable de les quantifier et de les dater. Il ne s’agit pas de trous de mémoire : je mets au défi quiconque de retrouver la date précise à laquelle tel échange a eu lieu six, sept ou huit mois auparavant ; même avec une bonne mémoire, la chose est difficile !
Ces échanges commençaient toujours de la même façon : « Est-ce que ça va ? », « N’est-ce pas trop dur ? ». Il faut que vous admettiez, même si cela vous choque, vous peine ou vous scandalise, que les personnes dont vous parlez me faisaient confiance, et qu’à partir du moment où j’avais déclaré ne pas avoir ce compte, elles m’avaient cru ; je le déplore amèrement aujourd’hui, mais c’est ainsi. On peut leur en faire reproche, mais elles ne furent pas les seules. Qu’elles prennent régulièrement des nouvelles me permettait de leur indiquer que j’avais pris des initiatives personnelles, via mes conseils, pour obtenir une attestation négative.
J’essayais bien sincèrement de le faire car, pour ce qui concerne la période de conservation légale des archives ou, du moins, la période non couverte par la prescription, cela aurait apporté les mêmes informations que celles obtenues par la demande d’entraide administrative. On peut comprendre que, dans le contexte de l’époque, je déployais, par l’intermédiaire de mes conseils, beaucoup d’efforts pour arriver à un résultat. Il est bien probable que, lorsque des collègues me demandaient des nouvelles, je leur indiquais ce qu’il en était.
M. le président Charles de Courson. Mais les avez-vous, oui ou non, informés de l’absence de réponse, c’est-à-dire que l’UBS refusait de vous donner cette attestation négative ? Est-ce qu’au moins l’une des trois personnalités citées a été avertie ?
M. Jérôme Cahuzac. L’échec de mes tentatives était patent : dès lors que je ne publiais pas ce courrier d’attestation négative, c’est que je ne parvenais pas à l’obtenir.
M. Alain Claeys, rapporteur. D’où les propos du ministre…
M. le président Charles de Courson. Mais avez-vous, oui ou non, dit à Pierre Moscovici, à compter du 13 décembre : « J’ai essayé et je n’ai pas réussi » ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne parlais pas de ces efforts au passé, mais au présent : « Je ne parviens pas ». En effet, je ne me suis pas arrêté là : la première réponse d’UBS n’était qu’une réponse générale, de principe. Ensuite, j’ai essayé d’obtenir une attestation négative me concernant ; cela a duré tout le mois de décembre.
M. Daniel Fasquelle. Vous n’avez donc pas été convoqué par le Président de la République et le Premier ministre, et ils ne vous ont pas demandé de fournir une attestation négative. Vous dites qu’ils vous ont cru ; ils se sont contentés de votre parole alors qu’ils disposaient des informations de Mediapart et de Michel Gonelle : voilà ce qui nous trouble !
M. Alain Claeys, rapporteur. La journaliste affirme que, le 5 décembre, le Président de la République vous a demandé, en présence du Premier ministre, de fournir la preuve que ce qu’avançait Mediapart était faux, et donc de faire cette demande à l’UBS. Vous dites que cette assertion est erronée ?
M. Jérôme Cahuzac. Je ne me souviens pas que le Premier ministre et le Président de la République m’aient demandé cela le 5 décembre. J’ai le souvenir que les dénégations que j’ai produites ont – hélas ! – suffi à les convaincre. Je leur ai demandé, en vain à ce jour – peut-être cela sera-t-il possible dans le futur ? –, de me pardonner d’avoir trompé la confiance qu’ils m’avaient accordée.
Mais je n’ai pas répondu à M. Fasquelle. Je n’avais pas besoin d’être convaincu par quiconque de la nécessité d’obtenir une attestation négative. C’est bien sincèrement que j’ai souhaité l’avoir ! J’ai d’ailleurs beaucoup sollicité mes conseils à cette fin.
M. Daniel Fasquelle. Ce qui me trouble, c’est que vous n’ayez pas été convoqué et que l’on n’ait pas exigé que vous produisiez une attestation négative. Dans pareille situation, la responsabilité du Président de la République et du Premier ministre eût été de le faire. Mais tel n’a pas été le cas, n’est-ce pas ?
M. Jérôme Cahuzac. Je le répète : je n’ai pas attendu qu’on me demande d’obtenir une attestation négative pour comprendre la nécessité d’une telle démarche. Quant à l’interrogation que vous manifestez, je comprends bien qu’elle ne s’adresse pas à moi.
M. Daniel Fasquelle. Je veux maintenant vous poser de nouveau la question que je vous avais posée lors de votre précédente audition, monsieur Cahuzac, en précisant que l’enquête judiciaire en cours ne vous empêche pas d’y répondre.
Vous aviez affirmé qu’il n’y avait eu aucun mouvement sur le compte ; or des informations contraires ont circulé. Quelles sont les origines des fonds qui alimentent ce compte ? Comment expliquez-vous ces mouvements ? Existe-t-il d’autres comptes, en Suisse ou ailleurs ?
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le député, vous savez parfaitement que vous entrez de plain-pied dans la procédure judiciaire : je ne peux pas vous suivre sur ce terrain !
M. le président Charles de Courson. Sur ce point, je pense que M. Cahuzac a raison, cependant, il peut nous répondre.
M. Gérald Darmanin. Monsieur Cahuzac, dans l’hémicycle, durant l’examen du projet de loi de finances, vous répondiez aux questions sans notes, en argumentant, sur des sujets aussi complexes que la TVA sur le bois – et, s’agissant de la réunion du 16 janvier, la mémoire vous ferait défaut ? Nous avons du mal à le croire !
« À qui profite le crime ? », demandiez-vous tout à l’heure : on peut poser la même question pour ce qui est de la divulgation au Journal du dimanche de la réponse des autorités suisses ! Au fil des auditions, nous avons appris que ni M. Fouks, ni vos collaborateurs – au sens large –, ni M. Moscovici, ni ses collaborateurs, ni M. Bézard n’ont fourni ce document au Journal du dimanche ; celui-ci a pourtant publié un grand article pour dire aux Français que vous étiez innocenté de ce dont on vous accusait.
Votre conseillère en communication a déclaré que vous aviez été déçu par la publication de cet article, M. Fouks, que vous vous en étiez réjoui. Savez-vous qui aurait pu transmettre ce document, ou une copie, ou encore la teneur de la réponse, aux journalistes du Journal du dimanche ?
M. Jérôme Cahuzac. Je l’ignore. J’avais clairement souhaité une très grande discrétion après qu’a été connu le résultat de l’entraide administrative. Avec le recul, je continue à penser que la publication de cet article ne fut pas une bonne chose pour moi.
M. Georges Fenech. Monsieur Cahuzac, nous avons aujourd’hui la démonstration flagrante que vous avez proféré un mensonge lors de votre première audition.
Vous dites avoir appris par vos avocats suisses l’existence de la demande d’entraide administrative. Or M. Pierre Moscovici a évoqué, avec une grande précision, des « propos échangés » – on interprétera cet énoncé comme l’on voudra – à l’issue du Conseil des ministres, dans une salle attenante : cela ne s’invente pas ! Il a dit que vous étiez serein et que vous aviez souhaité que la demande soit la plus large possible : cela non plus ne s’invente pas ! Nous comprenons qu’aujourd’hui, vous ne pouvez plus revenir sur vos premières déclarations, sans quoi le mensonge serait flagrant ; vous vous réfugiez donc derrière une perte de mémoire, mais cela ne peut pas nous satisfaire : nous avons besoin de lever cette contradiction.
Je rappelle que le président avait annoncé, au début de nos travaux, que s’il était établi qu’un mensonge avait été prononcé sous serment devant notre commission d’enquête, il n’hésiterait pas à saisir le procureur de la République. Nous sommes sur du sérieux !
Vous ne voulez pas vous souvenir de cet échange à l’issue du Conseil des ministres, sans doute pour protéger le Président de la République et le Premier ministre ; mais quatre personnes étaient présentes lors de cette réunion : Pierre Moscovici, qui dit, je le pense, la vérité ; Jérôme Cahuzac, qui ne dit pas la vérité ; le chef de l’État, que nous ne pouvons pas entendre ; et le Premier ministre. Je ne vois pas comment notre commission d’enquête pourrait conserver un quelconque crédit si nous n’entendions pas ce dernier sur ce point !
Le Premier ministre a déclaré : « Nous sommes dans un régime qui a un caractère parlementaire ; le rôle de contrôle qui est le vôtre doit être totalement respecté ». Pourquoi ne pas prendre ces propos à la lettre ? Je regrette que nos collègues de la majorité aient rejeté la demande d’audition du Premier ministre, car je crois que c’est l’intérêt même de ce dernier, et du Gouvernement tout entier, de venir s’expliquer devant la représentation nationale.
En effet, vos propos, monsieur Cahuzac, ne sont pas recevables. Vous ne pouvez pas prétendre ne plus vous souvenir de cet échange : cela n’est pas crédible. Je vous demande donc de bien peser vos déclarations, car on est là sous le coup de la loi pénale, qui punit le faux témoignage. Il est encore temps pour vous de renoncer au déni de réalité et de nous expliquer ce qui s’est passé ce jour-là, à l’issue du Conseil des ministres, dans la salle attenante.
M. Jérôme Cahuzac. Tout à l’heure, le président maniait l’ironie ; vous maniez maintenant la menace. C’est votre droit, mais ni l’ironie ni la menace ne me feront dire des choses dont je n’ai aucun souvenir.
M. Georges Fenech. Je n’accepte pas, monsieur Cahuzac, que vous me parliez sur ce ton !
M. le président Charles de Courson. Monsieur Fenech, restons calmes.
M. Georges Fenech. Je ne brandis pas de menace, j’applique seulement la loi et j’assume les pouvoirs de notre commission d’enquête. J’appelle solennellement l’attention de M. Cahuzac sur un mensonge aujourd’hui flagrant.
M. Pierre Moscovici a livré trop de détails dans ses explications – le lieu où cela s’est passé, les propos tenus par M. Cahuzac – pour qu’il en soit autrement. Il est invraisemblable que M. Cahuzac ne se souvienne pas de cet épisode.
Il s’agit, non pas d’une menace, mais d’un rappel à vos obligations, monsieur Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Avez-vous une autre question, monsieur Fenech ?
M. Georges Fenech. J’aimerais entendre une réponse !
M. Jérôme Cahuzac. J’ai répondu.
M. Georges Fenech. La réponse est édifiante.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’aurai beaucoup appris en matière de sémantique au cours de cette commission d’enquête…
M. Pierre Moscovici a évoqué un « échange » lorsque le Président de la République, le Premier ministre, lui-même et Jérôme Cahuzac se sont rencontrés ; tout à l’heure, M. Cahuzac a parlé d’« échange de mots ». Pour moi, si quatre personnes « échangent » des « mots », c’est une « réunion » – qu’elle soit grande ou petite !
Voici ce que vous aviez dit lors de votre première audition, monsieur Cahuzac :
« M. Alain Claeys, rapporteur. M. Bruno Bézard a indiqué, lors de son audition du 28 mai, que vous aviez « tenté d’entrer dans le débat sur la demande d’assistance administrative et de voir par exemple comment cette demande était rédigée » ; il vous avait répondu que cela était impossible et vous n’aviez pas insisté. Est-ce exact ?
M. Jérôme Cahuzac. Oui. Cet échange n’a duré que quelques secondes. J’ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu’une demande était soit en cours, soit faite. J’en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m’a répondu qu’il n’était pas envisageable que je puisse m’en mêler ; je lui ai donné raison et je ne lui en ai plus jamais reparlé. »
Juste après, vous avez ajouté : « Je n’ai pas souvenir de la date précise, mais ce sont mes avocats suisses qui m’en ont informé ».
Or M. Pierre Moscovici a été affirmatif : il a parlé, en votre présence, de la demande d’entraide administrative avec le Président de la République et le Premier ministre.
On a souvent mis en avant la « muraille de Chine » – qui relève selon moi plutôt de l’autoroute Paris-Pékin ! Comment expliquez-vous que, malgré votre déport, on vous ait informé qu’une demande d’entraide allait être rédigée et que vous ayez indiqué que la période d’interrogation devrait être la plus large possible ?
M. Jérôme Cahuzac. Je me souviens de l’échange avec Bruno Bézard, mais pas de celui décrit par Pierre Moscovici, et ni la menace ni l’ironie ne me feront dire des choses dont je ne me souviens pas – même si je comprends bien que cela simplifierait les travaux de la Commission d’enquête, voire que cela me simplifierait la vie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il n’y avait ni menace, ni ironie dans mes propos !
M. Jérôme Cahuzac. Si j’avais le souvenir d’une telle réunion, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas.
M. le président Charles de Courson. Pour l’information de la Commission, cet épisode se situe entre le 24 janvier, date d’envoi de la demande d’entraide, et le 31 janvier, date de la réponse de la Suisse. M. Bézard ne se souvenait plus quel jour précis M. Cahuzac l’avait appelé pour connaître le contenu de cette demande.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mais la réunion – pardon, « l’échange » ! – relaté par Pierre Moscovici a eu lieu le 16 janvier. Ma question portait sur l’incohérence entre la déclaration de Pierre Moscovici et les propos de M. Cahuzac.
M. Jérôme Cahuzac. « Incohérence » est un terme peut-être excessif. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, la seule conclusion raisonnable à laquelle on peut arriver, c’est que Pierre Moscovici se souvient de ce que vous appelez une « réunion » et que d’autres ont qualifié d’« échange informel » ou d’« échange de mots », alors que moi, je ne m’en souviens pas. Cela ne me paraît pas si choquant que cela : quoi qu’il se soit passé et quel que soit l’endroit ou cela s’est passé, je ne suis intervenu ni dans la décision de principe de déclencher l’entraide administrative, ni dans les modalités de sa mise en œuvre.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit quand même du Président de la République, du Premier ministre et de votre ministre de tutelle – soit les trois personnages hiérarchiquement au-dessus de vous. Ils abordent un sujet qui vous concerne directement, qui modifiera nécessairement la suite de ce dossier, et vous n’en auriez pas souvenir ?
M. Jérôme Cahuzac. S’agissant de l’affirmation de la journaliste selon laquelle cette réunion se serait tenue dans le bureau présidentiel, pour le coup, mes souvenirs concordent avec ceux de Pierre Moscovici.
M. le président Charles de Courson. Pierre Moscovici n’a jamais dit que cela s’était passé dans le bureau du Président, mais à l’issue du Conseil des ministres, dans une salle attenante !
M. Jérôme Cahuzac. Précisément, dans l’ouvrage que vous avez cité, l’auteure indique que cette réunion se serait tenue dans le bureau du Président de la République. Je ne m’y suis pas rendu assez souvent pour l’avoir oublié si cette réunion s’était tenue à cet endroit. J’ai souvenir de la dernière réunion de travail que j’ai eue, avec le Président de la République, dans son bureau : c’était bien antérieur, sur un sujet qui n’avait rien à voir. Quelle que soit la source des informations de la journaliste, si des échanges de mots ont eu lieu, ce n’était certainement pas dans le bureau du Président de la République.
M. le président Charles de Courson. Pierre Moscovici n’a pas dit autre chose.
M. Jérôme Cahuzac. Sur ce point, nos souvenirs convergent donc.
En revanche, nos souvenirs divergent, s’agissant de la réunion informelle, ou de l’échange de mots, survenu à l’issue du Conseil des ministres. La seule explication que je trouve à ce que vous jugez être une incohérence majeure, ou un mensonge – ce que je déplore –, c’est que cet échange a eu lieu à la sortie du Conseil des ministres ; j’étais peut-être à deux ou trois mètres, mais, formellement, je n’ai pas participé à cet échange – en tout cas, je n’en ai aucun souvenir.
Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la version, à aucun moment je ne suis intervenu, ni dans la décision de principe de déclencher l’entraide administrative, ni dans ses modalités de mise en œuvre.
M. Philippe Houillon. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je suis surpris que vous acceptiez et que nous acceptions, aujourd’hui comme le 26 juin dernier, de nous faire « balader » par M. Cahuzac presque à chaque question que nous lui posons, avec plus ou moins de mépris en fonction du sujet et de l’interlocuteur ! A fortiori au moment même où plus de 900 parlementaires – députés et sénateurs – travaillent avec application sur des textes de loi qui sont la conséquence directe de l’affaire Cahuzac.
Vous avez invité M. Cahuzac aujourd’hui pour tenter d’en savoir plus sur la « réunion », « l’entretien » ou « l’échange » qui a suivi le Conseil des ministres du 16 janvier 2013. M. Cahuzac dit n’en avoir strictement aucun souvenir. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette réponse. M. Fenech a estimé nécessaire d’entendre le Premier ministre. Certes, la majorité n’a pas souhaité que cette audition ait lieu, mais la manifestation de la vérité ne dépend pas d’un vote. À présent, je ne vois pas comment nous pourrions faire l’économie d’une telle audition – je le dis d’autant plus librement que je m’étais initialement prononcé contre.
Nous sommes dans une impasse : M. Cahuzac et M. Moscovici se contredisent. Il n’est d’ailleurs guère utile de poursuivre indéfiniment cette audition. Je demande donc que la Commission les auditionne conjointement.
D’autre part, vous ne devez pas vous contenter, monsieur le président, de réponses approximatives. De manière très pertinente, vous vous êtes étonné tout à l’heure que M. Cahuzac ait pu demander à M. Bézard d’être associé à la rédaction de la demande d’entraide administrative, alors même qu’il a prétendu ignorer l’existence de celle-ci. M. Cahuzac a alors bafouillé un peu – ce n’est pourtant guère dans ses habitudes – et vous a répondu qu’il en avait probablement appris l’existence par ses conseils. Vous lui avez fait observer que tel ne pouvait pas être le cas, puisque sa rencontre avec M. Bézard était antérieure à l’envoi de la demande. Nous n’avons donc pas de réponse sur ce point. À moins que M. Cahuzac n’ait été effectivement informé, comme l’a dit M. Moscovici, à l’occasion de la réunion qui fait l’objet de la présente audition. D’ailleurs, si M. Moscovici n’avait pas fait cette déclaration, nous n’aurions pas auditionné à nouveau M. Cahuzac. Il importe de faire la lumière sur cette question.
M. Alain Claeys, rapporteur. Au regard des déclarations des uns et des autres, la question soulevée par M. Houillon se pose en effet. Mais ce n’est pas le moment d’en parler.
M. le président Charles de Courson. Nous en reparlerons à l’issue de cette audition.
M. Philippe Houillon. J’entends bien, monsieur le président. Mais je le répète publiquement : la vérité ne se vote pas, elle se construit. Nous disposons aujourd’hui d’éléments qui plaident en faveur d’une poursuite de notre travail.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comme vous, je souhaite la manifestation de la vérité.
M. Jérôme Cahuzac. Au cours de ma première audition, j’ai été interrogé sur ma tentative – M. Bézard l’a qualifiée ainsi – de franchir la « muraille de Chine ». D’après le compte rendu de mon audition, ma réponse a été la suivante : « Oui. Cet échange n’a duré que quelques secondes. J’ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu’une demande était soit en cours, soit déjà faite. J’en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m’a répondu qu’il n’était pas envisageable que je puisse m’en mêler ; je lui ai donné raison et ne lui en ai plus jamais reparlé. » Vous constaterez, monsieur le député, que je n’ai parlé à aucun moment de la « rédaction » de la demande d’entraide administrative. Je tenais à lever toute ambiguïté, au moins sur ce point.
M. le président Charles de Courson. Pour l’information des membres de la Commission, le magazine Marianne a publié le 12 février le courrier adressé à UBS par les autorités fiscales suisses, lequel reprenait dans son intégralité le contenu de la lettre que leur avait envoyée l’administration fiscale française. Le courrier adressé à UBS n’était pas soumis aux mêmes règles de secret que la première lettre.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Comme beaucoup de collègues, j’ai du mal à concevoir qu’une telle différence existe entre l’intervention précise de M. Moscovici devant nous la semaine dernière et les souvenirs peu nombreux que vous avez.
Je cite quelques lignes, page 156, de l’ouvrage de Mme Charlotte Chaffanjon : « “Puisque tu n’arrives pas à avoir une réponse par la voie personnelle, on va passer par la voie conventionnelle !” expliquent François Hollande et Jean-Marc Ayrault à Jérôme Cahuzac, qui n’a d’autre choix que d’accepter. » L’auteur fait ici référence à la réunion, rencontre ou échange du 16 janvier 2013. Je poursuis : « “Dans un premier temps, il avait été demandé à Jérôme Cahuzac de faire la démarche lui-même, par ses avocats. Comme rien n’est venu de ce côté-là, il a été décidé d’engager la procédure prévue par la convention fiscale entre la France et la Suisse” confirme François Hollande après coup. » Suit un renvoi en bas de page : « Entretien avec l’auteur, 21 mai 2013. » Que vous inspirent ces propos du Président de la République ?
M. Jérôme Cahuzac. La décision de principe d’engager la procédure d’entraide administrative a manifestement été prise par le Président de la République ou par le Premier ministre, voire par les deux en même temps. Cette décision n’a été communiquée qu’à M. Moscovici, qui était le seul à pouvoir la mettre en œuvre. À aucun moment je n’avais à intervenir dans cette procédure et encore moins dans la décision de principe de l’engager. Tels sont les commentaires que m’inspire le passage que vous avez lu, qui me paraît assez compatible avec ce que je me suis efforcé de vous dire en convoquant tous les souvenirs que je peux avoir en la matière – je suis désolé s’ils ne sont pas assez nombreux ou précis. J’étais probablement la dernière personne à « mobiliser » au sein de l’exécutif pour engager cette procédure. Il me paraît donc normal de ne pas l’avoir été.
J’insiste sur le passage que j’ai lu tout à l’heure à la suite de l’intervention de M. Houillon : au cours de ma première audition, à aucun moment je n’ai indiqué avoir voulu être associé à la rédaction de la demande d’entraide administrative. Lorsque j’en ai parlé à M. Bézard, j’ignorais si cette demande était déjà faite ou si elle était en cours. M. Bézard m’a alors dit qu’il n’estimait pas souhaitable que je me mêle de la procédure, à quelque stade qu’elle pût en être. Je ne crois pas qu’il y ait là les incohérences que les uns ou les autres veulent voir, pour des raisons qui vont bien au-delà de mon sort personnel, lequel ne présente plus aucun intérêt.
M. le président Charles de Courson. Mais pourquoi avez-vous abordé ce sujet avec M. Bézard ?
M. Jérôme Cahuzac. Ma curiosité en la matière ne paraît pas totalement incompréhensible, monsieur le président. Elle a d’ailleurs duré moins d’une minute. M. Bézard m’a répondu, de manière aussi catégorique que courtoise, que cela n’était pas possible. Je lui ai immédiatement donné raison.
M. le président Charles de Courson. Vous vous souveniez pourtant d’avoir signé, le 10 décembre, une note indiquant à votre administration que vous n’aviez pas à en connaître ?
M. Jérôme Cahuzac. Il est d’ailleurs bien probable que M. Bézard me l’ait rappelé à cette occasion, et il a bien fait.
Mme Cécile Untermaier. Vous affirmez non pas que la réunion ou l’échange du 16 janvier n’a pas eu lieu, mais que vous ne vous en souvenez pas. Avez-vous néanmoins le souvenir, même imprécis ou fugace, d’avoir évoqué la demande d’entraide à un autre moment, même très rapidement, avec le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de l’économie et des finances, voire avec les trois ensemble ?
M. Jérôme Cahuzac. Je vous remercie, madame la députée, d’accepter la distinction que je m’étais permis de suggérer entre un mensonge assumé et le fait que ma mémoire ne retrouve pas, objectivement, les éléments sur lesquels je suis interrogé. Mon histoire personnelle récente me permet assez bien de faire la différence entre les deux.
Ai-je eu des discussions au sujet de la demande d’entraide avec les deux plus hauts personnages de l’État ? Avec le Premier ministre, oui. Il s’agissait d’échanges personnels et à caractère général, qui n’avaient pas trait à la procédure elle-même et relevaient davantage de l’amitié que d’autre chose. Cette affaire m’affectait – personne ne pourrait le contester ici. Le Premier ministre s’en apercevait, me croyait dans mes dénégations – je le déplore amèrement aujourd’hui – et s’inquiétait pour moi. Il m’interrogeait donc pour savoir si cela allait, si les choses s’éclaircissaient, si j’obtenais une réponse d’une manière ou d’une autre. Je m’efforçais de lui répondre en étant le plus précis possible sur les procédures, et le plus rassurant possible sur mon état. J’ignore si je parvenais à le convaincre.
Avec le Président de la République, non. Dès lors qu’il m’avait interrogé une fois et que je lui avais répondu par des dénégations, il estimait, je crois à juste titre, ne plus avoir à revenir sur ce sujet avec moi. Il ne m’a donc plus jamais interrogé. Cela peut paraître surprenant sur le plan humain, mais je pense qu’il a bien fait, au regard de la fonction qu’il exerce.
Mme Cécile Untermaier. Est-il exact que votre accord était nécessaire pour que la demande d’entraide aux autorités helvétiques couvre une période plus étendue que celle prévue par la convention fiscale franco-suisse ? Dès lors, il serait normal que vous ayez été informé de la demande d’entraide sinon par vos collègues ministres, du moins par l’administration.
M. Jérôme Cahuzac. Cette remarque me semble très utile. La convention fiscale oblige les parties à répondre pour la période postérieure au 1er janvier 2010. Pour couvrir la période antérieure non prescrite en droit français, c’est-à-dire celle du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, il convenait en effet de recueillir l’accord de la personne intéressée, non pas parce qu’il s’agissait d’un membre du Gouvernement, mais parce que les textes qui régissent les relations entre la France et la Suisse en la matière le prévoient explicitement.
C’est d’ailleurs ce qui explique sans doute la chronologie des faits entre le 15 et le 31 janvier, qui a pu vous surprendre : dans la mesure où mon accord était nécessaire, il est normal que mes avocats suisses se soient retournés vers moi ; dès lors qu’ils m’ont demandé cet accord – je le leur ai donné –, cela signifie qu’ils avaient été informés de la procédure à un moment ou à un autre, peut-être antérieur à celui envisagé par certains membres de votre Commission, voire par vous-même, monsieur le président.
M. le président Charles de Courson. À quelle date avez-vous, vos avocats ou vous-même, fait part de cet accord ?
M. Jérôme Cahuzac. Dans la deuxième quinzaine de janvier, c’est certain. Mais il m’est impossible de vous répondre au jour près.
M. le président Charles de Courson. M. Moscovici a affirmé que vous aviez vous-même suggéré une extension à la période de 2006 à 2009 lors de la fameuse réunion du 16 janvier à laquelle vous ne vous souvenez plus avoir participé. Ce serait cohérent. Si vous n’avez pas participé à cette réunion, la question soulevée par Mme Untermaier se pose : à quel moment avez-vous donné votre accord et à qui ?
M. Jérôme Cahuzac. À qui : à mes avocats suisses. À quel moment : entre le 16 et le 24 janvier – date que vous avez indiquée être celle de l’envoi de la demande – probablement autour du 20. C’est non pas un souvenir, mais une déduction.
M. le président Charles de Courson. Vos avocats vous ont-ils appelé pour vous demander votre accord ? Ou bien l’avez-vous donné directement soit à M. Bézard, soit à M. Moscovici ?
M. Jérôme Cahuzac. Quel que soit l’intérêt que pouvait avoir alors cette question pour moi – il était grand –, quelle que soit la connaissance que je pouvais avoir de la convention fiscale franco-suisse, je vous assure que j’ignorais totalement ces subtilités juridiques avant d’être directement concerné. Qui, à l’époque, savait que la réponse des parties au traité était obligatoire pour la période postérieure au 1er janvier 2010, tandis qu’il était nécessaire, pour la période antérieure, de recueillir au préalable l’accord de la personne concernée ? Ces points relèvent d’une telle précision technique que chacun d’entre vous peut admettre que le ministre délégué chargé du budget les ignorait alors, quand bien même ils le concernaient directement.
Dès lors, ce n’est évidemment pas moi qui, d’emblée, serais allé trouver je ne sais qui, à je ne sais quelle occasion, pour demander d’étendre la période sur laquelle portait la demande. J’y insiste : je n’ai aucun souvenir d’une réunion au cours de laquelle j’aurais suggéré une telle extension, tout simplement parce que j’ignorais alors que mon accord était nécessaire pour ce faire. Ce sont mes avocats suisses qui m’ont informé de ces subtilités.
M. le président Charles de Courson. Vous avez affirmé que vos avocats et vous-même ignoriez que la lettre avait été envoyée le 24 janvier. Comment vos avocats ont-ils pu donner un accord alors qu’ils ne connaissaient pas le contenu de la saisine ? Vous avez dû donner un accord, dites-vous, entre le 16 – date de la fameuse réunion à l’Élysée – et le 24 janvier – date d’envoi de la lettre, qui comprenait un paragraphe relatif à la période de 2006 à 2009. Dans leur lettre – qui n’est pas d’une lecture aisée –, les autorités suisses rappellent que vos avocats ont donné un accord, ce qui leur a permis de répondre également pour cette période. D’où l’importance de la question soulevée par Mme Untermaier. Entre le 16 et le 24 janvier, vous saviez donc bien ce qui se préparait, alors même que la lettre n’avait pas encore été envoyée.
M. Jérôme Cahuzac. J’ignorais ce qui se préparait dans le détail que vous avez indiqué, monsieur le président. Je n’ai été au courant de quelque chose que parce que mes avocats suisses m’en ont informé. Je l’ai dit au cours de ma première audition et le maintiens. Vous êtes libres de me croire ou non, mais c’est ainsi.
En réalité, la demande d’entraide administrative a dû être précédée de contacts. Sinon, comment expliquer qu’une demande d’entraide administrative adressée le 24 janvier ait reçu une réponse dès le 31, c’est-à-dire dans un délai record, alors même que le taux de succès de ces démarches est particulièrement faible – 6,5 % de réponses, dont très peu sont exploitables ?
Je pense donc que des contacts préalables ont été pris. Il me semble d’ailleurs que M. Moscovici vous a lui-même indiqué avoir sensibilisé l’administration suisse. Il paraît plausible que l’administration suisse ait alors informé UBS qu’elle aiderait son homologue française et qu’UBS ait elle-même indiqué à mes avocats ce qu’il en était. Je ne dispose pas d’informations avérées à ce sujet : ce sont des déductions qu’il vous appartient de vérifier auprès des personnes concernées. Mais c’est la seule façon d’expliquer, d’une part, que j’aie pu être informé de cette demande par mes avocats et, d’autre part, que cette demande ait pu comporter une question à laquelle il ne pouvait être répondu sans mon accord préalable.
M. le président Charles de Courson. Vous souvenez-vous d’un contact avec vos avocats au sujet de cet accord préalable ?
M. Jérôme Cahuzac. Bien entendu.
M. le président Charles de Courson. Vous le situez donc entre le 16 et le 24 janvier ?
M. Jérôme Cahuzac. Bien entendu. Je me souviens effectivement de ce contact. Je puis même vous préciser que mes avocats suisses étaient d’avis de ne pas donner de réponse favorable à cette demande d’extension de la période pour ne pas créer de précédent. Je leur ai indiqué que je souhaitais, pour ma part, y répondre favorablement. Ils en ont pris acte et ont agi en conséquence.
M. Guillaume Larrivé. Comme membres de cette Commission d’enquête, nous exerçons une fonction de contrôle du pouvoir exécutif et nous nous efforçons de faciliter la manifestation de la vérité. Or, nous nous heurtons aujourd’hui à un mur, celui des incohérences de M. Cahuzac, qui troublent jusque dans les rangs de la majorité. Incohérence d’abord entre la version de M. Cahuzac et celle de M. Moscovici : ce dernier a évoqué l’échange du 16 janvier à quatre reprises au cours de son audition, avec force précisions, notamment de date et de lieu. Incohérence ensuite entre les différentes versions de M. Cahuzac lui-même. Le 26 juin, évoquant la demande d’entraide administrative adressée aux autorités suisses, vous avez affirmé, monsieur Cahuzac : « M. Pierre Moscovici ne m’a jamais informé de cette procédure. » Aujourd’hui, vous vous réfugiez derrière cette amnésie d’autant plus troublante que nous nous souvenons de l’extrême précision de vos propos et des chiffres que vous citiez lorsque, ministre délégué chargé du budget, vous présentiez, sans notes, les projets de loi de finances.
Je formule deux suggestions pour la suite de nos travaux, monsieur le président. La première option est d’auditionner – je le souhaite ardemment – le Premier ministre. M. Moscovici a en effet affirmé que, outre le Président de la République, M. Cahuzac et lui-même, le Premier ministre avait participé à l’échange du 16 janvier. La deuxième option est d’auditionner M. Pierre-René Lemas, qui a pu assister à cet échange et pourrait contribuer utilement à la manifestation de la vérité. En effet, le secrétaire général de la Présidence de la République assiste aux débats du Conseil des ministres et il est d’usage qu’il suive le Président de la République dans le salon Murat, à la sortie du Conseil. En revanche, je ne propose pas que la Commission auditionne à nouveau M. Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République, que nous avons entendu à propos des faits survenus le 15 décembre et qui nous a indiqué ne plus s’être occupé de l’affaire Cahuzac par la suite.
Je tenais à faire ce commentaire publiquement.
M. Charles de Courson. Votre question s’adresse en effet non pas à M. Cahuzac, mais au président, au rapporteur et aux membres de la Commission.
M. Hervé Morin. Je ne participerai pas à la curée, monsieur le ministre. Le tambour de la machine à laver doit tourner à fond depuis des mois. Mais les Français méritaient mieux. Au cours de votre première audition, vous vous êtes drapé dans le secret de l’instruction. Aujourd’hui, vous faites des réponses d’une dialectique redoutable : ni « oui », ni « non », mais « je ne me souviens pas ». Par respect non pas tant pour les parlementaires que pour les citoyens que vous avez servis pendant des années en tant que responsable politique, vous auriez dû faire preuve de transparence, au moins sur certains sujets. Nous ne vous demandons pas de vous livrer à un exercice de psychothérapie publique ! Vous êtes d’ailleurs conscient des dégâts considérables causés par cette affaire – comme par d’autres – à la démocratie française.
Je reviens sur un seul point. Vous avez indiqué avoir procédé en deux temps pour obtenir une attestation négative de la banque UBS : vos conseils ont posé d’abord une question d’ordre général, puis une question vous concernant. On voit bien la manœuvre : vous avez pris la température afin d’être sûr de ne pas rencontrer de problème. Mais vos conseils ne vous ont-ils jamais proposé, pour régler cette affaire, de formuler la question de façon positive ? Si vous aviez posé à UBS non pas la question « Pouvez-vous confirmer que je n’ai pas de compte chez vous ? », mais « Pouvez-vous confirmer que nous avons une relation d’affaires ? », elle aurait été en devoir de répondre et sa réponse aurait été exploitable par les services de l’État. Tout le monde s’accorde sur ce point. Or, on a le sentiment que vous vous êtes organisé, pendant toute cette période, pour que la vérité ne soit jamais dévoilée – elle finit pourtant toujours par éclater – et pour que l’exécutif lui-même – j’ai encore la naïveté de penser que le Président de la République et le Premier ministre ont eu confiance dans vos propos, jusqu’à preuve du contraire – ne la découvre pas. Qu’en est-il exactement ?
M. Jérôme Cahuzac. J’ai été sensible, monsieur le ministre, à vos premiers mots, même si je ne réclame ni compassion ni pitié. Ce qui je vis est perceptible par chacune et chacun d’entre vous, mais cela ne regarde que moi et je m’efforce d’y faire face.
La question que vous posez appelle une réponse assez simple : j’ai fait tout ce que j’ai pu pour obtenir cette attestation négative en décembre, par mes propres moyens. J’ignore ce qu’aurait été la suite si je l’avais effectivement obtenue, mais je formais à l’époque l’espoir que les choses s’arrêteraient là. Vous affirmez que la vérité aurait fini par éclater de toute façon et vous avez probablement raison. Le choix que j’ai fait de mentir au Président de la République, au Premier ministre, puis à la représentation nationale a été catastrophique, non seulement sur le plan personnel, mais de manière générale. J’en paie aujourd’hui le prix – il est très élevé – et j’essaie de le faire le plus dignement possible.
J’aurais aimé avoir cette attestation négative. À un moment, mes conseils m’ont assuré être près de l’obtenir, et je pense qu’ils disaient la vérité. En définitive, la banque a refusé, probablement pour se protéger, pour ne pas se compromettre dans une opération qui aurait abouti à exonérer un responsable public d’une faute très grave qu’il avait pu commettre. Elle a sans doute fait, à l’époque, le même raisonnement que vous : la vérité finirait par éclater.
Quant à savoir si la question était bien ou mal posée, j’ai déjà donné mon sentiment à ce sujet tout à l’heure. Certains concluent ce débat juridique, intéressant en soi, de manière trop rapide et peu satisfaisante. Je ne crois pas que la formulation que vous suggérez aurait permis d’obtenir de la banque des éléments permettant de sortir de cette crise. Je suis même convaincu du contraire. Vous avez bien sûr le droit d’avoir un avis différent.
Mais la question que vous posez est plutôt celle-là : ai-je tenté bien sincèrement, en décembre, d’obtenir par mes propres moyens une attestation négative de la banque UBS ? Oui, tel est bien le cas. De son côté, l’administration fiscale a reçu une réponse partiellement négative par la voie de l’entraide administrative. Le document que j’aurais pu obtenir à ce moment-là par mes propres moyens n’en aurait évidemment pas différé quant au fond.
M. Thomas Thévenoud. Le ministre de l’économie et des finances a évoqué devant nous l’irritation, voire la colère qui a été la sienne après la parution de l’article du Journal du dimanche. Vous en a-t-il fait part à ce moment-là ? Avez-vous évoqué cet article avec lui ? Si oui, que vous a-t-il dit ?
M. Jérôme Cahuzac. Il a été en effet agacé par la parution de cet article, car il s’était, je crois, engagé auprès de son homologue suisse à ce que la réponse qu’apporterait la banque UBS ne fasse l’objet d’aucune publication. C’était peut-être une des conditions posées par l’administration suisse pour peser de tout son poids dans la procédure, afin d’obtenir une réponse d’UBS. C’était également une condition – M. Moscovici faisait un raisonnement judicieux sur ce point – pour que l’administration suisse coopère de manière tout aussi rapide et efficace à l’avenir, si d’autres questions de cette nature venaient à se poser. La parution de l’article violait donc en quelque sorte un engagement pris par M. Moscovici auprès de son homologue suisse et compromettait d’éventuelles démarches ultérieures. Sa colère était donc légitime pour ces deux motifs. Je lui ai donné raison et l’ai assuré que je n’étais pour rien dans cette publication. Et, ce jour-là, je ne lui ai pas menti.
M. le président Charles de Courson. Vous n’avez été pour rien dans cette publication, ni directement ni indirectement ?
M. Jérôme Cahuzac. Je n’ai été pour rien dans cette publication.
M. le président Charles de Courson. Vous avez tout de même parlé à M. Fouks de la réponse des autorités suisses ?
M. Jérôme Cahuzac. En effet, il vous l’a dit lui-même. Je lui en ai probablement parlé par téléphone. Je lui ai également dit qu’il ne fallait pas en faire état, que tel n’était pas mon intérêt. Stéphane Fouks et moi avons des relations d’amitié très anciennes et très sincères. Je n’imagine pas qu’il ait pu faire quoi que ce soit qui se serait avéré préjudiciable pour moi. Je suis convaincu que ce n’est pas lui qui a communiqué l’information au Journal du dimanche. Je le répète : je n’ai été pour rien dans cette publication.
M. le président Charles de Courson. Si ce n’est pas vous, directement ou indirectement, ni M. Moscovici, ni M. Bézard, qui est-ce ?
M. Alain Claeys. Ce n’est pas non plus le procureur.
M. Jérôme Cahuzac. Je ne peux parler que pour moi, monsieur le président. Quoi qu’il en soit, je n’y avais, objectivement, pas intérêt.
M. Thomas Thévenoud. Lorsqu’il a évoqué les raisons de sa colère devant nous, M. Moscovici n’a pas évoqué les relations avec la Suisse : il a estimé que la parution de cet article risquait de paraître exercer une forme de pression sur la justice. Vous a-t-il également fait part de son irritation sous cet angle ?
M. Jérôme Cahuzac. Je me souviens que M. Moscovici a évoqué deux arguments, tous deux très judicieux : l’engagement qu’il avait pris n’était pas respecté ; cela pouvait compromettre des procédures ultérieures. Quant à l’argument que vous évoquez, il me semble que les temps où la parution d’un article de presse pouvait exercer une pression sur un procureur ou sur un juge sont désormais révolus.
M. Thomas Thévenoud. Au cours de votre première audition, vous avez fait état d’une conversation avec M. Woerth, qui serait intervenue après la séance des questions au Gouvernement au cours de laquelle vous avez été interrogé par M. Fasquelle, c’est-à-dire le mercredi 5 décembre. Pour sa part, Mme Chaffanjon parle d’un contact entre M. Woerth et vous-même le lundi 3 décembre. Ce n’est pas tout à fait la même chose : le lundi 3 décembre, c’est le jour où votre conseillère chargée de la communication vous a remis, au banc des ministres, les questions que Mediapart souhaitait vous poser – elle nous l’a indiqué ce matin. Il semble que vous avez déchiré ce document. Dans son ouvrage, Mme Chaffanjon écrit que vous avez alors cherché M. Woerth du regard et que vous êtes allé le voir tout de suite après. Pourriez-vous préciser la chronologie des faits et nous indiquer pourquoi vous êtes allé trouver M. Woerth immédiatement après avoir pris connaissance de ces questions ?
M. Jérôme Cahuzac. C’est là une des très nombreuses inexactitudes ou erreurs patentes que contient le livre de Mme Chaffanjon. Pour quelle raison souhaitais-je parler à M. Woerth ? Parce que les journalistes de Mediapart m’avaient indiqué que M. Woerth avait reçu, en 2008 ou en 2009, un courrier l’informant que je détenais un compte non déclaré à l’étranger.
La théorie selon laquelle j’aurais commandé une étude juridique de complaisance pour aider M. Woerth à sortir indemne de l’affaire de l’hippodrome de Compiègne afin de le remercier d’avoir étouffé je ne sais quelle enquête me concernant lorsqu’il était lui-même ministre du budget, est une construction de Mediapart. Le mardi 4 décembre au matin, les journalistes de Mediapart me l’ont exposée dans ses grandes lignes – ils le feront de manière plus précise ultérieurement – et ont évoqué, à l’appui, le courrier qu’aurait reçu M. Woerth. Ce sont les journalistes qui m’ont informé oralement, à ce moment-là, de la possible existence d’un tel courrier. J’ignorais donc totalement cet élément le lundi 3 décembre. Mme Chaffanjon fait une erreur d’au moins vingt-quatre heures.
M. Thomas Thévenoud. Vous affirmez donc trois choses. Premièrement, que le courriel que vous a adressé Mediapart le 3 décembre ne comportait pas la question suivante : « Avez-vous été informé du fait que l’existence de ce compte ait été portée à la connaissance de votre prédécesseur, Éric Woerth, en juin 2008 ? » Deuxièmement, que les journalistes de Mediapart vous ont appris la possible existence de ce courrier le 4 décembre. Troisièmement, que vous avez eu une conversation avec M. Woerth après la séance des questions au Gouvernement le 5 décembre.
M. Jérôme Cahuzac. Je suis certain d’une chose : je suis allé voir M. Woerth le mardi 4 ou le mercredi 5 décembre pour lui demander s’il avait été informé par un courrier que j’aurais détenu un compte non déclaré à l’étranger. Il m’a répondu qu’il n’avait pas reçu de courrier de cette nature ; ce fait n’est contesté par personne.
La possible existence dudit courrier a-t-elle été mentionnée dans le courriel que m’a envoyé Mediapart le lundi 3 décembre ou les journalistes m’en ont-ils informé oralement le 4 ? Dans mon souvenir, ils m’en ont informé oralement le 4. J’ai reçu le courriel du 3 décembre sur mon téléphone portable personnel avant même qu’il ne me soit remis sous forme imprimée par Mme Marion Bougeard. Je ne me souviens pas si les journalistes de Mediapart m’y interrogeaient déjà à ce sujet. Je n’ai pas gardé ce courriel. Je ne suis pas sûr que cela change grand-chose à l’affaire.
M. Thomas Thévenoud. J’ignore si cela change quelque chose à l’affaire, mais il s’agit de savoir si M. Woerth a été la première personnalité politique avec laquelle vous avez discuté de l’éventuelle existence de votre compte à l’étranger. Cet élément est susceptible d’éclairer la Commission d’enquête.
M. Jérôme Cahuzac. Je n’avais pas vu les choses sous cet angle. Je conçois en effet que cela puisse intéresser votre Commission.
M. Thomas Thévenoud. D’où l’importance de la chronologie.
M. Jérôme Cahuzac. Je comprends bien. Dans mon souvenir, c’est le mardi 4 décembre que M. Arfi m’a indiqué que M. Woerth avait reçu le courrier en question. Je ne doute pas que les journalistes de Mediapart aient conservé un double du courriel qu’ils m’ont adressé. Nous pouvons donc connaître la réponse assez vite.
M. le président Charles de Courson. Sur ce point, les faits sont très précis. Le courriel du 3 décembre comportait la question suivante : « Avez-vous été informé du fait que l’existence de ce compte ait été portée à la connaissance de votre prédécesseur, Éric Woerth, en juin 2008 ? » La question visait peut-être le rapport de l’inspecteur Garnier daté du 11 juin 2008, qui mentionnait en effet l’existence d’un compte. Nous savons désormais que le rapport est remonté à la DGFiP, mais pas jusqu’au niveau du directeur général : l’actuel et le précédent nous ont affirmé n’en avoir jamais eu connaissance. La directrice de cabinet nous a indiqué avoir découvert son existence par l’article de Mediapart et l’avoir fait remonter à son bureau le lendemain. M. Woerth n’a donc jamais eu ce document en sa possession, et la réponse qu’il a faite à M. Cahuzac me paraît crédible au regard de ce que nous savons aujourd’hui concernant M. Garnier.
M. Jérôme Cahuzac. Si M. Arfi m’a posé, dans le courriel du 3 décembre, la question que vous avez lue, il est possible que je sois entré en contact avec M. Woerth dès cette date. Dans mon souvenir toutefois, c’est après une séance de questions au Gouvernement. Néanmoins, je retire l’appréciation que j’ai portée sur cette affirmation de Mme Chaffanjon. Dont acte. Cependant, il y a d’autres inexactitudes.
M. Thomas Thévenoud. Il est donc possible que M. Woerth soit la première personnalité politique avec laquelle vous ayez échangé quelques mots sur cette affaire.
M. le président Charles de Courson. Je rappelle que la Commission a décidé, à la majorité, de ne pas auditionner M. Woerth. Elle peut néanmoins changer d’avis.
M. Hugues Fourage. Vous avez dit avoir tout fait pour obtenir une attestation négative de la banque UBS. Dans le même temps, vous avez souhaité que la demande d’entraide administrative porte sur la période la plus large possible. Quels étaient l’objectif et l’intérêt pour vous d’une telle extension ?
M. Jérôme Cahuzac. J’étais accusé d’avoir détenu un compte à UBS et de l’avoir fermé en février 2010. Cette affirmation a d’ailleurs été reprise comme un fait acquis par certains d’entre vous, notamment par le président de la Commission, lors des premières auditions. La preuve a pourtant été apportée que je n’ai pas détenu de compte à UBS entre le 1er janvier 2006 et janvier 2013. Je n’ai donc pas pu fermer de compte à UBS en février 2010. Au moins une des accusations de Mediapart a donc volé en éclats. En tentant d’obtenir une attestation négative, je pouvais donc avoir cet objectif-là : prouver qu’une des affirmations catégoriques de Mediapart était erronée. C’est d’ailleurs ce que la réponse à la demande d’entraide administrative a fini par montrer.
M. le président Charles de Courson. Peut-être y a-t-il une lecture en creux à faire de cette réponse de M. Cahuzac.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je fais écho aux propos de MM. Fenech et Houillon. Au cours d’une interview sur BFMTV, vous avez employé une formule désormais célèbre : la « part d’ombre » qu’il y aurait en tout homme. Au terme de cette deuxième audition, qui a duré deux heures, estimez-vous avoir levé votre part d’ombre devant la Commission d’enquête ?
M. Jérôme Cahuzac. De mon point de vue, elle est levée depuis le 2 avril.
M. Jean-Marc Germain. Vous venez de confirmer à l’instant que vous n’avez pas détenu de compte à UBS entre 2006 et 2009. La réponse à la question de l’administration fiscale – que vous avez estimée bien posée – indique également que vous n’avez pas été ayant droit d’un compte à UBS au cours de la même période. La banque Reyl n’étant pas constituée sous forme de banque en Suisse avant le 1er janvier 2010, vous n’y avez pas détenu de compte non plus. Donc, si l’administration fiscale avait posé la question « M. Cahuzac a-t-il détenu ou été l’ayant droit économique d’un compte à UBS ou à la banque Reyl », elle aurait obtenu la même réponse que celle qu’elle a effectivement reçue. Est-ce bien exact ?
M. Jérôme Cahuzac. Je corrige une erreur de date : je n’ai pas détenu de compte à UBS entre 2006 et janvier 2013, et non seulement 2009. Le résultat de la procédure d’entraide administrative a été très clair sur ce point. Cette information étant publique, je peux d’ailleurs la confirmer. Me « réfugier » derrière la procédure judiciaire – pour reprendre l’expression de certains d’entre vous – serait absurde, et même déloyal à votre égard. Je ne le ferai donc pas.
Pour le reste, monsieur le député, au risque d’encourir la colère ou de causer la déception de certains de vos collègues – ce que je déplore –, je m’en tiendrai là : la chronologie et les éléments importants ou décisifs relèvent du champ de la procédure judiciaire. Par avance, je vous demande d’être compréhensif.
M. le président Charles de Courson. Il vous serait pourtant tellement simple, monsieur Cahuzac, de nous indiquer la date à laquelle vous avez ouvert un compte à UBS – sans doute au début des années 1990 – et celle à laquelle vous l’avez fermé pour le transférer à la banque Reyl, puis, semble-t-il, à Singapour ! Nous comprendrions alors pourquoi les mécanismes prévus par la convention fiscale franco-suisse n’ont pas fonctionné. Tel était l’esprit de la question de M. Germain. Je répète ce que j’ai dit en introduction : rien ne vous empêche de communiquer ces informations à la Commission. Je vous pose donc pour la dernière fois la même question : pouvez-vous nous indiquer ces deux dates ?
M. Jérôme Cahuzac. Je comprends bien l’intérêt qu’aurait la connaissance de ces dates pour apprécier la pertinence des termes de la convention fiscale. Cependant, tel n’est pas, me semble-t-il, l’objet de votre Commission d’enquête, qui consiste à établir l’existence d’éventuels dysfonctionnements dans l’action des services de l’État. La procédure judiciaire suit son cours et elle finira par être publique : un procès aura lieu au cours duquel tout sera dit. Les éléments qui seront portés à la connaissance des parlementaires à ce moment-là pourraient en effet permettre d’améliorer très utilement non seulement la convention fiscale franco-suisse, mais encore celles qui lient la France à de nombreux autres États.
M. le président Charles de Courson. Votre réponse nous permettrait de gagner deux à trois ans. C’est un détail…
M. Alain Claeys, rapporteur. Je m’adresse non pas à M. Cahuzac, mais aux membres de la Commission. M. Houillon nous a fait part de son sentiment ; il y a en effet matière à débat pour notre Commission. Pour ma part, j’ai l’intime conviction que l’entrevue mentionnée par M. Moscovici a bien eu lieu dans les conditions qu’il nous a décrites hier, même si j’entends que M. Cahuzac ne s’en souvient pas. Selon moi, au cours de cette entrevue, M. Moscovici a en quelque sorte demandé le feu vert pour engager la procédure d’entraide fiscale.
Je l’ai toujours dit très clairement depuis le début des auditions : jamais je n’ai eu le sentiment que l’État a cherché à égarer la justice ou à l’empêcher de fonctionner. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point : à partir du moment où la justice a été saisie, elle a travaillé sans entrave. C’est un acquis important.
Cependant, nous devons encore répondre à deux questions : qui est à l’origine de l’article du Journal du dimanche ? La participation de M. Cahuzac à l’entrevue du 16 janvier pose-t-elle un problème au regard de la « muraille de Chine » ? Ces deux points méritent réflexion. Nous pourrions en discuter demain au cours d’une réunion de travail.
M. le président Charles de Courson. Nous pourrons en effet en débattre demain entre les deux auditions prévues.
M. Jérôme Cahuzac. Je me permets de réagir aux propos du rapporteur. S’agissant de la discordance entre les souvenirs de M. Moscovici et les miens sur l’échange qui aurait eu lieu entre le Président de la République, le Premier ministre, lui et moi, j’aimerais tenter de vous convaincre, si c’est encore possible. L’un d’entre vous a dit que je refusais de reconnaître l’existence de cet entretien au motif que je souhaiterais protéger le Président de la République, le Premier ministre ou je ne sais qui encore. Mais, dès lors que M. Moscovici a lui-même reconnu l’existence de cet entretien, qui aurais-je à protéger ? Personne, absolument personne.
M. le président Charles de Courson. Peut-être vous-même ?
M. Jérôme Cahuzac. Au nom de quoi devrais-je me protéger ? Si j’ai participé à cette réunion ou à cet entretien dont je n’ai aucun souvenir, la faute n’est pas la mienne, mais celle des personnes qui m’ont associé à un processus décisionnel auquel je n’avais pas à l’être. En l’espèce, ce n’est donc pas moi qui serais à protéger. J’espère que certains d’entre vous au moins auront un doute, voire me croiront : je n’ai aucun, absolument aucun souvenir d’un échange qui aurait réuni le Président de la République, le Premier ministre, M. Moscovici et moi-même à la sortie du Conseil des ministres.
Comme plusieurs d’entre vous, j’ai été interpellé par la précision de la description faite par M. Moscovici. Je crois infiniment probable, pour ne pas dire certain, qu’il a eu un échange à ce sujet avec le Président de la République et le Premier ministre. Je crois également très probable que la décision d’engager la procédure d’entraide administrative a été prise à l’Élysée ou à Matignon, davantage qu’au ministère de l’économie et des finances. D’autres que moi sont plus qualifiés pour le dire, puisque je n’ai pas été associé, par définition, à ce processus décisionnel.
Si j’avais le souvenir de cet entretien, je ne vois pas ce qui m’empêcherait de le dire. Il est même probable que cette audition aurait duré moins longtemps et que certains seraient moins irrités contre moi. Si je dis ne pas en avoir le souvenir, c’est que je n’en ai pas le souvenir. C’est ainsi. Évidemment, comme j’ai nié avec tant de force ce que j’ai fini par reconnaître, chacun peut nourrir des doutes lorsque je nie à nouveau avec toute la force que je peux, mais cette fois-ci en conscience, avoir le souvenir de cet entretien. Il revient à chacun d’entre vous, mesdames, messieurs les députés, de se faire son opinion.
M. le président Charles de Courson. Au cours de votre première audition, vous avez affirmé : « M. Pierre Moscovici ne m’a jamais informé de cette procédure. » Quant à vos pertes de mémoire, elles sont peu crédibles : pendant plusieurs années, vous avez donné des preuves de votre très bonne mémoire en commission des finances. Que chacun se fasse, en conscience, son opinion. Comme l’ont évoqué deux de nos collègues, seule une audition du Premier ministre permettrait de vous départager, M. Moscovici et vous.
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le président, je ne conteste pas les affirmations de M. Moscovici : je dis que je n’ai pas le souvenir de cet échange.
M. le président Charles de Courson. En effet, c’est habile.
M. Jérôme Cahuzac. Vous faites référence aux qualités de mémoire que j’ai pu avoir. Cependant, la période que je viens de vivre n’a pas été totalement anodine. Si les facultés auxquelles vous rendez hommage se sont émoussées, j’espère que vous ne m’en tiendrez pas trop rigueur.
M. le président Charles de Courson. Je me suis engagé devant la Commission, vous le savez, à utiliser l’un des rares pouvoirs dont je dispose et dont aucun président de commission d’enquête ne s’est servi jusqu’à présent : celui de saisir la justice si je prenais l’une des personnes auditionnées en flagrant délit de mensonge. Or, effectivement, vous n’avez pas menti – et M. Moscovici non plus – : vous avez dit que vous ne vous souveniez pas. La règle ne peut donc pas s’appliquer.
M. Philippe Houillon. J’interviens d’autant plus volontiers que je ne fais pas partie de ceux qui ont dit que M. Cahuzac souhaitait protéger M. Moscovici. Dès lors que M. Moscovici a indiqué que la réunion du 16 janvier avait eu lieu, il n’y a évidemment plus aucune raison de nier son existence. Cependant, je rappelle un simple élément de chronologie : la première audition de M. Cahuzac s’est tenue avant celle de M. Moscovici. Je ne suis donc pas totalement convaincu par l’argumentation de M. Cahuzac, même si je ne conteste pas a priori sa bonne foi.
M. Jérôme Cahuzac. Monsieur le député, si les propos de M. Moscovici – dont j’ai évidemment eu connaissance avant la présente audition – avaient revitalisé la mémoire qui me fait défaut, je vous l’aurais dit et me serais excusé de ne pas avoir eu ce souvenir lors de la première audition. La chose aurait été réglée très simplement et je ne pense pas, d’ailleurs, que le président de la Commission ni quiconque m’en aurait tenu rigueur. Je le répète : les événements n’ont pas tous marqué ma mémoire, la période ayant été assez éprouvante pour moi. Chacun, je crois, peut l’admettre, même si je ne sollicite ni compassion ni pitié. Si je vous répète que je n’ai pas le souvenir de cette réunion, c’est que je n’en ai pas le souvenir. C’est ainsi.
Auditions du 24 juillet 2013
À 14 heures 30 : M. Alain Letellier et de M. Florent Pedebas, détectives privés.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, nous allons procéder à l’audition à huis clos de MM. Alain Letellier et Florent Pedebas, détectives privés. M. Letellier est installé à Paris et M. Pedebas à Muret, dans le département de la Haute-Garonne.
Messieurs, selon plusieurs sources d’information – dont l’audition, le 12 juin dernier, de M. Rémy Garnier, inspecteur des impôts à la retraite –, vous avez semble-t-il enquêté au cours de l’année 2012 sur la situation, notamment financière, de M. Jérôme Cahuzac. Cette enquête vous aurait conduit à réunir des informations sur les avoirs non déclarés que celui-ci détenait à l’étranger.
Comme vous le savez, notre commission d’enquête a pour objet de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement et des services de l’État dans la gestion de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac ». Nous sommes gênés dans cette mission par le refus de M. Cahuzac de répondre aux questions portant sur le fond de l’affaire, notamment sur la manière précise dont ses avoirs avaient été placés à l’étranger et à quelle date. Nous comptons sur vous pour nous éclairer.
Avant d’aller plus loin, je vous informe que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc de bien vouloir vous lever, lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(MM. Alain Letellier et Florent Pedebas prêtent successivement serment.)
M. le président Charles de Courson. Si cela vous convient, je vais vous laisser vous exprimer durant une quinzaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Claeys, pour un échange de questions et de réponses. J’inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions.
M. Alain Letellier. Je voudrais simplement préciser je suis le seul à avoir été mandaté par Mme Cahuzac. Si mon collègue Florent Pedebas dispose d’un bureau à Muret, à proximité de Toulouse, son agence et sa vie sont à Villeneuve-sur-Lot depuis plus de quarante ans. Je ne l’ai fait intervenir dans cette affaire que pour m’obtenir un rendez-vous le 4 octobre 2012 avec M. Rémy Garnier. M. Pedebas n’est donc absolument pas mandaté par Mme Cahuzac.
M. Florent Pedebas. Je suis effectivement originaire de Villeneuve-sur-Lot et j’ai eu connaissance de l’affaire en 2000 par l’intermédiaire de maître Gonelle : j’ai été l’un des premiers à entendre l’enregistrement sur son téléphone.
M. le président Charles de Courson. Vraiment ? Nous allons y revenir parce que c’est une information nouvelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’est un point important. Quand et comment avez-vous rencontré maître Gonelle ?
M. Florent Pedebas. J’ai été gendarme pendant vingt-et-un ans, dont seize ans comme officier de police judiciaire, au sein d’une unité de recherche. J’ai presque toujours eu des affectations dans le Lot-et-Garonne et j’ai connu maître Gonelle en tant qu’avocat à l’occasion de plusieurs affaires. Lorsque j’ai fait ma reconversion, il fut l’un des premiers à me faire travailler dans le département.
J’ai fait partie des trois ou quatre personnes qui ont écouté l’enregistrement sur son téléphone portable, peut-être le lendemain du jour où il l’avait obtenu. Comme je l’ai déclaré aux policiers de la division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF) qui m’ont interrogé, il y avait en fait deux messages.
M. le président Charles de Courson. Quand était-ce ?
M. Florent Pedebas. Fin 2000 ou début 2001.
M. Alain Claeys, rapporteur. Savez-vous quelles sont les autres personnes qui ont entendu l’enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Probablement des personnes de l’entourage proche de M. Gonelle.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais encore ?
M. Florent Pedebas. Au moins trois personnes : l’huissier de justice de Villeneuve-sur-Lot, M. Rémy Garnier et peut-être une autre personne des services fiscaux.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous eu une copie de l’enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans quelles circonstances M. Gonelle vous l’a-t-il fait écouter ?
M. Florent Pedebas. Je me trouvais à son cabinet pour un autre dossier. Il m’a fait écouter les messages, puis il m’a demandé si je pouvais procéder à la transcription de la communication. Je lui ai répondu que je ne pouvais rien faire, que cela n’aurait aucune valeur, et qu’il valait mieux qu’il s’adresse à un huissier de justice. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait.
M. le président Charles de Courson. S’agissait-il de M. Maurice Chassava ?
M. Florent Pedebas. Oui, c’est bien cela.
M. Alain Claeys, rapporteur. Par la suite, avez-vous parlé à d’autres personnes de cet enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non. Cela a ressurgi lorsqu’il a été mis en ligne par Mediapart, au début du mois de décembre.
M. le président Charles de Courson. Permettez-moi de vous signaler que j’ai reçu le 18 juillet la lettre « anonyme » suivante : « Président, Catuhe a menti : ce n’est pas Gonelle qui lui a fait écouter la cassette, c’est Chassava, huissier de justice entendu dans l’enquête, qui la lui a fait écouter. Demandez-lui. C’est grave de mentir sous serment ! Signé : Gégé ».
M. Florent Pedebas. Je ne connais pas de Gégé !
M. le président Charles de Courson. Cette lettre a été postée dans le Lot-et-Garonne.
M. Florent Pedebas. M. Catuhe doit être l’autre personne des impôts qui a entendu l’enregistrement.
M. le président Charles de Courson. Récapitulons : fin 2000 ou début 2001, vous allez voir maître Gonelle pour une tout autre affaire, et il vous dit : « Je voudrais vous faire écouter quelque chose ». Est-ce bien ainsi que cela s’est passé ?
M. Florent Pedebas. Oui. Comme il savait que j’étais un ancien officier de police judiciaire, rompu à ce genre d’exercice, il m’a demandé si je pouvais procéder à la transcription de cette communication. Je lui ai répondu que non.
M. le président Charles de Courson. Mais avez-vous entendu la communication ?
M. Florent Pedebas. Oui, j’ai entendu les deux messages qu’il y avait sur son téléphone. Dans le premier, M. Cahuzac se fait connaître et l’invite pour l’inauguration du commissariat de Villeneuve-sur-Lot ; le second message s’enregistre dans la poche de la chemisette, me semble-t-il.
M. le président Charles de Courson. Sur quel support vous l’a-t-il fait écouter ?
M. Florent Pedebas. Sur son téléphone mobile. Cela se passait le lendemain ou le surlendemain de la communication.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il n’y a une sauvegarde que pendant quinze jours.
M. le président Charles de Courson. Et qu’avez-vous fait de cette information ?
M. Florent Pedebas. Bah, je lui ai dit d’aller voir l’huissier en question, Maurice Chassava, et je n’ai rien fait d’autre.
M. le président Charles de Courson. C’est vous qui lui avez dit d’aller voir Maurice Chassava ?
M. Florent Pedebas. Non, je lui ai dit d’aller voir un huissier, mais nous travaillions régulièrement avec Maurice Chassava pour les constats d’adultère.
M. le président Charles de Courson. Quelle était votre idée ?
M. Florent Pedebas. Que l’huissier fasse une retranscription papier de la conversation. M. Gonelle voulait que les phrases apparaissent.
M. Philippe Houillon. Il voulait un constat !
M. Florent Pedebas. Oui, c’est cela.
M. le président Charles de Courson. Et vous n’en avez jamais reparlé avec cet huissier ?
M. Florent Pedebas. Non – sauf depuis le 4 décembre dernier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mais entre cette date et le 4 décembre 2012, vous n’avez jamais entendu parler de cet enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non, jamais.
M. le président Charles de Courson. Savez-vous ce que maître Chassava a fait ?
M. Florent Pedebas. Non. J’imagine qu’il a fait ou qu’il a fait faire la transcription. En tout cas, je sais que la conversation a été retranscrite.
M. le président Charles de Courson. Savez-vous s’il en a conservé un exemplaire chez lui ?
M. Florent Pedebas. Je sais seulement que les policiers de la DNIFF sont allés perquisitionner chez lui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et vous, monsieur Letellier, quand avez-vous eu connaissance de l’enregistrement ?
M. Alain Letellier. Je l’ai entendu pour la première fois le lendemain de la parution de l’article de Mediapart, sur mon ordinateur. Mon collègue – et ami – Florent Pedebas ne m’a même pas parlé de cet épisode lorsque nous avons vu Rémy Garnier, alors qu’il était l’un des seuls à avoir écouté cet enregistrement sur son support original, c’est-à-dire le téléphone mobile de M. Gonelle. Il faut dire qu’il a une formation militaire…
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, M. Rémy Garnier nous a indiqué vous avoir reçu tous les deux ; il avait cru comprendre que vous étiez mandatés par Mme Cahuzac, mais vous nous avez dit, monsieur Letellier, que vous étiez le seul à l’être ?
M. Alain Letellier. Absolument ; c’est une avocate spécialiste des affaires familiales qui me connait, maître Michèle Mongheal, qui m’avait envoyé cette cliente.
J’ai fait pour elle un travail tout à fait classique : il s’agissait d’établir la matérialité de faits privés, dans le cadre de son divorce. La mission a duré d’octobre-novembre 2011 à mars 2012. J’ai remis mon rapport à cette date.
J’avais chargé Florent Pedebas, que je connais depuis presque vingt ans, de certaines interventions à Villeneuve-sur-Lot. Je précise que cela fait trente-trois ans que je suis dans le métier, et que je suis vice-président de la chambre professionnelle des détectives français, le Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées (CNSP-ARP), dont il était l’un des administrateurs, dans la région de Toulouse.
M. Alain Claeys, rapporteur. À quelle date avez-vous rencontré Rémy Garnier ?
M. Alain Letellier. Le 4 octobre 2012, à la demande de ma cliente.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ?
M. Alain Letellier. M. Rémy Garnier – dont j’ai écouté attentivement l’audition – vous l’a expliqué longuement. J’avais demandé à Florent Pedebas de m’organiser un rendez-vous avec lui parce qu’il le connaissait.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et il partageait avec lui une information : l’existence de l’enregistrement. Est-ce bien cela, monsieur Pedebas ?
M. Florent Pedebas. Je n’ai su qu’après le 4 décembre 2012 que Rémy Garnier avait eu connaissance de cet enregistrement !
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans ce cas, pourquoi avoir évoqué Rémy Garnier tout à l’heure ?
M. Florent Pedebas. Parce que je l’ai appris depuis lors.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous arrivez donc chez M. Garnier à la demande de Mme Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Oui, dans le cadre d’un mandat lié à une affaire privée, à la suite de la réception de lettres anonymes faisant état de certains faits d’ordre privé – que Mme Cahuzac a probablement produites aux policiers qui l’ont entendue. Cela peut paraître incroyable, mais c’est lié à une rumeur dans le milieu des impôts.
Florent Pedebas, à qui j’avais parlé du dossier, a refusé de faire les filatures et les surveillances classiques sur Villeneuve-sur-Lot, parce qu’il avait un conflit d’intérêt ; c’est pourquoi j’ai fait appel à un collègue de Bordeaux – mais il est tout à fait normal de sous-traiter un dossier en accord avec la cliente.
Le dossier ayant été clos, on m’a demandé de faire une recherche de personnalité – c’est-à-dire qu’une fois que la matérialité des faits actuels a été établie, on oriente l’enquête sur des faits antérieurs, peut-être à la demande de son avocate ou de son avocat – à l’époque je ne savais pas qui c’était. Ce que M. Garnier a déclaré au départ est juste : nous sommes venus pour discuter d’un problème privé. C’est après qu’il s’est un peu emmêlé les pinceaux…
M. Alain Claeys, rapporteur. Mme Cahuzac avait-elle reçu des lettres anonymes ayant trait à des problèmes fiscaux ?
M. Alain Letellier. Non, à des problèmes privés, mais sur lesquels Rémy Garnier était susceptible d’avoir des informations parce qu’il était intervenu dans l’affaire France Prune. Selon une rumeur, des liens privés intéressant notre cliente s’étaient en effet créés à cette occasion. Elle voulait que je vérifie si c’était vrai.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, M. Garnier nous a dit que, quand vous l’aviez rencontré, vous connaissiez l’existence du compte à l’étranger non déclaré de Jérôme Cahuzac. Est-ce exact ?
M. Alain Letellier. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment l’avez-vous appris ?
M. Alain Letellier. Par ma cliente.
M. le président Charles de Courson. Avait-elle des soupçons ou s’agissait-il d’une certitude ?
M. Alain Letellier. Dans un dossier de divorce aussi important, un lien humain se tisse entre la cliente et l’agent de recherches privées. À l’époque, nous nous voyions deux à trois fois par semaine – j’avais juste l’avenue des Champs-Élysées à traverser pour aller à sa clinique. Nous parlions de l’avancée du dossier et, dans la conversation, elle m’a dit que son mari avait un compte en Suisse. Elle m’a d’ailleurs déclaré : « Si je suis entendue par les policiers, je dirai la vérité ».
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous a-t-elle dit que son mari avait un compte en Suisse ou qu’ils avaient un compte en Suisse ?
M. Alain Letellier. Que son mari avait un compte en Suisse
M. le président Charles de Courson. Comment le savait-elle ?
M. Alain Letellier. Vous savez, quand pendant huit à dix ans, vous vivez et travaillez tous les jours avec quelqu’un, des informations sortent ! Elle était également au courant du voyage que Jérôme Cahuzac avait fait en Suisse ; il lui avait dit qu’il avait fait le nécessaire pour clôturer le compte et qu’on n’en retrouverait jamais la trace.
M. Alain Claeys, rapporteur. C’était en octobre 2009 ?
M. Alain Letellier. Elle ne connaissait pas la date exacte.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous a-t-elle parlé de l’enregistrement ?
M. Alain Letellier. Non
Fabrice Arfi m’a rendu visite quelques jours avant la publication de son article. Évidemment, je lui ai demandé comment il m’avait trouvé. « C’est tout simple », m’a-t-il répondu. Il était allé voir Rémy Garnier – quiconque fait une enquête sérieuse à Villeneuve-sur-Lot tombe sur lui ! – et ce dernier avait ostensiblement laissé ma carte de visite sur son bureau. Je ne me suis pas caché, alors que la loi m’y autorise.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand avait-il vu M. Garnier ?
M. Alain Letellier. Trois semaines ou un mois après moi.
M. Alain Claeys, rapporteur. Résumons : quand vous allez voir M. Garnier, vous, monsieur Pedebas, vous connaissez l’existence de l’enregistrement, puisque vous l’avez entendu ; vous, monsieur Letellier, vous êtes mandaté pour une enquête sur des questions privées par Mme Cahuzac, mais vous savez de la bouche de celle-ci que Jérôme Cahuzac a un compte non déclaré à l’étranger et qu’il est allé en Suisse pour le clore en octobre 2009.
Avant d’aller au rendez-vous avec M. Garnier, échangez-vous vos informations ?
M. Florent Pedebas. Non, pas sur ce sujet.
M. Alain Letellier. J’ai juste demandé à Florent Pedebas s’il connaissait Rémy Garnier. Il m’a répondu : « Regarde sur Internet, tu trouveras des informations ».
Rémy Garnier, nous allons le voir par une très belle journée de fin d’été. Nous arrivons sur la place du petit village de Laroque-Timbaut, où nous avions rendez-vous. Le café où nous devions nous rencontrer étant fermé pour cause de décès, Rémy Garnier nous propose de venir chez lui.
Il faut se replacer dans le contexte de l’époque. Cela fait alors dix ans que Rémy Garnier est au fond du trou – lorsque nous l’avons rencontré, il n’était pas l’homme flamboyant que vous avez auditionné ! Lorsqu’il voit arriver un détective de Paris, accompagné d’un autre de Villeneuve-sur-Lot, que de surcroît il connaît, il décide de tout déballer : le dossier France Prune, son mémoire en défense, les procès qu’il a gagnés, etc. Il eût été incorrect de notre part, une fois qu’il avait répondu à nos questions, de ne pas l’écouter – surtout que cela pouvait être utile pour mes investigations. Nous sommes restés avec lui plus de trois heures ! Il avait mis plein d’espoir dans un rendez-vous qu’il devait avoir avec M. Cahuzac dans les jours suivants. Comme il a été éconduit lors de ce rendez-vous, il a tout déballé.
M. Alain Claeys, rapporteur. L’avez-vous interrogé sur le compte en Suisse ?
M. Alain Letellier. Non, c’est lui qui nous en a parlé. Je lui ai répondu que j’étais au courant.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et vous, monsieur Pedebas, qu’avez-vous dit ?
M. Florent Pedebas. Moi ? Rien. Je n’étais pas là pour poser des questions : ce n’était pas mon dossier. Mon rôle se limitait à servir d’intermédiaire et de chauffeur.
C’est vrai que Rémy Garnier est une machine à paroles ! Alain Letellier a commencé par lui poser ses questions concernant l’affaire privée pour laquelle il était mandaté, mais après, il ne nous a pas laissés partir : il voulait absolument nous dire tout ce qu’il savait !
M. Alain Letellier. Il était tellement content de pouvoir parler à d’autres personnes qu’aux correspondants locaux de Sud-Ouest qui avaient un peu relayé son combat ! Il sentait qu’il tenait enfin une occasion de se faire réhabiliter.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pensait-il que, détenant ces informations sur Jérôme Cahuzac, il pourrait avoir satisfaction sur son dossier administratif personnel ?
M. Florent Pedebas. Oui : il n’y avait que cela qui comptait pour lui !
M. Alain Letellier. Il ne demandait d’ailleurs pas grand-chose : obtenir sa réintégration et pouvoir toucher sa retraite.
M. Alain Claeys, rapporteur. Avez-vous effectué un déplacement à Singapour ?
M. Alain Letellier. Non.
M. le président Charles de Courson. Pourtant, Rémy Garnier nous a dit lors de son audition que vous auriez dit revenir de Singapour ?
M. Alain Letellier. Il a tout mélangé. Grâce à ses déclarations, la DNIFF a passé trois heures à perquisitionner dans mon bureau à Paris ! Ils ont épluché ma comptabilité sur les années 2011 et 2012, vérifié mes déplacements, mes frais de téléphone, bref tout ce qui pouvait être lié à un voyage à Singapour. Je ne suis pas allé à Singapour : je l’ai affirmé sur procès-verbal.
En revanche, il est vrai que nous avons parlé de Singapour avec M. Garnier.
M. le président Charles de Courson. Pour la bonne information de la Commission d’enquête, je précise que lorsque nous lui avons envoyé le compte rendu de son audition, M. Garnier nous a demandé de faire une correction : il avait bien dit que vous étiez allé à Singapour, mais, à la réflexion, il pensait avoir mal compris.
M. Alain Letellier. Monsieur le président, le lendemain de son audition, j’ai reçu sept appels de journalistes qui désiraient m’interviewer parce que j’étais allé à Singapour. J’ai donc téléphoné à Rémy Garnier pour lui signaler le problème. Il a reconnu avoir commis une confusion et m’a proposé de faire un démenti auprès de vous. Je lui ai répondu que cela ne ferait qu’engendrer des questions et des sous-entendus. Mais je sais que je ne suis pas allé à Singapour !
Si nous avons parlé de Singapour, c’est parce qu’un collègue en Suisse m’avait signalé en 2011 que des comptes étaient transférés là-bas.
M. Alain Claeys, rapporteur. Mme Cahuzac vous avait-elle parlé du compte à Singapour ?
M. Alain Letellier. Elle n’avait aucune information précise, mais elle savait qu’il y avait eu un transfert.
M. Daniel Fasquelle. Pourquoi avoir parlé de « comptes », au pluriel ?
M. Alain Letellier. En ce qui me concerne, s’agissant de la personne qui nous intéresse, je n’ai entendu parler que d’un seul compte.
M. le président Charles de Courson. Que vous a dit votre correspondant en Suisse, en 2011 ?
M. Alain Letellier. Je vous ai apporté, avec son autorisation, un document que personne n’a encore vu.
Comme nous n’avons pas le droit d’investiguer dans le canton de Genève, nous disposons de correspondants susceptibles de le faire à notre place. M. Léonard Bruchez, qui appartient à un grand cabinet et qui est mon correspondant depuis plus de vingt ans, m’a écrit le 18 janvier 2012 le courriel confidentiel suivant : « Je viens d’avoir un appel d’un confrère de Genève qui travaille sur une affaire concurrente concernant le nommé Dreyfus. Je te donne l’info, comme il me l’a donnée, en confidence absolue : il y a actuellement quatre agences qui sont à la recherche de Dreyfus. L’une d’entre elles – pas toi – cherche des sociétés offshore qui auraient été mises en place par Dreyfus pour le compte de notables français. Je te laisse méditer là-dessus. »
Je n’ai jamais vu un dossier comme cela : à chaque fois que l’on ouvrait un tiroir, un diable en sortait !
Je savais donc depuis près de deux ans qu’une restructuration était en cours à Genève : du fait des nouvelles dispositions du droit helvétique, l’UBS organisait à toute vitesse des transferts de comptes – notamment je pense celui de la personne qui nous intéresse, mais d’autres également.
M. le président Charles de Courson. Pourquoi votre correspondant établissait-il un lien entre le dossier Cahuzac, qui n’existe pas encore, et ce Dreyfus ?
M. Alain Letellier. Parce que ma cliente connaissait l’existence d’un certain Dreyfus, qui s’occupait des affaires de son mari – mais cela donna lieu à un quiproquo.
Le Dreyfus que nous avions trouvé – et qui est évoqué dans le courriel – était un certain Marc Dreyfus, envoyé par l’UBS à Singapour pour s’occuper de cet ensemble de comptes transférés à la va-vite. Mais ce n’est pas ce Dreyfus-là qui intéressait le dossier, puisque, comme nous l’avons appris par la suite, il s’agissait en fait d’Hervé Dreyfus, un homonyme, qui travaillait avec la banque Reyl. Je n’avais jamais entendu parler de lui avant les révélations de Mediapart.
M. Alain Claeys, rapporteur. Dans ce cas, pourquoi avoir enquêté sur ce Marc Dreyfus ?
M. Alain Letellier. Parce que Mme Cahuzac savait qu’un dénommé Dreyfus s’occupait des affaires de son mari, mais elle ne connaissait pas son prénom. Elle n’avait aucune autre information sur le sujet.
Vous savez, je suis intervenu dans les médias une seule fois, sur France Inter, parce qu’une certaine presse présentait Mme Cahuzac comme une personne vindicative, acariâtre – bref : la vilaine épouse jalouse, dont j’aurais été, moi, le bras armé. D’abord, la femme que j’ai côtoyée pendant plusieurs mois n’était pas ainsi : elle était calme, posée, pondérée. Ensuite, nous avons appris l’existence de l’enregistrement lorsque l’article de Mediapart a paru ; elle ne m’en avait jamais parlé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Résumons : vous rencontrez pour la première fois Mme Cahuzac en octobre 2011 ; elle évoque à ce moment-là l’affaire privée et, dans la conversation, l’existence d’un compte en Suisse non déclaré ; vous rencontrez ensuite, en octobre 2012, M. Garnier.
M. Alain Letellier. C’est cela.
En mars 2012, mon rapport est remis, les photographies sont déposées, les attestations sont faites, le dossier est clos.
En octobre 2012, un rappel est fait, certainement à la suite d’une demande de son conseil de l’époque, qui voulait un supplément d’informations sur des faits antérieurs relatifs à la vie privée de M. Cahuzac. Cela nous a amenés chez Rémy Garnier.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le 18 janvier 2012, vous avez un contact avec vos confrères de Suisse, qui vous expliquent le mécanisme « Dreyfus ».
M. Alain Letellier. Exactement.
En décembre 2011, se tient à Nîmes le congrès de notre chambre professionnelle. Y sont invités des collègues étrangers – dont Léonard Bruchez, de Suisse. Nous parlons investigations, et je lui demande de regarder si l’on peut avoir des informations sur le compte de M. Cahuzac ou sur le dénommé Dreyfus. Mais je n’ai pas été plus loin dans mes investigations, parce que je n’ai pas eu de mandat pour cela.
M. le président Charles de Courson. Il y a donc eu deux mandats. Dans lequel des deux vous a-t-on demandé de faire une recherche sur un éventuel compte détenu par Jérôme Cahuzac en Suisse ?
M. Alain Letellier. Je n’ai jamais eu de mandat en ce sens. J’ai eu un mandat, dans le cadre d’une procédure de divorce, pour établir la matérialité de faits relatifs à la vie privée – c’est tout.
Certes, j’ai essayé d’obtenir d’autres informations grâce à mes contacts, mais je sortais alors de mon mandat. J’ai transmis ces informations à ma cliente, mais je n’ai pas eu de mandat écrit pour aller plus loin.
M. Alain Claeys, rapporteur. Parmi les lettres anonymes que Mme Cahuzac a reçues, certaines parlaient-elles de questions fiscales ?
M. Alain Letellier. Je ne sais pas.
M. le président Charles de Courson. Les avez-vous lues ?
M. Alain Letellier. Seulement celles évoquant un certain problème privé, qui pouvait être très lourd pour une femme.
D’ailleurs, j’ai ici la copie d’un chèque datant du 6 septembre 2012, par lequel elle me mandate, alors que le dossier est clos, pour aller voir Rémy Garnier.
J’ai donc eu deux mandats, et les deux dossiers correspondants ont été saisis par la DNIFF : non seulement ils ont étudié mes courriels, mais ils ont emporté les rapports, les photographies et les photocopies des chèques ! Tous ces documents ont été placés sous scellés.
M. Alain Claeys, rapporteur. Rémy Garnier était donc parfaitement au courant de la vie privée des habitants de Villeneuve-sur-Lot, en particulier de celle de Jérôme Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Absolument.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’en pensez-vous, monsieur Pedebas ? C’était la tour de contrôle !
M. Florent Pedebas. Rémy Garnier en voulait tellement personnellement à M. Cahuzac depuis l’affaire France Prune, qu’il cherchait tout ce qu’il pouvait trouver sur lui ! Il a toujours ratissé large, y compris dans la sphère privée.
M. le président Charles de Courson. Cela sortait du champ de ses compétences ?
M. Florent Pedebas. Bien entendu !
M. Alain Letellier. Après notre visite, il est allé voir un journal satirique de Villeneuve-sur-Lot, La feuille.
M. Florent Pedebas. La directrice l’a même viré de son bureau !
M. Alain Letellier. La feuille a publié un article de deux pages reprenant l’intégralité de la conversation que nous avions eue : l’affaire du chien d’aveugle, l’enfant… Tout est paru dans la « feuille de chou » de Villeneuve-sur-Lot !
M. le président Charles de Courson. L’article évoque-t-il le fameux compte ?
M. Alain Letellier. Non : il évoque Jean François-Poncet, les lettres anonymes, mon enquête et des faits privés.
M. Florent Pedebas. En revanche, dans un numéro de 2008 ou de 2009, Anne Carpentier avait écrit un article de deux pages sur les liens de Jérôme Cahuzac avec certains laboratoires pharmaceutiques. La DNIFF m’a d’ailleurs demandé si j’avais des informations à ce sujet : je lui ai dit que ma seule connaissance provenait de cet article et elle a saisi mon exemplaire.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Letellier, aviez-vous évoqué avec Mme Cahuzac ces liens que son mari pouvait entretenir avec des laboratoires ?
M. Alain Letellier. Oui – c’est d’ailleurs la source d’une autre confusion de M. Garnier. Celui-ci vous a dit que nous possédions une liste de laboratoires, alors qu’en réalité, j’avais juste noté sur un bout de papier deux noms – dont celui du laboratoire Innothera à Monaco. Mme Cahuzac savait que son mari avait pu avoir des liens avec eux, mais nous n’avions aucune preuve.
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Pedebas, quels étaient les liens entre M. Gonelle et M. Garnier ?
M. Florent Pedebas. M. Gonelle était l’avocat conseil de M. Garnier dans ses procès contre l’administration fiscale.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous qui connaissez bien Villeneuve-sur-Lot, avez-vous une idée de la manière dont cet enregistrement a pu arriver chez Mediapart ?
M. Florent Pedebas. Je reprends les hypothèses des autres.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous avez surement votre idée. Dîtes-moi votre idée.
M. Florent Pedebas. Peut-être est-ce l’un de ceux qui ont eu le mini-CD entre les mains qui le leur a remis : à savoir, Maurice Chassava, Jean-Noël Catuhe ou le juge Bruguière.
M. Alain Claeys, rapporteur. Et Michel Gonelle ?
M. Florent Pedebas. Vu les relations professionnelles que nous avons, je pense qu’il me l’aurait dit.
M. Alain Claeys, rapporteur. D’après vous, qui est-ce ?
M. Florent Pedebas. Je pencherais plutôt pour une relation du juge. Je vois mal les deux agents des impôts remettre un enregistrement à Mediapart !
M. le président Charles de Courson. Et maître Chassava ?
M. Florent Pedebas. Ah non ! Depuis qu’il est à la retraite, il vit dans sa ferme ; il entretient sa vigne, ses volailles… Ce n’est pas le genre à venir à Paris. M. Catuhe, cela m’étonnerait aussi.
Attention : je n’ai pas dit que c’était le juge – mais je pense qu’il fallait avoir des relations à Paris pour le faire.
M. le président Charles de Courson. L’avocat de Jérôme Cahuzac, maître Jean Veil, a dit que le compte avait été alimenté par des versements provenant directement de certains laboratoires pharmaceutiques, mais aussi par des règlements en espèces de la part de clients de la clinique.
Mme Cahuzac, qui est la gestionnaire de cette clinique, vous a-t-elle parlé de l’alimentation de ce compte ?
M. Alain Letellier. Non, en aucune façon. Et je n’ai pas pour vocation de faire des enquêtes sur mes clientes !
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Letellier, avez-vous rencontré, dans le cadre de votre enquête, d’autres confrères qui enquêtaient sur la même personne, mais mandatés par d’autres.
M. Alain Letellier. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous pouvez nous expliquer ?
M. Alain Letellier. J’ai rencontré une personne, mais je ne citerai pas son nom. Si je suis interrogé par les magistrats, je verrai ce que je fais. Deux ou trois jours après avoir ouvert le dossier de Mme Cahuzac, j’ai rencontré, non pas un agent de recherches privées, mais une personne spécialisée dans les recherches immobilières, à qui j’avais demandé un travail – il n’a pas son pareil pour trouver très vite des informations dans le cadastre et les actes notariés. Dans mon bureau, il a vu des éléments du dossier Cahuzac et il m’a indiqué que d’autres personnes enquêtaient sur le patrimoine de Jérôme Cahuzac.
M. le président Charles de Courson. Cela se passait en octobre 2011 ?
M. Alain Letellier. Oui. De cette personne, on ne pourra rien apprendre d’autre que le nom du cabinet d’avocats qui le mandate : il ne cherche jamais à savoir qui est derrière le cabinet pour lequel il travaille. Moi, si un avocat me mandate et même si c’est lui qui me paye, je veux savoir qui est le client, les tenants et les aboutissants de l’affaire. Lui obéit à une autre règle. C’est quelqu’un que je connais depuis plus de vingt ans.
Il est évident qu’il ne s’agissait pas de ma cliente : elle n’allait pas faire une enquête sur son propre patrimoine. Il y a donc quelqu’un d’autre qui enquêtait sur le patrimoine sur M. Cahuzac en octobre 2011.
M. le président Charles de Courson. Savez-vous qui avait mandaté votre collègue ?
M. Alain Letellier. Non.
M. le président Charles de Courson. Il ne vous l’a pas dit ?
M. Alain Letellier. Il ne me le dira pas ! Il y a à peu près cinq ans, le hasard a fait qu’il intervenait sur un dossier qui concernait l’un de mes clients : ce dernier m’a harcelé pour savoir qui enquêtait sur lui, mais je n’ai jamais eu la réponse.
Toutefois, vu la structure et la méthode de travail, je ne pense qu’il s’agisse d’une agence de recherches privées : nous sommes, je pense, dans le domaine de l’intelligence économique. Des gens sont allés à Singapour, c’est vrai.
M. le président Charles de Courson. Qui ?
M. Alain Letellier. Je n’ai pas de noms, mais ils appartenaient nécessairement au milieu de l’intelligence économique. Je n’ai ni l’envergure ni la structure pour faire ce type d’enquête à Singapour.
M. le président Charles de Courson. Comment l’avez-vous appris ? Par un collègue de Singapour ?
M. Alain Letellier. Non, par la bande, en discutant avec d’autres collègues.
Certains journalistes ont des noms. Par exemple, M. La Bruyère, de Paris Match, sait que des personnes – pas des détectives – sont allées investiguer à Singapour à cette époque.
M. le président Charles de Courson. M. Garnier nous a dit que vous lui aviez dit que vous étiez « filochés ». Est-ce vrai ?
M. Alain Letellier. Non. Dans ce dossier, bien que je m’y attendais, je n’ai jamais reçu aucune menace, ni aucun coup de téléphone anonyme.
M. Alain Claeys, rapporteur. Connaissez-vous maintenant la chronologie des comptes de M. Cahuzac à l’étranger ?
M. Alain Letellier. Non, je ne peux pas vous aider sur ce point. Je n’ai fait que tâter le terrain pour savoir si l’on pouvait avoir des informations. Dans un autre courriel, mon collègue de Genève m’a écrit avec humour que ce n’était pas la peine d’en chercher à l’UBS, parce qu’ils ne voulaient même plus nous donner l’heure ! Cela est maintenant totalement verrouillé, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ou six ans.
Mme Cécile Untermaier. Vous avez dit que lorsque vous avez rencontré Rémy Garnier, en octobre 2012, il espérait beaucoup de sa prochaine entrevue avec M. Cahuzac, et qu’ensuite il avait « tout déballé ». Qu’entendez-vous par là ? Considérez-vous que c’est lui qui s’est vengé de M. Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Oui, c’est le sentiment que j’ai eu. Nous avons passé presque quatre heures avec lui. Nous sommes repartis avec une mine de renseignements : nous avions tous les éléments de ses dossiers !
Mme Cécile Untermaier. C’est une déduction que vous faites suite à l’échec de son entrevue avec M. Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Ce que je dis est étayé par le fait qu’il s’est épanché dans La feuille quelques jours après son rendez-vous avec M. Cahuzac – qui a tourné court.
Mme Cécile Untermaier. C’est ce que veut dire cette phrase ?
M. Alain Letellier. Oui. Comme je vous l’ai dit, si l’on enquête sur Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot, Rémy Garnier est une personne incontournable.
Mme Cécile Untermaier. Ceci dit, il ne détenait pas l’enregistrement ?
M. Alain Letellier. Non : s’il l’avait eu, comme il nous a tout sorti, je pense que nous l’aurions entendu !
Mme Cécile Untermaier. Malgré des investigations poussées, avec des moyens importants, vous n’avez trouvé aucune information sur un compte à l’étranger à rapporter à Mme Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Non : nous n’étions pas mandatés pour cela et nos investigations n’ont pas été poussées. Je n’ai eu qu’un contact avec un collègue du canton de Genève que je connais depuis vingt ans. J’ai essayé de voir si l’on pouvait trouver quelque chose et cela s’est arrêté là. D’ailleurs, ce n’était pas le souhait de ma cliente, elle avait déjà dans son dossier de quoi se défendre ! Je n’en dirais pas plus.
M. Jean-Marc Germain. Pourriez-vous préciser la chronologie des faits ? Quand avez-vous découvert l’existence de l’enregistrement : est-ce en octobre 2012, lorsque M. Garnier vous en a parlé, ou en décembre 2012, avec la parution de l’article de Mediapart ?
M. Alain Letellier. M. Garnier ne nous a jamais parlé de l’enregistrement. Il nous a dit qu’un aviseur l’avait appelé, peut-être vers 2006 – en tout cas avant qu’il rédige son mémoire –, pour lui signaler que l’intéressé avait un compte en Suisse. Il n’a pas parlé de l’enregistrement.
Mon collègue Florent Pedebas pense que M. Garnier avait écouté l’enregistrement, mais, au fond, on n’en sait rien.
M. Florent Pedebas. Disons que je présume qu’il l’a entendu dès le début, comme moi.
M. Jean-Marc Germain. Et pourquoi n’avez-vous pas partagé cette information importante avec votre collègue ?
M. Florent Pedebas. À l’époque, on n’en parlait pas !
M. Jean-Marc Germain. Vous saviez pourtant que M. Letellier enquêtait sur la situation de M. Cahuzac ?
M. Florent Pedebas. Oui, mais, depuis décembre 2000 ou janvier 2001, je n’en ai jamais parlé à personne.
M. Jean-Marc Germain. Pour quelle raison ?
M. Florent Pedebas. Parce que c’est ainsi.
M. Alain Letellier. Ah ça, quand je l’ai su, je l’ai attrapé ! Mais il est comme cela : c’est un gendarme…
M. Jean-Marc Germain. Avez-vous au moins aiguillé votre collègue vers M. Garnier ?
M. Florent Pedebas. Oui, lorsqu’il cherchait quelqu’un des services fiscaux du Lot-et-Garonne.
M. Jean-Marc Germain. Vous espériez donc que M. Garnier lui parlerait de l’enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non, pas du tout : je pensais qu’il détenait des informations sur l’affaire privée annexe à l’affaire France Prune. M. Cahuzac était alors intervenu auprès d’autres personnes.
M. le président Charles de Courson. Mais encore ?
M. Alain Letellier. Ce qu’il faut comprendre – et certains journalistes n’ont toujours pas compris, c’est que nous sommes allés voir Rémy Garnier pour un problème privé, lié à l’administration fiscale. Il vous a dit de quoi il s’agissait ! Ensuite, nous avons parlé du reste, mais c’était connexe.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi avoir fait cette démarche auprès de vos collègues en Suisse ?
M. Alain Letellier. Je vous l’ai dit : pour essayer de savoir si l’on pourrait obtenir des informations. Mon collègue m’a répondu par la négative, et cela s’est arrêté là.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quand le nom de Dreyfus vous a-t-il été donné ?
M. Alain Letellier. Je ne sais plus exactement, mais le courriel répondant à ma demande est daté du 18 janvier 2012.
M. Jean-Marc Germain. Nous confirmez-vous que des collègues à vous enquêtaient sur l’existence d’un éventuel compte de M. Cahuzac à Singapour ?
M. Alain Letellier. La réponse est dans le courriel que je vous ai lu : « Il y a actuellement quatre agences – en Suisse, il peut s’agir d’importants cabinets d’intelligence économique, comme Kroll ou Pinkerton – qui sont à la recherche de Dreyfus. L’une d’entre elles – pas toi – cherche des sociétés offshore qui auraient été mises en place pour le compte de notables français. »
M. Jean-Marc Germain. Cela ne concernait donc pas directement M. Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Non, cela concernait la panique qui s’est emparée d’UBS quand la législation suisse a changé et qu’elle lui a fallu rapatrier un certain nombre de structures qui lui brûlait un peu les doigts.
M. le président Charles de Courson. Comme nous l’ont expliqué des personnes précédemment auditionnées, par suite de la nouvelle réglementation suisse applicable au 1er janvier 2010, de nouveaux mécanismes ont été mis en place pour dissimuler les comptes : délocalisation à Singapour, trusts – bref, une série de montages juridiques destinés à les protéger.
M. Alain Letellier. C’est tout à fait cela.
M. le président Charles de Courson. L’hypothèse la plus vraisemblable est que Jérôme Cahuzac a fait un aller et retour en Suisse en octobre 2009 – la date a été confirmée par le Président de l’Assemblée nationale, car il avait pris ses billets ici – pour adapter sa situation à la nouvelle réglementation suisse et effectuer les opérations nécessaires. Et Mme Cahuzac le savait.
M. Jean-Marc Germain. Le Canard enchaîné prétend que vous vous êtes trouvé nez à nez avec une deuxième équipe de détectives privés au pied de l’appartement de M. Cahuzac. Est-ce vrai ? Étiez-vous, à votre connaissance, les seuls détectives privés à travailler sur cette affaire ? On a parlé d’autres équipes qui auraient pu être mandatées par des laboratoires pharmaceutiques par exemple.
M. Alain Letellier. Je ne suis pas à 100 % dans les secrets de Mme Cahuzac, mais, à ma connaissance, j’étais à cette époque le seul agent de recherches privées à investiguer sur ces questions.
Il reste que si M. La Bruyère, de Paris Match, qui est un bon journaliste, a publié un rectificatif après avoir écrit que j’étais allé à Singapour, il a maintenu que d’autres équipes y étaient allées.
D’autre part, Hervé Martin, dans Le Canard enchaîné, parle du « Roumain de Singapour ». ça, c’est vrai : en mai 2012, Mme Cahuzac, complètement paniquée, m’a appelé parce qu’un prétendu patient lui avait proposé, moyennant finances, des informations sur le compte de son mari à Singapour, avec les derniers mouvements ; il lui avait laissé deux numéros de téléphone. J’ai reproché à Mme Cahuzac de ne pas l’avoir fait patienter : nous aurions pu lui parler ou prévenir le procureur !
Il y a donc bien une autre équipe qui faisait des investigations sur l’intéressé.
M. le président Charles de Courson. Par qui étaient-ils mandatés, selon vous ?
M. Alain Letellier. Pour aller faire de telles enquêtes à Singapour, il ne pouvait pas s’agir d’une personne physique ; seule une personne morale en avait les moyens.
M. Alain Claeys, rapporteur. En avez-vous parlé avec votre cliente ?
M. Alain Letellier. Oui.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quelle fut son explication ?
M. Alain Letellier. Elle était dubitative.
M. Alain Claeys, rapporteur. A-t-elle évoqué une hypothèse ?
M. Alain Letellier. Elle savait que des personnes ne voulaient pas que son mari soit ministre. Elle me l’a toujours dit. D’ailleurs, elle m’a appelé trois jours avant sa nomination – à l’époque, elle ne savait pas s’il serait ministre du budget ou de la santé – pour me dire qu’elle comprendrait très bien si j’abandonnais l’affaire. Je lui ai répondu qu’il n’en était pas question.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ce serait ça, l’explication ?
M. Alain Letellier. Quand on fait une enquête sur le patrimoine et les aspects financiers, c’est qu’on cherche des casseroles pour casser quelqu’un.
M. le président Charles de Courson. Pouvait-il s’agit des services de renseignement français ?
M. Alain Letellier. Écoutez, moi, faisant depuis trente-trois ans ce métier et connaissant depuis deux ans l’ensemble du dossier, je n’ai jamais compris comment il avait pu être nommé ministre ! J’imagine qu’un dossier est transmis au moment de la nomination ?
M. le président Charles de Courson. Non, contrairement à ce que l’on pourrait croire !
M. Alain Letellier. Une cliente suisse m’a dit récemment que tout le monde sur la place de Genève connaissait l’existence du compte de Jérôme Cahuzac !
Mme Cécile Untermaier. Pourtant, vous n’avez pas pu le constater !
M. Alain Letellier. N’oubliez pas, madame la députée, que les enquêtes que j’aurais pu diligenter à l’UBS se seraient toutes soldées par une réponse négative, puisque le compte avait été monté par la structure Reyl et qu’il avait ensuite été transféré à Singapour. On aurait pu faire toutes les enquêtes possibles, on n’aurait rien trouvé.
M. Dominique Baert. Vous dites qu’une deuxième équipe avait été mandatée par une personne morale pour enquêter sur le patrimoine de M. Cahuzac, et que quatre agences – et non des moindres – menaient en Suisse des investigations sur des transferts de comptes appartenant à des notables français. À votre sens, qui ces informations intéressaient-elles au point de dépenser tant d’argent ?
M. Alain Letellier. Je n’ai malheureusement pas de réponse précise à votre question.
M. Dominique Baert. Peut-être des hypothèses ?
M. Alain Letellier. Tout est possible ; des laboratoires pharmaceutiques pouvaient ne pas souhaiter que M. Cahuzac soit ministre de la santé. Ce qui est sûr, c’est qu’il y avait du monde derrière lui qui cherchait à le casser. Je suis désolé, je ne sais pas qui.
On parle parfois d’« officines ». Moi, ce terme me hérisse. Nous sommes surveillés par notre chambre professionnelle, qui a adopté un code de déontologie. Mais c’est vrai que, avant chaque élection importante, nous avons des demandes concernant des personnalités de droite ou de gauche. Cela vient en général de chemins détournés, mais, avec le métier, on les sent venir. Personnellement, je refuse ce genre d’investigations.
Si mon collègue étudiait le patrimoine immobilier et le plan de financement de l’appartement de l’avenue de Breteuil, c’est qu’il y avait un problème – comme l’ont montré les articles publiés depuis lors.
M. Christian Eckert. Monsieur Letellier, vous dites avoir été mandaté par Mme Cahuzac pour faire des recherches sur des sujets d’ordre privé, mais vous avez néanmoins investigué auprès de M. Garnier, qui est un agent du fisc, ainsi qu’auprès d’un de vos confrères en Suisse, toujours sur des questions financières et fiscales. Pourquoi ?
M. Alain Letellier. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : je n’ai pas fait d’enquête fiscale.
En décembre 2011, ayant recueilli dans le cadre de mon enquête plusieurs informations, j’ai simplement examiné la possibilité de pousser plus loin certaines investigations. Mais à partir du moment où j’ai eu des réponses négatives, je ne les ai pas diligentées et elles n’ont fait l’objet d’aucun rapport.
M. Georges Fenech. Pourquoi avoir étudié cette possibilité ?
M. Alain Letellier. Parce que ma cliente m’avait demandé de voir si je pouvais avoir quelques informations, tout en me disant qu’elle ne pensait pas que je pourrais en obtenir. Elle savait que c’était mission impossible.
M. Christian Eckert. C’est un peu contradictoire !
M. Alain Letellier. Le courriel est clair : je cherchais un dénommé Dreyfus.
M. Christian Eckert. Est-ce que ce M. Dreyfus est concerné par des questions relevant de la vie privée ?
M. Alain Letellier. Non.
M. Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ? Que vous a-t-elle demandé précisément ?
M. Alain Letellier. De voir au niveau de l’UBS, car elle savait que le compte était là-bas. Elle ne savait même pas qu’il avait été transféré. Elle cherchait à savoir si nous pouvions obtenir des informations dessus.
M. le président Charles de Courson. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous étions dans le cadre d’une procédure de divorce. Sous quel régime étaient-ils mariés ?
M. Alain Letellier. Je ne sais pas. Peut-être en partie sous le régime de la communauté, en partie sous celui de la séparation.
M. Philippe Houillon. C’est soit l’un, soit l’autre !
M. le président Charles de Courson. M. Veil a déclaré qu’une partie du compte avait été alimentée par des versements en espèce depuis la clinique. Il me semble évident que, dans le cadre du divorce, Mme Cahuzac cherchait de quoi obtenir une compensation. C’était assez logique.
M. Christian Eckert. La question n’est pas fondamentale. Toutefois, n’aviez-vous pas précisé que votre mission ne concernait que la vie privée de M. Cahuzac ?
M. Alain Letellier. Au départ.
M. Christian Eckert. Elle a donc été étendue dans un deuxième temps aux aspects financiers liés au divorce ?
M. Alain Letellier. Non, il ne s’agissait que d’obtenir des informations sur un dénommé Dreyfus.
Vous faites la même confusion que les journalistes ! Je suis allé voir M. Garnier pour l’interroger sur une question d’ordre privé, consécutivement à la réception de lettres anonymes par Mme Cahuzac. Il se trouve que M. Garnier est inspecteur des impôts et qu’il avait un dossier fiscal sur l’intéressé, mais ce n’était pas l’objet de notre visite. Cet objet, M. Garnier vous l’a dit lui-même, explicitement !
M. Alain Claeys, rapporteur. Les autres équipes ont-elles rendu visite à M. Garnier ?
M. Alain Letellier. Non.
M. Florent Pedebas. Je ne sais pas. En revanche, tous les journalistes sont ensuite passés chez lui !
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Pedebas, avez-vous rencontré les journalistes de Mediapart ?
M. Florent Pedebas. Oui, ils sont venus me voir à Villeneuve-sur-Lot.
M. Alain Claeys, rapporteur. Vous ne les connaissiez pas avant ?
M. Florent Pedebas. Fabrice Arfi est venu me voir pour la première fois à Toulouse, vers le début janvier 2013.
Mme Cécile Untermaier. Après la publication de l’article ?
M. Florent Pedebas. Oui, bien après. Lui aussi cherchait à savoir qui étaient les autres équipes de détectives.
M. Christian Eckert. Monsieur Letellier, vous dites que la DNIFF a perquisitionné chez vous. Quand était-ce ?
M. Alain Letellier. J’ai noté la date sur mon agenda : le jeudi 14 février 2013.
Il s’agissait d’une visite domiciliaire : on m’a fait remplir un formulaire les autorisant à perquisitionner.
M. le président Charles de Courson. Ce n’était donc pas une perquisition ?
M. Alain Letellier. Ne jouons pas sur les mots : si j’avais refusé, on aurait appelé le procureur Molins, qui aurait envoyé immédiatement une commission rogatoire !
M. Philippe Houillon. Monsieur Letellier, vous avez été mandaté en octobre 2011 par Mme Cahuzac, dans le cadre d’une procédure de divorce, pour une recherche de griefs : c’est ce que vous appelez l’affaire privée. Cela ne nous intéresse pas mais il est vrai que M. Garnier nous en a dit un mot. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi sur une affaire privée, vous allez voir Garnier. Vous a-t-il renseigné ?
M. Alain Letellier. Oui.
M. Philippe Houillon. Il avait donc des éléments sur le sujet ?
M. Alain Letellier. Oui, cela se savait dans son service. Écoutez, je ne veux pas entrer dans le détail de cette affaire privée sordide.
M. Philippe Houillon. Mais a-t-elle un rapport avec notre affaire ?
M. Alain Letellier. Cela a un rapport avec l’intervention de M. Cahuzac et le service du budget à l’époque. Cela concerne le fisc, mais il s’agit d’une affaire privée.
M. Philippe Houillon. J’ai compris à demi-mot que Rémy Garnier n’avait pas digéré que Jérôme Cahuzac soit intervenu – avec efficacité – sur le dossier France Prune.
M. Alain Letellier. En l’occurrence, M. Garnier avait fait son travail.
M. Philippe Houillon. Peut-être, mais cette intervention, dites-vous, recoupait une affaire privée. Or, au même moment, le fisc était saisi, via Michel Gonelle – et cela a traîné sept ans : ce n’est donc pas totalement sans intérêt pour nous.
D’autre part, lors d’une séparation, il y a toujours des discussions sur la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire sur l’argent. J’ai bien compris que Mme Cahuzac connaissait l’existence du compte en Suisse ?
M. Alain Letellier. Oui.
M. Philippe Houillon. Il pouvait donc y avoir discussion sur la part auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Connaissait-elle le montant, même approximatif, de ce compte ? Avez-vous jamais évoqué avec elle la somme d’argent à laquelle elle aurait éventuellement droit ?
M. Alain Letellier. Non, elle ne m’a jamais donné de chiffres, et elle ne souhaitait pas d’autre information sur ce compte. N’oublions pas qu’elle a changé quatre fois d’avocat et que chacun a orienté le dossier dans un sens ou un autre.
Si nous sommes allés voir Rémy Garnier, c’est que nous recherchions des éléments sur le passé de M. Cahuzac, pour étayer un comportement.
M. Philippe Houillon. Excusez-moi d’insister, mais le fait qu’il existe un compte en Suisse ne veut pas dire qu’une fortune a nécessairement été déposée dessus. Vous avez dit que, quand on vit un certain nombre d’années avec quelqu’un, on sait nécessairement beaucoup de choses. Connaissait-elle la fréquence d’alimentation de ce compte ?
M. Alain Letellier. Je n’ai eu aucune information à ce sujet.
M. le président Charles de Courson. En tout cas, elle ne pouvait ignorer qu’une partie des honoraires étaient payés en espèces, puisque c’est elle qui gérait la clinique ! Ce n’est pas moi qui le dit, c’est maître Veil, l’avocat de Jérôme Cahuzac.
M. Alain Letellier. Nous l’avons su après.
M. Philippe Houillon. Avez-vous conservé les deux numéros de téléphone laissés par la personne qui a proposé, moyennant rémunération, des informations à Mme Cahuzac ?
M. Alain Letellier. La DNIFF a dû les saisir.
M. Philippe Houillon. À l’époque, aviez-vous essayé d’appeler ces numéros ?
M. Alain Letellier. Mme Cahuzac l’a fait, mais personne n’a répondu.
Un des numéros étant roumain, certains – dont Le Canard enchaîné – sont partis dans des supputations sur un prétendu « Roumain ». Or j’ai appris récemment que ces numéros étaient utilisés par des personnes qui voyagent beaucoup, notamment vers les pays d’Asie du sud-est, parce que cela leur permet de payer moins cher les communications. Ce n’est donc pas forcément un Roumain.
Il y avait un autre numéro de téléphone à carte, mais comme elle n’a pas donné suite immédiatement, l’affaire a tourné court. Il eût fallu battre le fer pendant qu’il était chaud.
M. Philippe Houillon. Il reste que Mme Cahuzac a vu la personne. N’a-t-elle pu l’identifier ?
M. Alain Letellier. Non. Il avait pris rendez-vous prétendument pour une consultation. Il lui a indiqué que, pour une somme modeste – 3 000 euros –, il pouvait lui donner des informations sur le compte et les derniers mouvements faits à Singapour. Cela se passait en mai 2012.
M. Philippe Houillon. Vous avez évoqué une autre personne, que vous connaissez bien, qui enquêtait sur M. Cahuzac, mandatée par un important cabinet d’avocats parisien. Pouvez-vous nous donner son nom ?
M. Alain Letellier. Non, parce qu’il m’a demandé de ne pas le faire. C’est comme le journaliste qui protège ses sources. Je ne peux pas trahir la confiance de quelqu’un que je connais depuis vingt ans.
M. Philippe Houillon. Pouvez-vous au moins nous donner le nom du cabinet d’avocats ?
M. Alain Letellier. Non, parce que je ne le connais pas ; comme je vous l’ai dit, la personne en question n’a pas coutume de donner des informations de ce type.
M. Philippe Houillon. C’est très ennuyeux.
M. Alain Letellier. Si vous le souhaitez, je peux toujours lui demander s’il accepterait de témoigner par écrit, mais cela apportera-t-il vraiment quelque chose à la Commission, dont l’objet est d’enquêter sur d’éventuels dysfonctionnements après le 4 décembre. ?
M. Philippe Houillon. C’est à nous de l’apprécier !
M. le président Charles de Courson. Nous nous demandons qui peut être le mandataire. Vous dites que c’est un institutionnel. Il n’y a que deux possibilités : il s’agit soit d’un service de renseignements français…
M. Alain Letellier. Non.
M. le président Charles de Courson. … soit d’une grande entreprise.
M. Alain Letellier. Oui, à ce niveau, ce sont rarement des personnes physiques.
M. le président Charles de Courson. Qui pouvait avoir intérêt à diligenter une telle enquête ? Vous dites que certaines personnes ne voulaient pas de lui à la santé ou au budget ?
M. Alain Letellier. Non, ce n’est pas cela.
M. Philippe Houillon. On ne voulait pas qu’il entre au Gouvernement, c’est tout !
Vous estimez que quand on connaît le dossier, on se demande comment il a pu être nommé ministre. Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce qui vous paraît d’une si grande évidence qu’il n’aurait pas dû être nommé ministre ?
M. Alain Letellier. Connaissant le dossier depuis octobre 2011, j’ai été étonné que les services de l’État n’aient pas eu connaissance de la situation de l’intéressé.
M. Alain Claeys, rapporteur. Quels services ?
M. Philippe Houillon. Et quelle situation ?
M. Alain Letellier. Mais, du fait qu’il a un compte non déclaré en Suisse depuis 1990 !
Alain Claeys, rapporteur. Il y a quelque chose qui me surprend. Ce compte en Suisse est connu d’un certain nombre de personnes, pour certaines depuis 2001. Comment expliquez-vous que, durant toute cette période, la justice ne soit jamais saisie ?
M. Philippe Houillon. J’ai bien entendu la réponse de M. Letellier, mais permettez-moi encore une fois d’insister.
Vous dites : « Il était pour moi évident qu’il n’aurait pas dû être nommé ministre, compte tenu de ce qu’il y a dans son dossier ». Or tout le monde n’est pas nécessairement au courant de ce que vous avez découvert dans le cadre de votre enquête. Votre raisonnement laisse entendre que ce que vous avez appris ne pouvait être ignoré de personne. Qu’y a-t-il dans ce dossier qui vous permette de dire cela ?
M. Alain Letellier. Ce que je dis tient compte de tous les éléments que j’ai réunis pendant presque deux ans, et notamment des déclarations et du mémoire de Rémy Garnier de 2008. Si les services de renseignement de l’État font correctement leur travail, cela doit être noté quelque part !
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur Pedebas, il semblerait qu’à Villeneuve-sur-Lot, on fasse tout à l’envers.
M. Florent Pedebas. C’est vrai, je suis d’accord avec vous !
M. Alain Claeys, rapporteur. D’abord, pendant plus de dix ans, la justice n’est pas saisie. Pourquoi ?
M. Florent Pedebas. Je pense que ceux qui, comme moi, avaient entendu cette conversation sur le téléphone de M. Gonelle ont pensé que le compte de M. Cahuzac pouvait très bien être déclaré. Si tel avait été le cas, c’eût été de la dénonciation calomnieuse. Nous n’avions aucun moyen de vérifier ce qu’il en était.
M. Alain Claeys, rapporteur. Ensuite, au lieu de saisir les services fiscaux directement, on le fait de manière détournée.
M. Florent Pedebas. Moi, depuis le moment où j’ai entendu l’enregistrement, en décembre 2000 ou en janvier 2001, jusqu’à décembre 2012, je n’en ai parlé à personne !
M. Alain Letellier. Pas même à moi !
M. Alain Claeys, rapporteur. N’en a-t-on jamais parlé à Villeneuve-sur-Lot pendant dix ans ?
M. Florent Pedebas. On en a parlé au moment de la campagne de M. Bruguière.
M. Alain Claeys, rapporteur. M. Bruguière a parlé de l’enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non, mais il se dit que M. Bruguière avait demandé une copie de l’enregistrement sauvegardé par Michel Gonelle.
M. le président Charles de Courson. Cela, c’est un fait, mais M. Bruguière prétend qu’il ne l’a pas écouté et qu’il l’a jeté.
M. Florent Pedebas. Qui va le croire ?
M. Christian Eckert. Pourriez-vous préciser les choses ? Au moment de la campagne de M. Bruguière, on parlait de l’enregistrement de M. Gonelle ?
M. Florent Pedebas. Oui : je ne sais pas comment M. Bruguière avait eu vent de l’enregistrement, mais il en avait demandé une copie à Michel Gonelle.
M. Christian Eckert. En 2007, il se racontait à Villeneuve-sur-Lot que M. Gonelle possédait un enregistrement de M. Cahuzac dans lequel ce dernier évoquait un compte en Suisse ?
M. Florent Pedebas. Non, cela, on vient de l’apprendre maintenant.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai du mal à vous comprendre. Vous êtes collègues, vous êtes tous les deux membres de votre chambre professionnelle, quand vous êtes en congrès à Nîmes, vous parlez à un de vos collègues suisses de cette histoire de compte…
M. Alain Letellier. Permettez-moi de vous interrompre, madame la députée : d’abord, M. Pedebas n’était pas à Nîmes ; ensuite, nous n’avons commencé à parler ensemble du dossier que lorsque nous sommes allés voir M. Garnier ; enfin, j’ai demandé à mon collègue suisse des éléments non sur le compte, mais sur le dénommé Dreyfus.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il reste qu’ensuite, vous allez voir ensemble M. Garnier, qui vous parle du compte en Suisse. À aucun moment, M. Pedebas ne révèle qu’il a entendu cet enregistrement ?
M. Florent Pedebas. Non, jamais.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je ne peux pas le croire !
M. Alain Letellier. M. Pedebas est un gendarme de formation, lieutenant de réserve ; il cloisonne tout et il est muet comme une tombe. Vous pouvez lui confier un secret, il n’en parlera jamais ! Il a toujours été comme cela.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mais, il fait le même métier que vous ! Il aurait pu vous aider à faire progresser votre enquête !
M. Alain Letellier. Mais cela ne m’aurait pas aidé ! J’aurais répété à ma cliente qu’il existait un enregistrement, mais je ne l’aurais pas eu pour autant.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’affaire serait sortie plus tôt !
M. le président Charles de Courson. Il s’agit en effet de la seule preuve matérielle existante ; c’est ce qui a permis l’ouverture de l’enquête préliminaire.
M. Alain Letellier. Mais qui a donné l’enregistrement à M. Arfi ? C’est moi qui ai trouvé Rémy Garnier le premier ; Fabrice Arfi, qui enquêtait sur les relations entre les deux anciens ministres du budget, est arrivé trois semaines ou un mois après.
M. Daniel Fasquelle. Le manque de curiosité de Mme Cahuzac me surprend. Dans le cadre d’un divorce, on a intérêt à connaître la réalité du patrimoine du couple et de chacun de ses membres. L’existence du compte, l’origine des fonds qui l’ont alimenté, étaient donc pour elle des informations importantes. Comment expliquez-vous qu’elle ne vous ait pas incité à pousser votre enquête ?
M. Alain Letellier. Elle savait que je n’avais ni la structure ni l’envergure pour le faire. En outre, elle était persuadée, après ce que lui avait dit son mari au retour de son voyage, que cela ne mènerait à rien. D’ailleurs, si l’on avait cherché un compte à l’UBS, on ne l’aurait pas trouvé, puisqu’il était chez Reyl, qui avait tout transféré à Singapour.
M. Daniel Fasquelle. Il y a eu cette personne qui lui propose des informations sur ce compte à Singapour. A plusieurs reprises, elle a eu la possibilité d’en obtenir. Si elle savait que cela dépassait vos moyens, pensez-vous qu’elle ait pu faire appel à une autre structure ?
M. Alain Letellier. Je ne peux pas répondre. Elle était libre de faire ce qu’elle voulait.
M. Georges Fenech. Comment avez-vous eu connaissance du transfert des avoirs de l’UBS à Reyl ?
M. Alain Letellier. Grâce à la lecture des articles que je fais depuis le 4 décembre.
M. Georges Fenech. Mais vous ne le saviez pas auparavant ?
M. Alain Letellier. Non. C’est d’ailleurs pour cela que j’avais demandé à mon collègue de faire une recherche.
M. le président Charles de Courson. Je voudrais revenir sur un point : l’affaire privée dont vous parlez avait-elle une incidence fiscale ?
M. Alain Letellier. Non. On pense, à tort, que si je suis allé voir Rémy Garnier, c’est pour avoir des informations financières, alors que ma visite avait pour objet celui que je vous ai dit et une autre affaire privée sur Villeneuve-sur-Lot.
M. Philippe Houillon. Je réitère ma demande : pourriez-vous nous dire qui est votre collègue, pour que l’on sache dans quel cadre il travaillait ?
M. Alain Letellier. Non, car il a réitéré pas plus tard qu’hier son souhait de ne pas apparaître nommément. Je lui en ai donné ma parole. Si le juge me le demande, je lui répondrai – mais je préviendrai la personne avant.
M. Jean-Marc Germain. Votre collègue pourrait-il, sans nous révéler son nom, nous dire pour quelle structure il travaillait ? Vous avez proposé de servir d’intermédiaire.
M. Alain Letellier. Je m’engage à le lui demander – mais il ne vous donnera pas le nom du mandant.
M. Gérald Darmanin. Nous avons déjà eu ce problème avec M. Garnier qui ne voulait pas nous donner le nom de son contact au sein de l’administration fiscale. Mais, nous avons fini par le trouver.
M. le président Charles de Courson. Cela m’a pris une quinzaine de jours, car au départ j’avais trois noms possibles.
M. Gérald Darmanin. Monsieur Letellier, vous êtes auditionné par une Commission d’enquête parlementaire, et le président vous a fait prêter serment, non de ne pas mentir, mais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vos engagements moraux vous honorent, mais vous êtes ici devant les représentants du peuple – et il me semble que ceux-ci sont au moins aussi légitimes que l’autorité judiciaire pour être renseignés sur ce point.
M. le président Charles de Courson. Monsieur Letellier, je vous saurais gré de contacter cette personne et de nous dire ce qu’il en est.
M. Alain Letellier. Je m’engage à le faire rapidement.
M. le président Charles de Courson. Messieurs, nous vous remercions.
Auditions du 24 juillet 2013
À 16 heures 30 : M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire.
M. le président Charles de Courson. Notre commission avait déjà entendu M. Jean-Louis Bruguière, le 19 juin dernier. Depuis cette date, nous avons auditionné, entre autres, M. Jérôme Cahuzac – à deux reprises –, M. Michel Gonelle – une deuxième fois –, ainsi que M. Gérard Paqueron, qui a été, au printemps 2007, le mandataire financier et le directeur de la campagne de M. Bruguière pour l’élection législative dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot. Ces différents témoignages nous ont permis d’éclairer plusieurs points, mais des contradictions persistent, en particulier entre certaines affirmations de M. Gonelle et celles de M. Bruguière.
C’est la raison pour laquelle, monsieur Bruguière, nous avons souhaité vous entendre une seconde fois.
(M. Jean-Louis Bruguière prête serment.)
M. le président Charles de Courson. Sauf si vous souhaitez faire un exposé liminaire de quelques minutes, je vous propose que nous passions directement aux questions.
M. Jean-Louis Bruguière, magistrat honoraire. Je suis à votre disposition.
M. Alain Claeys, rapporteur. Si nous vous revoyons, monsieur Bruguière, c’est parce qu’il y a, entre vos propos et ceux de M. Gonelle, un certain nombre de contradictions.
Tout d’abord, M. Gonelle est persuadé que l’enregistrement transmis à Mediapart avait pour origine la copie qu’il vous a remise. Lors de son audition, quand le président lui dit : « Donc, pour vous, c’est M. Bruguière. », voici ce qu’il répond : « Ce n’est évidemment pas lui qui a donné l’enregistrement à Edwy Plenel. Tout le monde sait que leurs rapports sont exécrables. Mais je pense que cet enregistrement a dû passer de main en main après que je m’en fus dessaisi. » Je pose alors la question : « Via le juge Bruguière ? », et il répond : « Évidemment. C’est lui qui l’a reçu en premier. ».
Que répondez-vous à ces accusations ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je vais redire sans ambiguïté ce que j’ai déjà dit : cet enregistrement, je l’ai détruit sans l’avoir donné à personne. Je ne l’ai pas confié à un tiers, ni facilité, par quelque moyen que ce soit, sa dissémination. Ce n’est donc pas par mon intermédiaire qu’il est parvenu entre les mains de Mediapart.
À propos de ce site d’information, permettez-moi une petite observation. Je suis un peu surpris, connaissant un peu M. Plenel et la déontologie dont il se prévaut – à juste titre – en matière de protection des sources, qu’il viole lui-même ce principe de façon négative. En effet, protéger ses sources, c’est non seulement ne pas les révéler, mais aussi s’interdire d’affirmer que quelqu’un n’en fait pas partie. Il s’agit donc d’une première, et je m’interroge sur les raisons qui ont conduit Mediapart à s’affranchir d’une règle revendiquée par toute la presse.
M. le président Charles de Courson. Mais que répondez-vous à la question du rapporteur ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je réponds qu’il ne s’agit que de suppositions de la part de M. Gonelle et que, bien évidemment, ce dernier ne peut apporter la moindre démonstration pour les étayer. Et je m’inscris totalement en faux contre ces affirmations : comme je l’ai dit très clairement, je n’ai remis cet enregistrement à quiconque, ni facilité sa circulation, directement ou indirectement.
M. Alain Claeys, rapporteur. Lorsque M. Gonelle vous rencontre dans son cabinet en novembre 2006, il ne peut vous faire entendre l’enregistrement car son équipement informatique a été remplacé depuis 2001. Disposiez-vous de votre côté d’un lecteur permettant d’écouter son contenu ?
M. Jean-Louis Bruguière. Tout d’abord, cette date, le 12 novembre 2006, résulte des déclarations de M. Gonelle. Pour ma part – et je m’étais exprimé dans ce sens devant la police judiciaire –, j’ai toujours pensé que cette rencontre avait eu lieu plus tard, sans doute au début de l’année 2007. Mais contrairement à M. Gonelle, je n’en ai pas conservé de trace écrite dans un agenda ou un dossier quelconque, et je n’ai pas de raison objective de contester la date qu’il a fournie. Il en est de même pour le lieu de l’entretien – son cabinet d’avocat.
Pouvez-vous me rappeler votre question ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Comment avez-vous pris connaissance de cet enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je conteste formellement les assertions de M. Gonelle selon lesquelles j’aurais insisté pour l’obtenir.
M. Alain Claeys, rapporteur. Selon lui, vous lui auriez affirmé avoir les moyens de le faire analyser, etc.
M. Jean-Louis Bruguière. C’est tout à fait faux, et de surcroît inopérant.
Tout d’abord – il le dit lui-même –, il m’a fait venir dans son cabinet, ce qui n’est arrivé que deux fois, peut-être trois. C’est donc un choix délibéré de sa part, probablement pour des raisons de confidentialité. Peut-être avait-il également des documents à me montrer ou à me remettre – mais à ce moment, j’ignorais tout de l’enregistrement.
D’après mon souvenir – car je ne peux parler que de ce dont je me souviens précisément –, M. Gonelle, au cours de l’entretien, commence à me parler de Cahuzac, un personnage qu’il semble surestimer, sur le plan politique comme sur le plan personnel. Il évoque son train de vie, mais pas ses relations avec les laboratoires Lilly ou Fabre – je ne garde du moins aucun souvenir de ce point. De même, je suis convaincu de ne pas l’avoir entendu aborder la question des associations.
À un moment donné, M. Gonelle me parle de l’enregistrement, que je ne sollicite pas. Il ne me le confie pas, il me le remet.
M. Alain Claeys, rapporteur. Il dit qu’il vous l’a prêté.
M. Jean-Louis Bruguière. C’est faux. Je le conteste. C’est habile de sa part, mais c’est inexact.
Il s’agit d’un juriste. S’il m’avait « confié » l’enregistrement, cela aurait été pour en faire quelque chose. J’ai d’ailleurs noté, dans le compte rendu de sa première audition, deux expressions significatives : l’« opportunité » qu’il dit s’être présentée à lui après sa première tentative en 2001, et le fait que, selon lui, je n’ai pas fait de l’enregistrement l’« usage » que j’aurais dû en faire. Mais quel usage ?
Je confirme de la façon la plus forte que je n’ai pas écouté l’enregistrement. Pourquoi l’aurais-je fait ?
M. Gonelle affirme que, averti de la mauvaise qualité de l’enregistrement, j’aurais répondu avoir à ma disposition des techniciens capables de l’améliorer. Mais ce n’est pas le cas ! Comme cet avocat le sait parfaitement, je n’allais pas faire diligenter une expertise alors qu’il faut, pour cela, une commission d’expert. Dans ce domaine qui, en 2000, était encore relativement nouveau, seul un laboratoire disposait d’experts judiciaires compétents : celui de la police judiciaire, situé à Écully, près de Lyon. Or, je n’allais pas demander à ce laboratoire, ni dans cette circonstance, ni dans aucune autre, de procéder à une expertise parallèle !
J’en viens à une question importante, celle du mobile. Si mon intention avait été d’améliorer l’enregistrement, cela n’aurait pu être que dans le but de comprendre les propos tenus et d’identifier les protagonistes. Or, je ne connaissais pas M. Cahuzac, et je ne l’avais jamais entendu. Contrairement à M. Gonelle, j’étais dans l’incapacité de reconnaître sa voix, qu’il s’exprime dans un contexte privé ou public. Par ailleurs, on ne m’a jamais dit qui était son interlocuteur – je ne connais d’ailleurs toujours pas l’identité de cette personne. Qu’aurait donc pu m’apporter, dans ces conditions, une opération technique destinée à améliorer la qualité du son ? Elle n’avait aucun intérêt pour moi.
M. Jean-Marc Germain. Comment connaissez-vous l’existence d’un interlocuteur, si vous n’avez pas écouté l’enregistrement ?
M. Jean-Louis Bruguière. C’est M. Gonelle qui me l’a dit. Il m’a parlé de « conversation », ce qui implique la présence d’au moins deux personnes. Notons qu’au moment de cette rencontre, je ne connais pas les informations précises que M. Gonelle va plus tard transmettre à M. Zabulon à l’occasion de leur conversation téléphonique, informations dont ce dernier a fait état lors de son audition devant vous. Il ne m’avait parlé que d’un enregistrement.
Ce que je comprends a posteriori – et sur ce point, je rejoins M. Zabulon –, c’est qu’il y a eu, incontestablement, une tentative d’instrumentalisation. M. Gonelle souhaitait sans doute deux choses : se défaire d’un fardeau devenu trop lourd en le transférant sur une autorité de l’État – en effet, toutes les personnes qu’il a « actionnées » pouvaient être ainsi qualifiées, qu’il s’agisse des douanes, de l’administration fiscale, de la présidence de la République ou de votre serviteur – ; trouver, dès lors que l’article 40 n’avait pas été invoqué ab initio, une autre voie, une voie oblique – l’expression a été employée ici même – pour faire en sorte que ce qu’il considérait comme une preuve soit utilisé par la justice et donne lieu à une enquête, fiscale ou pénale. Du reste, l’échec de la deuxième tentative, celle qui me concerne, sera suivi par une troisième, sa démarche auprès de la présidence de la République.
M. le président Charles de Courson. Mais pourquoi, à votre avis, n’a-t-il jamais eu recours à des moyens directs ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne peux que faire des suppositions, et je dois me montrer prudent. Je ne tiens pas du tout à engager une polémique avec M. Gonelle, mais j’essaie de comprendre ce qui a pu se passer, et pourquoi il y a eu – c’est incontestable – des tentatives avortées d’instrumentalisation de personnes représentant l’autorité de l’État : M. Catuhe, le haut fonctionnaire des douanes, votre serviteur, la présidence de la République.
M. Gonelle est un bon avocat, réputé dans le département, et qui passe pour un fin juriste – un pénaliste. Lorsqu’il reçoit cet enregistrement de façon fortuite – ce que nous n’avons aucune raison de contester puisque l’enquête judiciaire a écarté toute possibilité de manipulation –, il en perçoit, selon ses propres dires, toute l’importance dans le contexte politique de l’époque. Il sait que la mairie peut basculer lors des échéances électorales suivantes. Il sauvegarde donc l’enregistrement. Mais à partir de ce moment, il a dû réaliser que sa situation était difficile.
En effet, il y avait un risque réel de poursuites – en tout cas, des infractions auraient pu être relevées à son encontre. Or, il est prudent. Vous avez même pu constater à quel point il est soucieux de son image personnelle, voire donneur de leçons. Il était donc important pour lui de ne pas prendre de risques.
Il n’est pas très précis sur les dates, mais il semble y avoir une certaine latence entre le moment où l’enregistrement est réalisé, en décembre, et sa transcription dans les locaux du conseil régional d’Aquitaine, qui a lieu en janvier 2001. Ce délai de trois à quatre semaines entraînait un risque judiciaire : on pouvait considérer qu’il y avait soit soustraction – au sens de vol dit « par rétention », qui est prévu par la jurisprudence – soit violation du secret de la correspondance, via la notion de détournement. En effet, dans le cas où vous recevez fortuitement un document qui ne vous est pas destiné, il faut soit le détruire – aujourd’hui, de nombreux courriers électroniques comportent d’ailleurs un avis de confidentialité appelant à agir en ce sens –, soit en informer le procureur de la République. L’avantage de cette dernière solution est qu’une éventuelle opération de transcription est alors effectuée par réquisition judiciaire et ne pose pas de problème de légalité.
Un autre élément important me trouble, celui de la traçabilité. Si j’ai bien compris, le document dont nous parlons est l’enregistrement brut d’une conversation entre une personne A et une personne B. Mais nous ne savons pas d’où il vient. Même s’il est établi que cet enregistrement n’est pas le fruit d’une manipulation, les explications de M. Gonelle sur son origine, qui permettent d’identifier M. Cahuzac, ne peuvent être techniquement corroborées par la bande elle-même, dès lors que l’on a omis de sauvegarder la conversation précédente. De même, M. Gonelle, semble-t-il, n’a pas conservé la fadette, c’est-à-dire la facturation détaillée des appels téléphoniques dans laquelle l’opérateur retrace l’ensemble des communications émises ou reçues – même si la CNIL impose de masquer une partie des numéros –, qui aurait permis d’assurer cette traçabilité. Il n’est donc pas possible, semble-t-il, d’apporter la moindre démonstration technique permettant de confirmer l’origine de l’enregistrement. Il aurait été préférable de tout remettre entre les mains de la justice et de la laisser faire son travail.
Je me demande donc – tout en étant très prudent – si ce raisonnement n’a pas été effectué tardivement, au-delà du délai de quatorze jours au-delà duquel le message s’effaçait, à un stade où il ne restait plus de traces et où il devenait plus difficile d’expliquer pourquoi on avait tardé à agir. Peut-être qu’il ne se serait rien passé, mais on ne peut exclure qu’une inquiétude soit née dans l’esprit du détenteur de l’enregistrement, compte tenu de sa position au sein du barreau d’Agen et des critiques qui auraient pu être formulées à son encontre.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’en est-il de la démarche effectuée auprès de la présidence de la République ?
M. Jean-Louis Bruguière. Je ne suis pas concerné, mais j’ai été extrêmement surpris, voire choqué parce que j’ai appris à ce sujet. Au cours de mes activités, j’ai eu, depuis 1981, des relations avec tous les présidents de la République. D’une façon générale – et cela m’a parfois été reproché –, j’ai eu de nombreux contacts avec l’appareil d’État et l’exécutif, partant du principe que parler à quelqu’un ne signifie pas renoncer à son indépendance. Dans certaines affaires – l’affaire Habache, celles mettant en cause l’Iran, l’attentat contre le DC-10 d’UTA, qui impliquait la Libye –, il est de la responsabilité du juge de dialoguer avec l’exécutif afin que ce dernier puisse être informé de certaines de ses décisions autrement que par la revue de presse du matin. N’oublions pas qu’en France, la gestion des affaires mettant en cause la sécurité de l’État fait l’objet d’une gouvernance exemplaire, ce qui n’est pas partout le cas en Europe. J’ai donc trouvé normal d’avoir ce comportement à l’égard de tous les chefs de l’exécutif. En contrepartie, l’État m’a fourni l’ensemble des moyens matériels nécessaires pour accomplir ma mission. On a même mis, sur l’ordre personnel du Président de la République de l’époque, François Mitterrand, un navire de la marine nationale à ma disposition, ce qui m’a valu le sobriquet d’« amiral ».
Or, tous ces contacts n’ont jamais donné lieu à des fuites : d’un côté comme de l’autre, on a su conserver le secret. La confiance est en effet un élément essentiel de la bonne gouvernance, mais c’est également une exigence sur le plan personnel.
Pour en revenir à M. Gonelle, la remise de cet enregistrement et l’instrumentalisation qu’elle me paraît constituer, m’a convaincu que ma confiance avait été abusée. Or, il s’agit d’un domaine dans lequel je suis particulièrement intransigeant.
À aucun moment, en tout cas, je n’ai eu l’idée de faire fuiter des informations, ni même de me retrouver dans une position permettant à des fuites de survenir. On m’a confié, jusqu’en novembre 2012, des missions sur lesquelles j’estime ne pas avoir à m’étendre, pour des raisons de sécurité, dans le cadre d’une réunion publique. J’estime que lorsqu’il y a une fuite, c’est parce que l’on a fait en sorte qu’elle survienne. Je n’accuse personne, mais je note que des précautions n’ont pas été prises, car on peut fort bien empêcher les fuites, y compris au plus haut niveau de l’État. En l’occurrence, je me demande quel aurait pu être l’intérêt pour la présidence de la République de faciliter la divulgation d’une conversation privée.
M. le président Charles de Courson. Si je comprends bien, vous vous étonnez du fait que la presse se soit fait l’écho de la conversation entre M. Gonelle et M. Zabulon.
M. Jean-Louis Bruguière. Soyons clairs : je ne cherche pas à accuser M. Gonelle. Peut-être me trouvez-vous confus, mais je me dois d’être extrêmement prudent, vous en conviendrez.
M. Alain Claeys, rapporteur. Qu’est-ce qui vous a choqué ?
M. Jean-Louis Bruguière. Deux choses : d’une part, je ne vois pas l’intérêt de cette démarche effectuée par M. Gonelle auprès de la présidence de la République ; et de l’autre, lorsque l’on cherche à transmettre une lettre au Président – cela m’est arrivé –, on ne fait pas mine de l’envoyer sans l’envoyer vraiment, et on ne passe pas par un canal si compliqué que l’envoi finit par devenir difficile, voire impossible ! Il suffisait d’appeler le secrétariat privé du Président pour signaler que l’on allait déposer une lettre, sans faire plus de commentaires. Le chef de l’État l’aurait reçue et en aurait fait l’usage qu’il convenait, sans qu’aucune fuite ne survienne.
Sur ce point, je fais donc mienne la remarque de M. Zabulon – d’autant que je me suis retrouvé dans la même situation – : j’ai le sentiment qu’il y a eu instrumentalisation.
M. le président Charles de Courson. On comprend mieux.
Vous avez indiqué au cours de votre audition que vous aviez écarté M. Gonelle de votre équipe de campagne avant qu’elle ne soit constituée. L’intéressé nous a transmis un document datant du début du mois de janvier 2007 qui indique qu’il faisait partie, avec M. Merly, M. Costes et vous-même, du « comité stratégique » constitué en vue de votre candidature et qu’il était alors responsable du « pôle Villeneuve-sur-Lot ». Des messages électroniques attestent également du fait qu’il participait, au moins en janvier et février, à des réunions destinées à préparer votre campagne. Pourriez-vous nous expliquer ces contradictions ?
M. Jean-Louis Bruguière. C’est en mars – le 16, je crois – que j’ai fait ma déclaration de candidature. En janvier et février, nous étions donc encore dans une phase de réflexion préliminaire, d’autant qu’il me restait des dossiers à traiter. En outre, ma position administrative n’était pas encore assurée, et je me devais d’être extrêmement prudent, même si j’étais à peu près décidé à m’engager dans cette élection.
Au départ, j’avais peut-être une vision un peu technocratique de ce que devait être ma future équipe de campagne, avec un comité de pilotage, ou stratégique, et des groupes thématiques. Bien évidemment, on s’est rendu compte que tout cela ne pouvait pas fonctionner.
Incontestablement, nous étions donc encore dans la phase préparatoire de la campagne. J’ai consulté mes agendas, et j’ai été surpris de constater qu’en janvier et février 2007, je ne venais presque jamais à Villeneuve – au mieux une fois par mois. Nous avions donc mis en place ce comité composé de moi-même et de ces trois personnes. Cela ne fait que confirmer ce que je dis depuis le début : ce sont M. Gonelle et M. Merly qui, fin 2006, sont venus me chercher et ont tenté à plusieurs reprises de me convaincre de me présenter aux élections. Ils ont même organisé, dans ce but, un déjeuner à Prayssas. L’objectif était d’abord de reconquérir Villeneuve et de bouter M. Cahuzac hors de la mairie. Lorsqu’ils se sont aperçus que cette proposition ne m’agréait pas, ils ont changé de plan – ou plutôt Jean François-Poncet l’a fait, car lui seul pouvait imposer à Alain Merly de laisser son siège – et m’ont proposé de me présenter aux législatives. Cette option, je la jugeais possible, car je voyais arriver la fin de ma carrière en 2008. Nous avons donc créé ce comité stratégique réunissant les deux personnalités incontournables de la circonscription, ainsi que Jean-Louis Costes, dont on peut presque dire qu’il a été la pomme de discorde. Le choix de M. Costes allait en effet à l’encontre du scénario imaginé par Jean François-Poncet, selon lequel Alain Merly devait être mon suppléant. Le système a donc implosé, et ce comité n’a jamais fonctionné – non plus que les comités mis en place pour suivre diverses thématiques.
Tout cela était géré en direct, avec moi, Jean-Louis Costes, Alain Merly – qui a été assez actif, du moins pour tout ce qui ne concernait pas le Villeneuvois. J’ai trouvé d’autres interlocuteurs compétents pour l’examen de certains problèmes locaux sensibles, comme celui de l’hôpital – sur lequel M. Gonelle n’est jamais intervenu –, celui des personnes âgées ou celui de la sécurité. Il y avait notamment tout un débat au sujet de la vidéosurveillance, une question sur laquelle j’étais, à l’évidence, mieux placé que quiconque. C’est d’ailleurs à cette occasion que M. Gonelle, qui ne jouait plus le rôle qu’il estimait devoir jouer, ainsi que M. Cahuzac – car il y a eu une coalition sur ce point – ont lancé l’idée que je faisais peur à tout le monde avec ma voiture blindée et mes gardes du corps. Ils ont été jusqu’à dire que j’utilisais les fonds de la République pour ma campagne électorale, ce qui était complètement faux : je disposais d’un véhicule personnel, et quant à ma protection, c’est la République elle-même qui l’avait jugée nécessaire, compte tenu de la situation dans laquelle je me trouvais à l’époque. Voilà la réalité !
M. Gonelle évoque ensuite la mi-mai, qui est effectivement le temps de la campagne officielle. Mais il était déjà politiquement très pénalisant d’évincer une personnalité de son importance ; je ne pouvais pas, en plus, agir de façon vexatoire ni afficher partout son exclusion. De même, je ne pouvais lui interdire d’accéder à des lieux publics comme la permanence électorale ou les lieux de réunion. Il était même au premier rang de l’assistance lors du grand débat de deuxième tour organisé « chez lui », à Villeneuve, au mois de juin, d’ailleurs en présence des trois députés sortants du département : Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour et Alain Merly. Vous savez comment se passe une campagne : je n’allais pas demander à mes officiers de sécurité de veiller à ce Michel Gonelle ne vienne pas ! En tout état de cause, j’ai pris des décisions et conduit des actions politiques sans qu’il intervienne.
M. le président Charles de Courson. Tout en reconnaissant qu’il ne vous l’avait jamais redemandé, M. Gonelle soutien qu’il vous ne vous avait que « prêté » l’enregistrement et qu’il entendait que vous le lui rendiez. En aviez-vous conscience ? Pourquoi l’avoir détruit, ou plus exactement jeté, au lieu de lui rendre ?
M. Jean-Louis Bruguière. Parce qu’il ne m’a jamais dit qu’il me le prêtait : je conteste formellement l’emploi de ce verbe. À aucun moment, d’ailleurs, il ne me l’a réclamé. Nous avons pourtant eu quelques contacts postérieurs, ne serait-ce que le jour où je l’ai fait venir chez moi pour lui signifier clairement que la confiance était rompue et que je ne voulais plus le voir figurer dans le premier cercle de mon entourage. Cela faisait suite, je le rappelle, à trois incidents : l’affaire de l’enregistrement ; l’organisation, sans que j’en sois avisé, d’une réunion politique dont la responsabilité était imputée à quelqu’un de la campagne, avec les risques que cela faisait peser sur l’approbation des comptes de campagne ; et la plainte pénale déposée contre M. Cahuzac concernant cette affaire d’emploi dissimulé, dont on souhaitait ardemment, compte tenu de mes relations avec le procureur de l’époque, que je puisse la récupérer sur le plan politique. C’est à ce moment que j’ai dit, clairement et publiquement, que je ne voulais plus de campagne de caniveau.
Si vous m’y autorisez, je souhaite ajouter une remarque sur la question du mobile. Lors de toute action humaine, il faut un intérêt pour agir. Si on vous remet un enregistrement et que vous l’acceptez, c’est que vous y avez un intérêt, que vous voulez en faire quelque chose. Le problème est que je l’ai accepté, et j’ai eu tort de le faire. Mais quel intérêt pouvais-je avoir ? Vengeance personnelle, intérêt financier, intérêt politique ?
On peut exclure immédiatement l’intérêt financier. La question de la vengeance personnelle peut être facilement évacuée. M. Cahuzac pourra vous le confirmer : la campagne a été rude, mais loyale. M. Cahuzac n’est pas n’importe qui. Je ne le dis pas au sens où l’entend M. Gonelle, car je n’avais, moi, pas peur de mon adversaire. Mais c’est quelqu’un d’intelligent, qui analyse bien les choses et qui a le sens de la rhétorique. Il est également très pugnace. Nous avons eu un bon débat et l’ensemble a constitué une très belle expérience. J’ai été battu parce qu’il a été le meilleur et a su mieux que moi convaincre les électeurs. C’est la loi de la démocratie, et je ne lui en ai pas voulu. J’en ai davantage voulu à mon camp, je ne vous le cache pas, car j’estime qu’il n’a pas fait ce qu’il devait faire. C’est pourquoi, le jour de ma défaite, j’ai déclaré publiquement vouloir renoncer à toute activité politique, et notamment – laissant ainsi mon camp orphelin – à toute participation aux élections municipales de 2008. Je m’y suis strictement tenu : personne ne peut établir que j’aurais participé ne fût-ce qu’à un embryon de campagne électorale.
M. Gonelle est lui-même conscient de l’importance d’un éventuel « mobile » politique, puisqu’il a déclaré au début de son audition : « J’ai quitté la vie publique depuis plusieurs années, et n’étant plus impliqué dans la vie politique, je ne suis plus l’adversaire de qui que ce soit. » Je suis un peu surpris par ces propos. Je ne suis pas un homme politique, et contrairement à vous, je n’ai guère d’expérience en la matière, mais il me semble qu’exercer un mandat électif, c’est un acte politique ; qu’avoir des responsabilités de haut niveau au sein d’un appareil de parti constitue un acte politique. M. Gonelle s’est tout de même présenté en septembre 2011 aux élections sénatoriales, sous l’étiquette « divers droite ». Il s’agissait certes d’une candidature dissidente, dans la mesure où le candidat investi par l’UMP était Alain Merly. Michel Gonelle a été battu, mais il a pris part à cette élection. Si ce n’est pas un acte politique…
Par ailleurs, M. Gonelle est le délégué national de l’UMP pour la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. Il représente donc les militants locaux dans les conventions et congrès, auprès des instances nationales. Il est également membre du bureau de l’UMP 47. Je croyais naïvement qu’avoir des responsabilités au sein d’un parti, c’est aussi un acte politique. Enfin, il suffit de regarder la télévision pour savoir que M. Gonelle s’est montré extrêmement actif pendant la récente campagne de Jean-Louis Costes. Il s’est même présenté un moment comme son porte-parole, puisqu’il a donné une interview de 20 minutes sur i>Télé et mené un débat contradictoire avec Gilbert Collard, du Front national.
En ce qui me concerne, je n’ai eu aucune activité de cette sorte après 2007. Je n’avais donc aucun intérêt politique à divulguer cet enregistrement.
M. Jean-Marc Germain. Vous avez évoqué l’importance de la traçabilité, en soulignant que pour Michel Gonelle, fournir directement à la justice le document qu’il détenait lui aurait permis d’attester des conditions dans lesquelles il l’a obtenu. Mais d’après ce que j’ai cru comprendre, le disque réalisé à partir du téléphone mobile contient bien la première conversation relative à la visite de M. Vaillant à Villeneuve.
M. Jean-Louis Bruguière. Je l’ignorais.
M. Jean-Marc Germain. Ce point est important, dans la mesure où il tend plutôt à justifier, chez M. Zabulon, l’attitude consistant à suggérer à M. Gonelle de se tourner directement vers la justice.
M. le président Charles de Courson. L’enregistrement ne porte que sur la deuxième partie : l’entretien entre M. Cahuzac et M. Dreyfus n’y figure pas.
M. Jean-Marc Germain. J’avais compris le contraire.
M. le président Charles de Courson. La personne que nous avons auditionnée tout à l’heure nous l’a rappelé. Si lui-même a écouté sur le portable l’intégralité de l’enregistrement, seule la conversation a été gravée, ce qui a d’ailleurs alimenté dans un premier temps la thèse de la manipulation.
M. Jean-Marc Germain. Cela ne fait que renforcer ma remarque : pour que la justice puisse utiliser cet enregistrement, il était important que M. Gonelle témoigne de la façon dont il avait été réalisé, et donc qu’il saisisse directement la justice. Or c’est bien ce que M. Zabulon, après son contact avec M. Gonelle et les péripéties que l’on connaît, a été chargé par le Président de la République de répondre à ce dernier. Cela a d’ailleurs été confirmé publiquement par un communiqué.
Si j’ai compris votre raisonnement, monsieur Bruguière, le délai écoulé entre décembre 2006 et début 2007, pendant lequel M. Gonelle se demande ce qu’il va faire de cet enregistrement, peut être analysé comme une soustraction de preuve à la justice.
M. Jean-Louis Bruguière. Non, pas tout à fait.
M. Jean-Marc Germain. Mais ce raisonnement ne vaut-il pas pour la période où vous-même avez détenu un exemplaire de l’enregistrement, entre le moment où vous l’avez obtenu et celui où vous l’avez détruit ?
Par ailleurs, pensez-vous avoir eu la bonne réaction à l’époque ? N’auriez-vous pas dû faire constater par huissier que vous étiez détenteur de l’enregistrement, puis que vous le renvoyiez à M. Gonelle ou le placiez dans un coffre ?
M. Jean-Louis Bruguière. La situation était différente car, ne l’ayant pas écouté, j’ignorais tout du contenu de l’enregistrement. D’ailleurs, l’écouter ne m’aurait pas avancé à grand-chose, car je ne disposais d’aucun élément permettant d’en assurer la traçabilité. De même, j’ignorais tout des circonstances dans lesquelles il avait été réalisé, ainsi que des interventions successives de M. Gonelle. Il reconnaît lui-même ne pas m’avoir informé de sa démarche auprès de M. Catuhe, ni – excusez du peu ! – de ses tentatives de faire diligenter une enquête parallèle par une agence d’intelligence économique. D’une manière générale, si on analyse a posteriori l’ensemble de ses actions, on a le clair sentiment que M. Gonelle a toujours privilégié la voie parallèle plutôt que la voie officielle.
Je rappelle que l’article 40 du code de procédure pénale ne m’était pas applicable, du moins pas son alinéa 2, car je n’étais pas autorité constituée, et je n’avais pas reçu ce document dans l’exercice de mes fonctions. Mais à supposer même qu’il l’ait été, je n’aurais pas saisi le procureur, car « avoir la connaissance d’un crime ou d’un délit », c’est détenir des éléments suffisants, des indices précis et concordants laissant présumer la commission d’une infraction.
M. Gonelle le sait bien, d’ailleurs : il ne pouvait pas faire de dénonciation, dit-il, car il aurait pu encourir une plainte en dénonciation calomnieuse. Pourtant, dans son cas, la démonstration est moins pertinente. Il n’aurait probablement pas fait l’objet d’une telle plainte, car lui détenait tous les éléments, étant à l’origine de l’enregistrement. Je rappelle que la preuve indirecte est interdite : or, je ne disposais que du témoignage de M. Gonelle et d’indications très fragmentaires concernant un enregistrement dont j’ignorais le contenu et sur la sincérité duquel, l’ayant même écouté, je n’aurais pu qu’émettre les plus grands doutes. Je ne vous cache pas, d’ailleurs, que lorsque l’affaire a été rendue publique, je ne l’ai pas trouvée crédible – je n’avais jamais rien observé de tel au cours de ma carrière. De nombreux spécialistes se sont d’ailleurs interrogés sur la véracité de la relation qui a été faite de l’affaire – il appartiendra à la justice de se prononcer sur ce point. C’est donc à la fois pour des raisons juridiques et factuelles que je n’étais pas en situation de saisir le procureur.
Avec le courrier électronique, il est devenu très simple de recevoir un message qui ne vous est pas destiné. Dans ce cas, on vous dit de le détruire, car ce mail ne vous appartient pas. On ne peut pas vous reprocher de l’avoir reçu, mais on pourra vous reprocher de l’avoir utilisé : cela peut être qualifié de vol par rétention ou de violation du secret des correspondances. Il est évident qu’avec le développement d’internet, les possibilités sont devenues beaucoup plus nombreuses.
M. Jean-Marc Germain. Si je suis destinataire d’un document pouvant constituer un élément de preuve, vous me recommandez donc de le détruire ? La meilleure solution n’aurait-elle pas été celle que j’ai déjà suggérée : faire constater par huissier la réception du document, puis mettre ce dernier en dépôt, toujours sous constat d’huissier, afin que la justice puisse en disposer un jour si nécessaire ? On ne peut en tout cas détruire un élément matériel dont on vous dit qu’il constitue un élément de preuve.
M. Jean-Louis Bruguière. En droit, la preuve n’est pas présumée, elle doit être documentée.
M. le président Charles de Courson. Mon cher collègue, vous n’êtes pas ici pour demander une consultation juridique au juge Bruguière…
M. Jean-Marc Germain. Dans toute cette affaire, monsieur le président, les protagonistes, fonctionnaires, membres de cabinet, ministres, ont parfois été confrontés à des on-dit, et parfois à des choses plus précises, comme cet enregistrement auquel certains ont eu accès. La question de savoir ce que, sur le plan juridique, on doit faire d’un tel élément matériel est donc fondamentale.
M. Jean-Louis Bruguière. Vous avez raison de poser la question. Les choses sont claires : je reçois l’enregistrement dans les conditions déjà évoquées ; je ne l’écoute pas ; je le détruis. Pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que cela ne constituait pas pour moi, en l’état, un élément suffisant laissant présumer l’existence d’un crime ou d’un délit ! Si tel avait été le cas, je l’aurais bien évidemment transmis au procureur de la République.
Au cours de campagnes électorales, vous avez sans doute déjà reçu des lettres ou des coups de téléphone de dénonciation. Dans ce cas, que faites-vous ? Vous les mettez au panier, parce que vous ne disposez pas d’éléments de vérification, et que vous ne voulez pas submerger le procureur de la République de requêtes. Dans le cas contraire, d’ailleurs, vous risqueriez de faire l’objet d’une plainte en dénonciation calomnieuse.
Lorsque j’étais magistrat, j’étais parfois inondé de courriers de dénonciation ; je suppose qu’en tant que parlementaires vous en recevez aussi. Il faut faire un tri, et n’agir qu’en cas de forte suspicion de l’existence d’un crime ou d’un délit.
M. le président Charles de Courson. Personnellement, il m’est arrivé de recevoir, par mail, des informations que l’on me demandait de transmettre à la personne compétente. Dans un tel cas, la marche à suivre est claire : nous sommes tenus de transmettre ces informations au procureur.
M. Jean-Louis Bruguière. Je parlais de courriers électroniques reçus de manière accidentelle.
M. le président Charles de Courson. La question est en effet différente lorsque, comme c’est le cas ici, les informations sont obtenues par hasard, et non à la suite d’une démarche volontaire.
M. Jean-Marc Germain. En revanche, il s’agit ici d’un document plus substantiel en termes de matérialité, car pouvant constituer un élément de preuve.
M. le président Charles de Courson. Comme la suite l’a montré, en effet.
M. Jean-Louis Bruguière. La suite l’a montré, mais la preuve ne se présume pas.
Un bon exemple nous est fourni par la deuxième audition de Michel Gonelle, dans laquelle il évoque l’accusation de travail dissimulé portée à l’encontre de M. Cahuzac. Si j’ai bien compris, M. Merly, alors député, avait reçu à ce sujet une dénonciation anonyme et saisi, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Paris. Ce faisant, il était tout à fait dans son rôle.
M. le président Charles de Courson. Absolument. Monsieur Bruguière, je vous remercie.
n° 1.– Lettre du 24 juillet 2013 adressée par le Président et le Rapporteur à M. Jacques Menaspa et réponse du 1er août 2013. 3
n° 2.– Lettre du 4 septembre 2013 adressée par le Président et le Rapporteur à M. Michel Gonelle à la suite de la réponse de M. Menaspa du 15 septembre 2013. 9
n° 3.– Notes de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les ministres, datées du 1er octobre 2012 et du 31 octobre 2012, sur la situation de M. Rémy Garnier 13
n° 4.– Note du ministre délégué au budget au directeur général des finances publiques du 10 décembre 2012, dite « muraille de Chine » 21
n° 5.– Note du directeur général des finances publiques au ministre délégué au budget du 6 juin 2012, sur l’examen de la situation fiscale des nouveaux membres du Gouvernement. 25
n° 6.– Formulaire dit 754 de demande de renseignements adressé par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris à M. Jérôme Cahuzac le 14 décembre 2012. 29
n° 7.– Circulaires du ministre du budget au directeur général des finances publiques du 2 novembre 2010, sur les principes d’organisation du contrôle fiscal et l’évocation des situations fiscales individuelles auprès du ministre du budget (circulaire dite « Baroin ») et circulaire du ministre de l’économie et des finances au directeur général des finances publiques et au directeur général des douanes et des droits indirects du 31 décembre 2012, sur l’évocation des situations individuelles auprès des ministres. 33
n° 8.– Note du directeur départemental de la sécurité publique du Lot et Garonne au directeur central de la sécurité publique du 21 mai 2013, sur la mise en cause de sa direction départementale par M. Edwy Plenel. 45
n° 9.– Lettre du ministre de l’Intérieur au Rapporteur datée du 12 juin 2013 et note du 19 décembre 2012 retraçant les éléments en possession de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) concernant l’affaire UBS. 49
n° 10.– Lettre rédigée le 14 décembre 2012 par M. Michel Gonelle à l’attention du président de la République (lettre non envoyée). 55
n° 11.– Tableau de synthèse des échanges d’informations entre le parquet de Paris, le parquet général de Paris et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, établi par le parquet général de Paris. 61
n° 12.– Tableau de remontée d’informations entre le parquet général, la DACG et le cabinet de la ministre de la Justice entre le 7 décembre 2012 et le 2 avril 2013, établi par la DACG. 67
n° 13.– Liste des informations transmises au ministre de l’Intérieur sur « l’affaire Cahuzac », dressée par le ministère de l’Intérieur. 77
n° 14.– Courrier de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, au Président de la commission d’enquête du 18 juillet 2013, faisant suite à son audition. 81
n° 15.– Demande d’assistance administrative adressée par la DGFiP à l’Administration fédérale des contributions de la confédération Suisse (AFC), le 22 janvier 2013, et réponse de cette administration, en date du 31 janvier 2013. 85
n° 16.– Questionnaire envoyé à l’AFC le 10 juillet 2013 et réponse en date du 6 septembre 2013 91
n° 17.– Analyse de la DACG sur la possibilité de verser à la procédure judiciaire la réponse à la demande d’assistance administrative (message électronique du 1er février 2013). 99
n° 18.– Courrier du directeur général des finances publiques au Président et au Rapporteur du 21 juin 2013, faisant suite à l’audition du procureur de Paris, M. François Molins. 103
La suite de ce document est disponible en version pdf.
1 () Rapport (Assemblée nationale, n° 925, XIVème législature) de M. Charles de Courson sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative au fonctionnement de l’action du Gouvernement et des services de l’État entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement, 16 avril 2013.
2 () Réponse à une question de M. Daniel Fasquelle, compte-rendu intégral de la première séance du 5 décembre 2012 de l’Assemblée nationale.
3 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, le 26 juin 2013.
4 () Intervention de M. Charles de Courson, compte-rendu intégral de la première séance du mercredi 24 avril 2013 de l’Assemblée nationale.
5 () Proposition de résolution n° 896 rectifiée de M. Jean-Louis Borloo, Jean-Christophe Lagarde et plusieurs de leurs collègues.
6 () Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : « Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. »
7 () Les dispositions de la Constitution qui régissent les rapports du président de la République et du Parlement font obstacle à l’audition devant une commission d’enquête du président de la République. L’extension de l’irresponsabilité du président de la République (article 67) à ses collaborateurs est demeurée pendant longtemps un point débattu. Les auditions du secrétaire général de l’Élysée, M. Claude Guéant, et du conseiller diplomatique, M. Jean-David Lévitte, en 2007 par la commission d’enquête sur les conditions de la libération des infirmières bulgares constituent cependant deux précédents récents.
8 () Audition de M. Alain Zabulon, le 18 juin 2013.
9 () Les comptes rendus des auditions sont regroupés dans l’annexe I.
10 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013 : cette expression est utilisée par Mme Marie-Françoise Bechtel.
11 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
12 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
13 () Le président et le rapporteur de la commission d’enquête ont décidé de procéder par écrit après que la personne qui indiquait avoir effectué l’enregistrement – M. Jacques Menaspa – leur a fait part de son état de santé lui interdisant de se déplacer. Dans la réponse écrite, il apparaît que ce n’est pas cette personne, mais son fils – M. Julien Menaspa –, qui a réalisé l’opération. Le courrier qui a été adressé à M. Menaspa et la réponse qui y a été apportée figurent en annexe au présent rapport (annexe II, document n° 1).
14 () Michel Gonelle a réitéré cette affirmation dans sa réponse au courrier du Président et du Rapporteur daté du 4 septembre 2013 (annexe II, document n° 2).
15 () Audition de MM. Alain Letellier et Florent Pedebas, le 24 juillet 2013, et audition de M. Jean-Noël Catuhe, le 3 juillet 2013.
16 () Sauf en cas de non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, laquelle constitue un délit en application de l’article 434-1 du code pénal.
17 () Selon la transcription publiée par Mediapart, Jérôme Cahuzac dit par exemple : « Ça me fait chier d’avoir un compte ouvert là-bas, l’UBS c’est quand même pas la plus planquée des banques. »
18 () Toujours selon la transcription publiée par Mediapart, il aurait en effet dit : « Moi, ce qui m’embête, c’est que j’ai toujours un compte ouvert à l’UBS, mais il n’y a plus rien là-bas, non ? ».
19 () Audition de M. Jean-Noël Catuhe, le 3 juillet 2013.
20 () Audition de M. Bernard Salvat, le 4 juin 2013.
21 () Audition de M. Jean-Noël Catuhe, le 3 juillet 2013.
22 () Le formulaire correspondant à cette demande est daté du 9 février 2001 et il porte la seule signature de Christian Mangier ; le motif du prélèvement est « consultation ».
23 () Audition de M. Patrick Richard, le 18 juin 2013.
24 () Audition de M. Olivier André, le 18 juin 2013.
25 () Audition de M. Patrick Richard, le 18 juin 2013.
26 () Audition de M. Laurent Habert, le 18 juin 2013.
27 () Contrôle sur place à la DRFiP Paris - Île-de-France, le 10 juillet 2013.
28 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
29 () Fabrice Arfi, avec la rédaction de Mediapart, L’affaire Cahuzac. En bloc et en détail, Don Quichotte, mai 2013, p. 21.
30 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
31 () Audition de M. Thierry Picart, le 4 juin 2013.
32 () Cette thèse apparaît dans un article du Courrier picard du 5 avril 2013, puis dans un article de Marianne, le 13 avril 2013.
33 () Il existe depuis peu un délai maximal de vingt ans, pour les informations relatives aux auteurs de manquements à l’obligation de déclaration des transferts de fond, notamment.
34 () Audition de Mme Hélène Croquevieille et de M. Jérôme Fournel, le 4 juin 2013.
35 () Audition de M. Michel Gonelle, le 9 juillet 2013.
36 () Audition de M. Jean-Noël Catuhe, le 3 juillet 2013.
37 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
38 () Auditions de M. Michel Gonelle, le 21 mai et le 9 juillet 2013.
39 () Auditions de M. Jean-Louis Bruguière, le 19 juin et le 24 juillet 2013.
40 () Audition de M. Gérard Paqueron, le 17 juillet 2013.
41 () Notamment relatives au fait qu’il employait une ressortissante sans-papier à sa clinique : cette affaire lui a valu, à la fin 2007, une procédure devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel l’a déclaré coupable tout en le dispensant de peine et d’inscription au casier judiciaire.
42 () Un courriel du mois de mai, adressé à un groupe de destinataires, lui demande de confirmer sa présence à une réunion.
43 () Audition de M. Jean-Louis Bruguière, le 24 juillet 2013.
44 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
45 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
46 () Audition de M. Jean-Louis Bruguière, le 24 juillet 2013.
47 () Voir infra, III, A, 2.
48 () Le témoignage écrit de M. Julien Menaspa figure en annexe au présent rapport (annexe II, document n° 1).
49 () Article de Fabrice Arfi, « Le compte suisse du ministre du budget Jérôme Cahuzac ».
50 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, 26 juin 2013.
51 () Il se voit infliger, pendant cette période, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, en 2004 à raison de manquements à son obligation de secret professionnel, de discrétion professionnelle et de réserve, infirmée par deux décisions de première instance et d’appel des 7 octobre 2009 et 15 novembre 2010.
52 () Cette note est annexée au mémoire introductif d’instance daté du 14 avril 2009 devant le Tribunal administratif de Bordeaux (requête n° 0901621-5, enregistrée le 16 avril 2009).
53 () En l’espèce, c’est à l’administration qu’il revenait de présenter ses observations en défense, puisque la requête avait été introduite par M. Garnier. La confusion est entretenue par l’existence d’un mémoire « en réplique » (c’est-à-dire présenté par le requérant devant les juridictions administratives après sa requête, généralement pour préciser celle-ci), comme celui présenté par Rémy Garnier le 28 janvier 2013 devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
54 () Audition de Mme Amélie Verdier, le 21 mai 2013.
55 () Audition de M. Alexandre Gardette, le 4 juin 2013.
56 () Auditions de M. Bruno Bézard et de M. Philippe Parini, le 28 mai 2013.
57 () Voir l’annexe II, document n° 3.
58 () La seule reprise, dans l’une de ces notes, d’éléments biographiques et d’un nota bene qui figuraient déjà dans les observations en défense de l’administration sur l’instance formée le 16 avril 2009 par M. Garnier ne suffit pas à établir que son rédacteur ait porté à la connaissance de sa hiérarchie le contenu des pièces annexées au mémoire introductif d’instance.
59 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, le 26 juin 2013.
60 () Voir infra, II, D.
61 () Réponses annexées à la lettre du directeur général des finances publiques du 3 septembre 2013.
62 () Audition de M. Bruno Bézard, le 28 mai 2013.
63 () Voir la note du ministre délégué au budget au directeur général des finances publiques, en date du 10 décembre 2012, annexée au présent rapport (annexe II, document n° 4)
64 () Décret n° 2012-796 du 9 juin 2012 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget.
65 () Réponses de la DGFiP du 3 septembre 2013 au questionnaire de la commission d’enquête.
66 () Note pour les ministres du 6 juin 2012 (annexe II, document n° 5).
67 () Audition de Mme Amélie Verdier, le 21 mai 2013.
68 () Audition de Mme Janine Pécha, M. André Bonnal et M. Pascal Pavy, le 28 mai 2013.
69 () Audition de M. Edwy Plenel, le 21 mai 2013.
70 () Audition de M. Pierre Moscovici, le 16 juillet 2013.
71 () Voir annexe II, document n° 6.
72 () Auditions de M. Bruno Bézard, le 28 mai 2013, et de M. Alexandre Gardette, le 4 juin 2013.
73 () Communication de M. Philippe Marini, président, sur la gestion par les services de l’État d’informations relatives à la détention d’un compte à l’étranger par un ministre, CR de la commission des finances du Sénat, 26 juin 2013.
74 () Cette circulaire disposait : « Il appartient à l’administration fiscale de gérer au quotidien les relations avec les contribuables dans les différentes missions dont elle a la charge. J’entends m’abstenir de toute intervention dans le cours des procédures individuelles de contrôle et veillerai simplement à ce qu’elles soient mises en œuvre avec l’efficacité, la compétence et le souci déontologique qui sont ancrés dans la culture de vos services ». La nouvelle circulaire en vigueur depuis le 31 décembre 2012 reprend, sinon la lettre, du moins l’esprit de la précédente : « Il revient donc dans ce cadre à vos administrations de gérer au quotidien les relations avec les usagers dans les différentes missions dont elle a la charge » (annexe II, document n° 7).
75 () Par l’article 100 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ; auparavant, le ministre qui s’estimait diffamé ne pouvait ni mettre en mouvement l’action publique au pénal, ni saisir la juridiction civile d’une action en dommages et intérêts, et le ministère public pouvait exercer une poursuivre sans plainte de l’intéressé.
76 () Audition de Mme Amélie Verdier, le 21 mai 2012.
77 () Audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, le 9 juillet 2013.
78 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
79 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
80 () En application notamment des articles 55 et 56 de la loi sur la liberté de la presse, précitée. Ces principes sont rappelés dans un courriel transmis le 23 décembre 2012 par la direction des affaires criminelles et des grâces au cabinet de la garde des Sceaux, dont le Rapporteur a eu communication.
81 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
82 () Elle figure dans l’article de Fabrice Arfi intitulé « Les mensonges de Jérôme Cahuzac ».
83 () Audition de Mme Marie-Hélène Valente, le 5 juin 2013.
84 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
85 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013 : les propos cités ont été tenus par M. Arfi.
86 () Audition de MM. Pascal Lalle et Christian Hirsoil, le 2 juillet 2013.
87 () Voir annexe II, document n° 8.
88 () Audition de M. Manuel Valls, le 16 juillet 2013.
89 () Le compte rendu de cette audition n’est donc pas publié dans le cadre du présent rapport.
90 () Audition de M. Manuel Valls, le 16 juillet 2013.
91 () La Commission bancaire avait également été saisie, en avril 2009, par la source de la DCRI.
92 () Voir annexe II, document n° 9.
93 () Audition de M. Pascal Lalle, directeur central, à la direction centrale de la sécurité publique, et de M. Christian Hirsoil, contrôleur général de police, sous-directeur, à la sous-direction de l’information générale, le 2 juillet 2013.
94 () Les enquêtes de ce type ne sont d’ailleurs actuellement de la compétence d’aucun service de l’État ; la direction centrale des renseignements généraux, dont les missions ont été réparties depuis le 1er juillet 2008 entre la DCRI et la sous-direction de l’information générale, qui fait partie de la DCSP, avait instruction de ne plus travailler dans le domaine du renseignement politique depuis 1995.
95 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
96 () Edwy Plenel a déclaré à la commission d’enquête : « J’ai vu une fois M. le président de la République, devant témoin, aux vœux présidentiels. Nous nous sommes salués de loin, sans échanger un mot. »
97 () Mediapart a publié, le 29 décembre 2012, un entretien avec Jean-Pierre Mignard intitulé « Me Mignard : ce que l’affaire Cahuzac réclame de la justice ».
98 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013, et audition de M. Alain Zabulon, le 18 juin 2013.
99 () Voir l’annexe II, document n° 10.
100 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, le 26 juin 2013.
101 () Dans un article intitulé « Affaire Cahuzac : l’auteur de l’enregistrement reste anonyme ».
102 () Audition de M. Alain Zabulon, le 18 juin 2013.
103 () Lors de son audition du 24 juillet 2013, M. Jean-Louis Bruguière a expliqué que « "avoir la connaissance d’un crime ou d’un délit ", c’est détenir des éléments suffisants, des indices précis et concordants laissant présumer la commission d’une infraction ». En l’absence de tels éléments, la personne qui fait usage de l’article 40 du code de procédure pénale peut être poursuivie pour dénonciation calomnieuse.
104 () La secrétaire d’Alain Zabulon allait lui passer Michel Gonelle lorsque M. Zabulon a pris une communication interne.
105 () Audition de M. Alain Zabulon, le 18 juin 2013.
106 () Notamment dans un article de Stéphane Alliès et Lenaïg Bredoux du 21 décembre 2012, intitulé « Affaire Cahuzac : l’embarras croissant de l’Élysée ».
107 () Audition de M. Michel Gonelle, le 21 mai 2013.
108 () Selon les propos tenus par M Fabrice Arfi : audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
109 () Le texte intégral de cette lettre a été mis en ligne sur le site de Mediapart le 29 décembre 2012 ; il a aussi été publié dans le livre de Fabrice Arfi, avec la rédaction de Mediapart, L’affaire Cahuzac. En bloc et en détail, Don Quichotte, mai 2013, pp. 125-128.
110 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
111 () Voir supra, II, B, 1.
112 () Voir supra, II, D, 2.
113 () Cette qualification a été utilisée par le Procureur général Falletti au cours de son audition, le 12 juin 2013.
114 () Audition de M. François Falletti, le 12 juin 2013.
115 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
116 () Audition de Mme Christine Dufau et de M. Éric Arella, le 11 juin 2013.
117 () Audition de M. François Falletti, le 12 juin 2013.
118 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
119 () Audition de Mme Christine Dufau et de M. Éric Arella, le 11 juin 2013.
120 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
121 () Ces règles découlent de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et des articles 30 et suivants du code de procédure pénale.
122 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
123 () Voir l’annexe II, document n° 11.
124 () La directrice des affaires criminelles et des grâces a adressé ce protocole à la commission d’enquête.
125 () Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique.
126 () Le procureur général peut demander au procureur de la République d’engager des poursuites mais pas de classer sans suite.
127 () Audition de M. François Falletti, le 12 juin 2013.
128 () Audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, le 9 juillet 2013.
129 () Voir l’annexe II, documents n° 11 et 12.
130 () « Christiane Taubira a reçu 54 notes du procureur général sur l’affaire Cahuzac », Le Canard enchaîné, le 24 juillet 2013 ; « Cahuzac : le détail des notes transmises à Taubira », Mediapart, le 24 juillet 2013.
131 () Audition de Mme Christiane Taubira, le 16 juillet 2013.
132 () Audition de MM. Edwy Plenel et Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
133 () Audition de Mme Christine Dufau et de M. Éric Arella, le 11 juin 2013.
134 () Audition de M. Manuel Valls, le 16 juillet 2013.
135 () Voir l’annexe II, document n° 13.
136 () Audition de M. Pierre Condamin-Gerbier, le 3 juillet 2013.
137 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, le 23 juillet 2013.
138 () Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, le 9 juillet 2013.
139 () Audition de M. Pierre Condamin-Gerbier, le 3 juillet 2013.
140 () Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, le 9 juillet 2013.
141 () Courrier, rendu public, du 5 avril 2013.
142 () Audition de M. Pierre Moscovici, le 16 juillet 2013.
143 () Audition de M. Edwy Plenel, le 21 mai 2013.
144 () Audition de M. Alexandre Gardette, le 4 juin 2013.
145 () Deux accords : l’un entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, conclu le 28 octobre 1996, et l’autre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, conclu le 9 octobre 2007.
146 () Audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, le 9 juillet 2013. La garde des Sceaux a confirmé l’absence de précédent dans un courrier au Président de la commission (annexe II, document n° 14).
147 () Audition de M. Bruno Bézard, le 28 mai 2013.
148 () Voir l’annexe II, document n° 15.
149 () Audition de M. Alexandre Gardette, le 4 juin 2013.
150 () Réponse de l’AFC au questionnaire du Rapporteur, datée du 3 septembre 2013 (annexe II, document n° 16).
151 () Audition de M. Rémy Rioux, le 28 mai 2013.
152 () Audition de M. Pierre Moscovici, le 16 juillet 2013.
153 () Informations tirées d’un ouvrage publié par une journaliste de l’hebdomadaire Le Point, Mme Charlotte Chaffanjon : Jérôme Cahuzac : les yeux dans les yeux, Plon, 2013.
154 () Audition de M. Jérôme Cahuzac, le 23 juillet 2013.
155 () Audition de M. Pierre Moscovici, le 16 juillet 2013.
156 () Réponses annexées à la lettre du directeur général des finances publiques du 3 septembre 2003.
157 () Audition de M. Bruno Bézard, le 28 mai 2013.
158 () Audition de M. Fabrice Arfi, le 21 mai 2013.
159 () Audition de M. Pierre Moscovici, le 16 juillet 2013.
160 () Voir supra III, A, 2.
161 () Audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, le 9 juillet 2013, et réponse (en date du 3 septembre 2013) de la DGFiP à un questionnaire relative aux conditions dans lesquelles, au regard du principe de spécialité, la réponse faite par les autorités helvétiques à la DGFiP dans le cadre de la convention d’assistance administrative en matière fiscale pouvait être versée à l’enquête préliminaire en cours au parquet de Paris.
162 () Voir l’analyse de la DACG sur ce point (annexe II, document n° 17).
163 () Voir l’analyse du directeur général des finances publiques (annexe II, document n° 18).
164 () Symétriquement, la convention franco-suisse ne saurait pas non plus faire obstacle à ce que l’administration fiscale défère, conformément aux dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, à une réquisition judiciaire dans le cadre d’une enquête sur des faits de blanchiment de fraude fiscale.
165 () Audition de M. François Molins, le 19 juin 2013.
166 () Voir supra III, A, 1.
167 () Communiqué du département fédéral des finances du 14 septembre 2009.
168 () Interview du porte-parole du Secrétariat d’État suisse aux questions financières internationales dans le quotidien Le Temps du 12 avril 2013.
169 () Réponse de l’AFC au questionnaire du Rapporteur, datée du 3 septembre 2013 (annexe II, document n° 16).
170 () Contrairement à ce qu’avait laissé entendre Pierre Condamin-Gerbier, lors de son audition, le 3 juillet 2013.
171 () La presse suisse a, à compter du mois d’avril 2013, avancé que les fonds avaient été transférés dans la filiale singapourienne de la banque suisse Julius Baer ; Mediapart a décrit, dans un article paru le 25 septembre 2013, en détail le montage financier et juridique auquel Jérôme Cahuzac aurait eu recours (« Dans les arcanes du compte de Jérôme Cahuzac à Singapour »).
172 () Après avoir signé, le 29 mai 2013, la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE, Singapour a annoncé, en juillet dernier, que cette autorisation judiciaire ne serait bientôt plus nécessaire.
173 () Entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013, la France a adressé à Singapour 29 demandes et reçu 25 réponses, jugées globalement satisfaisantes.
© Assemblée nationale