

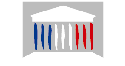
N° 3317
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 146-3, alinéa 8, du Règlement
PAR LE COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information n° 2385
du 20 novembre 2014 sur l’évaluation de la lutte contre l’usage
de substances illicites
ET PRÉSENTÉ PAR
par Mme Anne-Yvonne LE DAIN et M. Laurent MARCANGELI,
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE DU RAPPORT 5
INTRODUCTION 17
I. LES ENQUÊTES MENÉES EN 2014 ONT MIS EN ÉVIDENCE UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DES DROGUES ILLICITES 18
A. LA DIFFICILE DENSIFICATION DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 18
B. LA CONFIRMATION DE LA FORTE PRÉVALENCE DU CANNABIS 19
C. L’ESSOR DES NOUVELLES DROGUES DE SYNTHÈSE POUR LA PREMIÈRE FOIS MIS EN ÉVIDENCE 23
1. Le classement comme stupéfiants par famille de molécules 24
2. La surveillance de l’internet 26
II. LA PRÉVENTION : BÂTIR UNE VÉRITABLE POLITIQUE À DESTINATION DES PLUS JEUNES 26
A. FONDER LA PRÉVENTION SUR DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉS ET ÉVALUÉS 27
1. Les insuffisances du pilotage par l’éducation nationale 27
2. Les policiers et gendarmes formateurs anti-drogue 29
3. La commission interministérielle de prévention des conduites addictives 30
B. MODERNISER LA COMMUNICATION 33
III. LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET SOCIALE : DÉCLOISONNER LES DISPOSITIFS AFIN DE FACILITER LES PARCOURS DE SOINS INDIVIDUALISÉS 34
IV. LA RÉDUCTION DES RISQUES : POURSUIVRE ET APPROFONDIR UNE INDISPENSABLE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 38
A. LE CONTRÔLE DES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACÉS 39
B. DÉVELOPPER ET SÉCURISER LES PROGRAMMES D’ÉCHANGE DE SERINGUES 40
C. FAUT-IL EXPÉRIMENTER LA MISE EN PLACE DE SALLES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE ? 43
V. QUEL RÉGIME JURIDIQUE POUR L’USAGE DE CANNABIS ? 44
EXAMEN PAR LE COMITÉ 53
ANNEXE N° 1 : GLOSSAIRE 67
ANNEXE N° 2 : PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 69

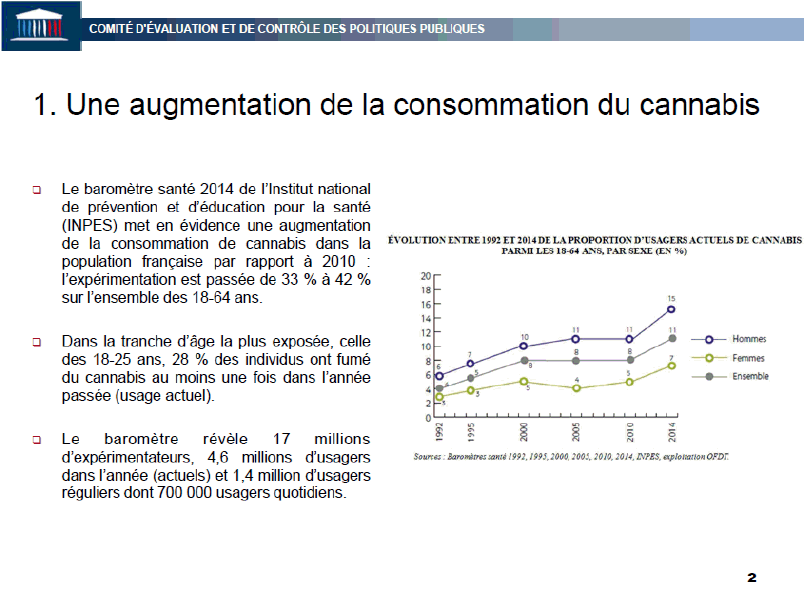
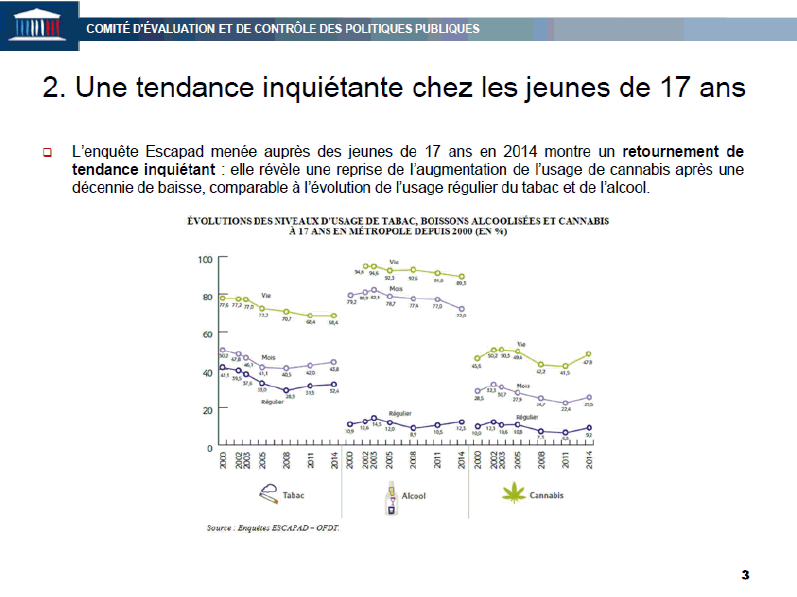
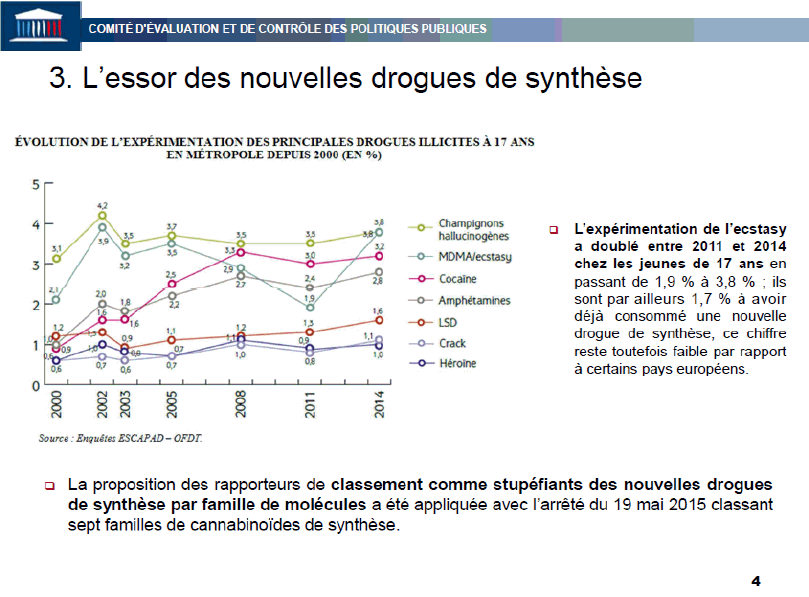
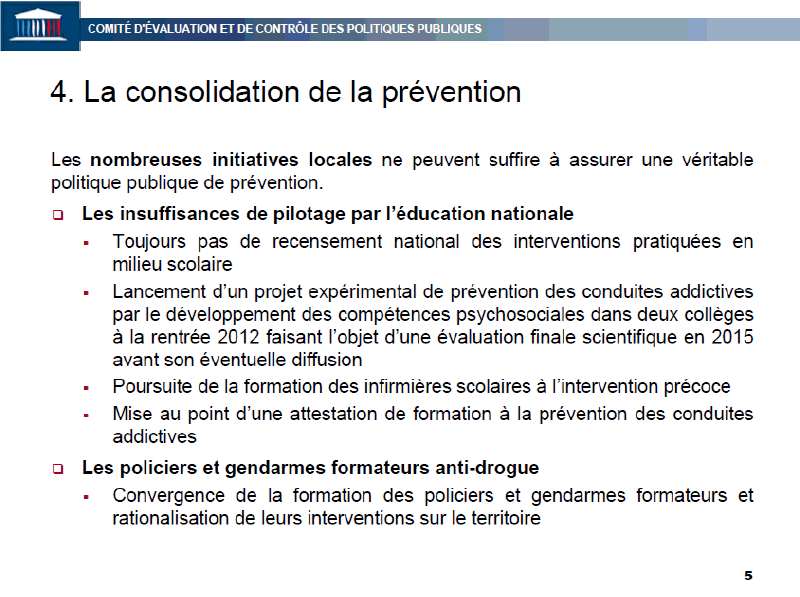
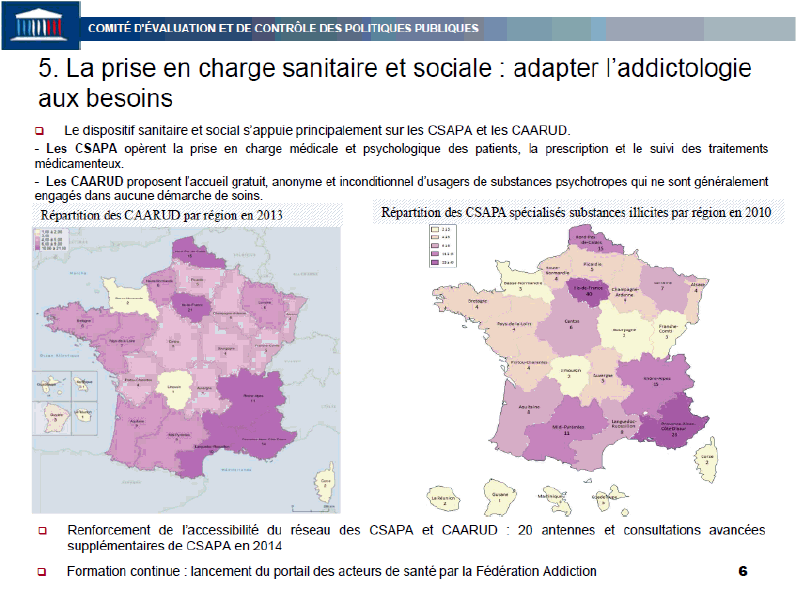
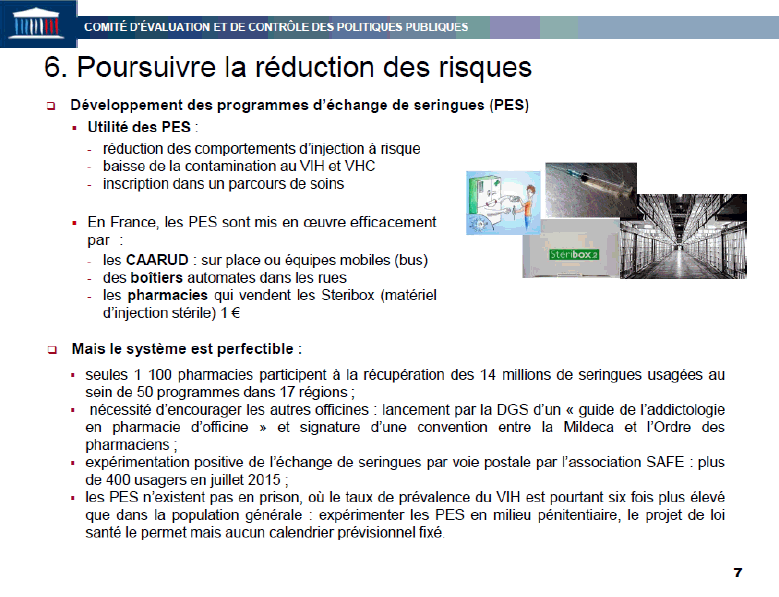

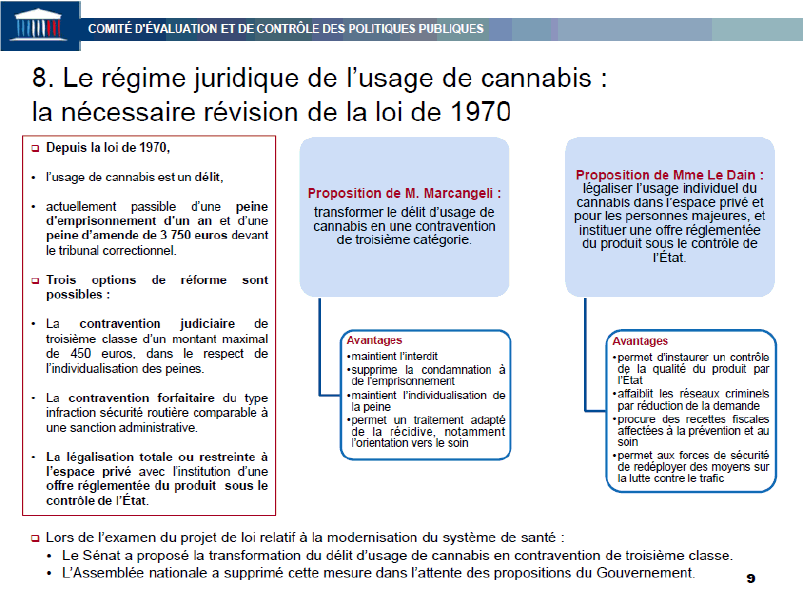
Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques a autorisé la publication du rapport d’évaluation de la lutte contre l’usage de substances illicites le 20 novembre 2014.
Conformément à l’article 146-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, il convient de présenter le suivi des conclusions des deux rapporteurs, qui reposaient sur douze propositions communes et deux propositions divergentes relatives, d’une part, au régime juridique de l’usage de cannabis, et d’autre part, à l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque.
Ce suivi est d’autant plus utile qu’il coïncide avec la fin de la discussion du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé devant le Parlement dont certaines dispositions, notamment en matière de réduction des risques, présentent des avancées importantes.
Il est aussi intéressant d’actualiser un certain nombre de données qui, pour la plupart, confortent l’analyse menée par les rapporteurs l’année dernière, au moment où la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) achève son plan d’actions 2013-2015, première séquence du plan gouvernemental adopté le 19 septembre 2013 pour la période 2013-2017.
I. LES ENQUÊTES MENÉES EN 2014 ONT MIS EN ÉVIDENCE UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DES DROGUES ILLICITES
En France, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) rassemble, analyse et synthétise les informations relatives aux substances illicites, via de grandes enquêtes épidémiologiques. Celles-ci mettent en évidence des niveaux de consommation élevés, tant en population générale que chez les jeunes français.
A. LA DIFFICILE DENSIFICATION DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Depuis 1995, les travaux de l’OFDT s’appuient sur un certain nombre de grandes enquêtes sectorielles menées à périodicité régulière.
En ce qui concerne la population générale, le baromètre santé de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), enquête réalisée tous les cinq ans sur un large échantillon (15 600 individus en 2014), comprend un module « produits illicites » qui mesure les consommations et les niveaux d’usage. L’OFDT essaie par ailleurs d’identifier les phénomènes émergents liés aux drogues illicites en France à travers l’enquête Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND).
Trois enquêtes cherchent ensuite à appréhender les attitudes des jeunes quant à leurs consommations, leurs modes d’usage de substances psychoactives, leur santé et leurs modes de vie. Ces enquêtes ciblent chacune une tranche d’âge particulière, entre onze et dix-huit ans, de sorte qu’il est possible d’affiner les résultats et d’observer l’évolution des pratiques, notamment lors du passage du collège au lycée. L’enquête ESCAPAD, menée tous les trois ans à l’occasion de la journée défense et citoyenneté, vise les jeunes de dix-sept ou dix-huit ans. L’enquête ESPAD cible quant à elle la population scolaire de l’enseignement secondaire de quinze ou seize ans. Enfin, une enquête internationale dite HBSC, réalisée pour la France par le service médical du rectorat de l’académie de Toulouse et au financement de laquelle l’OFDT participe, interroge des jeunes ayant entre onze et quinze ans.
Les données ainsi récoltées peuvent ensuite être mises en perspective au regard des statistiques des autres pays européens, grâce notamment aux travaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Celui-ci élabore chaque année un « rapport européen sur les drogues » qui réalise la synthèse des tendances et des évolutions du phénomène de la drogue en Europe et compile les données nationales communiquées par les États.
Tout en saluant la rigueur et l’exemplarité des enquêtes épidémiologiques menées en France, les rapporteurs avaient formulé une proposition de densification (proposition n° 2 tendant à augmenter leur fréquence et à les compléter par des suivis de cohorte dans la durée) qui n’a pas vraiment été suivie à ce jour, essentiellement pour des raisons budgétaires.
La périodicité du baromètre santé est toujours de cinq ans et celle de l’enquête ESCAPAD de trois ans et l’OFDT, lors de sa nouvelle audition devant les rapporteurs, n’a pas émis de grief particulier sur ce statu quo. Il est vrai qu’en 2014 les rapporteurs avaient joué de malchance puisqu’ils ne pouvaient disposer que de données 2010 (baromètre santé) ou 2011 (ESCAPAD), les deux enquêtes étant en cours de renouvellement. L’un des intérêts du présent rapport de suivi est de pouvoir disposer des données 2014 et 2015 au titre des deux études.
Quant au suivi de cohortes, ce sont des dispositifs lourds et coûteux. Le problème des perdus de vue est un écueil récurrent des cohortes, et le parcours souvent chaotique des usagers de substances illicites peut venir compliquer la participation au cadre d’une cohorte. Une réflexion est donc désormais en cours entre l’OFDT, une équipe de recherche de l’INSERM et la Mildeca afin d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un suivi longitudinal d’une cohorte de patients pris en charge dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Pour le moment, l’OFDT procède à des analyses secondaires de cohortes américaines dont les données sont publiées.
B. LA CONFIRMATION DE LA FORTE PRÉVALENCE DU CANNABIS
Le baromètre santé 2014 met en évidence une augmentation de la consommation du cannabis dans la population française par rapport à l’enquête de 2010, alors même que la France se signalait déjà par un niveau élevé par rapport aux autres pays européens.
Il est rappelé qu’un usage « régulier » consiste en au moins 10 usages dans les 30 jours précédant l’enquête, qu’un usage « actuel » consiste en au moins un usage au cours des 12 mois précédant l’enquête et qu’une « expérimentation » consiste en au moins un usage au cours de la vie.
Comme le relève l’OFDT dans son périodique Tendances (n° 99, mars 2015), « sur l’ensemble des 18-64 ans, l’expérimentation de cannabis est passée de 33 % à 42 % entre 2010 et 2014, prolongeant la tendance observée depuis les années 1990, mais de manière plus marquée. Cette hausse est principalement portée par un effet de stock, mais l’usage actuel (année) a également augmenté de façon notable, passant de 8 % à 11 %, tout comme les usages réguliers (de 2,2 % à 3,1 %), ceci étant observé pour toutes les tranches d’âge. »
Dans la tranche d’âge la plus exposée à cette addiction, celle des 18-25 ans, 28 % des individus ont fumé au moins une fois du cannabis dans l’année.
Transcrits en valeur absolue sur l’ensemble de la population française dans ces tranches d’âge, les taux du baromètre santé 2014 révèlent 17 millions d’expérimentateurs, 4,6 millions d’usagers dans l’année et 1,4 million d’usagers réguliers dont 700 000 usagers quotidiens.
ÉVOLUTION ENTRE 1992 ET 2014 DE LA PROPORTION D’USAGERS ACTUELS DE CANNABIS PARMI LES 18-64 ANS, PAR SEXE (EN %)
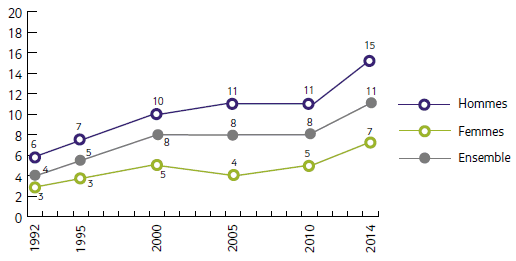
Sources : Baromètres santé 1992, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, INPES, exploitation OFDT.
Cette évolution défavorable, caractérisée par une croissance de la consommation constatée en 2014 après une longue période de stagnation entre 2000 et 2010, n’a pas échappé à l’observatoire européen qui l’a évoquée dans son rapport annuel 2015 dans les termes suivants : « Plusieurs pays disposent de données d’enquête suffisantes pour pouvoir produire une analyse statistique des évolutions à long terme en matière de consommation de cannabis chez les jeunes adultes (de 15 à 34 ans). Les enquêtes démographiques pour l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, qui totalisent près de la moitié de la population européenne, font état d’une prévalence stable ou en baisse de la consommation de cannabis au cours de la dernière décennie. Par contre, une prévalence accrue a été observée en Bulgarie, en France et dans trois pays scandinaves (Danemark, Finlande et Suède). »
Notre pays se situe désormais dans les plus vulnérables à cette addiction.
PRÉVALENCE DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE CHEZ LES JEUNES ADULTES (15-34 ANS)
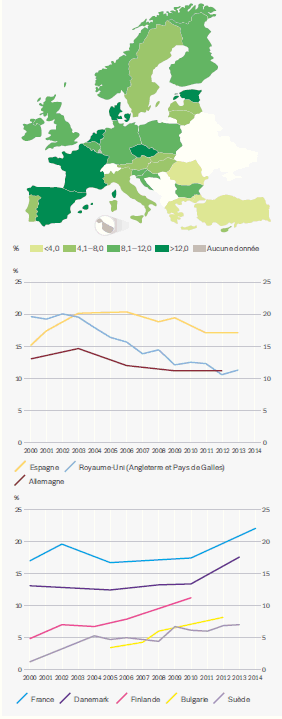
Source : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport européen sur les drogues 2015.
Cette très mauvaise performance est confirmée par l’enquête ESCAPAD 2014 qui porte sur plus de 26 300 jeunes de dix-sept ans accomplissant leur journée défense et citoyenneté. Cette enquête met en évidence une nette rupture de tendance par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle révèle une reprise de l’augmentation de l’usage de cannabis après une décennie de baisse, comparable à l’évolution constatée de l’usage régulier du tabac et de l’alcool.
ÉVOLUTIONS DES NIVEAUX D’USAGE DE TABAC, BOISSONS ALCOOLISÉES ET CANNABIS À 17 ANS EN MÉTROPOLE DEPUIS 2000 (EN %)
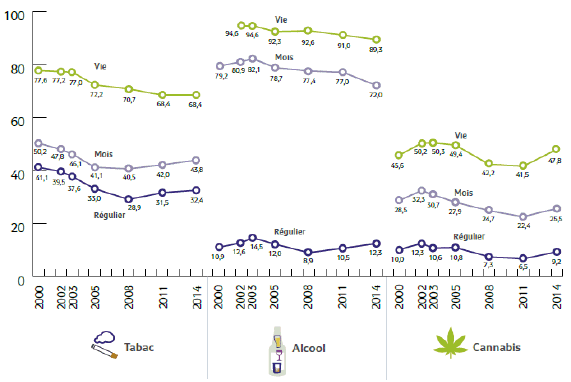
Source : Enquêtes ESCAPAD – OFDT.
De plus, la proportion de fumeurs de cannabis présentant un risque élevé d’usage problématique a augmenté entre 2011 et 2014 selon l’outil de repérage CAST (cannabis abuse screening test) développé par l’OFDT à partir d’un questionnaire en six points et qui fait référence en Europe. Cette proportion est en effet passée de 17,8 % des fumeurs dans l’année en 2011 à 21,9 % en 2014.
Enfin, les saisies de résine de cannabis opérées par les forces de sécurité en France confirment l’augmentation constante de sa teneur en THC qui a atteint 20,7 % en 2014, en croissance de 18 % par rapport à la teneur moyenne relevée en 2013. Cette teneur a triplé en l’espace de dix années, illustrant ainsi la sophistication d’une filière agro-industrielle, marquée par un véritable effort d’amélioration variétale du produit naturel.
Le volume des saisies de résine de cannabis a atteint près de 36,9 tonnes en 2014, en recul marqué (- 48 %) par rapport à l’année 2013, imputable aux facteurs suivants, selon le ministère de l’intérieur : adoption de la législation restreignant le cadre d’emploi des outils de géolocalisation, tensions diplomatiques et gel de la coopération opérationnelle avec le Maroc, réticences croissantes des juridictions à l’égard de la mise en œuvre des procédures de livraisons surveillées, et évolution du marché du cannabis, marqué par le succès croissant de l’herbe, dont la production sur les sols européen et français se développe de façon exponentielle.
La hausse notable (110 %) des saisies d’herbe de cannabis réalisées en 2014 (10,1 tonnes contre 4,75 tonnes en 2013), et des saisies de plants de cannabis (+ 12 %) confirme cette tendance.
Seul l’âge moyen d’entrée dans la consommation (premier usage) ne s’est pas dégradé puisqu’il est resté à 14 ans, comme en 2011. Cette variable est d’importance puisqu’une consommation précoce est particulièrement nocive et présente un gros risque d’usage problématique.
C. L’ESSOR DES NOUVELLES DROGUES DE SYNTHÈSE POUR LA PREMIÈRE FOIS MIS EN ÉVIDENCE
Outre l’augmentation de la prévalence du cannabis, l’enquête ESCAPAD a mis en évidence une reprise très significative de l’expérimentation de la MDMA/ecstasy ainsi que l’apparition des drogues de synthèse, alors que les autres drogues demeuraient à un niveau faible, voire marginal.
ÉVOLUTION DE L’EXPÉRIMENTATION DES PRINCIPALES DROGUES ILLICITES À 17 ANS EN MÉTROPOLE DEPUIS 2000 (EN %)
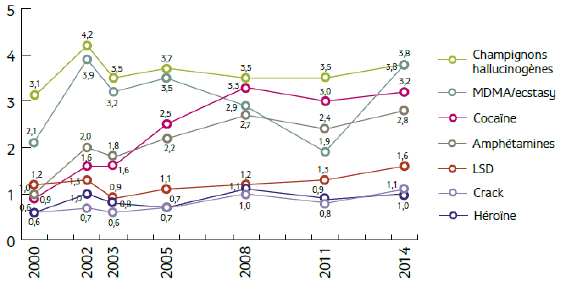
Source : Enquêtes ESCAPAD – OFDT.
L’expérimentation de la MDMA/ecstasy (les deux produits sont des dérivés des amphétamines très voisins voire identiques) a ainsi doublé entre 2011 et 2014, puisqu’elle est passée de 1,9 % à 3,8 % des jeunes de 17 ans, renouant ainsi avec les niveaux record de 2002. Cette résurgence est corroborée par l’augmentation des saisies d’ecstasy par les services répressifs français (pour l’essentiel, les douanes), qui se sont élevées à 940 000 comprimés en 2014, soit une hausse de plus de 120 % par rapport à 2013.
Par ailleurs et pour la première fois, une question portant sur la consommation de « substances qui imitent les effets d’une drogue », plus communément appelées nouvelles drogues ou produits de synthèse (NPS), a été posée dans l’enquête 2014 et 1,7 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà consommé ce type de produits. Même si ce chiffre reste faible, notamment en comparaison d’autres pays européens comme la Pologne ou l’Irlande, il confirme toutefois un début de processus précoce, confirmant ainsi les craintes exprimées par les rapporteurs l’année dernière. Il est probable que cette proportion d’expérimentateurs voire d’usagers réguliers augmente avec l’âge, notamment dans certains milieux festifs particulièrement exposés à ce type d’addictions.
« Nouveaux produits de synthèse », « research chemicals », « euphorisants légaux », « legal high », « sels de bains » ou « encens » : les nouvelles drogues de synthèse peuvent emprunter des appellations variées selon les différentes caractéristiques de ces produits. Il s’agit en effet de produits synthétiques, qui imitent les effets de psychotropes divers (cannabis, ecstasy, cocaïne…), mais dont la composition moléculaire s’en distingue suffisamment pour ne pas tomber sous le coup des interdictions légales. Sur le plan pharmacologique, plusieurs familles chimiques sont répertoriées. Deux d’entre elles génèrent la majorité des NDS identifiées sur le marché : les cathinones de synthèse et les cannabinoïdes de synthèse. Les premières, synthétisées à partir de la feuille de khat, possèdent des effets stimulants similaires à l’ecstasy, la cocaïne ou les amphétamines et les secondes imitent les effets du cannabis.
Les NDS peuvent s’avérer particulièrement dangereuses, et le sont d’autant plus que les consommateurs ont la fausse impression d’en maîtriser la composition, en raison notamment de la légalité supposée de ces produits et de la facilité de s’en procurer. Or, la maîtrise de la composition chimique de ces NDS est évidemment illusoire et les substances peuvent être nocives même à très faible dose. Pis encore, contrairement aux drogues « classiques » telles que l’héroïne ou la cocaïne pour lesquelles la prise en charge médicale en cas de surdose est désormais maîtrisée, les effets de ces NDS sont peu connus et peuvent laisser le milieu médical démuni quant au traitement à appliquer en cas d’intoxication. Les effets nocifs sont pourtant légion (agitation, délire, tachycardie, hypertension, problèmes psychiatriques, dépendance) et sont aggravés lorsque ces substances sont ingérées dans un contexte de polyconsommation, avec absorption d’alcool ou d’autres produits psychotropes. Dès 2011, plusieurs cas de décès ont été notifiés annuellement à l’OEDT, attestant de la dangerosité potentielle des produits.
C’est la raison pour laquelle les rapporteurs avaient tiré la sonnette d’alarme et avaient souhaité, dans leur proposition n° 3, une réaction plus ferme des pouvoirs publics, qui semble en train de se produire.
1. Le classement comme stupéfiants par famille de molécules
Une meilleure connaissance de la composition de ces substances serait de nature à faciliter la prise en charge des consommateurs victimes d’intoxication.
En France, l’Institut national de police scientifique (INPS) met à jour le fichier STUPS qui regroupe les données des laboratoires de police scientifique sur les produits saisis par des services d’enquête. Ces fiches, qui décrivent les composés principaux du produit saisi ainsi que les produits de coupage utilisés, contribuent à améliorer la connaissance sur les NDS.
Cependant, la police et la gendarmerie ont vocation à saisir un nombre limité de NDS puisque ces substances ne sont pas interdites tant qu’une procédure d’alerte puis de classement comme stupéfiants n’est pas achevée, à la différence des douanes, qui sont de fait à la source de l’essentiel des saisies dès lors qu’une infraction douanière est constituée. Il serait donc particulièrement indiqué que le service commun des laboratoires (SCL) des douanes intègre ses données recueillies par analyse dans le fichier à vocation interministérielle administré par l’INPS et inversement.
La difficulté de faire face à la réactivité des chimistes, souvent implantés en Chine ou en Inde, avait particulièrement frappé les rapporteurs. En France, l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants dresse le catalogue des produits et molécules dont l’usage est interdit par la loi de 1970. Or, les NDS imitent, sans en être jamais parfaitement identiques, les structures moléculaires des substances interdites par cet arrêté. Cela permet aux NDS de ne pas être soumises, en France, à la législation sur les stupéfiants. Pour surmonter ce problème, il pourrait sembler aisé de modifier l’arrêté de 1990 pour y ajouter la structure moléculaire de chaque nouvelle substance apparaissant sur le marché. Mais toute la difficulté tient précisément à ce que, par le jeu de modifications moléculaires mineures, les trafiquants adaptent leurs produits pour qu’ils échappent à chaque nouvelle modification de la réglementation. Or, les délais d’identification et d’adoption de la réglementation sont tels que le temps joue en faveur des trafiquants qui ont toute latitude d’adapter leur offre avant que leur produit ne soit rattrapé par le droit.
C’est la raison pour laquelle les rapporteurs avaient, dans une proposition n° 3, souhaité développer et accélérer les interdictions des nouvelles drogues de synthèse par famille de molécules et renforcer les outils de suivi sur internet et les réponses pénales correspondantes. Il semble qu’ils aient été suivis sur ces deux points.
En effet, aux deux arrêtés du ministre de la santé classant comme stupéfiants plusieurs substances cannabinoïdes (27 février 2009), puis l’ensemble des drogues de synthèse de la famille des cathinones (2 août 2012), s’est ajouté l’arrêté du 19 mai 2015, pris comme les deux autres sur le rapport de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) et classant comme stupéfiants sept familles de cannabinoïdes de synthèse, au motif de leur grande proximité avec le principe actif du cannabis, tant dans leur composition chimique que dans leurs effets sanitaires, ce qui constitue une réelle avancée dans l’adaptation de notre droit.
2. La surveillance de l’internet
S’agissant de l’internet, ce commerce illicite pourrait aussi subir les effets des récentes adaptations juridiques et organisationnelles des forces de sécurité destinées à mieux lutter contre la cybercriminalité.
La sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC) a ainsi été créée au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) par arrêté ministériel du 29 avril 2014, elle comprend aujourd’hui plus de 80 personnels. L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication bénéficie du soutien de la plateforme internet-signalement dénommée Pharos (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) qui est destinataire des signalements des citoyens et de certaines associations partenaires.
De même, la direction du renseignement douanier dispose d’une cellule Cyberdouane dont la mission consiste à surveiller les offres des sites de commercialisation et à identifier les personnes physiques ou morales qui se dissimulent derrière des pseudonymes sur les sites de ventes ou des barrières informatiques sur ce que l’on appelle le Deep web. Cyberdouane dispose de logiciels spécialisés reposant notamment sur l’utilisation de mots-clés et ses agents disposent de connexions internet anonymes permettant d’enquêter sans laisser de traces informatiques auprès des cibles visées.
Par ailleurs, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a étendu le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme, en le généralisant à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée et donc au trafic de stupéfiants.
La même loi a institué une procédure de blocage administratif des sites internet qui permet désormais à l’autorité administrative, de manière préventive, et en l’absence de retrait spontané du contenu illicite, de solliciter le blocage d’un contenu. Cette procédure, particulièrement efficace et plus rapide que la voie judiciaire reposant sur la coopération judiciaire internationale, est toutefois pour le moment limitée aux sites faisant l’apologie du terrorisme ou diffusant des contenus pédopornographiques.
II. LA PRÉVENTION : BÂTIR UNE VÉRITABLE POLITIQUE À DESTINATION DES PLUS JEUNES
Au cours de leur évaluation, les rapporteurs avaient constaté une insuffisance du pilotage de la politique de prévention à l’égard des plus jeunes, notamment au sein de l’Éducation nationale et ils avaient fait un certain nombre de préconisations (regroupées dans les propositions n° 4 réexaminer la procédure et le contenu des programmes de prévention et 5 développer les techniques de prévention qui ont fait leurs preuves) destinées à améliorer la coordination et l’impact des programmes de prévention proposés aux collégiens et lycéens.
Un an après, il serait exagérément optimiste d’affirmer que l’objectif est atteint mais il semble qu’un certain nombre d’outils se mettent progressivement en place, à un rythme plus ou moins rapide, principalement sous l’impulsion de la Mildeca, qui peuvent laisser espérer un progrès notable, notamment en matière d’évaluation et de normalisation des pratiques.
A. FONDER LA PRÉVENTION SUR DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉS ET ÉVALUÉS
1. Les insuffisances du pilotage par l’éducation nationale
La première action demandée par les rapporteurs consistait à effectuer un recensement actualisé des interventions pratiquées en milieu scolaire afin de disposer d’un état des lieux consolidé. Cette action n’est toujours pas entreprise au niveau national et il n’est pas garanti qu’elle le soit au niveau académique dans la totalité des académies. Le ministère ne semble disposer que de données quantitatives pas toujours récentes sur les actions menées au sein des établissements dans ce domaine et n’a donc pas mis en place une chaîne fiable de consolidation de l’information.
Ainsi, une enquête non publiée de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été réalisée en 2012 sur « l’éducation aux comportements responsables et la prévention des conduites à risques » auprès d’un échantillon représentatif de 810 établissements scolaires (560 collèges, 150 lycées d’enseignement général et technique [LEGT] et 100 lycées professionnels [LP]) dont seulement 438, soit un peu plus de la moitié, ont répondu au questionnaire du ministère. Selon cette enquête, 68 % des collèges, 67 % des LEGT et 61 % des LP auraient mis en œuvre des actions de prévention des conduites addictives dans le cadre de leur comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) au cours de l’année, mais seulement 40 % (collèges) à 46 % (LP) de leurs élèves auraient bénéficié d’au moins une séance spécifique sur la prévention des conduites addictives dans l’année. Ces chiffres ne sont pas vraiment rassurants car ils sont très loin des 100 % souhaitables.
Si l’on en croit cette enquête non publiée et dont les rapporteurs ont pu prendre connaissance grâce à l’attitude coopérative dont ont fait preuve les représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) qu’ils ont auditionnés, nous sommes donc encore loin de l’application littérale de l’article L. 312-18 (issu de la loi du 9 août 2004) du code de l’éducation disposant qu’une « information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupe d’âge homogène ».
Dans un second temps, les rapporteurs avaient souhaité la mise en place d’une évaluation scientifique des grands programmes de prévention dispensés en milieu scolaire. Sur ce point, le ministère a utilement signalé le lancement à la rentrée 2012 d’un projet expérimental de prévention des conduites addictives par le développement des compétences psychosociales, se déroulant de manière structurée et progressive avec le suivi d’une cohorte d’élèves dans deux collèges des académies de Créteil et Versailles. Les équipes en charge de cette action bénéficient de formations et d’un accompagnement méthodologique tout au long de l’année. Le programme est évalué à la fin de chaque année scolaire par l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) et des supports scientifiquement validés permettront de mesurer son efficacité ainsi que les conditions et les modalités de sa transférabilité à d’autres établissements.
L’évaluation finale portera sur l’impact du programme par rapport à un échantillon de collèges comparables aux collèges expérimentaux, scientifiquement identifiés sur la base de critères statistiques en possession de la DEPP, et s’appuiera sur des questions portant sur le bien-être physique et mental des élèves.
De même, les rapporteurs avaient constaté qu’un guide de repérage précoce « des signes de souffrance psychique et des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent » avait été diffusé auprès de tous les infirmiers et assistants de service social de l’éducation nationale, que des formations au repérage d’élèves consommateurs de produits psychotropes et à l’accompagnement d’élèves consommateurs avaient été conduites dans quatre académies durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 pour les personnels de santé des établissements scolaires, et ils avaient appelé de leurs vœux la généralisation de la formation des infirmières scolaires au repérage et à l’intervention précoce.
Il est rappelé que la méthode de l’intervention précoce repose sur la promotion d’un environnement favorable comprenant la formation des professionnels des champs santé, éducatif, social, la sensibilisation et le soutien de l’entourage, l’existence de dispositifs à même de recevoir, orienter et prendre en charge les jeunes consommateurs (points écoute jeunes, consultations jeunes consommateurs…).
En réponse, le ministère a confirmé qu’il était prévu de généraliser la formation des infirmières scolaires au repérage précoce et à l’entretien motivationnel, qu’une enquête récente de la DGESCO avait établi que plusieurs infirmières scolaires étaient déjà formées dans chacune des académies et que pour l’année scolaire 2015-2016, ce seront toutes les infirmières de l’académie de Toulouse qui seront formées. Dont acte mais quid du calendrier du déploiement du programme de formation à l’ensemble des académies ?
Le processus est actuellement complété avec un plan de formation à l’intervention précoce de l’ensemble des professionnels des consultations jeunes consommateurs déployés par la Fédération Addiction en lien avec les agences régionales de santé (ARS). Un total de 22 formations de formateurs sur tout le territoire sont prévues, dont 14 sessions réalisées ou planifiées depuis mars 2015.
Enfin les rapporteurs avaient souhaité l’identification d’un adulte référent dans chaque établissement, objectif que le ministère semble partager tout en délégant sa réalisation concrète à l’académie ou à l’établissement. La nouvelle gouvernance académique (circulaire n° 2014-068 du 20 mai 2014) confie ainsi la coordination et le pilotage de la prévention à un proviseur « vie scolaire » ou à un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional « établissements et vie scolaire ». Les conseillers techniques du recteur (médecin, infirmier, conseiller technique de service social, psychologue, etc.) participent à cette cellule académique de pilotage qu’il conviendra de nommer afin d’assurer sa visibilité. Au niveau de l’établissement scolaire, c’est le chef d’établissement qui définit les conditions favorables au déroulement d’une politique de prévention dans l’établissement. Il repère les personnes « référentes » de l’établissement formées à la prévention des conduites addictives (conseiller principal d’éducation, infirmier, adjoint, etc.). Il peut également s’appuyer sur le policier ou le gendarme référent.
Les rapporteurs prennent acte de ces bonnes intentions mais ils relèvent que trop déléguer aux seuls chefs d’établissement empêche parfois l’application d’une politique volontaire : est-il par exemple normal que la tenue d’une permanence des consultations jeunes consommateurs (CJC), dont l’État finance une importante campagne de promotion, soit uniquement soumise à la décision du chef d’établissement, sans possibilité de recours auprès du recteur ? Devant la prévalence des drogues illicites et de l’alcool et du tabac dans nos collèges et lycées, les rapporteurs souhaiteraient plutôt une obligation sur tout le territoire dans ce domaine. Combien de chefs d’établissement refusent cette permanence au motif erroné que l’accepter serait reconnaître que leur établissement se distingue des autres par une surconsommation de substances addictives, alors que la réalité est qu’il n’existe plus d’établissements préservés ou non concernés par ce phénomène ?
Faute d’une consolidation nationale de l’information et d’un véritable pilotage des initiatives locales, qui reposent encore trop souvent sur l’action d’un nombre réduit d’individus, les rapporteurs estiment qu’on ne peut pas considérer que le ministère de l’éducation nationale mette en œuvre une véritable politique publique de prévention des addictions.
2. Les policiers et gendarmes formateurs anti-drogue
Les rapporteurs avaient relevé lors de l’évaluation initiale la forte visibilité et l’évolution positive des contenus des programmes de prévention dispensés par les policiers formateurs anti-drogue (PFAD) et par les gendarmes formateurs relais anti-drogue (FRAD) dans les établissements scolaires et s’étaient prononcés en faveur de leur rationalisation en prônant un regroupement de la formation des deux forces de sécurité et une meilleure répartition territoriale de leurs interventions (proposition n° 1).
En 2014, près de 750 000 collégiens, lycéens et étudiants ont ainsi bénéficié d’actions de prévention dispensées par des PFAD ou des FRAD, contre près de 500 000 en 2013, ce qui témoigne d’une montée en puissance positive. Le ministère de l’intérieur semble ouvert à la proposition de faire converger leur formation : cette dynamique s’est déjà traduite par la signature d’une convention entre la police et la gendarmerie le 21 février 2013, en vertu de laquelle les formations initiale et continue dispensées à l’Institut national de formation de la police nationale à Clermont-Ferrand ont été ouvertes à des FRAD. Un colloque réunissant 80 PFAD et FRAD en novembre 2014 a par ailleurs permis de consolider leurs compétences pédagogiques, tout en favorisant les échanges et l’identification de pistes d’optimisation du dispositif. Si le ministère semble vouloir maintenir deux endroits différents de dispensation de la formation (Clermont-Ferrand et Fontainebleau), ce qui peut être de bonne gestion, ne serait-ce que pour limiter les déplacements des policiers et des gendarmes en formation, il semble acquis que le contenu de la formation sera identique. Pour être tout à fait clair, il faudrait préciser que les deux écoles auront bien vocation à former des groupes mixtes de gendarmes et de policiers.
Par ailleurs, le ministère de l’intérieur a pris un engagement de rationalisation ainsi formulé : « Le constat, établi dans le rapport parlementaire, du caractère hétérogène de la répartition géographique des interventions des PFAD et des FRAD et de la nécessité d’une meilleure coordination à l’échelle départementale et nationale sera pris en considération, notamment avec l’appui des chefs de projets Mildeca (directeurs de cabinet des préfets). Visant à rationaliser l’emploi des formateurs anti-drogue par la définition de priorités d’action adaptées aux problématiques locales, ce renforcement de l’animation et du suivi des actions de prévention permettra d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs intervenant en milieu scolaire », ce qui donne satisfaction aux rapporteurs, pour autant que la démarche soit suivie d’effets car il n’est pas efficient que certains élèves de nos établissements scolaires voient les PFAD ou les FRAD chaque année et d’autres jamais.
3. La commission interministérielle de prévention des conduites addictives
Enfin les rapporteurs avaient souhaité renforcer le pilotage interministériel de la politique de prévention autour de la nouvelle commission interministérielle de prévention des conduites addictives (CIPCA), mise en place par la Mildeca (proposition n° 4).
La CIPCA a ainsi pour objectif :
– de promouvoir et de diffuser de nouvelles méthodes de prévention s’appuyant sur des données probantes (recommandations des experts français et des organismes internationaux, programmes de prévention français ou étrangers validés ayant fait la preuve de leur efficacité, guide européen des standards de qualité pour la prévention) ;
– de proposer au niveau national une définition et des caractéristiques des programmes de prévention efficaces ne s’arrêtant pas à une action ponctuelle d’information des publics concernés (dont les effets ne sont par ailleurs pas évalués) et permettant de développer notamment les compétences psychosociales des jeunes et de leurs parents afin de resituer la consommation de substances dans le contexte personnel et l’environnement socio-économique du jeune ;
– de favoriser une culture commune de la prévention entre les différents ministères et acteurs de terrain intervenant dans ce champ, quel que soit le milieu concerné (scolaire, universitaire, du travail, social et santé, culturel, sportif, judiciaire, pénitentiaire, monde de la rue…) ;
– et de faciliter les échanges entre le monde de la recherche et les professionnels de la prévention afin d’améliorer la compréhension des conduites addictives et d’accroître la pertinence et l’efficacité des programmes de prévention.
La CIPCA a vocation à établir un véritable répertoire national des programmes de prévention évalués positivement par des experts indépendants et à bâtir le cahier des charges de référence des programmes de prévention présentés dans les établissements scolaires ou dans les entreprises.
La prévention doit en effet s’inscrire dans un continuum cohérent d’intervention (prévention, intervention précoce, soin, réduction des risques) en s’appuyant sur des programmes évalués. Les programmes de prévention basés sur des stratégies d’intervention ayant montré leur efficacité doivent être privilégiés. L’expertise collective de l’INSERM de 2014 sur les conduites addictives des adolescents a émis des recommandations en ce sens et cite des travaux de l’INPES et des programmes de référence. Il est ainsi démontré que les actions les plus efficaces s’inscrivent dans un cadre multi-interventionnel (qui cible plusieurs facteurs à la fois) et multi-systémique (qui agit sur l’ensemble des systèmes sociaux et institutionnels d’appartenance).
Les rapporteurs avaient aussi dans leur proposition n° 4 encouragé la mise au point rapide d’une attestation de formation à la prévention des conduites addictives dont l’objectif devait être de munir les acteurs de première ligne auprès des jeunes des compétences nécessaires préalablement à leur intervention car il n’est pas envisageable dans ce domaine de se former sur le tas. Ils ont été entendus puisque l’attestation de formation à la prévention des conduites addictives a été validée lors d’un comité interministériel qui s’est tenu le 25 juin 2015. Elle sera délivrée par les responsables des structures d’addictologie autorisées par les directeurs généraux des ARS et restera valide cinq ans sous réserve d’une formation continue d’actualisation des acquis.
Cette attestation, véritable première étape d’un parcours de qualification, sera exigée des acteurs, notamment du monde associatif, qui sont en contact avec les jeunes et qui n’ont pas bénéficié d’une formation initiale ou continue à la prévention des conduites addictives. Aucune exigence de niveau de formation initiale ou de qualification professionnelle ne sera demandée et elle pourrait être proposée aux assistants d’éducation des établissements scolaires et aux volontaires du service civique.
Enfin, les rapporteurs avaient souhaité que l’approche scientifique de la prévention permette de sortir du cloisonnement institutionnel des acteurs en recentrant les actions autour du seul intérêt du public concerné. Cette démarche devrait permettre d’aboutir à un rapprochement de ces acteurs et à des initiatives conjointes portant sur la conception et la commande de programmes auprès des porteurs de projets qui se plaignent à juste titre de la lourdeur et de la redondance des modes d’action des pouvoirs publics (Mildeca, agences régionales de santé, collectivités territoriales). Les rapporteurs avaient ainsi souhaité la généralisation des appels à projets communs entre la Mildeca et les ARS (proposition n° 4).
D’après le rapport d’activité des chefs de projet Mildeca pour 2014, on est encore loin du compte, du fait notamment de la dissymétrie du poids financier des différents partenaires institutionnels : « plusieurs rapports soulignent la volonté des chefs de projet de conforter le rapprochement engagé avec les ARS. Ces dernières ont en effet toute légitimité pour intervenir à titre de financeur principal sans toujours prendre en compte les objectifs de la Mildeca, car ils disposent de crédits importants dédiés à des actions proches. Sur certains dispositifs comme les consultations jeunes consommateurs, le pilotage par le chef de projet n’est pas aisé dans la mesure où l’ARS apporte l’essentiel des financements assurant le fonctionnement des CSAPA. Cette importante disproportion entre les crédits de l’ONDAM de l’ARS et les crédits Mildeca du chef de projet ne permet pas toujours à ce dernier d’impulser une réelle politique partenariale. »
Par ailleurs seulement 67 % des services déconcentrés de l’État au niveau des départements déclarent tenir un comité de pilotage départemental destiné notamment à améliorer la connaissance mutuelle de l’intervention des différents partenaires institutionnels.
La dissymétrie des moyens financiers des ARS, d’une part, et des interventions déconcentrées de la Mildeca, d’autre part, avait déjà été relevée par les rapporteurs l’année dernière. Elle ne peut que conduire à une remise en cause de cette modalité d’intervention de la Mildeca à terme, d’autant que la récente reconnaissance par le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé du caractère obligatoire de la prévention parmi les missions des CSAPA lui garantit un financement minimum par la CNAM, au titre d’un sous-objectif spécifique de l’ONDAM, sur l’ensemble du territoire.
B. MODERNISER LA COMMUNICATION
Le rapport coût-efficacité des grandes campagnes de communication faisant intervenir les médias traditionnels est de plus en plus fragile, notamment pour les substances illicites, qui, plus encore que le tabac ou l’alcool, doivent cibler de jeunes adolescents.
L’OFDT (drogues et addictions, données essentielles 2013) a dressé ce constat dans les termes suivants :
« Ces campagnes médias s’attachent à influer sur les représentations sociales, catalyseurs des changements comportementaux. En matière de drogues, ces actions consistent globalement à informer ou alerter un public donné sur les risques liés aux usages ou encore à l’interpeller sur la capacité de chacun à agir sur ses pratiques ou celles de son entourage.
Néanmoins, comme pour tout dispositif de prévention, la question de leur impact sur les pratiques demeure. Ces actions font le plus souvent l’objet de pré-tests et parfois aussi de post-tests, dont l’objectif est d’évaluer l’audience et l’impact des messages à court terme en matière de mémorisation, d’agrément, d’implication (se sentir concerné) et d’intentionnalité (se sentir enclin à changer son comportement conformément aux objectifs de la campagne). Toutefois, ces critères réfèrent à des attitudes et ne présument pas de l’impact effectif des campagnes sur les comportements. »
Il convient donc de développer davantage la communication segmentée en recourant à des médias plus adaptés à la cible recherchée, comme ont commencé de leur faire récemment les pouvoirs publics. Les rapporteurs avaient ainsi souhaité augmenter la fréquence et renforcer l’efficacité des campagnes de prévention en privilégiant les outils ciblés sur internet, de préférence aux médias traditionnels, plus coûteux et moins sélectifs (proposition n° 6).
Cette orientation ne pourra vraiment s’installer que dans la durée du fait de la diversité des cibles poursuivies par les différentes campagnes (adolescents mais aussi adultes référents) et de la persistance de la puissance des médias télévision et radio, comme le montre l’analyse de la campagne menée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) en faveur des consultations jeunes consommateurs au début de l’année 2015.
Cette campagne a pour but d’accroître la notoriété des CJC, de dédramatiser le recours à leurs services et de faciliter le dialogue au sein des familles sur les différentes addictions. Son cœur de cible est les parents d’adolescents avec des spots diffusés à la télévision mais aussi les jeunes eux-mêmes via un partenariat avec la radio Skyrock tout à fait intéressant, puisqu’il cumule diffusion de spots radiophoniques, espace réservé sur le site internet de la radio avec un quizz « idées reçues » et intégration éditoriale avec une soirée par semaine consacrée (focus éditoriaux et débat avec les auditeurs) au sujet des addictions pendant quatre semaines.
La campagne renvoie vers le dispositif Drogues info service (ligne téléphonique et site internet) qui oriente les demandes vers les CJC les plus proches.
Son efficacité a été évaluée par une enquête menée avant et après sa diffusion auprès de 300 parents et 200 adolescents. Outre la notoriété initiale quasiment nulle des CJC et très relative après la campagne (17 % des parents et 15 % des adolescents ont vraiment retenu leurs missions), l’enquête a mis en évidence un réel besoin puisque, après la campagne, 75 % des parents se sont dits incités à parler du sujet avec leurs enfants et un tiers d’entre eux (et un quart des adolescents) se sont dits incités à aller dans une CJC ou appeler la ligne téléphonique. Un premier effet a été constaté sur le volume des appels téléphoniques du dispositif Drogues info services (+ 27 % par rapport à la moyenne 2014) ainsi que sur la fréquentation du site internet (+ 100 %).
L’OFDT a prévu d’évaluer l’impact réel de la campagne sur la file active des CJC, démarche que les rapporteurs approuvent sans réserve. Les travaux ont été menés en 2015 et seront publiés en 2016.
De même, trois vidéos sur les drogues illicites réalisées par l’INPES (paroles de toxicomanes, la substitution, les formes de sevrage) vont paraître dans les prochaines semaines sur le site Drogues info service et feront l’objet de tweets depuis le compte Twitter de l’INPES.
III. LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET SOCIALE : DÉCLOISONNER LES DISPOSITIFS AFIN DE FACILITER LES PARCOURS DE SOINS INDIVIDUALISÉS
Lors de l’évaluation, les rapporteurs avaient décrit la diversité des intervenants du champ sanitaire et médico-social impliqués dans la prise en charge des addictions aux substances illicites.
Sur le plan sanitaire, le système de droit commun est mobilisé à travers trois secteurs que sont le secteur hospitalier, le secteur psychiatrique et les professionnels de santé exerçant en ville (médecine de ville, pharmaciens).
Dans le secteur hospitalier, la prise en charge des addictions peut impliquer différents services. Elle s’appuie d’abord sur les équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA), qui assistent, sur leur demande, les équipes soignantes des divers services de l’hôpital (services des urgences, service de psychiatrie, etc.) dans la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives. Elle repose ensuite sur des consultations hospitalières d’addictologie, des établissements dotés de lits de sevrages simples, et des établissements dotés d’une hospitalisation de jour. Après une période de sevrage, lorsque le patient nécessite encore des soins spécifiques avant de reprendre une vie ordinaire, il peut être fait appel à un service de soins de suite et de réadaptation en addictologie (SSR).
À côté de ce système de droit commun, des structures spécialisées ont été développées dans le champ médico-social.
La restructuration de la prise en charge autour de la notion d’addiction a mis fin à la spécialisation historique des structures par la création en 2005 des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), qui se substituent aux anciens centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA).
Les missions des CSAPA, définies à l’article D. 3411-1 du code de la santé publique, incluent l’accueil, l’information, l’évaluation et l’orientation de la personne concernée ou de son entourage, la prise en charge médicale et psychologique des patients, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, ainsi que la réalisation d’actions de réduction des risques et de prise en charge sociale et éducative (accès aux droits, réinsertion). Les CSAPA prennent la forme de centres médico-sociaux qui peuvent être gérés par des établissements publics de santé (hôpitaux) ou par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sous condition de l’obtention d’un conventionnement du ministère de la santé. Le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé a inscrit ces missions dans la loi.
Il est apparu également pertinent de concevoir des structures spécifiques pour des adolescents qui ne se reconnaissent pas comme nécessitant une quelconque prise en charge. Baptisées « consultations jeunes consommateurs » (CJC), elles sont rattachées aux CSAPA ou aux consultations hospitalières. Leur mission est d’assurer l’accueil, l’information, l’évaluation, la prise en charge brève et, si nécessaire, l’orientation de jeunes consommateurs de substances psychotropes. L’objectif est d’anticiper les risques de l’expérience addictive en agissant le plus en amont possible. Fonctionnant sur le modèle de l’intervention précoce, les CJC se situent au croisement de la prévention et du soin, et ont pour mission d’accompagner les jeunes mais aussi leur famille.
Enfin, pour la prise en charge des consommateurs de drogue les plus marginalisés, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) ont été institués en 2005. Il s’agit de structures qui proposent l’accueil gratuit, anonyme et inconditionnel d’usagers de substances psychotropes qui ne sont généralement engagés dans aucune démarche de soins, ou dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des risques majeurs (infections, notamment hépatite C, VIH, accidents, etc.). Les CAARUD réalisent des interventions de proximité afin d’établir un contact avec des usagers souvent en marge de la société. Outre l’accueil, l’information et le conseil aux usagers de drogues, les CAARUD facilitent l’accès aux soins, aux droits et à l’insertion professionnelle des usagers, mettent à leur disposition du matériel de prévention des infections (kit d’injection, etc.), et développent des actions de médiation sociale.
A. ADAPTER L’ADDICTOLOGIE AUX BESOINS
Tout en reconnaissant les efforts réalisés au cours de la dernière décennie pour structurer l’offre de soins en addictologie, les rapporteurs avaient relevé que des progrès pouvaient encore être faits dans le domaine de la formation des personnels de santé en addictologie et du rapprochement de l’offre de soins des usagers de drogue, dans la diversité de leurs profils.
Dans leur proposition n° 7, les rapporteurs avaient souhaité un approfondissement de la formation initiale et continue en addictologie des personnels de santé. Il ne s’agissait pas tant du contenu des modules prévus au titre des études de premier et deuxième cycles que de la manière dont ils étaient conçus, priorisant l’étude des pathologies liées aux addictions plutôt que la prévention, le diagnostic précoce et les conduites d’accompagnement. Il est peu probable que les choses aient fondamentalement changé sur ce point en l’espace d’une seule année même si les concepts de bien-traitance et de prévention se développent actuellement dans les programmes d’études médicales dès la formation initiale.
En revanche, les rapporteurs approuvent le développement de la capacité en addictologie et du diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) d’addictologie, réservés à des médecins dans le cadre d’une formation continue diplômante, puisque le nombre d’universités habilitées à les délivrer est passé de 18 à 21 en un an.
Ils se réjouissent également du lancement par la Fédération Addiction du portail des acteurs de santé « intervenir-addictions.fr ». Ce site partenarial vise à aider les professionnels de santé de premier recours à aborder la question des addictions avec leurs patients, repérer d’éventuels usages problématiques de substances, intervenir et orienter. Il propose plusieurs supports pédagogiques et pratiques et décrit les programmes ayant fait leurs preuves dans les différents types d’addiction. Ce site rassemble enfin des mises en situation filmées, des documents scientifiques, des informations sur les produits, les coordonnées des dispositifs présents sur chaque territoire, afin de partager et de renforcer les expériences et compétences en matière d’addictions.
Les rapporteurs avaient également identifié le besoin de proximité comme un facteur primordial de réussite de la prise en charge. Pouvoir accéder à une structure en addictologie à proximité de son domicile est non seulement conforme au principe d’égalité face à la politique de santé, mais aussi déterminant s’agissant de patients dont la motivation pour s’inscrire dans un parcours de soins est souvent fragile. L’éloignement géographique des structures, ou les délais d’attente très longs pour obtenir une place dans les structures existantes constituent des obstacles réels à l’entrée en soin. Le déficit structurel est aussi susceptible de décourager les professionnels de santé de première ligne, souvent les médecins généralistes, démunis face aux situations les plus graves.
C’est la raison pour laquelle les rapporteurs avaient souhaité renforcer l’accessibilité géographique des CAARUD et des CSAPA par un maillage territorial suffisant et explicite et envisager des solutions alternatives pour atteindre les territoires isolés (proposition n° 8).
Le dispositif actuel comprend 404 CSAPA avec une file active annuelle estimée à 270 000 personnes et 145 CAARUD avec une file active annuelle estimée à 60 000 personnes pour un budget de 393 millions d’euros en 2015 contre 380 millions en 2013.
Les rapports d’analyse de l’activité des établissements médico-sociaux publiés par l’OFDT montrent le caractère encore imparfait du maillage territorial.
En ce qui concerne les CAARUD, si chaque région française compte désormais au moins un CAARUD, ce qui constitue un progrès, des disparités demeurent quant à la file active moyenne gérée par les CAARUD des différentes régions. Au niveau départemental, ces différences se confirment puisque la France comptait encore en 2013 huit départements dépourvus de CAARUD (Ain, Cher, Corrèze, Creuse, Eure et Loir, Lozère, Manche, Meuse). Un constat similaire peut être fait s’agissant des CSAPA.
Renforcer l’accessibilité géographique des établissements médico-sociaux, notamment dans les territoires ruraux, ne passe pas forcément par la création de nouvelles structures qui ne rencontreraient pas une file active suffisante, mais plutôt par des dispositifs mobiles ou des antennes avancées. Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 prévoit ainsi la création de 30 antennes et 30 consultations avancées de CSAPA et d’antennes mobiles de CAARUD notamment en milieu rural.
Les rapporteurs se félicitent ainsi de la délégation complémentaire de 3,5 millions d’euros en 2014, destinés au déploiement de 20 antennes et de 20 consultations avancées de CSAPA ainsi que de 13 dispositifs mobiles de CAARUD et d’un engagement de poursuivre cette politique en 2015.
De même, les rapporteurs se réjouissent du développement du réseau des CJC, passés de 300 points de contact dans les premières années à 540 aujourd’hui et de l’engagement des pouvoirs publics en leur faveur (campagne de promotion début 2015, délégation de crédits supplémentaires).
S’agissant de la filière hospitalière, 10 millions d’euros de crédits complémentaires ont été alloués au début de l’année 2015 afin de créer une ELSA dans les régions qui n’en étaient pas encore pourvues, c’est-à-dire la Guadeloupe et la Guyane.
B. CRÉER DE VÉRITABLES RÉSEAUX DE SOINS
La multiplicité des structures de prise en charge des addictions est un signe positif de la diversité de l’offre de soins. Mais elle est aussi la source d’une complexité décourageante pour les patients. Face à un système difficilement lisible, les usagers de substances psychotropes éprouvent des difficultés pour identifier l’interlocuteur adéquat. L’éparpillement des structures peut aussi altérer la continuité de la prise en charge et faire peser des risques sur la réussite de la rémission. Il apparaît dès lors primordial que toutes les structures impliquées, établissements médico-sociaux, services hospitaliers et médecine de ville, collaborent efficacement dans le but de structurer l’offre de soins à partir des besoins du patient.
Or, les professionnels auditionnés ont confirmé l’existence de difficultés de communication entre les différents niveaux d’intervention, particulièrement en ce qui concerne les relations entre médecine de ville et structures hospitalières. Les rapporteurs avaient évoqué l’année dernière les différentes pistes d’amélioration possibles ; ils avaient souhaité préciser le positionnement des acteurs de l’addictologie dans le parcours de soins et améliorer la coordination de leurs actions (proposition n° 9) sans se prononcer pour un dispositif précis, considérant que ce sujet touchait à l’organisation même du système de santé et dépassait le cadre de l’addictologie.
Ils relèvent que la discussion du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé a permis d’établir le concept de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) regroupant des professionnels du premier et du second recours, ainsi que des acteurs du secteur social et médico-social, autour d’un projet de santé. L’organisation en CPTS vise à renforcer la coordination entre les professionnels de santé d’un même territoire, à améliorer la structuration des parcours de santé, ainsi qu’à concourir à la réalisation des objectifs du projet régional de santé (PRS) et paraît donc un outil mobilisable afin de mieux structurer l’addictologie dans notre pays, d’autant que l’ARS pourra attribuer des crédits du fonds d’intervention régional (FIR) afin de contribuer à financer le contrat territorial de santé passé entre celle-ci et les membres d’une CPTS.
IV. LA RÉDUCTION DES RISQUES : POURSUIVRE ET APPROFONDIR UNE INDISPENSABLE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Lors de leur évaluation, les rapporteurs avaient dressé un bilan positif de la politique de réduction des risques dont ils avaient décrit les grandes étapes : libéralisation de la vente des seringues en 1987, création des premier lieux d’accueil des usagers de drogue distribuant du matériel de réduction des risques et développement des premiers programmes d’échanges de seringues à partir de 1992, autorisation de la prescription des premiers traitements de substitution aux opiacés en 1993 et structuration de la politique de réduction des risques organisée par la loi relative à la santé publique du 9 août 2004 autour des CAARUD.
Ils avaient notamment constaté l’impact de cette politique sur l’endiguement de l’épidémie de sida parmi les usagers de drogue ainsi que sur la qualité de vie des personnes consommatrices et l’évolution du regard posé sur elles par la société.
Ils avaient toutefois relevé les efforts restant à accomplir, principalement afin de mieux lutter contre la transmission de l’hépatite C (VHC), et la nécessité de certaines adaptations de cette politique afin de toucher des populations qui en restaient éloignées, comme en milieu rural ou pénitentiaire. Ils se réjouissent donc de constater que la discussion parlementaire du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé a permis de consacrer de nouvelles avancées, rejoignant ainsi certaines de leurs suggestions ou observations.
A. LE CONTRÔLE DES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACÉS
Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) permettent de réduire les risques et les dommages liés à la consommation de substances psychotropes tout en répondant aux besoins de l’usager. Ils améliorent la qualité de vie du patient et renforcent la relation qu’il entretient avec son médecin. Si les TSO ne permettent pas toujours une « guérison » totale, ils autorisent néanmoins le retour à une vie normale et facilitent la stabilisation du comportement addictif sur le long terme.
Il existe actuellement en France deux options thérapeutiques pour la dépendance aux opiacés : la méthadone et la buprénorphine haut dosage (BHD) qui sont d’ailleurs incluses par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la liste des « médicaments essentiels ». La prescription en première intention de la méthadone relève des seuls médecins exerçant en structure hospitalière ou au sein d’un CSAPA et est soumise à un protocole strict. La prescription de la BHD, à l’utilisation moins risquée, intervient quant à elle dans des conditions plus souples, et peut être réalisée par les médecins généralistes.
Ces TSO sont remboursés sur le fondement du régime général de l’assurance maladie. En 2013, le total des montants remboursés de TSO par le régime général s’est élevé à un peu moins de 69 millions d’euros, pour un nombre total de 152 000 bénéficiaires selon les données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
En dépit de leur indéniable utilité comme instrument de soin et de réduction des risques, les TSO demeurent sujets à polémiques, nourries de façon récurrente par la révélation de cas de mésusages, de nomadisme médical, voire de trafics à plus grande échelle. L’expertise collective de l’INSERM relative aux médicaments psychotropes (1) reconnaît que les TSO peuvent faire l’objet de mésusages. Ceux-ci prennent la forme de non-respect des doses prescrites, ou d’utilisation par voie d’injection au lieu de l’absorption.
Face à ces pratiques dangereuses et contestables, les rapporteurs avaient appelé de leurs vœux une réaction des pouvoirs publics.
Ils avaient à ce titre pris acte des contrôles menés par la CNAMTS, mais estimé que ces efforts devaient être complétés par une sécurisation renforcée des ordonnances portant sur ces produits en évoquant la prescription électronique (proposition n° 10).
La France est l’un des derniers pays européens à ne pas avoir instauré la e-prescription alors même que ce système permettrait de résoudre en grande partie les problèmes de mésusage et de trafic. Il s’agit en effet pour le médecin de réaliser la prescription en ligne, en étant au besoin guidé par un logiciel d’aide à la prescription. La prescription passe ensuite par un hébergeur, puis est transmise au pharmacien lorsque le patient se présente dans une officine pour se procurer le médicament.
Aucune avancée décisive ne semble avoir été faite dans ce domaine depuis une année, même si un projet est à l’étude.
B. DÉVELOPPER ET SÉCURISER LES PROGRAMMES D’ÉCHANGE DE SERINGUES
Selon la définition donnée par l’INSERM, les programmes d’échange de seringues (PES) sont des structures qui mettent à disposition des usagers de drogues injectables du matériel d’injection stérile (gratuitement ou non) dans le but de réduire la transmission des virus et infections liés au partage de matériel de consommation. Ils offrent également du matériel servant à préparer l’injection (filtres, eau, récipients pour le mélange) ou la consommation de drogues sans injection (pailles/pipes à crack, feuilles d’aluminium...).
L’expertise collective de l’INSERM a conclu aux résultats positifs des PES. Ces programmes permettent de réduire les comportements à risque liés à l’injection tels que le partage et la réutilisation de matériel, et améliorent les pratiques visant à l’élimination sans risque du matériel usagé. La baisse de la fréquence de l’injection et l’augmentation de l’usage de désinfectants font aussi partie des résultats positifs observés, tout comme l’amélioration de l’orientation des usagers vers les services sanitaires et sociaux.
Les rapporteurs avaient estimé qu’à travers la variété des programmes d’échange de seringues mis en place, la France proposait une réponse pragmatique et efficace pour réduire les risques liés à l’injection de substances psychotropes. Ils avaient néanmoins proposé quelques pistes d’amélioration (proposition n° 11), consistant à instaurer la gratuité des kits dénommés « stéribox » (aiguilles, ampoules d’eau, tampons imbibés d’alcool, récipient en aluminium, filtre en coton et tampon sec) actuellement facturés au prix, il est vrai symbolique, de 1 euro, au prix d’une subvention annuelle de près d’1,4 million d’euros en 2014 (0,42 cents pour chacune des 3,4 millions de trousses vendues). La gratuité n’est donc pas mise en place pour des raisons budgétaires puisqu’elle équivaudrait à plus que tripler la subvention annuelle.
Les rapporteurs en prennent acte et approuvent les orientations poursuivies par la direction générale de la santé (DGS) consistant à améliorer l’efficacité du matériel proposé en termes de protection vis-à-vis du risque infectieux, en tenant compte des évolutions technologiques et des changements dans les pratiques d’injection (développement de l’injection de médicaments, nouveaux produits de synthèse). De même, ils partagent l’objectif de diversification des lieux permettant de se procurer des kits (pharmacies, CAARUD, PES postal, automates…), afin de s’adapter aux profils des usagers.
Par ailleurs, seules 1 100 pharmacies participent à la récupération des 14 millions de seringues distribuées et/ou vendues aux injecteurs (cela inclut les trousses de prévention et les seringues à l’unité) alors que 11 000 pharmacies participent au dispositif spécifique de récupération des déchets d’auto-soins (qui permettent de récupérer les seringues utilisées par les diabétiques). Des réticences demeurent donc à l’égard des drogues illicites, d’autant que les relations des pharmaciens avec les toxicomanes peuvent être tendues, les personnes dépendantes pouvant se révéler particulièrement difficiles. Les rapporteurs avaient privilégié l’idée de développer le partenariat avec les pharmaciens et saluent par conséquent le financement par la direction générale de la santé d’un « guide de l’addictologie en pharmacie d’officine » conçu par le réseau de prévention des addictions (Respadd) ainsi que la signature en 2014 d’une convention de collaboration entre la Mildeca et le conseil national de l’Ordre des pharmaciens portant notamment sur la réduction des risques.
Ils soulignent aussi la publication par le Respadd d’un annuaire 2015 des programmes d’échange de seringues en pharmacie qui permet à tout un chacun de prendre connaissance des officines participant à un des 50 programmes en activité en 2015 dans 17 régions (à l’exception de l’Alsace, de la Corse, de la Haute et Basse Normandie, et de l’outre-mer).
Une étude de l’ADEME est en cours pour évaluer la faisabilité de l’intégration du matériel d’injection dans la filière « DASRI-PAT » (récupération des déchets de soins à risque infectieux provenant de patients en auto-traitement) ce qui permettrait de considérablement développer le nombre d’officines partenaires.
Les rapporteurs préconisaient également d’étendre les programmes d’échange de seringues au milieu pénitentiaire.
Afin d’améliorer la prise en charge sanitaire des détenus, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a posé le principe de l’équivalence des soins dans la société et en milieu carcéral, et a transféré au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées. La politique de réduction des risques, dont l’efficacité sanitaire a été prouvée, a fait son entrée en milieu carcéral avec des consultations en addictologie et la prescription et la délivrance de TSO dans les unités sanitaires, unités fonctionnelles de services hospitaliers implantées dans chaque établissement pénitentiaire qui dispose aussi d’un CSAPA référent susceptible d’intervenir en milieu ouvert comme en milieu fermé.
Il faut néanmoins aller plus loin car la population carcérale est une population à haut risque sur le plan infectieux, présentant couramment des troubles psychiatriques, parfois sévères, et une forte prévalence de conduites addictives. Il en résulte une vulnérabilité accrue des personnes détenues aux maladies infectieuses. Les personnes incarcérées sont exposées à un risque très élevé de contamination infectieuse, multiplié par 10 pour le VHC et par 4 pour le VIH (InVS 2005).
Le risque de contamination en prison est d’autant plus élevé que le partage du matériel d’injection, reconnu comme facteur majeur de transmission du VIH et du VHC, est pratique courante. Il n’existe en effet aucun programme d’échange de seringues dans les établissements pénitentiaires français. Les usagers de drogue par injection, qui existent même s’ils ne sont pas précisément comptabilisés, sont alors amenés à procéder à l’injection dans des conditions sanitaires déplorables.
De tels programmes d’échange de seringues sont menés avec succès dans des établissements carcéraux à l’étranger, notamment en Suisse et en Allemagne. Toutefois, ces programmes, même sous forme d’expérimentations, mettent beaucoup de temps à démarrer en France, du fait des appréhensions de l’administration pénitentiaire.
Le débat opposant le Sénat et l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé et portant sur la mention de la restriction « selon des modalités adaptées au milieu carcéral » au principe général selon lequel la politique de réduction des risques s’applique aussi aux personnes détenues, illustre bien ces réticences. En anticipation du vote de la loi, la direction générale de la santé a ouvert la concertation avec la direction de l’administration pénitentiaire sur un projet de décret en Conseil d’État destiné à fixer les modalités d’application des actions de réduction des risques spécifiquement adaptées au contexte carcéral. À ce stade, et les rapporteurs le regrettent, aucune expérimentation n’est donc en cours ni envisagée et aucun calendrier prévisionnel n’a par conséquent été arrêté.
Les rapporteurs ont en revanche pris connaissance avec intérêt du bilan très favorable de l’expérimentation menée par l’association Safe depuis 2011 et consistant à procéder à l’échange de seringues par voie postale. L’envoi gratuit et personnalisé de matériel par voie postale a ainsi permis de répondre à une véritable demande (isolement géographique, impossibilité de se rendre au CSAPA ou au CAARUD par peur de stigmatisation ou du fait de contraintes horaires de travail). Ce programme a connu une croissance très rapide de la file active (de moins de 50 usagers à la fin 2011 à plus de 400 en juillet 2015) et en conséquence du volume de matériel distribué (nombre de seringues multiplié par 5 entre 2012 et 2015 avec une estimation de près de 240 000 seringues en 2015). Ce programme apparaît très prometteur parce qu’il rencontre des usagers « cachés » dont une part importante (25 %) ne fréquentait aucune structure de prise en charge avant, dont la moitié vit en milieu rural ou dans une ville de moins de 10 000 habitants et parce qu’il a permis de singulièrement améliorer les pratiques (réutilisation et partage des seringues et du petit matériel). Il conviendra d’en tirer les enseignements en vue d’une pérennisation et d’une extension.
C. FAUT-IL EXPÉRIMENTER LA MISE EN PLACE DE SALLES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE ?
Une étape supplémentaire dans la politique de réduction des risques est au cœur du débat public français depuis plusieurs années : l’instauration de salles de consommation à moindre risque (SCMR), parfois désignées sous l’expression « salles de shoot » dans la presse.
Dès 2012, le Gouvernement s’était montré favorable à l’expérimentation d’une telle structure. Il avait alors été décidé qu’une SCMR, portée par l’association Gaïa, pourrait ouvrir à Paris fin 2013. Toutefois, le Conseil d’État, par un avis du 8 octobre 2013, a recommandé au Gouvernement d’agir par voie législative pour assurer la sécurité juridique du dispositif.
L’article 9 du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, actuellement en fin de discussion devant le Parlement, prévoit et encadre l’expérimentation des SCMR.
Tel qu’il est actuellement prévu par le projet de loi, il s’agit d’un dispositif expérimental de six ans à compter de la date d’ouverture du premier espace. Six mois avant l’expiration de ce délai, un rapport d’évaluation sera remis au Parlement pour décider de la pérennisation des salles de consommation. Ces salles seront ouvertes par des CAARUD, mais dans des locaux distincts de ceux déjà utilisés pour l’accomplissement de leurs missions. Elles ne pourront accueillir que des usagers majeurs. Les produits consommés devront être apportés par l’usager lui-même, et dans la limite de sa seule consommation, qui devra être réalisée sur place. La consommation sera supervisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social.
Deux clauses d’irresponsabilité sont prévues. L’une empêche la poursuite des usagers pour détention de stupéfiants, lorsqu’ils détiennent un produit limité à l’usage personnel à l’intérieur de la salle. L’autre exempte de responsabilité les professionnels travaillant dans la salle, qui ne pourront donc être poursuivis pour complicité ou facilitation d’usage illicite de stupéfiants.
Après avoir étudié de près deux exemples étrangers de SCMR (Vancouver et Amsterdam) et entendu les différentes parties prenantes, dont l’association Gaia qui a conçu un projet pour Paris, les rapporteurs avaient tiré de leurs travaux des conclusions divergentes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain considère que l’efficacité de ces dispositifs est établie. Pour améliorer la situation sanitaire des usagers, pour renforcer la sécurité et la tranquillité publique, il est donc opportun d’introduire en France ce nouvel outil de réduction des risques : il ne s’agit pas de « laisser faire », mais de s’atteler à améliorer une situation qui existe, et qu’il faut résoudre. Elle recommandait de ne pas borner l’expérimentation à une seule salle, mais d’autoriser simultanément l’ouverture d’au moins trois établissements dans différentes villes.
M. Laurent Marcangeli s’était quant à lui prononcé contre l’ouverture des SCMR du fait de l’ambiguïté du message ainsi délivré par rapport à l’interdit frappant le produit, des risques que ce dispositif pouvait faire peser sur la sécurité publique et des questions non résolues quant à la responsabilité des personnels et des pouvoirs publics en cas d’accident.
Le principe de l’expérimentation des SCMR a été adopté par l’Assemblée nationale comme par le Sénat en première lecture, des divergences persistant entre les deux chambres sur leur localisation, le Sénat souhaitant les voir installées uniquement dans des locaux intégrés à un établissement de santé, alors que l’Assemblée nationale n’excluant pas de les voir davantage ouvertes sur la ville. Appelée à statuer en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a fait prévaloir cette conception.
Dès la promulgation de la loi, les premières expérimentations pourront être engagées sur la base d’un cahier des charges et d’une circulaire de politique pénale actuellement en cours de rédaction. Un démarrage est prévu à Paris (à proximité de l’hôpital Lariboisière) et Strasbourg dès le premier trimestre 2016, et à Bordeaux au cours de l’année 2016.
V. QUEL RÉGIME JURIDIQUE POUR L’USAGE DE CANNABIS ?
Les rapporteurs s’étaient prononcé en faveur d’une évolution du régime juridique de l’usage de cannabis après avoir pris connaissance des débats portant sur sa dangerosité relative et observé que la France se distinguait par des incriminations très sévères par rapport aux autres pays européens.
Ils avaient également observé l’important mouvement international de légalisation de l’usage de cannabis notamment dans certains états des États-Unis d’Amérique mais aussi en Uruguay et dans certaines instances de l’ONU (commission globale de politique en matière de drogue).
Le mouvement ne s’est pas ralenti en 2015 avec l’arrêt très important de la Cour suprême du Mexique autorisant le 4 novembre les activités d’un cannabis club (la société mexicaine d’autoconsommation responsable et tolérante ou Smart) et contraignant le président Enrique Pena Nieto à lancer un débat national sur la légalisation de la consommation du cannabis devant se conclure avant l’Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies consacrée à la politique contre les drogues, prévue en avril 2016. De même, le parti libéral du Canada, porté au pouvoir à la suite des élections d’octobre 2015, s’est engagé à légaliser l’usage du cannabis dans sa plateforme de campagne ce qui laisse augurer une évolution de la législation de ce pays.
A. UNE RÉPONSE PÉNALE TOUJOURS PEU LISIBLE
Depuis la loi du 31 décembre 1970, l’usage de cannabis est un délit, actuellement passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une peine d’amende de 3 750 euros devant le tribunal correctionnel.
Du fait de la consommation massive de cannabis observée dans notre pays, le législateur et le ministère de la justice ont progressivement diversifié les formes de la réponse pénale à l’usage de stupéfiants, tentant de s’adapter à cette délinquance de masse tout en restant fidèles aux principes de la loi de 1970.
Les rapporteurs avaient procédé l’année dernière à un examen approfondi de la réponse pénale qui avait montré que si le législateur n’avait pas remis en cause les grands principes de la loi de 1970 (soigner et punir), de nombreux outils avaient été progressivement fournis aux juridictions, soit sous forme de procédures rapides évitant l’audiencement, soit sous forme de mesures nouvelles, différentes de l’amende et de l’emprisonnement, comme les rappels à la loi ou les stages de sensibilisation.
Ils avaient conclu que ce pragmatisme innovant avait progressivement débouché sur une réponse pénale illisible et disparate qui posait des questions de principe : les inégalités territoriales de traitement, la modulation des peines (amendes, stages de sensibilisation) selon les moyens du délinquant, l’absence d’impact durable sur le comportement délictuel, les condamnations résiduelles à de l’emprisonnement d’une population sur laquelle les autres formes de réponse pénale n’ont pas de prise (migrants, jeunes en errance, personnes sans domicile fixe).
Les rapporteurs avaient enfin relevé que la France appliquait dans ce domaine une politique plus sévère que celle adoptée par de nombreux pays européens, comme les Pays-Bas, l’Espagne ou le Portugal.
Les choses n’ont pas significativement changé depuis et le constat posé l’année dernière garde toute son acuité, comme le montre l’actualisation des données disponibles sur ce sujet.
Tout d’abord, cette forme de délinquance a continué à progresser de manière importante en 2014, prolongeant même une accélération amorcée en 2013.
ÉVOLUTION DES PERSONNES INTERPELLÉES POUR ILS, PAR CATÉGORIE
(PERSONNES MISES EN CAUSE PAR LA POLICE OU LA GENDARMERIE) (1972-2013)
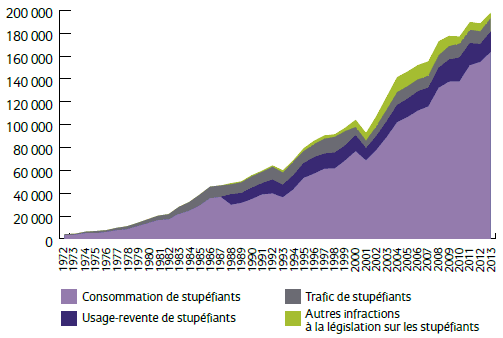
Source : OFDT.
Le nombre de personnes interpellées pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) s’est approché des 200 000 en métropole en 2013, (avec l’outre-mer, il s’élevait même à 207 000) dont plus de 163 000 pour usage (170 000 avec l’outre-mer).
Ce nombre a atteint près de 214 000 personnes en 2014 dont près de 177 000 pour usage, soit une nouvelle croissance de près de 4 % par rapport à 2013. Depuis plusieurs années, la consommation de cannabis représente autour de 90 % des interpellations pour usage.
La progression est toujours aussi spectaculaire en zone gendarmerie avec plus de 54 000 interpellations pour usage en 2014, soit une croissance de 11 % par rapport à 2013 et de 43 % par rapport à 2011.
Les rapporteurs avaient constaté l’année dernière que les chiffres du ministère de l’intérieur ne coïncidaient pas avec ceux du ministère de la justice et avaient demandé une harmonisation des statistiques de l’infraction d’usage de stupéfiants afin de supprimer les écarts constatés entre, d’une part, les interpellations comptabilisées par la police et la gendarmerie et, d’autre part, les dossiers orientés par les parquets (proposition n° 12).
Ces chiffres continuent à diverger de près de 60 000 unités puisque la justice ne compte que 113 000 personnes dans les affaires d’usage de stupéfiants en 2014.
Le ministère de l’intérieur s’appuie sur la statistique des faits constatés dite « état 4001 » qui fait référence à des qualifications policières établies selon 4 classes (trafic-revente sans usage, usage-revente, usage, autres ILS) alors que la statistique judiciaire s’appuie sur une nomenclature plus détaillée dite « Natinf », utilisée par l’infocentre Cassiopée, regroupant une trentaine de qualifications d’infractions agrégées en 7 classes (usage, provocation à l’usage, aide à l’usage, détention-acquisition, cession ou offre, trafic, autres). L’infraction est susceptible d’être requalifiée à chaque stade de la procédure pénale et le traitement pénal de l’usage est difficile à observer en propre car il est souvent associé à d’autres infractions. Il apparaît que les services de police et de gendarmerie qualifieraient plus souvent les faits en « usage » alors que la justice les classe en « autres infractions à la législation sur les stupéfiants dont trafic, cession, etc. ».
Un travail collectif est en cours entre les services statistiques du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice afin d’analyser les causes de divergence et travailler au rapprochement de leurs statistiques.
Interrogé par les rapporteurs, le ministère de l’intérieur a produit la réponse suivante, précisant les pistes de travail : « Une partie des procédures transmises à la justice le sont aujourd’hui par voie dématérialisée. Cela concerne pour 2014 56 % des affaires pour la gendarmerie et 24 % pour la police. Pour cette dernière, la procédure n’est déployée dans l’ensemble des commissariats que depuis avril 2015. Ce processus engendre des rejets que le ministère de l’intérieur semble avoir du mal à récupérer. Une partie, non quantifiable quant à présent des procédures ne serait donc pas prise en compte dans Cassiopée… De plus, une hypothèse non prouvée relèverait de l’enregistrement dans le cadre de la conduite après usage de produits stupéfiants au volant, les services de police et de gendarmerie seraient susceptibles de retenir des faits d’usage et de conduite après usage de stupéfiants, la Justice retiendrait uniquement celle de “conduite sous usage de stupéfiants”, contentieux routier exclu du champ commun (6 000 infractions ayant une origine police ou Gendarmerie dans Cassiopée en 2014)… La dernière hypothèse revient à considérer qu’un nombre important d’usagers ne ferait l’objet d’aucune réponse pénale. Il s’agit des usagers identifiés et entendus dans le cadre d’une procédure de trafic de produits stupéfiants. Dans le cadre de ces procédures lourdes, de nombreux consommateurs sont entendus afin de contribuer à matérialiser la vente régulière de produits par les revendeurs. Seulement, il s’avère que ces consommateurs ne font quasiment jamais l’objet d’une réponse pénale, l’autorité judiciaire se concentrant au moment des éventuels déferrements, mises en examen, ou convocations au tribunal correctionnel, sur les souvent nombreux membres de l’organisation criminelle (guetteurs, nourrices, revendeurs, blanchisseurs, trafiquants, etc.). Or, les logiciels de police et de gendarmerie enregistrent les faits d’usage qu’ils ont effectivement constatés et pour lesquels une audition de la personne mise en cause a été réalisée ».
Cette dernière hypothèse, si elle était vérifiée, ajouterait un nouvel élément au constat déjà fait par les rapporteurs de la grande difficulté à assurer une réponse pénale aux infractions d’usage de stupéfiants qui soit cohérente et partagée sur l’ensemble du territoire.
En matière d’usage, la doctrine est fixée par la circulaire de la directrice des affaires criminelles et des grâces du 16 février 2012 qui établit les principes suivants :
– exclusion des rappels à la loi par un simple officier de police judiciaire au profit du délégué du procureur ;
– application du classement avec rappel à la loi, assorti d’une convocation devant un délégué du procureur, aux consommateurs occasionnels, en possession d’une très faible quantité de produits et dans les ressorts de juridictions où la mise en œuvre du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants n’est pas encore totalement effective ;
– application prioritaire du stage de sensibilisation aux usagers occasionnels, dans le cadre d’une procédure de composition pénale ou, si impossibilité ou inopportunité, prononcé d’une peine d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle ;
– injonction thérapeutique systématique pour un usager toxicodépendant.
La circulaire précise que « les poursuites devant le tribunal correctionnel seront privilégiées à l’encontre des usagers récidivistes, ceux qui refusent de se soumettre aux mesures ordonnées par le parquet ou lorsque l’usage de stupéfiants est associé à une autre infraction, ainsi que dans l’hypothèse d’un usage aggravé (personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport). »
La prise en compte de l’ensemble de ces procédures conduit à afficher un taux de réponse pénale supérieur à 90 % à la délinquance pour usage, essentiellement grâce aux alternatives aux poursuites qui représentent 70 % des affaires et qui ont permis d’éviter l’engorgement des audiences correctionnelles.
Selon les chiffres transmis aux rapporteurs par la direction des affaires criminelles et des grâces, l’année 2014 confirmerait cette analyse puisque sur les 113 000 personnes mises en cause dans 103 000 affaires d’usage orientées par les parquets, 69 000 ont fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites (59 %), 42 000 (36 %) ont fait l’objet d’une poursuite et 2 000 (2 %) ont fait l’objet d’un classement sans suite en opportunité, ce qui permet à la chancellerie d’afficher un taux de réponse pénale de 98 %.
Les alternatives aux poursuites reposent encore largement sur les rappels à la loi (66 % en 2014) alors que les orientations vers des structures sanitaires s’établissent à un peu plus de 14 %.
Les peines prononcées en 2014 pour usage comme infraction unique (pour chaque condamnation, la peine la plus grave est retenue) se répartissaient en 64 % d’amendes, 9 % d’emprisonnement dont 40 % d’emprisonnement ferme, soit de l’ordre de 1 200 condamnations, et 27 % de peines autres que l’amende et l’emprisonnement (essentiellement stages de sensibilisation).
Le montant moyen des amendes était de 300 euros en 2014, alors que la durée moyenne des peines d’emprisonnement ferme prononcées pour usage était de 2 mois.
La proportion des emprisonnements fermes pour usage est actuellement de l’ordre de 1 % des interpellations, et son taux d’exécution n’est pas disponible dans les statistiques judiciaires, mais il est très probablement faible, du fait de la durée réduite des peines prononcées.
Les affaires d’usage de stupéfiants mobilisent 8,4 % de l’ensemble de la réponse pénale en 2014 auxquelles s’ajoutent les affaires de trafic pour 3,3 %, soit un total de 11,7 % de l’ensemble de la réponse pénale.
Sur le plan de la procédure, l’année 2015 a permis de définir le régime juridique de la transaction pénale, qui s’ajoutera à l’ordonnance pénale, la composition pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité déjà souvent utilisées dans les affaires de stupéfiants.
La transaction pénale a été créée par amendement parlementaire lors de la discussion de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Ses modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 et par la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces du 23 octobre 2015. Elle ne constitue pas la révolution juridique annoncée par certains observateurs car elle est finalement très proche de la composition pénale déjà en vigueur.
La transaction pénale permettra aux officiers de police judiciaire (OPJ), sur autorisation du procureur, de transiger avec l’auteur d’une infraction d’une gravité limitée dont l’usage de stupéfiants. L’OPJ pourra ainsi proposer à l’auteur de l’infraction le paiement d’une amende transactionnelle dont le montant ne pourra excéder un tiers de l’amende encourue. Le procureur de la République donnera son autorisation pour la mise en œuvre de cette procédure, qui fera ensuite l’objet d’une homologation par le président du tribunal de grande instance (TGI) ou son délégué. Une fois cette amende transactionnelle réglée, l’action publique s’éteindra et l’infraction ne sera pas consignée au casier judiciaire.
Elle permettra d’assurer, à l’initiative de l’OPJ, une réponse pénale immédiate pour des infractions qui peuvent régulièrement faire l’objet de simples rappels à la loi. En ce sens, et à l’inverse des éléments avancés dans certains médias, cette procédure n’entraînera pas une baisse de la répression de certaines infractions, l’hypothèse inverse étant même probable.
Elle ne constitue en aucune manière une contraventionnalisation de fait du délit d’usage de produits stupéfiants puisque l’OPJ conserve le choix de placer, ou non, l’auteur en garde à vue ou de proposer, ou non, une transaction.
Par ailleurs, la circulaire nécessitera encore de nombreuses précisions avant d’être effectivement mise en œuvre, portant notamment sur les moyens d’information et de saisine du comptable public, d’information du TGI sur le paiement effectif de la consignation, des suites de l’éventuel refus d’homologation du président du TGI et des modalités de notification de cette décision au mis en cause.
B. L’INDISPENSABLE RÉVISION DE LA LOI DE 1970
Si les deux rapporteurs avaient convergé sur la nécessité de réviser la loi de 1970 et de mettre fin au caractère délictuel de l’usage simple de cannabis et à la possibilité de prononcer un emprisonnement ferme pour cette infraction, ils avaient ensuite divergé, M. Laurent Marcangeli se prononçant en faveur d’une contravention de troisième classe alors que Mme Anne-Yvonne Le Dain souhaitait la légalisation de l’usage individuel dans l’espace privé et pour les personnes majeures, avec l’institution d’une offre réglementée du produit sous le contrôle de l’État, la contraventionnalisation ne constituant à ses yeux qu’une étape, pas forcément indispensable.
Il est rappelé que la contravention judiciaire de troisième classe, prévue à l’article 131-13 du code pénal, est d’un montant maximal de 450 euros et relève de la juridiction de proximité ou du tribunal de police.
Le Sénat a proposé la transformation du délit en contravention de troisième classe lors de sa première lecture du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé et l’Assemblée nationale a supprimé cette mesure lors de la nouvelle lecture du texte, dans l’attente des propositions du gouvernement.
La Mildeca a effectivement confirmé aux rapporteurs qu’un groupe de travail avait été mandaté par le Premier ministre afin d’examiner une éventuelle réforme sur ce sujet. Il semble difficile de concilier une contravention de troisième classe avec le maintien de certains éléments de l’individualisation de la peine comme le traitement de la récidive ou l’orientation sanitaire des consommateurs dépendants, notamment des jeunes : 50 % des adolescents fréquentant les consultations jeunes consommateurs y sont conduits par la justice et il peut être intéressant de maintenir ce flux, même si l’on a vraisemblablement davantage de motivation quand on vient de son plein gré que contraint et forcé.
Une conciliation possible pourrait être la contravention de cinquième classe que la loi pourrait constituer un délit en cas de récidive.
Il est patent que le principal défaut de la contraventionnalisation, aux yeux des représentants des forces de l’ordre, est d’empêcher le placement en garde à vue des simples usagers, jugé utile afin de remonter les filières et de démanteler les réseaux de trafiquants.
À cette objection, on peut répondre que la contravention proposée permettra toujours une rétention d’une durée maximale de quatre heures pour vérification d’identité, ce qui permet déjà d’avoir un échange approfondi avec la personne mise en cause, et que le démantèlement des réseaux repose rarement sur les simples usagers mais plutôt sur les revendeurs qui seront toujours susceptibles d’être placés en garde à vue sur le fondement des autres délits liés au trafic de stupéfiants (usage-revente, détention, transport). Les forces de l’ordre garderont aussi la possibilité de placer en garde à vue, sur le fondement du délit d’usage, de revente ou de détention pour usage autre que personnel, une personne qui ne souhaite pas spontanément donner l’identité du revendeur avec qui elle est en contact.
Le Comité examine le présent rapport lors de sa réunion du 9 décembre 2015.
M. Régis Juanico, président. Je vous prie d’excuser le président Bartolone qui m’a demandé de le suppléer.
Je vous prie également d’excuser M. Laurent Marcangeli qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd’hui.
L’article 146-3 du Règlement prévoit que les rapporteurs du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) lui présentent un rapport de suivi de la mise en œuvre de leurs conclusions, à l’issue d’un délai de six mois suivant la publication de leur rapport initial.
C’est sur le fondement de cet article que nous allons aujourd’hui examiner le rapport de suivi de l’évaluation de la lutte contre l’usage de substances illicites qui nous avait été présentée en novembre 2014.
La lutte contre l’usage de substances illicites vient de faire l’objet de plusieurs dispositions incluses dans le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé. Ce rapport de suivi arrive donc à un moment particulièrement opportun.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, rapporteure. Nous avions intitulé notre rapport de novembre 2014 : « L’augmentation de l’usage de substances illicites : que fait-on ? ». Notre réflexion reste aujourd’hui d’abord tournée vers l’action. Le rapport de 2014 contenait douze propositions communes et deux propositions faisant l’objet d’avis divergents, l’une relative à l’expérimentation de salles de consommation à moindre risque et l’autre relative au régime juridique de l’usage du cannabis.
Depuis un an, la discussion du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé et la publication des résultats de nouvelles enquêtes portant sur l’usage des substances illicites ont conforté les analyses que nous avions développées.
Le baromètre santé 2014 de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) met en évidence une augmentation de la consommation de cannabis dans la population française par rapport à 2010 : l’expérimentation est passée de 33 % à 42 % sur l’ensemble des 18-64 ans. Dans la tranche d’âge la plus exposée, celle des 18-25 ans, 28 % des individus ont fumé du cannabis au moins une fois dans l’année passée – ce qui est la définition de l’ « usage actuel ». Le baromètre révèle dix-sept millions d’expérimentateurs, 4,6 millions d’usagers actuels et 1,4 million d’usagers réguliers, dont 700 000 usagers quotidiens. Ces chiffres sont énormes.
En outre, l’enquête Escapad menée auprès des jeunes de dix-sept ans en 2014 montre un retournement de tendance inquiétant : elle révèle une reprise de l’augmentation de l’usage de cannabis après une décennie de baisse, comparable à l’évolution de l’usage régulier du tabac et de l’alcool. La proportion d’usagers réguliers de cannabis est ainsi passée de 6,5 % en 2011 à 9,2 % en 2014 parmi les jeunes de dix-sept ans. Seule bonne nouvelle, l’âge moyen d’entrée dans la consommation, ou premier usage, ne s’est pas dégradé, puisqu’il est resté à quatorze ans comme en 2011. Cette variable est d’importance puisqu’une consommation précoce est particulièrement nocive et présente un gros risque d’usage problématique. Plus tôt on entre dans l’usage de stupéfiants, plus longtemps on en reste dépendant.
Les nouvelles drogues de synthèse ont connu un grand essor. C’était un concept nouveau, mais il est devenu banal. L’expérimentation de l’ecstasy a doublé entre 2011 et 2014 chez les jeunes de dix-sept ans en passant de 1,9 % à 3,8 % ; ils sont par ailleurs 1,7 % à avoir déjà consommé une nouvelle drogue de synthèse, fabriquée dans des conditions souvent dangereuses. Ce chiffre reste toutefois faible par rapport à certains pays européens.
Nous avions souhaité développer les interdictions des nouvelles drogues de synthèse par famille de molécules et renforcer les outils de suivi sur internet : nous avons été suivis sur ces deux points. En effet, aux deux arrêtés du ministre de la santé classant comme stupéfiants plusieurs substances cannabinoïdes, pour celui du 27 février 2009, puis l’ensemble des drogues de synthèse de la famille des cathinones, pour celui du 2 août 2012, s’est ajouté l’arrêté du 19 mai 2015 classant comme stupéfiants sept familles de cannabinoïdes de synthèse.
Le commerce illicite de nouveaux produits de synthèse (NPS), qui privilégie l’internet, pourrait aussi subir les effets des récentes adaptations juridiques et organisationnelles des forces de sécurité destinées à mieux lutter contre la cybercriminalité : création de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité, autorisation des coups d’achat et de l’enquête sous pseudonymes.
Les nombreuses initiatives locales ne peuvent suffire à assurer une véritable politique publique de prévention. Le pilotage par l’éducation nationale présente des insuffisances : il n’y a toujours pas de recensement national des interventions pratiquées en milieu scolaire. Toutefois, un projet expérimental de prévention des conduites addictives par le développement des compétences psychosociales a été lancé dans deux collèges à la rentrée 2012, faisant l’objet d’une évaluation finale scientifique en 2015 avant son éventuelle diffusion. La formation des infirmières scolaires à l’intervention précoce s’est poursuivie et une attestation de formation à la prévention des conduites addictives a été mise au point, même si ces efforts restent insuffisants.
Les policiers et gendarmes, comme formateurs anti-drogue, rapprochent leurs formations et rationalisent leurs interventions sur le territoire.
Un an après, il serait exagérément optimiste d’affirmer que l’objectif est atteint, mais il semble qu’un certain nombre d’outils se mettent progressivement en place, à un rythme plus ou moins rapide, principalement sous l’impulsion de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), qui fonctionne bien. Ces outils peuvent laisser espérer un progrès notable, notamment en matière d’évaluation et de normalisation des pratiques.
Nous nous félicitons notamment de la création d’une attestation de formation à la prévention des conduites addictives, délivrée par les responsables des structures d’addictologie et qui sera exigée des acteurs, notamment du monde associatif, qui sont en contact avec les jeunes et qui n’ont pas bénéficié d’une formation initiale ou continue à la prévention des conduites addictives. L’apparition de cette attestation constitue vraiment une bonne nouvelle, car laisser le champ libre à des personnes ou à des associations qui développent des idées personnelles serait pire que de ne rien faire.
La prise en charge sanitaire et sociale est animée par la volonté d’adapter l’addictologie aux besoins. Le dispositif actuel comprend 404 centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), avec une file active annuelle estimée à 270 000 personnes, et 145 centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), avec une file active annuelle estimée à 60 000 personnes pour un budget de 393 millions d’euros en 2015 contre 380 millions d’euros en 2013.
Renforcer l’accessibilité géographique des établissements médico-sociaux, notamment dans les territoires ruraux, ne passe pas forcément par la création de nouvelles structures, mais plutôt par des dispositifs mobiles ou des antennes avancées. Les dispositifs mobiles permettent d’atteindre les personnes concernées partout, car l’addiction touche aujourd’hui tous les territoires, pauvres ou riches, urbains ou ruraux.
Nous nous félicitons de la délégation complémentaire de 3,5 millions d’euros en 2014, destinés au déploiement de vingt antennes et de vingt consultations avancées de CSAPA, ainsi que de treize dispositifs mobiles de CAARUD et d’un engagement de poursuivre cette politique en 2015.
De même, nous approuvons le développement du réseau des consultations jeunes consommateurs (CJC), passées de 300 points de contact dans les premières années à 540 aujourd’hui et de l’engagement des pouvoirs publics en leur faveur, par des campagnes de promotion début 2015 et par la délégation de crédits supplémentaires. Cela représente un effort substantiel.
Nous nous réjouissons également du lancement par la Fédération Addiction du portail des acteurs de santé « intervenir-addictions.fr ». Ce site partenarial vise à aider les professionnels de santé de premier recours à aborder la question des addictions avec leurs patients, repérer d’éventuels usages problématiques de substances, intervenir et orienter. Il est en effet très important de ne pas laisser seuls les infirmiers, les médecins et le personnel sanitaire et social. C’est une très belle initiative.
Des efforts ont aussi été faits pour poursuivre la réduction des risques. Favorables au développement des programmes d’échange de seringues, nous approuvons les orientations poursuivies par la direction générale de la santé (DGS) consistant à améliorer l’efficacité du matériel proposé en termes de protection vis-à-vis du risque infectieux, en tenant compte des évolutions technologiques et des changements dans les pratiques d’injection, tels que le développement de l’injection de médicaments ou de nouveaux produits de synthèse. De même, nous partageons l’objectif de diversification des lieux permettant de se procurer des kits, qu’il s’agisse des pharmacies, des CAARUD, de l’envoi postal ou d’automate. Il convient en effet de s’adapter aux profils des usagers.
Il faut continuer à faire preuve de pédagogie vis-à-vis des pharmaciens car seules 1 100 pharmacies participent à la récupération des 14 millions de seringues distribuées ou vendues aux injecteurs, alors que 11 000 pharmacies participent au dispositif spécifique de récupération des déchets d’auto-soins qui permettent de récupérer les seringues utilisées par les diabétiques. L’écart est donc de un à dix, ce qui révèle l’ampleur des efforts qui restent à faire.
Nous avions privilégié l’idée de développer le partenariat avec les pharmaciens et saluons par conséquent le financement par la direction générale de la santé d’un guide de l’addictologie en pharmacie d’officine, conçu par le réseau de prévention des addictions (Respadd), ainsi que la signature en 2014 d’une convention de collaboration entre la Mildeca et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens portant notamment sur la réduction des risques. Si des progrès restent à faire au niveau des officines, nous avançons donc sur le plan institutionnel.
Nous préconisions également d’étendre les programmes d’échange de seringues au milieu pénitentiaire mais, si la DGS, en anticipation du vote de la loi, a ouvert la concertation avec la direction de l’administration pénitentiaire sur un projet de décret en Conseil d’État destiné à fixer les modalités d’application des actions de réduction des risques spécifiquement adaptées au contexte carcéral, nous regrettons qu’aucune expérimentation ne soit en cours ni envisagée et qu’aucun calendrier prévisionnel n’ait été arrêté à ce jour.
Voilà où nous en sommes de la prévention des risques. Chacun a désormais pris conscience du problème. Mais la mise en application effective tarde un peu.
J’en viens aux salles de consommation à moindre risque. Ma position diverge sur ce point avec celle de notre collègue Laurent Marcangeli. Pour ma part, je suis en faveur de leur instauration. Les expériences étrangères semblent concluantes : à Vancouver, des résultats sanitaires très positifs ont été enregistrés ; à Amsterdam, une démarche pragmatique de tranquillité publique a prévalu, les salles ayant été ouvertes par les autorités locales pour mettre fin aux scènes ouvertes d’injection. Aux Pays-Bas, l’objectif poursuivi n’est donc ni moral, ni médical ; il s’agit bien d’assurer la tranquillité publique.
Ma proposition était d’expérimenter ces salles en France de manière courte, sur une période de dix-huit mois. En cas d’évaluation positive, le dispositif pourrait être généralisé sur le territoire national en tenant compte de l’expérience des travailleurs sociaux, de la police et de la justice des pays les pratiquant couramment.
Notre collègue Laurent Marcangeli préconisait quant à lui de refuser l’ouverture de salles de consommation à moindre risque, car ce dispositif soulevait à ses yeux d’importantes difficultés dont il fallait tenir compte : selon lui, affecter de l’argent public à un lieu dédié à l’injection risquait de brouiller le message des autorités sur la dangerosité de l’usage des drogues ; la fixation d’un lieu de consommation pourrait favoriser le trafic de stupéfiants, faisant naître des risques pour la sécurité publique ; enfin, des incertitudes concrètes pesaient sur le positionnement des forces de l’ordre aux abords de la salle.
Au bout du compte, le principe de l’expérimentation a été adopté dans la loi relative à la modernisation du système de santé. Dès la promulgation de la loi, les premières expérimentations pourront être engagées sur la base d’un cahier des charges et d’une circulaire de politique pénale actuellement en cours de rédaction. Un démarrage est prévu à Paris, à Strasbourg et à Bordeaux au cours de l’année 2016.
J’aborde enfin la question du régime juridique de l’usage de cannabis. Nous sommes tous deux d’accord sur la nécessité de réviser la loi de 1970. Depuis son adoption, l’usage de cannabis est un délit, actuellement passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une peine d’amende de 3 750 euros devant le tribunal correctionnel. Trois options de réforme sont possibles : la contravention judiciaire de troisième classe d’un montant maximal de 450 euros, dans le respect de l’individualisation des peines ; la contravention forfaitaire du type infraction sécurité routière comparable à une sanction administrative ; la légalisation totale ou restreinte à l’espace privé avec l’institution d’une offre réglementée du produit sous le contrôle de l’État.
Notre collègue Laurent Marcangeli voulait transformer le délit d’usage de cannabis en une contravention de troisième catégorie, ce qui correspond à la position adoptée par le Sénat. Il estime en effet que cette solution a pour avantage de maintenir l’interdit, de supprimer la condamnation à de l’emprisonnement, de maintenir l’individualisation de la peine et de permettre un traitement adapté de la récidive, notamment l’orientation vers le soin.
Pour ma part, je proposais de légaliser l’usage individuel du cannabis dans l’espace privé et pour les personnes majeures, et d’instituer une offre réglementée du produit sous le contrôle de l’État. Cette solution a pour avantage à mes yeux de permettre d’instaurer un contrôle de la qualité du produit par l’État – car la qualité des substances en circulation s’est fortement dégradée –, d’affaiblir les réseaux criminels par réduction de la demande, de procurer des recettes fiscales affectées à la prévention et au soin, et de permettre aux forces de sécurité de redéployer des moyens sur la lutte contre le trafic.
Lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, le Sénat a proposé la transformation du délit d’usage de cannabis en contravention de troisième classe. L’Assemblée nationale a supprimé cette mesure dans l’attente des propositions du Gouvernement. J’avais moi-même déposé des amendements visant à établir une contravention dont la répression aurait été placée sous le contrôle du procureur de la République, étape vers une légalisation. D’autres pays ont déjà institué celle-ci, la Cour suprême du Mexique a rendu une décision en ce sens et le premier ministre du Canada vient de l’annoncer dans son pays.
La Mildeca nous a confirmé qu’un groupe de travail avait été mandaté par le Premier ministre afin d’examiner une éventuelle réforme sur ce sujet. Il semble difficile de concilier une contravention de troisième classe avec le maintien de certains éléments de l’individualisation de la peine comme le traitement de la récidive ou l’orientation sanitaire des consommateurs dépendants, notamment des jeunes. Je souligne à cet égard que le rôle de l’éducation nationale doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les agences régionales de santé (ARS) ont en charge les questions d’addictologie. Elles jouent un rôle tutelle et doivent développer leur coopération, au niveau territorial, avec les rectorats et avec la Mildeca. Cette dernière, à la suite d’un renouvellement de ses instances, bénéficie d’une nouvelle dynamique et développe des campagnes contre les substances addictives, qu’il s’agisse de tabac, de drogue ou d’alcool. Ces campagnes utilisent tant le canal de la télévision que des réseaux sociaux, où ses efforts sont plus ciblés.
M. Régis Juanico, président. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, qui a même couvert les positions de votre co-rapporteur, notre collègue Laurent Marcangeli, alors que vous ne partagez pas la même opinion sur le régime juridique de l’usage du cannabis ou sur la mise en place de salles de consommation à moindre risque.
Grâce au projet de loi relatif à la modernisation de notre système santé, notre assemblée a récemment fait avancer la politique de réduction des risques, mais aussi la prise en charge sanitaire et sociale des usagers de stupéfiants. Dans ce cadre, la publication de votre rapport de suivi me paraît particulièrement importante.
M. Gilles Lurton. Je vous remercie à mon tour de votre présentation objective. La question des salles de consommation à moindre risque a en effet été abordée dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé. Sur ce point, je peux entendre l’argument selon lequel l’hygiène déplorable de la prise de stupéfiants dans les rues plaiderait en faveur de lieux où les conditions soient plus appropriées et où les usagers puissent être amenés vers un parcours de soins. Quant à dire que de tels lieux permettraient de ne plus trouver des seringues partout, cela ne correspond pas à ce que j’ai entendu jusqu’à présent en faveur de la mise en place de ces salles.
Au cours de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, je suis intervenu au sujet de la médecine scolaire. Alors que nous allons consacrer des moyens non négligeables à l’expérimentation de deux ou trois salles de consommation à moindre risque, rien n’est fait financièrement pour améliorer cette institution qui souffre pourtant énormément. Il n’y a qu’un médecin pour 12 000 élèves. Dans ces conditions, il est impossible de développer une politique de prévention de l’addiction, alors que c’est dans les établissements scolaires qu’elle doit être menée en premier lieu. J’y vois une grande défaillance. Même si ses services dépendent de l’éducation nationale, la médecine scolaire traite d’abord de problèmes de santé.
M. Régis Juanico, président. Je rappelle que notre Comité a autorisé la publication d’une évaluation de Mme Martine Pinville et de M. Gérard Gaudron sur la médecine scolaire, puis d’un rapport d’un suivi de cette évaluation. Nous relancerons l’exécutif sur ce sujet.
M. Gérard Sebaoun. Votre réflexion s’inscrit dans le droit fil du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé. C’est la première fois que j’entends l’argument de la tranquillité publique utilisé en faveur des salles de shoot. Je crois plutôt que ce type de mesures a d’abord un objet sanitaire. Leur mise en place coûterait un million d’euros par an. La somme n’est pas si grande au regard de l’ampleur de la population précarisée que la mesure pourrait concerner. Ces usagers se piquent dans des conditions effroyables. Elle leur éviterait la contamination par l’hépatite C ou le VIH.
Quant à la prévention, chère à notre collègue Gilles Lurton, je dirais que la nouvelle serait connue, si nous étions champions dans le domaine. Malheureusement, tel n’est pas le cas, contrairement à ce qui se passe en matière de soins. En matière de prévention, nous méritons plutôt un bonnet d’âne. Le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé a le mérite de mettre l’accent sur ce volet. Dans le rapport de notre collègue Martine Pinville sur la médecine scolaire – qui était de très bonne facture –, un constat avait été dressé, assorti de propositions.
Au cours du débat sur le projet de loi, nous avons adopté un article 9 ter relatif à la prévention et à l’usage de tests salivaires par la police, afin qu’elle puisse détecter la consommation de stupéfiants. J’ai émis un avis favorable à l’utilisation de cette technique. Je m’interroge pourtant sur la fiabilité de ces tests, qui sont erronés à 10 % tant dans un sens positif que négatif. Même si le but poursuivi est utile, l’usage de ces tests est donc risqué.
Quant à l’institution d’une contravention a minima pour l’usage de stupéfiants, à leur usage privé libre ou à leur légalisation, chacun adoptera une position différente, de même que la législation peut être différente d’un pays à l’autre. À mes yeux, il ne s’agit cependant pas d’une question d’éthique. Nous devons regarder ce qui se fait à l’étranger, tout en reconnaissant les méfaits du cannabis. J’étais pour ma part assez favorable autrefois à la légalisation sous contrôle, mais je n’en suis plus convaincu aujourd’hui, après avoir observé la situation dans certains états fédérés américains.
Je suis donc plutôt plongé dans la perplexité. Malgré certaines évolutions en Amérique du Sud et malgré les annonces du premier ministre canadien, je crois qu’il ne faut pas oublier les méfaits sanitaires des stupéfiants.
Mme Isabelle Le Callennec. Je regrette que votre rapport de suivi n’ait pas paru avant le débat sur le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé. Les effets des stupéfiants sont dévastateurs, notamment chez les jeunes. Dans le débat sur le projet de loi, nous nous sommes focalisés sur les salles de consommation à moindre risque, encore appelées salles de shoot. Mais nous ne nous sommes pas attaqués au fond et à la résolution de la question que vous posiez : que fait-on ?
Parmi vos propositions, dix sont communes à vos deux approches. Elles sont consensuelles, alors qu’il n’y a que deux autres points sur lesquels vous divergiez. Ne pourrions-nous aller déjà dans le sens de celles qui font consensus et les appliquer ? Je fais référence aux études épidémiologiques, à l’interdiction des NPS, à la réponse pénale ou encore aux réseaux de mise en œuvre des programmes de prévention. Je crois que le pilotage national doit être relayé au niveau de ces derniers, en s’interrogeant sur la place que doit y tenir l’éducation nationale. Dans mon territoire, la coopération fonctionne entre les services et les forces de l’ordre interviennent auprès des établissements. Malheureusement, dans certains départements, l’on retire pourtant des moyens aux brigades qui interviennent auprès adolescents.
Les CSAPA et les CAARUD font véritablement un bon travail. Mais la lutte contre l’usage de stupéfiants est-elle vraiment la priorité des agences régionales de santé ? Ce sont pourtant elles qui disposent des moyens pour financer la prévention. Les centres dont je salue l’action ont mis en place des équipes mobiles qui peuvent se déplacer. Mais je crois d’abord à l’efficacité des contrats locaux de santé, notamment pour lutter contre la consommation de cannabis.
Au cours du débat sur le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, j’ai posé à la ministre la question de savoir qui, du ministère de la santé ou du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, était compétent en matière de formation initiale et continue en addictologie. Il semblerait que ce soit ce dernier, mais je voudrais être sûre que les deux administrations dialoguent suffisamment entre elles.
Quant à la révision de la loi de 1970, nous attendons encore des propositions de la Mildeca. Je suis pour ma part défavorable à la légalisation de l’usage individuel pour les majeurs. Les conduites addictives qu’il induit sont en effet dangereuses. Mais notre Comité n’est pas forcément le lieu où mener ce débat nécessaire. J’espère que nous saurons l’ouvrir en commission des affaires sociales et y trouver les bonnes réponses à l’augmentation de la consommation de stupéfiants.
M. Pierre Morange. Je tiens à remercier notre rapporteure pour son diagnostic et pour l’état des lieux qu’elle a dressé. Vous vous efforcez également de trouver des réponses tant en amont, par la prévention, qu’en aval, par la répression.
S’agissant de la prévention, permettez-moi de signaler le rapport sur la prévention sanitaire que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), publié en 2012, sous la précédente législature. Nous y dressions le constat que les moyens alloués à cette politique sont suffisants, mais qu’ils sont mal coordonnés, voire employés de manière contre-productive. La médecine ambulatoire, la médecine hospitalière, la médecine scolaire et la médecine du travail représentent autant d’intervenants, entre lesquels la communication n’est pas toujours bonne.
Vous avez abordé le sujet de la prévention dans l’enseignement secondaire. Or, à mon sens, une première sensibilisation doit avoir lieu dès l’école maternelle et élémentaire, contre les grands risques que sont la surcharge pondérale, l’alcool, le tabac et la drogue. En Bretagne, mais aussi dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, un travail de prévention a été mené à ce niveau.
On trouve une trace de ces préoccupations dans l’article 2 du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, mais il n’a qu’une portée déclarative. N’enfermons pas le sujet de la prévention dans celui de la seule médecine scolaire. Le contenu du message doit être incarné par les enseignants eux-mêmes. Nous devons traiter le problème à enveloppe constante, vu l’état des comptes publics. Pour cela, il faut inclure cette dimension dans les projets éducatifs. Ne multiplions pas les interventions dans le domaine sanitaire, car l’adage nous le rappelle : qui trop embrasse mal étreint.
S’agissant du traitement en aval, je suis opposé à la légalisation de l’usage de cannabis et aux salles de consommation à moindre risque. Je note d’ailleurs l’évolution de notre collègue Gérard Sebaoun sur cette question. Rendre l’usage privé libre n’apporte pas la bonne réponse. Quant aux salles de shoot, elles sont inopportunes ; l’argument de la tranquillité publique ne saurait passer avant celui de la question sanitaire. Mais j’attire aussi votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un sujet très instable du point de vue des assurances et du droit. En 2005, il s’en est ainsi fallu de peu que des confrères médecins ne fussent radiés de l’ordre des médecins pour s’être hasardés à de telles pratiques.
M. Jacques Myard. Je suis étonné de ces sempiternels débats particuliers sur le cannabis, alors que nous n’abordons pas la question de l’héroïne ou du crack. Sur le cannabis, je déplore une certaine hypocrisie. En disant oui à la consommation privée, nous nourrissons en effet les réseaux. Il sera bien difficile de lutter contre les trafiquants tant qu’il y aura une demande en amont.
Que constate-t-on dans le monde ? La Suède avait ouvert la consommation légale ; elle a opéré sur cette question un virage à 180 degrés. Dans les états fédérés américains, une ouverture a parfois été pratiquée. Ainsi, le Colorado a attiré de nombreux consommateurs, avec des conséquences catastrophiques. Là où les vannes sont ouvertes, il faut donc tôt ou tard les refermer.
La nature des drogues elles-mêmes a changé. Le cannabis contient aujourd’hui dix fois plus de substance hallucinogène qu’il y a trente ans. L’époque baba cool du cannabis de Papa est finie ; il est devenu une drogue totale. J’ajoute que la France demeure liée par des conventions internationales sur les psychotropes, qu’elle n’a pas dénoncées, non plus que les Pays-Bas.
En matière de prévention, je citerai l’exemple de ma commune, où se tiennent régulièrement des forums santé. Il faut appuyer et soutenir ce type d’initiatives, qui ne coûtent pas cher et peuvent rapporter gros.
Je ne suis en revanche pas d’accord avec les propositions de notre collègue Anne-Yvonne Le Dain. Ne banalisons pas dans l’esprit de nos concitoyens ce qui est un véritable fléau. À la différence du vin, le cannabis provoque des troubles de mémoire durables, mais aussi, chez les hommes, des troubles érectiles. J’ai recueilli de nombreux témoignages à ce sujet. Les effets du cannabis sur le cerveau sont particulièrement difficiles à éliminer. Maintenons donc les interdits et faisons tout pour éviter ce fléau à nos jeunes.
Mme Monique Rabin. Je ne suis pas spécialiste de la question des substances illicites, mais je salue la volonté de donner des suites aux travaux du Comité.
S’agissant de la thématique elle-même, certaines propositions sont communes aux deux rapporteurs. Mais quels sont les autres types de prévention mis en pratique ailleurs ? Dans ma commune, nous avons fait venir un psychosociologue canadien, André Therrien, qui a su développer une approche adaptée à la jeunesse. Après l’échec de l’interdiction, il sait donner des conférences où il n’hésite pas à reconnaître que la consommation de substances illicites peut procurer du plaisir ; mais il s’attache bien sûr immédiatement ensuite à en décrire et à développer toutes les conséquences, à montrer aux jeunes que c’est un enfer.
Dans leur programme électoral, certains de nos adversaires n’hésitent pas à promettre qu’ils interdiront la drogue à l’école. Même si l’approche promise a montré qu’elle n’est pas viable, cela interpelle les parents, qui en espèrent une éradication du fléau. Ce n’est pourtant pas du tout ce qu’il faut faire. Comprenons plutôt ce que signifie l’usage de la drogue et quelles pistes nous pouvons suivre en nous appuyant sur l’exemple canadien.
Notre Comité représente une force au moins aussi importante qu’une instance à compétence législative. Il faudrait mieux tirer parti de ses travaux transversaux par rapport aux compétences des commissions. Nous devrions dire nettement quelles propositions nous présentons au Gouvernement, de telle sorte que nos travaux ne servent pas seulement à l’édification des personnes qui y participent.
M. Bernard Accoyer. Je voudrais remercier notre collègue d’avoir rendu hommage au Comité, institué à la suite de la réforme de notre règlement en 2009. Le Comité d’évaluation et de contrôle est un outil puissant à la disposition des parlementaires, mais malheureusement pas assez utilisé. Le Parlement, nos institutions et le pays tout entier auraient pourtant intérêt à ce que l’évaluation soit pratiquée plus souvent, plutôt que de se consacrer à une législation excessive et débordante, qui crée par définition de nouvelles normes et rend notre droit instable. La mission d’évaluation et de contrôle nous est du reste dévolue par la Constitution elle-même.
Il y a quinze ans, j’avais déposé une proposition de résolution visant à la constitution d’une commission d’enquête relative aux effets du cannabis sur la santé. Ses effets délétères n’étaient à l’époque pas aussi bien connus qu’aujourd’hui. La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), qui suivait la question, avait commandé à l’époque une étude bibliographique. Elle avait permis de faire connaître dans notre pays des effets déjà bien connus ailleurs.
Quinze ans plus tard, nous n’en avons guère tenu compte. Il est établi que la substance Delta 9 et le cannabinol ont des effets plus graves sur la santé que le tabac, qu’il s’agisse de la condition cardio-vasculaire ou de la cancérogénèse. Leurs effets sur le cerveau sont désormais documentés par l’imagerie cérébrale. Cette imagerie fonctionnelle montre les conséquences de leur imprégnation dans le cerveau. Ces substances conduisent ainsi à une désocialisation, à un éloignement du travail et de la vie quotidienne. Des jeunes étudiants d’écoles d’ingénieur peuvent s’éloigner de cette manière de leur cursus ou des lycéens de leur parcours scolaire. Ces effets sont de plus en plus problématiques, au fur et à mesure que les consommateurs sont plus jeunes, plus nombreux et que ces substances sont de plus en plus concentrées.
Mais nous connaissons aussi les effets de ces substances sur la santé psychiatrique et mentale. L’entrée en schizophrénie a souvent lieu par l’ivresse cannabique. Elle est un élément déclenchant de cette maladie dont les conséquences sont dramatiques pour les malades et pour leur famille.
Des travaux de recherche sont en cours, notamment à Bordeaux, sur ces addictions et sur leurs effets sur la mécanique intime du corps humain, telle que les neurosciences peuvent en rendre compte. Les travaux de recherche qui nous manquent sont donc ceux qui concernent plus particulièrement le fonctionnement du cerveau. Les équipes qui y travaillent méritent à tout le moins d’être encouragées et mises à l’honneur, à défaut de recevoir des moyens qui manquent partout aujourd’hui.
Oui, je propose que nous revenions à l’avenir régulièrement sur un certain nombre de sujets qui ont fait l’objet d’évaluations de notre Comité.
Mme Monique Rabin. Nous avons évoqué le sujet de la médecine scolaire, dans les collèges et dans les lycées. Mais j’ai aussi abordé, au cours d’une rencontre récente avec les chambres des métiers, le problème des accidents de travail des apprentis, qui peuvent aussi être dus à l’usage de stupéfiants. Voilà un sujet par rapport auquel les patrons d’apprentis peinent à se situer, ne sachant pas s’ils doivent être le référent adulte sur cette question. C’est pourquoi j’affecte une partie des fonds de ma réserve parlementaire au financement d’une association qui gère la question en faisant l’intermédiaire entre les entreprises et les chambres de métier. Je propose que nous abordions donc aussi la question de l’apprentissage, si nous poursuivons sur ce thème. Dans les centres de formation des apprentis, le désarroi règne.
M. Gérard Sebaoun. Une étude relativement récente de l’université de Stanford a montré que l’usage combiné du cannabis et du tabac, comme premier usage du cannabis, multiplie par une valeur oscillant entre trois et dix le risque d’addiction au tabac.
M. Jacques Myard. Il faudrait aussi parler de la drogue comme cause d’accidents de la route.
M. Bernard Accoyer. L’usage de stupéfiants est en effet à l’origine de 20 % des accidents de la route mortels, comme de nombreux accidents du travail. Il rend également très difficile l’insertion sociale des jeunes qui sont sous son emprise.
Les centres qui pourraient prendre en charge ceux qui sont tombés dans la dépendance du cannabis manquent cruellement. Au cours du débat sur la loi relative à la modernisation du système de santé, j’ai souvent abordé la question du cannabis, dans une volonté pédagogique. Une mesure simple serait de développer des structures légères qui puissent servir de portes d’entrée aux jeunes qui souffrent de leur dépendance, en les orientant vers les différents dispositifs de soins. Car, lorsqu’on a laissé la consommation se développer avec une telle ampleur, il faut agir et tendre la main à ces jeunes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, rapporteure. Je vous remercie d’avoir nourri ce débat, qui montre l’engagement, l’intérêt et les inquiétudes des parlementaires. Il n’est pas anodin que cette prise de conscience soit désormais collective. J’y vois le point de départ d’une dynamique de progrès.
En deux ans, les points de contact pour les consultations de jeunes consommateurs sont passés de 300 à 540. Il n’était pas nécessaire pour cela de passer par la loi. Leur budget a seulement été augmenté et le réseau s’est développé, tandis que des campagnes d’information ont eu lieu, à destination des jeunes consommateurs, tant à la télévision que sur les réseaux sociaux.
La consommation est stable chez les moins de 14 ans, mais elle augmente chez les plus de 17 ans. Le passage au lycée est donc un moment clé. La question de l’implication de l’éducation nationale doit donc être traitée de manière organique. Un système de récolement par établissement devrait être mis en place, soit au niveau national, soit au niveau académique. Les projets d’établissement comportent obligatoirement un volet consacré à l’addictologie, mais leur déclinaison dans le détail laisse parfois à désirer, par exemple sur la question de savoir combien de fois le sujet doit être abordé dans le parcours scolaire.
S’agissant de l’argument de la tranquillité publique développé en faveur des salles de consommation à moindre risque, c’est l’approche qui est retenue aux Pays-Bas. Les autorités de ce pays l’assument, même si l’ouverture de ces salles se traduit par des améliorations sanitaires. Au Canada, la situation est différente, puisque la question est envisagée à Vancouver sous l’angle sanitaire. Nous verrons quelles suites seront données aux déclarations récentes du premier ministre de ce pays.
À titre personnel, au cours de nos débats sur le projet de loi relatif à la contrainte pénale, j’ai déposé un amendement visant à modifier le libellé de l’incrimination retenue en cas d’accident de la route mortel. Il est difficile aux proches des victimes d’accepter que celles-ci ont été victimes d’un homicide « involontaire », même si cela est passible de dix ans d’emprisonnement. Je proposais donc, car je crois que les mots ont un sens, que la loi parle d’homicide par abolition volontaire du discernement. Convenez donc avec moi que je ne suis pas partisane d’une attitude laxiste. Je crois au contraire que nous devons poser le débat en des termes forts.
S’agissant des travaux de notre collègue Martine Pinville sur la médecine scolaire, je pense que nous pourrions en effet voir quelle réflexion commune développer.
Quant à la couverture du territoire, comme je vous le disais tout à l’heure, les CSAPA et les CAARUD ont mis en place des équipes mobiles. En 2014, non moins de vingt antennes et de vingt consultations avancées de CSAPA ainsi que treize dispositifs mobiles de CAARUD ont été déployés. L’engagement a été pris de poursuivre cette politique.
La décision a également été prise, dans le cadre de la récente loi relative à la santé, de ne pas se contenter de s’appuyer sur le réseau des pharmacies pour prendre en charge les programmes d’échanges de seringue, alors qu’elles ne sont aujourd’hui que 1 100 sur 22 000 à le faire volontairement. Outre la distribution dans les officines et dans les CAARUD, une distribution par la poste est explorée, en particulier dans les campagnes. Je privilégie donc une approche pragmatique et morale, politique au sens noble du terme, qui s’appuie sur les professionnels de santé.
Un travail important a été mené pour limiter l’incidence du VIH et du virus de l’hépatite C parmi les consommateurs de stupéfiants. Je rappelle que chaque traitement individuel de l’hépatite C coûte 60 000 euros par an. Il faudrait comparer ce coût à celui de la mise en place de salles de consommation à moindre risque.
La prévention est la clé du dispositif en direction de la jeunesse. Quant aux souhaits de modification de la loi de 1970, il faut en débattre. Une révision est-elle nécessaire, doit-elle être complète ou fragmentaire, en sommes-nous politiquement capables aujourd’hui ? Le débat doit être ouvert. En prônant une légalisation sous contrôle, je n’ai pas hésité à mettre les pieds dans le plat, précisément dans l’intention de susciter des réactions et d’amener des avancées.
Enfin, je vous indique que les Nations unies ont mis cette question à l’ordre du jour de leur session du printemps 2016. La prise en mains du problème est à la fois locale et globale.
M. Régis Juanico, président. Je vous remercie, madame la rapporteure, pour la qualité des travaux que vous avez menés.
J’attire votre attention sur le fait que le rapport d’évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale, que nous avons examiné la semaine dernière, fera l’objet d’un débat en séance publique le mardi 12 janvier 2016, à 16 heures 15.
Le Comité autorise la publication du présent rapport.
ANSM : |
Agence nationale de sécurité des médicaments |
ARS : |
agences régionales de santé |
BHD : |
buprénorphine haut dosage |
CAARUD : |
centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues |
CAST : |
cannabis abuse screening test |
CCAA : |
centre de cure ambulatoire en alcoologie |
CESC : |
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté |
CIPCA : |
commission interministérielle de prévention des conduites addictives |
CJC : |
consultation jeunes consommateurs |
CNAM : |
Caisse nationale d’assurance maladie |
CNAMTS : |
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés |
CPTS : |
communautés professionnelles territoriales de santé |
CSAPA : |
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie |
CSST : |
centre de soins spécialisés aux toxicomanes |
DACG : |
direction des affaires criminelles et des grâces |
DAP : |
direction de l’administration pénitentiaire |
DASRI-PAT : |
déchets d’activités de soins à risques infectieux pour les patients en auto-traitement |
DEPP : |
direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance |
DESC : |
diplôme d’études spécialisées complémentaires |
DGS : |
direction générale de la santé |
ELSA : |
équipes de liaison et de soin en addictologie |
ESCAPAD : |
enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense |
ESPAD : |
European school survey project on alcohol and others drugs |
FIR : |
Fonds d’intervention régional |
FRAD : |
formateur relais anti-drogue |
HBSC : |
Health behaviour in school-aged children |
ILS : |
infractions à la législation sur les stupéfiants |
INFPN : |
Institut national de formation de la police nationale |
INPES : |
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé |
INPS : |
Institut national de police scientifique |
INSERM : |
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
InVS : |
Institut de veille sanitaire |
IREPS : |
instance régionale d’éducation et de promotion de la santé |
MDMA |
méthylènedioxyméthamphétamine |
Mildeca : |
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
NDS : |
nouvelles drogues de synthèse |
NPS : |
nouveaux produits de synthèse |
OEDT : |
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies |
OFDT : |
Observatoire français des drogues et des toxicomanies |
OMS : |
Organisation mondiale de la santé |
ONDAM : |
objectif national des dépenses d’assurance maladie |
PES : |
programme d’échange de seringues |
PFAD : |
policier formateur anti-drogue |
Pharos : |
Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements |
PRS : |
projet régional de santé |
Respadd : |
réseau de prévention des addictions |
SCL : |
service commun des laboratoires |
SCMR : |
salle de consommation à moindre risque |
SDLC : |
sous-direction de lutte contre la cybercriminalité |
SSR : |
(service de) soins de suite et de réadaptation (en addictologie) |
STUPS : |
système de traitement uniformisé des produits stupéfiants |
THC : |
tétrahydrocannabinol |
TREND : |
Tendances récentes et nouvelles drogues (enquête) |
TSO : |
traitements de substitution aux opiacés |
ANNEXE N° 2 :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
– M. François Beck, directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) (29 septembre 2015).
– M. Alexandre Grosse, chef du service du budget, de la performance et des établissements, et Mme Véronique Gasté, cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (29 septembre 2015).
– M. Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction, accompagné de Mme Nathalie Latour, déléguée générale (6 octobre 2015).
– M. Clément Vivès, chef de la mission de lutte anti-drogue, ministère de l’intérieur (6 octobre 2015).
– Dr Pierre-Yves Bello, adjoint à la cheffe du bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé, accompagné du Dr Nathalie Joannard, chargée du dossier addictions, direction générale de la santé (DGS), ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (20 octobre 2015).
– Mme Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), accompagnée de M. Gilles Lecoq, délégué, et de Mme Katia Dubreuil, chargée de mission « Justice » (20 octobre 2015).
– M. Olivier Christen, sous-directeur de la justice pénale spécialisée, et M. Damien Martinelli, chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), ministère de la justice (27 octobre 2015).
1 () Expertise collective de l’INSERM, Médicaments psychotropes, Consommations et pharmacodépendances, Synthèse et recommandations, INSERM, 2012.
© Assemblée nationale