

L’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE
par
Mme Anne-Yvonne LE DAIN, députée
par M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président de l’Office |
par M. Bruno SIDO, Premier vice-président de l’Office |
Composition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques
Président
M. Jean-Yves LE DÉAUT, député
Premier vice-président
M. Bruno SIDO, sénateur
Vice-présidents
M. Christian BATAILLE, député M. Roland COURTEAU, sénateur
Mme Anne-Yvonne LE DAIN, députée M. Christian NAMY, sénateur
M. Jean-Sébastien VIALATTE, député Mme Catherine PROCACCIA, sénatrice
|
DÉputés |
SÉnateurs |
M. Bernard ACCOYER M. Gérard BAPT M. Christian BATAILLE M. Alain CLAEYS M. Claude de GANAY Mme Françoise GUÉGOT M. Patrick HETZEL M. Laurent KALINOWSKI Mme Anne-Yvonne LE DAIN M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Alain MARTY M. Philippe NAUCHE Mme Maud OLIVIER Mme Dominique ORLIAC M. Bertrand PANCHER M. Jean-Louis TOURAINE M. Jean-Sébastien VIALATTE |
M. Patrick ABATE M. Gilbert BARBIER Mme Delphine BATAILLE M. Michel BERSON M. François COMMEINHES M. Roland COURTEAU Mme Catherine GÉNISSON Mme Dominique GILLOT M. Alain HOUPERT Mme Fabienne KELLER M. Jean-Pierre LELEUX M. Gérard LONGUET M. Pierre MÉDEVIELLE M. Franck MONTAUGÉ M. Christian NAMY M. Hervé POHER Mme Catherine PROCACCIA M. Bruno SIDO |
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 9
I. LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 15
A. UN CALENDRIER DÉFAVORABLE 15
1. Une publication proche de la fin des travaux parlementaires 15
2. Une démarche anticipée par l’OPECST 15
3. Une portée nécessairement limitée 16
B. UN RETOUR EN ARRIÈRE ÉCLAIRANT 17
1. Une stratégie aux objectifs bien définis 17
2. Les conditions de l’évaluation 17
3. Des recommandations sur le fond et sur la forme 18
4. Une démarche inaboutie 19
C. SNR ET STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE : DEUX STRATÉGIES RÉELLEMENT CONNEXES ? 19
1. Les orientations de recherche centrées sur l’énergie 19
2. Les orientations de recherche transverses 20
3. Une articulation à réajuster 21
II. LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE : UNE BASE DE TRAVAIL SOLIDE 23
A. LE FRUIT D’UNE LARGE CONCERTATION 23
1. Un processus structuré 23
2. Les apports des travaux de la SNR à la SNRE 24
3. Le rôle des alliances de recherche 25
B. UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE À PROLONGER 26
1. Une multiplicité d’objectifs et de contraintes 26
2. Quatre orientations stratégiques 26
3. Quinze actions structurantes 27
III. TROIS ORIENTATIONS PRIORITAIRES POUR CONSOLIDER LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 29
A. LE BESOIN DE DÉFINIR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE EN ÉNERGIE. 29
1. Le manque d’une vision partagée 29
2. La nécessité d’objectifs propres à la recherche en énergie 30
B. L’ACCÉLÉRATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 31
1. Le besoin d’une accélération de la recherche scientifique en énergie 31
2. Identifier de nouveaux modes de financement de long terme 31
3. La dichotomie artificielle entre recherche fondamentale et appliquée 33
4. L’incontournable respect des engagements internationaux 34
C. L’IDENTIFICATION DE FILIÈRES D’AVENIR 35
1. Préparer l’industrialisation en amont 35
2. Prendre la mesure des obstacles réglementaires 36
IV. L’IDENTIFICATION D’AXES DE RECHERCHE PRIORITAIRES 39
A. LES RECHERCHES EN MATIÈRE DE PRODUCTION D’ÉNERGIE. 40
1. La recherche sur l’énergie solaire 40
2. La recherche sur l’énergie éolienne 41
3. La recherche sur l’énergie hydraulique 42
4. La recherche sur l’énergie nucléaire 43
5. La recherche pétrolière 44
B. LES RECHERCHES SUR L’INTÉGRATION DES ÉNERGIES VARIABLES 45
1. La recherche sur les réseaux intelligents 45
2. La recherche sur le stockage d’énergie 47
C. LES RECHERCHES SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 48
1. La recherche sur les économies d’énergie dans le bâtiment 48
2. La recherche sur la performance énergétique dans les transports 50
CONCLUSION 53
RECOMMANDATIONS 55
EXAMEN DU RAPPORT PAR L’OFFICE 57
ANNEXES 67
ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 69
ANNEXE N° 2 : COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 SUR « LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES DE L’INTEGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE » 75
OUVERTURE 75
PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELLES TECHNOLOGIES POUR INTÉGRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ? 76
INTERVENTIONS 78
DÉBAT 96
DEUXIÈME TABLE RONDE : RÉSEAUX INTELLIGENTS, EFFACEMENT, STOCKAGE, OPTIMISATION – QUELQUES PISTES DE RECHERCHE POUR L’INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 99
INTERVENTIONS 99
DÉBAT 118
TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE ET COMMENT ACCÉLÉRER L’INNOVATION ? 119
INTERVENTIONS 120
DÉBAT 135
CONCLUSION 135
ANNEXE N° 3 : COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE DU
9 FÉVRIER 2017 SUR « LES ENJEUX DE LA RECHERCHE EN ÉNERGIE » 139
OUVERTURE 139
PREMIÈRE TABLE RONDE : STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE POUR L’ÉNERGIE – DE 2007 A 2017 143
INTERVENTIONS 143
DÉBAT 159
DEUXIÈME TABLE RONDE : LES ORIENTATIONS MAJEURES DE LA SNRE, LEUR MISE EN ŒUVRE ET DÉCLINAISON INDUSTRIELLE 163
INTERVENTIONS 164
DÉBAT 172
TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES RUPTURES TECHNOLOGIQUES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 178
INTERVENTIONS 179
DÉBAT 195
QUATRIÈME TABLE RONDE : COMMENT ACCELERER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION POUR L’ÉNERGIE ? 202
INTERVENTIONS 202
DÉBAT 215
CONCLUSION 217
ANNEXE N° 4 : COMMUNICATION DE M. CHRISTIAN BATAILLE, DÉPUTÉ, VICE-PRÉSIDENT DE L’OPECST SUR UNE MISSION AUX ÉTATS-UNIS 219
ANNEXE N° 5 : COMPTE RENDU DE L’AUDITION OUVERTE À LA PRESSE DU CSTB, LE 13 DÉCEMBRE 2016 223
ANNEXE N° 6 : LETTRES AUX MINISTRES EN CHARGE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE EN DATE DU
27 SEPTEMBRE 2016 243
ANNEXE N° 7 : SYNTHÈSE ANRT – COMMENT LA RECHERCHE SUR L’ÉNERGIE PEUT-ELLE FAVORISER LE RAYONNEMENT MONDIAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES ? 249
ANNEXE N° 8 : ANRT – RAPPORT POUR L’OPECST SUR LES CIFRE TOUCHANT À L’ÉNERGIE DEPUIS 2006 269
ANNEXE N° 9 : AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 3 NOVEMBRE 2016 275
ANNEXE N° 10 : AVIS DU CSE DU 9 DÉCEMBRE 2016 279
ANNEXE N° 11 : ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2016 PORTANT PUBLICATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE 283
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche, confiée à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) par l’article 15 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
En complément de l’évaluation de la stratégie nationale de recherche elle-même, il s’intéresse plus particulièrement à son volet énergie, qui donne lieu à l’élaboration d’un document distinct, prévu par l’article 183 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte : la Stratégie nationale de recherche en énergie.
Trois raisons justifient que le législateur ait ainsi jugé nécessaire d’adjoindre à la Stratégie nationale de recherche un volet consacré à l’énergie.
En premier lieu, la France s’est engagée en 2015, avec les autres pays signataires de l’accord de Paris, dans une course de vitesse contre le changement climatique. Celle-ci nous impose de modifier profondément, et dans un temps très court, notre façon de produire et de consommer l’énergie.
C’est pourquoi, dans le cadre de la Mission innovation, avec vingt-et-un autres pays et l’Union européenne, la France a décidé de doubler, sur la période 2015 - 2020, le montant des investissements publics dans la recherche et le développement pour les énergies durables. Cet engagement budgétaire reste d’ailleurs à concrétiser en France, alors qu’il a déjà pris effet dans d’autre pays, par exemple aux États-Unis.
En deuxième lieu, l’énergie est au cœur de toute activité économique. Sans elle, il serait impossible de labourer les champs, de construire les bâtiments, de faire tourner les usines, de transporter les marchandises, d’éclairer les rues, de chauffer les habitations, d’assurer la connexion Internet des entreprises, etc. Sans énergie, nous serions démunis de tout confort et de tout lien moderne avec les autres. Lorsqu’elle vient à manquer, c’est tout un pays qui s’arrête de produire et, si son prix devient excessif, ce sont alors les populations et les entreprises les plus fragiles qui en souffrent le plus, et en premier.
Dans le passé, la France a pris en compte cet enjeu d’indépendance comme de puissance énergétique, en se dotant d’une industrie hydroélectrique, pétrochimique et gazière, puis d’une industrie nucléaire, également fortes. Cet effort d’indépendance doit être poursuivi mais, évidemment, pas seulement dans le domaine de la production énergétique, toute la question des énergies alternatives étant cependant encore devant nous, alors même que d’autres pays ont pris ce tournant bien plus tôt que nous.
En effet, bien d’autres éléments sont à considérer, dont évidemment la façon dont l’énergie est consommée, distribuée, facturée, économisée, ou stockée, ainsi que la manière dont ces différents items se combinent entre eux et s’insèrent dans l’économie européenne et mondiale. Certes, beaucoup a déjà été fait, ainsi les réseaux électriques de puissance sont interconnectés en Europe, seul continent où ces interconnexions sont effectives et efficaces.
Il conviendrait donc que les institutions scientifiques françaises travaillent explicitement sur ces différents items (production, consommation, facturation, effacement, distribution, connexions, individualisation, etc.), parfois de manière désordonnée ou au contraire de manière très dédiée, et tiennent compte explicitement de ce que la France peut aussi concevoir une stratégie nationale de recherche en énergie qui lui soit propre, et concerne tous ces secteurs.
Distribuant à la fois, sur tout le territoire nationale, une énergie de puissance et une énergie renouvelable qui pourrait, voire devrait, être réservée à des usages plus « locaux », l’électricité est un vecteur énergétique d’intérêt, sur lequel se focalisent aujourd’hui les débats publics, entre partisans et adversaires de l’énergie nucléaire. Indépendamment de ce point de crispation dans le débat public, d’autres énergies existent, par exemple le gaz, actuellement massivement importé, mais qui pourrait aussi devenir une source d’énergie nationale, par une optimisation technologiquement plus poussée de la biomasse.
La recherche scientifique française doit contribuer à ce débat qui ne peut se réduire à un échange, éventuellement musclé, entre partisans et opposants de telle ou telle technologie (le nucléaire, l’éolien, le solaire, les fermenteurs, etc.), sur tous les aspects qui concernent la gestion énergétique de la France, en métropole et dans les DOM-TOM. D’autres questions sont essentielles :
- en matière de distribution dans le domaine immobilier (particuliers, entreprises, administrations), il convient de poursuivre la recherche pour diminuer la consommation et pour comprendre et simuler les comportements des utilisateurs ;
- afin d’optimiser et d’accroître la part énergie électrique renouvelable intermittente (solaire, éolien), notamment dans les DOM-TOM mais aussi en métropole, des travaux de recherche devraient être explicitement lisibles sur l’opportunité du raccordement obligatoire au réseau national, qui indifférencie « l’électron » de son origine, tout en maintenant la péréquation nationale du prix du kilowattheure ;
- en utilisant mieux le caractère stable (étonnamment absent des débats) de l’énergie hydraulique, également renouvelable. L’on pourrait par exemple optimiser les « remontées » nocturnes en bas des chutes, au travers de calculs et technologies plus sophistiqués qu’aujourd’hui – des travaux pourraient être conduits pour mieux modéliser – ou en actionnant de manière plus adéquate le « petit hydraulique » local ;
- en sécurisant l’approvisionnement en électricité de tous les territoires, grâce à un parc nucléaire installé, déjà important, dont la production, et la diffusion via les réseaux, répondent actuellement aussi bien aux besoins instantanés que de puissance : l’optimisation mathématique et informatique des commandes de gestion des flux, au sein des centrales comme sur l’ensemble du réseau, dont les interconnexions nationales et européennes, doit pouvoir devenir une source de valorisation et de performance plus efficace ;
- en exploitant de façon astucieuse les infrastructures existantes des énergies fossiles (gaz et pétrole), actuellement massivement importées, et notamment le réseau gazier, très dense sur le territoire national (à cet égard, une production massive de biogaz permettrait de limiter ces coûts d’importation) ;
- et, donc, en accroissant l’utilisation de la biomasse sur le territoire français (métropole et outre-mer), notamment avec les résidus de cultures (nonobstant la question du retour au sol de la matière organique naturelle, dont les sols ont grand besoin…) et en travaillant plus énergiquement (sic) sur les micro-organismes de fermentation, et les technologies susceptibles d’améliorer l’efficacité de la méthanisation, notamment celle des résidus de l’agro-industrie ;
- en donnant plus explicitement la priorité à une diminution, potentiellement considérable, de la consommation énergétique des bâtiments, publics et privés, neufs comme anciens, et de la consommation des usagers (sur ce plan, une recherche sur les comportements domestiques et professionnels paraitrait utile) ;
- en optimisant les attitudes d’effacement de consommation, diurne ou nocturne, des entreprises comme des particuliers, afin que les « comportements vertueux » soient explicitement valorisés et favorise la naissance d’une vraie « économie d’effacement » permettant à des PME de s’engager dans cette voie prometteuse ;
- en explicitant le rôle majeur des réseaux interconnectés à l’échelle européenne, afin de construire un système efficace et optimisé en tous points ;
- en approfondissant le concept de résilience : « production locale/utilisation locale » pour toutes les énergies et à toutes les échelles ;
- en construisant des modèles mathématiques puissants, capables d’assurer l’égalité des territoires, en matière d’approvisionnement mais aussi de facturation énergétique ;
- en ayant une approche économique et scientifique de la question du chauffage et de la climatisation des bâtiments, collectifs et individuels, à partir des énergies fossiles, des énergies renouvelables, du bois de chauffage (origine, prix, réseau, distribution, …), du gaz issu de la biomasse renouvelable, etc. La valeur intrinsèque de la thermie utilisée pour le chaud ou pour le froid nécessite d’être scientifiquement explicitée, en termes financiers et en équivalent CO2 ;
- en travaillant de manière plus offensive aux « énergies embarquées », telle la pile à combustible ou l’hydrogène.
L’ensemble de ces axes nécessitent des travaux de recherche, publique et privée, alors même qu’ils sont le plus souvent absents des discussions scientifiques institutionnelles comme des débats publics.
La stratégie nationale de recherche scientifique dans le domaine de l’énergie ne saurait, en effet, se réduire à des arbitrages politiques entre énergies renouvelable et nucléaire. Au contraire, elle doit intégrer l’ensemble des besoins énergétiques, et les technologies afférentes, afin de permettre à la France de se doter, au travers de ses compétences scientifiques, publiques et privées, de forces très conséquentes pour optimiser la production, la distribution, les usages, les interconnexions, etc., et pour exporter ses compétences dans le monde, sans jamais oublier que le « tout électrique » n’est pas inéluctable mais peut constituer, ou pas, un choix, notamment en matière de chauffage, en l’accompagnant d’actions d’isolation massives et de mode de facturation individualisée par usager ; toutes choses faciles à concevoir et difficile à réaliser, y compris techniquement.
En troisième lieu, malgré les récentes difficultés, le secteur de l’énergie reste l’un des derniers, sans doute avec l’aéronautique, l’armement et l’agro-alimentaire, dans lesquels la France apparaît comme une nation industrielle puissante au plan international. Cette position repose, en bonne part, sur la capacité de nos chercheurs et de nos ingénieurs à innover. La concurrence internationale dans ce secteur se renforce, avec l’arrivée de nouveaux concurrents, notamment la Chine et l’Inde. Plus que jamais, la recherche apparaît comme une condition nécessaire au maintien de nos industries et de nos emplois dans l’énergie, sur le territoire national ou à l’export, au bénéfice d’entreprises nationales.
Car, nolens volens, il s’agit de l’indépendance de la France, et pas seulement de son indépendance énergétique. Or, augmenter les moyens financiers dévolus à tel ou tel aspect de la production énergétique n’y suffira pas : l’absence de considération actuelle pour d’autres sujets que la « production » obère le potentiel technologique et donc économique de notre pays; et les guéguerres entre institutions, entretenues par le débat entre « renouvelable » et « fossile » (dont nucléaire) sont contre-productives et empêchent une analyse et un suivi attentif et intelligent de cet enjeu premier de notre siècle : l’accès à l’énergie, et à quel prix pour les consommateurs français, par conséquent potentiellement pour les consommateurs du monde entier. Une entrée scientifique sur cet « accès » est pourtant une source évidente de produit intérieur brut pour la France et, donc, de travail pour les Français, ici en Europe.
Il est donc incontestable que le législateur a su se montrer clairvoyant en ajoutant à la Stratégie nationale de recherche, au travers de la loi pour la transition énergétique, un volet énergétique.
Pour ces mêmes raisons, il convient de considérer ce rapport, dont la publication intervient quelques semaines après celle de la Stratégie nationale de recherche en énergie, comme une première approche de son évaluation, destinée à être prolongée, dans le courant de la prochaine législature, par une deuxième étude visant à mesurer, conformément à la loi, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre, ainsi que la prise en compte des orientations proposées dans le cadre du présent document.
I. LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION
1. Une publication proche de la fin des travaux parlementaires
L’arrêté, du 21 décembre 2016, portant publication de la stratégie nationale de recherche énergétique, adoptée par les ministres chargés de l’énergie et de la recherche, est paru au Journal officiel du 27 décembre 2016.
Sa notice décrit la portée de la nouvelle stratégie : « Cette stratégie nationale, qui précise le volet énergie de la stratégie nationale de recherche (SNR), vise à identifier les enjeux de recherche et développement ainsi que les verrous scientifiques à lever dans le domaine de l’énergie pour permettre la bonne réalisation des objectifs de loi, tout en s’inscrivant dans une perspective internationale plus large. »
Son article premier indique que : « La stratégie nationale de la recherche énergétique arrêtée par les ministres chargés de l’énergie et de la recherche est annexée au présent arrêté ». Mais une note de bas de page précise : « Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat ».
La Stratégie nationale de recherche en énergie est, effectivement, devenue consultable le 2 janvier 2017, sur le site de ce dernier ministère, avant d’être officiellement publiée à son Bulletin officiel, le 25 janvier 2017. Si cette publication est bien intervenue dans les délais attendus, elle n’a laissé, en pratique, que quelques semaines pour étudier ce document, alors qu’une évaluation approfondie de la précédente stratégie, publiée en mai 2007, avait nécessité une étude d’une année.
Conscient de cette difficulté, l’OPECST avait engagé des démarches, en septembre 2016, auprès des ministres en charge de l’environnement et de la recherche pour demander la communication de la version courante de la Stratégie nationale de recherche en énergie (Cf. courriers adressés aux ministres en annexe du présent rapport), qui sont restées sans suite.
2. Une démarche anticipée par l’OPECST
Compte tenu du calendrier parlementaire – les travaux de l’Assemblée nationale s’achevant au premier trimestre 2017 –, l’OPECST a décidé d’anticiper sur la publication de ce document en engageant, dès mi-2016, la réalisation de l’évaluation de la future stratégie.
Avant-même cette décision, le 26 mai 2016, l’OPECST a organisé une audition consacrée à « L’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique » – l’un des axes de recherche majeurs pour la transition énergétique – visant à identifier les technologies à mettre en œuvre ou à développer pour prendre en compte la variabilité de la production électrique d’origine renouvelable et son caractère diffus, à présenter des pistes de recherche portant sur les réseaux intelligents, le stockage d’énergie, la gestion de la demande et l’optimisation des réseaux et, enfin, à faire un premier point sur les modalités d’élaboration de la Stratégie nationale de recherche en énergie, son avancement et son calendrier, en vue de sa future évaluation.
Nonobstant l’incertitude sur l’avancement de l’élaboration du document, dans les mois suivants, une quinzaine d’intervenants, impliqués dans la recherche en énergie dans notre pays, ont été entendus individuellement.
À la suite de la publication de la Stratégie nationale de recherche en énergie, l’OPECST a organisé, le 9 février 2017, une seconde audition publique, sur « Les enjeux de la recherche en énergie », destinée à mesurer les progrès réalisés, en termes de démarche d’élaboration et d’implication des parties prenantes, depuis la première Stratégie nationale de recherche en énergie de 2007, à préciser les orientations majeures de la nouvelle stratégie et les conditions prévues pour sa mise en œuvre, à présenter certaines des technologies de rupture dont elle doit accompagner l’émergence et, enfin, à analyser les conditions d’accélération de la recherche et de l’innovation qu’elle a vocation à promouvoir.
À côté de ces auditions consacrées à l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche en énergie, celle-ci tire également partie des travaux récents de l’OPECST sur les questions d’énergie, notamment les rapports de 2011 sur l’avenir de la filière nucléaire, de 2013 sur la filière hydrogène, de 2014 sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique et les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économie d’énergie dans le bâtiment, ainsi que l’audition du 13 décembre 2016, du président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
3. Une portée nécessairement limitée
Malgré l’anticipation de cette évaluation par l’OPECST, sa portée se trouve nécessairement limitée par le bref temps écoulé depuis la publication de la Stratégie nationale de recherche en énergie.
Aussi, le présent rapport doit-il être, avant tout, considéré comme une première étape dans l’évaluation de cette stratégie, étape qu’il serait souhaitable de prolonger, dans le courant de la prochaine législature, conformément à l’article 15 de la loi du 22 juillet 2013, notamment pour prendre la mesure des conditions de mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en énergie et, partant, de prise en compte des recommandations formulées dans le cadre de cette évaluation.
B. UN RETOUR EN ARRIÈRE ÉCLAIRANT
La publication de la première stratégie nationale de recherche en énergie, en mai 2007, a donné lieu, en 2009, à une évaluation approfondie par l’OPECST, qui a conduit les rapporteurs, MM. Christian Bataille et Claude Birraux, députés, à formuler vingt recommandations. La plupart d’entre elles restent d’actualité.
1. Une stratégie aux objectifs bien définis
La première stratégie nationale de recherche en énergie, publiée en mai 2007, faisait suite à un large débat sur la politique énergétique et la lutte contre le changement climatique, consécutif à l’engagement pris devant la scène internationale, en 2003, par le Chef de l’État et le Premier ministre de l’époque, de diviser par quatre, d’ici 2050, les émissions nationales de gaz à effet de serre, par rapport à celles de 1990.
Cet engagement a été, par la suite, inscrit dans la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, fixant les orientations de la politique énergétique. L’article premier de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le place d’ailleurs en tête des objectifs de la politique énergétique, en visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % dès 2030.
Son article 10 (1) confiait aux deux ministres chargés de l’énergie – à l’époque celui de l’industrie – et de la recherche l’élaboration d’une « Stratégie nationale de recherche énergétique », fondée sur une dizaine d’objectif généraux, définis par l’article 5 de cette même loi, tels que : « l’augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l’éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie » ou encore : « le soutien à l’industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ». La stratégie devait préciser « les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique » et organiser « l’articulation entre les recherches publique et privée ».
2. Les conditions de l’évaluation
La loi du 13 juillet 2005 prévoyait également une évaluation de cette stratégie par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. À la suite de la publication de cette première stratégie, l’Office parlementaire a chargé les députés Christian Bataille et Claude Birraux de son évaluation.
Conformément à la démarche d’évaluation de l’OPECST, au cours d’une investigation d’une année, les rapporteurs ont procédé à une large consultation, en auditionnant une soixantaine de spécialistes de l’énergie en France, et, dans une logique de comparaison internationale, une cinquantaine en Finlande, aux États-Unis et au Japon.
Par ailleurs, le Grenelle de l’environnement ayant commencé en juillet 2007, les rapporteurs de l’OPECST se sont attachés à en intégrer les apports, plutôt que de se contenter d’un stricte examen critique du document publié.
3. Des recommandations sur le fond et sur la forme
Dans leur rapport de mars 2009, dont la synthèse est annexée au présent rapport, les rapporteurs ont notamment souligné, par contraste avec l’organisation de la recherche en énergie dans d’autres pays, comme le Japon ou les États-Unis, l’implication insuffisante du Gouvernement, et l’absence de disposition permettant le suivi, dans le temps, de la mise en œuvre de la stratégie.
Aussi, ont-ils proposé de définir une responsabilité de pilotage pour l’ensemble de la politique énergétique, avec la nomination d’un Haut-commissaire à l’énergie, de coordonnateurs par programmes prioritaires de recherche, et la création d’une commission nationale, composée de scientifiques, chargée d’une évaluation annuelle.
Ensuite, sur le fond de la stratégie, MM. Christian Bataille et Claude Birraux ont distingué, d’un côté, la recherche sur les énergies établies : nucléaire et pétrole, qui ne demandait que quelques réajustement et, de l’autre, la recherche sur les nouvelles technologies, pour laquelle ils ont fixé plusieurs priorités, conformes aux orientations du Grenelle de l’environnement : la recherche sur l’énergie photovoltaïque, singulièrement en couches minces, sur les biocarburants de deuxième génération, sur les batteries rechargeables, sur les énergies marines, et, enfin, sur le stockage d’énergie de grande capacité, pour faciliter l’intégration des énergies intermittentes telles que l’éolien.
Enfin, les rapporteurs ont soulignés le rôle crucial de la formation des ingénieurs, pour la conception et le développement des systèmes, et des techniciens, pour leur installation et leur maintenance.
Les vingt recommandations formulées par les rapporteurs de l’OPECST, également annexées au présent rapport, concernaient pour moitié la forme et pour moitié le fond de la stratégie. Les premières n’ont été que très partiellement prises en compte, pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de recherche en énergie et son suivi. Elles demeurent, de ce fait, pour la plupart, encore d’actualité.
S’agissant des deuxièmes, relatives aux différents axes de recherche, plusieurs des priorités retenues apparaissent, huit ans plus tard, plus que jamais pertinentes. Par exemple, la valorisation du gaz carbonique, une idée novatrice en 2009, constitue aujourd’hui, une composante majeure de plusieurs scénarios énergétiques français et étrangers, comme le scénario 2017-2050 de l’association NégaWatt. Les recherches correspondantes doivent d’ailleurs être poursuivies, afin d’industrialiser des solutions à un coût économiquement acceptable.
Enfin, la loi du 13 juillet 2005 demandait que le Gouvernement transmette chaque année au Parlement un rapport sur « les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie et qui favorisent leur développement industriel », dont les conclusions devaient être présentées devant l’OPECST.
Ce bilan annuel des progrès réalisés n’a jamais été transmis au Parlement et n’a, très probablement, jamais été effectué. Un tel bilan apparaît pourtant indispensable, pour identifier les forces et les faiblesses de la démarche mise en œuvre, et pour apporter, périodiquement, les corrections nécessaires. À défaut, une stratégie de recherche risque rapidement d’apparaître comme un exercice purement théorique, sans conséquence notable sur les orientations des recherches entreprises.
Là encore, la dixième recommandation du rapport de 2009, relative à la création d’une commission indépendante, sur le modèle de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE), constituée de scientifiques de renommée internationale, chargée de réaliser annuellement une telle évaluation et de la présenter au Parlement, apparaît plus que jamais d’actualité.
C. SNR ET STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE : DEUX STRATÉGIES RÉELLEMENT CONNEXES ?
Après la « Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique », « Une énergie propre, sûre et efficace » constitue le deuxième des cinq défis de la Stratégie nationale de recherche. Ce défi se décline en cinq orientations de recherche, dont trois concernent en propre l’énergie et deux apparaissent plus transverses.
1. Les orientations de recherche centrées sur l’énergie
La première de ces orientations concerne la « Gestion dynamique des systèmes énergétiques », c’est-à-dire le développement de solutions permettant l’intégration au réseau électrique d’énergies renouvelables décentralisées, et le plus souvent intermittentes. C’est en raison du caractère critique de cette question pour l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France (40 % à l’horizon 2030), et en Europe, que l’OPECST a organisé sur ce thème, en mai 2016, la première audition publique destinée à préparer la présente évaluation.
La deuxième orientation, intitulée : « Gouvernance multi-échelles des nouveaux systèmes énergétiques », vise à préparer une gouvernance plus décentralisée de moyens de production plus diffus, en donnant leur place aux territoires, tout en assurant la cohésion au niveau national. Il s’agit là de mobiliser les sciences humaines, sociales et économique, afin d’imaginer de nouveaux modes d’organisation, ou des modalités de gestion des marchés innovantes, permettant d’accompagner cette évolution, un sujet également traité par l’OPECST, notamment dans le cadre d’un rapport de MM. Bruno Sido, sénateur, et Jean-Yves Le Déaut, député, datant de septembre 2013, sur la transition énergétique à l’aune de l’innovation et de la décentralisation.
La troisième orientation : « Efficacité énergétique », vise à réduire la consommation d’énergie dans les transports, les bâtiments ainsi que les entreprises et administrations. Elle implique d’engager des recherches destinées aussi bien à trouver de nouvelles solutions techniques, qu’à modifier les comportements, comme l’avaient démontré deux rapports de l’OPECST, publiés en 2014, l’un par M. Denis Baupin, député, et Mme Fabienne Keller, sénatrice, sur « Les nouvelles mobilités sereines et durables », et l’autre par M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Marcel Deneux, sénateur, sur « Les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment ».
2. Les orientations de recherche transverses
À côté des trois orientations précédentes centrées sur les questions énergétiques, le deuxième défi de la Stratégie nationale de recherche comporte également deux orientations plus transversales.
La quatrième orientation porte sur la « Réduction de la dépendance en matériaux stratégiques », qui a également fait l’objet d’un rapport récent de l’OPECST, relatif aux enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques, publié en mai 2016 par Mme Delphine Bataille, sénatrice, et M. Patrick Hetzel, député. Une audition publique avait d’ailleurs été organisée sur ce même thème, en août 2011, par MM. Claude Birraux et Christian Kert, députés. Les remèdes à cette dépendance relèvent aussi bien de recherches sur différents types de composants et de matériaux, que de dispositions organisationnelles, telles que la constitution de stocks stratégiques.
Enfin, l’orientation relative aux « Substituts au carbone fossile pour l’énergie et la chimie », porte sur les biocarburants et les applications issues de la chimie biosourcée. Cet aspect essentiel a lui aussi été abordé par l’OPECST, en juin 2015, notamment sous l’angle de la recherche, dans le cadre d’une audition publique intitulée : « De la biomasse à la bioéconomie : une stratégie pour la France », organisée par M. Jean-Yves Le Déaut, député, MM. Roland Courteau et Bruno Sido, sénateurs. Comme la précédente, cette orientation présente un caractère transverse.
Même si leurs impacts dans le domaine énergétique sont importants, ces deux orientations relèvent, en réalité, du domaine transverse de la science des matériaux qui n’est pas identifié, en tant que tel, par la Stratégie nationale de recherche.
3. Une articulation à réajuster
La constatation de la prise en compte de ces cinq orientations dans le cadre de travaux récents de l’OPECST confirme qu’elles portent, toutes, sur des questions essentielles pour la transition énergétique et, plus généralement, la recherche dans notre pays.
Néanmoins, il est clair que celles-ci ne couvrent qu’une partie de la problématique de la recherche en énergie, en laissant de côté des domaines majeurs tels que ceux de l’atome et des hydrocarbures. Par ailleurs, ces orientations, si elles touchent à des questions importantes pour le développement de l’énergie, concernent aussi d’autres domaines de recherche, notamment celui des matériaux.
Pourtant, comme l’a rappelé M. Pierre Vala, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, lors de l’audition du 9 février 2017, dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie nationale de recherche, « l’atelier énergie a présenté la particularité d’être copiloté par les deux directions générales (DGEC et DGRI), ce qui en fait un exemple d’interministérialité renforcée. Là encore, la plupart des membres ayant travaillé dans le cadre de cet atelier font partie du comité de suivi de la SNRE, ce qui constitue une façon d’organiser la cohérence entre les deux exercices. ».
Mais la structuration de la Stratégie nationale de recherche conduisait nécessairement à ne retenir qu’un petit nombre d’orientations pour chacun des défis. Quelle que soit la pertinence de celles qui ont été, au final, retenues pour le deuxième défi, elles ne pouvaient couvrir l’ensemble des enjeux énergétiques. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé M. Pierre Vala : « Nous avons cherché, dans cet exercice de Stratégie nationale de la recherche couvrant un ensemble large de défis sociétaux, à retenir un nombre limité d’orientations stratégiques par défi, afin de pouvoir focaliser et orienter les développements nouveaux et la constitution d’équipes sur les sujets paraissant encore insuffisamment traités. Il ne s’agissait pas en l’occurrence de traiter de façon globale l’ensemble des sujets sur lesquels il convenait que la recherche publique française travaille, mais de mettre en exergue les thématiques sur lesquelles un effort plus important, une attention particulière devaient être portés. »
Aussi semble-t-il difficile de considérer que le deuxième défi de la Stratégie nationale de recherche pourrait représenter le « socle de la nouvelle stratégie nationale de recherche dans le domaine de l’énergie », comme le suggère le chapitre correspondant de la stratégie nationale de recherche. Si les conséquences de ce glissement relatif ne doivent pas être exagérées, il peut être source de confusion ou d’incertitude pour la communauté de la recherche en énergie.
Une clarification sur l’articulation entre les orientations du deuxième défi de la Stratégie nationale de recherche et la Stratégie nationale de recherche en énergie apparaît, de ce fait, souhaitable à l’occasion d’une prochaine itération de ces deux documents.
II. LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE : UNE BASE DE TRAVAIL SOLIDE
L’OPECST salue la démarche collective d’élaboration de la Stratégie nationale de recherche en énergie, ainsi que le travail très important qui a été réalisé par l’ensemble des participants. Le document d’une cinquantaine de pages qu’ils ont produit constitue une base de travail solide, dont il convient, à présent, de mettre en œuvre les différentes orientations.
A. LE FRUIT D’UNE LARGE CONCERTATION
La démarche d’élaboration de la Stratégie nationale de recherche en énergie, placée, tout comme celle de la précédente stratégie, sous la double responsabilité des ministères en charge de l’énergie et de la recherche, s’est appuyée sur deux instances : un secrétariat permanent et un comité de suivi.
Le secrétariat permanent, créé au début de l’année 2015, regroupe les services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (direction générale de l’énergie et du climat et commissariat général au développement durable) et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de la recherche et de l’innovation). L’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ont également participées aux travaux de ce secrétariat.
Quant au comité de suivi, mis en place en 2016, il rassemble les participants aux travaux du secrétariat permanent, ainsi que les ministères de l’agriculture et de l’industrie, quatre des cinq alliances de recherche (en plus d’ANCRE, les alliances ALLENVI pour le volet environnement, ALLISTENE pour le numérique, ATHENA dans le domaine des sciences sociales), les organismes publics de recherche, des entreprises, et d’autres organisations (fédérations professionnelles, organisations syndicales, associations, collectivités territoriales et élus). Ce comité s’est réuni à trois reprises, en mars, juin et septembre 2016. Il a été consulté sur la méthode et les axes de travail ainsi que sur les orientations stratégiques proposées et le document lui-même.
Conformément à la loi, les régions ont également été consultées, au travers de l’Association des régions de France. Le Conseil national de la transition énergétique et le Conseil supérieur de l’énergie ont eux aussi été saisis pour avis.
À l’occasion des différentes auditions organisées dans le cadre de cette étude, aucun des interlocuteurs rencontrés n’a exprimé de critique sur ce processus d’élaboration. Contrairement à la précédente Stratégie nationale de recherche en énergie de mai 2007, celle de 2017 apparaît donc réellement comme le fruit d’un travail collectif, même si le rythme des réunions du comité de suivi apparaît insuffisant, en regard de la complexité du travail entrepris. Il s’agit incontestablement d’un progrès significatif.
Néanmoins, il serait sans doute souhaitable, pour la suite des travaux consacrés à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en énergie, de trouver les modalités adéquates pour permettre une participation plus directe des chercheurs à ce processus d’élaboration, tout comme du monde de l’entreprise, y compris les PME-PMI et ETI.
À cet égard, la création d’une commission nationale chargée d’évaluer l’avancement des recherches en énergie, proposée dans le cadre de l’évaluation de la précédente stratégie, apparaît toujours pertinente.
2. Les apports des travaux de la SNR à la SNRE
Si l’articulation entre la Stratégie nationale de recherche et son volet énergétique apparaît moins élémentaire qu’attendu, les travaux menés pour l’élaboration de la première ont assez directement alimenté ce dernier, comme l’a montré, à l’occasion de l’audition publique du 9 février 2017, M. Pierre Vala, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation, au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « On peut mettre en exergue le fait que les travaux de cet atelier énergie de la SNR, menés en 2014, ont nourri l’élaboration de la SNRE qui vient d’être publiée. Outre les contributions des alliances de recherche et du CNRS, on peut souligner le fait que certains thèmes mis en évidence dans ces ateliers se retrouvent assez directement dans la SNRE : citons notamment l’idée selon laquelle la problématique de l’énergie invite à une approche système nécessitant de jouer la complémentarité entre les filières, un cadre de stabilité suffisant pour les programmes de recherche, en vue d’une intégration cohérente sur le long terme, l’importance d’une recherche fondamentale de haut niveau, dont l’apport est critique pour l’émergence de concepts en rupture, le fait que c’est à l’aune des perspectives du marché et de la concurrence internationale que les priorités sectorielles en matière de R&D doivent être définies, la valorisation du levier communautaire à l’échelle européenne, indispensable pour se maintenir parmi les grandes nations en matière de R&D, l’évolution des politiques publiques à différents échelons (local, national, international), avec l’émergence de nouveaux acteurs et modes de gouvernance pour l’environnement local ou encore l’importance de démonstrateurs à l’échelle des territoires, et enfin la nécessaire pris en compte de la transition numérique dans la transition énergétique. »
Même si elles n’ont abouti, du fait de sa structure, qu’à un nombre très limité d’orientations stratégiques spécifiquement énergétiques, les réflexions menées dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche ont, en réalité, concerné, pour une large part, des enjeux de la recherche en énergie, comme le montre le compte rendu des travaux de l’atelier correspondant. La synergie entre ces deux démarches stratégiques apparaît donc beaucoup plus forte, au niveau de leur élaboration, que ne pourrait le laisser penser un simple examen des documents résultants, aux objectifs bien distincts.
3. Le rôle des alliances de recherche
Les cinq alliances thématiques de recherche ont été créées, sous l’impulsion du ministère chargé de la recherche, à partir de 2009, donc, postérieurement à la publication première Stratégie nationale de recherche en énergie. Ces instances de concertation regroupent les principales institutions de la recherche publique, notamment afin de mieux coordonner les priorités de recherche et développement.
Leur apparition dans le paysage français de la recherche a, incontestablement, facilité la coordination entre les différents acteurs dans la phase d’élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie et permis une prise en compte plus systématiques de leurs contributions.
Cela a naturellement été, au premier chef, le cas pour l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie, ainsi que l’a rappelé son président, M. Didier Houssin, lors de l’audition publique du 9 février 2017 : « L’Alliance a donc été très impliquée, dès l’origine, dans l’élaboration de cette Stratégie nationale, avec notamment la présence de deux de ses représentants dans le secrétariat permanent de la SNRE et des quatre membres fondateurs dans son comité de suivi. »
Cet apport s’est, par exemple, concrétisé par la mise à jour de seize fiches présentant, pour chaque filières énergétique, l’état de l’art, les verrous technologiques à lever, la répartition des compétences et le potentiel de développement économique.
Il a également porté sur la prise en compte de cinq priorités, initialement élaborées pour la Stratégie nationale de recherche. Elles concernent : l’accélération des efforts de recherche sur les trois invariants des scénarios de transition énergétique (réduction de la consommation finale d’énergie, développement d’énergies renouvelables compétitives, optimisation des systèmes énergétiques), la capitalisation sur les atouts compétitifs des filières hydrocarbures et nucléaire, la facilitation des ruptures technologiques susceptibles d’avoir un fort impact sur la transition énergétique, l’amélioration de la compréhension des comportements des acteurs, le développement de nouveaux modèles de marché adaptés et, enfin, l’émergence de concepts innovants pour l’énergie.
B. UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE À PROLONGER
1. Une multiplicité d’objectifs et de contraintes
Alors que la précédente Stratégie nationale de recherche en énergie devait répondre à un nombre restreint d’objectifs, précisés à l’article 5 de la loi du 13 juillet 2005, la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie doit, a minima, intégrer les onze objectifs définis pour la recherche en énergie à l’article 183 de la loi du 17 août 2015 et ceux, plus généraux, qualitatifs et quantitatifs, de la même loi, tout en prenant en compte les orientations de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ainsi que les cinq orientations stratégique « pour une énergie propre sûre et efficace » proposées par la Stratégie nationale de recherche de 2015.
Le chapitre d’introduction de la Stratégie nationale de recherche en énergie récapitule l’essentiel de ces différents objectifs et orientations, en rappelant également, à juste titre, la nécessité du maintien de la cohérence avec un certain nombre d’autres stratégies nationales, relatives au développement de la mobilité propre, à la transition écologique vers un développement durable 2015-2022, à la bioéconomie, à la biomasse, aux infrastructures de recherche et à l’enseignement supérieur, ainsi qu’avec le cadre européen et mondial de la recherche en énergie.
Par un souci, compréhensible, d’exhaustivité, le législateur a ainsi placé les rédacteurs de la Stratégie nationale de recherche en énergie dans la situation délicate de devoir prendre en compte, dans un contexte déjà complexe, une multiplicité d’objectifs et d’orientations, sans possibilité d’établir entre eux un ordre de priorité. Ceux-ci sont parvenus à contourner en partie cette difficulté, en déclinant une large palette de dispositions destinées à répondre de la façon la plus complète possible à l’ensemble de ces exigences.
Cette absence de priorisation constitue la principale faiblesse de la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie, tout comme de la précédente. Elle découle de l’absence, en amont de sa rédaction, de choix politiques suffisamment clairs sur les principaux objectifs de la recherche en énergie française, dans le cadre d’une transition énergétique qui, comme le rappel fort opportunément l’introduction de la Stratégie nationale de recherche en énergie, s’inscrit dans un contexte de mobilisation européenne et mondiale pour le climat.
2. Quatre orientations stratégiques
La Stratégie nationale de recherche en énergie est structurée autour de quatre orientations stratégiques : « Cibler les thématiques et dynamiques transformantes clés pour la transition énergétique », « Développer la R&D et l’innovation en lien avec le tissu industriel », « Développer les compétences et les connaissances pour et par la R&D et l’innovation », enfin, « Créer une gouvernance légère et performante pour assurer le pilotage opérationnel dynamique de la SNRE ».
Les trois premières orientations décrivent les enjeux portant sur le fond de la recherche ou les modalités de son organisation, avant de proposer des actions structurantes.
La quatrième et dernière orientation propose une démarche de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en énergie.
3. Quinze actions structurantes
Chacune des trois premières orientations de la Stratégie nationale de recherche en énergie se conclue par plusieurs actions structurantes, destinées à guider la mise en œuvre de celle-ci.
Ces actions, au nombre de dix au total pour ces trois orientations, concernent : le renforcement du caractère interdisciplinaire de la recherche ; la réalisation d’analyses comparatives des différentes solutions de flexibilité des réseaux ; l’amplification; en particulier en lien avec les collectivités locales; du déploiement de démonstrateurs de nouvelles technologies et solutions ; le renforcement du soutien au développement des PME et ETI du secteur ; la structuration des filières industrielles françaises de l’énergie ; la promotion des collaborations internationales et de la visibilité mondiale des acteurs de la recherche française ; la mise en œuvre de nouveaux réseaux thématiques de chercheurs; sur le modèle de celui existant pour le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) ; la création de capacité de modélisation et de prospective en vue d’élaborer des scénarios énergétique ; la mise en place de nouvelles formations pour les métiers de la transition énergétique ; l’association de la société civile aux projets de démonstration dans les territoires.
De la même façon, la quatrième orientation « Créer une gouvernance légère et performante pour assurer le pilotage opérationnel dynamique de la SNRE », prévoit cinq actions structurantes : réunir le comité des parties prenantes sur un rythme annuel après l’adoption de la stratégie, prévoir une évaluation de la stratégie par l’OPECST, mettre en place un échange régulier avec les régions sur les actions de soutien à la recherche, les priorités et les données de financement, suivre le respect par la France de l’engagement de doublement des financements publics de la recherche dans les énergies durables, et, enfin, s’assurer de la bonne complémentarité des dispositifs de financement de la recherche au niveau français et international.
L’ensemble de ces actions, issues de la concertation entre les parties prenantes, peuvent contribuer à faire progresser la recherche française dans le domaine de l’énergie.
Néanmoins, comme pour le reste du document, les dix premières actions apparaissent insuffisamment hiérarchisées, alors même qu’elles sont de natures très différentes. Surtout, aucune précision n’est fournie, les concernant, sur la façon dont elles pourront être mise en œuvre, sur les conditions à réunir à cette fin ou sur l’entité portant la responsabilité de chacune d’entre elles.
On pourrait considérer que la réponse à ces questions est apportée par la dernière orientation, puisque celle-ci porte justement sur la gouvernance de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en énergie.
Toutefois, cette dernière consistant, dans un souci de simplification de la démarche, à reconduire les instances de concertation qui ont permis l’élaboration de la stratégie, les responsabilités sur la mise en œuvre de ces actions structurantes demeurent diluées. Il est donc difficile de juger à ce stade, alors que la stratégie nationale de recherche en énergie vient à peine d’être publiée, de l’efficacité de l’organisation proposée.
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a clairement indiqué, lors de l’audition publique du 9 février 2017 qu’il considérait la SNRE comme un point de départ : « Je conclurai en indiquant que la SNRE n’est, au niveau des ministères, qu’un point de départ d’un travail de mise en œuvre à mener avec le comité de suivi, pour envisager les actions à entreprendre et effectuer une évaluation glissante jusqu’au terme des cinq années, où la Stratégie devra être révisée. »
Il semblerait très utile qu’une autorité politique puisse assurer un pilotage rapproché de la mise en œuvre d’une telle stratégie, qui nécessiterait un réajustement régulier, en fonction des progrès réalisés ou, au contraire, des difficultés rencontrées. C’est le cas dans d’autre pays, par exemple aux États-Unis, où la Commission de la science, de l’espace et des technologies est précisément chargée, au sein du Congrès, d’un tel suivi.
À tout le moins, il apparaitrait pertinent, comme le suggère la douzième action structurante, que l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques prolonge, au cours de la prochaine législature, la présente évaluation, réalisée quelques semaines seulement après la publication de la Stratégie nationale de recherche en énergie, par une seconde étude destinée à évaluer, comme le prévoit la loi, les conditions de sa mise en œuvre.
III. TROIS ORIENTATIONS PRIORITAIRES POUR CONSOLIDER LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE
En l’absence de hiérarchisation des actions structurantes proposées par la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie, il apparaît utile de mettre en avant trois orientations relatives à la définition d’objectifs clairs pour la recherche en énergie et à l’accélération de la recherche et de l’innovation.
A. LE BESOIN DE DÉFINIR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE EN ÉNERGIE.
1. Le manque d’une vision partagée
Malgré l’ampleur de la concertation organisée en préalable au vote de la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte, il n’existe pas, en France, de vision largement partagée de l’avenir du système énergétique du pays. La question énergétique demeure un sujet polémique, objet d’affrontements dogmatiques et convenus.
Ainsi, le sujet de l’énergie n’est-il que rarement abordé sous l’angle d’enjeux nationaux fondamentaux, comme ceux de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ou de notre dépendance énergétique, résultant de la persistance des usages des hydrocarbures. L’essentiel des échanges semble se cristalliser autour d’une opposition artificielle entre énergie nucléaire et énergies renouvelables.
Pourtant, ces deux modes de production d’électricité apparaissent complémentaires. L’énergie nucléaire a su, en devenant plus flexible, s’adapter à l’intermittence de l’éolien et du solaire. Qui plus est l’électricité ne correspond, à peu de choses près, qu’au quart de notre consommation d’énergie finale, bien après le pétrole, à un niveau équivalent à celui du gaz.
Une grande majorité de nos concitoyens s’accorderaient pourtant sur l’idée simple que, face au péril climatique, la priorité est bien de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, émetteurs de gaz carbonique, soit en diminuant notre consommation, soit en y substituant une énergie décarbonée, tout en préservant l’accessibilité de l’énergie à un prix raisonnable. À cet égard, la péréquation tarifaire, particularité française, constitue un atout, permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement sur tout le territoire.
Nos concitoyens, nos administrations, nos entreprises et les élus partageraient aussi une vision d’un système énergétique équilibré, comportant, d’un côté, des énergies renouvelables décentralisées (éolien, solaire, bois…), destinées à satisfaire des besoins locaux, et, de l’autre, des centrales puissantes et pilotables, nécessaires à la sécurité d’approvisionnement des usines et des bureaux, ainsi que du réseau, avec entre ces deux pôles, la gestion intelligente des réseaux et de l’effacement de la priorité de consommation, ainsi que des moyens de stockage, notamment le système hydraulique avec les barrages et les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), qu’il convient de développer.
L’absence d’un large consensus sur quelques principes simples ne permet ni d’emporter l’adhésion des Français – alors que nos voisins allemands, parce qu’ils partagent une vision de leur futur énergétique, acceptent sans protester de payer leur électricité au double du prix pour subventionner les énergies renouvelables, ni de donner une direction claire à la recherche en énergie.
Le manque d’une telle vision explique, au moins en partie, la multiplicité des objectifs et orientations assignés à la Stratégie nationale de recherche en énergie. Il apparaîtrait donc souhaitable, à tout point de vue, que le Gouvernement puisse définir et communiquer une vision claire de l’avenir énergétique du pays, de façon à ce que celle-ci puisse être partagée par une large majorité de nos concitoyens.
2. La nécessité d’objectifs propres à la recherche en énergie
De fait, les objectifs de la recherche en énergie ne peuvent se résumer à une récapitulation des orientations nationales ou internationales en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. De toute évidence, la recherche française ne résoudra pas, à elle seule, l’ensemble des défis scientifiques et technologiques liés à la transition énergétique, en France et dans le monde.
C’est ce qu’a rappelé, à l’occasion de l’audition publique du 9 février 2017, M. Olivier Appert, président de France Brevets et du Conseil français de l’énergie qui est également délégué général de l’Académie des technologies et président du groupe de travail de l’ANRT sur la Stratégie nationale de recherche en énergie : « Les problématiques de l’énergie, tout comme la diffusion de la technologie, sont clairement mondiales. Il est donc indispensable que la stratégie de recherche vise le marché mondial. Elle doit par ailleurs avoir pour objectif de créer des emplois ».
Ce n’est pas non plus en éparpillant ses efforts qu’elle pourra le mieux y contribuer. Il ne s’agit évidemment pas d’abandonner, du jour au lendemain, des pans entiers de la recherche française dans ce domaine, mais de concentrer sur les pistes où elle se trouve la mieux positionnée, sur le plan scientifique et industriel, des ressources suffisantes pour renforcer cette avance, afin de conduire à des applications créatrices de nouveaux emplois.
M. Didier Houssin, président de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie a insisté, lors de cette même audition publique, sur la nécessité d’une clarification des priorités : « Face à la prolifération des stratégies nationales, il est tout d’abord important de les mettre en cohérence générale, autour de priorités clairement affichées par les pouvoirs publics, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, à savoir décideurs politiques, monde académique et de la recherche, industriels et société civile. »
Aussi, revient-il au Gouvernement de définir des objectifs précis et en nombre limité pour la recherche française en énergie, prenant en compte à la fois la vision de l’avenir énergétique national et le caractère international de la recherche sur l’énergie, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique.
B. L’ACCÉLÉRATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
1. Le besoin d’une accélération de la recherche scientifique en énergie
L’atteinte des objectifs de réduction à deux degrés du réchauffement climatique et ceux définis dans par la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte nécessitera, dans le domaine de l’énergie, de véritables ruptures scientifiques. C’est ce qu’a confirmé M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, en ouverture de la première table ronde de l’audition du 9 février 2017 : « Tous les exercices de scénario conduits par divers acteurs nationaux et internationaux postulent, pour atteindre des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies, l’émergence et la diffusion d’évolutions technologiques fortes. »
Malheureusement, ainsi que l’a rappelé M. Olivier Appert, président de France-Brevets et du Conseil français de l’énergie, lors de la même audition publique : « les ruptures scientifiques ne se décrètent pas ». Pour autant, les exemples passés de survenue de telles ruptures peuvent permettre de cerner quelques conditions susceptibles de favoriser leur apparition.
2. Identifier de nouveaux modes de financement de long terme
Le processus créatif ne se limite pas à une recombinaison, cumulative et interactive, de connaissances existantes. Bien entendu, certaines découvertes sont de nature incrémentale et résultent du perfectionnement de technologies acquises ou de l’approfondissement de voies de recherche déjà consolidées. Mais les plus décisives impliquent d’explorer de nouvelles approches scientifiques, plus incertaines, voire hasardeuses.
Il faut laisser aux chercheurs la liberté d’explorer, de trouver et, parfois, d’échouer, car il ne peut y avoir d’injonction à inventer ou à trouver. Il faut fluidifier la recherche et donner à l’intelligence des chercheurs l’opportunité de s’exprimer. Les découvertes de rupture nécessitent, bien sûr, avant tout de la chance et du génie. Les images d’Archimède dans sa baignoire ou de Newton sous son pommier viennent tout naturellement à l’esprit. Mais la chance et le génie ne suffisent pas, si le chercheur n’a plus la liberté d’explorer.
Aussi faut-il privilégier les financements à long terme, qui conduisent à sélectionner les meilleurs chercheurs, au travers de l’évaluation par les pairs, plutôt que de travailler uniquement, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, dans une logique de projet, avec des finalités prédéterminées. Il faut leur donner la possibilité d’adopter, le cas échéant, de nouvelles approches, lorsque celles initialement choisies s’avèrent infructueuses. Il faut, enfin, une hiérarchie capable de les accompagner, en assurant un suivi de qualité de leurs recherches, ainsi qu’un soutien intellectuel, quasiment moral, et financier de leur inventivité.
C’est ce qu’a, par exemple, mis en évidence une étude (2) de 2011, de l’école de gestion de l’Institut de technologie du Massachusetts (en anglais, Massachusetts Institute of Technology ou MIT), qui montre que les scientifiques sont plus souvent susceptibles d’aboutir à des recherches innovantes s’ils suivent des objectifs et bénéficient de financement de long terme, que si leurs travaux s’inscrivent dans des projets à court terme.
Or, le financement de la recherche française s’est plutôt orienté, depuis plus d’une dizaine d’années, vers un renforcement progressif de la part des financements sur projets. Ces derniers présentent, en effet, des avantages indéniables, en termes de mesure de l’efficience des investissements réalisés, mais surtout d’absence d’engagement budgétaire récurent.
Une formule intermédiaire, pour rééquilibrer les financements vers le long terme, pourrait consister à sélectionner les meilleurs chercheurs, plutôt que des projets. S’il existe aux États-Unis (l’étude susmentionnée se fonde précisément sur les résultats obtenus avec des financements de la fondation Howard Hughes Medical Institute s’inscrivant dans cette logique), un tel mode de financement est relativement peu pratiqué en France.
Un exemple en a tout de même été fourni par Mme Clarisse Angelier, déléguée générale de l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), lors de l’audition publique du 9 février 2017, dans le contexte particulier des Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), relevant d’un financement partenarial public-privé, qui concernent cent à cent-cinquante doctorants chaque année, dans le domaine de l’énergie, plus de quatre mille tous secteurs d’activité et toutes disciplines scientifiques confondus.
Il s’agirait donc d’étendre ce type de dispositif à des chercheurs ayant déjà terminé leur thèse, pour financer leurs recherches dans un domaine donné, par exemple sur une période de quatre ou cinq ans, en leur donnant la possibilité d’adopter, le cas échéant, de nouvelles approches, lorsque celles initialement choisies s’avèrent infructueuses. Un tel financement devrait, bien évidemment, être accompagné d’une évaluation par les pairs de haut niveau, permettant d’assurer des échanges riches et un suivi de qualité des recherches menées.
À cet égard, l’intérêt de nouvelles formes de partenariat entre la recherche publique et les entreprises a été souligné, lors de l’audition publique du 9 février 2017, par M. Philippe Baptiste, directeur scientifique de Total : « Je crois par ailleurs que des passerelles public-privé restent encore à construire, au-delà simplement du recrutement d’étudiants ou de jeunes post-doctorants. Il faut établir des passerelles en termes de ressources humaines, entre des chercheurs qui sont aujourd’hui dans les laboratoires publics et qui pourraient venir demain dans nos laboratoires privés, mais aussi dans l’autre sens. »
3. La dichotomie artificielle entre recherche fondamentale et appliquée
La séparation entre recherche fondamentale et appliquée est relativement récente dans l’histoire des sciences, qui comporte de multiples exemples de recherches dirigées vers un objectif déterminé ayant conduit à des découvertes théoriques majeures, l’inverse étant tout aussi vrai.
Pour tracer de nouvelles voies de progrès, il s’avère souvent nécessaire, pour les organismes de recherche, les écoles et les universités, de transcender cette dichotomie entre science fondamentale et science appliquée qui s’est progressivement installée dans le vocabulaire courant. Cette dichotomie apparaît non seulement artificielle, mais dommageable pour le développement de la science, et même pour l’impact de la science sur l’économie. En effet, il n’existe que de la bonne recherche et de la mauvaise recherche, ainsi que des applications de la recherche.
C’est particulièrement vrai pour un enjeu majeur, comme celui de la lutte contre le changement climatique ou la transition énergétique. Cette question n’est pas spécifique à l’organisation de la recherche en énergie en France. Ainsi, est-elle abordée dans un article paru en octobre 2016 dans la revue Nature, traitant de l’accélération de l’innovation au sein des laboratoires du département de l’énergie américain (3) (les National Laboratories du Department of Energy).
Son importance a été soulignée par plusieurs des intervenants au cours l’audition du 9 février 2017. Ainsi, M. Didier Houssin, président de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie a-t-il noté que « La pluralité des guichets de financement porte en outre parfois préjudice à la continuité des financements alloués aux projets de recherche, ainsi qu’à l’articulation entre recherche fondamentale et technologique. » Quant à M. Sylvain David, directeur adjoint scientifique de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS, il a cité un exemple d’application de la recherche fondamentale en astroparticules, consistant « à utiliser les muons cosmiques pour faire de l’imagerie en trois dimensions des gisements d’uranium ».
M. Frédéric Ravel, directeur du secteur énergie au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, pour sa part, souligné qu’organiser des espaces d’échange entre chercheurs d’univers différents peut faciliter l’émergence des ruptures : « Le terme rupture tel qu’utilisé dans la vie quotidienne sous-entend la séparation de deux mondes. Or, dans la recherche, ceci relève plutôt de la rencontre de deux univers : pour que des ruptures se produisent, il faut en effet faire se rencontrer des populations, des types de chercheurs, qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. »
M. Michel Latroche, directeur de recherche au sein de l’Institut de chimie et des matériaux Paris Est du CNRS, a mentionné l’exemple du réseau RS2E (Recherche sur le stockage électrochimique de l’énergie) : « créé par le CNRS sous l’égide du ministère de la recherche, il met en contact des acteurs publics et privés, pour accélérer la recherche fondamentale et l’industrialisation des nouvelles technologies des batteries et des supercondensateurs. »
Ce type de structure transverse, associant recherche amont et recherche technologique, voire acteurs industriels, apparaît particulièrement adapté à l’émergence de découvertes incrémentales et de ruptures, ainsi qu’à l’accélération de leurs applications.
4. L’incontournable respect des engagements internationaux
La France s’est engagée en 2015, avec les autres pays signataires de l’accord de Paris, dans une course de vitesse contre le changement climatique. qui impose de modifier profondément, et dans un temps très court, les modes de productions et de consommation de l’énergie.
Malgré toutes les dispositions qui pourront être prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en énergie, pour faciliter l’émergence d’innovations de rupture, la question des moyens reste majeure. C’est ce que confirmait M. Michel Latroche le 9 févier 2017 : « Je suis d’accord avec le fait que les ruptures technologiques ne se décrètent pas. Elles existent néanmoins et sont globalement de l’ordre de la décennie. Je pense notamment au lithium ion ou au photovoltaïque sur les pérovskites. On sait que ces ruptures existent ; il faut ensuite s’en donner les moyens. Si les laboratoires ne disposent pas des moyens suffisants pour développer cette recherche, ils ne pourront pas produire de ruptures technologiques. »
Aussi, dans le cadre de la Mission innovation, avec vingt-et-un autres pays et la Commission européenne, la France a décidé de doubler, sur la période 2015-2020, le montant des investissements publics dans la recherche et le développement pour les énergies durables. Cet engagement budgétaire qui reste à concrétiser en France a déjà pris effet dans d’autre pays, par exemple aux États-Unis, où le budget de la recherche en énergie devrait être abondé à hauteur de quatre milliards de dollars supplémentaires jusqu’en 2020.
Compte tenu du rôle majeur de notre pays dans ces négociations, ne pas donner suite à ces engagements le placerait dans une position difficile, et aurait, par ailleurs, un impact sur la compétitivité de la France dans le domaine industriel, par rapport aux pays qui les respecteront.
C. L’IDENTIFICATION DE FILIÈRES D’AVENIR
1. Préparer l’industrialisation en amont
Dans le rapport d’évaluation de la précédente Stratégie nationale de recherche, MM. Christian Bataille et Claude Biraux avaient préconisé la mise en place de feuilles de route (en anglais, roadmap), destinées à améliorer la visibilité sur les échéances d’industrialisation des recherches : « La stratégie doit présenter des échéanciers des objectifs de recherche (roadmap), ainsi que des bilans prospectifs de moyen terme montrant comment l’aboutissement des recherches au niveau industriel permet de répondre à l’évolution des besoins d’énergie. Cela suppose l’appui d’une unité de prospective ».
L’importance de cette démarche pour le cadencement des innovations technologiques, en vue de l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a été également soulignée, à l’occasion de l’audition publique du 26 mai 2016, au nom de l’alliance ANCRE, par M. Jean-Guy Devézeaux
de Lavergne, directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé) du CEA : « Nous avons montré que des tensions risquaient de se produire vers 2030 et qu’il est de ce fait important d’avancer et de développer ces technologies. Ceci nécessite d’élaborer des feuilles de route ou roadmaps et de travailler sérieusement sur ces sujets, de façon pluridisciplinaire ».
M. Olivier Appert est revenu, durant l’audition publique du 9 février 2017, dans le cadre de la présentation d’une synthèse de l’ANRT, sur cette notion de feuille de route, en pointant qu’elle constitue une occasion d’impliquer plus fortement des entreprises, jusque-là relativement peu engagées dans le processus d’élaboration de la stratégie : « Il est indispensable de renouveler notre capacité d’analyse collective en impliquant tous les acteurs et pas uniquement les acteurs publics. Ceci devrait se faire par l’élaboration de feuilles de route sur quelques grandes filières, avec des objectifs chiffrés et partagés. »
Cet atout des feuilles de route a été confirmé, durant la même audition, par M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la direction générale de l’énergie et du climat : « S’ajoute à cette démarche la dimension de travail avec les entreprises. La vision développée dans les feuilles de route doit en effet pouvoir être réalisée en associant les groupes programmatiques d’ANCRE et les entreprises. Cet objectif doit pouvoir se concrétiser à l’occasion des prochaines mises à jour de nos feuilles de route. »
L’utilité des feuilles de route pour coordonner l’action de l’ensemble des acteurs d’une filière avait d’ailleurs été illustré par MM. Laurent Kalinowski, député, et Christian Pastor, sénateur, dans le cadre d’un rapport de l’OPECST sur l’hydrogène-énergie, publié en 2013 : « Nos entretiens sur place nous ont permis de constater qu’une fois identifié le potentiel de la filière hydrogène énergie, l’Allemagne et le Japon ont suivi une méthodologie somme toute assez similaire... ils ont défini, pour chacun des domaines d’application visés, une feuille de route précisant les objectifs scientifiques et industriels à atteindre. Ces derniers ont été fixés en commun accord avec les acteurs concernés, notamment les industriels qui seront conduits à réaliser l’essentiel des investissements. »
De plus, l’élaboration de ces feuilles de route, déjà engagée par l’ANCRE, permet de bien identifier les différentes étapes à franchir avant l’industrialisation d’une solution, par exemple les verrous technologiques restant à lever, ou les coûts qu’il reste nécessaire de baisser, pour assurer sa viabilité commerciale.
2. Prendre la mesure des obstacles réglementaires
Plusieurs rapports récents de l’OPECST ont identifié l’importance majeure des obstacles réglementaires, pour la recherche et la diffusion des innovations. En effet, si certains verrous technologiques peuvent s’avérer difficiles à lever, il en va de même avec les verrous réglementaires.
Dans le monde du bâtiment, cette question a fait l’objet d’un rapport spécifique de M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Marcel Deneux, sénateur, publié en 2014, intitulé : « Les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment : le besoin d’une thérapie de choc ». Ce rapport avait, notamment, mis en évidence que, dans la mesure où de tels freins peuvent intervenir à plusieurs niveaux, les identifier, avant de parvenir éventuellement à les lever, peut s’avérer relativement complexe.
Ainsi, dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, les rapporteurs ont identifié trois domaines pouvant produire des freins réglementaires à l’innovation : « au niveau des procédures évaluant la sécurité et la qualité des produits… des aides publiques… [et] des règles de la construction en général et à la réglementation thermique en particulier ».
Ce problème a été également soulevé, à un stade de développement moins avancé, par M. Laurent Kalinowski, député, et M. Jean-Marc Pastor, sénateur, dans leur rapport de 2013 sur la filière hydrogène énergie. Dans ce cadre, ils ont préconisé la mise en œuvre de mesure transitoires destinées à faciliter les recherches ou les premières expérimentations de nouvelles technologies : « Mais la réussite de cette démarche d’innovation implique aussi de repenser les procédures réglementaires. La réglementation fournit un cadre essentiel au développement économique, mais son adaptation à de nouvelles technologies ou de nouveaux usages requiert forcément du temps. En attendant, des dispositions provisoires doivent permettre de statuer, dans des délais acceptables, sur les projets innovants. »
À cet égard, la mise en place de feuilles de route par filière industrielle pourrait également permettre d’identifier ces difficultés, afin de les prendre en compte suffisamment en amont des premières phases de déploiement d’une nouvelle solution pour pouvoir les traiter dans la réglementation ou dans la loi.
IV. L’IDENTIFICATION D’AXES DE RECHERCHE PRIORITAIRES
La Stratégie nationale de recherche en énergie répertorie un très grand nombre de voies de recherche, aussi bien sur les technologies à développer, sur les sciences de base nécessaires ou les sciences humaines et sociales permettant d’accompagner les futures innovations.
Ce foisonnement ne permet pas d’identifier d’éventuelles voies prioritaires, de mesurer le chemin restant à parcourir pour chacune d’entre elles ou d’évaluer l’effort financier et humain à fournir pour les emprunter et parvenir à leur aboutissement.
L’identification de ces priorités pourrait découler des besoins propres à la transition énergétique française. À cet égard, la France dispose d’un immense avantage : son territoire s’étend sur tous les continents, toutes les latitudes et toutes les températures. A priori, elle a donc matière à explorer et à fabriquer toutes les formes d’énergie, et toutes les technologies associées.
Mais la recherche française en énergie s’inscrit également dans un cadre de coopération européenne et de concurrence internationale. Elle n’a donc pas réellement vocation à couvrir l’ensemble des pistes possibles. La priorité devrait, sans aucun doute, être donnée aux voies de recherche les plus prometteuses, en termes de développement économiques et d’emplois, et à celles pour lesquelles la France se trouve la mieux placée, sur les plans scientifique ou technologique.
Compte tenu des conditions de réalisation de la présente évaluation, explicitées plus haut, il n’a évidemment pas été possible d’examiner chacun des domaines de recherche couverts par la Stratégie nationale de recherche en énergie, comme réalisé dans le cadre de l’évaluation de la précédente stratégie, qui s’était déroulée sur une année.
Mais les travaux récemment menés par l’OPECST sur les questions énergétiques permettent de compléter, pour partie, les informations recueillies au cours des auditions individuelles et de deux auditions publiques organisées dans le cadre de la présente évaluation, sans permettre, toutefois, de couvrir de façon exhaustive l’ensemble des domaines de recherche à considérer, notamment en ce qui concerne la production d’énergie.
Ainsi, si les parlementaires membres de l’OPECST ont été parmi les premiers à s’intéresser aux énergies renouvelables avec, notamment, la publication, en 2001, par MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut, députés, d’un rapport sur l’état actuel et les perspectives techniques des énergies renouvelables, ce sujet n’a été revisité ces dernières années que sous l’angle des conditions d’intégration d’une part importante de production électrique d’origine éolienne et solaire dans le système énergétique national.
Aussi, le présent rapport ne traite-t-il que très partiellement des sujets de recherche importants tels que ces deux dernières formes d’énergie, ou encore l’énergie marine et les biocarburants. Une seconde étape de cette évaluation devrait notamment permettre de compléter cette première approche des différentes voies de recherche prioritaires.
A. LES RECHERCHES EN MATIÈRE DE PRODUCTION D’ÉNERGIE.
Si la production d’énergie constitue encore le premier domaine d’application qui vient à l’esprit en matière de recherche en énergie, celui-ci apparaît sans aucun doute moins prégnant aujourd’hui qu’il ne pouvait l’être en 2009, lors de l’évaluation de la première stratégie nationale de recherche en énergie.
C’est que des progrès considérables sont intervenus depuis, notamment dans le domaine des énergies renouvelables majeures que sont l’éolien et le solaire photovoltaïque, qui semblent presque arrivées à maturité. A contrario, la recherche sur les énergies traditionnelles, pétrolière et nucléaire, semble marquer le pas. Du moins, c’est l’image qui résulte de l’absence d’annonces majeures les concernant dans la dernière décennie.
1. La recherche sur l’énergie solaire
Le rayonnement solaire constitue la source d’énergie renouvelable la plus abondante et la mieux répartie sur la surface terrestre. Son exploitation fait appel à deux grandes types de solutions technologiques : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Toutes deux peuvent être mises en œuvre dans de grandes installations centralisées : centrales thermodynamiques ou fermes de panneaux solaires photovoltaïques, ou au contraire de façon décentralisée.
Le solaire photovoltaïque s’est clairement imposé au cours de la dernière décennie sur les solutions basées sur l’exploitation de l’effet thermique des rayons lumineux, moins en raison de ses performances intrinsèques, que des conditions de son industrialisation, qui ont permis une baisse très rapide des prix. Ainsi, en 2016, environ 75 GW de systèmes photovoltaïques ont été installés dans le monde, contre 50 GW en 2015 et 40 GW en 2014.
La domination écrasante des industriels chinois sur le marché des panneaux photovoltaïques, en raison de coûts de fabrication concurrentiels, voire volontairement minorés, doit conduire à concentrer les moyens de recherche sur des pistes technologiques susceptibles d’aboutir à des gains majeurs en termes de performances.
Comme le montre le graphique ci-après, présentant l’évolution du rendement des cellules photovoltaïques en laboratoire, c’est la technologie de cellules à quadruple jonctions développée par le CEA-LETI (Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information) et la société SOITEC, elle-même fondée par des chercheurs issus du CEA, en collaboration avec l’institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (en allemand, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ou ISE), qui présente, avec un rendement de 46 %, le potentiel le plus important dans ce domaine.
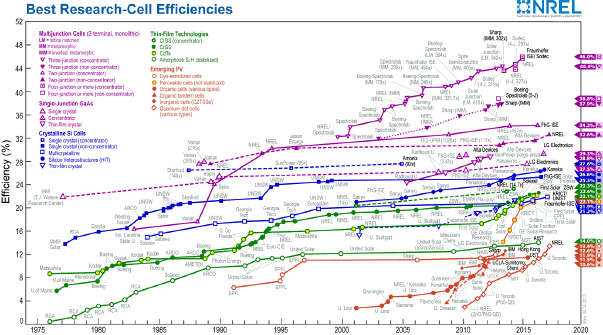
Évolution du rendement des cellules photovoltaïques obtenu en laboratoire
(source : National Renewable Energy Laboratory).
Cet exemple de réussite scientifique française et européenne, qui reste à transformer en succès industriel, démontre l’intérêt de poursuivre les recherches sur les technologies solaires de rupture. Néanmoins, les difficultés budgétaires devraient sans doute conduire à rationnaliser cet effort, en concentrant les moyens sur les voies les plus prometteuses, tout comme les centres de recherche.
Cette démarche vaut aussi bien pour les recherches sur le solaire photovoltaïque que pour celles sur le solaire thermique. S’agissant de ces dernières, on peut ainsi légitimement s’interroger sur la dispersion des ressources entre, d’une part, le PROMES, unité de recherche du CNRS implantée en région Occitanie, disposant notamment, à Odeillo, de l’un des deux plus puissants fours solaires au monde et, d’autre part, l’Institut national de l’énergie solaire (INES) du CEA, près de Chambéry, qui s’intéresse tout à la fois au solaire photovoltaïque, au solaire thermique et à l’énergétique du bâtiment.
2. La recherche sur l’énergie éolienne
La question de l’énergie éolienne n’a pas été abordée en tant que telle durant les auditions privées et les deux auditions publiques organisées dans le cadre de la présente étude, pas plus que dans les récents rapports de l’OPECST.
Comme pour l’énergie solaire photovoltaïque, l’éolien a connu, ces dernières années, un développement très rapide, accompagnant une forte baisse des prix, aussi pour l’éolien à terre que pour l’éolien en mer.
La France métropolitaine, avec ses 3 500 kilomètres de côtes, bénéficie de conditions géographiques très favorables au développement de l’éolien en mer. Devant l’Allemagne et derrière la Grande-Bretagne, elle bénéficie du deuxième gisement éolien d’Europe. Si l’on y ajoute les territoires d’outre-mer, la France dispose probablement de l’un des premiers gisements éoliens au monde.
Deux priorités peuvent néanmoins être identifiées a priori dans ce domaine de recherche : d’une part, la conception de technologies de production permettant de faciliter l’intégration au réseau et à l’environnement, en réduisant la variabilité de cette forme d’énergie et ses impacts, et, d’autre part, l’éolien en mer flottant, adapté à la configuration de côtes à fort dénivelé, comme sur le littoral méditerranéen, mais permettant aussi d’éloigner les éoliennes des côtes, indépendamment de la configuration de ces dernières, donc de profiter de rendements plus favorables.
3. La recherche sur l’énergie hydraulique
En France, l’hydroélectricité demeure, avec une puissance installée de 25,4 GW, de loin la forme d’énergie renouvelable la plus développée, permettant de couvrir, suivant la pluviosité et les besoins, en moyenne 12 % de la consommation électrique, avec une production maximale de l’ordre de 70 TWh.
Cette dernière correspond à l’estimation par le Conseil mondial de l’énergie du potentiel brut hydroélectrique économiquement exploitable en France. De fait, le potentiel de développement des grandes installations hydroélectriques, qui nécessitent des configurations géographiques très spécifiques, serait réduit à quelques centaines de mégawatts sur le territoire national. L’exploitation de ce potentiel résiduel sera elle-même freinée par la résistance à la construction de nouvelles installations.
Néanmoins, deux axes de recherche dans ce domaine, répondant à la fois aux besoins d’évolution du système énergétique français et à ceux du marché international, apparaissent particulièrement prometteurs. Il s’agit, d’une part, de l’optimisation des installations hydroélectriques existantes, notamment pour maximiser leur potentiel de stockage de l’énergie et, d’autre part, de l’hydraulique diffus (parfois qualifié de « petit hydraulique »), avec la conception d’installations de taille réduite, décentralisées et respectueuses de l’environnement, permettant de bénéficier des avantages de cette énergie renouvelable prévisible, au plus près des besoins.
4. La recherche sur l’énergie nucléaire
Le parc nucléaire fournit de l’ordre des trois quart de l’électricité produite en France. Conformément à loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sa part dans la production d’électricité devrait décroître, à terme, à 50 %.
Dans leur rapport final, publié en décembre 2011, M. Christian Bataille, député, et M. Bruno Sido, sénateur, rapporteurs de la mission parlementaire sur « La sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir », proposaient déjà d’inscrire l’avenir de la filière nucléaire dans une « trajectoire raisonnée », permettant de réduire progressivement la part de production d’électricité d’origine nucléaire à 50 %, à l’horizon 2050, en remplaçant partiellement les réacteurs nucléaires en fin de vie par des réacteurs de nouvelle génération, plus sûrs.
En France, la recherche sur l’énergie nucléaire est menée principalement au sein des laboratoires du CEA et, pour une part, au sein de ceux du CNRS. Elle couvre essentiellement trois domaines : le maintien et l’optimisation des installations du parc nucléaire français, y compris l’EPR, la conception des réacteurs du futur, dits de quatrième génération, et la gestion des déchets radioactifs, qu’ils soient issus du parc nucléaire ou d’autres activités.
Ces deux derniers domaines correspondent à deux des trois axes de recherche définis par la loi du n° 91-1381 du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Le suivi des recherches correspondantes est assuré par la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs (CNE2), qui présente son rapport annuel devant les membres de l’OPECST.
Par ailleurs, tous les trois ans, l’OPECST procède à une évaluation du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Le rapport d’évaluation du PNGMDR 2013-2015, par M. Christian Bataille, député, et M. Christian Namy, sénateur, a été publié en septembre 2014. La publication de celui relatif à l’évaluation du plan 2016-2018 par les mêmes parlementaires membres de l’OPECST intervenant quelques jours après celle du présent rapport, il s’est avéré possible d’en intégrer les principales conclusions.
Dans leurs rapports, MM. Christian Bataille et Christian Namy estiment que l’effort de recherche sur le retraitement des combustibles usés et le réacteur de quatrième génération ASTRID, qui en constitue le complément indispensable, doit être non seulement poursuivi mais accéléré, si la France veut conserver sa position dominante dans ce domaine.
À côté, des études sur les réacteurs de quatrième génération, un autre axe de recherche prometteur concerne les petits réacteurs modulaires (en anglais, Small modular reactors ou SMR), d’une puissance limitée à environ 150 MW à 200 MW, contre 800 MW à 1 500 MW pour les réacteurs de production classiques. Comme l’a indiqué, à l’occasion de l’audition du 26 juin 2015, M. Bernard Sahla, responsable de la recherche et du développement au sein d’EDF : « L’idée est de produire des systèmes plus simples, plus sûrs, plus compacts, plus modulaires, plus faciles à construire et dont les coûts peuvent par conséquent être mieux maîtrisés ». Plusieurs pays travaillent sur ce nouveau concept de réacteur, basé sur les technologies utilisées dans le domaine militaire, pour la propulsion maritime. Ainsi, la Nuclear Regulatory Commission, ou NRC, autorité de sûreté nucléaire américaine, instruit depuis quelques mois un dossier d’agrément d’un tel réacteur.
Parce qu’elle disposait de peu de matières premières fossiles dans son sous-sol, la France a cherché à garantir, dès la fin de la première guerre mondiale, son approvisionnement en hydrocarbures. Avec la mécanisation des armées, ces derniers étaient en effet devenus une ressource stratégique. Ils fournissent encore aujourd’hui 45 % de l’énergie finale consommée en France, 98 % dans les transports. Ce secteur industriel représente aujourd’hui en France plus de 600 000 emplois directs, indirects et induits, pour un chiffre d’affaire global proche de 30 milliards d’euros.
Près d’un siècle après la création, en 1924, de la Compagnie française des pétroles, la France est devenue l’un des acteurs majeurs de l’industrie mondiale dans ce secteur, avec de grandes entreprises comme Total, Schlumberger (encore français pour partie), CGG Veritas, Technip ou Vallourec, plusieurs centaines de PME et ETI et un organisme de recherche, l’IFP-Énergies nouvelles, qui s’intéresse à la fois à l’optimisation de l’usage des ressources fossiles et au développement de nouvelles énergies, respectueuses de l’environnement.
Le rapport publié en 2013, par M. Christian Bataille, député, et M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, sur « Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels », complété en 2016 par une communication annexée au présent rapport sur « La dimension stratégique du développement de l’exploitation des gisements non conventionnels d’hydrocarbures aux États-Unis », illustrent l’importance de la recherche pour le maintien de la compétitivité des entreprises dans ce secteur, frappé depuis quelques années par la crise résultant de la baisse des prix.
À cet égard, M. Christian Bataille a souligné, dans sa communication, que les acteurs du secteur, au nombre desquels Total, se sont laissés surprendre par le développement des techniques non conventionnelles aux États-Unis. Il a montré l’importance de l’effort de recherche engagé dans ce domaine plusieurs décennies avant l’industrialisation de ces nouvelles technologies : « Face au déclin de la production nationale, les laboratoires fédéraux ont investi, dès la fin des années 1970, dans le perfectionnement, à la fois, de la technique du forage horizontal et de celle de la fracturation hydraulique, dans le cadre d’un projet de démonstration d’exploitation de gaz de schiste conduit en partenariat. »
Le maintien de la position enviable de l’industrie française dans ce secteur, donc des emplois correspondants, implique de maintenir l’effort de recherche, a fortiori de ne pas créer des barrières à la poursuite de celles-ci sur le territoire national. C’est ce que préconise le rapport susmentionné, en matière de techniques non conventionnelles d’exploitation des hydrocarbures. Ces orientations valent, plus largement, pour les recherches dans toutes les disciplines, de la géologie à la science des matériaux, qui contribuent à la compétitivité des entreprises françaises dans ce secteur.
B. LES RECHERCHES SUR L’INTÉGRATION DES ÉNERGIES VARIABLES
La question de l’intégration des énergies renouvelables variables au réseau électrique se trouve aujourd’hui au cœur des préoccupations des responsables de l’énergie. En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre implique de diminuer la consommation en énergies fossiles, par exemple en leur substituant, dans différent usages, une électricité générée à partir d’énergies décarbonnées : solaire, éolien, hydraulique ou nucléaire.
La part de l’énergie hydraulique étant limitée par la géographie, et celle de l’énergie nucléaire étant déjà très élevée en France, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait logiquement conduire à accroître fortement la production d’origine éolienne et solaire, deux énergies renouvelables, décentralisées et variables.
Leur intégration dans un réseau initialement conçu pour acheminer vers les consommateurs l’électricité produite par un nombre réduit de centrales nucléaire et thermiques pilotables suppose, d’une part, une adaptation du réseau électrique, qui doit devenir plus intelligent pour gérer des flux plus nombreux et plus diversifiés, et, d’autre part, de disposer de moyens supplémentaires, permettant de faire face aux variations de la production d’origine renouvelable, sans émission de gaz à effet de serre : le stockage de l’énergie, pour l’emmagasiner lors des pics de production et la restituer lors des creux, ainsi que l’effacement, permettant de réduire les pointes de consommation.
1. La recherche sur les réseaux intelligents
Les réseaux électriques constituent des infrastructures extrêmement complexes et étendues, parmi les plus complexes que l’être humain ait eu à construire. Initialement, ces réseaux ont été conçus pour distribuer, vers les utilisateurs, l’électricité produite dans quelques grandes installations de production, centrales électriques à flamme ou nucléaires, non pour intégrer des énergies renouvelables décentralisées, diffuses et distribuées sur l’ensemble du territoire. De ce fait, il apparaît indispensable d’adapter les réseaux électrique, basés sur des technologies éprouvées et parfois anciennes, en y intégrant de nouvelles technologies, issues notamment du numérique, tout en maintenant, autant que possible, leur niveau de sûreté actuel.
C’est ce qu’a souligné M. Patrick Panciatici, conseiller scientifique, RTE, à l’occasion de l’audition publique du 26 juin 2016 : « La France fait partie d’un très grand système électrique interconnecté. D’aucuns affirment que ce serait le plus grand système industriel jamais construit par l’homme. Ce système complexe fonctionne depuis longtemps. Il est important d’en comprendre l’architecture et le fonctionnement. Trente-quatre pays sont ainsi interconnectés dans le cadre du système électrique européen. Le but est d’essayer d’assurer une sécurité de fonctionnement et d’alimentation, ainsi qu’une optimisation économique à cette échelle. »
C’est ce qu’a également confirmé, durant la même audition, M. Nouredine Hadjsaid, professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble et à Virginia Tech, directeur du laboratoire IDEA-GIE et président du conseil scientifique de Think Smart Grids : « il existe deux réseaux distincts : le réseau de transport et le réseau de distribution, intégrés dans un réseau continental européen, dans le cadre duquel on ne dispose pas toujours d’une connaissance fine de ce qui se passe à l’extérieur, alors même que les électrons ne connaissent pas les frontières… Les solutions et innovations développées doivent l’être en tenant compte de certaines contraintes, puisqu’elles doivent s’intégrer à l’existant… Il nous faut ainsi combiner les innovations les plus avancées avec des technologies qui existent depuis plus de trente ans, voire pour certaines depuis près d’un demi-siècle. Il s’agit là d’un défi majeur. »
Par ailleurs, les délais nécessaires à l’adaptation des réseaux électriques sont beaucoup plus longs que ceux requis pour le déploiement de moyens de production décentralisés. Ainsi, pour construire une nouvelle ligne électrique, suivant sa nature, au moins cinq à dix années sont nécessaires.
Les technologies dites de réseau intelligent (en anglais, smart grids), développées pour faire face à l’ensemble de ces défis, apparaissent très diversifiées, comme l’a également relevé M. Nouredine Hadjsaid : « le réglage de tension, les protections adaptatives pour faire face à toute défaillance dans le système, mais aussi les technologies d’auto-cicatrisation, permettant de limiter la durée des interruptions, donc les impacts. La question de la résilience de ces futurs réseaux est fondamentale, dans un contexte de variabilité forte et en augmentation. »
Un autre aspect concerne l’intégration massive des technologies numériques. Ainsi que l’a indiqué M. Patrick Ledermann, membre de l’Académie des technologies, à l’occasion de la même audition publique : « À cet égard, sur le plan technologique, le numérique va jouer un rôle très important, avec non seulement une meilleure prévision de consommation et de production, mais aussi le développement de compteurs et de réseaux intelligents, en lien avec les objets connectés, permettant aux consommateurs et aux gestionnaires de réseaux de définir les modalités d’effacement de la consommation, afin d’ajuster la demande à l’offre. »
Comme l’a, par ailleurs, précisé, lors de la même audition, M. Nouredine Hadjsaid : « Élaborer un modèle commun reste un défi majeur, notamment pour identifier les vulnérabilités et les effets de cascade entre infrastructures. Par exemple, face à la défaillance d’un logiciel ou d’une communication, l’existence d’une interpénétration importante entre les deux infrastructures fait que l’on doit comprendre quelles sont les interdépendances et comment les effets de cascade vont se produire d’une infrastructure à l’autre. »
2. La recherche sur le stockage d’énergie
Dans la plupart des pays, l’essentiel des réserves d’énergie sont aujourd’hui constituées par le stockage d’énergies fossiles. Ainsi, le pétrole représente à la fois une source d’énergie et un moyen de stockage de celle-ci, sous une forme très concentrée. Bien que son contenu énergétique soit moins dense, le gaz naturel emmagasiné dans les réseaux de pipelines et les réservoirs permet également un stockage massif d’énergie. En France comme aux États-Unis, l’uranium représente un autre réservoir extrêmement dense d’énergie, cent grammes de cette matière fournissant plus d’énergie qu’une tonne de pétrole.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre passant nécessairement par celle de la consommation des énergies fossiles, l’électricité décarbonnée, d’origine renouvelable ou nucléaire, prendra inexorablement une part croissante dans le bouquet énergétique. Or, elle ne peut être mise en réserve aussi facilement et directement que les énergies fossiles, et doit, de ce fait, être consommée juste après avoir été produite. Jusqu’à présent, la gestion de l’équilibre du réseau électrique est essentiellement assurée par le pilotage de moyens de productions centralisés, centrales à flamme ou nucléaires, en fonction des variations de la demande des consommateurs.
Mais le développement d’énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire, intermittentes car dépendantes des conditions météorologiques, vient augmenter les besoins de gestion des déséquilibres entre offre et demande sur le réseau électrique. Le besoin de réduire la part de la production d’électricité d’origine fossile impose de mettre en œuvre de nouveaux modes d’équilibrage du réseau électrique, parmi lesquels le stockage de l’électricité apparaît, de l’avis de la plupart des spécialistes, comme une composante incontournable.
C’est notamment l’avis exprimé, lors de l’audition du 26 juin 2016, après examen des solutions alternatives, par M. Davy Marchand-Maillet, directeur des opérations, Sun’R Smart Energy : « Le stockage est finalement le seul moyen qui permet d’absorber massivement la variabilité des énergies renouvelables, puisque la production classique, les réseaux et l’effacement sont limités. Seul le stockage peut être développé de façon massive, tout en étant rentable. »
Tel est également la conclusion de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir, dans son rapport final, publié au nom de l’OPECST, le 15 décembre 2011. Parmi les nombreux modes de stockages de l’électricité envisageables, cette même mission a préconisé de concentrer les efforts de recherche sur trois filières principales : les batteries électrochimiques, le stockage hydraulique, mentionné ci-dessus, et sous forme d’hydrocarbures de synthèse.
La production d’hydrocarbures de synthèses passe toujours par une première étape de production d’hydrogène, en principe par électrolyse, avec de l’électricité d’origine renouvelable ou nucléaire. L’hydrogène ainsi produit peut aussi être utilisé directement, par exemple pour la mobilité, via une pile à combustible ou par injection dans le réseau gazier.
Dans leur rapport intitulé : « L’hydrogène, vecteur de transition énergétique ? », publié au nom de l’OPECST en décembre 2013, M. Laurent Kalinowski, député, et M. Jean-Marc Pastor, sénateur, proposent cinq orientations pour structurer une filière hydrogène-énergie nationale. En matière de recherche, ils soulignent notamment l’importance d’une meilleure prise en compte de la dimension européenne des travaux sur l’hydrogène énergie, par exemple en développant la coopération scientifique avec nos voisins allemands, dans des domaines tels que les matériaux, l’électrolyse, la méthanation ou encore la sûreté de l’hydrogène.
Malgré la publication d’un certain nombre de scénarios ou modèles théoriques, sauf exception (4) jamais soumis à une revue par les pairs, comme l’exigerait toute démarche scientifique rigoureuse, minorant les enjeux de la recherche dans le domaine du stockage de l’énergie, jusqu’à preuve du contraire, celle-ci reste tout à fait fondamentale, pour assurer, sans perturbation majeure pour les consommateurs particuliers comme industriels, un déploiement accéléré et massif, en quelques décennies, des énergies renouvelables. À cet égard, les priorités de recherche définis par l’OPECST dans les rapports susmentionnés apparaissent, plus que jamais, pertinentes.
C. LES RECHERCHES SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
1. La recherche sur les économies d’énergie dans le bâtiment
L’efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments représente un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie en France. En 2015, ce secteur représentait 41 % de la consommation d’énergie finale en France. À cet égard, la loi Grenelle I du 3 août 2009 a fixé un objectif de baisse de 3 % par an jusqu’en 2020 pour le parc des bâtiments anciens, équivalent à une réduction de 38 % sur dix ans.
À l’occasion de l’audition par l’OPECST, le 13 décembre 2016, du président du président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), M. Étienne Crépon, dont le compte rendu est annexé au présent rapport, votre rapporteur a été conduit à l’interroger sur la quasi-stagnation de la consommation énergétique des bâtiments, avec une diminution de seulement 1 % depuis 2009, à comparer avec l’objectif susmentionné d’une diminution de 38 %, alors même que les dépenses fiscales relatives au logement contribuent à un grand nombre de rénovations.
Ce résultat décevant n’ayant été mis en évidence qu’en septembre 2016, à l’occasion de la publication d’un rapport de la Cour des comptes relatif à l’efficience des dépenses fiscales en matière de développement durable, M. Étienne Crépon a indiqué qu’il attendait justement une réponse de ses services, qu’il avait déjà saisis de cette question. La présentation, courant 2017, du prochain rapport d’activité du CSTB devrait permettre à l’OPECST d’obtenir des indications plus précises sur les causes de cette stagnation.
De fait, la mesure des résultats réels constitue une question centrale pour la recherche dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, comme l’a souligné le président du CSTB lors de cette même audition : « le secteur du bâtiment va être, de plus en plus, confronté à une obligation de résultats, et non plus à une stricte exigence de moyens. », en ajoutant que cette question « va poser d’énormes difficultés d’ordre scientifique à l’ensemble des acteurs, ne serait-ce que parce que l’occupation d’un bâtiment modifie les conditions de fonctionnement de celui-ci, par rapport aux simulations théoriques qui ont été effectuées lors de la conception. »
En la matière, la recherche sur la gestion active de l’énergie dans les bâtiments, qui permet notamment de piloter en temps réel des paramètres tels que la consommation d’énergie, en fonction de l’utilisation effective des locaux, représente une voie de recherche prometteuse, qui pourrait permettre tout à la fois d’augmenter notablement la performance énergétique des bâtiments existants et de mesurer de façon précise les gains réalisés. Ces atouts justifieraient à eux seuls de renforcer l’effort de recherche en la matière.
Qui plus est, comme l’a mis en évidence M. Frédéric Wurtz, directeur de recherche au CNRS, lors de l’audition du 26 mai 2016, ce domaine de recherche prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec la prise en compte des problématiques de production d’énergie, d’intégration au réseau, d’autoconsommation et d’effacement : « 66 % de la consommation dans le réseau électrique [est] réalisée dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et commerciaux. Il apparaissait donc pertinent de considérer le bâtiment comme un élément majeur, présentant éventuellement des capacités de stockage et de délestage. Les bâtiments semblent d’autant plus intéressants qu’ils peuvent être aussi des producteurs importants d’énergies renouvelables. »
Dans l’avenir, ces systèmes devraient donc non seulement permettre d’optimiser automatiquement la consommation en fonction des usages, mais aussi d’informer les utilisateurs pour faciliter l’évolution des comportements, et d’intégrer plus facilement les énergies renouvelables, en favorisant l’autoconsommation et l’effacement. Il s’agit donc là d’un domaine de recherche, issu des technologies numériques, de toute première importance pour accélérer l’évolution de la gestion de l’énergie dans les bâtiments, et disposer enfin d’outils de mesure des performances énergétiques réelles de ces derniers.
Dans le cadre du deuxième rapport que l’OPECST a consacré, en juillet 2014, à la question cruciale de la performance énergétique des bâtiments, intitulé : « Les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment : le besoin d’une thérapie de choc », M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Marcel Deneux, sénateur, distinguent deux axes de recherche majeurs en matière d’économie d’énergie dans le bâtiment : d’une part, les recherches sur de nouveaux produits plus performants, comme les matériaux à changement de phase et, d’autre part, les recherches sur les conditions de mise en œuvre des produits, la qualité de cette dernière s’avérant cruciale pour l’isolation.
Sur ce plan, les rapporteurs préconisent, d’une part, de remettre, à l’instar de l’Allemagne, la physique des bâtiments au cœur de la politique d’économie d’énergie française, et, d’autre part, de poursuivre l’effort, d’ores et déjà engagé, de regroupement des forces scientifiques disponibles, la France n’ayant pas les moyens de disperser ses efforts de recherche. Trois ans après la publication de ce rapport, ces deux orientations apparaissent encore d’actualité pour orienter la stratégie de recherche dans ce domaine majeur pour l’avenir énergétique du pays.
2. La recherche sur la performance énergétique dans les transports
En France, avec une part de 30 %, les transports représentent, après le résidentiel-tertiaire, le deuxième secteur le plus consommateur en termes d’énergie finale, bien avant l’industrie, dont la part s’est réduite, en quarante ans, de 33 % à seulement 18 %.
C’est l’une des principales raisons qui a conduit le président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, M. Jean-Paul Chanteguet, à saisir l’OPECST d’une mission sur les développements technologiques liés aux véhicules écologiques.
Dans le cadre de leur étude intitulée : « Les nouvelles mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser les véhicules écologiques », M. Denis Baupin, député, et Mme Fabienne Keller, sénatrice, ont souligné la nécessité d’adopter une approche globale de la mobilité, l’amélioration de la performance énergétique dans ce secteur pouvant aussi bien résulter d’avancées sur les technologiques automobiles existantes, telles que la réduction de consommation des moteurs de véhicules individuels à deux litres aux cent kilomètres, de leur substitution par des technologies alternatives comme le véhicule électrique ou au gaz naturel pour véhicules, dit GNV, de l’intégration plus poussée du numérique, avec les aides à la conduite, voire le véhicule autonome, que de changements majeurs des comportements sociaux, dont l’auto-partage ne représente qu’un exemple.
Les rapporteurs soulignent que cette « approche globale permettra d’intégrer les évolutions technologiques dans un cadre plus large, incluant leurs implications économiques, environnementales, sociales, et sociétales. » En matière de recherches, les sciences humaines et sociales auront donc un rôle important à jouer dans la prévision et l’accompagnement des changements d’habitudes sociales dans les transports.
Dans leurs recommandations, M. Denis Baupin et Mme Fabienne Keller mentionnent également l’importance des recherches sur le numérique « permettant un usage plus performant, plus écologique, plus serein et plus sécurisé des véhicules, notamment dans l’assistance à la conduite », en veillant à étudier « les implications en termes de sécurité informatique du développement des systèmes d’électronique embarquée dans les véhicules, et leur vulnérabilité au risque de piratage ».
À cet égard, l’audition publique sur « Les robots et la loi », organisée en décembre 2015, afin de répondre à une saisine du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, sur les enjeux juridiques de la robotisation, a permis de mettre en évidence l’importance des transformations susceptibles de résulter de l’avènement du véhicule autonome, et les gains induits, par exemple en matière de lutte contre le changement climatique.
Cette audition avait conduit l’OPECST à formuler huit recommandations, notamment sur la nécessité d’engager « une réflexion sur la façon dont il serait possible d’autoriser, dans des délais réduits, en dérogeant exceptionnellement à la réglementation en vigueur, avec une ampleur et une durée limitée, certaines expérimentations en matière de robotique, et plus généralement de technologies numériques, pour prendre en compte les cycles d’innovation extrêmement brefs dans ce domaine. »
Sur le plan des technologies, M. Denis Baupin et Mme Fabienne Keller préconisent de favoriser « les recherches sur la réduction de la consommation énergétique des véhicules et de leurs émissions polluantes, mais aussi sur la réduction de leur taille et l’allégement de leur poids », tout en assurant « un soutien constant à la recherche sur les motorisations alternatives et les carburants alternatifs, en particulier le biogaz, l’hydrogène et les agro-carburants de troisième génération », notamment en mobilisant « le grand emprunt et les investissements d’avenir en faveur de l’utilisation d’énergies alternatives dans la mobilité ». Enfin, ils jugent également nécessaire de « renforcer le réseau de R&D dédié aux batteries », dans la perspective de « construire une filière française et européenne sur les technologies des batteries et de stockage de l’électricité, pour les besoins énergétiques et de mobilité ».
La Stratégie nationale de recherche en énergie, document d’une cinquantaine de pages issu d’une démarche de concertation structurée, constitue, incontestablement, une base de travail solide qui devrait permettre à la recherche française de réaliser des progrès importants dans ce domaine.
Elle explicite convenablement le contexte et les nombreuses contraintes à respecter. Elle identifie quatre orientations stratégiques pertinentes, centrées sur les technologies, l’organisation de la recherche et de l’innovation, le développement des connaissances et des compétences et, enfin, la gouvernance de la stratégie elle-même. Elle recense de façon assez complète les différentes voies de recherche ainsi que les verrous scientifiques et technologiques à lever, en omettant inévitablement certaines pistes. Elle insiste sur la nécessité de la multidisciplinarité. Il propose enfin quinze actions stratégiques, sauf exception pertinentes.
Pour autant, ce document ne répond pas complétement, faute d’une identification préalable des priorités fixées à la recherche en énergie, à ce qui est attendu d’une véritable stratégie de recherche. Tout comme pour la présente évaluation, le travail engagé doit donc être poursuivi, pour concrétiser la mise en œuvre des actions structurantes identifiées, définir – comme le proposait déjà l’OPECST dans son rapport d’évaluation de 2009 – des filières nationales compétitives au plan international, en établissant une échelle de priorités basée sur des critères économiques et scientifiques et des feuilles de route portant, notamment, sur les verrous à lever et, enfin, identifier et lever à l’avance les freins d’ordre réglementaire au déploiement des innovations dans le domaine de l’énergie, par exemple en matière de performance énergétique des bâtiments.
En conclusion, la présente évaluation doit être considérée, compte tenu du contexte de sa réalisation, comme une première étape de l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche en énergie, qui devrait logiquement être prolongée, dans le courant de la prochaine législature, par une seconde étude destinée à mesurer, conformément à la loi, les conditions de mise en œuvre de la nouvelle stratégie, ainsi que la prise en compte des recommandations du présent rapport.
Il y a cinquante ans, la France a fait des choix, en abandonnant certaines pistes comme celle de l’hydrogène et de la pile à combustible, reprises depuis. Elle doit, aujourd’hui, à nouveau faire des choix, avec subtilité et intelligence, et faire preuve d’ambition.
1. L’OPECST estime important d’encourager les financements de long terme de la recherche, orientés vers la sélection des meilleurs chercheurs, plutôt que de projets, et donnant aux chercheurs la possibilité de réorienter, le cas échéant, leurs recherches, sous le contrôle de leurs pairs.
2. L’OPECST rappelle que la France doit respecter son engagement, pris dans le cadre de la Mission innovation, avec vingt-et-un autres pays et l’Union européenne, de doubler son effort de recherche dans les énergies durables sur la période 2015-2020.
3. L’OPECST estime que le Gouvernement devrait définir et communiquer une vision claire de l’avenir énergétique du pays, de façon à ce que celle-ci soit partagée par l’ensemble des citoyens.
4. L’OPECST invite le Gouvernement à définir des objectifs précis pour la recherche française en énergie, prenant en compte à la fois la vision de l’avenir énergétique national et le caractère international de la recherche sur l’énergie, dans le contexte d’urgence de la lutte contre le changement climatique.
5. L’OPECST estime qu’une place plus importante doit être faite, d’une part au monde de la recherche, et, d’autre part, au monde de l’entreprise, y compris les PME et ETI, dans le pilotage de la Stratégie nationale de recherche en énergie et sa mise en œuvre.
6. L’OPECST encourage vivement les parties prenantes à l’élaboration de la Stratégie nationale de recherche en énergie à poursuivre leurs travaux, afin de concrétiser la mise en en œuvre des actions structurantes qu’elles ont proposées dans le cadre des trois premières orientations de la Stratégie nationale de recherche en énergie.
7. L’OPECST incite notamment les parties prenantes, conformément aux recommandations formulées dans son rapport de 2009, à mener un travail complémentaire de définition de filières nationales compétitives au plan international, en établissant une échelle de priorité basée sur des critères économiques et scientifiques, ainsi que des feuilles de route, portant notamment sur les verrous à lever.
8. L’OPECST estime qu’un travail complémentaire doit également être mené pour identifier et lever, en amont, les freins d’ordre réglementaire au déploiement des innovations dans le domaine de l’énergie, par exemple en matière de performance énergétique des bâtiments, d’effacement de la consommation, de stockage ou de mobilité.
9. L’OPECST renouvelle la recommandation formulée en 2009, dans le cadre de l’évaluation de la précédente Stratégie nationale de recherche en énergie, concernant la création d’une Commission nationale d’évaluation chargée de présenter, chaque année devant l’OPECST, un état d’avancement de la recherche française en énergie. Le premier rapport de cette commission pourrait porter sur le bilan des progrès réalisés depuis 2007.
10. L’OPECST doit prolonger cette première évaluation, réalisée quelques semaines après la publication de la Stratégie nationale de recherche en énergie, par une seconde étude destinée à mesurer, conformément à la loi, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la prise en compte des présentes recommandations.
11. L’OPECST juge que le Gouvernement doit prévoir les moyens nécessaires à la poursuite, après 2019, des travaux de recherche sur le réacteur de quatrième génération ASTRID et le cycle du combustible associé.
12. L’OPECST estime que la coopération internationale en matière de recherche sur l’hydrogène-énergie doit être développée, notamment avec l’Allemagne, dans des domaines tels que les matériaux, l’électrolyse, la méthanation ou la sûreté.
13. L’OPECST encourage le développement de nouveaux programmes publics de recherche destinés à l’exploration des techniques de conversion du CO2, comme la méthanation.
14. L’OPECST incite à accorder un soutien renforcé à la recherche et à l’innovation pour atteindre rapidement l’objectif du véhicule consommant moins de 2L/100kms.
15. L’OPECST rappelle qu’une priorité doit être donnée à la physique des bâtiments, pour améliorer l’efficacité énergétique dans ce secteur, et les moyens de recherche dans ce domaine doivent être regroupés.
EXAMEN DU RAPPORT PAR L’OFFICE
M. Jean-Yves Le Déaut. Il nous reste à entendre la communication de Mme Anne-Yvonne Le Dain sur « L’évaluation de la stratégie de recherche en énergie ».
Je rappelle que, lorsque nous avons nommé Anne-Yvonne Le Dain comme rapporteur pour cette évaluation, le 28 juin 2016, la stratégie de recherche en énergie n’était pas encore disponible. Il était donc prévu qu’elle présenterait son travail d’analyse des projets de l’administration en charge de l’énergie, travail d’analyse qui ne pouvait pas être une évaluation proprement dite, sous la forme d’une simple communication. La situation était encore celle-ci lors de notre dernière réunion du 13 décembre 2016.
Mais, depuis, la stratégie nationale de recherche en énergie a été publiée en tout début d’année 2017 et nous sommes donc maintenant dans une situation permettant de considérer qu’une évaluation peut être effectuée. C’est pourquoi je propose que nous nous placions dans le cas de l’examen d’un rapport de l’OPECST.
Je constate qu’il n’y a pas d’objection, et je donne donc la parole à Anne-Yvonne Le Dain pour la présentation de son rapport.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Avant d’en venir au volet énergie de la stratégie, je voudrais féliciter Jean-Yves Le Déaut et Bruno Sido pour la qualité de leur rapport, dont je partage pleinement les conclusions et recommandations. Elles rejoignent d’ailleurs assez largement les préoccupations exprimées par les interlocuteurs que j’ai pu rencontrer au cours de mon étude, sur une durée extrêmement courte, puisque le document à évaluer a été mis en ligne seulement en début d’année.
Je souhaiterais y ajouter une ultime recommandation, de portée très générale, qui me tient à cœur : il faut laisser aux chercheurs la liberté d’explorer et, parfois, d’échouer, car il ne peut y avoir d’injonction à inventer ou à trouver. Il faut fluidifier la recherche et donner à l’intelligence des scientifiques l’opportunité de s’exprimer, sans téléguider en permanence ce sur quoi ils doivent travailler.
Le processus créatif ne se limite pas à une recombinaison, cumulative et interactive, de connaissances existantes. Bien entendu, certaines découvertes sont de nature incrémentale et résultent du perfectionnement de concepts ou de technologies qui existaient déjà, ou de l’approfondissement de voies de recherche consolidées auparavant, un moment abandonnées et reprises plus tard. Mais les plus décisives impliquent d’explorer de nouvelles approches scientifiques plus incertaines, voire hasardeuses. J’utilise ce mot à dessin car parfois les idées sont le fruit du hasard. Il ne faut jamais oublier que la recherche n’est pas déterministe.
Les découvertes de rupture nécessitent, bien sûr, avant tout, de la chance et du génie. Les images d’Archimède dans sa baignoire ou de Newton sous son pommier viennent tout naturellement à l’esprit. Mais la chance et le génie ne suffisent pas, si le chercheur n’a pas cette liberté d’explorer. Bien sûr, dans les laboratoires, grands ou petits, des contraintes existent, par exemple d’accès à des matériels toujours plus puissants et performants. Néanmoins, les chercheurs doivent pouvoir conserver une part d’inventivité et de liberté.
Aussi, faut-il privilégier les financements à long terme, qui conduisent à sélectionner les meilleurs chercheurs, au travers de l’évaluation par les pairs, plutôt que de travailler uniquement, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, dans une logique de projet, avec des finalités prédéterminées. Il faut leur donner la possibilité d’adopter, le cas échéant, de nouvelles approches, lorsque celles initialement choisies s’avèrent infructueuses. Il faut, enfin, une hiérarchie capable de les accompagner, en assurant un suivi de qualité de leurs recherches, ainsi qu’un soutien intellectuel, quasiment moral, et financier de leur inventivité.
Un dernier point d’ordre général que je voudrais aborder concerne la distinction qu’il y aurait entre recherche fondamentale et appliquée. Elle me semble non seulement artificielle, mais dommageable pour le développement de la science, et même pour l’impact de la science sur notre propre économie, car l’histoire comporte de multiples exemples de recherches dirigées vers un objectif déterminé qui ont conduit à des découvertes théoriques majeures, l’inverse étant tout aussi vrai.
Il me semble important, pour libérer de nouvelles voies de progrès, que nos organismes de recherche, nos écoles et nos universités transcendent cette dichotomie entre science fondamentale et science appliquée qui s’est progressivement installée dans le vocabulaire courant. Il n’y a que de la bonne recherche et de la mauvaise recherche, ainsi que des applications de la recherche. C’est particulièrement vrai pour cet enjeu majeur qu’est la lutte contre le changement climatique.
J’en reviens donc à la Stratégie nationale de recherche en énergie (SNRE) qui est corrélée à ce dernier sujet. Pourquoi adjoindre à la Stratégie nationale de recherche un volet consacré à l’énergie ? Au moins trois raisons le justifient.
En premier lieu, la France s’est engagée en 2015, avec les autres pays signataires de l’accord de Paris, dans une course de vitesse contre le changement climatique. Celle-ci nous impose de modifier profondément, et dans un temps très court, notre façon de produire et de consommer l’énergie. C’est pourquoi, dans le cadre de la Mission innovation, avec vingt-et-un autres pays et l’Union européenne, la France a décidé de multiplier par deux, sur la période 2015-2020 – nous y sommes – le montant des investissements publics dans la recherche et le développement pour les énergies durables. Cet engagement budgétaire reste d’ailleurs à concrétiser en France, alors qu’il a déjà pris effet dans d’autres pays, notamment aux États-Unis.
En deuxième lieu, l’énergie est au cœur de toute activité économique. Sans elle, il serait impossible de labourer les champs, de construire des bâtiments, de faire tourner des usines, de transporter les marchandises, d’éclairer les rues, de chauffer les habitations et les entreprises etc. C’est le monde réel et concret. Sans l’énergie, nous serions démunis de tout le confort moderne. Lorsqu’elle vient à manquer, c’est tout un pays qui s’arrête de produire et quand son prix devient excessif, les plus fragiles parmi les populations et les entreprises souffrent en premier.
Dans le passé, la France a pris en compte cet enjeu de l’indépendance énergétique et de la puissance, en se dotant d’une industrie du pétrole, puis d’une industrie nucléaire, également fortes. Cet effort d’indépendance doit être poursuivi, mais pas seulement dans le domaine de la production de l’énergie. Il y a d’autres éléments à considérer : la façon dont l’énergie est consommée, distribuée, facturée, et dont ses différents schémas s’insèrent dans l’économie européenne et mondiale. Beaucoup a été fait : par exemple les réseaux sont interconnectés en Europe. C’est d’ailleurs l’un des seuls continents où ces interconnexions sont efficaces.
En troisième lieu, malgré les récentes difficultés, le secteur de l’énergie reste l’un des derniers, sans doute avec l’aéronautique, l’armement et l’agro-alimentaire, dans lesquels la France apparaît comme une nation industrielle puissante au plan international. Cette position repose, en bonne part, sur la capacité de nos chercheurs et de nos ingénieurs à innover. La concurrence internationale dans ce secteur se renforce, avec l’arrivée de nouveaux concurrents, notamment la Chine et l’Inde, cette dernière étant trop souvent oubliée. Plus que jamais, la recherche apparaît comme une condition nécessaire au maintien de nos industries et de nos emplois dans l’énergie, sur le territoire national ou à l’export, au bénéfice d’entreprises nationales.
Il est donc incontestable que le législateur a su se montrer clairvoyant, en ajoutant à la Stratégie nationale de recherche, au travers de la loi pour la transition énergétique, un volet énergie.
Je voudrais souligner que la France a un immense avantage, c’est que son territoire s’étend sur tous les continents, toutes les latitudes et toutes les températures. Nous avons donc matière à fabriquer et à explorer toutes les formes d’énergie, pas seulement le pétrole et le nucléaire.
Mais nous n’avons pas, dans notre pays, contrairement à nos voisins d’Outre-Rhin, une vision partagée de l’avenir du système énergétique du pays, ce qui ne permet ni d’emporter l’adhésion des Français – alors que les Allemands acceptent sans protester de payer leur électricité au double du prix de leurs voisins pour subventionner les énergies renouvelables ni de donner une direction claire à la recherche en énergie.
Il me semble pourtant qu’une grande majorité de nos concitoyens s’accorderaient sur l’idée simple que, face au péril climatique, la priorité est bien de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, émetteurs de gaz carbonique, soit en diminuant notre consommation, soit en y substituant une énergie décarbonée, tout en préservant l’accessibilité de l’énergie à un prix raisonnable – la péréquation tarifaire est une particularité française et une force, garantissant la sécurité d’approvisionnement sur tout le territoire.
Nos concitoyens, nos administrations, nos entreprises et les élus partageraient ainsi une vision d’un système énergétique équilibré, comportant, d’un côté, des énergies renouvelables décentralisées (éolien, solaire, bois…), destinées à satisfaire des besoins locaux, et, de l’autre, des centrales puissantes et pilotables, nécessaires à la sécurité d’approvisionnement des usines et des bureaux, ainsi que du réseau, avec entre ces deux pôles, la gestion intelligente des réseaux et de l’effacement de la priorité de consommation, ainsi que des moyens de stockage, notamment le système hydraulique avec les barrages et les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), qu’il convient de développer.
Faute d’une telle vision, la loi demande à la Stratégie nationale de recherche en énergie d’intégrer, à la fois, onze objectifs de recherche, les objectifs généraux de politique énergétique, les orientations de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ainsi que les cinq orientations stratégiques « pour une énergie propre sûre et efficace » proposées dans le deuxième défi de la Stratégie nationale de recherche.
Les auteurs de la SNRE ont ainsi été placés dans la situation délicate de devoir prendre en compte une multiplicité d’objectifs et d’orientations, sans possibilité d’établir entre eux, ni un ordre de priorité, ni une certaine forme de lisibilité.
C’est dommage, car contrairement à la précédente stratégie de 2007, la nouvelle SNRE est effectivement le fruit d’un travail collectif, associant les deux ministères de la recherche et de l’environnement, mais aussi ceux de l’agriculture et de l’industrie, les alliances de recherche – au premier chef l’ANCRE pour l’énergie, les organismes publics de recherche, notamment le CEA et le CNRS, des entreprises, et d’autres organisations (fédérations professionnelles, organisations syndicales, associations, collectivités territoriales et élus).
Il s’agit d’un progrès significatif, même s’il faudra, à l’avenir, donner une place plus importante dans le pilotage de la SNRE et sa mise en œuvre, d’une part, aux scientifiques eux-mêmes et, d’autre part, au monde de l’entreprise, y compris les PME-PMI et ETI. À cet égard, la création d’une commission nationale chargée d’évaluer l’avancement des recherches en énergie, proposée dans le cadre de l’évaluation de la précédente stratégie, apparaît toujours aussi pertinente.
Je tiens, nonobstant ces ajustements souhaitables, à saluer cette démarche collective, ainsi que le travail très important qui a été réalisé par l’ensemble des participants. Le document d’une cinquantaine de pages qu’ils ont produit constitue, en effet, une base de travail solide.
Il explicite convenablement le contexte et les nombreuses contraintes à respecter. Il identifie quatre orientations stratégiques pertinentes, centrées sur les technologies, l’organisation de la recherche et de l’innovation, le développement des connaissances et des compétences, et, enfin, la gouvernance de la stratégie elle-même. Il recense de façon assez complète les différentes voies de recherche ainsi que les verrous scientifiques et technologiques à lever, en omettant, inévitablement, parfois de manière inopinée, parfois de manière déterminée, certaines pistes, par exemple les recherches sur les transmissions à longue distance et le courant continu ou sur l’organisation des marchés. Il insiste sur la nécessité de la multidisciplinarité qui devient quelque chose de banal. Il propose, enfin, quinze actions stratégiques pertinentes.
Pour autant, il ne répond pas, faute d’avoir identifié au préalable des priorités, à ce qui est attendu d’une véritable stratégie de recherche.
Tout comme pour la présente évaluation, le travail engagé doit donc être poursuivi, afin de concrétiser la mise en œuvre des actions structurantes identifiées, de définir – comme le proposait déjà l’OPECST dans son rapport de 2009 – des filières nationales compétitives au plan international en établissant, peut-être, une échelle de priorités, basée sur des critères économiques et scientifiques, et des feuilles de route portant notamment sur les verrous à lever, et, enfin, d’identifier et de lever à l’avance les freins d’ordre réglementaire au déploiement des innovations dans le domaine de l’énergie, par exemple dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Mais cela ne veut pas dire que les chercheurs doivent aller jusqu’au produit quasi fini.
En conclusion, j’estime que l’OPECST doit lui aussi s’engager à prolonger, dans le courant de la prochaine législature, cette évaluation réalisée quelques semaines après la publication de la SNRE, par une seconde étude destinée à mesurer, conformément à la loi, les conditions de mise en œuvre de la nouvelle stratégie, ainsi que la prise en compte des présentes recommandations.
Il y a cinquante ans, la France a fait des choix, en abandonnant certaines pistes, comme celle de l’hydrogène et de la pile à combustible, qui sont reprises aujourd’hui. Il nous faut à nouveau, aujourd’hui, faire des choix, avec subtilité et intelligence, et avoir de l’ambition.
Mme Dominique Gillot. L’évocation du soutien aux énergies renouvelables en Allemagne m’a fait penser à la façon dont le prix de l’eau est calculé chez nous, en intégrant le coût du traitement des eaux usées. Un système équivalent pourrait peut-être être mis en place de façon institutionnelle pour ces énergies.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Des travaux de recherche en économie pourraient effectivement être menés sur ce sujet.
Mme Dominique Gillot. Concernant la gestion intelligente de la consommation d’énergie, des algorithmes permettent aujourd’hui de la réaliser très finement. Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) le mettent en place pour leurs centres de données – datacenter, en anglais. Ils les installent dans des lieux ou la récupération d’énergie est possible et contrôlent ainsi leur consommation d’énergie, l’objectif étant d’atteindre une consommation zéro en 2020.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est effectivement cela qu’il faut développer. Des sociétés françaises le font également aujourd’hui.
Mme Dominique Gillot. Je sais que certains de nos chercheurs travaillent déjà sur ces sujets, mais il faudrait donner l’impulsion politique qui permettra de ne pas être distancés, d’autant que cette technologie peut être utilisée chez les particuliers. Celle-ci pourrait éviter à la Secrétaire d’Etat à l’écologie d’avoir à subir les railleries des sénateurs, comme c’est arrivé à l’occasion d’une réponse à une question sur la pointe de consommation, dans laquelle, tout en se voulant rassurante, elle indiquait que chacun pouvait faire preuve de responsabilité, en évitant de mettre en route ses appareils ménagers à l’heure où tout le monde fait appel à l’électricité.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je partage totalement cet avis, d’autant que les outils technologiques et les entreprises capables de les mettre en œuvre existent. J’ai évoqué la question de l’effacement. Lors du débat sur la loi relative à la transition énergétique, j’ai essayé d’introduire des amendements pour optimiser l’effacement et permettre à de nouvelles entreprises d’accéder aux données individuelles de consommation anonymisées. Les amendements ont été rejetés, parce que cet accès est réservé aux grands groupes industriels.
M. Bruno Sido. Pour revenir à l’incident en séance publique au Sénat évoqué par Mme Dominique Gillot, ce que la secrétaire d’État à l’écologie a oublié de dire, c’est que, pour la première fois en 2016, la France a été importatrice net d’électricité. Cela aurait pu être grave car si, comme deux députés allemands me l’ont indiqué dernièrement, nos voisins arrêtent leurs centrales au charbon et au lignite, leur système deviendra très fragile. Actuellement, nous bénéficions du surplus de puissance de ces centrales. Ce ne sera plus possible demain. L’Autorité de sûreté nucléaire doit prendre cet aspect en compte dans ses décisions.
Le deuxième point que je voulais évoquer concerne un rapport sur la gestion de la pointe de consommation électrique, que j’ai publié en 2009, en tant que président d’une mission commune d’information, à la demande de la commission des affaires économiques du Sénat. Dans ce rapport, qui m’a passionné, nous concluions à la nécessité de réfléchir à une autorité européenne de régulation de l’électricité et de multiplier les interconnexions. Je crois qu’avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, c’est devenu encore plus nécessaire.
Après les prochaines élections, je pense qu’il faudrait que l’Office demande à une commission de l’Assemblée ou du Sénat d’actualiser ce rapport, à l’aune des lois votées. Comme je le disais à l’occasion de l’audition de M. Jean-François Carenco, nouveau président de la Commission de régulation de l’énergie, ce que nos concitoyens attendent, avant même le coût de l’électricité, c’est la sécurité d’approvisionnement. Beaucoup de choses restent à faire sur le plan scientifique pour assurer cette dernière, notamment sur la gestion de la pointe.
Le principal intérêt du compteur Linky n’est pas de supprimer les emplois de ceux qui relèvent les compteurs mais de permettre la gestion de la pointe, en arrêtant automatiquement les chauffe-eaux et autres appareils ménagers. Sinon, cette pointe de consommation réclame des centrales à gaz coûteuses, fonctionnant seulement cinq-cents heures par an, donc non rentables. La recherche doit donc également porter sur la gestion de la pointe et l’équilibrage des réseaux entre l’est et l’ouest de l’Europe.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit effectivement de la question de l’effacement, pour laquelle je me suis heurtée à un mur, certains prétendant qu’elle est réglée, alors même qu’un énorme travail reste à faire, notamment sur l’accès aux données, les modalités de leur captation et de leur traitement – sujets relevant du droit et de l’organisation du marché. Ce pourrait être une question de recherche en économie. Sur le plan technique, le pilotage des réseaux peut se faire à la nanoseconde, tout comme celui de l’effacement, pas seulement dans les entreprises mais aussi dans les foyers. Cet axe n’est pas suffisamment mis en valeur dans la stratégie nationale de recherche en énergie.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je voudrais apporter deux compléments, ainsi que des propositions de rajouts dans les recommandations. Tout d’abord, une stratégie est un ensemble de choix d’objectifs et de moyens qui orientent, à moyen et long terme, l’ensemble des activités d’une organisation. Si on veut faire une stratégie de recherche en énergie, c’est pour être capable de répondre à nos besoins pendant trente ans.
Un certain nombre de scénarios ont été élaborés, dont le scénario à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050, publié par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui a été contesté par plusieurs spécialistes lors de l’audition publique du 9 février 2017. Pour orienter la recherche sur des voies permettant de répondre à nos objectifs, il convient d’abord de déterminer quel est le scénario le plus probable : énergies renouvelables seules, ou avec en complément des énergies nucléaire ou fossiles ? L’énergie hydraulique fait également partie des énergies renouvelables, mais on n’augmentera pas énormément sa production, même en faisant des investissements.
La première question que la Stratégie nationale de recherche en énergie doit régler, est celle de la façon dont la baisse de la production nucléaire, au moment où les centrales actuelles vont commencer à fermer les unes après les autres, pourra être compensée, tout en maintenant l’équilibre avec les énergies intermittentes. Existera-t-il d’autres solutions que les énergies fossiles ? En termes de recherches, devons-nous travailler sur des projets de réacteurs de quatrième génération, comme ASTRID. Est-ce que le projet ITER (en anglais : International Thermonuclear Experimental Reactor, en français : réacteur thermonucléaire expérimental international) pourra apporter une solution énergétique ?
M. Bruno Sido. La position de M. Sébastien Balibar, directeur de recherches au CNRS, qui a déclaré, lors de l’audition publique du 9 février 2017, que la fusion nucléaire ne marcherait jamais, m’a choqué.
M. Jean-Yves Le Déaut. Est-ce que l’Office ne devrait pas proposer qu’un certain nombre de recherches soient poursuivies sur la filière nucléaire, notamment le réacteur ASTRID ? Cela doit apparaître en conclusion du rapport d’évaluation.
Il en va de même pour certaines des conclusions du rapport relatif à l’apport de l’évaluation scientifique et technologique à l’innovation et au changement climatique, adressé en novembre 2015 aux négociateurs de la COP21.
Il convient de réaffirmer que les problèmes énergétiques de demain et ceux de la lutte contre le réchauffement climatique ne pourront être résolus sans l’apport de l’innovation. Il faut donc soutenir les innovations dans ce domaine, par exemple sur l’effacement – cela a été très bien dit, sur le pilotage des réseaux et sur le stockage de l’énergie, qui sont des conditions du développement des énergies renouvelables. Aussi, toutes les recherches sur les matériaux permettant de stocker l’énergie doivent-elles être fortement soutenues. Je souhaiterais que cela soit précisé dans les recommandations.
Par ailleurs, les pressions sur l’usage des énergies fossiles vont se faire de plus en plus fortes, au niveau international. Les Allemands y sont déjà soumis, mais elles se généraliseront. Aussi, souhaiterais-je que cette recommandation soit reprise dans les conclusions : « Maintenir un éventail large de pistes de recherche pour les techniques visant à réduire les émissions de CO2, en vue d’explorer toutes les options technologiques possibles et ainsi augmenter la probabilité de faire émerger de nouvelles solutions », de même que la suivante, relative à la méthanation : « Développer les programmes publics de recherche destinés à l’exploration des techniques de conversion du CO2, comme la méthanation ou d’autres technologies de transformation du CO2. »
Je souhaiterais également que deux pistes de recherche soient bien précisées dans le domaine des transports, d’une part sur la filière hydrogène, qui a fait l’objet d’un rapport en 2013, et sur l’objectif de consommation des moteurs de 2L/100kms, qui a fait l’objet de recommandations dans ce même rapport et dans celui sur les nouvelles mobilités : « Accorder une priorité au soutien à la recherche et l’innovation pour atteindre rapidement l’objectif du véhicule consommant moins de 2L/100kms ».
Enfin, je souhaiterais que soit ajoutée l’une des recommandations du rapport sur la performance énergétique des bâtiments, qui constate qu’aujourd’hui la physique des bâtiments est une discipline subsidiaires de la physique, alors que la visite du Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement (LASIE), au sein de l’université de La Rochelle, a montré la grande qualité de ce qui peut être fait dans ce domaine, tout comme c’est le cas à l’INES, à Chambéry, et au CETII, à Lyon. Quelques lieux existent ainsi en France où l’on travaille sur ce sujet, mais il convient de donner une priorité à la physique des bâtiments pour améliorer l’efficacité énergétique dans ce secteur.
De façon plus générale, il serait souhaitable de reprendre certains éléments des précédents rapports de l’Office sur l’énergie, pour donner une cohérence aux travaux, en les citant dans le texte du rapport.
L’OPECST a alors adopté à l’unanimité ce rapport et ses propositions.
ANNEXE N° 1 :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Jeudi 26 mai 2016, dans le cadre de l’audition publique : « Les enjeux technologiques de l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique »
- Pr Jeffrey M. Bielicki, Assistant Professor, Joint Appointment: Department of Civil, Environmental, and Geodetic Engineering, John Glenn College of Public Affairs The Ohio State University
- M. Thomas A. Buscheck, Ph.D, Group Leader, Geochemical, Hydrological and Environmental Sciences Group, Atmospheric, Earth and Energy Division (AEED), Physical and Life Sciences Directorate, Lawrence Livermore National Laboratory
- M. Jean-Marie Chevallier, professeur émérite de sciences économiques à l’université Paris-Dauphine, Senior associé au Cambridge Energy Research Associates (IHS‐CERA)
- M. Rémy Dénos, chargé des politiques (policy officer), DG Énergie, Commission européenne
- M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne, Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie (ANCRE), directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé), CEA
- M. Dominique Grand, docteur en physique, Realistic Energy
- M. Nouredine Hadjsaid, professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble et à Virginia Tech, directeur du laboratoire IDEA-GIE, président du conseil scientifique de Think Smart Grids
- M. Vincent Leclère, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, chercheur au Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique (CERMICS), École des Ponts ParisTech
- M. Patrick Ledermann, membre de l’Académie des technologies
- M. Sylvain Lemelletier, directeur de projet Power to Gas et gazéification, GRTgaz
- Pr Fabrice Lemoine, directeur du Laboratoire d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée de Nancy, université de Lorraine, groupe Stratégie de l’Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie (ANCRE)
- M. Pierre Lombard, McPhy Energy
- M. Pierre Mallet, directeur R&D et innovation, ERDF
- M. David Marchal, directeur adjoint Productions et énergies durables, ADEME
- M. Davy Marchand-Maillet, directeur des opérations, Sun’R Smart Energy
- M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
- M. Patrick Panciatici, conseiller scientifique, RTE
- Mme Anne Perrin, directeur de recherche en biophysique, chercheur à Minatec-Grenoble et Présidente de l'Association française pour l'information scientifique (AFIS)
- Mme Marion Perrin, CEA-LITEN
- Mme Vera Silva, responsable de programme R&D, EDF
- M. Benjamin Topper, président fondateur de WattStrat
- Mme Anne Varet, directrice de la recherche et de la prospective, ADEME
- Pr Dr Friedrich Wagner, directeur émérite du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, professeur émérite de l’université Ernst-Moritz-Arndt à Greifswald, membre du groupe Énergie de la Société européenne de physique (EPS, European Physical Society)
- M. Frédéric Wurtz, directeur de recherche au CNRS – G2ELAB – université de Grenoble Alpes
Jeudi 1er décembre 2016
- M. Pierre Mallet, directeur R&D et innovation, ENEDIS
- M. Christopher Fabre, chargé de mission des affaires institutionnelles, ENEDIS
- M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes, CEA
- M. Jean-Pierre Vigouroux, directeur des Affaires publiques, CEA
Mardi 6 décembre 2016
- M. Thierry Le Boucher, directeur délégué R&D, EDF
- Mme Véronique Loy, directrice adjointe des affaires publiques, EDF
Jeudi 8 décembre 2016
- M. Bernard Tardieu, président de la Commission « Énergie et Changement climatique » Académie des technologies
- M. Didier Houssin, Président d’IFP Energies nouvelles (IFP-EN)
- M. Jean-Jacques Lacour, Directeur de la Stratégie, IFP-EN
- M. Markus Birkhofer, vice-président en charge de la stratégie, de l’innovation et de la communication, AREVA NP
- M. Grégory Cherbuis, vice-président de la planification stratégique et des affaires publiques, AREVA NP
- Mme Morgane Augé, responsable des affaires publiques France, AREVA
Mardi 13 décembre 2016
- M. Yves Bréchet, Haut-commissaire à l’énergie atomique
Mardi 13 décembre 2016, dans le cadre de l’audition du CSTB par l’OPECST
- M. Etienne Crépon, président du CSTB
- M. Jean-Christophe Visier, directeur énergie environnement du CSTB
- Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe de la recherche pour les questions de santé et de confort, CSTB
Jeudi 15 décembre 2016
- M. Jean-Yves Marzin, directeur de l’INSIS, CNRS
- M. Sylvain David, directeur adjoint scientifique de l’IN2P3, CNRS
- M. Alain Dollet, directeur adjoint scientifique « Energie », CNRS
Mardi 17 janvier 2017
- M. Olivier Baud, président directeur général, Energy Pool
- Mme Lucie Péguet, directrice technique et R&D, Energy Pool
Mardi 31 janvier 2017
- M. Daniel Verwaerde, administrateur général du CEA
- Mme Françoise Touboul, directrice du développement durable, CEA
- M. Jean-Pierre Vigouroux, directeur des affaires publiques, CEA
Jeudi 9 février 2017, dans le cadre de l’audition publique : « Les enjeux de la recherche en énergie »
- Mme Nathalie Alazard-Toux, directrice économie et veille, IFP-EN, Alliance ANCRE
- Mme Clarisse Angelier, déléguée générale, Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)
- M. Olivier Appert, président de France-Brevets et du Conseil français de l’énergie
- M. Sébastien Balibar, directeur de recherches au CNRS, membre de l'Académie des sciences
- M. Philippe Baptiste, directeur scientifique, TOTAL
- M. Pascal Brault, directeur de recherche au CNRS, délégué scientifique énergie au CNRS, Alliance ANCRE
- M. Sylvain David, directeur adjoint scientifique IN2P3, CNRS
- M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne, directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé), CEA, Alliance ANCRE
- M. Didier Houssin, président de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE)
- M. Michel Latroche, directeur de Recherche au CNRS, chargé de mission INC , Institut de chimie et des matériaux Paris Est, CNRS, Alliance ANCRE
- M. Laurent Lefèvre, membre du groupe AVALON, Laboratoire de l’informatique du parallélisme, INRIA
- M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
- M. Laurent Michel, directeur de l’énergie et du climat, ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
- M. Christian Ngo, EDMONIUM
- M. Bernard Salha, directeur recherche et développement, EDF
- M. Stéphane Sarrade, directeur adjoint de l’innovation et du soutien nucléaire, CEA-DEN
- M. Abdelilah Slaoui, directeur adjoint scientifique - ENERGIE, CNRS
- M. Pierre Vala, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ANNEXE N° 2 :
COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 SUR « LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES DE L’INTEGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE »
M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à l’Assemblée nationale pour cette audition consacrée aux enjeux technologiques de l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique.
Je remercie les responsables et chercheurs qui ont accepté d’y participer, tout spécialement les professeurs Friedrich Wagner, directeur émérite du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, et Jeffrey Bielicki, de l’Ohio State University, qui n’ont pas hésité à entreprendre un long voyage pour être présents parmi nous. Je salue également M. Rémy Dénos, de la direction générale énergie de la Commission européenne, qui arrive de Bruxelles.
Je commencerai par dire quelques mots de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. L’OPECST est une délégation permanente, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans laquelle siègent dix-huit députés et dix-huit sénateurs. L’Office agit de trois manières : il peut soit être saisi par les autorités, soit organiser des auditions publiques sur des questions d’actualité, soit encore être saisi par la loi sur un certain nombre de sujets. Nous auditionnions par exemple hier, comme chaque année, conformément à la loi, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour contrôler son activité au cours de l’année écoulée. Nous pouvons recourir en tant que de besoin aux compétences d’un conseil scientifique composé de vingt-quatre membres. Nous sommes, par ailleurs, organisés en réseau européen, l’European parliamentary office of technology assessment (EPTA), dont fait partie le Science and Technology Options Assessment (STOA) du Parlement européen.
L’audition d’aujourd’hui s’inscrit dans la longue lignée des travaux de l’OPECST consacrés à la question de l’énergie qui, après la santé, est le sujet le plus souvent traité dans ses rapports.
Les conditions de l’intégration à grande échelle d’énergies renouvelables intermittentes dans le réseau électrique ont ainsi été examinées dans le cadre de plusieurs de nos études ou auditions publiques ces dernières années. Cela a par exemple été le cas en 2014, à l’occasion d’une audition sur les enseignements à tirer du tournant énergétique allemand pour la transition énergétique française, ou encore en 2013 dans le cadre de deux études respectivement consacrées à la transition énergétique à l’aune de l’innovation et de la décentralisation et au rôle de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique.
Deux ans auparavant, le rapport de l’OPECST sur l’avenir de la filière nucléaire, second volet de la mission qui lui a été confiée par les présidents des deux Assemblées après l’accident de Fukushima, a conclu à la nécessité de laisser le temps au développement, puis au déploiement, de technologies telles que le stockage massif de l’énergie, conditionnant l’intégration des énergies renouvelables.
Ce problème des développements scientifiques et technologiques nécessaires à la gestion de l’intermittence des énergies renouvelables avait déjà été étudié en 2009, lors de l’évaluation de la première stratégie de recherche en énergie, évaluation dont l’Office parlementaire s’est trouvé chargé par la loi du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique. Depuis lors, la loi du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, a également confié à l’OPECST l’évaluation de la stratégie nationale de recherche.
L’audition de ce jour constituera également une opportunité pour préparer l’évaluation de la future Stratégie nationale de recherche en énergie, en donnant un premier éclairage sur les mécanismes qui permettront son élaboration et de prendre en compte les multiples facteurs en jeu au niveau national, européen et international.
PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELLES TECHNOLOGIES POUR INTÉGRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ?
Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST.
M. Jean-Yves Le Déaut. Cette première table ronde ouvre l’opportunité d’entendre plusieurs acteurs majeurs du monde de l’énergie sur les besoins en termes de moyens scientifiques et technologiques à développer ou à déployer, afin de prendre en compte la montée en puissance des énergies renouvelables, tout en assurant la stabilité du réseau électrique et la satisfaction des besoins énergétiques.
Ne sera pas abordé aujourd’hui le sujet épineux des moyens de substitution à la production d’électricité renouvelable intermittente, qu’il s’agisse, comme en France, de l’énergie nucléaire ou, comme outre-Rhin, de centrales à flammes fonctionnant au gaz, au charbon ou au lignite. Cette question est évidemment de première importance, puisqu’il s’agit aujourd’hui, avec l’énergie hydraulique, d’une composante indispensable au maintien de l’équilibre du réseau électrique.
Les producteurs d’électricité sont aujourd’hui confrontés à de sérieuses difficultés pour maintenir ces moyens de production pilotables, dont la rentabilité est mise à mal par l’arrivée sur le marché d’une électricité d’origine renouvelable à coût nul voire négatif, puisque déjà rémunérée au travers des mécanismes d’achat à prix garantis.
Bien qu’en France les centrales à flammes soient principalement utilisées pour gérer la pointe de consommation, il conviendrait également de s’interroger sur leur impact sanitaire, y compris pour celles situées par-delà nos frontières. Ainsi, un récent rapport de l’université de Stuttgart, commandité par Greenpeace Allemagne, a fait grand bruit : il révèle que le parc de centrales à énergies fossiles en service ou en construction chez nos voisins aurait pour impact une perte totale de plus de quarante-cinq mille années de vie humaine, notamment du fait de la pollution due aux microparticules, maximale dans un rayon de cent à deux-cents kilomètres de ces installations.
Plus généralement, nous n’évoquerons pas non plus l’évolution technologique des moyens de productions renouvelables, susceptibles de faciliter leur intégration au réseau. Par exemple, il est clair que l’éolien en mer présente une courbe de production plus intéressante de ce point de vue que l’éolien terrestre.
Je souligne que l’éolien terrestre et le photovoltaïque classique n’ont pas connu de saut technologique décisif ces dernières années, malgré les quelque vingt milliards d’euros versés en France au titre des obligations d’achat d’énergies renouvelables pour la période 2002 – 2013. D’après la Commission de régulation de l’énergie, ces obligations devraient d’ailleurs dépasser les soixante-dix milliards d’euros pour la période 2014 – 2025, ce qui resterait encore inférieur à leur équivalent en Allemagne, qui s’élève à près de vingt-cinq milliards d’euros annuels. À partir du moment où l’on dispose de ces chiffres, il semble évidemment nécessaire de s’intéresser à la meilleure gestion possible de l’intégration de ces énergies au réseau.
Ne serons pas abordés non plus les questions de sobriété et de performance énergétique, qui sont pourtant au cœur de la plupart des scénarios énergétiques à forte composante d’énergies renouvelables présentés ces dernières années. Ce choix ne découle évidemment pas d’un oubli, ni d’une volonté d’ignorer ce problème essentiel. J’ai moi-même publié, voici deux ans, un rapport sur les freins à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment. Le rapport de la sénatrice Fabienne Keller et du député Denis Baupin sur les nouvelles mobilités sereines et durables, paru la même année, traitait quant à lui de la nécessaire réduction de la consommation énergétique dans les transports.
Le problème de l’extension du réseau électrique et du renforcement des liaisons ne sera pas traité en tant que tel, même s’il a de fortes implications technologiques et scientifiques, par exemple pour la transmission longue distance en courant continu ou l’enfouissement de certaines lignes électriques.
À côté de ces questions absolument fondamentales, il apparaissait en effet important de faire un point précis sur des technologies visant directement à faciliter la gestion de la variabilité de la production dans le réseau électrique, telles que les réseaux intelligents, le stockage de l’énergie ou encore l’effacement.
Je rappelle que chaque table ronde commencera par une série d’interventions de sept minutes chacune au plus. Deux exceptions seront toutefois consenties pour nos invités les plus lointains, qui bénéficieront de trois minutes supplémentaires. Ces interventions seront suivies d’un débat.
En introduction à cette première table ronde et pour donner un éclairage général à nos échanges, M. Patrick Ledermann va nous présenter, au nom de l’Académie des technologies, la problématique de l’intermittence et les enjeux technologiques de l’intégration des énergies renouvelables.
M. Patrick Ledermann, membre de l’Académie des technologies. La pénétration accrue des énergies renouvelables intermittentes, que sont le solaire photovoltaïque et l’éolien, a un impact sur la capacité d’équilibrage entre fourniture et consommation d’électricité sur les réseaux, à trois échelles de temps.
La première concerne le besoin augmenté d’une capacité de réserve, pour faire face aux pics de consommation. J’illustrerai mon propos en m’appuyant sur une étude récente d’EDF, dans laquelle a été simulé un parc de 280 GW d’éolien sur le réseau électrique européen. Sur la base de l’historique des variations climatiques, on observe que, pour une capacité de 280 GW, la production varie en hiver, sur une journée, entre 40 GW et 170 GW. Cela montre bien l’impact considérable en besoin de flexibilité et de capacité de réserve, donc de sécurité de l’approvisionnement. Il me semble également important de rappeler l’existence en Europe d’une tendance caractérisée d’accroissement du pic de consommation rapporté à la consommation moyenne sur l’année, en raison de la réduction de la consommation industrielle qui est stable.
Tous ces facteurs influent sur le besoin de réserve de capacité pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Du fait de la pénétration accrue des énergies renouvelables intermittentes, les centrales thermiques sont moins utilisées. Leur rentabilité est donc dégradée et l’on constate dans plusieurs pays d’Europe, notamment en Allemagne, la fermeture d’un certain nombre de centrales de type cycle combiné gaz. Cela montre l’intérêt du marché de capacité, en cours de discussion, et le lien existant entre les technologies, les règles de gouvernance et les règles du marché. Il est important de disposer de règles de gouvernance définies et stables, à charge ensuite pour l’industrie de définir le bouquet de technologies permettant de s’adapter à ces règles. Concernant la question du pic de consommation, les interconnexions entre les réseaux des différents pays sont également un élément important.
La deuxième échelle de temps concerne l’équilibrage continu du réseau, sur une heure voire moins, entre fourniture et consommation. Cela renvoie au marché de l’électricité, sur la base de prévisions de consommation et de production, un jour avant la production et le jour-même. En Allemagne, les relevés montrent, sur une heure, une variation de production du parc solaire photovoltaïque de plus ou moins 9 %. Sachant que l’Allemagne dispose de 40 GW de solaire photovoltaïque, l’impact de cette variation est considérable.
À cet égard, sur le plan technologique, le numérique va jouer un rôle très important, avec non seulement une meilleure prévision de consommation et de production, mais aussi le développement de compteurs et de réseaux intelligents, en lien avec les objets connectés, permettant aux consommateurs et aux gestionnaires de réseaux de définir les modalités d’effacement de la consommation, afin d’ajuster la demande à l’offre.
Le stockage d’électricité est un autre élément clé, avec les stations de pompage – turbinage, aussi appelées stations de transfert d’énergie par pompage hydraulique (STEP), disposant d’un bassin haut et d’un bassin bas permettant de remonter l’eau par pompage lorsque l’électricité est abondante et de turbiner l’eau pour générer à nouveau de l’électricité en période de pic de consommation. Il s’agit là d’une technologie importante et mature. En France, il existe environ 5 GW de STEP mais peu de nouveaux sites sont susceptibles d’être développés. L’autre aspect du stockage sera constitué par les batteries, pour lesquelles l’enjeu réside essentiellement dans la réduction des coûts, qui restent actuellement élevés.
Après l’heure, la troisième échelle de temps est la minute, voire la seconde. L’enjeu ici est le contrôle de la fréquence du réseau et son maintien à 50 Hz en cas d’erreur de prévision ou de défaut d’une centrale ou du réseau, sachant que la variation acceptable est de l’ordre de 1 %. Or, les énergies intermittentes, en particulier le solaire photovoltaïque, se caractérisent par une diminution de l’inertie mécanique, qui conduit à une accélération de la variation de fréquence du réseau en cas d’incident.
Typiquement, un problème de maîtrise de la fréquence du réseau se pose en période estivale, à midi, lorsque certaines centrales thermiques ont été déconnectées. Il faut souligner que l’on peut bénéficier, avec l’électronique de puissance pilotant les éoliennes, de l’inertie mécanique des pales en rotation. Là aussi, le stockage de l’électricité, avec des batteries ou des volants d’inertie, peut jouer un rôle pour compenser cette augmentation de variation de fréquence.
Voici, brièvement évoquées, les trois échelles de temps pour lesquelles la pénétration des énergies renouvelables intermittentes, photovoltaïque et éolienne, va impacter l’équilibrage du réseau.
M. David Marchal, directeur adjoint Productions et énergies durables, ADEME. Mes propos vont s’appuyer sur deux études menées par l’ADEME les années précédentes : la première concerne le stockage d’électricité à l’horizon 2030 et la seconde à l’horizon 2050, voire au-delà.
Dans le cadre de la première étude, il s’agissait d’évaluer, avec l’appui de l’Association technique énergie environnement (ATEE) et de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), les besoins de stockage du système électrique français à l’horizon 2030, selon différents scénarios de pénétration des énergies renouvelables. Ces travaux se sont fondés sur une évaluation horaire de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Le premier grand enseignement de cette étude est que nous disposons en France d’un système électrique déjà très flexible, si bien que les conclusions de ce rapport viennent finalement en assez forte opposition avec celles d’études similaires menées, par exemple, au Royaume-Uni où la flexibilité du système est beaucoup plus faible. À titre d’exemple, nous avons en France beaucoup d’hydroélectricité, dont une part susceptible de moduler la production. S’ajoutent à cela les STEP, citées précédemment. Notre parc de chauffe-eaux électriques, dont on peut aujourd’hui moduler la production avec le système « heures creuses – heures pleines », est également considérable et représente un gisement conséquent de déplacement d’énergie possible.
La grande conclusion de cette étude a été qu’à l’horizon 2030 il n’apparaissait pas, quel que soit le scénario envisagé, de besoin de développer de façon significative le stockage en France métropolitaine, en dehors de situations locales particulières qui n’ont pas pu être toutes analysées.
Nous avons mis en évidence la possibilité de développer en France métropolitaine, un ou deux gigawatts de nouveaux moyens de stockage de type STEP, susceptibles de trouver une rentabilité. Ces STEP pourraient entrer en concurrence avec d’autres moyens de flexibilité, tels que le pilotage de la demande. J’ai déjà parlé des chauffe-eaux, mais il convient de considérer l’effacement industriel, ainsi que le placement intelligent des recharges de véhicules électriques. À l’horizon 2030, ces véhicules pourraient se charger au moment opportun avec des signaux tarifaires. Ce pilotage de la demande, éventuellement par le biais tarifaire, pourrait au besoin prendre une place dans la gestion de ce gisement de stockage.
Cette évaluation concerne le cas général, en dehors de situations locales spécifiques, pour lesquelles il pourrait exister une rentabilité. Nous étudions ainsi, dans le cadre de différents projets accompagnés par l’ADEME, la rentabilité possible de dispositifs de stockage, notamment sur le réseau de distribution.
Il convient de mentionner ici un autre secteur dans lequel le stockage pourrait s’avérer utile. Il s’agit de la réserve tournante de 600 MW pour laquelle les volants d’inertie pourraient, par exemple, rendre un service.
Enfin, sur les territoires non interconnectés, îliens notamment, le stockage pourrait, dès aujourd’hui, représenter une opportunité intéressante pour des systèmes électriques de petite taille.
La seconde étude, publiée cette année, concerne la faisabilité en France métropolitaine d’un mix électrique très renouvelable, composé de 80 % à 100 % d’énergies renouvelables. Nous avons mis en évidence des résultats à la fois techniques et économiques. Cette étude a consisté à analyser la situation au pas horaire, et non, pour faire écho aux propos de M. Patrick Ledermann, aux conditions infra-horaires. Elle n’avait pas non plus pour vocation d’envisager les questions de scénario.
Cette étude a néanmoins permis de mettre en évidence différents points concernant notamment la faisabilité technique et le coût de production. Il existe différents mix électriques possibles, tous fondés majoritairement sur le photovoltaïque et l’éolien. Les coûts de production sont finalement assez peu éloignés de ceux d’autres mix électriques avec, par exemple, 40 % d’énergies renouvelables.
On constate enfin des résultats intéressants en termes de flexibilité et de stockage. Les besoins de flexibilité ont été évalués avec différents taux d’énergies renouvelables : 40 %, 80 % et jusqu’à 100 %, et différentes typologies de stockage susceptibles de rendre des services. En-deçà de 80 % à 95 % d’énergies renouvelables, les stockages de type batterie ou hebdomadaires – par exemple des STEP – peuvent prendre une part dans le mix électrique, avec environ 7 GW pour chaque type. Au-delà de ces taux, il serait nécessaire de recourir à des solutions de stockage inter-saisonnier, technologies aujourd’hui à l’état de prototype ou de petite démonstration. Nous avons ainsi retenu une technologie de type « power-to-gas », qui consiste à stocker du gaz de synthèse dans le réseau de gaz.
Il est important de souligner que la flexibilité dynamique de la demande, c’est-à-dire son pilotage, rend des services similaires à ceux rendus par le stockage infra-journalier en ce qui concerne l’équilibre entre l’offre et la demande. Toutefois cette flexibilité dynamique ne peut en aucun cas rendre des services en termes de stockage inter-saisonnier.
Je terminerai en évoquant la question des besoins en termes de technologies. Il apparaît notamment que les technologies de production sous-jacentes sont moins impactantes pour le réseau, au niveau des onduleurs, mais aussi des moyens de production. Par exemple, les technologies de photovoltaïque sur tracker, permettant d’orienter les panneaux suivant la position du soleil, ont des profils de production plus favorables au réseau, avec un pic moindre. De même, les éoliennes de nouvelle génération, de plus grand diamètre à puissance égale, peuvent également avoir un impact moindre sur le réseau.
J’ai déjà abordé le pilotage dynamique de la demande, avec l’opportunité offerte, dans les années à venir, par le pilotage intelligent de la charge des véhicules électriques.
En matière de stockage, un besoin de démonstration à l’échelle une a été pointé, notamment en zones non interconnectées (ZNI). Il faudra également affiner les connaissances sur les emplacements où ces dispositifs de stockage pourraient rendre un maximum de services.
Enfin, les outils de prévision pourront, tant à la maille nationale que locale, être utilisés pour améliorer les outils de conduite du réseau.
Les changements de vecteurs énergétiques, comme le « power-to-gas », ne seront nécessaires qu’à long, voire très long terme.
M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne, Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE), directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé), CEA. Je m’exprime devant vous au nom de l’ANCRE, Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie, qui produit régulièrement des rapports portant notamment sur des scénarios énergétiques, des analyses technologiques et des feuilles de route, ou roadmaps.
L’ordre de grandeur des sujets que nous traitons aujourd’hui est extrêmement vaste. Au niveau mondial, dans de nombreuses prévisions relatives à la proportion d’énergies renouvelables à un horizon 2050, les pourcentages sont de l’ordre de 40 %. La question de l’intégration de ces énergies renouvelables sera un sujet extrêmement important, non seulement en France et en Europe, mais aussi dans le monde.
Les technologies elles-mêmes, mondialisées et échangées de manière très large entre les différents pays, sont extrêmement nombreuses. Nous en avons décomptées plusieurs dizaines au sein de l’ANCRE. À titre d’exemple, parmi les technologies du futur qui viennent d’être présentées au ministre de l’économie, M. Emmanuel Macron, sept technologies spécifiques sur huit concernent notre sujet d’aujourd’hui, et quatre sur huit sont transverses. Les réseaux, ou peut-être les énergies renouvelables îlotées, seront ainsi des concentrés de technologies parmi les plus importants dans le monde de l’énergie de demain.
Il faudra bien sûr s’intéresser également aux aspects de coûts. J’y reviendrai en conclusion.
Nous avons par ailleurs analysé la question du stockage. Dans un contexte d’augmentation de la sollicitation des énergies renouvelables et de la demande, certains de nos scénarios laissant apparaître une demande électrique plus importante que dans les perspectives de l’ADEME, le stockage sera appelé à jouer un rôle central, à hauteur, dans certaines hypothèses, de 38 GW et 47 TWh à l’horizon 2050. Cela a été analysé par l’ANCRE comme appelant des ruptures significatives dans les technologies. Ce volet sera abordé ultérieurement par M. Fabrice LEMOINE. Il faut préparer ces technologies des années 2030 – 2050 dès maintenant et ne pas seulement travailler sur des taux de maturité élevés.
L’ANCRE a aussi mis en évidence l’importance de la dynamique. Par exemple, les coûts du solaire baissent, comme vous le savez, de façon très significative. Il faut envisager cette dynamique selon deux axes : d’une part, la baisse des coûts des technologies et l’augmentation des performances, et, d’autre part, les questions relatives au changement du parc. L’un des scénarios élaborés par l’ANCRE montre ainsi que si l’on souhaite diminuer la part en énergie nucléaire à l’horizon 2025, cela se traduira globalement par une augmentation des émissions de CO2, parce que les technologies ne seront pas disponibles et que les parcs électriques sont rigides. Ainsi, le pilotage de la transition, qui est l’objet même de la programmation pluriannuelle de l’énergie, devra intégrer aussi ces aspects de prise en compte des temps caractéristiques des parcs.
L’analyse des sujets que nous traitons aujourd’hui est assurément pluridisciplinaire. Les questions qu’ils soulèvent se posent, en effet, à différents niveaux et échelles (technique, local, régional, national, européen), dans le temps et en termes de filière énergétique, puisque l’énergie va s’interfacer de plus en plus avec du froid, du chaud, de l’hydrogène, avec les véhicules électriques, etc. De nombreux sujets se posent de façon multidimensionnelle dans les techniques de l’ingénieur, mais aussi dans les sciences humaines et sociales.
J’en veux pour preuve une courbe fournie par Réseau de transport d’électricité (RTE), montrant que la charge des véhicules électriques peut, en fonction de plusieurs hypothèses, considérablement modifier la charge horaire. L’un des enjeux sera de comprendre comment cela va réellement se passer, comment les comportements vont évoluer et quels seront les signaux à envoyer aux consommateurs pour qu’ils deviennent « consomm’acteurs » et parviennent à bien gérer ces phénomènes. Cela suppose donc que des recherches soient menées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diverses études ont été produites récemment sur les capacités à intégrer des taux élevés d’énergies renouvelables dans les réseaux. L’ANCRE a examiné de nombreux travaux de prospective à ce sujet et estime que la maturité du système n’est aujourd’hui pas suffisante. Il sera, selon nous, encore nécessaire de comparer et d’analyser, dans la mesure où la faisabilité des scénarios n’est pas toujours assurée, ni comprise. Nous sommes aujourd’hui à l’aube de cette phase au cours de laquelle il va falloir échanger et comparer, pour mieux comprendre, partager, expliquer et se mettre d’accord sur le fond, pour faire de la science sur ces sujets.
Ma conclusion ne peut être que temporaire, puisque la science évolue tous les jours. Elle tend à rappeler le besoin en technologies multiples et le fait que des solutions existent, mises en lumière notamment dans notre dernier rapport intitulé Decarbonization Wedges, élaboré en collaboration avec l’Organisation des Nations unies (ONU) et disponible sur notre site.
Pour autant, ces technologies ne suffiront pas. Nous avons montré que des tensions risquaient de se produire vers 2030 et qu’il est de ce fait important d’avancer et de développer ces technologies. Cela nécessite d’élaborer des feuilles de route et de travailler sérieusement sur ces sujets, de façon pluridisciplinaire, en veillant notamment à inclure dans ces travaux et réflexions les sciences humaines et sociales. Il nous apparaît ainsi indispensable de travailler avec des économistes en mesure d’indiquer, par exemple, qu’il existe des coûts de système importants dans le système électrique et qu’il ne suffit pas de raisonner en termes de parité de réseau. Les coûts de système pour les énergies renouvelables intermittentes sont peut-être, aujourd’hui, compris entre 10 € et 30 € par mégawattheure, ce qui est élevé. Un organisme de recherche comme l’ANCRE a vocation à les faire baisser, puisque nous souhaitons que ces nouvelles formes d’énergie se développent dans les parcs du futur. Il faudra, bien sûr, réfléchir à la conception de marché. Le développement des technologies ne pourra pas se faire sans modifications profondes dans ce domaine ; il faut y travailler, notamment dans le cadre d’une interface entre économistes et techniciens.
J’insiste enfin sur la nécessité de travailler sur les comportements, ce qui requiert de solliciter tout un éventail de compétences présentes au sein des sciences humaines et sociales. Nous savons que l’Office parlementaire s’est déjà beaucoup mobilisé sur ces sujets.
M. Pierre Mallet, directeur recherche et développement et innovation, ERDF. Je tiens à vous remercier de me donner l’occasion de présenter une vision industrielle, un peu différente peut-être de celle des autres intervenants. Je vais en effet vous exposer le point de vue d’un gestionnaire de réseau de distribution sur les technologies nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au réseau.
Mon entreprise, ERDF, est résolument tournée vers la préparation de l’avenir, avec un objectif d’excellence technologique, dans le but de toujours améliorer notre performance technico-économique, au service de nos clients.
ERDF consacre des moyens importants au développement de solutions innovantes et l’intégration des énergies renouvelables est évidemment l’une de nos priorités stratégiques en termes de recherche et développement, pour ne pas dire notre priorité. ERDF développe de nombreux projets dans ce domaine, que je ne pourrai vous présenter de façon exhaustive. Je ne vous donnerai donc que quelques exemples de nos actions.
Le premier, plutôt technique, est relatif aux technologies de réglage de la tension. Les moyens de production décentralisés modifient en profondeur la façon de régler la tension sur le réseau. ERDF a déjà développé une loi de réglage local, qui permet de limiter les élévations de tension générées par les producteurs. Sa mise en œuvre industrielle a commencé au début de l’année 2016. Permettant un raccordement moins coûteux et plus rapide, elle est plébiscitée par les filières photovoltaïque et éolienne. Au-delà de cette première étape, ERDF travaille sur une fonction de régulation coordonnée de tension au niveau de la zone d’action d’un poste source. Cette solution, actuellement en phase de test sur le terrain, a nécessité quatre à cinq années de recherches. Elle s’appuie sur des concepts très avancés en automatique, en optimisation et en électrotechnique. Je pense qu’ERDF se positionne vraiment comme leader mondial sur cette thématique de la gestion de la tension. Elle va permettre d’accueillir un volume plus important d’énergies renouvelables dans une zone donnée.
Un autre travail mené conjointement avec RTE porte sur la contribution des systèmes de distribution au soutien de la tension sur les réseaux de transport. L’évolution des systèmes fait que la relation entre transporteur et distributeur doit être revisitée, ce qui fait l’objet de travaux communs de recherche.
Plus généralement, le comportement électrotechnique, la stabilité des systèmes comportant des moyens de production répartis et peu de machines tournantes, sont des sujets complexes, sur lesquels de nombreux travaux restent nécessaires. L’entreprise est fortement mobilisée sur ces aspects, en partenariat avec d’excellents laboratoires universitaires français.
Le second exemple concerne la question de la flexibilité, indispensable pour accueillir un système avec des moyens énergétiques renouvelables intermittents. Elle peut se situer au niveau de la production, de la demande ou du stockage. Les équipes travaillent à faciliter son développement dans ces trois dimensions.
Par exemple, à l’échelle de la production, l’idée est de proposer, en échange de limitations de puissance demandées ponctuellement lorsque la conduite du réseau l’exige, des raccordements moins coûteux et plus rapides. Cette option sera proposée, et non imposée, aux producteurs. Chacun pourra opter pour cette celle-ci s’il estime y trouver son intérêt.
Pour mettre en œuvre ces solutions, il faut identifier en permanence les très rares situations nécessitant une action sur la production. On se dirige ainsi vers une gestion dynamique des systèmes de distribution. Cela implique notamment de développer, entre nos centres de conduite et les installations de production, des outils modernes de communication permettant de faire transiter des informations dans les deux sens.
L’intégration des énergies renouvelables passe aussi par la mise en œuvre d’une flexibilité au niveau de la demande en électricité. Afin de faciliter le développement des effacements et leur accès au marché, ERDF élabore des outils et méthodes permettant d’interpréter, de modéliser et d’utiliser au mieux les phénomènes ainsi que les mécanismes associés. L’entreprise travaille ainsi sur l’estimation de la réduction de puissance ex ante et les effets de bord induits (anticipation, report et rebond), et développe des méthodes de contrôle des effacements réalisés, facilitant la mise en place de mécanismes de marché correspondants.
Les solutions en matière de stockage apportent évidemment une réponse complémentaire aux enjeux d’intégration des énergies renouvelables. Par exemple, des algorithmes de commande de systèmes de stockage sont étudiés, pour optimiser leur intégration dans le réseau. Ce travaille porte notamment sur la comparaison de moyens très décentralisés, tels qu’une batterie dans le garage d’un client domestique ayant un panneau photovoltaïque sur le toit de son habitation, avec des solutions plus conséquentes raccordées aux moyennes tensions ou dans le poste source. Cela permet d’identifier les solutions les mieux adaptées, en termes de taille, à chaque situation. Cela fut notamment testé dans le cadre d’un démonstrateur près de Nice.
Il apparaît ainsi que la gestion des systèmes locaux devient de plus en plus complexe. Or, il faut continuer à garantir le bon fonctionnement du dispositif, en termes de stabilité et de continuité d’alimentation, ce qui amène ERDF à développer des solutions de gestion prévisionnelle, en termes de prévision locale de production et de consommation, d’identification des congestions éventuelles et de meilleures solutions pour y remédier par un mécanisme d’appel au marché.
Le troisième élément que je souhaitais évoquer concerne les outils numériques et les applications web, destinés à faciliter l’émergence des projets de production et l’exploitation des installations. Les capacités disponibles pour les producteurs font déjà l’objet de publications conjointes avec RTE et les entreprises locales de distribution (ELD). ERDF s’inscrit résolument dans la mise en place de nouveaux outils permettant la mise à disposition de données sur les capacités d’accueil de nos réseaux.
J’ai ainsi le plaisir de vous indiquer qu’ERDF lancera en 2016 le test d’un prototype d’application web qui permettra d’évaluer l’impact d’un projet de raccordement de production. Suivant la puissance de l’installation et la localisation du site, l’utilisateur pourra lui-même évaluer directement la plus ou moins grande facilité de raccordement au réseau basse tension. Cela offrira ainsi aux porteurs de projet la possibilité de mieux dimensionner leurs installations.
Par ailleurs, ERDF développe un portail « producteurs », pour aider à la coordination des travaux en phase d’exploitation du système.
Avant de conclure, je voudrais souligner que l’intégration des énergies renouvelables sera aussi facilitée par le développement de solutions innovantes pour la gestion des données massives. Le déploiement du système de comptage évolué Linky va entraîner la génération d’un très fort volume de données, dont la loi a confié la gestion à ERDF, qui devra notamment permettre à d’autres acteurs d’accéder à ces données : utilisateurs du réseau, fournisseurs, offreurs de services, collectivités locales, etc. Tout cela devra bien évidemment s’effectuer dans le respect des règlementations sur la protection de la vie privée et les conditions de maîtrise de la cybersécurité. Les nouveaux acteurs susceptibles d’accéder à ces données pourront être, par exemple, des agrégateurs de production, d’effacement ou de stockage qui vont développer de nouvelles solutions de flexibilité. Pour être en mesure de permettre ces évolutions, il va falloir développer et optimiser les capacités en matière de traitements massifs de données, ou Big Data, notamment par l’intermédiaire de nouvelles architectures de système d’information.
Ce tour d’horizon rapide illustre la variété des technologies nécessaires pour contribuer à l’intégration des énergies renouvelables. Les domaines scientifiques sollicités couvrent bien évidemment l’électrotechnique, mais aussi l’automatique, les mathématiques appliquées, l’optimisation ou encore l’informatique et les télécoms, avec des sujets comme le Big Data, les solutions web, l’Internet des objets, etc.
M. Patrick Panciatici, conseiller scientifique, RTE. Issu du domaine de la recherche et développement, je vais essayer d’apporter un regard original sur ces questions.
La France fait partie d’un très grand système électrique interconnecté. D’aucuns affirment que ce serait le plus grand système industriel jamais construit par l’homme. Ce système complexe fonctionne depuis longtemps. Il est important d’en comprendre l’architecture et le fonctionnement. Trente-quatre pays sont ainsi interconnectés dans le cadre du système électrique européen. Le but est d’essayer d’assurer une sécurité de fonctionnement et d’alimentation, ainsi qu’une optimisation économique à cette échelle. Quarante-et-un gestionnaires de réseaux de transport comme RTE contribuent à cette démarche.
Au-delà des questions classiques que sont l’intermittence et ses solutions de flexibilité et de stockage, ou encore les productions diffuses conduisant à des flux bidirectionnels, je souhaiterais évoquer des éléments plus techniques, avec une perspective « système » et de sécurité de fonctionnement.
Depuis leur émergence, les grands systèmes électriques fonctionnent de façon plutôt satisfaisante, sans télécommunication ni système informatique complexe et centralisé, grâce notamment à l’entraide « instantanée » en cas d’aléas. Il faut savoir que, en cas de perte d’un gigawatt en France, tous les groupes de production de la zone interconnectée synchrone, du Portugal à la Pologne et du Danemark à la Grèce, réagissent instantanément pour produire chacun moins de un mégawatt, ce qui est au final assez indolore pour chacun d’entre eux mais contribue énormément à la robustesse générale du système. La mesure locale de la fréquence du signal de tension électrique permet de connaître le besoin global du système, ce qui a d’ailleurs fait le succès des réseaux à courant alternatif, par rapport aux réseaux à courant continu.
Depuis leur émergence, ces systèmes électriques se caractérisent par une interconnexion massive et croissante des réseaux, ainsi que par l’augmentation de la taille unitaire des groupes de production, en vue d’atteindre une plus grande fiabilité et une réduction des coûts de production d’électricité. Or, il semble que la transition énergétique induise aujourd’hui un infléchissement de cette tendance historique. On se dirige ainsi vers des groupes de production de plus petite taille, interfacés au réseau via de l’électronique de puissance.
Il existait jusqu’alors des milliers de grands alternateurs synchrones, de taille moyenne – de l’ordre de 500 MW – connectés au système. Le système vers lequel on se dirige se caractérisera par l’existence de millions de générateurs d’électricité plus petits, interfacés par de l’électronique de puissance et dotés d’un pilotage numérique. On va ainsi passer de systèmes qui créaient naturellement la fréquence à des dispositifs qui mesurent la fréquence du réseau et injectent du courant à cette fréquence. On comprend bien que, s’il n’existait plus que des machines de ce type, le système ne fonctionnerait plus. Au-delà du réglage, il faut, en effet, que quelqu’un crée le signal pour connaître le besoin du système.
Un phénomène similaire se produit pour les réseaux de distribution. Historiquement, ces réseaux étaient passifs, donc prévisibles, et aidaient le système en cas d’aléas. La situation est actuellement en train d’évoluer. De nombreux systèmes vont être connectés, avec beaucoup de possibilités de contrôle sur les systèmes de distribution. La question est de savoir comment procéder. Si l’on adopte une vision trop locale, on risque de commettre des erreurs. Ainsi, effectuer un réglage trop rapide de tension ou synchroniser des comportements peut mettre le système en danger. De bonnes intentions locales peuvent, en effet, avoir des impacts très négatifs à l’échelle globale.
On assiste donc à un changement de paradigme assez conséquent. Autrefois, la dynamique du système était vraiment imposée par les lois de la physique et du matériel. On bascule aujourd’hui vers un monde dans lequel cette dynamique est davantage imposée par des boucles de contrôle et du logiciel. Hier, la physique assurait le fonctionnement stable du système, tandis qu’une couche informatique veillait à son optimisation. Perdre l’échelon « cyber » faisait perdre de l’argent, mais ne remettait pas en cause la stabilité du système.
Demain, cette couche « cyber » descendra dans la couche physique et assurera la sécurité du fonctionnement. Il est très important de prendre cela en compte et de l’anticiper. Des éléments que l’on ne spécifiait pas parce qu’ils venaient naturellement avec la physique du système, vont devoir l’être désormais. Il existe d’ailleurs une initiative européenne en ce sens, à laquelle je participe, qui vise à mener une réflexion globale sur ce type de cyber-physical systems of systems, systèmes complexes dans lesquels existent des interactions assez fines entre les parties « cyber » et « physique ».
Je souhaite, pour conclure, mentionner quelques exemples de projets européens dans lesquels RTE se trouve impliqué. L’entreprise collabore ainsi à un projet européen de recherche et développement intitulé MIGRATE (Massive InteGRATion of power Electronic devices). Piloté par nos amis allemands, il concerne justement la question de l’intégration massive d’électronique de puissance dans les réseaux. Les collègues irlandais sont également partie prenante à ce projet, l’Irlande, pays interconnecté mais doté de courant continu, étant particulièrement concerné. Imaginons qu’il y ait 100 % d’électronique de puissance dans les systèmes : comment cela fonctionnerait-il ? Qui créerait le signal de fréquence ? Le deuxième projet, GAPUR (Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment), vise à repenser la définition de la fiabilité des systèmes électriques à l’aune de ces nouveaux éléments, en faisant appel à des notions probabilistes. Le système doit être robuste à la perte d’un équipement. Enfin, le projet DYMASOS (DYnamic MAnagement of physically coupled Systems Of Systems) concerne les modalités de pilotage et de contrôle de grandes populations d’agents ou d’équipements relativement autonomes, connectés physiquement entre eux. Comment penser des systèmes moins hiérarchiques, composés d’agents autonomes devant interagir de façon raisonnable ?
M. Davy Marchand-Maillet, directeur des opérations, Sun’R Smart Energy. Sun’R Smart Energy faisant partie du groupe Sun’R, qui intègre un producteur d’électricité photovoltaïque, est totalement concerné par les différentes problématiques précédemment présentées, qu’elles soient techniques, puisque cela a un impact direct sur la valeur de la production et sur les coûts de raccordements au réseau des centrales, ou économiques. Vous avez ainsi indiqué en introduction que la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) coûtait cher aux Français. Sun’R Smart Energy souhaite trouver des solutions pour que cette charge soit moindre, et que ces systèmes soient intégrés dans les marchés de l’électricité. Son objet consiste précisément à concentrer son activité sur les métiers de l’agrégation des énergies renouvelables et du stockage.
Le stockage mutualisé et décentralisé est un élément fondamental pour l’intégration des énergies renouvelables. Aussi, proposons nous aujourd’hui des innovations assez classiques, portant sur des dispositifs d’intégration du solaire au bâti ou combinant l’agriculture et le photovoltaïque, mais incluant de la flexibilité et du stockage, notamment des solutions spécifiques de pompage-turbinage, extrêmement flexibles et décentralisées.
Pourquoi se tourner vers de telles solutions ? Pour développer les énergies renouvelables dans le mix électrique, il est évident que l’intégration des énergies renouvelables nécessite l’apport d’actifs flexibles sur les réseaux d’électricité. Or, il n’existe, a priori, que quatre types de solutions susceptibles de répondre à cette exigence.
Une première solution consiste à faire varier la production classique. Mais les actifs thermiques, potentiellement mobilisables dans ce cadre, sont générateurs pour la plupart de CO2 et ne constituent donc pas une solution viable. Quant à l’hydroélectricité, beaucoup plus propre en termes d’émission de gaz à effet de serre, elle présente un potentiel relativement réduit.
Une deuxième solution consiste à agir via les réseaux, ce qui peut entrainer des gains rapides. Néanmoins, il faut être conscient du fait que les réseaux vont surtout aller chercher les flexibilités là où elles se trouvent et non créer de la flexibilité en tant que telle. À un moment donné, il est plus utile d’étendre les réseaux, puisque les flexibilités potentielles sont toutes à disposition.
Une troisième solution concerne l’effacement, aussi bien en termes de production que de consommation. Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que l’effacement pur de production ou de consommation correspond à une destruction d’utilité. L’énergie produite et non injectée dans le réseau est perdue. Quant à la consommation que l’on efface, elle ne sera par définition pas convertie en un élément présentant une utilité. Il ne faut pas confondre cela avec l’effacement de consommation générant un report, qui constitue un déplacement de consommation, donc une forme de stockage.
Une quatrième solution consiste à développer le stockage d’électricité, avec deux possibilités. Le power-to-power consiste à stocker de l’électricité sous une forme donnée, restituée ensuite sous forme d’électricité. Le power-to-X, par exemple le power-to-gas, renvoie à la conversion de l’électricité en un autre élément susceptible d’être stocké et utilisé en tant que tel, sans requérir l’utilisation d’électricité. Il s’agit en fait d’un déplacement de consommation.
Le stockage est finalement le seul moyen qui permet d’absorber massivement la variabilité des énergies renouvelables, puisque la production classique, les réseaux et l’effacement sont limités. Seul le stockage peut être développé de façon massive, tout en étant rentable.
Quel est, partant de ce constat, l’échelon le plus pertinent pour déployer le stockage ?
Jusqu’à présent, Sun’R Smart Energy a beaucoup travaillé sur le stockage purement centralisé, comme les grandes stations de pompage – turbinage, qui offrent des capacités unitaires élevées et présentent un réel intérêt de par leur coût. Elles n’ont toutefois aucune interaction avec les réseaux locaux et sont myopes par rapport aux enjeux locaux. S’ajoute à cela la rareté de nouveaux sites susceptibles d’être développés, tant en France qu’en Europe. Une importante étude, menée par le Joint Research Centre (JRC) sur les moyens de stockage susceptibles d’être développés, montre qu’ils sont finalement assez peu nombreux. De plus, ce type de stockage requiert beaucoup de réseau et, généralement, un investissement public, dans la mesure où les structures privées ont du mal à porter ce type d’actif.
À l’autre bout de la chaîne, on peut aussi envisager un stockage sur site, c’est-à-dire chez le consommateur, derrière un site de production. Cette solution n’est pas efficace économiquement, parce qu’elle ne remplit qu’un certain nombre de fonctions, qui pourraient en outre être utilisées à d’autres moments.
La clé semble donc résider dans la mutualisation des équipements de stockage dans le réseau, non derrière les points d’injection ou de consommation. Elle permet, en effet, de mutualiser les capacités, de fournir davantage de services, notamment au réseau électrique, pour faire du réglage de tension ou de puissance active sur les réseaux de distribution. Cette solution permet d’optimiser les investissements et de se dispenser de renforcer le réseau à certains endroits. Par exemple, dans le cas d’un site solaire confronté à des difficultés de raccordement, un effacement de production de seulement quinze heures dans l’année peut permettre d’éviter le renforcement du réseau.
Il s’agit assurément d’un sujet nouveau et complexe, qui concerne, par ailleurs, des unités de taille moyenne, dont la rentabilité reste encore à consolider.
J’insisterai pour conclure sur la question des besoins auxquels notre entreprise se trouve confrontée. Pour travailler sur ces sujets, Sun’R Smart Energy a des besoins en termes de captation, de surveillance (monitoring), de contrôle et de gestion des données. La prévision des énergies renouvelables est également un enjeu, même si cette question est déjà relativement bien traitée. Il faut aussi travailler sur l’optimisation et sur les technologies de stockage.
Outre ces besoins technologiques, il existe aussi des besoins en recherche économique, notamment sur la conception de marché (market design) et sa traduction règlementaire. Aujourd’hui, la conception (design) du marché européen, orientée vers la production d’énergie (energy only) n’est pas complètement adaptée à la gestion du stockage, de même que le tarif d’utilisation, qui prend mal en compte la gestion des réseaux. Cela demande de la recherche, par exemple sur les incitations prenant en compte les dépenses totales (total expenditures).
M. Dominique Grand, docteur en physique, Realistic energy. Depuis quelques années, mes collègues et moi essayons d’observer les impacts du développement de l’éolien et du solaire, d’anticiper leur évolution future, et de prévoir les besoins de gestion de l’intermittence, en termes notamment de stockage. Pour ce faire, il semble important d’appliquer la méthode scientifique, avec toute sa rigueur d’observation, de primauté des faits, et de révision éventuelle des théories, en fonction des observations effectuées.
Dans ce cadre, mes collègues et moi avons eu connaissance des travaux du Pr Friedrich Wagner, qui s’inscrivent parfaitement dans la même démarche et ont inspirés notre propre réflexion. Ses études consistent tout d’abord à observer les résultats de l’éolien et du solaire en Allemagne, pays particulièrement riche en la matière. Elles proposent une méthode pour se projeter dans l’avenir, avec une croissance de ces énergies, pour en déduire des prévisions, sans préjuger les résultats ou solutions souhaitables. De plus, ces publications détaillent tous les moyens permettant de reproduire et de vérifier les démonstrations présentées, ce que se sont attachés à faire plusieurs collègues, dans différents pays européens, notamment en Suède et en Tchécoslovaquie. MM. Roland Vidil, Christian Le Brun et moi-même menons ce travail en France depuis trois ans, et nous avons réalisé plusieurs publications à ce propos.
Le mix électrique que mes collègues et moi avons projeté, aligné sur la loi de transition énergétique, compte 50 % de nucléaire et 50 % d’énergies renouvelables, composées de 15 % d’hydraulique et autres énergies renouvelables et de 35 % d’éolien et de solaire.
Ont été utilisés pour se projeter dans ce mix les relevés de l’année 2013, avec une consommation et une courbe d’hydraulique inchangées, un nucléaire réduit au fil du temps pour atteindre l’objectif de 50 %, et la production totale, des énergies renouvelables intermittentes, éolien et solaire, caractérisées par d’importantes fluctuations, avec des pointes pratiquement à zéro et d’autres au niveau de la consommation.
Si l’on considère l’ensemble des productions et qu’on les soustrait à la consommation, on obtient une courbe d’équilibrage. Celle-ci alterne entre le négatif, qui correspond à de l’excédent à stocker, et le positif, qui témoigne d’un manque à compléter en apportant davantage de puissance. Il convient de noter l’importance des fluctuations.
Si l’on effectue la monotone de ces mêmes courbes, avec un tri des puissances par valeurs croissantes, on obtient une figure beaucoup plus lissée, qui ignore toutes les fluctuations. On constate toutefois toujours l’existence d’une partie à stocker de 43 TWh et d’une autre à produire en complément. 43 TWh correspondent à un quart de ce que produisent les énergies renouvelables intermittentes. Chaque année, les productions ont des historiques différents. Des vérifications effectuées sur trois années montrent cependant que les monotones de ce type sont remarquablement stables. Ces dernières indiquent donc bien une tendance générale de la production au cours d’une année, très différente de celle obtenue en moyennant plusieurs années.
Une fois le besoin estimé, nous avons essayé de regarder l’estimation des apports, à chercher notamment du côté de l’hydraulique, avec à la fois les STEP et les moyens de flexibilité qui aboutissent à 10 TWh. Si l’on considère une estimation de la consommation de l’ordre de 2 TWh, et que l’on se fonde sur ce que l’on connaît de la flexibilité aujourd’hui, cela ferait une augmentation considérable. Nous avons prévu un peu de power-to-power, qui consiste en un retour à l’électricité de ce que l’on a transformé pendant un temps sous forme de gaz.
Sont également mentionnés dans nos travaux les puissances installées nécessaires pour produire tout cela. En photovoltaïque et éolien, ces puissances sont calculées grâce aux facteurs de charge tels que nous les observons aujourd’hui, remarquablement stables au fil des années et en cohérence avec les données de l’étude allemande. La puissance hydraulique, qui sert à la flexibilité, concerne essentiellement les STEP et les centrales de lac. Nous avons enfin fait figurer les installations fossiles, dans la mesure où il sera nécessaire d’y recourir pour toutes les parties qui n’auront pas été partiellement effacées.
Il ne faut toutefois pas oublier des éléments que les monotones cachent, à savoir l’historique, l’importance des fluctuations et la nécessité que les moyens s’y adaptent, ce que l’on a supposé dans nos travaux.
M. Jean-Yves Le Déaut. Comme je vous l’indiquais en introduction, l’Office parlementaire a consacré une audition publique à la transition énergétique française, en envisageant les enseignements à tirer du tournant énergétique allemand. Celle-ci avait permis d’inviter de nombreux acteurs et spécialistes du secteur de l’énergie en Allemagne et en France.
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui un physicien allemand de grand renom, M. Friedrich Wagner, directeur émérite du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, professeur émérite de l’université Ernst-Moritz-Arndt à Greifswald, au nord de Berlin, et membre du groupe énergie de la Société européenne de physique, qui va présenter, en conclusion de cette première table ronde, sa vision de scientifique sur les caractéristiques d’un approvisionnement en électricité par des sources intermittentes.
Pr Dr Friedrich Wagner, directeur émérite du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, professeur émérite de l’université Ernst-Moritz-Arndt à Greifswald, membre du groupe Energie de la Société européenne de physique (EPS, European physical society). Je vais vous parler des caractéristiques d’un système d’approvisionnement énergétique fondé sur les formes d’énergies renouvelables indentifiables, à savoir le photovoltaïque et l’éolien, qui sont des sources intermittentes. Je vais surtout vous présenter des calculs effectués pour l’Allemagne. Les études correspondantes ont été publiées dans des revues à comité de lecture.
La situation allemande actuelle se caractérise par une puissance éolienne et photovoltaïque de l’ordre de 80 GW. La puissance installée totale, incluant le thermique, représente près de 200 GW, tandis que les besoins maximum en pointe sont de 83 GW. Ces données correspondent au parc déjà installé en matière d’énergies renouvelables, pour l’éolien et le photovoltaïque.
Je souhaiterais souligner ici une différence essentielle entre la France et l’Allemagne pour ce qui concerne la production d’électricité : la France produit, en effet, de l’électricité en émettant sept fois moins de CO2 que l’Allemagne, en raison d’un mix dominé depuis quarante ans par l’hydraulique et le nucléaire. La France se trouve ainsi aujourd’hui dans la situation que l’Allemagne vise à l’horizon 2050.
La transition énergétique ou « Energiewende » présente plusieurs aspects, qu’il est possible de chiffrer à partir des méthodes exposées par M. Dominique Grand. Les calculs que je vais vous présenter sont fondés sur les données réelles de 2012, extrapolées à 100 % de production électrique par l’éolien et le photovoltaïque, soit 500 TWh. C’est là la cible de tous mes calculs.
Les données exposées présentent les résultats pour deux semaines, l’une située au mois de mars, avec une production optimale des énergies renouvelables le 31 du mois, l’autre en novembre, avec un besoin optimal de production d’appoint le 15 du mois. On constate une demande importante du lundi au vendredi, diminuant en fin de semaine, ainsi qu’une demande plus forte la journée que la nuit. Notez enfin les besoins d’appoint nécessaires. On observe un excédent d’énergie en mars, avec 175 GWh. On remarque aussi une longue période d’une semaine au mois de novembre au cours de laquelle le recours à la production d’appoint est nécessaire.
Que peut-on calculer ? On peut, par exemple, calculer la puissance à installer pour 500 TWh : pour l’Allemagne, cela représente 306 GW, ce qui est suffisant pour desservir toute l’Europe les bonnes journées. Que doivent représenter les systèmes d’appoint ? 73 GW sont nécessaires, ce qui correspond à 26 % du besoin total. Les investissements requis pour ces systèmes d’appoint ne sont que de 12 % inférieurs à ceux correspondant à un parc de production sans énergies renouvelables, ce qui implique l’exploitation de deux systèmes en parallèle. Par ailleurs, 130 TWh d’énergie excédentaire sont produits, ce qui est suffisant pour approvisionner la Pologne.
Les conditions à mettre en œuvre dans le cadre du pilotage de la demande concernent essentiellement des prix d’électricité bas pendant la journée. Cela n’est pas toujours favorable, dans la mesure où l’on constate beaucoup d’excédents dans la journée en valeur moyenne. L’effet majeur du pilotage de la demande serait de développer l’activité pendant les week-ends, dans la mesure où le soleil comme le vent se moquent de savoir si l’on se situe en cours ou en fin de semaine.
Quel sera le niveau de réduction des émissions de CO2 ? Nous ne parviendrons vraisemblablement pas, selon mes calculs, au niveau de la France, de la Suède, de la Suisse ou de la Norvège. Nous en connaissons les raisons.
Les principaux problèmes techniques liés à l’utilisation des sources intermittentes sont la production excédentaire d’énergie et la puissance excédentaire, à un niveau très élevé, la question du stockage et le problème de l’intermittence.
Les excédents constituent déjà un problème de nos jours. Les exportations d’électricité allemandes augmentent, pour atteindre un niveau que l’on connaissait seulement pour la France. Ces exportations correspondent à la production d’énergie photovoltaïque. Cela est d’ailleurs assez bien corrélé : l’énergie créée par le photovoltaïque est exportée à des prix faibles, voire négatifs. Cette production excédentaire cause de graves problèmes à nos voisins, dans la mesure où les périodes de prix bas interfèrent avec la production d’autres pays, comme les Pays-Bas. Des transferts de phase vers la Pologne ou la République Tchèque sont aussi créés.
Les besoins en stockage saisonnier en Allemagne, calculés sur la base de 100 % de production d’électricité renouvelable et 500 TWh, sont de 32 TWh. À l’heure actuelle, en Allemagne, le stockage est de 8 GW et 50 GWh, soit un facteur de plus de 600. Les besoins de capacité représentent un problème majeur qui requiert la mise en œuvre de nouvelles technologies de stockage, ainsi que cela a été précédemment exposé. Or, ces technologies ne sont pas encore développées et les aspects écologiques mal connus. On sait néanmoins que la disponibilité dépend de l’efficacité du système.
Pour illustrer mon propos, je vais m’appuyer sur l’exemple du power-to-gas, et du retour à l’électricité, qui pourrait constituer un bon candidat parmi les nouvelles technologies. L’efficacité est d’environ 50 % lorsqu’on utilise l’hydrogène et 30 % avec un vecteur méthane. Dans le premier cas, on récupère 65 TWh sur 130 TWh et dans le second 40 TWh seulement.
L’une des solutions serait d’envisager une surproduction, en installant deux fois plus de photovoltaïque et d’éolien, qui produiraient ainsi 1 000 TWh, alors que le besoin serait de 500 TWh. Il faut toutefois savoir que, sur ces 1000 TWh, 445 seulement seraient utilisés, le reste étant de l’excédent. Or, l’excédent étant supérieur à la demande, ceci montre bien les problèmes à surmonter. Une capacité de stockage de 6 TWh serait nécessaire. Les 55 TWh restants seraient sans débouché.
Il faut par conséquent prévoir énormément de stockage. La phase entrante doit, en outre, pouvoir supporter des quantités d’énergie à un fort niveau de puissance. Or, quelle que soit la technologie, ce ne sera pas le cas.
La question de l’intermittence est un vaste sujet. Cela concerne les pics de puissance, tout comme l’interférence croissante avec les réseaux ou les oscillations de puissance sur le réseau.
L’analyse des dynamiques de puissance, extraites des données tchèques avec une résolution d’une minute, montre que la puissance de contrôle doit être augmentée d’un facteur deux par rapport au niveau actuel. Le contrôle primaire est le plus critique. La variabilité, faible, peut être contrôlée en utilisant des turbines à gaz ou des centrales combinées. Cela ne peut toutefois être utilisé par les systèmes d’appoint, avec 100 % de solaire et d’éolien. La criticité peut augmenter lorsqu’on réduit l’inertie du système, car on ne peut plus alors faire démarrer facilement ces centrales.
La question est de savoir si un système interconnecté à l’échelle européenne serait utile. Cela pourrait faire baisser le besoin de production d’appoint ou de capacité de stockage de 30 %, tandis que le niveau d’intermittence diminuerait d’environ 40 %.
Il faut néanmoins tenir compte des conditions météorologiques en Europe. J’ai ainsi étudié l’utilité des pays voisins quant à leur possible apport d’excédent dans les cas où l’Allemagne aurait besoin de systèmes d’appoint. Le premier pays susceptible d’apporter son soutien est l’Espagne, dans la mesure où les conditions météorologiques locales ne sont pas fortement corrélées à celles de l’Allemagne. La plus petite contribution viendrait des voisins immédiats, qui connaissent des conditions météorologiques similaires à celles de l’Allemagne, la conséquence étant que ces voisins produisent aussi un excédent. Pour bénéficier d’un réseau européen est-ouest et nord-sud et faire face à ce surplus de puissance, il faut de grandes capacités d’interconnexion.
J’aimerais à présent évoquer les conséquences qu’aurait, pour un pays comme la Suède, le remplacement du nucléaire par l’éolien. La Suède consomme 134 TWh d’électricité, dont 62 TWh produits par l’hydraulique, 63 TWh par le nucléaire, 10 TWh par l’éolien. L’hydraulique n’étant pas en mesure de compenser les fluctuations introduites par l’éolien, il faut des systèmes d’appoint, comme les centrales à gaz. Il faut savoir que le remplacement de 9 GW de puissance nucléaire requiert 22 GW d’éolien et 9 GW de gaz. Les émissions spécifiques de CO2 augmentent d’environ 50 %. Le photovoltaïque est, en outre, assez inefficace pour remplacer l’appoint, et le stockage n’est pas significatif, dans la mesure où la puissance excédentaire est trop faible. Enfin, la surproduction ne fonctionne pas, car cela conduit à remplacer l’hydraulique par l’éolien, donc un système équilibré par un déséquilibré.
Pour conclure sur le sujet de cette audition, j’indiquerai que le maximum acceptable de sources intermittentes se situe aux alentours de 40 %.
Je m’attends à la survenue de problèmes économiques à cause du système de production excédentaire, des coûts du système d’appoint, et de la technologie nécessaire pour supporter ces augmentations de puissance.
Se pose aussi la question d’un réseau européen, dans lequel on puisse effectuer des transferts est-ouest et nord-sud, avec des interconnecteurs forts n’ayant pas de bonnes perspectives économiques.
Pour la France, la question est de savoir si le nucléaire et une production fortement intermittente peuvent s’accorder.
M. Jean-Yves Le Déaut. Il nous reste malheureusement peu de temps pour le débat. Je souhaiterais toutefois que l’ADEME puisse notamment réagir à la conclusion du Pr Friedrich Wagner. Vous avez, me semble-t-il, élaboré un scénario envisageant d’aller largement au-delà de 40 % d’énergies intermittentes.
M. David Marchal. L’ADEME s’est fondée, pour l’étude à laquelle vous faites référence, sur des logiciels de simulation de l’équilibre horaire d’un parc tout à fait reconnu, y compris par les gestionnaires de réseau.
L’une des principales différences avec les deux études présentées réside dans la modulation et le pilotage de la demande. Les chroniques de production considérées sont, par exemple, telles qu’aujourd’hui. On regarde finalement la demande nette, sans prendre en compte cette flexibilité. L’un des résultats des différents travaux menés en 2013 et 2015 est qu’à l’horizon 2030, avec 40 % de renouvelable, le plus intelligent pour le système électrique serait de déplacer les charges modulables, telles que le chauffage de l’eau chaude sanitaire, aux heures de production solaire. C’est le meilleur moyen pour que, globalement, le coût pour la collectivité soit le moins élevé possible. Or, je n’ai pas vu ce déplacement dans les chroniques qui ont été montrées.
L’étude 100 % énergies renouvelables de l’ADEME, qui considère un mix théorique, fait apparaître des gisements de flexibilité liés à la demande situés entre moins huit gigawatt et plus vingt-deux gigawatt. Une grande flexibilité existe donc au travers de la modulation de la demande.
M. Patrick Ledermann. Dans l’étude de l’ADEME envisageant 80 % à 100 % d’énergies renouvelables, vous prenez en compte, me semble-t-il, une réduction très importante de la consommation, à 420 TWh au lieu des 550 TWh actuels. Une réduction aussi conséquente est-elle vraiment envisageable ?
M. Dominique Grand. Les éléments présentés, qui n’ont pas encore été publiés, prennent en compte la flexibilité de la production hydraulique, et une estimation de 2 TWh au niveau de la consommation. Or, mis à part les chauffe-eaux électriques, les rapports sur la flexibilité produits par RTE indiquent, pour l’instant, un niveau cent fois inférieur. Il faut donc tenir compte de cette montée.
Lorsque l’on considère des monotones comme celles-ci, on ne cherche plus du tout à garder la corrélation avec le temps : on suppose que les moyens s’adaptent instantanément. Les installations à la fois de stockage et de production, ou les éléments de flexibilité, sont des installations industrielles qui vont devoir s’adapter à des transitoires très rapides. Cela reste à démontrer.
Pr. Dr. Friedrich Wagner. Si l’on considère des études à 100 % de renouvelable, il faut, bien sûr, envisager les conditions limites. Il s’agit d’augmenter l’efficacité, pas tellement d’économiser l’énergie. Dans le cas de l’Allemagne, si l’on considère la biomasse dans ces conditions, alors on peut parvenir à 100 % ; mais on réduit la consommation à 30 %. Si l’on veut obtenir 60 %, ce qui est déjà gigantesque, il faut doubler la biomasse ; or cela ne me semble pas possible pour l’Allemagne, qui importe déjà 50 % de sa biomasse. On voit donc là qu’il existe certaines limites.
Concernant la gestion de la demande, j’aimerais recommander que l’on chiffre les propositions, faute de quoi il est difficile de savoir précisément de quoi l’on parle. Le pilotage de la demande est, par exemple, un élément calculable. Il faut en analyser précisément les fluctuations au jour le jour. Peut-on fonder une activité économique sur un élément très fluctuant ?
De plus, il s’agit de voir en quoi cela aide à récupérer l’électricité manquante. On peut tout axer sur la production de chaleur, mais cela n’aide pas beaucoup, car, en Allemagne, la chaleur est de 950 TWh, alors que la production est de 230 TWh. Il est très important de quantifier les choses ; cela offre une base sur laquelle il est possible de réfléchir et de travailler.
M. Davy Marchand-Maillet. Il faut bien comprendre que l’effacement, de la production comme de la consommation, est en ligne avec les besoins. Pour gérer les pointes de consommation, il est nécessaire de disposer d’un gisement de consommation effaçable, quitte à détruire de l’utilité. De la même manière, on dispose toujours d’autant de production à effacer que possible. Le gisement est toujours présent. Il s’agit ensuite d’une question purement économique. Je défends pour ma part fortement l’utilisation du stockage pour tous les cas qui ne sont pas économiques. Néanmoins, le gisement existe.
M. Jean-Yves Le Déaut. Ce débat est très intéressant, dans la mesure où ce sont les modèles qui influencent les politiques. Or, on se situe dans des modèles de transition énergétique dans lesquels il est généralement indiqué qu’il faut augmenter la proportion d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique et baisser les consommations. Le problème résiderait dans le fait de se diriger vers des modèles impossibles, pour essayer de condamner d’autres types énergétiques. Votre débat est strictement scientifique, mais, en politique, d’aucuns n’hésitent pas à avancer des arguments visant simplement à conforter leur thèse.
Il est donc essentiel que la totalité des points en jeu soit clairement exposée. Il est, par exemple, important de savoir, ainsi que cela vient d’être souligné, qu’il existe des gisements importants en termes d’effacement. Il est également fondamental de bien mettre en lumière les limites de chaque système.
La question de l’économie est aussi centrale. Dans le système allemand, qui n’est pas à 100 % renouvelable, 70 milliards d’euros seront consacrés aux énergies renouvelables pour la période 2014 – 2025. Il faut que les chiffres du coût par rapport à d’autres bouquets énergétiques soient évoqués. Cette transition ne se fera pas à coût identique. Tous les experts confirment que cela entraine un coût supplémentaire, de l’ordre de trois ou quatre milliards d’euros par an, payés aujourd’hui par le consommateur.
Il faut aller vers cela, trouver les solutions de gisement, soutenir les petites entreprises qui travaillent sur les solutions d’effacement, tout en disposant de la totalité des éléments de réflexion nécessaires. Il faut éviter de faire croire à un public non averti que les choses sont simples et qu’il suffit d’aller vers du 100 % renouvelable pour résoudre les problèmes de notre système de consommation électrique et aplanir les difficultés d’adaptation entre la production et la consommation.
DEUXIÈME TABLE RONDE : RÉSEAUX INTELLIGENTS, EFFACEMENT, STOCKAGE, OPTIMISATION – QUELQUES PISTES DE RECHERCHE POUR L’INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Présidence de Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée,
vice-présidente de l’OPECST.
M. Jean-Yves Le Déaut. Mme Anne-Yvonne Le Dain ayant été retenue par un vote, je vais assurer la transition jusqu’à son arrivée. Je demanderai aux intervenants de cette deuxième table ronde de bien vouloir respecter le temps qui leur est imparti. Si vos interventions sont toujours passionnantes, il est en effet également très intéressant, pour nous parlementaires, qu’un débat puisse se nouer à l’issue des présentations. Je vous remercie.
Mme Marion Perrin, CEA-LITEN. Mon propos va essentiellement concerner le solaire photovoltaïque et le stockage, qui sont les deux points que le laboratoire et mon service maîtrisent le mieux.
L’agrégation d’un certain nombre de centrales sur un territoire permet une limitation de la variabilité. Une mesure de la production de dix-huit centrales photovoltaïques montre que si une centrale isolée présente une variabilité d’environ 20 % sur un pas de trente minutes, lorsqu’elles sont agrégées par deux, puis par quatre, et jusqu’à dix-huit, cette variabilité tend vers une asymptote, située aux alentours de 3,2 %. L’agrégation de centrales réduit donc fortement la variabilité. Il s’agit d’une évidence, qu’il convient malgré tout d’étudier, en termes de répartition territoriale, et par zones météorologique. En effet, il ne s’agit peut-être pas d’installer les panneaux photovoltaïques uniquement là où ils produisent le plus, mais aussi là où ils sont les plus respectueux du réseau.
Le deuxième point de mon intervention porte sur la prévision de la production, outil nécessaire pour l’exploitation des différentes sources de production reliées à un réseau intelligent, qui doit équilibrer offre et demande, en tout point du territoire. Cette prévision peut être basée sur des données météorologiques ou, pour des pas de temps plus courts, sur des données satellitaires. Pour des pas de temps inférieurs à trente minutes, il est possible de s’appuyer sur la vision du ciel depuis la centrale, ce qui permet d’obtenir un équilibrage très dynamique sur des systèmes de type micro-réseau, particulièrement intéressants pour des systèmes non interconnectés. Pour améliorer ces résultats, il est nécessaire de disposer d’apprentissage par surveillance (monitoring), et d’affiner les modèles météorologiques.
Un troisième aspect concerne l’utilisation de la flexibilité du solaire photovoltaïque pour participer aux services système. Il ne faut pas considérer le photovoltaïque uniquement comme un problème, mais éventuellement aussi comme une partie de la solution à certaines difficultés ou problématiques actuelles du réseau. Nous avons effectué un parallèle avec l’agrégation de la production photovoltaïque, pour évaluer dans quelle mesure les erreurs de prévision de production pouvaient se compenser. Alors que la production photovoltaïque s’avère dans une certaine mesure prévisible dans les heures suivantes, avec une marge d’erreur de l’ordre de 7 à 9 % pour une centrale isolée, celle-ci tend vers une asymptote à 2 %, pour dix-huit centrales agrégées. Il s’agit là d’une donnée tout à fait exploitable pour participer à des services au système, en particulier engager des blocs sur les services de régulation de fréquence, ce d’autant plus que le photovoltaïque est très simplement, par de l’électronique de puissance et du logiciel (soft), mobilisable dynamiquement à la baisse, mais exclusivement à la baisse, ce qui constitue, je le concède, un point faible.
Je ne vais pas m’appesantir sur la question de l’utilisation du stockage, que d’autres intervenants ont largement traitée auparavant. Dans un réseau de distribution ou dans une zone non interconnectée, comme celle de cette grande centrale couplée à du stockage, installée à La Réunion, les pistes de recherche portent sur le dimensionnement, l’architecture électrique avec le couplage éventuellement en courant continu des différents organes qui produisent et stockent, la conversion – car l’électronique de puissance est primordiale – les choix technologiques et la gestion optimale de tels systèmes.
Par ailleurs, je souhaiterais illustrer le concept de mobilité solaire. Un véhicule consomme, pour rouler quinze mille kilomètres par an, l’équivalent de ce que produit une place de parking couverte par une ombrière solaire. Le bilan énergétique est donc tout à fait satisfaisant. Il s’agit maintenant d’établir un bilan en puissance. Si l’on ne met pas en œuvre de gestion d’énergie entre le moment, par exemple, où les gens arrivent au travail, rechargent leur véhicule, et le moment où le soleil va sortir, qui sont probablement décalés, la synchronicité des besoins et de la production va conduire à un taux de couverture solaire des kilomètres de l’ordre de 40 %.
Pour augmenter ce taux, il va falloir mettre en œuvre une gestion d’énergie, prévoir la production, la consommation des véhicules, et gérer les bornes de recharge en fonction de la production. On peut alors atteindre un taux de couverture solaire des kilomètres de 60 %. Pour parvenir à 67 %, il est envisageable de recourir à un petit stockage localisé. Une ombrière solaire qui compte huit bornes de recharge – lentes, semi-rapides et rapides – dispose par exemple d’un très petit stockage de 4 KWh, qui sert juste à effectuer de la stabilisation dynamique et de la couverture de temps très court.
Le dernier levier pour maximiser le taux de couverture solaire relève d’une approche territoriale. Imaginons une ombrière implantée à Ajaccio et une autre à Bastia : pendant que l’une est déficitaire en énergie, l’autre est bénéficiaire, ce qui, pour la gestion actuelle, présuppose une plaque de cuivre, donc un réseau électrique non contraint entre les deux, mais peut aussi être géré en fonction des contraintes du réseau.
Mon dernier point porte sur la convergence entre véhicule électrique et photovoltaïque. Une approche du véhicule bidirectionnelle, qui ne soit pas seulement une charge supplémentaire pour le réseau, mais aussi un véhicule capable d’injecter dans ce réseau, me semble primordiale. Dans la mesure où il n’y a pas de barrière technologique à réaliser un tel véhicule, le seul verrou est sociétal. Il s’agit pourtant d’un scénario gagnant – gagnant, dans lequel le propriétaire du véhicule prolonge la durée de vie de sa batterie, qui est moins souvent à plein état de charge – la batterie lithium-ion vieillit de vieillissement calendaire – tout en aidant le soir le réseau national de distribution s’il est en déficit.
M. Frédéric Wurtz, directeur de recherche au CNRS – G2ELAB – université de Grenoble Alpes. Je vais aborder un sujet non encore évoqué aujourd’hui, qui concerne l’interaction du réseau avec le bâtiment. Historiquement, le G2ELAB, laboratoire de génie électrique de Grenoble, est identifié comme un acteur de recherche académique dans le domaine des réseaux intelligents ou smart grids. Comment développer des smart grids pour intégrer les énergies renouvelables, avec toutes les difficultés de gestion de l’énergie intermittente que cela suppose ?
Cette équipe, dont je me suis rapproché voici une dizaine d’années, a constaté que 66 % de la consommation dans le réseau électrique était réalisée dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et commerciaux. Il apparaissait donc pertinent de considérer le bâtiment comme un élément majeur, présentant éventuellement des capacités de stockage et de délestage. Les bâtiments semblent d’autant plus intéressants qu’ils peuvent être aussi des producteurs importants d’énergies renouvelables. Ce sont en effet des collecteurs naturels d’énergies renouvelables, de par leurs surfaces de toit.
À partir de là, nous avons décidé de travailler sur plusieurs axes en lien avec ces problématiques. Nous menons tout d’abord une recherche des réseaux vers les bâtiments. J’ai notamment pu contribuer dans ce cadre au projet GreenLys, qui s’est déroulé entre Lyon et Grenoble et dans lequel nous avons pu expérimenter l’effacement diffus, c’est-à-dire des charges pilotables à distance entre chauffage, chauffe-eaux, chauffage susceptible d’être délesté une heure par jour. Nous avons ainsi pu étudier notamment l’impact de ce délestage, selon différents scénarios, afin de travailler sur le degré de liberté au niveau du bâtiment, en jouant sur le chauffage et sur l’inertie du lieu.
Ce travail comporte aussi une dimension de recherche des bâtiments vers les réseaux. La problématique, que je connais mieux, est celle du smart building connecté au réseau. Il s’agit d’étudier le bâtiment, avec une capacité d’autoconsommation. Le réseau est, d’un point de vue scientifique, un système récursif avec, à différents niveaux, des nœuds qui doivent être en capacité de produire, de stocker et de gérer l’électricité, le premier nœud pouvant parfaitement être le bâtiment. On cherche donc, dans ce contexte, à développer des systèmes de gestion et de supervision optimale à l’échelle du bâtiment, qui vont aider l’usager à adapter sa courbe de production à sa courbe de consommation. On peut ainsi jouer sur le degré de liberté qu’offre le bâtiment, en termes de stockage et report de charge. Il s’agit, par exemple, d’inciter à déplacer la consommation lorsqu’il y aura de la production photovoltaïque sur leur toit. Nous travaillons ici sur des modèles, des stratégies de supervision optimale, des outils d’aide à la conception.
Les types de développement réalisés sont des environnements de supervision optimale, utilisant de la modélisation, de la prévision et s’appuyant sur les objets connectés. Le cœur du système est ainsi constitué par une centrale domotique (home box) ou un système de gestion domestique (home management system), connecté d’une part aux équipements de production, de stockage et de consommation de la maison, d’autre part au compteur intelligent. On entre ce faisant, pour gérer ces dispositifs, dans une problématique de traitements massifs de données (Big Data).
L’une des dimensions majeures de ces travaux concerne l’interaction avec l’usager. En termes de résultats de recherche, nous avons développé des méthodes et des outils de supervision de bâtiments intelligents, qui ont donné lieu notamment à de la valorisation par des start-up et permis de participer à de grands projets comme COMEPOS (conception et construction optimisées de maisons à énergie positive), conduit par l’ADEME, visant, à l’horizon 2018, à réaliser un certain nombre de bâtiments à énergie positive en France, avec des constructeurs de maisons individuelles.
Dans ce cadre, nous avons mis notre savoir-faire à disposition pour fournir des systèmes à base de tablettes connectées au compteur et aux équipements destinés à aider l’usager de la maison à faire, pour reprendre l’expression de mon ami Daniel Quénard du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), du « jardinage énergétique », c’est-à-dire à gérer ses productions et à essayer d’adapter sa consommation à sa production.
Nous essayons ainsi d’apporter une vision système, à l’échelle du bâtiment, mais aussi dans un contexte de bâtiment intégré dans le réseau, en tenant grand compte de l’usager.
Nos recherches étaient, au départ, très techno-centrées. Nous développions des techniques de supervision et cherchions à automatiser un maximum de choses. Aujourd’hui, nous infléchissons quelque peu cette démarche. Au lieu de tendre exclusivement vers un pilotage, une automatisation, nous prêtons une grande attention aux notions de conseil et d’aide aux usagers.
Ceci nous conduit à travailler régulièrement dans des Living Labs. Nous disposons par exemple d’une plateforme de 600 m2 à Grenoble, avec des véhicules électriques, des moyens de production et de stockage, utilisés par une cinquantaine d’usagers. Nous essayons de reproduire cela à l’échelle de GreEn-ER, bâtiment qui accueille l’école de l’énergie à Grenoble, soit deux mille personnes, sur vingt-deux mille mètres carrés. L’idée est de parvenir à mettre au point des systèmes de surveillance (monitoring), des dispositifs sur téléphones intelligents qui seraient mis à disposition des usagers. La question est alors de savoir quels signaux envoyer à ces usagers pour qu’ils adaptent leur consommation à la courbe de production des énergies renouvelables situées dans leur environnement. Nous essayons en outre d’étendre cette réflexion à l’éco-cité alentours, afin de développer la démarche.
Il s’agit là de travailler à l’interaction entre les réseaux et les systèmes et de voir, d’une part, quels signaux les réseaux pourraient envoyer à tous ces systèmes, d’autre part, comment ces derniers pourraient y répondre.
Nous essayons de mener ces recherches en lien étroit avec les sciences humaines et sociales, pour notamment comprendre les actions à mettre en œuvre, par exemple en termes d’ergonomie, pour impliquer au mieux les usagers. Nous collaborons également avec des économistes sur la question des mesures. Nous réalisons avec eux des expérimentations incluant le plus grand nombre possible d’utilisateurs et de systèmes, afin de mesurer in situ l’impact d’un système d’aide à la décision ou d’un tel signal adressé par le réseau aux usagers : signal tarifaire, suggestions ou nudge en lien avec l’impact des comportements sur la pollution ou la santé, etc.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit d’une autre forme d’automatisation, plus intelligente.
M. Frédéric Wurtz. On a, d’un côté, des systèmes automatisés et pilotables, de l’autre des systèmes dont on débraye totalement les automatismes, pour prodiguer du conseil et voir comment les usagers réagissent. Le défi est bien de trouver le juste compromis entre ces deux alternatives. En effet, les systèmes trop automatisés sont en général rejetés par les usagers, qui ne peuvent se les approprier, tandis qu’un excès de conseils risque de lasser les personnes et de finalement les dissuader de les suivre. Le sujet est donc bien de trouver un juste milieu.
M. Vincent Leclère, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, chercheur au Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique (CERMICS), Ecole des Ponts ParisTech. Le défi de l’optimisation pour les réseaux intelligents. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de rappeler que les énergies renouvelables vont prendre une part de plus en plus importante dans le mix énergétique français et européen. Cependant, du point de vue d’un gestionnaire de réseau, ces énergies renouvelables sont sources de problèmes, du fait de leur intermittence. Leur production varie en effet d’un quart d’heure à l’autre, de façon incontrôlée. À l’heure actuelle, on ne choisit pas le niveau de production, tout au plus peut-on éventuellement envisager, dans le futur, de le contrôler à la baisse.
Ces énergies se caractérisent également par leur imprévisibilité. Quel que soit le niveau de prédiction possible, il subsiste en effet toujours un résidu aléatoire, que l’on ne maîtrise pas.
Ces énergies sont donc très mal adaptées au marché de l’électricité tel qu’il se présente aujourd’hui. De nombreux travaux de conception de marché (market design) restent à mener dans ce domaine.
Face à cette production, la demande est, elle aussi, aléatoire, variable et maîtrisée seulement partiellement. Or, l’équilibre entre offre et demande sur le marché de l’électricité est physiquement indispensable. Contrairement au marché du riz où, si l’on ne se met pas d’accord sur le prix, les kilogrammes de riz ne seront pas échangés et on s’arrêtera là. Sur le marché de l’électricité, celle-ci continue à être échangée même si aucun accord n’est trouvé sur le prix. Si l’on ne fait pas en sorte que l’offre soit égale à la demande, c’est la qualité, la fréquence de l’électricité qui va varier.
La réalisation de cet équilibre requiert de la flexibilité, qui peut être envisagée de trois manières : une production plus flexible, avec par exemple une centrale thermique qui n’est ni à son maximum ni à son minimum, des solutions d’effacement permettant de diminuer ou de reporter la demande ou la production et, enfin, le stockage.
Afin de répondre à ce défi de l’utilisation de la flexibilité pour assurer l’équilibre entre offre et demande, des moyens humains et financiers conséquents sont aujourd’hui investis dans l’installation de moyens de mesure, comme le compteur intelligent Linky ou les objets connectés. Des investissements sont également réalisés dans les leviers d’action, comme le report de la demande, le déplacement du chauffage de l’eau ou encore le développement de simulateurs grandeur nature, à l’échelle d’une ville ou d’un bâtiment.
Ces investissements sont réalisés sur des moyens technologiques, pour répondre au défi des énergies renouvelables et de leur intégration dans le système. Ces technologies ont vocation à répondre à des promesses : la capacité à intégrer les énergies renouvelables dans un système qui, sinon, risquerait de tomber, d’une diminution des émissions de CO2 ou du coût financier. Or, il est souvent fait abstraction de la manière dont ces technologies vont permettre de tenir ces promesses.
À un instant donné, lorsqu’on voit que la demande est légèrement supérieure à la production, on peut recourir à de nombreux leviers d’action disponibles mais lequel activer ? Pour répondre à cette question, il faudra construire une interface logicielle incluant des algorithmes de décision, qui désigneront le type de stockage à mettre en œuvre ou d’effacement à activer.
La flexibilité consiste aussi à disposer d’unités de production flexibles, comme de centrales thermiques peut-être pas parmi les plus efficientes d’un point de vue économique – leur coût de production au mégawatheure étant supérieur à celui d’autres types de centrales – mais présentant précisément l’avantage de la flexibilité. La question est alors de savoir combien de centrales flexibles démarrer la veille, l’anticipation étant un élément majeur. Aujourd’hui, certains collègues aux États-Unis travaillent sur cette question de la réserve disponible, en concevant des algorithmes plus efficaces que la règle heuristique en vigueur auparavant. Ils parviennent environ à 1 % d’économie, ce qui correspond à un milliard de dollars par an pour un-septième du réseau électrique américain.
La question du système à utiliser entre mathématiquement dans la catégorie des problèmes d’optimisation stochastiques, dans la mesure où ils comportent une part d’aléatoire, et multi-étapes, puisqu’il faut considérer plusieurs pas de temps. Aujourd’hui, les problèmes les plus semblables dans le monde de l’énergie se rencontrent dans la gestion des stocks hydrauliques, généralement appréhendés à moyen terme, c’est-à-dire à l’horizon de l’année en France et de la dizaine d’années au Brésil, en négligeant un certain nombre de contraintes physiques réelles. Au final, il s’agit d’un problème de taille relativement réduite. De nombreux chercheurs et ingénieurs travaillent depuis des années sur ces problèmes, pour aboutir aujourd’hui à des solutions très satisfaisantes.
Pour autant, on ne peut espérer transposer ces solutions à la gestion d’un réseau intelligent (smart grid), pour intégrer les énergies renouvelables, ou de l’intégration et de l’utilisation de tous les nouveaux leviers d’action et données que l’on est en train de développer. Pour comprendre pourquoi, permettez-moi de traiter quelques instants de mathématiques. Il existe un problème intitulé « le voyageur de commerce », qui consiste à faire le tour des villes en un temps minimal. Ce problème a été résolu en 1954 avec quarante-neuf villes et en 1971 avec soixante-quatre villes. On a mis une dizaine d’années pour gagner quelques villes, ce qui aurait été, en force brute, cent-vingt fois plus compliqué. En 1994, on en était à 7 400 villes ; dix ans plus tard à 25 000. Ce passage de 7 400 à 25 000 n’a certainement pas été permis par la puissance des ordinateurs.
Il ne suffira donc pas, pour passer du problème de gestion d’une vallée hydraulique à celui de la gestion d’un réseau intelligent ainsi que de tous les outils et informations futurs, d’augmenter le nombre d’ordinateurs. Il va falloir faire une alliance entre l’intelligence humaine et les capacités informatiques pour réussir à trouver les algorithmes efficaces face aux problèmes posés, afin que les promesses attachées à ces moyens technologiques puissent être réalisées.
Or, ceci est aujourd’hui, à notre sens, le parent pauvre en termes d’efforts fournis. Nous avons l’impression que beaucoup d’énergie et d’argent sont dépensés par l’ADEME et les industriels sur des moyens technologiques que l’on pense être capable d’utiliser, en oubliant que cela requiert de réfléchir à la manière de les exploiter. Il ne suffira pas de mobiliser davantage d’ordinateurs pour y parvenir. Il faudra des personnes compétentes pour faire tourner ces ordinateurs, ce qui suppose de la recherche et développement ainsi que de la formation en amont.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie d’être parvenu à expliciter un élément très difficile à comprendre pour le commun des mortels, à savoir le fait que les grosses centrales sont finalement plus flexibles que les petites installations.
Mme Vera Silva, responsable de programme recherche et développement, EDF. Je souhaite tout d’abord rappeler que le groupe EDF est fortement investi dans les énergies renouvelables, avec sa filiale EDF Energies Nouvelles et un important parc hydraulique en France. L’enjeu pour nous est de faciliter l’intégration de ces énergies dans le système électrique et notamment de rechercher des moyens pour lever les difficultés liées à l’intermittence.
C’est la raison pour laquelle la direction de recherche et développement d’EDF a réalisé une importante étude, avec l’objectif d’examiner très précisément les différents aspects techniques et économiques d’une situation dans laquelle le système électrique européen serait approvisionné à 60 % par des énergies renouvelables, dont 40 % de production intermittente, éolienne et photovoltaïque. Cette étude a montré qu’avec 40 % d’énergies produites par du solaire et de l’éolien, le système électrique européen pouvait techniquement fonctionner, avec des niveaux de fiabilité et de sécurité proches de ceux du système actuel, pourvu que plusieurs solutions soient mises en place.
Ce système aura notamment besoin d’infrastructures de réseau et d’interconnexions supplémentaires entre les pays, afin de bénéficier du foisonnement géographique des énergies renouvelables. Cependant, une importante variabilité devra encore être gérée à l’échelle européenne et l’équilibre entre offre et demande deviendra fortement exposée aux aléas météorologiques et climatiques.
Dans ce système, différentes technologies coexistent. Les centrales thermiques demeurent nécessaires pour la sécurité de fourniture. Le stockage et la demande active contribuent à l’équilibrage du système, en complément des moyens de production.
Des analyses fines du fonctionnement dynamique du système électrique montrent que les énergies renouvelables devront aussi participer à l’équilibrage du système et aux réglages de tension et de fréquence. Dans le cas contraire, nos simulations indiquent qu’il existerait dans le système européen de gros risques d’instabilité et d’incidents étendus.
Le développement de modèles d’optimisation et de simulation du système électrique européen a été essentiel dans le cadre de ces études, à la fois pour la compréhension des enjeux techniques et économiques et pour l’identification des technologies nécessaires. Ce travail a comporté un effort important d’adaptation de modèles existants et le développement de nouveaux modèles.
Nous avons ainsi pu consolider une approche innovante, basée sur une chaîne d’outils complémentaires, et construire une vision des investissements dans des technologies existantes et nouvelles permettant de répondre aux besoins du système. Cette caractérisation des besoins s’appuie sur une modélisation fine de l’équilibre offre – demande au pas horaire, ainsi que sur une simulation du fonctionnement dynamique du système sur l’ensemble du système électrique européen, dont la France fait partie.
Cette simulation à l’échelle européenne est essentielle, dans la mesure où les marchés de l’électricité sont déjà intégrés au niveau européen. Ces efforts d’intégration se poursuivent avec plusieurs nouveaux codes réseaux, qui vont jusqu’à l’équilibrage de la production et de la consommation proche du temps réel. Ils sont soutenus par le renforcement des interconnexions entre les pays. La France fait en effet partie d’une zone dite « synchrone », qui couvre le continent européen et possède une seule fréquence. Ceci signifie que les impacts du développement des énergies renouvelables intermittentes, notamment de la fréquence, sont ressentis dans l’ensemble de la zone européenne.
Ces travaux de modélisation portent plus précisément sur cinq points. Nous avons tout d’abord travaillé sur la caractérisation fine des aléas, à partir d’une simulation locale de la production des énergies renouvelables, éolienne et photovoltaïque, et de la consommation électrique à l’échelle de l’Europe, au pas horaire, pour trente-et-une années climatiques. Ceci est combiné avec la simulation probabiliste des aléas sur la production. Nous avons traité l’optimisation des investissements dans divers moyens de production, capacités d’interconnexion et de stockage, ainsi que l’optimisation fine de l’équilibre offre – demande au pas horaire, pour cent années, soit cent scénarios d’une année chacun.
Nous nous sommes aussi intéressés à l’analyse de la flexibilité, nécessaire pour couvrir les erreurs de prévision infra-journalière avec des modèles probabilistes, qui, malgré les progrès significatifs de la prévision d’énergies renouvelables intermittentes, restent conséquentes vue la taille du parc installé.
Nous avons par ailleurs créé une plateforme pour la simulation de la stabilité de la fréquence du système électrique, à l’échelle européenne. Nous avons ainsi simulé pas moins de neuf cent mille pas de temps sur le fonctionnement dynamique.
Ces modèles nous ont enfin permis de simuler la mise en œuvre de différentes solutions, comme la contribution des énergies renouvelables intermittentes à la flexibilité et aux services système. Ceci a notamment porté sur la participation de la production éolienne à des services système existants, mais aussi à de nouveaux services, pour traiter les problèmes de baisse d’inertie dus au fait que les énergies variables sont interfacées par l’électronique de puissance.
L’intégration des différentes problématiques dans une seule approche d’optimisation et de simulation a représenté une avancée importante pour la valorisation de nouvelles technologies, ainsi que pour l’étude de systèmes avec une forte proportion d’énergies renouvelables.
Mais pour aller plus loin, il reste encore des progrès à accomplir, notamment concernant les modèles de simulation multi-énergies. Pour cela, un effort de modélisation visant à élargir les modèles du système électrique à d’autres énergies permettra notamment d’analyser l’apport complémentaire des réseaux de gaz et de chaleur à la flexibilité du système électrique.
Il convient également de citer l’optimisation locale globale, qui traite de la représentation des besoins et des contraintes locales et de leurs interactions avec l’équilibre du système interconnecté. Cette notion de « local » peut couvrir différents périmètres, allant du niveau national à des réseaux de distribution, voire à des périmètres plus fins. Ce type de modèle est essentiel pour aller plus loin en termes de valorisation des réseaux électriques intelligents et d’apport de flexibilité distribuée.
J’insiste enfin sur le nécessaire approfondissement de l’étude du fonctionnement dynamique du réseau, avec des scénarios présentant un très fort taux d’énergies renouvelables intermittentes. Il faut aller encore plus loin dans ce domaine et couvrir également les aspects de réglage de tension, le fonctionnement des systèmes de protection ainsi que les interactions entre les nouvelles technologies qu’il faudra ajouter au réseau et au système existant.
La simulation et l’optimisation d’un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables intermittentes constituent un sujet multidisciplinaire, nécessitant un travail conjoint de spécialistes de la métrologie, des mathématiques appliquées, des statistiques, de la science des données, de la gestion de la production, de l’automatique et du fonctionnement des réseaux électriques. Pour relever tous ces défis, nous avons besoin d’une forte coopération entre chercheurs et d’équipes spécialisées dans tous ces domaines.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le concept de « flexibilité distribuée » me perturbe quelque peu, notamment quant à la complexité que cela représente par rapport à la quantité d’énergie injectée dans le système à un moment donné. Cela pose de vraies questions.
Nous accueillons à présent M. Benjamin Topper, qui n’est pas étranger à l’Office puisqu’il a accompagné l’étude du président Jean-Yves Le Déaut sur l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques. Il est président fondateur de WattStrat, jeune entreprise innovante primée à plusieurs reprises, dans le cadre par exemple du programme européen d’accélération Climate-KIC et du concours national de création d’entreprises innovantes de BPI France, en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. WattStrat a développé la première plate-forme de simulation énergétique territoriale, accessible directement via une interface web.
M. Benjamin Topper, président fondateur de WattStrat – plate-forme de simulation énergétique territoriale. L’intégration des énergies renouvelables au système électrique est un enjeu important pour la décennie à venir. Le panel d’intervenants réunis aujourd’hui illustre bien la diversité des approches, qui sont d’ailleurs le plus souvent complémentaires, tant au niveau de la recherche que de l’innovation.
Je vais essayer pour ma part d’aborder cette question via une meilleure anticipation des évolutions du système énergétique, en se basant pour ce faire sur une couche de software, c’est-à-dire de logiciels, plusieurs fois évoqués dans les présentations précédentes.
On parle déjà beaucoup dans le grand public, souvent d’ailleurs par abus de langage, des données massives, du big data, comme d’une révolution en marche. Dans le secteur de la mobilité par exemple, la valeur ajoutée est clairement en train d’échapper aux constructeurs automobiles, au profit d’acteurs du numérique. En réalité, on devrait probablement évoquer une révolution du logiciel plutôt que de la donnée, concernant non seulement la donnée brute, mais aussi son exploitation, via une couche algorithmique qu’on lui superpose, afin de l’interpréter et de la questionner. La donnée seule n’est pas suffisante.
Dans le secteur de l’énergie, l’exploitation des centaines de données publiques déjà disponibles et leur mise en interaction permettent la construction d’outils puissants pour identifier les contraintes du système, anticiper ses évolutions et faciliter l’intégration des solutions de recherche et développement matériel ou hardware (stockage, power-to-gas, nouvelles technologies de production, etc).
Mais trêve de discussions théoriques : comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Je vous propose d’aborder la question par l’intermédiaire de l’analyse d’un cas simplifié : l’intégration des éoliennes au système électrique.
Il convient tout d’abord de récupérer des données et de construire son modèle. Ces données sont de différentes natures : des données météorologiques, en l’occurrence sur le vent, issues de plusieurs centaines de stations et qu’il faut ensuite étendre à l’ensemble de la France avec une couche algorithmique, des données topographiques, relativement disponibles, et enfin des données sur le parc éolien installé, en termes de géolocalisation des parcs, de hauteur des mâts, de types d’éoliennes, etc.
À partir de ces premiers éléments, on peut déjà, en imaginant prendre une éolienne typique et l’installer partout en France, s’interroger sur son taux de charge. En clair, on peut déjà produire une cartographie nationale de la ressource éolienne pour ce type précis de matériel. Mais est-elle correcte ? On peut le vérifier en testant le modèle. On se rend assez rapidement compte qu’un modèle statistique est largement suffisant pour nombre de besoins et qu’il n’a pas grand-chose à envier à un modèle hydrodynamique, qui nécessiterait des supercalculateurs. Sur la courbe présentée, vous voyez par exemple se superposer en bleu la production éolienne observée au niveau national, en rouge la reconstruction effectuée par nos modèles et en vert la prévision de production effectuée vingt-quatre heures auparavant, tout ceci réalisé simplement à partir de données publiques.
L’avantage d’une telle approche réside essentiellement dans sa très grande flexibilité, avec un degré de précision satisfaisant, suffisant pour interroger le modèle. On peut par exemple demander au modèle si l’intégration actuelle des éoliennes est optimale : a-t-on fait les bons choix d’implantation pour maximiser la production et en minimiser la volatilité par le foisonnement, qui constitue une externalité négative pour le réseau et pour les autres acteurs ?
Poser cette question revient en fait à demander à la simulation de tester toutes les configurations possibles des parcs éoliens en France et de fournir le meilleur arbitrage possible entre ces deux critères. La réponse est illustrée sur le graphique par la courbe bleue : si l’on se situe sur cette courbe, cela signifie que le parc est optimal, si l’on est à droite qu’il est sub-optimal. Il est impossible d’être à gauche de cette courbe ; cette configuration n’existe pas.
On peut parcourir cette courbe et regarder simultanément les différentes cartes de France possibles, avec les différentes implantations de parcs éoliens envisageables. Par exemple, le premier point situé en bas à gauche illustre la volonté de minimiser la volatilité, avec une production maximale pour ce niveau de volatilité. Si l’on regarde la carte correspondante, on n’est pas étonné de constater que cela se traduirait par la construction de petits parcs, répartis sur l’ensemble du territoire, afin de maximiser le foisonnement. Le quatrième point, tout en haut de la courbe, montre au contraire la volonté de maximiser la production. Il faut dans ce cas construire quelques gros parcs éoliens, notamment dans l’ouest et le sud. On peut ainsi générer tous les parcs possibles.
La véritable question consiste à savoir où se situe aujourd’hui la France par rapport à cette courbe bleue. Elle se trouve sans surprise dans la zone sub-optimale : ceci signifie que pour une même puissance installée, localisée différemment, on pourrait obtenir un meilleur arbitrage entre production et volatilité. Cette sub-optimalité est à la fois un enjeu financier pour les producteurs et les acteurs du réseau, et un élément qui impacte les technologies actuellement en recherche et développement.
En effet, les exigences techniques que l’on fait peser sur ces nouvelles technologies proviennent directement des contraintes empiriques mesurées sur les réseaux. Ceci est d’ailleurs fort bien apparu lors des discussions précédentes, dans lesquelles on s’appuyait sur des courbes reprenant des hypothèses nationales, sans prendre en compte ces effets de foisonnement ou de meilleur arbitrage dans le positionnement du parc éolien en l’occurrence, mais aussi d’autres moyens de production ou de la consommation, dans une approche géolocalisée.
On pourrait bien évidemment aller plus loin, en ajoutant d’autres types de contraintes, comme les capacités de raccordement. Ainsi que le soulignaient les intervenants d’ERDF et de RTE, il existe de plus en plus de données disponibles sur les capacités de raccordement locales. On peut aussi imaginer ajouter des contraintes réglementaires, concernant par exemple les aérodromes, les zones de protection des oiseaux, etc. Il est également possible de prendre en compte les autres secteurs de consommation et de production, pour disposer d’une vision vraiment complète.
Je vous remercie de m’avoir écouté et espère être parvenu à vous montrer l’intérêt de cette approche des énergies renouvelables pour orienter et accompagner les politiques publiques de recherche en énergie et d’énergie en général.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le parc actuel français est, si j’ai bien compris, sub-optimal ?
M. Benjamin Topper. Absolument, avec une même puissance installée, répartie différemment sur le territoire, on pourrait obtenir une production totale plus importante, avec une volatilité plus faible.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les interventions suivantes vont concerner plus précisément la question du stockage.
M. Pierre Lombard, McPhy Energy. McPhy Energy est une jeune PME industrielle française qui conçoit et fabrique des équipements de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que des dispositifs de stockage d’hydrogène et de chargement hydrogène pour la mobilité des stations. Elle est déjà présente à l’international et membre de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC).
McPhy est le fruit de plus de dix ans de recherches menées au CNRS, avec une consolidation en partenariat avec le CEA pour ce qui concerne le stockage dans les hydrures métalliques. Nous avons une vision pour les marchés et les potentiels de ces technologies, basée sur le constat d’une croissance de la production d’énergies d’origine renouvelable, décentralisées, avec la possibilité de stocker cette électricité sous des formes diverses. Notre objectif est également de décarboner les usages et de supprimer les pollutions de l’air.
L’hydrogène est présent partout. Composant 75 % de tous les éléments, il est le premier élément dans l’univers. Sur Terre, on le retrouve essentiellement sous forme d’eau. L’un des avantages que l’hydrogène est susceptible d’apporter aux réseaux réside dans sa densité de puissance : un kilogramme d’hydrogène permet en effet de parcourir cent kilomètres avec un véhicule classique, ce qui en fait, en volume, un élément trois fois plus énergétique que des énergies fossiles. Pour la même quantité d’énergie, cela correspond à quarante kilogrammes de batterie ion-lithium.
L’hydrogène présente également la propriété physique avantageuse d’être stockable, sous plusieurs formes : gaz compressé, gaz liquide ou encore, dans les hydrures métalliques que nous développons, solide. Il s’agit d’un composant stable, non auto-inflammable.
Il faut en revanche le produire. Nous avons pour ce faire opté pour une solution d’électrolyse simple, basée sur des technologies robustes, en l’occurrence l’électrolyse alcaline, développée depuis plusieurs dizaines d’années. Ces électrolyseurs répondent assez bien aux variations des énergies renouvelables. Nous disposons de toute une gamme d’équipements qui peuvent s’implanter aussi bien en local, dans les territoires, que dans le cadre de très grosses installations susceptibles de produire plusieurs tonnes d’hydrogène chaque jour.
Ces installations peuvent s’insérer comme vecteur dans toute la chaîne énergétique d’usage de l’hydrogène : piles à combustible, énergies de combustion ou utilités directes aux industriels. Pour ce qui concerne les réseaux, elles peuvent agir comme régulateurs. Nous disposons en effet de systèmes capables de moduler en fonction des arrivées d’électricité, sans problème de mise en route ou d’arrêt.
Cela permet également, en local, pour les réseaux d’énergies renouvelables, de recréer de nouvelles valeurs par rapport à de nouveaux usages. Nous en distinguons essentiellement trois. Le premier, qui risque d’être le plus important, est la mobilité à hydrogène, totalement décarbonée. Le second concerne les vecteurs en power-to-gas, en stockage d’énergie. Le troisième usage enfin vise à aider les industriels à décarboner leurs process qui produisent aujourd’hui huit cent millions de tonnes de CO2.
En termes de mobilité, il existe déjà aujourd’hui plusieurs véhicules en test sur le marché. Il s’agit par exemple de véhicules complétement (full) hydrogène, qui n’ont pas besoin d’être chargés autrement qu’avec de l’hydrogène. Nous testons aussi des prolongateurs d’autonomie, qui permettent de permuter entre des recharges électriques ou, sur de longues distances, de tripler l’autonomie d’un véhicule électrique classique.
Nous pensons que les véhicules à hydrogène sont plutôt orientés vers des usages très intensifs : véhicules utilitaires, par exemple pour La Poste, bus, camions pour les derniers kilomètres, engins de chantier ou engins agricoles. Nous nous sommes en effet aperçus, lors de tests récents, qu’un véhicule à hydrogène pouvait remplacer trois véhicules électriques dans des usages intensifs, puisqu’il dispense des problématiques de recharge, ce qui est très avantageux pour une flotte. Nous menons par ailleurs des recherches pour les futures mobilités transocéaniques.
Concernant le power-to-gas, nous envisageons deux solutions directes, à la fois en amont pour les réseaux, afin de permettre de décharger le surplus d’électricité sous forme d’hydrogène, et en aval avec une modulation pour les usages de mobilité électrique, puisque l’on peut imaginer que, si plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques se chargent en même temps le soir à dix-huit heures sur le réseau, cela nécessite une gestion spécifique. Une solution de rechargement basée sur l’hydrogène peut permettre de décaler cet appel au réseau. Nous travaillons actuellement à Fos-sur-Mer, avec GRTgaz et le CEA, sur un énorme projet intitulé « Jupiter 1000 » pour tester les injections directes d’hydrogène dans les réseaux de gaz. On estime pouvoir monter à 6 %, ce qui représente un volume possible de deux cents milliards de mètre cube. Dans le cadre de ce projet, nous allons également mener des travaux sur la méthanation, procédé consistant à récupérer du CO2 fatal pour fabriquer des gaz de synthèse d’origine renouvelable.
Nous sommes aussi en veille sur tout ce qui concerne le power-to-liquid, en lien avec les essences de synthèse et voyons émerger des recherches sur le kérosène (jet fuel), dans l’aéronautique.
Un avantage intrinsèque de l’hydrogène est de recréer de la valeur ajoutée dans les territoires, en termes de chaînes d’usage plus locales et de dépollution de nos villes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’avantage de l’hydrogène est d’être présent partout. Mais n’est-ce pas un élément un peu explosif ? Ma deuxième question concerne la transformation : toute transformation se caractérise par des pertes de charge, avec des coefficients d’abattement. Maîtrise-t-on tout cela ?
M. Pierre Lombard. Tout dépend des usages : le power-to-gas utilisé pour récupérer l’électricité sur le réseau peut conduire, ainsi que l’a montré le Pr Friedrich Wagner, à des rendements de 30 %. Il faut donc sélectionner les usages de l’hydrogène pour véritablement optimiser la valeur d’usage. Quant au côté inflammable et explosif, cela concerne uniquement l’hydrogène en mélange. À l’état complet, l’hydrogène est absolument stable. Pour information, les pompiers de Cherbourg sont déjà équipés de véhicules à hydrogène.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ce département est effectivement très actif sur le sujet. Je donne à présent la parole à M. Sylvain Lemelletier, directeur de projet Power to Gas et gazéification de GRTgaz, qui va nous présenter le projet de démonstrateur « Jupiter 1000 », implanté à Fos-sur-Mer, qui combine génération d’hydrogène et méthanation, à ne pas confondre avec la méthanisation.
M. Sylvain Lemelletier, directeur de projet Power to Gas et gazéification, GRTgaz. Je vais vous apporter quelques précisions concernant le projet « Jupiter 1000 », précédemment évoqué par mon collègue de McPhy.
L’électrolyse permet de générer de l’hydrogène. On peut ensuite éventuellement accoupler un deuxième étage consistant à associer, avec un méthaneur, du CO2 et de l’hydrogène, ce CO2 pouvant provenir de n’importe quelle source : cheminée d’un industriel, biométhane, etc. Il s’agit de stocker de l’énergie électrique intermittente sur le long terme, les batteries étant très bien adaptées au court terme. Nous allons, en l’occurrence, exploiter des périodes de production d’électricité intermittente excédentaire pour la stocker sur le long terme dans les réseaux de gaz, qui sont capables d’absorber de très grandes quantités d’énergie. GRTgaz, à lui seul, exploite trente-deux mille kilomètres de canalisations allant parfois jusqu’à 1,20 mètres de diamètre. Vous imaginez donc que l’ajout d’un peu de gaz supplémentaire dans ce stock ne pose aucun problème et peut permettre de passer des saisons.
L’un des avantages du power-to-gaz est de soutenir les réseaux électriques. Je ne reviendrai pas sur cet aspect déjà largement évoqué. Un autre avantage réside dans le fait de générer des gaz, hydrogène ou méthane, décarbonés et de les orienter ensuite vers les meilleurs usages : mobilité décarbonée, gaz naturel carburant, etc. Tous ces usages concernent un gaz produit à partir d’électricité. Il s’agit aussi d’absorber du CO2.
Recycler du dioxyde carbone et le réemployer pour produire de l’énergie relève d’une démarche similaire à celle consistant à capter et stocker le dioxyde de carbone (en anglais, CCS ou Carbon capture and storage), puisque tout mètre cube de gaz produit de cette façon va éviter d’extraire un mètre cube du sous-sol. Ceci revient donc à laisser du carbone dans le sous-sol, à valeur équivalente. Il s’agit d’une démarche très vertueuse. Cela permet aussi une production locale, dans les territoires. Il est toujours intéressant de produire de l’énergie localement, en l’occurrence à Fos-sur-Mer, plutôt que d’aller l’extraire dans un champ sibérien et de le faire transiter par nos tuyaux.
Ce procédé est aussi l’occasion d’initier des filières d’excellence et de nouveaux emplois en France. De nombreuses start-up émergent qui s’intéressent à ces sujets et peuvent, demain, se développer.
« Jupiter 1000 » est un projet industriel à partenaires multiples, piloté par GRTgaz. On y retrouve McPhy, qui va fabriquer l’électrolyseur, et Atmostat qui, avec l’aide du CEA, va travailler sur la méthanation. Grâce à Leroux & Lotz, nous allons aller capter le CO2 chez un industriel. GRTgaz et TIGF, autre opérateur de réseau de transport, vont collaborer sur la partie injection dans le réseau.
La CNR va nous fournir l’électricité décarbonée et s’intéresser aux usages et à la façon de piloter cela dans son parc de production d’énergie renouvelable (comment intégrer un stockage, optimiser les fonctionnements). Enfin, le port de Marseille-Fos nous accueille et construit la canalisation de CO2. Le projet est financé en partie par ces industriels, aidés par la Région PACA, le fonds européen FEDER et l’ADEME, avec le soutien de la Commission de régulation de l’énergie.
Le site qui résultera de ce partenariat est un démonstrateur industriel ou pré-industriel, d’un mégawatt d’électrolyse. On y trouvera notamment deux électrolyseurs de technologies différentes et un méthaneur. Nous en sommes actuellement à la phase de dépôt des dossiers d’autorisation, si bien que les opérations techniques, concrètes, vont bientôt pouvoir commencer, pour une mise en service prévue pour 2018.
Quels sont les enjeux de ce site ? Il s’agit, en premier lieu, de valider la technologie, en faisant fonctionner ces équipements ensemble, sachant qu’un électrolyseur est capable de réagir très vite aux besoins du réseau électrique, alors qu’un méthaneur est plus lent. Nous allons également tester la fiabilité de ces objets, notamment dans des situations de marche – arrêt à la demande du réseau électrique, pour voir s’ils continuent à bien fonctionner après quelques milliers d’heures.
Nous allons aussi devoir aborder des aspects règlementaires, dans la mesure où le gaz décarboné produit n’a pas de réalité règlementaire aujourd’hui. La réglementation en France ne connaît en effet que le biométhane produit par méthanisation. Il va donc falloir que nous travaillions pour le faire exister règlementairement. Par ailleurs, il nous incombera d’envisager la question des tarifs d’achat, en travaillant sur les modèles économiques. De tels modèles n’existent pas encore pour ce genre d’objet. Il va donc nous falloir examiner, pour construire un modèle économique, tous les gains latéraux : services système pour l’électricien, gaz vert pour le consommateur, valeur de l’oxygène produit, etc.
Il m’apparaît important de souligner qu’il ne s’agit pas, selon nous, d’un système unique, mais complémentaire des systèmes purement électriques. Notre vision se caractérise donc par une très forte interpénétration et interconnexion entre les réseaux. Aujourd’hui, lorsqu’il en a besoin, l’électricien utilise le gaz pour produire de l’électricité ; à un autre moment de l’année, il pourra, au contraire, produire du gaz, mobilisable pour de nombreux usages, à partir d’un surplus d’électricité. Pour nous, le réseau intelligent n’est pas un réseau électrique, mais un ensemble de réseaux : électrique, gazier et chaleur, avec beaucoup d’échange d’information.
J’aurai sans doute l’occasion de venir vous parler ultérieurement de projets visant à produire du gaz vert, qui ne sont pas l’objet de stockage mais nous interconnectent également, avec les réseaux de chaleur par exemple, pour la gazéification et d’autres sujets connexes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit assurément d’un projet très ambitieux.
M. Sylvain Lemelletier. Nous sommes encore au tout début de l’aventure. Il s’agit d’un démonstrateur et nous n’avons pas la perspective d’un développement massif dans les années qui viennent. Nous préparons l’avenir à l’horizon de quelques années.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je laisse la parole, pour conclure cette table ronde, au Pr Jeffrey Bielicki, de l’Ohio State University, que je remercie d’être là.
Pr. Jeffrey M. Bielicki, Assistant Professor, Joint Appointment, Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering ; John Glenn College of Public Affairs, The Ohio State University. Je propose de limiter les aspects techniques de cette présentation, afin que nous puissions avoir un temps de débat en fin de séance. Je travaille à l’Ohio State University et à l’École des affaires publiques John Glenn, où je m’occupe de recherches en ingénierie civile, environnementale et géodésique. Je représente également aujourd’hui le Dr. Thomas Buscheck, chercheur au laboratoire national Lawrence Livermore (en anglais Lawrence Livermore National Laboratory ou LLNL). Je vais vous présenter un projet émergent, que nous nommons « Batterie Terre » (Earth Battery), qui vise à intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique.
Les systèmes énergétiques modernes sont confrontés à un certain nombre de défis, notamment la réduction des émissions de CO2. Je voudrais à ce propos féliciter la ville de Paris qui a accueilli la COP 21, qui a abouti à l’accord de Paris, visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone et le réchauffement climatique à deux degrés.
L’un des défis majeurs consiste à augmenter le déploiement et l’utilisation des énergies renouvelables, et à les intégrer. Il ne s’agit pas uniquement de construire davantage d’installations solaires et éoliennes, mais d’utiliser au mieux chaque installation, d’accroître son utilisation, afin de pouvoir véritablement bénéficier de l’investissement financier effectué pour chacune d’elles. La production d’électricité à partir de ressources éoliennes et solaires n’est pas forcément en adéquation avec la demande. Ces technologies génèrent en effet de l’électricité lorsque le soleil brille dans un ciel sans nuage ou que le vent souffle.
Il faut, pour compenser cette variabilité, une solution permettant de stocker cette énergie et de gérer dans le temps une ressource énergétique extrêmement variable, que nous ne pouvons pas contrôler, afin qu’elle soit disponible lorsque nous en avons besoin. Il faut également pouvoir éviter les conflits avec les systèmes énergétiques existants, c’est-à-dire les centrales de base, qui ne seront peut-être pas en mesure d’intégrer cette énergie renouvelable.
Notre projet « Batterie Terre » vise à répondre à l’ensemble de ces défis, en utilisant des couches de roches sédimentaires souterraines, perméables et poreuses, dans lesquelles il est possible d’injecter et de stocker des volumes de fluides extrêmement importants. Ces couches sédimentaires sont présentes un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Elles couvrent environ 50 % de la surface de la planète, sous terre et sous les océans. Elles constituent des conteneurs bien isolés, à faible coût, et sont absolument idéales pour le stockage d’énergie, sous forme de fluide chauffé ou sous pression. Par exemple, si l’on produit de l’électricité avec du vent ou du soleil en excès par rapport à la demande, on peut parfaitement utiliser cette énergie pour injecter un fluide sous pression, puis le stocker.
Un autre grand défi concerne la capacité des centrales traditionnelles à réutiliser ces stockages. Nous pouvons par exemple mettre à profit la chaleur générée, la transformer en électricité, chauffer le fluide, avant de l’injecter en sous-sol et de stocker ainsi l’énergie sous forme de chaleur. Il faut savoir que l’eau chaude sous pression peut stocker cent fois plus d’énergie que l’eau stockée par pompage – turbinage.
Notre démarche est en outre tout à fait flexible, dans le sens où nous pouvons utiliser différents fluides : dioxyde de carbone, azote, eau ou air, comme « fluide de travail » pour stocker l’énergie. Nous stockons la chaleur en excès en sous-sol, en mettant sous pression et en injectant l’un de ces fluides lorsque la production d’énergies renouvelables est supérieure à la demande. Nous extrayons ensuite cette énergie lorsque nous en avons besoin. Pour modérer la pression en sous-sol, nous pouvons détourner une partie de la saumure présente pour produire de l’eau, que nous pouvons ensuite utiliser.
Parmi les questions techniques à traiter, figurent, d’une part, le contrôle de la pression, et, d’autre part, la migration du fluide de travail. Nous avons ainsi effectué quelques simulations, en utilisant des puits en anneaux concentriques dans lesquels nous avons injecté du dioxyde de carbone ou de l’azote, tout en produisant simultanément un fluide ailleurs. Ceci nous permet de bien maîtriser le niveau de pression et de faire en sorte que la migration des fluides soit contrôlée.
Je voudrais également ajouter que, d’après nos estimations, cette « Batterie Terre » est tout à fait compatible avec d’autres stockages d’énergie, en termes de capacité. Nous pouvons en effet utiliser ce conteneur bien isolé qu’est la Terre, dans le cadre notamment des variations saisonnières évoquées précédemment par d’autres intervenants.
Cette batterie vise donc à maximiser l’intégration des sources d’énergie sobres en carbone. Elle peut convertir les énergies renouvelables variables en énergie de base et de suivi de charge, capables de produire l’électricité lorsqu’elle est nécessaire. Les fluides supplémentaires préchauffés et injectés dans le sous-sol peuvent permettre aux centrales non flexibles de le devenir davantage et de produire non seulement en charge de base, mais aussi en électricité de pointe.
Nous utilisons également des données géologiques pour effectuer des simulations de sites réels, afin d’adopter une démarche de sites pilotes, avec deux ou trois puits. Nous travaillons notamment sur ce projet avec le Dr. Buscheck, du Laboratoire national Lawrence Livermore, des collègues de l’université du Minnesota et des collaborateurs de la société TerraCOH, basés à Zurich.
En résumé, cette « Batterie Terre » vise à relever les défis d’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants, pour utiliser au mieux la valeur de ces énergies et des centrales sobres en carbone.
M. Patrick Ledermann. Ma question porte sur la dernière présentation : quelle est la surface typique nécessaire pour produire un mégawatt ?
Pr. Jeffrey Bielicki. D’après nos simulations, la zone de surface est d’un rayon extérieur de quatre kilomètres ; mais cela dépend de la profondeur et de la pression en sous-sol. On peut arriver à une centaine de mégawatts.
M. Patrick Ledermann. Une centaine de mégawatts pour un rayon de 4 km ?
Pr. Jeffrey Bielicki. Oui, au moins une centaine.
Pr. Dr. Friedrich Wagner. Vous avez, Mme Vera Silva, parlé de 40 % d’énergies renouvelables intégrées dans votre réseau. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mme Vera Silva. En fait, nous n’avons pas fixé de limite. Nous avons pris 40 % à titre d’exemple et constaté que cela fonctionnait. Toutefois, au-delà de 40 % les solutions techniques à mettre en œuvre seraient beaucoup plus complexes. Pour autant, il ne s’agit pas d’une limite. Il faut simplement se donner le temps de développer les technologies et de les intégrer au système.
Le public. Ma question concerne le stockage de l’hydrogène, en particulier le coût du stockage d’un kilowattheure dans de l’hydrogène, par rapport au coût d’un stockage batterie classique.
M. Pierre Lombard. Le stockage est généralement réalisé aujourd’hui dans des bouteilles d’hydrogène classiques. Tout dépend ensuite de la pression. Nous considérons que nous sommes à environ un euro pour un kilogramme d’hydrogène produit. Pour information, nous vendons cet hydrogène aux alentours de dix euros le kilogramme. 10 % du prix est donc consacré au stockage. Sous les formes non hydrures, nous sommes sur d’autres technologies, qui dépassent aujourd’hui les usages classiques.
M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne. Je souhaiterais apporter un complément d’information sur la flexibilité. Peut-être n’avons pas suffisamment insisté sur le fait que nous disposons, en France, d’un mode de flexibilité important, aujourd’hui largement exploité. Il s’agit des réacteurs nucléaires, qui suivent la demande avec une assez forte agilité. Nous continuerons à bénéficier de cette caractéristique. Des travaux sont actuellement menés sur l’augmentation de l’agilité des réacteurs. On peut donc en déduire que notre pays est bien placé pour générer des synergies entre énergies nucléaire et renouvelables variables. Disposer de puissance nucléaire, sans utiliser cette dernière au maximum de ses capacités en termes d’énergie constitue aussi un avantage. Il s’agit d’un point à prendre en compte dans le suivi de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Nous disposons en effet d’une capacité importante, qui peut aussi servir à augmenter la proportion d’énergies renouvelables, en jouant un peu le rôle de back up.
M. Davy Marchand-Maillet. Bien qu’il ait été beaucoup question de stockage dans les différentes interventions, toutes les technologies n’ont pas été mentionnées, ou bien ont été assorties de limites qui ne m’apparaissent pas tout à fait exactes. Concernant le pompage – turbinage, on dit par exemple souvent qu’il n’y a plus beaucoup de sites disponibles pour installer de grandes unités. En revanche, il est possible de développer de petites unités sur des bassins artificiels, avec des coûts économiques à peine plus élevés que ceux des grandes unités. On peut ainsi développer plusieurs gigawatts avec ce type de projets, avec des rendements totalement équivalents à ceux des grandes STEP, et des technologies potentiellement aussi flexibles que des batteries.
De la même façon, les technologies dites d’air comprimé, avec des cycles thermodynamiques isothermes, permettent d’atteindre des rendements de l’ordre de 70 %, contre 40 % pour des centrales à air comprimé classiques.
Je mentionnerai enfin des technologies permettant de travailler sur l’intersaisonnier, dont le coût à la capacité est quasi nul : une fois la conversion construite, on peut stocker quasiment à l’infini, dans des réservoirs. Ces technologies, qualifiées de « séparation et mélange », notamment basées sur l’électrodialyse, mériteraient d’être davantage connues.
TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE ET COMMENT ACCÉLÉRER L’INNOVATION ?
Présidence de M. Bruno Sido, sénateur, premier vice-président de l’OPECST.
M. Bruno Sido, sénateur, premier vice-président de l’OPECST. Je tiens tout d’abord à remercier moi aussi toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu participer à cette audition publique.
Cette troisième table ronde constitue une opportunité pour préparer l’évaluation de la future Stratégie nationale de recherche en énergie, dont les ministères en charge respectivement de la recherche et de l’énergie ont déjà initié le processus d’élaboration. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a en effet prévu que cette stratégie soit évaluée par le Parlement, au travers de notre Office.
Ce sera aussi l’opportunité de prendre connaissance de la stratégie européenne en la matière, ainsi que d’entendre le point de vue de l’Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie (ANCRE), de l’ADEME et de l’association professionnelle Think Smart Grids.
Seront également abordées les questions des freins à l’innovation et de son accélération, au travers notamment des deux dernières interventions de cette table ronde.
Je vous remercie de veiller à respecter les temps de parole, afin que nous disposions d’un peu de temps pour débattre et conclure.
Je vais sans plus tarder donner la parole à M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) au sein du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, qui va nous présenter le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de recherche énergétique.
M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Je vais effectivement vous présenter le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de recherche énergétique, en me focalisant plus sur la méthode que sur le fond, dans la mesure où le travail, commencé au premier trimestre, est encore en cours et pourra d’ailleurs se nourrir des interventions présentées lors de cette audition publique.
Cette stratégie est, comme vous l’avez souligné, prévue par la loi. La loi de transition énergétique a modifié l’article du code de l’énergie relatif à cette stratégie de recherche énergétique, en précisant qu’elle devait être arrêtée par le ministre de l’énergie, conjointement avec le ministre de la recherche. C’est la raison pour laquelle le travail est co-piloté par la DGEC et nos collègues de la Direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère de la recherche.
La loi a également précisé que la SNRE devait décliner le volet énergie de la Stratégie nationale de recherche, elle-même publiée l’année dernière, qui comporte notamment un défi intitulé Une énergie propre, sûre et efficace, avec quelques orientations et priorités d’action qui vont devoir être précisées et déclinées dans la SNRE que nous élaborons.
Un premier opus de la SNRE, à réviser cette année, a été élaboré en 2007 et évalué en 2009 par l’OPECST, qui avait alors formulé quelques pistes que nous essayons de prendre en compte, concernant notamment la gouvernance, le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie dans le temps.
La SNRE va tenter de couvrir un champ assez large, allant de la recherche la plus amont jusqu’à l’innovation et les perspectives de valorisation des résultats de la recherche, tout en considérant des enjeux de cohérence multiples, notamment temporelle, par rapport aux exercices programmatiques et de scénarios menés dans le prolongement de la loi de transition énergétique, à commencer par la stratégie nationale « bas carbone » publiée à la fin de l’année 2015, qui nous donne des objectifs à l’horizon 2030 et est elle-même basée sur des scénarios allant quasiment jusqu’en 2050, en particulier pour ce qui concerne les trajectoires de réduction d’émission de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie.
Nous sommes également confrontés à des enjeux de cohérence géographique quant à la manière de bien mener cette recherche et cette innovation, avec une articulation à la fois à l’échelon européen – je pense que mon collègue de la Commission européenne abordera ultérieurement le Plan stratégique des technologies de l’énergie et le SET Plan, avec lesquels nous essayons de nous articuler au mieux – et au niveau local et régional, puisque les collectivités territoriales montent en puissance dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris en matière d’énergie. Il est donc essentiel pour nous de veiller à articuler l’ensemble des exercices et d’optimiser au mieux nos moyens pour cette recherche énergétique.
En termes de pilotage, nous avons mis en place, conformément aux préconisations de l’OPECST, un comité de suivi regroupant l’ensemble des parties prenantes. Comme la loi le prévoit, participent notamment à ce comité les membres du Conseil national de la transition écologique, qui sera amené à rendre un avis sur la future stratégie, ainsi que des représentants des entreprises actives dans la recherche en énergie, les organismes de recherche et les alliances de recherche (dont ANCRE).
Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, ce travail comporte des enjeux de pluridisciplinarité, avec de fortes adhérences entre la recherche en énergie, les questions de numérique et les sciences sociales. L’un des défis de cette stratégie est donc de mettre en mouvement une action collaborative entre ces différents domaines.
Bien évidemment, l’ensemble des institutions et administrations concernées suivent ce travail.
Le comité s’est réuni une première fois en mars, pour lancer les travaux. Nous sommes actuellement dans une phase de contribution des différentes parties prenantes. Nous espérons produire cet été une première version de cette stratégie, avec l’objectif de l’adopter d’ici la fin de l’année.
J’ai signalé, parmi les éléments de contexte, l’existence du SET Plan européen. Nous sommes bien sûr également très attentifs à ce qui se passe au niveau mondial. Des travaux ont ainsi été initiés l’an dernier, au moment de la COP 21. Je pense notamment à une initiative internationale nommée « Mission innovation », qui regroupe une vingtaine de pays parmi les plus actifs en matière de recherche énergétique au niveau mondial, lesquels se sont donnés des engagements assez forts en termes de financement de la recherche dans les énergies propres et de collaboration internationale. Il faudra donc essayer de faire levier sur ce que nous faisons déjà au niveau européen dans le cadre du programme « Horizon 2020 » et tenter de le transposer au niveau mondial.
Je citerai pour terminer les axes de réflexion proposés pour structurer le travail collectif sur cette SNRE.
Se pose tout d’abord, sur le fond, la question des dynamiques transformantes associées à la transition énergétique à l’horizon 2030 – 2050. L’un des éléments centraux fait précisément écho au débat qui nous réunit aujourd’hui, puisqu’il concerne la diversification du mix énergétique et les flexibilités nécessaires pour intégrer le plus possible d’énergies renouvelables. Cela inclut aussi les questions des services système susceptibles d’être apportées par les énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande et des consommateurs – acteurs, qui permettent une plus grande flexibilité dans les réseaux. Autant de thèmes qu’il conviendra de développer dans la stratégie.
Un autre axe de réflexion structurante concerne la question de l’articulation entre la recherche et l’industrie, sur les technologies matures comme sur les technologies émergentes, dont on peut espérer qu’elles favoriseront l’apparition et le développement de nouvelles filières industrielles.
Le troisième axe, très important, est celui des compétences. Il se décline d’une part dans le fait de disposer d’une communauté de recherche scientifique de haut niveau sur ces problématiques, autour de l’enjeu de pluridisciplinarité, d’autre part dans la manière dont le monde de la recherche et du développement peut contribuer à la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels du domaine.
Le dernier axe renvoie aux questions d’organisation collective et de gouvernance, avec la mise en place d’un suivi dans le temps de la mise en œuvre de cette stratégie et d’un mode de fonctionnement collaboratif entre les régions, l’Etat et une dimension internationale.
M. Rémy Dénos, chargé des politiques (policy officer), DG Energie, Commission européenne. Je travaille, au sein de la Direction générale de l’énergie, dans un département qui s’appelle Energy technologies et m’intéresse plus particulièrement dans ce cadre à la définition des programmes « Horizon 2020 ».
Avant de vous parler de recherche et d’innovation, je voudrais juste vous donner quelques chiffres datant de 2013 relatifs à la situation actuelle du mix énergétique européen. La proportion d’énergie renouvelable dans le mix électrique y est de 27 %, sachant que les objectifs climat – énergie de l’Union européenne, entrant également dans le cadre de la COP 21, sont, au niveau du mix énergétique global, de 27 % à l’horizon 2030. Cela montre bien que le réseau électrique est central pour la transition énergétique. Nous disposons en effet déjà de taux de renouvelable très élevés.
Concernant l’objectif de 27 % en 2030 au niveau du système énergétique global, les scénarios élaborés par l’intermédiaire des modèles, dont plusieurs exemples ont été présentés par les précédents intervenants, indiquent qu’il faudra être à environ 50 % de renouvelable pour la production d’électricité. En d’autres termes, il faudra que notre système électrique soit, en 2030, préparé pour fonctionner avec environ 50 % d’énergies renouvelables. Nous sommes actuellement à 12 % d’énergie hydraulique, avec des perspectives limitées de croissance. Cela vous donne une idée du pourcentage de renouvelable variable, et cela au niveau européen.
Aujourd’hui, on estime le taux de renouvelable variable en France à environ 3,6 %. Il est de 34 % au Danemark. Il existe ainsi, à travers l’Union, des situations très différentes. Les défis à relever seront donc divers selon les pays.
Cette Union pour l’énergie est très importante : l’existence d’interconnexions de grande capacité permet, par exemple, d’éliminer le besoin de stockage. Deux pays voisins ayant des besoins et des consommations différents peuvent ainsi mutualiser la production et la demande et, par une simple solidarité de fait, progresser vers davantage d’énergies renouvelables.
Dans « Horizon 2020 », l’innovation correspond pour nous à l’étape entre la recherche et la mise sur le marché. Nous mettons pour ce faire tous les ans à disposition cent millions d’euros environ pour les réseaux intelligents et le stockage, 70 % de cette somme concernant des projets de démonstration.
Comme le territoire européen est relativement vaste, nous sommes agnostiques en termes de technologie. Nous avons opté pour une approche basée sur des défis (challenge based), ce qui n’était pas le cas dans le programme précédent. Lorsque nous lançons des appels à projet dans ce cadre, nous demandons par exemple que nous soient montrés des systèmes susceptibles de fonctionner avec 50 % de renouvelable, intégrant d’une part des renouvelables intermittents introduisant de la variabilité dans la production, mais aussi toute la flexibilité nécessaire, tant en termes de mécanismes d’effacement (demand response) que de stockage, de production variable et de l’aspect de réseaux intelligents. Cette notion de réseau intelligent renvoie à la manière dont le réseau va être capable de gérer, d’interfacer cette production hautement variable, cette consommation et tous les facteurs de flexibilité, pour finalement parvenir à faire se rencontrer production et demande, en temps réel.
Environ soixante-dix millions d’euros sont consacrés annuellement à ces projets de démonstration. Les trente autres millions sont plutôt dédiés à des projets plus en amont. Les projets de démonstration consomment de l’ordre de dix à douze millions d’euros. Ils concernent en général plusieurs pays européens et représentent plusieurs types de solutions. En effet, les solutions, les technologies, les compositions testées ne sont pas les mêmes pour la Finlande et l’Espagne par exemple. Cela nous permet de disposer d’un panel relativement large de solutions à tester.
L’intérêt de ces projets est essentiellement de nous confronter à la réalité. Les opérateurs qui mettent en œuvre un stockage basé sur de grosses batteries doivent implanter celles-ci dans un quartier. Ils se trouvent, par exemple, face à des problèmes d’obtention de permis liés à la sécurité. L’innovation consiste ainsi parfois à considérer des défis non technologiques.
Du point de vue strictement technologique, les ingénieurs sont très inventifs et compétents. Mais au final, la différence se fait dans la capacité à transformer leurs travaux en un dispositif susceptible d’être mis sur le marché, avec un modèle d’affaire, sans barrière régulatrice et suscitant un intérêt et un engagement de la part des consommateurs.
Nous demandons à ces projets non seulement de réaliser une démonstration technologique, mais d’apporter des solutions aux problèmes non technologiques, ce qui requiert des profils différents, de sociologues, d’économistes. Ceci doit nous permettre de nous approcher au plus près de ce que sera la réalité de notre système énergétique en 2030.
Pr. Fabrice Lemoine, directeur du laboratoire d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée de Nancy, université de Lorraine, groupe Stratégie de l’Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie (ANCRE). Je vais m’exprimer ici au nom du groupe Stratégie de l’alliance ANCRE.
Les propositions dont vous faites état sont fortement corroborées par les scénarios produits par l’ANCRE, visant à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Ces scénarios sont forcément très contrastés, en termes de réduction de la demande énergétique, de pénétration de l’électricité – tout du moins des usages électriques – et au regard des énergies renouvelables. Le premier de ces scénarios, basé sur la « sobriété renforcée », implique davantage d’efficacité énergétique et une augmentation forte du taux d’énergies renouvelables.
Le second concerne la « décarbonation par l’électricité » : il s’appuie également sur un accroissement de l’efficacité énergétique et de la part de l’électricité dans les usages, à condition bien évidemment que l’électricité soit produite de manière décarbonée, c’est-à-dire par les énergies nucléaire ou renouvelables. Le troisième, intitulé « vecteurs diversifiés », vise une hausse de l’efficacité énergétique, un maintien des usages électriques et surtout une diversification des sources et des vecteurs énergétiques, notamment développés localement.
Ces différents scénarios enseignent tout d’abord qu’il faudra lever des verrous majeurs, scientifiques et technologiques, mais aussi règlementaires et économiques. Ils montrent en outre qu’il faut introduire, dans chacun des scénarios, au moins une révolution technologique, une rupture, d’où l’importance de la recherche dans ce domaine. Ces scénarios présentent par ailleurs des invariants, c’est-à-dire des propriétés communes. Tous appellent ainsi à davantage d’efficacité énergétique et de sobriété dans les domaines du bâtiment et des transports : véhicules sobres, mais aussi électriques à batteries et à hydrogène, et de l’industrie.
Tous nécessitent de gérer l’accroissement du taux des énergies renouvelables, qui génèrent évidemment de l’intermittence, que ce soit par le stockage de l’énergie – électricité et chaleur – le développement de réseaux intelligents, les micro-réseaux locaux et les stratégies d’autoconsommation avec stockage, le développement de nouveaux vecteurs énergétiques inter-convertibles et interopérables, en particulier basé sur l’hydrogène, et le suivi de charge des centrales nucléaires.
L’ANCRE s’est appuyée, dans le cadre de cette réflexion, sur une vision fortement systémique, prenant en compte d’un côté les usages, c’est-à-dire la demande énergétique, essentiellement dans le bâtiment, la mobilité, les systèmes urbains, l’industrie et les technologies de l’information et de la communication, de l’autre l’offre, qu’elle soit basée sur des énergies fossiles, pétrole et gaz, du nucléaire ou un mix d’énergies renouvelables, plus ou moins variables, le tout sous-tendu par la nécessité absolue d’assurer l’adéquation entre offre et demande, c’est-à-dire d’optimiser le système, en introduisant des réseaux d’énergies intelligents, du stockage d’énergie et en favorisant le développement de vecteurs flexibles, inter-convertibles, assurant l’interopérabilité entre les réseaux de gaz, d’électricité, l’hydrogène et éventuellement la chaleur.
Imaginer les technologies de demain, préparer les révolutions technologiques, implique de capitaliser sur les sciences de base pour l’énergie, donc sur une communauté forte, et de favoriser l’introduction de tous les usages du numérique pour les technologies de l’énergie.
L’ANCRE propose une double démarche : d’une part soutenir, de la recherche fondamentale jusqu’aux expériences de démonstration, les filières existantes ou émergentes dans les domaines du nucléaire, des hydrocarbures et des énergies renouvelables, d’autre part capitaliser sur une base de connaissances de l’état de l’art, pour se maintenir en capacité de faire émerger des concepts innovants à fort impact potentiel, qui permettront de préparer les ruptures technologiques.
L’ANCRE a dans ce cadre défini cinq priorités stratégiques.
La première concerne les invariants des scénarios : efficacité énergétique, sobriété et optimisation du système énergétique avec les réseaux d’énergies intelligents, le stockage et l’interopérabilité des vecteurs énergétiques.
La deuxième porte sur la consolidation et l’évolution des filières énergétiques nationales majoritaires : les hydrocarbures et les ressources minérales, indispensables pour les nouvelles technologies de l’énergie, le nucléaire et les énergies renouvelables, en particulier les filières nationales.
La troisième priorité touche aux révolutions technologiques, extrêmement contrastées selon les scénarios ; le scénario « sobriété » implique un captage important du CO2, en vue de son stockage ou de sa réutilisation ; on l’a vu avec le power-to-gas. Le scénario « décarbonation par l’électricité » impose un stockage massif de l’électricité et de l’énergie de manière générale, tandis que le scénario « vecteurs diversifiés » requiert une exploitation de la chaleur fatale, et en particulier de la cogénération nucléaire.
La connaissance des marchés et des comportements actuels et futurs représente une quatrième priorité qui nécessite la contribution des sciences humaines et sociales, par l’intermédiaire de nos collègues de l’alliance ATHENA.
Enfin, la cinquième priorité a trait au développement de concepts scientifiques innovants pour l’énergie, basés sur la recherche fondamentale et une approche interdisciplinaire.
Je conclurai en insistant sur deux priorités transversales : d’une part la nécessité d’une communauté nationale de recherche de haut niveau, visant à développer, à l’horizon 2030, un programme de sciences de base pour l’énergie, à l’instar de celui du Department of Energy américain (DoE), d’autre part une contribution de la recherche et développement à la formation des acteurs de la transition énergétique, en formation initiale et continue, avec la nécessité d’adapter les cursus aux nouveaux paradigmes de la transition énergétique, dans le cadre d’une approche systémique et interdisciplinaire, à destination des décideurs publics, multiples à l’échelle régionale, nationale et internationale, et de la société civile, pour permettre les changements nécessaires et l’adoption des nouvelles technologies et des nouveaux services de l’énergie.
Mme Anne Varet, directrice de la recherche et de la prospective, ADEME. Ma présentation s’inscrit dans le prolongement des éléments évoqués par M. David Marchal, lors de la première table ronde.
La stratégie de recherche ADEME 2014 – 2020 tient compte de priorités de recherche définies dans une feuille de route « réseaux électriques intelligents » et du projet « vision énergie climat 2030 – 2050 ».
Il nous semble nécessaire de rappeler combien il est important de poursuivre les recherches relatives à la baisse des coûts des technologies de production et des technologies présentant un moindre impact pour le réseau électrique. Il est également nécessaire d’améliorer les outils de prévision de la production, de la demande et de l’effacement. Il nous apparaît par ailleurs essentiel de travailler à la conception d’architectures de réseaux innovantes, limitant les pertes, les coûts de renforcement et de raccordement.
La compétitivité économique et technologique des solutions de stockage nous semble aussi constituer une priorité, tout comme le développement des outils de gestion et de pilotage de micro-réseaux et d’interaction entre réseaux. Il en va de même pour le pilotage des opérations de maîtrise de la demande et d’effacement, en lien avec les évolutions à l’œuvre dans les bâtiments et sur les véhicules électriques. Il ne faut enfin pas perdre de vue la nécessité d’évaluer et d’améliorer les performances énergétiques et environnementales des solutions développées.
M. Rémy Dénos a évoqué la question de l’adoption et de la diffusion des technologies développées : ceci suppose des recherches en sciences économiques et sociales.
Subsistent enfin, ainsi que le mentionnait M. Sylvain Lemelletier, des enjeux sur l’utilisation combinée de différents vecteurs énergétiques ; il convient donc de ne pas se limiter au réseau électrique.
Je souhaiterais à présent faire état de quelques exemples de projets d’expérimentation de smart grids, menés notamment dans le cadre du programme des investissements d’avenir de l’ADEME.
Le projet NICE GRID donne des résultats sur le résidentiel : pour les ménages chauffés à l’électricité, on parvient à effacer de 0,8 à 1 kW, ce qui est loin d’être négligeable. Le projet RéFLeXE montre que l’on peut obtenir une réduction momentanée de la puissance électrique dans le tertiaire et l’industrie de 20 à 30 %. La capacité en termes d’effacement est donc considérable.
Nous avons également pu travailler sur le comportement des utilisateurs, afin d’appréhender la question de l’acceptabilité sociale. Il nous semble vraiment important de renforcer les projets d’expérimentation intégrant les consommateurs. Nous avons en effet constaté l’existence de freins et d’interrogations autour de la sécurisation du réseau électrique et de son fonctionnement. Une moindre connaissance des dispositifs peut créer une frilosité chez les usagers. Il est donc important de favoriser les travaux en sciences humaines et sociales sur ces sujets.
Il ressort de nos études qu’il est par exemple essentiel de mettre en avant les bénéfices environnementaux et les externalités positives, pour impliquer réellement les consommateurs. Il nous semble nécessaire de renforcer les recherches dans ce domaine. Les démonstrateurs sont, par exemple, un moyen d’impliquer les consommateurs dans l’acceptabilité de ces technologies.
Il convient en outre d’accompagner la recherche dès le départ, des briques technologiques aux démonstrateurs, voire, dans le cadre de l’hydrolien, jusqu’à l’aboutissement optimal que sont les fermes pilotes. Nous disposons, en matière d’avancée de projets, d’exemple de telles réussites dans le domaine du stockage stationnaire d’électricité, notamment avec des volants d’inertie. Nous accompagnons ainsi aujourd’hui la création d’une ligne pilote de production au travers du programme des investissements d’avenir.
Ceci nécessite l’existence d’un continuum du financement public et privé des projets. Aujourd’hui, cette continuité est quasiment réalisée lorsque l’on combine les financements de l’Agence nationale de recherche (ANR), de l’Europe, du Fonds unique interministrériel (FUI) et du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Il reste toutefois un manque pour les « petits démonstrateurs », c’est-à-dire des démonstrateurs à l’échelle une, demandant peu de financements – de un à cinq millions d’euros – pour lesquels on constate une certaine absence du financement public en complément des fonds privés. Ces structures sont pourtant extrêmement intéressantes, pour tester notamment les problématiques réglementaires.
En conclusion, il nous semble important, au-delà des priorités de recherche, d’accompagner les entreprises jusqu’au marché, de favoriser la recherche, le développement et l’innovation, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans l’objectif de conforter la compétitivité des filières où il existe des leaders ou des filières à fort potentiel à l’export, puisque certaines technologies maîtrisées aujourd’hui en France ont surtout vocation à être exportées.
Il est également essentiel de conserver la capacité de stimuler l’émergence de solutions et filières industrielles compétitives, ce qui est possible notamment au travers du programme de recherche de l’ADEME et du programme des investissements d’avenir.
J’insiste par ailleurs sur la nécessité de favoriser la réalisation de petits démonstrateurs sur un certain nombre de sujets comme le power-to-gas ou la mobilité hydrogène, dont il a été question précédemment. Les financements nécessaires ne sont pas très importants, mais nous ne disposons pas aujourd’hui d’outils pour cela, notamment pour amplifier la mise sur le marché d’innovations portées par les PME et les ETI.
Continuer à soutenir les expérimentations préindustrielles est aussi un enjeu majeur, couvert aujourd’hui par le programme des investissements d’avenir et le PIA2.
Nous nous interrogeons enfin sur le besoin d’accompagner les premières applications industrielles pour limiter les risques et créer les conditions d’une expérience commerciale initiale, qui constitue aujourd’hui une réelle prise de risque pour les industriels. Nous pensons qu’un soutien apporté à cette étape favoriserait peut-être les mises sur le marché de la part des industriels. Nous menons déjà cette démarche sur des lignes de production et nous interrogeons sur l’intérêt d’aller au-delà. Ceci nécessite sans doute de mener des discussions avec l’Europe, notamment avec la BEI.
M. Nouredine Hadjsaid, professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble et à Virginia Tech, directeur du laboratoire IDEA-GIE, président du conseil scientifique de Think Smart Grids. Je suis désolé d’intervenir en visioconférence, faute d’avoir pu être parmi vous aujourd’hui.
L’association Think Smart Grids représente l’ensemble des acteurs français dans le domaine des réseaux intelligents ou smart grids : industriels, centres de recherche et institutionnels. Il se trouve que je préside le conseil scientifique de cette association, qui a en charge de l’éclairer sur les choix technologiques et les stratégies de recherche de la filière. J’ai également contribué, avec des collègues du CEA, du CNRS et d’autres personnes membres du groupe Réseaux et stockage, aux travaux de l’ANCRE, dans le cadre d’une réflexion sur les priorités de recherche et développement dans le domaine du développement des réseaux d’énergie.
Concernant les priorités et les freins à l’innovation, beaucoup de choses ont déjà été dites par les précédents intervenants, aux propos desquels je souscris majoritairement.
Je souhaiterais simplement ajouter quelques points sur la partie réseau. Le réseau est une infrastructure extrêmement complexe, peut-être même la plus complexe que l’être humain ait eu à construire. Il faut par ailleurs savoir que le réseau n’a pas été conçu pour intégrer les énergies renouvelables au-delà d’un certain pourcentage. Il va donc falloir l’adapter, sans surinvestir et tout en maintenant, voire en améliorant, le niveau de sécurité actuel.
Il est également important de souligner qu’il existe deux réseaux distincts : le réseau de transport et le réseau de distribution, intégrés dans un réseau continental européen, dans le cadre duquel on ne dispose pas toujours d’une connaissance fine de ce qui se passe à l’extérieur, alors même que les électrons ne connaissent pas les frontières.
Les solutions et innovations développées doivent l’être en tenant compte de certaines contraintes, puisqu’elles doivent s’intégrer à l’existant. Si l’on considère le réseau français actuel, cet existant correspond à environ 1,4 million de kilomètres de ligne, soit plus de trois fois la distance entre la Terre et la Lune. Il nous faut ainsi combiner les innovations les plus avancées avec des technologies qui existent depuis plus de trente ans, voire pour certaines depuis près d’un demi-siècle. Il s’agit là d’un défi majeur.
D’autre part, la dynamique d’évolution des réseaux est très différente de celle de la production décentralisée, ou des énergies renouvelables de manière générale. Or, pour construire, par exemple, une ligne de transport il faut, en l’absence d’opposition particulière, compter entre cinq et sept ans.
Il convient en outre de considérer la question de la maturité des technologies. Le réseau étant un système complexe, on ne peut se permettre d’y intégrer des innovations ou des technologies sans prendre d’immenses précautions. Il faut à tout prix éviter les défaillances. Contrairement à un ordinateur, il ne suffit pas, en cas de problème, d’appuyer sur les touches « Ctrl – Alt – Suppr » pour tout effacer et tout recommencer. Faire cela dans le réseau conduirait au black-out.
Ce sont là des contraintes majeures, à partir desquelles peuvent se définir les pistes de recherche et développement.
Je souhaiterais insister sur la nécessité d’adapter le réseau en termes d’architecture. La variabilité accrue et toutes les contraintes qui viennent d’être mentionnées impliquent d’avoir un réseau flexible, c’est-à-dire capable de s’adapter à des situations fortement contraintes, donc porteuses d’intelligence. C’est dans ce contexte qu’interviennent les technologies de réseaux intelligents ou smart grids : le réglage de tension, les protections adaptatives pour faire face à toute défaillance dans le système, mais aussi les technologies d’auto-cicatrisation qui permettent de gagner énormément de temps pour la réalimentation. Or, chaque minute gagnée correspond à une économie de plusieurs dizaines de milliers, voire millions d’euros.
De la même manière, l’intégration en masse des énergies renouvelables conduit à réfléchir à des questions liées à des architectures en courant continu. Ce ne sont pas là des sujets nouveaux, mais le contexte est différent. On parle en effet aujourd’hui de « courant continu maillé », ce qui suppose que l’on maîtrise des questions de coupure. Des éléments se mettent actuellement en place dans la cadre de super grids, mais la question de coupure du courant continu reste un thème majeur, dans la mesure où le courant continu a la mauvaise habitude de ne pas passer par zéro, contrairement au courant alternatif. On imagine donc le développement d’architectures en courant continu, à différentes échelles, des liaisons pour l’éolien maritime ou offshore jusqu’aux réseaux de distribution.
J’aimerais en outre insister sur la question, fondamentale, de la résilience de ces réseaux. Mme Vera Silva a évoqué l’importance de la stabilité du système, dans un contexte de variabilité forte, qui plus est en augmentation. Comment détecter des instabilités en temps réel, avec cette variabilité et des moyens de contrôle limités ?
Un autre aspect concerne l’intégration massive des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui représentent non seulement des opportunités, mais aussi des risques. Ceci suppose de comprendre ces risques et de disposer pour cela de modèles d’infrastructures couplées. Les dynamiques des technologies de l’information et de la communication et des technologies de réseau différent. Élaborer un modèle commun reste un défi majeur, notamment pour identifier les vulnérabilités et les effets de cascade entre infrastructures.
Par exemple, face à la défaillance d’un logiciel ou d’une communication, l’existence d’une interpénétration importante entre les deux infrastructures fait que l’on doit comprendre quelles sont les interdépendances et comment les effets de cascade vont se produire d’une infrastructure à l’autre. Tout cela permet de mieux préparer la résilience de ces réseaux, entre autres aux attaques cybernétiques. De plus en plus d’objets intelligents sont aujourd’hui présents dans le réseau, qui permettent une certaine capacité de décision, notamment locale. Il est donc indispensable de maîtriser la sûreté globale du réseau.
Un autre point de mon intervention concerne l’interaction entre le réseau de distribution qui, confronté aux nouveaux usages tels que les véhicules électriques et à l’avènement des « consommateurs – acteurs », subit une importante évolution, et le réseau de transport. La nécessaire flexibilité du réseau de distribution doit être appréhendée de manière holistique, systémique : on ne peut considérer uniquement des effacements locaux. Une action sur la consommation a un impact sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, du système et des acteurs. Il est important d’être vigilant quant à l’interaction entre réseaux de distribution et de transport, afin d’éviter une situation telle que celle qu’a connue l’Italie, où le manque de surveillance du réseau de distribution avait eu un impact sur le réseau de transport.
Le dernier élément de mon exposé renvoie aux freins, nombreux, au développement des innovations correspondantes, notamment les difficultés d’intégration sur un patrimoine existant considérable, la nécessaire maîtrise de la maturité technologique, la répartition des responsabilités entre acteurs, la prise en compte indépendante des énergies renouvelables et des évolutions de réseau, la lourdeur des investissements, les différences entre les mondes de l’énergie et des TIC, en termes de culture, de durée de vie des équipements, de standards et d’interopérabilité.
J’insiste enfin sur les compétences humaines, en termes de formation et de disponibilité. Nous rencontrons en effet aujourd’hui les plus grandes difficultés à trouver les compétences requises pour mener à bien tous nos projets.
Mme Anne Perrin, directeur de recherche en biophysique, chercheur à Minatec-Grenoble et présidente de l’Association française pour l’information scientifique (AFIS). Je m’exprime aujourd’hui en tant que spécialiste des effets biologiques et sanitaires des radiofréquences, thématique qui m’a conduite à élargir ma problématique à une réflexion philosophique sur le risque et la société. Je parle également en ma qualité de présidente de l’Association française pour l’information scientifique, association qui promeut la méthode scientifique et apporte de l’information sur les questions à l’interface des sciences, des technologies et de la société, qui mettent souvent en jeu des risques sanitaires.
Comme vous le savez, certaines innovations techniques sont soumises à des controverses et à des polémiques. Ceci concerne des risques considérés comme subis et des innovations entraînant des changements dans les habitudes et soumises à des politiques publiques. Il peut s’agir par exemple d’actions d’aménagement du territoire, avec le déploiement massif d’antennes de téléphonie mobile, ou de l’installation de compteurs Linky chez tous les habitants.
Il est intéressant de constater l’existence d’une forme commune à un certain nombre de ces controverses, par exemple sur les OGM, les nanoparticules, les ondes électromagnétiques ou le nucléaire, qui peuvent représenter un frein important au développement technologique. Dans tous ces cas, les controverses impliquent des collectifs, des organisations non gouvernementales, divers groupes et associations, c’est-à-dire des organisations non centralisées, qui n’agissent pas dans le cadre d’un réseau forcément bien organisé. Il existe également autour de ces controverses des demandes politiques, de moratoires, d’interdictions, de principe de précaution et de sobriété. On assiste aussi au développement d’une information pseudo-scientifique autour des questions de risque sanitaire, perçues comme centrales.
Le compteur Linky, développé dans le cadre de la transition énergétique, illustre parfaitement ce phénomène. Son déploiement rencontre en effet actuellement des oppositions, parfois relativement violentes localement, qui obligent ERDF à organiser des débats publics. Ceci se traduit même, à l’extrême, par une judiciarisation.
Or on constate que les scientifiques qui doivent intervenir pour éteindre la polémique sur ces sujets ne sont pas ceux qui sont impliqués dans la recherche et développement, mais des experts du risque.
Le paradoxe auquel on peut se trouver confronté réside dans le fait qu’une population peut parfaitement accepter le principe de la transition énergétique, être en demande d’énergies renouvelables et, au moment de la mise en œuvre d’une technique, s’y opposer, dans la mesure où les éléments mis en avant dans les conférences et dans les informations données localement sont anxiogènes, en l’occurrence centrées sur le danger de ce compteur, alors même que celui-ci respecte les normes en vigueur, tant en termes de sécurité sanitaire au niveau des ondes électromagnétiques que de protection des données.
La question du risque sanitaire est un outil important dans la controverse et permet de mobiliser l’opinion publique et les médias qui relaient ces informations alarmantes, ceci pouvant conduire à des blocages, à la prise de décisions politiques d’interdiction ou à l’insertion dans des textes de lois d’éléments allant à l’encontre de l’état des connaissances, mais laissant penser au public qu’il existe réellement un danger.
Il me semble ainsi qu’il serait judicieux d’intégrer dans les programmes de recherche tels que ceux dont il a été question tout au long de cette après-midi une réflexion sur la manière d’aborder et de gérer ces éléments. Cela va au-delà de l’acceptabilité des technologies. Il s’agit d’anticiper une éventuelle amplification sociale du risque, susceptible d’aboutir, à partir de groupes relativement réduits, à un blocage important.
La notion de pluridisciplinarité, incluant l’intervention de communicants et de sociologues, a été évoquée à plusieurs reprises lors des diverses présentations. Il me semble qu’il faut aussi impliquer dans ce processus les scientifiques travaillant dans la recherche et le développement de ces systèmes, afin qu’ils soient capables, en amont, de parler au public. À l’heure actuelle, la vulgarisation ne fait pas réellement partie des missions du chercheur. Or, il est important d’intégrer cette notion dès le début des projets et de faire participer activement les chercheurs à ces problématiques, pour qu’une fois la crise arrivée, ils soient en mesure d’en parler, voire d’anticiper en mettant en place des moyens de diffuser de l’information sur le projet, sur la méthode scientifique, sur l’esprit critique, etc.
Cette réflexion doit intervenir largement en amont. Ceci m’apparaît, dans le contexte actuel, comme un élément essentiel. En l’absence de cette nécessaire anticipation, de grands projets pourraient en effet devoir faire face à certaines surprises, du fait de controverses susceptibles de prendre une énorme ampleur.
Je n’ai pas de solution à vous apporter, mais préconise vraiment de réfléchir à ces sujets, d’accompagner la recherche, d’impliquer les scientifiques concernés et de les faire travailler sur ces questions avec les spécialistes de l’étude du risque.
M. Jean-Marie Chevallier, professeur émérite de sciences économiques à l’université Paris-Dauphine, Senior associé au Cambridge Energy Research Associates (IHS-CERA). Je souhaiterais faire état de réflexions menées à l’université Paris-Dauphine, avec le groupe du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP).
L’un des messages qu’il nous paraît important de faire passer est celui d’un changement institutionnel conduisant actuellement à l’existence d’une dynamique décentralisée de l’innovation.
J’insiste sur le fait que figurent dans ce cadre non seulement les innovations technologiques, mais aussi leur combinaison avec d’autres types d’innovations : institutionnelles, administratives, financières et juridiques. Il se crée ainsi un complexe d’innovations, qu’il est important de garder en mémoire.
Pourquoi cela se passe-t-il au niveau des régions ? Il s’est produit, depuis le Grenelle de l’environnement et les lois qui l’ont accompagné, auxquels est venue s’ajouter la loi sur la transition énergétique, une sorte de « réveil régional ». Petit à petit, les régions ont considéré qu’elles avaient à s’occuper directement des problèmes d’énergie et d’environnement, dans une vision plutôt durable et soutenable. Ceci s’est mis en place au cours des quatre dernières années. C’est aujourd’hui devenu très important.
Se développent ainsi, au niveau régional, des initiatives et des projets qui créent une espèce d’ébullition en matière d’innovation énergétique et écologique. Les régions ont maintenant des Plan climat-énergie territoriaux (PCET), qui concourent à une certaine effervescence dans ce domaine. Ce mouvement se déroule non seulement en France, mais aussi dans toute l’Europe et au niveau mondial. S’est ainsi tenue, parallèlement à la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP 21), une réunion des villes du monde dans le cadre du C40 Cities Climate Leadership Group (C40), dont Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, va peut-être prendre la présidence d’ici la fin de l’année. Ces villes se rassemblent pour répondre aux défis posés par l’énergie et l’environnement et construire quelque chose de nouveau.
J’ai entendu dire à propos de ces innovations, lors de débats locaux, que l’intelligence énergétique n’était plus à Paris, mais en région. Ceci est assez nouveau et conduit au développement d’un certain nombre d’expérimentations.
Le mot « expérimentation » est d’ailleurs extrêmement intéressant, alors que nous, économistes, considérons que nous sommes à un moment particulier de l’histoire de l’énergie, marqué essentiellement par une généralisation des incertitudes. Que l’on se tourne du côté du prix du pétrole, du gaz de schiste, de l’évolution des coûts des énergies renouvelables, du prix du CO2 ou de la mesure des externalités, on se trouve en effet face à de multiples incertitudes. Dans ce contexte, l’expérimentation prend tout son sens en tant que réponse à un faisceau extrêmement large d’incertitudes, à cause desquelles bien des économistes éprouvent des difficultés à croire encore au concept d’optimum. L’expérimentation apparaît alors comme un élément absolument fondamental.
Des innovations se font jour à différents niveaux (régions, collectivités locales, villes, etc) et un benchmarking s’opère, autour d’une reproductibilité possible. Ceci me semble capital, sachant qu’on est loin de la volonté d’un optimum à la Boiteux, dont on rêvait voici quelques années.
Il existe, dans cette ébullition, des interconnexions nouvelles, montantes : l’énergie n’est plus un problème particulier, mais s’interconnecte avec les problèmes d’eau, de transport et de collecte des déchets.
Je souhaiterais revenir quelques instants sur les travaux menés par l’ADEME dans le cadre des investissements d’avenir, dont aucun bilan n’a encore été réalisé, mais qui nous offrent des leçons, reproductibles ou non, qu’il nous faut suivre attentivement.
On constate actuellement l’existence d’un benchmarking international entre ces villes ou ces territoires, qui se situent dans une logique de concours d’innovations. J’ai ainsi été très frappé d’apprendre que le concours pour les territoires à énergie positive, lancé par Mme Ségolène Royal, avait reçu quelque cinq-cents réponses, ce qui va bien au-delà de ce que l’on pouvait imaginer. Ceci illustre bien le fait qu’il existe, dans les collectivités et les territoires, une réelle volonté de changer, d’innover, de créer. Cette donnée est extrêmement intéressante.
Dans ce mouvement, se créent en outre de nouvelles possibilités de financement. Je pense que la France est un pays qui compte beaucoup d’épargne et que de l’épargne locale peut parfaitement être attirée par des projets de proximité, créateurs d’emplois locaux, non délocalisables.
Cette ébullition régionale me paraît essentielle à l’heure actuelle. Elle mérite d’être suivie, comparée. Sans doute peut-on en effet en tirer des leçons pour accélérer certains projets ou évolutions qui semblent plus porteurs que d’autres.
M. Davy Marchand-Maillet. J’aimerais rebondir sur la question de la généralisation des incertitudes, pointée par M. Jean-Marie Chevallier. Pour ce qui concerne par exemple le stockage de l’électricité, on joue en effet sur la volatilité des prix de l’électricité et du mix de production énergétique à un instant donné. Or, cela représente un risque majeur. Il est extrêmement difficile de construire un business plan pour un actif de stockage, dans la mesure où cela dépend très largement des conditions du marché sur lequel on se positionne. Ceci nécessite finalement de penser de nouveaux instruments de financement pour les actifs de stockage, au-delà du market design, qui doit sans doute évoluer. Il existe en effet toujours un risque de variation et des incertitudes, qu’il va falloir couvrir par des instruments de financement. Il pourra s’agir de financements publics, mais aussi privés. Des mécanismes restent à inventer dans ce domaine. Je pense que cela devrait constituer un axe de recherche très important.
M. Bruno Sido. Je partage tout à fait votre point de vue. Il faudrait que nous consacrions une audition complète à l’aspect économique global de ces questions. Les Allemands dépensent par exemple 70 milliards d’euros par an pour leurs énergies renouvelables et sont obligés de vendre de l’électricité à prix négatif tout un week-end, parce qu’il y a du vent et du soleil. Ceci montre bien qu’il existe un vrai problème, qu’il faudra que nous envisagions très sérieusement. Il ne faudrait pas, en effet, jouer aux apprentis sorciers. Peut-être ne revient-il toutefois pas à l’Office parlementaire d’organiser ce type de débat.
M. Jean-Marie Chevallier. Nous sommes là face à un problème extraordinairement compliqué. Plusieurs séminaires vont d’ailleurs être organisés sur ce thème à l’université Paris-Dauphine. On ignore quel est le bon market design et l’on se trouve face à un marché électrique européen que l’on ne sait pas réguler et dont il est difficile d’anticiper les évolutions.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je voudrais clôturer cette journée en vous remerciant toutes et tous très sincèrement. Je salue notamment nos invités étrangers, qui nous ont fait le plaisir de venir des États-Unis, d’Allemagne ou de Bruxelles pour participer à cette audition.
Comme vous l’avez constaté, le mode de fonctionnement de l’Office parlementaire consiste à mêler les disciplines et à faire se croiser les points de vue des administrations, des chercheurs et des entreprises, souvent de jeunes entreprises, qui promeuvent des idées émergentes que nous soutenons. Divers scénarios, sensiblement différents, ont ainsi pu se confronter aujourd’hui. Nous estimons en effet que les discussions, les échanges, les réponses apportées par chacun, sont riches d’enseignements et constituent une ressource essentielle pour nous permettre d’informer nos collègues parlementaires.
Notre but est en effet d’informer et de préparer la loi en amont de la législation, c’est-à-dire de permettre à chaque parlementaire de connaître le mieux possible un sujet donné, d’en avoir appréhendé la complexité, sous tous ses angles (technologiques, politiques, économiques, etc). L’énergie peut sembler a priori être un sujet simple. Or, les évolutions que vous avez mentionnées, faisant appel à une imagination territoriale, créent pour les régulateurs d’électricité un paysage de plus en plus difficile à appréhender.
Nous appelons de nos vœux une diversification des sources énergétiques, mêlant énergies classiques et renouvelables, l’idéal étant d’aller vers un schéma comportant le plus possible de ces dernières, à un coût moindre.
Ceci ne va toutefois pas sans soulever de problèmes, en lien notamment avec les questions de ruptures technologiques, que vous avez clairement soulignés et dont il faut que le législateur soit conscient. J’ai eu aujourd’hui le sentiment que les ruptures technologiques évoquées voici une dizaine d’années, alors que l’on pensait que le stockage et le développement du numérique régleraient tous les problèmes, n’avaient pas eu lieu. Vous avez tous insisté sur le fait qu’il n’existait pas de solution miracle. C’est certainement en faisant progresser toutes ces technologies, en allant vers davantage d’inter-connectabilité, d’interopérabilité et en mettant toujours plus d’intelligence dans les systèmes que l’on avancera de façon satisfaisante.
Nous avons élaboré, au sein de l’OPECST, un rapport sur la filière hydrogène concluant que l’Allemagne est beaucoup plus avancée et performante que nous dans ce domaine, dans la mesure où il existe, à côté des capacités scientifique dont nous disposons aussi, une volonté politique. GDF et GRDF ont produit de très belles innovations sur un certain nombre de ces sujets. Les solutions de stockage par l’intermédiaire de gaz injecté dans le réseau méritent que l’on y travaille.
L’effacement n’est en outre pas un sujet simple. Des gisements existent toutefois dans ce domaine, ainsi que cela nous a été expliqué dans plusieurs exposés.
Il faut, en tout état de cause, préparer les révolutions technologiques à venir, afin d’être en mesure d’en toucher ensuite les dividendes. Si nous n’avançons pas sur certaines technologies, d’autres pays le feront et récolteront les fruits de leur développement, dans la mesure où nous serons contraints de les leur acheter pour aller dans les directions stratégiques choisies.
Vous avez également évoqué les territoires à énergie positive. Ceci me semble très intéressant : plus les initiatives partant de la base seront nombreuses, mieux nous nous porterons.
Certains d’entre vous ont par ailleurs mis l’accent sur la question des comportements et sur les controverses susceptibles de naître lorsque se développent de nouvelles technologies. Nous constatons aujourd’hui un tel phénomène avec les smart grids. Or, il semble évident que si l’on n’anticipe pas et si l’on ne s’attache pas à déverrouiller la polémique en amont, cela risque de créer des blocages. L’Office a beaucoup réfléchi sur les questions liées aux biotechnologies et je travaille moi-même actuellement sur le sujet du genome editing : nous voyons, dans ces domaines, naître des controverses avant même que les technologies ne se soient développées. Ceci illustre bien l’importance de favoriser la discussion et le débat avec le public dès l’amont et de ne rien cacher, d’agir en transparence.
Il n’existe, finalement, qu’une seule solution pour résoudre tout cela : cette solution s’appelle l’innovation. L’ancien président de l’OPECST, M. Claude Birraux, et moi-même avons rédigé un rapport sur l’Innovation à l’épreuve des peurs et des risques, dans lequel nous insistions sur le fait que l’innovation n’était pas uniquement technologique, mais existait dans de nombreux domaines. Il est essentiel qu’elle s’inscrive dans un cadre pluridisciplinaire.
Il est fondamental qu’un pays comme le nôtre favorise l’innovation. Nous avons d’ailleurs, pas plus tard qu’hier, adopté à l’unanimité une motion sur les coupes budgétaires opérées dans ce domaine.
L’Office apparaît, dans ce contexte, comme la passerelle entre la science, la technologie, le monde académique et universitaire et l’industrie, rôle que nous entendons jouer dans le cadre notamment d’auditions comme celle-ci, à laquelle je vous remercie encore d’avoir contribué.
ANNEXE N° 3 :
COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE DU 9 FÉVRIER 2017 SUR « LES ENJEUX DE LA RECHERCHE EN ÉNERGIE »
M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à l’Assemblée nationale pour cette audition consacrée aux enjeux de la recherche en énergie. Je remercie l’ensemble des responsables et des chercheurs qui ont accepté d’y contribuer, ainsi que les collègues députés et sénateurs, membres de l’OPECST, et toutes les personnes présentes dans cette salle, dont un groupe d’étudiants d’une grande école française, autour de Pierre-Benoît Joly.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques est une délégation permanente commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans laquelle siègent 18 députés et autant de sénateurs. L’OPECST est saisi par les autorités des assemblées (bureau de l’Assemblée, commissions, groupes politiques) et peut recourir en tant que de besoin aux compétences d’un conseil scientifique composé de 24 personnalités.
L’audition d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche, confiée à l’Office par l’article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Cette évaluation va d’ailleurs constituer le sujet de notre prochain rapport, qui sera rendu public dans une quinzaine de jours.
Son volet « énergie », la SNRE (Stratégie nationale de recherche pour l’énergie), qui nous mobilise aujourd’hui, a été défini par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Après une année de travaux, une nouvelle SNRE, prenant en compte les orientations de la politique énergétique et climatique, a été validée à la fin de l’année dernière par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la recherche, et publiée au tout début 2017. J’ai appris hier au ministère de la recherche que cette démarche s’était effectuée dans de bonnes conditions de coopération entre les ministères. Cette information répondait à une question de ma part motivée par notre inquiétude globale d’un paysage morcelé de la recherche et de l’enseignement supérieur français, qui me fait parfois dire, de façon quelque peu provocatrice, que nous sommes le seul pays de l’OCDE à disposer de quatorze ministres de la recherche et de l’enseignement supérieur, puisque cette responsabilité est partagée entre autant de ministères différents. Or, l’absence de coopération peut conduire à des politiques divergentes, sur des sujets qui appelleraient au contraire une convergence des approches.
Je rappelle que l’Office parlementaire a déjà organisé, durant l’année 2016, dans le cadre de l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche, trois auditions publiques : le 30 juin sur la valorisation de la recherche, le 6 octobre sur la formation des scientifiques et des ingénieurs, et le 8 décembre sur les conditions d’élaboration et de mise en œuvre de cette stratégie. Le ministre Thierry Mandon, qui nous avait fait l’honneur d’ouvrir cette dernière audition, est retenu aujourd’hui par d’autres obligations et regrette de ne pouvoir être présent.
S’agissant plus particulièrement de la Stratégie nationale de recherche pour l’énergie, l’Office a décidé, compte tenu du calendrier parlementaire (les travaux de l’Assemblée nationale s’achevant en pratique à la fin du mois de février) d’anticiper la publication de son rapport. Dès mai 2016, une audition sur l’intégration des énergies renouvelables, qui constitue l’un des axes de recherche majeurs pour la transition énergétique, avait permis de faire un premier point sur l’avancement de la SNRE et son calendrier. A la suite de cette audition, notre vice-présidente, Mme Anne-Yvonne Le Dain, a été chargée par l’OPECST de l’évaluation de ce futur document. Bien qu’une version provisoire de celui-ci ne lui ait pas été communiquée alors, elle a auditionné individuellement, au cours des mois qui ont suivi, la plupart des acteurs majeurs impliqués dans la recherche en énergie dans notre pays. Un peu plus d’un mois après la publication de la SNRE, l’audition de ce jour vise à compléter les éléments nécessaires à son évaluation.
Avant d’entendre Mme Anne-Yvonne Le Dain, qui présidera les différentes tables rondes de cette journée, je laisse la parole à notre premier vice-président, le sénateur Bruno Sido, qui va, je le crois, revenir sur d’autres travaux de l’Office susceptibles d’alimenter utilement notre réflexion.
M. Bruno Sido, sénateur, premier vice-président de l’OPECST. Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, le président de l’Office parlementaire, mon collègue député Jean-Yves Le Déaut, vient de présenter le contexte de cette journée d’audition publique sur les enjeux de la recherche en matière énergétique et de livrer un premier aperçu de ses analyses sur le sujet.
En ma qualité de sénateur et de premier vice-président de l’OPECST, j’ai à mon tour le plaisir de vous accueillir ce matin. Je salue le travail entrepris par notre collègue Anne-Yvonne Le Dain, en fort peu de temps et à un rythme très soutenu, sur la base de la Stratégie nationale de recherche énergétique rendue publique par le gouvernement au mois de décembre dernier.
Il n’est pas exagéré d’affirmer que les questions énergétiques se trouvent inscrites dans les gènes de l’Office. Historiquement, celui-ci a été institué par une loi en 1983 afin de fournir à la représentation nationale une expertise indépendante sur la gestion des matières et déchets radioactifs et, au-delà, sur toute la filière nucléaire française. Depuis lors, l’OPECST a très sensiblement élargi son champ d’intérêt initial pour l’étendre à toutes les autres formes d’énergie, fossiles ou renouvelables. Sans remonter au-delà des cinq dernières années, nous avons ainsi rendus publics des rapports sur l’avenir de la filière nucléaire en décembre 2011, sur la transition énergétique dans sa dimension innovante et décentralisée en septembre 2013, sur l’hydrogène comme vecteur de la transition énergétique en décembre 2013, sur les freins réglementaires aux économies d’énergie dans les bâtiments en juillet 2014 et sur le tournant énergétique allemand en décembre 2014. L’Office a ainsi développé une familiarité et acquis une véritable expertise dans tous les segments du domaine de l’énergie.
A titre personnel, je me suis également intéressé à ces sujets, au Parlement. J’ai ainsi été, en 2006 et 2007, président de la mission commune d’information du Sénat sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France, et, en 2009 et 2010, rapporteur du volet « énergie » de la loi portant l’engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II ». Fort de cette double expérience, je veux vous dire ce matin toute l’importance que la représentation nationale accorde aux enjeux de la transition énergétique. Pour légiférer de manière pertinente, les parlementaires doivent au préalable prendre toute la mesure de la complexité et de la difficulté des aspects scientifiques et technologiques de cette transition et, par voie de conséquence, du caractère stratégique de la recherche dans ce domaine. Les verrous au plein développement des énergies renouvelables, qui sont largement déconcentrées et difficilement stockables, ne pourront être levés qu’au terme d’un effort de recherche constant et concerté.
C’est donc avec grand intérêt que j’ai découvert le programme de cette audition publique, qui réunit des personnes hautement qualifiées chacune dans leur partie. Je ne pourrai néanmoins être présent tout au long de cette journée et vous prie par avance de bien vouloir m’en excuser. Je prendrai bien évidemment connaissance ultérieurement du compte rendu des interventions auxquelles je n’aurai pu assister.
Je laisse sans plus tarder la parole à notre collègue Anne-Yvonne Le Dain, qui a magistralement organisé cette audition publique.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Merci. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer l’ensemble des participants à cette audition, notamment les collègues députés et sénateurs présents, ainsi que ceux qui vont nous rejoindre tout au long de cette journée.
Comme l’a rappelé Jean-Yves Le Déaut, l’OPECST n’a pas attendu la présentation de cette nouvelle Stratégie de recherche en énergie pour préparer son évaluation. Après une première audition publique organisée au mois de mai dernier sur l’intégration des énergies renouvelables au réseau, j’ai entendu individuellement plus d’une quinzaine d’acteurs directement impliqués dans la recherche en énergie dans notre pays. L’audition publique d’aujourd’hui vise à la fois à présenter aux parlementaires et aux citoyens les principaux aspects de cette nouvelle SNRE, à mesurer le chemin parcouru depuis la première, publiée en 2007, et son évaluation par l’OPECST en 2009, et à appréhender dans quelles conditions elle pourrait être mise en œuvre dans les mois et années qui viennent.
Avant d’entamer la première table ronde de cette journée, je vais brièvement revenir sur les principaux constats de l’évaluation par l’OPECST de la première Stratégie nationale de recherche en énergie, menée par nos collègues les députés Christian Bataille et Claude Birraux. La première SNRE, publiée en mai 2007, faisait suite à un large débat sur la politique énergétique et la lutte contre le changement climatique consécutif à l’engagement pris sur la scène internationale en 2003 par le chef de l’État, Jacques Chirac, et le premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, de diviser par quatre les émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990. Cet engagement a été par la suite inscrit dans la loi de programmation du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique. Cette même loi demandait à l’OPECST d’évaluer la Stratégie nationale de recherche en énergie. Le Grenelle de l’environnement ayant commencé en juillet 2007, les rapporteurs de l’OPECST se sont attachés à l’époque à en intégrer les apports plutôt que de se contenter d’un strict examen critique du document publié.
Quels ont été leurs principaux constats ? Ils ont tout d’abord, par contraste avec l’organisation de la recherche en énergie dans d’autres pays, comme le Japon ou les États-Unis, souligné l’implication insuffisante du gouvernement et l’absence de disposition permettant le suivi dans le temps de la mise en œuvre de la Stratégie. Aussi ont-ils proposé de définir une responsabilité de pilotage pour l’ensemble de la politique énergétique, avec la nomination d’un Haut-commissaire à l’énergie et de coordonnateurs par programmes prioritaires de recherche, ainsi que la création d’une commission nationale, composée de scientifiques et chargée d’une évaluation annuelle.
Sur le fond de la stratégie, Christian Bataille et Claude Birraux avaient distingué d’un côté la recherche sur les énergies bien établies (nucléaire et pétrole), qui ne demandaient que quelques réajustements, de l’autre la recherche sur les nouvelles technologies, pour laquelle ils avaient fixé plusieurs priorités, à savoir la recherche sur l’énergie photovoltaïque (singulièrement en couches minces), sur les biocarburants de deuxième génération, sur les batteries rechargeables, sur les énergies marines et enfin sur le stockage d’énergie de grande capacité, pour faciliter l’intégration des énergies intermittentes telles que l’éolien.
Après ce bref rappel relatif à l’évaluation de la précédente SNRE, nous allons entrer dans le vif du sujet, avec la première table ronde, qui va commencer par une intervention d’une quinzaine de minutes environ présentée par M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, qui va exposer les grandes lignes de la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie et peut-être déjà évoquer la façon dont les recommandations de l’OPECST ont été prises en compte dans ce document. Les contraintes de son agenda ne lui permettant pas de rester parmi nous, ses collaborateurs seront présents tout au long de nos débats pour compléter son propos et répondre aux éventuelles questions.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je souhaiterais rappeler que, outre les travaux déjà cités menés par l’OPECST, dont l’évaluation de la première Stratégie nationale de recherche conduite en 2009, nous avons organisé ici en 2015, dans le cadre de l’European Parliamentary Office of Technology Assessment (EPTA), juste avant la Conférence de Paris sur la COP 21, une audition sur le thème « Innovation et changement climatique : l’apport de l’évaluation scientifique et technologique », à laquelle une trentaine de présidents de commissions de parlements européens ont assisté et qui a réuni quelque 300 personnes dans cette même salle.
Nous avons procédé, un an plus tard, à une nouvelle audition, qui va donner lieu à la publication d’un document dans quelques jours. Elle visait à appréhender ce qui, un an après, avait effectivement été fait. Ceci est étroitement lié à la Stratégie nationale de recherche, dans la mesure où l’une des conclusions de ce texte, qui offre l’avantage de présenter les contributions de nombreux pays membres du réseau des Offices parlementaires (l’EPTA), mais aussi des États-Unis et de la Russie, pourtant très prudente sur ce sujet, est qu’il ne faut pas laisser dériver le changement climatique en imaginant que la science résoudrait tout. Pour autant, il souligne que si l’on ne développe pas l’innovation et les technologies de rupture, en faisant un effort en matière de recherche, alors on ne parviendra pas à tenir les objectifs de lutte contre le changement climatique. Il a été souligné lors de cette audition, avant la COP 21, que cette dimension de recherche était peut-être insuffisante ; d’où l’importance d’une Stratégie nationale de recherche. Je vous encourage vivement à lire ce document, qui regroupe les contributions de nombreux pays, européens notamment.
PREMIÈRE TABLE RONDE : STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE POUR L’ÉNERGIE – DE 2007 A 2017
Présidence : Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée,
vice-présidente de l’OPECST
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Monsieur le président, Monsieur le vice-président, Madame la vice-présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d’abord vous présenter mes excuses de ne pouvoir être présent parmi vous durant toute cette journée. Les raisons qui me poussent à m’absenter ne sont toutefois pas totalement déconnectées du sujet qui nous réunit, puisqu’il va s’agir pour moi d’aller m’entretenir avec une entreprise étrangère concernant ses travaux en France, y compris peut-être jusqu’à la R&D. Comme l’a signalé Mme Le Dain, la DGEC sera toutefois représentée tout au long de cette journée. Dans la mesure où il s’agit par ailleurs de travaux conjoints avec nos collègues du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pierre Valla, qui intervient dès cette première table ronde, pourra également vous apporter tous les éléments d’information nécessaires.
Je souhaiterais, en introduction, aborder la question de la place de la recherche et développement dans la transition énergétique, et plus particulièrement dans l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
J’évoquerai ensuite le cadre législatif d’élaboration de cette stratégie, et le processus de concertation et de pilotage.
Puis je vous présenterai, au-delà de la stratégie, un éclairage sur le renforcement du soutien à la R&D, qui répondra à certaines questions soulevées à l’époque par l’OPECST.
Je terminerai enfin par un point sur des éléments qui me paraissent importants et significatifs dans la SNRE, tant en termes de contenus que de process.
Quelle est la place de la R&D dans la transition énergétique ?
Tous les exercices de scénario conduits par divers acteurs nationaux et internationaux postulent, pour atteindre des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies, l’émergence et la diffusion d’évolutions technologiques fortes. Dans cette perspective, la recherche et développement (R&D) et l’innovation doivent être abordés sur un champ large. Ceci englobe bien entendu la technologie de production d’énergie décarbonée, plus ou moins établie dans le paysage ou au contraire émergente, mais aussi le développement de solutions permettant des usages plus économes et une optimisation des systèmes énergétiques.
Il apparaît en outre que la R&D pour la transition énergétique est très interdisciplinaire, puisqu’elle implique les différentes disciplines de la physique et de la chimie, mais aussi les technologies de l’information et de la communication, l’économie (les modèles économiques du nouveau paysage énergétique évoluent, se diversifient et interagissent, au niveau des régions, de l’Europe et du monde) et les sciences sociales. Ainsi, l’innovation non technologique est indispensable pour la diffusion des nouvelles solutions, l’élaboration de modèles économiques, l’appréhension des questions d’acceptabilité, de diffusion, d’organisation. Le centrage sur les usages ou la flexibilité des systèmes énergétiques émerge fortement.
En termes d’outils de pilotage stratégique, il faut savoir qu’un débat s’est noué, lors de la préparation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, avec nos collègues du ministère chargé de la recherche. Ces échanges ont abouti à l’article 183 de la loi, qui prévoit l’élaboration d’une Stratégie nationale de la recherche énergétique arrêtée par les ministres chargés de l’énergie et de la recherche. Il y est également indiqué que cette stratégie doit prendre en compte les outils de programmation stratégiques et opérationnels de la politique climatique et énergétique que sont d’une part la Stratégie nationale bas carbone, qui fixe les trajectoires et actions, par période de quinze ans renouvelée tous les cinq ans, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, publiée en novembre 2015, d’autre part la programmation pluriannuelle de l’énergie, publiée en octobre 2016, qui s’intéresse spécifiquement, par période de dix ans renouvelée tous les cinq ans, aux systèmes de production et de consommation d’énergie.
Mais la SNRE ne doit pas seulement se connecter aux programmations énergétiques ; elle doit aussi être en lien étroit avec la politique plus générale de recherche. Il est en effet indiqué que la Stratégie nationale de recherche énergétique précise la Stratégie nationale de recherche adoptée fin 2015. Elle vise dans ce contexte à identifier les enjeux de recherche et développement, les verrous scientifiques à lever à différents horizons temporels et tout au long de la chaîne de l’innovation dans le domaine de l’énergie, pour permettre la bonne réalisation des objectifs de politique publique. Le texte législatif demande aussi qu’elle s’inscrive dans une perspective internationale plus large. Pierre Valla, adjoint du directeur général de la recherche et de l’innovation, reviendra sur cette articulation entre SNR et SNRE et sur les aspects de collaboration entre nos ministères.
Une démarche de concertation et de pilotage claire a été mise en place. La SNRE a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2016 par un arrêté conjoint des trois ministres en charge de l’énergie et de la recherche, Mme Ségolène Royal, Mme Vallaud-Belkacem et M. Thierry Mandon. Il s’agit là d’une réponse à l’une des principales recommandations formulées par l’OPECST lors de l’évaluation de la précédente SNRE effectuée en 2009, qui avait souligné le besoin d’un travail conjoint.
En termes de processus, une concertation a été menée avec les parties prenantes, en s’appuyant d’une part sur un secrétariat permanent, d’autre part sur un comité de suivi.
Le secrétariat permanent, impliquant les services des deux ministères, a par ailleurs bénéficié d’une participation active de l’Alliance ANCRE et de l’ADEME, alliant ainsi le monde de la recherche et celui de la mise en œuvre. Il a notamment fourni une base documentaire, sous forme d’une série de fiches consacrées aux filières et usages de l’énergie et analysant l’état de l’art, le positionnement des acteurs français de la R&D sur ces sujets, et a élaboré un premier projet de plan et de document soumis à l’ensemble des parties prenantes.
Le comité de suivi réunissait l’ensemble des acteurs de la recherche énergétique. Il rassemblait ainsi des représentants des organismes publics de R&D et des alliances (ANCRE, ALLENVI pour le volet environnement, ALLISTENE pour le numérique, ATHENA dans le domaine des sciences sociales), des entreprises actives dans la R&D et l’innovation dans l’énergie et des organisations membres des différents collèges du Conseil national de la transition énergétique. Je rappelle que le CNTE comporte des représentants du Parlement, des associations nationales représentatives de collectivités locales, un collège des acteurs économiques de tout secteur, un des organisations syndicales et un enfin des associations de protection de l’environnement et autres associations plus généralistes. Étaient également associés à ce comité de suivi d’autres ministères, dont ceux chargés de l’agriculture (autour par exemple des questions d’utilisation de la biomasse) et de l’industrie, via la Direction générale des entreprises. A en outre été réalisée, conformément à la loi, une consultation des régions, par l’intermédiaire de l’Association des régions de France. Après trois réunions du comité de suivi, le projet de SNRE a été soumis pour avis au Conseil national de la transition énergétique, avec un avis favorable rendu le 3 novembre, et au Conseil supérieur de l’énergie, qui a également donné un avis favorable, le 9 décembre.
Avant d’aborder plus précisément quelques points de cette Stratégie, je souhaiterais donner un éclairage sur la structuration et le renforcement du soutien à la R&D pour l’énergie. Selon les dernières données publiques disponibles consolidées et les éléments d’information fournis par la France chaque année à l’Agence internationale de l’énergie, il apparaît que le financement public de la R&D pour l’énergie en France est passé, entre 2007 et 2014, de 870 millions d’euros par an à environ 1,05 milliard d’euros. Cette augmentation a été concentrée sur les nouvelles technologies pour l’énergie décarbonée : énergies renouvelables, stockage de l’énergie, réseaux intelligents, hydrogène et piles à combustibles, captage, stockage et valorisation du carbone, efficacité énergétique dans tous les secteurs (bâtiment, industrie, transports). Sur ce périmètre, le financement annuel est passé, durant cette même période, de 270 à 440 millions d’euros, soit une augmentation de 60 %, avec des montants qui s’approchent de ceux alloués à la recherche dans le domaine du nucléaire, globalement stables depuis dix ans.
Je rappelle que lors de la COP 21, a été lancée l’initiative internationale Mission Innovation, qui regroupe vingt-deux États (dont des pays européens, mais aussi les États-Unis, la Chine et l’Inde) ainsi que la Commission européenne. Ces États se sont engagés à doubler leurs financements alloués aux énergies dites « vertes ». Au-delà de cet engagement pris lors de l’Accord de Paris en décembre 2015, ce groupe de pays se réunit régulièrement pour échanger sur les priorités et envisage de lancer sept ou huit défis internationaux, avec des perspectives de financements internationaux de projets de recherche. Il est également en train de structurer un travail d’échange avec une coalition fondée par des milliardaires américains, dont M. Gates, la Breakthrough Energy Coalition, qui s’était engagée, au moment de la COP 21, à investir de l’argent dans la R&D. Cette démarche s’inscrit donc dans un contexte international. Il convient en outre de signaler que nous participons aux discussions européennes sur la refonte des politiques énergétiques.
Cet effort financier repose en grande partie sur le Programme d’investissements d’avenir, le PIA. Globalement, la transition énergétique est l’un des rares thèmes, avec la transition numérique, à figurer dans les trois volets du PIA. Ceci s’était concrétisé, dans le PIA1, en 2010, par le lancement des Instituts de la transition énergétique de l’ANR (déclinaisons dans le système de l’énergie des Instituts de la recherche technologiques, consortiums publics-privés créés dans d’autres secteurs) et de l’action démonstrateurs pilotée par l’ADEME, avec aujourd’hui deux programmes majeurs autour des véhicules et transports du futur et des démonstrateurs de la transition énergétique (énergies renouvelables, stockage, économie circulaire, bâtiments, agriculture et industrie écoefficientes, etc.). Le PIA2, en 2014, a renforcé l’action de l’ADEME et les montants financiers consacrés aux démonstrateurs. Le sujet de la transition énergétique est également largement présent dans le PIA3, actuellement en cours de lancement.
En matière d’innovation, j’ai choisi de citer l’exemple des énergies renouvelables en mer, pour lesquelles l’OPECST appelait de ses vœux en 2009 un soutien fort. Depuis 2010, près de 500 millions d’euros ont été engagés par l’ADEME dans ce domaine, à la fois en amont, sur des projets de développement de briques technologiques, de démonstrateurs unitaires et aujourd’hui de fermes pilotes pré-commerciales permettant d’amener à maturité les technologies de l’éolien flottant (quatre projets de ce type ont été décidés) et de l’hydrolien. Dans le cadre de l’Institut de la transition énergétique, France énergie marine lance par ailleurs depuis 2015, avec l’ANR, des cycles d’appel à projets de recherche.
Les investissements d’avenir sont également beaucoup intervenus sur le thème des réseaux intelligents, pour lequel la France est bien placée au regard des comparaisons internationales. Des soutiens ont ainsi été accordés par l’ADEME au niveau des démonstrateurs, à hauteur de plus de 100 millions d’euros. L’État a par ailleurs sélectionné des régions pilotes, avec des projets en PACA (Flexgrid), en Bretagne – Pays de Loire (Smile) et dans les Hauts-de-France, l’idée étant de passer à un stade supérieur dans le développement et la démonstration des solutions de flexibilité des systèmes énergétiques électriques et gaz. Au-delà de la production et de l’aspect réseaux et stockage d’énergie, il convient également de considérer l’efficacité énergétique au sens large, avec de nombreux projets en matière de nouvelles méthodes d’isolation des bâtiments, de récupération de chaleur perdue dans l’industrie. Il s’agit là à mon sens d’un volet à poursuivre dans nos stratégies.
Du point de vue organisationnel, la création des alliances de coordination de la recherche a constitué un élément fort. ANCRE, créée en 2009 pour l’énergie, a ainsi apporté une contribution précieuse à nos travaux.
Enfin, la démarche de contractualisation avec les établissements de recherche se structure au travers des contrats d’objectifs et de performance, les COP. Ceci permet de piloter le travail des organismes de façon précise et transparente, en cohérence avec les objectifs de long terme de la loi. Les COP du CEA et de l’IFPEN, mis à jour récemment ou en voie de l’être, prennent ainsi pleinement en compte les enjeux de la transition énergétique.
Je terminerai en évoquant les orientations stratégiques de la SNRE, qui englobent la définition de priorités thématiques et le renforcement de la démarche de coordination des acteurs. L’accent est mis sur une vision globale des systèmes énergétiques et des flexibilités à développer, par exemple pour l’intégration des énergies renouvelables et des véhicules électriques. La stratégie préconise ainsi le développement et la comparaison des différents moyens de flexibilité (maîtrise de la demande et des moyens de production, stockage, couplage des réseaux et vecteurs), mais aussi une prise en compte forte du numérique dans la définition des feuilles de route des filières.
Le deuxième volet transverse concerne une prise en considération renforcée des exigences environnementales, avec un développement en amont des technologies, des analyses du cycle de vie et une démarche plus systématique d’économie circulaire appliquée à l’ensemble des filières énergétiques, pour mieux en maîtriser les impacts. Dans ce cadre, le développement des matériaux biosourcés et des solutions de réduction de l’utilisation du carbone d’origine fossile ou des matériaux stratégiques apparaît comme une priorité.
L’accent est également mis sur l’intégration d’une vision économique et sociale, dès les phases amont de la R&D, pour anticiper les besoins des consommateurs, accompagner la décentralisation des systèmes énergétiques et développer les nouveaux modèles économiques et de gouvernance.
La SNRE marque par ailleurs l’importance de la constitution d’une communauté de recherche énergétique et sa contribution à la formation des professionnels, des décideurs et du public, pour éclairer les débats et choix de société.
Je conclurai en indiquant que la SNRE n’est, au niveau des ministères, qu’un point de départ d’un travail de mise en œuvre à mener avec le comité de suivi, pour envisager les actions à entreprendre et effectuer une évaluation glissante jusqu’au terme des cinq années, où la Stratégie devra être révisée. J’ajoute que cette démarche de mise en œuvre s’accompagnera d’un travail de partage des priorités des actions et évaluations avec les conseils régionaux, dont l’action de soutien à la R&D se développe fortement, notamment dans le domaine de l’énergie. Les régions s’impliquent par exemple dans le développement des réseaux intelligents ou de l’énergie marine. Cet aspect doit être pris en compte, en associant les niveaux régionaux de l’État et en favorisant les échanges entre les ministères et les régions, afin que chacun ait parfaitement connaissance des actions menées par les autres.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci pour cet exposé très complet, qui a balayé l’ensemble de la démarche mise en œuvre.
Vous avez évoqué la création d’un comité de suivi, auquel aucun parlementaire n’est associé, contrairement à la Stratégie nationale de la recherche. Je vous suggèrerais donc d’y remédier.
M. Laurent Michel. Étaient à l’origine invités à participer à ce comité les parlementaires membres du Conseil national de la transition énergétique. J’ajoute que la composition du comité de pilotage n’est définie ni par une loi, ni par un décret ; nous pouvons donc parfaitement y accueillir toute personne désireuse d’y contribuer. Si les assemblées ou l’OPECST souhaitent y être représentés, je pense que cela est tout à fait envisageable, l’objectif de ce dispositif étant d’être le plus ouvert possible.
M. Jean-Yves Le Déaut. Dans le cas du Conseil supérieur de la recherche, un décret prévoit la présence d’un membre de l’Assemblée nationale et d’un membre du Sénat nommés par l’OPECST, ainsi que d’un représentant de l’ARF. En l’absence de décret, nous acceptons très volontiers de proposer un parlementaire qui pourra assister à vos travaux : Mme Anne-Yvonne Le Dain me semble toute désignée.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il est agréable de constater qu’une question peut ici trouver immédiatement une réponse adaptée. Je vous en remercie.
La parole est à présent à M. Sébastien Balibar, physicien de renommée internationale, spécialiste des changements d’état de la matière, ce qui, pour les questions énergétiques, est essentiel. Directeur de recherches au CNRS et membre de l’Académie des sciences, il est l’auteur d’un nombre considérable d’articles scientifiques et de plusieurs ouvrages sur des sujets aussi divers que l’atome, la lutte contre le changement climatique ou encore le processus de découverte scientifique. Nous souhaiterions, Monsieur, que vous nous fassiez part de votre point de vue sur la nouvelle Stratégie nationale de recherche en énergie.
M. Sébastien Balibar, directeur de recherches au CNRS, membre de l’Académie des sciences. Monsieur le président, Madame et Monsieur les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, merci infiniment de me donner la parole.
J’ai choisi, dans le temps relativement court qui m’est imparti, de formuler quelques commentaires essentiellement sur la loi sur la transition énergétique de 2015. Je crois que les objectifs visés dans ce texte sont les bons, mais je vais tenter de vous expliquer pourquoi les méthodes choisies pour les atteindre sont à mon sens contestables.
Les objectifs sont bons parce qu’ils sont cohérents avec les recommandations des climatologues du GIEC, qui se sont demandé, face à un réchauffement climatique en train de diverger, ce qu’il conviendrait de faire pour au moins stabiliser le climat avant la fin 2100. Ils ont pour ce faire élaboré plusieurs scénarios. Celui qui permet de stabiliser le climat après 2100 se caractérise par la suppression de toute augmentation nette des émissions de CO2 dans l’atmosphère en 2070, à la suite de quoi il faudrait qu’elles deviennent négatives, c’est-à-dire que l’on capture plus que l’on n’émet. Une étape intermédiaire consisterait, à l’horizon 2050, à abaisser la moyenne des émissions de CO2 par habitant dans le monde, actuellement de l’ordre de 4,5 tonnes par an, à environ 1,5 tonne. La France est proche de la moyenne mondiale. Viser des émissions de l’ordre de 1,5 tonne en 2050 correspond donc au facteur trois ou quatre dont il a déjà été question à plusieurs reprises. Si l’on ne prend pas de mesures urgentes, le climat va continuer à diverger et le réchauffement climatique intensifier encore les extrêmes. Ceci est déjà perceptible en France : la différence de pluviométrie dans le sud et le nord du pays et les problèmes qu’a rencontrés l’agriculture française cet été en sont une illustration typique.
Si ces objectifs me paraissent donc tout à fait cohérents, le scénario adopté en France me semble contestable, pour diverses raisons parmi lesquelles celles que je vais développer. Le scénario propose tout d’abord une réduction de la consommation totale d’énergie de 50 % en 2050. Si l’on tient compte d’une augmentation de la population d’environ 15 % en 35 ans, ceci reviendrait à diviser par trois la consommation d’énergie par personne. Je crois que nous aurons beau effectuer des économies d’énergie, par ailleurs indispensables, et isoler tous les bâtiments anciens, ce ne sera pas suffisant. La loi prévoit ainsi de rénover 500 000 logements par an, ce qui est très bien, mais coûte extrêmement cher, de l’ordre de 20 000 à 30 000 euros par logement en moyenne, soit 10 à 15 milliards d’euros par an, si bien que seuls 120 000 logements sont isolés chaque année. Il faudrait certainement augmenter les possibilités de prêts à long terme et très bas taux, comme cela existe en Allemagne, où 200 000 à 300 000 logements sont isolés chaque année sur les 700 000 qui devraient l’être. On pourra également développer les transports en commun, en les électrifiant, tenter d’inventer des processus industriels plus efficaces ; mais tous ces éléments ajoutés ne me semblent pas suffisants pour diviser par trois l’énergie consommée par personne, objectif qui m’apparaît quelque peu irréaliste.
Comment atteindre ce facteur 3 dans la diminution de la consommation d’énergie ? La loi prévoit de réduire la part du nucléaire à 50 % du mix électrique dès 2025 et d’augmenter, en une sorte de mécanisme de compensation, la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation d’énergie en 2030, ce qui représenterait alors 40 % de l’électricité. Comme vous le savez, le terme « énergies renouvelables » englobe divers éléments. L’hydroélectrique, absolument admirable et indispensable, représentant actuellement en France environ 11 % du mix électrique, il faudrait que le différentiel de 29 % soit comblé par d’autres énergies renouvelables, presque toutes intermittentes puisqu’il s’agit de l’éolien, du photovoltaïque et éventuellement du biogaz. Lorsque l’on implante des parcs d’éoliennes en mer ou sur terre ou que l’on installe des fermes de panneaux photovoltaïques, cela est très loin de fonctionner de façon continue et peu pilotable comparé aux barrages hydroélectriques, aux centrales à charbon ou aux installations nucléaires dans une large mesure. En effet, le photovoltaïque ne fonctionne pas la nuit, ni lorsque la couverture nuageuse est dense ou le temps pluvieux. Quant aux éoliennes, elles ont besoin d’une vitesse de vent très particulière pour fonctionner correctement : lorsque le vent est trop fort, il faut les arrêter pour qu’elles ne s’envolent pas, et quand il est trop faible, elles ne tournent pas. Il est très difficile de pallier l’intermittence de ces énergies renouvelables, y compris aujourd’hui dans un pays comme la France, qui compte seulement 4 % d’éolien et 1,5 % de photovoltaïque. On imagine aisément les difficultés rencontrées si ces énergies représentaient 29 % du mix électrique, sans parler d’aller jusqu’aux 100 % d’un pseudo scénario, que je qualifierais plutôt de calcul hypothétique totalement irréaliste, imaginé par l’ADEME.
Comment procède l’Allemagne ? Ce pays possédait déjà, en 2015, 12,3 % d’éolien et 6 % de photovoltaïque. Pour répondre à l’intermittence d’une énergie dont la part, bien qu’éloignée des seuils envisagés dans certains scénarios, est déjà considérable, l’Allemagne, qui ne possède pas de barrage, éprouve de grandes difficultés à stocker l’électricité : elle paie donc la Suisse, à des moments où le prix de l’électricité devient négatif (soit environ trois semaines par an), pour que celle-ci accepte de remonter l’électricité, dans des barrages hydroélectriques spéciaux appelés « stations de pompage », pour ensuite la turbiner quand la demande devient forte. Ainsi, la Suisse se fait payer une première fois pour consommer, une deuxième pour fournir. La Norvège procède de façon similaire et bénéficie elle aussi de la présence sur son territoire de nombreux sites permettant d’implanter de telles stations de pompage.
Mais cela ne suffit toujours pas et l’Allemagne importe aussi de l’électricité nucléaire de France. Elle a également construit sur son sol de très nombreuses centrales à lignite, dont elle est le premier producteur mondial. Il découle de ceci que les émissions de CO2 de l’Allemagne ne diminuent pas et sont plus de deux fois supérieures à celles de la France par personne. Pour produire un kilowattheure en France, on émet 73 grammes de CO2, contre 30 grammes en Suède et 460 grammes en Allemagne, ce qui, bien que faible face à la situation de la Pologne, du Qatar ou du Wyoming aux États-Unis, montre bien qu’il existe un problème très grave vis-à-vis des énergies renouvelables, dont on omet souvent de souligner qu’elles sont intermittentes.
Bien évidemment, il faut faire davantage de recherche, en particulier dans le domaine de la technologie des batteries, où les progrès sont considérables actuellement. Cela pose toutefois des problèmes de coût et de ressources, dans le cas notamment du cobalt pour les batteries lithium-ion.
Les énergies renouvelables se caractérisent en outre par les difficultés de stockage qu’elles supposent et sur lesquelles il faut travailler en profondeur.
Il a été fait allusion aux réseaux intelligents : quand je vois la somme totale des productions des éoliennes dans toute l’Europe, qui fluctue en permanence entre zéro et 40 % maximum de la valeur nominale, c’est-à-dire de la puissance installée, j’en déduis que l’on aura beau couvrir toute l’Europe de réseaux de câbles électriques, on ne parviendra pas à aller au-delà de la somme de l’énergie produite un peu partout et que le problème de l’intermittence demeurera. Rendre les compteurs électriques intelligents peut permettre d’améliorer un tant soit peu la situation, mais il ne faut pas, à mon avis, espérer de solution miracle des réseaux intelligents.
Pourquoi ce facteur trois dans la consommation d’énergie ? Je crois qu’il existe une sorte d’amalgame entre la lutte contre le réchauffement climatique et le combat anti-nucléaire mené par certaines organisations politiques, qui ne repose pas selon moi sur des analyses suffisamment rigoureuses.
Je voudrais terminer en évoquant le nucléaire, qui a une place centrale en France et nous permet de moins polluer, en termes d’émissions de CO2, que d’autres pays. Beaucoup de gens considèrent toutefois que le coût du nucléaire est devenu prohibitif, ce que je ne crois pas vrai. En effet, les subventions allouées actuellement aux énergies renouvelables intermittentes (qui augmentent au rythme d’un milliard d’euros par an, ont atteint 7 milliards pour l’année 2016, seront de l’ordre de 40 milliards d’euros de 2012 à 2020 et que nous payons tous dans nos factures d’électricité sous la forme de la CSPE) sont d’un montant bien supérieur non seulement au coût, réparti sur plusieurs années, de l’EPR de Flamanville (qui va produire beaucoup plus de valeur d’électricité en soixante ans de fonctionnement), mais aussi à celui du grand carénage (qui coûtera entre 50 et 100 milliards d’euros sur quinze ans), et à celui de l’enfouissement des déchets testé et approuvé grâce à l’admirable loi Bataille (qui représente une trentaine de milliards d’euros sur 140 ans). L’Allemagne a quant à elle dépensé 300 milliards d’euros pour développer les énergies renouvelables intermittentes, en faisant payer les consommateurs, puisque le prix du kilowattheure y est deux fois plus élevé qu’en France. Tout cela me paraît contestable.
J’aurais enfin aimé mentionner la sûreté de nos réacteurs, qui est à mon avis admirable, grâce à l’Autorité de sûreté nucléaire qui remplit excellemment sa mission.
Pour conclure sur certains aspects de la recherche en matière nucléaire, je crois qu’il faut tout de suite lancer la construction du réacteur expérimental ASTRID, qui représente l’avenir, car il règlera le problème des déchets et celui du combustible nucléaire. Quant à ITER et à la fusion, je pense qu’il n’est pas nécessaire de l’évoquer, dans la mesure où cela ne fonctionnera pas avant au moins le siècle prochain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie beaucoup pour les chiffres que vous venez de nous communiquer et les éléments extrêmement concrets que vous avez développés.
M. Laurent Michel, qui a dû s’absenter, vient de me transmettre une note relative aux rénovations de logements, dans laquelle il indique que les prévisions sont effectivement à 500 000, mais que les réalisations effectives sont bien supérieures aux 120 000 que vous venez d’évoquer et se situent autour de 250 000 par an dans le privé et de 100 000 à 120 000 dans le secteur du logement social, soit un total de 350 000 à 370 000 par an.
M. Sébastien Balibar. Voici une excellente nouvelle. Mes chiffres datent de quelques années et je me réjouis que des progrès aient été accomplis dans ce domaine.
M. Jean-Yves Le Déaut. J’ajoute qu’il y a 12 millions de logements actuellement en France dont les propriétaires n’ont absolument aucun moyen de faire la moindre rénovation. Ceci signifie que si l’on ne trouve pas de solutions originales pour financer ces travaux, on ne parviendra pas à une efficacité énergétique suffisante. Même si l’on rénovait 400 000 de ces logements par an, il faudrait trente ans avant de les avoir tous améliorés.
Dans notre rapport sur les freins à la rénovation thermique des bâtiments, publié voici deux ans, nous avons proposé une solution sans doute trop simple pour être mise en œuvre : il s’agissait du prêt viager hypothécaire, qui offrirait la possibilité, à un moment donné, soit par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, soit par le truchement des pouvoirs publics, d’avancer le prix des travaux sur un programme, et au moment de la mutation du bien, que la personne rembourse si elle est solvable ou que cette somme d’argent soit récupérée dans le cas contraire.
M. Sébastien Balibar. Il est dommage que cette solution ne soit pas mise en œuvre, car elle me paraît très adaptée aux problèmes graves auxquels nous faisons face. En citant ces chiffres, qui viennent d’être actualisés, je voulais démontrer que, même en effectuant cette rénovation, on ne divisera pas par trois la consommation d’énergie par personne. Peut-être aboutira-t-on à une économie de 20 ou 30 % si l’on y ajoute les transports, mais il est irréaliste de penser atteindre 66 %.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci pour cette contribution, qui va ouvrir le débat.
Nous allons à présent entendre l’intervention de M. Christian Ngô, directeur du laboratoire d’idées Edmonium Conseil, précédemment conseiller de l’administrateur général du CEA, directeur scientifique de la Direction de la recherche technologique et directeur délégué à la prospective, puis directeur scientifique au cabinet du Haut-commissaire à l’énergie atomique. Il a également contribué, en tant que membre de nombreux comités de pilotage, à plusieurs rapports de l’OPECST, dont celui de 2009 relatif à l’évaluation de la précédente Stratégie de recherche en énergie. Il va revenir sur les évolutions intervenues depuis la publication de ce rapport et en déduire des perspectives quant à celles qui pourraient survenir après la promulgation de la nouvelle SNRE.
M. Christian Ngô, Edmonium Conseil. Merci, Madame la présidente. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vais essayer, au fil de cet exposé, de me tourner vers l’avenir et d’énoncer quelques idées.
L’innovation en énergie est un élément important, qui conduit au progrès. Si la recherche mène à l’innovation, l’innovation ne saurait se réduire à la recherche. Elle peut en effet provenir d’une synthèse du meilleur état des connaissances. Se tourner vers l’avenir et essayer d’imaginer la situation en 2035, dans 18 ans donc, suppose ainsi de bien considérer la situation telle qu’elle était il y a 18 ans, c’est-à-dire en 1999. On constate ce faisant que la vie n’a guère évolué entre 2000 et 2017 ; sauf accident de parcours, il y a tout lieu de penser que 2035 sera une extrapolation de la situation d’aujourd’hui.
Depuis le choc pétrolier, on essaie de réduire la consommation de combustibles fossiles au niveau mondial. Les données chiffrées sont intéressantes : en 1973, près de 87 % de l’énergie primaire utilisée était constituée de combustibles fossiles, soit environ 5 milliards de tonnes équivalent pétrole. 44 ans plus tard, en 2014, ce chiffre a atteint péniblement 81 %, alors même que des programmes prioritaires avaient été mis en œuvre pour essayer de sortir des combustibles fossiles. Si l’on considère parallèlement le développement des énergies renouvelables autres que l’hydroélectricité, qui est la meilleure énergie, et la biomasse, on s’aperçoit qu’elles représentaient 0,1 % en 1973 et seulement 1,4 % en 2014. On est donc encore très loin de pouvoir remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.
Le défi énergétique auquel est confrontée la planète comporte deux volets, auxquels un troisième s’ajoute en France. Il s’agit d’une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’autre part de limiter la consommation d’énergies fossiles et enfin, en France, de réduire le déficit commercial. En 2011 par exemple, ce déficit avoisinait les 70 milliards d’euros, dont plus de 61 milliards provenaient des énergies fossiles. La priorité est donc de diminuer nos importations de pétrole, gaz naturel et charbon. Le montant de ce déficit dépend largement du prix du baril de pétrole : il a ainsi un peu diminué les années passées, lorsque le prix du baril s’est effondré. Mais si ce prix repart à la hausse, le déficit fera de même.
Par rapport à l’évaluation de la précédente SNRE, une percée est survenue, que personne n’avait anticipée : il s’agit du développement, aux États-Unis, de l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste, avec des conséquences très importantes du point de vue économique, géopolitique, sociétal et environnemental au niveau des États-Unis. Cette exploitation est le fruit de la synthèse de deux innovations du passé, à savoir d’une part le forage horizontal (qui date des années 1970), d’autre part la fracturation hydraulique (développée en 1947 et utilisée jusqu’alors pour exploiter des puits de pétrole conventionnels et dans le domaine de la géothermie). Cette évolution a considérablement modifié la donne, en déstabilisant la situation énergétique mondiale. Les États-Unis deviennent par exemple de plus en plus autosuffisants, au niveau du gaz notamment, et s’impliquent de moins en moins au Moyen-Orient. Ils disposent en outre de plus en plus de charbon, qu’ils exportent en Europe, créant ainsi le risque d’une augmentation de la pollution.
Le vrai point faible de la filière énergétique est le stockage. Si l’on savait stocker l’énergie comme les agriculteurs le font avec les céréales, on aurait besoin de beaucoup moins de moyens de production. On va assister dans les années à venir à un développement de plus en plus important des véhicules à motorisation électrique : ceci est basé essentiellement aujourd’hui sur des batteries lithium-ion, demain peut-être sur des batteries sodium-ion, voire dans un avenir plus lointain sur des batteries lithium-air, qui permettront d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 500, voire 1 000 km. Le problème principal, hormis le coût de la batterie, dont on peut espérer qu’il baisse dans le futur, réside dans le temps de recharge nécessaire. L’avantage des véhicules hybrides rechargeables est d’une part que la batterie coûte moins cher, d’autre part qu’ils sont adaptés autant aux courtes qu’aux longues distances. Ils peuvent également, au niveau du réseau, aider les énergies intermittentes.
Or, le vrai problème en termes de stockage actuellement concerne justement les énergies intermittentes. Le fait de ne pouvoir effectuer ce stockage conduit à démarrer des centrales à gaz ou à charbon, créant ainsi une augmentation des émissions de CO2. Cette situation est perceptible notamment en Allemagne où, malgré le développement des éoliennes et des panneaux solaires, les émissions de gaz carbonique s’accroissent chaque année, à cause des centrales thermiques. Ceci pousse à imaginer pour le futur, ainsi que le souligne François Lempérière depuis quelques années, le développement de STEPs (stations de transfert d’énergie par pompage) artificielles, mentionné notamment dans le dernier rapport SNRE. Ce type de stockage est très intéressant, mais nécessite de grandes quantités d’eau, puisqu’un kilowattheure correspond à 3,6 tonnes d’eau tombant de 100 mètres. Si la chute n’est que de 10 mètres, 36 tonnes d’eau sont nécessaires pour obtenir le même résultat.
Il convient en outre d’innover pour le démantèlement des centrales nucléaires. La solution privilégiée actuellement consiste à enlever le cœur, très radioactif, et à scinder le reste en petits morceaux, dont on ne sait que faire car personne n’en veut. Le plus simple serait le démantèlement in situ, dans lequel, après avoir évacué le cœur, on coule du béton sur les éléments restants, faiblement radioactifs. L’avantage de cette option est sa rapidité de mise en œuvre, puisqu’elle peut intervenir immédiatement après la fermeture de la centrale. Elle présente également l’atout de ne créer aucune pollution, dans la mesure où l’on ne découpe pas les éléments restants en morceaux, et bénéficie d’une meilleure acceptabilité sociale, puisque les populations locales sont déjà habituées à la présence d’un réacteur. Cette solution est enfin beaucoup moins coûteuse que la précédente, de l’ordre de 4 milliards d’euros, contre 40 milliards pour l’autre option.
L’un des autres éléments majeurs sur lesquels il faudra selon moi innover concerne l’acceptabilité sociale. Actuellement, la plupart des problèmes sur lesquels buttent les pays occidentaux concernent cet aspect. Ceci est tout à fait compréhensible : si une personne souhaite acheter ou louer un appartement dans un immeuble, il est évident qu’elle ne consentira pas à débourser la même somme si le bien se situe au rez-de-chaussée sur la rue ou au quatrième étage sur un parc. De même, si l’on construit une centrale électrique à un endroit donné, il est normal que les populations alentours ne paient pas l’électricité le même prix que celles vivant à plusieurs centaines de kilomètres, pour lesquelles le transport d’électricité va engendrer des frais et qui n’auront pas à subir les inconvénients liés à la présence de la centrale. Il faudra donc réfléchir à cette question de la péréquation tarifaire.
Il faut en outre savoir que lorsque des installations nucléaires, industrielles ou de déchets, sont implantées localement, des subventions sont souvent allouées aux collectivités locales, sans que les populations en bénéficient directement. Or, je trouverais normal qu’une partie de ces sommes (la moitié par exemple) soit affectée directement aux individus, sous des formes à définir (taxe d’habitation gratuite, revenu mensuel, etc). Développer ce genre d’approche rendrait les problèmes liés à l’acceptabilité sociale certainement beaucoup plus simples à résoudre.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans un livre que je viens de publier avec François Lempérière et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de ma société.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie, M. Ngô, de nous avoir présenté ces perspectives de recherche et d’avoir effectué ce retour sur le passé, qui démontre que l’innovation peut survenir même là où les rapporteurs de l’OPECST ne l’attendaient pas…
En conclusion de cette première table ronde et pour faire la transition avec la suivante, nous accueillons M. Pierre Valla, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, deuxième ministère à l’origine de la Stratégie nationale de la recherche en énergie.
M. Pierre Valla, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vais revenir sur les modalités d’élaboration d’une part de la Stratégie nationale de recherche, d’autre part de la Stratégie nationale de recherche pour l’énergie, afin de mettre en lumière la cohérence existant entre les deux exercices dont les finalités, pour être différentes, n’en sont pas moins complémentaires.
Sans revenir sur le cadre législatif, rappelé en introduction par le président Le Déaut, je rappellerai que la Stratégie nationale de recherche en énergie est placée sous le co-pilotage des deux ministères en charge de l’énergie d’une part, de la recherche d’autre part. Il s’agit en l’occurrence du deuxième exercice, le premier se plaçant déjà dans le cadre d’une collaboration entre nos deux ministères.
La Stratégie nationale de recherche constitue également un élément dans le pilotage duquel le ministère de la recherche a souhaité introduire le maximum d’interministérialité. Ainsi, à côté du Conseil stratégique de la recherche, dont la composition est fixée par décret, avec notamment des scientifiques, des représentants de l’industrie, des parlementaires, nous avons mis en place un comité opérationnel, qui est de fait un comité de pilotage de l’élaboration et du suivi de la SNR et dans lequel l’ensemble des ministères concernés sont représentés.
La SNR a été élaborée, comme vous le savez certainement, sur la base de dix défis sociétaux (dont un centré sur la thématique de l’énergie), autour desquels le travail s’est structuré. L’atelier « énergie » a présenté la particularité d’être co-piloté par les deux directions générales (DGEC et DGRI), ce qui en fait un exemple d’interministérialité renforcée. Là encore, la plupart des membres ayant travaillé dans le cadre de cet atelier font partie du comité de suivi de la SNRE, ce qui constitue une façon d’organiser la cohérence entre les deux exercices. Les documents préparatoires mentionnés par Laurent Michel et réalisés par l’alliance ANCRE, représentée ici par son président, et par l’ADEME, sont bien évidemment au cœur de l’élaboration de la SNRE, mais également des travaux relatifs au défi « énergie » de la Stratégie nationale de recherche.
On constate donc un enrichissement mutuel entre les deux exercices, construits avec la participation d’acteurs identiques et fondé sur un état des lieux des connaissances, avec une identification des verrous technologiques et non technologiques pour les différentes filières de production d’énergie, ainsi que pour les filières de gestion et d’usage de ces énergies.
On peut mettre en exergue le fait que les travaux de cet atelier « énergie » de la SNR, menés en 2014, ont nourri l’élaboration de la SNRE qui vient d’être publiée. Outre les contributions des Alliances et du CNRS, on peut souligner le fait que certains thèmes mis en évidence dans ces ateliers se retrouvent assez directement dans la SNRE : citons notamment : l’idée selon laquelle la problématique de l’énergie invite à une approche système nécessitant de jouer la complémentarité entre les filières ; un cadre de stabilité suffisant pour les programmes de recherche, en vue d’une intégration cohérente sur le long terme ; l’importance d’une recherche fondamentale de haut niveau, dont l’apport est critique pour l’émergence de concepts en rupture ; le fait que c’est à l’aune des perspectives du marché et de la concurrence internationale que les priorités sectorielles en matière de R&D doivent être définies ; la valorisation du levier communautaire à l’échelle européenne, indispensable pour se maintenir parmi les grandes nations en matière de R&D ; l’évolution des politiques publiques à différents échelons (local, national, international), avec l’émergence de nouveaux acteurs et modes de gouvernance pour l’environnement local ou encore l’importance de démonstrateurs à l’échelle des territoires ; et enfin la nécessaire pris een compte de la transition numérique dans la transition énergétique.
J’ai déjà mentionné le fait que la contribution de l’alliance ANCRE, tout à fait conséquente en la matière, mettait en lumière deux priorités qui se retrouvent dans les orientations stratégiques de la SNRE, à savoir l’accélération des efforts de R&D sur les invariants des scénarios de transition énergétique et la nécessaire capitalisation sur les atouts compétitifs des filières actuellement majoritaires dans le bouquet énergétique national et des industries qui contribuent à la sécurité énergétique.
Au niveau de la Stratégie nationale de recherche, le travail conduit a permis de dégager cinq orientations stratégiques, qui sont la gestion dynamique des systèmes énergétiques, la gouvernance multiéchelles des nouveaux systèmes, l’efficacité énergétique, la réduction de la dépendance en matériaux stratégiques et les substituts au carbone fossile pour l’énergie et la chimie. Nous avons cherché, dans cet exercice de Stratégie nationale couvrant un ensemble large de défis sociétaux, à retenir un nombre limité d’orientations stratégiques par défi, afin de pouvoir focaliser et orienter les développements nouveaux et la constitution d’équipes sur les sujets paraissant encore insuffisamment traités. Il ne s’agissait pas en l’occurrence de traiter de façon globale l’ensemble des sujets sur lesquels il convenait que la recherche publique française travaille, mais de mettre en exergue les thématiques sur lesquelles un effort plus important, une attention particulière devaient être portés. Cela a conduit également, pour focaliser encore davantage les priorités d’évolution, à identifier un certain nombre de grands défis sur lesquels des outils spécifiques devaient être développés. Cinq programmes d’action ont ainsi été définis : le Big Data, le système Terre (avec des aspects d’observation, de prévision, d’adaptation), la biologie des systèmes et applications, le passage du laboratoire aux patients et enfin homme et culture (sur l’évolution de nos sociétés).
On pourrait se demander pourquoi aucun sujet énergie ne figure dans cette liste. Je note que les enjeux de recherche sur l’énergie sont identifiés depuis un certain temps et que la focalisation des équipes, tout comme la réorientation des travaux, a déjà été faite. Il s’agit à présent de poursuivre et de travailler en profondeur. Le fait que le travail stratégique complémentaire que représente la Stratégie nationale de recherche en énergie soit prévu a peut-être également joué, dans la mesure où cette SNRE apportait la garantie qu’une focalisation serait effectuée sur ce sujet. Il existe en outre déjà de grands dispositifs à l’œuvre dans le domaine énergétique au niveau français, européen et international, qui structurent en profondeur la recherche sur l’énergie.
En conclusion, je soulignerais que le travail au cœur des deux exercices suit une démarche analytique. En cela, nous rejoignons, me semble-t-il, l’une des recommandations de l’OPECST sur la façon de mener une action stratégique. Dans le cadre de la SNR, un focus a été fait sur les enjeux de rupture ; pour ce qui est de la SNRE, l’objectif a plutôt été la recherche d’une vision globale, argumentée, sur l’ensemble des aspects de la recherche pour les applications énergétiques.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous allons à présent ouvrir le débat.
M. Pierre Médevielle, sénateur. Je souhaiterais intervenir sur la question, évoquée par M. Ngô, des véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Le virage semble avoir été pris par de nombreux constructeurs. PSA va ainsi présenter ses gammes en 2019. Que peut-on espérer réellement de ces techniques, en termes de délai, dans l’optique de disposer de batteries plus performantes ? Aujourd’hui, l’hybride rechargeable relève presque du gadget, avec des autonomies assez faibles, de l’ordre de 30 à 40 kilomètres pour la plupart des véhicules.
M. Christian Ngô. Je regrette que les constructeurs français ne se soient pas lancés plus tôt dans les véhicules hybrides, l’électrique m’apparaissant comme un marché de niche. Concernant l’autonomie de 40 à 60 kilomètres des hybrides rechargeables, il faut savoir que la plupart des gens parcourent dans la journée, pour se rendre à leur travail ou aller faire leurs courses, une distance inférieure à celle-ci. Ceci signifie par conséquent qu’ils pourraient rouler toute l’année à l’électrique, sauf peut-être pour partir en vacances ou accomplir de plus longs trajets. En moyenne sur l’année, on arriverait ainsi à environ 1 litre d’essence aux 100 kilomètres.
Pourquoi est-ce plus intéressant qu’un véhicule électrique pur ? Un véhicule hybride rechargeable peut permettre de parcourir mille kilomètres, puisque lorsque la batterie est épuisée, le trajet peut se poursuivre en mode hybride : on va donc économiser de l’essence. Un véhicule électrique pur nécessite environ 20 à 25 kWh d’énergie, ce qui correspond à un coût compris entre 10 000 et 15 000 euros ; avec une batterie de plus faible capacité, le coût sera beaucoup moins élevé. L’avantage du véhicule hybride par rapport à l’électrique est qu’il comporte plus de valeur ajoutée en termes de main- d’œuvre sur le territoire national. Un moteur électrique nécessite par ailleurs des terres rares, qu’il faut importer de Chine, avec les coûts que cela suppose.
Le véhicule hybride rechargeable est, selon moi, la solution pour les décennies qui s’annoncent. Il est d’autant plus important pour un industriel de maîtriser cela que l’avenir réside peut-être dans la pile à combustibles, avec l’hydrogène. Or, une voiture à hydrogène équipée uniquement d’une pile à combustibles n’aurait pas de reprise : il faudrait que ce soit un véhicule hybride, avec d’une part la pile à combustibles à la place du moteur à explosion, d’autre part un moteur électrique et une batterie pour les accélérations. Si l’on ne maîtrise pas le véhicule hybride maintenant, on part donc avec un handicap certain pour développer le véhicule à hydrogène. Le véhicule hybride m’apparaît ainsi comme une étape indispensable. Toute la difficulté réside, en ce domaine, dans l’électronique de puissance.
M. Sébastien Balibar. J’ai un point de vue un peu différent. L’un de mes amis, qui possède une Toyota Prius, m’a expliqué que, dans la mesure où la batterie était rechargée par le moteur à essence, cela ne représentait pas d’économies considérables. Personnellement, je crois davantage, surtout dans l’avenir immédiat, au tout électrique, en visant non pas les longues distances, pour lesquelles il vaudrait mieux, si possible, prendre un train électrique puis louer une petite voiture électrique à l’arrivée, mais plutôt le transport quotidien, par exemple celui des banlieusards qui ne disposent pas de tramway ou de bus électriques à disposition. L’idéal est donc de développer de petites voitures électriques et non pas les voitures Tesla de M. Elon Musk en Californie, dont l’idée de créer des Ferrari électriques est une utopie terrible. Je privilégierais pour ma part la petite Zoé de Renault ou son équivalent chez Nissan ou d’autres constructeurs, qui sont complètement électriques, bénéficient d’une autonomie de 100 ou 200 kilomètres, ce qui permet parfaitement d’effectuer la plupart des trajets quotidiens, et que l’on peut recharger la nuit dans son garage. Ce dernier point pose malgré tout un problème pour les gens qui habitent dans des immeubles ; il faudrait veiller à aménager cela.
Je pense en résumé que privilégier le développement de petites voitures électriques permettrait déjà d’effectuer un progrès absolument considérable en matière d’émissions de CO2.
M. Pierre Médevielle. Les véhicules hybrides représentent tout de même environ un tiers du parc des taxis parisiens. Il doit bien y avoir une raison à cela.
M. Sébastien Balibar. Il s’agit d’un effet de publicité commerciale.
M. Christian Ngô. Je possède depuis douze ans une Toyota Prius, avec laquelle j’ai parcouru plus de 200 000 kilomètres. En termes d’économies, je puis vous dire que lorsque je roule dans Paris l’été, avec la climatisation, je ne consomme pas plus de 5 litres aux 100 kilomètres. Je consomme davantage l’hiver, de l’ordre de 6,5 litres aux 100 kilomètres, puisqu’il faut chauffer la voiture et que la pompe à chaleur a un rendement pratiquement nul lorsque la température extérieure est inférieure à zéro degré. Certains taxis parisiens viennent de dépasser le million de kilomètres, en faisant les entretiens réguliers nécessaires.
Auparavant, je possédais une voiture classique : dans Paris, je consomme désormais 30 à 40 % de moins. Je suis très satisfait des voitures hybrides et n’achète désormais plus que ce type de modèle. Le véhicule électrique implique quasiment de posséder deux voitures : votre solution consistant à louer une voiture pour l’été me semble difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où tout le monde part en vacances en même temps. Nous ne disposerons jamais d’un parc suffisant pour fournir des véhicules à tous.
M. Sébastien Balibar. Une consommation de cinq ou six litres aux cent kilomètres est certes plus faible que celle d’une voiture classique, mais encore excessive si l’on vise zéro. Si le critère est celui-ci, certaines voitures à essence ne consomment que deux litres. Il faut être ambitieux et développer des voitures entièrement électriques, avec de l’électricité propre, donc probablement nucléaire en France.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ces échanges prouvent qu’il y a encore des travaux de recherche à mener, notamment sur les équilibres en kilowattheures de tous ces véhicules et les comparaisons avec les différents transports en commun, et montrent l’importance de cette évaluation de la Stratégie nationale de recherche en énergie.
Mme Catherine Génisson, sénatrice. Imaginez, au regard de ces échanges, combien la décision politique est difficile à prendre.
M. Franck Montaugé, sénateur. Je souhaiterais aborder deux points technologiques, à savoir la sustentation magnétique et les systèmes sur coussin d’air, ces deux sujets concernant les transports à moyenne, longue distance ou intramétropolitains. Des pays se sont lancés dans le développement de ces technologies, encore au stade de recherche et de mise au point. Je pense en particulier au système SkyTran, dans lequel est impliquée la NASA. Je crois que les Israéliens le testent aussi à Tel-Aviv. Hyperloop vient de s’installer sur l’ancienne base aérienne de Francazal. Il s’agit de technologies sur coussin d’air, pour des solutions technologiquement alternatives à ce que l’on connaît avec le TGV par exemple.
Mes questions sont les suivantes : quel intérêt à se lancer dans des technologies de ce type, qui sont en rupture avec un existant que la France développe par ailleurs avec succès ? Quelle articulation trouver entre les choix d’orientation à caractère privé faits sur ces technologies et les orientations nationales en la matière ? Je pense que l’on ne peut pas avancer sur des technologies de cette nature sans une collaboration étroite, à caractère politique et stratégique, entre le public et le privé. Quelle peut être la place du public, et en particulier des parlementaires, sur un sujet comme celui-ci ?
M. Philippe Nauche, député, vice-président de la commission de la défense. Il a été question précédemment de la question, très importante, des processus de stockage d’énergie. Nous avons bien compris que les STEPs étaient des dispositifs qui fonctionnaient, mais manquaient de mobilité. J’aimerais comprendre comment vous envisagez les avancées et le calendrier possible d’une amélioration des capacités de stockage pour toutes les énergies intermittentes. On parle beaucoup de l’hydrogène, mais ceci ne constitue pas, me semble-t-il, la seule voie de recherche. Quelles sont, selon vous, les perspectives dans ce domaine pour les dix ou quinze prochaines années ?
M. Christian Ngô. Il serait intéressant de développer des STEPs marines. On pourrait par exemple imaginer installer en Normandie, où il existe des falaises, des systèmes avec un petit lac en haut, qui permettraient de pomper l’eau de la mer avec l’électricité excédentaire et, en cas de besoin d’électricité, de la turbiner dans l’autre sens. D’autres solutions avaient été proposées par M. Lempérière : il s’agirait de construire des digues. Il faut savoir que pour qu’une STEP soit rentable, elle doit avoir la surface la plus grande possible. On peut donc ériger une digue à 20 ou 30 kilomètres au large de la côte, qui fera également office de brise lames en cas de tempête et créera une sorte d’énorme bassin dans lequel on pourra, lorsque l’on aura trop d’électricité, pomper l’eau, et en cas de besoin d’électricité, aux heures de pointe, turbiner vers la mer. Tout cela est techniquement possible et pas extrêmement coûteux (le surcoût engendré serait de l’ordre de 1 ou 2 centimes par kWh), mais pose le problème de l’acceptabilité sociale. Ceci permettrait d’apporter une solution aux énergies intermittentes. Le problème avec l’éolien par exemple réside dans le possible manque de vent. En termes de puissance installée, l’Allemagne a installé environ 70 GW d’éolien et la France 65 GW de nucléaire. On produit en France, avec le nucléaire, à peu près 450 TWh, alors que les Allemands produisent dans les 70 TWh d’électricité éolienne et pas forcément au moment où ils en ont besoin. Le problème des énergies intermittentes est là. Si l’on parvenait à résoudre la question du stockage, on pourrait construire autant d’éoliennes qu’on le souhaiterait, à condition toutefois de disposer des terres rares nécessaires.
M. Sébastien Balibar. Les trains sur coussin d’air permettent d’économiser le frottement des roues sur les rails ; or celui-ci est très faible. Il est bien d’avoir des idées, mais je serais très étonné que cela soit rentable. Il vaudrait mieux installer des rails conventionnels et y faire circuler des tramways électriques entre toutes les banlieues et tous les centres-villes par exemple ou d’améliorer le réseau de trains électriques classiques sur l’ensemble du territoire national.
Concernant les STEPs, il se trouve que j’ai rencontré récemment une personne d’EDF qui m’a expliqué que l’on avait environ 5 GW de puissance disponible dans les STEPs françaises, essentiellement grâce à celle du barrage de Grand’Maison, situé au-dessus de Bourg d’Oisans dans les Alpes et à quelques autres, plus petites. Apparemment, on pourrait en aménager à peu près autant, ce qui reviendrait à doubler les capacités de stockage en France. Il s’agit là, selon moi, d’une très bonne idée. Il serait très utile de subventionner EDF à cette fin.
A également été évoquée la possibilité de construire des lacs en haut des falaises : il me semble nécessaire d’avancer des chiffres à l’appui de telles propositions. Pour stocker des gigawattheures, il faudrait certainement couvrir toutes les falaises de piscines. Je crois que cela serait pire encore que le scénario à 100 % d’énergies renouvelables de l’ADEME, qui consisterait à installer, de mémoire, quelque 15 000 éoliennes en bord de mer, depuis Dunkerque jusqu’à Biarritz, et 50 000 à l’intérieur des terres. Ceci représenterait, sur le littoral Atlantique, une éolienne tous les deux kilomètres, sur trois rangées, ce qui ne me paraît pas sérieux. Quant aux 50 000 éoliennes installées à l’intérieur des terres, ceci reviendrait également, en supprimant les montagnes et les villes, à construire une éolienne tous les deux kilomètres. Ceci n’est pas plus réaliste que ce projet de construire des piscines en haut des falaises.
Quant à l’hydrogène, cela pose aussi des problèmes en termes de stockage. Pour assurer à une voiture à hydrogène une autonomie de cent kilomètres, il faudrait quatre kilogrammes d’hydrogène, ce qui représente vingt-trois mètres-cubes. Ce volume ne tenant pas dans une voiture, il faut pressuriser l’hydrogène à 700 atmosphères, ce qui est difficile. Ceci ne me paraît pas constituer une solution d’avenir pour les véhicules. En revanche, pour des installations fixes, industrielles par exemple, stocker l’hydrogène et en faire du méthane en le combinant avec le CO2 que l’on capturerait est une perspective très intéressante.
M. Philippe Boucly, vice-président de l’AFHYPAC (Association française pour l’hydrogène et les piles à combustibles), ancien directeur général de GRTgaz. Je souhaiterais évoquer la question du stockage de l’énergie par l’hydrogène. Je vous renvoie à une étude menée en 2012-2013 par GRTgaz avec des consultants, qui montrait, dans le cadre d’un scénario comprenant 70 000 MW d’éolien et 60 000 de solaire, avec des simulations effectuées sur une chronique de température d’une année donnée, que l’on arrivait à de l’énergie excédentaire. Nous avions considéré l’hypothèse que M. Balibar vient d’évoquer, c’est-à-dire 4 300 MW de STEPs disponibles, auxquels s’ajoutait un potentiel de 4 000 à 5 000 MW dont 2 000 accessibles à des coûts raisonnables. On arrivait, au terme des simulations, à 25 TWh disponibles pour transformation en hydrogène. Sur les 75 TWh disponibles au départ, on imagine en effet exporter vers les pays voisins, via les interconnexions des réseaux électriques. Une fois saturés tous les moyens disponibles, il resterait au final 25 TWh soit, compte tenu des rendements d’électrolyseurs, environ 20 TWh stockables. Cette énergie pourrait être utilisée pour produire de l’hydrogène industriel, pour la mobilité et être injectée dans les réseaux de gaz jusqu’à 6 % en volume, ce qui permettrait de stocker de grandes quantités d’hydrogène.
Concernant la mobilité, il faut savoir que l’on peut, avec 1 kilogramme d’hydrogène, parcourir 100 kilomètres environ. L’amélioration des rendements peut même faire envisager de descendre jusqu’à 0,8 kilogramme. Les réservoirs actuels permettent d’embarquer 5 kilogrammes d’hydrogène, soit une autonomie de l’ordre de 500 à 600 kilomètres.
DEUXIÈME TABLE RONDE : LES ORIENTATIONS MAJEURES DE LA SNRE, LEUR MISE EN ŒUVRE ET DÉCLINAISON INDUSTRIELLE
Présidence : Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée,
vice-présidente de l’OPECST
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cette deuxième table ronde est consacrée aux orientations majeures de la SNRE. Leur mise en œuvre dans le domaine de l’industrie sera finalement évoquée cet après-midi, en raison d’un changement dans l’ordre des intervenants.
Je vais, en introduction, donner la parole à M. Didier Houssin, président de l’Institut français du pétrole Énergies nouvelles, ainsi que de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie, dont la contribution à l’élaboration de la nouvelle Stratégie a été majeure, ainsi que cela a été souligné par plusieurs intervenants lors de la première table ronde. C’est justement sur cette contribution à l’élaboration puis à la mise en œuvre de la SNRE que portera son intervention.
M. Didier Houssin, président de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE). Merci, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous.
Je voudrais commencer ma brève présentation sur la contribution de l’ANCRE à l’élaboration de la SNRE en vous rappelant ce qu’est l’Alliance nationale pour la coordination de la recherche pour l’énergie. L’ANCRE, créée en 2009, rassemble aujourd’hui, aux côtés de ses quatre membres fondateurs (CEA, CNRS, Conférence des présidents d’université et IFP Énergies nouvelles), 19 organismes de recherche et d’innovation et conférences d’établissements supérieurs dans le domaine de l’énergie. Elle exerce ses missions en collaboration étroite avec les ministères compétents (recherche, énergie, industrie), les agences de financement et une quinzaine de pôles de compétitivité sur l’ensemble du territoire.
L’une des principales missions de l’ANCRE est de « contribuer à l’élaboration de la Stratégie nationale de recherche en matière d’énergie », thème qui nous réunit aujourd’hui. L’Alliance a donc été très impliquée, dès l’origine, dans l’élaboration de cette Stratégie nationale, avec notamment la présence de deux de ses représentants dans le secrétariat permanent de la SNRE et des quatre membres fondateurs dans son comité de suivi.
L’ANCRE a ainsi produit dans ce cadre un certain nombre de réflexions et documents préparatoires. En janvier 2016, nous avons actualisé seize fiches-filières, élaborées en 2012 en liaison avec l’ADEME, qui présentent un état des lieux factuel des différentes technologies et filières énergétiques, nouvelles en particulier, englobant l’état de l’art, les verrous technologiques à lever, la répartition des compétences et des acteurs et le potentiel de développement économique de ces différentes filières. En juin 2016, nous avons par ailleurs élaboré une réflexion portant d’une part sur les atouts et l’organisation d’une communauté nationale de recherche de haut niveau dans le domaine de l’énergie, d’autre part sur la formation des acteurs de la transition énergétique et la diffusion des connaissances.
S’agissant du nouveau texte de la SNRE, l’Alliance note avec intérêt que les cinq priorités thématiques qu’elle avait avancées en 2013 dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie nationale de recherche ont été largement prises en compte.
Je les rappelle brièvement.
En première lieu, il faut accélérer les efforts de R&D sur les invariants des scénarios de transition énergétique, grâce à un effort sans précédent de réduction de la consommation finale d’énergie et au développement d’une offre compétitive en matière d’énergies renouvelables, accompagnés d’une optimisation des systèmes énergétiques.
En deuxième lieu, il faut capitaliser sur les atouts compétitifs des filières actuellement majoritaires (et pour longtemps encore certainement) dans le bouquet énergétique, à savoir les hydrocarbures et le nucléaire.
En troisième lieu, il faut favoriser les révolutions technologiques susceptibles d’avoir un fort impact sur la transition énergétique, par exemple dans le domaine de la gestion de la chaleur ou du captage, du stockage et de la valorisation du carbone.
En quatrième lieu, il faut améliorer la compréhension des comportements et développer de nouveaux modèles de marché adaptés, dans un contexte de bouleversement profond de la scène énergétique, notamment en ce qui concerne le rôle des acteurs et l’évolution des chaînes de valeur.
En cinquième lieu, il faut favoriser l’émergence de concepts innovants pour l’énergie, en développant un socle de connaissances fondamentales au meilleur niveau mondial et en améliorant la dynamique du passage de la recherche fondamentale vers l’innovation technologique. Ce continuum entre l’amont et l’aval nous paraît absolument essentiel pour à la fois permettre l’émergence de technologies en rupture, indispensables à la transition énergétique, et poursuivre des améliorations incrémentales permettant d’accroître la compétitivité des nouvelles solutions.
Cette Stratégie nationale de recherche énergétique telle qu’elle est définie nous semble constituer un bon point de départ, mais sa mise en œuvre concrète nécessitera une impulsion forte des pouvoirs publics dans plusieurs domaines.
Face à la prolifération des stratégies nationales, il est tout d’abord important de les mettre en cohérence générale, autour de priorités clairement affichées par les pouvoirs publics, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, à savoir décideurs politiques, monde académique et de la recherche, industriels et société civile. Il est important d’associer les entreprises à cet exercice. Nous disposons en France d’entreprises de tout premier rang mondial dans le domaine de l’énergie, sur lesquelles nous devons nous appuyer pour assurer une mise en œuvre effective de la transition énergétique, avec un enjeu également en termes de présence sur les marchés mondiaux. Il est donc essentiel de renforcer les liens entre les entreprises et les organismes de recherche, pour orienter la SNRE vers la création de valeur économique.
Il est également impératif de créer les conditions d’un dialogue continu entre politique économique, développement industriel et politique environnementale. Ceci doit passer par un lien renforcé entre les différentes administrations en charge de la recherche, de l’énergie, mais également de l’industrie et de l’économie.
Les COP 21 et 22, le paquet européen Énergie-climat 2030 ou la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte ont défini des objectifs ambitieux, qui montrent que la question énergétique recouvre des enjeux économiques et sociétaux majeurs. Pourtant, force est de constater aujourd’hui que les financements consacrés à la R&D ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. En France, moins de 5 % des budgets de l’ANR sont consacrés à l’énergie. Au niveau mondial, l’Agence internationale de l’énergie a constaté que la part relative de l’énergie dans les dépenses de R&D avait fortement baissé. Dans le cadre de la Mission Innovation, un engagement a été pris par une vingtaine de pays de doubler les moyens affectés à la recherche sur l’énergie. Un effort financier important est nécessaire, passant notamment par un engagement budgétaire de l’État, tant en volume qu’en durée, susceptible de donner une visibilité aux différents acteurs sur le long terme.
La pluralité des guichets de financement porte en outre parfois préjudice à la continuité des financements alloués aux projets de recherche, ainsi qu’à l’articulation entre recherche fondamentale et technologie. La multiplicité des structures bénéficiaires de financements publics, dont le nombre a connu une très forte inflation, se traduit parfois par une dilution des moyens. C’est la raison pour laquelle l’ANCRE recommande une simplification du système français de recherche et d’innovation, devenu trop complexe, et une redéfinition des rôles des acteurs, dans un souci de transparence et de complémentarité. Elle préconise ainsi une meilleure coordination entre les agences nationales de financement, une augmentation des moyens de l’ANR et la réaffirmation de sa vocation visant à financer des projets ciblés sur les priorités économiques et sociétales de l’Etat et la simplification des procédures d’appels d’offres.
Il nous semblerait en outre important de parvenir à une meilleure coordination des politiques de recherche des différents ministères. M. Jean-Yves Le Déaut y a fait référence dans son introduction. Nous soulignons aussi la nécessité d’encourager les établissements qui accroissent leurs ressources propres au travers de partenariats industriels, en mettant en place des mécanismes d’abondement incitatifs, selon le modèle des Instituts Carnot par exemple.
Je tiens enfin à souligner l’importance de la formation aux nouveaux métiers de la transition énergétique, qui doit en particulier se définir à l’aune des besoins de l’industrie, et ce dans un contexte d’internationalisation accrue.
Je rappellerai pour conclure la disponibilité de l’alliance ANCRE pour travailler, dans la phase de mise en œuvre de la SNRE qui est en train de s’ouvrir, en liaison étroite avec les administrations compétentes et les entreprises, qu’il convient d’associer à cet exercice. À cet égard, l’ANCRE dispose de capacités de prospective et de modélisation qui font aujourd’hui autorité. Cet après-midi, vous seront ainsi présentés des scénarios élaborés pour envisager la manière dont les objectifs très ambitieux de la loi sur la transition énergétique peuvent être mis en œuvre et à quelles conditions.
Nous pouvons également nous prévaloir de dix groupes programmatiques susceptibles de produire des feuilles de route de recherche et d’innovation par grand secteur, à la fois du côté de l’offre et de la demande. Notre consortium de valorisation thématique, qui produit des études dans le domaine de l’intelligence économique, représente par ailleurs un véritable atout pour notre tissu industriel. Nous développons en outre nos collaborations avec les autres Alliances et l’industrie. Je souhaiterais notamment citer ici la coopération renforcée avec l’alliance ATHENA (la question des comportements est en effet essentielle, lorsque l’on parle par exemple de mobilité durable à long terme), mais aussi avec ALLISTENE dans le domaine du numérique et ALLENVI sur les thématiques de l’environnement.
Je terminerai en mentionnant différentes initiatives que nous avons lancées récemment, comme la réflexion en cours sur les sciences de base pour l’énergie, point d’appui nécessaire à l’établissement du continuum entre recherche amont et recherche appliquée permettant de développer des innovations susceptibles de contribuer à la transition énergétique.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La parole est à présent à M. Abdelilah Slaoui, directeur adjoint scientifique pour l’énergie au sein du CNRS, qui coordonne à ce titre les activités des différents laboratoires travaillant sur des sujets touchant à l’énergie et va traiter de l’implication du CNRS dans ce domaine. Il précisera les moyens qui y sont consacrés et présentera la façon dont les orientations de la nouvelle stratégie seront mises en œuvre.
M. Abdelilah Slaoui, directeur adjoint scientifique – énergie, CNRS. C’est un grand plaisir pour moi que d’être parmi vous aujourd’hui pour donner un éclairage sur l’implication du CNRS dans la recherche sur l’énergie et préciser la manière dont il répond aux orientations de la SNRE.
Je commencerai en citant quelques chiffres. Comme vous le savez, le Centre national de la recherche scientifique est impliqué depuis très longtemps dans la recherche et développement des matériaux et systèmes capables de répondre aux grands enjeux dans le domaine de l’énergie. D’après une enquête interne effectuée en 2015, l’effort en termes de personnes impliquées est de presque 6 000 équivalents temps plein, dont 1 600 purement CNRS, pour un montant de 412 millions d’euros au total, dont un tiers provenant des ressources mises à disposition par le CNRS. Il convient également de souligner que les dix instituts du CNRS sont concernés par ces travaux, y compris l’institut des sciences humaines et sociales, en forte cohésion avec l’alliance ATHENA.
Plus concrètement, nous disposons depuis 2012 d’une cellule « énergie », qui bénéficie d’un budget moyen d’action de 450 000 euros. Cette cellule a pour vocation de coordonner les visions des divers instituts du CNRS dans le domaine de l’énergie, de se ressourcer auprès des chercheurs via les groupes thématiques nationaux et de réaliser une enquête annuelle sur l’état de la R&D en énergie, utilisée essentiellement par l’Agence internationale de l’énergie et par les ministères qui souhaitent disposer d’un éclairage sur cette activité. Cette cellule a également pour objet de veiller à une bonne coordination avec les Alliances nationales, dont ANCRE, et européennes, comme l’EERA par exemple. Elle doit en outre être force de proposition pour les appels de l’ANR concernant notamment le défi énergie. Elle a par ailleurs pour mission de proposer des appels à projets exploratoires purement CNRS (de l’ordre de vingt projets par an).
Au regard de la nature même du domaine de l’énergie, nous animons en outre des actions de la mission interdisciplinaire et organisons diverses manifestations et conférences internationales.
La répartition des ressources humaines dans les différentes disciplines montre que les énergies renouvelables représentent une part extrêmement importante, dans laquelle le solaire occupe une place très significative. La répartition entre les autres domaines (nucléaire, stockage et distribution, transport, urbanisme, sciences humaines et sociales) est assez homogène. Le CNRS est ainsi présent dans un grand nombre de secteurs.
J’en viens à présent à la manière dont le CNRS va essayer de contribuer aux différentes orientations de la SNRE.
La première concerne le fait de cibler les thématiques transformantes clés pour la transition énergétique. Nous allons y contribuer par des appels à projets libres et thématiques annuels. En 2017, va ainsi être lancé un appel ouvert, mais aussi un appel avec la société Total sur l’efficacité énergétique dans les procédés industriels, et l’appel NEEDS, orienté vers le nucléaire. Nous continuerons par ailleurs à proposer des orientations pour l’ANR et contribuerons à enrichir le scénario ANCRE à 2050. Notre apport se traduira également par une participation au groupe de travail sur l’articulation de ces divers éléments, autour des avancées numériques notamment.
Concernant la deuxième orientation relative au développement de la R&D et de l’innovation, nous allons soutenir les infrastructures et démonstrateurs de recherche en relation avec l’énergie. Je pense notamment à des infrastructures de recherche sur le solaire thermique à concentration (FR-SOLARIS) ou encore de gestion des énergies renouvelables dans le bâtiment (ADREAM). Nous travaillons par ailleurs au renforcement des liens entre recherche et industrie, à travers le développement de laboratoires et instituts communs ou mixtes : citons par exemple l’IRDEP avec EDF, Nanosil avec Total, mais aussi ITE-IPVF qui implique plusieurs entreprises, de Total à Air liquide, ainsi que le CNRS et l’École polytechnique. Il s’agit enfin pour nous, évidemment, de développer des technologies de rupture dans plusieurs domaines sensibles tels que les batteries, le solaire photovoltaïque, le stockage sous toutes ses formes, qu’il soit thermique ou électrique. Ceci fait partie de notre cœur de métier, donc des éléments que nous développons très fortement.
La troisième orientation vise à développer les compétences et connaissances pour et par la R&D. Nous souhaitons dans ce cadre participer activement au nouveau groupe thématique « Sciences de base pour l’énergie », qui travaille notamment sur les matériaux innovants, ainsi que les modélisations des comportements et fonctionnements. Nous intervenons également dans le développement de réseaux thématiques de chercheurs. Nous souhaiterions par exemple que se mette en place un réseau français sur l’hydrogène, avec des implications fortes en termes de recherche, de développement et au niveau de l’industrie. Notre action consiste en outre à appuyer la participation à des projets européens, dont les ERA-NET et notamment Cofund sur le solaire, en plein développement actuellement.
Je terminerai en insistant sur la nécessité d’impliquer les sciences humaines et sociales dès la genèse des projets, y compris techniques, pour en appréhender les aspects sociologiques, juridiques, éthiques et en tirer les conséquences. Pour moi, l’économie circulaire doit intégrer les sciences humaines et sociales dès l’amont.
Pour mener à bien ces activités, un effort d’accompagnement s’avère indispensable, en termes de ressources humaines et de financements des travaux. Or, cela nous fait souvent défaut. Il a été mentionné précédemment que seuls 5 % des crédits de l’ANR étaient consacrés aux projets relatifs à l’énergie : une augmentation des sommes allouées à ce domaine nous semble nécessaire pour nous permettre de mener à bien nos missions et espérer atteindre les objectifs fixés.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vais donner la parole à un autre représentant du CNRS, M. Sylvain David, directeur adjoint scientifique de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), qui va préciser les implications de la SNRE dans les domaines de la physique nucléaire, de la physique des particules et des astroparticules, des développements technologiques et des applications associées, notamment dans le champ de la santé et de l’énergie.
M. Sylvain David, directeur adjoint scientifique IN2P3, CNRS. Je suis très heureux de cette opportunité de présenter, de façon relativement ciblée, quelques aspects de l’implication du CNRS, et plus généralement de la recherche académique, dans la recherche amont sur l’énergie nucléaire.
Je commencerai mon propos par un bref historique. Comme vous le savez, la recherche académique a été très mobilisée et structurée par la loi de 1991 dite « loi Bataille sur la gestion des déchets ». Très rapidement, le CNRS a pu mettre en place des programmes de recherche, toujours en partenariat avec les grands acteurs du nucléaire, pour explorer des voies innovantes dans ce domaine. Il s’agissait alors pour les chercheurs de mener des travaux sur des options parfois qualifiées d’exotiques, mais très mobilisatrices pour la recherche académique.
Le régime instauré par cette loi a pris fin en 2006 et le texte législatif qui lui a succédé a affiché deux grandes priorités nationales, à savoir les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et le stockage géologique dans l’argile pour les déchets de haute activité à vie longue. Clairement, ce recentrage sur des projets plus pré-industriels a demandé à nos équipes de se repositionner. Nous avons ainsi dû mettre en place une nouvelle approche et de nouveaux outils de pilotage pour continuer à mobiliser une communauté académique sur ces sujets.
Aujourd’hui, l’implication académique sur l’énergie nucléaire de fission est assez significative : elle correspond à environ 400 chercheurs en équivalents temps plein dans les unités mixtes de recherche, ce qui comprend à la fois des chercheurs CNRS, mais aussi des universitaires et des enseignants en écoles d’ingénieurs. L’estimation basse du budget associé est d’environ 30 millions d’euros par an, incluant les salaires et le soutien aux projets, mais non la mise à disposition de grandes infrastructures de recherche.
Je ne vais pas vous proposer une description exhaustive de ces activités, mais plutôt focaliser mon propos sur deux exemples qui me semblent assez emblématiques et illustrent bien, selon moi, la façon dont nous tentons de mettre en œuvre les recommandations de la SNRE dans la recherche amont sur l’énergie nucléaire.
Les équipes sont le plus souvent financées par l’extérieur. Je précise qu’il n’existe pas d’appel à projets spécifique de l’ANR sur le nucléaire. Les 5 % de budget dévolus à l’énergie ne concernent donc pas, ou vraiment très peu, le nucléaire. Il n’empêche que les activités à l’interface avec la physique appliquée sont souvent financées par l’extérieur et pas directement par le CNRS.
Le mode de fonctionnement se répartit en deux catégories : d’une part des collaborations bilatérales, généralement très dynamiques, avec un partenaire industriel, souvent sur des projets de recherche ciblés, plutôt à court terme, dans lesquels l’équipe de recherche est mise à contribution pour répondre à une demande précise émanant de l’entreprise, d’autre part un mode plus académique, en ce sens qu’il met en œuvre une évaluation scientifique en amont et en aval des projets et conduit plus naturellement à des publications scientifiques de haut niveau. C’est précisément le cas du premier exemple que je souhaitais présenter : le programme NEEDS.
Ce programme, dont l’acronyme signifie « Nucléaire Energie Environnement Déchets Société », existe depuis 2012. Il est porté par le CNRS, en fort partenariat avec l’Andra, Areva, le BRGM, le CEA, EDF et l’IRSN, pour un budget global d’environ 10 millions d’euros sur 5 ans, soit une moyenne de 2 millions d’euros par an. Je précise que ces chiffres ne concernent que le financement des projets et ne prennent pas en compte les salaires. Ce programme mobilise environ 120 chercheurs académiques en équivalents temps plein et s’inscrit, me semble-t-il, totalement dans l’objectif de la SNRE tel que décrit au paragraphe 3-1.3 : « avoir une vision pré-programmatique en mobilisant tout le spectre de la recherche, de sorte qu’une osmose entre recherche fondamentale et finalisée se réalise. Il peut émerger des projets exploratoires ou répondre à des commandes de recherche s’intégrant dans les objectifs finalisés ». Nous mobilisons en effet l’ensemble du spectre de la recherche de la partie académique et industrielle et avons, dans NEEDS, deux outils de financement qui répondent à ces deux objectifs en termes de projets exploratoires et de recherche plus finalisée.
Il s’agit d’abord un appel à projets ouvert permettant d’aller chercher des idées non identifiées, très nouvelles, qu’il n’aurait pas été possible de faire émerger ni par les partenaires industriels, ni par les pilotes académiques du programme. Je citerai notamment pour illustrer mon propos une application presque inattendue de la recherche fondamentale en astroparticules, qui consiste à utiliser les muons cosmiques pour faire de l’imagerie en trois dimensions des gisements d’uranium, qui pourrait par exemple être appliquée à la caractérisation des déchets ou des sites d’entreprosage et d’enfouissement. Il s’agit là de projets exploratoires, qui n’étaient pas dans le viseur avant cet appel à projets.
Le deuxième outil concerne des projets beaucoup plus structurants, consistant à bâtir de façon collective un projet de recherche amont ambitieux, qui fédère des équipes de différents partenaires (CNRS, universités, CEA, EDF, Areva, etc) et résulte de l’expression d’un besoin par le partenaire. Ceci nécessite une très forte mobilisation des équipes et une animation scientifique considérable en amont : bâtir un projet pertinent, incluant de la recherche amont et visant à répondre à une thématique très appliquée peut prendre plusieurs mois. Ces projets sont bien évidemment évalués et sélectionnés par un conseil scientifique, selon le modèle de fonctionnement académique.
Je citerai ici, parmi les dix ou quinze projets structurants que nous avons mis en place, celui relatif aux données nucléaires, qui participe à une amélioration continue de la connaissance des processus nucléaires en jeu dans les réacteurs et notamment des sections efficaces de réaction qui servent à modéliser le cœur du réacteur et à calculer les marges de sûreté associées. Ce projet fait figure de cas d’école, puisqu’il mobilise des physiciens nucléaires du CNRS et des universités, issus de la recherche fondamentale, qui font des expériences sur les grandes installations de recherche telles que le GANIL ou le CERN, des théoriciens et des évaluateurs, surtout présents au CEA, qui transforment ces données en bases de données utilisées ensuite par les simulateurs et les modélisateurs de l’industrie. Cet exemple montre comment il est possible d’articuler l’ensemble des compétences des différents acteurs pour répondre à une question de façon collective.
Je précise par ailleurs que la quasi-totalité des équipes académiques engagées et soutenues financièrement dans des projets de NEEDS portent, dans les universités, des formations professionnalisantes destinées à alimenter les grands acteurs du nucléaire.
Ceci constitue une bonne transition avec la deuxième initiative que je souhaitais vous présenter, qui s’inscrit dans l’orientation 3 de la SNRE concernant le développement des compétences et connaissances pour et par la recherche, le développement et l’innovation. Cet exemple concret, actuellement en cours de finalisation, réunit l’université Paris-Sud, le CNRS, l’I2EN et la plateforme France nucléaire (qui regroupe EDF, Areva et le CEA). Il consiste à organiser des stages de formation dans les laboratoires académiques, destinés à apporter des compétences d’intérêt pour la filière. Il s’agit vraiment de mobiliser les compétences des chercheurs, mais aussi des techniciens et des ingénieurs, souvent peu impliqués et selon moi insuffisamment valorisés dans l’enseignement, non pour prendre des stagiaires comme on le fait classiquement, pour être utiles à nos travaux de recherche, mais pour former les étudiants et les stagiaires à des techniques de pointe et leur permettre d’afficher des compétences visibles et reconnues d’intérêt par la filière.
Il s’agit véritablement d’une nouvelle façon d’envisager le stage dans nos laboratoires. Je crois que ce type d’action peut contribuer à accroître l’attractivité de la filière auprès des étudiants, dans la mesure où ces stages sont proposés dès le niveau L, c’est-à-dire précisément celui où les choix s’effectuent. Si nous voulons attirer les jeunes vers le nucléaire, que ce soit en licence professionnelle ou en master, c’est véritablement au niveau L2 qu’il faut commencer à travailler. Ce projet, qui sera finalisé dans les semaines à venir, illustre bien le lien fort qui peut s’établir entre recherche académique et formation.
Associer de façon ambitieuse la recherche académique à de tels projets et attirer les bons étudiants dans les formations proposées me semblent deux enjeux nationaux majeurs, très intimement liés, qui devraient selon moi faire l’unanimité et conduire à dépasser les clivages, quelle que soit la sensibilité de chacun sur le nucléaire ou la vision que l’on peut avoir de son évolution dans les années ou décennies à venir.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous allons sans plus tarder passer au débat.
M. Jean Vernier. Je suis étudiant. Il me semble que la pénétration des énergies renouvelables dans le réseau induit des instabilités, auxquelles il peut être remédié par des dispositifs de stockage. Actuellement, le chiffre de 30 % est avancé concernant la pénétration des énergies renouvelables. Aujourd’hui, on limite le stockage en raison de la pénétration limitée des énergies renouvelables et on limite la pénétration des énergies renouvelables au motif de capacités de stockage limitées : est-ce un problème de politique publique ou de technique ? Quelles solutions y apporter ?
M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Il me semble nécessaire, avant de répondre avec précision à votre question, d’apporter quelques éléments de recadrage concernant le stockage de l’énergie. Il existe différentes sortes de stockage : le stockage instantané pour faire face à une fluctuation d’énergie sur le réseau, le stockage interjournalier pour pallier le fait que les conditions de vent du lundi sont différentes de celles du dimanche et le stockage intersaisonnier visant à répondre au fait que l’on a besoin de climatisation en été et de chauffage en hiver, alors que certaines énergies produisent à certains moments seulement. Le stockage soulève une famille de problèmes, donc de solutions : batteries, hydrogène, stockage par l’air comprimé, par les STEPs. On ne peut réduire cela à une seule question, à laquelle on pourrait apporter une réponse unique.
Pour revenir plus précisément à votre question, il est vrai que, sur certains réseaux en France, des limites sont fixées règlementairement à 30 %. Au-delà de 30 % d’énergies renouvelables injectées sur le réseau, on préfère couper car on n’est pas certain d’être en capacité d’assurer la stabilité du réseau. Il existe toutefois des exemples, partout dans le monde, dans lesquels cette proportion d’énergies renouvelables sur le réseau a été largement dépassée, de façon instantanée. Je crois que l’Irlande a déjà atteint 60 ou 70 % d’électricité éolienne à certains moments. Il s’agit donc vraiment de questions de confiance et de limites que l’on se fixe. Je ne crois donc pas qu’il s’agisse d’une limite physique intangible. Cela relève plutôt d’une décision de prudence, visant à privilégier la sécurité de l’approvisionnement. Nous espérons progresser sur ce système.
En France métropolitaine, nous n’avons actuellement pas trop d’enjeu de stabilité du système électrique. Nous disposons en effet de STEPs pour plusieurs gigawatts, qui nous permettent de bien réguler la fréquence et la tension sur le réseau. Nous avons une capacité de production très forte. Les îles d’outremer sont par contre des territoires d’expérimentation très intéressants : dans ces zones non interconnectées, dans lesquelles le prix de l’électricité est très élevé (dans la mesure où il dépend largement d’hydrocarbures importés pour faire fonctionner les centrales thermiques), il est déjà rentable d’utiliser des batteries ou des systèmes de stockage pour intégrer plus d’énergies renouvelables et remplacer ainsi du fossile par du renouvelable.
Depuis quelques années, des appels d’offres commerciaux sont d’ailleurs lancés par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gouvernement pour intégrer du stockage avec des centrales solaires et augmenter ainsi progressivement le taux d’énergies renouvelables.
Le seuil de 30 % est donc davantage une limite réglementaire destinée à assurer une sécurité d’approvisionnement qu’une limite technique. Il n’y a aucune raison que l’on ne parvienne pas à la dépasser. Ceci ne passe d’ailleurs pas uniquement par le stockage électrochimique de l’énergie. De nombreuses solutions sont envisageables, comme les passerelles entre réseau électrique et réseau gazier, qui constituent actuellement l’un des grands sujets de R&D. Des projets sur le power-to-gaz sont en cours, qui donneront peut-être lieu à des développements à un horizon de dix ou quinze ans. Ces pistes méritent d’être explorées.
M. Pascal Brault, directeur de recherche au CNRS, délégué scientifique énergie au CNRS, alliance ANCRE. On raisonne actuellement en termes de réseau général électrique et de pénétration sur le réseau, ce qui correspond au fonctionnement du système en France. D’autres études sont en cours depuis quelques années, qui essaient d’adopter une vision plus délocalisée, d’autoconsommation, d’autoproduction. Cette approche doit permettre de gérer la question du stockage : en localisant le besoin et en ne répondant qu’à lui, on peut en effet décharger le grand réseau électrique. C’est le principe des micro-grids. Les territoires d’expérimentation de ces solutions sont les territoires insulaires, dont La Réunion et la Corse.
M. Didier Houssin. La problématique est bien celle du stockage de l’électricité et non de l’énergie, sachant que l’on peut souvent passer par la chaleur pour stocker l’énergie, ce qui est beaucoup plus facile et économique que les solutions actuelles de stockage de l’électricité, qui sont à 99 %, au niveau mondial, liées aux STEPs.
De même, la problématique n’est pas celle des énergies renouvelables, mais intermittentes. Il faut se souvenir que l’hydroélectricité, dont on ne parle pas, constitue une solution idéale, puisqu’elle n’émet pas de CO2 et peut être sollicitée à volonté. Les barrages hydroélectriques ont permis de faire face à des risques de blackout dans le système électrique européen. Les barrages français, qui représentent l’essentiel de notre production d’électricité renouvelable, jouent un rôle essentiel.
De nombreux pays ont absorbé des niveaux d’énergies intermittentes bien supérieurs à ceux que la France s’est donnée comme objectifs. Les façons d’y remédier ne résident pas uniquement dans le stockage d’électricité, mais aussi dans le fait de disposer de systèmes d’énergie et de capacités de réserve mobilisables à volonté, ce qui pose le problème des modèles économiques pour ces centrales à gaz qui peuvent être dispatchées comme on l’a vu récemment lors de la période de froid. Ceci renvoie au débat sur le marché des capacités.
Il faut également considérer le développement des interconnexions : plus le marché est large, plus le système de sécurité d’approvisionnement et de diversité du mix électrique est pertinent. Il existe aussi des solutions de gestion de la demande, avec des signaux prix adaptés et des systèmes de développement des réseaux intelligents, tels que les compteurs Linky. Notre système est encore relativement archaïque du point de vue de la demande d’électricité. À l’avenir, nous disposerons de solutions permettant de contribuer de façon très importante à la gestion de l’intermittence.
En France métropolitaine, le problème n’est pas immédiat ; en revanche, la question se pose dans les outre-mer, qui ne bénéficient pas de la même profondeur de marché et sont largement dépendants pour l’instant des énergies fossiles, lesquelles présentent le grand mérite d’être stockables. La gestion de la montée en puissance des énergies renouvelables est plus complexe dans les zones insulaires, où la mise en œuvre de solutions de stockage de l’électricité est donc la plus urgente.
M. Christian Ngô, Edmonium Conseil, membre du conseil scientifique de l’évaluation de la SNRE 2007. Il existe, dans la vie de tous les jours, une autre forme de stockage : les cumulus, malheureusement supprimés par la RT2012 dans les logements neufs. On compte ainsi 11 millions de cumulus en France. Ce système permet d’utiliser l’électricité qui ne sert pas à grand-chose la nuit pour chauffer l’eau que l’on utilise la journée. Cela représente environ 8 TWh de production d’énergie.
Pour revenir aux énergies intermittentes, le stockage est un élément important, qui permet d’atténuer l’intermittence. Si l’on envoie directement une énergie intermittente hautement fluctuante sur le réseau, on peut en effet le déstabiliser. L’important, dans un réseau électrique, est que la demande soit égale à l’offre. Si ce n’est pas le cas, cela fait varier la fréquence (nous travaillons en France sur du 50 hz). Or, si le différentiel de fréquence devient trop grand, le réseau disjoncte, ce qui peut occasionner une panne de plusieurs heures, voire jours. Je vais, pour illustrer l’importance de la fréquence, prendre l’exemple d’une perceuse : lorsque l’on introduit le foret dans le mur pour percer un trou, la vitesse de rotation (donc la fréquence) diminue. Il y a donc variation de fréquence. Ceci correspondrait, pour un réseau électrique, au fait que des clients demandent beaucoup d’électricité ; si le réseau n’est alors pas en capacité de fournir, alors il s’écroule.
De la même manière, on constate, une fois le trou percé, que le foret accélère quand on le sort du mur : ceci correspond en quelque sorte au cas où un coup de vent entraîne une éolienne, qui produit soudainement trop d’électricité, au risque de faire disjoncter le réseau. Ainsi, si l’on envoyait toutes les énergies intermittentes sur le réseau sans régulation comme le stockage, cela causerait des problèmes. L’électricité est aujourd’hui mieux filtrée qu’auparavant, mais on constatait au début des éoliennes que ces afflux d’énergie endommageaient les composants électroniques. Lorsque je faisais des expériences avec GANIL, j’avais mesuré la tension arrivant sur un ordinateur et constaté des pics de 1 000 volts. Lorsque le phénomène est très étroit, il ne crée pas de problème majeur, mais cela peut toutefois endommager un réfrigérateur ou un ordinateur.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Si je comprends bien, il n’existe pas de système d’onduleur pour les réseaux électriques.
M. Christian Ngô. Pour une grosse installation telle qu’un chauffage électrique, cela ne pourrait pas fonctionner.
M. Sébastien Balibar, directeur de recherches au CNRS, membre de l’Académie des sciences. Je me félicite que l’on ait mentionné la grande diversité des cas. Il existe effectivement plusieurs types de stockages et diverses situations géographiques. Je suis allé par exemple à l’île d’Ouessant, qui n’est pas reliée au réseau et où l’on importait par conséquent de grandes quantités de fioul pour produire l’électricité nécessaire, très importante notamment pour alimenter les phares. Ceci a été remplacé par des hydroliennes, sortes d’hélices qui fonctionnent quasiment en permanence dans le canal du Fromveur. Ce système fonctionne très bien. Le seul problème est que le coût est trois fois supérieur à celui de l’électricité ordinaire. Pour autant, cela a permis, dans ce cas particulier, d’effectuer des économies conséquentes.
J’ai par ailleurs eu l’occasion de me rendre en Guyane, où quelques erreurs ont été commises lors de la construction de barrages comme celui de Petit-Saut, où l’on a oublié de déforester avant de remplir le lac, si bien que la matière végétale a pourri, produisant des émissions de méthane qui ont tué les poissons. S’ajoute à cela les problèmes liés à l’activité des orpailleurs. Il faut savoir que la Guyane importe de grandes quantités de combustibles fossiles, essentiellement pour les transports. Entre Cayenne et Kourou par exemple, la seule liaison possible se fait par voiture ; un train électrique serait pourtant plus respectueux de l’environnement.
On pourrait parfaitement envisager de construire non des barrages avec de grands lacs, qui posent des problèmes pour cette région, avec en particulier l’accumulation de la pollution due à l’orpaillage, mais des barrages au fil de l’eau. Le territoire amazonien compte tellement d’eau qu’il serait possible d’installer de petits barrages successifs. Il s’agirait certes d’une solution à petite échelle ; mais je pense que c’est en cumulant les petites solutions adaptées que l’on peut espérer atteindre les objectifs fixés.
Nous avons peu parlé du solaire thermique, auquel je suis pour ma part très favorable. Je me suis ainsi rendu au Maroc, où j’ai pu discuter de la construction de l’installation de solaire thermique Noor I, Noor II et Noor III à Ouarzazate. Noor III est absolument remarquable, puisque le fluide caloporteur qui circule au point focal de miroir parabolique maintient chauds des réservoirs qui servent à la production d’électricité pendant environ huit heures, soit quasiment une nuit, si bien que le solaire thermique ne connaît pas le problème d’intermittence qui nous préoccupe. Pour des pays chauds, qui n’ont pas beaucoup d’eau et dans lesquels on ne dispose pas de la technologie, ni de la stabilité politique nécessaire à une surveillance sûre du nucléaire par exemple, le solaire thermique peut constituer une solution intéressante, dont on doit certainement pouvoir faire baisser le coût.
M. Abelilah Slaoui, directeur adjoint scientifique – ENERGIE, CNRS Je souhaiterais rebondir sur votre question concernant l’onduleur et les éventuelles recherches sur ce sujet. Un groupe de travail intitulé STIC-Energie, réunissant ANCRE et ALLISTENE, a été créé avec l’objectif de travailler sur les questions de digitalisation de l’énergie, les réseaux intelligents, les Big Data ou encore l’efficacité énergétique, autant d’éléments susceptibles de répondre, dans un avenir que nous espérons proche, à ce besoin très fort de contrôle des fluctuations du réseau.
Il a été question précédemment de stockage thermique. À Perpignan, le laboratoire PROMES, du CNRS, mène une étude autour de l’utilisation des roches pour stocker thermiquement. Cette technologie française pourrait parfaitement être appliquée à des domaines de stockage tels que les centrales solaires au Maroc, dont il vient d’être question, mais aussi dans de nombreux autres endroits.
M. Jean Vernier. Bonjour, je fais partie du Corps des ponts, des eaux et des forêts et vais commencer l’an prochain une thèse sur les batteries. Ma question porte sur la compétitivité des technologies développées, avec une phase de maturité très faible pour l’instant. Face à des concurrents à l’international, notamment en Asie, qui parviennent par différentes méthodes à obtenir des coûts très faibles, comment abordez-vous ce problème, sur des fleurons français comme Saft ou des technologies de power-to-gaz ou de stockage dans les roches sur lesquels la recherche française est en pointe, mais qui s’exportent mal si le problème de compétitivité n’est pas pris en compte ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La question de la compétitivité de ce qui émane directement du monde scientifique me semble être un enjeu, mais pas vraiment une question, dans la mesure où il n’appartient pas aux scientifiques d’élaborer les produits destinés à être vendus. Je crois, à titre personnel, que l’on a trop parlé, pendant trop longtemps, de recherche fondamentale et de recherche appliquée et qu’il serait préférable d’adopter un tout autre raisonnement et de parler plutôt de recherche et d’applications de la recherche.
M. Christian Ngô. Faire de la recherche et en avoir les moyens sont deux choses différentes. Actuellement, nous sommes par exemple envahis par les batteries lithium-ion, présentes dans les téléphones, les ordinateurs, un peu dans les voitures. Or, l’Europe et les États-Unis avaient délibérément coupé les crédits de recherche dans les années 1970 et laissé ce volet à l’Asie, si bien que c’est Sony qui a sorti la batterie lithium-ion, pour répondre au besoin spécifique d’alimentation des gros walkmans, qui nécessitaient de disposer de batteries légères. L’Europe et les États-Unis ont laissé filer ce marché et achètent aujourd’hui ces batteries en Asie. Le choix stratégique est donc un élément très important. Il existe dans le monde, notamment en Europe ou aux États-Unis, de nombreux chercheurs très compétents, capables de résoudre bien des problèmes. Pour autant, si l’on effectue de mauvais choix stratégiques, les recherches se font ailleurs.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans les années 1950, on a fait le choix d’abandonner la pile à hydrogène ; on y revient aujourd’hui. Le monde fonctionne ainsi, je le crains. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous avons fortement insisté pour pouvoir mener à bien le travail que nous effectuons actuellement au Parlement sur l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche en énergie. On peut déplorer les mauvais choix du passé, mais l’important est surtout de ne pas manquer les opportunités actuelles et à venir et de faire en sorte d’une part que des recherches soient menées, d’autre part que les découvertes puissent passer de facto au stade industriel et que des entreprises, petites ou grandes, de France et d’Europe, s’en saisissent au bon moment et de la bonne manière afin d’aller jusqu’au marché. L’enjeu est là, me semble-t-il. Il faut faire confiance à nos chercheurs.
J’ai beaucoup apprécié l’intervention qui a mis en exergue l’importance du lien entre le monde de la recherche et les étudiants, dès la deuxième année de licence. Il s’agit là d’un élément véritablement stratégique. Il faut veiller à ne pas déconnecter la recherche de celles et ceux qui vont devoir la mettre en œuvre concrètement dans le cadre de leur activité professionnelle future. Un étudiant en doctorat n’a pas forcément vocation à faire de la recherche dans le secteur public toute sa vie ; il peut aussi travailler dans le cadre de la recherche privée ou apporter les compétences acquises durant son parcours scientifique au monde de l’économie stricto sensu. La vision d’une trajectoire merveilleuse allant de la recherche amont à l’application et au marché nous a, je le crois, quelque peu handicapé pendant des années. Nous revenons aujourd’hui à des fondamentaux dans lesquels les notions d’inattendu et de stratégie se conjuguent et dont on peut espérer qu’ils porteront leurs fruits.
TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES RUPTURES TECHNOLOGIQUES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Présidence : Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée,
vice-présidente de l’OPECST
M. Jean-Yves Le Déaut. Cette table ronde a pour objectif d’envisager les ruptures technologiques susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs de la transition énergétique et plus généralement des engagements pris dans ce domaine, notamment au plan international, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Je rappelle que nous avons, à l’occasion du trentième anniversaire du premier rapport rendu par l’OPECST, organisé en 2015, année au cours de laquelle nous avons par ailleurs occupé la présidence du réseau des offices parlementaires des Parlements européens, une audition consacrée au thème « Innovation et changement climatique : l’apport de l’évaluation scientifique et technologique », qui a donné lieu à une publication disponible à l’entrée de la salle. Vous trouverez dans ce document non seulement les minutes de l’audition, qui avait réuni une trentaine de présidents de commissions de Parlements européens, mais aussi les positions d’un certain nombre de pays sur cette question, ainsi qu’une conclusion énoncée par Jean Jouzel, qui avait mis l’accent sur le fait que l’on n’atteindrait pas les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique sans développement de l’innovation, donc sans Stratégie nationale de recherche en énergie. Le sujet de cette table ronde est donc d’importance.
L’occasion va être donnée à chacun des intervenants d’exprimer ses positions sur la question et d’en débattre. Je donne tout d’abord la parole à Mme Nathalie Alazard-Toux, de l’alliance ANCRE, directrice économie et veille de l’IFP Energies nouvelles, qui va présenter le volet prospective, en termes de demande, du scénario de l’ANCRE « Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte » à l’horizon 2050.
Je précise que cette table ronde va être animée par Mme Anne-Yvonne Le Dain, en charge de l’élaboration d’un rapport sur la SNRE, qu’elle va nous présenter dans une quinzaine de jours. Je suis pour ma part chargé de la rédaction d’un rapport sur l’évaluation de la Stratégie nationale de recherche, que nous sommes actuellement en train de finaliser, raison pour laquelle je me vois contraint de vous quitter.
Mme Nathalie Alazard-Toux, directrice économie et veille, IFPEN, Alliance ANCRE. Le travail que je vais vous présenter a été initié en 2016. Il fait suite à tous les travaux de prospective menés par l’ANCRE, qu’il s’agisse des scénarios produits en 2013 dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ou d’un rapport, publié en 2015 au moment de la COP 21 et présenté dans le cadre d’un « side event », sur les technologies clés pour une décarbonation profonde du système énergétique mondial.
Dans le prolongement de ces expériences, l’idée était, en 2016, de recommencer un travail de scénarisation sur la France, en prenant en compte la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est-à-dire tous les objectifs figurant dans ce texte, ainsi que les actions et objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour ce faire, plusieurs outils ont été développés au sein de l’ANCRE, dont OPERA, un simulateur du système énergétique. Le travail a consisté en une approche itérative avec les groupes programmatiques de l’ANCRE, qui réunissent chacun plusieurs experts et sont centrés soit sur les technologies de demande d’un secteur, soit sur des technologies de l’offre (solaire, éolien, énergie marine ou nucléaire, etc.).
La réalisation de ces scénarios s’est appuyée sur le souhait de se montrer assez volontariste sur les évolutions des technologies, des progrès techniques et des innovations au service des changements de comportements, avec la volonté d’illustrer de manière précise les apports envisageables en termes de dynamique et de voir en quoi cela pourrait modifier les dynamiques et les tendances existantes.
Le scénario réalisé, finalisé à la fin de l’année 2016, répond aux objectifs en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 : il atteint quasiment un facteur quatre, tous secteurs confondus et le dépasse si l’on considère uniquement les émissions de CO2.
Je vais centrer mon propos sur la demande au niveau des différents secteurs et envisager les divers leviers technologiques qu’il est possible d’actionner pour atteindre les objectifs fixés dans la loi.
Commençons par le secteur des transports. Dans ce domaine, la trajectoire telle qu’elle est dessinée, avec les leviers mis en place, permet globalement, à l’horizon 2050, de diviser par deux la consommation d’énergie du secteur, tous transports confondus (passagers et marchandises), et par quatre la consommation d’énergies fossiles dans le secteur. Ceci nécessite néanmoins certaines modifications très importantes. Malgré l’augmentation de population, le scénario se fonde par exemple sur une diminution du parc de voitures particulières. La trajectoire telle qu’elle est dessinée fait ainsi l’hypothèse de modifications assez importantes des comportements, encouragée et soutenue par l’innovation. Les développements du numérique seraient par exemple au service d’une autre mobilité pour les usagers, comme le développement des transports en commun et des modes de déplacement doux.
Parallèlement, un comportement différent apparaîtrait vis-à-vis de la voiture particulière, avec le développement de flottes en auto-partage et des évolutions extrêmement rapides se produiraient au niveau des véhicules eux-mêmes. Dans ce scénario, le parc de véhicules fonctionnant avec des moteurs thermiques a tendance à diminuer. En 2050, les véhicules présents dans le parc auraient en outre une consommation d’énergie sans commune mesure avec celle que l’on connaît aujourd’hui. L’évolution se caractériserait par ailleurs par une augmentation assez forte des véhicules électrifiés. Le fait d’avoir des flottes servicielles partagées aurait enfin pour effet une utilisation accrue des véhicules, donc un taux de rotation beaucoup plus fort, permettant une pénétration plus rapide des meilleures technologies dans le parc.
Concernant le secteur résidentiel et tertiaire, les éléments mis en œuvre pour construire la trajectoire permettent une diminution des consommations d’énergie finale par deux à l’horizon 2050 et une division par quatre des énergies fossiles. La réalisation de cette trajectoire suppose un certain nombre de préalables, dont un taux de rénovation extrêmement important et dynamique du parc ancien, avec des rénovations profondes. Ceci conduirait, entre l’avant et l’après rénovation, à une baisse de consommation d’énergie de l’ordre de 60 %. Ceci nécessite de mettre en œuvre les dernières technologies et de mener des actions au niveau de la filière professionnelle, en termes de formation, mais aussi d’industrialisation de la chaîne d’acteurs, afin d’avoir un rythme de rénovation soutenu, avec des coûts acceptables pour les particuliers et pour le secteur tertiaire qui devra financer ces travaux.
Dans le secteur industriel, la trajectoire définie a pris en compte les évolutions de production tendancielles des différents segments, les grands consommateurs d’énergie, mais aussi la consommation d’énergie dans d’autres segments (comme les centres de données, ou data centers, et les réseaux internet), en très forte augmentation. Le scénario tel qu’il a été conçu s’appuie sur un taux de croissance de l’activité économique de 1,7 % par an sur toute la période, ce qui est assez soutenu, et une part de l’industrie dans l’activité économique globale qui reste stable. Il s’agit donc d’une vision assez volontariste. Dans ce cadre, le scénario parvient à infléchir la consommation d’énergie dans l’industrie, malgré l’accroissement de l’activité, et à réduire la part des énergies fossiles. Pour parvenir à atteindre les objectifs globaux fixés par la loi en matière d’émissions de CO2, il apparaît en outre nécessaire de mettre en place des filières de type captage – stockage, voire captage – recyclage du CO2 sur certains gros émetteurs du secteur industriel, et ce dès 2020.
Il est assez difficile, en un temps aussi court, de décrire l’ensemble des éléments de ce scénario. Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous transmettre un document plus précis.
Il faut en résumé retenir de ce scénario que le progrès technique y est assez volontariste. La technologie est à la fois au service de l’efficacité énergétique, de la décarbonation du mix et des changements de comportements. La dynamique de renouvellement des parcs (de véhicules, de logements, de production électrique), élément éventuellement susceptible de ralentir l’atteinte de certains objectifs, est également prise en compte. Nous avons en outre essayé de vérifier avec l’ensemble des groupes programmatiques que les variables mises en œuvre et ajustées au fur et à mesure de la construction de ce scénario étaient modifiées de manière équivalente dans les différents segments, c’est-à-dire que le degré d’ambition était le même partout. Malgré tout, dans les trois secteurs de demande que je viens de décrire, les ambitions sont très importantes pour le bâtiment, un peu moins pour le transport et beaucoup moins pour l’industrie. Merci.
M. Jean-Yves Le Déaut. Dans le scénario volontariste et ambitieux que vous nous présentez, il apparaît que des énergies fossiles subsistent en 2050. Croyez-vous au scénario, élaboré par l’ADEME, comportant 100 % d’énergies renouvelables ?
Mme Nathalie Alazard-Toux. Selon moi, le scénario 100 % renouvelables de l’ADEME, qui concernait essentiellement, me semble-t-il, la production d’électricité, est un exercice très intéressant, mais qui présente le défaut de faire table rase du passé et du présent, et de faire comme si l’on avait l’opportunité de tout reconstruire d’un seul coup. Cela pose un problème, dans la mesure où une trajectoire suppose une dynamique, des investissements ayant une durée de vie, engagés à des moments où des technologies sont disponibles et d’autres non. Je pense que la question de la dynamique, sur laquelle je me suis permise d’insister dans mon exposé, est essentielle dans la construction de tels scénarios.
M. Olivier Appert, président de France-Brevets et du Conseil français de l’énergie. J’ai lu cette étude de l’ADEME avec attention. Bruno Léchevin, dans son introduction, en relativise la portée, en indiquant qu’il s’agit d’une étude scientifique. Le problème selon moi réside dans le fait qu’elle n’ait pas été soumise à l’évaluation de ses pairs, comme cela est le cas en principe de tous les travaux de ce type.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je passe la parole, pour compléter cette présentation, à M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne, directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé) du CEA, qui va présenter le volet prospective de l’offre électrique de ce même scénario.
M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne, directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé), CEA, Alliance ANCRE. Le schéma qui vous est présenté fait apparaître les hypothèses d’accroissement de la production électrique, puisque nous nous situons dans une configuration dans laquelle la demande électrique croîtrait légèrement. Il existe de nombreux mécanismes de substitution. Or, le fait que l’électricité décarbonée se substitue progressivement à l’énergie fossile (ce qui constitue un mouvement de fond) joue contre les mécanismes d’efficacité et explique la légère augmentation de la consommation électrique dans le pays.
Le deuxième élément important réside dans l’accroissement considérable de la part d’énergie fournie par les énergies nouvelles et renouvelables, pour aboutir à l’horizon 2050 à environ 50 % de nucléaire et 50 % d’énergies renouvelables, ou énergies renouvelables. La structure du parc des énergies renouvelables va ainsi évoluer, en termes de puissance et d’énergie, selon un ensemble de phases successives. La phase actuelle se caractérise par un développement important de l’éolien, tandis que la deuxième vague verra l’éolien off-shore prendre le relais de l’éolien on-shore, dont la progression se poursuivra, mais à un rythme moins soutenu. Cette deuxième étape sera également marquée par une augmentation du solaire photovoltaïque, avec des gains de coût très importants. La troisième étape enfin se traduira par l’arrivée de nouveaux entrants, correspondant à de nouvelles technologies d’énergies renouvelables (énergies marines, cogénération et autres).
L’un des éléments de l’étude a également consisté à voir comment le système pourrait être rendu pilotable pour faire face à l’augmentation de la variabilité. Nous avons supposé dans le scénario l’arrivée de nouvelles techniques permettant d’y faire face. Des ruptures sont ainsi attendues dans le domaine du stockage, mais aussi dans les techniques faisant appel à de l’intercommunication entre systèmes énergétiques, avec l’électricité bien sûr, mais aussi le gaz, par des techniques hydrogène ou biogaz, la chaleur et le froid. La cogénération peut elle-même jouer un rôle important en permettant de s’effacer dans les zones de pointe. Les moyens non conventionnels permettant de piloter l’adéquation entre offre et demande tendent à se développer, même si la part essentielle reste aux moyens conventionnels, à savoir les centrales, avec évidemment un rôle extrêmement important dévolu au nucléaire, aujourd’hui très flexible en France et qui permettra dans les décennies à venir aux énergies renouvelables variables de continuer à pénétrer dans les réseaux.
Je tiens par ailleurs à souligner l’importance de la dynamique du parc. Nous avons, dans la logique de la loi de transition énergétique, modélisé un passage par l’objectif de 50 % de nucléaire à l’horizon 2025. Ceci aurait des implications en termes économiques, avec notamment des surcoûts significatifs, mais aussi une augmentation corrélative des émissions de CO2, dans la mesure où l’on ne disposerait pas, dans ce schéma, du temps et des moyens nécessaires pour développer des énergies alternatives avec l’ensemble des moyens permettant de piloter cette variabilité. On serait ainsi contraint de développer des turbines à gaz, puis de les démanteler au bout d’une quinzaine ou une vingtaine d’années, c’est-à-dire de les revendre sur le marché international. Ce scénario permet, contrairement à celui de l’ADEME, de révéler ces aspects dynamiques et de mettre en lumière des contraintes très significatives.
Dans quelle mesure sommes-nous en capacité, grâce à ce scénario volontariste, d’atteindre les objectifs de la LTECV et de la programmation pluriannuelle de l’énergie, eux-mêmes définis à plusieurs échéances de temps ? Nous avons essayé de classer les résultats selon que les objectifs étaient atteints (à plus ou moins 10 %), non atteints avec un écart de 10 à 25 % ou non atteints à plus de 25 %. Bien évidemment, les objectifs sont très variés, avec des enjeux économiques, énergétiques ou climatiques très différents. Néanmoins, il apparaît que la plupart des grands objectifs sont atteints, au prix parfois d’adaptations difficiles, ainsi que je vous l’ai montré pour le système électrique ; d’autres, en revanche, ne le sont pas. Ainsi, concernant la division par deux de l’énergie finale à l’horizon 2050, qui est l’un des grands paramètres de clivage entre les familles de scénarios qui illustrent la possibilité d’atteindre ou non la LTECV, il est apparu que les contraintes permettant d’atteindre ce but étaient trop importantes et que certaines d’entre elles auraient pesé spécifiquement sur ce seul indicateur, alors que les autres contraintes s’intégraient mieux dans un ensemble finalisé pour aller vers le facteur 4. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas atteint cet objectif.
En conclusion, j’insisterai moi aussi sur l’importance de la dynamique et sur le fait que les scénarios de l’ANCRE se situent d’une façon assez particulière. Nous sommes en effet des chercheurs en technologies. Or, les ruptures, qui sont le maître-mot de cette table ronde, sont de diverses natures, technologiques, mais aussi comportementales. Nous avons ainsi essayé non pas de ne pas travailler sur les ruptures comportementales, mais de les rendre possible à travers des évolutions de la technologie. D’autres scénarios, comme celui de NégaWatt, font le choix inverse et tablent d’abord sur des ruptures comportementales, ce qui se traduit par un moindre besoin de technologies.
Quelles conséquences en retirer pour la recherche ? Il était tout d’abord important pour nous de vérifier si les conclusions que nous avions tirées de notre exercice de 2014 – 2015 portant sur un ensemble de scénarios dans le cadre du débat national sur la transition énergétique étaient robustes : il apparaît qu’elles le sont.
En termes de positionnement en dynamique de la recherche, le court terme (soit dix ou quinze ans en matière énergétique) se caractérise par une recherche d’abord finalisée et son cortège de démonstrateurs notamment, qui cherche à montrer comment ces nouvelles technologies s’insèrent réellement dans les territoires et peuvent correspondre plus ou moins facilement à des comportements qui eux-mêmes évoluent. Cela reste un élément extrêmement important. Pour ce qui est du moyen et long terme, nous avions montré, dans une étude présentée à l’OPECST en son temps, qu’il existait un risque, si l’on n’accélérait pas au plan mondial les efforts dans le domaine de la R&D énergétique, de lacune technologique à l’horizon 2030 – 2035. Ceci prend tout son sens, suite notamment à l’Accord de Paris : il faut augmenter fortement la recherche amont, afin de permettre les ruptures.
Il est également nécessaire de développer une recherche transverse, dans deux domaines très différents que sont les systèmes (autour de la conversion de vecteurs et de la gestion de la chaleur) et les sciences humaines et sociales, avec lesquelles il est essentiel d’établir des passerelles.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’avoue éprouver quelques difficultés avec le concept de recherche finalisée et de recherche amont. Pour être une scientifique moi-même, je pense profondément que la distinction doit plutôt s’effectuer en termes de recherche et d’applications de la recherche. Les conséquences organisationnelles ne sont absolument pas du même ordre.
Je donne à présent la parole à M. Michel Latroche, directeur de recherches au CNRS, chargé de mission INC à l’Institut de chimie et des matériaux Paris Est, qui va évoquer les défis de la recherche dans le domaine du stockage et de la conversion d’énergie, axe de recherche fondamental pour l’intégration des énergies renouvelables.
M. Michel Latroche, Institut de chimie et des matériaux Paris Est, CNRS. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d’abord à vous remercier de nous avoir invités à cette réunion de l’OPECST consacrée aux enjeux de la recherche en énergie.
La France est, comme vous le savez, fortement impliquée dans le processus de transition énergétique et mène aujourd’hui des actions très concrètes dans ce domaine. Elle a notamment porté les accords de la COP 21 et défini des objectifs ambitieux en termes de limitation du réchauffement et de réduction des émissions de CO2. Ces accords internationaux se déclinent aujourd’hui dans la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte et se traduisent par l’élaboration d’un plan stratégique national de la recherche en énergie.
Les objectifs visés sont clairs : couvrir toute la chaîne de la recherche et de l’innovation, donc développer une recherche amont à bas TRL (Technology readiness level) pour préparer les technologies futures à l’horizon 2050, réunir et mobiliser les masses critiques de chercheurs sur les thématiques prioritaires et mieux coordonner ces recherches pour atteindre les objectifs, mettre en place des groupes de recherche thématiques et multidisciplinaires et enfin développer un partenariat fort entre recherche publique et privée.
Pour répondre à ces objectifs, le CNRS, acteur national de la recherche, participe à ces efforts en développant une recherche amont indispensable à la réussite de cette transition. En effet, les objectifs visés sont ambitieux et les scénarios envisagés aujourd’hui montrent qu’ils seront difficiles à atteindre. En développant une recherche fondamentale d’excellence et en la coordonnant au niveau national, le CNRS sera en mesure de proposer dans l’avenir des ruptures technologiques déterminantes.
J’en donnerai deux exemples, issus de la recherche fondamentale, apparus au cours des trois dernières décennies et qui ont révolutionné notre gestion de l’énergie. Le premier exemple de rupture concerne les batteries de stockage. La première batterie lithium-ion, commercialisée par Sony en 1991, a complètement révolutionné le monde de l’électronique nomade, qu’il s’agisse des ordinateurs portables, des smartphones ou des voitures électriques. Le deuxième exemple concerne les aimants permanents : développés en 1982 par General Motors et une compagnie japonaise, Sumitomo, les aimants au néodyme-fer-bore sont aujourd’hui les aimants permanents les plus puissants du marché et équipent tous les rotors des moteurs des centrales hydrauliques et des éoliennes. Si l’on avait dû bâtir les scénarios de la transition énergétique dans les années 1970, soit avant ces ruptures technologiques, ils se seraient appuyés massivement sur le développement des batteries alcalines ou l’utilisation d’aimants à base de ferrite, avec des performances très éloignées de celles des batteries ou aimants d’aujourd’hui.
Des ruptures technologiques sont donc à attendre dans les décennies à venir et les actions du CNRS pour les faire aboutir sont nombreuses. Elles visent à mieux mobiliser les chercheurs sur des thématiques prioritaires de la transition énergétique et à mieux coordonner ces recherches au niveau national, pour atteindre les objectifs fixés.
Dans ce contexte, le CNRS a créé et anime plusieurs réseaux. Nous pouvons ainsi, dans le domaine du stockage électrochimique, citer le réseau RS2E (Recherche sur le stockage électrochimique de l’énergie) : créé par le CNRS sous l’égide du ministère de la recherche, il met en contact des acteurs publics et privés, pour accélérer la recherche fondamentale et l’industrialisation des nouvelles technologies des batteries et des supercondensateurs. On peut mentionner de récentes avancées dans ce domaine, comme la découverte par les équipes de ce réseau du rôle inattendu joué par l’électrolyte dans le stockage de l’énergie des supercondensateurs. Ces chercheurs ont ainsi réussi, à partir d’électrolytes à base de liquide ionique, à augmenter la capacité de stockage d’un supercondensateur jusqu’à 300 %. Ces résultats ont été publiés récemment dans la revue Nature Materials.
Dans le domaine de l’énergie solaire, la création des fédérations de recherche FédEsol (sur l’énergie solaire), FedPV (sur le photovoltaïque) ou Nanorgasol (sur le PV organique et hybride), ainsi que celle de l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France sont autant d’actions structurantes pour réunir les acteurs de la recherche académique, tels que le CNRS ou l’Ecole polytechnique, et les industriels du secteur, parmi lesquels EDF, Total ou Air liquide. Ces structures, qui regroupent des centaines de chercheurs et des dizaines de laboratoires, seront complétées dans un proche avenir par un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le stockage solaire thermique, avec un soutien du Programme d’investissements d’avenir.
Enfin, dans le domaine de la chimie verte et biosourcée, le réseau Increase ambitionne d’utiliser la biomasse comme une source de carbone renouvelable et de matière première. Créé par le CNRS avec le soutien de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Increase est un réseau collaboratif public-privé dédié à l’écoconception et aux ressources renouvelables.
Parallèlement à ces structures phares, d’autres actions structurantes sont menées, sous la forme de Groupements de recherche (GdR) qui réunissent les communautés des chercheurs autour d’axes forts. On peut citer en particulier le GdR HySPàC, qui a pour vocation de fédérer les chercheurs et les industriels dans les domaines du stockage et de la production d’hydrogène, des piles à combustible et des systèmes associés. Ce groupement, qui rassemble principalement des chercheurs des Instituts de chimie et des sciences de l’ingénieur, devrait évoluer prochainement vers une fédération de recherche réunissant les laboratoires concernés, le CEA, l’AFHYPAC et tous les acteurs industriels du secteur.
Des démarches similaires sont en cours dans d’autres domaines, avec par exemple la création d’un GIS s’appuyant sur un GdR préexistant sur la thermoélectricité.
Ces actions s’appuient volontairement sur une approche multidisciplinaire des problématiques scientifiques. Elles associent la chimie, la physique, les sciences de l’ingénieur, mais aussi les sciences humaines et sociales, pour aborder des problématiques comme l’acceptation sociale des nouvelles technologies ou encore l’analyse des comportements et l’évolution des pratiques en matière de consommation d’énergie.
Ces réseaux ont également vocation à renforcer les collaborations internationales et la visibilité mondiale des acteurs de la R&D française dans le domaine de l’énergie. Ils permettent à nos chercheurs d’avoir une position forte et un spectre large pour répondre aux appels d’offres internationaux.
Ils jouent par ailleurs un rôle clé dans la formation des jeunes chercheurs (doctorants et postdoctorants), mais aussi dans la préparation des formations aux métiers de demain, pour lesquels les demandes seront fortes dans le domaine de l’énergie, pour des postes allant du technicien à l’ingénieur.
L’implication des personnels des unités du CNRS dans la recherche sur l’énergie représente aujourd’hui 300 unités de recherche, 1 625 équivalents temps plein et un budget de 137 millions d’euros. Ces efforts, conséquents, doivent être maintenus et renforcés si nous voulons répondre aux défis qui nous attendent dans le domaine du stockage et de la conversion d’énergie. Le succès ne pourra se bâtir sans la recherche fondamentale, sans des ruptures technologiques, ni une politique d’innovation forte.
En conclusion, le CNRS est prêt à remplir cette mission de recherche grâce à sa capacité à mobiliser son capital humain, à coordonner les programmes de recherche et à offrir une approche multidisciplinaire des problématiques abordées, pour apporter demain les ruptures technologiques qui nous permettront de réussir notre transition énergétique.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie d’avoir cité les exemples d’il y a trente ans. On a en effet souvent tendance à les oublier et à penser que la création scientifique et l’innovation sont des processus itératifs, à pente plus ou moins importante. Or, cela ne fonctionne jamais ainsi.
Je voudrais passer la parole à M. Laurent Lefèvre, d’INRIA, qui va aborder la question cruciale de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans un secteur qui représente une part croissante de la consommation d’énergie dans nos sociétés modernes : celui des équipements informatiques et des réseaux de communication. Est-il possible de continuer à faire appel de façon croissante à ces ressources, sans pour autant faire croître notre consommation d’énergie ?
Je me permets d’ajouter une question subsidiaire concernant la chaleur dégagée par les data centers, mais aussi à moindre échelle par chaque ordinateur individuel : ne serait-il pas possible de la récupérer et de la valoriser, au moins en partie ?
M. Laurent Lefèvre, INRIA AVALON – LIP. Merci, Madame la présidente. Je suis informaticien, chercheur en informatique et vais vous parler des technologies de l’information et de la communication, les fameuses TIC, qui nous permettent de construire une société numérique impressionnante, que nous utilisons chaque jour et qui répond à de nombreux enjeux. Ceci repose sur un ensemble de services distribués à l’échelle de la planète, qui nous sont aujourd’hui indispensables : moteurs de recherche, géolocalisation, réseaux sociaux, transfert et stockage de contenus multimédia. Ces besoins évoluent en permanence et les utilisateurs imposent aux TIC une pression en termes de qualité, de sécurisation, d’instantanéité. Nous sommes ainsi dans un monde en nuage, le Cloud, dans lequel les services et les données sont virtualisés. Tout devient transparent, éventuellement gratuit. Ceci reflète le côté agréable et sympathique des TIC.
Mais cette société numérique que nous avons construite est fragile. Elle repose sur une énergie abondante et peu coûteuse.
Il existe trois grandes familles de technologies de l’information, qui se partagent le monde et les usages des ressources : les équipements terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones), les data centers (qui génèrent effectivement beaucoup de chaleur, que nous essayons de récupérer pour chauffer des quartiers, de l’eau sanitaire, etc) et entre les deux les réseaux. Au niveau mondial, chacune de ces trois familles consomme environ 30 à 40 GW de puissance électrique, ce qui correspond au total à une centaine de gigawatts, soit une centaine de réacteurs nucléaires allumés en permanence dans le monde pour alimenter les TIC.
Le problème principal réside dans le gaspillage observé dans ces trois familles : les data centers sont surdimensionnés pour faire face à un afflux éventuel d’utilisateurs, les opérateurs surdimensionnent les tuyaux des réseaux dans la perspective d’un trafic important, votre smartphone est surdimensionné pour vous permettre de jouer à des jeux en 3D même si vous ne faites que passer des appels et envoyer des SMS, votre ordinateur l’est peut-être également au regard de l’usage que vous en faites. Tous les acteurs surdimensionnent ainsi les équipements dans l’optique d’offrir une meilleure qualité de service, mais génèrent parallèlement un gaspillage considérable.
Finalement, les TIC sont une industrie comme les autres, qui participe aux changements climatiques et à de multiples impacts environnementaux. On pense évidemment à la consommation d’énergie, mais il faut aussi considérer les émissions de gaz à effet de serre, la toxicité humaine, la pollution de l’air, des sols, de l’eau, la consommation et l’eutrophisation des eaux. Malgré une image lisse et dématérialisée, les TIC ne sont pas des technologies propres, à toutes les étapes de leur cycle de vie qui, comme pour tout produit industriel, compte cinq étapes : l’extraction des ressources pour les construire, la conception, le transport, l’utilisation et la fin de vie.
L’extraction des ressources concerne métaux et terres rares. Les besoins dans ce domaine vont croissant : dans les années 1980, on utilisait dix métaux dans les TIC, contre soixante dans les années 2000 – 2010. Ces métaux sont extraits dans des conditions peu satisfaisantes, souvent dans des zones de conflit. Cela coûte de plus en plus cher et engendre beaucoup de pollution.
La conception de l’informatique se déroule aujourd’hui le plus souvent en Asie, avec un certain manque de transparence dans les chaînes de sous-traitance. Cette situation nous arrange toutefois dans une certaine mesure, puisque les gaz à effet de serre ainsi générés ne sont pas comptabilisés en France dans les cycles de vie des produits ; il faudrait pourtant, pour établir un cycle complet, les y inclure.
L’usage des TIC est la partie la plus visible dans les médias, où il est souvent question des data centres, gros consommateurs d’énergie avec leurs millions de serveurs de calcul, que l’on installe près des barrages ou des fjords en Norvège. Les futures machines de calcul, à l’horizon 2022 – 2023, seront « exascale », donc capables d’atteindre une puissance de calcul de l’ordre de l’exaflop, soit 1018 opérations par seconde. Elles pourront être utilisées pour les très grosses applications, comme la prédiction météorologique, le calcul climatique et consommeront une centaine de mégawatts, ce qui correspond à une facture d’électricité de 100 millions d’euros par an. Ces énormes machines vont donc rapidement coûter aussi cher en énergie qu’à l’achat.
La dernière étape du cycle est la fin de vie. Cette phase s’améliore légèrement, les déchets d’équipements électriques et électroniques suivant les filières règlementaires de recyclage. Le problème provient essentiellement du fait que l’on utilise de plus en plus de métaux dans l’informatique, qui sont dispersés dans les équipements, diffus et en très petite quantité, si bien qu’il est difficile de les récupérer. J’ai visité récemment en Belgique l’usine Umicore, l’un des meilleurs recycleurs de métaux en Europe : or sur les soixante métaux présents dans une carte mère ou un smartphone, Umicore n’est en capacité d’en récupérer que 17. Le reste est incinéré, disparaît ou est enfoui.
L’informatique est toutefois une industrie à part. Depuis une dizaine d’années, de nombreuses initiatives de recherche concernent en effet l’efficacité énergétique et la manière de l’améliorer en réduisant les impacts environnementaux. Des chantiers divers et variés sont ouverts au niveau matériel et logiciel. Les constructeurs améliorent le matériel, et les chercheurs le logiciel : les deux doivent aller de pair. Cette écoconception doit être combinée.
Il est également essentiel de favoriser tous les travaux sur l’écoresponsabilité des TIC et d’étudier notamment quatre grandes familles de leviers : les leviers d’extinction (visant à éliminer les ressources inutiles à la volée, de manière dynamique), de ralentissement (pour que l’ordinateur ou l’équipement réseau ne délivre que la puissance nécessaire au service), d’optimisation (écoconception logicielle, green programing) et enfin d’agrégation (pour mettre plus de services sur moins de ressources physiques, par un phénomène Cloud, et limiter le nombre de serveurs allumés par exemple).
INRIA étudie l’ensemble de ces leviers et essaie de les combiner. Dans le domaine des réseaux par exemple, de nombreux équipements réseaux dans l’internet ont un modèle de consommation complètement plat : qu’ils soient utilisés ou non, ils consomment de la même manière et ne sont donc pas proportionnés à l’usage. Il s’agit là d’une source considérable de gaspillage d’énergie, sur laquelle il faut travailler. Ce secteur connaît aussi des initiatives sources d’espoir : de 2010 à 2015, le projet Greentouch, auquel a participé INRIA, avec des industriels et des acteurs académiques au niveau mondial, a réussi à démontrer que l’on pouvait concevoir les réseaux de l’internet avec une consommation diminuée d’un facteur 1 000, tout en garantissant la même qualité de service et en supportant l’explosion de trafic observée durant cette période. Les chercheurs ont fait une preuve de concept, un prototype à très grande échelle. Il faut à présent que cette recherche soit appliquée dans l’industrie, que les industriels prennent ces technologies, les maturent et les transforment en produits. Tout ceci doit se faire en douceur : il n’est pas question de tout remettre en cause du jour au lendemain, au risque de subir des effets rebonds, dans lesquels ce que l’on gagne d’un côté est perdu de l’autre en raison d’un changement trop précipité des équipements.
Les innovations que nous proposons sont souvent en avance de phase avec le monde industriel, ce qui permet de bien borner les progrès attendus et de valider nos modèles énergétiques et théoriques. Pour ce faire, nous avons besoin de plateformes vraiment instrumentalisées, expérimentales, permettant d’effectuer des validations sérieuses ainsi que des preuves de concept solides et reproductibles. J’en mentionnerai deux en France : la plateforme Grid 5000 pour les systèmes distribués et la plateforme Fit pour les réseaux.
On doit aussi former et sensibiliser les nouvelles générations d’étudiants et les ingénieurs présents dans l’enseignement supérieur et la recherche. Je pense notamment à une belle initiative en la matière, sous la forme d’un groupement de services du CNRS nommé EcoInfo, qui promeut l’écoresponsabilité des technologies de l’information et de la communication, les TIC.
Je tiens à souligner par ailleurs que le greenwashing n’est tout de même pas loin et guette dans l’ombre. On entend souvent dire qu’il n’est pas très grave que les TIC consomment de l’énergie, dans la mesure où elles vont pouvoir compenser de nombreux autres usages énergétiques : si je communique par visioconférence, cela va par exemple m’éviter de prendre le train ou l’avion. C’est ce que l’on qualifie d’» IT for green », c’est-à-dire le bon côté des TIC, celui qui permet de réduire certains impacts de l’industrie ou des modes de transport. Cela semble vrai et bien, mais n’est pour l’instant uniquement validé que par certains scénarios bien particuliers. De nombreux autres scénarios montrent que cet impact « IT for green » est vraiment négligeable et encore dans la marge d’erreur des mesures et évaluations. Ainsi, une visioconférence suppose de disposer du système et du réseau adéquat. Cette possibilité de communication à distance va en outre multiplier les contacts avec des collègues à l’autre bout du monde ; or il suffit de prendre une fois l’avion pour aller les rencontrer pour casser tout ce que l’on avait gagné petit à petit et générer davantage de gaz à effet de serre que si l’on avait rendu visite plus souvent à des collègues locaux.
En conclusion, les TIC sont vraiment au cœur de nombreuses sciences (physique, biologie, etc.) et innovations technologiques (voitures autonomes, réseaux, villes intelligentes, etc.). Il est donc vraiment important de favoriser la recherche dans des TIC plus économes, de réduire leur consommation et de maîtriser les effets rebonds. Il faut veiller à ce que les gains énergétiques ne soient pas compensés par un usage plus massif des infrastructures, mais aussi sensibiliser et former nos concitoyens, les encourager à faire évoluer leur usage des TIC. Imposer toujours un usage aussi instantané, avec une aussi grande qualité, à un niveau mondial, fait perdre de grandes marges de gains pour la prise en compte de l’efficacité énergétique. Merci.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à M. Stéphane Sarrade, directeur adjoint de l’innovation et du soutien nucléaire au sein du CEA-DEN, qui va lui aussi évoquer les énergies de demain au travers des pistes d’innovation et des ruptures possibles dans le domaine nucléaire.
M. Stéphane Sarrade, directeur adjoint de l’innovation et du soutien nucléaire, CEA-DEN. Merci beaucoup, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vais effectivement essayer de brosser brièvement un tableau des enjeux du domaine nucléaire en termes de développements et de possibles innovations.
Une bibliographie rapide, dans le monde, des réacteurs en cours d’études, fait apparaître le chiffre de 200 réacteurs possibles. Il s’agit donc d’un secteur assez foisonnant, structuré par le Forum Génération 4, forum international qui regroupe une douzaine de pays et a décidé de se focaliser sur six architectures de réacteurs.
La France est surtout impliquée dans trois d’entre elles, qui fonctionnent toutes avec des spectres neutroniques rapides. La première est un type de réacteur à sel fondu, plutôt étudié par nos amis du monde académique et du CNRS, qui fonctionne avec un combustible liquide mélangé à des sels fondus. Ce réacteur est très abouti en termes de concept. Il manque toutefois, à l’heure actuelle, les sauts technologiques permettant de le mettre en œuvre et d’en évaluer les performances réelles, en termes notamment de comportement des matériaux à haute température et en corrosion vis-à-vis de produits chimiques.
Le second modèle de réacteur, plutôt dans le giron du CEA, est celui des réacteurs à neutrons rapides avec caloporteur gaz, qui constituent pour nous des options à long terme, dans la mesure où ils ont du potentiel, mais connaissent aussi des verrous technologiques liés aux matériaux, aux combustibles et aux développements à mener sur le volet sûreté. Nous sommes par exemple en veille active, avec nos partenaires des pays de l’Est notamment, dans la conception d’un prototype nommé ALLEGRO, qui devrait voir le jour dans ce domaine.
Le CEA est essentiellement focalisé à l’heure actuelle, au sein de la Direction de l’énergie nucléaire, sur la troisième architecture, celle des réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium. Il s’agit du scénario de référence que l’État a validé, notamment au travers du PIA et du financement du prototype ASTRID, de 600 MW de puissance, qui doit nous aider à démontrer techniquement l’intérêt de ce type d’installation. Ce réacteur a été choisi d’une part en raison de l’existence en France d’une maturité technologique suffisante, notre pays pouvant se prévaloir a minima de 35 ans d’expérience du réacteur Phénix, qui a fonctionné dans le Gard, à Marcoule, mais aussi parce que cette architecture permet d’imaginer des innovations, voire des ruptures, dans les domaines de la sûreté, de la compétitivité de l’économie, de la disponibilité, ainsi que de l’inspection et de la réparation en ligne. Il me semble important de mettre en lien ce type de réacteur avec le cycle du combustible que l’on va y associer, puisque ce réacteur permettrait de consommer le plutonium produit par le parc électronucléaire et d’effectuer le recyclage total des matières énergétiques contenues dans les combustibles des réacteurs du parc actuel, mais aussi le plutonium des réacteurs futurs. Ceci permettrait donc une optimisation de la ressource uranium.
ASTRID et le cycle qui lui est associé m’évoquent trois domaines d’innovations. La première se situe dans la forme : le projet ASTRID est en effet assez atypique, puisqu’il s’est traduit dès le départ par la création d’un consortium industriel allant au-delà des acteurs institutionnels en France dans le nucléaire et incluant notamment des partenaires du génie civil. L’idée est ainsi de concevoir dès l’amont non seulement le réacteur, mais aussi son environnement. Ceci peut sembler anodin : il n’en est rien, puisqu’à l’heure actuelle des innovations sont en cours, notamment au niveau du génie civil, avec par exemple le développement de béton en couches, qui constitueraient des ruptures dans la conception d’édifices pour le nucléaire. L’innovation réside également dans le fait que ce consortium est international, dans la mesure où les Japonais nous soutiennent dans le développement.
Le deuxième champ d’innovation est bien évidemment celui de l’innovation technologique, l’objectif étant, à partir des enseignements tirés de notre expérience française de Phénix et Superphénix, d’aller beaucoup plus loin, notamment dans les thématiques liées à la sûreté sur ce type d’appareil.
Parmi les exemples d’évolutions, je citerai notamment la conception du cœur : celui envisagé pour équiper ASTRID, breveté en 2010, sera très particulier, puisqu’il s’agit d’un cœur à coefficient de vidange faible, voire négatif. Ceci signifie que lors d’un transitoire, lorsque se produit une augmentation de température au niveau du cœur, si le sodium devient lui-même gazeux et perd ainsi certaines de ses propriétés, cela n’entraînera pas une augmentation de température du cœur, puisque sa géométrie est telle que les neutrons seront évacués. Il s’agit d’un élément majeur en termes de sécurité. Un autre point de sécurité important concerne la réaction sodium – eau, extrêmement exothermique, donc susceptible de poser des problèmes : l’idée ici est de développer un système de conversion d’énergie, dans lequel un gaz, l’azote, sera utilisé entre le sodium et l’eau, de manière à empêcher tout contact entre ces deux composants. Pour ce qui est de la réactivité, en cas de fuite, du sodium vis-à-vis de l’oxygène de l’air, il faut savoir que des efforts importants en chimie analytique ont permis de diviser d’un facteur 10 les seuils de détection de fuite et surtout de mettre en place des systèmes d’inertage. Le cœur d’ASTRID sera par ailleurs conçu de manière à pouvoir absorber, en cas d’accident grave, un corium, c’est-à-dire le mélange formé par le combustible fondu et le béton. Il est prévu un système assez large de récupération de corium, dans des matériaux très particuliers à base de zircon. Je terminerai en mentionnant la question de la compétitivité : l’objectif est en l’occurrence de disposer de la possibilité d’inspecter et de réparer en ligne.
En termes de cycle, le but est vraiment de consommer et de recycler un certain nombre d’éléments. A l’heure actuelle, nous consommons en France environ 8 000 tonnes par an d’uranium naturel, transformés en 7 000 tonnes d’uranium appauvri et 1 000 tonnes d’uranium enrichi, qui vont fabriquer une dizaine de tonnes de plutonium. L’objectif, avec les réacteurs à neutrons rapides, est de pouvoir procéder à un multi-recyclage, c’est-à-dire à un recyclage permanent de ce plutonium. Si l’on considère par ailleurs le fait que l’on injecterait 50 tonnes par an d’uranium appauvri, on se retrouverait alors dans ce que l’on qualifie de « cycle fermé », qui représenterait une innovation majeure, puisque cela permettrait de fonctionner avec des réserves d’uranium appauvri. Je me permets de vous rappeler que nous disposons à Pierrelatte de 250 000 tonnes d’uranium appauvri, ce qui représente une réserve de 5 000 ans.
Je conclurai en soulignant que le CEA travaille aussi sur d’autres concepts plus novateurs, notamment des réacteurs de petite et moyenne taille, dont l’acronyme anglais est « SMR ». Nous étudions également les applications possibles sur ce genre de réacteur.
Ma volonté au fil de cet exposé était de vous montrer, dans les quelques minutes qui m’ont été imparties, la richesse et la diversité des développements sur lesquels nous travaillons, avec l’objectif d’avoir un nucléaire toujours plus sûr et plus compétitif.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci beaucoup. Je vais enfin passer la parole à M. Bernard Salha, directeur recherche et développement d’EDF, qui va nous faire partager la vision de ce grand industriel national et international sur les axes de recherche pouvant mener à des ruptures technologiques.
M. Bernard Salha, directeur recherche et développement, EDF. Merci, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vais vous donner quelques indications sur les activités de recherche industrielle menées par EDF.
Je commencerai par mentionner quelques éléments d’organisation. EDF dispose d’un potentiel de deux-mille chercheurs environ et d’un budget annuel de plus de 500 millions d’euros pour la Direction recherche et développement. Le groupe mène ses activités sur trois centres de recherche français et sept à l’international. La particularité de notre activité réside dans le fait que deux tiers sont menés au service direct des business units du groupe, tandis qu’un tiers est orientée vers de la prospective, de l’anticipation. C’est là ce que nous qualifions de rupture : il ne s’agit pas à proprement parler de ruptures technologiques, mais plutôt de ruptures d’activité, de modèles différents selon lesquels le métier d’électricien pourrait être exercé. Nous menons bien évidemment cette activité avec d’autres industriels, mais aussi avec des start-ups, ainsi qu’avec le monde académique et la recherche institutionnelle.
Notre activité de recherche s’articule autour de trois grandes priorités, à savoir le développement et la consolidation d’un bouquet électrique compétitif et décarboné, incluant des productions diverses (nucléaire, énergies renouvelables), le développement de nouveaux services pour nos clients et enfin la préparation du système électrique de demain, autour des smartgrids.
Au-delà de ces trois finalités, nous avons défini quatre grands programmes autour des principaux thèmes de ruptures identifiés (au sens de ruptures d’activité).
Le premier concerne l’articulation et la cohérence entre local et global. Le terme « global » renvoie au système électrique qui s’est développé de façon de plus en plus importante, avec des systèmes de grande taille, pour faire face au foisonnement de la demande et utiliser toutes les synergies des différents systèmes. Gérer vingt millions de clients n’est pas nécessairement plus compliqué que d’en gérer dix. Nous voyons également apparaître aujourd’hui des systèmes plus locaux, à l’échelle de quartiers, de villes, de territoires. La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir comment prévoir et dimensionner ces systèmes locaux, comment les articuler avec le système global et assurer l’optimisation de l’ensemble.
Le deuxième grand thème de rupture, relativement classique, concerne le numérique et le digital. Nous le divisons en trois sous-thèmes. Le premier est relatif au numérique pour le client : le maître mot en la matière est les données. Nous disposons déjà et allons disposer de plus en plus de données multiples, très nombreuses. La question est de savoir comment, grâce à ces données, apporter davantage de conseils et de services à nos clients. La même problématique est à l’œuvre dans les systèmes industriels, qu’ils soient de production ou de distribution sur les réseaux : davantage d’instrumentation signifie davantage de données, donc plus de moyens de les utiliser et d’optimisation de la maintenance et de nos investissements. Dans ces deux grands secteurs, l’intelligence artificielle joue un rôle clé. A ces enjeux métiers, s’ajoutent des thèmes transverses comme ceux de la cybersécurité, de la protection de la « privacy » (c’est-à-dire de l’intimité des clients), de la gestion du stockage des données dans des « clouds » nationaux, internationaux, privés ou publics, et enfin des systèmes de télécommunication, dont il faut minimiser les coûts pour en optimiser le fonctionnement.
Le troisième grand thème de rupture concerne des usages très locaux, que l’on globalise autour du photovoltaïque, du stockage et de la mobilité électrique. Nous travaillons beaucoup sur le photovoltaïque et notamment sur la recherche amont dans ce domaine, par le biais d’un institut, l’IPVF, que nous avons créé en Ile-de-France avec nos collègues de Total, du CNRS et d’Air liquide. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux, résumés dans la formule « 30/30/30 » : 30 centimes d’euros, 30 % de rendement, à l’horizon 2030. Nous travaillons aussi beaucoup sur les batteries, qui constituent clairement un sujet de rupture pour nous. Ceci concerne non seulement les batteries lithium-ion, dont il faut optimiser les performances, mais aussi d’autres technologies nouvelles, comme les batteries zinc air, sur lesquelles nous disposons de brevets. La voiture électrique est aussi un sujet important, puisque de nature à multiplier le volume de batteries susceptible d’être mis sur le marché. L’objectif est de faire baisser les coûts de ces batteries par effet de taille industrielle et de pouvoir disposer, si la technique le permet, de batteries de seconde vie, qui pourraient également être utilisées sur le système électrique. La conjonction de ces trois sujets (photovoltaïque ; batteries ; mobilité électrique) est de nature à changer de façon profonde le système électrique. Nous y travaillons donc très fortement.
La quatrième priorité en termes d’objet de rupture concerne le nucléaire et notamment les petits réacteurs modulaires ou SMR (Small modular reactors), dont la puissance est limitée (de l’ordre de 150 à 200 MW, alors qu’un réacteur civil de taille classique se situe plutôt entre 1 000 et 1 500 MW). L’idée est de produire des systèmes plus simples, plus sûrs, plus compacts, plus modulaires, plus faciles à construire et dont les coûts peuvent par conséquent être mieux maîtrisés. L’enjeu technologique de rupture réside dans le fait que la petite taille des installations peut occasionner des coûts plus élevés par rapport aux réacteurs usuels qui bénéficient d’un effet d’échelle favorable : il s’agit donc d’optimiser les coûts associés. Bien évidemment, les réacteurs de grande taille restent notre principale priorité. Pour autant, ces petits réacteurs pourraient présenter un intérêt, à la fois dans des pays émergents en termes de technologie nucléaire, mais aussi en Europe, sur des sites de petite taille n’étant pas susceptibles d’accepter de gros réacteurs. Nos collègues britanniques en particulier ont témoigné de leur intérêt pour ce type d’installation.
Nous travaillons donc sur ces quatre grands enjeux de rupture et considérons que même si la rentabilité immédiate n’est pas au rendez-vous, ces sujets sont majeurs et peuvent changer à terme le système électrique, notre métier et contribuer bien sûr à la réussite de la transition énergétique.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vais à présent ouvrir le débat.
M. Pascal Brault, directeur de recherche au CNRS, délégué scientifique énergie au CNRS, Alliance ANCRE. Ma question porte sur la récupération d’énergie des data centers. Je crois savoir que des recherches sont menées pour minimiser l’efficacité des microprocesseurs et autres systèmes qui consomment de l’énergie dans les ordinateurs ou les baies de stockage. Savez-vous où en sont ces recherches ? La meilleure façon de ne pas perdre d’énergie est en effet de ne pas en produire.
M. Laurent Lefèvre. Des optimisations sont effectuées au niveau de l’électronique et des processeurs. Des systèmes d’arcs silicone permettent par exemple que seule l’électronique réellement nécessaire soit alimentée. La récupération de la chaleur se fait actuellement sous deux formes : les gros centres de calcul, qui sont très denses et génèrent beaucoup de chaleur, essaient de la récupérer pour chauffer des bureaux ou de l’eau dans les quartiers environnants. On observe par ailleurs une explosion d’autres architectures, plus petites, que l’on qualifie de « edge data centers », c’est-à-dire data centers de proximité, plus proches des clients et des services. Le fait que ces installations soient distribuées permet de réduire le problème de densité et de génération de chaleur.
On trouve même, à l’extrême, des morceaux de data centers dans des objets du quotidien comme des chauffages électriques ou des ballons d’eau chaude, sous forme d’un ensemble de calculateurs qui se mettent en route en même temps que l’appareil et chauffent la pièce ou l’eau. La société parisienne Qarnot Computing propose par exemple cela sous forme de chauffages électriques calculateurs. De nombreuses initiatives se développent donc pour tout ce qui concerne le refroidissement et la récupération de chaleur dans les data centers. Ceci représente en effet un coût financier important pour les hébergeurs.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ne pensez-vous pas que les data centers vont, comme tout le reste, être miniaturisés un jour ou l’autre ? Dans l’affirmative, ceci ne se fera-t-il pas au prix de l’utilisation, dans nos ordinateurs, de composants supplémentaires que l’on ne saura pas nécessairement recycler ?
M. Laurent Lefèvre. Il est vrai que nos matériels sont de plus en plus miniaturisés et ont besoin d’être de plus en plus fiables, si bien qu’ils contiennent de plus en plus de métaux, de terres rares. De nombreux travaux sont ainsi menés sur la question de la substitution de ces métaux, dans la mesure où certains sont critiques et sont importés de pays lointains, avec les considérations géopolitiques que cela suppose.
Mais avec l’arrivée du Big Data et des objets connectés (dont on annonce qu’ils seront entre 30 et 70 milliards à l’horizon 2020), on va retrouver de l’informatique quasiment partout. Ces objets vont certes être miniaturisés, mais néanmoins générer de gros volumes de données, qu’il va falloir traiter. Or, la nécessité de répondre à cette demande de type Big Data entraînera une augmentation du nombre de data centers et du service rendu par ces installations. Cette perspective se situe donc à l’opposé de la miniaturisation.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’ai appris hier que Microsoft envisageait de créer trois data centers en France.
M. Abdelilah Slaoui, directeur adjoint scientifique – ENERGIE, CNRS. Ma question concerne les petits réacteurs, les SMR. Un échéancier a-t-il été établi, en termes de temps, de disponibilité, de déploiement éventuellement ?
M. Bernard Salha. La technologie des petits réacteurs est née dans la marine, mais des projets civils fleurissent aujourd’hui un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Chine et en Russie. L’événement marquant en Europe dans ce domaine est la sollicitation du gouvernement britannique, au mois de mars dernier, sous forme d’un avis à manifestation d’intérêt pour présenter des modèles de petits réacteurs susceptibles d’être déployés au Royaume-Uni à l’horizon 2030. La conception reste à faire, tout comme les études détaillées. Nous travaillons aujourd’hui avec nos collègues du CEA, d’Areva, de DCNS et des industriels britanniques à la réalisation d’avant-projets sommaires de tels réacteurs.
M. Stéphane Sarrade. Il est important de noter que les États-Unis et l’Angleterre sont deux pays qui ont perdu depuis longtemps les compétences dans le domaine de l’énergie nucléaire civile. Les seules compétences dont ils disposent et qu’ils maintiennent concernent la propulsion nucléaire. Ce n’est donc pas un hasard si ces deux pays sont moteurs dans le développement des petits réacteurs modulaires. Dans le cas des États-Unis, il faut savoir en outre qu’ils vont plus loin dans la notion de SMR, jusqu’à 600 MW, notamment en douze réacteurs de 5 MW développés par NewScale, ce qui correspond typiquement à la production d’une centrale au charbon américaine. Ceci témoigne bien de leur volonté actuelle de se positionner sur ces éléments. Notez que les Français sont, avec le réacteur I150, très largement dans la course.
Puisque nous sommes là aussi pour rêver un peu, j’entends beaucoup parler, à l’horizon 2030, de l’ordinateur quantique. Cela induirait-il des modifications importantes en termes de consommation d’énergie ?
M. Laurent Lefèvre. Je ne suis pas expert de l’ordinateur quantique, mais puis toutefois vous dire que nous en espérons une très forte amélioration de l’efficacité énergétique ; la conception, tout comme les usages, seront en effet différents.
M. Philippe Baptiste, directeur scientifique, Total. Les usages de l’ordinateur quantique, les codes, les calculs, seront en effet différents de ceux que l’on peut effectuer avec un ordinateur au silicium. Il semblerait que son arrivée ne suffise pas à faire baisser de manière significative la consommation énergétique de data centers.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le terme « ordinateur quantique » est passé dans le vocabulaire courant, y compris médiatique, depuis dix ans, au point que tout le monde pense qu’il existe déjà. Il est parfois lassant de repérer dans le langage usuel des éléments que le monde scientifique et industriel est en train d’envisager d’élaborer. Cette rapidité dans la communication, qui parvient à faire croire aux gens des choses qui ne sont pas, crée à la fois de la peur et de la frustration. Il faut, sans rien cacher, rester d’une extrême prudence et ne pas vendre des hypothèses de travail sur des réalisations qui existeront peut-être dans cinquante ans comme des éléments sur le point d’advenir dans la vie de tous les jours. Je vois là un problème de responsabilité profonde des sachants.
M. Olivier Appert, président de France-Brevets et du Conseil français de l’énergie. Je ne peux qu’appuyer vos propos. Il a largement été question, dans les premiers exposés, de ruptures scientifiques. Or, on vend très souvent du rêve. Une chose est sûre, que j’ai apprise en tant que président d’un organisme de recherche : les ruptures scientifiques ne se décrètent pas. Comme le disait excellemment Michel Rocard, « on ne fait pas pousser l’herbe en tirant dessus ».
Ma première question concerne les deux premières interventions : avez-vous élaboré un bouclage financier des scénarios que vous avez présentés ? Il a en effet été question de chiffrage en mégawatts/heure, mais pas en euros. Combien coûteraient ces scénarios ? Quels seraient les investissements nécessaires et l’impact sur les prix ? Ces modèles sont-ils finançables compte tenu de la situation des finances publiques ?
Mme Nathalie Alazard-Toux. Le scénario que nous vous avons présenté n’a pas fait l’objet d’un chiffrage ; ceci correspond à la deuxième étape du travail, que nous venons tout juste de démarrer. Néanmoins, nous avons effectué ce type d’étude lorsque nous avons développé les scénarios présentés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique et il est vrai que même en considérant des hypothèses d’amélioration des performances en termes de ratio coût – efficacité, on se situe soit sur des investissements plus importants, soit sur des porteurs d’investissements différents.
Dans le cas du transport par exemple, plusieurs scénarios ont été présentés lors du débat national sur la transition énergétique, dont l’un faisait appel à beaucoup d’efficacité énergétique, à des changements de comportements, au développement des transports en commun. Lorsque ce modèle a été évalué par rapport à un autre dans lequel l’accent était mis sur le développement des véhicules électriques, sans grand changement de comportements, on a observé d’un côté essentiellement des dépenses des communautés locales, qui doublaient, voire triplaient, de l’autre une augmentation des dépenses liées plutôt aux usagers (par l’achat de véhicules notamment). Les agents devant supporter les dépenses n’étaient pas les mêmes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous, politiques, sommes en charge d’élaborer la loi, de voter des budgets tous les ans, de prendre des décisions en termes d’autorisation, d’interdiction, de modulation, qui aboutissent à des textes législatifs et à des budgets. Tout cela est très concret. Or, que faire de ces informations ? Je viens par exemple d’apprendre que l’ordinateur quantique était une perspective à si long terme qu’il n’est même pas imaginable de la formuler. Il est très bien que des scientifiques travaillent sur ce sujet, mais la distorsion entre la construction idéale du monde et la capacité concrète que nous avons aujourd’hui de le transformer en objets ou en textes m’apparaît comme un vrai problème, qui n’est pas que politique et philosophique, mais renvoie à la notion de responsabilité collective. Il ne faut pas vendre du vent.
M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne. Il faut, pour vous aider à prendre ces décisions, des outils disposant des bons découpages en termes d’indicateurs. On peut effectivement, comme le signalait Olivier Appert, placer différents scénarios les uns à côté des autres, étudier leurs coûts respectifs et adopter une démarche visant l’efficacité économique. Cela est possible, mais pas toujours fait, car très compliqué. L’une des questions majeures dans ce domaine est de savoir qui paie quoi. Il ne suffit pas de chiffrer les montants en jeu.
L’une des questions n’est par ailleurs pas seulement de s’intéresser à telle ou telle trajectoire, dans le cadre de scénarios contrastés faisant appel à différentes ressources technologiques ou efforts par secteur, mais aussi de considérer la notion de dynamique. Un résultat majeur pour les économistes, que l’on retrouve en construisant des scénarios monétarisés, est que plus l’on va vite, plus le coût est élevé. Ceci constitue un élément central, surtout dans le cas des systèmes électriques. Si l’on veut évoluer rapidement, on peut aboutir à des coûts échoués très importants, car on stoppe alors des capacités qui auraient pu encore fonctionner.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. On sait tout cela. Comme on sait que l’on a certainement raté des choses. Mais peut-on considérer véritablement cela comme un problème, dans la mesure où l’on a fait autre chose à la place ? Je pense notamment aux piles à combustibles voici quarante ans ou à la question du nucléaire dans les sous-marins, qui vivent en autarcie grâce à une technologie que l’on n’a finalement pas développée pour l’appliquer dans d’autres secteurs. Il existe de nombreux exemples de la sorte. Pour ma part, je n’éprouve pas de regret et encore moins de remords, d’une part parce que je n’étais pas là, d’autre part parce qu’il n’est guère productif de passer son temps à battre sa coulpe. D’autres pays ont d’autres types de problèmes. Pour autant, comment optimiser la recherche pour qu’elle n’aboutisse pas à des impasses ?
M. Jean-Guy Devézeaux de Lavergne. L’un des grands problèmes, sur lequel nous travaillons avec nos collègues du CNRS et d’ATHENA, est celui de la décidabilité de ces questions. Nous essayons de définir les indicateurs nécessaires pour quantifier les différents scénarios. Nous allons proposer ceci dans le cadre d’un appel à projets intitulé OASIX. C’est là l’un des cas qui illustrent bien l’intérêt de mobiliser les sciences humaines et sociales pour aborder les questions de décidabilité et de clarté de ce que les économistes peuvent vous apporter. Vos propos montrent bien qu’il existe des manquesdans la manière de faire les calculs et de communiquer auprès de vous, les élus, afin que vous puissiez prendre des décisions.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les élus lisent les journaux ; l’élément clé, ce sont les journalistes.
M. Michel Latroche. Je suis d’accord avec le fait que les ruptures technologiques ne se décrètent pas. Elles existent néanmoins et sont globalement de l’ordre de la décennie. Je pense notamment au lithium-ion ou au photovoltaïque sur les pérovskites. On sait que ces ruptures existent ; il faut ensuite s’en donner les moyens. Si les laboratoires ne disposent pas des moyens suffisants pour développer cette recherche, ils ne pourront pas produire de ruptures technologiques.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je suis tout à fait d’accord, mais j’entends aussi les chiffres. Je suis une scientifique moi-même : j’ai dirigé de gros laboratoires, dans d’autres domaines que celui-ci, et connais le prix de la science. Les chiffres que j’entends depuis ce matin sont de l’ordre de millions d’euros, pas de milliards. Or, les intégrations d’intégrations finissent par consommer beaucoup d’argent.
M. Bernard Salha. Je souhaiterais revenir sur vos propos relatifs à la démarche de choix. Je pense qu’il existe deux réponses très pragmatiques, au-delà de tous les scénarios, par nature toujours très discutables.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je ne mets pas en doute les scénarios, que je trouve absolument passionnants.
M. Bernard Salha. Le parangonnage international est particulièrement instructif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle EDF a installé des centres de recherche à l’étranger. On apprend beaucoup en comparant et en observant ce que font les autres.
Le secteur de l’énergie est par ailleurs extraordinairement compétitif. Les technologies nouvelles y sont très rapidement mises en œuvre. Il peut donc s’avérer intéressant d’établir un lien très fort entre la recherche scientifique, peut-être académique, et l’industrie. Le pont entre ces deux champs est absolument crucial. Il n’est bien évidemment pas question d’affirmer qu’il devrait revenir aux industriels d’orienter la recherche académique ; pour autant, l’établissement d’un lien équilibré et constructif entre les deux parties me semble intéressant.
Ce que nous réalisons dans le cadre de l’Institut photovoltaïque Île-de-France illustre tout à fait cette démarche. Nous travaillons en effet avec des collègues du CNRS et de l’École polytechnique, qui nous apportent du savoir de premier plan, mais aussi avec d’autres industriels (Total, Air liquide, différentes PME). La rencontre entre ces deux mondes est particulièrement constructive. Elle permet à la fois d’avoir connaissance des nouveautés les plus prometteuses (les pérovskites par exemple), mais aussi d’évaluer la capacité de faire évoluer ces découvertes vers des applications réellement industrialisables (en l’occurrence des panneaux photovoltaïques). Il me semble que ce lien entre recherche amont et industrie fait un peu défaut dans le paysage actuel.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Voici plus de dix ans, le photovoltaïque a connu en France un énorme engouement. Je ne parle pas ici de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits, mais de la recherche. De nombreux chercheurs, dans beaucoup d’universités françaises, ont commencé à en fabriquer, y compris dans les salles de TP, avec leurs élèves de licence. Dans au moins cinq villes en France, il ne s’est rien passé au niveau de l’institution : ces chercheurs, essentiellement des maîtres de conférence, n’ont pas été aidés, ni par les industries, ni par la puissance publique. Comment se fait-il que ces initiatives émanant de scientifiques de bon niveau, mais ne disposant pas forcément d’un immense statut et des titres prestigieux des grandes écoles nationales, n’aient pas été soutenus, alors que l’on revient à ce sujet, dix ans après, en créant en région parisienne un institut qui va concentrer l’effort du CNRS ?
C’est une vraie question de fond. Nous sommes une puissance scientifique dans le secteur de l’énergie, dans le domaine industriel, dans le numérique. Pourquoi nous retrouvons-nous dans la situation d’énoncer aujourd’hui des choses qui étaient déjà évidentes il y a dix ans, décennie pendant laquelle les cellules photovoltaïques chinoises ont envahi le marché ? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d’aller chercher ce qu’inventent des jeunes hypersélectionnés et très brillants, au motif qu’ils ne sont pas dans un système normatif qui tend à les concentrer ? Mes questions n’appellent pas nécessairement de réponses immédiates. Vous pouvez également me répondre par écrit ; les éléments confidentiels le resteront.
M. Bernard Salha. Je pense que nous, les industriels, devons sans doute être plus à l’écoute du monde académique, pour prendre connaissance des technologies émergentes prometteuses. Peut-être faut-il également qu’un mouvement se produise dans l’autre sens et que le monde académique soit davantage à l’écoute de nos besoins, afin de pouvoir développer des projets de recherche qui y correspondent.
Se pose ensuite la question du processus permettant d’aller du projet à la phase industrielle. Ceci passe par différentes tailles d’acteurs : start-ups, PME, ETI, grands groupes. C’est peut-être sur cette chaîne qu’il nous faut travailler collectivement.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nos chimistes savent faire cela depuis longtemps en France. Il faut que le monde de la physique et de l’énergie s’en inspire.
M. Philippe Baptiste, directeur scientifique, Total. Lorsque Total fait de la recherche avec le monde académique, nous n’allons pas chercher des personnes susceptibles de faire de l’ingénierie de nos programmes ou de remplacer nos ingénieurs. Notre but est de trouver d’excellents académiques, ayant une démarche très créative, et de construire avec eux un certain nombre de nouvelles technologies et de nouveaux projets.
Nous menons également une recherche qualifiée précédemment de « technologique », passant par des stades permettant une montée en puissance. Il s’agit aussi d’un aspect important.
Dans notre esprit, les deux éléments sont essentiels : il faut à la fois travailler sur le terrain (l’exemple de l’IPVF en constitue une très bonne illustration, puisqu’il réunit des équipes qui sont véritablement forces de proposition et évoluent dans un grand espace de liberté pour construire ces nouvelles technologies et ces projets innovants) et développer des programmes plus construits. Je crois que la plupart des industriels se situent dans cette logique.
QUATRIÈME TABLE RONDE : COMMENT ACCELERER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION POUR L’ÉNERGIE ?
Présidence : Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée,
vice-présidente de l’OPECST.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je donne la parole, pour ouvrir cette quatrième table ronde au cours de laquelle nous nous demanderons comment accélérer la recherche et l’innovation pour l’énergie, à M. Pascal Brault, directeur de la recherche et délégué scientifique énergie au sein du CNRS, qui va évoquer le rôle fondamental des sciences de base pour l’énergie dans la préparation des ruptures scientifiques et technologiques de demain.
M. Pascal Brault, directeur de recherche au CNRS, délégué scientifique énergie au CNRS, Alliance ANCRE. Merci, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, l’alliance ANCRE a créé en juillet dernier un groupe de travail intitulé « Sciences de base pour l’énergie ». Cette initiative est issue du point 3 de la SNRE, visant à structurer la communauté nationale des sciences de base pour l’énergie. Elle a également pour objet de faciliter l’émergence de ruptures technologiques, scientifiques. S’il est évident que ces ruptures ne se décrètent pas, peut-être peut-on toutefois créer les conditions favorables pour qu’elles puissent être accélérées, ainsi que le suggère le titre de cette table ronde.
Dans le cadre de la SNR, de son volet énergie (la SNRE) et de la loi sur la transition énergétique, il a été noté qu’il fallait favoriser l’émergence d’une communauté de recherche interdisciplinaire « Sciences de base pour l’énergie » préparant les concepts en rupture dans le domaine, développer des propositions pour une structuration de la communauté nationale des sciences de base pour l’énergie et faciliter les ruptures spécifiques pour l’industrie française. C’est dans ce contexte que l’ANCRE a créé ce groupe de travail.
Il s’agit d’une démarche coopérative. On ne se situe pas là dans la compétition. L’ANCRE a en effet pour objet de coordonner les activités de recherche des organismes de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et des industriels. L’une des ambitions de ce dispositif est donc de mettre en place et de soutenir dans la durée un programme « Sciences de base pour l’énergie », à l’instar d’initiatives similaires mises en place à l’étranger, en particulier par le Département de l’énergie aux États-Unis et par l’Alliance européenne de la recherche.
L’objectif est d’irriguer la communauté « Énergie » des nouveaux concepts, connaissances et instruments issus des différentes disciplines, ces dernières n’étant pas nécessairement engagées dans des réflexions sur l’énergie.
Il s’agit de fédérer et d’amplifier une communauté basée sur une intelligence collective, c’est-à-dire un processus coopératif et non compétitif. Il a été indiqué précédemment que 5 % des financements alloués par l’ANR étaient consacrés à l’énergie, ce qui crée un processus compétitif entre les équipes. Il nous semble important de restaurer au contraire une démarche coopérative, pour augmenter la puissance de feu, avec le soutien des établissements (EPIC, EPST, universités) et des agences de moyens comme l’ANR, l’ADEME et d’autres encore.
Ce groupe de travail a en outre pour ambition de favoriser les approches génériques et transversales, et d’identifier en particulier les points de coopération susceptibles d’être mis en œuvre avec les domaines situés hors du champ de coordination de l’ANCRE, c’est-à-dire notamment avec les sciences humaines et sociales, le Big Data, etc.
Il s’agit par ailleurs d’assurer une veille permanente des sciences de base et des concepts nouveaux présentant potentiellement un intérêt pour l’énergie et d’en avoir une vision consolidée au niveau national, en lançant par exemple des programmes de recherche.
Pour ce qui est du domaine d’action, l’idée est d’aller jusqu’à la preuve de concept. Ces projets pourront donc se structurer autour de laboratoires « sans mur » (les fameux « réseaux » de la SNRE), sur le modèle des Energy frontier research centers américains, qui regroupent des laboratoires et coordonnent leurs activités de recherche sur des domaines particuliers (photovoltaïque, mécanique quantique, etc). Ceci vise notamment à encourager la prise de risque scientifique. Les programmes dont il est question sont à horizon de dix ou quinze ans. Il s’agit donc de créer les concepts nouveaux, par une démarche bottom-up, c’est-à-dire en partant de la créativité des chercheurs. Ceci s’inscrit dans le droit fil des propos de M. Baptiste sur le rôle des industriels vis-à-vis des scientifiques.
Dans le cadre de ce groupe, deux actions majeures ont été identifiées. La première concerne les matériaux et les milieux innovants. La conception de matériaux pour l’énergie y occupe une grande place, avec des focus sur leur mise en forme et leur caractérisation avancée. Cette action s’articule autour de trois volets : conception de matériaux innovants pour l’énergie, procédés de fabrication innovants et caractérisation avancée pour les systèmes énergétiques, visant notamment à inclure les petites échelles.
La deuxième action proposée concerne la modélisation et les simulations multi-échelles et multi-physiques des systèmes énergétiques. Il s’agit non seulement d’être en capacité d’effectuer des simulations à plusieurs échelles (macroscopiques, microscopiques), mais d’aller jusqu’aux dispositifs en fonctionnement, incluant toutes ces briques de simulation. Cette action comporte elle aussi trois volets : la conception assistée par modélisation et simulation des systèmes et des matériaux, les simulations multi-échelles des matériaux, des milieux et de leurs propriétés utiles pour l’énergie et les simulations multi-échelles des procédés énergétiques, allant jusqu’au couplage de systèmes à l’échelle des territoires (quartier, ville, usine, parc industriel).
Cette identification doit permettre d’organiser, dans le courant de l’année, deux séminaires pilotes, un sur chaque action, pour produire une feuille de route susceptible de permettre une programmation de la recherche dans ce domaine des sciences de base pour l’énergie, en coopération avec le ministère de l’enseignement supérieur, les autres ministères concernés et les agences de moyens.
Je soulignerai pour conclure l’importance des interfaces avec les autres Alliances, dont il a été question dans la table ronde précédente, et des couplages possibles et nécessaires.
Sur la première action, une forte interaction est possible (et a d’ailleurs déjà démarré) avec l’alliance ATHENA, qui a produit sa propre feuille de route « sciences de base », publiée dans un livre numérique intitulé L’énergie des sciences sociales, disponible gratuitement sur son site web. Sa réflexion s’appuie sur quatre éléments principaux : les visions du futur et scénarios, la gouvernance des politiques de l’énergie, les marchés, régulations et modes de consommation et enfin les territoires et recompositions sociales.
Une interaction est également possible, dans le cadre de ce premier défi, avec l’alliance ALLENVI, sur la question des ressources minérales, et avec Aviesan sur les nanomatériaux, en lien avec la santé, la bioéthique et la biophysique.
Pour la deuxième action, un lien a également été établi avec ATHENA sur les réseaux intelligents et avec ALLISTENE bien sûr sur les technologies de l’information et de la communication.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les questions d’effacement font-elles l’objet de travaux de recherche scientifiques ?
M. Pascal Brault. Tout à fait. L’une des questions relatives à l’effacement de la pointe est liée à celle du stockage qui va permettre de le réaliser. Les laboratoires qui travaillent sur la grille envisagent donc aussi la question de l’effacement, du foisonnement, etc.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Personne n’en parle jamais.
M. Pascal Brault. Peut-être, mais je pense que les laboratoires sont actifs sur ce sujet qui est effectivement d’importance, en lien avec la question du stockage.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vais passer la parole à M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, instance qui joue un rôle pivot dans l’élaboration de cette nouvelle stratégie de recherche.
M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Merci, Madame la présidente. Si vous me le permettez, et pour pousser jusqu’au bout la logique de collaboration que nous entretenons avec la DGRI, je souhaiterais solliciter la possibilité de partager mon temps de parole avec mon collègue Frédéric Ravel. Ceci nous permettra de bien illustrer le fait que la SNRE s’intéresse beaucoup, au-delà du ciblage des thématiques intéressantes pour la transition énergétique, aux questions d’organisation collective. Je vais par conséquent, si vous en êtes d’accord, laisser tout d’abord Frédéric Ravel s’exprimer.
M. Frédéric Ravel, directeur du secteur énergie au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Notre rôle est, comme cela vient d’être souligné, de créer les meilleures conditions possibles pour que les idées puissent un jour naître et se multiplier.
Le terme « rupture » tel qu’utilisé dans la vie quotidienne sous-entend la séparation de deux mondes. Or, dans la recherche, ceci relève plutôt de la rencontre de deux univers : pour que des ruptures se produisent, il faut en effet faire se rencontrer des populations, des types de chercheurs, qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. En France, les Alliances de recherche se sont construites depuis 2009 et se sont attachées dans un premier temps à se forger leur propre identité. Les cinq Alliances, toutes différentes les unes des autres, ont passé les quelques premières années à élaborer chacune sa propre image. Aujourd’hui, toutes sont majeures et le défi actuel est de parvenir à les faire travailler ensemble. Or, ceci n’est pas facile.
Prenez par exemple ANCRE, l’alliance des sciences humaines et sociales : elle utilise un langage particulier, qui n’est pas celui du chercheur physicien ou chimiste. L’enjeu est donc, en exploitant les pistes définies par la SNRE, de parvenir à établir des passerelles et à faire se rencontrer ces univers différents. Nous y sommes particulièrement attachés.
De même, les mondes du numérique et de l’énergie doivent travailler ensemble, mais ont une constante de temps terriblement différente : le numérique change tous les six mois, alors qu’il faut dix ans au secteur de l’énergie pour qu’une découverte effectuée dans un laboratoire parvienne à produire pour le client une électricité ou une chaleur avec un niveau de fiabilité satisfaisant. Pour autant, il s’agit d’un défi passionnant. Le groupe qui vient d’être créé entre ANCRE et ALLISTENE est de bon augure.
La Stratégie nationale de la bioéconomie a déjà apporté la preuve que les deux mondes représentés par ANCRE et ALLENVI pouvaient travailler ensemble. Il convient à présent de développer un nouveau thème de collaboration ayant pour objectif de quantifier les impacts environnementaux de la transition énergétique.
Le deuxième point de mon intervention concerne la constitution de réseaux de recherche et de développement. Nous disposons en France de chercheurs abondants et de valeur. Nous pensons néanmoins qu’il est important de travailler à des mises en réseaux, susceptibles de permettre la mobilisation des masses critiques et coordonnées de chercheurs, sur chaque thématique.
Il convient tout d’abord de travailler sur l’existant, ce qui correspond au S de la matrice d’analyse SWOT. Nous avons des forces, sur lesquelles il faut capitaliser en priorité. La première de ces forces est l’Alliance ANCRE, qui a déjà produit des feuilles de route programmatiques et dont nous attendons qu’elle en produise d’autres. Nous pensons en effet qu’il est indispensable, pour guider cette recherche, de faire appel aux spécialistes de la recherche ; il n’appartient pas à un ministère de remplir cette tâche. Les feuilles de route élaborées par ANCRE représentent donc l’un des premiers moyens de cette mise en réseau.
Le second aspect de ce travail sur l’existant renvoie au O de SWOT : les très grandes infrastructures de recherche (TGIR) constituent en France un réseau partagé entre les chercheurs. Il existe cinq TGIR dans le domaine de l’énergie, qui couvrent le solaire, le photovoltaïque, la capture du CO2, les énergies marines et les matériaux pour la fusion. Elles doivent servir de points de cristallisation et de mise en réseau entre les chercheurs.
Il est également envisageable de s’appuyer sur les outils collaboratifs du programme Horizon 2020, tels que les Eranets ou des entreprises conjointes. La création en France de « groupes miroirs » de ces spécimens bruxellois pourrait peut-être permettre de développer une position consolidée et plus large de l’ensemble de la communauté de recherche française.
Le deuxième aspect renvoie au fait que l’on dispose déjà de réseaux, dont le RS2E (Réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie), qui existe depuis 2010 et dont il est possible de s’inspirer, essentiellement dans les domaines de l’hydrogène et des matériaux. Il semble possible de dupliquer dans ces secteurs l’expérience réussie du RS2E. Les outils susceptibles d’être mobilisés dans ce cadre sont en partie ceux du PIA2, à savoir les LABEX (les laboratoires d’excellence), qui effectuent déjà de la mise en réseau de laboratoires académiques disséminés sur le territoire et permettent de concentrer et d’avoir une masse critique de chercheurs.
Le dernier point concerne la mise en réseau à l’échelle locale. Les ISITE, IDEX et autres COMUE, objets tant critiqués dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, présentent au moins un avantage : ceux d’entre eux qui sont concentrés sur la transition énergétique (ils sont au moins au nombre de cinq : à Paris-Saclay, à Marseille, en Lorraine, à Lyon Saint-Etienne, à Grenoble) doivent servir de germe à la fameuse mise en réseau, en commençant localement et en s’étendant peu à peu au niveau national.
M. Guillaume Méheut, directeur de cabinet de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. S’ajoute à cette démarche la dimension de travail avec les entreprises. La vision développée dans les feuilles de route doit en effet pouvoir être réalisée en associant les groupes programmatiques d’ANCRE et les entreprises. Cet objectif doit pouvoir se concrétiser à l’occasion des prochaines mises à jour de nos feuilles de route.
En termes de soutien à la R&D, il faut également considérer l’approche collaborative public-privé. Dans les actions du Programme d’investissements d’avenir par exemple, l’ADEME finance de nombreux projets collaboratifs, associant des établissements de recherche et des entreprises. Les Instituts de la transition énergétique représentent une autre tentative très ambitieuse de rapprochement, au sein de sociétés, de laboratoires et d’entreprises. Au-delà de ces gros objets, il est également important de parvenir à mobiliser les petits acteurs, les PME.
La plupart des grands groupes français sont en outre très actifs sur l’open innovation. Il convient aussi de citer les pôles de compétitivité, qui permettent de faire remonter, notamment dans le PIA ou le FUI, des projets avec des PME. Il faut poursuivre et consolider ce type de démarche, qui est inscrite fortement dans la SNRE.
Se pose par ailleurs, au niveau public, un véritable enjeu de coordination entre toutes les échelles géographiques : local (les régions ayant de plus en plus de prérogatives, de financements et de stratégies dans ce domaine, autour notamment des nouvelles Stratégies régionales de développement économique et d’innovation), national (avec les divers outils mentionnés ce matin, sachant que l’on dépense chaque année un milliard d’euros au niveau de l’État pour la R&D en énergie) et international (avec le programme Horizon 2020 ou des initiatives comme la Mission Innovation). Il faut parvenir à articuler tous ces dispositifs, ne serait-ce que pour une question de simplicité, de lisibilité (afin que les chercheurs ne perdent pas de temps à trouver le bon guichet) et de cohérence. Nous menons par exemple un travail avec Régions de France pour déterminer quelles régions ont priorisé tel ou tel domaine : ceci nous permettra de déceler les éventuels manques ou duplicata, de vérifier que les équipes de différentes régions savent que leurs voisins travaillent sur le même sujet, de favoriser les projets communs et de voir comment porter à Bruxelles un discours français qui soit le même au niveau de l’État et des régions en termes de demande d’allocation des crédits européens : pourrait-on par exemple parvenir à convaincre la Commission européenne qu’il faudrait financer davantage la recherche fondamentale et ne pas se concentrer uniquement sur les objets d’industrialisation ?
C’est cet environnement qu’il convient de construire. Il faut pour cela réunir, ainsi que cela a été le cas pour l’élaboration de la SNRE, toutes les parties prenantes de notre comité de suivi (associations, élus, chercheurs, entreprises), afin de continuer à se doter d’une stratégie collective.
Cette approche territoriale devient de plus en plus nécessaire dans l’expérimentation même des nouvelles solutions. On se situe de plus en plus dans le cadre d’une expérimentation de solutions de systèmes énergétiques qui vont mettre en œuvre, simultanément et sur un même territoire, de nombreuses technologies. Je pense notamment au cas des réseaux électriques intelligents, pour lesquels ont été sélectionnés des territoires pilotes sur lesquels on espère pouvoir tester toutes les solutions, en termes de maîtrise de la demande, de flexibilité ou de management du réseau. Rassembler toutes ces briques technologiques nécessite de pouvoir réunir tous les acteurs autour de la table, et pas seulement une entreprise et un utilisateur : doivent aussi être impliqués la collectivité territoriale concernée, des usagers, des entreprises et des laboratoires de recherche. Ceci doit également faire l’objet d’un retour d’expérience, afin de pouvoir éventuellement répliquer la solution ailleurs. C’est cet ensemble que nous devons réussir à organiser.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit là, indéniablement, d’un énorme défi, qui concerne essentiellement la France métropolitaine. Or, les départements d’outre mer, qui sont généralement des territoires insulaires, sont aujourd’hui massivement alimentés en énergie par desnavires-citernes . Que faire dans ce cas ?
M. Guillaume Méheut. Les DOM constituent un formidable territoire d’expérimentation pour les nouvelles technologies, précisément parce que le coût de l’énergie y est si élevé qu’il devient vite rentable d’utiliser des solutions à la pointe. Nous disposons, dans le cadre du PIA, de projets mis en œuvre outre mer, notamment sur la question du stockage. Sans doute faut-il renforcer cela. Dans le PIA 3, qui est en train de démarrer, un chapitre, intitulé Territoires d’innovation et de grande ambition, vise justement la mise en œuvre de nouvelles technologies en lien avec les territoires. Ceci reste à construire.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les départements d’outre mer constituent l’un des rares endroits en France où il est possible de mettre facilement en œuvre de la géothermie. Or, personne ne semble évoquer cet aspect, pas plus d’ailleurs que celui de la minéralisation – déminéralisation, qui sont pourtant des éléments de chimie sur lesquels nous disposons de compétences scientifiques.
M. Guillaume Méheut. Dans la SNRE, un encadré évoque cette dimension dans le chapitre consacré à l’idée de bâtir la R&D en se basant sur les filières déjà performantes et en en développant de nouvelles. La géothermie est citée dans ce cadre. Elle concerne non seulement l’outre mer, mais est aussi intéressante à l’export. La SNRE développe d’ailleurs cet axe et précise que l’on ne développe pas de la R&D et des filières uniquement pour le marché national, ce qui serait par trop réducteur, mais en envisageant l’ensemble du contexte et des marchés internationaux. Une alliance sur la géothermie a d’ailleurs été lancée à l’occasion de la COP 21, dont la France est, avec l’Islande, l’un des piliers.
M. Frédéric Ravel. Je souligne par ailleurs qu’il existe, dans les filières, une fiche documentaire sur la géothermie.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je suis géologue de formation, ce qui explique sans doute ma sensibilité à ce sujet, qui concerne d’ailleurs également la France métropolitaine : on sait très bien par exemple que pour descendre des forages pétroliers aux profondeurs pertinentes, il faut une maîtrise scientifique et technologique de très haut niveau, notamment en raison des températures rencontrées. Ce sujet dépasse donc le périmètre strict de l’énergie. La recherche sur l’énergie concerne l’ensemble du spectre, qui englobe la maîtrise de l’énergie, sa transformation, sa vente, sa consommation, son économie. L’utilisation de la compétence est aussi là.
La parole est à Mme Clarisse Angelier, déléguée générale de l’Association nationale de la recherche et de la technologie, qui va traiter d’une question fondamentale pour accélérer la recherche, au-delà même du domaine de l’énergie : celle des doctorants.
Mme Clarisse Angelier, déléguée générale, Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre accueil et de votre invitation.
Le sujet qu’il m’a été demandé d’aborder repose sur deux thématiques : d’une part les CIFRE vs. l’énergie, d’autre part l’ANRT vs. la SNRE. C’est la raison pour laquelle M. Appert et moi allons intervenir de concert.
La question nous a été posée de savoir comment les CIFRE se comportaient depuis dix ans quant aux sujets de l’énergie et des transports. Je rappelle que le dispositif CIFRE relève d’un financement partenarial public – privé et repose sur une thèse. Il réunit aujourd’hui 4 200 doctorants, tous secteurs d’activité et toutes disciplines scientifiques confondus. Les sujets liés à l’énergie correspondent depuis dix ans à près de 1 500 travaux, avec une courbe en cloche : entre 2000 et 2008, le nombre était d’environ 100 thèses par an, pour monter à 150 en 2010-2011, et une centaine à nouveau dans les années les plus récentes. Ces travaux ont été portés aux deux tiers par de grands groupes, le tiers restant étant le fait de PME et d’ETI. Ils ont convoqué essentiellement les sciences de l’ingénieur, la chimie et les mathématiques.
Il faut savoir par ailleurs que nous ne disposons pas de quota. La relation entre les entreprises et les laboratoires de recherche s’inscrit dans le cadre d’une demande. Nous répondons à une offre. Il me semble très important de veiller à développer ces relations partenariales public-privé autour de thèses de doctorants.
Je voudrais rappeler que les sciences humaines et sociales représentent 25 % de notre dispositif. Si les technologies sont importantes, il a également été beaucoup question, depuis ce matin, des usages. Or, je pense qu’il y a matière à développer des travaux autour des croisements entre technologies et SHS. Se pose aussi la question, au-delà des notions de gouvernance telles que vues par les politiques, les entreprises ou les experts, de la perception de l’individu : il reste, me semble-t-il, un travail considérable à accomplir dans ce domaine. Il faut en effet mettre au centre des réflexions les micro-choix quotidiens que ces sujets imposent à chacun. Je pense que la recherche doit aider les individus à effectuer ces choix et les éclairer sur les problématiques et les enjeux.
L’ANRT a publié, au sujet de la SNRE, une note élaborée grâce aux membres de l’Association, qui ont exprimé, parallèlement à l’audit relatif à la construction de la SNRE, la manière dont ils envisageaient la mise en œuvre concrète de cette Stratégie, afin qu’elle ne soit pas un rapport de plus, mais permette véritablement aux entreprises d’être actrices de la transition énergétique. Nous espérons d’ailleurs que l’ANRT et ses membres pourront continuer à travailler sur ce sujet. Je passe sans plus tarder la parole à mon voisin, qui est plus légitime que moi pour intervenir à ce propos.
M. Olivier Appert, président de France Brevets et du Conseil français de l’énergie, délégué général de l’Académie des technologies, président du groupe de travail de l’ANRT sur la SNRE. Je vais présenter les résultats du groupe de travail mené par l’ANRT avec les entreprises sur la SNRE, dans le cadre de Futuris.
Une demi-douzaine de messages ressort clairement de ces travaux. Apparaît tout d’abord la nécessité, dans le domaine de l’énergie, de privilégier la recherche technologique et de viser le marché mondial. Il faut également préserver une articulation étroite avec la recherche fondamentale, mais aussi prendre en compte la maturité de chaque technologie, s’interroger sur les coûts et les stratégies d’entreprise, élaborer des feuilles de route sur quelques grandes filières, avec des objectifs chiffrés partagés, et intégrer pleinement les défis du numérique. Il semble enfin urgent de simplifier le millefeuille institutionnel français de la recherche et de l’innovation.
La SNRE est la déclinaison de la SNR dans le domaine économique stratégique de l’énergie. Elle ne concerne donc pas directement la recherche fondamentale, qui vise à développer les connaissances, mais doit privilégier le domaine de la recherche technologique. En ce sens, il est indispensable d’y associer étroitement les entreprises. Je rappelle que, dans le secteur de l’énergie, plus de 50 % de l’effort de R&D national est réalisé par les entreprises, d’où le groupe de travail animé par l’ANRT sur la SNRE.
Ce groupe comportait bien entendu les grandes entreprises du secteur, mais aussi des PME et des ETI, que l’on oublie trop souvent et qui jouent pourtant un rôle important dans la dynamique de l’innovation. Je regrette que, dans cette audition publique, les entreprises ne soient pas représentées à leur niveau de contribution à l’effort de R&D et d’innovation, et notamment que ne figure autour de cette table aucune ETI ou PME.
Les problématiques de l’énergie, tout comme la diffusion de la technologie, sont clairement mondiales. Il est donc indispensable que la stratégie de recherche vise le marché mondial. Elle doit par ailleurs avoir pour objectif de créer des emplois. Dans cette optique, une association étroite avec les entreprises est totalement indispensable, car ce sont elles qui, in fine, créeront de la valeur et des emplois.
La recherche technologique n’a pas pour objet de développer les connaissances. Il est cependant très important de préserver une articulation étroite avec la recherche fondamentale, incontournable pour contribuer à lever les verrous technologiques. Les entreprises ont ainsi indéniablement besoin de l’apport des sciences.
Dans le secteur de l’énergie comme dans tous les développements technologiques, il est en outre indispensable de prendre en compte la maturité de chaque technologie. Les technologues utilisent pour ce faire une échelle intitulée TRL (Technology Readiness Level). Ainsi, on ne peut pas mettre sur le même plan une expérimentation de laboratoire de TRL1 et un démonstrateur de TRL6 : les risques et les modalités de financement n’ont en effet rien à voir. Je voudrais insister sur le rôle clé joué par les démonstrateurs, en particulier dans le domaine de l’énergie : ils sont indispensables pour transformer une invention de laboratoire en une innovation qui trouve son marché. Il faut toutefois savoir que plus l’on est proche du marché, plus les investissements sont conséquents. La réalisation de ces démonstrateurs nécessite ainsi une articulation entre financements des entreprises, financements publics et financements bancaires. Sur ce plan, il me semblerait nécessaire de réaliser un retour d’expérience des démonstrateurs déjà réalisés dans le cadre du PIA1 et du PIA2.
Si l’on veut que les efforts de R&D débouchent sur des créations de valeur et d’emploi, il faut s’interroger sur les coûts et les stratégies d’entreprise, évaluer l’état de la concurrence mondiale et s’intéresser le plus précocement possible au tissu de production industrielle qui commercialisera cette technologie sur le marché mondial. Ceci a notamment été entrepris avec succès en France dans le domaine des hydrocarbures et du nucléaire. Les coûts doivent être évalués le plus précisément possible à chaque phase de développement. Si les aides publiques peuvent accélérer le déploiement d’une technologie, les entreprises ne sauraient baser l’émergence d’une technologie au niveau mondial sur des subventions durables. Nous connaissons trop d’exemples de projets lancés et subventionnés grassement, qui ne prennent en compte ni les coûts, ni les stratégies d’entreprise. Ceci est notamment le cas de la Route solaire, présentée en décembre dernier.
Il est indispensable de renouveler notre capacité d’analyse collective en impliquant tous les acteurs et pas uniquement les acteurs publics. Ceci devrait se faire par l’élaboration de feuilles de route sur quelques grandes filières, avec des objectifs chiffrés et partagés. Les travaux menés par ANCRE s’inscrivent parfaitement dans cette optique. La création de valeur devrait être considérée comme un critère important pour identifier les priorités en matière de recherche et d’innovation dans le secteur de l’énergie. Ces feuilles de route ne sont pas un rapport de plus, mais un objet dynamique impliquant tous les acteurs, dans la continuité. Elles nous apparaissent comme un outil de pilotage indispensable aux pouvoirs publics et aux entreprises. Elles aideront sans doute également l’OPECST à remplir sa mission d’évaluation.
L’irruption récente des technologies numériques représente en outre non seulement un défi, mais aussi un atout pour les entreprises. Dans le secteur de l’énergie, la valeur ajoutée se déplace souvent de la brique technologique de base vers des systèmes globaux ou des systèmes de systèmes. Dans ces domaines, la France peut faire jouer une expertise reconnue dans le numérique. Il serait souhaitable de lancer en la matière des programmes ambitieux, sous la forme de partenariats public – privé.
Les entreprises considèrent enfin qu’il est urgent de simplifier le paysage institutionnel français de la recherche et de l’innovation, devenu trop complexe, illisible et absolument inaccessible pour les PME et les ETI. Il faudrait à tout le moins accroître les synergies entre les différentes structures de recherche partenariale qui se sont accumulées les unes au-dessus des autres. L’objectif pourrait être d’arriver à une cartographie claire et simplifiée par filière, en termes de plateformes technologiques. Les pôles de compétitivité (dont on a trop peu parlé jusqu’à présent), impliqués directement ou indirectement dans le domaine de l’énergie, devraient jouer un rôle plus important, en particulier pour les PME et les ETI. Ceci suppose toutefois d’améliorer la gouvernance interne des pôles et leur coordination. Ces derniers devraient enfin tenir une place plus importante auprès des PME et des ETI pour les accompagner dans l’obtention des financements européens, qui constituent un véritable casse-tête pour les entreprises (notamment les petites entreprises) et les organismes de recherche.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. De nombreuses questions ont été soulevées aujourd’hui, auxquelles des pistes de réponse ont été apportées. Il apparaît que de nombreux changements sont nécessaires, mais qu’il existe aussi des potentiels considérables. Nous sommes un pays puissant dans ces domaines, en matière de science et d’innovation. Nous sommes toutefois confrontés à un problème de visibilité et de rapidité. Le pas de temps est parfois un peu long dans ce qui n’est pas pré-décidé, notamment en matière de grosses stratégies énergétiques. Il existe là un espace de progression intéressant.
Je voudrais passer la parole, pour conclure cette table ronde, à M. Philippe Baptiste, directeur scientifique de Total, qui va donner la vision d’un grand industriel sur l’accélération de la recherche et de l’innovation en matière d’énergie.
M. Philippe Baptiste, directeur scientifique, Total. Merci, Madame la présidente. Je suis directeur de la R&D du groupe Total. La question posée par l’intitulé de cette table ronde est évidemment au cœur de nos préoccupations.
Nous avons pour ambition d’être la major de l’énergie responsable. Ceci signifie, aujourd’hui et demain pour Total, un spectre d’activités et de recherche extrêmement large, allant des biotechnologies au solaire (secteur dans lequel nous sommes l’un des leaders mondiaux), en passant par nos activités plus traditionnelles, autour de l’exploration, de la production, du raffinage, des polymères, des lubrifiants ou encore des chimies de spécialité.
Nous investissons massivement dans les activités de recherche et développement, à hauteur d’un peu plus d’un milliard d’euros par an. L’innovation ouverte existait par ailleurs avant même que l’on emploie ce terme : on parlait alors de partenariat entre des industriels, des PME et le monde académique. À titre d’illustration, plus de mille partenariats sont ainsi noués aujourd’hui par le groupe avec des instituts de recherche publics et privés, des universités ou d’autres industriels, sur des questions de R&D. 200 brevets sont déposés en moyenne chaque année. Les activités de recherche et développement représentent ainsi une part importante de l’effort du groupe pour préparer l’avenir, dans un monde de l’énergie en évolution constante et rapide.
J’ai prévu d’aborder trois aspects, envisagés du point de vue d’un gros industriel comme Total et articulés autour de la question suivante : de quoi avons-nous besoin pour accélérer la recherche et l’innovation dans le domaine de l’énergie, aujourd’hui et demain ?
Je commencerai par évoquer les hommes, qui sont essentiels : nous avons besoin de compétences. Cet effort est au cœur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Il nous faut des gens très bien formés, au niveau master et PhD. L’effort effectué par l’ANRT via le dispositif des CIFRE est par exemple tout à fait fondamental pour nous, car c’est selon nous le moyen essentiel de transférer de la compétence de nos laboratoires de recherche publics vers les entreprises. Je crois par ailleurs que des passerelles public – privé restent encore à construire, au-delà simplement du recrutement d’étudiants ou de jeunes post-doctorants. Il faut établir des passerelles en termes de ressources humaines, entre des chercheurs qui sont aujourd’hui dans les laboratoires publics et qui pourraient venir demain dans nos laboratoires privés, mais aussi dans l’autre sens. Tout ceci reste encore à mettre en œuvre, éventuellement sur des durées courtes, de l’ordre de quelques mois à quelques années. Un enrichissement mutuel est possible dans ce domaine. Les dispositifs nécessaires existent, mais sont encore insuffisamment utilisés. Ce sont pour nous, potentiellement, des sources de montée en compétences extrêmement importantes.
Je souhaitais en deuxième lieu aborder la nature des partenariats de recherche entre Total et son environnement. Il a été rappelé à plusieurs reprises aujourd’hui, à juste titre, que les problématiques de l’énergie étaient mondiales. Ceci semble évident. La recherche se joue également au niveau mondial. Notre volonté est avant tout de travailler avec les meilleurs. Lorsque nous allons chercher nos partenariats, nous nous situons ainsi dans une logique de recherche de l’excellence académique. Nous souhaitons avoir les chercheurs les meilleurs possibles dans leur domaine, avec en général une ouverture interdisciplinaire leur permettant de concevoir des champs de recherche au-delà même de leur spécialité. Ceci peut se jouer en France (c’est le cas pour environ la moitié de nos collaborations aujourd’hui), mais aussi à l’étranger. Cette volonté de travailler avec le monde académique, dont les recherches ne sont pas nécessairement programmées, mais sont des recherches de rupture de nature relativement fondamentale, constitue un élément auquel nous croyons beaucoup, car c’est là que s’instruisent les ruptures technologiques de demain.
Bien entendu, nous menons également un travail autour de feuilles de route, d’une recherche plus technologique, qui va nous permettre de monter dans l’échelle des TRL précédemment mentionnée, en passant notamment par des démonstrateurs, puis par des pilotes. Ceci s’effectue en collaboration avec des universités et des centres de recherche. Je pense qu’il faut disposer des outils pour continuer à mener de telles démarches de la manière la plus souple possible.
Il existe aujourd’hui, en France particulièrement, un très grand nombre de dispositifs permettant une collaboration entre différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ceci témoigne de l’importance accordée à ce volet par la puissance publique. Ce foisonnement est d’ailleurs presque trop important, ce qui nuit à la lisibilité globale du dispositif. Sa dynamique est en outre inquiétante, puisque le nombre de structures qui se créent et de sigles qui apparaissent chaque année dans ce domaine doit certainement doubler tous les ans. Peut-être y a-t-il là un travail absolument essentiel à mener en vue d’une stabilisation des dispositifs existants. Lorsqu’on connaît très bien un environnement, il est possible de s’adapter ; mais dans le cas contraire, il est très difficile de s’y retrouver. Il m’apparaît ainsi indispensable d’œuvrer à une certaine pérennité et stabilité de l’existant, ne serait-ce que pour rassurer les partenaires industriels.
Je pense aussi qu’il existe, parmi les collaborations et dispositifs existants, des dispositifs de type IRT, ITE, très pilotés. Il me semble important de ne pas oublier, à côté de cela, d’autres dispositifs plus « bottom-up », qui permettent de valoriser des recherches menées entre des équipes industrielles et académiques qui se connaissent et travaillent efficacement ensemble. Je pense en particulier aux dispositifs Carnot, qui existent de longue date, fonctionnent extrêmement bien et présentent l’avantage d’être poussés par des équipes qui se connaissent, ce qui constitue selon moi une réelle valeur ajoutée dans la co-construction de travaux de recherche.
Je crois enfin que la puissance publique doit jouer un rôle moteur dans le déploiement des innovations et des ruptures dans le domaine de l’énergie. L’enjeu carbone et la question de notre capacité à aller vers une empreinte carbone plus faible sont par exemple aujourd’hui un sujet sur lequel nous travaillons énormément. Nous montons ainsi très fortement en puissance sur les technologies de capture, de transport, de stockage et d’utilisation du CO2. De nombreux travaux de R&D sont menés dans ce domaine. Si l’on veut un jour être capable de passer à une phase industrielle, il faudra que l’on ait un prix du carbone, qui soit raisonnable. Le politique a en la matière un rôle à jouer, en France comme à l’échelle internationale. Certains pays se positionnent aujourd’hui de manière extrêmement forte sur ces questions : je pense notamment à la Norvège, mais aussi à la Chine. Il me semble nécessaire de mener une véritable réflexion sur ces sujets et d’affirmer une réelle volonté d’avancer, sans laquelle nous nous limiterons à de la R&D, sans possibilité de passer à des phases industrielles.
Je crois aussi que face à ces évolutions extrêmement rapides du monde de l’énergie, un travail doit être mené, dans lequel l’État et le Parlement ont un rôle à jouer, sur la manière dont celles-ci vont être acceptées demain par l’ensemble de la société. Nous sommes face à des changements brutaux. Prenons l’exemple du stockage du carbone : serons-nous demain en mesure de proposer, à tel endroit en France, de stocker des millions de tonnes de CO2 dans le sous-sol ? Cela est technologiquement faisable ; est-ce pour autant socialement acceptable ? Ces questions, qui se posent également pour l’implantation de champs d’éoliennes par exemple, doivent être posées avant que le sujet ne soit d’actualité. Il est important, dans ce domaine comme dans d’autres, de travailler en anticipation, avec la société, pour simplement présenter les faits et les enjeux, ainsi que les évolutions de nos usages et de notre environnement qui vont en découler. Il faut s’y préparer.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous allons à présent ouvrir le débat.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je souhaiterais ouvrir la discussion en posant une question sur le prix du carbone : comment aborder ce sujet ? Doit-on considérer la valeur du carbone consommé, du carbone stocké, du carbone transporté ou non transporté ? La question de fond est celle de l’économie négative et du financement des dégâts non apparus, qui était à l’honneur voici une quinzaine d’années, mais dont on ne parle plus guère aujourd’hui. Dans le domaine de l’énergie, ceci n’est pas très difficile, mais suppose d’importants travaux de modélisation.
L’Europe est par ailleurs l’un des rares continents ou sous-continents dans lequel des interconnexions de puissance existent entre tous les pays. Ceci permet de conduire des travaux de délestage et d’optimisation de l’énergie en fonction du tirage des besoins, et ce à des échelles de temps qui sont quasiment de l’ordre de la nanoseconde. Comment, conceptuellement, sociétalement, si je puis dire, parvenir à mettre cela en main, entre les parties électrique, gazière, pétrolière, la partie stockée, celle qui arrive dans les ports sous forme d’hydrocarbures ? Des travaux sont-ils menés sur le fait que l’Europe est un réseau énergétique ? Où en est-on de cette optimisation ? La France est au cœur du dispositif. Elle est le seul pays européen à se situer entre la Méditerranée et la mer du Nord, à avoir tous les climats, tous les vents, tous les soleils et toutes les froidures.
M. Bernard Salha, directeur recherche et développement, EDF. Je vais essayer d’amorcer des pistes de réponse à ces deux questions. Concernant le prix du carbone, je crois que le critère principal aujourd’hui dans ce domaine est la bascule entre charbon et gaz. Actuellement, sur le marché européen, la production d’électricité par centrale à charbon est plus compétitive que celle par centrale gaz, tout simplement parce que le prix du charbon sur le marché mondial est plus faible que celui du gaz. Si l’on avait un prix de la tonne de carbone autour de 30 euros, cela suffirait pour donner un avantage significatif aux centrales électriques à base de gaz par rapport aux centrales à charbon. Je rappelle que 1KWh produit à partir de gaz génère environ 400g de CO2, contre 800 à 900g s’il est produit par une centrale à charbon. L’atout est donc absolument énorme. Il « suffit » pour cela d’un prix de la tonne de carbone à 30 euros.
La question des interconnexions est évidemment un sujet crucial, puisque le marché électrique aujourd’hui n’est pas français, mais européen. Les interconnexions existent, mais sont malgré tout relativement limitées, puisqu’elles se situent entre 10 et 12 GW, pour une puissance française installée de l’ordre de 230 GW sur l’ensemble du territoire. Elles sont en outre difficiles à étendre, pour des questions d’acceptabilité de nouvelles lignes électriques à haute tension. Nous avons, à EDF, mené une étude, intitulée « énergies renouvelables 60 % », sur l’ensemble du paysage européen, en intégrant un fort développement des énergies renouvelables : ces travaux, présentés en de nombreux endroits et notamment à la Commission européenne, montrent bien que le système européen doit être considéré dans sa maille globale si l’on veut le gérer complètement et tirer bénéfice des atouts des uns et des autres, dans une solidarité globale de système. Il ne pourra fonctionner que comme cela. Le débat énergétique est donc avant tout européen. Nous tenons cette étude à votre disposition.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci beaucoup. La session parlementaire se terminant bientôt, je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous adresser ces documents le plus rapidement possible.
M. Olivier Appert. Concernant le prix du CO2, tout a été dit, au plan scientifique et économique, dans le rapport Quinet, de 2013. Ensuite, ceci relève d’un problème de consensus au niveau de l’ensemble des États, ce qui est autrement plus compliqué. S’il n’a pas été question du CO2 à Paris, lors de la COP 21, c’est précisément parce qu’un tel consensus était totalement impossible.
Le problème des réseaux électriques est très différent et beaucoup compliqué que celui des réseaux gaziers. Cela n’implique pas la R&D. Il s’agit avant tout d’un problème d’acceptation pour tirer des lignes. Je prendrai l’exemple de la ligne à haute tension Casaril-Aragon, entre la France et l’Espagne, qui a fait l’objet en 1990 d’un accord intergouvernemental entre ces deux pays, ratifié par les Parlements français et espagnol. Ce projet a par la suite donné lieu à des contestations, au motif que l’une des vallées concernées abritait une espèce rare d’escargot à trois cornes. Tout a donc été bloqué, malgré la ratification de l’accord. On vient d’inaugurer cette ligne, 25 ans après : il s’agit d’une ligne souterraine, qui a coûté dix fois plus cher que la ligne initialement prévue. Cette histoire illustre parfaitement la problématique du développement des réseaux. Or, les projections prévoyant une interconnexion des échanges sur la plaque européenne ne prennent pas suffisamment en compte cet aspect. La situation est plus simple pour ce qui concerne les réseaux de gaz, qui sont souterrains.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il est important que les choses soient dites. Tout ce qui n’est pas dit est suspect et provoque des réactions fortes. Il faut que les contestations éventuelles puissent s’exprimer sur des éléments formulés.
M. Stéphane Sarrade, directeur adjoint de l’innovation et du soutien nucléaire, CEA-DEN. Je souhaiterais revenir précisément au sujet de cette table ronde. Voici plus de vingt ans, j’ai été un docteur CIFRE, avec une PME pour partenaire industriel. A l’heure actuelle, je suis vice-président d’un pôle de compétitivité dédié aux PME. Je puis vous dire que le millefeuille évoqué pour le financement de la R&D est bien réel. Il manque dans le paysage actuel la dimension des PME et des ETI. Lorsqu’on regarde les dossiers et le besoin, ils se situent neuf fois sur dix dans la zone dite de la « vallée de la mort », c’est-à-dire entre TRL4 et TRL6, ce qui correspond au besoin d’investir dans un démonstrateur pour devenir crédible. Les partenariats englobant, sous forme de consortiums, des grands groupes et des PME – PMI existent, mais cela est à mon avis encore insuffisant pour accélérer l’innovation et l’accès de ces petites entreprises à la connaissance et à la valeur ajoutée que cela représente.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cette audition, si elle n’a pas apporté toutes les réponses, a néanmoins ouvert tous les champs de questionnement.
Nous disposons désormais d’une matière considérable pour élaborer le rapport qui doit être présenté avant la fin de la législature, en février ou mars. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos notes et les documents ayant servi de support à vos interventions. Ceci nous est en effet très utile pour rédiger des rapports pas nécessairement consensuels, mais dans lesquels les choses soient dites avec les bons mots et les analyses appropriées. Nous avons besoin de produire un travail qui soit, sur ces sujets, utile à la nation au sens large, c’est-à-dire à chacun des éléments qui la composent. Il s’agit d’aider l’économie à créer de la valeur, mais aussi un peu de fierté, à l’aube d’un XXIème siècle qui en a bien besoin, notamment dans nos démocraties occidentales, qui traversent une période quelque peu compliquée.
Je terminerai en évoquant la question du prix de l’électricité. Je souhaiterais rappeler le principe selon lequel, en France, le prix est le même en tout point du territoire. Ce système présente des contraintes, mais aussi beaucoup d’avantages. Or, à travers la question des smartgrids et de la localisation, émergent des questions économiques et scientifiques visant à aller vers une segmentation du prix de l’électricité en fonction de l’endroit où l’on se trouve. Ce n’est absolument pas anodin. L’exemplarité mondiale, s’appuyant sur le fait que ce type de pratique existe ailleurs, n’est pas nécessairement suffisante. Ceci ne serait ni forcément simple à mettre en œuvre, ni évident à accepter, dans un pays comme la France, qui a des atouts à faire valoir.
Je souligne au passage que le prix de l’énergie pour le consommateur est supérieur en Allemagne à ce qu’il est en France.
Merci, Messieurs, Mesdames, de vos précieuses contributions et à bientôt.
ANNEXE N° 4 :
COMMUNICATION DE M. CHRISTIAN BATAILLE, DÉPUTÉ, VICE-PRÉSIDENT DE L’OPECST SUR UNE MISSION AUX ÉTATS-UNIS
Communication de M. Christian Bataille, député, sur son déplacement aux États-Unis relatif à la dimension stratégique du développement de l’exploitation des gisements non conventionnels d’hydrocarbures
M. Bruno Sido, sénateur, Premier vice-président. Notre collègue Christian Bataille s’est rendu aux États-Unis du 13 au 18 mars 2016, dans le cadre d’une poursuite de sa réflexion engagée en 2013 avec notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir sur l’exploitation des gisements non conventionnels d’hydrocarbures. Leur rapport de 2013 était centré sur les alternatives à la technique de la fracturation hydraulique. Cette fois, il s’agissait d’évaluer le rôle de la politique fédérale d’innovation dans la réussite de l’exploitation des gaz et pétrole de schiste.
Mon cher collègue, vous avez la parole.
M. Christian Bataille, député, vice-président. Merci. Je vais m’efforcer de résumer le document que j’ai fait distribuer.
Je veux vous rendre compte d’une mission effectuée en mars aux États-Unis, sur le rôle de la politique fédérale d’innovation dans le succès de l’exploitation des gisements non conventionnels d’hydrocarbures.
Ma démarche visait à tirer les enseignements de la capacité de rebond de l’économie nord-américaine, qui est parvenue, en une dizaine d’années, grâce à ce nouveau type d’exploitation, à inverser ses rapports de force avec les grands fournisseurs mondiaux d’hydrocarbures.
En effet, les États-Unis sont devenus, depuis 2012, grâce aux gaz de schiste, le premier producteur mondial de gaz naturel devant la Russie mais aussi, depuis 2014, le premier producteur mondial de pétrole devant l’Arabie saoudite et la Russie grâce aux huiles de schiste qui représentent plus de la moitié de la production nationale en 2015, en incluant les « gaz naturels liquides », c’est-à-dire les hydrocarbures liquides récupérés directement en sortie de puits (éthane, propane, butane, isobutane, et pentane).
Les États-Unis restent certes importateur net de gaz naturel, pour 10 % de leur consommation, mais il s’agit essentiellement de gaz canadien arrivant par gazoduc. La baisse des cours permise par la production non conventionnelle a stimulé les exportations par gazoduc vers le Mexique, et poussé les projets de construction de ports d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Le premier d’entre eux, à Sabine Pass en Louisiane, est opérationnel depuis janvier 2016 et a été inauguré en avril 2016.
La consommation de pétrole des États-Unis, d’environ 19 millions de barils par jour, excède largement la production totale d’environ 10 millions de barils par jour, mais l’abondance nouvelle de production interne a conduit le Congrès à décider, en décembre 2015, de mettre fin à l’embargo aux exportations de pétrole qui était en vigueur depuis le premier choc pétrolier, et qui n’excluait que quelques rares pays comme le Canada.
Il me semblait qu’un tel basculement ne pouvait pas être un simple effet du hasard puisqu’il venait consolider la position stratégique d’hyperpuissance des États-Unis, la maîtrise des approvisionnements en énergie étant une condition de l’assise de leur domination militaire.
C’est donc à une réflexion sur les déterminants de la politique d’innovation qui a donné naissance à ces formes de production nouvelles d’hydrocarbures que ma mission a été consacrée, en essayant de faire, notamment, la part entre l’initiative privée et les impulsions de l’État fédéral.
Les grandes compagnies internationales comme Total, pourtant les mieux placées pour anticiper une évolution concurrentielle les concernant au premier chef, ont été « prise au dépourvu ». Cela en dit long sur la dimension assez mystérieuse de l’origine de cette révolution des gaz et pétroles de schiste.
De fait, si les autorités fédérales revendiquent une part de responsabilité dans l’émergence de cette révolution, il semble bien que celle-ci résulte aussi, pour une bonne part, d’une multitude d’initiatives privées prenant elles-mêmes appui sur une ancienne tradition de culture minière très largement partagée aux États-Unis.
S’agissant de la part prise par l’État fédéral dans cette révolution, les personnalités que j’ai rencontrées, aussi bien Mme Paula Gant, du Département de l’énergie, que les chercheurs du laboratoire de Livermore, comme Roger D. Aines, ont souligné une implication à trois niveaux.
D’abord, en termes d’innovation. Face au déclin de la production nationale, les laboratoires fédéraux ont investi, dès la fin des années 1970, dans le perfectionnement, à la fois, de la technique du forage horizontal et de celle de la fracturation hydraulique, dans le cadre d’un projet de démonstration d’exploitation de gaz de schiste conduit en partenariat avec des acteurs privés.
Ensuite, à travers la mise en place d’avantages fiscaux spécifiques, car le Congrès a créé dès 1980 un crédit d’impôt pour encourager l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels (la « section 29 » restée en vigueur jusqu’en 2002).
Enfin, via l’effort pour diffuser une information objective sur la réalité de l’exploitation des gaz de schiste. Cette tâche de rassembler des éléments d’information objectifs, des faits et des résultats de travaux scientifiques a été confiée à l’Environmental Protection Agency (EPA). Le débat autour des risques pour l’eau potable de l’utilisation de la fracturation hydraulique existe, en effet, aux États-Unis, même s’il est d’une intensité bien moindre qu’en Europe.
S’agissant du rôle joué par le secteur privé dans le succès des gaz et pétroles de schiste, il est considéré comme prépondérant par les acteurs économiques que j’ai rencontrés à La Nouvelle-Orléans et également par les responsables de l’Université d’État de Louisiane (LSU) à Bâton-Rouge.
Ils soulignent que trois conditions étaient réunies pour la réussite des initiatives entrepreneuriales qui ont assumé tous les risques des premières exploitations.
En premier lieu, le régime de propriété privée du sous-sol simplifie la négociation pour l’accès à la ressource et permet d’intéresser directement le propriétaire au succès de l’opération. Il est à noter que l’État fédéral et les États fédérés eux-mêmes font partie des propriétaires sollicités car ils possèdent en propre de vastes étendues de territoire, du fait notamment de la création des parcs nationaux.
Le deuxième facteur essentiel au déclenchement de la vague d’initiatives privées pour l’exploitation des gaz et pétroles de schiste a été la remontée des prix du gaz et du pétrole au tournant des années 2000, principalement en raison de la hausse de la demande mondiale. C’est une sorte de paradoxe, mais c’est parce que le pétrole et le gaz ont été chers à un moment donné que des technologies nouvelles d’exploitation ont pu être mises en œuvre qui ont entraîné la baisse des cours.
Le troisième facteur favorable au succès des pionniers des gaz et pétroles de schiste est lié à l’ancienneté de l’histoire de l’exploitation des hydrocarbures aux États-Unis, qui remonte aux premières décennies du XIXe siècle. Cette antériorité historique entraîne avec elle deux dimensions de contexte importantes : d’abord, la géographie du sous-sol étant bien connue aux États-Unis, l’on connaissait d’avance l’emplacement des gisements les plus intéressants avant de se lancer dans les forages pour atteindre les roches mères riches en huile ou en gaz ; ensuite, toute une infrastructure de services d’exploitation déjà utilisée par l’extraction conventionnelle pouvait servir d’appui aux nouvelles formes d’exploitation.
Un détour en voiture de près de 800 km auquel m’a contraint une inondation aux alentours de Lake Charles m’a d’ailleurs permis de constater par moi-même la réalité de l’implication de très petits entrepreneurs dans l’exploitation des gaz et pétroles de schiste. Ce détour m’a, en effet, fait découvrir, dans la campagne profonde de la Louisiane, au nord de la zone des marécages, des « fermes » d’exploitation des gaz et pétrole de schiste, c’est-à-dire de toutes petites installations constituées de deux à quatre citernes recueillant les écoulements de puits ayant précédemment fait l’objet d’une fracturation. Une fois la citerne remplie, le « fermier » l’apporte à un grossiste local, de la même façon qu’un exploitant agricole amène régulièrement son lait à la coopérative.
Cette expérience m’a confirmé que le succès du développement des gaz et pétrole de schiste s’est appuyé sur un véritable dynamisme entrepreneurial, qui touche aussi des très petites unités, et qu’il a bénéficié de l’ancrage profond de la culture américaine dans l’exploitation des richesses du sous-sol.
Dès lors, il m’apparaît qu’en engageant, dès les années 1970, la politique d’innovation qui visait à mettre au point les techniques d’extraction des hydrocarbures au sein des roches mères, l’État fédéral savait qu’il pouvait compter sur le dynamisme entrepreneurial américain et l’expérience industrielle des acteurs du pétrole et du gaz pour prendre le relais de la conversion de l’avancée technologique en un véritable mouvement économique d’ampleur.
Je passerai vite sur l’analyse des perspectives, dont l’objet, dans ma communication, est seulement de montrer la capacité de résilience du secteur de la production des gaz et pétrole de schiste face à la baisse des cours, encore d’actualité au moment de ma visite.
En effet, nos interlocuteurs nous ont indiqué, d’une part, que les investisseurs dans ce secteur s’inscrivaient dans une logique de rentabilité à moyen terme – un banquier de JP Morgan nous a dit qu’on s’attendait à y gagner de l’argent seulement une année tous les sept ans –, donc qu’ils étaient prêts à maintenir leur soutien un certain temps ; d’autre part, que la situation d’apport marginal pour le marché mondial des gaz et pétroles de schiste tendait à provoquer un mécanisme d’équilibrage automatique : lorsque les cours baissent, la production diminue car les puits sont mis en sommeil, donc la demande mondiale finit par être rationnée, ce qui fait remonter les prix. Même si d’autres phénomènes interviennent probablement, on peut observer que, à première vue, ce jeu de rééquilibrage semble fonctionner puisque les cours mondiaux du pétrole ont déjà un peu remonté au cours des dernières semaines.
M. Bruno Sido, sénateur, Premier vice-président. J’observe la complète convergence des analyses de M. Christian Bataille avec celles de M. Patrick Pouyanné, le président du groupe Total, qui a été auditionné ce matin par la commission des affaires économiques du Sénat. M. Pouyanné nous a précisé que les puits américains d’exploitation non conventionnelle, grâce à la baisse des coûts, restaient rentables à un cours mondial de seulement 40 dollars, et qu’il ne fallait pas compter sur une stabilité durable des prix du pétrole. Il a annoncé une grave crise d’approvisionnement en pétrole à moyen terme, même si les politiques d’efficacité énergétique commencent à faire sentir leurs effets, car les investissements mondiaux dans la mise à jour de nouveaux gisements diminuent, alors que la production à partir des anciens gisements baisse à un rythme de 5 % par an.
ANNEXE N° 5 :
COMPTE RENDU DE L’AUDITION OUVERTE À LA PRESSE DU CSTB, LE 13 DÉCEMBRE 2016
Audition, ouverte à la presse, du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST. Cette réunion a pour objet l’audition du président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), M. Etienne Crépon, que je salue et que nous sommes heureux de recevoir à nouveau pour un échange avec l’OPECST sur son rapport d’activité 2015.
À vos côtés, Monsieur le président, je salue également Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe de la recherche pour les questions de santé et de confort, ainsi que M. Jean-Christophe Visier, directeur énergie environnement, que nous connaissons bien aussi à l’OPECST, car c’est un familier de nos auditions publiques depuis 2009.
Cette audition relève des rencontres régulières entre l’OPECST et le CSTB prévues par l’article 9 de la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique, à l’image des habitudes similaires que nous avons déjà avec l’Autorité de sureté nucléaire ou l’Agence de biomédecine.
Nos liens sont maintenant assez réguliers, puisque, dernièrement, nous avons retrouvé M. Hervé Charrue, directeur général adjoint en charge de la recherche lors de l’inauguration de la plateforme technologique TIPEE à La Rochelle, et Hervé Charrue représentait le CSTB lors de notre audition publique du 24 novembre 2016 sur l’apport de l’innovation dans la lutte contre le changement climatique.
Cette audition publique a accueilli M. Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche, à l’innovation et à la science, ainsi que Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, et comportait un volet relatif aux progrès de l’efficacité énergétique des bâtiments.
Monsieur Crépon, je vous laisse quelques minutes pour présenter les dernières actualités du CSTB en débordant peut-être sur les activités de l’année 2016, puis nous vous poserons un certain nombre de questions en lien avec des sollicitations récentes dont nous avons été nous-mêmes l’objet.
Je dois dire que les premières pages du rapport d’activité 2015 qui mentionnent la nécessité d’une « garantie de résultats et non pas seulement de moyens », et font ressortir le souci de la mesure de la « performance réelle » entrent en cohérence avec l’une des analyses importantes du rapport que j’ai rendu en juillet 2014 avec l’ancien sénateur Marcel Deneux sur les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment.
Par ailleurs, la page 11, mentionnant les efforts pour mettre en réseau le monde scientifique du bâtiment, converge avec l’affirmation du besoin d’un nouvel élan dans notre pays en faveur de la physique du bâtiment.
Enfin, je souligne l’importance, tout à fait justifiée selon moi, que le rapport d’activité accorde à la question de la qualité de l’air intérieur (page 35) ; la présence à vos côtés de Mme Kirchner met en valeur également cet aspect essentiel des activités du CSTB, puisque les progrès de l’isolation imposent par contrecoup une vigilance accrue dans ce domaine.
M. Etienne Crépon, président du CSTB. En préambule, je précise que Mme Séverine Kirchner deviendra, d’ici quelques jours, directrice santé confort du CSTB, en remplacement de M. Christian Cochet, qui partira en préretraite tout en conservant des liens avec le CSTB.
Le CSTB ayant pour vocation d’aider, par ses travaux de recherche et de développement technologique, les acteurs du secteur du bâtiment, et au premier chef les pouvoirs publics, à se préparer aux principaux enjeux auxquels ce secteur va se trouver confronté au cours des prochaines années, je commencerai par évoquer ces enjeux.
J’en distingue quatre majeurs, sans que ma liste implique qu’il y ait entre eux un ordre de hiérarchie ou de priorité.
D’abord la transition environnementale, qui va au-delà de la transition énergétique, et a conduit à l’élaboration du nouveau label « Performance Environnementale des Bâtiments Neufs » qui a été présenté récemment par les deux ministres de l’environnement et du logement, et qui préfigure la future réglementation environnementale. Conformément aux vœux répétés du Parlement, exprimés tant lors de la loi Grenelle II que lors de la loi sur la transition énergétique, ce label prend en compte l’ensemble des paramètres environnementaux, et particulièrement les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Les importants travaux du CSTB à cet égard depuis le début de l’année 2015 ont été menés principalement pour le compte de l’État, mais aussi en accompagnement d’autres acteurs, dont des start-up souhaitant se positionner sur la question de l’énergie dans le bâtiment.
Le deuxième enjeu est la révolution numérique qui attend le secteur du bâtiment avec quelques années, après les autres secteurs de notre économie. Depuis maintenant deux ans, le secteur se saisit des outils numériques et cela va profondément modifier les modes de fonctionnement. Le CSTB avait porté la maquette numérique sur les fonts baptismaux voici déjà une trentaine d’années, et joue aujourd’hui un rôle essentiel dans le déploiement du plan de transition numérique ; il a accompagné un certain nombre d’acteurs dans leur propres efforts de mise en œuvre, notamment des centres hospitaliers universitaires dans diverses régions de France ou encore certains aménageurs responsables de grandes opérations d’intérêt national, comme Euroméditerranée à Marseille et Euratlantique à Bordeaux.
Le troisième enjeu est d’ordre social et sociétal, et concerne le confort d’utilisation des bâtiments, alors que l’esprit « productiviste » a dominé jusque-là dans la conception de bâtiments notamment non résidentiels. Des travaux de recherche, auxquels le CSTB a participé, ont montré que le confort d’utilisation des bâtiments jouait sur la qualité de vie dans les lieux de résidence et sur la productivité dans les lieux de travail. Au-delà, mes échanges avec des grands bailleurs sociaux me confortent dans l’idée que nous devrons réfléchir au moyen d’améliorer les conditions du « vivre ensemble » dans les logements collectifs. Il s’agit notamment de mieux gérer les bruits, et de permettre à des personnes ayant des rythmes de vie différents de cohabiter au sein d’un même immeuble. C’est un sujet à la fois scientifique et sociologique, qui sera au centre des préoccupations du secteur dans les années à venir.
Enfin le quatrième défi, rejoint un point que vous avez vous-même relevé en introduction, Monsieur le président. Il est lié au fait que le secteur du bâtiment va être, de plus en plus, confronté à une obligation de résultats, et non plus à une stricte exigence de moyens. C’est une évolution naturelle qu’ont connu antérieurement les autres grands secteurs industriels, mais qui va poser d’énormes difficultés d’ordre scientifique à l’ensemble des acteurs, ne serait-ce que parce que l’occupation d’un bâtiment modifie les conditions de fonctionnement de celui-ci, par rapport aux simulations théoriques qui ont été effectuées lors de la conception. Et la capacité à distinguer, dans les performances d’un bâtiment, ce qui relève du bâtiment lui-même et ce qui relève du comportement des habitants, constitue un des enjeux essentiels des travaux scientifiques pour le secteur, dans la prolongation de ceux déjà engagés par le CSTB.
Ce sont donc là les quatre principales orientations des activités scientifiques du CSTB.
Mais, au-delà de ses activités de recherche, le CSTB reste mandaté par l’État pour évaluer les produits nouveaux, notamment au travers de la procédure de l’avis technique. En 2015 et 2016, cette procédure a été recentrée sur les produits vraiment innovants.
Afin de rendre l’avis technique plus facile d’accès, notamment pour les TPE et les PME, nous avons poursuivi le déploiement de notre service Ariane, permettant d’accompagner les TPE et les PME dans leurs démarches d’évaluation technique sur les territoires, en concluant de nouveaux accords avec des partenaires locaux, la prochaine signature à Montpellier devant nous permettre de couvrir la région d’Occitanie.
J’en ai fini, Monsieur le président, avec les propos d’introduction que je souhaitais tenir et nous nous tenons maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
M. Jean-Yves Le Déaut. Avant de laisser la parole à mes collègues, j’aurai une question concernant le premier défi que vous avez mentionné, à savoir la transition environnementale. La discussion de la loi sur la transition énergétique a fait ressortir le fait que la réglementation thermique RT2012 ne tenait pas compte des émissions de CO2, comme si ce sujet avait été passé par pertes et profits ; cela a fait l’objet notamment d’un amendement de François Brottes. Nos collègues Claude Birraux et Christian Bataille avaient déjà préconisé dans un rapport de 2009 qu’un plafond de CO2 vienne recentrer la norme de performance énergétique sur l’objectif essentiel de la lutte contre l’effet de serre.
Certes, l’expérimentation « Performance Environnementale des Bâtiments Neufs » mise en place pour tester la future réglementation thermique comporte un « socle carbone ».
De ce qu’on nous en a dit, il ressort que ce « socle carbone » serait très peu contraignant. Comme le label prévoit par ailleurs un resserrement de la norme en énergie primaire, il renforcerait le phénomène d’éviction de l’électricité, d’autant que le moteur de calcul continuerait à prendre en compte le chauffage électrique sur le mode du convecteur classique, quel que soit la sophistication de l’équipement utilisé, par exemple lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur. Tout cela est-il exact ? Peut-on afficher un objectif de limitation des émissions de CO2 s’il n’a aucun effet contraignant ? Pourquoi ne pas reprendre l’idée d’un plafond d’émission de CO2 ?
Le CSTB a lui-même travaillé, c’est indiqué page 29 de votre rapport d’activité, à l’élaboration d’une méthode qui évalue l’impact carbone de la fourniture d’énergie d’un bâtiment en exploitation. Comment expliquez-vous alors que la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) ne vous suive pas en ce sens, et n’adopte pas dans ce domaine une attitude plus volontariste ?
La question a été soulevée au cours de notre récente audition publique du 24 novembre 2016 relative au rôle de l’innovation dans la lutte contre le changement climatique, lors d’un échange entre M. Yves Bamberger, membre de l’Académie des technologies et M. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable, et j’ai préféré éviter alors qu’on entre dans le vif du sujet. Nous avions compris qu’il n’était pas possible, en réponse à la préconisation du rapport de Claude Birraux et Christian Bataille, de modifier tout de suite la réglementation thermique alors qu’elle venait tout juste d’être finalisée. Mais une promesse a été faite à cette époque pour la prochaine réglementation thermique, confirmée l’an dernier par l’adoption de l’amendement de François Brottes qui a rapproché l’échéance à 2018. Si ces demandes répétées du Parlement ne sont pas satisfaites, nous allons finir par nous fâcher, et notre collègue Anne-Yvonne Le Dain pourra en rendre compte dans son prochain rapport sur la stratégie nationale de recherche en énergie.
De votre point de vue bien informé, puisque vous connaissez les textes qui ont été pris à cet égard, cette « Performance Environnementale des Bâtiments Neufs » permet-elle vraiment d’avancer dans la prise en compte des rejets de carbone ?
M. Etienne Crépon. Quelques éléments de réponse à ces questions. D’abord, le maître d’ouvrage du nouveau label de performance pour les bâtiments neufs, c’est le Gouvernement. En la matière, le CSTB est son bras armé scientifique, qui élabore les méthodologies de calcul et les partage avec les acteurs ; mais la définition des seuils relève totalement et complètement de l’exécutif.
Au-delà de cela, pour ne pas donner l’impression d’esquiver la question, j’observe qu’il faut avoir conscience que le calcul du carbone dans un bâtiment, en analyse du cycle de vie, est un exercice fondamentalement nouveau pour l’ensemble de la filière de la construction. Dans une première étape, l’ensemble de la filière, dans sa diversité, devra se saisir du sujet, et apprendre à tenir compte du carbone rejeté par les opérations réalisées, en vue de maîtriser cette nouvelle problématique comme elle est parvenue à appréhender par le passé, à force de pédagogie, la consommation d’énergie, ou la performance acoustique ou la performance sanitaire des bâtiments. Nous en sommes aujourd’hui dans cette étape d’apprentissage par l’ensemble des acteurs.
Enfin, concernant le label de performance environnementale, dont les seuils, je le répète, relèvent de l’exécutif, et auquel le CSTB a contribué pour l’élaboration des méthodes de calcul, je constate que, malgré des voix divergentes, il a été porté par l’ensemble des acteurs de la construction réunis au sein du Conseil supérieur de le la construction et de l’efficacité énergétique, mis en place par la loi sur la transition énergétique, et que tous, à l’issue des travaux de concertation menés par le Gouvernement, ont salué la mise en place de ce label. Donc qu’il soit imparfait, c’est possible, voire probable, comme toute première étape dans une démarche ; de là, à dire qu’il doit être rejeté car il existe quelques voix discordantes, me paraît un peu extrême.
Au-delà de cela, pour répondre à des questions plus techniques concernant le contenu même du label, je propose de passer la parole à M. Jean-Christophe Visier, qui a travaillé depuis plus d’un an sur le sujet.
M. Jean-Christophe Visier, directeur énergie environnement du CSTB. Suite aux demandes insistantes pour prendre en compte le rejet de carbone comme marqueur du changement climatique, les travaux qui ont été menés, dans le cadre d’un projet Assu-performance, qui pendant plus de deux ans, a associé l’ensemble des acteurs un peu en pointe sur ce sujet, ont montré que le carbone représentait en moyenne une émission d’une tonne et demi par mètre carré de surface construite, dont la moitié était liée à la manière dont on construit les bâtiments, à travers la mobilisation des matériaux de construction, la conduite du chantier, et l’autre moitié à l’énergie consommée pendant la phase d’exploitation. Avec la différence que cette première moitié est émise de suite, donc contribue instantanément au changement climatique, tandis que l’autre moitié est émise au cours de la vie du bâtiment. Il y a eu une prise de conscience des acteurs, non seulement qu’il fallait prendre en compte les émissions de carbone, mais aussi agir sur ces deux volets concernant d’une part la manière dont on construit, et d’autre part, l’énergie qu’on utilise en exploitation. Cette prise de conscience s’est faite progressivement.
M. Jean-Yves Le Déaut. Cela concerne les bâtiments neufs. Mais pour les bâtiments existants, et notamment les « passoires » thermiques ?
M. Jean-Christophe Visier. Oui, le label concerne les bâtiments neufs. Pour les « passoires » thermiques, l’émission de carbone atteint quatre tonnes par mètre carré en exploitation ; c’est donc bien la partie d’exploitation sur une durée de cinquante ans qui représente la composante majeure d’émission. De là, l’enjeu de travailler sur l’ensemble du cycle de vie, qui a d’ailleurs été bien pris en compte par la loi sur la transition énergétique (modification en ce sens de l’article L.111-9 du code de la construction et de l’habitation).
Le référentiel « Énergie-Carbone » a été élaboré autour de plusieurs niveaux. Le premier niveau en énergie représente en gros cinq pour cent de moins que le niveau en énergie de la réglementation thermique ; le quatrième niveau correspond à une couverture complète des consommations énergétiques par des énergies renouvelables. S’agissant du carbone, le référentiel prévoit deux niveaux. Le niveau un est peu exigeant ; son objectif est d’amener tous les acteurs de la construction à apprendre à peser le carbone, de manière à ce qu’ils puissent faire ensuite des progrès. En revanche, le niveau deux est nettement plus exigeant, à un point tel que les acteurs du gaz le considèrent comme inatteignable pour eux dans certaines zones géographiques. Il faut donc bien distinguer ce premier niveau d’apprentissage, accessible y compris avec de l’énergie carbonée, et le niveau « Carbone 2 » qui, lui, est très contraignant, même hors de portée pour certaines techniques, sauf à effectuer des progrès considérables.
Une précision par rapport à l’une de vos interrogations : dans la RT2012, l’utilisation des pompes à chaleur est bien évidemment valorisée beaucoup mieux que le chauffage électrique direct. Le recours à ce dernier impose, pour respecter la réglementation, une sur-isolation du bâtiment par rapport à l’isolation requise en combinaison avec les pompes à chaleur. D’ailleurs, celles-ci se sont fortement répandues dans les constructions de maisons individuelles, conférant à la France un leadership dans ce secteur, en termes notamment de nombre de pompes à chaleur installées.
M. Jean-Yves Le Déaut. Le nouveau label est donc peu exigeant pour le carbone ?
M. Jean-Christophe Visier. Le niveau « Carbone 1 » est peu exigeant dans l’absolu, sauf qu’il est exigeant au sens où il oblige tous les acteurs à travailler le sujet des émissions de carbone ; sachant que le nombre d’acteurs capables de faire une évaluation des émissions de carbone est extrêmement faible, et que c’est un véritable enjeu de faire évoluer la filière dans cette direction, et notamment d’obtenir des industriels qu’ils fournissent l’ensemble des données nécessaires pour pouvoir faire les calculs. Le CSTB a dû faire des approximations pour un millier de données qui n’existaient pas. Il y a, derrière cela, un enjeu de montée en compétence de la filière comme le disait M. Crépon.
M. Jean-Yves Le Déaut. C’est bien d’avoir un objectif pédagogique, mais il faut tout de même faire preuve d’un peu d’ambition, car, sans contrainte, on risque de ne pas avoir de progrès. Après une RT2005 qui favorisait l’électricité, puis une RT2012 qui favorise le gaz, il faudrait parvenir à une réglementation thermique qui ne s’occupe ni de l’électricité, ni du gaz, et qui permette d’atteindre les objectifs de la France en matière de rejet de gaz à effet de serre. On a tout de même l’impression que c’est l’idéologie et non la science qui prime sur certaines décisions qui pourraient être prises. On ne peut être que d’accord avec la décision prise par le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, sauf que le diable est dans les détails, lesquels, tels qu’ils sont en train de se préciser peu à peu, ne vont pas dans le bon sens.
M. Etienne Crépon. Faites confiance aux acteurs de la construction, Monsieur le Président, pour avoir regardé très en détail et négocier pied à pied l’ensemble des éléments de ce label. Ils sont conscients que c’est l’avenir de la construction qui se dessine globalement au travers de ce label, et par là, l’avenir de leur propre activité. Vous avez raison d’indiquer que le diable se niche dans les détails, mais justement ils ont été très vigilants sur les détails.
S’agissant du niveau d’exigence, on aurait pu effectivement partir sur un degré d’exigence très élevé, mais l’expérience qu’on peut avoir de ce genre d’expérience au CSTB, et que je peux avoir à titre personnel, montre qu’on rebuterait alors quatre-vingt-dix pour cent des acteurs, que seulement dix pour cent environ des acteurs se saisiraient véritablement de l’enjeu, et qu’on ne parviendrait pas à créer un mouvement de masse ; on manquerait alors l’objectif que l’ensemble de la filière, le million trois-cent mille personnes qui y travaillent, s’approprient cet enjeu de l’émission du carbone.
Or, clairement, l’enjeu majeur aujourd’hui, c’est celui-là. Il s’agit de faire en sorte qu’une filière industrielle, qui est la principale émettrice de gaz à effet de serre aujourd’hui, se saisisse de la question des rejets de carbone. L’atteinte de ce but passe par une exigence forte de pédagogie, et, le fait de mettre la barre à un niveau atteignable par tout le monde, niveau qui, encore une fois, relève clairement d’un choix politique qui appartient au Gouvernement et non au CSTB, constitue une bonne manière, en matière de politique publique, d’obtenir l’implication de l’ensemble des acteurs, sans qu’ils ne soient rebutés.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. J’aurai trois questions, qui concernent la stratégie de recherche du CSTB, d’une manière globale, ensuite les axes de cette stratégie, et enfin la place des start-up et autres entreprises innovantes dans le secteur.
Le contrat d’objectifs et de performance du CSTB fait bien référence à la stratégie nationale de recherche, mais j’aimerais savoir si le CSTB a bien été directement associé aux réflexions qui ont conduit à l’élaboration de la stratégie de recherche en énergie, et de quelle manière.
Ma deuxième question s’appuie sur le rapport de la Cour des comptes de septembre 2016 qui porte sur l’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, et qui observe une quasi-stagnation de la consommation énergétique des bâtiments, avec une diminution de 1 % depuis 2009 à comparer avec l’objectif d’une diminution de 38 % d’ici 2020 prévu par la loi Grenelle I, alors que les dépenses fiscales relatives au logement, qui sont considérables, contribuent à un grand nombre de rénovations. En particulier, il y a un biais à expliquer concernant le faible impact des progrès enregistrés sur le chauffage, qui a enregistré, pour sa part, une diminution de consommation énergétique de plus de 7 %.
M. Etienne Crépon. Le CSTB est membre de l’Alliance nationale pour la recherche dans le domaine de l’énergie, ANCRE, et à ce titre, a été associé aux travaux d’élaboration de la stratégie nationale de recherche en énergie.
S’agissant du décalage que vous évoquez, j’ai posé la même question à la direction des analyses et des études économiques et à la direction Énergie – Environnement du CSTB pour qu’ils m’apportent des éléments d’analyse dont je ne dispose pas pour l’instant, en tous cas de façon quantitative. Mais, pour ce qui concerne des éléments non quantifiés, non objectivés, je prendrais en compte d’abord l’augmentation du parc, qui se poursuit au rythme de trois à quatre cent mille logements supplémentaires par an, constructions neuves minorés des démolitions ; ensuite le fait que les bâtiments les plus difficiles à rénover sont les plus énergivores, notamment parce qu’ils concernent généralement les ménages les plus modestes qui n’ont pas les moyens d’effectuer des travaux de rénovation énergétique, et c’est la raison pour laquelle la loi de transition énergétique a mis en place des outils financiers spécifiques ; enfin, les changements de mode de vie et de comportements, l’émergence des objets connectés et des outils numériques au sein des logements ont peut-être eu un impact, mais qui reste à démontrer scientifiquement. Mais, sur ces différents points, je ne peux formuler que des pistes de réflexion sur lesquelles les équipes du CSTB sont en train de travailler.
Mme Delphine Bataille, sénatrice. J’aurais voulu savoir si le CSTB travaille en partenariat avec d’autres acteurs du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’économie circulaire ; si, à cet égard, le CSTB met en œuvre des outils spécifiques que vous pourriez nous décrire, et le cas échéant, quel bilan vous pourriez en tirer.
M. Etienne Crépon. Au plan scientifique, nous sommes en relation avec les principaux centres de recherche français, comme le CNRS, le CEA ou un certain nombre de laboratoires universitaires comme le LASIE (Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement) de l’université de La Rochelle, ou le LEMTA (Laboratoire énergétique et mécanique théorique appliquée) de l’université de Lorraine.
Nous avons aussi des partenariats avec les principaux centres de recherche étrangers intervenant dans le secteur du bâtiment : très fréquemment en Europe, avec nos collègues finlandais, suédois, danois, espagnols, dans le cadre de réponses à des appels d’offre de la Commission européenne ; en dehors de l’Europe, avec le NIST (National Institute of Standards and Technology) au États-Unis, le CNRC (Conseil national de recherches du Canada) au Canada, le BRI (Building Research Institute) au Japon, pour mentionner les principaux.
À chaque fois, il s’agit pour le CSTB d’aller chercher une expertise reconnue au niveau international, et inversement d’apporter notre collaboration sur nos domaines d’excellence, comme par exemple celui de la qualité de l’air qu’a évoqué le président Jean-Yves Le Déaut, les travaux menés par le CSTB dans ce domaine faisant globalement référence.
Au plan de l’accompagnement de l’innovation, nous avons établi des partenariats avec des plateformes sur tout le territoire ; nous en avons deux en nouvelle Aquitaine, un couvrant les Pays de Loire et la Bretagne, un en Haut-de-France, un dans le Grand Est, un en Bourgogne-Franche Comté, un en Auvergne-Rhône-Alpes, et comme je l’ai déjà mentionné, je signe après-demain une convention avec un partenaire en région d’Occitanie. Nous aidons tous ces membres de ce réseau d’accompagnement à guider les TPE et PME qui portent une innovation à aborder le marché de la construction qui est fondamentalement complexe du fait de la multiplicité des donneurs d’ordre, chacun ayant un pouvoir de blocage ; il s’agit de les convaincre de donner leur feu vert. Certains des partenariats sont, de ce point de vue, très productifs ; d’autres méritent d’être redynamisés, voire reconsidérés.
Dans ce domaine de l’accompagnement, nous avons également établi des partenariats à l’étranger, principalement avec nos homologues européens, là aussi avec quelques belles réussites et quelques expériences moins efficaces.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je voudrais revenir sur la question de la performance réelle. Nous avons appris que la DHUP avait commandé au CSTB une étude sur l’intégration de la gestion active de l’énergie au moteur de calcul. Qu’en est-il, et pouvez-vous nous en donner les principales conclusions ?
Par ailleurs, où en est-on dans la mise en œuvre, notamment sur la base de votre accord avec le bailleur 3F, des techniques des mesures de performance réelle mises au point par le CSTB ? À savoir notamment les méthodes ISABELE (In Situ Assessment of the Building Enveloppe Performance) et REPERE (Retour d’expérience sur la performance effective des rénovations énergétiques), que nous avons citées lors de notre audition publique du 24 novembre déjà évoquée ?
M. Etienne Crépon. Pour la première question, je passerai la parole à Jean-Christophe Visier. Pour la seconde, je rappellerai d’abord que la méthode REPERE consiste à appareiller un bâtiment devant être rénové avec des systèmes de mesure, un an avant le début du chantier, afin de disposer de données de référence sur l’intégralité d’une saison de chauffe, puis à laisser les capteurs sur place une fois les travaux faits, notamment un capteur thermique par pièce et un capteur sur le compteur d’électricité. Les données recueillies permettent ainsi d’effectuer une mesure de performance corrigée des effets des variations climatiques et des changements de comportement des utilisateurs ; il permet de détecter d’éventuelles erreurs de réalisation du projet de réhabilitation.
La méthode ISABELE concerne les logements neufs et permet de mesurer la performance de l’enveloppe en matière d’isolation.
Ces deux méthodes sont issues de travaux du CSTB remontant à plusieurs années ; un accord avec l’immobilière 3F permet de tester la méthode ISABELE qui est encore en phase de développement, les premiers essais ayant eu lieu au printemps de l’année 2016, et prévoit, par ailleurs, de tester la méthode REPERE grâce à l’appareillage prochain de 1 000 logements. Des accords ont été passés avec d’autres bailleurs pour conduire d’autres tests, en vue notamment de répondre à leur souhait de pouvoir s’appuyer sur un savoir d’expert indépendant opposable aux locataires, susceptible d’expliquer les écarts entre les performances annoncées et les résultats que ceux-ci constatent.
M. Jean-Christophe Visier. Concernant le contrôle actif des bâtiments, la DHUP a commandé une étude au CSTB consistant à identifier, dans l’ensemble des dispositifs concernés, ceux qui sont déjà intégrés à la RT2012, il y en a déjà beaucoup, et ceux qui ne le sont pas, en évaluant pour ces derniers les moyens à mettre en œuvre pour leur intégration. Cette intégration est complexe à l’image des 1 500 pages de la réglementation thermique, les 1 315 pages d’origine auxquelles se sont ajoutées les pages des « Titre V » venus le compléter entretemps. L’enjeu est d’intégrer tous les contrôles actifs en s’appuyant sur ceux qui correspondent au développement le plus large, et ceux qui suscitent un consensus quant à leur efficacité. Cette étude a conduit à réaliser des interviews d’industriels ; la DHUP a reçu le rapport récemment, et est en train de l’analyser.
Pour revenir sur la méthode ISABELE, elle vise à vérifier la performance du bâtiment au moment où il est livré. Nous sommes à cet égard confrontés à une large demande des industriels qui souhaitent pouvoir montrer à leurs clients la qualité du travail qu’ils ont effectuée, d’une part pour satisfaire à l’attente de ceux-ci, d’autre part, pour pousser leurs concurrents travaillant de façon un peu approximative, à progresser. La méthode permet de vérifier l’isolation du bâtiment dans sa globalité. Elle résulte d’une démarche scientifique ayant conduit d’abord à effectuer des essais sur des cellules expérimentales au sein du CSTB, ensuite à réaliser des mesures sur des bâtiments réels avec un équipement de laboratoire mis en œuvre par le CSTB, puis le CSTB a mis au point un kit d’instrumentation qui a été testé entre les mains d’opérateurs autres que ceux du CSTB, et l’on se rapproche maintenant du moment où l’on pourra transférer les outils correspondants à des acteurs de terrain, le but étant, non pas de laisser au CSTB la charge de faire toutes les mesures sur le terrain, mais plutôt de parvenir à un système pouvant être déployé à l’échelle de l’ensemble des constructions.
Aujourd’hui, lorsqu’on réceptionne un bâtiment, on mesure sa perméabilité à l’air, c’est à dire qu’on vérifie s’il n’y a pas de fuites, et les dispositifs pour effectuer cette vérification sont disponibles, et ont été imposés par la RT2012. Pour la mesure de la performance en isolation, on pense être en mesure de mettre les outils correspondants entre les mains d’opérateurs volontaires d’ici dix-huit mois, en espérant ensuite amorcer une généralisation sur le modèle de ce qu’on a pu faire avec la perméabilité à l’air.
M. Jean-Yves Le Déaut. Où en est-on des évolutions du moteur de calcul ?
M. Jean-Christophe Visier. Le moteur de calcul a été mis en mode de logiciel « ouvert », et est utilisé de trois manières différentes : les éditeurs de logiciel l’intègrent à leurs produits de conception, et travaillent sur les interfaces ; on en compte une quinzaine, qui ont pour clients tous les bureaux d’études français ; ensuite, certaines start-up intègrent le moteur de calcul à des outils d’assistance à la rénovation, destinés à fournir du conseil ; enfin, quelques scientifiques, quelques industriels utilisent la possibilité d’entrer dans le code source, mais cette utilisation demeure minoritaire par rapport à l’intégration sous forme compilée en vue d’utiliser le moteur par lui-même. Nous avons pourtant informé la communauté scientifique de cette nouvelle possibilité d’accéder au code source ; quelques équipes se sont emparées de cette possibilité, par exemple à l’université de La Rochelle, mais cela reste une affaire de spécialistes.
M. Jean-Yves Le Déaut. Avez-vous effectué des comparaisons d’autres moteurs de calcul, comme on l’a vu pratiquer dans d’autres pays, le but étant de vérifier que les mêmes variations produisent les mêmes effets ?
M. Jean-Christophe Visier. Des benchmarks sont conduits régulièrement pour permettre aux développeurs de nouveaux moteurs de se caler par rapport aux cas de référence. Des publications indiquent le positionnement du moteur de calcul par rapport à ces cas de référence. Mais ceux-ci sont généralement extrêmement courants, et ne comportent pas, par exemple, le moyen de tester la qualité d’intégration des systèmes de gestion active de l’énergie, parce qu’il n’y a pas suffisamment d’acteurs impliqués dans les développements logiciels correspondants.
Concernant les contrôles actifs, l’association européenne des industriels qui les développent a conduit une étude auprès des différents pays pour évaluer comment ces contrôles actifs étaient pris en compte ; et il apparaît que la France n’est pas à la traîne dans ce domaine.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je reviens à des questions de fond un peu différentes. Qu’est-ce que représente le CSTB pour la recherche publique, et, par ailleurs, pour le secteur privé ? À côté des missions d’accompagnement de l’action publique, qui mobilisent probablement des juristes, que représente le CSTB en termes de forces de recherche ? Est-ce qu’il conduit lui-même des recherches, et en lien avec quelles autres institutions de recherche ? En ce cas, quels sont les axes autour desquels se structurent ses travaux ? Est-ce que le CSTB essaime sous forme de jeunes entreprises innovantes ? Et à cet égard, y-a-t-il des domaines qui sont privilégiés, ou au contraire, dans une logique Open Bar, toutes les pistes sont-elles encouragées avec l’idée de donner sa chance à ce qui marche ? Pouvez-vous nous faire une présentation d’ensemble permettant de comprendre plus clairement le rôle du CSTB ?
M. Etienne Crépon. Je suis désolé que vous ayez un sentiment d’opacité. Le CSTB rassemble mille collaborateurs, exactement 919, dont une force de recherche de deux cents personnes. C’est un organisme qui fait de la recherche et de l’expertise sur l’ensemble des secteurs qui intéressent le bâtiment, notamment l’énergie, l’environnement, l’acoustique, la santé notamment pour la qualité de l’air, que ce soit au regard des émissions de composés organiques volatiles, ou de la présence d’amiante. Le CSTB s’occupe aussi de la sécurité, par exemple la sécurité incendie, et il est à ce titre l’un des laboratoires de référence pour le ministère de l’intérieur. Enfin, il s’occupe du déploiement du numérique dans le secteur du bâtiment.
Les axes de recherche du CSTB font l’objet chaque année d’une délibération de son conseil d’administration, et d’une évaluation par son conseil scientifique. Le CSTB bénéficie d’une subvention qui couvre 30 % de son activité de recherche. Elle a connu une baisse de plus de 30 % ces deux dernières années.
Sur les quarante millions de notre budget de recherche, un peu moins d’un tiers provient de la dotation publique, et permet de faire de la recherche amont ; un tiers consiste en un soutien technique aux pouvoirs publics, notamment pour l’élaboration ou l’évaluation des règlementations ; un tiers enfin s’appuie sur des contrats avec des partenaires économiques, dont des collectivités territoriales, qui sollicitent de plus en plus le CSTB sur les questions énergétiques et numériques, et des start-up qui ont besoin d’un accompagnement pour entrer sur le marché de la construction.
M. Jean-Yves Le Déaut. Placé où vous êtes, avez-vous une information sur l’état d’avancement de la rédaction du décret en conseil d’État sur la rénovation énergétique qui est prescrit par l’article 14 de la loi sur la transition énergétique ?
M. Etienne Crépon. Je ne sais pas du tout où en sont les ministères sur l’élaboration de ce projet de texte.
M. Jean-Yves Le Déaut. Vous n’avez pas été sollicités, d’aucune manière ?
M. Jean-Christophe Visier. C’est le genre de sujet, sur lequel nous n’intervenons potentiellement qu’en expertise. Mais, alors que, pour le label « Énergie-Carbone », nous étions au cœur du dispositif, là nous n’avons fait l’objet d’aucune demande structurée.
M. Etienne Crépon. Les ministères en charge de la construction disposent éventuellement d’autres ressources d’expertise que le CSTB. Le fait que nous n’ayons pas été sollicités n’implique pas forcément qu’aucun travail scientifique ne soit conduit sur le sujet.
Du côté du CSTB, les équipes scientifiques compétentes en matière d’énergie et d’environnement, qui représentent une quarantaine de chercheurs ont été, ces derniers mois, très, très fortement mobilisées par la préparation du label de performance environnementale des bâtiments neufs, Jean-Christophe Visier ayant fourni à leur tête un travail considérable.
M. Jean-Christophe Visier. La stratégie de recherche du CSTB comprend un programme « Énergie - Environnement » qui a été décliné en trois actions correspondant au développement, premièrement, des bases scientifiques du label « Énergie-Carbone », deuxièmement, de la méthode REPERE centrée sur la mesure de la performance énergétique, et troisièmement, d’outils pour gérer les parcs de bâtiments.
S’agissant du décret sur les bâtiments existants, en fait, avant de poser des questions scientifiques, la rénovation soulève prioritairement, d’une part, des problèmes de financement, qui ne se posent pas dans les mêmes termes pour la construction, laquelle s’appuie toujours au départ sur un budget, et, d’autre part, des problèmes de protection du patrimoine. Sur ces deux aspects, l’expertise scientifique du CSTB n’est d’aucun apport.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je suis d’accord avec vous sur le blocage lié au financement. Un calcul d’ordre de grandeur du coût de la rénovation, trois cents euros au mètre carré pour trois milliards de mètres carrés, permet d’estimer le besoin supplémentaire de financement pour la rénovation à neuf cent milliards d’euros. J’ai moi-même veillé à faire adopter, dans la loi sur la transition énergétique, un dispositif répondant pour partie à ce besoin, permettant de mobiliser la valeur patrimoniale du bien pour gager des emprunts, dont le remboursement s’opère au moment de la mutation du bien. Il n’empêche que la rénovation comporte une dimension scientifique importante, dans la mesure où il s’agit de définir, pour chaque cas, les techniques les plus appropriées afin de minimiser les coûts.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’ai justement une question relative à la dimension scientifique des activités du CSTB. Vos chercheurs publient-ils ? Dans ce cas, où publient-ils ? Dans quel type de revues ?
M. Etienne Crépon. Séverine Kirchner vous donnera des détails, mais effectivement, les chercheurs du CSTB publient dans des revues à comité de lecture. Le contrat d’objectif et de performance du CSTB prévoit même à cet égard des indicateurs chiffrés.
Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe de la recherche pour les questions de santé et de confort. Le CSTB formalise un programme de recherche annuel, et même pluriannuel. Un des indicateurs est le nombre de publications dans des revues de rang A. On accueille également des doctorants pour faire de la formation par la recherche ; le CSTB noue des partenariats comme celui qui le lie à l’université de La Rochelle pour accueillir des doctorants et des post-doctorants. Le CSTB accueille également des chercheurs étrangers qui viennent nous aider à exploiter les bases de données qui font l’originalité du CSTB, en particulier les bases de données nationales relatives à la qualité de l’air intérieur.
Il y a donc une véritable vie de recherche au sein du CSTB, y compris sous l’angle de l’évaluation, puisqu’un Conseil scientifique, composé de scientifiques indépendants est chargé de l’évaluation des programmes de recherche et notamment de la qualité des productions scientifiques des résultats, des partenariats et co-programmations, des publications et des travaux de valorisation.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Est-ce que vous financez des allocations de recherche ?
Mme Séverine Kirchner. Oui, nous finançons nos doctorants, en collaboration avec l’ADEME, notamment.
M. Etienne Crépon. Nous accueillons en permanence une soixantaine de doctorants, ce qui signifie un flux d’entrées et de départs de vingt par an en moyenne.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Sont-ils tous sur le site du CSTB ?
M. Etienne Crépon. Le CSTB a quatre implantations, dont la principale à Champs-sur-Marne, et les autres à Nantes, Grenoble et Sofia-Antipolis, et les doctorants se répartissent entre ces quatre sites.
M. Jean-Christophe Visier. Le CSTB pratique aussi les échanges de chercheurs avec d’autres établissements, ce qui fournit l’occasion de découvrir des cultures différentes.
Mme Séverine Kirchner. Tous nos doctorants suivent une formation doctorale qui fait l’objet d’un encadrement universitaire.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je voudrais revenir sur le coefficient de conversion de l’électricité. Dans le domaine de l’automobile, on encourage les véhicules électriques. Mais, dans le bâtiment, ce coefficient de conversion a un effet d’éviction de l’électricité, même si on a bien entendu que la RT2012 prend mieux en compte aujourd’hui les pompes à chaleur.
Mais la part de production d’électricité à partir des énergies renouvelables augmente, et cela devrait se refléter dans le calcul du coefficient de conversion.
J’observe d’ailleurs que l’industrie du gaz elle aussi s’inscrit dans une logique faisant progressivement augmenter la composante renouvelable du gaz pour limiter les rejets de carbone.
La Commission européenne serait, paraît-il, ouverte aujourd’hui à la fixation d’un coefficient de conversion de l’électricité qui pourrait descendre jusqu’à 2 au lieu du 2,58 actuel. Avez-vous été saisi pour des réflexions sur ce sujet ?
M. Jean-Christophe Visier. Tout à fait. Dans le cadre du label « Énergie-Carbone », une des importantes évolutions consiste à ne compter que la part non renouvelable de l’énergie, dans le but de limiter celle-ci, ce qui va complètement dans votre sens. Nous avons proposé d’adapter le coefficient de conversion de l’électricité en conséquence, mais la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a estimé que la variation, de l’ordre de 4 %, n’était pas suffisante pour justifier une modification du référentiel de calcul. Ce n’était donc pas une décision du CSTB.
M. Etienne Crépon. Quelques éléments de réponse complémentaires. On sait bien que ce coefficient de conversion fait débat, sachant que ce coefficient est censé représenter la part d’énergie qui se dilapide sur le réseau électrique entre le lieu de production et le lieu de consommation. Mais, même si nous avons été amenés à donner un avis dans le cadre de nos travaux sur le label « Énergie-Carbone », c’est clairement un sujet sur lequel le CSTB n’a pas de compétences scientifiques ; d’autres structures sont bien mieux placées scientifiquement pour évaluer, par exemple, les pertes sur les lignes à haute tension.
Concernant l’application du coefficient de conversion de 2,58 aux énergies renouvelables en autoconsommation, c’est une question que nous avons posée nous-mêmes à la DGEC, qui l’a tranchée en opportunité. Mais je répète que le CSTB n’a pas les compétences scientifiques pour valider ou invalider la valeur du coefficient de conversion de l’électricité.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. On parle très peu des réseaux de chaleur ; or, c’est un moyen de transporter de l’énergie sur de grandes distances, avec des déperditions assez faibles grâce à l’inertie thermique. Est-ce que le CSTB est associé à la politique menée dans ce domaine-là ? Je pense en particulier au logement collectif ou au réseau de ville.
M. Jean-Christophe Visier. Sur le plan réglementaire, le moteur de calcul de la RT2012 intègre depuis longtemps les réseaux de chaleur, et les récupérations de chaleur, par exemple en chauffant de l’eau grâce à la chaleur dégagée par la climatisation du bâtiment d’à côté, sont fortement valorisées. Sur le plan de la recherche et développement, le CSTB développe un outil logiciel qui permet d’optimiser les réseaux, qu’ils soient de gaz, d’électricité, de chaleur, de façon à les utiliser de façon optimisée dans les zones d’aménagement. Il s’agit notamment d’identifier des chaleurs fatales qui pourraient être récupérées pour le chauffage de logements, par exemple celles produites par les centres de calcul ou les business centers, qui sont quasi-gratuites. Pour le CSTB, ce développement constitue un investissement scientifique fort ; il vise à donner aux aménageurs, dès l’amont du projet, et ensuite tout au long du projet, les éléments de faire des choix en connaissance de cause.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le CSTB met en place des outils. Sont-ils certifiés ? Quelles normes leur sont appliquées ? Sont-ils vendus, voire exportés ?
M. Etienne Crépon. Comme nous l’avons fait pour le moteur de calcul, nous confrontons nos outils à l’ensemble de la communauté scientifique, et la vente de nos outils logiciels constitue l’un des aspects de nos relations avec les acteurs économiques ; le chiffre d’affaires ainsi réalisé est modeste, de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros ces dernières années ; il devrait atteindre en 2016 près de cinq cent mille euros, avec l’objectif de poursuivre cette croissance, car j’estime que, au-delà de l’aspect financier, la diffusion de ces outils auprès des acteurs du secteur, collectivités locales ou bureaux d’études, fait complètement partie de nos missions. Des partenariats permettent d’étendre les ventes à l’Espagne et au Maroc notamment.
M. Jean-Yves Le Déaut. Trois dernières questions pour conclure. D’abord, l’arrêté du 3 mai 2007 définissant la réglementation thermique des bâtiments existants « élément par élément » a été mis à jour récemment sous la pression du Réseau pour la transition énergétique (CLER) et de l’ONG France Nature Environnement (FNE), qui avaient porté plainte auprès de la Commission européenne afin d’obliger la France à réviser et adapter ce texte « obsolète » aux évolutions technologiques, conformément à ce qu’impose tous les cinq ans la directive européenne relative à la performance énergétique des bâtiments.
Comment la rénovation « élément par élément » se combine-t-elle avec la nécessité d’une approche globale de la rénovation énergétique, qui permet de cibler par priorité les opérations de rénovation les plus efficaces, ainsi que je l’ai souligné dans mon rapport de 2014 ?
M. Jean-Christophe Visier. Quand on fait une réglementation « élément par élément », on est confronté à des réactions sur le mode : « Sur tel élément, ce qui est exigé n’est pas possible ! ». Mieux vaut donc une réglementation « molle », car ce cas se rencontre toujours. À l’inverse, une réglementation globale permet d’avancer de manière plus pragmatique ; si l’isolation d’une certaine paroi n’est pas possible, on peut en isoler une autre, et atteindre d’une autre manière l’objectif d’une performance globale. Le CSTB est très impliqué dans ce domaine, avec une double vision : d’abord, utiliser le moteur de calcul réglementaire pour la rénovation ; ensuite, compléter l’approche réglementaire par une démarche volontaire, et c’est dans cette logique que le CSTB a équipé certaines entreprises d’outils permettant d’effectuer une évaluation globale afin d’identifier les opérations de rénovation les plus pertinentes. À cet égard, le CSTB se trouve engagé tant avec le secteur public qu’avec le secteur privé.
M. Jean-Yves Le Déaut. Comme j’ai pu m’en rendre compte lors d’un déplacement effectué, voici un an et demi, à Phoenix en Arizona, le label américain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) s’appuie sur un comptage des consommations d’énergie simple et transparent : on compte toutes les consommations du bâtiment, utilisation d’équipements comprise, et on évalue ces consommations à partir des factures. A partir des coefficients de conversion appliqués aux différentes énergies utilisées, on peut évaluer les émissions de CO2. Le fait de tout compter, et non pas seulement les usages liés à l’utilisation de l’enveloppe (chauffage, eau chaude, éclairage, ventilation, climatisation) semble aller plutôt dans le sens de l’histoire, puisque les normes européennes poussent par ailleurs à une meilleure efficacité énergétique des équipements. Quels inconvénients verriez-vous à ce qu’on en vienne à un tel système pour la future réglementation thermique française de 2018 ?
M. Etienne Crépon. Il faut bien séparer les choses. LEED est une certification volontaire à laquelle les maîtres d’ouvrage peuvent recourir sur une base déclarative. La France est dotée d’une certification volontaire similaire qui est la certification HQE performance, et en termes de performance et d’efficacité, la certification HQE performance est, aux dires des maîtres d’ouvrage, bien plus pointue que la certification LEED ; notamment, elle présente l’énorme atout d’être décernée par des tiers indépendants. Mais, à côté de la certification volontaire, c’est une autre chose d’établir une réglementation dont les critères doivent être pris en compte en amont, dès la conception, de façon à modifier si nécessaire le projet pour bien la respecter. On est vraiment là sur deux stades de vie différents du bâtiment, et deux démarches différentes : d’un côté le respect d’une obligation, d’un minimum réglementaire, de l’autre, la valorisation d’une performance, notamment au titre de la « valeur verte » pour le patrimoine tertiaire, et là-dessus, même si les Américains sont meilleurs commercialement, je ne pense pas que la certification française ait beaucoup à en rabattre par rapport à LEED.
M. Jean-Christophe Visier. Deux compléments d’information. D’abord, le label « Énergie-Carbone » prend en compte effectivement tous les usages au sein du bâtiment. Ensuite, le moment de l’évaluation de la performance est déterminant ; aussi bien pour LEED que pour HQE, on distingue l’évaluation de performance à la conception, qui ne se mesure pas, mais se prévoit, et l’évaluation de performance en exploitation, qui peut là se traduire par une mesure puisque le bâtiment existe concrètement. Les promoteurs de LEED doivent gérer de nombreux contentieux du fait de performances affichées non réellement atteintes.
M. Jean-Yves Le Déaut. Justement, on pourrait prendre pour norme l’objectif à atteindre, en mettant tous les outils de conception au service de l’atteinte de cet objectif réel. Une expérimentation en grandeur réelle à Berlin a montré qu’on pouvait avoir une consommation réelle d’énergie double de sa valeur théorique.
M. Etienne Crépon. Le décalage entre les consommations annoncées et les consommations réelles est l’un des sujets majeurs de préoccupation des grands maîtres d’ouvrage publics, pour lequel ils demandent des travaux scientifiques du CSTB. Quelquefois les écarts peuvent s’expliquer quand, par exemple, on livre une crèche sans expliquer au personnel comment utiliser la chaufferie de dernière génération.
M. Jean-Yves Le Déaut. Selon votre rapport d’activité, le nombre d’ATEX (Appréciation technique d’expérimentation) augmente vite, progressant de 23 % en 2015 par rapport à 2014 et de 43 % par rapport à 2013. Quels sont les domaines techniques qui paraissent les plus innovants ? Voyez-vous des innovations qui aident à une plus grande précision de mise en œuvre ?
M. Etienne Crépon. L’appréciation technique d’expérimentation est une procédure bien plus légère que l’avis technique ; elle s’obtient en deux mois, et c’est ce qui explique son succès auprès des industriels. Ce succès est aussi le résultat de la démarche d’accompagnement des innovateurs mise en place dans les territoires à travers le réseau ARIANE : cela permet de dire à l’industriel : voilà, dans votre cas, la procédure d’évaluation à suivre. Les domaines d’innovation les plus dynamiques en ce qui concernent les ATEX, sur les trois dernières années, sont principalement les solutions techniques pour les façades.
Une dernière remarque : jusqu’à l’an dernier, les appréciations techniques expérimentales se faisaient surtout sur des chantiers ; en 2016, on a constaté une très forte croissance des appréciations techniques expérimentales de procédés, qui concernaient donc le produit de manière générique. Ce basculement est révélateur d’un regain de confiance des industriels des matériaux de construction vis à vis d’une possible reprise du marché, puisqu’ils effectuent l’appréciation non pas uniquement sur la base d’un contrat donné, mais d’une manière générique en visant l’ensemble du marché.
M. Jean-Yves Le Déaut. Vous ne nous avez pas parlé de questions budgétaires. Comment cela se passe-t-il sur ce plan pour le CSTB ? Il faut que vous sachiez que nos relations régulières signifient aussi que nous pouvons intervenir si vous êtes victimes de coupures décidées en dépit du bon sens ; un communiqué de presse récent témoigne ainsi d’une intervention de l’OPECST en faveur des moyens de l’Autorité de sûreté nucléaire, agence qui rend compte également chaque année sur son rapport d’activités devant l’OPECST.
M. Etienne Crépon. Nous avons désormais des parlementaires au sein de notre conseil d’administration, et de toute façon, notre situation est différente de celle d’une autorité administrative indépendante. Mais nous assumons notre part des restrictions budgétaires imposées par la nécessité de lutter contre les déficits publics.
M. Jean-Yves Le Déaut. Ces restrictions budgétaires ont-elles une incidence sur le coût des évaluations techniques pour les entreprises ?
M. Etienne Crépon. En ce domaine, la tendance est plutôt à l’abaissement du barème des avis techniques. Au total, nous maintenons l’équilibre des comptes, mais cela passe par une politique salariale très rigoureuse.
M. Jean-Yves Le Déaut. Je vous remercie pour l’ensemble de vos explications. Nous savons maintenant que vous étiez au cœur de la définition du label « Énergie-Carbone », mais que les décisions quant aux différents seuils étaient de nature politique. Vous avez confirmé le bas niveau d’exigence de ce label s’agissant des rejets de carbone, et nous avons entendu l’argument de la nécessité d’une démarche progressive à des fins pédagogiques.
M. Etienne Crépon. Je me permets en effet de rappeler mes propos sur la nécessité d’une progressivité pour obtenir la pleine adhésion de tous les acteurs.
M. Jean-Yves Le Déaut. J’entends bien. Il existe effectivement un risque de donner un coup d’épée dans l’eau si l’exigence est d’emblée trop forte. Mais il y a néanmoins un meilleur équilibre à trouver pour que la réglementation, conformément aux vœux exprimés par le Parlement en 2010, puis à nouveau en 2015, permette tout de même de maîtriser un tant soit peu les émissions de gaz à effet de serre. Et puisque la définition de cet équilibre relève de la responsabilité du Gouvernement, c’est à nous d’intervenir en ce sens au niveau politique.
ANNEXE N° 6 :
LETTRES AUX MINISTRES EN CHARGE
DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE EN ÉNERGIE
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2016
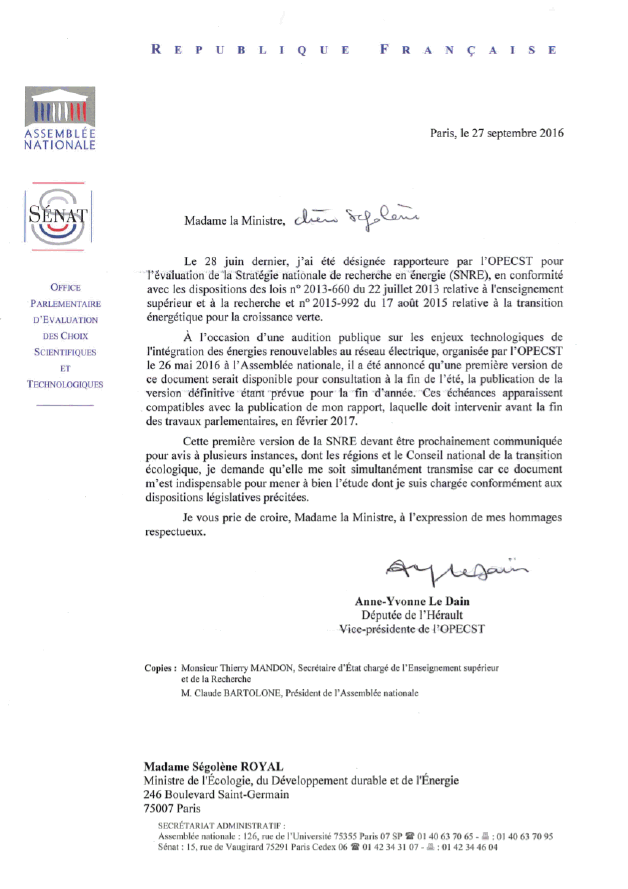
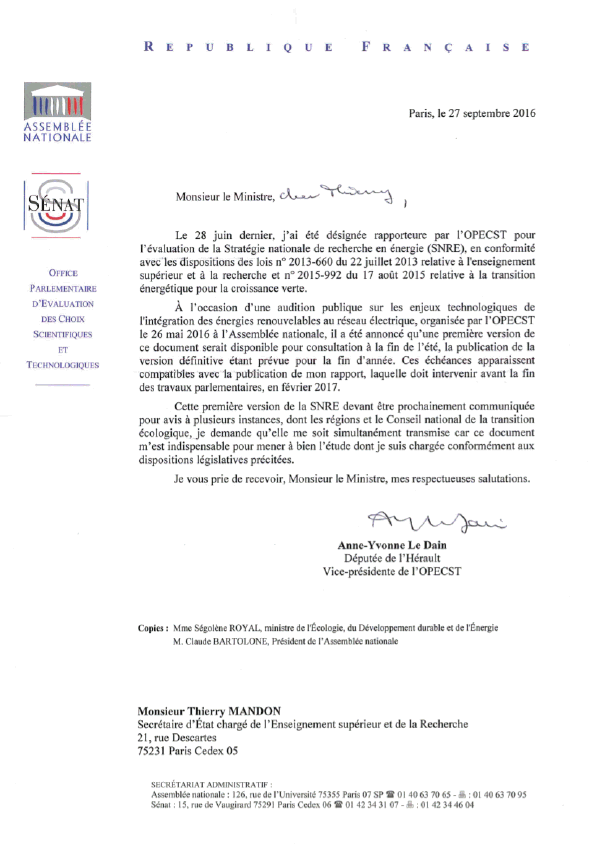
ANNEXE N° 7 :
SYNTHÈSE ANRT – COMMENT LA RECHERCHE SUR L’ÉNERGIE PEUT-ELLE FAVORISER LE RAYONNEMENT MONDIAL
DES ENTREPRISES FRANÇAISES ?
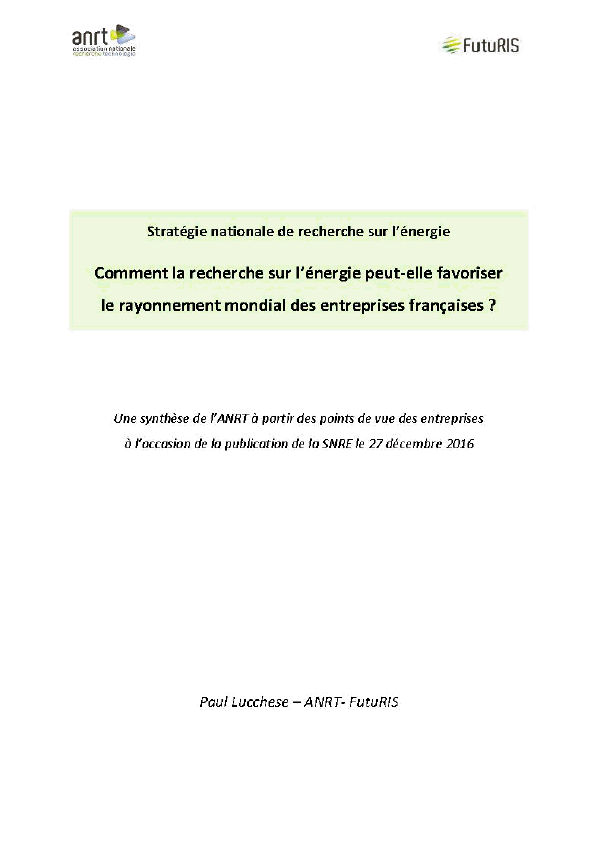
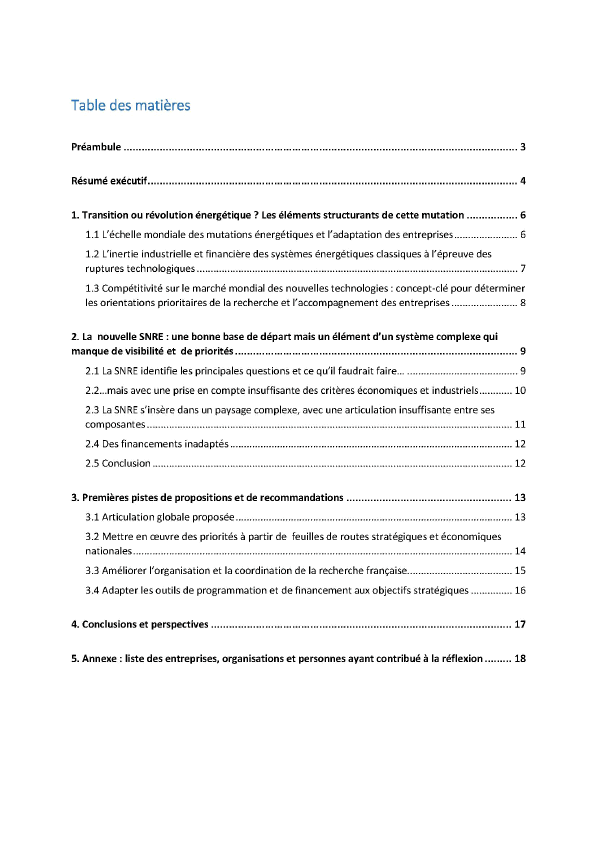
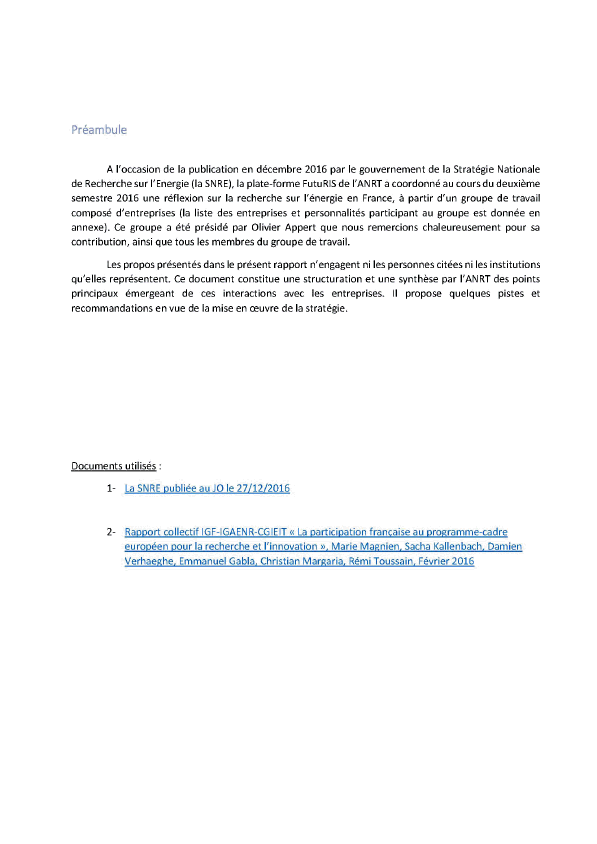
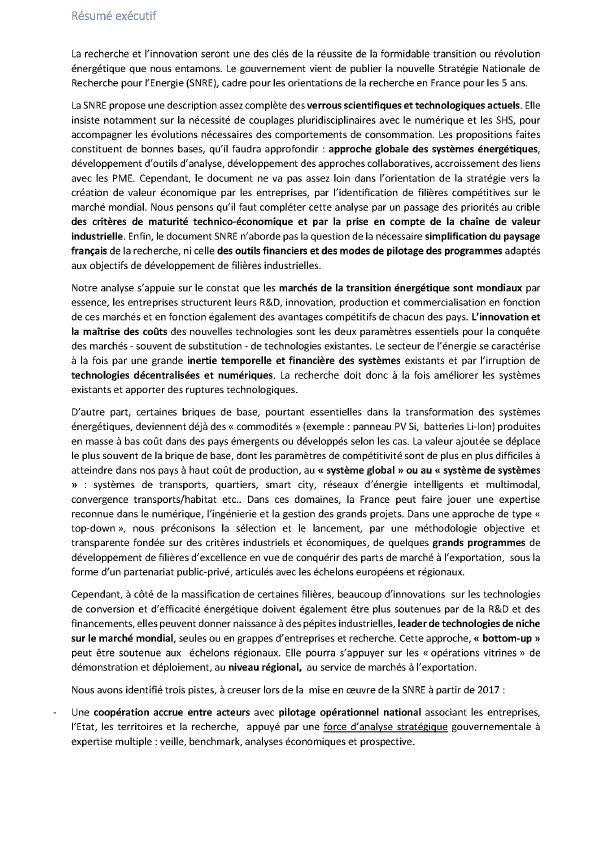
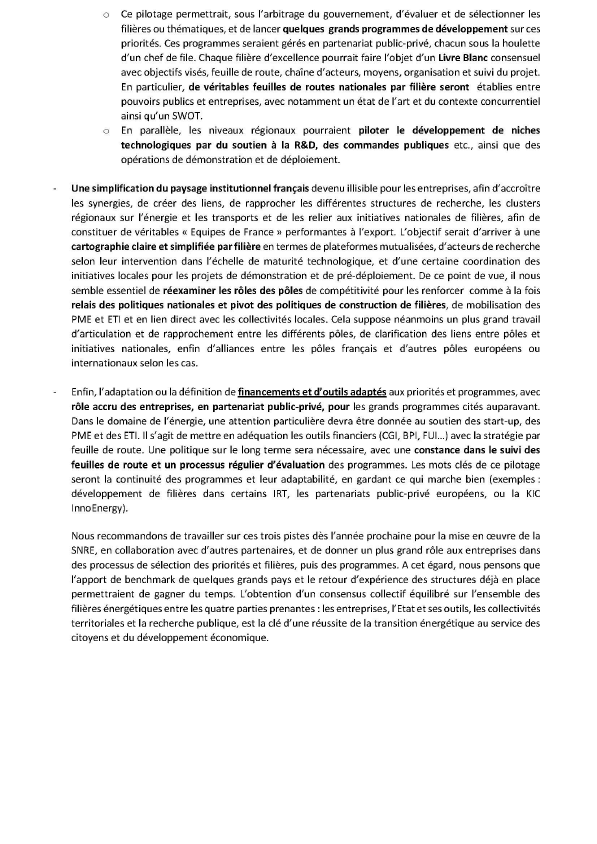

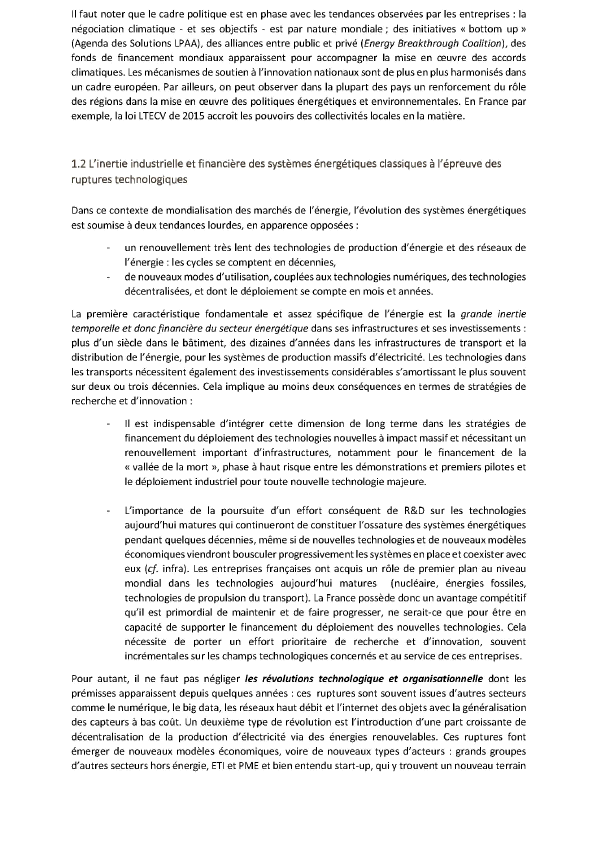
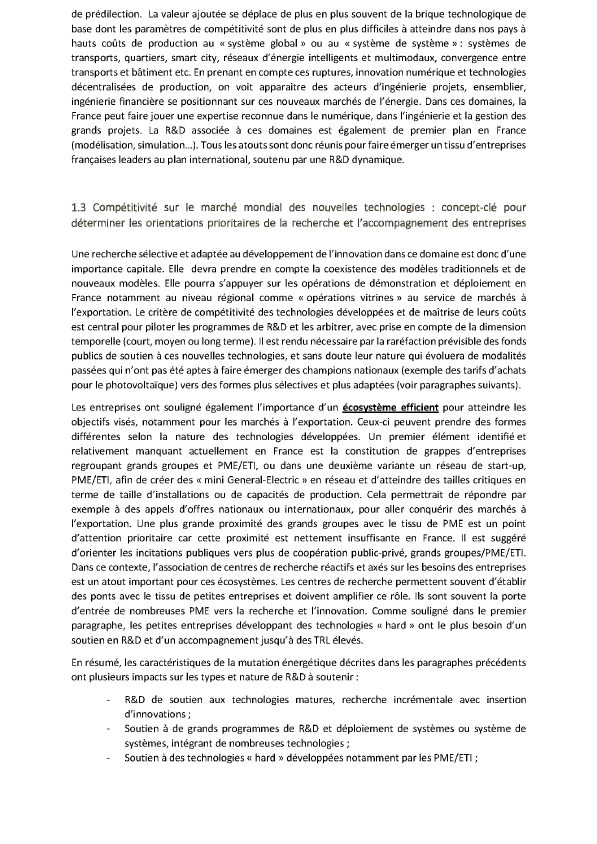
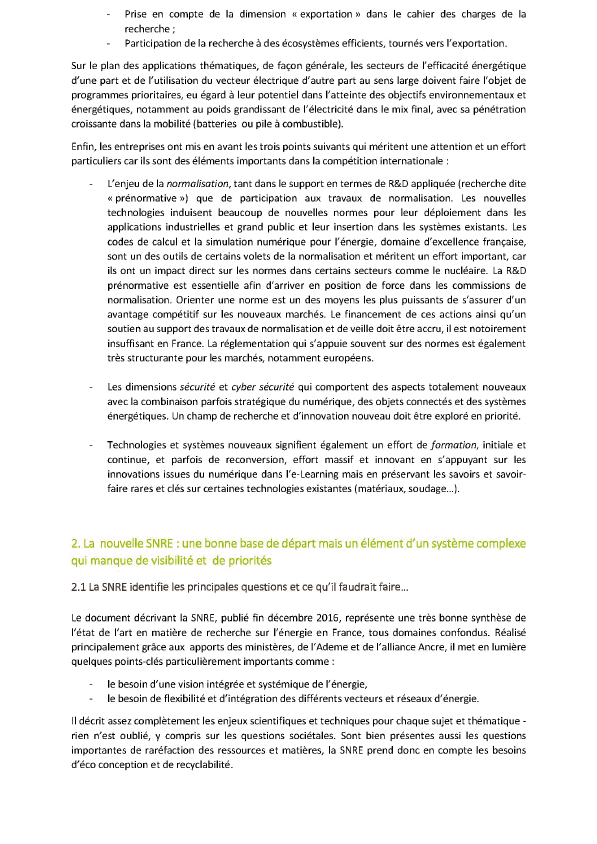
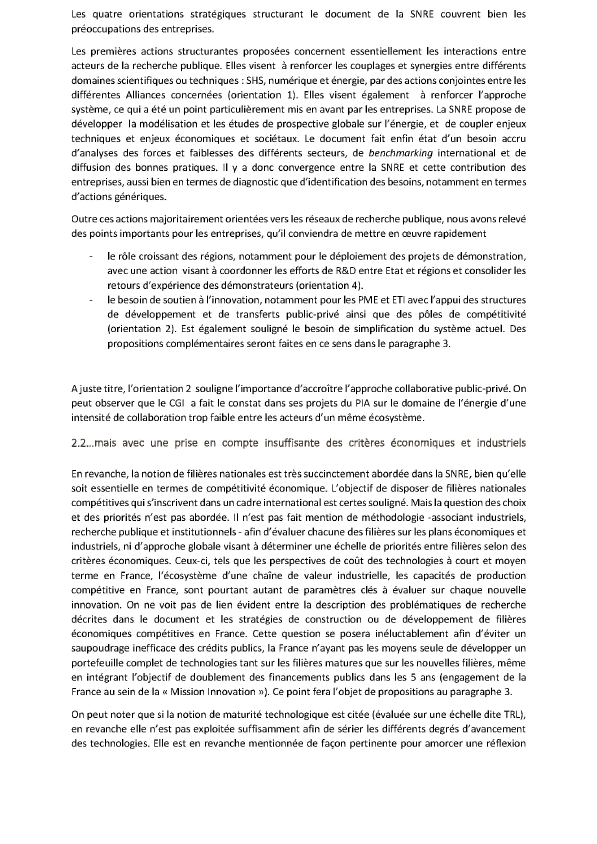
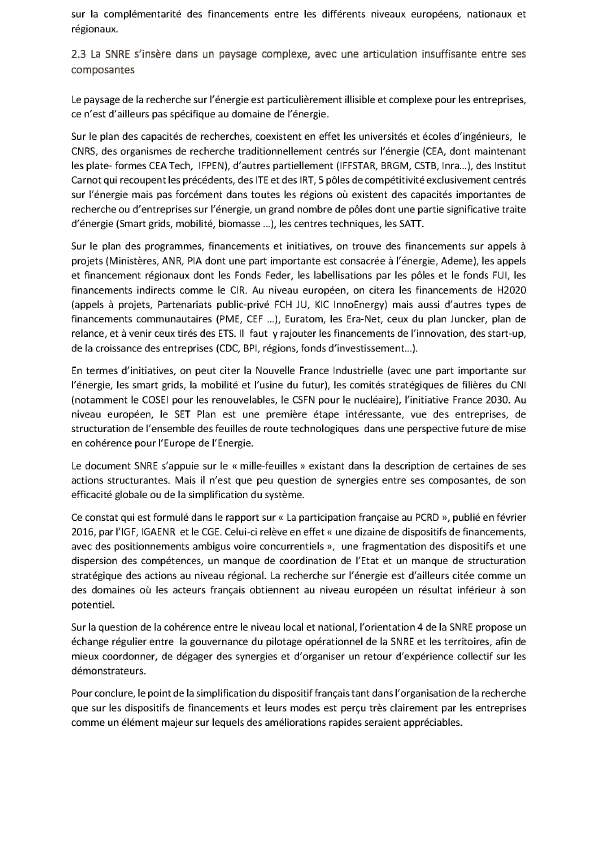
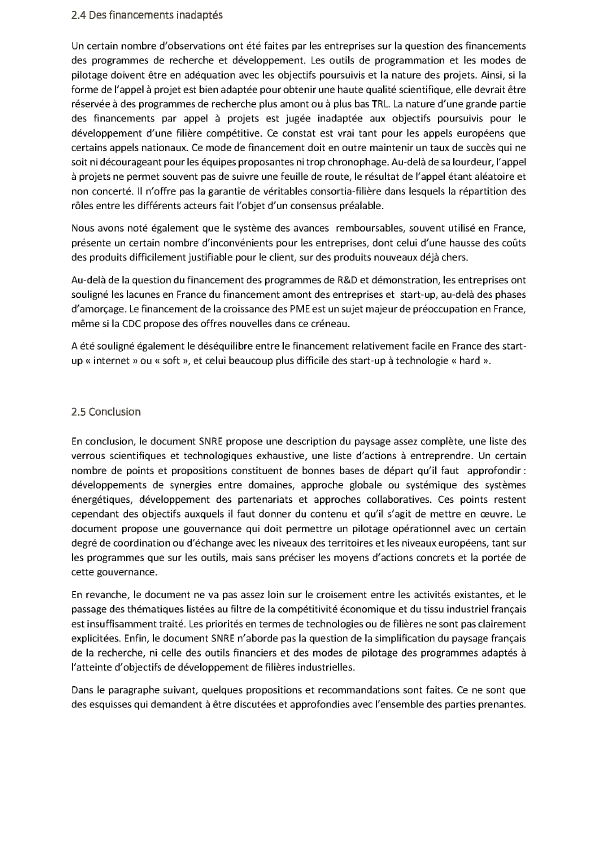
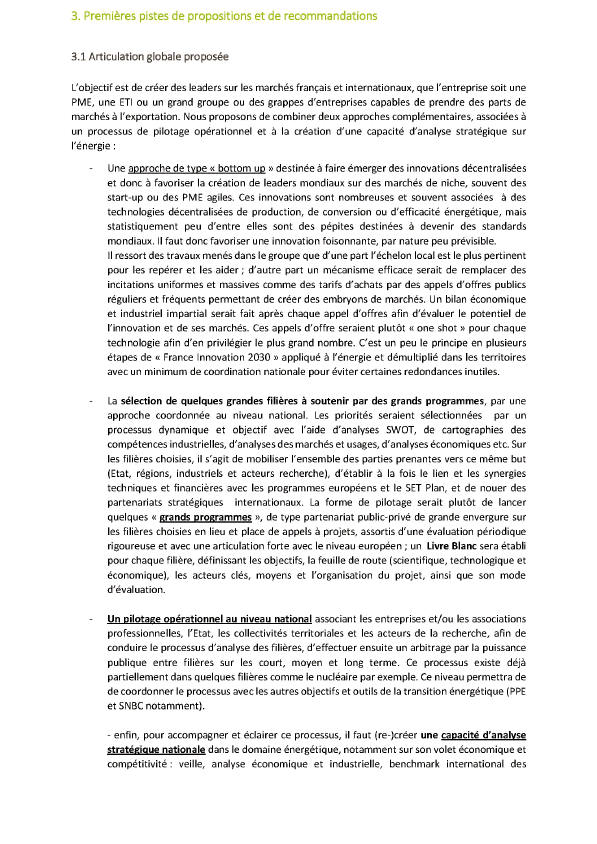
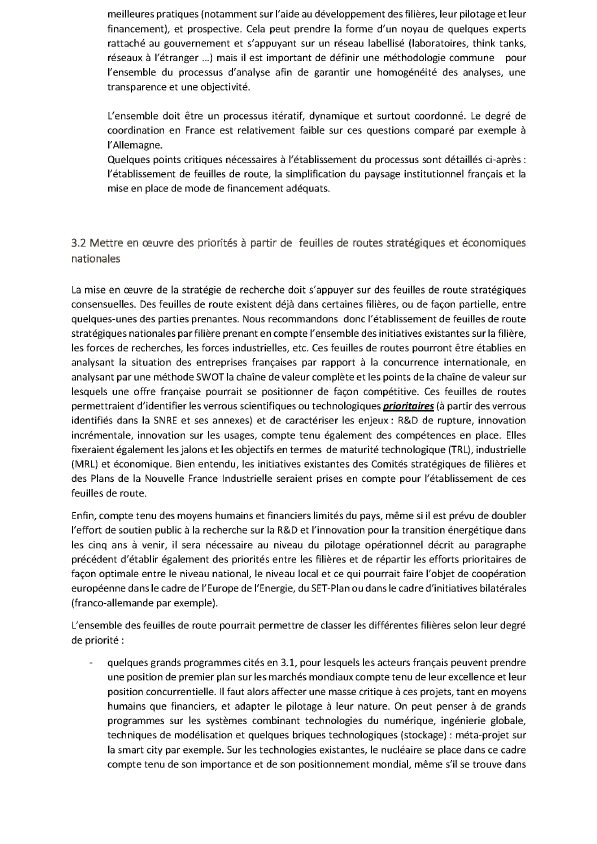
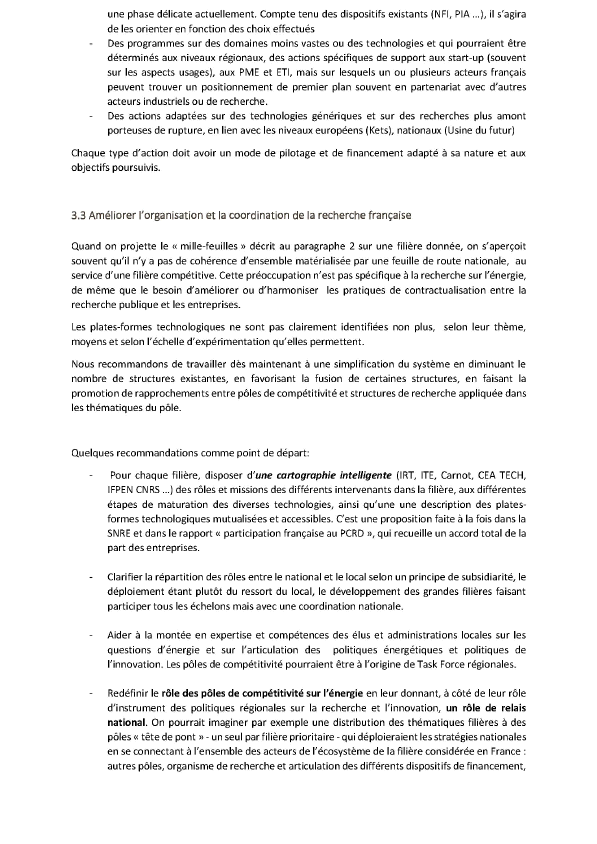
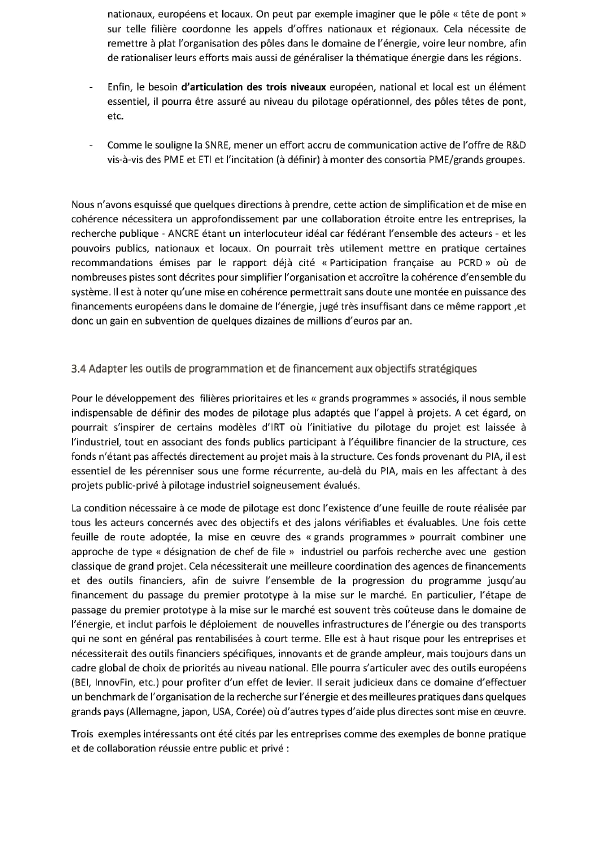
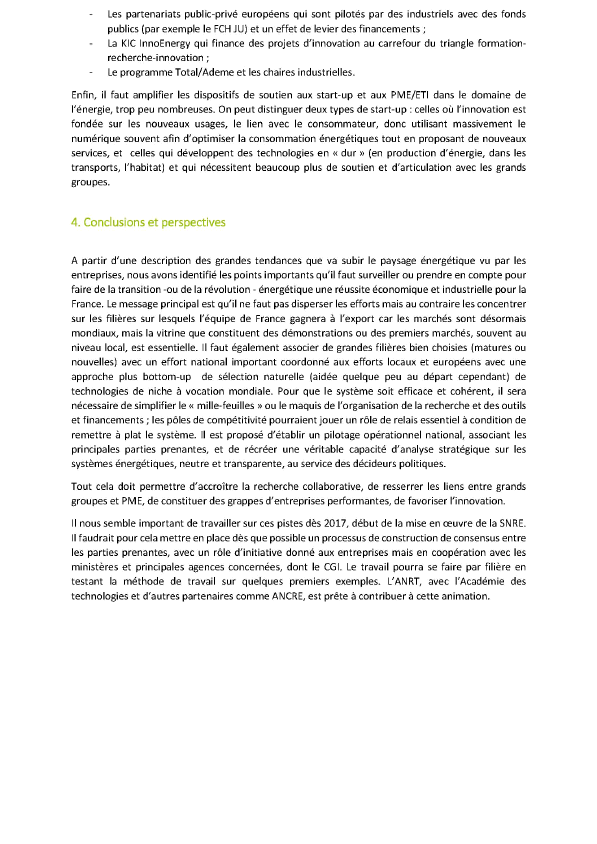
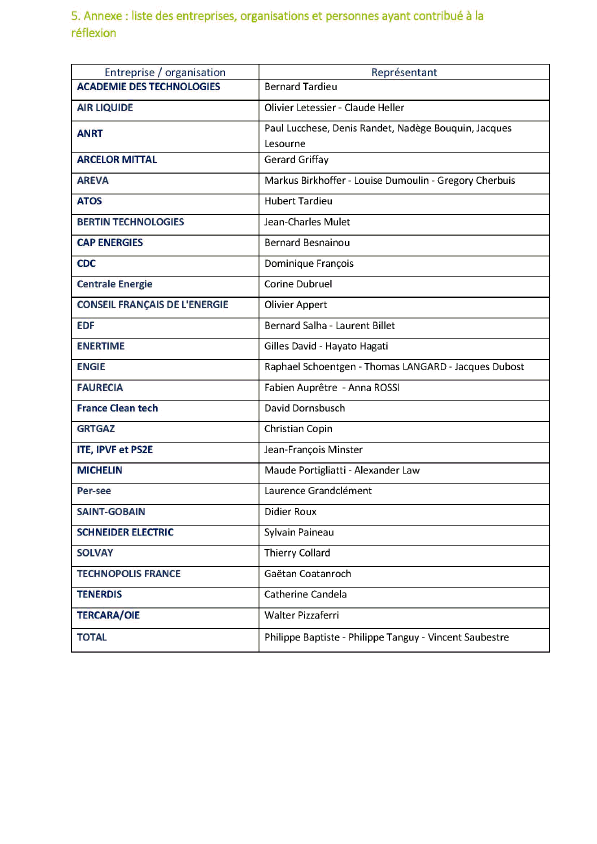
ANNEXE N° 8 :
ANRT – RAPPORT POUR L’OPECST SUR LES CIFRE TOUCHANT
À L’ÉNERGIE DEPUIS 2006
|
|
Rapport pour l’OPECST
Les Cifre touchant à l’énergie depuis 2006
Objet : Fournir des données chiffrées sur les Conventions Industrielles de Formation par la Recherche attribuées depuis 2006 à des doctorants sur des sujets de recherche touchant à l’énergie
Méthodologie de constitution de la base de données
1. Extraction de la base des Cifre acceptées sur la période 2006 à 2016
Ø Résultat : 12942 Cifre
2. Identification des Cifre attribuées à des sujets de recherche touchant à l’énergie
a. Recherche filtrée par mot-clés dans l’intitulé du sujet de thèse
Ø énergie/énergétique /pétrole /gaz /gazeux /houille /lignite /charbon /tourbe /hydrocarbure /minerais /cokéfaction /raffinage /nucléaire /raffinage /recycl (recherche partielle pour recyclage et dérivés) /hydraul (recherche partielle pour hydraulique et ses dérivés )/éolien /turbines /vapeur /générateur /chaudronnerie /chauffage / frigorifique / combust (recherche partielle pour combustion, combustible et ses dérivés) /thermoélectrique/ photovoltaïque/ géothermique /recyclage /moteur / électrique
b. Recherche filtrée concernant un panel d’entreprises leaders dans le domaine de l’énergie et du transport
c. Recherche orientée par code APE (pour secteur d’activité principale exercée)
Ø 23 : Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
Ø 292A : Fabrication de fours et brûleurs
Ø 292F : Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Ø 37 : Récupération de matières recyclables
Ø 40 : Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur
3. Nettoyage des trois listings de thèses Cifre (élimination des sujets ne touchant pas au domaine de l’énergie)
Résultat :
Ø Recherche Filtre par mot-clés : 752 résultats
Ø Recherche Filtre par entreprise : 951 résultats
Ø Recherche Filtre par code APE : 100 résultats
Ø Total : 1803 Cifre
4. Fusion des listes et élimination des redondances
Ø 327 doublons éliminés (18% des résultats, indice que les recherches se sont recoupées)
Résultats
a. Nombre total de Cifre touchant l’énergie initiées entre 2006 et 2016
Ø Total : 1476 Cifre
Ø Soit 11 % des Cifre analysées (1476 sur 12942)
b. Répartition des Cifre octroyées par année
Année d’octroi |
Nombre de Cifre « Energie » |
2006 |
96 |
2007 |
121 |
2008 |
165 |
2009 |
161 |
2010 |
146 |
2011 |
165 |
2012 |
147 |
2013 |
145 |
2014 |
123 |
2015 |
110 |
2016 |
97 |
c. Origine des doctorants Cifre
Ø Echantillon : 942 Cifre (parmi celles octroyées après 2011, date de changement de système informatique de gestion)
Etat de la thèse |
Nombre de Cifre « Energie » |
% de Cifre (sur 942 après 2011) |
Master 2 Recherche |
468 |
50 |
Master 2 Professionnel |
71 |
7 |
Ecole d’Ingénieur |
402 |
43 |
Ecole de Commerce |
1 |
0 |
Pas d’information |
534 |
- |
d. Répartition des thèses Cifre par discipline scientifique
Ø Echantillon : 765 Cifre
Discipline Scientifique (DS) |
Nombre de Cifre « Energie » |
% de Cifre (sur 765 après 2011) |
Mathématiques et leurs applications (DS1) |
81 |
11 |
Physique (DS2) |
7 |
1 |
Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace (DS3) |
15 |
2 |
Chimie (DS4) |
148 |
19 |
Biologie, Médecine, Santé (DS5) |
11 |
1 |
Sciences Humaines et Sociales (DS6) |
37 |
5 |
Sciences Juridiques, Politiques, Economiques de Gestion (DS7) |
43 |
6 |
Sciences pour l’Ingénieur : sciences de la mécanique et de l’énergie, génie des procédés et de la production génie électrique, transports, génie civil (DS8) |
356 |
46 |
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (DS9) |
59 |
8 |
Agronomie, Productions animales et végétales et agro-alimentaires (DS10) |
8 |
1 |
Pas d’information |
711 |
- |
Ø Les sciences pour l’ingénieur rassemblent - de loin - le plus de thèses Cifre touchant l’énergie (46%).
Ø Elles sont suivies par les sciences de la chimie et des mathématiques (19% et 11% respectivement).
e. Typologie des entreprises Cifre selon leur effectif
Ø Echantillon : 1344 Cifre
Effectif |
Nombre de Cifre « Energie » |
TPE (<10) |
58 |
PME |
141 |
ETI |
247 |
Grand groupe |
898 |
Pas d’information (Cifre avant 2011) |
132 |
Ø 2/3 des Cifre touchant l’énergie sont portées par des grands groupes.
Ø Seul 15% des Cifre touchant l’énergie sont initiées par des TPE et PME.
ANNEXE N° 9 :
AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DU 3 NOVEMBRE 2016
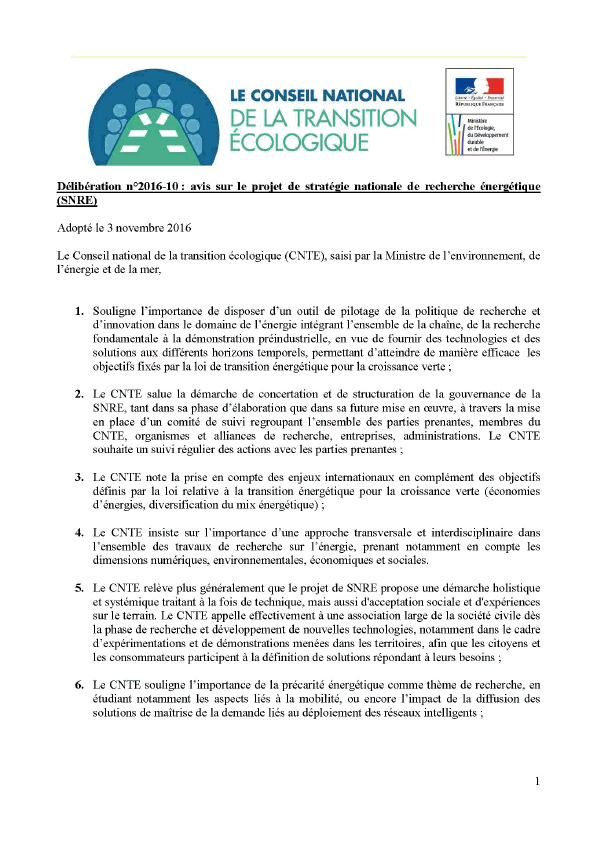
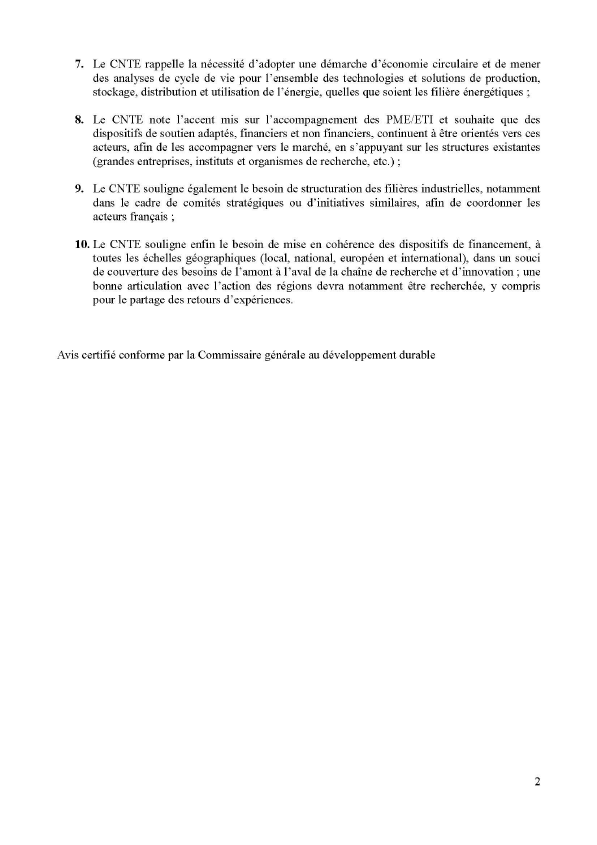
ANNEXE N° 10 :
AVIS DU CSE DU 9 DÉCEMBRE 2016
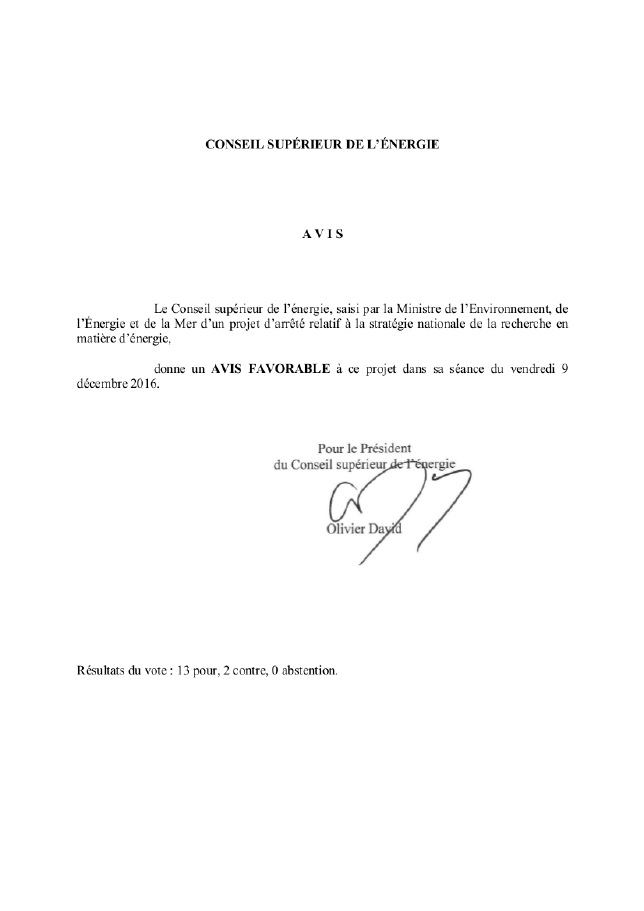
ANNEXE N° 11 :
ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2016 PORTANT PUBLICATION
DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE

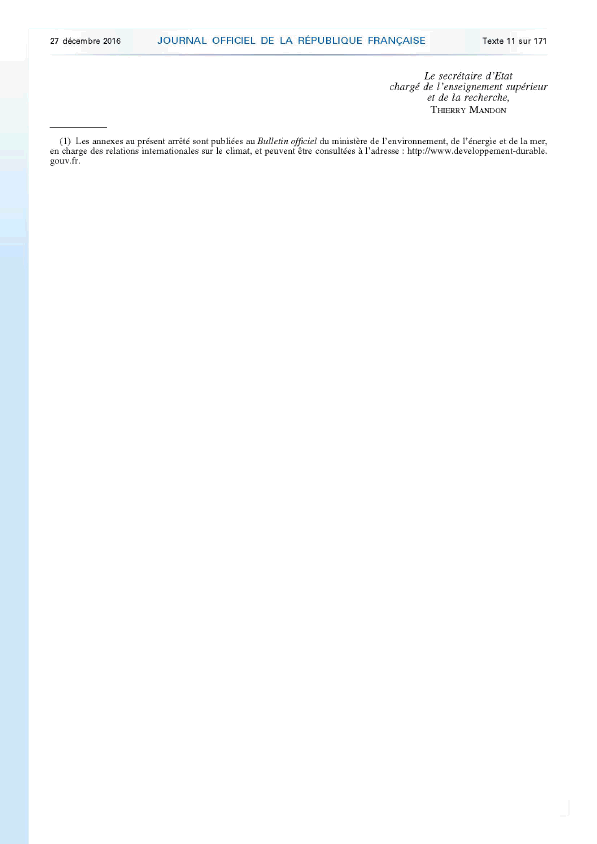
1 () Article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, fixant les orientations de la politique énergétique :
« I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre. »
2 () Azoulay, Pierre; Zivin, Joshua S. Graff; Manso, Gustavo. 2011. Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences, RAND Journal of Economics - Vol. 42.2011, 3, p. 527-554.
3 () Laura Diaz Anadon, Gabriel Chan, Amitai Y. Bin-Nun Venkatesh Narayanamurti. The pressing energy innovation challenge of the US National Laboratories, Nature - Energy Vol. 1, octobre 2016
4 () Le modèle « Internet of Energy (IOE) model for Europe », développé par l’Université de technologie de Lappeenrata (en finnois : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ou LTY, en anglais : Lappeenrata University of Technology, ou LUT), en Finlande, constitue, à cet égard, une exception qu’il convient de saluer, puisque l’ensemble des données correspondantes ont été mises à disposition de la communauté scientifique.
© Assemblée nationale
