


______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI (N° 2447) pour la croissance et l’activité.
TOME I
EXAMEN DES ARTICLES
Volume 2
Titres II à IV
PAR M. Richard FERRAND,
Rapporteur général
et
MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,
Rapporteurs thématiques
——
La commission spéciale est composée de :
M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ; M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, Mme Karine Berger, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Sandrine Mazetier, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.
TITRE II – INVESTIR 15
Article 26 (art. 9 et 20 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014) Extension de l’autorisation unique en matière d’ICPE et habilitation à légiférer par voie d’ordonnance 17
Article 27 (art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014) Extension du mécanisme du certificat de projet à la région d’Île-de-France 25
Article 27 bis [nouveau] (art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement) Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable 29
Article 28 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement 32
Article 29 (art. L. 480-13 du code de l’urbanisme) : Sécurisation des projets de construction 81
Après l’article 29 91
Article 30 (art. L. 431-3 du code de l’urbanisme et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) : Harmonisation des règles de recours à un architecte pour les exploitations agricoles 92
Article 31 (art. L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Facilitation du déploiement de la fibre optique dans les immeubles soumis au régime de la copropriété 94
Article 32 : Habilitation du Gouvernement à transposer deux directives européennes et à simplifier le droit applicable aux servitudes radioélectriques 100
Article 33 (art. L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques) : Ratification d’une ordonnance relative à l’économie numérique et clarification rédactionnelle 107
Article 33 bis [nouveau] (articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs 114
Article 33 ter [nouveau] (art. L. 32 du code des postes et des communications électroniques) : Définition de l’itinérance métropolitaine 118
Article 33 quater (art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) : Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques 122
Article 33 quinquies [nouveau] (article L. 34-8-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Mise en œuvre de l’itinérance métropolitaine 128
Article 33 sexies [nouveau] (art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Rapport annuel de l’ARCEP sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles 130
Article 33 septies [nouveau] (art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Adaptation au secteur numérique des dispositions relatives à la transparence sur le marché publicitaire 131
Article 33 octies [nouveau] (art. 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) : Reconnaissance dans la loi des agences de développement de l’économie sociale et solidaire 136
Article 33 nonies [nouveau] Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte 139
Section 2 : Améliorer le financement 143
Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts, L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale et L. 225-197-1 du code de commerce) : Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites 143
Article 35 (art. 154 quinquies et 163 bis G du code général des impôts) : Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) 166
Après l’article 35 176
Article 35 bis [nouveau] (art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Réduction de dix ans à sept ans de la condition de non-remboursement des apports pour le bénéfice des dispositifs « ISF-PME » ou « Madelin » 182
Article 35 ter [nouveau] (art. 200 bis et 238 bis du code général des impôts) : Assouplissement des critères permettant de bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés pour mécénat 189
Après l’article 35 ter 192
Article 35 quater [nouveau] (art. L. 214-154 et L. 214-162-1 à L. 214-162-12 [nouveaux] du code monétaire et financier et 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A, 1655 sexies B [nouveaux], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) : Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple 200
Après l’article 35 quater 205
Article 35 quinquies [nouveau] (article L. 214-164 du code monétaire et financier) : Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise 206
Article 35 sexies [nouveau] (article L. 214-164 du code monétaire et financier) : Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise doivent respecter dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés 207
Article 35 septies [nouveau] (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) : Distribution facultative de dividendes dans les fonds communs de placement en entreprise 208
Article 35 octies [nouveau] (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) : Suppression de la contribution spécifique à la charge de l’employeur sur l’abondement à un plan d’épargne pour la retraite collectif 209
Avant l’article 36 210
Article 35 nonies [nouveau] (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) : Taux réduit de forfait social en cas de placement des sommes issues de l’épargne salariale sur un plan d’épargne pour la retraite collectif 211
Article 35 decies [nouveau] (art. L. 3315-2 du code du travail) : Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises en cas d’absence de choix du salarié 214
Article 35 undecies [nouveau] (articles L. 3324-12 et L. 3334-11 du code du travail) : Instauration d’une gestion par défaut du plan d’épargne pour la retraite collectif en fonction de l’âge 216
Avant l’article 36 217
Article 36 (art. L. 3314 9 et L. 3324 10 du code du travail) : Harmonisation de la date de versement des primes d’intéressement et de participation 217
Article 36 bis [nouveau] (art. L. 3322-9 du code du travail) : Redynamisation de la négociation de branche sur l’épargne salariale 222
Article 37 (art. L. 3332 3 du code du travail) : Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation 223
Article 37 bis [nouveau] (art. L. 3333-7 du code du travail) : Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprises 226
Article 38 (art. L. 3334-2 du code du travail) : Instauration du plan d’épargne pour la retraite collectif par les salariés en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise 227
Après l’article 38 228
Article 39 (art. L. 3332-10 et L. 3334-8 du code du travail) : Alignement des quotas de jours transférables vers un plan d’épargne pour la retraite collectif selon qu’ils proviennent d’un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris en l’absence de compte épargne-temps 230
Article 39 bis [nouveau] (art. L. 3341-6 du code du travail) : Amélioration de l’information des salariés sur l’épargne salariale 233
Article 39 ter [nouveau] (art. L. 3341-7 du code du travail) : Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs 234
Article 39 quater [nouveau] (art.e L. 3346-1 du code du travail) : Avis consultatif du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié en matière de déblocage de l’épargne salariale 235
Article 40 (art. L. 3312-5 du code du travail) : Faculté offerte aux salariés, au même titre que les autres signataires, de renégocier un accord d’intéressement comportant une clause de tacite reconduction 236
Après l’article 40 bis 237
Article 40 bis [nouveau] (art. L. 144-1 du code monétaire et financier) : Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises 240
Après l’article 40 241
Article 40 ter [nouveau] (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) : Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés signant un premier accord d’épargne salariale 249
Article 40 quater [nouveau] : Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales 251
Après l’article 40 quater 252
Section 3 : Innover 257
Article 41 (art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle) : Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle 257
Article 41 bis [nouveau] (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) : Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié 261
Article 41 ter [nouveau] : Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte 262
Article 42 (art. L. 6143-1, L. 6143-4, L. 6143-7 et L. 6145-7 du code de la santé publique) : Prise de participation et création de filiales par les centres hospitaliers universitaires 263
Chapitre II – Entreprises à participation publique 270
Section 1 : Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique 270
Article 43 A (nouveau) : (articles L. 225-7-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, 1136 du code général des impôts et 4, 6-2, 14, 15 et 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence 270
Article 43 B (nouveau) : (articles 7, 8, 16, 22, 23, 24 et 34 de l’ordonnance n° 2014-948) Corrections rédactionnelles apportées à l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence 272
Article 43 C (nouveau) : (article 41 de l’ordonnance n° 2014-948) Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements 273
Article 43 : Ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence 274
Article 43 bis (article 22 de l’ordonnance n° 2014-948) : Abaissement des seuils entraînant la compétence du législateur en cas de privatisation d’une société détenue par l’État 286
Article 43 ter (article 26 de l’ordonnance n° 2014-948) : Abaissement des seuils entraînant la compétence de la Commission des participations et des transferts en cas de transferts de participations au secteur privé 288
Article 44 (articles 31 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, L. 111-69 du code de l’énergie, 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970) : Mise en conformité de l’action spécifique avec le droit constitutionnel et européen 289
Section 2 : Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire 298
Article 45 (article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables 298
Article 46 (article 32 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Transparence des sociétés holding de l’État pour l’application des seuils légaux de détention 301
Section 3 : Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique 303
Article 47 : (articles 4, 6, 7 et 8 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989) Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales 303
Article 48 (article L. 5124-14 du code de la santé publique) : Suppression de l’obligation de détention majoritaire par l’État ou ses établissements publics du capital de la société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » 320
Article 49 : Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État dans deux grands aéroports régionaux 332
Après l’article 49 347
Section 4 : Dispositions diverses 349
Article 50 (article 31 ter [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé 349
Article 51 (art. L. 2111-10-1 du code des transports) : Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire 354
Article 52 (article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014) : Applicabilité de l’exemption transitoire à l’obligation de déposer une offre publique d’achat du fait de l’attribution de vote double 359
Article 53 (article L. 433-1-2 du code monétaire et financier) : Renforcement du dispositif anti-« excès de vitesse » en matière d’augmentation de détention du capital ou des droits de vote 361
Article 53 bis : Changement de dénomination de BPI-Groupe 363
Article 53 ter (article 40-1 [nouveau] de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013) : Habilitation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques 364
Après l’article 53 ter 366
Chapitre III – Industrie 369
Article 54 (article L. 592-28-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Activités internationales de l’Autorité de sûreté nucléaire 369
Après l’article 54 377
Article 54 bis [nouveau] (article 266 quindecies du code des douanes) : Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale 383
Après l’article 54 386
Article 54 ter [nouveau] (article L. 321-19 du code de l’énergie) : Soutien au mécanisme d’interruptibilité en matière d’approvisionnement électrique 387
Article 54 quater [nouveau] (article L. 524-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Conditions d’accès à l’électricité des sites industriels électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale 388
Article 55 (art. L. 123-28-1 et L. 123-28-2 [nouveaux] du code de commerce) : Allégement des obligations comptables des TPE sans activité 391
Article 55 bis [nouveau] (art. L. 441-6-1 du code de commerce) : Allègement de l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement pour les entreprises ne publiant pas de rapport de gestion 398
Article 55 ter [nouveau] (art. 526-1 à 526-3 du code de commerce) : Insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels 400
Article 56 (art. L. 145-10, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49, L. 145-55 du code de commerce et art. 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) : Suppression de l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial 405
Article 56 bis [nouveau] (art. 1244-4 [nouveau] et 2238 du code civil, art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) : Création d’une procédure amiable de recouvrement des petites créances par l’intermédiaire des huissiers 409
Après l’article 56 bis 410
Article 57 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour transposer une directive et pour simplifier le droit relatif aux contrats de concession 413
Article 58 (art. L. 121-21, L. 132-2 et L. 141-1-2 du code de la consommation, art. L. 465-2 du code de commerce) : Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant 424
Article 58 bis [nouveau] (art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce) : Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL sur le territoire 427
Article 58 ter [nouveau] (art. L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce) : Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance 428
Article 58 quater [nouveau] (art. L. 232-25 du code de commerce) : Faculté, pour les sociétés, d’obtenir la non-publicité de leurs comptes annuels 432
Après l’article 58 quater 434
Section 2 : Procédures de l’Autorité de la concurrence 437
Article 59 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour préciser les règles applicables en matière de concentration économique et pour simplifier et améliorer l’efficacité des procédures devant l’Autorité de la concurrence 437
Article 59 bis [nouveau] (art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-8 et L. 461-3 du code de commerce) : Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations 443
Article 59 ter [nouveau] (art. L. 450-3 du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence 446
Article 59 quater [nouveau] (art. L. 462-8 et L. 464-9 du code de commerce) : Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale 447
Article 59 quinquies [nouveau] (art. L. 464-2 du code de commerce) : Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence 448
Section 3 : Faciliter la vie de l’entreprise 449
Article 60 A [nouveau] (art. 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) : Reconnaissance des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable 449
Article 60 : Carte d’identité virtuelle des entreprises 451
Après l’article 60 453
Article 61 : Dérogation, pour les trois EPIC du groupe public ferroviaire, à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l’État 457
Article 61 bis (nouveau) : Habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre le développement de la facturation électronique entre les entreprises 461
Article 62 (art. L. 581-10 [nouveau] du code de l'environnement) : Dispositifs publicitaires de grande taille implantés dans l’emprise d’équipements sportifs 462
Article 63 (art. L. 581-14 du code de l'environnement) : Dispositions de coordination 469
Après l’article 63 470
Article 64 (art. L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale) : Rapport annuel d’information sur les retraites chapeau 471
Article 64 bis [nouveau] (art. L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce) : Conditionnement des retraites chapeau des dirigeants mandataires sociaux à la performance de l’entreprise 487
Après l’article 64 : bis 488
Article 64 ter [nouveau] (Titre V : du code de commerce) : Création de la notion juridique de secret des affaires 496
Article 64 quater [nouveau] (article L. 821-5-3 du code de commerce) : Encadrement des modalités de communication d’informations ou de documents du Haut Conseil du commissariat aux comptes aux autorités étrangères 502
Article 64 quinquies [nouveau] (article 11-1 : de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972) Nouvelle exception à la publicité des débats en matière de procédure civile 503
Article 64 sexies [nouveau] (article 400 : du code de procédure pénale) Nouvelle exception à la publicité des audiences en matière correctionnelle 504
Article 64 septies [nouveau] (article 35 : de la loi du 29 juillet 1881) Extension de l’exceptio veritatis en faveur des journalistes au secret des affaires 505
Article 64 octies [nouveau] (loi n° 68-678 du 26 juillet 1968) Modifications de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage » 506
Après l’article 64 octies 508
Chapitre V – Assurer la continuité de la vie des entreprises 509
Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 509
Article 65 : Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce 510
Article 66 (art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce) : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 511
Article 67 (art. L. 662-2 du code de commerce) : Coordination et procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé 541
Après l’article 67 543
Article 68 : Application outre-mer 544
Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 545
Article 69 : Désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures 545
Article 69 bis (nouveau) (art. L. 811-1, 811-3, 811-7-1 [nouveau], 812-1, 812-2-1, 812-5-1 [nouveau], 814-3, 814-12, 814-14 [nouveau] du code de commerce) : Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire 551
Section 3 : Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire 556
Article 70 A (nouveau) (art. L. 621-4 du code de commerce) : Désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire 556
Article 70 (art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce) : Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société 558
Article 70 bis (nouveau) (art. L. 653-8 du code de commerce) : Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements 576
Article 70 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks 578
TITRE III – TRAVAILLER 581
Chapitre Ier – Exceptions au repos dominical et en soirée 581
Avant l’article 71 623
Article 71 (art. L. 3132-21 du code du travail) : Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale 631
Article 72 (art. L. 3132-24 du code du travail) : Création des zones touristiques internationales 640
Article 73 (art. L. 3132-25 du code du travail) : Création des zones touristiques 654
Article 74 (art. L. 3132-25-1 du code du travail) : Création des zones commerciales 660
Après l’article 74 664
Article 75 (art. L. 3132-25-2 du code du travail) : Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales 666
Article 76 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) : Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales 675
Après l’article 76 693
Article 77 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) : Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche 694
Article 78 (art. L. 3132-25-5 du code du travail) : Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares 699
Article 79 (art. L. 3132-25-6 du code du travail) : Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare 704
Article 80 (art. L. 3132-26 du code du travail) : Dimanches du maire 709
Article 80 bis [nouveau] (art. L. 3132-17-1 [nouveau] du code du travail) : Application du volontariat aux salariés privés de repos dominical au titre des « dimanches du maire » 722
Article 81 (art. L. 3122-29-1 du code du travail) : Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale 723
Article 81 bis [nouveau] (art. L. 3132-29 du code du travail) : Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture 738
Article 82 : Dispositions transitoires non codifiées 740
Après l’article 82 744
Article 83 : Réforme de la justice prud’homale 746
Article 84 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice prud’homale 795
Section 2 : Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail 7467
Article 85 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de renforcement du système d’inspection du travail et de révision des sanctions en matière de droit du travail 797
Article 86 : Modification du régime des impatriés 822
Section 3 : Le dialogue social au sein de l’entreprise 826
Article 87 (Art. L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2327-7, L. 2314-20 et L. 2324-18 du code du travail) : Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale 826
Article 88 (Art. L. 3142-7 du code du travail) : Congés de formation économique, sociale ou syndicale 830
Article 89 (Art. L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail) : Transmission du procès-verbal des élections aux organisations syndicales 833
Article 91 (art. L. 2323-4 du code du travail) : Banque de données unique 840
Section 4 : Simplification pour la vie des entreprises 848
Article 92 (Art. L. 5212-6 du code du travail) : Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les travailleurs indépendants handicapés 848
Article 93 (Art. L. 5212-7-1 du code du travail [nouveau]) : Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel 854
Article 94 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour remplacer, outre-mer, le contrat d’accès à l’emploi par le contrat initiative emploi et pour y abroger le contrat d’insertion par l’activité 858
Section 5 : Lutte contre la prestation de service internationale illégale 866
Article 95 (Art. L. 1264-3 du code du travail) : Renforcement des sanctions administratives en matière de détachement transnational de travailleurs salariés 866
Article 96 (Art. L. 1263-3 à 1263-6 du code du travail [nouveaux]) : Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail 874
Article 97 (Art. L. 8291-1 à L. 8291-3 du code du travail [nouveaux]) : Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment 880
Article 97 bis [nouveau] (Art. L. 4454-3 [nouveau] du code des transports) : Obligation pour les partenaires d’un contrat de transport, de matérialiser par écrit le contrat de transport de marchandises par voie fluviale 885
Article 97 ter [nouveau] (Art. L. 4451-7 (nouveau], L. 4461-1 et L. 4463-1 du code des transports) : Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises 887
Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi 889
Article 98 (Art. L. 1233-5 du code du travail) : Clarification du périmètre des critères de l’ordre des licenciements dans le cadre d’un document unilatéral de l’employeur 889
Article 99 (Art. L. 1233-53 du code du travail) : Rectification d’une erreur rédactionnelle 897
Article 100 (Art. L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail) : Obligation de reclassement à l’étranger 898
Article 101 (Art. L. 1233-58 du code du travail) : Plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire 901
Article 102 (Art. L. 1235-16 du code du travail) : Conséquences de l’annulation des décisions d’homologations des plans de sauvegarde de l’emploi fondée sur le motif de l’insuffisante motivation de la décision administrative 906
Article 102 bis [nouveau] : Conséquences de l’annulation des décisions d’homologations des plans de sauvegarde de l’emploi fondée sur le motif de l’insuffisante motivation de la décision administrative pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire 910
Article 103 (Art. L. 1233-66 du code du travail) : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 911
Article 104 : Entrée en vigueur des articles 98 à 103 914
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 915
Article 105 (art. L. 910-1 du code de commerce) : Dispositions spécifiques relatives au département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 917
Article 105 bis (art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) : Extension du dispositif des adultes-relais à Mayotte 919
Article 106 : Délai de dépôts des projets de loi de ratification des ordonnances 920
Titre du projet de loi 920
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 923
Lors de sa réunion constitutive du 16 décembre 2014, la Commission spéciale a désigné M. Richard Ferrand rapporteur général ainsi que huit rapporteurs thématiques selon la répartition suivante :
– M. Gilles Savary, rapporteur thématique pour les chapitres I, II et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives à la mobilité et à l’urbanisme ;
– Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique pour les chapitres III et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives aux professions règlementées ;
– M. Christophe Castaner, rapporteur thématique pour le chapitre Ier du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’investissement et à l’innovation ;
– Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique pour les chapitres II et III du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux entreprises à participation publique et à l’industrie ;
– M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique pour le chapitre IV du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à la simplification ;
– M. Alain Tourret, rapporteur thématique pour le chapitre V du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux tribunaux de commerce et aux procédures collectives ;
– M. Stéphane Travert, rapporteur thématique pour le chapitre 1er du titre III, c’est-à-dire les dispositions relatives aux exceptions au repos dominical et en soirée ;
– M. Denys Robiliard, rapporteur thématique pour le chapitre II du titre III, c’est-à-dire les autres dispositions relatives au droit du travail.
Le rapporteur général a, en outre, pris en charge les dispositions du titre IV, c’est-à-dire les dispositions finales du projet de loi.
TITRE II
INVESTIR
Section 1
Faciliter les projets
Article 26
(art. 9 et 20 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014)
Extension de l’autorisation unique en matière d’ICPE et habilitation à légiférer par voie d’ordonnance
I. LE DROIT EXISTANT
La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises avait autorisé celui-ci à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure législative visant :
– d’une part, à autoriser le représentant de l’État dans le département – à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans – à délivrer aux porteurs de certains projets d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de ce projet (installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installations de méthanisation et installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz) ;
– d’autre part, à autoriser le représentant de l’État dans le département, dans les mêmes conditions, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à une autre catégorie d’ICPE une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation des projets concernés.
L’article 14 de la loi du 2 janvier 2014 précitée constitue donc le fondement législatif de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Cette ordonnance est venue apporter les précisions et les compléments suivants :
– pour ce qui concerne les installations liées à la production d’énergie, les régions concernées par l’expérimentation triennale sont la Basse-Normandie, la Bretagne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.
Pour ces mêmes installations, l’arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique », vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette autorisation tient également lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation précités pour l’application des autres législations, lorsqu’ils sont requis à ce titre ;
– pour ce qui concerne les autres ICPE, les régions concernées par l’expérimentation triennale sont la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté (article 9).
Pour ces mêmes installations, l’autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations précédentes pour l’application des autres législations, lorsqu’elles sont requises à ce titre ;
– au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation (2017), le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à donner, le cas échéant, à cette expérimentation.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Cet article comprend deux paragraphes, modifiant l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée et habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
— Le paragraphe I (alinéas 1er à 7) modifie la rédaction des articles 9 et 20 de l’ordonnance du 20 mars 2014.
Outre des modifications rédactionnelles limitées, le paragraphe I de l’article 9 de l’ordonnance est complété afin de permettre la généralisation sur l’ensemble du territoire du mécanisme de l’autorisation unique pour les projets d’ICPE non liée à la production d’énergie. Plus précisément, à compter de la publication de la loi sur la croissance et l’activité, pourront bénéficier de cette procédure ceux de ces projets qui, soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, présentent un « intérêt majeur » pour l’activité économique, « compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible ».
Le caractère englobant de la formulation proposée présente l’avantage de permettre la couverture d’un large ensemble de projets d’installation, ce qui correspond bien aux objectifs de soutien à l’activité et de simplification du droit visés par le projet de loi. Si la relative imprécision qui s’attache aux concepts d’« intérêt majeur » et de « caractère stratégique » pourrait ouvrir la voie à de nombreuses interrogations – et vraisemblablement à des pratiques différenciées – au moment de la mise en œuvre de cette disposition au plan local, le rapporteur thématique observe néanmoins que cette disposition constitue le pendant de l’extension du dispositif de l’autorisation unique au bénéfice des installations classées de production d’énergie, opérée dans le cadre du I de l’article 38 ter (nouveau) du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 14 octobre 2014 et en instance de discussion devant le Sénat).
Pour ce qui concerne l’article 20, la modification rédactionnelle proposée se borne à tirer les conséquences des modifications opérées à l’article 9 précité.
— Le paragraphe II (alinéas 8 à 10) habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi sur la croissance et l’activité, de lui permettre de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi et visant :
– d’une part, à généraliser de manière pérenne – le cas échéant, en les adaptant et en les complétant, notamment pour ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées – les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
– d’autre part, à codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées.
Principales dispositions de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 L’article 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à expérimenter une autorisation unique en matière d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Cette expérimentation d’une durée de trois ans est prévue pour être appliquée à tous les départements relevant des régions Rhône-Alpes (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ain, Rhône, Loire, Ardèche) et Languedoc-Roussillon (Lozère, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). Dans ce cadre, le préfet de département est autorisé à délivrer aux porteurs de projets intéressés une décision unique, dans le cadre d’une procédure unique d’instruction, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant : – du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-3, y compris l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3), au titre des législations sur les réserves naturelles nationales (autorisation spéciale relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9) et des sites classés (autorisation relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10), dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (4° de l’article L. 411-2) ; – du code forestier : autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L. 341-3). Il est prévu que cette procédure et cette décision uniques s’articulent avec les procédures et autorisations connexes relevant d’autres législations, à savoir avec la délivrance : – des autorisations du code de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable) ; – de l’autorisation d’occuper le domaine public ; – de l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. Il faut par ailleurs rappeler qu’une généralisation de ce dispositif à l’ensemble du territoire est proposée dans le cadre du II de l’article 38 ter (nouveau) du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 14 octobre 2014 et en instance de discussion devant le Sénat). |
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a tout d’abord adopté une série d’amendements visant à améliorer la précision et la qualité rédactionnelle de certaines dispositions de cet article.
Sur proposition des rapporteurs et dans un souci de transparence, elle a également souhaité prévoir que le Conseil national de la transition écologique, mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement, serait associé à l’élaboration des ordonnances prévues au paragraphe II de l’article 26. A cette fin, le Conseil pourrait mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133‑3 du même code.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1414 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. S’agissant des éoliennes, les procédures d’instruction sont si complexes et si longues que le délai de construction d’une éolienne est aujourd’hui de huit ans en France, contre quatre en moyenne en Europe. La Cour des comptes a, du reste, souligné qu’au rythme actuel de développement des installations d’énergie renouvelable, notamment des éoliennes, nous ne serons pas capables de tenir les engagements du Grenelle de l’environnement et les objectifs inscrits dans le paquet climat-énergie. Afin de remédier à ce problème, l’ordonnance du 20 mars 2014 a créé une autorisation unique. Toutefois, le dispositif expérimental d’autorisation unique comporte encore une autorisation d’exploiter au titre des installations classées, un permis de construire au titre du code de l’urbanisme, une autorisation de défrichement au titre du code forestier, une dérogation à la réglementation des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, des autorisations d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie et une approbation des câbles au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie. La simplification est donc très limitée. Nous proposons de l’amplifier, en retenant, pour cette autorisation, la procédure des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui regroupe l’ensemble de ces prescriptions. L’amendement permettrait ainsi d’alléger les procédures non seulement pour les porteurs de projets, mais aussi pour les services instructeurs de l’État, sans pour autant affaiblir la protection de l’environnement.
M. le président François Brottes. À titre personnel, je conviens que nous pourrions faire utilement quelques efforts supplémentaires en matière de simplification.
M. le ministre. Monsieur Baupin, je ne peux que partager votre volonté de simplifier et d’accélérer, conformément à l’esprit de cet article, la réalisation de projets utiles à la collectivité. Toutefois, l’amendement proposé me semble contraire au droit communautaire. L’autorisation ICPE ne peut, en effet, dispenser de la dérogation à la réglementation des espèces protégées, la directive correspondante ayant été transposée dans le droit national aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement – et non aux articles réglementant les ICPE. Adopter un tel amendement reviendrait donc à introduire une insécurité juridique majeure pour les porteurs de projets. Néanmoins, l’expérimentation d’une autorisation unique ICPE permet d’ores et déjà de délivrer un acte unique, sur la base d’un dossier unique, à l’issue d’une procédure unique couvrant l’ensemble des législations environnementales auxquelles le projet est soumis. Il serait donc préférable d’étendre le mécanisme de l’autorisation unique, comme le prévoit d’ailleurs le projet de loi relatif à la transition énergétique pour les éoliennes. Le contenu du dossier et la procédure sont nécessairement adaptés pour tenir compte des enjeux des régimes ainsi intégrés qui ne peuvent être purement et simplement écartés.
Par ailleurs, je rappelle que l’expérimentation en cours peut permettre d’identifier d’autres pistes de simplification possibles sans régression du droit de l’environnement. Je vous propose donc que l’on intègre votre préoccupation dans le cadre de l’ordonnance prévue au II de l’article 26, et je vous invite à retirer votre amendement, non sans avoir rappelé que les ordonnances feront l’objet d’une discussion devant les commissions compétentes avant leur signature par le Président de la République.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Les observateurs pourront s’étonner de ce débat à front renversé. Je crois que nous sommes tous d’accord pour accroître la simplification des procédures sans abaisser le niveau d’exigence environnementale. Or, paradoxalement, en adoptant cet amendement, nous en prendrions le risque. Il me semble donc que Denis Baupin devrait, comme le suggère le ministre, le retirer afin que nous puissions l’intégrer dans la démarche globale de l’ordonnance.
M. Denis Baupin. Je suis loin d’être convaincu par les arguments qu’on m’oppose. Cela fait des années que l’on réfléchit à la simplification des procédures applicables aux éoliennes. Le problème juridique posé par la directive a peut-être échappé aux personnes qui ont travaillé sur ce sujet, mais que l’on ne nous dise pas que cette proposition nuirait à la protection de l’environnement. Quoi qu’il en soit, je vais retirer l’amendement, mais je le déposerai de nouveau en séance publique. Certes, l’extension de l’expérimentation de l’autorisation unique pour les éoliennes à l’ensemble du territoire prévue par le projet de loi relatif à la transition énergétique est une bonne chose, mais nous souhaiterions simplifier encore les choses. Tout le monde y gagnerait.
L’amendement SPE1414 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE469 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1413 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Il s’agit de préciser que les projets concernés favorisent la transition énergétique.
M. le ministre. Avis défavorable. Le projet de loi relatif à la transition énergétique a été amendé en ce sens dans son article 38 ter ; il étend déjà à l’ensemble du territoire l’autorisation unique ICPE pour les installations énergétiques que sont les parcs éoliens et les installations de méthanisation, qui contribuent à la transition énergétique. Il convient de distinguer, d’une part, les projets d’intérêt économique majeur qui sont des ICPE et qui pourront, grâce à la présente loi, être soumis à une autorisation unique et, d’autre part, les installations énergétiques qui sont également des ICPE et qui se verront, au travers de la future loi relative à la transition énergétique, délivrer une autorisation unique. Ces deux dispositions sont complémentaires, les sujets énergétiques étant traités dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. L’amendement est donc quasiment satisfait.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement aboutirait à imposer une double condition, puisque le projet devrait présenter un intérêt majeur non seulement, comme le prévoit le texte, pour l’activité économique – en termes de valeur ajoutée, de création d’emplois et de développement du territoire – mais aussi pour la transition énergétique. Or, ces deux conditions ne sont pas forcément liées, même si, aujourd’hui, les grands projets sont conçus, par nature et par obligation légale, dans un esprit de développement durable. Imposer cette double condition pourrait freiner la réalisation de certains grands projets. Je suis donc défavorable à l’amendement.
M. Denis Baupin. Je ne suis pas du tout convaincu par vos arguments, monsieur le ministre. Tout d’abord, la transition énergétique ne se limite pas aux éoliennes et à la méthanisation visées par le projet de loi relatif à la transition énergétique. Par ailleurs, on ne peut pas considérer, monsieur le rapporteur thématique, que tous les projets qui pourraient entrer dans le champ de cet article contribueront au développement durable. Ce serait formidable, mais je crains que ce ne soit pas le cas, comme en témoignent certains dossiers en cours d’arbitrage auprès de la ministre de l’environnement. Il est donc préférable de le préciser dans le texte. Il serait, en effet, dommage d’encourager des projets qui vont à l’encontre du développement durable, en particulier l’année où la France organise la conférence sur le climat.
Mme Michèle Bonneton. Préciser que les projets d’intérêt économique majeur visés à l’article 26 doivent favoriser la transition énergétique ne fait que renforcer la cohérence de ce texte avec le projet de loi relatif à la transition énergétique que nous avons voté à une large majorité ainsi qu’avec les objectifs de la COP21.
M. le ministre. Aussi vrai que la transition énergétique ne se réduit pas à la méthanisation et au parc éolien, l’économie ne se réduit pas à la transition énergétique. C’est – hélas ! – la réalité, et il faut bien la prendre en compte. Si votre amendement traduit une démarche positive, il fallait le déposer à l’article 38 ter du projet de loi relatif à la transition énergétique pour compléter la liste concernée. Si, en revanche, il traduit une approche restrictive, je dois vous dire qu’il n’est pas conforme à l’esprit du texte, car il surconditionnerait le recours à l’autorisation unique. Même si, de manière générale, nous privilégions la transition énergétique, il est possible qu’une usine ne corresponde pas à ses critères : certaines ont d’ailleurs été rouvertes et ses salariés sont heureux d’y travailler. Je suis tout à fait disposé à ce que l’on facilite la construction de certains projets cohérents avec la transition énergétique, mais je suis défavorable à votre amendement, qui réduirait le champ de l’article 26.
M. Denis Baupin. Je récuse l’affirmation selon laquelle notre démarche n’est pas positive. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas proposé, lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, d’étendre le régime d’autorisation unique ICPE à tous les dispositifs de transition énergétique que nous n’étions pas dans un état d’esprit positif. Ce qualificatif me paraît déplacé.
La Commission rejette l’amendement SPE1413.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE470, SPE524, SPE527, SPE529 et SPE528 des rapporteurs.
L’amendement SPE648 de M. Christophe Caresche est retiré.
La Commission en vient à l’amendement SPE1573 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement important vise à rappeler la nécessité d’associer le Conseil national de la transition écologique (CNTE) à l’élaboration des ordonnances.
M. le ministre. Il s’agit, en effet, d’un amendement important. Comme la ministre de l’écologie et moi-même nous y étions engagés, le CNTE sera associé à l’élaboration des ordonnances. Avis favorable.
M. Jean-Charles Taugourdeau. J’approuve entièrement la réponse que M. le ministre a faite à Denis Baupin. Il convient de ne pas trop charger la barque en matière de protection de l’environnement, car, aujourd’hui, ce n’est pas l’environnement qui se dégrade mais notre économie de production. Vous ne voudriez pas, monsieur Baupin, que le prochain texte de M. Macron s’intitule Décroissance et inactivité !
M. Jean-Louis Roumegas. Par cet amendement, le rapporteur essaie de limiter les dégâts du projet de loi, voire d’en assurer le service après-vente. Bien entendu, nous ne pouvons qu’approuver l’association du CNTE à l’élaboration des ordonnances, mais il faut bien savoir que celui-ci n’aura qu’un rôle consultatif. Bref, on nous demande de signer un chèque en blanc au Gouvernement. Vous comprendrez que les défenseurs de l’environnement, compte tenu des projets actuels, qui font parfois l’objet de conflits violents, ne puissent pas se contenter de telles mesures.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe UMP votera l’article 26.
La Commission adopte l’amendement SPE1573.
Puis elle adopte l’article 26 modifié.
Article 27
(art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014)
Extension du mécanisme du certificat de projet à la région d’Île-de-France
Cet article vise à étendre le mécanisme du certificat de projet à la région d’Île-de-France.
I. LE DROIT EXISTANT
L’article 13 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises avait autorisé celui-ci à prendre par voie d’ordonnance toute mesure législative visant à autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, un document dénommé « certificat de projet ».
Ce dispositif, issu de propositions présentées par notre ancien collègue Thierry Mandon dans le cadre de son rapport sur la simplification de la vie des entreprises et de la consultation des préfets de région, figurait également dans le programme de simplification adopté par le comité interministériel de modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013 et dans la feuille de route des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, arrêtée le 17 décembre de la même année.
Expérimenté dans quatre régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), il vise à donner une plus grande visibilité aux porteurs de projets sur les procédures et les règles auxquelles ces projets sont soumis et sur les délais d’instruction (2).
L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet autorise dès lors les porteurs de projets à demander au représentant de l’État dans le département la délivrance de tels certificats. Sur la base des informations fournies par le demandeur, le préfet doit délivrer sous deux mois un document dans lequel il dresse la liste des procédures auxquelles le projet est soumis au titre de différentes législations et réglementations, d’une part, et il s’engage sur les délais dans lesquels les décisions relevant de sa compétence seront délivrées, d’autre part.
Le certificat de projet comporte, en outre, des renseignements sur les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever, mentionne les éventuelles difficultés détectées à ce stade précoce et comporte les informations de nature, le cas échéant, à améliorer la conception dudit projet.
Par ailleurs, la délivrance d’un certificat de projet a pour effet de « figer » les règles de droit applicables pendant une durée de dix-huit mois, avec une possibilité de prorogation de six mois. Les opérateurs économiques disposent ainsi d’une vision claire du cadre juridique dans lequel s’inscriront leurs investissements, avec la garantie que ces règles n’auront pas changé au moment où l’administration statuera sur la ou les demandes d’autorisation nécessaires à la réalisation du projet en question.
L’intérêt du certificat réside aussi dans l’organisation en « mode projet » que doivent mettre en place les services déconcentrés sous l’autorité des préfets, puisque les porteurs de projets ne doivent avoir qu’un interlocuteur unique et qu’il appartient donc à l’État de s’organiser adéquatement en interne pour instruire les demandes de manière globale.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Les modifications apportées aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 précitée par l’article 27 du projet de loi visent à permettre à la région d’Île-de-France de bénéficier de ses dispositions.
Les 1° (alinéa 2) et 2° (alinéas 3 et 4) de cet article modifient ainsi la rédaction de l’article 1er de l’ordonnance, afin d’inclure l’Île-de-France dans la liste des régions éligibles et de prévoir qu’y pourront relever du mécanisme du certificat de projet « les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible ».
Les 3° (alinéas 5 et 6) et 4° (alinéa 7) modifient, quant à eux, la rédaction de l’article 7 de l’ordonnance, afin de prévoir une entrée en vigueur du mécanisme en Île-de-France à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi pour la croissance et l’activité. Des certificats de projet pourront alors être délivrés, dans les cinq régions précitées, jusqu’au 31 mars 2017.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté l’article 27 du projet de loi sans y apporter de modifications.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1415 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. L’article 27 vise à étendre l’expérimentation du certificat de projet à la région d’Île-de-France pour les projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique. Par cet amendement, nous proposons, là encore, d’ajouter qu’ils doivent également présenter un intérêt majeur pour la transition énergétique.
M. le ministre. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, un tel amendement apporterait une restriction qui n’est pas conforme à l’esprit du texte. Encore une fois, nous partageons l’ambition que représente la transition énergétique, mais limiter l’extension de l’expérimentation du certificat de projet aux projets qui y contribuent pourrait conduire à exclure des projets d’intérêt économique majeur.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il est important de réaffirmer l’esprit du développement durable, dont la première composante est l’efficacité économique ; l’équité sociale et les qualités environnementales trouvent notamment des supports dans les règles d’urbanisme. Il n’est pas nécessaire de limiter l’objet de cet article.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe UMP votera également l’article 27.
M. Denis Baupin. Je suis stupéfait par la relecture qui est faite de la notion de développement durable, qui viserait en priorité le développement économique. Certes, celui-ci en fait partie, mais comment peut-on affirmer qu’il passe avant la protection de l’environnement et les valeurs sociales ?
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je n’ai pas dit cela !
M. Arnaud Leroy. Le sujet mérite une discussion sérieuse. Je suis un peu gêné que l’on fasse systématiquement référence à la transition énergétique. Néanmoins, l’article 1er de la loi relative à la création de la Banque publique d’investissement (BPI) a été amendé pour qu’il soit précisé que celle-ci est la banque de la transition écologique et énergétique. Il est, en effet, extrêmement important que l’on relève le défi de la mutation de notre appareil productif, et je souhaiterais que cette ambition soit traduite dans ce texte qui fera date. Cela passe-t-il par des références continues et absconses à la transition énergétique ? Je ne sais pas. Quoi qu’il en soit, passer d’une économie grise à une économie verte, cela signifie assumer un modèle de développement qui crée de nouveaux emplois.
M. le ministre. Je veux rassurer M. Baupin. Il ne s’agit pas pour moi d’affirmer le primat de l’économie sur la transition énergétique ; les deux notions doivent être en cohérence l’une avec l’autre. Si, dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, on avait précisé que chaque projet devait présenter un intérêt économique, on aurait réduit la portée du texte – car il y a de bons projets de transition énergétique dont la rentabilité économique n’est pas assurée. C’est la complémentarité de ces approches que nous défendons : il s’agit de deux priorités de même rang, dont je suis convaincu non seulement qu’elles sont compatibles, mais qu’elles se renforcent l’une l’autre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement vous a présenté le projet de loi relatif à la transition énergétique et le présent texte de manière presque simultanée. Cependant, les ambitions de l’un ne doivent pas interférer dans la rédaction de l’autre, sous peine d’en restreindre la portée et de nous faire manquer l’objectif. On marche toujours mieux sur deux jambes, avec des chaussures dont les lacets ne sont pas ficelés entre eux. Il faut donc garder à chacun de ces deux textes sa cohérence.
La Commission rejette l’amendement SPE1415.
Puis elle adopte l’article 27 sans modification.
*
* *
Article 27 bis [nouveau]
(art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement)
Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté par M. Denis Baupin.
Les installations de production d’énergie renouvelable font aujourd’hui l’objet d’autorisations relevant de législations multiples, auxquelles s’attachent, pour les tiers, des délais de recours eux-mêmes différents : ainsi, alors que le permis de construire est soumis à un délai de recours de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain, l’autorisation des éoliennes au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) fait, quant à elle, l’objet d’un délai de recours de six mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision (hors champ de l’expérimentation régionale mise en œuvre par le décret n° 2014‑450 du 2 mai 2014). Pour ce qui concerne les autres ICPE et les autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (hydroélectricité, éolien offshore et centrales photovoltaïques au sol), le délai est d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision – délai qui peut être prolongé jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la mise en service, lorsque celle-ci n’est pas intervenue dans les six mois suivant la publication ou l’affichage.
Cette absence de coordination des délais se manifeste particulièrement lorsqu’un même projet d’installation nécessite l’obtention de plusieurs autorisations – par exemple, un permis de construire et une autorisation ICPE en matière d’éolien – ouvrant aux tiers des délais de recours différents.
Outre que cette intrication complique l’identification du point de départ du délai de recours et renforce l’insécurité juridique des projets, de tels délais sont à l’origine d’un renchérissement du coût de ces projets et créent une incertitude qui pèse sur la situation économique des acteurs des énergies renouvelables.
Cet article vise donc à harmoniser les différents délais en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la publication de l’autorisation, quelle que soit la décision attaquée.
*
* *
La commission examine les amendements SPE1416, SPE1417 et SPE1418 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. L’amendement SPE1416 va dans le sens de la simplification. Il propose d’harmoniser les délais de recours sur les projets visant à la production d’énergie renouvelable, qui dépendent actuellement de plusieurs codes. La longueur de ces délais a pour effet de freiner la transition énergétique et de renchérir le coût des installations, dont la construction est financée par la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Nous suggérons d’aligner les différents délais sur celui du recours de droit commun, qui est de deux mois, à compter de la publication de l’autorisation.
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Avis défavorable. L’amendement s’inscrit dans la logique du texte, puisqu’il vise à faciliter la construction d’installations favorisant la transition énergétique, mais il est déjà satisfait. L’expérimentation d’autorisation unique pour les installations permettant la production d’énergie renouvelable, que l’article 38 ter du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d’étendre à l’ensemble du territoire national, comporte une réduction des délais.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable, également. Je comprends l’objectif des auteurs des amendements, mais, compte tenu du nombre de recours déposés sur ces projets, l’adoption d’un délai de deux mois risque de fragiliser les procédures, que l’on peut sûrement sécuriser et accélérer autrement.
M. Francis Vercamer. Je trouve piquant que les Verts, qui ont tout fait pour complexifier le droit de l’urbanisme, plaident pour la simplification quand il s’agit des éoliennes. Mais c’est l’ensemble des procédures qu’il faut simplifier ! Quoi qu’il en soit, je confirme que les entreprises qui veulent implanter une installation classée pour la protection de l’environnement – ICPE – préfèrent s’installer à l’étranger plutôt qu’en France, tant notre droit est compliqué.
M. Patrick Hetzel. En simplifiant l’installation de tous les projets d’infrastructure, on développera la croissance et l’activité. C’est pourquoi je suis favorable à l’orientation adoptée par Denis Baupin. Il est regrettable que le mouvement auquel il appartient tente le plus souvent d’allonger les procédures et de multiplier les recours, ce qui, dans ma circonscription, a pour effet de limiter l’emploi.
M. Denis Baupin. Cette accusation n’est pas fondée : pourriez-vous citer un seul projet sur lequel Europe Écologie Les Verts – EELV – aurait déposé un recours ? Comme vous, je déplore que les ingénieurs qui s’intéressent à l’éolien partent développer des projets à l’étranger. Pour construire une éolienne, il faut huit ans en France, contre quatre dans le reste de l’Europe.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique ne prévoit pas d’harmoniser les délais de recours, même s’il tend à établir une autorisation unique, ce qui se traduit par l’obligation de remplir des documents relevant du code de l’urbanisme. Le délai de recours est de deux mois pour un permis de construire, mais de six pour une ICPE. Il faudrait que les bons projets avancent plus vite et que les mauvais soient arrêtés plus rapidement.
M. le ministre. Les trois amendements en discussion portent sur les éoliennes terrestres. J’émets un avis favorable à l’amendement SPE1416, afin d’assurer M. Baupin de ce que le Gouvernement partage ses préoccupations.
En revanche, je suggère le retrait de l’amendement SPE1417. À mon sens, le régime de la simple déclaration n’est pas suffisant pour construire une éolienne, qui appelle une procédure d’autorisation sur la base d’une étude d’impact et d’une consultation publique. Le régime de la simple déclaration serait d’ailleurs contraire au droit communautaire.
Je demande aussi le retrait de l’amendement SPE1418, qui me semble encore moins recevable. Il n’y a pas lieu d’introduire dans le droit une inégalité de traitement favorisant les projets liés à l’éolien terrestre, qui sont nombreux et appellent un investissement limité.
Avant la séance publique, je proposerai à M. Baupin de chercher avec lui le moyen de porter le plus loin possible les dispositions de l’amendement SPE1416.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement SPE1416. Je me rallie à la proposition du ministre, car il est important de simplifier ces procédures majeures.
M. Denis Baupin. Je remercie le ministre. Des trois amendements en discussion, le SPE1416 est le plus facile à mettre en œuvre. Je retire les deux autres.
Les amendements SPE1417 et SPE1418 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement SPE1416.
M. le président François Brottes. Je constate que le vote est acquis à l’unanimité.
*
* *
Article 28
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement
Depuis plusieurs mois, le Gouvernement s’est engagé dans un ambitieux projet de modernisation du droit de l’environnement, dont l’objectif est de rendre ce droit plus simple, plus lisible et plus efficace pour l’ensemble de ses utilisateurs tout en continuant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Une feuille de route a été adoptée, qui prévoit la conduite d’un ensemble d’actions ayant d’ores et déjà donné lieu, dans certains cas, à la mise en place de groupes de travail.
Cette démarche s’accompagne d’une réflexion conduite, à la demande du Premier ministre, par M. Jean-Pierre Duport, préfet honoraire, sur l’accélération des projets publics et privés en matière de logement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Le présent article a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions de nature législative permettant la mise en œuvre des mesures qui seront retenues à l’issue des travaux menés dans le cadre de la mission confiée au préfet Duport, d’une part, et des propositions de certains groupes de travail mis en place afin de moderniser le droit de l’environnement, d’autre part.
I. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et tendant à faire évoluer le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement au regard d’une série d’objectifs.
— Le premier objectif visé est celui d’accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation (alinéas 2 à 7).
Il s’agit de réduire les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme (3). Il s’agit également de modifier les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ainsi que d’aménager les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation.
Le Gouvernement souhaite également mieux définir les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
Il envisage, en dernier lieu, de supprimer la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et de revoir les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code (4).
— Le deuxième objectif est de modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à celle des plans et programmes (alinéas 8 à 12).
Le Gouvernement estime opportun d’engager une démarche de simplification de ces règles pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes, ainsi que d’améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part – notamment, en définissant mieux les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement.
Il envisage également de modifier les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences.
Le Gouvernement prévoit enfin d’assurer, par voie d’ordonnance, la transposition de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite directive « Étude d’impact », dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014.
— Le troisième objectif est de moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public (alinéas 13 à 16).
Le souhait du Gouvernement est de simplifier et harmoniser les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement – notamment, leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient – en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le Gouvernement envisage également de permettre que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet. Les modalités des enquêtes publiques seraient simplifiées afin de favoriser la participation du public, en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions. Les modes de consultation pourraient également s’adapter aux pratiques plus modernes et plus conformes aux usages de ce public.
— Le quatrième objectif est d’accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (alinéa 17) et d’assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge – notamment, en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
L’ensemble de ces ordonnances serait publié dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi sur la croissance et l’activité (dix-huit mois pour ce qui concerne la ou les ordonnances de transposition de la directive européenne 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE).
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a tout d’abord adopté une série d’amendements visant à améliorer la précision et la qualité rédactionnelle de certaines dispositions de cet article.
Elle a également souhaité que l’ordonnance prévue au 1° du I de l’article 28 contribue à simplifier les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation abusif à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, recours qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et cause un préjudice excessif à ce bénéficiaire.
Un amendement présenté par le Gouvernement a permis d’aménager le champ de l’habilitation prévue au 3° de l’article 28, afin que les mesures de simplification envisagées permettent concomitamment de renforcer et moderniser la participation du public, dans le respect des engagements pris par le Président de la République.
Sur proposition des rapporteurs et dans un souci de transparence, la commission a enfin souhaité prévoir que le Conseil national de la transition écologique, mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement, serait associé à l’élaboration des ordonnances prévues au paragraphe I de l’article 28. A cette fin, le Conseil pourrait mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133‑3 du même code.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE540 de M. Arnaud Leroy et SPE1420 de M. Denis Baupin.
M. Arnaud Leroy. L’amendement SPE540 tend à supprimer l’article 28 pour des raisons de méthode et de fond. Il n’y a pas lieu d’étendre le champ de l’ordonnance à des questions aussi vastes que la procédure d’autorisation, l’évaluation, la planification, la participation du public, la compétence des élus locaux et le pouvoir de substitution du préfet aux maires. Le rapport rédigé par M. Jean-Pierre Duport sur la réduction des délais d’obtention du permis de construire doit soulever bien des difficultés, puisqu’il n’a toujours pas été publié.
S’il faut avancer sur cette question, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Les États généraux de la modernisation du droit de l’environnement – dont l’organisation est lourde et complexe – doivent poursuivre leur travail, même si certaines parties ont du mal à se retrouver dans la méthode proposée. Pour l’heure, ne fragilisons pas le droit de l’environnement et installons un principe de non-régression, afin de nous assurer que la simplification ne perturbera ni les écosystèmes, ni les milieux naturels.
M. Denis Baupin. L’article 28 nous inspire certaines inquiétudes. Les écologistes souhaitent que l’on modernise les procédures, car, à l’heure d’internet, il est absurde que tout se règle dans des réunions publiques, auxquelles n’assistent que ceux qui ont du temps à y consacrer. On connaît les effets de cette situation : c’est le jour où le chantier démarre que la plupart des gens découvrent son existence, et ils ont le sentiment de ne pas avoir été consultés. Par ailleurs, nous contestons le fait que des projets ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ou des commissaires enquêteurs, tels le barrage de Sivens ou le Center Parcs de Roybon, puissent se poursuivre. Une fois que la situation est bloquée et qu’on demande à l’État de trancher des différends, collectivités locales, financeurs et entreprises se retrouvent fragilisés.
Si nous convenons qu’il faut améliorer certains points, nous n’approuvons pas le recours aux ordonnances. Comme vient de le rappeler Arnaud Leroy, ces questions font l’objet d’une étude à laquelle a été associé un groupe de travail du Conseil national de la transition écologique – CNTE. La semaine dernière, sous la présidence de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, nous avons fait pendant deux heures le point sur les différents groupes qui étudient les procédures. Mme la ministre nous a indiqué que les conclusions des États généraux trouveraient une traduction législative dans la loi relative à la biodiversité ou dans un texte spécifique. Il n’a pas été question d’ordonnances.
Par ailleurs, à l’occasion de la conférence environnementale, le Président de la République a estimé que, à la suite du drame de Sivens, il fallait revoir nos procédures. L’ouverture d’un grand chantier sur ces questions procède d’une logique très différente de celle des ordonnances.
Enfin, la Charte de l’environnement dispose, dans ses articles 3, 4 et 7, que l’évolution du droit de l’environnement doit se poursuivre « dans les conditions définies par la loi ». La jurisprudence du Conseil d’État comme du Conseil constitutionnel nous met en garde contre les habilitations trop larges à recourir aux ordonnances. Si l’article est adopté, il sera très fragile aux yeux du Conseil constitutionnel, tout comme les ordonnances qui suivront et les décisions qui en découleront. Beaucoup d’ONG sont irritées par une méthode qui n’a rien de nécessaire. Il existe en effet bien d’autres véhicules législatifs à notre disposition.
M. le ministre. Avis défavorable. Si les dispositions contenues dans l’article 28 figurent dans le projet de loi, c’est parce que le Gouvernement l’a choisi, et qu’il souhaite lever toute ambiguïté. Nous vous proposerons plusieurs amendements visant à clarifier certains points. En outre, les ministres de l’écologie et du logement et moi-même avons adressé à M. Castaner, rapporteur thématique, une lettre visant à lui apporter des garanties sur les modalités d’association du public et des parlementaires au processus de production de l’habilitation. Le CNTE interviendra via une commission spécialisée. D’ailleurs, si le Gouvernement a choisi de confier la rédaction d’un rapport au préfet Duport, c’est précisément parce que celui-ci préside un groupe de travail sur ces questions au sein du CNTE.
L’amendement SPE1575 des rapporteurs tend à inscrire dans la loi l’association pleine et entière du CNTE, dont les travaux seront connus du Parlement, non seulement parce que plusieurs personnalités siègent dans les deux instances, mais parce que, conformément aux engagements que j’ai pris hier et à une pratique déjà observée, les ordonnances seront débattues avant signature devant les commissions parlementaires compétentes. Enfin, comme il est de rigueur pour les textes environnementaux, une consultation sera organisée sur internet.
Les amendements tendant à associer les commissions parlementaires à la rédaction des ordonnances posent des problèmes juridiques, mais je m’engage à ce que celles-ci soient consultées. L’amendement SPE1560 du Gouvernement tend à aménager le champ de l’habilitation prévue à l’article 28, afin de mettre en œuvre des mesures de simplification tout en renforçant la participation du public, ce qui traduit les engagements pris par le Président de la République après les événements de Sivens.
La philosophie d’ensemble de l’habilitation devrait apaiser les inquiétudes de MM. Leroy et Baupin. Je répète qu’elle consiste, sans abaisser notre niveau d’exigence, à simplifier et à raccourcir la réalisation des projets, en coordonnant mieux leurs différentes phases.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable, même si je comprends les interrogations d’Arnaud Leroy et de Denis Baupin. Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a engagé un processus tendant à rendre le droit de l’environnement plus simple, plus lisible et plus efficace, sans pour autant réduire le niveau de protection de l’environnement. Sur le sujet, une réflexion est conduite, à la demande du Premier ministre, par M. Jean-Pierre Duport, préfet honoraire, que j’ai eu l’occasion d’auditionner. Ses travaux semblent aller dans le bon sens, tant en matière d’amélioration du droit que de protection de l’environnement. Pourtant, on peut hésiter à habiliter le Gouvernement à agir pour mettre en œuvre des conclusions qui n’ont pas encore été rendues.
En tant que rapporteur thématique, j’ai demandé au Gouvernement de prendre des engagements, pour éviter que les travaux ne se déroulent hors de notre contrôle et que le Parlement ne soit sollicité que pour ratifier l’ordonnance in fine, sans pouvoir la discuter dans les meilleurs délais. Le ministre a réaffirmé sa volonté de nous associer le plus possible, selon des modalités qui restent à définir.
Il aurait été préférable de passer par une loi plutôt que par des ordonnances, mais nous aurions couru le risque de ne pas disposer, au terme d’un long travail, d’un véhicule législatif approprié. Le projet de loi relatif à la biodiversité ne saurait contenir les mesures sur le logement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, sur lesquels a travaillé le préfet Duport.
M. Jean-Yves Caullet. S’il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, comme le disait justement Arnaud Leroy, il ne faut pas non plus jeter le manche après la cognée. En d’autres termes, nous devons poursuivre la tâche commencée. Le vote à l’unanimité de l’amendement SPE1416 de Denis Baupin est un signe : nous avons tous compris que la réglementation, en matière d’environnement, ne constitue plus un frein à la réalisation des projets.
Je comprends les réticences de mes collègues à l’égard des ordonnances. Reste qu’une ordonnance prise dans le cadre d’une habilitation, puis ratifiée, est une loi. Nous pourrions certes attendre un autre véhicule législatif, comme le projet de loi relatif à la biodiversité, mais celui-ci possède un objet clairement identifié : la préservation, la gestion et de développement de la biodiversité. Le texte en discussion aujourd’hui est un cadre plus pertinent pour souligner de manière symbolique la réconciliation entre croissance et activité, et le lien entre les projets concernés et la protection de l’environnement. En discutant l’article, nous prouverons que nous sommes capables de dépasser nos craintes et nos réticences pour construire un texte qui fera date. Je demande donc aux collègues qui ont déposé les amendements de bien vouloir les retirer.
M. Jean-Louis Roumegas. Il est pour le moins paradoxal que le ministre soutienne son projet de loi en invoquant des amendements dont il n’est pas l’auteur. On mesure la précipitation dans laquelle il travaille et la difficulté de réformer rapidement divers codes, même si les socialistes font ce qu’ils peuvent pour colmater les brèches et limiter les dégâts.
Le seul argument qu’on invoque pour nous rassurer est que le recours aux ordonnances ne serait pas si grave, puisque le CNTE et les commissions parlementaires concernées seront consultés. Nous voterons les amendements de repli si l’article n’est pas supprimé, mais nous n’entendons pas signer au Gouvernement un chèque en blanc, compte tenu du nombre de dossiers sur lesquels les défenseurs de l’environnement doivent se battre.
France Nature Environnement, fédération qui participe au CNTE, qui a toujours adopté une position légaliste et qui s’abstient de toute violence, souligne elle-même que le CNTE ne doit pas se substituer au Parlement et ne cautionne pas le recours aux ordonnances. Réduire la participation du public aux débats ne correspond pas à la position exprimée par le Président de la République lors de la conférence environnementale. Ce n’est pas à ce niveau qu’il faut simplifier le droit de l’environnement, mais en travaillant en amont sur la planification et les projets, afin d’éviter les recours inutiles.
M. Denis Baupin. Ces arguments ne me surprennent pas. Le CNTE n’a pas attendu l’examen du projet de loi sur la croissance et l’activité pour se mettre au travail. Les groupes de travail ont défriché bien des sujets. Reste à savoir qui prendra les décisions. L’association du CNTE à la réflexion n’empêchera peut-être pas que ce soit le ministère de l’économie – plutôt que les parlementaires – qui décide du droit de l’environnement. Je le répète, monsieur le ministre : relisez les articles 3, 4 et 7 de la Charte de l’environnement, qui appartient à la Constitution. Le Gouvernement risque de passer des heures à rédiger des ordonnances et, au bout de compte, de se retrouver fragilisé sur le plan juridique.
Mme Cécile Duflot. Je regrette de devoir passer trop peu de temps parmi vous, mais je siège dans le groupe de travail sur l’avenir des institutions, installé par le président Bartolone, qui se réunit en ce moment même. Mme Laurence Parisot a détaillé les défauts de la présidentialisation et M. Jean Pisani-Ferry a expliqué que le dessaisissement de plus en plus fréquent des parlementaires – que l’on n’observe ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni – affaiblit la loi et la démocratie françaises.
Hier, monsieur le ministre, tout en louant ma « sincérité » et ma « sensibilité », vous avez critiqué ma posture : la méthode, qui consiste à décrédibiliser l’émetteur du message pour éviter de lui répondre, n’est pas nouvelle. Mais il y a également une posture, dans le projet de loi dont nous discutons : elle consiste à confier tous les arbitrages au ministère de l’économie.
Voilà pourquoi c’est vous, monsieur le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui venez défendre le texte, alors même que la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie possède dans le Gouvernement un rang plus élevé que le vôtre – belle preuve de l’attachement accordé par le Premier ministre à la défense de l’environnement !
C’est vous qui parlez de l’environnement, comme vous allez bientôt parler de la privatisation de l’Établissement français du sang à la place de la ministre de la santé, ou du logement à la place de la ministre qui en est chargée. En matière d’environnement, le véritable pilote, ce n’est plus le Conseil national de la transition écologique, c’est le Conseil national de l’industrie. En d’autres termes, à travers cette loi, vous faites passer le message que « l’environnement, ça commence à bien faire » !
Nous avions déjà commencé à réformer et à simplifier le droit de l’urbanisme, en nous attaquant par exemple aux recours abusifs. Quelle utilité y a-t-il à réformer maintenant le droit de l’environnement par ordonnances ? Aucune. Vous vous apprêtez à utiliser les conclusions de M. Jean-Pierre Duport, que j’estime par ailleurs, mais pourquoi le préfet devrait-il reprendre la main en cas de refus du maire ? Votre propos n’est pas de protéger l’environnement, mais de faire comprendre que les décisions locales ne sont pas toujours bonnes. Certains ont hurlé quand nous avons proposé que les maires soient dessaisis du plan local d’urbanisme intercommunal, et l’on voudrait à présent que ce soient les préfets qui délivrent le permis de construire ?
Si vous entendez retirer le pouvoir de décision aux parlementaires, ce n’est pas à cause des contraintes du calendrier, mais pour des raisons idéologiques qui justifient à elles seules l’existence de l’article 28. Je comprends que vous préfériez parler de notre posture plutôt que de répondre sur le fond, mais la réforme du droit de l’environnement est un sujet trop sérieux pour qu’on le traite par ordonnances.
M. le ministre. Madame Duflot, vous ne pouvez pas prétendre que je ne vous ai pas répondu sur le fond en ce qui concerne la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dont nous préservons les avancées, tout en traitant les conséquences néfastes qu’elle a pu avoir et que plusieurs députés impliqués dans l’examen du projet de loi ont eux-mêmes constatées.
Par ailleurs, on ne peut pas dire tout et son contraire. M. Roumegas se plaint que le texte soit modifié par des amendements – preuve que nous collaborons avec le Parlement –, et Mme Duflot, que nous ne tenions pas compte de l’avis des députés : de tels reproches manquent pour le moins de cohérence.
Le texte ne contient pas la moindre disposition qui tende à privatiser l’Établissement français du sang. Il propose seulement d’ouvrir le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) à d’autres acteurs publics, en l’espèce la Banque publique d’investissement. Ces excès et ces approximations, madame Duflot, ne sont pas à la hauteur des débats que nous menons avec vos collègues. Peut-être cherchez-vous seulement à justifier la posture que vous adopterez lors du vote.
Le préfet Duport n’a été mandaté ni par moi-même, ni par mon prédécesseur, mais par le Premier ministre. La lettre que la ministre du logement et moi-même avons cosignée avec la ministre de l’écologie rappelle que c’est sous l’autorité de celle-ci que se poursuivra le chantier. Il n’y a donc pas lieu de dénoncer je ne sais quelle récupération des dossiers par le ministère de l’économie.
Monsieur Roumegas, je vous invite à relire l’article 28, qui prolonge la réflexion amorcée dans l’article 27. Nous voulons préserver notre degré d’exigence environnementale tout en simplifiant et en accélérant l’instruction des procédures et la délivrance des permis. L’objectif fixé au préfet Duport – un délai de cinq mois – est extrêmement raisonnable.
La vraie question est de savoir si vous faites confiance à l’action publique menée par le Gouvernement, car tous les éléments de fait et de droit ont été traités par l’article 28, compte tenu de la position du rapporteur général, de l’amendement du Gouvernement et des engagements que j’ai pris devant vous.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Si quelque chose affaiblit la crédibilité du Parlement, c’est le mensonge ou l’agressivité inutile. Aucun député n’aurait toléré que l’on privatise l’Établissement français du sang et prétendre le contraire n’est pas admissible.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de traiter le travail des parlementaires avec une sorte de compassion condescendante. Nous ne sommes pas en train de colmater des brèches ou de limiter des dégâts, mais de corriger le texte en supprimant des dispositions inadéquates et en réorientant celles qui doivent l’être. C’est-à-dire que nous remplissons exactement notre mission.
Il va de soi que le CNTE doit jouer son rôle sans se substituer au Parlement. Nous n’avons jamais prétendu l’inverse. La Charte de l’environnement affirme le rôle de la loi, mais qu’est-ce qu’une ordonnance ratifiée, sinon une loi ? C’est si vrai que le Gouvernement a usé de cette méthode dans le cadre de la loi ALUR. Je ne vois donc aucune raison de refuser le débat en supprimant l’article ni, sous l’effet d’une poussée d’agressivité matinale, de nier la qualité de notre travail.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Notre collègue Duflot a prétendu que les préfets allaient dessaisir les maires du droit de délivrer les permis de construire. Il s’agit seulement, quand un maire refuse d’appliquer la loi, de laisser au juge ou au préfet la possibilité de se substituer à lui, une fois qu’une décision de justice définitive aura été prononcée.
La procédure des ordonnances peut susciter bien des commentaires. Au sujet de celles du 3 octobre 2013 relatives au développement de la construction, Le Moniteur s’était montré enthousiaste : « Trois ordonnances pour faire sauter les obstacles ». Jugeant celles-ci nécessaires, nous avons soutenu Cécile Duflot, alors ministre, quand elle les a prises. J’ai même noté ce commentaire d’un internaute qui signe Loulou : « C’est parfait. Quelle audace et quelle énergie ! Enfin un ministre qui prend les choses en main pour résoudre la crise du logement et relancer l’économie... » Je partage l’avis de Loulou ! En revanche, Anticor titrait le même jour : « Des ordonnances taillées sur mesure pour les constructeurs ». Inutile de préciser que ces constructeurs sont les bailleurs sociaux, pour lesquels nous nous sommes mobilisés.
Certains craignent que, sous couvert de simplification, on ne renonce à protéger l’environnement. La meilleure des garanties est apportée par la ministre de l’écologie elle-même, qui a écrit de sa main « Cher Christophe », sur la lettre cosignée par les ministres de l’économie et du logement, ce qui prouve bien qu’elle ne me l’a pas adressée sous couvert des autres ministres.
Le recours aux ordonnances n’est pas une insulte au Parlement, mais une manière d’aller vite. En l’espèce, notre rôle s’apparentera moins à une ratification qu’à une coconstruction. En tant que rapporteur thématique, je veillerai à ce que les engagements pris dans la lettre des ministres soient tenus, faute de quoi je m’opposerai à la ratification.
Mme Michèle Bonneton. Le groupe des députés écologistes est favorable au raccourcissement et à la simplification des procédures, à condition que les textes que nous votons soient en cohérence. Il faut aussi que ceux-ci préservent l’avenir. C’est pour cette raison que, sur le terrain, certaines associations sont acculées à s’opposer à des projets, parfois pendant des années, dès lors qu’on a refusé de les écouter et de collaborer avec elles. Il est essentiel d’apprendre à travailler avec ceux qui jugent la protection de l’environnement déterminante pour notre avenir, voire notre survie.
Je regrette que certains recourent à la caricature, décrédibilisent leurs interlocuteurs et préfèrent les arguments d’autorité à ceux de la raison. Ce n’est pas ainsi qu’on noue un dialogue constructif. Si nous sommes vent debout contre le système des ordonnances – le texte en prévoit plusieurs dizaines sur des sujets aussi divers qu’importants –, c’est que les parlementaires, qui représentent les citoyens, n’ont pas vocation à être seulement informés ou consultés. Leur rôle est de participer aux décisions.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je suis choquée d’entendre Cécile Duflot céder à la provocation, en affirmant que la démocratie serait en danger à l’Assemblée nationale. Les députés écologistes sont favorables à la démocratie horizontale, qui consiste à être d’accord avec la personne qui n’est d’accord avec personne. Un conseiller me l’avait expliqué, un jour, dans un parc naturel régional, bien que le sujet n’ait pas grand-chose à voir avec la protection de la nature. La démocratie n’est pas en danger à l’Assemblée nationale, dès lors qu’un groupe ultraminoritaire peut s’y exprimer. Reste que sa décision n’a pas systématiquement à l’emporter.
Je rappelle à Cécile Duflot avant qu’elle ne quitte la salle, qu’elle n’a pas de leçon de démocratie à donner à la majorité actuelle, car, si le parti socialiste n’avait pas abandonné soixante circonscriptions aux Verts – qui en ont gagné dix-huit –, il n’y aurait pas un seul député écologiste à l’Assemblée nationale.
M. Arnaud Leroy. Pour en revenir à l’article 28, je veux dire à Jean-Louis Roumegas que je ne suis pas plombier, je ne suis pas là pour colmater les brèches : je suis parlementaire, et mon travail consiste à proposer des amendements, à entendre les réponses qui me sont faites et à rechercher une majorité pour que mes propositions soient adoptées. Même si j’ai l’intention de soutenir le Gouvernement, je m’interroge au sujet de l’étendue de l’ordonnance qu’il souhaite prendre : il ne faudrait pas que cela amène le Conseil constitutionnel à rendre une décision défavorable en raison du champ d’application de cette ordonnance.
Par ailleurs, je ne pense pas que l’on puisse s’abriter derrière le CNTE, en arguant du fait qu’il s’agit d’un organe de démocratie participative, d’élaboration ou de conseil : s’il y règne une bonne ambiance, il me semble qu’il est difficile d’y faire aboutir des textes. Le sénateur Alain Richard, qui pilote les États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, est également réservé au sujet de l’article 28.
J’aimerais voir lever certaines interrogations, mais aussi faire un point de sémantique au sujet de la croissance durable qui, à la différence de la croissance que certains veulent obtenir à tout prix – fût-ce un bouleversement des équilibres de la planète –, durera longtemps parce que nous aurons pris soin du milieu naturel. Pour ce qui est du diagnostic, les notions de participation et de planification ont été évoquées, et le ministre a répondu sur ce point. Reste que la planification continue à poser problème en matière de droit de l’environnement. La participation est un problème politique : si la loi du 27 décembre 2012 prévoit la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, encore faut-il que ce principe ne se trouve pas piétiné.
Pour ce qui est de la méthodologie, je ne peux me satisfaire de la liaison établie avec le CNTE par les quelques parlementaires ici présents et, pour moi, l’essentiel est qu’une discussion puisse avoir lieu au Parlement. Je demande donc l’instauration d’un groupe de liaison, éventuellement piloté par Christophe Castaner, et que l’on puisse entendre le préfet Duport dans un cadre parlementaire – en dehors du cadre d’une simple audition, qui ne nous offrirait aucune prise – quand ses conclusions seront rendues publiques. Il serait bon d’entendre également France Nature Environnement, qui a un rôle important à jouer dans le dialogue environnemental que l’on s’efforce d’instaurer en France. Si nous parvenions ce matin à mettre au point une méthode, chacun serait rassuré et nous pourrions avancer en direction des objectifs fixés par le Gouvernement.
M. Francis Vercamer. Nous avons assisté tout à l’heure à de vifs échanges, d’abord entre le ministre et Cécile Duflot, puis entre les socialistes et les Verts, et je m’étonne de voir à quel point la majorité est éclatée aujourd’hui.
Sur le fond, la simplification dans le domaine de l’urbanisme et des procédures me paraît extrêmement importante. Je regrette, moi aussi, que les dispositions portant sur cette question soient prises par voie d’ordonnances, mais cela vaut mieux que de ne rien faire et, bien qu’étant dans l’opposition, j’ai le respect de la parole ministérielle. L’UDI votera donc cet article, estimant que réduire les freins qui existent en matière d’urbanisme constitue l’une des clés de la croissance.
M. le président François Brottes. Les interrogations formulées par Arnaud Leroy peuvent-elles trouver réponse avant l’examen du texte en séance publique ?
M. le rapporteur général. Il sera sans doute possible de déterminer, en accord avec le ministère concerné, dans quelles conditions nous pourrions créer un comité de liaison ayant vocation à suivre l’ensemble des travaux afin que, le moment venu, les membres de la commission spéciale soient parfaitement éclairés sur la rédaction des ordonnances.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. J’appelle votre attention sur le troisième élément de proposition figurant dans la lettre qui nous a été adressée par les ministres, à savoir : « ce travail de concertation pourra être complété par des échanges avec la représentation nationale sous une forme dont nous vous proposons de convenir prochainement ». Je n’ai pas souhaité arrêter cette forme avant que nous n’en discutions ensemble, mais je pense que nous pourrions valider avec le Gouvernement, d’ici au 26 janvier, une forme particulière correspondant aux objectifs fixés par Arnaud Leroy et permettant d’associer l’ensemble de la représentation nationale.
M. le président François Brottes. Comme le disait le rapporteur général, le Parlement dispose également d’un pouvoir d’initiative – autrement dit, l’un n’empêche pas l’autre.
M. Denis Baupin. En tant que membre assez assidu des réunions du CNTE, je peux dire que j’apprécie beaucoup de pouvoir dialoguer avec les syndicats et le patronat, avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), les organisations non gouvernementales et les collectivités territoriales sur toutes sortes de sujets : cela permet de faire évoluer les esprits et de rechercher des consensus, de dépasser des contradictions ou de prendre acte de certaines différences d’appréciation. Pour autant, cet organisme est loin d’être un véritable lieu de décision où seraient mis au point les textes relatifs au droit de l’environnement. Si les choses ne peuvent se faire en ce lieu, elles se feront forcément dans un cadre interministériel.
Je m’étonne de constater que le ministre n’a pas même donné un début de réponse aux questions que j’ai posées tout à l’heure sur la Charte de l’environnement. Cette Charte, adossée à la Constitution française, fait référence à trois reprises aux « conditions définies par la loi », et plusieurs décisions du Conseil d’État ont déjà annulé des textes réglementaires au motif que celles-ci ne respectaient pas la Charte de l’environnement. Je m’interroge donc sur la solidité juridique de l’article 28, mais aussi sur celle des ordonnances et de l’ensemble des décisions qui seront prises ultérieurement. Les entrepreneurs dont vous avez l’intention de consolider les projets risquent en fait de se trouver fragilisés par le fait que certaines décisions auront été prises sur la base d’ordonnances qui ne sont pas nécessairement conformes aux dispositions constitutionnelles. Alors que vous voulez simplifier le système, vous risquez de le complexifier. J’aimerais vraiment prendre connaissance de votre analyse juridique sur cette question qui, je l’avoue, me laisse perplexe.
M. le président François Brottes. Contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes mal informées, une ordonnance n’a rien de comparable à une circulaire ou à un arrêté. En fait, il s’agit d’une loi à part entière, si ce n’est qu’elle est prise en deux temps : dans un premier temps, le Parlement indique au Gouvernement ce sur quoi il va pouvoir légiférer par ordonnances – en d’autres termes, il trace un périmètre qu’il conviendra de ne pas dépasser ; dans un deuxième temps, l’ordonnance est élaborée, éventuellement en concertation avec le Parlement, comme c’est le cas en l’occurrence ; enfin, le troisième temps est celui de la ratification par le Parlement.
Ce qui peut engendrer une frustration pour le Parlement, c’est que l’ordonnance ne donne pas lieu à un débat article par article, alinéa par alinéa, sur son contenu. C’est pourquoi il est parfois décidé de faire figurer les ordonnances dans le texte – cela a été le cas à plusieurs reprises lors de l’examen de ce texte –, ou de porter leur contenu à la connaissance des parlementaires. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un chèque en blanc au profit du Gouvernement pour prendre une disposition réglementaire : je répète qu’il s’agit d’une disposition législative à part entière.
M. Alain Tourret. Appartenant, comme Cécile Duflot, à la commission chargée par le président Bartolone de réfléchir à l’avenir de nos institutions, il m’a fallu choisir, ce matin, entre ses travaux et ceux de la commission spéciale. Considérant qu’un député doit toujours privilégier une commission décisionnelle par rapport à une commission consultative, j’ai choisi de prendre part à la présente réunion et de m’y cantonner, préférant appliquer le « J’y suis, j’y reste ! » du général Mac Mahon plutôt que de courir d’une commission à l’autre à la manière du furet de la chanson.
En ce qui concerne les ordonnances, je n’y suis pas du tout opposé, dans la mesure où elles constituent bel et bien une alternative à la loi. Je veux souligner, en revanche, que le Parlement ne respecte pas la distinction établie par la Constitution en ses articles 34 et 37 sur les domaines de la loi et du règlement. En matière de droit du travail, l’intervention du Parlement est en principe limitée aux grandes orientations générales. Or, le Conseil constitutionnel se refuse à sanctionner le fait que le Parlement outrepasse la répartition instituée par les articles 34 et 37 et que la loi inclue des dispositions qui ne devraient pas y figurer – sur ce point, je vous invite à consulter les analyses du professeur Dominique Rousseau, constitutionnaliste chevronné. Les députés en viennent donc à discuter de tout, alors qu’ils ne devraient débattre que de l’essentiel, conformément à l’esprit de la Ve République. Dans ces conditions, on ne comprend plus l’utilité des ordonnances.
J’estime donc que le Gouvernement a raison de recourir aux ordonnances dans le cadre d’habilitations contrôlées et vérifiées par le Parlement – qui peut toujours décider de ne pas ratifier l’ordonnance qui lui est soumise. Je rappelle que le travail du député ne consiste pas simplement à voter la loi, mais aussi à contrôler l’administration. Ce n’est pas un rôle réglementaire qui lui est confié, mais une mission relative aux grands principes.
M. le président François Brottes. Je rappelle que Cécile Duflot n’est pas membre de la commission spéciale, mais que cette commission donne la parole à tous ceux qui la demandent, car c’est à cette condition qu’elle pourra se prévaloir d’avoir effectué un travail de fond ouvert à tous les parlementaires.
M. Patrick Hetzel. J’ai été un peu surpris d’entendre Cécile Duflot affirmer que la démocratie était menacée – d’autant plus que, si les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas idéales, il n’y a rien à redire sur la qualité du travail effectué et l’écoute dont fait preuve le Gouvernement. Par ailleurs, j’ai été choqué qu’elle quitte notre salle de réunion sitôt après s’être exprimée, sans écouter ce que les autres députés avaient à dire. C’est en agissant ainsi que l’on menace la démocratie : en entrant dans un débat dont on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants et en jetant l’anathème sur l’ensemble du Parlement.
Enfin, quand j’entends parler de codécision, je veux souligner que c’est justement quand on revendique le fait de ne pas respecter la séparation des pouvoirs en empiétant sur les prérogatives du Gouvernement que l’on fragilise la démocratie. Chacun doit savoir rester dans le rôle qui lui revient.
M. Denys Robiliard. La question que pose Denis Baupin consiste en fait à savoir si la Charte de l’environnement déroge à l’article 38 de la Constitution en matière de droit de l’environnement, c’est-à-dire si l’on ne pourrait pas légiférer par ordonnance dans ce domaine. Pour ma part, je pense qu’il n’en est rien. La Charte de l’environnement a affirmé un certain nombre de principes, mais n’a pas interdit au Parlement de recourir aux techniques qui lui sont habituelles. On peut en penser ce que l’on veut d’un point de vue politique, mais, d’un point de vue juridique et constitutionnel, le fait de recourir aux ordonnances ne fragilise en rien la portée et la valeur des règles qui seront édictées.
Pour ce qui est de la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement, établie par les articles 34 et 37, chacun sait qu’il arrive que des dispositions essentielles soient prises par voie réglementaire. Sans vouloir anticiper sur la discussion de l’article 83 du projet de loi que nous examinons, il est évident que, en matière prud’homale, la réforme de la procédure, de nature réglementaire, est au moins aussi importante que d’autres dispositions prises par voie législative.
M. Jean-Louis Roumegas. Je regrette que certains se permettent d’interpeller Cécile Duflot alors qu’elle n’est plus là pour leur répondre. Je rappelle qu’elle n’est pas membre de la commission spéciale et que nous nous arrangeons pour qu’il y ait toujours au moins un membre de notre groupe présent au sein de cette commission – si l’on se penchait sur les ratios d’assiduité des différents groupes politiques tout au long de la semaine, on constaterait que, de ce point de vue, notre formation n’a certainement rien à envier aux autres. Si elle n’était pas venue du tout, vous lui en auriez fait grief : reconnaissez-lui donc plutôt le mérite d’avoir été présente pour exposer sa position.
J’ai eu le sentiment que les rapporteurs avaient peut-être été blessés par certains des mots que j’ai employés – je pense notamment à l’expression « colmater les brèches ». Ce n’était nullement mon intention, au contraire : je vous remercie très sincèrement d’accomplir votre travail dans les très mauvaises conditions que l’on connaît, afin d’aboutir à un projet de loi le moins mauvais possible.
Ce n’est pas par principe que nous refusons la procédure des ordonnances, que nous avons d’ailleurs acceptée dans d’autres cas, notamment quand il ne s’agissait que de légiférer sur des dispositions à caractère technique. Mais, pour ce qui est de l’article 28, chacun conviendra que l’habilitation est extrêmement large, ce qui n’est pas une bonne façon de procéder. Notre réticence ne procède donc pas d’une quelconque méfiance – ce Gouvernement a toute notre confiance –, mais de la crainte que nous ne finissions par perdre beaucoup de temps, du fait des contestations que cette méthode ne manquera pas de susciter. Le Président de la République a fait preuve d’une grande sagesse lors de la conférence environnementale, en déclarant que l’on pouvait effectivement procéder à des simplifications en la matière, à condition que cela se fasse en accroissant et en améliorant la participation du public.
Enfin, notre réticence s’explique aussi en partie par le fait que nous n’avons pas affaire au ministère de l’environnement, mais au ministère de l’économie. Quand le mot d’ordre est « croissance et activité à tout prix », il est normal que les défenseurs de l’environnement que nous sommes soient inquiets. Sans aller jusqu’à penser que certaines personnes se soient donné pour objectif de détruire l’environnement pour le plaisir, nous savons bien qu’elles le feraient sans hésitation au nom des intérêts économiques auxquels elles sont attachées. Nous tenions à dire qu’une telle approche est biaisée dès le départ.
M. le président François Brottes. Quand vous déplorez les mauvaises conditions dans lesquelles nous travaillons, monsieur Roumegas, je me demande si je ne devrais pas me sentir visé.
M. Denis Baupin. Je voudrais citer les propos d’une personnalité unanimement respectée, Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois. À propos du recours aux ordonnances, il a déclaré : « ils se révèlent souvent défectueux, avec des malfaçons qui n’apparaissent qu’a posteriori, là où il se serait sans doute trouvé un député pour soulever, fût-ce innocemment, le problème qui ne s’est découvert qu’après, à l’occasion de contentieux multiples. Le tamis parlementaire a des vertus intrinsèques que ne possède pas cette législation de chef de bureau que sont les ordonnances. » Je confirme notre réticence au sujet du recours aux ordonnances dans le cadre de l’article 28, et note que, en dépit de mes interrogations réitérées, le ministre ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet – ce qui me laisse penser que cette question lui pose effectivement problème.
M. le président François Brottes. Chacun aura compris que nous sommes en train d’élaborer une ordonnance comme on ratisse un jardin japonais.
M. le rapporteur général. Je remercie Denis Baupin de citer les bons auteurs, mais est-il bien certain que seules les ordonnances se trouvent modifiées a posteriori, et jamais les lois ? C’est bien plus souvent le contenu de la loi que son mode d’élaboration qui pose problème.
M. le ministre. Au regard de la Charte de l’environnement, des dispositions à valeur législative sont effectivement nécessaires. Nous requérons une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances, qui vont ensuite être soumises à un processus que nous allons définir ensemble. Une fois ratifiées par le Parlement, ces ordonnances, en vertu de la Constitution dans laquelle s’inscrit la Charte de l’environnement, auront valeur de loi : il n’y a aucun doute juridique sur ce point.
Quant à la rédaction des ordonnances, l’expérience que nous sommes en train de vivre montre que la discussion parlementaire a toujours pour effet d’améliorer un texte de loi – même si nous avons vu hier soir que le tamis que constitue cette discussion n’est pas toujours suffisant. Les dispositions de la loi ALUR que nous avons nous-mêmes corrigées montrent que, sans faire de la législation de chef de bureau, on peut faire de la bonne législation coproduite – qui n’est elle-même pas exempte d’imperfections. J’ai bon espoir que les discussions devant le CNTE, le fait que tous les avis rendus par cet organisme seront rendus publics – tout comme la consultation sur le texte de l’ordonnance –, et la discussion en commission sur le texte de l’ordonnance avant sa signature, constituent un processus de nature à lever toute ambiguïté et à nous permettre d’aboutir à un texte porteur du maximum de garanties au moment de sa ratification. Vos craintes portant sur la qualité de la production juridique et sur le rang du texte dans la hiérarchie des normes ne me semblent donc pas fondées, monsieur Baupin.
M. Arnaud Leroy. Nous allons bien devoir trouver une solution au problème qui se pose à nous. J’ai pris note de l’engagement du rapporteur thématique d’être vigilant et de prendre date pour la discussion en séance publique. Pour ma part, je réitère ma proposition d’instaurer un groupe de liaison qui constituera un tamis supplémentaire et, remerciant le ministre pour l’ouverture contenue dans sa réponse, je retire l’amendement SPE540.
L’amendement SPE540 est retiré.
La commission rejette l’amendement SPE1420.
Elle est saisie de l’amendement SPE1421 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Le vote qui a eu lieu précédemment impliquant le recours aux ordonnances, nous souhaitons savoir dans quel contexte elles vont être prises. J’ai bien entendu le ministre et les rapporteurs affirmer qu’il ne s’agissait pas de démanteler le droit de l’environnement, mais simplement de faire en sorte de rendre plus compatibles l’activité économique et le droit de l’environnement. Nous proposons de formaliser cette intention en précisant dans le texte que les ordonnances seront rédigées dans le respect du principe de non-régression du droit de l’environnement.
M. le ministre. Comme je l’ai dit, l’intention du Gouvernement n’est pas de remettre en cause les exigences environnementales, mais de permettre une instruction plus rapide des procédures qui, en l’état actuel, peuvent parfois prendre des années – je pense notamment aux installations de production d’énergie renouvelable. Il ne nous semble donc pas utile d’introduire dans ce projet de loi un nouveau principe de non-régression du droit de l’environnement, qui n’a pas davantage vocation à figurer dans ce texte que dans un autre – et, s’il fallait le faire figurer dans tous les textes, nous alourdirions considérablement la législation. Je vous confirme qu’il n’y a rien dans notre projet de loi qui témoigne d’une quelconque intention de reculer sur le plan environnemental, bien au contraire, et l’ensemble des engagements pris par le Gouvernement en termes de procédure vous donne toutes les garanties à ce sujet. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président François Brottes. Je conçois que vous ayez voulu obtenir une réponse du ministre, monsieur Baupin, mais vous avez sans doute conscience du fait que l’on ne peut faire figurer une telle disposition dans le texte de la loi. Souhaitez-vous maintenir votre amendement ?
M. Denis Baupin. En tout état de cause, je ne veux pas que l’on caricature mon amendement : il ne s’agit pas de faire figurer le principe de non-régression à chaque ligne de chaque article de la loi, mais simplement d’encadrer la façon dont vont être rédigées les ordonnances, en faisant en sorte qu’elles ne puissent aboutir à une régression en matière de droit de l’environnement. Si l’on est d’accord avec ce principe, je ne vois pas ce qui s’oppose à ce qu’il figure dans le texte.
M. le ministre. Il est fait référence à plusieurs reprises à la Charte de l’environnement dans ce texte d’habilitation, et le Gouvernement et les rapporteurs ont même déposé des amendements visant à sécuriser la procédure sur ce plan. En revanche, la rédaction que vous proposez ne me paraît pas satisfaisante, en ce qu’elle rend la loi verbeuse sans vous apporter d’autres garanties que celles que je vous ai fournies au nom du Gouvernement. Il vous a été remis une copie de la lettre cosignée par les ministres reprenant ces garanties, et je considère que l’ensemble des engagements qui vous ont été donnés constitue une sortie collective par le haut que je vous invite à emprunter en retirant votre amendement, qui me paraît satisfait.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Votre amendement, monsieur Baupin, me semble effectivement satisfait par la référence qui est faite à la Charte de l’environnement – et, quand vous dites que vous ne souhaitez pas inscrire ce principe à chaque ligne, je vous fais remarquer que vous avez tout de même déposé six amendements sensiblement identiques. Le principe de non-régression est un concept complexe, qui ne fait pas consensus. Dès lors, son introduction dans le texte impliquerait un risque juridique – ce qui constitue, je n’en doute pas, un argument auquel vous ne pouvez qu’être sensible. Si nous comprenons votre souhait de faire référence à la Charte de l’environnement, nous préférons un droit de l’environnement plus simple, plus compréhensible, plus moderne et bien adapté.
M. le président François Brottes. Il me semble que l’on ne peut faire régresser un droit sans modifier le droit et qu’à droit constant, il ne saurait y avoir de régression.
M. Arnaud Leroy. Je voudrais pour ma part souligner la puissance du droit européen de l’environnement, qui encadre notre droit national et procure une certaine sécurité. L’objectif que je poursuivais avec mon amendement de suppression était de limiter les contentieux, et c’est à mon sens l’objectif que nous devons garder à l’esprit.
M. Denis Baupin. Peut-être ne suis-je pas suffisamment attentif, mais une relecture rapide de l’article 28 ne m’a pas permis de découvrir les références prétendument nombreuses à la Charte de l’environnement qui ont été évoquées – et je n’ai pas davantage trouvé dans la lettre des ministres d’indication selon laquelle il n’y aurait pas de régression du droit de l’environnement. Je constate donc que le principe n’est pas écrit, et je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la raison de l’absence de toute formalisation de ce principe, car chacun sait qu’il n’est pas rare qu’une simplification se traduise par des régressions.
J’ai moi-même négocié avec les ONG de protection de l’environnement lors de l’élaboration de l’avis du CNTE sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, et l’avis écrit du CNTE précise que les évolutions en matière de facilitation des énergies renouvelables devaient se faire sans régression du droit de l’environnement. C’est pourquoi j’estime aujourd’hui que nous devrions nous assurer que les ordonnances seront, elles aussi, rédigées sans régression du droit de l’environnement.
M. le président François Brottes. Vous ne pouvez comparer l’avis d’une instance à une disposition législative, monsieur Baupin. Par ailleurs, on ne précise pas, chaque fois que l’on rédige un amendement, qu’il doit être conforme à la Constitution. La Charte de l’environnement est de niveau constitutionnel et s’applique de fait et de droit à tous nos textes. Il n’est pas question que la moindre initiative parlementaire vienne en contradiction avec cette Charte et, si cela arrivait, le Conseil constitutionnel censurerait la disposition en question.
M. Denis Baupin. Mon amendement ne porte pas sur la Charte de l’environnement, mais sur le droit de l’environnement au sens large, c’est-à-dire sur l’ensemble du code de l’environnement.
M. le président François Brottes. Vous venez tout de même de souligner que le texte ne contenait pas de référence à la Charte de l’environnement.
M. Denis Baupin. C’était simplement pour répondre au ministre.
M. le ministre. Il est bien fait référence à la Charte de l’environnement à l’alinéa 14 de l’article 28. En tout état de cause, vous savez bien que cette Charte est intégrée à notre droit et que, dans la hiérarchie des normes, elle est située au-dessus des dispositions que le Parlement nous habilite à prendre par ordonnance. Voudriez-vous que nous fassions référence à chaque paragraphe à la norme supérieure ? Ce n’est pas ainsi que l’on fait le droit : dans la mesure où la Charte de l’environnement est située au-dessus dans la hiérarchie des normes, elle sera forcément respectée.
Pour ce qui est du code de l’environnement, s’engager à ne pas y toucher n’aurait pas de sens : on peut en effet vouloir modifier des éléments de ce code pour aller dans le bon sens. Ainsi, si l’on souhaite simplifier les procédures d’autorisation pour les éoliennes – ce qui me paraît une bonne idée –, on est obligé de modifier plusieurs dispositions du code, car les éoliennes tuent des balbuzards et des chauves-souris. Vous pouvez, dans la pondération des facteurs que vous allez prendre en compte, considérer que certaines contraintes portant sur les projets en matière d’énergie renouvelable doivent être regardées différemment, en raison de l’importance de ces projets pour notre économie et pour la transition énergétique. Je trouve un peu paradoxal de vouloir tout sécuriser alors que vous disposez déjà des protections que constituent la Charte, l’engagement gouvernemental à ce qu’il n’y ait pas de régression et une lettre certifiant que les travaux seront faits sous l’autorité de la ministre compétente. En tout état de cause, il n’est pas cohérent d’avoir une approche maximaliste de la sécurisation, consistant à exiger que l’on respecte la Charte de l’environnement et que l’on ne touche pas au code de l’environnement, tout en formulant des propositions semblables à celles que vous venez d’émettre au sujet des éoliennes. Je vous répète par conséquent que l’intention que vous manifestez au moyen de cet amendement est satisfaite à la fois par la Charte, par les engagements que je vous ai donnés et par la lettre des ministres qui vous a été communiquée, et je vous invite à retirer cet amendement qui n’est pas cohérent avec la proposition que vous avez formulée précédemment.
M. le rapporteur général. L’engagement à ne pas provoquer de régression sur le plan environnemental est un engagement politique, un engagement de confiance, et c’est en exprimant cette volonté de manière collective que nous lui donnerons le plus de poids.
M. Denis Baupin. Je répète que la discussion sur la Charte n’a pas lieu d’être : je sais bien qu’elle s’applique à tous, et je ne l’ai évoquée que pour répondre au ministre.
Là où nous avons un vrai désaccord, c’est sur les amendements que j’ai déposés au sujet de l’éolien, qui n’avaient pas pour objet de restreindre la protection de la biodiversité : il ne s’agit pas de dire que les éoliennes valent mieux que les balbuzards et les chauves-souris, mais de simplifier les procédures, les documents et les délais de recours. Le fait même que vous citiez cet exemple, monsieur le ministre, aurait tendance à m’inquiéter plutôt qu’à me rassurer : si vous commencez à dire qu’il vaut mieux construire un building que protéger la biodiversité, il y a tout à craindre pour le droit de l’environnement ! Je le répète, il ne s’agit que de mettre par écrit un principe relatif à la rédaction des ordonnances, et je trouve inquiétant que nous ne puissions nous accorder sur ce point.
M. le président François Brottes. Ce que le ministre vous a expliqué, c’est qu’il était parfois nécessaire de modifier le code de l’environnement.
M. Denis Baupin. J’ai bien conscience du fait qu’il sera nécessaire de modifier certains articles du code de l’environnement. Ce qui m’importe, c’est que cela se fasse sans régression du droit de l’environnement.
M. le ministre. Ainsi, d’après vous, soit l’on écrit dans la loi que l’on s’interdit de modifier une autre loi – en l’occurrence, le code de l’environnement –, soit l’on y écrit ce qui relève de l’engagement politique, et qui figure dans le deuxième paragraphe de la lettre du 13 janvier 2015 : « dont l’objectif est de rendre le droit de l’environnement plus simple, plus lisible, plus efficace et mieux proportionné ». Or, on ne peut pas écrire dans la loi ce que vous proposez d’y faire figurer, car ce n’est pas du droit, mais simplement l’expression d’une volonté politique que nous partageons.
M. le président François Brottes. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Baupin ?
M. Denis Baupin. Je le maintiens.
M. le président François Brottes. Chacun a bien compris que si cet amendement n’est pas adopté, il ne faudra pas y voir un vote contre la non-régression du droit de l’environnement. Cela dit, je pensais que vous pourriez le retirer, monsieur Baupin, afin de nous permettre de sortir d’une ambiguïté qui ne me paraît pas très saine.
M. Jean-Yves Caullet. Au nom du groupe SRC, je voudrais exprimer notre attachement au droit de l’environnement, à l’objectif consistant à simplifier les procédures, et au principe selon lequel le droit de l’environnement doit s’intégrer dans le dispositif législatif au moyen de procédures plus simples. Notre groupe sera vigilant sur ces points et confiant dans les engagements du Gouvernement.
M. Laurent Grandguillaume. Toutes les mesures de simplification élaborées et validées par le Gouvernement l’ont toujours été dans le souci d’assurer la sécurité, c’est-à-dire dans l’objectif de simplifier les normes sans pour autant reculer du point de vue de la sécurité – qu’elle soit environnementale ou se rapporte à d’autres principes – et d’obtenir ainsi une accélération des procédures, de la création de richesses, mais aussi du développement des énergies renouvelables. Pour moi, il n’y a pas incompatibilité entre simplifier et assurer la sécurité. Dès lors, plutôt que de se lancer dans des débats idéologiques, il vaut mieux faire preuve de pragmatisme et travailler avec le Gouvernement afin de mettre en œuvre ces mesures le plus rapidement possible, dans l’intérêt général.
M. Denis Baupin. Ma démarche est évidemment positive, et je trouve déplacés les commentaires mettant en doute mes intentions. Surtout, puisque le débat semble prendre une tournure personnelle, je rappelle que nous avons reçu le ministre devant notre groupe il y a quelques jours, afin d’évoquer le présent projet de loi. Au moment où nous avons abordé l’article 28, il nous a dit qu’il ne fallait pas qu’il ait pour conséquence de faire régresser le droit de l’environnement, et je lui ai demandé s’il était possible de mettre ce principe par écrit, ce qu’il a accepté. Mais que l’on ne vienne pas me dire que c’est fait au motif que cela figure dans une lettre ! On ne vote pas les lettres, et la seule garantie qui vaille est celle consistant à inscrire le principe dans la loi.
Rien n’est normatif dans la façon dont on rédige une ordonnance : on ne fait que préciser le cadre dans lequel cela doit se faire – en l’occurrence, nous souhaitons juste qu’il soit précisé que la rédaction des ordonnances ne doit impliquer aucune régression du droit de l’environnement. Si j’ai posé la question au ministre lors de la réunion de notre groupe, c’était bien en pensant à l’amendement dont nous débattons actuellement.
M. le président François Brottes. Il faut considérer la lettre comme une forme d’amendement gouvernemental.
La Commission rejette l’amendement SPE1421.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE1434 et SPE1426 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Ces deux amendements prévoient un avis du CNTE sur les projets d’ordonnance, avis conforme pour l’amendement SPE1434 et avis simple pour l’amendement SPE1426.
M. le ministre. L’engagement de soumettre les projets d’ordonnance à l’avis du CNTE a été pris. Nous ne sommes pas opposés à l’inscription de cette étape de la procédure dans la loi. À cet égard, l’amendement SPE1426 me semble satisfait par l’amendement SPE1575 des rapporteurs, qui précise que le CNTE est associé à l’élaboration des ordonnances. Quant à l’amendement SPE1434, il n’est pas juridiquement possible d’imposer un avis conforme du CNTE. Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Prévoir un avis conforme du CNTE reviendrait à laisser celui-ci se substituer au Parlement, hypothèse que nos précédents échanges ont fermement écartée. Un représentant du MEDEF au CNTE ne peut pas avoir le même poids que les députés que nous sommes.
Toutefois, le CNTE doit être moteur dans le processus d’élaboration des ordonnances. C’est l’objet de l’amendement SPE1575, qui va plus loin que celui que vous proposez.
M. le président François Brottes. L’amendement SPE1434 est inconstitutionnel, puisqu’il s’assimile à une injonction au Parlement. Acceptez-vous de le retirer ?
M. Denis Baupin. Je le retire.
Toutefois, je n’ai pas le texte de l’amendement SPE1575. Associer le CNTE, ce que j’approuve, ce n’est pas demander son avis. Si nous sommes tous favorables à un avis du CNTE, pourquoi ne pas ajouter cette mention dans le texte ?
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE1575 indique que le CNTE « est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du code de l’environnement. »
M. le ministre. L’amendement SPE1575 va plus loin que le vôtre. L’association du CNTE à l’élaboration des ordonnances lui permet d’émettre des avis, mais aussi d’être régulièrement informé et consulté. En outre, la référence aux articles du code de l’environnement garantit la publicité des avis.
M. Denis Baupin. Il n’est pas écrit dans cet amendement des rapporteurs que le CNTE émet un avis sur les ordonnances. Je ne saisis pas pour quelle raison nous ne pourrions pas adopter les deux amendements.
M. le ministre. Compte tenu des textes qui régissent aujourd’hui son fonctionnement, le CNTE, dès lors qu’il est saisi, émet des avis. En outre, le terme d’avis figure expressément dans la seconde phrase de l’amendement des rapporteurs. Vous croyez voir de la malice là où il n’y en a pas. Au contraire, votre amendement est plus réducteur et moins sécurisant que celui des rapporteurs.
M. Christophe Caresche. Au vu du large accord sur le fond, ne pourrait-on pas fusionner les deux amendements ?
M. le président François Brottes. Il me semble que le ministre comme le rapporteur thématique ont clairement indiqué que le CNTE rendrait des avis.
M. le ministre. Afin de rassurer M. Baupin, je suis prêt à accepter une rectification de l’amendement SPE1575, visant à ajouter à la fin de la première phrase les mots : « et émet des avis ».
Les amendements SPE1426 et SPE1434 sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement SPE1458 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement prévoit la consultation du public sur les projets d’ordonnance, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
M. le ministre. Votre amendement introduit dans le projet de loi une disposition figurant déjà dans le code de l’environnement et en vertu de laquelle la consultation est obligatoire. Il est donc satisfait.
M. Denis Baupin. À quel moment de la procédure cette consultation intervient-elle ?
M. le président François Brottes. On est tenté de prévoir tout dans la même loi, en oubliant les textes en vigueur. La loi n’a pas vocation à se répéter...
Mme Sophie Errante. Le processus d’élaboration des ordonnances répond déjà à vos demandes. J’ai pu le constater s’agissant des mesures de simplification : les parlementaires sont consultés et les projets d’ordonnance sont mis en ligne sur un site accessible au public.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En application de l’article de la Charte auquel vous faites référence, il est prévu que le projet de décision – c’est-à-dire une fois la phase de co-élaboration achevée et avant la ratification –, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, soit mis à disposition du public.
L’amendement SPE1458 est retiré.
La Commission en vient à l’amendement SPE1427 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement prévoit que les commissions parlementaires permanentes émettent un avis sur les projets d’ordonnance. Je suis également ouvert à d’autres formes d’association en amont du Parlement.
M. le ministre. Je reviens un instant sur l’amendement précédent : c’est l’article L. 120-1 du code de l’environnement qui précise le modus operandi pour la consultation du public.
S’agissant du présent amendement, le Gouvernement a pris des engagements sur l’élaboration des ordonnances, qu’il a déjà honorés en matière de simplification : le projet de réforme du code des marchés publics a été adressé aux commissions parlementaires et est accessible en ligne.
Je le redis ici solennellement : les projets d’ordonnance seront présentés aux commissions permanentes compétentes du Parlement. L’ordonnance relative au logement intermédiaire, dont la commission spéciale a approuvé hier la ratification, en apporte la preuve, sans qu’il ait été besoin de le préciser dans la loi.
Il me semble inutile de multiplier les contraintes dès lors que le Gouvernement s’est engagé. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
L’amendement SPE1427 est retiré.
La Commission examine les amendements identiques SPE242 de M. Jean-Frédéric Poisson, SPE398 de M. Patrick Hetzel et SPE1422 de M. Denis Baupin.
M. Philippe Vitel. Cet amendement traduit le sentiment de frustration de la représentation nationale à l’égard du recours aux ordonnances. La richesse du débat de ce matin a néanmoins permis de nourrir notre réflexion et d’apporter certaines garanties.
J’ai lu avec attention le courrier adressé au rapporteur thématique par les ministres, en particulier la dernière phrase : « Ce travail de concertation pourra être complété par des échanges avec la représentation nationale sous une forme dont nous vous proposons de convenir prochainement. » Quelles formes envisagez-vous de nous proposer, monsieur le ministre ?
Notre principal souci reste la simplification, afin d’éviter les dérives auxquelles nous assistons dans de nombreux domaines. Je prends l’exemple de la gestion des ports, dont le développement, facteur d’attractivité, est freiné par l’absence de distinction entre le domaine public maritime naturel et le domaine public maritime artificiel ou portuaire.
Nous regrettons le flou sur le nombre et le contenu des futures ordonnances ainsi que sur les modalités d’association du Parlement. Nous avons néanmoins été partiellement rassurés par nos débats de ce matin, de sorte que nous pourrions retirer l’amendement.
M. Patrick Hetzel. Le texte provisoire correspondant aux quinze premiers articles adoptés par notre commission spéciale nous a été transmis. Quand pouvons-nous espérer la suite ?
M. le président François Brottes. La partie consacrée aux professions réglementées vous sera transmise en fin de journée. Je tiens toutefois à souligner que la mise à disposition du texte de la commission spéciale au fur et à mesure de l’examen des amendements est une pratique inhabituelle à l’Assemblée. Le sujet le mérite, mais il faut prendre le temps de faire ce travail d’exception.
M. Patrick Hetzel. Il est vrai que cette pratique est rare dans notre assemblée alors que le Sénat connaît cet usage depuis longtemps. Nous pouvons donc améliorer encore nos pratiques parlementaires.
M. Denis Baupin. On peut considérer que l’amendement SPE1422 a été défendu précédemment, puisqu’il traduit notre désapprobation du recours aux ordonnances pour réformer le droit de l’environnement.
M. le président François Brottes. Tirez-vous du débat de ce matin les mêmes conclusions que Philippe Vitel ?
M. Denis Baupin. Non, je ne suis toujours pas convaincu.
M. le ministre. Je réaffirme l’esprit dans lequel ce texte a été rédigé, que viennent compléter la lettre adressée aux rapporteurs et l’engagement pris de soumettre les projets aux commissions.
Le débat parlementaire aura bien lieu. Vous savez que je ne suis pas avare de mon temps, tout comme la ministre de l’écologie.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. J’émets un avis défavorable. Je plaide pour le retrait de ces amendements, compte tenu des engagements qui ont été pris.
Mme Sophie Errante. Nos échanges font écho au travail mené par les députés sur les conditions pour mieux légiférer. Nous pouvons nous féliciter des progrès que nous avons déjà accomplis en la matière.
Les amendements SPE242 et SPE398 sont retirés.
La Commission rejette l’amendement SPE1422.
Puis elle est saisie de l’amendement SPE1376 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Je prends acte avec satisfaction de la clarification du ministre sur la consultation des commissions permanentes du Parlement.
Cet amendement substitue au terme d’« autorisation » celui de « décision ». On ne peut en effet préjuger du sort de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement : il peut être décidé de l’accorder ou de la refuser.
M. le ministre. Une fois de plus, madame Bonneton, j’émets un avis favorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je partage l’enthousiasme du ministre.
La Commission adopte l’amendement SPE1376.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1457 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise à préciser que seuls les projets d’intérêt général seront concernés par l’évolution du droit de l’environnement par ordonnance.
M. le ministre. Cet amendement appelle deux réserves. Sur le fond, il n’est pas souhaitable de restreindre ab initio le champ d’application de l’ordonnance aux seuls projets d’intérêt général. L’élaboration de l’ordonnance sera l’occasion d’examiner la pertinence de ce choix. Sur la forme, l’amendement fait référence à des articles de nature réglementaire du code de l’urbanisme. Cela ne me semble guère satisfaisant au regard de la légistique. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. le président François Brottes. La hiérarchie des normes vous oblige à retirer cet amendement.
M. Denis Baupin. J’accepte de le retirer pour les raisons de forme que vous avez invoquées. Malgré tout, les projets dénués d’intérêt général restent visés, au risque d’une régression de l’environnement. Il me semble que nous aurions pu encadrer davantage l’habilitation.
L’amendement SPE1457 est retiré.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement SPE1456 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise à préciser que seuls les projets favorisant la transition énergétique sont concernés par l’évolution du droit de l’environnement envisagée au moyen des ordonnances.
M. le ministre. J’ai déjà exprimé mon avis défavorable sur ce point lors du débat d’hier soir.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En effet, nous abordons une série d’amendements dont nous avons déjà débattu. L’avis défavorable ne signifie en rien une régression du droit ou des ambitions de la transition énergétique.
La Commission rejette l’amendement SPE1456.
Les amendements SPE1339, SPE1338 et SPE1337 de M. Denis Baupin sont retirés.
La Commission examine l’amendement SPE1378 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. L’alinéa 5 de l’article 28 du projet de loi, que cet amendement propose de supprimer, tend à accorder au juge administratif qui a annulé le refus de permis de construire la faculté de délivrer ledit permis.
Après l’annulation du permis de construire, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au maire ou au préfet qui reste saisi de la demande de permis. Le juge administratif ne peut exercer ce pouvoir qu’autant que la procédure d’instruction est régulière et il n’a pas qualité pour conduire une procédure de participation du public lorsqu’elle est nécessaire. L’annulation du refus ne donne pas nécessairement un brevet de légalité au regard de toutes les normes applicables.
M. le ministre. L’objet de l’alinéa 5 est d’aménager les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur les recours contre des autorisations d’urbanisme. L’annulation du refus de délivrance doit pouvoir conduire à la réinstruction du dossier par le préfet. Tout en préservant les droits et les garanties dans les procédures, il s’agit d’éviter la procrastination ou la perte de temps pour des acteurs économiques qui sont de bonne foi.
Je suis sensible à vos préoccupations. Il n’est pas question d’empêcher les recours, mais de corriger les dysfonctionnements de la procédure pour la rendre plus simple, plus lisible et plus juste. C’est bon pour l’économie et l’environnement. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Fort de mon expérience, je souligne la difficulté à laquelle est confronté un maire qui a bloqué un permis et qui se trouve obligé, par une décision de justice qui devra être définitive, de réinstruire le dossier, entretenant ainsi le conflit qui l’oppose au bénéficiaire de la décision.
Il ne s’agit pas de se substituer au pouvoir des maires, mais de confirmer une décision définitive du juge et de donner les moyens de la mettre en œuvre. Il est proposé, dans cet alinéa, de donner au juge la possibilité de décider en lieu et place du maire dont la décision n’est pas fondée.
Toutefois, les auteurs de l’amendement ont raison de souligner que, dans un tel cas, le juge aura à contrôler la légalité de l’ensemble des procédures au regard des normes applicables et à prendre, le cas échéant, les initiatives nécessaires pour établir la légalité de celles qui seraient défaillantes.
Il est important de prévoir que le juge, pour mettre en œuvre sa décision, puisse s’appuyer sur l’autorité du préfet, qui doit être l’ultime recours. La substitution intervient en dernière extrémité lorsqu’un maire refuserait la bonne application du droit, après une décision de justice devenue définitive.
Mme Michèle Bonneton. Un certain flou demeure dans la rédaction de l’alinéa 5. La décision du juge valant permis de construire ne peut pas être contestée par un tiers. Celui-ci est donc privé du droit d’accès au juge, en violation de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’Homme, pour discuter d’éventuels autres griefs d’illégalité. Je veux bien vous croire sur parole, mais je maintiens que la rédaction n’est pas assez précise.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce sujet n’est pas nouveau. Voilà plusieurs décennies que le législateur cherche à concilier le droit d’ester en justice et l’efficacité opérationnelle, qui impose de purger les contentieux. En matière pénale, cette possibilité existe.
L’ordonnance doit être l’occasion de trouver un moyen d’empêcher que les contestations, une fois tranchées par la justice administrative de manière définitive, ne soient remises sur la table par d’autres techniques.
Pour résoudre ce problème, le juge pourrait non seulement dire la cause de la nullité, mais aussi indiquer les solutions pour la corriger. J’ai conscience que cette démarche est nouvelle et très compliquée.
Il n’est pas acceptable que le droit d’ester en justice soit l’instrument le plus efficace pour bloquer un certain nombre d’initiatives.
Mme Michèle Bonneton. Nous avons conscience de la nécessité de sortir de ces blocages. Je souhaite obtenir des assurances de la part du ministre sur la séparation des rôles entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, ainsi que sur le fait que le tribunal n’est pas juge et partie.
M. le ministre. Je peux vous donner ces assurances. Vous avez rappelé à juste titre les textes constitutionnels qui protègent les droits des citoyens, en particulier le droit au recours. Vous savez donc que, si nous méconnaissions ces droits, nous serions rattrapés par la hiérarchie des normes. Je le redis, le droit au recours des citoyens sera préservé dans la procédure future.
L’amendement SPE1378 est retiré.
La Commission adopte l’amendement de cohérence SPE538 des rapporteurs.
La commission est saisie de l’amendement SPE1169 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Les procédures sont parfois très longues et le recours abusif est trop souvent la règle dans certaines d’entre elles. Un article issu d’une récente ordonnance permet de limiter le contentieux. Cet amendement propose d’étendre son application aux affaires en cours.
M. le ministre. Le Gouvernement partage cet objectif. Dans le cadre de la loi ALUR, des expérimentations ont été mises en place. Il y a encore aujourd’hui beaucoup trop de recours abusifs. Votre souci rejoint celui de l’alinéa que nous venons d’évoquer, à savoir éviter les pratiques dilatoires. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Si je partage la préoccupation exprimée par cet amendement, j’appelle toutefois votre attention sur la référence aux affaires en cours. L’application à des contentieux en cours présente un risque au regard de la Constitution. J’invite à la prudence sur ce point.
M. le président François Brottes. La référence aux contentieux en cours ne me gêne pas. Nous voyons trop souvent le droit utilisé pour faire des profits sur le dos de ceux qui investissent ou paient des loyers. Alors que nous entendons durcir les règles, il ne faut pas envoyer un signal de mollesse qui encouragerait les moins scrupuleux à s’engouffrer dans la brèche et poursuivre les abus tant qu’il en est encore temps.
La Commission adopte l’amendement SPE1169.
Puis elle examine les amendements identiques SPE1252 de M. Joël Giraud et SPE1379 de Mme Michèle Bonneton.
M. Alain Tourret. J’insiste de nouveau sur les dégâts extrêmement graves causés par les recours abusifs. Ils sont responsables d’un préjudice direct, mais ils ont aussi pour conséquence de tout retarder : l’administration suspend tout, alors même qu’elle n’a pas à le faire puisque la décision positive vaut tant que la décision définitive n’a pas été prononcée. Ce blocage est insupportable. Rappelez-vous que le pont de l’île de Ré a été construit sans autorisation, malgré l’annulation du permis de construire... En outre, le demandeur débouté de son recours n’est pas sanctionné. On pourrait pourtant infliger une amende civile en cas de recours abusif. De même, les juridictions ne condamnent jamais à des dommages-intérêts correspondants au préjudice subi. Enfin, les frais irrépétibles mis à la charge de l’auteur du recours sont très faibles. Rien n’est fait pour décourager les recours abusifs ou intimider leurs auteurs.
S’agissant de l’amendement lui-même, il tend à supprimer l’alinéa 6 de l’article 38 du projet de loi, qui me paraît gênant au regard du droit des collectivités territoriales. Cette disposition semble imputer la responsabilité du blocage auxdites collectivités. Pourtant, le tribunal administratif peut déjà ordonner sous astreinte une remise de l’autorisation en cas d’annulation. Cette solution me paraît préférable à la substitution du représentant de l’État.
Mme Michèle Bonneton. Avec cet alinéa, les collectivités territoriales se trouvent dessaisies de leurs compétences, alors que le raccourcissement des délais d’instruction qui doit résulter de la mesure sera modeste.
M. le ministre. L’alinéa 6 s’applique aux cas dans lesquels le refus de délivrance d’une autorisation est annulé par le juge. Le porteur du projet revient devant le maire qui peut de nouveau lui refuser l’autorisation : il se trouve alors dans une impasse. Des projets se trouvent ainsi bloqués continûment pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Si le juge annule le refus d’autorisation, il faut donc pouvoir sortir de la situation d’impasse dans laquelle on se trouve en renvoyant systématiquement au maire. Lorsque le refus de délivrance a été annulé par le juge administratif, celui-ci doit pouvoir solliciter le préfet en lieu et place du maire.
Le cadre de cette procédure doit être précisément défini : c’est l’objet de l’habilitation. On ne peut pas se satisfaire d’une situation dans laquelle un maire peut continuer à refuser d’accorder une autorisation sans raison valable, et ce, malgré l’annulation de sa décision par le juge. Est-ce conforme à la liberté d’entreprendre, autre principe à valeur constitutionnelle ?
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En miroir des recours abusifs, on peut aussi parler des inactions abusives. La solution proposée par l’alinéa 6 permet de sortir de l’impasse de la meilleure manière. J’indique que la décision du juge de saisir le préfet est susceptible d’appel. Je rappelle également que cette possibilité est ouverte seulement en cas de blocage du système par le maire sanctionné par le juge au travers d’une décision définitive.
L’alinéa 6 est plus protecteur encore que l’alinéa 5, car les services du préfet sont en mesure de garantir l’instruction et la décision, qui est elle-même susceptible d’appel. Cette disposition apporte une réponse à l’inaction de certains maires, qui pénalise des opérateurs dans leur juste droit.
M. le président François Brottes. Pour complaire à Michèle Bonneton, il respecte le droit des tiers...
M. Alain Tourret. Nous ne partageons pas la même philosophie. Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, je préfère la sanction du maire à la substitution du préfet. La commune pourrait être condamnée à des dommages-intérêts substantiels en cas de refus d’une autorisation.
Vous oubliez aussi que le tribunal administratif peut ordonner la remise du document sous astreinte. Le recours à cette procédure efficace, qui est de plus en plus fréquent, permettrait de préserver le rôle des collectivités territoriales.
En redonnant ainsi du pouvoir au préfet, vous commettez un péché de jacobinisme. La solution que je propose est bien plus efficace et plus respectueuse des principes du droit.
M. le ministre. Je suis sensible à l’attachement de M. Tourret à la libre administration des collectivités territoriales. Le souci d’efficacité qui guide ce projet de loi conduit à écarter la sanction financière que vous préconisez. Elle est moins efficace et peut en outre entraîner des effets pervers.
J’ajoute que le préfet ne décide pas seul de se substituer à l’élu compétent. La substitution intervient sur décision du juge administratif. Je suis toutefois prêt à accepter un amendement pour préciser ce point.
M. Jean-Yves Caullet. L’amendement pourrait remplacer les mots : « se substitue », qui laissent entendre un pouvoir autonome, par les mots : « est substitué par décision de justice ».
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Dans l’esprit des rédacteurs du projet de loi, la substitution du préfet est autorisée par décision de justice. Je propose néanmoins d’introduire cette précision rédactionnelle.
Mme Michèle Bonneton. J’attends de connaître l’amendement pour me prononcer sur le sort de mon amendement.
M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur thématique, pourriez-vous présenter votre amendement SPE1954, qui sera appelé dans un instant ?
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement précise que c’est seulement sur décision du juge administratif que le préfet peut être saisi, ce qui sécuriser le dispositif et est de nature à rassurer Alain Tourret. Il est ainsi rédigé : « À l’alinéa 6, après le mot : “substitue”, insérer les mots : « “, sur décision du juge administratif,” ».
M. Alain Tourret. Je retire mon amendement de suppression de l’alinéa.
Mme Michèle Bonneton. Pour ma part, je persiste à défendre l’idée que les permis de construire doivent être délivrés par les maires. Je ne retire pas mon amendement.
L’amendement SPE1252 est retiré.
La Commission rejette l’amendement SPE1379.
La Commission est saisie de l’amendement SPE539 du rapporteur général et des rapporteurs thématiques.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement tend à réserver la possibilité d’une substitution du représentant de l’État à l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme aux seuls cas d’annulations devenues définitives afin de garantir l’ensemble des droits du justiciable.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE539.
Puis elle adopte l’amendement SPE1954 des rapporteurs.
Elle examine ensuite les amendements identiques SPE1250 de M. Joël Giraud et SPE1380 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Alain Tourret. L’amendement SPE1250 est défendu.
M. Jean-Louis Roumegas. La suppression de la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles – UTN – proposée par cet alinéa est prématurée. En effet, la loi ALUR prévoit une révision progressive des schémas de cohérence territoriale – SCoT – qui leur fera intégrer les dispositions de la « loi montagne » et, ce faisant, les rendra alors suffisants pour former écran à leur application pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). Cet amendement propose de rétablir la procédure jusqu’à ce que les SCoT aient effectivement intégré l’ensemble des dispositions des lois Grenelle et ALUR.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le dispositif des UTN a été utile, efficace et protecteur. Aujourd’hui, les UTN sont couvertes par la loi ALUR et cette protection me paraît suffisante. Le dispositif était devenu lourd pour seulement trois ou quatre projets par an. La mesure proposée permet d’éviter une double procédure sans abaisser le niveau d’exigence.
M. le ministre. Le rapporteur a rappelé l’état du droit. Désormais, les SCoT intègrent les projets d’UTN. La procédure d’autorisation, qui a été conçue pour éviter le suréquipement des communes, s’avère inadaptée à la gestion. Elle est particulièrement lourde pour les petits projets, en particulier les campings.
Afin de remédier à l’empilement des législations, il est donc prévu de supprimer la procédure d’autorisation des UTN et de prévoir un avis du préfet en distinguant deux cas de figure : en présence d’un SCoT, un avis plus léger, car le SCoT couvre les UTN ; et, en l’absence de SCoT, un avis conforme.
Je réitère l’engagement pris d’associer les parlementaires sur ce point également et je vous demande de retirer cet amendement.
Mme Michèle Bonneton. À l’heure actuelle, il s’agit plus d’aménager des stations existantes que d’en créer de nouvelles, mais ces procédures ont leur importance puisqu’elles impliquent un passage devant une commission. Si cette procédure était supprimée, le passage en commission le serait aussi et de nombreux acteurs de la montagne, en particulier les associations environnementales, ne seraient même plus au courant des projets de modification. Or, nous avons bien insisté sur le fait que ces réformes ne devaient pas nuire à la bonne information du public. De plus, les dossiers d’UTN sont concrets et nécessairement bien chiffrés. Peut-être y a-t-il des aménagements à faire en fonction de l’importance des projets concernés, mais nous pensons vraiment qu’il faut maintenir ce dispositif d’UTN.
M. le président François Brottes. Dès lors qu’ils sont étudiés dans le cadre d’un SCoT, ces projets n’échappent pas à la vigilance de nombreuses commissions départementales concernant la protection des sites, de l’agriculture, etc. Le SCoT n’exonère pas de consulter l’ensemble des commissions départementales pour des projets de ce type et la consultation ne sera pas meilleure si le dossier remonte à Paris.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En effet, ces consultations demeurent et il y a aussi des enquêtes publiques. C’est le SCoT qui garantit l’information, y compris sur les évolutions d’UTN. Cette procédure de simplification ne doit pas susciter d’inquiétudes, car elle ne remet pas en cause la transparence, l’ouverture et l’association du public et de tous les élus concernés.
Mme Bernadette Laclais. Plus ancienne que la « loi montagne », la procédure UTN a déjà été simplifiée. Elle a fait la preuve de sa pertinence, au moins au départ, mais le contexte a changé : l’intercommunalité et le droit de l’environnement ont évolué ; la « loi montagne » a pris en compte certaines problématiques. Pour avoir longtemps siégé dans les comités UTN, je pense que l’on peut s’interroger sur le rapport entre la lourdeur de la procédure et les bénéfices qu’elle procure en termes de qualité des décisions prises. Cela étant, il demeurait des interrogations et je remercie le ministre de nous avoir apporté toutes ces précisions, ces éléments de lecture et de compréhension.
Si vous le permettez, monsieur le président, je vais évoquer mon amendement SPE1185, qui aurait pu faire l’objet d’une discussion commune. Il propose d’écrire clairement que la procédure d’autorisation des UTN est maintenue « lorsque le projet touristique est en dehors d’un territoire couvert par un SCoT ou non prévu par un SCoT ». Dans ce dernier cas, il faudra intégrer le projet d’une manière ou d’une autre, soit en révisant le SCoT, soit en recourant à la procédure UTN. Quelle est la solution la moins lourde ? Il faudra répondre à la question si nous escomptons des retombées positives sur le territoire. Le Premier ministre a demandé des évaluations et des propositions, en vue du prochain Conseil national de la montagne. Pour ma part, je ne suis pas opposée aux simplifications, mais mon amendement vise à lever certaines inquiétudes.
M. le président François Brottes. J’estime, quant à moi, préférable de réviser le SCoT, par souci de cohérence et pour ne pas donner à penser que le projet n’est pas celui des élus. Rappelons que les directives territoriales d’aménagement – qui existent toujours – peuvent permettre à l’État de passer outre les procédures existantes, en se contentant d’un minimum de concertation. Elles ont été utilisées dans les Alpes, entraînant des conséquences qui ne sont pas forcément traumatisantes.
Mme Bernadette Laclais. Les propositions des élus n’impliquent pas systématiquement la révision du SCoT, processus qui est relativement lourd. Dans certains cas, le SCoT couvre un territoire beaucoup plus large. Si nous disposions d’une étude sur les UTN et leur évolution dans le temps, je pense que nous serions d’accord pour les simplifier, comme le propose le ministre. En tout cas, cette étude nous aiderait à prendre une décision.
M. le président François Brottes. Le monde change, les élus aussi. Pour ma part, je pense qu’un SCoT doit être révisable régulièrement.
M. Jean-Louis Roumegas. Dans les territoires où s’applique la « loi montagne », vous essayez de distinguer entre les zones qui sont couvertes par un SCoT et les autres. Or, cette distinction ne devrait pas exister : la loi ALUR prévoit que tout le territoire doit être couvert par des SCoT. Il convient de tenir compte de la situation spécifique des zones de montagne pour lesquelles ont été prévues ces UTN et des concertations supplémentaires, alors que vos propositions tendent à replacer ces territoires dans le lot commun. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
M. le président François Brottes. Les UTN ne concernent pas que la montagne.
M. Gérard Cherpion. En tant que président du comité de massif des Vosges, je pense que, si la procédure UTN a été utile lors de sa création, les choses ont beaucoup évolué. Les sujets traités dans ce cadre sont d’une très faible importance, pour ne pas dire marginaux, et ils font le plus souvent l’objet d’un consensus. Nous pouvons certainement simplifier le système en nous appuyant sur les SCoT et l’évolution territoriale en cours.
La Commission rejette les amendements SPE1250 et SPE1380.
Puis elle examine l’amendement SPE1185 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. J’ai déjà défendu cet amendement.
M. le ministre. Mon intervention précédente visait à répondre à cette préoccupation à laquelle je suis sensible, en évoquant les avis conformes du préfet. Dans l’étude d’impact, une vingtaine de pages montrent la grande difficulté que posent ces projets. Les grands projets – pour lesquels la procédure UTN était sans doute pertinente, parce que très contraignante – sont mûrs, arrivés à la phase de gestion. Pour de nombreux petits projets – campings et autres –, auxquels elles s’appliquent désormais – et qu’elles bloquent –, les dispositions UTN sont considérées comme excessivement lourdes.
Il n’y a pas de problème dans les territoires couverts par les SCoT, car l’avis conforme du préfet permet de s’assurer que les exigences proportionnées UTN sont bien reprises. Le Gouvernement souhaite que ces SCoT gagnent du terrain. Dans les territoires qui ne sont pas couverts par les SCoT, il y aurait finalement deux approches : la vôtre consiste à faire cohabiter deux systèmes et à garder les dispositions UTN, qui demeurent un peu disproportionnées pour les petits projets ; celle que je vous propose revient à conserver ce qui est proportionné dans les dispositions actuelles UTN pour les intégrer à la procédure que nous allons créer, suivant l’avis conforme du préfet. Je peux m’engager à travailler dans cette direction : garder ce qui est proportionné dans la procédure UTN tout en sortant de blocages manifestes. En dissipant tout malentendu, notre débat a été très utile. L’esprit de votre amendement est satisfait par notre démarche, et je vous invite à le retirer.
Mme Bernadette Laclais. Je le retire d’autant plus volontiers que sa rédaction laisse à désirer, puisque le système prévu s’appliquerait dans l’attente que tous les territoires soient couverts par des SCoT. Je note surtout votre volonté de travailler avec les personnes qui sont impliquées dans les UTN, car il est nécessaire d’associer les acteurs de la montagne. Cette procédure a eu le mérite de réunir autour de la table tout le monde socioprofessionnel, associations et porteurs de projet. Il faut garder cet esprit et consulter les élus de la montagne et l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM).
L’amendement SPE1185 est retiré.
La commission examine les amendements identiques SPE243 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE1423 de M. Denis Baupin.
M. Philippe Vitel. Cet amendement, homologue de celui que j’ai présenté sur les alinéas 2 à 7, tend à supprimer les alinéas 8 à 12. Il traduit le même sentiment de frustration face au recours à une ordonnance qui affaiblit le rôle du Parlement. Mais, à la réflexion, la procédure par ordonnance n’est-elle pas plutôt une façon d’intégrer le Parlement dans le réglementaire ou de l’exclure du législatif ? Compte tenu des explications du ministre et de nos débats de ce matin, je serais désormais plus enclin à retenir l’option positive et à y voir une forme d’intégration du Parlement dans un domaine réglementaire dont il est d’habitude totalement exclu. C’est pourquoi je retire l’amendement.
L’amendement SPE243 est retiré.
M. Jean-Louis Roumegas. Les alinéas 8 et 9 proposent de simplifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets. C’est dire la largeur et le flou de l’habilitation demandée à notre assemblée. Qu’est-ce qui va être simplifié ? Les procédures d’enquête publique, les études d’impact, les règles du débat public lui-même ? Certains peuvent considérer que le Parlement est davantage associé ; pour ma part, je n’en suis pas convaincu. Du reste, l’alinéa 12 – « En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE » – donne, au contraire, l’impression que la procédure qui nous est proposée ignore totalement l’importance du droit de l’environnement dans sa démarche même. Les alinéas 8 à 12 doivent donc être supprimés.
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Monsieur Vitel, je vous remercie de vous montrer sensible à l’esprit qui règne dans nos débats depuis ce matin. Je veux ici vous conforter dans votre opinion tout en répondant aux préoccupations de M. Roumegas.
Ces dispositions visent à mieux coordonner les études d’impact environnementales existantes. En tant qu’élus locaux, vous savez d’expérience la complexité de l’articulation de ces études d’impact environnementales : les mêmes études ou des études redondantes sont parfois réalisées à chaque niveau et pour chaque document d’urbanisme. Quant aux directives visées dans l’alinéa que vous avez mentionné, elles concernent précisément les études d’impact environnementales.
L’objectif de ce texte est de permettre une meilleure coordination de ces études sans en diminuer le fond ou l’ambition. Comme nous l’avons vu avec l’articulation entre les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les unités touristiques nouvelles (UTN), il s’agit de rendre le dispositif plus simple et plus efficace. C’est pourquoi je vous invite, vous aussi, à retirer votre amendement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis ravi que Philippe Vitel ait été convaincu par nos engagements et ceux du Gouvernement, que M. le ministre vient de réaffirmer avec force. Ce sont des alinéas de bon sens. Ainsi, le b du 2° vise à améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales, notamment pour les programmes d’intérêt local (PIL) qui avaient d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’un gouvernement précédent et que nous avons pu soutenir.
Alors que certaines opérations d’ampleur nécessitent jusqu’à trois enquêtes environnementales successives, nous voulons faire en sorte qu’il n’y ait qu’une seule enquête globale. Tant pour les décideurs publics que pour nos concitoyens, il est important d’avoir une vision globale et non pas un « saucissonnage » du projet. Quant à l’alinéa 12, il propose très classiquement de transposer par ordonnance une directive européenne.
Je voudrais donc une nouvelle fois rassurer nos collègues du groupe écologiste sur notre volonté politique, même si le principe même de l’ordonnance présente un risque et que nous devons veiller à ce que la discussion se passe de la meilleure façon.
M. Jean-Louis Roumegas. Le ministre et le rapporteur thématique ont répondu sur le b, c’est-à-dire sur l’articulation entre les évaluations environnementales sur laquelle, nous en convenons, il y a des améliorations à apporter. En revanche, le flou reste total sur le a, qui prévoit de simplifier les évaluations environnementales elles-mêmes, et sur le c. Dans quel sens voulez-vous modifier les attributions des autorités environnementales ? Vous n’avez apporté aucune réponse à cette question.
La commission rejette l’amendement SPE1423.
Puis elle examine l’amendement SPE544 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement propose d’insérer les mots : « de construction et d’aménagement » après le mot : « programmes » afin de préciser qu’il s’agit d’interventions dans les champs de la construction et de l’aménagement.
La commission adopte l’amendement SPE544.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette successivement les amendements SPE1453, SPE1454 et SPE1455 de M. Denis Baupin.
Puis elle examine l’amendement SPE1342 de M. Denis Baupin.
M. Jean-Louis Roumegas. Le Gouvernement serait-il prêt à apporter une réponse sur ce point particulier d’une question que nous avons déjà abordée à une autre occasion ?
M. le ministre. Je vais vous répondre, comme ce matin, que votre amendement est satisfait par les procédures de participation du public qui seront mises en œuvre, l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 120-1 du code de l’environnement n’ayant pas changé dans l’intervalle.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je confirme.
L’amendement SPE1342 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette l’amendement SPE1341 de M. Denis Baupin.
L’amendement SPE1340 de M. Denis Baupin est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements SPE1446 et SPE1445 de M. Denis Baupin.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE545 des rapporteurs.
Puis elle en vient à l’amendement SPE1381 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement propose de compléter l’alinéa 11 par les mots : « et de renforcer leur indépendance ».
M. le ministre. Il me semble que cet objectif est rempli par la rédaction actuelle de l’alinéa 12. Le Gouvernement partage l’objectif d’accroître l’autonomie fonctionnelle et organisationnelle des autorités environnementales exerçant notamment à l’échelon local, conformément au principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Pour autant, il n’entend pas créer une autorité indépendante.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’indépendance est bien évidemment garantie par les textes, mais la nature indépendante de l’autorité ferait prendre un risque à la légitimité de la décision de l’exécutif comme du législatif.
Mme Michèle Bonneton. L’indépendance doit s’entendre par rapport au maître d’ouvrage et à l’autorité décisionnaire, de façon à permettre la transparence nécessaire à tout débat public.
La commission rejette l’amendement SPE1381.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE546 des rapporteurs.
Puis elle examine les amendements identiques SPE244 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE1424 de M. Denis Baupin, ainsi que l’amendement SPE1560 du Gouvernement.
M. Philippe Vitel. L’amendement SPE244 est dans le même esprit que de deux précédents amendements. J’entends ce que disent nos collègues du groupe écologiste mais je crois, du fond du cœur, que la simplification est compatible avec le respect de l’environnement. C’est notre challenge et notre devoir. Que ce soit sous cette législature ou sous la précédente, nous avons tois montré notre attachement au développement durable et au respect de la nature et de l’environnement, au point de l’inscrire dans la Constitution. Je fais confiance au ministre pour qu’il aille au bout de ses intentions et de ce qu’il a écrit dans ce courrier. Je retire cet amendement.
M. Jean-Louis Roumegas. En principe, vous avez raison, la simplification n’est pas forcément synonyme de baisse d’exigence en matière d’environnement. Cependant, nous ne sommes pas encore persuadés que l’objectif du Gouvernement soit uniquement la simplification, car de nombreux contentieux sont en cours. Je ne peux que souligner le flou des objectifs en termes de révision de la participation du public à toutes les procédures environnementales en général.
J’insiste aussi sur le caractère contradictoire de cet article avec les déclarations du Président de la République lors de la conférence environnementale : il nous a promis une écologie citoyenne et a engagé une réflexion censée aboutir à une réforme des règles de participation. Il s’agit précisément d’éviter les conflits par défaut de participation en amont. Nous ne comprenons pas : d’un côté, on s’engage dans une réflexion qui devrait aboutir en juin et, de l’autre, on demande une habilitation pour procéder par ordonnance à cette simplification dès maintenant. Cela ne nous semble pas très clair.
M. le ministre. Je remercie une nouvelle fois M. Vitel de sa confiance et j’y vois le résultat concret des discussions que nous avons depuis ce matin. Monsieur Roumegas, je comprends que vous soyez gêné par la rédaction initialement proposée par le Gouvernement des alinéas visés par votre amendement de suppression.
Sensible à ce point, le Gouvernement a déposé l’amendement SPE1560, que je vais vous présenter sans attendre. La formulation initiale présentait effectivement quelques ambiguïtés. Ensuite, vous l’avez relevé, le Président de la République a pris des engagements lors de la conférence environnementale du 27 novembre. Le Gouvernement souhaite en tirer toutes les conclusions, en reprenant la philosophie et parfois même les termes du Président de la République. C’est pourquoi nous allons vous proposer de rédiger ainsi le 3° de l’article 28 : « Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée. »
Le fait de « mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles » est une acception large, qui couvre en particulier la Charte de l’environnement, à laquelle nous avons fait plusieurs fois référence ce matin, et qui fixe bien le cadre dans lequel nous serions habilités à prendre ces ordonnances.
À travers cette demande d’habilitation, le Gouvernement souhaite rendre ces procédures à la fois plus démocratiques et plus efficaces. Avec cet amendement, nous répondons à votre demande de mettre en cohérence le texte avec les déclarations du Président de la République. Dans la mesure où votre amendement sera de facto satisfait par celui du Gouvernement, je vous invite à le retirer.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis très favorable à cet amendement du Gouvernement. L’inquiétude exprimée par Jean-Louis Roumegas est parfaitement légitime, surtout dans le contexte actuel où la réforme du débat public, sous toutes ses formes, est nécessaire : l’enquête publique traditionnelle n’apporte par les résultats escomptés en matière de transparence et d’effectivité de la participation.
Le texte initial n’était pas en contradiction avec les propos du Président de la République, mais cet amendement précise très clairement l’objectif : renforcer le débat public sous toutes ces formes, y compris les plus modernes, afin d’associer les femmes et les hommes qui sont concernés par un sujet. Cela va dans le bon sens. Sur la base de cet amendement, nous pouvons accorder notre confiance au Gouvernement, même si nous veillerons à ce qu’il atteigne ses objectifs, que ce soit pendant le débat qui devra aboutir d’ici à juin ou lors de la mise en œuvre par ordonnance de ses décisions.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement gouvernemental est intéressant du point de vue des idées générales et manifeste beaucoup de bonnes intentions, mais il ne contient rien sur les moyens mis en œuvre. Sera-t-il possible de faire appel à des experts indépendants ? La participation du public interviendra-t-elle à un moment précis ou tout au long de l’élaboration des projets ? On reste malheureusement dans le domaine des généralités.
M. le président François Brottes. Aller plus loin dans le détail serait une forme d’injonction au Gouvernement. Les réponses précises que vous attendez ne peuvent pas être dans l’habilitation mais dans l’ordonnance elle-même. Si tout est écrit dans l’habilitation, il ne peut plus y avoir de méthode de concertation pour élaborer ensuite le détail de l’ordonnance. Je rappelle que nous ne parlons pas aujourd’hui de l’ordonnance, mais du texte d’habilitation.
Mme Michèle Bonneton. C’est bien l’une des limites de l’exercice qui consiste à légiférer par ordonnance.
M. Arnaud Leroy. Ce matin, j’avais proposé une méthode qui pourrait de nouveau être utile ici, afin de lever les ambiguïtés et de rassurer nos collègues écologistes. Pour pouvoir avancer, il faut que nous nous fassions mutuellement confiance. Comme le rapporteur thématique l’a rappelé ce matin, nous aurons des moyens pour peser ; nous aurons aussi l’occasion de manifester notre désaccord au moment des discussions dans l’hémicycle sur la ratification de la loi d’habilitation. Il y a une méthodologie, ce ne sont pas des mots creux, et les engagements du ministre figurent dans les comptes rendus.
L’amendement SPE244 est retiré.
La commission rejette l’amendement SPE1424.
Puis elle adopte l’amendement SPE1560 du Gouvernement.
En conséquence, les amendements SPE929, SPE1382, SPE547, SPE1452, SPE1345, SPE1444, SPE1344, SPE1343 et SPE951 tombent.
La commission adopte l’amendement de forme SPE549 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1451 rectifié de M. Denis Baupin.
Mme Michèle Bonneton. Il est défendu.
Suivant l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur thématique, la commission rejette l’amendement SPE1451 rectifié.
L’amendement SPE1348 rectifié de M. Denis Baupin est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements SPE1347 rectifié et SPE1346 rectifié de M. Denis Baupin.
Puis elle examine l’amendement SPE1442 de M. Denis Baupin.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement propose de préciser la nécessité d’une information complète des participants au débat public en présentant non seulement le projet soumis au débat, mais également les alternatives existantes.
C’est un point souvent évoqué par les défenseurs de l’environnement mais aussi dans la jurisprudence et dans les enquêtes publiques. Les commissaires enquêteurs donnent souvent des avis défavorables quand les alternatives ne sont pas présentées de façon équivalente au projet. Cette mesure ferait gagner du temps.
M. le ministre. En ce qui concerne la présentation des projets au public, il me semble que la demande est satisfaite : il n’existe aucun dispositif de participation qui ne prévoie que le projet ne soit transmis au public.
S’agissant des solutions alternatives, cet amendement sera satisfait par le b du 3° du I, et non par le c. Le c vise en effet le droit des enquêtes publiques qui interviennent en fin de processus décisionnel, à un stade où le public doit participer au sujet des modalités de mise en œuvre. Les discussions sur les solutions alternatives à un projet donné doivent se tenir en amont des procédures, à un stade où toutes les options sont encore possibles – y compris l’« option zéro ».
De plus, certains projets comme les lignes de transport d’électricité ne disposent que d’alternatives limitées et, dans certains cas, la liberté d’entreprendre et la maîtrise foncière sont difficilement conciliables avec l’examen exhaustif de toutes les solutions alternatives.
L’examen des solutions alternatives doit être développé chaque fois qu’il est possible et pertinent. L’objectif est bien de le faire, mais au bon moment de la procédure. Il me semble que la rédaction du b du 3° du I couvre le point que vous cherchez à mettre en œuvre. En tout cas, l’intention du Gouvernement est de prendre en compte les solutions alternatives à ce stade. Considérant que votre amendement est satisfait, je vous invite donc à le retirer.
M. Jean-Louis Roumegas. Après relecture de l’alinéa en question, je trouve que ce n’est pas du tout explicite. À notre sens, les alternatives – quand elles existent – doivent être présentées au public au cours de la phase de concertation, mais aussi dans les dossiers d’enquête publique. Dans les cas auxquels je faisais allusion, les commissaires enquêteurs signalent leur absence du dossier d’enquête publique, c’est-à-dire quand le choix d’une solution a déjà été fait. Il faut qu’elles soient présentes à tous les niveaux, y compris au stade de l’enquête publique.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Si la démarche est bonne, saine et nécessaire à la qualité du débat public, la formalisation proposée va trop loin : elle exposerait à la multiplication de contentieux, occasionnerait des coûts et des délais supplémentaires. Il sera en effet toujours possible à un requérant, éventuellement de mauvaise foi, de prétendre que telle ou telle option n’a pas été suffisamment étudiée ou qu’elle a été indûment écartée. En retenant une définition aussi large, nous prendrions le risque qu’il y ait toujours une alternative à celles qui seraient présentées. Il faut faire en sorte que les alternatives – qui sont une base de travail avant les décisions – soient présentées le plus largement possible, mais votre formulation nous exposerait à un risque juridique. Sachant que le nombre de recours est très significatif, il faut garder l’esprit de votre proposition, ne pas la retenir sous cette forme et veiller à ce que le Gouvernement intègre bien votre objectif.
M. Jean-Yves Caullet. Une exigence d’exhaustivité – impossible à satisfaire – fragiliserait en effet la procédure. On ne saurait imposer le même degré de précision pour l’exposé des alternatives que pour le projet lui-même, mais cela n’enlève rien à la nécessité de les présenter au public en amont – et non lorsque le projet est déjà bouclé.
M. Jean-Louis Roumegas. À titre d’exemple, le maître d’ouvrage responsable du dédoublement de l’autoroute au niveau de Montpellier avait été renvoyé à ses études parce qu’il n’avait pas présenté d’alternatives jugées sérieuses. Il est vrai que l’avis défavorable unanime de la commission d’enquête n’avait pas empêché le Gouvernement de l’époque de déclarer le projet d’utilité publique...
J’entends la remarque relative au caractère exhaustif des alternatives ; peut-on s’entendre, d’ici la séance, sur une formulation telle que « les projets et le cas échéant les alternatives existantes » ?
M. le président François Brottes. Vous pouvez toujours essayer...
La commission rejette l’amendement SPE1442.
Elle est saisie de l’amendement SPE1443 de M. Denis Baupin.
M. le ministre. Défavorable. Cet amendement est satisfait par le même article du code de l’environnement, qui prévoit le recours aux nouvelles technologies pour les consultations.
L’amendement SPE1443 est retiré.
La commission en vient à l’amendement SPE1383 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement vise à mettre l’alinéa 16 de l’article 28 en conformité avec la convention d’Aarhus – peu connue, mais ratifiée par la France –, qui prévoit la participation du public à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement.
M. le ministre. Défavorable. Le Gouvernement partage les objectifs de la convention d’Aarhus, mais le c du 3° du I ici visé l’autorise uniquement à améliorer par ordonnances le droit des enquêtes publiques. Les objectifs de l’amendement seront en revanche atteints aux termes du b du 3e du I, qui permettra de consulter le public sur l’opportunité d’un projet – et les solutions alternatives – à un stade où il est encore possible de le remettre en cause. Cette disposition fait suite aux propos du Président de la République lors de la conférence environnementale : « Un mauvais projet doit être arrêté rapidement, sans qu’il puisse durer inutilement et provoquer. »
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit d’un amendement d’appel sur un sujet important ; la réponse du Gouvernement montre qu’il a été entendu.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous proposons de préciser que la participation du public doit commencer au début de la procédure, le plus en amont possible. Or, sur ce point, le b du 3e du I – même modifié par l’amendement du Gouvernement – ne fournit aucune garantie. Pourtant plus on associe le public tôt, plus on gagne du temps ensuite.
M. le président François Brottes. Même pour les projets d’éoliennes...
M. Arnaud Leroy. Monsieur Roumegas, l’article 7 de la Charte de l’environnement, dont il a été question ce matin, ainsi que la loi de décembre 2012 qui en a découlé portent sur la transposition en droit interne de la convention d’Aarhus. Ces sujets sont donc bien pris en compte.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Dans notre démocratie, la participation du public commence au moment des élections municipales !
La commission rejette l’amendement SPE1383.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, elle rejette l’amendement SPE1441 de M. Denis Baupin.
La commission adopte l’amendement de clarification SPE553 des rapporteurs.
Elle est saisie de l’amendement SPE1167 de M. Francis Vercamer.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement tend à simplifier les procédures lorsqu’un projet nécessite plusieurs enquêtes publiques, afin de regrouper celles-ci au lieu de les juxtaposer.
M. le ministre. Votre amendement est satisfait.
L’amendement SPE1167 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette successivement les amendements SPE1450, SPE1351, SPE1439 et SPE1350 de M. Denis Baupin.
L’amendement SPE1349 de M. Denis Baupin est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette l’amendement SPE1440 de M. Denis Baupin.
Puis elle examine l’amendement SPE1384 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous proposons, sans pour autant en généraliser le principe, de permettre une contre-expertise dans des dossiers complexes qui font face à des oppositions fortes et à des propositions alternatives. Dans le cas du barrage de Sivens, par exemple, cette possibilité aurait permis au projet d’évoluer en amont, évitant ainsi les crispations.
M. le ministre. Les travaux sur la démocratie participative qui s’engagent aujourd’hui dans le cadre du Conseil national de la transition écologique (CNTE), conformément à la décision du Président de la République annoncée lors de la dernière conférence environnementale, devraient permettre de déterminer dans quelles conditions l’on peut et l’on doit faire appel à une contre-expertise, parfois effectivement très utile. Cette question a été longuement discutée dans le cadre du groupe de travail « Participation du public » issu du chantier de la modernisation du droit de l’environnement, mais à ce stade, le débat n’a pas permis de dégager un consensus. Au nom des principes mêmes de la démocratie participative, vous devriez donc retirer votre amendement ; le Gouvernement est sensible au problème que vous soulevez et en tiendra compte.
M. Jean-Louis Roumegas. Le principe et l’intérêt de la contre-expertise sont admis par tous, seules les conditions et les modalités de sa mise en œuvre font l’objet de désaccords. Or, l’amendement n’énonce justement qu’un principe : attention donc, monsieur le ministre, à ne pas passer de la philosophie au sophisme...
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Défavorable. Rien n’empêche aujourd’hui une collectivité territoriale ou un établissement public de demander une tierce expertise ; il n’est donc pas nécessaire d’en faire une déclaration de principe. Si l’on adoptait cet amendement, se poserait la question de savoir comment l’instance compétente procédera au choix de la contre-expertise, ce problème juridique risquant de complexifier, d’allonger et de rendre plus chère une procédure actuellement simple.
La commission rejette l’amendement SPE1384.
Elle étudie l’amendement SPE1385 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à instaurer un système d’agrément des personnes chargées des évaluations environnementales. D’une part, ce sont les porteurs de projets qui choisissent et rémunèrent les bureaux d’études, ce qui rend l’indépendance des conclusions incertaine ; d’autre part, la qualité du travail est parfois insuffisante. Ces deux éléments sont sources de contentieux qui retardent l’élaboration des projets. Tout le monde gagnerait à ce que les personnes en charge des évaluations environnementales aient des formations sérieuses et de l’expérience.
M. le ministre. Madame Bonneton, monsieur Roumegas, je crois avoir évité le sophisme ; j’ai surtout fait preuve de stoïcisme depuis ce matin !
La qualité des études d’impact environnementales et l’idée d’un éventuel agrément des bureaux d’étude constituent un vrai sujet de préoccupation qui a fait l’objet d’un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Les travaux conduits dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement l’ont également abordé. Dans le compte rendu de la séance du CNTE du 6 janvier 2014, le président du groupe de travail concerné estime qu’un agrément ne semble pas à ce stade opportun et qu’il serait plus approprié d’instaurer une charte permettant de garantir les compétences et l’objectivité des études environnementales. En outre – ce qui montre la cohérence de la démarche du Gouvernement – la modification apportée à la directive 2014/52/UE relative aux études d’impact impose désormais aux maîtres d’ouvrage de s’assurer que « le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est préparé par des experts compétents ». En somme, il s’agit d’un sujet bien analysé, auquel les dernières modifications législatives et les transpositions en cours ont imprimé des avancées significatives. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement soulève une bonne question, mais il faudrait préciser quelle instance délivrerait cet agrément, selon quelles modalités, sur quelle base et avec quel coût. S’il était retiré et réécrit, je serais prêt à le défendre en séance publique.
M. Jean-Yves Caullet. N’oublions pas la question de la déontologie et des conflits d’intérêts : les experts sur les sujets pointus étant rares, ils se retrouvent souvent à conseiller différents acteurs, y compris en cas de contentieux. Il faudrait donc élargir le champ de la réflexion pour interdire – à l’instar de ce qui se pratique chez les avocats – d’expertiser un projet si l’on est par ailleurs lié à l’une des parties. Cela donnerait de la crédibilité à l’expertise et de l’assurance aux porteurs de projets comme à ceux qui viendraient les contester.
Mme Michèle Bonneton. Je remercie le ministre et le rapporteur thématique pour leur esprit d’ouverture. Nous proposerons un nouvel amendement en séance.
L’amendement SPE1385 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques SPE245 de M. Jean-Frédéric Poisson, SPE1251 de M. Joël Giraud et SPE1425 de M. Denis Baupin.
M. Philippe Vitel. À vouloir toujours mieux faire, on complique les textes jusqu’à les rendre incompréhensibles, ce qui nous oblige ensuite à les simplifier. À l’avenir, efforçons-nous de les rédiger d’emblée de la manière la plus simple et la plus claire possible. L’opinion publique nous en saura gré. En attendant, je retire l’amendement SPE245.
M. Alain Tourret. L’amendement SPE1251 est défendu.
M. Jean-Louis Roumegas. Après avoir restreint les possibilités d’action des défenseurs de l’environnement, le Gouvernement, tout à sa volonté d’aller plus vite, souhaite désormais accélérer les procédures en cas de contentieux. La méthode de l’ordonnance ne nous paraît pas appropriée : les mesures envisagées – dont la capacité à permettre une meilleure préservation de l’environnement nous laisse sceptiques – méritent un débat parlementaire. D’où la suppression proposée de l’alinéa 17.
M. le ministre. Défavorable. L’alinéa 17 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative qui reprendront les recommandations formulées par le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement portant sur le contentieux administratif en matière environnementale. La lettre de mission adressée à sa présidente – Mme Delphine Hédary, conseillère d’État – lui demande de proposer des mesures qui, dans le respect de l’accès au juge et tout en assurant un haut niveau de protection de l’environnement, seront de nature à renforcer la lisibilité et la cohérence des règles, et à accélérer les procédures contentieuses. Il faut en particulier harmoniser les délais de recours, aujourd’hui extrêmement hétérogènes, et mieux articuler les différentes procédures entre elles. L’objectif du Gouvernement, constamment réitéré, est d’accélérer et de simplifier sans remettre en cause la priorité environnementale. Je prends devant vous l’engagement solennel de transcrire, dans les ordonnances, les propositions du groupe de travail de Mme Hédary. Dommage qu’après tant d’heures de débat, vous ne nous fassiez toujours pas confiance !
Mme Michèle Bonneton. La confiance se construit, monsieur le ministre. Vous nous avez donné des assurances : traduisez-les dans les actes en les gravant dans la loi !
N’ayant pas été élu local, vous ignorez peut-être que les responsables sur le terrain sont encore trop nombreux à ne pas avoir compris que l’on pouvait à la fois protéger l’environnement, développer l’économie et créer de nouveaux emplois. Ils rendent les exigences environnementales responsables de beaucoup de maux, alors que le plus souvent, la protection de l’environnement représente la solution et non le problème.
L’amendement SPE245 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements SPE1251 et SPE1425.
L’amendement SPE1449 rectifié de M. Denis Baupin est retiré.
La commission rejette successivement les amendements SPE1448 rectifié et SPE1437 de M. Denis Baupin.
Puis elle étudie l’amendement SPE1438 de M. Denis Baupin.
M. Jean-Louis Roumegas. Votre texte, monsieur le ministre, se concentre sur les bénéficiaires des projets, qui pourraient être lésés par un abus du recours au droit de l’environnement. Nous proposons, pour notre part, d’y réintroduire les victimes des atteintes à l’environnement.
M. le ministre. On ne peut pas s’opposer à l’idée de prendre en compte les victimes, mais leurs droits sont déjà couverts par d’autres dispositions : il serait donc superfétatoire de les mentionner ici. L’alinéa 17 cherche à combler le besoin de sécurité juridique en matière de contentieux, exprimé par les porteurs de projets, mais nous n’avons pas l’intention de revenir sur le droit des tiers et des victimes potentielles. L’objectif prioritaire de préservation de l’environnement – expressément mentionné par l’habilitation – permet de faire obstacle à toute mesure qui remettrait en cause le principe du plein accès au juge en matière environnementale. Consacré par le droit européen et international, ce principe à valeur constitutionnelle est conforté par les premières conclusions du groupe de travail présidé par Mme Hédary, notamment pour les associations environnementales. Votre amendement est donc satisfait.
M. Jean-Louis Roumegas. Je comprends ces arguments de droit ; nous voulions simplement souligner que votre projet de loi se concentrait surtout sur les porteurs de projets.
L’amendement SPE1438 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement SPE1386 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Si le ministre veut suspendre les recours et les actions des défenseurs de l’environnement, nous souhaitons pour notre part – conformément aux annonces du Président de la République – renforcer les possibilités de suspension des travaux en cas de doute sur leur légalité. Dans les cas simples, il faut aller vite ; mais parfois, il faut prendre le temps nécessaire, voire suspendre les projets de façon à ne pas atteindre un point de non-retour où les travaux seront effectués – d’autant qu’une disposition du projet de loi consacrera l’impossibilité de démolir les constructions illégales !
M. le président François Brottes. Ce n’est pas ce qui a été évoqué ce matin ! Ne laissons pas dire que ce texte entérine l’impossibilité de démolir ; c’est le positionnement du tribunal qui doit faire appliquer sa décision.
M. le ministre. Merci, monsieur le président, d’avoir restauré l’exactitude de notre débat de ce matin.
L’habilitation permet déjà au Gouvernement de prendre des dispositions relatives à la suspension des décisions – sujet traité par ailleurs dans le cadre du groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement, consacré au contentieux administratif en matière environnementale. Votre préoccupation est donc prise en compte, conformément aux engagements du Président de la République. Par ailleurs, le droit commun du référé suspension ne sera pas modifié ; les procédures ne pourront être revisitées, de manière encadrée, qu’en cas d’annulation ou de refus. Avis défavorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Défavorable. Bien évidemment, la procédure de référé devant le juge administratif permettra toujours la suspension ou des mesures conservatoires – solutions provisoires assurément nécessaires. À l’inverse, l’amendement proposé fait courir le risque de voir se multiplier les contentieux, notamment dans le domaine de la transition énergétique qui nous tient tous à cœur.
M. Jean-Louis Roumegas. Contrairement à ce que vous proclamez, votre conception de la simplification est à sens unique : c’est toujours pour limiter les recours contre les projets, jamais pour préserver l’environnement. Suivant les propos du Président de la République lors de la conférence environnementale, nous souhaitons une simplification dans les deux sens. Certes, il faut parfois pouvoir aller vite et limiter les recours abusifs ; mais inversement, dans certains cas, il faut renforcer la protection de l’environnement. Ainsi, s’il ne faut pas l’utiliser en permanence, la suspension des travaux est-elle parfois nécessaire pour éviter les contentieux ultérieurs.
M. Olivier Carré. Pour avoir lancé, en une dizaine d’années, une quinzaine de zones d’aménagement concerté (ZAC) sur mon territoire, j’ai mesuré à quel point les considérations environnementales viennent, au sens physique du terme, alourdir les procédures. Les éléments relatifs à l’environnement représentent entre les deux tiers et les trois quarts des analyses à effectuer en vue de la déclaration d’utilité publique d’une opération. On s’intéresse à l’impact du projet sur la qualité de l’air, l’environnement sonore, et jusqu’à la biodiversité – qui impose désormais d’attendre quatre saisons pour confirmer l’innocuité d’une construction. Les réponses à toutes ces questions pertinentes occupent une bonne partie des 1 500 à 2 000 pages rédigées par nos services et tous les bureaux d’étude auxquels nous faisons appel pour lancer une opération de logement. En cas de contestation et de recours, les points soulevés par les associations de requérants ont pour la plupart été déjà analysés et la réponse scientifique a déjà été apportée – une réponse d’ailleurs souvent favorable au projet, ce qui peut déplaire aux requérants. Tous ces éléments finissent par être pesants ; dès lors que la procédure de référé et le recours au juge administratif sont garantis, le texte va dans le bon sens.
M. le président François Brottes. Chacun pourrait y aller de son histoire... J’ai souvenir du projet d’une aire de grand passage pour les gens du voyage où l’on a eu beau jeu d’invoquer l’environnement pour en empêcher la réalisation !
La commission rejette l’amendement SPE1386.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, elle rejette l’amendement SPE1447 de M. Denis Baupin.
Les amendements SPE1354, SPE1353 et SPE1352 de M. Denis Baupin sont retirés.
M. Jean-Louis Roumegas. Voyez que nous ne voulons pas faire de l’obstruction !
M. le président François Brottes. Personne n’a jamais pensé cela, monsieur Roumegas. La confrontation n’est pas l’obstruction.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE556 et SPE560 des rapporteurs.
Elle est saisie de l’amendement SPE1575 rectifié des rapporteurs.
M. le rapporteur général. Il s’agit d’associer dans les meilleures conditions le CNTE à la réflexion du Gouvernement.
La commission adopte l’amendement SPE1575 rect.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe UMP votera l’article 28.
M. Jean-Louis Roumegas. Le groupe écologiste votera contre.
La commission adopte l’article 28 modifié.
*
* *
Article 29
(art. L. 480-13 du code de l’urbanisme)
Sécurisation des projets de construction
Le présent article vise à sécuriser les projets de construction, afin de limiter l’engagement d’une démolition aux seules situations où une telle démolition apparaît véritablement indispensable (constructions réalisées sans permis et dans des zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales).
I. LE DROIT EXISTANT
En droit de l’urbanisme, le principe est qu’une autorisation de construire est immédiatement exécutoire. Mais, dans la pratique, cette autorisation est rarement mise en œuvre lorsqu’elle est contestée, l’existence d’un recours en annulation faisant en effet craindre une démolition ultérieure à l’ensemble des acteurs de la construction (banques, notaires, acheteurs). Le contentieux contre les autorisations de construire peut ainsi avoir un effet paralysant, aussi bien sur le projet d’un particulier qui désire acheter un terrain à bâtir que sur une opération immobilière de plusieurs milliers de mètres carrés de logements.
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme réglemente les conditions de l’action en démolition consécutive à l’annulation d’une autorisation de construire par le juge administratif. Il prévoit ainsi que, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
– le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit alors être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
– le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
L’annulation par le juge administratif n’entraîne pas systématiquement le prononcé de la démolition par le juge civil. La démolition étant une action en responsabilité régie par les règles du code civil, la jurisprudence exige en effet qu’elle réponde aux conditions applicables en la matière, à savoir qu’il y ait une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre les deux. Si la faute est caractérisée par la violation des règles d’urbanisme, le demandeur devra démontrer le préjudice et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice – et ce lien de causalité n’est pas systématiquement établi. Dans les faits, la jurisprudence semble d’ailleurs prendre en considération l’importance de l’infraction pour accepter la démolition.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Issue d’une des propositions du rapport confié au président Daniel Labetoulle, la nouvelle rédaction de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme proposée par le projet de loi vise à réduire le nombre de cas dans lesquels le propriétaire d’une construction sera susceptible de se voir condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique (5). Si la condition tenant à une annulation préalable du permis de construire par la juridiction administrative constitue un prérequis indispensable et est donc maintenue, celle-ci se trouve désormais complétée par une seconde condition tenant à la localisation de la construction.
En d’autres termes, le droit existant ne se trouve maintenu que pour les constructions réalisées dans certains espaces vulnérables, dont la liste est dressée de manière exhaustive et comprend :
– les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6 (lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols) ;
– la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145-5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;
– les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
– les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
– les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1.
Cette liste comprend également un ensemble de sites sensibles :
– les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ;
– les zones figurant dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code, ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ;
– les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;
– les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages.
Au titre de la préservation du patrimoine architectural et urbain, cette liste comprend enfin :
– les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
– les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;
– les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313-1 du même code.
La mesure proposée permet donc de circonscrire l’action en démolition, à la suite de l’annulation d’un permis de construire, à certaines zones à risques ou particulièrement sensibles du point de vue patrimonial ou environnemental, de façon à constituer un instrument pertinent pour lutter contre l’effet paralysant d’une action en démolition.
Les possibilités des requérants qui souhaiteraient interrompre la construction demeurent totalement préservées, puisqu’ils conservent la possibilité d’agir par la voie du référé suspension pour empêcher le chantier. Alors qu’actuellement il est rare que les constructions dont le permis est annulé soient démolies, le référé suspension constitue un instrument efficace pour éviter en amont l’apparition de constructions illégales.
Cette mesure est apparue au groupe de travail présidé par le président Labetoulle comme « de nature à remettre de l’ordre dans la chaîne des contrôles : le permis délivré par l’autorité compétente en matière d’urbanisme retrouverait, en partie au moins, son caractère exécutoire, le référé retrouverait une importance première au lieu d’être délaissé comme il l’est aujourd’hui, et l’action en démolition serait recentrée sur les cas où elle est indispensable » (op. cit., page 22). Le groupe de travail qualifie positivement mesure comme « l’une des plus fortes pour modifier durablement les comportements des acteurs ».
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a souhaité clarifier certaines formulations de cet article, qui comprend de longues énumérations parfois peu lisibles. À cette fin, elle a donc adopté un amendement de rédaction globale, substituant notamment à ces énumérations une liste nettement articulée et prévoyant que le délai d’engagement d’une action en démolition serait désormais réduit à six mois – à l’exception des zones fragiles et sensibles, pour lesquelles le délai actuel de deux ans serait maintenu.
*
* *
La commission aborde l’amendement SPE1387 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. L’article 29 remet en cause l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, modifié par une ordonnance de 2005. Aux termes des dispositions proposées, les bâtiments construits illégalement, dont le permis aura été annulé par la juridiction compétente, ne pourront plus faire l’objet de démolition sauf dans certaines zones protégées : les rives des plans d’eau, les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, le cœur des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000 et les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels. Sur une très grande partie du territoire – y compris dans les parcs naturels régionaux et les aires d’adhésion des parcs naturels nationaux –, la démolition ne sera plus possible. Dans sa rédaction actuelle, l’article fait obstacle à une action en démolition d’une construction dont le permis est annulé en raison de sa localisation dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers ou pour non-respect des distances d’éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers.
Il s’agit d’un recul important par rapport aux travaux que nous avons menés sous cette législature pour lutter notamment contre l’artificialisation des sols. Nous y voyons surtout un gage donné aux constructeurs peu soucieux de l’environnement qui bénéficient de la complicité de personnes mal informées leur délivrant des permis de construire litigieux, ensuite annulés. L’article encourage ces bâtisseurs illégaux à aller vite en besogne puisqu’une fois la construction achevée, on ne pourra plus la faire démolir ; c’est une véritable incitation à ne pas respecter le droit.
Autre perversion de cet article : puisqu’on ne pourra plus faire démolir, les auteurs des recours demanderont probablement des indemnités, comme le prévoit l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Et ils ne manqueront pas de se retourner vers les élus locaux qui ont signé le permis, générant une insécurité pour ces derniers.
Autant de raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 29.
M. le président François Brottes. Expliquée ainsi, cette disposition autorise tous les fantasmes... Mme Bonneton lit-elle le texte tel qu’il est ?
M. le ministre. Madame Bonneton, contrairement à certains de vos collègues, vous m’aviez épargné jusqu’à présent les insinuations désagréables et un tantinet déplacées ; je me sens obligé de vous donner quelques éclaircissements.
Cet article n’est le fruit ni du hasard ni du mouvement spontané des ministères compétents, mais des propositions présentées le 30 octobre dernier par le Conseil de la simplification, coprésidé par M. Laurent Grandguillaume. Il fait suite au travail mené par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État, qui s’est longuement concerté avec tous les partenaires du secteur : acteurs du logement, représentants d’élus, associations. Certes, je ne suis pas élu local, mais vous pourrez peut-être corroborer les conclusions de ce groupe de travail : en matière de logement, les risques de démolition constituent aujourd’hui une épée de Damoclès excessive. La mesure proposée vise à recentrer la démolition sur les cas où elle est indispensable, à savoir les constructions sans permis et les zones protégées, le référé suspension restant par ailleurs possible dans tous les cas.
Aujourd’hui, lorsqu’on détient un permis de construire, si la décision est jugée illégale, le risque d’action en démolition peut perdurer quatre à cinq années, gelant tous les projets. Nous proposons de restreindre, dans le droit commun, ce risque aux constructions sans permis et aux zones protégées, qui continueront d’être régies par la loi actuelle ; hors de ces cas, nous rendons la règle moins pénalisante. Mais cet article, madame Bonneton, ne remet pas en cause le référé suspension des travaux, ni la possibilité de démolition sur d’autres fondements tels que le trouble du voisinage ou le droit pénal. Il s’agit d’une simplification qui préserve les intérêts essentiels des tiers, sans l’effet paralysant de la règle actuelle.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Les élus locaux de notre groupe – certains d’entre nous le sont encore, au risque de se voir reprocher de cumuler les mandats – livrent une double expérience : l’effet paralysant des actions en démolition, mais également la rareté de ces dernières, due notamment à la longueur des délais. La proposition consiste à lier la réalité de la pratique du droit avec le cadre légal.
Plus attaché à la prévention qu’à la répression, je suis convaincu que c’est dans l’anticipation que nous trouverons des solutions, le référé suspension constituant la mesure la plus efficace pour éviter ce type de désordres. Préserver le principe de la démolition dans toutes les zones à enjeu – parcs nationaux, zones inondables, etc. – me semble indispensable. Partout ailleurs, la sanction pénale – y compris indemnitaire – n’est pas non plus écartée, mais la mesure proposée évitera l’effet paralysant d’une action en démolition qui ne diminue d’ailleurs pas pour autant le nombre d’infractions que les maires constatent dans leurs communes. Cela permettra de démarrer des projets purgés des recours sérieux, sans les laisser suspendus à des recours dilatoires ou de mauvaise foi.
M. le président François Brottes. Les zones inconstructibles, où se nichent souvent les abus, font-elles partie de la liste des espaces où l’on pourra continuer à démolir ?
Mme Karine Berger. Je suis également étonnée de ne trouver dans la liste ni les zones inconstructibles, ni les parcs naturels régionaux. Nous venons d’obtenir la validation du parc régional des Baronnies et il serait troublant que ce statut n’autorise aucun recours en cas de problème. Le rapporteur thématique a raison de souligner que la démolition reste rare en pratique ; mais c’est précisément l’existence du recours juridique qui assure le respect des règles. Si l’on enlève cette possibilité, qu’est-ce qui empêchera les mauvais esprits d’aller au bout de leur démarche ou d’ignorer les pénalités ? Cet article m’étonne. En quoi simplifie-t-il les règles ? Combien de cas concrets concerne-t-il – par exemple au cours de la dernière année ? Pourquoi certaines zones ne figurent-elles pas dans la liste ? Il est en tout cas indispensable d’y inclure les zones de montagne.
M. Jean-Louis Roumegas. Je conçois l’effet pervers de la menace de démolition qui conduirait certains projets parfaitement légaux à être abandonnés – même s’il faut probablement vérifier l’importance du phénomène. La bonne solution consiste alors à simplifier et à accélérer les procédures, notamment celles d’instruction. Mais vous jetez le bébé avec l’eau du bain, remplaçant un effet pervers par un autre, plus pervers encore, puisqu’aux termes de cet article, une fois la menace de démolition levée, même des projets qui ne pouvaient pas passer l’épreuve de légalité sont encouragés à aller jusqu’au bout.
Voici l’avis du service juridique d’une fédération de défense de l’environnement, France Nature Environnement : « Cet article est un véritable scandale et doit absolument être supprimé. Le message adressé est catastrophique : “Pour construire en violant les règles d’urbanisme, privilégiez le passage en force, une fois la construction réalisée, plus personne ne pourra s’y opposer.” ; c’est tout le contraire de l’État de droit, c’est la politique du fait accompli, une stérilisation du droit d’accès à la justice, en totale contradiction avec le discours de François Hollande. ». Le remède que vous proposez est réellement pire que le mal qu’il est censé combattre.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le dispositif proposé modifie l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005, entrée en vigueur en 2007. Pour contraindre le propriétaire à la démolition – et le constructeur aux dommages et intérêts –, il faut d’abord obtenir l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. À partir de là, on dispose d’un délai de deux ans pour engager l’action en démolition. Le dispositif proposé introduit une dualité de situations qui m’apparaît complexe et anachronique : la juridiction administrative pourra toujours annuler le permis de construire pour l’ensemble des constructions jugées irrégulières, sur tous les territoires, mais la procédure en démolition – qui doit être prononcée dans le délai de deux ans par une juridiction de l’ordre judiciaire – ne pourra concerner qu’une partie seulement de ce qui aura été déclaré illégal. Quelle sera la sanction de l’annulation du permis par une juridiction administrative dès lors que l’on supprime la possibilité de rétablissement en l’état ? Pour les constructions situées en dehors des zones protégées, nous ferons face à une impossibilité manifeste de donner une suite concrète et réelle à la décision administrative d’annulation pour excès de pouvoir, ce qui la rendra totalement inefficace.
Mme Michèle Bonneton. Monsieur le président, plutôt que de fantasmes, il s’agit d’arguments ! Quant aux insinuations, ce n’est pas mon habitude, mais je présente mes excuses à ceux que j’ai pu offusquer. Certes, les démolitions sont rares, mais l’existence de cette possibilité est dissuasive et joue un rôle de prévention – principe cher aux écologistes. En encourageant la politique du fait accompli, cet article est très dommageable pour l’état d’esprit général de respect de l’État de droit, dont on ressent aujourd’hui plus que jamais le besoin.
M. Jean-Yves Caullet. Voici ce qui semble ressortir des explications apportées : pour les zones protégées – auxquelles il serait effectivement prudent d’ajouter les zones inconstructibles –, le nouveau dispositif ne changera rien. Pour les autres, si j’ai bien compris, le tribunal administratif, quand il décidera de l’illégalité du permis, pourra ou non l’assortir de mesures amenant à la démolition, mais le juge judiciaire ne pourra plus le faire pendant le délai de deux ans qui suit. Pourtant, le recours au référé reste possible... Compte tenu de la complexité du sujet, je demande une suspension de séance.
(Suspension des travaux)
M. le président François Brottes. Le rapporteur est en train de rédiger un nouvel amendement sur ce sujet. En attendant, continuons le débat sur les articles suivants.
M. Jean-Louis Roumegas. Sage décision, surtout si elle permet aux parlementaires de limiter les dégâts initialement prévus !
M. le président François Brottes. Le Parlement ne limite pas les dégâts, monsieur Roumegas, il fait son travail de proposition. J’ai toujours trouvé cette expression un peu pénible : est-ce à dire qu’il ne devrait y avoir que des décrets, des circulaires et des ordonnances ?
M. Jean-Louis Roumegas. Nous souhaiterions simplement que ce projet de loi n’existe pas et que nous travaillions normalement sur ces sujets...
Elle rejette l’amendement SPE1387 de Mme Michèle Bonneton.
Elle se saisit de l’amendement SPE1958 des rapporteurs.
M. le ministre. La discussion que nous avons eue tout à l’heure a éclairé plusieurs points et mis en lumière sinon les ambiguïtés, à tout le moins les angles morts possibles de ce texte.
Afin d’éviter toute fausse représentation, je souligne que l’article du code de l’urbanisme modifié par l’article 29 du projet de loi vise les situations dans lesquelles un permis de construire a été délivré : les situations où n’y a pas eu de permis de construire, ou bien de construction en zone non constructible, ne sont donc pas concernées.
Je reste toutefois mal à l’aise sur la question, soulevée par M. Le Bouillonnec, de l’articulation entre le juge administratif et le juge civil. Personne dans cette salle ou dans les services n’a pu m’apporter sur ce point une réponse intellectuellement satisfaisante.
Cette mesure a été suggérée par le groupe de travail présidé par M. Daniel Labetoulle. Mais je ne veux pas ici utiliser l’argument d’autorité et je ne suis pas aujourd’hui capable de reconstruire le cheminement intellectuel qui a mené à cette proposition. L’intention était de traiter certaines situations ubuesques dans lesquelles des projets durent infiniment longtemps, avec le risque d’une démolition qui n’est jamais ordonnée. Le ministère du logement donne de nombreux exemples de telles situations. De plus, les démolitions sont en réalité très rares : pour des raisons sociales, financières et autres, la décision du juge civil n’est en général pas appliquée. Notre régime juridique plonge donc de nombreux projets dans l’insécurité juridique, sans que les démolitions ordonnées soient finalement exécutées.
L’intention du groupe de travail présidé par M. Labetoulle, comme du Conseil de simplification, était donc saine. Toutefois, les points soulevés durant la discussion justifient que nous allions moins loin que ne le prévoyait le projet de loi présenté par le Gouvernement.
Les rapporteurs vont donc proposer un amendement auquel – je le dis d’ores et déjà – je suis favorable : c’est un amendement de repli, qui nous permettra d’interroger la ministre du logement, M. Labetoulle et votre collègue Grandguillaume, qui copréside le Conseil de la simplification. Nous saurons alors si les éléments qu’ils nous apporteront sont de nature à répondre à vos préoccupations légitimes ou s’ils font apparaître des dysfonctionnements juridiques.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Aux termes du a de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à démolir [une construction] du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. » L’annulation, qui ouvre le délai pendant lequel on peut démolir un bâtiment, est connue de tous ceux qui ont intérêt à agir.
Mais si le risque de démolition disparaît, le sens de la responsabilité de chacun pourrait effectivement en être altéré. Sous l’autorité de nos collègues Jean-Yves Caullet et Jean-Yves Le Bouillonnec, je vous propose donc d’aménager cette obligation de deux façons.
Avec l’amendement SPE1958, le principe du risque de condamnation à la démolition perdurera partout : l’épée de Damoclès, dont le rôle est au moins pédagogique, restera donc suspendue. Mais la durée pendant laquelle il est possible de demander une démolition sera réduite à six mois. Les projets ne seront ainsi pas menacés par des recours dilatoires. Il faudra bien sûr une décision définitive de la justice administrative pour que la démolition ait lieu.
Parallèlement, dans les zones à intérêt particulier, dont la liste est dressée par l’amendement, le principe actuel des deux années sera maintenu afin de ne faire courir aucun risque.
Ces propositions me paraissent de nature à rassurer tous les membres de la commission spéciale.
M. Jean-Louis Roumegas. Sous réserve d’expertise de la liste des zones protégées exclues du dispositif, nous sommes d’accord sur le principe. Il fallait couper court à un message qui pouvait passer pour un encouragement à l’illégalité et au passage en force.
Puisqu’il a rendu un avis favorable, je reconnais volontiers les qualités du ministre. Il pourrait d’ailleurs tirer une leçon générale de cet épisode et convenir que le recours aux ordonnances est une solution bien peu efficace : en quelques minutes, les commissaires socialistes réunis autour d’une table – et je les en remercie – ont fait un meilleur travail que certains bureaux ! Nous devrions étendre le procédé et écrire tous ensemble un projet de loi pour la croissance et l’activité durables...
M. le ministre. N’est-ce d’ailleurs pas ce que nous sommes en train de faire – travailler, coproduire, améliorer – depuis quatre jours, nonobstant quelques moments plus facétieux ?
M. Jean-Louis Roumegas. Tant bien que mal.
M. le ministre. De mieux en mieux, dirais-je plutôt !
M. Olivier Carré. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose actuellement que l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Nous ramenons ce délai à six mois, en ne le maintenant à deux ans que pour des zones spécifiques. Sans doute faudra-t-il retravailler un amendement qui durcit la situation alors que l’intention du Gouvernement était, je crois, de mieux l’encadrer.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le dispositif maintient le pouvoir du juge, pour toute construction illégale ou faisant l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir, de demander la démolition partout, toutes zones confondues. C’est l’exécution qui est encadrée dans un délai, et celui-ci passe de deux ans à six mois. Cette proposition devra être affinée dans les prochains jours et pourra faire l’objet d’adaptations lors du débat en séance publique, y compris en ce qui concerne la liste des zones protégées.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Aux termes de l’article L. 480-13 issu de l’ordonnance de 2005, « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. » Sauf erreur de ma part, l’action en démolition est celle qui est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire, puisqu’on la conditionne à une décision définitive du juge administratif pour excès de pouvoir.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je partage cette analyse : il s’agit bien de l’action en démolition et non de l’action de démolition.
M. le président François Brottes. Cet amendement – nous en sommes tous d’accord – fera l’objet d’améliorations en séance publique. Nous devrons aussi mesurer l’incidence des modifications sur la zone des cinquante pas géométriques outre-mer, héritage historique auquel nous avons consacré un texte de loi à part entière.
La commission adopte l’amendement SPE1958.
En conséquence, l’article 29 est ainsi rédigé et les amendements SPE577 rectifié des rapporteurs et SPE471 de Mme Laure de La Raudière tombent.
La commission étudie l’amendement SPE1492 de M. François Brottes.
M. le président François Brottes. Je voudrais à travers cet amendement poser une question au Gouvernement. En cas de désaccord sur un projet, lorsqu’on est allé au bout de l’enquête publique et que chacun campe sur ses positions, les initiateurs du projet rechignent à reprendre la procédure à zéro et ses opposants se livrent à des manœuvres dilatoires. Or, un projet contesté devrait pouvoir être reconfiguré ou ajusté sans recommencer toute la procédure. Le ministère en charge m’a répondu que cette possibilité était déjà prévue et que l’on pouvait suspendre l’enquête publique pour amender le projet et la poursuivre ensuite. Cette disposition est-elle connue au point d’éviter les crispations inutiles ? Combien de fois a-t-elle été utilisée ?
M. Olivier Carré. Le processus de l’enquête publique admet en effet des ajustements, les commissaires pouvant intervenir à tout moment de son déroulement. Sans cette possibilité, l’enquête est dénaturée ; elle n’a de sens que si elle bénéficie d’un minimum de souplesse – permise par les textes et en général autorisée par les commissaires sous la responsabilité du juge du tribunal administratif. Le dispositif est globalement bon ; pourtant, lorsque le projet définitif est présenté à l’État, il arrive qu’un groupe ultra minoritaire refuse de reconnaître ce résultat et multiplie les recours, rendant nécessaire l’intervention du juge. Ce comportement représente une forme de déni de démocratie.
M. le président François Brottes. Tout est dans la formule « un minimum de souplesse ». Je voudrais comprendre combien de fois ce dispositif a permis à des projets d’être significativement modifiés. En effet, cela permet de dédramatiser la concertation dont l’intérêt n’est pas de dire si l’on est pour ou contre, mais de faire évoluer des projets.
M. le ministre. Je vous ferai parvenir la réponse du ministère compétent avant le débat en séance publique.
L’amendement SPE1492 est retiré.
*
* *
Article 30
(art. L. 431-3 du code de l’urbanisme et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977)
Harmonisation des règles de recours à un architecte
pour les exploitations agricoles
I. L’ÉTAT DU DROIT
Depuis la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le recours à un architecte est obligatoire pour toute nouvelle construction, faisant l’objet d’un permis de construire, d’une superficie supérieure à 21 mètres carrés. Cette obligation est vérifiée au moment du dépôt de la demande de permis de construire.
La loi de 1977 et ses décrets d’application ont toutefois prévu une exception pour les constructions de faible importance, à la double condition que :
– elle soit réalisée pour le compte d’une personne physique ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique (EARL) ;
– cette construction ait une surface de plancher et une emprise au sol inférieures à un seuil de 800 m², si elle a un usage agricole, et à un seuil de 170 mètres carrés si elle a un usage autre qu’agricole.
Or, depuis trente ans, la forme sociétaire s’est beaucoup développée parmi les agriculteurs français, que ce soit sous la forme d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) à associés multiples. Il existe ainsi aujourd’hui 36 000 GAEC, couvrant 18,5 % de la surface agricole utile (SAU). Cette forme sociétaire est notamment très prisée dans le secteur de l’élevage et de l’exploitation laitière.
Une inégalité existe donc entre les agriculteurs indépendants et les autres agriculteurs quant aux coûts d’une construction sur une exploitation agricole, selon qu’ils doivent ou non recourir à un architecte.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article, en modifiant la loi sur l’architecture de 1977 et l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, généralise l’exemption de recours à un architecte, pour les constructions de faible importance, à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme juridique.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Le rapporteur thématique soutient cet effort de simplification et d’harmonisation. Il permettra à un nombre plus important d’agriculteurs de réduire les coûts d’investissement pour des constructions ou des extensions de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. Il facilitera encore davantage l’installation de jeunes agriculteurs, dans la lignée des mesures contenues dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre dernier.
Toutefois, conscient du risque que cette disposition peut avoir sur la qualité du bâti dans les zones agricoles, le rapporteur thématique considère que le seuil minimal de recours à un architecte, actuellement fixé à 800 mètres carrés par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n° 2012-677 du 7 mai 2012, pourrait, à terme, évoluer après la publication, par le Gouvernement, d’une étude permettant de déterminer la surface minimale pertinente au regard de la taille actuelle des constructions agricoles, comme cela est évoqué dans l’étude d’impact jointe au projet de loi.
*
* *
La commission adopte l’article 30 sans modification.
M. Patrick Hetzel. Je viens de consulter la base Eloi et je constate que notre rapporteur général a déposé plus d’une vingtaine d’amendements – notamment sur les articles 80 et 101 – que l’on ne peut pas encore consulter. Est-ce bien raisonnable ? Pourquoi ce dépôt massif ?
M. le rapporteur général. Ce travail va dans le sens d’une coconstruction législative toujours plus poussée, d’où la nécessité d’amendements parfois conséquents. Je ne vois pas d’objection à ce qu’ils soient rendus publics.
*
* *
Article 31
(art. L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Facilitation du déploiement de la fibre optique dans les immeubles
soumis au régime de la copropriété
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dite « loi de 1965 », a été introduit par l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite « LME », destiné à encourager le déploiement de la fibre optique dans les immeubles, tout en assurant des conditions loyales de concurrence entre les fournisseurs d’accès à très haut débit. Modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » pour de simples raisons de cohérence, l’article 24-2 prévoit, pour tout immeuble non équipé en fibre optique, l’inscription de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, des lignes à très haut débit en fibre optique permettant la desserte de tous les occupants de l’immeuble par un réseau à très haut débit ouvert au public. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, conformément au premier alinéa du I de l’article 24 de la même loi. Il s’agit d’une majorité dérogatoire par rapport à ce que prévoit le h de l’article 25, qui exige la majorité des voix de tous les copropriétaires pour « l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ». Cette dérogation est conforme à l’objectif général du dispositif : accélérer le déploiement de la fibre optique. Cette volonté a été confirmée par le Programme national très haut débit, lancé en 2010, auquel a succédé le plan « France très haut débit » en février 2013.
L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale est néanmoins conditionnée au respect, par l’opérateur, des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, également créées par l’article 109 de la LME, qui prévoient la signature d’une convention entre l’opérateur concerné et le ou les propriétaire(s) de l’immeuble ainsi qu’avec tout opérateur concurrent demandant à accéder à la fibre installée. Il s’agit ainsi d’encadrer, par une convention obligatoire, la relation entre les propriétaires (ou les bailleurs) et les opérateurs, et d’imposer le principe d’une mutualisation de la partie terminale entre opérateurs des réseaux en fibre optique déployés dans les immeubles : un opérateur ayant déjà raccordé un immeuble est tenu de partager son infrastructure avec les opérateurs concurrents qui le lui demandent, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, permettant « un raccordement effectif à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables », sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
Comme le soulignaient à l’époque les rapporteurs du projet de loi de modernisation de l’économie au Sénat (6), « ce dispositif s’inspire directement de celui créé par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin d’encourager le développement de la Télévision numérique terrestre (TNT) : l’article 9 de la loi du 5 mars 2007 a en effet créé l’article 24-1 dans la loi de 1965, qui prévoit l’inscription d’office à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute proposition commerciale d’un distributeur offrant un accès en mode numérique aux chaînes nationales en clair de la TNT par un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribuant des services de télévision. Cet article 24-1 soumet aussi l’acceptation de cette proposition à la majorité des voix des seuls copropriétaires présents ou représentés. »
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article a pour objet de conforter le dispositif de l’article 24-2 de la loi de 1965, afin d’accélérer encore le déploiement de la fibre optique et d’atteindre les objectifs du plan « France très haut débit ».
Le Plan « France très haut débit »
Les modalités du nouveau plan de déploiement du très haut débit, érigé en priorité nationale par le Président de la République, ont été précisées le 28 février 2013 par le Premier ministre à l’occasion de la présentation de la feuille de route numérique du Gouvernement.
Ce plan a pour ambition de couvrir intégralement le territoire en très haut débit d’ici 2022 – avec un objectif intermédiaire de 50 % de la population en 2017 – grâce à un investissement public et privé de 20 milliards d’euros. Si l’objectif final demeure une couverture de l’intégralité du territoire par des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH - Fiber to the Home), hors situations exceptionnelles, le plan a peu à peu évolué vers un objectif de couverture en très haut débit – débit descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s – d’ici 2022, grâce à la mobilisation de l’ensemble des technologies permettant d’atteindre du très haut débit :
– la fibre optique, un fil de verre transparent très fin qui conduit un signal lumineux codé permettant de véhiculer une large quantité d’informations. Elle a un débit d’informations nettement supérieur à celui du cuivre téléphonique classique, des câbles coaxiaux, de l’ADSL et du Wi-Fi. Par exemple, jusqu’à 100 Mbit/s constaté alors que l’ADSL offre un débit de 512 kbit/s à 20 Mbit/s ;
– la montée en débit, c’est-à-dire le remplacement systématique des câbles en cuivre situés en amont des répartiteurs (NRA) par une alimentation en fibre optique : le raccordement par un câble de cuivre limite les débits à 2 Mbit/s en moyenne, alors que les relier en fibre optique permet généralement de disposer de 10 Mbit/s ou plus. La montée en débit (FttN) est notamment pertinente dans les territoires ruraux où les habitats sont assez rapprochés, quand la technologie VDSL2 peut apporter rapidement des débits très importants sur le réseau cuivre (réseau cuivre amélioré grâce à une bande de fréquences plus large que celle de l’ADSL, permettant d’augmenter le débit entre le répartiteur et l’abonné final) ;
– les technologies hertziennes, afin d’améliorer rapidement le débit dans les zones les plus rurales et les habitats les plus isolés, où le transfert des données par des ondes radio se révèle plus efficace et largement moins coûteux. Trois types de réseaux hertziens sont encouragés dans le cadre du plan France THD :
i) la nouvelle génération de satellites ;
ii) le Wimax, une technologie hertzienne qui passe par des relais terrestres ;
iii) des solutions innovantes via les réseaux mobiles, comme la LTE (Long Term Evolution) dont la 4G fait partie.
Au 30 septembre 2014, 11,8 millions de logements sont éligibles au très haut débit (30 Mbit/s), dont 7,5 millions à 100 Mbit/s. Ainsi, un peu plus du tiers du parc total est équipé en THD :
- 8,6 millions de logements sont éligibles au câble modernisé (assimilable à un réseau de fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble - FTTB – fiber to the building), dont 5,8 millions pour un débit supérieur à 100 Mbit/s ;
- 3,6 millions via un réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH – fiber to the home), soit un débit dans tous les cas supérieur à 100 Mbit/s ;
- 2,9 millions en VDSL2, soit un débit dans tous les cas inférieur à 100 Mbit/s.
Les modalités de déploiement du très haut débit dépendent de la zone concernée :
– dans les zones dites « conventionnées », qui correspondent aux zones denses, les opérateurs privés s’engagent à déployer des réseaux de fibre optique, mutualisés, jusqu’à l’abonné pour l’ensemble des habitants d’ici 2020. Les déploiements sont effectués dans le cadre de « conventions », entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales concernées. Le déploiement du très haut débit dans ces zones, qui représentent 57 % de la population, devrait faire l’objet d’un investissement de 6 à 7 milliards d’euros ;
– dans les zones non conventionnées, les collectivités territoriales déploient des réseaux d’initiative publique (RIP). Le déploiement dans ces zones, qui représentent 43 % de la population, appelle un investissement de 13 à 14 milliards d’euros. Les collectivités territoriales sont accompagnées par l’État selon deux modalités : une enveloppe de subvention de 3,3 milliards d’euros afin de financer 50 % du coût public ; la mise à disposition d’un prêt de longue maturité (jusqu’à quarante ans) à taux très faible.
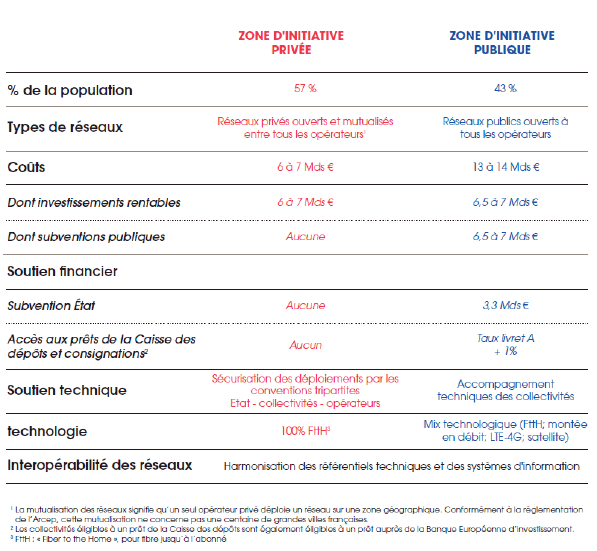
Source : Gouvernement – Plan « France très haut débit »
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/economie-numerique/tres-haut-debit/plan-france-tres-haut-debit-dp-2014-02.pdf
Alors que le plan France THD fixe des objectifs ambitieux en matière de déploiement, force est de constater que le taux de raccordement effectif des logements à la fibre optique évolue relativement lentement. Cela est notamment dû à un manque d’appétence de la part des usagers – un adhérent à une offre ADSL en zone dense ne perçoit pas forcément les gains d’un abonnement fibre optique, les débits ADSL étant de très bonne qualité en ville – mais également à des procédures d’autorisation peu efficaces. En effet, si l’article 24-2 de la loi de 1965, dans sa rédaction actuelle, a permis de faciliter l’équipement des immeubles en fibre optique, les objectifs initiaux n’ont pas été atteints, notamment car la loi n’impose qu’une réunion de l’assemblée générale des copropriétaires par an, afin de se prononcer sur le budget prévisionnel de la copropriété – article 14-1 de la loi de 1965. Dès lors, en l’absence de réunion d’une assemblée générale extraordinaire, l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition émanant d’un opérateur de raccorder un immeuble à la fibre optique peut être effective, dans le pire des cas, 364 jours après ladite proposition. Le présent article entend répondre à cette difficulté.
Le I du présent article complète d’un alinéa l’article 24-2 de la loi de 1965 afin de prévoir que l’assemblée générale des copropriétaires puisse, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. L’objectif poursuivi par cet alinéa est d’accélérer la procédure d’autorisation des travaux d’équipement des immeubles existants – la loi de modernisation de l’économie prévoyant déjà un équipement d’office des nouvelles constructions.
Le conseil syndical, dont le régime juridique est précisé par l’article 21 de la loi de 1965, est une émanation de l’assemblée générale des copropriétaires, qui assiste le syndic et contrôle sa gestion (comptabilité du syndicat, répartition des dépenses, conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et contrats, élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution). Il peut être amené à émettre des avis sur toutes les questions concernant le syndicat pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Par ailleurs, le conseil syndical doit obligatoirement être consulté par le syndic avant le vote de travaux, dès lors que le syndic passe un marché ou un contrat (par exemple avec un ascensoriste ou un chauffagiste) dont le montant dépasse une somme fixée par l’assemblée générale. Si le fonctionnement du conseil syndical est déterminé par l’assemblée générale, il a vocation à se réunir plus régulièrement ; lui confier la responsabilité de se prononcer sur l’équipement de l’immeuble en fibre optique permettra donc d’accélérer son déploiement. La dernière phrase de ce nouvel alinéa prévoir par ailleurs que l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat, et ce afin d’inviter expressément l’assemblée générale à déléguer cette compétence.
Cette disposition est directement inspirée de l’article 24-3 de la loi de 1965, créé par l’article 78 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, qui avait été introduit par amendement parlementaire (7). L’article 24-3 prévoit ainsi, afin d’assurer que l’arrêt de la diffusion analogique puisse se faire dans les mêmes conditions, que l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble recevant des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l’antenne collective de l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Surtout, son dernier alinéa prévoit également qu’à la majorité simple des copropriétaires représentés, l’assemblée générale puisse donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les modifications nécessaires. Ce mandat est exercé dans la limite d’un montant de dépenses défini par l’assemblée générale.
Les dispositions proposées par le présent article ne contiennent pas les mêmes réserves financières car, dans le cas du déploiement de la fibre optique, les frais relatifs aux travaux sont pris en charge par l’opérateur.
Le II est une disposition transitoire, ne rendant applicable le I que pour les assemblées générales de copropriétaires convoquées après la publication de la présente loi. L’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixe ainsi à vingt et un jours avant la date de la réunion le délai de convocation d’une assemblée générale de copropriétaires, sauf urgence ou si le règlement de copropriété prévoit un délai plus long.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE ET LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Le rapporteur thématique considère que de telles dispositions sont à même de faciliter le déploiement de la fibre optique, permettant ainsi d’atteindre l’objectif de couverture intégrale du territoire, dont le Président de la République a fait une priorité. Il a en effet été constaté que l’accès aux immeubles, notamment en raison du rythme de convocation des assemblées générales de copropriétaires, constituait l’une des difficultés les plus régulièrement mise en avant par les opérateurs dans le cadre du déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH). A l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels ou de précision.
*
* *
La commission adopte successivement une série d’amendements des rapporteurs : l’amendement de cohérence SPE81, l’amendement de précision SPE83 et l’amendement rédactionnel SPE77.
Puis elle adopte l’article 31 modifié.
*
* *
Article 32
Habilitation du Gouvernement à transposer deux directives européennes et à simplifier le droit applicable aux servitudes radioélectriques
Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions visant à transposer deux directives européennes et à simplifier le code des postes et des communications électroniques s’agissant des servitudes radioélectriques.
Aux termes de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement « peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si le recours aux ordonnances ne constitue jamais une décision appréciée des parlementaires, ainsi dessaisis de leur compétence, le rapporteur thématique reconnaît que lorsqu’il s’agit de transposer en droit national des dispositions d’une directive européenne, ou de procéder à un toilettage de dispositions législatives purement techniques, elles constituent un outil pertinent. Cela est particulièrement le cas en matière de transposition, lorsque le délai offert aux États membres est relativement court, et que le temps parlementaire – en raison de la « navette » – ne se révèle pas forcément adapté. Toutefois, le rapporteur thématique note que le projet de loi initial contient un très grand nombre d’articles d’habilitation, et souhaiterait que, dans la mesure du possible, certaines dispositions prévues dans de futures ordonnances puissent être intégrées au présent projet de loi par voie d’amendements.
I. LA DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2014 RELATIVE À L’HARMONISATION DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 1999/5/CE
Le 1° concerne la transposition de la directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. Elle doit être transposée au plus tard le 12 juin 2016.
Cette directive, dite RED (radio equipment directive), prend la suite de la directive RTTE (radio and terminal telecommunication equipement) sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. Comprenant cinquante-deux articles, cette directive s’applique aux équipements radioélectriques, c’est-à-dire « un produit électrique ou électronique qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage ». Sont notamment concernés les appareils tels que les téléphones mobiles, les récepteurs GALILEO/GPS ainsi que les télécommandes pour portières de voiture.
Comme le souligne l’étude d’impact, la précédente directive avait été transposée au sein des articles L. 32, L. 34-9 et L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
L’article L. 32 expose les définitions et principes appliqués par le droit des télécommunications.
L’article L. 34-9 traite des équipements radioélectriques et des terminaux. À ce titre, il rappelle le principe de liberté de leur fourniture, sous réserve d’une conformité aux « exigences essentielles » définies par le droit européen : protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et protection en termes de compatibilité électromagnétique. Par ailleurs, sans que ceci résulte d’une obligation juridique d’origine supranationale, l’article L. 34-9 prévoit, depuis le Grenelle de l’environnement, que les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie, c’est-à-dire les téléphones mobiles, ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, c’est-à-dire une oreillette ou un « kit mains libres ».
L’article L. 36-7 a trait aux compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : réception des déclarations d’établissement et d’exploitation des réseaux par les opérateurs, désignation des organismes habilités à évaluer la conformité des équipements radioélectriques et des terminaux au droit européen, contrôle du respect par les opérateurs de leurs obligations, détermination des montants des contributions au financement des obligations de service universel, définition des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs afin d’assurer le service universel et de lutter contre les situations de distorsion de concurrence – dégroupage –, affectation de fréquences, établissement du plan national de numérotation téléphonique, et fixation des obligations pesant sur les opérateurs « réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » – régulation asymétrique.
De manière générale, la nouvelle directive, d’une part, toilette quelque peu le droit européen en supprimant des dispositions devenues obsolètes, comme l’obligation d’agrément pour les terminaux fixes de réception de la téléphonie, et, d’autre part, clarifie et précise le droit applicable aux équipements radioélectriques. Ainsi, la directive :
– apporte une exigence plus claire concernant le niveau minimum de performance à respecter par les récepteurs pour contribuer à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique ;
– crée des obligations explicites pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs s’agissant de la commercialisation des produits. À ce titre, elle offre à la Commission européenne la possibilité d’instaurer un système d’enregistrement des équipements radioélectriques présentant un trop faible taux de conformité, afin de renforcer les obligations de traçabilité incombant aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs ;
– supprime des obligations administratives superflues, comme la notification préalable des équipements hertziens qui utilisent des bandes de fréquences non harmonisées ;
– complète la liste des exigences universelles, en instaurant notamment l’obligation de compatibilité avec des chargeurs universels :
a. les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels ;
b. les équipements radioélectriques interagissent au travers des réseaux avec les autres équipements radioélectriques ;
c. les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de l’Union ;
d. les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service ;
e. les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;
f. les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude ;
g. les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence ;
h. les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées ;
i. les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.
II. LA DIRECTIVE 2014/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 MAI 2014 RELATIVE À DES MESURES VISANT À RÉDUIRE LE COÛT DU DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À HAUT DÉBIT
Le 2° concerne la transposition de la directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. Elle doit être transposée au plus tard le 1er janvier 2016.
Cette directive vise à encourager le déploiement des réseaux de communication à très haut débit dans les États membres. La réduction des coûts de déploiement de réseaux de nouvelle génération, fixes et sans fil, passera essentiellement par quatre points principaux :
– l’exploitation des infrastructures passives existantes (gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis), notamment depuis celles des autres opérateurs d’énergie (gaz, électricité, eau...) ;
– une meilleure coordination des travaux de génie civil ;
– la simplification des démarches administrative (notamment l’accès aux autorisations de travaux de génie civil) et de leurs charges (notamment grâce à la centralisation sur un point unique des informations relatives à ces demandes d’autorisations) ;
– la présence systématique d’infrastructures de très haut débit dans tous les immeubles neufs et dans les projets de grande rénovation.
Cette directive apporte des avancées intéressantes, qui ne révolutionneront néanmoins pas le droit français, notre pays étant plutôt en pointe sur ce sujet, notamment grâce à l’action du régulateur. Le 27 février 2008, le président de l’autorité de régulation, M. Paul Champsaur, déclarait avoir identifié trois questions majeures pour les déploiements FTTH, dont la première, pour faciliter les déploiements sur le domaine public, « est l’accès aux infrastructures de génie civil de France Télécom (chambres, fourreaux...) ». En effet, les travaux de génie civil constituent une part essentielle du coût de raccordement d’un immeuble, entre 50 % et 80 % du coût total par abonné selon l’ARCEP. Le 24 juillet 2008, l’ARCEP a ainsi adopté une décision d’analyse des marchés, qui impose à France Télécom de donner accès à son génie civil (fourreaux, chambres) dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à un tarif orienté vers les coûts (8).
Par la suite, l’article 27 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite « loi Pintat », a renforcé les incitations à la mutualisation des travaux de génie civil au profit des communications électroniques. Ainsi, l’article L. 49 introduit, pour les maîtres d’ouvrage réalisant des travaux sur les réseaux routiers, aériens ou souterrains de toute nature, une obligation d’information systématique et préalable des collectivités territoriales concernées et des opérateurs de communications électroniques, afin d’offrir à ces derniers l’opportunité de déployer leurs propres infrastructures à moindre coût lors de la réalisation de ces chantiers.
Aujourd’hui, les opérations de déploiement du très haut débit recourent fréquemment aux points hauts du réseau d’ERDF, les poteaux étant la propriété des collectivités territoriales. Dans ce contexte, la Mission Très haut débit, chargée au sein du ministère de l’Économie d’accompagner les collectivités dans leurs actions de déploiement, a mis en place un groupe de travail visant à travailler sur des systèmes d’accrochage de câbles optiques innovants, dans le but de ne pas endommager le réseau électrique.
Le rapporteur thématique, s’il considère que la mutualisation des travaux de génie civil va évidemment dans le bon sens, attire néanmoins l’attention des acteurs concernés sur la faible participation des opérateurs aux réunions organisées par les collectivités territoriales en vue d’anticiper la pose de lignes de communications électroniques dans des tranchées dont la construction est envisagée. Par ailleurs, il attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de s’intéresser aux conditions dans lesquelles pourrait être envisagée la facilitation de l’accès aux fourreaux détenus par les collectivités territoriales.
III. LA SIMPLIFICATION DU DROIT APPLICABLE AUX SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES
Le 3° vise la simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques.
De manière générale, il s’agit de donner suite aux propositions d’un groupe de travail piloté par l’Agence nationale des fréquences (ANFr) depuis 2010, et composé de l’ensemble des administrations et autorités affectataires de bandes de fréquences (ARCEP, Conseil supérieur de l’audiovisuel, ministère de la Défense, ministère de l’Intérieur). Outre un objectif de simplification, il s’agit de mettre en conformité les dispositions du code des postes et des télécommunications électroniques avec les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou encore du code de la construction et de l’habitation.
Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre II du livre II du code traitent des servitudes au profit des départements ministériels. D’une part, les servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles visent à ce que ne soit pas perturbée la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels (articles L. 54 à L. 56). D’autre part, les servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques visent à assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les mêmes centres (articles L. 57 à L. 62). Par ailleurs, des servitudes ont été créées par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications au profit des opérateurs de communications électroniques, sans qu’elles n’aient jamais été mises en œuvre faute de décret d’application (articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code). Ces dernières ont donc vocation à être supprimées, leur manque d’effectivité n’ayant pas été regretté par les opérateurs.
Le régime juridique des servitudes radioélectriques est complexe.
S’agissant des servitudes contre les obstacles, la suppression ou la modification des immeubles en cause est menée, en l’absence d’accord amiable, dans le cadre de la procédure de droit commun d’expropriation pour cause d’utilité publique. Une fois rendus conformes, ces immeubles peuvent être revendus, sous réserve du respect des servitudes établies par l’acquéreur, l’ancien propriétaire disposant d’un droit de préemption. S’il n’y a pas lieu de procéder à une modification ou à une suppression d’un immeuble, les servitudes peuvent donner droit à une indemnité, fixée par le juge administratif à défaut d’accord amiable. De manière assez classique en matière de servitudes, la demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l’exécution des travaux dans un délai contraint. En l’espèce, elle doit être formulée dans un délai d’un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
S’agissant des servitudes contre les perturbations électromagnétiques, le pouvoir réglementaire doit fixer, par un décret de servitudes, les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d’installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique. Ceux-ci devront se soumettre aux servitudes ainsi définies dans un dans un délai maximum d’un an à compte de la date du décret. Les propriétaires et usagers des installations concernées, qui ne peuvent s’opposer à une procédure d’enquête préalablement à la prise du décret de servitudes, sont indemnisés en cas de dommage « direct, matériel et actuel ». Comme en matière de servitudes contre les obstacles, la demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre concerné dans le délai d’un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. Son niveau est fixé par le juge administratif en l’absence d’accord amiable. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 60 du code, « tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ».
En pratique, le régime des servitudes radioélectriques conduit à une surcharge d’actes administratifs, de multiples acteurs devant signer et contresigner des documents relatifs, selon l’étude d’impact, à plus de 5 500 stations protégées (9) par plus de 10 000 décrets de servitudes. Au-delà des gains d’efficacité et de clarté attendus d’une réforme de ce régime juridique, il existe un enjeu budgétaire pour l’Agence nationale des fréquences, confrontée par ailleurs à un accroissement de ses missions dans un contexte de réduction des dotations budgétaires (10). Actuellement, le temps moyen d’établissement d’une servitude est de trois ans. La seule suppression de la consultation administrative préliminaire et de la consultation interministérielle permet de gagner plus de six mois. Dans ce contexte, et alors que le nombre de servitudes a fortement augmenté ces dernières années, principalement en raison de l’augmentation des demandes émanant des ministères de l’Intérieur et de la Défense, les mesures envisagées par le Gouvernement seraient, d’après l’étude d’impact, articulées autour de trois axes :
– établissement des servitudes par arrêté et non plus par décret, sauf dans le cas de conclusion défavorable de l’enquête publique ;
– suppression du classement des centres en catégories ;
– suppression des servitudes dont bénéficient les opérateurs à l’exception des seules servitudes au bénéfice des centres exploités pour les besoins de la défense ou de la sécurité publique.
Ces dispositions, principalement issues des travaux du groupe de travail menés par l’Agence nationale des fréquences, font l’objet d’un large consensus parmi les acteurs concernés et ne peuvent que recevoir le soutien du rapporteur thématique. Toutefois, bien que la matière puisse paraître aride, le rapporteur thématique regrette que le recours à une ordonnance ait été retenu s’agissant de mesures connues depuis longtemps, et qui auraient pu être présentées dans leur intégralité devant la représentation nationale.
La commission spéciale a adopté un amendement de précision.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements de suppression SPE246 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE403 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’amendement de précision SPE80 des rapporteurs.
Enfin, elle adopte l’article 32 modifié.
Article 33
(art. L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques)
Ratification d’une ordonnance relative à l’économie numérique et clarification rédactionnelle
Le présent article procède à la ratification de l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique ainsi qu’à une clarification de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
I. LA RATIFICATION DE L’ORDONNANCE RELATIVE À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le I du présent article procède à la ratification de l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique, prise sur le fondement du 5° de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Aux termes de l’article 38 de la Constitution, toute ordonnance devient caduque dès lors qu’un projet de loi de ratification n’a pas été déposé sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée dans le délai fixé par la loi d’habilitation. Par ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis fin au régime jurisprudentiel de la ratification implicite, le deuxième alinéa de l’article 38 précisant dorénavant que toute ratification devait être faite « de manière expresse ». Dans ces conditions, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 30 juillet 2014, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014. Il est donc proposé aujourd’hui de ratifier cette ordonnance de manière expresse dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, plutôt que de charger l’ordre du jour du Parlement par l’inscription d’un projet de loi spécifique ne comportant qu’un article.
Conformément au champ de l’habilitation, cette ordonnance comporte trois volets.
A. LA CONFORMITÉ AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RELATIVES AUX DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU TERRITOIRE NATIONAL, C’EST-À-DIRE AU NOM DE DOMAINE « .FR »
Il s’agissait simplement de réintroduire les dispositions existantes figurant dans le CPCE (art. L. 45 à L. 45-7) après les avoir préalablement notifiées à la Commission européenne, conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, afin d’éviter qu’elles ne puissent faire l’objet d’une annulation contentieuse. En somme, il s’agissait d’une simple mesure de sécurisation juridique, que le rapporteur thématique ne peut qu’approuver.
Extrait de l’étude d’impact du 3 septembre 2013 sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
I.- Domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national
1.- Rappel du contexte
Les articles L. 45 à L. 45-7 du code des postes et des communications électroniques définissent les modalités selon lesquelles les noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci (comme le « .fr » ou le « .re ») sont attribués et gérés. En particulier, l’article L. 45 stipule que l’attribution et la gestion de ces noms de domaine sont centralisées par un organisme unique dénommé « office d’enregistrement », désigné par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour une durée fixée par voie réglementaire.
Par un arrêté du 19 février 2010 et conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction alors applicable, le ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie avait désigné, pour une durée de sept ans, l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) pour exercer la fonction d’office d’enregistrement du « .fr » et précisé, en application de l’article R. 20-44-36 du code des postes et des communications électroniques alors en vigueur, les prescriptions s’imposant à l’office d’enregistrement. Pour compléter cet arrêté, l’État avait passé avec l’AFNIC une convention portant sur l’attribution et la gestion du « .fr ».
Par décision n° 337320 du 10 juin 2013, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, ainsi que la convention entre l’État et l’AFNIC portant sur l’attribution et la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au « .fr », en raison de l’absence de notification de ces textes à la Commission européenne, en application des dispositions de l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998.
2.- Description des mesures proposées
Les textes visés par la décision du Conseil d’État sont aujourd’hui caducs, puisque, suite aux modifications législatives apportées au code des postes et des communications électroniques par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, une nouvelle procédure de désignation de l’office d’enregistrement en charge du « .fr » a été menée en 2012.
Toutefois, le Gouvernement souhaite notifier les dispositions législatives actuellement prévues par le code des postes et des communications électroniques à la Commission européenne conformément à la directive européenne précitée pour garantir leur sécurité juridique. Au terme de cette procédure de notification, ces mêmes dispositions pourront à nouveau être insérées dans le code des postes et des communications électroniques par voie d’ordonnance. Ainsi, elles ne pourront faire l’objet d’une annulation pour les motifs invoqués dans la décision du Conseil d’État n° 337320 du 10 juin 2013.
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite préciser, à l’article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes physiques ou morales pouvant demander l’enregistrement d’un nom de domaine sont les personnes résidant ou ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’Espace économique européen (et pas seulement sur le territoire de l’Union européenne comme stipulé dans la version actuelle du code).
3.- L’impact des mesures proposées
Les mesures proposées ayant comme objectif de sécuriser, au regard du droit de l’Union européenne, les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national, elles n’emportent pas d’impact autre que cette sécurisation juridique.
B. LE RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE SANCTION DE L’ARCEP
Prévu à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir de sanction de l’ARCEP lui permet de prendre des mesures à l’encontre des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre. Si l’ARCEP peut se saisir d’office, cette compétence peut également être exercée à la demande d’un opérateur ou de toute personne physique ou morale concernée.
Par sa décision n° 2013-331 QPC en date du 5 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a, sur renvoi du Conseil d’État, déclaré non conformes à la Constitution les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11, aux motifs « que, selon le premier alinéa de l’article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l’autorité du président de l’Autorité ; que, selon l’article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de l’Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l’Autorité ; que, par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n’assurent pas la séparation au sein de l’Autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le principe d’impartialité (11) ».
C’est donc sur le fondement des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions que le Conseil constitutionnel a privé le régulateur de tout pouvoir de sanction, le privant ainsi des capacités de jouer son rôle : en effet, selon le régulateur, se sentant à l’abri de sanctions, certains opérateurs ont rechigné à coopérer avec lui, voire ont clairement agi au mépris des règles régissant le secteur des communications électroniques. Le régulateur n’était ainsi même plus en mesure de brandir la menace de prononcer l’une des sanctions prévues par le code des postes et des communications électroniques : mise en demeure, par une décision du directeur général, de se mettre en conformité avec le droit applicable ; suspension totale ou partielle ou retrait, pour une durée déterminée, du droit d’exercer l’activité ; suspension totale ou partielle, réduction de durée ou retrait de la décision d’attribution ou d’assignation de fréquences, de numéros ou de blocs de numéros ; sanction pécuniaire ne pouvant excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (5 % en cas de récidive) ou calculée en fonction du manquement dans le cas de non-respect de l’obligation de couverture de la population dans le cas d’autorisation d’utilisation de fréquences ; suspension ou arrêt de la commercialisation d’un service pour les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché jusqu’au respect de ses obligations par l’opérateur.
La jurisprudence constitutionnelle, qui exige ainsi la séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein des autorités administratives indépendantes, n’impose pas un modèle particulier d’organisation particulier. Trois solutions différentes ont été envisagées :
– le modèle de la séparation fonctionnelle avec un directeur des services d’instruction nommé par le ministre, ce qui est incompatible avec le droit européen des communications électroniques ;
– le modèle de la séparation organique avec un comité des sanctions distinct du collège de l’Autorité, en vigueur à l’Autorité des marchés financiers, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou encore à l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
– le modèle de la séparation fonctionnelle avec une scission du collège de régulation en deux sous-collèges distincts dans le cas d’une procédure de sanction, mis en œuvre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par l’article 8 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
C’est ce dernier modèle qui a été retenu : une formation composée de quatre membres du collège, dont le président de l’Autorité, adopte les décisions en matière de mise en demeure, d’instruction, de règlement des différends et d’enquête, et une formation composée des trois autres membres du collège adopte les décisions de sanction. Pour ce faire, l’ordonnance modifie les articles L. 5-3, L. 36-11 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques.
Depuis la publication de cette ordonnance, les opérateurs sont rentrés dans le rang selon les observateurs, et le régulateur a retrouvé une capacité d’action, d’influence et de négociation renforcée, ce dont ne peut que se féliciter le rapporteur thématique. L’ARCEP est en effet confrontée à des enjeux essentiels pour le bon fonctionnement du secteur des télécommunications : la fusion entre Numericable et SFR pose en effet des questions s’agissant du déploiement de la fibre optique dans les zones denses, tandis que le modèle de déploiement du très haut débit, avec une forte mobilisation des collectivités territoriales via les réseaux d’initiative publique, conduit à un accroissement du nombre d’acteurs à réguler.
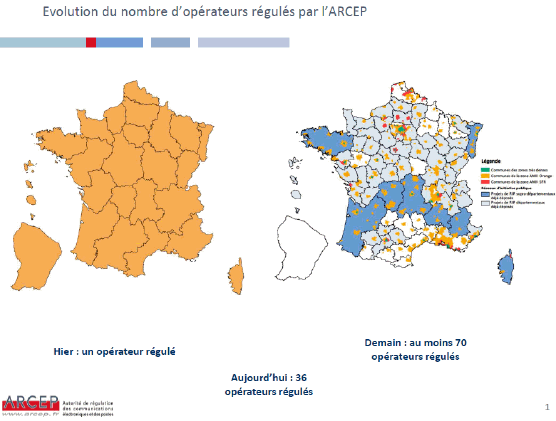
C. LA SIMPLIFICATION ET L’AMÉLIORATION DU CADRE JURIDIQUE RÉGISSANT LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX EN FIBRE OPTIQUE JUSQU’À L’ABONNÉ DANS LES IMMEUBLES
Comme l’indique l’étude d’impact sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (12), l’ARCEP et les acteurs concernés ont identifié des difficultés d’interprétation de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques concernant les opérations de raccordement final de l’abonné au réseau de fibre optique dans les immeubles existants. En effet, aux termes de cet article, « les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires » [...]. « Les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur », et la convention « fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature ».
Saisie par des associations de copropriétaires et des associations syndicales de difficultés pour la signature des conventions prévues par l’article précité, l’ARCEP a réalisé une consultation publique du 13 avril au 25 mai 2012, et publié des recommandations en 2013. L’ordonnance procède donc à une clarification du partage des responsabilités entre les opérateurs, d’une part, et les copropriétaires, d’autre part.
L’article 5 de l’ordonnance modifie ainsi l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques. Le dispositif, étudié de manière exhaustive par l’ARCEP (13), vise à lever l’incertitude sur le responsable à qui incombe la charge des travaux de raccordement :
– l’ordonnance restreint aux seules opérations réalisées dans les parties affectées à l’usage commun le principe selon lequel l’installation de la fibre se fait aux frais de l’opérateur signataire de la convention : les travaux réalisés dans les parties privatives d’un logement ou local à usage professionnel pour permettre le raccordement de celui-ci au réseau déployé dans l’immeuble, et qui bénéficient par conséquent au seul occupant du logement ou local à usage professionnel concerné, pourront être mis en partie ou en totalité à la charge de l’occupant. Cette évolution est cohérente avec les dispositions applicables à d’autres réseaux dits pénétrants – électricité, eau ;
– l’ordonnance rappelle que le principe selon lequel l’installation de la fibre optique se fait aux frais de l’opérateur signataire ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où deux propositions consécutives de fibrage de l’opérateur ont été refusées par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires dans les deux ans qui précèdent ;
– l’ordonnance précise que lorsque l’immeuble ne comprend pas d’infrastructures adaptées ou que celles-ci sont déjà totalement occupées, il revient au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l’association syndicale de propriétaires d’établir ces nouvelles infrastructures d’accueil et de les mettre à la disposition de l’opérateur signataire de la convention avant le début des travaux réalisés par cet opérateur. Ces travaux pourraient tout à fait être réalisés par l’opérateur dans le cadre d’une convention ;
– l’ordonnance, enfin, impose que les opérations d’installation de la fibre optique soient menées dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition effective des infrastructures d’accueil à l’opérateur signataire de la convention.
Les articles 6 et 7 de l’ordonnance modifient l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de mettre ces dispositions en cohérence avec l’article L. 33-6 du CPCE modifié.
II. LA CLARIFICATION DE LA RÉDACTION DE L’ARTICLE L. 33-6 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le II apporte des clarifications strictement rédactionnelles à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, afin de prendre en compte les spécificités des logements sociaux collectifs.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
*
* *
La commission adopte l’article 33 sans modification.
*
* *
Article 33 bis [nouveau]
(articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation)
Équipement en fibre optique des maisons individuelles
et des lotissements neufs
À l’initiative de Mme Corinne Erhel, la commission spéciale a adopté un amendement portant article additionnel visant à rendre obligatoire l’équipement en fibre optique des maisons individuelles neuves et des lotissements neufs.
Le I de ce nouvel article complète la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1er du code de la construction et de l’habitation, qui définit les règles générales de la construction. Le nouvel article L. 111-5-1-1 prévoit que les immeubles ou maisons individuelles ne comprenant qu’un seul logement ou un seul local à usage professionnel doivent être pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de ces locaux en fibre optique.
Le II procède à la création d’un nouvel article L. 111-5-1-2 au sein de la sous-section précitée, prévoyant que les lotissements neufs doivent être pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de ces locaux en fibre optique.
Le III renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application et le calendrier de mise en œuvre de ces obligations.
Concrètement, il s’agit de pré-équiper ces constructions neuves afin de faciliter le déploiement de la fibre optique et l’atteinte des objectifs du plan « France très haut débit ». Ces dispositions s’inspirent directement du deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit par l’article 29 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), qui impose l’équipement en lignes à très haut débit des immeubles collectifs neufs, afin de desservir chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public. Cette obligation est applicable depuis le 1er janvier 2010 pour tous les immeubles de moins de vingt-cinq logements, et depuis le 1er janvier 2012 ceux de plus de vingt-cinq logements.
Si le rapporteur thématique a conscience que cette obligation peut conduire à un surcoût de construction, il tient à souligner que les travaux nécessaires à cet équipement, d’un coût relativement minime, accroîtront la valeur des locaux concernés. Par ailleurs, il semble logique de réaliser ces lignes initialement, afin d’anticiper le raccordement à la fibre optique, plutôt que de devoir par la suite réaliser des travaux plus complexes, plus coûteux, et susceptibles de ralentir le déploiement de la fibre optique sur notre territoire.
Le rapporteur thématique soutient donc pleinement ces dispositions, et rappelle à ce titre que le déploiement de la fibre optique constitue une forte source d’emplois, la Fédération française des télécommunications estimant à plus de 20 000 le nombre d’emplois à même d’être créés dans le seul secteur de l’installation électrique par le déploiement du segment terminal d’un réseau en fibre optique.
*
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements SPE850 de Mme Corinne Erhel ainsi que les amendements SPE406 et SPE405 de M. Patrick Hetzel.
Mme Corinne Erhel. Dans la continuité des dispositions existantes, cet amendement vise à encourager le déploiement du très haut débit, enjeu industriel et économique majeur et grand chantier d’aménagement du territoire. L’objectif est de rendre obligatoire l’équipement des constructions neuves – maisons individuelles et lotissements – en lignes de communications électroniques en fibre optique.
M. Patrick Hetzel. Je suis également favorable au déploiement de la fibre optique. Les analyses internationales montrent que la mise en place de ce type d’infrastructures peut contribuer à la compétitivité d’un pays. La France a la chance d’avoir dans ce domaine une industrie très performante ; raison de plus pour en conforter le développement. Tel est l’objet de mes amendements SPE406 et SPE405.
M. le président François Brottes. Monsieur Hetzel, vos deux amendements concernent l’un les maisons, l’autre les lotissements, alors que celui de Corinne Erhel embrasse les deux à la fois. Seriez-vous prêt à retirer vos amendements au profit du sien ?
M. Patrick Hetzel. Tout à fait.
Les amendements SPE406 et SPE405 sont retirés.
M. le ministre. Favorable. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’ambition gouvernementale du plan « France très haut débit », qui se donne pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2022 – ambition importante et enjeu fondamental pour beaucoup de nos concitoyens. Le code de la construction et de l’habitation n’impose actuellement d’effectuer le préraccordement en fibre optique qu’aux constructeurs d’immeubles collectifs neufs, alors que les maisons individuelles représentent environ 60 % des logements neufs construits durant les dix dernières années. D’ici à l’examen du texte en séance publique, nous travaillerons avec le ministère du logement sur la question du report du coût sur les propriétaires, qu’il faudra aborder dans le décret.
M. le rapporteur général. Cet excellent amendement a l’avantage d’embrasser large et d’étreindre fort, couvrant l’ensemble des situations. Avis très favorable.
M. Patrick Hetzel. Je salue les propos du ministre comme du rapporteur général : c’est un sujet stratégique, et nos concitoyens seront sensibles à cet intérêt.
M. Jean-Frédéric Poisson. J’approuve la volonté de raccorder à la fibre tout notre territoire dans des délais brefs. Pour autant, ces dispositions ne doivent pas empêcher la montée en débit sur le réseau de cuivre existant : elle est parfois nécessaire. Dans la partie rurale de l’Île-de-France, nous avons encore des communes où l’accès à l’internet ne dépasse pas 256 kilo-octets par seconde... Et lorsque nous demandons une montée en débit, on nous oppose l’arrivée prochaine de la fibre, et on prétend que l’utilisation du réseau de cuivre serait complexe, voire interdite.
Mais on ne peut plus expliquer qu’il suffit d’attendre quelques années pour passer d’un seul coup d’un débit de 256 kilo-octets à 100 mégaoctets. Nos concitoyens ne peuvent pas le comprendre, et c’est bien naturel. Or, la fibre optique s’impose à toutes les décisions publiques, et il devient très difficile d’imposer une simple montée en débit. En zone rurale, de plus, le raccordement d’un lotissement nouveau à la fibre optique peut n’être tout simplement pas possible, parce qu’il faudrait aller à dix, quinze ou vingt kilomètres.
Je comprends donc l’intention de l’amendement, et je l’approuve, mais il serait dommage qu’il soit inopérant et même gênant.
M. le président François Brottes. La loi pour la modernisation de l’économie prévoyait déjà une obligation que l’amendement ne fait qu’étendre. Il me semble de plus que l’on peut être raccordé au réseau cuivre, puis à la fibre.
M. le ministre. Ce point est important. De manière constante, le Gouvernement ne choisit pas une option technologique plutôt qu’une autre. L’amendement, lui, privilégie explicitement la fibre optique, comme c’est souvent le cas en pratique ; mais vos préoccupations, monsieur Poisson, sont prises en considération par le Gouvernement et les principaux opérateurs. Êtes-vous opposé à la mention de la fibre optique dans l’amendement ?
M. Jean-Frédéric Poisson. Je n’exprime pas ici la position du groupe UMP, mais ma position personnelle, et je voterai cet amendement. Je me contente d’appeler votre attention sur les problèmes qui se posent aujourd’hui. J’ai parfaitement compris que la rédaction de l’amendement n’interdit nullement le raccordement au réseau cuivre, mais la domination conceptuelle, pour ne pas dire idéologique, de la fibre peut poser problème.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’objectif de cet amendement est d’éviter d’avoir à refaire des travaux quand la fibre arrivera à proximité. Le surcoût est relativement faible, et le raccordement à la fibre peut représenter une plus-value lorsque la maison est revendue.
Mais le problème soulevé par Jean-Frédéric Poisson est réel, et nous devons y répondre. Le plan « France très haut débit », qui a l’ambition de couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2022, implique une mobilisation financière forte de l’État et des collectivités territoriales : monsieur le ministre, il faut continuer de prêter une grande attention à ce sujet. Corinne Erhel restera de toute façon très vigilante !
Mme Corinne Erhel. Si je mentionne la fibre optique dans l’amendement, c’est parce que c’est une technologie pérenne. Nous avons vraiment tout intérêt à investir en ce domaine et à prévoir ces travaux en amont des constructions : ils sont mineurs pour une construction neuve, mais autrement plus coûteux s’il faut les réaliser ultérieurement.
Prévoir le raccordement à la fibre optique n’interdit pas, à l’évidence, l’usage d’autres technologies. Mais, sur le plan industriel comme sur celui de l’aménagement du territoire, c’est une ambition essentielle.
M. le président François Brottes. Le rapporteur thématique a raison : il serait absurde de ne pas prévoir d’ores et déjà le raccordement à la fibre, même si elle n’est pas utilisable immédiatement. Même si l’on a une mauvaise platine, mieux vaut choisir des enceintes de bonne qualité : ainsi, le jour où l’on change sa platine, tout est parfait ! On a trop souvent oublié ce principe pendant des années dans ce pays, ce qui nous a fait rater quelques échéances...
La commission adopte l’amendement SPE850 à l’unanimité.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE407 de M. Patrick Hetzel et SPE1796 de Mme Corinne Erhel.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE407 est défendu.
Mme Corinne Erhel. Dans le même ordre d’idées, l’amendement SPE1796 prévoit un raccordement obligatoire à la fibre lors de gros travaux de réhabilitation. J’ai conscience que c’est une mesure plus complexe que la précédente.
M. le ministre. Le Gouvernement, de nouveau, ne peut que partager votre souhait. Toutefois, l’article 8 de la directive européenne du 15 mai 2014 impose l’équipement en très haut débit lors de travaux de rénovation de grande ampleur. Cette directive sera transposée par ordonnance, vous le savez : certaines questions techniques se posent encore, mais votre demande sera pleinement satisfaite. Je demande donc le retrait de ces amendements, dans l’attente de la transposition de cette directive.
Les amendements SPE407 et SPE1796 sont retirés.
Article 33 ter [nouveau]
(art. L. 32 du code des postes et des communications électroniques)
Définition de l’itinérance métropolitaine
À l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, la commission a adopté un amendement portant article additionnel visant à définir l’itinérance métropolitaine.
Ce nouvel article modifie donc l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui définit les concepts essentiels utilisés dans ce code. Le rapporteur thématique évoquera également à ce stade les dispositions de l’article 33 quinquies, qui définit dans la loi les conditions dans lesquelles l’itinérance métropolitaine sur les réseaux mobiles peut être envisagée, également introduit à l’initiative de M. François Brottes et intimement lié au présent article.
Le présent article insère un 17° ter au sein de l’article L. 32 du CPCE, relatif à l’itinérance métropolitaine, définie comme celle qui est fournie sur tout ou partie du territoire métropolitain par un opérateur mobile autorisé à un autre opérateur mobile en vue de permettre l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second, pour émettre ou recevoir des communications électroniques. Saisis par le Gouvernement, le régulateur sectoriel – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – et l’Autorité de la concurrence ont rendu deux avis importants en 2013 (14), précisant les conditions dans lesquelles la mutualisation horizontale pouvait être envisagée sur les réseaux mobiles. Aujourd’hui, il est temps de préciser le régime juridique de l’itinérance métropolitaine, l’itinérance ultramarine étant déjà l’objet de l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques.
Le rapporteur thématique a accueilli favorablement cet amendement, tout en indiquant qu’il serait nécessaire de modifier la rédaction de ces nouvelles dispositions à l’occasion de l’examen du projet de loi en séance publique : elles pourraient être précisées, voire complétées en traitant de la mutualisation, dont l’itinérance n’est qu’une modalité.
En effet, plusieurs types de partage existent. Le partage des réseaux peut être limité aux seuls éléments passifs du réseau. Il peut également être étendu aux éléments actifs. Enfin, les fréquences elles-mêmes peuvent être exploitées en commun. Par ailleurs, on peut distinguer deux formes de partage. La première est symétrique, chaque opérateur étant sur un pied d’égalité et contribuant à la ressource commune : il s’agit des accords de mutualisation. La seconde est asymétrique, un opérateur produisant pour le compte d’un autre : on parle alors d’itinérance ou de « roaming ».
La mutualisation des installations passives concerne les infrastructures au sens strict du terme : pylônes, toits-terrasses, câbles coaxiaux, locaux techniques, voire partage du système antennaire, etc. Dans ce modèle, chaque opérateur installe par la suite ses propres équipements actifs et utilise ses propres fréquences et les échanges d’information sensibles sont faibles.
La mutualisation des installations actives, ou mutualisation des réseaux, est une forme plus avancée de partage. Les installations passives sont non seulement partagées, mais également les stations de base, les contrôleurs de stations de base et les liens de transmission associés. Davantage d’économies d’échelles sont réalisées, mais il existe moins de différenciation en aval, ce qui peut générer des risques concurrentiels.
La mutualisation des fréquences est une forme encore plus intégrée de partage puisque les fréquences sont mises en commun en vue de leur exploitation combinée. Le contrôleur du réseau radio et les stations de base sont ainsi mutualisés, ce qui nécessite une autorisation du régulateur – l’ARCEP – dans la mesure où il existe encore moins de possibilité de différenciation.
Enfin, dans le cas de l’itinérance, un opérateur hôte accueille sur son réseau les clients d’un autre opérateur qui, soit ne dispose pas de fréquences – itinérance internationale ou accord avec un MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) – ou alors en quantités insuffisantes, soit dispose de fréquences mais n’a pas de sites en propre – couverture des zones blanches, accord d’itinérance de Free-Orange, par exemple. Comme le souligne l’ARCEP dans l’avis précité, « l’itinérance est essentiellement asymétrique : l’un des partenaires, l’opérateur d’accueil, apporte l’ensemble des actifs, réseau et fréquences, alors que le second, l’opérateur accueilli, fait le choix de recourir à cette modalité précisément parce qu’il ne dispose pas d’un tel patrimoine, au moins temporairement. De plus, les accords d’itinérance sont réversibles et peuvent donc rester temporaires, contrairement aux accords de mutualisation qui s’inscrivent par nature dans des perspectives de long terme ».
Comme le rapporteur thématique l’a souligné, les conditions dans lesquelles l’itinérance et la mutualisation peuvent être envisagées ont été précisées en 2013 par l’ARCEP et l’Autorité de la concurrence. Si l’appréciation de la mutualisation diffère légèrement entre les deux autorités (15), elles fixent les mêmes conditions à son renforcement.
Dans les zones peu denses ou zones de déploiement prioritaire (ZDP), aucun type de mutualisation n’est exclu a priori, même si les accords de partage de fréquences doivent être étudiés avec une attention particulière. Dans les zones denses, la mutualisation d’installations passives ne présente donc pas de difficultés particulières. En revanche, le partage de fréquences enlève toute capacité de différenciation entre partenaires et suscite de très fortes réserves de la part de l’Autorité de la concurrence. La mutualisation d’infrastructures actives doit être encadrée et en tout état de cause limitée. Elle paraît risquée dans les zones très denses, dans lesquelles la mutualisation exige des échanges d’informations riches et fréquents sur la consommation des abonnés pour dimensionner correctement le réseau. Elle l’est vraisemblablement moins dans les zones « semi denses », dans lesquelles des échanges d’informations aussi précises ne sont pas indispensables pour déployer un réseau commun.
S’agissant de l’itinérance, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’elle pouvait « favoriser l’animation de la concurrence, notamment en abaissant les barrières à l’entrée pour un nouvel entrant. En effet, compte tenu du délai nécessaire au déploiement d’un réseau, un opérateur entrant ne pourrait en effet proposer d’offres compétitives dès son lancement s’il devait s’appuyer sur son seul réseau, faute d’une couverture suffisante. C’est pourquoi l’Autorité de la concurrence avait, dans un précédent avis (16), insisté sur la nécessité que Free puisse en bénéficier rapidement, le temps qu’il puisse déployer son propre réseau. Cependant, cette itinérance doit rester transitoire car elle présente aussi des risques concurrentiels. L’itinérance contribue à rapprocher l’offre de services de l’opérateur accueilli de celle de l’opérateur d’accueil sur des paramètres importants de concurrence tels que la qualité de service, les débits ou la couverture. Ce faisant, elle réduit la différenciation entre opérateurs. Elle peut également induire des risques pour la structure du marché. En effet, les parties à l’accord d’itinérance sont renforcées et la compétitivité des autres opérateurs de réseau s’en trouve, d’un point de vue relatif, dégradée. Cela peut à terme déséquilibrer le marché et ce, d’autant plus que l’opérateur d’accueil est un acteur majeur du marché, que l’accord est conclu sur une période longue et qu’il couvre une part importante du territoire. L’Autorité estime par conséquent qu’il convient d’être particulièrement attentif aux accords d’itinérance nationale, en particulier en ce qui concerne leur durée. Une surveillance étroite et un suivi de ces accords sont nécessaires, dans la mesure où il n’est pas forcément dans l’intérêt tant de l’opérateur accueilli que de l’opérateur d’accueil de mettre fin à un accord d’itinérance nationale. »
Tirant les conséquences de ces deux recommandations, le présent article procède donc à une définition de l’itinérance métropolitaine, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par l’article 33 quinquies du présent projet de loi.
*
* *
La commission examine ensuite l’amendement SPE840 de M. le président François Brottes.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement vise à définir précisément l’itinérance métropolitaine, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire, à l’inverse de l’itinérance locale, déjà définie par le code des postes et des communications électroniques.
M. le président François Brottes. Il témoigne d’un souci de rigueur dans l’écriture de la loi.
M. le ministre. Vous avez raison. La régulation des accords d’itinérance mobile, et plus généralement des solutions techniques qui permettent de partager des réseaux mobiles, peut être renforcée. Les débats sur les contrats qui lient entre elles certaines entreprises bien connues ont été nourris. L’objectif du Gouvernement est d’assurer un bon équilibre entre, d’une part, la concurrence par les infrastructures et les différentes solutions de mutualisation de réseaux mobiles – dont l’itinérance n’est qu’une forme – et, d’autre part, les critères d’investissement imposés à certains opérateurs.
Pour qu’elle soit bien régulée et bien pilotée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), il est – vous avez raison – nécessaire de donner une définition de l’itinérance. Vous avez tout récemment donné votre accord pour la nomination du nouveau président de l’ARCEP : la lettre de mission qui va être écrite inclura ces questions.
Cet amendement correspond donc à nos préoccupations, comme à celles exprimées par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 11 mars 2013. Nous devrons travailler, d’ici à la discussion en séance publique, à une rédaction plus précise ; l’enjeu est toutefois suffisamment important pour que j’émette aujourd’hui un avis favorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il est effectivement temps de définir l’itinérance métropolitaine, comme c’est déjà le cas de l’itinérance ultramarine. Cet amendement va donc dans le bon sens. La rédaction proposée pourrait semble-t-il être précisée, voire complétée. Mais, dans mon manuel de député débutant Le petit Brottes pour les nuls, j’ai appris qu’il vaut mieux adopter une rédaction imparfaite en commission pour la préciser en séance publique, plutôt que de tout renvoyer en séance, au risque d’être victime de funestes oublis...
J’émets donc un avis favorable. Nous veillerons, en lien avec l’ARCEP, à proposer une réécriture.
M. le président François Brottes. Je ne conteste pas la citation…
La commission adopte l’amendement SPE840.
Article 33 quater
(art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques)
Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques
Cet article a été introduit à l’initiative de M. Jean-Yves Caullet, Mme Corinne Erhel et les députés du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), dont l’amendement a été sous-amendé par Mme Laure de La Raudière afin de déplacer l’alinéa relatif à la neutralité de l’internet.
Il procède à la réécriture du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux objectifs de la régulation assignés concomitamment à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et au Gouvernement. Directement inspiré d’un rapport d’information de la commission des affaires économiques présenté par Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière (17), cet article vise à hiérarchiser ces objectifs et à clarifier la répartition des rôles entre le régulateur et le Gouvernement.
Le II de l’article L. 32-1 confie en effet indifféremment au Gouvernement et au régulateur la réalisation des objectifs de la régulation, alors que les différents « paquets télécoms » (18) ont précisé le rôle de chacun. Il énonce une liste de vingt-et-un objectifs non hiérarchisés, ajoutés au fil des paquets télécoms, sans approche globale :
– plusieurs objectifs auraient pu être regroupés, comme les 3° ter et 7° sur la prise en compte de l’intérêt et de la situation des territoires ;
– aucune hiérarchie n’a été opérée entre des objectifs d’intérêt national (3° sur l’emploi et l’investissement, etc.) et des objectifs plus techniques (16° sur la promotion des numéros européens harmonisés, 17° relatif à la neutralité technologique, etc.) ;
– plusieurs objectifs correspondent en fait à des principes au sens du droit communautaire : 9° sur l’absence de discrimination dans le traitement des opérateurs, 2+ sur la promotion de la concurrence par les infrastructures ;
– la rédaction est confuse, notamment en raison de l’ajout régulier de « bouts de phrases » : le cas du 3° est topique, puisqu’une seule phrase comprend des segments introduits par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du « paquet télécom ») adoptée le 3 juin 2004 et l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
– les objectifs établis par le droit communautaire ont simplement été recopiés dans le code, ce qui nuit à la cohérence de l’ensemble de l’article ;
– certains objectifs introduits à l’initiative du seul législateur national, et traduisant ainsi un souci particulier des responsables politiques, sont perdus au milieu de dispositions d’origine communautaire, ce qui limite leur impact.
La rédaction du II prête de plus à confusion dans la mesure où semblent placés sur un même plan des compétences, des objectifs et les modalités de les atteindre.
Comme le notaient Mmes Erhel et de La Raudière dans le rapport précité, « sans empiéter sur le domaine de compétence du régulateur, il convient de clarifier le partage de responsabilités entre le régulateur et le Gouvernement. À cet égard, il faut reconnaître que la rédaction actuelle de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques prête à confusion, dans la mesure où il attribue des mêmes missions aux deux acteurs : en 1996, par la rédaction de cet article, le législateur avait en effet entendu soumettre le ministre aux mêmes objectifs que l’autorité de régulation. La structure générale de cet article n’a pas changé depuis, alors que, dans le même temps, deux autres "paquets" de directives communautaires sectorielles ont été adoptés, conduisant aujourd’hui à une répartition claire des compétences entre Gouvernement et régulateur. Il apparaît donc nécessaire de procéder à une réécriture de cet article en vue de sa clarification. L’action du Gouvernement, précisée, pourrait donc être recentrée. »
La nouvelle rédaction du II du L. 32-1 vise donc à répondre à trois objectifs.
s Première évolution : hiérarchiser
S’il apparaît difficile de formellement établir une hiérarchie entre les différents objectifs assignés à la régulation, une rédaction plus fine pourrait permettre de dégager les priorités de la régulation. Il est donc proposé de suivre le modèle de l’article 34 de la Constitution relatif au domaine de compétence de la loi, en créant plusieurs blocs d’objectifs.
s Deuxième évolution : clarifier
Les différents objectifs assignés à la régulation sont très divers : certains sont politiques, d’autres plus techniques ; certains dépendent du droit communautaire, d’autres découlent d’une volonté du législateur national. La rédaction actuelle ne traduit pas ces différences. Il est donc proposé de regrouper les objectifs selon leur nature, politique ou technique, et leur thématique (consommateur/concurrence, investissement/emploi) afin de clarifier la rédaction.
s Troisième évolution : distinguer les responsabilités du régulateur et du Gouvernement
La rédaction actuelle confie la régulation au Gouvernement et au régulateur, et ce de manière indifférente. Or, les différents « paquets télécoms » ont précisé le rôle des autorités nationales de régulation. Il est donc proposé de distinguer l’action du régulateur et du Gouvernement, conformément au droit communautaire.
En fin de compte, le nouveau II énumère les objectifs assignés concurremment au régulateur et au Gouvernement.
Dans un premier temps, sont mentionnés les objectifs de nature politique : fourniture du service public des communications électroniques, développement de l’emploi, de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, aménagement du territoire, protection des consommateurs et satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs et, enfin, respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.
Dans un second temps, sont mentionnés les objectifs de nature plus technique : intégrité et sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et respect de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique, niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé.
Le III énumère les objectifs assignés uniquement au régulateur : l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale, la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence, l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ces services, la mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen, l’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation, la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix.
Enfin, le IV énumère les principes auxquels l’ARCEP et le Gouvernement doivent veiller dans l’exercice de leur mission de régulation : le respect de la plus grande neutralité technologique possible des mesures prises, la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération en tenant compte, lorsque des obligations en matière d’accès sont fixées, du risque assumé par les entreprises qui investissent, l’autorisation des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination, l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs, la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures. Par ailleurs, l’ARCEP et le Gouvernement sont invités à assurer l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.
Le rapporteur thématique a émis un avis favorable à cet amendement. Toutefois, il lui semble que la rédaction adoptée en commission spéciale devra faire l’objet de précisions lors de l’examen du projet de loi en séance publique. Si la rédaction proposée est conforme au droit européen, et notamment à l’article 8 de la directive « cadre » précitée, quelques ajustements mériteraient d’être apportés, par exemple sur la répartition des rôles entre le régulateur et le Gouvernement.
*
* *
La commission examine ensuite l’amendement SPE702 de M. Jean-Yves Caullet, faisant l’objet d’un sous-amendement SPE1874 rectifié de Mme Laure de La Raudière.
M. Jean-Yves Caullet. Cet amendement très technique est issu des travaux de Corinne Erhel, à qui je laisse le soin de le présenter.
M. le président François Brottes. Vous m’offrez l’occasion de signaler au ministre que Corinne Erhel et Laure de La Raudière ont rendu deux rapports très solides sur l’économie numérique et l’impact de la régulation sur la filière télécom.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement vise à réécrire l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, qui définit les objectifs de la régulation en matière de télécommunication.
Dans un texte qui a pour but de relancer la croissance et l’activité, le numérique et les télécommunications ont très évidemment leur place : ce sont des moteurs essentiels de la création d’activité et donc d’emplois, comme de l’aménagement du territoire.
En 2013, Laure de La Raudière et moi-même avons rendu un rapport qui abordait la question des objectifs de la régulation. Nous préconisions notamment de réécrire cet article L. 32-1, qui, au fur et à mesure des années, s’est allongé : il assigne maintenant vingt-et-un objectifs au ministre chargé des communications électroniques et à l’ARCEP, sans hiérarchie ni priorités. Certains objectifs sont plutôt économiques et industriels, d’autres plutôt techniques, la plupart étant issus de directives européennes.
Nous proposons donc de les hiérarchiser, de distinguer ce qui relève du droit communautaire et du droit national, mais aussi ce qui relève de la politique, notamment de l’aménagement du territoire, ou d’aspects plus techniques, et enfin de clarifier les responsabilités du régulateur et du Gouvernement.
Ce rapport, adopté par la commission des affaires économiques, remonte maintenant à deux ans. Nous avions reçu des engagements, mais nous attendons toujours cette réécriture dont la nécessité est largement reconnue. Ce projet de loi est une bonne occasion de la mener à bien, même si notre proposition est sans doute perfectible.
Le numérique et le développement de nos réseaux sont essentiels pour notre économie, et la régulation du secteur des télécoms doit à la fois conforter l’investissement, préserver et amplifier les créations d’emplois, développer l’innovation, et contribuer à l’aménagement du territoire.
M. le président François Brottes. La commission des affaires économiques avait exprimé unanimement son mécontentement sur la façon dont ce secteur avait été régulé au cours des dernières années, constatant notamment un retard de développement des infrastructures et des dégâts économiques réels chez les industriels, voire les opérateurs.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le sous-amendement SPE1874 vise à déplacer au sein des objectifs prioritaires le respect du principe de neutralité et de secret des correspondances, ainsi que la protection des données à caractère personnel.
M. le ministre. La clarification des objectifs de la régulation est évidemment une nécessité, que votre rapport a bien montrée. J’émets un avis favorable au sous-amendement et à l’amendement. Nous inscrirons ainsi ces principes dans le texte, même si nous devrons là encore retravailler la rédaction, afin de prendre notamment en considération quelques contraintes européennes et la compétence d’autres ministères, comme celui de la consommation.
M. le président François Brottes. Sans aller jusqu’à la qualifier de « béotienne », j’apprécie beaucoup cette méthode...
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable au sous-amendement et à l’amendement. En les adoptant, nous soutiendrons les débuts du nouveau président de l’ARCEP, qui disposera ainsi d’une feuille de route claire, même si des précisions devront être apportées à la rédaction. Nous en restons ainsi à la « jurisprudence Brottes » – qui va, je le note en passant, à l’encontre de la doctrine défendue par le président de la commission des finances, dont nous occupons aujourd’hui la salle.
M. le président François Brottes. Je le rappelle souvent : il revient au Parlement – et non à des ordonnances – de fixer des objectifs aux autorités de régulation. Il n’est pas mauvais de le rappeler à ce stade.
Mme Corinne Erhel. J’approuve également le sous-amendement, qui consiste à intégrer aux objectifs politiques le principe de neutralité de l’internet – sujet sur lequel la commission des affaires économiques a beaucoup travaillé. Il s’agit de concilier protection du consommateur, investissement, emploi, innovation et aménagement du territoire.
La commission adopte le sous-amendement SPE11874 rect.
Elle adopte ensuite l’amendement SPE702 ainsi sous-amendé.
*
* *
Article 33 quinquies [nouveau]
(article L. 34-8-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)
Mise en œuvre de l’itinérance métropolitaine
Introduit à l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, cet article vise à définir les conditions de mise en œuvre de l’itinérance métropolitaine. Le rapporteur thématique renvoie au commentaire de l’article 33 ter pour les éléments d’analyse et de contexte pertinents.
Le présent article crée, au sein du code des postes et des communications électroniques, un nouvel article L. 34-8-1-1 définissant les conditions de mise en œuvre de l’itinérance métropolitaine.
Le premier alinéa de ce nouvel article précise que toute prestation d’itinérance métropolitaine fait l’objet, entre les opérateurs mobiles concernés, d’une convention de droit privé qui détermine les conditions techniques et financières de fourniture de ladite prestation. Cette disposition, assez classique, reprend les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1 du même code, relatif à l’itinérance ultramarine.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article encadre les modalités de mise en œuvre de l’itinérance, en limitant le champ géographique et la durée de la prestation au regard des obligations de couverture mentionnées dans les licences mobiles. À cet égard, le présent article traduit les recommandations exprimées par l’ARCEP et l’Autorité de la concurrence dans les avis de 2013 précités. Pour rappel, appelée à se prononcer sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange, l’Autorité de la concurrence avait conclu que l’itinérance devait rester transitoire car elle présente aussi des risques concurrentiels :
– sur la 2 G, l’itinérance, si elle devait être maintenue au-delà du droit qui est accordé jusqu’en 2016, devrait être limitée aux seuls clients disposant de terminaux 2G exclusifs ;
– sur la 3 G, l’itinérance nationale ne doit pas être prolongée au-delà d’une échéance raisonnable :
o 2016 – date à laquelle expirera le droit à l’itinérance 2G et s’ouvrira la fenêtre de résiliation prévue dans le contrat d’itinérance entre Orange et Free ;
o ou 2018 – échéance prévue par ce contrat.
L’Autorité invitait donc l’ARCEP à vérifier que Free se trouvait sur une trajectoire d’investissement compatible avec les obligations de sa licence ;
– sur la 4 G, l’Autorité reconnaissait l’existence d’un handicap pour Free en zone peu dense, l’entreprise n’ayant pas obtenu de bloc de fréquences dans la bande 800 MHz, et se montrait prête à considérer que l’itinérance peut compenser un tel handicap dans les zones de déploiement prioritaire. En revanche, l’extension de l’itinérance 4G aux zones denses poserait un problème beaucoup plus sérieux et, si l’entreprise Free se trouvait handicapée, elle préconise plutôt une réallocation de fréquences qu’une extension de l’itinérance aux zones denses.
Comme le rapporteur thématique l’a indiqué à propos de l’article 33 ter, il soutient cette évolution, même s’il conviendra sans nul doute de préciser la rédaction adoptée par la commission spéciale à l’occasion de l’examen du projet de loi en séance publique.
*
* *
La commission se saisit de l’amendement SPE834 de M. le président François Brottes.
M. le président François Brottes. Cet amendement vise à préciser les usages de l’itinérance. Il faut davantage de transparence, et l’itinérance ne doit pas porter préjudice au développement des infrastructures.
M. le ministre. Avis favorable, sous les mêmes réserves que précédemment : il faudra procéder à une réécriture d’ici à la séance publique.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE834.
*
* *
Article 33 sexies [nouveau]
(art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)
Rapport annuel de l’ARCEP
sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles
Introduit à l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, cet article complète l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, relatif au rôle et aux missions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
Aux termes du I, l’ARCEP sera ainsi chargée de remettre annuellement un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles, évaluant les investissements réalisés dans le cadre des opérations de déploiement des infrastructures nouvelles et la compatibilité des niveaux d’investissement avec les obligations de déploiement mentionnées par les licences mobiles. Par ailleurs, ce rapport devra évaluer l’impact des accords de mutualisation ou d’itinérance sur l’évolution des déploiements des nouveaux réseaux. L’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’une telle disposition permettra à l’ARCEP d’approfondir l’analyse qu’elle mène dans le cadre de son observatoire (19).
Le II précise que le premier rapport de cette nature devra être publié dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
*
* *
Puis la commission examine l’amendement SPE817 de M. le président François Brottes.
M. le président François Brottes. Nous proposons que l’ARCEP rende chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles autorisés.
M. le ministre. Avis favorable.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE817.
*
* *
Article 33 septies [nouveau]
(art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)
Adaptation au secteur numérique des dispositions
relatives à la transparence sur le marché publicitaire
Introduit à l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, et complété par un sous-amendement du Gouvernement, cet article modifie les articles 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », afin d’adapter au secteur numérique les dispositions relatives à la transparence sur le marché publicitaire. Cette loi a défini de nouvelles règles de transparence pour le secteur de la publicité, fondées sur deux dispositions principales :
– la soumission de toutes les activités de service, dont la publicité, aux règles de droit commun sur la communication des prix et la délivrance des factures ;
– l’imposition aux intermédiaires du régime de mandataire, particulièrement transparent.
L’article 20 impose à l’intermédiaire de faire ses achats pour le compte de l’annonceur sous le régime du mandat. Il précise que ce mandat doit faire l’objet d’un contrat écrit et que celui-ci doit énoncer les prestations rendues et leur rémunération, en distinguant elles qui sont rendues dans le cadre du mandat et celles qui, le cas échéant, n’en relèvent pas. Par ailleurs, cet article prévoit que la facture est envoyée directement à l’annonceur et qu’elle mentionne tous les rabais accordés par le vendeur, qui ne peuvent être accordés qu’à l’annonceur.
L’article 23 prévoit que le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées. Par ailleurs, en cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire doit avertir l’annonceur et recueillir son accord sur les changements prévus. Il lui rend de plus compte des modifications intervenues. Enfin, dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, ces obligations incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur.
La « loi Sapin », adoptée il y a plus de vingt ans, a permis de mettre fin à l’opacité qui caractérisait auparavant le secteur de la publicité. Toutefois, force est de constater que cette législation n’est pas adaptée aux nouvelles formes de publicité numérique, qui reposent sur des modèles ne permettant pas toujours l’application des dispositions en vigueur. Chacun convient qu’il est nécessaire de réguler le marché de la publicité numérique, mais qu’il est impossible de calquer simplement des normes élaborées pour un support analogique à un univers numérique.
À titre d’exemple, les entreprises innovantes spécialisées dans le reciblage de la publicité – le retargeting – ne sont pas en mesure d’apporter les mêmes garanties de transparence que des entreprises plus classiques. En effet, le reciblage publicitaire fonctionne en temps réel et s’appuie sur un algorithme de recommandation, qui analyse les recherches effectuées par un internaute sur un site en particulier et effectue ensuite une recommandation, incrustée dans une bannière personnalisée et ensuite diffusée sur un réseau de sites où est susceptible de surfer l’internaute ciblé, identifié grâce à un « cookie » déposé sur son ordinateur. Le modèle économique de ce type d’entreprise conduirait à rendre leur activité illégale si les dispositions de la « loi Sapin » leur étaient appliquées en l’état.
L’entreprise française Criteo (20), considérée comme l’un des leaders mondiaux sur ce marché, indique ainsi utiliser des algorithmes d’apprentissage automatique de pointe, qui intègrent et se nourrissent continuellement de nouvelles données. Le moteur de recherche de Criteo comprend :
– des algorithmes prédictifs qui sélectionnent uniquement les utilisateurs susceptibles de cliquer et d’acheter à ce moment-là, en complétant par une estimation en temps réel du niveau d’enchère adéquat ;
– des algorithmes de recommandation qui déterminent les produits les plus pertinents à afficher pour un taux de clic et de conversion optimaux : une publicité véritablement personnalisée, à grande échelle ;
– des algorithmes d’enchères qui déterminent la valeur pour chaque utilisateur en temps réel afin d’établir le prix d’enchère correspondant ;
– des publicités display créées de manière dynamique, en temps réel, pour chaque utilisateur.
La nature même du service fourni par ce type d’entreprise, qui repose sur une allocation permanente et en temps réel des espaces, rend totalement inapplicables les dispositions de la « loi Sapin ».
Afin de remédier à cette difficulté, l’ensemble des acteurs concernés ont été réunis au sein d’un groupe de travail, à l’initiative du Gouvernement, afin d’élaborer des propositions concrètes permettant d’élaborer un cadre juridique adapté. Prenant acte de ce travail, la commission spéciale a ainsi tenu à préciser que les modalités d’application des dispositions de transparence de la « loi Sapin » au secteur de la publicité numérique seraient définies par décret en Conseil d’État. Il s’agit ainsi de laisser se poursuivre la concertation, tout en consacrant dans la loi le principe d’une réglementation à venir.
La commission en vient à l’amendement SPE762 de M. le président François Brottes.
M. le président François Brottes. La loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », a fixé les règles de transparence applicables au secteur de la publicité. Cet amendement vise à l’étendre à la publicité sur internet – moyen de communication qui n’existait pas encore en 1993. De nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques sont nés, mais les règles du jeu doivent valoir pour tous ; or, aujourd’hui, elles s’appliquent de façon très inégale. Ce modeste amendement précise donc que la régulation concerne tous les supports, quels qu’ils soient.
M. le ministre. Le Gouvernement a engagé sur ce sujet une concertation, menée dans le cadre du Conseil national du numérique. Vous avez bien rappelé la situation : il existe aujourd’hui un défaut de régulation. Les premiers échanges ont montré l’existence d’un accord pour garantir un fonctionnement transparent du marché publicitaire en ligne comme hors ligne, mais les modalités de mise en œuvre de ces règles seront forcément plus complexes que celles prévues par la « loi Sapin ». Il nous faut prendre en considération ce travail en cours, mais qui devrait aboutir rapidement, sur l’adaptation des obligations de transmission d’informations – de reporting en anglais.
Je vous propose donc, monsieur le président, de rectifier votre amendement en ajoutant les paragraphes suivants :
« 2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président François Brottes. J’accepte votre proposition, tout en soulignant qu’il est urgent d’agir : des travaux sont en cours, je le sais bien, mais les dérapages sont très nombreux.
M. le ministre. Je partage votre volonté d’aller vite, et c’est pourquoi je suis favorable à cet amendement, comme je l’ai déjà été à plusieurs amendements précédents, conformément à la désormais célèbre « jurisprudence Brottes ». Mais nous devrons aussi prendre en compte les conclusions de la concertation en cours. Vous mettrez ainsi la pression sur le Gouvernement...
M. le président François Brottes. Dans la jurisprudence à laquelle vous faites allusion, j’ai toujours considéré qu’il valait mieux s’accrocher à des textes inscrits à l’ordre du jour qu’à des textes qui n’y étaient pas encore. »
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je craignais de faire du « Brottes moins » en émettant un avis défavorable, car cet amendement pourrait avoir des conséquences défavorables pour des entreprises françaises spécialisées dans le ciblage de la publicité. Il ne faut pas les fragiliser ; certaines sont de belles réussites, puisque l’une d’entre elles a levé l’an dernier 250 millions de dollars auprès du NASDAQ. Mais compte tenu de la proposition du ministre, nous resterons attractifs dans ce domaine majeur. Avis favorable.
M. Olivier Carré. L’économie numérique vient en effet bousculer des secteurs déjà installés depuis très longtemps. Il faut donc veiller aux distorsions de concurrence – c’est vrai – mais cette situation pourrait aussi nous amener à poser la question de la pression fiscale et de la réglementation qui pèsent lourdement sur les secteurs économiques traditionnels.
Certains modèles économiques dans le secteur de l’internet ne reposent aujourd’hui que sur la publicité : la publicité, les contenus même, les services sont alors intimement liés, ce qui donne à l’utilisateur une sensation de gratuité, mais qui donne un rôle inconnu jusqu’ici à la publicité.
Il faut enfin tenir compte des distorsions de concurrence entre les entreprises installées en France – qui tomberont, si nous vous suivons, sous la coupe de la « loi Sapin » – et les autres. Or, pour celui qui est derrière son écran, la différence entre les premières et les secondes est tout sauf facile à établir. Aujourd’hui, tous les législateurs, notamment européens, cherchent donc plutôt à harmoniser les règles, afin de mettre en place un environnement juste, ce qui est votre objectif.
Des expertises approfondies sont donc tout à fait nécessaires. Je soutiens fortement l’initiative French Tech du Gouvernement, qui concerne de nombreuses entreprises, qui ne sont plus seulement des start-up, comme l’a rappelé notre rapporteur thématique. Il faut donc y regarder à deux fois avant de modifier le cadre réglementaire, et plus encore pour la publicité qui est, je le redis, au cœur des modèles économiques d’aujourd’hui.
M. le président François Brottes. Je remercie le ministre de sa proposition et le rapporteur thématique de sa compréhension. Né moi-même un peu avant l’ère numérique, je constate que l’on a organisé la régulation du secteur des télécommunications au sens large comme si nous étions seuls au monde, comme s’il n’y avait pas de convergence entre internet et télévision. Or, tout, désormais, est sur tous les supports ; mais certains doivent appliquer une règle du jeu ancienne, quand d’autres vivent avec des modèles économiques très performants mais sans ces règles. Il faut donc une harmonisation.
Le marché de la publicité n’est pas infini : le monde nouveau doit pouvoir prendre son envol, mais on ne doit pas tuer pour autant le monde ancien. Il est donc urgent d’agir et de remettre à plat notre réglementation. J’entends qu’une concertation est en cours, mais elle ne doit pas concerner que le secteur numérique : tout le monde doit être autour de la table pour mettre au point de nouvelles règles du jeu qui ne plombent pas le modèle ancien, sans entraver le développement du nouveau.
M. le ministre. Monsieur Carré, il y a aujourd’hui une ambiguïté juridique sur l’applicabilité de la « loi Sapin » au secteur numérique, certains juristes considérant qu’elle doit d’ores déjà s’appliquer. La rectification que j’ai proposée clarifie la situation et sécurise l’environnement législatif en renvoyant les modalités d’application de la « loi Sapin » à un décret en Conseil d’État. Le secteur numérique présente des spécificités fortes, dont il faut tenir compte, afin de préserver sa compétitivité.
Nous voulons réussir à corriger deux déséquilibres potentiels : celui qui existe entre l’économie classique et l’économie numérique ; celui qui existe entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères, comme vous l’avez souligné à juste titre. Nous voulons que nos grandes comme nos petites sociétés continuent de se développer. Le décret prendra en considération tous ces aspects. De plus, un travail de cadrage est mené au niveau européen. En attendant, nous sécurisons l’environnement législatif.
M. le président François Brottes. Notre débat éclaire les choses et montre qu’il y a du travail à faire, tout en soulignant l’urgence de clarifier la situation. Encore une fois, le marché de la publicité n’est pas infini. Il faut trouver les bons équilibres.
La commission adopte l’amendement SPE762 tel qu’il vient d’être rectifié.
*
* *
Article 33 octies [nouveau]
(art. 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)
Reconnaissance dans la loi des agences de développement
de l’économie sociale et solidaire
Introduit à l’initiative du groupe écologiste, et contre l’avis du rapporteur thématique, cet article vise à reconnaître dans la loi la possibilité pour les régions de recourir à des agences de développement par le biais d’une contractualisation. Cette possibilité est ainsi inscrite à l’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Le rapporteur thématique a émis un avis défavorable à l’insertion de cet article pour deux raisons.
Premièrement, il lui semble inopportun d’inscrire dans la loi qu’une collectivité a la possibilité de réaliser une action quelconque. En effet, rien n’interdit à ce jour aux régions de contractualiser avec des agences de développement pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire.
Secondement, cette disposition, qui avait été introduite dans le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire à l’occasion de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, avait par la suite était supprimée en commission mixte paritaire à l’initiative du Sénat.
Néanmoins, la commission spéciale a considéré qu’une telle disposition permettait de consacrer le rôle des agences de développement, et a ainsi tenu à reconnaître explicitement leur participation à l’essor de l’économie sociale et solidaire dans la loi.
*
* *
La commission se saisit ensuite de l’amendement SPE1410 de Mme Michèle Bonneton.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous souhaitons aider à créer de l’activité et de la croissance durable – c’est-à-dire de la croissance sans doute pas au sens où l’entend le ministre, mais une croissance respectueuse des ressources, de l’environnement, de l’emploi et des gens. Non, la destruction de l’environnement et l’économie mondialisée dont M. Macron se fait le chantre ne sont pas la seule solution qui s’offre à nous. Il en existe une qui marche très bien, peut-être plus modeste, mais qui n’est plus marginale puisqu’elle représente parfois jusqu’à 8 % à 10 % des emplois dans nos territoires : l’économie sociale et solidaire, que M. Hamon a très bien encouragée par sa loi.
Pour aller plus loin, nous proposons d’inscrire que les régions peuvent avoir recours à des agences de développement ; ces outils ont prouvé leur efficacité là où ils existent, ce qui avait été reconnu lors de la discussion de la « loi Hamon ». Cette disposition avait été votée en première et deuxième lectures, mais elle a disparu lors de la commission mixte paritaire.
M. le ministre. Ce Gouvernement a en effet reconnu fortement l’importance de l’économie sociale et solidaire. J’ajoute – pour essayer de vous convaincre, sans espérer y réussir, que je ne suis peut-être pas totalement mauvais ni entièrement mû par des intentions néfastes – que l’économie sociale et solidaire fait partie de mon portefeuille ministériel et que je lui accorde beaucoup de mon temps, votre collègue Blein pourrait en témoigner.
Sur le fond, la reconnaissance de ces agences peut être une bonne chose, mais l’argument qui a prévalu est qu’elles n’existent pas dans toutes les régions : cette disposition a, comme vous l’avez dit, disparu du texte issu de la commission mixte paritaire. Je m’en remets donc à la sagesse des parlementaires.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le fond de l’amendement ne pose pas problème, mais je m’interroge sur la méthode. Ce point a fait l’objet tout récemment d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat. J’ai peu d’expérience des usages parlementaires, mais le procédé ne me paraît pas opportun. Avis défavorable.
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous avons d’autant moins de réserves sur le fond que je ne vois pas pourquoi les régions auraient besoin d’être autorisées à recourir à des agences de développement. S’il faut préciser dans la loi tout ce que l’on a le droit de faire, il va falloir ouvrir quelques séances supplémentaires, monsieur le président ! Écrit-on la loi pour se rassurer ? Cela étant, nous ne nous opposerons pas à l’adoption de cet amendement.
M. Jean-Louis Roumegas. L’Assemblée nationale n’avait pas, en première puis en deuxième lecture, voté cette disposition pour des raisons frivoles : il s’agissait de sécuriser juridiquement ces agences, parfois contestées dans les territoires. Cet amendement n’est donc pas inutile, et je remercie M. le ministre de son avis de sagesse.
M. Jean-Yves Caullet. Je comprends l’argument du rapporteur, mais il serait dommage de laisser passer l’occasion d’exprimer sa sagesse... En adoptant l’amendement, nous enverrons un signal politique, quitte à revoir tout cela précisément d’ici à la séance publique.
M. Olivier Carré. Tout cela est très sympathique, mais vous donnez encore des moyens à de nouvelles structures. Comment seront-elles financées, qui recruteront-elles ? D’un côté, on cherche à clarifier le droit et à favoriser la croissance et tout le monde se plaint du manque de lisibilité de l’action publique du fait de la multiplication des intervenants ; de l’autre, on inscrit dans le marbre des structures qui existent déjà et dont l’intérêt est très relatif. C’est de la schizophrénie !
M. le rapporteur général. Ce qu’a dit le rapporteur thématique est juste. Il s’agit d’ouvrir aux régions la faculté de contracter avec des agences de développement, alors même que ce sont plutôt les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire qui structurent ce secteur. Mais, après tout, pourquoi ne pas donner à celles qui le souhaitent cette possibilité supplémentaire ? Il ne me paraît donc pas nécessaire de s’opposer à l’adoption de cet amendement.
M. le président François Brottes. Un certain Pierre Mazeaud considérerait qu’une telle mesure n’a rien à faire dans un texte de loi, mais l’époque change, les signaux politiques comptent...
M. Patrick Hetzel. Ce serait effectivement du bavardage législatif. Cela ne me paraît pas raisonnable.
La commission adopte l’amendement SPE1410.
*
* *
Article 33 nonies [nouveau]
Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte
À l’initiative de M. Arnaud Leroy, un amendement portant article additionnel a été adopté par la commission spéciale en vue de prévoir la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte.
La France, et particulièrement les secteurs de la croissance verte, souffrent en effet d’un manque structurel d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui constituent pourtant un rouage essentiel de l’activité économique. Les ETI ont la taille et la crédibilité nécessaires pour mettre les filières en mouvement, que ce soit en servant d’« aiguillons » auprès des acteurs de grande taille, ou en facilitant l’accès des plus petits aux marchés. Un certain nombre d’initiatives ont été lancées afin de favoriser la constitution d’ETI, principalement dans le secteur numérique et les technologies avancées de production. Aujourd’hui, il est temps de soutenir l’éclosion d’ETI dans les secteurs de la croissance verte.
Le rapport demandé par le présent article permettra sans nul doute d’identifier des pistes concrètes d’action afin d’atteindre cet objectif.
*
* *
La commission examine ensuite, en présentation commune, les amendements SPE542 et SPE543 de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Ces deux amendements portent sur les éco-PME, qui sont 10 000 sur notre territoire. Elles rencontrent aujourd’hui les mêmes difficultés que les autres petites entreprises, mais aussi d’autres qui sont spécifiques au secteur de l’économie verte : forte insécurité juridique, frilosité des investisseurs, encore renforcée par les mésaventures du secteur photovoltaïque, intense compétition des champions historiques.
Ces deux amendements tendent donc à demander des rapports sur la façon dont le Gouvernement pourrait apporter son soutien à ces éco-PME. Nous avons dans ces secteurs des PME qui grossissent, et qui sont à l’orée de devenir ces fameuses ETI dont nous rêvons tous. Il faut les soutenir. Il s’agirait d’écrire une courte feuille de route des initiatives à prendre pour doper ce secteur : je ne demande pas un énième rapport d’évaluation qui viendrait caler une table, une armoire, voire un billard pour les plus fortunés d’entre nous.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Ou pour les moins cultivés !
M. le ministre. La facilité voudrait que l’on accepte toutes les demandes de rapport... Il ne faut néanmoins pas les multiplier, car nous y perdrions en crédibilité.
Les entreprises que vous évoquez sont concernées par plusieurs initiatives du Gouvernement, au premier rang desquels les trente-quatre plans industriels, dont dix ciblent ce secteur. Il n’est pas inutile, cependant, de faire avec le Parlement un point d’étape sur le développement des PME et ETI liées à la croissance verte, dans un délai raisonnable qui permettre d’examiner par la même occasion les premières conséquences des plans industriels et de la loi sur la transition énergétique.
Je propose le retrait de l’amendement SPE542 et j’émets un avis favorable à l’amendement SPE543.
M. Arnaud Leroy. Je vous remercie cet avis favorable et je retire donc l’amendement SPE542. Je n’ai pas déposé ces amendements pour me faire plaisir ; ils découlent des discussions que j’ai eues avec de nombreux acteurs du secteur des éco-PME. Nous avons déjà un comité stratégique de filières éco-industries ; parallèlement, de nombreuses structures ad hoc se sont constituées à l’initiative d’opérateurs privés. L’attente – je vous l’assure – est bien réelle. Cette question doit être traitée sérieusement, et séparément de celle des grands plans industriels : il faut identifier très finement les besoins de ces acteurs.
L’amendement SPE542 est retiré.
M. Alain Tourret. Serait-il possible de savoir combien de rapports doivent être rendus au Parlement ? Combien coûtent ces rapports ?
M. le président François Brottes. Certains disparaîtront d’ici au vote final de la loi...
La commission des affaires économiques dispose d’une liste de tous les rapports demandés depuis le début de la législature, que nous affichons sur les écrans de notre salle de réunion lorsqu’un membre du Gouvernement est entendu. Nous en attendons toujours un certain nombre...
Sur le fond, je me demande si nous ne devrions pas demander à la Banque publique d’investissement (BPI) de faire le point sur son action.
M. Arnaud Leroy. Une mission d’information commune sur la BPI vient de débuter ses travaux. Nous regarderons ce point.
Je précise de nouveau que mon amendement se borne à demander une feuille de route, un kit de solutions, et non un énième bilan. Les besoins sont réels.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement SPE543.
M. Jean-Christophe Fromantin. C’est un sujet très intéressant : l’examen de l’effet d’entraînement des politiques environnementales sur l’économie d’un pays révèle de vraies surprises. Vous avez tous eu connaissance, il y a quelques mois, d’un rapport sur les incidences de la croissance verte pour l’économie américaine : il montrait bien l’absence de corrélation entre une politique environnementale plutôt tiède et la forte progression d’entreprises innovantes dans ce secteur. C’est sur l’effet d’entraînement d’un cadre normatif de plus en plus exigeant qu’il faut se pencher.
Si nous voulons pouvoir diminuer nos subventions, nous devons permettre la création d’entreprises innovantes de plus en plus efficaces. Le rapport demandé par Arnaud Leroy pourrait permettre de se demander si nos politiques, nationales et européennes, ont réellement un effet d’entraînement sur l’innovation des entreprises du secteur de l’environnement.
M. Olivier Carré. J’observe pour ma part que les résultats des investissements d’avenir doivent nous inviter à la prudence dans nos conclusions, en gardant en tête le contexte économique général dans lequel évoluent les entreprises.
Sur le fond, demander des rapports au Gouvernement, c’est bien ; mais l’Assemblée nationale dispose en la matière de pouvoirs aussi larges que peu utilisés. Libre à nous de nous saisir par de ces questions pertinentes. Je fais cette remarque dès que l’on demande un rapport...
La commission adopte l’amendement SPE543.
Elle se saisit ensuite de l’amendement SPE1018 de M. Jean-Yves Caullet.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement, certes un peu technique, concerne la norme IPv6. C’est essentiellement un amendement d’appel. Une adresse IP (Internet protocol address) est attribuée à tout appareil connecté à un réseau informatique qui utilise ce protocole. On utilise aujourd’hui les adresses IPv4, c’est-à-dire la quatrième version de cette norme ; la norme IPv6, autrement dit sixième version, permet d’attribuer un nombre d’adresses beaucoup plus important. Or, la pénurie d’adresses IPv4 menace, en raison de l’explosion du nombre d’appareils connectés.
L’amendement propose donc de rendre obligatoire pour tous les appareils loués ou vendus sur notre territoire la capacité d’utiliser la norme IPv6. L’attente chez les acteurs du secteur est forte, et j’ai déjà interpellé par diverses voies le Gouvernement sur ce sujet à plusieurs reprises. Pour soutenir l’innovation et le développement de l’économie numérique, la France doit se saisir de cette question.
Je n’ignore pas que nous sommes plutôt ici dans le domaine du droit européen, et d’ailleurs aussi dans le domaine réglementaire. Mais il est important que le Gouvernement envoie un signal fort ou, à tout le moins, s’engage à travailler sur cette question. Une fois de plus, nous devons agir en amont, sans attendre la pénurie d’adresses IPv4 pour nous réveiller. Beaucoup de pays ont déjà pris leurs précautions ; des organisations internationales tirent la sonnette d’alarme. Une réflexion sur ce sujet, certes technique, est essentielle pour l’innovation.
M. le ministre. Nous souscrivons à l’ambition de cet amendement : c’est tout à la fois une nécessité sur le plan technologique et industriel et un élément de compétitivité de notre économie. Néanmoins, comme vous l’indiquez, cela relève davantage du droit communautaire. Je m’engage à saisir formellement la Commission européenne de cette question dans les plus brefs délais, afin d’avancer dans le cadre de l’Agenda numérique pour l’Europe. Nous avons d’ailleurs déjà engagé ce débat, majeur pour nos industriels. Je vous transmettrai la réponse dès que je la recevrai.
Je propose donc le retrait de cet amendement.
Mme Corinne Erhel. Je vous remercie de cette réponse.
L’amendement SPE1018 est retiré.
*
* *
Section 2
Améliorer le financement
Article 34
(art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts, L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale et L. 225-197-1 du code de commerce)
Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites
Le dispositif d’attribution d’actions gratuites, mis en place par l’article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, permet aux sociétés par actions cotées ou non cotées d’attribuer, sous certaines conditions, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux.
Ce dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2005. D’après le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, son coût fiscal est évalué à 33 millions d’euros en 2013, sans qu’un chiffrage ne soit prévu en 2014 ou 2015.
D’après l’étude d’impact de cet article, son coût devrait être de 75 millions d’euros en 2015, de 191 millions d’euros en 2016 et de 125 millions d’euros en 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le dispositif d’attribution d’actions gratuites fait l’objet d’un encadrement législatif en trois volets :
– le code de commerce encadre les conditions dans lesquelles une société peut décider de l’attribution de telles actions ;
– le code général des impôts traite de l’imposition des actions ainsi attribuées, en distinguant l’avantage initial lié à cette attribution (ou gain d’acquisition), la plus-value éventuelle liée à leur cession et le versement des dividendes qui peut en résulter ;
– le code de la sécurité sociale fait peser sur l’avantage initial lié à ces attributions des prélèvements sociaux spécifiques.
Ces trois volets sont aménagés dans le cadre du présent article.
A. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES ACTIONS GRATUITES
Les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce prévoient un cadre législatif destiné à garantir que les opérations d’attribution d’actions gratuites (AGA) sont réalisées en toute transparence et en associant l’ensemble des organes de décision de l’entreprise concernée :
– une AGA doit en premier lieu être autorisée par une assemblée générale extraordinaire éclairée par un rapport du conseil d’administration ou du directoire et un rapport spécial des commissaires aux comptes. L’AGA peut concerner l’ensemble des salariés ou seulement une partie d’entre eux ;
– l’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être ainsi attribué. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut toutefois excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire, ou 15 % pour les entreprises répondant à la définition européenne de petite ou moyenne entreprise. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société ;
– l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq ;
– l’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions et ne peut être inférieure à deux ans ;
– le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié. Toutefois, il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution d’actions gratuites ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social ;
– un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des suites de l’AGA, notamment la valeur des actions attribuées aux mandataires sociaux ou aux salariés ;
– dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées gratuitement que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
1° La société procède à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ;
2° La société procède à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ;
3° Un accord d’intéressement, un accord de participation ou un accord de participation volontaire est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales.
B. LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES
L’attribution d’actions gratuites est susceptible de générer quatre types de revenus différents, qui font chacun l’objet d’un traitement fiscal particulier :
– l’avantage initial résultant de l’attribution de l’action gratuite, aussi appelé « gain d’acquisition » est actuellement pris en compte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
– la plus-value liée à la cession de telles actions est prise en compte dans la catégorie des plus-values mobilières, dont les conditions d’abattement pour durée de détention ont été réformées à plusieurs reprises ces dernières années ;
– les produits financiers liés à ces actions, ou dividendes, sont pris en compte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
– l’indemnité compensant la renonciation ou la perte des actions gratuites en cours d’acquisition est prise en compte dans la catégorie des traitements et salaires.
1. L’avantage initial ou gain d’acquisition
Le régime fiscal applicable au gain d’acquisition d’actions gratuites décrit ci-dessous est réservé aux opérations répondant aux conditions posées par le code de commerce.
À défaut, les avantages qui résultent pour les salariés ou les mandataires sociaux concernés de l’attribution d’actions gratuites constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun. Ce gain est imposé au titre de l’année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises par le bénéficiaire.
Les règles de droit commun des traitements et salaires sont également applicables en cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce qui ne sont pas conservées pendant la période de conservation prévue par le plan lorsqu’elle est supérieure à deux ans.
Lorsque les règles d’attribution des actions gratuites mentionnées précédemment sont respectées, deux régimes fiscaux sont susceptibles de s’appliquer, au titre de l’impôt sur le revenu, selon que l’attribution des actions gratuites a eu lieu avant ou après le 28 septembre 2012.
Les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 bénéficient d’un régime spécial d’imposition qui se traduit par un double avantage consistant en l’imposition du gain d’acquisition à un taux proportionnel de 30 % et au titre de l’année de cession des actions. Ce régime est toutefois soumis à la condition que les actions attribuées aient été conservées, sans être données en location, pendant une période minimale de deux ans à compter de leur acquisition définitive.
Les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 bénéficient uniquement d’une imposition du gain d’acquisition décalée à l’année de cession des actions. En revanche, le gain d’acquisition est imposable au barème de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires sans application, notamment, d’un quelconque abattement pour durée de détention.
2. La plus-value de cession d’actions gratuites
La plus-value résultant de la cession d’actions gratuites, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d’acquisition, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition, est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI).
Contrairement au gain d’acquisition, cette plus-value de cession est susceptible de bénéficier des abattements pour durée de détention prévus par l’article 150-0 D du CGI. Ces abattements ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine restent dus sur la totalité de la plus-value de cession réalisée.
La moins-value réalisée le cas échéant en cas de cession des actions gratuites pour un prix inférieur à leur valeur au jour de l’attribution définitive est déduite du gain d’acquisition. L’abattement pour durée de détention lui est également applicable conformément à l’interprétation de l’administration fiscale.
Les dispositions de la loi de finances pour 2014 en matière de plus-values mobilières (PVM)
Lors des assises de l’entreprenariat au printemps 2013, le Président de la République avait annoncé que « le soutien, la stimulation de l’entreprenariat » constituaient la « quatrième grande réforme » du Gouvernement.
En application de ces annonces, plusieurs dispositions importantes ont été mises en œuvre dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2014 :
– elle s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 ; elle est revenue sur plusieurs dispositions votées en LFI pour 2013, qui n’ont par conséquent jamais trouvé à s’appliquer ;
– elle supprime le prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % mis en place suite aux revendications des « pigeons », mais conserve celui de 19 % applicable aux gains réalisés lors de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ;
– elle supprime le régime d’exonération des plus-values de cession réalisées dans un cadre familial, de même que celui applicable aux jeunes entreprises innovantes ;
– elle supprime également le régime d’abattement pour durée de détention pouvant donner droit à une exonération totale après huit années de détention en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite ;
En contrepartie, les contribuables concernés par ces avantages particuliers bénéficieront d’un abattement pour durée de détention renforcé.
La LFI 2014 introduit deux abattements pour durée de détention :
– un abattement de droit commun applicable aux plus-values soumises au barème, aux FCPR, aux FCPI et aux OPCVM ; l’abattement ne s’applique que si ces organismes de placement collectif emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés ;
Le cadencement de l’abattement est alors de 50 % du montant des gains nets détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession. Cet abattement est porté à 65 % pour les titres détenus depuis au moins huit ans. Le taux d’imposition obtenu après deux ans de détention est ainsi très proche de celui du taux forfaitaire appliqué jusqu’en 2012 (et plus faible que le taux de 24 % fixé en 2012). Le taux obtenu après huit ans (13,46 %) est largement en dessous du taux de 19 % ;
– un abattement majoré en faveur de l’investissement dans les PME, qui s’applique aux PVM pour les PME de moins de dix ans soumises à l’IS ou un impôt équivalent. En compensation de la suppression des régimes particuliers, cet abattement s’applique aussi aux jeunes entreprises innovantes, aux gains réalisés dans un cadre familial et aux gains de cession des droits détenus par un dirigeant de PME partant en retraite.
Le taux de l’abattement est alors très attractif :
– 50 % d’abattement entre un an et quatre ans de détention ;
– 65 % d’abattement entre quatre et huit ans de détention ;
– 85 % d’abattement au-delà de huit ans de détention.
C. LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX PESANT SUR LES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES
Conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les actions attribuées à titre gratuit sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette exonération vaut aussi bien pour les salariés que pour les mandataires sociaux pouvant bénéficier de ces actions affiliés au régime général de sécurité sociale. Elle concerne également les prélèvements dont l’assiette est définie par référence à celle des cotisations de sécurité sociale.
Pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, l’exonération de cotisations est subordonnée à la notification annuelle à l’administration de la sécurité sociale par les entreprises de l’identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. Cette formalité n’étant pas requise pour le bénéfice de l’exonération fiscale attachée aux actions gratuites, son omission ayant pour seule conséquence la perte des exonérations sociales.
1. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
Le gain d’acquisition lié à l’attribution d’actions gratuites est soumis à la CSG et à la CRDS, sans application d’un quelconque abattement pour durée de détention.
Pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012, le gain était soumis aux prélèvements sociaux pesant spécifiquement sur les revenus du patrimoine, sans possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu la CSG correspondante.
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (la CSG au taux de 7,5 % et la CRDS au taux de 0,5 %). À l’impôt sur le revenu, la fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de son année du paiement.
2. Une contribution salariale spécifique depuis 2007
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007, une contribution salariale spécifique prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s’ajoute aux prélèvements sociaux mentionnés précédemment.
Elle pèse sur le bénéficiaire de l’attribution, à condition qu’il relève d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres.
Le taux de la contribution salariale est fixé à 10 % pour les gains de levée d’options et les gains d’acquisition d’actions gratuites pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012. Ce taux était de 2,5 % entre le 22 décembre 2007 et le 21 décembre 2010, puis de 8 % entre le 22 décembre 2010 et le 17 août 2007.
3. Une contribution patronale spécifique depuis 2007
Conformément à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007 sont en outre soumises à une contribution patronale est égale, au choix de l’employeur :
– soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;
– soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire.
Son taux est de 30 % pour les actions attribuées depuis le 18 août 2012. Il était de 14 % pour les actions attribuées avant cette date avec un taux spécifique de 10 % prévu lorsque la valeur annuelle par salarié était inférieure à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l’application de cette cotisation patronale spécifique est exclusive de l’application du forfait social, dont le taux est désormais fixé à 20 %.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article tend à modifier les trois volets juridiques applicables aux attributions d’actions gratuites :
– dans le domaine fiscal, le présent article tend à faire basculer le gain d’acquisition du régime des revenus de capitaux mobiliers vers celui des plus-values mobilières ;
– dans le domaine des prélèvements sociaux, le présent article tend à soumettre ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et adapte les contributions salariale et patronale spécifiques en vigueur ;
– il assouplit les conditions dans lesquelles ces actions gratuites peuvent être attribuées.
A. UN BASCULEMENT VERS LE RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES
Le I du présent article modifie l’article 80 quaterdecies du CGI, afin de soumettre le gain de cession d’une action attribuée à titre gratuit à un régime fiscal plus avantageux.
Actuellement, cet article du CGI indique que ce gain est « imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires », c’est-à-dire au barème de l’impôt sur le revenu sans abattement pour durée de détention mais en bénéficiant d’autres dispositifs, comme le quotient familial.
Désormais, ces gains d’acquisition seront imposés dans la catégorie des plus-values mobilières, qui sont désormais également soumises au barème de l’impôt sur le revenu mais après application des abattements pour durée de détention particulièrement avantageux mentionnés précédemment.
Le 2° du I du présent article précise par ailleurs que les abattements pour durée de détention s’appliquent à compter de la date d’acquisition définitive des actions gratuites. L’article L. 225-197-1 du code de commerce distingue en effet la date d’attribution initiale des actions, la date d’acquisition définitive de ces actions par le salarié au terme de la période dite « d’acquisition » qui est fixée par l’assemblée générale extraordinaire et ne peut être inférieure à deux ans (21) et la durée minimale de l’obligation de conservation également fixée par l’assemblée extraordinaire, pour une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive des actions.
Au total, les actions sont donc indisponibles pendant au minimum quatre années mais les abattements pour durée de détention commencent à courir à compter de l’attribution définitive des actions.
Le 4° du I du présent article précise enfin que ces actions gratuites pourront bénéficier de deux régimes différents d’abattement pour durée de détention :
– celui visé au 1 de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire l’abattement de droit commun de 50 % du montant de la plus-value nette entre deux et huit ans et de 65 % au-delà ;
– celui visé à l’article 150-0 D ter du CGI, qui vise spécifiquement le régime applicable aux cessions de petites et moyennes entreprises par leur dirigeant. Si le dirigeant cède la totalité de ses actions, il bénéficie non seulement d’un abattement de 500 000 euros sur la plus-value réalisée mais il bénéficie en outre (sur la partie de la plus-value excédant 500 000 euros) de l’abattement renforcé prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire 50 % entre un an et moins de quatre ans, 65 % entre quatre ans et moins de huit ans et 85 % au-delà de huit ans.
B. LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
1. La contribution sociale généralisée
Le paragraphe II du présent article conduit par ailleurs à soumettre les gains d’acquisition d’actions gratuites non plus à la CSG pesant sur les revenus d’activité et de remplacement mais à celle pesant sur les revenus du patrimoine.
Ce basculement a pour effet d’en modifier le taux ; en effet, l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux est de 7,5 % pour la CSG pesant sur les revenus d’activité et de remplacement, tandis qu’il est de 8,2 % pour celle pesant sur les revenus du patrimoine.
Ce basculement est en revanche sans effet sur l’application de la déductibilité partielle de la CSG ; en effet, l’article 154 quinquies du CGI prévoit une déductibilité de 5,1 points pour les revenus visés au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel est désormais rattaché un tel gain.
Le basculement vers les prélèvements sociaux pesant sur les revenus du patrimoine et non sur les revenus d’activité a en outre pour effet de faire passer le total de ces prélèvements sociaux de 8 % à 15,5 %.
En effet, les revenus d’activité sont actuellement soumis à la CSG au taux de 7,5 % et à la CRDS au taux de 0,5 % (soit 8 % au total) ; les revenus du patrimoine sont pour leur part soumis à la CSG au taux de 8,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 %, au prélèvement social de 4,5 %, à la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 % et au prélèvement de solidarité de 2 % (soit 15,5 % au total).
2. La contribution patronale spécifique
Le C du II du présent article procède à une adaptation de la contribution patronale spécifique pesant sur les gains d’acquisition d’une action gratuite.
Il prévoit en premier lieu que cette contribution n’est pas due lorsque l’attribution gratuite est décidée par une société qui n’a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création et qui répond à la définition européenne de PME, dans la limite de l’attribution à chaque salarié d’un montant correspondant au plafond de la sécurité sociale.
Il prévoit en deuxième lieu que l’assiette de la contribution est la valeur, à leur date d’acquisition, des actions distribuées. La faculté offerte à l’employeur de choisir entre la juste valeur des actions et la valeur des actions à la date de décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire est donc supprimée dans un souci de simplification.
La référence aux actions effectivement distribuées permet en outre d’éviter que la contribution ne soit due lorsque l’attribution des actions est décidée par l’entreprise mais que cette décision n’est pas suivie d’effet. Dans un arrêt du 7 mai 2014(22), la Cour de cassation a en effet indiqué que, dans une telle hypothèse, l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale indiquait clairement que la contribution restait exigible. Cette difficulté d’application de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale mérite par conséquent être corrigée.
Le présent article prévoit enfin que le taux de la contribution patronale est abaissé de 30 % à 20 %, à condition que ces actions soient attribuées dans le cadre prévu par le code de commerce. Le taux de 30 % reste applicable aux options de souscription d’actions.
3. La contribution salariale spécifique
Le D du II du présent article modifie l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, afin de supprimer la contribution salariale de 10 % applicable aux actions gratuites. Celle-ci reste applicable aux options de souscription d’actions.
C. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ACTIONS GRATUITES PEUVENT ÊTRE DISTRIBUÉES
Le III du présent article apporte au cadre juridique régissant la distribution d’actions gratuites plusieurs assouplissements.
En premier lieu, il modifie la disposition selon laquelle l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. Cette disposition est actuellement applicable quel que soit le pourcentage du capital social mis en distribution (soit au maximum 10 % dans le droit commun ou 15 % dans les PME non cotées, ce pourcentage étant porté au maximum à 30 % lorsque l’attribution concerne l’ensemble des salariés).
Le présent article indique que ce rapport de un à cinq ne s’applique que lorsque le taux du capital mis en distribution est supérieur à 10 % (ou 15 % pour les PME non cotées).
Il prévoit par ailleurs que l’attribution des actions à leur bénéficiaire est définitive au terme d’une période d’acquisition qui ne peut être inférieure à un an, contre deux ans dans le droit en vigueur.
L’obligation de conservation, qui était au minimum de deux ans, devient facultative et sa durée est laissée à l’appréciation de l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Le présent article prévoit enfin que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans, contre quatre ans dans le droit en vigueur.
D. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le IV du présent article prévoit que les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent aux actions gratuites distribuées par une assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Compte tenu du fait que la majorité des attributions sont autorisées dans le courant du mois d’avril ou mai, le présent article risque de ne pas pouvoir s’appliquer aux actions distribuées en 2015. Le rapporteur thématique propose donc de rendre applicable ces dispositions à compter du 1er janvier 2015.
E. LE CHIFFRAGE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Les éléments de chiffrage des conséquences financières de l’article fournies par le Gouvernement sont en partie incomplets, ce qui est regrettable.
D’après l’étude d’impact de l’article, « l’incidence budgétaire globale de la réforme concernant l’impôt sur le revenu n’est pas chiffrable », alors que le basculement du gain d’acquisition des AGA au régime des plus-values mobilières constitue l’une des principales dispositions de cet article.
Le rapporteur thématique appelle l’administration fiscale à ne pas considérer que la barémisation des revenus du capital fait systématiquement obstacle à l’évaluation des mesures nouvelles qui peuvent en affecter le régime ; un an après la stabilisation de cette réforme, il devient de plus en plus opportun d’en évaluer les conséquences y compris à l’occasion de l’examen de mesures nouvelles.
Cette même étude prévoit ensuite que « le coût annuel de la suppression de la cotisation sociale salariale est estimé à 25 millions d’euros. Le coût annuel de la réduction de la contribution sociale patronale est estimé à 100 millions d’euros et à 200 millions d’euros la première année pour tenir compte du décalage d’exigibilité de la contribution sociale patronale. »
Curieusement, il est toutefois précisé qu’il « convient, cependant de préciser que la suppression de la cotisation sociale salariale de 10 % sera en partie compensée par le paiement de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5 % au lieu de la CSG/CRDS sur les revenus du travail au taux de 8 % qui s’applique actuellement au gain d’acquisition ». L’impact du passage de 8 % à 15,5 % des prélèvements sociaux sur l’attribution des actions gratuites, soit presque un doublement du taux, n’est donc pas intégré au chiffrage proposé par le Gouvernement.
Compte tenu de ces deux lacunes majeures, l’étude d’impact propose un coût total estimé à 75 millions d’euros pour l’année 2015, 191 millions d’euros pour l’année 2016 et « 125 millions pour 2017 », dont il faut probablement comprendre qu’il s’agit d’un coût à compter de 2017.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Conformément à l’avis des personnes compétentes auditionnées, le présent article devrait permettre de rendre aux attributions d’actions gratuites leur attractivité, alors que le nombre de ces opérations a eu tendance à baisser ces dernières années.
Au-delà du cadre juridique régissant de telles émissions, qui méritait certainement quelques assouplissements ponctuels, c’est évidemment le poids des prélèvements obligatoires qui a conduit à un tel résultat.
Si l’on fait addition des différents prélèvements qui pesaient, avant la présente réforme, sur de telles attributions, on aboutit mécaniquement à un taux marginal d’imposition de 64,5 % pour l’attributaire de l’action (23). Ce taux marginal d’imposition était fixe dans le temps et il ne prend pas en compte la contribution patronale de 30 %.
Après la réforme, le taux marginal d’imposition est légèrement moins élevé, soit 62 %(24) ; avec la réduction de la contribution patronale, le poids global des prélèvements pesant sur ces opérations est en baisse.
Mais c’est surtout l’application de l’abattement pour durée de détention qui conduira à modérer le taux effectif de prélèvement de manière très sensible dès deux ans de détention.
Pour permettre une entrée en vigueur de ces dispositions dès les AGA opérées au premier trimestre 2015, les rapporteurs ont proposé un amendement permettant l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2015.
IV. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté deux amendements des rapporteurs à cet article :
– le premier amendement vise à prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés, y compris après leur période d’incessibilité dans le calcul de la proportion du capital détenu par les salariés dans la présentation des comptes de l’entreprise ;
– le second vise à anticiper l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2015, afin que ces dispositions puissent s’appliquer aux assemblées extraordinaires qui se tiennent, généralement, dans le premier trimestre de l’année.
*
* *
L’amendement SPE1798 des rapporteurs est retiré.
La commission est saisie de l’amendement SPE805 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE805 propose que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou les grandes entreprises qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l’exonération de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale, que le Gouvernement souhaite accorder aux PME qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création.
Si la volonté des pouvoirs publics est de développer l’actionnariat salarié, il n’y a pas de raison objective à réserver ce dispositif incitatif aux seules PME.
De plus, le critère de non-distribution de dividendes depuis trois ans proposé dans cet amendement est pertinent, car il permet de cibler les ETI et les grandes entreprises qui ont privilégié l’investissement et l’emploi pour préparer leur avenir et renforcer leur compétitivité, de préférence au versement de dividendes aux actionnaires. Aujourd’hui, les entreprises non financières distribuent 85 % de leurs bénéfices en dividendes.
M. le ministre. Une série de mesures dans l’article 34 visent à améliorer le régime fiscal et social des salariés de toutes les entreprises, de manière à le remettre aux standards internationaux. Ainsi, les gains d’attribution et de cession sont imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières, qui avaient elles-mêmes fait l’objet en 2013 d’une réforme prévoyant un abattement progressif en fonction de la durée de détention entre deux et huit ans ; la contribution salariale spécifique est supprimée ; les gains d’acquisition sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ; pour les entreprises, le taux de contribution patronale passe de 30 à 20 %. Bref, le texte améliore substantiellement le droit commun applicable à l’actionnariat salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Au-delà de ces dispositions, le mécanisme est rendu plus incitatif pour les PME. Votre amendement vise à élargir cette incitation, ce que je peux comprendre, mais nos services évaluent son coût fiscal à environ 200 millions d’euros. Il risque également de créer un effet d’aubaine pour certaines entreprises par ailleurs éligibles au reste du dispositif. Je vous invite à le retirer, faute de quoi, pour des raisons de coût, j’émettrai un avis défavorable. Une partie des objectifs énoncés dans votre exposé sommaire est satisfaite par le reste du dispositif proposé.
M. Patrick Hetzel. Je maintiens l’amendement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il est important de réaffirmer l’effort global en faveur de l’actionnariat salarié, mais il faut aussi souligner que le Gouvernement cible volontairement les PME, principales exclues d’un dispositif qui, par ailleurs, a connu une attrition générale du fait de l’évolution des prélèvements.
Soulignons aussi que le dispositif renforce l’attractivité des entreprises à l’embauche. Un cadre de bon niveau ne trouvera pas forcément une PME aussi attrayante qu’une grande entreprise. Grâce à cet article, il sera plus facile aux petites structures de recruter les cadres qui sont nécessaires à leur développement.
Si nous avions les 200 millions requis, je ne serais pas défavorable à un élargissement, mais je crains qu’en l’occurrence nous ne puissions maîtriser les conséquences financières de l’amendement. Le ciblage sur les PME améliore l’équilibre entre les différentes catégories de salariés. On sait que les petites entreprises souffrent d’une fragilité en matière d’actionnariat salarié et d’épargne salariale, mais aussi d’un problème d’attractivité. Il n’y a pas lieu d’être aussi généreux à l’égard des grandes entreprises. Avis défavorable.
Mme Karine Berger. Même si je n’ai pas déposé d’amendement de suppression, je souhaite revenir sur le contenu de l’article 34.
L’objectif, Christophe Castaner l’a indiqué, est que les PME, voire les TPE, mettent progressivement en place des mécanismes d’association de leurs salariés au capital. Ce schéma est assez rare aujourd’hui, bien qu’il soit souhaité par beaucoup de petites structures. Je trouve donc intéressante cette partie de l’article.
Mais le coût pour l’État ne se résumera pas à cela. L’article 34 prévoit non seulement une baisse de la part sociale patronale sur les actions gratuites mais aussi l’alignement de leur fiscalité sur le mécanisme d’imposition des plus-values mis en place après la polémique des « pigeons » à l’automne 2012. En outre, il supprime différents seuils qui visaient à encourager la distribution des actions gratuites aux personnes qui n’en détiennent pas beaucoup.
Bref, l’article 34 ne propose pas autre chose qu’une baisse de l’impôt et des prélèvements sociaux pour les plus gros détenteurs d’actions. J’avoue ne pas comprendre en quoi cela favorisera l’actionnariat des salariés ordinaires ! Ayant travaillé comme moi dans le privé, monsieur le ministre, vous avez eu l’occasion d’observer dans quelle proportion les actions gratuites sont distribuées entre cadres dirigeants et salariés. Si le coût de cet article est évalué à 200 millions d’euros, au moins 100 millions iront aux cadres dirigeants. Cela fait beaucoup d’argent. À titre personnel, je ne saurais approuver cette évolution.
M. Patrick Hetzel. L’avantage de l’article 34 est d’assouplir le régime juridique et les coûts fiscaux et sociaux de l’attribution gratuite d’actions (AGA) aux salariés. Cela pourrait être l’occasion de lancer un chantier plus vaste en matière d’actionnariat salarié. L’argumentation du rapporteur thématique est binaire : il a évoqué les PME, d’une part, les grandes entreprises, d’autre part. Ne pourrait-on au moins étendre le dispositif aux ETI, et quel en serait l’impact budgétaire ?
Beaucoup d’études montrent que la faiblesse structurelle de l’économie française, notamment par comparaison avec l’économie allemande, et l’insuffisance du nombre d’ETI. L’approche du Gouvernement serait-elle différente si la disposition n’était étendue qu’aux ETI ?
M. le ministre. Vous avez précisément décrit l’architecture de l’article, madame Berger. Pour nos entreprises, en particulier les plus innovantes, le régime fiscal et social doit rester compétitif par rapport à nos principaux voisins et à la concurrence internationale. Tel est l’objet de cet article et du suivant : avec les actions de performance et les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, nous traitons un des problèmes qui affectent l’attractivité de nos sociétés et la compétitivité française. Il existe aujourd’hui un grand décalage entre le régime fiscal construit par les réformes de 2011 et 2012 et celui de nos principaux voisins européens.
La question n’est pas ici celle de l’épargne salariale, que nous traitons par ailleurs : permettre un traitement différencié pour les cadres les plus performants relève d’une philosophie de compétitivité que nous assumons dans ce texte. Le régime actuel n’est pas adapté en termes de durée d’acquisition comme en termes de cotisations sociales ou de prélèvements. Je suis sensible à l’argument de l’équité que vous soulevez, mais ce point est traité via l’impôt sur le revenu.
Mme Karine Berger. Je ne le pense pas.
M. le ministre. Cette réforme ne supprime que la contribution salariale spécifique de 10 %, mais elle soumet les gains d’acquisition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elle ramène par ailleurs le taux de contribution patronale de 30 à 20 % à la date d’acquisition, là aussi pour revenir à des standards.
Une des forces de notre économie est d’avoir des grands groupes. On ne peut à la fois dire que l’on a besoin du CAC 40, s’émouvoir à chaque fois qu’une société qui y est cotée est reprise ou décide de délocaliser, et mettre ces groupes dans une situation où ils peuvent de moins en moins attirer leurs grands cadres, compte tenu des effets conjoints de la taxation des actions de performance et – ce que nous assumons – de l’impôt sur le revenu et sur la fortune. C’est pourquoi nous améliorons ce régime tant pour les grandes entreprises que pour les ETI et les PME, qui sont aujourd’hui toutes pénalisées par rapport à nos voisins.
Je veux ensuite lever une ambiguïté sur les éléments de coût. Nous avons estimé le coût des mesures proposées à 75 millions d’euros en 2015, 191 millions en 2016 – 125 plus 66 – et 125 millions en 2017. C’est l’extension de l’avantage accordé aux PME à la totalité des entreprises qui coûterait 200 millions – je ne dispose pas du chiffrage d’une éventuelle extension aux seuls ETI. Nous essaierons de l’établir avant la séance publique. De toute façon, cela représenterait un coût budgétaire additionnel par rapport à l’enveloppe qui m’a été « allouée » pour cette réforme.
L’article 34 consiste à aligner le régime fiscal appliqué aux attributions gratuites d’actions, comme nous l’avons fait en 2013 pour les plus-values mobilières. On peut, bien entendu, décider d’une surfiscalisation, mais on se heurtera alors à un problème de financement et d’attractivité. Je pense que la question de la justice sociale est traitée par les réformes que nous avons menées en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Nous avons observé à de nombreuses reprises que la surfiscalisation aboutissait finalement à de moindres rentrées d’argent.
La cotisation patronale est passée de 10 % en 2007 à 14 % en 2011 et 30 % en 2012. Les gros détenteurs, madame Berger, voient aussi leur imposition s’élever puisque nous avons intégré cette ressource dans le barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le taux moyen de fiscalisation des AGA est en moyenne de 64,5 %. Du coup, la distribution d’AGA a fortement chuté, ce qui pose un réel problème d’attractivité pour nos entreprises. Ajoutons à cela qu’il est difficile, pour une entreprise, d’acquitter une fiscalité de 30 % sur des actions qui ne sont susceptibles de générer des revenus que deux ans après.
Il faut donc trouver le point d’équilibre entre une fiscalité juste et la préservation d’un dispositif dont nous pensons qu’il est pertinent. Permettre aux salariés d’être actionnaires de leur entreprise et de contribuer de façon citoyenne à son bon fonctionnement et au partage de ses ressources va plutôt dans le bon sens. Or, les observateurs que nous avons auditionnés – y compris les représentants des salariés – le reconnaissent : ce point d’équilibre est trouvé. La proposition du Gouvernement établit le niveau de fiscalisation juste qui permet d’atteindre un double objectif : encaisser une recette fiscale et activer un dispositif que les hauts niveaux de fiscalité ont éteint, chassant les salariés de l’actionnariat. Les AGA, j’y insiste, sont un dispositif sain.
Mme Karine Berger. Je voudrais revenir sur ce taux de 64,5 %. Nous avons déjà eu ce débat presque mot pour mot en novembre 2012 au sujet de la taxation des plus-values et autour de l’idée noble qu’un euro gagné via le capital doit être taxé de la même façon qu’un euro gagné par le travail. En l’espèce, si le taux atteint ce niveau, c’est que la personne est dans la tranche correspondante.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La tranche supérieure est de 45 %.
Mme Karine Berger. Je ne l’ignore pas : de fait, la personne bénéficie de revenus élevés. Que ces revenus élevés soient taxés au taux maximal me semble être dans la nature de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, monsieur le ministre, il est bien précisé dans l’exposé des motifs que les gains de cession sont alignés sur la fiscalité des plus-values telle qu’issue de la « révolte des pigeons », à ceci près que le système en vigueur prévoit une durée de détention de six ans avant l’enclenchement des abattements. Sauf erreur de ma part, l’article 34 réduit à deux ans la durée de détention obligatoire des AGA, alors que la précédente réforme visait à inciter la détention du capital à long terme...
Je n’arrive pas à comprendre si cet article vise les start-up ou les grands groupes. S’il vise les premières, il faut absolument maintenir la limitation de détention de 10 % du capital. Comment se fait-il que, dans le même article, on abaisse la durée de détention obligatoire et on fasse sauter le seuil de 10 %, seuil qui permettait précisément de s’assurer que le mécanisme des AGA était appliqué aux salariés et pas aux seuls cadres dirigeants ? Sur les 191 millions de coût budgétaire prévu pour 2016, quelle sera la concentration sur les cadres dirigeants des grandes entreprises ? Je pense que cela représentera la plus grosse partie !
Enfin, on aura beau philosopher sur les prélèvements sociaux, il n’en reste pas moins que ceux-ci continuent de financer la sécurité sociale. Chaque fois qu’on abaisse un taux, on abaisse du même coup le financement.
M. le président François Brottes. Comparaison n’est pas raison, mais il n’est pas interdit d’examiner comment nos entreprises se situent dans la guerre mondiale économique.
Mme Karine Berger. Vous voulez nous comparer à Singapour, peut-être ?
M. Olivier Carré. Je suis heureux de retrouver dans la bouche de certains collègues de la majorité des arguments que nous avions soulevés en juillet 2012. Certes, plusieurs taux avaient déjà connu une hausse antérieure, mais les excès auxquels on a abouti ont fini par contrarier les espérances mêmes de recettes fiscales.
Sur la forme, monsieur le ministre, n’avait-il pas été convenu que toute modification du code général des impôts devait désormais passer par une loi de finances ?
M. le président François Brottes. C’était une convention, non une obligation.
M. Olivier Carré. Cela ne m’avait pas échappé, monsieur le président ! Mais le principe était sage. Une approche globale permettrait de mieux répondre à des questions telles que celles que pose Karine Berger, et il serait intéressant de recueillir l’avis de ceux de nos collègues qui ont beaucoup travaillé sur l’impôt sur le revenu et qui ne siègent pas tous dans cette commission spéciale.
S’agissant des ETI, le problème est bien celui de la concurrence en matière de recrutement de cadres commerciaux, d’ingénieurs, de dirigeants. Les ETI ont ceci de commun avec les PME que leurs zones de recrutement et leurs centres de décisions sont généralement hexagonaux. Les grands groupes, de leur côté s’adaptent à la concurrence internationale en s’implantant dans les pays où ils pensent avoir intérêt à le faire, et pas seulement pour des raisons fiscales : pour y trouver des compétences, des zones commerciales, etc. Dans ce contexte mondial, il est inutile de s’engager dans la course au moins-disant fiscal.
Je pense donc que nous devons poser la question de l’extension du dispositif aux ETI, en mesurant, évidemment, le coût que cela représenterait.
M. le ministre. Le point de forme que vous soulevez, monsieur Carré, renvoie à une circulaire prise par le Premier ministre en 2012. En l’occurrence, le Premier ministre a décidé, en accord avec le ministre des finances et le secrétaire d’État au budget, d’y déroger afin que l’on puisse intégrer dès maintenant ces éléments fiscaux dans la limite d’une certaine enveloppe – ce qui me contraindra à être peu ouvert à des propositions d’extension.
Quant au régime des plus-values mobilières, madame Berger, il est issu d’une concertation menée pendant plusieurs mois par Mme Fleur Pellerin lors des Assises de l’entrepreneuriat, et non de la pression de tel ou tel lobby. Ce n’est nullement la « réforme pigeons », c’est une vraie réforme, longuement mûrie par les services de l’État avec les entrepreneurs – qui ne sont pas une race indigne ! – dans l’intérêt de l’économie française, défendue par le Gouvernement et votée par cette majorité.
Si nous ramenons à deux ans la limite de durée s’agissant des plus-values mobilières, c’est parce qu’il s’agit de cadres et d’employés, et non d’actionnaires. Ce qui a motivé cette réforme travaillée par les services de Bercy dans la concertation, c’est un élément de comparaison – que nous n’avons d’ailleurs pas à chercher jusqu’à Singapour !
Le système actuel fait qu’un salarié soumis au taux supérieur de l’impôt sur le revenu est taxé à 96 % sur les actions de performance et l’entreprise à 38,75 %, après détention de deux ans. Au Royaume-Uni, aucun dispositif n’est soumis à délai. En Allemagne, le taux appliqué à la plus-value de cession est de 26 %. Bref, il est évident que nous ne sommes plus compétitifs par rapport à l’écosystème qui nous entoure. Ces mesures ne visent qu’à nous remettre dans la norme, et je tiens à votre disposition tous les chiffres sur lesquels repose notre analyse.
Conformément à votre souhait, je demanderai aux services du ministère des éléments sur la ventilation du coût.
Plus généralement, je veux souligner que le Gouvernement a œuvré pour l’équité fiscale en soutenant plusieurs réformes très fortes en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d’impôt de solidarité sur la fortune. Il a mis en place de puissants outils de redistribution. Si nous voulons combiner cet objectif de redistribution et l’objectif du présent dispositif, nous ne pouvons souscrire à des doublons fiscaux. Ce serait faire fi de l’environnement économique international dans lequel nous évoluons.
Dans le dispositif existant, les stock-options n’existent plus et les actions de performance sont en voie d’extinction. On peut décider d’augmenter encore les taux parce que cela paraît plus juste, mais je rappelle que les éléments indicatifs de coût budgétaire sont théoriques : ils partent de l’hypothèse d’une base inchangée. Si notre réforme a l’effet incitatif que nous recherchons, les entreprises utiliseront davantage le dispositif, ce qui créera un effet volume qui minorera d’autant le coût budgétaire.
Si l’on s’en tient à une vision statique de nos régimes fiscaux et sociaux, on trouvera toujours préférable d’augmenter les taux au maximum. Mais le raisonnement ne tient pas ! La logique que j’assume est une logique de compétitivité et d’alignement des taux par rapport au pays voisins. Elle s’appuie sur un travail technique et sur la concertation. Je m’engage à ce que les services vous transmettent les réponses supplémentaires qu’il est possible d’obtenir.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Une fiscalité est utile lorsqu’elle rapporte. Fiscaliser les stock-options à 100 % ne changerait pas grand-chose à la ressource fiscale !
Pour ce qui est des grandes entreprises, la proposition du Gouvernement consiste simplement à abaisser le taux de cotisation de 30 à 20 %. Sur une période de cinq ans, donc, ce taux aura doublé au lieu d’avoir triplé. On ne peut pas parler de cadeau aux grandes entreprises...
Un réel effort est en revanche consenti en faveur des PME, puisque le taux passe de 30 à 0 %. Nous retrouvons là les engagements du Président de la République, qui souhaitait une fiscalisation différenciée en fonction de la taille des entreprises.
Je précise aussi que le régime précédent imposait une durée d’incessibilité de deux ans et une durée de conservation de deux ans. Le texte ne prévoit plus qu’un délai de deux ans, sachant que les assemblées générales extraordinaires peuvent décider d’aller au-delà. Les AGA étant une incitation au maintien des cadres, en particulier dans les PME, je suis convaincu que la durée de détention sera souvent prolongée.
En outre, par un effet d’assiette, le nouveau dispositif devrait rapporter davantage que la taxation trop élevée qui prévaut actuellement.
Enfin, la différence entre le taux total de fiscalisation avancé par le ministre et le mien s’explique par le fait que j’avais retenu une tranche d’impôt sur le revenu inférieure à 45 %.
Mme Karine Berger. Il est un peu facile, lorsque l’on défend la réduction d’un taux, d’arguer que le même taux porté à 100 % ne rapporterait plus rien ! Jamais je n’ai parlé d’une augmentation des taux. Et permettez-moi de douter qu’une course au 0 % de taxation sociale et fiscale ne se traduise pas, en définitive, par quelques pertes ! La commission des finances sera en tout cas très heureuse d’apprendre que la France, dans le cadre de son programme de stabilité, doit d’ores et déjà renoncer à 191 millions d’euros en 2016 !
M. Olivier Carré. Le Gouvernement a bien trouvé 3,6 milliards en quinze jours !
La commission rejette l’amendement SPE805.
Elle en vient à l’amendement SPE1800 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit de prendre en compte les AGA après leur période d’incessibilité dans le pourcentage des actions détenues par les salariés. On résout ainsi la question de la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, dès lors que le salarié reste dans l’entreprise.
M. le ministre. La proportion des actions souscrites par les salariés ou attribuées à ces derniers est communiquée à l’assemblée générale dans le cadre du rapport annuel. La mesure proposée n’est pas anodine dans la mesure où elle modifie les conditions de dépassement de seuil déclenchant l’obligation de désigner un administrateur représentant les salariés actionnaires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés cotées. Elle s’inscrit néanmoins dans la philosophie de l’action du Gouvernement pour remettre en cohérence l’ensemble des éléments fiscaux, sociaux et de représentation. Sous réserve de l’examen d’éventuels effets imprévus, avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1800.
Elle examine ensuite l’amendement SPE806 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’assemblée générale extraordinaire ne prend pas stricto sensu de décision, mais elle autorise le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou émises dans les vingt-six mois qui suivent. La rédaction proposée par mon amendement SPE806 me semble mieux correspondre à la pratique réelle.
M. le ministre. Je comprends votre volonté d’accélérer l’entrée en vigueur du dispositif. Votre amendement reviendrait néanmoins à rendre éligibles à la réforme des programmes qui ont déjà été décidés.
M. Olivier Carré. C’est bien la question. Le risque est que deux régimes se superposent.
M. le ministre. C’est pourtant logique. Nous mettons en place un nouveau régime incitatif ; si les programmes déjà passés ou en cours deviennent éligibles, nous créons un effet d’aubaine dont le coût budgétaire n’est pas insignifiant.
M. Olivier Carré. Bien sûr. On dépasserait les 191 millions en 2016.
M. le ministre. Je le confirme. Notre intention est que le projet de loi ne s’applique qu’aux nouveaux programmes autorisés en assemblée générale extraordinaire. Avis défavorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement risque de soulever un problème juridique et fiscal pour les bénéficiaires. Le texte précise que la décision relève de l’assemblée générale extraordinaire. Si cette décision ne relevait que du droit commun de l’entreprise, les AGA seraient considérées comme équivalentes à un salaire et soumises aux prélèvements classiques sur les salaires.
Quant à la question du moment auquel s’applique la réforme, elle sera traitée dans l’amendement suivant, qui devrait vous satisfaire. Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Il faut en effet distinguer la question de l’entrée en vigueur et celle du régime fiscal et social applicable. Mais cet amendement a aussi pour objectif d’éviter la superposition de deux régimes, raison pour laquelle je le maintiens.
La commission rejette l’amendement SPE806.
Elle est saisie de l’amendement SPE1799 du rapporteur général et des rapporteurs thématiques.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Les assemblées générales extraordinaires qui statuent sur les AGA se réunissent en général au premier trimestre de l’année civile. Il est donc à craindre que cette loi ne devienne exécutoire qu’après la tenue de ces assemblées. Les décisions relèveraient alors de l’ancien régime fiscal, moins favorable. Cet amendement vise à appliquer le nouveau régime aux décisions prises à partir du 1er janvier 2015. Considérant que le dispositif est bon, j’invite le Gouvernement à faire preuve de volontarisme pour l’appliquer dès cette année. Ce n’est évidemment pas sans conséquences budgétaires, mais l’étude d’impact ne prend pas cette hypothèse en compte.
M. le président François Brottes. Quel est votre sentiment sur cette disposition peu commune de rétroactivité, monsieur le ministre ?
M. le ministre. Tout en comprenant la position du rapporteur thématique, je préférerais que l’on s’en tienne à une application aux programmes décidés après la publication de la loi. En effet, le coût fiscal pour 2015 n’est pas totalement budgété. Avis défavorable tant que nous n’aurons pas expertisé la disposition. Discutons de la meilleure manière de sécuriser juridiquement les nouveaux programmes, mais évitons les effets d’aubaine !
M. le président François Brottes. Était-ce un amendement d’appel, monsieur le rapporteur thématique ?
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je m’en réfère à votre pratique, monsieur le président : ce qui est voté aujourd’hui pourra faire l’objet de discussions et d’évaluations, quitte à être retiré en séance publique. L’objectif est de mettre en place le plus vite possible un dispositif qui, j’en suis convaincu, montrera son efficacité.
La commission adopte l’amendement SPE1799.
Elle en vient à l’amendement SPE977 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Mon amendement vise à étendre le bénéfice de l’article 34 aux stock-options dès lors que celles-ci sont assorties d’une incessibilité pendant deux ans.
Le régime des stock-options a l’avantage d’indexer le montant et la valeur de l’avantage sur une performance économique. Ce n’est pas le cas du mécanisme de l’article 34, qui fige la valeur de l’action gratuite. L’objectif est d’accroître l’attractivité des entreprises pour ses collaborateurs les plus performants, notamment dans les entreprises innovantes.
M. le ministre. Les actions gratuites et les stock-options sont différentes par leur nature et par leur objet. Il me semble que votre objectif est pour partie satisfait par notre réforme puisque, dans l’un et l’autre cas, le régime d’imposition n’est plus compétitif.
Cela dit, les actions gratuites sont utilisées beaucoup plus largement au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise et les délais réglementaires d’acquisition et de conservation sont des éléments de fidélisation qui n’existent pas dans le cas des stock-options. La philosophie de notre réforme nous fait donc pencher pour les actions de performance, nonobstant le coût budgétaire que représenterait votre amendement.
Considérant que votre amendement est largement satisfait, notamment en ce qui concerne les ETI, je vous invite à le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. Jean-Christophe Fromantin. Mon amendement – j’y insiste – prévoit une période d’incessibilité de deux ans qui met les stock-options au même niveau que les actions gratuites. Les stock-options étant indexées sur la performance, elles ont plus un grand pouvoir d’incitation que les actions gratuites. J’approuve l’évolution que vous prévoyez pour ces dernières, mais cela n’exclut pas pour autant une amélioration du régime des stock-options afin de disposer d’une palette d’incitations aussi large et attractive que possible par rapport à d’autres pays.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable. Le régime des stock-options est différent de celui des AGA. Il a connu des déviances telles que cette mesure ne me paraît pas opportune, sans compter les conséquences fiscales qu’elle emporterait.
La commission rejette l’amendement SPE977.
M. Olivier Carré. Le groupe UMP votera pour l’article 34.
La commission adopte l’article 34 modifié.
*
* *
Article 35
(art. 154 quinquies et 163 bis G du code général des impôts)
Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE)
Le présent article vise à aménager le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), auquel est associé un régime de taxation avantageux sous la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 % :
– d’une part, il assouplit les conditions dans lesquelles ces bons peuvent être attribués ;
– d’autre part, il étend la non-déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) pesant sur les revenus du patrimoine aux gains provenant de ces bons.
D’après le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), ce dispositif a été créé « afin de permettre aux jeunes sociétés de s’attacher, par le biais d’un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu’elles ne peuvent s’offrir compte tenu de leur faible surface financière ».
À ce titre, les BSPCE sont généralement considérés comme l’une des formes de l’actionnariat salarié. Ils confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
D’après le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, cet avantage fiscal représente un coût total de 4 millions d’euros en 2013 et devrait s’établir à 5 millions d’euros en 2014 comme en 2015.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA NATURE JURIDIQUE DES BSPCE
Les BSPCE présentent la particularité de voir leur définition associée au régime fiscal avantageux prévu par le code général des impôts (CGI) ; pourtant, l’article 163 bis G du code général des impôts se limite à appréhender, du point de vue fiscal, les gains de cessions des titres acquis par le biais de ces bons de souscription, sans véritablement en définir la nature juridique.
Les BSPCE entrent dans la catégorie des instruments financiers prévue par l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, selon lequel la catégorie des instruments financiers est composée des titres financiers et des contrats financiers. Les titres financiers sont, eux-mêmes, subdivisés en titre de capital, émis par les sociétés par actions, les titres de créances (qui ne comprennent pas les effets de commerce et les bons de caisse) et les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC). Les contrats financiers désignent pour leur part les instruments financiers à terme.
En l’absence de définition prévue dans la loi, celle donnée par le BOFiP semble rapprocher les BSPCE du contrat à terme.
L’article 163 bis G du CGI précise que ces bons, qui sont incessibles, sont émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce.
Ces deux articles prévoient que les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. Le contrat d’émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu’ensemble.
Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’article L. 228-92 du code de commerce prévoit que « les émissions de valeurs mobilières régies par l’article L. 228-91 [du code de commerce], qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ». Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Dans ce cas, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
B. UNE FACULTÉ RÉSERVÉE À CERTAINES ENTREPRISES
La définition mentionnée ci-dessus ne permet pas d’emblée de comprendre le lien entre ces bons et la création d’entreprise – et donc la distinction avec les produits voisins que sont par exemple les stock-options –, lequel se déduit en réalité du champ des entreprises couvert par le dispositif des BSCPE.
Seules les sociétés qui remplissent cumulativement certaines conditions peuvent en effet émettre des BSPCE.
1. Les sociétés par actions, quelle que soit leur activité
L’article 163 bis G précité réserve l’émission de ces bons aux sociétés par actions, c’est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes régies par les articles L. 229-1 à L. 229-14 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
L’émission de BSPCE est ouverte à toutes les entreprises innovantes, quel que soit leur domaine d’activité. Cette règle résulte de l’article 134 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (« NRE »), qui a supprimé, à compter du 27 avril 2000, la condition restrictive portant sur l’activité des entreprises émettrices.
Avant cette date, cet article 163 bis G du CGI réservait en effet l’émission de BSPCE aux sociétés qui exerçaient une activité autre que celles visées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 44 sexies du CGI, c’est-à-dire autre que bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime.
Les sociétés éligibles de plein droit à ce dispositif sont celles dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d’instruments financiers, qu’il s’agisse d’un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, c’est-à-dire un marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étrangers.
L’article 4 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a étendu la possibilité de distribuer ces bons aux sociétés par actions dont les titres sont cotés sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste a été fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie du 4 févier 2000.
Afin de tenir compte de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers ayant réformé le droit européen en matière d’instruments financiers, l’article 38 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a ensuite modifié le dispositif afin d’ouvrir la possibilité d’émettre des BSPCE aux sociétés admises aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
Cette disposition vise les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou un marché structuré d’un État membre de l’Union européenne ainsi que celles admises sur de tels marchés en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.
L’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a assoupli la condition tenant à la capitalisation boursière pour les bons attribués à compter du 30 juin 2008 en prévoyant que les sociétés dont la capitalisation a franchi le seuil de 150 millions d’euros peuvent continuer à attribuer des bons pendant trois ans au plus à compter de la date de franchissement de ce seuil pourvu que les autres conditions d’attribution continuent d’être remplies.
Cette mesure, initialement prévue jusqu’au 30 juin 2011, a ensuite été pérennisée par l’article 20 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les modalités de calcul de la capitalisation boursière sont définies à l’article 91 ter A de l’annexe II au CGI.
La capitalisation boursière d’une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-6-2 du code monétaire et financier admis à la négociation à l’ouverture du jour de négociation précédant celui de l’émission des bons par la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l’émission des bons, c’est-à-dire celui de l’attribution des bons.
Lorsque, durant les soixante jours qui précèdent l’émission des bons, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d’une augmentation de capital, d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif), la capitalisation boursière de la société s’apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d’ouverture des jours de négociation depuis le jour d’admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu’au jour précédant celui de l’émission des bons.
En cas d’émission des bons le jour de l’introduction en bourse de la société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre de titres de la société admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
En cas d’émission des bons lors de l’admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d’actif), la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre total de titres de la société admis à la négociation à l’issue de l’opération d’augmentation de capital, de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l’admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
Le II de l’article 163 bis G du CGI réserve l’émission de BSPCE aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.
Cette limite de quinze ans s’applique aux BSPCE attribués depuis le 1er septembre 1998. Dans sa rédaction initiale issue de l’article 76 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), cette condition s’appliquait aux sociétés immatriculées depuis moins de sept ans à la date d’attribution des bons.
Le II de l’article 163 bis G du CGI réserve l’émission des bons aux sociétés « passibles en France de l’impôt sur les sociétés ». Cette rédaction exclut les sociétés qui n’exercent aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés ; les sociétés ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du dispositif.
Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de cet impôt et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Les sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière temporaire restent ainsi éligibles au dispositif des BSPCE, comme c’est le cas par exemple pour celles qui sont éligibles à l’exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) ou les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU).
L’émission de BSPCE est réservée aux sociétés dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.
Jusqu’en 1999, seules les sociétés détenues directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues entièrement par des personnes physiques pouvaient émettre de tels bons. La doctrine administrative avait toutefois admis, à titre de tolérance, que les personnes morales associées de la société souhaitant émettre des BSPCE puissent être elles-mêmes détenues à hauteur de 75 %, au lieu de 100 % comme le prévoyait la loi, par des personnes physiques.
L’article 4 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a réduit le seuil de détention du capital de la société émettrice par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques de 75 % à 25 %, sans pour autant admettre la détention partielle des personnes morales intermédiaires par des personnes physiques. Aussi la tolérance évoquée ci-dessus, qui ne se justifiait plus, s’est-elle trouvée rapportée.
L’article 163 bis G du CGI, dans sa rédaction applicable à compter du 30 juin 2008, prévoit désormais que la société émettrice des BSPCE doit être détenue à hauteur de 25 % par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes détenues à hauteur de 75 % par des personnes physiques.
Le II de l’article 163 bis G du CGI réserve l’émission de BSPCE aux sociétés qui n’ont pas été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistantes.
C. UN RÉGIME RÉSERVÉ À CERTAINES CATÉGORIES D’EMPLOYÉS
Conformément au premier alinéa du II de l’article 163 bis G du CGI, les BSPCE peuvent être attribués par une société éligible aux membres de son personnel salarié, ainsi qu’à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
Sont considérés comme dirigeants soumis au régime fiscal des salariés :
– dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, les directeurs généraux et les membres du directoire. Sont en revanche exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations correspondantes sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’exercice dans la société de mandats, missions ou autres prestations dont, compte tenu de leurs conditions d’exercice, les rémunérations correspondantes sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ne confère pas aux intéressés la qualité de dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et, par suite, ne les rend pas éligibles à l’attribution de BSPCE par la société concernée. Cela étant, en cas de cumul régulier d’un mandat social précité et d’un contrat de travail, les intéressés sont éligibles au dispositif des BSPCE attribués au titre de l’activité salariée ;
– dans les sociétés en commandite par actions, les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées, en application du dernier alinéa de l’article 62 du CGI, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations sont en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont donc exclus du bénéfice des BSPCE.
La société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses salariés ainsi qu’à ceux de ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. En revanche, elle ne peut pas attribuer de BSPCE ni aux salariés ni aux dirigeants de ses filiales. Il est toutefois admis que, si elles remplissent les conditions du II de l’article 163 bis G du CGI, les filiales d’une société émettrice peuvent attribuer des BSPCE sur leurs propres titres à leurs salariés et dirigeants.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article procède à un aménagement du champ des bénéficiaires du dispositif, portant pour l’essentiel sur les sociétés éligibles à l’émission des BSPCE. Il clarifie en outre le régime des prélèvements sociaux applicables aux gains issus de ces bons.
A. UN AMÉNAGEMENT DE LA CONDITION DE DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES
Actuellement, l’article 163 bis G du CGI prévoit que le taux de droit commun du prélèvement libératoire pesant sur les gains liés à la cession de titres obtenus par le biais des BSPCE est de 19 %. Toutefois, ce taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité « dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession ».
Les cinq premiers alinéas du présent article apportent en premier lieu une clarification à cette dichotomie, en indiquant que l’activité doit avoir été exercée trois ans dans la société dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons.
En outre, il prévoit que la durée d’activité exercée au sein d’une filiale de la société émettrice est comptabilisée pour l’application de cette limite de trois années.
Pour l’application de cette disposition, la filiale est considérée comme la société dont la société émettrice détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote. Cette définition est donc plus large que celle retenue pour l’application du régime fiscal des groupes de sociétés, pour lequel une filiale est considérée comme telle dès lors que la société mère détient 95 % du capital. La détention du capital s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote, les deux conditions étant cumulatives et non alternatives comme dans le dispositif proposé.
B. UNE POSSIBILITÉ D’ATTRIBUER DES BSPCE AUX SALARIÉS DES FILIALES DU GROUPE
Les alinéas 6 à 17 procèdent à une réorganisation du II de l’article 163 bis G, dont le principal apport est de permettre l’attribution de BSCPE aux salariés et dirigeants salariés des filiales de l’entreprise émettrice. Cette attribution était déjà possible à titre de pratique, qui se trouve ainsi consacrée par la loi.
La filiale est également définie comme la société dans laquelle la société émettrice détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
C. UN ASSOUPLISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU SEUIL DE 150 MILLIONS D’EUROS
Actuellement, le II bis de l’article 163 bis G du CGI prévoit qu’en cas de dépassement du seuil de 150 millions d’euros de capitalisation boursière, la société concernée peut continuer à émettre de tels bons pendant trois ans. Il prévoit en outre qu’en cas de décès du titulaire du bon, ses héritiers peuvent « exercer les bons dans un délai de six mois ».
Les alinéas 18 à 22 du présent article prévoient qu’une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons sous réserve que :
– toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues pour bénéficier du dispositif ;
– le seuil de 150 millions d’euros est apprécié en « faisant masse » de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ;
– la règle selon laquelle la société doit être immatriculée depuis moins de quinze ans est appréciée par référence à l’immatriculation de la société la plus ancienne.
Dans le cas où une société attribue des bons aux salariés d’une filiale, le seuil de 150 millions d’euros est apprécié en consolidant les deux sociétés.
D. LA NON-DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
L’alinéa 23 du présent article prévoit que la contribution sociale généralisée (CSG) pesant sur les gains de cessions de BSCPE ne pourra pas bénéficier de la déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu. Cette exclusion, cohérente avec l’ensemble de la réforme de la barémisation des revenus du capital opérée en 2012 et 2013, était déjà prévue par le BOFiP et se trouve ainsi consacrée par la loi.
Actuellement, en application du II de l’article 154 quinquies du CGI, la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains revenus du patrimoine est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.
Est déductible la CSG afférente à des revenus du patrimoine désormais soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Cette déductibilité s’applique donc :
– aux revenus fonciers ;
– aux rentes viagères constituées à titre onéreux ;
– aux revenus de capitaux mobiliers ;
– aux plus-values, gains en capital et profits (notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, etc.) soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
– aux distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel ou d’un fonds professionnel de capital d’investissement ;
– aux distributions de plus-values réalisées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains placements collectifs (7 bis de l’article 150-0 A du CGI) ;
– aux distributions de plus-values de cession de titres effectuées par des fonds de placement immobilier (FPI) ;
– aux distributions de plus-values de cession de titres effectuées par des sociétés de capital-risque (SCR) ;
– aux distributions de plus-values nettes de cession de titres effectuées par les SCR et les entités européennes et les distributions de plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs par un FCPR, d’un fonds professionnel spécialisé ou d’un FPCI et aux distributions d’une fraction des actifs de ces mêmes fonds, afférentes à des parts ou actions dites de « carried interest » ;
– aux gains constatés lors de dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d’intérêt général, ouvrant droit à une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune ;
– aux revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) au sens du CGI.
À l’inverse, la CSG pesant sur certains revenus du patrimoine soumis à un taux proportionnel ne bénéficie pas de la déductibilité partielle ; sont notamment visés :
– les revenus d’activités non commerciales non professionnelles et les plus-values à long terme soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine et à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;
– les gains nets réalisés en cas de retrait, de rachat ou de clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) avant l’expiration de la cinquième année suivant l’ouverture du plan ;
– les gains de levée des options sur titres attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 et sur le gain d’acquisition d’actions gratuites attribuées jusqu’à la même date.
D’après les informations fournies par l’administration fiscale, le présent article répare, de ce point de vue, un oubli de la réforme de la barémisation des plus-values mobilières.
E. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions relatives à l’extension du champ des BSPCE entrent en vigueur à dater de la publication de la présente loi ; les dispositions relatives à la CSG entrent en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
On peut en premier lieu regretter l’indigence de l’étude d’impact du présent article ; en particulier, il n’est fourni à la représentation nationale aucun chiffrage de ses conséquences financières.
Sur le fonds, le présent article apporte quelques assouplissements bienvenus aux conditions dans lesquelles les BSPCE peuvent être attribués. Au-delà de ces ajustements techniques, il ne procède pas à un bouleversement fondamental de la fiscalité pesant sur l’attribution de ces bons.
Encore faut-il rappeler que ceux-ci bénéficiaient d’une fiscalité déjà fort avantageuse, puisqu’elle combinait un prélèvement forfaitaire libératoire maintenu dans le cadre du régime des plus-values mobilières, avec application de l’abattement pour durée de détention.
En droit, ces bons étaient en outre soumis aux prélèvements sociaux pesant sur les revenus du patrimoine avec application de la déductibilité de la CSG, ce qui constituait une anomalie au regard des principes retenus lors de la barémisation des revenus du capital opérée en 2012 et 2013.
Cette anomalie est corrigée par le présent article.
IV. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission n’a pas adopté d’amendement à cet article.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE987 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement vise à faire évoluer la part des personnes physiques dans le capital des entreprises qui peuvent bénéficier des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), en ramenant cette part de 75 % à 33 %. Dans ces entreprises en développement, des fonds d’investissement ou des acteurs industriels peuvent fréquemment dépasser le niveau de participation de 25 % prévu par l’article. En l’état, le texte risque de neutraliser l’efficacité du dispositif, d’autant que l’empêchement est applicable dès lors qu’un actionnaire dépasse cette proportion. Il s’agit, vous l’avez compris, d’élargir l’éligibilité aux BSPCE.
M. le ministre. L’article 35 vise à rendre le régime des BSPCE suffisamment attractif pour les start-up et à corriger un défaut du système. En effet, lorsqu’une start-up crée une filiale, comme c’est fréquemment le cas lorsque l’entreprise développe deux activités, ou lorsqu’elle se rapproche d’une autre, elle ne peut distribuer ces bons de souscription à l’autre société. Bon nombre d’acteurs ont signalé cette faiblesse du dispositif.
Il est donc proposé que, lorsqu’une société crée une société fille et la détient jusqu’à 75 %, elle puisse continuer à émettre des bons au niveau de la fille de manière à intéresser les salariés à l’ensemble de l’activité. La mesure est particulièrement importante dans le domaine du numérique.
En abaissant le seuil à 33 %, le dispositif couvrirait des situations qui ne relèvent plus de la même logique : participations financières, acquisitions en tant qu’actionnaire minoritaire... C’est une tout autre philosophie – assurément pas celle du texte – qui pourrait conduire des start-up à prendre une participation minoritaire dans le seul but de distribuer des BSPCE. Avis défavorable.
M. Jean-Christophe Fromantin. Beaucoup de créations d’entreprises se font autour d’un projet autour duquel, à un moment donné, un partenaire industriel est fortement présent sans être appelé pour autant à contrôler l’entreprise. Il participe à son développement à des étapes où existe un besoin capitalistique fort. La répartition du capital au sein d’une entreprise innovante – un fonds ou un partenaire industriel qui apporte du capital au-delà de 25 % avant de se retirer deux ou trois ans après – est analogue à la relation fille-mère à l’intérieur d’une holding. Bien qu’elle procède de la même logique, cette configuration n’est pas éligible à un dispositif par ailleurs très intéressant et incitatif.
Cela dit, mon amendement vise plus une exception qu’un cas général et je veux bien le retirer.
L’amendement SPE987 est retiré.
La commission adopte l’article 35 sans modification.
La commission est saisie de l’amendement SPE918 rectifié de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. L’amendement SPE918 est de cohérence.
M. le ministre. Les jeunes sociétés utilisent fréquemment la forme très souple de la société par actions simplifiée, mais les dispositions statutaires n’assurent pas une protection suffisante pour qu’elles puissent dans tous les cas procéder à des offres de titres financiers au public. Une dérogation spécifique a été introduite pour les sociétés par actions simplifiées financées dans le cadre de financements participatifs – nous y reviendrons. Cet assouplissement a été néanmoins encadré par des exigences statutaires nécessaires à la protection des investisseurs et des épargnants. C’est ce qui me conduit à émettre un avis défavorable. Mais je comprends l’intention de l’amendement et vous suggère, monsieur Leroy, d’examiner comment ces sociétés pourraient opter pour des régimes juridiques qui leur permettraient d’être éligibles aux dispositifs prévus.
L’amendement SPE918 rect. est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement SPE96 de Mme Véronique Louwagie.
M. Gilles Lurton. Un an après sa création, le PEA-PME – plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI – connaît un véritable succès populaire avec 80 000 ouvertures. Mais, paradoxalement, la collecte n’a pas dépassé 300 millions d’euros. La somme moyenne investie n’a été que de 4 000 euros par plan alors que le plafond est de 75 000 euros. Si seulement 5 000 PEA-PME étaient totalement remplis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux, ce qui apporterait un réel soutien à nos entreprises, à la croissance et à l’activité.
Il est donc proposé par cet amendement d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée – qui pourrait s’étendre sur l’année 2015 – les cessions de titres ou de parts de fonds communs de placement ou de SICAV dès lors que le produit de ces cessions serait réinvesti dans un PEA-PME.
En plus d’augmenter la collecte, cette solution conférerait une nouvelle lisibilité au dispositif, sans aucun coût pour les finances publiques – puisque, hors de ce cadre, les plus-values n’auraient de toute façon pas été réalisées – et même avec une rentrée immédiate via la CSG et la CRDS.
M. le ministre. Nous partageons tous l’objectif de financement des PME. Cependant, exonérer en totalité les plus-values de cession de tous types de titres avec pour seule condition le réemploi dans des PEA-PME provoquerait un appel d’air du fait du cumul de cet avantage avec celui qui est attaché auxdits plans. Par ailleurs, nous n’avons pas chiffré le coût fiscal de la mesure, mais il n’est certainement pas négligeable. Avis défavorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Si l’objectif est de garantir un succès immédiat au PEA-PME, la proposition est pertinente en ce qu’elle favoriserait un transfert par effet d’aubaine en 2015. On aurait là un choix fiscal et non un choix de financement de l’économie.
Le PEA-PME monte en puissance à un rythme peut-être insuffisant. Mais il a été instauré il y a moins d’un an et nous devons nous donner un peu de temps pour l’évaluer. Avis défavorable.
M. Gilles Lurton. La disposition, restreinte à une durée d’un an, a pour seul objet de relancer le PEA-PME.
La commission rejette l’amendement SPE96.
La commission se saisit de l’amendement SPE763 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Il est fréquent, dans la vie des entreprises, d’être obligé de procéder à un apurement des pertes accumulées avant de procéder à une recapitalisation du fait de l’arrivée de nouveaux actionnaires ou d’une modification de la structure actionnariale.
Cette opération, communément appelée « coup d’accordéon », consiste en une augmentation de capital précédée d’une réduction de capital par imputation des pertes accumulées, à cette occasion les titres annulés disparaissent et de nouveaux titres sont créés. C’est cette dernière date de création qui est prise en compte pour calculer la durée de détention dans le calcul de l’imposition des plus-values, alors que de fait la durée de détention « réelle » est beaucoup plus ancienne.
L’amendement propose de considérer les opérations d’annulation de titres comme des opérations intercalaires pour le décompte de la durée de détention, car le mode de calcul actuel constitue un frein à l’assainissement et à l’apurement des pertes des entreprises pour de simples considérations fiscales.
Nous proposons donc la prise en compte de la date de souscription et d’acquisition des titres annulés.
M. le ministre. Le constat que vous faites au sujet d’une insuffisance dans le système actuel est juste. Il y a cependant deux sujets sur lesquels je souhaite appeler votre attention.
Le premier est que le droit en vigueur applicable aux gains de cession des valeurs immobilières et droits sociaux des particuliers prévoit que l’abattement par durée de référence est toujours décompté depuis la date d’acquisition ou de souscription des titres par le contribuable – je vous renvoie à discussion précédente. Lorsque les titres cédés ont été souscrits dans le cadre d’une augmentation de capital, cet abattement est décompté depuis la date de souscription. Votre proposition conduit à déroger à ce principe en rendant plus complexe un régime récemment réformé alors même que vous souhaitez traiter une réelle aberration. Cela reviendrait à perturber un système qu’il faut stabiliser et qui, malgré tout, constitue une garantie juridique pour l’ensemble de nos contribuables.
Le second, est que, sur le plan juridique, on instaurerait une inégalité de fait selon que les titres cédés ont été souscrits lors d’une hausse de capital, précédée ou non d’une baisse de celui-ci motivée par des pertes. Dans l’hypothèse où les souscripteurs sont des actionnaires déjà présents dans la société des tiers, on déstabiliserait l’existant en créant une inégalité de traitement en fonction de la situation des actionnaires. Votre amendement soulève à cet égard des préoccupations d’ordre constitutionnel. Les cas que vous évoquez posent un problème réel à nombre d’entreprises ; la situation est connue mais nous ne l’avons pas traitée. Je vous propose de retirer votre amendement pour que nous puissions trouver avec vous une solution à même de rendre le système plus cohérent et de proposer une nouvelle réaction en séance.
Mme Bernadette Laclais. L’argument de l’inégalité de traitement me gêne, car il est réversible : ceux qui sont déjà actionnaires sont traités de façon inégale... En revanche, j’entends parfaitement ce que vous dites au sujet du régime actuel et souscris à votre demande de retrait afin de revoir la rédaction avec vous.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, l’amendement SPE763 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement SPE95 de Mme Véronique Louwagie.
M. Gilles Lurton. Cet amendement propose de permettre aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des sommes versées sur leurs contrats d’assurance-vie. Il s’agit de modifier un article du code général des impôts par l’insertion de la mention des contrats d’assurance-vie visés à l’article L. 131-1- du code des assurances.
M. le ministre. La réponse est toujours la même : nous nous heurtons à une contrainte de financement et un régime fiscal favorable existe déjà. La loi de finances rectificative pour 2013 a augmenté l’avantage comparatif de l’assurance-vie par rapport au droit commun, y compris par des produits permettant le financement de notre économie avec les contrats euro-croissance et vie-génération. Cela n’a pas entraîné de conséquences fiscales ou de coûts trop importants.
Il me semblerait injustifié de permettre la déductibilité des cotisations versées sur les contrats d’assurance-vie alors même que les capitaux et les rentes issus de ces contrats bénéficient déjà d’une fiscalité favorable. Dans un sens, votre proposition consiste à doubler cet avantage fiscal par un avantage social. Pour des raisons d’équité, on majorerait l’avantage fiscal existant à l’entrée et à la sortie du dispositif. La déductibilité des cotisations à l’entrée supposerait corrélativement de revoir le régime fiscal à la sortie si l’on souhaitait être neutre. Mieux vaut stabiliser le régime tel qu’il existe.
Votre proposition consiste à stimuler le dispositif et j’en comprends la philosophie, mais cela aurait un coût et induirait un avantage à l’entrée qu’on ne peut pas cumuler. Pour ces raisons, mon avis est défavorable.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Défavorable : cet amendement créerait un avantage fiscal inopportun ainsi qu’un effet d’aubaine peu compatible avec les objectifs que nous nous sommes fixés.
La commission rejette l’amendement SPE95.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE787, SPE769 et SPE740 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. La réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME dans sa version actuelle présente un intérêt non incitatif pour les raisons suivantes : le périmètre des sociétés concernées, à savoir les petites entreprises de moins de cinq ans, limite fortement les possibilités d’investissement ; le taux de 1 % n’est pas incitatif au regard du niveau de risque important et de la faible liquidité des participations ; il est en concurrence avec d’autres possibilités de déduction classiques.
L’amendement SPE787 propose de revenir au taux historique de déduction de 25 % voire 30 % et de bénéficier d’un plafond identique à celui des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA). Les comparaisons montrent que d’autres pays sont allés beaucoup plus loin dans ce domaine avec succès.
L’amendement SPE769 concerne la limitation de la déduction d’impôt sur le revenu aux sociétés de moins de cinq ans, qui ne correspond pas aux besoins ; les investisseurs sont régulièrement appelés à effectuer des troisièmes, voire des quatrièmes tours dans des sociétés suivies et le délai de détention des participations tend à s’allonger de sept à neuf ans.
Le taux de sinistralité des jeunes pousses est tellement élevé qu’il est important que les investisseurs puissent répartir leur risque sur des sociétés de maturité différente.
Il est proposé d’aligner les sociétés cibles des régimes de réduction de l’impôt sur le revenu sur le modèle de l’impôt de solidarité sur la fortune.
L’amendement SPE740 part d’un constat : de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés, inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d’amorçage. Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd’hui à de grandes difficultés : les entrepreneurs redoutent d’être confrontés à un nombre élevé d’investisseurs ayant trop de divergences de vues.
Il est donc indispensable de rendre éligibles aux dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu les sociétés en participation (SEP) pour disposer d’une structure de regroupement simple d’accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l’investissement collectif dans un seul projet.
Ces trois amendements, vous l’avez bien compris, ont pour objet de supprimer des contraintes et d’alléger un certain nombre de dispositifs.
M. le président François Brottes. J’ai constaté, madame Laclais, que vous aviez d’ores et déjà le soutien du rapporteur thématique, cosignataire de vos amendements.
M. le ministre. Je comprends votre volonté d’améliorer le dispositif ISF et l’imprimé fiscal unique existant ; toutes les situations que vous avez décrites sont avérées, je ne les contesterai pas sur le fond. Je vous épargnerai les longs argumentaires qui démontrent qu’on finance beaucoup les PME et que beaucoup a déjà été fait. Les moyens de rationalisation que vous proposez mériteraient d’être réalisés et je sais que vous avez défendu ces amendements dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, mais ils ont un coût. C’est pour cette raison que le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable à leur adoption.
En revanche, vos amendements suivants sont d’un autre ordre et participent mieux de l’esprit qui consiste à améliorer le financement de l’économie de façon pragmatique. J’aurai là plus de marge de manœuvre puisqu’ils n’emportent pas de coût fiscal.
Mme Bernadette Laclais. J’apprécie votre franchise car il est bon de se dire les choses aussi clairement ; je retire ces trois amendements. Cependant, en ce qui concerne les SEP, je vois mal quel coût peut être invoqué...
Les amendements SPE787, SPE769 et SPE740 sont retirés.
*
* *
Article 35 bis [nouveau]
(art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)
Réduction de dix ans à sept ans de la condition de non-remboursement des apports pour le bénéfice des dispositifs « ISF-PME » ou « Madelin »
Le présent article, issu d’un amendement des rapporteurs, vise à modifier les dispositifs dits « ISF-PME » et « Madelin » afin de ramener de dix ans à sept ans le délai pendant lequel les apports à la PME ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement, sauf à perdre les avantages fiscaux prévus par ces deux dispositifs.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, le code général des impôts (CGI) contient deux dispositifs parallèles, l’un ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR), dit « Madelin », l’autre permettant une réduction d’ISF, dit « ISF-PME ».
D’après le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le dispositif « Madelin » représenterait une dépense fiscale de 92 millions d’euros, exclusion faite du volet du dispositif spécifiquement applicable aux fonds communs de placement dans l’innovation, aux fonds d’investissement de proximité et à de tels fonds opérant en Corse ou outre-mer. Si l’on prend en compte l’ensemble des volets de ce dispositif, son coût total s’établit alors à 159 millions d’euros.
Le dispositif « ISF-PME » représente pour sa part un coût total de 468 millions d’euros en 2014 comme en 2015.
A. LE DISPOSITIF « MADELIN »
La réduction d’impôt dite « Madelin », créée par la loi de 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (25), s’applique soit aux souscriptions directes au capital des petites et moyennes entreprises (PME), soit aux souscriptions indirectes par le biais de holdings d’investissement.
1. La souscription directe
Les contribuables qui souscrivent au capital initial (ou aux augmentations de capital) de PME bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués, retenus dans une limite annuelle de 50 000 euros pour les personnes seules et de 100 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité. La fraction de la réduction excédant le plafond global des avantages fiscaux de 10 000 euros peut être reportée pendant cinq ans.
Pour ouvrir droit à la réduction, la société bénéficiaire des souscriptions doit répondre à de nombreux critères :
– la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et ses titres ne doivent pas être côtés sur un marché réglementé ;
– elle doit avoir son siège sur le sol européen ;
– elle doit répondre à la définition de la PME au sens européen, mais avoir au minimum deux salariés ; elle doit avoir été créée depuis moins de cinq ans et être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens européen ;
– elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérable ou agricole (l’exclusion des activités financières ou immobilières ne s’applique pas, toutefois, aux entreprises sociales et solidaires). Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art ; en outre, les sociétés bénéficiant du tarif de rachat applicable aux énergies renouvelables sont exclues du dispositif, de même que l’ensemble des sociétés exerçant une activité de production d’énergie solaire.
2. La souscription indirecte
La réduction d’impôt est également applicable aux souscriptions au capital de sociétés qui, sans être elles-mêmes éligibles au dispositif, investissent dans les sociétés visées ci-dessus.
Ces holdings d’investissement doivent respecter l’ensemble des conditions ci-dessus, sauf celle tenant à l’activité. Leur objet social doit être la détention des participations dans les sociétés mentionnées ci-dessus.
En l’état du droit, cette société ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires. Ses mandataires sociaux doivent être exclusivement des personnes physiques.
Le montant de la réduction d’impôt accordée au souscripteur est alors proportionnel au montant du capital de la holding investi dans des sociétés éligibles au dispositif « Madelin ».
3. Les conditions relatives à la détention des titres
Afin que l’avantage fiscal vienne soutenir un investissement stable dans les entreprises en création, le dispositif « Madelin » contient plusieurs verrous :
– lorsque les actions ayant donné lieu à la réduction d’impôt sont cédées moins de cinq ans avant leur acquisition, le montant correspondant fait l’objet d’une reprise par l’administration fiscale ;
– il en est de même lorsque les souscripteurs bénéficient d’un remboursement de leurs apports dans les dix années suivant leur souscription (sauf pour les entreprises sociales et solidaires) ;
– ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de décès, de licenciement ou d’invalidité. En cas de donation, le donataire s’engage à conserver les titres.
B. LE DISPOSITIF « ISF-PME »
Créé par l’article 16 de la « loi TEPA » (26) et codifié à l’article 885-0 V bis du CGI, le dispositif « ISF-PME » reprend la partition du dispositif « Madelin » entre souscription directe et indirecte via des holdings d’investissement.
Dans l’ensemble, les deux dispositifs sont parallèles ; toutefois, certaines dispositions complémentaires existent dans le dispositif « ISF-PME » s’agissant de l’obligation de conservation des titres.
La réduction d’ISF est égale à 50 % du montant des souscriptions ; l’avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 euros.
1. La souscription directe
Les entreprises pouvant bénéficier des souscriptions sont, dans l’ensemble, les mêmes que celles éligibles au dispositif « Madelin » ; dans le détail, on peut cependant relever certaines discordances entre le champ des deux dispositifs :
– par un renvoi à l’article 239 bis AB du CGI, le dispositif « Madelin » impose que les souscriptions soient réalisées dans une entreprise créée depuis moins de cinq ans, alors que cette condition n’existe pas au titre du dispositif « ISF-PME » ;
– au titre du dispositif « Madelin », les entreprises doivent en outre être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion et ne doivent pas être qualifiables d’entreprises en difficulté au sens du droit européen ; ces deux critères, qui existaient au titre de l’ISF jusqu’en 2010, ont été supprimés en loi de finances pour 2011 (27).
2. La souscription indirecte
Les conditions d’investissement par le biais d’une holding d’investissement sont les mêmes que pour le dispositif « Madelin ». La condition relative à l’interdiction d’accorder des garanties en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, qui s’appliquait, au titre du dispositif « ISF-PME », à la fois à l’entreprise bénéficiant de l’investissement et à la holding, a été corrigé en loi de finances pour 2011 afin que, comme dans le dispositif « Madelin », cette condition ne s’applique qu’à l’entreprise bénéficiant in fine de l’investissement.
3. Les conditions de détention des titres
Les conditions tenant à la détention des titres pendant cinq ans et au non-remboursement des apports pendant dix ans sont également reprises dans le dispositif « ISF-PME ».
Toutefois, certaines dispositions du dispositif « ISF-PME » offrent une certaine souplesse à l’application de ces conditions, qui n’existent pas dans le dispositif « Madelin » :
– en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, l’avantage n’est pas perdu si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; en cas d’annulation des titres, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause ;
– en cas de cession des titres rendue obligatoire par un pacte d’associé, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause si le montant correspondant est réinvesti dans un délai de douze mois dans une entreprise elle-même éligible à l’ISF-PME ;
– en cas d’offre publique d’échange, l’avantage n’est pas non plus perdu si les titres reçus sont ceux d’une entreprise qui répond aux critères du dispositif « ISF-PME ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit de ramener de dix ans à sept ans le délai dans lequel il ne doit pas être procédé à un remboursement des apports, ce délai commençant à courir à la date de la souscription.
Le raccourcissement de ce délai permettra en effet d’accroître les investissements des business angels, ce qui est particulièrement nécessaire à la création d’entreprises.
Compte tenu de l’économie générale des deux dispositifs, cet assouplissement devrait avoir un coût négligeable.
*
* *
La commission examine ensuite en discussion commune les amendements SPE750 et SPE753 de Mme Bernadette Laclais ainsi que les amendements SPE1914 et SPE1913 des rapporteurs.
Mme Bernadette Laclais. L’amendement SPE750 veut revenir sur une disposition de la loi de finances pour 2011 qui, en interdisant le remboursement des apports avant la fin du dixième anniversaire desdits apports, a imposé de porter la durée de vie des sociétés d’investissement de business angels (SIBA) à dix ans avec obligation de maintien de l’intégralité de l’apport en capital sur cette période. Cette durée est un frein important à l’investissement.
Un horizon de dix ans n’a pas la même signification en fonction de l’âge des personnes concernées. Or, l’âge moyen des investisseurs au sein des SIBA est supérieur à soixante ans, ce qui pose problème, même si la durée de la vie tend à s’allonger.
La période d’investissement des SIBA s’écoule sur deux exercices ISF, soit environ deux ans.
L’obligation de conservation des titres des sociétés cibles pendant cinq ans ainsi que l’obligation de réemploi en cas de sortie avant cette échéance ramènent naturellement la durée de détention à sept ans. L’obligation de durée de vie de dix ans représente donc une double contrainte dont on voit mal la justification.
C’est pourquoi l’amendement SPE750 a pour objet de ramener la durée minimum des remboursements des apports à sept ans. Le principe même du réemploi a pour effet d’allonger la durée d’investissement. Il convient de noter que la redistribution des capitaux de la SIBA aux actionnaires ne peut intervenir que lorsque toutes les participations ont été cédées. Or, nous nous situons dans un marché où la liquidité est un énorme problème, ce qui tend déjà à allonger structurellement la durée de vie des fonds.
L’amendement SPE753 vise à taxer la plus-value dès sa réalisation et à n’exiger le réemploi que pour la partie investie à l’origine, afin de permettre à l’investisseur de cristalliser sa plus-value, si elle existe, nette de fiscalité. De fait, en cas de cession dans le délai de cinq ans, l’investisseur est tenu de réinvestir le montant total de la vente, déduction faite de la taxation de la plus-value, pour les SIBA comme pour les particuliers. Or, nous savons d’expérience qu’au moins 40 % des investissements réalisés sont des échecs avec un taux de sinistralité important. Le simple principe du réemploi conduit statistiquement à la perte de la quasi-intégralité des capitaux investis.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je propose de retirer l’amendement SPE1914, ce qui sera beaucoup plus simple.
L’amendement SPE1914 est retiré.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En ce qui concerne l’amendement SPE1913, il devrait aussi porter le nom de Bernadette Laclais car il correspond à une réécriture de son amendement SPE750, qui fait par erreur mention de la sixième année et non de la septième ; je l’invite donc à retirer son amendement au bénéfice de mon amendement SPE1913, qui ramène effectivement la durée minimale des remboursements de dix ans à sept ans.
L’amendement SPE750 est retiré.
M. le ministre. L’amendement SPE1913 reste dans la philosophie de Mme Laclais, qui souhaite ramener de dix à sept ans la durée minimale requise. Ce problème s’est vérifié plusieurs fois pour des SIBA qui investissent dans des sociétés et qui, pour remplir les critères de durée nécessaire au bénéfice des dispositifs ISF-PME et Madelin, sont parfois amenées à casser la valeur des sociétés qu’elles ont en portefeuille. La difficulté que présente la rédaction de cet amendement réside dans sa capacité à définir ces SIBA ; je demanderai donc la sagesse, tout en m’engageant à poursuivre les travaux jusqu’à la séance publique.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Nous allons travailler avec le Gouvernement à la définition précise des SIBA afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, ce qui nous permet de maintenir l’amendement et de l’améliorer d’ici au vote.
M. le président François Brottes. Conformément à une jurisprudence bien connue...
Mme Bernadette Laclais. Cela me convient parfaitement.
M. le ministre. L’amendement SPE753 vise à ramener de cinq à trois ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier du dispositif ISF-PME, suivant la même logique que précédemment. Le Gouvernement partage le constat qui conduit à proposer cette mesure, car il est vrai que, pour certains investisseurs, deux années de plus sont nécessaires dans le cas particulier des start-up pour éviter les effets pervers.
Cependant, nous voulons être certains de maîtriser les effets pervers que cette mesure pourrait provoquer dans l’ensemble du paysage des investisseurs. Je vous suggère donc, madame Laclais, de retirer votre amendement, comme le rapporteur thématique l’a fait avec son amendement-miroir SPE1914, afin que nous puissions y travailler d’ici à la séance publique.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Je partage l’avis du Gouvernement.
Mme Bernadette Laclais. Je suis tout à fait d’accord pour y travailler avec le ministre ; et si l’on pouvait reparler des SEP en même temps, ce serait parfait.
L’amendement SPE753 est retiré.
L’amendement SPE1913 est adopté.
*
* *
Article 35 ter [nouveau]
(art. 200 bis et 238 bis du code général des impôts)
Assouplissement des critères permettant de bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés pour mécénat
Le présent article, issu d’un amendement présenté par M. Jean-Yves Caullet et plusieurs de ses collègues du groupe SRC, vise à assouplir les conditions dans lesquelles une entreprise peut, au titre du mécénat, attribuer des fonds à une structure de bienfaisance en bénéficiant en contrepartie d’une réduction d’impôt sur les sociétés.
Cette réduction d’impôt, prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, est égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
Cet article liste par ailleurs les structures qui peuvent bénéficier de ces versements ; il s’agit pour l’essentiel :
– d’œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportive, familial ou culturel ;
– de fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France ;
– des établissements d’enseignement supérieur ou artistique ;
– des structures dont l’objet est la présentation d’œuvres dramatiques, lyriques ou musicales ;
– de projets de thèse ;
– de sociétés publiques audiovisuelles ;
– de la Fondation du patrimoine ou d’une fondation associée à cette première ;
– de fonds de dotation.
D’après les auteurs de l’amendement, une condition supplémentaire aurait été ajoutée par la doctrine administrative, selon laquelle ces structures « ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ».
Cette dernière condition a été développée par l’administration à partir du début des années 2000, et a été consacrée par la jurisprudence en 2007 à propos d’une association d’anciens élèves d’une école d’ingénieurs.
Selon les auteurs de l’amendement, « depuis lors, l’administration a, à de nombreuses reprises, considérée que des associations d’anciens combattants, l’Orphelinat de la Police Nationale ou encore une association de sauvegarde des retraites ne présentaient pas un caractère d’intérêt général dans la mesure où leur objet consistait en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres (réponses D. Boisserie 2 novembre 2000 ; G. Lindeperg 24 janvier 2000 ; J. Peyrat 28 août 2003 ; J.-L. Reitzer 27 juillet 2004 ; L. Deprez 20 juin 2006) ».
Cette jurisprudence conduit donc plusieurs types d’organismes qui :
– défendent les intérêts matériels et moraux de leurs membres et développent une activité qui s’apparente à celle d’un syndicat ;
– procurent indirectement à leurs membres une contrepartie tangible ;
– fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes.
De fait, certaines structures, comme l’Association des paralysés de France ou l’UNAPEI, sont exclues du dispositif.
Le présent article a donc pour objet d’attirer l’attention du Gouvernement sur cette interprétation inutilement restrictive de l’administration fiscale. Les rapporteurs ont parfaitement conscience du fait que la rédaction de l’amendement initial était imparfaite, voire inopérante du point de vue de la technique légistique. Son adoption permettra toutefois d’engager un débat constructif en séance publique qui permettra probablement de rapporter, par un engagement du Gouvernement, cette interprétation de l’administration fiscale.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1009 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Les articles 200 bis et 238 bis du code général des impôts définissent les caractéristiques des organismes auxquels peuvent être adressés des dons bénéficiant des dispositions énoncées auxdits articles. Il est entre autres prévu qu’ils ne doivent pas développer d’activités lucratives, que leur gestion doit être désintéressée mais aussi qu’ils ne doivent pas non plus fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Cet élément de doctrine administrative a pour effet que nombre d’organisations – associations d’anciens combattants et associations au profit des orphelins de la police, notamment – sont considérées comme bénéficiant à un nombre restreint de personnes et ne peuvent donc bénéficier des dispositions des articles précités lorsqu’elles reçoivent des dons. C’est pourquoi nous proposons de remédier à cette situation anachronique.
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Le problème soulevé dans cet amendement correspond à une réalité. Je souhaiterais, en lien avec mon collègue Michel Sapin, retravailler à votre proposition d’ici à l’examen du projet de loi en séance publique. Mais étant en ligne avec la jurisprudence que vous avez décrite, et bien conscient qu’il ne s’agit pas d’une mesure dont le coût budgétaire serait significatif mais plutôt de la rationalisation d’un dispositif dont ne peuvent bénéficier certains acteurs bien identifiés, j’émets un avis favorable à cet amendement, sous la réserve rédactionnelle que je viens d’évoquer.
M. Jean-Yves Caullet. Ravi que cet amendement recueille un avis favorable, je tiens à souligner l’implication de mon collègue Yves Blein dans sa rédaction.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Dans une décision du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Lille a fait une interprétation moins stricte de la notion de « cercle restreint » que celle des services fiscaux. Il me semble donc opportun d’encadrer l’interprétation de ces derniers afin d’aller dans le sens d’une plus grande générosité, ainsi que le législateur l’avait initialement souhaité.
M. Olivier Carré. Je n’ai aucun titre à représenter ici la doctrine de la commission des finances. Mais nous débattons en l’occurrence d’un sujet qui relève davantage de la loi de finances initiale que de l’objet du présent projet de loi. Si au cours de l’examen de prochains textes, nous dérogeons de nouveau à la règle, il ne faudrait pas en profiter pour y insérer des amendements dont la nature est proche de cavaliers budgétaires, sans quoi l’on risque la censure par le Conseil constitutionnel de mesures pourtant soutenues par tous.
M. le président François Brottes. Cette règle n’est pas absolue. J’ai plusieurs exemples en tête qui le montrent. Qui plus est, nous siégeons actuellement dans la salle de la commission des finances, ce qui nous confère une forme de légitimité à agir, et au sein d’une commission spéciale dans laquelle siègent plusieurs membres de cette même commission des finances. Par définition et par nature, les commissions spéciales ont davantage le droit de prendre des initiatives d’opportunité de ce type – surtout lorsque le Gouvernement accepte la dérogation.
Cela dit, bien que cet amendement ne pose pas de problème de droit, je comprends votre remarque, d’autant que je connais bien la préséance que nous devons à la commission des finances. Celle-ci, d’ailleurs, ne se gêne pas parfois pour traiter de sujets non budgétaires, tels que la contribution au service public de l’électricité, sans consulter les commissions compétentes sur ces questions. Ayant pris l’initiative inédite – et qui sera renouvelée – de saisir une commission permanente pour avis sur le projet de loi de finances, je puis vous assurer qu’une telle décision a fluidifié nos relations.
La commission adopte l’amendement SPE1009.
*
* *
Puis elle examine l’amendement SPE972 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement vise à stimuler le financement participatif, dont le Gouvernement a ouvert la voie il y a quelque temps. En effet, en volume, celui-ci n’atteint pas encore des montants importants – 78 millions d’euros en 2013. Il constitue pourtant un véhicule de financement pour les petites entreprises et les entreprises, au regard du taux d’épargne des Français et de leur appétence pour ce type de financement de proximité. L’amendement instaure un mécanisme d’incitation fiscale : 50 % du prêt engagé dans le cadre d’un financement participatif pourrait faire l’objet d’une réduction d’impôt.
M. le ministre. Nous partageons l’objectif poursuivi, non seulement parce que nous avons pris des dispositions en la matière mais aussi parce que nous ouvrirons un débat sur le sujet. Le financement participatif est en effet essentiel à notre économie, et en particulier au financement de l’innovation.
Cet amendement pose néanmoins deux problèmes de fond. Sur le plan budgétaire, d’une part, autant le Gouvernement peut être favorable à des amendements de rationalisation, de portée marginale – le dernier amendement adopté ayant porté sur un secteur spécifique relevant de l’économie sociale et solidaire –, autant l’amendement que vous proposez aurait un coût budgétaire, de sorte que la plus grande précaution accompagnera mes propos.
Mais surtout, l’idée d’aménager un crédit d’impôt pour le prêt consenti par un particulier, quand bien même ce prêt s’inscrirait dans le cadre du financement participatif, me pose problème. Autant on peut avoir ce débat – même s’il a trouvé tout à l’heure une issue défavorable – sur le financement en fonds propres de l’investissement d’un particulier ou d’une société d’investissement, autant, en ce qui concerne le financement participatif, l’objectif est plutôt de libérer cette pratique et lui fournir un cadre sécurisé que de la développer à l’aide d’un crédit d’impôt.
Comme nous partageons votre objectif, je vous suggère que nous poursuivions ce débat plus tard en réfléchissant à d’autres instruments afin d’aménager ce financement participatif, plutôt que d’instaurer un crédit d’impôt. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire mon amendement. Je le redéposerai en vue de l’examen du projet de loi en séance publique si jamais nous n’aboutissons pas à des avancées significatives en ce domaine au cours de nos débats.
L’amendement SPE972 est retiré.
La commission aborde ensuite l’amendement SPE1020 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Je défends cet amendement au nom de mon groupe et en particulier de Françoise Dumas et Yves Blein. Il vise à une réévaluation du montant du chiffre d’affaires global des associations en deçà duquel on considère qu’elles n’ont pas un caractère lucratif et entrepreneurial. Le seuil fixé à 60 000 euros, instauré en 2000, n’a pas été réévalué depuis plus de douze ans. Nous proposons donc qu’il soit porté à hauteur de 77 000 euros. Il est vrai que ce seuil est désormais indexé, mais un retard s’est accumulé pendant toutes ces années. Il s’agit d’un amendement d’appel, compte tenu des remarques qui ont été formulées au sujet de l’amendement précédent.
M. le ministre. Avis défavorable. Votre préoccupation est connue et partagée. La loi de finances pour 2015 y répond au moins partiellement, en revalorisant le seuil de la franchise. En outre, les réductions d’impôt sur les dons ne sont pas l’objet du projet de loi, en l’espèce. Je vous invite donc à retirer cet amendement. Nous aurons une discussion avec le secrétaire d’État au budget. Autant l’amendement précédent apportait une rationalisation et visait à soutenir l’économie sociale et solidaire qui contribue à la croissance et à l’activité, autant cet amendement-ci porte sur un autre sujet.
M. Jean-Yves Caullet. Je retire cet amendement tout en émettant le souhait que ce sujet soit rediscuté lors de l’examen du projet de loi de finances.
L’amendement SPE1020 est retiré.
Puis la commission en vient à l’amendement SPE967 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. On ne peut débattre des petits aménagements qui parsèment ce texte sans évoquer deux mécanismes centraux dans notre dispositif d’incitation à l’investissement et d’équilibre budgétaire : l’impôt sur les sociétés – IS – et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE. Omettre d’en parler reviendrait à reconnaître que les dispositions de ce texte ne permettront pas de résoudre nos problèmes de croissance.
Le groupe UDI tient à rappeler à l’occasion de la discussion de cet amendement que le taux d’IS en France est l’un des plus élevés d’Europe. De plus, beaucoup de pays le font baisser afin de relancer leur économie, si bien que le taux français est de plus en plus en décalage par rapport aux taux européens. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, l’objectif de ce texte est de faire converger plusieurs dispositions fiscales afin que la France ne soit pas retardataire en matière d’investissements et d’attractivité. Nous avons donc le devoir d’introduire ce type d’amendements : le Président de la République a en effet déclaré souhaiter atteindre un taux d’IS de 28 % en 2020. Nous proposons d’enclencher ce mouvement de baisse de façon progressive.
Il serait par ailleurs également nécessaire de réfléchir à l’assiette de cet impôt. Le débat que nous avons eu il y a quelques mois concernant la taxation de l’excédent brut d’exploitation a illustré la nécessité de revoir la fiscalité des entreprises.
M. le ministre. Monsieur Fromantin soulève un véritable problème et je ne souhaite pas donner l’impression que l’on écarte les enjeux les plus importants dans le cadre du présent projet de loi. Le Gouvernement a retenu une approche consistant à recourir à deux leviers.
Le premier, d’ordre fiscal et social, est celui du Pacte de responsabilité et de solidarité. Celui-ci a permis des allégements massifs d’impôts et de charges, qui ont été décidés à la suite de négociations avec l’ensemble des partenaires sociaux. Le choix retenu consiste à octroyer une baisse de la fiscalité de production, finalement la plus douloureuse parce que la plus aveugle, portant au-dessus de la marge. Je songe en particulier à la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés – C3S –, au CICE et aux allégements de charges prévus par ce pacte. Les 40 milliards d’euros de réduction des prélèvements obligatoires prévus au cours des trois années contribuent à cette stratégie d’allégement.
Une politique alternative aurait pu consister à diminuer le taux de l’impôt sur les sociétés. Celle-ci présente un avantage en termes de comparaisons internationales mais aussi un inconvénient : pour être assujetti à l’IS, encore faut-il produire un résultat. Or, le problème principal auquel se heurtent nos entreprises est celui de la marge. Pour qu’elles puissent constituer des fonds propres et s’endetter, la priorité est de leur permettre de reconstituer leurs marges. Telle est la politique qui a été retenue par le Gouvernement : elle nous a conduits à instaurer le CICE et à diminuer les impôts de production – l’intégralité de cet effort se répercutant progressivement sur la marge des entreprises.
Le second levier relève d’une approche micro-économique, passant par les réformes sectorielles prévues par ce projet de loi. J’assume donc totalement le fait que ce texte ne comprenne pas de mesures fiscales macro-économiques telles que celle que vous proposez, cette dernière ayant fait l’objet du Pacte de responsabilité et de solidarité. Le dispositif que vous proposez aurait pu être une voie alternative à celle qui a été prise. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement, qui a néanmoins pu permettre d’éclairer le fait que le présent projet de loi est complémentaire de l’approche macro-économique retenue par le Gouvernement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cette proposition, qui représente un coût de 8 milliards d’euros, est sans doute, en effet, un amendement d’appel visant à provoquer un débat sur la fiscalité des entreprises. Compte tenu de la manière dont il est gagé, il ferait passer à 100 euros le prix du paquet de cigarettes et aurait donc un effet sur la consommation de tabac. Pour cette raison ainsi que pour celles invoquées par M. le ministre, j’émets un avis défavorable à cet amendement.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je maintiens l’amendement, car compte tenu de la situation de la France, il est de notre devoir de poser ce problème dans le cadre du débat en cours.
M. le ministre. Indépendamment de ce qui a été voté et qui constitue notre stratégie macro-économique, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés à plusieurs reprises à baisser le taux d’IS d’ici à 2020 à hauteur de 28 %. Réitéré plusieurs fois, cet engagement est complémentaire de cette stratégie et n’est pas finançable au cours des deux années qui viennent ; il visait à donner un signal tout en prenant en compte la perspective que vous ouvrez.
La commission rejette l’amendement SPE967.
Elle en vient à l’amendement SPE968 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. À la suite du précédent amendement, cet amendement SPE968 vise à permettre aux entreprises de reconstituer leurs marges. Le Président de la République a en effet annoncé que le CICE serait en vigueur pendant trois ans, avant que la dépense fiscale ne soit transformée en allégement du coût du travail. Ce débat mérite d’être posé dans le cadre du présent projet de loi. Monsieur le ministre, le Gouvernement a-t-il réellement la volonté de supprimer, comme le prévoit cet amendement, les charges patronales liées à la branche famille en substitution du mécanisme provisoire qu’est le CICE ?
M. le ministre. Je salue tout d’abord une forme d’adhésion progressive au CICE : dans la pratique, d’une part, puisque cette adhésion a été mesurée par deux rapports indépendants, et, d’autre part, dans l’expression d’une volonté de pérenniser le dispositif et de le transformer en allégement de charges. Le Président de la République a lui-même indiqué publiquement qu’il souhaitait que le Gouvernement œuvre à horizon de 2017 afin de transformer le CICE en allégements de charges pérennes.
Ce transfert est complexe à effectuer.
D’abord, le CICE est en train de monter en charge. Le dispositif fonctionne et est utilisé par les entreprises. Votre amendement vise à le pérenniser. Or, l’esprit du Pacte de responsabilité et de solidarité, auquel contribue le CICE, consistait à organiser un dialogue social par branches qui soit la contraposée de ce geste fiscal visant à rétablir les marges des entreprises. L’idée de pérenniser le dispositif du CICE pose à ce stade un problème politique, puisqu’il était essentiel de mener ces négociations de branche pour accompagner l’effort accompli dans un contexte difficile pour nos finances publiques. Il importe que dans les semaines et les mois qui viennent, avant que quelque option ne soit prise, des accords de branche continuent à se négocier et à être conclus car c’est ce à quoi les partenaires sociaux se sont engagés en mars 2013.
Sur un plan technique, le transfert du CICE sur un allégement de charges est extrêmement complexe. Il n’est neutre ni pour les entreprises, ni pour les finances publiques. C’est pourquoi il est nécessaire que nous menions des travaux préliminaires en ce domaine. L’intention du Gouvernement a été exprimée par le Président de la République. Mais on ne peut en décider du jour au lendemain.
Tant pour des raisons d’opportunité politique – finaliser la conclusion d’accords de branche – que pour la raison technique que je viens d’invoquer, je vous invite à retirer votre amendement, qui, s’il ouvre des perspectives futures, est sans objet à ce stade.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement représente cette fois-ci un coût budgétaire de 13 milliards d’euros. De plus, il importe de ne pas négliger la branche famille. Enfin, monsieur le ministre, souhaitons que ce soit aussi une contraposée réciproque.
M. Jean-Christophe Fromantin. Par cohérence, je maintiens cet amendement, d’autant plus que ce projet de loi vise à relancer la croissance et que le coût que représentent ces deux amendements se retrouve peut-être parmi d’autres dispositions du texte. Enfin, monsieur le ministre, parallèlement aux dispositions prises dans le cadre du Pacte de responsabilité, deux faits paraissent inquiétants pour l’économie française : notre balance commerciale est marquée par un déficit structurel croissant – ce qui signifie que la France perd des parts de marché à l’étranger ; d’autre part, on entend certains tirer la sonnette d’alarme quant à l’évolution de notre productivité. Il y a quelques mois, le Conseil d’analyse économique a présenté un rapport alarmant relatif aux perspectives de croissance, faisant état de la difficulté de la France à relancer sa productivité à l’instar d’autres pays de l’OCDE.
J’entends bien qu’il soit difficile de s’engager dans la voie d’une telle réforme et que cette dernière ait un coût important. Pour autant, j’observe aussi la performance de notre économie, la compétitivité de nos entreprises, des indicateurs tels que les parts de marché ou le déficit commercial de la France – emblématiques de la santé de notre économie.
M. Dominique Lefebvre. Je regrette que notre collègue Fromantin ne retire pas ses amendements, dont nous avons longuement discuté dans cette salle et dans l’hémicycle à l’automne dernier, lorsque nous avons examiné le projet de loi de finances.
Le CICE représente un effort d’abaissement des charges pour les entreprises qui n’avait jamais été réalisé jusqu’à présent dans notre pays. Nous avons été conduits à l’effectuer dans un contexte de forte dégradation de nos finances publiques, puisque la majorité précédente ne nous avait pas laissé de marges de manœuvre. Ce dispositif répond aujourd’hui aux besoins des entreprises et doit s’inscrire dans la durée. Hélas, nous ne disposons probablement pas en ce moment des marges de manœuvre budgétaires qui nous permettraient de dépenser davantage que les 41 milliards d’euros du Pacte de responsabilité et de solidarité. Quant au basculement, à terme, du CICE, il suppose de régler des problèmes de transferts entre secteurs économiques et de finances publiques que nous examinerons le moment venu. En attendant, il est inutile de maintenir des amendements qui ont déjà été rejetés à trois reprises en séance publique.
M. Olivier Carré. Dans la mesure où l’on entend souvent cette rhétorique, j’invite mon collègue à rester dans l’esprit des travaux de cette commission au sein de laquelle nous avons davantage parlé de l’avenir que du passé – non pas qu’il faille en faire table rase, la dette nous le rappelle tous les jours. Cela étant, le Gouvernement en place depuis 2012 sait que l’état de notre pays n’est pas le résultat de la seule action de son prédécesseur : il est la conséquence des problèmes que les gouvernements de tous bords ont laissé s’accumuler. La France est tout de même parvenue à surmonter la crise internationale dans des conditions honorables eu égard à sa situation et à ce que l’on a pu observer dans d’autres pays. Je salue le fait que le Gouvernement se soit attelé à résoudre les difficultés que cette crise a révélées, tout comme l’avait fait celui que j’ai soutenu sans hésitation précédemment. Je retrouve d’ailleurs dans certaines dispositions de ce texte une forme de continuité que j’avais regretté de voir interrompue pendant plusieurs mois depuis 2012.
Cela dit, le Gouvernement va aujourd’hui avoir du mal à exaucer le souhait présidentiel de faire converger toutes les aides existantes car il a choisi, dans les circonstances que l’on connaît et devant la nécessité d’agir vite et de donner un signal aux entreprises, de créer un produit hybride auquel il sera difficile de substituer un autre mécanisme. Ces réflexions sont partagées sur tous les bancs parce qu’il faut que l’on parvienne à faire converger l’ensemble des allégements sociaux vers un seul barème ou à uniformiser ces allégements. Telle est l’une des missions du Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements, dont je suis membre avec notre collègue Guillaume Bachelay.
La commission rejette l’amendement SPE968.
Elle examine l’amendement SPE1408 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Selon nous, si le CICE avait été mieux ciblé, il aurait sans doute permis de créer plus d’emplois que le projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Cela étant, doutant de convaincre M. le ministre ce soir, je retire mon amendement.
L’amendement SPE1408 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement SPE978 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement vise à prendre en compte dans la part déductible de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF – les titres détenus par les actionnaires en dessous de 25 % du capital d’une entreprise. En effet, ces titres ne sont pas éligibles aujourd’hui à cette déduction. En effet, qu’il s’agisse d’actionnaires individuels, dirigeants ou salariés, ou d’actionnaires collectifs dans le cadre de l’épargne salariale, ces acteurs participent eux aussi au développement de l’entreprise et prennent un risque. Il serait donc légitime que les mécanismes de déduction sur l’ISF puissent bénéficier aussi aux actionnaires atteignant ce niveau de participation. Leurs investissements permettent de drainer environ 1 milliard d’euros. Dans l’intérêt du financement de l’économie française, cela représente un effort, un risque et un investissement. Il serait donc légitime que ces actionnaires bénéficient des mêmes facilités que ceux qui ont un niveau d’investissement supérieur.
M. le ministre. Je remercie tout d’abord M. Roumegas d’avoir retiré l’amendement précédent : il reprenait effectivement l’une des pistes possibles pour le CICE qui n’a pas été retenue à l’époque – les investissements en faveur de la recherche-développement – et que l’on ne saurait ajouter à celle pour laquelle nous avons opté – à savoir la masse salariale. La piste proposée serait plus complexe puisque le bénéfice du CICE a un caractère automatique.
S’agissant de l’amendement de M. Fromantin, nous disposons déjà d’un système d’exonération partielle qui est dérogatoire. En baissant le seuil de cette exonération comme vous le proposez, on ciblerait effectivement certains acteurs qui, de fait, sont des business angels et qui investissent à titre personnel dans des sociétés avec des participations très minoritaires. Si une telle proposition n’est pas inutile, l’action menée par le Gouvernement en faveur des sociétés d’investissements de business angels – SIBA – et des aménagements dont nous avons discuté, d’une part, et en faveur des politiques de cofinancement d’autre part – la Banque publique d’investissement – BPI – cofinançant des investissements aux côtés des business angels – vise à traiter le problème du financement de l’économie. Ce dernier n’est pas totalement résolu mais la mesure que vous proposez ne serait pas sans coût. Elle n’est pas aujourd’hui au cœur des priorités du Gouvernement. Bref, je comprends le problème que vous souhaitez régler : il est connu et circonscrit. Les personnes concernées jouent un rôle important dans le financement de notre économie. Mais je ne peux émettre un avis favorable à cet amendement.
Je profite de cette remarque pour vous informer que nous vous avons transmis à tous par voie électronique le rapport remis hier par M. Jean-Michel Charpin à Mme Marisol Touraine, M. Michel Sapin et moi-même, relatif aux retraites chapeau. Il porte sur l’article 64, dont nous discuterons demain.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le régime des biens professionnels permet au dirigeant de l’entreprise de ne pas payer d’ISF sur son outil de travail. Or, l’amendement proposé tend à accorder une exonération fiscale totale d’ISF aux salariés et aux mandataires qui détiennent des parts dans leur propre société. C’est un avantage dont on ne mesure pas l’impact budgétaire potentiel mais qui serait certainement excessif et très ciblé sur de très gros revenus ou de grandes fortunes. Or, le contexte actuel ne nous permet pas d’appliquer une telle mesure.
La commission rejette l’amendement SPE978.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, elle rejette successivement les amendements SPE1494 et SPE1495 de M. Jean-Christophe Fromantin.
Puis elle examine en discussion commune les amendements SPE969 et SPE970 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. Ces amendements visent à relever le plafond des dépenses déductibles de l’ISF à 90 000 euros afin de stimuler davantage l’investissement dans les PME, qui draine aujourd’hui 1 milliard d’euros mais qui pourrait en mobiliser davantage.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette successivement les amendements SPE969 et SPE970.
Elle en vient à l’amendement SPE 778 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Cet amendement tend à traiter le problème de la diversité des dates de prise en compte des investissements des SIBA et d’autres investisseurs. On compte en effet aujourd’hui six dates différentes: celle de l’impôt sur le revenu « Madelin » est fixée au 31 décembre, celle de l’impôt de solidarité sur la fortune au 22 mai, mais avec des variantes, notamment celle du 15 juin pour les patrimoines supérieurs à 2,570 millions d’euros. Compte tenu de cette complexité, il est proposé de ne maintenir qu’une période de référence identique pour toutes les natures de réduction d’ISF, la date préconisée étant celle de dépôt des déclarations au format papier de l’impôt sur le revenu.
M. le président François Brottes. Il s’agit d’une mesure de lisibilité sinon de simplification.
M. le ministre. Vous mettez en évidence un point intéressant. Dans le même temps, les campagnes de levées de fonds existant aujourd’hui sont rythmées par les dates fiscales, entraînant une accélération des investissements avant la date limite applicable. Cet alignement créerait un effet d’instabilité dont il faut mesurer l’impact. On risque aussi de limiter la flexibilité des dates pour les périodes de souscription des investisseurs et de créer une instabilité des périodes de souscription qui poserait problème. Je vous invite donc à retirer votre amendement et vous propose d’en discuter avec les cabinets compétents. Je m’engage à travailler sur ce thème soit pour vous convaincre que cette mesure aurait davantage d’effets pervers que de vertus soit pour y revenir en séance publique.
Mme Bernadette Laclais. Je retire mon amendement et me tiens à la disposition de votre cabinet pour retravailler cette question. Nous pourrions au moins passer à trois dates.
L’amendement SPE778 est retiré.
Article 35 quater [nouveau]
(art. L. 214-154 et L. 214-162-1 à L. 214-162-12 [nouveaux] du code monétaire et financier et 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A, 1655 sexies B [nouveaux], 1763 B et 1763 C du code général des impôts)
Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple
Le présent article additionnel, résultant de l’adoption d’amendement présenté par M. Arnaud Leroy, vise à ouvrir le régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
1. Le régime juridique très souple des fonds professionnels spécialisés
Conformément à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, les fonds professionnels spécialisés, qui peuvent revêtir la forme d’une SICAV ou d’un fonds commun de placement (FCP), peuvent investir dans des biens à condition que :
– la propriété soit fondée sur une inscription, un acte authentique ou un acte sous seing privé dont la valeur juridique soit probante ;
– le bien ne fasse l’objet d’aucune sûreté et faire l’objet d’une valorisation fiable ;
– la liquidité du bien permette au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Conformément à l’article L. 214-153-1 du même code, seuls les investisseurs professionnels peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés. Par extension, l’investissement peut être réalisé par les dirigeants, les salariés ou les personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que la société de gestion elle-même.
L’article L. 214-156 renvoie à l’Autorité des marchés financier (AMF) le soin de déterminer les règles de fonctionnement de ces fonds.
La réglementation de l’AMF applicable aux fonds professionnels spécialisés D’après le site internet de l’AMF, les fonds professionnels spécialisés ont été créés « afin de mettre à disposition des investisseurs professionnels un véhicule de droit français régulé, disposant d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif ». Une déclaration à l’AMF Les fonds professionnels spécialisés ne font pas l’objet d’un agrément mais sont déclarés à l’AMF au plus tard un mois après leur constitution, conformément aux dispositions de l’instruction DOC-2012-06, et sont régulés tout au long de leur existence. En revanche, la société de gestion de portefeuille (française) doit avoir mis à jour au préalable, son programme d’activité. Les ratios d’investissement À la différence des autres organismes de placement collectif, les ratios d’investissement d’un fonds professionnel spécialisé sont fixés par son règlement ou ses statuts. Il n’est pas tenu de respecter les ratios réglementaires applicables aux autres organismes de placement collectif. La gestion du passif Par dérogation aux dispositions applicables aux autres organismes de placement collectif, un fonds professionnels spécialisé peut également fixer ses modalités de gestion du passif, conformément à l’article L. 214-157 du code monétaire et financier, notamment les conditions de souscription, les conditions de rachat et de cessions, les conditions de libération des parts ou actions souscrites. La périodicité de calcul de la valeur liquidative Les fonds professionnels spécialisés doivent respecter une périodicité minimale semestrielle du calcul de la valeur liquidative. |
2. Une structure juridique permettant d’attirer les investisseurs
Du fait de cette grande souplesse et d’un régime fiscal attrayant, les fonds professionnels spécialisés ont connu un certain engouement des investisseurs. La littérature financière les présente comme des concurrents du Specialised Investment Fund en vigueur au Luxembourg ou encore du Qualifying Investor Fund prévu par le droit irlandais. Ce véhicule permettrait de rapatrier en France certains fonds offshore particulièrement volatiles et sensibles aux différentiels de fiscalité.
Les chiffres transmis par l’AMF à l’occasion de l’examen de la dernière loi de finances pour 2014 mettent en effet en évidence une augmentation du nombre des fonds spécialisés et de leur encours, quelle que soit leur forme juridique.
évolution des fonds professionnels spécialisés
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | ||||||||
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV |
FCP |
SICAV | |
Nombre |
251 |
17 |
311 |
25 |
348 |
30 |
382 |
34 |
421 |
40 |
478 |
46 |
529 |
49 |
Encours |
29,8 |
0,6 |
32,6 |
0,8 |
37 |
1 |
36,8 |
1,5 |
39,8 |
1,6 |
46,5 |
2,1 |
61 |
2,6 |
Source : AMF.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article additionnel, qui a été travaillé en amont par les différents services de l’État en lien avec l’AMF, prévoit d’ouvrir aux sociétés en commandite simple la faculté de constituer un fonds professionnel spécialisé. Dans ce cas, elles s’appelleraient les « sociétés de libre partenariat » (SLP).
1. Le régime juridique et fiscal des sociétés en commandite simple
La société en commandite simple est une société de personnes dotée de la personnalité morale. Cette société, toujours commerciale en raison de sa forme et quel que soit son objet, est caractérisée par la présence de deux catégories d’associés :
– les commandités, commerçants indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, qui se trouvent dans la même situation juridique que les associés en nom collectif ;
– les commanditaires, simples bailleurs de fonds non commerçants dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
L’existence d’un régime d’imposition différent pour les sociétés de capitaux, d’une part, et pour les personnes physiques, d’autre part, conduit logiquement à soumettre à l’impôt sur les sociétés les bénéfices qui ne peuvent être considérés comme entrant dans un patrimoine privé au fur et à mesure de leur réalisation, ni, par suite, être taxés directement en tant que revenus de ce patrimoine. S’appuyant sur ce principe, le 4 de l’article 206 du code général des impôts dispose que, même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires.
Il s’ensuit que l’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés en commandite simple est fonction de la qualité des associés composant la société :
– les associés commandités sont, lorsque la société en commandite simple n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement passibles de l’impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux (distribués ou non) correspondant à leurs droits dans la société ;
– la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires est assujettie à l’impôt sur les sociétés au nom de la société elle-même.
Il en est ainsi quelles que soient les stipulations des statuts de la société en commandite simple et même si les associés ont convenu de mentionner le nom d’un commanditaire dans la raison sociale et de le rendre indéfiniment responsable des dettes sociales.
De même, le fait que la propriété de la part d’associé commanditaire soit dissociée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, lequel détient en outre une part d’associé commandité, ne met pas obstacle à l’assujettissement de la société en commandite simple à l’impôt sur les sociétés, à raison de la part des bénéfices correspondant à la part d’associé commanditaire.
2. La portée du présent article additionnel
Le présent article offre une souplesse complémentaire à des investisseurs qui souhaiteraient investir en France sous la forme d’un fonds professionnels spécialisé.
Fiscalement, la constitution d’une structure d’investissement sous la forme d’un fonds professionnel spécialisé est transparente : ainsi, s’il s’agit d’une SICAV, le régime particulier applicable à ces structures, notamment l’exonération d’impôt sur les sociétés, continuera de s’appliquer.
Il en sera de même pour les sociétés en commandite simple. Dès lors, l’intérêt de constituer ces nouvelles SLP résidera non pas dans avantage fiscal mais dans la souplesse qu’offrent les fonds spécialisés dans leur relation avec le régulateur des marchés financiers.
*
* *
La commission aborde l’amendement SPE864 de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Le capital risque est un secteur que l’on connaît peu et qui a mauvaise réputation en France. Il représente 250 000 emplois nets créés en quatre ans, dont 36 000 en 2013, des investissements à 60 % dans des PME et plus d’un quart des fonds investis dans des entreprises de taille intermédiaire – ETI.
Cet amendement vise à doter notre arsenal juridique d’une arme qui nous permette de nous battre à armes égales avec des pays comme l’Allemagne ou le Luxembourg, qui ont adopté une législation très attrayante pour les fonds de capital risque. Les fonds français ont de grandes difficultés à récolter des capitaux. Les grands investisseurs institutionnels, par manque de transparence, cherchent à aller au Luxembourg et en Allemagne. Nous avons donc le devoir, dans le cadre de cette loi, de nous adapter – et le dispositif proposé coûte peu cher – pour pouvoir nous aussi bénéficier d’une manne des investisseurs internationaux. Cet amendement contribue à la création d’un nouveau mécanisme juridique, la société de libre partenariat, forme de société en commandite.
M. le ministre. M. Leroy a parfaitement décrit la chose. Les neuf pages de cet amendement recouvrent un important travail technique. Il s’agit ici de la forme juridique la plus utilisée par les sociétés de capital risque. Elle offre une sécurité juridique permettant de contribuer au développement du financement de notre économie. Plusieurs dispositifs existent : la BPI qui, dans le secteur public, a une véritable part de marché dans les premières phases ; les business angels français, pour lesquels un régime a été créé et à l’aménagement duquel contribue notre discussion ; le dispositif « ISF-PME », qui joue un véritable rôle dans les premières phases de financement. Nous avons donc besoin de développer les sociétés de capital risque pour les deuxième et troisième tours de table et pour les financements technologiques les plus risqués. Il nous faut à la fois attirer des investisseurs – objet de la politique d’attractivité que nous essayons de conduire – et disposer de formes juridiques adaptées. C’est ce à quoi répond cet amendement. À cet égard, la création de la société de libre partenariat comble un véritable vide sur le plan juridique et financier. J’émets donc un avis très favorable à cet amendement.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. J’établis le même constat : nous avons besoin de financements de haut de bilan. On connaît les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de mobiliser du capital risque. C’est pourquoi il importe que nous créions cette nouvelle forme de société qui nous permettra d’y parvenir. L’impact budgétaire de cette mesure n’est pas forcément lourd. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. Olivier Carré. J’observe cette semaine de nombreuses conversions chez nos collègues de la majorité. Je précise néanmoins que nos partenaires étrangers disposent de tous les outils qui ont été rejetés précédemment et qu’avait proposés Jean-Christophe Fromantin – notamment ceux tendant à renforcer les allégements fiscaux et qui accompagnent l’investissement en capital. Il convient certes de disposer d’un véhicule juridique mais aussi des capitaux qui vont avec. Lorsque l’on compare les montants déductibles au Royaume-Uni ou au Luxembourg à ceux, très faibles, en vigueur dans notre pays, on s’aperçoit que l’on aura beau inventer des véhicules juridiques, se posera toujours un problème de masses financières à affecter. Si le Gouvernement était cohérent, il augmenterait le montant de l’avantage PME, de l’ISF-PME et de l’avantage PME applicable à l’impôt sur le revenu. Une telle augmentation n’aurait pas une incidence fiscale majeure.
M. Arnaud Leroy. La création de ce véhicule juridique vise aussi à attirer et à rassurer les investisseurs internationaux. Elle est donc indépendante du débat fiscal qui précède.
La commission adopte l’amendement SPE864.
L’amendement SPE915 rectifié de M. Arnaud Leroy est retiré.
Puis la commission en vient à l’amendement SPE996 de M. Yves Blein.
M. Christophe Sirugue. Depuis la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués gère un fonds alimenté par l’ensemble de ces biens. Ce fonds est relativement important – environ 450 millions d’euros par an. Une directive européenne du 3 avril 2014 invite les États membres à adopter des dispositions pour redistribuer, prioritairement à des fins sociales, les biens saisis de même nature que ceux que gère cette agence.
Cet amendement vise à intégrer les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire parmi les destinataires de ce fonds, dans la mesure où elles répondent au critère de l’utilité sociale défini à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
M. le ministre. Je partage l’intention exprimée par les auteurs de l’amendement. S’agissant de la confiscation des biens mal acquis, l’amendement risque d’apparaître comme un cavalier, compte tenu de la référence qui y est faite au code de procédure pénale. Tel qu’il est rédigé, il n’aurait pas une portée opérationnelle. Néanmoins, je vous propose qu’avec ma collègue Carole Delga, nous retravaillions la question indépendamment de ce projet de loi dans les prochains mois afin d’y apporter la réponse adaptée dans le texte qui convient.
Je tiens par ailleurs à préciser que, compte tenu du retrait de l’amendement SPE915 rectifié, nous reparlerons du financement participatif après l’article 40 du projet de loi.
L’amendement SPE996 est retiré.
*
* *
Article 35 quinquies [nouveau]
(article L. 214-164 du code monétaire et financier)
Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à renforcer la présence des salariés dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).
En effet, l’épargne salariale est l’épargne des salariés, comme l’a bien rappelé le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) dans ces travaux. En conséquence, leurs représentants doivent disposer d’un réel pouvoir de contrôle quand cette épargne est investie dans des FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne salariale.
Il s’agit donc de faire de la représentation des salariés aux deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance des FCPE la règle, en généralisant cette pratique en vigueur dans certains fonds, notamment ceux labellisés « investissement socialement responsable » (ISR) par le comité intersyndical de l’épargne salariale.
Le présent article fixe ainsi aux deux tiers la représentation minimale des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, au lieu d’une stricte parité avec les représentants de l’entreprise, comme c’est le cas actuellement.
La proposition consiste donc à abaisser le ratio minimal des représentants de l’entreprise dans les conseils de surveillance des FCPE de moitié à un tiers.
*
* *
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’un des enjeux de l’épargne salariale est celui de la gouvernance et de la place des salariés au sein des outils de gouvernance. Il est donc proposé, dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise, de faire progresser la représentation des personnels.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1854.
*
* *
Article 35 sexies [nouveau]
(article L. 214-164 du code monétaire et financier)
Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise doivent respecter dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, vise à faciliter l’orientation de l’épargne vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Il complète ainsi les considérations que doivent, s’il y a lieu, respecter les sociétés de gestion dans l’achat ou la vente des titres. Les règlements des fonds d’épargne salariale pourront ainsi préciser les considérations liées aux types d’entreprises financées (part des PME et ETI, par exemple) que les sociétés de gestion devront appliquer. Le rapport annuel du fonds devra rendre compte de leur application.
*
* *
La commission en vient à l’amendement SPE1653 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à faciliter l’orientation de l’épargne vers les PME et les ETI en complétant la liste des conditions que doivent respecter s’il y a lieu les sociétés de gestion dans l’achat ou la vente de titres. Le rapport annuel de chaque fonds devra rendre compte de cette application. Il s’agit là encore de renforcer le financement de l’économie réelle grâce à une meilleure orientation.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1653.
*
* *
Article 35 septies [nouveau]
(art. L. 214-165 du code monétaire et financier)
Distribution facultative de dividendes dans les fonds communs de placement en entreprise
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à mettre fin à l’obligation, pour les FCPE d’actionnariat salarié, de prévoir la distribution des dividendes attachés aux actions du portefeuille du fonds.
En effet, jusqu’à présent, le conseil de surveillance du FCPE ne peut pas y déroger. Cette mesure contraignante peut constituer un frein au développement de l’actionnariat salarié compte tenu de la complexité de l’organisation à mettre en place.
Le présent article supprime cette obligation pour rendre la distribution des dividendes facultative comme cela était le cas avant la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié. Le règlement du FCPE et son conseil de surveillance paritaire préciseront si les dividendes sont distribués ou capitalisés dans le fonds.
*
* *
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il est proposé de supprimer l’obligation pour les fonds communs de placement d’entreprise de prévoir la distribution des dividendes attachés aux actions du portefeuille du fonds. Le plus souvent, alors que les montants en cause sont faibles, la gestion en est compliquée. Bien sûr, les administrateurs pourront en décider autrement s’ils le souhaitent.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1859.
*
* *
Article 35 octies [nouveau]
(art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale)
Suppression de la contribution spécifique à la charge de l’employeur sur l’abondement à un plan d’épargne pour la retraite collectif
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à supprimer la taxe que doivent actuellement acquitter les employeurs en cas d’abondement d’un PERCO.
Le PERCO donne en effet aux salariés couverts la possibilité de se constituer, dans un cadre collectif, une épargne accessible au moment de la retraite sous forme de rente viagère ou, si l’accord collectif le prévoit, sous forme de capital.
Le PERCO est alimenté par le versement de la participation ou de l’intéressement des salariés ainsi que, le cas échéant, par les abondements des employeurs. L’ensemble de ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et assujetties au forfait social au taux de 20 %. La fraction des abondements des employeurs supérieure à 2 300 euros par an et par salarié est en outre assujettie à une contribution spécifique patronale, affectée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), au taux de 8,2 %, et dont le rendement s’élève à 7 millions d’euros.
Cette taxe génère des effets désincitatifs au développement du PERCO, puisqu’elle bloque les abondements des employeurs, tout en constituant une recette limitée pour les finances publiques.
En cohérence avec les conclusions des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), cet article propose de supprimer cette contribution spécifique afin d’encourager les abondements des employeurs vers les PERCO.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1658 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’abondement de l’employeur supérieur à 2 300 euros au plan d’épargne pour la retraite collectif – PERCO –, qui permet aux salariés de profiter de l’épargne salariale et de préparer leur avenir, fait l’objet d’une contribution spécifique de 8,2 %. Pour rendre plus attractive cette politique de distribution, il est proposé de supprimer cette contribution, dont le rendement est d’environ 7 millions d’euros. En effet, cette taxation produit des effets dissuasifs qui empêchent le développement du PERCO.
Cette suppression était l’une des propositions du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié – COPIESAS –, qui a travaillé à l’automne dernier avec l’ensemble des partenaires sociaux.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1658.
*
* *
Elle aborde l’amendement SPE412 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il est satisfait par le précédent donc je le retire.
L’amendement SPE412 est retiré.
*
* *
Article 35 nonies [nouveau]
(art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale)
Taux réduit de forfait social en cas de placement des sommes issues de l’épargne salariale sur un plan d’épargne pour la retraite collectif
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à réduire le taux du forfait social acquitté par les salariés et les entreprises lors du placement et de l’abondement des sommes issues de l’épargne salariale sur les plans d’épargne retraite pour la retraite collectifs (PERCO) investis en titres de PME-ETI.
Cet article vise ainsi à mieux orienter l’épargne salariale vers le financement de l’économie. La modulation du forfait social porte sur l’abondement de l’entreprise ainsi que sur les versements des salariés au titre de l’intéressement et de la participation.
Par conséquent, un taux réduit de forfait social, fixé à 16 % s’appliquera aux PERCO dont les règlements prévoient que la gestion pilotée est l’option par défaut du PERCO et que cette gestion pilotée est investie sur un fonds comprenant au minimum 7 % de titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire en actions de PME ou ETI ou en fonds investis à hauteur de 75 % minimum en titres de PME-ETI, dont les deux tiers en actions.
*
* *
La commission examine en discussion commune les amendements identiques SPE266 de Mme Véronique Louwagie et SPE411 de M. Patrick Hetzel, l’amendement SPE976 de M. Jean-Christophe Fromantin, les amendements identiques SPE265 de Mme Véronique Louwagie et SPE410 de M. Patrick Hetzel, l’amendement SPE962 de M. Jean-Christophe Fromantin, l’amendement SPE955 rectifié de M. Philippe Vigier et l’amendement SPE1857 des rapporteurs.
M. Olivier Carré. L’amendement SPE266 est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le forfait social, dont le montant a été multiplié par dix en cinq ans, est aujourd’hui appliqué de façon uniforme à l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale, sans prendre en compte le fait que les sommes soient perçues directement par le salarié ou épargnées sur le long terme, permettant ainsi de financer l’économie. Cette situation est injuste et contre-productive. C’est pourquoi il conviendrait de moduler le taux du forfait social en fonction de l’horizon de placement, comme l’ont souligné de nombreux rapports récents, notamment un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales. Le taux serait ramené à 8 % lorsque les sommes sont investies dans un plan d’épargne entreprise. Les sommes affectées à un dispositif d’épargne retraite seraient exonérées de forfait social afin d’inciter les salariés et les entreprises à constituer une épargne retraite.
M. Jean-Christophe Fromantin. L’amendement SPE 976 vise à ramener à 15 % le forfait social pour les sommes épargnées vers un plan d’épargne d’entreprise ou les PERCO.
M. Gilles Lurton. L’amendement SPE265 a pour objet de moduler le taux du forfait social selon que les sommes issues de la participation et de l’intéressement ainsi que de l’abondement de l’employeur sont distribuées immédiatement au salarié ou investies dans des dispositifs d’épargne salariale comportant une période de blocage. Dans ce cas, le taux serait ramené à 8 % lorsque les sommes attribuées sont affectées à un dispositif d’épargne retraite.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement SPE410 est défendu.
M. Jean-Christophe Fromantin. Les amendements SPE976 et SPE955 sont défendus.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE1857 vise à soutenir l’épargne salariale par une baisse du forfait social ciblée sur le financement de l’économie, qui compte parmi les objectifs que nous nous sommes fixés. Un autre amendement permettra de flécher ce flux vers les plans d’épargne en actions destinés aux petites et moyennes entreprises – PEA-PME. Pour ce faire, le présent amendement a pour objet de mieux orienter l’épargne salariale vers les PERCO qui ont investi en titres éligibles de PME et d’ETI en fixant le taux du forfait social à 16 %. Ce taux réduit s’appliquera aux PERCO dont les règlements prévoient que la gestion pilotée est l’option par défaut et se trouve investie dans un fonds qui comporte 7 % minimum en titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire en actions de PME ou d’ETI, ou en fonds investis à hauteur de 75 % minimum en titres de PME-ETI, dont les deux tiers en actions.
J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de tous les amendements présentés à l’exception de celui que j’ai déposé avec le rapporteur général.
M. le ministre. Le forfait social fait consensus, car il est important pour le financement des entreprises et pour la pleine participation des salariés à ce collectif humain. Le Gouvernement, le COPIESAS et le rapport piloté par M. Christophe Castaner puis négocié par les partenaires sociaux ont souligné leur attachement à ce dispositif. La série d’amendements cherche à revenir à l’ancien régime ; les rapporteurs proposent au contraire d’élaborer un système favorisant le financement des PME et le recours à l’épargne salariale de celles-ci, afin d’accroître les sources de financement de l’économie et d’étendre ce mécanisme aux PME, car il reste aujourd’hui presque exclusivement utilisé par les grandes entreprises. Cette réforme vise à accroître l’attractivité du dispositif pour les PME.
Ainsi, le taux du forfait social diminue de 20 à 8 % pour les premiers plans de PME ; la structuration d’un PERCO+ portera le taux à 16 %. Cet équilibre peut apparaître insatisfaisant pour certains auteurs d’autres amendements, mais il repose sur un paramétrage permettant d’alléger le forfait social de manière ciblée pour les PME tout en respectant nos contraintes budgétaires.
J’émets donc un avis favorable à l’adoption de l’amendement du rapporteur général et du rapporteur thématique et défavorable à celle des autres amendements.
M. Olivier Carré. Nous nous réjouissons que vous favorisiez une forme de capitalisation en vue de la retraite tout en renforçant une source de financement des entreprises. Cette stabilité capitalistique devrait permettre à des PME de devenir des ETI.
Il serait intéressant de disposer d’un tableau présentant l’ensemble des taux de fiscalité en la matière ; la grande hétérogénéité que nous sommes en train de construire nécessitera peut-être une nouvelle intervention du législateur pour simplifier le système.
La commission rejette successivement les amendements SPE266, SPE411, SPE976, SPE265, SPE410, SPE962 et SPE955 rectifié.
Puis elle adopte l’amendement SPE1857.
L’amendement SPE975 de M. Jean-Christophe Fromantin est retiré.
*
* *
Article 35 decies [nouveau]
(art. L. 3315-2 du code du travail)
Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises en cas d’absence de choix du salarié
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à proposer le placement par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI).
En effet, la loi du 3 décembre 2008 relative aux revenus du travail a conduit à inverser les logiques de l’intéressement et de la participation, l’intéressement étant versé par défaut aux salariés, alors que la participation est placée (pour moitié sur un PERCO). Pour les entreprises qui utilisent ces deux dispositifs, cela est source de complexité, et pour les salariés, source de confusion.
Aussi, comme le préconisent plusieurs rapports récents (rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales, rapport du COPIESAS), l’objet de cet article est d’harmoniser la logique de ces dispositifs en proposant le placement par défaut de l’intéressement. Sous réserve qu’un PEE ou un PEI ait été mis en place par l’entreprise à l’issue de la négociation obligatoire ou à son initiative, à défaut de choix du salarié, 100 % des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement seraient placées sur le PEE ou le PEI. Cela permettrait d’améliorer la lisibilité des dispositifs et de développer le financement de l’économie en incitant à l’épargne.
Le présent article simplifie et homogénéise donc les dispositifs d’épargne salariale en instaurant pour l’intéressement un dispositif déjà mis en place pour la participation.
Toutefois, le rapporteur thématique a considéré comme nécessaire de prévoir un « droit de rétractation » pour le salarié qui peut demander le déblocage exceptionnel de son intéressement fléché par défaut vers le PEE/PEI, pendant trois mois après qu’il a été informé du blocage de ses avoirs. Si le salarié demande le déblocage de ces sommes, ses droits sont calculés en fonction de la valeur liquidative applicable au moment où est formulée la demande de déblocage. La commission a adopté l’ensemble de ces dispositions.
*
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements SPE264 rectifié de Mme Véronique Louwagie et SPE1855 rectifié des rapporteurs.
M. Gilles Lurton. Cet amendement tend à résoudre la difficulté créée par l’existence de deux dispositifs, l’un sur l’intéressement, l’autre sur la participation. Le premier est versé par défaut au salarié, alors que la seconde se trouve placée. Afin d’accroître la lisibilité de ces mécanismes par les entreprises, l’amendement propose que la totalité des sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement soit placée sur le plan d’épargne entreprise – PEE – ou sur le plan d’épargne interentreprises – PEI.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Mon amendement offre en plus au salarié bénéficiaire la possibilité d’une rétractation ; il pourra ainsi demander le déblocage exceptionnel de son intéressement, fléché par défaut vers le PEE ou le PEI, trois mois après qu’il a été informé du blocage de ses avoirs.
Monsieur Lurton, l’idéal serait que vous retiriez votre amendement et que l’on adopte le mien.
M. Gilles Lurton. Je retire mon amendement.
L’amendement SPE264 rectifié est retiré.
M. le ministre. Je suis favorable au placement par défaut de l’intéressement, mais l’amendement présenté par les rapporteurs pourrait susciter des interrogations chez les salariés, habitués à percevoir directement l’intéressement. Or, vous proposez de leur laisser un droit de remords jusqu’au 31 décembre 2017, dont nous devons étudier les conséquences d’ici à la séance publique.
La commission adopte l’amendement SPE1855 rectifié.
*
* *
Article 35 undecies [nouveau]
(articles L. 3324-12 et L. 3334-11 du code du travail)
Instauration d’une gestion par défaut du plan d’épargne pour la retraite collectif en fonction de l’âge
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à prévoir que la gestion pilotée en fonction de l’âge du salarié soit l’option par défaut du PERCO, afin de mieux adapter l’investissement au profil de chaque salarié.
En effet, quelle que soit la technique employée, par arbitrages entre fonds ou par le biais de fonds dits « générationnels » conçus par tranche d’âge, la gestion pilotée permet une désensibilisation progressive et une réduction du risque du portefeuille à l’approche de la date de liquidation du PERCO par le bénéficiaire.
La gestion pilotée est donc tout à fait pertinente comme mode de gestion pour les salariés qui ne se sont pas prononcés de manière explicite sur le mode de gestion de leur PERCO.
Enfin, les mesures de déblocage exceptionnel prises depuis des années ne facilitent ni la lisibilité de l’épargne salariale, ni le financement de l’économie à long terme. Promouvoir la gestion pilotée devrait permettre d’atteindre ces deux objectifs.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1853 rectifié des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit de prévoir que la gestion pilotée en fonction de l’âge du salarié soit l’option par défaut du PERCO, afin de mieux adapter l’investissement au profil de chaque salarié. Cette mesure serait bénéfique au financement à long terme de l’économie : cette épargne pourra ainsi être constituée très tôt et donc abonder pendant longtemps l’économie réelle.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1853 rectifié.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique et du ministre, la commission rejette l’amendement SPE956 rectifié de M. Philippe Vigier.
*
* *
Article 36
(art. L. 3314 9 et L. 3324 10 du code du travail)
Harmonisation de la date de versement
des primes d’intéressement et de participation
Un nombre significatif d’entreprises verse à la fois des primes de participation et d’intéressement. Ainsi, en 2012, 55,8 % des salariés du secteur marchand non agricole ont eu accès à un dispositif d’épargne salariale, parmi lesquels 49 % bénéficiaient d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation, selon les chiffres de la direction de l’animation de la recherche et de la statistique (DARES) du ministère du travail.
Le présent article harmonise les dispositions relatives aux délais de versement des primes d’intéressement et de participation et fixe un taux unique d’intérêt de retard en cas de dépassement des délais prévus par la loi. Il s’inscrit dans un mouvement de réforme en profondeur de l’épargne salariale, voulu par le Gouvernement et qui s’inspire directement des recommandations du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) instauré au début de l’été 2014. Le COPIESAS a en effet articulé ses recommandations autour de trois axes : la simplification des dispositifs d’épargne salariale, leur élargissement aux PME et la mobilisation des fonds de l’épargne salariale au profit du financement de l’économie.
Le présent article s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification des dispositifs. Il s’agit essentiellement d’une mesure de clarification et d’harmonisation de nature technique qui apparaît assez consensuelle. Elle permettra de faciliter l’appréhension des règles en matière d’épargne salariale par les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs.
I. L’HARMONISATION DE LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION
En l’état actuel du droit, les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation doivent être versées aux salariés avant des dates légales différentes pour chacun des dispositifs. Ces dates, lorsqu’elles sont dépassées, déclenchent des intérêts de retard, à la charge de l’employeur.
En matière d’intéressement, la date limite est le dernier jour du septième mois suivant l’exercice de calcul. Ainsi, toutes les sommes versées au-delà de la date limite de versement produisent des intérêts calculés au taux légal (article L. 3314-9 du code du travail).
En matière de participation, la date limite est le dernier jour du quatrième mois suivant l’exercice de calcul (article R. 3324-21-1 du code du travail). Passé ce délai, les entreprises complètent le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privés (article D. 3324-21-2 du code du travail). Contrairement à l’intéressement, les dispositions applicables à la participation se trouvent donc dans la partie réglementaire du code du travail.
L’objectif de présent article est d’harmoniser les dates limites de versement et, en conséquence, le point de départ des intérêts de retard. Il est donc prévu une date limite unique pour le versement des primes d’intéressement et de participation, à savoir le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice de calcul au titre duquel les droits sont nés, date médiane entre celles actuellement en vigueur. Corrélativement, les intérêts de retard débutent, pour les deux dispositifs, le premier jour du sixième mois.
Par rapport au droit actuel, cela conduit à repousser d’un mois la date limite de versement en ce qui concerne la participation et à l’avancer de deux mois en ce qui concerne l’intéressement. La mesure permet donc de réduire la probabilité d’un versement avec retard de la participation et, inversement, elle accroît la probabilité d’un versement avec retard de l’intéressement. Ces dispositions doivent ainsi permettre de rendre le dispositif plus lisible et de renforcer l’incitation, pour les entreprises, à organiser au mieux le versement des deux primes, sous peine de pénalités de retard renforcées dans le cas de l’intéressement.
En effet, en raison de la fixation d’une date limite commune aux versements issus des deux dispositifs d’intéressement et de participation, ces intérêts de retard seront désormais calculés à partir du premier jour du sixième mois suivant l’exercice de calcul au titre duquel les droits sont nés (soit le lendemain de la date limite de versement). Ce point de départ de l’indisponibilité de la participation figurera dorénavant dans la partie législative du code du travail (article L. 3324-10), ce qui renforce sa portée juridique. Il s’accompagne également de la mise en place d’un taux d’intérêt de retard unique, fondé sur le taux applicable en matière de participation (article L. 3314-9 du code du travail).
II. LA MISE EN PLACE D’UN TAUX D’INTÉRÊT DE RETARD UNIQUE
En cas de dépassement de la date limite pour le versement des primes d’intéressement et de participation, le code du travail prévoit actuellement deux taux différents : le taux d’intérêt légal pour l’intéressement et le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la participation. Cette dualité de dispositifs nuit à la lisibilité du droit applicable à l’épargne salariale.
Par conséquent, les intérêts de retard seront désormais calculés sur la base de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des entreprises (TMOP), selon la formule qui n’était jusqu’ici appliquée que pour la participation. Ainsi, tout retard dans le versement des primes d’intéressement conduira à augmenter les intérêts de retard car le TMOP est supérieur en moyenne au taux d’intérêt légal (TIL), ainsi que le montre le graphique suivant :
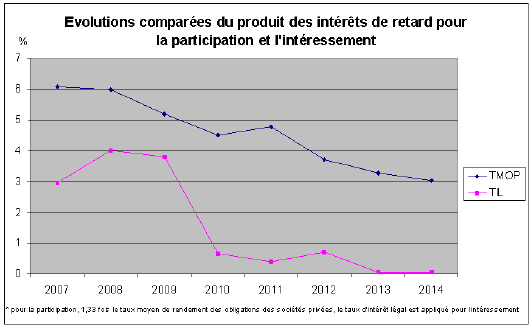
Source : ministère des finances.
Il s’agit donc de prendre comme seule référence le taux applicable aujourd’hui à la participation et de renforcer les incitations à verser les primes d’intéressement en temps et en heure aux salariés. Il convient toutefois de rappeler que peu d’entreprises versent avec retard les primes d’intéressement : au contraire, elles effectuent souvent leurs versements en avance par rapport à la date limite légale, notamment afin d’effectuer ces versements avant la période estivale (lorsque l’exercice est calculé sur l’année civile). De ce fait, la mesure constitue essentiellement une simplification pratique pour les entreprises.
*
* *
La commission aborde l’amendement SPE9 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement a pour objet la suppression de l’article, qui modifie de nouveau des dispositions relatives au régime de l’épargne salariale ; cette inconstance législative s’avère préjudiciable au bon fonctionnement de ce mécanisme, et de nombreux acteurs insistent sur le besoin de stabilité du cadre juridique.
M. le ministre. Monsieur Hetzel, je suis très sensible à votre argumentation sur la nécessaire stabilité, mais cet article 36 constitue une accroche permettant d’attendre la fin de la négociation des partenaires sociaux sur le rapport du COPIESAS et d’y intégrer les amendements que nous avons déjà votés – souvent à l’unanimité. Les éléments techniques de sécurisation et de clarification contenus dans cet article transposent le travail du COPIESAS, piloté par M. Christophe Castaner, négocié avec les partenaires sociaux et qui améliore le dispositif d’ensemble. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Patrick Hetzel. Je retire mon amendement.
L’amendement SPE9 est retiré.
La commission examine, en présentation commune, les amendements SPE807 et SPE808 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE807 vise à corriger une erreur technique, en proposant que le taux d’intérêt de retard unique en cas de dépassement de la date limite de versement des primes pour l’intéressement et la participation soit le taux d’intérêt légal qui sert à calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent – le taux d’intérêt légal s’applique déjà pour l’intéressement.
Le second amendement, de précision, propose, puisque les dispositions relatives aux délais de versement des primes et aux taux d’intérêt de retard, prévues par l’article 36, s’appliquent de plein droit aux accords d’intéressement et de participation des salariés, de préciser qu’il n’est pas nécessaire de modifier les accords en cours à la date de la publication de la loi. Il s’agit d’une mesure de simplification administrative et de bon sens, qui s’accorde à vos propos, monsieur le ministre.
M. le ministre. Le premier amendement est satisfait, car le texte prévoit l’alignement entre la participation et l’intéressement auquel votre proposition conduit – certes, par un autre chemin.
S’agissant du second amendement, le changement législatif modifie de droit les accords.
Je vous invite donc à retirer vos deux amendements, monsieur Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Je retire le premier amendement ; en revanche, je nourris un doute au sujet du second, car un risque existe si le texte ne précise pas que la modification des accords n’est pas nécessaire.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. À mon sens, l’article 36 prévoit que le nouveau droit ne sera applicable qu’une fois clos l’exercice en cours ; l’objet de l’amendement semble donc satisfait, même si nous vérifierons ce point d’ici à la séance publique.
Je remercie Patrick Hetzel d’avoir retiré son premier amendement, car le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées – TMOP – est aujourd’hui nettement plus favorable que le taux d’intérêt légal – TIL.
M. Patrick Hetzel. Je retire l’amendement SPE808, mais je le représenterai en séance publique en cas d’absence de réponse claire du Gouvernement sur cette question.
M. le ministre. Après consultation du cabinet de M. le ministre du travail, je vous confirme qu’il n’est pas nécessaire d’apporter cette précision dans la loi.
Les amendements SPE807 et SPE808 sont retirés.
La commission adopte l’article 36 sans modification.
*
* *
Article 36 bis [nouveau]
(art. L. 3322-9 du code du travail)
Redynamisation de la négociation de branche sur l’épargne salariale
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative de M. Jean-Christophe Fromantin, vise à redynamiser les négociations de branche sur l’épargne salariale.
En effet, alors qu’au niveau de l’entreprise, plus de 33 000 accords concernant le régime de participation ont été signés en 2012, seulement dix-sept avenants ou accords l’ont été au niveau des branches.
Afin de faciliter le recours des entreprises à des accords dérogatoires dont la formule de calcul de la réserve de participation serait mieux adaptée à leur secteur, le présent article prévoit de relancer l’obligation de négocier des accords de participation au niveau de la branche, dans un délai raisonnable.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE964 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement vise à réinstaurer la possibilité d’ouvrir des accords de branche sur l’épargne salariale ; parmi les 33 000 accords signés en 2012, seuls dix-sept d’entre eux comportaient un avenant permettant l’utilisation de cette faculté dérogatoire d’adaptation de l’accord à des spécificités sectorielles.
M. le ministre. Je comprends l’objectif qui concourt à dynamiser la négociation de branche sur l’épargne salariale ; néanmoins, le rétablissement d’une obligation de négociation d’accords de participation dans les branches serait un retour à la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, qui prévoyait que chaque branche devait se soumettre à cette obligation d’ici au 31 décembre 2009. Le bilan de cette disposition s’est avéré famélique, puisque seulement cinq branches ont signé un tel accord entre 2007 et 2009. Essayons donc de faire réussir dans les entreprises les dispositifs que nous venons de mettre en place et voyons si une nécessité de les développer dans les branches se fait jour.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Aucun partenaire social ne s’est fait l’écho d’une telle proposition au COPIESAS et j’ai peur que l’inscription d’une obligation dans la loi soit contre-productive. J’émets donc un avis de sagesse.
M. le ministre. Même avis.
La commission adopte l’amendement SPE964.
Article 37
(art. L. 3332 3 du code du travail)
Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation
Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif qui permet au salarié d’augmenter ses revenus par la constitution, avec l’aide de l’entreprise, d’un portefeuille de valeurs mobilières. Tout salarié peut bénéficier du PEE mis en place par son entreprise. Les sommes épargnées sur le PEE sont bloquées pendant au moins cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé autorisé).
Le présent article améliore la lisibilité des dispositions du code relatives à la mise en place de l’épargne salariale, en ce qui concerne le PEE. Celles-ci sont en effet, selon les dispositifs, tantôt entièrement définies dans la loi – participation, intéressement et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), tantôt précisées par décret – plan d’épargne d’entreprise.
Par souci de cohérence et de clarté, la mesure proposée inscrit donc dans la loi les modalités de mise en place du plan d’épargne d’entreprise. Conformément au droit actuel, celles-ci sont identiques à celles applicables en matière de participation (article L. 3322-6 du code du travail).
I. LA MISE EN PLACE D’UN PEE
La mise en place d’un PEE ou d’un PERCO est possible à partir d’au moins un salarié (même à temps partiel) titulaire d’un contrat de travail de droit privé, en plus du mandataire social ou du dirigeant non salarié. Toutes les entreprises, sauf les entreprises individuelles, peuvent donc mettre en place un PEE, et cela quels que soient leur taille, leur effectif et leur statut juridique.
Si l’entreprise dispose d’un comité d’entreprise (CE) ou de délégués syndicaux (DS), le PEE et le PERCO doivent être négociés. En revanche, ils peuvent être mis en place par décision unilatérale de l’employeur en cas d’absence de CE ou de DS (mais avec information préalable des délégués du personnel) ou s’il y a un désaccord avec le CE ou les DS lors de la négociation. Il doit alors consulter le CE ou, à défaut, les délégués du personnel (DP), sur le projet d’assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le procès-verbal de la consultation du CE ou, à défaut, des DP, doit être joint à ce dépôt).
Le présent article ne s’intéresse qu’au cas de mise en place d’un accord conclu avec le personnel de l’entreprise. Il a pour objectif d’inscrire dans la loi les règles qui prévalent déjà en matière de mise en place de PEE et qui sont identiques à celles prévues pour la mise en place d’accords de participation. Toutefois, jusqu’à présent, ces règles n’étaient définies que par décret.
II. LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’UN PEE EN CAS D’ACCORD AVEC LE PERSONNEL
Ainsi, le présent article prévoit d’insérer dans l’article L. 3332-3 du code du travail, qui organise la mise en œuvre des PEE, une référence aux modalités de mise en place des accords de participation, lesquelles sont prévues par l’article L.3322-6 du même code. Ces modalités de mise en place d’un PEE, comme d’un accord de participation, sont les suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;
4° ![]() la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Il s’agit ainsi essentiellement d’une mesure d’harmonisation législative visant à rendre plus lisibles les modalités de négociation qui président à l’adoption d’un PEE en cas d’accord avec le personnel. La précision apportée sur ces dispositions permettra aux partenaires sociaux de mieux appréhender les modalités de mise en œuvre d’un plan d’épargne d’entreprise, ce qui apparaît nécessaire depuis la généralisation des PEE dans toutes les entreprises soumises à la participation.
En effet, il convient de souligner que toute entreprise soumise à la participation, c’est-à-dire toute entreprise employant habituellement cinquante salariés ou plus (article L. 3322-1 du code du travail), doit obligatoirement mettre en place un PEE depuis le 1er janvier 2013.
Cette disposition a été introduite dans le code du travail (article L. 3323-2) par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Celle-ci rend obligatoire l’affectation de la réserve spéciale de participation dans un plan d’épargne entreprise dès lors que l’entreprise dispose d’un accord de participation, quel qu’en soit le mode de gestion : compte courant bloqué (CCB) ou fonds commun de placement d’entreprise (FCPE).
L’amendement SPE10 de M. Patrick Hetzel est retiré.
La commission adopte l’article 37 sans modification.
*
* *
Article 37 bis [nouveau]
(art. L. 3333-7 du code du travail)
Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprises
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à faciliter la modification des plans d’épargne interentreprises regroupant sur le territoire national plusieurs centaines d’entreprises n’ayant pas de lien entre elles.
Recueillir l’approbation directe d’une majorité d’entreprises apparaît en effet long et aléatoire. Il est donc proposé d’étendre la possibilité, déjà existante pour les modifications législatives et réglementaires, de rendre effective une modification du règlement dès lors qu’une majorité d’entreprises ne s’y oppose pas.
Toutefois, cette facilitation se limite strictement aux 2°, 3° et 5° du règlement tel que normé à l’article L. 3333-3 du code du travail, c’est-à-dire aux modalités d’alimentation, de gestion et d’abondement du PEI, en excluant le périmètre du plan, les frais de gestion et le fonctionnement des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1656 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement a pour objectif de faciliter la modification des PEI regroupant sur le territoire national plusieurs centaines d’entreprises n’ayant pas de lien entre elles.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1656.
*
* *
Article 38
(art. L. 3334-2 du code du travail)
Instauration du plan d’épargne pour la retraite collectif par les salariés
en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise
L’article 38 facilite la mise en place et l’alimentation des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Il autorise la mise en place du PERCO par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical ou de comité d’entreprise. Le recours à la ratification aux deux tiers des salariés en l’absence de délégué syndical ou de comité d’entreprise n’est aujourd’hui possible que pour la mise en place des plans d’épargne entreprise (PEE).
I. LA MISE EN PLACE D’UN PERCO EST ACTUELLEMENT MOINS AISÉE QUE CELLE D’UN PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE
Aux termes de l’article L. 3334-2 du code du travail, un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peut actuellement être mis en place, à l’initiative de l’entreprise ou par accord collectif de travail, qu’en présence d’un délégué syndical ou d’un comité d’entreprise.
Historiquement, le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (ancêtre du PERCO) ne pouvait en effet être mis en place qu’avec les organisations syndicales. Cependant, ce dispositif a progressivement été assoupli : dès la création du PERCO, il a été possible de mettre en place ce plan par accord avec le comité d’entreprise. Puis, dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, sa mise en place unilatérale par l’employeur, en cas d’inaboutissement d’un accord avec le comité d’entreprise ou le délégué syndical, est devenue possible.
Désormais, lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6, c’est-à-dire selon l’une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;
4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
L’alinéa 4 est au cœur de ce nouveau dispositif puisqu’il permet à l’employeur de proposer un contrat pour la mise en place du PERCO, lequel doit être validé par les deux tiers du personnel. Les organisations syndicales et le comité d’entreprise sont seulement associés à ce « référendum » mais leur présence simultanée ou alternative est obligatoire pour y recourir.
Toutefois, si aucun accord n’a été conclu au terme de la négociation, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Mais l’entreprise d’harmonisation n’a pas été poussée jusqu’à son terme, dans la mesure où il n’a pas été prévu de permettre la mise en place du PERCO via la ratification avec le personnel lorsque l’entreprise ne dispose pas de délégué d’entreprise ni de comité d’entreprise. Cette situation est insatisfaisante car elle prive certaines entreprises, notamment les plus petites, de la possibilité de mettre en place un PERCO.
II. UN ALIGNEMENT DE LA MISE EN PLACE DU PERCO SUR LES MODALITÉS APPLICABLES À L’INTÉRESSEMENT, À LA PARTICIPATION ET AUX PLANS D’ÉPARGNE ENTREPRISE
La réforme proposée permet de mettre en place un PERCO, même en l’absence de délégué syndical ou de comité d’entreprise, par ratification de la majorité des deux tiers du personnel du contrat proposé par l’employeur. Elle permet ainsi de faciliter la mise en place des PERCO dans les petites et moyennes entreprises.
Elle conduit ainsi à aligner les modalités de mise en place du PERCO sur les modalités d’intéressement et de participation déjà existantes, ce qui permet de rapprocher et de simplifier les différents dispositifs et d’accroître leur lisibilité pour les salariés et les employeurs.
*
* *
L’amendement SPE11 de M. Patrick Hetzel est retiré.
La commission adopte l’article 38 sans modification.
La commission examine, en discussion commune, les amendements SPE1856 des rapporteurs ainsi que les amendements identiques SPE263 de Mme Véronique Louwagie et SPE408 de M. Patrick Hetzel.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Afin de rendre plus fluides et plus réguliers les versements, la possibilité pourrait être donnée aux employeurs d’abonder les PERCO par décision unilatérale et indépendamment des dépôts des salariés. L’abondement serait calculé selon les mêmes modalités pour tous les salariés, qu’ils aient ou non alimenté leur PERCO. Aujourd’hui, cette disposition n’existe que pour l’abondement dit d’amorçage.
M. le ministre. Cet amendement prévoit un versement périodique de l’employeur sur le PERCO sans contrepartie du salarié, alors que cette possibilité n’est actuellement ouverte que pour la première année de bénéfice. Une telle autorisation comporterait deux risques : la remise en cause du caractère collectif de l’épargne salariale – celle-ci reposant sur un accord entre employeurs et représentant des salariés – et le renforcement de l’attractivité de ce dispositif aux dépens des salaires.
Je vous demande de retirer ces amendements, quitte à approfondir la réflexion avec les partenaires sociaux pour améliorer l’épargne salariale.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je retire mon amendement.
M. Gilles Lurton. Je retire l’amendement SPE263, pressentant que M. le ministre y donnera le même avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Je retire également mon amendement.
Les amendements SPE1856, SPE263 et SPE408 sont retirés.
*
* *
Article 39
(art. L. 3332-10 et L. 3334-8 du code du travail)
Alignement des quotas de jours transférables vers un plan d’épargne pour la retraite collectif selon qu’ils proviennent d’un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris en l’absence de compte épargne-temps
Dans le droit actuel, les salariés bénéficiant d’un compte épargne-temps (CET) dans leur entreprise peuvent transférer sur le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) l’équivalent de dix jours épargnés sur le CET. Ce transfert bénéficie d’un régime fiscal favorable dans la limite de dix jours épargnés.
En revanche, les salariés ne bénéficiant pas de CET dans leur entreprise ne peuvent transférer que l’équivalent de cinq jours épargnés, en bénéficiant des mêmes avantages.
Le présent article met fin à cette différence de traitement en permettant aux salariés ne disposant pas de CET à verser l’équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO.
I. LE DROIT EN VIGUEUR DÉFAVORISE LES SALARIÉS NE DISPOSANT PAS DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS POUR PRÉPARER LEUR RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Si l’accord instituant le dispositif du compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un PERCO. Les droits inscrits sur un compte épargne-temps qui sont utilisés, à compter du 22 août 2008, pour alimenter un PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite de dix jours par an.
Ces droits « compte épargne-temps » bénéficient également, dans la limite d’un plafond de dix jours par an, d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales (article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale). La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les autres cotisations et contributions assises sur les salaires (cotisations d’assurance chômage, contributions au Fonds national d’aide au logement et versement transports) restent dues.
Toutefois, afin de favoriser le transfert des sommes détenues par un salarié sur son CET vers un PEE ou un PERCO, un régime fiscal favorable (régime dit « d’étalement de l’imposition vers l’avant », déjà en vigueur pour les indemnités de départ en retraite ou en préretraite) est appliqué à ces transferts, à la demande expresse du salarié. Le salarié peut également opter pour le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts (l’un étant exclusif de l’autre).
En revanche, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO. Ces cinq jours, monétisés, bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les dix jours issus du CET. Toutefois, ces derniers sont pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement maximum du quart de la rémunération brute du salarié dans un dispositif d’épargne salariale.
Or, sur l’ensemble des salariés du secteur concurrentiel, seuls 12 % disposent d’un compte épargne-temps : 32 % parmi les salariés au forfait en jour, 10 % parmi les autres. Quel que soit le secteur d’activité, les ingénieurs et cadres sont plus fréquemment concernés : un quart d’entre eux est titulaire d’un CET, contre 15 % des techniciens et agents de maîtrise et 7 % des employés et ouvriers. En outre, 70 % des salariés de grandes entreprises (plus de 1 000 salariés) ont accès à un CET, contre seulement 33 % dans les entreprises de moins de 500 salariés.
Dans le même temps, seuls 20 % de l’ensemble des salariés ont accès à un PERCO et ceux-ci sont plus présents dans les grandes entreprises.
Par conséquent, il apparaît que ce sont majoritairement les salariés non cadres et/ou travaillant dans les PME qui n’ont pas accès à un CET ou à un PERCO. Les salariés des PME et des ETI sont donc pénalisés à deux titres : ils ne bénéficient pas des fonctionnalités du CET et n’ont accès qu’à une version dégradée de la passerelle CET-PERCO.
II. LA RÉFORME PROPOSÉE PERMET UN ALIGNEMENT DES QUOTAS DE JOURS TRANSFÉRABLES VERS UN PERCO SELON QU’ILS PROVIENNENT D’UN CET OU DE JOURS DE REPOS NON PRIS EN L’ABSENCE DE CET
Le présent article met fin à cette différence de traitement entre salariés disposant d’un compte épargne-temps et ceux n’en disposant pas. Il permet également d’accompagner le développement des PERCO, en complémentarité avec l’article 38 du présent projet de loi.
Les salariés ne disposant pas de CET pourront ainsi verser l’équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO, au lieu de cinq jours actuellement. Ce transfert devra néanmoins se faire dans le respect des règles tenant à la durée minimale de congés devant nécessairement être pris sous forme de repos.
Par ailleurs, il est proposé que ces jours de congés non inscrits et versés sur le PERCO ne soient pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement du quart de la rémunération brute, à l’instar de ce qui est prévu pour les droits CET versés sur le PERCO. Le développement de dispositifs de retraite complémentaire ne se fera ainsi pas au détriment de l’épargne salariale. Par ailleurs, l’ensemble de ces versements restent à la discrétion du salarié, qui est libre d’en user ou non.
Cette mesure se traduira par une perte de recettes fiscales et sociales, a priori d’ampleur limitée en raison des critères retenus. Elle concernera en effet les salariés des entreprises bénéficiant d’un PERCO mais n’ayant pas accès à un CET. Les salariés concernés par cette mesure sont principalement employés dans des PME (moins de 250 salariés), dans lesquelles l’existence d’un CET est peu répandue. Or, on estime que dans ces PME, environ 6 % seulement des salariés ont accès à un PERCO. De ce fait, le public concerné par la mesure sera donc très limité et l’impact sur les finances sociales faible. Le Gouvernement estime ainsi le coût maximal de cet alignement à 20 millions d’euros.
*
* *
L’amendement SPE12 de M. Patrick Hetzel est retiré.
La commission adopte l’article 39 sans modification.
*
* *
Article 39 bis [nouveau]
(art. L. 3341-6 du code du travail)
Amélioration de l’information des salariés sur l’épargne salariale
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à prévoir que les dispositifs présentés dans le livret d’épargne salariale sont les seuls dispositifs existants au sein de l’entreprise afin d’améliorer l’information du salarié sur ses versements et placements.
Il impose également de remettre le livret aux représentants du personnel dans le cadre de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail.
*
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements SPE1655 des rapporteurs et SPE965 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit, par cet amendement, de prévoir que seuls les dispositifs présentés dans le livret d’épargne salariale existent au sein de l’entreprise ; cela permettra d’améliorer l’information du salarié sur ses versements et ses placements.
Cet amendement impose également de remettre le livret aux représentants du personnel dans le cadre de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail.
M. Jean-Christophe Fromantin. Mon amendement va dans le même sens et vise à ajouter des informations relatives aux placements et à leur gestion dans le livret d’épargne salariale. Toute disposition étendant la quantité et la pertinence de l’information des salariés est positive.
M. le ministre. J’émets un avis favorable à l’adoption de l’amendement SPE1655.
La commission adopte l’amendement SPE1655.
En conséquence, l’amendement SPE965 tombe.
*
* *
Article 39 ter [nouveau]
(art. L. 3341-7 du code du travail)
Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à fournir au salarié une information sur la gestion de ses avoirs et les éventuels frais de tenue de compte y afférant, lorsque celui-ci quitte l’entreprise.
Il maintient la possibilité de prise en charge de ces frais par l’employeur, s’il le souhaite, dans les conditions fixées par l’accord de participation ou par l’accord collectif instituant le plan d’épargne entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.
*
* *
La commission en vient à l’amendement SPE1654 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à fournir au salarié, lorsque celui-ci quitte l’entreprise, une information sur la gestion de ses avoirs et les éventuels frais de tenue de compte y afférant, et il maintient la possibilité de prise en charge de ces frais par l’employeur, s’il le souhaite, dans les conditions négociées au moment du départ.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1654.
*
* *
Article 39 quater [nouveau]
(art.e L. 3346-1 du code du travail)
Avis consultatif du Conseil d’orientation de la participation,
de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié en matière de déblocage de l’épargne salariale
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative des rapporteurs, vise à recueillir l’avis consultatif du COPIESAS sur tout projet de loi de déblocage visant à débloquer les avoirs détenus en épargne salariale, qu’il s’agisse de déblocage anticipé exceptionnel ou d’une modification des cas classiques de déblocage.
Les déblocages exceptionnels de l’épargne salariale peuvent en effet entrer en conflit avec l’objectif de financement de l’économie sur le long terme.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1657 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement souhaite limiter les cas de déblocage de l’épargne salariale. Le Gouvernement devra recueillir l’avis consultatif du COPIESAS sur tout projet de loi visant à débloquer les avoirs détenus en épargne salariale, cet avis ayant une forte probabilité d’être négatif.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. J’ai eu l’honneur d’être le rapporteur de la loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, dont j’ai pu mesurer l’efficacité toute relative. Nous avons donc déposé cet amendement pour revenir sur cet échec.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1657.
*
* *
Article 40
(art. L. 3312-5 du code du travail)
Faculté offerte aux salariés, au même titre que
les autres signataires, de renégocier un accord d’intéressement
comportant une clause de tacite reconduction
Le présent article prévoit que lorsqu’un accord d’intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel prévoit une clause de tacite reconduction, les salariés peuvent demander la renégociation de l’accord, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Par ailleurs, cet article précise que si la clause de tacite reconduction est effective, l’accord est prolongé pour une nouvelle période de trois ans, soit la durée légale d’un accord d’intéressement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR EMPÊCHE LES SALARIÉS DE DEMANDER LA RENÉGOCIATION D’UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT
L’intéressement est nécessairement mis en place par accord, qui précise toutes les conditions permettant de bénéficier du versement d’une prime. Cet accord d’intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction si l’accord d’origine le prévoit.
Pour le modifier ou pour le renégocier, seuls le chef d’entreprise (ou son représentant), ou, pour les salariés, le délégué syndical, le salarié mandaté ou la majorité des membres salariés du comité d’entreprise, sont compétents. Dans l’hypothèse d’une renégociation, la demande doit en outre être formulée par l’un de ces acteurs dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord.
À défaut, l’accord est alors renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans, la durée de cette prolongation était implicite vu le caractère triennal de l’intéressement (ce que le 2° du présent article prévoit également de corriger, en introduisant cette durée dans la loi). Le renouvellement est notifié par la partie la plus diligente à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Cet état du droit est défavorable aux salariés puisque, si un accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés peut prévoir une tacite reconduction, cette même majorité des deux tiers des salariés ne peut demander la renégociation de l’accord. En effet, si les salariés ne disposent pas d’un représentant, d’un délégué syndical ou d’un comité d’entreprise, seul le chef d’entreprise peut demander la renégociation de l’accord.
II. LA RÉFORME PROPOSÉE VISE À PERMETTRE AUX SALARIÉS DE DEMANDER LA RENÉGOCIATION D’UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT COMPORTANT UNE CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION
Le 1° du présent article permet d’assurer l’égalité entre l’employeur et le salarié en matière d’intéressement.
En effet, la demande de renégociation interdit la tacite reconduction. Quelle que soit l’issue de la renégociation, la poursuite de l’intéressement dans l’entreprise nécessite un nouvel accord qui devra être négocié, conclu et déposé dans les conditions et délais de droit commun. Il est donc proposé que les salariés puissent bénéficier de ce droit, même en l’absence de représentants.
Cela est d’autant plus important que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, 90 % des accords d’intéressement sont conclus à la majorité des deux tiers des salariés. Cette mesure permet donc d’assurer la prise en compte de la volonté des salariés, tout en sécurisant l’employeur qui souhaite associer son personnel à une renégociation de l’accord.
*
* *
L’amendement SPE13 de M. Patrick Hetzel est retiré.
La commission adopte l’article 40 sans modification.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE97 de Mme Véronique Louwagie.
M. Patrick Hetzel. L’objet du présent amendement est de simplifier le financement via l’assurance-vie des PME, des PMI et des ETI. Tout en maintenant le système protecteur en vigueur et en prévoyant des garde-fous liés au montant minimum du contrat, il ouvre une option au-delà d’un certain montant, à l’instar de ce qu’offrent les compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises. Son adoption permettrait ainsi à certains de nos concitoyens d’alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu’à l’étranger. Rappelons, sur ce dernier point, que des études ont montré que les flux opérés par les résidents français vers le Luxembourg restent très soutenus, l’autorité de contrôle luxembourgeoise faisant même état d’une progression semestrielle de 18 % avec un encaissement brut de l’ordre de plus de 12 milliards d’euros. Cette mesure, conforme à la réglementation Bâle III, participerait de la redynamisation de l’économie française.
M. le ministre. Nous partageons l’objectif de cet amendement, qui vise à mieux financer, à travers l’assurance-vie, les PME et les ETI et qui se trouve en conformité avec les deux réformes de l’assurance-vie inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2013. Par ailleurs, nous avons demandé à M. René Ricol de conduire une mission visant à remobiliser l’épargne des Français.
Monsieur Hetzel, vous souhaitez favoriser la pratique du paiement en titres, répandue dans d’autres pays européens et permise également, dans certains cas particuliers, par le droit français. Ces cas excluent les catégories d’actifs comme les parts de fonds communs de placement à risque – FCPR – et de fonds communs de placement dans l’innovation – FCPI. L’assureur ne peut donc pas offrir de produits dont les actifs sont très peu liquides et non négociables. Les particuliers désirant bénéficier d’une telle remise en titres ont recours à des contrats d’assurance-vie luxembourgeois. Il s’avère donc utile de rationaliser le système pour favoriser le financement de notre économie. Néanmoins, la rédaction de l’amendement nous dérange, si bien que je vous propose de retirer votre amendement ; je m’engage à ce que mes services travaillent avec vous pour pouvoir déposer un amendement techniquement correct en séance publique.
M. Patrick Hetzel. Je retire mon amendement.
L’amendement SPE97 est retiré.
La commission en vient à l’amendement SPE979 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, les créanciers publics sont privilégiés par rapport aux créanciers privés. Cet amendement vise à revenir sur cette inégalité, sans empêcher l’administrateur d’arrêter des priorités dans le remboursement des créances, afin de ne pas mettre en difficulté les entreprises privées qui peuvent ne pas recouvrer leurs créances. Cet amendement propose de supprimer ce privilège.
M. le ministre. Ce sujet est ancien et fait souvent l’objet d’idées reçues. Si l’on supprimait le privilège du Trésor, nous ne pourrions plus protéger le contribuable car, en contrepartie de ce privilège, l’État ne prend pas de garanties. La réforme des procédures collectives que nous engageons est une réponse mieux adaptée au problème que vous soulevez, monsieur Fromantin, car elle apporte plus de certitudes aux investisseurs en les protégeant même des actionnaires. Sans privilège du Trésor, notre intérêt patrimonial ne pourrait bien souvent pas être garanti.
En outre, les conséquences budgétaires – y compris dans le périmètre maastrichtien – ne seraient pas nulles, et des requalifications en dette constatée pourraient avoir lieu.
Dans les faits, l’État utilise avec beaucoup de pragmatisme le privilège du Trésor et ne s’en prévaut pas dans beaucoup de situations difficiles.
Je vous invite donc à retirer cet amendement.
M. Jean-Christophe Fromantin. Si l’État arbitre vraiment entre sa créance et celle d’une entreprise pour laquelle le non-recouvrement aurait des conséquences sur sa survie et sur l’emploi, je suis prêt à retirer mon amendement.
L’amendement SPE979 est retiré.
*
* *
Article 40 bis [nouveau]
(art. L. 144-1 du code monétaire et financier)
Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative du Gouvernement, vise à élargir l’accès du fichier bancaire des entreprises (FIBEN) aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance ainsi qu’aux sociétés de gestion gérant des fonds de prêts à l’économie pour le compte de ces acteurs.
Cette évolution, attendue par ces acteurs et cohérente avec les réformes récentes du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, permettra de les placer dans une situation d’égalité vis-à-vis de l’information utile à l’exercice effectif de ces activités de financement.
En complément, l’article vise à permettre au Gouvernement de prendre les dispositions complémentaires nécessaires pour coordonner les différents dispositifs existants et assurer le suivi effectif du développement de nouvelles pratiques de financement des entreprises. Le rapporteur thématique soutient ces nouvelles dispositions qui permettront de renforcer la transparence des opérations financières.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1643 du Gouvernement.
M. le ministre. Depuis 2012, le financement des entreprises a connu une mutation profonde, soutenue par le Gouvernement, reposant sur une diversification des instruments de financement et des financeurs. La réforme du code des assurances d’août 2013, récemment transposée dans les code de la sécurité sociale et de la mutualité, a porté ce mouvement. Nous avons élaboré un cadre réglementaire prudent afin de sécuriser les financeurs et les entreprises ; le Gouvernement souhaite poursuivre cette démarche d’accompagnement de ces nouveaux acteurs du financement – qu’il s’agisse des entreprises d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés de gestion, des gérants de fonds de prêt à l’économie – en leur autorisant l’accès au fichier bancaire des entreprises – FIBEN – dans le cadre de leur activité de prêt ; ces développements pourront nécessiter d’autres évolutions législatives.
Au-delà de la mesure technique, cette disposition s’avère importante pour favoriser la désintermédiation du financement de l’économie ; on a incité de nombreux acteurs non bancaires à assumer cette fonction, si bien que l’accès au FIBEN les aidera dans cette tâche.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1643.
La commission examine, en présentation commune, les amendements SPE871 rectifié, SPE980 et SPE952 de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Ces amendements ont vocation à aider la France à rattraper son retard en matière de financement participatif – ou crowfunding –, secteur qui évolue très rapidement et qui bénéficie dorénavant d’un cadre européen. Le Royaume-Uni a conduit une réflexion approfondie pour participer activement à cette filière et pour ne pas pâtir, malgré la City, de son développement.
Il convient d’ouvrir l’accès du financement participatif aux personnes morales, par le biais de prêt interentreprises qui s’inscrivent parfaitement dans l’esprit du projet de loi en accroissant le financement de l’activité économique.
Le financement participatif ne concerne pas seulement les entreprises innovantes et des garagistes par exemple y ont recours du fait de la frilosité des banques à financer les petits projets des très petites entreprises – TPE – et des PME. Il y a lieu de se saisir de ce nouvel outil !
M. le ministre. S’agissant de l’amendement SPE871 rectifié, la commercialisation des produits financiers se trouve encadrée afin d’assurer la protection des épargnants. Les différents intermédiaires doivent respecter les règles entourant cette commercialisation et sa publicité – ainsi, les normes qui s’appliquent aux banques en matière de publicité diffèrent de celles qui pèsent sur les prestataires de services financiers. Il ne s’avère donc pas opportun de traiter de la même façon les exigences sur la publicité pour les conseillers participatifs et pour les intermédiaires en financement participatif, les premiers proposant des titres et les seconds des crédits. Par conséquent, je vous inviterais, monsieur Leroy, à retirer cet amendement.
Concernant l’amendement SPE980, l’assouplissement des règles de commercialisation des produits financiers pour favoriser le démarchage par internet ne me semble pas adapté. Je souhaiterais donc que vous retiriez également cet amendement.
En revanche, l’amendement SPE952 ouvre une voie intéressante : on a développé le financement participatif individuel, qui s’avère extrêmement important pour les start-up, qu’elles soient technologiques ou non, et on a encadré ce dispositif, qui prospère, par un décret pris à l’automne. Nous partageons l’idée d’un développement d’un mécanisme de financement participatif pour les personnes morales. Néanmoins, je vous invite à retirer votre amendement pour des raisons techniques et m’engage à travailler avec vous et M. Fromantin pour élaborer un dispositif qui permette le financement interentreprises par les bons de caisse et qui fasse l’objet d’un amendement déposé en séance publique. Les bons de caisse sont des titres, dont l’utilisation est régulée pour protéger les émetteurs et les épargnants, permettant aux entreprises de se financer entre elles sans limite de montant pour une période de cinq ans. Cela permet à des entreprises d’investir dans un écosystème ou de financer des sous-traitants qui n’ont pas accès au crédit. Cette réforme constitue une brèche dans le monopole bancaire, ce qui n’est pas rien.
M. le rapporteur général. Elle suscitera donc, monsieur le ministre, de nombreuses réserves de la part des banques, ainsi que des autorités et des administrations plus sensibles aux intérêts de ces établissements qu’à la volonté des parlementaires souhaitant innover. Nous porterons cette démarche collectivement, car de nombreuses sensibilités politiques partagent cette ambition. Il serait opportun que cette loi crée de nouvelles formes de financement des entreprises par les entreprises, puisque nous savons comme celles-ci souffrent du conservatisme des banques qui ne font plus leur métier consistant à prendre des risques pour prêter de l’argent à des entrepreneurs.
M. le président François Brottes. Le dispositif du tiers financement du projet de loi relatif à la transition énergétique avait déjà créé un précédent en la matière.
M. Olivier Carré. Le groupe UMP marque un vif intérêt pour le financement participatif, mais il ne faut pas oublier de vérifier la compatibilité des mécanismes avec le droit de l’Union européenne.
M. Arnaud Leroy. L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité
– ARPP – appelle à homogénéiser les informations données par les conseils en investissement participatif.
Je me range à l’argumentation de MM. les ministre et rapporteur général et retire mes amendements. Au-delà du financement interentreprises et de l’économie réelle, je souhaite que prospère une filière du financement participatif mûre, forte et capable de créer une voie française en la matière. Nous devons réfléchir aux moyens de parvenir à cet objectif.
Les amendements SPE871 rectifié, SPE980 et SPE952 sont retirés.
La commission examine l’amendement SPE1007 de M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Le financement de l’économie française rencontre un paradoxe : malgré un taux d’épargne des ménages très élevé, la plupart des acteurs économiques mettent en avant leurs difficultés à se financer. La création de la banque publique d’investissement a été une avancée importante, mais elle ne répond pas à l’ensemble de la question.
Après les mesures de dérégulation intervenues dans les années 1990, le secteur bancaire s’est tourné avec succès d’ailleurs vers la finance. La loi du 27 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’a apporté qu’une réponse imparfaite à la question de la séparation des activités bancaires et des activités spéculatives. Le nécessaire recentrement du secteur bancaire vers le financement de l’économie reste à accomplir ; en outre, il convient de donner toutes les garanties aux déposants par le biais du cantonnement.
L’absence de plafond consacrée par l’arrêté n° 2014-785 pris en application de la loi a fini de rendre inopérant le dispositif retenu à l’issue de la discussion parlementaire. Mon amendement propose de placer l’ensemble des activités de tenue de marché au sein des filiales de cantonnement prévues par la loi, mais non mises en œuvre à ce jour. Monsieur le ministre, la stimulation de la croissance et de l’activité nécessite de réguler la finance.
M. le ministre. Monsieur Laurent, je partage votre objectif, mais la mesure que vous proposez présente un paradoxe par rapport à votre exposé des motifs.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne remplissait certes pas le critère de la simplicité, mais elle s’avère proportionnée pour répondre à notre situation. La séparation totale de la tenue de marché du reste de l’activité bancaire affaiblirait les banques françaises, qui puisent leurs forces dans leur universalité ; en effet, celle-ci leur confère un bilan dont l’envergure leur permet de financer l’économie réelle ainsi qu’elles-mêmes. Le Gouvernement a établi un plafond pour les activités spéculatives de tenue de marché, ce qui constitue un élément de régulation. Les grandes banques françaises ne se sont pas mal comportées pendant la crise – à l’exception de Dexia, dont nous continuons à payer les déficits successifs liés à sa spécialisation dans un marché aux pratiques déviantes bien documentées – par rapport à leurs grandes concurrentes espagnoles, allemandes, italiennes et britanniques.
La mesure que vous proposez vise à cantonner les activités, ce qui affaiblirait nos banques universelles. Adopté, cet amendement réduirait la capacité des banques françaises à financer l’économie réelle en prêtant aux agents économiques. Nos banques sont stables, fortes et présentes partout dans le territoire ; deux banques ont développé des activités de marché importantes et subissent déjà l’impact des dispositions de la loi bancaire. Le modèle bancaire français a montré sa solidité pendant la crise, contrairement aux banques spéculatives, principalement anglo-saxonnes, qui ont surtitrisé des créances douteuses. Les lois de séparation s’avéraient donc pertinentes au Royaume-Uni et aux États-Unis avec l’application des normes britanniques Vickers et de la réglementation américaine Dodd-Frank. Néanmoins, la mise en œuvre effective de ces réformes reste très relative, et l’on écrit encore des thèses cherchant à déterminer leur mode d’application.
L’articulation des mesures prises après la crise et des normes dites « Bâle III » – qui ont fortement accru les exigences en matière de solvabilité et de liquidité qui pèsent sur nos banques – a conduit à sécuriser notre dispositif. Si nous allons plus loin, nous augmenterons les effets de la régulation Bâle III ; or, les conséquences de Bâle III se lisent dans la restriction du financement de l’économie par les banques, notamment dans le secteur immobilier. L’exposé de vos motifs devrait vous conduire, monsieur Laurent, à demander au Gouvernement d’ouvrir le sujet de la régulation de Bâle III auprès des enceintes compétentes pour stimuler le financement de l’économie réelle. Au contraire, la mesure que vous nous présentez alimenterait le problème que vous voulez traiter.
Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Jean-Luc Laurent. Je ne retirerai pas cet amendement, monsieur le ministre, car le cantonnement permettrait de sécuriser les déposants ; si les banques françaises se sont bien tenues dans la crise financière, cela résulte avant tout de l’intervention puissante de l’État, qui n’est pas restée sans conséquences sur les finances publiques.
Vous pensez qu’il serait préférable de rouvrir le chantier de Bâle III plutôt que de procéder au cantonnement, alors que les banques, profitant de la financiarisation excessive de l’économie, n’ont pas pris suffisamment de précautions sur les marchés. Il s’avère donc nécessaire de protéger l’action des banques nécessaire au financement des entreprises et de préserver l’outil bancaire alimenté par les contributions des déposants.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement SPE1007.
Elle est saisie de l’amendement SPE944 de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Défendu.
M. le ministre. L’amendement SPE915 rectifié de M. Leroy à l’article 35 visait à augmenter le seuil en capital permettant de ne pas réaliser une offre publique de titres financiers : s’il avait été défendu, j’aurais émis un avis défavorable à son adoption car le règlement général de l’Autorité des marchés financiers – AMF – fixe ce seuil ; nous pouvons ouvrir une discussion avec l’AMF sur ce sujet qui pose un problème de protection de l’épargnant.
J’invite M. Leroy à retirer son amendement SPE944, car son adoption conduirait à multiplier par quatre le plafond de financement par projet – actuellement fixé à 250 euros. Il y a cinq mois, un décret des ministres des finances et de l’économie a augmenté le seuil de 250 à 1 000 euros et les associations de consommateurs avaient alors exprimé leurs inquiétudes, puisque les garanties sont inférieures à celles offertes par les moyens de financement intermédiés classiques ; si l’on établissait son niveau à 4 000 euros, le mécontentement serait quatre fois plus fort ! Nous sommes tous attachés au financement participatif, mais laissons les premières plateformes se développer et le dispositif monter en régime. Il sera temps dans quelques mois de réfléchir à un nouveau seuil.
M. Arnaud Leroy. Un cadre juridique européen existe, et mes amendements cherchent à en tirer le plus grand parti. Nous sommes engagés dans une course pour la structuration de cette filière qui évolue très vite ; la survie des plateformes françaises se trouve aujourd’hui en jeu. Voulons-nous réellement développer une filière de financement participatif en France ?
Je retire néanmoins mon amendement.
M. le ministre. Monsieur Leroy, mes services vous apporteront une réponse sur la situation des filières de financement participatif en Europe.
M. le président François Brottes. Nous pâtissons d’un handicap culturel dans ce domaine.
L’amendement SPE944 est retiré.
La commission en vient à l’amendement SPE971 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. Le marché du financement participatif, très ouvert, dépasse la France et a pris le relais de l’externalisation ouverte – ou crowdsourcing – en matière d’innovation. Quelques plateformes américaines d’externalisation ouverte ont capté l’ensemble du marché désintermédié de l’innovation, où la France s’avère absente par manque d’ambition pour ces plateformes. Ne reproduisons pas cette erreur pour celles de financement participatif. Le Gouvernement a déjà agi sur l’organisation des plateformes, et il convient maintenant d’agir sur les seuils pour pouvoir suivre le marché.
M. le ministre. J’émets un avis défavorable, mais nous creuserons cette réflexion car vous avez, messieurs Leroy et Fromantin, intellectuellement raison.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit d’un enjeu majeur, et le Gouvernement agira dans ce domaine. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Olivier Carré. Ce sujet compte pour la croissance, comme plusieurs que nous avons déjà évoqués ; ce type de loi représente un texte de repli mû par le fait que la modernisation de l’économie s’avère plus rapide que celle de la réglementation. Il conviendrait de s’interroger sur la convergence entre nos économies et notre réglementation, cette dernière reposant souvent sur le droit du consommateur qui au lieu de protéger celui-ci le contraint dans les nouveaux choix que lui offre l’innovation économique. À la commission des finances, on nous propose souvent d’instaurer de nouvelles taxes, dans des secteurs comme l’hôtellerie, qui sont contraires au travail que l’on devrait accomplir.
M. le ministre. L’économie et les pratiques induites par l’innovation de rupture évoluent en effet plus rapidement que la réglementation. L’économie de l’ancien monde s’avère mieux représentée auprès du Gouvernement et du Parlement que la nouvelle économie. Cette situation est apparue très clairement au moment du débat sur les taxis, et la réglementation arrêtée se trouve en décalage avec la pratique d’ores et déjà en vigueur. Dans nos discussions sur ce projet de loi, il ne me semble pas que nous allions à rebours de la modernité ; nous n’allons peut-être pas assez vite, et notre débat sur le financement participatif vient de mettre cette question en lumière.
M. Olivier Carré. Ce que vous dites est vrai, monsieur le ministre, mais nous sommes confrontés à des questions de seuil et de masse. Le financement participatif ne représente en France que des montants très limités par rapport à la masse des encours de prêts et de financements qui interagissent au sein de la société.
Il en a été de même s’agissant de l’hôtellerie et des maisons d’hôtes : le jour où un nouveau modèle économique devient massif, l’ancien monde, si je puis dire, se réveille et souligne que l’État a poussé à cette émergence tout en le contraignant, lui, en termes de régulation de l’épargne, de prêts ou d’intermédiation financière. L’État est alors obligé de faire marche arrière et d’endiguer la rupture économique, l’ancien monde étant mieux représenté dans les institutions que celui qui émerge.
Ce serait l’honneur des politiques, qu’ils relèvent du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, d’anticiper les évolutions en engageant une réflexion de fond systémique – vous avez employé le mot à raison, monsieur le ministre –, qui porterait notamment sur la nature de la protection du consommateur : celle-ci n’engendre-t-elle pas des surprotections qui, à terme, provoquent des blocages et freinent la croissance que les ruptures pourraient créer ?
M. le président François Brottes. Une des possibilités de réconcilier l’ancien et le nouveau mondes économiques serait de favoriser les dynamiques de proximité. Lorsqu’il a créé le statut de l’auto-entrepreneur, qui a provoqué de la concurrence déloyale, M. Novelli avait autorisé les auto-entrepreneurs à contracter des petits crédits à La Poste pour leur permettre de débuter leur activité : c’était le mariage de la toute petite entreprise et de l’institution postale. Si l’idée était loin d’être absurde, il n’en est pas moins vrai qu’elle n’a pas rencontré le succès escompté.
Je suis à l’origine d’une disposition de la loi relative à l’économie sociale et solidaire qui permet aux plateformes de développement local, qui font des avances remboursables, d’instaurer des bourses locales, en vue de drainer une épargne de proximité au profit des entreprises locales. Dans de nombreux pays, des personnes acceptent de prendre un risque personnel et collectif pour des projets répondant aux besoins de l’économie locale.
La révolution économique ne saurait reposer sur les seules dispositions fiscales. Il est nécessaire de convaincre chacun qu’il peut contribuer au développement de l’activité économique. Nous devons, tous ensemble, travailler à favoriser une telle dynamique, internet ne pouvant pas être la seule solution pour résoudre nos problèmes d’implication en termes culturels.
M. Jean-Christophe Fromantin. Les stratégies de rupture innovante, qui sont des stratégies de leader, forment un écosystème au sein duquel les petits acteurs n’ont guère leur place et qui oppose les gagnants aux perdants de manière impitoyable, si bien que les seconds disparaissent. Chacun peut le constater dans de nombreux domaines, comme les places de marché ou les moteurs de recherche, où la stratégie des petits pas est inopérante, l’avance technologique prise par les plus performants étant irrattrapable. C’est particulièrement vrai dans le secteur des nouveaux médias. Or, ces plateformes relèvent bien du secteur des nouveaux médias.
M. Arnaud Leroy. Plutôt que d’ancien et de nouveau mondes, il vaut mieux, à mon sens, parler de nouvelle économie, dont les commandos veulent bousculer les règles existantes : il suffit d’évoquer Uber ou Airbnb.
Le secteur bancaire, aussi protégé soit-il, n’échappera pas au même bouleversement. Le Royaume-Uni, tout paradis du secteur bancaire qu’il soit, a compris tout l’enjeu du développement des plateformes de financement participatif. Il en est de même des États-Unis. Nous ne proposons pas un régime fiscal dérogatoire : nous voulons mettre ces plateformes au même niveau, en termes d’information, que les autres intermédiaires de crédit, afin de leur permettre de se battre avec des acteurs déjà présents dans divers pays. La présence de deux ou trois opérateurs sur ce secteur se profile d’ici à cinq à dix ans – Bercy en est conscient.
Je reprendrai le mot du ministre pour souhaiter, moi aussi, l’émergence d’une de « milliardaires » sur la planète du financement participatif.
Mme Corinne Erhel. Le principe de base de la nouvelle économie – et plus spécifiquement de l’économie numérique – est d’attaquer tout monopole et de bouleverser tous les modèles et toutes les organisations économiques existants. Plus aucun secteur d’activité n’est protégé : ils seront tous confrontés à l’arrivée de nouveaux acteurs et percutés par l’émergence de nouvelles façons de travailler. S’abriter derrière des digues de sable est d’avance voué à l’échec. L’exemple d’Uber est révélateur à cet égard. Je pense également au secteur de la logistique. La seule solution pour les entreprises françaises, notamment pour les grandes entreprises du CAC 40, est de refuser de se refermer sur elles-mêmes pour s’adapter en s’ouvrant aux innovations de rupture, que la commande publique devra, elle aussi, intégrer.
M. le président François Brottes. À condition que les acteurs de la rupture ne bénéficient pas de tous les avantages en laissant tous les inconvénients à ceux qui ne sont pas dans la même dynamique ! Attention, sinon, à des réveils douloureux !
Nous sommes là au cœur de la philosophie du texte.
M. le ministre. Je suis d’accord avec vous, monsieur le président.
Ce débat justifie la transversalité, les changements de fond étant toujours transversaux. D’aucuns – je le sais – ont ressenti ma présence permanente à ces débats comme celle d’un flibustier : il est vrai que cette loi a pour objectif de s’attaquer à tous les monopoles et aux intérêts acquis.
Ne perdez pas de vue que la France est, après le Royaume-Uni, le deuxième marché européen de financement participatif. Notre pays est donc déjà leader dans le domaine, non pas grâce au Gouvernement, du reste, mais parce que des innovateurs français privés ont pris des initiatives que nous avons eu l’intelligence d’encadrer en sécurisant les épargnants.
Certes, poser la question des plafonds est légitime et il conviendra de convaincre les associations de consommateurs de participer à ce mouvement.
La décision d’ouvrir le financement participatif aux personnes morales nous permettra d’aller beaucoup plus loin.
La commission rejette l’amendement SPE971.
*
* *
Article 40 ter [nouveau]
(art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale)
Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés signant un premier accord d’épargne salariale
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative du Gouvernement, vise à assujettir le premier accord de participation ou d’intéressement conclu au sein des entreprises de moins cinquante salariés au forfait social à un taux minoré fixé à 8 % (au lieu du taux de droit commun de 20 %).
En effet, bien que les encours de l’épargne salariale soient en progression (105 milliards d’euros en 2013) et que le nombre d’entreprises concernées ait augmenté de plus de 4 % en 2012, les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale sont surtout en vigueur dans les entreprises de grande taille et de taille moyenne.
À cet égard, le Conseil d’orientation de la participation, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié (COPIESAS), dont les conclusions des travaux viennent d’être rendues au Gouvernement, propose de favoriser le développement de l’épargne salariale dans les TPE et les PME de petite taille par la création d’un dispositif financier incitatif.
Afin de rendre ce dispositif plus incitatif, ce taux de 8 % reste applicable pour la même durée en cas d’accroissement d’effectif, hors les cas de fusion, cession ou scission. En outre, la durée de six ans, introduite par un sous-amendement du rapporteur thématique, correspond à la durée de deux accords, contre seulement trois ans envisagés initialement par le Gouvernement.
*
* *
La commission examine les amendements SPE1807 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement SPE1858 des rapporteurs, et SPE963 rectifié de M. Jean-Christophe Fromantin, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.
M. le ministre. L’amendement SPE1807 vise à favoriser le développement de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale dans les petites entreprises en proposant un forfait social réduit au taux de 8 % pour les entreprises de moins de cinquante salariés lors de la mise en place du premier accord d’intéressement et de participation, et ce pour une durée maximale de trois ans.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le sous-amendement SPE1858 vise à porter la durée du taux minoré de 8 % de trois à six ans pour rendre plus attractive l’entrée dans le dispositif. Le délai de trois ans me semble trop court pour convaincre le plus grand nombre possible de salariés d’entrer volontairement dans l’épargne salariale – je rappelle qu’à l’heure actuelle un salarié sur deux n’en bénéficie pas.
Si les amendements relatifs à cette question avaient été adoptés, aujourd’hui, le taux de droit commun s’élèverait à 20 %, le taux PERCO+ à 16 % et le taux dynamique à 8 %, visant l’entrée dans le dispositif d’une petite douzaine de millions de salariés.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire l’amendement SPE963 rectifié, qui est satisfait par l’amendement du Gouvernement.
L’amendement SPE963 rectifié est retiré.
M. le ministre. J’émets un avis favorable au sous-amendement du rapporteur thématique, dont je partage l’objectif, d’autant que son coût budgétaire n’est pas immédiat.
La commission adopte le sous-amendement SPE1858, puis l’amendement SPE1807 sous-amendé.
*
* *
Article 40 quater [nouveau]
Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales
Le présent article additionnel, adopté par la commission à l’initiative de M. Jean-Christophe Fromantin, demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou bourses régionales dans chaque métropole régionale afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.
Le but poursuivi par cet article est d’améliorer le financement des entreprises, notamment des PME régionales. Ces plateformes viendraient en outre renforcer l’évolution de la compétence des régions en matière de développement économique.
*
* *
La commission examine ensuite les amendements SPE950 et SPE982 de M. Jean-Christophe Fromantin ainsi que SPE973 de M. Philippe Vigier.
M. Jean-Christophe Fromantin. L’amendement SPE950 vise à autoriser le crédit interentreprises en permettant à une entreprise de consentir des prêts à moins de deux ans à des sociétés partenaires avec lesquelles elle entretient des relations commerciales.
Cet outil vise à autoriser des prêts entre, par exemple, un donneur d’ordre et un de ses sous-traitants. Il faut savoir que de trop nombreuses entreprises connaissent à l’heure actuelle des problèmes de trésorerie et que, de plus, les financements de court terme ne sont pas privilégiés par les banques du fait qu’ils sont faiblement rémunérateurs et ne sont pas attractifs en termes de gestion de flux.
Cette disposition complète le dispositif évoqué par le ministre visant à favoriser l’émergence d’un marché de bons de caisse ou à permettre aux personnes morales d’accéder au financement participatif. Elle a le mérite d’aller plus loin que le crédit fournisseur en autorisant un vrai prêt de trésorerie, inférieur à deux ans, pris sur les disponibilités du donneur d’ordre.
De plus, ce prêt interentreprises échappera, du fait de l’existence d’une relation commerciale entre les deux sociétés, au risque d’abus de bien social.
Je retire l’amendement SPE973.
L’amendement SPE982 vise, quant à lui, à réintroduire des bourses régionales. Le taux d’épargne, qui est important en France puisqu’il atteint 16 %, échappe au financement de proximité des PME. Or, la masse critique d’épargne des nouvelles régions permettra d’alimenter des bourses régionales en vue de financer les PME, les jeunes pousses ou les projets d’infrastructures des collectivités locales.
Compte tenu des perspectives de renforcement de leur compétence économique, les régions doivent pouvoir disposer de places de cotations intermédiées, d’actions ou d’obligations, pour le compte des entreprises ou des collectivités locales, afin de leur permettre de développer des boucles locales de financement.
M. le ministre. L’engagement pris par le Gouvernement de travailler à un amendement visant à la création de bons de caisse permettant le financement interentreprises me paraît satisfaire l’amendement SPE950. Cet amendement permettra même d’aller plus loin car le prêt interentreprises doit être très encadré pour éviter, comme vous l’avez souligné, le risque d’abus de bien social. Or, le bon de caisse autorisera des prêts à cinq ans sans plafond et pourra être souscrit par des personnes morales.
Je vous invite donc à retirer l’amendement SPE950 au profit de ce travail conjoint que je vous propose de conduire avec M. Arnaud Leroy, d’ici à la séance publique.
Je suis favorable à l’amendement SPE982 : les bourses régionales sont un élément important du dispositif. L’action conduite pour Paris Europlace n’entre pas en concurrence avec le développement des bourses régionales. La bourse de Lyon, du reste, s’était jointe aux assises du financement et de l’investissement organisées par le Président de la République.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire l’amendement SPE950 et remercie le ministre de son avis favorable à l’amendement SPE982.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement SPE982.
Les amendements SPE950 et SPE973 sont retirés.
La commission adopte l’amendement SPE982.
*
* *
La commission examine ensuite l’amendement SPE1011 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. L’amendement demande au Gouvernement un rapport relatif au financement du monde associatif, compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’économie sociale et solidaire. Ce rapport porterait à la fois sur les modalités pratiques de la mise en œuvre d’une conférence des financeurs du secteur associatif, visant à faciliter l’accès de celui-ci aux financements, et sur celles de la création d’un fonds de soutien aux associations, en vue de répondre à leurs difficultés chroniques en matière de trésorerie. Le rythme budgétaire des subventions ne correspond pas en effet au rythme d’activité des associations.
M. le ministre. Le rôle économique des associations a été pleinement reconnu dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Le rapport que vous demandez risquerait de faire doublon avec le « jaune budgétaire » sur l’effort financier de l’État en faveur des associations, qui contient un grand nombre des éléments que vous demandez.
Par ailleurs, des dispositifs de soutien à la trésorerie des associations existent déjà et sont dispensés par la SOGAMA crédit associatif (SCA), qui a rejoint le groupe BPI-France en juillet 2013.
Enfin, l’article 12 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire met en place un meilleur suivi statistique des entreprises de l’économie sociale et solidaire, dont 80 % sont des associations. Ce suivi, qui est assuré par l’INSEE, la Banque de France et la BPI, permettra de mieux connaître la contribution de ce secteur au produit intérieur brut.
Je m’engage, avant la fin du premier semestre de l’année 2015, à organiser, avec mes collègues Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, et Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, une conférence sur le financement de l’économie sociale et solidaire, laquelle demeure le seul point, à mes yeux, non satisfait de votre amendement.
M. Jean-Yves Caullet. Je retire l’amendement.
L’amendement SPE1011 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement SPE1395 de M. Éric Alauzet.
M. Jean-Louis Roumegas. L’amendement SPE1395 vise à renforcer la démarche d’investissement socialement responsable – ISR –, qui intègre des critères extra-financiers dans les décisions de placement et de gestion des portefeuilles, en vue de financer des entreprises et des projets plus respectueux de l’homme et de l’environnement.
Certains grands investisseurs jouent déjà un rôle important en la matière : la Caisse des dépôts et consignations et France Investissement ont ainsi précisé dans leurs statuts que la gestion de leurs fonds devait satisfaire des critères d’ISR.
D’autres investisseurs institutionnels étant plus réticents, afin de consolider leur démarche d’investissement responsable, un premier pas avait été franchi dans la loi Grenelle II, obligeant les sociétés de gestion à se montrer plus transparentes sur la manière dont elles prennent en considération les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans la gestion de leurs portefeuilles.
À la suite du rapport « Responsabilité et performance des organisations », nous souhaitons étendre à l’ensemble des investisseurs institutionnels cette obligation de transparence, en vue d’améliorer le financement de projets favorables, notamment, à la transition énergétique, qui doit être au cœur de nos investissements.
Il faut responsabiliser les investisseurs institutionnels.
M. le ministre. Si la Caisse des dépôts n’est pas soumise à l’obligation de communiquer des données extra-financières, contenue dans la loi Grenelle II, elle effectue d’ores et déjà – elle l’a fait en 2012 et en 2013 – une communication de données conforme à ces exigences, via la publication d’un rapport de responsabilité sociétale.
S’il était adopté, l’amendement risquerait d’entrer en concurrence avec les dispositions de l’article 226 de la loi Grenelle II, alors même que les textes réglementaires d’application n’ont pas encore été publiés.
Je suis sensible à votre objectif de sensibilisation des investisseurs institutionnels. Le ministère soutient à l’heure actuelle le développement d’un label ISR, qui me paraît un moyen plus efficace que la publication de rapports. Je suis prêt à vous y associer aux côtés d’autres parlementaires qui ont déjà été sollicités.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Jean-Louis Roumegas. J’accepte votre proposition, monsieur le ministre. C’est Éric Alauzet qui suivra le dossier.
L’amendement SPE1395 est retiré.
La commission examine l’amendement SPE1399 de M. Éric Alauzet.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement met l’accent sur la contribution des banques au financement de l’économie réelle en vue de les obliger à rendre un rapport annuel sur les financements accordés aux TPE, aux PME et aux ETI ainsi qu’aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement exige ainsi des autres banques la même transparence que celle qui est exigée de la BPI.
Il faut savoir que 80 % des PME sont aujourd’hui financées par les activités commerciales des banques. Or, elles pâtissent de l’évolution du secteur bancaire, lequel donne la priorité aux activités de marché à rentabilité élevée et immédiate aux dépens de l’activité économique réelle.
Pourtant, le financement de l’économie est une fonction majeure des banques : c’est même pour cette action d’intérêt général qu’elles bénéficient d’une garantie. Il est donc normal que nous disposions des informations nous permettant d’évaluer l’évolution de l’action des banques en matière de financement de l’économie réelle.
M. le ministre. Votre amendement risquerait de poser des problèmes de confidentialité pour les banques elles-mêmes ainsi que pour les entreprises qu’elles sont susceptibles de financer. La Banque de France dispose de ces éléments dont elle donne une concaténation statistique. Il est tout à fait possible d’avoir des informations plus précises auprès d’elle.
J’insiste sur le fait que la BPI, quant à elle, en tant qu’opérateur financier central de l’État, publie un rapport très détaillé des modes de financement.
Nous pouvons donc nous féliciter de l’exhaustivité des données de crédit aujourd’hui rassemblées par la Banque de France. Leur niveau de détail est largement supérieur à celui de tous les comparables. Nous avons même demandé à la Banque de France de recueillir des informations plus précises sur les refus de crédits apportés aux TPE et PME.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Jean-Louis Roumegas. Comment la transparence est-elle garantie et comment la Banque de France utilise-t-elle ces données ?
M. le président François Brottes. Le Gouvernement et le Parlement en disposent – nous avons organisé des tables rondes sur le sujet.
Ces données permettent d’effectuer une analyse macroéconomique de l’implication réelle des banques dans le tissu local de PMI et PME.
Je rappelle la tenue d’un débat sur la répartition de l’épargne entre niveau national et niveau local : les banques avaient pris l’engagement de financer davantage de projets locaux. L’impact de cet engagement a été réel.
M. le ministre. Les informations que vous évoquez, monsieur Roumegas, après avoir été recueillies par toutes les banques, remontent de manière détaillée à la Banque de France. Celle-ci en publie une approche statistique. Sur demande, elle peut fournir des informations très précises, qui ne sauraient toutefois être rendues publiques.
M. Jean-Louis Roumegas. Je retire l’amendement.
L’amendement SPE1399 est retiré.
M. le président. Je tiens à saluer le travail du médiateur du crédit, dont les équipes départementales contribuent à fluidifier les relations entre les entreprises et les banques.
L’amendement SPE984 de M. Arnaud Leroy est retiré.
*
* *
Article 41
(art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle)
Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle
Le présent article a pour objet d’accroître les possibilités offertes aux conseils en propriété industrielle de faire connaître leurs activités, en leur permettant de recourir de façon plus large à la publicité et à la sollicitation personnalisée.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Les conseils en propriété industrielle constituent, depuis la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, une profession réglementée. Celle-ci a pour objet, en application de l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, de conseiller, d’assister ou de représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle interviennent ainsi dans les domaines des brevets, des marques, des dessins et modèles.
Seules les personnes inscrites sur la liste dressée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) peuvent exercer cette profession. Les conseils en propriété industrielle réunissent généralement les compétences d’ingénieurs et de juristes spécialisés en droit de la propriété industrielle. En janvier 2014, d’après la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), il existait 925 conseils répartis dans 352 cabinets principaux et établissements secondaires. Ils représentaient un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros.
Aujourd’hui, l’article L. 423-1 du code précité leur interdit tout démarchage en vue de représenter les personnes concernées, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle. Cependant, les offres de service à destination d’entreprises ou de professionnels sont autorisées dès lors qu’elles sont effectuées par la voie postale et se bornent à la communication d’informations générales sur le cabinet, ses prestations, son organisation et sur le droit de la propriété industrielle (28). De la même façon, la publicité leur est permise, à condition qu’elle prenne la forme d’annonces dans la presse professionnelle ou de brochures et que son objet se limite, là encore, à la communication d’informations générales (1).
Pour la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, « cela exclut, d’une part, que le Conseil propose une offre de service adaptée à l’activité, et au besoin du prospect, quelle que soit la forme de cette offre, et d’autre part, cela exclut que le Conseil communique sur les services qu’il a à offrir autrement que par voie postale et par le biais d’une plaquette de présentation générale de son activité. Cela interdit qu’il se déplace personnellement, notamment sur des salons, pour distribuer des plaquettes de présentation de son activité. De plus, il ne peut aujourd’hui faire parvenir d’informations sur son activité, par le biais de plaquettes, qu’à des professionnels ou à des entreprises, il n’est donc pas en mesure d’informer les particuliers. » (29) De fait, la capacité des conseils en propriété industrielle de faire connaître leurs activités est aujourd’hui limitée tant dans sa portée et ses supports qu’en ce qui concerne son public.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
D’après l’exposé des motifs du présent projet de loi, les limitations apportées aux communications commerciales de cette profession constituent « des contraintes injustifiées et disproportionnées à l’exercice de leur activité ». Aussi le présent article permet-il aux conseils en propriété industrielle de recourir de façon plus large à la publicité et à la sollicitation personnalisée. L’objectif poursuivi est de permettre aux conseils « d’élargir leurs offres de service et de développer leurs activités de conseil auprès des entreprises innovantes et des inventeurs indépendants en les guidant dans leur stratégie de protection et de défense de leurs actifs immatériels ».
Surtout, comme les auditions conduites par le rapporteur thématique l’ont montré, une telle réforme permettrait aux conseils en propriété industrielle de mieux faire connaître leurs activités auprès des petites et moyennes entreprises (PME). En effet, si les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire sont familiers de cette profession, tel n’est pas le cas des PME, qui se trouvent généralement démunies face aux questions de propriété industrielle. Notamment, certaines estiment qu’elles ont la capacité de rédiger elles-mêmes leur brevet, quand d’autres recourent aux services d’avocats non spécialisés, faute d’information relative à la profession de conseil en propriété industrielle. Aussi, la possibilité offerte à cette profession de recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée permettrait de développer la stratégie de propriété industrielle des PME.
Les deux premiers alinéas du présent article modifient ainsi l’article L. 423-1 du code précité pour permettre aux conseils en propriété industrielle de recourir, au-delà de la publicité, à la sollicitation personnalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi, ce décret précisera que le recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée devra être respectueux de l’indépendance de la profession et ne pas induire le client en erreur. Il fixera également les moyens et supports que la publicité et la sollicitation personnalisée peuvent emprunter, vraisemblablement sur le modèle de ce qui a été prévu pour les avocats.
En effet, la profession d’avocat a récemment bénéficié de dispositions semblables, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant pris acte d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne aux termes de laquelle la réglementation nationale ne saurait interdire totalement aux professions réglementées le recours aux actes de démarchage (30). En application du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, les avocats peuvent désormais recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée « si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession » et si « elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ». Par ailleurs, certaines formes de publicité, comme les tracts ou les films télévisés, ne leur sont pas permises (31) ; de la même façon, la sollicitation personnalisée n’est autorisée que par un envoi postal ou un courrier électronique (32).
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Le dernier alinéa du présent article vise à appliquer les dispositions de l’article L. 423-1 du code précité dans les îles Wallis et Futuna. Il soulève deux problèmes majeurs : d’une part, sur la forme, l’article L. 811-1 du même code le rendrait déjà applicable (33), sans qu’il soit besoin de le préciser dans la future loi ; d’autre part, sur le fond, il ne semble pas opportun de rendre cet article applicable dans les îles Wallis et Futuna, qui ne connaissent pas la profession de conseil en propriété industrielle. Il était logique que l’interdiction de démarchage, qui s’adressait à toute personne physique ou morale, s’y applique ; mais la nouvelle version de l’article L. 423-1, qui vise directement les conseils en propriété industrielle, n’a pas vocation à y trouver une quelconque application. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises. Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement des rapporteurs visant à corriger cette erreur matérielle.
Enfin, la commission a adopté, à l’initiative des rapporteurs, un amendement visant à améliorer l’information des inventeurs en matière de droit de la propriété industrielle. Afin que la sollicitation personnalisée ne se borne pas à la présentation d’une offre commerciale, l’amendement adopté par la commission prévoit que les conseils en propriété industrielle, lorsqu’ils y auront recours, devront aussi délivrer de façon obligatoire des informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1080 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’article 41 prévoyant d’ouvrir, comme aux avocats, aux conseils en propriété industrielle (CPI) la possibilité de recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, les CPI doivent avoir l’obligation, en contrepartie, d’accompagner leurs sollicitations commerciales d’informations générales sur le droit de la propriété intellectuelle.
L’objectif est de donner les moyens aux entreprises, notamment aux PME, de comprendre l’enjeu du droit en la matière.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1080.
Puis elle examine l’amendement SPE1082 des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE1082 vise à corriger une erreur matérielle concernant les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1082.
Puis elle adopte l’article 41 modifié.
*
* *
Article 41 bis [nouveau]
(art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle)
Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié
Le présent article, adopté à l’initiative des rapporteurs, a pour objectif de favoriser la transparence des relations entre l’employeur et l’inventeur salarié. En effet, en application de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, le salarié qui est l’auteur d’une invention dans l’exercice de ses missions a droit à une rémunération supplémentaire dès lors que son invention est brevetable. Les conditions de cette rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Afin de limiter le contentieux susceptible de naître d’une action du salarié en paiement de ces créances salariales, le présent article introduit au deuxième alinéa de l’article L. 611-7 une obligation d’information à la charge de l’employeur. Celui-ci devra informer le salarié auteur d’une invention du dépôt d’une demande de brevet protégeant ladite invention, ou de sa délivrance effective. Ainsi, le salarié, mieux informé, sera en mesure d’exercer au mieux son droit à rémunération supplémentaire.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1128 rectifié des rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE1128 rectifié vise à favoriser la transparence dans les relations entre les inventeurs salariés et leur employeur en obligeant celui-ci à informer le salarié lorsque son invention fait l’objet d’une demande de brevet ou de la délivrance d’un brevet.
Il vise également à limiter le contentieux, susceptible de naître, relatif à la rémunération supplémentaire à laquelle le salarié a droit lorsque l’invention réalisée dans le cadre de ses missions est brevetable.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1128 rectifié.
*
* *
Article 41 ter [nouveau]
Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte
La commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet visant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur l’impact juridique des pratiques d’innovation ouverte et la nécessité de faire évoluer le cadre juridique actuel.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1013 de M. Jean-Yves Caullet.
Mme Corinne Erhel. L’amendement SPE1013 demande un rapport sur l’innovation ouverte et son impact sur le droit de la propriété intellectuelle.
Il est en effet nécessaire d’anticiper l’évolution du droit de la propriété intellectuelle liée au développement de l’innovation ouverte. Certains acteurs se demandent aujourd’hui si le brevet est adapté à l’économie innovante de rupture – l’élaboration d’un brevet coûte cher et demande du temps –, tandis que d’autres continuent de le plébisciter.
Il convient de réfléchir à l’adaptation de nos outils juridiques pour garantir leur efficacité.
M. le ministre. Avis favorable.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement est-il de nature législative ? Je n’en suis pas certain. Il suffirait que le Gouvernement s’engage à réaliser une telle étude.
M. le président François Brottes. Il faut donner un signal aux organismes concernés pour favoriser une remise en cause des pratiques en termes de coût et de modalités de protection. La nouvelle économie fuit les dispositifs existants et le monde entier s’adapte.
En outre, il conviendra de passer par voie législative pour toute adaptation de nos outils juridiques. Le Gouvernement, grâce à cet amendement, pourra exiger, de la part des organismes concernés, les informations et les propositions nécessaires.
La commission adopte l’amendement SPE1013.
*
* *
Article 42
(art. L. 6143-1, L. 6143-4, L. 6143-7 et L. 6145-7 du code de la santé publique)
Prise de participation et création de filiales par les centres hospitaliers universitaires
Le présent article a pour objet de permettre aux centres hospitaliers universitaires de prendre des participations financières dans des sociétés et de créer des filiales pour assurer des prestations d’expertise internationale, valoriser leurs activités de recherche et exploiter d’éventuels brevets et licences.
I. L’ÉTAT DU DROIT
À l’heure actuelle, en application de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire et sans porter préjudice à leurs missions principales, « assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux ». Toutefois, ils ne peuvent le faire que dans les limites des moyens matériels et humains affectés à la réalisation de leurs missions principales, en application de l’article R. 6145-48 du même code. Par ailleurs, ils demeurent soumis, pour ces activités, aux règles relatives aux établissements publics, tant en matière de comptabilité, de marchés publics que de ressources humaines.
En dépit de ce cadre relativement contraignant, plusieurs établissements publics de santé, en particulier les centres hospitaliers universitaires (CHU), établissements de santé d’envergure régionale associés à une université, ont développé une importante expertise internationale. Par exemple, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a formé en 2012, avec le SAMU, 150 personnels de santé brésiliens à la médecine de catastrophe, puis a remporté, en 2013, l’appel d’offres relatif à l’étude de faisabilité du CHU d’Hanoï.
De la même façon, ces établissements sont, pour certains, à la pointe dans le domaine de la recherche médicale et ont développé une réelle stratégie de valorisation de ces activités et de leurs résultats. C’est notamment le cas de l’AP-HP, par le biais de son Office de transfert des technologies et des partenariats. Cette structure mise en place en 1992 a pour but d’aider les employés de l’AP-HP qui auraient créé ou amélioré un produit ou un procédé, dans le cadre de leur activité de soin ou de recherche, à protéger leur innovation – par le biais d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’une marque ou d’un modèle – et à trouver des partenaires afin de la valoriser. Au total, l’AP-HP détient aujourd’hui environ 850 brevets, qui ont généré 11,3 millions d’euros de revenus en 2013.
Toutefois, comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, les règles liées au statut d’établissement public de santé ne sont pas favorables au développement de ces deux domaines que sont l’expertise internationale et la valorisation des activités de recherche et de l’innovation, par ailleurs soumis à une intense concurrence internationale.
Dans le domaine de la coopération internationale, les CHU doivent recourir à des montages complexes, parfois peu orthodoxes voire illégaux, pour recruter du personnel, accéder à des appels d’offres et exécuter des missions sur un pied d’égalité avec leurs concurrents privés. Le cadre juridique actuel prive ainsi les CHU d’opportunités majeures en même temps qu’il pousse le corps médical à se rapprocher du secteur privé pour réaliser ce type de missions. En matière de recherche médicale, les CHU pourraient valoriser de façon plus poussée les résultats de leurs activités de recherche, qui ont généralement une maturité importante, grâce à la validation clinique offerte par le cadre hospitalier. En matière de ressources humaines également, tant le plafond d’emplois que les grilles de rémunération limitent grandement le recrutement de profils parfaitement adaptés à ces missions de valorisation.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
De nombreux établissements publics menant des activités de recherche et d’expertise bénéficient aujourd’hui de la possibilité, ouverte par la loi ou le règlement, de prendre des participations ou de créer des filiales. C’est notamment le cas des établissements publics à caractère scientifique et technologique (34), mais aussi des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (35) ou encore de l’Établissement français du sang (36).
Aussi, pour permettre aux CHU de développer leurs activités d’expertise internationale et de recherche, le 4° du présent article modifie l’article L. 6145-7 du code de la santé publique afin de leur permettre de prendre des participations financières dans des sociétés – par exemple au sein de jeunes entreprises innovantes, en échange de l’exploitation d’un brevet – mais aussi de créer des filiales, notamment sous la forme de sociétés anonymes, comme c’est le cas de France Innovation Scientifique et Transfert, filiale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ou d’INSERM Transfert, filiale de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
Les retombées financières de cette réforme sont relativement importantes. En effet, comme l’a indiqué l’AP-HP au rapporteur thématique, elle pourrait permettre de tripler les revenus liés à la valorisation de la recherche, qui atteindraient potentiellement 75 millions d’euros par an. Dans le domaine des prestations de service internationales, l’utilisation du nom d’un hôpital reconnu rapporte, par exemple, environ 1 million de dollars par an et par partenariat.
Toutefois, de telles opérations ne pourraient poursuivre, en application du présent article, que trois buts : assurer des prestations d’expertise au niveau international, par exemple en matière d’organisation des flux, de stratégie hospitalière ou encore de gestion immobilière ; valoriser des activités de recherche et leurs résultats ; exploiter des brevets et des licences.
Par ailleurs, le 4° du présent article prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions et limites dans lesquelles de telles opérations peuvent intervenir.
En ce qui concerne la gouvernance hospitalière, le dispositif est également relativement encadré. En effet, le 3° du présent article prévoit que le directeur de l’établissement hospitalier soumet ces opérations au conseil de surveillance, après concertation avec le directoire de l’établissement. Le 1° modifie l’article L. 6143-1 du code précité pour permettre au conseil de surveillance de délibérer sur les prises de participation et les créations de filiales. Enfin, le 2° prévoit que ces délibérations sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé n’y fait pas opposition dans un délai de deux mois, lui permettant ainsi d’assurer un contrôle de légalité.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La référence à des prestations d’expertise semble trop réductrice par rapport aux activités internationales réellement déployées par les CHU ; notamment, elle semble faire obstacle tant à l’organisation de formations médicales ou paramédicales à la demande d’un partenaire étranger qu’à des prestations de gestion hospitalière déléguée, qui font aujourd’hui l’objet de nombreux appels d’offre internationaux. Aussi la commission a-t-elle adopté, à l’initiative des rapporteurs, un amendement visant à ajouter la notion de « prestations de service » à la liste fixée par l’article 42.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE776 de M. André Chassaigne, qui tend à supprimer l’article.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 42 autorise les centres hospitaliers universitaires – CHU – à créer des filiales à l’étranger.
Il y a lieu, évidemment, de se féliciter que le savoir-faire français en matière de soins, d’accueil et d’accompagnement des patients, soit reconnu et sollicité à travers le monde. Les établissements publics de santé peuvent du reste déjà répondre aux demandes étrangères puisque l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris – AP-HP – a été retenue, aux côtés de Bouygues, en mars dernier, pour construire un CHU à Constantine. Nous savons également que les besoins sont importants, notamment en Afrique, où on estime à 550 000 le nombre de lits supplémentaires nécessaires d’ici à 2020. Il est donc essentiel de donner les moyens aux établissements publics de santé de répondre à ces demandes étrangères.
Toutefois, il convient de ne pas porter atteinte à la vocation de ces établissements, qui n’est ni industrielle ni commerciale, comme le précise la loi. Est-ce bien leur rôle que de chercher des investissements à l’étranger ? Alors que les hôpitaux publics français sont aujourd’hui dans une souffrance extrême et que le Gouvernement leur demande de réussir le virage ambulatoire tout en réduisant de manière draconienne leur budget, nous pensons que la création de filiales à l’étranger n’est pas la priorité.
Telle est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’article.
M. le ministre. Je tiens, madame Fraysse, à lever les ambiguïtés que cet article pourrait susciter.
Même si certains de nos hôpitaux peuvent à l’heure actuelle fournir des prestations à l’international, ils ne jouissent pas du cadre juridique leur permettant de se développer en propre à l’international, pour se financer, s’installer et conserver la propriété intellectuelle en cas d’activités de recherche. Cette demande émane d’ailleurs des CHU : l’article 42 leur assure le cadre juridique qui leur permettra d’opérer à l’étranger.
Cet article renvoie évidemment à la question des activités accessoires des hôpitaux. Ceux qui ont des difficultés à financer la médecine ambulatoire ne seront pas en situation de procéder à des dépenses pour créer des filiales à l’étranger, exception faite d’une spécialité précise, puisque cette faculté s’exercera à la suite d’une délibération en ce sens du conseil de surveillance de l’établissement, soumise au contrôle de légalité du directeur général de l’agence régionale de santé – ARS.
Cet article, je le répète, a pour objectif de garantir un cadre juridique aux hôpitaux français qui assurent d’ores et déjà des prestations à l’international et veulent se développer –un développement qui, parfois, améliore leur financement –, en leur permettant de participer à un marché mondial où la filière française est reconnue pour son excellence.
Cette participation n’entrera donc pas en concurrence avec le développement de leur activité en France. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement.
M. le rapporteur général. Il entre bien dans le rôle des CHU de faire rayonner leur activité. L’article 42 est très attendu par les hôpitaux car il débloquera certaines situations tout en leur permettant de développer dans un cadre juridique adapté des missions, qu’ils mènent déjà, d’expertises internationales et de valorisation des brevets. Ils obtiendront ainsi de nouvelles recettes leur permettant d’améliorer le service rendu par l’hôpital public.
À l’heure actuelle, la situation budgétaire ne permet plus de se passer des instruments proposés. Cet article est un gage réel d’efficacité et de rayonnement pour les hôpitaux. À la seule échelle de l’AP-HP, 75 millions d’euros de recettes sont attendus de la disposition qu’il instaure.
Il faut donner une plus grande capacité de rayonnement aux CHU en leur permettant de partager à l’international leurs savoir-faire. Les hôpitaux en tireront des ressources complémentaires et la communauté internationale un bénéfice collectif.
Avis défavorable à l’amendement de suppression de l’article.
M. Patrick Hetzel. Cet article est une nécessité.
Les CHU exercent à la fois des activités de soins et de recherche. Or, les recherches s’exercent dans un cadre de plus en plus international. Les grands hôpitaux français étant amenés à développer leur coopération internationale, ils doivent pouvoir le faire dans un cadre juridique adéquat, lequel, madame Fraysse, garantira la bonne utilisation des deniers publics.
Cette faculté a déjà été accordée aux universités dans le cadre de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Or, les rapports révèlent que cette possibilité, loin d’avoir donné lieu à des dérives, est un élément de dynamisation.
Mme Jacqueline Fraysse. S’il ne s’agissait que de donner un cadre juridique sûr au développement international des CHU, je pourrais me lancer convaincre. Je reste toutefois préoccupée par le fait que, comme vous l’avez clairement souligné, il s’agit de trouver des recettes nouvelles au financement des hôpitaux. Est-il normal que les hôpitaux publics soient maintenus dans les difficultés financières actuelles et qu’on les invite à chercher des financements à l’étranger ?
Cela étant, nous sommes très ouverts à la coopération internationale : elle mérite assurément d’être développée dans tous les domaines. Il ne saurait y avoir de connaissance médicale qui ne soit mondialement partagée.
Je maintiens l’amendement.
La commission rejette l’amendement SPE776.
Puis elle examine l’amendement SPE992 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. L’amendement vise à donner toute latitude aux CHU pour s’associer comme acteurs majoritaires ou minoritaires avec d’autres hôpitaux ou des laboratoires, dans le cadre notamment de coentreprises. La rédaction actuelle de l’article me paraît trop limitative en termes de coopération.
M. le ministre. Le décret prévu à l’alinéa 8, en apportant cette précision, permettra de satisfaire votre amendement, que je vous propose donc de retirer.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire l’amendement.
L’amendement SPE992 est retiré.
La commission passe à l’examen de l’amendement SPE1133 des rapporteurs.
M. le rapporteur général. Le projet de loi prévoit que les CHU pourront créer des filiales et prendre des participations dans le but d’assurer des « prestations d’expertise au niveau international ». Or, cette rédaction paraît réductrice par rapport aux actions que les CHU mènent à l’heure actuelle.
C’est pourquoi l’amendement vise à étendre la possibilité de créer des filiales aux prestations de services. Ainsi les CHU seront-ils en mesure non seulement de répondre aux nombreuses demandes internationales qui comportent un volet relatif à la gestion hospitalière mais également d’organiser des formations médicales dans ce nouveau cadre, ce que vise d’ailleurs l’étude d’impact.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1133.
L’amendement SPE1134 des rapporteurs est retiré.
La commission examine l’amendement SPE988 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Compte tenu de la porosité des structures juridiques, l’objectif de cet amendement est de garantir à l’établissement hospitalier les bénéfices des activités qu’il financera et réalisera à l’international.
M. le ministre. Je remercie le rapporteur général d’avoir retiré l’amendement SPE1134, qui sera satisfait par un décret.
Monsieur Fromantin, lorsque les établissements publics de santé réalisent des bénéfices à partir de leurs activités subsidiaires gérées dans le cadre de comptes de résultat annexes, les bénéfices leurs sont déjà de fait restitués en intégralité.
La disposition que vous proposez dans le cadre des filiales à l’étranger des CHU interdirait aux CHU de s’associer avec des partenaires publics ou privés, cadre dans lequel la répartition des bénéfices relèverait d’un pacte d’actionnaires. Votre amendement risquant donc de restreindre les options offertes aux CHU, je vous invite à le retirer.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire l’amendement, tout en précisant que celui-ci visait la part liée au pacte d’actionnaires.
L’amendement SPE988 est retiré.
La commission adopte l’article 42 modifié.
*
* *
Chapitre II
Entreprises à participation publique
Section 1
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Article 43 A (nouveau)
(articles L. 225-7-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, 1136 du code général des impôts et 4, 6-2, 14, 15 et 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983)
Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence
Le II de l’article 43 du projet de loi pour la croissance et l’activité prévoit d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance diverses mesures en vue de compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation, qui n’est pas nécessaire, et de mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
*
* *
La commission examine les amendements SPE1524, SPE1516 et SPE1525 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je tiens à souligner la cohérence qui lie les amendements SPE1524, SPE1516 et SPE1525 : ces trois articles additionnels ont en effet pour objet d’insérer directement dans le projet de loi les corrections que nous souhaitons apporter aux alinéas 2 à 5 de l’article 43.
Je tiens à rappeler que l’article 43 a, dans sa rédaction actuelle, un double objectif : ratifier l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, et habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour, premièrement, compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ; deuxièmement, mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; troisièmement, préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.
Si ces trois articles additionnels, qui visent à répondre au souhait, exprimé par un grand nombre de parlementaires, de légiférer plutôt que d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances, sont adoptés, l’amendement SPE1515 à l’article 43 tendra, en cohérence, à supprimer les trois demandes d’habilitation correspondantes.
M. le président François Brottes. Je remercie la rapporteure thématique de la clarté de son exposé.
M. le ministre. Je me joins à vos remerciements, monsieur le président.
L’explication de la rapporteure thématique répond par anticipation aux questions posées par les amendements SPE247 et SPE414 de suppression de l’article 43.
Les corrections matérielles et les mises en cohérence effectuées par les amendements SPE1524, SPE1516 et SPE1525 permettent d’achever la refonte, entamée au mois d’août dernier, de la doctrine de l’État actionnaire, en vue de rendre plus fluide la gestion des participations, d’assurer sa mise en conformité avec le droit communautaire, de simplifier le fonctionnement de l’Agence des participations de l’État – APE –, d’encadrer la réalisation des cessions d’actifs et de rapprocher la gestion des entreprises publiques de celle des entreprises privées en termes de gouvernance et de représentation de l’État. La gouvernance de l’APE sera plus conforme à la gouvernance contemporaine : désormais, l’État pourra désigner des administrateurs issus d’un vivier élargi, afin de pouvoir bénéficier de leur expérience de l’entreprise.
Avis favorable aux trois amendements.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe UMP ne s’opposera pas à leur adoption.
La Commission adopte l’amendement SPE1524.
*
* *
Article 43 B (nouveau)
(articles 7, 8, 16, 22, 23, 24 et 34 de l’ordonnance n° 2014-948)
Corrections rédactionnelles apportées à l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence
Le II de l’article 43 du présent projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance diverses mesures en vue de compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation, qui n’est pas nécessaire, et d’insérer directement dans le texte du projet de loi les rectifications des erreurs ou omissions d’ordre matériel de l’ordonnance susvisée.
*
* *
La Commission adopte l’amendement SPE1516.
*
* *
Article 43 C (nouveau)
(article 41 de l’ordonnance n° 2014-948)
Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
Le II de l’article 43 du présent projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance diverses mesures en vue de compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
À l’initiative du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation qui n’est pas nécessaire et de proposer un encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, en rendant obligatoire une autorisation préalable de l’État au-delà de certains seuils en matière d’effectifs et de chiffre d’affaires.
Dans une démarche visant à harmoniser les seuils déclenchant une autorisation législative ou étatique, cet article diminue de moitié les seuils en capital et en effectifs qui déclenchent une autorisation de l’État.
*
* *
La Commission adopte l’amendement SPE1525.
*
* *
Article 43
Ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence
Cet article présente un double objet : il procède tout d’abord à la ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique avant d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures complémentaires en cette matière.
Le contexte : l’élaboration d’une doctrine de l’État actionnaire et le renforcement du pilotage stratégique de l’Agence des participations de l’État.
Le suivi et la gestion des participations de l’État au sein de sociétés commerciales ont longtemps relevé d’une forme de tutelle à la fois lointaine et interventionniste qui n’évitait pas la confusion de ses différentes « casquettes ». Constatant que « les exigences accrues qui se dessinent en matière de gouvernement des entreprises du secteur privé comme les insuffisances qui ont pu être relevées dans les processus de prise de décisions stratégiques concernant certaines entreprises publiques nécessitent une forte rénovation de l’exercice par l’État de sa fonction d’actionnaire, en dépit des progrès qui ont pu être accomplis ces dernières années », M. Francis Mer, alors ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, avait décidé de la création d’une mission sur les conditions d’exercice par l’État de sa fonction d’actionnaire, confiée le 6 novembre 2002 à M. René Barbier de la Serre.
Ce rapport (37) et ses préconisations ont été à l’origine de la création, en 2004, de l’Agence des participations de l’État (APE), au sein du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, sous la forme d’un service à compétence nationale placé auprès du directeur du Trésor (38).
Pourtant, même si la création de ce service dédié a permis d’améliorer le pilotage de l’État actionnaire, l’absence de doctrine et le mode de gestion « en bon père de famille » de l’Agence n’ont pas permis, en dépit des efforts de ses responsables successifs (39), de donner réellement un sens aux opérations en capital réalisées par l’État, ni de réellement dynamiser la gestion des participations de l’État.
Sous l’impulsion conjointe des ministres des finances et de l’économie et du redressement productif ainsi que du nouveau commissaire aux participations de l’État, M. David Azéma (40), l’État s’est doté en l’espace de deux ans des outils juridiques, programmatiques et managériaux permettant une nouvelle gouvernance plus ambitieuse et plus efficace.
L’Agence a tout d’abord profondément réformé son organisation et son fonctionnement, autour de quatre directions de participations dotées de portefeuilles plus cohérents (énergie, industrie, services et finances, transports) et en supprimant un niveau hiérarchique afin de faciliter l’allocation des ressources et accélérer les décisions. L’équipe de l’Agence est constituée de cinquante-deux personnes, fonctionnaires pour l’essentiel, parmi lesquelles vingt-six cadres dirigeants et chargés de participations, et le taux de féminisation se situe à 50 %. Le périmètre de compétence de l’Agence comporte 74 entreprises pour une valeur des participations s’élevant à 110 milliards d’euros (41).
Ensuite, l’État a entendu se doter d’une doctrine de gestion active de ses participations, clarifier sa présence directe au capital d’entreprises et adapter cette dernière à ses objectifs. Annoncées par le Gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du 2 août 2013, les lignes directrices pour l’État actionnaire ont été élaborées en étroite collaboration par le ministre de l’économie et des finances et le ministre du redressement productif ainsi qu’en relation avec les commissions des finances des deux assemblées. Elles ont fait l’objet d’une communication en Conseil des ministres le 15 janvier 2014.
Publiées et consultables sur le site internet de l’Agence des participations de l’État (42), les lignes directrices réaffirment que l’intervention de l’État en fonds propres est justifiée et nécessaire et précise ses quatre objectifs :
– s’assurer d’un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics stratégiques intervenant dans des secteurs particulièrement sensibles en matière de souveraineté ;
– s’assurer de l’existence d’opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du pays ;
– accompagner le développement et la consolidation d’entreprises, en particulier dans des secteurs et des filières déterminantes pour la croissance économique nationale et européenne ;
– intervenir ponctuellement, dans le respect des règles européennes, dans des opérations de sauvetage d’entreprises dont la défaillance présenterait des conséquences systémiques.
Enfin, le troisième chantier de la modernisation de l’État actionnaire porte sur le toilettage et la simplification des règles applicables qui figuraient dans un grand nombre de textes (43), dont le décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’État.
Faisant le constat de l’empilement, des incohérences, de l’inutile complexité ou des lacunes des règles applicables à l’État actionnaire, mais aussi des critiques récurrentes sur sa faiblesse, l’article 10 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (44) a autorisé le Gouvernement à adapter, simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés par ordonnance le cadre législatif applicable à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
C’est cette ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique que le I du présent article entend ratifier.
I. LA RATIFICATION DE L’ORDONNANCE RELATIVE À LA GOUVERNANCE ET AUX OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE
Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance (45) précise que « ces mesures visent à doter l’État actionnaire des outils qui lui permettront de rapprocher son cadre juridique de celui des actionnaires de droit commun, notamment dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont soumises à des principes spécifiques de gouvernement d’entreprises, tout en rendant plus efficace la gestion de ses participations. Elles visent aussi et surtout à simplifier et à moderniser tant les règles de gouvernance que les règles relatives aux opérations sur le capital des entreprises à participation publique, aujourd’hui trop complexes et parfois peu intelligibles. »
L’ordonnance n° 2014-948 et le décret n° 2014-949 du 20 juillet 2014 refondent l’ensemble du droit des privatisations auparavant assis sur les lois de 1986 et 1993, qui sont abrogées, ainsi que leurs décrets d’application, sauf en ce qui concerne les participations détenues par les collectivités territoriales, pour lesquelles les anciennes dispositions continueront à s’appliquer (les listes annexées auxdites lois sont donc aussi abrogées).
L’ordonnance procède à une extension des compétences de la Commission des participations et des transferts (CPT) et renforce ainsi le contrôle exercé sur les opérations en capital :
– la CPT est désormais compétente pour les participations majoritaires directes, inférieures à 20 %, ce qui n’était pas le cas auparavant, ainsi que pour les participations minoritaires directes ;
– la CPT est toujours compétente pour les participations majoritaires indirectes, dès lors que l’autorisation du ministre est requise, ce qui signifie un abaissement important du seuil ;
– la CPT ne perd ses compétences que pour des opérations a priori de faible ampleur (petites opérations de marché, opérations pour les salariés, dilution résultant de certaines opérations décidées par l’assemblée générale de la société) et jamais si l’opération entraîne une privatisation ;
– d’importantes précisions intégrant la jurisprudence du Conseil d’État sont apportées en ce qui concerne la transparence des sociétés holding intermédiaires et l’assimilation des cessions d’actif essentiel aux cessions de la société concernée ;
– enfin, la CPT pourra désormais être saisie de toute opération d’acquisition ou de cession.
L’ordonnance comporte quatre titre, respectivement consacrés aux dispositions générales, à la gouvernance, aux opérations sur le capital et à des dispositions diverses. Ces principales dispositions sont décrites ci-après.
Au titre Ier, l’article 1er circonscrit le champ de l’ordonnance aux sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou les établissements publics nationaux détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital. Il convient de noter que les entreprises ayant le statut d’établissement public de l’État n’entrent pas dans ce champ et sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Cet article rappelle également l’application de principe aux sociétés relevant de l’ordonnance des règles issues du code de commerce. Il est ainsi mis fin aux règles spéciales concernant la taille des conseils et la durée des mandats, issues de la loi du 26 juillet 1983 précitée, dont la rigidité a pu nuire au rôle premier du conseil d’administration ou de surveillance, qui est d’être un organe de décision.
L’article 2 reprend le critère actuel de la chaîne ininterrompue de participations publiques majoritaires pour la détermination du caractère public d’une entreprise ; il est ainsi sans incidence sur le périmètre du secteur public.
Au titre II, l’article 3 fixe le cadre général de la composition des conseils d’administration ou de surveillance, en prévoyant que sont susceptibles d’en être membres l’État, des membres désignés par l’organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l’État, ainsi que des représentants des salariés.
L’article 4 prévoit que l’État désigne un représentant dans toutes les sociétés dans lesquelles il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de 50 % du capital. Il s’agit pour lui d’une simple faculté dans les autres sociétés dont il détient plus de 10 % du capital. Il peut en outre être nommé membre du conseil par les organes compétents des autres sociétés où il détient une participation. Lorsque les participations de l’État sont détenues par des sociétés holding ou faîtières, ces participations sont assimilées à des participations directes de l’État pour l’application de ces règles.
L’article 5 dispose que le représentant de l’État siège avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres des conseils et que toute rémunération qu’il perçoit à raison de l’exercice de son mandat est versée au budget de l’État.
L’article 6 porte sur les membres désignés par l’organe compétent de la société et vise notamment à élargir le vivier des administrateurs, afin de pouvoir bénéficier de l’expérience de personnes issues tant du secteur public que du secteur privé.
Il prévoit que l’État actionnaire peut proposer la nomination d’un ou de plusieurs membres au conseil d’administration ou de surveillance pour les sociétés dans lesquelles lui-même ou ses établissements publics détiennent, directement ou indirectement, une participation. En outre, dans les sociétés dans lesquelles il détient directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges lui sont réservés, dans la limite d’un nombre proportionnel à sa participation.
Les membres proposés peuvent, ou non, avoir la qualité d’agents publics de l’État, qu’ils soient dirigeants d’établissements publics, militaires, fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État, en activité ou non.
La section 4 est relative aux représentants des salariés et reprend en grande partie les dispositions de la loi de démocratisation du secteur public.
L’article 7 confirme la règle du tiers de représentants des salariés au sein des conseils des entreprises du secteur public.
L’article 9 rappelle que les représentants des salariés ne sont pas soumis aux règles du code de commerce relatives à la parité dans les conseils, une disposition spécifique étant prévue par la loi de démocratisation du secteur public, et renvoie aux statuts pour déterminer la durée de leur mandat afin de bénéficier d’une règle harmonisée entre les différents membres des conseils.
La section 5, qui comprend les articles 10 à 14, concerne le fonctionnement des conseils.
La section 6 porte sur les autres dispositions.
L’article 15 prévoit qu’un commissaire du Gouvernement peut être institué auprès des sociétés dont l’État est membre du conseil d’administration, de surveillance ou de l’organe en tenant lieu. L’article précise les pouvoirs du commissaire du Gouvernement, sans préjudice des dispositions particulières le régissant. Par la création légale d’un statut ad hoc, le Gouvernement entend mieux distinguer le rôle de l’État actionnaire de ses autres fonctions, telles que l’État client ou régulateur.
Le chapitre II porte sur la présidence et la direction générale.
L’article 17 ouvre la faculté, en cas de vacance, de choisir le président parmi les agents publics de l’État ou dans les sociétés dont l’État détient la totalité du capital.
L’article 18 ouvre, par ailleurs, la faculté de dissocier, comme en droit commun, les fonctions de président et de directeur général, dans les sociétés anonymes à conseil d’administration dont plus de la moitié du capital est détenue par l’État et ses établissements publics.
L’article 19 précise les règles de nomination des dirigeants des sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu directement par l’État et tient compte de la faculté nouvelle de dissocier les fonctions de président et de directeur général et du cas des sociétés commerciales n’ayant pas la forme de société anonyme, notamment les sociétés par actions simplifiées.
Le titre III de l’ordonnance porte sur les règles applicables aux opérations en capital, qui sont bien entendu fondamentales. Il simplifie, clarifie et modernise les règles applicables aux opérations en capital de l’État, qui figurent à l’heure actuelle dans différents textes dont l’articulation est souvent malaisée, à savoir la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
Le chapitre Ier concerne les règles d’autorisation des opérations. La section 1 porte sur les opérations de cession et la section 2 sur les opérations d’acquisition.
Le I de l’article 22 prévoit que ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi, d’une part, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la propriété des sociétés dont il détient directement plus de la moitié du capital depuis plus de cinq ans et dont les effectifs ou le chiffre d’affaires, appréciés au niveau consolidé des groupes, sont respectivement supérieurs à mille personnes ou 150 millions d’euros et, d’autre part, celles qui concernent des sociétés qui sont entrées dans le secteur public en vertu d’une disposition législative. La rapporteure thématique souhaite élargir la compétence du Parlement en matière de contrôle des privatisations et proposera en conséquence d’abaisser de moitié les seuils précités.
Le II de l’article 22 prévoit que les autres opérations de privatisation par l’État sont décidées par décret, de même que les opérations de cession, lorsqu’elles ont pour effet de réduire la participation de l’État à moins de 66,67 % ou de 33,33 %. L’introduction de cette règle vise à renforcer les règles d’autorisation de cession pour le franchissement de seuils stratégiques de contrôle des entreprises. Les autres opérations de cession par l’État sont décidées par le ministre chargé de l’économie.
Le IV de l’article 22 concerne les opérations de transfert au secteur privé des sociétés dites « de second rang », c’est-à-dire les filiales d’établissements publics de l’État et de sociétés elles-mêmes détenues par l’État. Les cessions décidées par ces entreprises sont soumises à l’autorisation préalable du ministre en charge de l’économie lorsque leurs effectifs ou chiffre d’affaires, appréciés au niveau consolidé des groupes, sont respectivement supérieurs à mille personnes et 150 millions d’euros.
Le V de l’article 22 vise à donner une réponse et un cadre juridique précis à la question de la cession des actifs dits « essentiels », c’est-à-dire susceptibles d’une exploitation autonome. Il dispose que la cession d’un tel actif représentant plus de 50 % de l’actif net comptable, ou du chiffre d’affaires, ou des effectifs d’une société est assimilée à la cession de cette société. De même, les participations détenues par toutes sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées à des participations directes.
La section 2 du chapitre Ier concerne les opérations d’acquisition effectuées par l’État (hors les cas de nationalisations) et crée un cadre général qui n’est qu’esquissé par les textes actuels.
L’article 24 prévoit ainsi que de telles opérations sont décidées par décret lorsqu’elles entraînent le transfert de la majorité du capital d’une société au secteur public et par le ministre en charge de l’économie dans les autres cas.
La section 1 du chapitre II est consacrée à la Commission des participations et des transferts (CPT).
L’article 25 rappelle les règles de composition de la commission. Il prévoit les règles d’incompatibilités afférentes aux fonctions de membre de la commission.
L’article 26 est relatif au champ de compétence de la commission. En ce qui concerne les opérations réalisées selon les procédures des marchés financiers, elle est saisie lorsque l’opération entraîne le transfert au secteur privé de la majorité du capital des sociétés ainsi que des autres opérations de cession de participations directes représentant au moins 0,5 % du capital des sociétés dont l’effectif dépasse mille personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 millions d’euros.
La commission est également saisie des opérations entraînant le transfert au secteur privé des participations des sociétés de second rang dont l’effectif dépasse mille personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 millions d’euros. En ce qui concerne les opérations réalisées hors marché, elle est saisie de toutes les opérations de cession au secteur privé. Elle peut enfin être saisie à titre facultatif par le ministre chargé de l’économie de toute autre opération de cession ou d’acquisition.
Ces mesures visent à renforcer le contrôle des opérations de cession significative, qui est inexistant aujourd’hui pour les participations minoritaires de l’État ou pour celles dans les entreprises dans lesquelles l’État détient aujourd’hui moins de 20 % du capital. Elles introduisent, dans le même esprit, la faculté de saisine de la commission pour les opérations d’acquisitions de l’État.
La section 2 concerne les procédures d’évaluation.
L’article 27 précise le rôle et les prérogatives de la Commission des participations et des transferts dans chaque cas de figure. S’agissant des opérations réalisées en dehors des procédures des marchés financiers, la commission émet un avis conforme sur les modalités de la procédure puis sur le choix du ou des acquéreurs et enfin sur les conditions de la cession. Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération.
L’article 28 fixe un cadre minimal pour l’évaluation des opérations qui n’ont pas été soumises à une telle procédure par la Commission des participations et des transferts.
Le chapitre III porte sur la réalisation des opérations.
L’article 29 prévoit que le prix des opérations décidées ou autorisées par l’État est fixé par arrêté du ministre en charge de l’économie. Il réaffirme le principe selon lequel la propriété des participations ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur. Lorsque la commission a été saisie, les prix ou parités fixés par l’autorité compétente ne peuvent être inférieurs à son évaluation.
Le titre IV de l’ordonnance rassemble, aux articles 32 à 42, des dispositions diverses, en particulier des dispositions d’entrée en vigueur et transitoires. Les dispositions relatives aux opérations sur le capital et aux articles 17 et 21 sont d’entrée en vigueur immédiate alors que les dispositions relatives à la gouvernance n’entrent en vigueur qu’à la date fixée par l’organe compétent de chaque société et, en tout état de cause, avant la date de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Les sociétés resteront donc soumises aux anciens textes relatifs à la gouvernance au plus tard jusqu’à cette date. Le II de l’article 41 précise que les dispositions pertinentes des lois n° 86-793 et n° 86-912 restent applicables aux sociétés et opérations qui ne sont pas régies par le titre III de l’ordonnance, ce qui vise les opérations liées à la détention de participations dans des sociétés commerciales par des collectivités territoriales.
II. LES DEMANDES D’HABILITATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le II du présent article porte sur une demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, une série de mesures visant respectivement à :
– compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ;
– mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
– préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.
La rapporteure thématique considère que les deux premières demandes d’habilitation n’ont pas lieu d’être, s’agissant de modifications limitées et de coordination avec d’autres textes législatifs. Ces dispositions doivent figurer dans le présent projet de loi et ainsi modifier directement l’ordonnancement juridique.
La situation est différente s’agissant de la troisième demande d’habilitation, relative aux règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales. On sait que, par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales (SEML) ou prendre des participations dans ces sociétés.
Le régime juridique des SEML, fixé pour l’essentiel par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, a fait l’objet de plusieurs adaptations depuis le début des années 2000, par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales. Il est codifié, pour la partie législative, aux articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales.
La prise de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut avoir lieu que si la société revêt la forme d’une société anonyme régie par le code de commerce, sous réserve des dispositions applicables aux SEML. Par ailleurs, ces collectivités et groupements doivent détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix au sein des organes délibérants.
Au total, les règles applicables aux SEML afin de garantir la protection des intérêts publics sont d’ores et déjà précisées à l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. »
Il en va différemment pour ce qui concerne les participations prises par une collectivité territoriale dans une société commerciale qui, par leur nature même, rendent nécessaire de conserver un contrôle.
C’est la jurisprudence du Conseil d’État qui, à partir de 1930, a autorisé les communes à intervenir en matière économique et sociale, lorsqu’il existe un besoin public local, en raison d’une carence de l’initiative privée. L’arrêt initiateur de ce qu’on a appelé le « socialisme municipal » est la célèbre décision du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, rendu, dans le contexte de crise économique des années 1930, à propos de la création d’une alimentation municipale, contestée par un syndicat groupant des commerçants.
Cette jurisprudence est aujourd’hui affinée par une décision rendue en 2006 (46), qui dispose que si les personnes publiques entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. À cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
La rapporteure thématique n’a pu obtenir d’exemples concrets de ce type d’intervention mais il est important de fixer des règles qui vaudront à l’avenir si, par exemple, une région est amenée à acquérir une entreprise pour éviter sa disparition. On peut noter qu’il peut aussi s’agir d’opérations menées dans le cadre du droit de préemption commerciale que peuvent exercer les communes si elles ont défini un périmètre de référence. Dans un tel cas, la rétrocession au privé du bail commercial ou du fonds de commerce doit intervenir dans un délai de deux ans.
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement consistant à prévoir une autorisation préalable de l’État dès lors qu’une opération de privatisation concerne une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, seuils identiques à ceux retenus pour l’autorisation législative et la compétence de la Commission des participations et des transferts pour les opérations de l’État.
*
* *
La commission examine les amendements identiques SPE247 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE414 de M. Patrick Hetzel, qui tendent à supprimer l’article.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. J’émets un avis défavorable à ces amendements de suppression.
M. le ministre. Les amendements SPE1524, SPE1516 et SPE1525 que la commission vient d’adopter ne concernent en effet que le II de l’article 43, à savoir les alinéas 2 à 5. Ils ne visent pas à supprimer le I de l’article 43 – son premier alinéa –, qui prévoit la ratification de l’ordonnance du 20 août 2014, qu’il convient d’adopter.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à ces deux amendements visant à supprimer l’article 43 en son intégralité.
La commission rejette les amendements SPE247 et SPE414.
Puis elle examine l’amendement SPE1515 des rapporteurs et l’amendement SPE413 de M. Patrick Hetzel, qui peuvent être soumis à une discussion commune.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE1515 est un amendement de cohérence : il vise, à la suite de l’adoption des amendements SPE1524, SPE1516 et SPE1525, à supprimer les alinéas 2 à 5 de l’article 43.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE413, qui vise à supprimer l’alinéa 3, tombera de toute façon si l’amendement SPE1515 est adopté.
Je tiens simplement à souligner qu’il est tout de même surprenant que l’alinéa 3 prévoie de compléter et de corriger des dispositions d’une ordonnance qui n’a été prise que le 20 août dernier, c’est-à-dire il y a moins d’un an !
La commission adopte l’amendement SPE1515.
En conséquence, l’amendement SPE413 tombe.
Puis elle adopte l’article 43 modifié.
*
* *
Article 43 bis
(article 22 de l’ordonnance n° 2014-948)
Abaissement des seuils entraînant la compétence du législateur
en cas de privatisation d’une société détenue par l’État
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de renforcer le pouvoir du Parlement sur les opérations de privatisation des sociétés détenues par l’État, en diminuant de moitié les seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs déclenchant aujourd’hui sa compétence.
Cette modification permet de faire rentrer dans la liste des sociétés nécessitant une autorisation législative la SFIL, la Semmaris et l’aéroport de Marseille. Il convient par ailleurs de souligner que l’aéroport de Toulouse aurait aussi été concerné par cet abaissement des seuils. En outre, certains établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), tels la Monnaie de Paris ou les ports de Marseille, Paris et Dunkerque, seraient concernés, le cas échéant, par cet abaissement s’ils étaient préalablement transformés en sociétés anonymes.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1792 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE1792 s’inscrit dans la logique de nos travaux, qui est de renforcer le pouvoir du Parlement sur les opérations de privatisation des sociétés détenues par l’État, en réduisant de moitié les seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs déclenchant aujourd’hui sa compétence.
Cet amendement permettra donc d’accroître la liste des opérations nécessitant une autorisation législative.
M. le ministre. La réaction normale du Gouvernement eût été d’émettre un avis défavorable à un amendement qui le démet d’une partie de ses prérogatives au profit du Parlement.
Toutefois, l’expérience récente de la privatisation de l’aéroport de Toulouse démontre que la transparence assurée en amont dans le cadre d’un débat parlementaire permettra de clarifier bien des points et de préserver leur sérénité aux opérations de privatisations en évitant des situations de malentendus : il n’est pas bon que le ministre ait seul la responsabilité de privatisations mettant en jeu des seuils élevés.
Baisser les seuils d’intervention du Parlement pour permettre un débat préalable à des opérations importantes de privatisation est donc une œuvre de salubrité publique. Avis favorable.
M. le président François Brottes. Je tiens à vous féliciter, madame la rapporteure thématique, de votre audace et de votre capacité à convaincre le Gouvernement de redonner des prérogatives au Parlement.
La commission adopte l’amendement SPE1792.
*
* *
Article 43 ter
(article 26 de l’ordonnance n° 2014-948)
Abaissement des seuils entraînant la compétence de la Commission des participations et des transferts en cas de transferts de participations au secteur privé
À l’initiative des rapporteurs thématiques, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de renforcer le contrôle de la Commission des participations et des transferts (CPT) sur les opérations de transferts de participations de sociétés détenues par l’État, en diminuant de moitié les seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs déclenchant aujourd’hui sa compétence, comme cela est également proposé pour les autorisations législatives : il s’agit d’un amendement de cohérence des seuils au sein de l’ordonnance.
Dans la mesure où les seuils d’examen par la CPT concernent les cessions selon les procédures des marchés financiers, donc de sociétés cotées, cet amendement n’a pas d’effet immédiat au sein du portefeuille de l’Agence des participations de l’État. Il n’existe pas en effet dans le portefeuille de l’APE de société cotée dont le chiffre d’affaires se situe entre 75 millions d’euros et 150 millions d’euros. Mais cette situation pourra évoluer avec la composition du portefeuille de l’APE.
Pour les opérations de gré à gré, la saisine de la CPT est obligatoire et donc dépourvue de condition de seuil.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1910 rectifié des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE1910 rectifié est un amendement de cohérence, puisqu’il tend à renforcer le contrôle de la Commission des participations et des transferts – CPT – sur les opérations de transferts de participations de sociétés détenues par l’État, en diminuant de moitié les seuils et en les harmonisant, par conséquent, avec ceux prévus à l’amendement SPE1792 pour le déclenchement de l’intervention du Parlement.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1910 rectifié.
*
* *
Article 44
(articles 31 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, L. 111-69 du code de l’énergie, 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970)
Mise en conformité de l’action spécifique
avec le droit constitutionnel et européen
Cet article a pour objet de compléter l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique en créant un article 31 bis définissant les conditions d’existence et les modalités d’action du dispositif de « l’action spécifique ».
Ce nouvel article reprend et précise les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
I. LE CARACTÈRE EXORBITANT DU DROIT COMMUN DE L’ACTION SPÉCIFIQUE
La nécessité pour de nombreux États de privatiser tout ou partie de leurs entreprises publiques, en raison de l’ouverture à la concurrence prônée par l’Union européenne ou en raison de choix de gestion plus libérale, a été à l’origine depuis les années 1980 de privatisations d’entreprises et de services publics dans les secteurs des transports, des réseaux ou des énergies. Pour autant, la volonté de conserver une emprise sur les choix stratégiques de ces entreprises ou de les accompagner dans leur nouvel environnement concurrentiel a conduit les États à utiliser deux procédures de défense des intérêts nationaux, à savoir la constitution de « noyaux durs » d’actionnaires ou le recours à des actions aux prérogatives exorbitantes, les golden shares, conçues par le gouvernement dirigé par Margaret Thatcher lors de la vague de privatisations de 1981 et rebaptisées « actions spécifiques » dans notre pays.
L’action spécifique a été introduite dans le droit français par l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Il prévoyait qu’en cas de privatisation d’une entreprise, le ministre chargé de l’économie puisse prendre un arrêté transformant, si la protection des intérêts nationaux l’exigeait, une action ordinaire de l’État en une action spécifique assortie du droit d’agréer toute participation excédant 10 % du capital.
La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (47) a élargi les prérogatives attachées à l’action spécifique en prévoyant également la nomination au conseil d’administration ou de surveillance, selon le cas, d’un ou deux représentants de l’État désignés par décret et sans voix délibérative ainsi que le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux décisions de cession d’actifs ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
Comme le rappelle l’avis du Conseil d’État relatif au présent projet de loi, la Cour de justice de l’Union européenne met en œuvre une jurisprudence stricte et constante à l’égard de l’action spécifique. La Commission européenne a d’ailleurs publié une communication (48) à ce sujet, qui s’appuie sur cette jurisprudence pour exposer les règles générales s’attachant aux libertés fondamentales que sont le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux et les exceptions qu’elles peuvent supporter.
Cette grille d’analyse a notamment été suivie par la Cour de justice dans trois arrêts rendus le 4 juin 2002, dont un concernait la société Elf-Aquitaine (49).
La première étape de cette grille d’analyse consiste à distinguer les mesures discriminatoires des mesures non discriminatoires.
Les mesures discriminatoires sont celles qui ont ouvertement pour objet de limiter l’accès des étrangers au capital et/ou à la gestion de l’entreprise. Cette limitation peut se faire soit en leur imposant un seuil de capital maximal, soit en les contraignant à obtenir une autorisation administrative ou gouvernementale préalable à l’acquisition d’actions, soit par le cumul de ces deux moyens.
De telles mesures représentent une atteinte très grave aux principes les plus fondamentaux du droit communautaire et sont donc traitées avec rigueur par les autorités de régulation communautaire. En principe, de telles mesures sont interdites. Toutefois la Commission et la Cour de justice admettent une exception à ce principe d’interdiction : les dérogations prévues désormais aux articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visant entre autres l’ordre public et la sécurité publique restent applicables, dans la mesure où la réglementation satisfait à l’exigence de proportionnalité.
Les mesures non discriminatoires peuvent également représenter une menace pour la libre circulation des capitaux. la jurisprudence de la Cour de justice (50) exige que « les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions : qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ».
Ainsi la Cour a-t-elle validé les golden shares détenues par la Belgique (51), en relevant successivement leur caractère non discriminatoire, l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général valable, l’adéquation de la réglementation et sa proportionnalité par rapport au but poursuivi.
Depuis la communication de 1997, les autorités communautaires insistent également sur le fait que la mise en œuvre des prérogatives conférées par les golden shares doit obéir à des critères « objectifs, stables et rendus publics ». La Cour de justice désire éviter que ces procédures discrétionnaires ne permettent d’introduire une discrimination déguisée. Ce souci était déjà présent dans la communication précitée, qui précisait qu’« en l’absence de critère transparent, il est possible d’introduire un élément de discrimination à l’encontre des investisseurs étrangers ». Il serait très simple en effet de ne pas adopter de mesures discriminatoires, mais d’appliquer de manière discriminatoire la réglementation existante.
En second lieu, la Cour souhaite que ces procédures soient conformes au principe de sécurité juridique. Pour cela, elles doivent mentionner les circonstances spécifiques et objectives dans lesquelles une autorisation préalable ou un droit d’opposition a posteriori sera exercé. Ainsi la condamnation de la France dans l’arrêt concernant Elf-Aquitaine repose-t-elle sur le fait que « si l’objectif poursuivi par la France (la garantie de l’approvisionnement de produits pétroliers en cas de crise) relève d’un intérêt général légitime, la Cour estime que les mesures en cause vont manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif invoqué. En effet, les dispositions incriminées, dans la mesure où elles ne mentionnent pas les circonstances spécifiques et objectives dans lesquelles une autorisation préalable ou un droit d’opposition a posteriori sera accordé ou refusé, sont contraires au principe de sécurité juridique. » (52).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE ENTEND SÉCURISER L’ACTION SPÉCIFIQUE AU REGARD DU DROIT EUROPÉEN
Dans le souci de rassembler au sein d’un seul et même texte les différentes dispositions législatives concernant l’État actionnaire, le présent article complète le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 précitée, portant sur la réalisation des opérations, par un nouvel article 31 bis et prévoit, en conséquence, l’abrogation de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
L’alinéa 2 reprend la rédaction de l’article 10 de la loi n° 86-912 précitée en lui apportant un certain nombre de précisions ainsi qu’une modification suggérée par le Conseil d’État.
La première précision porte sur la chronologie des actes juridiques liés à une privatisation et précisément sur le moment où peut être pris un décret prononçant la transformation d’une action ordinaire détenue par l’État en action spécifique. Ce décret doit intervenir postérieurement au décret transférant au secteur privé la majorité du capital d’une société mais préalablement à la saisine de la Commission des participations et des transferts ou à la réalisation de l’opération s’il s’agit d’une société cotée.
La seconde modification par rapport à l’article 10 de la loi n° 86-912 précitée est plus substantielle, puisqu’elle porte sur le critère permettant le déclenchement d’une telle procédure. Le texte en vigueur vise l’hypothèse où « la protection des intérêts nationaux exige » une telle transformation et le texte soumis au Conseil d’État visait quant à lui la notion d’« intérêts essentiels de l’État ». Ainsi que cela a été précédemment rappelé, la jurisprudence européenne exige que ces intérêts soient précisés et qu’ils correspondent à des secteurs correspondant à des intérêts légitimes et souverains de l’État. La rédaction proposée mentionne les intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale, lesquels figurent d’ores et déjà à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, relatif à l’agrément préalable de certains investissements étrangers.
L’alinéa 3 constitue le « chapeau » de l’énumération des droits pouvant être attachés à une action spécifique. La nouvelle rédaction proposée est plus précise que celle en vigueur, puisqu’elle indique que ces droits doivent être définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis. Cet ajout tient compte des exigences de prévisibilité et de sécurité juridique posées par la jurisprudence de la Cour de justice.
L’alinéa 4 porte sur le premier droit qui peut être ouvert à l’État disposant d’une action spécifique au sein d’une entreprise privatisée, à savoir l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie en cas de franchissement par une personne agissant seule ou de concert d’un ou plusieurs seuils mentionnés à l’article L. 233-7 du code de commerce. Les différents seuils visés correspondent aux fractions suivantes : vingtième, dixième, trois vingtièmes, cinquième, quart, trois dixièmes, tiers, moitié, deux tiers, dix-huit vingtièmes ou dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote. Ils correspondent donc à un large éventail de cas, situés entre 5 et 95 % de détention du capital ou des droits de vote au sein de la société. Le texte précise, là encore dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique, que l’agrément pour une telle opération ne peut être refusé que si celle-ci est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique.
L’alinéa 5 décrit le deuxième droit potentiellement attaché à une action spécifique, à savoir la possibilité de nommer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, un représentant de l’État sans voix délibérative. Il convient de noter que le texte en vigueur permet la nomination d’un ou deux représentants.
L’alinéa 6 concerne le troisième et dernier droit : le pouvoir de s’opposer aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou encore d’affectation de ces actifs à titre de garantie, dans la mesure où ces décisions seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays. La rapporteure thématique remarque que ces intérêts ne font pas l’objet de la même précision qu’aux alinéas 2 et 4.
L’alinéa 7 est la reprise exacte du texte en vigueur. Il dispose que l’action spécifique produit des effets de plein droit sans qu’il soit nécessaire de modifier les statuts de la société et qu’elle peut à tout moment être transformée en action ordinaire par décret, sauf si l’indépendance nationale est en cause, formulation à la fois très forte et assez floue.
L’alinéa 8 énonce la sanction encourue par les détenteurs de participations acquises irrégulièrement, c’est-à-dire en méconnaissance de l’agrément prévu à l’alinéa 4. Cette sanction consiste en l’incapacité d’exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’une régularisation via un agrément du ministre chargé de l’économie. La rédaction en vigueur est plus contraignante, puisqu’elle ne prévoit pas seulement un gel des droits mais une incapacité totale accompagnée de l’obligation de céder ces titres dans un délai de trois mois.
Il convient également de souligner que la rédaction en vigueur comporte une disposition spécifique pour les entreprises dont l’activité relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté européenne (activités relevant de l’autorité publique, de la sécurité publique, de la santé publique ou de la défense nationale). Pour ces entreprises, les participations excédant 5 % prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant seules ou de concert, sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’économie. Une disposition similaire figurait dans le texte soumis au Conseil d’État qui a souhaité sa disparition au profit de la procédure générale d’agrément prévue à l’alinéa 4 pour différents seuils, dont celui de 5 %.
L’alinéa 9 décrit la procédure d’information relative aux prises de participations effectuées en méconnaissance de l’agrément. C’est le ministre chargé de l’économie qui en informe le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise concernée, charge à ce dernier d’en informer la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il s’agit de la rédaction en vigueur.
L’alinéa 10 reprend partiellement l’obligation de cession dans un délai de trois mois des titres acquis en méconnaissance de la procédure d’agrément qui figure dans le droit en vigueur. La rédaction proposée limite en effet cette obligation aux seules entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui semble d’ailleurs redondant.
L’alinéa 11 prévoit qu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la privation des droits de vote, le ministre chargé de l’économie notifie au président de la société le constat de non-cession des titres acquis en méconnaissance de l’obligation d’agrément.
L’alinéa 12 organise la procédure de vente forcée des titres acquis en méconnaissance de l’obligation d’agrément et qui n’ont pas été cédés dans le délai imparti de trois mois. La rédaction proposée organise une procédure beaucoup plus encadrée que le droit en vigueur, qui renvoie à un décret. Il est tout d’abord indiqué que la vente forcée s’effectue sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, ce qui constitue une garantie importante. La vente a lieu sur le marché réglementé où ces titres sont admis aux négociations (Euronext Paris, MATIF, Monep). Le texte précise que cette vente peut être échelonnée sur une durée maximale de deux ans afin de ne pas influencer anormalement les cours en cas de vente globale.
Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers figurant à l’article L. 151-3 du même code.
L’alinéa 13 dispose que le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.
L’alinéa 14 prévoit que les dispositions relatives à l’action spécifique s’appliquent également aux entreprises du secteur public, mentionnées au V de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 précitée, lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé. Le V de l’article 22 vise les actifs dits « essentiels », c’est-à-dire susceptibles d’une exploitation autonome, ainsi que les participations détenues par toutes sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État, assimilées à des participations directes. La rapporteure thématique estime qu’il s’agit d’une erreur de référence et que c’est le IV de l’article 22, concernant les opérations de transfert au secteur privé des sociétés dites « de second rang », qu’il est plus pertinent de viser.
L’alinéa 15 traite de l’hypothèse où une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion. Dans ce cas, un décret doit procéder à la transformation de l’action spécifique en action ordinaire, comme cela est possible à tout moment. Ce même décret peut, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion, transformer une action ordinaire de la société issue de cette opération en action spécifique, sous les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 2. Il est précisé que les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace, ce qui n’est pas d’interprétation très aisée et peut s’avérer problématique dans une hypothèse de fusion.
L’alinéa 16 précise, dans un souci de sécurité juridique, que les actions spécifiques instituées sur le fondement des dispositions législatives applicables à la date de publication de la future loi restent en vigueur.
L’alinéa 17 procède à une coordination de références au sein de l’article L. 111-69 du code de l’énergie.
L’alinéa 18 procède de même à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 de finances rectificative pour 2001.
L’alinéa 19 abroge l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations relatif à l’action spécifique, car ce dispositif est intégré par le présent article à l’ordonnance n° 2014-948 précitée. Il indique en outre que les dispositions du II de ce même article 10 restent applicables aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques. Il s’agit de la soumission à l’agrément du ministre chargé de l’économie des participations excédant 5 % par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger.
Les alinéas 20 à 24 procèdent à diverses modifications de l’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives :
– l’alinéa 21 procède à une modification rendue nécessaire par l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 précitée afin de mentionner le groupe SNPE (Société nationale des poudres et des explosifs), qui a été racheté par la société GIAT Industries ;
– l’alinéa 22 supprime la référence à l’article 10 de la loi n° 86-912 précitée, qui est abrogé par le présent article ;
– les alinéas 23 et 24 remplacent la référence aux I à III de l’article 10 de la même loi par celle à l’article 31 bis, créé par le présent article.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE248 de M. Jean-Frédéric Poisson, qui tend à supprimer l’article.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement tend à supprimer l’article 44, qui complète une ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique afin de permettre à l’État de conserver un contrôle sur les entreprises privatisées dans des secteurs majeurs stratégiquement sensibles.
Cette ordonnance avait été prévue par l’article 10 de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Nous regrettons qu’il soit ainsi légiféré dans l’urgence, en revenant aussi vite sur une loi récemment votée au lieu de mieux la concevoir d’emblée.
Nous souhaitons ensuite demander des précisions au Gouvernement sur la portée de ces mesures. L’étude d’impact sur cet article évoque la défense, mais qu’en est-il d’autres secteurs pouvant être considérés comme stratégiquement sensibles, dont le secteur énergétique et l’industrie agro-alimentaire ? Combien d’entreprises seront concernées ?
M. le ministre. L’article 44 reprend en effet l’ordonnance du 20 août 2014 et le dispositif juridique permettant à l’État de moderniser son actionnariat, en particulier par l’établissement d’une action spécifique – appelée en bon français golden share – lors de la privatisation d’une entreprise. L’État évite ainsi de mobiliser du capital public tout en conservant des droits particuliers, justifiés par la nature de l’entreprise. Le champ d’application de l’action spécifique, conformément au droit européen, s’étend à l’énergie, à la défense, ainsi qu’à la santé et à la sécurité publiques.
Vous vous émouvez, madame Louwagie, de la manière dont nous revenons ainsi sur des dispositions toutes récentes. J’y suis sensible : on ne peut évidemment se féliciter de cette situation, dont nous avons parlé hier à propos de l’article 43. Elle n’est toutefois pas l’apanage des ordonnances, comme l’ont montré des débats sur de précédentes lois ; par ailleurs, il est parfois nécessaire de procéder à des ajustements. J’en prends néanmoins ma part de responsabilité, pour l’article 43 plus que pour l’article 44 : il est toujours préférable de viser juste dès le premier coup.
L’action spécifique visée à l’article 44 n’en est pas moins une nécessité. Il en existe trois aujourd’hui, dont deux concernent respectivement GDF-Suez et Thales. Une action spécifique portera sur le capital de Nexter ; nous y reviendrons dans quelques instants.
Un décret détermine les droits de l’État attachés à une action spécifique, parmi lesquels le contrôle de certains franchissements de seuil par les actionnaires, le contrôle de cessions d’actifs et la représentation de l’État au conseil d’administration sans voix délibérative. L’État s’assure ainsi que certaines entreprises considérées comme stratégiques ne subissent pas une évolution qui attenterait à nos intérêts particuliers.
Je vous suggère donc de retirer cet amendement, madame la députée ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Comme l’a rappelé le ministre hier, le Gouvernement a défini une doctrine de l’État actionnaire que traduisent l’ordonnance de 2014 ratifiée par le texte ainsi que plusieurs articles à venir. Cette doctrine soulève à mon sens deux questions principales. Premièrement, comment permet-elle de garantir les intérêts de l’État, qu’il s’agisse de ses intérêts patrimoniaux, des prérogatives de puissance publique ou des intérêts essentiels de la Nation ? Peut-être cet aspect n’a-t-il pas été suffisamment explicité par le Gouvernement. Deuxièmement, comment les opérations en capital sont-elles décidées, par qui, selon quels critères ? Plus précisément, quels sont les rôles respectifs du Parlement et du Gouvernement, en particulier du ministre de l’économie, lorsqu’il s’agit d’autoriser ces opérations ?
C’est pourquoi j’ai proposé hier, par des amendements portant articles additionnels après l’article 43 qui ont été adoptés par la commission, d’abaisser les seuils déclenchant l’intervention du Parlement afin de renforcer ses pouvoirs lors de la privatisation et, en adoptant les mêmes seuils, d’étendre le champ de la saisine obligatoire de la Commission des participations et des transferts.
Sur l’amendement SPE248, je partage l’avis défavorable du Gouvernement. L’action spécifique est un outil extrêmement important pour la doctrine de l’État actionnaire et a vocation à l’être de plus en plus. L’article 44 vise la cohérence avec la jurisprudence européenne sur ce point. Il était important de préciser le champ d’application de l’action spécifique.
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous maintenons notre amendement, non par agressivité, mais par cohérence : l’article 44 pose les principes de la doctrine de l’État actionnaire, dont nous contesterons dans les articles suivants les modalités d’application.
La commission rejette l’amendement SPE248.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1517 des rapporteurs.
Elle en vient ensuite à l’amendement SPE1526 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Il s’agit d’inscrire dans la loi, qui n’est pas claire sur ce point, que le décret instituant l’action spécifique est dans tous les cas antérieur à la réalisation de l’opération.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1526.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1518 à SPE1523 et SPE1527 à SPE1529 des rapporteurs.
La commission adopte ensuite l’article 44 modifié.
*
* *
Section 2
Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire
Article 45
(article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)
Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables
L’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations a créé une commission de la privatisation, chargée de procéder à l’évaluation des entreprises privatisées. Sans en changer la composition ni les attributions, le décret n° 88-1054 du 22 novembre 1988 l’a intitulée « commission d’évaluation des entreprises publiques ».
La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 est revenue à la dénomination initiale et a renforcé les pouvoirs de la commission, tant pour ce qui est de l’évaluation des actifs transférés au secteur privé que pour la détermination des modalités de cession. Le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 a de nouveau changé son nom en « Commission des participations et des transferts ».
Sous l’empire de cette législation, la commission intervenait pour la détermination de la valeur des entreprises privatisables inscrites sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993 précitée, lors des prises de participations du secteur privé dans le capital d’une entreprise dont l’État détient directement plus de la moitié du capital social, et pour des entreprises faisant l’objet d’une opération de « respiration » dans les cas les plus importants (cessions d’entreprises dont l’effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires est supérieur à 375 millions d’euros).
L’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée a été abrogé par l’article 41 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La Commission des participations et des transferts fait désormais l’objet de deux sections au sein du chapitre II (« Contrôle patrimonial des opérations ») de ladite ordonnance. La section 1, intitulée « La Commission des participations et des transferts », comprend les articles 25 et 26, qui définissent la composition de la commission, le régime d’incompatibilités de la fonction de membre de la commission et les différents cas de saisine de la commission par le ministre chargé de l’économie. La section 2 s’intitule « Procédure d’évaluation » et comporte l’article 27.
I. LE RÉGIME EN VIGUEUR DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ORDONNANCE N° 2014-948
La Commission des participations et des transferts (CPT) est composée de sept membres (53), dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.
En cas de vacance d’un poste pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission doivent informer le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent.
Le membre de la commission qui a manqué aux obligations sus-définies est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Le régime des interdictions concerne également la période postérieure aux fonctions puisque les membres de la Commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises. Ces dispositions garantissent l’indépendance et la neutralité dont doivent faire preuve les membres de la commission.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article propose une série de quatre améliorations au texte en vigueur, en matière de durée des fonctions, de vacance de poste, de renouvellement ainsi que de parité. Ces dispositions n’avaient pu figurer dans l’ordonnance n° 2014-948 puisque la loi d’habilitation (54) portait sur les compétences de la Commission des participations et des transferts et non sur sa composition et son fonctionnement.
L’alinéa 2 modifie la durée du mandat de cinq à six ans et précise que le mandat n’est pas renouvelable à l’issue des six ans. Cette disposition vise à permettre le changement régulier des membres de la commission tout en assurant leur indépendance.
L’alinéa 3 précise qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, la règle de non-renouvellement ne s’applique pas au remplaçant ayant exercé un mandat de moins de deux ans. Il s’agit d’une précision indispensable pour susciter l’intérêt des candidats dans une telle hypothèse.
L’alinéa 5 introduit l’exigence de la parité au sein de la commission puisque les six commissaires en dehors du président, ou de la présidente, doivent se répartir également entre hommes et femmes. La rapporteure thématique salue cette mesure volontariste puisque la commission ne comporte à l’heure actuelle qu’une seule femme en son sein.
L’alinéa 7 dispose que le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
L’alinéa 8 concerne la définition de la fin du mandat des commissaires nommés sous l’empire de la loi n° 86-912 précitée. La fin de leur mandat intervient logiquement à la date de la nomination des nouveaux membres et au plus tard au terme d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
L’alinéa 9 définit les modalités de renouvellement des membres de la commission : il s’agit d’un renouvellement par moitié ou par moitié plus un (le président), selon les cas, tous les trois ans. Ainsi à l’occasion de la première constitution de la nouvelle commission, trois membres (hors le président) seront désignés par tirage au sort pour effectuer un mandat de trois ans. L’article précise, in fine, que les membres en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau. Il s’agit de permettre la mise en œuvre d’une certaine continuité nécessaire au bon fonctionnement de la commission.
*
* *
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1530 à SPE1532 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 45 modifié.
*
* *
Article 46
(article 32 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)
Transparence des sociétés holding de l’État
pour l’application des seuils légaux de détention
Le présent article introduit un nouvel article 32 bis au sein du titre IV (« Dispositions diverses ») de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Il a pour objet de combler une lacune de l’ordonnance s’agissant des règles de gouvernance applicables aux sociétés « transparentes », qui ne figurent aujourd’hui qu’aux articles 4 et 22. La règle selon laquelle lorsque les participations de l’État sont détenues par des sociétés holding, ces participations sont assimilées à des participations directes de l’État pour l’application de ces règles, doit être applicable à l’ensemble des dispositions de l’ordonnance prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieure à un seuil.
Les sociétés GIAT Industries ou Astrium constituent de telles sociétés holding détenues par l’État.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE249 de M. Jean-Frédéric Poisson.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement tend à supprimer l’article. Les raisons en sont les mêmes que pour l’article 44.
M. le ministre. Avis défavorable. L’article 46 se justifie par la nécessité de compléter l’ordonnance du 20 août 2014 qui était, par suite de la loi d’habilitation, lacunaire s’agissant des règles de gouvernance applicables aux sociétés « transparentes ».
La philosophie générale est de donner plus de marge de manœuvre à l’État dans sa gestion des participations publiques pour lui permettre d’activer son capital en cédant des actions sans perdre des droits de gouvernance. Les dispositions voulues par le Gouvernement au cours des derniers mois tendent à moderniser la présence de l’État au sein des conseils d’administration pour la rapprocher du professionnalisme d’une gestion privée, à lui permettre de gérer les sociétés de manière plus flexible et à préserver ses intérêts stratégiques par l’action spécifique, en conformité avec le droit européen.
Nous avons fixé des objectifs chiffrés : le but est que l’État cède pour 8 à 10 milliards d’euros d’actifs au cours des dix-huit mois à venir, ce qui lui servira à se désendetter – pour un peu plus de 4 milliards d’euros au titre de la loi de finances pour 2015 – et à réinvestir, comme nous l’avons fait dans PSA l’année dernière, comme nous le faisons dans la Banque publique d’investissement, comme nous le ferons dans plusieurs sociétés ou à plusieurs occasions, en particulier dans le secteur de la défense comme cela pourrait être envisagé cette année. Rappelons que le portefeuille de l’État représente 110 milliards d’euros et 70 entreprises.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la commission rejette l’amendement SPE249.
Puis elle adopte l’article 46 sans modification.
*
* *
Section 3
Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés
à participation publique
Article 47
(articles 4, 6, 7 et 8 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989)
Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales
Le présent article prévoit le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales, qui composent ensemble le groupe Nexter. En vertu de l’article 34 de la Constitution, ce transfert relève de la compétence du législateur, auquel il revient en effet de fixer « les règles concernant les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ».
Ce transfert est nécessaire pour autoriser la fusion de Nexter et du groupe d’armement terrestre allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW), détenu par la famille Wegmann-Bode, dans le but de créer une nouvelle structure franco-allemande, dénommé KANT (pour « Krauss-Maffei Wegmann And Nexter Together »). Ce projet, en discussion depuis de nombreuses années, s’inscrit dans une logique d’intégration industrielle européenne dans le domaine de l’armement, telle qu’elle a pu déjà être opérée dans le domaine de l’aéronautique (Airbus), des hélicoptères (Eurocopter devenu Airbus Helicopters) et des missiles (Euromissiles devenu MBDA).
Les titres du groupe Nexter étant apportés au sein de la nouvelle entité, et non cédés, cette opération de joint-venture n’aura pas d’impact financier ou budgétaire pour l’État, qui sera actionnaire à 50 % du nouveau groupe, à parité avec la famille Wegmann-Bode. À court et moyen termes, Nexter gardera son autonomie pour l’exécution des contrats en cours et l’écoulement du carnet de commandes, l’opération ayant ainsi un impact opérationnel limité. À terme, l’intégration progressive des activités de Nexter et KMW devrait donner lieu à une spécialisation des sites de manière à limiter les redondances internes au futur groupe.
I. UNE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE POUR AUTORISER LA FUSION TOUT EN CONSERVANT LE STATUT DES PERSONNELS
A. LES ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES DU GIAT
1. Le groupe et ses filiales
Le Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) était à l’origine un service du ministère de la Défense, créé en 1971, pour distinguer les missions industrielles de fabrication de matériels militaires terrestres des missions étatiques de conduite des programmes d’armement relevant quant à elles des attributions de la direction des armements terrestres.
Afin de bénéficier d’une plus grande souplesse de gestion, le GIAT est devenu, à partir du 1er juillet 1990, une société nationale dénommée GIAT Industries, en application de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du GIAT. De cette société est issu, en 2006, l’actuel groupe Nexter, par la filialisation du cœur de métier de Giat Industries.
Désormais, la société pivot est Nexter Systems SA, à la fois société opérationnelle dans le domaine des systèmes blindés/artillerie/armement et maison mère du groupe Nexter, groupe qui réunit outre Nexter Systems, des filiales spécialisées par secteurs d’activité et segments (munitions, équipements).
Par ailleurs, depuis décembre 2013, GIAT Industries détient également la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), suite à une cession réalisée par l’État. Filiale à 100 % de la SNPE, la société Eurenco SA regroupe les activités (poudres, explosifs, chimie de spécialité et additifs pétroliers) demeurées dans la SNPE après qu’eurent été cédés au groupe SAFRAN d’autres actifs du secteur de la propulsion solide ensuite réunis au sein d’Herakles, filiale de SAFRAN.
Enfin, GIAT Industries détient depuis 2011 une participation minoritaire de 22,68 % du capital de MNR Groupe SA, dont l’actif principal est constitué de la société Manurhin Equipment, constructeur de machines-outils spécialisées.
Ainsi, GIAT Industries compte désormais deux filiales contrôlées respectivement à 99,99 % et à 100 %, Nexter Systems SA et la SNPE, et détient une participation de 22,68 % dans MNR Groupe SA.
2. L’organisation et les performances du groupe
Le groupe est constitué de neuf filiales. L’ensemble est regroupé selon trois pôles, à savoir le pôle systèmes (Nexter Systems, Nexter Training et CTA International), le pôle munitions (Nexter Munitions) et le pôle équipements (Nexter Electronics, Mechanics, NC-Sys, Euro-Shelter et Optsys).
Ses principaux sites industriels sont situés à Versailles, Roanne et Bourges pour le secteur d’activité « Systèmes » et à La Chapelle-Saint-Ursin, à Bourges et à Tarbes pour le secteur d’activité « Munitions ». D’autres sites industriels de dimension moins importante, relevant tous du secteur d’activité « Équipement », sont situés à Rennes, à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, à Toulouse et à Tulle. Le groupe Nexter est également présent en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et en Inde, au travers d’implantations commerciales ou de services de soutien-client.
La plus importante entreprise du groupe en termes d’effectifs (65 % du total), de chiffres d’affaires (70 %) et de carnets de commandes (77 %) est Nexter Systems, la maison mère, qui produit par exemple des systèmes d’artillerie (modèle Caesar, camion équipe d’un système d’artillerie) et des véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI).
Nexter Munitions représente 20 % des effectifs et produit notamment des têtes militaires, des dispositifs de sécurité d’armement et des composants pyrotechniques pour des applications missile, torpille etc.
Nexter Electronics, spécialisée dans les équipements électroniques embarqués dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et du ferroviaire, et Nexter Mechanics, qui officie dans les équipements mécaniques pour ces mêmes secteurs, sont les deux autres filiales importantes du groupe en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires.
3. Une entreprise performante mais dépendante des commandes nationales
Le groupe Nexter constitue le fournisseur historique de l’armée de terre, mais est aussi tourné vers l’exportation (pour environ 20 % de son chiffre d’affaires).
En 2013, le groupe employait environ 2 800 personnes pour un chiffre d’affaires consolidé de 787 millions d’euros. L’acquisition en 2014 des sociétés munitionnaires Mecar SA et Simmel Difesa SpA (dont le chiffre d’affaires combiné était de 185 millions d’euros en 2013 avec un total de près de 600 employés) étend son empreinte industrielle à la Belgique et l’Italie. Le résultat net consolidé du groupe est de 73,7 millions d’euros en 2013 et son volume de commandes représente plus de trois ans d’activité (2,6 milliards d’euros en 2013).
Il s’agit également d’un groupe innovant, avec 18 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D et 85 brevets déposés en 2013.
Nexter est cependant fortement dépendant des commandes nationales. Celles-ci représentent en effet 80 % de l’ensemble des prises de commandes, contre environ 20 % pour l’allemand Krauss-Maffei Wegmann, qui est son concurrent sur certains produits. Cette spécificité explique les marges importantes dégagées par le groupe et l’autofinancement des activités de R&D, à hauteur de 100 millions d’euros, résultat d’une stratégie nationale suivie dans ce secteur stratégique.
Or, les marges relatives aux commandes nationales se réduisent à mesure que les incertitudes sur le budget de la Défense s’accroissent. En se rapprochant de KMW, Nexter espère pouvoir profiter de la compétence du groupe allemand en matière d’exportations tandis que le groupe allemand pourrait bénéficier de la capacité d’innovation du groupe français.
KMW s’est notamment montré intéressé par la production de munitions du groupe français et par ses sites de production qui comprennent des champs de tir plus adaptés. Le groupe allemand pourrait de même bénéficier du soutien public de l’État actionnaire français à l’exportation. À noter que le volume des carnets de commandes, avec 4 milliards d’euros pour KMW et 2 milliards d’euros pour Nexter (hors programme Scorpion de modernisation de l’armée de terre française), permettra à la nouvelle structure de disposer d’une visibilité accrue en termes d’activité pour les prochaines années.
B. LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE NEXTER SYSTEMS SA DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE EUROPÉEN PARTICULIÈREMENT CONTRAINT
Compte tenu de la réduction des budgets de défense au sein de l’Union européenne, l’industrie d’armement terrestre européenne doit désormais chercher à l’export, auprès d’une clientèle élargie, les moyens d’assurer son développement. Dans un contexte de concurrence accrue, lié notamment à l’arrivée des pays émergents sur des produits de même gamme, les acteurs voulant conserver une offre globale dans le secteur terrestre doivent atteindre une taille critique leur permettant d’investir et d’augmenter leur compétitivité.
Or, l’Europe compte aujourd’hui dix-sept lignes de production de blindés contre seulement deux aux États-Unis. Il est donc nécessaire de supprimer les doublons afin de gagner en efficacité et en cohérence. Le rapprochement entre KMW et Nexter devrait permettre de réaliser des économies d’échelle, notamment en partageant l’effort de recherche-développement et en mutualisant les achats de composants, alors que les deux groupes se font actuellement concurrence, notamment pour l’achat d’acier.
Cette « fusion des égaux », c’est-à-dire de groupes relativement similaires en termes de taille, de chiffre d’affaires et d’effectifs (55), permettrait la création d’une nouvelle structure, détenue à parts égales par l’État français, via GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa société de participations), cette structure détenant elle-même Nexter Systems à hauteur de 99,99 % et KMW à hauteur de 100 %.
Avec 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 6 000 salariés, le nouveau groupe sera le premier acteur d’armement terrestre européen et le troisième mondial.
Ce rapprochement permettra ainsi à Nexter d’augmenter sa résilience aux variations de la commande nationale et d’éviter les baisses de charges liées aux effets de cycle ou au retard pris dans la réalisation de programmes stratégiques (comme le programme Scorpion). Toutefois, le Gouvernement instituera également une action spécifique au capital de Nexter Systems afin d’assurer la protection des intérêts essentiels de l’État.
La mise en œuvre du projet nécessite cependant, au préalable, de faire sortir Nexter Systems du secteur public au sens de sa définition stricte. Or, en application du b du V et du I de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, une autorisation législative est nécessaire pour procéder au transfert de la majorité du capital au secteur privé.
Cette autorisation est l’objet du I du présent article.
C. LE MAINTIEN DU STATUT DES PERSONNELS À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉVOLUTIONS DE STATUT
L’opération de privatisation ne devrait toutefois pas affecter le statut des militaires, fonctionnaires et ouvriers sous décret employés au sein de Nexter Systems SA et de ses filiales.
En conséquence, et par cohérence avec les mesures prises précédemment, il est proposé au législateur de maintenir une nouvelle fois ces statuts dans le cadre du transfert de Nexter Systems au secteur privé. Ces dispositions sont l’objet du 1° du II du présent article, qui complètera l’article 4 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989.
Ainsi, comme lors des évolutions de statut de 1989 et de 2006, les personnels relevant du statut des ouvriers des établissements industriels de l’État auront le choix entre deux formules :
– être employés par la nouvelle société sous le régime commun du droit du travail ;
– être placés sous un régime spécifique leur permettant de continuer à bénéficier des mêmes dispositions (droits et obligations) que sous leur ancien statut d’ouvrier de l’État.
Sur le plan législatif, ces dispositions s’accompagnent de modifications afin d’assurer les coordinations nécessaires. Outre l’abrogation de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1989, qui renvoie à la loi du 8 août 1929 dont les dispositions ont été en grande partie abrogées par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, l’article 6 et l’article 7 sont modifiés à des fins de coordination.
II. LE PROJET DE FUSION SOULÈVE ENCORE DES INTERROGATIONS
Si le présent article ne permet que d’autoriser le rapprochement à venir entre Nexter et KMW, sans préjuger du résultat définitif, certaines interrogations liées à ce projet méritent d’être soulignées, que ce soit en termes de régime applicable aux exportations, d’implantation du siège social et d’impact sur les effectifs du groupe Nexter sur le territoire national.
A. LES EXPORTATIONS
L’Allemagne a traditionnellement des positions restrictives en matière de ventes d’armes. Cela étant, le pays était, en 2010, le troisième exportateur mondial d’armement, derrière les États-Unis et la Russie mais devant la France. Les accords Debré-Schmidt de 1971 et 1972 ont posé le cadre des relations franco-allemandes en matière de ventes d’armes. Toutefois, le ministre allemand de l’Économie, M. Sigmar Gabriel, a réaffirmé à plusieurs reprises, lors des derniers moins, son souhait que l’Allemagne cesse d’exporter vers les pays de la péninsule arabique, en particulier vers l’Arabie saoudite, qui figurent parmi les clients privilégiés de Nexter à l’export.
Si les deux entreprises garderont leur autonomie commerciale pour les matériels qu’elles produisent seules, la question de l’export des matériels qui seront créés en commun peut néanmoins constituer une source de difficultés à l’avenir.
B. LE SIÈGE SOCIAL
En l’état actuel des informations communiquées par le Gouvernement, Nexter et KMW devraient conserver leur autonomie juridique et leurs sièges sociaux, ce qui devrait donc s’avérer sans impact sur la fiscalité et les finances publiques.
Toutefois, l’opération nécessitera un transfert de capital au secteur privé (Nexter devenant la propriété de Newco, société privée de droit néerlandais). Basée aux Pays-Bas, cette nouvelle société, qui détiendra 100 % de Nexter et de KMW, sera organisée avec un conseil de surveillance de sept personnes (deux représentants de l’État français, deux de la famille Bode-Wegmann et trois indépendants), dont le président sera choisi parmi les indépendants, et un directoire, composé au minimum par les deux PDG de Nexter et de KMW, MM. Philippe Burtin et Frank Haun (56).
La domiciliation de Newco devrait a priori avoir peu d’incidences fiscales, celle-ci ne portant que sur la fiscalité des dividendes. Néanmoins, au fur et à mesure de l’intégration des deux groupes, la question de l’intégration des sièges sociaux pourrait se reposer. En outre, il convient de s’assurer que cette mesure ne se traduira pas par un affaiblissement de la capacité de l’État à agir sur l’attribution des marchés. Enfin, l’impact sur les règles, en matière de gouvernance et de participation des salariés au conseil d’administration, doit être précisé. L’État devrait ainsi disposer d’un veto sur les éventuelles cessions d’actifs ainsi que d’une action spécifique (golden share) dans la future société pour protéger les activités stratégiques (systèmes d’armes et activités munitionnaires). Il convient cependant de souligner que la validité de la pratique des golden shares a été questionnée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
C. LES CONSÉQUENCES POUR L’EMPLOI EN FRANCE
Certains syndicats présents dans l’entreprise, à l’instar de la CGT, ont pu exprimer des craintes sur les conséquences de la fusion sur l’emploi en France. La CGT souligne en particulier que certaines activités de Nexter et de KMW sont concurrentes tandis que la direction du groupe insiste au contraire sur leur complémentarité.
Selon le Gouvernement, il semble que des complémentarités importantes existent, notamment dans le domaine des munitions (dont KMW n’est pas producteur) et de l’artillerie (le Caesar français, à roues, est ainsi plus adapté aux sols sahéliens que le PzH 2000 allemand, à chenilles). La concurrence porterait essentiellement sur les véhicules de type 4x4 (Aravis français contre Dingo allemand) et sur le véhicule blindé d’infanterie (VBCI français contre Boxer allemand). Néanmoins, au regard du maintien de l’autonomie de KMW et de Nexter pour les contrats en cours, l’impact sur l’emploi et sur les sites de production ne semble ni immédiat ni certain.
Par ailleurs, en marquant une avancée importante dans l’édification d’une Europe de la défense, ce rapprochement franco-allemand paraît à terme constituer la meilleure solution à disposition pour assurer à long terme la viabilité de l’industrie de l’armement terrestre française.
*
* *
La commission aborde l’amendement SPE491 de M. Yves Fromion.
M. Yves Fromion. Cet amendement concerne une opération qui n’est pas sans risque pour la souveraineté de l’État, puisqu’il s’agit de transférer au secteur privé la majorité du capital du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. L’exposé des motifs nous en donne le contour général : il s’agit de poser les fondements d’une consolidation au niveau européen entre deux entreprises d’armement terrestre de taille assez comparable, le Français Nexter Systems et l’Allemand KMW.
La consolidation des industries de défense à l’échelon européen est une nécessité reconnue de longue date. Ce constat vaut tout particulièrement de l’armement terrestre, victime des surcapacités industrielles en Europe, chez nous comme chez nos partenaires, de la baisse continue des budgets de défense, notamment en Europe, et du développement de la concurrence extrêmement rude des pays émergents. La France doit s’intégrer à ce mouvement, nul ne peut le contester.
Mais elle doit aussi préserver les fondements de sa souveraineté en conservant le degré d’indépendance nécessaire à l’équipement de ses forces armées. À cet égard, l’armement terrestre est essentiel car il est déterminant dans l’issue d’un conflit armé ; on le voit bien dans la bande sahélo-saharienne, par exemple. La France qui se veut souveraine ne peut donc laisser échapper la maîtrise de son industrie d’armement terrestre.
En quelques années, au fil des recapitalisations successives, la reconfiguration de GIAT Industries a coûté 4,5 milliards d’euros au contribuable français. Ces chiffres sont incontestables et, me semble-t-il, incontestés.
Voilà pourquoi, si l’on peut approuver le transfert au secteur privé d’une part du capital de GIAT, l’opération doit nous permettre en priorité de consolider au niveau national nos propres entreprises d’armement, tout en recherchant un ou plusieurs partenaires européens. Ne négligeons pas cette première phase, ou du moins cette phase essentielle, même s’il n’est évidemment pas question d’en rester là compte tenu de ce que sont devenus les marchés.
L’État dispose de tous les moyens nécessaires pour organiser cette consolidation nationale, en particulier autour de Thales, comme je le propose depuis longtemps, dans le sillage du programme Scorpion de modernisation de notre armée de terre prévu par la loi de programmation militaire et qui vient d’être confié à trois entreprises : Nexter, Renault Trucks Défense et Thales.
Nous sommes face à une décision politique délibérée qui favorise la mainmise de l’industrie allemande sur GIAT, donc sur Nexter. L’enthousiasme de nos voisins d’outre-Rhin, que j’ai pu mesurer en me rendant chez KMW à Munich et lorsque le président-directeur général de cette entreprise a été reçu par la commission de la défense, fait d’ailleurs apparaître notre naïveté. Rappelons-nous comment les Allemands ont torpillé le rapprochement entre EADS et BAE, où ils ne trouvaient pas leur compte. Je crains que la France ne se prépare une fois encore à travailler pour le roi de Prusse, et il ne s’agit pas d’un vain jeu de mots !
C’est donc une opération en deux étapes, nationale d’abord, européenne ensuite, qui devrait permettre le transfert du capital de GIAT au privé. Tel est l’objet de mon amendement. Le schéma idéal aurait été le suivant : l’État apporte le capital de GIAT Industries à Thales, à condition que celui-ci devienne l’opérateur du rapprochement entre Nexter et KMW. Dans ce schéma, l’État, qui en a le pouvoir, pousserait à l’intégration du secteur défense de Renault Trucks. Je crois savoir que cette entreprise est favorable à la cession et à la consolidation telle que je viens de l’esquisser.
J’appelle solennellement votre attention sur les conséquences de l’opération telle qu’elle est proposée sur notre souveraineté nationale, sur notre outil de production qui en sortira affaibli, sur les emplois et les compétences que nous y perdrons inévitablement.
M. le ministre. Vous proposez en somme, monsieur Fromion, de créer un pôle national en limitant l’ouverture prévue du capital à un simple rapprochement franco-français. Or, c’est un leader européen de l’armement terrestre que le présent article vise à créer. L’audition récente par la commission de la défense de MM. Haun et Burtin, qui dirigent respectivement KMW et Nexter, a montré l’état d’avancement des discussions en ce sens.
Le programme Scorpion ne représente qu’un quart du plan de charge de Nexter ; il ne saurait donc suffire à maintenir une activité nationale. En outre, le rapprochement que vous envisagez ferait de Nexter un acteur de niche, beaucoup plus fragile sur un marché devenu concurrentiel. Voilà pourquoi le Gouvernement lui préfère, au vu de ses échanges avec ses partenaires et avec l’entreprise, le rapprochement avec KMW, plus protecteur pour Nexter puisqu’il lui confère une surface commerciale bien supérieure.
Ce qui est ici demandé, c’est la possibilité d’ouvrir le capital des filiales de GIAT Industries, de les privatiser. En effet, Nexter est un actif essentiel de GIAT et le rapprochement avec KMW requiert un équilibre 50-50 qui suppose d’en passer par la loi. Il fera l’objet d’une action spécifique de l’État, conformément au dispositif que vous venez d’adopter et qui protège nos éléments de gouvernance. À chaque étape de la négociation, nous serons particulièrement sensibles, comme toujours, à ses conséquences sur l’emploi, la recherche-développement et les intérêts stratégiques français.
Vous avez fait référence aux oppositions que nous rencontrerions lors d’autres négociations avec nos partenaires allemands en matière d’industrie de défense. Dans le cas des négociations sur la fusion entre EADS et BAE, ce sont des désaccords géopolitiques ou industriels qui étaient en jeu et qui ont été très débattus en France, bien loin des discussions sur la répartition de la recherche-développement ou des emplois au sein de l’entreprise. S’il faut trouver un précédent à l’opération envisagée, c’est plutôt chez EADS lui-même, devenu Airbus. Et, en l’espèce, la manière dont les intérêts français ont été préservés en matière de recherche et d’emploi ne nous donne pas lieu de rougir des projets franco-allemands. Les auditions que la commission a menées en témoignent. Voyez la géographie de la plupart des sous-holdings sectorielles du groupe Airbus, la répartition de la recherche-développement et la répartition stratégique des grands actifs.
Le Gouvernement demande ici l’autorisation de poursuivre les négociations entre Nexter et KMW. Après des échanges déjà nourris, nous en sommes au stade de la transmission d’informations confidentielles. Viendront ensuite les valorisations, puis la continuation du dialogue entre gouvernements, qui tendra naturellement à préserver les intérêts stratégiques et patrimoniaux de l’État.
Avis défavorable.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Même avis.
C’est une belle opération industrielle qui est envisagée. Rappelons que nous parlons des anciens arsenaux, dont l’avenir pouvait nous inspirer quelque inquiétude, à l’heure où, comme l’a souligné Yves Fromion, il s’agit pour eux de se doter d’une envergure internationale afin de se développer à l’exportation. C’est donc une opération « gagnant-gagnant ». Nous ne cessons de réclamer un partenariat européen : saisissons l’occasion qui nous est ici offerte d’en faire une réalité.
Le partenariat franco-allemand ici visé se caractérise par un équilibre 50-50 : l’État conserve 50 % du nouveau groupe. Il est encadré par toutes les garanties nécessaires : l’ordonnance déjà citée et l’autorisation législative, qui associe pleinement le Parlement à l’opération, ce dont nous pouvons nous féliciter ; la parité du capital ; l’action spécifique que nous venons d’adopter. Enfin, le conseil de surveillance du futur groupe sera composé de sept personnes, dont deux représentants de l’État français, deux représentants de la famille allemande actionnaire de KMW et trois indépendants, parmi lesquels sera choisi le président.
M. Yves Fromion. Ne nous trompons pas de débat : nous ne sommes pas défavorables au transfert au secteur privé d’une partie du capital. C’est la procédure qui nous pose un problème. En effet, nous avons le sentiment que les entreprises françaises sont laissées hors du circuit. Certes, on peut toujours espérer qu’elles y viendront ultérieurement. Mais EADS, qui a été cité en exemple, avait consolidé les entreprises françaises du secteur spatial et aérospatial, qui sont ainsi entrées dans la boucle ; c’est ce que vous n’avez pas su faire ici. Nos entreprises seront donc isolées face à la nouvelle co-entreprise franco-allemande.
Plus abouti, le projet aurait pu apporter beaucoup à notre industrie et à nos emplois. Mais vous vous contentez d’une opération a minima, animés d’un bel optimisme quant à la capacité de GIAT Industries à s’imposer au sein du futur binôme. Il faut être un peu naïf et ignorer les rapports de force entre la France et l’Allemagne en matière d’exportations pour s’imaginer que KMW va vendre les produits de GIAT sur le marché mondial !
M. Jean-Jacques Bridey. Depuis que le rapprochement a été annoncé le 1er juillet dernier, la commission de la défense a organisé nombre d’auditions et s’est rendue à Munich pour y rencontrer les dirigeants de KMW et visiter les installations. J’étais du déplacement, comme Yves Fromion, et je tiens à dire que son point de vue ne reflète pas celui de la commission de la défense, toutes tendances confondues. Nous verrons bien ce qu’il en est au moment du vote.
En définitive, Yves Fromion nous reproche de ne pas faire ce dont l’ancienne majorité n’a pas été capable. Le rapprochement entre Nexter et Renault Trucks, qui avait été étudié, n’a pu aboutir. Nous le regrettons tous, mais nous n’allons pas reprendre cette discussion. Après cet échec, la stratégie des dirigeants de Nexter et celle du ministère de la défense a complètement changé au profit d’un rapprochement avec un partenaire allemand de taille comparable qui propose des produits complémentaires dans la même gamme et se montre aussi offensif que nous. Il s’agit, comme l’a dit la rapporteure thématique, d’une belle opération, qui suppose de « privatiser » Nexter – en réalité, il s’agit que son capital devienne 50 % du capital d’une société deux fois plus importante et plus solide.
M. Jean-Frédéric Poisson. Il faut toujours se montrer prudent lorsque l’on annonce le vote d’un autre groupe que le sien, monsieur le député. La position que nous défendons est très majoritaire au sein du groupe UMP, même si certains collègues ont pu dire autre chose ailleurs, dans d’autres villes, pour ne pas dire d’autres pays.
Monsieur le ministre, vous faites valoir d’abord qu’il faut ouvrir le capital de GIAT, et ensuite que les opérations comparables devraient nous rassurer. Sur le premier point, nous sommes d’accord. Si nous ne l’étions pas, c’est un amendement de suppression de l’article que nous aurions déposé. Simplement, dans les circonstances actuelles, la comparaison avec EADS nous paraît hasardeuse. Beaucoup moins armé que ne l’était EADS – précisément à la suite d’agrégations –, le groupe français concerné ne peut absolument pas imposer – ou négocier, si vous voulez, mais enfin on connaît le monde des affaires – une prise en considération équilibrée des intérêts des parties à l’export. En effet, KMW, beaucoup plus puissant sur les marchés internationaux, ne va pas s’affaiblir pour nous faire plaisir.
Ce sont donc les modalités de la fusion qui nous divisent, car nous n’avons pas la même appréciation des circonstances. Pour être réussi du point de vue français, le rapprochement devrait conférer à nos entreprises une force de frappe mondialisée en créant un opérateur européen, franco-allemand, équilibré. Cette dernière exigence est la seule à laquelle votre article ne satisfait pas. Pour y remédier, il faut constituer un plus gros groupe français afin de discuter avec un Allemand plus gros que tous les Français réunis.
Que nous n’y soyons pas parvenus – non plus qu’à d’autres choses, d’ailleurs –, j’en conviens volontiers, mon cher collègue, mais nous verrons ce que vous trouverez dans votre escarcelle quand le moment sera venu de dresser le bilan de la présente législature.
M. le président François Brottes. Vous n’avez pas mentionné la golden share.
M. Yves Fromion. Soyons clairs. J’ai rédigé en 2002 un rapport parlementaire sur GIAT Industries, dans lequel je plaidais explicitement pour son ouverture à l’international dans le cadre d’un partenariat européen. Il ne s’agit absolument pas de faire un procès d’intention au Gouvernement d’aujourd’hui ; c’est plutôt à ceux qui n’ont pas agi en ce sens qu’il faudrait intenter un procès. Je n’ai aucun complexe à cet égard. Pendant dix ans, l’opposition actuelle était au pouvoir et aurait pu mener une telle action ; je l’ai réclamé à tous les ministres de la défense successifs, en vain.
Il n’est donc pas question de polémiquer à ce sujet. Simplement, l’opération telle que vous l’envisagez ne me paraît pas conforme aux intérêts nationaux. Les éléments du projet dont j’ai pu avoir connaissance évoquent une reconfiguration de l’entreprise qui entraînera inévitablement des suppressions d’emplois et de sites. La rationalisation, on sait bien ce que cela veut dire !
M. le ministre. D’abord, il n’est pas question de reprocher à qui que ce soit de n’avoir pu créer un champion français, car à l’impossible nul n’est tenu. On ne peut pas faire des mariages forcés entre acteurs industriels. En l’espèce, tout projet de rapprochement franco-français s’est heurté soit à l’absence de synergies, qui le vidait de tout sens industriel – c’est le cas du rapprochement évoqué avec Thales, qui produit très peu de blindés –, soit au refus des autres actionnaires, comme c’est arrivé avec l’actionnaire suédois majoritaire de Renault Trucks Défense. Ces voies ont été essayées par l’entreprise elle-même et elles ont échoué. Voilà comment on en est arrivé à l’opération actuellement envisagée. Ne laissons donc pas penser qu’il existerait d’autres options évidentes.
Ensuite, cette opération consolide Nexter. Les deux acteurs du rapprochement sont comparables du point de vue de leur chiffre d’affaires comme de leur valorisation. Voilà d’ailleurs pourquoi ils auront part égale dans l’entité combinée. À vous entendre, messieurs, on croirait que l’on marie un gros Allemand à un petit Français !
Enfin, les intérêts français seront préservés grâce à l’action spécifique et aux négociations que nous allons conduire et dont vous serez constamment informés au sein de la commission de la défense, comme vous l’avez été jusqu’à présent.
Tel est le sens de l’opération que l’article tend à permettre, dans le cadre et compte tenu des contraintes industrielles que j’ai évoquées. Les intérêts de Nexter – qui, d’ailleurs, soutient elle-même la démarche – y seront préservés, comme les intérêts de la France en termes stratégiques et d’emploi.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. J’ajoute qu’il existe un dispositif garantissant l’autonomie commerciale aux gammes de chacune des deux entreprises. Par ailleurs, l’objectif est notamment de développer d’autres produits en commun en vue d’une synergie à l’export ; en la matière, nous devrions bénéficier de la force de l’entreprise allemande dans ce domaine, que vous avez vous-mêmes rappelée.
La commission rejette l’amendement SPE491.
Elle en vient aux amendements SPE490, SPE488 et SPE489 de M. Yves Fromion.
M. le président François Brottes. Je vous suggère, mon cher collègue, de présenter en même temps vos amendements SPE488 et SPE489.
M. Yves Fromion. Je prendrai le temps de présenter l’amendement SPE490, car il s’agit d’un sujet majeur et c’est mon rôle de parlementaire que de défendre les intérêts des nombreux salariés concernés.
Aux termes de cet amendement, le Parlement devra donner son avis lorsque l’on aura suffisamment progressé sur ce dossier.
À l’heure actuelle, bien des aspects de l’opération restent flous. Ceux qui ont étudié le sujet ne peuvent le contester. Que deviendra GIAT après le départ de Nexter, qui représente 99,2 % de son chiffre d’affaires ? Qu’en sera-t-il des filiales SNPE et Eurenco ? Leur capital va être transféré au privé ; sont-elles couvertes par la golden share ? N’oublions pas qu’Eurenco œuvre dans le domaine de la dissuasion nucléaire.
Ni le personnel de Nexter ni les syndicats ne sont au courant de rien, alors qu’une data room devait être mise sur pied pour les informer. Il est prévu de créer une co-entreprise pour cinq ans, pendant lesquels les deux entreprises doivent travailler à leur intégration en une seule ; mais l’on ne sait rien non plus du processus d’intégration à terme de la co-entreprise ni de ses conséquences. Au bout du compte, il n’y aura plus qu’une seule entreprise où les intérêts français seront sans doute fragilisés.
Quelles sont les perspectives d’extension à d’autres partenaires européens de la société commune ? Quelles seront les conséquences de la délocalisation aux Pays-Bas ? On nous a d’abord assuré que l’installation dans ce pays du siège de la future co-entreprise n’en aurait aucune, chacun des deux partenaires continuant de payer ses impôts chez lui. Puis, en auditionnant M. Burtin, nous avons appris qu’il y aurait des conséquences fiscales sur les dividendes.
Le flou est également total quant à la valorisation de Nexter. Certains – comme vous, monsieur le ministre – soutiennent que les deux entreprises ont la même valeur, mais les valorisations ne sont pas arrêtées, à en croire le PDG de Nexter. D’aucuns estiment que Nexter vaut 2 milliards d’euros et KMW 1,5 milliard, ce qui devrait entraîner le paiement d’une soulte de 500 millions d’euros, d’ailleurs évoquée dans la presse. Mais le PDG de KMW a dit très clairement devant la commission de la défense qu’il n’était pas question de soulte.
Quant aux perspectives de rationalisation-optimisation des activités des deux entreprises, nul ne sait non plus ce que l’on entend par là, mais cela implique évidemment des conséquences sur l’emploi.
Dans le cadre d’une mission que m’avait confiée M. François Fillon lorsqu’il était Premier ministre, j’ai rencontré dans son bureau à Berlin l’homologue de notre délégué général à l’armement, avec qui je me suis entretenu de consolidation industrielle. Savez-vous, monsieur le ministre, ce qu’il m’a déclaré les yeux dans les yeux ? « Mais, monsieur le député, la consolidation des industries de défense en Europe se fera, et elle se fera sous pavillon allemand ! » Vous comprendrez qu’ayant entendu cela, je sois particulièrement sensible à certains aspects du dossier.
Enfin, on m’objecte l’action spécifique ; j’en vois bien l’utilité, mais quel en sera le contenu ? Qui prendra les décisions stratégiques ? Un exemple : la France ne fabrique plus d’armement petit calibre : en 1998, M. Alain Richard, ministre de la défense, a fermé les lignes de fabrication de munitions petit calibre de GIAT. Nous devons donc trouver une nouvelle arme que nous allons donc acheter à l’étranger, vraisemblablement en Allemagne, chez HK. Jusqu’où l’action spécifique permettra-t-elle donc d’aller ? Que permettra-t-elle de corriger ? Quels garde-fous offrira-t-elle ?
L’amendement SPE488 concerne un problème important qui a été abordé en commission de la défense : en matière d’exportations, la France et l’Allemagne n’ont pas le même point de vue ni la même pratique. Le PDG de KMW nous a dit lui-même que cela posait un problème et qu’il espérait bien que l’opération prévue conduirait le ministre allemand, M. Sigmar Gabriel, à rapprocher son point de vue de celui de la France sur les questions d’armement. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, il existe des blocages et des difficultés. Nous avons déjà du mal à vendre nos équipements ; voulons-nous en outre dépendre d’une autre vision politique que la nôtre ? J’aimerais obtenir des éclaircissements sur ce point.
Quant à l’amendement SPE489, il tend à ce que le transfert de capital soit abordé au sein du Conseil de défense, lequel est saisi, aux termes du code de la défense, des questions touchant à l’approvisionnement des armées.
M. le ministre. La nouvelle loi que vous demandez dans l’amendement SPE490 serait redondante par rapport au contenu du présent article. GIAT possède actuellement deux filiales : Nexter et SNPE, qui compte des actifs stratégiques. Mais SNPE est déjà privatisable depuis une loi de 2009. Si nous en passons par la loi aujourd’hui, c’est en vue d’ouvrir le capital de Nexter, actif essentiel de GIAT. En d’autres termes, ce que vous demandez, c’est ce que nous faisons par le présent article. Votre amendement est donc satisfait.
En ce qui concerne l’amendement SPE488, c’est bien parce que je suis attaché à préserver l’autonomie française que nous avons voulu consolider les fondements juridiques de l’action spécifique. J’en appelle à votre cohérence : l’article 44, qui vous chagrinait, détaillait l’action spécifique sur laquelle vous m’interrogez maintenant. C’est bien ce dispositif que nous comptons appliquer à l’opération de fusion. Parmi ses conséquences, rappelons la possibilité de soumettre tout franchissement de seuil de détention de Nexter Systems SA à un agrément préalable du ministère de l’économie et le pouvoir donné à l’État de s’opposer à certaines cessions d’actifs de Nexter Systems ou de ses filiales. Je pourrai vous transmettre d’autres précisions à ce sujet. La volonté du Gouvernement et l’apparatus juridique sur laquelle elle s’appuiera permettront donc de préserver nos intérêts présents.
S’agissant des éventuelles restrictions export de l’Allemagne, je me permettrai, là encore, de vous demander un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas à la fois soutenir que les Allemands ont une capacité d’export incomparablement supérieure à la nôtre et craindre que les restrictions export allemandes ne posent problème après le mariage ! S’ils sont si forts que vous le dites, le rapprochement nous permettra d’en bénéficier. En réalité, les relations entre la France et l’Allemagne en la matière sont régies par les accords Debré-Schmidt ; c’est un sujet sensible qui fait l’objet d’échanges au niveau politique – je m’en suis entretenu avec mon collègue Sigmar Gabriel – et administratif, et dont je puis vous assurer qu’il n’aura pas d’effet sur les intérêts constitués de Nexter.
En ce qui concerne enfin l’amendement SPE489, le Conseil de défense est présidé par le Président de la République, qui préside aussi le Conseil des ministres, lequel a adopté le projet de loi. Je ne vois donc pas l’intérêt de ce formalisme. Je veux toutefois vous rassurer, car ce débat légitime doit permettre d’apporter des éclaircissements sur une opération complexe. Il faut des échanges continus tels que ceux que vous avez au sein de la commission de la défense, et il y aura évidemment des débats au sein du Conseil de défense.
Avis défavorable, donc, à ces trois amendements.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la commission rejette successivement les amendements SPE490, SPE488 et SPE489.
Puis elle examine l’amendement SPE487 de M. Yves Fromion.
M. Yves Fromion. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Dans l’article, on trouve d’abord « et de ses filiales », puis « ou de ses filiales ». Pourquoi ?
M. le ministre. J’avoue avoir quelque difficulté à vous suivre. Vous vous inquiétiez tout à l’heure du sort des autres filiales de GIAT, et voilà que vous voulez les inclure dans l’ouverture de capital. En d’autres termes, vous proposez maintenant de privatiser SNPE. En réalité, l’amendement est satisfait puisque SNPE est privatisable depuis 2009. Voilà pourquoi on ne privatise aujourd’hui qu’une filiale de GIAT Industries : Nexter.
L’amendement SPE487 est retiré.
La commission en vient à l’amendement SPE486 de M. Yves Fromion.
M. Yves Fromion. On sait que la société KMW est touchée par une procédure judiciaire liée à un contrat de vente de chars Leopard à la Grèce. Je ne connais pas le dossier de l’intérieur, mais cette situation crée un malaise et des difficultés au sein de l’entreprise. Je veux bien que l’on pousse au mariage, mais je tiens à appeler l’attention sur cet état de fait à l’heure où la France dit vouloir adopter une attitude éthique en matière d’exportations d’armement, conformément à certains textes de l’OCDE, et où l’on entend dans cette enceinte des discours lénifiants sur le sujet.
M. le ministre. Je suis sensible à votre argument. Nous verrons quel sera l’aboutissement de cette affaire, mais il convient d’être vigilants.
Contrairement à ce que vous suggérez, il n’est pas question d’un mariage forcé. Par cette loi, nous voulons permettre à Nexter de se rapprocher d’un partenaire allemand parce que cela fait sens du point de vue industriel et que c’est ce que souhaitent les deux dirigeants. Rappelons que KMW est une entreprise à 100 % privée, à actionnariat familial ; la future entité aurait donc des actionnaires publics côté français et privés côté allemand. Il s’agit d’un mariage spontané, que nous rendons possible parce que nous sommes convaincus de sa pertinence industrielle et stratégique.
Ensuite, des négociations sont en cours, qui nous conduisent à soumettre l’ouverture du capital à votre autorisation. Dans ce cadre, les dirigeants de Nexter ont la responsabilité de regarder de très près, au titre de ce que l’on appelle due diligence, les risques de contentieux du côté de KMW. Les précautions nécessaires seront prises afin d’éviter tout transfert de contentieux, toute contamination, comme cela se fait toujours dans la vie des affaires.
Enfin, votre amendement est satisfait par la loi, plus précisément par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France (IEF) visée à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Avis défavorable.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Même avis.
En ce qui concerne le précédent amendement SPE487, je précise que la formule visée tend à protéger les intérêts des agents du ministère de la défense en fonction dans les entreprises concernées.
M. Yves Fromion. C’est bien pour obtenir une explication sur cette rédaction que j’avais déposé cet amendement.
J’en reviens à l’amendement SPE486. Monsieur le ministre, ne jouons pas les tartuffes. On demande à GIAT de prendre ses responsabilités, me dites-vous. Mais qui est actionnaire et qui pousse à cette opération, sinon l’État ? On peut toujours trouver un habillage pour apparaître vertueux dans cette affaire qui n’est pas très claire, mais ne nous voilons pas la face. Je comprends que vous essayiez de contourner ces difficultés ; c’est mon rôle de parlementaire que de rappeler leur existence. Certes, ces questions sont encadrées par des textes de loi et je m’en réjouis, mais, puisque tel est le cas, efforçons-nous de nous y conformer.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le ministre a fait référence à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, mais celui-ci donne la faculté au ministre de refuser des opérations, alors que nous demandons une interdiction par la loi. Nous ne sommes pas dans le même registre : entre la faculté pour le ministre de s’opposer à une opération et l’interdiction stricte, la différence n’est pas mince. Peut-être notre amendement trouverait-il davantage sa place dans le code monétaire et financier qu’à cet endroit, mais en ajoutant une disposition qui, sans ôter sa faculté au ministre, prévoirait clairement une impossibilité en cas de corruption, serait, je crois, un affichage utile.
M. Jean-Yves Caullet. Une interdiction fondée sur une procédure judiciaire en cours pose problème, car une telle procédure ne signifie pas que la société sera reconnue coupable. Dans une telle situation, l’article qu’a cité le ministre est bien plus pertinent, car il permet d’agir en opportunité.
M. Jean-Frédéric Poisson. Qui d’entre nous accepterait l’idée de passer un accord électoral avec une personne sous le coup d’une procédure pénale ? Tant que la procédure n’est pas éteinte, un danger existe.
M. Jean-Louis Roumegas. Je profite de ce dernier amendement pour donner l’avis du groupe écologiste sur l’article 47. Nous sommes favorables à un pôle européen en matière de défense et d’armement, mais nous refusons le principe d’une fusion avec une industrie qui, du côté allemand, est détenue exclusivement par des intérêts privés. Nous voterons donc contre cet article.
M. Jean-Yves Caullet. Le parallèle que fait Jean-Frédéric Poisson n’est guère pertinent. L’amendement entend fonder en droit une interdiction sur la base d’une procédure engagée à l’étranger. Si un partenaire potentiel est sous le coup d’une procédure, il paraît normal, en opportunité, de ne pas s’associer avec lui, et le texte, précisément, le permet, mais il ne convient pas de donner à des juges étrangers le pouvoir de nous lier les mains de cette façon.
M. le ministre. Beaucoup de nos grandes sociétés sont malheureusement sous le coup d’une procédure judiciaire à l’étranger pour faits de corruption. Si nous inscrivons de telles restrictions dans la loi, nous aurons bien des difficultés à l’expliquer à nos partenaires, allemands ou autres, qui n’imposent pas à nos sociétés les mêmes contraintes. L’article du code monétaire et financier apporte des garanties à deux égards. L’État ne laisse pas l’expert seul : nous suivons cette négociation de près, nous ne nous en lavons pas les mains. En outre, si, avant la conclusion de l’opération, la procédure prenait une tournure préoccupante, l’article du code nous permet de la stopper. Si votre intention est bonne, monsieur Poisson, votre proposition est excessive.
M. Yves Fromion. Compte tenu des explications apportées par le ministre, ainsi que des engagements qu’il a pris, je retire mon amendement.
L’amendement SPE486 est retiré.
La commission adopte ensuite l’article 47 sans modification.
*
* *
Article 48
(article L. 5124-14 du code de la santé publique)
Suppression de l’obligation de détention majoritaire par l’État ou ses établissements publics du capital de la société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies »
Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) est une entreprise publique créée en 1994, qui exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l’État ou ses établissements publics et son activité s’exerce dans un secteur très concurrentiel, face aux multinationales de la pharmacie et des biotechnologies.
À la suite de l’affaire du sang contaminé, le législateur a souhaité séparer complètement la collecte des dons du sang, monopole confié à l’Établissement français du sang (EFS), et la fabrication de produits thérapeutiques à partir du sang, confiée au LFB.
Dans un premier temps, le LFB a été organisé sous la forme d’un groupement d’intérêt public mais, face aux transformations du secteur (accélération des progrès techniques, internationalisation et concentration des entreprises pharmaceutiques), une évolution statutaire est apparue nécessaire. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a alors choisi le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial, plutôt que celui de société anonyme proposé initialement par le Gouvernement : il s’agissait de conserver un complet contrôle public sur l’activité de fractionnement. Cependant, le Gouvernement n’a jamais pris un arrêté indispensable à la modification de statut et la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit l’a autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, « toutes mesures pour [...] transformer le LFB en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l’État ou ses établissements publics ».
L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 a ainsi transformé le LFB en société anonyme détenue par l’État. Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement du plasma sont exercées exclusivement par une filiale, LFB Biomédicaments. Dans le cadre de la stricte séparation entre collecte et transformation du sang, l’ordonnance prévoit également qu’une personne morale se consacrant à l’activité de collecte ne peut pas détenir de participation, directe ou indirecte, dans le LFB ou ses filiales. Cela ne concerne en France que l’EFS, qui dispose avec ses établissements locaux du monopole de la collecte du sang.
Son statut figure à l’article L. 5124-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Aujourd’hui, le LFB est un groupe biopharmaceutique dont l’activité essentielle est le fractionnement des protéines plasmatiques du plasma sanguin. Il extrait du plasma une gamme de médicaments, les médicaments dérivés du sang (MDS), indiqués pour le traitement d’environ quatre-vingts pathologies différentes dans les domaines thérapeutiques majeurs de l’immunologie, des soins intensifs et de l’hémostase. Le laboratoire détient le droit exclusif de production des MDS à partir du plasma collecté par l’EFS.
Le laboratoire a également pour mission « d’approvisionner le marché français en MDS et de développer une politique dans le domaine des maladies orphelines. Il est également chargé de développer des produits de biotechnologies pouvant, à terme, remplacer les médicaments plasmatiques. » (57)
En raison du caractère entièrement bénévole du don de plasma en France, l’État ne perçoit aucun dividende du laboratoire et celui-ci réinvestit l’intégralité de son bénéfice annuel.
I. LE LFB EST CONFRONTÉ À UNE CONCURRENCE INTERNATIONALE ACCRUE MAIS DISPOSE D’UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE BIOTECHNOLOGIES
Avec un chiffre d’affaires de 477,2 millions d’euros en 2013, le LFB se place au premier rang français et au sixième rang mondial dans le domaine des médicaments dérivés du plasma. Ce chiffre d’affaires se répartit entre 371,3 millions d’euros en France (77,8 %) et 105,9 millions d’euros à l’international (22,2 %).
Le laboratoire dispose du monopole légal de la fabrication des MDS en France mais les hôpitaux étant soumis au code des marchés publics, ils doivent avoir recours à une procédure d’appel d’offres pour l’achat de leurs médicaments. On a pu constater ces dernières années que le LFB a progressivement perdu des parts de marché face à une concurrence internationale accrue des laboratoires, qui proposent souvent des médicaments à un coût inférieur. Le LFB est notamment soumis à des exigences sanitaires spécifiques qui accroissent largement le coût de production des médicaments (58).
Il apparaît notamment que dans le domaine de l’immunologie, qui constitue une part majeure des activités du laboratoire, la part de marché du LFB en France est passée de 69 % en 2006 à 56 % en 2011 (59).
Le marché des MDS s’est largement mondialisé ces dernières années et dans ce cadre concurrentiel accru, le LFB est amené à se tourner de plus en plus vers l’international. Ses médicaments sont désormais commercialisés dans trente-trois pays mais son poids reste modeste avec une part de marché mondial de 3,8 % (60). Cette concurrence accrue est la cause première des difficultés financières rencontrées par le LFB depuis plusieurs années (résultat faible, endettement, baisse des dépenses de R&D).
Le LFB possède une grande maîtrise dans les trois métiers industriels respectivement liés aux médicaments dérivés du plasma, aux protéines recombinantes et aux cellules issues des biotechnologies. Il est aujourd’hui le sixième laboratoire spécialisé dans les médicaments dérivés du plasma dans le monde.
II. OUVRIR LE CAPITAL À LA BPI POUR DÉVELOPPER LE LFB
Dans son rapport au Premier ministre consacré à la filière du sang en France, notre collègue Olivier Véran recommande d’élaborer une stratégie ambitieuse de développement du LFB en France et à l’international pour faire face à cette concurrence accrue. Il pose également la question de l’ouverture du capital du laboratoire, en expliquant que celle-ci impliquerait de modifier l’approche actuelle des résultats du LFB :
« La question de l’ouverture du capital du LFB a été posée, pour permettre des acquisitions d’envergure et un meilleur accompagnement de l’innovation. Si le LFB a aujourd’hui le statut de société anonyme et la qualification d’établissement pharmaceutique, aucun dividende n’est versé aux actionnaires, tout excédent est réinvesti dans l’entreprise. L’ouverture du capital, y compris à des acteurs publics comme la BPI par exemple, impliquerait de modifier cette approche des résultats du LFB. Dans cette optique, un rapprochement des établissements publics, notamment européens, respectant les règles de non rémunération et de réinvestissement des recettes, tels que la plupart des établissements regroupés au sein de l’IPFA (International Plasma Fractionation Association), pourrait par exemple en constituer le socle. Par ailleurs, l’existence de la filiale fournissant le seul marché français permet de favoriser le développement à l’international de LFB SA selon les mêmes règles que ses concurrents, tout en respectant la loi française qui, pour le sang et le plasma collectés en France, fait de l’absence de profit un des principes fondateurs de la transfusion sanguine nationale. » (61).
Lors de son audition par la commission spéciale le 16 décembre 2014, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, M. Emmanuel Macron, a répondu à une question posée par notre collègue Monique Rabin sur ce sujet :
« Il ne s’agit en aucun cas de remettre en question le fonctionnement de cet écosystème. Peut-être le projet de loi n’est-il pas suffisamment clair sur ce point mais, en tout état de cause, il a uniquement pour objet d’inscrire le LFB dans le droit commun des participations publiques en ouvrant la possibilité à d’autres acteurs publics que l’État d’en être actionnaires – en particulier d’autoriser la Banque publique d’investissement (BPI) à le faire. En effet, notre volonté est d’aider le LFB dans son développement – je pense notamment à l’une de ses filiales, extrêmement compétitive, dédiée aux biotechnologies et basée aux États-Unis. Peut-être conviendra-t-il de modifier la rédaction du texte sur ce point afin que nos intentions apparaissent plus clairement. »
En effet, le fait que l’État soit aujourd’hui majoritaire constitue un obstacle au développement de l’entreprise, qui n’a pas les moyens de financer les investissements nécessaires et doit vendre des brevets à l’étranger pour améliorer sa trésorerie, ce qui est extrêmement choquant.
L’article 48 propose donc la suppression, à l’article L. 5124-14 du code de la santé publique, de la mention selon laquelle le capital du LFB est détenu en majorité par l’État ou par ses établissements publics, nécessaire pour permettre l’entrée au capital de la BPI. En l’espèce le LFB est une ETI particulièrement performante dans le secteur des biotechnologies, secteur dans lequel la BPI est déjà très présente, soutient le développement de sociétés innovantes et a acquis une bonne connaissance.
La rapporteure thématique approuve donc l’intention du Gouvernement de favoriser le développement du LFB grâce à l’entrée de la BPI au capital. Pour autant, elle partage les inquiétudes de plusieurs collègues sur les dérives potentielles qu’une privatisation du LFB, qui n’est pas à l’ordre du jour, pourrait entraîner en matière éthique. C’est pourquoi elle entend apporter une réponse qui sécurise la détention majoritaire du capital par le secteur public. Le sang, le plasma et les médicaments qui en sont issus ne sont pas des produits comme les autres et doivent conserver un contrôle de la puissance publique.
À l’initiative du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, la commission a adopté un amendement qui réaffirme l’obligation de détention publique majoritaire du capital du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que la nécessité d’une autorisation législative pour transférer la majorité du capital au secteur privé. Cet amendement permet ainsi l’entrée au capital de la BPI. Il prévoit également la possibilité pour l’État d’instituer une action spécifique en cas de privatisation.
L’entrée de la BPI au capital, sans doute à hauteur de 20 % et pour une durée de l’ordre de quinze ans, doit permettre de dynamiser le développement du LFB, qui passe notamment par la construction d’une nouvelle usine destinée à multiplier par quatre ses capacités de production de médicaments (pour un coût de 250 millions d’euros), lesquels sont destinés à hauteur de 70 % à l’exportation.
*
* *
La commission est saisie des amendements SPE802 de M. André Chassaigne et SPE1242 de Mme Monique Rabin, tendant à supprimer l’article, ainsi que de l’amendement SPE1916 des rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 48 met fin à la propriété de l’État sur le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies – LFB. L’exposé des motifs indique qu’il s’agit de permettre des reclassements au sein du secteur public des titres du LFB ou de ses filiales sans autoriser le transfert de la société au secteur privé. Or, l’article procède purement et simplement à la suppression, dans le code de la santé publique, de toute référence à une détention majoritaire du capital par l’État ou d’autres acteurs publics. C’est une première contradiction.
La ministre de la santé, que j’ai interrogée, m’a affirmé que le texte prévoyait l’ouverture du capital du LFB à la seule Banque publique d’investissement (BPI), et que cette disposition ne ramènerait pas la part de l’État en-dessous de 51 %. C’est une seconde contradiction.
De plus, le LFB a déjà subi une mutation de statut en 2004, passant d’établissement public industriel et commercial à société anonyme à capitaux publics majoritaires. Le Gouvernement de l’époque a justifié cette modification par la nécessité pour le LFB de drainer des capitaux extérieurs afin d’augmenter ses dépenses de recherche et de développement. Pour quelle raison ouvrir aujourd’hui le capital à la BPI – si c’est bien celle-ci qui est concernée, car à ma connaissance rien ne le mentionne ? Cette ouverture se fera-t-elle uniquement en direction de cette BPI ? Quelle sera l’étape suivante, si ce n’est la privatisation à marche forcée du laboratoire ?
Il s’agit d’un sujet extrêmement sensible, en termes d’éthique comme de sécurité sanitaire. Notre pays a une tradition de non-marchandisation des produits du corps humain. Dans ce secteur plus encore que dans d’autres, la puissance publique doit maîtriser l’ensemble des activités. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme Monique Rabin. Cet article, même si je comprends qu’un projet de loi dédié à la croissance et à l’activité souhaite contribuer au développement du LFB, afin que celui-ci reste un laboratoire de niveau international, représente une attaque contre l’organisation de la collecte et du fractionnement du sang dans notre pays.
La France a décidé d’organiser la collecte et le fractionnement du sang à la suite de l’affaire du sang contaminé ; il suffit d’évoquer cette affaire pour que chacun comprenne combien le sujet est sensible. Des remises en cause sont pourtant déjà intervenues en 2004, 2006, 2009 et 2011. L’amendement que présentera notre rapporteure thématique à cet article me semble rester en deçà de ce qu’il conviendrait. Le LFB souhaite s’ouvrir à des entreprises, telles que Predica ou Eurazeo, qui ont déjà pris contact avec lui, et même entrer en Bourse. C’est très inquiétant.
Alors que l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a entériné une attaque d’Octapharma contre l’Établissement français du sang (EFS), il faudrait reprendre le sujet dans sa globalité avec la ministre de la santé, afin de concilier la philosophie française sur le vivant et notre ambition économique.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Le texte du Gouvernement supprime la mention selon laquelle le capital du LFB est détenu en majorité par l’État, ce qui est nécessaire pour permettre l’entrée de la BPI au capital, à défaut de quoi le LFB ne pourra réaliser son projet industriel, et notamment la construction d’une usine qui lui permettra de multiplier par quatre ses capacités de production, 70 % de celle-ci étant écoulée à l’exportation. Ce laboratoire a besoin de financements, ce que l’État actionnaire n’assure plus depuis des années. Nous avons découvert en audition que la LFB est aujourd’hui conduit, pour couvrir ses besoins courants de trésorerie, à vendre des brevets très prisés. Il est impensable que ce laboratoire, qui est une véritable pépite, ne puisse réaliser ses projets de développement. C’est pourquoi le Gouvernement a proposé une solution.
J’ai cependant entendu les inquiétudes qui se sont exprimées à ce sujet, et je présenterai donc un amendement en vue de clarifier la position du Gouvernement. Il consiste à permettre l’entrée de la BPI au capital, tout en ajoutant un marqueur de notre engagement à l’égard de cette entreprise, en indiquant que l’État a la possibilité d’instituer une action spécifique. Le Gouvernement, dans un premier temps, nous a répondu que cette dernière disposition n’avait pas de portée juridique immédiate. Or, nous souhaitons l’inscrire dans le texte afin que le législateur sache qu’en cas d’ouverture du capital, il devra réfléchir à cette action spécifique, car nous savons qu’autrement cette réflexion n’aura pas lieu.
M. le président François Brottes. Je rappelle que l’action spécifique est un moyen de blocage.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Nous avons une urgence et une obsession. L’urgence est que les projets de développement du LFB se concrétisent. Pour cela, la BPI doit pouvoir jouer pleinement son rôle. Nous avons également une obsession : c’est que cet établissement ne soit jamais privatisé. J’insiste sur ce point, car on nous a fait hier un procès d’intention. En aucun cas ce texte ne propose de revenir sur la propriété publique du LFB. L’amendement que nous avons cosigné avec Clotilde Valter permet de poser des verrous à cet égard. Il s’agit, en somme, de permettre le développement d’une « pépite », le mot est juste en effet, et de la protéger de toute intrusion contraire à la protection des intérêts de notre pays et des impératifs de santé publique.
M. Jean-Louis Roumegas. Lorsque Cécile Duflot a évoqué hier l’inquiétante possibilité d’une privatisation d’une partie de la filière du sang, j’ai entendu des cris d’orfraie. Or, l’article 48 tend à supprimer les dispositions suivantes : « le capital du LFB est détenu majoritairement par l’État ou ses établissements publics » et « le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l’État ou ses établissements publics ». Il y avait donc bien de quoi s’inquiéter, les intentions premières du Gouvernement étant plus que douteuses.
Les écologistes sont opposés à toute privatisation, et le présent article est un pas dans cette direction. Cette filière française du sang est fondée sur des principes éthiques dont l’histoire, tragique, nous a rappelé à quel point ils étaient importants. L’intrusion de laboratoires privés, à l’occasion d’un besoin de financement, serait une très mauvaise opération. Le Gouvernement confirmera sans doute qu’il s’agit d’ouvrir le capital à la seule BPI, mais une autre solution, très simple, était possible, à savoir que l’État continue de financer cette filière, comme il l’a toujours fait, sans recourir à la BPI, qui doit normalement servir à financer les PME. Cet article est le résultat des politiques d’austérité et de restrictions budgétaires, bien mal venues en la matière.
Mme Karine Berger. Loin de moi l’idée de douter des intentions du Gouvernement, mais tant l’article que la proposition de nos rapporteurs ouvrent la possibilité d’aller beaucoup plus loin. Le simple fait que la BPI entre au capital peut en effet poser problème. Comme vous le savez, la BPI souhaite recourir à la titrisation de sa dette. Elle utilisera le capital des entreprises où elle a investi pour servir de caution en cas d’émission de dette et, si nécessaire, titriser celle-ci. J’ai le sentiment que c’est ce type de montage que l’on souhaiterait pour financer le LFB. En cas de problème sur les titres émis par la BPI, c’est le capital de l’établissement servant de caution qui sera appelé, et cela peut bel et bien entraîner, qu’on le veuille ou non, une perte de contrôle d’une partie du capital dans les années à venir. Ni l’article, ni l’amendement ne peuvent techniquement garantir que le bilan du LFB soit maintenu sous le contrôle de l’État ou d’un organisme public, et ce en raison du fonctionnement de la BPI, qui a choisi de se porter caution par effet de levier plutôt que par la propriété du capital.
Mme Bernadette Laclais. Siégeant à la commission des affaires sociales, qui travaille sur le projet de loi relatif à la santé, je souhaite relayer l’inquiétude de nombreuses associations à ce sujet. L’activité du LFB est stratégique pour l’indépendance de notre pays en matière de médicaments dérivés du sang, qui représentent souvent la seule chance de survie pour les patients. Nos voisins belges sont aujourd’hui dépendants de pays étrangers, notamment de notre LFB, pour l’activité de fractionnement, et, malgré la qualité de leurs fournisseurs, ils nous disent regretter leur décision. En Italie, l’État a au contraire injecté 300 millions d’euros dans son laboratoire de fractionnement.
Selon le statut actuel du LFB, 49 % du capital peuvent être redistribués. Pourquoi ne pas prélever sur cette part, plutôt que d’ouvrir d’autres possibilités ? Le statut actuel permet déjà une redistribution. Sans mettre en cause les intentions du Gouvernement, je souhaite relayer les inquiétudes des associations, qui attendent des explications. Pourquoi sortir du cadre actuel ?
Mme Jacqueline Fraysse. Je fais mien le qualificatif de « pépite » pour ce laboratoire, qui mérite bien sa renommée internationale de pionnier dans le domaine. Ce fait à lui seul devrait conduire l’État à dégager des moyens pour le défendre, sans transgresser les règles éthiques du don anonyme et gratuit.
Avec l’entrée de la BPI au capital, le problème du contrôle de l’État est posé. L’amendement pourrait sembler y répondre mais, à y regarder de près, on s’aperçoit qu’il a le même objectif que l’article, à savoir un recul de l’État dans le capital, en permettant aux organismes publics, tels que la BPI, d’être majoritaires. Un scénario de 51 % de parts à la BPI et de 49 % au privé serait ainsi possible, ce qui est contradictoire avec les affirmations de la ministre de la santé et représente une perte de contrôle de l’État.
En ce qui concerne la seconde partie, à savoir la golden share, qui permet à l’État de conserver un certain contrôle sur une entreprise privatisée, vu l’amendement, il ne faut pas nous rouler dans la farine.
M. le ministre. L’Établissement français du sang, monsieur Roumegas, n’est pas le LFB, et la collecte n’est pas le fractionnement : c’était la confusion de votre collègue hier, ne la refaites pas aujourd’hui.
Le LFB, sur le fondement de son expertise scientifique, a développé bien d’autres activités, notamment des activités de biotechnologie aux États-Unis. Avec une croissance de 9 % par an, il a besoin d’un accompagnement en capitaux pour se développer, et notamment pour construire, en France, une usine de médicaments dérivés du plasma sanguin, pour un montant de 250 millions d’euros.
L’article 48 supprime la phrase selon laquelle le capital du LFB doit être détenu majoritairement par l’État ou ses établissements publics, dans la mesure où la BPI n’est pas, juridiquement, un établissement public mais un organisme public. Cette phrase étant supprimée, l’ordonnance du 20 août 2014, dont la commission spéciale a voté hier la ratification, précise qu’il faut passer par la loi pour privatiser toute entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du LFB étant de 480 millions d’euros, ce laboratoire ne peut donc être privatisé sans intervention préalable du législateur. Dans le cas où le législateur souhaiterait, à l’avenir, privatiser le LFB, le présent article ne peut l’en empêcher, ni aucune mesure législative que nous voterions, mais nous n’ouvrons aucunement cette possibilité nous-mêmes.
En matière de titrisation, madame Berger, la BPI ne peut pas tout faire, comme vous semblez le suggérer. Vous n’ignorez pas que l’on titrise rarement un seul actif. Imaginons cependant que la BPI souhaite titriser sa participation. Il s’agirait alors d’un transfert de propriété et l’ordonnance du 20 août 2014 s’appliquerait. Une privatisation ne peut donc avoir lieu par ce biais, en supposant que la BPI s’amuse à jouer à ce jeu-là.
Si, sur des sujets comme la défense, dont nous venons de discuter, et sur d’autres dont nous discuterons, nous avons cherché à donner de la mobilité aux détentions capitalistiques de l’État pour que les sociétés se désendettent ou réinvestissent, il ne s’agit ici que de faire bénéficier une entreprise des moyens de se développer. L’amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques rend cette intention plus claire. Le sang est un sujet éminemment sensible, mais nous avons aussi, en tant qu’actionnaire public, la responsabilité de développer un actif d’une grande qualité technologique.
Mme Monique Rabin. N’existe-t-il d’autre solution que de faire appel à la BPI ? Nous savons que les multinationales du médicament sont à la porte : le laboratoire, que j’ai interrogé, souhaite, à terme, s’ouvrir à ces sociétés.
Je sais que la rapporteure thématique a tout fait pour border le nouveau dispositif, notamment par l’action spécifique, mais à supposer que l’État décide d’engager une telle action, l’Union européenne ne partage pas du tout notre philosophie. La Cour de justice de l’Union européenne a ouvert l’EFS à l’entreprise Octapharma. De même, l’Europe a jugé illégale la détention de golden shares par l’État espagnol, par exemple. Le Conseil d’État français a par ailleurs décidé que les produits sanguins étaient désormais des médicaments, donc des produits de marché. Ne pourrait-on supprimer cet article et réfléchir à d’autres types de financement, pour donner satisfaction au LFB tout en préservant notre éthique ?
M. Jean-Yves Caullet. Nous pouvons faire litière des procès d’intention : le dialogue qui vient de s’instaurer montre bien que nous tenons tous à ce que ce laboratoire demeure sous contrôle public. De même, nous admettons tous que ce laboratoire a des potentialités technologiques qu’il est de notre devoir de mettre en valeur et de développer. L’amendement clarifie les garanties prévues par l’article. Sa première partie précise clairement que le capital ne peut être ouvert qu’à des établissements, entreprises ou organismes publics. La seconde partie pose une double garantie, en rappelant l’ordonnance d’août 2014, qui ne permet une privatisation que par la loi, et en prévoyant une golden share.
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais puisque nous cherchons à introduire des verrous pour éviter toute forme de dérapage, il me semblerait souhaitable d’indiquer que les opérations ne peuvent être mises en œuvre que dès lors que l’État détient une action spécifique. Nous indiquerions ainsi que, si la législation européenne mettait un jour en cause la golden share française, l’ensemble de la structure capitalistique devrait alors être verrouillée autrement.
M. Jean-Frédéric Poisson. Vous avez, monsieur le ministre, dans votre réponse, parfaitement identifié l’origine du problème. Insérer un sujet si sensible, si symbolique, si chargé de suspicions – alors même que l’affaire du sang contaminé a déjà plus de vingt-huit ans –, entre des dispositions concernant la cession de capitaux d’une industrie fabriquant des armes à feu et d’autres dispositions concernant la cession du capital des aéroports, a de quoi surprendre, et ne favorise pas la clarté.
Ensuite, alors que vous avez renvoyé au projet de loi de financement de la sécurité sociale le sujet des professions réglementées sur la santé, vous entendez traiter ici et maintenant le présent sujet, beaucoup plus sensible, sans justification particulière, à moins que les besoins de financement du laboratoire soient à ce point pressants.
Par ailleurs, l’article supprime toute référence à la maîtrise par l’État du capital. L’amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques rétablit les garanties que nous exigeons tous : il rétablit en réalité ce que vous venez de dire mais qui ne figure pas dans le texte de l’article.
L’articulation de la golden share avec le dispositif n’est pas possible autrement. À vrai dire, nous ne pouvons être sûrs des conséquences. Dès lors que l’on procède à une organisation de capital via un organisme bancaire, quel qu’il soit, la porte est entrouverte, et l’on prend des risques. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera l’amendement des rapporteurs mais s’abstiendra sur le vote de l’article.
M. Jean-Louis Roumegas. J’entends de nouveau des cris d’orfraie, à propos de prétendus procès d’intention. Sans la vigilance des députés, les intentions du Gouvernement sur cet article seraient restées inexpliquées, alors que les doutes étaient plus que fondés. Vous tentez à présent, monsieur le ministre, de lever ces doutes, mais votre réponse ne me satisfait pas. Monique Rabin a demandé si l’on ne pouvait faire autrement. Si le laboratoire a besoin de se développer, c’est que ses activités sont devenues extrêmement rentables, et chacun sait que les grands laboratoires privés souhaitent s’y associer. Alors que le secteur public, en investissant dans la recherche, a créé une pépite, voici que, maintenant qu’il s’agit de produire, vous appelez le secteur privé pour qu’il récolte les bénéfices. Si nous en sommes arrivés là, c’est que vous avez fait le choix d’une politique d’austérité. Il y a bien une autre solution : l’investissement public dans une activité stratégique et devenue rentable !
M. le président François Brottes. La BPI est publique et a des missions publiques.
Mme Jacqueline Fraysse. Si l’État ne dégage pas les moyens nécessaires pour permettre à ce laboratoire de se développer, c’est bien en raison de choix politiques : le Gouvernement ne veut pas mettre de l’argent de l’État dans ce laboratoire. Vous affirmez qu’il s’agit seulement de permettre l’entrée de la BPI, un organisme public, mais le texte supprime toute référence à la maîtrise de l’État. Si le problème est réglé par l’ordonnance, monsieur le ministre, qu’est-ce qui vous empêche d’inscrire dans la loi que l’État conserve, quoi qu’il arrive, le contrôle de cet établissement ? L’amendement, je l’ai dit, ne règle pas ce problème, malgré certaines apparences. Si vous n’avez pas l’intention de privatiser, ce qui se passe avec Octapharma est néanmoins très significatif : cette société privée fabrique et la société publique distribue !
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Notre amendement va au bout des garanties pouvant être apportées. Celles-ci consistent à rappeler que tout changement de la structure du capital devra passer par la loi – et je rappelle que sur ma proposition, la commission spéciale a adopté la nuit dernière un amendement élargissant les pouvoirs du Parlement en la matière par l’abaissement des seuils – et à prévoir pour l’avenir la possibilité d’une action spécifique : cette action elle-même ne peut toutefois être décidée aujourd’hui puisque nous n’ouvrons pas le capital au secteur privé. Si nous venons de voter l’article 44, madame Rabin, c’est parce que nous souhaitons mettre la législation française en conformité avec celle de l’Union européenne s’agissant de l’action spécifique.
Il y a urgence : le LFB, je l’ai dit, est en train de vendre, donc de céder à la concurrence, des brevets. L’entrée de la BPI au capital est très importante car, dans le portefeuille de l’Agence des participations de l’État (APE), la LFB est la seule entreprise de son genre, tandis que la BPI a investi ces dernières années dans ce secteur et connaît donc bien le domaine des biotechnologies et de la biopharmacie. Il est important de pouvoir s’appuyer sur une telle expertise ; c’est un atout supplémentaire.
Je ne vois pas quel problème poserait l’entrée de la BPI, un organisme public, sachant que la vocation de celle-ci est d’aider les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et PME, ce qu’est bien le LFB, qui a besoin d’être aidé dans la durée. En audition, M. Nicolas Dufourcq nous a confirmé que l’intention de la BPI était d’entrer au capital de cette entreprise dans la durée, entre quinze et vingt-cinq ans. Nous pensons avoir répondu à l’ensemble des préoccupations qui se sont exprimées.
M. le ministre. La rapporteure thématique vient de répondre aux préoccupations de M. Poisson sur l’articulation du dispositif. Le silence dans le code de la santé publique que crée l’article 48 est en réalité couvert par l’ordonnance du 20 août 2014, qui garantit une détention publique. Ce point est clarifié par l’amendement.
Je n’ai pas réagi aux propos de M. Roumegas, mais il arrive que l’approximation devienne offensante. Je relis donc l’exposé des motifs du projet : « L’article 48 permet des reclassements au sein du secteur public des titres du LFB ou de ses filiales. Il n’autorise pas le transfert au secteur privé de la société. »
M. le rapporteur général. Il ne faut pas faire du principe de précaution un principe de paralysie, car l’on sait très bien que, si nous n’agissons pas aux côtés de cette filiale, qui pour vivre vend des brevets, elle risque tout simplement de s’affaiblir et de s’éteindre. Nous aurions alors une responsabilité dans le fait d’avoir laissé ce que nous avons appelé une pépite devenir un astre mort.
Grâce au travail que nous avons mené avec Clotilde Valter, les choses sont verrouillées « ceinture et bretelles ».
Notre majorité ne veut pas laisser porter atteinte, par des intérêts privés, aux intérêts vitaux de la santé publique. Mais si une autre majorité devait nous succéder dans deux ou trois ans, je ne pense pas non plus qu’elle voudrait porter atteinte aux intérêts vitaux de la santé publique au bénéfice d’intérêts privés et marchands, parce que, de par l’histoire que nous avons vécue et la sensibilité qui est celle de notre pays, il n’y aura pas une majorité de républicains pour donner réalité aux fantasmes et aux angoisses qui ont été formulés ici ou là.
Faisons-nous un peu confiance. On ne peut pas manifester ensemble pour rappeler que l’on a des valeurs communes puis dire le lendemain qu’il faut se méfier de l’avenir. Je ne crois pas qu’il y aura dans notre pays une majorité suffisamment scélérate et imbécile pour solder les intérêts vitaux de la santé publique.
J’ai confiance à la fois dans les républicains de notre pays et dans la nécessité d’aider cet institut de recherche à prospérer et à permettre le développement et le rayonnement de la santé publique française.
Mme Jacqueline Fraysse. Ce n’est pas le sujet !
M. Jean-Yves Caullet. Tout à l’heure, je vous ai fait part de mes interrogations. Le ministre, la rapporteure thématique et, à l’instant, le rapporteur général, de façon extrêmement brillante, ont apporté, je crois, toutes les réponses à ceux qui se posent des questions. Au nom du groupe socialiste, je remercie le rapporteur général de permettre à chacun d’exprimer un vote positif sur cet amendement qui montre notre attachement à la République et au caractère public de ce secteur.
La commission rejette les amendements SPE802 et SPE1242.
Puis elle adopte l’amendement SPE1916 et l’article 48 est ainsi rédigé.
*
* *
Article 49
Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État
dans deux grands aéroports régionaux
Cet article autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. Une telle autorisation législative est nécessaire aux termes de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des lignes directrices de l’État actionnaire définies par le Gouvernement, qui ont fait l’objet d’une communication en Conseil des ministres le 15 janvier 2014. Elles visent à permettre à l’État, en gestionnaire actif de ses participations, de céder aux meilleures conditions possibles ses participations à travers des opérations valorisant le potentiel de développement de ces infrastructures, tout en conservant son rôle de concédant et de régulateur.
I. L’ÉVOLUTION DU STATUT DES GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX
Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport thématique de 2008 consacré aux aéroports français face aux mutations du transport aérien, l’État a fait le choix historique de concéder la gestion des aéroports régionaux aux chambres de commerce et d’industrie. Ainsi, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont été choisies par l’État comme concessionnaires pour tous les grands aéroports de province sur le fondement de la loi du 20 juin 1933 (62) qui a ajouté les aéroports à la « liste des établissements à l’usage du commerce que les chambres de commerce sont autorisées à créer et à administrer ».
La première étape de la réforme du statut des aéroports régionaux a été engagée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Son article 28 a transféré aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, la propriété et la gestion de cent cinquante aérodromes civils appartenant à l’État et ne présentant pas d’intérêt national ou international.
Dans un second temps, l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a permis une réforme progressive du mode de gestion des grands aéroports régionaux. En application de cette disposition, les concessions de ces aéroports ont en effet pu, à l’initiative des CCI concernées, être transférées à des sociétés spécialement constituées, entièrement détenues, au moment de leur création, par des capitaux publics.
La composition du capital de ces sociétés n’est pas précisée par la loi, mais le ministre chargé des transports a donné au cours du débat parlementaire quelques éléments de clarification : la participation des CCI et des collectivités territoriales devait atteindre respectivement 25 % et 15 %, l’État conservant 60 % du capital des sociétés.
II. LA SITUATION DES DEUX AÉROPORTS CONCERNÉS
Conformément à la loi n° 2005-357 précitée, la concession de l’aéroport de Nice a été transférée le 25 juillet 2008 à la société anonyme Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), créée à cet effet le 28 décembre 2006. Il en a été de même pour la concession de l’aéroport de Lyon qui a été transférée le 6 mars 2007 à la société Aéroports de Lyon (ADL). Les deux actionnariats présentent une répartition identique et conforme au modèle souhaité.
Aéroports de la Côte d’Azur |
Aéroports de Lyon |
État : 60 % |
État : 60 % |
CCI Nice-Côte d’Azur : 25 % |
CCI Lyon : 25 % |
Conseil régional PACA : 5 % |
Conseil régional Rhône-Alpes : 5 % |
Conseil général Alpes-Maritimes : 5 % |
Conseil général Rhône : 5 % |
Métropole Nice Côte d’Azur : 5 % |
Métropole Grand Lyon : 5 % |
Il s’agit dans les deux cas de groupements importants. En effet, Aéroports de la Côte d’Azur est le deuxième acteur aéroportuaire du pays, après Aéroports de Paris, et regroupe trois plateformes : Nice-Côte d’Azur (international), Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez. Le trafic de l’aéroport Nice-Côte d’Azur a atteint 11,55 millions de passagers en 2013, ce qui en fait le troisième de France après Charles-de-Gaulle et Orly.
Aéroports de Lyon regroupe deux plateformes : Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Bron. Lyon Saint-Exupéry est le quatrième aéroport de France en termes de passagers (8,56 millions en 2013) tandis que Lyon-Bron est le troisième aéroport d’affaires de France.
III. LA PROCÉDURE D’OUVERTURE DU CAPITAL
C’est l’Agence des participations de l’État qui conduira ces deux dossiers et élaborera le cahier des charges relatif aux procédures de transfert de participation. La réussite de ces opérations est conditionnée par la présence de nouveaux investisseurs capables d’assurer le développement et la performance à long terme de ces aéroports. La concertation qui sera menée avec les actionnaires locaux devra permettre, quant à elle, de tenir compte des attentes des acteurs locaux en relation avec l’activité aéroportuaire. La valorisation de ces deux sociétés sera déterminée, en application des articles 26 et 27 de l’ordonnance n° 2014-948 précitée, par la Commission des participations et des transferts selon une analyse multicritères.
En tout état de cause, ces aéroports demeureront gérés dans le cadre d’une concession dont l’État est le concédant et seul le capital des sociétés concessionnaires fera l’objet d’un transfert majoritaire au secteur privé. Les infrastructures aéroportuaires ainsi que le foncier demeureront la propriété du concédant. L’État disposera ainsi de pouvoirs étendus pour contrôler l’activité de la société (en matière d’investissements, de qualité de service, d’environnement, d’horaires d’ouverture). Dans le cadre de ses prérogatives de régulateur, l’État devra par ailleurs approuver chaque année les tarifs des redevances d’aéroport.
IV. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LE CONTRÔLE DE L’ÉTAT CONCÉDANT
Les auditions conduites par la rapporteure thématique ainsi que l’analyse de l’opération en cours relative à la privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac ont mis en lumière la nécessité pour l’État concédant de faire prévaloir les intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien sur une appréciation purement financière des offres qui s’apparente aujourd’hui beaucoup à une mise aux enchères.
Si c’est à juste titre que le Gouvernement veut promouvoir une gestion dynamique des actifs de l’État, il n’est pas pour autant acceptable que la logique financière l’emporte sur la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transports aériens.
L’autorisation donnée au transfert au privé d’une participation majoritaire au sein du capital de la société de gestion de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a été engagée par le pouvoir réglementaire en application de la législation en vigueur : en effet, le chiffre d’affaires de l’aéroport de Toulouse-Blagnac s’élevait en 2013 à 117 millions d’euros, soit en dessous du seuil de chiffre d’affaires de 150 millions d’euros exigé pour une autorisation législative. Les nouveaux seuils proposés par la rapporteure thématique auraient permis que cette opération fût décidée par le Parlement.
Afin de garantir la bonne prise en compte des enjeux liés au transport aérien à long terme et à l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de renforcer les prérogatives du Parlement relatives aux opérations de transfert au secteur privé de participations majoritaires détenues par l’État au capital de sociétés concessionnaires d’aéroports et d’autoroutes, en les soumettant de manière systématique à l’autorisation préalable du législateur, indépendamment de critères de chiffres d’affaires ou de nombre de salariés. Cet amendement permet également d’encadrer la procédure en inscrivant dans la loi le principe de l’autorisation préalable de telles opérations par le ministre chargé des transports, la nécessité de faire figurer dans le cahier des charges de l’appel d’offres les obligations pesant sur le futur concessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et d’exiger des candidats une expérience de la gestion aéroportuaire.
*
* *
La commission examine les amendements identiques SPE820 de M. André Chassaigne et SPE1388 de Mme Michèle Bonneton, tendant à supprimer l’article, ainsi que les amendements SPE825 et SPE819 de M. André Chassaigne, SPE993 de M. Jean-Christophe Fromantin, SPE1794 des rapporteurs et SPE810, SPE827 et SPE836 de M. Jean-Frédéric Poisson.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement SPE820 vise à supprimer cet article qui prévoit la vente des participations de l’État dans les sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon en transférant au secteur privé la majorité du capital des sociétés.
Ce n’est pas en bradant son patrimoine et en détricotant ses services publics que l’État relancera l’économie dans la justice sociale. Cette décision est d’autant plus irrecevable que ces deux sociétés sont rentables, puisque le résultat net de la société Aéroports de la Côte d’Azur a été de 13 millions d’euros en 2012 et de 16,6 millions d’euros en 2013. Quant à Aéroports de Lyon, qui a obtenu un prêt de 140 millions d’euros de la BPI pour construire un terminal flambant neuf, son résultat net est légèrement inférieur mais il reste bénéficiaire, puisqu’il s’est élevé entre 9 et 12 millions d’euros par an entre 2009 et 2012.
La décision de l’État, dans une logique de court terme, de brader deux aéroports dans lesquels il est encore majoritaire nous paraît complètement disproportionnée par rapport aux enjeux, dans la mesure où l’objectif affiché est d’éponger une dette qui est pour partie illégitime. Comment peut-on prendre une décision aussi grave au seul prétexte d’éponger un peu une dette ?
M. Jean-Louis Roumegas. Je suis pleinement en phase avec Jacqueline Fraysse.
Je voudrais rapprocher ce débat de celui que nous avons eu sur les concessions d’autoroutes. J’ai regretté le peu d’empressement dont a fait preuve le Gouvernement pour mettre fin à ces contrats de concession et remettre ces activités pourtant juteuses dans le giron public. Or, on voit que le Gouvernement s’apprête à céder très facilement au secteur privé des aéroports qui sont pourtant rentables. Nous ne comprenons pas cette logique fondée sur l’économie libérale et nous ne la partageons pas.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Avant de présenter l’amendement SPE1794, je souhaite vous dire comment j’ai enclenché le raisonnement et réfléchi à la question qui nous était posée, sachant que ma réaction spontanée a été celle qui vient d’être exprimée, c’est-à-dire de refuser le dispositif tel qu’il nous était proposé.
Pour avancer dans mon travail, je me suis posé une série de questions que je vais vous expliciter et qui m’ont permis de parvenir à l’amendement que je vous propose.
Quelles sont les prérogatives de l’État dans la situation actuelle où il est majoritaire dans les sociétés de gestion ? Je vous rappelle qu’il ne s’agit pas de privatiser les aéroports – l’État reste propriétaire des investissements et des infrastructures – mais les sociétés de gestion. Par ailleurs, l’État assure la fonction de régulateur du secteur. Dès lors que l’État reste propriétaire des infrastructures, qu’il reste régulateur et qu’il donne son accord sur la tarification et sur les ouvertures de lignes, il conserve des prérogatives extrêmement importantes, voire déterminantes s’agissant des aéroports concernés.
En revanche, le processus de privatisation doit être encadré par la loi, car nous avons pu constater, à travers les auditions que nous avons menées, sur la base de l’exemple de l’aéroport de Toulouse, qui nous a été offert comme sur un plateau par le Gouvernement, qu’il comporte des insuffisances. Le cahier des charges qui est établi ne comporte qu’un critère, celui du prix. Cela veut dire que le processus ressemble, sans en avoir les caractéristiques, à une mise aux enchères, ce que nous refusons. Le cahier des charges de l’appel d’offres doit prévoir des éléments importants en matière de transport aérien, comme la préservation des intérêts essentiels de la Nation, à laquelle notre amendement fait référence.
Comme je viens de l’indiquer, l’amendement tire tous les enseignements de la réflexion qui a été conduite à travers les auditions, et en particulier du cas de Toulouse. Nous devons avoir l’honnêteté de dire que le transfert n’a pas de conséquences importantes en tant que telles, dans la mesure où le seul élément que l’État perd dans ce transfert, ce sont les actes de gestion courante de la société de gestion.
L’État doit avoir la possibilité de faire prévaloir les intérêts essentiels de la Nation, s’agissant de la place de la France dans le transport aérien international, de notre compagnie nationale et du hub de Roissy.
La procédure, telle qu’elle est définie, pose problème, car seul le critère financier est examiné. Nous pensons certes qu’il n’est pas acceptable que l’État puisse être spolié, mais un élément au moins aussi important, aujourd’hui non pris en compte, est constitué par les intérêts essentiels de la Nation.
C’est pourquoi notre amendement prévoit qu’une autorisation préalable sera donnée par le ministre des transports, que les intérêts essentiels de la Nation seront préservés et que le candidat retenu dispose d’une expérience de la gestion aéroportuaire, en clair que ce ne soit pas une société financière.
Nous posons également le principe qu’à partir de l’entrée en vigueur cette loi – et c’est un profond changement avec le dispositif qui existe aujourd’hui dans notre droit –, tout transfert de participation majoritaire sera soumis systématiquement à l’autorisation du Parlement. Nous constatons, avec ce qui se passe aujourd’hui pour les aéroports de Nice et de Lyon, que le transfert au secteur privé d’une partie du capital des sociétés de gestion des aéroports est autorisé par la loi tandis que l’aéroport de Toulouse relève d’un décret. L’amendement que nous proposons prévoit que ces opérations devront faire systématiquement l’objet d’une autorisation du Parlement. Cette mesure renforce ce qui a été fait à l’article 43, qui conforte le rôle du Parlement dans les opérations en capital.
Avec ce principe général, une fois que la loi sera votée, aucune opération du type de celle de Toulouse ne pourra être conduite. Par ailleurs, nous prévoyons d’encadrer le processus de privatisation pour que les intérêts nationaux soient pris en compte.
M. le président François Brottes. Permettez-moi de saluer une fois de plus, d’une part le travail des rapporteurs qui, article après article, apportent des contributions de fond assez considérables, ce qui montre qu’ils ne sont pas trop de huit sous la coordination du rapporteur général, et d’autre part l’ouverture du Gouvernement, grâce à laquelle le dialogue se transforme en coconstruction législative.
Madame la rapporteure thématique, c’est la deuxième fois que vous donnez davantage de droits au Parlement à travers les propositions que vous faites. Je pense que l’histoire vous en saura gré.
M. le ministre. La rapporteure thématique a parfaitement décrit la situation et montré notamment en quoi l’ouverture du capital des sociétés de gestion aéroportuaires diffère profondément de celle des concessions d’autoroutes : en effet, l’ouverture du capital est limitée et un contrat de régulation économique l’encadre.
L’autorisation qui est demandée ici va dans le sens d’une meilleure utilisation du capital de l’État. Comme ce n’est pas en tant qu’actionnaire, mais en tant que régulateur que nous exerçons le rôle le plus important pour la population française, il nous paraît opportun de nous séparer des titres que nous détenons dans ces sociétés de gestion, tout en conservant une sensibilité plus particulière, renforcée encore par l’amendement des rapporteurs, à la régulation de ce secteur. D’ailleurs, lorsque l’on parle avec les gestionnaires ou les collectivités locales concernés, on se rend compte qu’ils sont bien plus préoccupés par l’ouverture des lignes que par la détention du capital. L’ouverture des lignes reste dans les mains de l’État. C’est la direction générale de l’aviation civile (DGAC) qui en a le contrôle et qui la régule.
Ce que nous proposons ici a un sens sur le plan capitalistique : il s’agit de mieux utiliser le capital. L’affaire de Toulouse a montré la forte rentabilité d’une telle opération, comme les chiffres l’attestent. En moyenne, les dividendes que nous avons perçus au titre de l’aéroport de Toulouse au cours des dernières années s’élevaient à 1,5 million d’euros – l’État détenait 60 % du capital. La cession de 49,9 % du capital représente 308 millions d’euros. Cette opération permet d’ouvrir le capital d’une société de gestion dont on pilote les équilibres économiques. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’une bonne opération sur le plan financier.
Tirons les expériences de la discussion que nous avons eue collectivement sur l’ouverture du capital de l’aéroport de Toulouse. La sensibilité de l’un des investisseurs, perçue par toutes et tous, a créé beaucoup d’émoi, notamment sur place. Cet émoi eût été moindre si une procédure d’autorisation préalable du Parlement avait existé. C’est pourquoi la mécanique proposée par la rapporteure thématique à travers cet amendement et celui que nous avons adopté hier me paraît de bon aloi. Ouvrir le capital ou privatiser une société n’est pas une opération neutre. Aussi est-il normal qu’il y ait un débat. Sans doute les seuils en vigueur étaient-ils un peu trop élevés. En tout cas, en tant que ministre de l’économie, il est de ma responsabilité de considérer que le fait d’avoir un vrai débat parlementaire en amont est une bonne chose à tous égards pour que l’opération se déroule mieux.
L’autre conclusion que je tire de l’opération de Toulouse, c’est que, constitutionnellement l’intérêt patrimonial de l’État est une priorité. La façon dont le décret encadrait l’opération nous a conduits à choisir la candidature d’un consortium chinois. Nous pouvons, pour ces infrastructures, enrichir la nature du cahier des charges en portant explicitement dans la loi les préoccupations industrielles, celles que la rapporteure thématique a mises en évidence, celles de l’aviation civile et donc partager la responsabilité avec le ministre compétent. C’est une bonne chose, une fois encore, que le ministère de l’économie ne soit pas seul à se pencher sur le sujet. Dans les faits, d’ailleurs, il y a des échanges, si cela peut vous rassurer.
Madame la rapporteure thématique, permettez-moi néanmoins d’apporter un léger correctif à vos propos. Aujourd’hui, l’intérêt du dispositif tel qu’il est défini par le texte et défendu par le ministère de l’économie n’est pas uniquement patrimonial : lorsque la Commission des participations et des transferts doit se prononcer sur un texte, elle regarde la bonne défense des intérêts patrimoniaux, mais le ministre de l’économie est en charge de l’intégralité des équilibres tels qu’ils sont définis par le cahier des charges.
Je salue le travail qui a été réalisé par la rapporteure thématique, permettant d’inscrire cette nouvelle philosophie qui rend à la fois plus transparent et plus clair le rôle du Parlement et le rôle intergouvernemental. J’émets un avis défavorable aux deux amendements de suppression de l’article 49 et un avis favorable à l’amendement SPE1794.
M. Christophe Caresche. On ne peut pas dire que la création dans les régions de certains aéroports et aérodromes ait toujours obéi à des logiques économiques irréfutables. Lorsque le volontarisme politique s’éloigne trop des logiques économiques, cela finit par poser des problèmes. Il ne faut pas traiter ces questions sous le seul angle régalien, mais aussi prendre en compte la question économique.
L’amendement SPE1794 vise à donner au Parlement la possibilité d’autoriser ou non le transfert de propriété de ces aéroports. Monsieur le ministre, si le Parlement s’était prononcé sur l’affaire de Toulouse, je ne suis pas certain qu’il aurait autorisé l’investisseur en question à entrer dans le capital de l’aéroport de Toulouse. Personnellement, cela ne me choque pas. Mais la séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement le permet-elle ?
M. Patrick Hetzel. Le débat sur l’évolution de la structure du capital nous rappelle celui qui opposait François Mitterrand et M. Michel Rocard lors des nationalisations de 1981, ce dernier estimant alors qu’il suffisait, pour contrôler une société, de détenir 51 % du capital.
Monsieur le ministre, vous avez dit qu’il fallait une gestion saine des participations de l’État et, en l’occurrence, s’inscrire dans des logiques de privatisation. Je pense qu’il s’agit là d’outils et je ne vois pas de problème de fond en la matière. En revanche, dès lors que l’on se dirige vers une ouverture plus grande du capital des sociétés aéroportuaires, ne sera-t-il pas nécessaire de faire évoluer le dispositif réglementaire pour s’assurer que la DGAC peut continuer à assurer un bon contrôle, c’est-à-dire la sécurité du transport aérien et du territoire ?
M. Jean-Louis Roumegas. L’amendement SPE1794 apporte évidemment un élément supplémentaire. D’ailleurs, je rappelle qu’au titre Ier du projet de loi, nous avions proposé une disposition similaire concernant les contrats de concession des sociétés autoroutières, mais cet amendement a été rejeté. C’est une bonne chose que de renforcer les prérogatives du Parlement. Toutefois, les alinéas 1 et 2 ne sont pas modifiés, c’est-à-dire que l’article 49 continue de prévoir le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur et le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon. Finalement, l’amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques ne change absolument rien en ce qui concerne l’article pris globalement.
M. Jean-Frédéric Poisson. Il s’agit en l’espèce de sujets d’une grande complexité. Aéroports de Paris exploite, je crois, un peu plus d’une vingtaine d’aéroports internationaux. La mécanique qui consiste à faire entrer des exploitants étrangers sur le sol national est nouvelle ; elle a été enclenchée il y a quelques semaines avec l’affaire de Toulouse. Notre groupe a considéré que cette opération posait problème, non pas tant à cause du principe même de l’ouverture du capital d’une société aéroportuaire, mais en raison du choix de l’opérateur. Installer à Toulouse des sociétés d’exploitation d’origine étrangère à quelques hectomètres d’activités extrêmement sensibles, stratégiques et concurrentielles dans le monde entier – je parle, bien sûr, du secteur aéronautique – alors que nous savons que nous sommes très peu armés en matière de défense du renseignement économique – à cet égard, je salue notre ancien collègue Bernard Carayon, qui a essayé pendant quinze ans de faire partager la nécessité de renforcer l’appareil d’État sur ce sujet –, voilà un cocktail qui peut présenter certains inconvénients. Du reste, il semblerait que cela fasse localement des remous, ce qui, à mon sens, est justifié.
Monsieur le président, j’indique d’ores et déjà que je retirerai les amendements SPE810, SPE827 et SPE836 que j’ai déposés sur cet article. Mais, avant, je veux les défendre.
Nous sommes tous attentifs à ce que l’État ait une politique de participations intelligente et proportionnée. Il y a des endroits où il n’a rien à faire, d’autres où il doit demeurer. Ce tri peut dépendre de choix politiques, d’impératifs stratégiques, etc.
S’agissant des sociétés de gestion des aéroports, dans la mesure où il concède l’exploitation de la société mais reste propriétaire de tout le reste et directement dépositaire de la sécurité aérienne et des ouvertures de lignes, pourquoi pas ? Mais je crains que nous soyons dans une politique de court terme. Je comprends que certains s’étonnent que l’on vende des actifs rentables, mais il est plus difficile de vendre des actifs qui ne le sont pas tout en faisant de bonnes opérations financières.
Je le répète, le problème réside surtout dans des lieux qui sont souvent stratégiques et porteurs de beaucoup de renseignements et d’informations importants pour le secteur économique français et au-delà. Étant donné notre faiblesse à nous défendre contre cela aujourd’hui, je suis très réservé quant à l’arrivée de ces opérateurs étrangers sur ces endroits du territoire.
Je retire mes amendements, considérant que celui des rapporteurs répond à mes préoccupations de maintien d’une forte décision de la puissance publique sur ces secteurs. Le groupe UMP ne s’opposera ni à l’adoption de l’amendement des rapporteurs, ni à celle de l’article 49.
Les amendements SPE810, SPE827 et SPE836 sont retirés.
Mme Karine Berger. Cette discussion arrive à point nommé, car les grandes questions soulevées par l’opération de Toulouse méritaient un débat dans notre assemblée, débat que nous n’avions pas encore eu l’occasion d’avoir.
L’amendement des rapporteurs permet de rappeler que la gestion patrimoniale d’un État est importante – d’ailleurs, elle relève de la responsabilité du ministre de l’économie – mais que ses intérêts stratégiques ne le sont pas moins. Même si les autorisations de lignes ne sont pas données par les aéroports, la pilote privée que je suis sait à quel point un aéroport a la main sur les trafics autorisés. Il est dommage que la disposition prévue par l’amendement SPE1794 n’ait pas existé lors de l’opération de Toulouse, car je reste persuadée que ce qui s’est passé là-bas est regrettable car c’est une solution essentiellement financière.
M. Yves Blein. Je remercie notre rapporteure thématique pour les précisions qu’elle a apportées.
Monsieur le ministre, vous avez indiqué que ce qui fait la valeur d’une société de gestion, ce sont les lignes qu’elle peut exploiter. L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry est une plateforme aéroportuaire importante. D’ailleurs, des acteurs économiques régionaux commencent à réfléchir, dans l’hypothèse d’une privatisation, au rôle qu’ils pourraient jouer, leurs investissements étant conditionnés à l’ouverture de lignes nouvelles auxquelles de nombreuses compagnies étrangères sont candidates. Pouvez-vous préciser votre point de vue sur le sujet ?
M. le président François Brottes. On n’a pas envie d’acheter le garage sans les voitures !
M. Jean-Christophe Fromantin. L’amendement SPE1794 permet d’apporter quelques précisions sur les critères liés aux ouvertures de capital.
Cet article va dans le bon sens. Le premier critère qui doit nous alerter sur l’évolution de ces infrastructures, c’est leur développement et les investissements qu’elles requièrent. Si nos aéroports sont décalés par rapport à la concurrence et aux besoins de mobilité, nous nous retrouverons petit à petit dans des situations difficiles. Notre ambition pour aménager notre territoire dans sa diversité nous impose de moderniser d’urgence nos aéroports.
Je ne comprends pas bien la méthode du Gouvernement, ni les raisons qui justifient qu’il faille un véhicule législatif pour chaque aéroport. Quand il a besoin de 300 millions d’euros, il privatise un aéroport. Dans deux ans, il aura peut-être besoin de 50 millions, et il en choisira un autre, plus petit. Si la doctrine du Gouvernement est de privatiser les aéroports, alors inscrivons-la dans le texte, quitte à l’assujettir à une liste, un agenda, un programme, au fur et à mesure que l’intérêt stratégique ou les investissements le nécessitent. Mon amendement propose d’inscrire ce mouvement de privatisation des aéroports et de l’assujettir à un programme qui serait proposé tous les deux ans par le Gouvernement et qui répondrait non à des stratégies de besoin de ressources mais d’aménagement et de développement. Les effets de levier qui en résulteraient nous encouragent à plaider en faveur de cette ambition, et donc d’un amendement plus général comme celui que je propose.
Le Gouvernement isole chaque aéroport, en considérant que le sujet n’est que l’aéroport. Or, pour des élus locaux, pour des régions, pour des acteurs économiques, l’avenir de l’aéroport appelle des investissements autoroutiers, logistiques, des installations d’entreprises, bref toute une série de décisions qui participent de l’écosystème dans lequel est placé l’aéroport. En inscrivant dans le texte que cette doctrine toucherait progressivement l’ensemble des aéroports, le Gouvernement enverrait un message de nature à permettre d’anticiper des projets qui viendraient se greffer sur un projet comme celui-là.
Je terminerai par un exemple, celui d’Aéroports de Paris, qui est le plus emblématique. On sait à quel point il est stratégique de réussir la liaison CDG Express, qui relie directement Roissy au centre de Paris et dont le montage est extrêmement compliqué. En l’espèce, ne faudrait-il pas plaider en faveur de la privatisation de l’aéroport de Roissy, pas tant pour l’aéroport en tant que tel mais pour l’ensemble des relations qu’il doit entretenir pour être compétitif et renforcer l’attractivité de Paris ?
M. le président François Brottes. Le CDG Express fait partie intégrante de ce projet de loi puisqu’il figure dans sa partie « mobilité ».
Par ailleurs, j’ai bien compris que votre amendement visait à réduire la portée de l’amendement SPE1794. Il y a des aéroports qui sont intermodaux et d’autres qui ne le sont pas, il y en a qui ont la fonction de hub et d’autres qui ne l’ont pas. Le sujet est parfois plus compliqué que cela.
Mme Monique Rabin. Comment a-t-il été possible de privatiser l’aéroport de Toulouse sans passer par la loi, alors que, pour privatiser ceux de Nice Côte d’Azur et de Lyon, il semble que ce soit nécessaire ?
J’ai une autre question. Les CCI sont opérateurs de plusieurs aéroports. Comment réagissent-elles par rapport à nos décisions ?
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement SPE825 propose d’introduire dans notre législation un principe général qui garantirait le maintien dans la sphère publique des sociétés aéroportuaires.
Comme plusieurs de mes collègues, je veux insister sur l’importance considérable de ces aéroports pour l’aménagement du territoire et pour la satisfaction des besoins des usagers en matière économique, industrielle et touristique. Moins que jamais, on ne peut se déterminer d’un seul point de vue financier. Il faut permettre à l’État de maîtriser l’aménagement cohérent et durable de son territoire au-delà du court terme. On vend, pour des raisons financières, les « bijoux de famille » et, ce faisant, on se prive d’un levier extrêmement important qui pourrait être au service de notre société et du pays.
L’amendement SPE819 vise à arrêter la procédure en cours s’agissant de l’aéroport de Toulouse. J’ai bien conscience que la mesure que nous proposons est très provocatrice, mais cette privatisation relève d’un triple scandale.
La procédure d’appel d’offres a sélectionné un groupe chinois qui a massivement recours aux paradis fiscaux, puisqu’il a des filiales installées aux îles Caïman et aux îles Vierges britanniques. Il sera accompagné d’un groupe canadien qui a été radié par la Banque mondiale pour dix ans, pour des faits graves de corruption. Je précise que c’est la sanction la plus grave qui puisse être décidée par la Banque mondiale.
Alors que le ministre avait indiqué, lors du lancement de l’appel d’offres, que la société d’exploitation de l’aéroport de Toulouse resterait majoritairement contrôlée par la puissance publique avec l’appui des collectivités publiques, nous apprenons que le pacte d’actionnaires, dont des extraits ont été publiés, laisse les mains libres au groupe chinois et à son ami canadien en lui accordant les pleins pouvoirs dans la prise de décisions stratégiques. Nous assistons là à des dérives extrêmement graves, puisqu’on se prive de leviers dont on dispose pour les confier à des sociétés pour le moins douteuses.
S’agissant de l’amendement SPE1794, je ne peux pas être hostile à ce que le Parlement soit consulté. Mais cela ne règle en rien les questions de fond qui nous préoccupent.
M. Alain Tourret. J’ai été très sensible à la fois aux explications données par la rapporteure thématique et aux propositions de Jean-Christophe Fromantin.
La création des aéroports de province a répondu non à une politique générale d’aménagement du territoire mais, pour l’essentiel, à des volontés régionales, ce qui conduit à des situations absurdes. L’aéroport de Saint-Gatien n’est toujours pas fermé, alors qu’il y en a un autre juste à côté, l’aéroport Rouen-Boos. Or, ils sont incompatibles. On peut même se demander s’il y a une compatibilité véritable entre l’aéroport de Caen-Carpiquet et celui de Saint-Gatien.
Il faut permettre le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l’ensemble de ces aéroports. J’ai beaucoup de mal à comprendre que l’on puisse raisonner aéroport par aéroport, aérodrome par aérodrome. Il faut parvenir à une privatisation généralisée, rationalisée et encadrée par l’État.
Quant à l’ouverture des lignes, la décision dépend uniquement de l’État.
Il y a un nationalisme antichinois, et l’on veut en faire une politique. Fermons tout simplement l’ambassade de Chine et celle du Qatar.
Mme Karine Berger. N’exagérons pas !
M. Alain Tourret. S’agissant du choix du gestionnaire, il faut définir un certain nombre de principes, de règles, de garanties. Ayons recours à des conseils de juristes plus avisés que ceux que l’État consulte en général. Je suis surpris de voir, dans l’affaire Ecomouv’ comme dans celle des concessions d’autoroutes, que les batteries d’avocats présentées par le secteur privé l’emportent très largement sur les batteries d’avocats ou de conseils du secteur public. Il faut donc repenser le conseil juridique de l’État. Lorsque je vois qu’il n’y a pas eu de clause d’indexation ou qu’il est impossible de se retirer sans avoir à payer des sommes considérables, je me dis qu’il n’y a pas eu de discussion sérieuse sur le prix.
M. le ministre. Effectivement, on peut contrôler des sociétés, même avec moins de 51 % du capital, surtout quand elles sont cotées.
Je veux revenir sur l’affaire de Toulouse, qui a suscité beaucoup de questions et d’émoi. J’ai cité des chiffres qui montrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une opération de court terme. Quand on a une telle rentabilité et un tel retour, on peut dire que c’est une bonne opération patrimoniale sur le long terme.
C’est aussi une bonne opération industrielle sur le long terme, parce que l’État est un mauvais actionnaire et il est inutile. C’est un actionnaire inutile parce que pour contrôler et réguler, on n’a pas besoin d’être dans le capital et j’ai expliqué pourquoi. Contrairement à ce qu’a dit Mme Berger, on peut avoir, dans des aérodromes privés, des pilotes privés qui soient autorisés...
Mme Karine Berger. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. le ministre. ... mais on ne peut en aucun cas ouvrir une ligne sans l’autorisation de la DGAC.
D’ailleurs, il suffit de discuter avec la plupart des aéroports régionaux pour s’apercevoir qu’ils sont tous en discussion avec la DGAC, qu’ils considèrent comme trop malthusienne en ce qui concerne le développement de leur aéroport. Les élus locaux sont souvent les premiers à vouloir ouvrir des lignes en direction du Golfe ou de l’Asie pour permettre le développement de leur aéroport régional. Mon collègue en charge de l’aviation civile doit gérer cette espèce de conflit d’intérêts qui existe entre le développement des aéroports régionaux et l’intérêt d’Air France et des deux aéroports parisiens.
J’irai même presque jusqu’à dire qu’il y a un conflit d’intérêts patrimonial à rester au capital de ces aéroports régionaux dont nous bridons nous-mêmes, en tant que régulateur, le développement.
C’est donc une bonne opération de long terme même sur le plan patrimonial, compte tenu des valorisations que nous en avons. Elle est d’autant meilleure que ceux que nous faisons entrer au capital ont des projets d’investissement et de développement que nous ne portons pas parce que nous n’aurions pas réinvesti.
Mme Fraysse a rappelé tout ce qui a pu être écrit par certains sites journalistiques sur l’affaire de Toulouse. J’ai beaucoup d’inconfort à considérer qu’il y aurait de bons et de mauvais Chinois.
Mme Jacqueline Fraysse. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. le ministre. Airbus réalise pratiquement 25 % de son chiffre d’affaires en Asie, dont l’essentiel en Chine. L’un des deux investisseurs qui compose le consortium a déjà acheté plus de dix Airbus et passé commande de plus de cent autres. On ne peut pas considérer que cet acteur n’est pas éligible à un investissement en France, mais qu’il serait éligible à un achat.
Mme Karine Berger. Dans ce cas, vendons la Joconde !
M. le ministre. Nous avons obtenu toutes les garanties s’agissant de la société d’acquisition constituée par ce consortium : elle paiera des impôts en France, et il n’y aura pas d’évasion de flux financiers. Mon collègue Michel Sapin et moi-même avons demandé dans la phase finale toutes les garanties et nous les avons obtenues.
Cette société d’acquisition a pris un exploitant, le groupe Lavalin. Ce groupe dont on s’émeut tant gère une quinzaine d’aéroports en province, dont celui de Toulouse-Francazal. Que l’on vienne m’expliquer que nous avons commis une forfaiture en laissant ce gestionnaire d’aéroports en gérer un nouveau et que le fait d’être condamné par la Banque mondiale est un crime irrémédiable ! Je vous invite à consulter la liste des sociétés françaises qui sont dans un cas comparable.
En ce qui concerne les intérêts français et le risque en termes d’intelligence économique, je vous renvoie au numéro du 13 janvier 2015 de La Dépêche où M. Enders, le président du groupe Airbus, se félicite de l’opération.
Nous avons eu plusieurs interactions dans la phase finale avec le groupe Airbus. D’abord, il souhaitait pouvoir conserver l’usage d’un couloir. Cette demande a été respectée. Ensuite, l’un des deux investisseurs, celui qui a acheté les avions, est présent sur le site aux côtés d’Airbus. Toutes les garanties ont été obtenues en termes d’intelligence économique et d’accès au site. La déclaration faite par M. Brégier le montre.
Les récents événements ont montré que les vrais enjeux d’intelligence économique ne sont pas liés au fait d’habiter le hangar d’à côté. Le problème, c’est celui de la cyberattaque et de la cybercriminalité. C’est un enjeu auquel toutes nos sociétés sont confrontées, et même les pouvoirs publics. Quand les Chinois cherchent à obtenir des informations sur nos grands groupes comme des pouvoirs publics, ils ne cherchent pas à acheter le hangar d’à côté mais ils se livrent à des attaques à travers internet, comme ils savent le faire, et comme d’autres pays le font.
Les collectivités locales et les autres opérateurs publics qui restent au capital ont demandé que nous puissions garder à leur côté certains droits de veto sur les opérations critiques. Il a été obtenu dans la négociation finale de pouvoir bloquer toute décision d’investissement structurante. À cet égard, nous vous ferons parvenir ces documents qui n’ont pas été communiqués par la presse. Dans la négociation finale, nous avons obtenu que soient protégés les intérêts des partenaires minoritaires.
Vous m’avez demandé pourquoi Toulouse n’avait pas fait l’objet d’une autorisation. Cela s’explique par le fait que le chiffre d’affaires de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, qui était de 110 millions d’euros, est inférieur au seuil d’autorisation législative, qui était de 150 millions d’euros. Hier, vous avez voté une mesure qui aurait nécessité que l’affaire de Toulouse fasse au préalable l’objet d’une autorisation du Parlement. Nous avons donc procédé à un changement important.
MM. Fromantin et Tourret proposent une politique plus volontariste. Sur un plan intellectuel, je comprends leur raisonnement, ayant moi-même donné la justification de la nature de l’ouverture du capital de ces aéroports. Demander le transfert au secteur privé de la majorité du capital de tous les aéroports régionaux me pose un problème en termes de transparence à l’égard du Parlement parce que cela reviendrait à ce que vous autorisiez aujourd’hui le Gouvernement à privatiser les sociétés qui gèrent les aéroports de Bordeaux, de Montpellier, de Marseille, de Strasbourg et d’outre-mer, avec un débat qui n’aura pas la même nature. Cette année, on veut ouvrir les deux plus gros aéroports régionaux. Quand une autre vague interviendra, il faudra demander une autre autorisation pour mener un débat à la lumière de l’expérience que l’on aura vécue sur les deux aéroports. Ce que nous avons discuté aujourd’hui montre bien que l’expérience toulousaine nous a permis d’enrichir notre approche sur les deux opérations que nous allons conduire.
S’agissant des gares ferroviaires et routières, elles appartiennent à la branche gares et connexions et elles font partie de l’établissement public SNCF Mobilités. L’ouverture du capital que vous proposez supposerait au préalable un aménagement juridique de la forme sociale de ces gares.
Quant aux grands ports maritimes et aux ports décentralisés, ce sont des établissements publics et non des sociétés anonymes dont seul le capital pourrait être ouvert au privé. Il y a donc là aussi une contrainte juridique liée à leur forme. Une fois qu’ils auraient été transformés en société anonyme, si telle était la volonté du Gouvernement, il est évident qu’un projet de loi serait déposé pour demander l’autorisation du Parlement pour en ouvrir le capital.
Je rappelle enfin que la doctrine de l’État actionnaire s’illustre parfaitement pour les autorisations que nous demandons. Nous allons libérer de l’argent qui servira, d’une part, au désendettement de la France – la loi de finances pour 2015 intègre un critère de désendettement de 4 milliards – et à la réduction de la charge que nous faisons peser sur les générations futures, et, d’autre part, à réinvestir ailleurs, parce qu’on ne peut pas avoir de l’ambition pour la puissance publique et considérer qu’elle se financerait de façon spontanée.
Oui, ces cessions d’actifs doivent nous servir pour moitié à réinvestir. Quand on réinvestit dans PSA, quand on peut porter la voix de l’État dans Alstom, quand on investit dans la BPI pour développer des financements et des investissements, c’est parce qu’on a arbitré et cédé d’autres actifs. Quand l’État investit 1 milliard d’euros dans le logement intermédiaire, c’est parce qu’il a procédé à des cessions d’actifs.
La commission rejette les amendements identiques SPE820 et SPE1388.
Puis elle rejette successivement les amendements SPE825, SPE819 et SPE993.
Elle adopte l’amendement SPE1794.
La commission adopte l’article 49 modifié.
*
* *
La commission est saisie des amendements SPE997 et SPE1006 de M. Jean-Christophe Fromantin, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
M. Jean-Christophe Fromantin. Dans le cadre de la discussion de l’article 49, le ministre de l’économie a déjà fourni des éléments de réponse concernant ces amendements, qui visent l’ouverture aux acteurs privés du capital des gares ferroviaires et routières, pour le premier, et des grands ports maritimes, pour le second.
Je ne reviens pas sur la question des gares. En revanche, en ce qui concerne les grands ports maritimes, il me semble que le statut juridique ne peut constituer un obstacle sérieux au moment où nous débattons d’un texte qui vise précisément à surmonter ce type de barrière.
Je rappelle que Rotterdam et Anvers sont les deux premiers ports « français » et que Gênes et Barcelone deviennent des ports majeurs du sud de la France, alors même que notre pays dispose d’une immense façade maritime et de grands ports qui devraient lui permettre de tenir un rôle de premier plan en matière portuaire, d’irriguer son territoire et son économie et de revitaliser son industrie. Nous devons réagir dès lors que les intérêts stratégiques de la France sont en jeu et que la perte de compétitivité de nos grands ports maritimes a des répercussions sur l’ensemble de notre économie.
Les investissements de l’État dans les grands ports maritimes sont aujourd’hui en baisse. Ils ne permettent même plus de draguer les ports afin d’y faire entrer des navires de plus en plus gros. Ce recul des investissements éloigne toujours plus nos ports des standards internationaux. Si l’État est en mesure de jouer son rôle d’investisseur et s’il fait aujourd’hui le choix stratégique d’un accompagnement auquel il a renoncé depuis des années, notre retard peut être rattrapé. Si ce n’est pas le cas, il doit consentir à l’ouverture du capital des grands ports maritimes à des investisseurs privés, comme cela existe déjà pour la manutention et l’outillage, afin de donner au secteur la forte impulsion que le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, appelait de ses vœux mercredi dernier, en séance publique, lors du débat sur la politique maritime de la France. Les ambitions qu’il affichait sont légitimes, encore faut-il que les moyens suivent dans un contexte difficile.
L’amendement SPE1006 s’inscrit parfaitement dans la logique du projet de loi. Il transpose aux grands ports maritimes la dynamique que vous mettez en œuvre pour les aéroports.
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement SPE997. Il ne nous semble pas opportun d’ouvrir le capital des gares ferroviaires qui sont structurellement détenues par l’établissement public de tête.
Concernant l’amendement SPE1006, je me réfugierai d’autant moins derrière l’argument juridique du statut des grands ports maritimes que je tiens le raisonnement de M. Fromantin pour juste, convaincant et parfaitement cohérent avec la démarche que nous avons adoptée concernant les aéroports. Je vais de ce pas demander un rapport à l’Agence des participations de l’État sur les moyens d’aller en ce sens. Je vous invite, monsieur Fromantin, à retirer votre amendement, en m’engageant à vous communiquer ce document pour que nous puissions discuter sérieusement du sujet dans les prochains mois.
L’amendement SPE1006 est retiré.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je suis défavorable à l’amendement SPE997.
Quant à l’ouverture du capital des grands ports maritimes, je suis réservée. En tout état de cause, les parlementaires auront leur rôle à jouer en la matière, l’expérience ayant montré qu’ils savaient imposer des contraintes qui ne sont pas inutiles.
M. Arnaud Leroy. S’agissant de l’investissement dans les ports maritimes, je partage les préoccupations de Jean-Christophe Fromantin : il y a une urgence absolue, notamment en matière d’entretien des voies d’accès et de dragage. Il faudra certainement « mettre la main au porte-monnaie ».
En revanche, je ne suis pas d’accord pour considérer que la propriété publique empêcherait le dynamisme, l’innovation et la puissance. Ainsi, les ports de Rotterdam et d’Anvers qu’il a cités sont détenus par des entités publiques, et, en Espagne, Ports de l’État est une structure nationale de gestion et de régulation qui permet de spécialiser les structures et de distribuer au mieux les investissements.
Je me félicite que le ministre s’empare de ce dossier, car la compétitivité maritime et portuaire est essentielle. La réforme portuaire en cours n’est pas terminée, mais il faut aller plus loin, tout en veillant à ne braquer personne en associant tous les acteurs.
La commission rejette l’amendement SPE997.
*
* *
Section 4
Dispositions diverses
Article 50
(article 31 ter [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)
Obligation de proposer une offre réservée aux salariés
en cas de transfert au secteur privé
Le présent article introduit un nouvel article 31 ter, qui complète le chapitre III du titre III (« Réalisation des opérations ») de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il a pour objet de compléter les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, qui ont rapproché le droit des offres réservées aux salariés dans les sociétés du secteur public de celui applicable aux salariés des autres sociétés. En effet, l’article 41 de cette ordonnance a abrogé toute une série de dispositions, dont l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, qui prévoyait les modalités de mise en œuvre d’offres réservées aux salariés en cas d’augmentation du capital ou de privatisation d’une entreprise publique.
De telles offres étaient soumises à deux restrictions : elles ne pouvaient dans le premier cas avoir pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l’entreprise et, dans tous les cas, la Commission des participations et des transferts pouvait s’opposer à de telles opérations si leurs conditions n’étaient pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.
Le dispositif proposé par ce nouvel article 31 ter vise toutes les opérations de cession de participation par l’État réalisées selon les procédures des marchés financiers entraînant un transfert au secteur privé, et ce, quel que soit le niveau de détention de l’État. Dans de telles hypothèses, la convocation par l’autorité compétente d’une assemblée générale extraordinaire, en même temps que la prochaine assemblée générale et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’opération, est obligatoire. Cette assemblée générale extraordinaire devra se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’article L. 3332-1 du code du travail. Cette obligation ne s’accompagne cependant pas de sanctions en cas de non-exécution.
Il supprime par ailleurs le contrôle de l’État sur les offres réservées aux salariés, même lorsqu’elles conduisent à sa dilution, c’est-à-dire à la réduction de son pourcentage au sein du capital de ces sociétés.
II. LA PROPOSITION DE LA RAPPORTEURE THÉMATIQUE
Même si la rédaction de l’article 50 permet de rétablir la possibilité pour les entreprises privatisées de réaliser une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, elle ne présente pas les mêmes garanties pour les salariés que celui de l’ancien article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.
En particulier, l’obligation de proposer 10 % du montant de la cession aux salariés ou anciens salariés répondant à certains critères, ou 10 % de l’augmentation du capital comme le prévoit l’article L. 3332-19 du code du travail, n’existe plus.
La rédaction de l’article 50 apparaît en conséquence trop restrictive, puisque l’augmentation du capital est décidée, ou non, par l’assemblée générale, qui peut ne pas avoir intérêt à une telle opération. Elle est également en décalage par rapport à la proposition n° 18 du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) (63), qui consiste à prévoir un pourcentage de titres réservé aux salariés ou anciens salariés en cas de cession d’une partie du capital dans les sociétés à participation publique.
L’actionnariat salarié permettant à la fois d’associer plus étroitement les salariés aux évolutions de l’entreprise et la création d’un actionnariat stable, il est proposé de rendre obligatoire une telle offre dans la limite de 10 % de la cession, charge à l’entreprise de consentir des conditions avantageuses pour constituer un tel actionnariat.
À l’initiative du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, la commission a donc adopté un amendement ayant pour objet de rétablir une procédure de cession de titres réservés aux salariés, adhérents d’un plan d’épargne entreprise, en cas de privatisation d’une entreprise selon les procédures des marchés financiers.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques SPE250 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE417 de M. Patrick Hetzel, qui tendent à supprimer l’article.
M. Jean-Frédéric Poisson. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, l’État, quand il cède ses participations, ne prend plus à sa charge l’éventuel écart entre la valeur réelle des actions et leur prix de vente aux salariés. Cela ne contribue pas à favoriser l’actionnariat salarié, dont l’incitation est pourtant une volonté proclamée dans l’exposé des motifs du projet de loi.
L’article 50 ne présente aucune valeur ajoutée : il n’offre aucune garantie supplémentaire par rapport à l’ordonnance ; il ne contraint pas non plus l’État à reprendre à sa charge le comblement entre prix de cession et valeur réelle des actions. Sur la forme, on ne comprend pas non plus qu’on introduise un article 31 ter dans une ordonnance qui ne comporte pas d’article 31 bis. Ce sont autant de raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression.
M. le ministre. Sur la forme, l’article 44 du projet de loi, que nous avons adopté ce matin, introduit dans l’ordonnance du 20 août dernier un article 31 bis relatif aux actions spécifiques de l’État. En toute logique, nous pouvons donc bien rédiger un article 31 ter.
Sur le fond, l’article 50 représente un apport réel par rapport au droit existant, car il rétablit les opérations réservées aux salariés des sociétés du secteur public, que l’ordonnance du mois d’août dernier avait supprimées. Elles se dérouleront désormais dans les conditions du droit commun puisque le financement par l’État de la décote par rapport aux opérations de marché n’existe plus.
Certains d’entre vous souhaitent manifestement rétablir la totalité du dispositif antérieur. Le Gouvernement préfère l’option moins dérogatoire retenue par les rapporteurs, qui oblige l’État à réserver 10 % des actions cédées aux salariés. Nous y reviendrons avec l’amendement SPE1795.
J’espère avoir convaincu MM. Poisson et Hetzel de retirer leurs amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Avis défavorable. L’amendement à venir des rapporteurs va améliorer le dispositif.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le code du travail restreint le bénéfice des opérations réservées aux salariés à ceux qui sont déjà adhérents au plan d’épargne entreprise (PEE) alors qu’à mon sens, tous les salariés devraient en bénéficier. Mon amendement SPE841, qui sera appelé dans quelques instants, vise à introduire cette précision dont je ne vois pas trace dans l’amendement SP1 de Patrick Ollier ni dans celui des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Vous avez bien vu, car elle n’y est pas !
La commission rejette les amendements SPE250 et SPE417.
Elle en vient à l’amendement SPE974 de M. Philippe Vigier, qui peut faire l’objet d’une présentation commune avec l’amendement SPE1795 des rapporteurs, et avec l’amendement SPE841 de M. Jean-Frédéric Poisson.
M. Jean-Christophe Fromantin. L’amendement SPE974 vise à réserver 10 % des actions cédées aux salariés, ce qui constitue une bonne mesure incitative pour les salariés et les anciens salariés du secteur public à prendre des participations dans leurs entreprises.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Malgré un exposé sommaire un peu sévère, l’amendement SPE974 est intéressant, car il vise à promouvoir l’actionnariat salarié. Comme notre amendement SPE1795, il réintroduit le caractère obligatoire de la cession réservée aux salariés. En revanche, contrairement au nôtre, qui ne concerne que les premières, il s’applique indifféremment aux cessions se déroulant selon les procédures des marchés financiers et à celles qui ont lieu hors marché.
M. le ministre. Les amendements SPE974 et SPE1795 visent à réintroduire pour l’État l’obligation, prévue par la loi du 6 août 1986, de réserver 10 % d’actions cédées aux salariés. Dans l’amendement des rapporteurs, qui a notre préférence, le décalage d’une partie du prix de cession de ces actions, qui ne peut être supérieur à 20 %, n’est pas pris en charge par l’État mais par l’entreprise, et seules sont concernées les cessions effectuées selon les procédures de marché.
Monsieur Poisson, vous vous interrogiez sur les salariés bénéficiaires de ces opérations. Le droit actuel prévoit que les offres réservées aux salariés peuvent être proposées à toute personne ayant passé cinq ans dans une entreprise publique. Or, la liste des personnes concernées est souvent très difficile à établir. Votre amendement SPE841 reprend une disposition du code de commerce qui est particulièrement délicate à mettre en œuvre, car elle s’adresse à des salariés qui ont changé d’employeur depuis longtemps.
Pour notre part, nous souhaitons réserver ces opérations aux adhérents au PEE, sachant que l’adhésion y est extrêmement simple et qu’il sera donc très facile d’être éligible pour ces offres. Nous devons être certains que personne ne sera oublié, alors que le champ très large que vous proposez ne peut être couvert pour des raisons pratiques.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je voudrais avoir la certitude que l’annonce officielle de la cession n’empêche pas les salariés d’adhérer au plan d’épargne entreprise.
M. le ministre. Aucune durée d’adhésion au PEE n’est prévue, et il est possible d’y adhérer entre l’annonce de l’opération de cession et son exécution.
L’amendement SPE974 est retiré, de même que l’amendement SPE841.
La commission adopte l’amendement SPE1795.
Puis elle adopte l’article 50 modifié.
*
* *
Article 51
(art. L. 2111-10-1 du code des transports)
Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LE DROIT EN VIGUEUR : L’ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997
Pour la mise en œuvre de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France », les missions et statuts de RFF ont été précisés par un décret du 5 mai 1997. Lors de la création de RFF, la loi avait inscrit à son passif une dette de 134,2 milliards de francs et prévu que les ressources de RFF seraient constituées par les redevances liées à l’utilisation du réseau ferré national et des concours financiers publics – RFF ayant également la possibilité de financer par l’emprunt ses dépenses d’investissement (renouvellement et développement). L’article 4 du décret a posé une règle « prudentielle » visant à encadrer les décisions d’investissement de RFF : elle implique que l’endettement de RFF pour financer un projet ne puisse pas excéder les recettes attendues de ce projet (péages).
L’article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997
relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France
« RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l’économie et du budget un programme d’investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d’investissements peuvent comporter un volet pluriannuel.
« Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d’un dossier indiquant l’objectif du projet, la consistance des travaux, l’évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l’investissement projeté. Les méthodes d’évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d’infrastructure.
« RFF ne peut accepter un projet d’investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l’État, d’une collectivité locale ou d’un organisme public local ou national, que s’il fait l’objet de la part des demandeurs d’un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d’amortissement de cet investissement. (…) »
Le mécanisme ainsi prévu, en principe vertueux, s’est révélé inefficace. En particulier, il n’a pas permis à RFF de refuser des investissements qui, même s’ils avaient un réel intérêt socio-économique, n’étaient pas amortissables en raison d’une surestimation des bénéfices liée à des prévisions de trafic trop optimistes.
Malgré des concours financiers publics cumulés de l’ordre de 13 milliards d’euros par an, et malgré des hausses significatives des péages depuis quelques années, le système ferroviaire français est en déficit annuel de financement, l’endettement de RFF ayant atteint un montant d’environ 34 milliards d’euros fin 2013, et 1,5 milliard d’euros étant dépensés chaque année par RFF en intérêts versés à ses prêteurs. La dégradation de l’état du réseau ferroviaire et le lancement de nombreux projets de développement de ce réseau ont contribué à détériorer gravement la trajectoire financière de l’établissement public.
B. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA RÉFORME FERROVIAIRE (LOI DU 4 AOÛT 2014)
Pour remédier au déséquilibre structurel des comptes de RFF lié essentiellement à sa dynamique d’endettement, la règle prudentielle du décret de 1997 a été inscrite dans la loi et renforcée. C’est l’un des principaux enjeux de la réforme ferroviaire adoptée le 4 août 2014 (loi n° 2014-872), dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
L’article 2 de la loi du 4 août 2014 a créé SNCF Réseau, établissement public en charge de l’infrastructure ferroviaire, par regroupement de RFF, SNCF-Infra et de la direction de la circulation ferroviaire. Le « gestionnaire d’infrastructure unifié » ainsi créé constitue l’un des trois EPIC formant le groupe public ferroviaire (SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau). Le législateur a assorti cette création de plusieurs garde-fous, définis par les articles L. 2111-10 et L. 2111-10-1 du code des transports.
L’article L. 2111-10 du code des transports prévoit ainsi :
– un contrat décennal actualisé tous les trois ans liant SNCF Réseau et l’État, déterminant notamment les objectifs de performance, les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau, les moyens financiers alloués aux différentes missions de l’établissement, les principes de fixation de la tarification des péages...
– une mission de surveillance de la trajectoire financière de SNCF Réseau confiée au régulateur (l’Autorité de régulation des activités ferroviaires – ARAF) ;
– un principe de répercussion du coût complet de l’infrastructure sur les péages : la loi a posé « l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État ». Le « coût complet » est défini par la loi, pour un état donné du réseau, comme « l’ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l’exploitation, à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure, y compris l’amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis ».
D’autre part, en ce qui concerne les investissements de SNCF Réseau, l’article L. 2111-10-1 instaure :
– une règle prudentielle renforcée pour les investissements de développement du réseau ferré national ;
– un contrôle ex ante par l’ARAF de l’équilibre économique prévisionnel de tout projet d’investissement dont la valeur excède un seuil (qui sera fixé par décret).
L’article L. 2111-10-1 établit une distinction entre les investissements de maintenance du réseau ferré, qui doivent être financés selon les modalités que fixera chaque contrat décennal État-SNCF Réseau, et les investissements de développement. Il prévoit que ces investissements « seront évalués au regard de ratios définis par le Parlement », et que, en cas de dépassement de ces ratios, les projets d’investissement ne pourront être réalisés que si la personne publique qui demande leur réalisation apporte elle-même l’intégralité des financements nécessaires. C’est cette exigence qui constitue l’innovation majeure du dispositif par rapport au décret du 5 mai 1997. Si les ratios ne sont pas dépassés, les autorités publiques demandeuses devront néanmoins fournir les concours financiers propres à éviter toute conséquence négative de l’investissement envisagé sur les comptes de SNCF Réseau au terme de sa période d’amortissement.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI
Comme prévu par la loi du 4 août 2014, le législateur doit définir, pour permettre la mise en œuvre de la nouvelle règle prudentielle applicable aux investissements de développement du réseau ferré national, quels ratios vont être utilisés comme critères d’évaluation des projets d’investissements.
Le présent article propose qu’un unique ratio soit retenu : le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. Il propose également de renvoyer à un décret les modalités d’application de cette disposition, notamment le mode de calcul des éléments du ratio et son niveau plafond. Le Gouvernement fait valoir que ce ratio est le plus simple et le plus pertinent pour mesurer la capacité de SNCF Réseau à s’endetter de manière soutenable.
La rapporteure thématique propose d’adopter l’article 54 moyennant deux modifications rédactionnelles.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques SPE251 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE418 de M. Patrick Hetzel, qui tendent à supprimer l’article.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne dénoncerai pas indéfiniment la mécanique consistant à nous faire voter des dispositions qui en modifient d’autres entrées en vigueur il y a six mois.
M. le ministre. Le projet de loi portant réforme ferroviaire, dans la version déposée au Parlement, prévoyait que les ratios à respecter en vue de maîtriser la dette de SNCF Réseau seraient fixés par décret. Le Parlement a souhaité que ces ratios relèvent plutôt de la loi. La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire précise ainsi que « les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement ».
Le Gouvernement souhaite répondre à la demande du Parlement en proposant de retenir un ratio unique correspondant au rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. La mise en œuvre de cette « règle d’or » du financement du secteur ferroviaire doit intervenir rapidement compte tenu de l’importance des enjeux liés à la maîtrise de la trajectoire financière du secteur. Cette règle d’or permettra d’encadrer la contribution de SNCF Réseau consacrée aux projets de développement du réseau et de concentrer son effort d’investissement sur le réseau existant, limitant ainsi la dérive d’un endettement qui progresse actuellement au rythme de 3 milliards d’euros par an.
Actuellement en cours de discussion, le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau sera transmis au Parlement avant sa signature, conformément à la même loi. Il déterminera notamment la trajectoire financière de SNCF Réseau, et il permettra de préciser l’impact de la règle d’or que nous vous proposons d’adopter aujourd’hui.
À défaut d’un retrait des amendements de suppression, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Ce nouveau ratio est certes plus simple que les précédents, mais je ne suis pas convaincu qu’il soit plus pertinent. Je crains qu’il ne se révèle un peu fruste pour mesurer la capacité de l’établissement à s’endetter.
M. le ministre. Ce ratio, qui prend en compte la marge opérationnelle de SNCF Réseau, permet de limiter l’endettement pour les investissements nouveaux mais pas pour la maintenance.
Nous sommes confrontés à des injonctions contradictoires : la SNCF doit investir pour la maintenance, elle doit consentir des investissements nouveaux, et, dans le même temps, tenir une trajectoire financière. L’objet de la règle d’or est de rendre ces objectifs compatibles, la primauté étant donnée à l’investissement en matière de maintenance. Les ratios précédents plus complexes permettaient de piloter divers paramètres ; celui-ci répond précisément aux objectifs définis par la loi.
L’amendement SPE418 est retiré.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la commission rejette l’amendement SPE251.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels SPE1469 et SPE1471 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 51 modifié.
*
* *
Article 52
(article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014)
Applicabilité de l’exemption transitoire à l’obligation de déposer une offre publique d’achat du fait de l’attribution de vote double
Le présent article vise à rectifier l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, qui a généralisé les droits de vote double dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé au bénéfice des actions détenues depuis deux ans au moins par le même actionnaire.
Le V de cet article 7 est un dispositif transitoire visant à neutraliser les effets de l’acquisition du vote double à l’égard de l’obligation de déposer une offre publique d’achat. Il prévoit un dispositif de dérogation temporaire à l’obligation de déposer une offre, pour les actionnaires qui passeraient en deçà du seuil de 30 % des droits de vote avant de revenir au-delà grâce à l’attribution de droits de vote double, tout en restant en deçà du pourcentage de droits de vote détenus à la date d’entrée en vigueur de l’article (le 2 avril 2014). Toutefois, la rédaction actuelle de la loi prévoit que cette dérogation n’est valable que pour les deux années qui suivent son entrée en vigueur, donc jusqu’au 2 avril 2016. Or, les droits de vote double ne sont acquis qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, de sorte que la dérogation prévue ne peut s’appliquer. Le texte étend en conséquence la période d’application de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, ce même V vise le cas d’une obligation de déposer une offre publique d’achat en raison du franchissement du seuil des trois dixièmes (30 %) mais n’intègre pas la dérogation en cas de franchissement du seuil de l’excès de vitesse, fixé à un centième d’augmentation par an. En effet, l’article 6 de la loi du 29 mars 2014 précitée a modifié l’article L. 433-3 du code monétaire et financier pour rendre obligatoire le dépôt d’une offre publique d’achat par tout actionnaire augmentant sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un centième du capital.
Ainsi, selon l’étude d’impact du projet de loi (64), « il n’est pas certain à ce jour qu’elle puisse s’appliquer à d’autres situations que celle d’un actionnaire entre 30 et 31 % de détention du capital ou des droits de vote, qui franchirait à la baisse le seuil de 30 %, puis à nouveau à la hausse du fait de l’attribution de droits de vote double, tout en demeurant finalement sous le pourcentage de droits de vote détenu au 2 avril 2014 ».
Il est donc proposé d’élargir le délai d’application de cette disposition transitoire et dérogatoire de sorte qu’elle puisse effectivement s’appliquer. Il est prévu d’élargir la dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat aux personnes qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent leur détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.
Il apparaît toutefois que la rédaction proposée par l’article 52 n’interdit pas à l’actionnaire bénéficiant de la dérogation d’augmenter sa détention en droits de vote au-delà de sa détention initiale au 2 avril 2014, au cours de la période de la dérogation, soit du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018. La seule condition posée étant en effet que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.
Il s’agit d’un effet non souhaité par le législateur, qui pourrait être contraire au bon fonctionnement des marchés financiers. L’objectif poursuivi par la rapporteure thématique est de fixer une condition pour l’ensemble de la période de la dérogation temporaire. L’actionnaire bénéficiaire ne doit pas pouvoir augmenter sa détention en droits de vote sur l’ensemble de la période, du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018. Celle-ci doit toujours être inférieure ou égale à celle constatée le 2 avril 2014.
À l’initiative du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, la commission a donc adopté un amendement en ce sens.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1534 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’article 52 permet à l’actionnaire bénéficiant de la dérogation d’augmenter sa détention en droits de vote au-delà de sa détention initiale au 2 avril 2014 sur l’ensemble de la période de la dérogation, soit du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018, avec pour seule condition que « le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014 ». Il s’agit d’un effet non souhaité de la rédaction proposée. L’objectif est de fixer une condition pour l’ensemble de la période de la dérogation temporaire, pas de permettre à l’actionnaire bénéficiaire d’augmenter sa détention en droits de vote. Celle-ci doit toujours être inférieure ou égale à celle constatée le 2 avril 2014.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1534.
Puis elle adopte l’article 52 modifié.
*
* *
Article 53
(article L. 433-1-2 du code monétaire et financier)
Renforcement du dispositif anti-« excès de vitesse » en matière d’augmentation de détention du capital ou des droits de vote
Cet article a pour objet de rectifier une malfaçon de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, en matière de lutte contre les prises de contrôle rampantes.
Le 2 du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-384 précitée, prévoit que l’initiateur d’une offre publique d’achat devenue caduque, si sa détention préalablement à la situation d’offre obligatoire était comprise entre 30 et 50 % du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est privé des droits de vote attachés aux actions pour la fraction excédant « le nombre d’actions qu’il détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté de 1 % du capital ou des droits de vote de la société ».
Or, la privation des droits de vote devrait porter sur la fraction excédant le nombre d’actions qu’il détenait préalablement à la situation d’offre obligatoire, c’est-à-dire avant l’excès de vitesse ayant déclenché l’OPA, de sorte que ce dispositif soit cohérent avec l’objectif de limiter l’emprise d’un actionnaire qui, à l’issue de son offre publique, n’a pas atteint la majorité du capital ou des droits de vote de la société concernée.
L’étude d’impact du projet de loi (65) cite l’exemple d’un initiateur qui dispose de 35 % du capital et des droits de vote d’une société et qui réalise l’achat d’un bloc de 5 % pour atteindre ainsi 40 % ; il doit donc déposer une offre du fait du dépassement du seuil d’excès de vitesse. S’il n’atteint que 45 % du capital de la cible à l’issue de l’offre, celle-ci devient caduque. Selon la rédaction actuelle de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, la participation de l’initiateur reviendra alors au nombre d’actions détenues « préalablement au dépôt du projet d’offre augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote », soit à 41 % de capital. Or, toujours selon l’étude d’impact, la volonté du législateur était que cette participation revienne à 36 %, qui correspondent à sa détention initiale augmentée de 1 % constitutif de l’excès de vitesse.
L’article propose en conséquence de substituer, au quatrième alinéa de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, à la référence à la « quantité excédant le nombre d’actions détenu préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » celle de « quantité excédant le nombre d’actions détenu préalablement au franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote ». Le point de référence est ainsi décalé en amont.
La commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1535 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 53 modifié.
*
* *
Article 53 bis
Changement de dénomination de BPI-Groupe
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet le changement de dénomination de « BPI-Groupe », institué par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement. La nouvelle dénomination proposée est « Bpifrance », plus conforme à l’identité visuelle, à l’image et au logo développés par la Banque publique d’investissement depuis sa création et permet également d’éviter tout risque de confusion avec les entités préexistantes.
*
* *
La commission en vient à l’amendement SPE1547 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Il s’agit de modifier la dénomination de BPI-Groupe, institué par la loi du 31 décembre 2012 créant la Banque publique d’investissement, et de le désigner sous le nom de « Bpifrance », qu’utilisent aujourd’hui l’ensemble des entreprises et des acteurs concernés.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1547.
*
* *
Article 53 ter
(article 40-1 [nouveau] de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013)
Habilitation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques
À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement ayant pour objet d’habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques et prononcer à l’égard de ces mêmes entreprises une amende administrative.
L’objectif général de réduction des délais de paiement, auquel s’est engagé le Gouvernement dans le « Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi » de novembre 2012, qui a été réaffirmé dans le « Plan pour le renforcement de la trésorerie des entreprises » de février 2013, s’est déjà traduit par plusieurs mesures.
Parmi celles-ci, les modifications apportées au code de commerce par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui est notamment venue renforcer le dispositif de sanctions, afin de permettre à l’autorité compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à un traitement rapide des manquements et infractions relevés en la matière.
Par ailleurs, le titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique transposent la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette directive étend les délais applicables dans le cadre de la commande publique à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit de l’Union européenne, dont les grandes entreprises publiques. Le décret du 29 mars 2013 fixe les délais à soixante jours pour les entreprises publiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs.
Toutefois, le contrôle du respect de ce délai de paiement par les entreprises publiques est effectué par le contrôle général économique et financier (CGEFI) et les juridictions financières, Cour des comptes et chambres régionales des comptes, uniquement dans le cadre d’un contrôle global sur la gestion économique et financière de ces établissements. La DGCCRF, compétente en matière de loyauté et de transparence des relations commerciales, n’est habilitée à contrôler que le respect des dispositions du code de commerce ; elle n’est donc pas compétente pour contrôler les délais de paiement pratiqués par ces établissements.
En outre, les dispositions relatives aux délais de paiement dans la commande publique ne prévoient aucune sanction, en cas de retard de paiement, autre que le paiement, de plein droit et sans formalité, d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Aussi, pour compléter le dispositif de lutte contre les retards de paiement par les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, le présent amendement prévoit l’habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques et leur confère la faculté de prononcer à l’égard de ces mêmes entreprises une amende administrative.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1536 des rapporteurs.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Cet amendement s’inscrit dans l’objectif général de réduction des délais de paiement auquel s’est engagé le Gouvernement. Afin de compléter le dispositif de lutte déjà en vigueur contre les retards de paiement par les entreprises, il est prévu d’habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques. Il leur est également donné la possibilité de prononcer une amende administrative à l’encontre de ces mêmes entreprises.
M. le ministre. Avis favorable à cet amendement extrêmement important. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avait accru la capacité de la DGCCRF à sanctionner les paiements tardifs des entreprises sans toutefois l’étendre aux entreprises publiques. C’est chose faite avec l’amendement.
Mme Karine Berger. En cas de paiement hors délai, les entreprises privées peuvent imposer des pénalités de retard à leurs clients. Or, celles qui ne le font pas sont susceptibles de se le voir reprocher par l’administration fiscale, redressement fiscal à l’appui. Même minime, à raison d’une quarantaine d’euros par facture, cela peut aller loin en cas de règlements tardifs nombreux. Du reste, c’est un problème que le redressement fiscal pèse sur celui qui subit les délais de paiement. Je déposerai un amendement sur le sujet d’ici à la séance publique mais, en tout état de cause, il faut éviter d’adopter une disposition qui poserait le même problème aux entreprises publiques.
M. le ministre. À mon sens, l’amendement ne devrait pas avoir cet effet. Il n’en demeure pas moins que vous avez raison d’évoquer cette difficulté. A priori, si vous déposiez un amendement sur le sujet, le Gouvernement y serait favorable.
Les retards de paiement sont un véritable fléau, en particulier pour les petites et les moyennes entreprises (PME) mais aussi pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ils sont souvent le fait des grands groupes publics ou privés. Tout ce que nous pourrons faire pour y remédier ira dans le bon sens.
M. Olivier Carré. Est-il prévu que l’État s’engage sur ses propres délais de paiement ? Certaines administrations, comme l’armée ou l’éducation nationale, ont fréquemment recours à des sous-traitants, qui nous font souvent part d’expériences assez négatives en la matière. Si l’État a affirmé sa volonté de ramener ses délais de paiement dans un premier temps à trente jours, puis à vingt jours, dans les faits, ceux-ci ont plutôt eu tendance à augmenter. Le Gouvernement reste-t-il vigilant ? La question est-elle traitée au niveau interministériel ?
M. le président François Brottes. Le médiateur national des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance, que nous auditionnons souvent, nous a confié qu’il était très fréquemment sollicité pour des retards de paiement de la part des collectivités locales et de l’État.
M. le ministre. Pour ce qui concerne l’État, un gros travail a été entrepris pour améliorer la situation et une réelle transparence est assurée grâce à l’Observatoire des délais de paiement. Les chiffres et les analyses montrent que les principales difficultés se situent du côté des hôpitaux, des collectivités locales et de l’armée.
M. Francis Vercamer. Le Trésor public aussi ! Même si les maires le mandatent en temps utile, il met parfois quatre à cinq mois pour régler les entreprises. Or, la loi rend l’ordonnateur responsable d’un acte de paiement qu’il n’effectue pas lui-même.
M. Alain Tourret. L’amende sera-t-elle prononcée pour une période couvrant plusieurs marchés ou bien marché par marché ?
M. le ministre. La pression est mise sur l’État par la transparence, et chacun, du Trésor public comme de l’ordonnateur, a sa part de responsabilité. Il faut bien avouer que les délais de paiement sont souvent liés aux problèmes budgétaires que rencontrent différents ministères. Il n’en demeure pas moins que certains retards sont abusifs. Je ne vois pas, pour l’instant, de piste possible.
En tout cas, la DGCCRF ne peut pas intervenir sur ce plan. Ce que comble l’amendement, c’est un vide en matière de contrôle et de sanction vis-à-vis des entreprises publiques. Rien ne justifiait que la DGCCRF n’ait pas, à cet égard, la même compétence que pour les entreprises privées. Je suis preneur d’une réflexion collective sur ce problème des délais de paiement excessifs de la sphère publique.
Monsieur Tourret, les sanctions prévues par la loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », sont prononcées contrat par contrat.
La commission adopte l’amendement SPE1536.
*
* *
Elle examine l’amendement SPE1019 de M. Jean-Yves Caullet.
Mme Corinne Erhel. Afin de faciliter l’innovation dite « de rupture », souvent portée par les jeunes entrepreneurs, cet amendement propose d’expérimenter un nouveau type de financement fondé sur un co-investissement public-privé entre l’État, ses opérateurs, et des référents-investisseurs privés reconnus au sein de leurs écosystèmes. Les entrepreneurs du numérique sont souvent considérés par les créateurs et fondateurs de start-up innovantes comme des interlocuteurs naturels partageant la connaissance du secteur, des réalités du terrain et des difficultés de financement.
Dans le cadre de l’expérimentation, les entrepreneurs et financeurs référents orienteraient les investissements de l’État qui s’engagerait, dans une limite définie par décret, à investir un euro pour chaque euro qu’eux-mêmes investiraient dans les projets. Un comité de pilotage regroupant les représentants des fonds et institutions publics concernés par écosystème validerait les investissements, sur proposition des référents privés.
M. le ministre. La BPI fonctionne déjà en grande partie selon cette logique, comme en témoigne sa participation à certains fonds privés, à la French Tech ou encore à des mécanismes de cofinancement public-privé semblables à ce que propose l’amendement. Observant les règles de l’investisseur avisé, elle est souvent conduite à investir aux côtés d’investisseurs privés sur les nouvelles situations, intervenant parfois dans une dynamique de levier. Ces mécanismes sont également à l’œuvre dans plusieurs dispositifs des programmes d’investissement d’avenir, ainsi que dans le fonds de cofinancement de nos start-up par les sociétés d’investissement de business angels (SIBA) en cours d’élaboration – comme dans votre amendement, il s’agira d’un mécanisme d’investissement à un euro pour un euro.
L’action de la BPI, de plus en plus tournée vers les mécanismes de cofinancement, donne satisfaction à l’esprit de votre amendement, que je vous suggère de retirer. Le Gouvernement estime qu’il est possible de faire plus pour le financement des industries technologiques, et nous continuerons à être collectivement vigilants en matière de co-investissement public-privé.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. J’étais tentée de donner un avis favorable à cet intéressant amendement afin que nous puissions continuer à travailler sur le sujet d’ici à la séance publique.
M. Olivier Carré. La France a l’occasion d’effectuer un choix fort en termes de financement de la nouvelle économie : soit nous optons pour des déductions fiscales qui laissent toutes leurs marges de manœuvre aux investisseurs privés, soit l’argent public est directement investi conjointement aux ressources privées. En privilégiant cette dernière solution, nous assumons notre singularité par rapport à nos partenaires européens comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni.
Membre du comité de surveillance des investissements d’avenir, je confirme que de nombreux fonds, souvent gérés par la Caisse des dépôts et consignations, permettent d’abonder les initiatives privées. En revanche, les collectivités locales ne peuvent que très difficilement accompagner ces initiatives en raison de l’extrême complexité des mécanismes à mettre en œuvre.
M. le ministre. Je suis sensible au cofinancement. C’est dans cet esprit que nous avons créé hier les sociétés de libre partenariat (SLP). À mon sens, les objectifs visés par l’amendement doivent être atteints grâce au pilotage de la BPI. Je suis moins à l’aise avec l’inscription dans la loi d’un engagement d’investissement d’un euro pour un euro, qui aurait un coût budgétaire. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Mme Erhel de bien vouloir retirer son amendement.
M. Olivier Carré. L’amendement n’a pourtant pas été déclaré irrecevable financièrement !
M. le président François Brottes. La recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution est examinée avec une plus grande tolérance dès lors qu’un amendement propose une expérimentation qui se déroule dans certaines conditions.
Mme Corinne Erhel. L’idée était d’expérimenter un dispositif plus réactif et décentralisé que ceux qui existent déjà, et capable d’intervenir dans tous les écosystèmes régionaux – hors des grandes métropoles, il est souvent difficile de trouver des systèmes d’accompagnement. L’association des créateurs de start-up au comité de pilotage chargé de détecter et de sélectionner les projets me semblait constituer une idée nouvelle. Si le ministre me garantit que cela existe déjà, je suis évidemment prête à retirer l’amendement.
M. le ministre. Je peux vous garantir que nous avançons sur cette voie. Peut-être pourrions-nous demander à la mission d’information de votre assemblée sur la BPI de vérifier ce qu’il en est. Si ses conclusions étaient négatives sur ce point, je m’engage à y revenir par la loi.
Mme Corinne Erhel. Les acteurs économiques de terrain sont demandeurs, et le fonctionnement et la réactivité des dispositifs doivent être regardés de près. J’accepte cependant de retirer l’amendement.
M. le président François Brottes. Les plateformes de développement économique territorial, qui apportent déjà des réponses de ce type sans pour autant entrer au capital, pourraient également évoluer.
L’amendement SPE1019 est retiré.
*
* *
Article 54
(article L. 592-28-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Activités internationales de l’Autorité de sûreté nucléaire
Cet article vise à donner un fondement législatif solide aux activités de conseil et d’appui de l’Autorité de sûreté nucléaire auprès des institutions homologues étrangères. Il vise également à lui permettre, sur saisine de l’autorité administrative, de se prononcer sur les options de sûreté retenues pour des modèles de réacteur ou d’installation destinés à l’exportation.
I. LE DROIT EXISTANT
Conformément aux dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN »), que l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement a codifiées au titre IX du livre V du code de l’environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante, est chargée au nom de l’État du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires civiles.
Le parc que contrôle l’Autorité est l’un des plus importants au monde, puisqu’il comprend un ensemble standardisé de cinquante-huit réacteurs qui produisent l’essentiel de l’électricité consommée en France, un réacteur de type EPR en construction à Flamanville, plusieurs réacteurs en démantèlement, ainsi que différentes installations du cycle du combustible, des usines et des équipements de recherche. L’Autorité assure également le contrôle de plusieurs milliers d’installations ou d’activités où sont utilisées des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, industrielles ou de recherche. Elle est de surcroît chargée de la veille en radioprotection, ce qui la conduit – avec l’appui de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – à organiser la surveillance radiologique de l’environnement et la surveillance des expositions des travailleurs et de la population aux rayonnements ionisants, comme les expositions médicales et les expositions au radon.
Les activités internationales de l’ASN prévues par la législation en vigueur relèvent aujourd’hui de deux missions principales :
– d’une part, une mission de proposition, puisqu’il appartient à l’Autorité d’adresser au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence ;
– d’autre part, une mission de représentation, puisque l’Autorité participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
Ces missions de proposition et de représentation ne donnent néanmoins qu’une vision très incomplète des activités internationales de l’Autorité. Le rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2013, publié par l’Autorité au printemps 2014, atteste en effet que ces activités sont nombreuses et qu’elles se déploient selon plusieurs axes et différentes modalités :
– au sein de l’Union européenne, dans le cadre du Groupe des chefs d’autorités de sûreté européens (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG), des groupes de travail du traité Euratom, de l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaires des pays d’Europe de l’Ouest (Western European Nuclear Regulators’ Association, WENRA) et de l’Association des responsables des autorités européennes compétentes en radioprotection (Heads of the European Radiation protection Competent Authorities, HERCA) ;
– au plan multilatéral, au sein notamment de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (66), de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), du Comité scientifique des Nations unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR), de l’Association internationale des responsables d’autorités de sûreté nucléaire (International Nuclear Regulators’ Association, INRA) ou de l’Association des autorités de sûreté nucléaire des pays exploitant des centrales de conception française (Framatome Regulators, FRAREG) ;
– au plan bilatéral, dans le cadre d’échanges de personnel entre l’autorité de sûreté et ses homologues étrangères ou dans celui d’actions de coopération et d’assistance.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
L’article L. 592-28-1 nouveau s’insérerait dans une section du code de l’environnement consacrée aux attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire ne relevant pas de son pouvoir de décision ou de ses missions de contrôle.
— L’alinéa 1er pose le principe selon lequel l’ASN coopère, dans ses domaines de compétence, avec les autorités compétentes des autres États.
Cet alinéa prévoit également que, sur demande de ces autorités de sûreté nationales, l’autorité de sûreté française puisse fournir des prestations de conseil et mener des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
Il s’agit donc de donner un fondement législatif solide à des activités et des actions de coopération déjà largement pratiquées.
À titre d’exemple, en 2013 et à leur demande, l’ASN a ainsi établi des contacts avec les autorités de sûreté de pays – notamment l’Arabie saoudite, la Turquie et le Vietnam – qui ont décidé de s’engager dans un programme électronucléaire ou qui sont désireux de connaître les mesures à mettre en place en matière de sûreté (mise en place d’une infrastructure réglementaire et de contrôle de la sûreté nucléaire), s’ils devaient décider de faire le choix de cette source d’énergie.
Conformément à la ligne de conduite qu’elle s’est fixée, l’ASN répond à ces sollicitations dans le cadre d’actions bilatérales avec l’autorité de sûreté du pays concerné, en complément des instruments européens (Instrument financier de coopération en matière de sûreté nucléaire de l’Union européenne) et internationaux (Regulatory Cooperation Forum de l’AIEA) susceptibles d’être mobilisés. L’objectif de cette coopération est d’acquérir, dans les pays bénéficiaires, la culture de sûreté et de transparence indispensables à un système national de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
— L’alinéa 2 prévoit que, sur saisine de l’autorité administrative et aux frais de l’entreprise intéressée, l’Autorité de sûreté nucléaire examine la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux exigences s’appliquant en France pour le même type d’installation.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement affiche l’ambition de développer et de soutenir une filière nucléaire dynamique à l’exportation, qui soit fondée sur le plus haut niveau de sûreté et la compétitivité de son offre et qui soit également source de retombées économiques substantielles sur le territoire national, en particulier en matière d’emplois. Après l’accident de Fukushima, la majorité des pays qui envisageaient de recourir à une part d’énergie nucléaire dans leur mix énergétique ont replacé la sûreté nucléaire parmi les critères déterminants du choix de leur technologie. Alors que la filière française rencontre une concurrence qui s’est intensifiée depuis 2011, la promotion des technologies les plus sûres constitue un facteur différenciant sur lequel l’offre nationale peut se mettre en valeur à l’exportation.
Si la possibilité de soumettre les modèles de réacteurs ou d’installations à un examen rigoureux, attestant que la France promeut bien les technologies les plus sûres, se justifie donc pleinement, il convient en revanche que le dispositif proposé ne laisse aucun doute quant à l’indépendance des avis rendus. Tel ne serait sans doute pas le cas si les relations entre l’autorité de sûreté, les fabricants et les exploitants s’écartaient du cadre aujourd’hui normé par les lois et règlements en vigueur et faisaient une place, même limitée, à des relations de type commercial ou contractuel.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Sur proposition du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, la commission a tout d’abord adopté un amendement de précision, destiné à corriger une erreur de référence.
Elle a estimé opportun que l’Autorité de sûreté nucléaire, sollicitée par l’institution homologue d’un pays étranger dans le cadre d’échanges et de coopérations, puisse conserver un pouvoir d’appréciation sur les modalités du conseil et de l’appui technique fournis.
Pour ce qui concerne l’examen de conformité des options de sûreté de modèles d’installation nucléaire destinés à l’exportation, la commission a souhaité que l’Autorité de sûreté puisse être saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 592-29 du code de l’environnement – c’est-à-dire par le Gouvernement, mais également par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Elle a également considéré que la mention d’un financement de cet examen par l’entreprise intéressée devait être supprimée, l’introduction d’une telle relation financière directe entre le demandeur et l’autorité chargée du contrôle étant de nature à introduire un doute sur l’impartialité de l’avis rendu par celle-ci.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1436 de M. Denis Baupin, qui tend à supprimer l’article.
M. Denis Baupin. J’appelle l’attention du Gouvernement et des parlementaires sur le fait qu’en adoptant l’article 54, nous mettrions le doigt dans un engrenage dangereux qui pourrait remettre en cause l’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cet article comporte, en effet, deux dispositions qui permettraient à cette autorité de chercher les financements dont elle a besoin grâce à des « contrats » extérieurs.
Un premier alinéa vise la coopération de l’ASN avec ses homologues étrangers. Les revues entre pairs existent déjà – et nous ne contestons pas leur utilité – mais certains propos invitent à la prudence en la matière. C’est ainsi que le précédent président de l’ASN, M. André-Claude Lacoste, devant la commission des affaires économiques, en juillet 2012, a reconnu qu’il savait – longtemps avant la catastrophe de Fukushima et parce que l’Autorité avait été mandatée pour une revue par les pairs au Japon – que « le modèle japonais de contrôle de sûreté nucléaire ne fonctionnait pas ». Á cette époque, AREVA envoyait pourtant du MOX en provenance de La Hague à Fukushima. M. Lacoste a encore admis : « Nous avons adouci notre propos suite à des discussions compliquées avec les autorités japonaises [...] » Permettez-moi de souligner la gravité de ces paroles : l’Autorité de sûreté nucléaire française a officiellement et publiquement laissé entendre que la sûreté nucléaire japonaise fonctionnait, alors qu’elle savait manifestement que ce n’était pas le cas.
Sachant ce qui s’est produit quelques mois après ce contrôle, nous voyons bien les limites de l’exercice des revues entre pairs, lorsque ces derniers veulent éviter de porter un jugement trop négatif sur leurs homologues. Si, en plus de cela, nous introduisions dans le code de l’environnement une disposition permettant à l’ASN d’être financée pour des prestations de conseil et des missions d’appui technique, le risque que son indépendance en pâtisse serait réel.
Le second alinéa pose encore plus problème. Il dispose que l’ASN « examine la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux exigences s’appliquant en France pour le même type d’installation. Les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise intéressée. » Il me semble légitime que l’autorité de sûreté française, qui est l’une des meilleures au monde, s’intéresse aux exportations de centrales nucléaires françaises. À mon sens, elle devrait même se préoccuper de la sécurité des installations, sachant que nous envisageons de vendre des centrales en Jordanie, en Turquie ou en Inde, pays où la stabilité politique n’est pas toujours parfaite et où les risques de violence existent – je ne parle même pas de la situation actuelle en Ukraine.
Je souligne tout d’abord que l’ASN n’est pas un bureau d’études – l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) aurait parfaitement pu tenir ce rôle. C’est une autorité qui a pour vocation de prendre des décisions. Or, rien dans la rédaction de l’article 54 ne précise ce qu’il sera fait de ses avis, ni s’ils seront suivis, et l’on ne lui donne pas les moyens de s’opposer à l’exportation d’une centrale nucléaire. Je relève ensuite que l’autorité sera rémunérée par l’entreprise concernée : autrement dit l’ASN, qui doit être totalement indépendante des entreprises qu’elle contrôle, comme EDF ou AREVA, deviendra en quelque sorte la cliente de ces dernières. Je ne prétends pas que ces dispositions aient été rédigées dans cet esprit ; il n’en demeure pas moins qu’elles affaiblissent l’autorité et l’indépendance de l’ASN.
Nous demandons en conséquence la suppression de cet article.
M. le président François Brottes. L’ASN a incontestablement gagné en éthique et en indépendance sous la présidence de M. André-Claude Lacoste, qui n’hésite pas à s’exprimer, comme vous l’avez constaté.
M. Denis Baupin. Vous avez raison. J’ai néanmoins été très choqué en entendant ses propos en commission.
M. le ministre. Je suis sensible aux problèmes soulevés par M. Baupin. Avant d’entrer dans le détail de l’article 54, rappelons la situation actuelle.
Aujourd’hui, l’industrie nucléaire, qui fait travailler plusieurs milliers de Français, est soumise à une compétition féroce de la part d’autres opérateurs internationaux pour la vente de centrales à l’export. Des interrogations légitimes se sont fait jour, notamment dans le cadre du Comité de politique nucléaire, à propos des standards de sûreté de certaines d’entre elles. La volonté du Gouvernement est de garantir que le niveau de sûreté de ces centrales est identique à celui de celles que nous construisons en France. Dans la bataille économique, la sûreté est aussi un élément de compétitivité, beaucoup de pays étant devenus très sensibles à ce critère.
Ce que nous proposons dans cet article, c’est d’organiser le cadre dans lequel l’ASN pourrait opérer à l’export et d’améliorer l’existant. Nous pouvons nous accorder sur le fait que, si l’ASN certifiait ces projets, ce serait un mieux par rapport à la situation actuelle où il est difficile de contrôler la bonne application des règles. Rappelons que, lors de la vente aux Turcs du projet ATMEA, l’ASN a émis un avis qui a été rémunéré par AREVA.
S’agissant de l’indépendance des membres de l’Autorité, il me semble qu’elle est garantie par le niveau de leurs rémunérations – dans le cadre des plafonds d’emplois fixés sous votre contrôle collectif – et par les critères qui président à leur nomination. Aucun ne peut être soupçonné d’avoir un intérêt personnel à rechercher tel ou tel contrat.
Vous avez plus particulièrement pointé deux sujets d’inquiétude.
Le premier est la possibilité offerte à l’ASN d’être défrayée par une autre autorité de sûreté. Je préfère que cette disposition soit conservée dans le texte, car cela nous placerait sinon dans une situation difficile. Le président Brottes a souligné l’autorité morale de M. André-Claude Lacoste et je ne peux imaginer que l’ASN serait susceptible de rendre des rapports différents si elle était défrayée. Un aménagement, d’ailleurs proposé par un amendement du rapporteur général, pourrait toutefois consister à donner la possibilité à l’ASN de refuser la sollicitation d’une autre autorité. Cela répondrait à une partie des préoccupations, de M. Baupin, me semble-t-il.
Le second sujet est la possibilité offerte à l’ASN d’être défrayée par l’entreprise intéressée à la vente d’une centrale française, au titre de l’examen de sûreté auquel elle aurait procédé. Si la dernière phrase du troisième alinéa vous gêne, je ne verrais pas d’obstacle à ce que vous déposiez un amendement tendant à la supprimer. L’ASN verra à l’expérience quelle est l’ampleur des frais occasionnés : il reviendra ensuite au Parlement, qui fixe le budget de l’Autorité, de l’autoriser à être défrayée ou bien d’augmenter les plafonds d’emplois, le cas échéant.
Je vous invite donc à retirer votre amendement.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je partage une partie des interrogations de notre collègue Denis Baupin. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons proposé, dans l’amendement SPE991 rectifié, une modification significative de la rédaction de l’article 54.
Nous sommes, nous aussi, attachés à l’indépendance de l’ASN. Nous savons l’autorité de cette institution au plan international : ses standards de sécurité sont parmi les plus élevés au monde. J’ai été frappée, moi aussi, lors de l’audition de M. Lacoste devant la commission des affaires économiques, par ses propos sur ses visites successives au Japon. Toutefois, celles-ci ne peuvent s’apparenter aux prestations visées par le deuxième alinéa de l’article. En 2007, il s’est rendu dans ce pays dans le cadre d’une mission internationale ; en 2011, il a été consulté par l’autorité japonaise. Ses avis n’ont pas la même valeur juridique en dehors de la France.
Nous avons également été gênés par la dernière phrase du troisième alinéa. Il est hors de question, pour nous, de mettre l’ASN dans les bagages de voyageurs de commerce, quels qu’ils soient et malgré tout l’intérêt que nous portons au développement de l’industrie nucléaire française à l’étranger. Nous ne pouvons accepter qu’il soit porté atteinte à l’indépendance de l’Autorité en l’associant, d’une manière ou d’une autre, à une démarche commerciale.
Notre amendement SPE991 rectifié apporte donc plusieurs modifications au troisième alinéa. Il supprime la mention de la saisine de l’autorité administrative, dans la mesure où celle-ci est déjà prévue par l’article L. 592-29 du code de l’environnement. Il procède à quelques substitutions de termes afin de marquer le fait que l’ASN n’est pas tenue d’examiner la conformité des options de sûreté mais « peut » le faire – ce qui lui laisse une marge de manœuvre. Enfin, il supprime la dernière phrase.
Nous avons cherché à respecter l’indépendance et l’autorité de l’ASN en la préservant d’une démarche commerciale à laquelle elle doit rester étrangère. Cela n’empêche pas que nous ne pourrions qu’être choqués que nos industriels vendent à l’étranger des réacteurs qui n’auraient pas le même niveau de sûreté que ceux qui sont installés en France. Celle-ci doit être la même partout et nous sommes très fermes sur ce point.
M. le président François Brottes. Pour ce qui est du mécanisme de financement, il me paraît utile de citer l’exemple d’un dispositif qui fixe les modalités des relations entre bureaux d’études et opérateurs de télécommunications. Pendant longtemps, il y a eu des polémiques sur le fait que les opérateurs obtenaient des bureaux d’études qu’ils sollicitaient des résultats à leur convenance. Pour mettre fin à toute relation directe entre celui qui est intéressé aux résultats de la mesure et celui qui réalise la mesure, un fonds de financement tampon, alimenté par les contributions des opérateurs, a été mis en place. Une solution analogue pourrait être envisagée dans le cas qui nous occupe, même si nous ne pouvons y travailler maintenant.
M. Denis Baupin. Je vous remercie, monsieur le ministre, de l’ouverture dont vous avez fait preuve à propos des frais. Je voudrais aussi dissiper tout malentendu : ma prise de position ne doit pas laisser penser que je tiens les membres du collège de l’ASN pour corruptibles. Simplement, ils sont soumis à de multiples pressions de la part d’EDF et d’AREVA, du fait du nombre considérable d’emplois en jeu.
Je reste préoccupé par le fait que l’ASN serait amenée à donner un label à l’export pour soutenir la compétitivité des réacteurs français. Certes, si des centrales nucléaires doivent être construites à l’étranger, je préfère qu’elles soient les plus sûres possibles, mais je me demande s’il est bien dans le rôle de l’Autorité de délivrer un label dans une compétition commerciale : cela me paraît problématique. L’Autorité doit être absolument au-dessus de tout soupçon, elle ne doit recevoir aucune pression pour accorder un label, même dans le cas de marchés très difficiles à obtenir – ou alors, il faudrait prévoir qu’elle peut opposer un veto. De plus, l’installation nucléaire en elle-même n’est qu’un élément à prendre en compte pour évaluer la sûreté ; le modèle national d’organisation de sûreté nucléaire est au moins aussi important et on sait à quelles conséquences a mené le manque d’indépendance de l’autorité de sûreté nucléaire japonaise par rapport à TEPCO.
Cela dit, je vais retirer mon amendement, car il avait surtout pour but de susciter le débat que nous avons eu, quitte à déposer d’autres amendements en séance. Il ne faut pas mettre l’Autorité de sûreté nucléaire au service de la compétitivité de notre industrie nucléaire : ce n’est pas son rôle.
L’amendement SPE1436 est retiré.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je voudrais redire à Denis Baupin que les amendements que nous avons déposés sont nés de préoccupations très proches des siennes.
Notre amendement SPE991 rectifié donne à l’ASN une marge d’appréciation : elle peut ou non examiner les réacteurs. Par ailleurs, ce sur quoi elle se prononce, si elle choisit de le faire, c’est la conformité avec les « obligations applicables en France ». Si les conditions d’implantation locales ne sont pas équivalentes, elle ne se prononcera pas. Ainsi ne s’est-elle jamais prononcée sur quelque installation que ce soit au Japon, dans la mesure où les conditions d’installation ne sont pas comparables à la France.
M. Denis Baupin. Je n’ai jamais prétendu que l’ASN s’était prononcée sur des réacteurs japonais. C’est M. André-Claude Lacoste, et non pas l’ASN en tant que telle, qui s’est exprimé sur le système d’organisation de la sûreté nucléaire au Japon.
Par ailleurs, je n’ai pas la même lecture que vous de l’article 54, madame la rapporteure. Je ne vois nulle part qu’elle n’aurait à examiner que des réacteurs déjà installés en France. Il me semble que peuvent être visés des réacteurs n’ayant pas été construits en France.
La commission adopte successivement les amendements SPE76, SPE822 et SPE991 rectifié des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 54 ainsi modifié.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1678 de M. François Brottes.
M. le président François Brottes. Je défendrai également mes amendements SPE1956 et SPE1957.
Les industriels électro-intensifs sont confrontés à de grandes difficultés, qui entament leur compétitivité internationale. Elles ne sont pas seulement dues à l’essor du gaz de schiste aux États-Unis et au Canada, dont on sait les conséquences pour l’industrie chimique, mais aussi à la concurrence de nos voisins européens. Des pays comme l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne apportent, en effet, des aides significatives à leurs industries électro-intensives. En France, si l’énergie nucléaire contribue à assurer des tarifs de l’électricité relativement bas aux ménages, il n’en va pas de même pour les industriels.
Depuis longtemps, la commission des affaires économiques s’intéresse à ces industriels, que notre collègue Clotilde Valter étudie aussi dans le cadre de la commission d’enquête sur les tarifs de l’électricité. Les électro-intensifs bénéficient de tarifs bas grâce à des contrats conclus antérieurement à l’ouverture du marché à la concurrence. Or, ceux-ci vont arriver à échéance dans les mois qui viennent. Il y a donc urgence à régler ce problème, car si leur facture d’électricité double, ils seront tentés de se délocaliser. Ces industriels ne sont pas seulement confrontés à la concurrence internationale à l’export, ils subissent aussi la concurrence de produits importés, fabriqués avec une énergie beaucoup moins chère.
Les pays voisins ont recours à plusieurs leviers, plus ou moins opaques, mais la transparence commence peu à peu à se faire. Nous avons récemment pu rencontrer des industriels allemands au Bundestag, dans le cadre d’une réunion commune des deux commissions des affaires économiques consacrée à l’énergie. Nous avons appris qu’ils ne sont pas obligés de contribuer aux énergies renouvelables et qu’ils n’ont pratiquement pas à acquitter de frais de transport. Par ailleurs, une rémunération forfaitaire annuelle leur est versée en échange de leur faculté à interrompre instantanément leur consommation d’électricité. En Europe, la rémunération par mégawatt de cette interruptibilité s’élève à 10 000 euros en France, 105 000 euros en Italie, 30 000 euros en Allemagne – auxquels s’ajoute l’exonération des coûts de transport – et 294 875 euros en Espagne.
Les pressions très fortes qui s’exercent, à l’exportation comme à l’importation, sur nos industriels électro-intensifs nous obligent à prendre des dispositions partout où cela est possible pour leur permettre de rester en France. Peut-on se réjouir que la consommation d’énergie diminue car certaines de nos industries ferment ? Certainement pas, car cette décroissance est d’abord une décroissance d’emplois. Certains craignent que les aides aux électro-intensifs viennent peser sur les ménages : ce n’est pas impossible ; simplement, si ces industries sont délocalisées à l’étranger, les conséquences pèseront plus encore sur les ménages. Il y a un peu le feu à la maison, il faut bien le dire.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique s’est attachée à réduire la facture du transport : le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) va être réduit d’environ 60 % pour les électro-intensifs – rappelons que cette réduction atteint 90 % en Allemagne. Pour ma part, je présente l’amendement SPE1956, qui tend à déverrouiller le dispositif de rémunération pour contribution potentielle à l’interruptibilité, en laissant le soin au Gouvernement d’en fixer les modalités par décret.
Pour ce qui est de l’amendement SPE1678, il tend à élargir le nombre de sites industriels bénéficiaires des dispositifs à destination des électro-intensifs en allant vers une sorte d’Exeltium II. Je suis prêt, monsieur le ministre, à examiner avec vous quelques aménagements. Mais je crains que si nous ne prenons pas en compte le cas des industriels grands consommateurs d’électricité sans être hyper électro-intensifs dans ce projet de loi, nous ne disposions plus d’occasion de le traiter dans un autre cadre législatif d’ici à l’année prochaine, lorsque les contrats que j’évoquais arriveront à échéance.
Toutes sortes de dispositifs ont été imaginés par le passé – certains se souviennent sans doute du tarif réglementé et transitoire d’ajustement au marché (TARTAM) – mais « ajouter du sparadrap à du sparadrap » ne nous fera pas rattraper nos voisins européens dans la course.
Bernadette Laclais a déposé un amendement portant sur ces mêmes questions, et c’est bien volontiers que je retirerai l’un des miens en sa faveur, lui demandant par avance de rectifier le sien de façon à le rattacher au code de l’énergie et de supprimer une disposition qui figure déjà dans le projet de loi relatif à la transition énergétique.
M. le ministre. La situation des électro-intensifs constitue effectivement un sujet de préoccupation, mais toutes les dispositions que nous sommes susceptibles de prendre en leur faveur doivent s’inscrire, d’une part, dans le cadre communautaire – c’est toute la difficulté de notre position – et, d’autre part, en cohérence avec le projet de loi relatif à la transition énergétique. Comprenant que vous m’invitez à me prononcer davantage sur l’amendement SPE1489, qui concentre l’esprit de vos trois amendements, je suis prêt à émettre un avis favorable à l’amendement de Mme Laclais rectifié selon vos souhaits – quitte à l’améliorer en séance, car c’est là un sujet très encadré.
Une double concurrence s’exerce : à l’échelle internationale, du fait des bas prix du gaz de schiste qui induisent une concurrence déloyale pour les électro-intensifs qui ne peuvent en bénéficier ; à l’échelle européenne, du fait de l’asymétrie entre la France et l’Allemagne. Toutefois, des mouvements se sont produits, côté allemand, à la suite d’échanges avec la Commission européenne et une renégociation est en cours.
Il faut prêter attention à plusieurs critères : le caractère temporaire du mécanisme, qui ne doit durer que jusqu’au renouvellement des concessions hydroélectriques ; le caractère obligatoire de la cession d’hydroélectricité par les concessionnaires ; les conditions de cession de l’hydroélectricité ; les concessions hydrauliques visées – ne peuvent être concernées que les centrales au fil de l’eau ; la précision à apporter que la cession forcée doit se faire dans un cadre contractuel entre le concessionnaire et les électro-intensifs. Nous sommes en train de discuter de ces critères avec la Commission européenne. M’engageant à accélérer ces discussions, je souhaiterais, d’ici à l’examen du texte en séance, avoir le plein soutien de la commission sur le dispositif avant de le confirmer.
Je serai donc favorable à l’amendement rectifié de Mme Laclais.
M. le président François Brottes. Puisque je retire le seul amendement SPE1957 à son profit, quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement SPE1678 ?
M. le ministre. Je vous invite à le retirer. Certes, c’est une bonne idée d’inclure certains secteurs stratégiques, comme les cimenteries, parmi les bénéficiaires du dispositif destiné aux électro-intensifs. Mais cela me gênerait qu’à ce stade de nos échanges avec Bruxelles, de telles dispositions figurent dans la loi.
Je m’engage, à la lumière des échanges que nous allons avoir dans la semaine qui vient avec la commission européenne, à intégrer les préoccupations que vous exprimez dans cet amendement. Il me semble que vous avez des garanties suffisantes avec l’amendement de Mme Laclais, que le Gouvernement est prêt à accepter.
M. le président François Brottes. L’amendement SPE1678 ne vise pas seulement les hyper électro-intensifs au cœur de l’amendement de Bernadette Laclais, mais aussi les gros consommateurs industriels : ces deux amendements sont donc complémentaires.
J’ai bien compris que le ministre m’engageait à retirer mon amendement pour ne pas braquer la Commission européenne. Je note toutefois que la discussion avec la Commission ne se déroule pas exactement dans les mêmes termes avec nos voisins, sur ces questions-là, et que les industriels français vivent cette dissymétrie comme une vraie injustice. Les Allemands ont triché pendant des années, il faut le dire, en exonérant leurs industriels du prix du TURPE : ils faisaient 100 % de cadeaux ; désormais, ils ne devront plus en faire que 90 % – voilà ce qui s’appelle une négociation bien menée ! Nous voulons toujours nous montrer extrêmement vertueux et, en fin de compte, nous sommes les dindons de la farce. Je le dis avec un peu de véhémence.
Je retire l’amendement SPE1678 pour ne pas perturber les discussions avec Bruxelles, mais croyez bien que j’y reviendrai lors de l’examen du texte en séance.
L’amendement SPE1678 est retiré.
Mme Karine Berger. Sauf erreur de ma part, cet amendement dit « Exeltium », qui vient d’être retiré, avait été rejeté par la commission des finances et en séance publique, lors de l’examen du dernier projet de loi de finances. Je crains que le débat n’ait déjà eu lieu.
M. le président François Brottes. Connaissant bien ces questions et depuis longtemps, je puis vous assurer qu’il ne s’agit absolument pas du même amendement. L’amendement SPE1678 n’a jamais été déposé !
Mme Karine Berger. Toujours est-il que, sur la modification de la fiscalité « Exeltium », nous avons déjà eu une forme de débat, et je trouverais dommage que cet amendement ne soit pas discuté dans le cadre d’une loi de finances, comme cela s’impose.
M. le président François Brottes. Le dispositif proposé n’a rien à voir avec la fiscalité : les impôts ne sont pas concernés et, si vous connaissiez le sujet, vous le sauriez. Le TURPE ne relève pas de la loi de finances, tout comme la CSPE. Les amendements « Exeltium » défendus par notre collègue Yves Blein étaient d’une autre nature.
M. Denis Baupin. Au risque de surprendre certains, nous sommes favorables aux dispositifs d’aide aux électro-intensifs. J’avais d’ailleurs formulé des propositions en ce sens dans le rapport que j’avais cosigné avec un représentant du MEDEF à l’occasion du débat national sur la transition énergétique. Nous partons du principe que si ces entreprises se délocalisent, elles consommeront à l’étranger toujours autant d’énergie, avec le même impact négatif dans le bilan global, alors que des emplois seront détruits en France.
Si l’un des amendements proposés par le président était adopté, je déposerais en séance un amendement complémentaire pour préciser que ces mesures d’aide ne doivent pas exonérer les entreprises concernées de faire des efforts en matière d’efficacité énergétique, considérant que leur facture énergétique n’est que la multiplication du tarif qui leur est appliqué par le volume de leur consommation. Il importe qu’en contrepartie des aides spécifiques qu’elles reçoivent, elles rendent un rapport annuel sur les efforts qu’elles ont fournis afin de les inciter à participer à l’objectif national de réduction de la consommation.
M. Yves Blein. Ce serait une excellente idée... pourvu néanmoins que vous distinguiez bien, parmi les électro-intensifs, ceux qui consomment de l’électricité pour faire fonctionner leur entreprise et ceux pour qui l’électricité est une matière première : dans ce dernier cas, vous ne pouvez pas exiger d’eux des économies, car celles-ci viendraient diminuer leur volume de production.
Monsieur le président, comme vous, j’insiste sur la nécessité de traiter cette question maintenant : les contrats arrivent à échéance et les écarts de prix sont très importants. Nous risquons, si nous n’agissons pas, de mettre nos entreprises en grande difficulté. Notre industrie chimique, en particulier, pâtit des écarts concurrentiels avec les complexes chimiques et pétrochimiques en Inde et aux États-Unis, qui vont d’un à quatre pour le coût de l’énergie. Or, pour certaines entreprises de ce secteur, l’énergie représente 30 % des coûts de fabrication.
Je suis également favorable à l’amendement de Bernadette Laclais.
J’entends aussi vos arguments, monsieur le ministre, sur l’interruptibilité, autre sujet tout aussi important. L’extension du dispositif devrait aussi contribuer à la réduction des écarts avec les concurrents étrangers de nos entreprises.
M. Dominique Lefebvre. J’aimerais apporter quelques précisions pour la clarté de nos débats. Deux amendements au projet de loi de finances relatifs à ces sujets ont été déposés : le premier, signé par Michel Vergnier, concernait les petites unités ; le second, au sujet duquel le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire, portait sur le consortium Exeltium. Il visait à l’exonérer du plafonnement de la déductibilité des intérêts de l’emprunt, qui a mis à mal son modèle économique principalement fondé sur l’endettement. Élargir ce dispositif à d’autres industriels, comme le propose l’amendement SPE1678, aurait donc un impact fiscal.
M. le président François Brottes. Pendant des années, nous nous sommes battus, droite et gauche confondues, pour créer ce consortium dans le double objectif de permettre aux industriels électro-intensifs de procéder à des achats collectifs d’énergie et de conclure des contrats à long terme – toutes possibilités que refusait la Commission européenne, au prétexte qu’elles empêchaient le marché de se mouvoir. Au bout de trois ans de combat, nous sommes parvenus à obtenir l’accord de Bruxelles. Certains industriels électro-intensifs sont entrés dans le consortium : leurs investissements leur ont ouvert le droit à un prix de l’énergie moindre, qui n’est d’ailleurs plus très attractif, compte tenu de la situation actuelle du marché de l’électricité. D’où les questions fiscales qui se posent, mais qui ne concernent pas l’amendement que j’ai déposé.
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, je tiens à exprimer les regrets du groupe UMP devant le retrait de votre amendement, que nous aurions volontiers soutenu.
M. le président François Brottes. Ceux qui me connaissent un peu savent que je le déposerai à nouveau. Je sais que j’ai le soutien de la rapporteure thématique et j’ai cru comprendre que le ministre n’était pas totalement indifférent à cette préoccupation.
*
* *
Article 54 bis [nouveau]
(article 266 quindecies du code des douanes)
Soutien aux biocarburants produits
à partir de matières premières d’origine animale
Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Christophe Caresche, vise à soutenir le potentiel de développement des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale (EMHA). La filière concernée offre en effet d’importants débouchés aux graisses animales issues d’abattoirs, qu’elle transforme en déchets, et elle contribue de ce fait à encourager l’économie circulaire au cœur du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Il est donc proposé de modifier la rédaction l’article 266 quindecies du code des douanes, afin de ne conserver dans la loi que la valeur cible du taux de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et le taux maximum d’incorporation de biocarburants produits à partir de ressources alimentaires, et de renvoyer l’ensemble des autres paramètres à un arrêté relevant du ministre compétent.
*
* *
La commission en vient à l’amendement SPE288 rectifié de M. Christophe Caresche.
M. Christophe Caresche. Cet amendement porte sur un tout autre sujet : les biocarburants.
Rappelons que les biocarburants sont fabriqués à partir de deux types d’huile : l’une d’origine végétale, l’autre d’origine animale. Pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m’étendre, la filière végétale connaît la prospérité et va même jusqu’à importer des huiles, tandis que la filière animale s’est peu développée, faute d’opérateurs. Depuis quelques années, certaines entreprises se sont lancées dans la production de biocarburants d’origine animale, fortes de l’engagement des pouvoirs publics d’augmenter le plafond d’incorporation des huiles animales dans le diesel ou le gazole. Malheureusement, l’adoption d’un amendement en loi de finances est venue bloquer cette possibilité, si bien que ces entreprises sont aujourd’hui mises en difficulté. Le développement d’une filière animale, qui repose sur le traitement des carcasses, permettrait de donner de nouveaux débouchés aux abattoirs dont on connaît les problèmes. Je sais que le Premier ministre a été sensibilisé à cette question lorsqu’il a visité l’abattoir Gad, dont les acheteurs comptent développer les débouchés liés aux biocarburants.
Cet amendement, qui devrait intéresser les députés bretons – mais aussi normands, car Le Havre compte une usine de production –, vise à faire sortir du domaine de la loi la fixation des contingents d’huiles animales et d’huiles végétales entrant dans la composition des biocarburants, pour la faire entrer dans le domaine réglementaire, en la renvoyant à un arrêté du Gouvernement. Nous espérons qu’un relèvement du contingent viendra soutenir l’activité des entreprises, peu nombreuses, de ce secteur.
M. le ministre. Cet amendement pose deux problèmes : d’une part, il n’est pas accompagné d’une évaluation de l’impact sur l’ensemble de la filière, notamment des effets de substitution pouvant affecter le biodiesel ; d’autre part, il a été déjà déposé dans le cadre de la loi de finances et rejeté. Il a un coût fiscal indéniable et je n’ai pas l’autorisation, compte tenu de la petite enveloppe dont je dispose, d’accepter ces dépenses supplémentaires.
Cela dit, le problème que vous soulevez mérite d’être débattu. S’agissant des biocarburants d’origine végétale, qu’en est-il de l’effet de substitution entre usage alimentaire et non-alimentaire ? Faut-il élargir les avantages fiscaux aux biocarburants d’origine animale et renforcer les filières en amont ?
Je souscris à tous les arguments que vous avez avancés et vous propose que nous travaillions ensemble à une étude d’impact, mais il me semble un peu trop tôt pour donner un avis favorable à votre amendement, même d’ici à la séance.
M. Christophe Caresche. Cet amendement diffère de celui que j’avais déposé au projet de loi de finances, qui visait à modifier les répartitions, alors que celui-ci tend à renvoyer à un arrêté gouvernemental la fixation des contingents d’huiles végétales et animales incorporées dans le biocarburant. En conséquence, il n’a pas de répercussion fiscale, puisqu’il ne concerne pas la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Je maintiens donc mon amendement.
Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je ne suis pas spécialiste de cette question, que j’ai découverte grâce à notre collègue Christophe Caresche. Il me semble que ses arguments, tout comme ceux du ministre, sont de bon sens. Je suis favorable à ce que nous continuions à travailler sur ce sujet.
M. Arnaud Leroy. J’apporte un soutien franc et massif à l’amendement de Christophe Caresche. J’ai étudié la question des biocarburants dans le cadre du transport maritime et fluvial. Sachant que la problématique de la substitution des terres est de plus en plus prégnante pour la filière, cela vaudrait le coup de s’intéresser à cette catégorie différente de carburant alternatif. Si l’on ajoute que des normes environnementales de plus en plus strictes pèsent sur l’utilisation du fioul par les navires marchands maritimes et fluviaux et que l’alimentation des bateaux en biocarburants se développe de plus en plus, cela fait encore des raisons supplémentaires d’encourager les potentialités de la filière française.
M. Gilles Lurton. Nous soutiendrons également fortement cet amendement.
En 2010, alors qu’aucune filière industrielle n’était en mesure de retraiter les huiles animales, le Gouvernement et le Parlement avaient fortement incité les industriels à construire des usines dédiées à ce type de production. L’usine du Havre a été installée, pour un coût de 41 millions d’euros au financement duquel ont participé les industries agro-alimentaires bretonnes. Or, en 2014, alors qu’elle fonctionnait parfaitement bien, la proportion d’incorporation des huiles animales dans les biocarburants a été révisée à la baisse. Cette décision a paru à ses responsables d’autant plus incompréhensible que les huiles animales sont brûlées si elles ne sont pas traitées. Qui plus est, la réutilisation des carcasses participe d’une économie circulaire qui n’offre que des avantages.
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de juin dernier, nos collègues Marc Le Fur et Édouard Philippe, maire du Havre, et moi-même avions déposé un amendement portant sur les biocarburants d’origine animale. Le secrétaire d’État au budget nous avait répondu qu’il ne pouvait l’accepter en l’état, qu’il nécessitait d’être étudié. La même réponse nous a été opposée lorsque nous l’avons redéposé dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, puis du projet de loi de finances pour 2015. Même celui que la rapporteure générale de la commission des finances a déposé a connu le même sort ! C’est d’autant plus incompréhensible que nous ne saisissons pas l’impact fiscal dont vous faites état.
M. Stéphane Travert. Les délais nécessaires pour saisir l’impact d’une telle mesure sont vraiment très longs, semble-t-il.
L’utilisation des carcasses pourrait être étendue à la filière de la pêche, à laquelle la Commission européenne va imposer une directive « zéro rejet ». Un projet a vu le jour en Normandie pour fabriquer des huiles Oméga-3 à partir de déchets de poisson, mais ceux-ci pourraient aussi être intégrés à la fabrication de biocarburants.
M. Dominique Lefebvre. Je confirme que les biocarburants font régulièrement l’objet de débats en loi de finances. À l’automne dernier, sous l’impulsion de notre collègue François André, des amendements relatifs à ces sujets ont été discutés et certains ont été adoptés.
Christophe Caresche a raison de souligner que son amendement diffère de celui qu’il avait déposé dans le cadre du projet de loi de finances. L’enjeu ne me semble pas essentiellement de nature fiscale, mais renvoie plutôt à la protection de certaines filières. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi la filière des huiles animales, dont les difficultés sont visibles, ne pourrait pas connaître la même prospérité que celle des huiles végétales. Chacun sait bien qui passe des appels pour empêcher que cet amendement soit adopté : des groupes de pression sont indéniablement à l’œuvre.
Mme Karine Berger. Monsieur le ministre, cet amendement me semble aller dans le bon sens. J’ai bien conscience que votre enveloppe est petite ; les finances publiques ont beau aller mal, cet argument ne me semble pas résister à la réalité du coût qu’impliquerait cette mesure : 3 millions d’euros – j’en ai fait la vérification avec la rapporteure générale de la commission des finances.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Pour une fois qu’un Parisien dépose un amendement favorable à la Bretagne, dont la pertinence est à ce point reconnue, je ne peux qu’y être favorable ! Il va satisfaire le girondinisme viscéral des Bretons.
La commission adopte l’amendement SPE288 rectifié.
*
* *
Elle en vient à l’amendement SPE198 de Mme Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement propose un nouveau calendrier de déploiement pour le projet de centre industriel de stockage géologique profond (Cigeo), en repoussant la date de dépôt de sa demande d’autorisation de 2015 à 2017, afin de tenir compte du débat public qui s’est tenu l’année dernière. Il s’agit de donner les moyens de mettre en œuvre la réversibilité dans une phase expérimentale opérationnelle pour ce projet porteur de perspectives économiques.
M. le ministre. La loi de 2006 sur les déchets nucléaires a défini le stockage géologique profond comme la solution de gestion des déchets radioactifs de moyenne et haute activité à vie longue. Le débat public de 2013 a permis de préciser et d’améliorer les définitions et les procédures de consultation du public. Il propose d’introduire une phase pilote et de définir la notion de réversibilité.
Cet amendement transcrit les conclusions du débat public et je n’ai donc aucun désaccord de fond. Ce sujet, d’une sensibilité politique toute particulière, nécessite néanmoins de mûrir encore à travers de nouveaux échanges. La loi nous laisse la possibilité de prendre les mesures requises. L’argument de la nécessité de débloquer des situations critiques, qui a pu être invoqué à plusieurs reprises pour justifier le dépôt d’amendements dans le cadre du présent texte, ne peut être repris pour ce qui concerne Cigeo, qui peut attendre la fin de l’année 2016. Sans vous dire que je ne partage pas vos arguments de fond, parce que je mentirais alors, je pense qu’il est préférable de remettre la rédaction de cet article à une phase ultérieure.
L’amendement SPE198 est retiré.
*
* *
Article 54 ter [nouveau]
(article L. 321-19 du code de l’énergie)
Soutien au mécanisme d’interruptibilité
en matière d’approvisionnement électrique
Le dispositif d’interruptibilité, prévu à l’article L. 321‑19 du code de l’énergie, prévoit la rémunération des industriels qui acceptent de se déconnecter instantanément du réseau électrique national en cas de menace grave sur le fonctionnement de ce dernier.
Pour l’année 2015, l’interruptibilité concernera seulement trois acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 mégawatts et une enveloppe totale de 18 millions d’euros. Ces chiffres sont très en deçà des mécanismes équivalents mis en place en Allemagne, en Espagne ou en Italie, qui assurent plusieurs centaines de millions d’euros aux électro-intensifs situés sur ces territoires.
Il est donc proposé que la compensation versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée – au titre des sujétions de service public ainsi imposées – soit déterminée « de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport » ainsi qu’à « refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou réduire ».
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1956 de M. François Brottes.
M. le président François Brottes. Cet amendement, je le rappelle, vise à déverrouiller le dispositif de rémunération des apports pour contribution potentielle à l’interruptibilité, en laissant le soin au Gouvernement d’en fixer les modalités par décret.
M. le ministre. Avis favorable.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, la commission adopte l’amendement SPE1956.
*
* *
Article 54 quater [nouveau]
(article L. 524-1 [nouveau] du code de l’énergie)
Conditions d’accès à l’électricité des sites industriels électro-intensifs
fortement exposés à la concurrence mondiale
La nouvelle organisation du marché de l’électricité impose la mise en place d’un cadre d’accès à l’électricité qui soit adapté aux sites industriels les plus électro-intensifs et fortement exposés à la concurrence mondiale : les conditions d’approvisionnement en énergie électrique sont en effet, pour ces sites, un facteur essentiel et critique de compétitivité.
Cet article prévoit donc la mise en place d’un dispositif ciblé et retient trois critères, appelés à être précisés par décret, pour en concentrer le bénéfice sur les sites concernés :
– un critère d’électro-intensivité, évaluant l’importance du rapport entre le volume d’électricité consommé et la valeur de production ;
– un critère de marché, à savoir une exposition commerciale directe à la concurrence sur les marchés internationaux ;
– un critère de procédé de production, à savoir l’utilisation massive de l’électricité comme intrant indispensable à la mise en œuvre du procédé industriel et l’absence de solutions techniques alternatives.
Ces sites industriels contribuent par ailleurs, de manière très significative, à la stabilité et à l’optimisation du système électrique : à l’instar des régimes existants dans de nombreux pays de l’Union européenne, il importe donc de prévoir un cadre réglementaire pluriannuel et pérenne, prenant en compte cette capacité contributive. En particulier, l’accès spécifique à l’énergie électrique au bénéfice des industries très électro-intensives doit donner lieu à des contreparties de la part des bénéficiaires, dont la définition est renvoyée au pouvoir réglementaire.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1489 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Tout d’abord, il me paraît important de souligner la chance que nous avons d’avoir un président de commission qui connaît extrêmement bien ces dossiers, qui en a fait avancer certains et qui est en mesure de rappeler l’historique des décisions dont ils ont fait l’objet au sein de notre assemblée.
Si nous avons choisi ce véhicule législatif plutôt qu’un autre, c’est non seulement parce qu’il y a urgence, mais aussi parce que la mesure que nous proposons se rattache bien à l’objectif de croissance et d’emploi affiché par le projet de loi – il s’agit de soutenir la compétitivité de nos entreprises et de créer de la croissance.
Je suis prête à rectifier mon amendement, dans la mesure où certains éléments sont redondants avec les dispositions, en cours de discussion, du projet de loi relatif à la transition énergétique. Je serais heureuse que, posant un cadre général et renvoyant à des dispositions réglementaires, il suscite l’unanimité, ce qui donnerait de la force au Gouvernement dans les discussions européennes et permettrait d’adresser un signe extrêmement positif aux industriels concernés.
M. le président François Brottes. Précisons la rectification apportée à votre amendement :
– le premier alinéa est ainsi rédigé : « Après le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : » ;
– au deuxième alinéa, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 524-1 » ;
– le troisième alinéa est supprimé.
M. le ministre. Favorable à l’amendement rectifié.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, l’amendement SPE1489 ainsi rectifié est adopté à l’unanimité.
L’amendement SPE1957 de M. François Brottes est retiré.
*
* *
Section 1
Alléger les obligations des entreprises
Avant l’article 55
La commission examine l’amendement SPE479 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Personne ne conteste aujourd’hui que les normes et les contraintes réglementaires sont un frein au développement économique de notre pays. La simplification des normes est un enjeu économique capital pour le maintien des outils de production et de l’emploi sur notre territoire.
Dans un élan louable de simplification, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 18 décembre 2012 a arrêté des mesures pour simplifier les normes en vigueur et endiguer la création de nouvelles normes. Parallèlement, à l’échelle européenne, le 23 novembre dernier, la commission a adopté un rapport soulignant l’importance d’alléger les contraintes réglementaires pour les entreprises. Dans cet esprit, elle préconise de libérer les microentreprises des réglementations contraignantes pour leur permettre de poursuivre leurs objectifs d’affaires. La stratégie de croissance de l’Union européenne Europe 2020 souligne également l’importance d’améliorer l’environnement des affaires grâce à une réglementation intelligente.
Il y a urgence pour le législateur à accompagner toutes les forces vives de notre pays créatrices de richesses. Les délais accordés par l’administration pour se conformer aux multiples règles prescrites par les soixante-huit codes en vigueur et les actes réglementaires sont souvent trop courts pour permettre aux entreprises de s’organiser et de trouver les financements nécessaires. Puisque le texte se revendique du fameux choc de simplification, il apparaît essentiel et nécessaire d’agir dès maintenant en faveur des entreprises en leur permettant d’éviter l’application brutale de normes et de contraintes réglementaires qui seraient manifestement défavorables à leur production et à leur compétitivité, ainsi qu’au maintien de l’emploi et de l’activité économique. Il s’agit ici non pas de supprimer les normes, mais d’exiger du bon sens et de l’intelligence dans leur application.
M. le ministre. L’amendement met en lumière un problème pour les entreprises que je ne nie pas. Il soulève néanmoins plusieurs difficultés.
D’abord, il ouvre la possibilité à une entreprise qui aurait engagé un dialogue avec les pouvoirs publics de déroger aux normes, ce qui est contestable sur le plan juridique. Ensuite, votre préoccupation devrait être en partie satisfaite par l’amélioration du fonctionnement des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). L’administration doit jouer davantage qu’elle ne le fait un rôle de conseil. C’est le sens du regroupement des services du ministère du travail et de Bercy dans ces entités régionales. La réforme de l’inspection du travail répond également au souhait de faire évoluer la culture de l’administration. Enfin, une importante négociation sociale est en cours pour rénover en profondeur le cadre du dialogue social dans l’entreprise. Il serait malvenu à l’égard des partenaires sociaux d’aller dans la direction que vous proposez.
J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je suis sensible aux explications du ministre. En écho à ses propos sur les DIRECCTE, je connais aussi des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui expliquent aux entreprises qu’elles ne sont pas là pour les aider mais pour les contrôler. C’est comme cela que des entreprises vont s’installer ailleurs qu’en France.
J’accepte de retirer l’amendement et je proposerai une nouvelle rédaction.
L’amendement SPE479 est retiré.
*
* *
Article 55
(art. L. 123-28-1 et L. 123-28-2 [nouveaux] du code de commerce)
Allégement des obligations comptables des TPE sans activité
Le présent article vise à alléger les obligations comptables des microentreprises en sommeil qui n’emploient aucun salarié, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Cet article concrétise l’une des cinquante nouvelles mesures proposées par le conseil pour la simplification des entreprises en octobre 2014.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LES OBLIGATIONS COMPTABLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
En application des articles L. 123-12 à 123-23 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit respecter un certain nombre d’obligations comptables :
– enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise chronologiquement ;
– réalisation d’un inventaire, au moins une fois tous les douze mois, pour contrôler l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
– établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire qui comprend le bilan, le compte de résultat et l’annexe, le tout étant indissociable.
Les artisans qui exercent à titre individuel et qui sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent également tenir une comptabilité commerciale.
Aux termes de l’article L. 123-16 du même code, les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
De plus, l’article L. 123-16-1 du même code précise que, par dérogation, les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir l’annexe.
Les petites entreprises et les micro-entreprises visées aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce sont des entreprises, personnes physiques ou morales, pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par l’article 1er du décret n° 2014-136 du 17 février 2014 ne sont pas dépassés (67) :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 millions d’euros, le montant net du chiffre d’affaires à 8 millions d’euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 50.
Il convient de préciser que la définition des micro-entreprises visées à l’article L. 123-16-1 du code de commerce est plus large que celle retenue par l’article 50-0 du code général des impôts qui prévoit un régime fiscal particulier en faveur des plus petites micro-entreprises (68), lesquelles ne sont d’ailleurs pas tenues d’établir des comptes annuels en vertu de l’article L. 123-28 du code de commerce (69).
Enfin, les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, sur option (70) ou de plein droit (71), peuvent bénéficier des mesures de simplification comptables prévues aux articles L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce (72).
B. DES OBLIGATIONS COMPTABLES MAINTENUES MÊME EN CAS DE MISE EN SOMMEIL DE L’ENTREPRISE COMMERCIALE
Lorsqu’une entreprise souhaite arrêter temporairement son activité, elle peut demander une « mise en sommeil » par le biais d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans le délai d’un mois suivant la cessation d’activité.
La mise en sommeil permet donc à une entreprise de cesser son activité sans que cette interruption n’entraîne sa dissolution ou sa radiation du RCS et, ce, pendant un délai maximal de deux ans :
– pour les personnes physiques, la cessation totale d’activité est inscrite au RCS avec le maintien de l’immatriculation pour une période d’un an, renouvelable une fois (article R. 123-45 et 6° et 8° de l’article R. 123-46 du code de commerce). Les entreprises individuelles exerçant une activité artisanale inscrites au RCS peuvent également la demander auprès du centre de formalités des entreprises relevant de leur chambre des métiers mais elle n’est pas renouvelable au-delà d’un an. À défaut de reprise d’activité, le greffier radie d’office l’entrepreneur au terme du délai d’un an ou de deux ans si la mention a été renouvelée (article R. 123-129 du code de commerce) ;
– pour les personnes morales, la cessation totale d’activité est également inscrite au RCS (article R. 123-66 et 1° de l’article R. 123-69 du code de commerce). Le greffier peut, en l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’activité et au terme d’un délai de deux ans après la mention au RCS de la cessation totale d’activité, procéder à la radiation d’office de la personne morale du RCS après l’en avoir informée par lettre recommandée avec avis de réception. Cette radiation d’office est portée à la connaissance du ministère public pour éviter les fraudes (article R. 123-130 du code de commerce).
Néanmoins, pendant sa mise en sommeil, l’entreprise continue de fonctionner normalement. Par conséquent, le représentant légal reste tenu d’établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice social et de convoquer l’assemblée annuelle d’approbation desdits comptes.
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, à ce jour, l’on dénombre au RCS 88 102 entreprises en sommeil dont 43 498 avec un effectif de 0 à 9 salariés, qui seraient donc potentiellement concernées par la réforme proposée.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le I du présent article vise à alléger les obligations comptables des micro-entreprises telles que définies à l’article L. 123-16-1 du code de commerce dès lors qu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont demandé au RCS une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire (ou mise en sommeil).
Pour ce faire, il introduit deux nouveaux articles, numérotés L. 123-28-1 et L. 123-28-2, à la fin de la sous-section 2 « Des obligations comptables applicables à certains commerçants » du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, pour déroger aux obligations comptables prévues par les articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce précités :
– l’article L. 123-28-1 permet aux microentreprises, personnes physiques, d’être exonérées de l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat sous réserve qu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles attestent sur l’honneur de leur demande de mise en sommeil au RCS ;
– l’article L. 123-28-2 autorise les microentreprises, personnes morales, à établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé sous les mêmes réserves, conformément à l’option prévue en ce sens par les dispositions de la directive comptable n° 2013/34/UE (73).
Dans les deux cas, ces dérogations cessent de produire leurs effets au-delà d’une période de deux ans suivant la déclaration de mise en sommeil ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice (c’est-à-dire en cas de reprise d’activité).
Les modalités d’application de ces deux articles seront fixées par décret, en particulier pour préciser le contenu du bilan et du compte de résultat abrégé pour les micro-entreprises personnes morales. Selon l’étude d’impact, un arrêté fixera également le modèle d’attestation sur l’honneur à déposer au greffe pour bénéficier de la mesure.
Le II du présent article précise que ce dispositif s’applique à Wallis-et-Futuna. Dans la mesure où cette collectivité d’outre-mer est régie par le principe de spécialité législative, cette mention expresse dans la loi est nécessaire pour pouvoir rendre le dispositif applicable sur son territoire.
Une telle mention n’est en revanche pas prévue pour les autres collectivités régies par le principe de spécialité, que sont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, car elles sont désormais exclusivement compétentes en matière de droit commercial de sorte que l’État ne peut plus intervenir en ce domaine.
Enfin, dans les autres collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité législative, la mesure est applicable de plein droit.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Le rapporteur thématique soutient vivement cette mesure de simplification administrative, tout en soulignant néanmoins qu’elle reste partielle dans la mesure où les obligations comptables des entreprises en sommeil à l’égard de l’administration fiscale demeurent inchangées.
Le rapporteur thématique estime en outre qu’une précision mériterait d’être apportée au dispositif proposé afin d’éviter tout risque de fraude. Ainsi, lui semble-t-il nécessaire que l’exonération de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce par les personnes physiques dont l’entreprise est mise en sommeil soit écartée en cas de cession d’actifs car celle-ci modifie nécessairement le contenu du bilan.
IV. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
Sur proposition des rapporteurs et après avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement visant à suspendre l’exonération de dépôt des comptes des personnes physiques enregistrées au RCS en cas d’opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1153 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Cet amendement vise à étendre l’allégement des obligations comptables pour les microentreprises sans activité comptant zéro salarié à celles qui emploient un salarié. En effet, l’emploi d’un salarié quelques heures par mois, à temps partiel ou à temps complet, leur ferait perdre injustement le bénéfice des allégements prévus.
M. le ministre. Cet exemple illustre la volonté partagée de simplification. Néanmoins, l’objet de l’amendement, tel que vous le présentez, est beaucoup plus large que celui de l’article 55 qui porte exclusivement sur les entreprises sans activité. En outre, la présence d’un salarié implique nécessairement des mouvements financiers et une activité de l’entreprise qui, de ce fait, n’entre plus dans le cadre de l’article. Ce sujet mérite toutefois d’être approfondi afin d’évaluer les conséquences d’une telle mesure et le nombre d’entreprises concernées. Je vous suggère de le retirer.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. L’article vise uniquement les entreprises mises en sommeil, qui, par définition, n’ont pas de salarié en activité. J’émets donc un avis défavorable.
Toutefois, l’idée de simplifier les obligations comptables des TPE et des microentreprises est bienvenue. Le comité de simplification y travaille.
M. Alain Tourret. J’accepte la proposition du ministre d’une étude d’impact. Je retire donc l’amendement. Vous m’opposez qu’une entreprise n’est pas en sommeil si elle ne dort pas. Il me semble toutefois qu’on peut continuer à dormir avec quelques heures d’activité.
L’amendement SPE1153 est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1506 et SPE1505 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1677 des rapporteurs.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Afin d’éviter d’éventuels détournements de la part de personnes mal intentionnées, l’amendement précise que l’exonération totale des obligations de déclaration comptable des personnes physiques qui ont mis en sommeil leur entreprise ne s’applique pas si l’entreprise réalise des opérations, notamment des cessions d’actifs, ayant un effet sur la structure de son bilan comptable.
M. le ministre. Avis favorable.
M. Jean-Frédéric Poisson. La « structure du bilan » est-elle le terme consacré en comptabilité ? Il me semble que les alinéas 2 et 3 pourraient être réunis puisque leur contenu est quasi identique.
M. Gérard Cherpion. L’expression « cessation totale d’activité temporaire » me semble insatisfaisante. Les entreprises mises en sommeil cessent totalement leur activité de manière temporaire. Le mot « temporaire » est sans doute mal placé. Il faudrait revoir la rédaction pour lever l’ambiguïté.
M. Jean-Christophe Fromantin. L’exposé des motifs évoque, pour les entreprises visées, un chiffre d’affaires de 700 000 euros qui suppose nécessairement des flux. L’argument de M. Tourret me semble donc parfaitement valable.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Il n’est pas possible de fusionner les deux alinéas, car l’un porte sur les personnes physiques qui sont totalement exonérées d’obligation de déclaration et l’autre sur les personnes morales soumises à des obligations de déclaration simplifiées.
Quant à la cessation d’activité, l’entreprise mise en sommeil pour une durée maximale de deux ans peut décider, à l’issue de ce délai, de reprendre son activité.
La commission adopte l’amendement SPE1677.
Elle adopte ensuite l’article 55 modifié.
*
* *
Article 55 bis [nouveau]
(art. L. 441-6-1 du code de commerce)
Allègement de l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement pour les entreprises ne publiant pas de rapport de gestion
L’article 24 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a imposé aux entreprises soumises à l’obligation d’avoir un commissaire aux comptes de publier des informations relatives à leurs délais de paiement en créant un nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce.
Cette obligation a été renforcée par l’article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui a prévu une attestation systématique de ces informations par le commissaire aux comptes.
En application de l’article D. 441-4 du code de commerce, ces informations doivent figurer dans le rapport de gestion.
Or, l’article 9 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit a introduit la possibilité pour les sociétés non cotées de ne pas publier leur rapport de gestion. Cette disposition, combinée à l’obligation de publier des informations sur les délais de paiement, a pour conséquence d’imposer aux sociétés non cotées choisissant de ne pas déposer leur rapport de gestion au greffe de publier un document spécifique relatif aux délais de paiement, ce qui est coûteux et complexe.
Le présent article, adopté à l’initiative des rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, a donc pour objet d’alléger cette obligation en modifiant l’article L. 441-6-1 du code de commerce pour permettre à ces entreprises de « communiquer » des informations sur leurs délais de paiement sans les contraindre à les « publier » dans un document spécifique.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1679 des rapporteurs.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement vise à alléger l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion.
La loi de modernisation de l’économie de 2008 ainsi que la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 ont prévu une attestation systématique de ces informations par le commissaire aux comptes. Or la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 a introduit la possibilité pour les sociétés non cotées de ne pas publier leur rapport de gestion. Cette disposition, combinée à l’obligation de publier les informations sur les délais de paiement, aurait potentiellement pour conséquence d’imposer aux sociétés non cotées choisissant de ne pas déposer leur rapport de gestion au greffe de publier un document spécifique relatif aux délais de paiement, ce qui serait coûteux et source d’une complexité injustifiée.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1679.
*
* *
Article 55 ter [nouveau]
(art. 526-1 à 526-3 du code de commerce)
Insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels
Le présent article, adopté à l’initiative des rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, vise à protéger d’office la résidence principale affectée à un usage non professionnel par la suppression de la déclaration obligatoire devant notaire.
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi n° 2003-271 du 1er août 2003 sur l’initiative économique a permis à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissables les droits qu’il détient sur l’immeuble formant sa résidence principale dans l’intention de favoriser ainsi la création d’entreprises (articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce). Elle a été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie (LME) pour étendre bénéfice de l’insaisissabilité aux droits détenus par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Elle a enfin été modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière afin de limiter les effets de la déclaration d’insaisissabilité en prévoyant que celle-ci n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsqu’elle relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
1. Nature de la déclaration d’insaisissabilité et personnes protégées
a. Nature de la déclaration d’insaisissabilité
Le patrimoine unique de l’entrepreneur individuel inclut en principe ses biens personnels et professionnels, ce qui fait que ses créanciers professionnels et/ou personnels peuvent le saisir indifféremment.
Certains biens peuvent faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, si bien que les créanciers professionnels ne peuvent saisir les biens visés. Elle ne prend effet pour les droits nés postérieurement à la publication de la déclaration, c’est à dire les dettes futures.
La déclaration d’insaisissabilité vise donc tout ou partie des biens immobiliers devant notaire pour se protéger de la poursuite des créanciers professionnels sur des biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel.
Si l’habitation principale protégée est vendue, son prix de la cession ne peut pas être saisi par les créanciers professionnels dont les droits sont nés après la publication de la déclaration, si les sommes obtenues sont réemployées dans un délai d’un an pour l’achat d’une nouvelle résidence principale. L’acte d’acquisition de ce bien devra contenir une déclaration de remploi des fonds établie selon les mêmes formalités de publicité que la déclaration initiale d’insaisissabilité.
b. Personnes protégées
Est concernée la protection des entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, les entrepreneurs au régime de la microentreprise et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Si l’entrepreneur est marié sous un régime de communauté, il devra justifier lors de son immatriculation, de l’information de son conjoint concernant les conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de l’activité professionnelle (ex : attestation sur l’honneur, lettre RAR).
Les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du mariage si le déclarant est attributaire des biens concernés. Par contre, en cas de décès du déclarant, elle est révoquée et ne peut plus produire d’effets (article L. 526-3 du code de commerce).
2. Les biens protégés, les modalités de la déclaration et les frais associés
a. Les biens protégés
Il s’agit de l’habitation principale, même démembrée, et tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à l’usage professionnel.
Si le bien immobilier est utilisé pour un usage professionnel et d’habitation, seule la partie précisée dans un état descriptif de division destinée à l’habitation sera protégée par la déclaration d’insaisissabilité. (cet état sera inutile si l’entrepreneur individuel domicilie son activité professionnelle dans son local d’habitation…)
b. Les formalités à respecter
La déclaration doit être reçue par un notaire et doit faire l’objet des mesures de publicité suivantes :
– une publication au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier ;
– une mention dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est, le cas échéant, immatriculée ;
– une publication, par extrait, dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle, lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un tel registre.
Ainsi, la déclaration d’insaisissabilité porte sur les biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel.
Elle se distingue de la déclaration d’affection du patrimoine du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, laquelle porte obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et facultativement sur les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés dans ce cadre (cette dernière, permet d’exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d’insaisissabilité). Ainsi, l’entrepreneur d’une EIRL peut limiter l’étendue de la responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société. Les deux déclarations peuvent être cumulées.
3. Les frais associés à cette déclaration
Les frais fixes demandés pour cette formalité correspondent aux :
– frais d’établissement de l’acte notarié : 139,93 euros ;
– frais d’accomplissement de formalités préalables ou postérieures à l’acte (demande de cadastres, extraits d’acte, copie de publicité foncière…) : 419,80 euros.
– frais de publication de la déclaration au bureau des hypothèques : 25 euros.
– salaire du conservateur des hypothèques : 15 euros.
À ces frais s’ajoutent des accessoires liés notamment au nombre de copies de l’acte.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Le présent article, adopté à l’initiative des rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, vise à instaurer une insaisissabilité d’office de la résidence principale des entrepreneurs individuels, par la suppression de la déclaration obligatoire devant notaire.
La déclaration d’insaisissabilité prévue aux articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce précités est en effet peu mise en œuvre en raison des formalités substantielles qu’elle implique et de son caractère onéreux. En pratique, lors de leur installation, les entrepreneurs individuels consacrent leur trésorerie au lancement de leur activité et remettent souvent à plus tard ces formalités, voire à jamais.
Afin de préserver la cellule familiale des conséquences des difficultés professionnelles éventuelles qu’ils pourraient rencontrer, le présent article instaure une protection par défaut de leur résidence principale, ou de la partie de leur résidence principale affectée à un usage non professionnel, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
La protection offerte par le présent article ne prendra effet que pour les créances professionnelles naissant après l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle ne remet pas en cause les dispositions actuelles rendant inopposables à l’administration fiscale l’insaisissabilité de la résidence principale en cas de fraude fiscale ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Le principe d’une déclaration d’insaisissabilité pour d’autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel est par ailleurs conservé.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1676 des rapporteurs.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement est le fruit de la ténacité. Issu de mon rapport sur l’entrepreneuriat individuel, il prévoit la protection par défaut – sans déclaration d’insaisissabilité devant notaire – de la résidence principale pour l’entrepreneur individuel. Cette mesure, qui n’avait pas été retenue dans la loi Pinel, est particulièrement importante, car de nombreux entrepreneurs individuels ignorent qu’ils engagent leur habitation principale en créant une entreprise.
Il s’agit d’une mesure de simplification et de protection pour les entrepreneurs individuels qui pourrait trouver un prolongement en matière fiscale dans l’établissement d’une distinction entre les revenus de l’entreprise et les revenus tirés de l’entreprise. Vous savez que les entrepreneurs individuels sont soumis à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs bénéfices sauf lorsqu’ils ont choisi le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). L’EIRL qui avait vocation à protéger le patrimoine de l’entrepreneur n’a pas rencontré le succès escompté en raison de la complexité du changement de statut.
M. le ministre. Cet amendement est très important. En apportant une protection, il répond à une problématique – de manière partielle, ne soyons pas naïfs, les aspects bancaires ne peuvent pas être occultés. Cette mesure d’équité, qui récompense plus justement la prise de risque, est dans la droite ligne de la philosophie du projet de loi. C’est une mesure de justice qui est bonne pour l’activité. J’y suis très favorable.
M. le président François Brottes. Je suppose que l’amendement précise que seule la partie de l’habitation qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est protégée.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe UMP soutient cet amendement.
M. Jean-Charles Taugourdeau. La signature bilatérale d’un billet à ordre continuera-t-elle à engager tous les biens du signataire ? Ce mécanisme automatique sera-t-il exclu ?
M. le ministre. Toutes les pratiques consistant à mettre en collatéral des biens propres demeurent.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. L’entrepreneur individuel sera protégé par défaut sur sa résidence principale ou la partie de cette résidence principale non affectée à l’usage professionnel. Il lui sera toujours possible d’affecter des biens personnels à son entreprise par une déclaration auprès du notaire.
La commission adopte l’amendement SPE1676.
*
* *
Article 56
(art. L. 145-10, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49, L. 145-55 du code de commerce et art. 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)
Suppression de l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial
Le présent article supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire délivré par un huissier dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial en leur offrant la possibilité de recourir à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la place.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le statut des baux commerciaux, définis aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, concerne les commerçants qui ne sont pas propriétaires du local dans lequel ils exercent leur profession en exploitant un fonds de commerce. Au profit du commerçant locataire (preneur), le statut des baux commerciaux tend à garantir la stabilité dans l’exploitation du fonds de commerce.
Dans les relations entre bailleur et locataire, il existe une obligation de recourir à un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire à un acte notifié par un huissier de justice en dehors de toute juridiction, pour communiquer les décisions suivantes :
– la demande et le refus de renouvellement du bail ;
– l’accord du bailleur de renouveler le bail après un refus ;
– la justification d’un refus de renouvellement du bail sans versement de l’indemnité ;
– l’acceptation par le locataire des conditions de refus de renouvellement du bail ;
– la volonté du preneur d’user de son droit de priorité de louer dans l’immeuble reconstruit lorsque celui-ci avait été démoli pour cause de danger ou d’insalubrité ;
– la demande d’ajout, par le preneur, d’activités connexes à celle prévue dans le bail (déspécialisation partielle) ou d’activités différentes à celle prévue dans le bail (déspécialisation totale) et le renoncement à ces demandes.
Dans d’autres situations, le choix est laissé aux parties contractantes de recourir à un acte extrajudiciaire ou à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, au titre de l’article 145-31 du code de commerce, le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer le local par une de ces deux options. Par ailleurs, le choix entre ces deux moyens de notification a été offert au locataire qui donne son congé par l’article 20 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises modifiant ainsi l’article L. 145-9 du code de commerce. Cette récente modification visait à assouplir le formalisme en matière de congé.
L’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial était motivée par deux raisons principales. Premièrement la signification d’un document par un huissier donne date et contenu certains aux actes. Deuxièmement il constitue le point de départ de certains délais en matière de recours.
Cette obligation comporte cependant deux principaux inconvénients. Elle alourdit la procédure en soumettant la relation entre le bailleur et le locataire à un formalisme contraignant. Par ailleurs, elle fait peser un poids financier sur les parties contractantes puisque le recours à un acte extrajudiciaire pour notifier une décision est plus onéreux que l’utilisation d’une lettre recommandée. Par exemple, la demande de renouvellement d’un bail commercial par acte extrajudiciaire coûte 80 euros conformément au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale alors qu’une lettre recommandée avec avis de réception coûte au minimum 4,55 euros.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le présent article supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans toutes les situations de la vie d’un bail commercial pour simplifier les relations entre bailleur et locataire et alléger les coûts afférents aux procédures relatives aux baux commerciaux.
Les parties disposeront désormais de deux options pour se communiquer les décisions qu’elles prennent : le recours à l’acte extrajudiciaire ou le recours à la lettre recommandée avec avis de réception. Ces deux options permettent de donner une date certaine à la décision transmise. Le recours à l’huissier devient par conséquent facultatif.
Le 1° du I du présent article modifie trois alinéas de l’article L. 145-10 du code de commerce afin d’introduire la possibilité d’avoir recours à une lettre recommandée en plus de celle déjà prévue de recourir à un huissier dans les cas d’une demande ou d’un refus de renouvellement du bail. Par conséquent, la terminologie relative à la signification des actes est remplacée par celle de la notification puisqu’une lettre recommandée ne « signifie » pas mais « notifie » une décision.
Le 2° du I du présent article étend cette possibilité de choisir entre l’utilisation d’une lettre recommandée ou d’un acte extrajudiciaire à d’autres notifications que sont :
– l’accord du bailleur pour renouveler le bail après un refus (article L. 145-12 du code de commerce) ;
– la justification d’un refus de renouvellement du bail sans versement de l’indemnité (article L. 145-17 du code de commerce) ;
– l’acceptation par le locataire des conditions de refus de renouvellement du bail (article L. 145-18 du code de commerce) ;
– la volonté du preneur d’user de son droit de priorité de louer dans l’immeuble reconstruit lorsque celui-ci avait été démoli pour cause de danger ou d’insalubrité (article L. 145-19 du code de commerce) ;
– l’information du bailleur en cas de déspécialisation partielle (article L. 145-47 du code de commerce) ;
– la demande de déspécialisation totale (article L. 145-49 du code de commerce) ;
– l’information du bailleur de renoncement à la déspécialisation (article L. 145-55 du code de commerce).
Le 3° du I du présent article effectue une modification rédactionnelle en cohérence avec l’adjonction de la lettre recommandée comme moyen de notification opérée à l’article L. 145-49 du même code.
Le II du présent article rend expressément applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du I, ce qui est nécessaire en raison du fait que cette collectivité est régie par le principe de la spécialité législative.
Il corrige également un oubli en ce qui concerne l’application de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’Allégement des démarches administratives dans cette collectivité d’outre-mer. Pour mémoire, cet article 2 a remplacé la notion de « tacite reconduction » par celle de « tacite prolongation » au sein des articles L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce car les effets juridiques attachés à ces deux notions sont différents : la « tacite reconduction » marque la formation d’un nouveau bail alors que la « tacite prolongation » manifeste simplement la poursuite du bail en cours, ce qui est bien la situation du bail commercial au-delà de son terme, en l’absence de congé ou de demande de renouvellement, y compris à Wallis-et-Futuna. Il convient donc de réparer cet oubli.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Le rapporteur thématique soutient l’objectif de simplification des relations entre bailleurs et locataires à travers la généralisation d’un droit d’option entre une signification par acte d’huissier ou une notification par lettre recommandée avec accusé-réception. Il lui apparaît néanmoins important de prévoir une exception à ce principe dans l’hypothèse la plus grave et qui comporte les conséquences les plus importantes pour le locataire en privilégiant la signification de l’acte notifiant le refus de renouvellement par le bailleur, suite à une demande en renouvellement notifiée par le locataire.
IV. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
Sur proposition des rapporteurs et après un avis de sagesse du Gouvernement, la Commission a supprimé le cinquième alinéa du présent article afin de maintenir l’obligation de procéder par signification en ce qui concerne l’acte notifiant le refus de renouvellement du bail par le bailleur, suite à une demande du locataire.
*
* *
La commission examine les amendements identiques SPE1508 des rapporteurs et SPE279 de M. Gilles Lurton.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement, identique à des amendements de l’opposition, propose de maintenir l’obligation de procéder par signification pour l’acte notifiant le refus de renouvellement par le bailleur, suite à une demande en renouvellement notifiée par le locataire.
Il importe, pour protéger les parties, de maintenir la signification dans ce cas.
M. le ministre. Avis favorable.
M. Alain Tourret. Je rappelle l’importance très lourde de conséquences que les tribunaux attachent à l’erreur consistant à utiliser la lettre recommandée ou l’acte extrajudiciaire au lieu de la signification : elle aboutit soit à un renouvellement automatique du bail soit à la nullité du congé. Le défaut de forme est considéré comme un défaut de fond. Il me semblerait utile de s’attaquer à ce problème tant les incidences sont graves.
La commission adopte les amendements SPE1508 et SPE279.
Puis elle adopte l’article 56 modifié.
*
* *
Article 56 bis [nouveau]
(art. 1244-4 [nouveau] et 2238 du code civil, art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution)
Création d’une procédure amiable de recouvrement des petites créances par l’intermédiaire des huissiers
À l’initiative des rapporteurs et de M. Sébastien Huyghe, Mme Véronique Louwagie et M. Gilles Lurton, la Commission a adopté un amendement introduisant, une nouvelle procédure amiable de recouvrement des petites créances à l’article 1244-4 (nouveau) du code civil.
1. La situation actuelle
Les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillance des entreprises. Si toutes les catégories d’entreprises sont concernées, les petites et moyennes entreprises (PME) et en particulier les très petites entreprises (TPE) ainsi que les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. La moindre facture impayée a, en effet, pour ces entreprises, un impact immédiat sur leur trésorerie, les obligeant à puiser dans leurs fonds propres.
En France, le retard de paiement moyen reste bloqué au-dessus du seuil des 12 jours. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. À titre d’exemple, une étude d’Altares-D&B, qui analyse en permanence environ 65 milliards d’encours clients au travers des balances âgées confiées par les entreprises françaises a constaté qu’à l’été 2013, 7,5 milliards étaient échus et non réglés soit 11,5 % du total des encours.
On constate par ailleurs que les procédures judiciaires actuelles ne sont plus adaptées pour permettre aux entreprises créancières de parvenir rapidement et de façon peu coûteuse à la mise en exécution forcées des factures impayées, notamment lorsque celles-ci concernent des petites créances. En effet, pour ces petites créances, une TPE ou une PME n’entame que rarement, contre son client, qui tarde ou néglige de le payer une procédure judiciaire qui s’avèrera longue et nécessitera d’engager des frais d’un montant disproportionné au regard du montant de la créance. Ces mêmes considérations valent aussi pour les professions libérales et plus généralement pour toutes les créances de faible montant.
2. Le dispositif proposé
Dans ce contexte, le présent article introduit une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des petites créances, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire lorsque la créance, de nature contractuelle et d’un montant limité, n’est pas contestée par le débiteur.
Les huissiers de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires en cas de chèques impayés pour défaut de provisions, pourront ainsi constater l’existence d’un accord entre le créancier et le débiteur sur le montant et les modalités de règlement de la créance et rendre celui-ci exécutoire dès lors que la créance serait reconnue et acceptée par le débiteur.
La procédure proposée se déroulerait selon les modalités suivantes :
– Production de la créance auprès de l’huissier de justice : le demandeur d’une créance contractuelle d’un montant inférieur à un plafond fixé par décret (qui pourrait se situer entre 1 000 et 2 000 euros au regard des expériences de droit comparé) pourra saisir tout huissier de justice par tout moyen de son choix, y compris par voie électronique, au moyen d’un formulaire détaillant la nature du litige, le montant réclamé et en joignant les pièces justificatives de sa créance.
– Notification au débiteur : quand l’huissier de justice aura reçu le formulaire de demande dûment complété, il en informera immédiatement, par lettre recommandée avec accusé réception, le débiteur. Cette demande de paiement, à laquelle sera jointe copie du formulaire adressé à l’huissier de justice par le créancier, ainsi que les pièces justificatives, invitera le débiteur, dans un délai de quinze jours, à indiquer s’il reconnaît l’existence et le montant de cette créance et l’invitera le cas échéant à la régler immédiatement, ou à proposer une négociation au créancier sur les modalités de règlement de la créance (échéances et/ou montant) ou sur le fond de celle-ci.
– En cas d’accord entre les parties, celui-ci sera constaté dans un procès-verbal établi par l’huissier de justice. Ce procès-verbal sera revêtu de la formule exécutoire, en vertu de la modification opérée au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant d’une procédure amiable, tous les frais seront à la charge du créancier.
En tout état de cause, cette procédure interrompra le délai de prescription visé à l’article 2238 du code civil au même titre que tout autre dispositif de médiation ou de conciliation.
3. L’impact de la mesure proposée :
L’introduction de cette procédure amiable de recouvrement des petites créances est positive :
– pour le créancier car elle lui offre une procédure rapide pour le recouvrement de créances aujourd’hui abandonnées, moyennant des frais très faibles ;
– pour le débiteur car la procédure garantit complètement son droit de refuser le paiement d’une créance qu’il estimerait non due. Dans ce cas, aucune démarche coercitive ne pourra être mise en œuvre à son encontre. Au demeurant, il ne subira aucune charge du fait de cette procédure ;
– pour l’économie : cette procédure nouvelle permettre d’augmenter le taux de recouvrement des petites créances, source de trésorerie pour les PME/TPE, tout en préservant le droit des débiteurs et participera au désengorgement des tribunaux pour des créances de faible montant.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques SPE1514 des rapporteurs et SPE1106 de M. Sébastien Huyghe.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement tend à créer une procédure de recouvrement des petites créances par huissier afin de remédier aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs des petites entreprises. Le retard de paiement moyen reste bloqué au-dessus du seuil des douze jours. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard.
Il est proposé de mettre en œuvre une procédure simplifiée et déjudiciarisée permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire lorsque la créance, de nature contractuelle et d’un montant limité, n’est pas contestée par le débiteur.
M. Gilles Lurton. Cette procédure permettra de résoudre les difficultés de trésorerie d’un grand nombre de petites entreprises.
M. le ministre. Avis favorable.
Mme Colette Capdevielle. En dépit de la faiblesse des montants, avez-vous prévu un moyen de contestation de la créance ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Il s’agit d’une procédure amiable.
La commission adopte les amendements SPE1514 et SPE1106.
*
* *
Après l’article 56 bis
La commission examine l’amendement SPE1484 de M. Jean-Frédéric Poisson.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement d’appel concerne les contrats de mise à disposition au sein d’un commerce – les grands magasins, par exemple – d’espaces de vente distincts dudit commerce. Il convient de clarifier le cadre juridique, car la fin de ces contrats suscite des contestations et peut donner lieu à une indemnisation indue.
M. le ministre. Sous réserve de plus ample expertise, la jurisprudence apporte déjà une réponse satisfaisante à la difficulté que vous soulevez en permettant de déterminer si les contrats de mise à disposition sont soumis au statut des baux commerciaux. Votre amendement risque de priver certains occupants de ces espaces de ce statut protecteur.
Nous sommes toutefois disposés à travailler avec vous pour clarifier ce point.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Je conviens de la nécessité d’un travail avec le Gouvernement pour trouver un équilibre entre la prise en compte de la spécificité des contrats de mise à disposition et la préservation de l’universalité des baux commerciaux.
M. Jean-Frédéric Poisson. Compte tenu de la proposition du ministre, je retire l’amendement, dont l’intention n’est évidemment pas de bouleverser les situations existantes ou de remettre en cause la validité des contrats en cours.
Sachez toutefois, monsieur le ministre, que vous prenez un risque en opposant à un commissaire aux lois l’argument selon lequel la jurisprudence exonère le Parlement de faire la loi.
L’amendement SPE1484 est retiré.
*
* *
Article 57
Habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour transposer une directive et pour simplifier le droit relatif aux contrats de concession
Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession et celles permettant de rassembler et de simplifier sous un corpus juridique unique les règles communes aux différents contrats de la commande publique.
Cet article s’inscrit dans le cadre du grand chantier de rénovation du droit de la commande publique initiée par l’article 42 la loi du 20 décembre 2014 (74), habilitant le Gouvernement à transposer deux autres directives du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatives à la commande publique, l’une dite « secteurs classiques », portant sur la passation des marchés publics (2014/24/UE), et l’autre dite « secteurs spéciaux », relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (2014/25/UE).
I. LE RÉGIME JURIDIQUE DES CONTRATS DE CONCESSION
A. LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Le 20 décembre 2011, la Commission européenne a présenté trois propositions de directives afin de moderniser le cadre normatif européen de l’achat public portant sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et spéciaux et sur l’attribution des contrats de concession.
Trois directives ont finalement été adoptées le 11 février 2014 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union et publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 28 mars 2014 :
– la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (dite « secteurs classiques ») abrogeant la directive 2004/18/CE ;
– la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (dite « secteurs spéciaux »), abrogeant la directive 2004/17/CE ;
– la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, dite directive « concessions ».
Ces directives doivent être transposées dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, c’est-à-dire avant le 18 avril 2016.
Les concessions sont des formes bien connues de partenariat entre le secteur public et des entreprises, privées pour la plupart, qui ont montré leur utilité, par exemple pour le développement des infrastructures. Selon la Banque européenne d’investissement, plus de 1 300 contrats de partenariat public/privé (PPP) ont été conclus dans l’Union européenne entre 1990 et 2009, ce qui représente plus de 250 milliards d’euros. Les concessions sont la forme la plus courante de PPP (60 %).
Les concessions diffèrent des marchés publics auxquels les autorités publiques ont généralement recours pour l’achat de fournitures, la réalisation de travaux ou la prestation de services. En effet, dans le cas d’un marché public, un opérateur économique reçoit une somme forfaitaire pour réaliser le travail ou fournir le service demandé tandis que dans le cas d’une concession, un opérateur économique reçoit une rémunération substantielle consistant dans le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service.
Or, le cadre juridique actuel est fragmenté et repose sur une jurisprudence complexe de la Cour de Justice de l’Union européenne et des législations nationales divergentes. Il manque de clarté et, par conséquent, ne garantit pas une sécurité juridique suffisante. Ainsi, seules les concessions de travaux faisaient l’objet de dispositions particulières dans la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a certes tenté de combler cette lacune, dans son arrêt Telaustria (75), en déduisant des règles fondamentales du traité une « obligation de transparence » consistant à garantir à tout soumissionnaire potentiel « un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication », mais le contenu et la portée de cette obligation n’ont pas été définis plus précisément et la jurisprudence postérieure n’a traité que partiellement de la passation des concessions de services. Les opérateurs économiques et les banques s’exposaient dès lors à des risques considérables lorsqu’ils engageaient de grosses sommes d’argent dans des concessions à long terme. Les autorités publiques pouvaient voir leurs contrats contestés et résiliés.
Les nouvelles règles proposées par la directive « concessions » mettent en place un cadre juridique unique et stable et, de ce fait, améliorent sensiblement la situation pour les États membres lorsqu’ils feront le choix de la concession. Elles devraient permettre de favoriser de nouveaux investissements, l’innovation, le développement des infrastructures et de services et, partant, contribuer à la relance économique au sein de l’Union européenne.
L’on peut ainsi relever quatre avantages majeurs résultant de l’adoption de la directive « concession » par rapport à la situation antérieure.
i. Une amélioration sensible de la sécurité juridique des entreprises liées à la création d’un cadre juridique approprié, équilibré et flexible
En premier lieu, la directive définit, pour la première fois, la notion de « concession de travaux » et de « concession de services » pour l’ensemble de l’Union européenne (article 5).
La « concession de travaux » est un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
La « concession de services » est un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée précédemment à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
Dans tous les cas, la directive précise que la concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux, contrairement à la passation de marchés publics. Il s’agit d’une précision utile qui s’inspire largement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (76).
Ainsi, par exemple, si un opérateur économique est rémunéré par le biais de redevances payées par les usagers, toute diminution du nombre d’usagers peut entraîner une perte. Toutefois, le contrat ne sera pas défini comme une concession si le pouvoir adjudicateur indemnise ledit opérateur pour les pertes subies. Il ne sera pas non plus considéré comme une concession si un opérateur économique est autorisé à exploiter certains domaines publics, notamment dans les secteurs maritime, portuaire intérieur ou aéroportuaire, sans fournir des ouvrages ou des services spécifiques au pouvoir adjudicateur.
La directive prévoit néanmoins différents cas d’exclusion applicables aux concessions : concession de service attribuée sur la base d’un droit exclusif, concession dans les secteurs de l’eau, des transports de voyageurs, de la défense et de la sécurité ou encore celles qui ont pour objet un service social (service de santé, restauration scolaire…). Dans ces cas-là, chaque État membre applique la législation nationale en vigueur.
En second lieu, la directive précise clairement les règles applicables en cas de modifications des contrats de concession en cours (article 43). Celles-ci aideront les autorités publiques à déterminer si les modifications sont de nature à nécessiter une nouvelle procédure de passation ou non.
Ainsi, reprenant la jurisprudence dégagée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Pressetext (77), la directive prévoit qu’il sera possible de modifier une concession sans passer par une nouvelle procédure d’adjudication si les modifications sont prévues dans l’acte de concession initial et font l’objet de clauses de révision claires, précises et sans équivoque. Elle prévoit également une certaine flexibilité dans le sens où elle permet d’adapter une concession en fonction de circonstances extérieures que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas prévoir.
ii. Une transparence accrue favorisant de nouvelles perspectives commerciales
La directive impose désormais une publication obligatoire des avis de concession lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 5,186 millions d’euros dans le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) (article 8).
Elle fixe également les délais de réception des candidatures et des offres pour la concession (article 39) ainsi que la nature des informations transmises aux candidats et aux soumissionnaires (article 40).
La directive offre enfin la possibilité, pour le concessionnaire, de confier à des tiers l’exécution d’une partie du contrat de concession, qu’il ne peut ou ne veut assurer lui-même (article 42). Le recours à d’autres entreprises devrait permettre de favoriser l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées, notamment des petites et moyennes entreprises (PME).
Grâce à une transparence accrue, de nouvelles perspectives commerciales s’ouvriront donc aux entreprises européennes, en particulier aux PME qui jusqu’alors n’étaient pas toujours informées du lancement d’une procédure d’attribution de concession et ne pouvaient y participer comme sous-traitants.
iii. La préservation de la liberté des pouvoirs publics dans le choix du mode de gestion de leurs services publics consacrant la spécificité des concessions
L’article 2 de la directive reconnaît le principe de libre administration par les autorités nationales, régionales et locales, conformément au droit national et de l’Union. Ces autorités sont libres de décider du mode de gestion qu’elles jugent le plus approprié pour l’exécution de travaux ou la prestation de services, pour assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.
En conséquence, les autorités peuvent choisir d’exécuter leurs missions d’intérêt public en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d’autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques. La directive n’affecte pas les régimes de la propriété des États membres. En particulier, elle n’impose pas la privatisation d’entreprises publiques qui fournissent des services au public. De plus, elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir ce qu’ils entendent par service d’intérêt économique général.
Enfin, la directive n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la valeur de la concession est inférieure au seuil de 5,186 millions d’euros ce qui reflète l’intérêt transfrontalier certain ou manifeste de ces contrats, comme le recommandait la France au cours des négociations. Les méthodes de calcul de ce seuil sont précisées clairement et, contrairement à la proposition initiale de la Commission européenne (78), la règle retenue fondée sur « le chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice » préserve pour l’essentiel les solutions du droit français des délégations de service public.
iv. L’instauration de garanties procédurales pour renforcer la confiance dans l’impartialité des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs
Pour assurer aux candidats et soumissionnaires participant aux procédures d’attribution de concessions une protection juridique adéquate et pour garantir le respect effectif de la directive « concessions » et des principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les directives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics n° 89/665/CEE (79) (article 46) et n° 92/13/CEE (80) (article 47) s’appliqueront aux concessions de services ou de travaux attribuées par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.
B. LE DROIT INTERNE
En droit français, les contrats de concession sont actuellement soumis à des règles variant en fonction de leur objet et de la qualité de l’autorité concédante.
L’attribution des contrats de concession de travaux publics relève de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 pour les pouvoirs adjudicateurs visés par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (81), du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 pour l’État et ses établissements publics, et des articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
L’attribution des délégations de service public est régie, pour l’État et ses établissements publics, par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1411-1 à L. 1 411-19 du CGCT.
En outre, les contrats de concession de service qui n’ont pas pour objet l’exploitation ou la gestion d’un service public ne sont pas réglementés en droit interne et sont simplement soumis aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’ils présentent un intérêt transfrontalier certain.
II. L’OBJET DE L’HABILITATION PROPOSÉE
L’article 57 du projet de loi a pour but d’habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour transposer la directive « concession », rassembler au sein d’un régime juridique unique les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne et procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
A. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « CONCESSION »
Le 1° de l’article 57 habilite le Gouvernement à transposer la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, dite « directive concession ».
Le choix du recours à une habilitation législative pour transposer cette directive ne saurait être analysé comme une dépossession injustifiée par le législateur français de ses compétences. Cette directive est un texte détaillé et technique qui ne confère que très peu de marge de manœuvre à chaque État membre. Les seules options qu’elles ouvrent n’offrent pas matière à débat dans la mesure où elles portent sur des dispositifs qui existent déjà dans notre droit national, favorables aux entreprises, en particulier les PME, et que nul ne songe à remettre en cause. Au demeurant, le délai particulièrement resserré de transposition (deux ans) milite lui aussi pour un recours aux ordonnances d’autant plus que de nombreux textes réglementaires d’application sont appelés à être élaborés en concertation avec les différents acteurs (publics, opérateurs privés, syndicats…).
Par ailleurs, le contenu de la future ordonnance, tel qu’il apparaît d’après les dispositions de l’article 57 et les précisions apportées dans l’étude d’impact, devrait éviter l’écueil de la surtransposition, contre lequel a mis en garde notamment la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France dans une contribution écrite qu’elle a fait parvenir au rapporteur thématique. Par conséquent, l’ordonnance se limitera à une transposition a minima de la directive en reprenant systématiquement toutes les mesures favorables à la compétitivité, à l’innovation et aux PME.
Ainsi, l’étude d’impact précise-t-elle que l’ordonnance n’aura pas vocation à étendre les dispositions de la directive aux secteurs exclus de son champ d’application. Par conséquent, les opérateurs économiques et les autorités concédantes agissant dans certains secteurs d’activité stratégiques tels que le secteur de la distribution, du traitement ou de l’assainissement de l’eau ou encore les services de transports de voyageurs ne seront pas impactés par les disciplines issues de la directive au regard du droit national existant. Ils resteront soumis au régime juridique simplifié résultant de la « loi Sapin ». Le Gouvernement n’entend pas non plus déréglementer les secteurs exclus du champ d’application de la directive s’ils étaient jusqu’à son entrée en vigueur, réglementés par un cadre spécifique tel que celui prévu par la loi Sapin.
L’étude d’impact précise que, pour les contrats de concession relevant du champ de la directive, le Gouvernement souhaite préserver toutes les mesures prévues par le texte européen qui s’inspirent ou s’apparentent à des dispositions en vigueur en droit interne telles que la durée des contrats ou le recours à la négociation comme procédure de droit commun pour la passation des contrats de concession.
L’ordonnance devrait également tirer parti des flexibilités offertes par la directive concernant la quasi-régie et la coopération entre personnes publiques jusqu’alors régies par la jurisprudence. Le champ des exceptions relatives à la quasi-régie a été clarifié et étendu par la directive, permettant ainsi aux autorités concédantes de confier sans publicité ni mise en concurrence, des prestations à des entités avec lesquelles elles entretiennent une relation particulière. La directive exclut en outre les contrats de concession conclus entre plusieurs autorités concédantes aux fins de fournir, conjointement et sans contrepartie, leurs services publics par la voie de la coopération. De telles dérogations, gages de souplesse pour les autorités concédantes, doivent être intégrées dans notre droit national par l’ordonnance car elles constituent le corolaire de l’affirmation du principe de libre administration des personnes publiques et du libre choix des modalités de mise en œuvre, par les collectivités publiques, de leurs missions d’intérêt général.
Enfin, la future ordonnance devrait transposer fidèlement les dispositions de la directive qui assouplissent les conditions de recours à un avenant pendant l’exécution d’un contrat de concession. Ce sont en effet des contrats de longue durée, qui doivent s’adapter aux nécessités des travaux et services en cause, pour garantir, à chaque instant dans l’exploitation du contrat, leur qualité et leur performance.
B. LE RASSEMBLEMENT AU SEIN D’UN RÉGIME JURIDIQUE UNIQUE DES RÈGLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS DE CONCESSION EN DROIT FRANÇAIS ; L’ADAPTATION DES RÈGLES PARTICULIÈRES PROPRES À CERTAINS DE CES CONTRATS
Le 2° de l’article 57 autorise le Gouvernement à compléter cette ordonnance par des mesures permettant de rassembler de simplifier, au sein d’un régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique, qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, et de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
La transposition de la directive « concessions » est en effet l’occasion de procéder à une harmonisation des notions françaises et européennes afin de garantir la lisibilité du droit et la sécurité juridique des différents contrats de concession (concession de travaux, délégation de service public…) au sein d’un régime juridique unique.
Ayant vocation à régir tous les contrats de concession quel que soit leur objet, l’ordonnance devrait donc mettre en cohérence avec la directive les régimes concessifs sectoriels qui figurent dans des textes particuliers, tels que le code des transports, le code de l’urbanisme ou le code du tourisme, tout en préservant leurs spécificités, comme le montrent les exemples ci-après.
Exemple 1 : Les concessions aéroportuaires
Aux termes de l’article L. 6321-2 du code des transports, l’exploitation des aérodromes peut être assurée directement par une personne publique ou privée dont ils relèvent ou confiée par cette personne à un tiers. Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, l’exploitation est réalisée conformément aux dispositions du livre IV de la première partie du CGCT. Parmi elles, figurent notamment les dispositions relatives aux délégations de service public. En l’état du droit actuel, le régime des délégations de service public s’applique aux seules personnes morales de droit public. Toutefois, à l’issue de la transposition, les contrats de concession, y compris ceux portant sur un service public, passés par des personnes publiques ou privées revêtant la qualité de pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, seront soumis aux dispositions de l’ordonnance. Il conviendra, dès lors, de substituer, à l’article L. 6321-2 du code des transports, « pouvoirs adjudicateurs ou entité adjudicatrices » au terme de « collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ».
Exemple 2 : Les concessions de remontées mécaniques
L’article L. 342-8 du code du tourisme rend applicable aux remontées mécaniques les dispositions de l’article L. 1221-3 du code des transports, qui renvoie, expressément au règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, dit règlement OSP (ROSP). L’article 10 de la directive exclut les contrats de concession régis par le ROSP. Toutefois, le ROSP n’est applicable qu’aux contrats de concession de services ayant pour objet le transport public de voyageurs par chemin de fer ou par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique. Le renvoi exprès fait à l’article L. 1221-3 du code des transports devra donc être abrogé et les concessions de remontées mécaniques soumises aux dispositions du projet d’ordonnance.
Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil d’application de la directive « concession » (5,186 millions d’euros) et pour les contrats qui sont exclus de son champ d’application (par exemple, secteur de l’eau et des transports de voyageurs) ou qui ont pour objet un service social ou un autre service spécifique, l’ordonnance reprendra, au sein de ce nouveau corpus juridique unique, les dispositions qui leur sont déjà applicables en droit français.
Enfin, elle qualifiera de « contrats administratifs » les contrats de concession passés par les personnes morales de droit public, clarifiant ainsi le bloc de compétence juridictionnelle issue de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009.
L’architecture de la future ordonnance est présentée dans l’encadré ci-après.
L’article 106 du présent projet de loi impose qu’un projet de loi de ratification de la future ordonnance soit déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de sa publication.
L’architecture juridique de la future ordonnance selon l’étude d’impact
L’ordonnance définira d’abord le champ d’application organique et matériel du nouveau régime des contrats de concession (définition des contrats de concession et des autorités concédantes, précision des exclusions dont la quasi-régie et la coopération public-public), rappellera les principes fondamentaux de la commande publique et leurs exceptions (notamment la possibilité de réservation de certains contrats de concession) et précisera les règles applicables dans l’hypothèse de contrats mixtes, c’est-à-dire de contrats dont une partie seulement relève du régime concessif.
En matière de passation des contrats de concession, l’ordonnance définira les procédures applicables et les règles de confidentialité, limitera la durée des concessions et déterminera les cas et le régime des interdictions de soumissionner. Elle habilitera le pouvoir réglementaire à préciser les mesures de publicité adéquates, les modalités de calcul de la valeur estimée des contrats, les conditions de définition des spécifications techniques et fonctionnelles, les modalités de sélection des candidatures et de choix des offres, ainsi que les conditions d’achèvement de la procédure.
Pour l’exécution des contrats de concession, l’ordonnance déterminera les règles générales en matière d’information des autorités concédantes, prévoira la possibilité de confier une partie de l’exécution des contrats de concession à des tiers, encadrera la faculté de modifier ces contrats en cours d’exécution et précisera certaines hypothèses de résiliation des contrats de concession.
L’ordonnance habilitera le pouvoir réglementaire à préciser les mesures d’application nécessaires.
Enfin, elle traitera de la question de l’application des nouvelles dispositions et de leur éventuelle adaptation en outre-mer.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
Hormis un amendement rédactionnel, la Commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques SPE252 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE419 de M. Patrick Hetzel.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement de suppression est justifié par les motifs de forme traditionnels.
M. le ministre. Le recours à l’ordonnance est la méthode traditionnelle pour transposer une directive, sous tous les régimes. Avis défavorable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements SPE252 et SPE419.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1503 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 57 modifié.
*
* *
Article 58
(art. L. 121-21, L. 132-2 et L. 141-1-2 du code de la consommation, art. L. 465-2 du code de commerce)
Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (82) a conféré aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) la compétence pour prononcer des amendes administratives sanctionnant :
– les manquements aux dispositions contenues aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation ;
– l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article, lequel autorise les agents habilités à cet effet à enjoindre à un professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ;
– tout contrat contenant des clauses abusives relevant de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dites « clauses noires », soit les clauses dont le caractère abusif est irréfragable, à la différence des « clauses grises », dont le caractère non abusif peut être démontré ;
– les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du code de commerce ;
– l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1 du code de commerce.
Dans chacun de ces cas, a également été introduite la possibilité, pour la DGCCRF, d’ordonner la publicité de ces amendes à titre de sanction complémentaire. Les articles R. 132-2-2 et R. 141-6 du code de la consommation et l’article R. 465-2 du code de commerce, introduits par le décret du 30 septembre 2014 portant application de la loi relative à la consommation (83), précisent que cette publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage, la diffusion et l’affichage pouvant être ordonnées cumulativement.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
S’agissant d’une sanction, il est logique que ce soient les entreprises sanctionnées qui assument le coût de cette publicité. De plus, s’agissant d’une sanction complémentaire, il va également de soi que son montant ne doit pas dépasser le montant de la sanction principale.
Toutefois, ces points ne sont pas, pour l’heure, expressément mentionnés dans la loi. Aussi le projet de loi propose-t-il de modifier les articles L. 141-1-2 et L. 132-2 du code de la consommation (I), ainsi que l’article L. 465-2 du code de commerce (II), afin de dissiper toute ambiguïté. Le III prévoit l’applicabilité du II dans les îles Wallis et Futuna.
S’agissant du I, son 1° (alinéa 2) modifie le V de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation afin de préciser que la publicité des amendes administratives et des injonctions décidées par l’administration en vertu du I du même article est effectuée aux frais de la personne sanctionnée. Il prévoit également que le coût total de cette diffusion ou de cette publication ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. Ce plafond est compris entre 3 000 et 15 000 € pour une personne physique et entre 15 000 € et 75 000 € pour une personne morale en cas de manquements aux I à III de l’article L. 141-1, et entre 1 500 € et 3 000 € pour une personne physique et entre 7 500 € et 15 000 € pour une personne morale en cas de non-respect d’une injonction prononcée en application du VII du même article.
Son 2° (alinéas 3 et 4) complète l’article L. 132-2 du même code afin de préciser que, lorsque la publicité d’une injonction faite à un professionnel de supprimer des clauses « noires » de ses contrats a été décidée, cette publicité s’effectue aux frais du professionnel concerné, et que le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. Ce plafond est compris entre 1 500 € et 3 000 € pour une personne physique et entre 7 500 € et 15 000 € pour une personne morale.
Le II (alinéa 5) complète le V de l’article L. 465-2 du code de commerce afin de préciser que la publicité des amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du même code, ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à son article L. 465-1, s’effectue aux frais de la personne concernée, et que le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. S’agissant des amendes sanctionnant les manquements au titre IV du livre IV, ce plafond est compris entre 15 000 et 75 000 € pour une personne physique, et entre 75 000 et 375 000 € pour une personne morale, selon le manquement constaté. S’agissant du non-respect d’une injonction prononcée en application du II de l’article L. 465-1, il est de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
Enfin, le III (alinéa 6) prévoit l’applicabilité du II dans les îles Wallis et Futuna. Cette précision est justifiée par le fait que Wallis-et-Futuna est une collectivité régie par le principe de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Or, comme le Conseil d’État l’a rappelé dans son arrêt du 9 février 1990 « Élections municipales de Lifou », il ne suffit pas qu’un texte modifie un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être lui-même, et de ce seul fait, applicable. Cette précision n’a pas lieu d’être pour les autres collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative car l’article L. 465-2 du code de commerce n’y est pas applicable.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Le rapporteur thématique approuve le dispositif proposé par le Gouvernement, qui complète utilement les dispositions adoptées par la représentation nationale dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
IV. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Outre trois amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement de M. Joël Giraud et de M. Alain Tourret, tendant à modifier l’article L. 121-21 du code de la consommation, afin de préciser que la possibilité, pour le consommateur, de se rétracter dès la conclusion d’un contrat, s’applique aux contrats conclus hors établissement.
*
* *
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1205 et SPE1206 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1246 de M. Joël Giraud.
M. le ministre. Avis favorable à cet amendement qui limite aux seuls contrats conclus hors d’un établissement commercial la possibilité pour le consommateur de se rétracter d’un contrat à compter du jour de sa conclusion.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1246.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1207 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 58 modifié.
*
* *
Article 58 bis [nouveau]
(art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce)
Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL
sur le territoire
Cet article, résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à faciliter le déplacement des sièges sociaux des sociétés à responsabilité limitée (SARL), en autorisant leur gérant à le réaliser sur l’ensemble du territoire.
À cette fin, il modifie l’article L. 223-18 du code de commerce, qui permet actuellement au gérant d'une SARL de déplacer le siège social de celle-ci au sein du même département ou d'un département limitrophe, sous réserve d’une ratification par l'assemblée des associés votant à la majorité des parts sociales. L’obligation de ratification par l’assemblée des associés et la majorité requise demeurent inchangées.
En conséquence, il modifie également les articles L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce, textes respectivement relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna, afin de tenir compte des modifications portées à l’article L. 223-18.
Cette modification s'inscrit dans la continuité de la disposition adoptée à l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, qui a assoupli la règle de majorité applicable à la ratification de la décision du gérant de déplacer le siège d'une SARL, en la faisant passer des trois quarts des parts sociales, à la moitié de celles-ci.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1538 du Gouvernement.
M. le ministre. Nouvelle mesure de simplification, cet amendement permet au gérant d’une société à responsabilité limitée de déplacer le siège social avec une formalité simplifiée en France et non plus seulement au sein du même département ou d’un département limitrophe. Cette décision doit être ratifiée par l’assemblée des associés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1538.
*
* *
Article 58 ter [nouveau]
(art. L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce)
Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils
de surveillance
Cet article vise à assurer l’information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance de celles-ci.
Il introduit, aux articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce, relatifs aux conditions de désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes, respectivement, une obligation de transmettre à l’assemblée générale, au moins une fois tous les cinq ans, des informations concernant la variété des profils professionnels parmi les administrateurs et les membres du conseil de surveillance.
*
* *
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements SPE1096, SPE1228 et SPE1230 de Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Ces amendements portent tous sur une chose qui doit changer dans l’économie française : la consanguinité dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des entreprises. En la matière, la France est à l’âge de pierre par rapport à ses concurrents.
Malgré les volontés politiques réaffirmées, la diversité a peu progressé dans ces conseils. La consanguinité et une forme de cooptation demeurent. Or nous pouvons agir.
L’amendement SPE1096 est modéré. Il soumet les entreprises à une obligation d’information sur la diversité de la composition de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance tous les cinq ans. Outre la parité entre hommes et femmes, pour laquelle des règles existent, la notion de diversité recouvre les différents profils, les parcours professionnels ou la formation des personnes qui siègent dans ces conseils.
L’amendement SPE1228 est plus provocant. Il tend à interdire aux représentants siégeant dans les conseils d’administration ou de surveillance et cumulant plus de deux mandats de bénéficier de jetons de présence pour les mandats excédant ce nombre. Sachez que la rémunération peut atteindre 500 000 euros pour certains grands patrons d’industrie.
L’amendement SPE1230 propose de restreindre de cinq à deux le nombre de mandats détenus par une même personne. En l’absence de sanctions associée à la limitation à cinq du nombre de mandats prévue par le code de commerce, certaines personnes, rares, s’autorisent à s’affranchir de cette contrainte. Alors que le nombre moyen mandats se situe entre un et deux aux États-Unis, au Royaume-Uni, et dans une moindre mesure en Allemagne, il est entre trois et quatre en France.
Il faut agir maintenant pour lutter, sinon contre les conflits d’intérêts, du moins contre les intérêts convergents de certains conseils.
M. le ministre. Je suis sensible à la question de la gouvernance des entreprises que vous soulevez au travers de ces amendements.
Le code de commerce prévoit déjà une information sur la parité. Je partage pleinement la philosophie de votre amendement et vous propose donc d’examiner si des informations supplémentaires peuvent être données au-delà de ce qu’imposent la directive sur le reporting non-financier et le code de commerce.
Quant aux deux autres amendements, il me semble que deux cas doivent être distingués : celui du mandataire social qui détient parallèlement un mandat d’administrateur, qui est le cœur du conflit d’intérêts que vous pourfendez mais qui correspond à la tradition du capitalisme croisé français. Dans ce cas, il me semble possible d’aller plus loin que la limitation de la rémunération en réduisant le nombre de mandats autorisés pour ceux qui sont mandataires eux-mêmes. Le cas est différent pour un ancien dirigeant à la retraite pour lequel la limitation à deux mandats peut être sévère dès lors qu’il met son expérience au service des entreprises. Il faut y réfléchir.
La volonté de clarification et de moralisation en cette matière me semble pertinente. Je vous propose d’adopter l’amendement SPE1096 qui mérite d’être retravaillé. Il nous servira de point d’appui pour réfléchir sur le distinguo que je viens d’évoquer. En limitant indistinctement le nombre de mandats, on risque de se priver de gens d’expérience qui ne sont pas concernés par les conflits d’intérêts. De ce fait, j’émets un avis favorable sur le premier amendement et je vous invite à retirer les deux autres.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Sur l’amendement SPE1096, l’ouverture du ministre va dans le bon sens. Il convient de corriger une erreur matérielle en substituant au mot « administration » le mot « assemblée ». Quant aux deux autres amendements, ils invitent au débat mais ne sont pas applicables en l’état.
Mme Karine Berger. Je rectifie évidemment l’amendement SPE1096 dans le sens indiqué par le rapporteur thématique. Je suis prête à retirer les deux autres amendements et à les réécrire. Je retiens de l’invite du ministre la limitation à deux du nombre de mandats pour ceux qui exercent une fonction exécutive et à trois ou quatre – nous en discuterons – pour les autres.
M. Alain Tourret. Je vous mets en garde sur l’amendement SP1096. Dès lors que vous employez le terme « diversité », vous tombez sous le coup de la loi pénale, car vous faites implicitement référence à des considérations ethniques. Je vous conseille de préférer le terme de parité.
M. Jean-Charles Taugourdeau. J’ai été choqué par l’utilisation de l’expression « consanguinité ». Entendez-vous par là que les enfants d’un chef d’entreprise ne pourraient pas siéger au conseil d’administration ?
Mme Karine Berger. La diversité renvoie aux parcours professionnels, d’autant que l’information sur la parité est déjà prévue. Je ne suis pas opposée à apporter cette précision dans l’amendement. Quant à la consanguinité, elle vise évidemment la consanguinité d’entreprises, elle ne met pas en cause l’ADN.
M. Patrick Hetzel. Outre que je n’adhère pas au principe de cet amendement, l’emploi du terme de diversité me semble poser un sérieux problème juridique, sauf à l’expliciter davantage.
Par ailleurs, je suis surpris que le Gouvernement soit favorable à un amendement aux antipodes de la simplification qu’il défend.
Enfin, cet amendement raisonne sur l’hypothèse d’une homogénéité des entreprises dont chacun sait qu’elle est fausse. Il faut prendre en compte la taille des entreprises, leur activité et non la seule structure juridique de société anonyme. Il faut impérativement introduire de la nuance sans quoi cette mesure risque d’être contre-productive, voire d’avoir des conséquences extravagantes pour les entrepreneurs qu’il ne faut pas oublier.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Pourquoi ne pas remplacer le mot de diversité par celui très ancien et très simple de variété ?
M. Jean-Christophe Fromantin. Mes propos iront dans le même sens que ceux de M. Hetzel. Pour évaluer le rôle des administrateurs, ne nous focalisons pas sur le statut et le nombre de mandats, fondons-nous sur les besoins de l’entreprise. Les PME et ETI ont souvent recours à des administrateurs pour des missions de conseil. C’est très utile.
Je ne suis pas favorable à la réglementation dans ce domaine en dépit de certains abus dans certaines grandes entreprises du CAC40. Dès lors que les administrateurs remplissent correctement leur fonction de conseil, peu importe le nombre de mandats qu’ils détiennent.
M. le président François Brottes. Pour une entreprise qui monte en puissance, il peut être intéressant d’avoir à ses côtés un administrateur de renom pour obtenir des garanties bancaires ou autres. La consanguinité dans les grands groupes est une question. Au-delà, gardons-nous d’empêcher des soutiens aux entreprises en devenir.
M. Olivier Carré. Très bonne remarque !
Mme Karine Berger. Je propose de rectifier l’amendement SPE1096 pour remplacer le terme de diversité par les mots : « variété des profils professionnels ».
M. le ministre. Il y a incontestablement à travailler les deux points soulevés par cet amendement. Sur le premier point, l’idée n’est pas d’imposer une obligation déclarative à toutes les entreprises. Ce sont les grands groupes qui sont visés. Il faut déterminer un seuil d’application. Au sujet des mandats, les entrepreneurs qui font appel à des administrateurs de renom pour aider la PME ou l’ETI n’ont pas de raison d’être soumis à une limite.
Le problème français historique, que vous cherchez à traiter, tient au nombre de mandats cumulés par des mandataires sociaux au sein des conseils d’administration de grands groupes. Il ne faut pas imposer des contraintes qui priveraient d’expérience les PME et ETI. La réflexion s’ouvre. Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’amendement SPE1096 pour avoir une base de travail, en vue d’apporter, d’ici à la séance, des solutions aux problèmes de gouvernance dans les grands groupes.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Il faut pouvoir mesurer l’impact des propositions. Il serait intéressant de disposer de chiffes sur le nombre de mandats, le type et la taille des entreprises afin d’éclairer le débat et d’éviter les dispositions susceptibles de mettre en difficulté des entreprises en croissance.
Mme Karine Berger. Je retire les amendements au bénéfice de l’engagement du ministre de travailler à la mise en place d’un seuil pour le nombre de mandats d’ici à la séance.
Je précise que l’amendement SPE1096 qui est rectifié prévoit une information tous les cinq ans. Il n’est pas question ici d’une information annuelle.
La commission adopte l’amendement SPE1096 ainsi rectifié.
Les amendements SPE1228 et SPE1330 sont retirés.
*
* *
Article 58 quater [nouveau]
(art. L. 232-25 du code de commerce)
Faculté, pour les sociétés, d’obtenir la non-publicité de leurs comptes annuels
Cet article, issu d’un amendement de Mme Bernadette Laclais, tend à modifier l’article L. 232-25 du code de commerce, afin d’étendre à l’ensemble des sociétés la possibilité prévue au même article, pour les microentreprises, de demander la non-publicité de leurs comptes annuels lors du dépôt de ceux-ci. Cette possibilité a été introduite à l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des très petites entreprises.
Il vise à remédier à la concurrence déloyale à laquelle sont exposées les sociétés françaises, astreintes à une obligation de publicité de leurs comptes, tandis que nombre de leurs concurrents ne le sont pas.
Toutefois, cet article maintient l’obligation de dépôt des comptes annuels, et prévoit que les autorités judiciaires et administratives y accèdent librement.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE818 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. C’est un amendement auquel je tiens beaucoup. Des entreprises de plus en plus nombreuses rechignent à déposer leurs comptes de peur que les informations publiées soient exploitées par la concurrence. En effet, ces informations renseignent sur l’état de santé de l’entreprise et ses marges, et permettent à des personnes plus ou moins bien intentionnées d’exercer des pressions. Cet amendement a donc pour objet de donner la possibilité aux sociétés, quelle que soit leur forme, leur activité et leur importance, de déclarer que leurs comptes annuels ne seront pas rendus publics.
Il s’agit de ne pas donner à la concurrence des munitions pour mettre en difficulté les entreprises françaises dans un monde ouvert. Les sociétés françaises peuvent être fragilisées par certains modes de fonctionnement que nous ne pouvons pas ignorer.
M. le président François Brottes. Et il n’y a pas nécessairement réciprocité.
M. le ministre. Je partage votre analyse. Toutefois, au regard des contraintes législatives, en particulier la directive du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, la dispense de publication que prévoit l’amendement paraît trop large. Je vous propose de travailler en vue de la séance sur un amendement conforme au cadre communautaire, qui autoriserait à déroger à la publication pour certaines informations.
Je vous demande de retirer votre amendement au bénéfice de cet engagement.
Mme Bernadette Laclais. J’accepte de retravailler l’amendement afin de résoudre les difficultés juridiques. Je tiens à ce que l’on repère très précisément les éléments dont la publication est susceptible de fragiliser l’entreprise et que l’on veille à ce qu’ils ne figurent pas dans des documents dont la publication serait autorisée. À cet égard, une analyse vigilante du contenu du compte d’exploitation et du bilan est indispensable. Nous devons être sûrs de protéger l’entreprise d’autant que, M. Brottes l’a dit, la réciprocité n’existe pas.
Le respect des règles européennes s’impose, j’en suis consciente. Mais les entreprises de certains pays européens qui sont moins réactifs que nous dans la publication des données jouissent d’un avantage concurrentiel.
M. le ministre. En présence de concurrents étrangers, dans certains secteurs réduits, la divulgation d’informations peut devenir stratégique et poser problème pour certains acteurs français. C’est la difficulté que vous souhaitez résoudre.
Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue que le développement du financement participatif que nous appelons tous de nos vœux ne réussira que si l’information est publique. Donner des informations aux tiers peut être une contrainte sur le plan stratégique et industriel, mais la transparence est la condition de l’accès à des financements intermédiés. La cohérence avec nos objectifs en matière de financement de l’économie impose sans doute de ne pas supprimer toutes les informations transmises par les entreprises.
M. Olivier Carré. Ce sujet revient régulièrement. Au départ, je défendais les mêmes principes que vous, monsieur le ministre. Mais, après avoir recueilli de nombreux témoignages, cette position paraît bien naïve : nous savons que ce sont surtout les concurrents européens qui regardent les comptes.
L’intérêt de l’amendement réside dans le choix donné aux entreprises : elles n’ont pas l’obligation de ne pas publier. Une entreprise désireuse de solliciter un financement participatif peut opter pour la transparence, qui, dans ce cas, sera volontaire. La proposition de notre collègue est intéressante, car elle laisse la responsabilité au chef d’entreprise et à ses équipes.
Mme Bernadette Laclais. Je souhaite vraiment qu’une solution soit apportée aux entreprises qui ont une monoactivité, dont les concurrents peuvent tout connaître avec une grande facilité. Je maintiens l’amendement.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement mérite un temps de rédaction supplémentaire pour éviter un champ d’application trop large.
M. le président François Brottes. Je ne peux pas m’empêcher, dans ce débat, de rappeler que les rapports de la Cour des comptes servent souvent de livre de chevet aux concurrents des entreprises publiques.
La commission adopte l’amendement SPE818.
*
* *
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements SPE1172 et SPE1171 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Ces amendements ont pour objet d’élargir le champ des sanctions en cas d’atteinte au secret professionnel, en ces temps où des organismes de contrôle de plus en plus nombreux interviennent dans les entreprises dans le cadre de plans de redressement, de contrôle par l’administration ou par des structures spécialisées, et sont autorisés à emporter des documents.
L’article L. 226-13 du code pénal punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne investie d’une mission temporaire d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’amendement SPE1172 vise également les personnes effectuant une mission de contrôle, tandis que l’amendement SPE1171 accroît la sanction au même niveau que celle prévue pour atteinte à la vie privée, en faisant passer le montant de l’amende de 15 000 à 45 000 euros.
M. le ministre. L’emploi du mot « notamment » n’est pas satisfaisant. Le champ de l’article L. 226-13 du code pénal est déjà très large et votre proposition n’ajoute rien au droit positif, qui répond déjà à votre préoccupation. Il pourrait même être lu a contrario comme retranchant par défaut d’autres éléments.
Avis défavorable aux deux amendements.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette successivement les amendements SPE1172 et SPE1171.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE404 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. La profession des guides-conférenciers s’inquiète de certaines dispositions récentes. Dans l’avant-projet de loi, l’article 16 prévoyait de supprimer l’exigence d’une carte professionnelle pour exercer l’activité de guide-conférencier. Cette mesure a finalement été intégrée dans le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. L’article 4 du même projet de loi habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour supprimer certains régimes d’autorisation préalable et les remplacer par des régimes déclaratifs. Les termes de l’habilitation prévue sont très larges et ne font pas mention des professions concernées. Cependant, lors des débats, le ministre avait précisé que cette réforme concernerait notamment les opérateurs de voyages et les guides-conférenciers.
Vous avez indiqué, monsieur le ministre, devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, que les guides-conférenciers n’avaient pas à s’inquiéter, car ils n’étaient pas concernés. Une précision explicite dans le corps du texte serait de nature à calmer l’inquiétude de ces professionnels. Tel est le sens de mon amendement.
M. le ministre. Depuis plusieurs semaines, le Gouvernement a décidé de retirer plusieurs professions réglementées ou autres de ce projet de loi. Néanmoins, l’habilitation pour simplification telle qu’elle a été votée couvre bien cette profession, qui a été citée par mon collègue Thierry Mandon. Devant la Délégation aux droits des femmes, j’ai bien indiqué, et je vous le confirme, que nous ne traiterions pas des guides-conférenciers dans ce projet de loi. Mais vous me demandez de contredire une habilitation qui vient d’être votée. L’intention du Gouvernement n’est pas de retrancher ici des éléments de simplification que nous comptons conduire par ailleurs.
On peut légitimement se demander si l’exigence de possession d’un niveau linguistique d’une autre langue à un niveau « quasi maternel », qui s’impose aujourd’hui aux guides-conférenciers, est pertinente pour toutes les situations et pour tous les guides-conférenciers. Je ne prends que cet exemple pour justifier de la volonté du Gouvernement de revisiter les contraintes de ces professions.
Par conséquent, je ne peux émettre qu’un avis défavorable à votre demande.
M. Patrick Hetzel. On pouvait vraiment déduire de vos propos devant la Délégation aux droits des femmes que la profession n’était pas concernée. Monsieur le ministre, il serait intéressant que vous les réécoutiez.
J’ai entendu vos arguments, mais j’insiste sur le fait que la suppression de la carte professionnelle de guide-conférencier aura de très fortes incidences sur les professionnels. Certes, il est important de libéraliser, mais il y a des sujets sur lesquels il faut savoir raison garder.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Nous avons déjà eu ce débat à propos des apprentis, le point étant de savoir si une déclaration préalable pour les travaux dangereux était préférable à une vérification au départ, qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup de formalités. Dans le cas qui nous occupe, doit-on vérifier au préalable toutes les qualifications des guides-conférenciers ? Une première simplification a eu lieu en 2011, puisqu’il ne reste plus qu’une seule carte sur les trois ou quatre qui existaient auparavant.
Pourquoi ne pas mettre en place une déclaration préalable pour avoir une carte ? Puisque, aujourd’hui, des étrangers en provenance de pays européens peuvent agir en tant que guides-conférenciers sur notre territoire en faisant une simple déclaration sans contrôle a priori, il y a, de fait, déjà une discrimination. Une simple déclaration préalable apporterait une nouvelle simplification qui permettrait à chacun d’exercer cette profession, à condition que des vérifications soient conduites a posteriori. Cela libérerait les énergies.
Avis défavorable.
Mme Monique Rabin. Alors que le ministre des affaires étrangères a lancé une grande offensive dans le domaine du tourisme, cette question mériterait de faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. La profession existe et elle est codifiée dans le code du tourisme, ce qui est un gage de qualité pour nos partenaires extérieurs.
Mme Bernadette Laclais. Je partage le sentiment de Monique Rabin. Nous avons la chance d’avoir en France des villes et des pays d’art et d’histoire, qui sont des formidables atouts touristiques pour notre pays. Au moment où l’on examine des textes pour renforcer notre compétitivité dans ce domaine, il serait dommage qu’on laisse la place à une moindre qualité. Les gens viennent chez nous parce qu’ils savent que des guides de qualité vont leur faire découvrir notre patrimoine. Il serait regrettable que celui-ci puisse être approprié par d’autres personnes que celles qui le connaissent très bien et qui en font véritablement la promotion.
Je ne voterai pas cet amendement, mais je me permets de plaider pour que cette disposition soit examinée dans le cadre d’un texte concernant le patrimoine, qui devrait être présenté au Parlement. Il serait logique qu’une réflexion sur ces questions soit menée de façon globale, et pas à travers le seul prisme de la simplification.
M. le président François Brottes. Vous pourriez peut-être, monsieur Hetzel, retirer l’amendement et poser une question écrite au ministre Mandon.
M. Patrick Hetzel. Je le maintiens, ce qui ne m’empêchera pas de poser une question écrite à Thierry Mandon !
La commission rejette l’amendement SPE404.
*
* *
Section 2
Procédures de l’Autorité de la concurrence
Article 59
Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour préciser les règles applicables en matière de concentration économique et pour simplifier et améliorer l’efficacité des procédures
devant l’Autorité de la concurrence
I. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi propose d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :
– de préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment en ce qui concerne les seuils de chiffre d’affaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise aux dispositions de l’article L. 430-3 du code de commerce, qui prévoit que les opérations de concentration réunissant certaines conditions doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence avant leur réalisation (1°) ;
– de simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle (2°).
A. LE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
S’agissant du contrôle des concentrations, les dispositions le régissant figurent aux articles L. 430-1 à L. 430-10 du code de commerce. L’étude d’impact indique que les mesures prévues viseront à :
– clarifier les volumes de chiffre d’affaires déclenchant le contrôle des opérations de concentration ;
– mettre fin à l’effet suspensif du contrôle sur les opérations concernées.
Rappelons qu’une opération de concentration a lieu en cas de fusion d’entités antérieurement indépendantes, ou lorsqu’une personne détenant déjà le contrôle d’une entreprise, ou une entreprise, acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une autre entreprise, de manière directe ou indirecte.
Actuellement, trois conditions doivent être réunies pour faire tomber une opération dans le champ du contrôle de l’Autorité de la concurrence :
– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises doit être supérieur à 150 M€ (ce seuil est ramené à 75 M€ dans le secteur du commerce de détail) ;
– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises doit être supérieur à 50 M€ (ce seuil est ramené à 15 M€ dans le secteur du commerce de détail) ;
– l’opération ne doit pas entrer pas dans le champ du contrôle des concentrations réalisé par la Commission européenne, conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Les concentrations remplissant ces conditions doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, et ne peuvent intervenir qu’avec son accord, ou celui du ministre chargé de l’économie lorsqu’il a évoqué l’affaire.
B. LA SIMPLIFICATION ET L’AMÉLIORATION DES PROCÉDURES DEVANT L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
S’agissant de la simplification et de l’amélioration des procédures devant l’Autorité de la concurrence, l’exposé des motifs et l’étude d’impact précisent les procédures visées par le Gouvernement. Il s’agira :
– de permettre à l’Autorité de la concurrence de rejeter une saisine contentieuse lorsque les pratiques concernées sont de dimension locale, donc susceptibles d’être traitées par l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 464-9 du code de commerce ;
– d’instaurer une procédure de transaction plus substantielle devant l’Autorité, en confiant un pouvoir de négociation au rapporteur général sur le montant des sanctions et sur les engagements proposés par les entreprises lorsque celles-ci ne contestent pas la réalité des griefs qui leur sont notifiés ;
– d’accélérer la procédure lorsque celle-ci fait suite à une demande de clémence des parties. Le rapporteur général pourrait décider, dans ce cas, que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport.
• Autoriser le rejet des saisines contentieuses par l’Autorité de la concurrence lorsque les pratiques concernées sont de dimension locale
L’article L. 464-9 du code de commerce dispose que le ministre de l’économie peut adresser lui-même des injonctions à une entreprise en cas d’entente, d’abus de position dominante ou de recours à des prix abusivement bas, lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d’affaires de chacune des entreprises concernées ne dépasse pas 50 M€ et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 M€. Dans ces cas, c’est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui instruit les affaires.
L’objectif est d’alléger les procédures contentieuses devant l’Autorité de la concurrence.
• Instaurer une véritable procédure transactionnelle devant l’Autorité de la concurrence
Le déclenchement de cette procédure, dite de « non-contestation des griefs », et prévue au III de l’article L. 464-2, est actuellement proposé par le rapporteur général à l’Autorité. Elle implique que le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Si l’entreprise s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité d’en tenir compte dans la fixation du montant de la sanction.
Cette procédure a été introduite par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (84), puis modifiée par l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence (85), qui a rendu la présentation d’engagements facultative et non plus obligatoire. Depuis lors, l’Autorité a la possibilité de tenir compte, soit de la seule renonciation à contester les griefs, soit d’une renonciation à contester les griefs couplée avec des engagements. Les réductions de sanctions consenties sont en général comprises entre 10 % et 25 % de leur montant (86).
L’objectif de l’instauration d’une procédure de transaction en bonne et due forme est de renforcer l’incitation, pour les entreprises, à recourir à la procédure de non-contestation des griefs. Dans la pratique actuelle, le montant des sanctions, et celui de la réduction pouvant être obtenue en cas de non-contestation, demeurent imprévisibles pour l’entreprise. Même en cas d’engagement de cette procédure, pourtant créée pour favoriser la coopération des entreprises dans le traitement des affaires, les entreprises finissent souvent par contester le montant de leurs sanctions devant la Cour d’appel de Paris.
• Accélérer le traitement des affaires faisant l’objet d’une demande de clémence
La procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence est régie par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce. Elle prévoit qu’une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ayant, avec d’autres, conclu une entente illégale si cette entreprise a contribué à établir la réalité de cette entente et à identifier ses auteurs en apportant des éléments d’information nouveaux. Elle permet de renforcer l’efficacité de la répression des atteintes à la concurrence en offrant à ses acteurs une incitation à coopérer. Citons le cas du « cartel des lessives », constitué par quatre fabricants de lessive entre 1997 et 2004, sanctionné en 2011 à hauteur de 367,9 M€, à la suite d’une demande de clémence de l’un de ses participants. L’entreprise ayant pris l’initiative de la clémence a bénéficié d’une exonération totale de la sanction pécuniaire qu’elle encourait, d’un montant de 248,5 M€ (87). Il s’agit de la plus importante affaire dont l’Autorité de la concurrence ait eu à connaître pour laquelle la procédure de clémence a été utilisée.
La possibilité, pour le rapporteur général, de décider un examen sans établissement préalable d’un rapport, donc avec un seul tour de contradictoire au lieu de deux, s’inspire de la règle appliquée dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, régie par le III de l’article L. 464-2 du code de commerce : lorsqu’une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, l’Autorité de la concurrence entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport. Cependant, dans le cas de la procédure de clémence, l’établissement d’un rapport deviendrait seulement facultatif, sur décision du rapporteur général.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Le rapporteur thématique salue l’initiative du Gouvernement sur ce sujet :
– la possibilité, pour l’Autorité de la concurrence, de rejeter une saisine lorsqu’une affaire peut faire l’objet d’un traitement par l’administration, lui permettra de traiter prioritairement les dossiers sur lesquels elle est seule compétente ;
– l’instauration d’une véritable procédure de transaction en cas de non-contestation des griefs renforcera l’attractivité de cette procédure pour les entreprises et permettra donc de mieux assurer l’application du droit de la concurrence et d’accélérer le traitement des affaires ;
– le caractère facultatif de l’établissement d’un rapport en cas d’engagement d’une procédure de clémence permettra d’accélérer le traitement d’affaires d’ententes dans lesquelles la coopération de l’une au moins des parties est assurée, tout en conservant un caractère pleinement contradictoire à l’instruction.
Il salue la démarche du Gouvernement ayant consisté à déposer, par amendement, le texte de l’ordonnance envisagée à cet article. Elle a en particulier permis à la commission de prendre connaissance des modifications envisagées au dispositif de contrôle des opérations de concentration, sur lesquelles les développements de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact demeuraient succincts.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques SPE255 de M. Jean-Frédéric Poisson, SPE422 de M. Patrick Hetzel et SPE1248 de M. Joël Giraud.
M. Jean-Frédéric Poisson. Avec l’article 59, vous voulez, monsieur le ministre, introduire dans l’article L. 430-3 du code de commerce la notion de seuil. S’agissant de la définition du seuil à partir duquel on considère qu’une entreprise est en situation de concentration, il me paraîtrait plus qu’opportun que le Parlement puisse débattre. Autant je peux comprendre qu’on veuille transcrire par ordonnance des directives européennes dont le caractère est plutôt technique, autant cette notion me semble éminemment politique et relever, de ce fait, de la compétence du Parlement. Je regrette donc le recours aux ordonnances sur ce sujet.
Par ailleurs, la modification de l’article L. 430-3 conduirait à une articulation différente du présent article avec l’article 11, à travers lequel la commission a adopté une nouvelle manière de considérer la position dominante. Je ne peux pas m’empêcher de faire le lien entre ces deux notions et je suis extrêmement sceptique quant aux conséquences de l’adoption en l’état de l’article 59, par lequel le Gouvernement, procédant par ordonnances, saisirait notre nouvelle amie de la semaine, l’Autorité de la concurrence, pour fixer le seuil à partir duquel la position de concentration serait considérée comme atteinte. L’Autorité serait alors juge et partie.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
L’amendement SPE1248 est retiré.
M. le ministre. Les amendements SPE1539, SPE1546, SPE1540, SPE1541 et SPE1543, que le Gouvernement a déposés après l’article 59, visent à inscrire dans le texte les éléments que l’article initial renvoyait à une ordonnance, répondant ainsi aux préoccupations de M. Poisson. Cette référence à des ordonnances n’était qu’une simplification légistique due à certains délais, en aucun cas une volonté de confisquer quelque information que ce soit au Parlement. Il ne s’agit pas de modifier les seuils, mais d’améliorer les procédures, d’harmoniser les pouvoirs d’enquête des autorités chargées de la répression des infractions économiques.
Les éléments relatifs à la concentration qui sont ici concernés n’auront pas d’effet sur l’article 11. Par contre, ils en auront sur le contrôle des concentrations, avec une rationalisation du dispositif, s’agissant notamment de l’articulation entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence.
Je pense que ces explications répondent, pour l’essentiel, aux préoccupations de M. Poisson, qui étaient légitimes à la lecture de l’article initial. S’il maintenait son amendement de suppression, j’aurais un avis défavorable.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Avis défavorable. D’autant que tous les éléments de réponse ont été présentés de façon très précise à travers les amendements gouvernementaux.
La commission rejette les amendements SPE255 et SPE422.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1208 et SPE1209 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 59 modifié.
*
* *
Article 59 bis [nouveau]
(art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-8 et L. 461-3 du code de commerce)
Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations
Cet article, résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à clarifier les règles encadrant le contrôle des concentrations et à renforcer son efficacité. Il insère, dans le corps du projet de loi, les mesures envisagées dans l’ordonnance prévue au 1° de l’article 59.
Son I modifie l’article L. 430-2 du code de commerce afin de préciser la portée de la deuxième condition faisant entrer une opération dans le champ du contrôle des concentrations. En effet, l’article L. 430-2 précité prévoit aujourd’hui qu’une opération, entre autres conditions, est soumise au contrôle des concentrations si le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 M€. Cet article précise qu’il n’est pas nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale, pour qu’une opération tombe dans le champ des opérations de concentration contrôlées.
En application du Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, qui a supprimé la Communauté européenne, son II substitue, à l’article L. 430-3 du même code, la mention de la compétence de l’Union européenne sur une opération à celle de sa dimension communautaire.
Le III modifie l’article L. 430-4 du même code afin de prévoir que, lorsque l’Autorité de la concurrence, à la demande des parties ayant procédé à la notification de l’opération, leur accorde une dérogation leur permettant de réaliser tout ou partie de la concentration sans attendre sa décision, cette dérogation peut être assortie de conditions. Est ainsi inscrit dans la loi le recours, par l’Autorité de la concurrence, à des lettres de dérogation, qui autorisent les parties à procéder à la réalisation effective de la concentration sans attendre la décision de l’Autorité. Le III renforce également les garanties qui entourent ces dérogations, en prévoyant que la dérogation devient caduque si l’Autorité n’a pas reçu sous trois mois la notification complète de l’opération.
Le IV complète l’article L. 430-5 du code de commerce afin d’ouvrir à l’Autorité la possibilité de suspendre le délai de 25 jours dans lequel elle est tenue de se prononcer sur une opération de concentration après sa notification, afin d’obtenir des parties les informations nécessaires à son examen. L’objectif de cette disposition est de contraindre les entreprises à transmettre rapidement les éléments d’information nouveaux ou manquants, faute de quoi la délivrance de l’autorisation de l’opération concernée est retardée. Il est prévu que le délai reprenne son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
Le V procède à plusieurs modifications à l’article L. 430-7 du même code, afin d’aménager la procédure régissant l’examen approfondi d’une opération de concentration par l’Autorité de la concurrence. L’article L. 430-7 du code de commerce prévoit actuellement que, lorsqu’une opération donne lieu à un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence dispose, pour se prononcer, d’un délai de 65 jours ouvrés à compter de l’ouverture de cet examen. Dans ce cas, les parties peuvent proposer à l’Autorité des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. Si ceux-ci sont transmis à l’Autorité moins de 20 jours ouvrés avant la fin du délai de 65 jours ouvrés, ce dernier expire 20 jours ouvrés après la date de réception des engagements. La modification adoptée vise à prévoir que l’expiration du délai de 65 jours ouvrés soit reportée, dans les mêmes conditions, lorsque les parties apportent une modification à leurs engagements.
Le VI modifie l’article L. 430-8 du même code afin de permettre à l’Autorité de la concurrence, lorsque les parties n’exécutent pas leurs engagements, de substituer à ces engagements initiaux d’autres mesures. Il clarifie également les compétences respectives de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie en prévoyant que, dans le cas où la décision non exécutée est une décision prise par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L 430-7-1, concernant les pratiques anticoncurrentielles de dimension locale, les injonctions, engagements ou prescriptions nouveaux sont fixés par le ministre, alors qu’il est actuellement prévu qu’ils sont fixés par l’Autorité de la concurrence.
Enfin, le VII complète l’article L. 461-3 du code de commerce afin d’autoriser le président du collège de l’Autorité de la concurrence, dans le cas où une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi, à prendre seul des décisions de révision des mesures mentionnées au III et au IV de l’article L. 430-7, à savoir :
– les mesures propres à rétablir une concurrence suffisante accompagnant une décision d’interdiction de l’opération ;
– les mesures propres à assurer une concurrence suffisante ou obligeant les parties à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence, accompagnant une décision d’autorisation de l’opération ;
– la mesure par laquelle l’Autorité de la concurrence soumet l’autorisation d’une opération à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
Il est également prévu que le président du collège de l’Autorité de la concurrence puisse prendre seul les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1539 du Gouvernement.
*
* *
Article 59 ter [nouveau]
(art. L. 450-3 du code de commerce)
Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence
Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement, modifie l’article L. 450-3 du code de commerce, afin de conférer aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence la faculté de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par les personnes offrant un accès à des services de communication au public ou de stockage en ligne. Sont en particulier visés les relevés téléphoniques détaillés, comprenant la liste des appels passés et reçus, également appelés « fadettes ».
Ces pouvoirs sont aujourd’hui reconnus à l’Autorité des marchés financiers, comme prévu à l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ainsi qu’en dispose l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux administrations fiscale et douanière, en application des articles L. 83 et L. 96 G du livre des procédures fiscales et de l’article 65 du code des douanes.
Cet article vise ainsi à remédier aux divergences existant dans l’étendue des pouvoirs d’enquête reconnus aux autorités et aux administrations chargées de la répression des infractions économiques.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1546 du Gouvernement.
*
* *
Article 59 quater [nouveau]
(art. L. 462-8 et L. 464-9 du code de commerce)
Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale
Cet article, à l’initiative du Gouvernement, insère, dans le corps du projet de loi, une partie des mesures envisagées dans l’ordonnance prévue au 2° de l’article 59.
Tout d’abord, il modifie l’article L. 462-8 du code de commerce afin de permettre à l’Autorité de la concurrence de rejeter une saisine contentieuse lorsque les pratiques invoquées sont de dimension locale et susceptibles, pour cette raison, d’être traitées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les conditions prévues à l’article L. 464-9 du code de commerce. L’objectif de cette disposition est de permettre à l’Autorité de la concurrence de se concentrer sur les affaires relevant de sa compétence exclusive.
De plus, il modifie l’article L. 464-9 du code de commerce, qui prévoit actuellement que le ministre chargé de l’économie, dans le cadre de sa compétence en matière de pratiques anticoncurrentielles de dimension locale, ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction si les faits concernés ont fait l’objet d’une consultation préalable de l’Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du même code, à savoir une collectivité territoriale, une organisation professionnelle ou syndicale, une organisation de consommateurs agréés, une chambre d’agriculture, une chambre de métiers, une chambre de commerce et d’industrie territoriale, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet et les observatoires des prix, des marges et des revenus de certains départements et régions et de certaines collectivités d’outre-mer.
La modification apportée vise à prévoir une exception à cette disposition, en autorisant le ministre chargé de l’économie à proposer une transaction et à prononcer des injonctions, même si les faits concernés ont donné lieu à une consultation par une entreprise ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, pour autant que la saisine ait été préalablement rejetée par l’Autorité de la concurrence.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1540 du Gouvernement.
*
* *
Article 59 quinquies [nouveau]
(art. L. 464-2 du code de commerce)
Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence
Cet article, résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à renforcer la procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence et à accélérer le traitement des affaires lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d’une demande de clémence des parties. Comme l’article 59 quater, il insère, dans le corps du projet de loi, une partie des mesures envisagées dans l’ordonnance prévue au 2° de l’article 59.
Tout d’abord, il confère au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence un pouvoir de négociation sur le montant des sanctions et les engagements proposés par les entreprises ou les organismes dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce.
De plus, cet article vise à accélérer le traitement des affaires devant l’Autorité de la concurrence lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d’une demande de clémence des parties, en ouvrant au rapporteur général la possibilité de décider un examen sans établissement préalable d’un rapport, donc avec un seul tour de contradictoire, au lieu de deux à l’heure actuelle, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour la procédure de non-contestation des griefs. Cette possibilité s’inspire de la règle appliquée dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs : lorsqu’une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, l’Autorité de la concurrence entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport. Cependant, dans le cas de la procédure de clémence, l’établissement d’un rapport deviendrait seulement facultatif, sur décision du rapporteur général.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1541rect. du Gouvernement.
*
* *
Section 3
Faciliter la vie de l’entreprise
Article 60 A [nouveau]
(art. 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005)
Reconnaissance des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement.
L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu qu’une commission attribue, sur la base de critères définis au même article, une reconnaissance publique à des labels de commerce équitable. Cette mission a été confiée à la Commission nationale du commerce équitable (CNCE) par le décret n° 2007-986 du 15 mai 2007.
L’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a largement précisé la définition du commerce équitable et les critères régissant l’appartenance à celui-ci. Il prévoit que le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur.
Il précise que ces relations commerciales doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
Enfin, il prévoit que les entreprises du commerce équitable doivent être en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits, et que celles faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
Le présent article vise à clarifier les missions de la Commission nationale du commerce équitable, en vue de sa fusion avec la Commission d’orientation du commerce de proximité et le Conseil national du commerce, au sein de la future Commission de concertation du commerce. De fait, la CNCE, installée en 2010, ne s’est pas réunie depuis 2012.
Il substitue à une reconnaissance publique des personnes physiques ou morales qui veillent au respect des critères du commerce équitable, une reconnaissance des systèmes de certification et des labels. L’objectif est d’améliorer, pour le consommateur, la lisibilité des produits estampillés « commerce équitable ».
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1955 du Gouvernement.
M. le ministre. Cet amendement rédactionnel vise à transférer la mission de reconnaissance publique des labels privés de commerce équitable de la commission nationale du commerce équitable à la commission de concertation du commerce.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1955.
*
* *
Article 60
Carte d’identité virtuelle des entreprises
I. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi autorise le recours aux ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi afin d’offrir aux entreprises un dispositif leur permettant de justifier de leur identité et de l’intégrité des documents transmis dans leurs relations dématérialisées, tant avec l’administration qu’avec des tiers.
Il s’agit de la 35ème des 50 nouvelles mesures élaborées par le Conseil de la simplification pour les entreprises, et annoncées le 30 octobre 2014. Elle doit permettre de faciliter la dématérialisation des démarches administratives pour les entreprises et de sécuriser leurs communications électroniques. Le Gouvernement s’est donné pour objectif d’installer ce dispositif dans le courant de l’année 2016.
Ce dispositif devrait prendre la forme d’un identifiant électronique unique, sécurisé et authentifié pour chaque entreprise. Cette « carte d’identité virtuelle » donnera valeur juridique aux transmissions qu’elle permettra de réaliser, ainsi qu’à leur contenu.
La création d’une carte d’identité virtuelle des entreprises est proche, dans ses objectifs, d’autres mesures du programme de simplification du Gouvernement pour les entreprises, notamment la dématérialisation de tous les formulaires (36ème mesure de simplification annoncée le 30 octobre 2014), ou la possibilité de déposer une demande d’aide publique pour une entreprise avec son seul numéro au système d’identification au répertoire des entreprises (SIREN) ou au système d’identification au répertoire des établissements (SIRET) (39ème mesure).
L’étude d’impact rappelle qu’elle permettra également de mettre notre droit en conformité avec le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (88), applicable à compter du 1er juillet 2016, et qui vise notamment à lever les obstacles à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique utilisés dans les États et à conférer une valeur juridique à plusieurs types de démarches dématérialisées (signature, cachet, horodatage, service d’envoi recommandé).
Des économies substantielles en sont attendues. La Commission européenne affirmait ainsi, dans son communiqué de presse du 20 avril 2012, que « les entités publiques qui ont déjà adopté la passation électronique de marchés déclarent avoir réduit leurs dépenses relatives aux passations de marchés de 5 à 20 %. Le volume total des marchés publics dans l'UE est estimé à plus de 2 000 milliards €, ce qui signifie qu'une économie de 5 % correspondrait à quelque 100 milliards € d'économies par an » (89).
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
À l’instar d’autres mesures de simplification engagées par le Gouvernement, cette mesure devrait permettre de contribuer à la réduction de l’ « impôt papier » pesant sur nos entreprises, et qui contribue à grever leur compétitivité. Rappelons que la Direction générale de la modernisation de l’État en avait chiffré, en 2008, le coût des procédures et démarches administratives pour les entreprises à 60 Mds € (90). Le rapporteur thématique ne peut donc qu’approuver la démarche du Gouvernement, qui s’inscrit dans un cadre européen et permettra de dégager des économies de frais de gestion utiles à la croissance, tout en sécurisant les communications des entreprises.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté quatre amendements rédactionnels à cet article.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la commission rejette les amendements identiques SPE256 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE423 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1210, SPE1211, SPE1213 et SPE1212 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 60 modifié.
*
* *
La commission examine, en présentation commune, les amendements SPE1306, SPE1312, SPE1373 et SPE1460 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Ces quatre amendements concernent l’export et les PME. L’amendement SPE1306 vise à moduler au cas par cas les exigences de la part française en fonction des objectifs de rétablissement de l’équilibre de notre commerce extérieur et de l’impact de l’opération sur l’emploi. L’objectif est d’interpeller le ministre sur la nécessité d’une telle souplesse.
L’amendement SPE1312 a pour objet de redéfinir les règles de délégation de l’État à Coface pour l’instruction et l’octroi des garanties publiques en faveur des PME, afin de les dispenser systématiquement d’un examen en commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Dans nombre de cas, en effet, une procédure simplifiée d’examen des projets pourrait être mise en place pour éviter la lourdeur de certaines procédures.
L’amendement SPE1373 vise à mieux coordonner entre Coface et BPI l’instruction des dossiers à l’export, aujourd’hui traités par chacun de ces organismes avec sa propre base de données, ses critères et ses modes d’évaluation des entreprises.
L’amendement SPE1460 appelle à compléter le dispositif Ubifrance en accordant des délégations de service public à des entreprises privées implantées dans différents pays ou métropoles mondiales. Leur présence et leur expertise permettrait, tout en assurant des prestations de service semblables à celles fournies par l’acteur public, d’atteindre une meilleure dispersion géographique et de meilleures connaissances sectorielles.
Ces propositions techniques sont extraites d’un rapport à la rédaction duquel j’avais participé dans le cadre de la commission d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Conformément à l’esprit du projet de loi, elles tendent à simplifier, moduler, assouplir un certain nombre d’instructions pour nos exportateurs.
M. le président François Brottes. À la liste que vient de donner Jean-Christophe Fromantin, j’ajouterai la question des délais de paiement, qui sont un élément de concurrence à l’export. Nos entreprises qui exportent sont obligées de les respecter, ce qui est bien normal, alors que les entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence à l’international ne respectent pas les mêmes obligations. Il leur arrive donc de perdre des marchés.
M. le ministre. Les différents soutiens publics, et parfois privés, à l’export sont un sujet essentiel sur lequel le Gouvernement a déjà beaucoup fait, en simplifiant le dispositif avec le rapprochement des deux acteurs, l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et UBI, la création d’une nouvelle entité, Business France, que dirige Mme Pénicaud, et le lancement d’un label BPI international qui vise à mettre en résonnance la BPI, Business France et Coface. Il y a eu, ces derniers mois, une simplification du dispositif français, qui répond, monsieur Fromantin, à vos préoccupations.
L’amendement SPE1306 tend à assouplir les exigences en termes de part française du contrat d’exportation. Compte tenu de la répartition de plus en plus mondialisée des chaînes de valeur ajoutée, une réflexion est en cours pour réformer ces exigences afin de les rendre plus incitatives, plus simples et plus lisibles. L’une des pistes sur laquelle nous travaillons serait d’adapter le montant du soutien public au montant français du contrat, de manière à augmenter le nombre de bénéficiaires du soutien public et à prendre en compte les spécificités de certains secteurs d’activité.
En revanche, la suppression totale de ces exigences ne nous paraît pas souhaitable parce qu’elle aurait pour conséquence inévitable d’augmenter le recours à la sous-traitance étrangère dans les contrats pour lesquels on nous demande des garanties Coface. Elle ne manquerait pas de susciter des interrogations, légitimes, dans la situation de nos finances publiques. Nous pourrions, en effet, favoriser le financement de certains contrats export sans aucune répercussion sur le territoire français. Une étude au cas par cas serait plus indiquée.
Les exigences de la part française sont déjà différenciées. Elles peuvent être plus importantes pour les aides-projets FASEP (Fonds d’étude et d’aide au secteur privé) et RPE (Réserve pays émergents) que pour les garanties publiques. Á cet égard, nous avons déjà aidé certains financements export sur des critères plus pragmatiques. Quant à une différenciation en fonction du déficit commercial avec le pays cible, elle serait très difficile à mettre en pratique pour l’assurance-crédit parce qu’il faudrait justifier de la différence de traitement entre les exportateurs. Les encours sont déjà très importants sur les grands émergents et c’est impossible pour les autres garanties qui fonctionnent en enveloppes, comme le risque exportateur ou le risque de change.
Voilà pour l’amendement SPE1306, dont je demande le retrait.
Pour ce qui est de l’amendement SPE1312, les règles de délégation de l’État à la Coface pour l’instruction et l’octroi de garanties publiques évitent d’ores et déjà un passage en commission des garanties à la quasi-intégralité des PME – ce fut le cas pour 96,3 % des garanties publiques accordées à des PME entre janvier et novembre 2014, ainsi qu’au cours des années précédentes. Les rares dossiers de PME qui font l’objet d’un tel examen présentent généralement un niveau de risque significatif. Du fait des montants en jeu, de la situation de l’entreprise ou du marché export concerné, il est préférable de maintenir cette procédure.
Si ces informations vous ont convaincu, monsieur Fromentin, je vous suggère de retirer cet amendement également.
Par l’amendement SPE1373, vous proposez de créer une plateforme d’échange d’informations entre Bpifrance et Coface. La mise en place d’un outil de gestion de la relation client implique de recenser l’ensemble des contacts de Coface et de Bpifrance. Une mutualisation des données individuelles ne paraît pas possible aujourd’hui, d’une part, au regard du secret bancaire de Bpifrance qui l’oblige à préserver la confidentialité de ses données, d’autre part, en raison du caractère d’entité cotée de Coface. Une telle plateforme d’échange existe déjà en partie à travers le label Bpifrance Export, qui a pour but d’améliorer et de simplifier l’offre des trois acteurs essentiels en matière d’export, et de favoriser l’accès des PME et des ETI aux produits qui leur sont les plus adaptés. Une rationalisation a donc été opérée et des outils de mutualisation ont été mis en place. Ce label s’est concrétisé par l’installation, au sein des structures régionales et locales de Bpifrance, d’une vingtaine de chargés d’affaires internationaux et d’une vingtaine de développeurs venant de Coface.
Le dispositif n’est pas aussi abouti que ce que vous proposez, monsieur Fromantin, mais cette plateforme et ce label répondent à votre volonté de créer des synergies. Nous l’avons simplifié pour le rendre plus efficace et plus lisible pour les PME. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce volet, en particulier en termes de rationalisation de l’ensemble des dispositifs publics. Entre les collectivités locales, l’État et ces établissements, la myriade d’acteurs publics est en effet telle qu’elle peut nuire à la lisibilité. De même, en ce qui concerne les garanties export, une simplification des critères est sans doute nécessaire.
Enfin, la loi permet déjà d’octroyer des délégations de service public à des prestataires exclusifs dans le domaine du commerce international. Votre amendement SPE1460 est donc satisfait.
M. Laurent Granguillaume, rapporteur thématique. Même avis que celui du Gouvernement. Le rapport mentionné contient beaucoup de propositions très intéressantes, dont plusieurs relèvent du pouvoir réglementaire. Qui plus est, la mission d’information commune sur la Banque publique d’investissement qui vient d’être mise en place à l’Assemblée en reprendra sans doute quelques-unes dans son rapport.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je retire les amendements.
Cela étant, monsieur le ministre, pourquoi ne pas remonter les activités de garantie de Coface dans Bpifrance ou BPI Export ? Ce serait plus simple, notamment pour les PME. Cela pourrait être une prochaine étape dans la mutualisation des aides et garanties aux entreprises dans le domaine du commerce international.
M. le ministre. Je comprends votre point de vue sur la simplification. Nous y travaillons, mais il faut savoir que ce n’est pas simple sur le plan technique. En poussant votre raisonnement jusqu’au bout, il faudrait détacher la part publique de Coface qui, de fait, a beaucoup de synergies avec la part privée puisqu’elle utilise les mêmes systèmes d’information. Compte tenu de la nouvelle entité, cela suppose des travaux techniques extrêmement complexes et des choix industriels qui ne sont pas neutres. Par conséquent, même si ces éléments sont à l’étude, je ne peux pas vous donner aujourd’hui plus de précisions sur ce sujet.
Quant aux délais de paiement pour les PME à l’export évoqués par le président Brottes, je peux d’ores et déjà indiquer que j’aurai un avis favorable sur la proposition de loi que Mme Guittet déposera à ce sujet dans le cadre d’une prochaine niche. S’il y avait un parfait respect des délais de paiement pour toutes les entreprises, nous pourrions avoir une sorte de rigueur absolue pour les PME. Comme ce n’est pas encore le cas, je pense qu’un régime d’exception relativement pragmatique est une bonne chose.
Les amendements SPE1306, SPE1312, SPE1373 et SPE1460 sont retirés.
*
* *
Article 61
Dérogation, pour les trois EPIC du groupe public ferroviaire, à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées
créée par l’État
I. L’ÉTAT DU DROIT
La dématérialisation des factures s’est développée sur la base des dispositions de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 modifiant une directive « TVA » de 1977 en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour être opposables fiscalement les factures peuvent être échangées entre partenaires commerciaux sous format électronique si elles remplissent les conditions techniques définies par les articles 289 et 289 bis du code général des impôts.
L’article 25 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prévu qu’ « à compter du 1er janvier 2012, l’État et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée ». Ce qui n’était obligatoire que pour l’État et simple faculté pour les collectivités locales est devenu une obligation avec un champ très élargi : l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique a abrogé l’article 25 de la loi de 2008 pour que le recours à la facturation électronique devienne la norme pour les contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Cette ordonnance a été prise sur la base de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, dont l’article premier prévoit l’institution d’une « obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures » entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, d’une part, et leurs fournisseurs d’autre part. Sont donc concernés non seulement les services de l’État et des collectivités locales, mais également les universités, la SNCF…
L’ordonnance rend, d’autre part, obligatoire l’utilisation d’un « portail de facturation » unique, le portail « Chorus » créé par l’État en 2008 et dont l’utilisation est gratuite, pour le dépôt, la réception et la transmission de toutes les factures sous forme électronique.
Les obligations ainsi créées ne sont pas encore en vigueur : l’ordonnance dispose qu’elle sera applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les personnes publiques et pour les grandes entreprises, et à des dates ultérieures pour les entreprises de taille intermédiaire et pour les petites entreprises. Un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de l’ordonnance.
La dématérialisation systématique des factures a plusieurs objectifs : simplifier la vie des entreprises, limiter l’utilisation de papier, contribuer à réduire les délais de paiement, et réaliser des économies significatives puisque les coûts de traitement des factures électroniques sont très inférieurs aux coûts de traitement des factures papier (archivage électronique, moins coûteux que l’archivage physique, coût d’envoi moins onéreux que les frais postaux…).
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
La SNCF propose déjà depuis plusieurs années à ses fournisseurs une plateforme dématérialisée permettant la réception et le traitement des factures. Comme sur le portail de l’État, l’inscription sur cette plateforme est gratuite. Le taux de dématérialisation des factures de ses fournisseurs est passé de 16 % en 2009 à près de 40 % en 2014.
La réforme ferroviaire portée par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, qui crée un « groupe public ferroviaire » composé de trois EPIC – la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités -, prévoit la mutualisation au sein du groupe de certaines fonctions, notamment en matière d’achats.
L’obligation de recourir systématiquement à la facturation électronique est applicable aux trois EPIC comme elle l’était à l’ancienne SNCF, mais le projet de loi propose de ne pas obliger le groupe public ferroviaire à utiliser la plateforme de l’État, dans la mesure où l’outil déjà existant pour la SNCF permet d’atteindre les objectifs de l’ordonnance. La dématérialisation des factures a notamment permis une réduction significative des retards de paiement de la SNCF vis-à-vis de ses fournisseurs (moins de 20 millions d’euros en 2014 contre plus de 100 millions d’euros en 2008).
Le rapporteur thématique propose que cet article soit codifié dans le code des transports. La commission spéciale a adopté cet amendement.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE424 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement de suppression n’est pas un simple amendement d’appel. L’article 61 aurait, dans la réalité, des effets qui s’écartent de l’exposé des motifs.
L’obligation de transmettre les factures aux fournisseurs sous forme électronique semble déjà remplie par la SNCF et, en toute logique, il n’est pas proposé d’y déroger. En revanche, en exonérant la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités des dispositions du II de l’article 1er de l’ordonnance du 26 juin 2014, il est bel et bien proposé de l’exonérer de l’obligation d’accepter les factures électroniques. Je ne vois pas pourquoi elle en serait dispensée alors que toutes les entreprises, des plus grandes aux plus petites, y seront contraintes à partir de 2017.
M. le ministre. Nous n’avons pas l’intention de limiter nos ambitions en matière de facturation électronique. L’objet de l’article 61 est de traiter le problème spécifique de la SNCF, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de sa propre plateforme de facturation. En la matière, elle est même avant-gardiste puisqu’elle gère 7 000 factures par jour, dont 40 % en dématérialisation. L’idée n’est pas de la détacher du régime de droit commun.
Si nous voulons sortir la SNCF du dispositif de l’ordonnance visant à la dématérialisation progressive de l’ensemble des échanges de factures entre les personnes publiques et leurs fournisseurs, c’est que le groupe dispose déjà, depuis plusieurs années, d’une plateforme dématérialisée lui permettant de recevoir les factures de ses fournisseurs. L’exemption sollicitée porte sur la seule obligation d’utiliser la plateforme commune mise à disposition par l’État pour ne pas réduire à néant l’investissement réalisé par SNCF. Si d’autres cas similaires nous étaient révélés, je n’exclus pas de les traiter. La constitution du groupe public ferroviaire par la loi du 4 août 2014 impose déjà une très lourde restructuration des systèmes d’information pour la SNCF. Si nous ne lui appliquions pas un régime d’exception pour la facturation électronique, nous lui imposerions des investissements peu légitimes qui viendraient grever sa situation financière.
Le Gouvernement est très attaché au développement de la facturation électronique, vous le verrez avec l’amendement SPE1561 rectifié que je vais présenter dès maintenant. Cet amendement a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre toute mesure de nature à généraliser l’e-facturation, avec une montée en charge progressive entre 2017 et 2020 pour tenir compte de la taille des entreprises.
M. Patrick Hetzel. Tel que l’article est rédigé, la SNCF n’aura pas l’obligation de réceptionner les factures électroniques. Je souscris à l’argument – qui est d’ailleurs développé dans l’exposé des motifs du projet de loi – que la SNCF ne soit pas obligée d’utiliser la plateforme mutualisée. Mais cet article est mal rédigé et ne permet pas d’atteindre le but recherché.
M. Olivier Carré. L’intention du Gouvernement semble relever de l’article 2 de l’ordonnance, qui fait référence à la mutualisation, alors que l’article 1er fait référence à la réception et à l’émission de factures électroniques.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Ce point doit, en effet, être éclairci.
Précisons tout de même que, grâce à cette plate-forme, les retards sont passés de 100 millions d’euros à 20 millions entre 2008 et aujourd’hui. Elle est donc efficace, et il serait dommage de remettre en cause un dispositif qui fonctionne.
M. Patrick Hetzel. Je souscris pleinement à ce que vient de dire M. le rapporteur thématique et je retire l’amendement. En tout état de cause, il faut sécuriser le dispositif ou au moins apporter des éclaircissements.
M. le ministre. C’est le II de l’article 1er de l’ordonnance qui est visé. Je le cite : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I, dans les conditions prévues à l’article 2. »
L’amendement SPE424 est retiré, ainsi que l’amendement SPE197 des rapporteurs.
La commission adopte l’article 61 sans modification.
*
* *
Article 61 bis (nouveau)
Habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre le développement de la facturation électronique entre les entreprises
Contrairement aux relations commerciales entre les personnes publiques et leurs fournisseurs dans le cadre des marchés publics, pour lesquelles l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a prévu une obligation d’utilisation de la facturation électronique (voir plus haut), il n’y a pas encore d’obligation pour les entreprises d’accepter les factures électroniques dans leurs relations avec d’autres entreprises.
La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, habilitant celui-ci à instaurer par ordonnance une généralisation de la facturation électronique entre entreprises. Cette généralisation sera assortie d’un calendrier d’entrée en vigueur progressive, l’obligation s’appliquant ainsi dans un premier temps aux grandes entreprises avant de devenir applicable aux petites entreprises.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE1561 rectifié du Gouvernement.
*
* *
Article 62
(art. L. 581-10 [nouveau] du code de l'environnement)
Dispositifs publicitaires de grande taille implantés dans l’emprise d’équipements sportifs
Cet article vise à assouplir les conditions de publicité dans les grands stades, afin d’accompagner l’effort financier attendu des collectivités territoriales pour satisfaire notamment aux exigences des cahiers des charges de l’Euro 2016 de football.
I. LE DROIT EXISTANT
L’effort important requis pour mettre à niveau les stades et autres équipements sportifs, dans la perspective de l’Euro 2016, pose la question de l’identification de recettes nouvelles et pérennes pour les collectivités territoriales, alors que le cadre juridique existant applicable à la publicité extérieure apparaît relativement contraignant.
— Les grands stades, lorsqu’ils sont en concurrence pour accueillir des événements sportifs d’importance européenne ou mondiale, doivent répondre à des cahiers des charges exigeants, qui leur demandent fréquemment des investissements très substantiels. En matière de places assises, par exemple, le cahier des charges de l’Union des associations européennes de football (UEFA) impose que chaque spectateur se voie attribuer un siège pour chaque match, interdit les sièges provisoires ou temporaires et prévoit que chaque siège devra être individuel, « de préférence fixé à la contremarche, confortable, équipé d’un dossier d’une hauteur minimale de 30 cm, incassable, protégé des UV et certifié conforme aux normes anti-incendie par les autorités locales ». Pour les sièges grand public, la profondeur de gradin doit être de 800 mm, la largeur des sièges centre-à-centre de 500 mm et tous les sièges doivent offrir une vue dégagée du terrain, sans obstacle visuel comme des piliers, barrières, rambardes, etc.
Dans la perspective de l’Euro 2016, doivent ainsi être construits ou rénovés :
– deux stades d’une capacité supérieure à cinquante mille places, pour la finale, le match d’ouverture et l’équipe jouant à domicile ;
– trois stades d’une capacité comprise entre quarante mille et cinquante mille places, pour les demi-finales et les quarts de finale ;
– quatre stades d’une capacité comprise entre trente mille et quarante mille places, pour les matchs de groupe et les huitièmes de finale.
— Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, l’effort financier envisagé par les collectivités territoriales au titre des projets de rénovation ou de construction de stades destinés à accueillir cette compétition représenterait un montant de l’ordre de 900 millions d'euros sous forme d’investissements directs, de subventions, de garanties ou d’autres mesures.
Alors que la construction ou la rénovation de dix stades devrait avoir un impact économique significatif sur l’activité des territoires concernés et que les événements sportifs ou culturels constituent des éléments de visibilité et de rayonnement importants pour une ville, un territoire ou un pays, la question du financement des investissements correspondants se trouve explicitement posée.
Dans un contexte de forte tension sur les équilibres budgétaires des collectivités territoriales, la possibilité d’installer des publicités de grand format sur l’emprise des stades présenterait un certain nombre d’avantages :
– création de valeur au profit de la collectivité territoriale, en rendant les espaces publicitaires plus exploitables ;
– association de la publicité à d’autres services (informations, statistiques, portraits de joueurs, fils d’actualité, résultats d’autres matchs, etc.) ;
– promotion des lieux et des événements qui s’y dérouleront ;
– perception d’une redevance d’occupation domaniale, fixe ou variable, susceptible de contribuer au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement ;
– amélioration de l’attractivité du territoire, dans la perspective de l’organisation d’événements futurs de portée nationale ou internationale.
— L’article L. 581-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 40 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », pose un principe général d’autorisation de la publicité dans les agglomérations.
Les installations publicitaires doivent néanmoins satisfaire à un ensemble de prescriptions – par exemple, en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses – fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes).
L’article L. 581-9 précité prévoit en outre que puissent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
L’installation de toiles ou d’écrans publicitaires, dérogatoires aux douze mètres carrés de droit commun, n’est donc aujourd’hui pas possible à titre permanent – sauf dans les aéroports, qui font l’objet de dispositions particulières. (91) Or le caractère pérenne de la ressource constitue un élément décisif de l’équilibre économique des opérations lourdes de construction ou de rénovation des grands stades attendues à très court terme.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
— L’article 62 du projet de loi propose de compléter le code de l’environnement par un article destiné à permettre l’installation de dispositifs publicitaires permanents et de grande taille dans les enceintes sportives.
Plus précisément, l’article L. 581-10 nouveau prévoit que les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins trente mille places assises peuvent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Toutefois l’implantation des dispositifs dérogatoires sera soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
— Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, douze stades de grande capacité seraient susceptibles de bénéficier de cette mesure, dont dix accueilleront les matchs de l’Euro 2016.
STADES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L’INSTALLATION
DE DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DE GRANDE TAILLE
Nom |
Agglomération |
Capacité maximale |
Stade de France |
Saint-Denis (93) |
81 338 |
Stade Vélodrome |
Marseille (13) |
60 031 |
Stade Pierre-Mauroy |
Villeneuve d’Asq (59) |
50 186 |
Parc des princes |
Paris (75) |
48 527 |
Stade de Gerland |
Lyon (69) |
41 842 |
Stade Bollaert-Delelis |
Lens (62) |
41 229 |
Stade de la Beaujoire |
Nantes (44) |
37 463 |
Allianz Riviera |
Nice (06) |
35 624 |
Stade Geoffroy-Guichard |
Saint-Étienne (42) |
35 616 |
Stadium municipal |
Toulouse (31) |
35 575 |
Stade Chaban-Delmas |
Bordeaux (33) |
34 694 |
Stade de la Mosson |
Montpellier (34) |
32 939 |
(*) En caractères italiques : stades de l’Euro 2016
Source : étude d’impact annexée au projet de loi.
La possibilité de louer les espaces supplémentaires ainsi mis à la disposition des annonceurs devrait générer des retombées positives pour l’ensemble des acteurs :
– pour les particuliers, la participation de la publicité au modèle économique du fonctionnement du stade devrait permettre la modération de l’augmentation des prix des billets. Par ailleurs, la publicité pourra être associée à l’apport de services connectés ou interactifs, à l’instar des services associés au mobilier urbain ;
– les entreprises pourront assurer la promotion de leur offre sur des supports de communication adaptés, en format, à la taille des grands stades et en tirer un retour sur investissement. La mesure leur ouvre également un espace d’expression publicitaire indépendamment de leur partenariat avec l’événement ;
– les collectivités bénéficieront d’une contribution de la publicité au financement des grands équipements sous forme d’une redevance domaniale.
Par ailleurs, en règle générale, chaque stade ne disposera que d’une ou deux « faces publicitaires » répondant aux critères de visibilité et d’audience indispensables à l’installation d’une publicité de grand format : le risque de surcharge inesthétique est donc strictement cantonné.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a tout d’abord adopté un amendement visant à améliorer la qualité et la précision rédactionnelles de cet article.
Dans un souci de clarté et de transparence, elle a également estimé opportun, compte tenu des enjeux économiques, financiers et environnementaux attachés à ces dispositifs publicitaires de grande taille, que leur éventuelle installation puisse faire l’objet d’un débat et que la décision y afférent appartienne au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent – et non au seul maire ou président de cet établissement public.
*
* *
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement de précision SPE1963 du Gouvernement.
La commission en vient à l’amendement SPE1154 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. C’est un amendement auquel nous tenons beaucoup – et, avec nous, nombre de villes moyennes.
Le texte du Gouvernement prévoit d’abaisser le seuil de la capacité d’accueil des équipements sportifs afin de permettre aux stades de 30 000 places de recevoir des enseignes publicitaires de grande taille. Mon amendement propose d’abaisser ce seuil à 15 000 places.
Il y a vingt ans, un certain nombre de stades ont été construits en France, sur un modèle de 15 000 à 20 000 places assises – celui de Caen en compte, par exemple, 18 000. Or, pour accueillir de grandes compétitions internationales comme en prépare actuellement l’UEFA, il est nécessaire de disposer de plus grands stades, ce qui explique le choix du seuil de 30 000 places. Le secrétaire d’État aux sports Thierry Braillard m’a assuré qu’il ne voyait aucun inconvénient à baisser ce seuil à 15 000 places pour des raisons d’équilibre.
En fixant le seuil à 30 000 places, vous allez renforcer l’inégalité qui existe déjà entre les grands stades et les autres, en raison de la différence de leurs budgets. Ne pas fixer le seuil à 15 000 places serait une erreur extrêmement préjudiciable à l’ensemble du monde du football et créerait un très fort déséquilibre, aggravant celui lié aux droits télévisés. Voilà pourquoi, à la demande du monde sportif, je vous demande d’abaisser le seuil à 15 000 places.
M. le ministre. L’article 62 propose de baisser à 30 000 places le seuil de référence qui constitue le critère déterminant pour qu’un stade obtienne des dérogations en matière de publicité. Il s’agit d’un véritable assouplissement de la réglementation. Si nous fixons le seuil à 30 000 places, c’est que nous nous apprêtons à accueillir des événements sportifs internationaux, d’où l’importance de ces dérogations pour les grands stades.
Si le ministère des sports est sensible au seuil de 15 000 places, monsieur Tourret, il n’en est pas de même pour d’autres ministères – en particulier, celui de l’environnement, qui porte d’autres préoccupations. La position gouvernementale a été aujourd’hui arrêtée au seuil de 30 000 : c’est pourquoi, bien qu’étant sensible à vos arguments j’émets un avis défavorable à votre amendement.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. En réalité, l’objectif de l’article 62 est de préparer l’Euro 2016. Et si notre collègue Alain Tourret soulève un problème réel, ce n’est pas ce soir que nous pourrons résoudre la question de l’abaissement du seuil sans en mesurer les impacts – d’autant que les besoins d’investissement ne sont pas les mêmes pour un stade de 15 000 ou de 30 000 places et que les dispositifs publicitaires doivent être en adéquation avec ceux-ci. Avis défavorable.
Mme Monique Rabin. La dérogation est-elle limitée dans le temps ou définitive ?
M. Jean-Charles Taugourdeau. J’observe que le ministère de l’environnement n’est pas favorable à l’accroissement de l’activité ni au business. Á voir les nombreuses mesures relevant de la garde des sceaux qui ont été prises, on peut se demander si la ministre de l’environnement n’a pas plus d’influence. Elle est bien en train de faire du blocage.
M. le ministre. Il s’agit bien, madame Rabin, d’une dérogation permanente puisqu’elle est codifiée. C’est pourquoi abaisser le seuil est un vrai sujet.
Monsieur Taugourdeau, je ne porte que des positions gouvernementales : qu’il s’agisse des professions juridiques ou de la publicité dans les stades, je défends la position gouvernementale, celle que je partage avec Mme Taubira comme avec Mme Royal et M. Braillard.
M. Alain Tourret. Les dérogations accordées aux stades de plus de 30 000 places survivront à l’Euro 2016. Vous rendez-vous bien compte de l’avantage monumental que vous allez donner à ces villes, en termes de publicité et de revenus ? Laissez intervenir les maires et ne tuez pas les villes moyennes !
La commission rejette l’amendement SPE1154.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE730 de M. Jean-Yves Caullet.
Mme Colette Capdevielle. Il s’agit d’un amendement de repli, par lequel nous proposons que l’implantation des dispositifs dérogatoires, en raison des conséquences des publicités sur le voisinage immédiat, soit soumise au conseil municipal ou au conseil communautaire concerné, plutôt qu’au seul maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, afin de garantir une meilleure transparence dans la décision et une meilleure information de la population.
M. le ministre. Avis favorable.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la commission adopte l’amendement SPE730.
En conséquence, les amendements identiques SPE257 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE 425 de M. Patrick Hetzel tombent.
M. Jean-Frédéric Poisson. Si j’avais imaginé que mon amendement tombât, je me serais exprimé avant !
La métropole n’étant pas mentionnée dans l’amendement qui vient d’être adopté, j’invite la commission à s’assurer que la notion d’EPCI inclut bien la métropole de Lyon. Celle-ci a été expressément désignée, dans la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), comme une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution. N’étant pas certain que la notion d’établissement public de coopération intercommunale recouvre lesdites collectivités, il me semblerait approprié de rajouter la métropole pour être sûr de couvrir tous les cas. Si vous oubliez M. Collomb dans cet article, je doute qu’il se réjouisse ! Il a, certes, été traité correctement dans la loi MAPTAM, mais s’il ne peut pas éclairer son nouveau stade, payé avec les fonds publics, cela ne collera pas !
M. le président François Brottes. Le ministre et le rapporteur thématique ont entendu le message. D’ici à l’examen du texte en séance publique, la question évoluera.
La commission adopte l’article 62 ainsi modifié.
*
* *
Article 63
(art. L. 581-14 du code de l'environnement)
Dispositions de coordination
Cet article s’inscrit dans le prolongement de l’article précédent et vise à permettre au règlement local de publicité de déroger aux règles applicables aux grands stades dans un sens plus restrictif.
I. LE DROIT EXISTANT
L’article L. 581-14 du code de l'environnement prévoit que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 du même code.
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13 du code de l'environnement, il appartient au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Cet article prévoit également que, le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
La modification apportée à la rédaction de l’article L. 581-14 précité par l’article 63 du projet de loi vise à soumettre les dispositions dérogatoires relatives à la publicité dans les grands stades (article L. 581-10 nouveau) aux prescriptions du règlement local de publicité, à l’instar des dispositions générales relatives à la publicité dans les agglomérations (article L. 581-9).
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
La commission adopte l’article 63 sans modification.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1160 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Jean-Christophe Fromantin. Cet amendement vise à s’assurer que les sommes versées par les entreprises pour soutenir la candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025 peuvent être assimilées à du mécénat d’entreprise, pour autant que l’intégralité des fonds servent au financement de la candidature et non à la promotion de produits.
M. le ministre. L’exposé de cet amendement est un peu négatif et peut-être trop direct. Il pourrait sans doute être rédigé différemment. Quoi qu’il en soit, je partage votre préoccupation, même s’il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans le texte. La volonté du ministère des sports, que nous partageons, est d’engager une réflexion sur la meilleure implication des entreprises dans les grands événements et dans leur financement, qu’il s’agisse d’événements sportifs ou de grandes conférences. Nous avons la même préoccupation pour la COP21, dans la préparation de laquelle il est nécessaire d’impliquer les entreprises françaises, selon les modalités que vous proposez.
Bien que je partage vos objectifs, monsieur Fromantin, je vous demande de retirer cet amendement.
L’amendement SPE1160 est retiré.
*
* *
Article 64
(art. L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale)
Rapport annuel d’information sur les retraites chapeau
Le présent article pose le principe d’un rapport adressé chaque année à l’INSEE et aux services statistiques ministériels par les organismes débiteurs de rentes versées au titre des régimes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires, communément appelées « retraites chapeau ». Ce rapport doit permettre d’améliorer la connaissance et le suivi des prestations versées à ce titre, afin d’éclairer d’éventuelles mesures ultérieures susceptibles d’être mises en œuvre pour rapprocher le fonctionnement de ces régimes de celui des autres régimes de retraite.
Si ces régimes dits « surcomplémentaires » peuvent concerner plusieurs catégories de salariés, ils sont souvent l’apanage des très grandes entreprises et peuvent conduire au versement de rentes particulièrement élevées au bénéfice de certains mandataires sociaux au moment de leur départ de l’entreprise. Un encadrement de ces pratiques serait souhaitable ; il n’est en revanche possible qu’à la condition de disposer d’une connaissance suffisante de ces régimes et de leur mode de fonctionnement, afin précisément de ne pas pénaliser la totalité des salariés qui bénéficient de ce type de régimes, mais bien de concentrer la mise en place de nouvelles règles sur les retraites chapeau très élevées, qui sont quasi exclusivement réservées aux mandataires sociaux des très grandes entreprises.
I. LE DROIT EXISTANT
A. QU’EST-CE QU’UNE « RETRAITE CHAPEAU » ?
Les « retraites chapeau » correspondent juridiquement aux rentes versées au titre de régimes de retraite supplémentaires relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, autrement dit de régimes à prestations définies et à droits aléatoires.
Il faut tout d’abord bien sûr les distinguer des régimes de base obligatoires par répartition, ainsi que des régimes conventionnels obligatoires que sont l’AGIRC et l’ARRCO. Ces régimes sont en effet des régimes « supplémentaires » facultatifs, qui fonctionnent par capitalisation, et qui offrent au salarié un complément de prestations de retraite au moment de son départ. Ensuite, les « retraites chapeau » stricto sensu doivent être distinguées des régimes à cotisations définies, caractérisés par des cotisations régulières de l’employeur comme des salariés. Dans le cas des régimes à prestations définies, le montant du complément de retraite versé sous forme de rente viagère est fixé à l’avance ; ces systèmes sont soit à droits certains, auxquels cas le salarié participe à leur financement et ses droits sont individualisés, soit à droits aléatoires, c’est-à-dire soumis à la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. C’est ce dernier système qui correspond aux « retraites chapeau ».
Concrètement, les contributions des employeurs à ces régimes donnent lieu à la constitution d’un fonds collectif dans lequel les droits aléatoires des salariés ne sont pas individualisés.
Les régimes en question peuvent être « additionnels » ou « différentiels ». Dans le premier cas, les rentes supplémentaires versées s’ajoutent aux prestations des régimes de base et des régimes complémentaires obligatoires ; dans le second cas, le montant de la rente versée dépend des prestations servies par ailleurs par la sécurité sociale et les régimes complémentaires, le régime « supplémentaire » garantissant au bénéficiaire un niveau de retraite global. Les « retraites chapeau » sont généralement « différentielles » : elles relèvent ainsi la plupart du temps de la seconde catégorie.
Il existe trois grandes catégories de systèmes à droits aléatoires, pour lesquels il faut rappeler que le choix des bénéficiaires peut être à la discrétion de l’employeur, qui n’est pas tenu de déterminer une catégorie objective de salariés bénéficiaires du dispositif.
La première est le plus emblématique, puisqu’il concerne les systèmes mis en place pour les cadres supérieurs et dirigeants, qui correspondent à ce que l’on entend communément par « retraites chapeau ». Il permet aux entreprises de permettre à des cadres dirigeants, sur une durée courte, d’acquérir des droits à retraite élevés. Il s’agit d’un système utilisé le plus souvent dans les grandes entreprises et les entreprises cotées.
S’agissant plus spécifiquement des dirigeants d’entreprise, dont les retraites chapeau peuvent atteindre des montants considérables (92), le rapport du cabinet d’audit ATH sur les rémunérations des 400 dirigeants de sociétés cotées en 2013 indique que 26 % des dirigeants, soit 100 dirigeants bénéficient d’une retraite supplémentaire, dont 42 dirigeants relevant de retraites à prestations définies (93).
Le premier rapport d’activité du Haut comité de gouvernement d’entreprise publié en octobre 2014 donne des informations s’agissant des dirigeants mandataires sociaux : ainsi, 47,7 % des sociétés de l’indice boursier SBF 120 et 77,8 % des sociétés du CAC 40 indiquent prévoir un engagement de retraite à prestations définies en faveur d’au moins un de leurs premiers dirigeants mandataires sociaux. Parmi les 28 sociétés du CAC 40 concernées, trois ont fermé leur régime, qui ne peut plus dès lors être ouvert à de nouveaux bénéficiaires, pas plus qu’il ne peut être modifié.
La deuxième catégorie recouvre les systèmes mis en place pour l’ensemble des salariés ou pour une grande partie d’entre eux, et qui correspondent majoritairement aux régimes antérieurement gérés par les institutions de retraite supplémentaires (IRS) : il s’agit de systèmes qui ont été le plus souvent créés à la suite de privatisations d’entreprises nationalisées, afin de compenser aux salariés la perte de droits qui leur auraient été accordés dans la fonction publique.
La troisième catégorie concerne des systèmes qui ont été mis en place en complément de l’instauration d’un régime à cotisations définies, pour garantir aux bénéficiaires les plus proches de la retraite un niveau de pension minimale. Le régime est alors le plus souvent différentiel par rapport aux régimes à cotisations définies. Cette catégorie de régimes, la plus difficile à cerner, représente vraisemblablement moins d’intérêt depuis la mise en place d’une contribution de 16 % au premier euro de rente versé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. En effet, avant 2011, la contribution patronale de 16 % n’était due que sur les rentes excédant un tiers du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
On le voit, les régimes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires recouvrent des réalités assez différentes. La problématique spécifique aux « retraites chapeau » de niveaux très élevés servies à des mandataires sociaux qui quittent leurs fonctions dans de grandes entreprises ne constitue qu’une partie de ces systèmes de retraites. L’encadrement de ces seules « grosses retraites chapeau » ne doit pas conduire à pénaliser la totalité de ces régimes qui bénéficient parfois à une grande partie, voire à la totalité des salariés, pour des montants qui sont tout à fait raisonnables et dont la légitimité n’est pas à remettre en cause.
Comme l’indique l’étude d’impact associée au présent projet de loi, le nombre total de bénéficiaires de régimes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires est évalué aujourd’hui entre un et trois millions, au sein de plus de 10 000 entreprises : 28 % de ces régimes concernent potentiellement tous les salariés, 53 % uniquement les cadres et seulement 12 % uniquement les cadres dirigeants. D’après les données issues du rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale d’octobre 2010, dont les données sont néanmoins un peu datées, il y aurait aujourd’hui autour de 100 000 pensionnés bénéficiant de ce type de régime, pour une pension moyenne évaluée à 3 875 euros par an et par bénéficiaire.
B. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL APPLICABLE AUX RETRAITES CHAPEAU
1. Le régime fiscal
Sur le plan fiscal, les sommes consacrées par l’employeur au financement de ces régimes « surcomplémentaires » à prestations définies et à droits aléatoires sont déductibles du bénéfice de l’entreprise, en application de l’article 39 du code général des impôts.
Depuis 2009, la déductibilité à l’impôt sur les sociétés (IS) du montant des retraites chapeau – de même, d’ailleurs, que des parachutes dorés – versés à certains mandataires sociaux postérieurement à leur départ est limitée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), autrement dit à 225 288 euros au 1er janvier 2014 (94). Rappelons également que les retraites chapeau sont incluses dans l’assiette de la taxe de 50 % à la charge de l’employeur, mise en place par la loi de finances pour 2014 et qui s’applique à la fraction des rémunérations individuelles de plus d’un million d’euros par an versées en 2013 et 2014.
S’agissant des bénéficiaires, les rentes versées au titre des retraites chapeau sont assujetties aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu : s’appliquent donc la CSG au taux de 6,6 %, la CRDS au taux de 0,5 %, la cotisation maladie de 1 %, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 %, en plus de l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou « surtaxe Fillon ».
2. Le régime social
Le régime social des « retraites chapeau » est défini à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où les contributions des employeurs sont réputées non individualisées par salarié, elles ne sont pas assimilées à du salaire et sont donc exclues de l’assiette des cotisations sociales. De plus, ces régimes se caractérisent par l’absence de contribution du salarié au financement du dispositif. Afin de pallier cette absence de prélèvements sociaux, deux contributions spécifiques ont été instaurées.
● Une contribution spécifique à la charge de l’employeur mise en place par la loi portant réforme des retraites de 2003, prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dont l’assiette et le taux sont fonction du choix de l’employeur sur le mode de prélèvement, selon que la retraite chapeau est gérée par l’employeur ou confiée à un organisme tiers et selon le moment auquel l’entreprise choisit d’être assujettie au prélèvement (à l’entrée, au moment de l’abondement de la retraite chapeau, ou à la sortie, au moment de son versement au bénéficiaire). La contribution s’applique :
– soit sur les primes versées à un organisme assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle au taux de 24 % ;
– soit sur les rentes versées aux bénéficiaires au taux de 32 % ;
– soit sur la partie de la dotation aux provisions gérées en interne à l’entreprise, au taux de 48 % (95).
Cette contribution s’accompagne d’une contribution additionnelle de 30 % à la charge de l’employeur sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 300 384 euros au 1er janvier 2014, et ce, quelle que soit l’option exercée par l’employeur quant à la contribution de base. Il convient de noter que dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, cette contribution additionnelle exceptionnelle a été portée de 30 à 45 % pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2015.
En outre, les nouveaux régimes créés après le 1er janvier 2010, sont tenus d’externaliser leur gestion auprès d’une institution de prévoyance, d’un organisme assureur ou d’une mutuelle.
● Une contribution spécifique, prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du bénéficiaire de la rente et dont le taux varie en fonction de la date de liquidation de la retraite et du montant mensuel de la rente :
– les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution pour leur fraction qui excède 500 euros par mois au taux de 7 % sur la fraction de la rente comprise entre 500 euros et 1 000 euros, et de 14 % sur la fraction de la rente comprise supérieure à 1 000 euros par mois ;
– les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois au taux de 7 % sur la fraction de la rente comprise entre 400 et 600 euros par mois, et de 14 % sur la fraction de la rente supérieure à 600 euros par mois.
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait initialement porté à 21 % le taux de la contribution applicable à la fraction de la rente supérieure à 1 000 euros par mois pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, et à 600 euros par mois pour les retraites liquidées après le 1er janvier 2011. Toutefois, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur le projet de loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnels ces taux de contribution applicables aux rentes supérieures à 24 000 euros par mois, qui devaient s’ajouter à la nouvelle tranche marginale d’impôt sur le revenu au taux de 45 % pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros, considérant que cette nouvelle imposition, combinée aux autres impositions existantes et à la contribution spécifique de 21 % au titre des retraites chapeau aboutirait à un taux maximal de taxation de 75,04 %, ce qui constituerait une « charge excessive au regard des facultés contributives de certains contribuables percevant des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies » (96).
C. DES RÈGLES D’ENCADREMENT DES RETRAITES CHAPEAU SERVIES AUX MANDATAIRES SOCIAUX QUI NE SE RÉVÈLENT PAS ASSEZ EFFICACES
Alors que le législateur a considérablement alourdi la taxation des retraites chapeau dans les cinq dernières années, ce durcissement du régime fiscal et social n’a pas produit les effets escomptés. En effet, depuis 2010, les contributions spécifiques à la charge de l’employeur comme du bénéficiaire ont été majorées presque chaque année, une nouvelle majoration de la contribution spécifique à la charge de l’employeur ayant, comme on l’a vu, encore été votée dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Et pourtant, cet alourdissement n’a, force est de le constater, pas répondu au problème spécifique des retraites chapeau de niveau très élevé perçues par certains mandataires sociaux qui quittent leurs fonctions dans de grandes entreprises.
L’instrument de la « taxation » du bénéficiaire des rentes atteint en effet ses limites sur le plan juridique, comme en témoigne la décision du Conseil constitutionnel. Si une marge de manœuvre subsiste du côté de l’employeur – le Conseil constitutionnel n’ayant pas jugé inconstitutionnel le taux de 45 % de la contribution exceptionnelle à la charge de l’employeur sur les rentes supérieures à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale -, ce taux peut raisonnablement aujourd’hui être considéré comme un plafond. Il ne sera guère possible d’aller au-delà.
Il convient de répondre à cette problématique par d’autres voies, qui ont commencé à être explorées, mais qui ont encore insuffisamment été exploitées à ce jour.
1. Des règles d’encadrement d’ores et déjà mises en œuvre
● Cet encadrement est d’abord législatif.
Depuis 2005, l’octroi du bénéfice de retraites à prestations définies à des mandataires sociaux de sociétés cotées doit suivre la procédure des conventions règlementées (97). Ces conventions doivent être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration puis approuvées par l’assemblée générale des actionnaires, sur rapport spécial des commissaires aux comptes.
En application du règlement communautaire dit « prospectus » (98), une société cotée doit publier le montant total des sommes provisionnées pour le versement de la retraite de chacun des mandataires sociaux.
La loi prévoit également des dispositions d’encadrement de l’octroi des retraites chapeaux spécifiques aux banques aidées par l’État. En application d’une disposition adoptée à l’initiative du Sénat dans le cadre du collectif « Dexia » d’octobre 2011 (99), les organes sociaux des établissements de crédit aidés financièrement par l’État ne peuvent décider l’octroi aux mandataires sociaux, pendant toute la durée de l’aide, de rémunérations différées, ce qui inclut les retraites chapeau.
En complément de ces mesures, on peut également rappeler que l’article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la participation de représentants des salariés, avec voix délibérative, au conseil d’administration ou de surveillance des grandes entreprises de plus de 10 000 salariés dans le monde ou de plus de 5 000 salariés en France. Les retraites chapeau octroyées aux mandataires sociaux de sociétés cotées devant être autorisées par le conseil d’administration, on peut estimer que ces représentants de salariés peuvent exercer une certaine influence sur la décision ou a minima favoriser la publicité des avantages consentis aux dirigeants.
● Ces dispositions législatives sont complétées par le code de bonne conduite AFEP-MEDEF (100), adopté en octobre 2008 et révisé en juin 2013, qui comporte notamment des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées et des conseils en matière de régimes de retraite supplémentaires.
Ces règles, qui tendent à poser des « conditions qui évitent les abus », sont les suivantes :
– la fixation globale de la rémunération doit intégrer l’avantage fourni par cette retraite ;
– le groupe des bénéficiaires d’un tel régime supplémentaire de retraite doit être « sensiblement plus large » que les seuls mandataires sociaux, sans que le périmètre des bénéficiaires ne soit clairement défini ;
– les bénéficiaires doivent satisfaire des « conditions raisonnables d’ancienneté », fixées par le conseil d’administration ou le directoire et dont le minimum est fixé, par le code de bonne conduite, à deux ans ;
– l’augmentation des droits potentiels doit être progressive en fonction de l’ancienneté dans le régime et ne doit représenter, chaque année, qu’un pourcentage limité à 5 % de la rémunération du bénéficiaire ;
– la période de référence prise en compte pour le calcul de la prestation doit être de plusieurs années et toute augmentation artificielle de la rémunération sur cette période à la seule fin d’augmenter le rendement du régime de retraite est à proscrire ;
– les systèmes donnant droit immédiatement ou au terme d’un petit nombre d’années à un pourcentage élevé de la rémunération totale de fin de carrière sont à exclure ;
– enfin, des informations sur les droits potentiels ouverts à titre individuel, notamment le revenu de référence et le pourcentage maximum dudit revenu auquel donnerait droit le régime de retraite supplémentaire, doivent être rendues publiques. Ce pourcentage ne saurait être supérieur à 45 % du revenu de référence (rémunérations fixes et variables dues au titre de la période de référence).
Un rapport examinant le respect de ces principes est publié chaque année. Le code révisé adopté en juin 2013 a institué le Haut comité du gouvernement d’entreprise, chargé d’assurer le suivi de l’application des principes posés par le code de bonne conduite. Le Haut comité a publié son premier rapport d’activité en octobre 2014.
S’agissant des engagements de retraite supplémentaire, qui couvrent exclusivement dans le code de conduite les régimes à prestations définies, le Haut comité constate que les entreprises ont souvent du mal à fournir l’ensemble des informations requises, parce que les plans de retraite eux-mêmes ne comportent pas ces règles ou fixent un plafond exprimé autrement, par exemple en multiple du plafond annuel de la sécurité sociale. Le Haut comité recommande que les sociétés amendent leurs plans de retraite lorsque cela est possible pour les rendre conformes au code ou, le cas échéant, présentent les informations nécessaires pour permettre d’apprécier la conformité de ces plans aux prescriptions du code.
Le Haut comité recommande également que la règle qui consiste à réduire la rémunération des dirigeants en cas de difficultés économiques de l’entreprise - celle-ci pouvant être automatique s’agissant des critères de rémunération variable - s’applique également aux avantages que représentent les engagements de retraite supplémentaire. Certes, la loi n’oblige pas les plans de retraite à comporter des conditions de performance ; néanmoins, cette pratique devrait être généralisée, notamment en prévoyant que l’acquisition de nouveaux droits soit réduite provisoirement – voire que l’acquisition nouvelle de droits soit suspendue - pendant une période de difficultés économiques pour l’entreprise.
Le tableau suivant récapitule le degré de satisfaction des critères du code de bonne conduite AFEP-MEDEF par les sociétés du SBF 120 et du CAC 40.
TAUX DE SATISFACTION DES CRITÈRES DU CODE DE BONNE CONDUITE AFEP-MEDEF
(en pourcentage)
SBF 120 |
CAC 40 | |||
Exercice 2012 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
Exercice 2013 | |
Catégorie de bénéficiaires plus large que les seuls mandataires sociaux |
94,4 % |
98 % |
96,3 % |
100 % |
Période de référence supérieure à un an |
81,5 % |
90,2 % |
85,2 % |
96,4 % |
Conditions d’ancienneté (deux ans minimum) |
– |
84,3 % |
– |
89,3% |
Progressivité de l’augmentation des droits potentiels (5 % maximum) |
76,5 % |
78,6 % | ||
Pourcentage maximum du revenu de référence (45 % maximum) |
76,5 % |
78,6 % | ||
Source : Haut comité de gouvernement d’entreprise
Si la quasi-totalité des sociétés indiquent une catégorie de bénéficiaires plus large que les seuls dirigeants mandataires sociaux et appliquent une période de référence supérieure à un an pour définir la base de la retraite chapeau – ce qui, on s’accordera sur ce point, constitue un critère minimaliste -, elles respectent également en grande majorité la condition d’ancienneté de deux ans minimum pour bénéficier d’une retraite chapeau (84,3 % des sociétés du SBF 120 et 89,3 % des sociétés du CAC 40). En revanche, elles ne sont qu’un peu plus de trois sur quatre à respecter la fourchette d’augmentation progressive des droits potentiels, de maximum 5 % par an ainsi que le plafonnement de la retraite chapeau à 45 % du revenu de référence.
Si un certain nombre de règles d’encadrement ont été édictées ces dernières années, elles demeurent insuffisantes. Les dispositions législatives adoptées sont soit des mesures de consultation préalables ou d’information, soit des mesures d’encadrement réel, mais limitées à une société en particulier. Le code de bonne conduite est certes une excellente initiative et on ne peut que souhaiter que l’évaluation par le Haut comité de gouvernement d’entreprise du respect de ses règles perdure et soit même renforcé à l’avenir. Ces règles demeurent néanmoins, au moins pour certaines d’entre elles, très peu strictes, et ne conduisent pas, en tout état de cause, à un plafonnement du montant des avantages servis au titre des retraites chapeau.
II. LA POURSUITE DE L’ENCADREMENT DES RETRAITES CHAPEAU
Fort de ce constat, le Gouvernement a fait le choix de « reprendre la main » en proposant des mesures législatives destinées à rapprocher le régime des retraites chapeau du droit commun.
Néanmoins, afin de ne pas déstabiliser ou remettre en cause un système qui bénéficie par ailleurs à près d’un million de personnes en France, pour des montants moyens de rente annuelle très raisonnables – moins de 4 000 euros par an –, il est avant tout indispensable de disposer d’une connaissance détaillée de ces régimes, du nombre de rentes versées par les organismes qui les gèrent, et de leurs montants.
C’est l’objet du présent article, qui pose le principe d’un rapport annuel de suivi des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et à droits aléatoires. Il s’agit d’un préalable indispensable pour disposer d’une bonne connaissance des enjeux des systèmes de retraites chapeau, avant l’adoption de mesures législatives d’encadrement qui ont vocation à être présentées dans le cadre de la discussion du présent projet de loi.
A. LES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DU PRÉSENT ARTICLE
Les dernières données relatives aux régimes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires remontent à octobre 2010, date de la remise au Parlement du rapport du Gouvernement sur la situation des régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ce rapport fait d’ailleurs état des difficultés à disposer de données consolidées sur ces régimes. En effet, le rapport se fonde sur trois séries de données chiffrées :
– celles de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), complétées par l’URSSAF de Paris pour le secteur géographique du ressort de cette dernière ;
– celles de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur la base d’une extension réalisée pour l’occasion de son enquête annuelle sur la retraite supplémentaire ;
– et enfin, celles de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) s’agissant des données spécifiques aux institutions de retraite supplémentaire (IRS).
Ces séries de données ne permettent pas de disposer d’une vue d’ensemble des masses financières concernées par les retraites chapeau et de leurs bénéficiaires. Chaque série est en effet partielle : les données de l’ACOSS et des URSSAF excluaient les rentes inférieures au plancher d’assujettissement à la contribution spécifique (celle-ci ne s’appliquant à l’époque que sur les rentes supérieures au tiers du PASS) ; les données de la DREES excluaient les systèmes gérés en interne et par des IRS, tandis que les données de la FFSA couvraient les seules retraites gérées par ces institutions de retraite supplémentaire (IRS). Le rapport concluait sur l’insuffisance des données relatives aux retraites « L.137-11 », estimant que « ce dispositif (...) est insuffisamment isolé dans les systèmes de gestion des entreprises et des organismes de protection sociale complémentaire » ; « les organismes concernés ont eu des difficultés à isoler très précisément les données des régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 parmi le grand ensemble des régimes de retraite à prestations définies. Ceci pourrait s’expliquer notamment par le fait qu’à la différence des systèmes de retraite à cotisations définies, le financement n’est pas individualisé pendant la phase de constitution de droits (l’assureur n’a dès lors pas connaissance des bénéficiaires), et qu’après le départ à la retraite, l’assureur n’isole pas l’information selon laquelle le droit était ou non conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite ».
Afin de pallier cette carence dans la connaissance des systèmes de retraites dites chapeau, le présent article propose de compléter l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui leur est relatif pour prévoir que chaque année, les organismes et entreprises débiteurs de ce type de rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année N-1 :
– le montant des engagements souscrits ;
– le nombre de rentes servies ;
– ainsi que le montant moyen et médian de celles-ci.
Ce rapport est adressé à l’institution nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) ainsi qu’aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité, autrement dit à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail.
Cette nouvelle obligation d’information est bienvenue. Elle pèse autant sur les organismes tiers gestionnaires de ces systèmes de retraite supplémentaire (institutions de prévoyance, mutuelles, assurances) que sur les entreprises, dès lors qu’elles gèrent de tels systèmes en interne. Les rapports de suivi fournis par les organismes et les entreprises concernés permettront aux instances statistiques de disposer de données consolidées, notamment sur le montant total des engagements souscrits à ce titre, le nombre de rentes servies, c’est-à-dire le nombre de bénéficiaires retraités, ainsi que sur le niveau moyen et médian des rentes servies à ce titre.
Le rapporteur thématique regrette toutefois que ces informations ne portent pas par exemple sur les montants minimal et maximal de rentes servies et ne permettent pas de connaître le nombre de bénéficiaires potentiels de retraites chapeau pour lesquels l’employeur procède à des versements, mais seulement le nombre de rentes servies.
Cette mesure préalable devra nécessairement être complétée par des règles législatives d’encadrement plus fortes. Le rapporteur thématique a entendu à ce sujet M. Jean-Michel Charpin, chargé par le ministre de l’économie, des finances et du numérique, le 11 décembre dernier, d’une mission d’évaluation des retraites chapeau qui doit aboutir à une série de propositions relatives à l’encadrement des retraites chapeau dont bénéficient les mandataires sociaux des très grandes entreprises. Ce rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales (IGF-IGAS) devait être remis au ministre au tout début de l’année 2015.
D’après les informations transmises au rapporteur thématique, les conclusions de ce rapport ne concerneraient bien que les seules retraites chapeau versées aux mandataires sociaux des entreprises cotées.
Plusieurs options d’encadrement seraient envisageables, qui ne sont d’ailleurs pas forcément exclusives les unes des autres.
● La première consisterait à faire dépendre soit l’acquisition de droits au titre d’une retraite chapeau, soit le niveau de la rente servie, de la performance de l’entreprise, comme c’est aujourd’hui le cas pour l’ensemble des autres éléments de rémunération versés au moment du départ du dirigeant. En effet, les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce prévoient que les éléments de rémunération, indemnités et avantages liés au changement ou à la cessation des fonctions respectivement des présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués pour l’article L. 225-42-1, et membres du directoire pour l’article L. 225-90-1 – autrement dit, l’ensemble des indemnités de départ –, doivent être soumis à la procédure des conventions réglementées déjà évoquées. Les régimes de retraite supplémentaire relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont également soumis à cette procédure en vertu respectivement du sixième alinéa de chacun de ces articles.
Les autres dispositions de ces articles ne sont pas applicables aux retraites chapeau, mais seulement aux indemnités de départ : ainsi, les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 disposent-ils par ailleurs que « sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée » ou « dont il est membre du directoire ».
Ils disposent également que l’autorisation de ces indemnités telle que donnée par le conseil d’administration doit être publiée sur le site internet de la société dans un délai maximal de cinq jours suivant la réunion au cours de laquelle elle a été accordée, que l’approbation par l’assemblée générale ordinaire doit faire l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire et doit intervenir à chaque renouvellement de mandat du dirigeant concerné, sous peine de nullité. Enfin, la réalisation des conditions de performance doit être constatée par le conseil d’administration avant le paiement de l’indemnité, lors ou après la cessation ou le changement effectif de fonctions. Cette décision doit également être rendue publique sur le site internet de la société dans les cinq jours suivant la décision du conseil d’administration et doit pouvoir être consultée jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
L’ensemble de ces obligations ne s’applique donc pas aujourd’hui aux retraites chapeau.
Il serait légitime que la corrélation à la performance de l’entreprise soit également valable pour les retraites chapeau, de même que les conditions d’autorisation de versement des rentes afférentes. Le rapporteur thématique souhaite en tout cas vivement qu’une telle modification des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 intervienne d’ores et déjà dans le cadre de l’examen du présent projet de loi pour intégrer cette dimension. La question se posera de savoir si doit être conditionné à la performance de l’entreprise le niveau de l’acquisition des droits au titre d’une retraite chapeau ou le niveau même de la rente versée.
● La deuxième option consisterait à durcir les actuels critères de niveau et de progression des retraites chapeau incluses dans le code de bonne conduite AFEP-MEDEF, dont on a vu qu’ils étaient relativement lâches. En effet, le taux maximal de remplacement de 45 % de la rémunération totale – rémunérations fixe et variables comprises – reste très permissif, et surtout, le rythme de progression annuel des droits potentiels de 5 % par an apparaît également assez important, puisqu’il autorise l’atteinte du taux de remplacement maximal au bout de neuf ans seulement.
La question est alors de savoir si le durcissement de ces règles d’encadrement doit passer par le renforcement des règles du code AFEP-MEDEF ou s’il doit figurer dans la loi. La première option présente l’inconvénient de laisser les acteurs maîtres des règles qu’ils appliquent, ce qui n’a malheureusement pas évité les excès régulièrement évoqués par la presse ; elle a néanmoins l’avantage de se donner comme une preuve de confiance, à l’heure où des progrès importants ont été réalisés grâce notamment aux travaux du Haut comité de gouvernement d’entreprise. La seconde option, qui consiste à légiférer, présente l’avantage de répondre de manière frontale et nette au problème des retraites chapeau excessives qui défraient la chronique ; elle comporte cependant des difficultés de mise en œuvre en aval, car il est très difficile de garantir le contrôle réel du respect de ces règles par les agents chargés de l’assurer. Une solution alternative consisterait à proposer un durcissement des critères énumérés par le code de bonne conduite AFEP-MEDEF, en prévoyant que ce code fait l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’économie.
● La troisième voie qui devrait être explorée par le rapport « Charpin » est celle du renforcement des obligations de transparence et de publication des informations relatives aux retraites chapeau servies aux anciens dirigeants ou mandataires sociaux non seulement au moment de leur départ de l’entreprise, mais aussi au moment de l’acquisition des droits. Il pourrait même être envisagé que les données demandées aux grandes entreprises à ce titre soient nominatives, et cela, afin de garantir une politique de transparence et de promouvoir l’exemplarité dans ce domaine.
● Enfin, une refonte plus globale et profonde de l’ensemble des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies – et pas seulement de ceux qui bénéficient aux mandataires sociaux dirigeants de grandes entreprises – ne semble pas pouvoir être évitée à plus long terme. En effet, la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 (101) fixe aux États membres un délai de quatre ans pour transposer ses dispositions qui prévoient en particulier que les droits à pension sont irrévocablement acquis au plus tard au terme d’une présence de trois ans, ce qui est clairement incompatible avec ce qui fait la spécificité des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et à droits aléatoires, qui conditionnent l’acquisition des prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. En outre, à l’échéance de 2018, il ne serait plus ni possible de créer de nouveaux régimes de retraites à prestations définies relevant de l’article L. 137-11, ni d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes existants, ni d’attribuer de nouveaux droits aux affiliés des régimes existants à cette date. En d’autres termes, la directive « portabilité » met à mal le principe même des retraites à prestations définies et à droits aléatoires, dont il faudra donc forcément envisager la refonte à l’échéance de 2018.
Il est évident qu’une telle refonte d’ensemble de ces régimes, qui, rappelons-le, concernera l’ensemble des bénéficiaires de ces régimes et pas seulement les dirigeants des sociétés cotées, nécessite des travaux et une réflexion d’ensemble de plus longue haleine. Le rapporteur thématique l’appelle de ses vœux et estime qu’il est ainsi d’autant plus urgent de prendre des mesures rapides d’encadrement des retraites chapeau des mandataires sociaux dirigeants, notamment en les conditionnant à la performance économique globale de l’entreprise, qu’une réforme d’ensemble ne pourra intervenir que dans un avenir plus lointain, autrement dit, d’ici trois ans.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Outre des amendements d’ordre rédactionnel, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à enrichir le contenu des rapports demandés aux organismes et entreprises gestionnaires de retraites chapeau, en prévoyant que ces rapports comportent également les éléments relatifs aux montants minimal et maximal de rentes servies au titre de ces régimes, ainsi que le nombre de leurs bénéficiaires potentiels.
*
* *
La commission examine l’amendement SPE1860 des rapporteurs.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Le présent amendement s’inspire des conclusions du rapport Charpin, rendu public ces jours derniers et qui traite des retraites chapeau. Il vise à ce que soit précisé dans le rapport de suivi de ces retraites les montants minimum et maximum des rentes servies, ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels, dans un objectif de transparence. Si quelques éléments sont, en effet, susceptibles d’être diffusés ici ou là, finalement les connaissances sur ces retraites sont peu précises. Le rapport décompte plus de 200 000 bénéficiaires pour une rente moyenne de 5 000 euros, à mettre en regard des cas très médiatisés qui seront abordés par plusieurs amendements que je défendrai par la suite.
M. le ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement SPE1860.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1684 des rapporteurs.
Puis elle en vient à l’amendement SPE1129 de Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. L’article 64 permet enfin d’obtenir une information statistique concernant les retraites chapeau. Aussi proposons-nous d’aller au bout de la démarche et de faire en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. Je sais que le Gouvernement est très attaché à la République numérique. Or ces données sont utiles pour comprendre le phénomène des retraites chapeau mais utiles aussi au débat public.
M. le ministre. Je comprends votre volonté. Les services statistiques doivent disposer des données nécessaires au suivi de ces engagements de retraites d’entreprises, mais la mesure d’anonymisation que vous proposez paraît néanmoins a priori assez lourde, assez contraignante.
Je vous invite à retirer votre amendement, au bénéfice d’un travail sur des dispositions plus concrètes ne consistant pas à rendre des analyses publiques. Du reste, celles qui concernent les grands groupes le sont d’ores et déjà et font d’ailleurs partie des procédures définies par le code de gouvernement d’entreprises AFEP-MEDEF. Prévoir une information statistique plus lourde aurait un impact réel essentiellement sur les sociétés non cotées qui aujourd’hui n’émettent pas de telles statistiques. Je ne suis donc pas sûr que la voie que vous proposez soit la bonne.
Mme Karine Berger. L’amendement ne propose pas la publicité d’autres informations que celles qui figurent déjà dans le rapport prévu par l’article 64. Quant à l’anonymisation, il suffit tout simplement de ne pas mentionner la personne ni l’entreprise. Nous souhaitons que ces données soient disponibles sous forme numérique. J’y insiste pour la bonne compréhension du débat : il ne s’agit pas de donner de nouvelles informations, mais de donner la possibilité aux chercheurs, aux analystes d’utiliser le rapport dans un format ouvert.
M. le ministre. Le problème, s’agissant de ces retraites chapeau, ce sont les mandataires sociaux qui touchent une retraite supplémentaire d’un montant particulièrement important, financée par l’entreprise par provisionnement, ce qui en fait un salaire différé, et exonérée de cotisations. Et cela n’est plus compris par les citoyens. Cependant, la notion de retraite chapeau recouvre également les retraites supplémentaires de millions de Français et, honnêtement, d’un point de vue politique, ce ne sont pas elles qui sont visées par cet article.
Nous avons bien une politique de publicité des données mais il faut la laisser prospérer d’elle-même. Je suis mal à l’aise à l’idée que, par le biais de l’article 64, on mène une politique dont la principale plus-value serait de faire porter aux ministères concernés – qui ne seraient pas forcément en mesure de le faire – ou aux entreprises la charge de l’anonymisation pour avoir une visibilité sur les millions de Français qui touchent des retraites supplémentaires. Concentrons-nous plutôt sur les quelques cas concrets qui nous ont conduits à commander un rapport à M. Charpin.
C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement qui sera de toute façon satisfait par notre politique d’open data.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Même avis, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission de ces données. On peut certes envisager un format ouvert, mais il faudrait procéder à une nouvelle rédaction de l’amendement avant l’examen du texte en séance publique afin que tous les éléments puissent être transmis aux différents organismes chargés de réaliser les études.
Mme Karine Berger. Je maintiens mon amendement, car notre volonté d’assurer la transparence des données doit commencer par la publication des rapports que nous commandons.
La commission rejette l’amendement SPE1129.
Puis elle adopte l’article 64 modifié.
*
* *
Article 64 bis [nouveau]
(art. L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce)
Conditionnement des retraites chapeau des dirigeants mandataires sociaux
à la performance de l’entreprise
Cet article, introduit à l’initiative des rapporteurs avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que les retraites chapeau bénéficiant aux dirigeants mandataires (présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et membres du directoire) sont subordonnées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de l’entreprise.
Ce conditionnement à la performance de l’entreprise existe déjà aujourd’hui dans le code de commerce pour l’ensemble des autres éléments de rémunération : il n’y a donc aucune raison que cette condition ne s’applique pas aux retraites chapeau.
Il s’agit là d’une des préconisations du rapport « Charpin » sur l’encadrement des retraites chapeau de décembre 2014, issu des travaux de la mission IGF-IGAS et qui a été remis aux ministres au début du mois de janvier 2015.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement SPE1861 des rapporteurs.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement vise à soumettre à la performance de la société les engagements pris par une entreprise au titre des retraites chapeau. Il convient, en effet, de faire reposer la rente envisagée sur le travail, l’effort et le mérite.
M. le ministre. Il est inadmissible que les mécanismes en question, qui sont des salaires différés pour les mandataires sociaux, soient totalement déconnectés de la performance de l’entreprise. Traiter ce sujet dans la loi constitue un durcissement par rapport au choix initialement fait en 2013 de traiter le problème à travers le code AFEP-MEDEF. M. Grandguillaume travaille – et nous y travaillerons avec lui – à la définition d’autres pistes qui pourront se révéler utiles pour aller encore plus loin. En attendant, l’amendement qu’il défend permet de franchir une étape en posant une contrainte en termes de performance. Il présente, en outre, l’avantage de ne pas chercher à dissuader par le biais de la fiscalité, méthode jusqu’à présent principalement suivie quelle que soit la majorité, et qui a touché non pas seulement des mandataires sociaux dont la rémunération a pu défrayer la chronique mais aussi des cadres de banque.
Outre le critère de la performance, on pourra aussi songer à celui de la fidélisation – le montant de la retraite chapeau de M. Varin avait ainsi fait d’autant plus polémique qu’il était resté très peu de temps au sein de l’entreprise.
Avis très favorable à l’amendement.
La commission adopte l’amendement SPE1861.
*
* *
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE1081 de Mme Karine Berger et SPE1296 de M. Joël Giraud.
Mme Karine Berger. Le présent amendement propose une évolution importante du droit en ce qu’il vise à aligner des pratiques françaises sur des pratiques allemandes plus que séculaires. Nous avons tous reçu des témoignages de créateurs de petites entreprises qui ont perdu la majorité du capital dès lors que leur start-up a pris une certaine ampleur. En Allemagne, un mécanisme protège ces actionnaires minoritaires à l’origine de l’entreprise. Il ne s’agit pas de leur donner tous les pouvoirs, mais de leur conserver celui d’influencer la stratégie de l’entreprise, y compris après avoir procédé à une augmentation de capital. Un exemple très connu en Allemagne est celui de la prise de contrôle de l’entreprise Wella par Procter & Gamble. Le grand groupe a voulu modifier complètement la stratégie de Wella, mais les actionnaires minoritaires, qui construisaient le pacte d’entreprise depuis des années, ont eu gain de cause devant la justice du fait de l’importance de la modification envisagée.
Il s’agit donc, ni plus ni moins, de donner la possibilité à des actionnaires qui ont défini la stratégie à l’origine du succès et de la croissance d’une entreprise de garder une certaine influence, y compris quand de grands groupes acquièrent la majorité de son capital.
M. le ministre. Dans une note qui vous a été transmise, madame Berger, la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy considère que la jurisprudence protège les actionnaires minoritaires et satisfait donc l’amendement. En outre, l’introduction dans le texte du terme « dominance » n’apparaît pas sûre à la DAJ. L’adoption d’un tel dispositif pourrait même, selon elle, dégrader la jurisprudence et la rendre moins protectrice pour les actionnaires minoritaires. Je suis prêt à poursuivre nos échanges et, à cette fin, je vous suggère de retirer votre amendement.
Cette question avait fait l’objet d’une proposition de loi de M. Assaf. Or la préoccupation du Gouvernement avait été la même compte tenu des nombreuses incertitudes juridiques que comportait le texte proposé.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Même avis.
Mme Karine Berger. Je suis un peu embarrassée par la réponse du ministre parce que l’amendement que nous proposons a été modifié à six reprises, depuis un an, au gré de nos échanges avec la DAJ. C’est ainsi, par exemple, que le terme « dominance » ne figure plus dans le dispositif proposé. Le but poursuivi avec cet amendement est de ne pas laisser à la jurisprudence le soin d’apprécier la façon dont les actionnaires minoritaires doivent être pris en compte. Et c’est parce qu’elle ne les a pas toujours protégés que nous défendons cette disposition bel et bien rédigée en fonction de cas concrets. Notre divergence me paraît moins porter sur la forme juridique – nous nous sommes, j’y insiste, alignés sur la note de la DAJ – que sur le fond du sujet.
M. le ministre. Il n’y a pas de désaccord sur le fond. Quand nous aborderons le droit des actionnaires au regard des intérêts de l’entreprise, vous pourrez constater que le Gouvernement entend aller plus loin que le droit en vigueur dans bien d’autres pays. Je le répète, l’amendement tel qu’il est rédigé n’est pas conforme aux considérations de la DAJ. Or, pour être honnête, tant que les services juridiques ne me donneront pas leur aval, mon avis restera défavorable.
Mme Karine Berger. Dans la perspective du retrait de l’amendement, monsieur le ministre, pouvez-vous demander à vos services de nous donner une formulation idoine, car depuis un an, quand bien même nous tâchons de nous conformer aux notes qui nous sont transmises, votre réponse est toujours négative. Si vous nous communiquez, d’ici à mardi, une version qui soit, d’un point de vue juridique, validée par la DAJ, je retirerai volontiers mon amendement.
M. Olivier Carré. Nous avons tous à l’esprit des cas particuliers. N’oublions pas non plus les investisseurs extérieurs qui ont fait preuve de loyauté envers des actionnaires qui devenaient de fait minoritaires. Du reste, ces derniers restant actifs au sein de l’entreprise, il n’est pas facile de déterminer un éventuel préjudice d’une partie vis-à-vis de l’autre. Ce climat de confiance qui prévaut entre les parties peut être complètement perturbé par une intervention législative, qui pourrait faire du risque qu’une entreprise prend en entrant dans le capital d’une autre, un élément à apprécier comme donnant lieu à réparation. Autant je peux comprendre l’intention des auteurs des amendements, autant les moyens qu’ils proposent me semblent totalement disproportionnés. Le juge a déjà la possibilité de trancher des litiges manifestes, et si l’on systématisait le dispositif envisagé, nous aurions un vrai souci d’attractivité.
M. le ministre. Je ne peux pas m’engager, madame Berger, car ce que vous cherchez à obtenir est tellement large que nous ne trouvons pas la rédaction qui convient. Il faudrait envisager une solution en fonction de cas particuliers. Nous avons travaillé avec des avocats spécialisés sur le sujet qui tous ont exprimé leurs craintes d’un changement législatif en la matière et qui tous ont souligné le fait que les Allemands sont en train de changer de système. Le plus simple serait de nous communiquer les cas concrets que vous cherchez à traiter afin que nous tâchions de clarifier les choses.
Mme Karine Berger. D’abord, le système en question fonctionne à merveille en Allemagne et a permis à des ETI de grandir, y compris quand leurs fondateurs sont devenus minoritaires. Je ne voudrais pas qu’on laisse penser qu’une intervention législative visant à instaurer un système qui, je le répète, fonctionne à merveille depuis plus de cent ans en Allemagne, pourrait avoir un effet immédiatement négatif en France.
Ensuite, monsieur le ministre, nous avons travaillé avec les avocats des entreprises qui ont vécu ces difficultés. Or ils nous assurent que le dispositif tel qu’il est rédigé convient. Je suis très gênée parce que voilà un an et demi que j’essaie de trouver un accord avec vos services sur la rédaction de l’amendement – comment dès lors ne pas penser que c’est bien le fond qui pose problème ?
Je retire mon amendement et, faute de nouvelle proposition de la part de la DAJ d’ici-là, je le représenterai en séance publique.
Les amendements SPE1081 et SPE1296 sont retirés.
La commission examine, en présentation commune, les amendements SPE1810 rectifié, SPE1812 rectifié, SPE1811 rectifié, SPE1814 rectifié, SPE1813 rectifié et SPE1815 rectifié du rapporteur général.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Ces amendements visent à introduire dans le code de commerce des articles destinés à définir le secret des affaires et à garantir sa protection civile et pénale. Dans une économie de l’innovation, la protection du capital stratégique des entreprises est déterminante pour préserver leur capacité de croissance et leur faculté de conquérir des marchés. Or la prédation est devenue une composante de la vie des affaires, qu’elle passe par l’espionnage industriel ou le détournement de procédure judiciaire. Nos entreprises sont juridiquement démunies face à ce phénomène, alors que de nombreux pays protègent les informations qui ne sont pas encore brevetables. De fait, la France accuse un retard préjudiciable.
L’amendement SPE1810 rectifié comble cette lacune en définissant le secret des affaires et en confiant le soin à chaque entreprise de protéger les informations qu’elle juge utiles. Ce sera le juge, in fine, qui appréciera la pertinence et la proportionnalité de la protection. Les dispositions ici présentées respectent la liberté de la presse et le droit syndical. Elles forment un ensemble conforme à la proposition de loi déposée par Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas le 16 juillet dernier, soutenue par le groupe SRC et par ailleurs réclamée par la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport public pour l’année 2014. Le Gouvernement s’est prononcé sur cette proposition de loi lors d’une réunion interministérielle qui en a validé le contenu, le ministère de l’économie et la Chancellerie ayant été étroitement associés à son élaboration.
L’amendement SPE1814 rectifié vise à aménager la procédure civile pour protéger les secrets d’affaires d’une entreprise devant assurer sa défense. La phase contentieuse est trop souvent exploitée, voire détournée, dans le but de récupérer des secrets d’affaires. Dans la mesure où le précédent amendement instaure la protection civile du secret des affaires et offre de nombreux outils au juge pour sanctionner une violation, il convient d’éviter de laisser une faille dans le système. Le dispositif envisagé permet donc au juge de décider si les débats se tiendront ou non en chambre du conseil, à savoir à huis clos.
L’amendement SPE1812 rectifié tend à permettre aux entreprises d’invoquer l’article 47 de la directive 2006/43/EC ou la convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale, afin de mettre en échec des demandes manifestement abusives concernant des informations stratégiques.
Autre élément très important, nous souhaitons protéger l’activité des journalistes qui dénonceraient des irrégularités. Ainsi, l’amendement SPE1813 rectifié introduit-il la notion de secret des affaires dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la plaçant à un niveau équivalent à la notion de secret professionnel. Il s’agit de sécuriser la capacité des journalistes à révéler des infractions commises par une entreprise.
Pour finir, l’amendement SPE1815 rectifié envisage les demandes extraordinairement diverses qui peuvent procéder de la volonté de profiter d’une procédure pour se livrer légalement à de l’espionnage économique. La France a recours à la commission rogatoire internationale qui assure une meilleure protection des droits de la défense. Dans cette optique, une loi a été adoptée en 1968 et modifiée en 1980 afin de faire obstacle à des demandes abusives. Toutefois, eu égard à la multiplication des procédures étrangères à l’occasion desquelles nos entreprises sont contraintes de communiquer des volumes de plus en plus considérables de documents dématérialisés, il convient de confirmer l’applicabilité de la loi de 1968 tout en renforçant son intelligibilité pour renforcer la sécurité juridique.
Cet ensemble de dispositions nous paraît indispensable pour assurer la sécurité, la créativité et la prospérité de nos entreprises innovantes.
M. le président François Brottes. Vous avez eu raison, monsieur le rapporteur général, de rappeler que la commission des lois a beaucoup travaillé sur la question.
M. le ministre. Avis favorable à cette série d’amendements.
M. Jean-Frédéric Poisson. Ces amendements très importants ont l’avantage de s’appuyer sur le travail remarquable de nos collègues Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas. Nous en partageons l’intention, même si nous n’avons pas disposé du temps nécessaire à l’examen détaillé des dispositions proposées. Si la loi sur la sécurisation de l’emploi octroyait à l’inspection du travail le pouvoir de photocopier tout document lui paraissant utile, le présent amendement met les entreprises à l’abri des dangers auxquels ce genre d’investigation poussée à l’excès pouvait les exposer. Ne serait-ce que pour ce motif, les préoccupations du rapporteur général rejoignent les nôtres.
Néanmoins, j’y insiste, nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner ces amendements en détail. Qui plus est, le mot « juge » a été prononcé à plusieurs reprises, ce qui nous conduira peut-être à émettre quelques réserves sur les procédures proposées. Compte tenu de ces remarques, les députés du groupe UMP s’abstiendront de manière positive pour prendre le temps d’étudier cet article volumineux d’ici à son examen en séance.
M. Francis Vercamer. Les députés du groupe UDI sont, pour leur part, très intéressés par ces amendements. Comme nos collègues du groupe UMP, nous n’avons pas eu le temps de les lire et la référence au président du groupe SRC et au président de la commission des lois ne saurait constituer pour nous une garantie. Néanmoins, nous voterons ces amendements qui nous paraissent aller dans le bon sens, tout en nous réservant le droit de les sous-amender en séance publique.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Une étape importante est ici franchie puisque la protection de l’activité des entreprises n’existe pas en droit français. Aucun instrument juridique ne permet de protéger le secret des affaires. Les présentes dispositions s’inspirent des prescriptions internationales datant de trente ans auxquelles la France ne s’est toujours pas conformée, mais également de pratiques que d’autres pays nous opposent.
D’abord, on définit le secret des affaires ; ensuite, on confie à l’entreprise le soin de dire ce qu’elle considère être sa zone de protection ; enfin, on confie au juge le soin de décider si le secret a été violé ou non.
Le dispositif s’appuie sur deux types de procédure – l’une pénale, envisagée par le rapport Carayon, l’autre civile, visée par les directives européennes en cours d’élaboration –pour corriger les risques énormes que représente l’usage des procédures. La technique, pour obtenir ce que vous voulez savoir d’une entreprise, est d’intenter un certain nombre de procès puisque les règles de communication de pièces prévues en droit anglo-saxon permettent de disposer de tous les éléments possibles. Cela s’appelle « aller à la pêche ».
Ces procédures pénales ou civiles sont des instruments très utiles pour assurer la confidentialité des éléments du dossier de l’entreprise en cause. En somme, ces amendements répondent à toutes les questions qui se posaient.
Mme Karine Berger. Que prévoit-on pour les lanceurs d’alerte ? Le secret des affaires doit certes être protégé dans 99,9 % des cas, mais si l’on n’avait pas violé celui de certaines entreprises luxembourgeoises, par exemple, on n’aurait jamais rien su de leurs pratiques. Je pose donc une question naïve : comment articuler les deux attitudes ?
Mme Corinne Erhel. Comment appliquer le dispositif prévu par l’amendement SPE1810 rectifié dans le cadre de la recherche collaborative et de l’innovation ouverte ?
M. le rapporteur général. Je répondrai à la « naïveté » de Mme Berger que l’amendement SPE1810 rectifié modifie l’article L. 151-9 du code de commerce afin de préciser que l’article L. 151-8 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, et à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance. Les lanceurs d’alerte sont donc protégés. Nous proposons, en effet, de renforcer la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Quant à la question de Mme Erhel, la recherche collaborative implique par définition que les informations échangées ne donnent pas lieu à protection particulière, faute de quoi on devrait parler de recherche non collaborative.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Je suis favorable à cette série d’amendements.
*
* *
Le monde économique contemporain se caractérise notamment par l’intense diffusion de l’information en raison du phénomène de mondialisation mais également du développement des technologies de l’information et de la communication (TIC). Or, cette nouvelle configuration, conjuguée à l’accroissement exponentiel des échanges internationaux, suscite une concurrence accrue entre les acteurs économique et favorise l’apparition de stratégies de prédation légales (détournement des contentieux ou des appels d’offres) ou illégales (attaques informatiques, surveillances techniques…). En conséquence, les données stratégiques économiques revêtent une valeur essentielle tout en étant plus aisément accessibles et objet de captation indue. Le patrimoine matériel et immatériel des entreprises est donc de plus en plus soumis à une tension préjudiciable pour les capacités de croissance, de recherche et développement, de conquête des marchés extérieurs…
De fait, l’un des défis majeurs à affronter pour les acteurs économiques réside dans la protection de leur capital stratégique, c’est-à-dire des informations qui ne sont pas ou pas encore brevetables mais pourtant indispensables à leur fonctionnement et à leur développement. En effet, l’obtention, l’utilisation ou la communication indue de telles informations peut peser sur la viabilité économique de ces entreprises.
En réponse à ces nouvelles conditions de la vie économique, l’instauration d’un cadre juridique est apparue nécessaire pour protéger ces informations économiques stratégiques. Les États-Unis ont notamment adopté des règles de confidentialité économique à travers le Clinger Cohen Act en 1996, conformément aux préconisations de l’article 39 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (102), annexé à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce.
D’une manière générale, nombreux sont les pays qui ont fait le choix de législations destinées à protéger le patrimoine stratégique de leurs entreprises (103). Plus récemment, la Commission européenne a adopté en novembre 2013 une proposition de directive visant à harmoniser les règles applicables à la protection civile des secrets des affaires (104). Cette proposition, actuellement en discussion au Parlement européen, a fait l’objet d’intenses discussions intergouvernementales afin de parvenir à une solution de compromis.
À rebours de ces exemples, en France, la notion de « secret des affaires » n’a pas de définition générique offrant une protection générale. À ce titre, depuis 2003, des travaux ont été menés afin d’instaurer un régime juridique de protection des données économiques stratégiques. Ainsi, notre ancien collègue Bernard Carayon avait-il eu l’occasion de plaider pour la création d’un « secret des affaires à caractère civil et/ou pénal » (105). Par la suite, dans un rapport d’information publié en 2004 (106), il réitérait cette préconisation – restreinte au champ pénal – avant de déposer en 2011 une proposition de loi de visant à sanctionner la violation du secret des affaires (107). Cette proposition de loi a d’ailleurs été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en janvier 2012.
Mais le dispositif envisagé par notre ancien collègue s’inspirait trop largement du secret de la défense nationale et induisait par conséquent des lourdeurs et des rigidités qui n’auraient pas manqué de le disqualifier aux yeux des acteurs du monde économique et auraient défavorisé (notamment lors d’un contentieux) les PME-PMI ou ETI incapables de consacrer les moyens humains, financiers et techniques nécessaires pour assurer une classification telle que prévue. Enfin, le texte soulevait de réelles difficultés en matière de liberté syndicale, de liberté de la presse ou concernant les lanceurs d’alerte dont le rôle au service de notre démocratie n’est plus à démontrer, notamment dans la sphère économique (scandale du Médiator…).
Tenant compte de ces réserves, une nouvelle réflexion a vu le jour après le changement de législature. Ce travail a abouti à la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas déposée à l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014 relative à la protection du secret des affaires (108), introduisant une protection civile et pénale en la matière.
À l’initiative du rapporteur thématique, la commission spéciale a adopté six amendements portant articles additionnels relatifs à la protection du secret des affaires et reprenant largement cette dernière proposition de loi.
(Titre V du code de commerce)
Création de la notion juridique de secret des affaires
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article a pour objet d’insérer au sein du code de commerce un titre V intitulé « Du secret des affaires ». Il s’agit de placer dans le code du commerce une définition générale de la notion de secret des affaires afin d’assurer sa protection effective dans le domaine civil et pénal.
À cet effet, le titre V du code de commerce, tel que prévu par l’article additionnel adopté par la commission spéciale, s’articule autour de deux chapitres, intitulés « De la définition et des mesures civiles de protection du secret des affaires » et « Des mesures pénales de protection du secret des affaires ».
Dans le détail, l’objet du chapitre premier est de définir la notion de secret des affaires et d’introduire un ensemble de mesures de protection en matière civile.
I. ÉTAT DU DROIT
En l’état actuel, la notion de secret des affaires n’est expressément définie dans aucune branche du droit, même si l’expression est citée dans différentes dispositions.
A. UNE ABSENCE DE DÉFINITION UNIFORME DU SECRET DES AFFAIRES
En France, la notion de « secret des affaires » n’a pas d’existence juridique stabilisée et de définition uniforme : elle est en premier lieu citée dans de nombreux textes tels que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le code de commerce (109), le code de la consommation (110), le code des postes et télécommunications électroniques (111) ou encore le code monétaire et financier (112).On pourrait au surplus citer la notion de secret industriel et commercial évoquée dans la loi du 17 juillet 1978 instituant la commission d'accès aux documents administratifs (113).
L’expression est aussi régulièrement évoquée dans la jurisprudence du Tribunal de première instance de l’Union européenne ou de la Cour de cassation, mais également du Conseil d’État (114) . Cependant, ces références multiples à une notion non définie s’inscrivent dans une approche fractionnée, impropre à garantir une protection efficace du secret des affaires.
B. UNE PROTECTION INSUFFISANTE DU SECRET DES AFFAIRES EN MATIÈRE PÉNALE
En raison de l’absence de définition et de régime juridique propre au secret des affaires, cette notion est insuffisamment protégée en droit français.
Les infractions pénales mobilisées de lege lata apparaissent inadaptées pour protéger efficacement les informations économiques sensibles des entreprises. Ainsi, le vol, réprimé par l’article 311-1 du code pénal, est applicable au vol de documents confidentiels et non d’informations confidentielles, en l’absence de soustraction du support matériel de ces informations. Le recel, en application du premier alinéa de l’article 321-1 du code pénal, permet de sanctionner la détention illicite d’informations confidentielles d’une entreprise, mais uniquement si cette détention s’accompagne de leur support matériel. Et si le délit d’abus de confiance, défini à l’article 314-1 du code pénal, peut porter sur des éléments incorporels, tels que des informations sans support matériel (115), cette incrimination suppose néanmoins la remise préalable de l’élément d’information avant son détournement. Cela s’inscrit donc souvent dans le cadre d’une relation contractuelle qui ne saurait recouvrir l’ensemble des violations du secret des affaires.
Ces infractions apparaissent insuffisamment adaptées pour protéger efficacement le secret des affaires.
C. L’EFFICACITÉ LIMITÉE DES ACTIONS CIVILES EN RÉPARATION
À l’heure actuelle, les victimes d’une violation du secret des affaires peuvent intenter des actions en réparation sur le fondement traditionnel de la responsabilité civile, prévue aux articles 1382 et 1383 du code civil. À ce titre, les entreprises peuvent également intenter une action en concurrence déloyale, par exemple contre un ancien salarié qui utiliserait un savoir-faire au profit d’un employeur concurrent.
Néanmoins, l’objet de telles procédures est de fait limité dans la mesure où la réparation intervient a posteriori, une fois le préjudice constaté. En outre, l’indemnisation du préjudice ne couvre pas l’enrichissement de la partie qui a profité de la violation du secret des affaires. En définitive, les actions en réparation au plan civil sont également inadaptées pour dissuader les violations du secret des affaires.
II. LA RÉFORME PROPOSÉE
Cet article additionnel, adopté par la commission spéciale, a pour objet de pallier cette absence de définition de la notion de « secret des affaires ».
Comme évoqué, le chapitre premier du titre V introduit par le présent article prévoit la définition juridique du secret des affaires et les mesures civiles de protection.
Le présent article crée un article L. 151-1 au sein du code de commerce, qui définit le secret des affaires, comme une information :
« 1° Qui ne présente pas un caractère public en ce qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de ce genre d’information ;
2° Qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique ;
3° Qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public. »
Ces trois critères cumulatifs sont de nature à circonscrire précisément la notion de secret des affaires, incitant ainsi les entreprises à prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger leurs informations économiques essentielles.
Cette définition reprend les critères prévus par l’article 39, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) (116). Elle est également conforme à la définition visée à l’article 2 de la proposition de directive européenne du 28 novembre 2013 relative aux secrets d’affaires (117).
Le présent article crée également un article L. 151-2 du code de commerce aux termes duquel une information protégée au titre du secret des affaires ne peut ni être obtenue, ni utilisée, ni communiquée, sans le consentement de son détenteur ou en violation des mesures de protection prises. Toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, cet article prévoit que la responsabilité civile de son auteur peut être écartée en cas de « sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information, ou la révélation d’un acte illégal ». De fait, les journalistes et lanceurs d’alerte ne pourront pas être poursuivis dans le cadre de leurs activités. L’expression « sauvegarde d’un intérêt supérieur » ouvre en effet un large champ afin de s’assurer que le texte ne portera pas atteinte aux activités précitées.
Le titre V relatif au secret des affaires, créé dans le code de commerce, offre aux juges compétents un large éventail de mesures pour prévenir ou faire cesser les atteintes au secret des affaires. A ce titre, l’article L. 151-3 du code de commerce, créé par le présent article, prévoit un ensemble de mesures conservatoires pouvant être ordonnées par le tribunal. Il institue en premier lieu une procédure de référé suspension « de nature à prévenir ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires ». Le tribunal peut également ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte, en cas de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages intérêts. Ce nouvel article L. 151-3 du code de commerce a donc pour objet de garantir l’efficacité des procédures de protection civile du secret des affaires.
L’article L. 151-4 du code de commerce, adopté par la commission spéciale, permet au tribunal de prononcer des mesures d’injonction, éventuellement sous astreinte, afin d’empêcher ou de faire cesser l’atteinte au secret des affaires. Le tribunal peut ordonner la saisie de tout support contenant l’information concernée, ou que les produits de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés ou écartés définitivement des circuits commerciaux. Ces dispositions sont de nature à garantir l’exécution de la chose jugée et à assurer une protection efficace du secret des affaires.
Le nouvel article L. 151-5 du code de commerce est relatif aux mesures de réparation pouvant être prononcées par le tribunal au bénéfice de la victime de l’atteinte. Tout d’abord, le tribunal peut classiquement accorder des dommages et intérêts à la victime. Cet article innove ensuite eu égard à l’approche traditionnelle en matière de réparation civile, selon laquelle le principe de réparation intégrale autorise l’indemnisation de la victime à hauteur de son préjudice. Le troisième alinéa du I du nouvel article prévoit que l’indemnisation peut également prendre en considération les économies ou bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Cette disposition permet de lutter contre des stratégies judiciaires hostiles qui calculent les risques encourus au regard des bénéfices retirés par une violation délibérée du secret des affaires.
Un nouvel article L. 151-6 du code de commerce dispose que les articles précédents s’appliquent aux situations où « l’obtention, l’utilisation ou la révélation du secret des affaires a eu lieu ou risque de se produire en France ». Il s’agit d’une disposition expresse de compétence territoriale facilitant, en France, la protection du secret des affaires.
Enfin, l’article L. 151-7 du code de commerce définit une modalité spécifique de communication des pièces lors de l’instance, en cas de risque d’atteinte au secret des affaires. La production de ladite pièce peut être refusée par le tribunal compétent ou autoriser dans une version non confidentielle. De même, cette pièce peut être mise à disposition des parties pour consultation sur place et sans reproduction à défaut de leur être communiquée. Ces dispositions sont prévues conformément aux exigences d’un procès équitable et permettent d’éviter que les contentieux soient détournés afin de révéler indûment des secrets d’affaires nécessaires à la défense.
Le présent article additionnel, adopté par la commission spéciale, crée l’article L. 151-8 du code de commerce instituant un délit de violation du secret des affaires. La commission de ce délit résulte du fait de « prendre connaissance ou de révéler sans autorisation, ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce ». Cette infraction est précise et circonscrite et renvoie à la définition du secret des affaires retenue au sein du même chapitre du code de commerce. Ce renvoi a la vertu de la simplicité et de faciliter l’articulation entre les volets civil et pénal de la protection du secret des affaires.
L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Cette peine peut être portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, en cas d’infraction de nature à porter atteinte « à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France ».
Ce nouvel article du code de commerce prévoit également un ensemble de peines complémentaires :
– l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
– l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, une fonction publique, ou d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
– la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables au titre de cette infraction, selon les règles de droit commun.
L’article L. 151-9 du code de commerce prévoit trois faits justificatifs dans lesquels le secret des affaires est inopposable :
« 1° Dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ;
2° À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance ;
3° Sous réserve des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, aux autorités juridictionnelles ou administratives compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction. »
Ces dispositions ont pour objet d’encadrer le champ d’application du secret des affaires, celui-ci ne saurait par exemple faire obstacle aux instances représentatives du personnel dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents de l’entreprise prévu par les lois et règlements. A nouveau, les journalistes et lanceurs d’alerte bénéficient également d’une protection afin que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à la révélation d’infractions commises.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1810 rectifié.
*
* *
(article L. 821-5-3 du code de commerce)
Encadrement des modalités de communication d’informations ou de documents du Haut Conseil du commissariat aux comptes aux autorités étrangères
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article additionnel vise à encadrer la communication d’informations ou de documents du Haut Conseil du commissariat aux comptes aux autorités étrangères. Cet article modifie l’article L. 821-5-3 du code de commerce qui dispense le haut conseil de l’application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 (118), dite loi de blocage. En vertu des articles L. 821-5-1 et L. 821-5-2 du code de commerce, le haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille aux autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces dispositions représentent une exception à l’application de la loi de blocage de 1968, dont l’objet est de restreindre la transmission d’informations économiques d’entreprises à des autorités étrangères.
L’article additionnel introduit un tempérament à cette exception, en prévoyant la transmission de ces informations, « sous réserve du droit de l’Union européenne, des traités ou accords internationaux ». Cette modification de l’article L. 821-5-3 du code de commerce est de nature à permettre aux entreprises d’invoquer l’article 47 de la directive 2006/43/CE (119) ou la convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (120), afin de faire échec à des demandes abusives de transmission d’informations économiques.
Cette modification législative s’inspire du constat dressé par le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014 (121), selon lequel l’espionnage économique emprunte également les voies légales.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1812 rectifié.
*
* *
Article 64 quinquies [nouveau]
(article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972)
Nouvelle exception à la publicité des débats en matière de procédure civile
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article vise à créer une nouvelle exception à la publicité des débats lors d’une procédure civile. L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 pose le principe de la publicité des débats en matière civile. Toutefois, les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil dans des cas limitativement énoncés au deuxième alinéa dudit article.
L’article adopté par la commission modifie l’article 11-1 de la loi n° 72-626 afin de prévoir un nouveau cas en vertu duquel le juge compétent pourrait décider la tenue des débats en chambre du conseil. Cela concerne les situations où il résulterait de la publicité des débats une « atteinte au secret des affaires ».
Cet article vise à assurer la protection du secret des affaires au cours des phases contentieuses en matière civile, trop souvent détournées à des fins de prédation économique.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1811 rectifié.
*
* *
(article 400 du code de procédure pénale)
Nouvelle exception à la publicité des audiences en matière correctionnelle
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article modifie l’article 400 du code de procédure pénale, afin d’introduire un nouveau motif de huis clos des audiences en matière correctionnelle. Le premier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale pose le principe de la publicité des audiences en matière correctionnelle. Le deuxième alinéa de cet article énumère limitativement des dérogations à ce principe, en vertu desquelles l’audience pénale peut se tenir hors la présence du public.
L’article additionnel adopté par la commission spéciale prévoit que le tribunal peut ordonner le huis clos des débats en constatant que la publicité des débats est dangereuse pour « le secret des affaires d’une personne physique ou morale tel que défini par l’article L. 151-1 du code de commerce ».
Il s’agit de protéger le secret des affaires lors des procédures contentieuses en matière pénale, afin de garantir qu’elles ne seront pas détournées dans un but de dévoilement d’informations économiques stratégiques.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1814 rectifié.
*
* *
(article 35 de la loi du 29 juillet 1881)
Extension de l’exceptio veritatis en faveur des journalistes
au secret des affaires
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article vise à étendre l’exceptio veritatis dont bénéficient les journalistes poursuivis pour diffamation au secret des affaires. Cet article modifie le dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En conséquence, toute personne poursuivie pour diffamation peut produire, pour prouver sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires, des pièces couvertes par le secret des affaires, sans courir le risque d’être condamnée pour recel.
Cet ajout constitue une extension au secret des affaires de la solution retenue pour le secret de l’enquête ou de l’instruction et le secret professionnel par la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.
Cette loi constituait la consécration et le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (122), selon laquelle « le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces d’une information en cours de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ».
Elle résultait également d’une jurisprudence conforme constante de la Cour européenne des droits de l’homme (123), selon laquelle « il convient d'apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l'instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d'une telle importance, exerçant ainsi leur mission de “chiens de garde” de la démocratie" ».
Il s’agit, en pratique, d’encadrer le champ d’application du secret des affaires afin de préserver les droits de la défense des journalistes. Cela sécurise également la capacité des journalistes à révéler des infractions commises par des entreprises.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1813 rectifié.
*
* *
(loi n° 68-678 du 26 juillet 1968)
Modifications de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage »
Introduit à l’initiative du rapporteur général, cet article procède à différents aménagements de la loi n° 68-538 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite « loi de blocage ».
La loi de blocage de 1968 avait pour objectif initial de faire échec aux procédures de discovery américaines et de protéger les ressortissants français contre le contournement des mécanismes de coopération judiciaire prévus par la Convention de La Haye du 18 mars 1970, notamment la commission rogatoire internationale.
L’article premier de la loi de blocage interdit, sous peine de sanctions, la communication à des autorités publiques étrangères de documents ou de renseignements « d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ».
En droit américain, la procédure dite de discovery ou de pre-trial discovery, consiste en une phase d’investigation et d’instruction préalable au procès civil et commercial, au cours de laquelle chaque partie peut exiger de l’autre qu’elle divulgue tous les éléments de preuve pertinents au litige. Dans un contexte de concurrence internationale et d’espionnage économique, cette procédure fréquente au sein des pays de Common Law est contestée dans la mesure où elle permettrait de déclencher des procédures contentieuses dans le seul objectif d’obtenir des informations économiques stratégiques d’entreprises concurrentes.
Les États de tradition romano-germanique ont réagi en adoptant le 18 mars 1970 la convention de La Haye, dont l’article 23 dispose que « tout État contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de Common Law sous le nom de ‘pre-trial discovery of documents’ ».
La loi de blocage française de 1968, modifiée et élargie en 1980 (124), poursuit donc cette même logique. Néanmoins, les juridictions étrangères, notamment américaines, ont pu considérer que la portée de cette loi a été relativement limitée dans la mesure où une seule condamnation a été prononcée sur son fondement (125). Le caractère ineffectif de la loi française de blocage constitue donc un argument en faveur des autorités étrangères pour réclamer la communication des documents et renseignements économiques. La loi de blocage est dès lors considérée comme inopposable, par exemple par une décision du 31 mars 1993 de la High Court de Londres. Mais la question est sujette à controverse dans la mesure où la cour du Delaware (respectée en matière économique) a récemment reconnu l’effectivité de cette loi (126). Il convenait donc de réassurer son applicabilité.
L’objet de l’article additionnel, adopté par la commission, est par conséquent de moderniser la loi de blocage de 1968 afin de renforcer son effectivité et de faciliter son application.
Ainsi, cet article modifie-t-il l’article premier de ladite loi en précisant qu’elle s’applique tant aux personnes physiques que morales. Cet article réduit au nombre de deux les motifs pour lesquels une personne doit s’opposer à une demande directe de transferts d’informations, selon qu’elle porterait atteinte « à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la nation », objectif à valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel.
Cet article supprime ensuite à l’article 1 bis de ladite loi l’incrimination des personnes qui demandent ou recherchent à se faire communiquer des informations. Seule la communication de telles informations sera dorénavant interdite. Il s’agit d’une correction utile dans la mesure où les autorités étrangères sont fondées dans le cadre de leur droit national à demander la transmission de ces pièces. Cette modification apparaît également pertinente, afin de recentrer l’application de la loi de blocage sur les personnes qui communiquent des informations ou des renseignements.
L’alinéa 5 du présent article additionnel prévoit désormais que toute personne faisant l’objet de telles demandes d’information devra informer non plus le ministre compétent, souvent dans les faits le ministre des Affaires étrangères, mais le Premier ministre ou son délégué. Ce changement de destinataire, qui devrait vraisemblablement impliquer la Délégation interministérielle à l’intelligence économique, permettra une véritable spécialisation des services en la matière. Cette compétence d’un service unique facilitera le traitement et le suivi des dossiers transmis par les entreprises concernées. Les services compétents du ministère des Affaires étrangères indiquent recevoir en moyenne une dizaine de signalements par an.
Enfin, cet article renforce le quantum des peines encourues par les entreprises qui violeraient cette loi. Toute infraction sera désormais punie de trois ans d’emprisonnement au lieu de 6 mois et de 375 000 euros d’amende contre 18 000 euros actuellement. Il s’agit à la fois d’alourdir les peines encourues afin de d’accroître la crédibilité de la loi et d’harmoniser les sanctions avec celles retenues au titre de la violation du secret des affaires.
*
* *
La commission adopte l’amendement SPE1815 rectifié.
*
* *
L’amendement SPE289 de M. Christophe Caresche est retiré.
*
* *
Chapitre V
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Ce chapitre comporte trois séries de mesures destinées à assurer la continuité de la vie des entreprises :
– les articles 65 à 68 prévoient la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour traiter des procédures collectives les plus importantes ;
– l’article 69 habilite le Gouvernement à prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans les procédures les plus lourdes et les plus complexes et lui permet d’autoriser le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ;
– l’article 70 ouvre la faculté au tribunal d’imposer une modification de capital ou une cession forcée à l’égard des associés d’une société en redressement judiciaire, dans ces conditions strictement encadrées.
L’objectif de ces trois mesures est de renforcer l’efficacité du traitement des difficultés des entreprises. En 2013, 55 524 jugements d’ouverture d’une procédure collective ont été prononcés, dont 1 353 procédures de sauvegarde, 15 351 redressements judiciaires, 19 162 liquidations judiciaires « classiques », 16 830 liquidations judiciaires « simplifiées » (127) et 2 828 résolutions de plans. La tendance est à la hausse (+ 2,1 % au premier trimestre 2014 par rapport au premier trimestre 2013).
Section 1
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
Les articles 65 à 68 de la présente section organisent la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour connaître des procédures collectives les plus importantes. Cette spécialisation vise à renforcer l’efficacité du traitement des dossiers les plus techniques et présentant des enjeux économiques et sociaux majeurs. Elle s’inscrit dans le cadre de la rénovation de la justice commerciale prévue par le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté en novembre 2012 (128).
Cette réforme vient compléter celle du droit des entreprises en difficulté opérée par les ordonnances du 12 mars 2014 (129) et du 26 septembre 2014 (130).
Article 65
Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII
du code de commerce
Cet article a pour objet de créer une section 1, intitulée « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce », au sein du chapitre Ier du titre II (« Du tribunal de commerce ») du livre septième (« Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce ») du code de commerce. Cette nouvelle section est constituée des articles L. 721-1 à L. 721-7 actuels dudit code.
Cette création est nécessaire pour distinguer les dispositions actuelles relatives à l’institution et à la compétence de droit commun des tribunaux de commerce (articles L. 721-1 à L. 721-7) des dispositions nouvelles relatives à l’institution et à la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (article L. 721-8), que l’article 66 du présent projet de loi insère au sein d’une section 2 du même chapitre Ier du titre II du livre septième du code de commerce.
*
* *
Les amendements identiques SPE258 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE426 de M. Patrick Hetzel, visant à supprimer l’article 65, sont retirés.
La Commission adopte l’article 65 sans modification.
*
* *
Article 66
(art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce)
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
Cet article a pour objet d’organiser la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour des procédures incluant notamment les procédures collectives relevant du livre sixième du code de commerce lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée dépasse certains seuils ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel.
La réforme proposée (II) s’appuie sur les réflexions et travaux menés depuis plusieurs années au sujet de la justice commerciale, qui ont préconisé la spécialisation de certains tribunaux de commerce en matière de procédures collectives (I).
I. ÉTAT DES LIEUX
Il convient de rappeler la composition et la compétence actuelles des tribunaux de commerce ainsi que leurs spécialisations existantes (A) avant d’évoquer les nombreux travaux ayant conclu à l’opportunité d’une spécialisation accrue de certains tribunaux de commerce en matière de procédures collectives (B).
A. COMPOSITION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1. Des juridictions consulaires à l’activité inégale
Les tribunaux de commerce sont les héritiers des « foires médiévales » et des juridictions consulaires créées par l’édit royal de Charles IX en novembre 1563, à l’initiative du chancelier Michel de l’Hospital, et par l’ordonnance sur le commerce de 1673 (dit « Code Savary »), à l’initiative de Colbert.
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges non professionnels choisis parmi des commerçants et des chefs d’entreprises et élus par eux, appelés « juges consulaires », et d’un greffier par tribunal, qui est un officier public et ministériel nommé par le garde des Sceaux.
Cette organisation n’est cependant pas uniforme sur l’ensemble du territoire français : dans les départements d’Alsace et de Moselle, une organisation échevinée, mêlant des juges professionnels et non professionnels, a été retenue. L’échevinage a également été choisi dans les départements d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La France comptait 227 tribunaux de commerce en 1998. Ils sont 134 aujourd’hui, à la suite d’une réforme de la carte judiciaire opérée par plusieurs décrets successifs pris depuis 1999 (131).
En 2013, ces tribunaux ont enregistré 76 976 affaires nouvelles et ont traité 76 663 affaires, achevant le traitement des affaires en 5,2 mois en moyenne. Ils comptent 3 200 juges consulaires et 2 000 salariés dans les 136 greffes associés.
L’activité des tribunaux de commerce est inégale d’une juridiction à l’autre. En matière de procédures collectives en particulier, l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (132) relève une forte concentration des ouvertures des trois procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) devant un petit nombre de tribunaux de commerce. Un quart des procédures sont ainsi enregistrées par seulement neuf tribunaux : Paris, suivi de Bobigny, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nanterre, Tourcoing, Toulouse et Créteil. Huit tribunaux ouvrent plus de 1 000 procédures par an, 18 entre 500 et 1 000 et 121 moins de 500.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître notamment :
– des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
– de celles relatives aux sociétés commerciales ;
– de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
– des procédures relevant du livre sixième du code de commerce, c’est-à-dire des difficultés des entreprises ;
– des litiges relatifs aux lettres de change.
Le tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre sixième du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou dans lequel le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. À défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce prévoient une procédure de délocalisation ou de « dépaysement » d’une affaire lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l’une des procédures prévues par le livre sixième de la partie législative du code de commerce devant une autre juridiction.
Ce renvoi peut être décidé d’office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel ou, s’il estime que l’affaire relève d’une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu’il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation. Cette procédure a été récemment réformée par le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui a notamment étendu la liste des personnes pouvant demander ce renvoi, en y ajoutant le débiteur et le créancier poursuivant au ministère public.
Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal de commerce, c’est le tribunal de grande instance qui connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce. Les tribunaux de grande instance restent les juridictions de droit commun en matière commerciale.
2. Les spécialisations existantes
Il existe déjà une spécialisation de certains tribunaux de commerce s’agissant des procédures relevant du livre sixième du code de commerce.
En effet, l’article 7, alinéa 2, de la loi n° 85-95 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a prévu une spécialisation d’un ou de plusieurs tribunaux de commerce par département pour les procédures de redressement judiciaire applicables aux entreprises employant plus de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires était supérieur à 20 millions de francs.
Cette disposition, codifiée le 1er janvier 2006 à l’article L. 621-5 du code de commerce puis étendue à l’ensemble des procédures relevant du livre sixième, figure aujourd’hui à l’article L. 610-1 du code de commerce, aux termes duquel « un décret en Conseil d’État détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues ».
La liste de ces tribunaux, initialement fixée à 96 tribunaux de commerce (plus 7 tribunaux de grande instance à compétence commerciale et 6 tribunaux de grande instance à chambre commerciale) par le décret du 27 décembre 1985 puis progressivement relevée jusqu’à atteindre 182 tribunaux par le décret du 30 juillet 1999, figure aujourd’hui à l’annexe 6-1 du code de commerce. Elle inclut 94 tribunaux de commerce (auxquels s’ajoutent 7 tribunaux de grande instance pour l’Alsace et la Moselle), ce qui marque un retour à l’esprit initial de la loi de 1985 sur ce point, avec la spécialisation d’un tribunal par département.
Sept tribunaux de commerce et un tribunal mixte de commerce spécialisés sont par ailleurs compétents pour connaître, depuis 2005 (133), des pratiques anticoncurrentielles et, depuis 2009 (134), des pratiques restrictives de concurrence entre commerçants et artisans. Il s’agit des tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence est la cour d’appel de Paris, en application de l’article D. 442-3 du code de commerce.
B. LES PROPOSITIONS DE SPÉCIALISATION DE TRIBUNAUX DE COMMERCE
Le fonctionnement de la justice commerciale a fait l’objet de nombreuses réflexions au cours des dernières années, dans le prolongement du rapport de MM. François Colcombet et Arnaud Montebourg au nom de la commission d’enquête sur l’activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce de 1998 (135). Ce rapport avait notamment recommandé une refonte de la carte judiciaire, d’étendre à l’ensemble des juridictions commerciales du territoire l’organisation échevinée qui existe en Alsace-Moselle et de spécialiser une juridiction commerciale par département dans le contentieux des procédures collectives.
Un projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce fut déposé en juillet 2000 afin de mettre en œuvre certaines de ces propositions. Il prévoyait notamment d’instituer la mixité des juridictions, en confiant la présidence des chambres chargées des procédures collectives à un magistrat professionnel, et à établir des règles déontologiques nouvelles à l’égard des juges consulaires. Ce projet de loi, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mars 2001, mais rejeté par le Sénat le 14 février 2002, n’a pas abouti.
Plus récemment, la justice commerciale a fait l’objet de travaux et de propositions de réformes de la part de la mission d’information de la commission des Lois sur le rôle de la justice en matière commerciale, de la Cour des comptes et des groupes de travail mis en place par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la réforme de la justice commerciale. Seules les recommandations relatives à la spécialisation des tribunaux de commerce seront présentées ici.
1. Les recommandations de la Cour des comptes
Dans un référé adressé à la garde des Sceaux, ministre de la justice, le 13 mai 2013, la Cour des comptes relève qu’en dépit de la réduction du nombre de tribunaux de commerce intervenue depuis 1998, plus de la moitié des tribunaux n’atteignent pas les 400 nouvelles procédures contentieuses par an (seuil minimum retenu à l’occasion de la réforme de la carte judiciaire). Selon elle, certains tribunaux ont une activité très réduite, alors qu’ils sont implantés à proximité d’un tribunal plus important. Dans 60 des tribunaux de commerce, chaque juge traite moins de 15 affaires contentieuses par an.
La Cour estime par conséquent que de nouveaux regroupements de tribunaux sont souhaitables, du point de vue de l’ordre public économique et de l’efficacité de la justice commerciale. Elle recommande en ce sens un approfondissement de la réforme de la carte des tribunaux de commerce concentré sur les zones dotées de plusieurs tribunaux et dont un au moins n’atteint pas la taille critique.
Par ailleurs, selon la Cour, afin d’apporter toutes les garanties d’une spécialisation adéquate dans les affaires les plus complexes, des pôles régionaux spécialisés pourraient être créés, sur le modèle de ce qui existe déjà dans le domaine de la concurrence, concernant, par exemple, le droit bancaire, le droit des sociétés ou le droit des marques. Cette spécialisation géographique pourrait se faire sur la base, soit des juridictions interrégionales spécialisées, soit des juridictions dotées d’un pôle financier, soit d’un tribunal de commerce par ressort de cour d’appel. Enfin, sans remettre en cause la possibilité d’un dépaysement des dossiers à fort enjeu, la création de chambres mixtes, communes aux tribunaux d’un même département ou d’un même ressort de cour d’appel, permettrait de renforcer la professionnalisation des juges et d’harmoniser les approches retenues sur des dossiers comparables.
2. Les propositions de la mission d’information de la Commission
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a créé, en janvier 2013, une mission d’information sur le rôle de la justice commerciale, dont les conclusions ont été rendues par ses rapporteurs, Mme Cécile Untermaier et M. Marcel Bonnot, en avril 2013 (136).
La mission d’information est parvenue à un constat commun s’agissant de la nécessité de créer des pôles spécialisés en matière de procédures collectives. Selon ses deux rapporteurs, la technicité croissante du droit des procédures collectives conduit à ce que les « petits » tribunaux de commerce sont souvent mal armés, aussi bien quantitativement que qualitativement, en cas d’ouverture d’une procédure collective concernant des entreprises d’une taille importante, pour faire face aux enjeux financiers, sociaux et juridiques soulevés. La mission recommande donc de confier à des pôles spécialisés les procédures affectant des entreprises dont le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice dépassent des seuils qu’il reviendrait à un décret en Conseil d’État de définir. Le rapport évoque, s’agissant du seuil de salariés, celui retenu pour l’intervention du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), à savoir 400 salariés.
Le rapport s’appuie sur les spécialisations déjà mises en œuvre :
– en matière pénale, des juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) ont été créées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et implantées à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France ;
– en matière de propriété intellectuelle, les tribunaux de grande instance de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy, Nanterre et Fort-de-France ont été désignés par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique, aux dessins et modèles, aux marques et aux indications géographiques ;
– en matière de droit de la concurrence, huit tribunaux de commerce et huit tribunaux de grande instance ont également été spécialisés (voir supra).
Les deux rapporteurs divergent en revanche sur les options que pourrait prendre la création de tels pôles spécialisés. Pour notre collègue Marcel Bonnot, ces pôles devraient être composés de juges consulaires désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel seraient créés ces pôles. À l’inverse, selon notre collègue Mme Cécile Untermaier, ces pôles devraient être mixtes et composés, en première instance comme en appel, tant de magistrats professionnels que de juges consulaires. En première instance, les formations de jugement des pôles spécialisés seraient présidées par un juge consulaire et les juges professionnels y seraient minoritaires. En appel, les formations seraient présidées par un magistrat professionnel et les juges professionnels y seraient majoritaires.
3. Les réflexions du groupe de travail sur l’organisation des juridictions commerciales créé par la garde des Sceaux
La garde des Sceaux, ministre de la Justice, a mis en place, en mars 2013, plusieurs groupes de travail sur l’amélioration de la justice commerciale, composés de magistrats professionnels et de juges consulaires, d’avocats, de juristes d’entreprises, de commissaires aux comptes, d’administrateurs et de mandataires judiciaires, etc. Les réflexions de ces groupes de travail doivent nourrir la préparation d’une réforme de la justice commerciale, qui devrait être intégrée au projet de loi sur la « Justice du XXIe siècle ».
L’un de ces groupes de travail était consacré à l’organisation des juridictions en matière de procédures collectives. Aucun consensus ne s’est dégagé en son sein sur l’opportunité de la mise en place de juridictions spécialisées.
Une partie des membres du groupe a considéré que le renvoi vers des juridictions spécialisées était indispensable pour les affaires les plus complexes ou présentant les enjeux sociaux ou économiques les plus importants. Plusieurs d’entre eux ont estimé que cette réflexion devait aller de pair avec celle sur la carte des tribunaux de commerce.
Une autre partie du groupe a émis d’importantes réserves et a jugé inutile la création de juridictions spécialisées. Selon ces membres, les affaires les plus importantes sont déjà jugées par les plus grands tribunaux de commerce compte tenu de l’implantation des sièges sociaux des grandes entreprises. Le nombre d’affaires potentiellement concernées serait donc très faible. La procédure de renvoi prévue à l’article L. 662-2 du code de commerce permettrait déjà de délocaliser des affaires lorsque les intérêts en présence le justifient. Il conviendrait simplement de faciliter sa mise en œuvre, notamment en multipliant les acteurs susceptibles de saisir le premier président de la cour d’appel de la question du renvoi d’une affaire et en rendant cette saisine obligatoire dans certaines conditions (137).
Divers points de vue ont été exprimés s’agissant de la délimitation du domaine de compétence d’éventuelles juridictions spécialisées et de la définition des critères de renvoi, parmi les membres favorables à une spécialisation. Certains membres ont proposé que la spécialisation ne se limite pas aux procédures collectives et inclut également le contentieux général d’une certaine importance ou d’une certaine complexité. Il a été préconisé de se référer à des seuils liés au chiffre d’affaires de l’entreprise et au nombre de salariés pour la définition des critères de renvoi, ainsi qu’à la présence d’un groupe dont les filiales sont installées sur plusieurs ressorts juridictionnels.
En ce qui concerne la répartition territoriale et l’organisation d’éventuelles juridictions spécialisées, certains membres ont proposé de s’inspirer du modèle des juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) et d’autres de celui des huit juridictions spécialisées sur les questions économiques, en ajoutant une juridiction à Nanterre.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le I du présent article crée une section 2 au sein du chapitre Ier du titre II du livre septième du code de commerce intitulée « De l’institution et de la compétence des tribunaux spécialisé » et composée d’un unique article L. 721-8.
Cet article permet la création, par le pouvoir réglementaire, de tribunaux de commerce spécialisés. Son premier alinéa précise qu’un tribunal de commerce dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel – ce qui exclut la création de plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une seule cour d’appel et permet la création d’un tribunal spécialisé compétent pour le ressort de plusieurs cours d’appel, lesquelles sont au nombre de 36, dont 30 en métropole, parmi lesquelles 28 comptent des tribunaux de commerce dans leur ressort (138) (qui est donc le nombre plafond des tribunaux de commerce spécialisés susceptibles d’être créés) – pourra être doté d’une compétence exclusive pour connaître de trois catégories de procédures (v. infra).
La liste et le ressort de ces juridictions seront fixés par un décret. L’étude d’impact ne précise pas les intentions du Gouvernement sur ce point, qu’il s’agisse du nombre de tribunaux de commerce envisagés ou de leur répartition territoriale. Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a précisé que ce décret sera pris après avis du conseil national des tribunaux de commerce, dont la consultation, facultative en l’état du droit, est ainsi rendue obligatoire pour l’élaboration de ce décret (139).
L’objectif recherché est de centraliser les procédures collectives concernant les entreprises dépassant le cadre strictement local ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’apporter des réponses plus rapides et plus efficaces aux difficultés que peuvent rencontrer certaines entreprises, en particulier les plus importantes d’entre elles.
Il ne s’agit pas de créer de nouveaux tribunaux de commerce, mais de faire de certains d’entre eux, parmi les plus importants, des tribunaux de commerce spécialisés disposant d’une compétence exclusive pour connaître des procédures collectives les plus importantes, sans modifier leur composition ou leur fonctionnement. Une spécialisation « à deux degrés » sera ainsi mise en place en matière de procédures collectives : celle prévue par l’article L. 600-1 du code de commerce, qui réserve, d’une manière générale, les procédures collectives à certains tribunaux de commerce (voir supra), puis celle prévue à l’article L. 721-8, qui réserve les plus importantes de ces procédures à certains de ces tribunaux.
A. COMPÉTENCE MATÉRIELLE ET TERRITORIALE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SPÉCIALISÉS
Le nouvel article L. 721-8 prévoit que les tribunaux de commerce spécialisés seront compétents pour quatre catégories de procédures :
– les procédures collectives dépassant certains seuils ;
– les procédures concernant une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel ;
– les procédures transfrontalières, qui se subdivisent elles-mêmes en deux catégories de procédures, selon qu’elles relèvent du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers ou du règlement en cours d’adoption par les institutions de l’Union européenne qui le remplacera ou non.
1. Les procédures collectives dépassant certains seuils ou concernant une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel
a. Détermination des procédures collectives relevant de la compétence exclusive d’un tribunal de commerce spécialisé
i. Le dispositif proposé par le Gouvernement
La première phrase du 1° du nouvel article L. 721-8 du code de commerce prévoyait que les tribunaux spécialisés auraient une compétence exclusive pour connaître des procédures prévues par le livre sixième du code de commerce (c’est-à-dire les procédures de prévention des difficultés des entreprises prévues en son titre I (prévention-détection, mandat ad hoc et conciliation), la sauvegarde (titre II), le redressement judiciaire (titre III) et la liquidation judiciaire (titre IV)) :
– lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;
– ou lorsque l’entreprise concernée dispose d’établissements (140) dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel.
ii. Les modifications apportées par la Commission
Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a adopté un amendement réécrivant le 1° de cet article :
– sur la forme, le 1° a été scindé et ces deux catégories de procédures font désormais respectivement l’objet d’un 1° et d’un 1° bis. Par ailleurs, la dernière phrase du 1° relative à la détermination du tribunal de commerce spécialisé territorialement compétent (voir infra) a été déplacée après le 3° afin de s’appliquer à toutes les procédures ;
– sur le fond, les procédures concernant une entreprise disposant d’établissements situés dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel ne pourront relever de la compétence exclusive des tribunaux de commerce spécialisés que si leur nombre de salariés ou leur chiffre d’affaires dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Dans la rédaction initiale du projet de loi, le critère des seuils ne s’appliquait pas à cette catégorie de procédures. Cela aurait pu conduire à ce que des procédures concernant des entreprises de petite taille mais disposant d’établissements situés dans le ressort de plusieurs tribunaux de commerce relèvent de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, ce qui n’était pas l’objectif recherché par la réforme.
iii. Les seuils en nombre de salariés et de chiffres d’affaires
● Les seuils envisagés par le Gouvernement
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les seuils à compter desquels une procédure relèvera exclusivement de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi (141) indique que les seuils envisagés par le Gouvernement sont :
– un nombre de salariés au moins égal à 150 ;
– un chiffre d’affaires au moins égal à 20 millions d’euros.
Ces seuils sont alternatifs et non cumulatifs, comme l’indique l’emploi de la conjonction de coordination « ou ». Ils correspondent aux seuils à compter desquels la création des comités de créanciers est obligatoire en application des articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce (142).
● L’absence d’évaluation précise du nombre de procédures qui relèveraient de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés en application de ces seuils
L’étude d’impact ne permet pas d’évaluer avec précision combien de procédures relèveraient de la compétence des tribunaux spécialisés en application des seuils envisagés par le Gouvernement. Elle indique seulement que :
– le nombre d’entreprises au sens économique du terme, c’est-à-dire celui retenu par l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie (LME) (143) dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros s’élève à 13 199, dont 6 388 emploient 150 salariés ou plus ;
– le nombre d’entreprises, au sens juridique du terme, c’est-à-dire d’unités légales, dont le chiffre d’affaires dépasse les 20 millions d’euros s’élève à 19 689, dont 8 264 emploient 150 salariés ou plus.
S’agissant des seules procédures de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire, l’étude d’impact, se fondant sur une étude réalisée par l’entreprise Altares (144), précise qu’en 2013, 46 liquidations judiciaires et 139 redressements judiciaires, soit 185 procédures au total, ont concerné des entreprises de 100 salariés ou plus. Ces 185 procédures représentent 0,3 % de l’ensemble des liquidations et des redressements (61 468) intervenus cette même année. Il convient d’y ajouter 44 procédures de sauvegarde la même année (145), ce qui conduit à un total de 229 procédures en 2013, soit 0,36 % de l’ensemble des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires (63 101).
Ce chiffre n’est cependant qu’une approximation du nombre de procédures susceptibles de relever de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés :
– le seuil retenu est celui des procédures concernant des entreprises ayant 100 salariés ou plus, et non 150 ;
– il n’est pas tenu compte du critère alternatif du chiffre d’affaires.
L’étude d’impact ne comporte par ailleurs aucune statistique concernant les entreprises disposant d’établissements situés dans le ressort de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel mentionnées au 1° bis, ce qui ne permet donc pas d’évaluer le nombre de procédures susceptibles de relever de la compétence exclusive des tribunaux spécialisés à ce titre. Si ce critère était combiné à des seuils identiques à ceux qui seront fixés pour les procédures relevant du 1°, le nombre total de procédures concernées ne serait pas augmenté. Il en serait autrement si ces seuils étaient inférieurs.
● La position du rapporteur thématique
La question du choix des seuils à retenir a été abordée par la plupart des personnes entendues par le rapporteur thématique au cours de ses auditions, qui ont souligné son importance. S’agissant du seuil relatif à l’effectif de l’entreprise, certains d’entre eux ont proposé que le seuil d’intervention du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), qui a pour mission d’aider les entreprises de 400 salariés ou plus en difficulté, soit retenu.
Le Gouvernement estime que retenir ce critère conduirait à restreindre considérablement la compétence des tribunaux de commerce spécialisé, à quelques dizaines d’affaires par an (146). Le rapporteur thématique partage cet avis : la création de juridictions spécialisées n’aurait guère de sens si la compétence de celles-ci devait se limiter à quelques affaires par an.
Le rapporteur thématique considère que le seuil de chiffre d’affaires de 20 millions d’euros envisagé par le Gouvernement ne soulève pas de difficulté. S’agissant du seuil de salariés, il convient de souligner qu’au niveau européen, le seuil à compter duquel une entreprise n’est plus considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME) est de 250 salariés (147). C’est cette définition qui a également été retenue en droit français par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique (article 2).
Le rapporteur thématique estime que le Gouvernement devrait procéder à une évaluation précise du nombre de procédures qui relèveraient de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés si ce critère de 250 salariés – qui semble a priori pertinent – et celui du chiffre d’affaires de 20 millions d’euros étaient retenus.
b. Détermination du tribunal de commerce spécialisé compétent
i. Les dispositions du projet de loi
Les deuxième et troisième phrases du 1° précisaient les critères permettant de déterminer, si une procédure relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce spécialisés, le tribunal spécialisé compétent : il s’agira du tribunal dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé ou situé le siège de la personne morale débitrice est présumé être celui de ses intérêts principaux.
ii. La notion de centre des intérêts principaux
La notion de centre des intérêts principaux est déjà employée par le code de commerce (148) et est définie par le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers comme devant correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers (149). L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement précise que, pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption simple est reprise par la troisième phrase du 1° du présent article.
La jurisprudence a apporté de nombreuses précisions sur cette notion. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé notamment que :
– lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l’État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement (150) ;
– le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue par l’article 3 du règlement n° 1346/2000 ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre (151) ;
– dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci (152).
iii. Les modifications adoptées par la Commission
Sur le plan formel, les deuxième et troisième phrases du 1° ont été déplacées par la Commission et figurent désormais au sixième alinéa de l’article L. 721-8 du code de commerce. Les critères de détermination du tribunal de commerce spécialisé compétent s’appliquent ainsi à toutes les procédures relevant desdits tribunaux.
Sur le fond, la Commission, sur la proposition des rapporteurs, a ajouté un alinéa à l’article L. 721-8 (devenu son alinéa 7) précisant que lorsqu’une procédure est en cours à l’égard d’une entreprise relevant des 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’égard d’entreprises détenues ou contrôlées par ladite entreprise. Cet amendement permet de prendre en compte la situation des groupes de sociétés : dès lors qu’une procédure a été ouverte à l’égard d’une société mère, le tribunal saisi est également compétent pour les procédures concernant ses filiales. Les procédures collectives ouvertes à l’égard de plusieurs sociétés d’un même groupe situées en France sont ainsi centralisées au sein de la même juridiction.
2. Les procédures transfrontalières
a. Les dispositions du projet de loi
Les 2° et 3° de l’article L. 721-8 prévoyaient que les tribunaux de commerce spécialisés seraient exclusivement compétents pour connaître :
– des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers (2°) ;
– des procédures ne relevant pas du règlement précité pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre principal des intérêts du débiteur (3°).
Le règlement n° 1346/2000 s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic (article premier, paragraphe 1). Les procédures collectives concernées sont, en droit français, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
L’article 3 de ce règlement précise les critères permettant de déterminer les juridictions de l’État membre compétentes en cas de procédures d’insolvabilité transfrontières. Cet article est ainsi rédigé :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.
3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.
4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en application du paragraphe 1 que :
a) si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur
ou
b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement. »
Les procédures mentionnées au 3° sont les procédures transfrontières ne relevant pas du règlement n° 1346/2000, soit parce qu’elle ne concerne pas un autre État membre de l’Union européenne mais un pays tiers, soit parce qu’elle concerne une procédure ne relevant pas de ce règlement, comme le mandat ad hoc et la conciliation.
b. Les modifications adoptées par la Commission
Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, est en cours de refonte par les institutions de l’Union européenne (153). Le nouveau règlement, qui se substituera au précédent, a été approuvé par le Parlement européen en première lecture le 5 février 2014 et a fait l’objet d’un accord politique au Conseil « Justice et affaires intérieures » du 10 octobre 2014, mais n’est pas encore finalisé.
Dans ces conditions, la Commission a considéré qu’il n’était pas opportun d’inscrire dans la loi une référence à ce règlement, qui sera prochainement abrogé.
Sur la proposition des rapporteurs, il est donc fait référence « aux actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité » (par analogie avec la solution adoptée par l’article 88-2 de la Constitution, selon lequel « la loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne »), ce qui permet de viser à la fois le règlement n° 1346/2000 et le texte qui le remplacera.
Une référence aux deux règlements, celui de 2000 (qui continuera à s’appliquer aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur du nouveau) et le nouveau, pourra éventuellement être substituée à cette expression au cours de la procédure parlementaire si le nouveau règlement est publié avant l’adoption du présent projet de loi.
B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA COMPÉTENCE TEMPORELLE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SPÉCIALISÉS
Le II du présent article précise que l’article L. 721-8 du code de commerce entrera en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. Les tribunaux de commerce initialement saisis demeureront compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 introduites antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article (154) , par dérogation au principe de l’application immédiate des lois nouvelles relatives à l’organisation judiciaire.
Cette solution est identique à celle retenue par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, dont l’article 8 précise que la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE259 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE427 de M. Patrick Hetzel.
M. Jean-Frédéric Poisson. Les articles 66 et suivants visent à créer des tribunaux de commerce spécialisés. Nos collègues Cécile Untermaier et Marcel Bonnot ont rendu, il y a quelques mois, un rapport sur le sujet. J’en profite pour saluer amicalement notre collègue Marcel Bonnot qui, souffrant, ne peut hélas participer au débat de ce soir.
Parmi les dispositions que nous allons examiner, nombreuses sont celles qui touchent à des sujets très sensibles, comme l’adjonction d’un deuxième mandataire judiciaire, la spécialisation des tribunaux, c’est-à-dire la définition d’un seuil d’affaires avec des critères multiples en fonction desquels il conviendra de changer éventuellement de juridiction.
Depuis deux ans, la réforme de la justice commerciale voulue par le Gouvernement se heurte à de nombreuses difficultés. Nous regrettons qu’elle ne s’inspire que très peu des travaux de la mission d’information, pourtant salués par tous les membres de la commission des lois. Je continue en outre de déplorer que Mme la garde des Sceaux ne participe pas à nos travaux.
Pour toutes ces raisons, notre groupe souhaite la suppression de l’article 66.
M. Patrick Hetzel. J’ajouterai à l’argumentation de Jean-Frédéric Poisson que, si l’on compare les travaux de la mission d’information et les préconisations du Gouvernement concernant les tribunaux de commerce, le décalage apparaît assez important. C’est pourquoi, en effet, nous souhaitons la suppression de l’article 66.
M. le ministre. Le Gouvernement souhaite la spécialisation des tribunaux de commerce, ce qui n’est en aucun cas une réforme en profondeur. L’idée est de désigner plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans les affaires les plus importantes et les plus sensibles. Parmi les affaires les plus concrètes qu’ait à traiter le ministère de l’économie figurent les situations très complexes où un même groupe en grande difficulté économique peut se retrouver devant deux tribunaux de commerce différents – ce fut le cas avec les entreprises Villeneuve Pet Food ou Mory Ducros. Or le traitement peut ne pas être le même et les intérêts locaux diverger – alors qu’il est impossible de dépayser le jugement.
J’indique en outre, pour rassurer M. Poisson, que la réforme en profondeur, statutaire, des tribunaux de commerce sera proposée dans le cadre du projet de réforme judiciaire « La justice du XXIe siècle » soutenu par la garde des Sceaux. Il ne s’agit ici, je le répète, que de spécialiser des tribunaux de commerce compétents dans les affaires les plus importantes et les plus complexes. Nous ne créons pas de nouvelles juridictions ni un nouvel ordre juridictionnel. Les tribunaux spécialisés seront des tribunaux de commerce déjà existants, simplement spécialisés dans ces affaires particulières. Ces juridictions, en nombre restreint, seront interrégionales, inter-cours d’appel. Elles sont devenues une nécessité en matière de propriété intellectuelle, de droit financier et boursier et de droit pénal. Il s’agit de moderniser notre justice.
Les seuils envisagés pourraient être de 150 salariés ou de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui, en 2013, aurait concerné 139 redressements judiciaires, 44 sauvegardes et 46 liquidations. On est donc bien loin du volume total des affaires courantes, mais il s’agit d’affaires pour lesquelles une spécialisation, au niveau de la cour d’appel ou un peu au-delà, se justifie. Ces juridictions seront compétentes de plein droit pour les procédures de prévention et les procédures collectives. Le Gouvernement émettra un avis favorable à l’amendement du rapporteur thématique Alain Tourret prévoyant qu’il reviendra au tribunal de commerce du lieu du siège de l’entreprise de saisir immédiatement, via la cour d’appel, le tribunal de commerce spécialisé.
Le tribunal devra désigner deux administrateurs et mandataires judiciaires par procédure pour renforcer l’expertise et les moyens mis à disposition pour sauver les entreprises et les emplois. Cette double nomination, qui va dans le sens d’une plus grande spécialisation pour des affaires aux enjeux plus forts et à la complexité plus importante, n’induira aucun coût supplémentaire et la rémunération due sera divisée entre les professionnels.
La réforme que nous proposons n’est donc pas systémique, mais elle est nécessaire d’un point de vue économique, en particulier en ce qui concerne les restructurations.
Au cas où je ne vous aurais pas convaincu et où vous maintiendriez vos amendements, j’émettrai un avis défavorable.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. C’est d’une belle réforme que nous allons parler ce soir, mes chers collègues, et je souhaite vous convaincre de son utilité.
Nous pouvons nous accorder sur un point : lorsque quelque 55 000 entreprises déposent leur bilan chaque année, il faut considérer de manière spécifique leur situation en fonction de leur importance. En effet, déposer le bilan, cela ne signifie pas tout à fait la même chose pour un coiffeur qui n’emploie qu’un apprenti, et pour la SNCM, qui emploie 600 personnes, ou Moulinex, qui compte 15 000 salariés. Chacun comprendra dès lors que, du seul fait de l’importance de l’entreprise, une certaine spécialisation des tribunaux de commerce est nécessaire.
Cela s’impose en premier lieu parce que les tribunaux sont loin d’avoir tous la même taille : qu’on songe à la différence entre le tribunal de commerce de Paris, pourvu de 170 magistrats très spécialisés, et celui d’une petite ville dont les effectifs se limitent à quelques magistrats. L’absolue spécialisation du monde des affaires s’impose à nous et nous devons pouvoir y répondre. Il faut d’abord gérer l’entreprise qui dépose son bilan, puis trouver un nouveau repreneur : ces tâches difficiles nécessitent les compétences du monde juridique, du monde économique et du monde des affaires.
Le Gouvernement a donc pensé qu’il était nécessaire que certains tribunaux, parmi ceux qui existent, traitent désormais des entreprises remplissant deux conditions sur lesquelles je vais revenir. Après avoir hésité, les présidents des tribunaux de commerce ont été très largement rassurés par la manière dont ils ont été écoutés et par les assurances que nous leur avons données que, à aucun moment, un dossier ne leur serait retiré faute de compétences.
Combien d’affaires sont concernées ? On compte chaque année, je l’ai dit, près de 55 000 jugements d’ouverture de procédures collectives. Si l’on fixe le premier seuil à 150 ou à 250 salariés et le second à 20 millions de chiffre d’affaires, c’est moins de 0,5 % des dossiers qui sera transmis aux tribunaux de commerce spécialisés. Il faut bien sûr que les dossiers soient suffisamment nombreux : nous n’allons pas créer des tribunaux spécialisés pour trois ou quatre affaires. En outre, il faudra prendre en considération la nécessaire proximité géographique du tribunal et de l’entreprise, car chacun sait qu’un dépôt de bilan oblige à de nombreuses démarches et à de nombreuses rencontres. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il fallait un nombre suffisant de tribunaux spécialisés.
Les propositions qui vous sont faites sont parfaitement conformes aux attentes du monde des affaires. Quand un entrepreneur est amené à déposer le bilan, il veut avoir affaire à des magistrats qui ont l’habitude de traiter des dossiers similaires au sien. C’est pourquoi il faut trouver un juste équilibre entre le nombre de tribunaux de commerce spécialisés et les entreprises concernées. Le ministre a mentionné des seuils dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Nous pouvons néanmoins avoir, sur la question, un avis personnel, et le mien est un peu différent. Certains députés de l’opposition, à l’instar du Comité interministériel de restructuration industrielle – CIRI –, souhaiteraient que l’on fixe le premier seuil à 400 salariés, ce qui reviendrait à diminuer de façon beaucoup trop importante le nombre des entreprises concernées. Les magistrats du tribunal de commerce spécialisé risqueraient de ne jamais avoir eu à connaître de telles affaires et d’avoir à n’en traiter que très peu. Je considère pour ma part que le seuil de 250 salariés est équilibré : au niveau européen c’est le seuil à compter duquel une entreprise n’est plus considérée comme une PME et c’est celui qui m’a été proposé par de nombreux présidents de tribunaux de commerce. Quant au second seuil de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, il fait consensus – à condition que les deux règles soient alternatives et non cumulatives. Nous reprenons ainsi, globalement, les règles européennes.
Après avoir procédé à de nombreuses auditions et travaillé pendant plusieurs mois, la mission d’information de la commission des Lois sur la justice commerciale a recommandé cette spécialisation – c’est sa proposition n° 27. Contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé sommaire des amendements de suppression de l’article, aucune des modalités retenues dans le projet de loi n’est contraire à ces préconisations.
Je soutiendrai des amendements visant à faire en sorte que le tribunal de commerce initialement saisi puisse intervenir au début de la procédure. Cette proposition rejoint celle des présidents des tribunaux de commerce. Je souhaite également qu’on associe à tous les niveaux de décision le procureur général qui représente l’ordre public et la protection des créanciers – qu’il ne faut pas plus négliger que celle des salariés.
La vie de l’entreprise est au centre de mes préoccupations, et j’ai le sentiment que, en ayant recours à des tribunaux de commerce spécialisés, nous parviendrons à donner un nouvel espoir, une seconde chance, à celles qui sont amenées à déposer leur bilan. Tout doit être fait pour favoriser une reprise qui préserve autant que possible le sort des salariés.
Je demande donc le rejet des amendements de suppression.
M. Gilles Lurton. Les juges consulaires ont une expérience de l’entreprise et une expertise économique qui n’est plus à démontrer. Ils travaillent beaucoup, bien et bénévolement. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce font rarement l’objet d’appel – environ, de mémoire, 5 %. Les arrêts rendus par la cour d’appel infirment encore plus rarement les jugements rendus en première instance, ce qui confirme le sérieux et la pertinence du travail des juges consulaires.
Les tribunaux de commerce, pour certaines affaires, ne refusent pas la spécialisation que vous proposez. Mais toute la question est de savoir ce que sont les affaires les plus importantes et les plus sensibles. Encore une fois, comme il y a quelques jours à propos de l’article 12 concernant les notaires, nous nous heurtons à la définition de seuils. Le CIRI, présidé par le Premier ministre, ayant fixé le premier seuil à 400 salariés, je ne vois vraiment pas pourquoi on en fixerait un autre.
Enfin, je rappelle qu’une affaire aussi importante que celle du groupe Doux, en Bretagne, n’a posé aucune difficulté : le dossier a été parfaitement traité et n’a fait l’objet d’aucun appel, ce qui montre bien que les juges des tribunaux de commerce sont d’excellents connaisseurs du monde économique et sont tout à fait capables.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le rapporteur thématique, je comprends mal ce que vous entendez quand vous considérez qu’un coiffeur qui dépose le bilan et qui n’emploie qu’un apprenti, ce n’est pas la même chose que Moulinex avec ses milliers de salariés. On a beaucoup parlé de la fermeture de l’usine PSA d’Aulnay, qui a entraîné la suppression de 8 000 emplois. Or 8 000 emplois, cela représente 0,8 % des artisans qui licencient. À force de vouloir tout spécialiser, il va falloir aussi spécialiser le législateur : pendant qu’on ne s’occupe que de ceux qui remplissent les premières pages des journaux, on finit par maltraiter, dans la loi, les petits cas, ceux qu’on ne voit pas et qui ne dérangent pas. Or tous les jours des emplois sont détruits dans ces secteurs.
Dès lors que les tribunaux de commerce font très bien leur travail, qu’ils ont une solide expertise, je ne vois pas pourquoi des magistrats, demain, en auraient davantage, surtout s’ils n’ont jamais exercé d’activité professionnelle et ne comprennent pas le fonctionnement d’une entreprise. Cela pourrait s’avérer pathétique au moment de certains jugements. Refusons de céder à la pression médiatique. Tout le monde est ému par le licenciement de 8 000 salariés, mais c’est tous les jours que des artisans sont obligés de licencier. De plus nous n’avons pas assoupli le code du travail ! Nous sommes même, sur certains points, en train de le durcir, ce qui ne facilitera rien.
En tout cas, cela n’encouragera pas les employeurs à créer des emplois. On parle souvent des emplois détruits, mais jamais assez des emplois non créés qui, je vous l’assure, sont beaucoup plus nombreux.
En ce qui concerne le seuil, certains parlent de 400 salariés et le rapporteur thématique évoque le chiffre de 250. Je me souviens que, dans le cadre d’une discussion sur les groupements d’employeurs, on évoquait les entreprises de plus de 300 salariés. Tout le monde aujourd’hui, à commencer par le Premier ministre, tend à considérer qu’il faut supprimer les seuils – je le préconise pour ma part depuis douze ans : et voilà que le législateur s’apprête à en créer de nouveaux !
Mme Colette Capdevielle. Dans leur rapport, Cécile Untermaier et Marcel Bonnot ont formulé des propositions très intéressantes et pragmatiques pour réformer les tribunaux de commerce de manière efficace. Elles seront très probablement reprises dans le cadre du projet sur la justice du XXIe siècle, auquel est renvoyée la réforme générale des tribunaux de commerce. Parmi les préconisations de Cécile Untermaier et de Marcel Bonnot figurait bien la spécialisation des tribunaux de commerce pour les affaires les plus complexes d’un point de vue technique et juridique, par exemple celles qui touchent aux brevets ou aux marques.
Le taux d’appel des décisions des tribunaux de commerce est certes peu élevé, mais cela tient à la nature des affaires : ce sont, pour la plupart, des actions en paiement. Or, une fois que la décision est rendue, la plupart du temps assortie de l’exécution provisoire, l’appel est onéreux ou inutile, voire les deux. Les défendeurs ne font donc généralement pas appel, et on passe alors au stade de la liquidation. Ce qui fonctionne bien aujourd’hui, c’est la prévention. Les tribunaux de commerce en font de plus en plus. L’objectif, nous en convenons tous, est bien d’éviter le dépôt de bilan.
Pour justifier la création de tribunaux de commerce spécialisés pour les affaires complexes au-delà d’un certain seuil, l’étude d’impact indique : « Lorsque des entreprises moyennes ou grandes rencontrent des difficultés, les conséquences sur l’emploi ou sur le développement économique de certaines régions peuvent être dramatiques. » Cependant, dans certains cas, il convient d’être très prudent, car « spécialisés » signifie aussi « éloignés du territoire », notamment des salariés. Cela peut être très dangereux, les liquidations – qui ne représentent certes qu’un pourcentage limité des affaires – faisant avant tout des dégâts dans un territoire donné, chez les salariés et chez les sous-traitants.
Un tribunal de commerce rattaché à un territoire connaît bien, lui, le tissu économique et industriel de son ressort, parce qu’il est composé de juges consulaires qui sont eux-mêmes des chefs d’entreprise, retraités ou en fonction, généralement dévoués, qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie et se forment de plus en plus. Et ces magistrats consulaires ont montré qu’ils étaient tout à fait compétents en matière de liquidation des entreprises. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect, a fortiori si l’entreprise est de taille importante. Je comprends bien qu’il soit nécessaire de spécialiser et que la proximité n’a pas toujours que des effets positifs, mais je plaide pour que nous soyons très vigilants en ce qui concerne la fixation des seuils. La proximité, c’est aussi la connaissance de la réalité économique d’un bassin de vie, qui n’est souvent pas la même à 200 ou 300 kilomètres.
M. le président François Brottes. Il convient en effet de distinguer deux temps : la prévention et le règlement des affaires.
Mme Véronique Louwagie. Vous avez déclaré, monsieur le rapporteur thématique, que tout devait être fait pour aider les entreprises et que les tribunaux de commerce devaient être à leur écoute. Or, d’une manière générale, les juges agissent bien dans ce sens. Rappelons qu’ils sont élus par leurs pairs, qu’ils sont bénévoles et qu’ils consentent un gros effort de formation. En outre, ils sont au contact du terrain, en lien avec la vie quotidienne, la « vraie vie » de leur territoire. Je rejoins Colette Capdevielle sur l’importance de la proximité, en particulier lorsque des conventions de revitalisation sont mises en place, ce qui arrive dans certains cas de cessation de paiement qui s’accompagnent de licenciements collectifs. La connaissance du terrain et le lien des juges tant avec les élus qu’avec les différents intervenants jouent alors un rôle très important, d’autant que les discussions peuvent être difficiles, plusieurs options étant possibles dans le cadre des conventions de revitalisation.
Par ailleurs, nous sommes tous un peu mal à l’aise avec la question des seuils, ainsi qu’en témoignent les discussions qui ont été menées sur le sujet et le nombre d’amendements que nous avons déposés. Indépendamment de notre appartenance politique, nous avons des appréciations très différentes en la matière. Certains proposent même des seuils cumulatifs, qui n’ont pas du tout le même impact que des seuils alternatifs.
Ainsi que vous l’avez évoqué, monsieur le rapporteur thématique, en fixant des seuils très élevés, nous risquons de limiter le nombre d’entreprises relevant des tribunaux spécialisés, et ceux-ci n’auront alors qu’un faible nombre d’affaires à traiter. Néanmoins, quel que soit le seuil retenu in fine, il y aura toujours une première fois : la manière dont un tribunal spécialisé traitera sa première affaire ne sera pas identique à celle dont il traitera sa énième affaire.
Vous proposez le même seuil de chiffre d’affaires que le ministre – 20 millions d’euros –, mais un seuil d’effectif différent – 250 salariés au lieu de 150. Selon moi, le seuil d’éligibilité aux prestations du CIRI – 400 salariés – présente une vraie pertinence, car il délimite une catégorie d’entreprises qui méritent une attention et une écoute particulières en cas de difficultés. Il serait d’ailleurs intéressant de retrouver les débats de l’époque, afin de voir pour quelles raisons ce seuil avait été choisi. En tout cas, c’est le seuil que nous vous proposerons de retenir dans un amendement de repli.
M. Francis Vercamer. Les articles 65 et 66 modifient profondément le fonctionnement de la justice commerciale, dont l’efficacité est pourtant reconnue par tous. Seuls 13 % des jugements des tribunaux de commerce font l’objet d’un appel, et seuls 5 % sont infirmés. Cette efficacité tient à une expertise de la vie économique propre aux juges consulaires. Ainsi que l’a rappelé Véronique Louwagie, ils sont bénévoles et ont tous une expérience professionnelle. De plus, ils peuvent se faire aider par des représentants du parquet, qui peuvent être présents au sein du tribunal en cas de besoin.
Nous avons un peu de mal à comprendre la réforme conduite par le Gouvernement, qui se fait à la découpe ou par étapes. Vous allez créer des tribunaux spécialisés, monsieur le ministre, mais, parallèlement, la garde des Sceaux a annoncé qu’elle engageait une réforme de l’ensemble des tribunaux de commerce qui porterait aussi sur la question de la spécialisation. Ces articles ont-ils vraiment leur place dans un projet de loi relatif à la croissance et à l’activité, alors qu’un autre projet de loi est prévu en la matière et qu’il procédera, selon toute vraisemblance, à une refonte de la carte judiciaire, à partir d’une vision d’ensemble ?
D’autre part, le nombre des dépôts de bilan s’envole depuis quelques années, et ce n’est pas en changeant le thermomètre que l’on va régler ce problème ! C’est en travaillant sur l’environnement économique et, éventuellement, juridique des entreprises, notamment en simplifiant la loi, que l’on pourra améliorer leur situation, certainement pas en créant des tribunaux de commerce spécialisés ! D’autant que nous avons du mal à voir quels seuils seront finalement retenus par le décret. Je propose que les dispositions relatives aux tribunaux de commerce soient retirées de ce texte, pour être, le cas échéant, réintroduites dans un projet de loi d’ensemble. Je voterai donc les deux amendements de suppression.
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur thématique, il n’est écrit nulle part dans l’exposé sommaire de mon amendement que le texte entre en contradiction avec les préconisations du rapport de Cécile Untermaier et de Marcel Bonnot. Le fait qu’ils ne soient pas identiques ne les rend pas pour autant contradictoires !
S’agissant de la faculté de dépaysement, elle existe déjà : elle est prévue par l’article L. 662-2 du code de commerce. Sous le contrôle de Cécile Untermaier, l’intention des rapporteurs est de la maintenir, mais en instaurant la possibilité pour l’une des deux parties, notamment le demandeur, de solliciter ce dépaysement. Pour l’instant, la procédure est dans la main des tribunaux.
Quant à la spécialisation, c’est en effet l’une des principales propositions du rapport, ainsi que le précise l’exposé sommaire de mon amendement. Mais le modèle préconisé par les rapporteurs pour cette spécialisation est celui des juridictions interrégionales spécialisées – il existe actuellement huit juridictions de ce type en France, sept dans les grandes villes de métropole et une outre-mer, à Fort-de-France. En cela, le texte n’est pas du tout dans l’esprit du rapport.
Je ne vois guère comment vous allez résoudre la quadrature du cercle et je rejoins le point de vue de Francis Vercamer : la justice commerciale fonctionne globalement bien. Certes, dans certaines décisions ou arbitrages, heureusement minoritaires, il arrive que les intérêts locaux ou personnels l’emportent sur le respect du droit. Quant à la proportion de litiges qui ne sont pas tranchés en première instance, elle est, somme toute, correcte.
À titre personnel, je suis très mal à l’aise avec un raisonnement qui serait purement quantitatif. D’une part, un tel raisonnement ne permet pas de régler la question de fond, le véritable enjeu étant la garantie du droit des justiciables. D’autre part, dans la pratique, un chiffre d’affaires élevé et un nombre de salariés important ne suffisent pas à déterminer un niveau de complexité : certaines procédures de redressement ou de liquidation judiciaire qui concernent de petites entreprises sont très complexes ; inversement, des procédures qui touchent des entreprises de taille plus importante peuvent être relativement simples.
Enfin, nous sommes tous très attachés à la notion de proximité, notamment ceux d’entre nous qui sont des élus locaux. Or la proximité sera nécessairement élastique dans le dispositif que vous proposez. Je comprends tout à fait que, de même qu’en matière pénale, le dépaysement s’impose lorsque les intérêts locaux sont trop prégnants, complexes ou conflictuels. Et, en l’état actuel de l’article L. 662-2 du code de commerce, le dépaysement n’est en effet pas décidé chaque fois qu’il serait nécessaire. Cependant, la bonne manière de procéder, ce serait de permettre aux deux parties, notamment au demandeur, de le solliciter. À ce moment-là, le nombre de dépaysements augmenterait considérablement. Certains représentants de la profession suggèrent, en outre, que la décision en la matière revienne au premier président de la cour d’appel. En tout cas, il existe d’autres systèmes que la mécanique de seuils que vous souhaitez instaurer. C’est une méthode trop quantitative pour donner pleinement satisfaction ; elle n’apportera pas de solution aux problèmes que vous entendez régler. Nous considérons que vous allez affaiblir un appareil judiciaire qui fonctionne bien. Il est sans doute nécessaire de le réformer, mais pas de le bouleverser ainsi.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous venez de confirmer, monsieur le ministre, que la réforme des tribunaux de commerce interviendrait dans le cadre du projet sur la justice du XXIe siècle, sur la base des conclusions du rapport de la mission d’information sur la justice commerciale. J’en prends acte. Il s’agissait d’un point important, notamment pour les membres de la commission des Lois.
Nous allons créer des tribunaux de commerce spécialisés à compétence exclusive, mais nous restons bien dans le cadre de la justice consulaire, avec son mode de fonctionnement actuel. Et nous ne privons les tribunaux de commerce existants d’aucune de leurs compétences ordinaires, dont découle le faible nombre d’appels. Nous ne changeons donc pas de système. Dès lors, les juges consulaires et leurs ardents défenseurs n’ont guère de raison de critiquer cette réforme.
Je me permets de relever une petite confusion à propos de la notion de dépaysement. Celui-ci intervient lorsque l’une des deux parties demande à faire juger le litige par une autre juridiction que le tribunal compétent, parce qu’elle nourrit des inquiétudes quant à son impartialité. Or, actuellement, il n’existe pas de procédure de dépaysement dans les tribunaux de commerce, sauf à l’initiative du procureur de la République. Quant au projet de loi, il ne prévoit rien de nouveau en la matière. En réalité, la question est moins celle du dépaysement que celle de la capacité pour une juridiction de centraliser un contentieux « multisites ». Aujourd’hui, lorsque des procédures sont ouvertes à l’encontre de plusieurs établissements d’une même entreprise situés dans des ressorts différents, il n’existe aucune modalité de dessaisissement pour faire en sorte qu’un seul tribunal de commerce soit saisi de l’affaire dans son ensemble. D’ailleurs, on n’a jamais vu un tribunal se dessaisir d’office, à supposer qu’il en ait la faculté.
Reste à fixer les seuils de chiffre d’affaires et d’effectif. Le seuil à partir duquel le CIRI est compétent – 400 salariés – est-il pertinent ? Je l’ignore. En tout cas, il est légitime qu’un tribunal de commerce spécialisé traite les dossiers relatifs aux entreprises les plus importantes, même si l’on voit bien le problème que peut poser à un territoire la perte ou la restructuration d’une telle entreprise.
Parmi ses hypothèses, la mission d’information avait envisagé le dépaysement et la spécialisation, mais elle n’a pas apporté de réponse tranchée sur ces sujets. Quoi qu’il en soit, le dispositif prévu par le texte est, de mon point de vue, excellent : il améliore l’intervention de la justice consulaire sur des affaires qui nécessitaient un investissement plus important de sa part.
M. Gérard Cherpion. Les tribunaux de commerce fonctionnent bien. Les juges consulaires sont des professionnels qui connaissent bien les entreprises et l’économie locale. Avec le système que vous proposez, le rôle de prévention des tribunaux de commerce va disparaître. Pourtant, il permet de régler un certain nombre d’affaires en amont. À qui les entreprises vont-elles désormais pouvoir s’adresser au moment où elles rencontrent des difficultés ?
D’autre part, lorsque le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège du groupe et non l’entreprise elle-même, il y a, aujourd’hui déjà, un éloignement par rapport au territoire, qui fait que les intérêts de l’entreprise ne sont pas nécessairement bien pris en compte, notamment lorsque l’administrateur judiciaire désigné est lui-même éloigné de ce territoire. Nous avons là une difficulté à résoudre. Vous apportez une partie de la réponse en rendant plus fréquente la nomination d’un deuxième administrateur, ainsi que l’a indiqué le rapporteur thématique. C’est un point important.
Enfin, la mise en œuvre tant des plans de sauvegarde de l’emploi – PSE – que des conventions de revitalisation ne peut se faire qu’au niveau du territoire, ce qui implique une connaissance de l’économie locale, que seul peut avoir un tribunal de commerce proche, et non une juridiction plus éloignée.
Mme Cécile Untermaier. Permettez-moi d’avoir une pensée pour notre collègue Marcel Bonnot, avec lequel j’ai beaucoup travaillé sur ce dossier et qui souhaitait venir le défendre devant vous ce soir.
La proposition du Gouvernement n’entre pas en contradiction avec les propositions que nous avions formulées. Nous avions bien envisagé la création de pôles spécialisés.
Je tiens à saluer l’action des juges consulaires. Ils ont beaucoup de mérite : bénévoles, dotés d’une compétence économique, mais dépourvus de formation juridique, ils parviennent à faire office de juges, à rendre des jugements qui ne font pas souvent l’objet d’un appel. C’est en effet assez impressionnant. Cela étant, il est bon de connaître les raisons de ce faible taux d’appel.
Il n’en reste pas moins qu’il est difficile pour ces juges consulaires de régler certaines affaires complexes. C’est pourquoi nous avions proposé, dans notre rapport, de « créer des pôles spécialisés ayant compétence exclusive pour connaître des procédures collectives affectant des entreprises dont le total de bilan, le chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés permanents dépassent certains seuils ». La question porte donc non pas sur l’opportunité de la spécialisation telle que l’envisage le Gouvernement, mais essentiellement sur la fixation des seuils. Nous recommandons au Gouvernement de les déterminer avec beaucoup de prudence et de précision, de telle sorte que les tribunaux spécialisés traitent suffisamment d’affaires et puissent développer une véritable compétence. Il convient de procéder à des modélisations – pour notre part, nous n’avons pas les moyens de le faire. Nous suggérons, en particulier, de tester l’hypothèse du seuil de 400 salariés retenu par le CIRI. En matière de revitalisation du territoire, il peut être plus facile de raisonner, comme le CIRI, à l’échelle d’un vaste bassin d’emploi.
M. le ministre. Je souhaite apporter quelques clarifications. Comme plusieurs d’entre vous, je tiens à saluer le dévouement des juges des tribunaux de commerce et la qualité de leur travail. Ils ne sont pas rémunérés et exercent parfois leurs fonctions dans des conditions difficiles.
Nous ne menons pas cette réforme contre les juges consulaires. Elle s’inscrit dans le mouvement de modernisation de la prévention et des procédures collectives engagé par les deux ordonnances prises en la matière à l’initiative de la garde des Sceaux. Elle ne vise nullement à remettre en cause la proximité des juges consulaires ni leur rôle de prévention. L’objectif est non pas de favoriser le dépaysement – cette procédure fonctionnant assez mal aujourd’hui –, mais de spécialiser certaines juridictions au-delà de certains seuils.
La fixation de ces seuils fait, légitimement, débat. Ainsi que l’a indiqué le rapporteur thématique, il convient que les tribunaux spécialisés traitent un nombre suffisant d’affaires complexes, afin de développer une compétence propre. Je n’adhère pas à tous les arguments qui ont été présentés en faveur du seuil de 400 salariés utilisé par le CIRI. D’une part, le CIRI exerce une compétence nationale, en amont des autres procédures. D’autre part, les comités départementaux d’examen des difficultés de financement des entreprises - CODEFI – n’appliquent pas le même seuil que le CIRI, ce qui leur permet de traiter un flux d’affaires nettement supérieur. Selon les chiffres du cabinet Altares, en 2013, 139 entreprises de plus de 150 salariés ont fait l’objet d’un redressement judiciaire. Avec un seuil à 250 salariés, nous tomberions probablement à moins d’une centaine de cas par an. Et, si nous retenions le seuil de 400 salariés, les tribunaux spécialisés ne traiteraient sans doute pas plus de quelques dizaines d’affaires dans l’année. Je ne suis pas convaincu que cela leur suffirait pour développer une véritable compétence. Nous devons mener une concertation sur ce point dans les mois qui viennent. En tout cas, je ne suis pas favorable à l’inscription d’un seuil dans la loi.
Je donnerai un avis favorable aux amendements proposés par le rapporteur thématique.
La Commission rejette les amendements SPE259 et SPE427.
Puis elle adopte l’amendement SPE1588 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
En conséquence, les amendements SPE530 de M. Marcel Bonnot et SPE1682 de M. François Brottes tombent.
La Commission adopte l’amendement SPE1589 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement SPE531 de M. Marcel Bonnot et l’amendement rédactionnel SPE1590 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement SPE531 vise à apporter une clarification. Le règlement – CE – n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dispose que les juridictions compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité en cas de litige transfrontalier sont celles de l’État membre où se trouve le siège statutaire de la société débitrice ou, à défaut, le centre principal de ses intérêts. Or l’alinéa 7, qui mentionne des procédures qui ne relèvent pas de ce règlement, fait lui aussi référence à la notion de « centre principal des intérêts du débiteur ». Afin d’éviter tout risque de confusion, qui pourrait être source d’éventuels litiges, il nous paraît préférable de ne pas retenir les mêmes termes que dans le règlement. C’est pourquoi nous proposons de remplacer « centre principal des intérêts » par « siège social ».
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Avis défavorable. La notion de « centre des intérêts principaux » est une notion désormais bien connue du droit des entreprises en difficulté. Elle est inscrite dans le droit de l’Union européenne, plus précisément dans le règlement n° 1346/2000. En outre, elle figure déjà aux articles R. 123-91, R. 600-1 et R. 743-145 du code de commerce. Sa reprise ne pose donc aucune difficulté. Elle constituera, au contraire, un critère clair pour déterminer la juridiction compétente.
M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Avis favorable à l’amendement SPE1590.
La Commission rejette l’amendement SPE531.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1590 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE1591 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Aux termes de cet amendement, lorsqu’une procédure sera ouverte à l’encontre d’une société mère, le tribunal spécialisé compétent le sera également pour connaître des procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle. Le tribunal spécialisé pourra donc étendre la procédure. Nous gagnerons ainsi en cohérence.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1591.
Puis elle examine l’amendement SPE1592 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement prévoit que le décret fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés sera pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1592.
Puis elle est saisie de l’amendement SPE532 de M. Marcel Bonnot.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à préciser que les juridictions dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont les juridictions « spécialisées » dont il a été question plus haut. Sans l’ajout de cet adjectif, on ne sait pas très bien de quelles juridictions il s’agit, et on peut penser que le décret fixera la liste d’un ensemble de juridictions plus large.
M. le ministre. Avis favorable.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE532.
Puis elle examine l’amendement SPE533 de M. Marcel Bonnot.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à supprimer la mention « selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État » à l’alinéa 9, qui nous paraît redondante avec celle qui figure à l’alinéa 5.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Avis défavorable. Cette mention n’est aucunement redondante avec celle qui figure à l’alinéa 5, laquelle permet au pouvoir réglementaire de fixer par décret en Conseil d’État les seuils – nombre de salariés et chiffre d’affaires de l’entreprise – à partir desquels les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents.
M. le ministre. Avis défavorable. L’un des deux décrets en Conseil d’État définira ces seuils, l’autre fixera les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 66.
L’amendement SPE 533 est retiré.
La Commission en vient à l’amendement SPE1593 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rectifier une erreur : il convient de se référer non pas à la date d’entrée en vigueur de la loi, mais à celle de l’article, qui interviendra selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la loi.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1593.
Puis elle adopte l’article 66 modifié.
*
* *
Article 67
(art. L. 662-2 du code de commerce)
Coordination et procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé
Cet article opérait initialement une simple modification de coordination à l’article L. 662-2 du code de commerce. Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a complété cette mesure de coordination par une procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé dont aurait été saisi un tribunal de commerce non spécialisé.
I. MODIFICATIONS DE COORDINATION
L’article L. 662-2 concerne la procédure de délocalisation ou de « dépaysement », qui permet à une cour d’appel de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction compétente dans son ressort et à la Cour de cassation de renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel, « lorsque les intérêts en présence le justifient ». Ses modalités procédurales sont organisées par l’article R. 662-7 du même code (voir le commentaire de l’article 66, I, A, 1).
Les 1° et 2° du présent article ajoutent la possibilité d’opérer un tel renvoi devant un tribunal de commerce spécialisé mentionné à l’article L. 721-8 du code de commerce.
II. CRÉATION D’UNE PROCÉDURE DE « DÉPAYSEMENT » OBLIGATOIRE DES DOSSIERS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE D’UN TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ
Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a adopté un amendement créant une procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé.
Le 3° du présent article complète ainsi l’article L. 622-2 du code de commerce par un second alinéa précisant que lorsqu’une procédure prévue par le livre sixième du code de commerce relève d’un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 et que le tribunal de commerce saisi n’est pas l’un des tribunaux de commerce spécialisés, le président du tribunal de commerce saisi devra transmettre immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d’appel de son ressort.
Le premier président de la cour d’appel transmet alors immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé compétent se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, le premier président de la cour d’appel ayant transmis le dossier devra informer le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se situe le tribunal commerce spécialisé de cette transmission.
Cet ajout répond à une préoccupation exprimée par de nombreux présidents de tribunaux de commerce.
*
* *
Suivant l’avis défavorable de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements identiques SPE260 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE428 de M. Patrick Hetzel.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE1594 rectifié de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Aux termes de cet amendement, lorsqu’une procédure prévue par le livre sixième du code de commerce relèvera d’un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 et que le tribunal de commerce saisi ne sera pas l’un des tribunaux de commerce spécialisé, le président du tribunal devra transmettre immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort. Celui-ci transmettra alors immédiatement le dossier, après avis du procureur général, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si ce dernier se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informera le premier président de ladite cour d’appel de cette transmission.
Nous proposons ainsi de mettre en place un mécanisme de délocalisation obligatoire des procédures remplissant les conditions prévues par l’article L. 721-8 du code de commerce, à l’initiative du président du tribunal de commerce initialement saisi. Nous avons retenu cette procédure après une longue discussion avec l’ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Elle permettra au président du tribunal de commerce initialement saisi de rester au courant du dossier. Les présidents de tribunaux de commerce sont très sensibles à cette faculté. C’est un élément de sagesse qu’il faut leur accorder.
M. le président François Brottes. Je partage votre point de vue, monsieur le rapporteur thématique. Nous avons tous entendu les arguments des présidents des tribunaux de commerce sur ce point.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1594 rect.
L’article 67 est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement SPE534 de M. Marcel Bonnot tombe.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE536 de M. Marcel Bonnot.
Mme Véronique Louwagie. Nous souhaiterions que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard six mois après la publication de la loi, un rapport sur la mise en place d’un dispositif de numéro vert national permettant aux chefs d’entreprise de s’entretenir par téléphone, dans l’anonymat et le secret les plus complets, avec des experts de la prévention. Ce nouveau service permettrait aux chefs d’entreprise d’obtenir des informations utiles. Cette proposition figure dans le rapport de Cécile Untermaier et de Marcel Bonnot.
M. le ministre. Je comprends votre préoccupation. Le Gouvernement, en particulier la garde des Sceaux, est favorable à cette idée. Nous devons réfléchir aux moyens de la mettre en œuvre. Néanmoins, je plaide pour que nous nous exonérions d’un rapport supplémentaire et vous suggère donc de retirer votre amendement.
L’amendement SPE536 est retiré.
*
* *
Article 68
Application outre-mer
Cet article prévoit que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et, depuis le 31 mars 2011, Mayotte), à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La présente section ne sera pas applicable non plus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna : en l’absence de mention expresse d’application, les statuts de ces trois collectivités ont pour conséquence que la mesure ne sera pas applicable, en application du principe de spécialité législative (155).
Les juridictions commerciales présentent des particularités importantes outre-mer, où ce sont des tribunaux mixtes de commerce, présidés par un magistrat professionnel et composés de six juges élus parmi les commerçants, qui sont compétents. Le Gouvernement a estimé que cette particularité ainsi que des considérations pratiques liées aux distances à parcourir par les justiciables justifiaient que la création de tribunaux de commerce spécialisés ne soit pas prévue dans ces collectivités d’outre-mer.
*
* *
Les amendements identiques SPE261 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE429 de M. Patrick Hetzel sont retirés.
La Commission adopte l’article 68 sans modification.
*
* *
Section 2
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Article 69
Désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures
Initialement, cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
– prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures (1°) ;
– permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (2°).
Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a substitué à cette habilitation l’insertion de dispositions directement applicables dans le projet de loi, modifiant et complétant le code de commerce.
L’habilitation figurant au 1° a été remplacée par le présent article, tandis que celle qui figurait au 2° a été remplacée par l’article 69 bis.
I. L’ÉTAT DU DROIT
En matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, la procédure prévoit la désignation d’un mandataire judiciaire, qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20 du code de commerce) et d’un administrateur judiciaire, chargé de surveiller ou d’assister le chef d’entreprise dans sa gestion (article L. 622-1 du même code).
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur (article R. 621-11 du même code). La nomination d’un administrateur ou d’un mandataire n’est pas obligatoire pour les entreprises de 20 salariés réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros.
En l’état du droit, le code de commerce permet la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L. 621-4, alinéa 3, dudit code, prévoit ainsi que le tribunal, lorsqu’il ouvre la procédure de sauvegarde, peut, à la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Il en va de même en matière de redressement judiciaire de l’article L. 631-9 du même code.
En matière de liquidation judiciaire, cette désignation peut intervenir d’office ou à la demande du ministère public, en application de l’article 641-1 du même code.
II. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La possibilité de désigner un second mandataire et un second administrateur n’est pas suffisamment utilisée par les tribunaux aujourd’hui, qui hésitent souvent à désigner des professionnels situés hors de leur ressort. Or, le nombre peu élevé de procédures concernant des entreprises de taille importante (une centaine par an sur 50 000) fait que la plupart des administrateurs et des mandataires ne sont que rarement confrontés au suivi de dossiers comportant un grand nombre de sites industriels et plusieurs milliers de salariés. Seuls quelques rares professionnels disposent de moyens matériels et humains adaptés à l’ampleur d’une telle tâche.
L’intervention systématique d’un second mandataire et d’un second administrateur permettrait d’apporter une réponse plus adaptée à ces dossiers complexes, rares et atypiques. L’efficacité du traitement des difficultés des entreprises concernées en serait accrue.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉE PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La modification du titre Ier du livre VIII du code de commerce prévue par le présent article, tel qu’amendé par la Commission avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à rendre obligatoire la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans les dossiers les plus complexes de sauvegarde, de redressement ou de liquidation d’une entreprise en difficulté.
Dans les procédures de sauvegarde, cette obligation nouvelle est prévue par un nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce, inséré par le 1° du présent article. Celui-ci précise dans quelles procédures la nomination d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire est imposée. Tel est le cas lorsque le débiteur :
– possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire (1°) ;
– ou fait partie d’un groupe d’entreprises, en tant que société mère ou filiale, comprenant au moins trois sociétés à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte (2° et 3°) ;
Dans les deux cas, l’obligation de désignation d’un second administrateur et mandataire ne s’appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés du groupe dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État (4°).
Ce décret précisera également les conditions d’expérience et de moyens que devra remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées (alinéa 7 de l’article L. 621-4-1).
S’il s’agit d’un groupe d’entreprises en difficulté, le second administrateur et le second mandataire seront, chacun en ce qui les concerne, communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées (alinéa 6 de l’article L. 621-4-1).
L’obligation de désignation d’un second administrateur et mandataire est rendue applicable dans les mêmes conditions aux procédures de redressement judiciaire par un renvoi de l’actuel article L. 631-9 du code de commerce au nouvel article L. 621-4-1 du même code, qui est opéré par le 2° du présent article.
Il en va de même pour les procédures de liquidation judiciaire, par l’introduction d’un nouvel article L. 641-1-2 dans le code de commerce, opérée par le 3° du présent article, lorsque les mêmes seuils seront franchis : un second mandataire judiciaire devra être désigné en qualité de liquidateur, qui sera également commun à l’ensemble des entités du groupe.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE262 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE430 de M. Patrick Hetzel.
M. Jean-Frédéric Poisson. Mon amendement est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le mien également.
M. le ministre. Avis défavorable. Je soutiens l’amendement SPE1595 du rapporteur thématique, qui vise à introduire directement dans le texte les mesures que nous prévoyions de prendre par ordonnance. Ainsi que le rapporteur thématique l’a souligné, il est nécessaire de prévoir la désignation d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième mandataire judiciaire pour les dossiers importants, afin de s’assurer que toutes les missions qui leur reviennent seront accomplies de la manière la plus efficace.
En outre, comme pour toutes les autres professions réglementées, il convient de mettre en place un statut d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire salarié, afin de combler l’important manque de professionnels et de constituer un vivier de futurs acteurs. Cette mesure participera de la rationalisation du paysage des professions réglementées que nous comptons mener à bien avec ce projet de loi.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements SPE262 et SPE430.
La Commission en vient à l’amendement SPE1595 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement vise à remplacer l’habilitation prévue au 1° de l’article 69 par un article insérant directement dans le code de commerce les dispositions nécessaires pour prévoir la désignation obligatoire d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures les plus importantes.
S’agissant des procédures de sauvegarde, cette obligation est prévue par un nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce. Celui-ci précise que la nomination d’un second administrateur et d’un second mandataire est imposée dans deux cas : lorsque le débiteur possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, ou bien lorsqu’il fait partie, en tant que société mère ou filiale, d’un groupe d’entreprises comprenant au moins trois sociétés à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte.
Dans les deux cas, l’obligation de désignation d’un second administrateur et d’un second mandataire ne s’appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés du groupe dépassent les seuils fixés par décret en Conseil d’État. S’il s’agit d’un groupe d’entreprises en difficulté, le second administrateur et le second mandataire seront, l’un et l’autre, communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées.
L’obligation de désignation d’un second administrateur et d’un second mandataire est rendue applicable, dans les mêmes conditions, aux procédures de redressement judiciaire par un renvoi de l’actuel article L. 631-9 du code de commerce au nouvel article L. 621-4-1. De même, elle est rendue applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’introduction d’un nouvel article L. 641-1-2 dans le code de commerce, lorsque les mêmes seuils seront franchis.
La sagesse commande souvent de désigner un deuxième administrateur et un deuxième mandataire. Cette possibilité existait déjà, mais elle n’était guère utilisée. Dans l’affaire de la SNCM, en particulier, le tribunal de commerce n’a pas jugé bon de désigner deux mandataires judiciaires. Il faut dire qu’un certain nombre de procureurs ne sollicitent même pas cette désignation. Il ressort de mes échanges avec l’ensemble du corps des administrateurs et des mandataires que la seule solution consiste à la rendre obligatoire dans certaines procédures.
Cette mesure n’entraînera aucun coût supplémentaire, puisque les honoraires des administrateurs et des mandataires lorsqu’ils dépassent certains seuils sont fixés par un magistrat de cour d’appel en considération des frais engagés et des diligences accomplies.
M. le ministre. Avis favorable.
M. Francis Vercamer. L’amendement du rapporteur thématique tend à réécrire l’article 69 dans son ensemble. S’il est adopté, notre amendement SPE913 tombera donc. Nous proposions que le deuxième mandataire judiciaire ait pour mission de trouver un repreneur pour l’entreprise. Les reprises se font, hélas, rares dans les procédures de redressement judiciaire et, à plus forte raison, de liquidation. Il nous paraît important de permettre à l’entreprise et aux salariés de poursuivre leur activité. Il faut limiter la « casse sociale » autant que possible.
Par ailleurs, j’avais déposé un autre amendement, déclaré irrecevable, qui visait à encadrer la période de liquidation, dans la mesure où celle-ci a tendance à durer très longtemps. Pendant cet intervalle, les fonds de commerce et les actifs se déprécient, ce qui induit une perte de moyens pour rembourser les fournisseurs et les créanciers chirographaires. J’aurais souhaité connaître l’avis du ministre sur ces deux points, de façon à pouvoir déposer éventuellement de nouveaux amendements pour la séance publique.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le rapporteur thématique, je suis choqué que vous ne teniez pas compte des effets de seuil. Vous ne rendez la nomination d’un deuxième mandataire obligatoire que pour les entreprises qui dépassent certains seuils. Or j’ai été témoin du dépeçage d’entreprises qui comptaient quarante ou cinquante salariés : une fois que le mandataire judiciaire a vendu tous les actifs intéressants, plus personne ne veut reprendre ces entreprises. La nomination d’un deuxième mandataire serait utile pour toutes les entreprises. Quant à l’affaire de la SNCM, indépendamment du problème qu’a pu constituer l’absence d’un second mandataire, elle aurait mérité un dépaysement.
M. le président François Brottes. Il est souvent difficile de choisir entre le paiement des créances et la reprise de l’entreprise.
M. Gilles Lurton. Dans de nombreuses affaires, deux mandataires ont été désignés. Tel a été le cas pour l’entreprise Doux, et cela s’est très bien passé.
M. Jean-Yves Caullet. Monsieur le rapporteur thématique, monsieur le ministre, vous avez évoqué le détail de la procédure et les moyens, mais qu’en est-il des délais ? Il faut garantir une certaine réactivité. Les différentes transmissions que nous avons prévues ne risquent-elles pas d’alourdir la procédure, voire de retarder la prise de décision ?
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. S’agissant de la procédure spécifique que j’ai prévue en cas de dépôt de bilan, il est précisé que la transmission du dossier est immédiate. En pratique, elle devrait donc être faite dans les vingt-quatre heures. Cela n’alourdira donc que peu la procédure.
M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur thématique : la transmission est immédiate, donc le coût de friction sera faible. D’autre part, avec des juridictions spécialisées qui développeront des compétences particulières, le traitement des affaires sera, en principe, plus rapide.
La Commission adopte l’amendement SPE1595.
L’article 69 est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement SPE913 de M. Philippe Vigier tombe.
*
* *
Article 69 bis (nouveau)
(art. L. 811-1, 811-3, 811-7-1 [nouveau], 812-1, 812-2-1, 812-5-1 [nouveau], 814-3, 814-12, 814-14 [nouveau] du code de commerce)
Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
Cet article additionnel est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la Commission, tel que sous-amendé par le Gouvernement. Il remplace l’habilitation qui était prévue au 2° de l’article 69, qui visait à permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, en lui substituant des dispositions directement applicables, qui seront insérées dans le titre Ier du livre VIII du code de commerce.
Cette réforme répond à un souhait exprimé depuis plusieurs années par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LE DÉVELOPPEMENT DU SALARIAT DANS LES PROFESSIONS JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES
Le salariat a été introduit dans plusieurs professions juridiques réglementées :
– les notaires et les avocats, par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
– les huissiers de justice et les greffiers de tribunaux de commerce, par la loi n° 2010-1609 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;
– les commissaires-priseurs judiciaires par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation par l’ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014 relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié.
Le présent projet de loi, en son article 18, vise à simplifier le recours au salariat dans les offices publics et ministériels, en abrogeant les dispositions législatives qui restreignent le nombre de salariés pouvant être employés par les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce.
L’étude d’impact annexée au présent projet de loi révèle d’ailleurs que le Gouvernement avait initialement envisagé de faire figurer la présente mesure relative aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires à l’article 18, sa présentation figurant parmi les développements relatifs à cet article et non parmi ceux concernant l’article 69 (156).
B. L’ABSENCE DE RECOURS AU SALARIAT POUR LES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE OU DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
En l’état du droit, l’exercice salarié de l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire n’est pas autorisé par le code de commerce.
L’objectif poursuivi par l’introduction de cet exercice salarié est, comme pour les autres professions réglementées dans lesquelles il a été autorisé, est qu’il constitue un instrument de souplesse, de promotion interne et de dynamisation, notamment dans l’optique d’une future installation ou association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions. Les administrateurs et les mandataires pourront mieux accompagner le développement de leur activité, en développant des études structurées dont la taille et la spécialisation permettent le traitement de dossiers complexes, et un plus grand nombre de candidats pourront acquérir l’expérience nécessaire pour envisager une installation. La mesure devrait aussi contribuer au rajeunissement et à l’attractivité de ces deux professions.
En 2014, il y avait 118 administrateurs judiciaires en France – soit moins que le nombre de juridictions commerciales – et 311 mandataires de justice. Il existe aujourd’hui un réel déficit de professionnels et un maillage territorial déficient.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Le 1° du présent article modifie le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de commerce relatif aux missions des administrateurs judiciaires, afin de préciser que les tâches que comporte l’exécution du mandat des administrateurs judiciaires désignés par le tribunal leur incombent personnellement, mais qu’ils peuvent en déléguer tout ou partie à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité.
Le 2° complète l’article L. 811-3 du même code, aux termes duquel « la liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d’appel », afin de préciser que lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de l’employeur.
Le 3° crée un nouvel article L. 811-7-1 au sein du même code, exclusivement consacré à l’exercice salarié de la profession d’administrateur judiciaire.
Le premier alinéa de ce nouvel article pose le principe selon lequel l’administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.
Son deuxième alinéa est issu d’un sous-amendement présenté par le Gouvernement, dont l’objet est de limiter à quatre le nombre d’administrateurs judiciaires salariés pouvant être employés par un administrateur judiciaire. Si c’est une étude, personne morale, qui est inscrite sur la liste, et non une personne physique, le nombre d’administrateurs judiciaires salariés pouvant être employés par celle-ci ne peut être supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession. Cette limitation a été adoptée par cohérence avec celle adoptée par la Commission pour les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers de tribunaux de commerce.
La première phrase du troisième alinéa du nouvel article L. 811-7-1 précise qu’en aucun cas le contrat de travail de l’administrateur judiciaire ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire, afin d’assurer la protection des salariés concernés sous l’angle déontologique, comme pour l’exercice salarié des fonctions d’officier public et ministériel. La deuxième phrase de ce même alinéa, issue du sous-amendement du Gouvernement précité, interdit toute clause de non-concurrence, qui sera réputée non écrite, afin de protéger la liberté d’établissement de ces professionnels. La troisième phrase protège également les salariés du point de vue déontologique, en leur permettant de refuser à leur employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission leur apparaissent contraires à leur conscience ou susceptibles de porter atteinte à leur indépendance, nonobstant toute clause du contrat de travail.
Le quatrième alinéa du même article L. 811-7-1 précise que l’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le dernier alinéa indique que le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
Les 4° à 6° opèrent des modifications identiques des dispositions du code de commerce applicables aux mandataires judiciaires. L’équivalent, pour les mandataires judiciaires, de l’article 811-7-1 est le nouvel article L. 812-5-1.
Le 7° modifie le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 du code de commerce afin que l’adhésion à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, chargée de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par ces derniers, ne soit pas imposée aux administrateurs et mandataires salariés.
Le 8° étend l’obligation pour tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur de la République, en supprimant la condition d’inscription sur les listes.
Le 9° habilite le pouvoir réglementaire à préciser, par un décret en Conseil d’État, les modalités d’application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1801 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs, faisant l’objet d’un sous-amendement SPE1961 du Gouvernement.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Il s’agit de permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, tout en veillant à la protection des salariés d’un point de vue déontologique. Ce sera un facteur de souplesse et de dynamisation pour les professionnels, notamment dans l’optique d’une future installation ou d’une association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions. Au cours de nos travaux, nous avons déjà adopté des dispositions qui visent à aménager les voies d’accès à ces deux professions.
Aujourd’hui, il existe un déficit réel de professionnels, et le maillage du territoire se caractérise par de véritables déserts. En 2014, il y avait en France 311 mandataires de justice et 118 administrateurs judiciaires, ces derniers étant donc moins nombreux que les juridictions commerciales – on compte 134 tribunaux de commerce en métropole, 5 tribunaux mixtes de commerce dans les départements d’outre-mer et 7 chambres spécialisées en Alsace-Moselle.
Le statut de salarié permettra non seulement à de jeunes diplômés d’exercer dans la profession et de parfaire leur expérience, mais tendra aussi à créer un vivier de jeunes professionnels susceptibles de s’installer à leur tour.
M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE1081, que je propose néanmoins de sous-amender, dans un souci de cohérence avec les dispositions que la Commission a adoptées il y a quelques jours en matière de salariat dans les offices publics et ministériels. Le sous-amendement SPE1961 du Gouvernement vise, d’une part, à limiter le nombre d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires salariés à quatre par titulaire et, d’autre part, à interdire les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail de ces administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires salariés. S’agissant du nombre de salariés autorisés par titulaire, nous partons de situations très hétérogènes dans les différentes professions réglementées : un titulaire pour un salarié chez les huissiers, un pour deux chez les notaires, etc. Nous avons homogénéisé ce ratio en le relevant à un pour quatre dans toutes les professions. D’autre part, nous avons interdit les clauses de non-concurrence, afin de permettre à ces professionnels de s’installer et de s’associer librement.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Avis favorable au sous-amendement SPE1961.
M. Gilles Lurton. Si le Gouvernement avait pris davantage d’arrêtés pour ouvrir des concours de mandataires judiciaires – il n’en a pris aucun ces dernières années –, ces professionnels seraient plus nombreux aujourd’hui.
La Commission adopte le sous-amendement SPE1961, puis l’amendement SPE1801 sous-amendé.
*
* *
Section 3
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
Article 70 A (nouveau)
(art. L. 621-4 du code de commerce)
Désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire
Cet article additionnel est issu d’un amendement des rapporteurs, adopté par la Commission avec l’avis favorable du Gouvernement.
Il complète l’article 69 prévoyant la désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire lorsque les procédures remplissent certaines conditions, de seuils de salariés et de chiffre d’affaires notamment.
Il a pour objet de favoriser, pour les procédures situées en deçà de ces seuils pour lesquelles cette co-désignation restera facultative, la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire lorsque la procédure le justifie, en prévoyant :
– en matière de redressement judiciaire (article L. 621-4 du code de commerce), que le tribunal puisse procéder à co-désignation d’office, ainsi qu’à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant. En l’état du droit, le tribunal ne peut procéder à cette co-désignation qu’à la demande du ministère public ;
– en matière de liquidation judiciaire (article L. 641-1 du même code), que le tribunal puisse décider cette co-désignation à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant. En l’état du droit, le tribunal ne peut procéder à cette co-désignation que d’office ou à la demande du ministère public.
Cette modification s’inspire de celle opérée à l’article R. 662-7 du code de commerce s’agissant de la procédure de délocalisation par le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1596 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet article additionnel vise à compléter celui qui prévoit la désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire lorsque les procédures remplissent certaines conditions, notamment lorsque l’entreprise concernée dépasse les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires prévus. Pour les procédures concernant des entreprises qui n’atteignent pas ces seuils, la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire restera facultative. Il s’agit de la favoriser lorsque la procédure le justifie. Ainsi, en matière de redressement judiciaire, le tribunal pourra procéder à cette co-désignation soit d’office, soit à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant. En matière de liquidation judiciaire, le tribunal pourra décider d’une co-désignation à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant.
Cette modification s’inspire de celle qui a été opérée pour la procédure de délocalisation prévue à l’article R. 662-7 du code de commerce par le décret du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Cet amendement me paraît de nature à répondre à la préoccupation que vous avez exprimée précédemment, monsieur Taugourdeau.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1596.
*
* *
Article 70
(art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce)
Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société
Cet article crée un dispositif destiné à prévenir la disparition d’une entreprise d’au moins 150 salariés en redressement judiciaire qui serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi, lorsque la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et d’assurer la poursuite de l’activité. Pour assurer la survie de l’entreprise concernée, le nouvel article L. 631-19-1 du code de commerce permet au tribunal, lorsque le projet de plan de redressement prévoit une augmentation du capital en faveur des personnes qui se sont engagées à exécuter ce plan :
– soit de désigner un mandataire chargé de voter l’augmentation du capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé celle-ci (« dilution forcée ») ;
– soit d’ordonner la cession des participations détenues par les associés ou actionnaires majoritaires au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan (« cession forcée »).
Cette mesure permettra de renforcer et de rééquilibrer les droits des créanciers – qui ne sont cependant pas les seuls visés par ce dispositif, qui peut s’appliquer au profit de tout tiers repreneur – par rapport à ceux des actionnaires et associés dans le cadre du redressement judiciaire.
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a introduit une procédure de cession forcée des droits sociaux des dirigeants d’une entreprise en redressement judiciaire.
Lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, l’article L. 631-19-1, deuxième alinéa, du code de commerce permet ainsi au tribunal, sur la demande du ministère public, d’ordonner la cession forcée des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait d’une entreprise en redressement judiciaire. Le même alinéa précise que « le prix de cession est fixé à dire d’expert » (157).
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (article 631-19-1, troisième alinéa).
Cette mesure n’est pas nouvelle dans notre droit : une disposition similaire de cession forcée des parts ou actions détenues par les dirigeants sociaux était prévue, dans le cadre de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d’apurement collectif du passif, par l’article 32 de l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
La conformité des dispositions de l’ancien article L. 621-59 du code de commerce – qui figurent désormais à l’article L. 631-19-1 du même code – à l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été reconnue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005, au motif qu’elles « sont justifiées par l’intérêt général » (158) .
Le dispositif prévu par l’article L. 631-19-1 du code de commerce est inapplicable aux associés, même majoritaires, dès lors qu’ils ne sont pas dirigeants de droit ou de fait à la date à laquelle le tribunal ordonne la cession (159).
II. LA NÉCESSITÉ DE LA RÉFORME PROPOSÉE
Le droit actuel permet au tribunal d’ordonner la cession forcée des droits sociaux des dirigeants, mais ne lui donne pas les moyens de surmonter l’opposition des actionnaires ou associés à une reprise interne d’une entreprise en redressement par un tiers, créancier ou non. Lorsque le projet de plan de redressement prévoit une modification du capital nécessaire à la survie de l’entreprise, le code de commerce soumet cette modification au vote favorable des assemblées des actionnaires compétentes. Les actionnaires peuvent ainsi s’opposer à toute dilution, alors que la valeur de leurs droits résiduels sur les actifs est très faible. Ce sont les seuls créanciers qui absorbent les pertes, via un rééchelonnement ou une réduction des dettes.
1. Les avantages économiques attendus d’un rééquilibrage du pouvoir de négociation en faveur des créanciers
Des travaux économiques récents démontrent la nécessité d’un rééquilibrage entre les droits des actionnaires ou associés et ceux des créanciers et des tiers repreneurs qui se sont engagés à exécuter le plan. Dans une note du conseil d’analyse économique de juin 2013 (160), les économistes Guillaume Plantin, David Themar et Jean Tirole – qui a depuis reçu, en 2014, le prix Nobel d’économie pour son analyse du pouvoir de marché et de la régulation – soulignent les avantages d’un droit plus favorable aux créanciers :
– une protection accrue des créanciers améliore leur taux de recouvrement (161) ;
– la protection des créanciers facilite l’accès au crédit des entreprises ;
– la protection des créanciers augmente la probabilité de poursuite de l’activité des entreprises défaillantes.
Ils ont par conséquent recommandé, parmi d’autres réformes, que le pouvoir de négociation des actionnaires soit réduit dans les procédures en amont de la liquidation judiciaire, notamment en empêchant les actionnaires de pouvoir s’opposer à leur dilution.
2. Les exemples étrangers : les législations allemande et américaine
Ces propositions s’inspirent de législations étrangères, qui prévoient des mécanismes similaires à celui proposé.
a. Le « Chapter 11 » américain
Le célèbre « Chapter eleven » relatif aux entreprises en difficulté du code des États-Unis a ainsi été significativement réformé en 2005 en faveur des créanciers. La procédure peut être ainsi résumée (162):
– le débiteur a la faculté exclusive de proposer un plan de réorganisation pendant 120 jours seulement. Les créanciers peuvent rejeter ce plan et faire des propositions concurrentes à l’expiration de ce délai. Par ailleurs, les extensions que le tribunal a la faculté d’accorder au débiteur ne peuvent excéder 18 mois ;
– un plan de réorganisation comporte des projections d’activité détaillées et une répartition des créanciers en classes. Au sein d’une même classe, toutes les créances ont le même rang. Des projections d’activité découlent trois types de classes : celles dont les droits initiaux ne sont pas affectés par le plan, celles qui perdent intégralement leurs droits au titre du plan, et les classes intermédiaires ou pivots qui ne recouvrent que partiellement leurs créances initiales du fait du plan ;
– pour le vote du plan, seules les classes pivot – celles dont les créances initiales sont partiellement remboursées selon le plan – prennent part au vote ;
– une classe votante est réputée accepter le plan si la moitié de ses membres au moins, dont les créances représentent au moins deux tiers du total de la classe, l’accepte ;
– le tribunal ne peut valider le plan que si au moins une classe votante l’accepte. En revanche, il peut sous certaines conditions imposer le plan à tous dès lors qu’au moins une classe votante l’accepte.
b. La loi dite « ESUG » allemande
En Allemagne, les procédures collectives ont été réformées par la loi facilitant le redressement des entreprises en difficulté, dite « ESUG » (163), entrée en vigueur le 1er mars 2012. Cette loi a également renforcé la place des créanciers dans le processus de redressement, réduit les possibilités juridiques de blocage d’un plan d’insolvabilité et autorisé la conversion des créances en capital.
La conversion des créances en capital existait auparavant mais nécessitait l’accord de la majorité des actionnaires en place. Le nouveau dispositif permet de leur imposer la conversion des créances en capital, selon la procédure suivante :
– le plan d’insolvabilité est approuvé par un vote séparé de divers groupes de créanciers et du groupe des actionnaires. Il est ensuite approuvé par le tribunal. Le paragraphe 245 (interdiction de faire obstruction) permet d’imposer aux actionnaires en place, dans le cadre du plan, une conversion de créances en actions de la société. La logique économique l’emporte ainsi sur le droit de veto des actionnaires ;
– en contrepartie de la dilution des actionnaires en place consécutive à l’augmentation de capital, les actionnaires peuvent se retirer, moyennant une éventuelle compensation, tenant compte de la situation financière de l’actionnaire si la société avait été liquidée. À cet égard, la conversion des créances en capital augmente les chances de redressement de la société, en diminuant son taux d’endettement, et en associant étroitement les nouveaux actionnaires qui ont un intérêt à la voir prospérer, leur propre capital étant engagé dans la société. Un mécanisme de protection a par ailleurs été prévu pour prémunir les créanciers entrant au capital contre tout recours ultérieur de la société, en cas de retour à meilleure fortune.
3. Le prolongement de réformes déjà engagées en droit français
L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a déjà renforcé les droits des créanciers dans le cadre des procédures collectives. Le mécanisme de la déclaration des créances a été simplifié, de même que les opérations de vérification du passif. L’ordonnance a renforcé aussi l’implication des créanciers en leur permettant dans certaines hypothèses de proposer des projets de plan de redressement, soumis au tribunal concurremment avec celui élaboré par le débiteur. Dans le cadre des procédures de prévention, le privilège de la conciliation, dit aussi privilège de l’argent frais (ou parfois, par référence au droit américain, privilège de « new money ») a été étendu.
Par ailleurs, en droit bancaire, la loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a introduit dans le code monétaire et financier des dispositifs novateurs afin de faire face aux crises bancaires. Ces nouvelles dispositions permettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en cas de défaillance d’un établissement de crédit, de changer ses dirigeants, de procéder au transfert ou à la cession d’office de tout ou partie de l’établissement ou encore de faire supporter les pertes par les actionnaires et les autres détenteurs de fonds propres de l’établissement et de faire émettre de nouveaux titres représentatifs de fonds propres.
III. LA RÉFORME PROPOSÉE
Le dispositif proposé par le présent article est soumis à des conditions précises et prévoit des garanties importantes au profit des actionnaires et associés concernés, qui assurent sa conformité aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Les modifications apportées par la Commission sur la proposition de vos rapporteurs ont eu pour objet d’étendre et de sécuriser le dispositif, afin de renforcer sa portée dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables.
A. UN DISPOSITIF STRICTEMENT ENCADRÉ
Le nouvel article L. 631-19-1 du code de commerce que le I du présent article insère dans le code de commerce a pour objectif d’éviter la disparition d’une entreprise en redressement judiciaire en permettant au tribunal d’imposer une modification du capital aux actionnaires ou aux associés d’une entreprise en redressement judiciaire qui s’y sont opposés.
Ce nouveau dispositif est fortement encadré. Certaines des conditions et des garanties prévues sont communes à l’ensemble du dispositif (c’est-à-dire à la « dilution forcée » comme à la « cession forcée ») tandis que d’autres sont spécifiques à l’une ou l’autre de ces deux options alternatives.
1. Les conditions et garanties communes
La mise en œuvre de l’ensemble du dispositif, qu’il s’agisse de la « dilution forcée » prévue au 1° ou de la « cession forcée » prévue au 2°, est subordonnée à des conditions précises et strictes et le nouvel article L. 631-19-1 comporte d’importantes garanties en faveur des actionnaires et associés « évincés ». Il convient de distinguer les conditions préalables, qui doivent impérativement être remplies pour que le tribunal puisse faire usage de la faculté alternative qui lui est ouverte, des conditions et garanties devant être respectées en cas de mise en œuvre du dispositif.
a. Conditions préalables
En application du premier alinéa de l’article L. 631-19-1, les conditions préalables devant être remplies pour que le dispositif puisse s’appliquer sont les suivantes :
– l’entreprise concernée doit avoir un effectif total d’au moins 150 salariés et sa disparition doit être de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale (164) et au bassin d’emploi ;
– la modification du capital doit apparaître comme une solution permettant d’éviter ce trouble, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise : les avantages attachés à la « reprise interne » par cession forcée ou conversion de créance en capital doivent avoir été comparés à ceux d’une « reprise externe ». Le texte initial du projet de loi employait l’expression : « la seule solution ». La Commission a considéré que cette condition était trop restrictive car la preuve qu’elle est remplie serait très difficile à établir. Il est suffisant que la modification de capital soit une solution pour sauver l’entreprise pour que ce dispositif soit justifié par un motif d’intérêt général ;
– la modification du capital doit avoir été refusée par les assemblées mentionnées au I de l’article 631-19 du code de commerce (165) ;
– la « dilution forcée » ou la « cession forcée » doit avoir été demandée au tribunal par l’administrateur judiciaire ou le ministère public ;
– cette demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette condition a été ajoutée par la Commission sur la proposition de vos rapporteurs, afin de laisser aux actionnaires ou associés de l’entreprise concernée un délai pour proposer leur propre plan. Cette précision s’inspire du droit américain (« Chapter 11 ») qui permet au débiteur de proposer un plan de réorganisation pendant 120 jours, délai à l’issue duquel les créanciers peuvent, si ce plan n’apparaît pas de nature à sauver l’entreprise, présenter des propositions concurrentes ;
– la modification de capital doit être prévue par le projet de plan de redressement ;
– la modification de capital doit être en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement.
Ce n’est que si ces conditions préalables sont remplies que le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public :
– soit, en application du 1°, désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan ;
– soit, en application du 2°, d’ordonner au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction de capital leur conférant une majorité de droits de vote dans les assemblées générales de l’entreprise concernée ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette entreprise en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires.
b. Conditions et garanties devant être respectées lors de la mise en œuvre du dispositif
Si les conditions préalables sont remplies et que le tribunal décide de recourir à l’une ou à l’autre des deux possibilités qui lui sont ouvertes, il lui appartiendra de veiller au respect des conditions et garanties suivantes :
– le tribunal doit statuer en présence du ministère public, après avoir entendu les associés ou actionnaires concernés, les associés et actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (alinéa 8 de l’article L. 631-19-1). Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a précisé qu’à défaut de délégués du personnel, le tribunal doit entendre le représentant des salariés élus par ces derniers mentionné à l’article L. 621-4 ;
– l’adoption du plan est subordonnée à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver leurs titres pendant une durée qu’il détermine, qui ne peut excéder celle du plan (alinéa 11 de l’article L. 631-19-1) ;
– l’adoption du plan peut également être subordonnée à la présentation par les souscripteurs ou cessionnaires d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement (alinéa 12 de l’article L. 631-19-1) ;
– la décision est subordonnée au paiement comptant du prix par les souscripteurs ou cessionnaires. À défaut de ce paiement comptant, le tribunal peut prononcer, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession (alinéa 13 de l’article L. 631-19-1) ;
– en cas de défaillance d’un associé ou d’un actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par la commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi sous la forme de dommages et intérêts. Il statue, dans cette hypothèse, en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis (alinéa 16 de l’article L. 631-19-1).
2. Les conditions spécifiques à la « dilution forcée »
Si le tribunal fait usage de la faculté prévue au 1° de désignation un mandataire chargé de voter l’augmentation de capital en lieu et place des actionnaires et associés majoritaires, les conditions spécifiques de procédure et de fond à respecter sont les suivantes :
– l’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération de l’assemblée compétente (alinéa 3 de l’article L. 631-19-2). Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous formes de remises ou de délais ;
– si l’augmentation du capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions, conformément au droit d’attribution préférentielle (alinéa 4 de l’article L. 631-19-2).
3. Les conditions spécifiques à la « cession forcée »
Si le tribunal fait usage de la faculté prévue au 2° d’imposer une cession forcée aux actionnaires ou associés, plusieurs conditions spécifiques de procédure et de fond s’imposent :
– les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° (c’est-à-dire autres que ceux ayant refusé l’augmentation de capital et détenant directement ou indirectement une majorité des droits de vote) disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires (alinéa 6 de l’article L. 631-19-2). Sur la proposition de vos rapporteurs, cette disposition – qui figurait à l’alinéa 12 de l’article L. 631-19-2 – a été modifiée par la Commission, qui a renforcé le droit de retrait des actionnaires minoritaires en prévoyant qu’il s’exerce simultanément à la cession forcée ;
– en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits sociaux des associés ou actionnaires cédants et des associés ou actionnaires ayant fait valoir leur volonté de se retirer de l’entreprise, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Ce dernier statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire (alinéa 7 de l’article L. 631-19-2) ;
– le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux offres publiques d’achat et d’échange doivent être respectées (articles L. 433-1 et suivants) ;
– le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants (alinéa 10 de l’article L. 631-19-2).
4. Les voies de recours
Le II du présent article complète l’article L. 661-1 du code de commerce afin de préciser que les deux décisions principales prévues par le dispositif créé par l’article L. 631-19-2 sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation.
Seront ainsi susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation :
– la décision statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 ;
– la décision statuant sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article.
Pourront former appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation, les principaux intéressés, à savoir : le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, les associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital, les cessionnaires et le ministère public.
Rappelons que l’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas, elle, susceptible de recours. Cette absence de recours a été prévue dans un souci de célérité, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise. Tout délai en la matière pourrait en effet être préjudiciable à l’entreprise concernée et donc, in fine, à la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants. L’expertise pourra être contestée lors de l’examen du recours portant contre la décision de cession.
5. Application outre-mer
Le III précise l’applicabilité outre-mer de ce dispositif. Il sera applicable à Wallis-et-Futuna et, sans qu’une mention expresse ne soit requise, dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité législative (c’est-à-dire les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et, depuis le 31 mars 2011, Mayotte) ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lesquelles aucune mention expresse n’est nécessaire en application de leurs statuts.
B. UN DISPOSITIF RESPECTUEUX DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES ET CONVENTIONNELLES
Il convient, après avoir rappelé la nature et la portée des exigences constitutionnelles et européennes applicables, d’examiner la conformité du dispositif proposé auxdites exigences.
1. La protection constitutionnelle du droit de propriété
La jurisprudence constitutionnelle distingue la privation de propriété, au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (166), et l’atteinte aux conditions d’exercice de ce droit, au sens des articles 2 (167) et 4 (168) de ladite déclaration. Dans le premier cas, la privation ne peut intervenir que « lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; dans le second cas, le Conseil constitutionnel examine si l’atteinte portée aux conditions d’exercice du droit de propriété est justifiée par des motifs d’intérêt général, proportionnée à l’objectif poursuivi et ne dénature pas le sens et la portée de ce droit.
Dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel juge ainsi que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité" ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (169) .
Le Conseil constitutionnel a déjà examiné la constitutionnalité de dispositifs de cession forcée à trois reprises. Dans les trois cas, il a jugé que les dispositions concernées ne constituaient pas une privation de liberté au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais une atteinte, qu’il a jugée conforme à la Constitution sans réserve dans le premier cas, conforme sous réserve dans le deuxième et contraire à la Constitution dans le troisième.
Dans sa décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 (170), le Conseil a ainsi jugé que la cession forcée de mitoyenneté prévue par l’article 661 du code civil (171) ne constituait pas une privation de propriété, mais une atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété, qu’il a jugé conforme à la Constitution car répondant à un motif d’intérêt général (172) et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (173), le Conseil a jugé que la cession forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire, prévue par le 2° de l’article 274 du code civil (174), ne constituait pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais une atteinte au droit de propriété. Il a jugé celle-ci conforme à la Constitution car répondant à un but d’intérêt général (garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce) et proportionnée à l’objectif poursuivi (l’attribution forcée est prononcée est ordonnée par le juge, les parties peuvent débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué et l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution de biens qu’il a reçus par succession ou donation).
Le Conseil a cependant émis une réserve, selon laquelle cette modalité d’exécution de la prestation compensatoire en capital devait être subsidiaire par rapport à l’autre modalité prévue au 1° de l’article 274 du code civil (à savoir le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties).
Dans la décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 (175), le Conseil constitutionnel a examiné la conformité au droit de propriété d’une disposition ne permettant à une entreprise de refuser une offre de reprise sérieuse de l’un de ses établissements que pour un motif légitime, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de son activité, sous peine de sanctions. Cette obligation, qui peut s’analyser comme une cession forcée d’un établissement sauf motif légitime de refus, n’a pas été considérée par le Conseil comme une privation de propriété, mais comme une atteinte au droit de propriété. Le Conseil a jugé que cette atteinte – qui restreignait également la liberté d’entreprendre – était manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi car elle privait l’entreprise de sa capacité d’anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques à un autre niveau que celui de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
2. Les exigences européennes
Le droit de propriété est également protégé, au niveau européen, par l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle de proportionnalité sur les atteintes à ce droit (176).
L’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, assure une protection similaire :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. »
Il convient également de prendre en compte la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012 (177) dont l’article 29 impose que toute augmentation de capital doit être décidée par l’assemblée générale et dont l’article 33 prévoit qu’un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires doit être garanti en cas d’augmentation de capital.
3. La conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et européennes
Le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur le présent projet de loi (178) a considéré que le dispositif proposé par le Gouvernement était conforme aux exigences constitutionnelles et européennes assurant la protection du droit de propriété.
Il a notamment relevé que, compte tenu des précautions prises pour ce nouveau dispositif par rapport à la mesure de cession forcée proposée en mars 2014 par le Gouvernement dans le projet de texte ayant abouti à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives qui avait fait l’objet d’une disjonction (179), l’atteinte aux droits de l’actionnaire prévu par ce dispositif « répond à l’objectif d’intérêt général de préserver l’activité d’une entreprise d’une importance économique et sociale avérée ». Le Conseil d’État a souligné, en particulier, les précautions ajoutées par le Gouvernement par rapport à la mesure précédemment proposée, tenant au seuil de 150 salariés, au débat et à la décision judiciaires et à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire de garder ses actions pendant un an.
S’agissant de la « dilution forcée », le Conseil d’État a pris en compte le risque que peuvent présenter en termes de constitutionnalité l’atteinte portée au droit de vote de l’associé ou de l’actionnaire qui est un attribut du droit de propriété ainsi que la perte par les associés concernés de leur qualité d’actionnaires majoritaires et les exigences des articles 29 et 33 de la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012, précitée. Toutefois, « l’impérieuse nécessité de sauver l’entreprise lorsqu’il n’existe plus d’autre solution que l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire et le fait que, par la « dilution forcée », l’ancien actionnaire majoritaire demeure le seul propriétaire de ses actions, conserve les droits qui naîtraient pour lui de la liquidation de la société et peut librement céder ses actions l’ont conduit à considérer que ces risques pouvaient être surmontés ».
Le rapporteur pour avis partage entièrement cette analyse. Le Gouvernement a entièrement revu le dispositif qui avait été soumis au Conseil d’État en mars dernier et les garanties et conditions qu’il a prévu limitent considérablement le risque d’inconstitutionnalité ou d’inconventionnalité. Sans reprendre toutes les conditions et garanties présentées précédemment, il convient de souligner en particulier que :
– le champ d’application du texte a été circonscrit aux entreprises de 150 salariés dont la cessation d’activité serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi ;
– la décision a lieu en présence du ministère public et après avoir entendu toutes les parties intéressées ;
– un droit de retrait est prévu pour les autres actionnaires et associés ;
– le tribunal statue sur la cession et la valeur des droits sociaux, qui est fixée par un expert nommé par le président du tribunal après une procédure contradictoire, dans un même jugement ;
– le prix des droits sociaux cédés ou souscrit doit être payé comptant ;
– les garanties d’exécution des engagements financiers des cessionnaires et souscripteurs ont été renforcées : ils doivent s’engager à conserver les titres un certain temps, une garantie bancaire peut être exigée par le tribunal, un commissaire à l’exécution vérifie le respect de leurs engagements lors de l’exécution du plan ;
– le non-respect de leurs engagements par les cessionnaires ou souscripteurs peut entraîner la résolution du plan, outre le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice, et le prix payé reste acquis.
Le délai de trois mois laissé aux actionnaires et associés pour présenter leur propre plan que la Commission a ajouté vient encore renforcer les garanties accordées à ces derniers.
Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement de la « dilution forcée » et de la directive 2012/30/UE, il convient de souligner que la compétence de l’assemblée générale pour décider de l’augmentation de capital, avec la possibilité de désigner un mandataire ad hoc à cette fin, est préservée, de même que le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’augmentation de capital en numéraire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dispositif proposé répond clairement à une nécessité publique ou d’intérêt général impérieux et s’accompagne d’un niveau élevé de garanties. Il satisfait par conséquent aux exigences constitutionnelles et européennes.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1611 et SPE1597 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1600 des mêmes auteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’article 70 prévoit une procédure exceptionnelle, très importante pour la vie des affaires. Lorsqu’une entreprise d’au moins 150 salariés dépose le bilan, ce qui provoque un trouble économique grave pour le bassin d’emploi concerné, il faut se demander si une modification de capital de l’entreprise peut apparaître comme une solution pour l’éviter et permettre la poursuite de l’activité après cession totale ou partielle de l’entreprise.
Depuis la réforme Badinter de 1985, c’est la première fois que le législateur s’intéresse à la situation des créanciers. Le présent article leur permettra de prendre le pouvoir dans l’entreprise si le propriétaire ne répond pas aux exigences fixées par le plan de redressement.
La possible transformation d’une créance sur l’entreprise en une part de son capital constitue une innovation majeure qui recueille l’assentiment général. Cependant, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont une approche restrictive de cette atteinte au principe de propriété. Aussi l’article pare-t-il aux objections en prévoyant, en cas de mise en œuvre de la procédure, une indemnisation juste et préalable des propriétaires, des certificats de garantie, mais aussi un délai pour que le propriétaire réponde aux exigences du plan de redressement.
L’innovation est si intéressante que j’ai reçu des demandes visant à ce qu’elle soit étendue. Le Conseil d’État a estimé que le seuil de 50 salariés était trop bas. Le Gouvernement propose donc de le fixer à 150. Mon amendement vise à l’établir à 100 salariés. Mais, au regard de la jurisprudence évoquée, ce seuil risque de mettre en péril cette solution novatrice et intéressante susceptible de donner une deuxième chance à l’entreprise. Aussi ai-je accepté d’y renoncer. À terme, cependant, il n’est pas douteux que nous nous orienterons dans cette direction.
L’amendement SPE 1600 est retiré.
La Commission adopte l’amendement de précision SPE1598 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE1599 des mêmes auteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Il est difficile d’établir qu’une modification de son capital soit « la seule solution » pour sauver une entreprise. Aussi l’amendement propose-t-il une rédaction moins restrictive : il suffirait d’établir qu’il s’agit d’« une solution ».
M. le ministre. Avis favorable.
Mme Karine Berger. Il s’agit en effet d’un article très important. S’il est bien mis en application, le redressement judiciaire pourra devenir une étape utile pour faire revivre une entreprise. Monsieur le ministre, quelles situations pourraient être débloquées par l’adoption de cette disposition, évitant une liquidation judiciaire ? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ? Y a-t-il des cas où les actionnaires d’une entreprise auraient bloqué la restructuration de sa dette ?
M. le ministre. Dans le cas de l’entreprise Arc International – qui n’est pas encore réglé –, cette procédure aurait bien facilité les choses. La famille qui en est propriétaire a eu, in fine, l’intelligence d’accepter de diluer ses parts de capital avec l’arrivée d’un fonds américain qui réinvestit à ses côtés, mais ce fut après un an de négociations difficiles. Un actionnariat familial peut parfois mettre une entreprise en danger plutôt que d’en ouvrir le capital. Le présent article consiste à faire primer l’intérêt des salariés et de l’entreprise sur celui des actionnaires historiques, quand le projet de société n’est plus porté par ces derniers.
La Commission adopte l’amendement SPE1599.
Puis elle en vient à l’examen de l’amendement SPE1601 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement vise à introduire un délai de trois mois après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, afin de laisser aux actionnaires de l’entreprise concernée un délai pour proposer leur propre plan. Je suis en effet très sensible au fait qu’il faut donner des garanties au Conseil constitutionnel quant au maintien du droit de propriété. Les droits de l’actionnaire déjà présent dans l’entreprise seront ainsi préservés. Cela s’inspire à la fois de la procédure américaine et de la procédure allemande, la première permettant au débiteur de proposer un plan de réorganisation pendant 120 jours, à l’issue desquels les créanciers peuvent, si le plan ne paraît pas de nature à sauver l’entreprise, présenter des propositions concurrentes.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1601.
Puis elle en vient à l’amendement SPE480 de Mme Laure de la Raudière.
M. le ministre. Avis défavorable. La mesure s’applique quand les actionnaires n’assurent plus le fonctionnement de l’entreprise, soit qu’ils ne le veuillent plus, soit qu’ils ne le peuvent plus. Elle doit donc être également ouverte à des plans concurrents à celui du débiteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE480.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1612 et SPE1602 à SPE1604 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE1605 des mêmes auteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement insère un nouvel alinéa qui améliore la coordination du droit de retrait des actionnaires minoritaires en cas de cession forcée avec le déroulement de la procédure, le droit de retrait s’exerçant simultanément à la cession forcée. Les intérêts de chacune des parties sont ainsi respectés.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1605.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1606 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1607 des mêmes auteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. Cet amendement vise à préciser que, en l’absence de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élus par ces derniers en application du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, qui est applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-9 du même code.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1607.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1608, SPE1609 rectifié et SPE1610 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Je tiens à souligner le caractère novateur, rénovateur et révolutionnaire de la disposition que nous venons d’examiner. Elle met fin à l’irresponsabilité illimitée d’actionnaires récalcitrants aux plans de redressement. Elle s’avérera ainsi profitable à la vie des entreprises, et partant à la survie et à la création d’emplois.
La Commission adopte l’article 70 modifié.
*
* *
Article 70 bis (nouveau)
(art. L. 653-8 du code de commerce)
Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements
Cet article additionnel est issu d’un amendement des rapporteurs, adopté par la Commission avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à éviter qu’un débiteur puisse être sanctionné pour ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, lorsque cette omission résulte d’une simple négligence de sa part.
En l’état du droit, l’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le non-respect de cette obligation peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L. 653-8 du code de commerce).
La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc proposé de limiter cette sanction aux cas d’omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner le dirigeant négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de 45 jours. À cette fin, le mot : « sciemment » est ajouté après les mots : « qui a omis » au troisième alinéa de l’article L. 653-8 du code.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1613 de M. Alain Tourret, rapporteur thématique, et des autres rapporteurs.
M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le non-respect de cette obligation peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, indépendamment du caractère fautif ou intentionnel, en vertu de l’article L. 653-8 du code de commerce.
La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc proposé de limiter cette sanction aux cas d’omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner le dirigeant négligent, qui aurait laissé s’écouler un délai de quarante-cinq jours.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1613.
*
* *
Article 70 ter (nouveau)
Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks
Cet article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement.
Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
– modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini par le chapitre II, du sous-titre II, du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini par le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire (180) ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession, et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock (1°) ;
– modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce (2°).
À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que la pratique de financement court-terme adossé à des actifs est très développée en Allemagne. Elle consiste pour les établissements de crédit à financer le besoin en fonds de roulement associé aux stocks, en prenant une garantie sur ces derniers. Ce financement des stocks consiste pour l’établissement de crédit à financer le stock de produits intermédiaires de l’entreprise après un abattement de 10 à 20 % sur sa valeur et déduction faite des montants dus aux fournisseurs. Une garantie est prise par l’établissement de crédit sur les stocks en cas de défaut. Ce dispositif permet un financement du besoin en fond de roulement de l’entreprise tout en limitant les risques pris par l’établissement de crédit. La pertinence de ce type de financement dépend de la nature du stock. Ce dernier doit être facilement valorisable, contrôlable et vendable.
Ce procédé, bien qu’existant en France, est aujourd’hui peu répandu : il est essentiellement pratiqué pour certains produits (produits agricoles, champagne, spiritueux) et comme outil de dernier recours pour les entreprises en difficultés (la garantie intervenant alors avec dépossession du stock et généralement des contraintes fortes sur son utilisation par l’entreprise).
En outre, il existe une incertitude juridique à la suite d’un arrêt du 19 février 2013 de la Cour de cassation (181) sur la portée du gage sur les stocks sans dépossession qui limite son utilisation par les établissements de crédit.
Compte tenu de ces éléments, le président de la République a annoncé lors des Assises du financement du 15 septembre 2014 que « la médiation du crédit travaillera à l’élaboration d’ici à la fin de l’année avec les banques d’un nouvel instrument de financement de la trésorerie des PME fondé sur les stocks, sur le modèle allemand ». Concernant les procédures collectives, il conviendra de revoir la place des différents gages au regard des autres créances et leur traitement.
Le présent article habilite le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires au développement de cet outil de financement des entreprises.
*
* *
Puis elle examine l’amendement SPE1964 du Gouvernement.
M. le ministre. L’amendement porte sur le gage des stocks. Les entreprises peuvent actuellement se financer grâce au crédit-bail, mais non, à la différence de ce qui se pratique en Allemagne, sur la base des stocks qu’elles détiennent – stocks de cuivre, de fer, etc. La section « Financement » du Conseil national de l’industrie, présidée par Mme Jeanne-Marie Prost, ancienne Médiatrice du crédit, plaide en faveur de ce mode de financement.
Le président de la République a annoncé, devant les Assises du financement, une réforme allant en ce sens. Il s’agirait cependant d’articuler deux régimes, celui du gage de meubles corporels et celui du gage de stocks, tous deux régis par des codes différents, à savoir le code civil et le code du commerce. Pour mener à bien cette opération délicate dans les meilleurs délais, le Gouvernement demande au Parlement de l’habiliter à légiférer en ce domaine par voie d’ordonnance. Le gage des stocks répondrait à un vrai besoin de financement des entreprises industrielles.
Mme Karine Berger. L’adoption de cet amendement aurait un impact sur la liquidation judiciaire et sur le redressement judiciaire. Le mécanisme envisagé est-il exclu, à l’instar du crédit-bail, de la suspension du paiement des créances en cas de liquidation judiciaire ? Conduirait-elle à ce que l’administrateur judiciaire, comme en Allemagne, puisse vendre lui-même les stocks au cours de redressement judiciaire ?
M. le ministre. Le texte s’inspire en effet du mécanisme du crédit-bail. Sur votre second point, nous travaillons à éviter une liquidation telle que celle que vous évoquez. Mme Prost a attiré notre attention sur ce sujet. Le Gouvernement a même envisagé – avant d’y renoncer pour ne pas bloquer le dispositif – de réformer le crédit-bail pour mieux protéger les entreprises. Nous voulons en tout état de cause éviter que les banques ne s’en prennent trop vite aux stocks, en préservant ce gage le plus longtemps possible d’une vente forcée.
M. le président François Brottes. Pareille vente ne fait en effet qu’accélérer la fin de l’entreprise.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE1613.
*
* *
Chapitre Ier
Exceptions au repos dominical et en soirée
I. LES RÈGLES LÉGISLATIVES ACTUELLES ENCADRANT LE TRAVAIL DOMINICAL
Le principe du repos hebdomadaire est garanti par la Constitution : en effet, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le repos hebdomadaire est l’une des garanties du droit au repos reconnu au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (182). En fixant la règle selon laquelle le repos est « en principe » donné le dimanche, le législateur a entendu opérer la conciliation entre la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
La règle du repos dominical a été consacrée par la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers et réaffirmée par la loi du 10 août 2009 dite loi « Mallié » (183). Le principe législatif du repos hebdomadaire dominical, qui figure à l’article L. 3132-3 du code du travail, souffre une série d’exceptions, dont la première tient évidemment à la nécessité d’assurer la continuité de certaines activités.
Certaines activités sont même autorisées à déroger à la règle du repos hebdomadaire : c’est le cas pour les travaux urgents, les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, les travaux dans les ports, débarcadères et stations, les activités saisonnières, les travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance, les travaux intéressant la défense nationale, les établissements industriels fonctionnant en continu, ainsi que les activités des gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux. Ces dérogations font la plupart du temps l’objet d’un encadrement assez strict. Elles ne concernent pas, en tout état de cause, les commerces.
A. POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL, DES DÉROGATIONS DE « DROIT COMMUN » AU REPOS DOMINICAL QUI EXISTENT DÉJÀ AUJOURD’HUI
S’agissant du repos dominical en tant que tel, outre la possibilité de déroger au repos dominical dans les activités industrielles pour organiser le travail en continu ou par l’instauration d’une équipe de suppléance (qui ne concernent donc pas les commerces de détail), il existe deux dérogations permanentes de droit au principe du repos dominical, qui ne nécessitent aucune démarche administrative particulière, pas plus qu’elles n’exigent de quelconques contreparties sociales au bénéfice des salariés concernés :
– la dérogation liée aux contraintes de production ou aux besoins du public ;
– et la dérogation applicable aux commerces de détail alimentaires.
Ces deux dérogations sont complétées par une troisième, également permanente et de droit, mais qui ne concerne que les commerces de détail situés dans une zone géographique déterminée, celle des zones dites touristiques.
1. Une première entorse à la règle du repos dominical : les dérogations sectorielles liées aux contraintes de production, de l’activité ou aux besoins du public
La première de ces dérogations, qui figure à l’article L. 3132-12, concerne « les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public », dont la liste est fixée à l’article R. 3132-5. Cette dérogation recouvre autant les abattoirs que les brasseries, les entreprises de journaux et d’information, les établissements industriels utilisant des fours, certains commerces comme les débits de tabac ou les fleuristes, les services de transports, les entreprises de télécommunications, les établissements de santé et l’ensemble des services de soins, les services de nettoyage et d’enlèvement des ordures ménagères, ou encore les activités récréatives, culturelles et sportives, de même que les activités de tourisme, les hôtels, cafés et restaurants, les garages, les activités de surveillance et de gardiennage, etc. Cette dérogation s’applique également aux établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, par exemple les boulangeries. La jurisprudence refuse toutefois de reconnaître les grandes surfaces commercialisant des produits alimentaires parmi les établissements de cette dernière catégorie, au motif qu’elles ne « fabriquent » pas les produits qu’elles commercialisent (Cass. soc., 25 juillet 1990).
Les dérogations sectorielles au repos dominical : l’exemple des jardineries, de l’ameublement et du bricolage
L’activité de jardinerie et de graineterie figure depuis 2005 parmi les activités autorisées à déroger au repos dominical, en complément des magasins de fleurs naturelles qui bénéficiaient d’ores et déjà de cette possibilité (184).
L’extension de cette autorisation aux établissements de commerce de détail d’ameublement est intervenue en 2008, par le biais d’un amendement sénatorial adopté dans le cadre de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Cette extension est questionnée par le rapport rendu par M. Jean-Paul Bailly au Premier ministre le 2 décembre 2013, qui préconise de l’exclure de la liste des secteurs d’activité autorisés à déroger au repos dominical. Le rapport note en effet que dans les faits, seuls les magasins d’ameublement situés en Île-de-France sont ouverts tous les dimanches de l’année, tandis que 59 départements sont couverts pour cette activité par un arrêté préfectoral de fermeture, à l’exception pour certains départements, de quelques dimanches par an. En outre, l’existence de cette dérogation sectorielle est facteur de distorsion de concurrence et conduit à des revendications sectorielles d’ouverture par contagion, comme par exemple dans le secteur de l’électroménager ou de l’équipement électronique.
S’agissant du bricolage, le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 avait autorisé temporairement, jusqu’au 1er juillet 2015, les établissements de commerce de détail de bricolage à déroger au principe du repos dominical. L’exécution de ce décret avait toutefois été suspendue par ordonnance du juge des référés du Conseil d’État le 12 février 2014, en raison précisément de son caractère temporaire : en effet, l’autorisation dérogatoire d’ouverture dominicale, prévue à l’article L. 3132-12 du code du travail, revêt un caractère permanent, dans la mesure où elle a vocation à satisfaire des besoins pérennes du public. Le caractère temporaire de la dérogation prévue par le décret était donc de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Un nouveau décret, n° 2014-302 du 7 mars 2014, a par conséquent été pris pour inscrire les commerces de ce secteur sur la liste des activités autorisées à déroger au repos dominical, cette fois sans limitation de durée. Saisi par plusieurs syndicats de la demande d’annulation de ce nouveau décret, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté cette demande, estimant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ce texte.
2. Les commerces du secteur alimentaire
La seconde dérogation, permanente et de droit, au principe du repos dominical, qui figure à l’article L. 3132-13 du code du travail, concerne les commerces de détail alimentaire, qui ont la possibilité d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures (185), sous réserve d’octroyer aux salariés un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Cette dérogation s’applique donc à l’ensemble des commerces de bouche (boucherie, fromagerie, etc.) qui ne sont pas concernés par la dérogation prévue à l’article R. 3132-5, c’est-à-dire qui ne fabriquent pas directement les produits alimentaires destinés à la consommation comme les boulangeries, aussi bien qu’aux commerces dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires, comme le précise l’article R. 3132-8 (supérettes, supermarchés).
3. Les commerces de détail de tout type situés dans une commune ou une zone touristiques
La troisième dérogation permanente et de droit figure à l’article L. 3132-25 et concerne l’ensemble des commerces de détail non alimentaires situés dans les « communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ».
La liste des communes et la définition du périmètre des zones touristiques concernées sont arrêtées par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des structures intercommunales concernées, lorsque celles-ci existent.
L’article R. 3132-20 dresse la liste des critères qui doivent être pris en compte pour figurer sur cette liste : les communes ou zones concernées doivent avant tout accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation ; il doit être tenu compte du rapport entre la population permanente et la population saisonnière, ainsi que du nombre d’hôtels, de gîtes, de campings, de lits et de places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles.
L’article L. 3132-25-5 prévoit explicitement que ne sont pas concernés par cette dérogation les commerces alimentaires régis par l’autorisation d’ouverture dominicale jusqu’à 13 heures prévue à l’article L. 3132-13.
Il existe aujourd’hui de l’ordre de 640 communes ou zones dites « touristiques », présentées par la carte suivante : la majorité d’entre elles se situe dans des communes de moins de 1 000 habitants ; seules 10 % d’entre elles sont situées dans des communes de plus de 10 000 habitants. Les périmètres de ces zones sont aujourd’hui très contrastés : la totalité de la commune de Bordeaux est ainsi classée en zone touristique, alors qu’à Paris, seules ont été classées sept petites zones touristiques limitées à quelques rues ou segments de rue.
RÉPARTITION ACTUELLE DES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES
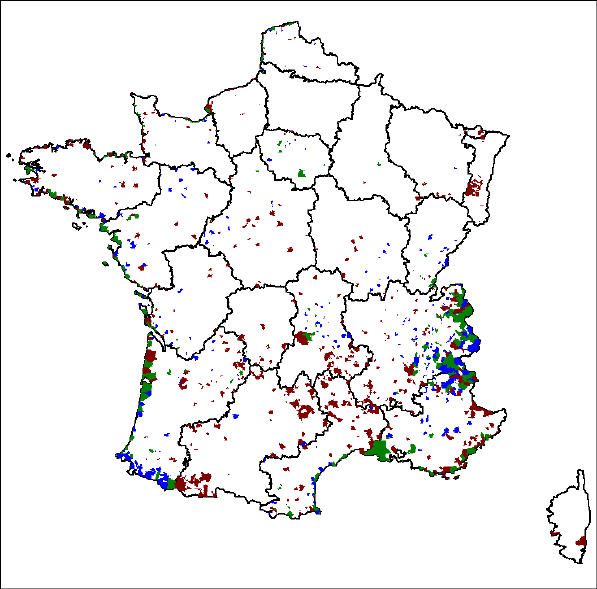
Les communes et zones touristiques concernées figurent en bleu et en vert sur la carte.
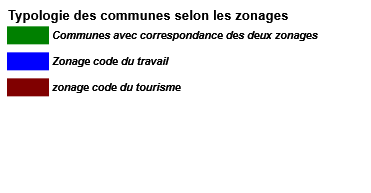
Source : ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
B. DES DÉROGATIONS SPÉCIFIQUES ET TEMPORAIRES DANS LE SECTEUR DU COMMERCE
Outre les trois modalités dérogatoires d’ouverture dominicale applicables à certains commerces de détail – contraintes de production, commerces alimentaires, zones touristiques -, il existe trois autres régimes d’ouverture dominicale, temporaires, qui doivent être sollicités auprès de l’autorité administrative et qui sont soumis à des contreparties sociales en faveur des salariés. Il s’agit :
– de l’autorisation préfectorale accordée aux commerces dont la fermeture porte préjudice au public ou atteinte à leur fonctionnement normal ;
– de celle accordée aux commerces situés dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) ;
– et enfin, de l’autorisation municipale d’ouverture des commerces cinq dimanches par an.
1. L’autorisation préfectorale donnée à un établissement dont la fermeture dominicale porterait préjudice au public ou atteinte à son fonctionnement normal
Aux termes de l’article L. 3132-20 du code du travail, le préfet peut autoriser un établissement à ouvrir ou exercer son activité le dimanche dans le cas où la fermeture ou l’absence d’activité ce jour-là « serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ». Le repos peut alors être autorisé soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, un autre jour que le dimanche, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine, ou encore par roulement à tout ou partie des salariés.
Une circulaire ministérielle (186) est venue préciser les notions de « préjudice du public » et d’« atteinte au fonctionnement normal » d’un établissement :
– La notion de préjudice du public doit s’entendre comme « l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, ou correspondent à des activités familiales ou de loisirs, qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine ». Il convient donc, pour évaluer ce préjudice, de tenir compte de la nature de l’activité exercée, de celle des produits vendus ainsi que de la clientèle. En outre, le préjudice doit être réel et ne peut pas relever de préférences ou de facilités ;
– Pour estimer l’atteinte au fonctionnement normal d’un établissement, il convient de tenir compte de trois éléments constitutifs des conditions de fonctionnement d’un établissement : la comparaison du chiffre d’affaires réalisé le dimanche avec celui des autres jours de la semaine ; l’impossibilité d’un report suffisant de clientèle sur les autres jours de la semaine ; et enfin, l’implantation géographique et commerciale du magasin. En tout état de cause, l’atteinte au fonctionnement de l’établissement doit être liée à la spécificité de l’activité exercée et son importance doit mettre en cause la survie même de l’entreprise.
S’agissant des commerces de détail, cette modalité dérogatoire a principalement une vocation de lutte contre les distorsions de concurrence entre commerces d’un même secteur exerçant leur activité sur une même zone de chalandise. En effet, en vertu de l’article L. 3132-23, le préfet peut étendre cette autorisation à plusieurs ou à la totalité des commerces de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle. A contrario, à la demande de la majorité des établissements intéressés de la localité, ces autorisations d’extension peuvent être retirées. Les recours exercés contre l’autorisation initiale d’ouverture ou contre les arrêtés d’extension de cette autorisation ont un effet suspensif (article L. 3132-24).
L’autorisation préfectorale de déroger au principe du repos dominical ne peut être accordée qu’en présence d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum (article L. 3132-25-3). Dans le cas où un accord collectif a été conclu, celui-ci doit prévoir « les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées », la loi ne fixant pas de plancher en la matière. En l’absence d’accord collectif, dans le cas où l’autorisation est accordée sur le fondement d’une décision unilatérale de l’employeur, celle-ci est prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés. En tout état de cause, cette décision unilatérale de l’employeur fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en matière d’emploi ou en faveur des publics en difficulté ou des personnes handicapées : s’agissant des contreparties, elles sont au moins équivalentes à un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Dans le cas où un accord collectif est conclu postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par la décision unilatérale.
Aux termes de l’article L. 3132-25-4, l’autorisation préfectorale de déroger au repos dominical dans ce cas de figure est accordée pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Cette procédure de dérogation au principe du repos dominical suppose le respect de la volonté des salariés : en l’occurrence, le travail dominical ne peut être mis en œuvre qu’après accord écrit du salarié. Elle est assortie d’une protection spécifique du salarié qui oppose un refus, autant à l’embauche que pour le salarié en poste qui bénéficie d’une protection contre toute mesure discriminatoire, qu’enfin, contre son licenciement abusif.
Dès lors que l’autorisation de déroger au repos dominical se fonde sur un accord collectif, ce dernier doit fixer les conditions de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. En l’absence d’accord, l’employeur est tenu de demander chaque année aux salariés qui travaillent le dimanche s’ils souhaitent bénéficier d’une priorité pour occuper un emploi n’occasionnant pas de travail dominical dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. Il doit également à cette occasion informer le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche si tel est son souhait : dans ce cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. Enfin, le salarié peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité d’occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. En présence d’une décision unilatérale de l’employeur, le salarié conserve la possibilité de refuser de travailler trois dimanches de son choix par an, sous réserve d’en informer préalablement l’employeur en respectant un délai d’un mois.
2. La dérogation au titre des PUCE
La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 dite « loi Mallié » a mis en place une possibilité supplémentaire pour les commerces de détail non alimentaires de déroger à la règle du repos dominical, par le biais de la mise en place des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » (PUCE), dans les unités urbaines de plus de un million d’habitants. La notion de PUCE est définie à l’article L. 3132-25-1 comme une zone caractérisée « par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre ».
La procédure de délimitation d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel est fixée à l’article L. 3132-25-2 : la décision appartient au préfet de région, qui se fonde en premier lieu sur les résultats du recensement de la population.
La demande de délimitation du PUCE doit émaner du conseil municipal, et le préfet arrête ce périmètre « au vu des circonstances particulières locales » et « d’usages de consommation dominicale » ou « de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ». La délimitation du périmètre intervient après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre. Le préfet doit également préalablement recueillir l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et n’appartenant pas à l’une des structures intercommunales consultées, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial situé sur leur territoire.
Les conditions d’autorisation d’ouverture dominicale accordées aux commerces non alimentaires (187) situés sur ce périmètre sont les mêmes que pour la dérogation accordée pour les commerces dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement : elles supposent la conclusion d’un accord collectif ou, le cas échéant, une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise et des délégués du personnel et approuvée par référendum auprès des salariés concernés, et fixant les contreparties sociales accordées aux salariés. Les dispositions relatives à la protection de la volonté du salarié et de son éventuel refus, ainsi que la procédure qui encadre l’éventuel souhait du salarié de revenir sur sa décision, font l’objet du même encadrement que pour cette première dérogation temporaire.
L’article L. 3132-25-6 précise que l’autorisation donnée à un commerce situé en PUCE de déroger au principe du repos dominical est valable pour une durée de cinq ans. Cette autorisation est accordée soit individuellement, à un commerce qui en fait la demande, soit collectivement, pour des commerces ou services exerçant la même activité. Elle est, en vertu de l’article L. 3132-25-4 accordée après recueil par le préfet de l’avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Actuellement, les unités urbaines concernées sont Paris, Aix-Marseille, Lyon et Lille. Il existe 41 PUCE au total, mais aucun d’entre eux n’est situé dans l’agglomération lyonnaise, et 38 d’entre eux sont situés en Île-de-France, comme l’illustre la carte suivante.
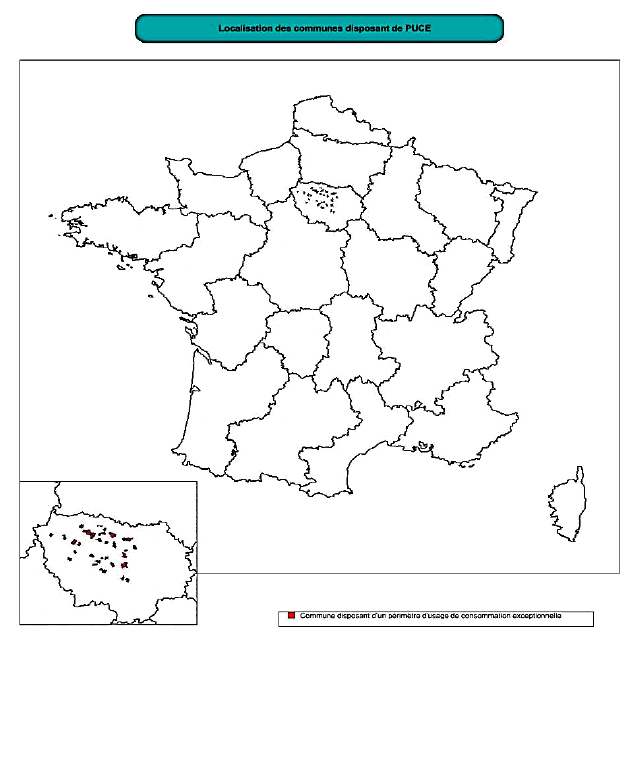
Source : ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
3. Les 5 dimanches du maire
Enfin, une dernière procédure de dérogation au repos dominical, prévue par l’article L. 3132-26, existe pour l’ensemble des commerces de détail : le maire peut en effet accorder la suppression du repos dominical pour cinq dimanches par an au maximum. À Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
L’article L. 3132-27 prévoit que chaque salarié privé à ce titre de repos dominical se voit accorder une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. L’arrêté municipal (ou préfectoral, à Paris) précise dans quelles conditions ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos. S’il est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
L’article R. 3132-21 précise que l’arrêté municipal ou, à Paris, l’arrêté préfectoral, est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés.
Le maire n’a donc aucune obligation de prendre cet arrêté et n’est d’ailleurs soumis à aucun délai en la matière. Ainsi, les municipalités de l’agglomération nantaise refusaient jusqu’alors de prendre de tels arrêtés autorisant l’ouverture dominicale des commerces entre un et cinq dimanches par an. Ce n’est qu’à la toute fin de l’année 2014 que, sur le fondement d’un accord territorial conclu entre les partenaires sociaux de la métropole nantaise, les maires des communes concernées ont autorisé l’ouverture des commerces de détail deux dimanches consécutifs avant Noël de 14 heures à 19 heures. À l’inverse, de nombreuses autres communes autorisent l’ouverture dominicale cinq dimanches par an. À Paris, les cinq dimanches autorisés sont concentrés aux mois de décembre et janvier ou à l’été, avec quelques spécificités pour les commerces de certains secteurs, comme la chocolaterie, autorisée à ouvrir pendant la période pascale.
C. LE MÉCANISME DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE FERMETURE
L’ensemble de ces procédures d’ouverture dérogatoire des commerces le dimanche peut être contrecarré par un mécanisme de fermeture par arrêté préfectoral des commerces relevant d’une profession et d’une zone géographique déterminées. Ce dispositif, prévu à l’article L. 3132-29, permet au préfet d’ordonner par arrêté la fermeture dominicale de ces commerces en présence d’un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs de cette profession et de cette zone géographique.
Cette procédure de fermeture a vocation à éviter un phénomène de concurrence déloyale entre des commerces d’une même zone géographique relevant d’une même activité. En effet, le principe du repos dominical ne valant que pour les salariés, un commerçant peut toujours ouvrir son établissement le dimanche sans y employer de personnel, et ce, a fortiori, s’il s’agit d’un petit commerce qui n’emploie pas de salariés ou qui est exclusivement tenu par le commerçant et des membres de sa famille (188). Il s’agit dans ce cas d’organiser les conditions d’une concurrence loyale au sein d’une profession.
Le secteur de la boulangerie est particulièrement concerné par ce type de fermeture : ainsi, comme l’indique le rapport rendu par M. Jean-Paul Bailly (189) au Premier ministre, la quasi-totalité des départements sont couverts par un arrêté préfectoral de fermeture dans le secteur de la boulangerie, soit que les commerces soient tenus de fermer un jour par semaine, à leur convenance, soit que ce jour de fermeture – dominical ou lunaire, par exemple – leur soit imposé. À Paris, un arrêté du 15 novembre 1990, impose ainsi un jour de fermeture obligatoire aux commerces de bouche.
Dans le même ordre d’idées, afin d’organiser une concurrence loyale dans un secteur d’activité pour lequel l’ouverture dominicale se révèle non rentable appliquée dans sa globalité, l’arrêté préfectoral de fermeture permet d’appliquer la même règle à l’ensemble des commerces concernés, en interdisant ainsi à un seul commerce d’ouvrir avec une rentabilité qui serait dès lors d’autant plus importante qu’il serait le seul à ouvrir. Le secteur de l’ameublement illustre cette problématique de fermeture imposée, à la suite de contentieux entre professionnels qui s’estimaient victimes d’une concurrence déloyale.
D. LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DE LA LÉGISLATION RELATIVE AU REPOS DOMINICAL
Un salarié privé de repos dominical de manière illégale peut prétendre à des dommages-intérêts devant le conseil des prud’hommes. Le juge reconnaît également aux organisations syndicales de salariés et aux organisations représentatives d’employeurs la capacité à ester en justice : une organisation syndicale de salariés peut ainsi se porter partie civile dans une instance contre un employeur pour une infraction à la règle du repos dominical, dans la mesure où les faits ont entraîné un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. crim., 23 juillet 1980) ; de la même manière, un syndicat d’employeurs a aussi qualité pour agir, dès lors que la violation par certains employeurs de la règle du repos dominical rompt l’égalité entre les employeurs d’une même profession et porte ainsi atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. ass. Plén., 7 mai 1993) : c’est le tribunal de grande instance qui connaît des actions des syndicats engagées sur le fondement de la défense des intérêts de la profession.
Outre des sanctions civiles, le non respect de la législation relative au repos dominical peut entraîner des sanctions pénales, qui relèvent des tribunaux de police : dans le cas d’une telle infraction constatée par l’inspecteur du travail, celui-ci n’a pas à remettre un exemplaire du procès-verbal au contrevenant, passible d’une amende pour contravention de la 5ème classe, égale au plus à 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Il convient de noter que l’amende est appliquée autant de fois que qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (article R. 3135-2).
Les sanctions pour non respect du repos dominical se cumulent avec celles infligées pour la violation d’un arrêté préfectoral de fermeture, même si elles ont été commises le même jour (Cass. crim., 16 mars 2010).
La fermeture d’un établissement le dimanche sous astreinte peut également être ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance (TGI), saisi par les organisations syndicales ou d’employeurs ou par l’inspecteur du travail. En vertu de l’article L. 3132-31, celui-ci peut en effet saisir en référé le président du TGI « pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 ». Le juge reconnaît également à une entreprise qualité pour agir en référé si un concurrent fait travailler ses salariés le dimanche illégalement : elle a en effet un intérêt légitime à faire cesser cette situation qui lui porte préjudice (Cass. soc., 30 mai 2012).
Dans les faits, il est très difficile pour l’inspection du travail d’assurer un contrôle satisfaisant du respect des règles relatives au repos dominical, principalement en raison de la multiplicité des régimes et de la complexité des règles applicables : en effet, l’inspecteur du travail doit d’abord s’assurer que l’établissement en question a bien le droit d’ouvrir et, le cas échéant, qu’il a bien le droit d’employer des salariés. En présence d’un petit commerce « familial », il reste très difficile de faire le départ entre un salarié et un aide familial.
II. LA LÉGISLATION RELATIVE AU TRAVAIL NOCTURNE
Le travail de nuit est régi par la section III du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, qui retrace l’ensemble des règles applicables en matière de durée du travail.
Le travail de nuit est rigoureusement encadré par la loi : en effet, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (article L. 3122-32 du code du travail).
Contrairement aux règles encadrant le repos dominical, aucune disposition législative ne réglemente l’ouverture nocturne des commerces, la loi ne traitant de cette question que sous le prisme du travail nocturne et de la protection du travailleur nocturne. Autrement dit, aucune limite n’est de ce point de vue imposée aux commerçants qui n’emploient pas de main-d’œuvre.
Aux termes de l’article L. 3122-29 du code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Cette amplitude horaire est en vigueur depuis la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (190). Avant 2001, l’ancien article L. 213-2 du code du travail fixait le travail de nuit entre 22 heures et 5 heures.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais incluant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être prévue :
– par convention ou accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ;
– ou, à défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’entreprise le justifient, sur autorisation de l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
Le recours au travail de nuit doit s’accompagner de contreparties au bénéfice des salariés concernés, sous la forme de repos compensateur rémunéré et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (article L. 3122-39). Le travailleur de nuit est en outre soumis à une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit et, par la suite, au minimum tous les six mois (article L. 3122-42). On remarquera donc que le principe d’une compensation salariale n’est pas obligatoire dans le cadre du régime du travail de nuit.
Toute mesure de mise en place du travail de nuit ou de modification de son organisation est subordonnée à la consultation du médecin du travail, conformément à l’article L. 3122-38.
L’article L. 3122-31 définit le travailleur de nuit comme le travailleur qui :
– soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la nuit ;
– soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit, ces données étant fixées par convention ou accord collectif étendu. Il s’agit, à défaut, du salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de douze mois consécutifs (article R. 3122-8).
Aux termes de cette définition, seuls bénéficient donc des protections prévues par le droit du travail les salariés entrant dans la catégorie des « travailleurs de nuit » et non tous les salariés effectuant des heures de travail la nuit, occasionnellement par exemple.
Les articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail fixent les durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, qui peuvent être effectuées par les travailleurs de nuit.
S’agissant de la durée quotidienne de travail, elle ne peut a priori excéder huit heures. Il peut être dérogé de deux manières à cette durée, dans la limite de douze heures :
– soit, aux termes de l’article R. 3122-9, par convention ou accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement, pour des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié ; pour des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; ou encore pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;
– soit, en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail, donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
S’agissant de la durée hebdomadaire de travail, elle ne peut a priori excéder quarante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Cette durée peut être fixée à quarante-quatre heures par convention ou accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient. Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Dans tous les cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne doit être accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées, ni rémunéré. Enfin, des temps de pause doivent obligatoirement être organisés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-33, la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement. Ladite convention ou ledit accord doit comporter les justifications du recours au travail de nuit et définir les types d’emplois susceptibles d’être concernés (circulaire DRT 9 du 5 mai 2002). Doivent également être précisées, aux termes de l’article L. 3122-40 :
– les contreparties, déjà évoquées, offertes aux salariés ;
– les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit ;
– les mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment concernant les moyens de transport ;
– les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;
– l’organisation des temps de pause.
2. À défaut d’accord, une mise en place du travail de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail
À défaut d’accord, l’article L. 3122-36 prévoit que l’autorisation d’affecter des salariés à des postes de nuit peut être demandée par l’employeur à l’inspecteur du travail, sous réserve d’avoir toutefois engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord dans un délai maximum de douze mois précédant cette demande.
Le caractère loyal et sérieux de l’engagement de négociations sur le travail de nuit suppose que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; leur ait communiqué les informations nécessaires pour les mettre en mesure de négocier en toute connaissance de cause ; et enfin, ait répondu aux éventuelles propositions formulées par les organisations syndicales (article L. 3122-36).
Dans le cas d’une absence d’accord et d’une demande formulée par l’employeur, l’autorisation de l’inspecteur du travail est conditionnée à la vérification par ce dernier :
– des contreparties accordées aux salariés concernés, prévues par l’article L. 3122-39 ;
– et de l’existence de temps de pause.
La demande d’autorisation formulée par l’employeur doit justifier de manière circonstanciée les contraintes propres à la nature de l’activité ou au fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire le travail de nuit, le caractère loyal et sérieux de l’engagement préalable de négociations, l’existence de contreparties et de temps de pause, ainsi que la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Elle doit être accompagnée de l’avis des délégués syndicaux et du comité d’entreprise, ou des délégués du personnel, s’il en existe. À défaut de représentants du personnel, un document attestant une information préalable des salariés doit être joint, qui doit être adressé à l’inspecteur du travail dont relève l’établissement employant les salariés concernés.
Conformément à l’article R. 3124-15, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe – soit 1 500 euros, voire 3 000 euros en cas de récidive -, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.
B. UNE JURISPRUDENCE RÉCENTE QUI EXCLUT LE RECOURS AU TRAVAIL NOCTURNE DANS LES COMMERCES DE DÉTAIL
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont, par deux décisions rendues au cours de l’année 2014, mis un terme à la « chronique contentieuse » déclenchée en 2012 contre le recours au travail nocturne de l’établissement de parfumerie Sephora situé sur l’avenue des Champs-Élysées.
Dans sa décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, le législateur (…) a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 46 (191) ». Autrement dit, les dispositions de l’article L. 3122-32 mises en cause par la société Sephora ne méconnaissent pas la liberté d’entreprendre.
Dans son arrêt rendu le 24 septembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel et confirmé sur ce point l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (192) , en jugeant que le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit « s’apprécie au regard du secteur d’activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n’existe pas d’autres possibilités d’aménagement du temps de travail, ce qui n’est pas le cas des commerces de parfumerie » ; « l’attraction commerciale liée à l’ouverture de nuit de l’établissement, qui n’offre pas des services d’utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique au sens de l’article L. 3122-32 du code du travail » ; « que la société Sephora ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l’article L. 3122-32 du code du travail, lesquelles, applicables à l’ensemble des salariés, sont d’ordre public » ; qu’il n’est, enfin, pas possible de se prévaloir d’un accord collectif organisant les modalités du recours au travail de nuit, un accord ne pouvant « déroger aux dispositions protectrices d’ordre public (…) et suppose pour être conclu, que les conditions du recours au travail de nuit énoncées à l’article L. 3122-32 soient réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
Par ces décisions, le juge constitutionnel, comme le juge judiciaire, ferment a priori définitivement la porte à toute possibilité pour un commerce de détail de recourir au travail nocturne, confirmant en cela la jurisprudence judiciaire antérieure. En effet, la Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que « l’activité de commerce alimentaire n’est pas inhérente au travail de nuit (…). Les caractéristiques de cette activité n’exigent pas davantage, même si elle répond à un besoin d’utilité sociale, la nécessité de recourir pour y satisfaire au travail de nuit (193) ». Les mêmes observations valent également pour la vente de consoles de jeux vidéo, des opérations promotionnelles, ainsi que pour l’habillement ou encore la réparation en urgence de produits informatiques.
III. LES INCOHÉRENCES LIÉES AUX DISPOSITIFS LÉGISLATIFS ACTUELS
A. EN MATIÈRE DE TRAVAIL DOMINICAL, UNE MULTIPLICITÉ DE DISPOSITIFS SOURCE D’UNE INUTILE COMPLEXITÉ
Le paysage juridique des dérogations au principe du repos dominical est aujourd’hui particulièrement inextricable et source d’insécurité juridique. En effet, la coexistence de six catégories spécifiques d’autorisations de déroger au repos dominical n’est guère satisfaisante : à côté des dérogations sectorielles, du cas particulier des commerces alimentaires ou encore des commerces situés en zones touristiques, toutes permanentes et de droit, existent des dérogations soumises à conditions : celle relative aux établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou porterait atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, celle applicable aux périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), ou encore, celle des « cinq dimanches du maire ». Ces exceptions relèvent de procédures différentes – selon que la dérogation soit de droit ou soumise à l’autorisation préfectorale ou municipale - ; les autorisations sont accordées pour des durées différentes – permanentes, cinq dimanches par an, quelques dimanches par an - ; les autorisations peuvent être individuelles ou collectives, soumises ou non à un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur, soumises ou non à la fixation de contreparties sociales au bénéfice des salariés ; enfin, elles peuvent varier en fonction du secteur géographique ou du secteur professionnel. Si une prise en compte de ces spécificités sectorielles et géographiques est nécessaire, le système actuel pèche surtout par l’imbrication de l’ensemble de ces critères, de laquelle il résulte qu’il y a quasiment autant de régimes applicables que de spécificités propres à chaque commerce !
Le système actuel entraîne une série d’effets néfastes, mis en évidence par le rapport de M. Jean-Paul Bailly, et qu’il convient d’examiner rapidement.
● Tout d’abord, le périmètre des dérogations sectorielles au repos dominical, prévues à l’article R. 3132-5 du code du travail, qui a fait l’objet d’élargissements dans les dix dernières années, est générateur de contentieux : après l’extension aux jardineries en 2005, l’autorisation d’ouverture dominicale a été élargie au secteur de l’ameublement en 2008, tandis que l’activité de bricolage en bénéficie depuis le 1er janvier 2014. Il convient de manier avec prudence la liste de ces activités dérogatoires : en effet, si la jardinerie traite du vivant et nécessite donc une activité continue, c’est également le cas des animaleries qui ne sont pourtant pas autorisées à déroger au repos dominical pour l’heure. L’élargissement au secteur de l’ameublement pose question : en effet, il génère une multiplication des revendications sectorielles en faveur de l’ouverture dominicale, que ce soit dans l’électroménager, l’équipement électronique et, par extension, les biens culturels. Pour ces derniers, l’existence d’une forte concurrence de la part des commerces en ligne pour lesquels les achats peuvent être réalisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des délais de livraison souvent inférieurs à 48 heures, invite à la réflexion.
En outre, l’autorisation donnée en 2008 est venue consacrer des situations antérieures d’illégalité de certaines grandes enseignes (en l’espèce, nordiques) qui ouvraient déjà le dimanche malgré l’interdiction qui prévalait avant cette date. L’autorisation permanente d’ouverture dominicale finalement donnée au bricolage en 2014 solde également une suite de contentieux qui ont affecté ce secteur assez concurrentiel : en effet, dans la situation antérieure, les magasins de meubles situés dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) pouvaient ouvrir, alors que d’autres magasins, situés hors des limites de ce périmètre, n’y étaient pas autorisés. Plusieurs contentieux ont ainsi opposé des organisations syndicales à des enseignes de bricolage, pour non respect de la législation sur le repos dominical, et des enseignes de bricolage entre elles, pour concurrence déloyale. Le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, qui procède à l’inscription des commerces de bricolage sur la liste des activités autorisées à déroger au repos dominical, vient donc a priori clore le sujet.
● La mise en place, par la loi du 10 août 2009, des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) n’a en réalité que contribué à brouiller davantage le paysage de la réglementation applicable en matière de repos dominical. En effet, ces périmètres ont été délimités sur la base d’« habitudes de consommation dominicale », c’est-à-dire d’usages constatés, autrement dit, la plupart du temps, d’ouvertures illégales, comme le montre le rapport de M. Jean-Paul Bailly. Autrement dit, la loi est venue en quelque sorte récompenser les « mauvais élèves », qui n’avaient pas respecté les règles alors en vigueur. En outre, les critères de délimitation de ces périmètres apparaissent particulièrement flous, puisqu’ils reposent sur ces habitudes de consommation constatées, et doivent être suffisamment éloignés des centres villes, c’est-à-dire de la clientèle concernée. Le croisement des autorités décisionnaires pour la délimitation des PUCE – initiative et proposition de délimitation de la zone par le maire, acceptation ou refus du préfet – est également potentiellement générateur de conflictualité, voire de contentieux.
● Si la légitimité de l’existence de zones touristiques, dans lesquelles les règles d’ouverture des commerces doivent être plus flexibles, est incontestable, le système actuel des zones touristiques n’est guère satisfaisant. En effet, les modalités qui président à la délimitation de ces zones sont floues : le périmètre est délimité par le préfet sur proposition du maire, sur la base de critères comme le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d’hôtels, de gîtes, de campings, etc., ou le nombre des places de stationnement. Le résultat en est une coexistence de zones dites touristiques à géométrie variable, qui peuvent aller de la totalité de la surface d’une commune aussi importante que celle de Bordeaux, à une seule rue dans des quartiers par ailleurs éminemment touristiques, comme dans certains quartiers parisiens. Dans la mesure où le travail dominical dans les commerces situés en zone touristique n’implique aucune contrepartie sociale obligatoire en faveur des salariés, il en résulte également une potentielle différence de traitement entre des salariés d’une même enseigne, selon que le commerce se situe en PUCE ou en zone touristique. On peut également, en dernier ressort, s’interroger, à l’instar du rapport rendu par M. Jean-Paul Bailly, sur la pertinence de classer la Défense en zone touristique, alors qu’il s’agit évidemment d’une zone commerciale : l’absence de contreparties sociales obligatoires pour les salariés apparaît dans ce cas comme une réelle injustice, voire un contournement de la loi.
● La multiplicité des catégories de dérogations au repos dominical se traduit également par la coexistence de différents régimes de compensations offertes aux salariés amenés à travailler le dimanche. Dans le cadre des dérogations de droit et permanentes d’ouverture dominicale – pour les établissements soumis à des contraintes de production, d’activité ou pour répondre aux besoins du public ; pour les commerces alimentaires ; et enfin, pour les commerces situés en zone touristique -, il n’existe aucune contrepartie obligatoire en faveur des salariés. Cela ne signifie pas que dans la pratique, aucun salarié dans ces cas de figure ne bénéficie de compensations, puisque de telles contreparties sont parfois négociées par les partenaires sociaux ; celles-ci ne relèvent toutefois d’aucune obligation légale. Dans le cas des PUCE et des dérogations préfectorales au titre du préjudice au public ou de l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, la loi prévoit que des contreparties sont soit fixées librement par accord collectif, soit, en l’absence d’accord, la loi fixe le niveau plancher des contreparties qui doivent être prévues dans le cadre de la décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, à savoir un repos compensateur et une rémunération doublée. Enfin, dernier régime applicable, et le plus protecteur : dans le cadre des cinq dimanches du maire, la loi prévoit expressément que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent en temps et d’un doublement de leur rémunération.
Ainsi, comme le montre le rapport de M. Jean-Paul Bailly, un magasin de chaussures peut ouvrir chaque dimanche sans offrir de contrepartie quelconque aux salariés, s’il est situé dans une zone touristique ; il peut également ouvrir tous les dimanches sous condition d’octroyer des contreparties sociales aux salariés, s’il est situé dans un PUCE et obtient une autorisation préfectorale à ce titre, ou s’il obtient une dérogation individuelle sectorielle ; enfin, s’il n’est situé dans aucune zone spécifique et n’a pas d’autorisation d’ouverture sectorielle, il ne pourra ouvrir que cinq dimanches par an moyennant l’octroi de contreparties sociales aux salariés. Il est évident que la multiplicité des cas de figure nuit à la concurrence en ne contribuant pas à mettre les commerces sur un pied d’égalité. Pire encore : des salariés de commerces exerçant des activités similaires, ou même relevant de la même enseigne, peuvent être soumis à un régime différent, en matière de rémunération comme de repos compensateur, en fonction du type de dérogation qui prévaut pour le commerce qui les emploie.
● Enfin, le régime des autorisations préfectorales individuelles d’ouverture en cas d’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou lorsque la fermeture serait préjudiciable au public, est clairement utilisé à des fins qui ne correspondent pas à l’esprit qui a présidé à la mise en place de cette règle dérogatoire. En effet, cette possibilité a théoriquement vocation à répondre à des problèmes ponctuels, tels que la nécessaire continuité d’un chantier, comme l’indique le rapport de M. Jean-Paul Bailly. Or, elle est aujourd’hui quasiment exclusivement utilisée pour répondre aux problèmes de distorsion de concurrence induits par les autres régimes dérogatoires, en l’occurrence les PUCE et les zones touristiques. Autrement dit, pour répondre aux effets négatifs d’une règle dérogatoire d’ouverture dominicale, est mobilisée une nouvelle règle dérogatoire d’ouverture dominicale, qui ne fait in fine que reporter le problème de distorsion de concurrence identifié.
Les principales préconisations du rapport « Bailly »
Le rapport rendu par M. Jean-Paul Bailly au Premier ministre le 2 décembre 2013 procède à une analyse de la diversité des situations existantes dans notre pays en matière de réglementation dérogatoire au repos dominical ; il conclut sur une série de propositions destinées à simplifier les règles et à éliminer les actuels facteurs de conflictualité sur ce sujet, tout en répondant aux évolutions récentes de la société, dans le respect de la spécificité du dimanche.
•Les commerces alimentaires
Le rapport préconise tout d’abord de maintenir inchangées les règles encadrant l’ouverture dominicale jusqu’à 13 heures des commerces à prédominance alimentaire, les spécificités de ces commerces pouvant justifier l’absence de compensations salariales ; en tout état de cause, l’introduction d’une telle obligation de contreparties salariales reviendrait clairement à mettre en danger le secteur des commerces alimentaires, dont la grande majorité est constituée de très petits commerces, en particulier les commerces de bouche.
•Les dérogations sectorielles
De la même manière, pour les activités autorisées à déroger au repos dominical en raison de leurs contraintes de production ou d’activité, ou des besoins du public, l’absence de contreparties sociales ne semble pas devoir être remis en cause, l’ensemble de ces activités correspondant (à l’exception du secteur de l’ameublement (194)), soit à des activités dont le fonctionnement le dimanche est indispensable (santé, sécurité, transports, etc.), soit à des activités répondant à des besoins du public, en particulier le dimanche (loisirs, sports, culture, restauration, etc.).
S’agissant de ces dérogations sectorielles, le rapport écarte tout élargissement de la liste des activités autorisées à déroger au repos dominical, notamment à l’électroménager ou au secteur des biens culturels, considérant que le risque de contagion d’autres secteurs est trop grand, eu égard à l’interpénétration croissante des activités. En conséquence, l’exclusion de l’ameublement de la liste des activités dérogatoires semble s’imposer. La même question se pose alors aussi pour le bricolage, pour lequel l’autorisation de déroger a été prise après la publication du rapport – d’abord de manière temporaire dans le cadre du décret du 30 décembre 2013, puis de manière permanente, par un décret du 7 mars 2014. Le rapport se contente d’envisager la mise en place d’une procédure d’ouverture spécifique aux secteurs de l’équipement de la maison (ameublement, bricolage et électroménager) et des biens culturels, qui serait obligatoirement assortie de compensations aux salariés, contrairement aux commerces alimentaires et aux établissements pour lesquels il existe une nécessité de continuité de fonctionnement ou des besoins du public. Cette hypothèse n’est finalement pas retenue, en raison de l’hétérogénéité des besoins d’ouverture sur le territoire national : en effet, cette dérogation spécifique aurait surtout l’avantage de répondre à une problématique francilienne ; d’autre part, elle constituerait une véritable brèche vers la généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche.
Le rapport préconise donc de « recentrer la liste des secteurs autorisés à déroger de plein droit au repos dominical sur les activités essentielles au fonctionnement de la société, qui revêtent une utilité sociale particulière ou qui sont liées à des processus opérationnels », en en excluant l’ameublement, et rigoureusement donc aussi, le bricolage (son inclusion dans cette liste étant intervenue postérieurement à la publication du rapport).
•Les « dimanches du maire »
Le rapport propose ensuite de porter de cinq à douze le nombre des « dimanches du maire », estimant que cette extension permettrait de répondre aux périodes de forte consommation, qui ne se limitent pas forcément à la période qui précède Noël. Sept dimanches relèveraient de la décision du maire et les cinq dimanches supplémentaires relèveraient de l’initiative des commerces eux-mêmes, sous réserve de l’autorisation de la municipalité. Cette extension est également cohérente avec le souci de ne pas « banaliser » l’ouverture dominicale des commerces, dans la mesure où les compensations offertes aux salariés dans le cadre des actuels « cinq dimanches du maire » sont les plus élevées.
•Les zones touristiques et les zones commerciales
Le rapport préconise la suppression des actuelles zones touristiques et périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) au profit d’un dispositif unique d’ouverture dérogatoire moyennant contreparties salariales dans des périmètres définis dans le cadre d’un dialogue territorial, et dont la mise en place dans les commerces serait subordonnée à la conclusion d’un accord d’établissement, d’entreprise, de site ou de branche ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur approuvée par les salariés, qui fixerait les contreparties sociales et garantirait le volontariat des salariés.
Ainsi, aux actuelles zones touristiques seraient substitués des « périmètres d’animation concertée touristique (PACT) », dont la délimitation devrait reposer d’une part sur des critères objectifs et d’autre part sur une large concertation territoriale sous la houlette du président de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération, à charge pour le préfet d’accorder son aval moyennant un véritable pouvoir d’appréciation de sa part, qui lui fait aujourd’hui défaut dans le cadre des zones touristiques.
Aux actuels PUCE seraient substitués des « périmètres d’animation concertée commerciale (PACC) », qui devraient également se fonder sur des critères objectifs, et non venir entériner des situations antérieures d’usage de consommation dominicale, qui constituaient en réalité une prime à l’illégalité. Le rapport préconise également d’abandonner la condition de continuité de la zone, qui conduit à des effets de bord importants et exclut aujourd’hui des enseignes situées à proximité des PUCE. Parmi les critères devant être pris en compte pour procéder à la délimitation des PACC, figurent la densité commerciale hors alimentaire, l’attractivité commerciale du périmètre considéré, l’adhésion des commerçants, mais aussi des éléments permettant d’évaluer le degré d’adhésion des salariés. Si l’initiative de la création d’un PACC serait laissée à l’autorité politique locale, l’instruction de la demande serait confiée au préfet de département et la décision finale relèverait du préfet de région. Le rapport estime que les PACC auraient également vocation à répondre à la problématique particulière des commerces de gares et des centres commerciaux.
Dans ces nouvelles zones touristiques et commerciales, la procédure d’autorisation serait unifiée, de même que les contreparties accordées aux salariés, là où aujourd’hui des écarts existent entre les zones touristiques et les PUCE. Ainsi, dans chaque PACT ou PACC, les commerces seraient autorisés à ouvrir sans avoir à solliciter une autorisation individuelle comme c’est aujourd’hui le cas en PUCE. En revanche, l’ouverture serait subordonnée à la conclusion d’un accord collectif fixant les compensations accordées aux salariés ou, en l’absence d’accord, à l’application de contreparties légales prévues par la décision de l’employeur approuvée par référendum. Ces contreparties devraient en tout état de cause obligatoirement fixer les règles relatives à la majoration de la rémunération et à l’attribution d’un repos compensateur, les règles relatives au recueil du volontariat du salarié, à sa protection en cas de refus, et enfin, les mesures destinées à améliorer la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle des salariés travaillant le dimanche. Afin de protéger les petits commerces indépendants que la charge de la compensation salariale du travail dominical pourrait mettre en danger, le rapport propose de rendre la compensation salariale facultative pour les entreprises de moins de onze salariés dans les seules zones touristiques (les petits commerces indépendants étant généralement absents des zones commerciales).
En conséquence de ces modifications, le rapport estime que le régime des autorisations individuelles d’ouverture prévu à l’article L. 3132-20 pour les établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, n’aurait plus réellement de raison d’être pour les commerces.
Enfin, le rapport recommande, de manière provisoire, d’accorder une dérogation d’ouverture dominicale sectorielle au bricolage, dans l’attente de la mise en place des zones commerciales, qui devraient répondre à la problématique de ce secteur, de même qu’à cette échéance, au secteur de l’ameublement, qui aurait également vocation à être exclu à terme de la liste des activités habilitées à déroger au repos dominical.
B. EN MATIÈRE DE TRAVAIL NOCTURNE
L’encadrement législatif du recours au travail de nuit est aujourd’hui cohérent et suffisamment solide : c’est pourquoi il ne saurait être envisagé de refondre massivement le corpus législatif qui lui est relatif.
La principale – voire, sans doute, l’unique – difficulté du système actuel tient à l’inadaptation de ces règles à des situations très particulières et géographiquement extrêmement localisées, puisqu’elles se limitent à la capitale. On le voit, en effet, à travers les contentieux qui ont marqué les dernières années : il s’agit toujours de quelques grandes enseignes de la capitale, le plus souvent situées sur des axes très touristiques, comme le montre l’exemple emblématique de l’établissement Sephora des Champs-Élysées. Pour répondre à cette problématique bien spécifique, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable, de bouleverser le cadre normatif applicable. Il n’est, surtout, pas question de remettre en cause le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit.
*
* *
M. le président François Brottes. Au moment d’aborder la question du travail dominical, je propose aux membres de la Commission spéciale de l’ouvrir par une discussion générale, en amont de la discussion sur les articles et sur les amendements.
M. le ministre. Je salue l’esprit d’à-propos du président, qui nous fait commencer dans les premières minutes d’un dimanche le débat sur le travail dominical. Je signale cependant que, même si la réforme était adoptée, nous serions au-delà des critères définis pour le travail de soirée dans les zones touristiques internationales – ZTI.
M. le président François Brottes. Le projet de loi a trait au commerce, alors que l’Assemblée nationale ne fait bien sûr commerce que de démocratie.
M. le ministre. Le chapitre Ier du titre III du projet de loi comporte douze articles. Plutôt que de les détailler, j’exposerai les trois grands principes sur lesquels repose la réforme envisagée du travail dominical.
Premièrement, alors que cinq dimanches par an peuvent aujourd’hui être travaillés à la discrétion des maires, ce seraient douze dimanches qui pourraient à l’avenir être déclarés ouvrables, dont un minimum de cinq dans l’année.
Deuxièmement, la réglementation actuelle des zones touristiques et commerciales, trop hétérogène, serait simplifiée. Nous devons en effet garantir l’homogénéité des règles de compensation applicables au travail dominical. Selon l’INSEE, 29 % des Français travaillent le dimanche de manière régulière ou occasionnelle. Or de fortes disparités existent entre eux sous ce rapport : alors que, dans les zones commerciales, le salaire est doublé en cas de travail dominical, aucune compensation n’est prévue sur une base légale dans les zones touristiques. La réforme imposerait que, dans le commerce de détail, toute exception à la règle du repos dominical soit soumise à un accord de branche, d’entreprise ou de territoire qui définisse la compensation due aux salariés. Serait ainsi instauré le principe d’une compensation garantie à tous les salariés. Un délai de trois ans serait prévu pour la mise en œuvre, afin que les commerces déjà ouverts le dimanche en zone touristique puissent s’adapter et qu’il n’y ait pas de fermetures non désirées.
Au lieu de fixer le seuil minimal par la loi, le Gouvernement préfère en renvoyer la définition à des accords. Un doublement du seuil légal pourrait en effet défavoriser les petits commerces, qui sont souvent ceux que l’on cherche à protéger. Il ne serait pas non plus pertinent partout, notamment dans le secteur alimentaire – pour cette raison, il n’est d’ailleurs pas retenu aujourd’hui en zone touristique. Mieux vaut donc garantir des modes de compensation adaptés à la réalité économique et territoriale de chaque entreprise, par exemple dans le secteur alimentaire. Sans accord, l’ouverture dominicale n’est pas possible.
Troisièmement, le Gouvernement pourrait décider l’ouverture cinquante-deux dimanches par an dans les ZTI : elle serait ainsi possible, de vingt et une heures à minuit, là où, en raison de l’afflux de touristes ou d’hommes d’affaires, elle créerait de l’activité.
Pour résumer, la réforme vise à clarifier les règles de l’ouverture dominicale ; à laisser plus de latitude aux élus locaux en ce domaine ; à simplifier et à rendre plus ambitieuses les règles de compensation applicables ; à consacrer le principe du volontariat, même si son respect est difficile à vérifier in concreto ; à définir des ZTI. Telle est la philosophie d’ensemble du chapitre Ier du titre III.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. De nombreux échanges ont eu lieu avec le Gouvernement, dont je salue la volonté d’écoute. Nous partons du principe que l’ouverture dominicale doit rester exceptionnelle, car le dimanche est un jour où l’on doit « faire société ». Mais il faut aussi considérer la réalité des territoires : qu’ils soient ruraux, urbains ou qu’il s’agisse de grandes métropoles, les modes de vie y varient.
La réforme repose sur trois piliers : la définition de zones ; des processus de décision clairs ; un nombre de dimanches d’ouverture. M. le ministre l’a rappelé, il ne saurait y avoir d’ouverture sans accord préalable. Le principe du volontariat s’impose, de même que l’idée selon laquelle l’ouverture dominicale doit être particulièrement favorisée là où elle crée de l’activité. Des propositions seront formulées pour que les représentants des territoires soient également intégrés dans le processus décisionnel : les élus, les municipalités, les établissements publics de coopération intercommunale – EPCI.
Il ne s’agit certes pas d’aller à l’encontre de la volonté des salariés ou des chefs d’entreprise, mais de trouver des accords là où l’activité peut se déployer, du fait d’une demande des consommateurs, tandis que le repos dominical reste le principe ailleurs. Nous allons examiner les articles relatifs à la définition des zones touristiques internationales, des zones touristiques et des zones commerciales, aborder la question du volontariat, des compensations et de l’extension des régimes dérogatoires à des secteurs tels que l’alimentation. Ce texte devrait pouvoir satisfaire tout le monde, en servant tant à la lutte contre le chômage qu’à la relance de la croissance. Les salariés pourront se retrouver dans un texte protecteur qui leur apportera garanties et compensations. Par le dialogue social au sein des entreprises, chacun doit pouvoir sortir de ces négociations sur un accord gagnant-gagnant.
Certes, des prises de position relevant de la posture ne sont pas à exclure. Je comprends qu’on puisse ne pas partager l’esprit du texte, mais j’aurai à cœur de démontrer qu’il va dans le sens de la justice sociale et qu’il est possible de libérer l’activité tout en protégeant les intérêts des salariés.
M. le rapporteur général. Je pressens une hausse de l’Audimat en cette heure matinale, certains ayant voulu faire croire que le projet de loi Macron se résumait au choix du nombre de dimanches où les commerces de détail pourraient ouvrir. Son ambition est pourtant plus vaste et ses dispositions forment un tout cohérent qui embrasse un grand nombre de domaines de la vie sociale. Il vise à aérer des professions, à assouplir des rigidités et à dynamiser notre économie. Mais, puisque le travail dominical focalise l’attention, il faut éviter à son sujet tout faux débat.
Tout l’enjeu est de gagner à la fois en efficacité économique et en progrès social. Aujourd’hui, les règles relatives à l’ouverture dominicale sont si confuses et contradictoires qu’il est difficile de comprendre comment s’organise la vie sociale de ceux qui doivent travailler le dimanche. Le ministre a rappelé les règles fondamentales de la réforme : le volontariat, pas d’ouverture sans accord, des compensations. Au cours des nombreuses auditions qu’a conduites Stéphane Travert, il est apparu que le commerce électronique a changé les règles de la consommation contemporaine. Parallèlement, les élus locaux ont bien du mal à relancer le petit commerce, qui fait vivre le cœur de nos communes. Enfin, nous voulons que notre débat débouche sur des règles lisibles, efficaces et justes.
M. Jean-Frédéric Poisson. La loi sur le travail dominical que le Gouvernement veut faire évoluer a bientôt six ans. Certes, elle n’est pas parfaite – peut-on dire d’une seule loi qu’elle le soit ? Lorsque le Parlement en avait débattu, j’avais été de ceux qui avaient œuvré pour en réduire les ambitions initiales. La discussion, longue et vive, avait permis d’atteindre un équilibre qui constituait un point d’arrivée, et non un point de départ pour des changements ultérieurs.
Il était apparu que des situations locales méritaient d’être clarifiées par la loi, alors qu’elles ne l’étaient que par des arrêtés préfectoraux dont la légalité était contestée devant tous les tribunaux de France, ce qui exposait à de lourdes amendes les entreprises qui avaient eu le tort de croire que les arrêtés les protégeaient. Il avait également semblé que, dans beaucoup d’endroits, il était nécessaire d’étendre les possibilités alors ouvertes par la loi qui prévoyait de manière laconique que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Tous les éléments du débat furent examinés entre les premières réflexions de septembre 2007 et l’adoption de la loi à l’été 2009. Ces éléments n’ont pas varié : principe du volontariat, potentiel de croissance de l’activité en cas d’ouverture plus fréquente, étendue des zones dérogatoires, compensations, sort des accords en vigueur, incidence sur les contrats de travail. À l’époque, j’avais prôné, en vain, une solution qui s’appuie sur le dialogue social et territorial, seul à même d’apporter une réponse adaptée aux besoins d’un bassin d’emploi, à la différence d’une solution législative. J’ai néanmoins voté la loi.
À l’époque, comme aujourd’hui, plusieurs questions restaient en suspens. Quel impact une telle réforme peut-elle avoir sur la vie des familles ? Cette incertitude nous avait conduits à adopter un dispositif sans doute moins offensif que ne l’auraient souhaité certains d’entre nous. Quant au potentiel de croissance qui se libérerait grâce à des ouvertures dominicales, il est tout sauf certain. Si j’en crois les déclarations des représentants des grands groupes de magasins de bricolage, qu’un décret autorise depuis un an à ouvrir le dimanche, il n’y aurait pas de réel intérêt pour eux à le faire, à moins que les commerces voisins ne le fassent aussi. De même, de grandes entreprises refusent l’ouverture dominicale, qui leur coûterait plus d’argent qu’elle ne leur en rapporterait. Enfin, comment croire que serait dépensé le dimanche l’argent qui n’est pas dépensé pendant la semaine ? L’état de crise aigu que nous connaissons, encore accentué par rapport à 2009, n’a pas changé la donne.
Par ailleurs, je ne connais pas d’élus qui se soient plaints que les commerces ne puissent ouvrir dans leur commune. À Nice, à Biarritz, à Bordeaux, les commerces peuvent ouvrir dix, quinze, voire vingt-cinq dimanches par an, en fonction des besoins locaux. Conformément à l’esprit de la loi de 2009, ce sont les élus qui sont à l’origine de la demande visant à obtenir que le seuil de cinq dimanches soit relevé sur un territoire donné. C’est d’ailleurs ce verrou local qui avait convaincu certains d’entre nous que, le pouvoir des élus locaux et des assemblées délibérantes étant respecté, nous pouvions accepter le dispositif. Si le problème ne se posait pas de manière aiguë à Paris, nous n’aurions pas eu à en débattre de nouveau. Je n’irai pas jusqu’à dire que, ce faisant, on prend le Parlement en otage pour des raisons de querelles internes à la majorité, qui ne nous regardent pas.
Nous avons entendu les organisations professionnelles. Les seules qui se soient montrées favorables à un élargissement de l’ouverture dominicale sont les grandes enseignes implantées dans des lieux où les touristes affluent. C’est loin de concerner les 36 000 communes de France.
Notre groupe suivra avec intérêt les échanges entre les groupes de la majorité. Nous poserons sur les ZTI un regard qui n’aura rien de malveillant, mais nous nous en tiendrons pour le reste à l’esprit de la loi de 2009. Du reste, c’est dans l’hémicycle que se conclura le débat, après des échanges dont on peut prévoir – en constatant quelques écarts statistiques entre la composition de l’Assemblée et celle de notre commission spéciale – qu’ils seront plus animés en séance publique qu’ils ne l’auront été en commission.
M. Jean-Louis Bricout. Élu du nord de l’Aisne, en Picardie, je constate combien le tourisme peut être peu développé dans un territoire dont les habitants n’ont pas, quant à eux, le pouvoir d’achat qu’ils souhaiteraient. Aussi l’ouverture des magasins le dimanche n’y favoriserait pas une augmentation du chiffre d’affaires du petit commerce, mais ferait au contraire, au détriment des bourgs centres, la part belle à une grande distribution, qui exerce une forte pression tant sur les agriculteurs que sur ses petits fournisseurs.
Dans ces circonstances, pourquoi inciter les commerces à ouvrir le jour où les charges sont le plus élevées ? Comment pareille mesure s’articule-t-elle avec la démarche qui a inspiré le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE –, censé restaurer les marges des entreprises ?
Le commerce électronique profite des achats d’impulsion. L’achat dominical se portera quant à lui plus naturellement sur l’équipement de la maison, alors que l’achat de première nécessité se justifie moins ce jour-là. Quel est l’intérêt de pouvoir acheter sa sauce tomate le dimanche ? D’autres choix s’ouvrent à la famille ce jour-là ! L’ouverture dominicale aurait également une incidence sur le monde associatif, qui peine à trouver des bénévoles. Dans le petit commerce, où les entreprises ne comptent que deux ou trois salariés, l’indemnisation pourra également poser des difficultés. Au cours de l’examen des amendements, j’interviendrai enfin sur le périmètre des autorisations d’ouverture.
M. Patrick Hetzel. Je suis favorable à une souplesse accrue dans les zones touristiques, là où c’est justifié. Mais la possibilité d’ouvrir douze dimanches par an risque d’introduire des distorsions entre les catégories de commerce. L’ouverture dominicale autorisée par les maires n’irait pas sans contrepartie, si la loi était adoptée. Elle profiterait avant tout à la grande distribution qui s’arrogera ainsi de nouvelles parts de marché. Aussi me semble-t-il hypocrite ou illusoire d’invoquer le recours à des accords collectifs pour fixer des contreparties, alors que la loi fixera la compensation par défaut si ces accords ne voient pas le jour. Drôle de conception du dialogue social, d’autant plus surprenante qu’elle est celle d’un gouvernement de gauche !
La réforme du travail dominical porterait un coup dur au commerce de proximité, car il détruirait des emplois actuellement pérennes tout en mettant à mal le lien social. L’activité économique s’en trouverait déstructurée et dénaturée. Croyez-en un élu alsacien : en Allemagne, pays économiquement très performant, l’ouverture dominicale est réglementée de manière très restrictive. Il est donc faux d’établir une corrélation entre la performance économique d’une nation et l’ouverture dominicale. Se pose en outre la question de l’articulation entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sociale. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a tiré la sonnette d’alarme, car ce sont les femmes qui sont en première ligne dès qu’il faut ouvrir un magasin le dimanche.
Quelle belle affaire que l’ouverture dominicale ! Faisant tout au plus naître de nouvelles frustrations chez nos concitoyens, elle n’apporterait pas de pouvoir d’achat supplémentaire. Telle est pourtant la question essentielle. Le présent projet de loi n’y apporte aucune réponse probante.
Mme Jacqueline Fraysse. Parce qu’il est un acquis social essentiel, le repos dominical doit rester un principe de notre droit. Le dimanche est le seul jour de repos commun à tous ; il y va donc de la cohésion sociale, du lien social. Au demeurant, on a tout de même autre chose à faire le dimanche qu’arpenter les allées des centres commerciaux en famille ; les activités sportives, associatives et culturelles sont plus enrichissantes et doivent être développées.
Je veux dire un mot des femmes, qui sont particulièrement concernées. De plus en plus nombreuses à élever seules leurs enfants, elles doivent donc, lorsqu’elles travaillent le dimanche, trouver une personne qui accepte de les garder, une personne qu’elles paieront du reste plus cher ce jour-là. Je pense également à leur sécurité, lorsqu’elles rentreront chez elles à minuit, après avoir travaillé en soirée.
Le groupe GDR veillera donc, au cours de ce débat, à limiter le plus possible le travail dominical afin qu’il ne soit pas banalisé.
J’en viens au contenu même du texte. Bien entendu, nous ne sommes pas hostiles à la modification du périmètre actuel des zones commerciales, mais les critères fixés dans le texte nous paraissent extrêmement flous. En outre, les élus, pourtant directement concernés, n’auront aucun pouvoir de décision. En matière de compensations, nous partageons l’objectif qui consiste à garantir leur homogénéité pour tous les salariés travaillant le dimanche, mais la rédaction actuelle du texte ne le permet pas. Nous estimons à cet égard que la loi aurait dû encadrer davantage la négociation collective, en définissant une compensation minimale. Quant aux arguments concernant la relance de l’économie et les créations d’emploi, ils nous laissent très dubitatifs, d’une part, parce que le pouvoir d’achat, qui ne se porte pas très bien depuis quelques années, n’est pas extensible et, d’autre part, parce qu’on n’observe aucune corrélation entre performance économique et travail du dimanche.
M. Francis Vercamer. En préambule, je veux saluer l’exploit du ministre, qui s’exprime au nom d’un gouvernement qui compte dans ses rangs Mme Marisol Touraine et MM. Christian Eckert et Alain Vidalies, tous opposés au travail du dimanche il y a cinq ans. Sur le fond, le groupe UDI étant assez partagé, je m’en tiendrai aux principes qui constituent le socle de notre position commune.
Premièrement, il faut prendre en compte la réalité des territoires – zones touristiques, zones frontalières… –, ce qui exclut un dispositif défini de manière homogène au plan national. Deuxièmement, le travail dominical doit reposer sur le volontariat et donner lieu à une compensation suffisante, équitable et définie dans le cadre du dialogue social. Troisièmement, les décisions d’ouverture dominicale doivent revenir aux élus locaux, précisément pour que soient prises en compte les réalités de terrain.
Sur la base de ces principes, nous avons déposé un certain nombre d’amendements par lesquels nous vous proposerons notamment de créer des zones frontalières sur le modèle des zones touristiques. Il s’agit de permettre à certaines villes de rivaliser avec les communes frontalières voisines où les commerces sont ouverts le dimanche et d’éviter ainsi, pour les commerçants français, une perte de chiffre d’affaires. J’en parle en connaissance de cause, car, élu du Nord, je constate que nos concitoyens se rendent le dimanche dans les communes belges situées à la frontière de la métropole lilloise, où les commerces sont ouverts.
Nous souhaitons également que la rémunération soit au minimum doublée, ce qui ne représenterait qu’un gain de salaire mensuel de 20 % pour le salarié qui travaillerait cinq dimanches par mois. Par ailleurs, nous tenons à ce que le travail dominical repose sur le volontariat. Enfin, afin d’éviter une concurrence déloyale entre les communes membres d’un EPCI, nous proposons que celui-ci puisse décider du nombre de dimanches ouverts, chaque maire étant ensuite libre de choisir ceux qui le seront sur le territoire de sa ville.
Sachant que la discussion en séance publique peut réserver des surprises, nous attendrons qu’elle ait eu lieu pour nous prononcer sur cette partie du texte.
Mme Monique Rabin. Je ne suis pas « fan » du travail dominical, mais force est de constater que, en ce début du XXIe siècle, la question du temps est devenue très prégnante. Ainsi, après avoir réformé les rythmes scolaires, nous nous penchons sur le travail du dimanche. Il s’agit d’une évolution profonde de la société, dont l’enjeu est peut-être beaucoup plus important que nous ne le pensons.
Je suis élue d’un département, la Loire-Atlantique, qui a résisté avec succès à l’ouverture des commerces le dimanche, bien que, en périphérie de Nantes, la concentration des hypermarchés soit une des plus élevées de France. Néanmoins, je sais que certains blocages entravent le développement de notre économie et qu’il nous faut prendre en compte certaines mutations, notamment le développement du commerce sur internet et l’apparition de nouveaux modes de livraison, qui ont été mises en lumière au cours d’auditions fort intéressantes.
Je veux souligner l’important travail réalisé par nos rapporteurs, Stéphane Travert et Richard Ferrand, ainsi que le dialogue noué avec le ministère. Je me félicite des avancées, dont certaines restent à confirmer, obtenues en matière de compensation, de travail en soirée et de responsabilité des élus locaux ; je pense également à la suppression de l’ouverture de droit de cinq dimanches par an, à laquelle j’attache une importance particulière. Je suis convaincue que le travail du dimanche ne sera jamais banalisé. À cet égard, le zonage est très important, car il permettra d’identifier les territoires où les ouvertures dominicales sont utiles au plan économique et de réaffirmer la liberté des élus locaux.
En revanche, deux points me laissent dubitative. Tout d’abord, le volontariat est, selon moi, un leurre, compte tenu des liens de subordination qui caractérisent le monde du travail. Ensuite, nous devrons nous pencher sur la réorganisation des temps sociaux ; la question des transports ou celle des modes de garde d’enfants pour les personnes travaillant la nuit, par exemple, se poseront très rapidement. Enfin, Dominique Potier, Christophe Sirugue et moi-même contestons le dogme des douze dimanches incompressibles ; nous proposerons donc que puissent être comptabilisés les jours fériés existants. En conclusion, je remercie le Gouvernement, car le dialogue a été constructif, mais il reste beaucoup à faire.
M. Jean-Louis Roumegas. La loi n’est pas encore votée que déjà nous en enfreignons les règles, puisque notre discussion, qui débute un dimanche, n’a été précédée d’aucun accord préalable et que nous ne bénéficierons d’aucune compensation. (Sourires.) Il est vrai, néanmoins, que nous sommes tous volontaires pour participer à ce débat. En dépit des très mauvaises conditions dans lesquelles il est organisé – le Gouvernement nous imposant de discuter dans un délai réduit d’un texte long qui aborde de nombreux sujets différents –, nous sommes présents ce soir, car nous entendons résister et nous battre contre un projet néfaste qui non seulement n’apporte rien sur le plan économique, mais marque un véritable recul pour les salariés de notre pays.
Car le ministre nous a fait une présentation quelque peu idyllique de son projet. Premièrement, la loi permettra aux maires de disposer du pouvoir d’autoriser le travail non plus cinq, mais douze dimanches par an, cinq dimanches étant ouverts de droit. En conséquence, non seulement la situation variera selon les villes en fonction de la philosophie du maire, mais les communes d’une même agglomération pourront se livrer une concurrence qui n’est pas de bon aloi. Deuxièmement, le ministre a insisté sur l’aspect positif de l’harmonisation des compensations, qui marque un progrès pour les salariés. Cela sera certainement vrai pour ceux travaillant dans les zones touristiques, puisqu’ils en sont actuellement privés ; en revanche, c’est plus douteux pour les salariés des zones commerciales, puisque les compensations, qui étaient jusqu’alors fixées par la loi, dépendront désormais d’accords de branche, dont rien ne dit qu’ils seront plus favorables. Surtout, les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle – PUCE –, limités aux communes de plus de 1 million d’habitants, seront remplacés par des zones commerciales qui pourront concerner toutes les communes. Enfin, et c’est peut-être le plus grave, le Gouvernement propose de créer des zones touristiques internationales où, nous dit le ministre, l’ouverture dominicale des commerces créerait un surcroît d’activité. Il reconnaît donc a contrario que, dans les autres zones, le développement du travail du dimanche n’entraînera qu’un transfert d’activité… Au demeurant, beaucoup contestent que le travail dominical crée un surcroît d’activité dans les ZTI. En tout état de cause, le Gouvernement souhaite non seulement y imposer le travail tous les dimanches, mais aussi y étendre le travail de nuit, qui plus est contre l’avis, le cas échéant, des maires ou des présidents d’EPCI.
Ce texte, en étendant largement le travail dominical et le travail de nuit, n’est pas conforme aux choix de société que défend le groupe écologiste. Comment accepter en effet que certaines catégories de la population n’aient d’autre choix que de travailler ou, faute d’avoir accès à la culture, de consommer ? Pour nous, ce n’est pas un progrès. Le texte marque en outre un recul du droit du travail. Ainsi, les heures travaillées entre 21h00 et minuit n’étant plus considérées comme du travail de nuit, elles ne pourront pas être comptabilisées dans le compte pénibilité. Pourtant, le travail de nuit est un problème de santé publique, puisqu’il est démontré qu’il augmente notamment le risque de cancer, notamment chez les femmes, particulièrement concernées par ces horaires.
Du reste, je rappelle que l’ensemble des syndicats de salariés sont opposés à l’extension du travail du dimanche et du travail de nuit et que la CGPME se montre très réservée en raison des risques que présente le texte pour le petit commerce. Enfin, faut-il rappeler que le parti socialiste lui-même s’opposait encore récemment à ce projet lorsqu’il était défendu par Nicolas Sarkozy ainsi qu’à la proposition de Mme Kosciusko-Morizet visant à étendre le travail de nuit ? Selon moi, il y a plus grave que les prétendues postures dénoncées tout à l’heure par M. le rapporteur : ce sont les impostures !
M. le président François Brottes. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, monsieur Roumegas.
Mme Sandrine Mazetier. Monsieur le ministre, les objectifs de ce chapitre, qu’il s’agisse de rationaliser la législation applicable à l’ouverture dominicale des commerces ou d’homogénéiser les règles en matière de compensation, sont tout à fait louables et, je crois, partagés par la majorité des membres de la Commission spéciale. Toutefois, la création de zones touristiques internationales paraît en contradiction avec cette démarche, puisqu’il s’agit tout de même d’y autoriser l’ouverture des commerces cinquante-deux dimanches par an et d’y généraliser le travail de nuit – le « travail en soirée », qui a été évoqué, étant une notion inconnue du droit du travail.
Puisque Jean-Frédéric Poisson a fait allusion aux propos que nous avions tenus sur la loi Mallié, je veux lui rappeler que le Conseil constitutionnel a censuré celles de ses dispositions qui concernaient Paris. En effet, la capitale n’est pas un territoire offshore ! Je m’étonne par ailleurs que notre collègue considère avec bienveillance la création des ZTI : les familles, qui sont pour lui un sujet de préoccupation, en particulier les familles franciliennes, apprécieront le peu de cas qu’il fait de l’impact qu’aura sur leur vie la généralisation du travail dominical et du travail de nuit.
Enfin, je ne peux pas ne pas citer, sans démagogie aucune, un extrait du communiqué de l’intersyndicale du Printemps intitulé « L’ouverture dominicale de la honte » : « Le dimanche 11 janvier 2015, le Printemps, les Galeries Lafayette et le Bon Marché ouvraient leurs portes au public sur autorisation préfectorale à l’occasion du premier dimanche des soldes, faisant voler en éclats une fois de plus le principe du volontariat en imposant cette ouverture dominicale […] qui a privé des milliers de salariés des grands magasins de la possibilité de participer à cette marche du rassemblement pour la liberté. » Le dimanche n’est pas un jour tout à fait comme les autres : il peut être consacré à la vie de famille, certes, mais aussi à la citoyenneté, et nous devons en tenir compte. Sur ces différents sujets, je défendrai des amendements qui, je l’espère, permettront d’obtenir des avancées.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le ministre, parmi les arguments que vous avez exposés pour justifier les dispositions de votre texte relatives au travail dominical, vous avez cité la simplification et l’harmonisation de la réglementation, les attentes des consommateurs et du monde économique. En revanche, vous n’avez évoqué ni la croissance ni l’activité, qui figurent pourtant dans le titre de votre projet de loi ; cela me laisse perplexe.
Si ce débat passionne les Français, c’est parce que le dimanche n’est pas un jour comme les autres : il est consacré à la vie familiale, aux amis, au repos, y compris pour les enfants, dont l’emploi du temps a été modifié par la réforme des rythmes scolaires. Mais le monde change et il nous faut tenir compte de ces évolutions ; je pense au développement du commerce électronique, à la situation particulière des zones frontalières et à l’importance du commerce touristique dans les capitales. Cependant, votre texte suscite l’inquiétude sur trois points.
Tout d’abord, il est important que les salariés travaillant le dimanche puissent bénéficier de compensations, mais je crains qu’en leur imposant cette charge supplémentaire, on n’aggrave encore les difficultés des très petites entreprises et des commerces ruraux. Ensuite, vous avez indiqué que l’ouverture dominicale sera soumise à la conclusion d’un accord de branche qui devra intervenir dans un délai de trois ans. Or on sait que la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 comporte un dispositif similaire – puisqu’elle renvoie aux branches la possibilité de déroger au plancher de vingt-quatre heures en matière d’emploi à temps partiel – et que très peu d’accords ont été conclus, les négociations étant bloquées. Enfin, puisqu’il est prévu que les nouvelles zones commerciales seront délimitées ou modifiées par le préfet de région sur proposition des élus locaux après consultation de différents acteurs, pouvez-vous nous dire quelles directives seront données aux préfets de région ?
M. Jean-Luc Laurent. Monsieur le ministre, une remise à plat de la législation actuelle en matière de travail dominical s’imposait, tant il est difficile de s’y retrouver. Toutefois, je suis très réservé sur le dispositif que vous nous avez présenté, car il aboutira à une généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche, que je considère comme une concession à l’air du temps et à un libéralisme dépassé. Non seulement votre texte conduira nécessairement à une déréglementation accrue, mais il mettra à mal la cohésion sociale. Il importe en effet que certains jours ne soient pas travaillés pour permettre à nos concitoyens d’avoir une vie civique, une vie sociale, une vie familiale. En outre, il conforte la société de consommation et, faute d’amélioration du pouvoir d’achat, il favorisera les grandes surfaces au détriment du commerce de proximité, qui souffre particulièrement de la dépression économique actuelle. Par ailleurs, la majorité de progrès que, je l’espère, nous formons encore doit penser aux salariés concernés et à leurs conditions de travail. Or les études nous montrent que ce sont surtout des femmes et des jeunes qui travaillent le dimanche, et qu’il s’agit souvent de « petits boulots ».
S’il est nécessaire de revoir la réglementation applicable au travail dominical, celui-ci doit demeurer exceptionnel et il doit être assorti de protections et de contreparties nettement plus importantes que celles qui sont prévues dans le texte qui nous est soumis.
Mme Karine Berger. Il est d’autant plus difficile de modifier la réglementation relative aux exceptions au repos dominical que, après un accouchement douloureux, cette réglementation avait fini par s’appliquer dans le cadre d’un dispositif équilibré qui faisait l’objet d’un consensus. Or, si nous abordons cette discussion avec le sentiment que, pour des raisons étrangères à la Commission spéciale, voire à l’Assemblée, il est impossible de remettre en question un chiffre figurant dans le texte du Gouvernement, il est à craindre que nous ne parvenions pas à prolonger ce consensus pourtant indispensable. À ce propos, je crois avoir compris que les orateurs qui m’ont précédée étaient tous d’accord pour que le travail dominical demeure une exception. Comment peut-il en être ainsi s’il est désormais possible de travailler douze dimanches par an, soit un quart des dimanches de l’année ?
M. Sébastien Huyghe. Il est heureux pour la majorité que les principaux acteurs de ce texte, c’est-à-dire les deux rapporteurs et le ministre, n’aient pas été parlementaires sous la législature précédente, car ils auraient pu être pris en flagrant délit de contradiction. Au reste, en écoutant les rapporteurs évoquer les zones touristiques internationales, le pouvoir des élus locaux, la règle du volontariat ou les compensations salariales, je me demandais s’ils n’avaient pas plagié le discours du rapporteur de la loi de 2009.
Au cours de la discussion, nous serons peut-être d’accord sur certains points, en désaccord sur d’autres, mais la véritable question qui se pose est celle de savoir s’il était vraiment nécessaire de relancer ce débat, alors qu’on avait fini par aboutir à un certain consensus. Si l’on rouvre ainsi la boîte de Pandore, n’est-ce pas parce que ce texte est le seul moyen qu’a trouvé le Gouvernement pour tordre le bras aux élus locaux qui, au sein même de la majorité, ne jouent pas le jeu de la loi de 2009 ?
M. Gilles Savary. Il ne vous étonnera pas qu’un élu du Sud-Ouest, où un grand nombre d’activités païennes se pratiquent le dimanche – la corrida, le rugby, la chasse – ne soit pas un partisan acharné du travail dominical. Cependant, je voudrais dédramatiser le débat en rappelant que le travail du dimanche est, hélas peut-être, très commun et que le premier employeur à le pratiquer est public – je pense notamment au secteur des transports.
Par ailleurs, reconnaissons que les choses ont évolué très vite. Tout d’abord, il est un type de commerce qui est ouvert cinquante-deux dimanches par an, c’est le commerce en ligne ; il connaît un développement considérable aux dépens du commerce d’établissement qui anime nos villes. C’est pourquoi si ce texte peut contribuer à réarmer ce dernier, nous ne devons pas nous en priver, tout en restant très mesurés. Ensuite, nous avons l’opportunité, grâce à la fréquentation par des étrangers de plus en plus nombreux et argentés de la capitale et de certaines villes de province, de profiter de la mondialisation sans recourir aux délocalisations. Ainsi, Bordeaux – peut-être faut-il ici rendre hommage à un éminent membre de l’opposition – est beaucoup plus animée depuis qu’une ouverture mesurée des commerces y est autorisée le dimanche. Quant aux zones frontalières, nous avons été étonnés de constater que les fameuses ventas espagnoles avaient résisté au désarmement douanier ; elles ouvrent désormais le dimanche et fragilisent les commerces des villes du Sud-Ouest. Nous devons donc nous pencher sur ce phénomène, qui se traduit par une perte de chalandise.
M. Jean-Luc Laurent. Que fait l’Europe ?
M. Gilles Savary. Elle ne les interdit pas ; le principe de subsidiarité, auquel je vous sais très attaché, mon cher collègue, permet en effet aux États membres de conserver leur souveraineté dans de nombreux domaines.
Pour le reste, étant de ceux qui pensent que la chalandise et le chiffre d’affaires sont limités par le pouvoir d’achat, je suis favorable à une très grande souplesse. Autant il me semble que l’ouverture des commerces le dimanche dans les grandes zones touristiques profite à tout le monde – notamment aux établissements de province des Galeries Lafayette, par exemple –, autant je pense qu’il ne faut pas faire de « prêt-à-porter » pour certaines villes de province où elle pourrait profiter aux grandes enseignes aux dépens du petit commerce. En conclusion, il me paraît nécessaire de toiletter le dispositif, et les compensations prévues sont bienvenues.
Mme Colette Capdevielle. La société change. Comment vit-on en 2015 ? Permettez-moi de vous raconter un dimanche ordinaire en province. Quand je me lève, je suis bien contente de trouver le journal dans ma boîte aux lettres, où quelqu’un l’a déposé à sept heures du matin. Pour préparer le petit-déjeuner, je vais acheter des croissants, des chocolatines et du pain frais à la boulangerie, qui est ouverte. Puis je me rends à la piscine, où un agent m’accueille et où un maître-nageur surveille les bassins. En sortant, je rencontre une amie avec qui je vais boire un café : la cafétéria est ouverte. À l’heure du déjeuner, je m’aperçois que je n’ai plus de tomates pour préparer ma piperade ; je vais donc au restaurant, en famille. Puis, avant de rendre visite à des amis, je m’arrête, pour ne pas arriver les mains vides, chez le fleuriste et à la pâtisserie. En fin d’après-midi, j’emmène mon fils, qui étudie à Bordeaux, à la gare ; elle est ouverte, de même que le guichet, où j’achète un billet. Et je m’aperçois que le conducteur et les contrôleurs travaillent également. Et pourtant, nous sommes un dimanche ! On dit aussi que cette journée devrait être réservée aux activités culturelles ou sportives. De fait, pour que le cinéma, le théâtre, le musée, la salle de concerts et le stade de rugby soient ouverts le dimanche, il faut bien que des personnes y travaillent. Enfin, après une telle journée, j’ai mal à la tête et je suis bien contente de trouver une pharmacie ouverte…
Soyons raisonnables et réalistes ; il n’est pas forcément question d’aller pousser des caddies dans les supermarchés. Regardons le monde tel qu’il est : toutes et tous, nous nous réjouissons que ces commerces ou ces services soient ouverts pour nous permettre de passer des dimanches agréables. Aussi voterai-je toutes les dispositions qui nous sont proposées, car la société change et la législation doit accompagner ces évolutions. J’ajoute que le Gouvernement prévoit des compensations qui n’existent pas actuellement, et je regrette que cette innovation n’ait pas été relevée par d’autres.
M. Jean-Yves Caullet. De l’ensemble des interventions, que j’ai écoutées avec beaucoup d’attention, chacun peut conclure que le sujet est complexe et qu’il faut se garder de tout simplisme outrancier. Jean-Frédéric Poisson a parlé du texte qui avait été adopté en 2009 après des débats animés comme d’un point d’arrivée. Depuis, les choses ont évolué. Le commerce en ligne s’est développé, les pratiques des touristes en matière de consommation se sont intensifiées, l’évasion commerciale s’est amplifiée dans les zones frontalières et ailleurs, et l’organisation de nos territoires a évolué, avec la généralisation des intercommunalités et les pôles d’équilibre. Il me semble donc tout fait légitime de revisiter la question, et nous serons sans doute amenés, dans les prochaines années, à y revenir encore et à définir une série de points d’équilibre successifs dont aucun ne sera définitif.
Je suis sensible au récit qui vient de nous être fait d’un dimanche en province. Pensons en effet à ceux qui travaillent déjà le dimanche ; ils pourraient ressentir certains propos sur les difficultés du travail dominical comme l’expression, sinon d’un dénigrement, du moins d’un apitoiement. Le travail du dimanche concerne tout le monde, comme l’a rappelé Mme Fraysse. J’ai moi-même travaillé dans une entreprise de transport qui fonctionnait 365 jours par an, où la question que l’on se posait était celle du nombre de dimanches libres dont on pourrait disposer…
Le projet du Gouvernement ne vise ni à généraliser le travail du dimanche, puisqu’il concerne des secteurs particuliers, ni à le banaliser, puisqu’il demeure une exception.
Nous abordons ce débat en ayant en tête un certain nombre de principes. Tout d’abord – et cette exigence est dans notre ADN –, les efforts demandés doivent être compensés et le principe du volontariat respecté, même si nous savons ce qu’il en est des rapports de force dans le monde du travail. Ces compensations, qui doivent être inspirées par le principe de justice, seront définies dans le cadre du dialogue social. Certains d’entre nous seront sans doute tentés de préciser l’ensemble des autres points qui devraient faire l’objet d’un accord : travail des femmes, gardes d’enfant, transport, etc. Nous en discuterons au cours du débat. Ensuite, il est nécessaire de faire en sorte que l’ensemble des salariés, qui se trouvent dans des situations très différentes, soient traités de la manière la plus égale possible. Par ailleurs, ce texte vise à favoriser l’activité ; à cet égard, nous devons saisir les occasions qui se présentent – mais je crois que ce point fait l’objet d’un consensus. Enfin, les décisions doivent être décentralisées, plus transparentes et assurer une meilleure cohérence territoriale.
Le groupe SRC sera attentif à ces quatre principes ; il adoptera une position constructive et ne doute pas que le Gouvernement saura, avec l’apport des rapporteurs, faire preuve d’ouverture pour que nous puissions aboutir à un nouveau point d’équilibre. Quant à nous, nous nous efforcerons d’éviter le simplisme abusif auquel je faisais allusion au début de mon propos.
M. le président François Brottes. Mes chers collègues, il me paraissait important de ne pas interrompre cette discussion dans laquelle chacun a pu s’exprimer sans limite de temps, mais il nous faut raison garder ; je crois sage que nous attendions demain l’ouverture de la séance du matin pour entendre la réponse du ministre.
M. le ministre. Je vous remercie toutes et tous d’être présents ce dimanche matin, après une semaine intense et très intéressante. La discussion qui a eu lieu lors de la séance précédente a soulevé nombre de questions intéressantes qui, par le débat qu’elles suscitent, vont permettre d’éclairer ce projet de loi et nous montrer de quelle manière nous pourrions l’améliorer.
Je commencerai par souligner que le fait pour notre majorité de défendre ce texte est cohérent, et n’est en rien contradictoire avec les réactions qu’elle a pu montrer face à la loi Mallié de 2009. Cette loi a eu trois effets essentiels : repousser de douze heures à treize heures la fermeture des commerces alimentaires le dimanche, élargir la définition des commerces éligibles aux zones touristiques, instaurer les périmètres d’usage de consommation exceptionnel – PUCE –, ce qui revenait pour l’essentiel à régulariser des situations de fait, illégales, dans des zones commerciales. Ce faisant, la loi Mallié a amélioré la situation des grandes surfaces au détriment des commerces de centre-ville, puisque son principal apport a résidé dans l’ouverture dominicale au sein des quarante et une PUCE ; mais ce faisant, elle a déstabilisé les écosystèmes des centres-villes. Elle n’a en revanche rien réglé des inégalités géographiques et sectorielles ni de la problématique de compensation : elle a donc laissé perdurer des situations d’injustice entre les différentes zones.
Aujourd’hui, quand on dit que 30 % des Français travaillent le dimanche, il est bien évident que le commerce de détail n’est pas le seul secteur concerné. Dans le commerce de détail, plusieurs dispositions prévoient le travail dominical : les « dimanches du maire », cinq dimanches possibles, sans volontariat mais payés double ; l’ouverture dans les zones touristiques, sans volontariat ni compensation – il y en a plus de 600 ; l’ouverture dans les PUCE, selon un principe de volontariat et avec des heures payées double en l’absence d’accord – les accords, quand ils existent, pouvant prévoir d’autres formes de compensation ; l’ouverture dérogatoire de droit pour les commerces alimentaires jusqu’à treize heures, sans compensation prévue par la loi ; enfin, l’ouverture en vertu de dérogations sectorielles, dont la liste est loin d’être négligeable. Face à une situation très complexe, pour ne pas dire illisible, et injuste, la réforme de 2009 a essentiellement consisté à régulariser, au prix de certaines fragilités juridiques, de grandes zones commerciales. S’opposer à la loi Mallié, c’était s’opposer à un modèle basé sur le consumérisme dans les hypermarchés et les grandes zones commerciales, préservant des formes d’inégalité en termes de compensation réelle et fragilisant les centres-villes.
Pourquoi rouvrir le dossier aujourd’hui ? Parce que plusieurs choses ont changé depuis 2009, à commencer par le commerce en ligne, qui a pris un essor considérable – il enregistre chaque année une croissance à deux chiffres. Le Printemps, qui a créé son site de commerce en ligne, réalise 20 % à 25 % de son chiffre d’affaires le dimanche ; Amazon réalise également environ 20 % de son chiffre d’affaires le dimanche. On peut toujours affirmer que l’on ne veut pas d’une société où l’on consomme le dimanche, mais il faut savoir regarder la réalité : les Français consomment déjà le dimanche. Dès lors, la vraie question est de savoir si l’on préfère que cela se fasse dans de vrais commerces, ou sur des sites internet qui créent beaucoup moins d’emplois et de richesse en France, et présentent une base taxable très différente. Quant au développement des drive, qui s’est largement accéléré ces dernières années, il est une autre preuve de la mutation des modes de consommation. Les chiffres montrent d’ailleurs que, lorsque ces fenêtres d’ouverture supplémentaires que sont les soirées ou les dimanches sont perdues, cela n’entraîne pratiquement pas de report de la consommation : ainsi, quand l’enseigne Monoprix a ramené sa fermeture de vingt-deux heures à vingt et une heures, 85 % du chiffre d’affaires réalisé durant cette heure s’est perdu. Le report sur les autres plages horaires n’a été que de 15 %.
Parallèlement, les différences sectorielles sont devenues intenables. Les enseignes de bricolage n’ont eu de cesse d’alimenter la chronique à coup d’épisodes parfois croquignolesques ; c’est du reste à l’issue d’une énième chronique de ce genre que le gouvernement précédent, appuyé par l’actuelle majorité, avait demandé à M. Jean-Paul Bailly un rapport destiné à clarifier la situation. Les injustices croissantes et de plus en plus visibles en matière de compensation justifiaient également une action de notre part. Enfin, le consensus social français, évoqué hier par Mme Berger, a évolué. En 2008, 52 % des Français étaient favorables au travail dominical ; fin 2014, un sondage réalisé à la demande de la ville de Paris a montré que 75 % des Français étaient favorables à l’ouverture des commerces le dimanche et que 57 % n’étaient pas opposés à l’idée de travailler eux-mêmes le dimanche ; fin 2013, selon un sondage IFOP, 69 % des Français adhéraient à l’idée d’une ouverture des commerces le dimanche. Les Français ont donc un nouveau rapport au travail du dimanche, qu’ils perçoivent déjà comme une réalité. Ils exigent cependant qu’il soit encadré dans des conditions justes et ayant du sens.
Le nouveau modèle de consommation et le fonctionnement de nos villes le requièrent également, et nous devons collectivement en prendre conscience. Pour l’heure, entre les cinq dimanches du maire et les cinquante-deux dimanches des PUCE ou de la zone touristique, il n’y a pas d’alternative : c’est tout de suite le grand bain. À l’évidence, ce système avantage les grands centres commerciaux implantés dans les PUCE, et désavantage les centres-villes. Plusieurs dizaines de villes, dont dix-huit grandes agglomérations – Orléans, Vichy, Reims, Troyes, Dieppe, Le Havre, Rouen, Limoges, Nancy, Toulouse, Lille, Amiens, Beauvais, Marseille, Antibes, Cannes, Lyon et Annecy –, qui avaient adopté le système des cinq dimanches, ont déjà demandé des zonages. Les villes de Bordeaux et Avignon ont obtenu d’être considérées comme des zones touristiques en totalité, parce que les cinq dimanches ne leur suffisaient plus. Mais du coup, elles sont immédiatement passées à cinquante-deux dimanches.
M. Hetzel soulignait hier qu’ouvrir tous les dimanches n’avait aucun sens dans les communes proches de l’Allemagne, où les commerces sont fermés à ce moment-là ; M. Vercamer estimait à l’inverse qu’ouvrir cinquante-deux dimanches pour les communes voisines de la Belgique est pratiquement une nécessité ; pour M. Savary également, cela aurait beaucoup de sens dans les zones voisines de l’Espagne. Nous avons en fait besoin de plus d’intelligence au niveau des territoires, afin de sortir de ce dualisme « cinq – cinquante-deux ».
M. Poisson a indiqué hier que certaines grandes enseignes s’étaient déclarées sceptiques sur l’utilisation de ces cinquante-deux dimanches, dont elles n’ont pas forcément besoin. Les grandes enseignes de bricolage elles-mêmes considèrent que cela leur coûte trop cher d’ouvrir cinquante-deux dimanches par an, car tous les dimanches ne sont pas rentables ; une dizaine suffiraient. À Bordeaux, où certains enseignes ouvrent tous les dimanches de l’année, la ville estime qu’un dimanche par mois constituerait une bonne régulation : instituer un dimanche sans voitures par mois en ouvrant les commerces de centre-ville, c’est la rentabilité garantie. Offrir aux élus locaux la possibilité d’ouvrir, en fonction du lieu où ils vivent, jusqu’à douze dimanches par an, c’est leur rendre une liberté, celle de trouver leur propre modèle, le plus adapté à leur écosystème, sans basculer dans l’ouverture à tous crins.
Les grandes surfaces sectorielles, celles qui se sont retrouvées dans les PUCE, ont intérêt à travailler le dimanche. Mais pour nombre d’hypermarchés, ouvrir tous les dimanches de l’année n’est pas rentable, car cela les oblige à compenser. Passer à douze dimanches par an n’entrainera donc pas un détricotage du commerce de centre-ville : la plupart du temps, les hypermarchés et les surfaces moyennes de périphérie n’ouvriront pas, dissuadés par les compensations massives qui leur seraient demandées en contrepartie.
Face à ces évolutions, la réforme propose de rendre aux élus la liberté de s’adapter aux spécificités de leurs territoires. Dans ce contexte, le système incitatif de cinq dimanches par an peut sembler paradoxal – pour certains territoires, je pense même que c’est déjà trop – et le chiffre de douze dimanches n’a pas été choisi au hasard : il résulte de la concertation approfondie menée par M. Bailly. On ne saurait le soupçonner d’être un crypto-libéral à la solde de la grande distribution : c’est un ancien haut fonctionnaire et grand dirigeant d’entreprise qui a été à la tête de La Poste et de la RATP, et il n’a fait que prendre note du consensus qui se dégageait sur ce chiffre de douze dimanches par an. Ce n’est donc pas un hasard si l’on voit ce chiffre réapparaître spontanément dans des villes telles que Bordeaux ou dans le secteur du bricolage, qui déclare y voir ce qui correspond à ses besoins réels.
Sans doute faut-il mieux définir le rôle de l’intercommunalité et des métropoles, trouver les bonnes régulations. Pour l’heure, tout se passe comme si l’on avait peur de donner cette liberté aux élus : et, de fait, ces douze dimanches par an, c’est bel et bien de la liberté donnée aux élus. Certes, il faudra peut-être chercher à corriger les comportements non coopératifs ou déstabilisants, mais ce ne peut être que le fruit d’un consensus. Pour ce qui est des règles de compensation, donc de justice, très justement pointées par Mme Fraysse, j’ai dressé tout à l’heure le tableau clinique des inégalités existant de fait selon les zones et les situations. Avec notre réforme, que va-t-il se passer ? Les dimanches du maire seront par définition payés double, tandis que tous les autres dimanches – que ce soit en zone touristique, en zone commerciale ou en ZTI – feront l’objet d’un accord ; à défaut d’accord définissant la compensation, il n’y aura pas d’ouverture.
Nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Pour ma part, je suis assez hostile à l’idée de définir un niveau de compensation dans la loi car ce système, qui découle des dispositions actuellement en vigueur, est très paradoxal. Si l’on sait qu’en l’absence d’accord, les heures travaillées le dimanche seront payées double, quelle incitation y a-t-il à trouver un accord ? Si vous imposez par la loi de les payer double, qui allez-vous tuer ? Les petits commerces de centre-ville, incapables de compenser à plus de 30 %. Les secteurs ouvrant traditionnellement le dimanche – la boulangerie, la boucherie – s’alignent d’ailleurs tous peu ou prou sur ces 30 %. Il faut donc laisser les accords – de branche, d’entreprise ou de territoire – définir les règles de compensation. Et si l’on ne trouve pas d’accord, il n’y a pas d’ouverture. Dans les 600 zones touristiques, qui ne sont pour l’instant couvertes par aucune règle de compensation, on laisse trois ans de délai pour conclure ces accords. Comme l’ont dit M. Hetzel et M. Vercamer, il faut éviter l’effet couperet de délais trop courts, six mois ou un an, qui obligeraient certains commerces à fermer faute d’avoir trouvé un accord. Grâce au nouveau système, plus simple et plus juste, on va dans de nombreuses zones sortir d’une situation où il n’y avait jusque-là aucune compensation. Et la compensation va donner du pouvoir d’achat.
Les zones touristiques internationales – ZTI – constituent un dispositif spécifique, assumé et très circonscrit. La réforme proposée par notre texte n’est en rien comparable, madame Mazetier, à celle que le Conseil constitutionnel avait censurée en 2009 au motif qu’il n’était pas acceptable de traiter différemment certaines collectivités dans le cadre d’un régime commun : en l’occurrence, nous créons un régime à part. Sans doute est-il possible d’ajouter d’autres critères, mais en l’état actuel des choses, le dispositif répond à notre principale préoccupation : favoriser l’activité. Dans certains quartiers – essentiellement à Paris et sur la Riviera –, ainsi que dans une quinzaine de gares françaises à gros trafic, ouvrir le dimanche crée, on le sait, de l’activité, engendrée par le passage de touristes et d’hommes d’affaires français et étrangers. Ne pas ouvrir le soir et le dimanche dans ces zones très spécifiques se traduit forcément par une perte d’activité, dans la mesure où il n’y a aucun report possible.
Je me méfie un peu des chiffres ; au demeurant, une étude d’impact sur le travail du dimanche de droit commun n’aurait aucun sens, puisque notre préoccupation première est de donner dans ce domaine une plus grande liberté aux élus. On peut toutefois relever qu’en ce qui concerne les ZTI, l’ouverture d’une quinzaine de gares le dimanche en France créerait environ 2 000 emplois directs et indirects, et l’ouverture des quatre grands magasins parisiens – le Printemps, les Galeries Lafayette, le BHV et le Bon Marché – autant, ce qui correspond à une augmentation de 5 % du chiffre d’affaires. Et l’on sait que, ce faisant, on crée de l’emploi, on crée de l’activité.
Le travail en soirée dans les ZTI soulève un problème très spécifique. Nous proposons de repousser la fermeture des magasins situés dans ces zones de vingt et une heures à minuit. La question qui se pose est celle des gens qui, dans ces zones, vont travailler le dimanche et en soirée. Actuellement, il s’agit en majorité de femmes et de jeunes à qui l’on proposera des contrats courts. Je sais qu’on a du mal à accepter l’idée que des étudiants prennent un job d’appoint, mais le fait est que les étudiants travaillent, parfois même durant leurs heures de cours ou tous les soirs, au risque de compromettre leurs études. Or, de ce point de vue, travailler le dimanche en bénéficiant de compensations est beaucoup moins nocif en termes de réussite scolaire.
Il est prévu que le travail effectué dans les ZTI entre 21h00 et minuit soit payé double, qu’il fasse l’objet d’un accord obligatoire – pouvant donner lieu à rétractation –, que les transports effectués en toute sécurité soient pris en charge par l’employeur – sujet important, plusieurs amendements de M. Travers viendront en préciser les détails. Le volontariat fait d’ores et déjà l’objet d’un formalisme prévu par la loi : il nécessite un document écrit et signé, reconfirmé tous les ans. Un dispositif spécifique aux femmes enceintes sera prévu par amendement, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection similaire à celle qui les couvre pour le travail de nuit. Transport et garde d’enfant doivent également faire partie des accords collectifs qui protégeront les femmes appelées à travailler en soirée. Quand Sephora ouvrait le soir sur les Champs-Élysées, les accords collectifs prévoyaient des compensations sous la forme d’heures payées double et de repos supplémentaires, ainsi qu’un retour en taxi payé par l’employeur : c’est un exemple de ce que pourront prévoir les accords collectifs à venir.
Défendre cette réforme n’a rien à voir avec le fait de défendre la loi Mallié en 2009, car notre texte constitue une réforme de justice sociale, qui ne traite pas uniquement des grandes zones commerciales, mais rend aux élus locaux la capacité d’adapter leur territoire à la réalité de la société. Il s’agit aussi de répondre aux évolutions de la société, dont nous devons tirer les conclusions – en disant cela, je pense à la « chronique d’un dimanche normal » que nous a détaillée hier Mme Capdevielle de manière très pittoresque. Permettre davantage de respiration, de liberté locale, garantir davantage de compensations et de justice, s’adapter à la réalité : tels sont les objectifs que nous poursuivons.
Cela ne nous exonère pas d’un vrai débat sociétal – ouvert hier par M. Poisson dans l’une de ses interventions – qui, dépassant largement le cadre du travail dominical, concerne toute l’organisation du travail dans notre pays, et qu’il serait tout à notre honneur de conduire de manière transpartisane : comment resynchroniser les temps au sein de la famille ? Comment conçoit-on et vit-on le travail dans ce pays ? Autant de questions qu’il faudra se poser. On travaillera plus longtemps, on arrive plus tard sur le marché du travail, on travaille différemment. De fait, la vraie question n’est plus celle du travail le dimanche ; c’est celle de la désynchronisation des temps au sein de la famille. D’ores et déjà, avec les 30 % de Français qui travaillent de manière occasionnelle ou régulière le dimanche, la synchronisation de la vie familiale soulève des questions. Pour dire les choses de manière triviale, mieux vaut être à deux à travailler dans un commerce de détail le dimanche, être payé double et bénéficier du même jour de repos compensateur dans la semaine, que ne jamais se voir parce que l’homme travaille le dimanche et la femme en semaine !
M. Francis Vercamer et Mme Élisabeth Pochon. Et les enfants ?
M. le ministre. Justement, il est plus facile de s’occuper de ses enfants quand on a le même jour de repos compensateur dans la semaine, et la garde de semaine est d’ores et déjà un problème pour de nombreux parents. La vraie question qui se trouve derrière tout cela, et que vous vous posiez légitimement, c’est celle de la synchronisation des temps au sein de la famille.
Je vous remercie, monsieur le président, de m’avoir permis ce rappel des faits et de la philosophie de cette réforme, dont l’objectif est de nous adapter à la réalité sans verser dans la libéralisation excessive, afin de rendre les choses meilleures.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1241 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. La solution proposée par le ministre – pas d’accord, pas d’ouverture – va constituer un levier extraordinairement efficace, qui va tout emporter. J’ai eu à connaître de la modulation du temps de travail, en particulier dans de grandes entreprises telles que le Crédit Lyonnais. Alors que tous les syndicats y étaient défavorables, un référendum a donné aux salariés l’occasion d’indiquer qu’ils étaient à 85 % favorables à la modulation du temps de travail – ce qui a, au passage, provoqué l’explosion de la CFDT au Crédit Lyonnais : les salariés ont pris le pouvoir contre les syndicats ! Et je ne doute pas que d’autres épisodes similaires se reproduiront.
Par ailleurs, à titre personnel, j’ai toujours eu tendance à considérer que c’était bien davantage au travail que devant sa télévision que l’on trouvait son épanouissement personnel. Mon amendement SPE1241 a pour objet de mettre en conformité les dispositions du code du travail relatives aux dérogations au repos dominical, et notamment les dérogations permanentes de droit, avec les stipulations de la Convention OIT n° 106 sur le repos hebdomadaire.
En effet, l’article 7 de la Convention précise que pour mettre en place les dérogations permanentes ou non, il faut tenir compte de toute considération sociale et économique pertinente. Il est également rappelé au préalable que le Conseil constitutionnel a affirmé, dans sa décision n° 2009-588 du 6 août 2009, le caractère constitutionnel du principe du droit au repos hebdomadaire, tout en excluant le caractère constitutionnel du repos dominical.
Nous avons donc estimé qu’il était impératif de mettre en conformité l’ensemble des dérogations au repos dominical avec les stipulations de la Convention OIT n° 106 en rappelant les principes suivants : principe de volontariat, principe de compensation en salaire ou en repos, report du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, mise en œuvre de ces principes soumise à négociation collective. Mais, je le répète, le principe essentiel est bien celui-ci : pas d’accord, pas d’ouverture.
M. le ministre. Nous sommes tout à fait d’accord avec la philosophie de cet amendement, identique à celle de notre texte. Nous reviendrons, lors de l’examen d’un amendement à venir, sur le volontariat du dimanche du maire – qui, en l’état actuel, est payé double justement parce qu’il n’est pas anticipable par le salarié. Plus généralement, les différentes dispositions prévues par votre amendement, qui seront satisfaites par ce qui va suivre, présentent l’inconvénient de ne pas correspondre à l’architecture de notre texte. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Alain Tourret. Je le retire.
L’amendement SPE1241 est retiré.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE1219 de M. Jean-Yves Caullet et SPE1868 des rapporteurs.
M. Jean-Yves Caullet. Cet amendement vise à remédier à une situation rappelant la chauve-souris de La Fontaine, qui se faisait passer tantôt pour un oiseau, tantôt pour une souris, en fonction des circonstances. En l’occurrence, les dérogations accordées par nature aux commerces alimentaires le dimanche sont également accordées aux grandes surfaces dites « principalement alimentaires ». D’un côté, les grandes surfaces disent être alimentaires afin de bénéficier du même régime que les petits commerçants ; de l’autre, elles mettent en avant le même motif pour refuser d’accorder des compensations à leurs salariés, ce qui induit une inégalité. Je précise qu’il s’agit d’un amendement d’appel, que je suis disposé à retirer une fois que M. le rapporteur nous aura présenté son amendement portant sur la même question.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. L’amendement SPE1868 a pour objet de répondre à la difficulté existant dans le cadre du régime applicable au commerce alimentaire, qui bénéficie d’une dérogation permanente et de droit au repos dominical jusqu’à treize heures. Nous entrons ici véritablement dans l’esprit du texte : le but est de redonner des contreparties et de la justice sous forme de compensations salariales à un certain nombre de salariés.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par l’arrêté du 26 juillet 2002, prévoit aujourd’hui que les salariés qui travaillent habituellement le dimanche bénéficient d’un jour et demi de repos consécutif dans la semaine ou, le cas échéant, d’une majoration de 20 % de leur salaire. Autrement dit, les contreparties salariales ne sont ni obligatoires ni systématiques et nous avons tous, sur nos territoires, des exemples de salariés éprouvant des difficultés dans la relation sociale qu’ils ont avec leur employeur, du fait de l’absence de compensations. Il s’agit souvent de femmes isolées, de familles monoparentales, pour qui le travail du dimanche matin est devenu une véritable épreuve, en raison des difficultés que pose la garde des enfants – le tarif de l’assistante maternelle étant souvent supérieur au salaire que les intéressés vont gagner en allant travailler le dimanche matin.
La convention collective actuellement applicable dans le secteur du commerce de détail ne prévoyant pas de contrepartie salariale systématique, l’amendement SPE1868 propose que de telles contreparties s’imposent dans les commerces dont la surface de vente excède 400 mètres carrés, et disposant de la surface financière suffisante pour offrir de telles contreparties – ce qui n’est pas le cas des petits commerces. L’amendement fixe le plancher de contrepartie à 30 % de la rémunération normalement due, et se place ainsi au-delà de la majoration actuellement prévue par la convention collective.
Les données de l’INSEE montrent qu’au cours des dernières années, les grandes surfaces ont beaucoup progressé au détriment des petits commerces alimentaires. Il y a donc ici un enjeu très fort, que l’on ne peut ignorer, en termes de protection du petit commerce et de garantie d’une concurrence à armes égales qui n’est pas totalement assurée aujourd’hui. Notre amendement vise à contribuer à la préservation du petit commerce de centre-ville sur nos territoires, mais aussi à garantir la mixité de notre tissu commercial.
M. Francis Vercamer. Il y a ce matin une chose que j’ai un peu de mal à comprendre. Monsieur le ministre, vous avez indiqué à plusieurs reprises que le fait de doubler les salaires dans les petits commerces allait pénaliser ceux-ci ; j’entends bien ce discours, ainsi que le dispositif du présent amendement, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux commerces de plus de 400 mètres carrés. Mais qu’en est-il actuellement dans la loi ? En vertu de l’article L. 3132-27 du code du travail, « chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. » Votre projet de loi n’abrogeant pas cet article, il va avoir pour conséquence de créer une inégalité entre les personnes travaillant dans les grandes surfaces, qui seront augmentées de 30 %, et celles travaillant dans les petits commerces, qui vont bénéficier d’un doublement de salaire. Cet amendement ne me semble donc pas aller dans le sens de ce qui est dit depuis le début de la séance.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Je précise qu’il s’agit des commerces alimentaires bénéficiant d’une dérogation pour l’ouverture dominicale de neuf heures à treize heures. Il ne s’agit pas des dimanches du maire, mais des dérogations s’appliquant aux supermarchés de chefs-lieux de canton.
M. Francis Vercamer. On n’en crée pas moins une inégalité !
M. le président François Brottes. Il ne vous aura pas échappé, cher collègue, que cette inégalité existe déjà, et de manière beaucoup plus criante.
Mme Sandrine Mazetier. Je partage la préoccupation exprimée par les députés du groupe socialiste, mais aussi par le ministre, me semble-t-il, d’assurer une égalité des compensations accordées. À ce titre, j’appelle votre attention sur le fait que vous n’excluez pas, monsieur le ministre, en l’absence d’accord au bout de trois ans – délai que je juge bien long –, un accord unilatéral avec référendum. Je ne fais de procès d’intention à personne, mais un chef d’entreprise peut en trois ans avoir renouvelé une bonne partie de son personnel afin de s’assurer de la réussite du référendum visant à proposer des compensations d’un montant très modeste.
L’actrice Marion Cotillard vient d’être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Deux jours, une nuit, des frères Dardenne, où elle incarne cette jeune femme qui dispose seulement d’un week-end pour convaincre ses collègues de renoncer à leur prime afin qu’elle puisse garder son travail. Ce film illustre de façon frappante l’inégalité du rapport de forces entre l’employeur et ses salariés, et la grande difficulté dans laquelle peuvent se trouver certains salariés dans le contexte de crise économique, de licenciements et de plans sociaux. En tant que législateur, nous devons veiller à protéger ceux qui n’ont pas les moyens de faire jouer le rapport de forces.
M. le ministre. Il n’y avait rien, dans ce que j’ai évoqué précédemment, au sujet du commerce alimentaire, que la loi Mallié a autorisé à ouvrir le dimanche jusqu’à 13h00 au lieu de 12h00, sans imposer de compensation légale – nombre de compensations, sous forme de repos ou de majorations salariales de 20 % à 30 %, étant cependant négociées branche par branche, comme le veut l’usage dans ces professions. Ce qui est proposé ici, c’est de restaurer un avantage au profit du commerce de centre-ville, en considérant qu’au-delà d’un certain seuil, les acteurs économiques concernés ont la capacité de payer une compensation de droit commun un peu supérieure sans que cela mette en péril leur équilibre financier – à moins que cela ne les incite à ne pas ouvrir, ce qui favorisera également le commerce de centre-ville.
Il y a là une réflexion intéressante à mener, étant précisé que les conséquences des dispositions proposées doivent, elles aussi, être soigneusement examinées au regard des critères d’égalité, en veillant notamment aux effets de bord. En tout état de cause, je suis ouvert à la discussion, car le seul secteur où aucune compensation n’est prévue serait celui du commerce alimentaire. Comme je l’ai déjà dit, prévoir une compensation par la loi ne correspond pas à la philosophie de notre texte. Je suggère donc au rapporteur et à M. Caullet de retirer leurs amendements, en leur donnant l’engagement du Gouvernement à travailler sur la question avant la séance, l’objectif étant de mettre au point des éléments de compensation s’inscrivant dans une approche aussi homogène que possible.
M. Olivier Carré. Et pour les enseignes de centre-ville ?
M. le ministre. Une réflexion mérite d’être menée pour les commerces situés entre 1 000 mètres carrés et 400 mètres carrés. Et M. Carré a raison de souligner que l’amendement proposé ne prévoit pas de compensation légale pour les commerces alimentaires de centre-ville – dans lesquels une telle compensation est très souvent prévue dans les accords de branche.
Réfléchir, au-delà d’un certain seuil, à des éléments de compensation – ou à l’obligation de conclure un accord – me paraît pertinent, et je suis disposé à ce que nous examinions ensemble la question de manière constructive. Pour le moment, je demande donc à M. Caullet et au rapporteur thématique de retirer leurs amendements, en l’invitant à redéposer le sien d’ici à la séance.
Mme Cécile Untermaier. Stéphane Travers et moi-même travaillons depuis deux ans sur cette question, et j’avais été étonnée par le décalage qu’avait produit la loi Maillé en assimilant, dans le dispositif qu’elle introduisait, les commerces à dominante alimentaire aux commerces alimentaires au sens strict. Cet amalgame a eu pour conséquence une injustice sociale que nous allons corriger, car il nous paraît insupportable de voir les salariés de ces grandes surfaces, le plus souvent des femmes, condamnés depuis à travailler tous les dimanches jusqu’à treize heures sans aucune compensation – je dis bien « condamnés », car la notion de volontariat est dans leur cas parfaitement illusoire. D’où la nécessité impérative d’introduire une compensation en leur faveur, le repos dominical restant la règle de droit commun.
Le dispositif qui va permettre aux maires d’autoriser jusqu’à douze ouvertures le dimanche par an ne les amènera pas à faire un usage systématique de cette prérogative, dont l’application ne serait pas justifiée pour certains territoires. Par ailleurs, les grandes enseignes que nous avons consultées nous ont indiqué ne pas être intéressées par l’ouverture du dimanche en milieu rural et, si un système de compensation était mis en place, nombre d’entre elles considéreraient certainement qu’il n’est pas intéressant de travailler le dimanche.
Enfin, les commerces pratiquant exclusivement le détail alimentaire souffrent beaucoup de ce dispositif d’ouverture dans les territoires ruraux non touristiques. Ils perdent quasiment 30 % de leur chiffre d’affaires à raison de l’ouverture excessive de commerces à dominante alimentaire. La loi Maillé a introduit une rupture d’égalité entre les grandes surfaces et les commerces alimentaires de détail, condamnant les salariés des grandes surfaces à travailler jusqu’à treize heures tous les dimanches sans aucune contrepartie. Le projet de loi s’efforce de restaurer un tant soit peu de justice sociale.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Il vaut mieux être condamné à travailler qu’être condamné au chômage…
M. Olivier Carré. Il me semble important que le ministre, qui a évoqué à plusieurs reprises les commerces alimentaires, rappelle que ce qu’il dit est en rapport avec l’amendement. Chacun sait que les petits artisans qui ont trouvé leur équilibre d’exploitation seraient extrêmement fragilisés s’ils avaient l’obligation d’augmenter les salaires de leurs employés.
Par ailleurs, j’entends bien ce qu’a dit Cécile Untermaier au sujet des salariés, mais il faut réaliser que le dimanche est, pour certaines personnes, le seul moment possible pour faire leurs courses de première nécessité. Il faut, à tous points de vue, trouver un équilibre entre les intérêts des uns et des autres dans la vie quotidienne, ce qu’avait fait la loi Maillé en son temps – mais je conçois que les choses aient évolué depuis et qu’il soit devenu nécessaire de trouver un nouvel équilibre.
M. Francis Vercamer. Je n’ai rien contre l’instauration de contreparties dans les commerces alimentaires d’une certaine taille – qui, la plupart du temps, ne sont pas strictement alimentaires. Cela dit, je ne vois pas ce qui peut justifier une rupture d’égalité entre ces magasins et les autres, par exemple ceux situés dans les PUCE, où les salariés bénéficient d’un doublement de leurs heures travaillées.
Par ailleurs, nous ne sommes pas dans une économie administrée : ce n’est pas parce qu’il est permis de travailler le dimanche que tous les employeurs vont ouvrir leur magasin le dimanche – en tout état de cause, ils ne le feront pas si ce n’est pas rentable.
Mme Élisabeth Pochon. Nous avons été particulièrement touchés par l’audition de salariés, souvent des femmes, qui travaillaient dans le secteur alimentaire le dimanche matin. On pourrait penser que, dans des entreprises de cette taille, les syndicats disposent d’un poids suffisant pour faire aboutir des accords satisfaisants. Or, la plupart du temps, le travail du dimanche n’ouvre droit à aucune compensation, ni financière, ni sous la forme d’une journée de repos compensateur à choisir dans la semaine. Sans aller jusqu’à parler d’esclavage, nous étions en présence de situations pénibles et imposées. L’amendement qui nous est soumis vient donc à point nommé pour exprimer notre souhait de voir les salariés de ce secteur être traités comme les autres. Ce n’est pas parce qu’une situation perdure depuis plusieurs années que l’on ne peut y remédier.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je souffre vraiment quand j’entends parler, dans des discussions sur le travail le dimanche, d’esclavage ou de personnes « condamnées à travailler ». Cela montre que nous avons en France un rapport compliqué à la notion de travail. Paradoxalement, plus on a encadré le travail au fil des années – le code du travail ne fait que s’alourdir –, plus on a protégé l’emploi, et plus il y a de chômage : nous en sommes à 5 millions de demandeurs d’emploi et de précaires. Prenons conscience que le plus pénible, ce n’est pas de travailler, mais bien de ne pas avoir de travail ou de perdre son emploi. Certains mots employés ici contribuent à adresser un message bien négatif, particulièrement aux jeunes qui peuvent nous écouter.
Mme Karine Berger. L’amendement soutenu par les rapporteurs et le groupe socialiste me paraît très important pour rétablir l’égalité. Je ne suis pas d’accord avec Francis Vercamer lorsqu’il affirme que la décision d’ouvrir ou non un commerce obéit à un équilibre social et de marché. Dans ma ville de Gap, sitôt qu’une ou deux boutiques décident d’ouvrir durant un des cinq dimanches autorisés par le maire, toutes les autres boutiques s’empressent de faire de même, de peur de se faire prendre du chiffre d’affaires par le voisin. Il n’y a donc pas de décision individuelle en la matière : si vous donnez la liberté d’ouvrir, vous créez inévitablement des phénomènes de chalandise, c’est-à-dire des comportements de nature collective : ce ne sont jamais des boutiques isolées qui ouvrent, mais toutes les boutiques situées dans une zone de chalandise donnée. C’est l’une des raisons qui justificie l’amendement du groupe socialiste rétablissant l’égalité, et qui va dans le bon sens économique et social.
M. Christophe Caresche. Si cet amendement me paraît tout à fait intéressant, encore faudrait-il clarifier les objectifs que nous poursuivons. Il subsiste en effet certaines ambiguïtés, notamment celle relative à la compensation salariale. Comme le ministre, j’estime que celle-ci doit, aussi souvent que possible, être renvoyée à la négociation et au dialogue social.
Une autre question est celle de la grande distribution par rapport au petit commerce. La loi Mallié ayant autorisé l’ouverture le dimanche de commerces à dominante alimentaire, un supermarché vendant des produits alimentaires, mais aussi de l’électroménager et des vêtements, pourra lui aussi ouvrir jusqu’à treize heures le dimanche. J’ai cru comprendre que l’amendement pourrait avoir pour effet de dissuader certains commerces d’ouvrir le dimanche en raison du coût induit par les compensations salariales, ce qui ne me paraît pas tout à fait correspondre à l’objectif poursuivi. Si véritablement la loi Mallié crée une distorsion de concurrence avec le petit commerce, posons-nous la question de savoir s’il faut revenir sur ce critère actuel de vente d’au moins 50 % de produits alimentaires, et d’autoriser l’ouverture aux seuls commerces strictement alimentaires, et non aux commerces hybrides, si vous me passez l’expression.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Sébastien Huyghe s’est étonné hier de nous voir rouvrir la boîte de Pandore. Les échanges que nous venons d’avoir montrent, à eux seuls, la nécessité de revoir cette question, tant nous avons de mal à comprendre, entre nous, de quoi nous parlons exactement. Il faut bien distinguer ce qu’il est convenu d’appeler les « dimanches du maire » et les ouvertures dérogatoires constantes des commerces dits à dominante alimentaire. Ces deux cas de figure montrent bien la complexité de l’entrelacs réglementaire dans lequel nous nous débattons, et qui empêche l’application de droits homogènes à l’ensemble des salariés.
Évidemment, la solution la plus commode eût été de cacher la poussière sous le tapis… Nous avons choisi de faire l’inverse et profité de cette affaire du nombre de possibilités d’ouverture dominicale pour nous préoccuper de situations sociales que le groupe de travail auquel ont pris part nos collègues Cécile Untermaier, Élisabeth Pochon et Stéphane Travers avait mises au grand jour.
J’entends dire que l’on ne peut laisser perdurer des inégalités. Nous en sommes bien d’accord, et c’est la raison pour laquelle nous avons rouvert le chantier, étant précisé que nous devons, du fait de la multiplicité des dispositions régissant les compensations – ici un accord d’entreprise, là un accord de branche, ailleurs un article du code du travail –, organiser des convergences et susciter des accords afin de tendre vers une réduction des inégalités de traitement des salariés concernés par le travail dominical, à défaut d’aboutir à l’égalité parfaite. Nous devons donc nous interroger sur la meilleure façon d’harmoniser et de corriger les règles en vue de la meilleure homogénéisation possible, afin de sortir d’un système de travail dominical imposé, subi et coûteux, notamment dans les commerces à dominante alimentaire, tout en mettant en œuvre l’objectif du projet de loi tel que le ministre l’a rappelé tout à l’heure. Les amendements que nous examinons constituent une première base d’approche pour ces deux chantiers, qu’il serait intéressant d’affiner d’ici à la discussion en séance publique.
Mme Jacqueline Fraysse. Jean-Charles Taugourdeau, nous explique que l’encadrement du travail excessif à ses yeux serait à l’origine d’un chômage important, encore aggravé par les effets nuisibles d’un rapport au travail qui serait spécifique à la France. Mais le chômage, malheureusement, n’augmente pas qu’en France : son appréciation est donc erronée.
« Le pire, c’est le chômage », a-t-il déclaré : c’est vrai, quoiqu’à mes yeux, le pire, c’est la mort. Mais si l’on suivait son raisonnement, ceux qui ont la chance d’avoir un travail devraient accepter les pires conditions, même en termes de pénibilité ou de santé.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je n’ai pas dit cela !
Mme Jacqueline Fraysse. Jean-Charles Taugourdeau n’a pas dit cela, mais c’est à cela que conduit son raisonnement, que je ne saurai soutenir. Du reste, si on le poussait jusqu’au bout, il n’y aurait plus qu’à supprimer le code du travail, qu’il trouve trop épais ! Il est vrai que s’il ne faisait que deux pages, cela faciliterait considérablement les choses, mais en portant atteinte aux droits et à la vie des salariés. Aller dans cette voie aurait des conséquences catastrophiques.
M. Jean-Yves Caullet. Nous avons reconnu unanimement qu’il fallait résoudre les problèmes d’injustice sociale, de concurrence déloyale et de calage de seuils, en articulant les régimes et en corrigeant certaines des situations existantes. J’ai été convaincu par l’engagement du ministre à travailler sur ces questions d’ici à la séance publique dans l’esprit de l’amendement SPE1219 que j’ai défendu au nom de mon groupe ; c’est pourquoi je le retire.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Le texte sur lequel nous travaillons ce matin ne touche pas aux dérogations dont bénéficie le commerce alimentaire. Les magasins à dominante alimentaire pourront continuer d’ouvrir le dimanche dans le cadre actuel. Il nous est toutefois paru nécessaire de revenir sur la question des compensations, dont la plupart des salariés ne bénéficient pas. Je tiens à saluer la volonté du ministre d’aboutir avec nous à une solution d’ici à la séance publique, car il s’agit d’un véritable problème de justice sociale qui concerne un grand nombre de salariés. Je retire également mon amendement.
Les amendements SPE1219 et SPE1868 sont retirés.
*
* *
Article 71
(art. L. 3132-21 du code du travail)
Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale
Cet article concerne la dérogation au repos dominical de l’article L. 3122-20 du code du travail accordée par le préfet pour les établissements dont la fermeture ou l’absence de fonctionnement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement. Il s’agit d’autorisations accordées également hors commerces de détail : elles peuvent l’être soit pour la poursuite de chantiers de bâtiments et travaux publics, le déménagement d’une entreprise, ou encore pour de la maintenance informatique. Elles peuvent en outre concerner aussi des établissements de services (coiffure, banques, sociétés immobilières, par exemple). Lorsqu’elles émanent de commerces de détail, – ce qui représente la majorité des demandes d’ouverture à ce titre –, celles-ci concernent le plus souvent des commerces situés en bordure d’une zone touristique ou d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), et reposent donc en réalité sur la dénonciation d’une situation de concurrence déloyale liée à l’ouverture dominicale des commerces voisins situés sur cette zone ou ce périmètre.
Cet article procède avant tout à une modification d’ordre rédactionnel de l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail. Le livre Ier recouvre en effet les dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés. Il s’agit ici du paragraphe consacré aux actuelles dérogations temporaires au repos dominical, qui concernent pour l’heure : les dérogations préfectorales accordées aux établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, les dérogations accordées aux communes d’intérêt touristique ou thermales et aux zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, les dérogations accordées aux périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), ainsi que les cinq dimanches du maire.
En conséquence des modifications apportées à l’ensemble de ces autorisations d’ouverture dérogatoires par les articles 71 à 82 du projet de loi, le I du présent article propose de substituer à l’intitulé : « Dérogations temporaires au repos dominical » l’intitulé : « Autres dérogations au repos dominical », dans la mesure où certaines dérogations couvertes par ce paragraphe seront désormais permanentes, et par opposition aux dérogations permanentes ou conventionnelles au repos dominical qui existent par ailleurs pour les établissements soumis à des contraintes de production, d’activité ou à des besoins du public (article L. 3132-12), pour les commerces alimentaires (article L. 3132-13), ou pour certaines industries ou entreprises industrielles qui doivent fonctionner en continu ou sur la base d’équipes de suppléance (articles L. 3132-14 à L. 3132-19).
Le II propose ensuite de réaffirmer le caractère temporaire de la dérogation individuelle accordée par le préfet aux établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, tout en le précisant. En effet, avant la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, le principe selon lequel cette autorisation préfectorale était accordée « pour une durée limitée » était prévu à l’article L. 3132-21, la loi « Mallié » l’ayant inscrit à l’article L. 3132-25-4, en précisant que cette autorisation était accordée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. Cet article fait l’objet d’une réécriture globale dans le cadre de l’article 77 du présent projet de loi. Le rétablissement de l’article L. 3132-21 ne fait donc que reprendre ces dispositions, en précisant toutefois que cette « durée limitée » est au maximum de trois ans.
En premier lieu, s’agissant de la consultation des partenaires sociaux au niveau de la commune, le principe de concordance implique que la consultation soit faite avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs implantées au niveau communal : en effet, l’octroi de la dérogation à un établissement pouvant avoir des impacts sur les établissements du même secteur et situés dans la même zone géographique, l’échelon communal semble être le niveau le plus approprié pour la consultation. De toute évidence, dans l’hypothèse où ces organisations n’auraient pas de structure territoriale de représentation dans la commune, il conviendra de consulter l’échelon territorial compétent de l’organisation, conformément à ses statuts, pour la zone concernée, soit le plus souvent l’échelon départemental, voire l’échelon régional.
Ensuite, s’agissant de la durée de l’autorisation préfectorale, dans les faits, ces autorisations sont parfois renouvelées quasi-automatiquement sur de très longues périodes. A contrario, dans certains cas, elles ne sont accordées que pour une durée d’un an, l’établissement devant alors formuler une nouvelle demande chaque année, ce qui ne lui permet pas de disposer d’une visibilité suffisante, tant pour l’employeur que pour les salariés. Le rapporteur thématique estime qu’une durée fixée à trois ans – ni plus, ni moins - serait plus appropriée et permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux établissements qui sollicitent une telle autorisation dérogatoire : une telle durée aurait l’avantage de leur offrir une capacité de projection de l’activité à moyen terme, mais aussi de permettre aux services instructeurs de réexaminer périodiquement que les critères pour l’octroi de la dérogation sont bien réunis.
*
* *
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de MM. Alain Tourret et Joël Giraud qui prévoit une consultation de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, préalablement à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant l’ouverture dérogatoire d’un établissement pour des motifs d’intérêt du public ou pour assurer le fonctionnement normal de l’établissement.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE103 de M. Gérard Cherpion et SPE431 de M. Patrick Hetzel, qui tendent à supprimer l’article.
M. Jean-Frédéric Poisson. La loi Mallié, c’est vrai, n’est pas parfaite : j’ai même sans doute été plus sévère que vous hier au soir à son sujet. Je pense en revanche que ceux qui soutiennent que cette loi a, non pas créé des droits, mais produit des injustices, ne l’ont pas lue avec précision. Je vous rappelle en effet que son premier article dispose que chaque salarié qui travaille le dimanche a droit à une rémunération double et à un repos compensateur équivalent, dans les PUCE comme dans les zones touristiques.
En revanche, ce que n’a pas traité la loi, c’est effectivement la question du commerce de détail. Monsieur le ministre, je vous souhaite bon courage pour trouver une solution équilibrée, qui ne mette personne en difficulté : nous n’avons pas réussi. Sans doute n’étions-nous pas mus par la force du progrès autant que vous l’êtes, par définition et par posture !
Je rappelle que la loi Mallié s’était cantonnée à un seul objectif : mettre du droit là où il n’y en avait pas : c’est ainsi que l’ouverture le dimanche des commerces des zones touristiques ou des zones commerciales situées autour des grandes villes n’était pas encadrée par le droit. Les arrêtés préfectoraux autorisant les ouvertures étaient systématiquement attaqués par les syndicats, notamment Force ouvrière, qui ont récupéré des sommes considérables devant les tribunaux qui leur ont toujours donné raison.
En revanche, je le répète, s’agissant du commerce de détail, nous n’avons pas réussi à régler les problèmes que l’ouverture le dimanche pose en termes de capacité financière des commerçants et des artisans ou de volontariat des salariés. Que le texte fasse le choix final de l’accord d’entreprise ou celui de l’accord de branche, peu importe au fond : vous ne pourrez jamais être assuré que le salarié qui travaille le dimanche est volontaire et n’a pas cédé à des pressions. Comment peut-on être sûr qu’il est réellement volontaire ? On ne peut pas.
J’ai bien entendu l’intervention – souriante – de Colette Capdevielle hier soir. Nous avons à peu près le même à Rambouillet, sauf que nous, nous avons même l’électricité… Et il faut bien que des gens pédalent dans la cave pour qu’il y ait du courant toute la journée ! Qui a dit qu’il fallait interdire le travail dominical ? Personne. Il s’agit simplement de veiller à ne pas élargir de manière disproportionnée des systèmes socialement contraignants pour les familles, car toutes les compensations du monde n’y changeront rien. Oui, les maires ont raison de penser qu’ouvrir cinquante-deux dimanches, ce n’est pas la même chose qu’ouvrir cinq dimanches. D’ailleurs, l’autorisation d’ouvrir tous les dimanches aurait de telles conséquences sociales qu’elle engendrerait sa propre limitation.
Je le répète : aucune mesure salariale ne viendra compenser la perte, en termes de richesse humaine, engendrée par le travail du dimanche. Telle est ma clé d’entrée dans ce débat depuis bientôt sept ans. Il est bien de penser au consommateur et à l’activité, à condition, toutefois, de ne pas oublier ceux qui seront contraints, même contre une compensation financière, de se lever tôt le dimanche pour aller travailler et qui rentreront tard.
Telles sont les raisons pour lesquelles je propose, par mon amendement SPE103 de supprimer l’article 71.
M. Patrick Hetzel. Le travail du dimanche existe déjà pour un nombre important de salariés, mais également de fonctionnaires ou de travailleurs libéraux.
Or l’article 71 modifie l’équilibre existant et c’est la raison pour laquelle mon amendement SPE431 vise à le supprimer. Karine Berger a eu parfaitement raison de souligner qu’il fallait raisonner non à l’échelle d’un commerce, mais en termes de zone de chalandise : la question de la distorsion de concurrence entre les grands magasins et le petit commerce de détail apparaîtra alors dans toute sa réalité. Bien que nous ne disposions d’aucune étude d’impact sur le sujet, il y a fort à penser que le nombre des emplois créés par l’ouverture le dimanche ne compensera pas celui des emplois détruits.
De plus, quelle sera l’incidence de cette mesure, en termes de précarité, sur les enfants, sur les femmes, et plus généralement la vie familiale, sociale et culturelle ? Il est tout de même surprenant que le texte ignore ces aspects-là. Certes, le projet de loi est centré sur les questions économiques : devons-nous pour autant accepter de déconnecter le volet économique de la vie sociale de nos concitoyens ? Le législateur doit prendre en considération l’ensemble des aspects touchés par le texte. Or ni l’exposé des motifs ni l’étude d’impact n’apportent de réponse à ces questions. Monsieur le ministre, vous voulez faire bouger les lignes sans avoir préalablement étudié l’impact réel que cette modification des équilibres aura sur la vie de nos concitoyens et sur l’activité économique.
M. le ministre. Monsieur Hetzel, je ne répéterai pas mon intervention liminaire : j’y ai décrit le monde dans lequel nous vivons et expliqué en quoi la situation avait changé depuis cinq ans.
Monsieur Poisson, vous vous trompez : la loi Mallié n’a prévu aucune compensation pour les salariés dans les zones touristiques. Si elle a prévu un doublement du salaire dans les PUCE à défaut d’accord, ce qui a permis de régulariser quarante et une zones, elle n’a en revanche prévu aucune compensation pour les Français qui travaillent dans les 600 zones touristiques. Je vous confirme donc bien que la loi Mallié a créé en matière de compensation des distorsions importantes et donc des injustices et qu’elle a favorisé les grands formats aux dépens des commerces de centre-ville en régularisant des PUCE où les salariés étaient payés double à défaut d’accord.
Non, la loi Mallié n’a rien à voir avec la philosophie qui est au cœur de ce projet de loi. Oui, celles et ceux qui se sont battus contre la loi Mallié ont eu raison. Le texte que nous vous présentons aujourd’hui, qui vise à homogénéiser les dispositifs, prévoit des compensations pour tous. Il s’inscrit de plus dans un souci de juste mesure entre cinq ouvertures et cinquante-deux ouvertures le dimanche.
L’article 71, quant à lui, vise à encadrer les autorisations préfectorales au titre du préjudice au public ou à l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement. Quant aux dimanches du maire, qui seront traités à l’article 80, ils doivent être perçus comme des instruments de flexibilité à l’échelon local.
Avis défavorable aux amendements de suppression.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Monsieur Poisson, le salaire double n’est prévu aujourd’hui que dans le cas des dimanches accordés par le maire et en cas de décision unilatérale de l’employeur. Comme l’a souligné le ministre, la loi Mallié ne prévoit aucune compensation pour les salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques.
S’agissant des amendements de suppression de l’article 71, je tiens à souligner que le texte ne modifie en rien la procédure applicable aux dérogations préfectorales, qu’elles soient accordées à titre individuel, pour assurer la continuité du fonctionnement d’un établissement, ou dans l’intérêt du public. Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Les dispositions de la loi Mallié ne s’appliquent pas en Alsace-Moselle où prévaut le code professionnel local. En sera-t-il de même des dispositions du présent texte ? Si tel n’était pas le cas, nous aimerions le savoir, car cela ne serait pas sans incidence sur le cours des débats en séance publique.
M. le président Brottes. C’est tout cela, la France…
M. le ministre. Je vous répondrai, monsieur Hetzel.
Je vous ferai remarquer que la loi Mallié elle aussi avait fait l’objet d’une étude d’impact assez réduite…
M. Patrick Hetzel. C’était une proposition de loi…
M. Gérard Cherpion. Deux logiques coexistent : la logique des dérogations de plein droit et permanentes, sans contrepartie spécifique pour les salariés – elle concerne le commerce alimentaire, le commerce de consommation immédiate comme les boulangeries, les commerces de certains secteurs non alimentaires comme l’ameublement, le bricolage ou les buralistes, et les commerces de détail dans les zones touristiques –, et la logique des dérogations temporaires avec contreparties. La difficulté est de réussir à trouver un système mixte : le retrait des deux amendements SPE1219 et SPE1868 révèle la complexité de la question, car il est difficile de résoudre la distorsion existant entre ces deux logiques.
En les mêlant, les mesures que vous voulez instaurer risquent de mettre en difficulté les commerces qui bénéficient de dérogations permanentes.
M. le ministre. L’article 71, qui concerne toutes les ouvertures dominicales, est un article de respiration qui vise uniquement des autorisations individuelles temporaires, par exemple pour réaliser un inventaire, autorisations qui sont à la main du préfet. Les consultations qu’il prévoit visent bien à pallier les effets pervers dus au zonage.
La Commission rejette les amendements SPE103 et SPE431.
Puis elle examine l’amendement SPE520 de M. Jean-Louis Bricout.
M. Jean-Louis Bricout. Il convient, en logique commerciale, de raisonner en termes de zones de chalandise, que les périmètres administratifs des communes et intercommunalités ne recouvrent pas nécessairement. On ne saurait ignorer les interactions entre les commerces du centre des bourgs et les zones commerciales périphériques des petites villes où, à l’intérieur d’une même zone de chalandise, entre les petites villes dont les commerces assurent un service de premier niveau et la plus grande ville qui satisfait des services de deuxième niveau – je pense notamment aux commerces d’équipement de la maison. Le samedi après-midi, les centres des bourgs sont siphonnés par la plus grande ville située à une distance raisonnable, où les consommateurs profitent de leur temps libre pour s’équiper en biens de deuxième service. J’ai peur que l’ouverture du dimanche n’ait le même effet.
C’est pourquoi mon amendement SPE520 vise à introduire le critère de la zone de chalandise en prévoyant la consultation des commissions départementales d’aménagement commercial.
M. le ministre. Les commissions départementales d’aménagement commercial – CDAC – jouent un rôle important en matière d’urbanisme commercial. Mais le champ de l’article 71 couvre des autorisations qui ne concernent pas seulement le commerce ; votre amendement concerne plutôt les dimanches du maire, qui sont traités à l’article 80. Par ailleurs, si votre souci d’une instance délibérative qui ne soit pas seulement municipale est légitime, les CDAC ne sont peut-être pas les instances les mieux adaptées à cette fin. Il convient en tout cas de prévoir une régulation des territoires évitant des comportements non coopératifs ou les effets de bord.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement à ce stade du texte.
L’amendement SPE520 est retiré.
La Commission examine ensuite les amendements SPE752 et SPE755 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Comme vous l’avez souligné, l’article 71 concerne non seulement les commerces mais tous les établissements qui, pour assurer un fonctionnement normal, doivent travailler le dimanche. Les contraindre à déposer une demande d’autorisation tous les trois ans au maximum n’est pas un signe de simplification administrative, compte tenu, en plus, du nombre de pièces justificatives que ces établissements devront joindre à leur demande.
C’est la raison pour laquelle l’amendement SPE752 vise à supprimer la nécessité de devoir demander une autorisation tous les trois ans et l’amendement SPE755, qui est de repli, à accorder une autorisation minimale de trois ans.
M. le ministre. Je le rappelle : l’article 71, qui cible des autorisations individuelles, vise à corriger les effets pervers liés au zonage en accordant localement, de manière flexible, un ou plusieurs dimanches, tout en prenant en considération les nuisances occasionnées et tous les autres effets possibles. Je tiens à vous rassurer : le formalisme qui accompagnera la demande sera léger.
Ces demandes concerneront, par exemple, des magasins souhaitant faire travailler leurs salariés un ou deux dimanches par an pour faire l’inventaire. Il s’agira de cas très individuels. Le délai de trois ans est celui qui est apparu le plus raisonnable à l’issue de la concertation.
Avis défavorable aux deux amendements.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. La proposition de Francis Vercamer ne va pas dans le bon sens. Les autorisations sont aujourd’hui données en moyenne pour trois ans, certaines pour un an seulement.
Je me suis moi-même demandé s’il ne convenait pas de fixer la durée de l’autorisation à trois ans dans tous les cas : en effet, les commerces qui n’obtiennent qu’une autorisation annuelle sont contraints chaque année de redéposer une nouvelle demande.
Quoi qu’il en soit, supprimer toute référence à une durée ne permettra pas d’assurer une sécurité juridique suffisante aux établissements concernés car rien n’interdira de prendre des arrêtés pour une durée inférieure. Fixer une durée maximale autorise un réexamen à une échéance raisonnable des autorisations qui ont été octroyées.
Avis défavorable aux deux amendements.
La Commission rejette successivement les amendements SPE752 et SPE755.
Puis elle examine l’amendement SPE1064 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. La décision de l’ouverture dominicale doit s’entendre à un échelon pertinent, à savoir l’intercommunalité. Tel est l’objet de l’amendement SPE1064.
M. le ministre. J’ai déjà répondu sur le sujet : l’article 71 cible des autorisations individuelles liées à des effets de zonage. Le niveau communal me semble le plus pertinent : l’intervention du préfet relève parfois du chirurgical et il ne faudrait pas exagérément l’alourdir. Votre amendement vise davantage les dimanches du maire, où se pose effectivement la question de la régulation intercommunale, que le texte a omis de mentionner.
C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement à ce stade du texte.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Je ne suis pas opposé à la consultation des EPCI pour des autorisations qui ont un impact sur l’intercommunalité. Je me demande toutefois si une telle consultation est pertinente pour des dérogations qui concernent des situations non commerciales, telles que des poursuites de chantier, des déménagements d’entreprises et de bureaux ou des autorisations qui n’ont pas d’impact particulier en dehors du territoire de la commune.
C’est pourquoi je vous propose de rectifier l’amendement en faisant précéder les mots : « le cas échéant, » par le mot : « et, ». En effet, dans la rédaction actuelle de l’amendement, les mots « le cas échéant, » portent également sur les autres acteurs consultés dans ce cadre, à savoir la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et les syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
M. Alain Tourret. J’accepte la proposition de rectification du rapporteur thématique.
M. le ministre. Je m’en remets également à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement SPE1064 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1685 des rapporteurs.
En conséquence, l’amendement SPE634 de M. Gérard Cherpion tombe.
La Commission examine ensuite les amendements SPE1135 et SPE1137 de M. Joël Giraud.
M. le ministre. L’amendement SPE1064 rectifié ayant déjà introduit à l’article 71 la consultation, le cas échéant, des EPCI, prévoir en sus la consultation de la Commission paritaire interprofessionnelle départementale – CPID – alourdirait exagérément le dispositif.
M. Joël Giraud. Je retire les deux amendements.
Les amendements SPE1135 et SPE1137 sont retirés.
Puis, la Commission adopte l’article 71 modifié.
*
* *
Article 72
(art. L. 3132-24 du code du travail)
Création des zones touristiques internationales
Cet article propose d’instituer des « zones touristiques internationales » codifiées à l’article L. 3132-24 du code du travail, au sein desquelles les commerces de détail seraient autorisés à ouvrir le dimanche.
Le rapporteur thématique remarque avant tout que le texte retenu s’éloigne ici des préconisations du rapport « Bailly », qui ne retient qu’une seule catégorie de zones touristiques, baptisées « périmètre d’animation concertée touristique (PACT) », et n’opère pas de distinction entre des zones touristiques à dimension « nationale » et des zones touristiques à dimension internationale.
Le I de cet article revoit avant tout l’architecture du paragraphe 3 consacré aux dérogations au repos dominical autres que celles rendues nécessaires par les contraintes de production, d’activité ou pour répondre aux besoins du public, celles existant pour les commerces alimentaires et les dérogations liées au besoin de fonctionnement en continu de certaines entreprises industrielles.
Ce paragraphe 3 comportera désormais trois sous-paragraphes : le premier concerne les dérogations sectorielles ou individuelles accordées par le préfet, dont l’intitulé demeure inchangé ; le deuxième sous-paragraphe est créé par le 2° du I et recouvre les « dérogations sur un fondement géographique », autrement dit les dérogations accordées aux zones touristiques internationales, aux zones touristiques, aux zones commerciales ainsi qu’aux commerces situés dans l’emprise des gares ; enfin, l’actuel second sous-paragraphe, qui recouvre les dérogations accordées par le maire, devient le troisième sous-paragraphe.
Le II procède au rétablissement de l’article L. 3132-24, qui posait précédemment le principe de l’effet suspensif des recours présentés contre les arrêtés préfectoraux d’autorisation ou d’extension de l’autorisation d’ouverture accordée dans certains secteurs d’activité. En effet, par une décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’effet suspensif du recours exercé contre l’autorisation temporaire d’ouverture dominicale : saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le contentieux opposant la société Sephora à des organisations syndicales de salariés, le juge constitutionnel a estimé que l’effet et la durée d’une telle suspension – qui se prolonge en effet jusqu’à la décision de la juridiction administrative compétente – rapportés au caractère temporaire de l’autorisation accordée, étaient contraires aux principes constitutionnels en matière de droit à un recours juridictionnel effectif et d’équilibre des droits des parties.
Sur le fond, rappelons que le rapport remis par M. Jean-Paul Bailly au Premier ministre le 2 décembre 2013 sur les exceptions au repos dominical (195) préconisait également de supprimer l’effet suspensif automatique, prévu à l’article L. 3132-24, des recours à l’encontre des dérogations individuelles accordées sur le fondement de l’article L. 3132-20. En effet, cette procédure avait initialement vocation à garantir les droits des salariés à une époque où ces autorisations individuelles n’étaient pas assorties de garanties sociales, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ensuite, ce sont actuellement les tribunaux administratifs qui statuent sur ces recours, et qui ne sont tenus au respect d’aucun délai, alors même qu’antérieurement, le Conseil d’État était compétent et devait se prononcer dans un délai d’un mois. Enfin, la suppression de cette procédure ne signifie pas que la suspension d’une autorisation d’ouverture ne pourra plus être prononcée par le juge : celui-ci devra, sur une saisine en référé-suspension, estimer si l’urgence est constituée, et pourra donc le cas échéant prononcer une telle suspension ; celle-ci perdra simplement son caractère automatique.
Ces dispositions sont donc supprimées par la nouvelle rédaction proposée par le II du présent article, qui instaure une nouvelle possibilité d’ouverture dominicale dérogatoire des commerces situés dans les zones touristiques internationales. Les commerces de détail de ces zones pourront donc, en vertu du I de l’article L. 3132-24 dans sa nouvelle rédaction, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4, qui font l’objet des articles 76 et 77 du projet de loi, commentés infra.
Le II de l’article L. 3132-24 précise la procédure de délimitation de ces zones. La compétence de la délimitation des zones touristiques internationales est confiée aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque celui-ci existe, et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, « compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France ».
Cette procédure appelle plusieurs remarques.
En premier lieu, la compétence de la délimitation des zones touristiques internationales revient à l’autorité ministérielle, et non plus comme c’est le cas aujourd’hui pour les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente à l’autorité préfectorale. Cette modification s’explique par le profil de ces zones touristiques internationales, qui jouent un rôle important pour l’attractivité du territoire et son rayonnement à l’étranger, qui dépasse le cadre territorial départemental et même régional. La délimitation de la zone par arrêté ministériel intervient après consultation du maire, du président de l’EPCI le cas échéant si celui-ci existe, ainsi que des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés. Rappelons qu’aujourd’hui c’est le maire qui est à l’initiative de la demande de classement en zone touristique.
Ensuite, la délimitation de ces zones tient compte de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidanst hors de France. En effet, la spécificité de ces zones – qui seront a priori peu nombreuses sur le territoire – réside dans leur pouvoir d’attraction des touristes au-delà des frontières nationales. D’après les informations fournies au rapporteur thématique, à Paris, ces zones pourraient couvrir l’avenue des Champs-Élysées, la rue du Faubourg Saint-Honoré, la place de l’Opéra, la Place Vendôme, la rue des Francs-Bourgeois, l’avenue Montaigne et le quartier Saint-Germain, mais aussi la proximité des quatre grands magasins parisiens (Galeries Lafayette, Printemps Haussmann, BHV et Le Bon Marché) ou des Champs-Élysées. Le nombre exact des futures zones touristiques internationales n’est pas arrêté, mais en dehors de Paris, ces zones devraient être très peu nombreuses. Si le Mont-Saint-Michel a pu être évoqué dans les débats, le rapporteur thématique estime qu’une telle désignation n’aurait que peu d’impact sur les commerces du Mont, au vu de la configuration actuelle du paysage commercial de l’îlot. Ont également pu être évoqués des quartiers de front de mer de certaines villes, telles qu’Antibes, Nice ou encore Deauville. Toutefois, certaines de ces zones pourraient par ailleurs d’ores et déjà figurer dans le classement en zone touristique.
Le rapporteur thématique estime que dès lors qu’il s’agit de zones dont le rayonnement est « international », il n’y aurait pas lieu de tenir spécifiquement compte de l’affluence des touristes nationaux pour les définir : la seule prise en compte de l’affluence touristique étrangère semblerait plus appropriée.
En outre, s’agissant des « syndicats d’employeurs et de salariés intéressés », et eu égard au caractère national de la zone, les organisations à consulter sont a priori celles qui sont représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour autant, selon la nature des activités présentes dans la zone, il pourrait apparaître nécessaire de consulter les organisations représentatives des professions concernées : c’est pourquoi le texte ne précise pas de niveau déterminé de consultation des partenaires sociaux.
Le III prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. Ce décret aurait notamment vocation à préciser les modalités de consultation et les délais impartis à l’autorité ministérielle pour arrêter ces zones.
*
* *
La Commission examine les amendements SPE432 de M. Patrick Hetzel, SPE843 de Mme Jacqueline Fraysse, SPE1355 de M. Jean-Louis Roumegas et SPE1403 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l’article.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE432 vise à supprimer l’article 72 qui traite des exceptions au repos dominical et en soirée dans les zones touristiques internationales.
Le projet de loi, qui va au-delà des équilibres définis en 2009 par le Parlement, suscite des interrogations jusque dans les rangs de la majorité, puisque Mme Hidalgo, maire de Paris, a fait part de sa désapprobation tant sur la méthode que sur le contenu. Je partage son regret de voir réduire les pouvoirs du maire dans le seul but d’accroître ceux de Bercy.
Nous ne disposons d’aucun chiffre nous permettant d’évaluer les effets du départ supposé de touristes étrangers le week-end à Londres pour y faire leurs achats. Pouvez-vous nous apporter des données statistiques probantes sur ce point, monsieur le ministre ?
Mme Jacqueline Fraysse. Les dérogations prévues dans les zones touristiques internationales auront les conséquences sociales les plus lourdes pour les salariés, puisqu’elles prévoient l’ouverture tous les dimanches et tous les jours en soirée.
Qui plus est, les critères de délimitation de ces zones sont très flous. Le texte évoque, pour les définir, leur rayonnement international ainsi que l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France. Mais à quoi mesurera-t-on ce rayonnement international ou cette affluence exceptionnelle ?
Enfin, la décision finale de la création de ces zones reviendrait aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce et non aux élus locaux. Ceux-ci seront consultés, certes, mais n’auront pas le dernier mot. Pourtant, ce sont bien les territoires que les élus locaux administrent qui subiront les conséquences, en termes d’aménagement, de ces décisions ministérielles. Une telle démarche va à l’encontre de l’objectif affiché d’un texte qui prétend s’inscrire dans une logique prospective d’aménagement du territoire.
Si la loi Mallié mérite à coup sûr de nombreuses critiques, plusieurs de ses dispositions sont à bien des égards meilleures que certaines de ce projet de loi. Ainsi, alors que la loi actuelle prévoit, dans les PUCE, le doublement du salaire à défaut d’accord, si le projet de loi est adopté, les PUCE deviendront des zones commerciales et les salariés n’auront plus aucune certitude de toucher un salaire double le dimanche. Les compensations seront subordonnées à un accord dont le texte ne fixe pas le plancher.
Voilà pourquoi je propose par mon amendement SPE843 de supprimer l’article 72.
M. le président François Brottes. Ces questions précises devront recevoir des réponses précises.
M. Jean-Louis Roumegas. C’est l’extension du travail du dimanche qui, à nos yeux, pose problème.
Le ministre, pour justifier cette extension, argue que nous avons changé d’époque et qu’il faut désormais tenir compte de la concurrence du commerce en ligne. Or le commerce en ligne étant accessible de jour comme de nuit, si l’argument du ministre était pertinent, pour rétablir une concurrence équitable, il faudrait ouvrir les commerces de nuit comme de jour, sept jours sur sept, 365 jours par an… De plus, le commerce en ligne ne permet pas d’obtenir immédiatement ses achats : il implique un délai de livraison. Ce n’est donc pas la fermeture des magasins le dimanche qui aggrave la concurrence que ceux-ci subissent de la part du commerce en ligne, puisqu’elle est permanente : l’ouverture du dimanche ne rétablira donc pas l’équilibre.
L’ouverture du dimanche pose un autre problème, celui de l’exacerbation de la concurrence entre les magasins eux-mêmes. Les petits commerces s’en trouveront encore affaiblis par rapport à la fois aux grandes enseignes et au commerce en ligne, auquel les grandes enseignes, qui ont les moyens de réagir, se sont déjà mises, vous le savez fort bien.
Il convient de s’interroger plus particulièrement, à l’article 72, sur la pertinence de la création de ces zones touristiques internationales : quelles sont, en France, les zones très touristiques qui ne sont pas déjà ouvertes le dimanche ? Paris compte déjà sept zones dont les commerces sont ouverts le dimanche. Les touristes qui visitent le Mont-Saint-Michel le dimanche peuvent y faire leurs achats. Le seul enjeu posé par la création de ces zones touristiques internationales est celui de l’ouverture des grands magasins parisiens. Pourquoi décider leur ouverture sans respecter les règles de la décentralisation, c’est-à-dire en passant par-dessus le maire, d’autant qu’une telle décision risque de détruire des équilibres locaux, notamment, à Paris, de déstabiliser le petit commerce situé dans d’autres secteurs ? Le maire de Paris a raison de s’en inquiéter. Pourquoi le Gouvernement devrait-il avoir le dernier mot en la matière ?
Quel est, de plus, le potentiel économique réel de l’ouverture le dimanche dans les zones touristiques internationales créées par le texte ? Les arguments avancés ne sont pas convaincants. Les touristes étrangers, en particulier extracommunautaires, ne viennent pas à Paris pour une seule journée. Leur tour est organisé de façon à leur permettre d’effectuer leurs achats. La concurrence avec Londres est loin d’être crédible, d’autant qu’il faut un visa spécifique pour s’y rendre puisque le Royaume-Uni est en dehors de l’espace Schengen. La création de ces zones touristiques internationales, au seul profit de quelques grands magasins parisiens, nous semble d’un intérêt limité : nous y sommes donc opposés.
C’est pourquoi notre amendement SPE1355 vise à supprimer l’article 42.
Mme Sandrine Mazetier. J’ai déposé l’amendement SPE1403 pour ouvrir un débat sur la création des zones touristiques internationales.
Tel qu’il est actuellement rédigé, le texte autorisera, dans les zones touristiques internationales qu’il crée, l’ouverture des commerces vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. L’étude d’impact cite les Champs-Élysées comme exemple de ce que pourrait être une de ces zones touristiques internationales.
Selon les données du dernier salon international de l’immobilier commercial, le prix du mètre carré des baux commerciaux sur les Champs-Élysées s’élève en moyenne à 13 255 euros – il peut atteindre 18 000 euros. Des enseignes capables d’assumer un tel prix du mètre carré sont également capables d’assumer, au profit de leurs salariés, des contreparties et, surtout, un plancher de contreparties, en termes financiers et de repos compensateur, clairement fixé par le législateur. En effet, si le législateur ne peut tout maîtriser, il a au moins la possibilité d’inscrire dans la loi des contreparties.
Au demeurant, même si ces contreparties sont accordées, elles n’effaceront en rien l’effet dévastateur, en termes de prix du foncier, de la création de ces zones, y compris à leur périphérie. On parlait de services publics qui fonctionnent le dimanche : il n’y a plus de bureau de poste sur les Champs-Élysées. La Poste l’a fermé, car elle n’a plus les moyens de payer le loyer.
Comme Jacqueline Fraysse, je pense que le législateur doit préciser les critères présidant à la création de ces zones touristiques internationales. Sinon, rien n’interdira à une autre majorité ou à un autre Gouvernement d’élargir le périmètre de ces zones sans consulter le Parlement. Le risque est que, demain, tout Paris, voire le Grand Paris, ne devienne une zone touristique internationale, où les commerces seront ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Les contreparties fondront alors comme neige au soleil.
Nous devons également mettre des bornes à l’ouverture des commerces vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, trois cent soixante-cinq jours par an. J’ai déposé un amendement pour permettre aux salariés du commerce de remplir leur devoir civique les jours d’élections. Il faut garantir la possibilité de participer à la vie de la société : une société a besoin non seulement d’activités économiques mais également de la participation de tous les citoyens aux choix collectifs lors de temps communs.
M. le président François Brottes. Cela vaut mieux que de supprimer des élections…
Mme Karine Berger. Cet article soulève une question qui est au cœur du chapitre Ier du titre III : la définition de la zone chalandise, qui fait l’objet d’une jurisprudence importante et très claire des juges français et européens. Les décisions relatives au commerce, qu’il s’agisse notamment des autorisations de fusion-acquisition ou des abus de position dominante, s’appuient en effet sur trente années de jurisprudence qui précisent la notion de concurrence au sein des zones de chalandise.
L’adoption de ce chapitre provoquera assurément une grande évolution. Je tiens toutefois à signaler que le commerce électronique n’a jamais été assimilé à une zone de chalandise comme zone de concurrence, et ce pour une raison très simple : cette zone de chalandise serait mondiale et le commerce texan y entrerait en concurrence avec la petite épicerie des Hautes-Alpes… Il n’est donc pas possible d’intégrer dans une zone de chalandise précise la concurrence du commerce électronique, faute de références possibles permettant de déterminer la concurrence instaurée par ce commerce. C’est pourquoi il convient d’oublier l’argument du commerce électronique pour véritablement s’interroger sur ce qui fait concurrence et ce qui ne le fait pas.
L’adoption en l’état de l’article 72 entraînera la création de zones de chalandise européennes à l’intérieur desquelles des quartiers de Paris seront mis en concurrence avec des quartiers de Londres ou de Bruxelles : je ne suis pas convaincue par la pertinence d’une telle démarche, qui justifierait, en tout cas, un niveau exceptionnel de protection des salariés. Or le texte ne prévoit rien de ce genre, s’agissant notamment du travail entre 21h00 et minuit. Sans doute suis-je un cas un peu spécial, mais ma nuit à moi commence avant minuit…
Le Gouvernement doit préciser la définition de la zone de chalandise recouverte par ces zones touristiques internationales en répondant à ces deux questions : quelles capitales européennes le Gouvernement entend-il mettre en concurrence à l’intérieur de Paris et quelles mesures exceptionnelles de protection à la fois des salariés et de l’équilibre des zones périphériques compte-t-il proposer ?
M. Christophe Caresche. Le moment me semble venu pour la France de tirer les conclusions d’une évolution profonde du tourisme international, de plus en plus lié à la question commerciale. Les tour-opérateurs organisent les séjours en fonction de l’ouverture des commerces. Alors que d’autres métropoles européennes ont déjà pris ce tournant, le régime de Paris est un des plus restrictifs, comme le montre l’étude d’impact.
Voulons-nous valoriser l’atout économique que constitue l’afflux en France de touristes à haut pouvoir d’achat ou ne le voulons-nous pas ? Qui plus est, cette question ne concerne pas seulement les emplois créés dans les zones touristiques concernées : la France – dois-je le rappeler ? – fabrique encore sur son territoire les produits de luxe qui seront vendus dans ces zones touristiques. L’ouverture de ces magasins favorisera donc l’emploi non seulement au plan local mais également dans toute la France.
Le Gouvernement va dans la bonne direction, d’autant que les déclarations des dirigeants des grands magasins, que vise en premier lieu cette disposition, ne peuvent que nous rassurer : ils sont prêts à accorder d’importantes compensations à leurs salariés. Les fonctionnaires qui travaillent le dimanche à Paris seraient heureux de bénéficier des compensations salariales que les Galeries Lafayette sont prêtes à offrir à leurs employés ! Soyons lucides : puisque les grands magasins voient dans cette mesure une possibilité d’améliorer très significativement leur chiffre d’affaires, il est évidemment normal qu’une partie des bénéfices supplémentaires qu’ils en retireront aille aux salariés. Il est tout à fait possible de mettre en place un dispositif qui permette à chacun de s’y retrouver.
M. le ministre. Avis défavorable à ces amendements de suppression.
Je rappelle à M. Roumegas et à Mme Berger que j’ai donné dans mon propos liminaire des éléments sur le commerce électronique et la notion de zone de chalandise.
Je prends un exemple : la notion de zone de chalandise, telle qu’elle est habituellement utilisée dans le droit de la concurrence, ne peut pas s’appliquer au secteur culturel, du fait que ce secteur voit le passage massif de plusieurs millions de visiteurs par an sur des durées réduites. Leurs flux momentanés transforment de facto la zone de chalandise. On peut analyser de la même façon l’impact du commerce en ligne : les effets de déport de la vente directe sur la vente en ligne sont massifs – je tiens les chiffres à votre disposition. Le Printemps a créé son propre site de commerce en ligne, qui réalise presque 50 % de son chiffre d’affaires le dimanche. Ceux qui ne peuvent pas physiquement consommer le dimanche dans les grands magasins ont donc plébiscité la stratégie de contournement du Printemps. C’est une réalité qu’il ne faut pas nier.
S’il faut traiter ces zones touristiques internationales de manière différente, c’est tout simplement parce qu’elles font l’objet de flux spécifiques. La France, première destination touristique du monde, n’est que la troisième en montant des recettes liées au tourisme et la neuvième en montant des recettes par visiteur. C’est bien la preuve que notre organisation actuelle ne nous permet pas d’optimiser les potentialités du secteur touristique. Et lorsque l’on n’offre pas aux touristes les moyens de consommer sur place, ils s’en vont consommer ailleurs.
Les magasins réalisent entre 30 % et 50 % de leur chiffre d’affaires hebdomadaire le dimanche lorsqu’ils sont ouverts ce jour-là.
À Mme Fraysse et à Mme Mazetier j’indique que le projet de loi prévoit des compensations beaucoup plus importantes que celles qui ont jamais été octroyées dans aucun texte, puisque l’ouverture dépend d’un accord. Hier au soir, vous avez donné lecture d’un tract émouvant. Le grand magasin dont il était question était ouvert le dimanche parce que c’était la période des soldes : la loi actuelle n’empêche pas l’incivisme de certaines enseignes, qui refusent de donner du temps à leurs salariés pendant une telle période pour aller manifester. Mais demain, une telle situation ne sera plus possible : jamais une enseigne comme le Printemps, compte tenu de l’équilibre syndical qui est le sien, ne parviendra pas à un accord dans des conditions aussi peu satisfaisantes. Or, je le répète : pas d’accord, pas d’ouverture…
On peut toujours créer de nouvelles PUCE dans lesquelles la loi prévoit le doublement du salaire et un jour de compensation : une telle démarche créerait immédiatement des effets de bord majeurs pour les salariés. Le plus intelligent est de renvoyer à des accords de territoire, de branche ou d’entreprise, dont la signature conditionnera l’ouverture et qui définiront les termes de la compensation.
La ville de Paris n’est pas seule concernée. À Nice, 53 % des nuitées sont le fait d’étrangers. Ouvrir le dimanche et en soirée permettra de prendre en compte la réalité du commerce international dans ces zones spécifiques.
S’agissant du commerce en soirée, madame Berger, j’ai déjà indiqué les compensations prévues : doublement du salaire entre 21h00 et minuit, raccompagnement du salarié à son domicile à la charge de l’employeur, volontariat explicite, capacité de rétractation, protection des femmes enceintes.
S’agissant des effets de bord, personne n’arrivera à me faire croire que c’est l’ouverture dominicale et en soirée qui explique le prix du foncier d’ores et déjà constaté aux Champs-Élysées ! Ce prix élevé est un vrai problème, je vous l’accorde, mais il n’est pas lié à la réforme que le Gouvernement veut conduire. Qui plus est, en aucun cas le texte ne prévoit l’ouverture des commerces vingt-quatre heures sur vingt-quatre, même dans les zones touristiques internationales.
C’est vrai : permettre aux salariés de voter lorsqu’ils travaillent le dimanche est une préoccupation civique. Mais il faudrait y réfléchir non seulement pour les salariés des commerces, mais également, par exemple, pour les ambulanciers ou les conducteurs des transports en commun.
Au-delà de ces arguments, je suis conscient que la rédaction proposée peut causer un certain inconfort. Pour quelques zones – la Riviera, Paris ainsi que certaines gares très fréquentées –, ce sont les problématiques locales qui ont bloqué l’ouverture. Je ne pense pas que l’expérimentation soit une piste intéressante, car les acteurs économiques ont besoin de visibilité pour s’organiser et réorienter les flux. Il serait plus judicieux de définir des critères chiffrés objectifs, tels que le volume de détaxe. On montrera ainsi que les zones spécifiques et les types de commerce visés par le projet de loi ne concurrenceront pas les zones de chalandise classiques. Dès lors nous aurons mieux défini le contour des ZTI, zones très fréquentées par les touristes et dédiées au commerce de luxe, l’inconfort que vous pouvez encore ressentir disparaîtra. Je suis tout à fait prêt à avancer sur cette question d’ici à la séance.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable, mais je pense comme le ministre qu’il faut préciser les critères permettant de définir les zones concernées.
La Commission rejette les amendements SPE432, SPE843, SPE1355 et SPE1403.
Elle étudie l’amendement SPE1459 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Il n’y a aucune raison de ne pas mener le débat sur l’expérimentation jusqu’à son terme. L’hypothèse sur laquelle repose le texte – à savoir que l’ouverture des commerces le dimanche dans les ZTI fera augmenter le montant dépensé en France par chaque touriste – mérite à tout le moins d’être vérifiée.
J’ajoute qu’il y a probablement moyen de faire participer davantage les touristes étrangers aux sacrifices que consent la collectivité pour les accueillir dans de bonnes conditions. Les feux d’artifice sont gratuits pour tout le monde à Paris, sauf pour le contribuable parisien. À Londres, il faut payer : le feu d’artifice, c’est un business, ce n’est pas le contribuable londonien qui finance. Même gratuité pour la visite de l’église Saint-Sulpice qui a attiré des flots de touristes, intrigués par un succès de librairie mondial, le Da Vinci code, alors que la restauration de la tour Nord a coûté très cher aux Parisiens, puisque l’église appartient au patrimoine de la ville de Paris, et même au contribuable tout court, puisqu’elle est classée. En un mot, l’attractivité de la France, dont les Français supportent le coût, ne tient pas uniquement au shopping. Au demeurant, en dépit d’une législation que certains observateurs étrangers n’hésitent pas à qualifier de marxiste ou de communiste, les Champs-Élysées sont la troisième artère la plus chère du monde. Il y a tout de même matière à s’interroger, et peut-être à trouver d’autres moyens de faire participer davantage le touriste étranger à ce que la collectivité met en œuvre pour l’accueillir dans de bonnes conditions. Un an, je le reconnais, monsieur le ministre, c’est un peu court pour vérifier si les objectifs que vous assignez à votre texte sont atteints, mais cela ne remet pas pour autant le bien-fondé d’une évaluation.
M. le ministre. Avis défavorable. Votre argumentation porte moins sur l’évaluation du dispositif que sur le juste retour que les Parisiens doivent pouvoir en attendre. Mais vous avez vous-même répondu à la question que vous posez : le prix élevé du foncier à Paris est déjà un retour pour la collectivité. Quant à l’idée de mieux faire contribuer les touristes, elle est légitime : nous nous sommes posé la question à propos de la taxe de séjour. Mais cela n’a rien à voir avec l’expérimentation.
Je serai en revanche tout à fait à vos côtés sur l’évaluation. Mieux vaut que la loi prévoie une évaluation régulière, tous les deux ans par exemple, qu’une expérimentation qui serait facteur d’instabilité : si nous limitons le dispositif à dix-huit mois, les acteurs ne feront pas l’effort de se réorganiser, d’autant que la ZTI est un dispositif national, certes, mais très spécifique.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable à l’amendement, qui procède de la même logique que le SPE1959 et le SPE1960; cela étant, il serait bon de prévoir une évaluation du dispositif, dans un délai de deux ans.
Mme Sandrine Mazetier. Sensible au fait que le ministre accepte le principe d’une évaluation, je retire mon amendement. Je souligne cependant que, quand les prix du foncier sont élevés mais qu’il n’y a plus de ventes, les collectivités ne perçoivent plus guère de droits de mutation à titre onéreux
– DMTO –, qui ne constituent d’ailleurs pas les ressources les plus souhaitables.
L’amendement SPE1459 rectifié est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1686 des rapporteurs.
Elle examine, en discussion commune, les amendements SPE1419 et SPE1430 de Mme Sandrine Mazetier, et SPE1114 de M. Alain Tourret.
Mme Sandrine Mazetier. Alors que la création comme l’évolution du périmètre des zones touristiques ou commerciales fait l’objet de concertations avec les élus locaux, ceux-ci ne sont pas associés à la délimitation des ZTI. L’amendement SPE1419 vise à corriger cette anomalie et avant tout à lancer le débat : ces zones sont d’intérêt national, me dit-on ; mais à mes yeux, tout ce qui dans la loi touche au moindre mètre carré de territoire, qu’il soit métropolitain ou ultramarin est d’intérêt national – c’est en tout cas la vision que j’ai de mon rôle de législateur.
L’amendement SPE1430 propose que les zones touristiques internationales soient délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis conforme – et non un simple avis – du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale et des syndicats d’employeurs et de salariés.
M. Alain Tourret. L’amendement SPE1114 est rédactionnel.
M. le ministre. Avis défavorable aux amendements SPE1419 et SPE1430. Nous pourrions inscrire dans la loi le principe d’une évaluation régulière de l’efficacité et de la pertinence du dispositif, au vu de critères à définir, ce qui permettrait de mieux le gérer ; les décrets seraient ainsi contraints par l’évaluation. Nous rechercherons une rédaction appropriée au cours des prochains jours. Avis favorable à l’amendement SPE1114.
Mme Sandrine Mazetier. Je retire mes amendements, qui étaient des amendements d’appel.
Les amendements SPE1419 et SPE1430 sont retirés.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement SPE1114.
La Commission adopte l’amendement SPE1114, puis l’amendement rédactionnel SPE1687 des rapporteurs.
Elle examine, en discussion commune, les amendements SPE1959 de Mme Sandrine Mazetier et SPE1688 des rapporteurs.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement SPE1959 est encore un amendement d’appel. Il faut définir plus précisément ce qu’est une ZTI, en mesurant ou en évaluant les notions de rayonnement international et d’affluence exceptionnelle. Je me félicite que le ministre soit prêt à aller dans ce sens et je retire.
L’amendement SPE1959 est retiré.
M. le rapporteur général. L’amendement SPE1688 est rédactionnel.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1688.
Elle en vient à l’amendement SPE1866 des rapporteurs.
M. le ministre. Puisque nous sommes en train de réfléchir à la définition de nouveaux critères, je propose au rapporteur général de retirer son amendement, que nous examinerons en séance publique.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. D’accord.
L’amendement SPE1866 est retiré.
La Commission étudie les amendements SPE1470 et SPE1960 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Le régime tout à fait dérogatoire qui prévaudra dans les zones touristiques internationales – ouverture durant les cinquante-deux dimanches, travail de nuit – impose, outre un plancher de compensations, que celles-ci soient très précisément caractérisées. Je propose de caractériser les ZTI par le fait que 60 % du chiffre d’affaires constaté y sont effectués par des acheteurs internationaux. Ce critère pourra être vérifié par l’analyse de deux éléments d’information : le montant de la détaxe, calculé par les douanes, et les paiements par carte bancaire, qui permettent d’identifier le lieu de résidence des acheteurs. J’ai proposé de cumuler ces deux informations, car la seule détaxe ne permettrait pas d’identifier les touristes européens, qui ne bénéficient pas du régime d’achat en duty free.
Mme Karine Berger. Je trouve la démarche excellente. Nous ne pouvons rouvrir le débat sur la définition de la zone de chalandise, qui aboutira à modifier profondément l’équilibre du commerce français, qu’en nous fondant sur des critères chiffrés et précis. En fonction de quelles données le Gouvernement envisage-t-il de caractériser les ZTI ? Considère-t-il, par exemple, que la moitié du chiffre d’affaires doive y être réalisé avec des touristes ?
M. Christophe Caresche. La délimitation des ZTI est un réel problème. Même à Paris, leur définition n’est pas très claire. Montmartre et le Marais, que visitent chaque année de millions de touristes, répondent aux critères de l’amendement. Nous devrons travailler, y compris avec la ville de Paris, si cela est possible, à la mise au point de critères de délimitation qui permettent aux zones de fonctionner le mieux possible. En tant qu’élu du XVIIIe arrondissement, je regrette que la ville ne soit pas favorable à une extension de la zone touristique de Montmartre. Reste à trouver des critères satisfaisants, et qui ne soient pas nécessairement redondants.
Mme Jacqueline Fraysse. Je regrette de n’avoir pas pu intervenir sur les amendements que Sandrine Mazetier a retirés, mais je me réjouis que le débat ait permis d’avancer et que le ministre ait accepté de retravailler sur les critères permettant une définition précise des ZTI.
Comme Sandrine Mazetier, je considère qu’une évaluation est indispensable, car nous devons pouvoir revenir en arrière si le dispositif n’apporte pas les résultats escomptés. En revanche, je suis plus réticente sur la façon dont sera pris en compte de l’avis des élus, qui ont naturellement tendance à défendre leur chapelle… Leur avis conforme doit être fondé non sur leur ressenti, mais sur des critères précis et sur l’évaluation des résultats obtenus, qui permettra d’apprécier l’intérêt général. Même si cela ne leur fait pas plaisir, les élus doivent être capables de prendre une décision répondant objectivement à une nécessité d’intérêt général.
M. le président François Brottes. L’église Saint-Sulpice n’est pas une chapelle, madame Fraysse…
M. Jean-Louis Bricout. On peut caractériser une ZTI par le nombre de touristes qui la fréquentent, mais il faut aussi réfléchir au moyen de les attirer ; auquel cas, pour définir la zone, on pourrait prendre en compte le désir de développer l’offre de shopping souvent liée aux produits du luxe, particulièrement attractifs.
M. Jean-Yves Caullet. La définition de critères objective la délimitation, donne un support à l’évaluation et ménage la possibilité d’une évolution. C’est dans ce triptyque que doit se nouer un dialogue constructif entre l’État et les élus de la collectivité.
Dans la capitale, l’ouverture des commerces le dimanche ne se réduit pas au strict aspect commercial. Elle a également une dimension de sécurité publique, qui incombe à l’État comme à la ville. Chacun retrouve ses prérogatives dans le dossier de l’attractivité touristique.
M. le président François Brottes. La manière dont Sandrine Mazetier a engagé le débat semble susciter une large adhésion.
M. le ministre. Je le répète : je suis favorable à ce que nous inscrivions dans la loi des critères. Ceux-ci ne doivent pas être strictement quantitatifs, car l’approche chiffrée risque d’être biaisée, les touristes étant nécessairement moins présents dans les zones où les commerces ne sont pas ouverts le dimanche. Dans le Marais, l’ouverture dominicale fait mécaniquement augmenter la proportion de touristes étrangers, que la détaxe permet facilement d’évaluer. Je propose donc de retenir également un critère qualitatif ou encore un troisième critère : le prestige de la zone. Si l’on fait du seul commerce de luxe un critère, on retiendra peut-être les Champs-Élysées, mais on exclura le Marais. Le cas de Montmartre est également particulier.
Mme Sandrine Mazetier. Le commerce de luxe est minoritaire sur les Champs-Élysées.
M. le ministre. C’est surtout pour le travail en soirée que le problème s’y pose. Quoi qu’il en soit, il faut associer l’approche quantitative et qualitative. On pourrait inscrire dans la loi l’avis conforme de la collectivité locale, liée aux résultats de l’évaluation. On me pardonnera le côté un peu jésuite de cette association, mais c’est un moyen de lui redonner une place… En attendant que je retravaille la rédaction en ce sens, je vous suggère de retirer votre amendement.
Mme Sandrine Mazetier. Je remercie le ministre de son engagement et je retire l’amendement SP1470. J’insiste sur la nécessité, dans les zones où l’on travaillera cinquante-deux dimanches par an, ce qui dégagera des profits importants, de fixer dans la loi un plancher de contreparties en termes de salaire et de repos. Cette précision étant apportée, je retire également l’amendement SPE1960.
M. le président François Brottes. Je ne sais si cela est lié au fait que nous travaillons un dimanche, mais je me félicite de la tonalité et de la qualité de nos échanges.
Les amendements SPE1470 et SPE1960 sont retirés.
La commission adopte l’article 72 modifié.
*
* *
Article 73
(art. L. 3132-25 du code du travail)
Création des zones touristiques
Cet article procède à la réécriture de l’article L. 3132-25 du code du travail, pour substituer aux actuelles communes d’intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente la catégorie des « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ».
La nouvelle rédaction se contente de préciser que les commerces de détail situés dans ces nouvelles « zones touristiques » seront habilités à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4, qui font respectivement l’objet des articles 76 et 77 du projet de loi et sont commentés infra.
Cette refonte des zones touristiques devrait être de nature à clarifier les choses par rapport à la situation actuelle.
Rappelons que dans le droit actuel, c’est l’article R. 3132-20 qui énumère les critères qui doivent être pris en compte pour figurer sur la liste des communes ou zones concernées : celles-ci doivent avant tout accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation ; il doit être tenu compte du rapport entre la population permanente et la population saisonnière, ainsi que du nombre d’hôtels, de gîtes, de campings, de lits et de places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles. Force est de constater, comme le fait le rapport « Bailly », que ces critères, conjugués à la procédure actuelle qui laisse au maire l’initiative de la création d’une zone touristique, conduisent à une carte nationale des zones touristiques très disparate. En effet, malgré le fait que l’ensemble des critères exigés d’une zone touristique sont a priori largement remplis à Paris, la capitale continue de ne compter que sept petites zones touristiques, dont la majorité est limitée à un segment de rue ou à une rue unique. A contrario, le territoire de la commune de Bordeaux est intégralement classé en zone touristique, tandis que Toulouse, Montpellier ou Lille n’ont délimité aucun périmètre touristique en leur sein. Enfin, si le quartier de la Défense remplit bien l’un ou l’autre des critères exigés d’une zone touristique, il n’a pas en réalité de légitimité à relever de cette catégorie, dont il faut rappeler qu’elle est aujourd’hui soumise à un régime délié de contreparties obligatoires en faveur des salariés ; les commerces de ce quartier relèvent au mieux d’une zone commerciale, mais de toute évidence pas d’une zone touristique. En tout état de cause, le paysage actuel des zones touristiques n’est guère satisfaisant, et il convenait de le revoir.
Le rapport « Bailly » précité préconisait bien de procéder à une reconfiguration des zones touristiques, sur la base des critères suivants :
– le nombre et l’importance des points d’attractivité touristique ;
– les flux de touristes ainsi que leurs modalités de déplacement (transports, existence d’une zone piétonne) ;
– la présence de services tels que les hôtels-cafés-restaurants, de lieux de divertissement et d’espaces verts ;
– des critères liés au tourisme international, fondés par exemple sur la notoriété mondiale de certaines zones ;
– et enfin, le chiffre d’affaires généré par les achats des touristes étrangers.
Si ces deux derniers critères semblent a priori davantage devoir être retenus pour la délimitation des zones touristiques internationales, – le rapport ne distinguant pas deux catégories de zones touristiques -, les trois premiers critères devraient sans doute entrer dans la liste qui a vocation à être redéfinie par voie réglementaire.
D’après les informations transmises au rapporteur thématique, les critères actuels resteront bien pris en compte pour la délimitation des éventuelles nouvelles zones touristiques, qui devraient présenter un ensemble de spécificités naturelles, pittoresques, thermales, historiques ou artistiques résultant de leur situation géographique ou de l’existence d’installations de loisirs à forte fréquentation ou thermales et qui connaissent, de ce fait, un afflux saisonnier très important de population. Pourront également être incluses les activités saisonnières littorales ou de montagne. L’importance de cet afflux doit être telle qu’il nécessite la mise en place d’infrastructures propres à accueillir ce public et à répondre à ses besoins particuliers. La réalité d’une fréquentation touristique peut être établie par tous moyens, notamment par le rapport entre population permanente et population saisonnière, mais aussi le nombre d’hôtels, de gîtes ou de campings : ces deux critères président déjà aujourd’hui à la définition de ces zones. Un nouveau critère pourrait s’y ajouter : celui de l’importance de l’appareil commercial, autrement dit des points de vente susceptibles d’être ouverts le dimanche pour satisfaire la demande des touristes.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE104 de M. Gérard Cherpion, SPE433 de M. Patrick Hetzel et SPE846 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Gilles Lurton. L’amendement SPE104 tend à supprimer l’article 73. Le ministre soutient que la véritable inégalité a été créée par la loi Mallié de 2009, qu’il entreprend de corriger. Certes, celle-ci n’impose pas de condition de volontariat ni de compensation. Elle prévoit du moins que les organisations professionnelles ou les employeurs et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de signer un accord déterminant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise ne sont pas couvertes par un accord spécifique. À défaut, aucune ouverture dominicale n’est possible.
À Saint-Malo, dont je suis maire, nous avons créé une zone touristique, comme l’ont fait les élus de Cancale et de Dinard. Toutes trois fonctionnent très bien. Je crains que le texte ne compromette cet équilibre et n’entraîne une dévitalisation des zones touristiques. Si les employeurs hésitent à recruter, par peur des complications qu’entraînera votre projet de loi, vous aboutirez à l’effet inverse de celui escompté.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE433 est défendu.
Mme Jacqueline Fraysse. Contrairement à la loi Maillé, qui dans les PUCE a imposé un doublement de la rémunération et un repos compensateur, le projet de loi ne prévoit rien de ce genre et marque par conséquent un recul. J’insiste sur la nécessité de prévoir un plancher en termes de rémunération et de repos, pour le travail dominical, ainsi que d’autres protections. Et ce seuil supérieur devra être supérieur aux dispositifs applicables aux autres zones, car le régime des ZTI ne se limite pas au travail du dimanche, et le doublement du salaire sera vite englouti dans les frais de garde des enfants tous les soirs. Même pour les zones commerciales, il faut fixer un minimum de compensation dans la loi, en laissant bien sûr aux accords collectifs la possibilité d’aller un peu plus loin.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable. Les auteurs de ces amendements reprochent au texte de ne pas proposer de critères de définition objectifs des zones touristiques alors que la détermination de ces zones relève jusqu’à présent du pouvoir réglementaire, qui ne met en avant aucun critère de ce type. Par ailleurs, ils s’opposent à l’obligation de conclusion d’un accord collectif, à la mise en place de contreparties sociales et à la protection du volontariat des salariés dans ces zones, autant de principes auxquels, pour notre part, nous sommes extrêmement attachés.
Mme Jacqueline Fraysse. Provocateur !
M. le ministre. Je vous propose de considérer l’articulation de l’article 73 avec les articles 76 et 77. La loi Mallié, que j’ai sous les yeux, ne prévoit pas d’accord obligatoire prévoyant compensation : elle mentionne seulement la possibilité de conclure des accords. D’ailleurs, dans bien des zones touristiques, il n’y a ni accord ni compensation. À Saint-Malo comme à Marseille, c’est un accord territorial qui a été conclu, option que les articles suivants présentent comme une des possibilités permettant l’ouverture le dimanche.
L’article 73 permet de toiletter la loi Mallié et de définir les zones touristiques. Les articles 76 et 77 introduisent dans celles-ci l’obligation du volontariat, jusqu’alors non obligatoire en zone touristique, qu’ils formalisent en prévoyant un accord du salarié, écrit et réitéré chaque année. Ils prévoient enfin un mécanisme de compensation, actuellement absent dans les zones touristiques. La grande différence de notre texte avec la loi Mallié, c’est qu’il oblige à conclure un accord, en laissant dans zones touristiques un délai de trois ans pour le conclure. Saint-Malo, où a été conclu un accord territorial, est une exception : dans de nombreuses zones touristiques en France, on travaille le dimanche sans aucune compensation.
N’en déplaise à Jacqueline Fraysse, je ne suis pas favorable à l’instauration d’un seuil dans la loi. Si vous dites aux partenaires sociaux : « Mettez-vous d’accord, sinon c’est payé double », vous faussez d’emblée le jeu. Mieux vaut leur faire confiance pour qu’ils s’entendent. Qui plus est, dans bien des zones touristiques, personne n’a les moyens de payer double. Je serais surpris que l’accord de Saint-Malo prévoie un doublement de la rémunération : le supplément envisagé se limite généralement à 30 % ou 40 %.
M. Gilles Lurton. Le salaire y est majoré de 100 %
M. le ministre. Si dans les PUCE, la loi Mallié a prévu le « payer double », c’est parce que les acteurs pouvaient le supporter. Ce n’est pas le cas dans les zones touristiques peu intenses, où les petits commerces en sont incapables. Voilà pourquoi nous renvoyons à un accord, de territoire, de branche ou d’entreprise. Le grand apport de ce dispositif, c’est que s’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas d’ouverture. Et pour préserver l’existant et éviter l’effet couperet, il laisse un délai de trois ans en zone touristique pour conclure un accord.
M. Gilles Lurton. Le point mérite d’être vérifié. Le texte de l’accord conclu à Saint-Malo, renvoie expressément à l’article 2, chapitre IV de la loi Mallié.
M. le ministre. Parce que c’était un accord de territoire.
Mme Jacqueline Fraysse. J’entends l’argument du ministre. Certains commerces peuvent soutenir la dépense, d’autres non ; mais il appartient au législateur de protéger les salariés en prévoyant un minimum de compensations. Puisque le ministre nous assure que son texte apporte un progrès, qu’il aille au bout de son raisonnement ! Au reste, quelles que soient les règles que nous fixions, il est certain que le texte nuira aux intérêts des petits commerçants, qui, contrairement aux grandes enseignes, ne pourront pas ouvrir en soirée et le dimanche.
M. Jean-Yves Caullet. Madame Fraysse, en posant le principe « Pas d’accord, pas d’ouverture », nous donnons une main très forte à ceux qui demandent des compensations par rapport à ceux qui seront intéressés à ouvrir le dimanche. Si en revanche nous imposons un seuil dans la loi, de deux choses l’une : ou bien nous fixons un seuil relativement élevé, ce qui sera bon pour les garanties, mais économiquement dévastateur pour les petites structures ; ou bien nous le plaçons à un niveau plus soutenable au risque de tirer l’accord de sortie vers le bas. Je fais le pari que la solution proposée sera plus favorable aux salariés.
M. le rapporteur général. C’est juste. Le principe même « Pas d’accord, pas d’ouverture » est plus protecteur pour les salariés. Du reste, Jacqueline Fraysse parle elle-même d’un minimum de compensations, alors que précisément, nous voulons amener les partenaires sociaux à s’accorder sur un maximum de compensations…
Mme Cécile Untermaier. Il me semble difficile d’annoncer aux salariés des grandes surfaces à dominante alimentaire, qui ne perçoivent actuellement aucune contrepartie, qu’ils devront attendre trois ans avant que leur situation ne puisse s’améliorer.
M. Jean-Louis Bricout. Le critère de surface me semble pertinent pour caractériser les commerces à même de verser une compensation minimum.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il faudrait prévoir un délai différent selon que le régime actuel prévoit ou non le versement d’une compensation. Là où aucune compensation n’était prévue jusqu’alors, et où la loi laissera un délai de trois ans, une des parties aura tout intérêt à faire durer la négociation au moins deux ans et demi. Dans les zones où il y avait déjà une compensation, on peut concevoir un délai de montée en charge ; mais là où il n’y en avait pas, il faudrait pouvoir non seulement provoquer l’engagement immédiat de négociations, mais également pousser à l’aboutissement de la discussion.
M. le président François Brottes. C’est juste.
Mme Véronique Louwagie. Il est bon de sanctionner l’absence d’accord de branche par l’interdiction d’ouvrir le dimanche, car il n’est pas rare que des blocages surviennent au niveau des branches. Nous le constatons aujourd’hui avec la délivrance de dérogations à la durée minimale de vingt-quatre heures du temps travail hebdomadaire à temps partiel, qui devait faire l’objet d’accords de branche ; on constate de nombreux blocages, qui mettent bien des entreprises en difficulté.
Je conviens que trois ans représentent un délai relativement long, mais dix-huit mois se sont écoulés depuis l’adoption de la loi de sécurisation de l’emploi, et très peu d’accords ont été signés. Qu’arrivera-t-il si l’on constate un blocage ? Des alternatives sont-elles prévues ? Avez-vous envisagé des solutions de substitution ?
M. le ministre. Nous reviendrons sur le point lors de l’examen des articles 76 et 77. Nous devons trouver un équilibre qui, dans un souci de justice, protège tout le monde, et, dans un souci de pragmatisme, évite la fermeture des commerces. C’est ce qui nous a amenés à ne pas fixer un délai trop court.
Il me semble difficile de distinguer selon les cas au risque de créer une distorsion de concurrence entre des commerces voisins. Peut-être pourrait-on raccourcir le délai à deux ans. L’essentiel est que nous ouvrions la porte à trois types d’accords – accord territorial, accord de branche ou d’entreprise –, ce qui n’a pas été le cas pour le temps partiel. Sur le sujet qui nous occupe, l’accord territorial, à l’exemple de celui de Saint-Malo, ne manque pas de pertinence. Il permet à une ville de sortir de l’impasse d’une négociation de branche bloquée en raison de considérations d’équilibre syndical ou polluée par d’autres sujets.
La commission rejette les amendements SPE104, SPE433 et SPE846.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1689 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE635 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. La notion d’affluence ne me semble pas un critère suffisant pour définir les zones touristiques. Je propose de prendre également en compte des caractéristiques naturelles, artistiques, historiques, ainsi que la capacité d’accueil d’une population touristique importante à certaines périodes.
M. le ministre. Il existe actuellement 640 zones touristiques telles que définies par les critères figurant à l’article R. 3132-20 du code du travail. Nous cherchons à clarifier le dispositif, mais il n’est pas question de réduire le périmètre actuel. Le décret maintiendra l’existant et permettra à toute collectivité précédemment éligible à demander, si elle le souhaite, à passer en zone touristique.
M. Gérard Cherpion. Retrait.
L’amendement SPE635 est retiré.
La Commission adopte l’article 73 modifié.
*
* *
Article 74
(art. L. 3132-25-1 du code du travail)
Création des zones commerciales
Cet article procède à la réécriture de l’article L. 3132-25-1 du code du travail, en substituant aux actuels périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) des « zones commerciales » dans lesquelles les commerces de détail seraient habilités à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 qui font l’objet des articles 76 et 77 du projet de loi, commentés infra.
Alors que les PUCE concernent des périmètres situés dans les seules unités urbaines de plus de un million d’habitants et caractérisés par un « usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre », les futures zones commerciales sont définies par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ».
En d’autres termes, il ne sera plus nécessaire pour délimiter une zone commerciale dans laquelle les commerces seraient autorisés à ouvrir le dimanche de relever d’une unité urbaine de plus d’un million d’habitants. En outre, la nouvelle catégorie de zones commerciales a l’avantage de répondre à l’un des inconvénients majeurs des actuels PUCE, celui de la consécration juridique d’un usage d’ouverture dominicale antérieure illégal. En effet, dans la mesure où il s’agissait pour délimiter un PUCE de se fonder notamment sur des habitudes de consommation dominicale existantes, la procédure constituait en quelque sorte une « prime à l’illégalité », comme le note le rapport Bailly.
Des dispositions réglementaires doivent intervenir pour préciser les critères retenus pour déterminer « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ».
Le rapport Bailly énumère une série de critères qui devraient présider à la délimitation des futures zones commerciales :
– la densité commerciale, par exemple 20 000 m², hors alimentaire, dans le périmètre demandé ;
– l’attractivité, par exemple, 3 millions de visiteurs dans la zone, afin d’objectiver le caractère exceptionnel de l’attractivité commerciale du périmètre ;
– l’adhésion des commerçants, par exemple, 50 % des commerçants du périmètre ;
– ainsi que des éléments consultatifs permettant de mesurer l’adhésion des salariés.
D’après les informations dont dispose le rapporteur thématique, les critères qui devraient présider à la définition des zones commerciales devraient permettre non seulement la prise en compte des usages de consommation – ce qui était le cas des PUCE –, mais également le potentiel de développement commercial assis sur la rencontre d’une offre et d’une demande. À cet égard, seraient requis :
– une densité commerciale conséquente incluant toutes les formes de commerces, alimentaires et non alimentaires, dans la zone demandée. Le choix serait donc ici différent des recommandations du rapport Bailly, qui préconisait de ne tenir compte que de la densité commerciale hors commerce alimentaire ;
– l’attractivité de la zone, découlant de la présence importante de visiteurs ou de consommateurs, afin de permettre d’identifier la zone de chalandise ;
– et enfin, l’adhésion des commerçants.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE105 de M. Gérard Cherpion, SPE434 de M. Patrick Hetzel, SPE847 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1371 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Gérard Cherpion. Cet article vide de sa substance la loi de 2009 puisqu’il écrase les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle – PUCE – pour créer les « zones commerciales caractérisées par une offre et une demande particulièrement importantes » dont la définition est plutôt vague. La notion d’unité urbaine de plus de un million d’habitants disparaît totalement. De plus, l’ouverture en zone commerciale est conditionnée à l’existence d’un accord collectif. À défaut d’accord, aucun seuil de contreparties minimales n’est fixé par la loi. Le projet de loi est donc moins protecteur que la législation actuelle des PUCE.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement repose sur les mêmes arguments.
Mme Jacqueline Fraysse. Pour ma part, j’insiste sur le flou de la notion de « zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » contenue dans l’alinéa 2 de cet article. Les salariés concernés seront moins bien protégés qu’ils ne le sont actuellement.
M. Jean-Louis Roumegas. Ce sont les zones touristiques internationales – ZTI – qui ont attiré l’attention, mais ce sont les dispositions sur les zones commerciales qui recèlent le plus grand risque de banalisation sinon de généralisation du travail du dimanche. Alors que les fameux PUCE se limitent à quatre zones en France puisqu’ils concernent les agglomérations de plus de un million d’habitants, le présent texte offre aux maires – à leur demande et après validation par le préfet – la possibilité de généraliser ces zones commerciales de façon très large, le seul critère étant le taux de fréquentation. Les grands centres commerciaux pourraient donc être concernés par cette disposition. Le fait que la création de telles zones soit laissée à l’appréciation du maire ne nous met à l’abri de rien. En ce qui concerne les éventuelles compensations, le texte renvoie à des accords dont il y a fort à parier qu’ils seront moins protecteurs que la législation actuelle. J’y insiste : cet article est celui qui comporte le plus de risques en termes de généralisation du travail le dimanche et nous proposons sa suppression.
M. le ministre. Il y a deux sujets : le périmètre d’activité et les risques pour les PUCE existants ; les compensations.
Dans le cadre de la rationalisation du dispositif à laquelle nous procédons, l’article 74 vise à clarifier les choses et à redéfinir des critères, en renvoyant à un décret en Conseil d’État comme nous l’avons fait précédemment pour les zones touristiques. Le rapport Bailly qui a inspiré ce travail en définissait quelques-uns : la densité commerciale, l’attractivité de la zone au travers de sa fréquentation, l’adhésion des commerçants au projet, etc. Ils sont plus précis que les critères retenus pour les PUCE qui ne faisaient que constater des habitudes de consommation. À travers cet article 74, en particulier le critère de demande potentielle particulièrement importante qui sera développé dans le décret en Conseil d’État, l’idée est de reprendre les quarante et un PUCE existants et d’y créer ces dispositifs à la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) – ce qui n’est pas le cas dans les ZTI précédemment évoquées – là où ils seront pertinents. Ces zones seront créées, en cas de demande et de besoin identifiés, dans la lignée de l’évaluation faite par le rapport Bailly. Il n’y a pas de restrictions ou de fermetures ; nous ne revisitons pas ce qui a été fait dans le cadre de la loi Mallié.
Pour ce qui est de la compensation, monsieur Roumegas, il faut rapprocher cet article des articles 76 et 77. Actuellement, les PUCE obéissent à la règle de l’accord ou, à défaut, de la double rémunération ; le présent texte prévoit que sans un accord de branche, d’entreprise ou de territoire sur les conditions de compensation, il n’y aura pas d’ouverture : l’accord est la condition de l’ouverture.
Premier cas : les PUCE où il existe un accord seront en conformité avec le présent texte ; rien ne sera changé par le nouveau dispositif. Deuxième cas : la création de nouvelles zones, à la demande des élus, maires ou EPCI, sera conditionnée à la signature d’un accord sur les compensations. Sans accord, il n’y aura pas d’ouverture même si c’est le souhait du maire et qu’il est validé. Troisième cas, le plus compliqué sur le plan théorique : faute d’accord, c’est la double paie qui s’applique dans le PUCE existant, en vertu de la loi Mallié. Cette situation est rare, pour ne pas dire quasi inexistante, puisque la règle de la double paie a incité à conclure des accords. Logiquement, les salariés refuseront de signer un accord s’ils ne sont pas payés double, ce que leur garantit la loi. Dans ces zones, le seul risque est plutôt d’assister à quelques fermetures, si les salariés ne se voient pas proposer un accord suffisamment ambitieux sur le plan salarial. Jean-Louis Roumegas a démontré que notre texte va dans le sens du progrès social. Avis défavorable.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Monsieur Cherpion, votre amendement repose sur deux justifications : la définition des zones commerciales serait confuse ; le dispositif prévoyant un accord collectif obligatoire sera moins protecteur que la législation actuelle.
Pour répondre à votre premier argument, je dirais que la notion de « périmètre d’usage de consommation exceptionnelle » n’est pas forcément beaucoup plus claire, d’autant qu’elle n’avait d’autre vocation que de consacrer des usages relevant de la clarification de situations illégales. Quant à votre deuxième argument, il est inexact : les contreparties sociales sont obligatoires ; nous laissons aux parties prenantes le soin de les fixer ; nous ne remettons pas en cause les périmètres existants qui seront reconnus de plein droit comme des zones commerciales, sachant qu’un délai de trois ans est prévu pour conclure un accord quand il n’y en a pas. Rappelons que les PUCE actuels permettent le recours à la voie unilatérale ou à la signature d’un accord, ce qui est le cas de celui de Plan de Campagne.
Les critères présidant à la définition des zones commerciales ont naturellement vocation à être définis par voie réglementaire. Il s’agit de tenir compte des usages de consommation et de l’importance de la densité commerciale, en incluant toutes les formes de commerce – alimentaire ou non – de la zone demandée. Signalons que le rapport Bailly préconisait d’exclure les commerces alimentaires. Il faut aussi tenir compte de l’attractivité de la zone – présence importante de visiteurs ou de consommateurs – et de l’adhésion des commerçants. Avis défavorable.
M. le président François Brottes. Monsieur Roumegas, êtes-vous convaincu que « qui peut le plus ne peut pas le moins » ?
M. Jean-Louis Roumegas. Je suis convaincu de l’habileté de la dialectique du ministre, mais pas nécessairement de la pertinence de ses arguments. Le problème est que les gens n’ont pas vraiment le choix de travailler ou pas le dimanche : l’effet d’entraînement qui existe entre les enseignes risque de gagner les communes elles-mêmes. Si une commune commence à le faire, la pression sera très forte sur les communes voisines qui seront mises en concurrence. C’est cela le libéralisme. Vous n’obligez personne mais vous créez les conditions pour que les choses évoluent dans ce sens.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cet article doit en effet se lire avec les suivants. Même après vos explications, monsieur le ministre, je maintiens que votre dispositif viendra percuter des contrats existants et la possibilité pour certains de maintenir des ouvertures respectueuses de la loi actuelle dans la mesure où l’alinéa 6 de l’article 76 ne précise pas que les dispositifs actuels resteront valides.
Cet alinéa est ainsi rédigé : « Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L.3132-24, L.3132-25 et L.3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l’article L.5121-4. » De toute façon, il est fait mention de la nécessité d’être couvert par un accord.
Même si vous considérez qu’il s’agit d’un nombre réduit de situations, il s’agit d’un principe de droit : n’y aurait-il qu’un seul cas, il faudrait pouvoir le traiter. Je maintiens qu’il y a une forme de conflit entre les gens qui ont appliqué la loi dans les zones concernées sans référence à un accord collectif, simplement dans le cadre de l’application de l’article 1er de la loi Mallié, et le dispositif que vous proposez. Votre réponse ne règle pas la situation qui est prévue à l’article 76 et que vous nous avez invités à aborder dès le présent article.
La Commission rejette les amendements SPE105, SPE434, SPE847 et SPE1371.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1690 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 74 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE773 de M. Francis Vercamer.
M. Philippe Vigier. Cet amendement portant article additionnel après l’article 74 tend à corriger un oubli. En matière d’extension du travail dominical, nous souhaitons que les décisions soient prises sur le plan territorial, qu’il s’agisse de zones de grande capacité touristique ou de zones commerciales dont il faudra redéfinir le périmètre. Il nous semble indispensable que les acteurs locaux que sont les maires ou les présidents d’intercommunalité soient au cœur du dispositif.
Certains territoires se trouvent en situation de concurrence déloyale. Alors que cette loi affiche la volonté d’améliorer la croissance et l’activité, est-il nécessaire de laisser des parts de marché partir vers des pays limitrophes, sans essayer d’apporter une réponse à la hauteur d’enjeux qui sont loin d’être anodins ? Parmi ces territoires, citons ceux qui sont frontaliers avec la Belgique où les entreprises décident librement de leurs jours de fermeture : la concurrence joue sur cinquante-deux dimanches et le fait de passer de cinq à douze dimanches ne va pas rétablir l’équilibre. La concurrence n’est pas la même selon que le pays limitrophe est la Belgique, le Luxembourg, l’Italie ou l’Allemagne.
Comme nous avons le dialogue social chevillé au corps, nous proposons d’inclure ces territoires frontaliers, en trouvant les moyens de donner ce repos hebdomadaire à tout ou partie du personnel. Monsieur le ministre, ne faisons pas l’impasse sur ces territoires. Comme Christophe Caresche, je pense qu’il faut bien réfléchir aux grandes zones touristiques mais ces territoires frontaliers sont aussi des zones d’activité et, au risque d’être à contre-courant, je signale que certaines personnes ont envie de travailler le dimanche. De plus, ainsi que l’avait souligné Francis Vercamer, les fameux articles 31 et 32 s’appliquent et prévoient cette double rémunération. S’il existe un accord de branche, si la zone frontalière est bien définie – et elle peut l’être par les préfets –, il est possible de répondre à un besoin local et d’accroître l’activité.
M. le ministre. Vos préoccupations sont pour partie satisfaites par les PUCE et elles pourront l’être totalement, à la demande des élus locaux, grâce aux dispositions prévues dans cet article. Le Gouvernement souhaite que toutes les zones transfrontalières actuellement éligibles au dispositif PUCE soient intégrées dans le décret en Conseil d’État qui est mentionné à l’article.
M. Philippe Vigier. Je vous entends, monsieur le ministre, mais je préférerais que ce soit écrit. Dans ces territoires, il faut aller au-delà des douze dimanches prévus dans le dispositif PUCE. Il ne s’agit pas d’une ouverture généralisée jusqu’à 150 kilomètres de la frontière ; les zones frontalières font vingt kilomètres. Regardez ce qui se passe avec l’Espagne, Andorre ou l’Italie. Nous devons apporter une réponse territoriale qui aille au-delà du contenu actuel du texte parce qu’il n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Le mot « frontalier » doit apparaître.
M. le ministre. Pour lever une confusion, je vous signale qu’il s’agit ici des PUCE qui permettent d’aller jusqu’à cinquante-deux dimanches, avec la mécanique déjà décrite. Les zones commerciales transfrontalières qui sont déjà dans des PUCE y resteront ; d’autres seront éligibles au dispositif, compte tenu de la rédaction de l’article. Il ne s’agit donc pas de douze dimanches mais d’un potentiel de cinquante-deux dimanches. Nous ne voulons pas écrire le décret par petits bouts au niveau de la loi, mais je m’engage à ce que ces zones soient dans le décret en Conseil d’État.
M. Philippe Vigier. Je prends acte de l’engagement que le ministre prend devant la représentation nationale. Je saurai le lui rappeler, le cas échéant. Je retire mon amendement.
L’amendement SPE773 est retiré.
*
* *
Article 75
(art. L. 3132-25-2 du code du travail)
Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales
Cet article procède à la réécriture de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, en substituant à la procédure de délimitation des périmètres d’usage de consommation exceptionnels (PUCE) une nouvelle procédure, unique, de délimitation des futures zones touristiques (article L. 3132-25) et zones commerciales (article L. 3132-26).
L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales appartiendrait concurremment au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque celui-ci existe.
La demande, qui doit être motivée et comporter une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone, est transmise au préfet de région, qui procède à la délimitation ou à la modification du périmètre après avis :
– du conseil municipal ;
– des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;
– des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, autrement dit, de l’ensemble des structures intercommunales, lorsqu’elles existent ;
– du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et n’appartenant pas à une structure intercommunale par ailleurs obligatoirement consultée, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;
– du comité départemental du tourisme, s’il s’agit d’une zone touristique ;
– de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat s’il s’agit d’une zone commerciale.
Le tableau suivant retrace les différences affectant les procédures aujourd’hui respectivement applicables aux communes et zones touristiques et aux PUCE et la future procédure applicable aux zones touristiques et aux zones commerciales.
PROCÉDURES DE DÉLIMITATION OU DE MODIFICATION DES ZONES TOURISTIQUES ET DES ZONES COMMERCIALES AVANT ET APRÈS RÉFORME
Communes d’intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente |
Périmètres d’usage de consommation exceptionnel |
Zones touristiques |
Zones commerciales | |
Initiative de la demande |
Maire |
Conseil municipal |
Maire ou président de l’EPCI | |
Responsabilité de la délimitation ou de la modification de la zone |
Préfet de département |
Préfet de région |
Préfet de région | |
Organes consultés |
– Comité départemental du tourisme – Syndicats d’employeurs et salariés intéressés – Structures intercommunales, si elles existent |
– Conseil municipal – Chambre de commerce et d’industrie – Chambre des métiers – Syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune – Organe délibérant des structures intercommunales, si elles existent – Conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et n’appartenant pas à une structure intercommunale par ailleurs consultée, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial situé sur leur territoire. |
– Conseil municipal ; – Syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ; – Structures intercommunales si elles existent ; – Conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et n’appartenant pas à une structure intercommunale par ailleurs consultée, lorsque la zone en question est située en tout partie sur leur territoire. | |
– Comité départemental du tourisme |
– Chambre de commerce et d’industrie et chambre de métiers et de l’artisanat | |||
Alors qu’aujourd’hui, l’initiative de la création d’un PUCE appartient au conseil municipal et celle de la création d’une zone touristique au maire, à l’avenir, la création des zones touristiques ou commerciales relèvera du maire ou de président de l’EPCI. Conformément aux préconisations du rapport « Bailly », il s’agit en effet de privilégier le pilotage par l’autorité politique locale, et de préférence par la structure intercommunale si elle existe, dans le respect des compétences et attributions de ces structures : rappelons en effet que l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales confie à la communauté de communes l’exercice de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de l’aménagement de l’espace et des actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. De la même manière, l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales confie à la communauté d’agglomération l’exercice de plein droit au lieu et place des communes membres des compétences en matière notamment de développement économique, et en particulier en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, etc.
Le pouvoir d’initiative de la création ou de la modification d’une zone appartiendrait donc concurremment au maire et au président de l’EPCI : autrement dit, si le maire propose la création d’une zone touristique ou d’une zone commerciale et que le président de l’EPCI est en désaccord avec cette initiative, il pourra faire valoir son opposition lors de la procédure d’avis préalable. Le préfet de région tiendra compte de cette opposition au moment de décider de délimiter la zone, de même que de l’ensemble des autres avis préalables qu’il aura recueillis et de l’étude d’impact justifiant de l’opportunité de la création de la zone.
Il revient au porteur du projet de création ou de modification de la zone de réaliser cette étude d’impact ; celle-ci a bien entendu vocation à être établie en lien avec les acteurs à même d’apprécier les effets économiques, environnementaux et sociétaux de la délimitation de la zone.
S’agissant de ce pouvoir d’initiative, le rapporteur thématique estime qu’au vu des compétences qui sont celles des structures intercommunale en matière de développement économique et d’activité touristique, il serait légitime que ce pouvoir soit confié par priorité au président de l’EPCI et de ne laisser au maire l’initiative que dans le cas où n’existerait pas de structure intercommunale.
Ensuite, la responsabilité de la délimitation de ces zones, qui incombe aujourd’hui au préfet de département s’agissant des zones touristiques, et au préfet de région s’agissant des PUCE, reviendra au seul préfet de région pour la délimitation des futures zones touristiques ou zones commerciales. Le rapport « Bailly » ne préconisait pas sur ce point de modifier l’autorité compétente en la matière, mais prévoyait néanmoins, s’agissant des zones commerciales, une instruction du dossier par le préfet de département avant validation par le préfet de région. Néanmoins, l’attribution au préfet de région de la compétence en matière de délimitation ou de modification de ces zones apparaît opportune : elle a l’avantage d’unifier les deux procédures actuelles, et permet de disposer d’une vision suffisamment large des enjeux de la création de ces zones, qui peuvent se situer sur ou, du moins, à proximité d’une frontière administrative. En outre, la compétence en matière de tourisme étant partagée entre la commune et la région, il apparaît pertinent de confier au préfet de région et non plus au préfet de département la compétence de délimitation d’une zone touristique.
Le texte ne précise pas dans quelle mesure le préfet de région aura un pouvoir d’appréciation sur la délimitation du périmètre des zones commerciales ou touristiques. Il s’agit pourtant d’une proposition formulée par le rapport « Bailly », qui considère que l’absence actuelle de latitude du préfet, qui ne peut actuellement que valider ou rejeter dans son ensemble le périmètre d’une zone touristique ou d’un PUCE, est dommageable. Elle participe de l’incohérence de certaines zones actuellement existantes, qu’elles soient touristiques ou commerciales, qui créent des « effets de bord » et engendrent « des distorsions de concurrence flagrantes ».
S’agissant des acteurs qui sont consultés préalablement à la décision préfectorale, le texte s’aligne essentiellement sur les avis aujourd’hui recueillis dans le cadre des PUCE, sous la réserve que pour une zone touristique, le comité départemental du tourisme reste consulté comme il l’est aujourd’hui, tandis que pour une zone commerciale, ce sont les chambres consulaires qui sont consultées. La consultation du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et ne relevant pas d’un EPCI dont l’avis serait par ailleurs recueilli n’existe pas pour l’heure dans les zones touristiques, dans la mesure où une telle zone ne peut, dans le droit existant, être délimitée sur le territoire de plusieurs communes. Cela sera désormais le cas : il est donc pertinent de prévoir une telle consultation.
Le texte reste également silencieux sur la question des délais d’encadrement de la procédure de création ou de modification d’une zone touristique ou commerciale. De ce point de vue, le rapport « Bailly » rappelle que l’absence de réponse du maire ou du président de l’EPCI à une demande de création d’une zone vaut rejet dans un délai de deux mois, conformément à l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Il préconise ensuite :
– qu’un délai de quatre à six mois soit prévu pour l’instruction du dossier par l’autorité compétente (le rapport prévoyant en effet une étape intermédiaire d’instruction avant validation par l’autorité préfectorale) ;
– et qu’un délai de deux mois soit ensuite donné à l’autorité préfectorale pour approuver ou rejeter la création de la zone, et déterminer son périmètre ; à l’expiration de ce délai, la proposition sera réputée acceptée.
Le rapporteur thématique est sensible à l’idée de prévoir des délais encadrant la procédure de délimitation ou de modification du périmètre d’une zone. Néanmoins, l’inconvénient du double encadrement proposé par le rapport « Bailly » réside dans l’hypothèse où le préfet aurait procédé aux consultations nécessaires et à l’instruction du dossier dans un délai inférieur à quatre mois : le délai de deux mois pour la détermination du périmètre ne courrait qu’à l’expiration des quatre mois. Plutôt qu’un double délai d’instruction qui pourrait conduire à porter la durée totale à six, voire à huit mois, il juge plus pertinent de prévoir un délai global d’instruction et de prise de décision par l’autorité préfectorale, qui pourrait être de l’ordre de six mois. Ce délai pourrait être réduit à trois mois dans le cas d’une simple modification du périmètre d’une zone déjà existante.
*
* *
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté, outre une série d’amendements rédactionnels, deux modifications de fond au dispositif proposé s’agissant de la procédure de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales.
Elle a dans un premier temps prévu, à l’initiative des rapporteurs, que l’initiative de la demande de délimitation ou de modification d’une zone touristique ou d’une zone commerciale qui excède le territoire d’une seule commune est attribuée au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque celui-ci existe, le maire n’intervenant que de manière subsidiaire, en l’absence d’EPCI. En revanche, la commission a maintenu la compétence du maire dès lors que la zone concernée se situe sur le territoire d’une seule commune.
La commission spéciale a ensuite souhaité, à l’initiative des rapporteurs, encadrer le délai d’instruction par le préfet de région des demandes de délimitation ou de modification des zones commerciales et des zones touristiques, en fixant à ce dernier un délai de six mois pour instruire une demande de création d’une zone et un délai de trois mois lorsque la demande concerne la modification d’un périmètre déjà existant.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE106 de M. Gérard Cherpion et SPE437 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. C’était un amendement de cohérence par rapport au précédent mais nous l’avons développé.
M. Patrick Hetzel. Même chose.
La Commission rejette les amendements SPE106 et SPE437.
M. Yves Blein. Il faut vraiment veiller au fait que la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier. Or elle ne figure pas à l’alinéa 2 de cet article 75 qui indique : « appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe. »
M. le président François Brottes. D’après ce qui a été dit hier, c’est le terme de métropole qui doit figurer.
Mme Sandrine Mazetier. Cet article réserve au maire ou au président de l’EPCI l’initiative de la création ou de la modification d’une zone touristique ou d’une zone commerciale. Nous avons ajouté une autre condition : « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone. » Ces conditions sont tout à fait légitimes mais on ne peut pas prendre de telles précautions dans ce cadre alors que l’on n’en prend aucune dans d’autres territoires. Nous légiférons pour l’ensemble du territoire de la République.
La Commission est saisie de l’amendement SPE1869 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Le présent amendement prévoit que la demande de délimitation d’une zone est faite par le président de l’EPCI lorsque le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune ; elle reste de la compétence du maire lorsque le périmètre de la zone ne sort pas du territoire de la commune. Il s’agit de tenir compte des structures intercommunales actuelles mais aussi du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République – NOTRe –, qui est en cours de discussion au Sénat. Il convient de ne pas aller à rebours de la future loi réformant les compétences territoriales des EPCI.
M. le ministre. Je tiens à dire à Mme Mazetier, qu’il y a des critères objectifs et je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendus sur ce sujet, par référence sous-jacente avec la décision du Conseil constitutionnel de 2009 sur la loi Mallié qui, pour un même dispositif, avait souligné la différence de traitement de certaines collectivités territoriales. Ce n’est pas le cas du présent dispositif, ce qui n’a pas échappé au Conseil d’État : les ZTI relèvent d’un dispositif différent du droit commun. On peut s’interroger sur l’opportunité politique mais vous avez pu constater que nous travaillons dans un esprit d’ouverture. Quoi qu’il en soit, j’insiste sur le fait qu’il s’agit de deux dispositifs distincts.
M. Blein, a tout à fait raison de soulever le problème de la métropole de Lyon comme M. Poisson l’avait fait hier à un autre endroit du texte. Par souci de cohérence, nous devons relire le texte en tenant compte de la spécificité lyonnaise à chaque fois que nécessaire.
Enfin, je suis favorable à l’amendement SPE1869.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je comprends la logique de cet amendement mais j’ai un doute sur sa rédaction. D’ici à la séance, nous devrions nous assurer que les zones commerciales qui sont à cheval sur plusieurs intercommunalités – ou sur une métropole et une intercommunalité – soient bien prises en compte. Je ne suis pas sûr que la rédaction actuelle soit parfaite à cet égard.
M. Jean-Charles Taugourdeau. En retravaillant le texte, il faudrait aussi y intégrer la notion de communes nouvelles qui peuvent comprendre des bassins de vie complets. Une communauté peut se transformer en commune nouvelle.
M. le président François Brottes. Une commune nouvelle reste une commune.
La Commission adopte l’amendement SPE1869.
En conséquence, l’amendement SPE1125 tombe.
La Commission examine les amendements identiques SPE133 de M. Gérard Cherpion et SPE435 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Cet article laisse au préfet de région le soin de délimiter les nouvelles zones touristiques ou commerciales après organisation d’un dialogue territorial. Or, dans la perspective de la création des grandes régions, le préfet de région, face à des demandes éloignées, devra se retourner vers le préfet de département. Pour rester au plus près de la réalité du terrain, cet amendement propose de confier directement cette responsabilité au préfet de département.
M. Patrick Hetzel. Mes arguments sont les mêmes.
M. le ministre. Le Gouvernement estime que la création de ces zones relève du niveau régional de l’organisation de l’État. Un amendement à venir sur le même sujet proposera de laisser quelques respirations. Avis défavorable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements SPE133 et SPE435.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1691 des rapporteurs.
L’amendement SPE814 de M. Jean-Louis Roumegas est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1692 des rapporteurs.
Puis elle en vient à l’amendement SPE1217 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Cet amendement revient sur un sujet déjà abordé : les mesures que nous sommes en train de prendre n’auront pas le même impact sur les femmes et les hommes. Il propose de compléter l’alinéa 3 de l’article pour intégrer cette préoccupation dans l’étude d’impact.
M. le ministre. Nous sommes évidemment d’accord avec l’objectif poursuivi ici mais la demande nous semble un peu lourde pour certains élus. C’est un sujet sensible qui continue à être mesuré sur le plan statistique mais j’invite au retrait de l’amendement, compte tenu de la contrainte que son adoption ferait peser sur les élus concernés.
M. Jean-Yves Caullet. J’imagine que tous les acteurs du territoire veilleront à faire figurer cette donnée dans l’étude. Je retire l’amendement.
L’amendement SPE1217 est retiré.
La Commission adopte l’amendement de précision SPE1693 des rapporteurs.
Puis elle en vient à l’amendement SPE1830 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il répond à la préoccupation exprimée par Yves Blein.
La Commission adopte l’amendement SPE1830.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision SPE1831, SPE1694, SPE1695, SPE1698 et SPE1699 des rapporteurs.
M. Jean-Frédéric Poisson. J’appelle l’attention de notre commission sur l’adoption rapide – mais dans les formes prévues par le règlement, il va sans dire, monsieur le président – de l’amendement SPE1830 qui retire le pluriel à l’alinéa 7. Pour ma part, je maintiens que plusieurs communautés de communes ou d’agglomérations peuvent être concernées par le sujet. L’alinéa 7 sera ainsi rédigé : « 3° De la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine ; ». Si cela inclut le pluriel, allons-y. Comme disait Courteline à propos de son émolument : « On ne va pas déranger le pluriel pour si peu. » Toutefois, j’invite à considérer que cela peut ne pas inclure la dimension de pluralité qui existe dans certains territoires.
M. le président François Brottes. Je fais mienne la phrase de Courteline : quand plusieurs amendements viennent d’un même groupe, on ne doit pas déranger le pluriel pour si peu. (Sourires.)
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques SPE134 de M. Gérard Cherpion et SPE436 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement SPE1870 des rapporteurs et l’amendement SPE293 de Mme Colette Capdevielle.
Mme Véronique Louwagie. L’article 75 établit une procédure de délimitation du périmètre des zones touristiques et commerciales sans fixer le moindre délai. Le présent amendement propose donc d’encadrer, dans des délais raisonnables, la réponse de l’administration aux demandes des maires ou présidents des EPIC. Il s’agit donc de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « III– Le préfet de département recueille les avis mentionnés au II dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande. Il statue ensuite dans un délai maximum de deux mois sur la demande de délimitation ou de modification de la zone. » Il est fait référence aux préfets de département, par corrélation avec notre amendement précédent.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. L’amendement SPE1870 répond à vos préoccupations, madame Louwagie, puisqu’il propose de fixer des délais d’instruction maximum au préfet : six mois s’il s’agit de délimiter une nouvelle zone ; trois mois s’il s’agit de modifier une zone existante. Il est temps de fixer un cadre temporel pour des motifs de sécurité juridique, conformément aux recommandations du rapport Bailly.
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement prévoit que l’autorité administrative contrôlera tous les six ans que la zone respecte toujours les critères ayant présidé à sa création. Il s’agit de vérifier que les conditions sont toujours réunies.
M. le ministre. Le décret définira les critères de zonage, après concertation en amont, et une étude d’impact devra être produite à l’appui de la demande. Ce sont des gages suffisants pour une juste délimitation. En outre, la loi prévoit que le président de l’EPCI ou de la commune peut, à tout moment, enclencher la même procédure aux fins de modifications. Le dispositif présentant les garanties recherchées afin d’éviter des lourdeurs administratives supplémentaires, j’invite au retrait de l’amendement SPE293. Quant aux deux amendements identiques, ils sont satisfaits par celui du rapporteur auquel je donne un avis favorable. J’invite donc leurs auteurs à les retirer.
Mme Véronique Louwagie. Notre amendement peut être considéré comme satisfait par celui des rapporteurs. Cependant, cet amendement SPE1870 évoque le représentant de l’État dans la région ; il serait plus pertinent de faire état du préfet de région, comme dans l’alinéa 3, sauf s’il s’agit d’une autre personne. Je retire mon amendement.
M. Patrick Hetzel. Je retire le mien également, même si nous aurions préféré garder des délais plus courts que ceux prévus par le rapporteur.
Mme Colette Capdevielle. Je retire aussi mon amendement. Nous ne cherchons pas à imposer des contraintes administratives mais ces contrôles peuvent se révéler nécessaires. La question pourra se poser dans l’avenir.
M. le ministre. Merci pour ces retraits. Toutes les situations sont couvertes : soit la modification progressive du périmètre est en infraction avec les critères du décret, auquel cas, dans le cadre de son contrôle et sans qu’on le précise ici, le préfet peut intervenir ; soit elle ne correspond pas à la volonté de la collectivité, et celle-ci a la capacité d’initiative dans le dispositif.
Les amendements SPE134, SPE436 et SPE293 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement SPE1870.
Puis elle adopte l’article 75 modifié.
*
* *
Article 76
(art. L. 3132-25-3 du code du travail)
Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales
Cet article introduit une procédure spécifique conditionnant l’ouverture dominicale des commerces dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales tout en laissant subsister la procédure actuelle qui figure à l’article L. 3132-25-3 pour les autorisations préfectorales dérogatoires individuelles ou sectorielles.
En effet, pour l’heure, figure à cet article une série de conditions spécifiques applicables pour l’ouverture des commerces sur le fondement de l’article L. 3132-20 – à savoir l’autorisation préfectorale d’ouverture dominicale accordée aux établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement – ainsi que pour les périmètres d’usage de consommation exceptionnels (PUCE).
Rappelons en effet qu’en vertu de l’article L. 3132-25-3, ne sont autorisés à ouvrir sur le fondement de ces deux procédures dérogatoires que les établissements de vente au détail couverts par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur approuvée par les salariés concernés par référendum :
– en présence d’un accord collectif, ce dernier doit fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
– en l’absence d’accord collectif, l’employeur peut néanmoins ouvrir de manière dérogatoire sur le fondement d’une décision unilatérale prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent, et approuvée par les salariés concernés par référendum. La décision unilatérale doit comporter les mêmes types d’engagements qu’un accord collectif, mais la loi encadre le niveau des contreparties offertes aux salariés privés de repos dominical, qui doivent obligatoirement bénéficier d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
En tout état de cause, dès lors qu’un accord collectif est régulièrement négocié alors qu’une décision unilatérale de l’employeur était jusqu’alors applicable, cet accord et les contreparties qu’il fixe se substituent de droit à la décision unilatérale de l’employeur et aux contreparties que celle-ci comportait.
Rappelons que les accords collectifs pouvant être conclus à ce titre sont des accords de branche, d’entreprise ou d’établissement. Dans le cas d’une dérogation préfectorale accordée à titre individuel, l’accord collectif est par hypothèse un accord d’entreprise ou d’établissement.
S’il n’est pas possible de disposer d’éléments statistiques relatifs aux nombres d’accords collectifs conclus s’agissant des dérogations préfectorales accordées à titre individuel, un tel suivi a néanmoins pu être réalisé s’agissant des PUCE.
Le tableau suivant retrace la répartition des demandes de dérogation des établissements situés dans les PUCE entre celles qui sont fondées sur un accord collectif – soit environ un tiers des demandes – et celles qui reposent sur une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum – les deux tiers des demandes.
RÉPARTITION DES DEMANDES D’AUTORISATION EN PUCE ENTRE ACCORD COLLECTIF
OU DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR
Département |
Nombre de demandes |
Accord collectif |
Décision unilatérale de l’employeur |
Nord |
136 |
12 |
124 |
Bouches-du-Rhône |
129 |
122 (1) |
7 |
Val-d’Oise |
161 |
29 |
132 (2) |
Val-de-Marne |
21 |
3 |
18 |
Essonne |
28 |
14 |
14 |
Yvelines |
91 |
16 |
75 |
Hauts-de-Seine |
8 |
5 |
3 |
Seine-et-Marne |
52 |
26 |
26 |
Total |
626 |
227 |
399 |
(1) dont 108 situés dans la zone Plan de Campagne
(2) dont 87 pour Usines Center
Source : direction générale du travail
On notera qu’à l’exception notable du PUCE de Plan de Campagne, la décision unilatérale de l’employeur concerne 80 % des autres demandes déposées.
En conséquence de la suppression des PUCE, le 1° du présent article restreint le champ d’application de ces conditions – accord collectif ou, à défaut, décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum - aux seules autorisations d’ouverture dominicale accordées sur le fondement de l’article L. 3132-20 (pour répondre à des besoins du public ou permettre le fonctionnement normal d’un établissement).
Le 2° instaure, au sein de ce qui constituera un nouveau II à l’article L. 3132-25-2, une nouvelle série de conditions applicables aux autorisations d’ouverture dominicale dérogatoires accordées aux commerces situés dans les zones touristiques internationales, dans les zones touristiques et dans les zones commerciales.
Pour être autorisés à ouvrir le dimanche, les commerces situés dans ces zones devront être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord territorial, soit par un accord conclu avec des salariés mandatés.
La notion d’« accord territorial » renvoie au champ géographique d’un accord collectif : en effet, aux termes des articles L. 2232-1 s’agissant des accords interprofessionnels et L. 2232-5 s’agissant des accords de branche, le champ d’application de tels accords peut être national, régional ou local. Un accord territorial renvoie donc à un accord interprofessionnel ou à un accord de branche ayant un champ régional ou local. Du point de vue de la hiérarchie des normes, un accord territorial est régi par le seul principe de faveur : en d’autres termes, il ne peut comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les accords de niveau supérieur ou que les accords d’entreprise ou d’établissement si ces derniers prévalent sur les accords de niveau supérieur du fait de l’inversion de la hiérarchie des normes.
On peut s’interroger sur les règles qui seraient applicables en cas de coexistence de plusieurs accords de niveaux différents : en effet, il est probable que, dans le cas du travail dominical, un accord territorial couvre un champ géographique relativement limité (une ou plusieurs communes) mais un champ professionnel large, qui recoupe même celui de la convention collective applicable dans le secteur du commerce. Il est ainsi possible qu’un même accord territorial couvre des activités où sont applicables des règles diverses, notamment lorsque la convention de branche n’a pas interdit aux accords de niveau inférieur de prévoir des dispositions pouvant être moins favorables aux salariés ou dans les domaines où prévaut l’accord d’entreprise ou d’établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’accord territorial ne pourront prévoir, pour chacune des branches ou entreprises concernées, que des dispositions plus favorables aux salariés. Les dispositions de l’accord territorial seront applicables sous réserve de l’application, dans ces entreprises, des dispositions résultant des accords de branche ou d’entreprise dont elles relèvent. Enfin, dans l’hypothèse où un conflit de coexistence de conventions ne pourrait être résolu par l’application des règles hiérarchiques, le principe posé par la jurisprudence veut que seule la disposition conventionnelle la plus avantageuse reçoive application (Cass. ass. plén. 18 mars 1998), cette appréciation devant se faire « eu égard à l’ensemble des intéressés et non eu égard à l’un d’eux en particulier » (Cass. soc., 11 janvier 1962).
L’accord collectif conclu, quel que soit son niveau, doit fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Ces dispositions figurent déjà dans le cadre des accords collectifs conclus dans les PUCE ou pour un établissement bénéficiant d’une dérogation préfectorale individuelle : en réalité, le contenu de ces engagements peut être très variable, puisqu’il peut porter par exemple sur la limitation du recours à des contrats à durée déterminée (CDD) ou à des contrats de travail temporaire pour travailler le dimanche ; il peut prévoir que l’entreprise fera appel en priorité au personnel interne des magasins et plus particulièrement aux salariés à temps partiel, etc. S’agissant des engagements pris en faveur de certains publics en difficulté, ceux-ci peuvent consister dans l’aménagement du poste de travail en cas d’inaptitude de certains salariés ou la mise en place d’une politique de recrutement de travailleurs handicapés.
Le 2° du présent article insère enfin un nouveau III à l’article L. 3132-25-2 qui prévoit que pour les dérogations accordées sur le fondement de l’article L. 3132-20 qui sont conditionnées soit à la conclusion d’un accord, soit à une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, ainsi que pour les dérogations accordées aux zones touristiques internationales, aux zones touristiques et aux zones commerciales, qui sont conditionnées à la conclusion d’un accord collectif, cet accord ou, le cas échéant – quand cela est possible – la décision unilatérale, fixe obligatoirement les conditions dans lesquelles « l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ». Cette condition figure déjà aujourd’hui à l’article L. 3132-25-4, pour les dérogations individuelles ou sectorielles (article L. 3132-20) et pour les PUCE. Elle a donc vocation à être également exigée pour l’ensemble des commerces situés dans les zones dérogatoires nouvellement créées. Il s’agit essentiellement de prévoir les modalités selon lesquelles les salariés amenés à travailler le dimanche et dont la situation personnelle évolue peuvent demander à cesser de travailler le dimanche.
La nouvelle procédure de concertation obligatoire qui devra présider à l’ouverture dominicale des commerces situés dans les zones touristiques internationales, dans les zones touristiques et dans les zones commerciales, appelle plusieurs remarques.
Cette procédure présente d’abord l’avantage de supprimer le traitement différencié qui existe aujourd’hui pour de nombreux salariés selon qu’ils travaillent dans un commerce situé en zone touristique ou dans un commerce situé en zone commerciale. La condition d’une concertation préalable obligatoire fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical sera désormais applicable autant aux zones touristiques qu’aux zones commerciales. Il s’agit donc bien d’une harmonisation des régimes « par le haut », qui permet de mettre fin à la situation désavantageuse des salariés des zones touristiques, qui ne bénéficient d’aucune contrepartie sociale obligatoire à l’heure actuelle.
Le tableau suivant retrace les différents régimes des contreparties sociales applicables avant et après mesures du présent projet de loi.
MODALITÉS D’AUTORISATION D’OUVERTURE ET RÉGIMES DE
COMPENSATIONS SOCIALES AVANT ET APRÈS PROJET DE LOI
Droit existant |
Droit proposé | |
ZTI |
Sans objet |
Obligation de couverture par un accord collectif fixant : – les contreparties accordées aux salariés ; – les engagements en termes d’emploi en faveur de publics en difficulté ou de PH ; – prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. |
ZT |
Autorisation de droit après classement préfectoral sans contreparties obligatoires en faveur des salariés | |
PUCE / ZC |
Accord collectif fixant : – des contreparties obligatoires pour les salariés ; – des engagements en termes d’emploi ou en faveur de PH ; OU : Décision unilatérale de l’employeur prise après référendum (doublement de la rémunération et repos compensateur obligatoires) | |
Gares |
Sans objet | |
Alimentaire |
Ouverture jusqu’à 13 heures. Aucune obligation de contrepartie salariale (garantie de repos compensateur seulement) |
En ZTI et dans les gares, ouverture après 13 heures : avec application des règles ZTI/gares après 13 h (accord ; contreparties) |
Ensuite, la nouvelle procédure prévue pour déroger à la règle du repos dominical dans les nouvelles zones (touristiques internationales, touristiques ou commerciales) exclut la possibilité de mettre en place le repos en roulement sur le fondement d’une décision unilatérale de l’employeur, alors que cette possibilité existe aujourd’hui, à défaut d’accord collectif, pour les commerces situés en PUCE. Autrement dit, cette possibilité ne sera plus ouverte qu’aux dérogations individuelles accordées par le préfet sur le fondement de l’article L. 3132-20 (fermeture préjudiciable au public ou qui nuit au fonctionnement normal de l’établissement). Pourquoi avoir supprimé cette possibilité pour les nouvelles dérogations géographiques? Le texte fait en réalité le choix de faire reposer la mise en place des règles dérogatoires au repos dominical sur le seul dialogue social : en effet, rien ne vaut la négociation collective pour fixer des mesures compensatoires adaptées à chaque établissement, entreprise, secteur d’activité ou territoire spécifique, là où la fixation par la loi de mécanismes de compensation se révélerait impraticable dans certains secteurs ou insuffisante dans d’autres. Le principe que pose le texte est donc bien : « pas d’accord collectif, pas d’ouverture dominicale ».
En outre, le recours à une décision unilatérale de l’employeur avait en réalité surtout pour objet de répondre à la problématique des petits commerces indépendants, souvent très démunis pour mettre en place les conditions d’une négociation collective en leur sein, ceux-ci étant la plupart du temps dépourvus de délégués du personnel. Or, le texte aménage la possibilité de conclure des accords d’établissement ou d’entreprise par le biais du mandatement d’un ou de plusieurs salariés, afin de permettre aux toutes petites structures de négocier sur l’aménagement du repos hebdomadaire. En effet, le nouveau II de l’article L. 3132-25-3 prévoit qu’il est possible de conclure un accord « dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 5125-4 » pour mettre en place le régime dérogatoire de travail dominical.
Rappelons que cet article est issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a instauré, pour la conclusion d’un accord de maintien de l’emploi dans une entreprise confrontée à des difficultés économiques conjoncturelles, une voie de négociation sui generis pour les entreprises dépourvues de délégué syndical, en prévoyant que l’accord collectif pouvait dans ce cas être conclu par:
– un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel;
– par un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet dans les mêmes conditions, en l’absence de représentants élus du personnel.
Dans les deux cas, l’accord ainsi signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit faire l’objet d’une approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Dès lors que les conditions sont réunies pour rendre possible la conclusion d’un accord collectif dans les très petites entreprises que sont souvent les commerces de détail de proximité, il n’est plus nécessaire de prévoir la possibilité de procéder par voie unilatérale.
On remarquera toutefois que ce faisant, disparaît également du corpus de règles encadrant les dérogations géographiques le renvoi au plancher de contreparties sociales que sont le doublement de la rémunération et le repos compensateur, qui s’appliquait obligatoirement en présence d’une décision unilatérale de l’employeur. Le rapporteur thématique se demande si la disparition de la référence à ce plancher légal n’est pas un mauvais signal donné, quand bien même celui-ci n’avait pas obligatoirement vocation à s’appliquer dans le cadre d’un accord collectif. Il pouvait toutefois servir d’étalon dans les entreprises amenées à négocier pour mettre en place le régime dérogatoire au repos dominical. En outre, le texte reprend la formule selon laquelle « l’accord (...) fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical », qui s’applique déjà aujourd’hui en présence d’un accord collectif dans les PUCE et pour les dérogations individuelles sur le fondement de l’article L. 3132-20, sans que ne soit précisée la nature de ces contreparties. Certes, celles-ci peuvent être variées, et il faut d’ailleurs souhaiter qu’elles le soient : on peut en effet tout à fait concevoir que les salariés privés de repos dominical bénéficient d’un abondement spécifique de leur compte personnel de formation, d’une aide spécifique à la garde d’enfants ou destinée à faciliter leur transport entre leur domicile et leur lieu de travail, et pas seulement d’un repos compensateur et d’une rémunération plus élevée. Le rapporteur thématique considère toutefois que de telles compensations ne doivent pouvoir venir qu’en complément des contreparties salariales et d’un repos compensateur. Le texte gagnerait sans aucun doute à être complété sur ce point, a minima en précisant que ces contreparties sont obligatoirement de nature salariale. En effet, en l’état du texte, rien n’obligerait une entreprise située dans une zone touristique ou une zone commerciale d’assortir la privation du repos dominical d’une majoration salariale; cela ne serait évidemment pas acceptable.
On remarquera enfin que le texte ne retient pas la proposition du rapport « Bailly » d’exonérer les commerces de moins de onze salariés de l’obligation de prévoir des contreparties sociales pour pouvoir ouvrir le dimanche. En effet, on peut considérer qu’une telle exonération des petits commerces n’avait de sens que dans l’économie globale prévue par le rapport, à savoir la possibilité de procéder par la voie unilatérale en l’absence de conclusion d’un accord, avec dans ce cas, une obligation de doublement de la rémunération et de repos compensateur. Les commerces de grande taille disposant d’une surface financière importante et dont la représentation des salariés est institutionnalisée peuvent en effet sans difficulté engager des négociations avec leurs salariés et offrir des contreparties sociales équitables, alors que les petits commerces, qui ne disposent pas de représentants du personnel et ne sont donc pas armés pour organiser une négociation collective, auraient dû, pour ouvrir le dimanche, forcément passer par la voie unilatérale, et proposer un doublement de la rémunération à leurs salariés privés de repos dominical, alors même qu’ils n’en ont souvent pas les moyens. C’est pour cette raison que le texte a fait le choix d’instaurer une modalité de négociation collective dans les petits commerces, devant permettre la fixation de contreparties sociales aux salariés, sans que le niveau de ces contreparties ne pèse de manière excessive sur les petits commerces et ne mette en danger le commerce de proximité.
Le rapporteur thématique s’interroge toutefois sur les possibilités concrètes pour des petits commerces indépendants de négocier un accord par le mandatement d’un ou de plusieurs salariés. Les représentants des petits commerces doutent en tout cas de leur capacité à mener de telles négociations dans ce cadre, et redoutent simplement de ne pas pouvoir ouvrir le dimanche, au moment où les plus grands magasins pourront, eux, le faire.
*
* *
Outre des modifications d’ordre rédactionnel, la commission spéciale a, lors de son examen du texte, adopté trois modifications substantielles au dispositif dérogatoire d’ouverture dominicale sur la base d’un accord collectif.
Elle a ainsi adopté un amendement des rapporteurs, destiné à faciliter pour les petites entreprises les modalités dérogatoires, au vu de leurs difficultés à passer par la négociation collective en raison de l’absence d’interlocuteurs dans l’entreprise : l’amendement a ainsi prévu que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la mise en place du travail dominical peut intervenir sur le fondement d’une proposition de l’employeur, soumise à l’accord des deux tiers des salariés concernés par la privation du repos dominical.
La commission spéciale a également souhaité, à l’initiative des rapporteurs, préciser que l’accord collectif qui doit être conclu pour recourir au travail dominical doit obligatoirement comporter des contreparties salariales, le texte du projet de loi ne précisant pas la nature des contreparties offertes.
Dans la continuité de cet amendement, la commission spéciale a ensuite adopté un amendement des rapporteurs, précisant que l’accord collectif doit également comporter des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, afin de s’assurer que les contreparties exigées des accords collectifs sont bien d’une part, de nature salariale, et d’autre part, toute autre contrepartie sociale, qu’il s’agisse de mesures destinées à faciliter la garde d’enfants, le transport entre le domicile et le lieu de travail, ou encore à améliorer les droits à la formation des salariés concernés.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE107 de M. Gérard Cherpion et SPE438 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Sous couvert d’harmonisation du régime social des contreparties accordées aux salariés qui travaillent le dimanche, le projet de loi menace les équilibres territoriaux actuels. En conditionnant l’ouverture dominicale à l’existence d’un accord collectif, il menace l’ouverture des très petites, petites et moyennes entreprises qui n’auront pas réussi à conclure leur négociation. Étant donné l’opposition forte de l’ensemble des organisations syndicales de salariés à l’extension de l’ouverture du dimanche, la procédure de mandatement, déjà source de complexité, risque de ne pas faciliter la conclusion d’accords dans les petites structures. Il y a donc un risque de fermeture de ces très petites et petites entreprises.
M. Patrick Hetzel. Même argumentation.
M. le ministre. Dans le dispositif prévu, les commerces alimentaires, dont l’ouverture jusqu’à treize heures est autorisée par dérogation depuis 2009, ne sont pas touchés par cette mesure. Les dimanches du maire ne sont pas concernés non plus puisque le doublement de la paie s’applique : le passage de cinq à douze dimanches n’est donc pas concerné non plus.
Cette mesure s’applique aux zones touristiques, aux zones commerciales et aux zones touristiques internationales. Dans ces trois cas, l’ouverture est conditionnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, de branche ou de territoire qui prévoit les règles de compensation. Nous avons déjà abordé le cas des zones commerciales et des ZTI, qui ne sont pas des petits commerces : à défaut de la signature d’un accord, là où il n’y en a pas, il y aura fermeture.
Le problème ne se pose vraiment que pour les zones touristiques. Dans les nouvelles zones touristiques, où il faudra un accord préalable, nous pensons que l’existence des trois modalités que j’ai évoquées précédemment en réponse à Véronique Louwagie, laisse la possibilité de trouver une voie de sortie. La ville de Saint-Malo nous fournit un bon exemple d’accord territorial qui fonctionne avec des compensations généreuses.
Restent les commerces actuellement ouverts en zone touristique qui ne sont pas couverts par un accord. En proposant un délai de trois ans, une sorte de phase d’adaptation, nous voulons éviter que le nouveau dispositif ne conduise à des fermetures de petits commerces. Le délai de trois ans nous paraît raisonnable, et il est en tout cas beaucoup plus long que celui d’un an prévu dans l’accord sur le travail à temps partiel. Grâce à l’instauration de ce délai et à la triple possibilité offerte pour conclure ces accords, il me semble que nous répondons à votre préoccupation de ne pas sacrifier les petits commerces dans le cas très spécifique que je viens de rappeler où aucun accord n’existe. Avis défavorable.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il convient de chercher une harmonisation en prévoyant une solution de facilitation pour les petits commerces. C’est le sens de l’un de mes amendements à venir dans le cadre de cet article. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
Mme Sandrine Mazetier. C’est un article très important car il affirme le principe qu’il ne peut y avoir d’ouverture sans accord sur les compensations. Nous devons donc examiner avec attention son contenu et son périmètre de couverture, que vous venez de rappeler, monsieur le ministre.
Or il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez l’expression. Cet article affirme qu’en zone touristique, en zone commerciale et en zone touristique internationale, les établissements – et non pas les salariés – doivent être couverts par un accord. L’un de mes amendements à venir pose la problématique de l’évolution du commerce. Nous avons beaucoup fait référence au commerce sur internet, mais dans les grandes chaînes de magasins, parfumeurs et autres, il y a de moins en moins de salariés de l’établissement et de plus en plus de représentants de marques, qui viennent ponctuellement travailler. Ceux-là ne seront pas couverts par les accords. Il faut traiter cette question, en particulier dans les ZTI, en gardant à l’esprit que l’évolution du commerce n’en est qu’à ses débuts. Les grandes surfaces alimentaires – je ne vous parle pas du Printemps, des Galeries Lafayette ou du Bon Marché – sont déjà de vastes halls d’exposition où les entreprises louent des corners. Il faut que nous soyons bien conscients de l’évolution du commerce et des rapports sociaux.
L’article 76 n’exclut pas – y compris pour les ZTI où les commerces sont extrêmement rentables – la possibilité d’un accord unilatéral, conclu au terme de trois ans par l’employeur, après un référendum associant une partie des personnels. Je peux comprendre que l’on puisse se poser la question du temps nécessaire à l’élaboration d’un accord et à la négociation de contreparties pour les zones où la rentabilité des commerces n’a rien à voir avec celle qui est constatée dans les ZTI, mais je m’étonne que ces dernières figurent dans l’article 76. Monsieur le ministre, cela m’étonne d’autant plus que vous avez pris la peine de fixer noir sur blanc des contreparties explicites au travail en soirée. Pour les cinquante-deux dimanches des ZTI, le texte devrait aussi mentionner des contreparties explicites. La pratique du travail dissimulé est constatée dans certaines ZTI où des restaurateurs emploient pour faire la plonge des auto-entrepreneurs ne sachant pas écrire le français. La réalité des ZTI, c’est aussi cela.
M. Gilles Lurton. Monsieur le ministre, je vous remercie de reconnaître que l’accord conclu à Saint-Malo est très généreux. Il a été possible grâce à un maire particulièrement social qui a dit d’emblée qu’il n’y aurait d’accord que si les compensations étaient pleines et entières.
La Commission rejette les amendements SPE107 et SPE438.
Puis elle examine l’amendement SPE848 rectifié de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet article 76 est extrêmement important puisqu’il fixe le cadre des négociations et donc les contreparties, notamment salariales, accordées aux personnels privés du repos dominical. Il précise aussi la nature des engagements pris par les entreprises en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté et en situation de handicap. Nous souhaiterions que le « ou » soit remplacé par un « et ».
Notre amendement propose de réécrire partiellement cet article. Le texte actuel prévoit une négociation collective sans encadrement, sans plancher. Nous pensons qu’il serait plus juste de fixer dans la loi une compensation unique calquée sur les modalités actuelles les plus favorables, c’est-à-dire le doublement du salaire et le repos compensateur pour tous les salariés concernés, afin que les négociations collectives aillent plus loin. Au passage, je signale à notre rapporteur que ce n’est ni loyal ni très convainquant d’affirmer, comme il l’a fait tout à l’heure, que nous sommes contre la négociation collective.
En outre, nous souhaitons que ces négociations se fassent au niveau de la branche, le seul qui permette à l’ensemble des acteurs d’une profession de discuter de l’opportunité d’ouvrir le dimanche et des conditions dans lesquelles le faire. Cette prise de hauteur permet une forme de régulation de la concurrence. À l’inverse, au niveau plus étroit de l’entreprise, la négociation est plus déséquilibrée car l’employeur agite sans cesse la menace de la suppression d’emplois pour contraindre à la signature de l’accord. Quant à la négociation territoriale, on peut en discuter mais le problème est qu’elle est loin d’être stabilisée. Qui peut négocier ? De grandes incertitudes demeurent sur ce point dans certains endroits.
Monsieur le ministre, votre ambition serait de réduire les inégalités et de ne pas nuire aux petits commerces de centre-ville. Nous partageons ces objectifs mais nous considérons que, en l’état, votre texte ne permet pas de les atteindre. En ce qui concerne la réduction des inégalités, les progrès sont indiscutables dans les ZTI. Mais certains salariés, notamment ceux qui sont sous le régime des cinq dimanches du maire, bénéficieront d’un doublement de la rémunération avec repos compensateur, tandis que d’autres auront des contreparties issues de la négociation collective qui seront éventuellement moins favorables. Nous constatons que l’inégalité persiste. En ce qui concerne la protection des petits commerces, je répète que ce texte les pénalise de toute façon, parce qu’ils ne peuvent pas faire face à la concurrence des grandes enseignes ouvertes le dimanche, quelles que soient les conditions. La seule avancée réelle contenue dans cet article est la disposition qui conditionne l’ouverture à la signature d’un accord.
Venons-en à l’alinéa 8 : « Dans tous les cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. » Cette formulation laisse à penser qu’en cas d’échec de la négociation, l’employeur pourrait unilatéralement décider des contreparties. Cela ne correspond pas à vos explications et je souhaiterais une clarification sur ce point.
M. le président François Brottes. Nous pouvons constater que vous tenez une comptabilité précise des choses, madame Fraysse, et vos interventions permettent de lever des incertitudes qui peuvent parfois demeurer.
M. le ministre. Je remercie Mme Fraysse de noter les avancées existantes en ZTI mais il en existe partout. Pour les dimanches du maire, le principe du doublement est acquis. Pour les commerces alimentaires ouverts jusqu’à treize heures, j’ai indiqué que j’étais ouvert à l’idée de prévoir des compensations à partir de certains formats commerciaux, car il s’agit de ne pas pénaliser les petits commerces tout en étant juste sur le plan social.
Nous sommes plongés dans ce dilemme depuis le début de cette discussion : nous voulons protéger les salariés en prévoyant des compensations ; nous voulons aussi protéger les petits commerces qui sont ceux qui ont le moins la capacité de compenser le travail dominical. Ce dilemme nous oblige à prendre des précautions. C’est pour cela que nous n’avons pas retenu le principe unilatéral et permanent du doublement de la rémunération. Suite aux remarques de M. Poisson, nous avons discuté du fait que ce principe était retenu dans les seuls PUCE, ce qui créait des disparités et des inégalités. À partir du moment où l’on impose la conclusion d’un accord de branche, de territoire ou d’entreprise, la compensation est garantie par le dialogue social. Le Gouvernement croit aux vertus du dialogue social.
M. Gérard Cherpion. Il n’est pas le seul !
M. le ministre. Vous avez raison, nous n’en avons pas l’exclusive et la loi Larcher avait permis d’avancer en ce sens. Je ne fais pas ici de polémiques inutiles. Il y a une continuité sur ce sujet, mais nous allons jusqu’au bout. Il est un peu paradoxal de vouloir déterminer un niveau de compensation dans la loi pour tous les territoires et toutes les situations, tout en prétendant croire au dialogue social. C’est d’ailleurs comme cela que le dialogue social a été souvent stérilisé.
Mme Jacqueline Fraysse. Il est déséquilibré, ce dialogue !
M. le ministre. Les options sont multiples puisque ce dialogue peut avoir lieu dans l’entreprise, la branche ou le territoire. Sans accord, il n’y a pas d’ouverture ; cet accord prévoit les règles de compensation. Pour le dimanche du maire, le doublement de la rémunération est maintenu dans la loi parce que le volontariat peut être très limité, non prévu, non contractuel. Pour le travail en soirée dans les ZTI, qui passe de vingt et une heures à minuit, le doublement de la rémunération est aussi inscrit dans la loi car il s’agit d’une dérogation au travail de nuit. Pour tout le reste, c’est le principe de l’accord qui s’applique.
Quant à l’alinéa 8, il répète la clause de sécurité : l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et le doublement de la rémunération s’impose. Le système est plus sûr et plus généreux que les dispositions actuelles. J’espère que ces rappels auront levé vos inquiétudes.
M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur thématique, Jacqueline Fraysse vous a fait un procès en déloyauté auquel vous souhaitez peut-être réagir.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Pardonnez-moi, madame Fraysse, pour cette maladresse de langage. En répondant à plusieurs amendements de suppression en même temps, on court ce risque. Je connais la valeur de l’apport du groupe GDR à la négociation collective et je comprends l’intention de votre amendement.
Nous convenons tous que les salariés privés de repos dominical doivent obtenir de justes compensations. Néanmoins, je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons : l’obligation d’un accord de branche va poser des problèmes dans certains secteurs d’autant qu’il peut exister des commerces qui ne relèvent d’aucune branche ; la fixation d’un plancher de rémunération au moins égal au double de la rémunération normale va désavantager les petits commerces qui seront le plus souvent incapables de respecter cette condition et ne pourront pas ouvrir, contrairement aux grands groupes.
Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais suggérer de fixer un plancher mais aussi un critère de taille de magasin – le nombre de mètres carrés, par exemple – qui permettrait de ne pas imposer cette obligation à ceux qui ne pourraient pas la supporter sur le plan financier. Nous pourrions travailler sur cette distinction. Qu’est-ce qu’un petit commerce ? Quelle surface ou quel autre critère retenir ? Cela maintiendrait une différence de traitement entre les salariés tout en l’atténuant considérablement, dans l’intérêt général de tous ces travailleurs privés du repos dominical.
Mme Karine Berger. L’échange entre notre collègue Fraysse et le ministre m’inspire trois remarques. Tout d’abord, j’en suis désolée mais je n’ai pas compris la réponse que le ministre a apportée à propos de la notion de « décision unilatérale de l’employeur » contenue à l’alinéa 8. Cette expression est-elle vraiment indispensable ? Mme Fraysse a raison de souligner que la formulation de cet alinéa – « Dans tous les cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical » – trouble le message. Si l’on pouvait trouver une autre rédaction, je pense que cela rassurerait tout le monde.
Ensuite, ne peut-on pas essayer de trouver une limite de surface commerciale au-delà de laquelle s’appliqueraient des seuils de compensation ? Je suis bien convaincue que tout n’est pas possible dans les petits commerces mais je ne suis pas satisfaite de voir que de très grandes surfaces auront trois ans pour prévoir d’éventuelles compensations. C’est un peu ennuyeux. D’ici à la séance, ne pourrait-on décider qu’à partir d’une certaine surface commerciale, l’accord est non seulement nécessaire mais qu’il comporte aussi des compensations minimum ? Cette idée devait recueillir l’assentiment de l’ensemble de nos collègues. Enfin, d’une manière générale, je trouve que le délai de trois ans est très long.
M. le président François Brottes. Il faut aussi tenir compte de la nature de l’activité et de l’état de la concurrence pour déterminer si un commerce se trouve ou non en situation difficile. Il est peut-être possible de paramétrer tous ces critères mais cela me semble compliqué. Quoi qu’il en soit, le seul critère de surface n’est pas suffisant.
M. Jean-Louis Bricout. Dans la même logique, et en particulier pour les ouvertures accordées par le maire, il faut trouver un critère qui permette d’établir une différence entre la grande distribution et les petits commerces car ces derniers ne pourront pas supporter le doublement des rémunérations. La surface me semble être le critère le plus pertinent. Y en a-t-il d’autres ? D’ici à l’examen du texte en séance, il faut travailler sur ce point.
M. Jean-Christophe Fromantin. Comme vous, monsieur le président, je pense qu’il est impossible de retenir le seul critère de surface commerciale, sans tenir compte de la nature du commerce et de la valeur ajoutée qu’il dégage. Prenez un petit commerce de la place Vendôme et un magasin de 2 000 mètres carrés dans la banlieue d’une ville moyenne et vous aurez une idée de la difficulté de l’exercice. C’est la valeur ajoutée qui peut générer la capacité à absorber un supplément de rémunération et elle n’est pas forcément corrélée à la taille du commerce. Retenir un critère de surface relève du contresens économique : la capacité d’un magasin à absorber un supplément de rémunération dépend de ses marges et de sa valeur ajoutée.
M. le ministre. L’alinéa 8 s’inscrit dans un périmètre plus large et il couvre à la fois les accords et les dérogations préfectorales individuelles que nous avons évoquées précédemment. La « décision unilatérale de l’employeur » fait référence à la situation des dérogations préfectorales individuelles. Par souci de clarification, je vous propose de faire référence à l’article L. 3132-20 lorsque l’on mentionne la décision unilatérale individuelle de l’employeur. Cette précision rédactionnelle permettrait de lever toute ambiguïté.
Comme plusieurs intervenants, je considère que le critère de taille n’est pas pertinent quand il s’agit de classer les commerces pour appliquer des seuils de compensations minimum. Certaines jardineries seraient pénalisées car elles occupent des surfaces immenses alors qu’elles sont assez peu profitables. Cependant, ce critère est plus pertinent pour les commerces alimentaires, où il n’y a pas de règles de compensation. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous proposons d’explorer cette voie d’ici à la présentation du texte en séance.
M. le président François Brottes. Vous avez donc pris l’engagement d’apporter cette précision en séance, monsieur le ministre.
La Commission rejette l’amendement SPE848 rectifié.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1700 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE636 rectifié de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Après vos explications, monsieur le ministre, je vais le retirer.
Cela étant, je voudrais revenir sur l’alinéa 6 de cet article : « les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu au niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l’article L.5125-4. » Or ces conditions mentionnées au II de l’article L.5125-4 du code du travail concernent le maintien de l’emploi. Que viennent-elles faire dans cette liste ?
M. le ministre. Il s’agit en effet d’un renvoi aux conditions de l’accord de maintien de l’emploi. Plutôt que d’être générique, l’accord dans l’entreprise peut être facilité par l’application de ces conditions qui sont plus simples. Pour répondre à une partie des préoccupations exprimées dans votre amendement, même si vous l’avez retiré, je souligne qu’il est toujours possible de conclure un accord au bon niveau selon les modalités les plus simples. L’amendement SPE1871 des rapporteurs procède de la même philosophie.
L’amendement SPE636 rectifié est retiré.
La Commission examine l’amendement SPE1871 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Pour répondre à la problématique spécifique des petits commerces, l’amendement prévoit que dans les seules entreprises dépourvues de délégué syndical, il sera possible de mettre en place l’ouverture dominicale dérogatoire sur la base d’une proposition de l’employeur approuvée à la majorité des deux-tiers des salariés concernés.
L’obligation de conclure un accord collectif peut en effet poser un problème dans les petits commerces. Rappelons que, a priori, les entreprises de moins de cinquante salariés n’ont pas de délégué syndical et que les entreprises de moins de onze salariés n’ont pas de délégué du personnel.
Le texte prévoit que l’entreprise dépourvue de représentation syndicale peut conclure un accord sur la base de la procédure de mandatement du salarié qui s’applique dans le cadre des accords de maintien de l’emploi. Cette procédure suppose toutefois un mandatement par des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. Autrement dit, dans la pratique, il sera très compliqué pour un petit commerce d’être couvert par un accord. Mon amendement tend à pallier cette difficulté.
M. le ministre. Monsieur Cherpion, la référence à l’article L. 5125-4 a été insérée dans le texte à la demande du Conseil d’État, de manière à englober les entreprises dépourvues de délégué syndical, que l’accord d’entreprise de droit commun ne couvrait pas.
C’est également l’objet de l’amendement du rapporteur, qui propose que, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le travail dominical fasse l’objet d’une proposition de l’employeur approuvée par les deux tiers des salariés. S’il devait être retenu, il doit être clair qu’il ne doit en aucun cas s’agir d’une voie de contournement du dialogue social classique. Les réserves du Gouvernement concernent plus particulièrement le périmètre d’une telle mesure : si elle se justifie pleinement dans les entreprises comportant moins de onze salariés où n’existe aucune représentation, doit-elle s’appliquer dans les entreprises où existe un représentant du personnel, c’est-à-dire dans les entreprises comportant entre onze et cinquante salariés ? N’ayant pour autant aucune opposition de principe à une telle proposition, je m’en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement SPE1871.
En conséquence les amendements SPE1829 et SPE108 tombent.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement SPE1872 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement précise que les accords collectifs devront obligatoirement comporter des contreparties salariales pour les salariés privés de repos dominical.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1872.
Puis elle examine l’amendement SPE783 de M. Francis Vercamer.
M. Philippe Vigier. Je retire cet amendement, tout en insistant sur le fait qu’il importe de poursuivre une vraie réflexion sur la valeur ajoutée des commerces soumis aux règles régissant le travail dominical.
L’amendement SPE783 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE1876 des rapporteurs, SPE1065 de M. Alain Tourret, SPE1136 de M. Joël Giraud et SPE1034 de Mme Catherine Coutelle.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement complète l’amendement SPE1872 et prévoit qu’en complément des contreparties salariales, l’accord collectif inclue obligatoirement des mesures destinées à tenir compte des contraintes particulières liées au travail dominical, afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
M. Alain Tourret. Nous proposons d’instaurer un plancher minimal pour les majorations salariales perçues en cas de travail dominical.
Mme Sandrine Mazetier. Les accords d’entreprise doivent explicitement prévoir des mesures destinées à faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en matière de garde d’enfant.
M. le ministre. La philosophie de ce texte est plutôt d’éviter les effets de seuil ou les coefficients multiplicateurs. Je proposerai donc à M. Tourret de retirer ses amendements.
Quant à l’amendement de Mme Mazetier, je pense qu’il est satisfait par l’amendement SPE1876, auquel je suis favorable.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement des rapporteurs ne me paraît pas satisfaire l’amendement SPE1034, déposé par la délégation aux droits des femmes. Je le retire néanmoins, quitte à le redéposer en séance.
Les amendements SPE1065, SPE1136 et SPE1034 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement SPE1876.
M. Jean-Frédéric Poisson. J’attire l’attention de la commission sur l’engrenage dans lequel nous avons mis le doigt, en inscrivant dans la loi que les accords sur le travail dominical doivent tenir compte de la manière dont les travailleurs doivent pouvoir faire garder leurs enfants ou se déplacer. Nous dénoncions déjà, il y a cinq ans, la multiplication des enjeux sociaux liés à cette question du travail dominical, et je ne peux que le regretter.
M. le président François Brottes. À vous écouter, je ne sais trop comment interpréter les regrets dont vous nous faites part et ce sur quoi ils portent précisément.
La Commission en vient à l’examen, en présentation commune, des amendements SPE295 et SPE296 de Mme Colette Capdevielle.
Mme Colette Capdevielle. Ces amendements visent à fixer a minima les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical sur l’ensemble du territoire. Dans cette perspective, il est proposé, d’une part, que la rémunération soit majorée d’au moins un tiers – ou d’au moins un quart, selon notre amendement de repli – de la rémunération due pour une durée équivalente et, d’autre part, que la période travaillée donne lieu à un repos compensateur d’une durée au moins équivalente. Cela permettra d’éviter les abus de la part des employeurs et garantira le volontariat chez les salariés.
M. le ministre. Je ne suis pas favorable à la fixation d’un taux plancher dans la loi, qui risque d’inciter les employeurs à y coller. Qu’il s’agisse des exemples de Marseille ou de Saint-Malo, ils montrent que des négociations au plan local peuvent permettre d’aboutir à des compensations plus avantageuses que ce que prévoit la loi. Soucieux de ne pas complexifier inutilement la loi, le Gouvernement préfère donc renvoyer aux accords sinon le principe du moins le montant des compensations. Je demande donc le retrait de ces amendements.
Mme Colette Capdevielle. J’admets que fixer un plancher dans la loi comporte le danger de tirer les compensations vers le bas. Je retire donc mes amendements.
Les amendements SPE295 et SPE296 sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement SPE1473 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je continue de m’étonner, compte tenu de la profitabilité des commerces situés dans les ZTI, que l’article L. 3132-24 ne fixe aucun minimum en matière de rémunération ou de repos compensateur.
L’objet de cet amendement est que, dans les ZTI, les compensations prévues par les accords dont le principe est affirmé par l’article 76 vaille pour tous les intervenants dans les établissements. Il s’agit de couvrir les travailleurs qui ne sont pas directement salariés par ces établissements.
M. le ministre. N’oublions pas que notre discussion ne porte que sur le commerce de détail et que les garanties en termes de compensations ne concerneront que les salariés du secteur et non, par exemple, les infirmières ou les employés de la SNCF. D’où la nécessité de faire attention aux effets de bord entre les différents secteurs.
Vous soulevez néanmoins une vraie question en évoquant le cas des intervenants extérieurs réalisant des prestations dans les établissements situés au sein des zones concernées. Ces salariés peuvent en effet relever de conventions collectives qui n’entrent pas nécessairement dans le champ des accords collectifs, dès lors, par exemple, que leur société de rattachement a son siège dans une autre localité. Il s’agit d’un problème auquel nous n’avons pas trouvé de solution satisfaisante, et votre amendement, tel qu’il est rédigé, comporte de trop grands risques d’insécurité juridique. Je vous suggère donc de le retirer, et m’engage à travailler avec M. Rebsamen pour vous proposer, d’ici la discussion du texte en séance publique, une réponse juridiquement appropriée.
J’ajoute qu’au-delà des intervenants extérieurs au sein des magasins, cette question des compensations se pose, par contamination, pour les transporteurs sollicités par ces magasins le dimanche et ainsi de suite, jusqu’à concerner, secteur après secteur, l’ensemble de l’économie. Il est donc impératif que nous trouvions des solutions.
Mme Karine Berger. Le ministre est hostile à la fixation d’un montant minimum de compensation salariale dans la loi au motif que cela inciterait les employeurs à converger vers ce minimum. La loi établit pourtant de fait un minimum : l’absence de majoration salariale, et je ne vois pas ce qui empêchera les employeurs de vouloir s’en rapprocher. Cela m’amène à mon second sujet de préoccupation. Il y a tout lieu de craindre, en effet, qu’en mettant en place des dispositifs qui ne couvrent qu’une partie des salariés concernés par le travail dominical, on laisse ouvertes des possibilités de contournement de ces dispositifs, par le biais par exemple de systèmes de franchise ou de sous-traitance, qui annuleront tous les effets des accords collectifs. Dans ces conditions, agissons-nous de manière responsable en ouvrant comme nous le faisons le travail dominical, si nous ne sommes pas capables de mieux protéger les salariés concernés ? Je tiens ici à préciser à Jean-Frédéric Poisson que ce n’est pas parce que je m’efforce de fournir à ces salariés la couverture sociale et les compensations les plus complètes possible que je suis forcément d’accord avec le fait de multiplier les exceptions au repos dominical.
M. Patrick Hetzel. Les auteurs de cet amendement parlent du repos dominical comme d’un acquis social. C’est oublier un peu vite qu’il trouve sa source dans un ouvrage de la tradition judéo-chrétienne qui a dû leur échapper…
M. Christophe Caresche. Je ne suis pas aussi pessimiste que Karine Berger, et je me demande même si nous ne sommes pas en train de mettre en place un mécanisme contagieux, qui va permettre à d’autres salariés, comme d’ailleurs à des fonctionnaires, de revendiquer de nouvelles conditions de travail.
Mme Sandrine Mazetier. Faut-il déduire des propos de Christophe Caresche qu’il considère que tout amendement visant à inscrire des contreparties salariales dans un accord collectif entraîne mécaniquement une hausse des charges publiques ?
L’amendement SPE1473 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1701 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 76 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1220 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Il s’agit de prévoir que la Commission nationale de la négociation collective inclue dans ses missions le suivi annuel des dispositions des accords collectifs sur le travail dominical, en particulier celles visant à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
M. le ministre. Je partage l’objectif poursuivi par cet amendement, mais le bilan annuel de la négociation collective permet aujourd’hui aux partenaires sociaux de suivre la réalité de la négociation. Les dispositions relatives au travail dominical font l’objet d’un point particulier dans ce bilan, à l’instar des accords en matière d’égalité professionnelle. Votre amendement est donc satisfait.
L’amendement SPE1220 est retiré.
*
* *
Article 77
(art. L. 3132-25-4 du code du travail)
Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche
Cet article propose de « généraliser » la procédure de protection de la volonté du salarié amené à travailler le dimanche, qui s’applique aujourd’hui uniquement aux dérogations individuelles accordées par le préfet aux établissements dont la fermeture serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement (article L. 3132-20) et aux commerces situés en périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE). Cette procédure serait désormais applicable autant à ces dérogations individuelles qu’aux dérogations applicables aux commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques ou les zones commerciales.
Il s’agit là d’un progrès important par rapport à la situation actuelle des zones touristiques, dans lesquelles, on l’a vu, les salariés privés de repos dominical ne bénéficient pas de compensations obligatoires, pas plus que n’est prévu de respect de la règle du volontariat du salarié. Le tableau suivant retrace les évolutions initiées par le projet de loi dans ce domaine.
PROCÉDURE DE GARANTIE DU VOLONTARIAT DU SALARIÉ
Droit existant |
Droit proposé | |
ZTI |
Sans objet |
Procédure de recueil du volontariat : accord écrit du salarié ; protection du refus du salarié à l’embauche et dans le cadre de son contrat de travail. |
ZT |
Aucun | |
PUCE / ZC |
Procédure de recueil du volontariat : accord écrit du salarié ; protection du refus du salarié à l’embauche et dans le cadre de son contrat de travail. | |
Gares |
Sans objet | |
Alimentaire |
Aucun |
Volontariat après 13 heures pour les commerces alimentaires en ZTI ou gare qui souhaitent ouvrir l’après-midi. |
Rappelons les règles du respect du volontariat du salarié, que le texte se contente d’élargir à l’ensemble des zones géographiques dérogatoires.
En premier lieu, il n’est pas possible de priver un salarié de repos dominical en l’absence d’un accord écrit de celui-ci à son employeur.
La protection du volontariat du salarié repose ensuite également sur le respect de l’éventuel refus de travailler le dimanche ainsi, un tel refus ne peut être pris en considération par l’employeur pour refuser d’embaucher un salarié, pas plus qu’une quelconque mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ne saurait être prise à l’encontre du salarié refusant de travailler le dimanche. Enfin, un tel refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le rapporteur thématique se réjouit de ce progrès incontestable, qui permet de rendre applicables à l’ensemble des zones géographiques dans lesquelles il sera possible de déroger à la règle du repos dominical les dispositions relatives au volontariat du salarié. Il se demande toutefois si ces règles ne gagneraient pas à être renforcées.
En effet, le texte actuel de l’article L. 3132-25-4 prévoit qu’en présence d’une décision unilatérale de l’employeur, celui-ci doit également :
– demander chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
– et informer chaque année le salarié à cette occasion de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Dans ce cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité d’occuper un emploi n’impliquant pas de travailler le dimanche.
Enfin, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement l’employeur en respectant un délai d’un mois.
Rien ne justifie que de telles garanties de la réversibilité du choix du salarié ne s’appliquent qu’en présence d’une décision unilatérale de l’employeur. C’est d’ailleurs ce que préconise le rapport « Bailly », qui propose que la loi encadre le contenu des accords collectifs en fixant des clauses obligatoires notamment s’agissant des mesures visant à garantir le respect du volontariat, en précisant que celui-ci repose en particulier sur « le droit à la réversibilité » du choix du salarié, chaque salarié devant « pouvoir revenir sur son choix de travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance permettant à l’employeur de réorganiser le travail (un mois par exemple) ». Le rapporteur thématique estime que ces dispositions doivent s’appliquer quelle que soit l’origine de la dérogation (dérogation individuelle accordée par le préfet ou dérogations géographiques applicables aux zones touristiques internationales, aux zones touristiques et aux zones commerciales), et quel que soit le mode d’aménagement du régime dérogatoire, par accord collectif ou par voie unilatérale (pour la seule dérogation individuelle accordée par le préfet).
On peut estimer que la garantie de la réversibilité du choix du salarié est couverte par la disposition qui prévoit que l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur « prend en compte l’évolution de la situation personnelle » du salarié. Mais il faudrait dans ce cas que soit explicité clairement quel intérêt il y a alors à prévoir une telle prise en compte dans le cadre de la décision unilatérale de l’employeur, alors que par ailleurs, dans ce cas, l’employeur est tenu d’appliquer la procédure d’information annuelle du salarié sur sa possibilité de refuser de travailler le dimanche.
Ces deux séries de dispositions semblent recouvrir des choses différentes : il s’agit d’une part, de fixer dans le cadre d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, les modalités selon lesquelles un salarié qui souhaiterait voir évoluer ses conditions de travail dominicales doit en formuler la demande auprès de l’employeur, alors que dans le second cas, il s’agit bien d’une procédure qui prévoit une garantie de la réversibilité du choix de chaque salarié pris individuellement.
*
* *
Outre un amendement rédactionnel, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à garantir la réversibilité du choix du salarié, qui peut en effet être volontaire pour travailler le dimanche pendant un certain laps de temps, mais peut aussi, notamment en fonction de ses contraintes personnelles ou familiales, changer d’avis à ce sujet. L’amendement adopté par la commission spéciale précise que l’accord collectif détermine les modalités de prise en compte d’un éventuel changement d’avis du salarié qui travaille le dimanche, en particulier en aménageant les délais de notification de son refus à l’employeur.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE109 de M. Gérard Cherpion et SPE439 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à étendre, dans l’hypothèse d’un maintien de la législation actuelle, la condition préalable du volontariat des salariés à toute ouverture d’un commerce le dimanche dans les zones touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation permanente.
M. le ministre. Le dispositif mis en place par la loi fait du volontariat la règle, à l’exception des cas où le travail dominical est payé double. Ce volontariat est formalisé par le code du travail, soumis à la signature du salarié et réitéré chaque année. Par ailleurs, l’amendement SPE1878 des rapporteurs, qui complète le dispositif, me paraît satisfaire votre amendement.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. J’indique que l’amendement SPE1878 a pour objet de garantir expressément la réversibilité du choix du salarié, y compris lorsque existe un accord collectif.
Les amendements SPE109 et SPE439 sont retirés.
La Commission examine, en présentation commune, les amendements SPE854 et SPE856 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement SPE854 vise à maintenir le troisième alinéa de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, qui stipule que « l’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ». Cette précision nous paraît essentielle, à la fois pour que les employeurs mesurent l’impact du travail dominical sur la vie des salariés concernés et pour que des ajustements puissent, le cas échéant, être apportés.
Nous considérons par ailleurs que les salariés n’ont pas toujours le choix du volontariat et que celui-ci est trop souvent une condition d’embauche et une condition à la pérennité de l’emploi, en particulier en période de fort chômage, lorsque l’asymétrie de la relation entre l’employeur et l’employé s’aggrave au détriment du salarié. Pour que le volontariat ne constitue pas une condition d’embauche, comme le texte tend d’ailleurs à l’interdire à l’alinéa 5 de l’article 81 sur le travail nocturne, il est absolument nécessaire qu’il fasse l’objet d’un accord écrit, distinct du contrat de travail et signé à la fin de la période d’essai du salarié, afin d’éviter toute discrimination à l’embauche en amont. C’est l’objet de l’amendement SPE856.
M. le ministre. L’amendement SPE854 est satisfait. En effet, les termes de l’alinéa auquel vous faites référence ont été repris à l’identique à l’article 76.
En ce qui concerne le volontariat, il devient la règle générale. De surcroît, en inscrivant dans la loi la réversibilité du choix du salarié, l’amendement SPE1878 le déconnecte des critères d’embauche, ce qui satisfait votre amendement.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Je partage l’avis du ministre.
L’amendement SPE854 est retiré.
La Commission rejette l’amendement SPE856.
Puis, suivant l’avis favorable du ministre, elle adopte successivement deux amendements des rapporteurs : l’amendement rédactionnel SPE1877 et l’amendement SPE1878 qui vise à garantir expressément la réversibilité du choix du salarié de travailler le dimanche, y compris en présence d’un accord collectif.
Elle en vient ensuite à l’amendement SPE853 rectifié de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Le code du travail prévoit que les employeurs sont tenus chaque année de demander à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi respectant le repos dominical. L’employeur doit également, à cette occasion, informer le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Cette disposition essentielle permet au salarié de renouveler son volontariat annuellement. Nous proposons qu’elle soit applicable, qu’il existe ou non un accord collectif dans l’entreprise.
M. le ministre. Avis défavorable.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Cet amendement est pleinement satisfait par l’amendement SPE1878. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement SPE853 rectifié.
Puis elle adopte l’article 77 modifié.
*
* *
Article 78
(art. L. 3132-25-5 du code du travail)
Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares
Les règles relatives au repos hebdomadaire dans les commerces alimentaires figurent à l’article L. 3132-13 du code du travail. Aux termes de cet article, les commerces de détail alimentaire peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures, les salariés bénéficiant à ce titre d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Rappelons toutefois que les commerces alimentaires fabriquant des produits destinés à la consommation immédiate – ce qui est le cas des boulangeries et des pâtisseries sont autorisées à ouvrir le dimanche toute la journée, en vertu de la dérogation permanente et de droit dont ils bénéficient en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail (ouverture rendue nécessaire par les contraintes de production, d’activité ou les besoins du public).
L’article L. 3132-25-5 précise aujourd’hui que les commerces alimentaires qui bénéficient de l’autorisation d’ouverture jusqu’à 13 heures – ce qui est le cas des boucheries, charcuteries, poissonneries, fromageries, primeurs, épiceries, supérettes, grandes surfaces alimentaires, etc. – ne peuvent bénéficier ni du régime dérogatoire applicable aux communes d’intérêt touristique ou thermales et aux zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, ni du régime dérogatoire des périmètres d’usage de consommation exceptionnels (PUCE), pour les commerces qui sont situés dans de tels périmètres : autrement dit, les commerces situés dans ces zones géographiques spécifiques ne peuvent s’en prévaloir pour ouvrir le dimanche toute la journée ; leur régime reste le régime de droit commun applicable aux commerces alimentaires.
Le présent article propose de modifier le régime d’ouverture des commerces alimentaires situés dans les seules zones touristiques internationales ou dans l’emprise des gares.
En effet, il laisse inchangée la rédaction du premier alinéa de l’article L. 3132-25-5, qui, à numérotation inchangée, renvoie désormais aux zones touristiques et aux zones commerciales : dans ces zones, les commerces alimentaires ne pourront donc pas ouvrir leurs portes le dimanche au-delà de 13 heures, comme c’est le cas aujourd’hui.
Il prévoit en revanche, aux deuxième et troisième alinéas, que les commerces alimentaires situés dans les zones touristiques internationales (article L. 3132-24) ou dans l’emprise des gares (dont la définition est fixée à l’article L. 3132-25-6 modifié par l’article 79 du projet de loi, commenté infra.) sont soumis au régime de droit commun applicable aux commerces alimentaires pour la période du dimanche jusqu’à treize heures, mais qu’après 13 heures, ils pourront basculer dans le régime dérogatoire d’ouverture prévu respectivement pour les commerces situés en zone touristique internationale et pour les commerces situés dans l’emprise d’une gare, sous réserve de respecter les conditions par ailleurs posées pour bénéficier de l’autorisation d’ouverture dominicale à ce titre, à savoir :
– être couvert par un accord collectif fixant les compensations accordées aux salariés privés de repos dominical, les engagements pris en matière d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, ainsi que les conditions de la prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés (II et III de l’article L. 3132-25-3) ;
– respecter les conditions destinées à protéger la volonté des salariés qui travaillent le dimanche ou qui refusent de travailler le dimanche (article L. 3132-25-4).
Autrement dit, les commerces alimentaires situés en zone touristique internationale ou dans l’emprise d’une gare pourront désormais ouvrir leurs portes après 13 heures le dimanche, à condition de respecter les conditions évoquées précédemment.
Le rapporteur thématique s’interroge sur la pertinence de l’application d’un double régime aux commerces alimentaires situés dans ces zones qui ouvriraient le dimanche toute la journée. En effet, cela signifierait par exemple que les salariés travaillant dans une épicerie située dans une zone touristique internationale le dimanche matin ne bénéficieraient d’aucune majoration salariale pour ces heures, mais qu’ils en percevraient une dès lors qu’ils travailleraient l’après-midi ? Rien ne permet de justifier une telle différence de traitement entre les heures travaillées le dimanche matin et les heures travaillées le dimanche après-midi ! Les salariés qui travaillent dans un commerce d’habillement situé dans une telle zone bénéficieraient quant à eux de majorations salariales pour l’ensemble de leurs heures travaillées le dimanche, ce qui crée une distorsion importante entre des salariés placés dans des situations identiques. Ne serait-ce que sur le plan matériel, on voit mal comment un commerce alimentaire situé dans l’emprise d’une zone touristique internationale pourrait conclure un accord fixant des contreparties aux salariés privés de repos le dimanche après-midi, mais excluant de son champ les salariés travaillant le dimanche matin. Il semblerait donc légitime que les commerces alimentaires situés en zone touristique internationale ou dans l’emprise des gares qui souhaitent ouvrir le dimanche toute la journée basculent de ce fait dans le régime dérogatoire applicable à l’ensemble des commerces de détail de ces zones, à savoir celui d’une obligation de contreparties sociales, du respect du volontariat et de conclusion d’un accord collectif organisant le travail en roulement. Une telle unification du régime applicable aux commerces alimentaire qui feraient le choix d’ouvrir le dimanche après 13 heures dans ces zones aurait en tout cas l’avantage d’être plus protectrice pour les salariés concernés.
*
* *
Conformément aux souhaits du rapporteur thématique, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à unifier le régime applicable aux commerces alimentaires situés dans une zone touristique internationale ou dans l’emprise d’une gare, en prévoyant que dès lors que ces commerces souhaitent ouvrir au-delà de treize heures, le régime applicable pour toute la journée du dimanche est celle qui est la plus favorable aux salariés, autrement dit, le régime applicable en zone dérogatoire. Il s’agit en effet de ne pas maintenir un double régime applicable d’une part aux salariés travaillant avant treize heures, sans contreparties salariales obligatoires, et d’autre part, aux salariés travaillant après treize heures, avec de telles contreparties. Cette dichotomie serait en effet préjudiciable aux salariés.
*
* *
La Commission examine les amendements de suppression identiques SPE110 de M. Gérard Cherpion, SPE440 de M. Patrick Hetzel et SPE858 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Véronique Louwagie. Aux termes de l’article 78, les commerces de détail alimentaire situés dans les ZTI ou les gares restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant avant 13h00, à la règle actuellement en vigueur, c’est-à-dire que leurs salariés ne bénéficient d’aucune contrepartie. Après 13h00 en revanche, le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement à tout ou partie du personnel, selon les modalités prévues par l’accord collectif. Il en résulte cette situation paradoxale que des salariés employés dans le même commerce seront soumis à des régimes différents selon qu’ils travaillent le matin ou l’après-midi. Nous proposons donc la suppression de cet article, pour remédier à cette rupture d’égalité.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 78 étend au-delà de 13h00 la possibilité d’ouverture des commerces de détail alimentaire, disposition que nous contestons, eu égard aux spécificités du commerce à dominante alimentaire. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, bien que favorable à une extension généralisée du travail dominical – ce que je regrette –, s’est lui-même prononcé publiquement en faveur du maintien de la fermeture obligatoire de ces commerces à 13h00. Il considère en effet que l’extension des amplitudes horaires d’ouverture nuirait fortement à l’attractivité de ces métiers, déjà contraignants et qui connaissent des difficultés de recrutement. Afin, comme le ministre en a exprimé le souhait, de ne pas porter préjudice au petit commerce, nous proposons donc la suppression de cet article.
M. le ministre. L’article 78 sert à coordonner le dispositif que l’on met en place avec ce qui existe dans le commerce alimentaire, et sa suppression me semble aller à l’encontre des objectifs que vous poursuivez. Il permet en effet aux petits commerces alimentaires installés dans les ZTI ou les gares de conserver leur régime actuel en cas d’ouverture dominicale jusqu’à treize heures, sans être soumis aux contraintes qui s’appliquent à leur zone d’implantation en termes de compensations.
La plupart des petits commerces alimentaires qui ouvrent le dimanche matin n’appliquent guère de compensations ou appliquent, comme dans la boulangerie ou la boucherie, des compensations résultant d’accords de branche. Leur appliquer les mêmes règles qu’aux autres commerces reviendrait à tuer le commerce de proximité dans les ZTI et les gares. Cela posé, si ces commerces décident d’ouvrir après 13h00, c’est qu’ils considèrent que c’est dans leur intérêt. Ils peuvent alors le faire, avec l’accord des salariés et en appliquant les conditions de compensations en vigueur dans la ZTI ou la gare. Avis défavorable.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Je partage cet avis, tout en proposant, à l’article 79, un amendement clarifiant le dispositif s’appliquant aux gares.
M. Jean-Yves Caullet. Il est normal que les commerces alimentaires situés dans les ZTI soient soumis à un système de compensations s’ils décident d’ouvrir le dimanche après-midi. Mais, dans la mesure où les ventes de denrées alimentaires sont assez faibles à ce moment de la semaine, ce système de compensations risque de dissuader bon nombre de ces commerces d’ouvrir, ce qui, mécaniquement, va rétablir la concurrence avec les commerces situés hors zone, qui n’ont pas, eux, la possibilité d’ouvrir le dimanche après-midi.
Mme Sandrine Mazetier. Les ZTI se caractérisent par une affluence exceptionnelle et internationale, et c’est précisément pour profiter du pouvoir d’achat des touristes étrangers qu’on crée ces zones. Les baux commerciaux y atteignent des tarifs exorbitants, et il me semble que les commerces – y compris les commerces de bouche – qui peuvent les assumer ont tout à fait les moyens d’accorder à leurs employés des compensations salariales. Les ZTI sont des zones d’hyperprofitabilité, et il est normal que le principe du gagnant-gagnant s’y applique à tous.
Mme Véronique Louwagie. Je reste inquiète de la disparité des situations qui vont coexister dans ces zones, avec tous les risques de rupture d’égalité et de distorsion de concurrence que cela comporte.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Il est bien temps de s’apercevoir des distorsions de concurrence qui ont cours aujourd’hui ! C’est à les réduire, en quantité et en amplitude, que nous travaillons avec cette loi. Il me semble que c’est un progrès, même si tout n’est pas encore parfait.
Mme Véronique Louwagie. Les gestionnaires de paie ont encore de beaux jours devant eux !
La Commission rejette les amendements SPE110, SPE440 et SPE858.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1702 des rapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1879 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement propose d’unifier le régime applicable aux commerces alimentaires situés en gare ou en ZTI pour lesquels le texte prévoit qu’ils pourront ouvrir le dimanche toute la journée. En effet, je considère qu’il serait anormal que, dans un même commerce, le salarié qui travaille le dimanche matin ne bénéficie d’aucune compensation salariale, puisque cela n’est pas obligatoire pour les commerces ouverts jusqu’à 13h00, tandis que son collègue travaillant le dimanche après-midi bénéficie quant à lui d’une majoration salariale. Les heures du matin et de l’après-midi n’ont pas de raison d’être distinguées, et il est donc proposé de s’aligner sur le mieux-disant, en prévoyant que, dès qu’un commerce alimentaire, en gare ou en ZTI, souhaite ouvrir toute la journée, il est soumis au régime dérogatoire le plus favorable au salarié.
M. le ministre. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement SPE1879.
Puis elle adopte l’article 78 modifié.
*
* *
Article 79
(art. L. 3132-25-6 du code du travail)
Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare
Cet article crée une nouvelle autorisation de dérogation aux règles du repos dominical pour les commerces situés dans l’emprise d’une gare.
Le mécanisme mis en place repose sur une alternative.
Soit les commerces sont situés dans l’emprise d’une gare qui est par ailleurs incluse dans une zone touristique internationale, dans une zone touristique ou dans une zone commerciale : dans ce cas, ces commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche conformément aux règles qui s’appliquent aux commerces de détail dans chacune de ces zones (conclusion d’un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et protection du volontariat du salarié ainsi que des salariés refusant de travailler le dimanche).
Soit les commerces en question sont situés dans l’emprise d’une gare qui ne figure pas dans l’une de ces zones : dans ce cas, ces commerces peuvent être autorisés à ouvrir le dimanche par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce, après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s’il existe, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares. Pour être autorisés à ouvrir, les commerces situés dans l’emprise de ces gares devront en tout état de cause respecter les mêmes conditions que celles prévues pour les commerces situés dans les zones déjà évoquées, autrement dit être couverts par un accord collectif fixant les compensations accordées aux salariés travaillant le dimanche et respecter la procédure de recueil de la volonté du salarié et de protection du salarié qui refuse de travailler le dimanche.
Les commerces situés dans l’emprise d’une gare doivent être définis comme étant l’ensemble des commerces inclus dans l’enceinte de la gare. Il convient de noter que la notion de gare est entendue de façon générique et qu’elle ne couvre pas les seules gares ferroviaires, mais peut potentiellement aussi s’étendre aux gares autoroutières ou aux gares maritimes.
On peut s’interroger sur les modalités prévalant pour les commerces situés dans l’emprise de gares hors zone géographique spécifique bénéficiant par ailleurs d’un régime dérogatoire. En effet, le texte prévoit que les commerces de ces gares pourraient être autorisés à ouvrir le dimanche par arrêté ministériel, après avis du maire et du président de l’EPCI lorsqu’il existe. Le rapporteur thématique s’interroge sur l’opportunité de confier à l’autorité ministérielle la compétence pour autoriser l’ouverture de commerces situés dans des gares qui n’ont forcément pas de rayonnement national. En effet, quelles pourraient être les gares concernées ici ? Rappelons qu’elles doivent être marquées par une affluence exceptionnelle de passagers, alors de deux choses l’une : soit il s’agit d’une affluence touristique, et alors, la gare en question a de fortes chances de se situer dans une zone touristique, qu’elle soit ou non internationale ; soit il s’agit d’une affluence liée aux migrations pendulaires de la population, et alors, si cette affluence doit être exceptionnelle, elle concernerait avant tout les gares parisiennes qui se trouveraient hors zone touristique (la gare Saint-Lazare et la gare du Nord, par exemple), quelques gares de grandes villes françaises, telles que Lyon Part Dieu, Marseille Saint-Charles ou encore Lille Europe. On peut aussi envisager que l’affluence exceptionnelle de passagers soit saisonnière ou temporaire, effectivement touristique, ce qui pourrait dans ce cas concerner des gares situées hors des centres-villes et donc logiquement hors zones touristiques, comme la gare d’Avignon TGV ou d’Aix-en-Provence TGV par exemple.
En tout état de cause, dès lors que l’on sort du champ d’une zone à rayonnement international (qui dépasse donc les préoccupations locales, et justifie la compétence de l’autorité ministérielle), on voit mal ce qui peut justifier de déposséder les exécutifs locaux de l’initiative et du pouvoir de décision en la matière.
D’après les informations transmises au rapporteur thématique, dix gares devraient dans un premier temps relever de cette catégorie des gares caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers ; à échéance 2020, une vingtaine de gares pourraient être concernées.
On remarquera enfin que le texte s’éloigne sur ce point des préconisations du rapport « Bailly », qui recommandait de traiter la problématique spécifique aux commerces de gares conjointement avec celle des zones commerciales, les commerces des gares étant le plus souvent regroupés dans un ensemble commercial unique. Le texte s’en éloigne aussi s’agissant de la recommandation de privilégier la concertation au niveau territorial : en effet, en confiant au niveau ministériel le pouvoir de décision en matière d’autorisation d’ouverture dominicale des commerces de gares situés hors zones spécifiques, le projet de loi opère un virage centralisateur qui ne semble pas souhaitable.
*
* *
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a, outre des amendements rédactionnels, adopté deux modifications au dispositif dérogatoire d’ouverture dominicale prévu pour les commerces situés dans l’emprise d’une gare.
Elle a en premier lieu prévu, à l’initiative des rapporteurs, de supprimer le dispositif spécifique prévu pour les commerces des gares situées en zone touristique internationale (ZTI), en zone touristique (ZT) ou en zone commerciale (ZC) : en effet, dès lors que ces commerces se situent de facto dans ces zones, nul n’est besoin de préciser que le régime applicable est bien celui qui s’applique dans ces mêmes zones.
Elle a ensuite adopté un amendement de M. Gérard Cherpion et ses collègues, prévoyant que l’arrêté ministériel autorisant les commerces situés dans l’emprise d’une gare située hors d’une zone dérogatoire à ouvrir le dimanche est précédé d’une consultation des employeurs et des salariés des commerces concernés.
*
* *
La Commission examine les amendements de suppression identiques SPE111 de M. Gérard Cherpion, SPE442 de M. Patrick Hetzel et SPE1372 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Gérard Cherpion. Les dispositions de l’article 79 relatives aux gares relèvent plus du décret que de la loi, comme c’est le cas, par parallélisme des formes, pour les aéroports. Par ailleurs, l’arrêté visé à l’alinéa 3 autorisant l’ouverture des commerces situés dans l’emprise des gares qui n’appartiennent pas à une ZT, une ZC ou une ZTI ne prévoit aucune concertation avec les commerces concernés.
M. Jean-Louis Roumegas. En demandant la suppression de cet article, nous sommes cohérents avec notre refus des ZTI.
M. le ministre. M. Cherpion a raison, ces mesures pourraient être prises par décret, comme c’est le cas pour les aéroports. Mais, par décret, il n’y aurait pas de compensations. C’est donc pour que ces commerces soient soumis au dispositif de compensations que nous avons choisi la loi.
Par ailleurs, les gares, à la différence des aéroports, s’inscrivent dans le tissu urbain, et il est donc normal qu’elles soient soumises aux mêmes règles que les autres zones concernées par ces mesures. Avis défavorable.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Même avis.
M. Gérard Cherpion. À vous entendre, monsieur le ministre, il vaut donc mieux travailler dans une gare que dans un aéroport…
Mme Karine Berger. J’ai du mal à saisir la philosophie qui sous-tend l’article 79. Que l’on veuille faciliter l’ouverture des commerces le dimanche dans les zones à forte densité internationale est une chose, et cela peut en effet concerner les aéroports. Mais cela n’a pas grand-chose à voir avec les gares qui, de surcroît, sont, à la différence des aéroports, situées au cœur des villes. Pourquoi, dans ce cas-là ne pas étendre les exceptions au repos dominical aux gares de RER ou aux stations de métro ?
M. le président François Brottes. Toutes les gares ne sont pas à l’intérieur des villes. Prenez l’exemple des gares TGV, à Valence ou à Avignon.
M. Gilles Savary. Je ne comprends pas non plus pourquoi les gares et les aéroports – où, d’ailleurs des dispositifs de compensations plutôt généreux ont déjà été négociés avec les employeurs – seraient soumis à des régimes différents. Le ministre argue que les unes sont en ville et les autres à l’extérieur, mais cette distinction, on vient de le dire, n’est pas pertinente. Par ailleurs, les aéroports sont au premier chef des zones touristiques puisque ce sont des zones frontières.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Les touristes ne viennent pas en France que par avion ; ils empruntent aussi le train. D’autre part, les gares ou les aéroports sont aussi des zones de transit, dont on ne sort pas entre deux correspondances et où l’on peut avoir envie de faire des achats.
Mme Karine Berger. L’article ne vise-t-il que les gares déjà classées dans des zones touristiques ? La gare de Gap, qui se caractérise d’autant moins par une forte affluence internationale qu’elle n’accueille plus assez de trains, relèvera-t-elle désormais des dispositions qu’il instaure pour l’ouverture des commerces le dimanche ?
M. le ministre. Toutes les gares situées en zone touristique sont concernées, les gares ferroviaires comme les gares maritimes. Par ailleurs, l’article établit un critère d’affluence exceptionnelle de passagers – qui ne concerne pas, me semble-t-il, la gare de Gap – permettant d’étendre par arrêté le régime de dérogation au repos dominical à certaines gares. Le ministère et la SNCF ont identifié une dizaine de ces gares, où l’ouverture des commerces le dimanche permettrait la création, directe ou indirecte, de deux mille emplois. En ce qui concerne spécifiquement les gares maritimes, plusieurs demandes ont été adressées en ce sens au ministère ; elles émanent toutes pour l’instant de l’outremer.
J’ajoute que, comme le faisait observer M. Savary, nous pourrions, par esprit de système, inclure les aéroports, où existent déjà des accords de compensation, dans ce dispositif. Nous allons y travailler.
M. le président François Brottes. D’autant que certaines gares sont aussi des aéroports – je pense à Lyon-Saint-Exupéry.
Mme Karine Berger. Les dix gares auxquelles fait allusion le ministre ne sont-elle pas déjà classées en zone touristique ? De quelles gares s’agit-il ?
M. le ministre. La gare Saint-Lazare n’est ni en ZT ni en ZTI. D’où la nécessité d’établir un critère d’affluence. De la même manière, tous les aéroports ne sont pas non plus en zone touristique.
La Commission rejette les amendements SPE111, SPE442 et SPE1372.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1880 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement propose de simplifier la rédaction de l’article 79 en supprimant l’alinéa spécifique aux commerces situés dans l’emprise des gares incluses dans les ZTI, les ZT ou les ZC. En effet, une telle précision n’a pas lieu d’être, car un commerce de gare, dans l’une de ces zones, relève déjà du dispositif spécifique d’ouverture applicable à ces zones. Il n’y a donc lieu de conserver que le dispositif applicable aux commerces des gares situées hors d’une zone dérogatoire.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1880.
L’amendement rédactionnel SPE1703 des rapporteurs tombe.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1130 de M. Alain Tourret.
Puis elle examine les amendements identiques SPE112 de M. Gérard Cherpion et SPE441 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à promouvoir le dialogue social, en permettant la consultation des commerces situés dans l’emprise des gares concernées avant signature de l’arrêté autorisant leur ouverture.
M. le ministre. Avis favorable.
Suivant l’avis du rapporteur thématique, la Commission adopte les amendements SPE112 et SPE441 à l’unanimité.
Puis elle adopte l’article 79 modifié.
*
* *
Article 80
(art. L. 3132-26 du code du travail)
Dimanches du maire
Cet article modifie le régime applicable aux « dimanches du maire », prévu à l’article L. 3132-26 du code du travail. Il prévoit aujourd’hui que le repos dominical peut être supprimé par décision du maire pour les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, dans la limite de cinq dimanches par an. À Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
Il convient avant tout de noter que les cinq dimanches du maire s’appliquent donc aux seuls commerces de détail dans lesquels il n’y a pas de régime dérogatoire existant par ailleurs d’ouverture dominicale. Autrement dit, les dimanches du maire ne s’appliquent pas aux commerces alimentaires qui bénéficient d’une autorisation permanente et de droit d’ouverture dominicale, que ce soit jusqu’à treize heures pour la majorité de ces commerces ou toute la journée du dimanche comme pour les boulangeries et les pâtisseries.
Le I propose deux modifications majeures au régime des « dimanches du maire » :
– En premier lieu, le chiffre de cinq dimanches par an devient de droit, autrement dit, le maire doit obligatoirement désigner cinq dimanches par an pour lesquels le repos dominical peut être supprimé. La liste de ces cinq dimanches doit en outre obligatoirement être arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante.
– En second lieu, le maire peut autoriser les commerces à supprimer le repos dominical certains autres dimanches dans la limite de sept dimanches supplémentaires. La désignation de ces dimanches est également effectuée par le maire.
Autrement dit, alors qu’aujourd’hui, de nombreuses mairies ne prennent aucun arrêté municipal d’ouverture dominicale des commerces, l’ensemble des communes de France devront théoriquement désigner cinq dimanches pour lesquels les commerces seront autorisés à ouvrir. Cela ne signifie évidemment pas que les commerces de détail aient l’obligation d’ouvrir.
Au total, dans certaines communes où le maire jugera opportun d’ouvrir plus largement les commerces de détail le dimanche, ce seront jusqu’à douze dimanches d’ouverture qui pourront s’appliquer.
Il s’agit là d’une mesure qui avait été préconisée dans le cadre du rapport de M. Jean-Paul Bailly, qui constate en effet que les cinq dimanches actuels ne permettent pas de couvrir toutes les périodes de forte consommation : ils sont souvent concentrés sur les quatre dimanches du mois de décembre et le premier dimanche des soldes de janvier, alors même que selon les secteurs, d’autres périodes de forte consommation existent, à la rentrée des classes, pour les soldes saisonnières, les vacances d’été, ou encore, pour un événement local particulier, la fête des mères, la fête des pères, voire la Saint-Valentin. Le rapport préconisait ainsi de porter à douze le nombre de dimanches du maire, mais contrairement au texte du projet de loi, il proposait que sept de ces dimanches soient laissés à la main du maire, tandis que les commerces pourraient bénéficier d’un « droit de tirage » de cinq dimanches supplémentaires. Autrement dit, les commerces auraient la garantie de disposer de cinq dimanches d’ouverture à leur convenance, et pourraient même ouvrir jusqu’à douze dimanches au total dans les zones où les maires accorderaient l’intégralité des autorisations dont ils disposent.
Le texte du projet de loi inverse cette logique, en prévoyant que les cinq dimanches « de droit » soient fixés par le maire, celui-ci disposant de toute latitude pour fixer jusqu’à sept dimanches supplémentaires par an d’autorisation d’ouverture. Il est en effet plus pertinent que le choix des dimanches ouverts ne soit pas fixé directement par les commerces, qui risqueraient de privilégier une logique commerciale personnelle au détriment des consommateurs.
On rappellera que le dispositif dit des « dimanches du maire » correspond au régime présentant le plus de garanties de compensations pour les salariés : en effet, aux termes de l’article L. 3132-27, que le présent projet de loi laisse inchangé, le salarié privé de repos dominical à ce titre bénéficie d’un doublement de sa rémunération et d’un repos compensateur équivalent en temps.
Le II procède à un ajustement rédactionnel : dans la mesure où il pourrait désormais y avoir deux décisions municipales – l’une, obligatoire, fixant les cinq dimanches d’ouverture, la seconde, facultative, pouvant fixer jusqu’à sept dimanches d’ouverture supplémentaires –, il est nécessaire de passer du singulier au pluriel pour la mention de la décision prise.
Le rapporteur thématique estime que la fixation de cinq dimanches « de droit » – qui seraient obligatoirement fixés par la maire – revient à exercer une contrainte forte sur les élus locaux, pour des besoins qui sont très contrastés sur l’ensemble du territoire national, et qui, hors des grandes villes, sont très limités, voire inexistants dans un très grand nombre de petites et moyennes communes. Faut-il dès lors véritablement imposer à l’ensemble des communes de France sur le territoire duquel se situent des commerces de détail non alimentaire de fixer cinq dimanches par an d’ouverture potentielle de ces commerces, alors même que les habitants de ces communes ne sont absolument pas demandeurs d’une telle ouverture ? On rétorquera que les commerces en question restent libres d’ouvrir ou de rester fermés. Néanmoins, il semble que la réponse donnée par le texte est davantage une réponse générale à une question qui reste somme toute restreinte aux grandes villes. Pourquoi imposer aux maires des petites et moyennes communes, beaucoup plus nombreuses sur notre territoire, de fixer cinq dimanches d’ouverture des commerces, alors même que cette problématique ne concerne qu’un très petit nombre de grandes villes ?
Le rapporteur thématique estime nécessaire de revenir à une liberté d’appréciation par les élus locaux des besoins qui sont ceux de leur commune.
La question de l’ouverture dominicale des commerces pouvant avoir un impact plus large que celui de la seule commune, il semblerait plus pertinent que la fixation des dimanches du maire intervienne après une phase de concertation avec les structures intercommunales éventuellement existantes.
Enfin, s’agissant du nombre de ces dimanches, si le texte prévoit de passer potentiellement à douze dimanches, le rapporteur thématique estime que peu de communes sont en réalité concernées par des besoins à une telle hauteur. Un retour à une liberté totale de fixation pour le maire permettra précisément d’ajuster le nombre de dimanches aux besoins spécifiques des consommateurs des grandes villes comme des petits bourgs.
*
* *
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs proposant une rédaction globale de l’article 80 relatif aux « dimanches du maire ». Cet amendement propose de maintenir à douze le nombre maximum des dimanches « ouvrables », comme le prévoit le projet de loi, tout en laissant aux maires une entière latitude du choix du nombre de ces dimanches d’ouverture, entre zéro et douze dimanches.
Cet amendement prévoit également la consultation du conseil municipal avant la décision prise par le maire, et, dès lors que le nombre de dimanches d’ouverture envisagé excède sept, la consultation obligatoire de l’EPCI.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE113 de M. Gérard Cherpion, SPE444 de M. Patrick Hetzel, SPE860 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1356 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Gérard Cherpion. Nous proposons de supprimer cet article qui vise à rendre obligatoire l’ouverture des commerces cinq dimanches par an et à laisser un maximum de sept dimanches supplémentaires à la discrétion du maire. En effet, notre discussion montre que cette mesure conduirait à des baisses de chiffres d’affaires pour les commerces de proximité. Selon les estimations, l’extension des dérogations pourrait supprimer à terme jusqu’à 200 000 emplois. On est loin de la croissance et de l’activité !
M. Patrick Hetzel. Aucune étude d’impact ne permet d’estimer le nombre d’emplois que cette disposition permettrait de créer ; en revanche, nous savons qu’elle mènera à la suppression d’emplois dans les commerces de proximité.
Mme Jaqueline Fraysse. Cet article, d’une part, rend obligatoires les cinq dérogations au repos dominical délivrées par les maires, et d’autre part, porte le nombre de dérogations possibles de cinq à douze. Nous ne voyons pas l’intérêt de ces dispositions. J’ai cru comprendre que le ministre était disposé à revenir sur l’obligation d’accorder cinq dimanches travaillés ; il faut en effet faire confiance aux élus locaux pour autoriser ces ouvertures seulement s’ils les jugent utiles.
Rien ne justifie non plus la possibilité de multiplier les dérogations jusqu’à douze par an. L’étude d’impact met en exergue la nécessité de permettre aux commerces d’ouvrir le dimanche en période de soldes et en fin d’année – ce qui coïncide avec les cinq dimanches déjà autorisés –, et au plus fort des saisons touristiques – besoin couvert dans votre projet par les dispositions concernant les ZT et les ZTI.
Par ailleurs, ni l’étude d’impact ni l’expérience ne prouvent que cette mesure contribuerait à l’objectif affiché du texte : stimuler la croissance et la création d’emplois. Auditionné par la mission d’information et d’évaluation de la ville de Paris en septembre dernier, le directeur adjoint au département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a estimé qu’elle ne produirait pas d’effets significatifs sur l’emploi, mais risquerait de rompre l’équilibre entre le petit commerce et la grande distribution. Plus généralement, selon l’OFCE, l’ouverture dominicale conduira à des transferts de dépenses entre les secteurs économiques et non à une augmentation de la consommation, les budgets des consommateurs n’étant pas extensibles.
Au-delà de leur nombre, le type d’emplois éventuellement créés pose également problème. Ainsi, le dispositif est censé profiter aux étudiants ; mais s’ils travaillent moins de soixante heures par mois, ceux-ci ne seront pas couverts par le régime général de la sécurité sociale. De plus, la mutuelle étudiante ne couvre les accidents du travail que s’ils sont en relation avec leurs études. Ces deux aspects devraient être approfondis.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet article procède à une véritable banalisation du travail du dimanche. Non seulement introduit-il la possibilité, pour les maires, d’autoriser jusqu’à douze dimanches travaillés par an, mais en plus il transforme la possibilité actuelle d’en permettre cinq en une obligation, alors que, souvent, seuls trois dimanches – qui précèdent les fêtes de fin d’année – sont de fait utilisés.
La mesure apparaît purement idéologique car les justifications avancées pour les ZT et les ZTI – la possibilité d’augmenter le chiffre d’affaires grâce à un surcroît d’activité – ne peuvent pas être invoquées. Pour les dimanches du maire, il ne pourra s’agir que d’un transfert, le chiffre d’affaires se retrouvant étalé sur sept jours au lieu de six. En revanche, ce jour supplémentaire d’ouverture générera des charges additionnelles, et c’est le petit commerce qui en souffrira le plus. Les élus locaux savent bien que le travail dominical profite au commerce indépendant qui survit souvent grâce à des horaires décalés par rapport aux grandes enseignes ; l’extension de la dérogation à douze dimanches lui portera atteinte. On ne peut que regretter que les effets de cette mesure aient été mal évalués dans l’étude d’impact.
Le ministre s’apprête à revenir sur le caractère obligatoire des cinq dimanches travaillés ; mais la possibilité d’en autoriser douze est tout aussi problématique. En effet, elle produira un effet d’entraînement : la décision d’un maire de permettre l’ouverture des commerces douze dimanches mettra les communes voisines sous pression, créant les conditions du développement du travail dominical. Nous avons au contraire besoin d’une règle qui n’exacerbe pas la concurrence entre communes et entre grandes enseignes et petits commerces.
M. le président François Brottes. Le petit commerce n’est pas toujours indépendant !
Monsieur le rapporteur général, avant de demander son avis au ministre, je vous invite à présenter votre amendement SPE1881 qui change en profondeur les dispositions de l’article.
M. le rapporteur général. Ce texte – nous l’avons tous admis au fil de nos débats – est inspiré par la volonté de conférer aux acteurs économiques et territoriaux une plus grande capacité d’initiative et d’action, élargissant le champ des possibles. Fixer un quota obligatoire de dimanches travaillés constitue à cet égard une exception paradoxale, d’autant que l’examen de ce texte sera suivi par celui du projet de loi de Mme Lebranchu sur la décentralisation, qui proposera de donner plus de responsabilités aux acteurs locaux. C’est pourquoi Stéphane Travert, Jean-Yves Caullet – au nom du groupe SRC – et l’ensemble des rapporteurs ont engagé une discussion avec le Gouvernement pour faire valoir que par souci de cohérence avec l’esprit du projet de loi, il fallait laisser l’initiative élargie aux élus locaux, les mieux placés pour adapter la possibilité de l’ouverture dominicale des commerces de détail aux réalités territoriales. En effet, le groupe de travail prévenait clairement que, les besoins et les volontés locales n’étant pas partout les mêmes, les pratiques différaient selon les territoires. Nous proposons donc que les cinq jours restent à la main des maires ; au-delà, il faudrait trouver un accord à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui détient généralement la compétence économique.
Monsieur Roumegas, je trouve étrange qu’alors que nous sommes tous acquis à la cause de la décentralisation et affirmons avec véhémence que les élus locaux connaissent mieux que quiconque les réalités et les besoins du terrain, à la moindre tentative de leur donner plus de facultés, on crie au danger de la compétition entre les territoires. Il faut pourtant choisir : réduire les compétences des élus ou bien leur faire confiance. Je fais partie de ceux qui souhaitent que les libertés locales se développent ; c’est pourquoi nous avons collectivement plaidé auprès du ministre de ne pas faire de l’élargissement des possibilités du travail dominical une exception. À un moment où l’on souhaite assouplir beaucoup de règles, il serait paradoxal de créer une rigidité nouvelle en rendant obligatoires cinq dimanches travaillés sur douze. Il faut qu’ils restent tous possibles, au nom du respect des libertés locales et de l’adaptation aux besoins des territoires. Voilà l’esprit de cet amendement.
M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, à l’aune de l’amendement à venir que vient de présenter le rapporteur général, quel est votre avis sur les amendements de suppression ?
M. le ministre. Je ne reviendrai pas sur les raisons pragmatiques qui nous ont conduits à proposer le nombre de douze dimanches. Les arguments qui pointent l’incohérence du caractère obligatoire des cinq dimanches travaillés – avancés notamment par M. Cherpion – me semblent justes ; ce point est corrigé par l’amendement des rapporteurs. Le risque de comportements non coopératifs entre les communes, mis en avant par plusieurs d’entre vous – en particulier par les rapporteurs –, n’a pas été suffisamment identifié. L’idée de disposer d’une soupape au-delà du seuil actuel, soumise au contrôle de l’EPCI, me paraît répondre aux préoccupations exprimées. J’émettrai donc un avis défavorable aux amendements de suppression et favorable à l’amendement des rapporteurs.
M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur Ferrand, vous défendez la décentralisation dans le cas des douze dimanches, mais non dans celui des ZTI puisque vous acceptez d’imposer à la maire de Paris des ouvertures dominicales dont elle ne veut pas ! Deux poids, deux mesures…
Ne nous y trompons pas : la possibilité d’ouverture dominicale mettra automatiquement les communes en concurrence. Sans rien imposer formellement aux maires, on crée une situation où la pression des communes avoisinantes rend l’ouverture obligatoire. Cet effet pervers obéit à la logique de l’économie libérale où c’est l’absence même de règles qui pousse les gens à la concurrence exacerbée. La loi devrait protéger, y compris dans le cas du travail du dimanche ; cette idée est admise par tous, même par les tenants de l’économie libérale – parfois moins libéraux que le Gouvernement actuel.
M. Jean-Yves Caullet. Monsieur Roumegas, alors que les maires sont aujourd’hui totalement libres d’accorder jusqu’à cinq dimanches travaillés, ils en ont très fréquemment autorisé moins ; la mécanique censée conduire tout le monde à atteindre le maximum n’est donc pas vérifiée. D’ailleurs, les communes qui en sont à zéro, un ou deux dimanches travaillés par an nous ont fait part de leurs réticences face à l’obligation de monter jusqu’à cinq – d’où la proposition des rapporteurs que le ministre vient d’approuver. Le fait de fixer le maximum à douze dimanches, pas plus que celui de le fixer à cinq, ne conduira mécaniquement tous les élus, dans une sorte de panurgisme irresponsable, à utiliser cette possibilité.
M. Jean-Louis Bricout. La décision du maire n’empêche pas les interactions entre les commerces. Si Saint-Quentin accorde douze dimanches par an, la ville de 6 000 habitants dont je suis maire – située à trente kilomètres, mais ne faisant pas partie du même EPCI – fera face à une fuite des flux commerciaux. Étant donné ces interactions, je préférerais être partie prenante de la zone de chalandise.
M. le président François Brottes. En effet, les élus doivent organiser leur territoire en fonction de la manière dont vivent leurs administrés, et il est utile que les intercommunalités s’appuient sur de vrais bassins de vie !
M. Christophe Castaner. Il s’agit d’un amendement de transparence démocratique. Aujourd’hui, le maire prend la décision d’accorder jusqu’à cinq dimanches travaillés seul, dans l’opacité de son bureau et peut-être sous la pression – particulièrement bien organisée – des commerçants. Aux termes de l’amendement des rapporteurs, cette décision devra passer devant le conseil municipal ; au-delà de cinq dimanches, pour réduire les risques de concurrence territoriale – à condition d’avoir une organisation spatiale cohérente –, elle sera discutée au niveau de l’EPCI, cadre des migrations pendulaires qui font le quotidien de nos territoires. Le dispositif revient sur le droit acquis du maire de disposer librement des cinq dimanches et met en place un processus démocratique et transparent qui l’oblige à consulter le conseil municipal et donc à informer la population.
M. Gilles Savary. J’ai évoqué ce matin les disparités entre les communes dont certaines ne souhaitent accorder aucun dimanche afin de ne pas déstabiliser leurs petits commerces ; en autorisant entre zéro et douze dimanches travaillés, on leur apporte une solution. Certes, on pourrait, dans un esprit radicalement décentralisateur, conférer aux maires la liberté d’accorder autant de dimanches qu’ils le souhaitent dans l’année ; mais il manquerait alors une limite. Avec le seuil de douze dimanches, le texte apparaît équilibré ; l’obligation de consulter le conseil municipal et l’EPCI représente une avancée de transparence remarquable, gage de démocratie et d’équilibre au-delà du niveau communal. L’objection de Jean-Louis Bricout montre toutefois qu’il faut affiner le dispositif ; en cas de risque de déstabilisation à l’intérieur d’une zone de chalandise, il peut être utile de demander l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. En tout état de cause, l’amendement des rapporteurs ménage la diversité des situations locales de façon plus satisfaisante encore que les textes antérieurs.
Mme Karine Berger. Il va de soi qu’il faut garder le principe de la décision locale et s’efforcer de tenir compte des zones de chalandise. Mais si l’association du conseil municipal constitue une amélioration indéniable, il s’agit bien de passer de cinq à douze dimanches. Or à ce niveau, on ne peut plus parler d’une exception, mais d’une habitude. Si cette proposition est adoptée, certaines communes ouvriront désormais leurs commerces tous les premiers dimanches du mois. On procède donc à une banalisation du travail du dimanche. Dès lors, pourquoi ne pas autoriser quatorze, vingt ou vingt-six dimanches par an ? Souhaite-t-on réellement préserver le caractère exceptionnel de l’ouverture dominicale des commerces en France ?
M. le président François Brottes. Il ne s’agit pas d’une règle puisque l’ouverture reste optionnelle.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je reprendrais à ma façon la question de Karine Berger. Si l’élargissement de la possibilité de travailler le dimanche répond à l’ambition de renforcer la justice et la cohérence des règles – objectif éminemment positif –, pourquoi le limiter ? Puisqu’on crée l’habitude d’un dimanche travaillé par mois, pourquoi frustrer ceux qui voudraient en profiter davantage ? En effet, même s’il ne s’agit que d’une faculté et que le maire ne peut plus en décider seul, le seuil de douze dimanches par an nous fait quitter le registre de l’exception – que nous avions préservé dans la loi de 2009 en maintenant ce nombre à cinq, malgré les tentations. Aujourd’hui, vous l’augmentez, ouvrant une porte qui n’a été qu’entrebâillée il y a cinq ans. Vous considérez donc que l’engagement dans le travail dominical ne rencontre plus de problème de principe ; à vous d’assumer politiquement ce choix qui n’a rien d’anodin !
Mme Jacqueline Fraysse. Nous débattons là d’un problème sociétal de fond : voulons-nous maintenir la règle du repos dominical qui permet aux familles de partager des activités ou bien banaliser et étendre le travail du dimanche ? En portant à douze le nombre de dimanches où le maire pourrait autoriser l’ouverture des magasins, on sort évidemment du domaine de l’exception. Il faut bien mesurer les conséquences de cette décision.
M. Philippe Vigier. Nous sommes globalement favorables à l’idée de pouvoir aller jusqu’à douze dimanches. Madame Fraysse, il ne s’agit pas de généraliser la mesure à tous les dimanches : nous restons attachés à la notion de repos dominical, mais beaucoup de salariés aimant travailler le dimanche, il faut laisser à chacun un peu de liberté. Il faut simplifier les choses au maximum dans les zones où il est possible de trouver un surcroît de croissance et d’activité. J’ai lu l’amendement du rapporteur général avec beaucoup d’intérêt car nous sommes aussi favorables à ce que les élus locaux – maires et présidents d’agglomérations ou de communautés de communes, qui connaissent mieux que quiconque les zones de chalandise de leur territoire – aient la capacité de décision en main.
Nous souhaitons que ce soit le président de l’agglomération qui décide du nombre maximum – entre zéro et douze – de dimanches travaillés par an, et le maire qui, après avis du conseil municipal, fixe leur nombre exact par arrêté. En effet, dans notre droit, la compétence de développement économique est transférée aux agglomérations et aux communautés de communes ; mais il faut également respecter le principe de subsidiarité et éviter de mettre les communes en situation de concurrence déloyale entre elles. Ainsi, on fait vivre la démocratie en renforçant la capacité des élus locaux à participer à la vie de leurs territoires. Certes, on ne règlera jamais tous les cas car les concurrences entre agglomérations contiguës ou les particularismes au sein même des agglomérations restent possibles ; mais nous proposons d’encadrer la décision du maire par la vision globale d’une agglomération.
M. Gilles Savary. D’un dispositif où l’on pouvait aller de cinq à douze dimanches travaillés, l’amendement des rapporteurs propose de passer à un dispositif où l’on peut aller de zéro à douze. Ce dernier nombre n’a pas de valeur totémique et l’on pourrait choisir treize, quatorze ou dix-huit dimanches. Mais n’oublions pas que dans beaucoup d’agglomérations, sous la pression des populations qui souhaitent s’adonner au bricolage ou au jardinage, le système est d’ores et déjà tacitement dérégulé et risque de contaminer l’ensemble du pays de façon anarchique. L’amendement nous propose un système réglementé qui offre, en guise de soupape, des ouvertures tolérées – et non légales – au-delà des cinq jours du maire. Cette proposition – qui vaut mieux que la dérégulation totale qui nous menace – apparaît très équilibrée et mérite d’être expérimentée, quitte à être corrigée dans deux ou trois ans.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je voudrais exprimer une réserve quant à cette extension à douze dimanches. L’activité commerciale n’est pas lisse sur l’année, certaines périodes concentrant un maximum d’échanges. Ainsi, douze dimanches répartis sur les soldes, les fêtes de fin d’année et quelques autres périodes de surconsommation permettent de toucher 50 % à 80 % de la consommation annuelle en France, ce qui ne peut manquer d’inquiéter sur le sort du commerce de proximité. La proposition me paraîtrait acceptable si l’activité commerciale était linéaire ; puisqu’elle ne l’est pas, l’ouverture des commerces douze dimanches par an déséquilibrerait l’ensemble du système économique lié à la distribution.
M. le rapporteur général. Revenons à la portée concrète de notre proposition. Le maire – ou l’EPCI – ne fait qu’autoriser les ouvertures ; ce sont les commerçants qui décident s’il est opportun pour leur activité et leur croissance d’ouvrir leur enseigne. Si par son arrêté, le maire donnait à ses commerçants instruction de travailler, nous serions dans une économie très administrée ! Notre amendement propose de laisser cinq dimanches à la main du maire, et au-delà de ce chiffre et jusqu’à douze, de soumettre la décision à l’avis de l’EPCI.
Monsieur Bricout, prévoir la faculté d’autoriser l’ouverture sur douze – et non plus cinq – dimanches par an ne modifiera pas les réalités d’entente ou de mésentente entre les territoires. Cela devrait au contraire inciter les élus locaux à approfondir leur collaboration pour éviter d’éventuelles rivalités.
Monsieur Roumegas, dans le cadre de notre volonté de développer nos capacités d’accueil à l’échelle nationale, il ne me paraît pas choquant d’identifier des ZTI – qui excèdent largement la seule ville de Paris – dont la gestion ne saurait relever uniquement de la compétence des élus locaux. Cette conviction n’invalide en rien mon raisonnement sur le sujet qui nous occupe ici. Vous indiquez que la faculté accordée ne sera pas simple à utiliser car augmenter la liberté locale conduirait à accentuer les pressions locales. Mais si depuis lundi dernier, nous avions cédé à toutes les pressions, nous n’aurions pas adopté les deux tiers de ce texte ; faisons donc confiance à nos élus ! Les pressions ne manqueront pas de survenir, mais donneront lieu à des discussions publiques au conseil municipal ; chacun pourra se positionner politiquement, différentes associations pourront faire valoir leurs droits, etc. Plus de démocratie muscle la démocratie ; ce n’est pas en la diminuant qu’on la renforce !
Enfin, madame Berger, dire qu’élargir la possibilité d’ouverture dominicale enlèverait à celle-ci son caractère exceptionnel, c’est oublier que cette faculté ne conduira pas ceux qui n’ouvrent jamais à ouvrir davantage. À l’inverse, ceux qui ouvrent aujourd’hui au maximum de ce qui est autorisé – cinq dimanches – pourront aller au-delà si cela correspond à leur réalité territoriale. Les dispositions que nous proposons me paraissent permettre à la fois plus d’autorisations par les maires et plus d’ouvertures par ceux qui le souhaitent, le tout encadré par un corpus de règles sociales claires, lisibles et porteuses de progrès. C’est ce tout cohérent que nous essayons de synthétiser dans notre amendement.
La Commission rejette les amendements SPE113, SPE444, SPE860 et SPE1356.
M. le ministre. Loin de relever d’un caprice, le nombre de douze est le fruit du travail de plusieurs mois de M. Jean-Paul Bailly, qui a dégagé un consensus porteur d’équilibre. Monsieur Fromantin, les prémisses sur lesquelles se fonde votre préoccupation devraient vous faire arriver à une autre conclusion. En effet, si l’essentiel de l’activité se concentre sur une petite dizaine de dimanches par an, il n’existe aujourd’hui aucune option intermédiaire entre les cinq dimanches du maire et les cinquante-deux des ZT ou des PUCE, cette dernière solution avantageant les grands formats. La possibilité de monter à douze dimanches, de façon contrôlée et régulée, permettra aux maires de tirer profit de ces journées sur lesquelles se concentre la valeur ajoutée et dont ils ne peuvent aujourd’hui pas profiter.
Une vingtaine de grandes et moyennes villes autorisent déjà cinq dimanches travaillés ; trois d’entre elles ont demandé des dérogations pour obtenir le statut de ZT. Avignon comme Bordeaux ont bénéficié de cinquante-deux dimanches ouvrés ; après plusieurs mois de pratique, ils sont revenus à un dimanche par mois – soit douze dimanches par an –, solution la plus pertinente pour capter la valeur ajoutée. Dans les PUCE également, cinquante-deux dimanches ne sont parfois pas rentables ; ainsi, les enseignes de bricolage, qui l’ont tant réclamé, ont progressivement décidé de n’ouvrir qu’un dimanche par mois. Cette convergence – qui corrobore notre intuition collective – montre que dans certaines zones, aller jusqu’à douze dimanches permet d’augmenter les bénéfices, et c’est aux élus d’en décider dans le cadre des éléments de régulation prévus. C’est pourquoi j’émettrai un avis favorable à l’amendement des rapporteurs.
La Commission en vient à l’amendement SPE1881 des rapporteurs, qui fait l’objet du sous-amendement SPE1966 de Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Je souhaite sous-amender l’amendement des rapporteurs en remplaçant, au 1° b), le mot « douze » par le mot « sept ». Avec cette modification, l’amendement permettra de faire évoluer le nombre de dimanches où l’on peut ouvrir les commerces afin de profiter des périodes d’activité commerciale plus importante, conservera la possibilité pour le maire de décider des cinq dimanches et pour l’EPCI de donner son avis sur les ouvertures au-delà de ce nombre. En même temps, il préservera le caractère exceptionnel de l’ouverture dominicale des commerces, alors qu’avec douze dimanches, monsieur le ministre – vous l’avez vous-même souligné –, on passe dans le registre de l’habitude.
M. Jean-Frédéric Poisson. Opposé aux dispositions de cet article dont il avait demandé la suppression, mais soucieux d’une meilleure appropriation par les assemblées locales de ce type de décisions, le groupe UMP s’abstiendra lors du vote sur l’amendement des rapporteurs. Nous voterons contre le sous-amendement proposé.
M. Jean-Yves Caullet. N’atteindront le plafond de douze dimanches qu’un nombre réduit de collectivités dans lesquelles la collégialité des élus de l’EPCI comme les commerçants eux-mêmes le considéreront utile. Les conditions requises pour une telle décision n’étant pas souvent réunis, je suis persuadé que ces cas resteront exceptionnels. Mais abaisser le niveau maximal du curseur risque de recréer le vide entre les cinquante-deux dimanches systématiques et les sept, huit ou neuf – qui ne seraient pas douze – optionnels, empêchant la réforme d’apporter la solution aux quelques rares cas où elle serait utile. J’approuve la nécessité de solliciter l’avis de l’EPCI pour dépasser le seuil de cinq dimanches ; on peut soumettre le passage d’un autre seuil à un autre avis – idée à étudier d’ici au débat en séance. Mais abaisser le plafond qui ne sera que très rarement atteint au motif que l’ouverture ne serait plus exceptionnelle constitue une erreur. Je comprends la préoccupation de Karine Berger, mais sa manière de la traduire dans son sous-amendement est trop brutale.
Mme Karine Berger. Alors même que nous nous étions fait la promesse de ne privilégier aucune solution a priori, nous sommes en train de rendre fétiche ce chiffre de douze comme s’il n’admettait aucune discussion. L’économie comme la politique excluent le fétichisme et il faut pouvoir débattre de tous les aspects de la loi. Quel est l’avis du rapporteur général et du ministre sur mon sous-amendement ? Le chiffre sept que j’ai proposé peut évoluer pour devenir six ou huit.
M. Jean-Louis Bricout. La zone de chalandise dépend de l’offre proposée. Pour un petit commerce situé dans un village, elle ne recouvre que ce dernier ; une petite ville comme la mienne propose un premier niveau de services – incomplet, avec souvent des commerces franchisés ; dans une grande ville, l’offre est bien plus importante. Si l’on ouvre les commerces douze dimanches par an dans le niveau le plus élevé de la zone de chalandise, celui-ci siphonne mécaniquement toutes les villes et villages qui ont un niveau de services inférieur.
M. le président François Brottes. Il faudrait associer les schémas de cohérence territoriale (SCoT) à la réflexion.
M. le rapporteur général. Il ne s’agit pas de fétichisme, mais de rationalité. Le ministre a cité le rapport Bailly et expliqué qu’il fallait prévoir des options intermédiaires entre cinq et cinquante-deux dimanches. Le chiffre de douze apparaît logique et ne renvoie de surcroît qu’à une faculté donnée aux maires. Depuis le début de l’examen des dispositions concernant le travail du dimanche, nous avons efficacement discuté de tous les aspects relatifs à cette question : les compensations, la réversibilité du choix, la clarification des règles. Mais ne confondons pas discussion et maquignonnage ! N’ayant rien entendu qui invalide notre proposition, je ne souhaite pas la sous-amender. Nous avons proposé de passer de l’obligation d’autoriser l’ouverture des commerces cinq dimanches par an à une simple faculté ; augmenté les libertés locales dans le mode de décision ; transformé les règles régissant le travail du dimanche pour instituer le progrès social là où il n’y avait que stagnation ou régression. Cet ensemble cohérent est construit autour de l’hypothèse de douze dimanches – dont le ministre a plusieurs fois expliqué la pertinence –, sur laquelle je ne reviendrai pas. Ne transformons pas notre débat en un jeu de chiffres ; ayant collectivement obtenu satisfaction sur des modifications importantes du projet de loi initial, nous devrions nous en tenir à cette proposition qu’il sera toujours possible de faire évoluer en fonction des remontées du terrain et des retombées économiques et sociales qui en constituent tout l’enjeu. Je ne suis donc pas enclin à retenir votre sous-amendement.
M. le ministre. On parle bien du travail dominical, payé double, et d’une possibilité d’aller jusqu’à douze dimanches, avec des éléments de régulation apportés par les rapporteurs. Comme je viens de le rappeler, ce chiffre se fonde sur l’expérience, le rapport commandé par le Gouvernement appuyant cette décision. Depuis une semaine, nous menons ensemble un travail collectif fécond qui montre l’ouverture du Gouvernement, sa volonté d’avancer et d’accepter les arguments rationnels. Votre sous-amendement, madame Berger, est orthogonal à cette démarche. C’est le chiffre que vous proposez qui représente un fétiche : pourquoi sept plutôt que six ou huit ? Ce chiffre n’a pas de fondement rationnel et votre démarche n’incite pas à la discussion. J’émettrai donc un avis défavorable à votre sous-amendement.
Mme Karine Berger. Votre réponse m’étonne. En quoi un sous-amendement parlementaire peut-il être orthogonal à la démarche de débat d’une commission spéciale ? Ayant participé à la discussion sur plusieurs articles – et, je l’espère, à l’évolution du texte –, je ne comprends pas votre commentaire.
Je maintiens que nous n’avons pas été au bout du débat sur la raison pour laquelle les commerces de notre pays pourraient désormais ouvrir douze dimanches par an. J’ai présenté ce sous-amendement parce que l’évolution proposée par les rapporteurs sur la partie décisionnelle de l’article m’apparaissait très positive par rapport à la version du Gouvernement. J’espère que leur amendement sera adopté par la Commission afin que nous puissions en discuter dans l’hémicycle. Pour ne pas être accusée de discréditer les débats de notre Commission longs d’une semaine entière, je retire mon sous-amendement qui pourra faire l’objet d’une discussion directe en séance, où nous n’aurons plus, grâce à la proposition des rapporteurs, à préciser quelles parties du texte nous contestons ou approuvons.
Le sous-amendement SPE1966 est retiré.
La Commission adopte l’amendement SPE1881 des rapporteurs. En conséquence, l’article 80 est ainsi rédigé.
Les amendements SPE300, SPE301, SPE694, SPE796, SPE1035, SPE1428, SPE1704, SPE1067, SPE1705, SPE1706, SPE1071, SPE114, SPE443, SPE1083, SPE1121, SPE728, SPE1707, SPE1365, SPE1036 et SPE1708 n’ont plus d’objet.
*
* *
Article 80 bis [nouveau]
(art. L. 3132-17-1 [nouveau] du code du travail)
Application du volontariat aux salariés privés de repos dominical
au titre des « dimanches du maire »
Cet article, adopté par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs, propose de rendre applicable au travail dominical effectué en application des « dimanches du maire » la procédure de volontariat du salarié prévue pour l’ensemble des zones géographiques dérogatoires.
En effet, dès lors que le nombre des dimanches du maire peut potentiellement s’établir à douze, il est tout à fait justifié d’instaurer une telle procédure préalable de recueil du volontariat du salarié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1882 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise à renforcer l’harmonisation des régimes dérogatoires au repos dominical initiée par le projet de loi, en prévoyant que la procédure applicable dans les ZTI, les ZT et les ZC en matière de protection du volontariat du salarié s’applique également aux dimanches du maire. Ce dispositif apparaît d’autant plus pertinent que le nombre de ces derniers augmentera et que leur calendrier sera beaucoup plus prévisible, le maire devant le fixer dans son arrêté avant le 31 décembre de l’année précédente.
M. le ministre. Vous proposez un véritable changement puisque, aujourd’hui, la notion de volontariat n’existe pas pour les dimanches du maire. Les services des ministères du travail et de l’économie sont réservés sur cette mesure qui peut se révéler complexe dans la mesure où ces dimanches n’ont pas de caractère régulier – ce qui justifiait le double salaire de droit. Mais cette précaution ne suffit pas à me faire pencher pour un avis défavorable. Compte tenu du mouvement que nous avons engagé, le souci de cohérence du rapporteur général et son ambition en cette matière justifient une sagesse bienveillante du Gouvernement. Il s’agit, en effet, d’une véritable avancée.
M. le président François Brottes. Le Gouvernement accepte à nouveau de modifier significativement sa position de départ !
La Commission adopte l’amendement SPE1882.
*
* *
Article 81
(art. L. 3122-29-1 du code du travail)
Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale
Cet article s’attache à assouplir les règles du travail de nuit dans certains commerces de détail, sans remettre en cause le régime dérogatoire et protecteur applicable en la matière.
Parce qu’il ne s’agit nullement de revenir sur le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit, pas plus qu’il n’est question de généraliser l’ouverture nocturne des commerces de détail, le texte ne modifie ni la définition du travail de nuit et son amplitude horaire, prévues à l’article L. 3122-29, ni les conditions de recours au travail de nuit prévues à l’article L. 3122-32.
Il est ici proposé d’insérer un nouvel article L. 3122-29-1 dans la sous-section qui définit le travail de nuit, pour donner une nouvelle définition du travail nocturne applicable aux seuls établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, par ailleurs créées par l’article 72 du présent projet de loi.
Le I du nouvel article L. 3122-29-1 précise ainsi que le début de la période de nuit peut, pour ces commerces, être reporté jusqu’à minuit, au lieu de 21 heures.
Le II du nouvel article L. 3122-29-1 prévoit ensuite que pour employer des salariés entre 21 heures et minuit, les commerces de détail situés en zone touristique internationale doivent être couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Le texte ne précise pas de quel niveau d’accord il s’agit : rigoureusement, il peut donc s’agir autant d’un accord d’établissement, que d’un accord d’entreprise ou même d’un accord de branche dont les dispositions ne seraient applicables qu’aux commerces de détail de la branche situés dans ces zones.
Il s’agit donc d’une dérogation de droit non soumise à autorisation préalable : autrement dit, comme pour le travail dominical dans les commerces au titre des dérogations géographiques, l’autorisation d’ouverture d’un établissement n’est soumise qu’à la présentation de l’accord collectif à l’administration.
L’obligation de couverture par un accord collectif est aujourd’hui une condition de droit commun pour pouvoir recourir au travail de nuit : en effet, l’article L. 3122-33 prévoit déjà que le recours au travail nocturne ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnés à la conclusion d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Ce dernier doit en particulier comporter les justifications du recours au travail de nuit, dans la mesure où, rappelons-le, l’article L. 3122-32 prévoit que celui-ci « est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ». Cette justification ne sera pas exigée dans le cadre du recours au travail en soirée.
Ce même II prévoit également que pour chacune des heures travaillées entre 21 heures et le début de la période de nuit – au plus tard à minuit -, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
À l’heure actuelle, l’article L. 3122-39 prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. S’agissant de la nouvelle autorisation de recourir au travail en soirée pour les commerces situés en zone touristique internationale, les exigences sont donc plus fortes puisque le texte prévoit une obligation de doublement de la rémunération et un repos compensateur équivalent en temps.
En revanche, l’ensemble des dispositions des articles L. 3122-31 à L. 3122-45 relatives au travail de nuit ne seront pas applicables au travail en soirée, le principe étant précisément la mise en place d’un régime dérogatoire.
Ces articles prévoient, outre les conditions pour être reconnu comme un travailleur de nuit (quota horaire), la limitation des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, et toute une série de garanties spécifiques apportées aux travailleurs de nuit : en particulier, le travailleur de nuit bénéficie d’une protection contre le refus de passer à un poste impliquant de travailler la nuit en cas d’incompatibilité « avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante ». Ce refus ne peut en effet être regardé comme une faute ou un motif de licenciement (article L. 3122-37). En outre, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les travailleurs de nuit bénéficient également d’une surveillance médicale particulière avant leur affectation à un poste de nuit et ensuite régulièrement au moins deux fois par an (article L. 3122-42). Enfin, ils bénéficient d’une garantie en matière de retour à un travail de jour : ils sont en effet prioritaires pour occuper un emploi de jour ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. Ils peuvent demander leur affectation sur un poste de jour en cas d’obligations familiales impérieuses, et sont obligatoirement transférés sur un poste de jour, à titre temporaire ou définitif si leur état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige (articles L. 3122-43 à L. 3122-45). Enfin, on rappellera que l’accord collectif organisant le recours au travail nocturne doit comporter des contreparties au bénéfice des travailleurs de nuit, à travers des mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail, à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et enfin, à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Le rapporteur thématique regrette qu’aucune de ces dispositions protectrices des travailleurs de nuit ne puisse bénéficier aux travailleurs de soirée. Certes, dans de nombreux commerces situés en zone touristique internationale, le début de la période de nuit a vocation à être reporté à 22 heures ou 23 heures et non à minuit. On peut aussi entendre que les protections particulières dont bénéficient les travailleurs de nuit concernant avant tout les salariés qui travaillent de manière régulière toute la nuit ou une grande partie de la nuit. Néanmoins, on aurait tort de croire que le travail régulier en soirée – fût-ce jusqu’à 22 heures – n’a pas d’impact sur la santé des salariés, sur la manière dont ils organisent leur vie personnelle. Il semblerait donc légitime de prévoir que les travailleurs de soirée puissent bénéficier au moins en partie des garanties applicables aux travailleurs de nuit.
Le second alinéa du II du nouvel article L. 3122-29-1 prévoit également que l’accord collectif conclu pour l’organisation du travail de nuit comporte notamment les mesures permettant la mise à disposition du salarié d’un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu d’habitation.
Ces dispositions appellent deux remarques.
En premier lieu, la sécurité reste une notion éminemment subjective. Il convient donc de mettre en garde contre le risque de contentieux et partant, d’interprétation jurisprudentielle, qui est créé par l’utilisation de ce terme. On peut en effet considérer que tout moyen de transport collectif garantit les conditions de sécurité minimales et alors, tout moyen de transport – individuel comme collectif – doit être regardé comme sûr. On peut aussi estimer que si un moyen de transport collectif est sûr, le trajet que devra effectuer le salarié entre sa destination par voie de transport et son lieu de résidence ne l’est pas forcément. On peut aussi considérer que tout moyen de transport collectif, emprunté la nuit, ne présente pas les garanties de sécurité qui sont celles de la période diurne. Le rapporteur thématique estime en conséquence qu’il serait pertinent de supprimer la référence à la sécurité, qui prête trop à interprétation, de même que la précision relative au mode de transport prévu pour le rapatriement des travailleurs en soirée. Il semblerait assez légitime que les commerces situés en zone touristique internationale qui souhaitent ouvrir en soirée jusqu’à minuit organisent en conséquence le rapatriement de leurs salariés en mettant à leur disposition un mode de transport individuel ou collectif C’est d’ailleurs le cas pour des commerces qui ont par le passé pratiqué des ouvertures tardives, comme par exemple le magasin Sephora sur les Champs-Élysées. Rappelons que l’employeur peut également organiser un mode de rapatriement par taxi collectif par exemple. Le rapporteur thématique estime que le point essentiel s’agissant de ce moyen de transport consiste dans sa prise en charge obligatoire par l’employeur : cela semble aller de soi, mais cela va peut-être mieux en le mentionnant explicitement.
Deuxièmement, la notion de « lieu d’habitation » ne semble pas usuelle ; elle n’est à tout le moins pas utilisée dans le code du travail, qui utilise en revanche les notions de « domicile » ou de « lieu de résidence » ou de « résidence habituelle ». Le rapporteur thématique estime qu’il conviendrait donc plutôt de renvoyer à l’un ou l’autre de ces termes.
Enfin, le III du nouvel article L. 3122-29-1 instaure un dispositif de protection du volontariat du salarié qui est calqué sur celui applicable pour le travail dominical dans le cadre des dérogations géographiques créées par le projet de loi dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales.
S’il est normal que le travail de nuit fasse l’objet de protections particulières en raison de son impact sur la santé et la sécurité des travailleurs, la protection des salariés refusant de travailler la nuit n’est pas aussi élevée que dans le cas du travail dominical.
Le texte du projet de loi prévoit bien que dans le cadre des commerces situés en zone touristique internationale et qui souhaitent employer des salariés entre 21 heures et 24 heures, l’employeur devra recueillir le consentement écrit du salarié de travailler en soirée.
Il prévoit ensuite la double garantie du salarié contre les discriminations à l’embauche et dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail : ainsi, l’employeur ne pourra prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et minuit pour refuser de l’embaucher, de même qu’un salarié refusant de travailler pendant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Enfin, son refus ne peut être regardé comme une faute ou un motif de licenciement.
Néanmoins, contrairement au régime applicable en matière de travail dominical dans les zones géographiques spécifiques, s’agissant du travail en soirée dans les commerces des zones touristiques internationales, l’employeur ne sera pas tenu de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle de ces salariés, dans des conditions fixées par accord collectif.
S’agissant de la priorité de réoccuper un poste de jour, le travailleur de nuit bénéficie bien d’une priorité à ce titre, mais son souhait n’est pas forcément pris en compte, comme c’est le cas pour un salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche (dans le cadre d’un établissement où le travail dominical est mis en place sur décision unilatérale de l’employeur). On peut certes arguer du fait que dès lors qu’il existe un accord collectif, les salariés sont réputés représentés dans le cadre de cette négociation, et qu’une procédure individuelle de basculement sur un poste de jour ne s’impose pas forcément dans ce contexte. De la même manière que le rapporteur thématique a souligné l’importance de rendre les dispositions relatives au changement de poste applicables en matière de travail dominical en présence d’un accord collectif, il semble indispensable qu’elles le soient aussi en matière de travail de nuit, pour permettre à tout salarié qui souhaiterait ne plus travailler la nuit de formuler un tel vœu chaque année à l’occasion de l’information annuelle effectuée par l’employeur concernant la priorité dont bénéficient ces salariés pour occuper un poste de jour. Comme pour le travail dominical, le refus du salarié de travailler la nuit prendrait effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
*
* *
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a, outre une série d’amendements rédactionnels, adopté plusieurs modifications substantielles à cet article instaurant une dérogation au travail de nuit jusqu’à minuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale.
Elle a adopté un amendement de Mme Catherine Coutelle et les membres de la Délégation aux droits des femmes prévoyant que le moyen de transport que l’employeur doit mettre à disposition du salarié pour lui permettre de regagner son domicile est bien pris en charge par l’employeur.
Elle a ensuite adopté un amendement des rapporteurs supprimant la référence à la catégorie du mode de transport, qu’il soit collectif ou individuel, celui-ci ayant logiquement vocation à être l’un ou l’autre sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Elle a ensuite adopté quatre amendements destinés à renforcer les garanties prévues par l’accord collectif de mise en œuvre du travail en soirée, en prévoyant que :
– seront fixées les modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant en soirée – à l’initiative des rapporteurs ;
– seront également fixées les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfants en soirée - à l’initiative de M. Jean-Yves Caullet et des commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ;
– doivent être déterminées les modalités de prise en compte d’un éventuel changement d’avis du salarié qui travaille en soirée, à l’instar de ce qui a été proposé dans le cadre du travail dominical – à l’initiative des rapporteurs ;
– doivent être prévues les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés travaillant en soirée – à l’initiative des rapporteurs.
La commission spéciale a également adopté un amendement des rapporteurs prévoyant que les salariées enceintes peuvent, à leur demande, ne pas travailler en soirée, cette disposition étant d’effet immédiat pour elles.
Enfin, la commission a souhaité, à l’initiative des rapporteurs, rendre applicables aux travailleurs en soirée les dispositions protectrices par ailleurs applicables aux travailleurs de nuit, en matière de surveillance médicale, de protection du refus du salarié et d’aménagement des conditions de retour au travail de jour.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE861 de Mme Jacqueline Fraysse, SPE1358 de M. Jean-Louis Roumegas et SPE1474 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Jaqueline Fraysse. Je précise tout d’abord que la référence aux ZC, ZT et emprises de gare dans l’exposé des motifs relève d’une erreur. Cet article, important à plus d’un titre, vise à donner aux établissements situés dans les ZTI la possibilité de reporter jusqu’à minuit le début de la période de nuit, que le code du travail fixe actuellement à 21h00. Quel est l’intérêt de cette modification, lourde de conséquences pour les salariés ? Cet article – qui pourrait porter le nom de Sephora car il répond à la demande de cette grande enseigne – détourne le sens de la notion de travail de nuit. Le 24 septembre dernier, les magistrats de la Cour de cassation ont donné raison aux salariés du magasin situé sur les Champs-Élysées en y interdisant l’ouverture de nuit parce que l’activité de parfumerie ne répondait pas aux critères actuellement prévus dans le code du travail qui y justifient le recours. Le travail de nuit est très réglementé parce qu’il a des conséquences sociales graves, mais aussi des effets sur la pénibilité du travail et la santé des travailleurs. Il est ainsi strictement limité aux obligations de service public – l’électricité, l’eau, les trains, la santé, quelques services communaux – et à certaines activités industrielles qui ne souffrent pas l’interruption. Avec cet article, dès que le magasin Sephora des Champs-Élysées sera classé en ZTI, il pourra légalement faire travailler ses salariés de nuit – ou plutôt en soirée car c’est toute la nuance de cet article. Nous ne pouvons pas soutenir cette disposition, faite sur mesure pour permettre aux grandes enseignes de contourner les décisions de justice favorables aux salariés, et proposons de supprimer cet article qui représente une atteinte grave à notre droit du travail et aux protections des salariés.
M. Jean-Louis Roumegas. Mon amendement vise également à supprimer cet article. Il s’agit toujours des fameuses zones touristiques internationales, où s’accumuleront les aggravations des conditions de travail : dimanche imposé, nuits imposées – qui ne seront même pas comptabilisées comme des nuits, puisque vous repoussez la définition du travail de nuit de 21h00 à minuit. Ce travail quotidien ne sera donc même pas pris en compte pour calculer la pénibilité du travail.
Pourtant, les recherches sur les effets néfastes du travail de nuit se multiplient, et il ne faut pas les prendre à la légère. Une étude de l’université Harvard montre que la mortalité des femmes est augmentée de 11 % par un travail de nuit de trois fois par mois seulement ; leur risque de maladies cardio-vasculaires est accru de 23 %. Une étude de l’INSERM montre que le travail de nuit augmente de 30 % les risques de cancer du sein.
Le travail de nuit n’a pas été reconnu par hasard comme facteur de pénibilité. C’était la seule avancée sociale de cette législature, et la voilà rognée avant même qu’elle ne se mette en place !
De plus, vous négligez des problèmes sociaux : l’organisation de la vie familiale en sera terriblement compliquée ; le supplément de salaire sera avalé par des charges nouvelles, de garde d’enfants par exemple : trois heures de garde quotidienne pour des femmes qui élèvent seules des enfants, cela représente un coût considérable.
Vous imposez d’en haut des zones touristiques internationales, et vous ne prévoyez pas de compensations pour les salariés à la hauteur des inconvénients qu’ils vont subir.
Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement SPE1474 est également un amendement de suppression. Je voudrais ici rappeler des propos de M. Michel Sapin, alors ministre du travail, tenus lors de la discussion, le 5 décembre 2013, d’une proposition de loi déposée par certains de nos collègues de l’UMP : « il existe une structure sociale, un droit du travail qui prend en considération un fait : l’employeur et le salarié, pris isolément, ne sont pas dans un rapport libre et égal, un pur rapport de contrat sans lien de subordination […] Il y a clairement là une question qui relève des relations individuelles et collectives du travail, donc de la négociation sociale ». Il rappelait aussi les évidences que viennent de redire Jacqueline Fraysse et Jean-Louis Roumegas.
Les partenaires sociaux, que nous avons auditionnés avec les rapporteurs, nous ont dit leur surprise d’avoir vu apparaître cet article 81 dans ce projet de loi, sans en être prévenus d’aucune manière. Je redonne la parole à M. Sapin : « plus on fragilise ainsi les corps intermédiaires et les forces sociales légitimes, plus on fait le lit d’une forme de spontanéisme désordonné, informe, incapable de donner une voix au monde social, de construire des compromis avec ceux qui ne sont pas d’accord ».
La proposition de loi débattue alors ne correspondait pas en tous points à l’article 81 de ce projet de loi : ce dernier, limité aux ZTI, prévoit des contreparties, avec un plancher. Dans les ZTI, les profits sont très importants et les employeurs ont parfaitement la possibilité d’offrir aux salariés des compensations – salaire augmenté, repos compensateur, attentions particulière portée à la santé des salariés concernés… Je serai donc très vigilante sur ces contreparties, et sur le fait que celles qui figurent d’ores et déjà dans la loi soient bien des planchers. Elles doivent concerner le travail du dimanche, le travail en soirée comme le travail au-delà de minuit – certains commerces demanderont à ouvrir au-delà de minuit.
M. le ministre. Avis défavorable. Nous restons ici, en effet, dans le cadre bien précis des ZTI. J’entends l’argument de Mme Mazetier, qui fait ici preuve de cohérence sur le doublement des compensations. Vous souhaitez également que les critères de définition des ZTI soient précisées : ce sera fait d’ici à la séance publique, je m’y suis engagé.
Le travail de nuit commence à 21h00 ou 22h00 selon les zones, et même plus tard pour certaines professions – dans le secteur du spectacle, le travail de nuit commence à minuit. Il est normal, madame Fraysse, que dans l’industrie, par exemple, la nuit continue de commencer à 21h00. Nous nous limitons bien ici au commerce de détail dans les ZTI.
Cette exception est faite pour des raisons d’activité ; nous définissons donc des compensations : volontariat, réversibilité, paie doublée, accord obligatoire, réversibilité spécifique pour les femmes enceintes et prise en charge par l’employeur du retour au domicile.
Un débat très intéressant s’est tenu au sein de la Délégation aux droits des femmes. C’est un sujet auquel je suis sensible : le rapporteur présentera tout à l’heure des amendements sur la situation spécifique des femmes – le silence de la loi aurait pu, malgré nos bonnes intentions, faire naître des ambiguïtés.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
La Commission rejette les amendements identiques SPE861, SPE1358 et SPE1474.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels SPE1710 et SPE1709 des rapporteurs.
Elle se saisit alors de l’amendement SPE1476 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. En 2001, l’heure du début du travail de nuit a été fixée, pour le secteur du commerce, à 21h00 au lieu de 22h00. Depuis, la pression pour modifier cet horaire a été constante. Ma démarche peut donc apparaître paradoxale : mon amendement vise à rétablir l’horaire ancien, tout en conservant les acquis sociaux, notamment la pénibilité. Ainsi, nous pourrions peut-être régler certaines difficultés.
M. le ministre. Avis défavorable. Mais si les amendements des rapporteurs ne vous semblent pas suffisants, nous pourrons compléter le dispositif.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable. Nos propositions pourront peut-être, en effet, satisfaire les préoccupations exprimées par Sandrine Mazetier.
Je rappelle que cet article concerne des zones extrêmement limitées, comme les Champs-Élysées, où l’on constate une forte affluence jusqu’à minuit. Il est donc logique de porter à minuit le début de la période de nuit.
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de cet article, car nous sommes conscients de la nécessité d’assurer un équilibre entre la situation de certaines entreprises, plus ou moins contraintes de profiter de l’afflux de clients qui arrivent tard le soir, et celle de leurs salariés. Si les zones concernées sont limitées, elles sont aussi situées au cœur de grandes villes : ceux qui y travaillent auront à coup sûr de longs trajets pour y venir puis rentrer chez eux. Les conséquences pour leur vie de famille seront donc importantes. En revanche, les cadres de ces sociétés, eux, seront peu concernés par ces horaires.
Nous ne sommes pas aujourd’hui capables de connaître les conséquences pour l’ensemble de notre droit de l’invention de cette nouvelle catégorie.
Je fais miennes, pour de nombreuses raisons que j’ai déjà évoquées lors de discussions semblables, les remarques qui ont été faites sur la pénibilité du travail de nuit. Les études de l’INSERM traitent du déficit de sommeil entre minuit et 6h00 : ceux qui achèvent leur travail à minuit sont donc concernés. Il faut faire très attention, même s’il n’y a pas ici de raison de considérer que cet article 81 remet en cause le dispositif sur la pénibilité – quelque efficace, ou peu efficace, que celui-ci soit par ailleurs. Veillons surtout à ce que les salariés concernés ne soient pas mis en danger par une organisation du travail nouvelle, alors que nous sommes parfaitement informés, et depuis longtemps, des conséquences du travail de nuit à long terme.
Il en va du travail en soirée comme du travail dominical : un peu et de temps en temps, pourquoi pas ; de manière régulière, systématique, planifiée, le travail de 21h00 à minuit accroîtrait à l’évidence la pénibilité du travail. Il ne faut pas que les mêmes personnes soient conduites à travailler cinq jours de suite sur la tranche horaire seize heures-vingt-quatre heures ; c’est difficile à admettre par ceux qui, comme moi, ont connu le travail posté en usine.
Vous dites que toutes les garanties seront prises. Est-ce vraiment possible ? Je n’en suis pas convaincu. Il faut éviter d’exposer les salariés à des risques connus. Nous ne soutiendrons donc pas cet article.
M. Christophe Castaner. La mairie de Paris a mis en place un Bureau des temps, destiné à adapter les services publics aux nouveaux rythmes de vie. On peut lire sur son site internet que ces rythmes se décalent – on se couche aujourd’hui à 23h00 en moyenne, contre 21h00 en 1950. Près d’un actif parisien sur deux a des horaires de travail décalés, en soirée ou le week-end. La mairie de Paris prévoit donc des nocturnes dans les piscines, les musées, les bibliothèques…
Nous ne faisons ici qu’adapter le droit et la sécurité des salariés à la réalité actuelle. Nous assurons la sécurité juridique des salariés du privé, en prévoyant des garanties : volontariat, réversibilité, paie doublée, transports…
La mairie de Paris a su montrer sa capacité d’adaptation. Ses employés sont sécurisés. Il nous faut trouver des réponses au moins équivalentes pour les salariés du privé.
La Commission rejette l’amendement SPE1476.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision SPE1711 des rapporteurs.
Elle se saisit alors de l’amendement SPE637 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le projet de loi prévoit que l’employeur a l’obligation de fournir aux salariés un moyen de transport pour regagner leur domicile. Ce n’est certes pas choquant, mais il y a bien d’autres sujets dont il faudra discuter, à commencer par les gardes d’enfants. Il me semblerait donc préférable de supprimer cette obligation et de renvoyer ce point à la négociation, en l’incluant dans le décret.
M. le ministre. Je suis sensible à votre argument. Les rapporteurs ont choisi de mentionner tous ces points dans la loi ; il aurait en effet été possible d’adopter une autre manière de faire, en les renvoyant à un décret. Je vous propose de retirer cet amendement pour avancer dans le débat et examiner les amendements des rapporteurs.
M. Gérard Cherpion. Je retire l’amendement, mais je le déposerai à nouveau si la commission n’avance pas sur ce sujet.
L’amendement SPE637 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1712 des rapporteurs.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE1038 de Mme Catherine Coutelle et SPE1890 des rapporteurs.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement SPE1038 tend à inscrire explicitement dans la loi que le moyen de transport mis à la disposition des salariés demeure à la charge de l’employeur.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Certes, cela va sans dire, mais ça va mieux en l’écrivant. Je retire mon amendement, qui a le même objet, au profit de celui présenté par Sandrine Mazetier.
L’amendement SPE1890 est retiré.
M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE1038.
La Commission adopte l’amendement SPE1038.
Puis elle se saisit de l’amendement SPE1884 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer la mention « individuel ou collectif » : cette précision paraît inutile, puisque ce moyen de transport sera forcément soit individuel, soit collectif.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1884.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1888 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. L’amendement vise à supprimer la mention « en sécurité », éminemment subjective et qui, comme telle, pourrait être à l’origine de contentieux. L’insécurité peut aussi exister à dix heures du matin…
M. le ministre. Je comprends la préoccupation du rapporteur thématique, et il est utile de soulever ici cette question. Néanmoins, d’après les échanges que nous avons eus avec le Conseil d’État, il ne s’agit pas ici d’instaurer une obligation de sécurité au sens du code du travail, c’est-à-dire avec une obligation de résultats. Le risque encouru n’est pas professionnel : il n’y aurait donc qu’une obligation de moyens. Le transport peut se faire de nombreuses façons différentes : taxi individuel ou collectif, par exemple. Les accords prévoyant un transport pour les salariés travaillant le soir existent déjà, il ne s’agit donc que de confirmer l’existant.
Je propose donc plutôt le retrait de l’amendement.
M. Jean-Frédéric Poisson. Soit nous retirons purement et simplement la mention « en sécurité », soit il faut préciser qu’elle n’emporte pas une obligation de résultats. En la matière, l’ambiguïté est évidemment l’ennemie du bien. Il me paraîtrait préférable de voter l’amendement, et de retravailler la question d’ici à la séance publique.
Mme Élisabeth Pochon. Ne peut-on pas écrire « le moyen de transport le plus adapté » ? Cela impliquerait une solution individualisée.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Pour le coup, cela laisserait le champ aux interprétations les plus diverses.
L’intention de notre amendement était surtout de permettre l’usage d’un transport collectif. Je comprends la difficulté soulevée par le ministre, et je retire l’amendement.
L’amendement SPE1888 est retiré.
La Commission examine alors l’amendement SPE1889 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise à substituer à la notion de « lieu d’habitation » du salarié, inconnue du code du travail, celle de « lieu de résidence », plus usitée.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1889.
Puis elle se saisit de l’amendement SPE1891 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement a pour objet d’intégrer aux accords d’aménagement du travail en soirée dans les commerces en zone touristique internationale les dispositions qui s’appliquent dans le cadre des accords organisant l’ouverture dominicale en zone dérogatoire. Il est légitime que ces accords tiennent aussi compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés.
Mme Karine Berger. De quelle façon ces accords prennent-ils en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés ? Comment cela fonctionne-t-il ?
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cela joue surtout pour l’écriture des modalités d’application des clauses sur la réversibilité, le volontariat…
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1891.
Elle examine alors l’amendement SPE1226 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Suivant une méthode déjà utilisée pour répondre à une inquiétude déjà exprimée, cet amendement d’appel vise à préciser que l’accord collectif doit également fixer les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés qui travaillent entre vingt-et-une heures et minuit.
M. le ministre. Le projet de loi prévoit que l’accord doit offrir aux salariés des contreparties satisfaisantes, qui seront détaillées en fonction des situations individuelles et collectives. L’amendement peut être compris comme un amendement de précision.
L’intention initiale du Gouvernement était de ne pas trop contraindre ces accords. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Nous souscrivons à l’idée de contreparties autres que salariales, et notamment de mesures destinées à favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés : coût de la garde des enfants, mais aussi formation et santé au travail. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement SPE1226.
Elle se saisit ensuite de l’amendement SPE1894 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise à protéger la réversibilité du choix du salarié de travailler en soirée.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1894.
Elle examine alors l’amendement SPE1932 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. À l’instar des accords sur le travail dominical, les accords portant sur le travail en soirée doivent comporter des mesures tendant à faciliter la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1932.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1713 des rapporteurs.
Elle se saisit ensuite de l’amendement SPE1892 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise à préciser que les femmes enceintes peuvent refuser de travailler en soirée.
M. le ministre. Avis favorable.
Mme Karine Berger. N’importe qui peut refuser, si j’ai bien compris : en quoi cette précision est-elle nécessaire ?
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Les accords devront prévoir le cas précis des femmes enceintes, auxquelles l’employeur devra proposer un autre poste, ou des horaires à un autre moment de la journée, si elles peuvent continuer à travailler.
Mme Sandrine Mazetier. J’avais déposé un amendement qui a été jugé irrecevable, et Sylvie Tolmont ne pourra pas défendre ses amendements, qui me semblaient plus protecteur pour les femmes que celui des rapporteurs.
Il ne suffit pas de pouvoir refuser de travailler le soir pour protéger les femmes enceintes : dans le cas du travail de nuit, non seulement elles peuvent refuser, mais l’employeur est tenu de proposer un travail aménagé. Ce n’est pas exactement ce que vous prévoyez ici.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Les femmes enceintes pourront refuser à n’importe quel moment : pour elles, l’effet est nécessairement immédiat ; pour les autres salariés, les accords prévoiront sans doute un délai pour pouvoir cesser le travail en soirée.
Mme Sandrine Mazetier. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur le rapporteur : il me semble que l’amendement du rapporteur est moins protecteur que le droit actuel sur le travail de nuit, puisque l’employeur n’est pas tenu de proposer aux femmes enceintes un poste aménagé assurant une rémunération équivalente.
M. le rapporteur général. N’ergotons pas. L’article L. 1225-9 du code du travail dispose que « la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l’article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal ». Le droit actuel, auquel nous faisons ici explicitement référence, suffit à répondre à votre préoccupation.
Notre amendement précise simplement que l’arrêt du travail en soirée est, à la demande de la salariée, immédiat et de plein droit.
La Commission adopte l’amendement SPE1892.
Elle examine alors l’amendement SPE1893 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement prévoit de rendre applicables aux travailleurs en soirée l’ensemble des dispositions applicables aux travailleurs de nuit : surveillance médicale, protection du refus en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, aménagement des conditions de retour à un travail de jour… Ce régime dérogatoire doit être aussi protecteur que possible pour le salarié.
M. le ministre. Nous parlons ici, je le rappelle, de zones très spécifiques et du seul commerce de détail. Je comprends votre volonté commune de protection, et je l’approuve.
Toutefois, en l’espèce, il s’agit essentiellement de surveillance médicale. Or nous rencontrons déjà de grandes difficultés à assurer celle-ci pour les travailleurs de nuit, car nous manquons de médecins. Une mission vient d’être lancée sur ce sujet. Je suis donc réticent et propose plutôt le retrait de l’amendement.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous sommes favorables à cet amendement, qui confirme ce que nous disions : il n’est pas normal de ne pas considérer comme du travail de nuit les heures consacrées à la parfumerie, à Sephora en particulier.
M. Jean-Yves Caullet. Je comprends ce que le dit le ministre, mais si nous appliquons à ceux qui travaillent en soirée les obligations qui s’imposent déjà à ceux qui travaillent la nuit, les premiers seront obligatoirement inclus dans les réflexions et les éventuelles réformes. Sinon, ils risquent d’être laissés de côté.
M. le ministre. C’est vrai. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement SPE1893.
Puis elle adopte l’article 81 modifié.
*
* *
Article 81 bis [nouveau]
(art. L. 3132-29 du code du travail)
Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture
Cet article, adopté par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs, propose de revoir les modalités préalables à la prise d’un arrêté préfectoral de fermeture, en vertu de l’article L. 3132-29 du code du travail.
Cet article prévoit en effet que sur la base d’un accord intervenu entre les organisations syndicales et patronales représentatives d’une profession ou d’une zone géographique, le préfet peut, à leur demande, imposer par arrêté, à l’ensemble du secteur ou de la profession, la fermeture dominicale ou, d’ailleurs, celle d’un autre jour de la semaine.
L’amendement adopté par la commission spéciale n’a pas vocation à remettre en cause la grande majorité des arrêtés préfectoraux pris dans de très nombreux départements français, pour réguler la concurrence et coordonner l’ouverture des commerces de bouche et des boulangeries, puisqu’il s’agit le plus souvent de ces deux catégories d’établissements qui sont concernées par les arrêtés de fermeture.
En revanche, certains arrêtés très anciens reposent sur un accord entre professionnels ancien et non formalisé, ce qui est source d’insécurité juridique. Ces arrêtés se sont souvent révélés avec le temps inadaptés aux mutations des pratiques de consommation, sans que cela ne conduise pourtant à les modifier.
Cet article propose donc d’imposer un certain formalisme à l’accord des professionnels concernés pour assurer une meilleure base juridique aux arrêtés préfectoraux, qui peuvent, en l’absence d’une telle formalisation, être livrés à une contestation permanente. Il prévoit également que dès lors qu’un accord formalisé des professionnels concernés est intervenu, le préfet est tenu de prendre sa décision par arrêté dans un délai de six mois. Enfin, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux arrêtés préfectoraux en cours dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1943 des rapporteurs.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Le formalisme des arrêtés préfectoraux fait parfois perdurer des arrêtés anciens, inadaptés aux pratiques actuelles de consommation – je n’en veux pour exemple qu’un arrêté pris par le préfet de Seine-et-Oise en 1936… Le présent amendement n’a pas pour objet de remettre en cause les accords collectifs qui sont correctement formalisés – comme le sont les accords collectifs de branche ou territoriaux – mais de réexaminer les plus anciens, régulièrement contestés.
Suivant l’avis favorable du ministre, la Commission adopte l’amendement SPE1943.
*
* *
Article 82
Dispositions transitoires non codifiées
Cet article aménage les modalités d’entrée en vigueur des dispositions des articles 71 à 81 du projet de loi, en organisant en particulier la transition entre le régime applicable aux actuelles zones géographiques dérogatoires – zones touristiques et périmètres d’usage de consommation exceptionnels (PUCE) – et le nouveau régime qui s’appliquera aux zones touristiques internationales, aux zones touristiques, aux zones commerciales et aux commerces situés dans l’emprise d’une gare.
Le I concerne les actuelles communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente régies par l’article L. 3132-25 dans sa rédaction actuelle : il prévoit que ces communes ou zones constituent de plein droit des zones touristiques telles que définies par cet article dans sa nouvelle rédaction.
Dans la mesure où ces zones ne sont actuellement pas soumises à une obligation de couverture par un accord collectif fixant des compensations sociales aux salariés privés de repos dominical et n’impliquent pas le respect d’une procédure de protection du volontariat du salarié, le second alinéa du I du présent article prévoit que ces nouvelles obligations, codifiées aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4, s’appliqueront aux salariés des commerces situés dans ces communes ou zones touristiques le premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la loi. Une période de trois ans est donc laissée à ces communes ou zones pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.
Le II concerne les PUCE régis par les articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 dans leur rédaction actuelle : il prévoit que ces périmètres constituent de plein droit des zones commerciales telles que définies par l’article L. 3132-25-1 dans sa nouvelle rédaction.
Dans les actuels PUCE, la dérogation au repos dominical peut être organisée sur le fondement d’un accord collectif ou, le cas échéant, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après approbation de la majorité des salariés concernés : dans la mesure où le projet de loi supprime la possibilité de recourir à l’organisation du travail en roulement par voie unilatérale, le deuxième alinéa du II pose le principe selon les actuelles décisions unilatérales de l’employeur restent applicables jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la loi. Le troisième alinéa précise que pendant cette période de transition de trois ans, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié conformément aux dispositions prévues par le II de l’article L. 3132-25-3 dans sa nouvelle rédaction, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de la décision unilatérale de l’employeur.
Le III concerne les « dimanches du maire » : son premier alinéa prévoit que les nouvelles règles qui portent potentiellement à 12 les dimanches du maire – dont cinq de droit, et sept laissés à l’initiative du maire – s’appliquent pour la première fois au titre de l’année suivant celle de la publication de la loi, autrement dit, très vraisemblablement en 2016.
Toutefois, le second alinéa du III prévoit que pour l’année au cours de laquelle la loi est publiée, soit 2015, le maire fixe par arrêté dans un délai d’un mois suivant la publication de la loi :
– la liste des trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, les commerces de détail de la commune seront autorisés à ouvrir ;
– ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches supplémentaires auxquels les commerces seraient autorisés à ouvrir, dans la limite de trois.
En tout état de cause, le nombre total de dimanches désignés par le maire pour 2015 sera au maximum de six, compte tenu des éventuels dimanches qu’il aurait déjà désignés dans le cadre de l’actuelle rédaction de l’article L. 3132-26.
Ainsi, en 2015, les commerces pourraient être autorisés par le maire à ouvrir au maximum six dimanches dans l’année et au minimum trois dimanches dans l’année.
Ces dispositions transitoires appellent plusieurs remarques.
La reconnaissance de droit des anciennes communes ou zones touristiques et des PUCE comme « zones touristiques » ou « zones commerciales » vise à assurer une continuité et une sécurité juridique à ces zones parfois anciennes dans le cas des zones touristiques. Néanmoins, elle va directement à l’encontre des préconisations du rapport Bailly, qui recommandait au contraire qu’une nouvelle instruction soit réalisée pour chaque zone touristique ou PUCE actuels.
S’agissant des PUCE, le rapport préconise en effet « de ne pas créer de nouveaux PUCE et, d’autre part, de laisser s’éteindre les PUCE existants en ne renouvelant pas les autorisations individuelles déjà accordées au moment de leur échéance. Les PUCE existants devraient faire l’objet d’une étude de validation, avec un éventuel réajustement des contours (en cas de distorsions de concurrence flagrantes), pour intégrer le nouveau dispositif ». En effet, on l’a vu, en consacrant des situations d’illégalité – reconnues à travers le critère de l’antériorité de l’usage de consommation dominicale –, ces périmètres ont créé des distorsions importantes de concurrence. De la même manière, le critère de continuité de la zone n’est pas toujours pertinent. Au total, les PUCE conduisent à de graves incohérences, puisqu’elles ont souvent été créées au détriment de zones « plus vertueuses » et n’ayant donc pas d’antériorité d’ouverture dominicale, et sont source de nombreux contentieux.
Le rapport estime que la configuration des actuelles communes et zones touristiques souffre également de défauts : l’absence de critères objectifs de classement et de modalités de gouvernance adaptées conduit à des situations extrêmement contrastées entre ces zones, qui couvrent jusqu’à la totalité de la surface d’une ville comme Bordeaux, à « quatre numéros dans une rue de Paris à Montmartre », comme le note le rapport.
Pour ces raisons, le rapport « Bailly » concluait à la nécessité de « ré-instruire » les périmètres de ces zones, tout en indiquant que les PUCE, communes et zones touristiques existants avaient bien entendu vocation à devenir des zones touristiques et des zones commerciales, mais qu’il convenait pour ce faire pour assurer la continuité, de procéder à des études de validation, avec le cas échéant, un réajustement de ces zones.
La reconnaissance de plein droit de ces zones anciennes dans le cadre des nouveaux dispositifs a l’inconvénient de ne pas gommer les défauts structurels de ces zones. Elle conduira à laisser coexister des zones dont le périmètre aura été défini de manière concertée et objective sur la base d’une étude d’impact, comme cela sera le cas pour les futures nouvelles zones touristiques ou commerciales, avec des zones aux contours beaucoup plus contestables.
Le rapporteur thématique estime qu’il convient de revoir ces modalités transitoires, en prévoyant que dans le délai de trois ans imparti par le projet de loi, chacune des communes et zones touristiques et des PUCE actuels puisse monter un dossier présentant l’opportunité d’une reconnaissance de plein droit comme nouvelle zone touristique ou nouvelle zone commerciale ou le cas échéant, un dossier présentant une zone reconfigurée. Un délai de trois ans semble de ce point de vue bien suffisant.
À défaut, si l’on estimait nécessaire, par souci d’assurer à ces zones une sécurité juridique suffisante, de prévoir leur reconnaissance de plein droit comme nouvelles zones touristiques ou commerciales, le rapporteur thématique juge qu’un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec le nouveau régime est excessif. Un délai de deux ans serait de ce point de vue amplement suffisant. Il considère en tout état de cause que l’on ne peut pas décemment attendre trois ans pour que les salariés des zones touristiques bénéficient des contreparties salariales dont ils sont aujourd’hui privés et qui devront être prévues par accord collectif.
Enfin, s’agissant des zones touristiques internationales, dans le silence de la loi, le dispositif législatif a vocation à entrer en vigueur dès la publication de loi : autrement dit, une fois la loi promulguée, le ou les arrêtés ministériels devraient intervenir pour délimiter ces zones. Les commerces de détail de ces zones pourront alors ouvrir le dimanche dès qu’ils seront couverts par un accord collectif organisant le travail en soirée, et fixant les contreparties sociales rendues obligatoires par la loi.
Les amendements SPE115 de M. Gérard Cherpion et SPE445 de M. Patrick Hetzel sont retirés.
La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel SPE1714 des rapporteurs.
Puis elle se saisit des amendements identiques SPE916 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1359 de M. Jean-Louis Roumegas.
Mme Jacqueline Fraysse. Le projet de loi prévoit que les accords doivent être conclus en trente-six mois : c’est beaucoup trop. Je pense qu’en travaillant d’arrache-pied, il doit être possible de réduire ce délai à douze mois. Soyons sérieux.
M. Jean-Louis Roumegas. Vous prévoyez que deux régimes bien différents coexisteront pendant trois ans : ce n’est certes pas un délai couperet, c’est même plutôt de la complaisance !
M. le rapporteur général. Trois années nous amèneraient au-delà du terme de l’actuelle législature, ce qui me paraît un peu gênant. C’est un débat qui doit être mené, même s’il ne sera pas tranché cet après-midi : une durée intermédiaire entre un et trois ans me paraîtrait bonne. Il faudra trouver un compromis en séance publique.
M. le ministre. Madame Fraysse, je suis sensible à votre argumentation. Nous avons essayé de trouver la juste proportion entre l’intérêt des salariés et l’intérêt des petits commerces eux-mêmes, mais on peut effectivement arriver à des situations injustes. Un an, c’est sans doute trop court, parce qu’un petit commerce en zone touristique ne travaille sans doute pas d’arrache-pied à ces sujets ; trois ans, c’est trop long. Je vous propose de retirer votre amendement pour que nous reprenions cette discussion en séance, après concertation notamment avec les associations de commerçants concernées. Il faut aussi éviter de fixer des objectifs très ambitieux qui ne sont pas atteints par la suite, comme c’est arrivé avec les accords de sécurisation de l’emploi.
Mme Jacqueline Fraysse. Je ne retirerai pas mon amendement, car je crois vraiment que douze mois peuvent suffire, mais je suis sensible à votre écoute, monsieur le ministre. Nous soutiendrons toute proposition de réduction du délai : qui peut le plus peut le moins.
La Commission rejette les amendements SPE916 et SPE1359.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1715 à SPE1723, SPE1726 et SPE1727 des rapporteurs.
Elle adopte alors l’article 82 modifié.
La Commission se saisit de l’amendement SPE1479 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Les exceptions au principe du repos dominical se justifient pour nécessités économiques ou de service public. Il faut encore me démontrer que l’exception au repos dominical est fondamentale pour pouvoir acheter du vernis à ongles.
Mme Élisabeth Pochon. Remarque sexiste ! (Sourires.)
Mme Sandrine Mazetier. Pas du tout, le vernis à ongles pour tous est une réalité sur les Champs-Élysées. (Sourires.)
Mon amendement vise donc à interdire les dérogations au travail dominical, toutes zones confondues, les journées où sont organisées des élections.
M. le ministre. J’entends bien la distinction que vous faites, avec les services publics notamment. Mais qu’en est-il de l’ouvreuse du cinéma, du gardien de musée ? J’appelle votre attention sur le fait que, par souci collectif de bien faire, nous avons prévu des protections importantes pour les travailleurs du dimanche dans le commerce de détail. Mais, ce faisant, nous créons une distorsion par rapport à beaucoup d’autres salariés qui travaillent déjà le dimanche.
J’entends votre argument, mais je suis défavorable à cet amendement. Cette mesure n’aurait de sens que dans le cadre large d’une réflexion sur la citoyenneté et la liberté offerte aux salariés lorsqu’un commerce ouvre le dimanche.
M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. J’avoue avoir été séduit par cet amendement : en tant qu’élus, nous voulons tous combattre l’abstentionnisme. Mais le vote par procuration existe. Nous traitons ici seulement du commerce de détail : ce projet de loi n’est pas, me semble-t-il, le bon véhicule pour une telle mesure. Avis défavorable.
Mme Karine Berger. Nous pourrions ici, je crois, trouver un moment de consensus. Nous discutons d’ouvertures dominicales supplémentaires : prévoir que les travailleurs qui seront concernés pourront effectuer normalement leur devoir électoral me paraît relever de l’évidence. J’entends que le Gouvernement est favorable à ce que cette mesure soit généralisée à d’autres cas de travail du dimanche : c’est une excellente nouvelle, et je m’étonne que nous n’ayons pas réussi à le faire jusqu’à présent.
Puisque nous travaillons ce dimanche sur le nouveau travail du dimanche, commençons par protéger le devoir électoral de ces salariés-là. L’adoption de l’amendement de Sandrine Mazetier permettrait de traiter la question, et montrerait que nous envisageons toutes les conséquences de ce qu’il faut bien appeler une augmentation du travail dominical.
M. Jean-Yves Caullet. Sur la forme, la rédaction vise-t-elle uniquement ceux sur lesquels le projet de loi dont nous débattons aurait des conséquences, ou bien tous ceux qui travaillent déjà le dimanche seraient-ils concernés ?
M. le rapporteur général. Il faut le vérifier.
Mme Sandrine Mazetier. Il porte, je crois, sur le travail du dimanche dans le secteur du commerce de détail.
M. Dominique Lefebvre. Je comprends la volonté de favoriser la participation de nos concitoyens aux élections. Mais les salariés concernés par ce projet de loi sont très peu nombreux par rapport à ceux qui travaillent déjà les jours d’élection, et pas seulement pour des nécessités de service public : tous ici, nous avons tenu des bureaux de vote et rencontré des électeurs qui venaient à l’ouverture parce qu’ils travaillaient ensuite, ou qui venaient à la dernière minute parce qu’ils avaient travaillé toute la journée. Il est aussi possible de donner une procuration. Si nous voulons traiter cette question sans arrière-pensée, alors il ne faut pas prendre de mesure pour les seuls salariés du commerce de détail : il faut poser la question de façon beaucoup plus générale.
Mais je n’ai jamais rencontré personne que son travail ait empêché d’accomplir son devoir électoral.
M. le président François Brottes. Je suspends la séance quelques minutes pour faire le point sur la portée exacte de l’amendement.
M. le rapporteur général. Le but de l’amendement est que l’augmentation du nombre de dimanches travaillés n’empêche pas ceux qui travailleront dans le commerce de détail d’aller voter. La rédaction proposée paraît toutefois inadaptée.
Si la volonté de nos collègues est largement partagée, il faudra trouver – avec le Gouvernement – une rédaction qui prévoira que les dimanches où l’ouverture des commerces sera autorisée par les maires ou les présidents d’EPCI ne pourront pas être ceux où se déroulent des opérations électorales.
Mme Sandrine Mazetier. Il doit être possible de compléter la rédaction que je propose. Certains citoyens doivent voter par procuration pour une nécessité économique, ou pour une nécessité de service public, j’entends bien. Mais obliger un citoyen à accomplir des démarches administratives pour la seule raison que l’on autorise l’ouverture dominicale du commerce de détail, cela me paraît une chose tout à fait différente, et pour tout dire difficile à justifier.
L’amendement SPE1479 est retiré.
*
* *
Cette section se compose de deux articles, l’article 83 visant à réformer la justice prud’homale et l’article 84 établissant les modalités d’entrée en vigueur de l’article 83.
Article 83
Réforme de la justice prud’homale
(art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-11, L. 1423-11-1 [nouveau], L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveau], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4 du code du travail, art. 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, art. 2064 du code civil, art. L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire)
Instituée en 1806 par Napoléon Ier, puis généralisée et réformée à de nombreuses reprises − notamment par la loi « Boulin » du 18 janvier 1979 (196) −, la justice prud’homale est aujourd’hui confrontée à d’importantes difficultés qui mettent en cause son efficacité, voire sa légitimité.
L’enjeu de cet article est donc d’entreprendre les réformes nécessaires, dans l’intérêt des justiciables – salariés et employeurs –, tout en veillant à préserver certains particularismes des conseils de prud’hommes.
À cet effet, l’article 83 refonde, tout d’abord, le statut des juges prud’homaux, en redéfinissant les critères de déontologie auxquels ils sont soumis, en instaurant une obligation de formation et en réformant en profondeur la procédure disciplinaire qui leur est applicable.
Il réforme ensuite la procédure devant les conseils des prud’hommes, en enrichissant le rôle du bureau de conciliation et en créant une formation de jugement restreinte, dans l’objectif d’améliorer la qualité des jugements rendus et de diminuer les délais de jugement.
Il vise également à permettre de nouvelles procédures de conciliation extrajudiciaire pour les litiges s’élevant en matière de travail. Enfin, il crée un véritable statut des défenseurs syndicaux afin de sécuriser l’activité de ceux qui accompagnent les justiciables dans la procédure prud’homale.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est chargé de régler, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et les salariés à l’occasion de tout contrat de travail. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Il existe actuellement 210 conseils de prud’hommes, regroupant plus de 14 500 conseillers, chargés de traiter environ 200 000 affaires chaque année.
La justice prud’homale se caractérise par plusieurs spécificités qui la rendent relativement atypique au sein de l’Union européenne et de l’ordre judiciaire français.
En premier lieu, la justice prud’homale française se distingue par son caractère paritaire, c’est-à-dire qu’elle est composée à proportion égale de représentants des salariés et des employeurs. Les conseillers prud’hommes sont ainsi des juges non professionnels, qui connaissent la réalité du monde du travail et exercent leurs fonctions à temps partiel et pour une durée limitée. Le mode de désignation des conseillers prud’hommes a vocation à évoluer dans un avenir proche : alors qu’ils sont jusqu’à présent élus pour un mandat de cinq ans, ils devraient être bientôt désignés en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, en application de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes.
La seconde spécificité des conseils de prud’hommes tient à la procédure prud’homale. En premier lieu, celle-ci respecte les principes de l’oralité et de la gratuité : en vertu du principe d’oralité, la comparution personnelle des parties est la règle ; celles-ci peuvent néanmoins être représentées ou assistées soit par des avocats, soit par des délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales et patronales, les défenseurs syndicaux.
Par ailleurs, la procédure prud’homale accorde une large place à la conciliation, qui est un préalable obligatoire, sauf quelques exceptions, à la saisine du bureau de jugement. Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, c’est seulement en cas d’échec de la conciliation que le conseil des prud’hommes doit juger les litiges. Les résultats de la conciliation sont toutefois modestes et en diminution continue depuis 2004, comme l’indique le tableau ci-dessous. En cas d’échec de la conciliation, les affaires sont renvoyées devant le bureau de jugement, composé d’un nombre égal de conseillers employeurs et salariés.
En cas de partage du bureau de jugement, l’affaire est de nouveau renvoyée devant une formation composée à part égale de conseillers employeurs et salariés, mais présidée par un juge départiteur, juge professionnel du tribunal d’instance, chargé de trancher le litige. Depuis 2008, un peu plus de 10 % des décisions rendues par les conseils de prud’hommes ont été rendues après l’intervention du juge départiteur.
DÉCISIONS RENDUES SUR LES AFFAIRES INTRODUITES AU FOND
|
Ensemble des affaires au fond terminées |
Dont devant le bureau de conciliation |
Dont décisions rendues après l’intervention du juge départiteur | |||
|
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
2004 |
151 281 |
100,0 |
23 573 |
15,6 |
14 602 |
9,7 |
2005 |
147 237 |
100,0 |
22 714 |
15,4 |
13 986 |
9,5 |
2006 |
145 440 |
100,0 |
21 837 |
15,0 |
14 467 |
9,9 |
2007 |
142 060 |
100,0 |
21 536 |
15,2 |
13 948 |
9,8 |
2008 |
145 527 |
100,0 |
20 951 |
14,4 |
15 359 |
10,6 |
2009 |
131 562 |
100,0 |
19 770 |
15,0 |
14 506 |
11,0 |
2010 |
151 225 |
100,0 |
19 928 |
13,2 |
15 353 |
10,2 |
2011 |
150 280 |
100,0 |
17 894 |
11,9 |
16 655 |
11,1 |
2012 |
146 067 |
100,0 |
14 234 |
9,7 |
15 346 |
10,5 |
2013 |
145 470 |
100,0 |
13 699 |
9,4 |
19 276 |
13,3 |
Source : Sous-direction de la statistique et des études du ministère de la Justice – Répertoire général civil (SDSE-RGC)
Le contentieux prud’homal présente enfin certains traits caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans d’autres juridictions.
Ainsi, les demandes formulées devant les conseils de prud’hommes émanent dans la majorité des cas des salariés : plus de 99 % des demandes en 2013.
En outre, les demandes sont liées, dans la quasi-totalité, à la rupture du contrat de travail : en 2013, 92,8 % des demandes étaient liées à la rupture du contrat de travail et, parmi celles-ci, 78,1 % contestaient un licenciement.
Par ailleurs, selon les informations transmises à aux rapporteurs par le ministère de la Justice, la plupart des affaires portent sur des relations de travail terminées puisqu’en 2013, moins de 2 % des demandes introduites au fond et en référé concernaient des affaires pour lesquelles l’employeur et le salarié sont encore liés par un contrat de travail au moment de la saisine de la juridiction.
NATURE DES CONTENTIEUX PORTÉS DEVANT LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES EN 2013
Effectifs |
En % | |
Total des demandes |
206 039 |
100 |
Demandes formées par les salariés ordinaires |
194 700 |
94,5 |
Demandes liées à la rupture du contrat de travail dont : |
191 302 |
92,8 |
- Contestation du motif de licenciement |
160 929 |
78,1 |
- Pas de contestation du motif de licenciement |
30 373 |
14,7 |
Demandes en l’absence de rupture du contrat de travail dont : |
3 398 |
1,7 |
- Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire |
446 |
0,2 |
- Demandes de remises de documents |
1 728 |
0,8 |
- Demandes en paiement de créances salariales |
1 214 |
0,6 |
- Autres demandes |
10 |
0,0 |
Demandes formées par les salariés protégés (197) |
151 |
0,1 |
- Contestation du motif de licenciement |
67 |
0,0 |
- Pas de contestation du motif de licenciement ou pas de rupture |
84 |
0,0 |
Demandes formées par les apprentis |
224 |
0,1 |
Demandes formées par un employeur |
736 |
0,4 |
Autres demandes formées dans le cadre d’une procédure SRLJ |
6 134 |
3,0 |
- Dont demandes d’indemnités ou de salaires liées ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l’ouverture d’une procédure collective |
6 099 |
3,0 |
Autres demandes |
4 094 |
2,0 |
Dont demandes liées à un risque professionnel |
3 419 |
1,7 |
Source : SDSE-RGC
Les principes de la justice prud’homale ne sont toutefois plus en phase aujourd’hui avec les nécessités des justiciables et les exigences du procès équitable. Comme le souligne le rapport de M. Alain Lacabarats remis à Mme la garde des Sceaux en juillet 2014, « la juridiction du travail ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connaît de graves carences » (198).
Le rapport de M. Lacabarats recense un ensemble de dysfonctionnements, connus de longue date, qui freinent le bon fonctionnement de la justice prud’homale : les délais de traitement exagérément longs ; les taux d’appel élevés ; le recours de plus en plus fréquent aux juges professionnels pour corriger les insuffisances de la procédure prud’homale, ou encore la défaillance de la procédure conciliatoire.
En premier lieu, l’allongement des délais de jugement est particulièrement préoccupant. La durée moyenne des affaires portées devant les conseils de prud’hommes était de 15,9 mois en 2013, soit quatre mois de plus qu’en 2004.
À titre de comparaison, la durée moyenne de jugement est de 5,4 mois au tribunal de commerce et de 7 mois au tribunal de grande instance (TGI). Comme le montre le tableau ci-après, le temps moyen de jugement en cas de départage atteint des durées élevées de 29,7 mois au fond en 2013, contre 22,1 mois en 2004.
COMPARAISON DES DURÉES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES AU FOND TERMINÉES, SELON L’INSTANCE AYANT RENDU LA DÉCISION EN 2004 ET EN 2013(*)
Affaires au fond terminées |
Durée moyenne (en mois) | ||
2004 |
2013 | ||
Bureau de conciliation |
13 699 |
1,9 |
2,5 |
Bureau de jugement |
112 495 |
12,8 |
15,1 |
Départition |
19 276 |
22,1 |
29,7 |
Total des décisions |
145 470 |
11,9 |
15,9 |
(*) Hors jonction et interprétation
Source : Étude d’impact.
Ces délais de jugement sont très supérieurs aux limites fixées par le droit : le premier alinéa de l’article R. 1454-29 du code du travail dispose par exemple que l’audience tenue par le juge départiteur doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de renvoi. Plus préoccupant encore, ces délais sont incompatibles avec les exigences européennes en matière de procès équitable telles qu’elles sont fixées par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable ». En 2013, l’État a ainsi été condamné à 51 reprises pour déni de justice en matière prud’homale.
Selon la sociologue Mme Evelyne Serverin, l’analyse détaillée des délais de jugement révèle surtout des différences significatives entre conseils de prud’hommes, en raison de l’inégale répartition des affaires et de l’inadéquation de la carte judiciaire : en 2013, 28 conseils de prud’hommes, soit à peine plus de 10 % d’entre eux, ont traité à eux seuls la moitié des affaires.
Lorsque la conciliation échoue, les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement, voire la formation de départage.
Alors que la recherche de la conciliation était l’un des piliers de la justice prud’homale depuis sa création en 1806, elle ne rencontre aujourd’hui qu’un succès très limité : en 2013, 6 % des affaires portées devant les conseils de prud’hommes se sont achevées par un procès-verbal de conciliation (contre 8,8 % en 2000). Selon le rapport Lacabarats et l’étude d’impact attachée au projet de loi, trois facteurs peuvent être mobilisés pour expliquer le moindre succès de la conciliation.
Tout d’abord, la diminution croissante de la part de la conciliation dans le règlement des litiges s’expliquerait dans certains cas par la complexification du droit du travail : les litiges posent des questions juridiques de plus en plus sophistiquées qui ne peuvent être résolues par la conciliation.
Le faible nombre d’affaires résolues par la conciliation peut s’expliquer ensuite par l’absence de volonté commune d’accord, qui se traduit souvent par le défaut de comparution des parties devant le bureau de conciliation. Dans d’autres cas, le montant des engagements financiers représenté par les affaires portées devant les conseils de prud’hommes dissuaderait également les parties prenantes de régler leurs différends par la voie de la conciliation.
Enfin, le faible taux d’affaires réglées par la conciliation peut s’expliquer par le fait que de nombreux accords interviendraient en dehors de la juridiction prud’homale : « la conciliation hors les murs serait trois fois plus importante que la conciliation rendue obligatoire par l’article L. 1411-1 du code du travail ». En outre, selon le rapport de M. Lacabarats, de nombreuses affaires trouveraient une solution amiable tout au long de la procédure prud’homale, sans que cela apparaisse pour autant dans les statistiques relatives à la conciliation. Depuis 2008, le succès de la procédure de rupture conventionnelle, prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, peut justifier également de la diminution du nombre d’affaires résolues par la conciliation devant les conseils de prud’hommes. L’étude d’impact considère par conséquent que « le cadre procédural ne répond pas aux attentes du justiciable ; les parties finissent par trouver un accord, mais hors du cadre qui a été prévu à cet effet ».
Pour sa part, le rapporteur thématique considère que deux facteurs s’ajoutent à ceux identifiés ci-dessus :
– en premier lieu, dans 98 % des cas, selon les informations transmises aux rapporteurs par le ministère de la Justice, le contrat est rompu entre les parties aux litiges lorsque l’affaire arrive devant le conseil des prud’hommes. Or, le besoin de conciliation est surtout très fort lorsque le contrat poursuit son exécution ;
– en second lieu, les parties sont très généralement assistées, et les avocats ont pour habitude de transiger au terme de discussions qui s’exercent dans la confidentialité, ce qui leur paraît préférable à une discussion sous le regard du juge.
La qualité de la procédure prud’homale est également remise en question compte tenu de la proportion élevée et en constante augmentation du recours à la formation de départage : le départage concernait 9,7 % des affaires terminées en 2004, contre 13,3 % des affaires terminées en 2013.
L’augmentation du recours au juge départiteur dans la procédure prud’homale peut trouver sa source à la fois dans la complexité accrue du droit du travail, dans la présence de plus en plus courante des avocats pour représenter les parties ou encore dans les insuffisances de la formation des conseillers prud’hommes. Mais selon l’étude d’impact, elle découle également d’un déficit de confiance des justiciables à l’égard des conseillers prud’homaux : en faisant appel au juge départiteur, la majeure partie du contentieux prud’homal est en définitive traitée par des juges professionnels.
Le rapporteur thématique souhaite toutefois rappeler que les statistiques nationales ne font pas état des très fortes disparités qui existent selon les conseils de prud’hommes : dans certains conseils, le taux de départage est inférieur à 10 % alors que pour d’autres, le taux de départage moyen dépasse les 30 %.
Par ailleurs, le taux d’appel des décisions rendues par les conseils de prud’hommes demeure élevé. Comme le montre le tableau ci-dessous, en 2012 et 2013, plus de deux tiers des décisions rendues sur les affaires au fond ont fait l’objet d’appel, contre 60 % en moyenne les années précédentes. La proportion d’appel s’élève entre 25 % et 32 % pour les décisions rendues en référé. À titre de comparaison, le taux d’appel des décisions rendues par les tribunaux d’instance dans les contentieux des relations individuelles du travail s’élève à 29,2 % en moyenne, et à 16 % dans les tribunaux de grande instance s’agissant des contentieux collectifs du travail.
TAUX D’APPEL SUR LES DÉCISIONS RENDUES PAR LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES
Ensemble des décisions |
Décisions rendues sur les affaires au fond |
Décisions rendues en référé(*) | ||||
Année de la décision rendue |
Nombre d’appels |
Taux d’appel (en %) |
Nombre d’appels |
Taux d’appel (en %) |
Nombre d’appels |
Taux d’appel (en %) |
2004 |
45108 |
58,8 |
43205 |
61,5 |
1903 |
29,4 |
2005 |
46665 |
59,9 |
44927 |
62,9 |
1738 |
27,0 |
2006 |
44859 |
56,5 |
43274 |
59,9 |
1585 |
22,4 |
2007 |
42783 |
55,9 |
40825 |
58,9 |
1958 |
27,1 |
2008 |
47039 |
57,7 |
45178 |
60,8 |
1861 |
26,0 |
2009 |
39954 |
55,8 |
37917 |
60,0 |
2037 |
24,3 |
2010 |
49213 |
59,7 |
46671 |
62,5 |
2542 |
32,4 |
2011 |
49663 |
59,9 |
47484 |
62,7 |
2179 |
30,3 |
2012 |
53246 |
63,3 |
51722 |
66,2 |
1524 |
25,7 |
2013 |
53807 |
68,8 |
51800 |
66,2 |
2007 |
32,2 |
(*) Hors demandes en référé devant le premier président de la cour d’appel.
Source : SDSE-RGC
Le taux d’appel des jugements rendus par la formation de jugement présidée par le juge départiteur est supérieur de 6 % au taux d’appel des jugements rendus sans départage, sans doute en raison de la nature du litige.
Par ailleurs, moins d’une affaire sur trois poursuivie en appel est confirmée dans toutes ses dispositions ; la cour d’appel infirme partiellement la décision dans la moitié des cas, et infirme totalement la décision du conseil de prud’hommes dans plus d’une affaire sur cinq.
Toutefois, le taux de confirmation totale est supérieur de 22 % lorsque le jugement est rendu après départage selon le ministère de la Justice.
TAUX DE CONFIRMATION ET D’INFIRMATION DES DÉCISIONS DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES STATUANT SUR LA DEMANDE
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total des décisions statuant sur la demande |
33 137 |
32 398 |
32 110 |
29 094 |
30 568 |
33 595 |
32 941 |
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions |
7 834 |
7 200 |
7 491 |
6 373 |
6 638 |
7 158 |
7 085 |
Infirme (*) partiellement, reforme ou modifie certaines dispositions |
13 637 |
14 065 |
14 302 |
13 392 |
14 126 |
16 947 |
16 157 |
Confirme la décision déférée dans tous ses dispositions |
11 666 |
11 133 |
10 317 |
9 329 |
9 804 |
9 490 |
9 699 |
Taux de confirmation sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (en %) |
35,2 |
34,4 |
32,1 |
32,1 |
32,1 |
28,2 |
29,4 |
(* )Le rapporteur thématique considère qu’en toute rigueur, il faut constater qu’un taux d’infirmation partielle est également un taux de confirmation partielle.
Source : SDSE-RGC
Le constat de ces différents dysfonctionnements, partagé unanimement par l’ensemble des acteurs, montre qu’il est urgent d’engager une réforme d’envergure pour rénover la justice prud’homale. Il convient notamment d’en améliorer l’efficacité, d’accélérer les délais de jugement et de restaurer sa légitimité.
Sur le fondement des constats précédemment exposés, le présent article entreprend de réformer le statut des acteurs de la justice prud’homale − les juges prud’homaux et les défenseurs syndicaux – afin de renforcer leurs droits et obligations, ainsi que leur formation. Afin de diminuer les délais de jugement devant les conseils de prud’hommes, il propose également de réformer la procédure devant les conseils de prud’hommes et d’encourager la médiation dans un cadre extrajudiciaire.
S’inspirant d’une proposition du rapport de M. Lacabarats selon lequel « la valorisation de la justice prud’homale passe par un renouvellement de la réflexion sur la formation, l’indemnisation, la déontologie, la discipline des juges prud’homaux », l’article 83 entreprend dans un premier temps de mieux encadrer juridiquement les droits et les devoirs auxquels sont assujettis les conseillers prud’hommes.
Les conseillers prud’homaux exercent leur fonction à temps partiel et pour une durée définie dans une juridiction spécialisée. À ce titre, ils ne sont pas soumis au statut des magistrats pris en application de l’article 64 de la Constitution. Mais les conseillers prud’hommes n’en sont pas moins des juges, investis du pouvoir de trancher les litiges relevant de leur compétence. Aussi, à l’instar des autres juges non professionnels, les conseillers prud’hommes sont soumis à un certain nombre d’obligations déontologiques, définies notamment par le code du travail.
En application de l’article L. 1442-12 du code du travail, le conseiller prud’homme a une obligation de statuer ; il ne peut refuser de juger, sous peine d’être déclaré démissionnaire. Il doit également prêter serment d’exercer ses fonctions « avec zèle et intégrité » et « de garder le secret des délibérations ». L’indépendance du juge prud’homal se traduit par l’interdiction du mandat impératif, fixée à l’article L. 1442-11 du code du travail. Le conseiller prud’homme doit en outre faire preuve d’impartialité, d’honnêteté – il ne peut mettre ses fonctions au service de ses propres intérêts – et de compétence dans l’exercice de ses fonctions.
Dans la pratique, le rapport de M. Alain Lacabarats souligne que les règles déontologiques sont parfois méconnues des conseillers prud’hommes, soit en raison d’une formation insuffisante, soit en raison de l’imprécision qui les entoure. Il est donc proposé de réaffirmer les règles déontologiques auxquelles doivent se soumettre l’ensemble des conseillers prud’homaux.
● Le 1° du I insère un nouvel article L. 1421-2 dans le code du travail qui énonce clairement l’ensemble des obligations déontologiques qui s’appliquent aux conseillers prud’hommes. Le premier alinéa de l’article L. 1421-2 dispose que ces derniers doivent exercer leur fonctions « en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ».
L’indépendance doit ainsi permettre de donner sa véritable portée à l’interdiction du mandat impératif dont les modalités sont précisées par la nouvelle rédaction de l’article L. 1442-11 du même code proposée au 11° du I du présent article : elle s’oppose à ce qu’une organisation syndicale ou patronale intervienne auprès des conseillers prud’hommes dans le cadre de la procédure prud’homale, de quelque manière que ce soit − instructions, recommandations, etc. −, car le juge prud’homal ne saurait représenter de quelque manière que ce soit l’organisation syndicale qui l’a désigné ou sous le nom de laquelle il a été élu.
L’impartialité s’entend dans une double dimension, objective et subjective : le juge prud’homal doit par exemple se comporter de manière impartiale à l’audience, et s’abstenir de juger dans toute affaire dans laquelle il aurait des intérêts.
Quant aux devoirs de probité et de dignité, ils découlent tous deux du principe d’intégrité du juge. Le devoir de probité implique le respect des dispositions légales par le conseiller prud’homal ; ce dernier doit également éviter tout comportement indélicat. Le devoir de dignité suppose que le juge s’abstienne d’utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants, selon la définition donnée par le Conseil supérieur de la magistrature (199).
● La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1421-2 vise par ailleurs à soumettre les conseillers prud’hommes au devoir de réserve. Ce devoir implique, d’une part, de s’abstenir, « notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions » et de respecter, d’autre part, le secret des délibérations, comme le rappelle le deuxième alinéa de l’article L. 1421-2 nouvellement créé.
Le rapporteur thématique considère que le projet de loi peut être source de malentendus : s’adressant à des membres d’organisations syndicales, il peut être compris comme portant atteinte à l’exercice de leurs fonctions syndicales. Tel n’est évidemment pas l’objet du texte qui vise la réserve dans l’exercice des fonctions et relativement aux affaires dont un conseiller peut avoir à connaître. Pour dissiper toute ambigüité, le rapporteur propose par conséquent de supprimer la référence au devoir de réserve.
● Le troisième alinéa de l’article L. 1421-2 nouveau dispose enfin que les conseillers ont interdiction de conduire « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ». Cette disposition, qui revient à interdire le droit de grève des conseillers prud’hommes, fait écho à l’interdiction du droit de grève applicable aux magistrats. Selon les informations transmises aux rapporteurs, cette formulation, qui se borne à reprendre l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut des magistrats, ne saurait porter atteinte, le cas échéant, au libre exercice du mandat syndical des conseillers prud’hommes.
Malgré cette ordonnance, des mouvements de grève ont pu être observés dans des juridictions composées de magistrats professionnels. L’avant-projet de loi organique relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire envisage de préciser que seule sera interdite l’action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions et portant atteinte aux libertés individuelles. Par conséquent, le rapporteur thématique propose d’aménager le droit de grève des conseillers prud’homaux en limitant ce droit aux seuls cas où le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.
Afin de compléter ce dispositif législatif, l’étude d’impact indique que le Conseil supérieur de la prud’homie sera chargé d’élaborer et de rendre public un guide déontologique des juges prud’homaux, destiné à expliciter et préciser les sens des obligations déontologiques définies par le présent article, selon des conditions précisées par décret.
● Afin d’améliorer les connaissances juridiques et procédurales des conseillers prud’hommes, les 9° et 10° du I procèdent à une importante refonte du système de formation des conseillers prud’hommes, en conférant à la formation initiale un caractère obligatoire.
La formation des conseillers prud’homaux est actuellement prévue aux articles L. 1442-1, L. 1442-2 et D. 1442-1 à D. 1442-10 du code du travail et financée par l’État. Son organisation est déléguée à des établissements publics d’enseignement supérieur ou de formation des personnels de l’État, ainsi qu’à des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu au niveau national au moins 150 sièges aux dernières élections prud’homales. La liste des établissements agréés est fixée par un arrêté du ministère du travail ; dix-huit organismes de formation ont reçu cet agrément à ce jour.
Or la formation des conseillers prud’hommes se révèle insatisfaisante à plusieurs égards. Le caractère facultatif de la formation conduit la plupart des conseillers prud’homaux à s’exonérer d’une formation exhaustive à l’exercice de leurs fonctions : en moyenne, les conseillers se forment 13 jours par mandature, alors qu’ils disposent d’un maximum de 36 jours pour s’y consacrer. D’ailleurs, sur les huit millions de crédits annuels réservés à la formation prud’homale, seuls 87 % de ces crédits sont effectivement consommés.
En outre, le contenu de la formation est peu encadré et porte insuffisamment sur les techniques de procédure et de conduite du procès, selon le rapport de M. Alain Lacabarats. Ce dernier regrette par ailleurs que les formations dispensées par les organisations syndicales soient « naturellement orientées », car « il est des domaines que tout juge doit apprendre à connaître de manière neutre : l’aptitude à la conciliation, la conduite du procès, la procédure, etc. ».
● Pour corriger ces dysfonctionnements, le 9° du I du présent article insère deux nouveaux alinéas à l’article L. 1442-1 du code du travail qui instaurent une obligation de formation initiale pour l’ensemble des conseillers prud’hommes. Le premier alinéa dispose que la formation obligatoire des conseillers prud’hommes se décompose en deux parties :
– Une formation initiale « à l’exercice de leur fonction juridictionnelle » ;
– Une formation continue, qui doit intervenir au cours du mandat du conseiller.
En pratique, la formation prud’homale continue ne fait pas l’objet de modifications majeures dans le cadre de cet article. Contrairement à la formation initiale obligatoire, elle continuera d’être assurée intégralement par les organismes de formation agréés actuels. En revanche, le contenu de la formation pourra aborder de nouvelles thématiques, en complémentarité de la formation initiale obligatoire, et se concentrer sur l’actualisation des connaissances en droit du travail.
S’agissant de la formation initiale, en revanche, il est précisé que le fait de ne pas se soumettre à l’obligation de la suivre sera sanctionné ; le second alinéa inséré à l’article L. 1442-1 indique en effet que nul ne peut déroger à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret, sous peine d’être déclaré démissionnaire.
Par ailleurs, selon les informations transmises aux rapporteurs, un tronc commun de formation initiale, portant plus spécifiquement sur les thématiques et techniques liées à la procédure, à la déontologie, aux spécificités de la tenue d’une audience et à la méthodologie de rédaction d’une décision de justice, sera élaboré dans des conditions déterminées par décret.
L’École nationale de la magistrature (ENM) ainsi que les cours d’appel devraient participer à la mise en place de ce tronc commun de formation initiale, mais les modalités précises de ces participations ne sont pas arrêtées à ce jour.
L’instauration de cette obligation de formation initiale obligatoire doit, selon l’étude d’impact, « permettre aux conseillers prud’hommes nouvellement désignés d’appréhender au mieux les enjeux socio-économiques des dossiers, la technique juridique et les règles déontologiques ». Elle doit également encourager « une homogénéisation des pratiques », en permettant à l’ensemble des conseillers prud’hommes, salariés comme employeurs, de disposer des mêmes connaissances initiales relatives à la procédure prud’homale.
● Afin de satisfaire à l’obligation de formation initiale, le 10° du I insère un nouvel alinéa à l’article L. 1442-2 du même code qui prévoit que tout employeur doit accorder cinq jours d’autorisation d’absence aux salariés de son entreprise membres d’un conseil de prud’hommes. Cette durée est supérieure à la durée moyenne des formations initiales dispensées aujourd’hui : selon l’étude d’impact, la plupart des formations initiales durent entre une et cinq journées, la moyenne s’établissant à trois jours. Les cinq jours d’autorisation d’absence s’ajoutent aux six semaines réservées à la formation prévues par le premier alinéa de l’article L. 1442-2 dans sa rédaction actuelle ; ces six semaines pourront dès lors être plus spécifiquement consacrées à la formation continue.
Comme pour l’ensemble des dispositions du texte, sauf mention contraire, un décret en conseil d’État précisera les conditions d’application de cet article (V).
Le régime disciplinaire des conseillers prud’hommes repose actuellement sur les articles L. 1442-11 à L. 1442-18 du code du travail ainsi que sur les articles D. 1442-20 et suivants du même code, qui renvoient partiellement au code de l’organisation judiciaire et au code de procédure civile. Outre certaines interdictions, telles que l’interdiction d’accepter un mandat impératif, le régime disciplinaire actuel fixe les différentes sanctions applicables aux conseillers prud’hommes en cas de manquement à leurs devoirs.
Mais selon l’étude d’impact, cette procédure disciplinaire est inadaptée : entre 2005 et octobre 2014, sur un total de 87 signalements reçus, seules 16 sanctions ont été prononcées, dont deux arrêtés de censure, huit arrêts de suspension provisoire et six décrets de déchéance. Les paragraphes 11° à 16° du présent article entreprennent donc de réformer l’ensemble du régime disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes.
En raison de l’obligation d’indépendance du juge prud’homal, ce dernier ne peut accepter sous aucune condition un mandat impératif : ce principe est fixé à l’article L. 1442-11 dans sa rédaction actuelle. Le 11° du I de cet article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1442-11, qui maintient l’interdiction du mandat impératif au premier alinéa, mais propose de substituer à l’expression « à quelque époque » les termes « avant ou après son entrée en fonction », dans un souci de précision.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1442-11 reste inchangé. En revanche, l’alinéa 25 du présent article modifie au troisième alinéa de l’article L. 1442-11 les références aux conditions de déchéance du mandat, afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées aux 13° et 14° du I du présent article.
• La faute disciplinaire
Dans la rédaction actuelle de l’article L. 1442-13 du code du travail, tout conseiller prud’homme manquant à ses devoirs est susceptible d’être appelé « devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés », l’initiative de cette procédure appartenant conjointement au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République.
Le 12° du I propose une nouvelle rédaction globale de l’article L. 1442-13 du code du travail qui dispose que « tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire ».
Outre la création de la notion de « faute disciplinaire » applicable aux conseillers prud’hommes, le 12° supprime donc l’initiative conjointe du président du conseil de prud’hommes et du procureur de la République, en raison de la création d’une commission nationale de discipline au 13° du I, chargée d’exercer le pouvoir disciplinaire.
• L’avertissement
Le 13° du I du présent article insère trois nouveaux articles dans le code du travail. Le premier d’entre eux, l’article L. 1442-13-1, propose de conférer aux premiers présidents de cours d’appel le pouvoir de délivrer un avertissement aux conseillers des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
Cette disposition, qui s’inspire du modèle du pouvoir pré-disciplinaire des premiers présidents sur les magistrats du siège de l’ordre judiciaire (200), vise à renforcer le rôle des premiers présidents des cours d’appel en matière de contrôle des conseils de prud’hommes, afin d’éviter tout blocage en leur sein.
Le rapporteur thématique considère toutefois que le terme d’ « avertissement » est inadapté, puisqu’il renvoie à la notion de sanction disciplinaire, alors que cet avertissement doit précisément intervenir « en dehors de toute sanction disciplinaire ». Le rapporteur propose donc de substituer au terme d’ « avertissement » un simple rappel aux obligations du conseiller prud’homme.
• La redéfinition des sanctions applicables aux conseillers prud’hommes
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1442-14 du code du travail définit trois niveaux de sanctions applicables aux conseillers prud’hommes : la censure (1° de l’article L. 1442-14), la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois (2°) et la déchéance (3°).
Le 14° du I propose une nouvelle rédaction globale de l’article L. 1442-14 afin de définir une nouvelle échelle de sanctions disciplinaires, ces termes se substituant à celui de « peines » :
– au 1° de l’article L. 1442-14 nouvellement rédigé, la censure est remplacée par « le blâme » (1°) ;
– la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois est maintenue au 2° ;
– au 3°, la déchéance est assortie d’une « interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans » ;
– enfin, une nouvelle sanction est créée au 4° : « la déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme ».
Le présent article renforce d’une part le niveau des sanctions applicables aux conseillers prud’hommes, et il simplifie d’autre part la procédure d’édiction d’une sanction, puisqu’en vertu du 13°, le pouvoir disciplinaire exercé à l’encontre des conseillers prud’hommes revient entièrement à la commission nationale de discipline nouvellement créée.
RÉFORME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES À L’ARTICLE L. 1442-14 DU CODE DU TRAVAIL
Rédaction actuelle |
Nouvelle rédaction proposée | |||
« Les peines applicables aux conseillers prud’hommes sont » : |
« Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont » : | |||
Type de sanction |
Prononcée par |
Type de sanctions |
Prononcée par | |
1° |
Censure |
Arrêté ministériel |
Blâme |
Commission nationale de discipline |
2° |
Suspension pour une durée maximale de six mois |
Suspension pour une durée maximale de six mois | ||
3° |
Déchéance |
Décret |
Déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pendant une durée maximale de dix ans | |
4° |
− |
Déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme | ||
• La suspension à titre conservatoire
Le 15° du I propose une nouvelle rédaction globale de l’article L. 1442-16 du code du travail relatif à la procédure de suspension conservatoire d’un conseiller prud’homme. Deux cas de figure sont concernés : s’il existe contre un conseiller prud’homme des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire, ou si ce conseiller fait l’objet de poursuites pénales.
Dans ces deux situations, le nouvel article L. 1442-16 donne la possibilité au président de la commission nationale de discipline créée au 13° du I du présent article – c’est-à-dire un président de chambre de la Cour de cassation – de suspendre provisoirement de ses fonctions un conseiller prud’homme, pour une durée ne pouvant excéder six mois. La suspension doit être proposée soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le premier président de la cour d’appel compétent. Le conseiller prud’homme susceptible d’être suspendu doit par ailleurs être préalablement entendu par le premier président de la cour d’appel.
En cas de faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire, l’article donne au président de la commission nationale de discipline le pouvoir de renouveler une fois l’interdiction temporaire, pour une durée maximale de six mois. En revanche, en cas de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé, la suspension peut être ordonnée « jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive » et n’est donc pas soumise au délai de six mois.
Cette disposition s’inspire directement de la procédure de suspension applicable aux juges des tribunaux de commerce et définie à l’article L. 724-4 du code de commerce.
En l’état actuel du droit, les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont à l’initiative ou prononcées soit :
– par le président du conseil de prud’hommes ou par le procureur de la République, en cas de manquement à ses devoirs d’un conseiller ;
– par arrêté ministériel, pour les cas de censure et de suspension ;
– par décret, pour la déchéance ;
– par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près de cette cour, lorsque le ministre est saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud’homme.
Or cette procédure pose un certain nombre de difficultés ; en particulier, le fait que les poursuites disciplinaires puissent être exercées par le président du conseil de prud’hommes lui-même va à l’encontre du principe d’impartialité des juges.
Le rapport de M. Alain Lacabarats suggérait deux pistes de réforme de la procédure disciplinaire : l’une consistant à élargir les attributions du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en matière disciplinaire aux juges prud’homaux ; l’autre proposant la création d’une instance disciplinaire ad hoc, sur le modèle de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce créée en 2006. Dans la mesure où les conseillers prud’hommes, magistrats du siège non professionnels, ne relèvent pas du statut de la magistrature défini à l’article 64 de la Constitution, c’est la seconde option qui a été retenue dans le cadre du présent article.
Les paragraphes 13° et 16° du I proposent ainsi la création d’une commission nationale de discipline en charge d’exercer l’ensemble du pouvoir disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes.
● Au 13° du I, les alinéas 30 à 36 insèrent deux nouveaux articles dans le code du travail.
L’article L. 1442-13-2 dispose que « le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline » et en définit les modalités de présidence et la composition.
La commission nationale de discipline serait ainsi présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation. La composition de la commission ainsi que le mode de désignation de chacun des membres, tels que proposés aux alinéas 31 à 35 du présent article, sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Composition de la commission |
Mode de désignation |
1° Un membre du Conseil d’État |
Vice-président du Conseil d’État |
2° Deux magistrats du siège des cours d’appel |
Premier président de la Cour de cassation, sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel |
3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme |
Représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie. |
4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme |
Représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie. |
Le dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 indique que des suppléants en nombre égal sont désignés « dans les mêmes conditions ». En outre, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans.
L’article L. 1442-13-3 précise le mode de saisine de la commission nationale de discipline : celle-ci peut être saisie « par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui-ci par le premier président ».
● Le 16° du I insère également deux nouveaux articles dans le code du travail.
L’article L. 1442-16-1 définit les conditions de délibération de la commission nationale de discipline : il fixe un quorum de quatre membres, « y compris le président », dont la présence est requise pour le délibéré. Il dispose également qu’en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Enfin, l’article L. 1442-16-2 nouveau dispose que les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Selon les termes du rapport Lacabarats, cette obligation de motivation « est une exigence procédurale qui fait corps avec la notion de procès équitable, car elle permet, d’une part, d’exposer le raisonnement qui a conduit au dispositif de la décision, et, d’autre part, éventuellement le contrôle ».
L’étude d’impact précise que les décisions de la commission nationale de discipline ont un caractère juridictionnel et qu’elles peuvent à ce titre faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Comme pour l’ensemble des dispositions de l’article 83, les autres règles applicables à la commission nationale de discipline seront fixées par voie réglementaire (V).
Afin de redonner un intérêt à la procédure de conciliation et de réformer la procédure prud’homale, les 2°, 3°, 8° et 19° proposent de transformer les missions du bureau de conciliation, en créant notamment une formation de jugement restreinte et en lui donnant la capacité de renvoyer directement une affaire devant le juge départiteur.
• La nouvelle dénomination du bureau de conciliation
L’article 83 propose de transformer le bureau de conciliation en un « bureau de conciliation et d’orientation » pour enrichir et diversifier ses missions, tout en préservant le principe fondamental de recherche de la conciliation entre les parties.
Le 2° du I opère tout d’abord un changement de l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code du travail relative au Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé. Le nouvel intitulé retenu pour cette section est « Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé ».
De même, les 3° et 8° du I substituent respectivement dans les articles L. 1235-1, L. 1454-2, L. 1454-4 et L. 1423-13 du code du travail les termes « bureau de conciliation et d’orientation » aux termes de « bureau de conciliation ».
En outre, le b) du 19° du I rétablit un nouvel article L. 1454-1 dans le code du travail, qui procède également au changement de dénomination du bureau de conciliation en un « bureau de conciliation et d’orientation ».
• Une nouvelle mission d’orientation en cas d’échec de la conciliation
Les nouvelles missions confiées au bureau de conciliation et d’orientation visent à réduire les délais de jugement en orientant plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.
Le b) du 19° du I rétablit un article L. 1454-1 dans le code du travail qui réaffirme que la mission principale du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) est de « concilier les parties ».
Les deux nouveaux articles que le b) du 19° propose d’insérer après l’article L. 1454-1 définissent quant à eux une nouvelle procédure en cas d’échec de la conciliation, qui vise à réformer en profondeur la procédure devant les conseils de prud’hommes en diminuant notamment les délais de jugement. Le a) du 19° procède pour sa part à une simple modification de coordination, l’article L. 1454-1 devenant l’article L. 1454-1-3.
● Lorsque le litige porte sur « un licenciement » ou « une demande de résiliation judiciaire », l’article L. 1454-1-1 nouveau crée une nouvelle procédure à suivre en cas d’échec de la conciliation. En 2013, près de huit affaires sur dix concernaient un licenciement (78,1 %) ; cette nouvelle procédure est donc susceptible d’être utilisée dans la majorité des litiges portés devant les conseils de prud’hommes.
Dans ces deux situations, l’article propose qu’après avoir obtenu l’accord des deux parties, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) puisse renvoyer l’affaire « devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 », c’est-à-dire devant un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié, contre au minimum deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers salariés dans la composition habituelle du bureau de jugement. Toutefois, si les parties s’opposent au renvoi devant cette formation restreinte, l’article L. 1451-1-1 prévoit que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dans sa composition habituelle.
Le passage devant la commission de jugement dans la composition restreinte est censé permettre de diminuer les délais de jugement, puisque l’article L. 1454-1-1 dispose que le bureau de jugement dans sa composition restreinte doit statuer « dans un délai de trois mois », contre 15,1 mois en moyenne pour les affaires traitées devant le bureau de jugement en 2013.
Enfin, si le bureau de jugement en composition restreinte estime que le dossier ne relève pas de sa compétence, ou en cas de partage des voix, l’affaire serait renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454-2 du même code, c’est-à-dire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur.
● En second lieu, en cas d’échec de la conciliation, l’article L. 1454-1-2 nouveau autorise le bureau de conciliation et d’orientation à renvoyer certaines affaires directement devant la formation présidée par le juge professionnel, c’est-à-dire sans passer au préalable devant le bureau de jugement.
Plusieurs conditions sont énoncées pour encadrer ce renvoi du BCO vers la formation présidée par le juge départiteur.
Le premier alinéa dispose tout d’abord que le renvoi est « d’office » si le BCO estime que « la nature de l’affaire » le justifie. Cette disposition part du principe que certaines affaires peuvent, dès l’origine, être détectées comme relevant d’une formation avec juge départiteur, le plus souvent parce qu’il s’agit d’affaires sérielles, ou d’affaires posant une question de droit nouvelle.
En dehors de ces affaires, les juges prud’homaux pourraient considérer que certains litiges peuvent être utilement proposés à une formation où siégerait le juge départiteur. Le second alinéa de l’article L. 1454-1-2 énonce ainsi d’autres possibilités de renvoi vers la formation de jugement présidée par un juge professionnel :
– Le renvoi est « de droit » si toutes les parties le demandent ;
– Si une partie demande le renvoi mais pas les autres parties, il revient au BCO de trancher. Il peut décider de renvoyer l’affaire soit devant le bureau de jugement dans sa composition habituelle, c’est-à-dire deux conseillers prud’hommes salariés et deux conseillers prud’hommes employeurs, soit il peut la renvoyer devant la formation de jugement présidée par un juge professionnel.
– Si le BCO ne parvient pas à se mettre d’accord sur la demande formulée par une des parties, il est prévu que l’affaire soit renvoyée de plein droit vers la formation de jugement présidée par un juge professionnel.
Enfin, il est précisé que l’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement présidée par le juge professionnel, c’est-à-dire que le juge départiteur ne peut statuer seul en cas d’absence d’un conseiller.
Dans tous les cas de figure prévus à l’article L. 1454-1-2, il est précisé que le BCO se prononce « par simple mesure d’administration judiciaire », c’est-à-dire, selon l’article 537 du code de procédure civile, que ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.
L’objectif visé par cette disposition est à nouveau de raccourcir les délais de jugement d’une affaire, en évitant aux parties de se rendre devant la formation de jugement dans sa composition habituelle, lorsque le litige soumis au conseil de prud’hommes donne habituellement lieu à départage.
Le présent article vise également à faciliter ou à modifier les conditions de l’intervention de juges professionnels dans la procédure prud’homale.
Lorsqu’un conseil de prud’hommes rencontre des difficultés pour se constituer ou ne peut fonctionner, l’article L. 1423-8 du code du travail donne compétence au premier président de la cour d’appel pour désigner un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes.
Le 5° du I du présent article restreint la portée de cet article aux seuls cas de défaut de constitution du conseil de prud’hommes, et propose de supprimer la compétence du tribunal d’instance pour lui substituer celle d’ « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel ».
Le 6° du I est une disposition de coordination – l’article L. 1423-11 devient l’article L. 1423-11-1 – car le 7° propose une nouvelle rédaction globale de l’article L. 1423-11.
En l’état actuel du droit, l’article L. 1423-11 prévoit qu’en cas d’interruption durable du fonctionnement d’un conseil de prud’hommes, ce dernier peut être dissous par décret motivé. Dans l’attente de l’organisation de nouvelles élections, les litiges sont portés devant le conseil de prud’hommes le plus proche du domicile du demandeur ou, à défaut, devant le tribunal d’instance. Or le rapport de M. Lacabarats a souligné que cette procédure n’est en pratique pas mise en œuvre, en raison de sa lourdeur mais également parce que les délais de traitement constatés dans les conseils de prud’hommes ne permettent pas de traiter rapidement le surcroît d’affaires engendré par le transfert d’activité.
Le 7° du I propose par conséquent dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1423-11 de confier à un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel, désignés par le premier président de la cour d’appel, le soin de connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes « en cas d’interruption durable du fonctionnement d’un conseil de prud’hommes » ou « de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales ». Dans la rédaction proposée, il reviendrait également au premier président de la cour d’appel de fixer la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou ces juges.
Cette situation s’appliquerait jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner : alors, « il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil ».
Ces dispositions devraient permettre, quelle que soit l’origine de la paralysie d’un conseil de prud’hommes, d’assurer la permanence et la continuité de la justice prud’homale.
Dans le cadre de la refonte des missions du bureau de conciliation et d’orientation, le paragraphe 19° du I du présent article permet de renvoyer plus rapidement une affaire devant la formation de départage. En conséquence, la composition de la formation de départage ainsi que le rôle du juge départiteur sont revus par les 4° et 20° du I.
• Le rôle du juge départiteur
Tirant les conséquences du recours accru au juge départiteur dans la procédure prud’homale, le 4° du I propose de l’associer plus régulièrement au fonctionnement du conseil de prud’hommes, en insérant un nouvel alinéa à l’article L. 1423-3 du code du travail qui dispose que le juge départiteur peut assister, « à sa demande et au moins une fois par an », à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. Cette dernière réunit les conseillers prud’hommes à la demande du premier président de la cour d’appel, de la majorité des membres en exercice, du président ou du vice-président.
Cette volonté d’associer le juge départiteur s’explique par sa présence de plus en plus fréquente aux côtés des conseillers prud’hommes, lorsqu’il s’agit de trancher les litiges qui n’ont pu faire l’objet de départage entre les conseillers représentant les salariés et ceux représentant les employeurs. Le juge départiteur sera ainsi amené à formuler un avis sur les décisions relatives à la vie de la juridiction prud’homale, telles que l’organisation des audiences. Il ne participera cependant pas aux décisions relatives à la désignation des présidents et vice-présidents du conseil de prud’hommes, des sections, des chambres et formations de jugement.
• La composition de la formation de départage
Le 20° du I du présent article propose par ailleurs de modifier la composition de l’instance de départage convoquée en cas de partage des voix.
En l’état actuel du droit, en vertu de l’article L. 1454-2 du code du travail, la formation de départage est présidée par un juge du tribunal d’instance, désigné par le premier président de la cour d’appel. Le a) du 20° propose de supprimer cette compétence du juge d’instance pour confier la présidence de la formation de départage à un juge du tribunal de grande instance (TGI), dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
Le b) modifie le mode de désignation des juges appelés à présider la formation de départage. Il prévoit que les juges du tribunal de grande instance seront désignés annuellement par le président du TGI, et non plus par le premier président de la cour d’appel. Ces juges devront être désignés « en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières ».
Enfin, le c) supprime le troisième alinéa de l’article L. 1454-2 qui précisait les conditions de désignation du juge d’instance en cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un TGI ; cet alinéa devient en effet obsolète en raison de la modification de la compétence du juge d’instance effectuée par le a) du 20°.
Ces différentes réformes pourront nécessiter davantage de moyens humains. L’étude d’impact prévoit ainsi que la charge supplémentaire pourra nécessiter entre 28 à 71 postes supplémentaires en équivalent temps plein travaillé (ETPT). Cette estimation, relativement peu élevée, tient compte des hypothèses de redéploiement des juges professionnels tout au long de la procédure prud’homale. Selon les estimations réalisées par le ministère de la Justice et transmises aux rapporteurs, la formule retenue permet de mobiliser moins de juges professionnels que d’autres réformes envisagées, telles que l’échevinage, qui aurait nécessité la création de 359 postes.
S’inspirant d’une proposition du rapport de M. Alain Lacabarats, le IV de l’article 83 prévoit une nouvelle procédure permettant de solliciter l’avis de la Cour de cassation en matière prud’homale. Il propose en effet de compléter l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire par un nouvel alinéa, qui dispose que « le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale » peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation « avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif ».
Deux conditions sont requises pour solliciter l’avis de la Cour de cassation : la convention ou l’accord doit présenter « une difficulté sérieuse » et doit être susceptible de se poser « dans de nombreux litiges ».
Cette procédure existe depuis 1991 pour les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle devrait permettre d’unifier l’interprétation des règles de droit en matière prud’homale, en évitant les décisions contradictoires sur un même sujet, permettant ainsi de sécuriser juridiquement les contentieux.
L’article 83 s’intéresse également au rôle des défenseurs syndicaux. Ces derniers, délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés, peuvent assister ou représenter en justice les parties devant le conseil de prud’hommes, comme en dispose l’article R. 1453-2 du code du travail. En 2013, 86,5 % des demandeurs étaient assistés ou représentés lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes. Parmi eux, 82,6 % étaient assistés ou représentés par un avocat, et 15,4 % par un délégué syndical.
Or il n’existe aucun statut relatif aux conditions de recrutement, de formation ou de travail des défenseurs syndicaux ; seules des autorisations d’absences, à hauteur de dix heures par mois, sont actuellement prévues par l’article L. 1453-4 du code du travail, qui précise que ces absences ne peuvent faire l’objet d’une rémunération.
Les défenseurs syndicaux ne bénéficient donc pas du statut de salariés protégés et exercent cette fonction bénévolement.
Les paragraphes 17° et 18° du I proposent de créer un véritable statut des défenseurs syndicaux, afin de sécuriser l’intervention de ces derniers devant les juridictions prud’homales et de renforcer leurs droits.
● Le 17° propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1453-4 du code du travail visant à définir les missions du défenseur syndical. Selon la rédaction proposée, le défenseur syndical exerce « des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ».
Le second alinéa de cet article prévoit l’inscription du défenseur syndical sur une liste, arrêtée par l’autorité administrative, présentée par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national. Il est précisé qu’un décret précise les conditions d’inscription sur cette liste.
● Le 18° propose d’insérer cinq nouveaux articles après l’article L. 1453-4 du code du travail visant à définir ou préciser les droits, obligations et modalités de protection des défenseurs syndicaux.
En premier lieu, l’article L. 1453-4-1 nouveau reprend et complète les dispositions de l’actuel article L. 1453-4 relatives aux autorisations d’absence des défenseurs syndicaux. Il consacre d’ailleurs l’expression « défenseur syndical » dans le code du travail, en la substituant aux termes de « salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national ».
Le nouvel article L. 1453-4-2 modifie le statut des heures consacrées par les défenseurs syndicaux à l’assistance et à la représentation aux prud’hommes. Le premier alinéa reprend le principe défini à l’article L. 1453-4 selon lequel le temps passé par le défenseur syndical pour accomplir sa mission est « assimilé à une durée de travail effectif ».
Mais contrairement à la rédaction actuelle de l’article L. 1453-4, le second alinéa de l’article L. 1453-4-2 nouveau dispose que les absences sont « rémunérées par l’employeur », cette rémunération n’entraînant « aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants ».
Afin de ne pas pénaliser les employeurs dont les salariés s’absentent pour accomplir leur mission de défenseur syndical, l’article prévoit le remboursement par l’État des salaires maintenus pendant ses absences, ainsi que « des avantages et des charges sociales correspondants ». S’agissant des modalités d’indemnisation des défenseurs syndicaux exerçant leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, ou dépendant de plusieurs employeurs, il est prévu qu’un décret détermine les modalités d’indemnisation de ces défenseurs.
L’article L. 1453-4-3 nouveau prévoit que l’employeur doit accorder au défenseur syndical, sur demande de ce dernier, des autorisations d’absence « pour les besoins de sa formation ». L’article prévoit que ces autorisations peuvent être délivrées deux semaines d’absence par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
À l’instar des conditions prévues pour le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale définies à l’article L. 3142-12 du code du travail, ces autorisations ne peuvent être imputées sur la durée des congés annuels. En outre, elles sont assimilées à une durée de travail effectif « pour la détermination des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail ».
Le second alinéa de l’article L. 1453-4-3 nouveau dispose enfin que ces absences pour formation sont rémunérées par l’employeur. À ce titre, elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1 du même code, qui définit les conditions de versement de la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Le nouvel article L. 1453-4-4 dresse ensuite une liste des obligations et devoirs qui s’imposent au défenseur syndical. Ce dernier est ainsi tenu, d’une part, au respect du secret professionnel s’agissant de toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, ainsi qu’à une obligation de discrétion s’agissant des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. En cas de méconnaissance de ces obligations par le défenseur syndical, l’article L. 1453-4-4 prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de radier le défenseur de la liste des défenseurs syndicaux.
Afin de mieux protéger l’intervention du défenseur syndical, l’article L. 1453-4-5 nouveau dispose enfin que l’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut en aucun cas être une cause de rupture du contrat de travail.
Afin de limiter le nombre d’affaires portées devant les conseils de prud’hommes, le projet de loi souhaite développer en matière prud’homale les procédures de médiation et de conciliation conventionnelle intervenant en amont de tout litige.
La recherche de solutions aux litiges négociées en dehors du cadre judiciaire constitue un mouvement important du droit du travail actuel. En complément de la revalorisation du rôle du bureau de conciliation et d’orientation, les II et III proposent par conséquent d’étendre aux litiges soulevés en matière de travail l’application de deux procédures de conciliation extrajudiciaire qui n’existent actuellement qu’en matière civile.
Le II propose d’abroger l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative modifié par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, qui dispose que la médiation conventionnelle ne s’applique aux différends s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
La médiation visée par ledit article concerne tout processus par lequel deux parties ou plus tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. L’accord auquel les parties parviennent peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
L’exclusion du champ prud’homal de la médiation avait fait suite aux réserves exprimées par le Conseil supérieur de la prud’homie le 26 mai 2011 sur le fondement que, selon le code du travail, seul le conseil de prud’hommes est compétent pour régler ces litiges, par voie de conciliation ou de jugement.
En supprimant l’article 24 de la loi du 8 février 1995, le II du présent article autoriserait les parties à un litige s’élevant en matière de contrat de travail à recourir à la médiation, définie aux articles 21 à 21-5 de la loi n° 95-125 précitée, pour régler leurs litiges internes, tout en sécurisant juridiquement le résultat de cette médiation grâce à la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour faire homologuer judiciairement l’accord conclu.
Le recours à la médiation resterait toutefois facultatif, et ne se substituerait en aucun cas à la procédure de conciliation obligatoire devant les conseils de prud’hommes. Certaines personnes auditionnées par le rapporteur thématique ont toutefois émis plusieurs réserves sur l’extension de la médiation en matière prud’homale puisque, d’une part, le recours à la médiation ne serait pas gratuit et que d’autre part, la médiation ne serait pas soumise aux règles de procédure prévalant au sein de la juridiction prud’homale, à l’instar du respect du contradictoire.
Le III vise par ailleurs à étendre la possibilité de conciliation dans un cadre extra-judiciaire, en supprimant le second alinéa de l’article 2064 du code civil, qui interdisait la conclusion d’une convention de procédure participative pour la résolution de tout litige s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail.
La convention de procédure participative, instaurée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires et présentée à l’article 2062 du code civil, est un mode de résolution amiable des différends qui s’exerce en dehors de la saisine d’un juge ou d’un arbitre.
Il s’agit d’une convention, écrite – à l’inverse de la procédure orale qui prévaut devant les conseils de prud’hommes –, conclue par des parties assistées par avocat. Pendant la durée de la convention, selon l’article 2065 du code civil, tout recours au juge est irrecevable.
En 2010, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait choisi d’exclure la matière prud’homale du champ de la convention de procédure participative (201), afin de préserver la tentative préalable de conciliation devant les conseils de prud’hommes. Le III du présent article propose de supprimer cette exception, en considérant que cette procédure est complémentaire des tentatives de conciliation réalisées devant les conseils de prud’hommes.
En cas d’échec de la convention, les parties peuvent saisir le juge, et sont, en vertu du second alinéa de l’article 2066 du code civil, dispensées de conciliation devant le juge. Le rapporteur thématique considère toutefois que cette dernière disposition est inappropriée en matière prud’homale, dans la mesure où la recherche de conciliation, réalisée par le bureau de conciliation, permet également la mise en état de l’affaire et, à l’avenir, l’orientation des affaires vers la formation de jugement appropriée.
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté vingt-quatre amendements au présent article, dont dix-sept amendements rédactionnels des rapporteurs.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a tout d’abord adopté un amendement visant à supprimer la référence au devoir de réserve des conseillers prud’hommes, afin de lever toute ambigüité sur l’éventuelle restriction de l’activité syndicale des conseillers prud’hommes suggérée par la notion de « réserve ».
La commission spéciale a également adopté un amendement des rapporteurs visant à aménager l’exercice du droit de grève des conseillers prud’hommes. L’interdiction de l’action concertée des conseillers prud’hommes est limitée aux seuls cas où le renvoi d’une affaire en raison d’une action concertée « risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».
La commission spéciale a ensuite adopté un amendement prévoyant l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pendant une durée maximale de dix ans, fixée par le juge, en cas d’acceptation d’un mandat impératif.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a également adopté un amendement visant à remplacer l’avertissement prononcé par les premiers présidents de cour d’appel à l’encontre des conseillers prud’hommes par un simple rappel à leurs obligations, qui s’exerce en dehors de toute action disciplinaire.
Elle a ensuite adopté un amendement des rapporteurs visant à ce que les deux magistrats du siège des cours d’appel désignés membres de la commission nationale de discipline créée par le projet de loi soient un homme et une femme, tout comme les deux représentants des salariés et les deux représentants des employeurs membres de la commission.
La commission spéciale a également adopté, à l’initiative des rapporteurs, un amendement modifiant la réforme de la procédure prud’homale proposée dans le projet de loi. Outre plusieurs modifications rédactionnelles ou de conséquence, les principales modifications sont les suivantes :
– en cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur une demande de renvoi vers la formation de jugement restreinte ou vers la formation de jugement présidée par le juge départiteur, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 du code du travail, composé de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs ;
– dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1454-1-1 du même code, le renvoi vers la formation de jugement présidée par le juge départiteur n’est plus autorisé que dans deux situations : si le bureau de conciliation et d’orientation en décide d’office en raison de la nature du litige, ou si toutes les parties le demandent.
Enfin, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs permettant le maintien de la procédure de conciliation devant le conseil de prud’hommes en cas d’échec de la convention de procédure participative.
*
* *
La Commission se saisit d’abord des amendements de suppression SPE119 de M. Gérard Cherpion et SPE453 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. C’est la troisième fois cette année que nous abordons la question de la justice prud’homale : un premier texte a été retiré, un deuxième texte a établi un régime transitoire.
Aujourd’hui, vous nous présentez un article fleuve de plus de sept pages, qui aborde des sujets aussi divers et aussi cruciaux que la déontologie, la formation et les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes… Vous voulez procéder à une réforme de fond de la procédure de la justice prud’homale. Or cela n’a pas grand’chose à faire dans un projet de loi destiné à relancer la croissance et l’activité dans notre pays. Le fonctionnement des prud’hommes conditionnerait-il le développement économique de la France ? Nous n’adhérons pas à cette vision économique de la justice.
Cet article devrait être porté par le ministre du travail dans un projet de loi spécifique.
Ces propositions sont majoritairement issues du rapport rendu par M. Lacabarats à la ministre de la justice – rapport qui devait servir de support à une concertation qui n’a jamais eu lieu. Cela explique la demande unanime des partenaires sociaux de disjoindre la section relative à la prud’homie du présent projet de loi. Par respect du dialogue social, je me rallie à cette position.
M. Patrick Hetzel. Le décalage est immense entre l’ambition affichée de ce texte – rendre la justice prud’homale plus simple, plus prévisible, plus efficace, améliorer la formation des juges, raccourcir les délais… – et la réalité.
La question des délais, en particulier, n’est pas traitée de façon pertinente : les retards ne viennent pas en général des tribunaux eux-mêmes ; souvent, ce sont les conseils des parties qui demandent à repousser le procès. Les retards ne sont donc pas imputables à l’organisation des prud’hommes.
De plus, le juge départiteur n’intervient aujourd’hui que lorsque les quatre juges prud’homaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Si vous vous penchez sur la question, vous constaterez que les magistrats professionnels ont déjà les plus grandes difficultés à tenir les délais. Or, en prévoyant un recours plus rapide à la formation de départage, vous allez significativement augmenter leur charge de travail. Prévoyez-vous de recruter des magistrats ? Il existe un risque significatif de dégradation de la justice prud’homale.
M. le ministre. Avis défavorable.
M. le président François Brottes. Chers collègues, je vous propose de mettre aux voix dès maintenant ces amendements de suppression et de renvoyer les explications complètes du rapporteur thématique, Denys Robiliard, sur cet article au début de la séance de ce soir.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements SPE119 et SPE453.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n’interviendrai, à ce stade, que sur la partie du texte relative à la réforme prud’homale, qui fait l’objet de l’article 83. Nous aborderons plus tard diverses dispositions qui ont trait au droit du travail : le licenciement, le délit d’entrave, l’inspection du travail.
La France compte 210 conseils de prud’hommes et quelque 15 000 conseillers prud’hommes. Il s’agit de juridictions paritaires au sein desquelles employeurs et employés ont le même nombre de représentants, et qui sont composées de deux collèges. Les conseillers sont aujourd’hui élus et seront prochainement désignés, au terme de leurs mandats de cinq ans qui ont été prorogés par deux fois, pour deux années chacune, par le Parlement, et auront donc duré neuf ans.
Les conseils de prud’hommes ont une longue histoire, dont les racines remontent au Moyen Âge. Le plus connu est le conseil de prud’hommes de Lyon, institué par Napoléon Ier le 18 mars 1806. Le 27 mai 1848, sous la IIe République, la parité est instituée. Dès 1907, les femmes y deviennent électrices, puis, en 1908, éligibles, ce qui prouve la modernité de cette institution, généralisée comme juridiction du travail par la loi Boulin du 18 janvier 1979.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation et, à défaut, par jugement, les litiges individuels du travail – ceux qui opposent, à propos du contrat de travail, un salarié à un employeur. Dans 99 % des cas, ils sont saisis par des salariés. Dans près de 98 % des cas, le contrat de travail a déjà cessé, soit qu’il ait été rompu, soit qu’il soit arrivé à son terme : en 2013, seules 4 332 affaires, sur un total de quelque 200 000, ont impliqué des salariés encore sous contrat. 92 % des affaires ont trait à la rupture du contrat de travail. Une petite minorité de saisines, 3 493 au total, concernaient un licenciement économique ; les autres portaient sur un licenciement disciplinaire ou pour une autre cause, telle que l’aptitude ou la compétence du salarié. Bref, le conseil de prud’hommes, aujourd’hui, est surtout le juge de la rupture du contrat de travail.
L’idée communément admise est que la conciliation fait la spécificité du conseil de prud’hommes. À une certaine époque, en effet, elle aboutissait dans quelque 90 % des affaires. Cette époque est depuis longtemps révolue, puisqu’aujourd’hui ce taux est inférieur à 6 %. Le jugement, qui ne devait intervenir que par défaut, est donc devenu la règle. Certains s’interrogent, dès lors, sur le bien-fondé de la procédure de conciliation, et c’est ce qui motive la réforme.
C’est le paritarisme qui fait la grandeur de cette institution. Pour ma part, j’y vois une formidable université populaire, et il n’est pas indifférent que ce soient des salariés et des employeurs qui rendent la justice au nom du peuple français, au sujet des relations qui les lient. Comme vous le savez, devant le bureau de jugement, leurs représentants sont deux contre deux, et le juge départiteur intervient dans 20 % des cas, ce qui signifie qu’une fois sur cinq ils ne se mettent pas d’accord. On peut estimer que c’est beaucoup, mais on peut aussi souligner, de façon plus optimiste, qu’il y a accord dans 80 % des cas, ce qui n’est pas rien, s’agissant de juger des situations individuelles qui sont forcément conflictuelles.
Il faut cependant se méfier des statistiques et des moyennes. Dans certains conseils, le taux de départage est très faible, parfois inférieur à 3 % ; dans ma circonscription, à Blois, il est de 10 %, il en est de même à Tours, mais ailleurs il peut dépasser les 30 %. C’est alors l’essence même de l’institution, le paritarisme, qui est en cause, puisqu’en cas de départage on a recours à un juge dit départiteur, magistrat professionnel attaché au tribunal d’instance du ressort du conseil concerné.
Le problème majeur est celui des délais, de plus en plus longs et en constante augmentation. En 2004, lorsque l’affaire s’arrêtait en première instance au bureau de jugement, il fallait en moyenne 12,8 mois pour juger une affaire ; en 2013, il fallait 15,1 mois, soit 2,3 mois de plus, ce qui est considérable. Il faut plus de temps, donc, pour obtenir une décision du conseil de prud’hommes que du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance – TGI – ou du tribunal de commerce. Lorsque l’on en vient à la départition, c’est-à-dire lorsque l’on fait appel au juge, ce délai s’accroît encore, et de façon significative. Il fallait 22,10 mois en 2004, et 29,7 mois en 2013, soit un allongement de 7,5 mois en neuf ans. Cela signifie que le délai est aujourd’hui de 14 mois entre le passage devant le bureau de jugement et le départage, alors même que la loi prévoit l’intervention du juge dans un délai d’un mois. On observera au passage que, dans les bureaux de jugement, les délais ont augmenté de 18 %, tandis que les délais d’intervention du juge départiteur se sont allongés de 34 %.
J’ai entendu Patrick Hetzel dire que ces délais ne sont pas imputables aux conseillers prud’hommes mais aux conseils des parties, avis que je partage partiellement. Il y a un problème d’organisation et les conseillers ne sont pas en cause, la preuve étant que les délais augmentent davantage lorsque le juge intervient. Ce n’est donc pas le non-professionnalisme des conseillers qui est cause de l’allongement des délais. Cependant, si M. Hetzel a eu la délicatesse d’évoquer les « conseils » plutôt que les avocats – je le suis moi-même de profession –, ces derniers, avec leurs qualités et leurs défauts, ne sont pas à l’origine du problème : ils sont les mêmes aujourd’hui qu’hier. Je crois fondamentalement qu’il s’agit d’un problème de moyens et qu’il faut intégrer le juge dans l’institution. La seule explication rationnelle à l’augmentation des délais en ce qui concerne les bureaux de jugement, c’est l’insuffisance des moyens de la justice, qui a été frappée au même titre que les autres administrations par la révision générale des politiques publiques – RGPP.
Une autre motivation de la réforme est le taux d’appel, très important : 67 % en 2013, soit les deux tiers, pour les jugements rendus en premier ressort. En comparaison, ce taux est de 13,2 % dans les tribunaux de commerce, de 5,3 % dans les tribunaux d’instance et de 19,7 % dans les tribunaux de grande instance. Cela est-il dû au non-professionnalisme des conseillers ? Je ne le pense pas, puisque, entre les tribunaux d’instance et les TGI, composés les uns et les autres de magistrats professionnels, la différence est du simple au quadruple. La comparaison avec une juridiction entièrement échevinée est parlante : s’agissant ainsi des décisions des tribunaux paritaires des baux ruraux, qui ne traitent que 1 500 affaires par an et sont présidés par un magistrat professionnel, le taux d’appel est de 50 %, soit plus du double que pour les décisions des TGI. J’ajoute que le taux d’appel des décisions des conseils de prud’hommes est supérieur de 6 points quand le juge départiteur intervient. Ce n’est donc pas la qualité du magistrat professionnel qui est en cause, mais la complexité de l’affaire qui nécessite son intervention, puis conduit à l’appel plus fréquemment que dans les autres cas.
Le taux de réformation des décisions constitue un autre motif de préoccupation. On distingue la confirmation totale, cas dans lequel la cour d’appel valide complètement la décision du premier juge, de la confirmation partielle, qui est également, dans les faits, une infirmation partielle, portant sur certains chefs de demande, et cette infirmation partielle se distingue également de l’infirmation totale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le taux de confirmation totale était de 35,20 % en 2007, de 29,44 % en 2013 ; le taux de confirmation partielle était, quant à lui, de 44,25 % en 2007, de 49,04 % en 2013 ; le taux d’infirmation totale, enfin, était de 23,64 % en 2007, de 21,5 % en 2013.
Je propose de raisonner à partir de deux chiffres que l’on peut juger terribles : le taux de réformation partielle ou totale était de l’ordre des deux tiers en 2007, de 70 % en 2013. Mais, l’infirmation partielle étant aussi une confirmation partielle, on peut considérer, à l’inverse, que ce sont, en 2007 comme en 2013, 80 % des affaires qui donnent lieu à une confirmation partielle ou totale. Il me semble que l’honnêteté commande de donner les deux chiffres : dans la mesure où j’ai mentionné le taux d’appel en cas d’intervention du juge départiteur, il faut dire que le taux de réformation est alors supérieur à 20 %. Lorsque tous les chefs de demandes sont confirmés, le taux est de 1,2 fois supérieur lorsque le juge départiteur est intervenu ; on voit là la marque du professionnalisme.
Tel est le tableau de la situation. Il présente des nuances, des difficultés de lecture, mais il convient d’être objectif au sujet de juges qui font leur travail et s’estiment injustement dénigrés. Il faut reconnaître aussi que la non-conciliation n’est pas une bonne chose et que le taux de recours au départage est à améliorer, de même que le taux d’appel, car l’esprit de l’institution, qui est le paritarisme, n’est pas respecté lorsque les affaires sont jugées, in fine, par des magistrats professionnels : c’est un constat d’échec.
Quelles sont les réponses proposées par le projet de loi ?
Une partie de la magistrature considère que l’échevinage est la bonne solution. C’est ce que le rapport de M. Didier Marshall sur « la justice au XXIe siècle » propose clairement. Le ministre de la justice a toutefois commandé à M. Alain Lacabarats, président de la chambre sociale de la Cour de cassation, un rapport, rendu au mois de juillet dernier, dont la lettre de mission indiquait de ne pas recommander l’échevinage. J’ai auditionné M. Lacabarats, et il a en effet considéré que cette juridiction paritaire pouvait fonctionner sans échevinage. Par ailleurs, beaucoup de ses propositions, susceptibles de réduire considérablement les délais, concernent la procédure. Relevant du domaine réglementaire, elles ne figurent pas, par définition, dans le projet de loi.
La première de ces propositions consiste à formaliser davantage la saisine, qui ne l’est pas assez aujourd’hui. Un bordereau de communication de pièces serait établi et adressé à l’employeur, qui est le défendeur dans 99 % des cas. La deuxième consiste en un premier échange avant la conciliation. L’employeur remettrait ses pièces au greffe du conseil de prud’hommes, ce qui permettrait à la conciliation d’avoir lieu non pas à dossier clos, comme aujourd’hui, mais à dossier ouvert sur la base des pièces communiquées par les deux parties. La troisième proposition concerne l’oralité de la procédure, qui a d’ailleurs été réformée pour le tribunal d’instance. Le souhait du ministère de la justice est d’instituer une clôture, c’est-à-dire une date au-delà de laquelle pièces et conclusions ne peuvent plus être échangées. Cela permettrait de limiter le nombre des renvois devant les bureaux de jugement.
Sur le plan législatif, il faut réformer l’amont de la saisine des prud’hommes – ce qui n’est pas l’ordre dans lequel nous discuterons ces propositions, mais je souhaite respecter l’ordre logique dans ma présentation. Il s’agit d’éviter autant que possible la judiciarisation. Le Gouvernement souhaite – ce qui est contesté par les conseillers prud’hommes – que les techniques de la médiation et de la procédure participative soient désormais ouvertes aux litiges individuels du travail.
Une autre mesure importante vise à améliorer l’image d’indépendance et d’impartialité des conseillers prud’hommes par la réforme de leur statut, de leur déontologie et de leur discipline. Une formation commune d’une semaine sera instituée, qui portera sur la procédure, le contradictoire, la façon de rédiger les jugements et, éventuellement, les techniques de conciliation. Actuellement, les conseillers sont formés par des instituts de droit du travail, proches de telle ou telle organisation syndicale ou patronale. Cette partie commune aux deux collèges serait dispensée par l’École nationale de la magistrature, éventuellement par l’École nationale des greffes, enfin par les cours d’appel. En revanche, les six semaines de formation continue dont disposent ou peuvent disposer les conseillers prud’hommes seraient maintenues. Sur les trente jours de formation proposés, seuls treize, en moyenne, sont utilisées ; c’est l’un des rares domaines où les crédits prévus, qui s’élèvent à huit millions d’euros par an, ne sont pas consommés entièrement – le taux est de 87 %.
Un autre élément de la réforme concerne les suites de la conciliation. Il faut, pour réduire les délais, que le juge départiteur puisse intervenir plus vite : il deviendrait président de bureau de jugement dans les cas où il n’y a pas recours au départage. Actuellement, il y a trois modes de saisine du juge sans départage : sur décision du bureau d’orientation et de conciliation ; sur demande des deux parties ; sur demande de l’une des parties avec l’accord de l’un des deux conseillers du bureau de conciliation. Je présenterai tout à l’heure un amendement qui vise à supprimer le troisième mode.
Par ailleurs, l’affaire pourrait être renvoyée, avec l’accord des deux parties, devant une formation restreinte, composée d’un représentant de chacun des deux collèges, ce qui permettrait d’obtenir une décision dans les trois mois.
Reste la réforme, d’ailleurs contestée, du statut de ce que l’on appelle aujourd’hui le délégué syndical, et qui serait désormais dénommé défenseur syndical, qu’il assiste le salarié ou l’employeur. Il faut cependant reconnaître que, dans les faits, cette assistance est exercée le plus souvent par un avocat : les salariés ne sont assistés que dans 13 % des cas par un délégué syndical, les employeurs dans 3 % des cas.
M. le président François Brottes. Merci, monsieur le rapporteur, pour la clarté de votre exposé, qui répond par avance, j’en suis sûr, à bon nombre des questions que vos collègues souhaitaient poser…
M. le ministre. Le rapporteur a effectivement été exhaustif, ce qui me permettra d’être plus bref. Pour répondre aux préoccupations de M. Cherpion, je rappelle qu’il y a bien eu concertation avec les partenaires sociaux. Le Conseil supérieur de la prud’homie s’est réuni le 26 novembre dernier, et chacune des organisations syndicales et patronales a été reçue par le ministre du travail dans les semaines qui ont suivi. La procédure prévue a donc été respectée. Cela n’implique pas que les partenaires sociaux soient d’accord avec la réforme mais, compte tenu des constats établis, il appartient aux pouvoirs publics de faire leur devoir, l’accord des partenaires sociaux ne constituant pas un préalable.
Cette réforme préserve le paritarisme, elle tend à réduire les délais de jugement et à rendre la procédure plus efficace. Elle ne remet pas en cause la qualité des conseillers prud’hommes, bien au contraire. Il s’agit d’une réforme organisationnelle, mais aussi, pour une partie, d’une réforme de moyens, qui permet de mieux structurer la phase de conciliation, dont les résultats sont parfois médiocres : il est possible de les améliorer, même si, dans 98 % des cas, le contrat de travail est déjà rompu.
M. Jean-Patrick Gille. Le débat est très ouvert, et l’on constate un accord général sur la nécessité de réduire les délais. Le rapporteur thématique a fourni honnêtement tous les éléments, mais j’ai un doute quant à la méthode. Le taux d’appel, tout comme le taux de rupture des contrats doivent nous interpeller. Il y a dans le texte un non-dit à ce sujet : le fait que l’employeur fasse appel dans deux cas sur trois et que le taux d’infirmation soit plus élevé en cas d’intervention du juge départiteur posent problème. Il est paradoxal, dès lors, de limiter la procédure de conciliation.
Les modifications d’ordre réglementaire évoquées par le rapporteur thématique sont bienvenues. Il est vrai que, généralement, les deux parties souhaitent aller vite et arrivent mal préparées ; il est vrai aussi que les conseils ont tendance à demander des délais pour gagner du temps, au détriment de la conciliation. Celle-ci n’est donc plus guère prise au sérieux, et ce d’autant moins que, si le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, l’appel n’est pas possible.
Je comprends la logique des propositions qui tendent à recourir plus vite au juge, mais cela conduit à l’échevinage, qui est contraire à la culture et l’esprit des prud’hommes. Le risque, en outre, est de se heurter au manque de juges départiteurs.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1579 des rapporteurs.
L’amendement SPE816 de M. Jean-Louis Roumegas est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement SPE919 de Mme Jacqueline Fraysse et de l’amendement SPE1616 des rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à supprimer une rédaction qui risque de limiter le droit des conseillers prud’hommes à exercer une activité militante. Il est certes légitime que les devoirs d’indépendance, d’impartialité et de dignité des conseillers soient réaffirmés, et qu’ils ne puissent intervenir dans aucun mouvement concernant l’entreprise sur laquelle ils auraient à statuer. Mais il n’y a aucune raison de les brider dans leurs activités militantes, d’autant qu’ils sont souvent délégués syndicaux.
M. le ministre. Je comprends votre position, madame Fraysse, et je reconnais une possible ambiguïté, dans la rédaction, quant à la compatibilité entre l’exercice du mandat et une activité syndicale. Je vous propose cependant de retirer votre amendement au profit de l’amendement SPE1616 des rapporteurs, qui propose une rédaction plus précise.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Dans sa formulation actuelle, la seconde phrase du troisième alinéa, qui reprend celle de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, pourrait avoir pour effet de restreindre l’activité syndicale des conseillers prud’hommes, ce qui n’est nullement dans l’esprit de la réforme. Je propose donc de supprimer les mots « la réserve que leur imposent », qui sont inappropriés à leur situation.
Mme Jacqueline Fraysse. La proposition du rapporteur thématique est intéressante et je la soutiendrai si mon amendement, que je maintiens néanmoins, n’est pas adopté.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE919.
Elle adopte l’amendement SPE1616.
L’amendement SPE830 de M. Jean-Louis Roumegas est retiré.
La Commission examine l’amendement SPE921 de Mme Jacqueline Fraysse et l’amendement SPE1920 des rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à supprimer une rédaction qui interdirait aux conseillers prud’homaux tout mouvement de grève. C’est en effet la nature syndicale de leur engagement qui fait la richesse du paritarisme.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le texte reprend la rédaction de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, qui a son âge, il est vrai, et qui doit être prochainement modifié. Il est arrivé, du reste, que des magistrats professionnels observent des mouvements de grève.
L’amendement SPE1920 que j’ai déposé précise toutefois que l’action concertée en question ne serait pas possible « lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».
La formation de référé qui connaît des demandes pour des paiements de salaire, des remises de certificats de travail ou d’attestations Pôle emploi doit, même en cas de mouvement de grève, pouvoir fonctionner pour que les salariés puissent obtenir un titre afin de faire valoir leurs droits. En cas de prise d’acte de rupture, il peut y avoir une urgence particulière à faire reconnaître qu’elle était bien fondée. Ce ne sont là que des exemples et une jurisprudence se développera, encore que je n’espère ne pas voir les actions concertées se multiplier.
Mme Jacqueline Fraysse. Ces explications répondent partiellement à mes préoccupations, mais je maintiens l’amendement, ne serait-ce que pour que ce débat ait lieu en séance publique.
Mme Véronique Louwagie. La rédaction de l’amendement du rapporteur m’inquiète, car les termes sont très subjectifs : que signifient des « conséquences irrémédiables ou manifestement excessives » ? Le rapporteur thématique a donné des exemples pour, ensuite, nous dire de façon peu rassurante que la jurisprudence allait « se développer ». Je crains surtout que ce soient les contentieux qui se développent, car la définition est beaucoup trop large, et ne permet pas de répondre aux questions soulevées par Jacqueline Fraysse. Les juges des prud’hommes agissant dans le cadre d’un mandat, le droit de grève, qui concerne les salariés, leur est-il applicable ? Je suis très dubitative.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je constate que les mouvements de grève existent chez les magistrats et que ceux-ci ont toujours réussi à s’organiser pour qu’une permanence soit assurée, notamment afin de préserver les libertés individuelles. Je pense que les conseils de prud’hommes sauront faire preuve du même esprit de responsabilité. Le statut que nous construisons se fonde sur celui des magistrats, en aménageant certaines de ses dispositions.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE921.
Elle adopte l’amendement SPE1920.
Elle examine ensuite l’amendement SPE1374 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Le texte prévoit la possibilité de renvoyer directement les affaires au juge départiteur, ce qui n’est pas dans l’esprit de l’institution des prud’hommes. Par ailleurs, les magistrats sont en nombre insuffisant et nous n’avons pas de garanties du Gouvernement, loin de là, quant aux moyens qui seront consentis pour accompagner la réforme.
Au demeurant, il est curieux que cette réforme figure dans un texte consacré à la croissance et l’activité. Le sujet mériterait de faire l’objet d’un projet de loi ad hoc, défendu par le ministre de la justice.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 6 et 7, 15 et 16, 63 à 72.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. J’ai exposé le sens de cette réforme, et l’amendement SPE1933 rectifié que j’ai déposé, et qui viendra en discussion tout à l’heure, en reprend l’architecture.
En fonction de la nature de l’affaire, et lorsque les juges estimeront qu’elle est prête à être jugée, ils pourront proposer aux parties de passer devant une formation restreinte à deux conseillers. Il est vrai que cette réforme suppose une réorganisation, puisque ce ne sera plus un juge d’instance qui interviendra, mais un juge du TGI. Cela permettra de bénéficier de la spécialisation plus grande de cette juridiction, ainsi que d’une gestion plus souple de l’effectif de magistrats en son sein. L’étude d’impact montre que la réforme ne peut réussir sans moyens supplémentaires, et j’ai reçu toutes assurances sur ce point. Je suis donc défavorable à l’amendement.
M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur thématique, d’autant que l’amendement auquel il vient de faire allusion supprime plusieurs procédures existantes et simplifie le dispositif. L’économie de la réforme, c’est la simplification et la sécurisation des procédures. Le but est de rendre une meilleure justice pour les salariés, en particulier les plus fragiles, et pour les entreprises, notamment les plus petites. Il s’agit d’accélérer la procédure tout en conservant les fondamentaux de l’institution.
La Commission rejette l’amendement SPE1374.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1622 et SPE1580 des rapporteurs.
Elle étudie ensuite l’amendement SPE922 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 qui prévoient, pour les litiges portant sur un licenciement ou sur une demande de réalisation judiciaire, la constitution d’un bureau réduit à deux conseillers au lieu de quatre aujourd’hui. Cette juridiction restreinte risque de placer les juges dans un face-à-face conflictuel susceptible d’aboutir à encore plus de demandes de départage.
Ce qui nous gêne le plus est la mise en cause de la collégialité, qui risque de porter atteinte à la qualité des décisions. Le fait d’avoir quatre juges issus d’autant de milieux professionnels et d’organisations syndicales différentes, constitue une garantie de richesse et d’impartialité des débats. Accepter ce « un contre un », c’est se résigner à ce qu’il y ait un fort et un faible, et des décisions déséquilibrées.
M. le ministre. La collégialité commence à deux, madame Fraysse… J’ajoute qu’il n’y a pas, au sein du conseil de prud’hommes, le rapport de subordination qui existe entre un salarié et son employeur. Mon avis est donc défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Si le fait que les conseillers ne soient que deux était une atteinte à l’impartialité, cela vaudrait aussi pour les bureaux d’orientation et de conciliation et pour les formations de référé, où ils siègent actuellement à deux. Il y a bien, comme vient de le dire le ministre, une collégialité, restreinte certes, mais avec des garanties puisque c’est le bureau de conciliation et d’orientation qui demandera le renvoi en formation restreinte et qu’il faudra, en outre, que les deux parties soient d’accord. Mon avis est donc défavorable.
La Commission rejette l’amendement SPE922.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE1785 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit de préciser clairement que les six semaines de formation actuelle sont maintenues et qu’on y ajoute simplement cinq jours de formation spécialisée, organisée par la magistrature.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1785.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel SPE1562 des rapporteurs.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE823 rectifié de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Je retire cet amendement.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. C’est dommage, car j’y étais favorable ! (Rires.)
M. le ministre. Moi aussi !
M. Jean-Louis Roumegas. Dans ce cas, je le maintiens…
La Commission adopte l’amendement SPE823 rectifié.
Elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1581 des rapporteurs.
Elle étudie ensuite l’amendement SPE924 de Mme Jacqueline Fraysse et l’amendement SPE1563 des rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous proposons de supprimer l’alinéa 29, qui prévoit que le président de la cour d’appel peut sanctionner par un avertissement un conseiller prud’homme, sans aucune procédure. Cette absence de procédure, contraire au principe du contradictoire ainsi qu’aux droits de la défense, s’inscrit dans une gestion autoritaire des conseillers prud’hommes. Par notre amendement, nous voulons souligner qu’aucune sanction, même mineure, ne peut être mise en œuvre en dehors d’une procédure disciplinaire permettant à la personne accusée d’entendre ce qu’on lui reproche et de s’expliquer.
M. le ministre. Vous avez raison, madame Fraysse, le terme d’« avertissement » est impropre, mais je vous suggère de vous rallier à l’amendement SPE1563 du rapporteur, qui emploie l’expression, préférable, de « rappeler à leurs obligations ».
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le mot « avertissement », sans être impropre en soi – c’est là ma divergence avec le ministre – prend une résonance particulière, il est vrai, dans le contexte prud’homal, car il s’agit, en droit du travail, d’une sanction disciplinaire, alors qu’il revêt, s’agissant de magistrats, un caractère seulement pré-disciplinaire. La rédaction de mon amendement vise à lever toute équivoque.
L’amendement SPE924 est retiré.
La Commission adopte l’amendement SPE1563.
La commission examine, en discussion commune les amendements SPE1875 des rapporteurs et SPE1468 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Mon amendement est la réécriture d’un amendement proposé par la délégation aux droits des femmes, qui tend à rendre la commission de discipline paritaire, non pas au sens que prend ce terme dans le contexte prud’homal, mais au sens de la parité entre hommes et femmes. Je propose donc d’écrire, par exception, « un magistrat et une magistrate » et « un représentant et une représentante ».
L’amendement SPE1468 est retiré.
La Commission adopte l’amendement SPE1875.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1564 et SPE1778 des rapporteurs.
L’amendement SPE831 de M. Jean-Louis Roumegas est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1565 et SPE1771 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE449 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux. Le recours à un défenseur syndical les priverait des garanties offertes par l’auxiliaire de justice qu’est l’avocat. Le dispositif proposé, qui privilégie le défenseur syndical, est un peu réducteur. Nous proposons de le supprimer.
M. le ministre. En pratique, les parties sont souvent représentées en première instance et en appel, bien que la procédure ne l’impose pas. Le Gouvernement souhaite renforcer, dans les règles de représentation prud’homales, la place des représentants syndicaux et leur donner un statut pour professionnaliser cette fonction. Plusieurs articles du texte développent les garanties nécessaires qui seront attachées à ce statut.
En outre, il est proposé que l’appel des décisions des conseillers des prud’hommes soit jugé selon la procédure avec représentation obligatoire. Afin de tenir compte de la spécificité de ce contentieux, le Gouvernement souhaite que cette représentation obligatoire soit assurée par un avocat ou un défenseur syndical, ce qui est conforme à l’esprit paritaire de la réforme. En conséquence, avis défavorable à la suppression de ces alinéas.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. En l’état, la représentation n’est pas obligatoire : elle est du domaine de la représentation facultative ou de l’assistance. Mais il est question de la rendre obligatoire, par voie réglementaire, au stade de l’appel, et les avocats s’en inquiètent. Cela dit, la défense syndicale est une pratique très ancienne des syndicats de salariés. Il serait inconcevable de la remettre en cause. Elle s’exerce aujourd’hui devant les conseils des prud’hommes et a connu une diminution, passant de 16 % à 13,5 % en cinq ans. Les avocats ont toute leur place dans la défense prud’homale mais ils n’ont pas toute la place.
M. Patrick Hetzel. Je maintiens l’amendement, d’autant que ce nouveau statut engendre des dépenses nouvelles qui n’ont pas été inscrites dans la loi de finances pour 2015.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Les dispositions entreront en application dans un an. C’est donc le projet de loi de finances pour 2016 qui devra les intégrer. Le coût sera modeste, puisqu’il s’agit de financer dix heures par mois et par défenseur syndical – ces défenseurs, précisons-le, ne sont pas des permanents syndicaux. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement SPE449.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1786 et SPE1566 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE927 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Ce texte crée enfin un statut pour les défenseurs syndicaux et nous nous en félicitons. Cependant, il ne précise pas que le défenseur syndical est un salarié protégé au même titre que les représentants des salariés dans l’entreprise, les conseilleurs prud’homaux ou les conseillers du salarié. Cette protection spécifique définie aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail est pourtant justifiée, dans la mesure où ces salariés sont amenés à prendre la parole publiquement pour défendre d’autres salariés, s’exposant ainsi à d’éventuels actes de rétorsion de la part des employeurs. Cet amendement vise donc à faire du défenseur syndical un salarié protégé.
M. le ministre. L’activité du défenseur syndical n’étant pas exercée au sein de l’entreprise, en faire un salarié protégé n’aurait guère de sens. En outre, les dispositions de droit commun sur la nullité de toute mesure discriminatoire en raison de l’exercice d’activités syndicales sont très larges et permettent de couvrir les cas de figure que vous évoquez. Le statut de salarié protégé serait, de ce point de vue, exorbitant. Par ailleurs, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal renforcent encore la protection contre d’éventuelles discriminations. Je suggère donc le retrait de l’amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Sur le fond, je suis sensible à l’amendement. L’activité du défenseur syndical s’exerce certes en dehors de l’entreprise, mais c’est également le cas du conseiller du salarié, qui bénéficie, lui, d’une protection.
En revanche, je ne pense pas que la rédaction de l’amendement soit adaptée. Ne pourrions-nous réfléchir à une rédaction commune, madame Fraysse, que nous présenterions en séance publique ? En l’état, je suggère le retrait.
Mme Jacqueline Fraysse. Je suis d’accord pour y retravailler. C’est un amendement auquel je tiens d’autant plus que l’argumentation du ministre ne me convainc pas. Nous en reparlerons en séance publique.
M. le ministre. J’y suis tout disposé.
M. le président François Brottes. Retirez-vous l’amendement, ma chère collègue ?
Mme Jacqueline Fraysse. Non.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis défavorable, donc.
M. le président François Brottes. Il est plus facile pour le rapporteur thématique d’être soutenu par un retrait pour remonter au front sur des amendements auxquels le Gouvernement n’est pas favorable, madame Fraysse. Le maintien affaiblit sa position.
Mme Jacqueline Fraysse. Denys Robiliard a l’habitude de travailler avec moi en commission des affaires sociales. Il sait que je soutiendrai farouchement toutes ses initiatives pour peu qu’elles aillent dans le bon sens !
La Commission rejette l’amendement SPE927.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1787et SPE1788 des rapporteurs.
Elle est saisie de l’amendement SPE584 de Mme Laure de La Raudière.
M. Gilles Lurton. L’article 83 du projet de loi crée un statut de défenseur syndical chargé d’assister le salarié et pouvant le représenter. Il instaure également un maintien du salaire pendant les heures d’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois remboursées à l’employeur par l’État. Or nous ne disposons d’aucune estimation du coût de cette mesure dans l’étude d’impact, ce qui est d’autant plus étonnant que le budget consacré à l’aide juridictionnelle est déjà dépassé chaque année. Devons-nous considérer que l’on recourra au fonds de péréquation que nous avons créé pour financer l’aide juridictionnelle et les maisons de justice ?
C’est aussi une nouvelle complexité pour les entreprises, qui vont devoir avancer ces fonds pour se les faire rembourser ensuite – dans les délais que l’on sait – par l’État.
Rappelons que les salariés peuvent déjà se faire assister par un représentant syndical ou par un délégué du personnel, notamment lors d’un entretien préalable à un licenciement. En outre, les syndicats disposent de moyens financiers de la part de l’État, et ces fonctions d’assistance entrent dans les attributions qui justifient leur existence.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cette rémunération assurée par l’employeur et remboursée ultérieurement par l’État.
M. le ministre. Ces sommes, mobilisables à partir de 2016, sont relativement réduites. Le dispositif de maintien du salaire et de remboursement par l’État est déjà bien connu des employeurs, puisqu’il s’applique pour les conseillers prud’hommes et les conseillers du salarié. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis défavorable pour les mêmes raisons qu’à l’amendement précédent.
La Commission rejette l’amendement SPE584.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1567 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE928 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Le nouveau statut prévoit un droit à une formation spécifique pour laquelle le détenteur d’un mandat de défenseur syndical pourra demander des autorisations d’absence. L’amendement vise à préciser que cette autorisation lui est accordée automatiquement : il doit être clair – et c’est le sens du texte – que l’employeur a l’obligation d’accorder ces congés pour formation.
M. le ministre. Cette précision n’est pas utile dans la mesure où l’alinéa 47 ne prévoit aucune possibilité, pour l’employeur, de refuser lesdites autorisations d’absence. L’adverbe « automatiquement » n’apporterait rien ; il introduirait au contraire des incohérences rédactionnelles au sein du code du travail.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. En droit, l’indicatif vaut impératif. Il n’est laissé aucune possibilité à l’employeur de refuser. Il ne faudrait pas aller jusqu’à assortir tous les verbes à l’indicatif de la mention « et sans refus possible » !
L’amendement SPE928 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1770 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE930 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’alinéa 60, que nous proposons de supprimer par cet amendement, prévoit que le défenseur syndical « est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ».
Nous ne contestons pas, bien entendu, que le défenseur soit tenu de ne pas divulguer les secrets de fabrication dont il aura eu connaissance du fait du dossier qu’il traite. Il n’en va pas de même pour les autres informations. Or, tel que l’alinéa est rédigé, c’est l’employeur qui décide seul du caractère confidentiel ou non des informations, donc, in fine, de ce que le défenseur pourra ou ne pourra pas dire.
On constate d’ailleurs que le patronat utilise de plus en plus l’argument de l’obligation de discrétion face aux représentants du personnel, et qu’il s’agit trop souvent d’un moyen de freiner, voire d’entraver, l’action syndicale : les représentants des salariés finissent par ne plus savoir ce qu’ils ont le droit de communiquer ou non. Pour une action efficace, le défenseur syndical ne doit pas être dans la crainte permanente de violer telle ou telle information au gré des humeurs patronales !
M. le ministre. Il serait inopportun de supprimer cette obligation de discrétion, d’autant que, dans le dispositif proposé, le défenseur syndical peut se substituer à l’avocat. Ne pas le soumettre à une telle obligation ruinerait notre argumentation en faveur de la préservation de son rôle y compris en empiétant sur le monopole théorique de l’avocat. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’obligation de discrétion est aussi dans l’intérêt du défenseur syndical. Celui-ci intervenant par définition dans un litige prud’homal, les éléments que l’employeur donne pour sa défense sont publics. Il ne peut les rendre confidentiels. Mais d’autres éléments doivent être confidentiels : d’abord ce qui se dit devant le bureau de conciliation – sans confidentialité, personne ne dira plus rien, ce qui est un des problèmes de la conciliation aujourd’hui – ; ensuite, en cas de négociation pour arriver à une transaction hors conciliation, la teneur des discussions qui ont conduit à la transaction. Cette confidentialité est exigée par les règles professionnelles des avocats. Par ailleurs, un protocole de confidentialité peut être rédigé au préalable, ce qui permet de sécuriser le cadre de la discussion. L’obligation de discrétion renforce donc, sans qu’il soit besoin d’établir un tel protocole, la capacité du défenseur syndical à assister le salarié dans la négociation.
Je reconnais néanmoins que je n’avais pas perçu ainsi cet alinéa à la première lecture et que l’on aurait peut-être pu le rédiger un peu différemment.
Mme Jacqueline Fraysse. Pourquoi le texte ajoute-t-il : « et données comme telles par l’employeur » ? Si l’objectif est de sécuriser le cadre de la discussion, pourquoi l’employeur décide-t-il de ce qui est confidentiel ou non ? Le cadre est confidentiel pour tout le monde ! Cette rédaction est insatisfaisante et doit être retravaillée.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Peut-être faut-il en effet la retravailler. Puisque le défenseur syndical peut assister aussi bien un employeur qu’un salarié, la règle devrait être bilatérale.
Je vous propose de retirer l’amendement et que nous en rédigions ensemble un nouveau pour la séance publique.
L’amendement SPE930 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement SPE1789 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je le retire dans la perspective d’une nouvelle rédaction avec Mme Fraysse.
L’amendement SPE1789 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement SPE1933 rectifié des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. J’ai déjà défendu cet amendement dans ma présentation de la réforme. La possibilité, pour une des parties, d’imposer son point de vue à l’autre avec l’accord d’un seul conseiller n’est pas conforme au paritarisme.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1933 rectifié.
En conséquence, les amendements SPE1777 des rapporteurs, SPE120 de M. Gérard Cherpion, SPE450 de M. Patrick Hetzel, SPE932 de Mme Jacqueline Fraysse, SPE1584, SPE1728 et SPE1583 des rapporteurs, SPE135 de M. Gérard Cherpion, SPE451 de M. Patrick Hetzel et SPE1772 des rapporteurs tombent.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1773 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement SPE1466 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Il s’agit de maintenir l’alinéa 2 de l’article 2064 du code civil, qui dispose que les procédures à l’amiable ne peuvent concerner les contrats de travail.
Aujourd’hui, lorsqu’un contentieux relatif au contrat de travail survient entre un employeur et son salarié, le conseil des prud’hommes a l’exclusivité de son règlement, qui ne peut se résoudre, aux termes dudit alinéa, par l’intervention d’une « convention de procédure participative ». Ce dispositif, inspiré du droit collaboratif anglo-saxon, consiste en la conclusion d’une convention entre les parties à un conflit, assistées de leurs avocats, en vue de rechercher ensemble une solution constructive dans une démarche de discussion. Il a été introduit dans le code civil par l’ancienne majorité en 2010.
Je rappelle que la procédure de rupture conventionnelle est déjà très usitée : il y en a actuellement 240 000 par an. Dans les autres cas, les conflits du travail doivent se résoudre soit par le dialogue social dans l’entreprise, soit par la conciliation, avec le dispositif du bureau de conciliation et d’orientation que nous venons de voter. Si l’alinéa 79 était voté, nous sortirions de ce cadre et nous rallierions à la conception, très anglo-saxonne, selon laquelle le contrat de travail est un contrat comme les autres où tout peut être négocié. Je ne crois pas que ce soit dans notre culture des relations sociales.
La proposition du Gouvernement fragilise l’exclusivité des conseils des prud’hommes au profit d’une procédure qui, de surcroît, n’a pas montré son efficacité – jusqu’à présent, très peu de conventions de ce type ont été passées – et qui a un coût pour le justiciable. Le risque est que des pressions s’exercent sur le salarié pour qu’il accepte de passer par cette procédure plutôt que d’aller aux prud’hommes.
Le contrat de travail, qui établit un lien de subordination, est un contrat spécifique. C’est bien pour cela qu’il y a un code du travail !
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je suis sensible à cette argumentation qui veut réserver aux conseils des prud’hommes les litiges relevant du droit du travail. Cela dit, j’ai lu dans la presse des considérations qui me dépassent. Comment peut-on imaginer que la possibilité d’un recours à la médiation ou à la procédure participative mette en péril la nature même du droit du travail ?
La procédure participative a été instituée par une loi du 22 décembre 2010 et la médiation par une ordonnance du 16 novembre 2011. Il ne s’agit pas d’alternatives à la conciliation, mais d’alternatives à la judiciarisation. Elles se situent en amont de la saisine judiciaire.
Faut-il les interdire en matière prud’homale au motif que l’on renforce la conciliation ? Gardons quand même à l’esprit qu’elles sont très peu utilisées. Nous ne disposons de statistiques que pour le nombre d’homologations – facultatives – par les juridictions : en 2013, 46 procédures participatives, 71 médiations et 5 621 transactions ont été homologuées. C’est donc la transaction qui est le principal mécanisme opératoire auquel recourent les parties.
Pourquoi refuser l’élargissement de la palette dont celles-ci peuvent disposer ? Personne n’est obligé de conclure ces procédures, qui ont un coût et ne garantissent pas forcément, de ce point de vue, l’égalité entre l’employeur et le salarié. Avis défavorable.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La procédure participative exige la présence d’un avocat. Dans la mesure où les parties sont l’une et l’autre assistées, il est concevable que des pressions s’exercent.
M. le ministre. Je souscris aux arguments du rapporteur thématique. Ces modes alternatifs de règlement des conflits sont utiles et participent de la philosophie de la réforme : encourager la conciliation, dont les résultats sont aujourd’hui médiocres, et développer les nouveaux modes de résolution amiable. Cela n’enlève rien aux conseils de prud’hommes, qui pourront d’ailleurs apprécier la teneur de ces accords puisqu’ils seront seuls compétents pour leur donner force exécutoire. De telles procédures ne constituent pas une menace : au contraire, elles peuvent aider, en amont, à désengorger le système et à réduire les délais. Avis défavorable.
M. Jean-Patrick Gille. Je remercie le ministre pour sa franchise. Ce n’est donc pas une petite ligne du code civil qui se serait égarée comme ça, c’est une mesure qui s’inscrit pleinement dans la logique de la réforme.
Mais, comme le rapporteur thématique l’a reconnu à demi-mot, il est pour le moins maladroit de proposer cette forme coûteuse de conciliation au moment même où l’on essaie d’améliorer et de relancer la conciliation dans le cadre des prud’hommes. Ce que l’on voit se dessiner et qui confirme mes craintes, c’est une conciliation à deux vitesses.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Personnellement, je ne vois pas la différence entre une procédure participative et une discussion visant à parvenir à une transaction, chaque partie étant dans l’un et l’autre cas assistée par son avocat, à ceci près que la transaction est définie depuis 1804 et que les avocats continueront de la privilégier. Si certains veulent suivre la procédure participative, au nom de quoi peut-on leur interdire de le faire ? C’est plutôt la médiation – avec l’intervention d’un tiers, d’un maïeuticien cherchant les conditions de l’accord – qui s’inscrit dans une forme de concurrence par rapport au bureau de conciliation. Je maintiens mon point de vue et vous invite à retirer votre amendement.
M. Jean-Patrick Gille. Je le maintiens.
La Commission rejette l’amendement SPE1466.
Elle examine l’amendement SPE1790 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Dès lors que l’on réintroduit la possibilité, pour un employeur et un salarié, de conclure une convention de procédure participative, il est nécessaire de préciser ce qu’il advient en cas d’échec de la procédure et de saisine du conseil des prud’hommes. La dispense de conciliation prévue en général ne doit pas s’appliquer en matière prud’homale, puisque le bureau de conciliation a, en l’espèce, la double fonction de rapprocher les parties et, à défaut de conciliation, de se transformer en bureau de mise en état. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1790.
Elle est saisie des amendements identiques SPE121 de M. Gérard Cherpion et SPE452 de M. Patrick Hetzel.
M. le président François Brottes. Reconnaissez, mes chers collègues, que ces amendements sont quelque peu perfides ! (Sourires.)
M. Gérard Cherpion. L’allongement des délais est dû avant tout au manque de moyens de la justice prud’homale. Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur le lien entre l’allongement des délais du rendu de la justice prud’homale et les moyens humains et financiers dont dispose cette juridiction.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne vois pas comment le ministre pourrait s’opposer à des amendements qui apportent un tel soutien aux fabricants de bibliothèques !
M. le ministre. La loi impose déjà au Gouvernement de remettre un tel rapport. L’amendement est satisfait.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements SPE121 et SPE452.
Puis elle adopte l’article 83 modifié.
*
* *
Article 84
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice prud’homale
Cet article détermine les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 83 du présent projet de loi relatif à la réforme de la justice prud’homale.
Le I dispose que les dispositions mentionnées aux 1° à 7° du I, aux II, III et IV de l’article 83 sont d’application immédiate. Ces dispositions sont relatives respectivement aux règles de déontologie applicables aux conseillers prud’hommes (1° du I), à l’intitulé du bureau de conciliation et d’orientation (2° et 3°), à la participation du juge départiteur à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes (4°), aux mesures prises en cas de dysfonctionnement d’un conseil de prud’hommes (5° à 7°) ainsi qu’aux procédures de conciliation extrajudiciaires (II et III) et à la procédure d’avis auprès de la Cour de cassation (IV).
Le II dispose que les 8° et 19° du I, qui réforment la procédure prud’homale, sont applicables aux demandes introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi.
Il est proposé au III que les dispositions des 9° et 10° du I relatives à la formation des conseillers prud’hommes entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers suivant la publication de la loi.
Au IV, il est précisé que les dispositions des 11° à 16° du I relatives à la procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes entrent en vigueur « au plus tard le premier jour du dix-huitième mois » suivant la promulgation de la loi.
Le V prévoit que les dispositions créant un statut du défenseur syndical (17° et 18° du I) entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Le VI dispose que les dispositions mentionnées au 20° du I, relatives au tribunal de grande instance, sont applicables aux instances faisant l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Enfin, le VII dispose que, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, la désignation des membres de la commission nationale de discipline interviendra lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 13° du I de l’article 83 du présent projet de loi.
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements rédactionnels des rapporteurs.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE122 de M. Gérard Cherpion et SPE454 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 83 est devenu caduc. Je le retire.
M. Patrick Hetzel. Je fais de même.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1568 à SPE1572 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 84 modifié.
*
* *
Section 2
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
Article 85
Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance
des mesures de renforcement du système d’inspection du travail
et de révision des sanctions en matière de droit du travail
Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance « les mesures relevant de la loi (…), afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanctions et réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail ;
2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ».
Le champ de l’habilitation couvre également l’ensemble des modifications de conséquences et de coordination liées aux dispositions législatives prises dans ce cadre.
Enfin, le texte prévoit que l’habilitation gouvernementale couvre également les mesures de niveau législatif « concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté ».
Il s’agit donc :
– d’une part de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail, qui a par ailleurs connu une profonde réforme de son organisation depuis la fin de l’année 2013, et dont l’extension des moyens d’action a déjà fait l’objet de deux initiatives sur le plan législatif en 2014 ;
– et d’autre part, de supprimer les peines d’emprisonnement applicables en cas de délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, conformément à l’engagement pris par le Président de la République le 20 octobre 2014.
Face aux mutations récentes du marché du travail et aux défis qu’elles emportent, avec l’émergence de nouveaux risques, tels que ceux liés aux nanotechnologies ou aux substances cancérogènes, et l’identification de nouvelles formes de fraude, l’organisation de l’inspection du travail et les outils dont disposent aujourd’hui ses agents sont parfois inadaptés et peuvent manquer d’efficacité.
C’est ce constat, partagé au moins partiellement par tous les acteurs intéressés, qui a conduit le Gouvernement et la majorité à proposer un renforcement du système d’inspection du travail en trois temps.
Le Gouvernement a, tout d’abord, déployé deux projets de réforme par la voie réglementaire, puis il a intégré au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, un article 20 consacré à l’inspection du travail.
Cet article n’ayant pas été adopté par le Sénat, ses dispositions de fond ont ensuite été reprises, pour le volet organisationnel de la réforme, par le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, et, pour les autres volets, par la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail du 27 mars 2014.
Le Gouvernement a ainsi déployé deux projets de réforme de l’inspection du travail, dont il convient de rappeler les principaux apports.
Le projet « ministère fort » a, tout d’abord, été lancé en octobre 2013, avec l’envoi d’une instruction. Celle-ci énonce les trois principales orientations retenues par le Gouvernement pour guider la rénovation du système d’inspection du travail, et qui sont les suivantes :
– son organisation et son fonctionnement doivent évoluer pour développer une action à la fois plus collective et efficace, grâce : à l’instauration d’unités de contrôles constituées de huit à douze sections ou agents sous l’autorité d’un responsable ; à une meilleure intégration des dispositifs d’appui existants ; à la création de réseaux sur des risques particuliers, d’unités régionales dédiées à la lutte contre le travail illégal et d’un groupe national de contrôle d’appui et de veille ;
– ses priorités doivent être en nombre limité pour avoir un véritable impact, elles seront donc redéfinies selon un processus associant les agents ;
– ses pouvoirs doivent être étendus, via un élargissement des dispositifs d’arrêt temporaire de travaux, l’institution d’amendes administratives, la facilitation de l’accès aux documents utiles aux contrôles, et l’ouverture du recours à l’ordonnance pénale.
Poursuivant le même objectif de renforcement de l’efficacité de l’action de l’inspection du travail et intervenant en complément du projet « ministère fort », un plan de transformation des emplois a été lancé dès septembre 2013 par le Gouvernement.
Il vise à la requalification progressive en postes d’inspecteurs, par voie d’examen professionnel, de tous les postes de contrôleurs du travail, dont le corps a donc été mis en extinction. Un premier plan triennal de 540 emplois a été acté pour la période 2013-2015, sur le fondement du décret n° 2013-511 du 23 juin 2013 pris en application de l’article 6 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. Ce dernier a en effet prévu que « pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel ». Le décret déjà cité est ainsi intervenu pour fixer le nombre total de postes pouvant être ouverts sur ces trois années ainsi que leur répartition annuelle. Deux sessions de sélection ont d’ores et déjà été organisées respectivement au titre de l’année 2013, pour 130 postes, et de l’année 2014, pour 205 postes. La première promotion a pris ses fonctions en section d’inspection le 1er juillet 2014 après une formation de six mois à l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La deuxième promotion entrée en formation le 3 novembre 2014 achèvera sa formation en mai 2015. La troisième sélection, pour 205 postes, sera réalisée à partir de mai 2015.
Afin de permettre une mise en œuvre rapide des deux projets de réforme décrits en a) et b), le Gouvernement avait intégré au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, un article 20 dédié à l’inspection du travail (202).
Cet article procédait à une rénovation globale du système, et comportait les mesures législatives nécessaires à la déclinaison du projet « ministère fort » et du plan de transformation d’emploi, pour l’ensemble de leurs volets, qu’il s’agisse de l’organisation du système d’inspection, comme des prérogatives d’intervention et de sanction des agents et de l’administration du travail.
Après avoir été adopté par l’Assemblée nationale, il a été cependant supprimé par le Sénat, puis n’a pas été rétabli en commission mixte paritaire, afin de ne pas retarder la promulgation de la réforme de la formation professionnelle par un échec certain de cette dernière en cas de rétablissement de cet article.
L’article 20 proposait, tout d’abord, une nouvelle organisation des différents échelons du système d’inspection du travail, du niveau de la section au niveau national.
Au niveau local, il visait à créer des unités collectives de contrôle, nouveaux échelons de proximité d’intervention dans les entreprises en remplacement des sections, qui subsistaient cependant comme cadre d’exercice indépendant de leurs prérogatives par les inspecteurs du travail. Ces nouvelles unités ont un responsable principalement chargé d’assurer, dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance.
Il opérait ensuite un renforcement des capacités de contrôle de l’inspection du travail au niveau de la région, qui ne jouissait jusqu’alors d’aucune structure permanente assumant ces fonctions. Il tendait ainsi à créer des unités régionales de contrôle, revêtant un caractère permanent dans le cas de lutte contre le travail illégal et temporaire pour tout autre besoin spécifique, et des missions régionales de prévention et de contrôle des risques particuliers, constituées sous la forme de réseaux ayant pour objectif d’améliorer la prise en charge des risques complexes. Par ailleurs, il facilitait la mise en place d’unités de contrôle interdépartementales ou interrégionales.
Enfin, au niveau national, il visait à créer un groupe national de contrôle, d’appui et de veille, compétent pour des situations impliquant, sur l’ensemble du territoire, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles.
Bien que les règles déterminant l’organisation de l’inspection du travail relèvent du pouvoir réglementaire, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 janvier 2008 (203), le Gouvernement avait fait le choix de les intégrer à l’article 20 du projet de loi pour permettre une appréhension globale de la réforme proposée.
Suite à la suppression de cet article, a donc été pris le décret du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, qui a mis en œuvre les dispositions initialement prévues par celui-ci.
Auditionnés par le rapporteur thématique, les représentants de la direction générale du travail (DGT) ont fait état du quasi achèvement de cette réforme, avec la mise en place effective du groupe national de veille, d’appui et de contrôle doté de cinq agents – et qui devrait à terme être constitué de dix agents -, ainsi que de la réorganisation de l’ensemble des échelons territoriaux du système d’inspection du travail.
L’article 20 proposait, ensuite, d’étendre les pouvoirs d’intervention des agents de contrôle.
Il accroissait ainsi leurs pouvoirs d’enquête, en améliorant leur droit d’accès aux documents des entreprises et en élargissant leur droit de demander aux employeurs de faire procéder à des analyses techniques.
Il renforçait également leurs prérogatives en cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, en étendant le périmètre de la procédure d’arrêt temporaire de travaux, en simplifiant celle d’arrêt d’activité en cas de risque chimique, et en unifiant les voies de recours ouvertes.
Enfin, en vue d’accroître l’autorité des agents de l’inspection du travail, il durcissait les peines réprimant les actes d’entrave et de violence envers ceux-ci.
Puis, l’article 20 proposait deux innovations majeures pour améliorer le dispositif de sanction des infractions au code du travail : la création d’amendes administratives et l’ouverture du recours à la transaction et l’ordonnance pénales.
D’un montant maximum de 2 000 euros, les amendes administratives devaient permettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sur rapport de l’agent de contrôle et après avoir suivi une procédure contradictoire, de sanctionner des infractions ciblées concernant des éléments fondamentaux de la législation et du contrat de travail. Ce nouvel outil ne se substituait pas à la voie pénale : les agents conservaient la possibilité de déclencher l’action publique s’ils l’estimaient préférable.
L’article 20 dotait également le DIRECCTE d’un autre mécanisme de sanction : la transaction pénale, un mode d’extinction de l’action publique résultant du pouvoir octroyé à l’administration de renoncer à l’exercice de poursuites contre l’auteur d’une infraction, en le contraignant à verser une somme tenant lieu de pénalité. La transaction pénale était limitée à certaines contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an et devait être homologuée par le Procureur de la République.
Cet article ouvrait, de plus, la possibilité d’un traitement judiciaire accéléré des contraventions via la procédure d’ordonnance pénale. Celle-ci constitue, en effet, une procédure de jugement simplifiée, qui permet au ministère public de communiquer par écrit son dossier de poursuite et ses réquisitions au juge du fond, qui statue, ensuite, sans débat public en prenant une ordonnance portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.
Enfin, il proposait d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation requises par les réformes proposées, tant au sein du code du travail que dans les autres codes concernés (code des transports, code rural et de la pêche maritime, code de la sécurité sociale et code du travail applicable à Mayotte).
Au sein du code du travail, il s’agissait d’adapter les dispositions relatives aux attributions des agents de contrôle, de réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail, d’abroger les dispositions devenues sans objet et d’assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes.
Pour les autres codes, il s’agissait d’y transposer les avancées du projet de loi et d’y actualiser les références au code du travail, pour remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
Suite à la suppression de l’article 20 du projet de loi, les députés du groupe SRC ont décidé de déposer une proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail, dès le 27 mars 2014, qui entendait reprendre les dispositions de fond de l’article 20 tel qu’amendé par l’Assemblée nationale (204).
L’article 1er de cette proposition visait, tout d’abord, à renforcer les missions et garanties accordées aux agents de contrôle.
Il procédait ainsi à la consécration législative du principe d’indépendance, en inscrivant, dans le code du travail, cette garantie dont jouissent les agents de l’inspection du travail, et en prévoyant qu’ils soient associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général du système d’inspection du travail (205).
Il étendait également le champ matériel des contrôles que peuvent mener les agents de l’inspection du travail, en les autorisant à constater les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude (206).
En vue d’anticiper les conséquences du plan de transformation des emplois, il unifiait enfin les compétences de contrôle des agents, qu’ils soient inspecteurs ou contrôleurs du travail, et donnait une base législative à l’extinction du corps des contrôleurs (207).
L’article 4 reprenait, ensuite, les dispositions d’extension des pouvoirs d’intervention des agents, prévues initialement par l’article 20 :
– pour simplifier et étendre la procédure d’arrêt d’activité en cas de risque chimique, élargir le périmètre de la procédure d’arrêt temporaire de travaux et unifier les voies de recours ouvertes en la matière ;
– mais aussi pour accroître les pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail, en élargissant son droit de faire procéder à des analyses, et en garantissant un meilleur droit d’accès et de copie des documents.
Toutefois, à l’initiative du rapporteur thématique, la Commission des affaires sociales avait élargi et précisé les modalités d’accès des agents aux documents, le droit d’en prendre copie sous réserve du nécessaire établissement de leur liste, la possibilité d’une copie dématérialisée, et avait également prévu l’élargissement à tout élément d’information utile à leurs contrôles (208) .
La Commission des affaires sociales avait également souhaité compléter les moyens d’investigation des agents de contrôle de l’inspection du travail, par l’amélioration du dispositif existant de repérage de l’amiante : il s’agissait en effet de poser l’obligation pour les donneurs d’ordre de propriétaires de faire rechercher, préalablement à toute opération, la présence d’amiante (209).
S’agissant de la rénovation du dispositif de sanction des infractions au code du travail, les mesures prévues initialement par l’article 20 étaient reprises par l’article 2 pour la création des amendes administratives, et l’article 3, pour l’ouverture du recours à la transaction et à l’ordonnance pénales.
De plus, la notification d’une amende administrative ou la conclusion d’une transaction devait être désormais portée à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lorsque le manquement avait trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel (210).
S’agissant des amendes administratives, la Commission des affaires sociales avait également souhaité renforcer la procédure contradictoire en matière d’amendes administratives, en prévoyant que le délai d’un mois fixé à l’employeur pour l’informer du montant de l’amende envisagée et recueillir ses observations pourrait être prorogé d’autant à la demande de l’employeur si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient (211).
L’article 5 portait, enfin, les mesures d’adaptation législative du code du travail, du code des transports et du code rural et de la pêche maritime, rendues nécessaires par la réforme de l’inspection du travail proposée, notamment au regard du plan de transformation des emplois.
Par ailleurs, il faut signaler que les articles 2 et 3 comportaient également les mesures de coordination nécessaires dans le code de commerce, le code des transports ainsi que le code rural et de la pêche maritime, pour y rendre applicables les nouvelles amendes administratives et possibilités de transiger.
Toutefois, malgré son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en mai 2014, cette proposition de loi n’a finalement pas pu être examinée en séance publique.
C’est pourquoi, afin de permettre d’approfondir la concertation et de dissiper, autant que faire se peut, tout malentendu, et afin de tenir compte si nécessaire de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives permettant de :
– renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail ;
– étendre et coordonner les différents modes de sanction ;
– et réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 85 prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour prendre les mesures législatives concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
Le champ de ces ordonnances appelle plusieurs remarques.
● Tout d’abord, concernant les pouvoirs de l’inspection du travail, et d’après l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, le renforcement du rôle de surveillance et des prérogatives du système d’inspection du travail recouvre à la fois l’extension et l’optimisation des procédures d’arrêt temporaire de travaux et d’activité, le renforcement des moyens d’investigation des agents de contrôle (en termes d’accès aux documents mais aussi en termes de demandes de vérification, d’analyses ou de mesurages, et de repérage de l’amiante avant travaux).
Ensuite, l’extension et la coordination des différents modes de sanction ainsi que la révision de l’échelle des peines, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, recouvrent quatre mesures majeures :
– la création d’amendes administratives pour réprimer certaines infractions ciblées (infraction aux règles relatives à la durée du travail, au repos, au salaire minimum, aux conditions d’hygiène et d’hébergement), ainsi que certaines infractions dans le champ de la santé et de la sécurité au travail, avec la mise en place d’une amende administrative en cas de refus de l’employeur de se conformer à une décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pour risque chimique ou à une demande de vérifications, de mesures et d’analyses, ou encore à l’obligation de repérage de l’amiante avant travaux ;
– l’instauration d’un mécanisme de transaction pénale pour réprimer une série d’infractions punies d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an (notamment relatives au contrat de travail, à la durée du travail, aux accords collectifs, au salaire, à la santé et à la sécurité au travail, ou encore au contrat d’apprentissage) ;
– l’ouverture de possibilité de procéder par voie d’ordonnance pénale pour le traitement judiciaire des contraventions en droit du travail ;
– et enfin, le durcissement de certaines peines, que ce soit celle encourue en cas de refus de l’employeur de se conformer à une mise en demeure du DIRECCTE concernant l’existence d’une situation dangereuse pour les salariés ou celle encourue pour entrave ou violence envers les agents de contrôle de l’inspection du travail.
L’ensemble de ces mesures coïncide précisément avec le texte de la proposition de loi n° 1942 relative aux pouvoirs de l’inspection du travail, adoptée par la commission des Affaires sociales de notre Assemblée le 14 mai 2014. Dans la mesure où ces mesures ont donc déjà fait l’objet d’un ample débat parlementaire en commission, – et cela, il faut le rappeler, à deux reprises, puisque l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui traitait de l’inspection du travail a, quant à lui, été adopté par notre Assemblée le 7 février 2014 -, il serait souhaitable que le Gouvernement explique davantage sa demande d’habilitation et les différences qu’il envisage par rapport à la proposition de loi.
D’après les informations transmises au rapporteur thématique, la seule mesure nouvelle au titre de cette habilitation du Gouvernement à légiférer sur l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, concernerait les jeunes travailleurs. Il s’agit de la problématique déjà largement débattue à l’automne dernier de l’accès des apprentis mineurs à certains travaux dangereux ou à certaines situations dangereuses. La simplification de la procédure de dérogation aux travaux interdits et réglementés concernant les jeunes en formation professionnelle mineurs, prévue aux articles R. 4153-40 et suivants du code du travail passerait par le remplacement du dispositif actuel d’autorisation administrative par une procédure déclarative; elle s’accompagnerait également de la création d’une procédure de retrait d’un jeune de sa situation de travail ou de formation en cas de constat de mise en danger résultant d’une violation de la réglementation du travail.
Ces dispositions sont vraisemblablement d’ordre strictement réglementaire : rien n’empêcherait donc le Gouvernement de les mettre en œuvre par ailleurs. Si une base législative était nécessaire, son ajout à une rédaction globale de l’ensemble des dispositions couvertes par le 1° du présent article pourrait toujours être opéré en cours de navette parlementaire.
Il serait intéressant et plus satisfaisant d’un point de vue parlementaire, d’examiner la possibilité de discuter en séance des nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail en introduisant par amendement le texte tel qu’amendé par la Commission des affaires sociales de la proposition de loi n° 1942 qu’avait déposée le rapporteur thématique le 27 mars 2014.
Un tel examen en séance publique suppose toutefois d’avoir préalablement clairement établi l’impact potentiel de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à son interprétation du principe non bis in idem, sur le cumul des sanctions pécuniaires administratives avec des sanctions pénales prévu dans le cadre de cette réforme.
En effet, il peut être craint que la sanction administrative interdise une poursuite judiciaire sur décision du parquet, voire sur l’initiative d’une partie civile. Cette situation juridique est différente de celle envisagée par l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, puis par la proposition de loi. Elle nécessite, pour doter l’inspection des pouvoirs nécessaires, d’assumer les conséquences juridiques de la notification d’une sanction administrative et d’apporter les précisions techniques nécessaires pour la lisibilité aisée des nouvelles règles.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
sur le principe non bis in idem
Aux termes du premier paragraphe de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure de cet État ».
Dans l’arrêt de grande chambre rendu le 10 février 2009 dans l’affaire Zolotukhine c/ Russie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que ce principe ne s’applique :
– qu’à des sanctions ou procédures de caractère « pénal » ;
– pour la poursuite d’infractions identiques (idem factum) ;
– et au titre de décisions définitives.
Elle a toutefois récemment précisé son interprétation s’agissant du point de savoir s’il y a « répétition des poursuites », par trois arrêts rendus le 20 mai 2014.
La Cour prohibe clairement l’engagement de procédures consécutives si les premières poursuites ont déjà donné lieu à une décision définitive lorsque les secondes ont été commencées, mais n’interdit pas en tant que tel l’engagement de plusieurs procédures concomitantes ou parallèles.
Elle reconnaît également la possibilité d’engager de nouvelles poursuites ou de poursuivre une procédure antérieure après la décision mettant fin à une première série de procédures, lorsqu’il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre elles. La Cour considère que ne constitue pas une répétition de procédures prohibée par la Convention l’engagement de différentes procédures donnant lieu à différentes sanctions infligées par différentes autorités à raison des mêmes faits, lorsque ces procédures présentent un lien matériel et temporel suffisamment étroit (CEDH, 20 mai 2014, Glantz c/ Finlande).
● S’agissant des mesures législatives concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté, il faut rappeler que la proposition de loi déjà citée comportait, dans son article 1er, une série de mesures relatives aux missions et garanties accordées aux agents de contrôle de l’inspection du travail : celui-ci gravait en effet dans le marbre de la loi le principe d’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail, et associait des derniers à la définition des orientations et des priorités de contrôle ; il tirait également les conséquence de la mise en extinction du corps des contrôleurs du travail, en procédant à l’ensemble des modifications nécessaires pour unifier les compétences et les pouvoirs de contrôle des agents de l’inspection du travail. Son article 5 tirait enfin les conséquences rédactionnelles de cette unification dans l’ensemble des codes où il est fait référence à l’inspection du travail, autrement dit dans le code du travail, le code rural et de la pêche maritime et le code des transports. Les mesures qui avaient adoptées dans le cadre de cette proposition de loi couvrent bien a priori le champ de l’ordonnance prévue sur ce point. L’habilitation au dernier alinéa du présent article n’a vraisemblablement d’autre vocation que de poursuivre l’intégration des contrôleurs du travail dans le corps de l’inspection. Si les dispositions de la proposition de loi n° 1942 devaient ne pas suffire à finaliser cette intégration, celle-ci pourrait en tout état de cause toujours intervenir en cours de navette parlementaire.
Conformément à la volonté affirmée par le Président de la République lors de son discours devant le Conseil stratégique de l’activité le 20 octobre 2014, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives permettant de « réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ».
L’étude d’impact précise que les peines d’emprisonnement actuellement applicables en la matière « revêtent un caractère dissuasif pour les investisseurs étrangers » ; leur suppression aurait donc l’avantage de contribuer au « renforcement de l’attractivité du territoire ».
Les dispositions pénales du code du travail en matière de délit d’entrave répriment identiquement l’atteinte à la constitution d’une institution représentative du personnel, celles relatives à son fonctionnement, et enfin les atteintes aux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en tant que salariés protégés, autrement dit, à leur protection contre le licenciement ou la rupture de leur contrat.
La sanction du délit d’entrave concerne l’ensemble des institutions représentatives du personnel, autrement dit :
– les délégués du personnel (article L. 2316-1 du code du travail) ;
– le comité d’entreprise, le comité d’établissement ou le comité central d’entreprise (article L. 2328-1 du même code) ;
– le comité de groupe (article L. 2335-1) ;
– le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen, ainsi que la procédure d’information et de consultation, dans les entreprises de dimension communautaire (article L. 2346-1) ;
– le groupe spécial de négociation ou le comité de la société européenne (article L. 2355-1) ;
– le groupe spécial de négociation ou le comité de la société coopérative européenne (article L. 2365-1) ;
– le groupe spécial de négociation ou le comité de la société issue d’une fusion transfrontalière (article L. 2375-1) ;
– et enfin, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (article L. 4742-1).
Pour l’ensemble de ces instances, le code du travail prévoit que le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à leur constitution, à la libre désignation des membres de ces institutions ou à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Des précisions sont apportées pour certaines de ces instances : en effet, l’article L. 2328-1 précise que constitue un délit d’entrave le fait de porter ou tenter de porter atteinte notamment à l’organisation des élections du comité d’entreprise. L’article L. 2335-1 prévoit que constitue également un délit d’entrave le fait de ne pas réunir pour la première fois un comité de groupe.
L’article L. 2328-2 prévoit également que le fait pour une entreprise ou un établissement distinct d’au moins 300 salariés de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Enfin, l’article L. 4742-1 relatif au CHSCT précise également que la méconnaissance des dispositions relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité – protection en cas de licenciement, en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, en cas d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire ou en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement – est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Cette précision est apportée pour le CHSCT car elle ne figure pas par ailleurs au titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui prévoit que la rupture du contrat en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative de tout autre salarié protégé (délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, etc.) est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Pour le seul CHSCT, ces dispositions figurent donc à l’article L. 4742-1 relatif au délit d’entrave à ce comité.
Comme l’indique l’étude d’impact, l’entrave est constituée en cas de refus de l’employeur d’organiser l’élection des délégués du personnel (Cass. crim., 20 octobre 1970), en cas de non-convocation d’un délégué aux réunions mensuelles des délégués du personnel (Cass. crim., 17 décembre 1996). Se rend également responsable de délit d’entrave l’employeur qui crée une association pour tenter de supplanter le comité d’entreprise dans ses activités sociales et culturelles (Cass. crim., 22 novembre 1977), ou encore l’employeur qui refuse un congé de formation sans consultation préalable du comité d’entreprise (Cass. crim., 4 janvier 1983), de même que l’employeur qui fixe unilatéralement l’ordre du jour du comité d’entreprise (Cass. crim., 16 septembre 1985) ou ne respecte pas le délai de convocation du comité d’entreprise (Cass. crim., 27 septembre 1988).
En réalité, les procédures pénales relatives au délit d’entrave ne représentent qu’une infime part du total des procédures. Ainsi, en 2009, d’après les données issues de l’Observatoire des suites pénales (OSP), on a recensé 276 procédures relevant de la thématique de la représentation du personnel, dont 96 % concernent les entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP) : sur ces 276 procédures, seules 194 ont fait l’objet d’une suite judiciaire et seules 22 ont donné lieu à une décision du tribunal principalement sous forme d’amendes.
Le tableau suivant retrace le poids des procédures relatives au délit d’entrave par rapport au nombre de procédures totales, ainsi que la décomposition des délits en question, selon qu’il s’agisse d’une entrave à la constitution d’une IRP, à son fonctionnement, aux garanties applicables à des salariés protégés ou encore d’une discrimination.
POIDS RESPECTIF DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES D’ENTRAVE
AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
Total des procédures |
7 518 |
8 435 |
7 624 |
6 374 |
Nombre de procédures d’entrave |
247 |
302 |
279 |
186 |
dont entrave au fonctionnement |
154 |
193 |
190 |
132 |
dont entrave à la protection |
10 |
6 |
8 |
4 |
dont entrave à la constitution |
55 |
83 |
64 |
37 |
dont discrimination |
28 |
20 |
17 |
13 |
Poids des procédures d’entrave / procédures totales |
3 % |
4 % |
4 % |
3 % |
Source : Observatoire des suites pénales
Qui plus est, parmi ces procédures, rares sont celles qui aboutissent à une peine d’emprisonnement : en 2009, il n’y a eu que deux peines d’emprisonnement prononcées sur les 276 procédures déjà évoquées ; et en 2008, une seule peine d’emprisonnement a été prononcée sur un total de 170 procédures engagées. Sur la base de cette même enquête de l’Observatoire des suites pénales, aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée pour entrave au fonctionnement sur les cinq dernières années.
B. UNE RÉFORME DE LA SANCTION DE L’ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Le caractère essentiellement « symbolique » de ces peines – très rarement prononcées – combiné à son effet sur les investisseurs étrangers, auxquels il peut apparaître comme rédhibitoire, plaident pour une réforme des sanctions à ce titre.
Certes, le premier argument peut être utilisé pour critiquer toute réforme à ce sujet : ainsi, nombreux sont les représentants des organisations syndicales entendues par le rapporteur thématique qui jugent qu’il est au contraire essentiel de conserver le caractère délictuel de l’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, qui a le mérite de rappeler l’importance que revêtent l’existence même d’une représentation des salariés et leur consultation. Cette sanction devrait ainsi être maintenue précisément parce qu’elle n’est quasiment jamais appliquée, mais constitue davantage une sorte d’« épée de Damoclès » sur la tête des employeurs.
C’est précisément la nécessité de cette « épée de Damoclès » qui est discutée par des représentants d’employeurs. Elle est dénoncée comme diminuant l’attractivité française pour des investisseurs internationaux alertés par leurs conseils du risque, même s’il est infime, d’emprisonnement.
Il faut par ailleurs constater que sont actuellement identiquement réprimés des faits de gravité différente. Les entraves au fonctionnement peuvent être le fruit de l’inattention s’agissant des délais à respecter ou d’une incertitude relative à l’étendue des informations devant être communiquées. Elles ne sont pas du même ordre que l’atteinte, nécessairement délibérée, à la constitution d’une IRP ou que l’irrespect de la protection légale d’un représentant du personnel.
Une modification de ces sanctions apparaît donc opportune, la question étant en réalité : quelles modifications envisage-t-on ?
L’habilitation proposée donne carte blanche au Gouvernement qui peut procéder à une dépénalisation comme contraventionnaliser. Il lui est aussi possible de conserver à cette infraction son caractère délictuel.
Le rapporteur thématique considère qu’il n’est pas nécessaire de passer par une ordonnance. Cette réforme peut être initiée de manière assez simple, pour peu que l’on sache précisément à quel résultat on souhaite aboutir. Qui plus est, le Président de la République a réitéré son souhait que cette réforme aboutisse rapidement. Elle le serait d’autant plus vite en l’inscrivant directement dans le texte, alors que le délai imparti au Gouvernement pour prendre ces dispositions par ordonnance est fixé à neuf mois, auquel s’ajoute un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance pour la présentation du projet de loi de ratification par le Parlement.
Outre quelques amendements d’ordre rédactionnel, la commission spéciale a, lors de son examen du texte, adopté un amendement, présenté par le rapporteur général et les rapporteurs thématiques, qui propose de préciser le champ de l’habilitation prévue par l’article 85, s’agissant de la révision de l’échelle des peines : en effet, dans les moutures précédentes des textes examinés sur la réforme des pouvoirs de l’inspection du travail, la révision de l’échelle des peines ne concernait que les seules matières de santé et de sécurité au travail. La rédaction du projet de loi pouvait laisser entendre que cette habilitation serait plus large et pourrait « notamment » porter sur ces matières. La commission spéciale a donc restreint le champ de l’habilitation à la révision de l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE456 de M. Patrick Hetzel, SPE933 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1361 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.
M. Patrick Hetzel. En janvier de l’année dernière, le Gouvernement voulait faire passer une réforme de l’inspection du travail dans son projet de loi relatif à la formation professionnelle. Devant les problèmes soulevés au sein même de l’inspection du travail, il décida finalement de retirer les articles de son projet de loi.
En mars 2014, c’est le groupe socialiste de l’Assemblée nationale qui déposait une proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail. Après avoir passé l’examen en commission, ce texte ne fut pas inscrit à l’ordre du jour de la séance publique.
Cela nous conduit à nous interroger sur les orientations de la majorité et du Gouvernement, et à considérer que l’article 85 est singulièrement prématuré.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous sommes extrêmement préoccupés par la forme et par le fond de cet article. La réforme de l’inspection du travail n’est pas un détail. Que vient-elle faire dans ce texte sur l’activité et la croissance ? Et, pour comble, le Gouvernement veut la mener par ordonnance !
L’article 85 tend à autoriser le Gouvernement à modifier, par ordonnance, les prérogatives de l’inspection du travail et le régime des sanctions applicables en cas d’entrave aux institutions représentatives du personnel. Il est pour nous inacceptable que des modifications sur des points aussi importants se fassent sans que nous ayons connaissance de ce qu’il est prévu de mettre en place et sans possibilité de débat démocratique.
Il s’agit, je le rappelle, de rien de moins que de « renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, d’étendre et de coordonner les différents modes de sanctions et de réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail », et de « réviser la nature et le montant de peines et des sanctions applicables en cas de délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ». Sur tous ces points essentiels, le Gouvernement fixerait donc les nouvelles règles sans débat au Parlement. Sans doute aura-t-il la courtoisie de nous en informer, et nous sommes sensibles à cette attention, mais cela ne saurait nous détourner du fond de l’affaire. Si, parmi les modifications proposées, certaines peuvent constituer un progrès, beaucoup d’autres, comme le déclassement du délit d’entrave, sont extrêmement préoccupantes. Toutes méritent, en tout cas, un débat de fond. L’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel est une infraction grave qui revient à priver les salariés de leur expression collective et qui renforce le caractère inégalitaire lié à la subordination de la relation de travail.
On nous refuse de débattre sérieusement de ces sujets, comme nous le faisons ce soir sur d’autres points. C’est incroyable !
M. Jean-Louis Roumegas. Dans le projet de loi relative à la formation professionnelle de 2014, les articles concernant la réforme de l’inspection du travail ont soulevé de vives polémiques. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils furent supprimés à la faveur de la navette parlementaire.
Par la suite, en mars 2014, le ministère a fait passer certains éléments de réorganisation de l’inspection du travail par décret. Là aussi, le contenu a suscité beaucoup d’émoi dans la profession.
Le reste de la réforme portait sur les sanctions à la disposition des inspecteurs du travail. Nous avions commencé à y travailler en commission, dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de Denys Robiliard, que nous aurions votée si elle avait été menée à son terme.
L’actuel projet de loi vient donc enterrer cette proposition de loi et prévoit d’en traiter les sujets. Dans le cas où les ordonnances seraient conformes à ce texte, pourquoi ne pas l’avoir tout simplement repris dans le projet de loi ? Cela nous aurait permis de poursuivre notre procédure d’amendement.
Par ailleurs, le délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel soulève de nombreux problèmes et recouvre des situations très différentes. De telles entraves sont inacceptables, surtout de la part de ceux qui se réclament du dialogue social. Nous devons aussi y revenir.
L’inspection du travail est un sujet trop important pour que nous acceptions ce refus du débat. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article d’habilitation.
M. Jean-Patrick Gille. D’une certaine manière, nous avons déjà eu le débat en commission et dans l’hémicycle lors de l’examen en première lecture du projet de loi relative à la formation professionnelle. Les articles en question ont été supprimés par le Sénat. Cela relativise la brutalité que certains voient dans le recours à l’ordonnance…
Mme Véronique Louwagie. Nous avons en effet débattu de ce sujet dans le cadre de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. À l’époque, nous avions indiqué qu’il s’agissait à nos yeux d’un véritable cavalier législatif. Le vote négatif au Sénat, venant de tous les bords, a confirmé cette analyse et le ministre Michel Sapin a renoncé à maintenir l’article.
Le Gouvernement est revenu sur le sujet de manière quelque peu masquée, en le scindant en deux parties. Une première partie relative à l’organisation interne de l’inspection du travail a fait l’objet d’un décret du 21 mars 2014, deux semaines à peine après la promulgation de la loi relative à la formation professionnelle, ce qui fut perçu comme un véritable déni de démocratie. Une deuxième partie prit la forme de la proposition de loi examinée en commission des affaires sociales, inscrite à l’ordre du jour de la séance publique de l’Assemblée nationale, mais finalement jamais débattue.
Aujourd’hui, le Gouvernement veut revenir sur ces sujets par voie d’ordonnance. Reconnaissez, monsieur le ministre, que le Parlement se trouve de cette manière complètement dessaisi de son rôle, alors qu’il avait été invité par deux fois à débattre. Il y a quelque chose d’iconoclaste dans ce cheminement. Par certains aspects, c’est même une véritable provocation à l’égard des partenaires sociaux et des parlementaires.
Sur le fond, il semblerait que l’ordonnance puisse reprendre différents dispositifs et procédures contenus dans la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail signé par les députés du groupe SRC. Nous en sommes inquiets, estimant que le texte de la proposition de loi est dangereusement déséquilibré : préconiser l’intrusion et la suspicion ne rend pas service aux entreprises et porte immanquablement atteinte à la volonté d’entreprendre.
Nous sommes notamment inquiets en ce qui concerne l’articulation des niveaux de compétence au sein de l’inspection du travail et le respect de l’indépendance des agents de contrôle. La disparition du corps des contrôleurs est envisagée. Dans ce cas, les contrôleurs et inspecteurs du travail seront appelés à exercer le même métier avec les mêmes compétences. Or les premiers sont assermentés, pas les seconds, ce qui pose un réel problème de cohérence et d’application.
Nous nous inquiétions également, dans cette proposition de loi, du niveau des amendes administratives. S’il est vrai que l’amende répond à un souci d’efficacité, un niveau excessif peut la transformer en arme de destruction massive. Il faut donc faire preuve de pragmatisme. Le texte proposait le principe d’un montant maximal de 2 000 euros appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement, ce qui nous paraît tout à fait excessif.
Enfin, nous nous inquiétons du pouvoir exorbitant qu’il était prévu de donner aux agents de contrôle en matière d’accès aux documents. Les agents pourraient se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie sans que soit définie une liste exhaustive de la nature de ces documents. Cette latitude laissée à l’appréciation subjective présente un véritable risque en matière de secret professionnel. Dans l’univers très concurrentiel où évoluent les entreprises, les « fuites » peuvent être extrêmement préjudiciables. Mon propos n’est nullement de faire un procès d’intention aux contrôleurs, il est d’attirer l’attention sur la rédaction de la proposition de loi.
M. le ministre. En matière de délit d’entrave, le Gouvernement demande une habilitation à procéder par ordonnance pour mener la réforme annoncée par le Président de la République lors du dernier Conseil stratégique de l’attractivité.
Les procédures pour délit d’entrave, très dissuasives, sont très peu utilisées dans leur forme actuelle, mais leur impact en termes d’attractivité est extraordinairement négatif. En effet, la peine d’emprisonnement telle qu’elle figure aujourd’hui dans les textes paraît disproportionnée par rapport aux faits visés. L’intention du Gouvernement n’est pas de supprimer le caractère pénal du délit d’entrave – rien ne sera donc retranché du caractère dissuasif réel de la peine – mais de supprimer la peine de prison qui, je le répète, apparaît disproportionnée, en particulier pour des investisseurs ou des employeurs internationaux, par exemple lorsque c’est une mauvaise information des partenaires sociaux qui est en cause.
Compte tenu du fait que l’emprisonnement n’est jamais pratiqué, cette modification serait un élément de clarification et ne changerait en rien le caractère dissuasif du dispositif, puisque le délit d’entrave restera de nature pénale.
Si nous arrivons à élaborer le texte de l’ordonnance d’ici à la séance publique, je m’engage à ce que ce soit fait « en dur ».
S’agissant de la réforme de l’inspection du travail, M. Robiliard, rapporteur de la proposition de loi que vous avez évoquée, est le plus à même d’en tenir la chronique.
Je voudrais là aussi dissiper d’éventuels malentendus concernant le recours aux ordonnances. L’idée est bien de repartir du texte des parlementaires. Mais, précisément pour les raisons avancées par Mme Louwagie, ce texte n’est pas évident. L’exécutif a estimé qu’il était nécessaire de procéder à une concertation avec les partenaires sociaux pour effectuer les dernières vérifications et, éventuellement, les derniers ajustements.
Conscients des arguments que vous avez mis en avant, nous avons souhaité prendre du temps, nullement pour contourner le Parlement ou pour travestir ses travaux mais parce qu’une phase de décantation du texte parlementaire avec les organisations syndicales et patronales nous a semblé nécessaire. Accessoirement, quelques sujets juridiques justifient aussi cette décantation.
Comme pour les autres articles d’habilitation à prendre des ordonnances, je répète que ces textes, une fois prêts, seront évidemment soumis aux commissions parlementaires compétentes. Une discussion sur le texte abouti aura donc lieu avec les parlementaires avant qu’il ne soit soumis à la signature du Président de la République puis à la ratification.
Espérant avoir levé certaines des inquiétudes très légitimes qui ont été exprimées, j’émets un avis défavorable aux amendements de suppression.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’habilitation proposée ne porte que sur une partie du délit d’entrave : il ne s’agit que des cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel – IRP –, et non d’entrave à leur constitution ou d’atteinte à la protection dont bénéficient les représentants du personnel.
Quand un employeur porte atteinte au statut d’un salarié protégé ou le licencie sans demander l’autorisation administrative de licenciement, il le fait de façon intentionnelle et prend un risque dont il sait qu’il est pénalement sanctionné. De même, lorsqu’il reçoit une lettre recommandée réclamant l’organisation de l’élection de délégués du personnel ou d’une autre instance représentative et qu’il ne le fait pas, il est dans l’intentionnalité de façon caractérisée.
S’agissant du fonctionnement, les choses sont un peu plus délicates. La jurisprudence de la chambre criminelle déduit l’intention de l’absence de diligence suffisante. En d’autres termes, manquer le délai de convocation d’une institution est un délit. Même chose lorsque l’on ne donne pas aux IRP toute l’information nécessaire, bien que le périmètre de cette information ne soit pas parfaitement établi par la jurisprudence. Il s’agit donc de délits formels. Même s’il peut y avoir, pour certains employeurs, une intention de les commettre, cette intention est beaucoup moins caractérisée que dans les autres cas. Il y a clairement une différence de degré entre l’entrave au fonctionnement et l’entrave à la constitution ou l’atteinte au statut d’un salarié protégé.
Les textes actuellement en vigueur relatifs au délit d’entrave sont rédigés institution par institution. Figurent dans un seul et même texte et sont assortis d’une seule et même peine les trois types d’entraves : à la constitution des instances représentatives du personnel, à leur fonctionnement et à la personne du salarié protégé. Il n’est donc pas inopportun d’introduire entre elles une distinction et de ne plus sanctionner par une peine d’emprisonnement l’atteinte au fonctionnement des instances représentatives du personnel, les délits commis en la matière n’étant souvent que d’ordre formel.
L’habilitation prévue par le projet de loi laisse entièrement le choix au Gouvernement entre dépénaliser ce délit ou maintenir son caractère pénal et dans ce cas, en conserver le caractère délictuel ou en faire une contravention. Compte tenu de la simplicité des mesures à prendre, j’ai demandé au Gouvernement que l’on parvienne à un accord en séance publique sur le choix à retenir. Si aucun accord n’a encore été trouvé à ce jour, il semble qu’on s’oriente plutôt vers le maintien du caractère délictuel de l’entrave au fonctionnement, quand bien même ce délit ne serait plus puni d’une peine d’emprisonnement.
S’agissant de l’inspection du travail, sans doute est-il nécessaire d’apporter des explications supplémentaires afin de lever tout malentendu. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé sommaire de l’un des amendements de suppression de cet article, en aucune façon nous n’avons de suspicion à l’égard des entreprises. Si nous avons besoin d’une police en France, ce n’est pas que l’on soupçonne le peuple français dans son entier, mais bien parce que des infractions sont commises. Nous avons besoin, auprès des entreprises, d’un corps de contrôle qui exerce notamment, mais pas uniquement, une mission de conseil. Certains employeurs, après avoir été dûment conseillés, persistent dans certaines attitudes, parfois de façon délibérée. Les phénomènes de travail dissimulé et de contournement des règles qui encadrent le détachement international constituent des infractions qu’il importe de pouvoir réprimer.
Si les inspecteurs du travail disposent déjà d’un arsenal de mesures, il reste que, lorsqu’ils dressent un procès verbal, celui-ci est classé sans suite dans quatre cas sur cinq. Il fallait donc que nous mettions à sa disposition d’autres moyens d’action. Tel était le sens de l’article 20 du projet de loi relatif à la réforme de la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Cet article 20 ayant été supprimé par le Sénat, il n’a pas été réintroduit dans le texte en commission mixte paritaire afin d’éviter l’échec de cette dernière, car nous souhaitions que la réforme de la formation professionnelle entre en vigueur rapidement. Puis a été déposée une proposition de loi reprenant les dispositions de l’article 20 précité : nous en avons débattu au sein de la Commission des affaires sociales. Et si l’UMP n’avait pas fait durer la discussion du projet de loi relatif à la famille, la proposition de loi précitée aurait pu être discutée en séance publique.
Pourquoi, aujourd’hui, ne pas reprendre cette proposition de loi par amendement ? D’abord parce que, comme l’a souligné le ministre, il est nécessaire de rediscuter de ces mesures afin de dissiper tout malentendu et éventuellement de les améliorer. D’autre part, l’état du droit international a évolué. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 20 mai 2014 – soit juste après que nous avons discuté en Commission des affaires sociales de la proposition de loi précitée – quatre arrêts concernant la Finlande, dans lesquels elle a fait évoluer l’interprétation qu’elle faisait auparavant de la règle non bis in idem, s’agissant notamment du cumul entre sanctions pénales et administratives. La question de savoir dans quelle mesure ces arrêts nous concernent n’est pas parfaitement claire. C’est pourquoi il nous faudra peut-être modifier cette proposition de loi.
M. Jean-Frédéric Poisson. Sur ces deux sujets, des évolutions doivent évidemment être apportées à la législation en vigueur. Mais ne pourrait-on, à cette occasion, graduer les sanctions applicables ? L’envoi d’une lettre recommandée en plein mois d’août et la convocation d’élections en dehors du délai légal ne sauraient être sanctionnés de la même manière que la volonté délibérée de ne pas constituer d’instances représentatives du personnel.
Il nous paraît essentiel de maintenir le caractère pénal du délit d’entrave dans la mesure où le respect par l’employeur des instances représentatives du personnel revêt quasiment un caractère d’ordre public social. Mais si la peine d’emprisonnement en vigueur n’est jamais appliquée, autant la supprimer, surtout si elle effraie les investisseurs étrangers.
Pour revenir sur l’intervention de notre collègue Véronique Louwagie, l’instauration, au profit de l’inspecteur du travail, d’un droit sans limites de quitter les locaux de l’entreprise avec tous les documents de son choix, sous prétexte qu’il considère qu’ils pourraient lui être utiles, nous paraît fort dangereuse. La rédaction de l’article 20 issue du projet de loi initial du Gouvernement, ne comportait aucune limitation quant aux documents concernés mais les dispositions que nous avons adoptées hier ici même en matière de secret des affaires devraient constituer une limite aux pratiques de l’inspection du travail. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous confirmer que c’est le cas ?
Ainsi que l’a parfaitement souligné Denys Robiliard, nous ne contestons nullement le principe même de la nécessité d’une inspection du travail. Et compte tenu des missions qui lui sont imparties, chacun comprendra la nécessité que ce corps d’inspection soit indépendant. Mais si l’on pouvait déterminer un équilibre plus marqué entre ses missions de contrôle et de conseil, personne ne s’en porterait plus mal. En dehors des cas de brigandage caractérisés, il importe de faire la distinction entre employeurs de bonne foi et de mauvaise foi. Alors qu’il est inique que ces deux catégories de personnes soient traitées de la même manière en droit et en fait, telle est pourtant la pratique des inspecteurs.
Bref, compte tenu de l’incertitude pesant encore sur contenu des ordonnances qui seront un jour soumises à notre ratification, nous maintenons nos amendements de suppression de l’article 85.
Mme Jacqueline Fraysse. M. le ministre affirme que la sanction applicable au délit d’entrave porterait atteinte à l’attractivité de notre pays du point de vue des investisseurs étrangers. Or, ceux-ci ont le moyen de vérifier que cette peine de prison n’est pas appliquée et qu’ils ne risquent donc pas grand-chose. Dans le même temps, il me semble qu’un allègement excessif de cette sanction lui ôterait son caractère dissuasif. Il est essentiel que les investisseurs étrangers sachent que la France accorde une importance particulière au délit d’entrave. Enfin, quels que soient les arguments avancés, la suppression de la peine de prison aujourd’hui en vigueur et la question du maintien ou non du caractère pénal de la sanction applicable sont des points essentiels qui devraient être débattus au sein du Parlement. Ainsi que l’a souligné Denys Robiliard, le Gouvernement aura le choix entre plusieurs options possibles, et l’on ignore laquelle il retiendra. Je suis surprise que le Gouvernement procède de la sorte car cela ne correspond pas à la tradition de cette maison.
M. le président François Brottes. D’après ce que j’ai compris, non seulement un débat parlementaire a eu lieu, mais en outre une concertation sera organisée, qui portera sur le texte adopté par le Parlement en première lecture ; enfin, le ministre s’est engagé à nous présenter l’ordonnance en amont de sa ratification.
M. Jean-Louis Roumegas. Le bref échange que nous venons d’avoir nous aura permis de nous rendre compte que le Gouvernement est incapable de nous dire ce qu’il va décider. Nous ne pouvons nous contenter d’un débat au rabais : on nous propose une simple concertation alors que le Parlement dispose d’un droit d’amendement et de discussion. Le Gouvernement ne peut continuer à nous demander de lui faire confiance et nous accuser de suspicion alors qu’il s’agit d’une question de principe, sauf à transformer le Parlement en instance de concertation et à donner les pleins pouvoirs au Gouvernement. Il me semble que l’on dépasse les bornes !
M. Richard Ferrand, rapporteur général. S’agissant du délit d’entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel, l’objectif n’est pas de remettre en cause le caractère pénal de la sanction encourue, mais de trouver un substitut à la sanction en vigueur, qui constitue un répulsif inutile : inutile parce que jamais appliqué, répulsif parce que donnant l’impression que les conflits du travail en France se régleraient nécessairement par des peines de prison. L’intention du Gouvernement est donc claire. Le ministre nous a d’ailleurs indiqué sa volonté de nous présenter un texte consolidé lors du débat dans l’hémicycle. L’affaire étant circonscrite, ne faisons pas un incendie de ce qui n’est qu’une adaptation.
La Commission rejette les amendements identiques SPE456, SPE933 et SPE1361.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1840 des rapporteurs.
Elle en vient aux amendements identiques SPE123 de M. Gérard Cherpion et SPE457 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Plutôt que de stigmatiser l’entreprise, mieux vaudrait repenser le rôle de l’inspecteur du travail. Celui-ci doit être le premier soutien et conseiller du chef d’entreprise. Si cette peine d’emprisonnement est un « répulsif », il y en a d’autres dans le code du travail !
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE457 est un amendement de repli par rapport à l’amendement SPE456.
M. le ministre. Avis défavorable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette les amendements SPE123 et SPE457.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1841 des rapporteurs.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement SPE1842 rectifié des rapporteurs et l’amendement SPE826 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’amendement SPE1842 rectifié a pour objet d’aménager le champ de l’habilitation afin d’y inclure une révision de l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail.
L’amendement SPE826 est retiré.
M. le ministre. Avis favorable à l’amendement des rapporteurs.
La Commission adopte l’amendement SPE1842 rectifié.
Elle aborde ensuite les amendements identiques SPE124 et SPE638 de M. Gérard Cherpion et SPE455 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Les sanctions pénales constituent un instrument de dissuasion. Même si elles ne sont jamais appliquées, il convient de les maintenir. Mais dès lors que le ministre s’engage à nous présenter un texte précis en séance publique, je retire mes amendements.
M. le ministre. Je m’y engage.
Les amendements sont retirés.
Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1724 et SPE1725 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 85 modifié.
*
* *
Après l’article 85
La Commission est saisie de l’amendement SPE565 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement vise à adjoindre aux agents de contrôle de l’inspection du travail des collaborateurs bénévoles susceptibles de jouer le rôle de conciliateurs du travail, à l’image du rôle de conciliateur de justice. En liaison avec les inspections du travail, ils pourraient jouer un rôle de filtre des demandes adressées aux agents de contrôle, un rôle de médiateur entre salariés et employeurs, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et un rôle dans la transmission d’informations à l’inspection du travail.
M. le ministre. Le Gouvernement partage la philosophie de votre amendement qui vise à instaurer des modes alternatifs de règlement des conflits. Cela étant, les différends entre employeurs et salariés ne relèvent pas de la compétence de l’inspection du travail, mais bien des conseils de prud’hommes.
La conciliation est un élément important. Les dispositifs complémentaires dont nous avons débattu participent de cette philosophie, mais toute évolution de ces dispositifs nécessiterait que l’on révise le livre Ier du code du travail, ce qui suppose un dialogue social préalable. La préoccupation sous-jacente à cet amendement étant partiellement satisfaite à l’article 85, et compte tenu des contraintes de procédure que je viens de citer, je vous invite à retirer votre amendement.
M. Michel Zumkeller. Loin de se situer dans le contexte d’un litige, cette proposition vise précisément à l’éviter en favorisant le dialogue.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. À la lecture de votre amendement, il me semble que je peux considérer comme un litige ce que vous appelez « différend », d’autant que vous y évoquez un « préalable » à une démarche contentieuse. C’est pourquoi je m’associe aux propos du ministre.
À vrai dire, je m’étais posé la question de savoir si le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ne pouvait pas être saisi avant tout litige, à l’image de la procédure suivie par les juges consulaires : dans le cadre de cette dernière, lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés mais qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement, intervient une cellule de prévention des difficultés des entreprises – présente dans la plupart des tribunaux de commerce de France. Les entreprises ont ainsi la possibilité de s’adresser à une juridiction afin de recueillir ses conseils. Cela étant, la formalisation de la conciliation pré-litigieuse est presque impossible car, pour qu’il puisse y avoir conciliation, il faut nécessairement qu’il y ait litige. C’est pourquoi je maintiens mon avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement SPE565.
*
* *
Article 86
Modification du régime des impatriés
Afin de faciliter le recrutement de cadres étrangers de haut niveau par les entreprises françaises, lequel recrutement constitue un facteur important de localisation de quartiers généraux d’entreprises en France, un régime fiscal spécifique à destination des « impatriés », c’est-à-dire les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France a été institué par la loi de finances rectificative pour 2003. Son dispositif a été assoupli et renforcé par la loi de finances rectificative pour 2005 et par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
I. LE DROIT EXISTANT
Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts, le régime des impatriés est ouvert aux salariés et à certains dirigeants de sociétés, que ces personnes viennent travailler sur le territoire français dans le cadre de la mobilité interne d’un groupe international ou qu’elles soient directement recrutées à l’étranger par l’entreprise établie en France. Elles ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonction en France, et elles doivent fixer leur domicile fiscal en France à compter de cette prise de fonction.
Ces contribuables bénéficient d’exonérations d’impôt jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France :
– sur leurs revenus d’activité (prime d’impatriation et fraction de rémunération correspondant à l’activité éventuellement exercée à l’étranger). Au choix des intéressés, soit l’exonération globale est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée à l’étranger n’est exonérée qu’à hauteur de 20 % de la rémunération imposable au titre de l’activité exercée en France ;
– sur certains revenus patrimoniaux de source étrangère, à hauteur de 50 %, sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les produits de droits d’auteur perçus à l’étranger, ainsi que sur les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l’étranger.
Ce régime a occasionné une dépense fiscale de l’ordre de 140 millions d’euros en 2013, dont 135 millions d’euros au titre de l’exonération des primes d’impatriation et de la fraction des rémunérations correspondant à l’activité exercée à l’étranger, et 5 millions d’euros au titre de l’exonération partielle des revenus non salariaux. Il bénéficie à plus de 11 000 personnes au titre des revenus salariaux et à environ 300 personnes pour les revenus non salariaux.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Le présent article vise à préciser le dispositif existant lorsque le contribuable change d’employeur ou d’entreprise avant le 31 décembre de la cinquième année suivant son installation en France.
En effet, l’administration fiscale a estimé, par rescrit, que le régime fiscal s’applique « au titre d’un emploi précis occupé dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un mandat social conclu entre le salarié concerné et une entreprise déterminée, établie selon le cas à l’étranger ou en France », et que « tout changement d’employeur ou d’entreprise équivaut pour l’application de ce régime à une nouvelle prise de fonctions, au titre d’un nouveau contrat de travail. Il en va notamment ainsi lorsque le salarié vient à travailler auprès d’une entreprise autre que celle pour laquelle il s’est installé en France, y compris dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, ou bien lorsque l’entreprise étrangère met fin à son détachement et que le salarié signe un contrat de travail avec la société française dans laquelle il exerce ses fonctions. » Dans ces cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime des impatriés au titre de ce nouvel emploi.
Le présent article vient donc compléter l’article 155 B du code général des impôts afin de préciser que le bénéfice du régime fiscal des impatriés est maintenu lorsque le contribuable change de fonctions au sein de l’entreprise ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe – la notion de groupe s’entendant de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce.
Cette mesure vise donc à permettre aux personnes venues s’installer en France de conserver le bénéfice du régime fiscal dérogatoire lorsqu’elles effectuent une mobilité au sein du groupe auquel appartient leur entreprise – la durée du bénéfice du régime fiscal dérogatoire restant bien évidemment de cinq années, à compter de l’installation du contribuable en France.
L’étude d’impact ne fournit pas d’évaluation de l’incidence budgétaire de la mesure proposée, probablement du fait de la difficulté à évaluer le nombre de personnes concernées et les sommes exonérées en jeu.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
*
* *
La Commission aborde l’amendement SPE934 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Pour recruter de hauts cadres étrangers, les entreprises françaises leur proposent des primes d’« impatriation » en sus d’une rémunération élevée. Quant à l’État, il a instauré un régime fiscal favorable à ces cadres en les exonérant d’impôt sur une partie de leur rémunération. Toutefois, en l’état du droit, ce régime plus avantageux n’est pas maintenu lorsque, bien que résidant toujours en France, l’impatrié change d’employeur ou d’entreprise. L’article 86 vise donc à maintenir ce régime fiscal plus favorable en cas de mobilité et ainsi à élargir cette niche fiscale. À l’heure où nous réclamons une fiscalité plus juste et plus lisible, il ne nous paraît pas judicieux de multiplier les dérogations. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
M. le ministre. Vous avez bien rappelé la nature du dispositif, dont l’enjeu budgétaire est extrêmement réduit : le régime d’impatrié, qui ne concerne que quelques cadres dirigeants de haut niveau, permet aux entreprises de leur offrir des rémunérations compétitives à l’échelle internationale. Le dispositif consiste en effet à exonérer d’impôt, pendant cinq années, 30 % des primes d’impatriation.
La mesure ici proposée consiste à simplifier le régime en vigueur en permettant aux salariés impatriés, lorsqu’ils changent de fonction au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises établi en France, de conserver le bénéfice dudit régime. Objectivement, cela n’altère en rien sa nature ni sa philosophie. Il s’agit simplement de mettre fin aux situations aberrantes auxquelles les impatriés ont pu être confrontés. Annoncée par le Président de la République lors du Conseil stratégique de l’attractivité, cette mesure est particulièrement attendue par les groupes internationaux qui opèrent en France. Elle s’accompagnera de dispositions complémentaires qui seront soutenues dans les prochains mois par d’autres ministres, tel le « passeport talents » qui sera présenté par le ministre de l’intérieur.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Institué en loi de finances, ce régime, qui relève du code général des impôts, a une durée de validité de cinq ans. L’article 86 ne vise qu’à simplifier son application dans l’hypothèse où un impatrié déjà en poste en France changerait d’employeur au cours de ces cinq années. Je vois donc mal comment on pourrait justifier le traitement fiscal différencié d’un tel impatrié, compte tenu du principe d’égalité.
La Commission rejette l’amendement SPE934.
Puis elle adopte l’article 86 sans modification.
*
* *
Après l’article 86
La Commission examine l’amendement SPE555 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement vise à favoriser le recours au télétravail, enjeu important pour la modernisation de notre pays. Je rappelle que le télétravail peine à se développer en France : seuls 16 % des salariés sont concernés, contre 40 % au Royaume-Uni. Créer de nouvelles possibilités en la matière permettrait de renforcer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, d’améliorer les conditions de travail des salariés et de désengorger les transports.
M. le ministre. Je partage l’objectif poursuivi dans cet amendement. Les chiffres cités par M. Zumkeller sont tout à fait justes et le télétravail doit être développé, surtout dans certaines régions. Néanmoins, le dispositif proposé paraît déroger au système actuel. Je considère plutôt cette proposition comme un amendement d’appel nous incitant à réfléchir au sujet. Nous pourrions d’ailleurs envisager dans les prochaines semaines de commander un rapport à cet effet, car aussi bien les centres d’appel que les centres de service partagé et le télétravail permettraient de relancer l’activité dans certaines régions.
M. Michel Zumkeller. Il s’agissait effectivement d’un amendement d’appel, que je retire dans l’espoir que le sujet soit retravaillé.
L’amendement SPE555 est retiré.
*
* *
Section 3
Le dialogue social au sein de l’entreprise
Cette section est composée de cinq articles visant à rénover le dialogue social au sein de l’entreprise.
Article 87
(Art. L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2327-7, L. 2314-20 et L. 2324-18
du code du travail)
Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale
Cet article propose de supprimer la compétence administrative en matière préélectorale pour les élections des représentants du personnel, ainsi que la compétence de l’inspecteur du travail en matière de dérogations aux conditions d’ancienneté pour les élections professionnelles.
Toute entreprise de plus de onze salariés doit organiser à échéance régulière des élections professionnelles : élection des délégués du personnel pour les entreprises de onze à quarante-neuf salariés, ou élection des membres du comité d’entreprise pour les entreprises d’au moins cinquante salariés. L’organisation de ces élections professionnelles relève de la compétence de l’employeur.
En cas de contestation s’élevant en matière électorale, le litige est tranché, en fonction de sa nature, soit par le juge judiciaire, qui est le juge de l’élection professionnelle, soit, de manière résiduelle, par l’autorité administrative.
Les contestations relatives au contentieux de l’électorat, de l’éligibilité et de la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application de l’article L. 2314-25 du code du travail.
En matière préélectorale, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité de la négociation du protocole préélectoral, ainsi que l’a rappelé un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 (212).
L’autorité administrative est quant à elle compétente pour trancher les différents points de désaccord du protocole préélectoral.
La négociation du protocole d’accord préélectoral
L’employeur doit inviter toutes les organisations syndicales intéressées et remplissant les conditions fixées respectivement par les articles L. 2314-3 pour les délégués du personnel et L. 2324-4 pour les membres du comité d’entreprise, à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir leurs listes de candidats.
Lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales doivent trouver un accord sur les clauses suivantes :
− La répartition du personnel dans les collèges électoraux (art. L. 2314-11 pour les délégués du personnel et art. L. 2324-13 pour les membres du comité d’entreprise) ;
− La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnels (art. L. 2314-11 et art. L. 2324-13) ;
− La division de l’entreprise en établissements distincts (art. L. 2314-31 et L. 2322-5) ;
− Les voies et moyens permettant d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats (art. L. 2324-6) ;
− Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, telles que la date de dépôt des candidatures, le lieu du déroulement du scrutin, les règles de vote, la composition du bureau de vote, etc.
Ainsi, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales sur les différentes clauses obligatoires de négociation du protocole, il revient au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de déterminer le périmètre de déroulement des élections, la répartition des électeurs entre les collèges, ou la répartition des sièges entre les collèges.
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, le recours à l’arbitrage de l’autorité administrative est subordonné à la condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation de négocier, cette négociation ayant échoué. La loi du 5 mars prévoit également de suspendre le processus électoral et de proroger le mandat des élus en cours en cas de saisine de l’autorité administrative.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, l’inspecteur du travail peut, après consultation des organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur ou éligible aux élections professionnelles de délégué du personnel ou du comité d’entreprise, notamment lorsque l’application des conditions d’ancienneté aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il résulte parfois de la répartition des compétences entre juge judiciaire et autorité administrative en matière d’élections professionnelles un certain enchevêtrement des compétences qui est source d’incohérence et de confusion pour les entreprises.
À titre d’exemple, selon l’article L. 2324-12 du code du travail, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande de modification de la composition des collèges par catégorie ; en revanche, la répartition du personnel entre les collèges relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative.
De même, seule l’autorité administrative peut trancher un litige relatif au découpage entre établissements distincts en l’absence d’accord préélectoral. Cependant, si un accord majoritaire prévoyant le découpage de l’entreprise en établissements distincts a été conclu, et que des élections ont été organisées, un syndicat non signataire peut saisir le tribunal d’instance pour les faire annuler, en lui demandant de statuer sur la validité de l’accord procédant au découpage (213), car cette question relève de la compétence du juge judiciaire.
En multipliant les voies de recours contentieux, cette répartition est, dès lors, susceptible d’allonger significativement le déroulement du processus électoral et retarder l’organisation des élections professionnelles. En effet, selon l’étude d’impact, cette répartition « conduit souvent à ce qu’une juridiction soit contrainte de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction ou de l’administration ».
Poursuivant un objectif de simplification pour les entreprises, le présent article propose d’unifier les compétences en matière d’élections professionnelles en supprimant la compétence administrative en matière préélectorale.
Les paragraphes 1° et 2° substituent à la compétence de l’autorité administrative – en l’espèce, celle du Direccte – la compétence du juge judiciaire dans les articles L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-13 et L. 2327-7 du code du travail.
Ainsi, il reviendrait au juge judiciaire et non plus au Direccte de déterminer la répartition entre les collèges électoraux, de reconnaître le caractère d’établissement distinct, de fixer le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre établissements pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise.
Les 3° et 4° procèdent à des modifications rédactionnelles résultant de la suppression de la compétence administrative en matière préélectorale effectuée aux 1° et 2°.
Enfin, le 5° procède à un transfert similaire de compétence de l’inspection du travail au juge judiciaire en ce qui concerne les dérogations aux conditions d’ancienneté nécessaires pour être électeur ou éligible aux élections de délégué du personnel ou de membre du comité d’entreprise.
Le a) du 5° substitue aux articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code toutes les occurrences relatives à l’inspecteur du travail par la référence au juge judiciaire, en matière de dérogation aux conditions d’ancienneté.
En conséquence, le b) du 5° supprime l’obligation de consultation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui s’imposait à l’inspecteur du travail.
Les dispositions de la loi du 5 mars 2014 précitée visant à proroger le mandat des représentants du personnel en cas de litige et de saisine du juge judiciaire continueraient de s’appliquer après le transfert de compétence au juge judiciaire.
Selon l’étude d’impact, cette disposition devrait représenter une « charge raisonnable » pour le juge judiciaire, dans la mesure où le nombre de litiges nécessitant le recours à l’autorité administrative est relativement peu élevé : seules 117 décisions d’arbitrage préélectoral ont été rendues en 2012.
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1574, SPE1576 et SPE1577 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 87 modifié.
*
* *
Article 88
(Art. L. 3142-7 du code du travail)
Congés de formation économique, sociale ou syndicale
Cet article est une disposition de cohérence rédactionnelle visant à préciser une référence relative aux organisations syndicales dans le cadre du congé de formation économique, sociale ou syndicale. Cette disposition fait suite à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a modifié les modalités de financement de la formation syndicale.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) est un congé ouvert à tous les salariés, dans la limite de douze jours par an, permettant de participer à des stages ou sessions de formation dans les domaines économiques, sociaux et syndicaux.
Les stages ou sessions de formation effectués dans le cadre du CFESS sont organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés agréés, dont la liste est fixée par arrêté.
Le CFESS constitue par conséquent un moyen privilégié pour les représentants du personnel de suivre une formation correspondant au mandat qu’ils exercent.
Le mode de financement de la formation syndicale a par ailleurs été réformé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 précitée, qui a créé un fonds paritaire concourant notamment au financement de la formation syndicale. Le nouvel article L. 2135-12 du code du travail, introduit par l’article 31 de cette loi, fixe ainsi la liste des organisations représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national et interprofessionnel éligibles au financement du fonds paritaire instauré à l’article L. 2135-9 du même code.
Ce fonds paritaire contribue au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11 du même code.
Parmi les missions pouvant donner lieu à la participation financière du fonds paritaire figure au 3° de l’article L. 2135-11 la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. Le fonds peut donc concourir au financement de l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation dans le cadre du CFESS.
Compte tenu de cette évolution des modalités de financement des congés de formation économique, sociale et syndicale, l’unique alinéa du présent article propose de substituer, à l’article L. 3142-7 du code du travail, la référence « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 » du code du travail à la référence retenue jusqu’ici « aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national ».
Le 3° dispose en effet que peuvent bénéficier des crédits du fonds paritaire, au titre de la mission de formation économique, sociale et syndicale mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11 du même code, « les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3% des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11 ».
Cette modification est donc une simple disposition de cohérence rédactionnelle dans le code du travail faisant suite à la loi du 5 mars 2014 ; elle présente en outre l’intérêt d’être plus précise que la formulation actuelle de l’article L. 3142-7.
Désormais, le salarié souhaitant participer à un stage ou à des sessions de formation économique, sociale et syndicale pourra effectuer ces sessions :
− soit dans un centre rattaché à des organisations syndicales reconnues représentatives selon les critères fixés au 3° de l’article L. 2135-12 et bénéficiant à ce titre d’un concours financier du fonds paritaire ;
− soit dans un institut spécialisé, cette disposition restant inchangée.
Selon l’étude d’impact, cette disposition n’aura aucune conséquence sur le financement des organisations syndicales dispensant ces formations, dans la mesure où l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel bénéficiant à ce jour des financements au titre du CFESS remplissent les conditions fixées au 3° de l’article L. 2135-12.
*
* *
La Commission adopte l’article 88 sans modification.
*
* *
Après l’article 88
La Commission est saisie de l’amendement SPE990 rectifié de M. Jean-Frédéric Poisson.
M. Jean-Frédéric Poisson. Il s’agit de favoriser le vote électronique dans les entreprises.
M. le ministre. La rédaction qui nous est soumise pose des difficultés juridiques et techniques. Le site de vote retenu doit en effet permettre d’assurer à la fois la confidentialité des données transmises et une stricte égalité de traitement en matière d’accès au vote électronique des salariés au sein de l’entreprise. La loi prévoit d’ores et déjà l’instauration du vote électronique par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe mais non par le biais d’un accord d’établissement, ce afin de garantir l’égalité de traitement entre les salariés d’une même entreprise. Il ne nous paraît donc pas opportun de permettre, au sein d’une même entreprise, le recours au vote électronique d’une manière qui ne soit pas uniforme pour l’ensemble des salariés.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le ministre n’ayant pas d’objection de principe à ce sujet, nous essaierons de trouver une rédaction idoine d’ici à l’examen du texte en séance publique. En attendant, je retire mon amendement.
L’amendement SPE990 rectifié est retiré.
*
* *
Article 89
(Art. L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail)
Transmission du procès-verbal des élections aux organisations syndicales
Cet article complète les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail par deux alinéas visant à améliorer l’information des organisations syndicales de salariés relative aux résultats des élections professionnelles. Il prolonge ainsi la démarche de refonte de la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise introduite par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La loi du 20 août 2008 a procédé à une importante refonte des conditions de représentativité des organisations syndicales de salariés, en supprimant la présomption irréfragable de représentativité des cinq grandes confédérations syndicales.
Aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est désormais fondée sur un ensemble de critères : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l’audience, l’influence ainsi que les effectifs d’adhérents et les cotisations.
En introduisant le critère de l’audience pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, la réforme de la représentativité syndicale a conféré de facto une nouvelle finalité aux élections professionnelles : ces dernières ne visent désormais plus seulement à élire des représentants au sein des institutions représentatives du personnel ; elles permettent également de mesurer l’audience syndicale dans l’entreprise et, par conséquent, la représentativité des organisations syndicales.
Sont ainsi représentatives au sein de l’entreprise ou de l’établissement, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail, les organisations syndicales satisfaisant les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 et obtenant « au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » et ce, quel que soit le nombre de votants.
2. Le renforcement de l’information des organisations syndicales en amont des élections professionnelles
Afin de mettre en conformité ces nouvelles exigences de représentativité des organisations syndicales de salariés avec la préparation et l’organisation des élections professionnelles, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a procédé à une série d’aménagements visant à donner aux organisations syndicales la possibilité de mieux anticiper les élections professionnelles.
• L’information des organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles
Les élections professionnelles concernent tous les employeurs de droit privé ainsi que certains établissements du secteur public, dès lors que leur effectif compte au moins onze salariés. L’élection des délégués du personnel – dans les établissements de onze salariés et plus – et celle des représentants du personnel au comité d’entreprise – dans les entreprises employant au moins cinquante salariés – se déroulent en principe tous les quatre ans (214).
L’initiative, la préparation et l’organisation des élections professionnelles incombent à l’employeur, qui est tenu d’en informer les représentants des salariés et, le cas échéant, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Les articles L. 2314-2 (élection des délégués du personnel) et L. 2324-3 (élections au comité d’entreprise) du code du travail déterminent les modalités d’information : l’employeur doit prévenir les salariés de l’organisation des élections par voie d’affichage, en précisant la date envisagée pour la tenue du premier tour, celui-ci ne pouvant avoir lieu plus de quarante-cinq jours après le jour de l’affichage.
L’employeur invite par ailleurs les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral, qui doit permettre à l’employeur et aux partenaires sociaux de s’accorder sur les éléments clés de l’organisation du scrutin, à savoir le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel et des sièges dans ces collèges, ainsi que les modalités pratiques du scrutin : vote électronique ou par courrier, date limite de présentation des candidatures, heure et lieu du scrutin, etc.
Pour négocier ce protocole dans de bonnes conditions, l’employeur est tenu de fournir aux syndicats participant à la négociation un ensemble d’informations nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale. Les syndicats qualifiés sont prévenus par voie d’affichage, tandis que les syndicats représentatifs sont quant à eux prévenus par courrier.
• Le renforcement des modalités d’information par la loi du 5 mars 2014
Faisant suite à une série d’arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 janvier 2012, la loi du 5 mars 2014 a défini les nouveaux délais dans lesquels l’employeur doit inviter les partenaires sociaux à négocier le protocole d’accord. Désormais, les organisations syndicales doivent avoir eu connaissance de l’invitation à négocier le protocole d’accord au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ; dans le cas du renouvellement de l’institution, cette invitation doit avoir été adressée au minimum quarante-cinq jours avant l’expiration du mandat des délégués en exercice.
Cependant, alors que l’information des organisations syndicales a été renforcée en amont des élections professionnelles, aucune disposition législative ne prévoit à ce jour la communication des résultats de l’élection aux partenaires sociaux ayant participé au scrutin ou à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Cette situation se révèle problématique au regard des nouvelles modalités de mesure de la représentativité des organisations syndicales, les résultats des élections professionnelles en constituant désormais l’un des critères essentiels.
Dans le prolongement de la loi du 5 mars 2014, le présent article envisage donc de rendre obligatoire la transmission des résultats des élections aux représentants des organisations syndicales qui ont pris part, soit aux élections professionnelles, soit à la seule négociation du protocole préélectoral.
Le I insère un nouvel alinéa à l’article L. 2314-24 du code du travail instaurant une obligation de transmission d’une copie des procès-verbaux des élections de délégués du personnel aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés, ainsi qu’aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Il est précisé que la transmission du procès-verbal doit intervenir « dans les meilleurs délais » après la proclamation des résultats. L’article précise également que la transmission du procès-verbal peut être effectuée « par tout moyen ».
Le II procède à la même modification que le I s’agissant des élections des membres du comité d’entreprise, en insérant un nouvel alinéa à l’article L. 2324-22 du même code.
*
* *
La Commission adopte l’article 89 sans modification.
Article 90
(art. L. 4614-8 du code du travail)
Inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires
Cet article vise à renforcer les règles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en prévoyant l’inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations qui lui sont obligatoirement soumises.
Tout établissement d’au moins cinquante salariés dispose d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CHSCT bénéficie d’une compétence générale l’amenant à se prononcer sur l’ensemble des projets ayant un impact significatif en matière de santé et de sécurité au travail dans l’entreprise. En vertu des dispositions de l’article L. 4612-1 du code du travail, le CHSCT a notamment pour missions :
– de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
– de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, en veillant particulièrement à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
– de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le CHSCT est également chargé de procéder à l’analyse des risques professionnels (art. L. 4612-2) et de promouvoir la prévention de ces risques (art. L. 4612-3). En outre, il peut procéder à des inspections (art. L. 4612-4) ou à des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (art. L. 4612-5).
• Le champ étendu des consultations obligatoires
La deuxième section du chapitre II du titre premier du livre VI de la quatrième partie du code du travail (articles L. 4612-8 à L. 4612-15) recense une partie des nombreuses consultations obligatoirement soumises au CHSCT ; d’autres consultations obligatoires peuvent être prévues par des dispositions réglementaires ou par un accord collectif de travail.
Selon le code du travail, le CHSCT doit tout d’abord impérativement être consulté avant toute décision d’aménagement « important » modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, résultant par exemple de la modification de l’organisation du travail, d’un changement des cadences ou des normes de productivité.
Le CHSCT doit également être consulté préalablement sur les projets d’introduction de nouvelles technologies, sur les plans d’adaptation établis lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides, ainsi que sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre ou civils et des travailleurs handicapés.
Le CHSCT est ensuite nécessairement consulté sur les documents se rattachant à sa mission, tels que le règlement intérieur de l’entreprise – qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été soumis au comité – ou le document unique d’évaluation des risques.
Enfin, le CHSCT doit se prononcer sur toute question relevant de sa compétence dont il serait saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.
• Les modalités de la consultation obligatoire
La consultation du CHSCT doit intervenir selon un ordre précis : lorsque le CHSCT et le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, le CHSCT doit impérativement être consulté en premier, afin que le comité d’entreprise dispose de l’avis du CHSCT avant de se prononcer lui-même sur la validité du projet en question. En cas de non-respect de l’ordre de la consultation, le comité d’entreprise est fondé à soulever l’irrégularité de la procédure devant le juge (215).
Par ailleurs, la consultation obligatoire du CHSCT suppose que les membres du comité disposent de l’ensemble des éléments d’information nécessaires pour mesurer les incidences des projets soumis sur la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise. La présentation du projet de l’employeur doit donc nécessairement être accompagnée de toutes les indications relatives aux conséquences éventuelles sur les conditions de travail.
Le non-respect par l’employeur de l’obligation de consultation ou des règles s’appliquant à la consultation obligatoire est susceptible de constituer un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT.
Composé du président – l’employeur ou son représentant – et d’une délégation du personnel, dont les membres sont désignés par un collège constitué de membres élus du comité d’entreprise et de délégués du personnel, le CHSCT se réunit, à l’initiative de l’employeur, au moins une fois par trimestre.
Les réunions du CHSCT se déroulent conformément à l’ordre du jour fixé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du comité, en vertu des dispositions de l’article L. 4614-8 du code du travail. L’employeur ne peut en aucun cas déterminer seul l’ordre du jour de la réunion, même en cas de défaillance du secrétaire. L’employeur et le secrétaire doivent donc s’entendre sur l’ensemble des points à examiner lors de la réunion du CHSCT.
L’ordre du jour ne peut pas prévoir d’aborder des sujets qui ne relèvent pas des missions du CHSCT. En revanche, il doit indiquer clairement les sujets sur lesquels le comité est consulté, les sujets sur lesquels il reçoit une information ainsi que les décisions ou les résolutions du comité.
L’ordre du jour peut également prévoir l’approbation des procès-verbaux des précédentes réunions ainsi que l’examen de questions soumises au CHSCT par les représentants du personnel.
Une fois l’ordre du jour fixé, il doit être transmis à ses membres ainsi qu’à l’inspecteur du travail dans un délai de quinze jours, ou de trois jours minimum avant la réunion si celle-ci porte sur un projet de restructuration et de compression des effectifs.
En cas de désaccord relatif à l’inscription à l’ordre du jour entre le président et le secrétaire, l’un ou l’autre de ces derniers doit saisir le juge des référés, à qui il revient de mettre fin au blocage et de déterminer lui-même le contenu de l’ordre du jour en cause.
En l’état actuel du droit, l’employeur ne peut décider unilatéralement d’inscrire une question qui ne fait pas consensus à l’ordre du jour, même s’il s’agit d’une consultation obligatoire. Dans un arrêt rendu le 4 janvier 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet estimé que la modification unilatérale de l’ordre du jour par l’employeur constituait une irrégularité constitutive d’un délit d’entrave. De même, si l’employeur refuse d’inscrire à l’ordre du jour un sujet soumis obligatoirement à la consultation du comité soulevé par le secrétaire, son refus constitue un délit d’entrave.
Or ce recours systématique au juge est de nature à entraver le bon fonctionnement du CHSCT, notamment lorsqu’il conduit à différer l’examen des consultations obligatoires qui s’imposent au CHSCT.
Afin de limiter le recours au juge en cas de désaccord lié à la fixation de l’ordre du jour du CHSCT, le présent article propose d’inscrire de plein droit l’ensemble des consultations obligatoires à l’ordre du jour du CHSCT.
Cette disposition s’inspire d’une disposition similaire relative à l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise : la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a en effet créé une obligation d’inscription de plein droit des consultations obligatoires à l’ordre du jour du comité d’entreprise, par l’employeur ou par le secrétaire, à l’article L. 2325-15 du code du travail.
Le 1° du présent article propose d’insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article L. 4614-8 du code du travail prévoyant l’inscription de plein droit des consultations obligatoires du CHSCT à son ordre du jour. Il est précisé que cette inscription d’office vaut pour l’ensemble des consultations obligatoires, qu’elles soient prévues par « une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail ».
En outre, il est indiqué que l’inscription peut être effectuée indifféremment « par le président ou le secrétaire ». La portée de cette formulation, identique à celle retenue pour l’ordre du jour du comité d’entreprise, a été précisée par un arrêt du 12 juillet 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a estimé que la possibilité donnée au président ou au secrétaire d’inscrire d’office les consultations obligatoires à l’ordre du jour du comité d’entreprise ne remet pas en cause le principe de la recherche d’un compromis entre le président et le secrétaire sur le contenu de l’ordre du jour. Ainsi, s’agissant du comité d’entreprise, l’inscription d’office ne dispense pas l’employeur qui entend faire inscrire une question à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, quand bien même la consultation en cause est obligatoire.
En prévoyant l’inscription de plein droit des consultations obligatoires à l’ordre du jour du CHSCT, cet article devrait donc permettre d’assurer l’inscription des consultations obligatoires à l’ordre du jour en limitant les risques pour l’employeur de commettre un délit d’entrave, tout en permettant au CHSCT d’assurer pleinement sa mission de consultation.
Le recours au juge sera désormais limité aux seuls cas de désaccord sur le caractère obligatoire de la consultation ; il lui appartiendrait alors d’apprécier a posteriori si le point litigieux constituait bien un sujet devant être obligatoirement soumis à la consultation du CHSCT.
La modification proposée au 2° de l’article est rédactionnelle.
Lors de son examen du texte, la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1578 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 90 modifié.
Article 91
(art. L. 2323-4 du code du travail)
Banque de données unique
Cet article a pour objet de compléter le champ des informations transmises par l’employeur aux membres du comité d’entreprise pouvant être mises à disposition par le biais d’une base de données actualisées. Il s’inscrit dans la continuité de l’article 8 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoyait la mise en place et les modalités de fonctionnement de cette banque de données.
Le comité d’entreprise, constitué dans toutes les entreprises employant « au moins cinquante salariés », est notamment chargé d’assurer l’« expression collective des salariés » : selon les termes de l’article L. 2323-1 du code du travail, cette représentation permet de prendre en compte de façon permanente les intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité d’entreprise est ainsi doté d’une double mission d’information et de consultation.
Pour mener à bien sa mission d’information, le comité d’entreprise doit bénéficier d’une information adéquate sur la situation de l’entreprise. À cet effet, le code du travail prévoit la transmission par l’employeur d’informations « écrites et précises » aux membres du comité d’entreprise.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de consultation, le comité d’entreprise est amené à formuler un avis sur les documents transmis par l’employeur préalablement à la décision de ce dernier. L’employeur doit par conséquent communiquer au comité d’entreprise les éléments d’information indispensables à la formulation d’un avis motivé.
Afin de faciliter la transmission des données et le partage de l’information au sein des entreprises, l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoyait la mise en place d’une base de données unique ayant vocation à servir de support pour les informations transmises de façon récurrente par l’employeur au comité d’entreprise.
L’article 8 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 précitée est la déclinaison de cette mesure. Il insérait en effet deux dispositions nouvelles, codifiées aux articles L. 2323-7-2 et L. 2323-7-3 du code du travail, visant à mettre en place une base de données économiques et sociales dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés.
Cette base de données, accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise (CCE), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et aux délégués syndicaux, contient notamment des informations relatives aux investissements et à la situation financière de l’entreprise, à la rémunération des salariés et des dirigeants ou encore aux activités sociales et culturelles de l’entreprise.
L’article L. 2323-7-3 précise que la mise à disposition des éléments d’information contenus dans les rapports et informations par l’intermédiaire de la base de données « vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise ».
La base de données unique vise ainsi à offrir aux membres du comité d’entreprise une vision claire et complète de la situation économique et sociale de l’entreprise. La nature des informations transmises par l’employeur aux membres du comité d’entreprise n’a donc pas été modifiée ; en revanche, les informations deviennent accessibles en permanence et bénéficient d’une actualisation plus régulière.
S’inscrivant dans le prolongement de la loi du 14 juin 2013, le présent article tend à étendre le champ d’utilisation de la base de données unique dans le cadre de la mission de consultation du comité d’entreprise.
Les principes de la consultation du comité d’entreprise sont définies à l’article L. 2323-4 du code du travail, qui dispose que l’employeur transmet au comité d’entreprise des informations « précises et écrites » afin de lui permettre de formuler un avis motivé à l’égard des décisions de l’employeur.
Il est proposé ici de prévoir que ces informations pourront désormais non seulement être transmises selon les modalités présentées ci-dessus, mais elles pourront également être communiquées, « le cas échéant », par l’intermédiaire de la base de données unique, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE936 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la création d’une base de données comprenant de nombreuses informations à destination des représentants du personnel. L’article 91 du projet de loi vient en préciser les modalités d’utilisation. Cependant, lorsque l’employeur doit fournir des informations obligatoires au comité d’entreprise, il n’est pas précisé qu’il doit en informer les salariés. Il peut donc se contenter de publier ces informations dans la base de données. Mais, s’il n’en prévient pas les salariés, ceux-ci ne pourront le deviner. Notre objectif est de faire en sorte que l’employeur en informe les représentants du personnel.
M. le ministre. Cette base de données a été conçue comme support d’un dialogue de proximité devant permettre aux élus d’exercer utilement leurs compétences respectives. Le Gouvernement comprend l’esprit de votre amendement, qui vise à assurer au salarié une information pertinente en temps utile. Néanmoins, cela relève de la négociation entre partenaires sociaux. La négociation relative à la modernisation du dialogue social ou la réflexion menée dans le cadre du bilan de la loi relative à la sécurisation de l’emploi en sont le bon cadre. C’est pourquoi je vous propose de ne pas faire figurer ces dispositions dans la loi et, à ce stade, de laisser les partenaires sociaux négocier.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement me semble satisfait par l’article R. 2323-7-3 du code du travail, aux termes duquel l’employeur informe les représentants du personnel de l’actualisation de la base de données précitée selon des modalités qu’il détermine et en fixe les modalités d’accès.
Mme Jacqueline Fraysse. Dans ces conditions, je retire mon amendement. Cela étant, monsieur le ministre, la nécessité pour l’employeur d’informer les salariés du fait qu’il vient de modifier les informations présentées dans cette base de données ne devrait pas relever du dialogue social mais du bon sens.
M. le ministre. Je partage votre préoccupation. Mais s’il s’agit d’une disposition de bon sens, alors il est inutile de la faire figurer dans la loi. Je souhaitais simplement souligner que l’évolution de ces normes suppose le recours au dialogue social.
L’amendement SPE936 est retiré.
La Commission adopte l’article 91 sans modification.
*
* *
Après l’article 91
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques SPE253 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE420 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements SPE1043 et SPE1044 de M. Jean-Christophe Fromantin.
M. Gérard Cherpion. Puisque le projet de loi vise à relancer la croissance et l’activité dans notre pays, nous proposons de supprimer les dispositions de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi « Florange » qui entravent celles-ci.
M. Patrick Hetzel. Ainsi, je le précise, qu’un article de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, adaptant aux PME l’une des dispositions de la loi « Florange ». En effet, ces dispositions jettent le discrédit sur l’ensemble des chefs d’entreprise et instaurent un climat de méfiance, alors que le Gouvernement a exprimé le souhait de relancer la croissance et l’activité.
M. le président François Brottes. C’est mal connaître la loi « Florange » que d’en tirer de telles conclusions !
M. le ministre. La loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle a instauré l’obligation pour le chef d’entreprise de chercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement. Cette disposition étant circonscrite à un nombre limité de cas, elle ne me semble pas de nature à inquiéter outre mesure les chefs d’entreprise. Elle a d’ailleurs déjà permis, dans plusieurs cas, de sauver une centaine d’emplois. Elle contribue plutôt à améliorer le dialogue social au sein de l’entreprise. Elle assure un équilibre entre la nécessité de maintenir une liberté de gestion de l’entreprise et celle de préserver l’emploi sur le territoire concerné. En outre, elle comporte une disposition prévoyant qu’un rapport sera remis au Parlement dans un délai d’un an à compter de sa promulgation. Ce sera l’occasion d’établir un premier bilan de ces mesures.
À titre personnel, je considère que ce dispositif rejoint la philosophie des dispositions que vous avez adoptées il y a un peu plus de vingt-quatre heures s’agissant des procédures collectives. Celles-ci consistent à permettre de trouver un nouveau projet d’entreprise lorsque le projet existant n’est plus poursuivi.
Les dispositions de la loi « Florange » ne sont pas aussi anxiogènes qu’on a pu le dire, même si elles ont crispé certaines organisations patronales. Le législateur ayant prévu que ce texte soit évalué, j’émets un avis défavorable à ces amendements.
M. le président François Brottes. Cette loi tend à favoriser les entrepreneurs qui souhaitent continuer à entreprendre sur le territoire national. Les dispositions que vous visez ne concernent que ceux qui, ayant décidé de se délocaliser afin de supporter des coûts moins élevés ailleurs, refusent absolument que leur activité soit reprise par tout autre entrepreneur, alors même qu’elle a encore un avenir.
Il nous paraît trop facile de quitter le territoire en laissant à d’autres le soin de payer les cotisations patronales et les indemnités de licenciement des salariés qu’on a mis au chômage, et cette loi nous semble parfaitement compatible avec l’esprit d’entreprise. C’est bien parce que nous avons constaté dans de nombreux cas que l’on avait fermé la porte à des repreneurs potentiels que nous l’avons adoptée.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous nous apprêtons à examiner une série d’amendements portant sur des sujets qui nous opposent régulièrement. Or je ne suis pas favorable à ce que l’on rouvre systématiquement des débats ayant déjà eu lieu. La discussion de la loi « Florange » ayant déjà été tranchée, j’émets un avis défavorable à ces amendements.
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous allons les retirer. Je comprends que vous vous lassiez de nous voir revenir constamment sur des dispositions qui nous paraissent défavorables à l’économie française. Si nous nous répétons, c’est parce que c’est là une des lois de la pédagogie. Nous redéposerons donc cet amendement en séance publique.
Les amendements SPE253 et SPE420 sont retirés.
M. le ministre. Quant aux amendements défendus par M. Zumkeller, ils relèvent d’une logique similaire, même s’ils concernent un autre dispositif, au sujet duquel le Premier ministre a confié une mission à une députée afin de dissiper les inquiétudes qui ont pu apparaître. Avis défavorable, donc.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements SPE1043 et SPE1044.
La Commission examine ensuite les amendements SPE1069 rectifié et SPE1062 rectifié de M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Ces amendements visent à améliorer la gouvernance des entreprises et à constituer l’« alliance des producteurs », indispensable à la croissance et à l’activité. Il s’agit de renforcer la présence des salariés dans les instances dirigeantes des entreprises. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui a transposé l’accord national interprofessionnel – ANI – du 11 janvier 2013, a ouvert à deux représentants des salariés les conseils des entreprises comptant plus de 5 000 employés. Le premier amendement propose d’augmenter ce nombre de deux à quatre ; le second a pour objet la suppression de conditions restreignant cette présence – implantation du siège social en France et existence d’un comité d’entreprise – et d’abaisser le critère de taille de 5 000 à 1 000 salariés.
Mes propositions suivent les recommandations du rapport de M. Louis Gallois sur la compétitivité, et je regrette que la loi de transposition de l’ANI soit restée en retrait des préconisations de l’ancien commissaire général à l’investissement.
M. le ministre. Vous avez raison, monsieur Laurent, sur le degré d’ambition élevé du rapport Gallois par rapport à la loi de juin 2013. J’émets néanmoins une réserve sur le seuil, car il convient de mener progressivement ces évolutions et nous ne disposons pas de suffisamment de recul pour évaluer les effets de ce texte législatif. La rédaction de ce dernier permet d’ailleurs à beaucoup d’entreprises, selon leur forme juridique, de contourner cette obligation. J’ai exprimé cette préoccupation devant le Haut Comité de gouvernement d’entreprise, organe indépendant qui rend des avis à la demande de l’Association française des entreprises privées – AFEP – et du Mouvement des entreprises de France – MEDEF –, et à qui j’ai commandé un rapport sur le sujet.
Je partage la philosophie de votre premier amendement, mais nous devons réfléchir à sa bonne traduction juridique sachant que nous souhaitons limiter le nombre total d’administrateurs. Je vous demande de retirer votre amendement et m’engage à préparer avec vous d’ici à la séance un amendement qui serve votre ambition tout en étant sûr juridiquement. En revanche, j’émets un avis défavorable à l’adoption du second amendement.
Nous devons stimuler l’« alliance des producteurs », comme nous l’avons déjà fait à l’occasion de la réforme de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale.
M. Jean-Luc Laurent. Je retire les deux amendements et forme le vœu que nous pourrions aboutir en séance à l’adoption d’une disposition permettant d’élargir la représentation des salariés dans les instances de gouvernance des entreprises. Les salariés doivent en effet être associés à la définition des intérêts stratégiques des entreprises.
Les amendements SPE1069 rectifié et SPE1062 rectifié sont retirés.
Les amendements identiques SPE254 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE421 de M. Patrick Hetzel sont retirés.
La Commission étudie les amendements SPE835 et SPE829 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. L’examen des données fiscales met en lumière le grand nombre d’entreprises dont les effectifs se situent juste en dessous des seuils sociaux ; ceux-ci pourraient donc expliquer les difficultés rencontrées par les entreprises françaises à atteindre une taille critique pour leur positionnement international. Sans ces seuils, la probabilité qu’une entreprise employant neuf salariés en embauche un supplémentaire passerait de 24 % à 29 % et augmenterait respectivement de neuf et de quatorze points pour celles comptant 19 et 49 salariés. Sans remettre en cause l’organisation des institutions représentatives du personnel, le présent amendement vise à porter le seuil de 11 salariés à 21 et celui de 50 salariés à 60, le franchissement de ce dernier déclenchant la mise en œuvre de trente-cinq obligations nouvelles.
M. le ministre. Le Gouvernement partage votre raisonnement puisque nous avons ouvert une négociation relative à la modernisation du dialogue social dont l’un des thèmes porte sur la réforme des seuils sociaux. Néanmoins, si votre proposition pourrait certes créer des emplois, j’émets un avis défavorable à son adoption car la discussion entre les partenaires sociaux a lieu actuellement. Ceux-ci se réunissent d’ailleurs le 22 janvier prochain et s’ils parvenaient à un accord, le Gouvernement vous le soumettrait pour le transcrire dans la loi.
M. Michel Zumkeller. Je retire mes amendements, mais nous suivrons de près les résultats de cette négociation, car on nous dit depuis des années qu’un accord va intervenir sur ce sujet et tel n’est toujours pas le cas.
Les amendements SPE835 et SPE829 sont retirés.
La Commission en vient à l’amendement SPE585 de Mme Laure de La Raudière.
M. Gilles Lurton. Cet amendement propose de geler les seuils sociaux à titre expérimental et pour une durée de trois ans dans les entreprises employant de onze à cinquante salariés. Il serait procédé à une évaluation du dispositif au bout de cette période.
M. le ministre. Pour les raisons que je viens d’évoquer, je vous demande de retirer votre amendement.
L’amendement SPE585 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement SPE683 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement concerne le financement des organisations syndicales de salariés qui doit reposer sur la représentativité issue des élections professionnelles pour que la démocratie sociale soit plus efficace et plus transparente.
M. le ministre. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale fixe un cadre au financement des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs. Les dotations de l’État concernent la formation syndicale, économique et sociale et la participation de ces organisations aux politiques publiques. Vous proposez de revoir les principes posés par ce texte législatif, alors que la négociation sociale en cours pourrait avoir un impact sur les critères de représentativité ; les organisations syndicales et professionnelles étudieront le fonctionnement et les conséquences de la représentation au sein de l’entreprise. Puisque nous avons voté récemment une loi sur ce sujet, j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Comme vient de l’expliquer le ministre, la loi est très récente et le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et professionnelles n’existe que depuis le 1er janvier dernier. Il s’avérerait donc singulier de modifier une règle à peine entrée en vigueur. Si les partenaires sociaux souhaitent la faire évoluer, nous prendrions en compte cet élément nouveau, mais notre majorité n’a pas à agir si peu de temps après avoir adopté une loi. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
S’agissant des seuils, attendons de voir ce qu’en pensent les partenaires sociaux.
La Commission rejette l’amendement SPE683.
Puis elle aborde les amendements identiques SPE701 de M. Charles de Courson et SPE705 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Ces amendements visent à rendre toute sa place au dialogue social en précisant qu’une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peuvent déroger aux dispositions du code du travail, à l’exception de celles touchant aux principes fondamentaux.
M. le ministre. Plusieurs économistes et juristes, comme MM. Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, portent cette proposition consistant à inverser l’ordre public social. Cela supposerait toutefois que le législateur définisse le socle minimal commun à la suite d’une négociation approfondie et ambitieuse – celle qui se déroule en ce moment pouvant en constituer l’indispensable premier pas ; nous ne pouvons pas adopter cette mesure par un amendement à ce texte et j’émets donc un avis défavorable à son approbation.
Les amendements SPE701 et SPE705 sont retirés.
*
* *
Section 4
Simplification pour la vie des entreprises
Article 92
(Art. L. 5212-6 du code du travail)
Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
pour les travailleurs indépendants handicapés
Cet article propose d’intégrer les contrats de sous-traitance passés avec des travailleurs indépendants handicapés dans les modalités d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi de 6 % des personnes handicapées.
Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant au moins vingt salariés, doit employer des personnes handicapées, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées
En vertu de l’article L. 5212-13 du code du travail, sont bénéficiaires de cette obligation :
– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
– les personnes mentionnées aux articles L. 394, L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (à titre d’exemple les invalides de guerre, les victimes civiles de la guerre et les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service) ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
– les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
L’employeur peut s’acquitter de son obligation en embauchant directement les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et ce, à hauteur de 6 % de l’effectif total de ses salariés. Ces personnes peuvent être embauchées en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Il peut aussi s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi :
– en accueillant en stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise. Sont prises en compte les personnes qui effectuent un stage mentionné à l’article L. 6341-3 du code du travail, un stage organisé par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), un stage prescrit par Pôle emploi, un stage au titre de l’article L. 331-4 du code de l’éducation ou un stage au titre de l’article L. 612-8 du code de l’éducation. La durée de ce stage doit être égale ou supérieure à 40 heures. Ces personnes sont décomptées au titre de l’année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise.
– en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services soit avec des entreprises adaptées (EA) ou des centres de distribution de travail à domicile, soit avec des établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Cette modalité n’entre en compte au maximum que pour 50 % de l’obligation légale d’emploi (soit 3 %) ;
– en faisant application d’un accord de branche, d’un accord de groupe, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d’embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : plan d’insertion et de formation, plan d’adaptation aux mutations technologiques ou plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.
Les employeurs tenus à l’obligation d’emploi peuvent s’acquitter de cette obligation en versant à l’AGEFIPH une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer. Cette contribution est égale :
– au nombre de bénéficiaires manquants, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration applicables au titre des efforts consentis par l’employeur en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
– multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration applicable au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières occupés par des salariés de l’établissement ;
– multiplié par des montants fixés pour tenir compte de l’effectif de l’entreprise.
II. INTÉGRER LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS HANDICAPÉS DANS LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT PARTIEL DE L’OBLIGATION D’EMPLOI
En l’état actuel du droit, les contrats passés avec les travailleurs indépendants handicapés ne sont pas pris en compte au titre de l’obligation d’emploi des entreprises. Or, l’activité indépendante peut offrir des perspectives d’emploi aux personnes handicapées.
Le rapporteur thématique considère, en effet, qu’il est plus opportun de voir une entreprise être incitée à conclure un contrat de prestation de services avec un travailleur indépendant handicapé que de verser une contribution à l’AGEFIPH sans respecter son obligation d’emploi. Cette mesure permet aussi de revenir sur l’inégalité de traitement qui existe actuellement entre les travailleurs handicapés indépendants et les travailleurs handicapés salariés.
C’est pourquoi, et conformément à l’engagement pris dans le cadre du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, le présent article propose d’intégrer les contrats de sous-traitance passés avec les travailleurs indépendants handicapés dans les modalités d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi, à l’instar des contrats de sous-traitance passés avec des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
En effet, pour pouvoir valoriser ces contrats dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise ne peut les conclure qu’avec les structures agréées par l’État qui emploient les travailleurs les plus lourdement handicapés. En l’état actuel du droit, les entreprises ne bénéficient pas de cette possibilité lorsqu’elles concluent un contrat de prestation avec un travailleur indépendant.
L’étude d’impact indique que l’ouverture de cette possibilité devrait permettre de favoriser ces travailleurs, qui représentaient en 2008, 8 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, soit environ 71 500 personnes.
L’article 92 modifie donc l’article L. 5212-6 du code du travail relatif à l’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des personnes handicapées.
Le 2° ajoute à la liste des cas permettant pour l’employeur de s’acquitter partiellement de son obligation un 4° mentionnant les « travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de l’article L. 5212-13. »
Le 2° précise que les travailleurs indépendants concernés par ces dispositions sont ceux répondants aux conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1 du code du travail.
Les travailleurs indépendants au sens des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail
Article L. 8221-6
« Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Article L. 8221-6-1
« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
En l’état actuel du droit, l’article L. 5212-6 du code précité indique que l’acquittement partiel de l’obligation d’emploi est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
Le 3° précise donc que « cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
Le rapporteur thématique tient à souligner que cette nouvelle possibilité pour les entreprises sera strictement encadrée.
En effet, l’étude d’impact indique qu’un décret précisera quels seront les travailleurs handicapés concernés par cette disposition, et quelles seront les modalités et limites de cet acquittement partiel. Il déterminera notamment la part de la facture qui pourra être prise en compte au titre de l’acquittement partiel de l’obligation d’emploi en fonction du nombre de salariés éventuellement employés par le travailleur indépendant handicapé. Il est notamment précisé que « le dispositif sera encadré de façon à limiter les effets d’aubaine tout en restant attractif pour les entreprises souhaitant recourir aux services d’un travailleur indépendant handicapé. »
D’après les informations transmises au rapporteur thématique par le ministère, la formule retenue devrait être calquée sur les dispositions de l’article R. 5212-7 du code du travail, retenant – comme pour la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées (ou établissement et service d’aide par le travail) – la base horaire de 1 600 heures, soit l’équivalent d’un emploi. Il est en effet possible d’estimer qu’un travailleur handicapé indépendant, est considéré comme apte à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sous certaines conditions d’aménagement.
La formule retenue serait donc le prix hors taxes des fournitures, des travaux ou des prestations figurant au contrat, déduction faite du coût des matières premières des produits, des matériaux, des consommations et des frais de vente (consommations intermédiaires) divisé par 1 600 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi.
Par rapport aux modalités de calcul de la déduction utilisées pour les EA et ESAT, deux modifications devraient être proposées pour les travailleurs indépendants handicapés :
– dans le cas où le travailleur indépendant handicapé a un ou des salariés : le montant de la facture « hors taxe » moins les consommations intermédiaires est divisé par le nombre de salariés. Ainsi seul sera déductible de l’obligation d’emploi le volume de travail effectué par le travailleur indépendant handicapé, puisque c’est lui qui est visé par la mesure ;
– dans le cas où le travailleur indépendant handicapé bénéficie du régime de la micro-entreprise et ne dispose pas d’une comptabilité détaillée lui permettant d’évaluer le coût réel des consommations intermédiaires, le montant de celles-ci pourra être forfaitaire.
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a adopté plusieurs amendements rédactionnels.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1369 de Mme Barbara Pompili.
M. Jean-Louis Roumegas. Je retire notre amendement, mais je souhaite pointer le danger d’un effet aubaine pour des entreprises faisant appel à des travailleurs handicapés indépendants.
M. le ministre. Monsieur Roumegas, je vous remercie de retirer votre amendement. Cet article 92 transcrit dans la loi la mesure décidée le 25 septembre 2013 par le Comité interministériel du handicap, visant à soutenir l’activité indépendante de personnes handicapées, les collaborations suscitées par les contrats de sous-traitance pouvant favoriser des recrutements.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Monsieur Roumegas, je ne vois pas pourquoi il devrait exister un traitement discriminatoire entre travailleurs handicapés selon qu’ils sont salariés ou indépendants. C’est le handicap qui compte, pas le régime juridique ! Cet article répond à une demande d’associations de travailleurs handicapés indépendants souhaitant bénéficier des mêmes avantages que les entreprises employant des salariés handicapés.
L’amendement SPE1369 est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1816 et SPE1817 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 92 modifié.
*
* *
Article 93
(Art. L. 5212-7-1 du code du travail [nouveau])
Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel
L’article 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (216) a créé un nouveau dispositif d’insertion dans l’emploi, ouvert à la fois aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, et leur permettant de jouir d’une expérience professionnelle. Cet outil a unifié les dispositifs éclatés qu’étaient les périodes d’immersion, les périodes d’évaluation en milieu de travail et les périodes en milieu professionnel. Il est codifié au chapitre V, dénommé « Périodes de mise en situation en milieu professionnel », au sein du titre III, consacré aux aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi, du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
En vertu de l’article L. 5135-1 du code précité, la période de mise en situation en milieu professionnel doit permettre à un travailleur ou à un demandeur d’emploi :
– soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
– soit de confirmer un projet professionnel ;
– soit d’acquérir de nouvelles compétences ;
– soit d’initier une démarche de recrutement.
Peut accéder à ce dispositif « toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé », à savoir : tout demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle emploi, tout jeune inscrit auprès d’une mission locale, toute personne inscrite auprès de Cap Emploi, toute personne engagée dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle pouvant être coordonné par un conseil général, un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ou une association, tout salarié du secteur de l’insertion par l’activité économique, en contrat aidé ou accompagné par une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) (article L. 5132-2 du code du travail).
Le bénéficiaire d’une période de mise en situation professionnelle conserve le régime d’indemnisation qui lui était auparavant accordé. Il n’est donc pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue sa période. En revanche, aux termes de l’article L. 5135-6 du code précité, il suit les règles applicables aux salariés de la structure pour ce qui a trait aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, et à la santé et à la sécurité au travail.
Le décret du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel (217) précise que chaque période nécessite la signature d’une convention entre l’entreprise, le bénéficiaire, l’organisme qui a prescrit ce dispositif (Pôle emploi, missions locales, etc.), et la structure d’accompagnement si elle est différente du prescripteur. Cette convention ne peut, en principe, pas excéder un mois, renouvelable une fois. Sachant que par année, deux conventions maximum peuvent être conclues pour un même bénéficiaire à condition qu’elles aient un objet différent et que leur durée totale n’excède pas soixante jours.
L’article 93 a pour objectif d’inciter les entreprises à mettre en œuvre cette disposition en faveur des travailleurs handicapés, en en faisant une modalité d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, au même titre que pour les stages prévus à l’article L. 5212-7 du code du travail.
Dans ce but, il crée un nouvel article L. 5212-7-1 qui prévoit que l’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Une telle mesure permettra à des personnes handicapées « de renouer » avec le monde du travail et très certainement aussi à des employeurs de se rendre davantage compte de la possibilité d’employer des personnes handicapées.
Comme pour les travailleurs indépendants, un décret en Conseil d’État précisera les modalités et limites de cet acquittement partiel.
D’après les informations transmises au rapporteur thématique par le ministère, les modalités d’accomplissement de l’obligation d’emploi pour les périodes de mise en situation en milieu professionnel seront calquées sur les modalités prévues actuellement pour les stages à l’article R. 5212-10 du code du travail c’est-à-dire en divisant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle du travail dans l’entreprise.
Cependant, afin d’apporter des garanties complémentaires, le rapporteur thématique proposera par amendement, en séance publique, que l’employeur ne puisse s’acquitter de son obligation d’emploi des personnes handicapées en les accueillant en stage ou dans le cadre de périodes de mise en situation professionnelle que dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE937 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1370 de Mme Barbara Pompili, ainsi que l’amendement SPE1895 des rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article L. 5212-7 du code du travail prévoit que l’accueil des stagiaires en situation de handicap permet à un chef d’entreprise de remplir partiellement son obligation d’employer des travailleurs handicapés, même si le pouvoir réglementaire a encadré cette possibilité. L’article 93 du projet de loi propose d’étendre cette dérogation pour l’ouvrir aux périodes de mise en situation en milieu professionnel ; nous contestons cette disposition qui permettrait aux entreprises de se dédouaner davantage de leurs obligations d’emploi de personnes handicapées. Il s’avérerait plus judicieux d’élaborer des mesures incitatives à l’embauche de personnes handicapées. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. Jean-Louis Roumegas. La loi pose une obligation d’emploi des personnes handicapées, et les stages ne sont pas des embauches. Cependant, le rapporteur thématique a présenté un amendement réglant le problème que nous pointons, si bien que je retire mon amendement.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je ne partage pas votre inquiétude, madame Fraysse. En effet, cet article vise à aider les personnes reconnues comme handicapées qui ont perdu le contact avec l’emploi, et à qui les périodes de mise en situation en milieu professionnel permettront de renouer avec le monde de l’entreprise. Les employeurs peuvent déjà contourner leur obligation de compter 6 % de salariés handicapés en contribuant à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) ; tout ce qui permet de favoriser l’insertion d’une personne handicapée dans l’emploi me paraît préférable au versement d’une somme d’argent. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
En revanche, comme l’objectif réside dans le développement d’emplois stables pour les travailleurs handicapés, je propose, par l’amendement SPE1895, que les stagiaires handicapés et que les personnes handicapées bénéficiant de périodes de mise en situation en milieu professionnel ne puissent représenter que 2 % des salariés de l’entreprise.
Mme Jacqueline Fraysse. Je retire mon amendement.
M. Jean-Patrick Gille. Cet article incitera les entreprises à accueillir des personnes handicapées car elles pourront constater, lors des stages, l’intérêt de les embaucher.
M. Gilles Lurton. Tel que rédigé, l’article 93 favorise l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cependant je souhaite améliorer la rédaction de mon amendement ; je le retire et je le redéposerai en séance publique.
Les amendements SPE937, SPE1370 et SPE1895 sont retirés.
La Commission adopte l’article 93 sans modification.
*
* *
Article 94
Habilitation à prendre par ordonnance des mesures
pour remplacer, outre-mer, le contrat d’accès à l’emploi par le contrat initiative emploi et pour y abroger le contrat d’insertion par l’activité
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures pour remplacer, outre-mer, le contrat d’accès à l’emploi par le contrat initiative emploi et pour y abroger le contrat d’insertion par l’activité.
Il est proposé, pour ce faire, une habilitation du Gouvernement d’une durée de douze mois à compter de la publication de la loi. L’article 106 du projet de loi précise que, pour chacune des ordonnances qui pourraient être prises en application du présent article, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de chacune d’elles.
En 2011, la mise en œuvre du contrat unique d’insertion s’est traduite, outre-mer, par la mise en œuvre du même contrat qu’en métropole dans le secteur non-marchand – le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) – alors que dans le secteur marchand, le contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM) a été maintenu, bien qu’adapté – le contrat applicable en métropole est le contrat initiative emploi (CUI-CIE).
Depuis 2011, les objectifs de mises en place des CAE-DOM ne sont plus atteints. C’est ainsi qu’en 2013, seuls 3 916 contrats ont été signés au lieu des 5 806 programmés.
Par ailleurs, les garanties offertes aux titulaires de contrats, notamment en termes de qualité du parcours d’insertion sont plus importantes dans le cadre du contrat initiative-emploi (CIE) en vigueur en métropole : désignation d’un tuteur, définition d’actions d’accompagnement et de formation, exclusion des recrutements par des particuliers.
L’habilitation du Gouvernement concerne trois domaines :
– il s’agit, en premier lieu, de supprimer le « contrat d’accès à l’emploi » spécifique à l’outre-mer, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail.
– il s’agit, en deuxième lieu, de permettre corrélativement au Gouvernement d’étendre et d’adapter aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du code du travail ;
– Il s’agit, enfin, de supprimer le contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles.
Sur ce dernier point, il s’agit simplement de tirer les conséquences juridiques de l’abandon du contrat d’insertion par l’activité depuis 2012.
Cet article vient donc clarifier et mettre en cohérence les dispositifs de contrats aidés en outre-mer, rendant le contrat initiative emploi applicable tant en métropole qu’outre-mer.
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a adopté plusieurs amendements rédactionnels.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1818 et SPE1924 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 94 modifié.
*
* *
Après l’article 94
La Commission aborde l’amendement SPE568 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement vise à inscrire l’intérêt social de l’entreprise dans la loi, afin de permettre aux administrateurs et aux partenaires du dialogue social de se saisir des sujets liés aux impacts économiques, environnementaux et sociétaux de l’activité de leur entreprise.
M. le ministre. Je partage l’ambition portée par cet amendement, et nous avions d’ailleurs essayé d’introduire une mesure analogue dans ce texte, la définition de l’entreprise dans le code civil s’avérant inadaptée puisqu’elle n’évoque que le capital et ne reflète donc pas la vie de l’entreprise ni l’ambition que portent ce projet de loi et nos débats.
S’il importe d’introduire la notion d’intérêt social dans le code civil, ce sujet éminemment complexe a soulevé beaucoup d’observations du Conseil d’État car elle engendrerait des conséquences non négligeables pour les entrepreneurs et pour la définition de l’abus de bien social. Nous n’avons donc pas retenu une telle disposition dans le projet de loi et j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement, mais le Gouvernement continuera de travailler sur ce sujet afin de présenter un projet au Parlement dans quelques mois.
L’amendement SPE568 est retiré.
La Commission étudie les amendements identiques SPE125 de M. Gérard Cherpion et SPE458 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à abroger l’article L. 124-8 du code de l’éducation. La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a mis en place un quota maximal de stagiaires par entreprise, ce qui tarira l’offre de stages alors que ceux-ci constituent une étape importante dans la validation d’un cursus. Les entreprises innovantes engagent beaucoup de jeunes stagiaires qu’elles forment avec une haute valeur ajoutée.
M. Patrick Hetzel. La loi encadrant les stages a d’ores et déjà entraîné une contraction de l’offre de stages.
M. le ministre. Le Parlement a encadré les stages en votant une proposition de loi du groupe SRC qui était en fait, à mon humble avis, une fausse bonne idée engendrant de nombreux effets pervers. Pour autant, multiplier le nombre de stagiaires dans une entreprise n’est pas une bonne solution, et il convient de réfléchir aux moyens d’endiguer ce phénomène, mais la loi récente ne s’avère pas satisfaisante. En tant que membre du Gouvernement, je dois néanmoins émettre un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Mon avis est également défavorable. Des universités et des établissements d’enseignement supérieur ont élaboré des dispositifs visant à adapter les stages à la nouvelle réglementation ; ces solutions nous dispenseront de modifier la loi du 10 juillet 2014.
La Commission rejette les amendements SPE125 et SPE458.
Puis elle en vient à l’amendement SPE570 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Chacun connaît l’importance de la formation et cet amendement vise à accroître le volume de formation continue en encourageant par une incitation fiscale toute personne salariée ou en recherche d’emploi souhaitant abonder son compte personnel de formation – CPF.
M. Jean-Patrick Gille. Le CPF n’est en vigueur que depuis le 1er janvier et les représentants des cadres estiment que la mise en œuvre de la mesure proposée par cet amendement constituerait une mauvaise idée, car elle inciterait les entreprises à laisser les salariés financer leur formation plutôt que de négocier l’abondement du CPF. Attendons le plein déploiement du CPF et évaluons-le dans quelques années.
M. le ministre. Nous ne souhaitons pas créer de nouveaux dispositifs fiscaux alors que le CPF vient juste d’entrer en application. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je suis du même avis, d’autant que nous ne disposons pas d’étude d’impact évaluant les conséquences financières de cette incitation fiscale.
La Commission rejette l’amendement SPE570.
Puis elle est saisie de l’amendement SPE561 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Le groupe UDI est très attaché aux emplois de service à la personne, qui sont l’une des mesures phare du plan de cohésion sociale de M. Jean-Louis Borloo, si profitable pour l’économie de notre pays. Depuis deux ans, le secteur des services à la personne connaît une dégradation inédite et une recrudescence du travail au noir. En 2013, 29,5 millions d’heures de moins ont été déclarées que l’année précédente, soit près de 16 500 emplois équivalents temps plein – ETP – détruits ; pour la première fois, la masse salariale nette du secteur des particuliers employeurs a reculé, à hauteur de 2,2 %. L’allègement du coût du travail de 75 centimes d’euros par heure s’avère insuffisant et nous proposons de l’amplifier pour redonner du souffle à ce dispositif créateur d’emplois.
M. le ministre. Un dispositif en faveur des particuliers employeurs a déjà été adopté en décembre : vous le jugez insuffisant, mais il a un coût pour les finances publiques. Il convient de dynamiser ce secteur, important pour la croissance et l’emploi, non plus en subventionnant davantage la demande par des mécanismes de défiscalisation mais en réfléchissant aux moyens de mieux organiser l’offre. Je porterai cette ambition, en lien avec la Commission nationale des services – CNS.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Monsieur Zumkeller, nous avons déjà eu ce débat en décembre dernier lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale – PLFSS – pour 2015, et il s’avère prématuré de revenir sur le dispositif proposé alors par M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget.
Un rapport de la Cour des comptes a fait état des incertitudes portant sur les effets des aides aux services à la personne. Parmi ces derniers, nous pourrions soutenir davantage ceux liés à l’enfance et aux personnes âgées, tout en veillant à ne pas encourager la reconstitution d’une abondante domesticité comme au XIXe siècle. J’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Michel Zumkeller. Le plan de cohésion sociale de M. Jean-Louis Borloo était très novateur et a porté ses fruits, si bien que nous n’avons aucune leçon à recevoir en termes d’inventivité. Quant à la domesticité, je ne pensais pas que vous en étiez encore là, car ces dispositions permettent à des gens de travailler, ce qui est le plus important.
La Commission rejette l’amendement SPE561.
Puis elle aborde l’amendement SPE550 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement vise à lancer un débat, celui du contrat de travail unique. Nous devons étudier ce système, car le contrat de travail à durée indéterminée – CDI – se trouve à la dérive aujourd’hui.
M. le ministre. Le contrat de travail unique est un vrai et ancien sujet. Plusieurs ministres de la majorité précédente ont tenté de le mettre sur la table et des lauréats du prix Nobel d’économie ont défendu son instauration.
Les quatre cinquièmes des contrats sont, en France, des CDI, mais les embauches se font à 90 % en contrats à durée déterminée – CDD. L’économie s’est adaptée à la rigidité du CDI, contrat très protecteur.
Le contrat de travail unique répond moins à une préoccupation de création d’emplois que de résolution des problèmes causés par le dualisme du marché du travail. Le CDD rend difficile l’accès au crédit et à une vie familiale stable. Une époque de chômage de masse comme la nôtre n’est pas adaptée à la mise en œuvre du contrat de travail unique car, si nous lançons une négociation pour en définir les critères, ceux-ci s’avéreront plus exigeants que l’actuel CDD ; un tel contrat serait aujourd’hui plus contraignant en termes de création d’emplois. Il conviendra d’ouvrir cette réflexion, utile au regard de la justice sociale, en période de croissance et de chômage faible.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE550.
Puis elle examine les amendements identiques SPE117 de M. Gérard Cherpion et SPE447 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. En vue de soutenir la croissance et l’activité, ce qui devrait plaire à M. le ministre, cet amendement propose de simplifier la procédure de signature des accords d’aménagement du temps de travail. Comme actuellement, ceux-ci pourront être collectifs, mais nous proposons qu’ils puissent également être signés par l’employeur et les représentants du personnel de l’entreprise après une négociation au sein du comité d’entreprise ou une ratification par une majorité des deux tiers du personnel d’un projet présenté par l’employeur.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous avons déjà débattu cette idée à l’occasion du dépôt de votre proposition de loi, monsieur Cherpion, et je n’ai pas changé de position. Les personnes pouvant signer un accord d’aménagement du temps de travail doivent être qualifiées et disposer d’une culture syndicale, car il s’agit d’un acte important. J’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. le ministre. Même avis.
La Commission rejette les amendements SPE117 et SPE447.
Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements identiques SPE116 de M. Gérard Cherpion et SPE446 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements identiques SPE558 de M. Francis Vercamer et SPE681 de M. Philippe Vigier.
M. Gérard Cherpion. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré une durée minimale de temps de travail de 24 heures par semaine. Cette idée semblait intéressante, mais son application se solde par un échec que vous avez-vous-même reconnu à demi-mot, monsieur le ministre ; il convient donc d’abroger cette disposition.
M. Michel Zumkeller. Cette durée minimale crée en effet de nombreux problèmes qu’il convient de régler.
M. le ministre. Cette disposition résulte d’un accord entre les partenaires sociaux, si bien qu’il est difficile de revenir sur son existence. Les accords de branche permettent de déroger à l’obligation légale définissant le temps partiel à vingt-quatre heures ; plusieurs branches rencontrent des difficultés pour signer des accords, et seules quarante en ont conclu dont trente-trois sont d’ores et déjà étendus. Les négociations se poursuivent dans une trentaine de branches.
La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a permis de sécuriser juridiquement le refus éventuel de l’employeur en cas d’impossibilité d’accéder à la demande d’un salarié de revenir à vingt-quatre heures de travail. Par ailleurs, le Conseil d’État examine actuellement une ordonnance qui sera bientôt publiée et qui sécurisera la procédure de dédit du salarié afin de lui accorder une priorité d’accès aux vingt-quatre heures s’il travaille actuellement moins longtemps.
Pour mettre en œuvre ce dispositif ambitieux, il convient de trouver les mécanismes d’application capables d’atteindre les objectifs fixés et de tirer les leçons de ces difficultés. Le Gouvernement continue d’identifier les obstacles empêchant la signature d’accords et à réfléchir à l’adaptation progressive du système, par exemple dans le domaine des soins à domicile. Nous ne souhaitons pas son abrogation et j’émets donc un avis défavorable à l’adoption de ces amendements.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette successivement ces amendements SPE116, SPE446, SPE558 et SPE681.
Puis elle en vient à l’amendement SPE557 de M. Francis Vercamer.
M. le ministre. Avis défavorable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE557.
Puis elle examine les amendements identiques SPE126 rectifié de M. Gérard Cherpion et SPE459 rectifié de M. Patrick Hetzel.
M. le ministre. Une mission conduite par M. Michel de Virville réfléchit actuellement à l’application du compte personnel de pénibilité ; dans le même temps, M. Gérard Huot, chef d’entreprise, et votre collègue Christophe Sirugue se penchent sur les critères de ce compte. Les quatre premiers d’entre eux sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier et les six autres seront mis en œuvre le 1er janvier prochain. L’ouverture des droits individuels a eu lieu, et l’enjeu réside dans la conciliation entre l’avancée sociale constituée par la prise en compte de la pénibilité et l’absence de contraintes trop lourdes pour la vie quotidienne des entreprises. Il convient à la fois de ne pas recréer des mécanismes de préretraite et de régimes spéciaux, de ne pas bâtir un système suradministré qui serait insoutenable pour les entreprises, et de faire vivre cette belle idée de droits individuels intégrant les difficultés réelles que vivent les salariés.
J’émets un avis défavorable à l’adoption des amendements, mais le Gouvernement souhaite que ce dispositif soit adapté aux entreprises, notamment aux plus petites d’entre elles.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. La création du compte personnel de pénibilité répond à l’écart d’espérance de vie de six ans existant entre un ouvrier et un cadre âgés de 35 ans. Nous devons continuer de réfléchir à l’application pertinente de ce compte, mais il ne faut pas revenir sur son principe.
M. Gilles Lurton. La mise en œuvre des quatre premiers critères pèse déjà lourdement sur la vie des entreprises.
La Commission rejette les amendements SPE126 rectifié et SPE459 rectifié.
Puis elle étudie les amendements identiques SPE118 de M. Gérard Cherpion et SPE448 de M. Patrick Hetzel.
M. le ministre. Le Gouvernement souhaite dresser un premier bilan des accords dits défensifs de maintien dans l’emploi ; en vertu de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social – dite loi Larcher –, une négociation des partenaires sociaux sera nécessaire pour aller plus loin et, éventuellement, reprendre l’esprit de vos amendements. J’émets donc un avis défavorable à leur adoption.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Même avis.
La Commission rejette les amendements SPE118 et SPE448.
La Commission examine l’amendement SPE686 de M. Francis Vercamer.
M. Michel Zumkeller. Afin de pallier l’absence du décret d’application prévu par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie réglementant les travaux dangereux pour les apprentis mineurs, l’amendement propose de laisser à des accords de branche le soin de définir les métiers dans lesquels les apprentis peuvent accomplir tous les travaux nécessaires à leur formation.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Ce décret maintes fois annoncé commence à ressembler à l’Arlésienne. Je suis intéressé par la réponse du ministre sur ce point.
En tout état de cause, la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité relève clairement de l’État. Il me semble inenvisageable de renvoyer cette question aux partenaires sociaux.
M. le ministre. Le décret est annoncé pour la fin du mois de février.
L’amendement SPE686 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette successivement les amendements SPE569, SPE563 et SPE564 de M. Francis Vercamer.
Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE571 de M. Francis Vercamer.
M. Jean-Patrick Gille. J’indique aux auteurs de l’amendement que celui-ci est satisfait depuis longtemps puisque les deux instances – comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et comité régional pour l’emploi – ont fusionné au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, prévus par la loi relative à la formation professionnelle.
L’amendement SPE571 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE724 de M. Thierry Benoit.
*
* *
Section 5
Lutte contre la prestation de service internationale illégale
Article 95
(Art. L. 1264-3 du code du travail)
Renforcement des sanctions administratives en matière de détachement transnational de travailleurs salariés
Cet article vise à renforcer les sanctions administratives applicables aux entreprises en cas de non-respect de la déclaration des travailleurs détachés et de désignation d’un représentant de l’entreprise en France.
Le détachement de travailleurs permet à un employeur d’envoyer un ou plusieurs de ses salariés travailler temporairement à l’étranger, c’est-à-dire dans un autre État que leur pays d’emploi habituel, pour y exercer une mission.
Durant ce temps déterminé, le travailleur continue d’être affilié au régime de protection sociale de son pays d’emploi, à trois conditions :
– durant toute la période du détachement un lien de subordination doit être maintenu entre le travailleur et son employeur ;
– l’employeur qui détache doit avoir une activité significative dans le pays d’origine ;
– le détachement ne doit pas intervenir en remplacement d’un autre salarié détaché.
Ces travailleurs détachés ne doivent donc pas être confondus avec trois autres types de travailleurs exerçant leur profession à l’étranger :
– les travailleurs migrants, qui ont résidé et ont travaillé dans un ou plusieurs États et qui résident et travaillent dans le dernier de ces États ;
– les travailleurs transfrontaliers qui exercent une profession dans un État membre (État d’emploi) mais résident dans un autre État membre (État de résidence) ;
– les travailleurs « plurinationaux », qui exercent simultanément et de manière permanente dans plusieurs États différents.
Le détachement est donc une procédure caractérisant une mission ponctuelle et temporaire, et qui a été encadrée progressivement par des règles internationales protectrices des droits des travailleurs détachés.
Pour gérer les conséquences de l’espace Schengen sur la circulation des travailleurs, la Commission européenne a présenté une proposition de directive relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, devenue directive 96/71/CE.
Entrée en vigueur le 10 février 1997 avec un délai de transposition fixé au 16 décembre 1999, la directive vise à concilier l’exercice, par les entreprises, de leur liberté fondamentale de fournir des services dans tout État membre conformément à l’article 49 CE et la protection adéquate des droits des travailleurs détachés temporairement à l’étranger pour exécuter cette mission.
La directive concerne spécifiquement les entreprises qui détachent un travailleur à titre temporaire dans un État membre autre que celui dont la loi régit la relation de travail. Elle couvre, à condition que la relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur ne soit pas rompue pendant la période de détachement, trois cas de figure :
– le détachement dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi du travailleur et le destinataire de la prestation de services (« contrat ou sous-traitance ») ;
– le détachement sur le territoire d’un autre État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant à un groupe (« transferts internes » ou « mobilité intra-groupe ») ;
– la mise à disposition d’un travailleur par une entreprise de travail intérimaire ou une agence de placement, l’entreprise utilisatrice étant établie sur le territoire d’un autre État membre.
L’un des grands mérites de la directive est d’avoir imposé aux employeurs de travailleurs détachés le respect d’un « noyau dur » de dispositions du pays d’accueil en matière de droit du travail – sauf dispositions du pays d’origine plus favorables pour les salariés – garantissant ainsi les droits essentiels de ces salariés envoyés temporairement à l’étranger.
Plus précisément, l’article 3, paragraphe 1 de la directive prévoit que le socle des conditions de travail et d’emploi à respecter, comprend :
– les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;
– la durée minimale des congés annuels payés ;
– le taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires (cela ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels) ;
– les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des sociétés d’intérim ;
– la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;
– les mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes ;
– l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que les autres dispositions en matière de discrimination.
Pour autant, les lacunes de la directive, les insuffisances du dispositif de coopération et de contrôle entre les États membres et l’impuissance des règles de contrôles face à la sophistication des fraudes, des abus et des contournements soulignés par le rapport de notre collègue Gilles Savary l’ont conduit à déposer une proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (218) pour permettre l’adoption de mesures complémentaires au niveau national.
En effet, comme le constate notre collègue Gilles Savary dans le rapport précité : « Faute d’une véritable harmonisation sociale dans l’Union européenne et la crise économique et le chômage de masse aidant, la directive est devenue un objet d’opportunisme social et un outil redoutable de concurrence déloyale. Consciente du danger délétère pour l’image et la légitimité de la construction européenne aux yeux des travailleurs, la Commission européenne a donc présenté le 21 mars 2012 une proposition de directive d’application de la directive (219), renonçant à proposer une nouvelle directive pourtant annoncée par le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, lors de sa seconde investiture devant le Parlement européen en 2009. La directive d’exécution en cours de discussion entre les institutions européennes apportera certainement des avancées cruciales. Toutefois, ces mesures qui ne concernent que le détachement ne sauraient être opposables avant 2016, ce qui laissera donc au moins deux ans encore aux fraudeurs pour saper un peu plus la concurrence et le droit des travailleurs au sein du marché intérieur. »
Un renforcement de ces règles est d’autant plus nécessaire qu’en douze ans, le nombre de salariés officiellement détachés a été multiplié par plus de vingt en France, passant de 7 495 en 2000 à 169 613 en 2012, et devrait atteindre près de 210 000 en 2013, selon les dernières estimations du ministère du Travail (220). Mais les services de l’inspection du travail estiment que leur nombre s’élèverait au double, soit près de 320 000 travailleurs détachés.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE PRESTATIONS
DE SERVICES REÇUES ET DE SALARIÉS DÉTACHÉS ENTRE 2000 ET 2012
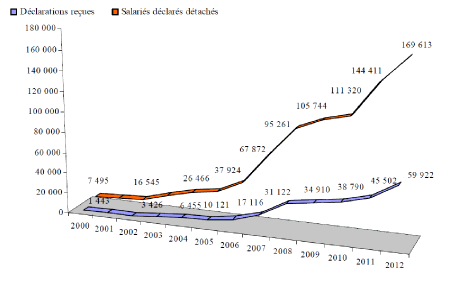
Source : Direction générale du travail (DGT).
L’étude d’impact indique, quant à elle, qu’en 2013 on dénombrait 67 000 déclarations et 212 000 salariés détachés. Les 67 000 déclarations effectuées équivalent à plus de 7,4 millions de jours de détachement, soit plus de 32 000 équivalents temps plein. Le nombre de déclaration a progressé de 12 % par rapport à 2012 et le nombre de jours détachés de 30 %, continuant ainsi la progression à deux chiffres observée depuis plusieurs années. En 2013, environ 1 000 contrôles ont été effectués sur les entreprises étrangères.
Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre dernier (221), la Cour des comptes a estimé à 380 millions d’euros le montant du manque à gagner pour la Sécurité sociale provenant de l’emploi de travailleurs détachés non déclarés.
Ce type de fraude, qui organise la concurrence déloyale, est un phénomène « peu aisé à combattre », écrit la Cour, car il nécessite des moyens de contrôle très importants et une coopération administrative entre États. Mais quand elle est débusquée, elle peut concerner des volumes d’emplois conséquents. Ainsi, l’affaire du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville porte sur le travail dissimulé de 460 ouvriers polonais et roumains.
La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (222) a procédé à la transposition anticipée de la directive européenne du 15 mai 2014 relative au détachement de travailleurs et a renforcé les moyens à la disposition des agents en charge de la lutte contre le travail illégal et les fraudes aux prestations de services internationales :
– en instaurant de nouvelles sanctions administratives tant à l’égard de l’employeur recourant à du détachement qu’à l’égard du donneur d’ordre en cas, notamment, de non-respect de l’obligation de dépôt d’une déclaration de détachement en France ;
– en mettant en place de nouveaux cas de responsabilité solidaire de la chaîne de sous-traitance, en cas de non-respect, par l’employeur des salariés et avec l’accord tacite des donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage, de certaines dispositions de droit du travail, en cas de non-paiement du salaire au minimum légal ou conventionnel ou en cas d’hébergement de salariés dans des conditions indignes ;
– en ouvrant aux officiers de police judiciaire, dans les affaires les plus graves de travail illégal, des techniques d’enquêtes applicables à la délinquance et la criminalité organisée (223).
L’article L. 1262-2-1 du code du travail, introduit par l’article 1er de la loi du 10 juillet précitée, a consacré l’obligation, pour toute entreprise non établie en France qui souhaite fournir des prestations de services sur le territoire national en détachant ses salariés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de services, de déposer une déclaration préalable de détachement et de désigner un représentant de son entreprise en France et instauré des sanctions administratives en cas de non-respect.
Cette déclaration est adressée à l’inspection du travail compétente. Elle renseigne les services de contrôle notamment sur le nom de l’entreprise, le nombre de salariés détachés, le lieu d’exécution de la prestation, la durée de la prestation, le montant de la rémunération. Elle permet l’exercice d’un contrôle effectif sur les situations de détachement, notamment en en permettant la localisation et le suivi statistique.
Les articles L. 1264-1 à L. 1264-3 du code du travail fixent les modalités de mise en œuvre d’une amende administrative en cas de défaut de déclaration préalable de détachement transnational de salariés ou de défaut de désignation d’un représentant par le prestataire de services étranger ainsi que de défaut de vérification par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la réalisation de ces obligations.
L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail. Cette sanction est applicable non seulement à l’employeur des salariés détachés, en cas de non-respect de l’une ou l’autre de ses obligations, mais également au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, co-contractant du prestataire, en cas de manquement à leur obligation de vigilance sur l’une ou l’autre de ces obligations.
Son montant maximal est de 2 000 euros par salarié détaché et de 4 000 euros en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 10 000 euros.
Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Le délai de prescription de l’action de l’administration est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Le rapporteur thématique constate que le montant de ces amendes, notamment le plafond de 10 000 euros, est trop faible pour être dissuasif compte tenu de l’ampleur des fraudes parfois constatées impliquant plusieurs centaines de travailleurs, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, comme le montre l’exemple du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville.
L’ensemble des personnes auditionnées par le rapporteur thématique se sont d’ailleurs accordées sur le fait que ce montant devait être significativement augmenté pour être réellement efficace et permettre d’endiguer le développement de la fraude.
Comme l’étude d’impact annexée au présent projet de loi le rappelle : « le rythme de progrès pouvant en être attendu ne paraît pas à la hauteur de l’enjeu. Le développement de la fraude est rapide et atteint dans certains cas un niveau très élevé. Il est corrélé à l’augmentation très forte du nombre de détachements déclarés en France (plus de 30 % de jours d’emploi détachés supplémentaires en 2013 par rapport à 2012). L’adaptation des fraudeurs aux nouvelles contraintes posées par le cadre législatif est constante. La complexité des montages frauduleux est aujourd’hui relevée par l’ensemble des corps de contrôle. »
C’est pourquoi le présent article modifie l’article L. 1264-3 du code du travail en portant le montant maximal de la sanction administrative de 10 000 à 150 000 euros.
Ce nouveau plafond de sanction permettra d’avoir un réel impact en termes d’efficacité pour les cas de fraude transnationale organisée ou d’ampleur importante comme le montre l’exemple cité par l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
Extrait de l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, page 74
« Les services de contrôle ont constaté la présence de plus de 200 ouvriers détachés sur un chantier de travaux, alors que la déclaration de détachement mentionnait seulement une vingtaine de travailleurs. Ces ouvriers travaillaient sans que les règles du travail applicables soient respectées. Dans cet exemple, si le dispositif actuel ne permet de sanctionner ce manquement que par une amende de 10 000 euros maximum, ce qui équivaut à une amende administrative concernant 5 salariés dont le détachement n’est pas déclaré, le nouveau dispositif permettrait quant à lui de sanctionner ce même manquement par une amende de 150 000 euros, soit une amende administrative relative à 75 salariés dont le détachement ne serait pas déclaré. »
*
* *
La Commission examine les amendements identiques SPE127 de M. Gérard Cherpion et SPE460 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. L’article 95 porte de 10 000 à 150 000 euros le plafond de l’amende administrative applicable en cas de défaut de déclaration préalable de détachement d’un salarié par une entreprise prestataire étrangère. Les députés du groupe UMP avaient approuvé la mise en place d’une obligation de vigilance dans la loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, considérant qu’elle était équilibrée. Or la hausse du plafond de l’amende fait voler en éclat cet équilibre et fait peser une lourde menace financière sur les maîtres d’ouvrage ou les donneurs d’ordre.
Enfin, je reprendrai à mon compte l’argument que vous nous avez régulièrement opposé : pourquoi corriger une loi dont l’encre est à peine sèche ?
M. Patrick Hetzel. J’ajoute que le Gouvernement s’était engagé à ne pas modifier cette disposition. Je m’étonne qu’il puisse revenir ainsi sur sa parole.
M. Richard Ferrand, rapporteur général. Le Gouvernement ne revient pas sur sa parole. Il ne fait qu’écouter avec retard ce que les parlementaires lui avaient demandé naguère, à savoir des sanctions pénales plus fortes. Compte tenu de la gravité du phénomène de détachement abusif de travailleurs, il semble, en effet, opportun d’aggraver l’amende prévue.
Cet amendement est aussi l’occasion d’interroger le Gouvernement sur les décrets d’application. Peut-on enfin espérer leur publication prochaine ?
M. Gilles Savary. L’équilibre que vous avez évoqué tient aussi à ce que le maître d’ouvrage n’est pas directement responsable des manquements du prestataire. La loi lui impose une obligation de vigilance.
L’amende prévue est de 2 000 euros par salarié détaché. Le montant total de l’amende plafonné à 10 000 euros ne permet donc de sanctionner que les petites infractions limitées à cinq salariés au maximum. En portant le plafond à 150 000 euros, le projet de loi n’aggrave pas la sanction par salarié ; il permet d’infliger une amende proportionnée à l’ampleur de la fraude, puisque celle-ci peut désormais sanctionner des infractions constatées pour soixante-quinze salariés.
M. le ministre. Face aux constats accablants des derniers mois en matière de fraude aux règles du détachement, l’aggravation de la sanction s’impose. Dans certaines entreprises, on a dénombré plus de 200 salariés détachés en situation illégale, ce chiffre justifiant l’augmentation du plafond de l’amende.
Le Gouvernement publiera au cours du premier trimestre les décrets relatifs à la loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, issue du travail de Gilles Savary et de Richard Ferrand.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je cite les exemples d’une ferme solaire dans le Cantal dans laquelle 300 salariés détachés étaient employés, dont seulement vingt étaient déclarés, ou encore le chantier de Flamanville avec 460 salariés non déclarés. Le plafond de 10 000 euros n’est absolument pas dissuasif, le risque étant quasi nul pour l’employeur. Ce plafond est malheureusement inadapté à l’ampleur de la fraude.
M. Gérard Cherpion. Dans ce cas, maintenez l’amende unitaire et supprimez le plafond.
Mme Véronique Louwagie. J’abonde dans le sens de mon collègue : pourquoi conserver un plafond ?
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’idée de déplafonner l’amende ou d’instituer une amende proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé grâce à la fraude mérite d’être étudiée. Il faut toutefois prendre garde, d’une part, à la constitutionnalité du dispositif et, d’autre part, à d’éventuels effets collatéraux indésirables.
Les amendements SPE127 et SPE460 sont retirés.
La Commission adopte l’article 95 sans modification.
*
* *
Article 96
(Art. L. 1263-3 à 1263-6 du code du travail [nouveaux])
Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension
temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger
en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail
Cet article propose de permettre à l’autorité administrative compétente de suspendre temporairement l’activité d’un prestataire de services établi hors de France en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail.
Comme l’a rappelé le rapporteur thématique précédemment, le détachement de travailleurs en France donne lieu à des infractions graves particulièrement en matière de droit du travail et plus particulièrement concernant le salaire minimum légal, la durée du travail et l’hébergement de travailleurs salariés.
Or, les procédures actuelles ne permettent pas de faire cesser immédiatement ces infractions, les opérations illicites se poursuivant en dépit des procédures pénales mises en œuvre par les services de contrôle :
– d’une part, le dispositif de fermeture administrative temporaire d’établissement pour une durée maximale de trois mois en cas d’infraction de travail illégal n’est pas applicable, dans la mesure où toutes les infractions ne relèvent pas du travail illégal, et est par nature inadapté aux entreprises établies à l’étranger qui ne disposent pas d’établissement en France contre lequel une fermeture pourrait être ordonnée ;
– d’autre part, il est très difficile, dans les faits, de poursuivre sur le plan pénal les entreprises prestataires étrangères qui, par nature, ne sont pas établies en France pour des infractions au droit du travail – l’extranéité des entreprises est un obstacle important aux procédures juridictionnelles – et qui, de plus, interviennent sur des périodes très courtes incompatibles avec les délais de mise en œuvre des actions juridictionnelles.
Il apparaît donc nécessaire, quand des infractions flagrantes sont constatées, de pouvoir suspendre immédiatement le chantier, comme le montre notamment l’exemple du chantier photovoltaïque de Marmanhac.
L’exemple du chantier photovoltaïque de Marmanhac
Un contrôle a été mené, en novembre 2013, à Marmanhac à l’initiative du comité opérationnel départemental anti-fraude du Cantal.
Alors que seuls une vingtaine de travailleurs détachés avaient été déclarés, plus de 300 travailleurs recrutés par sept sociétés sous-traitantes étrangères, essentiellement portugaises et roumaines ont été dénombrés.
Un certain nombre d’entre eux ne percevait que 195 euros par mois, pour dix heures de travail par jour, sept jours sur sept. Outre la non-déclaration de salariés détachés, des problèmes d’hygiène et de sécurité ont été relevés. 1 445 infractions ont été relevées au total et douze procès-verbaux ont été établis par l’inspection du travail.
Cet article propose de permettre à l’autorité administrative compétente de suspendre temporairement l’activité d’un prestataire de services établi hors de France en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail.
Dans ce but, il insère quatre nouveaux articles dans le code du travail :
• L’article L. 1263-3 du code du travail
Le nouvel article L. 1263-3 du code du travail (alinéas 2 et 3 du présent article) prévoit qu’un inspecteur du travail peut enjoindre par écrit à un employeur, établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, de faire cesser une situation dans laquelle sont constatées des infractions d’une particulière gravité caractérisées par :
– le non-respect manifeste du salaire minimal légal ;
– le large dépassement des limites de durée maximale du travail (quotidienne ou hebdomadaire) ;
– l’hébergement collectif indigne des travailleurs salariés.
L’inspecteur du travail en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
• L’article L. 1263-4 du code du travail
Le nouvel article L. 1263-4 du code du travail (alinéas 4 et 5 du présent article) prévoit que l’employeur dispose d’un délai qui sera fixé par voie réglementaire pour présenter ses observations, régulariser la situation constatée et apporter à l’administration les éléments tangibles de la mise en conformité.
Dans le cas où l’inspecteur constate que les manquements se poursuivent, l’article L. 1263-4 prévoit que la mesure de cessation d’activité est alors susceptible d’être prononcée par l’autorité administrative compétente, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois. Rien ne s’oppose, cependant, à ce que cette suspension soit renouvelée si ces manquements persistent.
L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.
• L’article L. 1263-5 du code du travail
Afin de garantir les droits de travailleurs concernés, le nouvel article L. 1263-5 du code du travail (alinéa 6 du présent article) précise que la décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
• L’article L. 1263-6 du code du travail
Le nouvel article L. 1263-6 du code du travail (alinéas 7 à 10 du présent article) vient parachever l’effectivité du dispositif en prévoyant une sanction administrative financière pour non-respect de la mesure administrative de cessation temporaire d’activité. Cette dernière est fixée à 10 000 euros maximum par salarié concerné.
Le délai de prescription de l’action de l’administration est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Outre plusieurs amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Caullet et du groupe socialiste, républicain et citoyen, après un avis favorable du Gouvernement et du rapporteur, ajoutant à la liste de manquements gaves justifiant une suspension de la prestation de services :
– le manquement au repos quotidien de onze heures consécutives minimum mentionné à l’article L. 3131-1 du code du travail ;
– le manquement au repos hebdomadaire, mentionné à l’article L. 3132-2 du code du travail.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE128 de M. Gérard Cherpion et SPE461 de M. Patrick Hetzel.
M. Gérard Cherpion. Le projet de loi propose d’ajouter à l’arsenal de sanctions inscrites dans la loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, un nouvel outil de lutte contre la fraude en matière de détachement des travailleurs. Ce dispositif ne manque pas d’intérêt. Néanmoins, l’indigence de l’étude d’impact rend nécessaire son expérimentation afin d’évaluer les conséquences du nouvel outil pour les maîtres d’ouvrage établis en France. La situation du secteur du BTP n’étant guère florissante, il ne faudrait pas que ce dispositif de lutte contre la fraude signe du même coup l’arrêt de mort des entreprises françaises commanditaires.
M. le ministre. La mesure administrative de suspension temporaire de l’activité répond au constat de l’urgence face à une infraction grave au droit du travail. En retardant l’effectivité de la mesure, l’expérimentation contribuerait au maintien de situations frauduleuses. Elle serait contraire à l’ambition du Gouvernement de prendre le plus rapidement possible toute la mesure de l’ampleur de la fraude en matière de détachement des travailleurs et de son aggravation.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’objet de l’article 96 est de doter l’administration des pouvoirs nécessaires pour faire cesser une situation gravement illicite. Il n’est pas besoin d’expérimentation en la matière. Je partage votre inquiétude sur le secteur du bâtiment, mais les organisations de ce secteur sont plutôt favorables à cette mesure.
L’expérimentation enverrait un signal de faiblesse alors que l’incendie est déclaré.
M. Jean-Luc Laurent. Je me félicite de ce dispositif. Néanmoins, quels sont les moyens prévus pour le mettre en œuvre ?
M. Gilles Savary. Je veux rassurer nos collègues. Le secteur du bâtiment lui-même réclame une extension du champ d’application de la mesure administrative.
La suspension d’activité, qui est déjà prévue par la loi, est rendue plus aisée. Les deux critères – la gravité des faits et la répétition – auxquels la décision était soumise ne sont plus cumulatifs, donnant ainsi plus de souplesse au préfet.
M. le ministre. La proposition de loi de MM. Gilles Savary et Richard Ferrand doit donner lieu à deux décrets d’application au cours du premier trimestre. En appui des services existants sur le terrain, 150 agents ont été affectés dans des unités de contrôle spécialisées dans la lutte contre le travail illégal.
Mme Véronique Louwagie. Faisant le lien avec la discussion précédente, j’observe que, dans cet article, l’amende n’est pas plafonnée.
La Commission rejette les amendements SPE128 et SPE461.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE1819 des rapporteurs.
La Commission aborde l’amendement SPE1216 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Cet amendement complète la liste des manquements pouvant donner lieu à une suspension temporaire d’activité, en faisant référence au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
M. le ministre. Avis favorable.
M. Jean-Frédéric Poisson. Quel est l’intérêt de cet ajout ?
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’amendement introduit des critères supplémentaires de violation grave du droit du travail pour justifier la suspension temporaire d’activité.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE1216.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1820 à SPE1827 et SPE1832 des rapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement SPE939 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Le pouvoir de prononcer une sanction doit appartenir aux agents de contrôle qui, à la différence de l’autorité administrative, sont indépendants aux termes de la convention n° 81 de l’OIT. En effet, les directeurs régionaux ou d’unité sont placés directement sous la responsabilité du ministre et du préfet.
Cet amendement tend à donner aux seuls agents de l’inspection du travail le pouvoir d’infliger une amende, l’employeur ayant la possibilité de contester cette décision devant les juges.
M. le ministre. L’inspection du travail constate les manquements aux règles tandis que l’autorité administrative inflige l’amende : cette séparation des compétences prévaut dans toutes les procédures prévues dans le code du travail, en vertu de nos engagements européens. J’émets un avis défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous avons déjà débattu de ce point lors de l’examen de l’article 20 du projet de loi sur la formation professionnelle ainsi que de la proposition de loi sur l’inspection du travail. Il est sain et protecteur pour les administrés de distinguer celui qui constate de celui qui sanctionne. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement.
Mme Jacqueline Fraysse. Je vous donne acte de ce que nous avons déjà débattu de cette question. Je n’ai toutefois pas changé d’avis faute d’avoir été convaincue. S’il est sain de séparer les pouvoirs, il n’en demeure pas moins que la personne prononçant la sanction n’est pas indépendante.
La Commission rejette l’amendement SPE939.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1833 et SPE1828 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 96 modifié.
*
* *
Article 97
(Art. L. 8291-1 à L. 8291-3 du code du travail [nouveaux])
Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment
Cet article propose de rendre obligatoire la carte d’identité professionnelle du bâtiment et de l’étendre aux salariés détachés.
En 2007, à l’initiative du réseau des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, a été créée une carte d’identification des salariés des entreprises du secteur du bâtiment – dénommée carte d’identification professionnelle – afin de lutter contre le travail illégal. En 2009, une nouvelle version de la carte, désormais baptisée « carte BTP », a été mise en place.
La carte BTP d’identification professionnelle est destinée à tous les salariés du bâtiment et des travaux publics, quel que soit l’effectif ou l’activité de l’entreprise. L’employeur doit la demander à sa caisse de congés, lors de toute nouvelle embauche, celle-ci étant établie gratuitement après la déclaration unique d’embauche du salarié.
Cette carte numérotée, difficilement falsifiable grâce à un hologramme, intègre des informations sur le salarié (nom, prénom, date de naissance, photo), et sur l’entreprise (n° de SIREN, logo). Elle comporte également certaines mentions administratives (numéro de la caisse de congés payés, année et mois de délivrance, numéro de gestion.)
Toutefois, cet outil présente les désavantages de reposer sur une adhésion volontaire des employeurs et de s’appliquer aux seules entreprises établies en France qui relèvent du régime particulier des congés payés institué par le législateur, en 1937, pour prendre en compte le morcellement des périodes d’emploi des travailleurs du bâtiment et des travaux publics chez différents employeurs, et ainsi garantir leurs droits à des congés payés.
En outre, la carte ne concerne que les salariés affiliés à la caisse de congés payés et ignore les salariés intérimaires qui sont aussi présents sur les chantiers de BTP en nombre important.
Or, comme le rappelle l’étude d’impact : « ce secteur d’activité connaît aujourd’hui une très forte augmentation des détachements de travailleurs d’entreprises établies dans un État de l’Union européenne ou dans un pays tiers, puisque le nombre de travailleurs détachés pour effectuer des travaux de bâtiment et de travaux publics représente un peu moins de la moitié du nombre total de travailleurs détachés en France, soit 92 500 auxquels il faut ajouter 16 000 salariés employés par des entreprises établies hors de France et détachés sur le territoire national, en qualité d’intérimaires, dans des entreprises utilisatrices afin d’effectuer des travaux de bâtiment et de travaux publics en 2013. Il convient de souligner que le nombre total de travailleurs détachés, soit 210 000, ne se rapporte qu’aux travailleurs qui ont fait l’objet d’une déclaration de détachement à l’inspection du travail. »
Lors de son audition par le rapporteur thématique, le président de la Fédération française du bâtiment, M. Jacques Chanut, s’est montré particulièrement préoccupé par l’ampleur actuelle du phénomène de fraude en matière de détachement. Tout type de chantier, de petite ou grande taille, peut être concerné. Le président a considéré que le développement de la fraude mettait en place un nouveau modèle économique qui concurrençait illégalement les entreprises françaises, mettait en cause les droits fondamentaux des salariés et était susceptible de « menacer la survie du secteur » si aucun encadrement plus strict n’était adopté.
L’article 97 prévoit de rendre obligatoire pour l’ensemble des entreprises, établies en France ou à l’étranger, occupant ou faisant travailler des salariés, y compris les salariés intérimaires, le cas échéant détachés en France, sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, un dispositif d’identification professionnelle.
Le dispositif proposé repose sur une carte d’identification nominative que le salarié devra avoir sur lui afin de la présenter à toute demande d’un agent de contrôle compétent en matière de travail illégal ou d’un agent de contrôle d’une caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics.
La carte devrait concerner également l’ensemble des salariés détachés par une entreprise non établie en France, afin que sur un chantier l’ensemble des salariés puissent être identifiés aisément et justifier d’une déclaration effective. Il s’agit d’une mesure complémentaire à celle de la déclaration de détachement.
Il est donc proposé de créer un titre IX au sein du livre II de la huitième partie du code du travail consacré à la déclaration et à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Il s’agit d’insérer un nouvel article L. 8291-1 dans le code du travail qui prévoit la création d’une carte d’identification professionnelle délivrée à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement.
Cette carte sera délivrée « par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État » qui sera la caisse de congés payés.
Cette carte devrait comporter les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national compétent en matière de congés payés.
Un décret en Conseil d’État devrait déterminer les modalités de déclaration des salariés par l’employeur établi en France ou, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, ou par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
Il pourra s’appuyer sur l’organisation déjà en place pour la délivrance de la carte BTP et ne constituera pas une charge supplémentaire pour les entreprises, qui doivent déjà adresser les données nécessaires à l’édition de la carte dans le cadre de l’affiliation de leurs salariés à leur caisse de congés.
Pour les entreprises non établies en France qui procèdent au détachement de salariés, il est envisagé que ce soit la déclaration de détachement qui serve de support aux informations à délivrer à l’organisme chargé de l’édition de la carte d’identification professionnelle. Les employeurs détachant des salariés en France n’auront donc pas à effectuer une déclaration spécifique mais simplement à adresser la même déclaration à la caisse de congés.
La carte sera éditée à chaque changement d’employeur, étant rappelé qu’il est obligatoire de procéder à une déclaration préalable à chaque embauche (ou à une déclaration à chaque détachement). Ainsi, le salarié ne sera nullement tenu de conserver la carte d’un emploi à l’autre. Il incombe, en revanche, à chacun de ses employeurs de déclarer son embauche en vue de l’édition d’une carte pour chaque emploi.
Le présent article prévoit aussi, dans un nouvel article L. 8291-2, que le manquement à l’obligation de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Il est proposé que le montant maximal de l’amende soit de 2 000 euros par salarié à l’instar de la sanction prévue en cas de défaut de déclaration préalable de détachement transnational de salariés, de défaut de désignation d’un représentant du prestataire de services étranger et/ou de défaut de vérification par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la réalisation de ces obligations. Ce montant sera porté au plus à 4 000 euros en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 euros. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
Enfin un nouvel article L. 8291-3 prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les données personnelles des salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Selon l’étude d’impact, ce nouveau dispositif de carte d’identité professionnelle généralisé et obligatoire devrait concerner :
– environ 1 400 000 salariés du secteur du BTP d’ores et déjà employés par des entreprises établies en France et déjà titulaires, en grande partie, d’une carte d’identité professionnelle délivrée par la Caisse des congés payés du bâtiment ;
– environ 330 000 salariés du secteur du BTP entrant chaque année dans ce secteur d’activité ;
– environ 93 000 salariés employés par des entreprises établies hors de France et détachés sur le territoire national dans le secteur du BTP en 2013 ;
– environ 16 000 salariés employés par des entreprises établies hors de France et détachés sur le territoire national, en qualité d’intérimaires, dans des entreprises utilisatrices afin d’effectuer des travaux de BTP en 2013 ;
– environ 120 000 salariés employés par des entreprises de travail temporaire établies en France et mis à disposition, en qualité d’intérimaires, dans des entreprises utilisatrices afin d’effectuer des travaux de BTP en 2013 (224) susceptibles toutefois de réaliser une pluralité de missions pour le compte de la même entreprise utilisatrice ou de plusieurs entreprises utilisatrices différentes.
Au total, environ 2 000 000 de salariés devraient être concernés.
Lors de son audition par le rapporteur thématique, le Président de la Fédération française du bâtiment a précisé que la nouvelle carte serait munie d’un système de « flash code » permettant de « charger » l’ensemble des informations concernant le salarié, de les actualiser facilement et permettant ainsi d’étendre cette carte aux salariés intérimaires, qui sont nombreux dans ce secteur. Ce « flash code » permettra aussi de centraliser les informations dans une base de données unique et de faciliter, par conséquent, l’actualisation de l’information.
Il a aussi souligné que la mise en place de cette carte était prise en charge par la profession et qu’il n’y avait pas de cotisation spécifique la concernant.
Il a, enfin, considéré que le développement des contrôles, notamment les soirs et les week-ends, était indispensable pour endiguer efficacement le développement de pratiques qui menacent véritablement l’équilibre économique du secteur du bâtiment.
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a adopté plusieurs amendements rédactionnels.
*
* *
M. Jean-Yves Caullet. Cet article introduit un moyen de contrôle pertinent mais réservé aux salariés du bâtiment et des travaux publics. Pourtant, il est d’autres secteurs – je pense notamment aux travaux forestiers – pour lesquels cette mesure pourrait être intéressante. Peut-on envisager de l’appliquer à d’autres branches ayant signé des accords ?
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cette mesure a pu être proposée grâce à l’existence d’une caisse de congés payés du bâtiment. Je serai étonné que nous trouvions une solution technique avant la séance pour satisfaire votre demande.
M. le président François Brottes. Je soutiens, à titre personnel, la proposition de Jean-Yves Caullet.
M. le ministre. L’idée, avec l’article 97, est d’expérimenter la carte d’identification professionnelle. Je précise que si le secteur du bâtiment est très demandeur, le secteur des travaux publics est plus réservé.
Je vous promets néanmoins d’apporter une réponse à votre question.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE1834, SPE1835, SPE1925, SPE1837 à SPE1839, SPE1851 et SPE1843 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 97 modifié.
*
* *
Article 97 bis [nouveau]
(Art. L. 4454-3 [nouveau] du code des transports)
Obligation pour les partenaires d’un contrat de transport, de matérialiser par écrit le contrat de transport de marchandises par voie fluviale
Le présent article additionnel a été adopté par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs et vise à obliger les partenaires d’un contrat de transport, de matérialiser par écrit le contrat de transport de marchandises par voie fluviale.
En effet, en matière de transport fluvial, en l’état actuel du droit, aucune disposition n’impose aux partenaires d’un contrat de transport de matérialiser par écrit leur accord avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement. Il résulte de cette situation une très forte incertitude juridique pour les transporteurs.
Afin de faire respecter les engagements pris au cours de la négociation, il est aujourd’hui fortement recommandé aux transporteurs d’adresser immédiatement après la négociation une « confirmation de transport ». Ce document, qui s’inspire directement de la « commande de transport », prévue en matière de transport routier par l’article L. 3222-4 du code des transports, permet en effet aux parties de conserver une trace écrite des négociations entreprises au préalable, notamment par téléphone. Il constitue donc une confirmation des conditions contractuelles préalablement négociées et, au plan juridique, une « mini-convention » écrite qui confirme les conditions de rémunération et énumère les prestations annexes convenues entre le donneur d’ordre et le transporteur.
Cet article vise donc à corriger l’encadrement du contrat de transport de marchandises par voie fluviale, en imposant l’obligation, pour les partenaires d’un contrat de transport, de matérialiser par écrit leur accord verbal avant la conclusion effective du contrat et avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement, à l’instar de ce qui est prévu en matière de transport routier. Les contrats à temps ou au tonnage n’étant pas concernés par les mêmes problématiques, cet encadrement est limité au contrat de transport au voyage.
Afin de rendre effective cette nouvelle disposition, cet article prévoit que tout manquement à cette obligation entraîne l’application d’une sanction équivalente à celle prévue en cas de non-présentation de la déclaration de chargement ou de la lettre de voiture, mentionné à l’article L. 4461-1 du code des transports dont le manquement est puni d’une contravention de grande voirie (L. 4463-1 de code des transports).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1927 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement très technique vise à garantir la sécurité des mariniers. Sans entrer dans le détail, il s’agit de rendre obligatoire la confirmation écrite du contrat de transports de marchandises par voie fluviale avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement. Cet amendement transpose au transport fluvial la lettre de voiture.
M. Jean-Frédéric Poisson. Mon nom étant mon seul titre de compétence sur cet amendement, je fais une totale confiance au rapporteur thématique.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1927.
*
* *
Article 97 ter [nouveau]
(Art. L. 4451-7 (nouveau], L. 4461-1 et L. 4463-1 du code des transports)
Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises
Le présent article additionnel a été adopté par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs et vise à encadrer la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises.
La pratique de la location de bateau de marchandises avec équipage est aujourd’hui utilisée par des transporteurs établis à l’étranger comme moyen de contourner les règles de cabotage.
En transport fluvial, la pratique du cabotage est encadrée par des règles communautaires (225) et par des règles françaises (226) :
– les règles communautaires définissent le cabotage fluvial comme la réalisation d’un transport de marchandises (ou de personnes) par voies navigables dans un État membre de l’Union européenne dans lequel l’entreprise qui réalise la prestation de transport n’est pas établie ;
– le droit français précise, quant à lui, la limitation de durée pour réaliser des transports nationaux de cabotage, fixée à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois.
Les règles sociales relatives à l’obligation de déclaration de détachement des salariés travaillant à bord d’un bateau utilisé par une entreprise étrangère pratiquant le cabotage fluvial sont fixées par le décret du 19 avril 2010 (227).
Nonobstant l’existence de dispositions encadrant le cabotage fluvial en France, certaines entreprises établies hors de France continuent à exploiter sur le territoire un bateau de commerce pour une durée supérieure aux seuils fixés pour le cabotage en mettant leurs unités fluviales et leurs équipages à la disposition d’un locataire établi sur le territoire. On parle dans ce cas de location transfrontalière.
La location transfrontalière en transport fluvial ne fait actuellement l’objet d’aucun encadrement juridique. Le recours à la location transfrontalière de bateau avec équipage peut créer une distorsion de concurrence pour les transporteurs français qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations sociales et fiscales.
L’objet de cet article est donc d’encadrer la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises en interdisant, comme en transport routier, la location transfrontalière de bateau avec équipage. L’article sanctionne le non-respect de ces dispositions par les mêmes peines que pour le non-respect des règles sur le cabotage.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1926 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement encadre la location transfrontalière de bateaux de marchandises en interdisant la location avec équipage afin d’éviter une distorsion de concurrence au détriment des transporteurs français.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1926.
La Commission examine l’amendement SPE1215 de M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Il s’agit de pouvoir sanctionner le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui, informé des conditions indignes d’hébergement des salariés de son sous-traitant, ne prend pas en charge leur hébergement.
Je crois toutefois comprendre que ma préoccupation est satisfaite.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. En effet, monsieur Caullet, la sanction est prévue par l’article 225-14 du code pénal.
L’amendement SPE1215 est retiré.
*
* *
Section 6
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi
Article 98
(Art. L. 1233-5 du code du travail)
Clarification du périmètre des critères de l’ordre des licenciements dans le cadre d’un document unilatéral de l’employeur
Cet article propose de clarifier les compétences de l’employeur pour déterminer le périmètre des critères de l’ordre des licenciements, lorsqu’il prend une décision unilatérale pour déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à la suite de l’échec d’un accord collectif.
L’article 18 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réformé la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le plan de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi, communément appelé « plan social » est défini aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail. Il est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent en prévoir un, mais il n’y est pas obligatoire. Il en est de même pour les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.
Le plan de sauvegarde de l’emploi vise à éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Il prévoit un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Le PSE doit prévoir les mesures suivantes :
– des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure,
– des créations d’activités nouvelles par l’entreprise,
– des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise (notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi),
– des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés,
– des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents,
– des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière (lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée),
– les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (lorsqu’il est obligatoire).
Le plan de sauvegarde de l’emploi peut également prévoir d’autres mesures, facultatives, telles que, par exemple, des primes d’incitations au départ volontaire, la mise en place d’une cellule de reclassement ou des aides à la mobilité géographique ou professionnelle.
En effet, l’entreprise peut désormais établir le plan de sauvegarde de l’emploi selon deux modalités différentes. Elle peut soit négocier un accord avec les organisations syndicales soit décider d’élaborer un document unilatéral, dans le respect de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
L’article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer :
– le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ;
– les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements.
Cet accord collectif doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
L’article L. 1233-24-2 du code précité précise que l’accord collectif, qui comprend obligatoirement le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, peut également porter sur :
– les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise (1°) ;
– la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 (2°) ;
– le calendrier des licenciements (3°) ;
– le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées (4°) ;
– les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement (5°).
L’ordre des licenciements
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte, en vertu de l’article L. 1233-5 du code du travail :
– les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
– l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
– la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
– les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste n’est pas limitative et l’employeur peut y ajouter d’autres critères. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères mentionnés ci-dessus.
Avant la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation, avait jugé que l’article L. 1233-5 du code du travail conduisait à faire application des critères d’ordre des licenciements au niveau de l’entreprise et que seul un accord collectif permettait de retenir un périmètre inférieur correspondant à un établissement ou une agence (228).
Cependant, l’article 18 de la loi précitée a inséré, au sein du code du travail, un nouvel article L. 1233-24-4 qui dispose qu’à défaut d’accord collectif « un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
Par conséquent, l’article L. 1233-24-4 prévoyant que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement comprend les dispositions mentionnées à l’article L. 1233-24-2, laissait penser que l’employeur avait désormais la possibilité de fixer un autre périmètre que celui de l’entreprise pour l’application des critères d’ordre, que ce soit par le biais d’un accord collectif ou d’un document unilatéral alors qu’avant la loi relative à la sécurisation de l’emploi, seul un accord collectif permettait de fixer un périmètre inférieur à celui de l’entreprise tout entière.
Cependant, le nouveau texte est ambigu car si le document unilatéral comprend le périmètre de l’ordre des licenciements c’est « dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
Dans un jugement du 11 juillet 2014 relatif à la société Mory-Ducros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’« il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qu’il incombe à l’employeur de préciser dans le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l’emploi le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements » tout en précisant que « le périmètre retenu ne saurait toutefois aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés, le licenciement pour motif économique étant, suivant les dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail, non inhérent à leur personne. »
Saisie par l’employeur, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé à l’inverse, dans un arrêt du 22 octobre 2014 (229), que : « la définition d’un tel périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’est envisageable que dans le cadre d’un accord collectif, les dispositions précitées des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, éclairées par les travaux préparatoires, n’ayant pas entendu remettre en cause un tel principe. » et donc, en l’espèce, qu’en l’absence d’accord collectif, l’homologation du document unilatéral devait être annulée.
Dans ses conclusions, Mme Claire Rollet-Perraud rapporteure public sur cette affaire a conclu que la loi du 14 juin 2013 n’a pas eu pour objet de revenir sur l’interprétation donnée par la Cour de cassation à l’article L. 1233-5 du code du travail en considérant, d’une part, que la « loi n’a pas modifié les dispositions de l’article L. 1233-5 » et d’autre part qu’il « ressort des travaux parlementaires, que le législateur n’a pas entendu revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Plus précisément lors de la séance du 20 avril 2013, la sénatrice Françoise Laborde a proposé un amendement ainsi rédigé : “ ces critères sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés ”. La sénatrice a précisé qu’il s’agissait là de transcrire dans la loi “ une jurisprudence unanime ”. Cet amendement n’a finalement pas été adopté au motif qu’il ne faisait que reprendre une jurisprudence déjà existante laquelle, nous citons, “ apporte toutes les garanties ”».
L’employeur a formé un pouvoir actuellement pendant devant le Conseil d’État.
Soucieux de sortir au plus tôt de l’incertitude et de réduire les difficultés de mise en œuvre de l’ordre des licenciements, le Gouvernement propose, dans le cadre de cet article, de compléter l’article L. 1233-5 du code du travail par un alinéa précisant explicitement que pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
En effet, l’impossibilité de modifier le périmètre de l’application des critères d’ordre du licenciement peut donner lieu à des situations inextricables. Ainsi, l’étude d’impact annexée au présent projet de loi souligne les difficultés que rencontraient les entreprises qui ne parvenaient pas à aboutir à un accord avant la loi du 14 juin 2013 : « À titre d’illustration, dans l’hypothèse d’une entreprise comportant un établissement à Lille et un établissement à Marseille engageant une restructuration sur son seul site de Marseille, celle-ci pouvait par le jeu des critères d’ordre être conduite à licencier un salarié travaillant dans son établissement de Lille pour proposer à un salarié de Marseille un reclassement interne à Lille, proposition que ce salarié refuse quasi systématiquement. Au final, l’application des critères d’ordre au niveau de l’entreprise peut aboutir, non pas à un, mais à deux licenciements. »
Le rapporteur thématique considère cependant, que cette possibilité ouverte au chef d’entreprise est trop importante. En effet, le fait de pouvoir fixer unilatéralement le périmètre des critères de l’ordre des licenciements, y compris à un périmètre inférieur à celui de l’entreprise, permettrait au chef d’entreprise de viser un service particulier.
En outre, cette possibilité ouverte à l’employeur pourrait décourager la conclusion d’un accord collectif et contrevenir à l’objectif poursuivi par la loi sur la sécurisation de l’emploi d’encourager la conclusion de tels accords pour fixer le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi.
Cependant, une modification de la législation est indispensable afin d’éviter les situations défavorables aux salariés évoquées par l’étude d’impact.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement visant à encadrer la possibilité de l’employeur de restreindre le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement
Ainsi, en cas d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un document unilatéral de l’employeur, l’employeur ne pourra limiter le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement qu’au niveau de la « zone d’emploi ». Cette notion, définie par l’INSEE et dont la nomenclature est largement connue, sera précisée par un décret.
Une telle mesure permet de concilier la nécessaire clarification de la compétence de l’employeur dans ce domaine et permet une définition objective du périmètre minimal de l’application des critères d’ordre des licenciements.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques SPE129 de M. Gérard Cherpion, SPE462 de M. Patrick Hetzel, SPE940 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1362 M. Jean-Louis Roumegas.
M. Gérard Cherpion. Je retourne au ministre l’argument qu’il nous a opposé s’agissant du temps partiel, de la nécessité de respecter le texte de l’accord national interprofessionnel – ANI. Je l’invite à faire de même s’agissant du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont les modalités de fixation avaient été déterminées par l’ANI sur la sécurisation de l’emploi.
Mme Jacqueline Fraysse. Aujourd’hui, en cas de licenciement économique collectif, il faut déterminer des critères de licenciement pour objectiver le choix des salariés licenciés. Sauf accord collectif contraire, ces critères s’appliquent à l’ensemble du périmètre de l’entreprise. Avec l’article 98, ces critères pourront être appliqués par l’employeur dans un périmètre plus restreint : un établissement, un atelier, un service.
Nous contestons cette nouvelle disposition car, en réduisant le périmètre, celle-ci permet à l’employeur de cibler les personnes qu’il veut licencier : les critères pourront ainsi opportunément correspondre à la personne dont le licenciement est envisagé. Si nous admettons que le périmètre de l’entreprise n’est pas toujours le plus adapté, il faut néanmoins définir un périmètre qui empêche l’employeur de choisir les personnes qui seront licenciées.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 98. Nous vous ferons des propositions en séance pour déterminer un périmètre pertinent.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. La loi sur la sécurisation de l’emploi a profondément remanié le dispositif d’adoption des plans de sauvegarde de l’emploi : le PSE donne lieu soit à un accord collectif, soit, à défaut, à un document unilatéral établi par l’employeur, qui doit ensuite être homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – DIRECCTE – dans des délais réduits. Ce document peut faire l’objet de recours devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans un délai de trois mois, la cour administrative d’appel disposant du même délai pour se prononcer.
Dans l’affaire Mory Ducros, la Cour administrative d’appel de Versailles a estimé qu’à défaut d’accord sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le périmètre retenu est nécessairement celui de l’entreprise dès lors que le législateur n’a pas entendu, dans la loi sur la sécurisation de l’emploi, revenir sur les règles de fixation de ce périmètre.
L’ANI n’a pas envisagé la modification de ces règles. Quant au législateur, il n’en a pas discuté. Je serai d’ailleurs curieux de connaître les travaux parlementaires qui ont pu éclairer les juges de la cour administrative d’appel de Versailles.
La difficulté tient à ce que le choix du cadre de l’entreprise peut être déstabilisant pour les salariés. Dans le cas de Mory Ducros, il y avait quatre-vingts agences partout en France. L’application de l’ordre des licenciements au périmètre de l’entreprise obligeait à tenir compte de toutes les agences. Pour schématiser, ce n’est pas parce qu’une agence fermait que ses salariés étaient licenciés. La règle actuelle n’est donc pas satisfaisante.
Deux possibilités s’offrent à nous : soit nous attendons l’avis du Conseil d’État, soit nous opérons à chaud. Cette solution me semble préférable, car il convient de faire cesser une situation d’insécurité juridique que nous avons créée.
Pour ce faire, deux options sont possibles. L’une est de réaffirmer la règle selon laquelle, en l’absence d’accord, c’est le cadre de l’entreprise qui prévaut. Cette possibilité présente l’avantage d’inciter les parties à conclure un accord. Mais cela ne vaut pas dans tous les cas. Ainsi, dans les entreprises implantées sur plusieurs sites, les représentants syndicaux privilégieront une logique par site qui de facto exclut la signature d’un accord global.
L’autre possibilité, qui a ma faveur, consiste à définir un périmètre minimal que devra respecter le chef d’entreprise. Si ce dernier souhaite retenir un périmètre plus restreint, il devra obtenir un accord. En résumé, l’incitation à conclure un accord demeure, l’employeur ne fixe plus unilatéralement le périmètre et il est astreint à un périmètre minimum.
Mon amendement SP1582 propose de retenir le périmètre du bassin d’emploi – zone d’emploi dans la terminologie de l’INSEE – qui correspond à une nomenclature objective, les zones d’emplois étant recensées dans un atlas.
Interdire la fixation unilatérale du périmètre par l’employeur permet d’objectiver les critères et de maintenir une incitation à négocier. Qui plus est, l’existence d’un accord prémunit contre d’éventuels recours, ce qui n’est pas négligeable pour l’employeur.
M. le ministre. Je n’ai rien à ajouter, M. Robiliard ayant parfaitement expliqué le dispositif. J’émets un avis défavorable aux amendements de suppression et favorable à l’amendement des rapporteurs qui le complète utilement.
Mme Jacqueline Fraysse. Le choix du bassin d’emploi comme périmètre répond sans doute à ma préoccupation. Je retire mon amendement.
Les amendements SPE940 et SPE1362 sont retirés.
La Commission rejette les amendements SPE129 et SPE462.
Puis elle adopte l’amendement SPE1582 des rapporteurs ainsi que l’amendement rédactionnel SPE1844 des mêmes auteurs.
Elle adopte ensuite l’article 98 modifié.
*
* *
Article 99
(Art. L. 1233-53 du code du travail)
Rectification d’une erreur rédactionnelle
Une erreur matérielle figure dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1233-53 du code du travail issue de la loi du 14 juin relative à la sécurisation de l’emploi (230) : il prévoit, en effet, que ses dispositions s’appliquent, aux entreprises de moins de cinquante salariés, d’une part et aux entreprises de cinquante salariés et plus qui ont un projet de licenciement concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, d’autre part
Or le législateur n’a pas modifié les règles applicables aux « petits licenciements », qu’ils soient individuels ou collectifs et concernant entre deux et neuf salariés. Ceux-ci font l’objet d’une information de l’administration une fois les licenciements prononcés dans les conditions des articles L. 1233-19 et L. 1233-20 du code du travail et ils sont régis par les dispositions d’une autre section, la section III du chapitre relatif au licenciement économique que celle dans laquelle s’inscrit l’article L. 1233-53 qui n’aurait pas dû les mentionner.
C’est pourquoi, le présent article propose de supprimer, au premier paragraphe de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours ».
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1363 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis défavorable. L’article 99 corrige une erreur rédactionnelle. La disposition relative aux licenciements économiques de moins de neuf salariés qu’il supprime n’a pas sa place dans l’article L. 1233-53 du code du travail.
L’amendement SPE1363 est retiré.
La Commission adopte l’article 99 sans modification.
*
* *
Article 100
(Art. L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail)
Obligation de reclassement à l’étranger
Cet article simplifie la procédure de l’obligation de reclassement des entreprises s’agissant salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise employeur a des implantations à l’étranger ou appartient à un groupe international.
La loi du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement (231) a aménagé la procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l’employeur dispose d’implantations à l’étranger.
Cette nouvelle procédure, – détaillée à l’article L. 1233-4-1 du code du travail – applicable lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d’implantations hors du territoire national, et qu’un licenciement économique est envisagé, comporte les étapes suivantes :
– l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ;
– le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées (par exemple, le niveau de rémunération), pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et tiennent compte des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
Le présent article prévoit de simplifier la procédure pour les entreprises.
En effet, l’obligation de rechercher des solutions de reclassement dans l’ensemble des entreprises du groupe peut être difficile au vu de la structuration souvent complexe des groupes et de la difficulté à identifier et à actualiser les offres pour les entreprises. L’étude d’impact considère que : « Cette obligation se traduit par un formalisme excessif faisant peser sur l’employeur ou son représentant une insécurité juridique puisqu’il suffit qu’il ait omis de solliciter l’une des entreprises du groupe pour encourir l’annulation de la procédure par le juge administratif. En outre, les entreprises du groupe ne sont, au demeurant, pas tenues de lui répondre. »
Par ailleurs, cette obligation est conséquente pour les entreprises alors que très peu de salariés peuvent ou acceptent de quitter la France pour aller travailler dans un pays étranger, particulièrement hors d’Europe ou sur des emplois équivalents pour lesquels les niveaux de salaires peuvent être très inférieurs, car indexés sur le niveau de vie local.
C’est pourquoi le I modifie l’article L. 1233-4 du code du travail afin de prévoir que l’employeur ne devra plus, pour être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, avoir proposé a priori au salarié des postes de reclassement situés en dehors du territoire national : ainsi alors que le reclassement du salarié doit être actuellement opéré « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe », il est proposé que ce reclassement soit désormais opéré « sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».
Le II simplifie, par ailleurs, considérablement la procédure prévue à l’article L. 1233-4-1 en proposant que le salarié, dont le licenciement est envisagé, ait accès sur sa demande à la liste précise des offres d’emploi situées hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient. La procédure actuelle de l’article L. 1233-4-1 est donc considérablement simplifiée, l’employeur n’ayant plus à demander au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation et à attendre que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées dans un délai de six jours ouvrables.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser que les salariés qui expriment un intérêt pour les postes situés en dehors du territoire national bénéficient de l’obligation de reclassement dans les mêmes conditions que pour les offres nationales. Ainsi, l’employeur transmet toutes les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt, ces offres sont écrites et précises et le salarié intéressé bénéficie d’une priorité en matière de reclassement.
La Commission est saisie des amendements identiques SPE942 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1364 de M. Jean-Louis Roumegas.
Mme Jacqueline Fraysse. La jurisprudence du droit au reclassement oblige l’employeur à proposer aux salariés tous les postes disponibles dans l’entreprise mais également dans le groupe auquel elle appartient, y compris lorsqu’ils sont situés à l’étranger si le salarié le souhaite.
L’article 100 inverse cette démarche s’agissant des postes situés à l’étranger, puisqu’il reviendra au salarié d’en faire la demande. Plus grave, contrairement aux règles de reclassement applicables dans les entreprises situées en France, si le salarié est candidat à un poste disponible à l’étranger, il ne bénéficiera pas d’un traitement prioritaire.
Le régime actuel n’est certes pas parfait, mais il est plus favorable aux salariés et il responsabilise davantage l’employeur que celui que mettrait en place cet article, dont nous demandons la suppression.
M. le ministre. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’obligation de reclassement international est rétablie par mon amendement SPE1585 que nous examinerons dans un instant. Il tend à en modifier le mécanisme relativement complexe par une nouvelle rédaction de l’article L. 1233-4-1 du code du travail. En l’espèce, le salarié définira lui-même les critères auxquels devront répondre les offres de reclassement à l’international qui lui seront faites – pays souhaités, emplois brigués, conditions de rémunération. Ainsi, les choses sont claires pour tout le monde.
Les amendements SPE942 et SPE1364 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1845 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’amendement SPE1585 des mêmes auteurs.
Puis elle adopte l’article 100 modifié.
*
* *
Article 101
(Art. L. 1233-58 du code du travail)
Plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire
Cet article propose, d’une part d’alléger le formalisme des décisions d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire et, d’autre part, de prévoir que l’obligation de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise et non au sein du groupe.
Le plan de sauvegarde de l’emploi doit, pour être considéré comme suffisant, être adapté aux « moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe », selon les termes du 1° de l’article L. 1233-57-3 du code du travail.
Or, dans le cas d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ne peut pas remplir cette condition puisqu’il ne dispose d’aucun moyen de contraindre le groupe à financer le plan. Seul le dirigeant d’une entreprise dispose des moyens de convaincre sa société-mère de l’intérêt de participer au financement du PSE : elle est, en effet, intéressée par la santé financière et la restructuration de sa filiale, qui influe sur la valorisation de l’actif qu’elle détient.
En revanche, dans le cas d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, aucune d’obligation légale ne contraint le groupe à participer au financement du PSE, la mère pouvant décider de sacrifier sa fille.
L’administrateur ou le liquidateur judiciaire ne peut donc pas, en pratique, adapter le plan de sauvegarde de l’emploi aux « moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ».
Cette situation peut avoir de lourdes conséquences puisqu’elle peut entraîner un refus d’homologation du plan pour ce motif.
La situation qui en découle est kafkaïenne : l’administration peut se retrouver confrontée à une situation où elle refuse l’homologation du plan, au risque, au-delà du délai de prise en charge du PSE – de trente jours – par l’assurance garantie salaires (AGS), de placer les salariés dans une situation où ils ne peuvent pas être licenciés, tout en ne pouvant être rémunérés, faute de moyens dans l’entreprise pour le faire.
Si l’administration homologue malgré tout le PSE, elle encourt une annulation devant le juge administratif qui donnera lieu, en cas de recours des salariés devant les conseils de prud’hommes, à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire qui risque d’être financée in fine par l’AGS du fait de l’insolvabilité de l’employeur. En l’état, sauf fraude démontrée de la part du groupe, sa responsabilité ne peut être recherchée.
En conséquence, le présent article propose, pour le cas d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, de permettre à l’autorité administrative d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des « moyens dont dispose l’entreprise ». Cette modification est également nécessaire pour ne pas rendre l’État financièrement responsable de l’homologation d’un plan en fonction, par la force des choses, des seuls moyens de l’entreprise.
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le présent article propose que, dans le cas d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, l’obligation de reclassement soit mise en œuvre dans l’entreprise et non au sein du groupe. Pour autant, l’administrateur ou le liquidateur solliciteront, malgré tout, les autres entreprises du groupe de reclassement afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles. Cette liste sera mise à la disposition des salariés susceptibles d’être licenciés.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté, outre plusieurs amendements rédactionnels, un amendement visant à supprimer l’alinéa 3 du présent article, de sorte que l’état actuel du droit ne soit pas modifié.
En effet, les entreprises appartenant au même groupe qu’une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, qui procède à des licenciements, sont en mesure de lui communiquer la liste des postes disponibles permettant d’établir des offres de reclassement au sein du groupe. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur objet d’une procédure collective au périmètre de la seule entreprise.
*
* *
La Commission est saisie des amendements de suppression SPE131 de M. Gérard Cherpion, SPE466 de M. Patrick Hetzel, SPE945 de Mme Jacqueline Fraysse, et SPE1366 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Gérard Cherpion. L’appréciation du caractère suffisant et proportionné des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des moyens dont dispose l’entreprise, et non plus en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel elle appartient, n’est pas acceptable et présente un réel risque de voir certains employeurs peu scrupuleux organiser la liquidation d’une entité sans avoir à en assumer les conséquences sociales.
Mme Jacqueline Fraysse. Selon l’étude d’impact, « la portée d’un éventuel refus d’homologation au motif que les mesures ne seraient pas proportionnées aux moyens du groupe est inopérante » puisque l’administrateur/liquidateur judiciaire n’a pas les moyens légaux d’obliger la maison-mère à financer le PSE. En conséquence, vous décidez de dédouaner totalement le groupe en affirmant qu’en cas de liquidation ou de redressement, le PSE n’est apprécié qu’au regard des moyens de la seule entreprise et que le périmètre de l’obligation de reclassement est réduit.
L’expérience prouve qu’une disposition de cette nature présente un risque en termes de fraude, car la maison-mère peut être tentée d’organiser la mise en difficulté financière de l’une de ses filiales et se trouver ainsi libérée de toutes ses obligations à l’égard de cette dernière en matière de licenciement économique.
Je me félicite que la jurisprudence s’attache de plus en plus à rechercher la responsabilité des sociétés-mères dans ce type de situation. Force est toutefois de constater que le droit du travail n’affirme pas suffisamment cette responsabilité qui mériterait pourtant d’être renforcée.
Il aurait été logique de créer une obligation d’abondement du PSE par le groupe en bonne santé financière afin que l’administrateur/liquidateur dispose de moyens de contrainte. À défaut, nous demandons la suppression de l’article 101.
M. le ministre. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Aujourd’hui, qu’il soit en redressement judiciaire ou pas, l’employeur a l’obligation d’établir un PSE en fonction des moyens de l’entreprise mais aussi de ceux du groupe auquel elle appartient. L’obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du groupe.
L’article 101 dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, seuls sont examinés les moyens de l’entreprise. De même, l’obligation de reclassement s’entend dans les limites de cette dernière. À mon sens, la mise en redressement judiciaire d’une entreprise ne justifie pas que l’on dispense sa « mère » ou ses « sœurs » de fournir la liste des postes disponibles pour un reclassement. J’ai donc déposé un amendement SPE1965 visant à maintenir l’obligation de reclassement au niveau du groupe. S’il est adopté, les amendements de suppression seront à demi satisfaits.
Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère suffisant et proportionné des mesures du PSE au regard des moyens du groupe, nous ne dédouanons personne, contrairement à ce qu’a expliqué Jacqueline Fraysse. Nous ne faisons que tirer les conséquences du fait qu’aucun instrument juridique ne permet aujourd’hui de contraindre un groupe à abonder le PSE de sa « fille ».
Devrions-nous créer cette obligation ? Les choses ne sont pas si simples car, juridiquement, les personnes morales font écran : la responsabilité des sociétés reste limitée, même lorsqu’elles ne sont pas à proprement parler « à responsabilité limitée ». Sauf faute ou situation particulière, il n’est pas possible de remonter à l’actionnaire.
Il est vrai qu’en la matière, la jurisprudence évolue depuis plusieurs années. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi pu rendre, le 8 juillet 2014, sur le fondement très classique de l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité, un arrêt dit « Sofarec » qui peut se résumer ainsi : « Ayant constaté que l’actionnaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société, avait pris des décisions profitables à lui-même mais dommageables pour l’entreprise et qui avaient aggravé la situation économique difficile de cette dernière, la cour d’appel a pu en déduire, pour allouer des dommages-intérêts aux salariés, que ces sociétés avaient, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée. »
Il n’en demeure pas moins qu’aucune obligation n’incombe au groupe à l’égard de sa « fille » en redressement judiciaire, alors même que l’administrateur judiciaire est légalement tenu de construire un PSE prenant en compte les moyens du groupe. Cette injonction légale est bien incohérente et « inopérante » puisqu’elle ne peut trouver aucune traduction dans la réalité. Sur le terrain, l’administrateur judiciaire, qui ne dispose que d’un délai de trente jours pour licencier afin que les salariés restent couverts par l’assurance de garantie des salaires – AGS –, est donc contraint d’utiliser les seuls moyens auxquels il a accès : ceux de l’entreprise. Localement, la DIRECCTE n’a ensuite guère d’autre choix que d’homologuer un PSE qui permet aux salariés d’être payés, alors même que la responsabilité de l’État, en plus de celle de l’employeur, peut être engagée pour méconnaissance d’une obligation légale pourtant inapplicable. C’est kafkaïen ! Il faut que cela cesse !
M. le président François Brottes. Malgré Kafka, je salue l’expertise de notre collègue et la pédagogie dont il fait preuve sur une matière extrêmement complexe. Nos collègues ont sans doute été convaincus de retirer leurs amendements.
Les amendements SPE131, SPE466, et SPE1366 sont retirés.
Mme Jacqueline Fraysse. Pour ma part, je crains de m’être quelque peu égarée dans le raisonnement de M. Robiliard. Á ce stade, je maintiens donc mon amendement.
La Commission rejette l’amendement SPE945.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels SPE1846 et SPE1847, tous deux des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement SPE1965 des mêmes auteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Comme je l’ai expliqué en me prononçant sur les amendements de suppression que nous venons de rejeter, alors que le texte du projet de loi entend réduire le champ de l’obligation de reclassement à l’entreprise, cet amendement tend à maintenir le droit en vigueur qui oblige au reclassement au sein du groupe.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1965.
Puis elle adopte l’article 101 modifié.
*
* *
Article 102
(Art. L. 1235-16 du code du travail)
Conséquences de l’annulation des décisions d’homologations des plans de sauvegarde de l’emploi fondée sur le motif de l’insuffisante motivation de la décision administrative
I. LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DES DÉCISIONS D’HOMOLOGATIONS D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI FONDÉE SUR LE MOTIF DE L’INSUFFISANTE MOTIVATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (232) a considérablement renforcé le rôle de l’administration dans les procédures de licenciement, plus particulièrement lorsque doit être élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
En vertu de l’article L. 1233-57-1 du code du travail, l’accord collectif majoritaire ou le document unilatéral élaboré par l’employeur sur le projet de licenciement sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.
L’article L. 1233-57-2 précise que l’administration valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée de :
– sa conformité aux dispositions des articles qui régissent le contenu et le régime de l’accord majoritaire ;
– la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
– la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures qui y sont imposées par la loi.
S’agissant de l’homologation du document unilatéral de l’employeur, l’administration doit vérifier la conformité de ce document aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à son contenu obligatoire, ainsi que la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise. Elle doit également apprécier le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, en fonction des critères suivants :
– les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
– les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
– les efforts de formation et d’adaptation déployés.
Elle doit, enfin, s’assurer que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement.
L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur (article L. 1233-57-4 du code du travail).
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l’administration au terme de ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, il appartient à l’employeur d’en informer les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Il est tenu, par ailleurs, d’informer les salariés de la décision de l’administration par voie d’affichage sur le lieu de travail.
En revanche, l’article L. 1233-57-4 du code du travail dispose simplement que « la décision prise par l’autorité administrative est motivée » sans pour autant préciser quel doit être le contenu ou le niveau de détail de la motivation. Cet article n’impose ainsi pas qu’il soit fait référence à chacun des points de contrôle de l’administration dans le cadre de l’homologation et de la validation des PSE.
Or, certains jugements concluant à l’annulation des décisions d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi sont fondés sur ce motif de l’insuffisante motivation de la décision administrative (233).
Or comme le rappelle l’étude d’impact annexée au présent projet de loi : « l’annulation, après que les licenciements ont commencé d’être mis en œuvre, d’une décision d’homologation sur le seul motif de l’insuffisance de motivation, alors même que la procédure d’information-consultation conduite par l’employeur est régulière et que les mesures du PSE sont de bonne qualité et proportionnées, a pour effet paradoxal d’entacher a posteriori les licenciements prononcés et de faire retomber sur l’employeur les conséquences d’un acte qui lui est extérieur. »
L’article L. 1235-16 du code du travail prévoit en effet qu’un tel jugement donne lieu soit à la réintégration du salarié dans l’entreprise, soit au versement au salarié d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C’est pourquoi, le 2° complète l’article L. 1235-16 du code précité par deux alinéas :
– le premier prévoit qu’en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation d’un PSE sur le seul motif d’une insuffisance de motivation de cette décision, l’autorité administrative devra prendre une nouvelle décision suffisamment motivée. Bien évidemment, la nouvelle décision sera susceptible de recours comme la décision initiale ;
– le second alinéa prévoit que dès lors que l’autorité administrative a satisfait à l’obligation d’édiction d’une seconde décision suffisamment motivée, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.
Par ailleurs le 1° précise au premier alinéa de l’article L. 1235-16 que dans le cas prévu par le 2° du présent article l’annulation de la décision de validation ou d’homologation ne donne pas lieu à la réintégration du salarié dans l’entreprise.
À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement précisant que la seconde décision motivée de l’administration doit être prise dans un délai de quinze jours, afin de limiter les conséquences pour les salariés de cette situation anxiogène et d’une situation délicate sur le plan juridique. Un amendement rédactionnel a aussi été adopté.
*
* *
La Commission est saisie des amendements de suppression SPE946 de Mme Jacqueline Fraysse et SPE1367 de M. Jean-Louis Roumegas.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 102 prévoit que lorsqu’une autorisation de validation d’un accord ou document unilatéral fixant le PSE est annulée en raison de son insuffisante motivation par l’administration, celle-ci prend une nouvelle décision suffisamment motivée. Le problème c’est que, dans l’intervalle, les salariés ne peuvent demander ni leur réintégration ni des dommages et intérêts.
L’étude d’impact n’évoque que les cas où la décision est annulée parce qu’elle est mal motivée, alors même que la procédure d’information-consultation conduite par l’employeur est régulière et que les mesures du PSE sont de bonne qualité et proportionnées. Il s’agit d’une vision parcellaire, car l’expérience nous a appris que l’insuffisance de motivation peut cacher des vices de fond. Dans ce cas, si l’administration prend une nouvelle décision, cela ne changera rien à l’illégalité du PSE et n’aboutira qu’à repousser la date à laquelle les salariés verront leur affaire jugée et obtiendront réparation de leur préjudice. De plus, quelles que soient les raisons de l’insuffisance de motivation, les salariés subissent un préjudice lié à l’instabilité de la situation et au flou dans lequel elle les plonge quant à leur avenir.
Nous proposons de maintenir le dispositif en vigueur, qui est à la fois dissuasif et juste. Il donne des arguments à l’administration pour convaincre l’employeur qu’il est inutile d’exercer une quelconque pression sur la DIRECCTE afin d’obtenir l’homologation ou la validation d’un PSE qui ne serait pas conforme à la loi, l’annulation de la décision de l’administration pour insuffisance entraînant soit la réintégration des salariés, soit leur indemnisation.
Nous demandons la suppression de l’article.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. J’ai déposé un amendement SPE1586 qui est de nature à rassurer Jacqueline Fraysse puisqu’il prévoit que la nouvelle décision suffisamment motivée doit être prise par l’autorité administrative « dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement » annulant la décision précédente.
À mon sens, le simple fait d’instaurer ce mécanisme a de fortes chances de dissuader les avocats de soulever le grief d’insuffisance de motivation. Notre démarche n’est pas entièrement satisfaisante, mais il faut bien voir que l’annulation de la décision d’homologation de la DIRECCTE produit des effets non pas sur l’État mais sur l’employeur – qui doit réintégrer les salariés et les indemniser, et qui, en l’état du droit, peut toujours saisir à nouveau la DIRECCTE. C’est là un dispositif moins kafkaïen peut-être, mais suffisamment tout de même pour qu’on y remédie.
Les amendements SPE946 et SPE1367 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement SPE1586 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE1848 des mêmes auteurs.
Puis elle adopte l’article 102 modifié.
*
* *
Article 102 bis [nouveau]
Conséquences de l’annulation des décisions d’homologations des plans de sauvegarde de l’emploi fondée sur le motif de l’insuffisante motivation de la décision administrative pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire
Le présent article additionnel a été adopté par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs.
Il permet d’harmoniser le régime applicable aux entreprises en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire s’agissant des conséquences de l’annulation de la décision d’homologation en cas d’insuffisance de motivation de la décision de l’administration avec celui prévu à l’article 102 du présent projet de loi.
De même que pour les entreprises in bonis, en cas d’annulation pour insuffisance de motivation, celle-ci ne remet pas en cause la validité des licenciements sous réserve que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision d’homologation ou de validation suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement annulant la décision d’homologation ou de validation.
*
* *
La Commission examine l’amendement SPE1587 des rapporteurs.
M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement vise à harmoniser le régime applicable aux entreprises en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire s’agissant des conséquences de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation en cas d’insuffisance de motivation avec celui que nous venons d’adopter pour les entreprises qui ne sont ni en liquidation ni en redressement.
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1587.
*
* *
Article 103
(Art. L. 1233-66 du code du travail)
Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a institué, pour les salariés des entreprises de moins de mille salariés ayant subi un licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Ce contrat permet au salarié qui l’accepte de bénéficier d’un parcours de retour à l’emploi comportant une évaluation de ses compétences, un accompagnement, une formation et des périodes de travail en entreprise. Ses modalités de mise en œuvre sont détaillées dans un accord national interprofessionnel du 31 mai 2011.
Le contrat de sécurisation professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle concerne les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (quel que soit le nombre de salariés) qui ont engagé une procédure de licenciement économique.
Il est proposé aux salariés dont le licenciement économique est envisagé et remplissant les conditions suivantes :
– avoir au moins un an d’ancienneté ou, à défaut, justifier des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
– être aptes à l’emploi.
À titre expérimental, tout demandeur d’emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD), de mission d’intérim ou de contrat de chantier peut bénéficier de ce contrat s’il a acquis des droits au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours à partir de la date de remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle pour accepter ou refuser la proposition.
Si le salarié accepte de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu d’un commun accord, à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Le salarié perçoit l’indemnité de licenciement (s’il remplit les conditions d’ancienneté). Il perçoit également toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.
Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle a droit au versement de l’allocation de sécurisation professionnelle. Le bénéficiaire d’un CSP peut réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat de travail temporaire. La durée du contrat est d’au moins 14 jours. Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Le cumul total de ces périodes d’activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre 4 et 6 mois. Pendant ces périodes, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
La durée du contrat de sécurisation professionnelle est fixée à 12 mois maximum.
Se pose cependant aujourd’hui la question de l’articulation entre la proposition obligatoire du contrat de sécurisation professionnelle et la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en œuvre par l’employeur.
En effet, l’article L. 1233-66 du code du travail dispose, qu’en cas de licenciement économique donnant lieu à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Parallèlement, l’article L. 1233-39 du même code précise qu’en cas de PSE, l’employeur notifie le licenciement après avoir obtenu une décision favorable d’homologation ou de validation.
Or la proposition du CSP est l’acte qui, si le salarié l’accepte – ce qui survient dans l’immense majorité des cas – enclenche le processus de rupture du contrat de travail. En cas de décision de refus d’homologation, l’employeur qui proposerait le CSP à l’issue de la dernière réunion du comité d’entreprise pourrait se retrouver dans la situation où il met en œuvre le PSE sans être couvert par une décision administrative favorable.
Le présent article propose donc de compléter l’article L. 1233-66 du code du travail en précisant que lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur est tenu de proposer le contrat de sécurisation professionnelle seulement après avoir reçu la décision administrative favorable relative à l’homologation ou à la validation du PSE.
*
* *
La Commission adopte l’article 103 sans modification.
*
* *
Article 104
Entrée en vigueur des articles 98 à 103
Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur des articles 98 à 103 du projet de loi afin de sécuriser les procédures de licenciement collectif qui auraient déjà été ouvertes à la date de publication de la loi. Faute de dispositions particulières, ces procédures pourraient être prolongées – voire redémarrées – afin de s’adapter au nouveau cadre législatif, induisant ainsi des tensions sociales et des coûts financiers supplémentaires.
Ainsi, les articles 98 à 103 s’appliquent pour des entreprises procédant à des licenciements collectifs pour motif économique avec des impacts de suppressions d’emploi de deux ordres de grandeur :
– d’au moins dix salariés dans une même période de 30 jours : dans ce cas, l’entreprise doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ; les nouvelles dispositions de la loi s’appliqueront à compter de la première réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif ;
– de moins de dix salariés dans une même période de 30 jours : c’est la date de la première réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel qui sera retenue pour analyser l’applicabilité des dispositions de la nouvelle loi.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE1849 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 104 modifié.
*
* *
Après l’article 104
La Commission examine les amendements identiques SPE463 de M. Patrick Hetzel et SPE632 de M. Gérard Cherpion.
M. Patrick Hetzel. L’amendement SPE463 vise à élargir les possibilités de recours aux accords de maintien de l’emploi – AME –, en supprimant la condition de l’existence de « graves difficultés économiques conjoncturelles » dans l’entreprise pour aller vers des accords à vocation offensive. Les conditions trop strictes prévues dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui transpose l’ANI du 11 janvier 2013, n’ont permis de conclure à ce jour que cinq accords. Le Premier ministre lui-même avait indiqué, lors de la conférence de presse de présentation du présent projet de loi, qu’il fallait « corriger dans la loi ce qui doit l’être ».
Sur le même sujet, l’amendement SPE464 à venir tend à modifier les conséquences du refus d’un ou de plusieurs salariés d’un tel accord, en faisant reposer leur licenciement sur un motif personnel, à l’instar de ce qui est prévu par l’article L. 1222-8 du code de travail, issu de la loi Aubry II, pour les salariés refusant une réduction conventionnelle du temps de travail.
Mme Véronique Louwagie. Les accords de maintien de l’emploi, qui reposent sur une logique donnant-donnant entre flexibilité des avantages acquis et sécurisation de l’emploi, constituent pour les entreprises des solutions favorables à la croissance et à l’activité. De ce point de vue, et alors que cinq accords seulement ont été conclus depuis dix-huit mois, les amendements que nous proposons ont toute leur place dans le projet de loi, dans la mesure où ils offrent aux entreprises la possibilité d’avoir plus souvent recours à ces instruments.
M. le ministre. Je reviens d’abord sur un point de procédure que j’ai déjà évoqué concernant les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi transposant l’ANI du 11 janvier 2013. Il me semble difficile de modifier substantiellement par voie d’amendement la nature défensive des accords de maintien dans l’emploi en les transformant en AME « offensifs ». J’ai précédemment indiqué à M. Cherpion que, selon nous, en application de la loi Larcher, une telle évolution nécessitait de repasser par la négociation collective.
Ensuite, nous considérons que si les accords de maintien dans l’emploi défensifs, tels qu’ils sont définis dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi, ne sont pas suffisamment répandus, c’est sans doute que certains des critères retenus peuvent être améliorés. Plutôt que de rouvrir une négociation complète, ce qui serait indispensable si l’on voulait supprimer la condition de graves difficultés économiques conjoncturelles de l’entreprise, le Gouvernement pense qu’alléger certaines des procédures inciterait davantage les entreprises à recourir à ces accords. En particulier, la nécessité de retourner devant le juge pour passer de l’accord de maintien dans l’emploi à un plan de sauvegarde de l’emploi, comme la durée ou le plancher définis dans la loi, semblent constituer des freins à l’utilisation de cet instrument.
En tout état de cause, les partenaires sociaux se réuniront autour du Premier ministre pour faire un point sur ces AME. Des aménagements pourront ainsi être mis en place pour améliorer le dispositif avant que ne soient envisagées des modifications plus ambitieuses telles que celles proposées par les amendements, sur lesquels j’émets en conséquence un avis défavorable, sans toutefois nier qu’ils proposent des pistes qui pourraient être intéressantes.
Les amendements SPE463 et SPE632 sont retirés, de même que les amendements identiques SPE464 de M. Patrick Hetzel et SPE633 de M. Gérard Cherpion.
*
* *
Article 105
(art. L. 910-1 du code de commerce)
Dispositions spécifiques relatives au département de Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
I. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi prévoit d’exclure le département de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon de l’application de certaines de ses dispositions et procède à une modification d’un article du code de commerce à des fins de coordination.
Le I prévoit que les articles 10 et 11 du projet de loi ne sont pas applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’agit respectivement de l’article instituant une consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme, et de celui modifiant la procédure d’injonction structurelle par la même Autorité.
Le II modifie, à des fins de coordination, l’article L. 910-1 du code de commerce, afin d’y mentionner l’applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 752-27 du code de commerce, déjà expressément prévue à ce dernier article.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR THÉMATIQUE
Tout en approuvant le projet d’article présenté par le Gouvernement, vos co-rapporteurs estiment que ses dispositions devraient être codifiées, et qu’elles auraient davantage leur place à la fin du chapitre II du titre Ier du projet de loi, qui contient ses articles 10 et 11. De plus, l’inapplicabilité de l’article 11 découle logiquement, pour le département de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’existence d’une procédure d’injonction structurelle spécifique, figurant à l’article L. 752-27 du code de commerce.
En conséquence, ils ont déposé un amendement portant article additionnel après l’article 11, qui procède à l’ensemble de ces modifications.
III. LES DISPOSITIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté un amendement à cet article, qui tire la conséquence du déplacement du I au nouvel article 11 bis.
*
* *
La Commission adopte l’amendement de conséquence SPE1221 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 105 modifié.
*
* *
(art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte)
Extension du dispositif des adultes-relais à Mayotte
Cet article résulte de l’adoption par la Commission d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Il tend à insérer dans le code du travail applicable à Mayotte les dispositions du code du travail concernant les contrats relatifs aux activités d’adultes-relais, en les adaptant, aux nécessités locales, afin d’autoriser la signature des conventions de recrutement et d’assurer leur financement.
Il convient de rappeler que le dispositif adultes-relais vise un double objectif : donner un cadre stable aux actions de médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et offrir, dans une logique d’insertion, des opportunités d’emploi aux adultes de ces quartiers et notamment aux femmes.
Les besoins du département de Mayotte en la matière sont très importants puisque les dix-sept communes de Mayotte ont toutes au moins un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville et qu’elles connaissent un contexte de croissance démographique dynamique.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement SPE1559 du Gouvernement.
M. le ministre. L’amendement permet d’insérer dans le code du travail applicable à Mayotte les dispositions législatives concernant les contrats relatifs aux activités d’adultes-relais déjà insérées dans le code du travail.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement SPE1559.
*
* *
Article 106
Délai de dépôts des projets de loi de ratification des ordonnances
Cet article prévoit que les projets de loi de ratification des ordonnances, résultant des habilitations figurant dans le présent projet de loi, devront être déposés devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
En vertu de l’article 38 de la Constitution, le non-respect de ce délai entraîne la caducité des ordonnances.
*
* *
La Commission adopte l’article 106 sans modification.
*
* *
Titre du projet de loi
La Commission examine, en discussion commune, l’amendement SPE1791 rectifié des rapporteurs, et les amendements identiques SPE219 de M. Jean-Frédéric Poisson, et SPE302 de M. Patrick Hetzel.
M. le rapporteur général. « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrivait Albert Camus. Attachons-nous donc à être précis dans la dénomination de ce projet de loi.
En effet, outre qu’il a vocation à relancer la croissance et l’activité, ce texte entend aussi faciliter la vie aux jeunes, à ceux qui ne sont pas dans l’emploi, et à ceux qui voudraient investir. Cela passe par l’assouplissement d’un certain nombre de rigidités qui jouent d’abord au détriment des plus jeunes et des plus modestes.
Nous venons d’adopter des dispositions qui visent à rétablir une certaine égalité des chances économiques.
Nous avons autorisé l’exploitation de lignes d’autocars sur le territoire national afin de créer de la mobilité pour tous. Nous avons libéré des places, réduit les coûts et uniformisé les délais de présentation pour l’examen du permis de conduire. Nous avons créé une liberté d’installation régulée pour certaines professions juridiques réglementées, ce qui promeut l’égalité des chances là où une forme de cooptation faisait parfois obstacle, tout en assurant l’égalité du maillage territorial. Nous avons redonné une dynamique en faveur de l’épargne salariale, en particulier dans les PME, pour associer plus largement les salariés à leur entreprise et leur permettre de bénéficier des fruits du travail commun. Nous avons, enfin, réformé les règles relatives au travail dominical dans les commerces de détail, en garantissant pour tous volontariat, compensations et dialogue social, ce qui est faire œuvre de justice sociale tout en répondant aux besoins économiques.
Un tel texte serait, en conséquence, fort justement intitulé « projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
M. le ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement SPE1791 rectifié.
En conséquence, les amendements identiques SPE219 et SPE302 tombent, et le titre du projet de loi est ainsi rédigé.
Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Auditions de M. Richard FERRAND, rapporteur général
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
– M. Alain Giffard, secrétaire national en charge de l’économie et de l’industrie
– M. Franck Mikula, secrétaire national en charge de l’emploi et de la formation
– M. Jean-Michel Pecorini, secrétaire national en charge du développement syndical et du dialogue social
– Mlle Barbara Reginato, juriste en droit social
– M. Alexandre Grillat, secrétaire national en charge du développement durable, énergies, logement et RSE
Union professionnelle artisanale (UPA) :
– M. Jean-Pierre Crouzet, président
– M. Pierre Burban, secrétaire général
– Mme Caroline Duc, conseillère technique
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) :
– M. Joseph Thouvenel, secrétaire confédéral
Confédération française démocratique du travail (CFDT)* :
– M. Hervé Garnier, secrétaire national
– Mme Lucie Lourdelle, secrétaire confédérale
– Mme Caroline Leloup-Werkoff, secrétaire confédérale
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
– M. Michel Guilbaud, directeur général
– Mme Dorothée Pineau, directrice générale adjointe en charge de la sphère publique et de l’international
– M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques
Confédération générale du travail (CGT) :
– Mme Marie-Laurence Bertrand, membre du bureau confédéral
– Mme Michèle Chay, membre de la commission exécutive confédérale
– M. Jean-Pierre Gabriel, responsable du secteur droits, libertés et actions juridiques
– M. Didier Lassauzay, conseiller confédéral
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) :
– M. Luc Bérille, secrétaire général
– M. François Dodin, secrétaire nationale
– Mme Vanessa Jereb, secrétaire nationale
Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
– M. Jean-François Roubaud, président
– M. Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général
– M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques
– Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe
Force ouvrière (FO) :
– Mme Sylvia Veitl, assistante confédérale
– M. Didier Porte, secrétaire confédéral
– M. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral
Auditions de M. Christophe CASTANER
– M. Arnaud Gossement, avocat
– M. Antoine Darodes, directeur de la Mission Très Haut Débit
– M. Jérôme Goellner, chef du service des risques technologiques au ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
– M. Christophe Caron, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et professeur à l’université Paris-Est
Institut national de la propriété industrielle (INPI) :
– M. Yves Lapierre, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
– M. Laurent Mulatier, chef du service des affaires juridiques et contentieuses
Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) :
– M. Martin Hirsch, président du directoire de l’AP-HP
– Dr Florence Veber, déléguée aux relations internationales
– Dr Florence Ghrenassia, directrice de l’Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels
– M. Jean-Pierre Duport, préfet de région honoraire, chargé d’une mission de simplification du droit de l’urbanisme par le Premier ministre, conseiller du président d’Unibail-Rodamco
Fédération française des associations d’actionnaires salariés (FAS) :
– M. Philippe LEPINAY, président
– M. Philippe Bernheim (Orange)
– M. Loïc Desmouceaux (Technicolor)
– M. Benoit Gaillhac (EDF)
– Mme Sylvie Lucot (membre collège AMF)
– M. Laurent Legendre (Airbus Group)
Association Française de la Gestion financière (AFG) :
– Mme Laure DELAHOUSSE, membre du directoire
France Énergie éolienne :
– Mme Sonia LIORET, déléguée générale.
Auditions de M. Gilles SAVARY
iDBUS (groupe SNCF) :
– Mme Maria Harti, directrice générale iDBUS
– M. Christophe Garat, directeur délégué à la réforme ferroviaire (SNCF)
– M. Matthieu Jacquier, président d’iDVroom
– Mme Karine Grossetête, directrice déléguée aux Affaires publiques (SNCF)*
Transdev* :
– M. Jean-Marc Janaillac, PDG de Transdev
– Mme Laurence Broseta, directrice générale
– M. Bernard Lavoix, directeur Interurbain
– M. Laurent Mazille, responsable Relations institutionnelles
Réseau REUNIR :
– M. Alain-Jean Berthelet, président de REUNIR
– M. Stéphane Duprey, délégué général
– Mme Nadège Py, responsable du pôle Développement
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) :
– M. Pierre Cardo, président de l’ARAF ;
– Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ;
– M. François Wernert, directeur de cabinet.
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) :
– M. François Poupard, directeur général
– M. Thierry Guimbaud, directeur des services de transport
– Mme Radia Ouarti, conseillère pour les transports routiers et urbains au cabinet au secrétariat d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Conseil national de la sécurité routière (CNSR) (groupe de travail permis de conduire) :
– M. Gérard Acourt, président de l’école de conduite française et de la commission jeunes et éducation routière du CNSR
– M. Bruno Garancher, président du syndicat national des salariés enseignants de conduite et de la sécurité routière (CNSR)
Syndicat Autonome National des Experts de l’Éducation Routière :
– M. Christophe Nauwelaers, secrétaire général
– Mme Laurence Pascal, secrétaire nationale
Syndicat national des personnels techniques, administratifs et de services (SNPTAS-CGT) :
– M. Jean-Bernard Marcuzzi, secrétaire national.
Délégation interministérielle à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières :
– M. Jean-Robert Lopez, délégué interministériel
– M. Pierre Ginefri, sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire
Association des communautés de France (ADCF) :
– Mme Corinne Casanova, vice-présidente Urbanisme de l’AdCF, et viceprésidente de la communauté du Lac du Bourget (Savoie)
– M. Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF
– M. Philippe Schmit, délégué général adjoint de l’AdCF
– M. Atte Oksanen, chargé des relations avec le parlement
Groupe SNI :
– M. André Yché, président
– M. Yves Chazelle, directeur général
– M.Thomas le Drian, conseiller du président
– Mme Anne Frémont, directrice des relations institutionnelles
Fédération du commerce et de la distribution* :
– M. Jacques Creyssel, délégué général
– Mme Fabienne Prouvost, directrice de la communication et des affaires publiques
– M. Franck Derniame, directeur juridique
– M. Antoine Sauvagnargues, responsable des affaires publiques
Union sociale pour l’habitat (USH) :
– M. Frédéric Paul, délégué général
– Mme Marianne Louis, secrétaire générale
– Mme Francine Albert, conseillère pour les relations avec le Parlement
Autorité de la concurrence :
– M. Bruno Lasserre, président
– M. Thierry Dahan, vice-président
– Mme Virginie Beaumeunier, rapporteur général
– M. David Viros, chef du service du président
Association des régions de France (ARF)
– M. Jacques Auxiette, président de la Commission Transports
Fédération des enseignes du commerce associé :
– Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale
– M. Miguel Jonchère, vice-président
– M. Alain Souilleaux, directeur juridique
Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes ou d’ouvrages :
– M. Christian Descheemaeker, président
Auditions réalisées par Mme Cécile UNTERMAIER
Bâtonniers des barreaux de province pratiquant la multipostulation :
– Barreau de Bordeaux : Me Anne Cadiot-Feidt, bâtonnière, et Me Jérôme Dirou, vice-bâtonnier
– Barreau de Libourne : Me Dominique Millas-Contestin, bâtonnier et Me Raphaël Monroux, membre du Conseil de l’Ordre
– Barreau de Nîmes : Me Jean-Claude Monceaux, bâtonnier
– Barreau d’Alès : Me Marie-Christel Goubet, bâtonnière
Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
– Me Xavier Huertas, président (administrateur judiciaire)
– Me Marc André, vice-président (mandataire judiciaire)
– M. Alexandre de Montesquiou, chargé des relations institutionnelles, consultant
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) :
– Mme Christine Thin, présidente, et M. Philippe Steing, secrétaire général
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) :
– M. Yves Nicolas, président
– Mme Claire Nourry, membre du comité de coordination du contrôle d’activité CNCC/H3C et membre des normes d’exercice professionnel
– M. François Hurel, délégué général
Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation :
– Mme Hélène Farge, présidente de l’ordre des avocats aux conseils
Caisse des dépôts et consignations :
– Mme Odile Renaud-Basso, directrice générale adjointe du groupe Caisse des Dépôts, Mme Nathalie Gilly, directrice des services bancaires de la Caisse des Dépôts, et Mme Marie-Michèle Cazenave, directrice adjointe, direction des relations institutionnelles et de la coopération européenne et internationale
Autorité de la concurrence :
– M. Bruno Lasserre, président
– Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale
– M. Éric Maurus, rapporteur
– M. Gilles Vaury, rapporteur
– M. Sébastien Lecou, économiste
– M. David Viros, chef du service du président
Auditions communes de Mme Cécile UNTERMAIER
et de M. Laurent Grandguillaume
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables :
– M. Joseph Zorgniotti, président
– M. Olivier Salamito, secrétaire général du CSOEC
– Mme Gaëlle Patetta, secrétaire générale adjointe, directrice juridique
Institut français des experts comptables et commissaires aux comptes :
– M. Charles-René Tandé, président
– M. Bruno Delmotte, secrétaire général
– M. Thibaut Astier, chargé des questions gouvernementales et parlementaires
Chambre nationale des huissiers de justice :
– M. Patrick Sannino, président
– M. Jean-Francois Richard, vice-président
– M. Gabriel Mecarelli, directeur des affaires juridiques
Auditions de Mme Clotilde VALTER
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
– M. Pierre-Franck Chevet, président
– M. Jean-Christophe Niel, directeur général
– M. Alain Delmestre, directeur général adjoint
Institut français des administrateurs :
– Mme Agnès Touraine, présidente
Commission des participations et des transferts :
– M. Bertrand Schneiter, président
– M. Dominique Augustin, secrétaire général
Autorité des marchés financiers :
– M. Benoit de Juvigny, secrétaire général
– Mme Laure Tertrais, conseillère parlementaire
Laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie :
– M. Christian Bechon, président-directeur général
Me Paul Lignières, associé chez Linklaters, expert du Club des juristes, avocat spécialisé
Agence des participations de l’État :
– Mme Astrid Milsan, directrice générale adjointe
– Mme Juliette d’Aboville, chef du Pôle juridique
– M. Julien Mendez, conseiller au cabinet du ministre de l’économie
– Me Paul Lignières, associé chez Linklaters, expert du Club des juristes
– Me William Feugère, président national des Avocats conseils d’entreprises
BPIfrance :
– M. Nicolas Dufourq, directeur général
– M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles
SNCF Réseau* :
– M. Alain Quinet, directeur général délégué
– Mme Karine Grossetête, directrice déléguée aux affaires publiques
Caisse des dépôts et consignations :
– M. Franck Silvent, directeur du pôle finances, stratégie et participations
– Mme Marie-Michèle Cazenave, directrice adjointe à la direction des relations institutionnelles et de la coopération européenne et internationale
Nexter :
M. Philippe Burtin, président-directeur général
Auditions de M. Laurent GRANDGUILLAUME
Haut comité de gouvernement d’entreprise :
M. François Soulmagnon, directeur général de l’Association française des entreprises privées (Afep)
Autorité de la concurrence :
– M. Bruno Lasserre, président
– Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale
– M. David Viros, chef de cabinet
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de-France* :
– Pierre-Antoine Gailly, président
– M. Jean-Claude Hanus, rapporteur, élu de la CCIR et de la CCID de Versailles et président du pôle de compétitivité Mov’eo
– Mme Anne Outin-Adam, directrice des politiques législatives
– Mme Véronique Etienne-Martin, directrice des affaires publiques et de la valorisation
Groupe La Vallée Village :
– M. Benjamin Martin, directeur conseil affaires publiques, consultant Publicis
– Mme Emmanuelle Delanoë, directrice générale de « La Vallée Village » et directrice de la stratégie du groupe Value Retail
Auditions de M. Alain TOURRET
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique :
– M. Emmanuel Lacresse, directeur de cabinet adjoint
– M. Xavier Hubert, conseiller juridique
– M. Stéphane Séjourné, conseiller parlementaire
Ministère de la Justice :
Cabinet de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice
– Mme Delphine Humbert, conseillère droit civil et économique et des professions judiciaires
– M. Benoit Joxe, chargé de mission
– Mme Céline Roux, conseillère technique
– M. Elie Patrigeon, conseiller parlementaire
Direction des affaires civiles et du Sceau
– Mme Carole Champalaune, directrice
– Mme Pascale Compagnie, sous-directrice du droit économique,
– Mme Adeline-Lise Khôv, magistrate au bureau du droit de l’économie des entreprises.
Direction des services judiciaires
– M. Jean-François Beynel, directeur
– M. Eloi Buat-Ménard, adjoint à la sous-directrice de la performance et des méthodes
Conseil national des tribunaux de commerce (CNTC) :
– M. Jean Bois, vice-président
– M. Yves Chaput, professeur des universités à l’École de droit de la Sorbonne, membre
– M. Éric Feldman, président du tribunal de commerce de Lille métropole
– Mme Flora Lavergne, secrétaire générale
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
– M. Philippe Bobet, président
– M. Jean Pouradier Duteil, vice-président
– M. Jean-Marc Prétat, chargé de mission
Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) :
– Me Xavier Huertas, président (administrateur judiciaire)
– Me Marc André, vice-président (mandataire judiciaire)
– M. Alexandre de Montesquiou, chargé des relations institutionnelles, consultant (cabinet « Accompagnements institutionnel vers les pouvoirs publics » – AI2P *)
Conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF) :
– M. Yves Lelièvre, président
– M. Guillaume Labbez, directeur associé de Boury, Tallon & Associés *
Table ronde avec des présidents de commerce :
l Tribunal de commerce de Caen
– M. Pierre Estorges, président
l Tribunal de commerce de Marseille
– M. Georges Richelme, président
l Tribunal de commerce de Paris
– M. Frank Gentin, président
l Tribunal de commerce de Tours
– M. Didier Gadiou, président
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)* :
– M. Michel Guilbaud, directeur général
– Mme Dorothée Pineau, directrice générale adjointe en charge de la Sphère publique et de l’International
– Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques
– Mme Emeline Touzet, chargée de mission à la direction des affaires publiques
Association syndicale professionnelle des administrateurs judiciaires (ASPAJ) :
– M. Patrice Brignier, président
– M. Christophe Thévenot, président d’honneur
Association des mandataires judiciaires (AMJ)
– Me Philippe Delaere, président
Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC)
– Me François Legrand, président
Union professionnelle des mandataires judiciaires (UPMJ)
– Me Christophe Basse, président
– Me Marc Sénéchal, membre
Auditions de M. Stéphane TRAVERT
Comité de liaison intersyndical du commerce de Paris (CLIC-P) :
– SCID-CFDT – M. Alexandre Torgomian
– SECI-UNSA – M. Éric Scherrer
– FNECS-CGC – M. Jacques Biancotto
– Union syndicale CGT du commerce – M. Karl Ghazi
– FEC-FO Commerce – M. Brice Bellon
– SUD Commerce – M. Laurent Degousée
Association française des entreprises privées (Afep)* :
– Mme Stéphanie Robert, directeur
– Mme France Henry-Labordere, directrice des affaires sociales
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) :
– M. Jacques Creyssel, délégué général
Conseil du commerce de France* :
– M. Gérard Atlan, président, Mme Sofy Mulle, déléguée générale
– Mme Fanny Favorel-Pige, secrétaire générale
Fédération des magasins de bricolage (FMB)* :
– M. Frédéric Sambourg, président
– Mme Caroline Hupin, secrétaire générale
Union du grand commerce de centre-ville (UCV) :
– M. Claude Boulle, président exécutif
Chambre de commerce et d’Industrie région Paris Île-de-France (CCI de Paris Île-de-France)* :
– M. Dominique Mocquax, membre élu de la CCIT de Seine et Marne
Assemblée des Communautés de France (AdCF) :
– Mme Corinne Casanova, vice-présidente de la communauté du Lac du Bourget (Savoie) et vice-présidente - Urbanisme
– M. Paul Martinez, président de la communauté de Mantes en Yvelines et membre du Conseil d’administration
– M. Philippe Schmit, délégué général adjoint
– M. Atte Oksanen, chargé des relations avec le parlement
Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC Que Choisir) :
– M. Cédric Musso, directeur de l’action politique, et Mme Karine de Crescenzo, responsable des relations institution
Auditions de M. Denys ROBILIARD
Direction générale du travail :
– M. Yves Struillou, directeur général du travail
− M. Yves Calvez, directeur adjoint du Travail
− Mme Catherine Vedrenne, chef du Bureau des prud’hommes
Table ronde syndicats salariés du conseil supérieur de la prud’homie :
– Confédération générale du travail (CGT) : M. Bernard Augier, membre du CSP, M. Jean-Pierre Gabriel, responsable confédéral du service juridique, et Mme Véronique Hosson, conseillère prud’homme de Versailles
– Confédération française démocratique du travail (CFDT)* : M. Laurent Loyer, secrétaire confédéral
– CGT-FO : M. Didier Porte, Secrétaire Confédéral
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : M. Denis Lavat, conseiller confédéral
– CFE-CGC : M. Gérard Behar, expert secteur développement syndical
Syndicat de la magistrature :
– Mme Françoise Martres, présidente
− M. Patrick Henriot, secrétaire national
Table ronde Syndicats d’avocats :
– Syndicats des avocats de France : M. Florian Borg, président et M. Sylvain Roumier, trésorier
– Conseil national des Barreaux* : M. Jérôme Gavaudan, ancien bâtonnier de Marseille et membre du CNB, M. Jacques-Edouard Briand, conseiller relations avec les pouvoirs publics
Association française des entreprises privées (Afep)* :
– M. François Soulmagnon, directeur général
− Mme France Henry-Labordere, directrice des affaires sociales
Association des paralysés de France (APF) :
– M. Alain Rochon, président
– Mme Véronique Bustreel, conseillère nationale travail-emploi-formation & ressources
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)* :
– M. Michel Guilbaut, directeur général
− M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques
Fédération Française du Bâtiment (FFB)* :
– M. Jacques Chanut, président
– Mme Laetitia Assali, directrice des affaires sociales
– M. Benoît Vanstavel, directeur des relations institutionnelles
Mme Hélène Masse-Dessen, avocate au Conseil d’État et à la Cour de Cassation
Mme Evelyne Serverin, sociologue
Union syndicale des magistrats (USM) :
– Mme Marie-Jane Ody, secrétaire générale adjointe, et Mme Pascale Loue-Williaume, secrétaire nationale.
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle :
− Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale
−M. Pierre Ramain, sous-directeur à la DGEFP
Cour de Cassation :
– M. Alain Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation
(*) Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale
1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
2 () Le champ des projets éligibles diffère selon les régions, de façon à tenir compte le plus possible des spécificités locales : dans la région Aquitaine, il s’agit des projets d’implantation d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement et des projets d’installations, d’ouvrages ou de travaux destinés à l’accueil d’une ou plusieurs entreprises ; dans la région Champagne-Ardenne, des seuls projets relevant du titre Ier du livre V précité ; dans la région Franche-Comté, des projets d’implantation d’installations relevant du titre Ier du livre V précité, des projets d’installations, d’ouvrages ou de travaux destinés à l’accueil d’une ou plusieurs entreprises et des projets de lotissement ; dans la région Bretagne, des seuls projets relevant du titre Ier du livre V précité, à l’exception des installations d’élevage.
3 () Lors d’un déplacement à Toulouse, le 9 janvier 2014, sur le thème de la simplification de la vie des entreprises et de la construction de logements, le Président de la République avait demandé au Gouvernement d’agir rapidement afin que les délais pour l’attribution des permis de construire soient réduits à cinq mois – contre, en moyenne, huit mois à l’heure actuelle.
4 () L’unité touristique nouvelle (UTN) est aujourd’hui définie comme toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet, en une ou plusieurs tranches, soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher, soit de créer des remontées mécaniques, soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surface de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État (article L.145-9 du code de l’urbanisme).
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le contrôle des projets touristiques en montagne apparaît désormais trop lourd et complexe et « la procédure d’autorisation des UTN apparaît comme un échelon supplémentaire d’autorisation, par rapport aux autres procédures applicables de permis de construire ou de permis d’aménager, et désormais inadapté dans le contexte actuel ».
5 () Cf. D. Labetoulle, Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, Ministère de l’Égalité des territoires et du logement, 2013.
6 () Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 24 juin 2008.
7 () http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1209/120900840.asp.
8 () http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/08-0835.pdf.
9 () http://www.anfr.fr/fr/emetteurs/servitudes/listes-des-servitudes.html#c260.
10 () Voir à ce sujet l’avis budgétaire de Mme Corinne Erhel sur le projet de loi de finances pour 2015 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/a2262-tVII.asp#P103_20204
11 () http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-331-qpc/decision-n-2013-331-qpc-du-05-juillet-2013.137601.html
12 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1341-ei.asp
13 () http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/14-0191.pdf.
14 () Avis n° 2012-1627 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 décembre 2012 sur la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles et avis n° 13-A-08 de l’Autorité de la concurrence du 11 mars 2013 relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles.
15 () Pour l’Autorité de la concurrence, il est essentiel de préserver le modèle de concurrence par les infrastructures tandis que pour l’ARCEP, il s’agit de garantir un équilibre entre concurrence par les infrastructures et partage d’infrastructures afin d’assurer la conciliation des différents objectifs assignés à la régulation.
16 () Avis du 14 juin 2010 relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle.
17 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0704.asp.
18 () Directive « cadre », directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; directive « accès », directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; directive « autorisation », directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; directive « service universel », directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; directive « vie privée et communications électroniques », directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 ; directive « concurrence », directive 2002/77CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2002.
19 () http://www.arcep.fr/index.php?id=12612.
20 () Informations publiques sur le site de l’entreprise - http://www.criteo.com/fr/what-we-do/technology/
21 () Le III du présent article ramène ce délai à un an.
22 () Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 743 du 7 mai 2014 (13-15.790).
23 () En intégrant le taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 %, la surtaxe dite « Fillon » de 4 % et la déductibilité de 5,1 % de la CSG, on aboutit à un taux marginal d’impôt sur le revenu de 46,5 %. Il faut y ajouter 8 % de prélèvements sociaux et 10 % de contribution salariale spécifique.
24 () Selon la même méthode de calcul, le taux marginal de l’impôt sur le revenu est de 46,5 %, auquel il faut ajouter 15,5 % de prélèvements sociaux.
25 () Loi n° 94-126 du 11 février 1994.
26 () Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
27 () Article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
28 () Article R. 423-2 du code de la propriété intellectuelle.
29 () Contribution écrite de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux travaux de la commission spéciale.
30 () Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 avril 2011, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, considérant n° 46.
31 () Article 2 du décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.
32 () Article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
33 () En effet, il prévoit que « les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna [...] à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2 ».
34 () Article L. 321-4 du code de la recherche.
35 () Article L. 711-1 du code de l’éducation.
36 () Article R. 1222-6 du code de la santé publique.
37 () R. Barbier de la Serre, J.-H. David, A. Joly, P. Rouvillois : L’État actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, mars 2003.
38 () Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l’État ».
39 () MM. Denis Samuel-Lajeunesse, Bruno Bézard et Jean-Dominique Comolli.
40 () Nommé par décret du 1er août 2012.
41 () APE, Rapport annuel 2014.
42 () http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-etat/Documents/Textes_de_reference/Lignes_directrices_de_l%27Etat_actionnaire_-_17_03_2014.pdf
43 () Notamment la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
44 () Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
45 () Journal officiel, 23 août 2014, page 14007.
46 () Conseil d’État, Assemblée, 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au barreau de Paris, publié au recueil Lebon.
47 () Il est intéressant de relever que lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement qualifia l’action spécifique de « bizarrerie du droit des sociétés », en réponse à M. Xavier de Roux, Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, 28 juin 1993 (page 2663).
48 () Communication de la Commission concernant certains aspects juridiques touchant aux investissements intracommunautaires (97/C 220/06), Journal officiel des Communautés européennes, C 220 du 27 juillet 1997, p. 15.
49 () Commission c/France, 4 juin 2002, C-483/99.
50 () CJCE, 14 décembre 1995, Emilio Sanz de Lera, affaires jointes C-163, 165 et 250/94 ; CJCE, 1er juin 1999, Konle, affaire C-302/97.
51 () CJCE, Commission/Belgique, C-503-99 du 4 juin 2002.
52 () Communiqué de presse n° 49/02 du 4 juin 2002.
53 () MM. Bertrand Schneiter, président, Pierre Achard, Daniel Deguen, Philippe Martin, Mme Inès Mercereau, MM. Philippe Rouvillois et Jean Sérisé, membres de la commission.
54 () Cf. article 10 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
55 () Le groupe KMW emploie environ 3 100 personnes dans le monde (dont environ 2 700 en Allemagne) et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 800 millions d’euros par an environ.
56 () Cette structure a été pensée pour permettre d’accueillir d’éventuels futurs partenaires, comme peut-être le groupe italien Finmeccanica avec lequel un rapprochement avait également été envisagé par le passé.
57 () Compte rendu du Conseil des ministres du 26 octobre 2005.
58 () La législation française impose notamment, au nom du principe de précaution, la destruction des lots de médicaments contenant du plasma issu d’un donneur suspecté d’être porteur de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
59 () Olivier Véran, La Filière du sang en France, rapport au Premier ministre (juillet 2013).
60 () Olivier Véran, La Filière du sang en France, rapport au Premier ministre (juillet 2013), p. 24.
61 () Ibid. p .45.
62 () Loi du 20 juin 1933 comprenant les aéroports parmi les établissements à l’usage du commerce que les chambres de commerce sont autorisées à fonder et à administrer en vertu de la loi du 9 avril 1898.
63 () COPIESAS, Propositions en vue d’une réforme de l’épargne salariale (26 novembre 2014), page 28.
64 () Page 77.
65 () Page 77.
66 () Dans le cadre de l’AIEA, l’ASN participe activement aux travaux de la commission des normes de sûreté (Commission on Safety Standards, CSS) qui élabore des normes internationales pour la sûreté des installations nucléaires, la gestion des déchets, les transports de substances radioactives et la radioprotection. Ces normes, si elles ne sont pas juridiquement contraignantes, constituent une référence internationale, y compris en Europe. Elles sont aussi le référentiel documentaire des audits internationaux pilotés par l’Agence. Parmi ceux-ci, figurent notamment les missions d’audit des autorités de sûreté (Integrated Regulatory Review Service, IRSS), dont le développement est soutenu par l’ASN, ainsi que les missions d’audit des centrales en exploitation (Operational SAfety Review Team, OSART).
Par ailleurs, l’ASN contribue également au travail d’harmonisation de la sûreté en participant activement au programme Multinational Design Evaluation Programme (MDEP), dont l’objectif est d’évaluer, entre autorités de sûreté, la conception de réacteurs – y compris le réacteur EPR.
67 () Ces seuils correspondent à ceux fixés par la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés de certaines formes d’entreprises, et aux rapports y afférents.
68 () L’article 50-0 du code général des impôts s’applique aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 82 200 euros hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407 du même code, ou 32 900 euros hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises.
69 () L’article L. 123-28 du code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus ».
70 () Microentreprises au sens de l’article 50-0 du code général des impôts.
71 () Sociétés civiles de moyens et entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 777 000 euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises.
72 () Les simplifications résultant des articles L. 123-25 et L. 123-26 du code de commerce permettent un enregistrement comptable journalier du détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n’étant constatées qu’en fin d’année. Les simplifications résultant des articles L. 123-27 et R. 123-208 du code de commerce permettent une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours.
73 () La directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises autorise en effet les États membres à exempter les microentreprises de tout ou partie des obligations suivantes : établissement de l’annexe, établissement du rapport de gestion, publication des états financiers annuels à condition que les informations relatives au bilan soit dûment déposées auprès d’une autorité compétente désignée par l’État membre. De plus, les États membres peuvent autoriser les microentreprises à n’établir qu’un bilan et un compte résultat, davantage abrégés que ceux des petites entreprises.
74 () Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
75 () CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlag GmbH, aff. C-324/98.
76 () Voir par exemple l’arrêt CJUE, 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH, aff. C. 458/03, paragraphe 40.
77 () CJUE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur contre République d’Autriche, aff C-454/06.
78 () Qui recommandait de prendre en considération « le montant des ouvrages ou des services exploités ».
79 () Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.
80 () Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
81 () Il s’agit de :1° Les organismes de droit privé ou de droit public dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, non soumis au code des marchés publics, et placés sous la dépendance d’un pouvoir adjudicateur lui-même soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; cette dépendance de l’organisme en cause est établie par le fait que le pouvoir adjudicateur assure majoritairement son financement, exerce un contrôle sur sa gestion ou désigne la majorité des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ; 2° La Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques ; 3° La Caisse des dépôts et consignations ; et 4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics en vue de réaliser certaines activités en commun.
82 () Articles 113, 114 et 121 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
83 () Articles 2, 8 et 35 du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions.
84 () Article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
85 () Article 2 de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
86 () Communiqué de procédure du 10 février 2012 de l’Autorité de la concurrence, relatif à la procédure de non-contestation des griefs : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/communique_ncg_10fevrier2012.pdf.
87 () Décision 11-D-17 du 11 décembre 2011 de l’Autorité de la concurrence.
88 () Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
89 () Communiqué de presse IP/12/389 du 20 avril 2012 de la Commission européenne : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm.
90 () Cité par l’Organisation de coopération et de développement économiques : http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/45269061.pdf , p. 134.
91 () L’article L. 581-7 du code de l’environnement, également issu des dispositions de la loi Grenelle II, prévoit qu’en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
L’article R. 581-32 du même code prévoit ainsi que, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol « peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. »
92 () Les cas de dirigeants de grandes entreprises quittant leurs fonctions avec un montant de retraite chapeau particulièrement élevé défraient régulièrement la chronique : on peut citer M. Lars Oloffson, qui a quitté Carrefour en 2012 avec une retraite chapeau de l’ordre de 500 000 euros par an, M. Pierre Richard qui touche une retraite chapeau de l’ordre de 600 000 euros par an depuis son départ des fonctions opérationnelles de Dexia en 2006, ou encore plus récemment, M. Gérard Mestrallet, qui devrait percevoir une retraite chapeau de plus de 630 000 euros par an à partir du printemps 2016 et de son départ de la présidence de GDF Suez.
93 () L’étude ATH-Observatoire de l’information financière : Zoom sur les rémunérations des 400 dirigeants de sociétés cotées, 2013, porte en réalité sur 388 dirigeants.
94 () Article 39-5 bis du code général des impôts
95 () Ces taux étaient respectivement fixés à 12 %, 16 % et 24 % lors de la mise en place de la contribution en 2003. Ils ont été doublés par la loi de finances rectificative pour 2012 de juillet 2012.
96 () Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, considérants 12 à 22.
97 () Art. L. 225-42-1 du code de commerce.
98 () Règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.
99 () Art. 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
100 () Ce code peut être désigné par les sociétés cotées comme étant leur « code de gouvernement d’entreprise » en application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce.
101 () Directive2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
102 () L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.
103 () Pour de plus amples détails, se reporter au rapport présenté par Jérôme Frantz à la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, La protection des secrets d’affaires dans l’Union européenne, 11 septembre 2014.p. 35 et suivantes.
104 () Directive 2013/0402 du 28 novembre 2013 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
105 () Rapport de Bernard Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, juillet 2003, La Documentation française, proposition n° 18.
106 () Rapport d’information n° 1664 de la commission des finances, de l’économie générale et du plan, sur la stratégie de sécurité économique nationale, 9 juin 2004.
107 () Proposition de loi n° 826 visant à sanctionner la violation du secret des affaires, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2012.
108 () Proposition de loi n° 2139 relative à la protection du secret des affaires du 16 juillet 2014.
109 () Articles L. 463-4 et L. 430-10.
110 () Articles L. 534-9 et L. 534-10.
111 () Articles L. 5-6 et L. 36-8.
112 () Article L. 612-24.
113 () Les travaux de cette dernière ont d’ailleurs contribué à quelque peu clarifier la notion (sur ce point, se rapporter au Rapport public du Conseil d’État 1995, La transparence et le secret, Paris, La Documentation française, 1996, p. 104).
114 () Voir par exemple Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres, Assemblée, 5 mars 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Chantepy, rapp. ; M. Piveteau, c. du g., 233372 ; ou encore Conseil d’État, 9 mai 2001, n°231320, Société Chef France SA.
115 () Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866.
116 () L’Accord sur les ADPIC est reproduit à l’Annexe 1 C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994.
117 () Directive 2013/0402 du 28 novembre 2013 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
118 () Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
119 () Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
120 () Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, 18 mars 1970.
121 () Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014, par M. Urvoas, 18 décembre 2014.
122 () Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 01-86-696.
123 () CEDH, affaire Dupuis c. France, 7 juin 2007, req. n° 1914/02.
124 () Loi n° 80-538 du 16 juillet 1980.
125 () Cass. crim., 12 décembre 2007, MAAF, n° 07-83.228.
126 () Cf. Noëlle Lenoir, « Le droit de la preuve à l’heure de l’extraterritorialité », RFDA, mai-juin 2014, p. 487-501.
127 () La procédure de liquidation judicaire simplifiée s’applique obligatoirement lorsque l’entreprise n’a pas de bien immobilier, n’emploie pas plus d’un salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300 000 euros. Elle est facultative lorsque l’entreprise n'a pas de bien immobilier, que son effectif ne dépasse pas cinq salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes est compris entre 300 000 et 750 000 euros.
128 () Action n° 33.
129 () Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
130 () Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
131 () Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, décret n° 2005-624 du 27 mai 2005 portant suppression de tribunaux de commerce, décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, décret n° 2012-1047 du 13 septembre 2012 portant suppression des tribunaux de commerce de Lille et de Roubaix-Tourcoing et création du tribunal de commerce de Lille Métropole.
132 () Étude d’impact, tome 2, p. 120.
133 () Décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises, codifié à l’article R. 420-2 du code de commerce.
134 () Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, codifié aux articles D. 442-3 et D. 442-4.
135 () Rapport n° 1038, 2 juillet 1998. Voir aussi le rapport d’enquête sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce de l’Inspection générale des finances (n° 98-M-019-01) et de l’Inspection générale des services judiciaires (n° 8-98), juillet 1998.
136 () Rapport d’information n° 1006, Trente propositions pour l’avenir de la justice commerciale, avril 2013.
137 () La première de ces modifications a été opérée par l’article 120 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui a modifié l’article R. 662-7 du code de commerce.
138 () Il n’y a pas de tribunaux de commerce dans les ressorts des cours d’appel d’Alsace-Moselle.
139 () Le conseil national des tribunaux de commerce, créé par le décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 et présidé par la garde des Sceaux, a une mission de concertation relative à la justice consulaire. Il est composé de cinq membres de droit (le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le président de la conférence générale des juges consulaires de France et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce) et de quatorze membres désignés par le garde des Sceaux (dont un premier président de cour d’appel, un procureur général près une cour d’appel, un membre du Conseil d’État et neuf juges consulaires) pour quatre ans. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut consulter le conseil sur l’organisation, le fonctionnement et l’activité des tribunaux de commerce ainsi que sur leur compétence et leur implantation notamment (article R. 721-11 du code de commerce).
140 () Le code de commerce distingue, aux fins de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’établissement principal et les établissements secondaires. Aux termes de l’article R. 123-40 du code de commerce, l’établissement secondaire est un établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. L’article 2 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers définit pour sa part l’établissement comme tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la notion d’établissement requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique et que la seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition (CJUE, 20 octobre 2011, C-396/09, Interedill Srl c.Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA).
141 () Étude d’impact, tome 2, p. 121.
142 () L’article 626-30 du code de commerce prévoit que les créanciers sont réunis en deux comités. Le comité des établissements de crédit réunit les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services, tandis que chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l’administrateur, peuvent être membres du comité des principaux fournisseurs.
143 () Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d’une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique précise que la notion d'entreprise utilisée pour l’application de l’article 51 de la loi de modernisation de l'économie est celle du règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d’analyse du système productif dans la Communauté, c’est-à-dire la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
144 () Altares, Bilan 2013, Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, janvier 2014.
145 () Ibid., p. 23.
146 () Selon le dernier rapport public du CIRI, qui date de 2011 et porte sur l’année 2010, le CIRI a été saisi par 46 entreprises en 2009 et par 44 entreprises en 2010, par exemple.
147 () Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. L’article premier de l’annexe de cette recommande précise que les PME sont des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
148 () Art. R.123-91, R. 600-1 et R. 743-145.
149 () Considération 13 dudit règlement.
150 () CJCE, 2 mai 2006, C-341/04, Eurofood IFSC.
151 () CJUE, 20 octobre 2011, C-396/09, Interedill Srl c.Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA.
152 () Ibid.
153 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (COM [2012] 744 final).
154 () Le texte initial du projet de loi se référait à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Sur la proposition des rapporteurs, la Commission a rectifié cette erreur : il convient en effet de se référer à la date d’entrée en vigueur de l’article, et non à celle de la loi.
155 () V. article 7 de la loi organique n° 2044-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, article 6-2 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie et article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.
156 () Étude d’impact, tome 1, p. 90, 92 et 93.
157 () Les textes antérieurs (article 32 de l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises) renvoyaient expressément à l’article 1843-4 du code civil relatif à la détermination du prix des droits sociaux par un expert. Cette référence a disparu dans la rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 (ancien art. L. 621-59 du code de commerce, devenu l’article L. 631-19-1 du même code). La Cour de cassation a néanmoins jugé que l’article 1843-4 du code civil – dans le cadre duquel l’expert n’était pas lié par les conventions ou les directives des parties (Com., 5 mai 2009, n° 08-17.465 et 16 février 2010, n° 09-11.668) – s’appliquait en cas de cession forcée des parts d’un dirigeant en application de l’article L. 631-19-1 (Com., 9 février 2010, n° 09-10.800). Cette jurisprudence a cependant été rendue sous l’empire de la rédaction ancienne de l’article 1843-4 du code civil, qui a été récemment modifiée par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. Cette modification a notamment restreint l’application de l’article 1843-4 aux cas dans lesquels la loi renvoie à cet article ou dans lesquels les statuts prévoient la cession sans que ces derniers ne précisent les modalités de calcul du prix, au lieu de « tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un assuré ».
158 () Com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045.
159 () Com., 9 février 2010, n° 09-10.800.
160 () G. Plantin, D. Thesmar et J. Tirole, « Les enjeux économiques du droit des faillites », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 7, juin 2013.
161 () Voir également, en ce sens, S. Djankov, C. McLiesh et A. Shleifer, « Private Credit in 129 Countries », Journal of Financial Economics, vol. 84, n° 2, p. 299.
162 () Voir G. Plantin, D. Thesmar et J . Tirole, note précitée.
163 () Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (loi facilitant le redressement des entreprises en difficultés).
164 () Les mots : « nationale ou régionale » ont été ajoutés, dans un souci de précision, par la Commission sur la proposition des rapporteurs. La notion de « troubles grave à l’économie nationale ou régionale » était employée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et par l’ancien article L. 621-34 du code de commerce.
165 () Le I de l’article L. 631-19 du code de commerce renvoie lui-même :
– aux assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 du même code, c’est-à-dire l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (qui réunit les titulaires d’action d’une catégorie particulière) et L. 228-35-6 (qui réunit les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote), les assemblées générales des masses et l’assemblée mentionnée à l’article L. 228-103 (qui réunit les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital) ;
– à l’assemblée prévue par l’article L. 626-32, qui réunit l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations.
166 () « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
167 () « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
168 () « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
169 () Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag (droit de vote dans les sociétés cotées) ; décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre (exploitation numérique des libres indisponibles).
170 () M. Pierre B. [Mur mitoyen].
171 () Aux termes de cet article : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûtée est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. »
172 () Selon le Conseil, « le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d’utilisation rationnelle de l’espace, tout en répartissant les droit des voisins sur les limites de leurs fonds ».
173 () M. Jean-Jacques C. [Attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire].
174 () Aux termes de l’article 274, « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : […] 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
175 () Loi visant à reconquérir l’économie réelle.
176 () Voir, par exemple, CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth ; 8 juillet 1986, Lithgow et autres ; 15 novembre 1996, Katikaridis/Grèce et Tsomtos/Grèce ; 10 juillet 2014, Milhau/France.
177 () Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.
178 () Assemblée générale du Conseil d’État, 8 décembre 2014, avis n° 389.494. Cet avis a été publié par plusieurs médias et est disponible en ligne (voir, par exemple :
179 () Assemblée générale du Conseil d’État, avis n° 388389 du 6 mars 2014.
180 () Le pacte commissoire a été introduit dans le code civil par l’ordonnance. Il est défini sous l’article 2348 du code civil. Celui-ci prévoit qu’il peut être convenu, soit lors de la constitution d'un gage, soit postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
181 () Com., 19 février 2013, n° 11-21.763.
182 () « La Nation garantit à tous (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
183 () Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
184 () Le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 a permis aux jardineries et graineteries de déroger au repos dominical, en les intégrant à la liste des établissements énumérés à l’article R. 221-4-1 du code du travail dans sa numérotation en vigueur à cette date. Les magasins de fleurs naturelles figuraient d’ores et déjà sur la liste des activités autorisées de plein droit à déroger au repos dominical, en vertu de l’article L. 221-9 du code du travail dans sa numérotation en vigueur à cette date.
185 () La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 a porté de midi à treize heures l’autorisation d’ouverture dominicale des commerces alimentaires.
186 () Circulaire DRT n° 94-5 du 25 mai 1994.
187 () Comme pour les autorisations d’ouverture dominicale des commerces dans les zones touristiques, l’autorisation d’ouverture dominicale est, en vertu de l’article L. 3132-25-5, exclusivement applicables aux commerces non alimentaires.
188 () En effet, la jurisprudence confirme que l’ouverture d’un magasin sept jours sur sept est possible dès lors que seul le commerçant ou les membres de sa famille y travaillent dans le cadre de l’entraide familiale (Cass. soc., 4 juin 2002).
189 () Rapport de M. Jean-Paul Bailly au Premier ministre sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces : « Vers une société qui s’adapte en gardant ses valeurs », 2 décembre 2013.
190 () Cette loi, prise en application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, a levé l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, qui datait de 1892.
191 () « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». « Elle garantit à tous (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
192 () CA Paris, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12-23124 : « L’attraction commerciale liée à l’ouverture de nuit » d’un commerce de parfumerie, « qui n’offre pas des services d’utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique au sens de l’article L. 3122-32 du code du travail ».
193 () CA Paris, 1ère ch., 11 octobre 2011, n° 11-04978.
194 () Le rapport de M. Jean-Paul Bailly est antérieur à l’inscription du secteur du bricolage sur la liste des dérogations sectorielles.
195 () Rapport de M. Jean-Paul Bailly au Premier ministre sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces : « Vers une société qui s’adapte en gardant ses valeurs », 2 décembre 2013.
196 () Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud’hommes.
197 () Il s’agit, notamment des délégués syndicaux, des délégués du personnel, des membres du Comité d’entreprise, des représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des conseillers prud’homaux, en application des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail.
198 () Rapport de M. Alain Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation : « L’avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle », remis le 16 juillet 2014 à Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
199 () Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil supérieur de la magistrature, 2010.
200 () Tel que prévu par l’article 44 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
201 () Amendement n°55 de M. Yves Nicolin, rapporteur au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, adopté le 9 juin 2010.
202 () Voir le rapport n° 1754, du 30 janvier 2014, de M. Jean-Patrick Gille, au nom de la Commission des affaires sociales, sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
203 () « Si l’indépendance de l’inspection du travail doit être rangée au nombre des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, la détermination de l’autorité administrative chargée des attributions en cause au sein du « système d’inspection du travail », au sens du titre II du livre premier de la huitième partie du nouveau code, relève du pouvoir réglementaire », Considérant 14, Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 relative à la loi ratifiant l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail.
204 () Voir le rapport n° 1942, du 14 mai 2014, de M. Denys Robiliard, au nom de la Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail.
205 () Il faut rappeler ici que ce renforcement des garanties accordées aux agents trouvait son origine dans une initiative du groupe SRC, qui avait présenté un amendement n° 732 en ce sens lors de l’examen en séance publique de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
206 () Il faut rappeler ici que cette extension du champ des contrôles trouvait son origine dans une initiative du groupe SRC, qui avait présenté un amendement n° 733 en ce sens lors de l’examen en séance publique de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
207 () Cette base législative découlait de l’adoption en Commission des affaires sociales d’un amendement n° AS55 du rapporteur.
208 () Amendements n° AS87, AS88, et AS89 du rapporteur.
209 () Amendement n° AS37 de M. Gérard Sebaoun et des commissaires du groupe SRC.
210 () Il faut rappeler ici que cette obligation d’information des représentants des salariés trouvait son origine dans une initiative du groupe SRC, qui avait présenté des amendements n° 737, 739 et 740 en ce sens lors de l’examen en séance publique de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
211 () Amendement n° AS38 de M. Gérard Sebaoun et des commissaires du groupe SRC.
212 () Cass, soc., arrêt n°1855 (n°11-60.231) du 26 septembre 2012.
213 () Cass. soc., 2 mars 2011, no 09-60.483, Bull. civ. V, no 67, JSL, no 298-12
214 () Sauf fixation par accord d’une durée inférieure, comprise entre deux et quatre ans, en application des dispositions de l’article L. 2314-27 du code du travail.
215 () Cass. Soc., 4 juillet 2012, n°11-19.678.
216 () Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
217 () Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel.
218 () Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale par M. Gilles Savary (n° 1785, 11 février 2014).
219 () Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs (texte E 7220).
220 () Bilan du plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) 2013-2015, Perspectives 2014, commission nationale de lutte contre le travail illégal, 5 décembre 2013.
221 () Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Cour des comptes, 17 septembre 2014.
222 () Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
223 () Mises sur écoute en enquête préliminaire, captation d’image dans un lieu privé sur commission rogatoire.
224 () Source DGT – chiffres 2013
225 () Règlement 3921/91.
226 () Articles L4413-1, L4463-4 et L4463-5 du code des transports.
227 () Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux.
228 () Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458.
229 () Cour administrative d’appel de Versailles, arrêt du 22 octobre 2014.
230 () Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
231 () Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement.
232 () Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
233 () À titre d’exemple, l’arrêt du 22 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
